|
Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
|
République du Cameroun
(Paix-Travail-Patrie)
|

MINISTÈRE DES FINANCES DIVISION
DE LA PRÉVISION
CELLULE DES SYNTHÈSES
MACROÉCONOMIQUES
Institut Sous-régional de
Statistique
et d'Économie
Appliquée
(ISSEA)
Organisation Internationale
BP : 294
Yaoundé
Tél : (237) 222 220 134 Fax: (237) 222 229
521
E-mail :
isseacemac@yahoo.fr
Mémoire professionnel en vue de l'obtention du
diplôme d'Ingénieur Statisticien Économiste
Hypothèse des déficits jumeaux:
évaluation empirique appliquée au
Cameroun
Présenté par :
NDI ZAMBO Jean
Élève Ingénieur Statisticien
Économiste - 3ièmeAnnée
Encadreur académique Jeannot NGBANZA
Chef du département Enquêtes et
Publications
(ISSEA)
Année académique 2019-2020
Encadreur professionnel
Serges MENDOUGA
Ingénieur Statisticien Économiste Chargé
d'études assistant
(MINFI/DP)
Dédicace

À
ma mère Nlo Marie Colette
ii
Remerciements
La production du présent mémoire professionnel a
été rendue possible grâce au soutien de tout le personnel
de la Division de la prévision du Ministère des Finances, organe
au sein duquel j'ai effectué mon stage, et de tout le corps professoral
de l'ISSEA. Á cet effet, je tiens à remercier Monsieur Ngakounda
Gabriel : Directeur de la Division de la Prévision. Je remercie
également Monsieur Mendouga Serges : chargé d'études
assistant à la cellules des synthèses macroéconomiques
pour son encadrement en dépit de ses multiples occupations. Je tiens
aussi à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de :
· Dr. Francial Giscard Baudin LIBENGUE DOBELE-KPOKA,
Directeur Général de l'Institut sous-régional de
Statistique et d'Economie Appliquée (ISSEA) de Yaoundé;
· monsieur Marcel OPOUMBA, Directeur des études
à l'ISSEA;
· monsieur Dieudonné KINKIELELE, coordonnateur de
la filière ISE à l'ISSEA;
· monsieur Thierry Manga, chargé d'études
assistant pour son accueil et les premières orientations sur le
thème du présent mémoire de recherche;
· monsieur Yves Beyina, chargé d'études
assistant à la cellule des synthèses macroéconomiques pour
son aide sur la fixation du présent thème de recherche;
· Tout le reste du personnel de la Division de la
Prévision;
· mon co-stagiaire Martial BONYOE, pour son
assistance;
· MOUNDOU MEGNA Moubarak, pour ses conseils en tant
qu'aîné académique.
· Je remercie également ATANGANA BODO Norbert,
BENGONO Cathérine, EYINGA Hermane et NGANDJUI Lafontaine pour avoir
consencré de leur temps, en dépit de leurs multiples occupations
pour la relecture avant l'impression du présent travail.
· Je remercie également tous mes camarades de
classe pour leurs différents conseils durant la rédaction du
présent mémoire.

sommaire
Dédicace i
Liste des figures vi
Résumé ix
Abstract x
Introduction générale 1
I Cadre conceptuel, cadre théorique et empirique 6
1 Cadre Conceptuel de l'étude 7
2 Fondements théoriques, mise en évidence des
travaux empiriques et choix
méthodologique 17
II Analyse du lien empirique entre le déficit
budgétaire et le déficit courant 34
3 Aperçu global d'un point de vue descriptif du
phénomène des déficits ju-
meaux 35
4 Analyse du lien économétrique entre le solde
budgétaire global et le solde
du compte courant 49
Limites et recommandations 64
Conclusion générale 65
Bibliographie 67
A Tests de stationnarité xiii
B Test cointégration de Johansen xix
C Estimation du modèle xx
D Test de causalité de Granger xxi
E Encadré sur les critères de convergence en zone
CEMAC xxii
iv
Liste des abréviations
BC : Balance Commerciale
CAN : Coupe d'Afrique des Nations
CEMAC : Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
CNC : Commission National de Concurrence
DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et
l'emploi
ECAM4 : 4-ième Enquête Camerounaise auprès
des Ménages
IAS : Ingénieur d'Application de la Statistique
INS : Institut National de la Statistique
ISE : Ingénieur Statisticien
Économiste
ISSEA : Institut Sous-régional de Statistique et
d'Économie Appliquée
FMI: Fond Monétaire International
FOB : Free On Board
MCE : Modèle à Correction d'Erreur
MCO : Moindres Carrés Ordinaires
MINFI : Ministère des Finances
OCDE : Organisation pour la Coopération et le
Développement Économique
OMC : Organisation Mondiale de la Santé
PIB : Produit Intérieur Brut
PRII : Pays à revenu Intermédiaire, tranche
Inférieure
PRIS : Pays à Revenu
Intermédiaire, Tranche Supérieure
PLANUT : Plan d'Urgence Triennal
PNB : Produit National Brut
PPTE : Pays Pauvre Très Endetté
RDC : République Démocratique du Congo
RN : Revenu National
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE Page v
SBG : Solde Budgétaire Global
SNH : ociété Nationale de
Raffinage
RDM : Reste Du Monde
TCA : Taxe sur le Chiffre d'Affaire
TSS : Technicien Supérieur de la Statistique
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UE : Union Européenne
UEMOA : Union Économique et Monétaire de
l'Afrique de l'Ouest
USA: United States of America
ZEP : Zone d'Education Prioritaire
ZFI : Zone Franche Industrielle
vi
Table des figures
|
3.1
|
Dynamique des recettes publiques (en milliards de FCFA)
|
36
|
|
3.2
|
Dynamique des dépenses publiques
|
37
|
|
3.3
|
Dynamique de l'exécution budgétaire (en milliards
FCFA)
|
38
|
|
3.4
|
Dynamique du solde budgétaire global (en %PIB)
|
39
|
|
3.5
|
Dynamique de la balance commerciale
|
43
|
|
4.1
|
Évolution graphique des variables
|
52
|
|
4.2
|
Nuages de points des variables
|
53
|
|
4.3
|
Position des racines du polynôme caractéristique du
VECM sur le disque unité .
|
56
|
|
4.4
|
Réponses impulsionnelles des variables
|
61
|
|
4.5
|
63
|
|
vii
Liste des tableaux
|
2.1
|
Recensement de quelques études empiriques
|
24
|
|
2.2
|
Différentes formes du modèle VECM
|
27
|
|
3.1
|
Commerce extérieur du Cameroun entre 2016 et 2017 (en
milliards)
|
46
|
|
4.1
|
Desciption et effets attendus des variables
|
50
|
|
4.2
|
Caractéristiques descriptives des séries
|
51
|
|
4.3
|
Stationnarité des séries
|
53
|
|
4.4
|
Nombre optimal de retards
|
54
|
|
4.5
|
Test de cointégration de Johansen
|
55
|
|
4.6
|
Test de normalité des résidus
|
56
|
|
4.7
|
Test de non-autocorrélation des résidus
|
57
|
|
4.8
|
Test d'hétéroscédasticité des
résidus
|
57
|
|
4.9
|
Relation de long terme et force de rappel
|
58
|
viii
Avant-propos
L'Institut Sous-régional de Statistique et
d'Économie Appliquée (ISSEA) a trois missions statutaires que
sont : la formation initiale des cadres statisticiens et économistes; le
recyclage et le perfectionnement et la recherche appliquée. Concernant
la formation initiale de cadres statisticiens de niveau moyen et
supérieur, l'institut propose trois filières pour l'année
académique 2019-2020 : la filière Techniciens Supérieurs
de la Statistique (TSS) qui dure 2 ans accessible avec le Baccalauréat
d'enseignement secondaire; la filière Ingénieurs d'Application de
la Statistique (IAS) dure 4 ans accessible avec le Baccalauréat
d'enseignement secondaire et la filière Ingénieurs Statisticiens
Économiste (ISE) dure 3 ans accessible avec le diplôme de licence
en mathématiques ou en sciences économiques.
Dans le cadre de la formation des Ingénieurs
Statisticiens Économistes (ISE) à l'ISSEA de Yaoundé, les
élèves sont appelés à effectuer un stage de trois
(3) mois à la fin de leur deuxième année à
l'institut. Ce stage a pour but essentiel non seulement de compléter les
enseignements théoriques reçus par les élèves ISE
par une formation professionnelle en les confrontant à des études
grandeur nature, mais il permet aussi d'apprécier les qualités de
rédaction et de communication des élèves. C'est donc dans
ce contexte que le présent document a été
rédigé suite à un stage effectué à la
Division de la Prévision du Ministère des Finances du Cameroun
sur le thème : «Déficit budgétaire,
Déficit courant : une évaluation empirique appliquée au
Cameroun».
L'objectif principal de cette étude est de tester
l'hypothèse de déficits jumeaux pour le cas du Cameroun sur la
période 1989-2018 :« il existe une relation de cause à
effet entre le déficit public et celui du compte courant». De
façon générale, puisqu'il s'agit de la prévision,
cela pourra orienter les décisions politiques des gouvernants sur la
gestion du phénomène de double déficit budgétaire
et courant au Cameroun. Le présent travail comporterait certes des
insuffisances, mais nous sommes bien disposés à prendre en compte
toutes les remarques et suggestions visant à l'améliorer.
ix
Résumé
Au cours des 30 dernières années,
l'économie camerounaise a enregistré simultanément et sur
de longues périodes des déficits budgétaires et courants
chroniques. L'objectif du présent travail est de tester la
validité de l'hypothèse des déficits jumeaux pour le cas
du Cameroun à la lumière de la littérature sur la
théorie des déficits jumeaux. Á cet égard, la
méthode de cointégration dans le cadre d'une modélisation
vectorielle à correction d'erreur (VECM) a été
utilisée suivie du test de causalité de Granger. Les
résultats montrent que l'hypothèse des déficits jumeaux
est valide à long terme pour le cas du Cameroun et qu'il existe une
relation causale allant du déficit budgétaire vers celui du
compte courant.
Mots clés : Déficit budgétaire,
Déficit Courant, Déficits Jumeaux.
Abstract
Over the past 30 years, the economy of Cameroon has recorded
chronic budget deficits and log-term losses over long periods of time. The
objective of the present work is to see if there is a cause-and-effect
relationship between the two deficits based on the litterature on the theory of
twin deficits. In this end, the method of cointegration in the case of error
correcting vector modeling (VECM) was used followed by the Granger causality
test. The results show that the hypothesis of twin deficits is valid in the
long term in the case of Cameroon and that there is a causal relationship going
from the budget deficit to that of the current deficit.
x
Keywords : Budget Deficit, Current Deficit, Twin
Deficits.
1
Introduction générale
Contexte et justification
Depuis plusieurs années déjà, les
différents déséquilibres macroéconomiques
(concernant notamment le déficit et l'excédent de la balance
courante, le déficit budgétaire et bien d'autres) sont au centre
des domaines de recherche de nombreux économistes ainsi que certaines
grandes institutions telles que le Fond Monétaire International
(Blanchard et Milesi-Ferreti, 2009; Taylor, 2013) et la Banque Centrale
Européenne (Bracke et al.,2008). La conférence «Analyse
des déséquilibres extérieurs» organisée
par le Fond Monétaire International en Février 2012 a
réuni plusieurs économistes qui ont souligné la menace
potentielle des déséquilibres globaux considérée
comme étant préoccupante.
Depuis le début de la crise financière de 2008,
beaucoup d'économies à l'échelle mondiale sont
caractérisées par l'enregistrement simultané des
déficits budgétaire et courant. Cette situation ne concerne pas
que les Pays en voie développement (PVD). On peut citer le cas des
états unis où les déficits budgétaire et courant en
2018 se sont élèvés respectivement à 3,9% et 2,4%
du PIB (rapports annuels 2018 de United States Department of Treasury et United
States Department of Commerce). Le Cameroun quant à lui n'a pas
échappé à ce fléau de rang mondial. Depuis plus
d'une décennie déjà, l'économie camerounaise a
toujours enrégistré un double déficit budgétaire et
courant. En 2018, avec à la crise sécuritaire dans la
sous-région, le déficit budgétaire s'est
élevé à -2,8% du PIB tandis que celui du compte courant
s'est situé à -6,20% du PIB (rapport annuel de l'exécution
budgétaire de l'État de 2018 et rapport annuel 2018 de la BEAC
sur la situation des comptes courants des pays membres).
C'est ainsi que, dans sa vision d'émergence à
l'horizon 2035, l'une des préoccupations importantes du gouvernement
camerounais est la réduction considérable du déficit
budgétaire et l'atteinte de l'équilibre de la balance commerciale
chroniquement déficitaire. L'un des objectifs majeurs de la
vision est précisément de réduire la
vulnérabilité du pays aux chocs intérieurs et
extérieurs (selon le DSCE). Les politiques spécifiques mises en
oeuvre à cet effet obéisent naturellement au constat de
préserver la stabilité du cadre macroéconomique. Il
s'agira en particulier de préserver la vulnérabilité des
finances publiques et de l'endettement extérieur. Selon le DSCE,
l'expérience en Afrique montre que les pays connaissant un large
déficit budgétaire
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 2
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
sont en bute à des chocs intérieurs à
répétition (comme par exemple une pluviométrie
irrégulière ou des conflits armés) et également
à des chocs extérieurs (par exemple la volatilité des
marchés internationaux de produits agricoles). Le gouvernement
camerounais s'est alors lancé dans un vaste chantier de projets
structurants devant lui permettre d'accroitre considérablement son
niveau de production et d'industrialisation, afin de rétablir
l'équilibre de sa balance commerciale restée déficitaire
depuis fort longtemps. La vision d'émergence qui guide depuis un peu
plus d'une décennie l'action gouvernementale l'oblige donc à
effectuer des dépenses qui sont supérieures à ses
recettes, créant ainsi un déficit budgétaire à la
fin de chaque exercice comptable. Pour financer son déficit, le
gouvernement camerounais fait recours aux emprunts. Cependant, le fait que ces
emprunts financent non seulement le déficit budgétaire mais aussi
l'amortissement de la dette, le remboursement des crédits TVA et autres
a des incidences directes sur le niveau de production et par ricochet sur celui
des exportations, affectant ainsi la balance commerciale du pays. Selon les
calculs de la Banque mondiale (cahier économique du Cameroun 2018), pour
l'ensemble de la période 1965-2018, le Cameroun enregistre une moyenne
annuelle de -1,57 de sa balance commerciale. Sur la base des données
disponibles sur 54 ans, la Banque mondiale estime qu'en 2025 la valeur devrait
osciller autour de -6,22%.
La réduction de déficit budgétaire et du
déficit courant apparaissent dès lors comme une urgence du
gouvernement camerounais. En 2017, le gouvernement du Cameroun a conclu avec le
FMI un programme triennal économique et financier dont les objectifs
sont entre autres : de rééquilibrer les finances publiques, se
prémunir contre des situations de vulnérabilité
budgétaire telles que l'augmentation de la dette publique, bref assurer
la stabilité macroéconomique, facteur essentiel à une
croissance soutenue. Plusieurs préalables dont la gestion plus prudente
des finances publiques par une rationalisation des choix d'investissement
public et des appuis budgétaires dans le cadre du programme
économique et financier du FMI, ayant permis de réduire le solde
global à -2,6% du PIB en 2018 contre -3,1% du PIB en 2017 continuent
d'être poursuivis par le gouvernement. On note également des
actions comme l'Opération de Comptage Physique du Personnel de
l'État (OCPPE) lancée par le Ministère des Finances en
2018 qui a permis la détection de plus de 10 000 fonctionnaires fictifs.
Cette opération vise à assainir le fichier solde de l'État
et réduire la masse salariale; on dénote également la
lutte acharnée du gouvernement contre l'invasion fiscale. Pour les
responsables du Ministère des Finances, il convient donc de
définir ce concept de déficit comme «soutenable». Ces
derniers soulignent qu'il importe d'accroitre les recettes non
pétrolières, tout en augmentant l'efficacité des
dépenses. L'expansion prévue de la couverture des impôts et
des exonérations fiscales, par la loi des finances de 2019, sont
essentiels pour élargir l'assiette fiscale et créer un espace
budgétaire supplémentaire pour les
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Fage 3
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
dépenses prioritaires. Les administrateurs soulignent
aussi d'améliorer l'efficacité des dépenses sociales et
des dépenses d'investissement, pour continuer de réduire la
pauvreté, les inégalités et les disparités
liées au genre tel que prévu par le Document de Stratégie
pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) servant d'agenda sur la période
2010-2020 pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035.
Problématique et question de la recherche
Au cours de la dernière décennie, le Cameroun
n'a pas pu rétablir ni l'équilibre de sa balance
budgétaire ni celui de son compte courant. En 2018, la balance
commerciale du Cameroun s'établit à -6,20% du FIB et le solde
budgétaire quant à lui se situe à -2,8% du FIB.
Malgré les réformes du dispositif de surveillance
multilatérale en zone CEMAC et les efforts du gouvernement qui
mène des politiques visant à relever le niveau de la production
dans le but d'accroitre les exportations, l'on constate la persistance du
double déficit budgétaire et courant d'année en
année. L'intérêt de la présente étude
réside dans le fait qu'elle va participer à l'identification des
déterminants du déficit courant au Cameroun, notamment les
déterminants exogènes liés à l'action
discrétionnaire de l'État. Selon le rapport de la surveillance
multilatérale en zone CEMAC, les efforts du Cameroun en termes
d'assainissement des finances publiques depuis les réformes de 2016 ne
sont pas négligeables. Cependant, ce qui n'est pas souvent
analysé dans la littérature c'est le lien entre les indicateurs,
notamment le lien entre les efforts réalisés en termes de
réduction du déficit budgétaire et l'amélioration
du compte courant. Á cet effet, la présente étude permet
de combler ce vide en explorant la relation de causalité entre le solde
budgétaire et le solde du compte courant au Cameroun.
Dès lors, l'on s'interroge sur la nature du lien
existant entre le solde budgététaire et celui de la balance
courante au Cameroun.
Dans le présent travail, nous souhaitons donc aborder
la question de la mesure selon laquelle le déficit budgétaire
pourrait entraîner celui de la balance courante au Cameroun.
L'interrogation correspondante à cet effet est la suivante :
l'accroissement de la dépense budgétaire
comme instrument de politique économique est-il antagoniste avec la
réduction de la balance courante? En d'autres termes, un creusement du
déficit budgétaire pour assurer la croissance du PIB est-il cause
de la dégradation du déficit de la balance courante?
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 4
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Objectifs de l'étude
L'objectif général de ce travail est de tester,
pour le cas du Cameroun, l'hypothèse de déficits jumeaux :
«il existe une relation positive entre le déficit budgétaire
et le déficit de la balance courante».
Afin de parvenir à l'objectif final
sus-évoqué, il est judicieux de se fixer des objectifs
intermédiaires à savoir :
1. identifier les facteurs susceptibles d'expliquer la
coexistence du double déficit budgétaire et courant au
Cameroun;
2. déterminer l'effet d'un choc du déficit
budgétaire sur la balance courante au Cameroun;
3. tester le sens de causalité entre les déficits
budgétaire et courant et dégager la nature du lien (dans les cas
où celui-ci existe) entre les deux soldes considérés;
4. déduire (dans le cas de la confirmation de
l'hypothèse des déficits jumeaux) les effets de ceux-ci sur
l'économie camerounaise.
Hypothèses de recherche
Dans le but d'atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés, il est judicieux d'adopter quelques hypothèses
tirées des résultats de quelques études empiriques portant
sur les déficits jumeaux. D'une part, inspiré des
résultats de MAHAMADOU DIARRA (2015) sur le thème:
«L'hypothèse de déficits jumeaux: une évaluation
empirique appliquée au pays de l'UEMOA», nous adoptons
l'hypothèse suivante :
H1 : Une amélioration du déficit
budgétaire pourrait induire celle du solde du compte courant au
Cameroun, mais dans une proportion moindre.
D'autre part, les travaux de Véronica Sulikova (2015)
sur la dynamique des déficits jumeaux dans le contexte des
déséquilibres macroéconomiques mettant en lien
l'investissement public, le solde budgétaire et le solde du compte
courant, nous conduisent à la formulation de l'hypothèse suivante
:
H2 : Un accroissement des dépenses d'investissement
public pourrait améliorer le solde du compte courant tout en
détériorant le solde budgétaire au Cameroun.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 5
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Méthodologie
Pour atteindre les objectifs fixés, il sera question de
:
· procéder à l'identification des
variables qui permettent de tester l'hypothèse des déficits
jumeaux au Cameroun en se basant sur la revue théorique et empirique des
déficits jumeaux et faire une analyse descriptive de ces variables afin
de retenir celles qui, d'un point de vue descriptif, de prime à bord,
semblent expliquer la persistance simultanée des déficits
budgétaire et courant au Cameroun.
· estimaer des équations de comportement à
l'aide d'une spécification de type VECM.
Á noter que les données utilisées sont
tirées du tableau des comptes nationaux de l'INS et du Tableau des
Opérations Financières de l'État (TOFE), produit par le
MINFI.
Organisation du travail
De façon structurelle, le présent travail de
recherche qui vise à tester l'hypothèse des déficits
jumeaux pour le cas du Cameroun comporte deux parties. La première
partie s'intitule : cadre conceptuel, cadre théorique et empirique.
Cette partie comporte deux chapitres : le premier chapitre intitulé :
cadre conceptuel de l'étude, présente les définitions des
différents concepts qui permettent de mieux appréhender le
phénomène des déficits jumeaux et propose un cadre
analytique des déficits jumeaux par l'approche des comptes nationaux. Le
second chapitre présente le cadre théorique et empirique de
l'étude. Ce chapitre aborde les différentes approches
théoriques qui permettent de tester l'hypothèse des
déficits jumeaux ainsi que quelques travaux empiriques ayant
addresé la question.
La seconde partie beaucoup plus pratique est consacrée
à l'analyse du lien empirique entre le solde budgétaire et le
solde courant au Cameroun. Cette partie comporte également deux
chapitres. Le premier chapitre de cette seconde partie fait un aperçu
global d'un point de vue descriptif, du phénomène des
déficits jumeaux pour le cas du Cameroun. Ce chapitre analyse non
seulement les indicateurs économiques en lien avec les déficits
budgétaire et courant, mais présente en outre les principales
mesures d'optimisation des dépenses publiques au Cameroun, ainsi que les
mesures agissant sur les exportations, les importations, la production et le
commerce.
Notons que ces deux parties ci-haut mentionnées seront
encadrées par une introduction générale et une conclusion
générale assortie de quelques recommandations à l'endroit
des futurs chercheurs ainsi qu'à l'endroit du politique.
6
Première partie
Cadre conceptuel, cadre théorique et
empirique
7
CHAPITRE 1
Cadre Conceptuel de l'étude
Le présent chapitre est subdivisé en deux
parties. La première partie donne les définitions de certains
concepts utiles pour la bonne compréhension de nos travaux et la seconde
partie présente une approche par les comptes nationaux de la preuve de
l'existence simultanée d'un déficit budgétaire et d'un
déficit courant. Cette seconde partie consiste à partir des
identités de la comptabilité nationale pour prouver la
possibilité d'existence d'une relation positive entre le déficit
budgétaire et le déficit courant dans une même
économie.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 8
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
1.1 Définition des concepts
Dans cette section nous définissons les concepts de
déficit budgétaire, déficit courant et déficits
jumeaux ainsi que tous les autres concepts qui entrent dans le calcul des
soldes budgétaire et courant.
1.1.1 Compte de l'État : déficit
budgétaire, excédent budgétaire
1.1.1.1 Les recettes de l'État
Les recettes puliques comprennent tous les encaissements non
remboursables, avec ou sans contrepartie, à l'exception des
encaissements non-remboursables et sans contrepartie correspondant à des
versements non obligatoires provenant des autres administrations publiques
intérieures ou étrangères et d'institutions
internationales. Les recettes sont réparties entre recettes courantes et
recettes en capital, ces dernières ne comprenant que le produit des
ventes de biens de capital et de transfert en capital qui proviennent de
sources autres que les administrations publiques. Les recettes courantes
englobent donc toutes les recettes fiscales et les ventes non fiscales
courantes. Les recettes non courantes comprennent les encaissements avec
contrepartie : revenu de la propriété, droits et redevances,
ventes des branches non marchandes et ventes d'accessoires, ainsi que les
excédents d'exploitation des unités de production marchande des
administrations publiques et certains décaissements sans contrepartie
tels que les amendes, les confiscations et les donations privées de
caractère courant (SCN 2008).
1.1.1.2 Les dons
Les dons sont les encaissements sans contrepartie et non
remboursables, correspondant à des versements non obligatoires au profit
des administrations publiques et provenant d'autres administrations publiques
ou institutions internationales (SCN 2008). Dans le présent travail, le
terme «don» s'applique uniquement aux décaissements et
encaissements entre administrations publiques ou institutions internationales.
Les versements sans contrepartie, non remboursables et non obligatoires qui
proviennent d'autres sources ne sont pas classés dans les dons mais
plutôt dans les recettes.
1.1.1.3 Les dépenses des l'État
Les dépenses comprennent tous les paiements non
remboursables des APU, qu'il s'agisse des opérations avec ou sans
contrepartie et qu'il s'agisse des dépenses courantes ou en capital.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 9
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Les versements de dons ou transferts à d'autres APU ne
constituent pas une autres catégorie distincte mais sont compris dans
les dépenses (SCN 2008).
1.1.1.4 Les prêts moins les recouvrements
Les prêts moins les recouvrements comprennent les
opérations des APU relatives aux créances sur les tiers qu'elles
acquièrent pour mettre en oeuvre la politique générale, et
non pour gérer leurs liquidités ou pour obtenir un revenu. Cette
catégorie recouvre la dette de tiers aussi bien que les participations,
et les décaissements, aussi bien que les encaissements. On y enregistre
donc les prêts des APU à des fins de politique
générale, diminués de leurs recouvrements
ultérieurs, et les participations qu'elles prennent aux mêmes
fins, diminuées de toute vente ultérieure de participation (SCN
2008).
1.1.1.5 Le déficit ou l'excédent
En comptabilité nationale, la notion de déficit
budgétaire s'utilise lorsque le budget de l'État est en
déficit : les recettes de l'État (hors emprunt) sont
inférieures à ses dépenses (hors remboursement d'emprunt)
d'où le solde budgétaire négatif. Dans le cas contraire,
on parlera d'excédent budgétaire.
De même, les administrations publiques perçues
comme l'ensemble composé de l'État, de l'administration
territoriale et des administrations de sécurité sociale,
connaissent un déficit public lorsque les dépenses publiques pour
une année donnée sont supérieures aux recettes publiques;
le solde de finances publiques est alors négatif.
Le déficit budgétaire peut se traduire par de
nouveaux emprunts contractés par l'État au cours de
l'année, en plus de ceux destinés à amortir les emprunts
antérieurs arrivés à échéance.
La formule retenue dans le manuel de statistiques de finances
publiques est la suivantes :
Déficit ou Excédent = Dépenses au
titre de biens et services et transferts + prêts moins recouvrements -
Recettes - Dons.
1.1.2 Compte courant : déficit courant,
excédent courant
Dans cette partie, nous allons voir comment se définit
la balance courante. Ainsi, nous allons débuter par un rappel sur
l'équilibre comptable.
NDT ZAMBO Jean *** Mémoire TSE
Page 10
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
1.1.2.1 Équilibre comptable en économie
fermée
En économie fermée, la production finale
domestique est égale aux achats finals de biens et services par les
ménages, les entreprises et l'État :
Y = C + I + G (1.1)
En retranchant C et T des deux membres et en ajoutant -T
+T dans le membre de gauche, nous obtenons une nouvelle équation
comptable selon laquelle l'épargne est égale à
l'investissement :
(Y-C-T)+(T-G)=I,==S=I (1.2)
Cela signifie que la production des entreprises qui est
égale au revenu distribué (Y S = C + I + Spriv + T) leur
revient sous la forme d'une demande (Y D = C + I + G).
En revanche, en économie ouverte, l'épargne ne
sera pas nécessairement égale à l'investisse-ment national
puisqu'un excès d'investissement sur l'épargne peut être
financé par un emprunt au reste du monde et tout surplus
d'épargne par rapport à l'investissement pourra être
investi à l'étranger.
1.1.2.2 Équilibre comptable en économie
ouverte
En économie ouverte, une grande partie de la production
finale domestique est toujours achetée par les ménages, les
entreprises et l'État, la partie restante est vendue au reste du monde
(RDM) :
Y = CD + ID + GD + EX - IM
(1.3)
On retranche les importations TM de la somme des emplois
finals C + I + G + EX, car la production finale domestique a pour
contrepartie une demande s'adressant uniquement à cette production.
Puisque les ménages consomment les biens importés d'un montant
CF, les entreprises et l'État achètent des
biens produits par le RDM pour le montant IF +
GF, on doit retrancher le montant des importations de
façon à obtenir la seule demande s'adressant à la
production finale domestique. La relation comptable pourrait être
réécrite de la façon suivante:
Y = CD + ID + GD + EX
(1.4)
Où CD + ID + GD
représente la composante de la demande agrégée
formulée par les seuls résidents s'adressant au PTB.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 11
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
En résumé, en économie ouverte :
1. la production finale domestique est toujours égale
à la demande finale s'adressant aux biens et services domestiques, une
part de la production étant vendue aux non-résidents
(c'est-à-dire exportée);
2. les revenus Y peuvent être supérieurs ou
inférieurs à la dépense finale des ménages, des
firmes et du gouvernement C + I + G selon que les exportations, EX,
sont supérieures ou inférieures aux importations, IM.
1.1.2.3 Flux internationaux de capitaux et la balance
commerciale
Pour déterminer l'équilibre du marché des
capitaux à partir de l'équilibre comptable sur le marché
des biens et services, nous retranchons et ajoutons l'impôt dans le
membre de gauche. Nous obtenons une nouvelle relation comptable qui peut
être interprétée de deux façons :
Y = C + I + G + TB
(Y-T-C)+(T-G)-I=TB,
Spriv + Spubl - I =
TB
En économie ouverte, la part des revenus peut
être dépensée en biens et services produits par le reste du
monde et une part de la production peut être vendue au reste du monde.
Lorsque le pays domestique ne peut pas emprunter sur le marché des
capitaux, il doit équilibrer sans cesse la balance commerciale.
|
=0
z }| {
Spriv + Spubl - I =
|
=0
z}|{
TB,S = I
|
Si la balance commerciale est en déficit, TB <
0, cela signifie que les importations excèdent les exportations, ce
qui est le reflet d'une consommation élevée par rapport à
la production et au revenu puisque :
TB = Y - (C + I + G) < 0
Le corollaire est que l'épargne est faible et va
être insuffisant pour financer les dépenses d'investissement :
l'économie pourra alors emprunter à l'étranger. Si S
- I < 0 : on dit que le pays connaît une entrée
nette de capitaux.
Si l'État décide de réduire les
impôts, T, l'hypothèse des déficits jumeaux suppose que
l'épargne privée n'est pas modifiée car la baisse des
impôts est entièrement dépensée sous la forme
d'achats
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 12
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
supplémentaires de biens et services. En revanche, dans
l'équivalence ricardienne, la baisse de l'épargne publique est
parfaitement compensée par une hausse de l'épargne privée,
la consommation n'étant pas modifiée.
En résumé, l'excès d'investissement sur
l'épargne est financé par un flux de capitaux provenant du RDM et
cette entrée de capitaux a pour contrepartie un déficit
commercial. La relation des flux de capitaux et du solde commercial est
décrite par les équations suivantes :
I - S = entrée de capitaux
=déficit commerciale
S - I = sortie nette de
capitaux=excédent commercial
De manière intuitive, S - I > 0
correspond à un excédent commercial EX - IM
> 0. Quand les dépenses sont faibles relativement à la
production, le pays exporte une fraction plus importante de la production et
importe une fraction plus faible. Comme la consommation est faible par rapport
au revenu, l'excès d'épargne sur l'investissement domestique est
investi à l'étranger. Dans ce cas, le pays est
prêteur net. si le pays emprunte à
l'étranger pour financer l'investissement domestique, il est
emprunteur net.
1.1.2.4 Le produit intérieur brut (PIB)
Le PIB représente la richesse créée par
une économie au cours d'une période donnée. Il est
égal (1) à la valeur totale des biens et services vendus aux
utilisateurs finals (c'est-à-dire la production finale), (2) à la
sommes des valeurs ajoutées des entreprises, et (3) la somme des revenus
distribués dans l'économie. Mais ces revenus ne coïncident
pas effectivement avec les revenus effectivement obtenus par les
résidents puisque le PIB mesure le revenu total gagné sur le
territoire d'un pays : il comprend le revenu gagné sur le territoire par
les non-résidents et n'intègre pas les revenus des
résidents d'un pays obtenus à l'
étranger. si l'on cherche
à obtenir une mesure du revenu des résidents d'un pays en prenant
en compte les revenus versés par le RDM aux résidents et
déduisant les revenus versés par le pays domestique aux
non-résidents, on obtient le PNB :
PNB = PIB + RNF = PIB + RNI + RNL
Où RNF est le revenu net des facteurs,
composé de somme de RNI et RNL qui représentent
les revenus nets des investissements (revenus obtenus par les résidents
moins les revenus obtenus par le non-résidents) et les revenus nets de
travail. Le produit national brut représente le
revenu
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 13
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
effectivement reçu par les résidents qui se
limite plus aux revenus sur le territoire considéré. Il comprend
donc le revenu reçu à l'étranger par les résidents
de ce pays mais n'intègre pas les revenus que les non-résidents
obtiennent sur le territoire (qui ont été déduits du
PIB).
En ajoutant les transferts courants nets (TCN) qui
correspondent à des transferts d'argent sans contrepartie d'actifs
(comme le versement de retraite à des non-résidents qui ont
travaillé sur le territoire ou l'aide aux pays étrangers :
retraites versés aux non-résidents, rapatriement d'argent
'remitances', aides au PVD, transferts aux organisations internationales), on
obtient le revenu national (noté RN) :
RN = PNB + TCN
1.1.2.5 Balance courante et identité
comptable
Quelle est la différence entre la balance courante et
la balance commerciale? L'écart entre ces deux grandeurs est du
même ordre que l'écart entre le PIB et le revenu national (RN). On
note RNF le revenu net des facteurs ce qui permet de réécrire
l'équilibre sur le marché des biens et services de la
façon suivante :
Y + RNF _ T = C + I + (RNF + EX _ IM) (1.5)
Le membre de gauche de (1.5) représente le revenu
national des résidents après impôts. En utilisant le fait
que l'épargne privée est égale à la part du revenu
disponible qui n'est pas consommée, c'est-à-dire, SP
= Y + RNF _ C _ T, on obtient une identité comptable qui nous
permet de définir la balance courante :
CA = RNF + EX _ IM = (SP + SG _ I) = S
_ I = /B (1.6)
Cette relation confirme que la balance courante est
très proche de la balance commerciale. En supposant que la position
extérieure nette est nulle (en mettant de côté les TCN et
les revenus nets du travail), lorsque les importations du pays sont
supérieures aux exportations, le pays enrégistre un
déficit courant. Lorsque le pays enregistre un excédent courant,
le pays accumule les actifs étrangers ou réduit sa dette
extérieure nette. Par conséquent, la balance courante peut
être définie comme la variation de la position extérieure
nette, notée L B. Si un pays consomme plus que ce qu'il
produit, il doit emprunter la différence au RDM. Lorsque les actifs
étrangers détenus par le pays domestique sont plus faibles que
les actifs financiers détenus par le RDM, alors le pays est
débiteur net : sa position extérieure nette est
négative.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 14
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
1.1.3 Déficits jumeaux
En économie, les déficits jumeaux ou double
déficit désignent la situation d'un pays enregistrant en
même temps un déficit public et un déficit de sa balance
courante (Abell, 1990).C'est-à-dire une situation dans laquelle les
dépenses des administrations publiques excèdent leurs revenus, et
où les importations de biens et services sont supérieures aux
exportations. L'expression de déficits jumeaux est utilisée pour
caractériser l'économie des États-Unis au début des
années 1980, et au cours des années 2000. La monnaie des
États-Unis, le dollar américain, qui joue le rôle de
monnaie de référence à l'échelle mondiale
malgré la disparition des Accords de Bretton Woods, permet probablement
le maintien d'une telle situation sur le court et moyen termes.
1.2 Cadre analytique des déficits jumeaux :
approche par les comptes nationaux
Les déficits jumeaux sont issus de deux équations
comptables, celles de la demande inté-
rieure et des revenus, qui sont des identités donc
toujours vrais d'un point de vue comptable.
Soit les équations de l'équilibre
emplois-ressources de la comptabilité nationale :
- Ressources : Y + M
Les ressources sont l'ensemble des biens et des services
disponibles dans l'économie nationale
et dans le reste du monde.
- Emplois: C + I + G + X
Les emplois désignent la manière dont les
ressources sont utilisées (employées) par les agents
résidents et non-résidents (ménages qui
consomment, entreprises qui investissent, les adminis-
trations publiques (APU) qui investissent et consomment). Toutes
les ressources sont employées.
Dès lors,
Y + M = C + I + G + X est toujours
vérifiée d'un point de vue comptable.
- Demande intérieure/interne/C + I + G
- Demande extérieure/externe : X
- Demande globale: C + I + G + X
- Offre intérieure/interne : Y
- Offre extérieure/externe :
M
- Offre globale : Y + M
Y est le PIB (offre des entreprises résidentes), M
désigne les importations (demande des ménages
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 15
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
résidents en biens et services des produits par le
reste du monde), C représente la consommation (ou consommation finale
des ménages= demande des ménages résidents en biens et
services produits par les entreprises résidentes et du reste du monde),
I les investissements (ou formation brute de capital fixe=les investissements
des entreprises résidentes), G les dépenses publiques (la
consommation des APU+ investissement des APU) et X les exportations (demande
des ménages du reste du monde de biens et services produits par les
entreprises résidentes).
Et l'équation comptable des revenus : Y = C + S +
T.
S désigne l'épargne privée, T le montant
des prélèvements obligatoires (impôts + cotisations
sociales) et C la consommation telle que définie
précédemment.
Démonstration :
Reformulons l'équation de l'équilibre
emplois-ressources :
|
Y + M = C + I + G + X
|
(1.7)
|
|
Nous obtenons donc :
|
|
|
C + S + T = C + I + G + X - M
ce qui équivaut à :
|
(1.8)
|
|
Y-T-C-I-(G+T)=X-M
|
(1.9)
|
|
On note l'épargne nationale:
|
|
|
S = Y - C - G
ce qui équivaut à :
|
(1.10)
|
|
S + T = I + G + (X - M)
|
(1.11)
|
|
Équivaut à :
|
|
|
(S - I) + (T - G) = (X - M)
|
(1.12)
|
· S - I représente le solde de
financement des agents privés. Si S > I, les
capacités de financement du secteur privé du pays excèdent
ses besoins de financement.
· T - G est le solde budgétaire de
l'État. Quand l'État a un déficit budgétaire nous
avons
T < G
· X - M est le solde de la balance commerciale que
nous notons par X - M = BC Soit :
(S-I)+(T-G)=BC (1.13)
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 16
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
En différentiant par rapport à G on
constate que :
d(BC)/dG < 0. (1.14)
On conclut qu'une augmentation des dépenses publiques
dégrade la balance commerciale d'où le terme «
déficits jumeaux ».
Conclusion
Le présent chapitre a porté sur le cadre
conceptuel de l'étude. Il a permis de comprendre la signification des
différents concepts qui seront utilisés dans le cadre de ce
travail. Ce chapitre a également permis, grâce à des
équations d'équilibre de la comptabilité nationale, de
donner un intérêt à cette étude, en faisant une
preuve mathématique de la coexistence du déficit
budgétaire et courant au sein d'une même économie.
17
CHAPITRE 2
Fondements théoriques, mise en évidence
des travaux empiriques et choix méthodologique
Le présent chapitre est subdvisé en deux
sections. La première setion présente le cadre théorique
et empirique de l'étude. Dans le cadre théorique, quatre
approches sont présentées : la théorie behaviouriste et
l'approche keynésienne ainsi que la vision néoclassique et
l'hypothèse d'équivalence ricardienne. La seconde section quant
à elle présente les motivations du choix méthodologique
ainsi que la méthodologie retenue en ehxaustivité.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 18
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
2.1 Cadre théorique et empirique
Cette section présente un cadre théorique
suivant différentes approches ainsi qu'un cadre empirique regroupant
quelques études ayant tester l'hypothèse des déficits
jumeaux.
2.1.1 Cadre théorique
2.1.1.1 Théorie behavioriste et approche
keynésienne
La relation entre déficit budgétaire et le
déficit courant ne fait pas l'unanimité des économistes.
Dans la littérature qui affirme l'hypothèse des déficits
jumeaux, la nouvelle école de Cambridge représentée par
Godley et Cripps (1974) adopte l'une des premières approches
théoriques : la théorie «behavioriste». Les partisans
de cette école soutiennent l'idée selon laquelle tout
déficit budgétaire conduit à une
détérioration du compte courant. La théorie behaviouriste
admet donc l'existence d'une relation unilatérale allant du
déficit budgétaire vers le déficit du compte courant.
En outre, dans le cadre de la libéralisation des
marchés financiers, la plupart des gouvernements se sont
appropriés les fondamentaux de Keynes, à savoir pratiquer le
déficit public pour générer de la croissance.
Á ce sujet, Keynes substitue à la classique
approche de la monnaie une nouvelle approche par le revenu : ainsi, si les
entrepreneurs viennent à faire des anticipations plus optimistes
liées à l'accroissement de la confiance, ils accroissent alors
leurs investissements nets (total des dépenses des entreprises moins les
coûts d'usage, c'est-à-dire le vieillissement du capital dû
au progrès technique qui augmente d'autant avec la concurrence),
augmentant alors le niveau d'emploi mis en oeuvre pour ce faire, accroissant de
fait ainsi le revenu (somme des couts de production et du profit non
distribué exprimée en monnaie) et la consommation des
ménages.
En amont de leur démarche, les entrepreneurs financent
l'accroissement de leurs investissements, non pas par de l'épargne
thésaurisé, donc inexploitée, mais par une demande
supplémentaire engendrant la création de la monnaie aux
banques.
Or, l'État, par les règles et conventions qu'il
met en oeuvre, est le seul entrepreneur qui puisse réellement
réduire l'incertitude de leurs anticipations, notamment par une action
sur le taux d'intérêt. D'où la pensée de Keynes qui
souhaite voir l'État prendre une responsabilité de plus en plus
grande dans l'investissement. Selon Keynes, si le budget de l'État est
en équilibre, et s'il a toujours été en équilibre
dans le passé, l'offre de monnaie, par définition, serait nulle
et aucune
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 19
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
demande de réserves liquides ne pourrait être
satisfaite. Si par contre le marché de la monnaie doit être en
équilibre, pour que l'on puisse réaliser une
égalité entre l'offre et la demande de monnaie, il faut que le
gouvernement soit prêt à créer ou annuler le déficit
budgétaire, non pas selon les exigences de la dépense publique,
mais selon les variations qui se vérifient dans la demande de
monnaie.
Par ailleurs, dans l'optique keynésienne, le
déficit budgétaire a une incidence significative sur le compte
courant. Les études de Fleming (1962), Mundell(1963), Kearney et
Mond-jemi(1990) et Haug(1996) montrent qu'à travers les canaux de taux
d'intérêt et de change, le déficit budgétaire cause
le déficit extérieur courant. En considérant une petite
économie ouverte, dans le modèle IS-LM-BP, un accroissement du
déficit public pourrait induire une pression à la hausse sur les
taux d'intérêt. Cela pourrait causer l'entrée des capitaux
étrangers. Cette entrée de capitaux entraine une
appréciation de la monnaie nationale à travers la demande
élevée des actifs domestiques induisant une
détérioration du compte courant, à travers le
découragement des exportations et l'encouragement des importations.
Ainsi, selon la théorie keynésienne, le sens de causalité
entre le déficit budgétaire et celui du compte courant va du
premier vers le second.
Bipsham (1975), dans l'idée des prolongements de
l'hypothèse behaviouriste et l'approche keynésienne
traditionnelle, arrive à la conclusion selon laquelle c'est le
déficit extérieur qui cause le déficit budgétaire.
Cet auteur soutient cette dernière conclusion par le fait que : lorsque
les exportations augmentent suite à une expansion de la demande
mondiale, le solde du compte courant s'améliore. La production et
l'emploi domestique s'accroissent, ce qui est de nature à
améliorer les recettes fiscales et par conséquent le solde
budgétaire. Ainsi, une amélioration du solde extérieur va
donc induire une amélioration du solde budgétaire.
On peut donc cependant retenir que les deux
approches admettent l'existence des déficits jumeaux même si le
sens de la relation ne fait pas l'unanimité.
2.1.1.2 Vision néoclassique et hypothèse
d'équivalence ricardienne
La nouvelle théorie classique récuse la
relation causale entre les déficits budgétaire et courant. En
effet, selon l'hypothèse d'équivalence ricardienne
formulée par Barro(1974) et fondée sur l'idée que lorsque
l'État génère un déficit par une baisse des
impôts (ou une hausse des dépenses publiques), les ménages
anticipent une hausse des impôts futurs. La valeur actualisée des
impôts futurs anticipés sera exactement égale à la
baisse des impôts courants. En conséquence, la richesse des
ménages ne change pas et la baisse des impôts n'a pas d'effet sur
l'activité.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 20
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
D'après cette hypothèse, il n'y a aucune
relation entre les deux variables. En d'autres termes, le déficit
extérieur n'est pas la conséquence du déficit des finances
publiques. Selon cette vision, les changements dans les dépenses
publiques et/ou dans les recettes publiques n'ont pas d'effets réels sur
le taux d'intérêt, l'investissement ou le solde du compte courant;
dans la mesure où le creusement du déficit budgétaire
(diminution de l'épargne publique) est compensé par la
constitution d'épargne privée supplémentaire
équivalente. Cependant, cette hypothèse peut s'appliquer dans le
cas particulier de pays en développement où les marchés de
l'assurance et du crédit sont imparfaits. Par ailleurs, les contraintes
de liquidité (à l'exemple du rationnement des crédits
bancaires) limitent la possibilité pour les agents de lisser leur
consommation dans le temps qui dépend davantage du revenu courant que du
revenu permanent (TANIMOUNE et all, 2005).
2.1.2 Cadre empirique
Comme on a pu le constater, la théorie
économique reste ambigüe dans l'explication du lien causal entre le
déficit des finances publiques et celui du compte courant. Ces
différentes approches théoriques souvent opposées
constituent le point d'ancrage de l'importante littérature empirique qui
continue d'être développée jusqu'à nos jours. En
effet, de nombreuses études testent l'hypothèse des
déficits jumeaux en recourant à différentes
méthodes. Elles aboutissent à des résultats parfois
divergents.
De façon générale, les résultats
empiriques sur le lien de causalité entre le déficit
budgétaire et le déficit extérieur sont mitigés
Mouhamadou(2015). Au regard des études trouvées, quatre groupes
de travaux se dégagent dans la littérature empirique :
· le premier type de travaux est celui qui corrobore
l'hypothèse keynésienne (Hypothèse1). Ces travaux
aboutissent au résultat selon lequel le lien de causalité entre
le déficit budgétaire et le déficit courant va du premier
vers le second (Vamvoukas, 1999; Endegnanew et all, 2012; Trachanas E. et al,
2013; Hutchuison et al., 1984; Bacham, 1992; Piersanti, 2000; Leachman et al.,
2002);
· le deuxième groupe concerne les travaux qui
mettent en exergue un lien causal allant du déficit extérieur
vers celui des finances publiques (Hypotèse2) (Alkswani, 2000; Marashdeh
H. et al. 2006; Marinheiro, 2007; Ardiyanto, 2010);
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 21
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
· le troisième groupe de travaux établit
un lien bidirectionnel entre les deux variables (Hypothèse 3) (Islam,
1998; Lau et al., 2004; Mukhtar et al., 2013);
· Le dernier groupe d'étude valide
l'hypothèse d'équivalence ricardienne (Hypothèse4)
(Ha-liciglu et al., 2013; Sobrino, 2013; Algieri B., 2013).
Les premiers travaux empiriques qui valident
l'hypothèse de déficit jumeaux portent sur les Etats-Unis.
Hutchison et Pigott (1984) présentent un modèle
macroéconomique théorique qui met en relation le déficit
budgétaire, le taux d'intérêt, le taux de change et le
compte courant pour une économie ouverte en régime de change
flexible. Leur modèle suggère que le déficit
budgétaire tend à accroitre le taux d'intérêt
domestique, ce qui pousse à la hausse le taux de change réel,
conduisant en dernier ressort à la dégradation du compte courant.
En appliquant ce modèle au cas américain, ils montrent que la
politique de déficit budgétaire est la cause principale du
déficit extérieur. De même, Bundt et Soloch (1988), en
utilisant un modèle standard de portefeuille à deux pays,
montrent que l'accroissement de la dette publique américaine est
à l'origine de l'appréciation du dollar américain
relativement au mark allemand et au dollar canadien sur la période
1973-1987. Selon Bundt et Soloch, cela met en exergue le lien entre
déficit budgétaire et le déficit commercial dont le canal
de transmission est le taux de change. En outre, les travaux d'Abell (1990) et
de Rosenweig et Tallman (1993) montrent qu'il y a un lien fort entre le
déficit commercial et le déficit budgétaire
américains.
Cependant, Feldstein (1992) montre qu'il n'y a pas de lien
entre le déficit budgétaire et le déficit commercial
américain au cours des années 1980. Il affirme que le gap
d'épargne qui conduit au déficit extérieur n'est pas
dû à l'accroissement du déficit budgétaire mais
plutôt à une forte baisse de l'épargne privée. Le
déficit budgétaire tend à accroitre les taux
d'intérêt réels et à évincer l'investissement
privé et les exportations nettes. Cette idée a été,
selon l'auteur, la principale explication du grand déficit du compte
courant américain dans les années 1980. Selon l'auteur, l'effet
adverse le plus important de ce faible taux d'épargne n'est pas sur le
compte courant mais sur la croissance économique de long terme.
Dans le cadre des pays de l'OCDE, Piersanti (2000) s'appuie
sur un modèle d'équilibre général qui
intègre les anticipations sur les déficits budgétaires
pour appréhender la relation entre les déficits budgétaire
et extérieur. Ses résultats empiriques soutiennent fortement
l'hypothèse
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 22
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
des déficits jumeaux dans la plupart de ces pays sur
la période 1970-1997. De ce fait, l'hypothèse des déficits
jumeaux est valide quand les anticipations sur les déficits
budgétaires sont prises en compte. Ce résultat semble contredire
l'hypothèse d'équivalence ricardienne qui prétend que les
anticipations des déficits budgétaires annihilent les effets de
la politique budgétaire.
Dans les pays en développement, quelques études
testent l'hypothèse des déficits jumeaux. Par exemple,
Islam(1998) examine la relation causale entre les deux variables au
Brésil sur la période 1973-1991. En utilisant les tests de
causalité de Granger, il met en exergue une relation causale
bidirectionnelle entre les deux déficits. De même, Khalid et Guan
(1999) utilisent la technique de cointégration proposée par
Johansen et Juselius (1990) pour examiner cette relation causale entre les deux
soldes. Leur étude s'applique à cinq pays
développés (USA, RU, France, Canada et Australie) et cinq pays en
développement (Inde, Indonésie, Pakistan, Egypte et Mexique).
Elle couvre la période allant de 1950 à 1994 pour le premier
groupe et de 1955 à 1993 pour le second. Les résultats mettent en
évidence une forte corrélation statistiquement significative
entre les deux déficits à long terme dans les deux groupes de
pays. De plus, ils montrent que la corrélation est plus forte dans les
pays en développement que dans les pays développés. Quant
au sens de causalité, les deux auteurs obtiennent des résultats
ambigus. Par exemple, pour l'Inde, la relation est bidirectionnelle tandis que
pour l'Indonésie et le Pakistan, la relation causale va du
déficit extérieur vers le déficit budgétaire. Ils
expliquent cette relation inverse par le fait que le déficit
extérieur est financé par des emprunts extérieurs. Cela
contribue à alourdir la dette de sorte que le poids élevé
de la dette extérieure engendre un service de la dette important, toute
chose qui creuse le déficit budgétaire. Aussi, Lau et Baharumshah
(2004) examinent-ils la relation entre les deux soldes dans le cas de la
Malaisie en utilisant le test de Wald modifié développé
par Toda et Yamamoto (1995). Leur résultat empirique atteste l'existence
de lien de causalité bidirectionnel entre le déficit
budgétaire et le déficit du compte courant.
Pour le cas spécifique des pays de l'Afrique au Sud du
Sahara (ASS), des travaux récents adressent la question. On peut citer
par exemple l'étude d'Omoniyi et al. (2012) qui porte sur le
Nigéria. Ces auteurs utilisent le test de causalité de Granger
pour mettre en exergue un lien bidirectionnel entre les deux soldes. Il s'agit
également de l'étude de Kwame (2013) dont les résultats
valident l'hypothèse keynésienne des déficits jumeaux au
Ghana.
L'étude de Mouhamadou DIARRA(2015) portant sur sept
pays de l'UEMOA à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire, le
Sénégal, le Bénin, le Burkina, le Niger et le Togo. Ses
résultats sur le test
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 23
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
de causalité au sens de Granger montrent qu'il y a une
causalité de long terme allant du déficit budgétaire vers
le déficit du compte courant au Sénégal et au Togo, pour
le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est plutôt le déficit
courant qui cause le déficit budgétaire, au Bénin et au
Mali les deux variables se causent mutuellement. Pour ce qui est du dernier
pays, à Savoir le Niger, aucune des deux variables ne cause l'autre.
Par ailleurs, la crise des dettes souveraines que les
économies industrialisées connaissent depuis 2008 suscite un
regain d'intérêt pour le thème. Dans cette perspective, un
ensemble d'études effectuées au sein du FMI, sur données
de panel, confirment en général l'hypothèse des
déficits jumeaux. De ces travaux, on peut citer Endegnanew et al (2012)
qui, à travers un panel de 155 pays dont 42 petits pays, montrent qu'une
amélioration du déficit budgétaire de 1 point de
pourcentage se traduit par une amélioration du solde du compte courant
de 0.4%. Il s'agit également des travaux empiriques d'Abbas et al.
(2010) qui prouvent que l'amélioration du compte courant est 0.2
à 0.3% du PIB suite à une amélioration du solde
budgétaire de 1%.
Cependant, lorsque Algieri (2013) réévalue la
relation de long terme entre les deux variables dans les pays de l'UE les plus
durement frappés par la crise de la dette (Espagne, Grèce,
Irlande, Italie, et Portugal), ses résultats supportent
l'hypothèse ricardienne. Cela l'amène à conclure que les
programmes de consolidation budgétaires en cours dans ces pays n'auront
pas d'impact significatif dans ces pays.
2.2 Choix méthodologique
Cette question présente la méthodologie retenue
dans le cadre de ce travail, ainsi que les procédures de tous les tests
économétriques primitives à l'exécution de cette
méthodologie.
2.2.1 Recensement de quelques études selon la
méthodologie utilisée
La présente section fait un récapitulatif de
certaines études empiriques selon la méthodologie utilisée
et le sens de causalité entre les déficits budgétaire et
courant dans quelques pays.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 24
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Tableau 2.1: Recensement de
quelques études empiriques
Pays
|
Auteur et année
|
Variables
|
Modèle
|
Causalité
|
UEMOA
|
M.
DIARRA(2015)
|
Solde Budgétaire
(SB), Solde Courant
(SC)
|
ARDL
|
SB vers SC au Sénégal et au Togo, SC vers SB au
Burkina et en Côte d'Ivoire, causalité bidirectionnelle au Mali et
au Bénin, absence de causalité au Niger
|
RDC
|
J.L Bombonayo (2015)
|
Solde Budgétaire
(SB), Solde Courant
(SC), Taux de crois-
sance économique
(CE)
|
MLM
|
Absence de causalité
|
Trois pays
Bqltes :
Estonie, Lituanie, Lettonie
|
V.Sulinikova (2015)
|
Solde Budgétaire
(SB), Solde Courant
(SC), Investissement
public
|
VECM
|
SB vers SC en Litua-nie et en Estonie, abs-cence de
causalité en Lettonie
|
Maroc
|
Z.Belkadem(2018)
|
Solde Budgétaire
(SB), Solde Courant
(SC)
|
VAR
|
SB cause SC
|
R. Congo
|
A.Ngakosso
(2016)
|
Solde Budgétaire
(SB), Solde Courant
(SC)
|
ARDL
|
Absence de causalité
|
Nigéria
|
Omoniyi(2012)
|
Solde Budgétaire
(SB), Solde Courant
(SC), Taux de change réel (TCr), Taux de croissance
économique (CE)
|
VECM
|
Causalité bidirection-nelle entre BC et SB
|
|
Source : l'auteur, constitué après consultation
de certaines études empiriques
Après avoir parcouru la théorie servant de base
pour l'analyse de l'hypothèse des déficits jumeaux ainsi que bon
nombre d'études empiriques portant sur les déficits jumeaux dans
divers pays, nous faisons la remarque que la plupart des méthodes
employées pour l'analyse des déficits jumeaux sont celles faisant
appel à des valeurs retardées des variables (VAR, VECM, ARDL). Au
regard des données dont nous disposons dans le cadre de cette
étude, et en s'inspirant des travaux de Veronika Sulinikova (2015), il
convient dans notre cas d'estimer un modèle vectoriel à
correction d'erreur (VECM). Cet auteur utilise ce modèle pour exhiber
une relation de long terme entre le solde du compte courant et le solde
budgétaire tout en validant l'hypothèse des déficits
jumeaux en Lituanie et en Estonie. Grâce au test de causalité au
sens de Granger, il
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 25
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
parvient à la conclusion selon laquelle le solde
budgétaire «cause» au sens de Granger le solde du compte
courant dans ces deux pays.
2.2.2 Généralités sur le
modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM)
Pour estimer un modèle vectoriel à correction
d'erreur, la méthode impose que les chroniques soient
intégrées au même ordre et qu'il existe une relation de
cointégration entre les variables considérées. Pour
vérifier l'ordre d'intégration des chroniques, nous faisons
recours aux tests de stationnarité des séries de Dikey-Fuller
Augmenté (ADF) et d'Andrew et Zivot (AZ). Ce choix est justifié
par le fait que ces tests sont faciles d'application et couramment
utilisés. Bien connus dans la littérature, ces tests testent la
présence ou non de racines unitaires dans une série. En fait, le
test ADF est efficace en cas d'autocorrélation des erreurs et le test AZ
est utilisé pour une série qui accuse une rupture de structure ou
changement de régime identifié de façon
endogène.
La vérification de l'existence d'une relation de
cointégration se fera à l'aide du test de cointégration de
Johansen.
2.2.2.1 Le test de Dickey-Fuller Augmenté
(ADF)
Il consiste à vérifier l'hypothèse nulle
de non stationnarité H0 : p =1 contre
l'hypothèse alternative H1 : p > 1. Ce test est
basé sur l'estimation des moindres carrés des trois
modèles suivants:
/xt =(p -1)xt_1 + Pk
j=2èj/t_j_1+åt :
processus sans trend et sans constante
/xt =(p -1)xt_1 + Pk
j=2èj/t_j_1+á +
åt : processus sans trend et avec constante
/xt =(p -1)xt_1 + Pk
j=2èj/t_j_1+á
+/3t + t : processus avec trend et avec constante.
2.2.2.2 Le test d'Andrew et Zivot (AZ)
Zivot et Andrews (1992) ont développé un test
de racine unitaire avec une rupture structurelle introduite de manière
« endogène », c'est-à-dire que le point de changement
(inconnu) est estimé plutôt que fixé.
Ils considèrent l'hypothèse nulle de racine
unitaire sans rupture structurelle exogène, et l'hypothèse
alternative d'un processus stationnaire en tendance avec un changement dans la
tendance à un moment inconnu du temps TB (1 < TB < T).
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Zivot et Andrews (1992) régressent l'équation de
régression suivante :
Xt = I-L +
8DUt(A)+i3t +
áXt_1 + Pk
j=1cjÄXt-j
+ åt.
Où DUt(A) =1 si t
> TA, 0 sinon et A= TB/T est la localisation du
point de rupture. Puisque la rupture structurelle est endogène, on
utilise la statistique de Dickey-Fuller minimum pour tester la présence
d'une racine unitaire, et on rejette l'hypothèse nulle d'une racine
unitaire si :
Inf
À
tá(A)<KInf,á
Où KInf,á
représente la valeur critique de
Inf
ë
tá(A).
2.2.2.3 Test de cointégration de Johansen
Pour tester l'existence d'une relation de long terme entre
des variables, l'on fait recours à des procédures statistiques,
notamment celle d'Engle et Granger (1987) et celle de Johansen (1988, 1991).
Étant donné que le test de Engle et Granger ne se limite qu'au
cas bivarié, nous n'allons pas l'appliquer dans notre cas précis
où nous testons la cointégration de plus de deux variables (le
test s'appliquera à quatre variables). La cointégration entre les
variables retenues sera donc testée à l'aide du test de
Johansen.
Johansen (1988) teste la cointégration à l'aide
des estimateurs du maximum de vraisemblance. Il s'agit d'un test de rang de
cointégration, utilisé lorsqu'il y a plusieurs vecteurs
cointégrants ou dans le cas d'une régression multiple (plus de 2
variables), qui exige que les séries soient intégrées de
même ordre. Dans ce test, l'on procède par élimination ou
exclusion d'hypothèses alternatives pour deux fins: (i) identifier le
nombre de relations de cointégration optimal indispensable pour
l'estimation d'un vecteur à correction d'erreurs (modèle VECM ou
VEC), et (ii) identifier la forme du modèle VECM/VEC en optant pour des
équations avec ou sans tendance déterministe, soit des
équations avec ou sans tendance linéaire, soit avec ou sans
tendance quadratique. Les différentes formes ou spécifications de
modèle VECM en fonction de types de processus sont reprises dans le
tableau ci-dessous :
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 26
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 27
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Tableau 2.2:
Différentes formes du modèle VECM
|
Forme ou type de spécification VECM
|
Processus
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
Tous les processus sont DS sans
dérive
|
*
|
*
|
|
|
|
Aumoins un processus est un DS avec
dérive
|
|
|
*
|
|
|
Aumoins un processus est TS
|
|
|
|
*
|
|
Aumoins un processus a une tendance
quadratique
|
|
|
|
|
*
|
|
Source : Bourbounais R., 2015, p 313
Les hypothèses du test sont :
H0 : Pas de relation de cointégration ou
rang de cointégration r = 0 -+ LR < CV
H1 : Cointégration ou rang de cointégration
r ~ 1 -+ LR > CV
Avec :
· LR : likelihood Ratio (le Ratio de vraisemblance,
statistique calculée de Johansen);
· CV : Critical value (1%, 5% et 10%)
2.2.3 Présentation du modèle vectoriel
à correction d'erreurs
Lorsque les séries temporelles sont
générées par des processus non stationnaires et
coin-tégrés, il convient d'estimer leurs relations de long termes
aux travers d'un modèle à correction d'erreurs (MCE)
Ce modèle a été introduit dans la
littérature par DAVID HENDRY(1986).
2.2.3.1 Spécificaion du MCE et son estimation :
cas bivarié
On considère deux chroniques {x1,...,
xn} et {y1,..., yn} toutes
intégrées à l'ordre 1.
La relation de long terme s'écrit: yt=
á+13xt+et avec {et, t = 1...,
m} un bruit blanc (espérance
nulle et variance constante).
Les erreurs estimées bet forment
également un bruit blanc .
Les résidus estimés bet peuvent
s'interpréter comme l'écart entre les valeurs réelles de
yt et celles
observées dans l'échantillon.
Cet écart est donc utilisé pour lier le
comportement de court terme (représenté par les séries
en
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 28
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
différence première) et leur comportement de long
terme au travers d'un modèle à correction d'erreurs.
La dynamique de long terme s'écrit :
yt = a + b1yt-1 +
b2xt + b3xt-1 +
et.
A long terme yt = yt-1 et xt =
xt-1
yt = a + b1yt +
b2xt + b3xt + et.
-<,-(1-b1)yt = a +
b2xt + b3xt + et.
En isolant yt, on obtient :
ab2+b3 et
yt= 1-b1 +
1-b1 xt + 1-b1
En posant á=1-b1a ,
â=b2+b3
1-b1 et ut = et
1-b1 , la dynamique de long terme s'écrit :
yt = á + âxt +
ut
Le modèle à correction d'erreur MCE s'obtient
à partir du comportement de court terme : en isolant yt, on
obtient :
yt-yt-1=a+b1yt-1 - yt-1 +
b2xt - b2xt-1 +
+b2xt-1 + b3xt-1 +
et
Dyt = b2Axt - (1 -
b1)[yt-1-âxt-1 - a
1-b1]+ut
En posant : ã=b2, ë=1 -
b1, â=b2+b3
1-b1 on a :
Ayt=a+ãLxt+ëût-1+et
Où {et, t = 1...., n}
BB(0,ó) et .ût est le résidu de
l'estimation entre yt-1 et
xt-1 et ë mesure la force de rappel à
l'équilibre.
Remarque : la spécification du MCE est
justifiée si le paramètre ë est significativement
négatif.
L'estimation des paramètres de ce modèle
nécessite simplement la technique des moindres carrés ordinaires
(MCO) car les composantes du modèle ne font intervenir que des termes
stationnaires. La méthodologie en deux étapes proposée par
ENGLE et GRAGER est :
Étape 0 : Vérification de
l'ordre d'intégration des chroniques : verifier que xt
I(d) et que
yt I(d)
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 29
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
1. Si les deux séries ne sont pas intégrées
de même ordre, la procédure s'arrête;
2. Si les deux séries sont intégrées de
même ordre on passe à l'étape suivante.
Étape 1 :(Existence de la relation de
cointégration) Estimation par MCO de yt = á +
âxt + ut
1. Si .Ût-'~ I(0) alors la
procédure s'arrête
2. Sinon les séries sont cointégrées
à l'ordre 1 et on adopte un MCE.
Étape 2 :(Estimation d'un MCE)
Estimer par MCO, 1yt = a + b/xt
+ ë.Ût_1 + et et
s'assurer que ë est significativement négatif.
2.2.3.2 Spécification du MCE et de son
estimation : cas multivarié
Lorsqu'un test de cointégration révèle
que k séries temporelles de termes génériques
x1t, ..., xkt sont cointégrées,
celà signifie qu'il peut y avoir jusqu'à k-1 relations
de cointégration. Il faut distincguer deux cas : le cas d'un unique
vecteur de cointégration (c'est le seul cas que nous allons
présenter dans cette partie) et le cas où il peut y avoir
plusieurs vecteurs de cointégration.
* Cas d'un veteur unique de
cointégration
Dans la situation où le vecteur de cointégration
est unique, la spécification du MCE présentée au
paragraphe précédent se généralise de la
manière suivante :
Äx1t = u +
ã2Lx2t + ... +
ãk/xkt +
ëbçt_1 + Et {Et, t =
1, ..., n} --*BB(0,ó)
etbçt_1 le résidu de la regression
cointégrante :
bçt_1=x1t_1 -
bá0 - x2t_1 -
...-bákxkt_1
et ë mesure la force de rappel vers
l'équilibre de long terme (ë < 0). La
méthodologie en deux étapes proposée par Engle et Granger
est : Étape 0 :(Ordre d'intégration des
chroniques)
1. S'il existe deux séries qui ne sont pas
intégrées du même ordre alors la procédure
s'arrête;
2. Si toutes les séries sont intégrées
de même ordre, c'est-à-dire x1t --* I(d), ..., xkt
--* I(d), alors on passe à l'étape suivante.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 30
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Étape 1 :(Existence de la relation de
cointégration)
On estime par MCO le modèle:
x1t=á0 +
á2x2t + ...
+ ákxkt +
çt.
Si le résidu du modèle estimé
bçt n'est pas stationnaire, la
procédure s'arrête; Si le résidu
bçt est stationnaire on passe
à l'étape suivante.
Étape 2 :(Estimation du modèle
MCE) Par les MCO, estimer le modèle :
Äx1t = u +
ã2Lx2t + ...
+ ãk/xkt
+
ëbçt-1 +
Et
et s'assurer que b ë est
significativement négatif.
Remarque : la procédure en deux
étapes de Engle et Granger présentes plusieurs faiblesses qu'il
convient de relever :
1° Elle ne s'applique que dans le cas où le vecteur
de cointégration est unique;
2° Le biais sur les paramètres du modèle
est considérable lorsqu'elle est appliquée à des
séries temporelles de petite tailles;
3° Si elle est appliquée aux k - 1
vecteurs cointégrants issus de k chroniques
cointégrées, la distribution limite des paramètres des
vecteurs cointégrants rend l'inférence statistique sur ces
parmètres impossible.
2.2.4 Test de causalité au sens de Granger
En économétrie, la causalité entre deux
chroniques est généralement étudiée en termes
d'amélioration de la prévision selon la caractérisation de
Granger, ou en termes d'analyse impulsionnelle, selon les principes de Sims. Au
sens de Granger, une série « cause » une autre série si
la connaissance du passé de la première améliore la
prévision de la seconde. Selon Sims, une série peut être
reconnue comme causale pour une autre série, si les innovations de la
première contribuent à la variance d'erreur de prévision
de la seconde. Entre ces deux principaux modes de caractérisation
statistique de la causalité, l'approche de Granger est certainement
celle qui a eu le plus d'échos chez les économètres; elle
sera donc retenue dans le cadre de cette étude.
Le fondement de la définition de Granger est la
relation dynamique entre les variables. Comme indiqué, elle est
énoncée en termes d'amélioration de la
prédictabilité d'une variable. Chez Granger, la succession
temporelle est centrale et on ne peut discuter de la causalité sans
prendre en considération le temps (Sekkat, 1989). On peut formaliser
la
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 31
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
causalité au sens de Granger comme suit : si l'on note
par xt et yt deux séries stationnaires ; en effectuant
la régression linéaire de yt sur les valeurs
passées ys, s < t, et sur les valeurs
passées xt, s < t ; si l'on obtient des
coefficients significatifs, alors la connaissance de leurs valeurs peut
améliorer la prévision de yt : on dit que xt
cause yt unidirection-nellement. Il y a causalité
instantanée, lorsque la valeur courante xt apparaît comme
une variable explicative supplémentaire dans la régression
précédente.
Ce qui précède s'écrit de façon
formelle (Gourieroux et Monfort, 1990 ; Lardic et Mignon 2002) : - xt
cause unidirectionnellement yt à la date t si :
E[yt|yt-1, xt-1] =6
E[yt|yt-1]
- xt cause instantanément yt à
la date t si :
E[yt|yt-1, xt] =6
E[yt|yt-1, xt-1]
- xt ne cause pas yt à la date t si
:
V (E)E[yt|yt-1,
xt-1] = V(e) E[yt|yt-1]
Où V (å) désigne la
matrice de variance covariance de l'erreur de prévision.
Á partir de la définition ci-dessus, on
définit les mesures de causalité suivantes :
- Mesure de causalité unidirectionnelle de xt
vers yt :
Cx_yy=log detV
(å)E[yt|yt-1]
detV
(å)E[yt|yt-1,xt-1]
- Mesure de causalité de instantanée xt
vers yt :
Cx_yy=log detV
(å)E[yt|yt-1]
detV
(å)E[yt|yt-1,xt]
Une version du test de Granger issue directement de la
représentation autorégressive précédente, propose
d'estimer par la méthode des moindres carrés les deux
équations suivantes :
K
xt=á + EiK=1
~ixt-i + Ei=1Çiyt-i
+ Et (a)
K K
yt=b+ E i=1Xiyt-i +
Ei=1 Yixt-i + Ut (b)
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 32
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Un test d'hypothèses jointes permet de conclure sur le
sens de la causalité. Ainsi xt cause yt au sens de
Granger (équation (b)) si l'hypothèse nulle définie
ci-dessous peut être rejetée au profit de l'hypothèse
alternative :
H0 : ã1 = ã2 =
... = ãk = 0
H1 : Aumoins un des ãi =6 0.
Ce sont donc des tests de Fisher classiques. Par ailleurs, si
l'on est amené à rejeter les deux hypothèses nulles, on a
une causalité bidirectionnelle, on parle de boucle rétroactive
(feedback effect).
Considérons maintenant deux autres
spécifications : la première reprend l'équation (b); la
deuxième est construite à partir de (b) en supposant que x ne
« cause » pas y . Soit :
yt=á + i2K i=1 æixt-i
+ i2K i=1öiyt-i + åt
yt=á+ i2K i=1÷iyt-i + ít
(b')
Á partir de ces deux équations, Geweke (1983) a
proposé des tests de causalité de Granger basés sur le
principe de Wald, du ratio de vraisemblance et du multiplicateur de Lagrange,
en supposant que : xt et yt sont stationnaires, les erreurs
sont normalement distribuées et une paramétrisation optimale du
nombre de retards. Ces statistiques sont
les suivantes : T GW = T
s2*-s2
s2
TGR = log( s2
s2* )
TGL = T s2*-s2
s2*
Où : est le nombre d'observations; s2
l'estimation du maximum de vraisemblance de V
(åt) et s2* celle
de V (ít).TGW, TGR
et TGL sont respectivement les statistiques du
test de Wald, du ratio de vraisemblance et du multiplicateur de Lagrange, qui
dans l'hypothèse de causalité de xt vers yt
tendent vers zéro; chaque distribution suivant une loi chi deux
à k degrés de liberté.
Jusqu'à présent, nous sommes limités
à l'analyse causale dans des systèmes stationnaires. Or, depuis
plus d'une vingtaine d'années, de nombreux articles
révèlent que la majorité des séries
macroéconomiques sont non stationnaires, en particulier l'article de
Nelson et Plosser (1982). Ceci suppose qu'avant d'appliquer une quelconque
méthode d'estimation, une analyse approfondie des
propriétés des séries est indispensable. Pour contourner
cette difficulté, Engle et Granger (1991) ont montré que si les
variables sont intégrées, le test classique de Granger,
basé sur le VAR, n'est plus approprié. Ils recommandent pour ce
faire d'utiliser le modèle à correction d'erreur. En outre, le
test de causalité basé sur le
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 33
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
modèle vectoriel à correction d'erreur
présente l'avantage de fournir une relation causale même si aucun
coefficient estimé des variables d'intérêt
décalées n'est significatif.
34
Deuxième partie
Analyse du lien empirique entre le
déficit budgétaire et le
déficit
courant
35
CHAPITRE 3
Aperçu global d'un point de vue descriptif du
phénomène des déficits jumeaux
Le présent chapitre est consacré d'une part
à l'analyse descriptive des indicateurs macroéconomiques
permettant d'appréhender le phénomène des déficits
jumeaux au Cameroun, d'autre part, ce chapitre présente les principales
mesures d'optimisation des dépenses publiques ainsi que les mesures
agissant sur les exportations, les importations, la production et le
commerce.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 36
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
3.1 Examen des indicateurs économiques
Cette section s'intéresse à l'analyse
descriptive des indicateurs macroéconomiques permettant de mieux
analyser le phénomène des déficits jumeaux. Nous
présentons également les efforts du gouvernement en terme de
mesures d'optimisation des dépenses publiques ainsi que la situation des
exportations, des importations et de la politique commerciale au Cameroun.
3.1.1 Dynamique des recettes publiques au Cameroun
Au cours de la dernière décennie, les recettes
de l'État ont considérablement augmenté passant de 2182,2
milliards de FCFA en 2008 à 3284,8 milliards de FCFA en 2018, soit une
augmentation globale de 30%, avec une moyenne annuelle de 3%. Toutefois, l'on
remarque que la contribution des recettes pétrolières aux
recettes totales de l'État diminue au fil du temps (passant de 37% en
2008 à 15% en 2018), preuve de la poursuite du processus de
diversification de l'économie camerounaise. Cette
accélération des recettes publiques, bien qu'importante au cours
des 10 dernières années, n'a pas pu assurer l'équilibre de
la balance budgétaire du pays en raison d'un accroissement plus
important des dépenses publiques au cours de la période
considérée. Le graphique 3.1 permet visualiser l'évolution
des recettes de l'État sur la période 2008-2018.
Graphique 3.1: Dynamique des
recettes publiques (en milliards de FCFA)
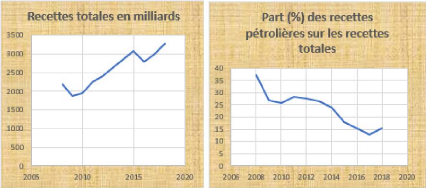
Source : MINFI, calculs de l'auteur sur Excel
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 37
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
3.1.2 Évolution, composition et efficacité
des dépenses publiques
Les dépenses publiques du pays se sont
considérablement accrues entre 2008 et 2017, passant de 13,94 à
25% du PIB. Cette hausse a notamment financé le programme Vision 2035,
le DSCE 1 et le PLANUT
2, soit une augmentation des dépenses en
capital de 5,89% à 13,37% du PIB entre 2008 et 2017 (Graphique 3.2).
Malgré cette hausse, les dépenses publiques du Cameroun restaient
encore inférieures en 2015 (19% du PIB) à la moyenne des pays
d'Afrique subsaharienne (ASS), des pays à revenu intermédiaire,
tranche supérieure (PRIS) et des pays à revenu
intermédiaire, tranche inférieure (PRII), soit respectivement
28%, 25% et 31,5% (Source : revue des dépenses publiques au Cameroun,
publiée par la Banque Mondiale, 2018).
Graphique 3.2: Dynamique des
dépenses publiques
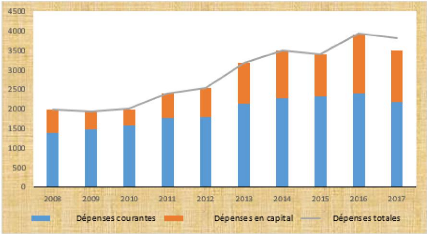
Source : MINFI, calculs de l'auteur sur Excel
1. DSCE=Document de Stratégie pour la Croissance et
l'Emploi. C'est un document qui sert de cadre de référence
à l'action gouvernementale sur la période 2010-2020
2. PLANUT=Plan d'Urgence Triennal. C'est un programme mis sur
pied par le gouvernement pour l'accélération de la croissance
économique.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 38
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
3.1.3 Exécution du budget
Si les taux officiels d'exécution budgétaires
sont élevés, ils masquent cependant des faiblesses dans la
comptabilité budgétaire. Au Cameroun, les taux d'exécution
budgétaire se sont globalement améliorés entre 2008 et
2017 (confère Graphique 3.3), ce qui signifie que l'enveloppe globale
des dépenses publiques a été généralement
contenue dans les limites des plafonds budgétaires approuvés.
Cependant, les dépenses publiques en biens et services ont largement
dépassé le budget alloué en 2017 (Source : Revue des
dépenses publiques sur le Cameroun, publié par la Banque
Mondiale, 2018). L'évaluation des dépenses publiques et de la
responsabilité financière, réalisée en 2017, note
qu'un niveau élevé de dépenses publiques doit encore
être régularisé et que certaines pratiques dans
l'exécution budgétaire (des avances en espèces, des
déblocages de fonds, des avances et des paiements directs par la
Société Nationale des Hydrocarbures (SNH), par exemple)
entravaient jusque très récemment3 la fiabilité
des données sur la répartition des dépenses. En
conséquence, les documents comptables et financiers officiels ne
reflètent pas complètement la réalité de la
répartition des dépenses effectuées.
Graphique 3.3: Dynamique de
l'exécution budgétaire (en milliards FCFA)
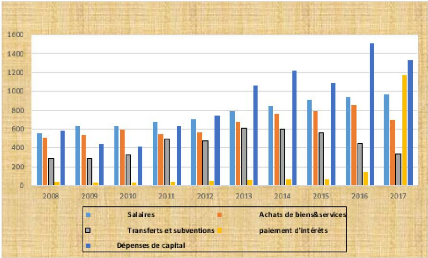
Source de données : MINFI, calculs de l'auteur
3. Ces procédures sont dorénavant
limitées dans le cadre du programme économique et financier
soutenu par le FMI.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 39
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
3.1.4 Dynamique du solde budgétaire global
Sur la période allant de 2008 à 2018, le
Cameroun compte une seule année d'excédent budgétaire
(année 2008). Le solde budgétaire est resté négatif
depuis 2009 malgré le léger accroissement observé en 2015.
En effet, la baisse observée au niveau des recettes
pétrolières en 2015 a été compensée par la
hausse des recettes non pétrolières qui ont subi une augmentation
de 7,87% par rapport à 2014.
L'année 2016 est celle pour laquelle le solde s'est le
plus creusé sur la période considérée, en passant
de -1,4% en 2015 pour atteindre -6,2% du PIB en 2016. Le rapport du Fond
Monétaire International (FMI) sur la seconde revue au titre de la
facilité élargie de crédit, souligne qu'en 2016, la
politique budgétaire a porté essentiellement sur
l'améliora-tion des recouvrements et l'accroissemnt des dépenses
d'investissement dans le cadre du plan trienal d'urgence.
En ce qui concerne les ressources, les recettes totales ont
baissé de 11,2% par rapport à 2015 pour s'établir à
FCFA 2732,9 milliards de FCFA, notamment à cause du fléchissement
de 41,8% des recettes pétrolières, insuffisamment
compensées par la faible augmentation de 2,3% des recettes hors
pétroles.
S'agissant des charges, les dépenses budgétaires
totales ont augmenté de 10,8% pour se situer à FCFA 3785,2
milliards. Les dépenses courantes ont progressé de 1,9%
particulièrement sous l'effet des régularisations des situations
administratives des fonctionnaires. Par contre, afin de maintenir l'effort de
construction des infrastructures pour couvrir la CAN féminine et le plan
d'urgence trienal, les dépenses publiques d'investissement ont
augmenté de 29,9% par rapport à 2015.
Graphique 3.4: Dynamique du
solde budgétaire global (en %PIB)
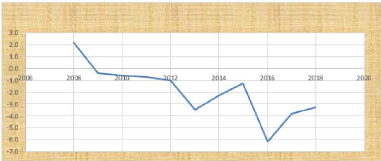
Source : MINFI, calculs de l'auteur sur Excel
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 40
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
3.1.5 Principales mesures d'optimisation des
dépenses publiques
Le Cameroun aspire à rejoindre, d'ici 2035, le groupe
des nations industrialisées à revenu intermédiaire de la
tranche supérieure, avec de faibles taux de pauvreté, une
croissance économique soutenue et une démocratie
consolidée. Élaboré par le gouvernement dans ce but, le
Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi table sur un taux
annuel de croissance du PIB de 5,5% et la création de milliers d'emplois
formels chaque année. Fort d'une économie relativement plus
diversifiée que ses voisins de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale, plus dépendants du
pétrole, le Cameroun semblait, du moins jusqu'au milieu de cette
décennie, en bonne position pour concrétiser ses objectifs. Mais
une conjoncture extérieure moins favorable et des contraintes internes
menacent les ambitions de développement du pays, où le taux de
pauvreté reste élevé, à 37,5% en 2014 (Source
résultats de ECAM44 publié par l'INS5 en
2018).
Avec les effets durables du choc pétrolier de 2014 et
la détérioration de la situation intérieure,
l'économie camerounaise a marqué le pas. Les flambées de
violence dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord,
conjuguées à un mouvement séparatiste dans les
régions anglophones, ont porté un coup d'arrêt à
l'activité. En réaction, les dépenses de
sécurité ont monté en flèche, aggravant le
déficit budgétaire qui est ressorti à 6,1% du PIB en 2016,
le taux de croissance atteignant en 2017 son niveau plancher depuis sept ans,
à 3,5%. L'insuffisance et l'inefficacité des dépenses en
faveur de la santé maternelle et infantile ainsi que le coût trop
élevé des manuels scolaires ont également rejailli sur les
performances en matière de santé et d'éducation. En
parallèle, une hausse sensible des emprunts en vue de financer de lourds
projets d'infrastructures ont fait grimper la dette publique à 35,7% du
PIB en 2017, contre 15,9% en 2006.
Le pays dispose néanmoins d'atouts pour renverser la
situation : la récente revue des dépenses publiques
réalisée par la Banque mondiale et intitulée : Aligner
les dépenses publiques aux objectifs de la Vision 2035 identifie
cinq leviers pour y parvenir :
(1) Rectifier l'assise macroéconomique.
Les pouvoirs publics doivent afficher leur volonté de
respecter une discipline macroéconomique et budgétaire. Cela
passe par la rationalisation des dépenses publiques, la recherche de
nouvelles sources de revenu et la maîtrise de la dette publique. L'une
4. ECAM4=Quatrième Enquête Camerounaise
auprès des Ménages
5. INS=Institut National de la Statistique
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 41
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
des conclusions du rapport est sans appel : seuls un
redéploiement des dépenses publiques et des réformes
structurelles parviendront à améliorer l'efficacité des
dépenses publiques sans menacer la stabilité budgétaire.
La réduction de la part des dépenses de l'administration
générale et financière dans le total des dépenses
--en particulier les frais de représentation, de missions, de
cérémonies, de carburant, de voyages et de services externes --
pourrait entraîner de substantielles économies budgétaires.
Les économies réalisées sur ces frais, de même que
les gains liés à la réduction des dépenses fiscales
et la diminution des transferts et des subventions, permettraient de
dégager une véritable marge de manoeuvre en faveur des secteurs
sociaux (et autres secteurs prioritaires).
(2) Réduire la dette et mieux gérer les
investissements publics.
Pour maîtriser son endettement, le gouvernement doit
optimiser la gestion des entreprises d'État et des investissements
publics. Il doit pouvoir identifier et adopter les mesures à prendre
pour éviter l'accumulation de pertes financières chaque
année. Louable, la volonté du pays de réduire son
déficit d'infrastructures ne doit pas empêcher d'approfondir et
d'accélérer les efforts consentis pour rendre les investissements
publics plus efficaces. Le ministère des Finances et le ministère
de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du
territoire doivent hiérarchiser les projets existants et renforcer le
cycle des projets d'investissement public. Pour ce faire, le gouvernement doit
fixer des critères précis pour déterminer le degré
de maturité des projets et procéder à des
évaluations à chaque étape. Au lieu de recourir à
de coûteux emprunts commerciaux qui aggravent le risque de
surendettement, il doit privilégier les financements concessionnels et
les partenariats public-privé.
(3) Améliorer l'efficacité dans le secteur de
l'éducation.
L'efficacité accrue des dépenses passe par une
allocation directe des fonds aux établissements scolaires, via un
mécanisme de financement tenant compte de leurs besoins
spécifiques et intégrant des incitations à la performance.
Le transfert direct des fonds devrait renforcer sensiblement la
responsabilité des établissements et augmenter le montant des
dépenses par élève. Par ailleurs, l'introduction de
mécanismes de financement basé sur la performance à
l'échelle des écoles devrait accentuer les incitations à
obtenir de meilleurs résultats. La révision des politiques de
recrutement, de rémunération et d'affectation des enseignants
pourrait favoriser une répartition plus équitable des ressources
éducatives. Alors que plus de 80% du
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 42
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
budget de l'éducation sont consacrés à la
rémunération des enseignants, le nombre d'enseignants dans les
zones qui en ont le plus besoin, les ZEP (zones d'éducation
prioritaire), est en recul constant.
(4) Augmenter et optimiser les dépenses de
santé.
L'État doit allouer davantage de ressources à
la santé et mieux les gérer. Un rééquilibrage de la
distribution des ressources entre l'administration centrale et les lieux de
prestation des services à l'échelon local contribuerait à
améliorer l'efficacité et l'équité des
dépenses de santé, sachant que les établissements de soins
primaires au niveau des districts tendent à offrir les interventions les
plus rentables tout en desservant les ménages les plus pauvres et les
plus vulnérables. Dans le cadre de l'extension du programme de
financement basé sur la performance, le gouvernement devrait introduire
un système de budgétisation équitable reposant sur une
formule de calcul transparente dans le but d'affecter des moyens aux
régions qui en ont le plus besoin. Plusieurs pays ont adopté des
formules de ce type, où l'allocation des ressources est fonction des
spécificités de chaque centre de soins et des besoins de la
population desservie.
(5) Renforcer le système de protection sociale et les
filets sociaux. Le gouvernement a également beaucoup à faire pour
améliorer le dispositif de protection sociale du pays. Il doit pour cela
modifier sensiblement la composition des dépenses en faveur de l'aide
sociale, d'un meilleur ciblage et d'une couverture complète des risques.
Plus de 90%: la revue des dépenses publiques du Cameroun
réalisé par la Banque Mondiale des dépenses sociales
actuelles subventionnent le régime de pensions de la
fonction publique et les subventions aux carburants deux types
de dépenses qui
ne couvrent ni les pauvres, ni les principaux risques
encourus tout au long de la vie.
3.1.6 Situation des exportations, des importations et de la
Politique commerciale au Cameroun
3.1.6.1 Évolution (% du PIB) de la balance
commerciale et politique commerciale
Au cours de la dernière décennie,
l'évolution de la balance commerciale du Cameroun a gardé une
tendance baissière. Entre 2008 et 2018, cette balance s'est davantage
détériorée, passant d'un déficit commercial de
-3,8%PIB en 2008 à un déficit de -6,2%PIB en 2018. Selon l'INS,
malgré les efforts consentis du gouvernement en faveur de la
ré-
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 43
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
duction du déficit commercial, celle-ci semble se
détériorer davantage. L'on enregistre le plus grand écart
entre 2017 et 2018 du déficit de la balance commerciale. Cette
réduction résulte essentiellement de l'excédent
enregistré sur les échanges de pétrole brut, dû
à la baisse des exportations de ce produit, en raison de l'arrêt
observé à la SONARA6 au premier trimestre d 2017,
détaille l'institut.
La balance commerciale hors pétrole brut du pays, elle,
enregistre une hausse de 13,0% par rapport à 2016 et est
déficitaire de 1 705,5 milliards de FCFA en 2017. Cette hausse du
déficit hors pétrole, tel que mentionné dans le rapport de
l'INS sur le commerce extérieur du Cameroun en 2017, est liée
à la baisse des exportations hors pétrole de 10,0%, suivie d'une
hausse des importations de de 2,5%. Le taux de couverture hors pétrole
se détériore d'environ 6 points pour se situer à 40,0% en
2017.
Graphique 3.5: Dynamique de la
balance commerciale
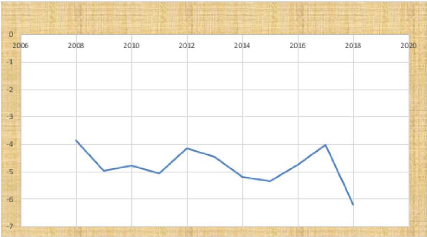
Source : MINFI, calculs de l'auteur sur Excel
Pour comprendre les causes du déficit de la balance
commerciale présentée ci-haut, il est important de regarder la
situation des des exportations ainsi que celle des importations au Cameroun et
ainsi identifier les principaux produits importés et exportés.
6. Société Nationale de Raffinage
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 44
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
3.1.6.2 Situation des exportations et des
importations
Selon le rapport de la Direction Générale du
trésor français sur la situation des échanges commerciaux
du Cameroun, rapport publié en 2018, les échanges commerciaux
camerounais se sont contractés en 2017. En effet, en 2017, les
exportations du Cameroun baissent de 11,9% en volume et de 4% en valeur pour
atteindre 1 881,9 Mds FCFA . Il s'agissait de la troisième année
consécutive de baisse malgré la reprise des cours de certaines
matières premières (pétrole, coton, aluminium).
(i) Sitution des principaux produits à
l'exportation
Les exportations d'huiles brutes de pétrole (qui
représentaient 39,6% en 2017 des exportations totales) ont
enregistré une baisse de 19,8% en volume mais une hausse de 7% en valeur
grâce à la légère remontée des cours
observée sur les marchés internationaux. Celles des carburants et
lubrifiants se sont inscrits en baisse de 38,8% en volume et de 10,3% en valeur
en raison des capacités limitées de production de la SONARA.
Celle-ci a signé en 2017 un accord de financement de 44,6 Mds FCFA avec
la Banque islamique de développement pour augmenter sa production.
Les ventes des principaux produits d'exportation ont connu des
évolutions contrastées. Le cacao brut (12,4% des exportations
totales), a connu en 2017 une baisse de ses exportations en volume de 16% et de
41,1% en valeur. Cette contre performance s'explique par la baisse des cours du
cacao et par une attitude prudente des producteurs qui ont constitué des
stocks, anticipant une remontée future des cours (INS : rapport sur le
commerce extérieur de 2017). Les exportations de pâte de cacao,
ayant représenté 2,2% des exportations totales, se sont
affichées en revanche en forte hausse (+52,2% en volume et +16,2% en
valeur).
Les bois sciés (8,1% du total), avec des exportations
en baisse de 3,4% en volume et 10,6% en valeur, occupaient le troisième
rang des produits les plus exportés par le Cameroun. Le bois brut (6% du
total) a réalisé une bonne performance, avec des exportations en
hausse de 26,1% en volume et de 26,2% en valeur.
Le coton brut (5,1% du total), malgré les
difficultés financière de la Sodécoton, a
enregistré une légère progression de ses ventes en volume
(0,5%) et une progression plus importante en valeur (9%) grâce à
la reprise des cours mondiaux.
L'aluminium brut (4,1% du total) poursuivait ses bonnes
performances à l'exportation,
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 45
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
avec des ventes en hausse de 18,8% en volume et de 15,6% en
valeur.
(ii) Sitution des principaux produits à
l'importation
Les importations s'établissent à 2 971,4 Mds
FCFA, en diminution de 4,8% en volume et de 3,8% en valeur, contre -5,9% en
volume et -13,6% en valeur en 2016. La diminution moins importante des
importations en valeur en 2017 est notamment liée la reconstitution
progressive des réserves de change en devises à la banque
centrale. Á fin décembre 2017, les réserves de change
représentaient 5,6 mois d'importation, contre 4,1 mois à fin
décembre 2016. Elle suit toutefois le ralentissement économique
observée depuis 2016.
La qualité de la production pétrolière
camerounaise ne permettant pas son raffinage dans les infrastructures locales,
le Cameroun procède en parallèle à des importations de
pétrole, essentiellement en provenance du Nigeria, pour le raffiner et
le commercialiser sur le marché local. En 2017, les importations
d'huiles et de pétrole brut ont reculé de 65,8% en volume et de
59,1% en valeur, toujours en lien avec les difficultés de la SONARA.
Afin de compenser le déficit de production locale, les importations de
carburants et lubrifiants ont quasiment doublé sur un an (+97,2% en
volume et +95,8% en valeur).
Les importations hors pétrole progressent en volume et
en valeur pour s'établir à 2 843 Mds FCFA en 2017, , en hausse de
9,3% en volume et de 2,5% en valeur par rapport à 2016. Elles sont
principalement constituées de céréales (riz, farines et
froments) (10,1% du total), de véhicules automobiles et tracteurs
(6,8%), de machines et appareils électriques (6,8%), de produits
pharmaceutiques (4,4%), de poissons et crustacés (3,9%), de clinkers
(2,7%).
On note l'augmentation des importations de riz (+18,8% en
volume et 27,9% en valeur) en dépit du rétablissement des droits
de douane qui avaient été suspendus en 2008 suite aux
manifestations contre la vie chère.
On relève également la baisse des achats de
machines et appareils électriques (-3,6% en volume et -35,9% en valeur)
qui ont certes bénéficié du démantèlement
des barrières tarifaires camerounaises dans le cadre de l'APE avec
l'Union européenne, principal fournisseur de ces produits, mais
subissent la baisse d'activité liée à la fin des
principaux projets structurants. Enfin les importations de véhicules
automobiles et tracteurs baissent
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 46
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
de 14,8% en volume et 5,5% en valeur.
Tableau 3.1: Commerce
extérieur du Cameroun entre 2016 et 2017 (en milliards)
|
2016
|
2017
|
Variation (en %)
|
|
Exportations
|
1 959
|
189
|
-4,0
|
|
Pétrole brut
|
696
|
745
|
7
|
|
Exportations hors pétrole
|
1 264
|
1 138
|
-10,0
|
|
Importations
|
30 787
|
2 971
|
-3,8
|
|
Pétrole brut
|
314
|
129
|
-59,1
|
|
Importations hors pétrole
|
2 773
|
2 843
|
3
|
|
Balance commerciale
|
-1 127,7
|
-1 127,7
|
-3,4
|
|
Balance commerciale hors pétrole
|
-1 509,2
|
-1 705,5
|
13
|
Source de données : INS, calculs de l'auteur
3.2 Principales mesures régissant le commerce au
Ca-
meroun
Selon le plan de modernisation de l'économie
camerounaise dans les perspectives de l'entrée en vigueur de l'accord de
partenariat économique, les mesures de politique envisagées
visent à consolider l'excédent de la balance commerciale. Trois
axes sont explorés, à savoir :
(1i) comprimer les importations; (2i) Accroitre les exportations;
(3i) accroître la production.
3.2.1 Mesures agissant sur les importations
De par son appartenance à la CEMAC, le Cameroun
applique le TEC7 sur les importations en provenance des pays hors
CEMAC. Ce qui a contribué à réduire significativement son
niveau de taxation des produits importés. Les consolidations tarifaires
sont réalisées par le Cameroun à des taux plafond de 80%
sur les produits agricoles et de 50% sur trois biens non-agricoles, soit au
total seulement 14,0% de toutes les lignes tarifaires. Les autres droits et
taxes sont consolidés à 80%, 150% ou 230% selon la
catégorie
7. TEC=Tarif Extérieur Commun, loi adoptée par
acte 16/96-UDEAC-556-CD-57 du premier Juillet 1996 portant adoption du tarif
extérieur commun, complété par l'acte additionnel
n03/00-CEMAC-046-CM 05 du 14 Décembre 2000 et l'ensemble des textes
modificatifs subséquents.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 47
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
de produits.
Pour les importations en provenance de l'Asie, le Cameroun a
recours à des valeurs minimales, ce que les autorités justifient
par les difficultés du Cameroun à mettre en oeuvre l'Accord de
l'OMC sur l'évaluation en douane.
Le Cameroun applique le Code des douanes de la CEMAC à
l'importation, à l'exportation, et à la réexportation des
des produits.
3.2.2 Mesures agissant sur les exportations au Cameroun
Le Cameroun applique des droits de sortie de 2 % de la valeur
FOB8 des marchandises exportées, à l'exception du bois
en grumes soumis à un taux supérieur. Ainsi, les produits du sol
(tels que l'hévéa, le cacao, le café, la banane ou le
coton) et du sous sol ne sont soumis au paiement d'aucun droit de sortie tandis
que des prohibitions s'appliquent aux exportations de grumes de certaines
essences pour des considérations économiques. Les exportations
sont en principe soumises à la TVA9 au taux zéro.
Cependant, pour faire face aux exportations fictives, les ventes hors TCA
10/TVA réalisées par les unités de production
à des intermédiaires chargés d'effectuer les
opérations d'exportation sont proscrites.
En matière de subvention, des avantages fiscaux
liés aux exportations sont accordées sous le régime des
zones franches industrielles (ZFI).
3.2.3 Mesures sur la production et le commerce du
Cameroun
La loi sur la concurrence s'applique aux entreprises tant
publiques que privées et aussi lorsque les effets des pratiques
anticoncurrentielles d'entreprises situées à l'extérieur
se font sentir sur le territoire camerounais, sous réserve des accords
et traités liant le Cameroun aux pays d'accueil des entreprises en
question. La loi interdit toutes pratiques qui auraient pour effet
d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible
l'exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur.
La CNC11, rattachée au Ministère en
charge du commerce, est chargée des questions de concurrence et de
superviser la mise en oeuvre de la législation en la matière. Un
certain nombre de produits et services continuent à être soumis
à l'homologation des prix. Dans
8. FOB=Free on Board. Une marchandise est achetée ou
vendue "FOB" quand celle-ci est achetée sans les frais de transport et
autres frais et taxes y afférents et sans les assurances.
9. TVA=Taxe sur la valeur ajoutée
10. TCA=Taxe sur le Chiffre d'affaires
11. CNC=Commission Nationale de Concurrence
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 48
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
deux cas (le poisson congelé et la farine de froment),
l'homologation ne s'applique qu'aux produits importés.
En 2001, le Cameroun a créé l'Agence de
régulation des marchés publics (ARMP) et introduit une nouvelle
réglementation en la matière. Les marchés publics sont
attribués sur appel d'offres. Toutefois, ils peuvent exceptionnellement
être attribués selon la procédure de
gré-à-gré (c'est-à-dire sans appel d'offres),
après l'autorisation spéciale du Premier ministre, et pour des
questions de compétence, d'urgence, ou de propriété
intellectuelle.
Conclusion
Le présent chapitre a porté sur une analyse
globale, d'un point de vue descriptif des indicateurs macroéconmiques
permetttant d'appréhender les causes et les effets d'un double
déficit budgétaire et courant au Cameoun. Le constat
gérnéral est qu'aucours des 10 dernièress années,
les resources de l'État ont fortement augmenté (50% entre 2008 et
2018). Toutefois, cette augmentation, bien qu'importante des recettes de
l'État, n'a pas pu restaurer l'équilibre de la balance
budgétaire du fait d'une augmentation plus importante, soit 94,28% entre
2008 et 2018 des dépenses publiques. Sur la même période,
la balance commerciale s'est davantage dégradée, passant d'un
excédent de +2,2% du PIB en 2008 à un déficit de -3,3% du
PIB en 2018. Face à cette situation de lutte contre le double
déficit budgétaire et courant, les efforts du gouvernement n'ont
pas été négligeables en ce sens que plusieurs mesures
portant d'une part sur l'assainissement des finances publiques avec l'adoption
des critères de convergence dans le cadre de la surveilllance
multilattérale en zone CEMAC ainsi que le contrat signé avec le
FMI en 2017 plaçant le Cameroun sous prommame économique et
financier. D'autre part, plusieurs mesures agissant sur les exportations, les
importations, la production et le commerce ont été
adoptées, ceci dans le but de rétablir l'équilibre de la
balance courante qui, pour le cas du Cameroun se réduit à
l'équilibre de sa balance commerciale.
49
CHAPITRE 4
Analyse du lien économétrique entre le
solde budgétaire global et le solde du compte courant
Le présent chapitre est consacré à
l'analyse du lien économétrique entre le solde budgétaire
et le solde courant au Cameroun. Comme mentionné au chapitre 2, cette
analyse passe les techniques d'économétrie des séries
temporelles basées sur l'estimation d'un modèle vectoriel
à correction d'erreur (VECM) suivi du test de la causalité au
sens de Granger et se termine par l'analyse des chocs sur le compte courant au
Cameroun, notamment l'analyse des réponses impulsionnelles et la
décomposition de la variance de l'erreur de prévision sur le
solde du compte courant.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 50
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
4.1 Présentation des données et des
variables retenues
Les données utilisées sont annuelles et sont
tirées du tableau des comptes nationaux de l'INS et du Tableau des
Opérations Financières de l'État (TOFE) du MINFI. Ces
données annuelles couvrent la période allant de 1989 à
2018. Au regard des différentes études ayant testé la
validité de l'hypothèse des déficits jumeaux, il ressort
que le choix des variables dépend du fait que l'économie
considérée fonctionne ou non en régime de change flottant
ou fixe.
(i) Pour les économies à régime de change
fixe, les variables permettant de testter l'hypothèse des
déficits jumeaux sont : le solde du compte courant, le solde
budgétaire global, l'investissement public et le produit
intérieur brut. (ii) Pour les économies à régime de
change flottant, il faut en plus des quatre variables précédentes
ajouter le taux de change et le taux d'intérêt.
Cela étant, il convient donc pour notre cas de retenir
les quatre premières variables pour le test de l'hypothèse des
déficits jumeaux au Cameroun, étant donné que ce pays
fonctionne en régime de change fixe. La variable BC représentant
la balance commerciale est utilisée comme variable endogène car
nous estimons qu'elle est peu contrôlable par rapport à la
variable SBG représentant le solde budgétaire global qui
apparaît parmi les variables explicatives du modèle et permet de
capter les effets des fluctuations des dépenses publiques sur le compte
courant. L'investissement public permet de capter l'effet d'un accroissement
des dépenses publiques d'investissement sur le compte courant. Et en
fin, le Produit intérieur brut quant à lui est utilisé
pour comme variable de contrôle et permet de la mise en évidence
d'une relation de cointégration entre les variables.
Le tableau 4.1 renseigne sur les variables utilisées
:
Tableau 4.1: Desciption et
effets attendus des variables
|
Variable
|
Description
|
Effet attendu su BC
|
|
BC
|
Balance courante
|
|
|
SBG
|
Solde budgétaire global
|
+
|
|
logPIB
|
logarithme népérien du PIB
|
+
|
|
FBCF
|
Formation brute de capital fixe
|
+
|
Source : l'auteur, tiré de la littérature
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 51
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
4.2 Caractéristiques descriptives des
séries et représentation graphique des variables
Cette section présente la description des séries
dans le but d'en savoir un peu plus sur les caractéristiques de tendance
centrale. Un regard particulier est fait au niveau des écarts-types afin
d'avoir une idée précise sur la volatilité des
séries laquelle permettra d'être fixé sur le type de test
sur l'existence ou non des racines unitaires dans les séries. La
représentation graphique permettra de mieux visualiser
l'évolution des séries.
Tableau 4.2:
Caractéristiques descriptives des séries
|
BC
|
SBG
|
logPIB
|
FBCF
|
|
Mean
|
-1.567000
|
-0.352975
|
23.5813
|
3.738344
|
|
Median
|
-1.645000
|
-0.65532
|
23.52275
|
3.675923
|
|
maximun
|
5.600000
|
4.795133
|
24.37398
|
9.069615
|
|
Minimum
|
-6.200000
|
-6.164952
|
22.98690
|
1.054832
|
|
Std.Dev
|
3.216207
|
2.594517
|
0.484268
|
2.013633
|
|
Skewness
|
0.369923
|
0.035607
|
0.231721
|
0.761471
|
|
Kurtosis
|
2.014647
|
2.598109
|
1.422931
|
3.304823
|
|
|
|
|
|
|
Jarque-Bera
|
1.897866
|
0.208234
|
3.377405
|
3.015338
|
|
Probability
|
0.387154
|
0.901120
|
0.184759
|
0.221426
|
|
|
|
|
|
|
Sum
|
-47.01000
|
-10.58925
|
707.6439
|
112.1503
|
|
Sum sq.Dev
|
299.9756
|
195.2140
|
6.800943
|
117.5868
|
|
|
|
|
|
|
Observations
|
30
|
30
|
30
|
30
|
Source de données : MINFI/INS, calculs de l'auteur sur
Eviews
Comme l'illustre le tableau 4.2, le solde budgétaire
global et la balance commerciale sont plus volatiles que les autres variables
(de contrôle) avec un sérieux creux en 2016 pour la variable SBG
(imputable à la baisse des recettes pétrolières de 2016)
et le logPIB l'est moins au regard de l'écart-type (std. Dev). Le test
de stationnarité d'Andrews Zivot sera donc préféré
à celui de Dickey-Fuller pour ces deux variables. Aussi, l'on note que
les variables sous-étude sont normalement distribuées (Prob.
Jarque-Bera > 5%). Dans ce cas, une modélisation
hétéroscédastique serait privilégiée en
présence d'effets ARCH.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 52
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
4.2.1 Évolution graphique des variables et nuages de
points
La lecture du graphique 4.1 témoigne de la non
stabilité globale des variables sous étude dans le temps.
Cependant on peut remarquer que cette volatilité n'est pas très
accentuée et ce quelque soit la variable considérée. Il
y'a donc de bonnes raisons de faire une présomption de la
stationnarité en différence première des variables
d'études (les tests de racine unitaire nous en diront davantage).
Toutefois, les variables FBCF et logPIB semblent présenter une
évolution beaucoup plus stable. Quant aux deux autres à savoir :
BC et SBG, elles ont des évolutions en dents de scie; et sur la
période 2000 à 2015, ces dernières semblent évoluer
dans le même sens (présomption d'une corrélation
significative entre ces deux variables).
Graphique 4.1:
Évolution graphique des variables
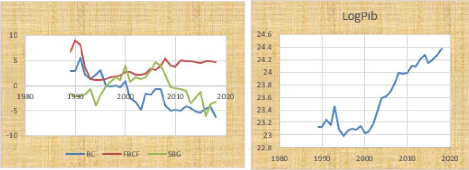
Source : calculs de l'auteur
Pour ce qui est du sens du lien entre le déficit
budgétaire sur la balance commerciale au Cameroun, le graphique (??)
montre qu'il est positif. Ce constat, informel jusqu'ici, va dans le sens des
résultats des études empiriques qui corroborent avec
l'hypothèse keynésienne. 1
1. Selon cette hypothèse, le déficit
budgétaire cause celui du compte courant
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 53
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Graphique 4.2: Nuages
de points des variables
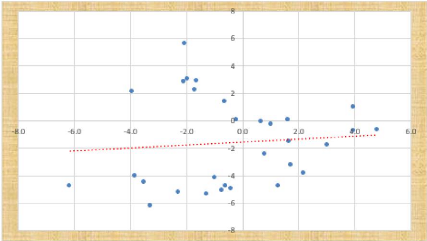
Source : calculs de l'auteur sur Excel
4.3 Résultats empiriques
Les résultats présentés dans cette partie,
notamment l'étude de la stationnarité des series, le test de
cointegration, le test de causalité de Granger et les estimations ont
été obtenus à l'aide du logiciel eviews 9.
4.3.1 Stationnarité des séries
Les résultats du test de stationnarité à
niveau et en différence première sont donnés comme
suit2 (les statistiques calculées sont de student) :
Tableau 4.3:
Stationnarité des séries
|
Niveau
|
Différence Première
|
Constat
|
|
Variables
|
ADF
|
AZ
|
Date de rupture
|
ADF
|
|
|
BC
|
-3,67 (0.699)
|
-4,44(0.699)
|
2000
|
-3,603(0.03)
|
I(1)
|
|
logPIB
|
-3,62(0.058)
|
-
|
-
|
-3,58(0.002)
|
I(1)
|
|
SBG
|
-3,57(0.52)
|
-4,85(0.937)
|
2010
|
-3,580(0.0000)
|
I(1)
|
|
FBCF
|
3,57(0.460)
|
-
|
-
|
-3,58(0.0028)
|
I(1)
|
Source : calculs de l'auteur sur eviews
2. les résultats détaillés des
différents tests de non-stationnarité sont consignés
à l'Annexe A
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 54
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
L'on note que toutes les séries retenues sont
intégrées d'ordre 1 (stationnaire après la première
différence). Les séries sont ainsi intégrées au
même ordre, ce qui rend opportun le test de cointégration de
Johansen.
4.3.2 Détermination du nombre optimal de retards
Avant d'estimer le modèle réduit, il convient de
determiner au préalable le nombre de retards p du modèle VAR(p)
sous-jacent. Le tableau 4.4 donne les retards optimaux suivant différent
critères d'information.
Tableau 4.4: Nombre optimal de
retards
|
Lag
|
LogL
|
LR
|
FPE
|
AIC
|
SC
|
HQ
|
|
1
|
-97.51804
|
NA
|
0.073571
|
8.732157
|
9.506370
|
8.955102
|
|
2
|
-81.42535
|
22.28218
|
0.078546
|
8.725027
|
10.27345
|
9.170918
|
|
3
|
-49.76724
|
34.093335
|
0.029330
|
7.306142
|
9.843197
|
8.189393
|
|
4
|
-30.97985
|
14.45184
|
0.039633
|
7.520557
|
10.40300
|
8.197924
|
Source : calculs de l'auteur sur eviews
Au regard du critère d'Akaike (AIC), le nombre optimal
de retards est égal à 3. Il convient donc de lancer le test de
cointégration de Johansen avec 3 retards sachant que le modèle
vectoriel à correction d'erreur (VECM) sous-jacent sera estimé
avec 3-1, soit 2 retards.
4.3.3 Test de cointégration de Johansen
Il ressort du test de Johansen (Tableau :4.5) que : il existe
une unique relation de cointé-gration suivant le critère d'Akaike
(AIC). En effet, les statistiques calculées de la trace et la valeur
propre maximale (valant respectivement 22,40277 et 15,70241) sont
inférieures aux valeurs critiques (seuil de 5%), (valant respectivement
29,68 et 20,97) pour le rang de cointégration égale à 1,
ce qui traduit l'existence d'un vecteur unique cointégrant. Ainsi, nous
pouvons estimer un modèle vectoriel à correction d'erreur
(VECM).
NB : Cette spécification sera justifiée si la
force de rappel dans l'output de l'estimation du VECM est significativement
négative.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 55
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Tableau 4.5: Test de
cointégration de Johansen
|
Hypothesized
|
|
Trace
|
5 Percent
|
1 Percent
|
|
N0 of CE(s)
|
Eigenvalue
|
Statistic
|
Critical Value
|
Critical Value
|
|
None**
|
0.744553
|
60.61548
|
47.21
|
54.46
|
|
At most 1
|
0429248
|
22.40277
|
29.68
|
35.65
|
|
Atmost 2
|
0.201687
|
6.700380
|
15.41
|
20.04
|
|
Atmost 3
|
0.013946
|
0.383226
|
3.76
|
6.65
|
|
Hypothesized
|
|
Max-Eigen
|
5 Percent
|
1 Percent
|
|
N0 of CE(s)
|
Eigenvalue
|
Statistic
|
Critical Value
|
Critical Value
|
|
None**
|
0.744553
|
38.21271
|
27.07
|
32.24
|
|
Atmost 1
|
0.429248
|
15.70241
|
20.97
|
25.52
|
|
Amost 2
|
0.201687
|
6.307134
|
14.07
|
1883
|
|
Atmost 3
|
0.013048
|
0.303226
|
3.78
|
6.65
|
Source : calculs de l'auteur sur eviews
4.3.4 Test post-estimation et interprétation des
résultats du modèle
4.3.4.1 Test post-estimation : validation du
modèle
· Position des racines du polynôme
caractéristique du VECM sur le disque unité
Après estimation, le graphique (4.3) donne la position
sur le disque unité des racines du polynôme caractéristique
du modèle VECM. Celles-ci étant toutes à
l'intérieur du disque unité, nous déduisons que le
modèle est stable, et en vertu du théorème de
représentation de Wold, il peut être mis sous la forme vectorielle
moyenne mobile infinie, laquelle permet justement la dérivation des
statistiques pour l'analyse des réponses impulsionnelles et de la
décomposition des variances totales des erreurs de prévisions.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 56
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Graphique 4.3:
Position des racines du polynôme caractéristique du VECM sur
le disque unité
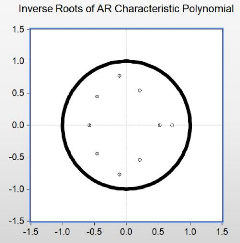
Source : calculs de l'auteur sur eviews
· Test de normalité des résidus du
modèle estimé
Afin de voir si les résidus du modèle
estimé sont gaussiens, le test de Jarque-Bera a été
appliqué sur ces derniers. Le résultat de ce test
révèle (confère Tableau 4.6) que les
résidus du modèle suivent une loi normale (p-value >
5%).
Tableau 4.6: Test de
normalité des résidus
Component
|
Jarque- Bera
|
df
|
Prob
|
1
|
12.90767
|
2
|
0.2151
|
2
|
7.200757
|
2
|
0.5486
|
3
|
5.804589
|
2
|
0.2460
|
4
|
5.240313
|
2
|
0.4727
|
Joint
|
31.15333
|
8
|
0.3946
|
|
Source : calculs de l'auteur sur eviews
· Test d'autocorrélation des
résidus
Pour cette étape, le test d'autocorrélation LM
est appliqué dans le but de tester le caractère de
non-autocorrélation des résisus du modèle estimé.
L'hypothèse nulle de ce test stipule qu'il y a absence
d'autocorrélation contre l'hypothèse alternative
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 57
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
de présence d'autocorrélation.
Les résultats de ce test renseignés dans le
tableau 4.7 indiquent une absence d'auto-corrélation, puisque la
probabilité associée est supérieure au niveau du risque
retenu (5%)..
Tableau 4.7: Test de
non-autocorrélation des résidus
Lags
|
LM-Stat
|
Prob
|
1
|
13.16077
|
0.6610
|
2
|
12.59417
|
0.7022
|
3
|
15.93977
|
0.4572
|
4
|
10.92592
|
0.8140
|
5
|
11.54005
|
0.7750
|
6
|
20.81474
|
0.1857
|
7
|
20.54399
|
0.1967
|
8
|
20.51527
|
0.8022
|
9
|
11.11635
|
0.8022
|
10
|
16.82818
|
0.3970
|
|
Source : calculs de l'auteur sur eviews
· Test
d'hétéroscédasticité des résidus
L'hypothèse d'homoscédasticité impose que
la variance du terme d'erreur soit constante pour chaque observation.
L'hétéroscédasticité qualifie les données
qui n'ont pas une variance constante. Les résultats 4.8 de ce test sont
consignés dans le tableau 4.8.
Tableau 4.8: Test
d'hétéroscédasticité des résidus
Chi-sq
|
Df
|
Prob
|
171.5441
|
180
|
0.8346
|
|
Source : calculs de l'auteur sur eviews
Le test indique que la probabilité associée
à la statistique de test (0,8346) est supérieure à 0,05.
L'hypothèse d'homoscédasticité es résidus est donc
vérifiée au seil de 5% et on peut donc conclure que les
résidus du modèle estimé sont bruit blanc. Les
résultats des tests précédents sur l'analyse des
résidus confirment la validation du modèle vectoriel à
correction d'erreur (VECM).
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 58
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
4.3.4.2 Présentation et interprétation
des résultats du VECM
Tableau 4.9: Relation de long
terme et force de rappel
CointegratingEq
|
CointEq1
|
BC(-1)
|
1.00000
|
logPIB
|
-7.055195(1.03799)[-7.56773]
|
SGB(-1)
|
-0.727039(0.16384)[-3.96257]
|
FBCF(-1)
|
2.786387(0.33420)
|
C
|
117.5166
|
Error Correction
|
D(BC)
|
CointEq1
|
-0.127608(0.06005)[-2.12497]
|
|
Source : calculs de l'auteur sur eviews
La force de rappel du moèle estimé vaut
À = -0,127 et la statistique de student T associée est
telle que T |=2,12 > 1,96 (quantile d'ordre 1 -
á/2 de la loi normale centrée réduite, avec
á = 5%). Cela atteste de l'adéquation du vecteur
à correction d'erreur. Ainsi, si à une période
donnée, la relation d'équilibre de long terme entre les deux
soldes est perturbée, il y'a un mécanisme correctif qui induit le
retour à cet équilibre à la période suivante.
Il ressort de l'estimation du VECM (Annexe C) que
l'accroissement du déficit budgétaire n'a pas d'effet
significatif à court terme sur le solde du compte courant (les
coefficients dans la dynamique de court terme sont non significatifs au seuil
de 5%). Á cet égard, l'hypothèse keynésienne d'un
lien positif entre le solde budgétaire et le solde du compte courant est
invalidée à court terme dans l'économie camerounaise.
Au total, les résultats suggèrent qu'à
court terme, on ne peut établir de lien significatif de cause à
effet entre entre le solde budgétaire global et le solde du compte
courant au Cameroun. Cela implique qu'à court terme, l'hypothèse
keynésienne des déficits jumeaux est rejetée au profit de
celle qui évoque l'absence de lien entre les deux soldes.
Quant aux coefficients de long terme, ceux-ci sont tous
significatifs et la dynamique de long terme est représentée par
l'équation (4.1).
BCt = + 17.75186 + 0,727039SBGt
+7,855195lobPIBt + 2,786387FBCF t_1
(4.1)
La dynamique de long terme traduite par l'équation
(4.1) précédente permet d'observer que le signe du coefficient
associé à la variable SBG est positif (+0,7270039), c'est
à
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Fage 59
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
dire qu'il y'a une relation positive entre les deux variables
d'intérêt (BC et SBG). Ce résultat amène à la
conclusion selon laquelle l'hypothèse des déficits jumeaux est
confirmée à long terme pour le cas du Cameroun. Autrement dit, la
hausse du déficit budgétaire s'accompagne par celle du
déficit de la balance courante, et inversement. Ce résultat est
similaire à celui des travaux de Kwame(2013) dont les résultats
valident l'hypothèse keynésienne des déficits jumeaux au
Ghana.
En outre, la dynamique de long terme traduite par
l'équation (4.1) indique que le signe de la constante est positif
(+17,75186) : nous pouvons l'interpréter comme le facteur qui englobe
l'épargne domestique. 3
En se basant toujours sur l'équation (4.1) les
constatats suivants sont faits sur la réponse à long terme de la
balance courante aux changements de la balance budgétaire. Ainsi, si le
rapport déficit budgétaire sur le FIB augmente de 1%, le rapport
du déficit de la balance courante sur le FIB augmentera de 0,72%
à long terme (l'hypothèse H1 de départ est ainsi
confirmée car l'on assistera à une augmentation mois
proportionnelle du déficit courant consécutive à celle du
déficit budgétaire).
Le coefficient associé à la variable SBG de
l'équilibre de long terme traduite par l'équation (4.1)
étant significatif, positif et inférieur à 1 (il vaut
0,7270) pourrait traduire le fait qu'un accroissement du déficit
budgétaire est partiellement couvert par une baisse des importations
ainsi que par un accroissement de la production des biens et des services
domestiques.
Il faut également souligner que le modèle
estimé indique une relation positive et significative entre la balance
courante et les investissements d'une part, et le produit intérieur brut
d'autre part. Cette relation positive entre le solde du compte courant et les
investissements publics permet d'en déduire qu'un accroissement de
l'investissement public améliore à long terme le solde de la
balance commerciale (Hypothèse H2 partiellement
confirmée).
Au total, on peut dire qu'à long terme, il y'a un lien
positif unidirectionnel allant du déficit budgétaire à
celui de la balance des transactions courantes. Ce résultat est conforme
à la vision keynésienne de l'hypothèse des déficits
jumeaux. En effet une augmentation du déficit budgétaire conduit
à une augmentation de la demande intérieure ou absorption.
L'accroissement de la demande intérieure induit la hausse des
importations et partant la détérioration du compte courant.
Toutefois, étant donné que l'économie camerounaise est
3. Rappelons que la balance courante est définie par :
BC = (Sp - Ip) + (T-G); donc
BC = (Sp - Ip) + BB, où
Sp = l'épargne privée, Ip
= les investissements privés, T les impôts , G = les
dépenses publiques, BB= la balance budgétaire.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 60
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
exportatrice de produits de base, c'est probablement le canal
de la demande qui lie les deux déficits dans ce pays.
4.3.4.3 Résultat du test de causalité de
Granger
L'hypothèse nulle selon laquelle le solde
budgétaire ne domine pas le solde du compte courant est rejetée
(confère les résultats du test de causalité de Granger
dans l'Annexe D). En fait, la p-value = 0,0404 <0,05). Selon Granger, le
solde budgétaire influence le solde du compte courant jusqu'à
atteindre un niveau de signification de 5%. Cependant, il est à noter
que la causalité inverse est statistiquement rejetée.
Cette constatation est similaire à celle de Diarra
(2015) concernant les cas du Sénégal et du Togo.
Ce résultat semble contraire à la vision
néoricardienne du déficit budgétaire qui stipule que les
changements dans les dépenses publiques et/ou dans les recettes
publiques n'ont pas d'effets réels sur le compte courant. Cela implique
que les efforts d'assainissement des finances publiques enregistrés dans
le cadre de la convergence multilatérale des pays de la zone CEMAC et
dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le FMI en
2017 auront un impact significatif sur les déficits courants structurels
qu'enregistre le Cameroun.
Outre le lien de causalité unidirectionnel allant de
SBG vers BC, le test met également en é vidence une
causalité bidirectionnelle de FBCF vers logPIB, une causalité
unidirectionnelle allant de BC vers FBCF selon la schématisation
suivante :
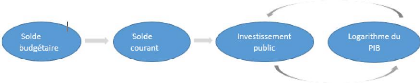
Source : auteur sur eviews
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 61
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
4.3.4.4 Analyse des chocs
L'une des principales application du modèle VECM est
d'analyser les effets d'une variable sur les autres grâce à la
simulation des chocs aléatoires sur les valeurs présentes et
passées des variables du modèle. Cela consiste à
étudier la réaction du modèle au choc d'innovation
(analyse des réponses impulsionnelles) et la contribution des chocs
à la variance des erreurs de prévision (décomposition de
la variance des erreurs).
4.3.4.5 Fonctions de réponses
impulsionnelles
Pour l'application d'un modèle VECM, il est
nécessaire d'analyser les fonctions de réponses impulsionnelles.
Celles-ci résument l'information concernant l'évolution d'une
variable suite à une impulsion, un choc sur une autre variable à
la la date t=0, toutes choses égales par ailleurs.
Un choc sur le solde budgétaire est sans effet sur le
compte courant durant la première année. En effet, si
l'État décide de creuser brusquement son déficit
budgétaire à une année donnée dans le but de
relever la balance courante, le solde du compte courant de la même
année n'est pas significativement affecté, mais une telle
politique portera ses fruits à partir de la deuxième
année. Cette amelioration va se poursuivre légèrement et
progressivement durant les cinq années consécutives à
l'année du choc. Après la cinquième année, ces
effets commencent à s'atenuer de sorte qu'au bout de dix ans, ceux-ci
deviennent nuls.
Graphique 4.4:
Réponses impulsionnelles des variables
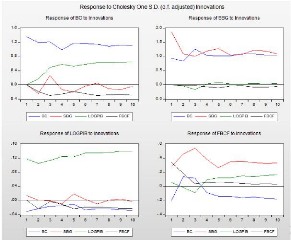
Source : calculs de l'auteur sur Eviews
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 62
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
4.3.4.6 Décomposition de la variance de
l'erreur de prévision sur BC
La décomposition de la variance de l'erreur de
prévision a pour objectif de calculer pour chacune des innovations (ou
chocs), sa contribution à la variance de l'erreur de prévision
sur la variable endogène. L'interprétation des résultats
est importante, elle est donnée comme suit :
Les résultats sur la décomposition de la
variance de l'erreur de prévision sur le compte courant, (Graphique 4.5)
permet de constater que les sources de variation du solde du compte courant
proviennent uniquement de ses valeurs passées au cours de la
première année de telle sorte que, si l'on voudrait modifier la
structure de ce solde à court terme, les décisions doivent
être prises en tenant beaucoup plus compte des valeurs passées de
ce solde plutôt que les autres variaables économiques. Ainsi, les
politiques visant à réduire les importations et accroître
les exportations seront préférables à court terme devant
celles qui ont tendance à accroître les dépenses publiques.
Ce résultat rejoint celui obtenu plus haut sur les effets
négligeables à court terme des autres variables sur ce solde.
Á partir de la deuxième année, les
sources de variations de la balance courante proviennent à 90% de ses
valeurs passées et de 10% du passé des autres variables, soit 8%
du passé du solde budgétaire, preuve que les effets de long terme
du solde budgétaire sur celui du compte courant commencent à se
ressentir. En effet, les politiques budgétaires émises à
une année donnée affecteront significativement le solde du compte
courant qu'aucours de l'année suivante. Ces effets vont très vite
augmenter de sorte qu'au bout de cinq ans, les variations du compte courant
sont expliquées à auteur de 25% par le solde budgétaire.
En d'autres termes, les politiques budgétaires visant à ameliorer
le solde du compte courant doivent être au plus de moyen terme (moins de
cinq ans). Au delà de la
5ième année, les effets de
ces politiques recommencent à s'atténuer pour atteindre 6,8%
à la fin de la 10ième année.
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 63
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
Graphique 4.5
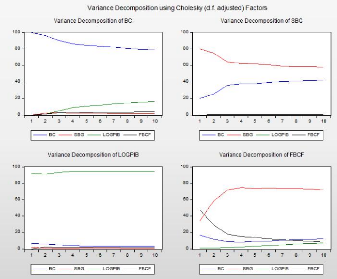
Source : calculs de l'auteur sur Eviews
Conclusion
Parvenu au terme du présent chapitre qui était
consacré à l'analyse économétrique de
l'hypothèse des déficits jumeaux au Cameroun, il ressort que les
variations sur le solde budgétaire global sont sans effet, à
court terme, sur la balance des transactions courantes au Cameroun. Á
long terme, le solde budgétaire a un effet significatif sur le solde du
compte compte courant de sorte qu'une augmentation du solde budgétaire
de 1% induit une augmentation du solde du compte courant de 0,72%.
L'étude met en évidence une causalité unidirectionnelle
partant du solde budgétaire vers le solde courant; une causalité
unidirectionnelle du solde du compte courant vers l'investissement public et
une causalité bidirectionnelle entre l'investissement public et le
PIB.
64
65
Limites et recommandations
Limites
Nous n'avons pas la prétention à travers cette
recherche d'avoir présenté des résultats sans faille et
exhaustifs sur tous les éléments pouvant permettre de bien
appréhender le phénomène des déficits jumeaux au
Cameroun. Aussi tout au long de ce travail, nous avons rencontré divers
obstacles qui sont identifiés dans cette partie :
· L'indisponibilité de longues séries de
données nous a poussées à jumeler des séries de
données provenant de diverses sources (MINFI, INS, BEAC, rapports) dans
le but d'avoir des série tenant au moins sur 30 ans. Cette provenance
à différentes sources pouvant mettre en jeu la fiabilité
des données pourrait à cet effet introduire un biais dans les
analyses.
· La non utilisation des données de panel. En
effet, on a pu constater que les études qui captaient des effets de
court terme du phénomène des déficits jumeaux
étaient celles qui utilisaient les techniques
économétriques des données de panel.
Recommandations
Recommandation à l'endroit des futurs
chercheurs
Aux futurs chercheurs qui tenteront d'analyser
l'hypothèse des déficits jumeaux au Cameroun, nous leur
recommandons de recourir aux techniques d'économétrie en
données de panel. Ils pourraient par exemple faire un panel sur les pays
de la CEMAC, de la CEEAC, ou même de l'Afrique toute entière.
Recommandation à l'endroit du
politique
Au politique, nous recommandons de consacrer plus les efforts
dans la luttes contre le déficit budgétaire plutôt que dans
celui de compte courant, car la présente étude montre qu'en
réduisant le premier, le second se réduit
systématiquement.
Conclusion générale
En somme, l'objectif du présent travail était la
vérification de l'hypothèse des déficits jumeaux pour le
cas du Cameroun. Pour répondre à la problématique
posée qui consistait à rechercher la nature du lien et le sens de
causalité entre le déficit budgétaire et le déficit
du compte des transactions courantes du Cameroun, nous nous sommes fixés
quatre objectifs spécifiques à savoir : (i) identifier les
facteurs susceptibles d'expliquer la coexistence du double déficit
budgétaire et courant au Cameroun; (ii) Déterminer l'effet d'un
choc du déficit budgétaire sur la balance courante au Cameroun;
(iii) tester le sens de causalité entre les déficits
budgétaire et courant et dégager la nature du lien entre les deux
soldes; (iv) déduire (dans le cas de la confirmation de
l'hypothèse des déficits jumeaux) les effets de ceux-ci sur
l'économie camerounaise. Pour atteindre ces objectifs, nous nous sommes
fixés deux hypothèses tirées des résultats
empiriques de deux auteurs. Il s'agit ici de l'étude de Mahamadou DIARRA
(2015) qui a testé l'hypothèse des déficits jumeaux dans
les pays de l'UEMOA et la thèse de doctorat de Véronica Sulikova
(2015) qui étudie la dynamique des déficits jumeaux dans le
contexte des déséquilibres macroéconomiques dans trois
pays baltes. Il ressort donc du présent travail ce qui suit :
- la première hypothèse libellée : une
augmentation du solde budgétaire global induit celle du solde du compte
courant au Cameroun, mais dans une proportion moindre a été
confirmée;
- de même, la seconde hypothèse libellée :
un accroissement des dépenses d'investissement public améliore le
solde du compte courant tout en détériorant celui du compte de
l'État a également été confirmée.
Pour ce qui est de l'atteinte des quatre objectifs
spécifiques fixés, il ressort que ceux-ci ont été
atteints. En effet :
1° le présent travail, se servant des outils du
modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM) met en
évidence une relation entre le solde du compte courant, le solde
budgétaire, la formation brute de capital fixe du secteur public ainsi
que la croissance économique; la relation obtenue expliquant à
81% la variabilité du solde du compte courant;
2° l'analyse des chocs a permis de voir qu'à court
terme, la variabilité du solde budgétaire
NDI ZAMBO Jean *** Mémoire ISE
Page 66
Hypothèse des déficits jumeaux: évaluation
empirique appliquée au Cameroun
global est sans effet sur la balance courante. Ces effets
commencent à se faire ressentir à partir de la deuxième
période où la variabilité de la balance courante est
expliquée à hauteur de 8% par la variabilité du solde
budgétaire. Ces effets vont progresser jusqu'à atteindre 25%
à la fin de la cinquième période, et à partir de la
sixième période, ces effets se dissipent de telle sorte
qu'à la fin de la dixième période, ils ne
représentent plus que 6%;
3o le troisième objectif visant à tester la
causalité entre les deux soldes a été atteint.
En effet, les résultats obtenus mettent en
évidence un lien causal unidirectionnel allant du solde
budgétaire vers celui du compte courant;
4o quant aux quatrième objectif, celui-ci a
été atteint. Le présent travail a montré
qu'à court terme, le solde budgétaire global n'a pas d'effets sur
celui du compte courant. Á long terme, ces effets sont tels qu'une
augmentation du déficit budgétaire de 1% entraîne
l'augmentation du solde des transactions courantes de 0,72%. Aussi, en
présence des déficits jumeaux, l'accroissement du solde
budgétaire est partiellement couvert par l'accroisse-ment des
importations des biens et des services.
En définitive, sur la période 1989-2018,
l'économie camerounaise vérifie l'hypothèse
keynésienne des déficits jumeaux mettant en évidence un
lien positif entre le solde budgétaire et celui du compte courant. Ce
résultat permet de conclure que les efforts d'assainissement des
finances publiques enregistrés dans le cadre de la convergence
multilatérale des pays de la zone CEMAC et dans le cadre du programme
économique et financier conclu avec le FMI en 2017 vont contribuer de
manière significative à l'amélioration du solde du compte
courant au Cameroun.
67
Bibliographie
[.]Abell.J, 1990 : «Les déficits jumeaux
durant les années 1980 : un examen empirique», Journal of
Macroeconomics, 12(1), PP.81-96
[.]Algieri.B, 2013 : «Une analyse empirique du lien
entre la balance extérieure et la balance des finances publiques :le cas
des pays GIIPS»
[.] Augusto Graziani, 19988 : «Le financement de
l'économie dans la pensée de Keynes» [.]Bacham.D.
D, 1992 : «Pourquoi le déficit du compte courant américain
est-il si important? Preuves provenant d'autorégressions»
[.] Barro, 1974 : «Les emprunts du Gouvernement
sont-ils nets?»
[.] Bispham.J, 1975 : «La Nouvelle école de
Cambridge et les critiques monétaristes du conventionnel»
[.] Bundt T. and Solocha A, 1988 : «Dette,
déficit et dollar»
[.] Endegnanew, Y. Amo-Yartey et Turner-Jones,T, 2012 :
«Politiques fiscal et compte courant : les Micro-Etats sont-ils
différents ?»
[.]Fleming.M.J, 1962, :«Politiques
financières nationales en taux de changes flottants» [.]
Feldstein M, 1992 : «Les déficits budgétaire et
extérieur sont-ils réellement jumeaux ?» [.]
Francis Malerbe, 1983 : «Théorie et pratique du déficit
budgétaire», page 65-90 [.]Hutchuison M et Pigott C, 1984
: «Ajustement réel et financier dans les économies en
croissance»
[.]Islam F.M, 1998 : «Déficits jumeaux au
Brésil: une évaluation empirique»
[.]Johansen S and Juselius K, 1990 :«Maximum
likelihood estimation and inference on cointegration whith application to the
demand for money»
[.]Kearney.C et Monadjemi.M, 1990 : « Politique
fiscale et performance du compte courant : vision internationale sur les
déficits jumeaux»
[.]Leachman L. L et Francis.B,2002 : «Twin deficit
: Apparition or Reality»
[.] MAX Maurin, 2010 : «J.M. Keynes, le
libre-échange et le protectionnisme»
[.] Mahamadou. DIARRA, 2015 : «L'hypothèse
des déficits jumeaux: une évluation empirique appliquée
aux pays de l'UEMOA», revue économique et monétaire N15-Juin
2014 - BCEAO
[.]Marinheiro C.F, 2013 : «Equivalence ricardienne,
déficits jumeaux et le puzzle de Feldstein-Horioka en Egypt»
page xii
[.]Mukhtar T et Zakaria M and Ahmed M, 2007 :
«Test empirique de l'hypothèse de des déficits jumeaux au
Pakistan»
[.] Mundell,Robert. A,1963 : «Politique de
Mobilité et de Stabilisation des Capitaux dans le Cadre de Taux de
Change flexibles et fixes»
[.]Omoniyi.O.S, Olasunkamiq.I et Babatunde O.A, 2012
: «Analyse empirique des déficits jumeaux au
Nigéria»
[.]Piersanti.G, 2000 : «Dynamique des comptes
courants et déficits budgétaires prévus dans l'avenir :
quelques preuves internationales»
[.]Rosenweig J.A and Tallman E.W, 1991 :
«Politique fiscale et ajustement du commerce» [.]
Système de Comptabilité Nationale SCN 2008
[.]Sobrino C.R, 2013 : «L'hypothèse de
déficits jumeaux et la causalité inverse : une analyse à
court terme du Pérou»
[.] Trachanas E. et Katradilidis.C, 2013 : «The
dynamic linkages of fiscal and current account deficits : New evidence from
five highly indebted European countries accouning for regime shifts and
asymetries»
[.]Toda H. Y and Yamamoto T, 1995 : «Statistical
inference in vector autoregressions whith possibly integrated
processes»
[.] Vamvoukas.G, 1999 : «Phénomène
des déficits jumeaux: Cas de la Grèce»
ANNEXE A
Tests de stationnarité
A.1 Test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF)
A.1.1 Stationnarité à niveau
A.1.1.1 Balance commerciale
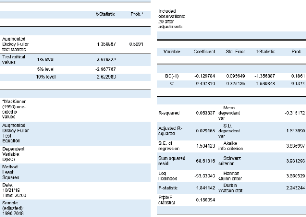
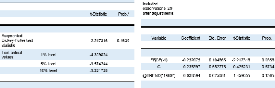
A.1.1.2 Formation brute de capital fixe
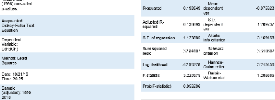
xiii
A.1.1.3 logarithme népérien du PIB
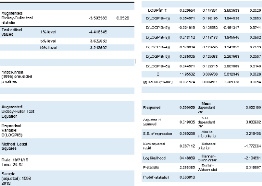
A.1.1.4 Solde budgétaire global


page xiv
A.1.2 Stationnarité en différence première
A.1.2.1 Balance commerciale
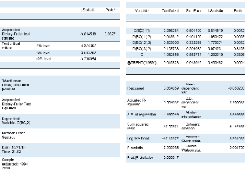
A.1.2.2 Formation brute de capital fixe
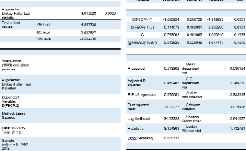
page xv
A.1.2.3 Logarithme népérien du PIB
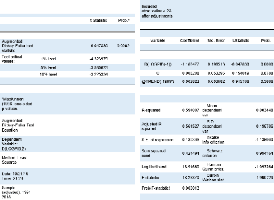
page xvi
A.1.2.4 Solde budgétaire global
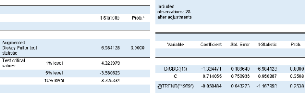
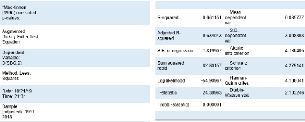
A.2 Test d'Andrew et Zivot (AZ) : stationnarité
à niveau
A.2.0.1 Balance commerciale
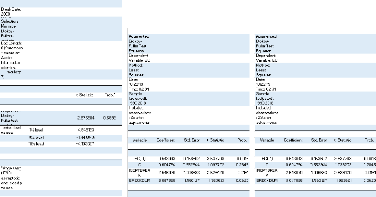
page xvii
A.2.0.2 Solde budgétaire global
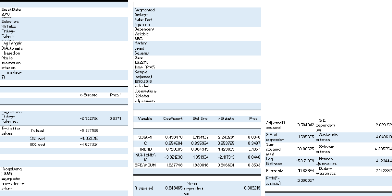
page xviii
xix
ANNEXE B
Test cointégration de Johansen
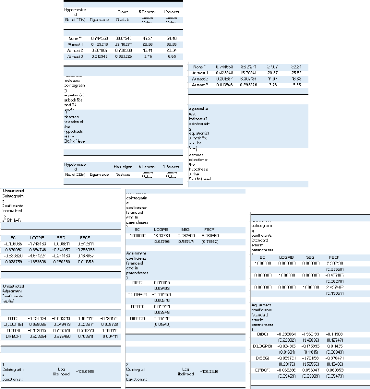
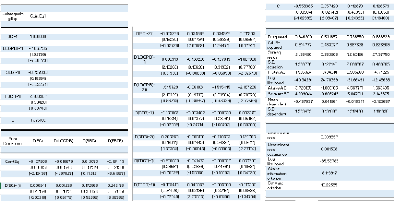
xx
ANNEXE C
Estimation du modèle
xxi
ANNEXE D
Test de causalité de Granger

ANNEXE E
Encadré sur les critères de convergence en zone
CEMAC
Anciens critères de 1994 2002
-le taux de couverture extérieure de la monnaie
supérieur ou égal à 20%.
-Le solde budgétaire primaire positif ou nul.
-La non accumulation des arriérés intérieurs
et extérieurs.
-Une croissance de la masse salariale de la fonction publique
inférieure ou égale à celle des recettes publiaues.
Anciens critères de 2002 en 2017
-Un solde bulgétaire de base (hors dons)
rapporté au PIB nominal positif ou nul.
-Un taux d'inflation annuel moyen inférieur ou égal
à 3%.
-La non accumulation d'arriérés
intérieurs et extérieurs sur la gestion de la période
courante.
Nouveaux critères depuis 2017
L'ancien critère relatif au solde budgétaire
présentait d'importantes faiblesses, tant sur le plan de la conception
que de la mise en oeuvre. Pour pallier ces faiblesses, les autorités ont
adopté un nouveau critère de solde budgétaire, qui
présente de grands avantages de conception. Ce critère, qui est
entré en vigueur avec le budget 2017, fixe un plancher de -1,5 comme le
solde budgétaire global moins : 20 recettes pétrolières et
leur moyenne par rapport au PIB des trois années
précédentes.
xxii
xxiii
Table des matières
Dédicace i
Liste des figures vi
Résumé ix
Abstract x
Introduction générale 1
I Cadre conceptuel, cadre théorique et empirique
6
1 Cadre Conceptuel de l'étude 7
1.1 Définition des concepts 8
1.1.1 Compte de l'État : déficit budgétaire,
excédent budgétaire 8
1.1.1.1 Les recettes de l'État 8
1.1.1.2 Les dons 8
1.1.1.3 Les dépenses des l'État 8
1.1.1.4 Les prêts moins les recouvrements 9
1.1.1.5 Le déficit ou l'excédent 9
1.1.2 Compte courant : déficit courant, excédent
courant 9
1.1.2.1 Équilibre comptable en économie
fermée 10
1.1.2.2 Équilibre comptable en économie ouverte
10
1.1.2.3 Flux internationaux de capitaux et la balance commerciale
11
1.1.2.4 Le produit intérieur brut (PIB) 12
1.1.2.5 Balance courante et identité comptable 13
1.1.3 Déficits jumeaux 14
1.2 Cadre analytique des déficits jumeaux: approche par
les comptes nationaux 14
page xxiv
|
2
|
Fondements théoriques, mise en évidence des
travaux empiriques et
|
|
|
choix méthodologique
|
17
|
|
2.1 Cadre théorique et empirique
|
18
|
|
2.1.1
|
Cadre théorique
|
18
|
|
|
2.1.1.1 Théorie behavioriste et approche
keynésienne
|
18
|
|
|
2.1.1.2 Vision néoclassique et hypothèse
d'équivalence ricardienne
|
19
|
|
2.1.2
|
Cadre empirique
|
20
|
|
2.2 Choix méthodologique
|
23
|
|
2.2.1
|
Recensement de quelques études selon la
méthodologie utilisée
|
23
|
|
2.2.2
|
Généralités sur le modèle vectoriel
à correction d'erreur (VECM) . . .
|
25
|
|
|
2.2.2.1 Le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF)
|
25
|
|
|
2.2.2.2 Le test d'Andrew et Zivot (AZ)
|
25
|
|
|
2.2.2.3 Test de cointégration de Johansen
|
26
|
|
2.2.3
|
Présentation du modèle vectoriel à
correction d'erreurs
|
27
|
|
|
2.2.3.1 Spécificaion du MCE et son estimation : cas
bivarié . . . .
|
27
|
|
|
2.2.3.2 Spécification du MCE et de son estimation : cas
multivarié
|
29
|
|
2.2.4
|
Test de causalité au sens de Granger
|
30
|
|
II
|
Analyse du lien empirique entre le déficit
budgétaire et le déficit courant 34
|
3 Aperçu global d'un point de vue descriptif du
phénomène des déficits
jumeaux 35
3.1 Examen des indicateurs économiques 36
3.1.1 Dynamique des recettes publiques au Cameroun 36
3.1.2 Évolution, composition et efficacité des
dépenses publiques 37
3.1.3 Exécution du budget 38
3.1.4 Dynamique du solde budgétaire global 39
3.1.5 Principales mesures d'optimisation des dépenses
publiques 40
page xxv
3.1.6 Situation des exportations, des importations et de la
Politique com-
merciale au Cameroun 42
3.1.6.1 Évolution (% du PIB) de la balance commerciale et
poli-
tique commerciale 42
3.1.6.2 Situation des exportations et des importations 44
3.2 Principales mesures régissant le commerce au Cameroun
46
3.2.1 Mesures agissant sur les importations 46
3.2.2 Mesures agissant sur les exportations au Cameroun 47
3.2.3 Mesures sur la production et le commerce du Cameroun 47
4 Analyse du lien économétrique entre le
solde budgétaire global et le
solde du compte courant 49
4.1 Présentation des données et des variables
retenues 50
4.2 Caractéristiques descriptives des séries et
représentation graphique des va-
riables 51
4.2.1 Évolution graphique des variables et nuages de
points 52
4.3 Résultats empiriques 53
4.3.1 Stationnarité des séries 53
4.3.2 Détermination du nombre optimal de retards 54
4.3.3 Test de cointégration de Johansen 54
4.3.4 Test post-estimation et interprétation des
résultats du modèle 55
4.3.4.1 Test post-estimation : validation du modèle
55
4.3.4.2 Présentation et interprétation des
résultats du VECM . 58
4.3.4.3 Résultat du test de causalité de Granger
60
4.3.4.4 Analyse des chocs 61
4.3.4.5 Fonctions de réponses impulsionnelles 61
4.3.4.6 Décomposition de la variance de l'erreur de
prévision sur
BC 62
page xxvi
Limites et recommandations 64
Conclusion générale 65
Bibliographie 67
A Tests de stationnarité xiii
A.1 Test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) xiii
A.1.1 Stationnarité à niveau xiii
A.1.1.1 Balance commerciale xiii
A.1.1.2 Formation brute de capital fixe xiii
A.1.1.3 logarithme népérien du PIB xiv
A.1.1.4 Solde budgétaire global xiv
A.1.2 Stationnarité en différence première
xv
A.1.2.1 Balance commerciale xv
A.1.2.2 Formation brute de capital fixe xv
A.1.2.3 Logarithme népérien du PIB xvi
A.1.2.4 Solde budgétaire global xvii
A.2 Test d'Andrew et Zivot (AZ) : stationnarité à
niveau xvii
A.2.0.1 Balance commerciale xvii
A.2.0.2 Solde budgétaire global xviii
B Test cointégration de Johansen xix
C Estimation du modèle xx
D Test de causalité de Granger xxi
E Encadré sur les critères de convergence
en zone CEMAC xxii
| 


