|
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE KINDU
UNIKI
BP. 122
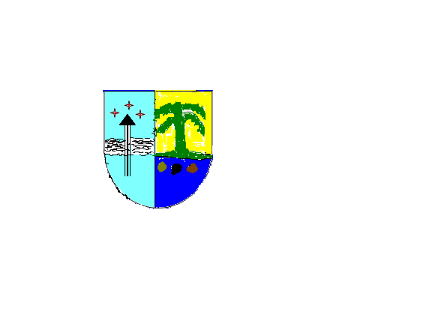

KINDU
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES ADMINISTRATIVES ET
POLITIQUES
DEPARTEMENT DE SCIENCES POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
TRANFORMATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN SOCIETES
COMMERCIALES VUE PAR LE PERSONNEL : CAS DE LA SNEL KINDU
DE 2009 A 2011
Par :
John KULUMBA
SHABANI
Mémoire Présenté en vue de l'obtention
du
Diplôme de Licence en Sciences
Politiques
et Administratives.
Option : Sciences Administratives
Directeur : Alexis MBIKAYI MUNDEKE
Professeur
Associé
Encadreur : Léon ALENGO DJEMBE
Chef de Travaux
ANNEE ACADEMIQUE 2011-2012
Première Session
DEDICACE
A nos parents Jean KULUMBA BIN LUSINDE et Pascaline ANDJELANI
LUNGUMBU, pour tant des sacrifices consentis à notre égard.
A nos oncles Stanislas LUNGUMBU, Lazare LUNGUMBU, NUMBI le
génie, BALA NUMBI, Maître BALA, Gaby, Maître Vincent
LUKUNDULA, Bienvenu, Donatien pour l'expression de tendresse à notre
égard.
A nos frères et soeurs AMADI ZAKWANI, ZAKWANI wa
ZAKWANI, Trésor KULUMBA, Nancy KULUMBA, Claire KULUMBA, MANGAZA SHABANI,
SALUFA, y compris nos nièces et neveux pour nous avoir soutenu pendant
toute la période de nos études.
A notre beau frère, Maître Pascal MBUYU KIONO
pour le sage conseil et les sacrifices pour la réussite de cette oeuvre
scientifique.
A notre marâtre Charlotte KULUMBA pour tous les conseils
et sacrifices consentis auxquels nous sommes devenus ce que nous sommes
aujourd'hui.
A notre chère fiancée Christelle MUKUNGULU, pour
l'encadrement matériel et le soutien moral qu'elle nous a toujours
apporté.
REMERCIEMENTS
«Le feu brûle quand chacun y ajoute un morceau de
bois» dit-on. Nous voici enfin au terme de nos études
universitaires de deuxième cycle en Sciences sociales,
département des Sciences Politiques et Administratives.
Après un long moment de rêve, la
réalité se concrétise aujourd'hui à travers cette
recherche scientifique qui nous a permis de nous outiller en nouvelles
connaissances dans notre formation.
Cependant, il nous faut reconnaître que la
réalisation de cette oeuvre a été rendu possible
grâce au concours de beaucoup de personnes envers lesquelles nous tenons
à présenter notre gratitude.
C'est à ce titre que nous remercions infiniment et de
façon particulière le professeur Alexis MBIKAYI MUNDEKE qui,
malgré ses préoccupations, a dirigé de mains de
maître ce travail, ses divers conseils et remarques nous ont
été bénéfiques.
Nous tenons également à remercier le chef de
Travaux Léon ALENGO DJEMBE pour avoir encadré ce travail et
l'assistant KAFAMBO SADIKI pour nous avoir orienté dans la construction
de notre sujet de mémoire. Nous leur sommes grandement
reconnaissants.
Nous sommes et restons reconnaissants à tous les
enseignants de l'école primaire, de l'école secondaire ainsi
qu'aux Professeurs, Chef de travaux et Assistants de l'Université de
Kindu en particulier ceux de notre faculté pour nous avoir soutenu avec
des conseils nécessaires à la réalisation de la
présente étude.
Nous ne pouvons pas oublier nos intimes et connaissances tels
que : SEFU BUSHIRI, FARAY ASSANI, DEGALOU DJEKA, SALEH DJAKA, TCHOMBA,
BABA, TIPE BAVON, DONATIEN BAKWALUFU, ANIFA BENEDICTE, PAPY AMUNDALA, YUMA
STALLONE, BIENVENU RAPHAEL, JUNIOR, BUSHIRI, MATAMATA, couple HONORINE, couple
Justin, couple KAMBA, couple Jacques, ADOLPHINE, DJAMBOLEKA, BULISINA, CARINE,
MOTEMA, ZAKWANI, AMADI, ARIDJA, BIBI, ZABIBU, JUSTIN MUSTO, KASONGO, MULAMBA,
BASONGE, PASCAL, LAZARE, ABIBU, MADO, SALIMA, YUMA, MOYONI, KASHANVU, OMARI,
BORA, PASCALINE, BLANDINE, VERONIQUE pour leur réconfort moral.
Que tous nos compagnons de lutte : Rémy KATCHOKO,
KIKUKAMA STEPHANO NGONGO, ASSANI DJUMA, MANARA SELEMANI, KABINDA KAZADI Taylor
mon opérateur de saisie et sa chère épouse IDA REHEMA
Irène, KELO NKIKU, SYLVIE MWAPE MBOKO, Elizabeth MWAMINI, Jacques LOKALA
DJUNGU, KELESHIMA KIMASHI BIBI, MADO WALO, RENE, MARIE LOUISE, LILIANE NAFU.
Veillez bien accepter nos sentiments de reconnaissance.
A nos grands-mères ALUA VERONIQUE, ALIMOYA YOLI pour
l'expression de tendresse à notre égard.
Nos remerciements s'adressent à tous les jeunes du bloc
Circo pour le développement et l'entraide ainsi que les jeunes de la
huitième communauté de l'Eglise catholique Romaine, la famille
KULUMBA, la famille LUSINDE, Charlotte KULUMBA, BALA NUMBI, BALA, Gaby, Vincent
LUKUNDULA, Bienvenu, Donatien, MULAMBA MBELOS, Jacques MUEMEDI,
Joséphine, MWAYUMA, MWAVITA LUSINDE, ATOSHA LUSINDE, ELAYA LUSINDE,
MATISHO, SHABANI LUSINDE, MASUDI LUSINDE, ANYEMBO, AMURI, MOLISHO, RAMAZANI,
KIMENYA et tous ceux qui nous ont soutenu par les prières pour la
réussite de cette oeuvre scientifique.
Nous disons également merci à tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué à l'élaboration de
ce travail.
John KULUMBA SHABANI
SIGLES ET ABREVIATIONS
A
ATT.B1 : Attaché de Bureau de 1ère
classe
ATT.B2 : Attaché de Bureau de 2ième
classe
AG.B1 : Agent de Bureau de 1ère classe
AG.B2 : Agent de Bureau de 2ième classe
B
B.T : Basse Tension
C
C.V.S : Chef de Vente et de Service
C.C.V.S : Centre de Commerce et de Vente de Service
CO.PI.R.E.P : Comité de Pilotage de la Réforme
des Entreprises du Portefeuille de l'Etat
D
Droit Eco. : Droit Économique
F
F : Fréquence
G
G.C.L : Gestion Clientèle
H
H.T : Haute Tension
J
J.O : Journal Officiel
L
L2 : deuxième licence
M
M.T : Moyenne Tension
MERLIN : Medical Relief Lasting Health Care
N
No : Numéro
O
O.C.C : Office Congolais de Contrôle
P
P.I.B : Produit Intérieur Brut
P.U.W : Presse Universitaire du Zaïre
R
R.D.C : République Démocratique du Congo
S
S.S.A.P : Sciences Sociales Administratives et Politiques
S.S.P.A : Sciences Sociales Politiques et Administratives
SEG : Sciences Economiques et Gestions
S.N.EL : Société Nationale
d'Electricité
S.N.C.C : Société Nationale de Chemin de fer
Congolais
S/T : Sous Total
S.A.R.L : Société A Responsabilité
Limitée
T
T.F.C : Travail de Fin de Cycle
T.M.B : Trust Merchant Bank
T.G : Total Général
U
UNI.KI : Université de Kindu
W
Wx : Travaux
% : pourcentage
INTRODUCTION
01.
Etat de la question
Les difficultés économico-financières des
années 30 ont poussé certains théoriciens tels que Keynes
à mettre au point une théorie fondée sur l'intervention de
l'Etat dans l'économie. Cette intervention de l'Etat procure une masse
monétaire dans la vie économique d'un pays.
L'affectation correcte de cette masse monétaire produit
des richesses énormes dans l'économie nationale. Dans le cas
contraire le pays s'expose à une inflation.
Comme nous le savons, l'inflation reste le premier ennemi de
la croissance économique. Il suffit qu'elle dépasse un certain
pourcentage, (à titre illustratif nous citons 40%). Par rapport à
la vitalité économique du pays pour qu'elle devienne un
véritable frein à la croissance économique.
La République Démocratique du Congo, pays en
période post-conflit se trouve dans une crise économique,
financière grave. Pour y faire face, le pouvoir politique congolais a
mis en place des politiques publiques capables de redresser la situation
économique du pays.
Le gouvernement central, soucieux de réorganiser et de
stabiliser l'économie nationale s'est vu dans l'obligation de
transformer les entreprises publiques en sociétés commerciales.
C'est-à-dire reformer toutes les entreprises publiques sous-tutelle
administrative du ministère du portefeuille et techniquement sous
tutelle du ministère de l'énergie.
Signalons à ce niveau que, bon nombre d'études
intéressantes ont déjà été
réalisées dans le domaine des entreprises publiques de l'Etat. Il
importe de les passer en revue afin de marquer l'originalité de notre
étude et en quoi elle se démarque de celles de nos
prédécesseurs.
Nous citons à titre illustratif les travaux
de :
Joseph NUMONDJO NDJOVU, P. PLANE, MWINYIMALI MBILIKA, MUDIMBI
KASENDE Charles, Elisabeth Patience NYONBO MWALITAMA.
Joseph NUMONDJO NDJOVU1(*) dans son étude sur la privatisation des
entreprises publiques en République Démocratique du Congo ;
l'auteur s'est posé la question ci-après :
Quels sont les enjeux politiques et administratifs de la
privatisation des entreprises publiques en République
Démocratique du Congo ?
Au terme de sa recherche, il aboutit aux résultats
selon lesquels plusieurs faits prouvent à suffisance cette
privatisation. C'est notamment la destruction du capital des entreprises
publiques, la gestion calamiteuse sur base du clientélisme.
A ceci, s'ajoute le non paiement par l'Etat de ses
consommations aggravant ainsi la crise des entreprises publiques, les
engagements financiers extérieurs non justifiés, des fonctions
financières multiples sont opérés par ceux là
même qui sont chargés de surveiller la bonne gestion des dites
entreprises, soit directement, soit par des contrats léonins et
abusifs.
Dans le même contexte, P. PLANE2(*) indique que les privatisations
qui ont vu le jour vers la décennie 90 ne cessent de se
développer. Et bien que le bilan de ces privatisations soit à ce
jour mitigé, des études montrant que là où l'Etat a
conduit ce processus avec maitrise, les résultats ont été
globalement bons ; mais il est donc interdit toute improvisation.
MWINYIMALI MBILIKA3(*) dans son étude basée sur la contribution
de l'OCC/Kindu au trésor public, s'est posé les questions
suivantes :
- La présence et le travail de l'Office Congolais de
Contrôle au Maniema sont-ils objectifs ?
- Quels sont les domaines d'activités concernés
par le contrôle de l'Office Congolais de Contrôle au
Maniema ?
- A quel Auteur peut-on évaluer la contribution de
l'Office Congolais de Contrôle au trésor public durant les
années en études ?
A l'issue de sa recherche, l'auteur est arrivé aux
résultats selon lesquels :
La présence et le travail de l'OCC/Kindu sont soutenus,
bien que la province soit enclavée. Nous y trouvons les articles de
consommation importés ou produits localement. L'Office Congolais de
Contrôle analyse les produits de consommation courante du type
alimentaire, des intrants de production industrielle et agricole.
Tout compte fait pour les années en étude,
l'Office Congolais de Contrôle a une contribution moins importante au
trésor public.
En fin l'auteur a remarqué que la contribution de
l'OCC/Kindu au trésor public n'est pas différente de celle d'un
opérateur économique qui doit commencer d'abord par la
déclaration des recettes réalisées sur lesquelles l'Etat
tire sa part à travers l'impôt.
MUDIMBI KASENDE Charles4(*) qui a parlé de l'impact du non application des
mesures de la mise à la retraite des agents pensionnables sur le
rendement de la SNCC/Kindu, s'est posé des questions
ci-après :
- Quelles sont les conséquences du non application de
la mise en retraite des agents pensionnables à la SNCC/Kindu ?
- Quelles sont les manifestations ou les indices de cette
utilisation ?
Au terme de ses investigations, l'auteur a abouti aux
résultats selon lesquels : la lourdeur dans la coordination des
travaux, le blocage de recruter un personnel actif, l'improductivité,
etc. sont des conséquences de la non application de la mise en retraite
des agents pensionnables à la SNCC /Kindu.
Alors que les arrivées tardives au lieu de travail, les
absences fréquentes et les faits de somnoler dans les bureaux sont des
grands indices de non application de la mise en retraite des agents
pensionnables à la SNCC/Kindu.
Elisabeth Patience NYONBO MWALITAMA5(*) dans son Analyse critique et
suggestive de la gestion de la SNCC/Kindu, voulait savoir :
- Qu'est-ce qui définit la liberté d'action
financière de la SNCC/Kindu jusqu'à nos jours ?
- Quel est le mode qui convient pour la gestion de la
SNCC/Kindu ?
A la fin de cette étude, le chercheur aboutit aux
résultats tels que: depuis les années, la liberté
financière doit être définie en rapport avec l'objectif qui
consiste en un mode de conception et d'orientation pouvant être à
la fois une stratégie de choix, une cohérence, une
décision, etc.
Selon cet auteur, la privatisation de cette entreprise
paraétatique reste le seul mode qui convient pour sa gestion. A partir
de cette privatisation, l'auteur a trouvé des avantages
ci-après :
· L'Etat peut obtenir des ressources financières
ou capitaux, frais nécessaires pour la recherche de l'efficacité
de la rentabilité et de l'expression de l'entreprise quel que soit le
propriétaire ;
· Il y a la réduction de poids et par sa
diminution de sa part dans le P.I.B ;
· Il y a le rétablissement de la concurrence sur
le marché.
De ce qui précède, il se dégage que tous
ces auteurs ont examiné des questions relatives à la gestion des
entreprises publiques. Ce qui peut paraitre à la première vue
comme des sujets similaires au notre.
Toute fois, il nous parait important de dégager la
nette démarcation entre notre étude et celles de nos
prédécesseurs. D'où, au delà de ce qui a
déjà été fait, notre étude se
démarque de celles des autres en ce qu'elle cherche à dominer un
problème spécifique lié à la transformation des
entreprises publiques en sociétés commerciales.
02. Problématique
Le renforcement du rôle de l'Etat en République
Démocratique du Congo a eu comme conséquence, un accroissement de
dépenses publiques. A cet effet, alors que jadis les taches
dévolues de l'Etat consistaient à assurer la police, la
diplomatie et la défense nationale, ce dernier intervient de nos jours
dans tous les secteurs de la vie nationale : le secteur économique,
le secteur social et le secteur culturel. Dès lors ici crée des
entreprises et des établissements, qui produisent les biens et les
services destinés au marché et au profit de son environnement.
Depuis 2009 certaines de ces entreprises de portefeuille de
l'Etat ont connu une transformation les rendant ainsi en sociétés
commerciales. C'est dans ce contexte que la SNEL qui était une
entreprise de l'Etat a eu le statut d'une société commerciale.
Certes, il convient de noter que de cette transformation,
l'Etat congolais veut mettre fin à la dégradation
économique par l'assurance des services de meilleure qualité
l'accroissement de l'offre des biens à la communauté,
l'allégement des contraintes budgétaires et par le partage des
risques avec les partenaires privés.
A Kindu, les agents de la SNEL/Kindu interprètent
différemment ce passage de leur entreprise en société
commerciale. Raison pour laquelle notre choix porte à cette étude
dont l'objet est celui de déterminer les avis (opinions) du personnel au
sujet de la mutation fonctionnelle qu'a connu la SNEL/Kindu.
L'intérêt de cette étude est à la
fois pratique et scientifique.
Sur le plan scientifique, elle permet d'approfondir nos
connaissances dans le domaine des services publics de l'Etat. Elle constitue
également un cadre de référence aux futures chercheurs qui
mèneront des sujets similaires.
Sur le plan pratique, cette étude pourra permettre au
personnel de connaitre les différents avis sur la transformation du
statut de la SNEL.
L'étude se limite dans la ville de Kindu où
fonctionne la SNEL, pendant la période allant de 2009 à 2011.
Cette période nous concerne dans la mesure où la transformation
s'était faite en 2009, mais exécutée en 2011.
Eu égard à tout ce qui précède, la
présente étude est centrée au tour de la
préoccupation suivante :
· Quelles sont les opinions des agents de la SNEL/Kindu
par rapport à la transformation de leur entreprise en
société commerciale ?
03. Hypothèses et objectifs
du travail
Au regard de la préoccupation soulevée à
la problématique, l'hypothèse ci-dessous est envisagée.
Nous avons estimé que la politique publique d'un Etat
relative à la transformation d'une entreprise publique en
société nationale d'électricité serait
perçue différemment par son personnel : pour certains
agents, l'opinion serait positive tandis que pour les autres, elle serait
négative.
Elle serait positive dans le sens que l'Etat aurait voulu
encore encourager certains particuliers qui veulent intervenir sur le
même domaine d'énergie et qui peuvent investir leurs moyens en vue
de concurrencer la SNEL dans un but de satisfaire l'intérêt
général.
L'opinion de certains agents serait négative en ce qui
concerne leur nouveau statut par rapport au traitement et la situation des
usagés de service.
L'objectif poursuivi dans cette étude est
d'évaluer les avis positifs et négatifs du personnel de la
SNEL/Kindu en ce qui concerne la transformation de leur entreprise en
société commerciale.
04. Méthodologie
4.1 Méthode
Nous ne pouvons pas atteindre l'explication concernant la
transformation des entreprises publiques en sociétés
commerciales, sans recourir à une démarche
méthodologique ; c'est pourquoi dans le cadre de cette
étude, nous avons opté pour la méthode
structuro-fonctionnelle selon le protocole descriptif de TALCOT PARSON6(*)
L'opérationnalisation de cette méthode nous
place devant la réalité telle que :
1. La société nationale
d'électricité est considérée comme étant une
structure composée des dirigeants et des abonnés sans lesquels
elle disparait. Ces éléments vivent toujours en interaction dont
la modification d'un élément engendre aux autres.
2. La SNEL/Kindu étant une réalité
analytique, il y a lieu de décrire le schéma de quatre
impératifs fonctionnels « AGIL» indispensables pour le
maintien de tout système.
Avec :
A : comme (ADAPTATION)
C'est-à-dire que la SNEL/Kindu jadis une entreprise publique devra
prendre une réglementation en vue de s'adapter au contexte actuel de son
statut de société commerciale ;
G : (Goal attainment) comme
réalisation des objectifs, c'est-à-dire dans l'exercice de son
statut, la SNEL/Kindu se fixe les objectifs comme celui d'approvisionner en
énergie son environnement. Cela n'est possible qu'avec la
disponibilité de ses ressources ;
I : (comme intégration) ce
protocole nous permettra d'analyser les différentes stratégies
prises par la SNEL en vue de s'intégrer dans son environnement en
s'adaptant à son nouveau statut de société commerciale et
son niveau de mobilisation de ses abonnés à s'acquitter de leurs
obligations pour son bon fonctionnement ;
L: (comme maintien de la cohésion du
système de valeur et de résolution de tension)
c'est-à-dire la SNEL/Kindu cherche à réduire les tensions
éventuelles en intervenant de façon équitable dans la
ville de Kindu et également en infligeant chaque fois des sanctions aux
agents et à la population fautive conformément aux règles
et à la loi.
4.2 Techniques
La méthode structuro-fonctionnelle a été
soutenue par les techniques documentaires et de questionnaire.
C'est grâce à la technique documentaire que nous
avons réussi à rassembler les informations disponibles, tout en
exploitant les archives, les documents et les ouvrages en rapport avec le sujet
de notre analyse.
Le questionnaire : nous a permis à interroger et
à questionner nos interlocuteurs qui sont respectivement le personnel de
la SNEL/Kindu.
Il s'agit de 122 agents dont les cadres de commandement, de
collaboration et d'exécution, parmi lesquels nous avons tiré au
hasard 21 sujets à interroger dont les cadres de commandement, ceux de
collaboration ainsi que les agents d'exécution.
Pour le traitement des données, nous avons recouru
à l'analyse des contenus quantitatifs. Celle-ci nous a permis à
quantifier les opinions du personnel par rapport à la transformation de
la SNEL.
La réalisation de ce travail s'est butée
à quelques difficultés entre autres : le manque d'une
documentation appropriée sur la société commerciale
à Kindu ainsi que la résistance des responsables de la SNEL/Kindu
de pouvoir nous fournir les explications, mais suite à notre courage et
diplomatie, nous sommes parvenus à surmonter toutes ces
difficultés en vue d'atteindre notre objectif.
05. Subdivision du Travail
Hormis
l'introduction et la conclusion, les pages qui suivent montrent le corps du
travail qui est subdivisé en trois chapitres dont le premier porte sur
le cadre conceptuel et théorique, le deuxième quant à lui,
traitant de la problématique sur la transformation de la
société national de l'électricité à la
société commerciale et enfin le troisième quant à
lui, est focalisé sur les opinions du personnel de la SNEL/Kindu sur la
transformation de celle-ci en une société commerciale.
CHAPITRE PREMIER : CADRE THEORIQUE ET CADRE
CONCEPTUEL
Avant d'entrer dans le vif de ce travail, il est de coutume
scientifique que nous commencions par passer en revue certains points qui
faciliteront la compréhension du travail. Il s'agit notamment du cadre
conceptuel (Section première), cadre théorique, (Section
deuxième) et enfin la description du milieu d'étude.
Section première : Cadre Conceptuel
Pour éviter toute confusion dans la
compréhension de notre travail, nous avons jugé utile de
clarifier les concepts ci-après : Transformation, Entreprise
publique, les personnels, la SNEL et la ville.
I.1 La
transformation
Selon le dictionnaire Bordas, la transformation est une
«modification apportée en transformant»7(*).
C'est l'action de changer, de modifier quelque chose ;
c'est le passage d'un état à un autre. Bref, c'est une
modification profonde ou tout ce qui bouleverse l'ordre établi.
Pour ce qui nous concerne dans cette étude, le concept
«transformation» c'est un passage d'un état initial à
un autre jugé acceptable. C'est notamment dans la production8(*).
I.2. Entreprise publique
Le concept «entreprise publique» fait l'objet de
nombreuses définitions, les points de vue de ceux qui les adoptent sont
souvent divers et différents.
Selon M.WEBER, M. CROSIER et E. FRIEDBERG cités par J.
ETIENNE et autres, l'entreprise publique est une organisation
financièrement indépendante, produisant pour le marché des
biens ou des services (...) c'est aussi le lieu de jeux de pouvoir, mais elle
n'acquiert pas, dans l'analyse stratégique, une épaisseur sociale
en elle-même9(*).
L'entreprise publique n'est ni organisation comme les autres,
ni une catégorie particulière d'organisation. La contrainte de
rentabilité, dans une économie de marché influé sur
les jeux des acteurs. Ces jeux entre les acteurs sont structurés par la
relation du salariat qui impose une contrainte fondamentale quelque peu
minorée par la sociologie des organisations.
En réalité, il existe de nombreuses formes
d'entreprises et, au-delà de leurs différences, elles sont
souvent définies par leur fonction économique principale. La
création des biens et des services marchands et partage des
revenus.
Le concept d'entreprise publique en droit congolais,
M.KINZONZI et C. PEROCHON considèrent de manière
générale, l'entreprise publique ou semi publique comme celle qui
appartient en totalité à l'Etat10(*).
Au terme de la loi No78-002 du 06 Janvier 1978,
relative aux dispositions générales applicables aux entreprises
publiques ; le concept d'entreprise publique se définit comme tout
établissement qui, quelque soit sa nature ;
ü Est créé et contrôlé par les
pouvoirs publics pour remplir une fonction d'intérêt
général ;
ü Est créé à l'initiative des
pouvoirs publics entre eux pour l'exploitation en commun d'un service ou d'une
activité donnée ;
ü Est créé à l'initiative des
personnes morales de pouvoir public entre elles pour l'exploitation en commun
d'un service ou d'une activité donnée ;
ü Est créé à l'initiative des
pouvoirs publics en association avec les personnes d'un service ou d'une
activité donnée.
Quant à son organisation et fonctionnement,
l'entreprise publique est présidée par un conseil
d'administration, administré au quotidien par un comité de
gestion, contrôlé par la cour de compte et dépendant d'une
ou de plusieurs organes de tutelle.
En République Démocratique du Congo, depuis une
décennie, les présidents des conseils d'Administration et les
membres du comité de gestion des entreprises publiques concentrent tous
les pouvoirs. Ils sont parachutés et ils provoquent un manque de
cohésion.
La tutelle des entreprises publiques congolaises pose des
problèmes, certains d'entre elles ont deux ou trois tutelles et ne
savent où commencer. Cela crée un véritable
désordre mais qui constitue un terrain favorable au pillage des
entreprises publiques, surtout lorsque l'on sait que les présidents des
conseils d'administration, les Administrateurs Délégués
Généraux et les autres membres des comités sont
nommés parmi les militants actifs des partis politiques au pouvoir. La
référence est ainsi faite à la décision politique
du partage équitable et équilibré de 34 entreprises
publiques décrétées du 04 Août 2005.
L'entreprise publique s'est définie par ce qu'elle est
et ce qu'elle fait. Elle est une organisation sociale produisant des richesses
sur base des réunions des capitaux et des hommes11(*).
I.3. Personnel
Si nous considérons la fonction publique congolaise
comme l'ensemble des agents et fonctionnaires qui animent les différents
services publics administratifs de l'Etat, le personnel est l'ensemble de ces
agents et fonctionnaires.
Ainsi, le personnel constitue l'ensemble des fonctionnaires de
l'Etat faisant partie de la fonction publique de l'Etat et gérés
par les statuts du personnel12(*).
Est un agent public, qui a été nommé,
titulaire à l'un des emplois ou de différents échelons de
la hiérarchie de l'Etat.
Le concept personnel, nous pouvons le définir comme
l'ensemble des agents de carrière des services publics de l'Etat qui
sont chargés du fonctionnement de l'appareil administratif en contre
partie d'une rémunération afin de satisfaire
l'intérêt général.
I.4. La société
nationale d'électricité en sigle la S.N.EL
C'est une entreprise publique de l'Etat à
caractère industriel et commercial, aujourd'hui suite à la
transformation, elle devient une société commerciale à
caractère marchand de droit congolais ayant son siège social
à Kinshasa ou encore elle devient la gestion clientèle13(*).
I.5 Ville
Il est difficile de donner au vocable «ville» une
définition unique qui puisse mettre tout le monde d'accord les auteurs
s'appuient sur des critères différents. On peut cependant
s'entendre sur quelques caractères qui découlent des
critères divers.
Le premier critère est statistique. Il varie selon les
pays. A l'intérieur d'un même pays, il faudrait tenir compte de
différenciations régionales.
Un autre critère repose sur l'analyse des
activités dominantes des habitants. Ainsi, l'industrie et le secteur
tertiaire caractérisant les activités urbaines.
On peut définir une ville par l'aspect ou par le
passage. Le paysage urbain se différencie d'un groupement rural par le
style des maisons, la façon dont elles se juxtaposent et les dessins des
rues. On peut en outre définir une ville par la densité des
bâtiments, comme par celle des habitants.
Eu égard à ce qui précède, on peut
tenter de donner une définition qui tient compte des différents
critères analysés ci-haut :
MAX WEBER (Economiste et Sociologue Allemand) la
définit comme suit : «la ville est un noyau d'habitation d'une
certaine taille ayant une fonction de centre de consommation et de production,
non agraire». En liant le rôle de marché local à celui
du comptoir pour les marchands et servant en outre de centre local ayant son
propre système de droit et sa propre structure juridique14(*).
A la conférence de Prague de 1966, les
géographes ont donné la définition suivante :
«Une agglomération urbaine est celle qui est formée d'un
ensemble de 10.000 habitants vivant du travail de la terre et ne dépassa
pas 25%»15(*).
André Journaux la définit comme «une
agglomération formée, habitée en permanence, plus ou moins
importante et dense, en grande partie ou totalement indépendante de son
territoire pour sa substance, animée par une vie de relation intense et
produisant dans son aspect un certain degré
d'organisation»16(*).
Selon le journal officiel No 08/16 du 07 Octobre
2008, il faut entendre par ville :
- Tout chef lieu de province ;
- Toute agglomération d'au moins 100.000 habitants
disposant des équipements collectifs et des infrastructures
économiques et sociales à laquelle un décret du premier
ministre aura conféré la nature de la ville17(*).
Quant à nous la ville de Kindu est le chef-lieu de la
province du Maniema, comptant 272.369 habitants.
Section deuxième : Cadre théorique de
l'entreprise publique et de la
Société
commerciale
I.2.1. Entreprise Publique
Jadis, la mission de l'Etat était d'assurer l'ordre et
la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette mission
classique de l'Etat n'est pas restée figée, ou immuable, elle a
évolué pour inclure les secteurs de l'économie, de
l'industrie et de commerce jusque là réservés à la
seule initiative publique. C'est ainsi que depuis lors l'Etat se charge de
réglementation de l'économie, de la production industrielle et
agricole, de la législation sociale, des hôpitaux, de l'habitat,
de l'enseignement, des assurances, de la production et de la distribution d'eau
potable, de l'électricité et du gaz, du ramassage des immondices,
de la voirie, de pompe funèbre. Bref, de toute activité ou
prestation susceptible de contribuer au bien être des citoyens.
Ces interventions de l'Etat se font grâce aux services
publics de l'Etat qui sont respectivement des entreprises publiques et
société de l'Etat.
Est entreprise publique toute personne morale de droit public
jouissant de l'autonomie de gestion sous la tutelle des autorités
supérieures et disposant d'un patrimoine propre spécialement
affecté à son objet social. On peut retenir que l'entreprise
publique est un patrimoine public personnalisé, affecté à
son objet social.
Elle est tout établissement créé et
contrôlé par le pouvoir public pour remplir une tâche
d'intérêt général18(*).
De ces définitions, il ressort que l'Etat constitue un
actionnaire de taille de l'entreprise publique. Des lors, l'Etat contrôle
les décisions de l'entreprise et oriente les activités
stratégiques. Tels sont les avantages d'une entreprise publique.
L'entreprise publique est gérée suivant les
caractéristiques telles que : le principe de continuité, le
principe de mutabilité, le principe de l'égalité et le
principe de légalité.
- Le principe de continuité : c'est l'exigence selon
laquelle la mission de service public doit être poursuivie en toute
circonstance sans courir les risques d'interruption car le service public est
créé pour rendre à un besoin impérieux
d'intérêt général. Il manquerait donc à sa
mission s'il connait des interruptions et se heurte dans son fonctionnement aux
obstacles de diverses formes.
- Le principe de mutabilité : repose sur
l'idée que l'intérêt général n'est pas une
idée immuable et que le service public soit susceptible de se conformer
à chaque instant à l'intérêt général
et qu'il s'adapte constamment aux circonstances et aux besoins pour remplir
efficacement sa mission.
- Le principe de neutralité : corollaire du
principe de l'égalité devant les services publics, ce principe
repose sur l'idée que, dans son fonctionnement, le service public ne
doit pas favoriser ou défavoriser ou pénaliser une
catégorie des usagés en particulier.
- Le principe de légalité : c'est
l'obligation pour l'administration ou le service public de respecter les
règles constitutionnelles, législatives, jurisprudentielles,
réglementaires et le cas échéant, contractuelles en
vigueur préétablies. La méconnaissance d'une de ces
règles par une autorité administrative est sanctionnée.
Toute entreprise publique est de deux types. Elle est la fois
centralisée et décentralisée. Dans le premier type, seuls
les ministres du gouvernement central sont habiletés de prendre les
décisions qui les engagent. La délégation des pouvoirs en
faveur des agents subalternes est donc strictement interdite. Par
conséquent, les gestionnaires de services publics centralisés
d'une manière absolue, ne sont que des simples exécutants des
décisions émanant des ministres du gouvernement central.
Elle s'appelle décentralisée à partir du
moment où l'entreprise publique au niveau local ou central est
dotée de la personnalité juridique propre et jouissant de
l'autonomie financière et organique. Ce type de décentralisation
est connu sous le nom de la décentralisation technique ou par
service.
I.2.2 Entreprise publique à
gestion privée
Elle n'est pas le fruit de la seule initiative de l'Etat ou de
collectivités publiques. Mais le fruit d'une initiative combinée
de l'Etat et des particuliers. En outre, le contrôle que le gouvernement
exerce sur une société commerciale se limite à un simple
contrôle administratif. C'est-à-dire la vérification du
respect par la société, de son objet social et de la
législation économique en vigueur. Enfin, la réalisation
de l'intérêt général n'est pas la
préoccupation première des créateurs d'une
société, c'est avant le profit qui est recherché,
l'intérêt général pouvant en être une
éventuelle conséquence heureuse. La société ne
répond donc pas à la définition du service public.
Les actionnaires privés dans les
sociétés, de même que les membres des organes de direction
n'ont jamais souhaité que les sociétés soient des services
publics. Pour éviter le contrôle de l'Etat (Contrôle de
tutelle) dont ils ont honneur.
L'Etat lui-même ne semble pas y tenir. En effet, l'Etat
a tous les pouvoirs de faire d'une société, une entreprise
publique par l'achat des actions des particuliers ou par la nationalisation
pure et simple. Or, l'Etat ne fait pas. Cette réserve de l'Etat
d'utiliser les moyens mis à sa disposition pour provoquer un changement
de statut des sociétés, laisse suffisamment voir que l'Etat
lui-même ne souhaite pas ce changement. Le souhait général
de l'opinion est donc que les sociétés demeurent des
sociétés privées soumis au régime de droit
commun.
Ainsi, les avantages de cette gestion combinée des
secteurs publics et privés restent le redressement de la production.
Ici, il y a la concurrence et dont le but est de générer le
profit. Donc les sociétés commerciales veulent à tout prix
rendre l'efficacité dans la productivité des entreprises
transformées19(*).
Section troisième : La description du milieu
d'étude : la SNEL/Kindu
I.3.1 Historique de la SNEL
Le long historique de la société nationale
d'électricité «S.N.EL» en sigle n'a pas d'égal
que sa complexité. Elle a été créée par
l'ordonnance loi No 70/0033 du 16 Mai 1970. A l'origine,
l'entreprise n'avait essentiellement qu'un rôle de maître d'ouvrage
dans les travaux d'aménagement du site Inga.
En effet, soucieux de répondre aux besoins
énergétiques du pays, le Gouvernement, par l'ordonnance
présidentielle No 07 - 391 du 23 Septembre 1967, institue le
comité de contrôle technique et financier pour les travaux d'Inga,
comité qui sera remplacé en 1970 par la S.N.EL et ce n'est
qu'à la suite de la mise en service d'Inga le 24 Novembre 1972, que
l'objet social de la S.N.EL sera complexe20(*).
S.N.EL devenait le producteur d'énergie, le
transporteur et le distributeur d'énergie à l'instar d'une
société d'Etat, Régideso et des sociétés
commerciales privées préexistantes ayant le même objet
social :
- COMECTRIK à Kinshasa ;
- Force de L'Est à Bukavu et Bendera ;
- Force du Bas-Congo au Bas-Congo ;
- Sogefor du Shaba ;
- Solega au Shaba ;
- Congolin.
La même année, le gouvernement mis en marche le
processus d'absorption progressive de ces sociétés privées
par la S.N.EL. A l'issus de ce processus d'absorption se traduire par
l'instauration d'une situation de monopole au profit de la S.N.EL
conforté en suite par la loi 74/012 du 14 Juillet 1974 portant reprise
par la S.N.EL de leur droit, obligation et activité. Celle-ci traduit la
volonté d'Etat de s'assurer le contrôle direct de la production,
le transport et la distribution de l'électricité, matière
stratégique dans le développement économique et social du
pays. Cependant, en ce qui concerne la Régideso, la prise totale par la
S.N.EL de ses activités électriques y compris ses centrales
hydro-électriques n'interviendra qu'en 1979, depuis lors, la S.N.EL
contrôle en réalité toutes les grandes centrales
électriques du secteur minier et petites centrales thermiques
intégrées aux installations d'entreprises isolées
demeurant indépendantes.
Toutefois, ajoutant que le service public de
l'électricité est confié à la S.N.EL
érigé sous forme des sociétés d'Etat par la loi
cadre sur les entreprises publiques et sur l'ordonnance loi N°78/196 du 05
Mai 1978 approuvant ce statut sous la tutelle du ministre de l'énergie.
La gestion courante de la S.N.EL est assurée par le conseil
d'administration composé de 9 membres et le comité de gestion
constitué de 5 membres, mais, le pouvoir public qui l'ont
créé, l'ont placé sous une double tutelle :
- D'une part au département de l'énergie en ce
qui concerne la tutelle administrative et technique ;
- D'autre part, au conseil supérieur du portefeuille,
en ce qui concerne la tutelle financière.
Au niveau du capital, l'Etat congolais est l'unique
actionnaire de la S.N.EL. Celle-ci détient des participations
financières dans quelques entreprises (SOFIDE, AGIP, BCDE, TRANZAM).
Ainsi, après sa création, ses structures sont
devenues fonctionnelles sur terrain. En 1994, l'ouverture du sous secteur de
l'électricité aux privés pour la construction et
l'exploitation des centrales hydro-électriques des réseaux
associés à des fins commerciales. En 2003, début du
processus de reforme dans tous les secteurs d'activités publiques dont
celui de l'énergie.
I.3.2 Historique de la S.N.EL
Kindu
La S.N.EL Kindu a été implantée en 1979
et c'est la Régideso qui gérait les deux secteurs.
C'est-à-dire le secteur eau et électricité. Quand il y a
eu scission entre les deux secteurs hydriques et électrique pendant ce
temps la S.N.EL Kindu fonctionnait comme unité d'exploitation et
s'appelait unité mixte d'exploitation de Kindu. Cette entité
s'est passée de l'unité à district aujourd'hui la gestion
clientèle de Kindu, de centre autonome à la gestion
clientèle. En son sein possède deux centres :
- Centre de Kindu ou gestion clientèle de
Kindu ;
- Centre de Kasongo ou gestion de Kasongo.
I.3.3 Mission de la S.N.EL
La S.N.EL a comme mission, la production, le transport, la
distribution et la commercialisation de l'énergie électrique
à travers tout le pays et à l'étranger.
I.3.4 Statut Juridique
La société nationale d'électricité
est un établissement du droit public à caractère
industriel et commercial créé par l'Ordonnance N°70033 du 16
Mai 1970. Loi N° 78/002 du 06 Janvier 1978 ; l'Ordonnance
N°78/196 du 05 Mai 1978. La S.N.EL n'a qu'un seul propriétaire qui
est l'Etat congolais et c'est le gouvernement de la République
Démocratique du Congo qui exerce toutes les prérogatives
dévolues au propriétaire de l'entreprise. Ainsi, ce sont les
ministères de l'énergie et de portefeuille qui exercent les
tutelles.
- La tutelle technique est exercé par le
ministère de l'énergie et concerne : la conclusion des
marchés, des travaux et fournitures, l'organisation des services, le
cadre organique, le statut du personnel, le barème de
rémunération, le rapport annuel et l'établissement des
agences à l'intérieur du pays.
- La tutelle administrative et financière est
assurée par le ministère du portefeuille et concerne : les
acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts et
prêt, les reprises et gestions de participations financières, le
plan comptable, le budget annuel et le bilan de fin d'exercice.
I.3.5 Situation
Géographique
Le bâtiment qui abrite la Société
nationale de l'électricité/Kindu est situé dans la ville
de Kindu, commune de Kasuku, Quartier Kasuku, sur l'avenue du 04 Janvier
N°25 en face de la TMB et MERLIN Kindu.
I.3.6
ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT
I.3.6.1 Structure
Organisationnelle
GCL-KINDU
SECRETARIAT
COORDINATION COMMERCIALE
GESTION DES MT RESEAUX
GESTION DU PERSONNEL
SECTION FINANCIERE
DISPENSAIRE
CAISSIER OPERATEUR MT
CHARGE DES STATISTIQUES
PREPOSE DU PERSONNEL
CHEF DE SCTION FINANCIERE
C.C.V.S
TECHNICIENS MT
AGENTS CHARGES DES SERVICES GENERAUX
CHARGE DE PS COMPTABILITE ET BUDGET
EXPLOITATION BT & ECLAIRAGE PUBLIQUE
GESTION DES STOCKS
SERVICE TECHNIQUE BT
GESTION DES ABONNES
GESTION DES COMPTEURS
NOUVEAUX CLIENTS
SERVICE DE VENTE
SECRETAIRE DU C.C.V.S
COUPURE ET RETABLISSEMENT
ENCAISSEMENT
POINTS DE RECEPTION
SERVICE PAIEMENT ET RECOUVREMENT
FACTURATION
PRELEVEMENT D'INDEX
TENASSIER RESEAUX SOUTERAINS MT
CAISSE FONCTIONNEMENT SECTION FINANCIERE
MAINTENANCE ET TRAVAUX BT
I.3.6.2. Structure
fonctionnelle
A. Gestion
Clientèle Kindu
C'est le gestionnaire au niveau provincial et à la
qualité de représentant de l'employeur, il est chargé
d'organiser, de commander et contrôler tous les services d'exploitation
et de distribution se trouvant sous sa direction. Il coordonne toutes les
activités, fait appliquer les instructions et signe dans tous les
documents comptables.
B.
Secrétariat
Comme reconnu par tout le monde, le secrétaire est le
moteur de l'administration. Le secrétariat est un service qui
dépend directement de la direction. C'est-à-dire au gestionnaire.
Ce bureau a comme rôle de garder le secret de la société et
ses archives. D'une part il joue l'intermédiaire entre la direction et
les services à l'intérieur de la société et d'autre
part entre la société et l'extérieur. Il est chargé
de réceptionner, enregistrer, rédiger les correspondances et de
veiller au classement des dossiers de la direction. Les documents
ci-après y sont tenus quotidiennement.
ü Le cahier des lettres expédiées ;
ü Le cahier des lettres reçues ;
ü Le cahier de transmission ;
ü Le signataire, etc...
Le cahier d'enregistrement des lettres reçues contient
six colonnes ou rubriques à savoir :
ü Le numéro ;
ü La date de réception ;
ü L'expéditeur ;
ü Le numéro de référence ;
ü L'objet de la lettre ;
ü Le classement
Le cahier d'enregistrement des lettres expédiées
contient cinq colonnes ou rubriques à savoir :
ü Le numéro de la lettre ;
ü La date d'expédition ;
ü Le destinataire ;
ü L'objet de la lettre ;
ü L'ordre de classement.
C. Dispensaire
C'est un service sensé de soigner les personnels de la
société. Ce service a comme rôle :
v D'examiner le personnel avant d'être
embauché ;
v De soigner les agents de la société en cas de
maladies.
D. Section
Financière
C'est un service qui est considéré comme un
coordonnateur et le géant de finance de la société. Comme
charge de l'administration à la S.N.EL, il se charge de :
Ø Connaitre les recettes du jour ;
Ø Elaborer le budget de la
société ;
Ø Effectuer les dépenses courantes.
Bref,
chargé de la gestion des fonds de la société.
E. Gestion du
personnel
C'est un service administratif qui est chargé
de :
ü Pointer les agents ;
ü Régler les conflits entre les agents.
Bref, chargé du personnel de la
société.
La gestion du personnel est un bureau qui est chargé de
contrôler, fonctionner et coter tous les personnels de la
société d'où la tâche d'être en collaboration
avec le gestionnaire pour mieux gérer les différends entre les
agents et cadres de la société.
La S.N.EL Kindu fonctionne avec un effectif de 33 agents
matriculés et un nombre réduit des journaliers qui sont pris en
cas de nécessité.
F. Gestion des
réseaux MT
Ce bureau s'occupe de tous les électriciens et
trésoriers attachés à ce service. Ceux-ci sont
chargés d'entretenir les réseaux sur toute la ville et les
différentes pannes survenues sur les différentes lignes et aux
maisons des abonnés. Les électriciens assurent aussi la
permanence dans les différentes cabines érigées dans la
ville. En cas de non paiement des factures de la S.N.EL par un abonné,
les électriciens ont encore la mission de descendre sur le terrain pour
procéder à la coupure du courant dans cette parcelle. Bref, la
gestion de réseaux s'occupe de la production, le transport et la
distribution à partir du poste jusque dans les maisons des
abonnés.
G. Coordination
Commerciale
Le gestionnaire clientèle est celui qui gère la
clientèle et tous les agents affectés à ce service
notamment les préposés au commercial, les préposés
aux abonnés, etc. Ce service est le poumon de la société
car celle-ci est appelée à réaliser les recettes, et c'est
à travers ce service que la société réalise ses
recettes pour son fonctionnement, un service chargé de paiement, de
facturation et de recouvrement auprès de différentes
catégories d'abonnés (abonnés domestiques, abonnés
semi industriels et commerciaux ainsi que les abonnés moyennes
tension).
H. Caissier
opérateur
Ce service est géré par une caissière ou
un caissier qui a comme tâche :
§ L'enregistrement des recettes dans les journaux.
C'est-à-dire : le livre de caisse ;
§ Donner la situation journalière de la caisse.
C'est-à-dire : le solde du jour.
§ Effectuer les dépenses avec la signature du
secrétaire administratif.
La caisse est alimentée par le paiement de factures par
les abonnés.
I. Centre de Commerce et de Vente de
Service
C'est un service qui s'occupe de :
· Recevoir et traiter les réclamations de la
clientèle ;
· Appliquer la politique et les stratégies
arrêtés par la direction Générale ;
· Elaborer le plan d'actions de son
entité ;
· Signer tous les documents de gestion du CVS et
pré-comptabilité ;
· Contrôler ;
· Procéder à la réconciliation des
comptes avec ses clients.
J. Secrétaire du
CVS
Celui-ci est chargé de :
· Réceptionner les réclamations des
clients ;
· Expédier les affaires qui concernent le
service ;
· Enregistrer et classer certains documents qui concerne
le service ;
K. Service de
Vente
Celui-ci s'occupe de la commercialisation électrique,
et de sa distribution aux abonnés par le service technique.
L. Nouveaux
Abonnés
Il s'occupe de la gestion des abonnés qui sont
nouvellement enregistrés.
M. Gestion des
Compteurs
Il s'occupe de différents compteurs dans les
différents services, maisons des abonnés, etc...
N. Gestion des
Abonnés
S'occupe de la gérance des abonnés.
O. Relève
d'index
S'occupe de connaitre la consommation mensuelle de chaque
abonné.
P. La
facturation
S'occupe de facturer les abonnés selon leur
consommation mensuelle.
Q. Service paie et
recouvrement
Celui-ci s'occupe d'accroitre les recettes, élaborer le
programme de recouvrement, déterminer les stratégies,
contrôler les échéances de paiement, contrôler et
assurer minutieusement toutes les opération de la société,
gérer et analyser les chèques impayés, analyser les
résultats de payer en désengagement les écarts.
R. Point de
Réception
Comme attribution :
Ø Coordonner et contrôler les encaissements de
recouvrement forcé ;
Ø Elaborer les programmes de coupures ;
Ø Déterminer les objectifs ;
Ø Les prévisions budgétaires des
entités.
S.
Encaissement
Les attributions :
Ø Il procède à la réception de la
pièce comptable ;
Ø Il contrôle les différents
encaissements ;
Ø Il contrôle la réception comme à
la remise.
T. Coupure et
Rétablissement
S'occupe de :
Ø Etablir les différentes listes des
abonnés insolvables ;
Ø Tracer les listes de rétablissement des
abonnés en ordre avec la société.
U. Service technique
BT
Le bureau s'occupe de la technique de la S.N.EL a comme
tâche : la production, le transport, et la distribution. La gestion
technique de Kindu est conservée par la distribution à partir du
poste jusqu'aux maisons des clients.
Bref, poste, ligne, cabine, les maisons enfin installer,
exploiter et dépanner.
CONCLUSION PARTIELLE
Il ressort dans ce chapitre les aspects de
généralités articulés sur :
v La classification des concepts clés ;
v Le cadre théorique de l'entreprise publique et de la
société commerciale ;
v La présentation de notre champ d'étude qui est
la «S.N.EL».
L'analyse minutieuse de ces aspects, nous conduit à
démontrer la transformation stricte de la S.N.EL en
société commerciale.
CHAPITRE DEUXIEME : LA PROBLEMATIQUE SUR LA
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE NATIONALE DE L'ELECTRICITE
A LA SOCIETE
COMMERCIALE
Les entreprises publiques congolaises sont transformées
selon les cas :
- En société commerciales dans lesquelles l'Etat
est actionnaire unique par dérogation aux dispositions légales en
vigueur ;
- En Etablissements publics ou services publics dans le but de
régler la problématique du statut juridique des Etablissements
publics qualifiés d'entreprises publiques, mais dont les
activités sont en réalité le prolongement de celle-ci, de
l'Administration publique bénéficiaire d'une
parafiscalité ;
- Certaines entreprises publiques sont dissoutes et
liquidées dans la mesure où elles sont en cessation de paiement
ou leurs activités économiques ne se justifient plus.
Dans le cadre de ce travail, nous allons nous atteler plus aux
sociétés commerciales parmi lesquelles s'inscrit la
SNEL/Kindu.
Pour mieux expliciter cette transformation, ce chapitre tourne
autour de deux points essentiels : le rappel sur le désengagement
de l'Etat des entreprises du portefeuille et la vague de transformation des
entreprises publiques.
II.1. Rappel sur le
désengagement de l'Etat des entreprises du
Portefeuille
Ce désengagement s'est opéré par la loi
09-008 du 07 juillet 2008 relative au désengagement de l'Etat des
entreprises du portefeuille de l'Etat.
En effet, au sens de l'Etat-entrepreneur, on peut
affirmer qu'en l'état actuel de l'économie congolaise,
l'Etat-entrepreneur constitue une alternative justifiée ainsi qu'une
nécessité comme facteur d'impulsion de la relance
économique et plus qu'en période coloniale, la période
actuelle requiert un rôle actif de l'Etat dans la mobilisation au profit
de l'économie.
Il est important pour l'Etat de renforcer ses capacités
de gestion pour redynamiser ses entreprises devant satisfaire des besoins
sociaux. Vu sous cet angle, le désengagement est une opération
très complexe dans sa mise en oeuvre.
Le désengagement s'avère un processus par lequel
l'Etat personne morale de droit public se retire totalement ou partiellement du
capital social ou de la gestion d'une entreprise du portefeuille de l'Etat ou
toute autre forme de partenariat public-privé mettant à
contribution un ou plusieurs opérateurs privés dans le capital ou
la gestion d'une entreprise du portefeuille de l'Etat.
Le désengagement est une politique qui vise à
soustraire une activité des missions de l'Etat.
C'est différent d'une privatisation de gestion ou de
capital. En effet, cette nouvelle approche qui circonscrit néanmoins le
rôle de l'Etat n'a pas la vocation à s'installer dans les affaires
en lieu et place de l'initiative privée, mais se doit d'intervention
occasionnellement dans l'économie au moyen de l'appropriation des
activités productives qui intègrent le désengagement
progressif des capitaux publics en fonction de la croissance de
l'économie et de maturation de la relève privée.
§1. Conditions et
modalités du désengagement
Le désengagement est soumis aux préalables
suivants :
1. L'évaluation du patrimoine de l'entreprise
concernée et les modalités de sa valorisation ;
2. La détermination des secteurs stratégiques et
de la part du capital que l'Etat entend conserver sous forme d'actions
spécifiques, et/ou d'action non diluables ;
3. La sauvegarde des intérêts de l'Etat par la
recherche des conditions les plus avantageuses ;
4. La promotion de l'entrepreneuriat national et des
intérêts des communautés locales ;
5. Le droit du personnel et tout autre aspect social ;
6. La suspension du monopole et l'interdiction d'abus des
positions dominantes ;
7. La diversification et la rentabilisation du portefeuille de
l'Etat à court, moyen et long terme en profitant des opportunités
qu'offre le marché ;
8. Le redressement de l'entreprise concernée.
Le désengagement s'effectue selon les modalités
suivantes :
1. La cession à titre onéreux au profit d'une ou
plusieurs personnes physiques et/ou morales de droit privé, de la
propriété de tout ou une partie des actifs ou de tout ou partie
du capital social d'une entreprise du portefeuille de l'Etat ;
2. La renonciation volontaire dans le délai imparti
à la souscription, aux augmentations du capital jugé vital et
indispensable, dispensable, décidées par l'organe
délibérant compétent ;
3. Le transfert à une ou plusieurs personnes physiques
et/ou morale de droit privé de la gestion des entreprises du
portefeuille de l'Etat ;
4. Toute autre forme de partenariat public ou privé
mettant à contribution l'initiative privée dans le capital et/ou
la gestion de l'entreprise.
§2. Exécution et
procédure du désengagement
La gestion du processus de désengagement est
assurée sous l'autorité et la responsabilité du ministre
ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions par un organe
technique.
Pour bien illustrer le désengagement, cinq situations
peuvent être évoqués :
1. L'Etat peut libéraliser le secteur des assurances
par exemple en autorisant cette activité aux privés sans pour
autant se désengager de l'activité ;
2. L'Etat peut se désengager de toutes les
activités des assurances ; L'Etat peut privatiser partiellement le
capital de la Sonas en créant une société
d'économie mixte ;
3. L'Etat peut privatiser la gestion de la SONAS en confiant
sa gestion à un privé ;
4. L'Etat peut privatiser totalement le capital de la Sonas en
vendant ses actions aux privés.
Pour la réussite de ce processus, il est
créé un établissement public à caractère
technique doté de la personnalité juridique,
dénommé « Comité de pilotage de la reforme
des entreprises du portefeuille de l'Etat », en sigle COPIREP.
Il se substitue au service public
« COPIREP », dont il reprend le personnel, les biens, les
droits et les obligations.
Dans ce cadre de loi portant disposition
générales relatives au désengagement de l'Etat des
entreprises du portefeuille de l'Etat, le COPIREP a pour mission de :
1. Elaborer le cahier de charges propre à chaque
opération et le soumettre à l'appréciation du
ministre « ayant le portefeuille de l'Etat dans ses attributions
pour approbation par le gouvernement ;
2. Proposer le mode de partenariat public-privé ou de
désengagement à retenir pour chaque entreprise publique
identique ;
3. Faire procéder à une évaluation
préalable des entreprises identifiées par les experts
indépendants ;
4. Etablir et publier les avis prévus à
l'article 13 de la loi susmentionnée ;
5. Rédiger le rapport indiquant, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles une procédure
exceptionnelle de cession de gré à gré est
envisagée.
6. Proposer la liste des entreprises identifiées pour
le désengagement et le calendrier de réalisation ;
7. Définir les procédures de
présélection et d'engagement des soumissions, des offres
publiques et des publicités.
Le gouvernement sur proposition du ministre du
portefeuille :
§ Définir les objectifs du programme ;
§ Identifier les entreprises desquelles, l'Etat a
décidé de se désengager ;
§ Consulter les partenaires sociaux des entreprises
concernées ;
§ Approuver le cahier de charges du
désengagement ;
§ Choisir les opérateurs privés retenus
pour acquérir les actions, les parts sociales, les actifs ou la gestion
de l'entreprise du portefeuille concerné.
La procédure de la mise en oeuvre du
désengagement se réalise par :
a. Avis au journal officiel
Le ministre ayant le portefeuille dans ses attributions,
préalablement à toute opération de désengagement,
publie un avis au journal officiel et dans au moins trois organes de presse en
vue d'en assurer une large publicité.
Cet avis public outre le nom, le capital, le siège
social de l'entreprise concernée, les résultats d'exploitation de
trois dernières années, les éléments d'actifs, le
délai de soumission des offres ainsi que les conditions
particulières de cession.
b. Désengagement proprement dite
Le désengagement par cession de titre au moyen d'appel
au public par l'offre publique de vente ou l'offre publique
d'échange.
Les offres présentées par le soumissionnaire
sont adressées à l'organe technique.
L'ouverture et l'analyse des plis sont effectuées par
une commission at hoc, présidée par cet organe.
Tous les soumissionnaires sont informés du lieu de la
date et de l'heure de l'ouverture des plis, et ont le droit d'y assister ou de
se faire représenter.
Le gouvernement fixe pour chaque entreprise, la proportion des
autres susceptibles d'être cédés, en priorité aux
personnes physiques ou morales de nationalité congolaise.
Lorsqu'il existe un droit de préemption dans
l'acquisition des actions ou parts sociales d'une entreprise du portefeuille de
l'Etat, sa mise en oeuvre tient compte de la meilleur offre reçue de
tous les candidats acquéreurs de l'évaluation réaliste des
actifs concernés suivant un rapport de circonstance d'experts
indépendants désignés de commun accord par les parties.
A la fin de chaque année, le ministre ayant le
portefeuille de l'Etat dans ses attributions fait rapport au gouvernement des
opérations de désengagement.
Ce rapport donne toutes les précisions sur les
opérations terminées ou en cours, les conditions de chacune
d'elles, les procédures suivies, les obstacles rencontrés, les
mesures prises, le bilan financier ainsi les perspective d'avenir.
II.2 La vague de transformation
des entreprises publiques
§1. Transformation des
entreprises publiques en société commerciales
Les entreprises publiques, du secteur marchand sont
transformées en sociétés commerciales soumises au
régime du droit commun et aux dispositions dérogatoires de loi
08/007 du 07 Juillet 2008.
La notion d'entreprise publique était un
échec ; pourtant dans le portefeuille de l'Etat congolais, il
existe des établissements publics à caractère industriel
et commercial, des sociétés d'Etat ou des sociétés
nationalisées et voire même des sociétés
d'économie mixte qui, par nature, avaient pour vocation la recherche du
profit, c'est donc cette catégorie d'entreprise qui est concernée
par l'article 4 de la loi sous étude.
En conséquence, le législateur a choisi le forme
d'une société à responsabilité limitée en
sigle : S.A.R.L dont la constitution est mise à l'autorisation
préalable du Président de la république,
conformément à l'article 6 du décret du 27 Février
1887 issu de la loi sur les sociétés commerciales.
Exceptionnellement, les entreprises publiques
transformées en sociétés commerciales sous la forme d'une
SARL n'ont besoin d'aucune autorisation pour leur constitution et par
dérogation aux règles relatives au fonctionnement d'une SARL,
l'Etat est l'unique actionnaire.
Et à ce sujet, Claude CHAMPAUD, dans son ouvrage
« Le pouvoir de concentration de la société par
action », a fait une analyse de la société anonyme
c'est-à-dire : la SARL, comme étant un remarquable
instrument de concentration des capitaux, du pouvoir économique et de
puissance industrielle.
Mais il pourrait être difficile de comprendre la
société anonyme qui a été conçue pour des
intérêts privés, qui peuvent être distincts mais qui
restent liés par la recherche du profit, ait l'attrait de l'Etat et non
comme un instrument d'intervention économique pour des
collectivités économiques pourtant, l'Etat a manifesté
très tôt son intérêt pour cette structure.
Cependant, il est presque inadéquat d'opter pour la
forme consacrée par les sociétés commerciales et
fonctionner comme une SARL au lieu de créer une forme
particulière adaptée à cette réalité.
Le décret N°09/12 du 24 Avril 2009 pris par le
Premier ministre en exécution de la loi sus mentionnée donne, en
annexe, la liste des entreprises publiques transformées en
sociétés commerciales.
Il s'agit entre autre de :
1. Le secteur des Mines ;
v La Générale des carrières des mines
« GECAMINE »
v La société de développement
industrielle et mines au Congo « SODIMCO »
v L'office des mines d'or de Kilo-Moto
« OKIMO »
v Entreprise Minière de Kisenge Manganèse
« EMK-Mn »
2. Le secteur de l'Energie ;
v La Régie de distribution d'eau
« REGIDESO »
v La Société Nationale d'Electricité
« SNEL »
v La Congolaise de Hydrocarbures
« COHYDRO »
3. Le secteur de l'industrie ;
v La société de sidérurgie de Maluku
« SOCIDER »
v La société Africaine d'explosifs
« AFRIDEX »
4. Le secteur de transport ;
v L'Office Nationale des Transports
« ONATRA »
v La Société Nationale des Chemins de fer du
Congo « SNCC »
v La Régie de Voies Maritimes
« RVM »
v La Ligne Aérienne Congolaise
« LAC »
v La Compagnie Maritime du
Congo « CMDC »
v Les chemins de fer des Uélé
« CEFU »
5. Le secteur de télécommunication ;
v L'Office Congolaise des postes et
télécommunications « OCPT
6. Le secteur des Finances
v La Caisse d'Epargne du Congo
« CADECO »
v La Société Nationale d'Assurance
« SONAS »
7. Le secteur des Services
v Hôtel Karavia, KARAVIA
II.2.1 La loi portant sur la
transformation des entreprises Publiques en
Société
commerciales.
Loi N°08/007 portant dispositions générales
relatives à la transformation des entreprise publiques en
sociétés commerciales21(*).
Un exposé des motifs et dix-huit articles :
Les entreprises publiques du secteur marchand sont
transformées en sociétés commerciales soumises au droit
commun et aux dispositions dérogatoires de la présente loi. Elles
sont au nombre de :
- Vingt qui sont transformées en sociétés
commerciales et reparties sur sept secteurs à savoir : Mines,
Energie, Industrie, Transport, Télécommunication, Finances et
Services.
- Vingt qui sont transformées en établissements
publics et reparties sur dix secteurs : Agriculture, Transport,
Communication, finances, Constructions, Services, Commerce, Recherche,
Conservation de la nature et Formation.
- Cinq qui sont transformées en services publics et
reparties sur quatre secteurs : Agricole, Mines, Financier et Services.
Au terme de la présente loi, il faudrait entendre
par :
1. Secteur marchand : tout secteur
d'activités économique soumis à la concurrence et dont le
but est de générer des profits ;
2. Etablissements publics : toute
personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de
remplir une mission de service public ;
3. Service public : tout organisme ou
activité d'intérêt général relevant de
l'Administration publique.
Loi N°08/008 portant dispositions générales
au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille.
Un exposé des motifs et vingt-six articles.
Elle définit conformément à l'article 123
de la constitution, les dispositions de désengagement du capital de la
gestion d'une entreprise du portefeuille et s'articule sur les principaux
points suivants :
- Les conditions et les modalités de
désengagement ;
- La gestion du processus de désengagement par l'organe
technique et la responsabilité du ministre ayant le portefeuille dans
ses attributions ;
- Les dispositions financières.
Au terme de la présente loi, il faudra entendre
par :
1. Désengagement : le processus
par lequel l'Etat ou toute personne morale de droit public se retire
partiellement ou totalement du capital social ou de la gestion d'une entreprise
du portefeuille de toute autre forme de partenariat public-privé,
mettant en contribution un ou plusieurs opérateurs privés dans le
capital ou la gestion d'une entreprise du portefeuille de l'Etat.
2. Entreprise du portefeuille de
l'Etat : toute société dans laquelle l'Etat ou
toute personne de droit public est destinée la totalité du
capital social ou une participation.
3. Entreprise publique : Toute personne
morale ou toute entreprise de portefeuille de l'Etat dans laquelle l'Etat ou
toute personne morale de droit public détient la totalité ou la
majorité absolue de capital social.
Loi N°08/009 portant dispositions générales
applicables aux établissements publics.
Un exposé des motifs et trente-cinq articles.
Le décret du premier Ministre
délibéré en conseil des ministres, crée la nature
de sa mission et sa dotation initiale.
Loi N°08/10 fixant les règles relatives à
l'organisation et la gestion du portefeuille de l'Etat, de la nouvelle
entreprise publique et détermine la représentation de l'Etat -
actionnaire ainsi vue la prise, le maintien ou l'organisation des
participations de l'Etat.
A ce titre, les entreprises du portefeuille de l'Etat sont
régies par le droit commun et prennent l'une des formes prévues
par le décret du 27 Février 1887 sur les sociétés
commerciales.
Toute fois, les actions, parts sociales et autres titres
revenant à l'Est sont toujours nominatifs dans le but d'en éviter
la dissimulation.
Au terme de cette forme, l'Etat conservera, dans son
portefeuille, un certain nombre d'entreprises, notamment dans les secteurs
stratégiques.
CONCLUSION PARTIELLE
Notre deuxième chapitre s'est basé sur la
transformation des entreprises publiques en sociétés
commerciales, pour mieux expliciter ce chapitre, nous avons jugé utile
de prendre ou d'expliquer les deux notions de cette transformation l'une, le
rappel sur le désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille et
l'autre, la vague de transformation des entreprises publiques.
En définitive, ce chapitre montre seulement la
finalité de certaines entreprises du portefeuille de l'Etat. Dans le cas
d'espèce, nous nous sommes attelés à examiner la
transformation de la SNEL. A l'issu de cette transformation, l'Etat congolais
redynamise ses entreprises afin de satisfaire les besoins sociaux des
gouvernés. Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer un partenariat
public-privé mettant à contribution un ou plusieurs
opérateurs privés dans la gestion de la SNEL/Kindu.
CHAPITRE TROISIEME : OPINIONS
DU PERSONNEL DE LA SNEL SUR LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN
SOCIETES
COMMERCIALES
Vu le retard d'application de la loi sur la transformation des
entreprises publiques en société commerciales, les avis du
personnel de la SNEL/Kindu ont un caractère prospectif. Pour ce faire,
ce chapitre comprend deux grandes parties à savoir : la perception
des opinions du personnel et les pistes de solutions.
III. 1. Perception des
opinions du personnel au sujet de la
Transformation de la S.N.EL à la
société commerciale
Les opinions du personnel sont diverses, mais nous citons
quelques unes dans les lignes suivantes :
III.1.1. Opinions positives
(favorables)
III.1.1.1. Augmentation des
recettes de la S.N.EL/Kindu
La gestion calamiteuse des entreprises publiques par l'Etat
congolais a réduit les actifs (avoirs) de la S.N.EL en
général. Cette diminution des recettes était
étayée par les abus des responsables de la S.N.EL. Il s'agit dans
ce cas des exonérations accordées à certains clients
évasions et fraudes fiscales orchestrées par les agents
percepteurs et surtout les interférences de la hiérarchie par
conséquent la S.N.EL/Kindu n'a pas atteint l'efficacité dans sa
productivité. Elle a réalisé moyennement 40% de la
production par rapport à sa prévision budgétaire.
Cependant, après qu'elle ait le statut de la
société commerciale et surtout dans la prospective de vendre les
bénéfices, il est fort probable que sa production pourra
évoluer. Elle peut largement dépasser le taux de 40% au
delà.
L'augmentation des recettes, peut également influer sur
le travail surtout que celles-ci s'orienteraient en grande partie au
fonctionnement de la Société nationale
d'électricité. Ces recettes sont incitatives dans la mesure
où le paiement du personnel dépendra de leur production.
Dès lors la SNEL se forcera de mobiliser les profits et
entreprendra plusieurs actions afin de gagner plus et de disposer à
temps les primes de ses journaliers.
III.1.1.2 Accès
à la concurrence des particuliers dans le domaine de
L'énergie
L'Etat qui se contactait à procurer des
transformateurs et à prendre le coût du personnel, laisse la
latitude à toute autre particulier. Raison pour laquelle, la direction
provinciale de la S.N.EL peut à partir de ses recouvrements, acheter une
machine susceptible de fournir l'énergie à ses abonnés. Il
en est de même pour les particuliers qui peuvent également faire
des actions dans le but de garantir la desserte en énergie. Cette
dynamique instaure la culture de la concurrence dans le domaine de
l'énergie à Kindu. L'Etat ne pourra plus interdire les gens de
bonne volonté à intervenir dans l'électrification.
Certes, l'Etat considéré comme seul actionnaire
dans le domaine de l'électricité ; n'empêche pas le
concours des particuliers.
Cette situation orchestre le système de paillage en
faveur du particulier. C'est-à-dire un particulier peut bâtir un
barrage afin de fournir l'électricité en qualité et en
quantité suffisante ; toutefois, l'Etat par ses prérogatives
de puissance publique, peut s'approprier cet ouvrage à condition qu'il
restitue le coût investi. A ce titre la SNEL peut tout faire pour attirer
la confiance de ses abonnés par des bons services et par
conséquent affaiblir cette concurrence.
III.1.1.3. Redynamisation
de la S.N.EL
Dans la redynamisation, il faut comprendre
l'amélioration qualitative et le renforcement quantitatif des
résultats, ainsi que la rationalisation du travail par la
réduction des coûts au vu des résultats à
obtenir.
Au regard de cette considération, la transformation du
statut de la S.N.EL a procuré un certain nombre d'avantages :
d'abord la production améliorée de l'énergie et en suite
le déchargement de l'Etat congolais face à la
rémunération du personnel et matériel pouvant produire
l'électricité.
Ce redressement de l'administration a permis à la
direction provinciale de mobiliser des agents et des journaliers à
partir de leurs compétences et expériences. Il en est de
même le fait que chaque agent titularisé au poste reçoit
son salaire à la TMB à travers son compte bancaire.
S'agissant des journaliers, ils sont payés par la
direction provinciale de la S.N.EL sans se référer à la
hiérarchie située à distance (Kinshasa). Cela amoindrit la
lourdeur qui devrait se poser.
Vu, le cumule de fonction pour les agents de carrière
de la S.N.EL, cette redynamisation de l'administration octroi à la
direction provinciale les prérogatives d'engager un personnel
étoffé et compétent. Celui-ci est
sélectionné sur place selon les critères prévus par
l'administration. Il s'agit du teste et de l'expérience requise.
Raison pour laquelle, nous avons actuellement un personnel qui
s'acquitte loyalement à son rôle (mission) sans commettre beaucoup
d'abus Administratif. Etant donné que les prestations sont suivies sur
place par la direction, le personnel règlemente leurs temps du travail.
Ainsi il y a diminution sensible des absences, des retards voire de
l'indiscipline dans le service.
Chaque agent s'occupe du travail et non comme au paravent
où les bureaux étaient confondus au lieu de conseillerie, de
causerie, de racontar et de jeux. Au lieu de faire huit heures de travail, mais
son personnel faisait huit heures au service. Dans ce cas, la production
était légère, car le personnel se contentait de faire
autre chose à part celles qu'il devrait réaliser dans le compte
de la communauté.
III.1.1.4. Rapidité
dans la gestion administrative de la S.N.EL
La gestion administrative se présente comme un
processus qui consiste à planifier, à organiser, à
contrôler les ressources et à prendre des décisions
judicieuses en vue d'offrir des produits et des services aux meilleures
conditions de qualité et de prix22(*). La combinaison de ces différents facteurs
conduit aux meilleurs résultats de la société. Avec la
transformation du statut de la S.N.EL, le personnel constate une
rapidité dans la planification, l'organisation, le suivi et dans la
prise des décisions. Point n'a jamais besoin d'attendre tout au sommet.
La direction provinciale de la S.N.EL détient les prérogatives
pour sa propre destinée.
Ainsi dans le souci d'éliminer la lourdeur
Administrative, la S.N.EL conçoit son programme d'action
conformément à la demande et aux problèmes de la
communauté. Ici, la société doit sélectionner les
vrais problèmes qui se posent réellement dans le milieu. En
outre, la S.N.EL a la possibilité de repartir des responsabilités
par fonction et compétences. Les fonctions attribuées sur base
des compétences des agents. Dans ce contexte, elle met en exergue le
principe de la technocratie et non de la politique comme dans l'autre fois.
Cette règle managériale reste centrée sur l'expertise et
la compétence des agents appelés à conduire les services
de la société nationale d'électricité du Maniema.
La politique n'influence plus rien, car le personnel n'est plus
recommandé selon le critère d'appartenance au parti politique de
la majorité présidentielle.
Ladite gestion managériale de la S.N.EL, mobilise les
ressources humaines par performance sans faire allusion au tribalisme, à
la connaissance, la parenté, etc...
En définitif, cette performance dans la gestion de la
S.N.EL est conditionnée par le contrôle ou suivi organisé
quotidiennement par la direction provinciale de la S.N.EL. D'aucun n'ignore que
la multiplicité de contrôle conduit à l'amélioration
continue des services.
TABLEAU N°1 Opinions
positives des nos enquêtés sur la transformation de la S.N.EL
à la Société
Commerciale.
|
Les opinions positives du
personnel au sujet de la
transformation
du
Statut de la
S.N.EL
Réponses
|
POPULATION ENQUETEE
|
|
CADRE DE COMMANDEMENT
|
CADRES DE COLLABORATION
|
CADRES D'EXECUTION
|
|
|
DIRECTEUR
|
C.B
|
S/TOTAL
|
ATTB 1
|
ATTB 2
|
S/TOTAL
|
AGB1
|
AGB2
|
S/TOTAL
|
TOTAL GEN
|
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
|
Augmentation de recette de la SNEL/Kindu
|
1
|
4,8
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
2
|
9,5
|
1
|
4,8
|
3
|
14,3
|
2
|
9,5
|
1
|
4,8
|
3
|
14,3
|
8
|
38,1
|
|
Accès à la concurrence des particuliers dans le
domaine de l'Energie
|
2
|
9,5
|
1
|
4,8
|
3
|
14,3
|
-
|
|
1
|
4,8
|
1
|
4,8
|
-
|
|
2
|
9,5
|
2
|
9,5
|
6
|
28,6
|
|
Redynamisation de la SNEL/Kindu
|
-
|
|
-
|
|
-
|
-
|
1
|
4,8
|
-
|
|
1
|
4,8
|
1
|
4,8
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
3
|
14,3
|
|
Rapidité dans la gestion Administrative de la
SNEL/Kindu
|
1
|
4,8
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
1
|
4,8
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
4
|
19
|
|
TOTAL GENERAL
|
4
|
19,1
|
3
|
14,4
|
7
|
33,3
|
4
|
19,1
|
3
|
14,4
|
7
|
33,4
|
3
|
14,3
|
4
|
19,1
|
7
|
33,3
|
21
|
100
|
Source : Enquête par interview.
Commentaire : Il ressort de ce tableau
que les avantages de la transformation de la SNEL sont entre autre :
l'augmentation de recettes de la société optée pour 8
sujets soit 38,1%. Tandis que 6 sujets soit 28,6% fustigent de l'accès
à la concurrence des particuliers dans le domaine de
l'énergie.
Quatre autres sujets soit 19% parlent de la rapidité
dans la gestion Administrative de la SNEL. Enfin, trois sujets soit 14,3%
indiquent la redynamisation de la SNEL comme avantage de transformation du
statut de cette société.
III.I.2. Opinions négatives
(défavorables)
D'autres opinions montrent que le passage de la SNEL, en
société commerciale n'est pas bénéfique. Il s'agit
de :
III.1.2.1. Diminution de
crédit de L'Etat
Pour accroître les ressources pécuniaires, la
SNEL multiplie ses taxes. Le fait que l'Etat actionnaire vend sa production,
réduit sensiblement sa valeur dans son environnement. La SNEL
imputée de la gratuité, crée le mécontentement dans
le chef de la population.
L'incivisme fiscal, amène la population
bénéficiaire du courant électrique à dévier
le recouvrement de la SNEL. Au lieu de s'acquitter de son devoir, la population
abonnée fustige la tracasserie administrative qui diminue sensiblement
la valeur de l'Etat. Partout dans la ville de Kindu, l'administration de la
SNEL s'affronte à la résistance de la population n'ayant pas une
culture fiscale.
III.1.2.2 Incapacité
de L'Etat d'assumer ses charges
Dans un Etat, c'est l'Administration qui a les
prérogatives de gérer les finances et le personnel d'une
entreprise publique.
Le rôle de l'Etat étant mal assuré, peut
créer son rejet par les abonnés.
La SNEL, au lieu de s'engager plus au développement est
marqué par l'incapacité de son appareil administratif dans
l'accomplissement de sa mission. Cela se justifie par le fait que depuis
quelques années, il existe des désordres établis, lesquels
sont dénoncés par des couches sociales et des élites
dirigeantes23(*).
Toutefois, l'attitude de la population face à ces
désordres administratifs se caractérise par une forte
variabilité d'appréciation du phénomène en
matière «de gestion des Entreprises publiques».
La majorité du peuple congolais a ainsi opté
pour le statut de société commerciale capable d'insister une
production abondante en vue de la vendre aux abonnés.
Il s'ajoute l'idée selon laquelle la gestion
calamiteuse de la SNEL a orchestré plusieurs arriérés des
salaires de ses fonctionnaires. C'est l'incapacité de l'Administration
congolaise à payer toutes ces dettes (arriérés) qu'elle a
procédé à ladite transformation. Il y a au moins 23 mois
d'arriéré que l'Etat devrait payer aux fonctionnaires.
Pour sa réussite, Robert PAPIN24(*) estime aussi que tout
créateur digne de ce nom, doit trouver un parrain chef d'entreprise qui
connait bien son future secteur d'activité.
III.1.2.3 Perte de
contrôle Etatique sur les gains du particulier investis dans le domaine
d'électrification
L'Administration ne pourra pas avoir les prérogatives
de contrôler les capitaux investis par les particuliers au cas où
il intervenait dans le domaine d'électrification. Tous les
intérêts financiers réalisés reviennent au patron
(particulier). Aucune partie des finances ne revient à l'Etat
congolais.
L'Etat se dépouille de toute responsabilité, son
rôle reste celui d'observer la manière dont le particulier
réalise l'objectif lui assigné.
Dans le contexte de notre recherche, l'Administration
congolaise se limite d'apprécier l'énergie électrique
fournie par la SNEL. Au cas il y a dérapage, le pouvoir en place
interpelle le gestionnaire afin de le remettre dans sa finalité. Dans le
cas contraire, il y a nécessité de rompre le contrat qui l'unit
avec le particulier.
Le management est la méthode de gouvernement qui assure
la cohérence25(*).
TABLEAU No 2
Opinions Négatives (Défavorables)
|
Les opinions négatives du
personnel au sujet de la
transformation
du
Statut de la
S.N.EL
Réponses
|
POPULATION ENQUETEE
|
|
CADRE DE COMMANDEMENT
|
CADRES DE COLLABORATION
|
CADRES D'EXECUTION
|
|
|
DIRECTEUR
|
C.B
|
S/TOTAL
|
ATTB 1
|
ATTB 2
|
S/TOTAL
|
AGB1
|
AGB2
|
S/TOTAL
|
TOTAL GEN
|
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
F
|
%
|
|
Diminution de poids de l'Etat
|
2
|
9,5
|
1
|
4,8
|
3
|
14,3
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
3
|
14,3
|
1
|
4,8
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
8
|
38,1
|
|
Incapacité de l'Etat d'assurer ses charges
|
1
|
4,8
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
1
|
4,8
|
-
|
-
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
1
|
4,8
|
3
|
14,3
|
6
|
28,6
|
|
Perte de contrôle étatique sur les gains du
particulier investis dans le domaine d'électrification
|
1
|
4,8
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
3
|
14,3
|
1
|
4,8
|
1
|
4,8
|
2
|
9,5
|
7
|
33,3
|
|
TOTAL
|
4
|
19,1
|
3
|
14,4
|
7
|
33,3
|
3
|
14,4
|
4
|
19
|
7
|
33,4
|
4
|
19,1
|
3
|
14,4
|
7
|
33,3
|
21
|
100
|
Source : Enquête par interview.
Commentaire : il ressort de ce tableau que
la transformation de la SNEL a provoqué les effets comme la
diminution du poids de l'Etat, la perte de contrôle étatique sur
les gains du particulier investis dans le domaine d'électrification et
l'incapacité de l'Etat d'assurer ses charges.
III.2 Piste des
solutions
Depuis 2009 la SNEL est devenue société
commerciale fonctionnant sur les nouvelles bases juridiques.
C'est-à-dire pouvant vendre ses bénéfices afin de
renforcer ses productions énergétiques et économiques.
Dans tous cela, c'est l'Etat qui reste actionnaire principal
qui finance et qui gère la SNEL à travers les mandataires. Au
regard de cette considération de l'Etat, il est vrais qu'aucune chose ne
pourra changer dans la mesure où il reste imputé de mauvais
patron. Même, visant la performance de ces capitaux dans cette
transformation, la situation des congolais restera la même comme
auparavant.
L'Etat congolais, continue à canaliser les capitaux
vers ses intérêts égoïstes au détriment de ceux
dit généraux. Ainsi, on pouvait espérer dans ce changement
ou au cas où il s'orienterait vers la privatisation de la SNEL ou sa
restauration en société mixte. C'est à ce niveau que sa
gestion pourrait être efficace et rationnelle avec la concurrence des
particuliers. Une entreprise à gestion privée, vise la
maximisation des gains tout en se forçant à normaliser le
fonctionnement. Pour produire davantage la SNEL devrait consacrer ses
bénéfices au paiement de ses agents et à
l'équipement. Chose que l'Etat congolais n'assure plus
aisément.
Cette concurrence devrait en principe permettre à
l'Etat de renforcer ses capacités afin de faire face au particulier.
Il s'ajoute aussi la qualification intégrale du
personnel de la SNEL. Les capitaux seuls ne suffisent pas, mais il faut les
agents qui les gèrent selon la finalité de la
société. Donc un personnel doit nécessairement être
éduqué afin qu'il remplisse la mission de l'intérêt
général assigné pour tout service public. Cette
éducation lui permet de concentrer les bénéfices en faveur
du bon fonctionnement de la SNEL. C'est à ce titre que le
détournement et le vole des deniers publics peuvent prendre fin.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici à la fin de notre travail scientifique
intitulé «Transformation des entreprises publiques vue par le
personnel : Cas de la SNEL/Kindu de 2009 à 2011».
Dans ce travail, nous nous sommes fixés l'objectif
d'identifier les avis du personnel de la SNEL/Kindu au sujet de la
transformation de leur entreprise en société commerciale.
Du début à la fin, notre réflexion a
été d'examiner les différents avis (opinions) des agents
de la SNEL/Kindu face au passage de leur entreprise en société
commerciale. Ceci nous a conduit à nous poser la question de savoir
«Quelles sont les opinions des agents de la SNEL/Kindu par rapport
à la transformation de leur entreprise en société
commerciale?»
Pour répondre à cette question, nous avons
utilisé la méthode structuro-fonctionnelle selon le schéma
de TALCOT PARSON. Celle-ci a été soutenue par des techniques de
récolte de données à savoir : la documentation
écrite et l'enquête par entretien. Nous avons également
utilisé l'analyse de contenu quantitative pour le traitement
(dépouillement) des données recueillies.
Au terme de cette étude, nous sommes arrivé aux
résultats suivant ayant confirmé nos hypothèses du
travail.
La disparité des opinions allant dans le sens positif
et négatif, sont les considérations du personnel face à
cette transformation.
Outre l'introduction et la conclusion, ce travail a
été subdivisé en trois chapitres dont le premier a
porté sur le cadre conceptuel et théorique de la transformation
des entreprises publiques ; alors que le deuxième a concerné
la problématique de la transformation de la SNEL à
société commerciale ; enfin, le troisième chapitre a
tourné autour des opinions du personnel sur la transformation des
entreprises publiques en sociétés commerciales.
Au terme de nos investigations, nous sommes arrivés aux
résultats selon lesquels : l'augmentation des recettes, l'accès
à la concurrence des particuliers dans le domaine de l'énergie,
la redynamisation de la SNEL et la rapidité dans la gestion
administrative sont les opinions positives du personnel au sujet de la
transformation de SNEL à la société commerciale. Tandis
que la diminution de crédit de l'Etat, l'incapacité de l'Etat
d'assumer ses charges et la perte de contrôle étatique des gains
du particulier investis dans le domaine d'électrification, sont des avis
négatifs de ces personnels vis-à-vis de cette transformation.
A la lumière de ces résultats, nous pensons
avoir atteint nos objectifs et nous signalons que notre hypothèse de
départ a été confirmée.
De tout ce qui précède, nous
suggérons :
Que la SNEL soit privatisée dans sa gestion car, ce
statut poussera les actionnaires privés à s'impliquer totalement
dans la gestion. Au cas où cette privatisation ne sera pas
acceptée par l'administration congolaise, il convient
nécessairement de renforcer les capacités de son personnel
affecté à cette entreprise publique de l'Etat.
C'est-à-dire le motiver pour qu'il puisse travailler pour le compte de
la population (intérêt général).
Nous ne prétendons pas terminer à circonscrire
tous les aspects relatifs à la transformation des entreprises publique
en sociétés commerciales. Car, d'autres aspects peuvent faire
l'objet des futures recherches soit par nous même, soit par d'autres
chercheurs.
C'est ainsi que nous laissons encore le soin à d'autres
chercheurs intéressés à ce thème d'approfondir
davantage les propositions en vue d'améliorer le fonctionnement de la
SNEL comme société commerciale ou d'autres encore de la ville de
Kindu en particulier et de la province du Maniema en général.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. BERNARD, Gournay Introduction à la Science
administrative, Paris, Armond Colin, 1966, P 191.
2. Cabanes, Robert et Lautier, Bruno Profils d'entreprises
publiques au sud, Ed. Karthala, Paris, 1996.
3. Etienne ; Dictionnaire de Sociologie, Ed. Hatier,
Paris, 1997.
4. KINZONZI, M. et PEROCHON, C. Manuel de
comptabilité générale, Ed. Faucher, Paris, 1992.
5. PAPIN, Robert stratégies pour la création
d'entreprises, Ed. Dunod, Paris, 2007.
6. TERRY, R et STEPHEN, J. Les principes du management
économique, Paris, 1988.
II. TRAVAUX DE FIN DE CYCLE
1. Charles MUDIMBI, K. l'impact de la non application de
mesure de la retraite des agents pensionnables sur le rendement de la
SNCC/Kindu, Mémoire, L2, SPA, FSSAP, UNIKI, 2010-2011, inédit.
2. Joseph NUMONDJO, N. Des enjeux politiques et administratifs
de la privatisation des entreprises publiques en RD Congo, Mémoire, L2
SPA, FSSA, UNIKI, 2010-2011, inédit.
3. MWINYIMALI, M. Etude de contribution de l'OCC/Kindu
au trésor public, TFC, G3 S.E.G, UNIKI, 2010-2011, inédit.
4. NYOMBO, E. Analyse critique et suggestion de la gestion de
la SNCC/Kindu, Mémoire, L2 Droit Eco. UNIKI, 2008-2009,
inédit.
III. ARTICLES DES REVUES
1. MARX, K. «Manifestation du parti
communiste», in Une revue de Sciences humaines Lubumbashi, PUZ, 1974,
P 129.
2. PLANE, P. «Les privatisations dans les pays en
voie de développement : qu'avons-nous appris?» in revue
Française d'économie, vol. IX, Paris 1994, P2.
IV. INSTRUMENTS DE TRAVAIL
1. Dictionnaire Bordas, Paris, 1998, Montréal.
V. DOCUMENTS OFFICIELS ET AUTRES
1. Journal Officiel de la République du Zaïre, 32
années, No15 du 1er août 1981.
2. Journal Officiel loi No 08/16 du 07 Octobre
2008.
3. Journal Officiel de la RDC, 148ième
année numéro spécial du 24 avril 2009.
4. Le manuel de la SNEL exercice 2011.
5. Rapport annuel de la SNEL/Kindu en 2011.
VI. NOTES DES COURS
1. NYEMBO, CHOMA S. Cours d'Aménagement du territoire
approfondi, L2 SPA, FSSAP, UNIKI, 2009, inédit.
2. JOURNAUX, cité par CHOMA, Aménagement du
territoire approfondi, L2 SPA, FSSAP, UNIKI, 2009, inédit.
3. WEBER, M. cité par MALIKIDOGO. S, Cours
d'Administration des villes, L2 SA, FSSAP, UNIKI, 2009-2010, inédit.
4. MANDEFU, OTEMKONGO J. Cours de Grands services publics, G3
SPA, FSSAP, UNIKI, 2001-2002, inédit.
5. PARSON, TALCOTT cité par ESSISO ASIA AMANI,
Méthode de recherche en Sciences Sociales, cours dispensé en G3,
SSPA, UNIKI, 2009-2010, inédit.
ANNEXE
Questionnaire d'enquête
Chers cadres de commandement, collaboration ainsi que
d'exécution, de la SNEL/Kindu, nous sommes finaliste du second cycle de
la faculté de Sciences Sociales, Administratives et Politiques de
l'Université de Kindu.
Nous voici alors auprès de vous, pour avoir certaines
informations pouvant nous permettre à bien rédiger notre travail
intitulé «Transformation des entreprises publiques en
société commerciales vue par le personnel : cas de la
SNEL/Kindu de 2009 à 2011».
I. CONSIGNES
1. Déterminez votre grade et votre fonction ;
2. N'écrivez pas votre nom ;
3. A la sixième question, répondez par oui ou
non tout en justifiant votre réponse par assertion ;
4. Répondez aux papiers qui sont à l'annexe.
II. QUESTIONS
1. Quels sont les avantages du passage d'une entreprise
publique en société commerciale ?
2. Quelles sont les missions d'une société
commerciale ?
3. Quels sont les objectifs poursuivis par une
société commerciale ?
4. Par rapport à la performance : y a-t-il
l'amélioration de :
a. Salaire?
b. Les recettes ?
c. Fourniture de la quantité du courant sur toute
l'étendue de la ville de Kindu ?
5. Quelle serait votre opinion vis-à-vis de cette
transformation ?
6. Avez-vous d'autres informations ou éléments
relatifs à cette transformation ?
Lesquelles ?
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHIE..........................................................................................................I
DEDICACE..............................................................................................................II
REMERCIEMENT.....................................................................................................III
SIGLES ET
ABREVIATIONS..........................................................................................V
INTRODUCTION
1
01. Etat de la question
3
02. Problématique
3
02. Hypothèses et objectifs du
travail
3
04. Méthodologie
3
4.1 Méthode
3
4.2 Techniques
3
05. Subdivision du Travail
3
CHAPITRE PREMIER : CADRE THEORIQUE ET CADRE
CONCEPTUEL
3
Section première : Cadre Conceptuel
3
I.1 La transformation
3
I.2. Entreprise publique
3
I.3. Personnel
3
I.4. La société nationale
d'électricité en sigle la S.N.EL
3
I.5 Ville
3
Section deuxième : Cadre
théorique de l'entreprise publique et de la
3
Société commerciale
3
I.2.1. Entreprise Publique
3
I.2.2 Entreprise publique à gestion
privée
3
Section troisième : La description du
milieu d'étude : la SNEL/Kindu
3
I.3.1 Historique de la SNEL
3
I.3.2 Historique de la S.N.EL Kindu
3
I.3.3 Mission de la S.N.EL
3
I.3.4 Statut Juridique
3
I.3.5 Situation Géographique
3
I.3.6 ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT
3
CONCLUSION PARTIELLE
3
CHAPITRE DEUXIEME : LA PROBLEMATIQUE SUR LA
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE NATIONALE DE L'ELECTRICITE
3
A LA SOCIETE COMMERCIALE
3
II.1. Rappel sur le désengagement de l'Etat
des entreprises du
Portefeuille
3
§1. Conditions et modalités du
désengagement
3
§2. Exécution et procédure du
désengagement
3
II.2 La vague de transformation des entreprises
publiques
3
§1. Transformation des entreprises publiques
en société commerciales
3
II.2.1 La loi portant sur la transformation des
entreprises Publiques en
3
CONCLUSION PARTIELLE
3
CHAPITRE TROISIEME : OPINIONS DU PERSONNEL DE
LA SNEL SUR LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES EN SOCIETES
3
COMMERCIALES
3
III. 1. Perception des opinions du personnel
au sujet de la
Transformation de la S.N.EL à la
société commerciale
3
III.1.1. Opinions positives (favorables)
3
TABLEAU N°1 Opinions positives des nos
enquêtés sur la transformation de la S.N.EL à la
Société
Commerciale.
3
III.I.2. Opinions négatives
(défavorables)
3
TABLEAU No 2 Opinions Négatives
(Défavorables)
3
CONCLUSION GENERALE
3
BIBLIOGRAPHIE
3
TABLE DES MATIERES
3
* 1 Joseph MUNONDJO
N. Des enjeux politiques et Administratifs de la privatisation des
entreprises publiques en
R. D.
Congo, Mémoire, L2 SSPA, UNIKI, 2010-2011, Inédit.
* 2 PLANE.
P, (1994), «Les privatisations dans les pays en voie de
développement : qu'avons-nous appris?» in revue
Française
d'économie, Vol. IX, 2 Paris.
* 3 MWINYIMALI
M, Etude de la contribution de l'OCC/Kindu au trésor
public, T.F.C, G3 S.E.G. UNIKI, inédit.
* 4 Charles MUDIMBI,
K. L'impact de la non application des mesures de la mise à
la retraite des agents
pensionnables
sur le rendement de la SNCC/Kindu, Mémoire, L2 SSPA, UNIKI,
2010-2011,
inédit.
* 5 NYEMBO.
E, Analyse critique et suggestive de la gestion de la
SNCC/Kindu, Mémoire, L2, Droit, UNIKI, 2008-2009,
Inédit.
* 6 TALCOT PARSON,
cité par ESSISSO ASIA AMANI, Méthode de recherche en sciences
sociales, cours dispensé en G3, SSPA, UNIKI, 2009-2010, page 83,
inédit.
* 7 Dictionnaire Bordas,
Paris 1998, Montréal, page 1208.
* 8 KARL MARX, Manifeste du
parti communiste, Une revue de sciences humaines, Lubumbashi, P.U.Z,
1974,
page 129.
* 9 ETIENNE ;
dictionnaire de sociologie, Ed. Hatier, Paris 1997.
* 10 M. KINZONZI et C.
PEROCHON, Manuel de comptabilité générale, Ed. Fourcher,
Paris, 1992.
* 11 Robert Cabanes et Bruno
Lautier, Profils d'entreprises publiques au sud, Ed. Karthala, Paris, 1996,
P68.
* 12 Journal Officiel de la
République du Zaïre, 32 années, No 15 du 01
Août 1981.
* 13 Rapport annuel de la
SNEL Kindu en 2011.
* 14 MAX WEBER cité
par MALIKIDOGO. S, Cours d'Administration des villes, L1 SA, UNIKI, FSSAP,
2008, Inédit.
* 15 CHOMA NYEMBO, Cours
d'Aménagement du territoire approfondit, L2 SA, UNIKI, FSSAP, 2009,
inédit.
* 16 A, JOURNAUX,
cité par CHOMA N, Op.cit.
* 17 J.O, Loi No
08/16 du 07 Octobre 2008.
* 18 OTEMKONGO MANDEFU. J,
Cours des Grands services publics, G3 SPA, FSSAP, 2001-2002, inédit.
* 19 Journal Officiel de la
R.D.Congo, 48ieme année, numéro fiscal du 24 Avril
2009.
* 20 Le manuel de la S.N.EL,
exercice 2011.
* 21 Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo, 48ième
année numéro spécial du 24 Avril 2009.
* 22 Terry. R, et STEPHEN J,
Les principes du Management Economique, Paris, 1985, P.4.
* 23 GOURNEY, BERNARD,
Introduction à la Science Administrative, Paris, Armond Colin, 1966, p.
191.
* 24 Robert PAPIN,
stratégies pour la création d'entreprises, Ed. Dunod, Paris,
2007, P. 208.
* 25 Jacques DEFRAINE et
Chantal DELVAUX, Le management de l'incertitude, Ed. De B oeck.
Bruxelles, 1990, P.
68.
| 


