|
REPUBLIQUE DU BENIN
************
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
***********
GROUPE BK UNIVERSITE CHAMBRE ECONOMIQUE
EUROPENNE
Institut International de Management
Fondation Universitaire Mercure
Cotonou-Bénin
Bruxelles Belgique

**********
Mémoire de Master in Business Administration
(MBA)
Option : Gestion des
Projets
Superviseurs :
Présenté par :
Directeur de mémoire : Hamissou AFFO
DAOUDOU Essodina NDAYAKE
Enseignant-chercheur à l'IIM
Directeur de stage : Dr Edgard LAFIA,
Médecin biologiste,
Coordonnateur National du PASTAM.
Promotion: 2011-2012

AVERTISSEMENT
1. Tous droits réservés à
l'auteur contre le copyright et le plagiat.
2. Le Groupe BK-Université et ses institutions
n'entendent donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans ce mémoire. Ces opinions doivent être
considérées comme propres à leur auteur.
I
DEDICACE
Je dédie ce mémoire :
- A l'Eternel Dieu le père
créateur du ciel et de la terre, sur qui nous comptons
- En mémoire de mon très cher et regretté
feu père Kodjoda NDAYAKE, homme brave pour qui je
porte une très grande affection
- A ma très chère et bien-aimée
mère : Patawèbou KATAWI, qui a
bravé vents, pluies, soleils, et accepté beaucoup de privations,
afin que je reçoive une bonne éducation, qui m'a enseigné
l'amour du travail et le savoir-être, et qui demeure pour moi un exemple
à suivre. Ce travail est le fruit de tes efforts
- A ma très chère épouse
Pélagie OUASSA et à nos trois enfants
Jean-Paul, Marinella et Loane-Marie, vous qui m'avez toujours
accompagné de vos prières et de vos bonnes intentions. Que Dieu
nous garde toujours unis.
II
REMERCIEMENTS
Sincères remerciements :
- A notre directeur de mémoire, Monsieur AFFO DAOUDOU
Hamissou pour sa constante disponibilité.
- Au Docteur LAFIA Edgard (Directeur de stage, Coordonnateur
National du PASTAM) pour m'avoir fourni tous les documents et informations
utiles et recommandé au cours de mes recherches.
- Au groupe BK-UNIVERSITE et à toutes ses institutions
partenaires.
- A tous les professeurs de Gestion de Projet qui n'ont
ménagé aucun effort pour partager avec nous leur savoir
- Aux Frères Boniface SAMBIENI et Fiorenzo PRIULI de
l'Hôpital saint Jean de Dieu de Tanguiéta qui m'ont
spontanément autorisé à poursuivre cette formation de
master en gestion des projets.
- A tous les collègues et responsables des services de
la transfusion de l'Atacora de la Donga et de l'Hôpital Saint Jean de
Dieu de Tanguiéta.
- Au personnel de l'administration de l'IIM de Cotonou pour sa
disponibilité et son assistance renouvelées.
A TOUS CEUX QUI DE PRES OU DE LOIN ONT CONTRIBUE
A LA REALISATION DE CE TRAVAIL, NOUS DISONS INFINEMENT MERCI.
III
HOMMAGES
AU PRESIDENT DU JURY,
Vous nous faites un grand honneur en acceptant de
présider le jury de notre soutenance de mémoire de fin de
formation.
Soyez persuadé que vos conseils serviront à
améliorer ce travail. Veuillez accepter l'expression de notre profond
respect et de notre éternelle gratitude.
AUX ILLUSTRES MEMBRES DU JURY,
C'est un grand honneur pour nous que notre travail soit
jugé par vous.
Veuillez recevoir le témoignage de notre reconnaissance
pour votre contribution à la perfection de ce travail.
IV
LISTE DES SIGLES ET
ABREVIATIONS
|
ACDI
|
Agence Canadienne de Développement intellectuel
|
|
AIMS
|
Appui Institutionnel au Ministère de la Santé
|
|
ANAES
|
Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en
Santé
|
|
ANTS
|
Agence Nationale de la Transfusion Sanguine
|
|
BS
|
Banque de Sang
|
|
CDTS
|
Commissions Départementales de la Transfusion Sanguine
|
|
CENAGREF
|
Centre National de Gestion des Réserves de Faune
|
|
CNHU- HKM
|
Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou
Maga
|
|
CNTS
|
Centre National de Transfusion Sanguine
|
|
CTMS
|
Comité Technique Médico-social
|
|
DDS
|
Direction Départementale de la Santé
|
|
DEDTS
|
Direction des Explorations Diagnostiques et de la Transfusion
Sanguine
|
|
EEZS
|
Equipe d'Encadrement de la Zone Sanitaire
|
|
ELISA
|
Enzyme linked Immuno-Sorbent Assay
|
|
HCV
|
Hépatite C Virale
|
|
HSJD
|
Hôpital Saint Jean de Dieu
|
|
HZ
|
Hôpital de Zone
|
|
IIM
|
Institut International de Management
|
|
MS
|
Ministère de la Santé
|
|
MSP
|
Ministère de la Santé Publique
|
|
OCDE
|
Organisation de Coopération et de Développement
Economique
|
|
OMD
|
Objectif du Millénaire pour le Développement
|
V
OMS
|
Organisation Mondiale de la Santé
|
|
ONG
|
Organisation Non Gouvernementale
|
|
ONUSIDA
|
Programme Commun des Nations Unies sur le SIDA
|
|
PARZS
|
Projet d'Appui au Renforcement des Zones Sanitaires
|
|
PASS
|
Programme sectoriel de santé
|
|
PASTAM
|
Projet d'Appui à la Sécurité
Transfusionnelle dans l'Atacora Donga et le Mono Couffo
|
|
PNDS
|
Plan National de Développement Sanitaire
|
|
PNUD
|
Programme des Nations Unies pour le Développement
|
|
PSL
|
Produits Sanguins labiles
|
|
PTS
|
Poste de Transfusion Sanguine
|
|
QBD
|
Qualification Biologique des Dons
|
|
SIDA
|
Syndrome de l'immunodéficience humaine Acquise
|
|
SNTS
|
Service National de la Transfusion Sanguine
|
|
SPSS
|
Statistical Package of Social Science
|
|
STS
|
Service de transfusion Sanguine
|
|
TPHA
|
Tréponème pallidum Hémagglutination Assay
|
|
VIH
|
Virus de l'immunodéficience humaine
|
|
ZS
|
Zone Sanitaire
|
|
ZST
|
Zone Sanitaire Tanguiéta
|
|
SPIRS
|
Service de la Planification de l'Informatique et de la Recherche
en Santé
|
SOMMAIRE
|
Résumé
|
P.VII
|
|
Abstract
|
P.X
|
|
Introduction
|
P.1
|
|
Chapitre I : Cadre général de
l'étude
|
P.4
|
|
Section 1 : Contexte et problématique de la recherche
|
P.5
|
|
Section 2: Objectifs et hypothèses de recherche
|
P.9
|
|
Chapitre II: Approche théorique de la
recherche
|
P.11
|
|
Section 1: Clarification conceptuelle des mots clés.
|
P.11
|
|
Section 2: Revue de la littérature
|
P.28
|
|
Section 3 : Organisation du sous système de la
transfusion sanguine et présentation de PASTAM
|
P. 29
|
|
CHAPITRE III : Approche méthodologique de la
recherche
|
P. 35
|
|
Section 1 : Du cadre méthodologique à la
collecte des données
|
P.35
|
|
Section 2 : Variables d'analyses et seuil de
décision
|
P.44
|
|
CHAPITRE V : Appréciation de l'impact de
PASTAM sur la sécurité transfusionnelle
|
P.49
|
|
Section 1 : Présentation et analyse des
résultats
|
P.49
|
|
Section 2: Interprétation et vérification des
hypothèses
|
P.52
|
|
Section 3 : Observation et suggestion
|
P. 54
|
|
CONCLUSION
|
P. 57
|
|
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
|
P. 59
|
|
ANNEXES
|
P.65
|
VII
LISTE DES TABLEAUX
|
PAGE
|
|
Tableau 1 : Cadre de
référence pour le monitoring et l'évaluation des projets
et programmes de santé
|
P. 21
|
|
Tableau 2: Zone d'intervention de
PASTAM
|
P. 32
|
|
Tableau 3: Technique
d'échantillonnage et taille d'échantillon
|
P. 41
|
|
Tableau 4: Techniques et outils de
collectes avec leur cible respective
|
P. 42
|
|
Tableau 5: Synthèse des
variables et indicateurs par hypothèse de recherche
|
P. 45
|
|
Tableau 6 : Répartition des
données selon la sélection des donneurs
|
P. 49
|
|
Tableau 7: Répartition des
données selon la conformité de la Qualification Biologique des
Dons.
|
P. 50
|
|
Tableau 8: Mobilisation des donneurs
pour le don bénévole de sang
|
P. 50
|
|
Tableau 9 : Répartition des
données sur l'organisation interne du poste de transfusion sanguine
|
P.51
|
|
Tableau 10: Répartition des
données sur la conservation et la mise en pratique des normes et
procédures par service
|
P. 52
|
|
Tableau 11: Récapitulation des
scores de la variable « Amélioration de la
sécurité transfusionnelle
|
P. 53
|
LISTE DES FIGURES
|
PAGE
|
|
Figure 1: Modèle
d'évaluation d'impact santé selon Andem
|
P. 18
|
|
Figure 2: Modèle
d'évaluation d'impact projet santé selon Lehto et Ritsatakis
|
P. 19
|
|
Figure 3 : Modèle
d'évaluation de PASTAM
|
P. 23
|
VIII
RESUME
En 2000, plusieurs pays en voie de développement dont
le Bénin ont pris l'engagement de contribuer à la
réalisation des objectifs du millénaire pour le
développement. Pour y parvenir le gouvernement béninois a
initié plusieurs programmes et projets dont le projet d'appui à
la sécurité transfusionnelle dans les départements de
l'Atacora-Donga et du Mono-Couffo (PASTAM) grâce à l'appui
technique et financier de l'agence belge au développement. Aucune
étude d'impact sanitaire à Tanguiéta n'a été
faite après la fin de ce projet. Trois années après sa
clôture, une évaluation de ce projet dans la zone sanitaire
Tanguiéta, Matéri, Cobly, nous a semblé
nécessaire.
La présente étude, de type transversale,
descriptive et évaluative concernant les interventions du PASTAM entre
mai 2006 et Août 2009 vise à évaluer l'impact de ce
projet en termes d'amélioration de la sécurité
transfusionnelle et de la pérennisation des acquis trois années
après la clôture du projet.
Nous avons collecté les données d'une
part dans le service de la transfusion sanguine et dans les différents
pavillons de l'hôpital de zone de Tanguiéta et d'autre part au
moyen des entretiens et interviews avec les acteurs et surtout par
administration d'un questionnaire aux donneurs bénévoles de sang.
A l'issue de cette étude les résultats
ont montré que PASTAM a contribué au renforcement des
capacités organisationnelles du service de la transfusion sanguine et
les capacités techniques, individuelles des acteurs de l'hôpital
de zone de Tanguiéta.
La sécurité transfusionnelle est plus
améliorée à l'hôpital de zone de Tanguiéta
trois années après sa clôture. Le nombre de candidats aux
dons ayant subi l'ensemble des étapes de présélection
correspondant à l'ensemble des items définis par le service de la
transfusion sanguine passe de 75,44% avant le projet à 99,85 % trois
années depuis la clôture du projet. 93,33 % des
enquêtés ont eu une proposition systématique du don de sang
au cours de leur visite à l'hôpital de zone de Tanguiéta.
94,74 % des bénéficiaires trouvent que l'organisation interne de
la transfusion est plus renforcée grâce à l'intervention de
ce projet. 92,98 % des acteurs interrogés mettent en pratique les normes
et procédures applicables à la transfusion sanguine.
Mots clés :
Evaluation, Impact, PASTAM, Hôpital de zone de Tanguiéta
IX
ABSTRACT
Since 2000, several emerging countries including Benin made a
commitment to contribute to the achievement of the Millennium Development
Goals. To achieve the Beninese government has initiated several programs and
projects that support project for blood safety in Atacora-Donga and Mono-Couffo
(PASTAM) with technical and financial support from the Belgian development
agency. No health impact study has been made after the end of the project.
Three years after its completion, an evaluation of the project in the health
area Tanguiéta Matéri, Cobly we seemed necessary.
This study was cross-descriptive and evaluative on interventions PASTAM between
May 2006 and August 2009, aims to assess the impact of this project in terms of
improving blood safety and sustainability of acquired three years after project
closure.
We collected data on the one hand in the blood transfusion
service and the various pavilions of the hospital area Tanguiéta and
secondly through interviews and interviews with actors and especially
administration a questionnaire volunteer blood donors. Following this study,
the results showed that PASTAM contributed to the organizational capacity of
the blood transfusion service and technology, individual capacities of actors
of the hospital area Tanguiéta. The blood safety is improved in the
hospital area Tanguiéta three years after its completion. This is due to
the sustainability of the achievements and strengthening the internal
organization of the service station blood. The number of candidates for
donations has undergone all stages of screening corresponding to all items
defined by the department of blood transfusion increased from 75.44% before the
project to 99.85% for three years project closure. 93.33% of respondents had a
routine offer of blood donation during their visit to the hospital area
Tanguiéta. 94.74% of the beneficiaries are the internal organization of
the transfusion is enhanced thanks to the intervention of this project, 92.98%
of people interviewed put it into practice and standards applicable to blood
transfusion procedures.
Keywords: Evaluation, Impact,
PASTAM, Tanguiéta's Hospital
X
INTRODUCTION
La question de la santé a toujours été
une préoccupation pertinente pour les acteurs de développement
tant au niveau national qu'international (ANAES 2007). L'un des droits
fondamentaux de tout être humain est le droit à la santé et
le ministère de la Santé a pour tâche de garantir la
santé pour tous les citoyens Béninois (Constitution du 11
décembre 1990).
Aujourd'hui encore la question de l'amélioration de
l'état de santé des populations constitue plus que jamais une
préoccupation majeure et une priorité.
Le développement de la santé apparaît
comme un processus visant l'amélioration, le bien-être physique,
mental et social de l'individu dans la famille et dans la communauté,
afin qu'il soit capable de relever les défis socio-économiques et
politiques qui l'interpellent (OMS, 2005). Loin d'être uniquement
l'affaire des professionnels, la santé des populations préoccupe
les acteurs à tous les niveaux à savoir: gouvernants,
sociétés civiles, institutions internationales. Cette
mobilisation, visant à assurer une meilleure santé aux
populations, pour être efficace, est définie à travers une
politique appropriée. Laquelle politique élaborée, mise en
oeuvre et suivie par les pouvoirs publics notamment le Ministère de la
Santé s'appuie sur la pleine participation des partenaires techniques au
développement et celle de la société civile.
Au Bénin dans le souci d'améliorer l'état
de santé de la population, le gouvernement avec l'appui technique et
financier de l'Agence belge au développement a élaboré et
exécuté plusieurs projets et programmes intégrés de
santé. Parmi ceux-ci, le Projet d'Amélioration de la
Sécurité Transfusionnelle dans les départements de
l'Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo (PASTAM), dont l'objectif global
est d'améliorer la sécurité transfusionnelle pour les
populations du Bénin a été exécuté entre Mai
2006 et Août 2009.
A cet effet, plusieurs réalisations ont
été faites dans les différents postes de transfusion
sanguine (PTS) et de banque de sang (BS) couverts par la zone d'intervention
du projet.
Mais à ce jour aucune évaluation d'impact n'a
encore été faite à l'hôpital de zone de
Tanguiéta pour faire le bilan des acquis de ce projet, d'évaluer
son impact et de vérifier l'effectivité de la
pérennisation de ces acquis trois années après la fin de
son intervention. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent
mémoire intitulé : « Evaluation de l'impact du
projet d'appui à la sécurité transfusionnelle
à l'Hôpital de zone de Tanguiéta »
Le présent mémoire est structuré en deux
parties et subdivisé en quatre chapitres.
Dans la première partie, intitulée
« cadre général et théorique », le
chapitre 1 présente le contexte de la recherche et la
problématique. L'objet de la recherche y est décrit, la
problématique formulée ainsi que les objectifs et les
hypothèses de travail. Cette partie fournit les repères
théoriques nécessaires à la compréhension du
développement opéré, il établit les balises
nécessaires à une bonne appréciation du chapitre suivant.
Dans le second chapitre, le cadre conceptuel est
exposé. Les concepts clés de la recherche sont clarifiés.
PASTAM est présenté et la revue de la littérature est
décrite. Ce chapitre informe le lecteur sur les enjeux essentiels du
projet, les objectifs qu'il a poursuivis et sur les éléments
à prendre en compte dans l'évaluation de l'impact de PASTAM.
Enfin, dans la deuxième partie nous
aborderons :
Au troisième chapitre l'approche méthodologique
de la recherche : la présentation du cadre de l'étude, la
méthodologie, l'échantillonnage, les indicateurs, la collecte
des données et les techniques d'analyse des données.
Dans le quatrième et dernier chapitre, nous
présenterons l'analyse des résultats de recherche, celle de
l'impact du projet. Cela permettra de savoir dans quelle mesure PASTAM a
contribué à l'amélioration de la sécurité
transfusionnelle et de faire des observations et des suggestions.
PREMIERE PARTIE
CADRE GENERAL ET THEORIQUE DE L'ETUDE
CHAPITRE I : CADRE GENERAL DE L'ETUDE
Ce chapitre présente le contexte, la
problématique, les objectifs et les hypothèses.
SECTION 1 : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE LA
RECHERCHE.
Cette section évoque le contexte professionnel dans
lequel la recherche a pris source, décrit la situation qui a
suscité la réflexion scientifique et formule la
problématique appuyée de son cadre d'analyse.
Paragraphe 1: Cadre contextuel
de la recherche.
Le présent travail de recherche s'inscrit dans le cadre
de la présentation du mémoire de fin de formation pour
l'obtention du diplôme de Master en Gestion des Projets. La
formation est assurée par l'Institut International de Management
(I.I.M), une filiale du Groupe BK-Université basé à
Lomé (Togo) et reconnu par la Chambre Economique Européenne sise
à Bruxelles (Belgique).
Le stage pour la réalisation de ce mémoire est
une exigence de la formation pour l'obtention du Master en gestion de projet.
L'hôpital de zone de Tanguiéta est le cadre institutionnel de la
recherche.
Dans ce cadre, nous avons suivi la mise oeuvre des
activités liés au projet PASTAM arrivé à terme
depuis trois années environ. Celle-ci porte spécifiquement sur
l'unité de la transfusion sanguine du PTS de l'hôpital de zone
qu'il convient de faire connaître.
L'objectif de ce stage professionnel est d'évaluer
l'impact de ce projet et d'analyser les résultats opérationnels
obtenus pour le compte de ce projet à l'identification de nouvelles
stratégies pour la pérennisation de ces acquis trois
années après sa clôture.
Cette évaluation servira de base et offrira les balises
nécessaires à d'autres partenaires qui pourront appuyer le
système transfusionnel de cet hôpital afin de participer à
l'atteinte des objectifs du millénaire.
Paragraphe 2: Problématique de la recherche
Les anémies palustres constituent l'une des principales
causes de la mortalité infantile dans les pays sous
développés après les infections respiratoires aigües.
En 2000, plusieurs pays en voie de développement dont le Bénin
ont pris l'engagement de contribuer à la réalisation des
objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Trois des
ces huit objectifs, ont été consacrés à la
santé. La réduction de la mortalité infantile (OMD 4),
l'amélioration de la santé maternelle (OMD 5), la lutte contre
le VIH, le paludisme, la tuberculose et les autres maladies (OMD 6). Pour
atteindre ces Objectifs, le Bénin a doté son Ministère de
la Santé d'un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS
2009-2018). La mission du Ministère de la Santé a
évolué avec cette prise en compte des objectifs du
millénaire pour le développement. Désormais, elle consiste
à « améliorer les conditions socio sanitaires des familles
sur la base d'un système intégrant les populations pauvres et
indigentes ». Parmi les axes stratégiques retenus par le
Ministère pour atteindre ces objectifs, figurent l'amélioration
de la qualité des soins et le renforcement du sous-secteur de la
transfusion sanguine par
(i) la décentralisation des actions
d'amélioration de la sécurité transfusionnelle,
(ii) l'approvisionnement régulier des structures de
transfusion sanguine en réactifs et consommables et
(iii) la formation du personnel sur les risques
transfusionnels (Plan directeur ANTS 2008-2012). A ce titre, l'Agence belge de
développement s'est engagée dans le secteur de la santé
au Bénin en initiant le projet d'amélioration et de
sécurisation de la transfusion sanguine dans les départements de
l'Atacora-Donga et du Mono-Couffo (Projet PASTAM). Ce projet vise
l'amélioration de l'état de santé de la population
béninoise par la réduction de la mortalité des enfants de
moins de cinq ans et de celle des femmes enceintes en rendant disponibles les
produits sanguins en qualité et en quantité suffisantes dans les
zones d'intervention.
En effet, le sous secteur de la transfusion sanguine dans ces
quatre départements est confronté à de nombreuses
difficultés. Au nombre de ces dernières, on peut citer une
insuffisance de financement, des ruptures périodiques de stocks de
produits sanguins, de réactifs et de consommables médicaux, une
insuffisance du plateau technique due au caractère réduit des
équipements adéquats et à un déficit de
maintenance. Aussi, les activités de promotion du don et de collectes
mobiles de sang ne sont-elles pas réellement effectives dans les
départements faute de moyens matériels, financiers et
logistiques.
Or, la pénurie de sang observée relève
de plusieurs facteurs dont les plus importants sont entre autres l'insuffisance
des donneurs de sang et de réactifs pour la qualification du sang, ainsi
que le manque d'équipements nécessaires pour le fractionnement
des produits dérivés du sang entrainant l'utilisation peu
rationnelle du sang (transfusion du sang total, prescriptions abusives...)
Pour pallier la pénurie de sang, l'OMS recommande aux
pays, d'atteindre un taux de 2% de la population pour satisfaire les besoins en
matière de produits sanguins, d'allouer un budget substantiel à
la santé et de former tout le personnel intervenant dans la chaîne
transfusionnelle (OMS, 2005).
En 2005, ce taux était de 0,47% pour les
départements de l'Atacora/Donga et de 0,35% pour celui du Mono/
Couffo, bien loin des recommandations de l'OMS contre 2,87 % dans l'ensemble
des pays du Maghreb. (PASTAM 2005).
Avec l'appui de l'agence belge de développement le
Ministère de la santé a bénéficié de l'appui
du projet d'amélioration de la sécurité transfusionnelle
dans les départements de l'Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo en
abrégé PASTAM. Ce projet qui a duré trois ans a pris fin
en Août 2009. Depuis lors, aucune évaluation d'impact du projet
n'a eu lieu.
Le présent mémoire fait l'inventaire des
résultats de ce projet en termes d'effets induits du point de vue
amélioration de la qualité de la transfusion sanguine et par voie
de conséquence l'amélioration des soins et réduction de
la mortalité dans les zones d'intervention et particulièrement
à l'Hôpital de zone de Tanguiéta.
Le projet a été mis en oeuvre selon les
principes de la cogestion avec l'agence nationale de la transfusion sanguine et
le ministère de la santé d'une part et l'Agence Belge de
développement d'autre part qui, en mettant en scène les
bénéficiaires eux-mêmes, vise le renforcement des
capacités techniques et organisationnelles des acteurs à la base,
afin qu'ils puissent assurer la pérennisation des acquis une fois
l'intervention achevée.
Trois années après la fin du projet une
évaluation d'impact sur la sécurité transfusionnelle
semble nécessaire.
D'où la question centrale de la
recherche : PASTAM a-t-il eu un impact sur la
sécurité transfusionnelle à l'hôpital de zone de
Tanguiéta ?
Cette principale interrogation nous amène à
poser les questions spécifiques suivantes :
La qualité de la transfusion sanguine est-elle
améliorée à toutes les étapes du
processus avec l'intervention du projet?
PASTAM a-t-il favorisé l'amélioration de
l'organisation interne du poste de transfusion sanguine de
l'Hôpital ?
Les techniques de la sécurité transfusionnelle
sont elles conservées trois années après la clôture
de PASTAM ?
SECTION 2 : OBJECTIFS
ET HYPOTHESES DE RECHERCHE.
En vue d'apporter des réponses à ces questions
précédentes, nous nous sommes fixés des objectifs.
Paragraphe 1: Objectifs de recherche
A.
Objectif
général :
L'objectif général de cette présente
recherche est d'évaluer l'impact de PASTAM sur la sécurité
transfusionnelle à l'hôpital de zone de Tanguiéta
Spécifiquement, il s'agit :
- D'évaluer l'amélioration du système de
sécurisation des produits sanguins à toutes les étapes du
processus.
- D'évaluer le renforcement de l'organisation interne
des services de Transfusion Sanguine (TS) au niveau du Poste de Transfusion
Sanguine (PTS) de Tanguiéta.
- D'analyser l'appropriation et la pérennité
des acquis de PASTAM en termes de techniques de sécurisation des
produits trois années après sa clôture.
Paragraphe 2: Hypothèses de recherche
Afin d'atteindre les objectifs de recherche, les
hypothèses suivantes ont été formulées:
Hypothèse 1 : Le
système de sécurisation des produits sanguins est
amélioré dans toutes les étapes de son processus avec
l'intervention de PASTAM.
Hypothèse 2:
L'intervention de PASTAM a favorisé le renforcement de l'organisation
interne du poste de transfusion sanguine (PTS) de l'Hôpital de zone de
Tanguiéta
Hypothèse 3: Les
acteurs de la transfusion sanguine de l'hôpital de Zone de
Tanguiéta ont continué à mettre en pratique les techniques
proposées par PASTAM malgré la fin du projet.
La vérification de ces trois hypothèses nous
permettra d'évaluer l'impact du projet en termes d'amélioration
de la sécurisation des produits sanguins et de la réduction de la
mortalité maternelle et infantile dues à la pénurie de ces
produits dans l'une des zones de son intervention».
CHAPITRE II : APPROCHE THEORIQUE DE L'ETUDE
Ce chapitre présente la clarification des concepts de
l'étude et la revue de la littérature
SECTION 1 : CLARIFICATION
CONCEPTUELLES DES MOTS CLES
Cette section décrit la clarification des concepts
liés à l'évaluation d'impact et à la
sécurité transfusionnelle.
PARAGRAPHE1 : Approche conceptuelle de
l'évaluation d'impact de projet
Pour mieux appréhender le thème il
s'avère nécessaire de délimiter le cadre conceptuel de
notre recherche. Ceci suppose la définition de façon
opérationnelle des concepts utilisés tout au long de cette
recherche. Il s'agit essentiellement de :
A-Evaluation
La définition de l'évaluation est un exercice
complexe, car fonction de perceptions subjectives et donc discutables. Il n'y'a
pas de définition unique et reconnue par tous les acteurs.
Selon le PNUD (1997), l'évaluation est un exercice de
durée limitée qui vise à apprécier
systématiquement et objectivement la pertinence, la performance et le
succès des programmes et projets en cours ou achevés.
Pour AFFO (2012) « L'évaluation est un
processus qui consiste à analyser et porter un jugement de valeur sur
une action, un programme, un processus de décision... en utilisant,
autant que possible, les bases objectives (grâce à un suivi
régulier des faits consignés et des rapports et documents
disponibles) et un processus impliquant les acteurs. »
En somme, l'évaluation est donc une mesure d'un
système à une période déterminée, et
à l'aide des critères déterminés.
Ø La finalité de
l'évaluation
Suivant la finalité de l'évaluation on distingue
deux types :
L'évaluation formative vise à améliorer
le fonctionnement d'un projet, d'un programme ou d'une politique existante.
Elle est effectuée durant la mise en oeuvre du projet et correspond
à l'évaluation en cours ou à mi-parcours. Cette
évaluation associe acteurs et opérateurs, qui vont se former
durant l'évaluation pour ensuite réorienter le cours du projet si
nécessaire. Cependant, cette évaluation peut être
réalisée aussi bien par l'équipe de suivi
évaluation interne au projet que par une équipe
d'évaluation externe. Lorsque l'évaluation est mise en oeuvre par
l'équipe de suivi évaluation interne au projet, les conclusions
de l'étude courent le risque de ne pas avoir un point de vue neutre ou
d'être influencées par la direction du projet, ce qui pourrait
biaiser la prise de décision (AZONDEKON, 2012). Ce type
d'évaluation reste limité, car il ne permet pas d'avoir une
lisibilité claire des résultats et de l'impact du projet. (Banque
Mondiale, 2002)
L'évaluation sommative vient couvrir les limites
observées dans l'évaluation formative. En effet, elle est
effectuée pour évaluer les résultats des projets et
programmes, ainsi que les effets générés. Ceci
étant, elle est réalisée juste après, ou alors bien
après la fin du projet. Dans le dernier cas, il s'agira de mesurer
l'impact du projet sur les populations bénéficiaires.
Pour une bonne conduite des projets de développement,
les évaluations formatives et sommatives restent
complémentaires
Ø Le moment de l'évaluation par rapport
au cycle de projet
Par rapport au moment de l'évaluation on
distingue :
- l'évaluation ex-ante ou évaluation
préalable pour analyser les rapports d'identification et de formulation
des projets ;
- l'évaluation pendant l'exécution du projet ou
l'évaluation continue ;
- l'évaluation à mis-parcours ou
l'évaluation qui se réalise au beau milieu de l'exécution
du projet.
- l'évaluation à la fin du projet ou
évaluation finale;
- l'évaluation après le projet ou
l'évaluation ex-post.
La présente étude constitue une évaluation
ex-post du projet PASTAM.
B- Impact
L'impact se définit selon le glossaire de l'OCDE comme
« effets à long terme, positifs et négatifs, primaires
et secondaires, induits par une action de développement, directement ou
indirectement, intentionnellement ou non ».
Par ailleurs, l'ACDI (2002) considère l'impact comme
« conséquence ou effet à long terme plus
général et plus important lié à
l'objectif ». L'impact constitue des retombées
résultant de réalisations des activités des projets et
programmes.
C- Evaluation d'impact
Le concept d'évaluation d'impact des projets et
programmes dans la santé est un concept récemment apparu dans les
projets dans les pays noirs africains. La littérature est
particulièrement pauvre dans ce domaine et les rares documents pouvant
servir de supports scientifiques sont difficiles d'accès. Les ouvrages
les plus rencontrés dans ce champ d'action sont ceux
élaborés et mis à disposition des programmes nationaux par
les principaux partenaires techniques et financiers.
L'évaluation d'impact prend essentiellement en
considération les changements qui découlent d'un projet ou d'un
programme. Elle se fonde sur le niveau le plus élevé des
objectifs poursuivis, c'est-à-dire l'objectif global du projet. Elle
vise également à déterminer les changements intervenus
dans les conditions de vie des populations du fait de la mise en oeuvre d'un
projet ou d'un programme (ANAES, 2007).
En somme, l'impact du projet sera une appréciation des
changements ou les perturbations intervenues dans l'exécution des
activités dans son environnement. Il s'agit des effets induits aussi
bien positifs que négatifs sur le plan de la sécurisation des
produits sanguins et de l'amélioration des soins administrés aux
patients dans la zone d'intervention du projet.
Paragraphe 2 : Les différents concepts de la
sécurité transfusionnelle
A- La transfusion sanguine
La transfusion sanguine consiste à administrer le
sang ou l'un de ses composants (globules rouges, plaquettes, granulocytes,
plasma, protéines) provenant d'un ou plusieurs sujets sains
appelés « donneurs » vers un ou plusieurs sujets malades
appelés « receveurs » (Dictionnaire Larousse Médical).
Le fait que le sang d'un seul donneur puisse être utilisé pour
plusieurs malades tient à ce que, désormais les indications
réelles du sang total restent restreintes, le sang doit être
fractionné en ses composants qui sont alors utilisés
séparément (Dictionnaire permanent bioéthique)
Au sens large du terme, la sécurité
transfusionnelle sanguine regroupe les étapes suivantes (Norme OMS) :
- Recrutement de donneurs de sang,
- Conservation du sang selon les normes.
- Interrogatoire, Examen clinique
- Prélèvement de sang
- Conservation du sang
- Tests donneurs : Hémoglobine, groupage sanguin,
dépistage de HIV dépistage d'hépatite B et de
l'hépatite C et recherche des trypanosomes (Si zone très
endémique)
- Tests receveurs : groupage, test compatibilité
direct et indirect
- Transfusion.
B- Sécurité transfusionnelle
Par définition, la sécurité
transfusionnelle est l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour assurer la
disponibilité en quantité et en qualité des produits
sanguins et ses dérivés afin de répondre efficacement
à la demande.
La stratégie OMS pour la sécurité
transfusionnelle et la disponibilité des approvisionnements en sang
comporte cinq volets principaux:
· la mise en place de services de transfusion sanguine bien
organisés coordonnés au niveau national pour garantir la
disponibilité rapide de sang et de produits sanguins
sécurisés pour tous les patients ayant besoin d'une
transfusion;
· la collecte de sang auprès de donneurs de sang
volontaires non rémunérés appartenant aux populations
à faible risque;
· le dépistage avec assurance de la qualité
des infections à transmission transfusionnelle, la recherche des groupes
sanguins et les tests de compatibilité;
· l'utilisation sûre et appropriée du sang et
une réduction des transfusions superflues;
· des systèmes de qualité couvrant l'ensemble
du processus transfusionnel, du recrutement des donneurs au suivi des
transfusés.
DIARRA (2008) définit la sécurité
transfusionnelle comme l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour assurer une
surveillance immunologique des transfusés grâce à une
étroite collaboration entre le service transfuseur et le centre
chargé de la fourniture du sang compatible (recherche d'agglutinines et
test de compatibilité).
SECTION 2 : REVUE DE LA LITTERATURE
La revue de la littérature nous a amené à
nous intéresser aux travaux de recherches antérieures et à
la littérature générale sur les différents concepts
pertinents à notre sujet de recherche.
Dans cette section les différentes approches et les
modèles de l'évaluation, l'historique de la transfusion sanguine
et l'organisation de ce sous secteur au Bénin sont décrites.
PARAGRAPHE1 : Approches et modèles
d'évaluation
Pour mieux cerner notre travail nous distinguerons les
aspects suivants :
A- Les approches d'évaluation
Il existe trois approches d'évaluation à
savoir :
- les approches participatives, qui nécessitent la
participation et l'implication des acteurs (personnel du projet,
bénéficiaires, et les parties prenantes) ;
- les approches non participatives, qui sont dirigées
par des évaluateurs extérieurs à l'organisation, au
projet. Le but visé est d'avoir des renseignements objectifs sur les
réalisations et les impacts du projet ;
- les évaluations conjointes, qui peuvent être
menées par des personnes aussi bien extérieures au projet qu'une
équipe interne pleinement impliquée dans la gestion du projet.
Ces types d'évaluation permettent de rapprocher des renseignements issus
de l'évaluation par des acteurs internes au projet, et ceux issus de
l'évaluation par des acteurs externes ;
La présente étude se situe dans le cadre d'une
évaluation participative où toutes les parties prenantes ont
été impliquées dans l'évaluation.
B- Les modèles d'évaluation
Par définition, les modèles sont les moyens
utiles pour comprendre les liens entre un programme et ses réalisations
prévues. Des actions de développement sont en quelques sortes des
hypothèses. En faisant l'action A, un résultat X sera
provoqué. Ce lien de causalité entre les différentes
composantes d'un programme constitue ce qu'on appelle : le modèle
logique du programme. Une compréhension des relations entre composantes
peut permettre aux évaluateurs d'élaborer des stratégies
pour mesurer le niveau d'atteinte des effets voulus (HONFOGA, 2012).
Plusieurs modèles d'évaluation sont
proposés dans la littérature. ANDEM (1995) propose un model
d'évaluation basé sur la méthode déductive (figure
1). Il construit un ensemble organisé de questions appropriées
qui renvoient à autant de procédures indispensables à
finaliser. À travers cette méthode, la démarche
d'évaluation est décomposée en opérations
élémentaires d'évaluation puis recomposée en trois
grandes étapes essentielles (Avant, pendant et après le projet),
À chacune de ces étapes correspond un certain nombre de questions
auxquelles les évaluateurs se doivent de répondre.
Evaluation finale
Analyse préliminaire
(Évaluation a priori)
Situation Besoin Choix Faisabilité
Initiale attentes des
(modalité
thèmes
d'action)
Conception de l'action ou du programme de santé
publique
Objectif Moyens Ressources Intervenants
Conception du projet d'évaluation de
l'action
Après
L'action
Evaluation en cours 2
Evaluation en cours 3
Evaluation en cours 1
Avant
L'action
Pendant
L'action
Résultats intermédiaires
Cohérence Conditions de
Résultats
Des
différents déroulement
attendus
Eléments
de l'action
De l'action
Résultats terminaux
Conditions Efficacité
Efficience Effets de déroulement (indicateur
(Impact)
de l'action de résultat)
Source : Andem, 1995
Figure 1 : Modèle
d'évaluation d'impact santé selon Andem
Par ailleurs LEHTO et RITSATAKIS (1999) proposent un autre
schéma de processus d'évaluation d'impact sous forme d'un
document dénommé «Consensus de Göteborg». Ils
résument le document sous forme de schéma (figure 2).
Etude de l'impact santé, la
démarche
Valeurs, buts et objectifs
Politiques, programmes, projets
Demande de plus d'information S é l e
c t i o n Impact négligeable
en fonction d'opinions éclairées
et/ou de données probantes
et/ou de données probantes
Analyse de l'impact Santé Evaluation
approfondies
Evaluation rapide de l'impact santé
Analyse de l'impact Santé Large vue
d'ensemble
Modification de la politique du projet ou programme
opportun
Conclusions de l'étude / Rapport
Conclusions de l'étude Rapport
D
é
l
Conclusi i
m
i
t
a
t
i
o
n
Source: LEHTO J., RITSATAKIS A, 1999.
Figure 2 : Modèle d'évaluation
d'impact projet santé selon Lehto et Ritsatakis.
D'autres types de modèles sont également
utilisés par les évaluateurs tels que le modèle de
réalisation, présenté en termes d'intrants,
d'activités, d'extrants, de réalisations et d'impact.
La logique est que : des ressources sont investies dans un
programme ou projet afin de permettre l'exécution des activités
(Tableau 1 ci-dessous).
Les activités permettent la production ou la mise en
oeuvre des services ou produits appelés extrants qui contribuent
à provoquer des changements appelés impact. Tableau 1 (FALL et
al, 2005)
L'utilisation des modèles aide les évaluateurs
à réfléchir sur la manière de mesurer chaque
composante afin de déterminer son niveau de réussite.
Tableau1 - Cadre de référence
pour le monitoring et l'évaluation des projets et programmes de
santé.
|
Monitoring de la mise en oeuvre
Evaluation des effets et de l'impact
Intrants Processus
Résultat
Effets Impact
|
|
Ressources
Logistique
Information
Planification
Infrastructure
|
Formation
Appui technique
Production de guide et de document
Fourniture d'équipements
|
Personnels formés
Services produits
Information
Mécanisme de coordination
Infrastructure
Partenariat mis en place
|
Amélioration des performances-Augmentation des
couvertures
Amélioration de l'utilisation des services
(bien-être socio-économique)
|
Réduction de la mortalité
Amélioration de la qualité de vie
|
|
Indicateurs d'entrées
|
Indicateur de processus
|
Indicateur de résultat
|
Indicateurs d'effets
|
Indicateurs d'impact
|
Dans le cadre de la présente étude nous avons
proposé un modèle d'analyse (figure 3) nommé modèle
d'évaluation de PASTAM. Ce modèle s'inspire du modèle
proposé par ANDEM.
Il s'agit en effet d'un modèle qui permet d'expliquer
la logique d'intervention du projet. Les différentes flèches
indiquent les relations qui lient les éléments encadrés
(les activités du projet). Le modèle explique la façon
dont les activités se déroulent l'une après l'autre afin
d'atteindre l'objectif final qui est la sécurité transfusionnelle
des populations.
Dans ce modèle, les processus et méthodes
utilisés avant l'arrivée de PASTAM (situation d'avant projet ou
situation de référence) sont examinées.
La disponibilité des produits sanguins est
assurée grâce à la mobilisation et à la
fidélisation des donneurs bénévoles de sang et à
une mise en pratique correcte des méthodes acquises durant le projet
PASTAM.
Une fois la sécurité transfusionnelle
améliorée et les produits sanguins disponibles en qualité
et en quantité, on peut mesurer les perturbations positives que le
projet a eues dans l'atteinte de certains objectifs du millénaire tels
que la réduction de la mortalité, de l'amélioration de la
santé maternelle.
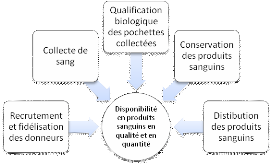
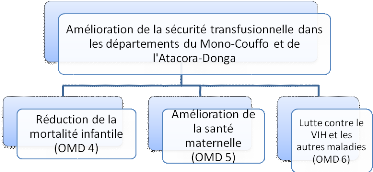
Après PASTAM
Source : Nos travaux ; adapté
de Andem,
Avant PASTAM
Pendant PASTAM
Résultats terminaux
Pertinence Efficacité Efficience
Effet
Durabilité (indicateur
impact
de résultat)
Figure 3 : Modèle
d'évaluation de Pastam
Paragraphe 2 : Evolution du système de la
transfusion sanguine dans le temps et l'espace
A- Historique de la transfusion sanguine
Plusieurs étapes de la sécurité
transfusionnelle ont été décrites depuis la
découverte des groupes sanguins par KARL Landsteiner en 1900 jusqu'
à nos jours et ceci dans le souci permanent de l'amélioration de
la sécurité transfusionnelle.
La première réussite en transfusion sanguine fut
réalisée le 27 mars
1914 par
Albert Hustin sur un
patient anémié par des hémorragies coliques de longues
durées.
En
1916 :
Albert Hustin
réalise la première fois la conservation du sang humain :
en ajoutant du citrate de soude, il ne coagule presque plus. Par ailleurs, Rous
et Turner, ont l'idée d'ajouter un sucre, le
dextrose, pour augmenter la
durée de conservation du sang. Mais cette méthode ne pourra
être appliquée qu'à partir de
1943, avec Loulit qui montre
qu'il faut ajouter un peu d'acide citrique pour éviter
l'inconvénient de la caramélisation du sucre lors de la
stérilisation des flacons. La conservation du sang peut ainsi atteindre
trente à quarante jours, alors qu'elle n'était que de quatre
jours en 1915. (LOODTS 2005)
En
1918 : pendant la
Première
Guerre mondiale de nombreux progrès ont été fait en
médecine et en particulier sur le sang. C'est pendant ces années
que les premières « vraies » transfusions ont lieu
à grande échelle (transfusions en tenant compte des groupes
sanguins).
En
1940 : Karl Landsteiner et
son compatriote Wiener découvrent ensemble le facteur rhésus du
nom du singe de race macaque ayant servi à l'expérience. Les
transfusions deviennent de plus en plus sûres pour les receveurs.
C'est
Charles
Richard Drew qui conceptualisa et organisa la première
banque du sang, qui
permit d'apporter du sang aux
Britanniques durant
la
Seconde Guerre
mondiale, entre
1940 et
1941.
De
1985 à
1990: 4400 personnes sont
contaminées par le virus du l'immuno déficience humaine (VIH)
après administration de produits sanguins.
En
1998 : filtration
systématique des prélèvements de sang (sang total,
plasmas, plaquettes) afin d'éliminer les globules blancs
(déleucocytation).
C'est à partir des années
2000 que les
premières notions de sécurité transfusionnelle sont
apparues (ROUGER 2011).
B- Organisation du sous secteur de la transfusion au
Bénin
Conformément à l'organigramme du Ministère
de la Santé, le sous-secteur de la transfusion sanguine dépend de
la Direction des Explorations Diagnostiques et de la Transfusion Sanguine
(DEDTS).
Il est organisé sur un système
décentralisé (calqué sur la Pyramide Sanitaire du Pays
selon la structure ci-après.
Direction de tutelle
Approvisionnement en Réactifs DEDTS
(Ministère)
et consommables
Coordination Formation ANTS (National)
Recrutement des donneurs Collecte de sang
SDTS (Niveau départemental)
Qualification
DISTRIBUTION
Transfusion sanguine BS/ PTS
(Périphérique HZ)
STRUCTURES DE SOINS
Figure 4: Présentation schématique
de l'organisation du sous système de Transfusion Sanguine
Pour accomplir sa mission le sous secteur de la transfusion
est subdivisé en trois organes :
Organes de production
Organes d'administration
Organes de consultation
Les organes de production
Ils comprennent :
Le Service National de Transfusion Sanguine
(SNTS) : installé à Cotonou dans
l'enceinte du CNHU - HKM. Le SNTS est la tutelle technique de toutes les
structures transfusionnelles du Bénin. Il élabore et assure
l'application de la politique nationale en matière de transfusion
sanguine au niveau des structures sanitaires publiques et privées
(DEDTS / MS, Politique et Stratégie de Développement du sous
secteur de la Transfusion Sanguine 2007-2011).
Six (6) Services Départementaux de
Transfusion Sanguine (SDTS)
Les six (6) structures transfusionnelles sont :
SDTS Atacora-Donga à Natitingou
SDTS Atlantique Littoral à Cotonou
SDTS Borgou Alibori à Parakou
SDTS Mono-Couffo à Lokossa
SDTS Ouémé-Plateau à Porto-Novo
DTS Zou-Colline à Abomey
Le SDTS a une mission départementale. A ce titre, il est
chargé de :
Recruter les donneurs de sang bénévole ;
Assurer le prélèvement et la qualification
biologique du sang ainsi que la préparation des produits sanguins
labiles ;
Assurer la distribution du sang et des produits sanguins labiles
(PSL) ;
Approvisionner les banques de sang et les postes de transfusion
sanguine en réactifs et consommables ;
Promouvoir le développement des structures de transfusion
sanguine périphériques ;
Assurer le secrétariat de la Commission
Départementale de Transfusion Sanguine (CDTS).
Chaque SDTS dispose également d'une Banque
Départementale de Sang (BDS) qui a pour mission d'une part
d'approvisionner les banques de sang et les postes de transfusion sanguine en
produits sanguins qualifiés, d'autre part d'attribuer nominativement les
PSL aux malades. En outre, le SDTS est chargé de l'encadrement des
structures transfusionnelles relevant de sa juridiction (formation,
supervision, contrôle de la qualité...).
Douze (12) Banques de Sang (BS)
Elles sont implantées dans les hôpitaux du pays
(CNHU-HKM, Hôpitaux de Zone et autres). Elles ont pour mission de :
Assurer le stockage de produits sanguins testés par les
SDTS dans l'unité hospitalière ;
Réaliser tous les tests indispensables avant l'attribution
nominative des produits sanguins aux malades.
Trente Quatre (34) Postes de Transfusion Sanguine
(PTS) Ils sont installés dans les hôpitaux de zone
et certains centres de santé de communes du pays situés dans des
localités enclavées ou éloignées des SDTS. Ces
postes sont autorisés à prélever du sang et à le
qualifier en cas d'urgence lorsque les conditions requises sont remplies. Ces
postes distribuent le sang au sein de leur propre structure sanitaire. Ils
jouent également le rôle d'une banque de sang.
Les organes d'administration Ils comprennent
La direction des explorations diagnostiques et de la
transfusion sanguine (DEDTS) qui est la tutelle technique de toutes les
structures transfusionnelles.
Les directions départementales de la santé (DDS)
qui réalisent l'intégration de toutes les activités du
Ministère de la Santé au niveau du département. Elles
disposent d'un SDTS dont elles assurent la tutelle administrative.
Les organes de consultation
Ils comprennent :
La Commission Nationale de la Transfusion Sanguine (CNTS) avec
en son sein un Comité Technique Médico-social (CTMS)
Les Commissions Départementales de la Transfusion
Sanguine (CDTS).
De plus, ce dispositif est assorti d'une mobilisation
communautaire pour assurer la collecte et la disponibilité du sang.
C'est le cas des associations de donneurs de sang. Ces associations existent
sur toute l'étendue du territoire national. L'analyse du processus de la
transfusion sanguine, depuis la collecte du sang jusqu' à l'injection du
sang au patient, révèle des défaillances au niveau de :
- Le nombre de poches de sang collectées : en effet les
donneurs se font rares avec l'avènement du VIH/SIDA et ceux qui sont
restés fidèles au don de sang deviennent de plus en plus
exigeants en termes de compensation. Moins de 1% de la population est Donneur.
De plus, il existe des moments de grande consommation de sang. Ces
périodes sont connues. Les campagnes de dons de sang sont
organisées pendant ces moments critiques mais les résultats sont
souvent en deçà des besoins.
- Les pochettes qui doivent recevoir le sang
prélevé ne sont pas toujours disponibles en quantité
suffisante dans les différents sites de transfusion sanguine du pays.
Leur financement dépend pour une grande part de l'appui des partenaires.
Le matériel médico technique pour les
différents tests de contrôle de la qualité du sang bien que
largement subventionné par le gouvernement dépend aussi pour son
financement de l'appui des partenaires.
SECTION 3: ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE ET
PRESENTATION DE PASTAM
Paragraphe 1 : Organisation du système de la
santé au Bénin
Le système de santé du Bénin a une
structure pyramidale inspirée du découpage administratif. Le
découpage administratif consacré par la loi n°97-028 du 15
janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale a
subdivisé le Bénin en douze départements: l'Alibori,
l'Atacora, l'Atlantique, le Borgou, les Collines, le Couffo, la Donga,
le Littoral, le Mono, l'Ouémé, le Plateau et le Zou.
Chaque département est subdivisé en
communes. Le pays compte au total 77 communes dont trois sont à statut
particulier. Les communes sont subdivisées en arrondissements. On
dénombre en tout 546 arrondissements subdivisés à leur
tour en 3747 villages et quartiers de ville. Chaque village ou quartier de
ville constitue l'unité administrative de base autour de laquelle
s'organisent la vie sociale et les activités de production. Le
système de santé comporte ainsi trois niveaux que sont: le niveau
central ou national, le niveau intermédiaire ou départemental, et
le niveau périphérique organisé suivant l'approche de zone
sanitaire. Le taux de couverture en infrastructures sanitaires est de 91% en
2010. Il existe 27 hôpitaux de zone sur les 34 prévus constituant
le premier niveau de référence, cinq centres hospitaliers
départementaux qui constituent le deuxième niveau de
référence et au niveau national, le Centre National Hospitalier
et Universitaire, le Centre National de Pneumo-phtisiologie, l'Hôpital de
la Mère et de l'Enfant et le Centre National de Psychiatrie. Quand au
secteur privé, il est libéral et est surtout implanté en
zones urbaines. De 631 structures privées enregistrées lors du
recensement des formations sanitaires privées en 1998, leur nombre est
évalué à plus d'un millier de nos jours. En ce qui
concerne les ressources humaines, les ratios de personnel donnent 1,4
médecin pour 10 000 habitants, 2 infirmiers pour 6 000 habitants, et 1,6
sage-femme pour 10 000 habitants en 2005 (MS, 2005). Le système de
santé ainsi décrit essaie de faire face à la situation
sanitaire du pays caractérisée par une prédominance des
affections tropicales, avec de fréquentes épidémies
(Choléra au Sud et Méningite au Nord). Le paludisme, les
infections respiratoires aigües et les maladies diarrhéiques
constituent les affections dominantes du profil épidémiologique
béninois.
Paragraphe 2. Présentation de PASTAM
Dans cette section, il s'agira de présenter le contexte
de mise en oeuvre du projet, les objectifs et stratégies, les zones
retenues, et les résultats attendus
A. Justification du PASTAM
Le Bénin tout comme les autres pays en voie de
développement s'est engagé à réduire la
mortalité infantile (OMD4) et à améliorer la santé
maternelle (OMD 5) d'ici 2015. Le sous secteur de la transfusion sanguine
étant confronté à de nombreuses difficultés. Le
gouvernement a obtenu un appui de la part de la coopération de l'Agence
Belge de développement qui a initié le projet
d'Amélioration de la Sécurité Transfusionnelle dans les
départements de l'Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo
(PASTAM).
B. Objectifs de PASTAM
L'objectif global est d'améliorer la
sécurité transfusionnelle pour les populations du
Bénin.
L'objectif spécifique est formulé
comme suit : « La sécurité transfusionnelle pour
les populations des départements de l'Atacora, de la Donga, du Mono et
du Couffo est améliorée ».
Les indicateurs de l'objectif spécifique sont :
- Nombre de poches transfusées validées avec
test ELISA / Total nombre de poches transfusées
- Taux de satisfaction de la demande pour la transfusion
sanguine
Les sources de vérification de l'objectif
spécifique:
- Registres de transfusion et registres du laboratoire des
services de transfusion
- Statistiques des structures de santé
C. Zone d'intervention de
PASTAM
La zone d'intervention de PASTAM a pris en compte quatre
départements et neuf zones sanitaires communes à savoir :
|
Départements
|
Zone sanitaire
|
|
Atacora
|
Tanguiéta, Materi, Cobly
|
|
Natitingou, Boukoumbe Toucountouna
|
|
Kerou, Kouandé Ouassa-Péhunco
|
|
Donga
|
Djougou Ouake Copargo
|
|
Bassila
|
|
Mono
|
Lokossa, Athiémé
|
|
Comé, Grand-Popo, Houéyogbé et Bopa
|
|
Couffo
|
Klouékanmé, Tovoklin, Lalo
|
|
Aplahoue - Djakotomé- Dogbo
|
Tableau 2 : Zone d'intervention de PASTAM
D. Résultats prévus par PASTAM
Les résultats intermédiaires sont au nombre de 4
et présentent chacun leurs propres activités (et
sous-activités) ci-après :
RI 1 : L'équipement nécessaire
pour assurer la sécurité transfusionnelle est fonctionnel et
pérenne
Activités
1.1 Mettre en place le matériel nécessaire
à chaque niveau
1.2 Former le personnel du SDTS et des laboratoires sur
l'utilisation de l'équipement
1.3 Assurer la maintenance de l'équipement
1.4 Aménager le laboratoire du SDTS AD
(électricité)
RI 2 : L'organisation interne des services de
transfusion sanguine dans les départements est
renforcée
Activités
2.1 Améliorer le fonctionnement du SDTS
2.2 Renforcer la relation du SDTS avec les PTS
2.3 Etablir une meilleure intégration du sous-secteur
de la TS dans le système de santé
RI.3 La qualité de la transfusion sanguine
est améliorée dans toutes les étapes du
processus
Activités
3.1 Augmenter le nombre de donneurs de sang
3.2 Améliorer la sélection des donneurs et la
qualité du prélèvement
3.3 Améliorer la qualité de la qualification du
sang
3.4 Améliorer la qualité de l'étape
hospitalière de la transfusion sanguine
3.5 Appuyer la formation continue
RI.4 Le financement des dépenses
récurrentes des services de TS à long terme est
assuré
Activités
4.1 Mettre en place un stock de consommables au début
du projet avec une ligne budgétaire dégressive
4.2 Chercher des sources de financement alternatives
DEUXIEME PARTIE :
DU CADRE METHODOLOGIQUE A LA PRESENTATION DES
RESULTATS
CHAPITRE III : APPROCHE METHODOLOGIQUE DE LA
RECHERCHE
Ce chapitre présente le cadre de l'étude, la
méthodologie de la collecte des données,
l'échantillonnage, les indicateurs et les techniques d'analyse des
données
Section 1: Du cadre d'étude à la
méthodologie de la collecte des données
Paragraphe 1. Présentation du cadre
d'étude
Dans le but d'évaluer l'impact de PASTAM ainsi que sa
contribution sur l'amélioration de la santé de la population, le
poste de la transfusion sanguine installé dans le laboratoire de
l'hôpital de zone de Tanguiéta nous a servi de cadre
d'étude.
A. Cadre physique de la zone
L'Hôpital de Tanguiéta est l'Hôpital de
référence de la Zone Sanitaire de
Tanguiéta-Matéri-Cobly (ZST) qui est l'une des trois zones
sanitaires que compte le département de l'Atacora. Elle est
située dans la partie septentrionale à l'extrême Ouest du
Bénin. Elle regroupe les communes de Tanguiéta, Matéri et
Cobly et est limitée :
- Au Sud par la commune de Boukoumbé et la
République du Togo ;
- A l'Est par les communes de Toucountouna, Kouandé et
Kérou ;
- Au Nord et à l'Ouest par la République du
Burkina Faso.
La superficie totale de la zone est de 7900 Km2.
Elle occupe le second rang en matière de superficie dans l'Atacora.
B. Climat et hydrographie
Le climat est de type tropical à deux saisons. La
saison pluvieuse commence généralement en mai et se termine en
octobre. L'harmattan sévit de novembre à janvier et cède
place à une intense chaleur qui s'étend de février
à avril.
Le relief est essentiellement marqué par la
chaîne de l'Atacora qui borde la commune de Tanguiéta et de la
pénéplaine qui s'étend sur le reste de la zone.
Le réseau hydrographique est dominé par deux
principaux fleuves dans sa partie Nord. Il s'agit de la Pendjari (135 km), le
Mékrou (410 km) et d'autres affluents du bassin du Niger qui baignent
toute la Zone à l'exception de Cobly.
La végétation est constituée de savane
arborée dans la partie nord. C'est la principale zone
cynégétique du nord-ouest du Bénin avec 275.000 ha. Le sol
est pierreux en zone montagneuse, argileux et sablonneux ailleurs.
C. Population et démographie
La zone est essentiellement peuplée de Berba (la plus
importante numériquement avec environ 14%), de Gnindé, de Waama,
de Natemba, de Gourmantché et de Bourba. A ces ethnies se sont
ajoutés à travers les courants migratoires les Dendi, Germa,
Haoussa, Bariba, Yoruba, Fon et Mina.
Les principales religions sont : la religion traditionnelle,
le christianisme et l'islam.
La population de la zone est concentrée dans sa partie
méridionale et au Centre. En 2007, elle est estimée à 222
119 habitants d'après les projections des résultats du RGPH 3,
soit respectivement 100 461 ; 55 989 et 65 669 habitants pour les communes de
Matéri, Cobly, Tanguiéta (SPIRS/DDS Atacora 2007).
La densité de la population est de 28 habitants par
km2 en 2007.C
D. Données économiques de la ZST
v L'agriculture
L'agriculture est la première activité et la
première source de revenu des populations de la zone. Elle absorbe
environ 74 % de la population. Les techniques agricoles sont encore
traditionnelles et rudimentaires. Les produits agricoles sont très
variés : igname, sorgho, mil, arachide, néré, fonio,
sésame soja, manioc, tabac, haricot, gombo. La culture de rente de la
zone est le coton.
Les autres activités sont par ordre d'importance
l'élevage, la pêche, la chasse, l'artisanat, le commerce et le
tourisme.
v L'élevage
C'est la seconde activité de la population de la zone.
Les espèces élevées sont : les bovins, les ovins, les
caprins et les volailles.
v La pêche
C'est une activité marginale et traditionnelle. Les
cours d'eau sont les lieux de pêche. Plusieurs cours d'eau comme la
pendjari et ses nombreux affluents à Tanogou, Manougou, Cotiakou
connaissent la pêche à la ligne et à la nasse.
v La chasse
Cette activité est pratiquée dans la zone du
parc de pendjari sous le contrôle du CENAGRF et des associations
villageoises de chasse. Dans les territoires villageois des communes de
tanguiéta et de Matéri, c'est une petite chasse à la
battue, au fusil et aux pièges qui est faite en dehors de la zone
cynégétique.
v Autres
Les cascades de Tanougou et le parc animalier de la Pendjari
sont les principaux sites touristiques de la zone.
Les infrastructures de loisirs publiques et privées
sont quasiment inexistantes en milieu rural. L'activité industrielle est
aussi inexistante dans la Zone Sanitaire.
La zone est traversée par les rout es
inter-état Bénin Burkina-Faso (bitumées) et Bénin
Togo (non bitumée) qui favorisent les trafics avec les pays
limitrophes.
E. Organisation de l'administration territoriale.
Ø Organisation administrative de la
ZST
La zone sanitaire regroupe trois communes du
département de l'Atacora que sont celles de Tanguiéta,
Matéri et Cobly dirigées chacune par un maire. Elle comporte
quinze (15) arrondissements et cent vingt six (126) villages ayant chacun pour
autorité respective un chef d'arrondissement et un chef village.
Par ailleurs, la zone dispose de quatre (04) brigades
territoriales de gendarmerie dont deux (02) dans la commune de Matéri,
d'un commissariat spécial de police à Porga, de deux (02)
Recettes Perception (Matéri et Tanguiéta), de deux (02) bureaux
de postes (Matéri et Tanguiéta).
F- Organisation du système sanitaire de la
zone
La Zone Sanitaire de Tanguiéta est constituée de
18 aires sanitaires ayant chacune au moins un centre de santé.
L'organe suprême de représentation et de
décision de la zone sanitaire est le comité de santé qui
est chargé d'assurer le développement socio-sanitaire de la zone.
L'hôpital de référence de la zone est l'Hôpital Saint
Jean de Dieu.
Ø Hôpital de zone de
Tanguiéta
Situé dans la zone sanitaire de
Tanguiéta-Matéri-Cobly, l'Hôpital Saint Jean de Dieu est un
hôpital confessionnel fondé en juin 1968 par la Province LOMBARDO
-VENETA de Milan de l'Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu. Il a
été inauguré le 29 juin 1970 par le président en
exercice, son Excellence Hubert K. MAGA. Le gouvernement du Bénin par
une convention du 13 Avril 1989 l'a reconnu officiellement. Le 14
décembre 1998, Il a été institué en hôpital
de référence de la zone de tanguiéta par
arrêté ministériel N° 6022. De 82 lits à
l'ouverture en 1970, l'hôpital compte aujourd'hui 280 lits et dispose de
plusieurs départements de soins et d'un plateau technique assez fourni.
Avec la signature d'une convention de coopération entre l'école
de Médecine de l'Université de Parakou le 29 Octobre 2005,
l'hôpital a affirmé son caractère universitaire (Plan
Directeur HJSD, 2008-2012).
Au plan technique, il convient de souligner que
l'hôpital de Zone de Tanguiéta est le centre de première
référence en matière de prestation de soins des centres de
santé de la Zone Sanitaire de réseau des centres de santé
qu'il soutient. Il est chargé de la prise en compte des problèmes
de santé dépassant les compétences desdits centres et
dispose pour jouer ce rôle des services et unités techniques
ci-après :
Le service de la Pédiatrie ;
Le Service de la maternité ;
Le Service de la Chirurgie ;
Le Service de la Médecine
Le Service des Urgences
Le service des soins Intensifs ;
Le Service de Laboratoire d'Analyses et de Banque de Sang ;
Le Service de Radiologie ;
Le Service de Kinésithérapie
Le service de Physiothérapie et de
kinésithérapie avec un atelier orthopédique;
Les services généraux (Garage, cuisine,
buanderie)
Le poste de transfusion sanguine de l'hôpital de zone
qui a bénéficié de l'appui du PASTAM est logé dans
l'enciente du laboratoire d'analyse.
Paragraphe 2 : Méthodologie de la collecte des
données
A. Type d'étude
Il s'agit d'une étude transversale, descriptive et
évaluative concernant les interventions du projet PASTAM dans la zone
sanitaire Matérie Cobly et particulièrement à
l'hôpital de zone de Tanguiéta.
B. Unités de recherche
Dans la présente recherche, les enquêtes
proprement dites ont été effectuées principalement
à l'hôpital de zone de tanguiéta qui constitue la
principale unité de recherche, notamment dans les pavillons de
pédiatrie de la maternité des urgences, du bloc opératoire
et du service de laboratoire. La seconde unité de recherche est
constituée de l'association des donneurs bénévoles de sang
de la zone d'étude.
C. Technique d'échantillonnage et taille de
l'échantillon
La population mère est constituée de touts les
acteurs impliqués dans le système transfusionnel de
l'hôpital de zone de Tanguiéta. Compte tenu de
l'incapacité de porter les observations sur toute la population cible,
il a été constitué un échantillon.
L'échantillon est un ensemble d'individus choisis dans une population
donnée de manière à représenter de façon
significative et fidèle cette population.
L'échantillonnage est constitué au niveau de
tous les services impliqués dans la transfusion sanguine de
l'hôpital et au niveau de l'association des donneurs de sang
La taille de l'échantillon obtenue est de 60. Le
tableau ci-dessus présente les différents types de technique
d'échantillonnage ainsi que la taille de l'échantillon
Tableau3 : Technique
d'échantillonnage et taille de l'échantillon
|
GROUPE
|
EFFECTIF
|
Pourcentage
ET/EP en %
|
Techniques d'échantillonnage
|
|
Population
mère (PM)
|
Effectif prévu
(EP)
|
Effectif
touché (ET)
|
|
Laboratoire
|
12
|
12
|
10
|
83,33
|
Choix raisonné
|
|
Médecine
|
18
|
11
|
9
|
81,81
|
Choix raisonné
|
|
Maternité
|
15
|
12
|
11
|
91,66
|
Choix raisonné
|
|
Pédiatrie
|
17
|
15
|
13
|
88,23
|
Choix raisonné
|
|
Chirurgie
|
18
|
16
|
9
|
88,88
|
Choix raisonné
|
|
Soins intensifs
|
8
|
5
|
5
|
100
|
Exhaustif
|
|
Sous total 1
|
88
|
71
|
57
|
80,28
|
|
|
Responsables des associations des donneurs
|
03
|
03
|
03
|
100
|
Exhaustif
|
|
Sous total 2
|
03
|
03
|
03
|
100
|
Exhaustif
|
|
TOTAL
|
191
|
74
|
60
|
81,08
|
|
D- Techniques et outils de collectes des données
Nous avons utilisé plusieurs techniques et outils pour
collecter les données. Ainsi, nous avons utilisé comme
techniques; la recherche documentaire, l'observation directe, l'enquête
par questionnaire et les entretiens
La recherche documentaire est la collecte d'information
à l'aide de supports écrits (ouvrages, rapports, mémoires,
supports informatiques). Nous avons réalisé notre recherche
documentaire en deux étapes à savoir ; dans un premier temps
l'identification des sources d'information et dans un second temps
l'exploitation des différents registres de transfusion sanguine
utilisés à l'hôpital de zone de Tanguiéta
L'observation directe est une méthode qui consiste
à consigner dans un formulaire détaillé ce qui a
été vu et entendu sur les lieux de réalisation.
Ces différentes techniques et outils ont
été choisis au besoin pour permettre d'atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés.
Les techniques et outils de collecte de données ainsi
que leurs cibles respectives sont présentés dans le tableau ci
après :
Tableau 4 : Techniques et outils
de collecte de données utilisés avec leurs cibles respectives
pour la détermination de l'impact du PASTAM.
|
Techniques
|
Outils
|
Cibles
|
Aspects étudiés
|
|
Recherche documentaire
|
Fiche d'exploitation documentaire
|
Registre de sélection des donneurs de sang
Registre de prélèvement et de qualification
Registre de demande et de session des produits et
dérivés sanguins
Registre de transfusion dans les divers pavillons
|
Fonctionnement actuel du système de la transfusion
sanguine.
Mesure des paramètres concernant les données
(recrutement et fidélisation des donneurs, Sélection des
donneurs, qualification, conservation et distribution).
|
|
Entretien individuel
|
Guide d'entretien individuel
|
Informateurs clés : personnels chargé
d'effectué la transfusion sanguine dans les services et aux personnes
ressources de PASTAM
|
Fonctionnement du système de la transfusion sanguine
|
|
Observation directe
Enquête par questionnaire
|
Grille d'observation directe
Questionnaire
|
Ressources matériel mis en place par PASTAM
Disponibilité des équipements
Mises en pratique des méthodes et techniques
initiés par le projet
Personnels chargé d'effectué la transfusion
sanguine dans les services et aux personnes ressources
|
Méthodes de mise en oeuvre des recommandations de
Pastam lors des accidents liées à la transfusion
Sécurité de la transfusion sanguine
|
E. Traitement des données
Les données primaires et secondaires recueillies ont
fait l'objet d'un traitement statistique. Nous avons utilisé à
cet effet différents outils de traitement, à savoir : le
logiciel Excel qui nous a permis de calculer les écarts observés
dans l'atteinte des résultats prévus, et le logiciel SPSS pour
analyser les données.
Section 2 : Variables d'analyses et seuil de
décision
Paragraphe 1 : Variables et indicateurs d'analyses
En vue de l'atteinte des objectifs de recherche, nous avons
décomposé les hypothèses en deux types de
variables : La variable dépendante ou expliquée et les
variables indépendantes ou explicatives.
§ Variable dépendante ou
expliquée
La variable dépendante de cette recherche est
l'amélioration de la sécurité transfusionnelle. Cette
amélioration nous permet de mettre en exergue l'impact de ce projet
à l'hôpital de zone de Tanguiéta. Les paramètres
d'appréciation de la variable dépendante sont :
- L'amélioration de la sécurité
transfusionnelle dans toutes les étapes de son processus
- L'amélioration de l'organisation interne des
activités de la transfusion sanguine
- La conservation des méthodes et techniques mises en
place par le projet.
§ Variables indépendantes ou
explicatives
Les variables indépendantes retenues dans le cadre de
cette étude sont :
- Le recrutement des donneurs
- La sélection des donneurs
- Qualification biologique du don (QBD)
- Mobilisation des donneurs de sang
- Pratique de la transfusion sanguine et méthode de
conservation des produits sanguins
Les indicateurs des variables indépendantes
sont :
· Le recrutement des donneurs : Le
rapport entre les donneurs bénévoles reçus et le nombre
des donneurs sélectionnés
· La sélection des
donneurs : Le nombre des donneurs ayant subi le processus de
sélection basé sur les recommandations de l'OMS
· Qualification biologique du don
(QBD) : Le nombre de pochette de sang qualifiée selon les
normes OMS. La qualification biologique permet de distribuer les produits
sanguins indemnes de tout agent pathogène connu et d'informer le donneur
en cas de résultat positif. La qualification biologique après le
dépistage obéit à une logique du « tout ou
rien » pour l'utilisation du produit sanguin et à
qualification binaire « conforme » ou « non
conforme » (Alexandra et El-Ghouzzi ; 2012)
Le tableau ci-dessous regroupe la synthèse des
indicateurs par hypothèse de recherche
Tableau 5: Synthèse des
variables et indicateurs par hypothèse de recherche
|
Hypothèses
|
Variables dépendantes
|
Variables indépendantes
|
Indicateurs
|
Données à collecter
|
|
Hypothèse 1 : La sécurité
transfusionnelle est améliorée dans toutes les étapes de
son processus avec l'intervention du projet.
|
La sécurité transfusionnelle est
améliorée dans toutes les étapes à l'hôpital
de zone de Tanguiéta
|
Recrutement des donneurs
Sélection des donneurs
Qualification biologique des dons
|
Nombre de donneurs recrutés
- Nombre de donneurs bénévoles
sélectionnés
- Nombre de pochette de sang ayant subit la qualification
biologique
|
-Les donneurs recrutés
- Donneurs bénévoles sélectionnés
- Pochette de sang disponible
|
|
H2 : L'intervention de projet PASTAM a permis a
l'Hôpital de zone de Tanguiéta de renforcer l'organisation interne
de son poste de transfusion sanguine.
|
Mobilisation des donneurs de sang
|
- Nombre des séances de mobilisation
|
- Données sur les réunions de sensibilisation
- Compte rendu des séances de sensibilisation
|
|
H3 : Les acteurs de la transfusion sanguine de
l'hôpital de Zone de Tanguiéta ont continué à mettre
en pratique les techniques proposées par le projet depuis qu'il est
arrivé à son terme
|
Pratique actuelle de la transfusion sanguine et méthode de
conservation des produits sanguins
|
L'effectif des acteurs impliqués dans le processus
pratiquant les techniques de PASTAM
|
- Pratique des techniques de la transfusion sanguine
- Méthode de conservations et de traitement des produits
sanguins labiles
|
Paragraphe2 : Seuil de décision pour la
vérification des hypothèses et limite de l'étude
A-Seuil de vérification
Pour une hypothèse, le problème
spécifique identifié (variable dépendante) et sa cause
probable (variable indépendante) seront confirmés si un niveau
de plus de 80 % des répondants concernés est atteint.
B- Dispositions d'ordre éthique :
L'autorisation requise pour réaliser la recherche a
été obtenue au niveau de l'administration de l'hôpital
étant donné que le recueil d'informations médicales
concernant ceux de la transfusion sanguine peut porter atteinte au respect de
la confidentialité des dossiers médicaux.
Nous pouvons de plus garantir que ces informations ne
serviront pas à d'autres fins que celle de la présente
recherche.
C- Difficultés et limites de la recherche
Ici, nous passons en revue les difficultés et les
limites des données recueillies.
- Difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées n'affectent pas les
données recueillies. Elles n'expliquent que les limites de ces
informations. Diverses difficultés ont été
rencontrées et ont constitué des obstacles au bon
déroulement de l'enquête.
Les difficultés liées à l'enquête
tiennent surtout à la diversité, et à
l'indisponibilité parfois des individus ciblés. Néanmoins,
nous avons su mettre à profit notre chronogramme afin de recueillir les
données nécessaires à notre étude.
- Limites des données de
l'enquête
Au cours de notre recherche, nous avons rencontré des
difficultés relatives au déroulement du stage et à la
réalisation de l'enquête. Au nombre de ces difficultés nous
pouvons citer :
- la réticence de certaines personnes
interrogées à nous fournir des informations nécessaires
pour notre travail ;
- le désintéressement de certains
enquêtés à travers leurs réponses parfois laconiques
aux questions qui leur sont posées.
De même, le fait que notre stage ne couvre qu'une
période de trois mois, ne nous a pas réellement permis de nous
rendre compte des causes endogènes des faits constatés.
Quels résultats avons-nous obtenus de
l'évaluation de l'impact de PASTAM ? Le chapitre suivant nous en donne
une large connaissance.
CHAPITRE IV: APPRECIATION DE L'IMPACT DE PASTAM SUR LA
SECURITE TRANSFUSIONNELLE
Section 1 : Présentation et analyse des
résultats
Après la validation de nos questionnaires, les
résultats issus de l'enquête sont ici présentés et
analysés en tenant compte de chacun des hypothèses émises.
Ainsi, les résultats qui émanent de nos
enquêtes seront présentés sous formes de tableaux.
Paragraphe 1 : Présentation et analyse des
données d'enquête relatives au Système de
sécurisation des produits sanguins à toutes les étapes du
processus
Pour apprécier l'amélioration de la
sécurité transfusionnelle, nous avons dépouillé les
fiches de sélection des donneurs qui sont au niveau du service de
laboratoire, les divers registres de qualification biologique et de demande des
produits sanguins labiles (PSL)
A) Le recrutement et la sélection des
donneurs :
Le dépouillement des registres des donneurs entre 2004
et 2012 permet de noter les données consignées dans le tableau
suivant
Tableau 6: Répartition des
données sur la sélection des donneurs reçus au poste de
transfusion sanguine
|
Année
|
Avant PASTAM
|
Avec PASTAM
|
Après PASTAM
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
Nombre de donneurs reçus
|
1035
|
1185
|
1285
|
1305
|
1730
|
1410
|
1525
|
1571
|
1657
|
|
TOTAL DONNEURS RECUS
|
3505
|
4445
|
4753
|
|
Nombre de donneurs
|
555
|
890
|
1199
|
1108
|
1527
|
1400
|
1521
|
1569
|
1656
|
|
Sélectionné selon les procédures
|
|
TOTAL DONNEURS SELECTIONNES
|
2644
|
4035
|
4746
|
|
Pourcentage %
|
75,44
|
90,78
|
99,85
|
Source : Données terrain
recueillies en Janvier 2013
Le nombre de candidats aux dons ayant subi l'ensemble des
étapes de présélection correspondant à l'ensemble
des items définis par le service de la transfusion sanguine passe de
75,44% avant le projet à 99,85 % trois années depuis la
clôture du projet.
b) Qualification biologique du don :
Tableau 7: Répartition des
données suivant la conformité de la qualification biologique
|
PASTAM
|
Années
|
Conformité
|
Pourcentage
|
Moyenne
|
|
QBD Conforme
|
QBD non conforme
|
|
Avant
|
2004
|
555
|
5
|
99,10
|
99,21
|
|
2005
|
890
|
8
|
99,10
|
|
2006
|
1199
|
7
|
99,42
|
|
Pendant
|
2007
|
1108
|
2
|
99,82
|
99,78
|
|
2008
|
1527
|
5
|
99,67
|
|
2009
|
1400
|
2
|
99,86
|
|
Après
|
2010
|
1521
|
0
|
100,00
|
100,00
|
|
2011
|
1569
|
0
|
100,00
|
|
2012
|
1656
|
0
|
100,00
|
Source : Données terrain
recueillies en Janvier 2013
Trois années après la clôture du projet,
le score attribué à la qualification biologique est de 100%. Elle
est conforme aux normes OMS.
c) Mobilisation des donneurs de sang:
Tableau 8: Mobilisation des donneurs
pour le don bénévole de sang
|
Modalités
|
Fréquence Absolue
|
Fréquence relative %
|
|
Enquêté ayant eu des propositions du don de
Sang
|
56
|
93,33
|
|
Enquêté n'ayant pas eu des propositions du don de
Sang
|
4
|
06,67
|
|
TOTAL
|
60
|
100,00
|
Source : Données terrain
recueillies en Janvier 2013
93,33 % des enquêtés ont eu une proposition du
don de sang au cours de leur visite à l'hôpital de zone de
Tanguiéta.
Paragraphe 2: Présentation et analyse des
données d'enquête relative à l'organisation interne du
poste de transfusion sanguine
Pour apprécier l'organisation interne du poste de
transfusion sanguine, nous avons soumis un questionnaire aux
bénéficiaires de la transfusion sanguine. Les résultats
sont consignés dans le tableau ci-dessus.
Tableau 9 : Répartition des
données sur l'organisation interne du poste de transfusion sanguine
|
Services
|
Enquêtés
|
Fréquence relative
|
Fréquence relative %
|
|
Laboratoire
|
10
|
10
|
100
|
|
Médecine
|
9
|
8
|
88,89
|
|
Pédiatrie
|
13
|
12
|
92,31
|
|
Maternité
|
11
|
10
|
90,91
|
|
Chirurgie
|
9
|
9
|
100
|
|
Soins Intensifs
|
5
|
5
|
100
|
|
Total
|
57
|
54
|
94,74
|
Source : Données terrain
recueillies en Janvier 2013
94,74 % bénéficiaires interrogés trouvent
que l'organisation interne de la transfusion est plus renforcée
grâce à l'intervention de ce projet
Paragraphe 3: Présentation et analyse des
données d'enquête relatives à la conservation des
techniques de PASTAM
Pour apprécier la mise en pratique des normes et
procédures mise en place par le projet trois années après
sa clôture au poste de transfusion sanguine, nous avons soumis un
questionnaire aux acteurs clés de la transfusion sanguine dont les
résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 10: Répartition des
données sur la conservation et la mise en pratique des normes et
procédures par service.
|
Services
|
Enquêtés
|
Fréquence absolue
|
fréquence relative %
|
|
Laboratoire
|
10
|
10
|
100,0
|
|
Médecine
|
9
|
9
|
100,0
|
|
pédiatrie
|
13
|
11
|
84,6
|
|
Maternité
|
11
|
10
|
90,9
|
|
Chirurgie
|
9
|
9
|
100,0
|
|
Soins intensif
|
5
|
4
|
80,0
|
|
Total
|
57
|
53
|
93,0
|
|
Pourcentage
|
92,98
|
Source : Données terrain
recueillies en Janvier 2013
92,98 % des acteurs interrogés mettent en pratique les
normes et procédures applicables à la transfusion sanguine.
Section 2 : Interprétation et discussion
des résultats
Cette section traite de l'interprétation des
résultats et de la vérification des hypothèses.
Paragraphe 1 : Système de sécurisation des
produits sanguins à toutes les étapes du processus
Trois indicateurs nous ont permis d'apprécier
l'amélioration de la transfusion sanguine.
Le tableau ci-dessous récapitule les indicateurs des
variables indépendantes liées au système de
sécurisation des produits sanguins
Tableau 11: Récapitulatif des
scores de la variable « Amélioration de la transfusion
sanguine »
|
Variables
|
Résultats obtenus
|
Score de référence
|
|
Le recrutement et la sélection des donneurs
|
99,85 %
|
100%
|
|
Qualification biologique des dons
|
100%
|
100%
|
|
Mise en pratique des normes et procédures
|
95,45 %
|
100%
|
|
TOTAL
|
95,36 %
|
100 %
|
Hypothèse 1 : Vérification
Nous avons émis cette hypothèse pour montrer la
relation entre l'amélioration de la sécurité
transfusionnelle et l'intervention de PASTAM.
La moyenne des trois scores donne le score de la variable
« Amélioration de la sécurité
transfusionnelle ». Ce score est de 95,36 sur 100. En nous
référant au seuil de décision, la sécurité
transfusionnelle est améliorée à l'hôpital
grâce à l'intervention de PASTAM d'après les
résultats de notre recherche. L'hypothèse 1 est
confirmée.
Paragraphe 2: Organisation interne du poste de transfusion
sanguine
Hypothèse 2 :
Cette hypothèse a été émise pour
montrer la relation qui pourrait exister entre le renforcement de
l'organisation interne du service de la transfusion sanguine et l'intervention
du projet. De cette étude 94,74 % des acteurs interrogés trouvent
que l'organisation interne de la transfusion est plus renforcée
grâce à l'intervention de ce projet. En nous
référant au seuil de décision.
L'hypothèse 2 est confirmée.
Paragraphe 3: Conservation des techniques de PASTAM
Hypothèse n°3: Les
acteurs de la transfusion sanguine de l'hôpital de Zone de
Tanguiéta ont continué à mettre en pratique les techniques
proposées par PASTAM trois années après sa
clôture.
Les résultats de notre enquête montrent que 92,98
% des acteurs interrogés continuent de mettre en pratique les normes et
procédures applicables à la transfusion sanguine.
L'hypothèse 3 est également confirmée.
Section 3 : Observations et suggestions
Paragraphe 1: Observations et Suggestions
A- Observations
Durant notre stage nous avons fait des remarques et
observations. La mauvaise gestion et le manque des méthodes de
l'économie de sang sont les principaux facteurs qui conduisent à
sa pénurie. Il s'agit en fait d'un manque factice qui s'explique par
l'importance de la demande en produits sanguins la surconsommation par les
praticiens et le manque des méthodes d'économie de sang. L'accent
doit donc être mis sur l'amélioration de la thérapeutique
transfusionnelle, sur les techniques d'économie de sang, et les
indications de la transfusion sanguine.
B- Suggestions
Au regard de ces observations sur le terrain, il paraît
utile de faire quelques ébauches de suggestions pour proposer une
amélioration du système transfusionnel tel qu'il a
été observé.
Ø A l'endroit de l'ANTS
- Renforcer les supervisions nationales
- Approvisionner régulièrement les SDTS et PTS
en réactifs de qualification biologique.
- Equiper les laboratoires en matériels adéquats
pour la bonne réussite et assurer la continuité.
Ø A l'endroit du SDTS Atacora Donga
- Appuyer le PTS de Tanguiéta dans le suivi
régulier de la collecte des données.
-Mettre en place un système de contrôle de
qualité.
Ø A l'endroit des praticiens du PTS de
Tanguiéta
- Instaurer une promotion de l'autotransfusion dans les
interventions programmées
- Mettre en place le comité d'hémovigiliance.
- Mettre en place un système efficace de collectes et
d'informations des accidents transfusionnels
Ø A l'endroit des acteurs du PTS de Tanguiéta
- Mettre en pratique les normes et pratiques standards
recommandées en matière de transfusion sanguine.
Ø A l'endroit de la population
Participer aux campagnes de dons bénévoles de
sang pour aider les acteurs de la transfusion à faire face aux
problèmes de pénurie de sang
Ø A l'endroit des autorités de l'hôpital
Saint Jean de Dieu
- Assurer la formation continue,
régulière du personnel de l'hôpital de zone en
matière de transfusion
- Rechercher d'autres partenaires au développement pour
assurer la poursuite des projets qui arrivent à terme
- Réduire les dons familiaux et encourager les dons
bénévoles
- Mettre en place un cadre de concertation formel entre les
donneurs bénévoles et le PTS de Tanguiéta
CONCLUSION
Les investigations menées, dans le cadre de cette
étude nous ont permis d'évaluer l'impact du projet d'appui au
sous secteur de la transfusion sur l'amélioration de la
sécurité transfusionnelle et de la santé de la population
de la zone sanitaire Tanguiéta Matéri Cobly à partir du
cas de l'hôpital de zone Saint Jean de Dieu.
A l'issue de cette évaluation, les paramètres
mesurés ont permis de noter que :
- La sécurité transfusionnelle est plus
améliorée à l'hôpital de zone de Tanguiéta
trois années après sa clôture. Ceci s'explique par la
pérennisation des acquis et le renforcement de l'organisation interne du
service du poste de transfusion sanguine
En effet, le nombre de candidats aux dons ayant subi
l'ensemble des étapes de présélection correspondant
à l'ensemble des items définis par le service de la transfusion
sanguine passe de 75,44% avant le projet à 99,85 % trois années
depuis la clôture du projet.
93,33 % des enquêtés ont eu une proposition
systématique du don de sang au cours de leur visite à
l'hôpital de zone de Tanguiéta.
94,74 % des bénéficiaires trouvent que
l'organisation interne de la transfusion est plus renforcée grâce
à l'intervention de ce projet
92,98 % des acteurs interrogés mettent en pratique les
normes et procédures applicables à la transfusion sanguine.
Les trois hypothèses émises pour expliquer et
répondre à nos questions de recherche sur la relation entre
l'intervention du projet et les résultats de l'investigation ont
été confirmées.
Au vu des résultats obtenus, nous avons fait des
ébauches de suggestions à tous les acteurs et toutes les parties
prenantes pour une forte mobilisation des ressources afin de mieux faire face
à la pénurie du sang et réduire considérablement
les décès infantiles dus aux manques de sang.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
[1] ACDI (2002) : Agence canadienne de
développement International .La gestion axée sur les
résultats à l'ACDI. Enoncé du principe.
[2] ANDDRIANARIVO S. O. (2011). Analyse
organisationnelle du système de don de sang à Madagascar.
Mémoire de master en santé publique, Institut de la francophonie
et des maladies tropicales
[3] BANQUE MONDIALE, (2002). Suivi et
Evaluation - Quelques outils, méthodes et approches.
[4] COMMISSION EUROPEENNE, 2002. Indicateurs
pour le suivi et l'évaluation : une méthodologie indicative ; CE,
Bruxelles.
[5] Ministère de la santé,
DEDTS (2008) : Plan directeur du développement du sous secteur
de la transfusion sanguine 2008-2012 - Document Technique
[6] ADANGUIDI J. Janvier (2012), Etudes et
montage de projets Notes de cours. Université Parakou.
[7] AFFO D. H. ; (2012) : Suivi
évaluation des projets, Notes de cours. Institut international de
management. Cotonou
[8] Agence belge de Développement
(2005), Rapport enquête de base du projet PASTAM : principaux
résultats
[9] ALEXANDRA K, M. H., EL-GHOUZZI, P. M.
(2012): La qualification biologique du don de sang et la
sécurité transfusionnelle. Revue francophone des laboratoires Num
439
[10] ANAES, (2007) : Méthodes
quantitatives pour évaluer les interventions visant à
améliorer les pratiques transfusionnelles. Paris.
[11] ANANI L.Y. et coll, (2003) Evaluation
du groupage sanguin dans les formations sanitaires du BENIN. IV Congrès
de la SAFHEMA avec la participation du RAFTS et de " SOS Hémopathies
malignes.
[12] ANDEM, (1995) Évaluation d'une
action de santé publique : Recommandations. Paris.
[13] COMMISSION EUROPEENNE, (2001). Manuel-
Gestion du cycle de projet ; CE, Bruxelles.
[14] Constitution béninoise du 11
Décembre 1990 : Article 26 relatif aux Droits et Devoirs
[15] d'ALMEIDA A. M. (2001) Définition
opératoire annotée de quelques termes courants de santé
publique et communautaire. Cotonou : MEPS
[16] DAOUDA B. M. ; (2012) :
efficacité des systèmes de suivi et d'évaluation des
projets de développement de la commune de Natitingou. Mémoire de
fin de formation de Master2 en évaluation et gestion des projets.
Université de Parakou
[17] DIARRA M., (2008) indication de la
transfusion sanguine au cours de l'insuffisance rénale chronique au CHU
du Point G, Thèse de Doctorat d'Etat en Médecine, Mali 76 Pages
[18] Dictionnaire médical Larousse
Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies
sur les responsabilités transfusionnelles.
[19] FALL I. S., Seck I, et al (2005),
Monitoring et évaluation des programmes de santé en Afrique Sub
saharienne Med tropical Vol 65.
[21] FAROUK M., BOUZOUANI M., (2008)
Statistique et Epidémiologie : Objet et méthodes ; Oran
Algérie.
[22] GADO O. (2005): Impact du système
de suivi évaluation des activités de financement du fonds mondial
sur la gestion axée sur les résultats dans le secteur sanitaire
au Bénin : Etude de cas appliquée au PNLS/IST. Mémoire de
fin de formation MBA en gestion de projets ;
[23] HINSON A. Eric ; (2001) Planification
sanitaire au ministère de la santé publique; Mémoire de
fin de formation en planification et aménagement du territoire.
[24] HONFOGA G. B. ; (2012) Analyse
économique des projets. Notes de cours. Institut international de
management. Cotonou
[25] INGRAND P., SALMI LR, BENZ-LEMOINE E, DUPUIS
M ; (1998) : Evaluation de la traçabilité effective des
produits sanguins labiles à partir des dossiers médicaux.
Transfus Clin Biol.
[26] JAFFRE, Y. et Olivier de SARDAN, J.P.
(2003), Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations
entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest,
Paris.
[27] LEHTO Juhani, RITSATAKIS Anna, (1999).
Health impact assesment as a tool for intersectorial headline Policy (Etude
d'impact santé, un outil pour une politique de santé
intersectorielle). de la théorie à la pratique, Göteborg,
Suède.
[28] LOKOSSOU K. Virgile (2009):
contributions du suivi évaluation aux interventions financées
par le fonds mondial au Benin : cas du programme national de lutte contre le
sida. Mémoire de fin de formation MBA en gestion de projets,
[29] LOODTS P. (2005) Médecine de la
Grande Guerre: Histoire de la transfusion sanguine pendant la Grande Guerre
[30] Ministère de la santé (2006):
Manuel de Suivi Evaluation du Programme National de Lutte contre le
SIDA.. Cotonou, République du Bénin
[31] MIGNONSIN D. et al (1991) Transfusion
sanguine en Côte d'ivoire perspective d'avenir Medecine d'Afrique
noire Vol 30 Num 11
[32] Ministère de la
santé (2011): politique et
stratégies de développement du sous secteur de la transfusion
sanguine 2007-2011.
[33] Ministère de la santé:
Plan national de développement sanitaire 2009-2018
[34] Ministère de la santé,
(2011) Politique et Stratégie de Développement du sous secteur de
la Transfusion Sanguine 2007-2011.
[35] OCDE (2004): Glossaire des principaux
termes relatifs à l'évaluation et la gestion axée sur les
résultats édité par le comité d'aide au
développement. Trousse d'outils de l'administrateur des programmes pour
la planification le suivi et l'évaluation. UNFPA, Mai 2004.
[36] Organisation Mondiale de la Santé
: Actualité Scientifique : environnement macro-économique et
santé (Études de cas dans les pays les plus démunis).
[37] Organisation Mondiale de la
Santé, (2012) : Statistique annuaire mondial de la santé
[38] PNUD, 1997. Suivi Evaluation dans une
perspective de résultats. Manuel pour les responsables de programmes,
BEPS.
[39] PNUD, 2003. Guide du suivi et de
l'évaluation axés sur les résultats.
[40] ROUGER P. LEFEVRE J-J. (2011)
Transfusion sanguin, 4eme édition, Masson,
[41] RAVOLANJARASOA L. (2011)
Sécurité transfusionnelle à Madagascar, évaluation
des pratiques et profil sérologique des donneurs vis-à-vis des
agents pathogènes transmis par le sang, Mémoire de Master en
Médecine tropical, Institut de la francophonie et des maladies
tropicales.
Sites Internet
http://www.unaids.org. (Octobre
2012)
http://www.oecd.org (Novembre 2012)
http://www.acdi-cida.gc.ca
(Janvier 2013)
www.undp.org (Février 2013)
www.beninsante.org (Octobre
2012)
ANNEXES 1
QUESTIONNAIRE
Madame, Monsieur,
Nous faisons une enquête sur la sécurité
transfusionnelle dans la zone sanitaire Tanguiéta. Les résultats
de cette étude permettront de mieux appréhender le rôle
qu'à joué le projet PASTAM ainsi que son impact dans
l'amélioration de la sécurité transfusionnelle au sein des
postes de transfusion et la satisfaction des besoins en demande des produits
sanguins.
Cette étude rentre dans le cadre de la
préparation du Master (DESS) en management des projets. Les
renseignements individuels fournis contenus dans ce questionnaire sont couverts
par le secret statistique et les résultats seront publiés sous
forme d'anonymat. Nous vous prions de répondre avec une
sincérité aux questions suivantes :
A. fiche d'identification de
l'enquêté
|
a-1 Numéro Fiche : /_______/
a-2 Sexe 1-M /__/ 2- F /__/
|
|
a-3 Etat matrimonial
1-Célibataire /__/
2-Marié (e) /__/
3-Veuf/Veuve /__/
4 -Divorcé (e) /__/
5 Autre /__/
(Une seule réponse possible)
|
a-4 Qualification
1-Médecin /__/
2-Infirmier /__/
3- Sage femme /__/
4-Biotechnologiste /__/
5 Aide soignant /__/
(Une seule réponse possible)
|
a-5 Unité de service
1-Laboratoire /__/
2-Médecine /__/
3- Pédiatrie /__/
4-Maternité /__/
5 Chirurgie /__/
6 Soin Intensif /__/
(Une seule réponse possible)
|
2
a-6 Quel est votre âge ?
4
3
1
Moins de 18 ans [18-24ans]
[25ans-34ans] [35ans-44ans]
6
5
[45ans-60ans] + de 60 ans
B- Application des normes et procédures de la
transfusion sanguine
|
b-1 Remplissez-vous des fiches de demande de sang ?
1-Oui
2-Non
|
b-2 Réalisez-vous systématiquement les tests de
compatibilité ?
1-Oui
2-Non
|
|
b-3 Respectez-vous systématiquement la quantité
nécessaire à demander ou à servir?
1-Oui
2-Non
|
b-4 Enregistrez-vous toutes les demandes/cessions de produits
sanguins labiles ?
1-Oui
2-Non
|
|
b-5 Quelle est votre appréciation globale par rapport
à la mis en application des procédures de bonnes pratiques
transfusionnelle ?
1-Contraignant 2- Pas contraignant 3-
Obligatoire 4-Nécessaire
|
b-6 De quelle manière avez-vous été
associé aux différentes étapes de l'amélioration de
la transfusion sanguine au sein de votre service ?
..............................................................................................................................................................................................................................
b-7 Avez-vous entendu parler du projet PASTAM?
1=OUI 2= NON
b -8 Pouvez-vous nous décrire ce qu'a fait PASTAM dans
votre zone ?
1=OUI 2= NON
b-9 si Oui Veuillez nous donner quelques descriptions
..............................................................................................................................................................................................................................
b-10 Comment trouvez-vous la sécurité
transfusionnelle ces trois dernières années ?
1= Peu performant 1 2= performant 3=
très performant
b-11 Appréciation de l'organisation interne de la
transfusion sanguine
1= Moins Organisée 2= Organisée
3= Plus organisée
C-Mobilisation de la population pour le don de
sang
c-1 Avez-vous déjà donné au moins une fois
votre sang?
1=OUI 2= NON
c-2 Si oui, combien de fois avez-vous donné le sang au
cours des deux dernières années ?
|
1
|
0 fois
|
|
2
|
Une fois
|
|
3
|
2 à 3 fois
|
|
4
|
4 à 6 fois
|
|
5
|
+ de 6 fois
|
c-3 Où donnez-vous généralement votre sang
?
1-Dans les collectes fixes (centres de don)
2-Dans une collecte mobile
c-4 Quels types de dons de sang faîtes-vous ?
(Plusieurs réponses possibles)
1-Don bénévole
2-Don parent (Seulement quand un proche parent est malade)
3-Don pré opératoire
c-5 Pourriez-vous citer une campagne pour le don du sang dont
vous vous souvenez ?
1-Oui
2-Non
c-6 Pour vous, le support idéal pour une campagne de
sensibilisation (Trois réponses maximum)
1-La presse locale
2-La presse nationale
3-Des spots à la télévision
4-Des spots au cinéma
6-Des forums sur internet (facebook)
7-Des courriers adressés personnellement
8-Des SMS
9-Autres, précisez :
______________________________________
|
c-7 Etes-vous membre d'une ou plusieurs associations ?
1-Oui
2-Non
|
c-8 Si oui, dans quel(s) domaine(s) ?
1-Culturel Oui Non
2-Sportif Oui Non
3-Humanitaire Oui Non
Autres, Oui Non
Si autres, veuillez préciser .......................
|
D-Qualification biologique des dons
d-1 Quelle est la technique utilisée pour la
qualification biologique des pochettes avant le projet :
1-Sérologie VIH : Méthode standard /___/
Technique Elisa /__/ test rapide/__/
2-Sérologie hépatite B :
Méthode standard /__/ Technique Elisa /__/ test rapide/__/
3-Sérologie hépatite C : Méthode
standard /___/ Technique Elisa /__/ test rapide/__/
4-Sérologie Syphilis : Méthode standard /___/
d-2 Quelle est la technique utilisée pour la
qualification biologique des pochettes après le projet
1-Sérologie VIH : Méthode standard /___/
Technique Elisa /__/ test rapide/__/
2-Sérologie hépatite B :
Méthode standard /__/ Technique Elisa /__/ test rapide/__/
3-Sérologie hépatite C : Méthode
standard /___/ Technique Elisa /__/ test rapide/__/
4-Sérologie Syphilis : Méthode standard /___/
ANNEXES 2
GUIDE D'ENTRETIEN
En direction des acteurs de
la production et de la qualification des produits sanguin
1. Quel a été l'apport du projet
PASTAM ?
1.2 Equipements
..............................................................................................................................................................................................................................
1.3 Organisation
..............................................................................................................................................................................................................................
Réactifs et consommables
................................................................................................................
..............................................................................................................
2. Quel est le coût de qualification d'une
pochette au sein de l'hôpital
|
EXAMENS
|
Coût
|
|
Sérologie VIH
|
|
|
Sérologie Hépatite B
|
|
|
Sérologie hépatite C
|
|
|
Sérologie Syphilis
|
|
3. Sources et provenance du Sang
|
VARIABLES
|
Avant Pastam
|
Pendant Pastam
|
Après Pastam
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Dons bénévoles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dons parents
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autotransfusion
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Quantité des pochettes
prélevées
|
VARIABLES
|
Avant PASTAM
|
AVEC PASTAM
|
APRES PASTAM
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
|
Nombre de pochettes prélevées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de pochettes qualifiées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de pochettes servies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de pochettes rejetées
|
|
|
|
|
|
|
|
5-Existe-il un plan d'action de
la mise en oeuvre des recommandations du projet
Oui /__/
Non /__/
Si oui veuillez compléter ce tableau
|
PLAN D'ACTION (si nécessaire)
|
|
Actions à
suivre
|
Personnes Responsables
|
Ligne du temps
|
Observation
|
|
|
|
|
ANNEXE N°3 : GRILLE D'OBSERVATION
DIRECTE
N° Fiche : /_______/
Date de l'enquête : /_______/ /_______/ /_______/
Service/Unité:..................................................................
I Matériel de qualification de produits sanguins
Conforme
Non conforme
II - Matériel de stockage des produits sanguins
.............................................................................................
III - Procédure de cessions de sang
Test de compatibilité
Oui
Non
Annexe 4 : Localisation de la ZST au
Bénin et dans l'Atacora
Source : EEZS Tanguiéta 2006
TABLE DES MATIERES
|
Sommaire
|
P.VII
|
|
Résumé
|
P.IX
|
|
Abstract
|
P.XI
|
|
Introduction
|
P.1
|
|
Chapitre I : Cadre général de
l'étude
|
P.5
|
|
Section 1 : Contexte et problématique de la
recherche
|
P.5
|
|
Paragraphe 1 : Cadre contextuel de la
recherche
|
P.5
|
|
Paragraphe 2 : Problématique de la
recherche
|
P.6
|
|
Section 2: Objectifs et hypothèses de
recherche
|
P.9
|
|
Paragraphe 1 : Objectif de la recherche
|
P.9
|
|
Paragraphe 2 : Hypothèse de la
recherche
|
P.10
|
|
Chapitre II: Approche théorique de la
recherche
|
P.11
|
|
Section 1: Clarification conceptuelle des mots
clés.
|
P.11
|
|
Paragraphe 1 : Approche conceptuelle de
l'évaluation d'impact
|
P.11
|
|
Paragraphe 2 : Les différents concepts de la
sécurité transfusionnelle
|
P.14
|
|
Section 2: Revue de la littérature
|
P.16
|
|
Paragraphe 1 : Approche et modèle
d'évaluation
|
P. 28
|
|
Paragraphe 2 : Evaluation du système de la
transfusion sanguine dans le temps et dans l'espace
|
P. 29
|
|
Section 3 : Organisation du sous système de
la transfusion sanguine et présentation de PASTAM
|
P. 29
|
|
Paragraphe 1 : Organisation du système de
santé au Bénin
|
P. 29
|
|
Paragraphe 2 : Présentation de
PASTAM
|
P. 31
|
|
CHAPITRE III : Approche méthodologique de la
recherche
|
P. 35
|
|
Section 1 : Du cadre méthodologique à
la collecte des données
|
P. 35
|
|
Paragraphe 1 : Présentation du cadre
d'étude
|
P. 35
|
|
Paragraphe0 2 : Méthode de collecte des
données
|
P.35
|
|
Section 2 : Variables d'analyses et seuil de
décision
|
P. 44
|
|
Paragraphe 1 : Variables et indicateur
d'analyses
|
P.44
|
|
Paragraphe 2 : Seuil de décision pour la
vérification des hypothèses et limites de
l'étude
|
P.47
|
|
CHAPITRE IV : Appréciation de l'impact de
Pastam sur la sécurité transfusionnelle
|
P.49
|
|
Section 1 : Présentation et analyse des
résultats
|
P.49
|
|
Paragraphe 1 : Présentation et analyse des
résultats relatifs au système de sécurisation des produits
sanguins
|
P.49
|
|
Paragraphe 2 : Présentation et analyse des
résultats relatifs à l'organisation interne du PTS
|
P. 49
|
|
Paragraphe 3 : Présentation et analyse des
résultats relatifs à la conservation des techniques de
PASTAM
|
P. 63
|
|
Section 2: Interprétation et vérification
des hypothèses
|
P.64
|
|
Paragraphe 1 : système de sécurisation
des produits sanguins
|
P. 64
|
|
Paragraphe 2 : Organisation interne du
PTS
|
P. 64
|
|
Paragraphe 3 : Conservation et pérennisation
des techniques de PASTAM
|
P. 64
|
|
Section 3 : Observation et suggestion
|
P. 67
|
|
Paragraphe 1 : Observation
|
P. 67
|
|
Paragraphe 2 : Suggestion
|
P. 67
|
|
CONCLUSION
|
P.57
|
|
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
|
P. 59
|
|
ANNEXE 1 : Questionnaire
|
P.64
|
|
ANNEXE 2 : Guide d'entretien
|
P.68
|
|
ANNEXE 3 : Grille d'observation
|
P.69
|
|
ANNEXE 4 : Localisation de la zone
sanitaire
|
P. 70
|
|
Table des matières
|
P. 71
|
|
|

| 


