
1
DEDICACE
A mes parents Barnabé BULATI et Isabelle MASIKA,
auteurs de mon existence et pour les sacrifices qu'ils ont consentis
malgré les vicissitudes de la vie actuelle pour faire de moi ce que je
suis aujourd'hui ;
A mes tantes et oncles : Josée BUANZO et Jeanne AGIKO ;
A mes frères, soeurs, cousins, cousines, neveux et
nièces : Anne Marie KATINA, Rose KATINA, Patrick NZANZU, Dieu merci
MIRENGE, Séraphin, Félicité DEDEBA, Bertrand BOLI,
Abbé Guy René CHERMANI, Solange ALARUKA, Justin BEDELO, Blaise
BAHATI, Trésor LOBINI, Jolie MAVELEO, MAPENZI, Franck N'SIMBA, SHUKURU
MAVE, Judith, Eric TANDEMA, Beata, Daniella et autres ;
Enfin à mes amis et connaissances.

DABA BULATI Trésor Jean Marie
2
REMERCIEMENTS
Le présent mémoire sanctionne nos études
universitaires en Sciences Economiques et de Gestion à
l'Université de Bunia. Sa rédaction répond aux exigences
académiques qui veulent que les étudiants finalistes du second
cycle présentent une dissertation relative aux matières de
spécialisation apprises durant toute la période de formation.
Nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont
apporté leur soutien à sa reprographie. Nos remerciements
s'adressent de prime à bord au Seigneur Dieu le Tout Puissant qui nous a
comblés de sa présence tout au long de notre vie estudiantine
à l'Université de Bunia.
Nos remerciements s'adressent ensuite au Professeur KALONJI
NSENGA Joseph et à l'Assistant RIKRIYO DJOZA Jean Claude, respectivement
Directeur et Encadreur du présent travail pour leur entière et
parfaite disponibilité pour notre cause.
Nous pensons également à tous nos enseignants en
général, qui ont guidé nos pas sur le chemin labyrinthique
de la science, en particulier ceux de la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre
sincère et profonde gratitude.
Sous cette page de remerciements, nous pensons à
l'Assistant UCOUN ZEKPA Jean Claude de l'ISP-Bunia pour sa contribution dans la
reprographie de ce travail.
Il nous parait indispensable de savoir un gré infini
aux familles : Jean Bosco DILE, Jean Chrysostome NDJABU, Jean Claude LOKY, Omer
SAPA et Roland MANDABA de leurs assistances inconditionnelles. Le coeur est le
seul laboratoire de sentiments, la langue est hypocrite !
Et vous amis : Trésor BULATI, Serge ASIMWE ISSAMBA,
GULE TAZOLE, ZAWADI AGO, KASANGAKI, AWINGA Caleb, Patricia NGOLE, David
MBUTYABO et les autres qui échappent à notre mémoire, vos
conseils et vos souhaits n'ont pas été vains.
Aux camarades de lutte, à l'instar de : Papy ANOALITE,
BAHATI LABA, BAHATI GACHINYA, Jean BATCHU, Bellarmin PIGA, MUGISA AMOTI, USE,
Gloire ANKWA, Dave LIBABA, Prudent MAPENDO, Jonas UYERGIU, Anne Marie MONE,
Philo ANGALI, Mimy ASHURA, Chantal KAHWA, Francine KAMWIMA, Patience KOSSO,
Patience ONZIA, Joseph OPANA, qui avez partagé avec nous période
d'abondance et de vaches maigres, vicissitudes et remous académiques,
voici le fruit de la sueur de nos fronts. Nous transitons la
péripétie !
3
ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES
BCC : Banque Centrale du Congo
° C : Degré Celsius
CABMINESU : Cabinet du Ministère de l'Enseignement
Supérieur et Universitaire

CADECO : Caisse Générale d'Epargne et de
Crédit au Congo
CANDIP : Centre d'Animation et de Diffusion Pédagogique
CRP : Centre de Recherches Pédagogiques
CRIDH : Centre de Recherche Interdisciplinaire et des Droits
Humains
CUEB : Centre Universitaire Extension de Bunia
CUIB : Centre Universitaire de l'Ituri à Bunia
EDAP/ISP-BUNIA : Ecole d'Application de l'Institut
Supérieur Pédagogique de Bunia
FSEG : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
FSSPA : Faculté des Sciences Sociales, Politiques et
Administratives
HQ/MONUSCO : Humanitary Quarter/ Mission de l'Organisation des
Nations-Unies pour
Stabilisation au Congo
ISTM/Bunia : Institut Supérieur des Techniques
Médicales de Bunia
ISP/Bunia : Institut Supérieur Pédagogique de
Bunia
Km2 : Kilomètres carrés
N° : Numéro
Op.cit. : Opus Citatum
RDC : République Démocratique du Congo
Union Economique Monétaire de l'Afrique de l'Ouest
Université Libre de Pays de Grands Lacs
Université de Bunia
% : Pourcentage

4
INTRODUCTION GENERALE
1. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question, appelé aussi
l'énoncé du sujet, est l'inventaire indiquant la position du
problème, les motifs pour lesquels le problème méritait
d'être posé, la contribution que compte apporter l'étude
à la science.1
Nous ne pouvons prétendre être le premier
à aborder une telle analyse, lors de nos recherches dans des
bibliothèques, nous avons trouvé quelques travaux similaires avec
le nôtre. Parmi les chercheurs qui ont réalisé des travaux
dans ce domaine, nous citons :
- ULUGA MADI E. « Problématique de taux de
bancarisation dans la Cité de Bunia : cas de la Banque Congolaise et la
Caisse Générale d'Epargne du Congo. De 2006 à 2009
», Mémoire inédit, FSEG, UNIBU, 2010.
Il conclut que le taux de bancarisation était
très faible, car il y avait sous bancarisation pendant toute la
période de son étude, un nombre de comptes en banques qui ne
faisait que diminuer parce qu'il n'y avait pas une augmentation ou
amélioration dans l'évolution des activités d'ouverture
des comptes en banque.
- NDJONDJO P. « Le système bancaire et
monétaire congolais de la RDC est non
seulement étroit mais en crise également
», Mémoire inédit, ULPGL-GOMA, 2006.
Il conclut que le système bancaire de la RDC est
caractérisé actuellement par :
y' L'illiquidité
y' L'insolvabilité
y' Et l'absence de rentabilité au niveau
de la gestion des banques de crédits et de la
plupart des établissements de crédit de la RDC.
- AGOSSOU GANSINHOUNDE J., « Déterminants de la
faible bancarisation dans
l'espace UEMOA », Maîtrise en Finances,
Université Polytechnique du Benin, 2007.
Il conclut que les causes de la faible bancarisation sont
diverses. Ses résultats montrent qu'il y a les facteurs
systémiques tels que le niveau de développement
économique, social et institutionnel qui déterminent
l'environnement global et les facteurs particuliers au secteur bancaire comme
les conditions d'ouverture des comptes, la taille de banque, etc. d'où
il faut non seulement appliquer les mesures correctives à ces deux
facteurs, mais également stimuler la
1 BURA DHENGO, Méthodes de Recherche en
Sciences Sociales, Cours inédit, G2 FSEG, CUEB, 2006.

5
distribution de microcrédits qui paraît
être d'un apport certain pour l'insertion des populations les plus
démunies dans la vie économique.
Quant à notre investigation, elle se démarque
par rapport à nos prédécesseurs en ce sens qu'elle
cherchera à recueillir les opinions des enseignants de l'enseignement
supérieur et universitaire public de Bunia sur la bancarisation de la
paie des agents et fonctionnaires de l'Etat.
2. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL
Elle se réfère généralement
à un ensemble d'éléments ou informations dont la mise en
relation engendre chez un chercheur un écart se traduisant par un effet
de surprise ou de questionnement assez stimulant pour le motiver à faire
une recherche.2
Le secteur bancaire congolais est d'une formation
récente. Tout remonte vers les années 1909 avec la
création de la première banque dénommée la Banque
du Congo Belge, l'actuelle Banque Commerciale du Congo (BCDC).
Par ailleurs, la Cité de Bunia, Chef-lieu de la
sous-région agropastorale de l'Ituri, enregistrait un certain nombre des
institutions bancaires avant les années 1990, notamment la Nouvelle
Banque de Kinshasa, la Banque Commerciale du Zaïre et l'Union
Zaïroise de Banques.
Après les années 90, la dégradation de
l'économie congolaise s'est accentuée, d'abord par les deux
pillages systématiques (1991 et 1993), ensuite par le discours du
Président MOBUTU prônant le multipartisme et enfin les guerres
dites de libération et d'agression où il y a eu la destruction
physique de plusieurs entreprises.
La persistance de la crise dans cette période
postcoloniale a entraîné plusieurs conséquences, notamment
celle de la faillite de ces trois institutions précitées mais
aussi la réduction de la densité bancaire sur toute
l'étendue du territoire national en général et
particulièrement la Cité de Bunia et la difficulté de
paiement de salaire des agents et fonctionnaires de l'Etat à la
banque.
Depuis 1996 jusqu' à ce jour la RDC est toujours en
guerre. La conjugaison de tous ces faits a eu comme difficulté majeure
la non maîtrise de l'effectif du personnel dans le secteur public.
D'où la décision de payer les fonctionnaires et agents du service
public dans leurs postes d'attachement.
2 OTEMIKONGO MANDEFU J., Méthodes de
Recherche en Sciences Sociales, Cours inédit, G2 FSEG, CUEB, 2009,
p34.

6
Plus tard, des soupçons de détournement ont
commencé à peser sur certains responsables des institutions
publiques. La population accusait les responsables d'engager des fictifs,
d'amputation de salaire, etc. Mêmes les autorités de
l'armée congolaise ont été citées par la population
dans ce même ordre d'idée.
C'est ainsi que l'Etat congolais voulant savoir le nombre
exact de son personnel et maîtriser l'enveloppe lui allouée, a
décidé de procéder à la bancarisation. Celle-ci est
le processus qui consiste pour les banques à ouvrir à l'ensemble
de la population (ménages et entreprises) des comptes bancaires
répondant à la fois à l'objectif des banques qui est de se
procurer des ressources indispensables au développement de leur
activité de crédit, et à celui qui, pour les
autorités publiques et monétaires, est de contrôler la
création et les différents flux monétaires.
La présente opération est une nouveauté
à laquelle la Cité de Bunia en particulier n'a pas
échappé en vue de mettre fin à la pratique maffieuse qui
enrichissait les minorités aux frais de la majorité.
Etant étudiant chercheur voulant s'intéresser
spécialement aux enseignants, nos formateurs, les interrogations
suivantes se présentent devant nous :
- Quelles sont les opinions des enseignants d'enseignement
supérieur et universitaire public de Bunia sur la bancarisation de la
paie des agents et fonctionnaires de l'Etat ?
- Cette bancarisation leur permet-elle d'épargner, quels
en sont les avantages et contraintes ? 3. 3. HYPOTHESES DU
TRAVAIL
L'hypothèse est une réponse provisoire à
la question posée, une proposition relative à l'explication d'un
problème ou phénomène admis provisoirement avant
d'être soumis à la vérification ou au contrôle de
l'expérience, c'est'- à-dire une cause provisoire qui explique ce
phénomène.3
Autrement dit, c'est l'énoncé de fait
normalement déduit du modèle théorique qui doit être
soumis à la vérification.
Dans le cadre de ce travail, nous partons des hypothèses
selon lesquelles :
3 OTEMIKONGO MANDEFU J.,
Op.Cit, p. 32.

7
- Il semble que les enseignants d'enseignement
supérieur et universitaire public de Bunia auraient des opinions
positives sur la bancarisation de la paie à cause de l'importance que
présente cette opération.
- Cette bancarisation de la paie ne permettrait pas à
ces derniers d'épargner, ses avantages et contraintes seraient
nombreux.
4. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
Elle désigne l'ensemble de procédés
d'investigations et techniques employées pour arriver à la
connaissance ou à la démonstration de la
vérité.4
4.1. Méthodes
Une méthode est un ensemble d'opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie.5
Ainsi, pour mener à bon port notre étude, nous
allons opter pour certaines méthodes qui, nous l'espérons,
s'avéreront efficaces, à savoir :
- Méthode statistique : consiste à
dégager l'analyse numérique ou l'analyse de données
chiffrées sur base des données générales pour
aboutir à la décision.
Elle nous sera utile pour interpréter les données
afin de prendre une décision.
- Méthode historique : est un type de
théorie qui fait appel à la succession temporaire de faits et
à leur enrichissement pour comprendre et expliquer les
phénomènes sur lesquels porte l'étude.
Elle nous permettra de présenter les historiques des
établissements d'enseignement supérieur et universitaire publics
de Bunia en vue de comprendre leur évolution dans le passé jusqu'
à nos jours.
- Méthode structuro-fonctionnelle : est un
mouvement intellectuel rattaché à l'étude des
organisations. Ses théoriciens souhaitent mettre l'accent d'une part sur
des structures, d'autre part sur la relation de l'individu à
l'organisation, en termes de rôle et de fonction.6 Elle nous
permettra d'étudier la structure, l'organisation et les relations entre
les
personnels de chaque établissement d'enseignement
supérieur et universitaires publics de Bunia.
4 OTEMIKONGO MANDEFU J.,
Op.cit.
5 GRAWITZ M.,
Méthodes de Recherche en Sciences Sociales,
Ed. Dalloz, Paris, 1979, p20.
6 SHOMBA KINYAMBA S.,
Méthodes de Recherche en Sciences Sociales,
5ème Ed. MES,
Kinshasa, 1995.

8
- Méthode inductive .
· est une
méthode qui consiste à partir d'un cas particulier à un
cas général et d'en tirer une conclusion.7
Cette méthode nous permettra de
généraliser les résultats obtenus de notre
échantillon sur l'ensemble de la population.
4.2. Techniques
Elles sont les outils utilisés dans la collecte des
informations (chiffrées ou non) qui devront plus tard être mises
à l'interprétation et l'explication sur l'ensemble de la
population grâce aux méthodes.8
Nous allons utiliser les techniques suivantes :
- Technique documentaire .
· consiste
à chercher des documents en rapport avec le sujet d'étude,
suivant l'objectif visé.
De ce fait, elle nous servira pour récolter les
données écrites dans des bibliothèques, des offices, des
journaux pour soutenir notre recherche.
- Technique d'enquête ouverte et fermée
.
· est un guide préfabriqué, détaillé
et identique pour tous les enquêtés, comportant une série
de questions, concernant un problème sur lequel on attend de
l'enquêté une information.9
Cette technique nous permettra d'élaborer des questions
auxquelles chaque enseignant va répondre librement sur base des
questions que nous lui poserons.
5. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix du sujet est le motif individuel pour lequel le
chercheur est motivé, tandis que l'intérêt du sujet est la
contribution de l'étude à la résolution des
problèmes constatés et apport scientifique.10
En effet, le choix de ce sujet portant sur « opinions des
enseignants d'enseignement supérieur et universitaire public de Bunia
sur la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat »
n'est pas un fait du hasard.
7 KWONKE ALYEGERA J., Initiation à la
Recherche Scientifique, cours inédit, G1 FSEG, CUEB, 2008 -
2009.
8 OTEMIKONGO MANDEFU J., Op.it.
9 Idem.
10 BURA DHENGO, Op.Cit.

9
Il est justifié par la nécessité et le
rôle que joue la banque dans la vie économique d'un pays.
L'encouragement à la paie par la voie bancaire, surtout dans un pays
comme la RDC, est un élément motivationnel d'une croissance
économique du pays dans le cas où cela constituerait le reliquat
pour l'Etat qui sera utilisé pour d'autres fins, c'est-à-dire
financer le projet du gouvernement, ou même améliorer le
bien-être desdits enseignants.
En regard de cette réalité, notre travail
présente un double intérêt :
- Sur le plan scientifique : il
permettra de découvrir les théories importantes en rapport avec
la bancarisation et constituera un document de référence pour
tous les chercheurs intéressés par ce domaine d'investigation
dans le future ;
- Sur le plan pratique : vu
l'importance de l'opération de bancarisation, notre étude
permettra de connaître le vrai effectif des enseignants de l'enseignement
supérieur et universitaire public de Bunia afin de cerner la masse
salariale de l'Etat.
6. DELIMITATION DU SUJET
Vu l'immensité du sujet à traiter, il importe de
le délimiter dans le temps et dans l'espace. Ainsi, ce travail porte sur
« les opinions des enseignants d'enseignement supérieur et
universitaire public de Bunia sur la bancarisation de la paie des agents et
fonctionnaires de l'Etat ».
S'agissant de la délimitation temporelle du travail,
nous avons choisi une période allant de décembre 2012 à
Août 2013, car c'est la période où la bancarisation est
devenue effective en RDC.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion générale,
le présent travail comprend trois chapitres. Le premier chapitre
traitera des considérations générales ; le second chapitre
se consacrera sur le système bancaire congolais ; enfin dans le
troisième chapitre ressortiront la présentation des
données, analyse et interprétation des résultats de la
recherche.
8. DIFFICULTES RENCONTREES
Dans toute oeuvre humaine, les difficultés ne manquent
pas. En effet, lors de notre investigation, nous nous sommes buté
à des multiples difficultés dont quelques unes sont
énumérées ci-dessous :
? Le manque de documents ayant trait direct avec le sujet du
présent travail ;
10
? Le non respect de rendez-vous de la part des responsables
des établissements d'enseignements supérieurs et universitaires
publics de la place ;
? Les difficultés liées aux coupures
intempestives et prolongées de l'électricité dans la
Cité.


11
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES
Le présent chapitre se focalise essentiellement sur la
présentation de la Cité de Bunia où nous allons
développer quelques points qui s'inscrivent dans notre plan, à
savoir : son historique, sa situation géographique, son organisation
administrative, les données géophysiques, son économie ;
ensuite nous allons présenter les différents
établissements d'enseignements supérieur et universitaire publics
de Bunia comme sujet de la présente étude enfin, nous allons
essayer de définir quelques concepts clés de la présente
étude.
1. PRESENTATION DE LA CITE DE BUNIA
1.1. HISTORIQUE DE LA CITE
A l'époque, la Cité de Bunia était un
village du nom de KINDABARA et placée sous l'autorité du Chef
MBUNYA. C'était un milieu où se rencontraient les ressortissants
de différentes communautés de la région faisant des
échanges entre eux.
La Cité de Bunia a trouvé son origine par sa
position physique et économique liée aux caractères
pastoraux et agricoles de la population.
La Cité de Bunia fut créée en 1946 sur un
site du village « BIRA » pour des motifs économiques, pistes
commerciales entre les régions de forêt et de savane. Elle est le
point d'escale des produits en destination des régions minières
de l'Office des Mines d'Or de Kilo - Moto (actuellement, la
Société Minière de Kilo - Moto).
Bunia a connu de fréquents changements de fonctions
administratives au cours de son évolution. Suivant l'Arrêté
N°91/AIMO de la Province Orientale, la Cité de Bunia fut
érigée en centre extra-coutumier à l'époque de la
région de Haut-Zaïre. Cette cité est devenue le Chef-lieu du
Territoire d'Irumu en 1952, celui du District de l'Ituri en 1966.
L'Ordonnance-Loi n° 82-006 du 25 février 1982
portant sur l'organisation territoriale et administrative du Zaïre fait de
Bunia une Entité Administrative Décentralisée, mais
dépourvue de la personnalité juridique. C'est plutôt avec
l'Ordonnance Présidentielle n°87-236 du 29 juin 1987 portant la
création et délimitation des cités dans le Haut-Zaïre
que la Cité de Bunia retrouvera sa forme actuelle.11
11 Ordonnance-Loi n°87-236 du 29/06/1987, codes
larciers vol VI, Tome, 2003, p118.

12
La conception juridique de Bunia a été dynamique
durant le temps. Ainsi, depuis le 25 février 1982, elle devient une
Entité Administrative Décentralisée dotée de la
personnalité juridique par l'Ordonnance - Loi n°009-82 portant sur
l'organisation territoriale, politique et administrative.
La Cité de Bunia est l'une des entités
administratives qui composent le Territoire d'Irumu, dans la Province Orientale
en RDC.
Ainsi, beaucoup d'auteurs ont défini le concept «
Cité ». Dans le cadre de notre travail, il nous paraît utile
de définir une cité comme étant une collectivité
territoriale administrée par un chef de cité, qui a
qualité d'un Administrateur de Territoire Assistant. Elle est reconnue
comme l'une des entités administratives décentralisées en
vertu de l'Ordonnance-Loi N°082/06 du 25 février 1982,
modifiée et complétée par l'Ordonnance-Loi N°026/176
promulguée le 15 novembre 1988 portant sur l'organisation politique et
administrative de la République du Zaïre, à ce moment.
1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE
A 1270 mètres d'altitude, la Cité de Bunia est
entourée de la chaîne de montagnes des Mont-bleus et est
située au Nord de l'équateur à 1°35' de latitude Nord
et de 30°15' de longitude Est. La température moyenne annuelle
varie entre 23° et 28°C.
Sur le plan hydrographique, la Cité de Bunia est
traversée par les rivières NYAMUKAU, NGEZI et SHARI. La
rivière NYAMUKAU se jette dans la rivière NGEZI et NGEZI à
son tour se jette dans la rivière SHARI, où se trouve le barrage
hydroélectrique de BUDANA.
La Cité de Bunia et ses environs possèdent un
sol fertile et un climat tropical humide qui favorise la production des
produits culturaux commercialisés dans des différents
marchés de Bunia. On y trouve également les matières
premières très importantes.
1.3. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
La Cité de Bunia, située au Nord-est de la RDC,
en Territoire d'Irumu dans le District de l'Ituri en Province Orientale, a
été créée en 1946 comme un Centre Extra-Coutumier.
Elle est subdivisée en 12 quartiers, à savoir : Bankoko,
Mudzi-pela, Simbilyabo, Sukisa, Salongo, Nyakasanza, Saïo, Lembabo,
Kindia, Lumumba, Ngezi et le quartier Rwambuzi.

13
Elle couvre une superficie de 575,06 km2. La
Cité de Bunia est limitée au Nord par la Chefferie de BABOA BOKOE
à MIALA, à l'Est par la Chefferie des BAHEMA BANYWAGI, au Sud par
les chefferies des BABOA-BOKOE et BASILI et à l'Ouest par celle de
BAHEMA d'Irumu.
Dirigée par un Chef de Cité et les
différents quartiers par des chefs de quartiers, Bunia est une
Entité Territoriale Décentralisée. Une Entité
Territoriale Décentralisée est une circonscription propre
à l'administration territoriale de l'Etat, distincte de lui et jouissant
d'une certaine autonomie de gestion.
Bunia est aussi le Chef-lieu de District de l'Ituri. Le Bureau
du District se trouve dans la même cité. Le District a à sa
tête un Commissaire de District et le Commissaire chargé des
affaires politiques et de l'administration et l'autre chargé des
finances et du développement.
1.4. DONNEES GEO-PHYSIQUES
V' Végétation
Dans l'ensemble, l'Ituri où se situe Bunia est, du
point de vue botanique, le domaine par excellence de la savane qui, selon les
saisons, est d'un vert tendre ou d'un jaune d'or. Cette savane est
limitée au Sud et à l'Ouest par la forêt équatoriale
et se caractérise par la quasi rareté de la
végétation arbustive.
Actuellement, la Cité de Bunia est dominée par
une végétation artificielle notamment l'eucalyptus. Ce dernier
est le produit de l'homme et se rencontre dans les zones d'habitation. Ce qui
explique une discontinuité du peuplement de cette
végétation.
V' Hydrographie
L'hydrographie de la Cité de Bunia est dominée
par deux rivières, notamment la rivière NGEZI et son affluent la
rivière NYAMUKAU appartenant toutes au bassin du fleuve Congo. NYAMUKAU
charrie les eaux de ses affluents NGUGU, KOLE, RWAMBUZI et NYARUGIMBA dans
NGEZI qui reçoit également les eaux de l'affluent BIGO. NGEZI
draine les eaux de ces rivières dans SHARI qui se jette dans la
rivière ITURI.

14
? Sol
Le District de l'Ituri, faisant partie du monde intertropical,
est entièrement compris dans la zone de latérite
c'est-à-dire du grand groupe du sol qui caractérise les
régions tropicales et subtropicales.
Ainsi, la Cité de Bunia d'une façon
générale est bâtie sur des terrains constitués d'un
sol de granite dont l'altération donne un sol argilo-sablonneux pauvre
en humus.
La variation de la température du sol conduit à
distinguer deux types d'activités de microorganisme : lorsque les
températures sont très élevées, les
bactéries deviennent très actives et inactives dans les
conditions thermiques contraires. La faiblesse des micro-organismes aura pour
conséquence une lente décomposition de la litière et
entraîne une faible teneur en humus de la région.12
1.5. ECONOMIE DE LA CITE DE BUNIA
Bunia est une Cité commerciale regroupant plusieurs
petits commerçants. On y trouve des denrées alimentaires de
toutes espèces, des produits venant de coupe de bois, de la pêche,
de l'élevage, de la chasse et des produits manufacturés.
Les petits commerces des denrées alimentaires de toutes
espèces sont concentrés dans différents marchés
publics organisés par l'administration locale.
Ainsi, nous avons le Marché Central de Bunia qui se
situe au Quartier NGEZI et plusieurs autres petits marchés comme le
marché SAIO qui se situe au Quartier SAIO, le marché YAMBI YAYA
qui se trouve au Quartier LUMUMBA, le marché du Cinquantenaire au
Quartier BANKOKO, le marché Martyre au Quartier LUMUMBA, le
marché de Pacification à KOLOMANI qui se trouve au Quartier
MUDZI-PELA, le marché MUDZI-PELA Centre au Quartier MUDZI-PELA, le
marché KINDIA au Quartier KINDIA, etc.
Les échanges s'effectuent en monnaie locale, le franc
congolais, en dollars américains, quelque fois en euro ou en shillings
ougandais. A part le commerce des produits, on y trouve également le
commerce de services de production et d'exportation des photos et les services
de communication.
12 MBABAZI BEBWA, Facteurs et incidences de
l'érosion dans la Cité de Bunia, Mémoire
inédit, ISP-Bunia, 2008.

13 Arrêté Ministériel
N°157/MINESU/CABMIN/MML/EBK/PK/2010 du 27/09/2010 portant l'autonomisation
de l'Université de Bunia.
15
2. PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE PUBLICS DE BUNIA
2.1. UNIVERSITE DE BUNIA
2.1.1. Localisation
L'Université de Bunia, UNIBU en sigle, se situe au
Centre ville de la Cité de Bunia, au Quartier Lumumba sur le Boulevard
de libération, numéro 26 et son adresse postale est 292 Bunia.
Elle est limitée :
- Au Nord : par la Concession de la Communauté
Hellénique,
- Au Sud : par l'Hôtel Morgan, - A l'Est : par l'Avenue
Ituri et
- A l'Ouest : par le Boulevard de libération.
Située à plus de 700 km au Nord-est du
Kisangani, Chef-lieu de la Province Orientale, l'Université de Bunia
dispose de neuf (9) bâtiments dont quatre grands bâtiments et cinq
petits bâtiments et quatre hangars au sein desquels elle exerce ses
activités.
2.1.2. Historique
L'Université de Bunia telle qu'elle se présente
actuellement est récente. En effet, elle est une Institution d'Etude
Supérieure et Universitaire créée en 1994 par
l'Arrêté Ministériel N°ESU/CABMIN/0133/1994 du 12
janvier 1994 comme Centre Universitaire de l'Ituri à Bunia, CUIB en
sigle, devenu une extension de l'Université de Kisangani « CUEB
» par l'Arrêté Ministériel
N°EDN/CABMIN/ESU/0021/1997 du 04/10/1997, le CUEB a été
érigé en UNIBU par l'Arrêté Ministériel
N°157/MINESU/CABMIN/MML/EBK/PK/2010 du 27/09/2010. C'est depuis 1994 que
l'Université de Bunia fonctionne. Sa création répond aux
principes d'essaimage de l'Enseignement Supérieur et Universitaire
décidés par le gouvernement et appuyés par la
Conférence Nationale Souveraine, en vue de décongestionner les
villes universitaires de fortes concentrations et de porter l'enseignement
universitaire à l'arrière-pays, vu la distance la séparant
des trois anciennes villes universitaires du pays (Kinshasa, Lubumbashi et
Kisangani).13
La création de l'Université de Bunia rencontre
parfaitement la demande toujours croissante en formation de
l'arrière-pays. Elle apparaît, non seulement comme une
réponse à une longue

16
attente mais aussi comme bénéfique à plus
d'un égard. L'engouement observé dans la jeunesse pour la
formation universitaire au sein de cette institution, ainsi que l'effectif
enregistré chaque année, en est une preuve éloquente.
Le District de l'Ituri et sa population peuvent ainsi
bénéficier d'un outil performant de développement
intégré d'épanouissement culturel et scientifique de
diffusion du savoir, de mise au point de nouvelles connaissances par des
recherches solidement axées sur le milieu. Cet épanouissement a
été une manne pour la jeunesse iturienne qui n'avait que
l'Institut Supérieur Pédagogique de Bunia comme une institution
d'enseignement supérieur et universitaire dont les filières de
formation ne correspondaient pas au choix de beaucoup de jeunes.
2.1.3. Fonctionnement
2.1.3.1. Centre Universitaire de l'Ituri à
Bunia
Créé en 1994, son Comité de Gestion a
été désigné par l'Arrêté
Ministériel N°ESU/CABMIN/0135/1994 du 12 janvier 1994. Le
Président, le Vice-président et le Secrétaire permanent du
Conseil d'Administration ont été désignés par
l'Arrêté Ministériel N°ESU/CABMIN/0160/1994 du 12
janvier 1994. Il lui était reconnu l'autonomie de gestion.
Les arrêtés ministériels
N°ESU/CABMIN/0205/1994 du 12 Janvier 1994 et N°ESU/CABMIN/0360/1994
autorisa le CUIB à ouvrir les enseignements suivants :
1. Une année préparatoire avec :
- Propédeutique en sciences humaines et - Une
propédeutique en sciences exactes.
2. La Faculté des sciences humaines avec un premier cycle
de graduat en : - Sciences sociales,
- Sciences économiques et
- Lettre.
3. La faculté des sciences exactes avec un premier cycle
de graduat en : - Sciences biomédicales conduisant à la
médecine
- Sciences agronomiques.
Signalons qu'au départ CUIB a connu des sérieux
problèmes quant à son démarrage et son organisation ; qui
étaient liés au manque de bâtiments, des enseignants et au
nombre réduit des étudiants.

C'est ainsi que par l'Arrêté Ministériel
du 27 septembre 2010, le CUEB a changé à l'Université de
Bunia, UNIBU en sigle.
17
C'est ainsi que par l'Arrêté Ministériel
numéro précité portant ouverture des extensions de
certains établissements supérieurs et universitaires, le CUIB est
devenu « Centre Universitaire Extension de Bunia », CUEB en sigle.
2.1.3.2. Centre Universitaire Extension de
Bunia
Né pendant la deuxième république, le
CUEB a connu plusieurs problèmes dont les rebellions armées
conduites par l'Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo, AFDL en sigle et les conflits interethniques qui
ont handicapé son bon fonctionnement. Ce centre était régi
par les textes légaux et réglementaires de l'ESU et, a la
même mission que toutes les universités du pays. Son Comité
de Gestion était désigné par l'article 5 de
l'Arrêté ministériel N°EDN/CABMIN/ESU/0021/1997 du 04
octobre 1997, qui disposa que les organes du centre universitaire qui sont : le
Conseil du Centre, le Comité de Gestion, le Directeur du Centre, le
Conseil de Facultés et les Conseils des Départements. Au CUEB
jusqu' à 2010, les Conseils des Départements n'existaient pas.
Le CUEB à sa création n'a pas
dérobé à la mission universitaire dévolue aux
universités de par le monde c'est-à-dire assurer la formation des
cadres de conception dans le domaine le plus divers de la vie humaine. Ainsi
donc l'arrêté ministériel N°EDN/CABMIN/ESU/0021/1997
du 04 octobre 1997, autorisa le CUEB à organiser les enseignements
ci-après :
1. Faculté de droit : cycle de graduat et de licence,
2. Faculté des sciences économiques et de gestion
: cycles de graduat et de licence,
3. Faculté des sciences agronomiques : cycle de
graduat,
4. Faculté des sciences sociales, politiques et
administratives : cycle de graduat et de licence,
5. Faculté de médecine, avec ses sections :
- Le département des santés publiques (cycle de
graduat)
- Le département des techniques médicales (cycle de
graduat).
Le CUEB, dans son fonctionnement, a connu beaucoup de
difficultés. Son encadrement pédagogique, administratif et
financier par l'Université de Kisangani lui causait un certain retard
dans l'organisation académique, scientifique et administrative de ses
activités.
18
2.1.3.3. Université de Bunia
Devenue autonome, fonctionnant avec une autonomie
pédagogique, administrative et financière, l'UNIBU dispose des
organes suivants : le Conseil de l'Université, le Comité de
Gestion, le Recteur, le Conseil des Facultés et les Conseils des
Départements.
L'UNIBU organise les enseignements suivants :
1.

Faculté de droit : cycle de graduat et de licence,
2. Faculté des sciences économiques et de
gestion : cycle de graduat et de licence et le cycle de graduat en
Département des Etudes en Sciences Commerciales et Financières,
DESCOFIN en sigle.
3. Faculté des sciences agronomiques : cycle de
graduat et de licence (ingéniorat),
4. Faculté des sciences sociales, politiques et
administratives : cycle de graduat et de licence en sciences politiques et
administratives et en relation internationale,
5. Faculté de médecine : cycle de graduat et de
licence (doctorat).

RELATIONS PUBLIQUES
ADMINISTRAT DU BUDGET
SEC. AB
FINANCES
COMPTAB.
TRESOR.
B U DG ET &
CONTROLE
ACHAT & APPRO
Source : Bureau Personnel de l'UNIBU
APPARITORAT GENERAL
CRIDH
SEC. GEN. ACAD.
INSCRIPTIONS
ASS. SEC. GEN. ACAD.
FACULTES
BIBLIOTHEQUES
JARDINAGE
PERSONNEL
TRANSPORT
PATRIMOINE
MAINTEN.
SEC. GEN. ADMIN.
INFORMAT.
GARD&SECUR
ASS. SEC. SGAD
OEUVR ESTUD .
PARA-ACAD.
19
2.1.4. Organigramme de l'Université de Bunia
CONSEIL DE L'UNIVERSITE
COMITE DE GESTION
RECTEUR
CABINET DU RECTEUR

Ainsi, pour mieux cerner ce problème du site de
l'ISP/Bunia, passons à l'historique de celui-ci.
20
2.1.5. Objectifs et missions
En tant qu'institution publique qui s'occupe de l'enseignement
supérieur et universitaire, l'Université de Bunia a comme
objectifs de :
- Former les cadres universitaires qualifiés capables de
savoir-faire et du savoir-être,
- Organiser des recherches scientifiques fondamentales et
opérationnelles pour le
développement de tout l'homme,
Elle a comme missions de :
- Donner l'enseignement universitaire de haut niveau,
- Organiser des recherches fondamentales et appliquées
ainsi que de favoriser le
développement intégré.
2.2. INSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE DE BUNIA
2.2.1. Localisation
L'Institut Supérieur Pédagogique de Bunia,
ISP/Bunia en sigle, est situé dans la Cité de Bunia et plus
précisément dans le Quartier Mudzi-pela, à environ 2 km et
demi au Nord du Centre ville de la Cité qui lui porte son nom. Sa
boîte postale est 340.
Il a comme limites :
- Au Nord : la Procure de missions du Diocèse de Bunia,
- Au Sud : la rivière Ngezi,
- A l'Est : l'embranchement routier allant du grand pont de la
rivière Ngezi et qui
débouche sur la principale au niveau du Grand
Séminaire Saint Cyprien de Bunia.
- A l'Ouest : la route de l'Hôpital Général
de Référence de Bunia.
Notons toutefois que, la délimitation de l'ISP/Bunia
pose certains problèmes dus à sa création. Au fait,
l'ISP/Bunia, à ses origines, fut l'oeuvre de la Paroisse Catholique de
Mudzi-maria. Ainsi, son site actuel lui fut concédé par ladite
Paroisse dans son vaste domaine de Mudzi-pela.

21
2.2.2. Historique
L'Institut Supérieur Pédagogique de Bunia,
ISP/Bunia en sigle, a été fondé sous l'agréation de
principe EDN/SR/02/1406/SG/3042 du 02 janvier 1968 pour former des cadres
nationaux indispensables au bon fonctionnement des écoles secondaires de
la sous-région de l'Ituri.
Parler de l'ISP/Bunia sans parler de l'Ecole Normale Moyenne
de Bunia serait non sens, car celle-ci est à l'origine du premier. Dans
les lignes qui suivent, nous essayerons de montrer comment l'ISP/Bunia est
passé de l'Ecole Normale Moyenne à sa forme actuelle.
En effet, l'Ecole Moyenne avait ouvert ses portes le 07
octobre 1968 avec un effectif de 25 étudiants répartis dans deux
options : Français-culture Africaine et Mathématique-technologie
et son premier Directeur fut le Révérend Père JAN PICKERY.
A ses débuts, elle fonctionnait provisoirement dans les bâtiments
de l'actuel Institut UJIO WA HERI.
En 1969, ses effectifs connaissaient une légère
augmentation. Ils passèrent de 25 en 1968 à une soixantaine
répartis en cinq auditoires (section préparatoire, premier et
deuxième année de graduat pour chacune de deux sections
déjà créées). En outre, cette même
année, elle bénéficiera de l'appui financier de l'USAID,
à savoir l'Agence Américaine pour le Développement
International ainsi que de l'intervention du Père PAILLET (Inspecteur de
l'Enseignement Catholique en Ituri), ce qui permettra la construction de
nouveaux bâtiments propres à l'Ecole Normale Moyenne qui furent
opérationnels en octobre 1970.
Le 6 août 1971, l'Ecole Normale Moyenne, qui
lançait cette année-là ses 15 premiers gradués sur
le marché de l'emploi, fut intégrée à
l'Université Nationale du Zaïre, UNAZA en sigle, et devient
désormais par l'ordonnance N°71/075, l'ISP/Bunia.14
En octobre 1972, deux autres options seront ouvertes :
Biologie-Chimie et Géographie-Histoire. Mais en octobre 1980 cette
dernière fut scindée en deux options autonomes d'une de l'autre.
Il s'agit des options Géographie-Science Naturelle et Histoire-Science
Sociale.
En 1973, dans le cadre général des ouvertures
des écoles secondaires des Instituts Supérieurs
Pédagogiques au Zaïre (à l'époque), le Comité
de Gestion de l'ISP/Bunia prit la décision de créer la Section
d'Application de l'ISP/Bunia, en son sein : il s'agissait alors de
14 BURA PULUNYO, 10ème
Anniversaire de l'ISP-Bunia, Presse du CANDIP/ISP-Bunia,
ISP-Bunia, Juillet 1987.

22
l'Institut d'Application de l'ISP/Bunia qui fut dirigé
au début par Monsieur DEWAEGHENEIRE, Ancien Directeur
Général du CANDIP.
Le 14 janvier 1974, fut mis sur pied le projet CANDIP. Sa
réalisation était possible que grâce à l'appui moral
et financier du Comité de Gestion de l'ISP/Bunia d'une part et d'autre
part à l'approbation verbale et encouragement du citoyen MABOLIA,
Commissaire d'Etat à l'Education Nationale. Durant plus d'une
année, le centre n'a commencé qu'avec un personnel très
réduit qui bénéficiait du concours du Directeur de
l'EDAP.ISP-Bunia.
En mars 1975, le Commissaire d'Etat permettait alors de
présenter une embauche de statut et officialisait le CANDIP.
Dans sa forme actuelle, l'ISP/Bunia organise cinq sections et
un Centre de Recherche Interdisciplinaire (CRI en sigle), outre celles
précitées, à savoir :
1. Section Lettres et Sciences Humaines :
- Anglais Culture Africaine
- Sciences Commerciales et Administratives
- Français-Langue Africaine
- Français-Latin et Histoire-Sciences Sociales et Gestion
du Patrimoine
2. Section Groupe Scolaire :
- Ecole Maternelle - Ecole Primaire
- Ecole Secondaire
3. Section d'Orientation et de Guidance (COG en sigle).
2.2.3. Missions
L'ISP-Bunia s'assigne comme missions suivantes :
- De pourvoir le pays en fonction de ses besoins en
enseignants de très haut niveau de
formation générale et spécialisée,
aux qualités morales et pédagogiques éprouvées ; -
De stimuler chez le futur enseignant une prise de conscience de son rôle
d'encadreur
politique, de la noblesse de sa mission et de la
dignité de sa personne ;
- D'organiser la recherche dans le domaine de la
pédagogie en vue de découvrir les méthodes susceptibles
d'améliorer la qualité de l'enseignement primaire et secondaire
;
23
- De vulgariser les résultats de ces recherches par la
rédaction et la diffusion des manuels scolaires adaptés à
ces deux niveaux d'enseignement.

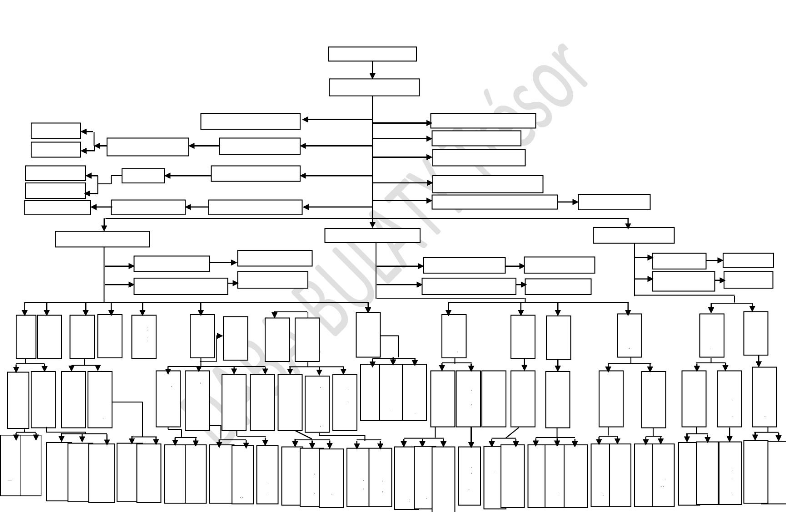
24
CB GESTION
CD Gest Académ.
Dir Sc Acad
Source : Direction du
Personnel/ISP-Bunia, Liste déclarative du Personnel Actif de
l'ISP-Bunia, mise en jour le 13/07/2013.
CB ENS PROGR.
CB de Coopération
CD RELATION
CB Sécurité
CD PR INF
CD Inscript&Contr.
CB Garde
COG
INSCRIPTIONS
SECRET. GENERAL ACAD.
CD Plan& Stat.
CB Contr. Scol.
D ir Para-Acad
CD S pot&Act.Cu lt
CB Arch.&Di p l.
Sect/CANDIP
CD Garde et Sécurité
CD de Coopération
CB Actv. S port.
CD RP PI
Bibliothèque
COORD SCES ACAD. (DCS)
ASS. DU SGA (CD)
CB Activ. Cultu.
Dép Franc L.A.
Opt. Fr. Lat.
Opt. Fr. Lang Afr.
Dép. Hist. SS et GP
Sect Sc. Hum.
Chef Sces Contentieux (CD)
Direction de Coopération
Opt. Hist. Sce Soc.
Dir Relations Publiques
Dr. Garde et Sécurité
Dép. Angl. C. A.
A p pa rito ra t
Opt. Hist Gest. Pat
SECRETARIAT (CB)
SECRETAIRE (CB)
Dép. Com&Adm.
Opt. Ang. Cult. Afr.
2.2.4. Organigramme de l'Institut Supérieur
Pédagogique de Bunia
A p pa ri to rat
Dép. C-Phys&Bio
Opt. Bio-Chi m.
Sect Sc. Exact
Opt. Chimie-Ph.
Dép. M-P et M-Inf
Opt. Bio logie
CONSEIL DE L'INSTITUT
SECRET. GENERAL ADM.
Dép. G éo&G.E.
DIRECTION GENERALE
Opt. Math-phys.
SectGr. Scol
I DA P
Opt. Math-Info .
E cole Prim aire
CB Gest et Cont Eff
Ecole Maternelle
CB Dossiers et Arch.
ASS DU SG ADM (CD)
COORD SCES ADM (DCS)
CD Gest du Pers.
CB Pesntion et Rente
DIRECTEUR DE CABINET (CD)
SECRETARIAT&INFORMAT (CB)
ASS/Q. ADMINISTR (CD)
COORDO DES SCES DE LA DG (DCS)
ASS/Q. ACADEM (CD)
Dir. Perso nnel
CD Rému nération
CB Veérif &Paie
CD I NFO RMAT.
CB Santé
CB Aff. Soc.et Cant.
CD Aff. Sociales
Dir. Aff. Soc.
SECRETARIAT (CB)
SECRETAIRE (CB)
CB Intern &Extern.
CB Bourses Etud.
CD Int. Et Ext.
Dir Oeuvr. Est
CBO Estid.
SECRETARIAT (CB)
CB M ainte nance
ADMIN. DU BUDGET
CD Entr. Et Maint.
CB Entretien
Dir. Patrim.
CB Intendance
CD Gest. Biens
CB Achat
Coord Sces Fin
Ass de l'AB
CB Trésorerie
CD
Très. Com p
CB Co m ptab ilité
Dir. Des Fin.
CB Unités de prod.
CD Unités P rod.
Secret. (CB)
Secret (CB)
Dir. Budget
CB Ordo n na ncem.
Division U n ique
CB Tenue Doc .

25
2.3. INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MEDICALES DE
BUNIA
2.3.1. Localisation
L'Institut Supérieur des Techniques Médicales de
Bunia fonctionne dans le bâtiment de Laboratoire Médical de
Référence de l'Hôpital Général de
Référence de Bunia implanté dans le Quartier Mudzi-pela,
Sous-quartier Bigo III.
Mudzi-pela, quant à lui, est séparé de
quartiers voisins par des limites naturelles : la rivière Bigo à
l'Ouest forma avec la rivière Kabazo au Nord la limite Nord-ouest ; la
rivière Ngezi, à l'Est, forme sa limite avec le Quartier
Simbilyabo et au Sud avec le Quartier Bankoko.
2.3.2. Historique
L'ISTM/Bunia a ouvert ses portes l'année
académique 2004 - 2005 au sein de Centre Universitaire Extension de
Bunia, en sigle CUEB.
Demandé par la population suite au déplacement
de sites de l'Institut des Techniques Médicales/Nyakunde à Beni
(Nord Kivu) et l'ISP/Bunia à Aru, l'ISTM fut créé par le
Gouverneur de la Province de l'Ituri et Recteur du CUEB comme un ISTM/CUEB qui
fonctionnera au sein de la Faculté de Médecine du CUEB
jusqu'à 2009 - 2010.
En 2010 - 2011, cet ISTM/CUEB, par la volonté de son
Excellence Monsieur le Ministre de l'ESU est devenu ISTM/Bunia comme une
Institution Supérieure Publique autonome par l'Arrêté
Ministériel N°208/MINESU/CABMIN/ML/CB/RB/2010 du 29/11/2011.
La notification de la création et de la prise en charge
par le trésor public a été faite par Madame le
Secrétaire Général le 22 février 2011 par la note
N° MINESU/SG/18/01/0292/2011.15
15 Archives de la Direction
Générale/ISTM-Bunia.

26
2.3.3. Fonctionnement
A l'instar d'autres Institutions Supérieures
Techniques, l'ISTM/Bunia a reçu la noble mission stipulée dans la
loi-cadre N°86/005 du 22 septembre 1986 de l'Enseignement National
à l'article 28 :
- De former des cadres spécialisés dans le
domaine des sciences, des techniques, des arts et métiers ;
- D'organiser la recherche scientifique en vue de l'adaptation
des techniques et technologies nouvelles aux conditions spécifiques du
pays ;
- D'encourager la promotion des arts et métier.
Par ailleurs, l'Institut Supérieur des Techniques
Médicales de Bunia organise les enseignements suivants :
a. Cycle de graduat :
V' Techniques de laboratoire
V' Sciences infirmières :
- Orientation accoucheuse
- Orientation hospitalière
- Orientation pédiatrique
V' Santé Publique (communautaire)
b. Cycle de licence : V' Santé Publique
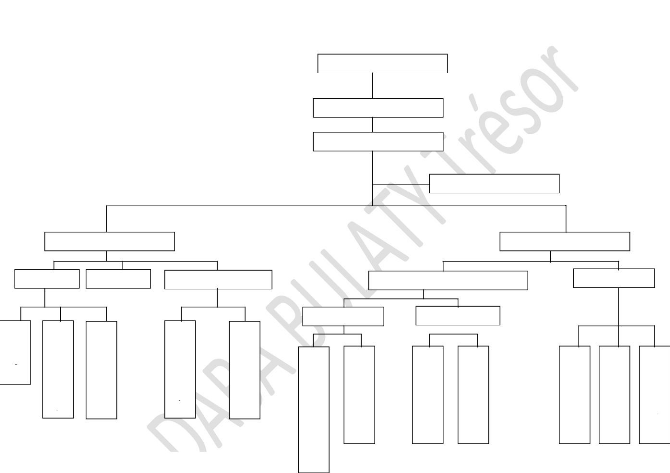
27
2.3.4. Organigramme de l'Institut Supérieur des
Techniques Médicales de Bunia
CONSEIL DE L'INSTITUT
COMITE DE GESTION
DIRECTION GENERALE
DIRECTEUR DU CABINET
SEC. GEN. ACADEM.
SEC. GEN. ADMINISTR.
SECTION
FINANCES
BIBLIOTH.
SERVICES ACADEM.
PERSONNEL & PATRIMOINE
PERSONNEL
PATRIMOINE
LABO
INSCRIPTIONS
SANTE PUBLIQUE
APPARITORAT
SOINS INFIRMIERS
CAISSE
GESTION
BUDGET
ACHAT
MAINTENANCE
COMPTABILITE
Source : Bureau Sec.
Général Administratif
DOSSIERS DU PERSONNEL

28
3. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE
Le parcours de ce que nous avons fait jusque là sur
notre travail « Opinions des enseignants d'enseignement
supérieur et universitaire public de Bunia sur la bancarisation de la
paie des agents et fonctionnaires de l'Etat ; nous jugeons
impérieux d'énoncer quelques concepts que nous trouvons
utiles.
3.1. Opinions
Une opinion est une réaction verbale ou verbalisable,
comportant un jugement sur une situation prêtant à
discussion.16
Partant de cette définition, l'opinion est un accord
avec une formule nuancée qui, sur une question déterminée,
à un moment donné, reçoit l'adhésion sans
réserve d'un sujet.
Par conséquent, si la question déterminée
se trouve être changée dans sa formulation ou dans son contexte
social, l'individu à qui l'on pose la question n'y répondra pas
exactement de la même façon.
En outre, on pose une question par référence
à une situation donnée et en un moment donné et par
définition les situations historiques changent, et le moment change
constamment. Il est donc normal de changer d'opinion en fonction de
l'évolution de la situation extérieure.
Eu égard de ce qui précède, nous allons
présenter le concept opinion sous deux facettes, à savoir : les
opinions individuelles et les opinions publiques ou collectives.
- Opinions individuelles : sont
celles émises par une personne considérée dans son
individualité et17
- Opinions publiques : est
l'ensemble d'opinions individuelles semblables sur un sujet
d'intérêt général et rassemblant une portion
significative des membres de la communauté. L'influence de l'opinion
dépend du nombre, du dynamisme, de la conscience qu'ont les individus
qui la composent et de la façon dont ils les extériorisent se
conformant à la nature du thème et de la force des
opposants.18
16 GRAWITZ M. Lexique des Sciences Sociales,
8ème Ed. DALLOZ, Paris, 2007.
17 PATRICK CHAMPAGNE, Faire l'opinion in Le
nouveau jeu politique, Ed. De Minuit, Paris, 1990.
18 Dictionnaire le Larousse, Grand format, Ed.
Larousse, Paris, 2001.

29
3.2. Enseignant
Le mot « enseignant » vient du verbe «
enseigner » qui signifie « faire acquérir la connaissance ou
la pratique d'une science, d'un art, etc. ».19
De ce fait, un enseignant est une personne qui enseigne une
discipline, qui donne une leçon. Synonyme de : maître,
instituteur, pédagogue, précepteur, instructeur et
professeur.20
3.3. Bancarisation
La notion de bancarisation se rencontre de plus en plus,
depuis la dernière guerre mondiale, dans la littérature
économique. Bien que les économistes aient songé les
premiers, semble-t-il, à faire usage de cette notion, on entend encore
une unanimité dans la définition de ce terme.
A ce propos, PIROU et CLERC définissent la
bancarisation en se référant au néologisme qui
désignait la proportion de ménages utilisant les services d'une
banque, notamment en y ouvrant des comptes à vue, le paiement par
chèque, virement ou carte se substituant alors au paiement en argent
liquide. Lorsque la bancarisation augmente ou progresse, le pouvoir des banques
augmente puis qu'elles sont à l'origine d'une proportion croissante des
paiements effectués dans l'économie.
Par ailleurs, GLOUKOVIEZOFF définit la bancarisation
comme une proportion de la population titulaire d'un compte en banque. Elle est
mesurée par un indicateur appelé taux de bancarisation. Ce
dernier traduit le niveau de pénétration des services bancaires
et financiers dans le pays ou la région concernée.
Le petit Larousse illustré définit la
bancarisation comme étant une tendance des banques à influencer
la vie des ménages en leur permettant d'ouvrir des comptes, drainant
ainsi de multiples ressources favorisant la vie économique.
De ce fait, on peut définir la bancarisation comme un
processus consistant, pour les banques, à ouvrir à l'ensemble de
la population (ménages, entreprises) des comptes bancaires. Donc une
population bancarisée à 70% signifie que les 30% restant n'ont
pas accès au service
19Dictionnaire le Larousse, Op.cit. 20
Idem.
30

bancaire. C'est donc une caractéristique qui traduit le
niveau du développement d'un pays. Plus un pays est
développé, plus il sera bancarisé.
3.4. Salaire
Le salaire est une rémunération en argent ou en
nature, contrepartie du travail fourni par un salarié. Son montant et
les conditions de travail dépendent d'un minimum légal, des
conventions collectives, d'accord et de pratiques.21
3.5. Agent de l'Etat
Un agent de l'Etat est une personne chargée de
gérer, d'administrer pour le compte de l'Etat.22
3.6. Fonctionnaire de l'Etat
Un fonctionnaire de l'Etat est une personne qui travaille dans
une administration publique de l'Etat.23
21 GRAWITZ M., Op.Cit.
22 Dictionnaire Larousse, petit format, Ed. Larousse,
Paris, 2012.
23 Idem.

24 MABI MULUMBA, Les Banques congolaises face
aux mutations structurelles de l'économie zaïroise, Ed. CRP et
IRES, Kinshasa, 1983, p 15-18.
31
CHAPITRE DEUX : SYSTEME BANCAIRE CONGOLAIS
Dans ce deuxième chapitre, nous allons parler de : la
présentation du système bancaire congolais en
général, son historique, son organisation, son fonctionnement et
faire un aperçu général de ce système sur le plan
national et local. Nous allons aussi tabler sur les causes de sa
fragilité et sa place dans l'économie congolaise.
2.1. HISTORIQUE
Le système bancaire congolais tel qu'il se
présente à l'heure actuelle est de formation récente. Il
est en évolution et se complète au fur et à mesure
qu'apparaissent de nouvelles exigences du développement du pays. C'est
pourquoi, il faut suivre les étapes de son évolution pour mieux
cerner ses particularités.
En effet, avant l'indépendance du pays, il existait une
dizaine de banques dont la première à avoir vu le jour est la
Banque du Congo Belge, qui était une filiale de la Banque de la
Société Générale de Belgique créée en
1909. Elle remplissait son rôle originel de banque de dépôts
et celui de banque d'émission, privilège dont elle fut investie
le 7 Juillet 1911.24 Le 10 Août 1911, naissait la Banque
Commerciale du Congo, la Standard Bank of South Africa en 1911, le
Crédit Général du Congo en 1920, l'Union Zaïroise de
Banque en remplacement de la Banque Belge d'Afrique en 1971, la Banco National
Ultramarino en 1919, l'Union du Crédit d'Elisabethville en 1928, la
Société Congolaise de Banque en 1947 devenue Banque du Peuple
depuis que le Congo est devenu Zaïre, la Banque Congolaise pour
l'Industrie, le Commerce et l'Agriculture en Octobre 1950 ; la Banque Nationale
pour le Commerce et l'Industrie (Paris) en Mai 1951 ; le Crédit
Congolais ouvrait ses portes le 28 Septembre 1951 ; la Krediet bank
s'installait au pays le 25 Septembre 1952 et enfin la Banque de Paris et des
Pays-Bas (Société française) ouvrait ses guichets à
Kinshasa, en Juillet 1954 et fut la dernière banque à s'installer
au pays avant 1960, année de l'indépendance.
Après l'indépendance, il a fallu attendre 10 ans
pour enregistrer l'implantation de nouvelles banques, plus exactement en
Décembre 1969 avec la création de la Banque de Kinshasa qui est
d'initiative des nationaux. En Avril 1970, la Banque Internationale pour
l'Afrique au Congo, filiale de la Banque Internationale pour l'Afrique
Occidentale voit le jour ; la First City Bank ouvre ses portes le
1er Juin 1971 et deux ans plus tard c'est le tour de

32
la Grindlay Bank (Mars 1973) ; la Banque de Crédit
Agricole en 1982 ; la Banque à la Confiance d'Or en 1983 ; dix ans
après la Banque Congolaise (1993) ; la Stanbic Bank Congo en 1994 ;
l'African Trade Bank en 1994 ; la Banque Internationale de Crédit en
2001 avant de voir apparaître les banques comme : la Rawji bank, la
Procrédit Bank Congo, Afriland First Bank Congo Democratic, la Trust
Merchant Bank et d'autres au courant de deux dernières
décennies.
Dès lors, on assiste à une multiplication
d'acteurs, source de concurrence et d'innovation qui ne peut que stimuler un
système bancaire que l'Association des Banques Congolaises juge encore
peu profond.25
2.2. PRESENTATION
La RDC, où sévissent des guerres marquées
par des désordres civils, connaît une inflation vertigineuse
(hyperinflation) et des crises économiques, a rencontré des
difficultés et se confronte encore à bien d'autres obstacles
sérieux (insécurité, corruption, mauvaise gouvernance,...
par exemple), mais il accomplit tout de même des progrès non
négligeables.
Par exemple, sur le plan économique, l'inflation semble
être maîtrisée et sur le plan politique, les deux
élections présidentielles démocratiques se sont tenues
respectivement en 2006 et en 2011. Des réformes économiques ont
été ainsi initiées dans différents secteurs de
l'économie y compris le secteur financier, lesquelles réformes
ont permis au gouvernement et à la BCC de réaliser des
progrès remarquables notamment : l'assainissement du secteur bancaire et
l'amorce de la restructuration de la BCC.26
Alors que dans un pays où moins de 10% de la population
a accès à un compte bancaire, l'activité des banques reste
concentrée sur le secteur relativement minier de l'Etat, des entreprises
et certains particuliers. Raison pour laquelle, le pouvoir public cherche
à assainir et accroître l'indépendance de la BCC, à
poursuivre l'élaboration et la mise en place de la législation et
réglementation afférentes aux micro-finances, aux renforcements
de la surveillance des secteurs bancaires et de la micro-finance.
25 ACB, La
crise financière et les banques congolaises,
conférence Institut des Réviseurs Comptables,
Kinshasa-BCC, 4 novembre 2008.
26 ISERN J et Alli,
Diagnostic du cadre réglementaire et politique sur
accès aux services financiers en RDC, CGAP, Avril,
2007.

27 KUKUNGAMA KUMBIKUMBI E-B, Gestion des
Institutions Financières Congolaises, Cours inédit, L1
GF-FSEG, UNIBU, 2012.
33
Il reste néanmoins de nombreux obstacles à la
création d'un secteur financier viable et rentable qui offre un
accès élargi aux services financiers et, nous cherchons à
recueillir les opinions des enseignants de l'enseignement supérieur et
universitaire public de Bunia sur la bancarisation de la paie des agents et
fonctionnaires de l'Etat à travers ce système.
2.3. APERCU GENERAL
Avec l'avènement de la troisième
république, le secteur bancaire congolais a connu une traversée
dans le désert. Malgré le ralentissement de l'activité
économique observé en fin 2008 suit à l'effondrement de la
demande internationale, ses principaux groupes bancaires ont été
bons, voire excellents.
En effet, leurs arrivées restructurent le paysage
économique congolais autour de deux catégories d'acteurs : les
« Anciens », qui sont les établissements qui ont vécu
le haut et le bas de l'économie congolaise et les « Nouveaux
», vecteurs de nouvelles dynamiques sectorielles. Dans le premier groupe,
on retrouve la BCDC, présente depuis 1909 en RDC et les banques
opérant au pays depuis au moins trois décennies telles que
Citigroup, la Banque Congolaise, la BIAC ou la Stanbic Bank
Congo.27
Du côté des nouveaux, on retrouve des acteurs en
quête de diversification comme la RawBank (filiale du groupe Rawji), la
TMB, des banques à vocations panafricaines (Ecobank, Afriland, Fibank)
ou celles ciblant des clientèles souvent marginalisées par les
banques traditionnelles comme les Petites et Moyennes Entreprises ou la classe
moyenne (Advans Bank ou ProCredit).
D'où le système bancaire congolais revient de
loin. Il a traversé des périodes d'hyperinflation qui ont
érodé les actifs bancaires (année 1990) et réduit
le réseau d'exploitation. Les banques nouvelles ont, quant à
elles, beaucoup de chemins à parcourir pour se faire une place sur le
marché dominé par des anciennes pendant des années.
Dans la Cité de Bunia particulièrement, il ya
plus de trois décennies, où on comptait trois banques
commerciales (Nouvelle Banque de Kinshasa, l'Union Zaïroise de Banques et
la Banque Commerciale du Zaïre) implantées dans le milieu et cela
jusqu'aux années 2009,
34
hormis la BCC et la CADECO. Aujourd'hui, elle en compte six en
activité, une en liquidation forcée, une fermée et une qui
sera opérationnelle bientôt (voir le tableau ci-dessous).

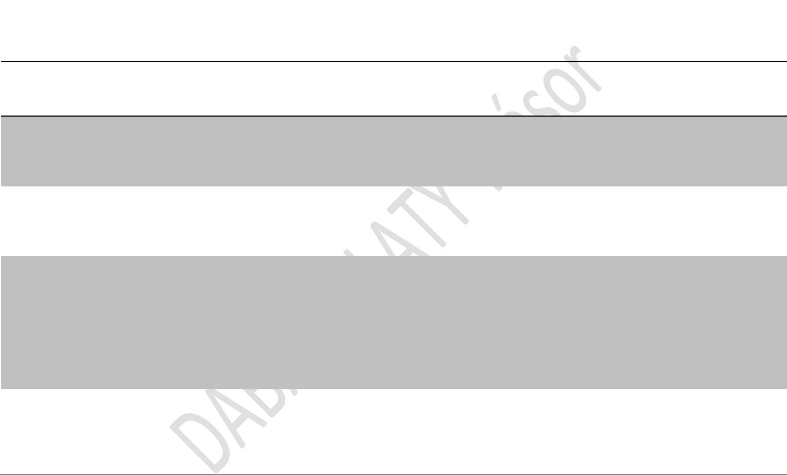
Western union En activité
1997 Kinshasa En diagonal de la
SONAS/Bunia
MoneyGram En activité
13/6/2011 Kinshasa En face de la Zone
OPS
35
Tableau n° I : Liste des banques commerciales de
Bunia agréées par la BCC
|
N°
|
Raison sociale
|
Sigle
|
Autorisation de
fonctionnement
|
Année de
création
|
|
1
|
Banque
Commerciale du
Congo
|
BCDC
|
-
|
10/08/1911
|
|
2
|
Banque
Internationale de Crédit
|
BIC
|
Lettre Gouv.
n°94/035 du
6/04/1994
|
-
|
|
3
|
RawBank
|
-
|
Ordonnance
Prés. Lettre
Gouv. n°02954
du
18/5/2001
Décret prés
n°40/2001 du
|
17/05/2001
|
8/08/2001
Année
d'installation
Observation
Siège social Localisation Réseau de
transfert
4 First
International Bank
FiBank Lettre
Gouv./D.14/ n°001319 du
28/9/2007
2001 1er Juin 2010 Kinshasa En face de la
tribune de libération
Western union
et
MoneyGram
En activité
2010 Kinshasa Rond point PIK-
NIK
Western union En activité
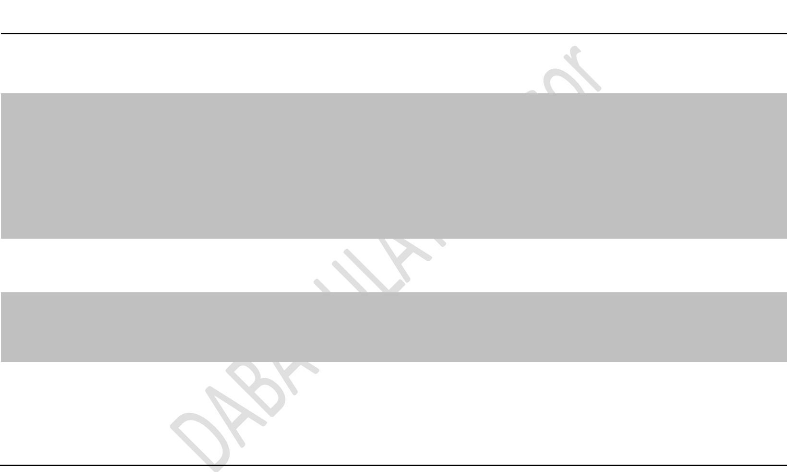
Ord. Prés n°8/035 du
1/04/2008
5 Ecobank Banque Panafricaine
- Lettre
Gouv./D14/ n°001317 du
28/9/2007
Western union En activité
25/06/1988 17/12/2012 Kinshasa En diagonal avec
le Vodashop
LCB
-
BC
1993
-
A coté de la BIC
7 Banque
Congolaise
- Kinshasa
- En fermeture
depuis le
29/09/2010
36
8 Trust Merchant
Bank
TMB Lettre Gouv.
n°03191 du
12/12/2003
Décret Prés n°04/022 du
Lubumbashi En face de
HQ/MONUSCO
- Bientôt
opérationnelle
Fin 2003
-
6 La CRUCHE
Banque
2000 2005 Goma En face de la
SOKIMO
- En liquidation
Ord. Prés
n°08/032 du
1/04/2008

37
15/3/2004
|
9 BG FIBank Lettre
Gouv./D14/
n°000428 du
5/3/2010 et
Ord
Prés n°10/036
du 28/5/2010
|
2010 Septembre
2013
|
Kinshasa En face du
vodashop
|
- En activité
|
Source : Elaboré par nos
soins.
L'observation de ce tableau nous montre que la plupart de
banques qui existent actuellement dans la Cité de Bunia sont
récentes (voir de n°2 jusqu'à 9). Cela se justifierait par
le fait que ces années marquent la période de la pacification du
milieu après les conflits interethniques.
Au niveau national, hormis les banques commerciales
précitées, l'environnement bancaire compte sept banques en
activité et sept autres en liquidation.
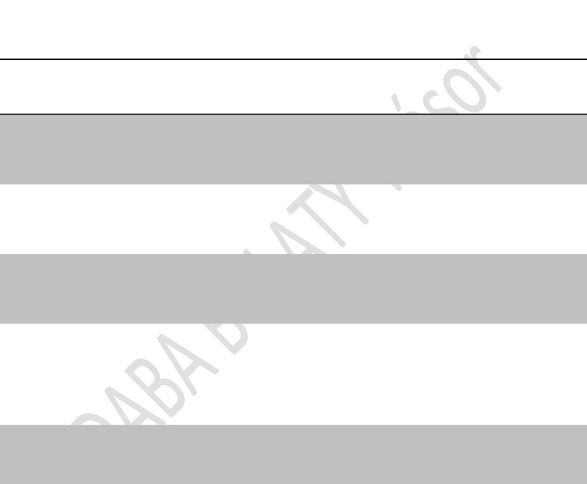
Avril 1970 Kinshasa
1 Banque Internationale pour
l'Afrique au Congo
BIAC Ord. Prés. n°070/325
du 30/11/1970 Lettre Gouv.:Réf
Ord. Présid. n°73/215
du 25/7/1973
Lettre
Gouv.
- Kinshasa
3 Standard Bank Congo
-
2004 Kinshasa
- Lettre
Gouv./D.14/n°00297 du 03/3/2005 Décret
5 Afriland First Bank Congo Democratic
38
Tableau n° II : Liste des banques commerciales
agréées par la BCC, en activité
N° Raisons sociales Sigles Autorisation de
fonctionnement
Année de création Sièges
2005 Kinshasa
- Décret Président.
n°71/098 du 01/6/1971 Lettre Gouv.
1er Juin 1971 Kinshasa
2 City Group (CityBank)
- Lettre
4 ProCrédit Bank Congo
Gouv./D.14/n°01829 du
27/9/2004
Décret
Présid. n°5/042 du
24/5/2005
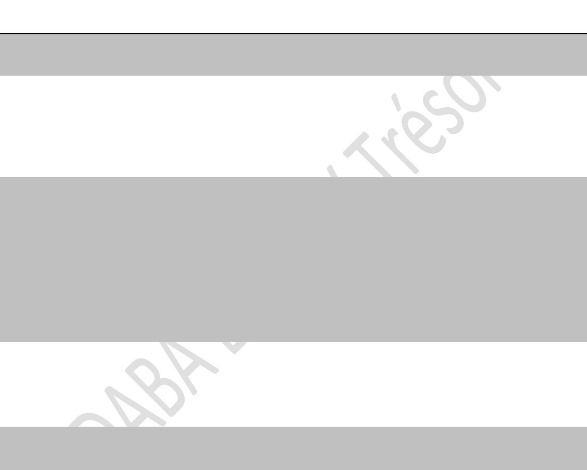
- Lettre
7 Byblos Bank RDC
2010 Kinshasa
-
9 Advans Bank
Lettre Gouv.:/D.14/
n°001286 du 8/10/2008
Avril 2009 Kinshasa
39
Présid. n°05/032 du
13/5/2005
6 Access Bank Congo - Lettre
Gouv.:/D.14/n°00799
du 07/6/2005
Décret
Présid. n°06/005-C du
15/2/2006
2006 Kinshasa
Lettre Gouv.:/D.14/
n°1137 du 08/9/2/2006
Ord.
Présid. n°8/038 du
1/04/2008
2008 Kinshasa
8 SOFIBanque
-
Gouv.:/D.14/n°01556
du 12/12/2005
Décret-
Présid. n°06/091 du
24/5/2006 Changement
de
dénomination
sociale : lettre
Gouv.:/D.14/ n°000633
du
25/5/2010
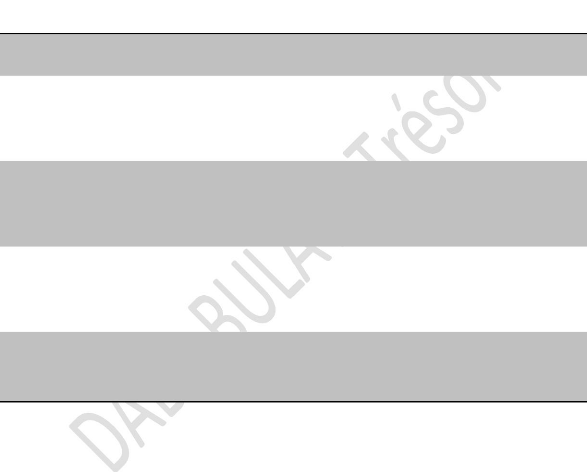
Lettre Gouv.:/D.14/
n°000170 du 06/3/2009
Ord.
Présid. n°10/037
du 23/05/2010
2010 Kinshasa
11 United Bank for Africa
-
-
Lettre Gouv.:/D.14/
n°000517 du
22/juin/2009
13 CRANE Bank Congo
2009 Kinshasa
40
Ord. Présid. n°09/017 du 23/3/2009
10 Bank Of Africa BOA Lettre Gouv.:/D.14/
n°001456 du
12/11/2008 Ord. Présid. n°09/016 du 23/4/2009
2009 Kinshasa
Source : BCC, 2011 Septembre.
12 Invest Bank Congo
2008 Kinshasa
Lettre Gouv.:/D.14/
n°0621 du 12/5/2006
Ord.
Présid. n°08/033
du 1/4/2008
-
41

Tableau n° III : Liste des banques
commerciales radiées ou fermées par la BCC
N° Raisons sociales Sigles Adresses
1 African Trade Bank ATB Kinshasa/Gombe

2 Banque à la Confiance d'Or BANCOR Kinshasa
3 Banque Congolaise de Commerce Extérieur BCCE Kinshasa

4 Banque Continentale du Congo BANCOC Kinshasa
5 Banque de Commerce et de Développement BCD Kinshasa

6 Banque de Crédit Agricole BCA Kinshasa
|
7 Compagnie Bancaire de Commerce et Crédit (Ex
SOZABANQUE)
|
COBAC Kinshasa
|

8 First Bank Congo Corporation FBCC Kinshasa

42

10 Union de Banques Congolaises UBC Kinshasa
11 Nouvelle Banque de Kinshasa NBK Kinshasa

12 Banque Continentale au Zaïre BACAZ Kinshasa
13 Banque Congolaise BC Kinshasa
|
14 Mining Bank of Congo
|
|
- Kinshasa
|
15 La Cruche Banque LCB Kinshasa
Source : BCC, Septembre 2011.
Notons que, malgré cette multitude
d'établissements bancaires dans le pays proposant plusieurs produits
dont les cartes bancaires, les distributeurs automatiques, les comptes
spécialisés, etc. avec 650 milles comptes bancaires, contre 450
milles comptes en 2010 dont la plupart en dollars américains pour une
population estimée au nombre de 70 millions d'habitants, le pays souffre
d'une sous-bancarisation.
En outre, les crédits que ces banques octroient
à leurs clients (sociétés ou particuliers) sont en
majorité basés sur des contrats libellés en monnaies
étrangères, ce qui témoigne la faible confiance des
opérateurs économiques dans la monnaie nationale.

43
2.4. ORGANISATION DU SYSTEME BANCAIRE CONGOLAIS
Le système bancaire congolais est organisé selon
un système pyramidal comprenant la Banque Centrale et un ensemble
d'établissements constituant les banques dites de second rang.
2.4.1. La Banque Centrale du Congo
La Banque Centrale du Congo a été
créée par le Décret-loi du 23/02/1961 mais n'entra en
activité que le 22/06/1964.28 Le Décret-loi
n°005/2002 du 7/05/2002 relatif à la constitution, à
l'organisation et au fonctionnement de la BCC reconnaît, en son article
1er, l'indépendance de celle-ci dans l'élaboration et
la mise en oeuvre de la politique monétaire visant à stabiliser
le niveau général des prix intérieurs.29
La BCC est donc indépendante et jouit de l'autonomie de
gestion dans la réalisation de ses missions et
attributions.30Elle est donc responsable des interventions sur le
marché des changes en opérant l'achat des devises
étrangères et leurs ventes lorsque le franc congolais
s'apprécie ou déprécie. Outre cela, elle est
chargée de maintenir la valeur externe de la monnaie de l'Etat (Francs
Congolais) pour le compte duquel elle agit et c'est dans cette optique qu'elle
réglemente l'activité des établissements de
crédits. Garante du bon fonctionnement du système bancaire et
financier, la BCC établit et impose à toute banque de respecter
un ensemble de règles prudentielles d'activités. Celles-ci visent
à couvrir les risques d'insolvabilité des banques.
La qualité de banque est sollicitée par
écrit auprès de la BCC et ainsi donc, toutes les banques
opérant à travers l'étendue de la RDC, fonctionnent avec
les imprimées de la Banque Centrale du Congo (feuille de liquidation,
avis de débit et de crédit, feuilles des états financiers,
etc.).
La BCC dispose d'une « DIRECTION-HOTEL DE MONNAIE »
pour l'impression de documents de sécurité et la fabrication,
outre des billets de banque, des passeports, des vignettes, des diplômes,
des chèques, des timbres, etc.31 Bref, des documents
infalsifiables.
28 MABI MULUMBA, Op.Cit, p19.
29 Journal Officiel de la RDC, Mai 2002, p56
30 Article 16 de la Constitution de la 3eme
république.
31 BAKU F. cité par MULOJI SHIMUNDA,
Enjeux des NTIC dans la gestion de la clientèle d'une banque.
Cas de la RawBank, Mémoire inédit, FSEG, Université
de Lubumbashi, 2008
44
2.4.2. Les banques de second rang
Parmi les banques de second rang, on distinguait
traditionnellement les banques de dépôt des banques d'affaires.
Néanmoins, ce principe de spécialité n'était pas
adopté à l'activité réelle des banques, et les
différences entre ces deux catégories d'établissements
bancaires se sont peu à peu estompées.
Les banques du second rang (appelées aussi banques
secondaires, banques ordinaires, privées, ou tout simplement banques)
collectent les dépôts des ménages (des particuliers), des
entreprises et des administrations publiques. Ces dépôts sont en
premier lieu les revenus des ménages et les rentrées d'argent des
entreprises, les plus souvent directement versés sur les comptes de
dépôts, ou payés par l'intermédiaire de
chèques ou carte de paiement. C'est aussi l'épargne des
ménages, déposée sur des « comptes sur livrets
», ou d'autres formes de placements utilisés surtout par les
entreprises en excédant temporaire de liquidités.
Cette masse de monnaie collectée n'est pas
conservée stérilement par les banques, mais est bien sûr
prêtée. Soit à leur clientèle habituelle, soit par
l'intermédiaire des marchés monétaires ou financiers.
Une partie de l'activité des banques est de servir
d'intermédiaire financier. Quand une entreprise ou l'Etat veut se
refinancer, il émet des titres qu'il vend par l'intermédiaire des
banques commerciales. Ces banques proposent ainsi à leur
clientèle divers produits financiers, (actions de société,
obligations d'entreprises, bons du Trésor, ...), ainsi que des services
de gestion de ces produits.
Un autre rôle des banques commerciales, beaucoup moins
connu que les précédents, est de créer de la monnaie
scripturale.
Banques du second rang
ou commerciales
Reprêtent les dépôts collectés
Servent d'intermédiaires financiers
Source : Elaboré par nos
soins.
Créent de la monnaie scripturale

|
|
|
Schématiquement, on a :
|
|
|
Collectent les dépôts des ménages, des
entreprises et administrations
|
|

Dans une autre mesure, la distribution de crédit est
régulée par le blocage sans intérêt auprès de
la BCC, d'un pourcentage variable des dépôts à vue et
à terme.
45
2.5. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME BANCAIRE CONGOLAIS
2.5.1. Organe de contrôle
Le contrôle du système bancaire congolais s'organise
autour des organes suivants :
a. Le Comité de la Réglementation Bancaire
.
· supervisé par le Ministre des Finances qui en assure la
présidence et coordonné par le gouverneur de la BCC, il se charge
des règles générales applicables aux établissements
de crédits, notamment le montant du capital, les conditions
d'implantation des réseaux, les opérations avec la
clientèle, les règles de liquidité et de
solvabilité, etc.
b. La Commission Bancaire .
· contrôle
la situation financière des institutions bancaires. Elle est investie
des pouvoirs disciplinaires lui permettant de sanctionner.
c. Le Conseil National de Crédit .
·
est un organe consultatif à la BCC et au gouvernement d'orienter la
politique monétaire et de crédit au niveau national.
2.5.2. Mécanisme de contrôle
Le contrôle s'effectue par la régulation de
l'émission et de la distribution du crédit d'une part et des
ressources et emplois des banques d'autre part.
Cette régulation mise en oeuvre par la BCC permet aux
banques de se refinancer auprès d'autres banques ayant des ressources
excédentaires.
Par ailleurs, cette opération entraîne une
fluctuation pouvant provoquer des besoins de trésorerie très
temporaire.
Dans ce contexte, une action se fait sur le taux
d'intérêt directeur sur appel d'offre planchée. Ainsi, la
BCC provoque et centralise les appels d'offre des banques qui souhaitent se
refinancer. Elle n'accorde son concours qu'à celles qui proposent un
taux moins égal à celui annoncé.

46
2.6. PLACE DE LA BANQUE DANS L'ECONOMIE CONGOLAISE
« Sans banquier point d'échange de richesse de
stimulant à la production, à la distribution, et à la
consommation ». Ainsi, DESCHANEL relevait-il la place de l'activité
bancaire dans la vie économique, intermédiaire obligé
entre la population en excédant de trésoreries et celle en besoin
de financement. Ainsi, le banquier collecte l'épargne et distribue le
crédit moyennant un taux d'intérêt.
En RDC, comme dans tous les pays du monde en
général et en particulier la Cité de Bunia, quel que soit
le système économique, la banque est étroitement
liée à l'économie, à la monnaie et au commerce. Ce
statut d'intermédiaire l'incline à une recherche permanente d'une
clientèle et des déposants de fonds en particulier.
2.7. CAUSES DE LA FRAGILITE DU SYSTEME BANCAIRE
CONGOLAIS
Après les pillages et les rebellions qu'a connu le
pays, respectivement vers les années 1990-1992 et 1997-2004,
l'économie bancaire congolaise s'est rapidement rétablie suite
notamment à la relative stabilité du cadre
macro-économique. Cela a eu des effets plus perceptibles à partir
de 2002. Le volume des capitaux (financiers) investis dans ce secteur a connu
une croissance moyenne annuelle de 7% entre 2002 et 2012 contre une
décroissance décennale de -76,65% (1993-2002).32
Néanmoins la reprise manifeste du secteur bancaire est
caractérisée par un taux de pénétration faible de
10% ; cette statistique indique la fragilité de ce secteur. Mais alors,
quelles sont ces causes ? Nous les saurons dans les points qui suivent.
2.7.1. Réglementation inadéquate et mauvaise
qualité des institutions
Une réglementation lourde et les coûts
afférents à la constitution du dépôt et à la
liquidation de l'épargne sont notamment des freins pesants. Les banques
exigent au minimum trois documents dont la carte d'identité que n'ont
pas 16% au moins des congolais majeurs. En outre, la mauvaise qualité
des institutions constitue un autre blocage. La RDC se place à la
181ème position sur 185 pays classés en 2012 par Doing
Business selon le climat des affaires.33 Plus encore, elle a pour la
même année un indice de responsabilité des dirigeants
relativement faible, de 3 sur 10. Cette contreperformance est
caractérisée notamment par le non-respect des droits de
propriété privée laissant une tendance (des potentiels
épargnants) à se refugier dans l'informel ; ce qui affaiblit le
taux de bancarisation.
32 Doing Business, Rapport annuel 2012, janvier 2013, page
consultée le 8/03/2013 disponible sur :
http://afrikarabia.org 33Idem

47
2.7.2. Taux d'inflation
Les banques rémunèrent l'épargne par un
taux d'intérêt fixe. En outre, il est établi en
économie que l'inflation favorise les débiteurs (banques) au
détriment de créanciers (épargnants). Si l'inflation est
nulle, l'effet de l'inflation sur l'intérêt est nul. Cependant, la
RDC connaît un taux d'inflation moyen annuel (2006-2012) de 9%. Signalons
que l'instabilité de la politique monétaire n'encourage pas
l'épargne.
2.7.3. Pauvreté et effet mémoire
Comme signalé ci-haut, les pillages et les rebellions
des années 1990-2004 ont fortement fragilisé le secteur bancaire
par au moins deux canaux :
? l'augmentation de l'incidence de la pauvreté ? et
l'effet mémoire
L'épargne qui est la différence entre le revenu
disponible et la consommation demeure incertaine du fait de la faiblesse des
revenus des pauvres. En outre, l'instabilité institutionnelle
liée à l'absence d'Etat de droit constitue une incertitude (effet
mémoire) qui empêche certaines gens de se projeter dans le futur :
ils n'épargnent pas, n'investissent pas non plus.
2.7.4. Espérance et cycle de vie
Le graphique ci-dessous indique la fréquence relative
des congolais disposants d'un compte d'épargne. Il montre que la
proportion des personnes disposant d'un compte bancaire diminue avec leur
âge au-delà de 34 ans. L'espérance de vie moyenne à
la naissance en RDC étant à 46 ans (2010)34,
l'intérêt à épargner chute plus tôt
comparativement à la moyenne de pays pauvres.
34 BUJU NDALI, Démographie, Cours
inédit, G2 FSEG, CUEB, 2010.
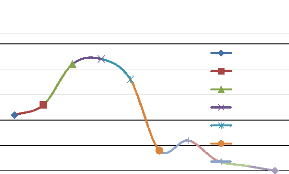
48
Culture d'épargne selon les tranches
d'âge
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
35
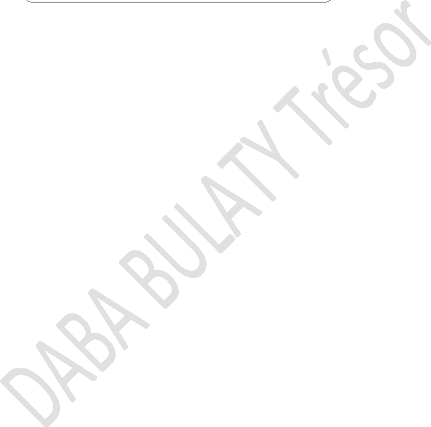
En outre, ces résultats vérifient la
théorie du cycle de vie de MODIGLIANI F.36 qui certifie qu'au
début de sa vie d'adulte, l'homme a des revenus faibles,
inférieurs à sa fonction de consommation, ce qui explique qu'il
doive désépargner (phase I). Lors de sa vie active, l'homme peut
rembourser ses dettes et constituer une épargne (Phase II) qui servira
à financer la consommation de la période de vieillesse (Phase
III). Ainsi sur ce graphique, en RDC, la phase I de ce cycle couvre les
tranches d'âges inférieurs à 25 ans. Celle de la phase II
est comprise entre 25 et 34 ans, elle est caractérisée par des
forts taux d'épargnants. Donc, la période d'épargne dans
la vie du congolais est courte. Cela induit un niveau d'épargne formelle
faible préjudiciable au développement : un cercle vicieux dont il
faut sortir via l'amélioration des institutions.
Les causes de fragilité de l'économie bancaire
de la RDC demeurent essentiellement structurelles et institutionnelles. Toute
thérapie de surface ne serait efficace.
2.8. STRATEGIES RECENTES DE BANQUES
2.8.1. Nouveaux enjeux
On assiste ce dernier temps à la révolution
informationnelle et technologique de la communication, ce qui favorise :
l'entrée massive de nouveaux établissements bancaires ; ce qui
oblige les banques, surtout anciennes, d'avoir pour enjeu majeur (défis)
: la fidélisation des anciens clients et non d'en chercher les
nouveaux.37 Il ne s'agit plus de penser à la part du
marché mais ce qui compte, c'est la valeur client.
2.8.2. Nouvelles relations commerciales
Dans ce cas, les banques sont contraintes d'enrichir leur
relation commerciale (clientèle). Ainsi, on privilégie les
produits vendus et les objectifs essentiellement quantitatifs à court
terme. Il
35 http// :
www.google.com//contrepoint.org/2011/05/1
:24801-la-frafile-economie-bancaire-en-epargne-rdc
36 BWAZOKA MBULA MAPATHA D., Economie Politique
II, Cours inédit, G2 FSEG, CUEB, 2010.
37 KUKUNGAMA KUMBIKUMBI E-B., Op.Cit.
49
s'avère alors essentiel de créer une
proximité renforcée et construire un partenariat à long
terme. Ce qui devient le levier de la différenciation voire la
fidélisation pour la banque ou une institution financière.


50
CHAPITRE TROIS : PRESENTATION DES DONNEES, ANALYSE
ET
INTERPRETATION DES RESULTATS
Après que nous avons passé par l'analyse des
différents points composants le deuxième chapitre, nous voulons,
dans ce troisième chapitre, présenter les données, les
analyser et interpréter les résultats.
Pour y parvenir, nous avons estimé la taille de notre
échantillon à 75 sur 169 enseignants pris sur base des listes du
personnel actif de chaque établissements d'enseignement supérieur
et universitaire publics présents dans la Cité de Bunia.
3.1. ORGANISATION DE L'ENQUETE
Etant donné que notre travail porte sur les opinions
des enseignants de l'enseignement supérieur et universitaire public de
Bunia sur la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'Etat,
l'enquête sur le terrain reste la seule technique appropriée pour
en savoir plus.
Dès lors, on se pose la question de savoir comment cela
va se passer. Pour ce faire, nous avons d'abord localisé notre aire
géographiquement c'est-à-dire la décrire et relever le
nombre ou l'effectif des enseignants y prestent.
Après cela, nous leur avons adressé un
questionnaire d'enquête qui consistait à répondre de
façon anonyme sur base de questions ouvertes et fermées.
Rappelons que notre enquête a porté sur 75
enseignants sur l'ensemble de 169 prestant dans ces différents
établissements d'enseignement supérieur et universitaire publics
de la Cité de Bunia.
3.2. POPULATION ET ECHANTILLON
3.2.1. Population d'étude
On entend par population, l'ensemble des personnes, des choses
ou en général des éléments, ayant des
caractéristiques communes c'est-à-dire l'ensemble
d'éléments qui font l'objet d'étude et dans lesquels un
échantillon doit être tiré afin de rendre l'étude
aisée.38
38 KAMATE MULUME F., Théories et pratiques
des sondages, Cours inédit, L2 Gestion Financière, UNIBU,
2013.

51
En effet, en ce qui concerne la présente étude,
cette population est constituée de 169 enseignants prestant dans les
différents établissements d'enseignement supérieur et
universitaire publics dans la Cité de Bunia.
3.2.2. Echantillon choisi
D'après DE LANDSHEERE cité par DHEDONGA,
échantillonner, c'est choisir un nombre limité d'individus,
d'objets ou d'événements dont l'observation permet de tirer des
conclusions applicables à la population entière (univers)
à l'intérieur de laquelle le choix a été fait.
Donc, c'est un certain nombre d'individus choisi dans une
population de manière à la représenter et pouvant servir
pour l'appréciation de cas du même genre, c'est-à-dire le
sous-ensemble de la population étudiée.
Ainsi, notre étude porte sur un échantillon de 75
enseignants qui a été choisi sur base de listes de personnels
enseignants actifs de chaque établissement retenu.
3.3. ADMINISTRATION DU QUESTIONNAIRE
Le questionnaire peut être administré de bien de
façons : soit directement (c'est-à-dire, oralement), soit par
téléphone, soit par courrier électronique et soit par
poste (sous forme de formulaire). Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous
avons fait recourt au questionnaire dont l'administration s'est
déroulée de la manière suivante :
- Questions ouvertes
Ce type de question demande aux gens interrogés de
formuler à leurs propres termes en partie ou la totalité de
réponse.39 Pour que les réponses soient
satisfaisantes, il faut donc que les personnes sachent lire et écrire,
soit bien informées de thème sous étude et
désireuses de coopérer. Nous avons utilisé ce genre de
question pour que nos enquêtés nous fournissent ce qu'ils
entendent du sujet sous étude.
- Questions fermées
Ce type de question comporte une série de questions
appelant des réponses précises, sans que les commentaires soient
retenus. Les réponses sont déterminées d'avance par
l'enquêteur. Le
39 KAMATE MULUME F., Opcit.
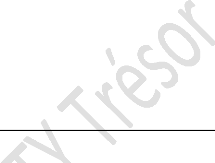

52
questionnaire fermé convient très bien pour
préciser des informations, des faits qu'il est difficile d'obtenir
à partir d'autres sources.
Nous avons utilisé ce type de questions pour rendre
facile la récolte des opinions des enseignants de l'enseignement
supérieur et universitaire public de Bunia sur la bancarisation de la
paie des agents et fonctionnaires de l'Etat.
3.4. ANALYSE DES RESULTATS
Sous ce point, nous allons analyser les différents
résultats obtenus à partir du traitement statistique des
données, qui nous permettra de confirmer ou d'infirmer nos
hypothèses du départ.
3.4.1. Du sexe des enquêtés
Tableau n° IV : Répartition des
enquêtés selon le sexe
Sexe Effectif %
Masculin 63 84

Féminin 12 16
Total 75 100
Source : Par nos soins.
De ce tableau, il se fait voir que sur 75 enseignants
enquêtés, 63, soit 84% sont des hommes contre 12, soit 16% de la
population enquêtée qui sont des femmes.
Figure n°1 : Répartition des
enquêtés selon le sexe
|
Effectif
|
%
|
|
Masculin
|
63
|
84
|
|
Féminin
|
12
|
16
|
Source : Sur base des données du
tableau n° IV.
53
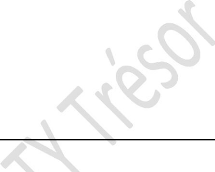
3.4.2. De la détention du compte bancaire
Un compte peut être défini comme l'état du
patrimoine financier d'une personne morale ou physique dans une institution
spécialisée (banque, trésor public, services financiers de
la poste). Lorsque le compte est créé dans une banque, on parlera
de compte bancaire bien que cette appellation soit parfois étendue aux
autres institutions.
Cette définition montre qu'un compte représente
un solde qui peut être dans le temps négatif (débiteur),
nul (équilibré) ou positif (créditeur). Mais cela
dépend du type, certains doivent obligatoirement avoir un solde positif
ou nul.
De ce fait, le tableau ci-dessous représente le nombre
de nos enquêtés ayant un compte bancaire.
Tableau n° V :
Répartition des enquêtés ayant un compte en banque par
grade
Nombre réponses par grade Oui Non

|
%
|
Effectif
|
%
|
|
6,666
|
02
|
2,66
|
|
57,33
|
05
|
6,66
|
|
24
|
01
|
1,33
|
|
00
|
00
|
00
|
|
1,33
|
00
|
00
|
|
89,32
|
08
|
10,68
|
Effectif


Chargé(e) de Pratique Professionnelle 05
Assistants 43
Chef de Travaux 18
Professeur Associé 00
Professeur Ordinaire 01
Total 67

Totaux généraux 100
Source : Nous-mêmes par nos
soins. Avec les formules : Pourcentage (Oui)=
Pourcentage (Non)=
54
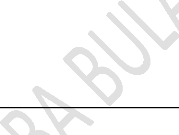
De ce tableau, il ressort ce qui suit : parmi les enseignants
enquêtés qui détiennent le compte bancaire, seuls les
assistants occupent un pourcentage élevé, 43 soit 57,33 %, suivis
de Chef de Travaux avec 24 %, pendant que les Chargés de Pratiques
Professionnelles, le Professeur Ordinaire et le Professeur Associé
représentent respectivement 6,66 ; 1,33 et 0 %. Tandis que ceux
là qui ne détiennent pas le compte bancaire étaient au
nombre de 8, soit 10,68% se justifiant de la manière suivante.
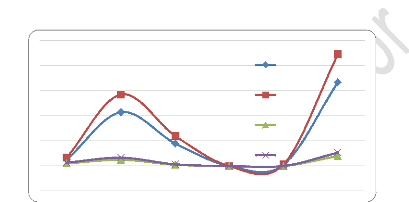
Figure n°2 : Répartition des
enquêtés ayant un compte en banque
Nombre réponses par
grade Effectif
Oui %
Oui Effectif
Non %
Source : Sur base de données du
tableau n°6
3.4.3. Des raisons avancées de non détention
de compte en banque
Tableau n° VI relatif aux raisons
avancées de non détention de compte en banque
Raisons avancées
Manque de confiance aux institutions bancaires
Revenus faibles
Pas important
Autres
Total
Source : Par nos soins.

Faute de revenus
Effectif
|
%
|
|
03
|
37,5
|
|
02
|
25
|
|
02
|
25
|
|
00
|
00
|
|
01
|
12,5
|
|
08
|
100
|
55

De ce tableau, il ressort les résultats ci-dessous : 3
enquêtés, soit 37,5% se disent qu'ils n'ont pas de compte en
banque suite au manque de confiance aux institutions bancaires de la place car
ils ont été victimes de détournements par les
micro-finances que venait de connaître la Cité de Bunia ; les 2
autres, soit 25 % disent qu'ils n'ont pas de moyens, c'est-à-dire que
leurs revenus sont faibles ; tandis que le reste avance d'autres raisons, soit
12,5%.
Figure n° 3: Tendance des raisons
avancées de non détention d'un compte bancaire

effectif
Pourcentage


Source : Sur base du tableau
n°7.
3.4.4. De la durée de la détention du compte
en banque
Tableau n° VII relatif à la durée
de la détention du compte en banque
1 an au moins

2 ans
Durée de la détention du compte bancaire
3 ans
4 ans
5 ans ou plus
Total
|
Effectif
|
%
|
|
17
|
25,4
|
|
21
|
31,3
|
|
09
|
13,4
|
|
13
|
19,4
|
|
7
|
10,5
|
|
67
|
99,95
|
Source : Par nos soins.
Source : Par nos soins.
56
De ce tableau, nous remarquons de compte bancaire de deux ans
viennent en tête soit 21 enquêtés sur 67, soit 31,3% ; le
groupe de ceux d'un an suit immédiatement avec 17 enquêtés
soit 25,4 % et que ceux de trois, quatre et cinq ans ou plus constituent
respectivement : 9, 13 et 7 soit 13,4 ; 19,4 et 10,5 %. Cela se justifie par le
fait que les institutions bancaires dans la Cité de Bunia ont connu une
interruption dans leurs activités suite aux divers facteurs dont les
guerres interethniques qui ont secoué le milieu et la crise
financière qui ont frappé les institutions de micro-finances en
RDC, en général et à la Cité de Bunia en
particulier ; mais aussi l'arrivée récente de la plupart des
institutions bancaires dans ladite cité (vers les années
2010).

Figure n°4 relative aux raisons avancées
de non détention de compte bancaire
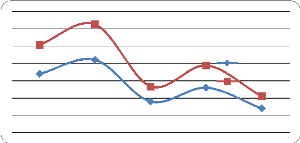
Effectif Pourcentage
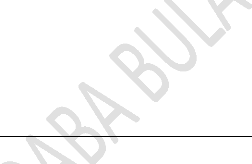
Source : Sur base des données du
tableau n° VII.
3.4.5. De la détention de compte bancaire avant la
bancarisation de la paie
Tableau n° VIII relatif à la durée
de la détention du compte bancaire avant la bancarisation
de
la paie
Grade Effectif %
Chargé de Pratiques Professionnelles 3 4,84

Assistants 41 66,13
Chef de Travaux 17 27,42
Professeur Associé 0 0
Professeur Ordinaire 1 1,61
Total 62 100
57
Ce tableau nous montre que sur les 62 enquêtés
ayant le compte bancaire avant la bancarisation 41 soit 66,13% sont des
assistants ; 17, soit 27,42% sont des Chef de Travaux ; 3 sont des
Chargés des Pratiques Professionnelles et 1 soit 1,61% est un Professeur
Ordinaire. Ce qui veut dire qu'ils sont des multibancarisés (qu'ils ont
au moins deux comptes en banque).
Figure n°5 relative à la
détention de compte bancaire avant la bancarisation de la
paie
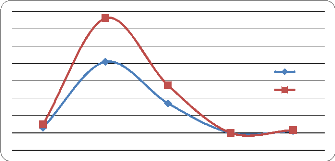
Effectif
%

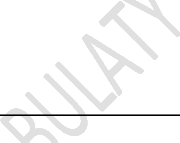
Source : Sur base des données du
tableau n°VIII.
3.4.6. De la détention de compte bancaire
après la bancarisation de paie
Tableau n° IX relatif à la
détention du compte en banque après la bancarisation de la
paie
Grades Effectif %
Chargé de Pratiques Professionnelles 2 33,3

Assistants 2 33,3
Chef de Travaux 1 16,7

Professeur Associé 0 0
Professeur Ordinaire 1 16,7
Total 6 100
Source : Nous-mêmes par nos
soins.
Ce tableau nous montre la répartition de
enquêtés qui détiennent des comptes bancaires après
l'opération de la bancarisation de la paie. Il reste maintenant de
savoir la raison qui les pousser à ne pas ouvrir un compte, car la
plupart des enseignants enquêtés en ont.
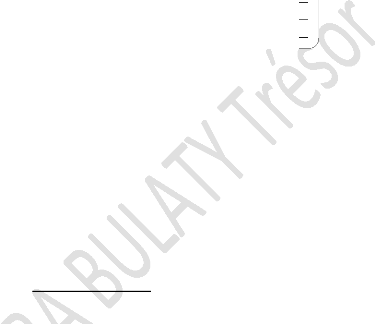

Effectif
Pourcentage
Source : Sur base de données du tableau n° IX.
3.4.7. De la mécanisation des enquêtés
La mécanisation peut être définie comme un
emploi généralisé de la machine en remplacement de
l'activité manuelle.40
De cela, nous pouvons dire que la mécanisation, dans le
domaine de l'emploi, c'est le fait qu'un employé de la fonction publique
soit reconnu et payé au niveau national par le ministère de sa
juridiction.
Tableau n° X relatif à la
mécanisation des enquêtés
Etes-vous mécanisé (e) Effectif %
58
Figure n°6 relative à la
détention de compte bancaire après la bancarisation de la
paie

Non 57 76
Source : Nous-mêmes sur base du
questionnaire d'enquête.
De ce tableau, on remarque que le nombre des
enquêtés qui sont mécanisés est de 18 sur 75, soit
24%, tandis que ceux qui ne sont pas mécanisés sont au nombre de
57, soit 76%. Donc nous affirmons que la plupart de nos enquêtés
sont des non mécanisés. La question reste de savoir maintenant
s'ils sont des mécanisés payés ou non payés.
40 Dictionnaire illustré, Le Larousse, Petit
format, Op.cit.

59
Figure n°7 relative à la
mécanisation des enquêtés
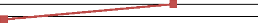
|
Effectif
|
%
|
|
Non
|
57
|
76
|
|
Oui
|
18
|
24
|
Source : sur base du tableau n°
X.
3.4.8. Des avantages de la bancarisation
Il s'agit dans ce point de parler de ce que pensent les
enquêtés sur les avantages de la bancarisation de la paie.
Ainsi, ces avantages peuvent se résumer de la
manière suivante :
a. La bancarisation facilite la gestion de son argent, donne la
possibilité d'octroi des crédits par l'institution bancaire et le
compte bancaire assure la sécurité du fonds contre le vol, la
perte, etc.
b. La bancarisation facilite la maîtrise de nombre des
agents par le pouvoir public, permet d'effectuer les encaissements et les
décaissements au moment voulu par l'agent détenteur.
c. La bancarisation a comme avantages : le fonds est
gardé en toute sécurité, on peut réglementer tous
les retraits en fonction des dépenses enfin on peut aussi
bénéficier d'un crédit en banque.
d. La bancarisation réduit le cas de détournement
de fonds par les responsables des institutions publiques et élimine les
fictifs.
e. Avec la bancarisation, on peut effectuer des
opérations de transaction financière en toute
sécurité.
Il y a encore d'autres points de vue similaires qui nous ont
été donnés, mais faute de temps, nous nous sommes
limités à ces cinq opinions, néanmoins, nous pouvons
résumer ces opinions en quelques mots, entre autres :
? La sécurisation de l'épargne des
détenteurs,
60

y' La possibilité pour les détenteurs d'un compte
bancaire de recourir à des instruments scripturaux de paiement pour
assurer les transactions en toute sécurité, y' La constitution de
reliquats issus des opérations de paie et enfin y' L'accroissement des
possibilités de financement bancaire de l'économie.
3.4.9. Des contraintes à la bancarisation
Ici, il est question de soulever certaines contraintes
liées à cette opération de la bancarisation selon nos
enquêtés, il s'agit entre autres :
a. En cas de fermeture de l'institution bancaire, il y a
risque de la perte de fonds, s'il n'ya pas eu retrait, il en est de même
lors de la faillite.
b. Le système n'est pas bien organisé, les
agents de l'Etat ne sont pas encore informés sur les opérations
bancaires.
c. Le nom n'apparaît pas sur la liste (listing) de la
paie, le retard dans la paie et la longue file d'attente devant la banque.
d. Le manque de liquidité dans des institutions
bancaires concernées et les caprices techniques.
e. L'insécurité dans des milieux ruraux
où il n'existe pas d'institutions bancaires, les agents et
fonctionnaires de l'Etat sont obligés de parcourir des longues distances
pour être payés.
3.4.10. De la culture de l'épargne des
enquêtés
L'épargne vient du verbe « épargner »
qui signifie mettre en réserve. Elle est une partie (fraction) du revenu
individuel ou national qui n'est pas affectée à une consommation
immédiate.41 Elle apparaît donc comme un retranchement
à une consommation possible.
41 GRAWITZ M., Op.cit.
61
Tableau n° XI relatif à la culture
d'épargne des enquêtés
Grades Effectif %
Chargé de Pratiques Professionnelles 02 2,98

Assistants 48 71,6
Chef de Travaux 21 31,3

Professeur Associé 00 00
Professeur Ordinaire 01 1,49
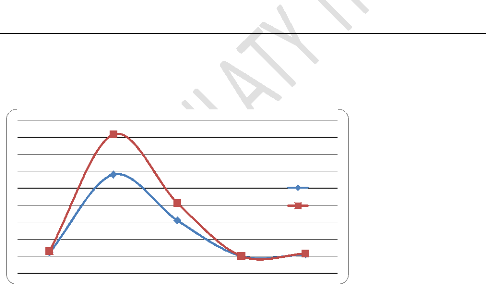
Total 67 100
Source : Nous-mêmes sur base du
questionnaire d'enquête.
Figure n°8 relative à la culture
d'épargne des enquêtés
%
Effectif
Source : Sur base des données du
tableau n° XI.

3.4.11. De la propension marginale à épargner
des enquêtés
L'épargne joue un rôle très important dans
le développement économique d'un pays. C'est grâce à
elle que peuvent être lancés les projets de développement.
De ce fait, l'épargne se formera si l'agent économique, avec son
revenu, renonce à des dépenses inutiles et qu'il accepte de
constituer des dépôts dans une institution bancaire du pays et non
dans celle de l'étranger.
62
La propension marginale à épargner est
considérée comme une variation de l'épargne par rapport
à la variation du revenu d'un agent économique.42 Elle
peut s'écrire comme suit :
1 -- ou encore comme :
De ce fait, le tableau suivant nous présente la
propension marginale à épargner de nos enquêtés.

Tableau n° XII relatif à la propension
marginale à épargner des enquêtés
Grades [ <-- 20%] [ 21 -- 39%] [
[+50 %] Effectif
]
|
Chargé de Pratiques
Professionnelles
|
|
01 04
|
|
|
|
|
|
Assistants 32 10
Chef de Travaux 11 07
Professeur Associé 00 00
Professeur Ordinaire 00 01


44 22
Total
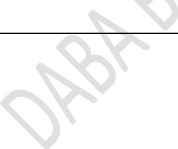
00
|
00
|
05
|
|
01
|
00
|
43
|
|
00
|
00
|
18
|
|
00
|
00
|
00
|
|
00
|
00
|
01
|
|
01
|
00
|
67
|
Source : Nous-mêmes sur base de
données de l'enquête.
De ce tableau, il ressort ce qui suit : parmi les 75
enseignants enquêtés 67 détiennent des comptes bancaires et
leur propension marginale à épargner se répartit de la
manière suivante :
ü 44 enseignants ont l'habitude d'épargner leur
salaire mensuel de <-- 20% ;
ü 22 enseignants enquêtés épargnent
leur salaire mensuel de 21 à 39%,
ü 1 enseignant arrive à épargner son salaire
mensuel entre 40 et 50%.
Ce qui nous permet de confirmer que la plupart de nos
enquêtés n'arrivent pas à épargner comme il faut
car, disent-ils, à ce propos le salaire qu'ils touchent est insuffisant
face aux dépenses auxquelles ils doivent faire face tous les jours et
que le gouvernement songe à améliorer
42 RIKRIYO DJOZA JC.,
Economie Politique I, Cours inédit, G1 FSEG,
CUEB, 2008.
63
leurs conditions de travail. D'où, la bancarisation
leur permettra tout simplement de sécuriser leur salaire contre les
quelques antivaleurs déjà précitées.
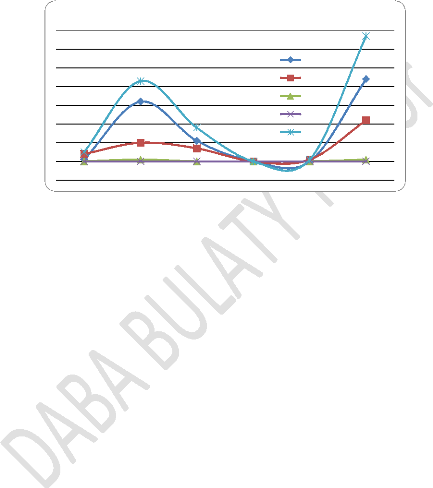
Inférieur ou égal à 20%
21-39%
40-50%
50%
Effectifs
Source : Sur base des données du
tableau n° XII.
Figure n°9 relative à la propension
marginale à épargner des enquêtés

64
CONCLUSION GENERALE
Après avoir examiné tous les
éléments de notre argumentation, plus d'un lecteur constatera que
notre investigation a porté sur « les opinions des enseignants
de l'enseignement supérieur et universitaire public de Bunia sur la
bancarisation de la paie des agents et fonctionnaire de l'Etat ».
Dans le présent travail, un ensemble des questions a
conduit notre démarche, à savoir :
- Quelles sont les opinions des enseignants de l'enseignement
supérieur et universitaire public de Bunia sur la bancarisation de la
paie des agents et fonctionnaires de l'Etat ?
- Cette bancarisation leur permet-elle d'épargner,
quels en sont les avantages et contraintes ?
Ces questions nous ont permis d'émettre les
hypothèses selon lesquelles :
- Il semble que les enseignants de l'enseignement
supérieur et universitaire public de Bunia auraient des opinions
positives sur la bancarisation de la paie à cause de l'importance que
présente cette opération.
- Cette bancarisation de la paie ne permettrait pas à
ces derniers d'épargner, ses avantages et contraintes seraient
nombreux.
La vérification des hypothèses ne pouvait
être possible qu'en faisant recours à une méthodologie
appropriée et pour ce faire, nous avons dû faire appel aux
méthodes inductive, statistique, historique et structuro-fonctionnelle
appuyées par les techniques documentaire et d'enquête.
Les méthodes inductive et statistique nous ont permis
respectivement de généraliser et d'interpréter les
résultats obtenus afin de tirer une conclusion ; et les méthodes
historique et structuro-fonctionnelle nous ont permis, respectivement, de
présenter les historiques, la structure, l'organisation et les relations
entre les personnels des établissements de l'enseignement
supérieur et universitaire publics de la Cité de Bunia.
La technique documentaire nous a permis d'exploiter des divers
documents contenant des informations relatives à notre investigation et
la technique d'enquête nous a permis de descendre sur le terrain pour
contacter les enseignants concernés.

65
Le présent travail comprenait trois chapitres, hormis
l'introduction et la conclusion générale.
- Le premier a traité des considérations
générales
- Le deuxième s'est axé sur le système
bancaire congolais et
- Le troisième chapitre était consacré
à la présentation des données, à l'analyse et
à l'interprétation des résultats.
Après les investigations effectuées auprès
de nos enquêtés, nous avons abouti aux résultats
ci-après :
y' La plupart de nos enquêtés saluent cette
mesure de la bancarisation de la paie, mais souhaitent que l'initiateur puisse
faire une actualisation, c'est-à-dire le contrôle
biométrique ;
y' 44 enseignants ont l'habitude d'épargner leur
salaire mensuel de 20% ; 22 enseignants enquêtés épargnent
leur salaire mensuel de 21 à 39% ; 1 enseignant arrive à
épargner son salaire mensuel entre 40 et 50%, ce qui ne dit pas que la
bancarisation de la paie doit leur permettre d'épargner davantage leur
salaire mensuel ;
y' La sécurisation de l'épargne des
détenteurs ; la possibilité pour les détenteurs d'un
compte bancaire de recourir à des instruments scripturaux de paiement
pour assurer les transactions en toute sécurité ; la constitution
de reliquats issus des opérations de la paie et enfin l'accroissement
des possibilités de financement bancaire de l'économie.
y' En cas de fermeture de l'institution bancaire, il y a
risque de la perte de fonds, s'il n'ya pas eu retrait, il en est de même
lors de la faillite ; le système n'est pas bien organisé, les
agents de l'Etat ne sont pas encore informés sur les opérations
bancaires ; le nom n'apparaît pas sur la liste (listing) de paie, le
retard dans la paie et la longue file d'attente devant la banque ; le manque de
liquidité dans des institutions bancaires concernées et les
caprices techniques et enfin l'insécurité dans des milieux ruraux
où il n'existe pas d'institutions bancaires, les agents et
fonctionnaires de l'Etat sont obligés de parcourir des longues distances
pour être payés, telles sont les contraintes à la
bancarisation de la paie.
Ainsi, à la lumière de différents faits
ci-haut mentionnés, nous confirmons nos hypothèses du
départ de notre étude.
Au regard, de ce qui précède, nous
suggérerons ce qui suit :

66
V' Aux autorités compétentes
(Gouvernement) :
- Tout en félicitant le gouvernement pour cette
opération de la bancarisation, il serait souhaitable qu'il pense
à des modalités pratiques, pour garantir la paie
régulière et décente de ses agents et fonctionnaires des
milieux non encore pourvus des structures bancaires ;
- Par le truchement de la banque centrale (l'autorité
monétaire), de veiller sur le fonctionnement de toutes les institutions
financières oeuvrant dans ce domaine afin que cette opération de
la bancarisation soit efficace et efficiente.
V' Aux responsables des institutions bancaires
:
- De sous-traiter avec des opérateurs mobiles qui
utilisent le « mobile banking » pour payer les agents et
fonctionnaires dans les milieux où ils ne disposent pas d'agence, mais
qui sont couverts par les réaux téléphoniques.
Pour clore, nous nous garderons de prétendre avoir
épuisé un sujet aussi vaste que celui-ci, nous espérons
avoir contribué à poser le problème d'une manière
plus claire ouvrant des brèches qui méritent d'être
étudiées par d'autres chercheurs tout en privilégiant la
mise en place d'un cadre scientifique conséquent ; ainsi, toute oeuvre
humaine étant imparfaite, loin de nous la prétention de croire
que ce modeste travail est parfait, vos critiques et suggestions serons les
bienvenues. Aux responsables des institutions bancaires.
67
BIBLIOGRAPHIE
A. Ouvrages
1. BAKU F. et Al., Le défi démocratique :
Bilans et perspectives, éd. Promotion Afrique, 2004.
2. DESCHANEL Jean Pierre, Droit bancaire :
L'institution bancaire, Dalloz, 1995.
3. DOMINIQUE PLIHON, Nouveaux enjeux et nouvelles
stratégies, Ed. la documentation française, Paris, 1998.
4.

GRAWITZ M., Méthodes de Recherche en Sciences
Sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1979.
5. ISERN J. et Alli, Diagnostic du cadre
réglementaire et politique sur accès aux services financiers en
RDC, CGAP, Avril, 2007.
6. MABI MULUMBA, Les banques commerciales face aux mutations
structurelles de l'économie Zaïroise, éd. CRP et IRES,
Kinshasa 1983.
7. PATRICK CHAMPAGNE, Faire l'opinion in le nouveau jeu
politique, Ed. De minuit, Paris, 1990.
8. PIEDELIEVRE S., les nouvelles relations entre les banques
et les consommateurs, Semaine juridique, Ed. Entreprises et affaires,
Paris, 28 juillet 2005.
9. PIROUX et CLERC D., Lexique des Sciences
économiques et sociales, Ed. Ladécouverte, Paris, 2007.
10. SHOMBA KINYAMBA S., Méthodes de Recherches
Scientifiques, Ed. MES, Kinshasa, 1995.
11. SREVEL JR., Les banques et les transferts
électroniques, OCDE, Paris, 1983.
B. Revues et Articles
1. Archives de la Direction
Générale/ISTM-Bunia.
2. Arrêté Ministériel
N°157/MINESU/CABMIN/MML/EBK/PK/2010 du 27/09/2010 portant l'autonomisation
de l'Université de Bunia.
3. Association Congolaise de Banques, La crise
financière et les banques congolaises, Conférence Institut
des Réviseurs Comptables, Kinshasa-BCC, 4 novembre 2008.
4. Banque Centrale du Congo, Rapport annuel 2011, BCC,
2011.
5. Dictionnaire le Larousse, Grand format, Ed.
Larousse, Paris, 2001.
6. Direction du Personnel/ISP-Bunia, Liste
déclarative du personnel actif de l'ISP-Bunia, mise en jour le 13
Juillet 2013, ISP-Bunia, 2013.
7. Doing Business, Rapport annuel 2012, Janvier
2013.
8. Journal officiel de la République Démocratique
du Congo, Mai 2002.
9. Ordonnance-Loi n°87-236 du 29/06/1987, Codes
Larciers vol VI, Tome, 2003.
68
10. Université de Bunia, Vade-mecum du Gestionnaire
de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, UNIBU, 2013.
C. Mémoires
1. AGOSSOU GANSINHOUNDE J., Déterminants de la faible
bancarisation dans l'UEMOA, Maîtrise en Finances, Université
du Bénin, Benin, 2007.
2. KEZA Jean-Placide, Enjeux de la faible bancarisation en
Afrique subsaharienne, Doctorat en Sciences Economiques, Alger, 2009.
3.

MATAR FALL, Promotion de la bancarisation dans l'espace
UEMOA, Maîtrise en Droit des Entreprises, Université Gaston
Berger de Saint - Louis, 2008.
4. MBABAZI BEBWA, Facteurs et incidences de l'érosion
dans la Cité de Bunia, Mémoire inédit, ISP/Bunia,
2008.
5. MULOJI SHIMUNDA, Enjeux des NTIC dans la gestion de la
clientèle d'une banque. Cas de la RawBank, Mémoire
inédit, FSEG, Université de Lubumbashi, 2008
6. NDJONDJO P., Le système bancaire et
monétaire congolais de la RDC est non seulement étroit mais en
crise également, Mémoire inédit, ULPGL-GOMA, 2006.
7. ULUGA MADI E., Problématique du taux de
bancarisation : cas de la Banque du Congo et de la CADECO, Mémoire
inédit, Université de Bunia, 2010.
D. Notes de cours
1. BUJU NDALI, Démographie, Cours inédit,
G2 FSEG, Université de Bunia, 2010.
2. BURA DHENGO, Méthodes de Recherche en Sciences
Sociales, Cours inédit, G2 FSEG, CUEB, 2006.
3. BWAZOKA MBULA MAPATHA D., Economie Politique II,
Cours inédit, G2 FSEG, Université de Bunia, 2010.
4. DEDHONGA H., Méthodes de Recherche en Sciences
Sociales, Cours inédit, G2 FSEG, Université de Bunia,
2010
5. KAMATE MULUME F., Théories et Pratiques des
Sondages, Cours inédit, L2 Gestion Financière/FSEG,
Université de Bunia, 2013.
6. KUKUNGAMA KUMBIKUMBI E-B., Gestion des Institutions
Financières Congolaises, Cours inédit, L1 Gestion
Financière/FSEG, Université de Bunia, 2012
7. KWONKE ALYEGERA J., Initiation à la Recherche
Scientifique, Cours inédit, G1 FSEG, CUEB, 2008.
8. OTEMIKONGO MANDEFU J., Méthode de Recherche
Scientifique en Sciences Sociales, Cours inédit, G2 FSSPA, CUEB,
2006.
9. RIKRIYO DJOZA JC, Economie Politique I, Cours
inédit, CUEB, 2010.
69
E. Webographie
1. http//
www.google.com ;
2. http//
www.memoireonline.com ;
3. http/www.bcc.cd ;
4. http/
www.optimiseafrica.org ;
5. http//www.ministèredubudget.cd.
6. http//
www.afrikarabia.org.

70
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES iii
INTRODUCTION GENERALE 1
1. ETAT DE LA QUESTION 4
2.

PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL 5
3. HYPOTHESES DU TRAVAIL 6
4. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 7
4.1. Méthodes 7
4.2. Techniques 8
5. CHOIX ET INTERET DU SUJET 8
6. DELIMITATION DU SUJET 9
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9
8. DIFFICULTES RENCONTREES 9
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS GENERALES 11
1. PRESENTATION DE LA CITE DE BUNIA 11
1.1. HISTORIQUE DE LA CITE 11
1.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 12
1.3. ORGANISATION ADMINISTRATIVE 12
1.4. DONNEES GEO-PHYSIQUES 13
V' Végétation 13
V' Hydrographie 13
V' Sol 14
1.5. ECONOMIE DE LA CITE DE BUNIA 14
2. PRESENTATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET
UNIVERSITAIRE PUBLICS DE BUNIA 15
2.1. UNIVERSITE DE BUNIA 15
2.1.1. Localisation 15
71
2.1.2. Historique 15
2.1.3. Fonctionnement 16
2.1.4. Organigramme de l'Université de Bunia 19
2.1.5. Objectifs et missions 20
2.2. INSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE DE BUNIA 20
2.2.1. Localisation 20

2.2.2. Historique 21
2.2.3. Missions 22
2.2.4. Organigramme de l'Institut Supérieur
Pédagogique de Bunia 24
2.3. INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MEDICALES DE BUNIA 25
2.3.1. Localisation 25
2.3.2. Historique 25
2.3.3. Fonctionnement 26
2.3.4. Organigramme de l'Institut Supérieur des Techniques
Médicales de Bunia 27
3. DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE 28
3.1. Opinions 28
3.2. Enseignant 29
3.3. Bancarisation 29
3.4. Salaire 30
3.5. Agent de l'Etat 30
3.6. Fonctionnaire de l'Etat 30
CHAPITRE DEUX : SYSTEME BANCAIRE CONGOLAIS 31
2.1. HISTORIQUE 31
2.2. PRESENTATION 32
2.3. APERCU GENERAL 33
2.4. ORGANISATION DU SYSTEME BANCAIRE CONGOLAIS 43
2.4.1. La Banque Centrale du Congo 43
2.4.2. Les banques de second rang 44
2.5. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME BANCAIRE CONGOLAIS 45

72
2.5.1. Organe de contrôle 45
2.5.2. Mécanisme de contrôle 45
2.6. PLACE DE LA BANQUE DANS L'ECOMIE CONGOLAISE 46
2.7. CAUSES DE LA FRAGILITE DU SYSTEME BANCAIRE CONGOLAIS
46
2.7.1. Réglementation inadéquate et mauvaise
qualité des institutions 46
2.7.2. Taux d'inflation 47
2.7.3. Pauvreté et effet mémoire 47
2.7.4. Espérance et cycle de vie 47
2.8. STRATEGIES RECENTES DE BANQUES 48
CHAPITRE TROIS : PRESENTATION DES DONNEES, ANALYSE ET
INTERPRETATION DES
RESULTATS 50
3.1. ORGANISATION DE L'ENQUETE 50
3.2. POPULATION ET ECHANTILLON 50
3.2.1. Population d'étude 50
3.2.2. Echantillon choisi 51
3.3. ADMINISTRATION DU QUESTIONNAIRE 51
3.4. ANALYSE DES RESULTATS 52
CONCLUSION GENERALE 64
BIBLIOGRAPHIE 67
TABLE DES MATIERES 70
ANNEXES .70
73
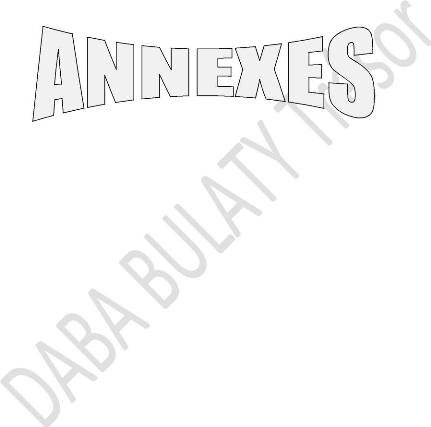
74
LISTE DES TABLEAUX

Tableau n° I : Liste des banques commerciales
agréées par la BCC oeuvrant à Bunia
|
32
|
|
Tableau n° II : Liste des banques commerciales
agréées par la BCC, en activité
|
35
|
|
Tableau n° III : Liste des banques radiées ou
fermées par la BCC
|
38
|
|
Tableau n° IV : Répartition des enquêtés
selon le sexe
|
.49
|
Tableau n° V : Réparation des
enquêtés ayant un compte bancaire par grade ..50
Tableau n° VI Relatif aux raisons avancées de non
détention de compte en banque .51
Tableau n° VII Relatif à la durée de la
détention du compte en banque 52
Tableau n° VIII Relatif à la détention du
compte avant la bancarisation de la paie 53
Tableau n° IX Relatif à la détention du
compte en banque après la bancarisation de la paie 54
Tableau n° X Relatif à la mécanisation des
enquêtés .55
Tableau n° XI Relatif à la culture
d'épargne des enquêtés 58
Tableau n° XII Relatif à la propension marginale
à épargner des enquêtés ...59
LISTE DES FIGURES
Figure n°1 relatif à la répartition des
enquêtés selon leur sexe 49
Figure n°2 relatif à la répartition des
enquêtés ayant un compte en banque 51
Figure n°3 tendance des raisons avancées de non
détention d'un compte bancaire 52
Figure n°4 relative aux raisons avancées de non
détention de compte bancaire 53
Figure n°5 relative à la détention de
compte bancaire avant la bancarisation de la paie 54
Figure n°6 relative à la détention de
compte bancaire après la bancarisation de la paie 55
Figure n°7 relative à la mécanisation des
enquêtés 56
Figure n°8 relative à la culture d'épargne
des enquêtés 58
Figure n°9 relative à la propension marginale
à épargner des enquêtés 60
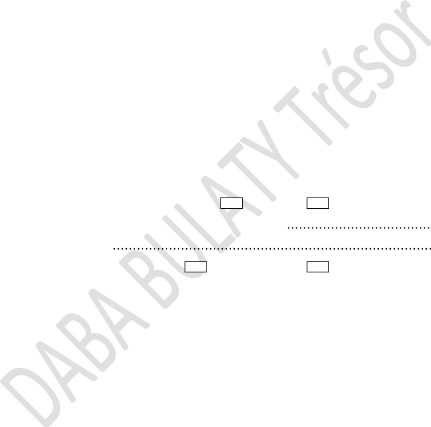
75
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
I. IDENTITE DE L'ENQUETE (E)
1. Sexe : M F
II. QUESTIONS
1. Avez-vous un compte en banque : Oui
|
Non
|
2. Si oui, la durée de la détention du compte en
banque :
a. 1 an ou moins, b. 2 ans, c. 3 ans, d. 4 ans, d. 5 ans ou
plus.
3. Grade de l'enquêté ayant un compte avant la
bancarisation de la paie : a. Chargé des Pratiques Professionnelles, b.
Assistant, c. Chef de Travaux,
d. Professeur Associé, e. Professeur Ordinaire
4. Grade de l'enquêté ayant un compte bancaire
après la bancarisation de la paie : a. Chargé des Pratiques
Professionnelles, b. assistant, c. Chef de Travaux,
d. Professeur Associé, e. Professeur Ordinaire
5. Si non, les raisons avancées de non détention
du compte en banque : a. Faute de revenu, b. Manque de confiance aux
institutions bancaires, c. Revenu faible
d. Pas important, e. Autres.
6.
Non
Etes-vous mécanisé (e) et payé (e) : Oui
7. Quels avantages présente la bancarisation, selon vous
:
8.
Non
Et les contraintes :
9. Vous arrive-t-il à épargner : Oui
10. Si oui, quel pourcentage de votre salaire arrivez-vous
à épargner
mensuellement ?



