2.3- Revue empirique
Des études empiriques sont effectuées dans
divers pays sur la masse salariale et révèlent que :
- Au Sud de Bigouden, selon le Maire Daniel Couïc de la
Commune d'Aquasud (2008-2009), le poids de la masse salariale plombe la
capacité d'investissement de la commune. Chiffre à l'appui le
maire déclare : «En deux ans, la masse salariale aurait dû
baisser or elle a augmenté de 13,55% ce qui ne permet pas à son
équipe de se lancer dans des investissements ».
- En Côte d'Ivoire, les travaux de Kouakou (2010) ont
montré que la part du budget consacrée au fonctionnement du
secteur public ivoirien, et en particulier les charges de personnel,
s'accroît de plus en plus, au détriment d'une affectation
conséquente de moyens aux autres postes de dépenses, notamment
les dépenses d'investissements publics. Pour inverser cette tendance, la
Côte d'Ivoire entreprend, avec l'appui des partenaires financiers, des
politiques pour assainir ses finances publiques, par l'optimisation de ses
dépenses afin de ramener le ratio masse salariale/recettes fiscales au
niveau de la norme communautaire de l'UEMOA.
2012-2013
Réalisé par Romaric
DOSSA
Analyse des effets de la masse salariale sur
l'investissement public au Bénin
21
En effet, la masse salariale est passée de 454,1
milliards de FCFA en 2000 à 749 milliards de FCFA, soit un taux de
croissance de 5,13%.
- Selon le Rapport 2006 d'AFRODAD, il ressort que quand le FMI
introduit une limitation de la masse salariale du secteur public, « les
plafonnements deviennent permanents », et même si les conditions
changent, la limitation demeure. Et « le fait que les limitations de la
masse salariale soient maintenues peut indiquer qu'ils constituent une
solution, mais au bout du compte, ils ne résolvent pas les
problèmes qu'ils tentent de résorber ». Cependant, les
mêmes mesures prescrites par ces partenaires et mises en oeuvre dans
d'autres pays ont permis aux Etats concernés de réussir leur
politique de maîtrise des dépenses en général, et en
particulier les dépenses de personnel dans l'Administration Publique.
Baldacci et al. (2003), montrent que parmi les pays à faible revenu
ayant appliqué un programme d'ajustement pendant les années 90,
les Etats qui ont réduit les déficits budgétaires de moins
d'un demi-point du P11B pendant la période considérée, par
la compression des dépenses courantes (par exemple les traitements et
salaires), ont enregistré une croissance additionnelle du revenu par
habitant de 0,5 % par an, pendant cette période de mise en oeuvre des
PAS.
- Les travaux de Cannac (1991) révèlent
également qu'il y a une corrélation positive entre
l'évolution du taux de chômage et celle du pourcentage du P11B
consacré à la rémunération des agents publics.
Ainsi, au cours des années 1990, le chômage a augmenté en
France en même temps que la dépense salariale des administrations.
Au contraire, le Royaume-Uni a connu dans le même temps une forte
diminution des dépenses salariales publiques et une réduction
parallèle du chômage.
- Par ailleurs, Zerrouq (2001) indique que la masse salariale
influence d'une façon très importante le creusement du
déficit budgétaire structurel au Maroc et que la réforme
de l'administration et de l'emploi dans le secteur public a contribué
d'une façon déterminante à l'assainissement de la
situation financière italienne grâce à un gel des
embauches, le nombre des agents publics a été réduit et
les dépenses pour les salaires publics sont passées de 12,8% du
P11B au début des années 90 à 10,6% du P11B en 2001.
- Au Sénégal, l'activité
économique en termes réel a cru de 2,9% en moyenne entre 1985 et
1991 soit un taux légèrement supérieur au croît
démographique. Le solde budgétaire est passé d'un
déficit de 5,7% en 1985/1986 à 1,1% en 1990/1991 avec un poids
réduit de la masse salariale de la Fonction publique qui
représente 41% des recettes courantes. Les arriérés de
2012-2013
Réalisé par Romaric
DOSSA
Analyse des effets de la masse salariale sur
l'investissement public au Bénin
22
l'Etat sont passés de 45 milliards en 1985/1986
à 10 milliards au 30 juin 1991. Le solde courant extérieur ne
représente que 3,6% du P11B en 1991.
- Au Togo, les études faites en mai 2003 par Hessou ont
montré que l'Etat engage plus de dépenses salariales qu'il en a
les moyens en recettes. En effet, le coefficient de la masse salariale (+2,34)
peut s'expliquer par le fort ratio de cette dernière par rapport aux
dépenses publiques pendant ces dernières années où
elle a évolué de 28,5% en 1990 à 36,9% en 2001, soit en
moyenne 32% pour toute la période de l'étude (1970 à
2001). Le ratio moyen de 50% de la masse salariale sur les recettes confirme
que seulement la moitié des recettes est réservée à
couvrir les autres charges de l'Etat dont l'investissement (Hessou, 2003).
- Au Maroc, les études ont montré que la masse
salariale constitue une contrainte majeure car elle limite les marges de
manoeuvre des pouvoirs publics en matière de développement de
l'investissement. « En 2001, la masse salariale a représenté
43,4% des dépenses globales de l'Etat, 53,2% des dépenses de
fonctionnement et l'équivalent de 2,4 fois le budget d'investissement
(hors Fonds Hassan II pour le Développement Economique et Social et hors
solde des comptes spéciaux du Trésor) ». Dans le même
pays, les études empiriques ont montré qu'à
fiscalité inchangée et par rapport au scénario de
référence, cette mesure se traduirait par un recul des revenus
des ménages. Celui-ci engendrerait à court terme une baisse de la
consommation. A moyen terme, il se produirait une hausse de la croissance
économique en raison de la maîtrise du déficit
budgétaire et de l'amélioration qui résulterait des
conditions de financement de l'économie. La baisse de la demande
susciterait un recul des prix intérieurs (1 point en moyenne à
court terme) dont l'impact serait bénéfique sur la
compétitivité des entreprises et le développement des
exportations. Pour ce qui est des importations des biens et services, il y
aurait un ralentissement sous l'effet conjugué de la baisse de la
demande et des prix relatifs. La réduction du poids de la masse
salariale aurait ainsi un effet favorable sur le compte courant de la balance
des paiements. Pour les finances publiques, la maîtrise de la masse
salariale entraînerait un accroissement de l'épargne publique et
partant une baisse du déficit budgétaire de 0,5 point du P11B au
cours de la première année et de 0,3% du P11B au cours des
années suivantes. L'amélioration du déficit serait
inférieure à la baisse des salaires en % du P11B. En plus du
manque à gagner en termes d'impôt général sur le
revenu des fonctionnaires, les recettes fiscales de l'Etat seraient
affectées par le ralentissement à court terme de
l'activité économique lié à un recul de la demande
(MFP_DPEG_MAROC, Janvier 2003).
2012-2013
Analyse des effets de la masse salariale sur
l'investissement public au Bénin
23
Réalisé par Romaric
DOSSA
- Sur la période 2007-2009 au Bénin, la
croissance réelle annuelle de la masse salariale du service public a
atteint en moyenne 14,7 %. En 2009 en particulier, les coûts salariaux en
termes réels ont augmenté de 21 % et, en pourcentage des recettes
fiscales, ont atteint 45,1 %, chiffre nettement supérieur au
critère de convergence de l'UEMOA (maximum de 35 %). Sur les dix
dernières années, la croissance réelle annuelle de la
masse salariale s'est établie en moyenne à 9,6%, pour une
croissance moyenne du PIB réel de 4,2 %. Bien que l'on constate
d'importantes variations annuelles, cette hausse est due à une
croissance annuelle moyenne du nombre de fonctionnaires de 2,6 % et à
une croissance annuelle réelle des salaires moyens de 6,9 %.
De tous les pays de l'UEMOA, seuls le Burkina-Faso et la
Guinée-Bissau (qui sort d'un conflit) dépassent le Bénin.
Par rapport au PIB, le Bénin affiche la masse salariale la plus
élevée de la région UEMOA, là encore hormis la
Guinée-Bissau (FMI, 2010).
Notre étude, « Analyse des effets de la masse
salariale sur l'investissement public au Bénin », qui couvre la
période de 1980 à 2012, se veut un éclairage sur le
pilotage de la masse salariale au Bénin et donc par conséquent
sur le pilotage de la politique budgétaire.
Analyse des effets de la masse salariale sur
l'investissement public au Bénin
2012-2013
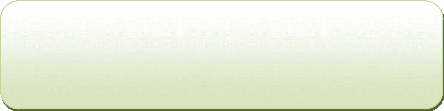
MeThODOLOgIe, PRESENTATION ET ANALYSE DES DONNEES
| 


