|
ECOLE DE SAGES-FEMMES
DE CLERMONT-FERRAND
Université d'Auvergne Faculté de
médecine
PREPARATION A LA NAISSANCE ET A LA PARENTALITE:
CE QUE
VEULENT LES FEMMES.
Etat des lieux, attentes et satisfaction des femmes
quant à la préparation à la naissance et
à la parentalité en Auvergne.
MEMOIRE PRESENTE ET SOUTENU
PAR
AMBRE ACOULON
NEE LE
06 DECEMBRE 1984
DIPLOME D'ETAT DE SAGE-FEMME
Année 2008
« La préparation transforme le comportement
des femmes. Cette transformation ne peut être le fruit d'une simple
suggestion qui resterait bien fragile en face des puissants conditionnements
défavorables du milieu social actuel. [En fait], il s'agit d'une
transformation de leur connaissance rationnelle des problèmes de
l'accouchement. »
Docteur Fernand Lamaze
Introduction
Dans les années 1950 naissait l'Accouchement Sans
Douleur (ASD) . Loin de la sentence divine, les femmes avaient désormais
le droit et quelques moyens pour lutter contre la douleur de l'accouchement .
Aujourd'hui, avec l'avènement de l'analgésie péridurale,
cette lutte est une norme, voire un dû . Et la préparation
à la naissance, ayant perdu son but premier, semble tomber en
désuétude .
En 2005, le plan de périnatalité mettait
l'accent sur l'importance de la préparation à la naissance dans
le suivi des femmes enceintes [1] . La même année, des
recommandations de bonnes pratiques, éditées par la Haute
Autorité de Santé (HAS), proposaient des solutions pour adapter
cette préparation aux attentes des femmes et des couples [2] .
Pourtant, lors de nos stages, nous avons pu remarquer que ces
recommandations étaient peu suivies .
De plus, il nous a semblé que la Préparation
à la Naissance et à la Parentalité (PNP) semblait avoir
perdu ses lettres de noblesse auprès des femmes, et que nombre d'entre
elles ne trouvaient pas d'utilité à ces séances .
Ceci semblait être confirmé par le fait qu'en
France, seulement 47% des femmes enceintes bénéficient d'une
Préparation à la Naissance .
Malgré tout, avec la médicalisation de plus en
plus poussée de la naissance, cette préparation paraît
nécessaire afin de rendre aux femmes et couples la
sérénité pour leur grossesse et la naissance de leur
enfant .
Nous nous sommes donc posés la question de
l'état des lieux actuel de la Préparation à la Naissance
et à la Parentalité en Auvergne . La préparation à
la naissance telle qu'elle est proposée aujourd'hui correspond-elle aux
attentes des femmes et des couples ? En sont-ils satisfaits ? Quelles sont les
raisons qui font que seule la moitié des femmes choisissent de
bénéficier d'une préparation à la naissance ?
Rappels
I-Contexte de l'apparition de la préparation
à la naissance
« J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu
enfanteras avec douleur . »
Voici la sentence divine promise à la femme . Dans
notre société judéo-chrétienne, et ce jusqu'au
début du XXe siècle, la douleur de la femme au moment de
l'accouchement était indispensable au rachat de la faute originelle et
à l'accession au statut de mère, elle était donc
justifiée [3] . A cette époque, la femme devait être
passive, dépendante et soumise . Ignorante à cause de la
persistance des tabous, notamment au sujet de la sexualité, elle
était lors de l'accouchement en proie à la peur et à la
douleur, et dépendante de « celui qui sait », à savoir
la sage-femme ou le médecin . Mais cette douleur était
valorisante pour la femme . « En mon accouchement, fortifiez mon coeur
pour supporter les douleurs qui l'accompagnent, et je les accepte comme un
effet de votre justice sur notre sexe, pour le péché de la
première femme . », disait une prière [4]. Il se
perpétuait de mère en fille un conditionnement dans ce
schéma doloriste . La femme qui enfante sans souffrir était
d'ailleurs considérée comme suspecte .
Certains médecins ont pourtant dès cette
époque soupçonné l'importance des peurs, des souvenirs,
des récits, dans l'augmentation de la douleur . Des conseils
étaient donnés aux sages-femmes, comme par exemple encourager,
rassurer la femme en couches, éviter d'avoir une attitude qui puisse
l'effrayer ... Mais cet effort n'avait que peu de poids devant la coutume
populaire, et la transmission de la peur se faisait de génération
en génération . Jusqu'en 1950, les progrès de la science
médicale n'ont pas été dans le sens de l'allègement
des douleurs .
Au cours de années 1950 à 1970, une modification
profonde de la perception sociale de la douleur s'est produit . De
fatalité, la douleur devint symptôme . Elle était nocive,
injustifiée, et il devint légitime de la combattre . Le statut
social de la femme évolua également : elle acquit le droit de
vote et devint légalement l'égale de l'homme ...
C'est dans ce contexte qu'apparût l'Accouchement Sans
Douleur . La femme abandonna ainsi son rôle de victime passive et
ignorante pour être reconnue en tant que personne capable de lutter
contre la douleur par sa propre volonté et son travail personnel .
Le souverain pontife Pie XII lui-même, dans un discours
prononcé le 8 janvier 1956 devant 700 gynécologues [5],
déclarait : « En punissant Eve, Dieu n'a pas voulu
défendre et n'a pas défendu aux mères d'utiliser les
moyens qui rendent l'accouchement plus facile et moins douloureux . Aux paroles
de l'écriture, il ne faut pas chercher d'échappatoire : elles
restent vraies dans le sens entendu et exprimé par le créateur :
la maternité donnera beaucoup à supporter à la mère
. De quelle manière Dieu a-t-il conçu ce châtiment et
comment l'exécutera-t-il ? L'Ecriture ne le dit pas . [...] La
science et la technique peuvent donc utiliser les conclusions de la psychologie
expérimentale, de la physiologie et de la gynécologie (comme dans
la méthode psychoprophylactique), afin d'éliminer les sources
d'erreur et les réflexes conditionnés douloureux, et de rendre la
parturition aussi indolore que possible ; l'Ecriture ne le défend pas
. » .
II- La préparation à la naissance 1- Historique
En 1956, le docteur Fernand Lamaze définit ainsi la
méthode de l 'accouchement sans douleur [6,7] : «L'accouchement
sans douleur par la méthode psychoprophylactique est le résultat
d'une éducation physique et psychique de la femme enceinte pendant les
derniers temps de sa grossesse . Cette méthode physiologique,
expérimentale, vise très exactement à abolir la douleur
soi-disant fatale liée à la contraction de l'utérus en
travail . Elle ne requiert l'usage d'aucun médicament . Elle n'a pas de
contre-indication . Elle ne comporte aucun risque ni pour la mère, ni
pour l'enfant .»
L'aboutissement à cette méthode est le
résultat de plusieurs travaux que l'on peut définir en trois
périodes [4] .
a-Les accouchements sous suggestion hypnotique
C'est au XIXe siècle que l'intérêt se
porte sur l'hypnose . Les travaux de Charcot à la
Salpêtrière en 1888 et de Bernheim à Nancy en 1891
aboutissent à l'introduction de l'hypnose dans la thérapeutique
médicale . Des petites opérations sont tentées sous
hypnose, et dans les années 1880 Liebeault relate de manière
très détaillée les résultats de plusieurs
tentatives d'analgésie hypnotique lors d'accouchements . Par la suite,
plusieurs médecins français réussissent à
analgésier des parturientes, et rapportent leurs expériences .
En 1899, Paul Joire, un médecin de Lille,
développe l'idée de l'inutilité de la douleur dans le
travail d'accouchement, et démontre que la suggestion hypnotique
accélère l'accouchement et évite souvent les interventions
. Il propose la suggestion à l'état de veille, et en explique la
technique : « Il consiste uniquement à placer une des mains sur
les yeux du sujet qui ferme spontanément les paupières sous cette
légère pression . L'autre main est appliquée sur le
ventre, et en même temps l'on fait une suggestion verbale, lente,
persuasive, sans avoir l'air, en quoi que ce soit, d'imposer à la
patiente une volonté ou une idée qui s'insinue doucement, qu'elle
accepte et qu'elle réalise sans se douter qu'elle est
suggestionnée . » Ainsi, « la femme ressentira les
contractions [...] mais cette contraction ne sera nullement
pénible et ne s 'accompagnera d'aucune douleur . »
C'est Kogerer, médecin viennois, qui, en 1922, reprend
et systématise les résultats antérieurs, et obtient
l'indolorisation par suggestion post-hypnotique . L'hypnose n'est plus
nécessairement pratiquée au moment même de l'accouchement
.
Malgré ces travaux, l'analgésie hypnotique n'a
jamais fait l'objet d'une application de masse pour trois raisons :
· L'emploi de l'éther aux USA et la mise au point de
l'anesthésie pharmaceutique entre 1842 et 1846 ont diminué
l'intérêt pour les recherches sur l'analgésie
hypnotique .
· L'hypnose reste entourée d'un halo magique, et
bénéficie d'une mauvaise réputation .
· Son application nécessite une formation
difficile et une longue pratique .
b-La naissance de la méthode psychoprophylactique
C'est en Russie que cette méthode trouve sa source .
L'hypnose y a connu un large succès et, en 1917, l'Etat donne à
Pavlov son appui pour développer ses travaux sur l'hypnose. Platonov,
psychiatre, et Velvovski développent la méthode hypnosuggestive
et en concluent que :
· la douleur est inutile dans le déroulement de
l'accouchement,
· la suppression de cette douleur est possible par la
suggestion verbale,
· ces méthodes sont sans danger pour la mère
et l'enfant .
Ils manifestent également deux inquiétudes :
l'emploi difficile de la suggestion hypnotique, et la passivité des
parturientes dans cette méthode .
Ils cherchent donc à mettre au point une
méthode dans laquelle la parole permettrait aux femmes de
prévenir la douleur .
En 1936, Nicolaïev insiste sur la
nécessité de remanier le psychisme des femmes par l'acquisition
de la confiance et du savoir . A sa suite, Platonov et Velvovski mettent au
point un programme qui permet de réaliser une éducation
préventive de toutes les femmes, afin de les prémunir contre le
dogme de la douleur inévitable . Ce programme est appliqué
à des femmes en fin de grossesse, et fait intervenir aussi bien des
informations sur l'anatomie, la physiologie, l'accouchement, que
l'entraînement à la respiration, à la poussée ...
En France, Lamaze fut l'apôtre de cette méthode .
c-L'accouchement sans crainte
Dans les années 1930, G.D. Read, un accoucheur
anglais, met au point sa méthode d' « accouchement naturel »,
après avoir eu « la révélation qu'aucune loi
naturelle ne justifiait la souffrance de l'accouchement » . En 1933
paraît Childbirth without fear, où il explique
qu'éduquer les femmes éviterait la peur et donc la douleur, ceci
grâce à des informations, de l'entraînement physique, et de
la relaxation .
Aujourd'hui, l'Accouchement Sans Douleur a
évolué en plusieurs méthode de Préparation à
la Naissance et à la Parentalité.
2-Fernand Lamaze, père de l'accouchement sans douleur.
« Il n'y a donc là pas de miracle, pas plus
que d'illusionnisme ou de subterfuges . La femme apprend à accoucher,
comme elle apprendrait à nager, comme elle a appris à lire et
à écrire, et elle accouche sans douleur . » F. Lamaze,
1956.
Né à Nancy en 1891, Fernand Lamaze arrive
à Paris en 1910 pour y étudier la médecine [8, 9] .
D'abord destiné à la neurologie, il s'oriente en 1923 vers la
carrière de médecin accoucheur . En 1947, il devient directeur de
l'hôpital des Métallurgistes, qui le nomme à la tête
de la Maternité des Bluets, établissement géré par
la CGT, liée à l'époque au parti communiste .
En 1951, il part en voyage d'étude en Russie .
Très intrigué par les travaux du professeur A.P. Nikolaiev, qui
démontrait qu'une éducation psychique de la femme enceinte
pouvait l'amener à accoucher sans douleur, il assiste à un tel
accouchement et en ressort enthousiaste : « Ce fut pour moi un
véritable bouleversement de voir cette femme accoucher sans aucune
manifestation douloureuse ... tous ses muscles étaient
relâchés ... pas la moindre angoisse dans ses yeux, pas un cri,
pas la moindre goutte de sueur ne perlait sur son front, pas une seule
contraction du visage . Le moment venu, elle a fait les efforts de
poussée sans aucune aide, dans un calme absolu ... Après avoir
été le témoin d'une chose pareille, je n'avais plus qu'une
préoccupation : transplanter
cela en France et ... cela devenait pour moi une
idée fixe . » (Lamaze, 1953) [9] .
À son retour, avec l'aide du docteur Vellay, il jette
les bases d'une expérimentation reposant sur trois conditions
essentielles : obstétricale (normes d'un accouchement naturel), physique
(entraînement régulier et méthodologique, sous
contrôle médical, permettant d'obtenir une parfaite condition
physique) et psychique, où « il s'agit de placer
l'écorce cérébrale, le cortex, dans des conditions
d'activité maximale. Pour cela, on s'efforce de supprimer tous les
éléments qui peuvent être dépresseurs ... ; une
éducation, une connaissance des faits réels de l'accouchement
parviendront à atteindre ce résultat . La parole jouera le
rôle d'un puissant excitateur conditionnel qui fera disparaître les
vieux réflexes conditionnés qui liaient dans l'esprit des femmes
la douleur à l'acte de l'enfantement . » (Vellay)
En 1952, il réalise aux Bluets le premier accouchement
sans douleur . Mais cette méthode ne fait pas l'unanimité dans le
monde médical . A deux reprises, Lamaze et Vellay sont traduits devant
le Conseil de l'Ordre et ils sont blanchis en 1954 .
Le 8 Janvier 1956, le Pape Pie XII prend position en faveur
de l'ASD devant 700 gynécologues et médecins [5] .
Aux Bluets, l'organisation de la préparation se met en
place, avec le soutien logistique des syndicats qui entreprennent sa
popularisation dans les entreprises de la région parisienne . Le
personnel bénéficie de formations adaptées, de modules
d'accueil, et la maternité devient un lieu de stage pour les
médecins et les sages-femmes .
Le 13 mars 1953, un projet de loi, déposé par
le groupe parlementaire communiste, recommande l'enseignement
généralisé de la méthode . Le 1er juillet 1956,
l'Assemblée Nationale adopte le projet de remboursement des six
séances préparatoires à l'ASD, étendu à huit
entretiens en 1960 . Des moyens financiers sont mis à disposition pour
diffuser cette méthode .
Mais en 1957, des difficultés financières et
politiques rattrapent la maternité des Bluets et Lamaze est
écarté de son poste .
Le 6 mars 1957, le Docteur Lamaze meurt d'une crise cardiaque
.
3-Les différentes préparations à la
naissance
[10, 11]
a-La sophrologie
La sophrologie a été créée en
1960 par Alfonso Caycedo, médecin neuropsychiatre colombien d'origine
basque espagnole [12] . Il propose une approche psychocorporelle basée
notamment sur une conscience accrue de soi-même et sur le renforcement
des structures positives .
La sophrologie s'appuie sur trois principes fondamentaux :
· Amener le schéma corporel à plus de
réalité vécue, pour habiter le corps en bonne
santé, et conquérir l'harmonie physique et psychique . Il ne
s'agit pas tant de se représenter notre corps que de le
sentir-ressentir, de le vivre tel qu'il est réellement .
· Renforcer l'action positive, afin de développer
les éléments positifs du passé, du présent et du
futur, et de mieux utiliser tous nos potentiels . Ce principe s'appuie sur le
fait que toute action positive dirigée vers notre corps ou vers notre
mental a une répercussion positive sur notre être tout entier .
· Développer la réalité objective,
pour apprendre à voir les choses davantage comme elles sont, à
développer plus de réalisme et donc d'efficacité dans
l'action.
Huit séances sont remboursées à 100% par
la sécurité sociale à partir du 6e mois de grossesse
révolu (70% avant ce terme) .
b-L'haptonomie
L'haptonomie est un accompagnement parental plus qu'une
préparation à la naissance [13] . Du grec haptein, qui
signifie toucher, cette méthode est basée sur le toucher et la
communication verbale . Elle a été créée par Frans
Veldman, un médecin hollandais .
Le toucher de l'enfant à travers la paroi abdominale
marque les débuts des relations affectives avec l'enfant . La
méthode a l'avantage de créer un lien supplémentaire entre
le bébé et ses parents bien avant la naissance . Cet
échange tactile sécurise à la fois l'enfant, le
père et la mère .
En haptonomie, la place du père est fondamentale . Cet
accompagnement se fait dans l'intimité du trio père, mère
et futur bébé, et, bien sûr, de l'hapnothérapeute .
De la première à la dernière séance, il y a une
évolution préparant les futurs parents d'abord au contact avec le
futur enfant, puis à la naissance, et ensuite aux premiers gestes avec
le nouveau-né . Les dernières séances sont axées
sur la descente du bébé, en lui montrant le chemin à
suivre jusqu'à la naissance . Les séances se poursuivent
jusqu'à l'âge de la marche de l'enfant .
L'haptonomie se pratique à partir du quatrième
mois de la grossesse, voire avant, mais jamais après le septième
mois . Les séances ne sont jamais collectives et se déroulent
toujours en couple .
Le remboursement de la sécurité sociale se fait
sur la base d'une consultation de généraliste ou de sage-femme
.
c-Le chant prénatal
Basé sur la psychophonie, méthode introduite
par la cantatrice Marie-Louise Aucher dans les années 50, le chant
prénatal s'appuie sur les correspondances vibratoires entre les sons et
le corps humain [14] . Les séances hebdomadaires, qui réunissent
futures mères et nouvelles mamans avec leurs bébés,
commencent par des exercices physiques de mise en condition : travail
respiratoire,
mouvements du bassin, étirements, enchaînements de
vocalises aiguës et graves, et chants à tonalité affective
s'adressant au bébé, qui est particulièrement
réceptif aux sons provenant de la voix des parents .
Au cours des séances, on apprend les sons aigus, qui
libèrent des tensions tout au long de la grossesse, et les sons graves,
pour se détendre au moment de l'accouchement .
On pratique cette méthode dès le 5e mois de
grossesse .
A moins de s'inscrire dans le cadre de séances de
préparation classique avec une sage-femme, cette pratique n'est pas
remboursée par la sécurité sociale .
d-La préparation en piscine
L'activité aquatique fait travailler le corps
harmonieusement et en souplesse car chaque mouvement se fait en douceur [15] .
L'eau permet en outre de ne plus sentir les effets de la pesanteur et de se
détendre totalement .
Cette préparation permet surtout de travailler le
souffle, l'ouverture du bassin, et la relaxation . Les exercices initient le
couple aux attitudes facilitant la naissance ou tout simplement à la
détente tout au long de la grossesse . Cette gymnastique douce
améliore également le tonus musculaire .Surmonter certaines peurs
en affrontant des exercices en apnée fait partie du volet psychologique
de cette préparation .
La préparation aquatique peut-être
assurée par un duo sage-femme/maître nageur dans une piscine
chauffée à environ 30°C .
On commence en général vers le 5e mois de
grossesse . Les séances ne sont pas remboursées par la
sécurité sociale .
e-Le yoga
Inspiré de la philosophie orientale, le yoga vise
à créer une harmonie totale entre le corps et l'esprit [16] . La
future mère apprend à adopter naturellement les positions qui la
soulagent que ce soit pendant la grossesse ou lors de l'accouchement . Il
s'agit d'un travail sur soi et sur son corps, autant psychique que physique
.
Le cours commence par une relaxation, puis viennent des
exercices respiratoires, de contrôle du souffle . Une grande partie de la
séance est ensuite consacrée à des mouvements plus
dynamiques, et à des positions favorisant la détente du
périnée et la descente du bébé .
Huit séances dispensées par une sage-femme sont
remboursées par la sécurité sociale . f-La
préparation classique
Elle se pratique généralement à partir
du septième mois et a d'abord pour objectif d'informer les futurs
parents sur la physiologie et le déroulement de la grossesse et de
l'accouchement, sur la péridurale, l'accueil du bébé,
l'allaitement ... [17] La pratique des différentes respirations, des
positions et des exercices de relaxation permet de préparer le corps
à la naissance .
Les séances d'une à deux heures sont en
général suivies de discussions entre futures mères
permettant d'aborder questions, angoisses, doutes ...
Généralement au nombre de huit séances,
cette préparation est intégralement remboursée par la
sécurité sociale .
4-Recommandations professionnelles
En 2005, la Haute Autorité de Santé
émettait des recommandations quant à la préparation
à la naissance et la parentalité .
Il s'agissait d'abord d'élaborer des recommandations
par rapport à l'information des femmes enceintes [18] . Le premier
principe de cette information est énoncé ainsi
:«Informer toute femme enceinte du bénéfice pour elle et
son bébé d'un suivi régulier de sa grossesse. Ce suivi est
complété par une éducation prénatale au cours de
séances de préparation à la naissance et à la
parentalité.»
Le quatrième principe déclare que «
cette information porte sur les services de soins disponibles, le
coût des prestations, les possibilités qui lui sont
proposées pour le suivi de la grossesse, la préparation à
la naissance et à la parentalité, [...] . »
Quant au sixième principe, il énonce qu'il faut
« proposer systématiquement à chaque femme enceinte ou
au couple une préparation à la naissance et à la
parentalité dès le premier trimestre de la grossesse en
participant à des séances, collectives ou individuelles . Par une
approche préventive et éducative, la PNP a pour objectifs
:
· d'accompagner la femme et le couple tout au long
de leur évolution vers la parentalité en étant à
leur écoute .
· de développer la confiance de la femme ou
du couple en leur capacité à mettre au monde et à
s'occuper de leur enfant .
· de renforcer l'information délivrée
à l'occasion des consultations prénatales . »
Dans des recommandations professionnelles spécifiques
à la PNP [2], l'HAS a déclaré que la PNP contribuait
à l'amélioration de la santé des femmes enceintes, des
accouchées et des nouveaux-nés . Ces recommandations concernent
tous les professionnels impliqués dans la périnatalité
.
Pour l'HAS, la PNP doit comporter 4 étapes :
· Entretien précoce, individuel ou en couple .
· Planification des séances prénatales,
individuelles ou en groupe, en s'adaptant à chaque femme et couple .
· Mise en oeuvre des séances .
· Évaluation individuelle par rapport aux
objectifs de la PNP pour chaque femme et couple .
Idéalement, les séances de PNP ne doivent pas
avoir lieu uniquement pendant la grossesse mais aussi après
l'accouchement et après le retour à domicile .
Huit séances prénatales de 45 minutes minimum
sont prises en charge par l'Assurance Maternité, y compris l'entretien
du premier trimestre . Ces séances sont individuelles ou en groupe, sauf
le premier entretien qui est obligatoirement individuel ou en couple . La
taille du groupe doit favoriser la participation active des femmes et couples,
et les séances doivent être ouvertes aux futurs pères .
« Il est recommandé de présenter les
séances de PNP au cours de l'entretien individuel sous la forme d'un
programme comportant les objectifs, le contenu, les techniques de travail
corporel, les techniques éducatives, la fréquence, la
durée et le déroulement des séances, les modalités
s'évaluation afin :
· de présenter les possibilités
locales de PNP au sein du réseau périnatal ou des ressources de
proximité [...] ;
· de permettre à la femme ou au couple de
choisir le programme qui satisfera le mieux leurs besoins et leurs aspirations
;
· de planifier individuellement les séances
en fonction des besoins de prévention et
d'éducation de chaque femme ou couple ;
· d'adapter dans la mesure du possible leur contenu
à chaque femme enceinte ou couple . »
La PNP effectuée durant la période
prénatale doit être poursuivie systématiquement à la
maternité après la naissance et en cas de retour précoce
à domicile .
La Charte Européenne des Droits de la Parturiente,
votée en 1988, stipule en outre que doit être assuré
à toute femme enceinte le droit de participer « avec le
partenaire, à des cours de préparation à l'accouchement,
afin de connaître le déroulement de la grossesse et de
l'accouchement sur le plan physique, ainsi que les techniques et les
méthodes en usage . » [19] .
Méthodologie
I-Objectif de la recherche
L'objectif principal était :
· Evaluer la situation de la préparation à la
naissance et à la parentalité en Auvergne, et proposer des
solutions afin de remédier aux problèmes rencontrés .
Les objectifs secondaires devaient :
· Déterminer les attentes des femmes par rapport
à cette préparation .
· Déterminer la satisfaction de ces femmes suite
à cette préparation .
· Etudier la population des femmes n'effectuant pas de
préparation .
II-Type d'étude
Il s'agissait d'une étude descriptive non
randomisée .
III-Sélection
La population étudiée était
constituée de patientes ayant suivi ou non une préparation
à la naissance et à la parentalité, ayant accouché
par voie basse ou par césarienne (prophylactique ou en urgence) dans
l'une des 10 maternités publiques d'Auvergne, à savoir :
· maternités de niveau III : Maternité de
l'Hôtel Dieu et Polyclinique du CHU de Clermont-Ferrand (63) .
· maternités de niveau II : Montluçon (03),
Moulins (03), Vichy (03), Issoire (63), Le Puy-en-Velay (43), Aurillac (15)
.
· maternités de niveau I : Thiers (63),
Saint-Flour(15) .
IV-Critères de jugement
Nous avons choisi différents critères en fonction
de la population étudiée :
Pour toutes les femmes :
· le niveau de maternité
· l'âge des femmes
· la parité
· les professionnels ayant suivi la grossesse
· le choix de péridurale
· l'opinion par rapport à l'utilité de la PNP
vis à vis de la douleur du travail d'accouchement
Pour les femmes ayant effectué une préparation
:
· le type de préparation
· le lieu de préparation
· l'information reçue par rapport à cette
préparation
· le mode d'orientation vers la préparation
· le nombre de personnes présentes lors des
séances et l'opinion vis à vis de ce nombre
· le nombre de séances effectuées
· les informations attendues de cette préparation
· les éléments à rajouter à
cette préparation
· la satisfaction globale par rapport à cette
préparation
Pour les femmes n'ayant pas effectué de
préparation :
· la raison de ne pas faire de préparation
· le souhait a posteriori d'en faire une
V-Méthode d'intervention
Nous avons utilisé un questionnaire qui a
été distribué aux accouchées lors de leur
séjour par les sages-femmes du service de suites de couches . 20
questionnaires ont été donnés dans chaque
maternité, soit un total de 200 questionnaires .
Les questionnaires ont été remplis entre novembre
2007 et janvier 2008 .
132 questionnaires nous ont été retournés,
soit 66% de réponse .
VI-Méthode d'observation
L'outil utilisé était le questionnaire (Annexe I)
.
VII-Méthode d'évaluation
Les résultats ont été exploités et
analysés grâce au logiciel Epiinfo .
Pour les variables qualitatives, nous avons utilisé le
test du Khi2 .
Pour les variables quantitatives, nous avons utilisé la
comparaison de moyennes .
Le « p » utilisé permet d'affirmer que la
différence observée n'est pas due au
hasard, le seuil étant de 5% .
Si p<0,05, la différence est statistiquement
significative .
Si p>0,05, la différence n'est pas statistiquement
significative .
18
Résultats
et
Analyse
I-Population étudiée
Les réponses provenaient volontiers des
maternités de niveau 2 (graphique 1) . graphique 1: niveaux de
maternité
|
niveau 1 : 23,5%
niveau 2 : 62,9%
niveau 3 : 13,6%
|
|
|
15-19 ans : 3,03% 20-24 ans : 12,12% 25-29 ans : 34,09% 30-34
ans : 34,85% 35-39 ans : 13,64% >40 ans : 2,27%
|
|
La classe d'âge la plus représentée est celle
des 25-34 ans (graphique 2) .
graphique 2: âge des patientes
Les primipares et les multipares sont présentes en
quantité égales (graphique 3) .
graphique 3: parité
|
primipare : 52,3%
multipare : 47,7%
|
|
|
PNP+ : 52,27%
PNP- : 47,43%
|
|
Les femmes ayant fait de la préparation à la
naissance sont en proportion égale par rapport à celles n'en
ayant pas fait (graphique 4) .
graphique 4: préparation à la naissance
II-Etat des lieux de la PNP 1-Parité
Les primipares effectuent plus de préparation à
la naissance et à la parentalité (PNP) que les multipares, et
cette différence est statistiquement significative (p=0,00000643)
(graphique 5) . 71% des primipares et 31,75% des multipares ont
bénéficié de PNP .
graphique 5: PNP en fonction de la parité
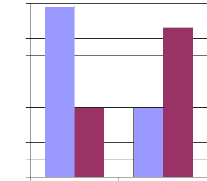
Effectifs
45
40
25
20
50
35
30
15
10
5
0
PNP +
PNP -
primipare multipare
PNP+ = femmes ayant bénéficié de PNP PNP- =
femmes n'ayant pas bénéficié de PNP
PNP+ = multipares ayant bénéficié de PNP
pour cette grossesse . PNP- = multipares n'ayant pas
bénéficié de PNP pour cette grossesse .
Chez les multipares, 44% des femmes ayant
bénéficié de PNP lors de leurs précédentes
grossesses ont choisi d'en faire lors de cette grossesse, contre 13,6% chez les
femmes n'ayant pas fait de PNP pour les grossesses précédentes
.
Chez les multipares ayant bénéficié de
PNP durant cette grossesse, 85,7% avaient fait une PNP pour les grossesses
précédentes ; chez les femmes ne faisant pas de
préparation pour cette grossesse-là, 54,8% en avaient
bénéficié pour les grossesses
précédentes.
graphique 6: PNP chez les multipares
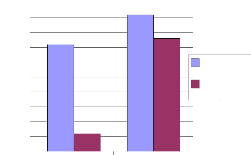
Effectifs
22,5
17,5
12,5
2,5
7,5
25
20
15
10
5
0
PNP+ autres grossesses
PNP- autres grossesses
PNP + PNP -
2-Niveau de maternité
Il n'y a pas de différence statistiquement
significative entre les niveaux de maternité, entre les femmes qui ont
fait de la PNP et celles qui n'en ont pas fait (p=0,718) (graphique 7) .
graphique 7: PNP et niveau de maternité
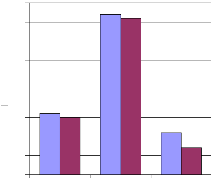
Effectifs
45
40
25
20
35
30
15
10
5
0
PNP+
PNP-
niveau 1 niveau 2 niveau 3
Malgré tout, on remarque une légère
différence en maternité de niveau 3 puisque 61,1% des femmes ont
bénéficié de PNP . Dans les autres niveaux, on retrouve
autant de femmes dans le groupe ayant fait de la PNP que dans l'autre groupe
.
3-Age
La différence d'âge entre les femmes ayant fait
une PNP et celles n'en ayant pas fait n'est pas statistiquement significative
(p=0,4651) (graphique 8) . Cette moyenne est de 29,6 ans .
graphique 8: âge et PNP
Effectifs
|
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
|
|
PNP-
PNP+
|
|
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 >40
ans ans ans ans ans ans
Chez les 20-24 ans et les 25-34 ans, on retrouve autant de
femmes ayant fait de la PNP que de femmes n'en ayant pas fait .
Chez les femmes de 35 ans et plus, 60% des femmes ont
bénéficié de PNP .
Chez les 15-19 ans, 75% des femmes ont
bénéficié de PNP .
4-Suivi des femmes
Les femmes suivies par les sages-femmes libérales et
les gynécologues de ville font plus de Préparation à la
Naissance et à la Parentalité et cette différence est
statistiquement significative (respectivement p=0,0045 et p=0,032) ; par
contre, celles suivies par un gynécologue en maternité en font
moins et cette différence est également statistiquement
significative (p=0,0044) (graphique 9) . Les femmes suivies par une sage-femme
en maternité font également plus de préparation mais cette
différence n'est pas statistiquement significative (p=0,1567) . Aucune
différence n'est constatée pour les femmes suivies par des
médecins généralistes .
graphique 9: suivi des patientes
Effectifs
|
55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
|
|
PNP+ PNP-
|
|
gynéco ville
gynéco mater
sf libérale
général sf
mater
général = médecin
généraliste
sf = sage-femme
mater = maternité
gynéco = gynécologue-obstétricien
5-Travail
Il n'y a pas de différence statistiquement
significative entre les femmes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas
(p=0,0704) (graphique 10) .
graphique 10: travail et PNP
PNP + PNP -
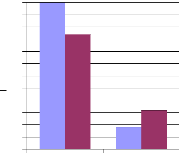
Effectifs
45
40
25
20
60
55
50
35
30
15
10
5
0
travail + travail -
travail+ = femmes ayant une activité professionnelle
travail- = femmes n'ayant pas d'activité professionnelle
6-Choix de la péridurale
Il n'y a pas de différence statistiquement
significative entre les femmes souhaitant immédiatement une
analgésie péridurale (APD) en arrivant en salle d'accouchement
(ou ayant une césarienne programmée) et celles n'en souhaitant
pas de suite, par rapport à la PNP (p=0,4145) (graphique 11) .
graphique 11: PNP et choix de
péridurale
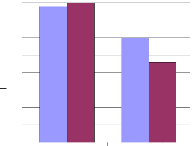
Effectifs
40
25
20
35
30
15
10
5
0
PNP + PNP -
péri + péri -
péri+ = femmes souhaitant bénéficier
immédiatement d'une APD dès l'arrivée en salle de
naissance péri- = femmes ne souhaitant pas immédiatement
d'APD.
Chez les femmes ayant bénéficié de la
PNP, 56,5% souhaitaient immédiatement la péridurale, contre 63,5%
chez celles n'ayant pas bénéficié de la PNP .
Chez les femmes souhaitant bénéficier
immédiatement de la péridurale, 49,4% ont
bénéficié de la PNP, contre 56,6% chez les femmes ne
souhaitant pas immédiatement la péridurale .
Les femmes ayant bénéficié d'une PNP
sont plus nombreuses à penser que la PNP est utile pour gérer les
douleurs de l'accouchement, par rapport à celles n'ayant pas fait de
PNP, et cette différence est statistiquement significative
(p=0,00000158) (graphique 12) .
graphique 12: utilité de la
PNP
|
70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
|
|
|
|
Effectifs
|
|
PNP +
PNP -
|
|
PNP utile PNP non utile
PNP utile = femmes trouvant que la PNP est utile pour
gérer les douleurs de l'accouchement
PNP non utile = femmes ne trouvant pas d'utilité
à la PNP pour gérer les douleurs de l'accouchement
Effectifs
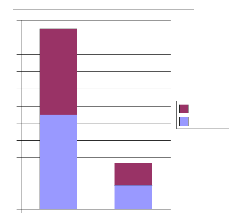
graphique 14: utilité de la PNP et
parité
110
100
40
90
80
70
60
50
30
20
10
0
multipare primipare
PNP utile PNP inutile
Par contre, il n'y a pas de différence en ce qui
concerne cette utilité selon le choix immédiat de
péridurale ou non (p=0,711) (graphique 13) .
Chez les femmes ne souhaitant pas de péridurale, 81,1%
jugent la PNP utile pour gérer la douleur, contre 79,5% chez les femmes
souhaitant immédiatement bénéficier de la
péridurale .
Effectifs
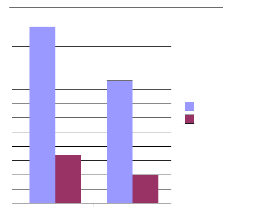
45
40
graphique 13: utilité de la PNP et choix de la
péridurale
65
60
55
50
35
30
25
20
15
10
5
0
PNP utile PNP non utile
péri + péri -
péri+ = femmes souhaitant bénéficier
immédiatement d'une APD dès l'arrivée en salle de
naissance
péri- = femmes ne souhaitant pas immédiatement
d'APD.
Il n'y a pas non plus de différence entre les primipares
et les multipares sur l'utilité de la PNP par rapport à la
gestion de la douleur (p=0,96) (graphique 14) . 79,7% des primipares et 79,3%
des multipares trouvent la PNP utile .
Il n'y a pas non plus de différence entre les
primipares et les multipares, par rapport au choix immédiat de
péridurale ou non (p=0,545) (graphique 15) .
graphique 15: péridurale et parité
Effectifs
|
80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
|
|
multipare primipare
|
|
péri+ péri-
Chez les primipares, 62,3% souhaitent immédiatement
une analgésie, contre 57,1% chez les multipares .
Chez les femmes souhaitant immédiatement une
péridurale, on trouve 54,4% de primipares, contre 49% chez celles ne
souhaitant pas d 'analgésie tout de suite .
La PNP est jugée utile en raison principalement des
informations données et de l'apprentissage de la respiration (graphiques
16 et 17) .
graphique 16: raison de l'utilité et PNP
PNP-PNP+
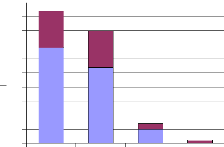
Effectifs
45
40
25
20
50
35
30
15
10
5
0
information respiration relaxation autre
graphique 17: raison de l'utilité et
parité
Effectifs
|
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
|
|
multipare
primipare
|
|
informatio n
|
respiration relaxation autre
|
|
7-Type de préparation
La préparation classique est la plus prisée,
que ce soit chez les primipares ou les multipares (graphique 18) .
graphique 18: type de préparation
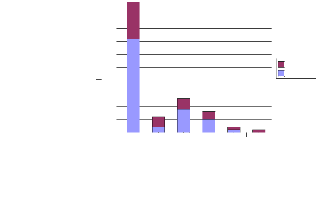
50
45
40
35
multipares
primipares
15
10
5
0
classiq yoga piscine sophro hapto chant
8-Information sur la PNP
Effectifs
30
25
20
Les femmes ayant bénéficié de la PNP sont
70% à avoir reçu une information sur les différentes
sortes de préparation (graphique 19) . 67,35% des primipares et 75% des
multipares ayant bénéficié de la PNP ont reçu cette
information .
graphique 19: information sur la pnp
info+ info-
Ce sont les femmes suivies par des sages-femmes
libérales qui sont le mieux informées sur les différentes
sortes de préparation, mais cette différence n'est pas
significative (graphique 20) .
graphique 20: information sur la pnp
Pourcentages
|
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00%
10,00% 0,00%
|
|
info-info+
|
|
générali ste
sf libérale
sf mater gynéco
mater
gynéco ville
L'information par rapport à cette PNP vient
principalement des magazines ou du bouche à oreille chez les primipares
; chez les multipares, l'information vient autant du médecin ou de la
sage-femme que d'une source non médicale (graphique 21) .
graphique 21: source de l'information
Effectifs
|
32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0
|
|
multipare
primipare
|
|
info médecin info autre
info autre = information reçue par le
bouche-à-oreille ou les médias (magazines, émissions
télévisées...) .
9-Lieu de la PNP
La majorité des femmes effectuent la PNP à la
maternité, que ce soit les primipares ou les multipares (graphique 22)
.
graphique 22: lieu de PNP
Effectifs
|
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
|
|
multipare primipare
|
|
maternité sf libérale autre
10-Orientation vers la PNP
Une fois sur deux, les femmes décident seules de faire
de la PNP . Chez les primipares, l'orientation se fait autant seule que par le
médecin ou la sage-femme (graphique 23) (49% et 43%) . Chez les
multipares, 75% ont décidé seules de faire de la PNP, et 30% ont
été orientées par leur médecin .
graphique 23: orientation vers la PNP
Effectifs
|
40 37,5 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5
0
|
|
multipare primipare
|
|
seule famille médecin autre
/sf
11-Nombre de personnes
Les groupes de PNP comprennent volontiers 6 à 10
personnes (graphique 24) . Il n'y a pas de différence statistiquement
significative du nombre de personnes par groupe entre les primipares et les
multipares (p=0,905) . 14,5% des patientes ayant fait une PNP ont
bénéficié de séances individuelles, 18,37% chez les
primipares, 5% chez les multipares .
graphique 24: nombre de personnes
|
1 à 5 : 42,86% 6 à 10 : 52,38% 10 à
15 : 3,175%
>15 : 1,587%
|
|
12-Nombre de séances
Il n'y a pas de différences statistiquement
significative du nombre de séances entre les primipares et les
multipares (p=0,433) ; 21,74% des femmes effectuent 7 séances, la
moyenne étant de 5,6 chez les multipares et de 6 chez les primipares
(graphique 25) .
graphique 25: nombres de
séances
Effectifs
|
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
|
|
multipares
primipares
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14
nombre de séances
III-Attentes de femmes
Les femmes souhaitent quasi constamment en priorité
des informations sur la grossesse et l'accouchement, ainsi que sur la gestion
de la douleur pendant le travail (graphique 26) .
graphique 26: attente première
Effectifs
|
32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0
|
|
multipare
primipare
|
|
grosse sse/ac ct
|
rencon tre
|
gestio n
douleu
|
enfant autre
|
|
Les femmes sont peu intéressées pendant la
grossesse par les informations sur la rééducation
périnéale, la sexualité, la contraception, et la rencontre
avec d'autres futures mamans (graphique 27)
graphique 27: attente dernière
Effectifs
|
37,5
35
32,5
30
27,5
25
22,5
20
17,5
15
12,5 10 7,5 5 2,5 0
|
|
multipare
primipare
|
|
gross
esse/
acct
renco ntre
gestio n
doule
enfan t
périn ée
sexua lité
IV-Satisfaction des femmes
La moyenne du nombre de personnes présentes par
séance est de 6,474 chez les femmes qui sont satisfaites de cet
effectif, et de 10,167 chez celles qui n'en sont pas satisfaites . Cette
différence est statistiquement significative (p=0,0035) .
Les femmes auraient rajouté de la relaxation à la
PNP qu'elles ont pratiquée (graphique 28) .
graphique 28: rajout à la PNP
Effectifs
|
22,5 20 17,5 15 12,5
|
|
|
|
|
|
infor mati ons
|
respi ratio n
|
pous sée
|
relax ation
|
écha
nges
entr
|
autr e
|
|
91,3% des femmes sont globalement satisfaites de la
préparation dont elles ont bénéficié (graphique 29)
.
graphique 29: satisfaction
Effectifs
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
|
|
multipare primipare
|
|
satisfait non satisfait
|
|
|
V-Les femmes n'ayant pas fait de PNP
La raison principale invoquée par les femmes n'ayant
pas fait de PNP sont qu'elles n'en ont pas saisi l'utilité . Elles ont
aussi précisé que le manque de temps, la garde des autres
enfants, la trop grande distance par rapport au lieu de préparation et
la contre-indication médicale aux trajets en voiture constituaient
également des obstacles à la pratique de la PNP (graphique 30)
.
graphique 30: raison de ne pas faire de
PNP
Effectifs
|
40 37,5 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5
5 2,5 0
|
|
multipare primipare
|
|
non connue
|
où s'adres ser?
|
non utile
|
ne convien t pas
|
autre
|
|
1/3 des femmes n'ayant pas fait de PNP aurait aimé en
faire une a posteriori (graphique 31) ; chez les primipares, la moitié
aurait souhaité en bénéficier .
graphique 31: désir de PNP a
posteriori
Effectifs
|
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
|
|
multipare
primipare
|
|
oui non
Discussion
Aucune étude similaire n'ayant été
retrouvée, il ne nous a pas été possible de confronter nos
résultats avec d'autres .
I-Limites de l'étude
Notre étude manque de puissance du fait du faible
échantillon de population étudié .
De plus, la difficulté à évaluer les
attentes et la satisfaction lors d'une telle étude rend nos
résultats difficiles à interpréter .
II-Population étudiée
La majorité des réponses provient de
maternités de niveau 2, ce qui est représentatif de la
répartition des maternités en Auvergne, où les niveaux 2
sont les plus représentés .
III-Etat des lieux de la PNP 1-Parité
Le pourcentage de femmes effectuant la PNP est
légèrement différent par rapport aux chiffres de l'HAS
[20] , mais reste dans les mêmes proportions .
La répartition des femmes selon la parité, dans
le groupe ayant bénéficié de PNP, est similaire à
ce qui a pu être retrouvé [21] .
Chez les multipares, il semble que le fait d'avoir
bénéficié de PNP lors des grossesses
précédentes influence le choix d'en faire pour la grossesse
actuelle . Les femmes n'ayant pas déjà
bénéficié de PNP ne sont pas enclines à en faire
une pour les grossesses suivantes, d'où l'intérêt de bien
informer les primipares sur la PNP . Aussi, chez les multipares, la femme est
tentée par de nouvelles expériences (yoga, chant ... ) ce qui
semble logique, mais il est alors nécessaire qu'elle
bénéficie de l'information nécessaire lui permettant de
s'orienter vers ces préparations.
2-Niveau de maternité
On remarque une légère différence
d'effectif entre les deux groupes en maternité de niveau 3 . Il faut
cependant signaler que ce niveau correspond à la ville de
Clermont-Ferrand, où l'offre de PNP est importante, ce qui incite
peut-être plus les femmes à en faire . On peut aussi expliquer
cette différence par une meilleure proximité par rapport au
domicile des lieux de PNP à Clermont-Ferrand par rapport au reste de la
région .
3-Age
L'âge des patientes correspond à ce qui a pu
être retrouvé [21] .
L'âge n'influe pas sur le choix ou non de PNP,
malgré une légère prédominance des femmes en ayant
bénéficié chez les plus de 35 ans .
Il est rassurant de constater que chez les moins de 20 ans,
les femmes choisissent la plupart du temps de faire de la PNP . Cela montre que
ces jeunes femmes sont soit décidées à s'investir dans la
grossesse, soit bien prises en charge et orientées par les
professionnels de santé .
De plus, chez les primipares, cette information provient
essentiellement des magazines ou du bouche-à-oreille et non du
médecin ou de la sage-femme .
4-Suivi des patientes
Il semble que les gynécologues travaillant en
maternité orientent moins leurs patientes vers une PNP . Peut-être
considèrent-ils que les femmes suivies en maternité sont
informées à ce sujet et qu'ils n'ont pas besoin de le faire ?
Au contraire, les femmes suivies en ville, que ce soit par
des sages-femmes ou des gynécologues, font plus de PNP .
Il existe sûrement un biais par rapport aux
sages-femmes libérales . En effet, à la question « par qui
avez-vous fait suivre votre grossesse? », il semble que certaines
patientes aient répondu « sage-femme libérale » alors
qu'elles n'avaient effectué que la PNP avec elle . Le nombre de femmes
suivies par des sages-femmes libérales semble donc être
surévalué .
5-Travail
Le fait de travailler ou non n'influence pas le choix de
faire une PNP . Ce n'est donc pas parce que les femmes sont plus disponibles
qu'elles effectuent plus de préparation . Cela peut être dû
au fait que des femmes ne travaillant pas ont des enfants, et que le
problème de leur garde se pose pendant les séances .
6-Choix de la péridurale
Le pourcentage de femmes qui effectue une préparation
à la naissance, chez les femmes qui ne souhaitaient pas
bénéficier immédiatement de la péridurale, est
à rapprocher d'un chiffre similaire retrouvé dans une autre
étude [22] . Il semblerait donc que moins de la moitié des femmes
souhaitant effectuer une partie du travail sans analgésie
péridurale décide d'effectuer une préparation à la
naissance .
Pourtant, dans ce même groupe de femmes, plus de 80%
pensent que la PNP est utile pour gérer la douleur du travail . La
moitié de ce même groupe est constitué de multipares, ce
qui pourrait expliquer le nombre réduit de femmes effectuant une PNP
.
Il semble important de constater que la douleur reste une
préoccupation des femmes, en particulier des primipares, et il convient
donc lors des séances d'en parler et de donner les moyens aux femmes et
aux couples de gérer cette douleur .
7-Type de préparation
La préparation classique est la plus
représentée, ce qui correspond à ce qui a
été retrouvé dans d'autres études [20, 22] .
Il est difficile de savoir si ce fait provient du choix des
femmes, de leur ignorance de l'existence d'autres sortes de préparation,
ou de l'absence d'une offre différente dans leur zone
géographique .
8-Information sur la PNP
3/4 des multipares sont informées sur les
différentes sortes de PNP, un peu moins chez les primipares .
Il semble donc nécessaire de débuter les
séances plus tôt dans la grossesse, afin que toutes les femmes
puissent bénéficier de toutes les séances prévues
.
Il semblerait donc que les primipares ne
bénéficient pas d'une information suffisante de la part des
professionnels de santé, et qu'on considère que la PNP classique
leur est préférable ...
9-Lieu de la PNP
La maternité est le lieu privilégié par les
femmes pour la PNP . On peut cependant se poser la question du choix de ce lieu
.
En effet, en Auvergne, l'offre de sages-femmes
libérales est inégale selon la zone géographique, et
certaines femmes n'ont certainement pas d'autres choix que la maternité
(trajet, organisation, parking ... ) .
Quant à la Protection Maternelle et Infantile et aux
Centres Périnataux de Proximité, qui dispensent également
des séances de PNP, ils sont malheureusement peu connus des femmes,
peut-être car les professionnels de la maternité ne les
connaissent pas non plus ...
10-Orientation vers la PNP
Les multipares décident le plus souvent seules de
faire de la PNP, ce qui se comprend du fait que souvent elles en ont
déjà bénéficié lors de
précédentes grossesses . Chez les primipares, le médecin
ou la sage-femme semble jouer un rôle important dans l'orientation des
femmes vers la PNP .
11-Nombre de personnes
Le nombre de personnes par groupe est relativement
élevé en moyenne, que ce soit chez les primipares ou chez les
multipares .
Hors, dans la cotation des actes sage-femme, le nombre
maximum de personnes présentes lors des séances est fixé
à 6 [23] ; le nombre constaté en général est
supérieur.
On pourrait expliquer ce fait par la forte demande alors que
l'offre est limitée, ce qui oblige les maternités et les
sages-femmes à ouvrir leurs séances à un plus grand nombre
de femmes ou couples . Ainsi, on trouve peu de sages-femmes sur des postes de
PNP, et peu de salles disponibles ...
12-Nombre de séances
Les primipares et les multipares bénéficient du
même nombre de séances . Ce nombre de séances est en
moyenne de 6, alors que le nombre remboursé par la
sécurité sociale est de 8 [24] .
Les raisons que l'on pourrait trouver à cette
situation sont le fait que les séances débutent tard dans la
grossesse, à cause du travail ou de l'information donnée trop
tard, ce qui fait que certaines femmes ne peuvent pas bénéficier
de toutes les séances avant l'accouchement .
Il faut préciser que nombre de femmes qui travaillent
attendent d'être en congé maternité pour commencer la PNP,
ce qui explique qu'elles ne font pas l'ensemble des séances .
IV-Attentes des femmes
Pendant la grossesse, il semblerait que les attentes des femmes
portent principalement sur la grossesse, l'accouchement et la gestion de la
douleur pendant le travail (en particulier chez les primipares) .
Les informations sur la contraception, la sexualité, la
rééducation périnéale sont de second ordre pendant
la grossesse, ce qui n'est pas pour nous surprendre . Les femmes sont sans
doute plus réceptives à ces informations après la
naissance .
V-Satisfaction de femmes
Les femmes, que ce soit les primipares ou les multipares,
sont quasi constamment satisfaites de la PNP dont elles ont
bénéficié .
Malgré tout, le nombre de personnes présentes
dans les groupes est un motif de non-satisfaction . En effet, un nombre trop
élevé de participants dans les groupes de PNP est
corrélé à une moindre satisfaction des femmes vis à
vis de ce nombre .
La question n'a pas été posée, mais il
aurait été intéressant de savoir combien de femmes avaient
pu être accompagnées par leur conjoint lors des séances de
PNP .
Malgré tout, certaines femmes ont
précisé qu'il était dommage que les conjoints ne soient
pas acceptés lors des séances, car selon eux ils étaient
aussi concernés qu'elles par les informations données .
VI-Les femmes n'ayant pas fait de PNP
Les raisons pour lesquelles les femmes ne font pas de PNP
sont pour une grande partie indépendantes de leur volonté. On
retrouve cela dans le fait que 1/3 des femmes n'ayant pas fait de PNP aurait
souhaité en faire une . Une meilleure offre de PNP semble donc
nécessaire afin que toutes les femmes qui le souhaitent puissent
bénéficier de PNP.
Rares sont les femmes qui n'avaient pas connaissance de
l'existence des séances de PNP ou qui ne savaient pas où
s'adresser pour en faire, mais ils y en a quand même et cela souligne le
manque d'information dont les femmes bénéficient parfois par
rapport à la PNP .
La moitié des primipares n'ayant pas effectué
de PNP aurait a posteriori souhaité en bénéficier ; cette
proportion relativement élevée semble confirmer le manque
d'information des primipares en matière de PNP .
Projet d'action
Il semble au vu des résultats obtenus que les
recommandations de l'HAS [2] ne sont pas suivies . Déjà en 1994,
l'Agence Nationale pour le Développement de l'Evaluation Médicale
proposait de commencer les séances dès le 4e ou 5e mois, et
d'intégrer les pères à cette préparation [25] .
Cette proposition a été réitérée par la
Convention Nationale des Sages-Femmes en 2002 [26] . En 2007, une Convention
Nationale pose la volonté des sages-femmes de mettre en place une
première séance individuelle ainsi que des séances
post-natales [23] . Mais aucune de ces propositions n'est encore
respectée en Auvergne .
Il convient donc d'informer toutes les sages-femmes et les
médecins intervenant notamment en consultations prénatales et en
PNP sur ces recommandations, et de favoriser leur mise en place dans toutes les
maternités étudiées :
· Mettre en place, dans toutes les maternités
étudiées, l'entretien précoce individuel avec une
sage-femme, réalisé systématiquement en début de
grossesse, qui permettrait notamment au couple d'exprimer ses envies par
rapport à la Préparation à la Naissance et à la
Parentalité . Cet entretien permettrait également une meilleure
information du couple sur les différentes sortes de préparation,
les lieux où il est possible d'en bénéficier, ses
objectifs ...
· Inclure le futur père aux séances de
PNP, en respectant les désirs de toutes les patientes du groupe .
· Mettre en place des séances post-natales, qui
permettraient d'informer les femmes sur la contraception, la sexualité,
la rééducation périnéale, ainsi que sur les soins
au bébé, l'allaitement maternel ... Ces séances pourraient
également permettre aux couples de partager leurs expériences, et
de parler des situations mal vécues . Ces séances pourraient par
exemple avoir lieu quelques jours après le retour à domicile,
puis 1 mois après l'accouchement ...
· Débuter les séances plus tôt, afin
que toutes les femmes puissent bénéficier de toutes les
séances nécessaires . Ces séances plus précoces
pourraient également permettre de donner une information sur
l'hygiène de vie pendant la grossesse ( alimentation, activités
sportives...), la prévention de la menace d'accouchement
prématuré, le sevrage tabagique, l'auto-médication pendant
la grossesse...
On pourrait proposer de mettre en place des séances en
soirée ou le samedi, ce qui permettrait aux femmes souhaitant commencer
les séances avant le congé maternité de le faire . Ces
séances seraient également utiles pour les conjoints souhaitant
s'impliquer dans la PNP .
· Réduire le nombre de personnes dans les
groupes, afin que les femmes puissent s'exprimer librement sans être
gênées par le nombre trop important de participants . Il faut pour
cela augmenter le nombre de sages-femmes en PNP, prévoir un nombre de
salles suffisant ...
· Mettre en place un service de PNP à domicile,
que ce soit grâce aux sages-femmes libérales, à la PMI ou
aux sages-femmes des centres périnataux de proximité, afin de
permettre aux femmes ne pouvant pas se déplacer, pour cause de
problème de garde d'enfants ou pour contre-indication médicale,
de bénéficier de PNP malgré tout . Ce service
nécessiterait d'augmenter le nombre de sagesfemmes libérales ou
de PMI, ce qui était prévu par le Plan de
Périnatalité (mais y avait-il le budget?) .... mais
également de mieux informer les femmes de cette possibilité (et
donc il conviendrait que les professionnels de la périnatalité
soient eux aussi mieux informés de l'existence des ces structures) .
· Adapter le contenu des séances de PNP aux
demandes des couples, que ce soit en matière d'information, de
relaxation, d'exercices de respiration, ... ; adapter également ce
contenu en fonction de la parité de la femme et du vécu des
grossesses et des accouchements précédents . La séance
précoce pourrait permettre au couple de préciser leurs attentes
par rapport à la PNP . De la même façon que certaines
maternités proposent aux couples de rédiger un projet de
naissance, on pourrait mettre en place un « projet de préparation
» ...
· Mettre en place des séances individuelles pour
les couples qui le souhaitent, que ce soit pour toutes les séances ou
pour quelques-unes .
Nous proposons également la création, au sein de
toutes les maternités, de brochures permettant d'informer les patientes
et les couples sur les PNP disponibles près de leurs lieux d'habitation
.
Un exemple de brochure concernant Clermont-Ferrand se trouve
en annexe (annexe II) mais une telle brochure devrait être
réalisée pour chaque maternité étudiée .
Elle devrait être disponible non seulement dans toutes les
maternités étudiées mais également dans les
cabinets des médecins généralistes, des
gynécologues et des sagesfemmes libérales .
Afin de permettre une plus large diffusion, il pourrait
également être envisagé que ces brochures soient
envoyées à toutes les femmes enceintes, via les
déclarations faites à la Caisse d'Allocation Familiale .
Conclusion
L'exploitation des questionnaires nous a permis de constater
qu'une meilleure information de femmes et des couples serait nécessaire
afin de remettre la préparation à la naissance à sa place
dans le suivi de grossesse . La mise en place de l'entretien précoce de
grossesse semble également nécessaire afin de permettre cette
information .
Seule la moitié des femmes bénéficient
d'une préparation à la naissance, indépendemment de
l'âge ou de l'activité professionnelle . Par contre, le choix du
professionnel effectuant le suivi de grossesse semble influer sur le choix ou
non de PNP.
La préparation classique est la plus
représentée, sans que l'on sache si cela relève d'un choix
conscient ou d'un manque d'information .
Pour ce qui est des attentes des femmes, la douleur reste au
centre de leurs préoccupations malgré l'avènement des
techniques d'analgésie, en particulier chez les primipares .
Certaines informations n'ont pas d'impact durant la grossesse
et des séances postnatales seraient nécessaires afin d'aborder
des thèmes qui n'avaient pas leur place durant la grossesse .
Les femmes sont en majorité satisfaites de la
préparation dont elles ont bénéficié, toutefois il
semble nécessaire de mettre en place des groupes plus réduits
afin de leur permettre de mieux s'exprimer . Il ressort également que
les pères doivent être inclus dans cette préparation .
Quant aux femmes qui choisissent de ne pas
bénéficier de préparation à la naissance, il semble
que ce choix ne soit souvent pas de leur propre chef, en particulier chez les
primipares . Une meilleure information des femmes et couples ainsi qu'une
meilleure offre de préparation à la naissance, notamment à
domicile, semblent nécessaires afin que toutes les femmes qui le
souhaitent puissent bénéficier d'une préparation .
Loin d'être uniforme, la Préparation à la
Naissance et à la Parentalité doit s'adapter aux femmes et
couples, à leurs attentes, à leur vécu ... Elle fait
partie intégrante du suivide la grossesse et doit donc être
encouragée dès le début du suivi prénatal .
La mise en place de l'entretien précoce,
préconisé par le plan de périnatalité 2005- 2007,
ainsi que le respect des recommandations de bonnes pratiques
éditées par l'HAS et du Plan de Périnatalité
devraient permettre d'apporter des solutions et d'adapter la Préparation
à la Naissance et à la Parentalité à la demande des
femmes et couples .
Enfin, des brochures seraient des outils d'information
intéressants pouvant répondre aux attentes de femmes en
matière d'information par rapport à la PNP.
Bibliographie
[1] Ministère de la santé et de la protection
sociale.Plan de périnatalité 2005/2007 .2004 . [consulté
le 18/02/2008] Disponible à partir de : URL :
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/perinatalite04/planperinat.pdf
[2] Haute Autorité de Santé. Recommandations
professionnelles : Préparation à la naissance et à la
parentalité . 2005 . [consulté le 10/11/2007] Disponible à
partir de : URL :
http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/preparation_naissance_recos.pdf
[3] LE DU Maï . France, 1952-2006 : de l'acouchement
sans douleur à l'anesthésie péridurale :
l'évolution du traitement de la douleur de l'accouchement et son
éclairage sur l'image sociale de la femme . Les Dossiers de
l'Obstétrique 2006 ; 349 ; 26-29.
[4] REVAULT D'ALLONNES Claude . Le mal joli: accouchements et
douleur . Paris : Plon ; 1991 ; 15-35 .
[5] Souverain pontife PIE XII . L'accouchement sans douleur .
[consulté le 20/09/2007] Disponible à partir de : URL :
http://docs.leforumcatholique.org/src/pdf/PieXII_accouchementsansdouleur.pdf
[6] MERGER Robert et CHADEYRON Pierre-André .
L'accouchement sans douleur . Paris : Presses Universitaires de France,
collection « Que sais-je? » ; 4e édition ; 1983 ; 45-80 .
[7] LAMAZE Fernand . Qu'est-ce que l'accouchement sans
douleur ? Paris : Savoir et Connaître ; 1965 ; 11-89 .
[8] MIGNOT Sandra . Les 50 ans de l'accouchement sans douleur
. Profession sagefemme 2002 ; 90 ; 4-8 .
[9] GUTMANN Caroline . Le testament du docteur Lamaze,
médecin accoucheur . Paris : JC Lattès ; 1998 .
[10] AMIENS Anne . Sophrologie et douleur de l'accouchement .
Mémoire de fin d'études : Ecole de Sages-Femmes :
Université Clermont 1 ; 1993 ; n° de classement M93-07 .
[11] Se préparer à l'accouchement, à la
naissance, à la parentalité . Paris : Editions E.L.P.E.A.,
collection « Grands Sujets » ; 2006 .
[12] Les Maternelles : Choisir sa préparation à
la naissance : Sophrologie . [consulté le 22/12/2007] Disponible
à partir de : URL :
http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119058.cfm
[13] Les Maternelles : Choisir sa préparation à
la naissance : Haptonomie . [consulté le 22/12/2007] Disponible à
partir de : URL :
http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119062.cfm
[14] Les Maternelles : Choisir sa préparation à
la naissance : Chant prénatal . [consulté le 22/12/2007]
Disponible à partir de : URL :
http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119057.cfm
[15] Les Maternelles : Choisir sa préparation à
la naissance : Préparation en piscine . [consulté le 22/12/2007]
Disponible à partir de : URL :
http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119060.cfm
[16] Les Maternelles : Choisir sa préparation à la
naissance : Yoga . [consulté le 22/12/2007] Disponible à partir
de : URL :
http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119061.cfm
[17] Les Maternelles : Choisir sa préparation à la
naissance : la préparation classique . [consulté le 22/12/2007]
Disponible à partir de : URL :
http://www.france5.fr/maternelles/grossesse/W00257/4/119056.cfm
[18] Haute Autorité de Santé . Recommandations
professionnelles : comment mieux informer les femmes enceintes ? 2005 .
[consulté le 17/11/2007] Disponible à partir de : URL :
http://www.hassante.
fr/portail/upload/docs/application/pdf/femmes_enceintes_recos.pdf
[19] Charte européenne des Droits de la Parturiente .
[consulté le 23/12/2007] Disponible à partir de : URL :
http://www.ansl.org/Pages/charte.htm
[20] Haute Autorité de Santé . Recommandations
pour la pratique clinique : Préparation à la naissance et
à la parentalité . Argumentaire . 2005 . [consulté le
10/11/2007] Disponible à partir de : URL :
http://www.hassante.
fr/portail/upload/docs/application/pdf/preparation_naissance_rap.pdf
[21] CHAPOULY Marion . L'application de la préparation
à la naissance en salle d'accouchement . Mémoire de fin
d'études : Ecole de Sages-Femmes : Université Clermont 1 ; 2007 ;
n° de classement M07-05 .
[22] SAGE Camille . On m'avait pourtant promis la
péridurale ! Ou vécu de l'accouchement des femmes n'ayant pu
bénéficier de l'analgésie péridurale .
Mémoire de fin d'études : Ecole de Sages-Femmes :
Université Clermont 1 ; 2002 ; n° de classement M02-12 .
[23] République Française : Arrêté du
10 décembre 2007 portant approbation de la convention nationale
destinée à organiser les rapports entre les sages-femmes
libérales et les caisses d'assurance maladie. [consulté le
15/02/2008] Disponible à partir de : URL:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017717806&dateTexte=
[24] République Française : Arrêté du
11 octobre 2004 modifiant la nomenclature générale des actes
professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sagesfemmes
et des auxiliaires médicaux . [consulté le 15/02/2008] Disponible
à partir de : URL :
http://admi.net/jo/20041121/SANS0423374A.html
[25] BLANCHARD Elisabeth, DELAYEN Annie . Gyneweb : Guide de la
surveillance de la grossesse, chapitre 24 : Préparation à la
naissance . [consulté le 16/02/2008] Disponible à partir de : URL
:
http://www.gyneweb.fr/sources/obstetrique/andem/chap24.htm
[26] Avenant n°4 à la convention nationale des
sages-femmes . 2002 . [consulté le 18/02/2008] Disponible à
partir de : URL :
http://admi.net/jo/20030227/SANS0320602X.html
| 


