|
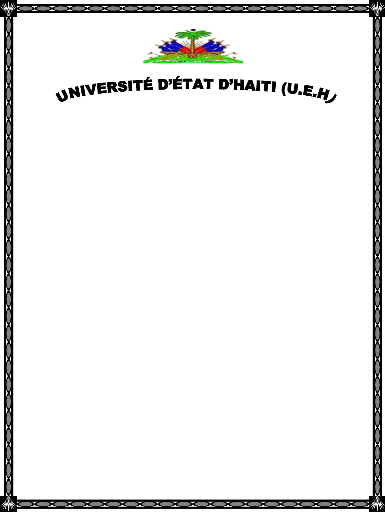
FACULTÉ D'ETHNOLOGIE(FE)
DÉPARTEMENT DES SCIENCES DU
DÉVELOPPEMENT(DSD)
Sujet de recherche : Conditions socio-économiques des
paysans de Lociane, une Section de la Commune de Thomassique.
Mémoire présenté par Frantz ISIDOR
Promotion 2020-2022
Pour l'obtention du grade de Maître en Sciences du
Développement
Sous la direction du professeur Jean-Maxius BERNARD, Ph. D.
Février 2024

Université d'État
d'Haïti
Faculté d'Ethnologie
Département des Sciences du
Développement
Ce mémoire de maîtrise intitulé :
Conditions socio-économiques des paysans de Lociane, une
Section de la Commune de
Thomassique
Préparé par :
Frantz ISIDOR
A été évalué par un jury
composé des professeurs suivants :
M. Lamarre CADET, Ph. D.
Président
M. Jean-Maxius BERNARD, Ph. D.
Directeur de Recherche
M. Adma DESSEIN, Ph. D.
Lecteur critique
II
Table des Matières
Antécédents vi
Résumé 1
Introduction générale 2
1.-Justification de l'étude 5
2.-Problématique 7
3.-Principaux objectifs de l'étude 11
4.-Structuration de l'étude 13
Chapitre I. Cadre conceptuel et méthodologie de
la recherche 14
1.1.-Cadre théorique et conceptuel 14
1.2.-Revue de littérature 16
1.3.-Méthodologie de recherche 22
1.3.1.-Collecte de données 25
1.3.2.-Méthode utilisée pour la collecte de
données 26
1.3.3.-Méthode d'analyse et d'interprétation des
données 27
1.4.-Contextualisation de l'observation ethnographique 27
1.4.1.-Rapport descriptif du paysage observé 29
1.4.2.-Grille d'observation 38
1.5.-Contrainte sur le terrain de recherche 41
Chapitre II. Lociane et conditions
socio-économiques des paysans 42
2.1.-Géo-localisation de la frontière
Haïti-République Dominicaine 42
2.2.-Thomassique et la 2e Section Lociane 44
2.2.1.-Délimitation 46
2.2.2.-Localisation de la Commune de Thomassique 46
2.2.3.-Localisation directe de la Section communale de Lociane
47
2.2.4.-Histoire de Thomassique et la 2e Section
Lociane 47
2.3.-Voies de pénétration dans la 2e
Section Lociane 50
2.3.1.- Comparaison entre des localités de la
2e Section Lociane 53
2.4.-Facteurs de développement des conditions
socio-économiques des paysans de Lociane 53
2.4.1.-Intégration des forces actives dans
l'économie productive 54
2.4.2.-Appropriation de l'espace territorial en
développement 58
2.4.3.-Cheminement socio-historique de l'acteur local et sa
place fonctionnelle 60
III
2.4.4.-Caractéristique particulière dans
l'éclosion de la couche paysanne haïtienne 62
2.4.5.-Activités économiques des paysans de
Lociane 64
2.4.6.-Tenure de la terre 66
2.4.7.-Engloutissement de l'économie du pays 68
2.4.8.- Conséquence de la réalité des
secteurs économiques disjonctés 69
Chapitre III. Gestion de la frontière
Haïti-République Dominicaine 71
3.1.-Différentes théories sur la
thématique de la frontière 72
3.1.1.-Approche traditionnelle de la notion de
frontière 72
3.1.2.-Considération sur l'approche moderne du
phénomène de frontière 73
3.1.3.-Préférence accordée à
l'utilisation des approches post-modernes de la frontière 74
3.2.-Question de la délimitation de la ligne
frontalière Haïti-République Dominicaine 81
3.2.1.-Rapports Haïtiens et Dominicains 82
3.3.-Contexte socio-historique de la frontière
Haïti-République Dominicaine. 84
3.3.1.- À partir de l'action de Toussaint Louverture
86
3.3.2.- À l'ère de l'indépendance
d'Haïti 87
3.3.3.-Situation qui découle de l'indépendance
de la République Dominicaine 89
3.4.-Négociation sur la ligne frontalière
Haïti-République Dominicaine 90
3.5.-Considération sur l'évolution
hégémonique de la Dominicainie par rapport à Haïti
93
3.6.-Systématisation de la discrimination raciale
à l'égard de l'Haïtien 95
3.7.-Regard sur les Puissances internationales dans les
relations entre Haïti et la République Dominicaine
97
3.7.1.-Insouciance des autorités haïtiennes
vis-à-vis de la frontière 100
Chapitre IV. Décentralisation et organisation
des collectivités territoriales 102
4. 1.-Rappel historique du fondement de la
décentralisation en Haïti 104
4.1.1.-Fondement légal de la décentralisation en
Haïti 104
4.1.2.-Approche théorique de la décentralisation
106
4.1.3.-Théorie juridique de la décentralisation
107
4.2.-Responsabilité des ordonnateurs dans la gestion de
la finance dans le cadre de la décentralisation 108
4.2.1.-Prégnance de la corruption : l'érection
des institutions efficaces de contrôle 108
4.3.-Organisation de l'administration centrale de
l'État 109
4.3.1.-Finance dans le processus de la décentralisation
110
4.4.- Rôle de l'État dans la mise en place de la
décentralisation : dotation des collectivités territoriales
des
moyens de concevoir de véritables politiques publiques
112
iv
4.4.1.-Définition du concept de la collectivité
territoriale 113
4.4.2.-Définition fondamentale dans la conception de
l'État 114
4.4.3.-Définition des choix stratégiques de
développement économique en matière de politiques
publiques 117
4.4.4.-Politique publique : de la naissance à
l'acception moderne 118
4.5.-Condition nécessaire à
l'implémentation de la décentralisation 119
4.5.1.-Distinction entre intérêt
général et affaires locales 121
4.5.2.-Question de l'autonomie de gestion des
collectivités territoriales 121
4.5.3.- Organisation de la Section communale Lociane sur le
plan politique 122
Chapitre V. Résultat de l'étude
123
5.1.-Rapport de proximité des autorités de la
collectivité territoriale avec la population 124
5.2.-Certains aspects anthropologiques du politique 127
5.3.- Responsabilité manifestée par le paysan
dans la sphère du développement local 128
5.4.- Organisation sociale à Lociane 130
5.5.-Représentation du commerce des produits agricoles
dans la frontière de la 2e Section Lociane par
rapport à la dynamique interne 133
5.6.-Impact de l'importation des produits agricoles sur la
production du paysan haïtien 135
5.7.-Accès aux services vitaux 137
5.7.1.-Eau 137
5.7.2.-Soin de santé 138
5.7.3.-Éducation 139
5.7.4-Encadrement agricole 140
5.8.-Perception de l'État haïtien dans son abandon
du monde paysan dans l'opinion des paysans. 142
5.8.1.-Ressources humaines 145
Conclusion 148
Perspectives propositionnelles 154
Limites de l'étude 155
Références bibliographiques
157
Annexe 169
V
Liste des abréviations, sigles et
acronymes
AFPEC Académie de Formation et de Perfectionnement des
Cadres
AF Année Fondamentale
ASEC Assemblée de la Section Communale
CASEC Conseil d'Administration de la Section Communale
CEA Conseil d'État du Sucre (c'est un sigle d'un organe
dominicain)
CFPB Contribution Foncière des Propriétés
Bâties
CFGDCT Contribution au Fonds de Gestion et de
Développement des Collectivités Territoriales
CSCCA Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif
CTE Hinche Centre Technique d'Exploitation de Hinche
CT Collectivité Territoriale
DINEPA Direction Nationale de l'Eau Potable et de
l'Assainissement
GVCM Global Vision Citadelle Ministries
IDH Indice de Développement Humain
IGF Inspection Générale des Finances
IHSI Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique
Km, Km2 et mm Kilomètre, Kilomètre
carré et millimètre
MAE Ministère des Affaires Étrangères et
des cultes
MARNDR Ministère de l'Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural
MDE Ministère De l'Environnement
MICT Ministère de l'Intérieur et des
Collectivités Territoriales
MEF Ministère de l'Économie et des Finances
MENFP Ministère de l'Éducation Nationale et de
la Formation Professionnelle
MPCE Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe
MPP Mouvement Paysan Papaye
MSPP Ministère de la Santé Publique et de la
Population
NTIC Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication
ODD Objectifs de Développement Durable
ODPSL Organisation pour le Développement des Paysans de
la 2e Section Lociane
OJUDT Organisation des Jeunes pour l'Unité et le
Développement de Thomassique
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OREPA Centre Office Régional d'Eau Potable et
d'Assainissement du Centre
PIB Produit Intérieur Brut
PLD Partido de la Liberacion Dominicana
PNUD Programme des Nations Unies pour le
Développement
PRSC Partido Reformista Social Cristiano
TI Transparency International
SMCRS Service Métropolitain de Collecte des
Résidus Solides
SNGRS Service National de Gestion des Résidus
Solides
UCREF Unité Centrale de Renseignement Financier
ULCC Unité de Lutte Contre la Corruption
USAID United States Agency for International Development
vi
Antécédents
La présente étude est dédiée
à :
1) La mémoire de Franck ISIDOR, mon père,
François ISIDOR, mon grand-père, Maurice BRUN, mon
grand-père maternel et Lucita DUBUISSON (man François),
ma grand-mère paternelle, en souvenir des valeurs sacrées de
courage au travail inculquées en moi.
2) Clermana JOSEPH (man Maurice), ma
grand-mère maternelle, qui vit encore1 plus d'un
siècle, combattante de toujours.
3) Ma mère Irlande BRUN, une bâtisseuse
d'avenir. Elle ne cesse jamais de serrer ses reins aux mille cordes de passion,
d'amour, de tendresse pour alimenter mon coeur d'énergie
nécessaire à surmonter les épreuves de la vie. D'autant
qu'elle m'a doté d'une éducation digne qui a fait de moi ce que
je suis aujourd'hui.
4) Mon épouse Gina CASIMIR, la manifestation de son
indéfectible soutien m'a souvent été d'une double
force.
5) Mes filles jumelles Gihandris Hassia, Nahandris Irlandie
et mon garçon Rybklussen Yka-Ludrantz.
6) Mon frère Wensky ISIDOR et ma soeur Guerdeline
ISIDOR qui m'ont toujours gratifié de tout accompagnement
nécessaire et suffisant pour pouvoir valoriser mes aptitudes aux
études universitaires et le côté intellectuel de la
famille.
7) Mon Oncle Hubert ISIDOR, agronome, dont l'assistance dans
l'adversité est un arbre donnant des fruits précieux pour
l'avenir.
8) Natacha JEAN, une amie distinguée parmi mes
condisciples de la promotion 2000-04 de l'École Supérieure
d'Infotronique d'Haïti.
9) La mémoire de Maître Rosalès TRISTANT,
pour la consécration de sa vie à l'enseignement, en particulier,
celui du Droit aux élèves-avocats de l'École du Barreau de
Petit-Goâve.
1 Par grâce, elle vit sa deuxième année
après le siècle au moment de la réalisation de ce travail
de mémoire. Longue vie à elle !
VII
Remerciements
Tout projet d'étude confronte une réalité
de sacrifice et de passion. Ce qui caractérise la force de sa
réalisation. Sans doute, notre travail ne saurait être
réalisé sans l'aide et le soutien de mes proches de
manière générale.
Je tiens à leur adresser mes plus sincères
remerciements, et à tous ceux qui ont apporté leur soutien
à son élaboration, en particulier :
Au Professeur Jean-Maxius BERNARD Ph. D., pour ses
suggestions, conseils et critiques en tant que responsable du
Département des Sciences du Développement et comme professeur
accompagnateur. Des remarques ont été précieuses et
indispensables pour orienter la recherche et aboutir aux résultats
trouvés.
Au Doyen ad intérim de la Faculté d'Ethnologie,
Professeur Claude Mane DAS ; tous les professeurs ayant participé et
contribué à ma formation, pour m'avoir inculqué les
valeurs et compétences pour pouvoir contribuer aux réflexions sur
la problématique du développement en Haïti.
Comment ne pas adresser, de manière spéciale,
des remerciements aux professeurs de méthodologies Ilionor LOUIS, Ph. D.
et Jean Mary LOUIS S.J. / Ph. D. ;
À l'ensemble de mes camarades du DSD de la promotion
(2020-2022) et autres amis pour leurs conseils avisés ;
À toute la communauté thomassiquoise et
particulièrement les habitants de la 2e Section Lociane qui
ont collaboré à la réalisation de cette étude et
à tous ceux que j'ai omis involontairement, ils sont tous dans mon
coeur, je leur adresse mes plus profonds remerciements.
VIII
Avant-propos
Il serait fastidieux et même impossible
d'énumérer toutes les difficultés de la vie en Haïti.
Parler des déplacements forcés et les violences physiques,
psychologiques auxquels la population s'expose sous le simple fait qu'elle vit
dans tel ou tel autre endroit qui puisse tomber sous la domination totale des
bandes criminelles lourdement armées s'avère franchement
écoeurant.
Les gangs armés extorquent, vandalisent, tuent,
lynchent, incendient, pillent, volent, violent, kidnappent et
rançonnent... sous les yeux passifs et impuissants de l'État
central et des administrations locales. À travers la plupart des
Départements du pays, toute la population haïtienne vit des moments
d'effroi devant la terreur des criminels notoires opérant en toute
impunité. Qui ne les a pas qualifiés de terroristes dont les
actes ignobles n'émeuvent en rien des structures répressives du
Gouvernement se faisant ainsi leur complice. En droit, il est admis le principe
de responsabilité criminelle par omission. De par ce principe, n'y
a-t-il pas lieu de questionner l'indifférence des gouvernants de
l'État central et des agents des collectivités territoriales ?
C'est le signe d'une inertie coupable dans cette prolifération des gangs
armés qui commettent de manière plus directe et inimaginable des
actes terroristes2 caractérisant une haine
invétérée contre la société
haïtienne.
De mon état de déplacé forcé et
involontaire de mon lieu d'habitation à Pernier 17-A, où je
m'étais installé depuis 2005, il m'est nullement besoin
d'exprimer les chances que j'ai eues de pouvoir réaliser ce travail
malgré le choc psychologique confronté en m'accommodant à
de nouvelles résidences, parfois même à encourir des nuits,
ô combien instructrices dans les locaux de la Faculté de Droit et
des Sciences Économiques de Port-au-Prince.
2 Selon la Convention internationale du 9
décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme ,
dans son article 2.1 (b), un acte terroriste se définit comme «
tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou
toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités
dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou par son
contexte, cet acte vise à intimider une population ou à
contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à
accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ».
1
Résumé
L'histoire d'Haïti3 - Kiskeya ou Bohio est
marquée par des évènements qui déterminent la
frontière entre les deux Républiques partageant l'île du
même nom. Des moments conflictuels à la dialectique diplomatique,
un nouvel ordre s'impose. Par exemple, l'intervention du Président Fabre
Nicolas Geffrard, survenue en juillet 1861 dans l'affaire Rubalcava, constitua
des actions fortement imprégnées des objectifs formels pour
restaurer l'indépendance de la République Dominicaine et
renforcer celle de la République d'Haïti. La
nécessité pressante de créer et de maintenir des relations
de coopération entre ces deux Républiques exige des efforts de
relever le niveau de gestion et d'autonomie dans la décentralisation des
collectivités territoriales en général, et surtout celles
se trouvant sur la frontière. Des deux côtés, il importe de
mettre en place des structures susceptibles d'assurer la production nationale.
Ce, pour équilibrer des échanges commerciaux, culturels et
même diplomatiques. Eu égard au constat fait, la République
Dominicaine a pris le devant dans la course au développement : son
économie est sortie bénéficiaire de ces échanges.
Qu'est-ce qui justifie cette avance ? La décentralisation ne peut-elle
pas contribuer à la dynamisation des régions frontalières
?
Le transfert de compétences dans le processus de la
décentralisation interpelle les décideurs de l'État. Il
leur incombe de définir de nouvelles politiques publiques visant
l'amélioration des conditions socio-économiques des masses
paysannes. Le cas de la deuxième Section Lociane, regroupant des
localités rurales de la Commune de Thomassique, est
révélateur. Dans cette Section communale, comme dans toutes les
autres, la gestion de l'espace territorial se fait grandement sentir quant aux
besoins exprimés par la population locale, surtout dans le cadre de sa
participation dans le développement local.
La présente étude titrée : conditions
socio-économiques des paysans de Lociane, une Section de la Commune de
Thomassique participe aux réflexions sur la nécessité
de permettre aux paysans haïtiens d'avoir plus de possibilité
financière et gestionnaire pour prendre en main leur destin.
Mots-clés : Frontière,
État, condition socio-économique, décentralisation,
participation, masses paysannes, développement local, politique
publique, collectivité territoriale.
3 La dénomination Haïti-Kyskeya ou Bohio
désigne l'île d'Haïti. Des historiens en désignent le
nom que les premiers habitants naturels donnèrent à cet espace
insulaire caractérisé par ses hautes montagnes.
2
Introduction générale
La situation géographique de la 2e Section
Lociane engendre l'importance primordiale de la frontière parmi les
facteurs agissant sur l'évolution des conditions
socio-économiques des paysans du milieu. L'interface directe des
frontières représente des ressources économiques et
culturelles. Les conditions socio-économiques des populations vivant
dans les frontières relèvent d'abord des facteurs nationaux et
internationaux. En effet, celles-ci sont étroitement liées au
modèle de gestion politique et aux relations existant entre États
contigus. Le niveau de développement atteint par les États en
question joue aussi un rôle majeur dans l'appropriation de l'espace
commun en lui donnant une caractéristique particulière dans la
compréhension des phénomènes historiques et culturels qui
ont façonné cette frontière.
La frontière internationale est la droite de division
de premier ordre des structures territoriales des États
indépendants. En droit international, les frontières font
état d'objet inviolable, mais elles ne sont pas intangibles (Faucher,
2023). Au cours du temps, les frontières entre les États se font
et se défont au gré de la conjoncture géopolitique du
moment. Aujourd'hui, nous comptons cent quatre-vingt quinze États
indépendants reconnus par l'ONU à travers les cinq continents qui
se répartissent ainsi : deux en Amérique du Nord,
cinquante-quatre en Afrique, quarante-huit en Asie, quarante-quatre en Europe,
quatorze en Océanie et trente-trois en Amériques latines et
Caraïbes (Deluzarche, 2023).
Dans le bassin de la Caraïbe se situent Haïti et la
République Dominicaine, deux pays indépendants partageant la
deuxième grande île de la région. Des 76,480 km2
dont mesure l'île entière, la République d'Haïti
occupe le tiers soit 27,750 km2. Cette superficie est faite à
80% de montagnes contre seulement 7,000 km2 de plaine. Selon les
estimations récentes, la partie occidentale abrite une population de
près de douze millions d'habitants. Force est d'essayer de saisir
l'impact des phénomènes socio-historiques de la frontière
sur les représentations sociales et mentales des différentes
composantes de la société haïtienne.
Les documents écrits nous permettent de faire remonter
l'histoire de la frontière haïtiano-dominicaine aux traités
de Ryswick (1697) et d'Aranjuez (1777). Abstraction faite des circonstances
particulières favorisant ces traités, des
événements conflictuels ont conduit à des effacements
répétitifs des frontières entre ses deux territoires. Le
premier moment d'effacement en date serait le traité de Bâle de
1795 qui prenait plein effet sous l'administration de Toussaint
3
Louverture, gouverneur de Saint-Domingue 1800-1802. La
deuxième période fut l'unification administrative et politique
qui s'établissait à l'intervalle entre 1822 à 1844. La
troisième occasion s'est produite durant l'occupation américaine
de la République d'Haïti qui a engendré l'unification
administrative de l'île entière au cours de la période de
1916 à 1924.
Cette mouvance de rapprochement s'achemine vers une dynamique
d'ouverture réciproque des deux sociétés, bien
évidemment à l'avantage déterminant de la
République Dominicaine, et enfin, aboutit à la logique de la
coopération (Alexandre, 2020, p. 61). Néanmoins, la rengaine des
positions extrémistes et racistes de l'anti-haïtianisme n'en
démord pas. Une preuve se justifie dans les récentes actions
politiques qui trouvent une expression dans l'arrêt TC 0168/13 de la Cour
constitutionnelle dominicaine adopté en date du 23 septembre 2013.
Près de 250,000 personnes d'origines haïtiennes qui jouissaient de
la nationalité dominicaine deviennent apatrides avec l'application de
cet arrêt. Mais aussi, la compréhension de l'évolution des
alliances politiques4 en 1994, selon Pérez (2020, p. 101),
pour contrer la montée de Peña Gomez à la
présidence, - Dominicain noir, disciple de Juan Bosch au parti de
PRD5-, illustra fort bien les sentiments racistes, xénophobes
et anti-haïtianistes qui sont toujours vivaces dans les classes sociales
dominantes en République Dominicaine. Les conséquences
éprouvantes se répercutèrent plus fortement depuis le
massacre de 1937 sur les rapports entretenus avec les populations
haïtiennes des milieux frontaliers. D'où résulte
l'importance de la compréhension du phénomène de
frontière entre Haïti et la République Dominicaine dans la
dimension socio-historique de sa création.
À chaque moment d'agitation discursive sur la ligne
frontière entre Haïti et la République Dominicaine,
l'épineux problème de sa délimitation s'impose, entre
autres, dans toute sa complexité. Rappelons bien, qu'avant
l'arrivée de la proclamation6 de 1794 consacrant l'abolition
de l'esclavage à Saint-Domingue, Toussaint Louverture qui, - s'alliant
tour à tour avec les
4 César Pérez a projeté une analyse sur
le caractère invraisemblable de l'alliance de deux partis politiques PLD
(Partido de la Liberacion Dominicana), parti fondé par Juan Bosch,
incarnation du marxisme en République dominicaine et PRSC (Partido
Reformista Social Cristiano), parti fondé par Joaquin Balaguer,
héritier politique de Trujillo, conservateur historiquement
opposés et même des adversaires pour bloquer l'arrivée de
Dr Peña Gomez à la présidence en 1996. Parmi d'autres
raisons, la classe politique le considérait comme un Dominicain noir
à descendance haïtienne.
5 PRD (Partido Revolucionario Dominicano) est le parti
politique de tendance gauche que Juan Bosch avait créé. Ce qui
lui avait permis d'arriver au pouvoir aux élections de 1962 après
la mort de Trujillo. Juan Bosch s'opposait toujours au secteur dominant
représenté par Trujillo puis Balaguer. Après avoir
été évincé au pouvoir en 1963 par un coup
d'État, il partit pour l'exil et son parti, sous la direction de
Peña Gomez, organisa la résistance contre l'invasion
américaine de 1965 et entra en opposition contre Balaguer, revenu au
pouvoir en 1966. Lorsque Bosch eut à revenir au pays, il abandonna son
parti et créa le parti PLD.
6 La proclamation du 4 février 1794 de
l'abolition de l'esclavage par la Convention est l'application du décret
de Santhonax du 29 août 1793 pris à cet effet à
Saint-Domingue.
4
Espagnols et les Anglais contre les Français, à
la recherche des moyens de l'émancipation du peuple de Saint-Domingue -
devait se résoudre à renouer ses relations avec les
Français qui dominaient à l'Ouest. De son retour dans le camp
français, il permit la conquête de toute la région du Nord
qui rejoint à la rivière massacre.
Par ailleurs, le fait que Toussaint Louverture fut fondateur
de la ville de Barahona y justifia bien plus une grande affluence de Noirs
devenus Haïtiens après 1804, tout comme à bien d'autres
endroits. Cantonnée à la frontière, dans les hauteurs de
Mirebalais avant la campagne de l'Est, une branche de l'armée ayant
à sa tête Jean-Jacques Dessalines a été rejointe par
celle du Nord pour faire le siège de Santo Domingo en 1805. Cette
campagne a certainement permis l'occupation des villes frontalières de
Lascahobas, Hinche, Saint-Michel et Saint-Raphael. Il en ressort donc une sorte
de maniement et remaniement de points de limites qui bougent soit au gré
des situations de statu quo post bellum (Castor, 1988/2021) ou de tentatives de
négociations où se sont proposées en cession à
Faustin Soulouque (1847-1859), les plaines de Vega Real et Neyba7
(De Lespinasse et al., 2013). Mais l'intransigeance de l'Empereur Faustin
1er le tailla en mille pièces en voulant toute l'île
sous la domination haïtienne. Certaines villes frontalières, toutes
occupées par des Haïtiens, ont été bien obtenues par
le combat diplomatique du Président Fabre Nicolas Geffrard (1859-1867).
Mais cependant, l'indétermination des lignes a été si
perplexe que la Constitution de 1874 a admis la fixation des limites en raison
de l'occupation des habitations des Haïtiens sur l'île. Plus tard
encore, dans les négociations de 1924 et 1931, il y a lieu de relever la
revendication du droit de propriété d'Haïti sur une bande de
l'espace de Monte Cristi et la région d'Azua.
Avec l'exiguïté des plaines dans la partie
occidentale de l'île et la forte croissance démographique de la
République d'Haïti, les Haïtiens avaient l'habitude d'occuper
beaucoup de terres laissées en friche dans la zone frontalière de
la partie de l'Est pour entreprendre des activités de l'agriculture, et
également, s'y installèrent tout simplement8.
L'évolution des conditions socio-économiques en obligeaient la
plupart du temps.
7 L'historien Michel Hector souligne que Neiba eut un
campement de Noirs fort nombreux en population qui existait depuis le
début du XVIIe siècle. Ce campement portait le nom de maniel de
Neiba. Cf [Hector, Michel. « Les traits historiques d'un protonationalisme
populaire » in Hurbon Laënnec, dir. L'insurrection des esclaves
de Saint-Domingue (22-23 août 1791). Actes de la table ronde
internationale de Port-au-Prince du 8 au 10 décembre 1997, 2e
éd. Port-au-Prince, Éditions de l'Université
d'?État d'Haïti, 2023, pp 203-218].
8 Entre autres procédés qui ont permis
l'installation des populations dans la zone frontalière, il y a le
mouvement va-et-vient des esclaves en marronnage. Au début, les marrons
sortent de l'Est. Rappelons par exemple, la rébellion des esclaves
à Saint-Domingue en 1679 avec Padrejean qui fut esclave en fuite de la
partie espagnole. La grande plantation qui s'intensifie avec la
5
L'occupation des espaces territoriaux par les paysans de la
zone frontalière de la 2e Section de Lociane dans la Commune
de Thomassique suscite l'intérêt de la présente
étude sur les conditions socio-économiques dans la recherche de
compréhension des facteurs potentiels de développement de cette
zone. À telle enseigne, il revient à comprendre
l'évolution de la production des échanges économiques et
culturels dans leurs rapports systémiques qui traversent ce milieu
frontalier.
1.-Justification de l'étude
Grande fut notre curiosité intellectuelle pour orienter
notre recherche vers l'espace géographique nous permettant de comprendre
les déterminants des facteurs socio-économiques qui expliquent
l'évolution de la zone frontalière entre Haïti et la
République Dominicaine. Et particulièrement, le travail noue le
rapport de spatialité avec la frontière de la 2e
Section Lociane dans les conditions socio-économiques des paysans y
vivant tout en considérant les phénomènes sociaux qui s'y
produisaient au cours de la période allant de 2010 à 2021.
Nous sommes convaincus que la zone frontalière de la
Commune de Thomassique dispose des potentialités qui lui permettraient
d'avoir un élan de progrès en faveur de la majorité de ses
habitants. Le point culminant de ses atouts se focalise sous sa position
frontalière. La 2e Section Lociane est le point frontal sur
la frontière. Elle joue un rôle important dans les rapports des
échanges commerciaux avec la République Dominicaine. Mais nous
croyons que la 2e Section Lociane pourrait faciliter de plus vastes
avantages par d'autres types de relations concernant des points
d'échanges culturels, soit le tourisme environnemental et culturel, de
productions coopératives. Aussi l'espace frontalier peut-il accueillir
des projets de développement d'infrastructures, de création de
zones industrielles indépendantes, de gestion commune de services,
d'aménagement commun de territoire (nouvelles voies de communication,
extension du réseau de transports en commun, parcs binationaux, etc.)
À telle enseigne qu'il importe de souligner la valeur historique des
localités de Playe et de Savane Mulâtre. La première
localité fut un lieu de combat des cacos dans la résistance
contre l'occupation américaine dès le mois d'août
19159, et la seconde transpire les retranchements des éclats
épiques de champs de bataille au cours
colonie française à l'ouest provoquera la tendance
inverse. Il fut évident que ce mouvement de traversée conduisit
à des campements dans les zones de tampons entre les deux colonies (par
exemple, il y eut le campement de Noirs insurgés dans la zone de
Hinche). Depuis lors, la nécessité d'une délimitation
officielle des frontières commença bien à s'imposer. 9 La
localité de Playe dans la 2e Section Lociane de Thomassique
fut l'objet d'une confrontation entre les cacos en 1917 (mouvement armé
de paysans sous la direction de Charlemagne Péralte et Benoit
Batraville) et des troupes de marines de l'occupation américaine en
1915-1934. Cf [Gilles, Justin, « Des choses à savoir sur
la Commune de Thomassique », Loop Haiti News, publication du 13
septembre 2022, en ligne,
www.haiti.loopnews.com,
consultation au cours du mois de juin 2023.]
6
des campagnes de l'Est après 1844. C'est un fort
potentiel touristique qui se renferme dans la substantivité historique
des quelques rares évènements qui survinrent dans ce milieu.
Cependant, la réalité ne semble augurer de telles perspectives
à ce jour dans cette zone d'étude de l'espace frontalier
haïtiano-dominicain. Mais, malgré tout, il s'avère que les
échanges commerciaux s'intensifient continuellement dans cet axe central
qui jouit de l'avantage de la proximité géographique à la
grande région métropolitaine et par rapport au Nord, en
particulier.
Des raisons d'ordre personnel nous conviennent
également à étudier certains aspects sur Thomassique,
Commune ayant en front de l'Est, la zone frontalière de la 2e
Section Lociane. Car, il parait sincèrement d'une obligation toute
naturelle de participer à la recherche d'une explication scientifique
par rapport aux difficultés auxquelles est confrontée la
population de la 2e Section Lociane, en guise de contribution
sociale au processus de production de réflexions scientifiques. Ainsi,
des raisons du moins personnelles et intellectuelles animent-elles notre
curiosité à investiguer et explorer ce champ d'étude. La
période de onze années retenue, pour développer cette
étude est motivée dans l'optique de suivre la
régularité de certaines données autant que possible qui
puissent nous permettre de bien établir notre objectif de recherche. La
2e Section Lociane caractérise un choix
privilégié en fonction de sa situation directe sur la ligne
frontalière de la Commune de Thomassique.
Cette position de grande proximité avec la
République Dominicaine répond pour la plupart des paysans
à une logique d'opportunité économique. D'ailleurs,
celle-ci s'offrant par la facilité d'échanger de marchandises
existe depuis des lustres. En outre, il y a la mobilité de travail
à court, moyen et long terme dans l'autre partie, la proximité
familiale avec des personnes qui vivent de l'autre côté. Et, au
cas échéant, la possibilité de bénéficier
des services scolaires et de soins médicaux qui sont disponibles dans la
partie de l'Est. Des raisons d'attachement aux patrimoines justifient encore la
vie de beaucoup de paysans dans cette zone. Les paysans se résignent
tant bien que mal à cultiver de la terre comme principale
activité généralement occupée par la plupart
d'entre eux dans la 2e Section Lociane. C'est à la faveur de
bien de pareilles considérations socio-historiques qu'il convient
globalement de faire poindre les horizons du sujet de recherche sur une
explication démontrant l'importance particulière de la
frontière de la 2e Section Lociane entre autres facteurs
significatifs et déterminants dans l'évolution des conditions
socio-économiques des paysans du milieu. Ce qui revient à
caractériser une analyse profonde de la problématique du mileu et
de ses paysans dans la dimension de leurs conditions
socio-économiques.
7
2.-Problématique
Jusqu'en 2021, selon les estimations des Nations Unies
10(World Population Prospects), Haïti est
habitée par une population de 11, 541,683 personnes. Mais les
données de l'IHSI en accusent, pour la même année, une
estimation de population de 11, 905,892 personnes dont 5, 906,934 hommes et 5,
998,963 femmes. Alors que la République Dominicaine, occupant plus de
2/3 tiers du territoire de l'île, est peuplée de 11, 118,000
personnes11 dont 50.2% d'hommes et 49.8% de femmes. Les rapports des
échanges commerciaux et culturels entre les deux peuples sont
importants. Néanmoins, les contrôles des flux transfrontaliers
restent une difficulté énorme pour les autorités
haïtiennes qui manifestent une véritable incapacité à
assurer la sécurité de leur territoire national. Les seize points
frontaliers non-contrôlés (OIM, 2021) et les quatre autres
considérés officiels sont susceptibles des toutes sortes de
trafics illégaux qui exposent les paliers de la sécurité
intérieure du pays. La sécurité nationale englobe un tout
y compris le complexe environnemental incluant des facteurs de conditions
socio-économiques.
La dynamique de construction et de production itérative
d'idées compréhensives du milieu en vue se délimite dans
les confins de la 2e Section Lociane de la Commune de Thomassique du
Haut Plateau Central comme unité spatiale de l'étude, au cours de
la période de 2010 à 2021. De là, elle recoupe
l'intérêt d'appréhender les principales
caractéristiques du niveau de développement qui y sont
susceptibles avec les données sur les conditions
socio-économiques des paysans actées dans le prisme de la gestion
accentuée sur le schéma organisationnel
décentralisé en fonction des prescriptions de la Constitution de
1987. La démarche visant à cerner la complexité de la
question des conditions socio-économiques des paysans de Lociane
saurait-elle écarter la logique d'instrumenter les rapports
d'échanges développés avec la frontière dans son
développement ?
Le développement d'Haïti, comme la plupart des
pays ex-colonisés encore sous-développés, dépend de
quelques enjeux majeurs qui sont, en général : l'accès aux
services de santé en fonction des principaux indicateurs sanitaires et
autres services de bases placés au coeur de la problématique de
développement (Mathon, 2012). De plus, il y a lieu d'interroger des
aspects qui touchent :
? L'intégration économique régionale ;
10 Ces données ont été disponibles sur le
site internet
Https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=HT
11 Ces données sont fournies sur le site internet
www.donneesmondiales.com/republiquedominicaine.
·
8
Les réflexions sur la problématique de
l'industrialisation par les transformations 12 technologiques ;
· Les choix sur les questions migratoires, le
renforcement institutionnel des cadres normatifs d'État : la lutte
contre la corruption, l'établissement d'un État de droit, la
concrétisation des mécanismes de décentralisation et la
garantie de la sécurité nationale.
Les discussions s'enchainent à la définition d'un
agenda sur :
· Les thématiques de l'environnement :
réduction des risques de catastrophes diverses et désastres,
arrêt et renversement de la dégradation écologique et de la
pollution ;
· La maîtrise de la stabilisation des tensions
économiques et financières à l'ère
néolibérale : la réduction de la croissance des
inégalités (la lutte contre la pauvreté) ;
· La lutte contre les trafics illégaux de toutes
sortes et la lutte contre la contrebande ;
· La gestion des espaces frontaliers, etc.
Ce sont autant de préoccupations vitales et cruciales
qui déterminent les conditions socio-économiques et politiques
des populations des pays en question. Ce, dont l'élévation du
niveau de vie de manière significative requiert, en grande partie, d'un
effort réel pour institutionnaliser un régime de gouvernance qui
permet de prendre en compte des principes fondamentaux de la défense des
intérêts généraux de la Nation13,
indépendamment du contexte social et politique d'autant bien qu'ils
soient égoïstes ou non. À cet égard, la Nation
haïtienne accuse une absence complète de vision d'État
moderne14 dans son fonctionnement.
En général, les dysfonctionnements de
l'État sont aigus : son désengagement en milieu rural rend la
situation encore plus chaotique. En ce qui concerne la réalité de
la 2e Section Lociane, nous disposons des données
récentes qui ressortent de l'observation au cours de plusieurs visites
sur les lieux en 2022. Il s'agissait de procéder directement à
des déplacements dans plusieurs localités de la Section Lociane
qui se trouve dans la Commune de Thomassique. Nous avons observé
l'état
12 À ce propos, Irma Adelman affirme que dans les pays
en développement, les transformations technologiques se font davantage
sous la forme de transferts de technologie que des Recherches et
Développement qui sont trop couteuses.
13 L'académie française, 1694,
définit la nation comme l'ensemble des habitants d'un même Etat,
d'un même pays, vivant sous les mêmes lois et utilisant le
même langage.
Http://www.universalis.fr,
consulté le 02/7/2022.
14 Le concept d'État moderne renferme un mode
d'organisation politico-administrative qui présente des capacités
étatiques et de structures institutionnelles internes de garantie de
droits dans une territorialité. Cf [Sassen Saskia. Critique de
l'État. Territoire, autorité et droits, de l'époque
médiévale à nos jours, en ligne, 14/05/2009,
https://www.contretemps.eu/wp-contents/uploads/Sassen
ch1.pdf, site visité en janvier 2024].
9
précaire des conditions de vie des habitants ou paysans
de cette zone. La lecture faite de la situation des habitants dans cette zone
frontalière interroge l'efficacité des politiques publiques qui
visent au développement de la Commune y compris celui de ses deux
Sections communales. Il s'agit de projets effectifs tendant à justifier
la mobilisation et l'affectation des fonds communaux15 (Cadet,
2014). Les courantes utilisations faites par les autorités de ces fonds
ont-elles un impact concret sur les conditions de vie de la population ? Cette
dernière est confrontée à bien des problèmes sur
tous les plans qui comptent de manière non exhaustive,
l'assèchement des rivières et cours d'eau qui présente
l'état de fait assez visible où les rivières (Lociane, Don
Diègue, Rio Hondo, Los Ratones16 et Boucan Taureau) et le
cours d'eau (Augustina) diminuent considérablement en débit. Tout
compte fait, la situation observée semble accuser des difficultés
de toutes sortes dans les facteurs de développement visant à
fournir un accès aux services relatifs à la santé, l'eau
potable, l'éducation, etc.
La considération de certains indicateurs
économiques permet d'évaluer la détérioration des
conditions socio-économiques résultant de l'incapacité de
l'État à propulser la modernisation des filières
économiques. Celles-ci se fondent surtout sur l'agriculture,
l'élevage, la commercialisation et sur la fabrication du charbon de
bois, un fléau pour la couverture végétale. Les terres
quasi désertiques deviennent moins rentables pour les cultures
traditionnelles telles que la patate douce, le maïs, le manioc, le pois
congo, etc. L'aridité des terres est une préoccupation pour les
paysans étant bien confrontés aux problèmes de
l'exploitation agricole manuelle traditionnelle sur des superficies
extrêmement réduites au fil du temps. Les difficultés de
communication ne sont pas les moindres : la plupart des routes sont tortueuses,
impraticables aux convois par camions.
Le contexte de la 2e Section Lociane de la Commune
de Thomassique accuse la complexité de la gestion territoriale qui
semble jouer un rôle prépondérant dans les conditions
socio-économiques des paysans haïtiens vivant dans cette zone
frontalière. Comme toute Section communale, Lociane est concernée
par la décentralisation qui fait l'objet des articles 61 à 87 de
la Constitution de 1987. Par exemple, l'article 66 fait injonction aux
autorités de l'État de permettre aux collectivités
territoriales de jouir de l'autonomie nécessaire à leur
développement.
15 Depuis l'exercice 2012-2013,
le budget national a prévu un décaissement de 10 millions de
gourdes disponibles pour chacune des 142 communes du pays. Le montant sert
à financer des projets qui concernent leur développement
socio-économique.
16 Les rivières de la zone sont
dénommées en espagnol. Loratoun en créole tire sa
traduction du mot espagnol Los Ratones.
10
Mais en réalité, il y a une centralisation
à outrance dont souffrent toutes les Sections communales accentuant de
surcroît une situation de disparité entre les localités.
Entre autres conséquences de ce fait, sans de véritables
réseaux d'organisation communautaire, les paysans de Lociane sont
empêtrés dans une dynamique d'échange commercial avec la
République Dominicaine qui est tout à fait défavorable
à leur encontre et tendant à les entrainer dans une
dépendance accrue. Cette situation est exploitée pour
caractériser une position hégémonique - tant
supputée par le système néo-colonialiste et
impérialiste raciste de l'Occident - de la République Dominicaine
sur Haïti. Ces problèmes observés sur le terrain,
constituent l'objet de la présente étude. Des nombreuses
questions qui pourraient susciter les débats, retenons quelques-unes
dont : comment les collectivités territoriales appréhendent-elles
la question de la décentralisation ? Comment pouvons-nous comprendre les
réticences de l'État haïtien à concéder
l'autonomie pleine et entière des collectivités territoriales qui
doivent planifier et implémenter leur développement ? Quelles
sont les causes fondamentales expliquant ou conditionnant la
détérioration des conditions socio-économiques des paysans
haïtiens des zones frontalières en général, et ceux
de la 2e Section Lociane en particulier ? Quelle relation peut-elle
exister entre gestion de l'espace territorial et les conditions
socio-économiques des paysans ? Quel peut être
l'intérêt à tirer d'une gestion plus efficace de ces zones
frontalières pour l'amélioration des conditions
socio-économiques des paysans y vivant ?
Ainsi, une revue de littérature et les informations
tirées des données recueillies sur le terrain de la recherche
s'avèrent-elles nécessaires à la clarification des
questions posées. Entre-temps, nous prenons soin de préciser le
champ de notre d'étude en formulant des questions comme : quels sont les
facteurs qui déterminent les conditions socio-économiques des
paysans haïtiens de la zone frontalière de la 2e Section
Lociane? En quoi le processus de décentralisation consiste-t-il à
fournir des facteurs de gestion constituant un modèle autre que celui
qui est en vigueur dans l'espace territorial de cette zone frontalière ?
Quel peut être l'apport de la décentralisation par rapport
à la dynamique d'accentuation des politiques publiques visant à
affecter ou impacter les conditions socio-économiques des paysans de la
2e Section Lociane de la Commune de Thomassique ? En quoi le levier
déterminant des conditions socio-économiques des paysans de
Lociane constitue-t-il un facteur corollaire de l'intervention de
l'État, des autorités de la collectivité territoriale dans
le prisme de la décentralisation, des rapports d'échanges sur la
frontière et des différentes formes d'organisation
développées pour défendre les intérêts locaux
?
11
Quels sont les facteurs de relation des groupes sociaux
internes et des relations internationales qui s'emploient-ils à affecter
les conditions socio-économiques des paysans de la zone
frontalière de la 2e Section Lociane de Thomassique ?
2.1.-Question de recherche
Toutes ces questions peuvent être
résumées comme il suit : en quoi consistent-elles
l'évaluation et la compréhension de l'impact de la
frontière de la 2e Section Lociane sur les conditions
socio-économiques des paysans dans la dynamique politique de la
décentralisation et l'évolution des structures d'organisation du
milieu pour un développement local ?
2.2.-Hypothèses
L'implantation de la décentralisation dans la
frontière de la 2e Section Lociane entraine la gestion
territoriale pénétrant une nouvelle dynamique de participation de
ses paysans dans la production de développement local tout en
intégrant les agents de la collectivité territoriale et les
structures d'organisation dans la défense des intérêts
locaux pour améliorer les conditions socio-économiques.
D'où découle une autre qui enjoint la
volonté politique de l'État pour le processus de la
décentralisation de la frontière de la 2e Section
Lociane comme clé de réussite en complément de la gestion
des ressources de tous ordres qui doivent être mobilisées dans la
définition de politiques publiques affectant les conditions
socio-économiques dans cette spatialité spécifique.
3.-Principaux objectifs de l'étude
3.1.-Objectif général
Comprendre l'évolution des facteurs
déterminants des conditions socio-économiques des paysans de
Lociane dans les rapports systémiques établis à ce niveau
sur la ligne frontière entre Haïti et la République
Dominicaine.
3.2.-Objectifs spécifiques
Comprendre la forme de relation développée
entre les autorités de la collectivité territoriale et les
paysans de Lociane dans la dynamique de recherche de participation.
Montrer l'enjeu de la géopolitique dans les rapports
d'échanges au niveau de la frontière de la 2e Section Lociane.
12
Relever les traits caractéristiques de la vie
organisationnelle des paysans dans la 2e Section Lociane.
Évaluer certains indicateurs sur les conditions
socio-économiques des paysans de Lociane.
Dans le but de mieux organiser les données de cette
recherche, nous avons jugé utile de retenir un certain nombre
d'indicateurs pour la vérification des concepts de l'hypothèse.
Ces indicateurs permettent de construire les variables à vérifier
ou de mieux opérationnaliser les concepts.
La méthode mixte de recherche exploratoire et
descriptive nous permet de saisir les dimensions qui définissent et
opérationnalisent des variables de l'hypothèse
multi-variée caractérisant ce travail. C'est ainsi que
l'hypothèse première comporte la variable indépendante de
l'implantation de la décentralisation avec la participation des forces
vives dans le développement local. La variable dépendante
comprend l'amélioration des conditions socio-économiques des
paysans de Lociane. La variable intermédiaire ressort de
l'intégration des agents de la collectivité territoriale et des
structures d'organisation dans la défense des intérêts
locaux.
Aussi, la seconde hypothèse contient-elle la variable
indépendante de la volonté politique de l'État dans le
processus de la décentralisation de la frontière de la
2e Section Lociane. La variable intermédiaire se dresse dans
la gestion des ressources de divers ordres qui doivent être
mobilisées dans la définition de politiques publiques.
Ces différentes variables comportent des concepts qui
vont essentiellement caracteriser l'outillage de cette étude de
recherche. Pour l'élaboration de ces outils, un certain nombre
d'indicateurs ont été d'abord sélectionnés, puis
traduits sous forme de questions. Les principales questions de l'argumentation
portent sur les constructions des variables suivantes :
? Compréhension des acteurs locaux de la CT de la
2e Section Lociane du processus de la décentralisation.
? Niveau d'adaptation des paysans de Lociane aux rapports
d'échanges dans la frontière de la 2e Section
Lociane.
? Participation des paysans de Lociane aux structures
d'organisation en vue défendre les intérêts locaux.
? Importance de la gestion territoriale dans la production de
développement local dans la 2e Section Lociane.
13
4.-Structuration de l'étude
La présente étude comporte cinq (5) chapitres.
Le premier chapitre, présenté sous le nom de Cadre
conceptuel et méthodologie de la recherche, contient la
documentation qui nous permet de définir les concepts et de faire choix
des méthodes ou des outils méthodologiques adaptés
à l'étude et renferme la revue de la littérature tout en
démontrant des points justificatifs. Le deuxième chapitre,
intitulé Lociane et conditions socio-économiques des
paysans, comporte la dimension caractérisée sur la
géolocalisation de la spatialité de l'étude tout en
présentant le contexte de l'observation de terrain qui permet de
déceler les différents facteurs agissant dans la
détermination des conditions socio-économiques des paysans. Il
établit également l'enjeu du développement local avec la
participation de l'acteur paysan. Ce qui prouve le degré d'engagement du
paysan dans la lutte pour son émancipation socio-économique. Le
troisième chapitre, intitulé Gestion de la
frontière Haïti-République Dominicaine, entend
démontrer la complexité de la notion de frontière et la
particularité socio-historique de la frontière
haïtiano-dominicaine et présente les enjeux de la
délimitation de la ligne frontalière entre les deux États.
Le quatrième chapitre, dénommé
Décentralisation et organisation des collectivités
territoriales, embrasse succinctement la question de la
décentralisation de l'État et détermine le rôle
prépondérant qu'il joue dans la mise en oeuvre de la
décentralisation à côté d'autres acteurs. Enfin, le
cinquième chapitre, présenté sous le titre de
Résultat de l'étude, se déroule
autour de la démonstration des résultats
interprétés après l'analyse des données pour en
dégager une étude scrutée sur une réalité
concrète des informations vérifiables. Ces dernières
permettent de saisir la situation globale de la population-cible qui
éprouve des contraintes majeures dans son développement. Les
considérations objectives sur les données significatives
suscitent toutes sortes d'intérêts pour des études de
recherche scientifique.
14
Chapitre I. Cadre conceptuel et méthodologie de la
recherche 1.1.-Cadre théorique et conceptuel
En Haïti, la concrétisation des mécanismes
de la décentralisation de l'État est toujours
considérée comme une opportunité pour les
collectivités territoriales. Elle consiste à favoriser
l'intervention croissante et consistante des collectivités territoriales
dans la définition de politiques publiques de gestion spécifique
de leurs régions pour déterminer la production nécessaire
de développement local qui puisse conduire à
l'amélioration des conditions socio-économiques des populations
concernées. La collectivité territoriale de Thomassique devrait
être en mesure de partager des responsabilités qui favoriseraient
son développement et surtout tirer profit de sa position
frontalière. La responsabilité des autorités locales
s'avère nécessaire au développement local. Les structures
sociales, mentales, politiques, économiques sont importantes dans la
prise en compte de politique publique. Ce qui implique donc d'ouvrir tout
l'espace de réflexion à accueillir la participation des paysans
concernés dans l'implantation du modèle de développement
dans leur communauté en tenant compte des efforts associatifs
déjà germés un peu partout dans les localités de la
2e Section Lociane en dehors même de toute
représentativité significative de l'État.
La recherche sur les conditions socio-économiques des
paysans de la 2e Section Lociane de la Commune frontalière de
Thomassique introduit implicitement le concept de frontière à
côté d'autres qu'ils s'avèrent nécessaire de
considérer en ampleur pour pouvoir saisir toute la dimension de cette
étude. Il s'agit bien d'une obligation cruciale de préciser le
champ d'orientation conceptuelle qui permet de chevaucher sur deux courants
partageant la conception des conditions socio-économiques dans cette
recherche. Premièrement, elles renferment des considérations sur
le développement économique, des salaires dans le marché
du travail, le prix des marchandises, le capital, l'état des transports,
la diffusion des medias, etc. Et, deuxièmement, elles sont
perçues dans l'optique d'un certain nombre de facteurs de
bien-être qui sont entre autres une alimentation suffisante, de l'eau
potable, un abri sûr, de bonnes conditions sociales et un milieu
environnemental et social apte à maîtriser les maladies
infectieuses (Yonkeu et al., 2003). Ce second aspect concentre des facteurs
d'intérêt pour la présente étude. Des facteurs qui
articulent des composantes de développement économique,
renfermant des éléments nécessaires à la croissance
économique. Par croissance économique, nous entendons, selon
Perkins et al. (2014, p. 29), une élévation du revenu par
habitant, ainsi que de la production de biens et de services.
15
D'après eux, le développement économique
contient davantage d'implications, et, en particulier, des améliorations
de la santé, de l'éducation et d'autres aspects du
bien-être humain. Il importe d'assurer une augmentation de
l'espérance de vie, la réduction de mortalité infantile et
l'accroissement des taux d'alphabétisation qu'autant d'élever le
revenu per capita pour combler certains paliers substantiels du
développement.
Par développement, nous entendons l'ensemble des
transformations techniques, sociales, territoriales, démographiques et
culturelles accompagnant la croissance de la production. Un défi de la
société haïtienne tient à concevoir un
développement qui puisse inclure le milieu paysan.
La notion de paysan17 est abordée dans le
sens de la déclaration adoptée en décembre 2018 par les
Nations Unies sur les droits des paysans. Ceux-ci sont considérés
comme des personnes18 se consacrant individuellement ou
collectivement aux activités de production agricole (culture,
élevage, etc.). Il importe aussi de voir l'aspect symbolique de sa
fonction. Ce qui comporte aussi les intérêts de cette classe
sociale19 évoluant en marge d'influence des sphères
centrales de direction des affaires politiques, économiques et sociales.
Ce qui a donc interpellé l'importance de la décentralisation
étant entendue comme le partage, l'octroi, le transfert de
responsabilité et de pouvoir que l'État unitaire
centralisé consent de manière dévolutive ou subsidiaire
aux collectivités territoriales qui s'engagent à gérer en
toute autonomie leurs propres ressources en vue de mener des actions de
développement économique pour leurs populations. Une telle
dynamique peut favoriser le potentiel catalytique du développement
local. Le développement local 20 est une dynamique
économique et sociale, concertée et impulsée par des
acteurs individuels et collectifs -- collectivités locales, acteurs
économiques, organisations de la société civile, services
de
17 En 2018, l'Organisation des Nations unies (ONU)
déclare que si les paysans sont à la base de l'alimentation des
humains, ils rencontrent souvent des problèmes quant à leurs
droits, par exemple à cause de politiques ou de relations
économiques qui sont en leur défaveur. Paysan --
Wikipédia (
wikipedia.org)
18 La Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de
l'homme, Michelle Bachelet, a aussi rappelé que les paysans et les
autres personnes travaillant en zone rurale contribuent à
préserver la culture, l'environnement, les moyens de se nourrir et de
vivre et les traditions des humains, et qu'il faut donc en tenir compte dans le
cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable.
19 La notion de classe sociale renvoie au groupe social de
grande dimension pris dans une hiérarchie de fait et non de droit.
20 Le développement local fait l'objet de
définitions nombreuses et variées. Pour Mengin (1989) le
développement local constitue pour une communauté la
faculté de relocaliser son développement en s'appuyant sur les
caractéristiques de son espace : richesses naturelles, humaines,
spécificité de l'espace, organisation sociale propre et tradition
culturelle ; Selon Bernard Vachon (cité dans Dorvilier, 2011), il est
une stratégie qui vise, par des mécanismes de partenariat
à créer un environnement propice aux initiatives locales,
à s'adapter aux nouvelles règles du jeu de la croissance
macro-économique, à travers d'autres formes de
développement qui, par des modes d'organisation et de production
inédits, intègreront des préoccupations d'ordre social,
culturel et environnemental parmi des considérations purement
économiques ; De l'avis de Diane-Gabrielle Tremblay et Jean-Marc Fontan,
aussi cités par Dorvilier(2011), le développement local constitue
un processus global, une stratégie intégrée dont
l'objectif est de promouvoir une autre manière de penser et de faire
inclusivement les lieux de vie et mettant l'accent sur les notions de
solidarité et de citoyenneté .» (p. 15).
16
proximité et administrations
déconcentrées de l'État, etc. -- sur un territoire
donné21. À tel égard, Azoulay (2002, p.
27)22 estime que « l'état des conditions
matérielles d'existence d'une population constitue un niveau de
développement parallèlement à l'amélioration de ses
conditions matérielles qui sont un préalable au processus du
développement ». C'est ainsi qu'il parait intelligent de
considérer l'aspect de développement local dans un espace
frontalier sous le même angle qu'un espace métropolitain. La
spatialité de la 2e Section Lociane, dans sa
prépondérance frontalière entre Haïti et la
République Dominicaine, constitue une base solide d'appropriation de
l'influx nerveux du cadre conceptuel sur la notion de frontière dont la
revue de la littérature de la recherche rôde essentiellement tout
autour de son champ.
1.2.-Revue de littérature
Depuis toujours, la frontière suscite beaucoup
d'intérêts dans ses différents aspects. La frontière
haïtiano-dominicaine n'en fait pas exception. La corrélation
existant entre l'évolution de la conscience sociale et les ambitions de
développement des conditions socio-économiques des peuples des
deux Républiques ressort de la saisine de la file historique qui
confectionne les actions des hommes politiques dans l'espace et le temps.
Ainsi avons-nous recensé, pour la plupart, quelques
textes récents d'étude traitant de la question du
développement de la frontière entre Haïti et la
République Dominicaine qui renferme notre intérêt
particulier. Nous en abordons certaines approches théoriques de
plusieurs auteurs dans les lignes suivantes :
Selon Diamond (2006), il y a une histoire qui démarre
avec l'arrivée des Européens sur l'île baptisée
Hispaniola, toute couverte de forêt. L'exploitation colonialiste et
esclavagiste qui s'ensuivait au cours des siècles23
accouchera deux peuples dont les différences recoupent :
l'environnement, l'économie et une frontière. Il souligne que
l'exploitation à outrance qui se produisait du sol de la tiers partie
ouest de l'île et le déboisement provoqué par le
colonialisme
21 Voir le site d'internet IRAM
(Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de
développement). France. URL :
Https://www.iram-fe.org>développement-local-et-décentralisation,
page consultée le 6/7/22.
22 Azoulay, G. Les théories du
développement. Du rattrapage des retards à l'explosion des
inégalités, France, Presses Universitaires de Rennes,
2002.
23 Diamond, J., dans son ouvrage intitulé
Effondrement. Comment les sociétés décident de leur
disparition ou de leur survie, expose les effets désastreux du
système colonialiste et esclavagiste, au cours des trois siècles
successifs à partir du XVIe jusqu'au XVIIIe, des Européens sur la
destinée des peuples de l'île Hispaniola dans une division
territoriale imposée sans l'avis des individus du terroir et d'autres
considérations d'aucunes sortes d'eux.
17
entrainera un déséquilibre se créant en
défaveur de celle-ci devenue Haïti qui connaitra, au final, un plus
fort taux de croissance démographique résultant
spécifiquement de l'établissement accru des masses d'esclaves.
Dilla Alfonso (2008, pp. 89-110), dans son texte sur la
question du développement de la frontière
dominico-haïtienne24, défend le point de vue que le
développement de la frontière dominico-haïtienne
dépend de quatre aspects :
1) perspective de développement local comme processus
d'activation économique, vu des opportunités locales par rapport
à la frontière en termes de ressource ; 2) investissement social
en vue d'augmenter le capital humain dans la frontière ; 3) vision et
programmation transfrontalières par des accords politiques et
commerciaux, etc. ; 4) règlement d'un cadre juridique institutionnel
révisé.
En général, la frontière est
génératrice d'échanges culturels qui permettent de
nouvelles perspectives de développement socio-économique des
communautés impliquées. Cela n'opère pas pour autant un
changement systématique dans le coût socio-culturel qu'implique le
regard différent fait, du contexte historique et politique de la
frontière, par les deux peuples. La frontière devient un
processus marqué par l'asymétrie, la discontinuité
spatiale et fragmentation systémique. À la croisée des
deux sociétés si inégales, dans la concurrence de
marché, sans contrepoids publics et sociaux, il en résulte donc
un échange inégal qui - marqué par le commerce de biens,
la migration de main-d'oeuvre et les processus naissant d'investissement -
prend place à la frontière tout en mettant en évidence la
vulnérabilité haïtienne. Il subsiste une situation qui
génère une restructuration spatiale à régions et
couloirs transfrontaliers inégaux dans leurs niveaux de
développement et leurs rôles fonctionnels qui affectent gravement
les composantes du système transfrontalier (économie, relations
sociales, légalité, idéologie, etc.). Fragmentation qui
s'explique dans le retard juridico-politique par rapport aux évolutions
dans les sociétés. La frontière connait une dynamique
démographique variée au travers des deux côtés de
l'île. Et, les populations entretiennent des échanges commerciaux
qui constituent la principale ressource économique. Mais, ces
considérations du moins encourageantes dans les relations entre les deux
économies de l'île ne vont pas anéantir le poids des
facteurs idéologiques qui conduisent les mécanismes
d'exploitation des travailleurs haïtiens en République Dominicaine.
Tout ce dont il
24 Dilla Alfonso, H., « La question du
développement de la frontière dominico-haïtienne »
in Les défis du développement insulaire.
Développement durable, migrations et droits humains dans les relations
dominico-haitiennes au XXIe siècle, Wilfido Lozano et Bridget
Wooding (sous la dir de), 2008, Editions Editora Buho, Rép.
Dom.
18
faut recadrer par concertation binationale en touchant des
questions telles que : la migration, le commerce, l'usage des ressources
naturelles partagées (en particulier l'eau).
Dilla Alfonso (ibid.), précise plus loin dans
ce texte, - avec un oeil optimiste sur les bonnes relations entre les deux
Républiques -, qu'on peut profiter des multiples opportunités que
génère l'interaction transfrontalière pour bâtir des
solides liens de coopération en parallèle au développement
local.
Entre autres, des articles de presses et des articles
scientifiques de certains auteurs, qui nous sont parvenus sous les mains
jusqu'à présent fournissent une documentation assez
enrichissante, notamment le travail académique de Mathon (2012)
présente l'intérêt d'une ressource extrêmement
notable sur le sujet crucial de l'accès aux services de base en
santé dans les Communes respectives de Hinche et de Thomassique.
Théodat (2020, p. 81), dans son papier
dénommé la frontière haitiano-dominicaine : une île
dans l'île, s'attarde sur une démonstration d'expressions
distinctives25 de deux identités historiquement
conflictuelles qui rejoignent un pont en la valeur de la région
frontalière pour faciliter des échanges sur tous les plans :
social, commercial, culturel, etc. L'adresse politique des gouvernements
dominicains leur a conduit à saisir les voies d'orientations
économiques assez substantielles qui déterminent leur position
dynamique à prendre avantage de producteur-vendeur sur l'île
où Haïti est simplement client-consommateur. Les échanges
entre les deux parties sont une base historique depuis la période
coloniale qui soude les mailles de la chaine de
population-frontière-échanges à travers tous les
points de passage. Les règlements politico-administratifs ne sont que
procédure subsidiaire d'une réalité propre à la
nature des deux peuples qui se complémentent. Ainsi, la migration se
pratique en dépit de tout, les marchés binationaux fonctionnent,
les échanges continuent au profit de la partie de l'Est et
l'Haïtien s'accommode à la réalité.
Aussi Théodat (ibid.) poursuit-il, la
conjonction du fait des dispositions de circulation via Carrizal et la
construction d'un nouveau marché dominicain vis-à-vis de la
Commune haïtienne de Belladère, fait accroître l'importance
de cette ville dans le commerce transfrontalier. Aussi, deux fois par semaine,
des marchés fonctionnent-ils à Tilori, Los Cacaos, Las Matas de
Farfán, Hato
25 Théodat, J-M., « La frontière
haitiano-dominicaine: une île dans l'île » in La
négation du droit à la nationalité en République
dominicaine. La situation d'apatridie des dominicains et dominicaines
d'ascendance haïtienne, Denis Watson (sous la dir.), Editions de
l'Université d'Etat d'Haïti, Port-au-Prince, Haïti, 2020.
19
Viejo, Banica, etc. Des relations sociales interagissent en
plus des échanges commerciaux entre les acteurs des deux pays.
Cependant, en raison des avantages structuraux dont dispose la
République Dominicaine, elle fournit d'autres biens et services à
la plupart des femmes constituant le noyau névralgique des
commerçants transfrontaliers. En somme, les Dominicains profitent de
l'acquisition des marchandises ou biens produits en Haïti à vil
prix, à défaut, du côté haïtien, de conditions
adéquates de stockage et de moyens de transport. Enfin, de plus en plus,
les habitants de Belladère dépendent des infrastructures sociales
de la République Dominicaine.
Un article du journal en ligne Alter Presse 26 en
date du 3 octobre 2012, a fait état d'une rencontre que les
autorités des municipalités des Communes respectives de la
région frontalière du haut plateau, ont eue avec leurs homologues
dominicains des municipalités de Pedro Santana, de Elias Pina, de las
Matas de Farfán. La partie dominicaine en a profité pour
dénoncer la légèreté dont font montre les
autorités locales haïtiennes en matière de gestion de
frontière, le vol de bétail qui fait rage, l'immigration
clandestine, le commerce illicite et la protection des droits fondamentaux des
personnes menant des activités commerciales le long de la
frontière. Du côté haïtien, soutient cet article
d'Alter Presse, certains habitants de la zone frontalière qualifient
d'humiliante cette réalité de deux poids et deux mesures,
à partir de laquelle les Dominicains se déplacent librement,
à l'heure voulue, pour se procurer de la pintade ou autre produit
haïtien, tandis que les nationaux font toujours face à des
restrictions.
Aussi, ce même article s'enchaine-t-il, des habitants
des zones frontalières du Plateau central se plaignent des avantages des
termes des échanges commerciaux qui vont aux Dominicains se constituant
en véritable fournisseur du marché haïtien des
matériaux de construction, une grande variété de produits
alimentaires. En contrepartie, les Haïtiens leur vendent principalement du
tamarin, du pois congo27 et de la pintade.
Depuis le début de l'année 2016, des Communes
frontalières telles que « Ouanaminthe, Belladère,
Anse-à-Pitres, Savanette, Fonds-Verettes et Thomassique sont
confrontées à des problèmes de sécheresse qui
plongent leurs populations dans la famine. » Suivant (Alter Presse,
2016)28.
26 Odatte, R., « Plateau Central-
Problématiques frontalières : Les municipalités
dominicaines et haïtiennes en quête de solutions »,
[AlterPresse] | [en ligne], publié le 3 oct. 2012, Url :
https://alterpresse.org,
(page consultée le 08/04/2022).
27 Cette expression désigne un haricot
commun des variétés typiques d'haricots en Haïti.
28 Odatte, R., « Haïti : Des communes
frontalières frappées par la sécheresse spécial
», [AlterPresse] | [en ligne], publié le 29/03/2016, Url :
https://alterpresse.org,
(page consultée le 08/04/2022).
20
Un long discours s'étire sur la thématique de la
frontière entre Haïti et la République Dominicaine par la
contribution de plusieurs écrivains, notamment avec l'un des papiers de
Théodat (2007) ayant abordé la différence des deux
territoires29 qui s'étaient pourtant soumis à une
trajectoire historique en partie similaire. Son idée aiguise la
compréhension sur l'importance de l'orientation des politiques
économiques dans le processus de développement d'un pays. Mathon
(2012), dans le fond de son travail sur l'accès aux services de
santé de base dans deux Communes du Haut Plateau central : Hinche et
Thomassique, a réalisé le diagnostic de la distribution spatiale
des services de santé qui renferme le besoin d'améliorer :
l'accessibilité géographique aux équipements (centre de
santé fonctionnel) et le réseau routier sur
l'accessibilité spatiale. Dans un texte assez convaincant, Bobea (2008)
propose une analyse sur la sécurité
frontalière30 qui s'inscrit dans une dimension
interdépendante et régionale dans une démarche
concertée pour endiguer l'effet de débordement
générant l'instabilité sociale et politique, narcotrafic,
armes, trafic humain. Cette situation sécuritaire caribéenne
résulte de la répercussion de plusieurs schémas
contextuels : le niveau international de l'atmosphère post 11 septembre
2001. Elle caractérise le nouveau rapport des États-Unis
d'Amérique avec la région des caraïbes, la perspective
intra-caribéenne qui renvoie à une révision des forces de
sécurité des États caribéens pour affronter la
criminalité organisée dans l'espace caribéen avec
l'état délétère de la sécurité
nationale d'État caribéen. Cette situation interpelle l'action
d'appropriation par d'autres États pour concourir à la
défaillance sécuritaire nationale. Enfin, elle redoute toute
confrontation entre l'État de droit et des pratiques de gouvernance qui
s'apparentent à l'État délinquant dans l'optique de
conservation de pouvoir. D'autres écrivains dominicains, Lozano et
Wooding (2008, p. 11)31 ont fait état d'une
détérioration du niveau de vie des populations qui habitent la
région frontalière des deux côtés de la
frontière dominicano-haïtienne. La question reste à
comprendre les causes d'une telle situation de détérioration des
conditions de vie au niveau de la frontière entre Haïti et la
République Dominicaine?
29 Théodat, J-M., « Les localités
d'Aménagement Concerté. L'exemple de la Mésopotamie
banicéenne», EchoGéo [en ligne], 2 | 2007, mis en ligne le
25 janvier 2010, URL :
http://journals.openedition.org/echogeo/1350;
DOI :
https://doi.org/10.4000/echogeo.1350,
consulté le 01 août 2021.
30 Bobea, L., « Insécurité insulaire
vis-à-vis sécurité régionale » in Les
défis du développement insulaire : Développement durable,
migrations et droits humains dans les relations dominicano-haitiennes au XXIe
Siècle, Wilfido Lozano et Bridget Wooding (sous la dir de), 2008,
Editions Editora Buho, Rép Dom.
31Lozano, W. et Wooding, B., (sous la dir. de),
Les défis du développement insulaire : Développement
durable, migrations et droits humains dans les relations dominicano-haitiennes
au XXIe Siècle, Rép. Dom., Editora Buho, 2008.
21
Lozano et Wooding (ibid.) ont, par ailleurs, mis en
exergue des réflexions sur le processus d'articulation de schémas
nouveaux de libre-échange et d'ouverture économique qui comprend
les questions d'assurer des agendas liés à des thèmes
urgents requérant des actions coordonnées entre Haïti et la
République Dominicaine sur le thème de l'environnement et de la
gestion des risques, en particulier des réserves d'eau des deux pays.
En passant en revue quelques documents qui ont
été jusqu'ici disponibles sur la question, nous remarquons un
manque de données précises fournissant des explications assez
rigoureuses sur des causes qui justifient pourquoi les conditions
économiques des populations des régions frontalières des
Communes respectives haïtiennes ont connu de tels désavantages par
rapport à l'importance de la frontière. Tandis qu'il y a une
augmentation croissante du volume des échanges qui se réalisent
entre les classes d'affaires respectives d'Haïti et la République
Dominicaine. Et enfin, qu'est-ce qu'il est urgent de faire en vue d'en proposer
des pistes de solution pour cette situation ? Aussi ne rencontrons-nous pas
encore une étude qui cherche spécifiquement à expliquer
une telle situation de détérioration du niveau de vie de la
population qui habite la région frontalière des deux
côtés. Ce qui nous permettrait d'avoir plus d'éclairage sur
la question. Bien évidemment, cette étude sur la zone
frontalière haïtiano-dominicaine est circonscrite dans la Commune
de Thomassique du Haut plateau central, et plus particulièrement dans la
2e Section Lociane dont la démarche consiste à
fouiller les données sur les conditions socio-économiques des
paysans qui y vivent en nous étendant sur la période allant de
2010 à 2021. Par ailleurs, nous n'avons pas trouvé de politiques
publiques32 qui s'articulent autour de la spécificité
de la zone frontalière, malgré le fait qu'il existe des organes
qui sont créés dans cette optique. Par exemple, le fonds de
développement frontalier fonctionnant sous la tutelle du MEF. En cela,
il y a une nécessité d'accorder une gestion spécifique des
Communes respectives de la frontière qui, même si elles sont
rurales pour Haïti, sont placées sur une porte internationale avec
la République Dominicaine. Cela traduit une interface économique
traditionnelle rurale s'ouvrant sur une dynamique commerciale internationale et
présentant bien plus d'intérêts à capitaliser (en
termes de gestion et de contrôle) que le délaissement pur et
simple qui s'y fait maintenant. Peut-être, était-ce une
préoccupation qui s'apparentait au projet du Président
Dumarsais33 Estimé dans la construction
32 Les politiques publiques désignent un ensemble de
dispositions légales, techniques, financières que le secteur
public met en place pour résoudre des problèmes dans un secteur
donné. Elles caracterisent la prépondérance de la
gouvernementalisation qui, dans le sens de Michel Foucault, institue un
rôle déterminant du gouvernement dans le service donné
à la population tout en implémentant son emprise sur elle.
33 Le président Dumarsais Estimé a gouverné
le pays au cours de la période allant du 16 août 1946 au 10 mai
1950.
22
moderne34 de la ville frontalière de
Belladère en 1948 (Nelson, 2018), bien que cette ville fût
fondée35 en 1910. En quoi cette intervention de l'État
peut-elle présupposer la détermination de ses prérogatives
spécifiques dans la politique publique de développement local et
frontalier ? À propos du concept de développement, il est
sous-entendu dans la finalité du sujet à traiter comme
aboutissant de toute action de politique publique.
1.3.-Méthodologie de recherche
Les approches méthodologiques caractérisent
l'orientation des réflexions qui sont produites dans l'application des
concepts de l'hypothèse multi-variée formulée pour la
réalisation de ce travail de recherche. Il faut remarquer que les normes
élémentaires de la pédagogie canadienne ont
été appliquées pour le codage bibliographique et dans le
corps du document de recherche. Ces règles fournissent une
méthode de rédaction dans le domaine des sciences sociales
(Dionne, 2008). Ces éléments de méthodologie fournissent
un cadre indispensable à l'élaboration des travaux scientifiques
(Toussaint, 2017, p. 62). La méthode est enjointe à conduire
l'ensemble des procédures qui aboutissent à la finalité
des résultats déterminés dans le cadre de la recherche.
Elle fait recours à la méthode de recherche
exploratoire et descriptive privilégiant à la fois l'approche
qualitative et quantitative, dite recherche par méthodes mixtes. Le
choix est fait sur la conception à systèmes embarqués en
vue de disposer des données qualitatives et quantitatives en même
temps. L'emprunt de la ligne directrice de l'essence théorique permet de
rapprocher à l'esprit scientifique. Une tournée est faite vers
Gingras et Côté (2009, p. 110) qui considèrent que la
théorie crée la capacité d'imaginer des explications pour
tout phénomène social. La théorie est à la base des
hypothèses et des concepts. Elle reprend la stimulation à poser
de nouvelles questions qui visent à enrichir le savoir. Plusieurs
approches sont donc abordées pour essayer d'apprécier les
différentes thématiques de la recherche. Ainsi, la question de la
frontière Haïti-République Dominicaine est-elle d'abord
abordée dans le vaste champ doctrinaire de structuralisme36.
Ensuite,
34 Nelson, G., (Un documentaire pour les 70 ans de
Belladère), Le nouvelliste | [en ligne] publication du 12 octobre
2018|url :www.lenouvelliste.com, page consultée le 12/09/2022.
35 Ces informations sont fournies sur le site internet
www.fenamh.org.ht/belladere,
site consulté le 12/09/2022.
36 Le structuralisme est la méthode
d'analyse qui tend à détecter des relations constantes à
travers un ensemble d'éléments qui sont variables. Il revêt
une forme atemporelle. Il consiste à déceler l'ordre
présent derrière les faits et leurs variations. La mise en
évidence de relations constantes malgré la modification pousse
à établir l'existence pertinente de la structure. Cf [Juignet
Patrick, « structuralisme et sciences humaines » |en ligne,
publication mise à jour 11/02/2023|
http://www.philosciences.com,
page consultée le 29/05/2023]
23
c'est l'approche d'analyse fonctionnaliste37 que
nous tentons de privilégier dans la compréhension des
mécanismes sociaux du paysan dans la société
haïtienne, en considérant les finalités des conditions
d'évolution des paysans de la 2e Section Lociane. Et puis,
pour la notion de l'espace territorial des localités dans le processus
de la décentralisation dans la 2e Section Lociane, il est
question de procéder par considération d'étude de
cas38 dans une démarche inductive.
D'après Robert K. Yin (cité dans Sballil, 2015,
p. 70), un phénomène contemporain suivant un contexte réel
peut être décortiqué par une recherche empirique,
étant une étude de cas à partir des frontières
où se cache une réalité entre le phénomène
et le contexte, mais que de ressources empiriques multiples puissent y
être mobilisées. De poursuivre, Alex Mucchielli (cité dans
Sballil, 2015, p.70) estime que la recherche empirique consiste à
décrire une situation réelle dans son contexte et à
l'analyser pour en faire ressortir les phénomènes suivant
l'intérêt du chercheur. L'étude de cas gagne en importance
en observant directement dans le contexte la réalité des
personnes et de recueillir les données. Cette approche s'applique
à l'induction que Chevrier (2009) considère comme une
réalité en quête d'une théorie, donc inductive et
générative.
Dans cette étude de cas, portée à
décrire la qualité dans la dimension d'analyse sur les conditions
socio-économiques des paysans dans la zone frontalière de la
deuxième Section Lociane de Thomassique, il est entendu
nécessaire d'adopter une approche interpretative dont la nature se
révèle heuristique39, descriptive40,
particulariste41 et inductive. En fonction de l'étude de cas,
il peut se présenter une approche s'inscrivant dans une perspective
interprétative et visant à la compréhension, la
découverte et la description du phénomène
étudié. Ce qui permet de faciliter l'émergence de
nouvelles interactions, de nouvelles variables et peut mener à
redéfinir le phénomène en fonction du raisonnement du
chercheur qui se base sur l'observation des faits. Le
37 Le fonctionnalisme est pris dans le sens absolu tel que
prôné par Bronislaw Malinowsky et Radcliffe Brown pour camper une
analyse fonctionnelle qui tient compte de la fonction vitale que remplissent
les idées, les objets matériels, les coutumes et les croyances
dans l'ensemble systémique de la société. Chacune de ces
entités représente une partie indispensable d'une totalité
organique. Cf [Delas, Jean-Pierre, Mily, Bruno, « Les fonctionnalismes
» in Histoire des pensées sociologiques |en ligne, publication du
9/3/2016|
https://doi.org/10.3917/arco.delas.2015.01.0293].
38 L'étude de cas est une approche de
recherche empirique consistant à enquêter sur un
phénomène, un groupe d'individus, sélectionnés de
façon non aléatoire, afin d'en tirer une description
précise et une interprétation qui dépasse ses bornes. Cf
[Simon N. Roy « L'étude de Cas » in Recherches sociale. De
la problématique à la collecte de données. Benoit
Gauthier (sous la dir.), 5e Edition, Presses de l'Université du
Québec, Québec, 2009, p 207].
39 La nature est heuristique parce qu'elle fournit
une nouvelle description trouvée dans le phénomène
étudié par la découverte de nouveau sens ou
l'élargissement des expériences déjà vécues
par la confirmation.
40 La description apporte une présentation riche et
profonde du phénomène étudié.
41 Elle s'effectue dans une focalisation sur un cas
particulier. Ce cas lui-même représente un élément
très important pour le phénomène étudié.
24
raisonnement inductiviste fait recours à la logique et
l'expérience à la base de la science dans sa démarche
objective (Chalmers, 2009).
Quant au concept propre de la décentralisation, nous
l'approchons dans la perspective théorique descriptive. Mais en fait, la
thèse se limite dans l'analyse d'un sous-système à travers
des conditions socio-économiques des habitants de quelques
localités territoriales qui permettra de mieux comprendre un
système plus large. Sur ce, la perspective globale de l'étude
renvoie, au final, à l'adoption de la démarche sociale
systématique de Talcott Parsons (cité dans Louis, 2019, p. 141)
dans le cadre du structuro-fonctionnalisme. L'initiative rejoint la
préoccupation de déceler les fonctions des acteurs sociaux dans
le processus de la décentralisation dans leur unité d'action pour
dégager une compréhension des liens tissant la globalité
du corps social. Aussi cette vision méthodologique a-t-elle guidé
nos objectifs dans la recherche de compréhension des facteurs
déterminants des conditions socio-économiques des paysans de la
2e Section Lociane. Cette option théorique conduit à
un système axiomatique qui permet de concevoir la théorie et la
logique de développement comme des systèmes ouverts qui
s'associent dans un enchevêtrement de compétences des acteurs
sociaux. C'est un modèle d'étude qui permet aussi de
considérer le sens des actions individuelles devant la confrontation des
options variées dans l'intérêt du corps social. Elle adopte
également dans cette même logique l'approche théorique des
parties prenantes.
Selon Lorraine Savoie-Zajc (cité dans Sballil, 2015,
p. 69), les sciences humaines devraient généralement s'attacher
à la compréhension des situations humaines et sociales. Cette
tournure va à l'encontre de la finalité d'élucider un
phénomène par le lien de cause à effet entre les variables
constructives du phénomène. Aussi le courant
épistémologique est-il caractérisé par cette
finalité. Ce faisant, il a été logique de recourir
à la méthode de recherche à la fois qualitative et
quantitative en mettant l'emphase sur une étude de cas à
côté de celle du structuro-fonctionnalisme. Ce type de recherche
se justifie par deux raisons. La première raison est qu'il s'agit de
relever certaines données non quantifiables sur des
phénomènes sociaux à l'instar du type de relation qui
existe entre les acteurs sociaux présents dans cette zone
frontalière. La seconde raison est que les données sur les
conditions socio-économiques des habitants de la 2e Section
Lociane de la Commune de Thomassique par rapport aux résultats des
politiques publiques qui pilotent les actions évolutives et
développementistes de l'espace frontalier de ce ressort, ne sont
disponibles dans les manières précises et convenables à
cette recherche ni au niveau des ministères, ni au niveau des
institutions non gouvernementales, d'où résulte la
nécessité de mener des enquêtes directes auprès
de
25
différents acteurs. L'interaction des différents
acteurs sociaux définit l'importance du rôle remplit par chacun
dans un système global.
1.3.1.-Collecte de données
Un précieux temps a été mis pour aller
rechercher des données dans les bureaux du MAE, plus
précisément dans les bureaux de la Direction des Affaires
Dominicaines, du MPCE et de certaintes organisations nationales et
internationales. Les bibliothèques de la Faculté d'Ethnologie et
de la Faculté des Sciences Humaines ont été
régulièrement fouillées à la recherche des ouvrages
en rapport avec les thématiques du sujet de recherche et ceux qui s'en
rapprochent de près. Aucunes données précises n'ont
été trouvées à même de satisfaire notre
recherche. Aussi avons-nous consulté des bibliothèques virtuelles
de notoriété telles que google scholar, erudit, corpus.ulaval,
etc., pour essayer de tirer les meilleurs partis des connaissances disponibles
en la matière, en vue de conduire une recherche rigoureuse qui
répond aux normes académiques de la méthodologie
adoptée ici.
Ainsi, s'avère-t-il important de faire l'utilisation
aussi bien de la source primaire que secondaire. La source primaire consiste au
fait de nous disposer, autour d'une semaine de déplacements dans les
différentes localités au cours de cinq (5) jours
consécutifs. En somme, il s'agit de mener des observations42
participantes ouvertes et des entrevues (entretiens)
semi-dirigées43 qui se déroulent au cours d'une
semaine de collecte de données lors de nos déplacements à
pied et à mototaxi sur les lieux. L'échantillonnage est
constitué de manière aussi variée que des couches sociales
qui vivent dans sept localités de la 2e Section Lociane,
à savoir : Boc Banic, Nan Croix, Savane Mulâtre, Don Diègue
2, Malary, Carrefour Suzely et Terre Blanche. Ces localités sont
situées sur le flan Nord'est, Est et Sud'est, bordant la
frontière dans la zone de la Commune de Thomassique vis-à-vis de
la Commune dominicaine de Banica et des localités comptées
respectivement Hato Viejo, Savanna Cruz, Mata Jaja, etc. Mais, au final, les
participants ne sont pas statistiquement représentatifs de l'ensemble de
la population étudiée et le chercheur ne peut extrapoler les
résultats à cette population. C'est d'ailleurs une des faiblesses
de la méthode qualitative en termes de représentativité.
Cependant, il ne relève d'aucune exigence d'avoir une quantité
donnée de participants dans un échantillonnage. Mais, par rapport
à l'échantillon de la population de 37,467
42 Selon Dionne(1998), l'observation
participante ouverte est une tâche dans laquelle le chercheur qui,
s'appliquant à la description d'un portrait global d'un
phénomène inconnu, s'intègre ouvertement dans la situation
comme observateur extérieur.
43 Dans ce type d'entretiens le chercheur suit
l'interviewé dans la direction de l'entrevue avec ses idées.
26
habitants de la 2e Section Lociane, une
étude comportant des données sur cinquante-et-une (51) personnes
fournit une vision relative de l'ensemble de la population. Néanmoins,
c'est surtout par la consultation des informateurs-clés et à
l'analyse systématique des données quantitatives que nous avons
pu caractériser l'objet scientifique de cette étude.
1.3.2.-Méthode utilisée pour la collecte
de données
La collecte de données détermine
l'activité par laquelle les données sont recueillies dans le but
de conduire à la mise à l'épreuve de l'hypothèse.
Des outils tels que les entretiens semi-dirigés et l'observation sont
employés pour ramasser des données sur le terrain de
l'étude. Une observation systématique a été
réalisée au cours de deux séances de visite sur le terrain
dans les localités ci-dessus évoquées en fonction des
critères objectifs que requiert la réalisation de la recherche.
Aussi avons-nous continué avec la série d'observations
participantes d'où résulte une description à partir d'une
grille d'observation qui comprend les services publics, leur
disponibilité, leur fonctionnalité et leur potentialité.
Il s'agit aussi de faire la description de la culture agricole
prédominante dans la zone, les différentes activités
économiques et commerciales et la présentation de la faune et de
la flore de la région. Le rôle prépondérant des
acteurs locaux sur le plan socio-économique et politique et les grands
propriétaires de terres et d'autres moyens de productions sont des
éléments pris également en compte dans notre étude.
Le travail consiste à dégager une analyse de manière la
plus objective que possible.
Il faut souligner l'utilisation des entrevues
semi-dirigées qui a été faite dans cette recherche pour
créer une plus grande flexibilité. Cela donne de la
possibilité de changer l'ordre des questions en conséquence et en
fonction des commentaires des répondants.
En fait, la collecte de données a été
réalisée au cours de la semaine du 26 au 30 décembre 2022.
Des déplacements ont été effectués dans le cadre
d'observation systématique. Et des entretiens ont eu lieu avec
cinquante-et-une (51) personnes réparties en vingt-et-une (21) femmes et
trente (30) hommes à travers les sept (7) localités choisies pour
piloter la recherche. Les personnes avec qui ont été tenus des
entretiens constituent des informateurs clés. L'âge moyen des
participants à l'échantillonnage de l'étude est de 40
ans.
27
1.3.3.-Méthode d'analyse et
d'interprétation des données
Aussi, la recherche mixte s'en tient-elle à un double
avantage qui contient, d'une part, les résultats étant
accessibles et la production de connaissance pour rechercher des données
en raison des variables interprétées par le chercheur et en
fonction de la teneur sensorielle de la recherche, d'autre part, quant aux
résultats formulés en des termes clairs et simples aux
participants à la recherche, il y a une interaction qui se
développe entre les paysans de Lociane eux-mêmes et avec leur
environnement dans le cours de la recherche. Les individus, en prenant
connaissance des résultats de la recherche, se mettent en position de
délibération, de critique et questionnent son
applicabilité et sa transférabilité dans leur propre
contexte, c'est-à-dire ils s'imaginent des retombées positives
suivant des possibilités d'une prise en compte des propositions
formulées en termes de perspectives à travers la conclusion de
l'étude. La démarche méthodologique permet
l'étalage de différents procédés scientifiques qui
ont guidé les contours réflexifs et discursifs de l'étude.
Ce qui nous amène à être rigoureux dans la façon
dont les données sont interprétées et les méthodes
appliquées pour les collecter. Car, la meilleure façon que nous
jugeons utile d'aborder une étude de terrain est de considérer la
situation globale de la population-cible dans la mise en contexte de
l'observation et des entretiens in situ.
1.4.-Contextualisation de l'observation
ethnographique
La démarche d'observation retrace l'attention
portée sur le déroulement du travail de terrain effectué
dans les différentes localités déterminées dans le
choix de l'étude. C'est la descente des lieux. Des parcours
systématiques réalisés à pied et à mototaxi
au cours des journées entières impriment des moments forts de
pénétration des espaces intérieurs de cette partie du pays
qui détient toute sa spécificité dans la paysannerie
haïtienne. Le besoin de comprendre les conditions socio-économiques
des paysans de la 2e Section Lociane ne saurait être
comblé que de la nécessité d'aller écouter les gens
dans la paysannerie pour pouvoir saisir leurs réalités de vie. La
recherche sur les conditions socio-économiques des paysans de la
2e Section Lociane répond aux méthodes qualitatives et
quantitatives qui adoptent une approche inductive impliquant de collecter des
données à partir des techniques. Comme moyens techniques de
collecte de données, nous utilisons, d'abord de l'observation ensuite
nous procédons à des entretiens semi-dirigés.
L'expérimentation de terrain offre un créneau de source
première pour la collecte de données qui sont ensuite
28
analysées et interprétées44.
L'arrivée sur le terrain attire la curiosité des paysans qui sont
vigilants en ce temps-ci face à tout visage inconnu. Cela traduit le
niveau de risque qu'il comporte dans le fait pour des jeunes gens de se
déplacer n'importe où sur le territoire en ce moment. Vu la
conjecture sociale d'insécurité. Il aura fallu vite expliquer
amplement la signification de la présence sur les lieux. Après
s'être identifié comme étudiant de la Faculté
d'Ethnologie à l'Université d'État d'Haïti menant une
recherche de données avec pièces d'identification à
l'appui, les paysans comme brigades des lieux ont fini par accepter
dubitativement de laisser le libre champ aux démarches de
l'étude. Sitôt, on a entendu loin des voix résonnant :
Primo, quien es esse moreno? Ki sa nèg sila vini chache por
aqui ? De ceux-là qui se tenaient tout près en sortait cette
question : tù tienes problemas nèg an mwen ?
Entre-temps, des gens venant des quatre coins s'amassent rapidement autour de
nous ...
Des questions tendancieuses ont exprimé la
méfiance vis-à-vis des jeunes garçons dans l'insinuation
de pouvoir intercepter tout suspect qui serait en fuite dans la
frontière. La notoriété de quelques personnes nous a aussi
facilité la protection nécessaire à la libre circulation.
Mais l'étranger n'est pas bien perçu à priori. Surtout,
ils réprouvent la présence des politiciens. N'empêche
qu'ils espèrent que des projets soient nécessaires à
réaliser dans la zone pour aider à améliorer les
conditions de vie des habitants de la 2e Section Lociane.
Aussitôt disposés à nous entendre, nous leur avons beau
expliquer que notre présence ne s'inscrivait dans aucun des deux cas
ci-dessus évoqués.
Nous supposons que leur méfiance, à prime
abord, démontre qu'ils ont l'habitude de rencontrer des politiciens, des
enquêteurs des ONG, des arnaqueurs et des imposteurs. De grands efforts
ont été déployés pour faire passer le discours sur
la recherche de données dans le cadre d'une étude universitaire.
Il a fallu incessamment reprendre le but et l'objectif de notre
présence. Le motif de cueillette de données pour la
compréhension d'un tel phénomène social dans ce milieu
leur paraissait nouveau. Donc, ils en appréhendent une dissimulation des
vraies raisons de notre présence. Preuve que ces paysans ne s'appliquent
pas à tout croire du premier coup. Ils questionnent beaucoup comme des
juges d'instruction qui posent une même question sous des formes
différentes pour corréler la cohérence des
réponses. Ils cherchent même à se montrer prêts
44 L'interprétation des données
répond à une organisation cohérente des données, la
transparence au processus utilisés et la limitation des biais
subjectifs. Nous tenons compte de la relativité des données,
c'est pour cela que nous en avons procédé à trois phases :
au nettoyage, à l'analyse et au codage des données.
29
à sympathiser à votre cause si vous leur dites
votre réelle intention. Ils ne sont pas dupes. Même s'ils vous
parlent, ils ne vous livrent pas tout. Il avait fallu que nous nous
entretenions avec des leaders communautaires en tant qu'informateurs
clés, en l'occurrence Edouard communément appelé `Ti
Edouard' à Carrefour Suzely pour que d'autres paysans acceptent
volontiers de nous parler. Aussi fallait-il que nous tombions, à Savane
Mulâtre, sur le jeune Alpha Pierre qui a fait des études
classiques à Thomassique pour que d'autres gens s'entendent à
entrer dans nos démarches. Certaines figures servent de leaders
communautaires qui inspirent de la confiance nécessaire pour d'autres
personnes qui manifestent un sentiment répulsif vis-à-vis de
l'étranger. Malgré tout, plusieurs personnes ont refusé de
nous parler.
1.4.1.-Rapport descriptif du paysage
observé
La plupart des paysans de la 2e Section Lociane
sont propriétaires de leur maison de deux à trois pièces,
faites de toit en tôle à pavée non cimentée qui sont
de plus en plus dispersées au fur et à mesure que nous entrons
dans la profondeur de la Section communale. Encastrées dans des
clôtures en raquette, à grandeur inégale, les maisons ont
des portes en bois, les parois en palissade pour certaines et en
clissade45 et pisé pour la plupart.
Sur la route empruntée par Nan Latte, en passant par savane
sucre, nous remarquons le chantier d'un tronçon de route en
béton, étant donnés les caniveaux des deux
côtés de la chaussée en terre sablée, pour conduire
au nouveau lycée encore inachevé, qui est en construction depuis
2015. Une route de sept (7) mètres de largeur longe savane sucre
pour arriver à ravine Zoranje, aux bordures
déboisées, qui est presque asséchée en ce
moment de fin de décembre. Poursuivant ainsi notre traversée des
passes des ravières Loratoun 1 et 2 sur la route en terre
battue qui conduit à Malary dans une distance de près de deux
heures de marche. De vastes champs presque dépourvus d'arbres sont
encerclés en pâturage à raquette à piquants. Nous
atteignons Malary à partir de l'écriteau du mur qui enclôt
le puits d'eau à traction humaine qui se situe devant le champ de pois
congo quasi desséché en aval d'une église
protestante en palissade à toiture en tôle sur une petite pente.
Une foule de personne en majorité de jeune fille avec des gallons de
couleur jaune débordent l'encerclement du puits en attente de son
ouverture. Il est presque 16 heures d'horloge. La manche de manoeuvre du puits
artésien est cadenassée en ce moment de la journée. Un
responsable de l'église détenant les clés doit venir
ouvrir le puits artésien, a répondu une jeune fille à qui
nous avons demandé : à quelle heure vous allez pouvoir
45 La clissade c'est l'expression qui désigne
l'armature en lattes disposées horizontalement entre les poteaux en bois
de maison.
30
remplir vos seaux ? Il fonctionne le plus souvent fort tard
dans l'après-midi, en rajoute-t-elle. Dans un horaire variant à
intervalle de deux jours durant la semaine. Des jeunes femmes ou jeunes filles
et petits enfants sont amassés sous un arbre à l'attente de
l'ouverture du puits.
Avec une quantité imposante de demande, c'est fort
tard dans la soirée que beaucoup d'entre ces personnes vont parvenir
à avoir un peu d'eau pour pouvoir tenir pendant deux jours. Il semble
que la crainte de toute éventualité soit d'une panne ou autre du
puits artésien attise plus de cupidité à tirer la plus
grande quantité d'eau possible.
Un peu plus avant à près de 200 mètres,
nous constatons, sur le côté droit en direction du point central
de l'artère principale de Malary, un espace déboisé
presque enclos qui constituait un lagon où se tenaient des trous
creusés dans un amas de boue en plein air, sans aucun arbre de
couverture sous le vif fouet du soleil. Des enfants s'y retrouvèrent,
notamment il y avait une petite fille s'agenouillant sur la bouche d'un trou
assez coincé en forme de puits d'eau pour pénétrer un
petit bol en vue de tirer de l'eau sale à jeter en guise de filtrage de
la substance potable. N'a-t-il pas raison, Alexis (1955), dans son roman
Compère Général Soleil, de soutenir que : « le Soleil
est le seul service d'hygiène dans les campagnes haïtiennes. Il
attaquait les microbes...» (p. 171).
En approchant plus près d'eux, après une
respectueuse salutation, nous leur avons questionné en ces termes :
« bonswa ti moun, kouman nou ye ? Epi kisa nap fè la ?
» De répondre, ils ont adressé en choeur : « Bonswa
wi tonton, nap pran ti dlo pou nou sèvi.» De relancer, nous
leur avons exclamé : « men nou bwè li tou ! »,
ils nous ont répliqué : « wi, si nou pa jwen n dlo nan
pi a, nou kon n kite'b poze ak ti bout rakèt pou nou ka bwè`b
».
En voici des prises de photographie illustrant la situation
de l'eau potable à Malary. La première photographie (photo 1),
affichée à la page 31, montre la partie de devant du puits
artésien qui comprend un écriteau en anglais. GVCM, est une ONG
qui caractérise une mission chrétienne opérant dans divers
endroits dans le Plateau Central. Elle intervient dans la fourniture de
quelques services de bases aux populations démunies de certaines
localités. Elle a donc financé la construction de ce puits
artésien qui dessert la population de Malary.
La deuxième prise de vue photographique (photo 2),
présentée aussi à la page 32 de l'encadrement
photographique, montre la source de filtrage d'eau qui est investie par des
enfants à la recherche de l'eau en attendant que le cadenas du puits
artésien soit ouvert. C'est l'autre point de ravitaillement
immédiat en eau sur place. Après avoir parcouru à pied une
longue distance pour arriver à Malary, il se faisait déjà
tard.
31
Il n'était nullement conseillé de poursuivre ce
chemin au-delà des quatre heures de l'après-midi. Le chemin
était rebroussé pour rentrer à Thomassique...
Dans l'amas d'eau de la rivière Loratoun à la
seconde passe dite Loratoun 2, aux deux bords vidés des arbres dont les
bouts enracinés justifient des existences anéanties dans
l'exploitation du charbon de bois, le lendemain matin, il est presque 7 heures,
nous avons remarqué beaucoup de gens qui viennent chercher de l'eau dans
une source d'eau dans ce qui reste de la rivière de Loratoun.
Des motocyclettes vrombissent leur bruit de cylindres à la rampe des
mornes abruptes dans les traces peu praticables des sentiers ruisselés
par les pluies des dernières saisons. Des animaux à sacs en
paille remplis d'objets, certains sont montés par des personnes tenant
les cordes à brider, d'autres sont laissés libres avec une corde
autour du cou, bien chargés et suivis de meneurs portant de petits sacs
ou une cuvette à la tête en allant au marché. Pour le coup,
une dispute vive s'engage entre un motard et un meneur d'animal à un
endroit de passage coincé où l'un et l'autre se croient avoir la
priorité de passage. Un local peint en vert et blanc loge
l'écriteau d'un centre socio-médical dans la zone, placé
à quelques 50 mètres à droite au fond d'une cour sans
barrière et quasi encerclée de grande raquette à piquants.
Mais, il ne fonctionne pas depuis plus de 10 ans nous a annoncé des
riverains. Le centre de santé servait surtout à la vaccination
dans la zone, en rajoutent-ils. Aussi s'indignent-ils de l'absence de
politiques publiques visant à intégrer Malary dans une dynamique
de développement local. Kermanci, un jeune motard de 23 ans, avance :
« depuis plus de deux ans, l'ex-député Francisco Delacruz,
originaire de la zone, avait rompu tout contact avec nous parce qu'il fut
vivement critiqué pour son manque délibéré
d'intérêt pour les problèmes de Malary ».
PHOTO 1: ILLUSTRATION DE PUITS ARTÉSIEN DE
MALARY

Le puits artésien construit par l'ONG GVCM
à Malary
Le mur à écriteau qui est devant le puit
artésiens Par-derrière
Source : Frantz Isidor en date du 26 décembre
2022
Source : Frantz Isidor en date du 26 décembre
2022

PHOTO 2: ILLUSTRATION DE SOURCE D'EAU À MALARY
32
Chemin faisant, nous traversons Malary en direction de
Savanette et atteignons vers les 10 heures et demie, l'espace semi-aride de Don
Diègue 2. Les arbres ne tiennent plus débours ici. Les sentiers
sont difficiles même pour les motocyclettes. Des terres quasi non
cultivées sont habitées par des arbustes clairsemés. Un
établissement d'école assez grand et long avec sa toiture en
tôle soutenue par des poteaux en bois en paroi de béton à
faible épaisseur dont le socle de ferrailles s'en tient aux fils de fer.
C`est la modernité par rapport à la palissade ou la clissade
et pisé. Cet établissement dispose des portes
d'entrée et des fenêtres qui empêchent à n'importe
quel individu d'y pénétrer. Les raquettes à piquants
enclosent la cour. C'est une école congréganiste de section
primaire, car, dirigée par un prêtre catholique. Les gens se
plaignent que ce dernier augmente le prix annuel de
33
1000 mille gourdes en sortant des 2000 mille. Plus loin, nous
avons vu un chaume à toiture en tôle et cloisonné en
feuille de tache à palmis. C'est quand même rare. En ce
beau matin de décembre, au sommet de la morne qui conduit à la
rivière de Don Diègue, le regard peu lointain sur les cimes du
Pico Duarte décrit une image pittoresque de grande sensation. En y
traversant pour atteindre l'autre rive de Don Diègue 2, il y a un petit
carrefour où le chemin à gauche mène à Terrier
Rouge, la Playe, Don Diègue 3, Locoray, La Saintery, Canicey, etc.
Mais prolongeant la route droite nous traversons Kolorine et
pénétrons à Boc Banic, il est presque 12 heures. C'est un
centre attractif avec beaucoup d'activités commerciales. Des maisons en
bloc sont recouvertes de béton et comportant même des
étages à côté de celles gardant le style
démodé de la zone rurale. Des cours encerclées en fil de
fer accroché aux poteaux en bois. La principale artère est en
chantier avec les caniveaux aux deux côtés de la chaussée
en terre battue. Une petite place publique datée des vieux temps tient
lieu de réception des visiteurs. Les gens y sont moins curieux des
étrangers. Il y a un sous-commissariat de police avec 2 ou 3 policiers
en poste, un tribunal de paix, une chapelle de l'Église catholique, et
plusieurs églises protestantes, un centre de santé pour
l'État et trois cliniques privées. Il y a aussi un bureau du
ressort de CTE Hinche de l'Orepa Centre relevant de la Dinepa qui se tient tout
près des installations des antennes-relais de transmission pour le
réseau d'une compagnie de télécommunications
(téléphonie mobile desservant la population haïtienne de
l'ère des NTIC). Quelques écoles primaires privées, une
école nationale et un collège de niveau 9e A.F.
desservent cette grande localité que certains s'abusent d'appeler
quartier. Il y a des débits d'eau au domicile de certains habitants dans
un périmètre réduit. Un marché à quelques
tonnelles en paille. En effet, la présence de l'État s'y fait
pourtant montre.
Mais les structures ministérielles de MDE, MARNDR,
MPCE et les agents de la collectivité territoriale n'interviennent pas
encore dans la protection de l'environnement qui est dévasté par
le déboisement dans cette Section communale. Aucun plan n'est tenu pour
remédier à la dégradation de l'environnement avec la coupe
des arbres pour fabriquer du charbon de bois. D'ailleurs, l'article 253.1 de la
Constitution de 1987 amendée le 9 mai 2011 impose toute action de
politique publique nécessaire et urgente pour remédier à
la dégradation de la couverture végétale en dessous de
10%. Cependant depuis quelque temps déjà les estimations de la
couverture végétale du pays sont à moins de 2%. L'absence
d'arbre est à la base de la sécheresse prolongée qui
chauffe davantage la terre. Une terre chaude rend inapte toute agriculture dans
certaine partie du paysage. À côté de
34
Lociane, une rivière bien propice à
l'agriculture mais d'où le risque de perte est plus élevé
avec l'inondation. Des mornes abruptes rendent plus nécessaire
l'ingéniosité des techniciens qualifiés pour
étudier les possibilités d'irrigation.
Des camions à 6 et 10 roues de transport de
matériaux de construction, de produits manufacturés et des
mototaxi portant des passagers et autres objets provenant de la
République Dominicaine se dressent devant la chaine de police barrant la
route sur la pente descendante vers la grande rivière de
Lociane46 d'une faible largeur dans un très grand lit. C'est
sa beauté renfermée dans sa longue portée de circuits
à travers plusieurs localités qui impose son nom à la
Section communale. Après l'avoir traversée, peu profonde en ce
moment, nous parcourons quelques 30 minutes de marche à pied avant
d'arriver au fleuve de l'Artibonite qui s'étend sur une assez grande
largeur. Les véhicules traversent les deux rivières dans ce mois
de sécheresse sans difficulté.
Une cotisation pécuniaire est exigée à
verser à l'agent du point d'arrêt pour laisser-passer. Ainsi, un
agent de la police nationale détient-il l'autorité du droit de
passage. Il n'y a pas de service de douane à Thomassique depuis
après 7 décembre 2015. Par suite des altercations entre les
agents du poste douanier de Thomassique et des chauffeurs de camions qui ont
occasionné la mort de deux d'entre ces derniers atteints de projectiles
des agents douaniers. Allait s'ensuivre l'incendie du poste douanier par des
membres de la population en réaction de leur colère.
Le service douanier s'est installé depuis lors
à Papaye, près de Hinche, aux environs de 18 kilomètres de
Thomassique, dans un chaume sous des grands arbres. Des hommes lourdement
armés font office d'agents douaniers travaillant dans des conditions
très précaires (Odatte, 2016)47. L'absence de service
douanier est un vaste champ libre pour la circulation de marchandises
importées en République Dominicaine dans toute la zone. C'est
seulement lorsqu'il faut traverser Papaye pour se rendre à Hinche que la
douane puisse taxer. Mais, comme le souligne Théodat (2014, p. 99), le
prélèvement de taxes ne sert pas le financement direct des
politiques publiques de développement de la communauté locale
sans parler de la question de la contrebande48.
46 La rivière Lociane mesure 45 km. Sa source
découle du massif du Nord. Elle se jette dans le fleuve de l'Artibonite.
Elle traverse toutes les principales localités de la 2e
Section de Lociane. Cette raison explique le choix nom du ruisseau
attribué à la Section communale.
47 Odatte, R. « Haïti-économie : des agents
douaniers toujours absents à Thomassique. Plus d'un mois après
l'incendie de la douane »|En ligne publication du 27/01/2016|
www.alterpresse.org, page
consultée le 04/12/2022.
48 La contrebande est prise ici dans un sens
plus large, la frontière avec la République Dominicaine est
l'objet de pertes de recettes pour Haïti de l'ordre annuel de 350 à
500 millions de dollars au minimum. Alors que le pays n'y collecte qu'environ
50 millions par an. Cf [Laleau, Wilson, Haïti, pétrocaribe et
ses déraisons. Manifeste pour une éthique de
responsabilité, Editions C3, Delmas, Haïti, 2020, p. 86].
35
En sortant de Boc Banic, nous empruntons la route principale
qui traverse Don Diègue 1 et Carrefour Suzely. Cette voie en terre
battue est praticable pour les gros véhicules de transport. Tout
à Carrefour Suzely, un chemin conduit à Savane Mulâtre. Et,
de poursuivre le chemin nous atteignons Latine qui constitue la localité
de limite de la 2e Section Lociane par rapport à la
circonscription de Cerca-la-Source.
Carrefour Suzely est une localité tout aussi
ravagée dans sa structure environnementale. L'église adventiste,
structurée en paroi de palissade est en rénovation pour une
construction en bloc. Une école de niveau primaire y est logée.
À l'autre côté de la route se situe l'école
nationale. Les maisons à toiture en tôle, aux cours toutes
cloisonnées démontrent le symbolisme de la
propriété privée dans toute cette zone frontalière.
C'est chez Edouard que des personnes tombées malades peuvent se procurer
des premiers soins à frais payé. Il n'y a pas de puits d'eau et
débits d'eau du bassin de captage de 75 mètres cubes construit en
2019 à Don Diègue 1, non loin de Carrefour Suzely dont la
distribution concerne uniquement Boc Banic. Mais l'absence
d'électricité est palliée avec des panneaux solaires que
certains exposent par devant leurs maisons. Un habitant eut à nous dire
qu'en « République Dominicaine, le panneau solaire se vend à
plus bas prix y compris le coût de revient par rapport à
Haïti. Et qu'il lui parait plus facile de parcourir une plus longue
distance telle que se rendre à Santo Domingo au lieu d'aller à
Hinche ». Les routes sont dans de mauvais états de circulation dans
cette zone.
Savane Mulâtre, au nord, s'enfonce dans un long chemin
d'un état calamiteux qui regorge les deux artères qui viennent
soit de Terre Blanche ou de Carrefour Suzely. La motocyclette et le
véhicule tout terrain sont les seules automobiles capables de se rendre
à Savane Mulâtre. Mais la majorité de la population
pratiquent la route à dos d'âne ou à motocyclette de nos
jours. La pratique du charbon de bois a affecté tout l'environnement de
cette Section communale, notamment Savane Mulâtre qui ne renferme que des
arbustes de bayarondes49 parsemées
sur un sol rocailleux. Les pluies ont ruisselé des pans entiers des
ravins dépossédés des bordures boisées. La
rivière Lociane juxtapose l'entrée de la localité qui
s'abrite sur une basse altitude. Des toits de chaume résonnent
l'état de misère des habitants qui assomme
l'émerveillement historique caractérisant ce coin de terre.
Savane Mulâtre est en situation très difficile sur le plan
socio-économique en dépit de sa proximité avec la
frontière comparativement à Boc Banic. Elle renferme un petit
cimetière débordé de sa capacité à
accueillir des cadavres. Il n'y a pas de marché public ni centre de
santé. Les
49 C'est l'expression haïtienne qui
désigne un arbuste très répandu dans nos régions
campagnardes.
36
habitants disposent d'une chapelle de l'église
catholique et quatre autres églises protestantes. Il y a deux
écoles primaires dont l'une est nationale. Elles ont grande raison
pratique d'enseigner les bienfaits de l'eau potable pour la santé. La
conscience citoyenne en sera bien prise en compte. La rivière de Lociane
pourrait faire l'objet de projet d'assainissement. Mais, la localité ne
dispose pas de l'eau potable. Rien que penser à voir la rivière
de Lociane en crue effraie. D'ailleurs, il n'y a aucun pont jeté sur une
rivière dans la 2e Section de Lociane. C'est une zone qui est
très dangereuse parce que des paysans y sont assassinés en plein
jour par des voyous criminels ou bandits armés opérant
systématiquement dans cette zone frontalière.
À l'effroi des motards pour emprunter la route de
Savane Mulâtre, s'ajoute la longue distance qui renchérit le
coût de transport. Autre risque de déconvenue expose à la
frayeur de s'y retrouver bloqué par manque de motard transporteur
(taximoto) qui ne s'y aventure pas au-delà des deux heures de
l'après-midi. Les paysans y sont pourtant courtois, quoiqu'ils soient un
peu indifférents vis-à-vis de l'étranger. C'est la teneur
de la conversation engagée qui peut faciliter la tâche.
Grâce à des leaders communautaires, les entretiens se
déroulent plus facilement. Le travail de recherche est pourtant tenu
dans la rigueur. Les problèmes de la localité sont exposés
avec clarté. Des maisons à toit en tôle contrastent avec
d'autres chaumes de styles plus antiques qui diversifient le décor du
paysage semi-aride d'où balaye un léger vent qui bouffe les
visages. Des petites croix symbolisent les refuges mortuaires consacrés
dans les basses-cours des familles à côté des latrines sans
cloison où certains habitants font leur aisance en plein air. Il faut
souligner que la plupart de cette population ne dispose pas de latrines. Sans
électricité, le panneau solaire est d'une grande utilité
pour recharger les appareils de télécommunication dont les
compagnies démontent fort bien qu'elles s'étendent
véritablement dans tout cet espace du territoire national mais la palme
revient à la compagnie de télécommunications Natcom. Parce
que tous les contacts que nous avons établis avec les habitants du
milieu en ressortaient absolument.
À la sortie de Savane Mulâtre, au passage
à Terre Blanche, le paysage incruste le délaissement d'un endroit
livré à la nature sauvage. La localité de Terre Blanche
est dépourvue de tout type de services sociaux. À part de deux
petites églises protestantes abritées dans des chaumes à
tromper le soleil, sans école ni rivière, ni puits d'eau, des
petites maisons de deux pièces en palissage ou en clissade et
pisé, cette localité abrite une faible quantité de
population dans une situation dispersée. Des caveaux sont construits
dans des cours en absence de cimetière qui est
généralement
37
la norme dans cette zone pour enterrer les morts. C'est un
signe qui démontre également la différence de quelques
valeurs anthropologiques des habitants de cette localité.
Les arbres y sont extrêmement rares. Des haies vives
séparent les champs de pois congo qui résistent au
soleil de plomb massacreur de fin décembre se réduisant à
leur plus simple expression de plantes rabougries et fanées. À
Terre Blanche, des cours clôturées en candélabre gardent
une propreté de balayage entretenu. Les localités proches
Hatonuevo, Savane Plate et Garde Salnave desservent respectivement Terre
Blanche aux besoins d'éducation au niveau atteignant la 6e
année fondamentale et d'eau potable à près de 4 à 5
km. Pour ce qui concerne le besoin en soin de santé, un
déplacement plus conséquent de près de 8 à 12 km
s'impose relativement au choix de se rendre soit à Thomassique ou soit
à Cerca-la-Source ou soit à Boc Banic.
Au rythme saccadé, ronflant son moteur avec trois
passagers à bord d'une mototaxi, deux ont dû descendre pour
marcher à pied afin de permettre au véhicule de ramper le morne
abrupt et tortueux de la rivière loratoun avec l'autre passager
agrippé au motard qui n'arrête de plaindre de l'attitude des
dirigeants politiques qui ne font semblant de connaitre la douleur de la
population que pour obtenir le vote aux élections. Après mille et
une promesses, plus jamais on ne les reverra. « Si se pou mwen,
s'indignait-il, volè sa yo pap jwen n yon vwa ankò nan
eleksyon bò isit la. Se sèl manman yo ak papa yo ak rès
fanmi yo kap bay yo vòt ».
Nous n'osons pas imaginer l'emprunt de cette route dans la
saison pluvieuse. Nous allons à Nan Croix qui est une localité
gardant plus ou moins une couverture végétale. La route en terre
battue, en très mauvais état, bordée de candélabre
aux deux côtés regroupe de nombreux chaumes à
l'intérieur des arbres fruitiers, des cocotiers. Certaines cours des
paysans renferment des sacs de charbon empilés. C'est une aussi un
constat valable pour toutes les localités de la zone. Les
rivières traversées pour pénétrer la
localité sont dépourvues de bordure végétale. Rares
sont des cabrits qui sont amarrés au bord du chemin qui s'amenuise au
fur et à mesure que s'apercoive l'entrée au centre du bourg de
Nan Croix. Les maisons à toiture en tôle de diverses dimensions
à portes en bois constituent la seule originalité d'une
région qui abrite une population dépourvue de tout service
même au minimum. Des latrines précaires desservent une faible
portion de cette population.
Le puits d'eau à traction humaine que l'ONG World
Vision avait construit depuis 2004 est la source de débit d'eau
disponible dans la localité. « Dans les moments de panne, c'est
à deux heures
38
de marche que nous nous rendons au fleuve de l'Artibonite pour
prendre de l'eau », a martelé Faton, ancien membre de Casec,
près de 60 ans qui est natif natal de la zone. Les saisons pluvieuses
sont encore plus dures pour nous avec la route qui est impraticable, en a-t-il
ajouté.
Très dépendants de la Dominicanie, les paysans
des localités les plus proches de la frontière profitent des
jours de marché des localités frontalières dominicaines
pour s'y approvisionner en produits tels que l'huile, sucre, macaroni, salami
et en volaille50. Cette volaille est de plus forte grosseur que la
poule de race en Haïti. Cette affaire de volaille importée en
République Dominicaine a grandement attiré notre attention dans
ce milieu rural. Cette étude ne va pas y entrer. Mais c'est très
important ! Les volailles ont subi de fortes maladies qui les déciment
en grande quantité. De manière générale, à
chaque année il y a une période de maladie pour les volailles
mais c'est la forte recrudescence des maladies au cours d'une même
année qui rend la situation plus inquiétante.
Le commerce occupe une grande place dans les activités
des femmes paysannes de la 2e Section Lociane, mais le métier
agriculteur est général dans la région. Selon Bastien
(ibid.), le paysan apprend non seulement à manier de la houe et
de la faucille mais aussi quand, et comment semer, nettoyer le terrain et
procéder à la récolte.
1.4.2.-Grille d'observation
TABLEAU 1 : DÉMONSTRATION DES INDICATEURS
SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA 2E SECTION LOCIANE
Grille d'observation des localités : Boc Banic, Savane
Mulâtre, Terre Blanche, Nan Croix, Carrefour Suzely, Malary et Don
Diègue 2
|
Disponibilité
|
Fonctionnalité
|
Accessibilité
|
Eau potable
|
Dinepa à Boc Banic, un puits artésien à
Malary et à Nan Croix. Les autres localités n'ont pas d'eau
potable
|
La distribution d'eau se
fait 10 jours/mois à
Boc
Banic. Les pannes sont
fréquentes avec les
puits à traction
humaine.
|
Un nombre réduit dispose
de l'eau à Boc
Banic. Un
horaire drastique indispose
une large population à
Malary et à Nan Croix
|
Infrastructure routière
|
Les routes sont en terre
battue. Sauf que le
bitume de la route de
|
Même en temps sec, les
routes sont
difficilement
|
Le bitume de la route de Cerca-la-Source arrivant à
Garde Salnave aménage
|
|
50 La volaille importée par la Haïtiens sur la
frontière est cette qualité de poule appelée mannil
ou glinn par les paysans d'ici, de couleur blanche en
général.
39
Cerca-la-Source arrivant
à Garde Salnave
aménage une partie de la route
de Boc Banic.
|
praticables voire en
saison pluvieuse.
|
une partie de la route de Boc Banic dont le reste
est en terre battue mais
praticables pour les
véhicules robustes et les
motocyclettes.
|
Centre de santé
|
À Boc Banic il y a un centre de santé de MSPP.
Les autres localités n'en disposent pas.
|
Le centre de santé
fonctionne à minima.
|
La distance éloignée des autres
localités par rapport à Boc Banic rend le centre de santé
qui s'y trouve quasi insignifiant pour elles.
|
Électricité
|
Aucune trace de la
compagnie de
l'Electricité d'haïti dans la
2e Section de Lociane.
|
Il n'y a pas de trace de
projet d'électrification
de la zone
|
De façon isolée, des
Personnes possèdent des
énergies alternatives
à
Boc Banic.
|
Encadrement agricole
|
Pas de bureau de services techniques agricoles ni de
crédit agricole
|
Aucune initiative n'est relevée en ce sens.
|
Aucun cultivateur n'a fait état de disposition de
crédit agricole.
|
Source : Frantz Isidor en fonction du travail de terrain en
date de 26 au 30 décembre 2022
|
|
Les images des photographies (photo 3),
présentées à la page suivante, démontrent quelques
types d'habitat où demeurent des paysans dans les localités
telles que Malary, Carrefour Suzely et Savane Mulâtre.
Il s'agit de montrer les types de petites baraques couvertes
en tôle, clissées, enduites de boue d'argile. Ce sont les
principales caractéristiques des logements du milieu rural de la
2e Section Lociane. Il est loin d'y voir un modèle
d'architecture à négliger. Nous pouvons plutôt en imaginer
des modèles aménagés. La construction de ces logements ne
comprend pas de latrines et de douche. À deux ou trois pièces,
ils abritent des familles de sept (7) personnes au moins.
PHOTO 3: TYPE D'HABITAT OÙ VIVENT CERTAINS PAYSANS DANS LA
2E SECTION LOCIANE

Source : Prise photographique de Frantz Isidor en
décembre 2022
40
41
1.5.-Contrainte sur le terrain de recherche
Nous avons bien pris soin de ne pas tomber dans les
situations apparemment les plus faciles à observer. Nous avons donc
insisté à rencontrer un grand nombre de personnes pour pouvoir
réaliser des entrevues avec elles. Les entretiens se sont
déroulés dans une atmosphère de convivialité avec
des paysans qui constituent des informateurs-clés. Des leaders
communautaires ont manifesté un grand intérêt à
cerner les contours de notre démarche. Des jeunes gens ont aussi
montré leur attention. Malgré tout, des personnes dont des femmes
ont surtout décliné nos sollicitations à des entretiens.
Comme nous l'avons tantôt évoqué, la réticence de
certains paysans vient en grande partie de la méfiance des
étrangers. Mais le budget disposé n'aurait pas permis de
prolonger la durée des déplacements pour réaliser beaucoup
plus de travaux sur le terrain. Vu ces contraintes, nous avons convenu de bien
utiliser les faibles moyens du bord pour apporter le maximum de rendement en
termes de résultats de recherche.
Le cadre conceptuel et méthodologique a
caractérisé l'orientation des réflexions qui sont
produites dans l'application des concepts. La démarche substantielle
tend à conjuguer des assertions théoriques avec des
données empiriques pour asseoir une analyse objective sur les conditions
socio-économiques des paysans de la 2e Section Lociane. Ce
travail a rendu toute l'importance d'une observation qui a abordée les
points marquants ayant permis d'établir le panorama de la situation de
l'étude dans les principales composantes des conditions
socio-économiques des paysans des différents milieux
considérés dans la 2e Section Lociane.
Dans le prochain chapitre, un schéma classique se
dessine dans la contextualisation de la présente recherche afin de
mettre en relief la position géographique particulière de la zone
frontalière de la 2e Section Lociane qui en détermine un point
crucial d'intérêt. Il sera également question de montrer
l'étendue des besoins généraux des paysans de la zone dont
résulte l'importance des réflexions sur les stratégies de
développement qu'il est possible d'implémenter dans cette partie
du pays.
42
Chapitre II. Lociane et conditions
socio-économiques des paysans
Ce chapitre décrit le noeud gordien de la recherche
qui se cristallise dans la notion de conditions socio-économiques autour
de laquelle gravitent d'autres entités conceptuelles telles que
frontière, décentralisation, développement local et
l'acteur paysan. Les différentes approches théoriques sur
l'économie politique présentent un intérêt capital
pour comprendre la défaillance de la construction stratégique des
mécanismes de gestion incriminée aux pouvoirs publics. Surtout,
dans le phénomène de frontière qui interagit à
plusieurs dimensions dans des facteurs socio-économiques
déterminant les vécus quotidiens des paysans de la 2e
Section Lociane. Il s'agit également de présenter les paradigmes
de développement à plusieurs étapes de l'évolution
de la pensée économique rejoignant le bien-fondé des
décisions dégagées de la participation des
différents acteurs impliqués dans le processus de
développement d'un espace territorial. Force est donc de saisir,
après l'observation, la position géographique définissant
l'unité de l'étude dans ses dimensions concrètes d'une
réalité prise dans ses éléments de fait.
L'unité de l'étude fournit le privilège de
prélèvement des données qui caractérisent le
fondement même de la sociologie. D'ailleurs, celle-ci s'intéresse
principalement aux phénomènes sociaux dans leurs états
concrets. Sur ce point, les pages 43, 46 et 47 présentent des cartes
géographiques. La première de celles-ci (carte 1) permet de
visualiser la tracée de la frontière entre Haïti et la
République Dominicaine. S'ensuivent la carte démontrant la
géolocalisation de la Commune de Thomassique (carte 2) et celle montrant
la position directe de la 2e Section Lociane (carte 3) dans la
Commune de Thomassique, l'endroit où seront prélevées les
données de l'étude.
2.1.-Géo-localisation de la frontière
Haïti-République Dominicaine
L'île Hispaniola, selon Price-Mars (1953/1998a, p. 39),
comprend une cordillère centrale qui domine l'agencement orographique.
Sa partie de l'Est contient les plus grandes vallées et les plus larges
plaines où la distribution hydrographique favorise une abondance de
cours d'eau, remplie par des pluies saisonnières plus drues. Et à
l'Ouest, le développement des montagnes s'enchevêtre en une
série de chaines coupées de plaines côtières de
faible dimension superficielle.
Notre étude est focalisée sur la Commune de
Thomassique, plus précisément sur la 2e Section
communale de Lociane, une localité limitrophe de la frontière.
Cette dernière commence : Au Nord, de la rivière massacre
jaillissant de la Cordillera Central.
Au Centre, par une partie du fleuve de l'Artibonite.
À l'Ouest, par les lacs Azuei et Enriquillo,
Au Sud, elle se termine par la rivière Pedernales.
CARTE 1 : ILLUSTRATION DE LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA
FRONTIÈRE ENTRE HAÏTI ET LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Situation géographique de la frontière de
la République d'Haïti avec la République
Dominicaine
43
Source:
Https://www.Haiti-bing.com/maps
Cette ligne frontalière qui - a une portée qui
s'évalue sur une bande d'environ 380 km de long (PNUE, 2013),
s'étendant du Nord au Sud, sur à peu près 10-20 km de
chaque côté de la frontière actuelle, et dont la largeur
varie en fonction de l'infrastructure, des cours d'eau, de la topographie et du
niveau d'interaction transfrontalière entre les communautés -
recoupe des particularités morphologiques contrastes de la mer aux
montagnes abruptes qui s'élèvent à plus de 2,000
mètres d'altitude. Elle traverse des régions où les
précipitations sont tour à tour très abondantes ou
très faibles, et où l'on trouve une grande variété
de sols et de substrats géologiques.
L'île Hispaniola, agrippée entre les latitudes
20oN et 17oN, se déploie sur près de 77.000
km2 d'étendue, avec les chaines de montagnes
escarpées, réparties en quatre grandes de l'ouest/nord-ouest vers
l'est/sud-est dont les plus hauts sommets sont élevés
respectivement à 3,098 mètres et 2,680 mètres au-dessus de
la mer pour la République Dominicaine et la République
d'Haïti. La couverture forestière comprenait une estimation de 85%
de l'île au moment de la découverte par les Européens au
XVe siècle.
La colonisation française de la partie occidentale a
grandement contribué à la déforestation de cette
région. L'intensification de la culture de la canne à sucre et du
café et l'abattement des arbres précieux comme les
campêches et autres ont détruit les forêts qui couvraient
les mornes et les montagnes de Saint-Domingue. Cette déforestation se
poursuit jusqu'à nos jours et fait d'Haïti le
44
pays le moins couvert sur le plan végétal. Comme
conséquence, les précipitations pluvieuses s'amoindrissent. Elles
se dégradent de 4000 mm à 350 mm par an. La période de
rude sécheresse s'étend de décembre à avril. Mais
avec le phénomène du changement climatique qui se précise
de nos jours, la saison pluvieuse devient moins intense en
précipitations. Dans les deux parties de l'île, la
température varie respectivement à 26 o C et 26.2
o C en Haïti et en République Dominicaine. Aussi des
régions plus chaudes près des côtes maritimes
connaissent-elles des niveaux de température de 35o C. Dans
les hauteurs des montagnes, la température varie entre 20o C
à 10o C.
L'exploitation outrancière qui se faisait de plus de
trois siècles de colonialisme esclavagiste a laissé les sols de
la partie occidentale dans l'état d'extrême minceur. Les pentes
les plus abruptes, enrichies en calcaire, connaissent de fortes
dégradations dues à l'érosion qui résulte de la
déforestation sévère. La partie de l'Est, ayant
été moins exploitée, conserve des sols plus épais.
Les versants de précipitations pluvieuses y sont plus importantes, parce
que non contrariés de chaines montagnes qui se dressent plutôt aux
confins de la partie occidentale. L'érection de telle haute chaine de
montagne défavorise la partie occidentale en précipitation de
pluies. De toute façon, les responsables dominicains ont
développé un sentiment plus soucieux de la question
écologique que ceux d'Haïti.
Les régions montagneuses renferment des cours d'eaux
courts et tortueux. Les ressources hydriques haïtiennes repartissent entre
trente (30) principaux bassins versants qui sont extrêmement
exposées à des menaces. Ces dernières, si évidentes
soient-elles, interpellent notre responsabilité à définir
de véritables plans d'action de renversement de la dégradation
des bassins versants, de la pénurie d'eau, des inondations et de la
contamination bactérienne des sources.
2.2.-Thomassique et la 2e Section
Lociane
La répartition territoriale de la République
d'Haïti s'institue à travers la mise en place de trois niveaux de
collectivités territoriales (Dorner, 1998) y compris leurs nombres (10
Départements, 146 Communes, 571 Sections communales) sur
l'étendue géographique de 27,750 km2.
Depuis la Constitution de 1957, le législateur a
évalué l'ampleur des responsabilités des régions en
procédant à l'augmentation des gestionnaires régionaux qui
s'articulent dans la réduction de l'étendue de certains
Départements pour en élargir le nombre. Ainsi la
répartition territoriale
45
devient-elle à neuf au lieu de cinq Départements
qu'il y avait dans la Constitution51 de 1946, à savoir les
Départements : du Nord, du Nord Est, du Nord-Ouest, du Centre, de
l'Artibonite, de l'Ouest, du Sud-est, du Sud et de la Grande Anse. Chaque
Département se divise en Arrondissements, chaque Arrondissement se
subdivise en Communes et chaque Commune se subdivise en Quartiers et Sections
rurales. Ce principe a pris son ampleur gigantesque avec l'adoption par voie
référendaire de la Constitution du 29 mars 1987 qui a
été considérée comme un gage d'espoir pour avoir
jeté les bases sur lesquelles devait s'opérer un long processus
pour conduire à la décentralisation du pays tout en restant un
État unitaire ». (Fleur-Aimé & Thomas, 2015).
Entre-temps, la loi du 18 juin 2003 a consacré l'élévation
de la région des Nippes au rang de Département pour en
comptabiliser le dixième.
Mais le lieu prédominant privilégié dans
l'étude se concentre dans la 2e Section Lociane de la Commune
de Thomassique qui se retrouve dans l'Arrondissement de Cerca-la-Source qui
compose les quatre sous-ensembles administratifs de Communes (Hinche,
Mirebalais, Lascahobas et Cerca-la-Source) constituant le Département du
Plateau Central. Ce Département est un vaste bassin, bordé au
Nord par le massif du Nord, à l'Ouest par le massif des Montagnes
Noires, au Sud par les montagnes du Trou d'eau et à l'Est par le bassin
de San Juan.
La cartographie (carte 2), présentée ci-dessous
à la page 41, précise la localisation de la Commune de
Thomassique dans la proximité de la ligne frontalière qui
délimite les deux territoires de l'île Hispaniola. Cependant, ce
gros plan sur la position géographique ne livre pas tous les
détails. C'est pour cette raison que la troisième cartographie
(carte 3) est aussi présentée à la page 42 en vue
d'indiquer toutes les spécificités qui caractérisent la
position géographique plus ou moins exacte de la situation de
l'étude.
Selon les données de l'IHSI, en 2005, la population de
la Commune de Thomassique fut estimée à 51,155 habitants. Ces
derniers étaient répartis sur une superficie totale de 260.01
km2. Cela donnait une densité de 195.0 habitants au
km2. Elle est comparativement faible par rapport à la moyenne
nationale qui est de 289 habitants au km2. La 2e Section
Lociane est une Section rurale qui est une dénomination que la
Constitution de 1946 a introduite dans la subdivision territoriale à
côté des Quartiers. La Constitution de 1987 en a fait la
désignation de Section communale qui est la plus petite entité
territoriale administrative suivant son article 62. Elle fait partie d'une
autre
51 Voir l'article 2 de la Constitution d'Haïti
de 1946.
collectivité territoriale qui est la Commune et
celle-ci d'une autre plus large qui est le Département (Privert,
2006).
La 2e Section Lociane fait partie
intégrante de La Commune de Thomassique qui est située entre les
latitudes nord d'Équateur 18°58' et 19°12' et les longitudes
ouest méridiens de Greenwich 71°42' et 71°55'. Elle est
à 27 kilomètres de Hinche, chef-lieu du Département. Elle
est établie sur une altitude moyenne de 450 mètres (300-600).
Mais la Commune s'étend rapidement au cours des années, une
étude faite en 2014 rapporte que la Commune de Thomassique couvre une
superficie de 264,76 km2 répartie sur deux Sections
communales (Matelgate et Lociane). Celles-ci comprennent respectivement 55 et
79 habitations et localités selon les dernières données de
l'IHSI. Cependant le nombre de localités a augmenté dans la
2e Section Lociane pour passer maintenant à 84. La
2e Section Lociane occupe une superficie sensiblement
inférieure à celle de la 1ère Section Matelgate mais dont
la population est supérieure à celle de la 1ère
Section. Ainsi la 2e Section Lociane compte-t-elle 84 localités (CIAT,
2008).
2.2.1.-Délimitation
La Commune de Thomassique est limitée :
Au Nord par la Commune de Cerca-la-Source ;
Au Sud par la Commune de Thomonde et la République
Dominicaine;
À l'Est par la République Dominicaine et la
Commune de Cerca-la-Source;
Et à l'Ouest par la Commune de Hinche et de Thomonde.

2.2.2.-Localisation de la Commune de
Thomassique
CARTE 2 : ILLUSTRATION DE LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE
THOMASSIQUE Illustration de la situation géographique de
Thomassique près de la frontière
46
Source:
https://www.bing.com/images-
carte thomassique - Bing images
47
Mais précisément, la 2e Section
Lociane elle-même est délimitée au Nord de Latine par Fort
Biassou (une localité de la première Section communale
Acajou-Brulé de la Commune de Cerca-la-Source), à l'Est de Boc
Banic par la République Dominicaine, à l'Ouest de Loratoun 1 par
le centre urbain de la Commune de Thomassique et au Sud de Baranque par
Bouloume (1ère Section Matelgate). Les Sections communales
sont constituées d'habitations ou localités. Cependant, les
habitants n'arrivaient pas toujours à s'entendre sur la
délimitation de ces habitations ou localités.
2.2.3.-Localisation directe de la Section communale de
Lociane
CARTE 3 : ILLUSTRATION DE LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA
2E SECTION LOCIANE
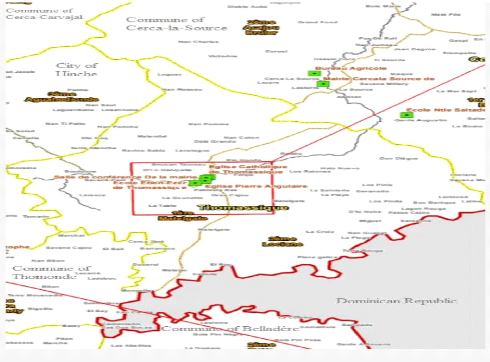
Source: https:www.bing.com/images/search?...
vignette.wikia.nocookie.net
2.2.4.-Histoire de Thomassique et la 2e Section Lociane
La Commune de Thomassique fait partie de l'Arrondissement de
Cerca-la-Source du Département du Centre, Haïti. Bien avant, la
Commune portait le nom de « Thomassico ». Elle fut d'abord
48
élevée au rang de quartier en 1889 de
l'Arrondissement de Hinche par décret du gouvernement provisoire de
Légitime. Antérieurement, la localité était
rattachée à la République Dominicaine, plus
précisément à la vallée San Thomé où
se sont déroulés un bon nombre d'évènements
historiques52. C'est par le traité haïtiano-dominicaine
de 1874, sous le gouvernement de Michel Domingue que Thomassique cessera
officiellement à l'instar de Thomonde, de Hinche et de Cerca Carvajal
d'appartenir à la partie orientale de l'île. Enfin, elle fut
élevée au rang de Commune en 1954. La date de sa création
se rapporte à 1950 en tant que bourgade53 (I. Isidor,
2014).
En 2014, la population de la Commune de Thomassique fut
estimée à près de 70,000 habitants. La vie
économique de la Commune se base foncièrement sur l'agriculture,
l'élevage, l'artisanat et les corps de métiers tels que la
maçonnerie, l'ébénisterie, la charpenterie et la couture,
etc... De par sa position stratégique sur la frontière centrale,
le commerce y joue une place prépondérante. Le charbon de bois
constitue actuellement la filière extra agricole la plus rentable du
circuit commercial de la Commune. L'exploitation à outrance du charbon
de bois constitue aussi une entrave très sérieuse à
l'équilibre environnemental et écologique de la ville et de la
Commune. En l'occurrence, la 2e Section Lociane présente
toutes les caractéristiques de dévastation des arbres par
l'activité du commerce de charbon de bois qui est la cause principale de
la quasi désertification de nombreuses localités dans les
Sections communales. Néanmoins, l'histoire retient un récit de
combat épique qui s'est déroulé dans cette zone
frontalière au moment conflictuel guerrier des deux Républiques.
En effet, dans la dernière bataille qu'engageait le gouvernement de
Soulouque en décembre 1855 contre les Dominicains, Sabana mula qui
devint Savane Mulâtre, localité près de Fort Biassou, autre
lieu aussi historique, fut le théâtre d'un terrible champ de
combats.
Dans la projection économique et financière, la
proximité du marché est un avantage de taille. La relation de
proximité entre le centre de production qui se trouve depuis quelques
décennies en République Dominicaine et le marché de
consommation qui représente Haïti relève l'importance
stratégique de l'axe central de Thomassique qui concourt à la
trajectoire qui passe par Belladère. Entre les deux grands pôles
économiques du pays, le Nord et l'Ouest, la voie du Plateau central,
52 En février 1856, dans les hostilités
haïtiano-dominicaines, d'intenses combats s'engageaient dans toutes les
villes frontalières dont la savane de Santomé. Cf [Price-Mars,
Jean. La République d'Haïti et la République Dominicaine
[1953], Tome 1, Editions Fardin, Collection du Bicentenaire Haïti
1804-2004, Port-au-Prince, Haïti, 1998].
53 Dans une trajectoire tourmentée, le Quartier de
Thomassique - rattaché à l'arrondissement de Hinche relevant du
Département du Nord en 1906, puis rapatrié à celui de
l'Artibonite en 1909- fut érigé en Commune 5e classe
par la loi du 24 juin 1934, puis un arrêt présidentiel abrogea
cette loi en date du 7 septembre 1942.Enfin, la loi du 24 juin 1952
l'éleva en Commune de 4e classe.
49
particulièrement la 2e Section Lociane
acquiert de l'importance grandissante d'une ligne d'échanges commerciaux
par voie terrestre. C'est un défi qui se dresse devant l'économie
haïtienne de concentrer ses énergies productives pour renverser la
situation en ses faveurs. Elle peut profiter de ces mêmes voies de
pénétration pour échanger avec la République
Dominicaine.
2.2.5.-Population de la Section communale
Toutes les données trouvées concernent
généralement la Commune de Thomassique. Mais notre étude
s'attache à en extraire les données précises concernant la
2e Section Lociane, pour ne pas la perdre de vue. C'est ainsi que
nous avons relevé des données qui annoncent une occupation
spatiale de 81.7 % de la population dans le milieu rural, durant la
période intercensitaire de 1982-2003. Cette population avait
cumulé un taux de croissance au rythme annuel de 3.4%. La densité
était estimée à 195 habitants par kilomètres
carrés. L'habitat est fort dispersé dans ce milieu rural.
La 2e Section Lociane s'étend sur une
superficie de 128.69 km2 avec une population de 21,944 habitants
selon les données de l'IHSI en 2005. En considérant le taux de
croissance démographique annuel dans sa valeur constante, la population
s'accroit en 2021 au nombre de 37,467 habitants dans la 2e Section
Lociane.
2.2.6.-Cadre de vie dans la 2e Section
Lociane
La 2e Section Lociane de la Commune de
Thomassique, en raison de sa position frontalière, dispose d'une
facilité d'échanges culturels et commerciaux avec la
République Dominicaine. La Commune dispose également de quelques
sites pittoresques particulièrement avec les chaînes Paincroix qui
accordent des vues panoramiques attrayantes. Malgré ces atouts majeurs,
la 2e Section Lociane de Thomassique est, tout comme la Commune restant
entièrement enclavée, démunie des infrastructures,
services et équipements les plus élémentaires avec des
influences négatives sur la qualité de vie de la population qui
est très pauvre54. La 2e Section Lociane dispose
de certaines localités à forte concentration d'habitat qui
comprend : Boc Banic, Nan Croix, Carrefour Suzeli, Savane
Mulâtre, etc.
54 Selon « la carte de pauvreté pour Haïti
» élaborée par le MPCE (Ministère de la Planification
et de Coopération Externe) en juin 2002, la commune de Thomassique
occupe le 122ème rang sur 135 en termes de niveau de pauvreté
à l'échelle nationale (soit le dernier quintile faisant
référence au groupe de Communes à niveau de
pauvreté extrêmement élevé).
50
La 2e Section Lociane est située à
moins de 15 km du fleuve de l'Artibonite55 qui fournit la ligne
limite entre les deux États de ce côté-ci. La 2e
Section Lociane comprend 84 des 138 localités de la Commune. Elles sont
bien ouvertes à la circulation malgré l'état des routes.
Le répertoire rythmique bachata est largement
apprécié des musiques dominicaines diffusées de
manière tonitruante sur des postes de Radio. Des bribes de conversations
des habitants entremêlent souvent le créole et l'espagnol dans une
création langagière : « pale pannyòl
».
2.3.-Voies de pénétration dans la
2e Section Lociane
Il est à remarquer que la route menant à
Thomassique en sortant de Hinche est en terre battue. Elle est en très
mauvais état pour la circulation de véhicules, avec beaucoup de
reliefs, une végétation rabougrie, des arbres dispersées
sur de vastes superficies presque dessertes où l'on dénombre des
habitats dispersés. De prime abord, il est tout à fait facile de
remarquer l'absence d'ingénierie sociale d'État qui y fait
ménage. Combien de temps devra-t-on attendre la construction du
tronçon de route Hinche-Thomassique ?
Au bout de 35 minutes à bord d'une taxi-motocyclette,
la traversée de la 1ère Section Matelgate est faite
pour arriver au milieu de la Commune. Le boulevard Jean Jacques Dessalines
tranche la 1ère Section Matelgate à l'Ouest et la 2e
Section Lociane à l'Est. Il y a donc des options permettant d'emprunter
plusieurs voies pour pénétrer les différentes
localités dans la 2e Section Lociane.
Premièrement, en nous dirigeant au Sud le sentier
traversant la rivière de Louratoun conduit jusqu'à Baranque.
Cette voie mène à la frontière. Deuxièmement,
à l'arrière du marché qui caractérise le centre
urbain de la Commune, se trouve une route qui conduit à Nan croix en
passant par Loratoun 1, Nan Kokoye. Matelgate. La traversée de Nan Croix
conduit aussi à la frontière. Troisièmement, en partant du
point central de la place publique de Thomassique, en empruntant la route
logeant la rue espagnole, en traversant Nan Latte, Savane Sucre, Loratoune 1 et
2, s'ouvre le chemin qui conduit à Malary puis Savanette. Poursuivant
ainsi c'est l'atteinte des hauteurs de Don Diègue 2, Kolorine et Boc
Banic.
55 Le fleuve de l'Artibonite prend sa source dans
les hauteurs de la cordillère centrale en République Dominicaine.
Les 2/3 du fleuve sont du côté haïtien, coupant la partie
centrale d'Haïti. Il continue sa trace avec de fort débit dans une
largeur considérable jusqu'à la région du
département de l'Artibonite où il constitue une source
d'irrigation en passant par le captage en réservoir au niveau de
Péligre [Péligre est une localité de la 3e
Section communale des Bayes de la Commune de Boucan Carré]. Le barrage
de Péligre fut construit dans les années 1950, avec un
réservoir d'une capacité de 400 millions de mètres cubes
d'eau pour le développement de l'irrigation et de la production de
l'énergie électrique .Cf. [Lucien Georges Eddy, Espaces
périphériques et économiques d'archipel. La trajectoire
contemporaine de la commune de Verrettes. Éditions de
l'Université d'État d'Haïti, Port-au-Prince, 2009].
51
Et enfin, l'axe partant du Nord sur le morne fort, en
prolongeant la route de Cerca-la-Source, qui est la seule à avoir
été revêtue de bitume, à côté d'autres
routes et sentiers en terre battue. Ils sont tous en très mauvais
état. Il est possible de poursuivre en traversant plusieurs
localités de cette Section communale, notamment Felipite et Morne
Avèlin avant d'arriver à Garde Salnave où la route est
subdivisée en trois branches ou artères. La première
artère est la route principale conduisant à Cerca-la-Source en
direction du Nord. La deuxième artère, en direction du Nord est,
traverse Terre Blanche, puis mène à Savane Mulâtre. La
poursuite de cette voie mène à Latine près de Fort
Biassou. Évidemment, il est possible de se rendre à la
frontière de ce côté. La troisième artère, en
direction de l'Est, mène à Boc Banic en passant par Hatonuevo 1
et 2, Carrefour Suzely et Don Diègue 1. Cette route est la mieux
entretenue. Cependant, la saison pluvieuse s'annonce un calvaire dans la
pratique de ces routes pour quelque soit le type de véhicule. Parce que
la masse de poussière que ces voies contiennent sera des amas de boues
impénétrables. Ces insinuations expriment les qualités
déplorables de ces voies de communication dans la 2e Section
Lociane. La première photographie de l'illustration suivante
représente la route de Malary qui conduit à Boc Banic et la
deuxième photographie en dessous indique l'état de la route de
Nan Croix qui conduit aussi à la frontière. Aussi importe-il de
reprendre la revendication soutenue par les paysans pour réclamer
l'amélioration des routes qui permettent d'atteindre la frontière
respectivement par Kolorine et Nan Croix.
Des sentiers servent de liaison entre des localités.
Sur la route de Malary, dans les hauteurs de Loratoun 2 au premier carrefour,
si l'on prend la direction du côté droit, la poursuite du chemin
conduit à Nan Croix en passant par Monbin Trou et Nan Francique. Ces
sentiers découpés sont des moyens utilisés pour faciliter
des échanges entre des localités sans obliger de passer par le
point de Thomassique pour prendre la route principale. L'emploi de ses voies de
communication inter-localité peut servir aussi un moyen de contourner
les contrôles de circulation. Pour un convoi signalé à Nan
Croix en direction de Thomassique, il est fort possible qu'il puisse prendre un
découpé pour déboucher sur une autre route. Même si
les chemins vacinaux sont déplorables.
La République Dominicaine exploite une situation
économique favorable pour écouler ses produits en Haïti. Ces
voies contribuent à la circulation des marchandises. L'accroissement des
affaires concourt à la perspective de croissance démographique
qui se projette dans la zone en raison de la sensibilité de
sécurité face à la menace sismique planant sur le pays.
Par l'avènement du séisme de 12 janvier 2010 qui marque encore
l'esprit, et plus récemment, le séisme du 14 août 2021
dans
le grand Sud, il y a une grande appréhension de la
population. La région du centre du pays représente un tampon de
sécurité dans la situation tectonique de l'île par rapport
aux deux principales zones de failles actives : au Nord à partir de la
mer vers la terre d'Est en Ouest ; dans les terres du Sud jusqu'à
l'Ouest s'abattant dans la vallée d'Enriquillo à l'Est
(Prépetit, 2011, p. 21). Malgré ces potentialités de la
zone, l'observation ethnographique et les données des entretiens nous
permettent de déceler des contraintes majeures auxquelles sont
confrontées les populations-cibles dans le processus du
développement. Il nous importe donc de pister quelques facteurs qui
permettent de fonder des réflexions sur l'amélioration des
conditions socio-économiques des paysans de la 2e Section
Lociane.

PHOTO 4: ILLUSTRATION DE L'ÉTAT DE ROUTES DANS LA
2E SECTION LOCIANE Illustration de l'état de quelques routes
dans la 2e Section Lociane
52
Source : Prise de vue photographique de Frantz Isidor en
décembre 2022
53
2.3.1.- Comparaison entre des localités de la
2e Section Lociane
La comparaison du niveau de développement des
localités de la Section communale n'est pas très importante pour
l'étude. Il serait plus juste de se mettre à comparer les
Communes frontalières des côtés haïtien et dominicain.
Mais une chose est certaine, celles du côté dominicain accusent un
niveau d'organisation qui dépasse largement celui des Communes du
côté haïtien. Banica est un exemple frappant par rapport
à Thomassique. La localité frontalière de Hato Viejo en
Dominicanie est tenue dans une splendeur qui peut fouetter notre orgueil dans
la gestion globale de l'espace territorial. Rien qu'à voir l'impact
environnemental avec la couverture végétale de l'autre
côté de la frontière, il est évident que la
différence est réelle. D'une certaine manière, nous nous
permettons de nous livrer à une comparaison sporadique entre quelques
localités. Bien que nous essayons plus spécifiquement de
détecter l'impact de la connexion étroite qui existe dans le
développement des échanges commerciaux à travers les
différentes localités par rapport à l'infrastructure
routière disponible. En effet, ces échanges sont plus intenses
à Boc Banic par rapport à d'autres localités de la
2e Section Lociane étant placées dans une position
tout aussi favorable que celle-ci. Mais, il faut rappeler que les
infrastructures routières favorisent beaucoup les échanges
commerciaux. Cela fait grandement défaut aux différentes
localités telles que Nan Croix, Savane Mulâtre, etc.
Les acteurs les plus importants dans les décisions de
développement ont été évoqués ici pour fixer
leurs responsabilités. C'est un fait que chacun a ses propres
intérêts à défendre. Mais l'intérêt
général incombe à primer l'adoption des meilleures
politiques publiques qui seront applicables. Dans le cas de la 2e
Section Lociane, il y a des intérêts particuliers pour la
collectivité territoriale à défendre en vue d'apporter les
éléments de services de base indispensables pour
l'amélioration des conditions socio-économiques des paysans. La
tracée des lignes directives montre l'importance des facteurs
intégrateurs de l'unité des forces vives pour réaliser le
développement.
2.4.-Facteurs de développement des conditions
socio-économiques des paysans de Lociane
À travers les facteurs qui sont susceptibles de
déterminer les choix de politiques économiques,
l'élément essentiel est caractérisé dans la
définition des priorités. Celles-ci découlent des
décisions adoptées par les structures organisées qui
s'attachent globalement à la prise en compte des différents
acteurs s'impliquant dans le champ de développement local. Le
développement se réalise dans un espace territorial qui
désigne une collectivité territoriale que ce soit dans le
54
Département ou la Commune ou la Section communale.
Dorvilier (2011, p. 25) souligne que « l'espace haïtien est l'objet
d'une territorialisation dans sa structure physique et sociale à travers
le temps en fonction des aspirations, de multitude de manques et
différenciés des différents groupes sociaux ». Cette
spécificité convient davantage à la dénomination de
développement local. L'interpénétration des réseaux
sociaux, des échanges de marchandises et de coopération de projet
de développement conditionnent l'ouverture internationale des espaces
ruraux qui subissent de l'influence des acteurs externes. Léger (2000,
pp. 87, 89) considère quatre types d'acteurs qui s'y côtoient :
les acteurs locaux et la société civile, l'État, les
collectivités territoriales et la coopération internationale. Ces
groupes d'éléments hétérogènes interagissent
sous des motivations propres et différentes avec des attentes
divergentes qui caractérisent l'enjeu résultant de l'ensemble des
contrepoids qui font balancer les intérêts dans la
détermination, l'orientation, la réalisation, l'installation et
l'opérationnalisation de projets dans les milieux ruraux.
2.4.1.-Intégration des forces actives dans
l'économie productive
En Haïti, l'un des défis majeurs qui persiste,
réside dans le besoin d'élever notre économie dans ses
dimensions de croissance, dans un cadre viable et équitable qui comporte
de mobile de création d'emplois massifs, productifs et
rémunérateurs. Il s'agit, entre autres, d'arriver à
garantir la stabilité macro-économique sans sacrifier la
stabilité sociale en procédant graduellement à agir en
fonction des priorités fixées (F. Deshommes, 2005, p. 9).
Une première démarche consiste à
identifier les ressources humaines, matérielles et financières
qui devront être valorisées dans un cadre de gestion efficiente de
ressource et de planification de politique publique dans la durabilité.
Enfin, une prochaine étape doit permettre à l'intégration
dans la division du travail, l'ensemble des citoyens où chacun puisse
jouir des fruits de son apport (F. Deshommes, 2005). Mais comment parvient-on
à une coalition inclusive ? C'est le grand problème des
différentes forces sociales haïtiennes. Elles n'arrivent pas encore
à se superposer dans une conjonction idéale de vivre ensemble
constituant une contenance de la domination d'un groupe.
2.4.1.1.-Approche théorique sur la condition
socio-économique
En 1990, le premier Rapport annuel sur le
développement humain du PNUD a introduit une plus grande
considération sur l'harmonisation des aspects socio-économiques
du développement (Besnainou, 1991).
55
Le récipiendaire du prix Nobel d'économie en
1998, l'Indien Amartya Kumar Sen soutient que le développement exige un
système démocratique, parce que la démocratie suppose la
jouissance des droits civiques aux individus par la possibilité de
revendiquer la satisfaction des besoins élémentaires ou la
protection de la vie. La démocratie accorde aussi les libertés
sociales et politiques conduisant aux libertés économiques, et
celles-ci entrainent des retombées sur les libertés politiques et
sociales (Sen, 2000). Mais la démocratie est-elle une condition
suffisante ou nécessaire pour construire ou avoir le
développement ?
Cette transitivité qui s'établit entre
démocratie et développement économique est une exigence de
responsabilité des divers acteurs politiques dans la gestion du bien
commun résidant dans le travail productif pour réaliser la
croissance économique positive. Cette exigence impose également
des instruments équitables de définition de politiques publiques
prenant en compte des intérêts généraux et vitaux de
la société.
De la nouvelle approche qui apparait, après avoir
privilégié la seule croissance de la production de richesses par
des indicateurs comme le PIB, le concept de développement s'est
élargi pour inclure différentes dimensions constitutives du
bien-être, voire du bonheur : l'état global de santé des
populations, les niveaux d'instruction, d'une manière
générale, les conditions de vie56. La réflexion
sur les indicateurs pertinents pour mesurer le développement prend de
plus en plus en compte la dimension du bien-être (et/ou du bonheur) et il
y a une profusion d'indicateurs économiques, sociaux et environnementaux
qui tentent de l'évaluer, le mesurer.
En ce sens, l'État central se doit de redynamiser le
levier de la contribution consistante des entités des
collectivités territoriales qui renferment de nouvelles
prérogatives en matière de gestion, d'administration et
d'aménagement du territoire. Ainsi, subsiste-t-il toujours l'objectif
principal d'améliorer les conditions de vie des populations par la
fourniture de services publics collectifs de manière efficiente et
efficace. Donc, parvenir à réduire la pauvreté. Mais, la
notion de la pauvreté caractérise une approche analytique avec
Sen (1992) mettant en évidence le déficit de
capabilités57 qui interpelle au prime abord l'action
politique de l'État. Celui-ci se retrouve dans l'obligation de s'engager
dans une voie économique dépendant des infrastructures et des
ressources dont il dispose en vue d'assurer un développement
économique. Aussi nous sommes-nous amenés à
considérer le
56 Voir le site d'internet :
http://www.geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/développement
/ (consulté en juin 2022).
57 La capabilité renvoie à l'état de la
corrélation entre les politiques publiques et les capacités
publiques.
56
problème politique et même géopolitique
qui sous-tend la problématique du développement. Sur ce, nous
pouvons reprendre une idée de Jörg Mayer-Stamer (cité dans
Freund et Lootvoet, 2005) concevant que l'économie politique de
développement est essentiellement de la revendication politique avant
d'être du ressort de l'appareillage technico-scientifique. Dans le cas
d'Haïti, il est impératif de concentrer des efforts pour trouver
une concertation qui tend à relever la puissance de l'État pour
rétablir les mécanismes institutionnels garant des
libertés individuelles motrices de l'initiative de la mobilisation des
facteurs intégrateurs de développement.
Rappelons que le développement désigne
l'ensemble des transformations techniques, sociales, territoriales,
démographiques et culturelles accompagnant la croissance de la
production. Il traduit l'aspect structurel et qualitatif de la croissance et
peut être associé à l'idée de progrès
socio-économique eu égard des conditions
socio-économiques. Ainsi, les approches théoriques sur les
principaux courants de développement économique
révèlent-elles nécessaires à éclaircir les
horizons.
Le concept de développement tel que prôné
dans le point IV du discours d'investiture du Président américain
Harry Truman en janvier 1949 constitua un idéal de changement pour tous
les pays dits sous-développés. Sans signification précise,
il est conçu en fonction du lieu d'expérimentation. Au cours du
temps, le paradigme du développement change constamment pour moduler les
réalités sociales et économiques, malgré des
controverses. Parmi les diverses approches du développement, celle dite
participative nous intéresse dans la présente étude pour
ses inclinaisons à l'empowerment. La vision induite de
pôles de développement de François Perroux peut s'y
rejoindre pour mettre les individus dans un rôle de catalyseur de
développement. Cela implique de contrôler des ressources par la
maîtrise des capacités s'exerçant sur les plans :
politique, culturel et institutionnel.
Aussi importe-t-il de saisir le jeu interactif des acteurs
agissant dans le cadre du développement. À l'analyse des
interactions entre acteurs sociaux, Olivier de Sardan(1995) montre un paradigme
altruiste concernant l'aspect moral et un autre modernisateur relevant du
caractère évolutionniste et techniciste (pp. 8, 85).
Mais les couches démunies subissent le contact des
porteurs du développement dans le schéma interactionniste. Cette
perception n'échappe pas à Sainsiné (2009) qui
réalise que le porteur de développement concentre toute sa
stratégie dans les moyens d'intégrer le milieu récepteur,
le plus souvent le milieu local, à la modernité marchande (p.15).
Le développement requiert pourtant
57
l'apport des citoyens en plus des seules prérogatives
de l'État ou des ONG (Jean-François, 2021,
p. 113). Aussi faut-il considérer les
intérêts animant les différents acteurs du
développement. Si bien qu'il importe de désigner ces acteurs
sociaux. L'État, les ONG, les entreprises privées, les acteurs
locaux (société civile) et des acteurs internationaux
interagissent dans le cadre de la théorie des parties
prenantes58 pour apporter une contribution aux efforts de
réalisation des objectifs organisationnels du développement
local. L'État a grand intérêt à placer le
développement économique au centre de ses préoccupations
politiques selon Myrdal Gunnar (cité dans ARNDT, 1987). Cet avis est
partagé par O. Deshommes (2014) en vue d'attribuer une fonction
régulatrice et fonctionnaliste dans le rôle de l'État
intervenant dans la mise en place des moyens pour faciliter l'investissement
dans les secteurs porteurs de développement (p. 15).
Mais en Haïti, l'État est
caractérisé par ses faiblesses dans la gouvernance
économique qui bloque le développement. Quelles en sont les
causes ? Des auteurs en disent beaucoup. Pour Price-Mars (1953/1998a),
l'indemnité de 150,000 millions de franc en or payée à la
France par l'ordonnance de Charles X en 1825 a eu de graves conséquences
dévastatrices pour Haïti. Des puissances internationales ont
acculé les dirigeants haïtiens dans une mauvaise gouvernance
économique. Il suffit de voir que les réformes économiques
entreprises en 1826, 1874 et 1880 répondaient aux exigences favorables
de la France. Et, celles des années 1910, 1916 et 1924 servaient aux
intérêts des Etats-Unis d'Amérique. En effet, toutes ces
réformes engagées pour rembourser des dettes externes jouaient
contre les intérêts des masses paysannes. Pour sa part, Olius
(2022) qualifie tout cela de mégouvernance 59 . Mais Joachim
(1979/2014), lui, précise qu'en dehors de ces considérations
accablantes des pressions financières des puissances
étrangères, l'État a toujours fait un sursis sur ses
obligations envers les masses populaires et paysannes en s'accommodant aux
caprices des ayants-droits d'un groupe d'affairistes qui, se prétendant
bourgeois, n'ont jamais eu besoin de s'inquiéter pour les questions
relatives à l'émancipation économique du pays. Encore,
l'auteur souligne-t-il incessamment que les dirigeants militaro-politiques
haïtiens alliés à une
58 La théorie des parties prenantes a pris son
envolée avec les travaux de E. Freeman en 1990, en dépit des
travaux de Dood(1932) et Bernard(1938) qui ont initié
l'intérêt pour le terme dans le sens qu'une entreprise doit
rechercher l'équilibre des intérêts concurrents des
différents participants. Freeman a mis en avant la construction d'une
constellation d'intérêts à la fois coopératifs et
concurrents qui affectent les décisions managériales par la
recherche de la nature des relations entre les processus et des
résultats en vue d'aboutir à un équilibre
d'intérêt. Voir les sites d'internet
www.sitemanagement.fr
et
www.brimag.com.
59 La mégouvernance désigne le fait
que des pressions extérieures contraignaient les dirigeants
haïtiens à la mauvaise gouvernance du pays. C'est la thèse
de Gary Olius dans son papier Haïti 1804-2018. 2014 ans de servitude
économique et d'une gouvernance assistée, Delmas, C3
Éditions, 2022.
58
bourgeoisie d'affaires ont creusé la dépendance
de l'économie nationale dans la seule opération de vente des
produits fabriqués dans les grands pays capitalistes (p. 164).
Dans la même logique, O. Deshommes (2014, p. 25)
renchérit pour démontrer que l'État haïtien faisant
des caractéristiques de faiblesse, d'incompétence et parfois de
malveillance un modèle de gouvernance, n'a jamais su animer d'une
volonté de structurer un projet pour répondre aux besoins de la
population. De son côté, Gilles (2008) souligne à juste
titre le caractère conflictuel que l'État a toujours
développé envers les masses paysannes laborieuses qui n'ont
été l'objet d'aucun investissement. (p. 41). Le paysan se
retrouve dans une confrontation avec les autres composantes constitutives de la
société tout étant livré à lui-même.
Mais en aucune façon, nous ne saurions dédouaner nos dirigeants
de la responsabilité de la gouvernance du pays. Les circonstances
difficiles ne les délient pas du devoir d'assumer la bonne gouvernance
politique, économique et sociale.
2.4.2.-Appropriation de l'espace territorial en
développement
Dans les années 1950, selon Bastien (1951/1985),
l'espace territorial haïtien était occupé à plus de
80% dans le milieu rural. La production agricole constitua l'économie
nationale. Mais depuis les années 1970, comme l'indique Lucien (2009),
l'espace rural haïtien qui se transforme progressivement en
collectivités territoriales, connait un processus
d'urbanisation60. En 2018, l'urbanisation est passée à
64% (AFP, 2018)61. Elle accuse un taux annuel de 5%. L'espace rural
ne bénéficie pas d'investissement industriel tout comme le milieu
urbain n'enregistre pas non plus de bond industriel en Haïti. Le
problème fondamental ne se pose pas ici dans ce travail. Il s'agit
plutôt de considérer le délaissement du milieu rural en
dehors de tout accompagnement de l'État et des agents des
collectivités territoriales.
Le milieu rural est constitué des régions
géographiques (Communes et Sections communales) situées à
l'extérieur d'une agglomération urbaine dans un
pays62. Les Communes se développent, selon Lucien (2009),
dans une dynamique de démonstration des conditions naturelles du
milieu,
60 L'urbanisation constitue ce
phénomène démographique qui se traduit par la forte
concentration de la population dans les villes. Ce processus s'agrandit
considérablement depuis la première révolution
industrielle.
61 L'agence France-Presse a démontré
une accélération importante du taux d'urbanisation s'est produite
en Haïti surtout après le séisme de 2010. Mais qu'aucune
politique publique n'accompagne ce phénomène. Voir l'article
« Haïti : l'urbanisation s'accélère sans créer
de richesses », publication 24/01/2018, En ligne,
www.lexpress.fr, site
consulté en date du 14 mai 2023.
62 Ces informations ont trouvées sur le
site internet
www.uis.unesco.org, consultation
en date de 14/05/2023.
59
leurs techniques de culture, les paysages agraires, une
présentation des rapports juridiques entre les hommes et la terre et des
précisions sur les circuits économiques (organisation des
marchés, confrontation de l'offre et de la demande, formation des prix
(p. 173).
La paysannerie subit l'assaut de globalisation des
marchés économiques. Cela tend à entrainer une
dépendance des zones rurales. Jacques Girault (cité dans Lucien,
2009) s'est penché sur une analyse assez complexe pour situer une poulie
attractive dans les relations de dépendance du milieu rural à
double attache. Il en détecte d'abord dans les échanges
internationaux où les produits agricoles font l'objet d'échanges
inégaux et ensuite, dans le système de commercialisation interne
où dans les endroits reculés, les gens sont liées à
un monopole d'achat, subissant la plus forte taxation, et soumis à un
contrôle du régime politique et social sévère (p.
25).
2.4.2.1.-Rôle de l'acteur paysan et de la
société civile
La société civile est une thématique
privilégiée dans la réflexion des acteurs de la
communauté internationale. Elle jouit d'une grande promotion pour
inclure les paliers de décisions de l'État pour contribuer
à la gestion des affaires publiques. Elle s'entend l'ensemble des
associations non gouvernementales qui se constituent en force de pression pour
la défense des intérêts tant individuels que collectifs de
leurs membres. Ces associations agissent comme des acteurs et de
contre-pouvoirs indépendants de l'État et du marché
financier et économique. Elles sont donc très importantes pour le
fonctionnement de la démocratie. Alors de nouveaux rapports se dressent
entre la société civile, le secteur privé et les pouvoirs
publics.
2.4.2.2.-Société civile dans un
rôle de contre-pouvoir de l'État
Par cette position, la société civile facilite
les échanges et les relations entre les acteurs privés en dehors
de l'intervention des pouvoirs publics. Le marché des échanges
articule les rapports entre les individus dans la défense de leurs
propres intérêts et le gouvernement se confine dans la
régulation de l'ordre public, la garantie des droits de
propriété et la libre circulation.
2.4.2.3.-Société civile comme facteur
intégrateur de partenariat avec l'État
Avec l'évolution intégrationniste du
libéralisme économique et politique, les tissus sociaux
traditionnels s'amenuisent et se fissurent considérablement. Et comme
conséquence, les besoins vitaux des citoyens ne sont plus assurés
par l'État. La société civile devient un outil de la
communauté internationale pour fournir les services en manque des
pouvoirs publics dans une
60
sorte de partenariat public/privé. Entre-temps la
notion de bien commun reprend son sens originel dans l'articulation d'instance
décisionnelle de pouvoir qui assure la planification et la gestion de la
chose publique qui intègre les structures de base. Ces dernières
expriment des actions efficaces dans le niveau d'implication des membres de la
population dans les structures organisées. À cet effet, la
localité Nan Croix démontre une forte conscience d'organisation
avec l'initiative du leader communautaire Pierre Onès dans la
création de la structure ODSL.
2.4.3.-Cheminement socio-historique de l'acteur local et
sa place fonctionnelle
L'auteur Léger (2000) détermine une seule place
pour la société civile à côté des acteurs
locaux qui interagissent activement autour des autres dans le processus de
décentralisation. L'acteur local est d'abord membre de la population.
L'acteur local est une couche de la population localisée dans un milieu
géographique. Il se situe par rapport à l'international, le
national, le régional.
Pour la population, nous regardons l'aspect de sa
répartition sur l'espace géographique qui nous renvoie à
la géographie de la population tout en cherchant à comprendre les
mécanismes d'implantation des individus dans un espace
géographique. Quels sont les motifs qui déterminent la fixation
des individus dans une zone telle qu'une frontière ? Ce que Pierre
George (cité dans Marois, 2008) développe en faisant ressortir
des points assez cruciaux sur : diversité et inégale occupation
de l'espace de l'oekoumène (surface habitable de la terre) ; population
et inégal développement ; les formes d'implantation de la
population ; l'accroissement naturel ; les migrations de population. Il insiste
beaucoup sur l'important besoin d'identifier les mécanismes des faits et
processus des populations et de peuplement, de montrer les relations entre le
comportement des collectivités humaines et les faits de structure
économique et sociale.
Dans cet ordre d'idées sur la géographie de la
population, l'auteur met l'emphase sur les interactions entre l'homme et son
milieu : « il s'agit d'analyser les rapports réciproques et un
façonnement bilatéral permanent des groupes de population et de
leurs oeuvres. » (Marois, 2008). Presque dans la même
période, Glenn Trewartha (cité dans Marois, 2008) propose une
définition différente et qui met l'accent sur la
compréhension et la dynamique de l'espace : « (...) l'essence de la
géographie de la population réside dans la compréhension
des différences régionales dans le peuplement terrestre - une
étude de la compréhension et de la dynamique de l'espace.
»
61
Aussi, nous permettons-nous un détour sur Foucault
(2004, p. 69) pour voir que le personnage politique de population a fait son
entrée dans la pensée politique au XVIIIe siècle. Mais
l'emploi du terme même dans les techniques et des procédés
de gouvernement, voire dans les textes anciens tenait une modalité
essentiellement négative. La population signifiait alors le mouvement
par lequel, après quelque grande catastrophe : épidémie,
guerre et disette qui causaient beaucoup de mort d'hommes avec une
rapidité et une intensité vraiment spectaculaire, se repeuplait
un territoire devenu désert. À cette époque, surtout en
Angleterre, la population était perçue à la
mortalité des hommes à travers les données
démographiques qui concernaient le dénombrement des morts et les
lieux et des causes. Il s'agissait d'établir un rapport à la
mortalité dramatique concernant la problématique de repeuplement
de la population.
Mais avec l'époque du caméralisme et du
mercantilisme, au XVIIe siècle, la population devient au centre de la
dynamique de la puissance de l'État et du souverain. La population
produit de la richesse dans le travail de l'agriculture et les manufactures.
Les physiocrates au XVIIIe siècle vont évoluer par rapport aux
mercantilistes. Ils vont accepter des variables dans le comportement de la
population qui n'est plus obligée d'être vassale du souverain. Le
désir devient un facteur capital dans le comportement de la population,
et déterminera sa naturalité dans son action. L'économiste
François Quesnay (cité dans Foucault, 2004) : « reconnait
qu'il n'était pas possible d'empêcher les gens à venir
habiter là où ils considèrent qu'il y aura le plus de
profit pour eux et où ils désirent habiter, parce qu'ils
désirent ce profit. »(p. 76).
La population va s'étendre depuis l'enracinement
biologique par l'espèce jusqu'à la surface de prise offerte par
le public. En cela, F. Quesnay (idem) ajoute que : « le vrai
gouvernement économique, c'était le gouvernement qui s'occupait
de la population. » (p. 79). Mais une controverse s'interposera entre
Malthus qui résonnait sur le problème de la population en termes
de facteur bio-économie et Marx en envisage une donnée
historico-politique de classe, d'affrontement de classes et de lutte de
classes, ce dont la société de Saint-Domingue en faisait une
caractéristique essentielle. Or, les luttes de classes sociales, dont
Haïti hérite, n'ont pas été grand maître de
direction pour le développement intégré par la
transformation des structures sociales. La fracture sociale haïtienne met
à mal tout effort des acteurs locaux et collectifs dans leurs
unités élémentaires sans une vision commune. Il y a donc
une urgence de concilier des intérêts pour générer
des ambitions nationales.
62
2.4.4.-Caractéristique particulière dans
l'éclosion de la couche paysanne haïtienne
La population haïtienne, après
l'indépendance, déterminera dans une orientation dualiste,
l'acteur local à travers les bossales qui se distancieront des
créoles - dans leurs pratiques cruelles des politiques
économiques d'élites dirigeantes - en se dispersant dans les
montagnes intérieures du plus loin des grandes villes des côtes
maritimes pour aller construire un pays en dehors suivant les raisonnements de
Barthélemy (1989). Les bossales vont constituer les masses paysannes qui
évolueront dans un premier temps dans un effet pervers de compression
dans la passivité économique, dans l'occultation sociale et dans
la marginalité politique. Cependant, Michel Hector (cité dans
Corten, 2013, p. 29) affirme que l'économie paysanne
concentrée dans le Lakou63 aura connu une
période très florissante, en particulier entre 1859 à
1889, et permettra de manière paradoxale à ce que l'État
arrive à répondre aux obligations financières du paiement
de la double dette de l'indépendance. Les hauts fonctionnaires et les
officiers supérieurs comme élite militaro-politique
couplée des gens d'affaires, toute minoritaire représentait
l'État même et exploitait, brimait en charges et taxes les masses
paysannes, majoritaires. Il va s'en dire que les élites haïtiennes
n'ont jamais accordé de la priorité à la question de
développement du pays en prouvant de l'aptitude à l'innovation
des structures sociales. Ce qui aurait servi de base concertée pour
l'émergence de l'intérêt général ou
commun.
La dimension de l'analyse de la responsabilité des
élites haïtiennes ne cesse de prendre proportion avec la
méthodologie de sa vocation. Cette dernière se décline
dans l'obligation de rechercher les potentialités du peuple pour forger
un destin en surmontant les contradictions et difficultés par le
privilège de l'accord sur la définition de l'intérêt
général. En ce sens, nous pouvons considérer avec
Price-Mars (1919/2002) qui précise : « qu'il est en effet
d'évidence historique que les plaintes les plus légitimes, les
protestations les plus circonstanciées, les révoltes même
les plus justifiées de la classe des affranchis n'auraient jamais pu
aboutir à un résultat appréciable sans le concours des
masses. Nous savons également que les revendications des affranchis pour
l'égalité des droits politiques si pleines de bon sens
fussent-elles, les eussent amenés certainement à des
échecs sanglants, s'ils n'avaient pas eu l'heureuse pensée,
à un moment donné, de taire tous les griefs de classe pour
élever leur coeur à un sentiment de haute
générosité humaine en réclament la liberté
générale des esclaves. » (p. 16).
63 Le mot créole haïtien Lakou
est une dérivation de l'expression nominale française 'la
cour ' (qui renferme une caractéristique spatio-politique des monarchies
d'Europe) renvoie en Haïti à une bio-spatialisation civile. C'est
l'espace où sont rassemblés les différents membres d'une
même famille élargie. Ce rassemblement spacio- sanguin constitue
une force matérielle et humaine qui s'applique à l'entreprise
économique de la culture agricole et la défense politique et
civile du groupement familial en cas d'agressions extérieures.
63
Au contraire de l'attitude intelligente qui a donné
résultat par l'unité telle que postulée par
l'éminent écrivain Jean Price-Mars, les élites
haïtiennes, selon Saint-Armand (cité dans Mézilas, 2021),
ont mis tout leur poids dans la balance pour évacuer les masses
paysannes incapables d'assurer leur propre transformation. Ces masses sont
agrippées dans leur situation de non-sujets, de victimes, de marginaux,
d'exclus. (p. 109). Nous n'avons même pas besoin de reprendre ici la
littérature sur la rupture sociale que provoque l'exclusion. Par
ailleurs, cette dernière est un système entretenu de nos jours
par la persistance de la corruption64 dans la sphère
sociétale.
En effet, un fossé abyssal se creuse dans cette
orientation dualiste entre l'État allié de
l'élite65 et les paysans haïtiens. À tel
égard, Gilles (2008) renchérit que les masses toutes
miséreuses seront l'objet d'exploitation systématique par
l'État. Ainsi, Paul Moral (cité dans Gilles, 2008) affirme-t-il
que : « la majorité de la population rurale vit dans
l'extrême dénuement où elle se nourrit chichement, au seuil
de la faim chronique.»(p. 41). Les gouvernements et les élites
urbaines manifestent une indifférence et insouciance criminelle à
l'égard des couches paysannes rurales qui ont été pourtant
l'objet de grande sollicitation, par l'imposition de toutes sortes de taxes,
à supporter le fardeau destructeur du paiement de la dette de
l'indépendance.
Dans un second temps, les masses commencent par se
réveiller en prenant conscience de leurs forces massives. Elles se
mettront à intégrer les structures politico-religieuses des
communautés ecclésiastiques de base, selon Dorvilier (2011, p.
14), en guise de réclamation d'une place plus active dans la
société. Ce changement de stratégie des paysans a
fortement caractérisé la résistance contre les Duvalier
pour culminer leur accessibilité à la citoyenneté sociale.
De telles aspirations se cristallisaient également de manière
implicite dans la possession de la terre.
Au fait, les couches créoles et les masses populaires
bossales, devenues des Haïtiens après 1804, développaient de
grandes affinités pour la possession des terres depuis l'époque
de Toussaint après l'abolition de l'esclavage en 1793. Les cultivateurs
entendaient toujours posséder la terre qu'ils travaillaient. Ils
voulaient à tout prix échapper à la grande habitation
exploitée au profit d'un maître. La vaste quantité de terre
libre sur un espace sensé considéré sien ne saurait
être négligée
64 La corruption est l'abus fait
au profit d'un particulier dans l'exercice de sa fonction au détriment
de l'intérêt général que représentent les
finances, deniers et ressources économiques de l'État, selon
l'article 3 de la loi 12 mars 2014 sur la prévention et
répression de la corruption.
65 Nous refusons d'entrer dans la théorie des
élites telle que développée par des auteurs comme Gaetano
Mosca, Wilfrido Pareto et Roberto Michels (cités dans Etienne, 2007).
Cette théorie renvoie à la réalité sociale de la
distribution inégale des ressources, et, c'est une minorité qui
en bénéficie toujours. Cela se justifie par sa
supériorité d'intelligence ou sa capacité d'organisation
(p. 34).
64
dans le désir d'acquérir de la petite
propriété privée des paysans haïtiens. D'ailleurs, il
faut inscrire dans cette logique la loi du 30 octobre 1850 interdisant
l'occupation sans titre des terres vacantes de l'État (Joachim, 2014,
p.176). Ce, dans le dessein exact de freiner l'appétit insatiable des
paysans à la petite propriété privée. Cette
tendance continue à la contention des biens ruraux avec les lois de 3
septembre 1932 et de 12 septembre 1934. Sans pouvoir freiner les paysans dans
l'occupation anarchique de terres. Les vastes plaines des zones
frontalières ne s'échappaient pas à l'occupation des
Haïtiens. D'ailleurs, malgré toutes les dispositions prises, les
réactions paysannes ont marqué de forte capacité
d'adaptabilité. Aussi la frontière servait-elle de lieu de refuge
pour les opposants politiques contre les dictatures. Pendant le règne
des Duvalier, il y avait même des entreprises de déboisement de la
frontière pour limiter la subversion à partir de ces lieux.
L'empressement du besoin d'agrémentation d'une
dynamique de changement politique et socio-économique alimente l'espace
territorial des paysans qui se tanguent de réelles autonomies dans leurs
mouvements de groupes dans les communautés locales. C'est à la
faveur de telles considérations que nous nous versons dans l'analyse
structurale-fonctionnaliste qui s'établit dans la recherche des
structures internes de la société haïtienne qui
dérivent des rapports sociaux et des pratiques inféodées
dans une mécanique statique, rouillée,
stéréotypée sur la fonction.
Les bases théoriques structuro-fonctionnalistes
proviennent des réflexions de ces auteurs (cités dans Dorisca,
2010), à savoir : Jean-Philippe Peemans place le développement au
centre des rapports entre le pouvoir et l'ensemble des acteurs politiques.Le
développement ne saurait être concevable sans les contradictions
qui sont elles-mêmes relatives à l'évolution de la
pensée des acteurs sociaux et politiques. Jacques Attali concentre ses
analyses sur l'importance de l'autonomie des acteurs locaux et nationaux pour
penser leur développement tout en diminuant la dépendance
vis-à-vis des puissances extérieures. Martin Verlet confirme le
rôle essentiel joué par l'acteur local dans le
développement. D'où l'entrain de la trajectoire du circuit
décisionnel partant du bas vers le haut entérinant la version
institutionnelle de garantie de la cohésion sociale. (p. 49).
2.4.5.-Activités économiques des paysans
de Lociane
Les métiers de maçonnerie, de charpentier,
d'ébénisterie et d'autres se pratiquent dans la 2e
Section Lociane, mais l'agriculture et l'élevage occupent toutes les
préoccupations de la vie économique à la base du commerce
de produits agricoles. Il s'agit d'une économie agropastorale. Elle
s'adapte bien à leur logique qui tient à la diversité des
moyens de subsistance.
65
Le niveau des activités commerciales est plus intense
à Boc Banic. Son niveau de développement est plus
élevé par rapport aux autres localités. C'est une preuve
que le commerce avec la frontière est attrayant pour les couches
sociales qui pratiquent essentiellement du commerce dans la frontière.
La route qui s'y ramène est de meilleure qualité par rapport aux
autres endroits. C'est un avantage que Boc Banic détient en ce sens. Sa
proximité est aussi un autre avantage important. Savane Mulâtre et
Nan Croix sont aussi proches de la frontière, mais ces localités
n'ont pas le même élan de progression économique par
rapport à Boc Banic. L'infrastructure routière est un indice
important qui manque dans l'équation de comparaison pour Savane
Mulâtre et Nan Croix. En général, les voies de
communication restent un grand outil pour faciliter les échanges.
L'administration locale a tout intérêt à engager des
actions concrètes pour améliorer les routes.
2.4.5.1.-Rôle de la femme
paysanne
Pour Ans (1987, p. 181), la femme paysanne joue un rôle
clé de communication économique entre le centre urbain pourvoyeur
de biens industriels (toiles, outils et d'autres menus articles
d'équipements ou de consommation courante) et l'entreprise agricole
familiale. Cette entreprise renferme une double particularité
d'autosatisfaction à la consommation et rentière à une
moindre échelle. Les femmes de la 2e Section Lociane,
très enclines à l'activité commerciale, se plaignent
beaucoup de l'absence de crédit agricole qui leur permettrait d'investir
dans la production agricole. Les bénéfices engrangés dans
la vente de la récolte des jardins contribueraient à constituer
un capital à même de réinvestir. L'épargne qu'elles
engageaient dans l'élevage d'animaux autrefois n'est plus possible de
nos jours à cause de nombreuses maladies qui les tuent : de gros et
menus bestiaux. À Don Diègue 2, nous avons eu un entretien avec
Solange, femme de 52 ans dont les parents sont des Dominicains. Elle est
née ici dans l'habitation de ses parents. Ils ont laissé en
héritage de vastes propriétés terriennes dans la
localité. La dame au teint clair a dit « éprouver de grandes
tristesses pour voir les difficultés économiques qui les frappent
avec la sécheresse qui a presque détruit toute la production de
l'année. Cette situation ralentit énormément les
activités commerciales dans la zone. Parce que les femmes paysannes ont
l'habitude d'aller vendre les produits agricoles qui sont disponibles dans le
champ de la famille et achètent d'autres produits. En matière
proprement légale, cette activité ne répond pas au statut
de commerce. C'est pour cela qu'il est important de définir le statut du
paysan qui participe dans les échanges commerciaux de produits
agricoles. Evidemment, c'est une autre paire de manche qui ferait l'objet
d'autre étude.
66
2.4.5.2.-Exploitation dans le secteur
agricole
L'agriculture est pratiquée dans la 2e
Section Lociane à la merci de la pluie. Aucun type d'engrais chimique ne
s'y applique. L'irrigation des terres reste une revendication majeure des
paysans, parce que les eaux de Lociane et de l'Artibonite sont un atout pour
l'arrosage des terres. Les paysans utilisent la charrue et les animaux de trait
pour préparer les champs en plus du sarclage qui est
généralement utilisé par les petites exploitations. Les
principales productions agricoles renferment : les céréales
(maïs, sorgho qui est devenu très rare à cause de maladie de
plante), les légumineuses (pois congo, arachide) et les tubercules
(manioc, patate douce). Le pois congo, le maïs et la pistache constituent
les principaux produits agricoles qui supportent la part d'exportation des
paysans. Le cabri avant l'intrusion d'une maladie mortelle jusqu'ici
ignorée par les paysans s'ajoutait à la demande dominicaine.
Dépourvue de service vétérinaire, la Section communale,
confrontée à la mort des animaux constituant un capital pour le
paysan, ne fait pas l'objet de préoccupation d'aucune autorité.
La pintade est très achalandée mais se trouve de plus en plus
rare. Le boeuf devient un bétail à grande spéculation que
beaucoup de paysans ne possèdent plus. En outre, il est très
convoité par les voleurs. Par ailleurs, les vols de bétails et
les maladies des animaux et la sécheresse accrue sont des
éléments perturbateurs qui tuent comme dans une guerre
larvée l'économie paysanne de la 2e Section
Lociane.
2.4.6.-Tenure de la terre
Les données analysées montrent que les paysans
de cette Section communale sont presque tous propriétaires en
héritage des terres qu'ils exploitent. Cette partie présente la
qualité de la tenure agraire des paysans dans cette zone. C'est
très important de montrer toute la nuance que nous avons
remarquée dans les données recueillies. Une majorité de
paysans est propriétaire en héritage. En ce sens, la
majorité des terres de la 2e Section Lociane est d'origine
familiale qui se transmet de génération Père/fils en
héritage. Nous trouvons les héritiers des familles Marelien et
Lopin qui détiennent de grandes propriétés. Ce qui les
classe dans la catégorie considérée de grandons
dans la zone. Ces familles ne travaillent pas toutes leurs terres. Une
part non négligeable a acquis sa petite propriété mais
contracte aussi des baux-à-ferme pour agrandir le champ d'exploitation.
Nous avons remarqué aussi que les paysans se plaignent du manque de
ressources financières qui les privent des possibilités
d'agrandir leurs moyens de production agricole.
67
Un nombre réduit de paysan fait état de la
caractéristique de sans propriété et cette
catégorie contracte des baux-à-ferme d'une petite
propriété d'un propriétaire héritier qui part
à l'étranger, plus particulièrement en République
Dominicaine. Le paysan haïtien est généralement prolifique
en progéniture. Dans cette enquête de terrain, nous avons
trouvé la moyenne des enfants à 5 par ménages. Il s'ensuit
que des paysans propriétaires terriens qui ont des enfants vont laisser
un héritage partitionné au nombre de progéniture. La
partition de la propriété réduit la capacité de
production. Cette problématique a été l'objet du fondement
des contradictions qui relèvent de différents facteurs à
divers moments de notre parcours historique.
À différentes périodes, souligne
Ethéard (2014, p. 18), nous avons une tenure propre qui se faisait sur
la propriété foncière. La période coloniale
priorisait les grandes plantations de plus de dix carreaux. À
côté, l'arpent vivrier désignait la parcelle donnée
à l'esclave pour sa petite culture suivant une ordonnance de 1785, et
enfin, il y avait des terres que les marrons occupaient en marge de la
société coloniale. La période révolutionnaire se
révéla très décisive dans le mode d'appropriation
des terres restées vacantes par les grands propriétaires blancs
de la classe dominante. Du mouvement d'émigration massive de la classe
des blancs, les affranchis se réclamèrent des ayant-droits
naturels et les chefs révoltés qui obtenaient leur liberté
avec la proclamation de 1794, donc les nouveaux libres, se firent plein panier
du foncier. N'étant pas disposés au travail de la terre, ils
allèrent donner lieu au métayage à des petits paysans. Ces
derniers, quoique libérés, ne disposèrent que leur force
de travail. Ils trouvèrent donc dans le métayage une pratique qui
leur procura un sentiment de liberté qui s'apparenta au modèle de
l'arpent vivrier et au mode d'organisation sociale pratiqué par les
anciens marrons dans Lakou. Toutefois la
contradiction66 subsistait avec l'idéalisme
de la politique économique qui commandait à garder les grandes
plantations. Face à cette réalité, Toussaint a
instauré le caporalisme67 agraire. Mais la
pression montait avec l'Indépendance en 1804, l'État céda
en adoptant le pragmatisme qui caractérisa la coexistence des terres de
l'État et celles appartenant à des particuliers qui
regroupèrent des grandons68 et des paysans ayant
possession de terres. Un grand nombre de
66 Face à l'aspiration des masses paysannes
pour avoir la petite propriété, L'Etat se voit obligé
d'innover avec le système portionnaire en imposant une taxe sur
l'ensemble de la production et le partage qui donne 2/3 au propriétaire
et le tiers pour les cultivateurs.
67 Le caporalisme agraire consistait à
contraindre l'exploitation des grandes propriétés de
plantation.
68 Cette expression désigne le grand
propriétaire de terres qui en a reçu à partir des
donations de l'État. Mais avec le temps l'expression tend à
signifier tout court, une personne qui possède de grandes
propriétés de terres. Peu en importe la forme ou la provenance
des moyens d'acquisition.
68
paysans restait sans terres en dépit de l'anarchie qui
s'installât dans la distribution des terres du domaine de l'État
au cours du XIXe siècle. Les agitations timorées de
quelques gouvernements ne trouvèrent efficacité dans les
dispositions légales qui s'estompèrent devant les
évidences politiques.
Cependant un petit nombre de paysan s'est tout de même
constitué un petit patrimoine foncier à partir de quelques
moyens, mais en général, c'est par occupation anarchique sans
titres. L'option de la petite propriété gagne en proportion
grandissante. Ce dont les doctrines néo-libérales ne souffrent de
démontrer le bien-fondé de telles aspirations.
Le métayage fait l'affaire des absentéistes qui
ne s'obligent d'aucunes redevances en termes d'investissement dans les moyens
de production, et l'État ne les y contraignent en rien. Le paysan
s'emploie avec les moyens du bord pour produire. L'État, complaisant
dans son échec, s'attache à extorquer le fruit du travail des
paysans avec l'imposition de taxes. Seul son prélèvement compense
ses devoirs.
Mais l'occupation américaine se convaincra de
remédier à l'expansion de la petite propriété en
renforçant l'arsenal juridique et en activant des plans de
reconstitution de la spatialité plantationnaire. De nouvelles
problématiques confrontèrent l'espace foncier et les rapports de
production. Le paysan paiera les frais dans la nouvelle dynamique.
L'historienne Castor (1971/1988) souligne que l'exploitation capitaliste de
l'occupant caractérise à l'expropriation systématique des
paysans de leurs petites propriétés (p. 90). Cette situation
entraine une paupérisation de la couche paysanne.
2.4.7.-Engloutissement de l'économie du
pays
À l'évincement des paysans des terres en leur
possession, les terres deviennent une part marchande de la spéculation
financière. Laquelle activité s'éloigne essentiellement de
la fonction d'exploitation agricole. Les grandes firmes
étrangères pratiquent la corvée. Et, les réactions
des masses travailleuses contraignent vite en désillusion les faibles
investisseurs dans le secteur agricole. Le fossé entre deux classes :
possédantes et non possédantes s'agrandit de plus en plus. Du
fonds de toute cette tranchée qui se creuse entre les deux factions,
c'est l'économie nationale qui, se reposant essentiellement sur le
travail du paysan, s'assombrit dans la récession. Une diminution
constante de la production s'affiche au cours des années 1970. Le choix
que l'État s'offre face à cette situation, souligne encore Gilles
(2008, p. 42), sous l'instigation de l'USAID,
69
c'est le recours à l'importation des produits
alimentaires. Cette mesure néfaste assiégera davantage
l'économie nationale sous deux angles : 1) créer une concurrence
écrasante pour la faible production nationale. 2) entrainer le pays dans
la dépendance aggravante de l'extérieur. Cette dépendance
s'établit envers des produits agricoles des États-Unis
d'Amérique et de la République Dominicaine. Il en résulte
une détérioration systématique des conditions de vie dans
la paysannerie haïtienne.
Le problème du relèvement de la capacité
de production de la paysannerie haïtienne est posé. C'est un
défi de développement local. Il est essentiel de déployer
tous les efforts nécessaires pour attirer tous les apports
nécessaires qui sont disponibles à l'extérieur. Mais les
directives fondamentales doivent être définies par les agents
nationaux et locaux. C'est tout à fait normal que la
responsabilité de l'État et des autorités locales soit
interpellée dans la définition de politiques publiques qui
correspondent à la hauteur de la dimension du problème de la
production nationale. En ce sens, notre préoccupation majeure se penche
sur ce qui a été envisagé pour monter des
opérations de mobilisations de moyens de production agricole avec les
fonds communaux budgétisés depuis l'exercice fiscal 2012-2013.
Ces interventions ne devaient-elles pas toucher les producteurs locaux de la
2e Section Lociane ?
2.4.8.- Conséquence de la réalité
des secteurs économiques disjonctés
Un autre cas plus révélateur de la
fragilité de l'économie haïtienne se démontre dans sa
caractéristique économique dualiste. Il est un fait qu'il y a une
absence de complémentarité, selon Delince (2000) entre
l'économie urbaine fondée sur l'industrie manufacturière,
le commerce et le service et l'économie paysanne basée
essentiellement sur l'agriculture et l'élevage. Au final, la rupture
systémique entre ces deux secteurs entraine l'économie nationale
dans un problème d'articulation fonctionnelle. Il s'ensuit un vide
structurel dans le marché interne pour liquider les produits locaux par
la conséquence de la réalité disjonctive de fonctionnement
des secteurs économiques urbain et rural.
Il faut également rappeler un autre trait marquant du
secteur économique urbain est qu'il s'accroche aux économies des
puissances capitalistes extérieures. Elles y apportent de faibles
capitaux destinés à l'investissement, les cadres techniques et
les approvisionnements en biens d'équipement et de consommation
courante, comme en souligne encore Délince (idem).
L'exportation est la solution privilégiée pour des
rentrées de devises. En passant, l'économie
70
nationale est devenue bien tributaire des fluctuations du
commerce international. En un sens, le producteur agricole de la 2e
Section Lociane s'entraine dans la même logique pour écouler le
pois congo, le maïs, etc., sur la frontière. Mais en fait, s'il y
avait une industrie locale ou régionale qui se chargeait de lui acheter
ses produits il aurait un choix, soit vendre dans la frontière ou soit
en découler sur le marché intérieur. La présente
recherche se penche sur la question en raison d'une opportunité offerte
pour réfléchir sur la construction d'une connexion structurelle
entre les secteurs économiques piliers du pays en vue d'accroître
les possibilités de maximisation des rendements productifs. C'est dans
ce sens que Bernis (1974) a repris la plaidoirie de Friedrich List (1789-1846)
pour montrer l'importance d'une économie complexe qui s'appuie sur le
développement agricole et le développement industriel (p. 105).
Il s'agit d'une étape importante pour atténuer les énormes
déséquilibres économiques et sociaux qui s'aggravent au
jour le jour. Quitte à faire abstraction de la question de la
répartition de la richesse engendrée dans cette économie
imbriquée.
Mais ce fait met bien à l'évidence des carences
chroniques dont souffrent les instances locales n'arrivant point à
entrainer des rapports avec les populations des régions reculées,
c'est-à-dire les couches paysannes dans une dynamique inclusive. Il est
tout à fait facile de questionner le rôle de l'État dans la
cohérence de la gouvernance de l'espace territorial. Cela implique toute
la matrice fonctionnelle de la décentralisation qui permet
essentiellement l'implantation des assises pour le développement local.
Le troisième chapitre de l'étude s'annonce pratiquement
très intéressante dans l'épilogue d'un modèle de
gestion de la frontière entre Haïti et la République
Dominicaine en vue de caractériser des rapports d'échanges
commerciaux, culturels, etc., des paysans de la 2e Section Locaine qui y
vivent. En particulier, la zone frontalière de Lociane requiert une
démarche logique de vision interpellant la mise en liaison des
différentes conceptions de la notion frontière. Elles devront
faire cours à l'élucidation des idées dominantes
permettant d'épiloguer sur les ressorts socio-historiques qui ont
accouché des particularités de la frontière entre
Haïti et la République Dominicaine. Aussi, sera-t-il évident
de cogiter sur la meilleure manière de raccorder et ragaillardir les
relais des objections plausibles de la résistance haïtienne contre
l'implantation du système raciste et de favoritisme dans la
praticabilité des avancées théoriques du
néocolonialisme à multiples facettes qui se construit à
travers la domination d'une partie sur une autre. Cela justifie en partie
combien il est crucial de faire une mise en contexte historique et sociologique
du phénomène frontière. Ce qui reste en lui-même un
domaine spécialement complexe et particulier dans le cas de l'île
baptisée Hispanola par les conquérants espagnols en 1492.
71
Chapitre III. Gestion de la frontière
Haïti-République Dominicaine
La dynamique de la géopolitique internationale traduit
fort bien la condition d'autonomie de gestion d'un État. Celui-ci se
déclarant indépendant expressément ou tacitement est la
principale source de la création de frontière. La
réalité des frontières est dynamique. La limologie
désigne le domaine d'études des conflits et
représentations délimitatives des frontières. De
manière conventionnelle, les frontières se décomposent en
dyades - « frontières communes à deux États » -
faites de segments. Elles sont des constructions sociales et politiques.
Hormis des considérations sur les récentes
avancées dans le conflit mettant aux prises la Russie et l'Ukraine qui
affectent du moins temporairement, depuis 24 février 2022, le panorama
de la géographie des frontières où la carte des
frontières du monde était relativement stable depuis trois
décennies. En 1989, le monde était scindé par 264 dyades
et 232,106 km de frontières, et en 2020, par 311 dyades et 261,570 km de
frontières. Ce phénomène est complexe, compte tenu des
rapports internationaux qu'il renferme.
La gestion de la frontière est abordée dans ses
spécificités qui relèvent des aspects nationaux et
internationaux de l'espace territorial. La prise en charge du contrôle de
cet espace engage plusieurs niveaux de responsabilités qui s'activent
dans la gestion spécifique des intérêts stratégiques
que représente ce milieu. C'est ainsi que le rôle des agents
locaux des collectivités devient un pallier important dans le dispositif
global de la gouvernance d'un pays. Avec le transfert, le partage ou l'octroi
de compétences aux collectivités territoriales qui s'effectuent
dans la cohérence de l'unité étatique, la gouvernance se
régionalise. Les autorités locales autonomes sont donc astreintes
à des normes de gestion. Elles disposent des ressources qui leur sont
propres. Elles sont aptes à créer des droits et redevances pour
augmenter les recettes fiscales et concourir à des règlements
pour élargir l'assiette fiscale. Concernant la 2e Section
Lociane, l'importance des acteurs locaux s'accroît avec le volume
grandissant des activités transfrontalières qui s'enclenchent
dans la dynamique économique globalisante qui s'y réalise.
Mais la question traitée ici ne s'intéresse pas
à l'aspect de la globalisation. Il est justement utile de
préciser à titre de rappel que la question de la frontière
est un point important dans cette recherche. C'est à partir du milieu
frontalier que repose toute la concentration des activités
économiques qui contribuent à l'occupation de la majorité
des paysans haïtiens dans la zone frontalière de la 2e Section
Lociane.
72
Ainsi, le travail en fond d'écran consiste-t-il
à soulever les points de conjonction qui cristallisent l'influence des
puissances occidentales dans les rapports d'échanges avec les deux pays
institués par des pratiques disproportionnées par ordre de
traitement. Cela constitue la toile de fond des relations internationales par
rapport à Haïti et la République Dominicaine. Mais cette
situation offre aux Haïtiens une occasion bien propice qu'ils peuvent
profiter pour faire une autocritique constructive. De même, ils pourront
essayer de se mettre en état de compaison avec les Dominicains. Mais
avant tout, il y a lieu de comprendre certaines théories du
phénomène. Alors, il s'agit de retracer les différentes
approches théoriques qui concernent la frontière, en
général, en vue d'arriver à la particularité de la
frontière entre Haïti et la République Dominicaine dans sa
position géographique au niveau de la 2e Section Lociane.
3.1.-Différentes théories sur la
thématique de la frontière
Les théories indiquent des idées qui sont
développées dans la compréhension d'un
phénomène social. La notion de frontière a connu une
évolution assez spectaculaire avec le temps pour partir d'une conception
traditionnelle en passant par une conception moderne pour atteindre des
approches post-modernes. Ces dernières, étant donné leurs
plus grandes vues sur les différents aspects qui composent le
phénomène de la frontière, servent péremptoirement
de support théorique dans cette étude. L'intérêt se
traduit par le point de vue de la sécurité de la frontière
qui permet de contrôler cet espace. Il s'agit de maîtriser les
paramètres des échanges commerciaux et autres qui constituent des
facteurs importants des conditions socio-économiques. Il en
résulte que les théories sur la frontière fournissent un
guide de compréhension des différentes exploitations qu'elle peut
être l'objet. De plus, c'est dans la perspective de l'application de ces
différentes théories que notre recherche a interrogé sur
les représentations que les paysans se font de la zone
frontalière dans les entretiens avec les informateurs-clés sur le
terrain.
3.1.1.-Approche traditionnelle de la notion de
frontière
L'approche traditionnelle du phénomène
frontière conduit à projeter un regard sur la théorie
d'Henry Dorion (cité dans Grenier, 1964) qui consiste à :
décrire formellement et objectivement la ligne frontalière
elle-même en faisant référence aux données
juridiques et politiques ; décrire la région où s'inscrit
cette ligne frontière en se référant aux données
historiques, économiques et géomorphologiques ; enfin,
établir les relations qui se tissent autour de ces données au
regard de
73
la géographie. Cette approche ne permet pas de saisir
toute la complexité de la nouvelle réalité qui s'y
développe. Aussi, l'évolution considérable qu'a connue le
phénomène frontière nous amène-t-elle à
considérer d'autres conceptions qui concernent la période moderne
avec plusieurs autres approches.
3.1.2.-Considération sur l'approche moderne du
phénomène de frontière
Le phénomène de frontière s'explique
dans ce courant sur des aspects plus variés. Cette matière
fournit assez d'éléments qui permettent de confronter une
démarche assortie de différentes conceptions de nombreux auteurs
produisant sur la thématique de la frontière. En ce sens,
Breugnot (2012) affirme que la frontière joue des fonctions multiples
dans de différents aspects allant du cas personnel à l'espace
d'enjeux publics internationaux du point de vue politique et économique.
La complexité subsiste du fait que la frontière renferme des
éléments de dimension politique d'autant qu'elle constitue un
espace économique générateur de ressources. Cependant,
elle demeure un phénomène social au regard de la vie, d'histoire
et de mémoire caractérisant sa dimension sociologique, sociale,
culturelle, symbolique ou imaginaire. Le caractère géopolitique
de la frontière se détermine dans la ligne ou la zone qui culmine
la jonction du territoire d'un État à un autre État
constituant des entités politiques indépendantes69.
La construction de l'Europe, après la seconde guerre
mondiale, engendrait la notion d'espace frontalier qui offrait un tableau
spatial voué spécifiquement à diminuer la fonction
historique des frontières qui consistait à différencier
officiellement deux populations ayant été
caractérisées par leur appartenance nationale, linguistique et
culturelle. D'une manière à susciter la quête de
compréhension sur le fait que des populations vivent à quelques
kilomètres l'une de l'autre et persistent à se considérer
comme parfaitement étrangères les unes aux autres. En ce sens, la
réalité de la proximité ne simplifie pas
nécessairement la communication à cause de la complexité
de la psychologie humaine définissant les charges émotionnelles
résultant de l'histoire ancrée dans les traits culturels et les
rapports d'identité.
69 Cette indépendance peut concerner des
états dans un même territoire. On parle alors de frontières
internes. C'est le cas pour la Suisse et le Canada qui tiennent au fil d'une
pression politique visant à maintenir une cohésion minimale en
vue d'écarter l'option séparatiste.
74
De l'avis des auteurs Dubois et Rérat (2012), le cours
de l'histoire a beaucoup contribué à redéfinir les
frontières nationales. Certes, leur trace reste plus ou moins statique,
mais leurs rôles et fonctions ont subi des évolutions dynamiques
par rapport aux contextes historiques, politiques, économiques et
sociaux durant le XXe siècle où de profondes mutations
géopolitiques et économiques se sont produites dans le monde. La
mondialisation s'implante en comprimant l'espace-temps tout en libérant
la circulation de flux de capitaux, de personnes, d'informations et de
marchandises. Alors, la frontière, par les pratiques des habitants qui y
vivent, signifie de nouvelles perspectives qui contribuent à en
redéfinir.
Ces auteurs conçoivent aussi que la frontière
est une composante territoriale remplissant des fonctions de
délimitation de souveraineté entre États,
possibilité de contrôler la circulation qui s'y fait,
défense du territoire national. L'accomplissement de ces fonctions
participe à la construction d'une identité nationale.
Assimilée à un binôme barrière/interface et
coupure/couture, la frontière dispose d'un ensemble de règles, de
normes et de procédures qui régulent et contrôlent leurs
effets sur les acteurs sociaux, politiques et économiques dans une
construction politique évolutive qui interagit avec le
développement territorial des régions frontalières (partie
déterminée de la frontière) et les pratiques spatiales de
leurs habitants.
Encore Dubois et Rérat (2012) estiment-ils que la
frontière place la distance dans la proximité entre deux
États différents dans leurs systèmes institutionnels qui
peuvent disposer souverainement des modalités de circulation sur
l'espace frontalier. Il existe une réalité qui atteste
l'incapacité du pouvoir central à faire respecter son ordre
juridique sur ses frontières parce que celles-ci sont devenues l'objet
de contrebandes de tout genre à cause du degré de leur
porosité. Encore que les NTIC défient-elles toute
législation et les frontières des États et rendent
incontrôlables les flux d'échanges d'information que les
États veulent souscrire.
3.1.3.-Préférence accordée à
l'utilisation des approches post-modernes de la frontière
La responsabilité de l'État et des agents
locaux s'engage dans la gestion (politique, sécuritaire,
économique, etc.) de l'espace territorial. La préférence
accordée aux approches post-modernes se justifie dans l'importance de la
sécurité et du contrôle dans la limologie. En cette
matière, l'identification du responsable de la sécurité
est capitale. La sécurité recouvre : la macro-région,
l'État ou ses parties. Le rôle symbolique de la
sécurité d'une frontière, des images et du discours
75
contemporain joue beaucoup dans sa perception70. En
référence aux approches considérées postmodernes,
il s'agit aussi de chercher à comprendre la position
hégémonique que les autorités dominicaines se font dans
leur conduite. À tel point qu'elles se donnent des motifs pour imposer
une clôture qu'elles sont en train de construire sur la frontière.
Par ailleurs, il est évident qu'à travers le monde, le
développement des échanges économiques et culturels tend
à amoindrir la rigidité absolue des frontières.
La présente étude aborde avec privilège
un article de Dressler(2007) traitant des approches postmodernes qui se
convergent dans une théorie de la sécurité
frontalière. Cette théorie strictement sécuritaire
découlant de la période post-moderne est considérée
sur un territoire déterminé. Ses différentes parties
recoupent l'identification des gens qui en est une appréciation
symbolique. Elles intègrent également une identité
ethnique et nationale71. La notion de sécurité
nationale se familiarise aux représentations des frontières qui
se confondent à l'utilisation de l'appareil policier de l'État
pour assurer cette sécurité. Les zones de frontière sont
acceptées comme des frontières naturelles pour les
gardes-frontières, les services de douane et les concentrations
d'unités militaires, spécialement dans les endroits perçus
comme menacés par l'opinion publique. Dans sa complexité, la
sécurité 72 renferme plusieurs subdivisions de types :
la sécurité militaire, économique, politique et
environnementale, etc. Concernant la 2e Section Lociane, l'absence
de contrôle est un fait qui expose le pays à tout type de menace
qui peut provenir de la République Dominicaine. Les routes qui passent
par Nan Croix, Baranque et Savane Mulâtre conduisant à la
frontière sont libres de tout contrôle du côté
haïtien. Elles sont souvent empruntées par des criminels, notamment
les voleurs de bétail qui opèrent dans cette zone. Des paysans
ont été assassinés à Savane Mulâtre au cours
du mois d'octobre 2022 par des hommes qui sortaient de la frontière. Et,
ils s'y sont repartis après la perpétration de leur acte
meurtrier en toute quiétude. La présence de la police nationale
d'Haïti se manifeste seulement à Boc Banic qui détient la
voie de communication en terre battue la plus appropriée pour atteindre
à la frontière. Cependant, les rivières Lociane et
l'Artibonite à traverser ne disposent pas de ponts de passage. (Voir
Annexe 2).
70 Ainsi, Paasi(1996) et Aolto(2002) pensent-ils qu'en
dépit des conflits historiques entre la Suède et la Finlande, les
représentations sociales concernant leurs frontières sont
positives, alors que la frontière de la Finlande avec la Russie est
perçue comme une source d'immigrants illégaux, de
criminalité, de pollution et autres menaces.Cf. [Camille Dressler «
L'approche des frontières du point de vue de la
sécurité» publication en date de 01/12/2007|En ligne
sur www.cairn.info, site consulté le 14/02/2023].
71 Nous pouvons considérer Sebastopol en
Russie et le Kossovo en Serbie sont de tels territoires symboliques
72 Dans son acception étendue, la sécurité
renvoie à celle des systèmes vitaux et l'absence de menace sur la
vie des habitants et sur leurs activités.
76
La prévention de la menace militaire échafaude
le socle primaire de l'interprétation traditionnelle du rôle des
frontières étatiques dans la question de la
sécurité nationale. La priorité accordée à
l'efficacité de combat militaire en vue de repousser l'agression d'un
ennemi potentiel détermine le régime spécial des zones
militarisées engendrées par des zones frontalières. La
sécurisation d'une zone frontalière entraine le maximum de
contrôle sur les flux frontaliers. Les individus, les marchandises ou les
informations indésirables, etc., sont maitrisés,
contrôlés, bloqués ou laissés passer devant la ligne
frontalière du territoire d'État. La frontière qui permet
de remplir facilement le contrôle du flot transfrontalier est
généralement moins dense et par conséquent,
l'activité économique y est stagnante. L'approche basée
sur la sécurisation de l'État exige que cette fonction lui soit
dévolue et que les intérêts sécuritaires des
régions frontalières s'intègrent dans ceux de
l'État lui-même. La géopolitique détermine donc la
géo-économie.
Il y a une pluralité de vue des frontières dans
les études post-modernes. On priorise le cas où tout le
territoire de l'État est impliqué dans les échanges
commerciaux qui rendent particulièrement ces régions
frontalières des attractions de croissance économique et des
centres d'innovation. Il y a une perspective de déboucher sur des
agglomérations urbaines, zones industrielles, etc. Il peut aussi en
résulter des mariages ethniques et des changements de structure ethnique
et identitaire dans la population en termes de donnée
démographique et sociale dans ces régions frontalières.
Lorsque la confiance s'accroit mutuellement les préjugés
stéréotypés disparaissent. Cette situation permet l'emploi
des méthodes modernes de contrôle
télécommandé au lieu d'en tenir aux moyens traditionnels
de contrôle. Aussitôt qu'il y ait un changement dans la perception
de menace de la sécurité nationale ou régionale. Il s'agit
de supposer de l'efficacité des forces militaires à conjurer tout
danger. Mais, il est une constante que seules les forces militaires ne peuvent
arrêter l'immigration illégale, les trafics de drogues et d'armes,
les risques d'épidémies, de pollution transfrontalière et
de désastres environnementaux globaux. Alors, l'économie est
terriblement affectée et la société est
dérangée avec la persistance de l'emploi des méthodes
traditionnelles dans le contrôle des flux transfrontaliers croissants.
L'une des méthodes privilégiée de nos jours est la
coopération étroite entre les États voisins. Elle requiert
de la confiance mutuelle73. L'approche post-moderne de la
sécurité des frontières interpelle la contribution des
gouvernements dans le développement de la coopération
transfrontalière au niveau des autorités locales. Les
intérêts
73 La notion de confiance mutuelle renferme une
opération conséquente de dé-militarisation des zones
frontalières et l'ouverture des frontières
(dé-sécurisation).
77
spécifiques des zones frontalières ne peuvent
plus longtemps être restés ignorés par le pouvoir central
qui dès fois fait obstacle à la coopération
régionale qui intègre désormais la sécurité.
Cette théorie insinue le rôle prépondérant des
initiatives des autorités locales dans la gestion de l'espace
territorial. Elle démontre aussi l'importance de la
décentralisation qui s'exprime dans sa teneur dévolutive.
3.1.3.1.-Approche systématique de la
défense des frontières
Cette approche entend élaborer un plan pour la
défense de tout le territoire du pays en même temps que les
frontières. Le combat s'engage donc contre l'immigration illégale
et le trafic de drogues au-delà des mesures défensives au niveau
des frontières74. L'espace s'étendant sur les
régions intérieures en plus de la zone du long des lignes
frontalières contribue au développement du transport des
échanges commerciaux et des communications pour créer des
frontières au- dedans du territoire de l'État...
Les acteurs locaux et internationaux sont interpellés
à partager la responsabilité de la sécurité
frontalière au côté de l'État. Car, il n'est pas
question de se leurrer à prévenir à toutes les
éventualités, mais le mieux est de se préparer à
réagir promptement le cas échéant, d'une manière
flexible et appropriée.
La vie réelle présente d'autres vues à
l'application idéaliste des recommandations post-modernes. L'inertie des
vues traditionnelles, la culture géopolitique, les impératifs de
construction de l'État et de la Nation, sont en quête de
renforcement opéré par le rôle symbolique des
frontières, le caractère même de l'espace frontalier et
d'autres facteurs géopolitiques75.
3.1.3.2.-Approche discursive des frontières
comme représentations sociales
Le discours et les représentations sociales
intègrent des valeurs en soi, des fonctions des frontières et
souventes fois concernant leur démarcation. Les études de la
limologie s'en intéressent donc.
74 À l'appréciation des
données de Prozrachnye Granitsy(2002), (cité dans Dressler,
2007), au niveau international, seulement 5 à 10% du trafic de drogues
sont susceptibles d'être interceptés dans les points de passages
officiels. C'est pour cette raison qu'il convient de s'attaquer aux sources de
ce trafic -les organisations criminelles internationales. Il s'agit de faire
preuve d'attitude d'ouverture pour rendre la transparence de l'information sur
le flot transfrontalier avec la possibilité d'un audit international et
le télé-contrôle via les technologies modernes (Lalliner,
2001 ; Moisio, 2002).
75 Les processus d'intégration dans les
nouveaux Etats indépendants de la CEI avancent souvent dans deux
directions : Ils essayent de combiner l'aspiration à
l'intégration à la grande Europe avec les relations stables avec
le Russie. Mais ils sont souvent obligés de choisir soit l'UE, soit la
Russie ; soit les frontières relativement transparentes avec les
nouveaux membres ou les pays candidats de l'UE, soit avec la Russie. Les
frontières européennes et les frontières politiques et
administratives dans l'espace post-soviétique forment en fait un
système intégré. En fait, la transparence de
l'énorme frontière entre la Russie et le Kazakhstan ne fait pas
bon ménage avec l'ouverture des frontières occidentales, plus
particulièrement les frontières frontales. Cf. [Camille Dressler
(ibid]).
78
La théorie de la géopolitique
critique76 désigne une géographie haute et une
géographie basse. La première, décomposée en
géopolitique théorique et pratique, embrasse un champ de
politiciens et d'experts par la création des concepts tentant d'estimer
une haute représentativité de leur contrée au niveau
international.
La géopolitique basse recoupe l'ensemble des
représentations géopolitiques, de symboles et d'images dans les
médias, etc. C'est le socle visionnaire de la géopolitique
mondiale. La construction de l'État s'y rejoint un élément
d'identité politique et ethnique et un outil d'action. L'espace
politique comprenant la sécurité nationale et des menaces, les
avantages et désavantages d'une stratégie spéciale dans
les relations internationales forme les représentations des relations
constitutives de la vision géopolitique77 mondiale. Les
différents groupes sociaux interprètent à leur sens le
rôle des frontières. Un phénomène mythique couvre
alors les représentations des frontières pour la plupart des
groupes. L'identité politique et ethnique dérive donc des
représentations78 des frontières. Le renforcement de
régime des nouveaux États indépendants se réalise
dans le rôle symbolique des frontières79.
3.1.3.3.-Le rôle fonctionnel de l'approche
politique-pratique-perception dite approche `PPP'
Cette approche fait une synthèse de différentes
approches traditionnelles pour rejoindre les valeurs pratiques de l'approche
fonctionnelle80. Des niveaux spatiaux différents provoquent
l'analyse combinée de cette approche qui s'avère importante de
:
1) relever les flux transfrontaliers propulsés par la
frontière en se concentrant sur les réseaux d'affaires
frontalières de l'ensemble des acteurs sociaux ; 2) considérer
les facteurs des flux
76 La notion de géopolitique critique est
développée par Toal(1996) et d'autres auteurs, Cf.[Camille
Dressler(ibid.)]
77 Selon Djikink(1996), Taylor et Flint(2000), repris dans
l'article de Camille Dressler, cette vision regroupe également les
représentations du territoire des groupes ethniques ou de la nation
politique et leurs frontières, les modèles d'Etat idéal,
la mission historique et les forces prévenant sa réalisation. De
même d'après Kolossov(1996) cité par Camille Dressler,
cette vision provenant de l'histoire et de la culture nationale, est une
synthèse des vues véhiculées par différents strates
de l'élite politique, les experts académiques, l'intelligentsia
des créateurs et l'opinion publique générale.
L'activité du gouvernement est légitimée par
l'équivalence de la géopolitique haute et basse.
78 Il importait pour les dirigeants politiques
d'Europe centrale et orientale de présenter leur frontière
à l'échelle globale comme les démarcations entre l'est et
l'ouest, comme frontière européenne à l'échelle
macro-régionale et de présenter, à l'échelle
locale, les frontières naturelles de leur groupe ethnique comme des
frontières historiques ; ou à l'inverse, comme résultat de
compromis sages mais difficiles à réaliser au nom de la
stabilité internationale (Berg et Oras, 2000 ; Moisio, 2002).
79 Les frontières des pays baltes avec la Russie sont
ainsi interprétées comme les limites entre l'ouest et l'est,
l'Europe civilisée et l'Asie `Barbare`. Il s'agit d'une
dynamique très politisée des rapports entre la Russie et ses
voisins dont les intérêts de coopération frontalière
seront toujours mis à mal en fonction de la haute géopolitique.
C'est ainsi qu'en ex-URSS, l'attitude sacrée envers la frontière
de l'Etat est profondément inscrite dans la conscience collective
(Kolossov, 2003).
80 Selon Henri Lefebvre, une pratique sociale
découle de la frontière qui représente plus qu'une
institution légale visant à assurer l'intégrité du
territoire de l'Etat. S'y ajoute le résultat d'un long
développement historique et géopolitique, un décisif
symbole d'identité ethnique et politique.
79
transfrontalier et la connexion fonctionnelle
barrière/contact qui engendrent la capacité des États dans
les stratégies de leurs autorités locales ; 3) entendre à
l'interdépendance entre les activités frontalières, la
perception81 des frontières et leurs infrastructures
institutionnelles et légales.
Cette approche tenant compte du comportement des
individus82 dans la zone frontalière relève surtout de
la théorie traditionnelle. Il en résulte que la zone des cycles
de vie humaine s'en transforme également. Idéalement, cette zone
adopte la forme des cercles concentriques reflétant l'affaiblissement
avec la distance, des contacts d'individus avec son lieu d'origine. Certains
critères personnels s'ajoutant au développement des transports,
des facteurs politiques et légaux contribuent à former cette zone
des cycles de vie qui montre un aspect différent des autres
régions du territoire national. Les personnes les mieux
éduquées se rapprochent le plus aux structures étatiques
que celles les moins éduquées. Les comportements des individus et
ces zones des cycles de vie sont des variables déterminées par
les facteurs internes subordonnés à la proximité de la
frontière.
Ces facteurs internes recoupent les conditions
socio-économiques autant que les restrictions administratives et
légales. L'association des gens aux intérêts de leur groupe
ethnique, des citoyens à leur État et des habitants à leur
région ou à leur proximité joue un rôle
prépondérant dans l'identité ethnique et nationale. Dans
le cas de la 2e Section Lociane, cette approche `PPP' permet de
comprendre les relations personnelles que les Dominicains et les Haïtiens
se développent dans leurs rapports de proximité.
3.1.3.4.-Détermination structurelle de
l'approche Eco-politique
Les considérations sur les frontières sociales
ne relèvent pas des processus naturels. Les frontières
administratives ou politiques agissent sur les montagnes, les bassins fluviaux
83 , les zones ornithologiques ou poissonneuses, les monuments de la
nature, les mers intérieures et autres
81 Selon Scott(2000) et Van Houtum(1999), la «
perception de la frontière dans son caractère, son
évolution et les canaux d'influence des représentations sociales
relatives aux frontières, régions frontalières, relations
entre États et régions voisines, coopération
frontalière et discours spécifique des géopolitiques
hautes et basses »Cf [Camille Dressler (ibid.)]
82 C'est ainsi que l'approche PPP, selon
Lunden(2000), Lunden et Zalamans (2000), est considérée proche de
la théorie du comportement humain dans les zones de frontières.
John House(1987), estime qu'elle est apparentée aux approches
post-modernes et à la théorie fonctionnelle. Cf [Camille Dressler
(ibid.)]
83 Les bassins fluviaux représentent des
régions naturelles étroitement intégrées qui, en
même temps, représentent la base d'habitation et de transport. Ils
déterminent souvent les frontières entre les territoires
créés historiquement et les communautés culturelles. Mais
les problèmes d'utilisation de l'eau, des ressources biologiques et
énergétiques sont des sources classiques de conflits frontaliers
internationaux.
80
régions naturelles qui y sont souvent divisées.
D'autant plus que les dépôts de minéraux connaissent le
sort partagé entre plusieurs unités politiques.
La diffusion des polluants dans l'air et dans l'eau se
réalise à travers le milieu naturel relevé des
régions naturelles intégrées84.
3.1.3.5.- Imaginaire d'un monde sans
frontières
Le courant de pensées néo-libérales
véhicule une libération de l'économie, le
développement des nouvelles technologies de l'information et de la
communication et une prospérité croissante débouchant sur
l'ouverture graduelle plus intégratrice des frontières politiques
au lieu de leurs formes aliénantes actuelles. La nécessité
de coopération internationale pour résoudre les problèmes
environnementaux et énergétiques à l'échelle
planétaire convainc à l'effet de telle option. Des lois
internationales faciliteront plus aisément des solutions aux conflits
frontaliers. Les contradictions à ce propos seraient surmontées
avec la séparation des fonctions économiques et
idéologiques85 des frontières. L'unanimité ne
se dégage pas autour du paradigme d'un monde sans frontières,
parce que dans les régions où les processus d'intégration
sont très avancés, les frontières demeurent encore une
barrière. En Amérique du Nord et en Europe où se
répartissent généralement des démarcations
pacifiques, intégratrices, ouvertes, internationalement reconnues, cette
idée pourra s'appliquer plus facilement que dans d'autres continents
tels qu'en Asie et en Afrique où subsistent les conflits 86
potentiels frontaliers. D'ailleurs, toutes les régions du monde bercent
des mouvements nationalistes. La loi internationale bute à de nombreuses
contradictions qui touchent au droit illimité des peuples à
l'auto-détermination et à l'intégrité territoriales
des pays souverains et à l'inviolabilité de leurs
frontières. Autant d'obstacles qui mettent ainsi à mal
l'idéal néo-libéral à ce sujet. Cette
réalité de point d'obstacle n'échappe pas à la zone
de frontière de la 2e Section Lociane qui présente
différents points de contrôle du côté dominicain. La
partie haïtienne
84 Les travaux de Young(1997) et
d'autres chercheurs (cités dans Dressler, 2007) révèlent
l'incitation à la coopération internationale et avec elle les
coopérations frontalières dans la recherche de solution des
problèmes environnementaux à l'échelle régionale et
globale. Des chercheurs en sciences politiques spécialistes des
relations internationales et des géographes physiques se concentrent sur
l'étude des problèmes d'environnement et de politiques
transfrontalières.
85 A ce propos Ohmae (1995), Prescot(1999) pensent que «
l'excès de nationalisme ainsi qu'un droit illimité des peuples
à l'auto-détermination doivent être dépassés
grâce à la démocratisation en profondeur et en largeur.
» Wu Chung-Tong(1998) souligne que l'optimisme se dégage du
développement rapide des coopérations transfrontalières
entre les régions du monde par des modèles identiques.
86 L'Europe et l'Amérique du Nord disposent
des frontières au sol qui représentent 5% de longueur entre les
Etats, alors qu'en Afrique, 42% de longueur des lignes frontalières sont
tracées sans aucunes considérations des réalités
sociales. La période colonialiste des Français et des
Britanniques en a imposé 37% sur le seul motif de partage territorial.
Cf [Camille Dressler, idem]
81
correspond mieux à cet idéal de frontière
libre dans les seize points non contrôlés par l'administration
douanière haïtienne.
3.2.-Question de la délimitation de la ligne
frontalière Haïti-République Dominicaine
La question de la délimitation de la frontière
Haïti-République Dominicaine s'inscrit dans la démarche de
la recherche de la vérité historique et sociologique qui peut
permettre de saisir les évènements qui ont accouché la
frontière de l'île Hispaniola.
Le cours de l'histoire montre bien comment s'est
évoluée cette île qui a été l'objet de
découverte87 par Christophe Colomb pour le compte d'Espagne,
en 1492, d'où provient sa dénomination Hispaniola (Isla
Hispagnola) : petite Espagne. La population autochtone - composée
de Tainos, Ciboneys88 et d'Arawaks, l'ayant appelé Haïti
(Ayiti), Quisqueya (Kiskeya) ou Bohio, repartie en
cinq caciquats ou royaumes : le Marien89, le Xaragua, la Maguana, la
Magua et le Higuey - y sera presque totalement décimée en
quelques décennies (C. Lespinasse, 2020, p.68). L'occupation de
l'île connaitra des mouvements qui donneront lieu à la domination
des Espagnols en débutant la traite négrière en 1503 avec
Nicola Ovando. Et puis, l'intrusion des corsaires français au cours de
1625 dans la côte occidentale déterminera un état de fait
de rivalité grandissante entre les puissances européennes,
notamment celle entre l'Espagne et la France conduira à un partage qui
marquera le début du processus de différenciation de domination.
Il se produisit un phénomène de coïncidences existentielles
de ces deux puissances sur l'île. Celles-ci orienteront leurs espaces
territoriaux dans des choix différents sur les plans social,
économique et politique. Cela constitue une donnée
socio-historique qui démontre et/ou détermine la valeur
anthropologique des deux peuples sur la même île. Et par-dessus, il
en résulte un complexe institutionnel de deux Républiques avec
deux peuples bien distincts dans leurs moeurs et coutumes dont une
frontière étanche s'établit entre eux en des circonstances
particulièrement singulières.
87 Le concept de conquête convient mieux pour rentrer dans
la logique de Laënnec Hurbon dans son papier : le Barbare imaginaire,
Les éditions du cerf, Paris, 2007, p 8.
88 Benoit Joachim a fait mention de cette
couche raciale parmi les habitants primitifs de l'île d'ayiti en 1492
dans son ouvrage intitulé : les racines du sous-développement
en Haïti [1979].Editions de l'université d'Etat
d'Haïti. Port-au-Prince, 2014, p98.
89 La distribution territoriale des naturels de
l'île Ayiti en cinq caciquats ou royaumes est une illustration qui
détermine que la puissance d'un chef (cacique) sur une spatialité
et ses sujets. Le marien représente l'actuelle région du
Nord-ouest, gouverné par Guacanagaric, il acceuillit Christophe Colomb;
le xaragua, représente la partie de l'Ouest occidental jusqu'à
l'actuelle pointe de Tiburon dont le centre de pouvoir était à
Léogâne avec Bohecio et sa soeur la reine d'Anacaona à
l'arrivée des espagnols ; la maguana, gouvernée par Caonabo,
s'étendait dans la région centrale d'une partie de l'Artibonite
au Centre échouant dans les hauteurs de San Juan rejoignant les lieux de
Barahona ; la magua comprenait la partie nord-est jusqu'à la baie de
samana à l'océan atlantique, dirigée par Guarionex; enfin
le higuey couvrait la partie extrême orientale baignant sur la mer
atlantique, dirigé par Cayacoa. Ces deux derniers caciquats
étaient situés la partie orientale de l'île, la
République Dominicaine.
82
3.2.1.-Rapports Haïtiens et Dominicains
Les peuples partagent des élans de solidarité
et de rapprochement dans toute situation qui interpelle les raisons objectives
et subjectives de leurs intérêts. Les considérations
socio-historiques façonnent bien des traits dans le comportement des
peuples. Mais les intérêts économiques sont d'une
importance capitale dans la gestion des rapports entre des peuples. En
substance, les deux peuples de l'île Hispaniola fonctionnent ensemble
dans un esprit de solidarité, de coopération et d'entente pour
développer des échanges commerciaux et autres en dépit de
la frontière qui les sépare.
La frontière représente un point de jonction
entre ces deux peuples qui regorgent autant de différences de par la
culture, la langue et la législation. Les Dominicains manifestent un
plus grand penchant pour laisser la zone frontalière en direction des
villes urbaines, alors que les Haïtiens, eux, ont tendance à s'y
rapprocher en vue de profiter des opportunités économiques et
commerciales de l'espace frontalier et bénéficier des services de
bases qui font défaut dans leur contrée. En fait, Haïti ne
fournit pas assez de services de base aux habitants de la zone
frontalière.
Selon Lamothe (2008, p. 146), entre les habitants qui vivent
dans la zone frontalière et les autorités politiques, il existe
un grand écart d'appréciation de la ligne frontière. Cette
ligne frontalière que les administrations politiques tendent à
surveiller est une ligne imaginaire. Les habitants des deux côtés
s'entendent pour vivre ensemble, ils font du commerce et partagent des traits
culturels en commun. Mais cette considération est nuancée par
d'autres auteurs qui décrivent clairement le sentiment anti-haïtien
se propageant dans certains milieux sociaux en République
Dominicaine.
Selon Alexandre (2009), il reste un fait qu'un fort sentiment
anti-haïtien s'intensifie avec des actes de violences contre les
Haïtiens en République Dominicaine. Par ailleurs, depuis
après les années 1990 du coup d'État et de l'embargo, il
se réalise un important développement de réseaux de
transport entre les deux pays, trouvant un relais de progression avec
l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication
qui constitue un moyen de communication de masses nécessaires à
faciliter l'extension des échanges commerciaux. D'autant plus qu'un
nombre croissant d'étudiants haïtiens investissent les centres
d'enseignement supérieur en République Dominicaine. En outre, il
se développe un réseau touristique de la petite bourgeoisie
haïtienne, divisée en deux catégories dont l'une,
d'après Louis (2019, p. 235) est qualifiée d'aile
83
établie et l'autre, d'aile nouvelle
de la classe moyenne haïtienne, qui pratique
régulièrement ou par saison en visite à la
République Dominicaine.
Théodat (2010) affirme « qu'entre
Belladère et Elias Piña, s'établit un couloir
inachevé, tant le potentiel de croissance du plus important bassin
versant commun aux deux pays semble receler de défis. Les villes de
Hinche, Thomassique, Mirebalais et Lascaobas sont en train de subir l'influence
cristallisante de San Juan et d'Elias Piña, les deux localités
dominicaines les plus importantes dont la prégnance s'exerce en
profondeur désormais sur le territoire haïtien.
L'amélioration des liaisons terrestres renforcera cette emprise dans un
premier temps si rien n'est fait pour renforcer simultanément des
politiques publiques renvoyant aux capacités de production des campagnes
et des provinces limitrophes haïtiennes. Sans ces garde-fous
nécessaires, l'accélération du volume d'échange
avec le territoire haïtien se fera au détriment de son agriculture
et de son artisanat ; son commerce étouffera ses ateliers et ses usines
». C'est aussi un fait que la 2e Section Lociane s'encastre
dans sa dépendance accentuée de la partie orientale avec Banica,
Hato Viejo et Savana Cruz. Une question dans les entretiens cherche même
particulièrement à relever cette relation de dépendance
des Haïtiens par rapport à la frontière.
Des positions exprimées par nombreux auteurs insinuent
un mal être social et économique du peuple de la République
d'Haïti souffrant des précarités qui résultent de
l'abandon de l'État. En raison surtout du manque d'éducation
politique, surgit l'avis de Joachim (1979/2014, p.169). Concernant
l'État haïtien, Corten (2013, p. 21) qualifie de
déliquescence toute l'infrastructure sociale d'un État qui
s'apparente à un État failli. Par la difficulté majeure
d'établir une concordance dans les intérêts des
élites et le reste de la société, il s'ensuit le
renforcement des inégalités sociales privant la majorité
de la population du minimum de bien-être. Les conditions
socio-économiques se dégradent de plus en plus en Haïti.
Cette situation pousse à rechercher, entres autres, pour certains, les
causes structurelles dans la gouvernance qui s'écarte de l'État
de droit.
En effet, la gouvernance doit être articulée aux
niveaux : politique, social et économique. Aussi passe-t-elle par la
transparence dans les actions gouvernementales, les bonnes mesures, les
sanctions, la reddition de comptes entre autres qui forment le pilier de
l'État de droit démocratique eu égard des conditions
d'évolution technologique. Et, ces conditions sont primordiales à
la réalisation de la construction du projet socio-politique et
économique de l'État. Comme l'a souvent
répété Denis (2018) : « une stratégie de
développement économique s'engage dans un processus. Ce dernier
implique le savoir scientifique, les connaissances techniques et empiriques,
des innovations
84
technologiques et une ingénierie dans les pratiques
sociétales. Lesquelles déterminent un certain seuil dans la
marche du développement socio-économique du pays. Ces
stratégies de développements économiques ont
été appliquées dans le but de parvenir à un certain
niveau de bien-être économique et social collectif. »
(p. 174).
Les difficultés d'Haïti à assumer les
conséquences de ses rapports transfrontaliers avec la République
Dominicaine ne datent pas d'aujourd'hui. Mais, les effets négatifs de
ces rapports disproportionnés n'ont jamais manifesté autant
d'impact sur la dynamique interne du pays. D'ailleurs le traitement de la
question de la sécurité nationale a grandement consommé
l'énergie de ce travail dans la démonstration des
intérêts majeurs qui caractérisent cette matière. La
prolifération des armes à feu et des munitions ne serait-elle pas
une preuve de la porosité de la frontière entre autres voies ?
Aussi la compréhension de notre perception de la frontière avec
la République Dominicaine ne suffit-elle pas pour expliquer le moindre
degré d'importance que nous accordons à la dimension
socio-historique qui a donné lieu à ce
phénomène.
3.3.-Contexte socio-historique de la frontière
Haïti-République Dominicaine.
L'histoire de la création de la frontière
retrace des particularités sur plusieurs ordres et présente une
réalité bien particulièrement complexe et
intéressante, compte tenu des contentieux historiques qui marquent les
relations substantielles qui lient les destins des deux pays qui en ressortent
des fonts baptismaux dans l'île Hispaniola.
L'auteur Price-Mars (1953/1998a) souligne que l'implantation
de l'emblème de la Rédemption : la croix du Christ dans la
région du Nord de cette île montagneuse de l'archipel des Antilles
en 1492, par Christophe Colomb fait entrer l'île d'Haïti dans
l'histoire du monde. Allaient s'ensuivre deux évènements aux
lourdes conséquences humanitaires : l'extermination graduelle des
700,000 possesseurs naturels qui donnait lieu, quelques décades plus
tard, à la conjoncture de la traite des Nègres d'Afrique pour
assurer l'exploitation dans un système colonialiste et esclavagiste.
Pour consacrer droit aux puissances de la péninsule ibérique :
L'Espagne et le Portugal, en 1493, le Pape Alexandre VI leur avait
distribué les terres de l'Amérique. Cette décision fut
méprisée par les autres puissances à savoir : la France,
L'Angleterre et la Hollande. Ces dernières se réclamèrent
également le droit de jouir des aventures aux Amériques.
85
Au fil des ans, le système d'exploitation colonial
privilégié par l'Espagne ne donnait plus de rendement avec
l'épuisement des mines d'or et d'argent dans la partie occidentale. Les
Espagnols se concentraient essentiellement dans la partie orientale qui pompait
encore de métaux précieux. Le délaissement de la partie
occidentale allait favoriser l'avancement dans les grandes terres des
boucaniers et flibustiers français vers 1625 qui s'établirent et
menèrent des activités pirates déjà quelque temps
dans l'île de la Tortue. Dans la guerre européenne de la France
contre L'Espagne, l'île Hispaniola va être un sujet de transaction.
En nombre supérieur, les Français occupèrent
progressivement beaucoup de terres dans la partie occidentale. Les
Espagnols90 , en position de faiblesse, étaient contraints de
négocier. Ainsi, en est-il sorti le traité de paix de Ryswick en
1697 où l'Espagne cède le tiers (1/3) occidental du territoire de
l'île à la France (Price-Mars, 1953/1998a), tout en conservant
l'autre deux tiers (2/3). Selon C. Lespinasse (2020, p. 56), la volonté
de ne pas mélanger ses sujets catholiques aux flibustiers
français de confession protestante était une raison qui poussait
les Espagnols à se séparer des Français dans la signature
de ce traité. C'est le socle fondamental de création de la
frontière entre les deux futures Républiques de l'île.
Alors, il est évident de constater la construction sociale et politique
de cette frontière à partir de ces éléments. En un
mot, les Européens ont créé cette frontière sur
l'île Hispaniola.
Entre-temps, les Espagnols ont bien trouvé des
opportunités plus fructueuses dans les conquêtes minières
des terres sud-américaines qui les font négliger l'île
dominée et exploitée depuis 1492. Il est rapporté que
depuis le dernier quart du XVIe, leur nombre se réduisait
considérablement sur toute l'île. Lequel constat avait
été réalisé par l'anglais Sir Francis Drake, en
planifiant l'attaque et le pillage de Santo Domingo en 1586. Même avec
l'arrivée des premiers noirs d'esclaves en 1503, sous l'insistance du
prêtre catholique Las Casas, l'ensemble ne pouvait donner la
supériorité numérique des occupants pour le compte
d'Espagne. La forte concentration d'immigrés d'Espagne s'accentua en
1506 sous le proconsulat de Nicola Ovando. Cette période montra
l'opulence de la richesse d'or qui coulait à Hispaniola. Peu
versés dans les quelques fermes de culture de manioc, du tabac en
parallèle aux tentatives d'élevage et de la pratique de la coupe
de bois précieux rougeâtres, tels que l'acajou, le campêche,
depuis vers 1530, les Espagnols ne montrèrent plus
d'intérêt pour l'île Hispaniola. Surtout, ils se rendaient
compte de la plus grande difficulté à défricher la partie
occidentale. Défis que les flibustiers français ne tarderont pas
à relever en
90 En 1695, les Espagnols avaient pourtant
lancé une opération qui solda par l'incendie complète de
la bourgade du Cap-Français fondée par des boucaniers et des
flibustiers en 1670. Cf [André-Marcel d'Ans, Haïti : Paysage et
société, Éditions Karthala, Paris, France, 1987,
op.cit., p.118].
86
introduisant d'intenses cultures agricoles dans la partie
occidentale qu'ils s'infiltrèrent à cause de l'alanguissement des
Espagnols.
Mais est-ce que le traité de Ryswick de 1697
définissait-elle une délimitation précise du partage de
territoire de l'île Hispaniola ? Évidemment, la solution dans la
spatialité délimitative ne se résolvait pas avec ce
traité. Il eut fallu la réalisation du traité d'Aranjuez
en 1777, selon Théodat (2008, p. 115), qui accorda une
répartition frontalière en fixant deux contrées distinctes
aux points des embouchures des rivières du Massacre et de Pedernales.
3.3.1.- À partir de l'action de Toussaint
Louverture
Toussaint Louverture, dans ses manoeuvres et tactiques
politiques pour parvenir à l'émancipation des Noirs à la
liberté, n'hésitait pas tantôt de côtoyer les
royalistes du camp espagnol. Par cela, il leur donnait des empiètements
à l'Ouest. Et, lorsqu'arriva la proclamation de Santhonax du 29
août 1793 de l'abolition de l'esclavage par les Français - acte
qui visait surtout à contenir l'effervescence destructrice des masses
esclaves -, Toussaint devient donc républicain en renouant l'alliance
avec les armées françaises. Il permit alors à la partie
occidentale de regagner en territoire avec l'occupation de toute la
région du Nord. La proclamation de la Convention française en
date du 4 février 1794 raffermit davantage la position de
Toussaint91 dans la lutte territoriale. Ces actions politiques de
Toussaint ont grandement joué sur le maniement de la ligne
frontière.
L'intérêt des Espagnols se désengage sans
cesse pour l'île Hispaniola qu'ils abandonnèrent au fur à
mesure que les mines de la grande terre d'Amérique gisaient en
abondance. Voyant au contraire l'intérêt manifesté par les
Français, les Espagnols leur cédèrent la partie orientale
par le traité de Bâle en 1795. Toute l'île appartient
légalement à la France à partir de cette date. Cette phase
est considérée comme un moment de la déshipanisation des
Antilles (Ans, 1987, p. 93).
91 Au début de 1793, la
France entre en guerre contre l'Angleterre et l'Espagne. L'île Hispaniola
en sera un terrain de conflit avec le ralliement des insurgés ayant
à leur tête Jean-Francois, Biassou et Toussaint, dans le camp de
l'Espagne. En ce moment, les français contrôlaient pratiquement
seulement l'espace territorial du Cap. La frontière avec l'Est ne tenait
qu'en ce lieu. Les anglais avancèrent dans le Sud et les Espagnols ont
progressé jusqu'à Fort-Liberté, les mornes du Nord, la
région de Mirebalais et tout près de Port-au-Prince. Toussaint,
lui-même pénètre pour le compte du roi d'Espagne les
milieux du nord-ouest sur Plaisance, Gros-Morne, Terre-Neuve, Acul,
Limbé, Port-Margot et à l'ouest sur les hauteurs de Verrettes, la
Petite Rivière. Il entre aux Gonaïves et s'établit à
Marmelade en tant colonel de l'armée espagnole. A la fin de
l'année 1793, Toussaint se sépare des siens et de la couronne
royale pour rejoindre la République française en se proclamant
général en chef de l'Armée des insurgés. Il attaque
Saint-Raphaël et puis Gonaïves. Ces entreprises ont permis à
la France de reprendre des territoires dans les limites qui ont
été consignées dans l'accord d'Aranjuez en 1777. Les
luttes de Toussaint ont été incisives dans les décisions
des Espagnols avec le traité de Bâle en 1795 (Pluchon, 1989, pp.
83,84).
87
Après la guerre du Sud et la mise en cachot de Rome
à la fin de l'année 1800, Toussaint Louverture a connu une
fulgurante montée. Il devient gouverneur général de la
Colonie de Saint-Domingue qui l'attribue aux fonctions d'administrateur civil
et de chef des armées. Selon Price-Mars (1953/1998b), il est à
remarquer l'opportunisme du génie de Toussaint Louverture qui
conçoit audacieusement le dessein d'unification des parties Ouest et Est
en un tout administratif à partir du 7 février 1801 par la force
des armes et en proclamant la fin de l'esclavage à l'Est. Son
entrée à Santo Domingo a mis aussi fin à la domination du
gouverneur espagnol Joachim Garcia avec ses troupes et les
généraux français Chanlatte et Kerverseau. Alors, il
réalisa effectivement le voeu politique du traité de Bâle
sous son court règne 1800-1802. Aussi la proclamation de la Constitution
de 1801 en fut-elle un socle inébranlable de sa volonté (Etienne,
2020, p. 176). Toussaint Louverture a montré par ses actions la
corrélation directe de la politique intérieure avec les actions
politiques de l'extérieur.
3.3.2.- À l'ère de l'indépendance
d'Haïti
Après la proclamation de l'indépendance
haïtienne en 1804, seule la partie s'étendant entre le cap Tiburon
et la rivière massacre respirait de la liberté. Avec la reddition
de capitulation des troupes expéditionnaires après la bataille de
Vertière en 1803, certains colons et les débris de l'armée
vaincue se rendaient dans la partie de l'Est en considérant l'effet du
traité de Bâle qui leur donnait un quelconque droit sur cette
partie-là. Par cette action, les vaincus de 1803, réactivent une
ligne de frontière. Ils limitent la révolution de 1804 dans la
seule partie occidentale. Comment les héros de l'indépendance
appréciaient-ils une telle situation ? Quelle en fut la meilleure action
à entreprendre ? Entre-temps, l'esclavage se pratiquait à
l'Est.
C'est dans de telle circonstance que l'Empereur Jacques
1er se retrouvait dans l'obligation de faire valoir le droit pour
toute l'île d'être libérée de l'emprise des
débris du vestige de l'armée expéditionnaire
française. Car, il ne saurait question pour lui de penser consolider
l'indépendance haïtienne avec la présence d'une puissance
esclavagiste vaincue en 1803 dans la partie de l'Est. Alors, surgit le principe
de la mer pour frontière. L'île entière forme le territoire
indivisible du peuple d'Haïti ! Mais la résistance du
côté de l'Est s'affirma. Malgré la soumission des habitants
de Santiago de Cabelleros et ceux d'autres villes à la conquête
haïtienne, Dessalines n'arriva pas à pénétrer la
ville de Santo Domingo.
88
Après l'assassinat de l'Empereur, les gouvernements
haïtiens immédiats, en situation de schisme de la partie
occidentale, ont soutenu de manière séparée, toutes les
initiatives des patriotes de l'Est pour arriver à obtenir le
départ des soldats du débris92 de l'armée
française dans la partie de l'Est en date du 9 juillet 1809. Mais, c'est
à l'avènement de Jean-Pierre Boyer à la présidence
que le pays va retrouver la stabilité intérieure
nécessaire qui, par la réunification de la République, lui
permettra d'adresser la question de la partie de l'Est.
Les manoeuvres politiques des patriotes dominicains
emmenés par Nuñez de Caceres ont conduit à proclamer une
indépendance en date du 1er décembre 1821 de
l'Hayti Espaniole, tout en cherchant un rattachement à la
Confédération de la Colombie, à peine d'être
créée en sortant du jouc colonialiste espagnol. Ce jeu politique
consistait à garder une distance à la fois avec l'Espagne et la
République d'Haïti, et par conséquent, garder une
frontière étanche. Mais la situation qui prévalait dans la
partie de l'Est était véritablement fluctuante, des forces
opposées et des coïncidences géopolitiques ont coupé
court au projet de Caceres. Cependant, Boyer usa de toute son habilité
dans la compréhension des enjeux géopolitiques par l'emploi des
facteurs circonstanciels de la stabilité intérieure dans la
partie occidentale, réunifiée sous son administration, pour
canaliser les énergies nécessaires à la
réunification administrative de l'île d'Haïti. Les
méthodes diplomatiques dont Boyer s'employait de manière fine
consistaient à l'ingéniosité de la démonstration
des avantages comparatifs qu'une unification sous l'égide d'Haïti
était la seule solution viable pour l'émancipation des deux
peuples étant donné la conjoncture géopolitique
internationale. L'Espagne était en guerre avec la France et
l'Amérique du Sud jouait son émergence politique. D'autant plus,
dans une grande majorité, les Dominicains manifestaient une faiblesse
certaine d'avoir une puissance extérieure sur qui compter au cas
échéant d'une forte pression des Espagnols.
Alors le Président Boyer essaya de rassurer les
protagonistes de l'Est par tous les moyens qu'Haïti était bien la
solution raisonnable. Devant les tergiversations des divers groupes, d'une
part, Nuñez de Cacerez, croyant la situation répond à une
hypothétique alliance à la confédération de la
Colombie, d'autre part, des groupes moins importants envisageaient
l'alternative de l'unité haïtienne, et le reste dans sa
majorité vivait au gré des évènements. Mais surgit
alors l'épineux point de divergences qui font mugir les remous
historiques entre les deux Républiques. L'entrée
92 C'est un terme cher à Jean
Price Mars qui veut montrer le vestige délabré de l'armée
française vaincue par l'armée indigène victorieuse
à vertière en 1803 à Saint -Domingue.
89
du Chef d'État d'Haïti le 9 février 1822
à Santo Domingo à la tête de son armée sans
hostilité, du moins avec de grandes acclamations,
caractérisait-elle un envahissement ou une réponse à une
sollicitation circonstancielle ?
Bien évidemment, des intérêts du petit
nombre de possédants n'en concordaient pas. Le célèbre
écrivain Jean Price-Mars rapporte qu'il y a lieu de reconnaitre la
conclusion d'une union de raison ou même circonstancielle qui soumettait
le destin des 63,000 habitants de l'Est d'après le dénombrement
de 1820 au plan commun de l'unité de l'île d'Haïti.
D'ailleurs, l'action d'unification de l'île,
conformément à l'article 40 de la Constitution de 1816,
répondait à un impératif de présomption de
l'indépendance et le rejet de l'esclavage qui subsistait encore dans la
partie orientale. C'était dans cette vision de protection de
l'indépendance haïtienne qu'il incombait aux dirigeants
haïtiens de réaliser l'annexion des quatre divisions
administratives : Santo Domingo, Cibao, Azua et Seybo pour rendre la population
une et indivisible sous une même direction qui caractérise la
stratégie de défense contre la menace extérieure de
l'indépendance haïtienne.
3.3.3.-Situation qui découle de
l'indépendance de la République Dominicaine
Alors, se réalisa l'unité politique et
administrative93 sous la présidence de Jean-Pierre Boyer
(1818-1843) qui marqua une domination haïtienne durant 22 ans sur
l'île entière et se termina en 1844 (Price-Mars, 1953/1998b, p.
169). Des tentatives avortées de conquête de l'Est firent le bilan
de nombreux gouvernements haïtiens jusqu'au milieu du 19e
siècle, en précision historique de période gallum
: 1844, 1845, 1849 et 1855. Aussi, Price-Mars (ibid.) en dit-il,
les Haïtiens défendaient leurs prétentions de garder la
gouvernance de l'île entière sous leur domination afin
d'empêcher qu'une puissance étrangère ne s'installât
dans la partie de l'Est et ne menaçât leur indépendance
nationale. Parce que, d'après eux, les Dominicains n'étaient pas
capables de se défendre face à une puissance
étrangère. Mais, les Dominicains n'entendaient plus rester sous
l'obédience haïtienne avec leur indépendance
proclamée depuis 27 février 1844.
Par cette déclaration d'indépendance des
Dominicains, la situation qui se présente aux dirigeants politiques
haïtiens était complexe. Il s'agissait de considérer le
principe de l'unité territoriale indivisible de l'île d'Haïti
et ses îles adjacentes se retrouvant pourtant depuis 1801 dans toutes
les
93 Jean Prince-Mars rapporte que Nuñez de Caceres donnait
le nom `Haïti Espagnole' au nouvel État qui se constitua,
après sa révolution, le 30 novembre 1821.
90
constitutions haïtiennes. Les tentatives
guerrières de reprise de possession ont aggravé les tensions
entre les dirigeants des deux territoires. De la présence des
Haïtiens dans les villes frontalières, notamment à Hinche et
ses environs depuis la campagne de l'Est de Dessalines alla enjoindre la
disposition constitutionnelle de 1874 qui mit en substance, les limites
frontières du territoire aux positions occupées actuellement par
les Haïtiens (Deux siècles de constitutions haïtiennes
18011987, 2011). Donc, la division de l'île s'assuma
péremptoirement avec l'évidence d'une frontière qui
subsista pourtant dans une indétermination des lignes
frontalières. Ce dont un traité en 1935 aura tenté de
résoudre. Mais le massacre des Haïtiens et des Dominicains noirs
habitant la zone frontalière du côté de l'Est en 1937
allait envenimer les tensions dans la cohabitation difficile aux relations
transfrontalières ternes94 propageant en ondes
sinusoïdales entre les deux Nations. Et, d'autant plus récemment,
les évènements de juillet- août 2005 qui ont causé
la mort à treize Haïtiens en République Dominicaine. Sans
oublier la politique systématique de rapatriement d'Haïtiens qui se
conduisit depuis l'été 1991, en application du décret du
13 juin 1991 du Président Balaguer (Alexandre, 2013, pp. 35-88).
L'arrêt TC/0168/13 du Tribunal constitutionnel
dominicain en 2013 enlevant leur nationalité à des milliers de
Dominicains d'origine haïtienne (Gabriel, 2017) et l'exécution en
cours du projet dominicain de construction d'un mur d'une longueur de 164 km
(Le Monde-AFP, 2022), débuté le 20 février 2022 dans la
zone Dajabon (Nord-Ouest) sur la frontière sont parmi d'autres actes
récents qui mettent en évidence, en soubassement, les tensions
historiques qui accablent les relations entre les deux Républiques.
3.4.-Négociation sur la ligne frontalière
Haïti-République Dominicaine
L'île Hispaniola a vécu l'acharnement de la
guerre en 1801 avec Toussaint, et en 1805, Dessalines faisait trembler les
rideaux de Santo Domingo. Puis la redoutable période de
belligérance qu'entretenaient particulièrement les gouvernements
successifs de Rivière Hérard, de Louis Pierrot et de Faustin
Soulouque qui s'étalent de 1844 à 1856, sont des confrontations
qui insinuent la détermination de l'éloignement des puissances
esclavagistes hors des vues dans les parages de Cibao. Le principe de la mer
pour limites frontières devenait un idéal dont n'importe quel
sacrifice n'était épargné pour concrétiser.
94 Jean Price-Mars a justement montré des incidences
diplomatiques que le conflit Haïti-Rép. Dominicaine entre 1844
à 1855 a suscité par des tractations à connotations
raciales mettant aux prises des intérêts géopolitiques que
les puissances européennes et nord américaines exploitaient dans
leurs velléités colonialistes et expansionnistes in La
Rép. D'Haïti et la Rép. Dom, Tome 2.
91
L'avènement de Fabre Nicolas Geffrard à la
présidence en 1859 donna une nouvelle orientation dans l'affirmation des
prétentions haïtiennes en usant des voies diplomatiques pour
corroborer une dynamique de protection de l'indépendance d'Haïti
à travers celle de la République Dominicaine dans toute sa teneur
souveraine, loin de toute influence des puissances esclavagistes. Voilà
qu'en date du 18 mars 1861, à la surprise des Haïtiens, la
réalité marque une réinstallation des Espagnols dans la
partie de l'Est suivant un accord passé entre Pedro Santana,
Président de la République Dominicaine et la cour d'Espagne.
Cette nouvelle donne va marquer un tournant dans la diplomatie haïtienne
qui se résout à compter sur ses forces pour aider à
libérer le territoire dominicain de l'ancienne puissance esclavagiste :
Espagne.
Les efforts diplomatiques du Président Geffrard pour
la restauration de l'indépendance de la Dominicanie restent une page non
valorisée par les études sur les relations entre Haïti et la
République Dominicaine, surtout par les idéologues racistes
dominicains. Depuis l'affaire Rubalcava en juillet 1861 Haïti montra sa
force décisive dans un nouveau rôle. Dans ses correspondances
diplomatiques, la partie haïtienne usa de toutes ses adresses politiques
pour délimiter le territoire. Bref, les villes de Hinche, Lascahobas et
Saint Raphael, occupées par les Haïtiens sont l'objet de
précieux acquis que Fabre Nicolas Geffrard rejette de toutes quelconques
prétentions. La recherche d'une délimitation de la
frontière est commissionnée par la diligence haïtienne au
cours de 1862.
Le problème de la ligne de frontière demeure
désormais un trait extraordinairement sensible dans les relations entre
les deux Républiques. Des tensions répétées
à divers endroits dans la frontière charrient la fragilité
de la question. Entre-temps, des pourparlers en vue d'apporter une
résolution pacifique à la question de délimitation de la
frontière ont fait l'objet d'accord sous le Président Michel
Domingue (1874-1876) et le vis-à-vis dominicain Ignacio Gonzales en 1874
et de même qu'entre Tirésias Simon Sam (1896-1902) et Ulisses
Heureaux en 1898. Mais il en résulta des échecs. (Castor,
1988/2021).
L'évolution des négociations poussa en vain
à la sollicitation de l'arbitrage du Pape Léon XIII à la
fin du XIXe siècle. La commission mixte formée en 1901 à
cet effet se solda aussi en échec. Le noeud gordien de la tracée
de la frontière butte assez souvent sur le fait qu'il y a les
données du dernier traité de partage d'Aranjuez de 1777, celles
du statu quo post bellum de 1856 et celles de l'occupation
pacifique.
92
Devant l'avantage que chacune de parties prétend
vouloir tirer à l'une ou l'autre de ces données, il parait
évident de déduire l'enjeu que recèlent de telles
négociations. Une deuxième division d'information militaire des
États-Unis a opéré une solution de délimitation en
1907 et 1908. À la résurgence de la question frontalière
en 1912, Haïti a sollicité la médiation de la puissance
nord-américaine qui a proposé provisoirement une solution
délimitative pour rester en attente d'une résolution
définitive. Venait en date du 21 janvier 1929 un accord signé
entre Haïti et la République Dominicaine sous l'encouragement des
États-Unis suivant les arrangements conclus en 1924. En ce sens, les
Présidents Louis Borno (1922-1930) et Horacio Vasquez s'entendaient
à trancher définitivement la question de la tracée de la
frontière.
La réalité de l'arrangement fait qu'Haïti
devait céder au Nord, une portion de terre à Monte Cristi et la
région d'Azua, en échange, dans le Sud, il lui revenait
près de 200 mètres de terres destinées à construire
une route à son propre compte. Très vite, l'opinion publique
haïtienne dénonçait et rejetait avec fracas les propositions
de cet accord qui était très défavorable à
Haïti. La multiplication de graves altercations et d'incidents sur toute
la ligne frontalière indiquait l'acuité et l'insatisfaction du
côté des Haïtiens.
C'est ainsi qu'à partir de mai 1931, des
négociations diplomatiques se sont reprises en vue de résoudre la
question de la démarcation de la ligne de frontière dans l'esprit
de révision de l'accord de 1929. En effet, un traité fut
signé le 27 février 1935. Mais l'agissement de Trujillo pour
forcer un nouvel accord en date du 9 mars 1936 démontre le ravissement
des droits de propriété retrouvés par les Haïtiens en
situation de possession avant l'accord de 1929.
L'auteure Castor (1988/2021) tenait à faire remarquer
que chacune des deux Républiques de l'île développe une
urgence propre au traitement de la délimitation de son territoire. Au
début du XIXe siècle, les gouvernements haïtiens utilisaient
la question de l'Est pour répondre à des motifs
stratégique, militaire et économique. La consolidation de
l'indépendance prévalait dans tout engagement y relatif.
Après cette phase, les autres gouvernements attisaient aux aspirations
expansionnistes en ralliant la partie de l'Est à la République
d'Haïti. Mais, en général, la question de la
délimitation de la frontière du territoire national n'a jamais
fait l'objet d'intérêt supérieur pour les gouvernements
haïtiens ni pour la population dans sa majorité. En dehors de la
fréquentation de la zone frontalière, l'influence dominicaine
n'était aucunement perçue dans sa tendance dominante. C'est ainsi
qu'il est généralement reproché à Haïti de
montrer plus d'attention aux nations lointaines qu'à la
République Dominicaine. L'intérêt pour la République
Dominicaine
93
demeurait toujours insignifiant pour Haïti. Par contre,
les Dominicains ont très tôt essayé par tous les moyens de
forger une idéologie prouvant la menace que constitue Haïti pour
leur nation. L'anti-haïtianisme devient donc une doctrine d'identification
pour eux. Cette tendance est fortement exprimée avec l'arrêt TC :
0168/13 de la Cour constitutionnelle pris en date du 23 septembre 2013.
3.5.-Considération sur l'évolution
hégémonique de la Dominicainie par rapport à
Haïti
Un retournement de la perspective frontalière
s'opère de nos jours dans la relation entre les deux pays. Des points
frontaliers attirent considérablement des activités
d'échanges commerciaux. Les centres ruraux les plus proches de la
frontière gagnent en importance dans la dynamique d'attractivité.
En particulier, la localité de Boc Banic est devenue une plaque
tournante pour la 2e Section Lociane dans les échanges avec la Commune
dominicaine de Banica. Le géographe Théodat (2020, p. 81)
considère que cette ligne est inachevée, mais participe
grandement dans le découlement librement de certains produits les mieux
achalandés sur le marché dominicain tels que le pois congo, la
pintade, le cabri, l'avocat. Du côté dominicain, en
général, nous nous procurons de tous les produits agricoles qui
sont devenus rares, des blocs pour les parois dans la construction, le ciment,
les barres d'acier, les produits alimentaires, les poulets, et autres.
La monnaie d'échange exigée par les Dominicains
est le peso dominicain qui prend des points sur la gourde. L'économie
dominicaine dispose de plus grands moyens de production qui
caractérisent sa force dans les termes des échanges et
prééminence de l'offre et la demande. La République
d'Haïti est justement placée en troisième position de
partenaire économique des Dominicains après les États-Unis
et le Porto-Rico. L'avantage de proximité de transport de marchandises
est atout majeur. Le volume des échanges est propre à chaque
région. Dans le Nord par Dajabon, rapporte Théodat (2020), on
enregistre pour l'année 2006, 62.33 millions de dollars américain
par an (M $/an), au Centre via Elias Pina, 23.42 M $, au Sud Independencia et
Pedernales font respectivement 48.17 M $ et 5.09 M $. L'importance des
activités commerciales transfrontalières tend à faire
augmenter le flux de population dans ces régions qui voient une
croissance dans la densité de population au kilomètre
carré.
Le progrès enregistré sur les plans politiques
et économiques conforte un bond vers une économie en voie de
développement pour la République Dominicaine. Cette situation est
exploitée à certains égards pour essayer d'asseoir une
position hégémonique par rapport à Haïti. Pour
illustrer cette assertion, il s'avère important d'établir une
comparaison de l'évolution économique des deux pays
94
à partir de 1960. Alors, selon Théodat
(ibid.), ils avaient le même PIB/hab. : 800 $/an. Les
composantes de l'IDH démontrent une relative équilibre avec
l'espérance de vie 44 ans en Haïti et 54 en République
Dominicaine ; la mortalité infantile : 253/1000 en Haïti contre
149/1000 en République Dominicaine et la population en dessus de 15 ans
relevait un taux d'analphabétisme de 33% contre 78% en Haïti. Mais
les orientations différentes des politiques publiques qui s'ensuivront
entre-temps expliquent les écarts dans l'IDH 95 qu'ils
connaissent de nos jours en signe de réussite de la République
Dominicaine dans les domaines de l'éducation, de la santé
publique et de l'économie.
Au tournant des années 1980, une transformation de
l'économie d'exportation de matières premières s'est
opérée pour embrasser une filière de substitution à
l'importation. Ces mesures rendent plus d'autonomie au pays par rapport au
marché mondial. En outre, il y a eu l'adoption d'une législation
amplement incitative aux flux de capitaux étrangers pour dynamiser
d'autres secteurs d'investissements productifs : le tourisme et les zones
franches.
En août 1994, la classe politique dominicaine a
signé un accord politique96 pour permettre au pays de jouir
d'une certaine stabilité politique qui va grandement favoriser l'essor
économique qui s'enchevêtre à la tendance
hégémonique que la posture trujilliste échafaudait
à divers égards. Aussi Corten (2013, p. 19) précise-t-il
qu'à partir de 2011 la République Dominicaine a pris le large
dans la course pour un développement économique
considérable par rapport à Haïti.
Avec l'emploi créé dans les villes
industrielles, l'urbanisation s'accentue. L'agriculture irriguée,
bénéficie des investissements en équipements
mécanisés pour augmenter le rendement de la terre et accroitre la
production du pays tandis que la part de la main-d'oeuvre y diminue. En 2005,
le PIB de la République Dominicaine provenait de 56% des services, 32%
de l'industrie et de 12% de l'agriculture. Tandis que cinq ans plus tard, les
données montraient qu'en Haïti le PIB provenait des pôles
d'emplois de services et industriels absorbant 43% en service et 13 % en
industrie de la population active de 3.6 millions d'habitant suivant les
données de l'IHSI en 2010. Et face à cela, il y avait 44% de la
population active qui s'adonnait à l'agriculture de subsistance. Avec
une période de cinq (5) ans d'écart, il n'est pas
théoriquement crédible pour asseoir une comparaison
95 L'indice de développement humain, allant de
0 à 1, est un indice composé de l'espérance de vie
à la naissance, la scolarisation en fonction du taux
d'analphabétisme et le pib per capita en tenant compte de la
parité du pouvoir d'achat. En 2019, Haïti avait un idh de 0.510
contre 0.756 pour la République Dominicaine. Cf [
www.
perspective.usherbrooke.ca].
96 Les turbulences politiques qui ont survenue après des
élections frauduleuses pour reconduire le président Joaquin
Balaguer au pouvoir au détriment de Francisco Pena Gomez ont
poussé l'OEA et l'Eglise catholique dominicaine à jouer un
rôle de médiation pour parvenir à un accord politique en
date du 12 août 1994 en République dominicaine. Cf «
République dominicaine le mandat du président Balaguer est
écourté », en ligne publication 12 août 1994,
www.lemonde.fr.
95
objective. Mais, étant donné que la situation
devrait donner l'avantage à Haïti pour améliorer son score
et elle ne l'a pas fait. Parce qu'un taux aussi élevé de
population qui se retrouve dans le secteur agricole rend difficile le parcours
au développement. Une économie productive moderne n'a pas besoin
d'un tel pourcentage de sa population active dans l'agriculture de subsistance
qui fournit généralement des produits à très faible
valeur ajoutée.
La République Dominicaine profite encore de sa
position pour définir les règles dans les échanges
commerciaux avec Haïti, parce qu'il n'y a pas d'accord récent de
libre-échange entre les deux pays. Le traité réglant
principalement ce domaine remonte à novembre 1874. Il stipule en son
article 14 que « les citoyens des deux nations contractantes peuvent
entrer, demeurer, s'établir ou résider dans toutes les parties
des deux territoires, et ceux qui désirent s'y livrer à une
industrie quelconque, auront droit d'exercer librement leur profession et leur
industrie, sans être assujettis à des droits autres ni plus
élevés que ceux qui pèsent sur les nationaux
respectifs... » (C. Lespinasse, 2020, p. 72). Par ailleurs, Castor
(1988/2021, pp. 157,158) révèle un traité commercial
signé en août 1941 par les deux pays. Mais cependant, le commerce
qui datait depuis l'époque coloniale se renforçait entre les deux
parties de l'île peu après 1867. À considérer que
les exportations des deux pays l'un vis-à-vis de l'autre accusent 1
milliard $ USD pour la République Dominicaine contre 100 millions $ USD
pour Haïti en 2005 démontrent clairement le
déséquilibre énorme qui s'installe dans les termes des
échanges. La croissance non contrôlée du volume
d'échanges informels présuppose bien des montants plus
élevés comparativement à ceux-ci.
3.6.-Systématisation de la discrimination raciale
à l'égard de l'Haïtien
L'auteur Etienne (2020) soutient que des mythes
d'identification existentielle d'un ennemi réel ou imaginaire participe
à bien des égards à la construction de
l'État-Nation (p. 179). Les réactionnaires dominicains se sont
convaincus à faire d'Haïti un ennemi fictif et/ou réel en
contre-façonnant des faits historiques dans les rapports relatifs
à l'évolution des deux parties de l'île. Optant à
s'assimiler le fonds culturel de l'occident et de l'Espagne, en particulier les
élites dominicaines ont pu s'imaginer plus proches des valeurs
occidentales qui comportent, de fait, des préjugés de toutes
sortes. Et les habitants des zones frontalières qui côtoient les
centres de services publics chez les Dominicains évoquent amplement des
traitements humiliants qu'ils subissent.
Ce qui permet de voir l'approche de classes sociales dans les
rapports entre les dirigeants des deux États. Parce qu'il y a un
complexe de supériorité que Castor (1988/2021)
décèle dans certains
96
aspects qui déterminent l'attitude et le comportement
réactifs de la République Dominicaine après la
période de domination haïtienne. Les autorités de la partie
de l'Est essayent de tirer avantage sur le plan de la réussite
économique et géopolitique. Les Dominicains ont pris grandement
conscience du favoritisme racial (Diamond, 2006) qu'ils ont
bénéficié des puissances esclavagistes depuis le
XIXe siècle. Puisque l'Occident aurait toujours
considéré Haïti comme une classe d'esclave parvenue à
la liberté. C'est un fait que Price-Mars (1953/1998a) a beau
démontrer l'irrationalité de telles considérations de
supériorité raciale puisque la structure épidermique ne
saurait constituer une prédominance raciale en ce cas-ci. Le
mélange d'Européens avec les femelles naturelles de l'île
ajouté à la faible quantité de Noir esclave ne saurait se
considérer de la race blanche pleine de futiles prétentions
inimaginables d'une quelconque supériorité telle qu'elle a
été véhiculée au XIXe siècle et
subtilement ainsi jusqu'à nos jours. En 1788, la partie de l'Est
dénombrait 125,000 habitants dont 15,000 esclaves noirs. Cette
donnée illustre bien évidemment l'infirmité de
possibilités pour les bronzés d'ébène de
prédominer dans de telles structures de classes sociales.
Aussi, Mézilas (2022) fustige-t-il les
idéologues dominicains qui se donnent une raison
hégémonique en portant une prédominance qui converge des
idéologies : hispanité, indianité et anti-haïtianisme
(p. 10).
Pour sa part, Wooding (2020, pp. 136,137) a manifesté
un grand intérêt à analyser le caractère raciste,
xénophobe dans l'attitude des Dominicains envers les Haïtiens que
le régime de Trujillo (1930-1961) s'acharnait à répandre
avec virulence dans toutes les couches de la société. Bien
évidemment, elle reconnait que ce sentiment existait bien avant la
période de Trujillo et cela continue encore de nos jours mais pas dans
de telle proportion. Aujourd'hui, il y a une ignorance et des
préjugés qui sont très répandus dans des couches
extrémistes qui s'en servent à des fins politiques. Entre-temps,
reconnait le diplomate et sociologue Alexandre(2009), beaucoup d'efforts sont
consentis pour redonner une autre image dans les rapports entre les deux pays.
Nous avons trouvé un geste magnanime dans le dévouement des
Dominicains pour secourir Haïti après le séisme du 12
janvier 2010. De même, nous admettons énorme la contribution des
Dominicains à hauteur de 50 millions de dollars américains comme
donation97 pour la construction faite par leur propre firme, dans le
Nord, en 2012, de l'immeuble universitaire dénommé Campus
Henry
97 RadioTélévision 2000 a rapporté ces
faits dans son article intitulé « Haïti/Education :
République dominicaine finance la construction d'une université
dans le Nord » |En ligne publication du 2/08/2010, page consultée
le 14/03/2023.
97
Christophe de Limonade. Mais dans la complexité de
relations entre les deux pays nous ne pouvons pas tout ignorer pour nous verser
dans l'admiration des gestes de la Dominicanie. En cela, quand nous regardons
avec Elie (2020, p. 61) l'orgueil qui caractérisa la fierté du
roi Henri Christophe, bâtisseur par excellence par la réalisation
de la Citadelle LaFerrière, huitième merveille du monde, il y a
lieu d'imaginer l'arrière-pensée qui cristallise les gestes des
Dominicains. Nous pouvons facilement supposer l'avantage géopolitique et
économique qu'ils peuvent en tirer. L'idée de soupçon
d'une certaine condescendance dans ces gestes serait-elle
exagérée ? Autrement dit, serait-ce une attaque voilée
à la fierté du peuple haïtien dans l'imaginaire
héroïque de ses ancêtres ? Le sentiment anti-haïtianiste
est un outil que les dirigeants dominicains utilisent aussi pour marquer leur
différence dans la perception de l'intérêt
général et dans la gestion de l'espace territorial. Cela
s'explique dans les réalisations d'infrastructures qui se font chez eux
et le souci qu'ils manifestent pour tenir la stabilité politique. Cette
différence de gestion se fait ressentir dans les villes
frontalières. Par exemple, Banica est une Commune qui caractérise
des différences majeures en termes d'infrastructures par rapport
à la Commune de Thomassique. En particulier, les paysans de la
2e Section Lociane qui fréquentent souvent des villes
frontalières s'indignent de l'inertie des actions des dirigeants
haïtiens. Il se trouve que la plupart des gouvernants haïtiens ne se
montrent pas autant soucieux que ceux de la Dominicanie.
3.7.-Regard sur les Puissances internationales dans
les relations entre Haïti et la République Dominicaine
Il n'est pas trop évident de reprendre ici les faits
qui démontrent les résistances que la diplomatie haïtienne a
dû engager face aux pressions des puissances internationales qui n'ont
jamais voulu accepter les prescriptions constitutionnelles haïtiennes qui
l'ont conféré droit de propriété sur toute
l'étendue de l'île jusqu'en 1874, hormis la Constitution de 1801
de Saint-Domingue. L'occupation américaine de 1915 assignait la part
d'Haïti à l'accomplissement des fondements de la division
internationale du travail qui trouvait sa base dans la théorie des
avantages comparatifs (1817) développée sur le commerce
international98. Dans ce contexte, Haïti est définie
à fournir de la
98La théorie des avantages comparatifs de
l'économiste britannique David Ricardo (1772-1823) se précise
ainsi : les pays participent dans le commerce international pour deux raisons
fondamentales ; chaque raison contribue aux gains qu'ils retirent de
l'échange. Les différences des pays diversifient leurs apports de
biens et services. Ce qui peut les faire bénéficier de leur
différence c'est l'accord que se dégage que chacun se consacre
à ce qu'il fait relativement le mieux. 2) Les pays entretiennent le
commerce international en raison d'engranger des économies
d'échelle de production. En effet, si chaque pays produit seulement un
registre limité de biens, il produira chacun de ceux-ci à une
échelle plus grande-et donc de manière plus efficiente-que s'il
essayait de les produire tous. Chaque pays peut se spécialiser dans le
bien dans lequel il a un avantage comparatif. Un pays possède un
avantage comparatif dans la production d'un bien si le coût
d'opportunité de cette production exprimé en termes d'autres
biens est inférieur
98
main-d'oeuvre à bas prix dans les entreprises
multinationales à capitaux nord-américains implantées dans
le bassin caribéen, notamment à Cuba et en République
Dominicaine. L'économie de cette dernière a toujours jouit d'un
intérêt plus alléchant pour le système capitaliste.
Depuis la période conflictuelle de 1844 à 1856 qui opposa
Haïti et la République Dominicaine, les puissances
européennes et les États-Unis d'Amérique ont toujours
manifesté un favoritisme à l'égard de la République
Dominicaine. Plusieurs raisons peuvent expliquer leurs choix. Mais un fait est
certain, les préjugés raciaux et ethniques qui
caractérisaient le système esclavagiste et colonialiste n'ont
point été cessés envers Haïti après la
Révolution de 1804.
L'investissement des capitaux étrangers implanté
en République Dominicaine a toujours été plus
conséquent en termes de grandeur qu'en Haïti. Bien entendu, il
n'est pas crédible de reposer une analyse sur ce fait pour accuser tous
les maux que connait Haïti dans ses relations avec la République
Dominicaine. Mais cependant l'élan de favoritisme 99 que
jouit la République Dominicaine a occasionné une prise de
conscience des facteurs raciaux qu'ils prétendent
bénéficier et s'en servent pour évoquer un sentiment
pro-occidental à même d'en tirer un pressentiment dominant.
Dans le même dessein, nous considérons que la
question de la construction de l'Université roi Henri Christophe ayant
été confiée aux firmes dominicaines pour en faire don
à Haïti constitue un acte très significatif de la grandeur
paternaliste. La communauté internationale les encourage ou les force
ainsi à démontrer leur qualité exemplaire vis-à-vis
des Haïtiens. Que dire des déclarations des Présidents
Dominicains depuis Leonel Fernandez à Luis Abinader qui n'ont jamais
raté des occasions que leur ont offertes des tribunes internationales
pour faire des sollicitations d'aide pour Haïti contre sa descente aux
enfers ! D'ailleurs, ce peuple se perd dans son insouciance pour de ne voir la
récupération de la possession du patrimoine culturelle et
historique de l'île d'Haïti que les Dominicains s'attribuent depuis
un certain temps. Alors que l'Haïtien sait bien qu'ils l'identifient
à un peuple d'une nation d'ennemis. Lamothe (2008, p. 48)
détecte aussi dans la caraïbe, une opinion qui reconnait que les
Dominicains assimilent leur identité à une expression de
l'anti-haïtianisme. Certainement, Price-Mars (1953/1998b) n'eut cesse de
démonter les contre-vérités
dans ce pays-là à ce qu'il est dans d'autres
pays. Le commerce international entre deux pays peut être
bénéfique pour les deux pays si chaque pays exporte les biens
pour lesquels il possède un avantage comparatif. Cf [Paul R. Krugman et
Maurice Obstfeld, Economie internationale, 3e, Editions De
Boeck Université, Bruxelles, Belgique, 2001, pp 14-15].
99 Le géographe Jared Diamond reconnait le fait que
des préjugés raciaux aient toujours guidé la
communauté internationale à privilégier les rapports de
préférence avec la République Dominicaine au lieu de la
République d'Haïti.
99
historiques et sociologiques sur lesquelles
s'appuyèrent les idéologues racistes dominicains pour attiser la
xénophobie et l'ostracisme envers Haïti. La déraison des
groupes extrémistes dominicains est inquiétante et se manifeste
au vu et au su de tout le monde.
Mais la communauté internationale a ses
préférences même si ce sont ses intérêts qui
la préoccupent avant tout dans les affaires internationales. C'est ainsi
que le tout-puissant de cette communauté internationale a toujours tenu
la main pour s'assurer de la compagnie des groupes de Droite au pouvoir en
Haïti. Ces tenants n'ont jamais fait preuve d'aucune sensibilité
pour soulever les questions d'équité dans les rapports entre
l'international avec la République Dominicaine et Haïti. L'histoire
rapporte le tollé des agitations des courants de la Gauche de
Port-au-Prince depuis après 1937 qui insistaient sur la
nécessité de redéfinir les rapports entre les deux
pays.
À chaque moment de graves incidents dans les relations
entre les deux Républiques de l'île, les groupes de Droite qui ont
pratiquement toujours gardé le pouvoir sous protection des
États-Unis n'ont jamais rien fait d'autre que de se soumettre, d'une
part, au diktat du Département d'État qui leur imposait
toujours de conclure coûte que coûte des accords avec les
Dominicains. Raison est que les intérêts économiques des
États-Unis sont énormes en République Dominicaine (Alexis,
1955, p. 157), il n'y a pas lieu de laisser des conflits avec Haïti
viennent salir la réputation de la République Dominicaine pour ne
pas attirer les foudres de l'opinion internationale et, en particulier,
l'opinion américaine. Et d'autre part, les dirigeants haïtiens se
courbent souvent devant les autorités de Santo Domingo pour
bénéficier de leur support en vue de contenir les actions
subversives des opposants haïtiens opérant depuis le territoire
voisin.
Pour preuve, nous reprenons l'issue des protestations
haïtiennes sur la tragédie exterminatrice des gens de couleurs en
1937 par le régime naziste de l'impitoyable Trujillo. Le
Président Sténio Vincent(1930-1941), prototype parfait des
inconditionnels fonctionnaires de la défense des intérêts
du système capitaliste néo-féodal en application en
Haïti, n'eut aucune gêne pour conclure un accord avec les
Dominicains en ramenant les négociations au niveau bilatéral.
Lamothe (2008, p. 48) rapporte les termes du contrat signé en date du 14
octobre 1978 par le Président Jean-Claude Duvalier(1971-1986) et le CEA
sous le gouvernement dominicain Antonio Guzman Fernandez, pour la
zafra100 de 1978-79 qui consistait à embaucher des
travailleurs paysans haïtiens pour aller
100 C'est le terme qui désigne la période de la
récolte de la canne à sucre dans les pays hispaniques de la
région caribéenne.
100
travailler- au prix de 0.5 $/jour- dans les
batey101 en République Dominicaine comme coupeur de
canne102. Après l'Arrêt TC 0168/13 qui mettait toute
l'opinion internationale dans un élan de fraternité envers les
Haïtiens pour pointer le caractère raciste des autorités
dominicaines, le gouvernement haïtien n'a pas eu le courage pour
capitaliser sur la conjoncture favorable de l'opinion internationale et
nationale, le Président Michel J. Martelly (2011-2016) et le Premier
ministre Laurent S. Lamothe ont pris la tangente dans des négociations
bilatérales avec le gouvernement dominicain. Dans toutes ces situations,
ce sont les consignes des États-Unis qui orientent les dirigeants
haïtiens dans la recherche de normalité dans la relation entre les
deux Républiques. Les relations internationales exigent une politique
intérieure qui cristallise la bonne combinaison des facteurs de
production de biens économiques.
3.7.1.-Insouciance des autorités
haïtiennes vis-à-vis de la frontière
L'histoire de la frontière Haïti -
République Dominicaine reste et demeure une notion encore non assez
étudiée pour pouvoir apporter toutes les lumières sur
toutes les facettes des évènements qui se sont produits dans
cette unité phénoménale depuis le traité de Ryswick
en 1697. Les zones frontalières sont les premiers endroits à
subir l'influence grandissante de la République Dominicaine qui exploite
toutes les occasions qui lui sont offertes par la gestion insouciante de
l'administration de l'État en Haïti. La dynamique de
l'évolution dans la société haïtienne exige de
nouvelles analyses dans les rapports avec la République Dominicaine. Les
paysans haïtiens de la 2e Section Lociane se retrouvent donc à la
croisée des chemins d'une situation de survie et d'indignation dans les
rapports des échanges commerciaux avec la partie dominicaine de la
frontalière vis-à-vis de la leur. Le côté
haïtien ne fait l'objet de gestion pouvant conduire à faciliter son
développement.
De toute évidence, il faut créer un cadre
normatif qui propose des moyens pour trancher sur les actions favorables
à entreprendre pour arriver à remonter la pente qui se dresse
dans la gestion irresponsable de l'espace territorial, en particulier l'espace
frontalier de la 2e Section Lociane. Au
101 C'est l'expression espagnole qui désigne les
milieux extrêmement précaires où demeurent les travailleurs
de la canne à sucre en République Dominicaine depuis la fin du
19e siècle. En 2014, il y avait 425 bateys qui
hébergeaient plus de 200000 personnes. Cf [Inès Da Gracia Gasper
« le batey en République Dominicaine : espace présent d'un
temps passé »| en ligne, publication du 1/12/2019, https :
doi.org/10.400/etudescaribeennes.17582].
102 Nous signalons que ces genres de contrat entrent dans une
routine depuis après l'occupation américaine. Gérard
Pierre Charles mentionne un accord signé le 20 janvier 1967 entre
Balaguer et Duvalier pour envoyer 20 mille travailleurs haïtiens dans les
Bateys au cours de l'année. Cf [Pierre-Charles, Gérard,
Radiographie d'une dictature. Haïti et Duvalier, Éditions de
l'Université d'État d'Haïti, P-au-P, 2013, op. cit., p
206].
101
devoir de changer la donne, l'amélioration des
conditions socio-économiques des paysans de la 2e Section Lociane est un
défi qui s'impose, entre autres, aux Haïtiens et
particulièrement aux agents locaux avec la participation des paysans de
Lociane.
Dans toutes les approches abordant la notion de
frontière, il y a une dimension de gestion qui se fait de l'espace
frontalier par rapport à la réalité des conditions
socio-économiques des habitants qui y évoluent. À propos,
la présente étude a essayé aussi de faire ressortir
l'apport des pays occidentaux dans la détermination d'une trajectoire
plus faste pour la partie de l'Est. Mais, il va s'en dire que les dirigeants de
l'autre côté ont, tout de même, su faire preuve de plus de
perspicacité dans la définition d'un idéal commun dans
l'intérêt national.
Le rôle de l'État dans l'aménagement du
territoire en termes de développement est prépondérant.
Ses interventions sont nécessaires afin d'établir des conditions
de vie suffisamment adéquates par l'offre de services de base aux
habitants de n'importe quel espace du territoire. La zone frontalière
présente un haut niveau d'intérêt stratégique de
sécurité et de coopération qui requiert la disposition
d'un équipage technique bien rôdé pour le contrôle.
Pour cela, la contribution des autorités locales dans la gestion directe
des espaces frontaliers est généralement essentielle. Tout ce
dont, la compréhension de certaines études enseigne la
viabilité de réussite possible dans une option dynamique de
décentralisation effective.
C'est pourquoi le prochain chapitre se penche sur la question
de la décentralisation où se réalise le transfert de
compétences de l'État à une entité juridique
distincte de lui (Jean-Charles, 2002). L'État central se cantonne alors
dans ses attributions formelles. Les collectivités territoriales peuvent
jouir d'une sorte d'autonomie organique et financière dont
l'effectivité est la finitude de la décentralisation.
102
Chapitre IV. Décentralisation et organisation des
collectivités territoriales
Ici, la perspective d'analyse met en exergue surtout la
question de l'État dans un dynamisme de décentralisation.
À cet égard, la nation haïtienne est confrontée
à un dilemme qui permet soit, dans une simplicité non viable, de
rester accrocher au bon office de la communauté internationale, ou soit,
dans un esprit combattif, de mobiliser ses ressources en priorisant ses
intérêts pour reconquérir l'essence de
l'indépendance nationale. Ce combat, s'il est engagé, est
fonction du respect de l'application du minimum consensus qui s'établit
fondamentalement dans la Constitution de 1987 et sur certains aspects
socio-anthropologiques des valeurs traditionnelles de la société
haïtienne.
Par cette indépendance, il s'agira de pouvoir disposer
de la latitude de définir des politiques103 publiques qui,
ressortant des plans : politique, économique et social, concernent les
entreprises publiques, la production nationale, l'agriculture, la
réforme agraire, etc. Ainsi, une des principales démarches
revient à disposer des connaissances réelles et approfondies des
mécanismes de fonctionnement de notre économie, des ressorts
profonds de la société et des sources de son dynamisme. Ce
faisant, le but se détermine dans la définition des
priorités dans les choix de politique économique (F. Deshommes,
2005).
Aussi convient-il de disposer des allocations
budgétaires nécessaires par rapport au processus de
développement. Ce qui exige des facteurs préalables de
planification en matière de politiques publiques qui doivent soutenir un
effort programmé d'action visée au mécanisme de production
de développement des ressources humaines, d'infrastructures
routières et de services de bases qui participent dans la ligne
d'intérêts généraux de l'État et des
collectivités territoriales dans leurs intérêts locaux. Ces
actions programmées sont donc vouées à conduire à
une économie qui renoue avec la croissance positive. Mais, cette
croissance doit être bénéfique pour toutes les couches
sociales. Et, l'une des voies privilégiées par la Constitution de
1987 pour arriver à acheminer les signaux de progrès
économique dans tous les coins du pays est la bonne gouvernance. Cette
dernière peut être effectuée dans le cadre de la
décentralisation qui est un choix structurel de changement de politique
administrative accordant de l'autonomie aux collectivités territoriales.
En ce sens, elle entame la décentralisation politique qui est une
dévolution de compétence limitée à
103 Nous entendons par politique publique toutes les
décisions politiques qui accordent des priorités à des
objectifs qui s'intéressent à certains enjeux fondamentaux
théoriques et pratiques pour le développement de la
communauté en question.
103
l'intérieur des frontières géographiques.
Les collectivités territoriales sont l'émanation de l'article 61
de la Constitution de 1987 qui leur confère des compétences en
qualité d'institutions locales autonomes jouissant de
personnalité juridique et des ressources propres en vue d'administrer
leurs affaires locales sous l'égide de l'État unitaire (Privert,
2006). Les autorités locales sont élues par la population de la
circonscription géographique pour assurer la gestion des affaires
collectives y relatives.
À la considération d'un besoin de
décentralisation de l'État, il parait évident qu'il y a
une relation de transitivité entre la décentralisation et le
développement local (Deberre, 2007). La décentralisation est ce
partage de responsabilité que l'État unitaire centralisé
consent de manière dévolutive aux collectivités
territoriales qui s'engagent à gérer en toute autonomie leurs
propres ressources en vue de mener des actions de développement
économique pour leurs populations. La décentralisation de
l'État à travers des collectivités territoriales est un
acte significatif qui engage deux entités.
L'État central transfert des pouvoirs aux
autorités locales et garde ses prérogatives de contrôle.
Les autorités locales accusent des responsabilités de gestion qui
les habilitent à concevoir de véritables politiques publiques
pour le développement de leur communauté dans le respect des
intérêts généraux de l'État. Chaque concept
sera développé de manière séparée dans
toutes ses dimensions théoriques.
Léger (2000, p. 87) précise que la
décentralisation est un projet de société qui
réunit tous les acteurs : nationaux, régionaux et locaux. Un
partage proportionnel de responsabilités s'y opère dans la
gestion publique des domaines relatifs au développement. Le but
essentiel renvoie à l'emploi adéquat et rationnel de moyens pour
satisfaire des besoins.
Cette assertion démontre le caractère purement
économique de la décentralisation, celle de l'homo-oeconomicus.
Or il n'y a pas de frontière étanche entre l'économique et
le social. Dans ce sens, Azoulay (2002) précise que : «
l'amélioration des conditions matérielles d'existence des
personnes impose finalement le fondement de l'économique et cette
amélioration est comme le tissu nerveux dans la biologie humaine pour la
notion de développement.»(p. 26).
104
4. 1.-Rappel historique du fondement de la
décentralisation en Haïti
Ce concept est largement développé par la
Constitution de 1987 qui en fait une option structurelle de
développement par excellence. Mais en réalité, il y a
diverses dispositions légales attestant les idées de la
décentralisation en prélude de cette Constitution. En effet, deux
courants disputent le fondement des idées de la décentralisation
dans ses parcours historiques. L'un détecte son immixtion dans notre
législation depuis la création de la Commune en 1816 dont la
subdivision de l'Arrondissement en Commune104 dispose d'un
représentant de la Commune dans une chambre de communes et un chef
tenant lieu dans le département, et, l'autre en décrit sa
prépondérance fonctionnelle avec la Constitution de 1843. La
charge des écoles primaires est confiée aux Communes et aux
villes celle des écoles supérieures105. En outre,
d'autres responsabilités à la fois civiles et financières
sont attribuées à un projet comme chef d'administration (conseil
d'arrondissement) et un maire de la Commune. Il est créé depuis
lors le principe d'autonomie des collectivités territoriales. Mais en
réalité, aucun effort concret n'a été engagé
dans un processus d'implémentation de la décentralisation.
Contrairement à la France qui a dû affronter les
difficultés de la centralisation à outrance pour commencer avec,
d'abord des programmes d'aménagement du territoire, puis la
décentralisation au cours des années 1960. C'est au cours des
années 1980 qu'Haïti a timidement commencé à pencher
sur la solution de la décentralisation pour permettre aux
collectivités territoriales de contribuer à la gestion de
l'espace territorial.
4.1.1.-Fondement légal de la
décentralisation en Haïti
L'idée de la décentralisation a traversé
la société haïtienne depuis le XIXe
siècle. Elle a laissé des traces vivaces avec plusieurs lois et
décrets qui ont consacré des matières constructives au
renforcement des capacités fonctionnelles des Communes. Certaines
dispositions légales ont été prises en vue de permettre la
réalisation de l'autonomie de gestion et l'augmentation des revenus
communaux qui sont nécessaires au processus de décentralisation.
C'est notamment le cas de la loi du 13 février 1968 règlementant
les services hydrauliques de la République, de la loi du 12 juin 1974
relative à l'usage des eaux souterraines, des décrets du 3 mars
1981 et du 21 avril 1983 sur le SMCRS désormais transformé en
SNGRS. Mais cette transformation tend à centraliser. C'est
104 Ces informations sont fournies dans la constitution
d'Haïti de 1816, les articles 42 et 43.
105 Ces informations sont fournies dans la constitution
d'Haïti de 1843, les articles 31 et 135.
105
une manière d'enlever le pouvoir de décider des
collectivités territoriales sur la gestion de leurs déchets. Il
peut bien y avoir de la coopération inter-régionale,
inter-communale, etc.
En effet, depuis 1974, on commença à utiliser
formellement le terme de décentralisation avec des textes légaux
portant sur la mobilisation fiscale en faveur des structures communales. S'y
ajoutent le décret du 5 avril 1979, modifié par le décret
du 23 décembre 1981 relatif à la CFPB, stipulant un impôt
réel communal basé sur la valeur locative de tout immeuble
(Paillant, 2015), la loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations
territoriales et la loi du 19 septembre 1982 relative à l'adoption d'une
politique cohérente d'aménagement du territoire et de
développement à partir des entités régionales
issues du regroupement des départements géographiques et des
arrondissements de la République.
Selon Privert (2006, p. 197), l'article 67 du
décret-loi du 22 octobre 1982 sur la Commune institue le schéma
d'inscription des recettes et des dépenses au budget communal par
chapitres et sections. Cela démontre bien, dès lors, l'effort qui
se déployait pour structurer la gestion administrative des Communes qui
vont être considérées comme des collectivités
territoriales avec des compétences fiscales plus étendues.
Reste que le chantier de la décentralisation
présente encore de nombreux travaux à faire, en dépit de
différents textes de loi et décret qui rejoignent des dispositifs
constitutionnels tendant à encadrer le processus, faciliter la
disponibilité des ressources, etc. En 1991, il y avait une loi sur les
collectivités territoriales qui a été votée, mais
non promulguée par le pouvoir exécutif. Rien ne précise si
le pouvoir exécutif en avait fait objection. La CFGDCT instituée
par la loi du 20 août 1996 apporte un complément sur le plan
financier aux revenus communaux dans l'objectif de promouvoir l'autonomie
administrative et financière des collectivités territoriales.
Certainement, nous retenons la promulgation de la loi du 4 avril 1996 portant
organisation de la collectivité territoriale de la Section communale.
Aussi le décret du 28 septembre 1987 sur la Patente et le décret
du 15 janvier 1988 portant sur les recettes des collectivités
territoriales contribuent-ils aux efforts visant à accroître les
revenus des collectivités territoriales. En outre, sont introduits les
décrets du 1er février 2006 : 1) fixant le cadre
général de la décentralisation ; 2) portant organisation
et fonctionnement des Sections communales ; 3) portant sur l'organisation et le
fonctionnement du Département ; 4) portant sur l'organisation et le
fonctionnement de la collectivité territoriale municipale ; 5) portant
sur la fonction publique territoriale. Ils participent dans l'optique de
renforcement des structures d'organisation de ces entités pour leur
établissement
106
opérationnel. Enfin, sont arrivés le
décret de 2007 sur la création du fonds de développement
au niveau local, le décret du 22 juillet 2015 identifiant et
établissant les limites territoriales des Départements, des
Arrondissements, des Communes et des Sections rurales et le décret de
2017 qui établit des révisions sur la fiscalité locale des
collectivités territoriales. Mais dans un autre registre, la loi
constitutionnelle du 9 mai 2011 portant amendement à la Constitition du
29 mars 1987 a enlevé des fonctions dans l'appareillage des
collectivités territoriales. La modification au niveau de l'article 192
de la Constitution amendée est assez significative. Compte tenu des
attributions que les conseils départementaux détenaient dans le
processus de désignation des membres du conseil électoral
permanent.
4.1.2.-Approche théorique de la
décentralisation
L'approche de la décentralisation se distingue
à travers deux grands courants théoriques : en premier lieu, nous
retrouvons les théories normatives ou celles dites encore
libérales prônant dans leurs objets, la gestion efficace et
efficiente des affaires publiques dans la promotion de la démocratie et
le développement. S'y rejoignent des théories politiques de la
bonne gouvernance estimant que la décentralisation est un facteur de
stabilité politique, la théorie de la gestion de
l'efficacité qui établit la nécessité de la
relation harmonieuse entre le gouvernant et le citoyen en vue de recueillir de
meilleures informations sur les besoins de la population et d'autres
théories de choix politiques qui concernent l'accès de la
population à des services de meilleure qualité avec des
institutions de contrôle spéfiquement établies.
L'approche normative s'opère ainsi par de nombreuses
dispositions légales contraignantes ; en second lieu, les
théories analytiques dites descriptives qui, reconnaissant les
caractéristiques de la bonne gouvernance et la gestion de
l'efficacité, se distinguent par l'idée que l'État est un
instrument au service des classes dominantes qui se rattachent
elles-mêmes aux superstructures de la communauté internationale.
C'est ainsi qu'elles considèrent l'importance de la prise en compte du
contexte dans lequel s'appliquera la décentralisation qui établit
toujours une confrontation des intérêts divergents entre des
acteurs différents. Cette étude dégage ses
affinités pour l'approche normative. Mais, il est important d'interroger
à quel degré ses multiples dispositions légales ont-elles
contribué à changer les comportements et modifier les
mentalités ? La question de mentalité se révèle
donc un paramètre crucial qui doit conduire à la
concrétisation des mécanismes de la décentralisation.
À propos, l'enjeu de la décentralisation enjoint des
préoccupations sur la mise en
107
place d'un espace de concertation d'où surgissent
l'alliance, l'articulation entre les opérations, entre les acteurs
socio-économiques (Mengin, 1989, p. 22). Mais comment arriver à
mettre ensemble des groupes aussi hétérogènes des
composantes sociales haïtiennes ?
4.1.3.-Théorie juridique de la
décentralisation
La décentralisation, étant donné la
multitude d'instances autonomes de décisions, interpelle les organes
locaux106 de maitriser juridiquement leurs actions et de prendre en
toute liberté dans l'unique respect des lois et règlements, la
décision qu'ils veulent. En ce sens, Aron (1965) précise que la
caractéristique fondamentale des collectivités territoriales est
l'organisation des pouvoirs (p. 37).
Nombre d'écrivains produisent des réflexions
sur la thématique de la décentralisation. Nous passons à
pieds joints sur une revue de littérature du concept en
commençant par Baguenard (1980/2006, p. 9) qui conçoit que la
décentralisation renvoie à l'idée de gouvernement local.
Elle met l'accent sur l'auto-administration des collectivités
territoriales. Elle s'inscrit dans une logique de démocratie
locale107. Pour sa part, Léger (2000, p. 87) estime que la
décentralisation est un projet de société visant à
impliquer les instances locales dans la gestion publique par un partage plus
équilibré des responsabilités dans des domaines importants
du développement.
La décentralisation conduit à la bonne
gouvernance par trois moyens : premièrement, en améliorant
l'efficacité de l'allocation de ressources ; deuxièmement, en
promouvant la transparence qui réduit les possibilités pour la
corruption ; et enfin, en améliorant le recouvrement de coûts. Les
gouvernements locaux, étant plus proche aux citoyens, se retrouvent en
mesure de répondre à leurs besoins. Mais des conditions
préalables s'imposent pour pouvoir influencer la performance des
autorités publiques locales : la définition claire des
responsabilités de tous les niveaux de l'État pour éviter
tout quelconque chevauchement en matière de pouvoir et juridiction. Il
faut instituer une loi décrivant en détail les structures et
statuts des institutions publiques, surtout au niveau local (Thélusme,
2017). Car, les dispositions du code rural ne sont pas suffisantes. Le
contrôle est le point crucial qui garantit la bonne utilisation des
deniers de l'État. Pour cela, il est
106 Pour pouvoir mieux s'organiser dans la défense de
leurs intérêts, les organes locaux se regroupent en Haïti.
Les maires font partie de la Fédération Nationale des Maires
d'Haïti(FENAMH), créée en 1995. Les CASEC rejoignent
l'Association des CASEC d'Haïti qui est créée en 2005 et les
ASEC intègrent la Fédération Nationale des Asec
d'Haïti. Cf [
www.fenamh.org.ht].
107 Ce concept de démocratie locale est compris dans un
sens de foyer naturel de la démocratie et de la participation citoyenne
qui tend à la valorisation contemporaine de la proximité des
citoyens de la concentration et la personnalisation des pouvoirs en vue de
porter un regard actif sur les pouvoirs exécutifs et
délibératifs. CF [Lefebvre, Rémi, « Démocratie
locale» in Dictionnaire des politiques territoriales |En ligne
publication 2020 |http :www.cairn.info, page consultée le
16/03/2023].
108
nécessaire d'instituer une loi sur les
mécanismes de contrôle et de suivi. En support des lois
organiques, il faut un cadre réglementaire, les pratiques de
l'institution détaillées. Finalement, les élections
locales devraient se tenir régulièrement à un moment
différent de celles étant nationales.
4.2.-Responsabilité des ordonnateurs dans la
gestion de la finance dans le cadre de la décentralisation
La gestion des comptables de deniers publics tient à
l'efficacité et leur responsabilité en tant qu'ordonnateurs et
liquidateurs des dépenses publiques. Ils encourent une
responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et
civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être
infligées par le Juge des Comptes à raison de leurs fautes de
gestion108.
4.2.1.-Prégnance de la corruption :
l'érection des institutions efficaces de contrôle
La gestion financière est un domaine très
important pour caractériser les activités financières qui
concourent à réaliser les objectifs des politiques publiques pour
le développement des communautés. Mais comme le souligne Gousse
(2012), « l'organisation et la gestion des administrations publiques dans
les pays en développement souffrent souvent de lourdeurs et de
dysfonctionnements qui vont les rendre particulièrement
vulnérables à la corruption. L'inflation des
réglementations contraignantes et complexes et la faiblesse des
contrôles y sont des caractéristiques fréquentes. »
(p. 55). Pour Haïti, le procès du fonctionnement de
l'administration publique est accablant dans son verdict. La corruption est un
fait socio-historique qui accable toutes les structures sociales. Des efforts
doivent être engagés pour en sortir à travers des
dispositifs fonctionnels du renforcement et de consolidation des institutions
efficaces dans le contrôle et la répression des actes
corruptibles.
Dans sa thèse intitulée : vers une
refondation du droit des finances publiques locales en Haïti,
Valmera(2021) a repris l'idée de Julien Mérion qui a dit que
la réforme constitutionnelle de 1987 vise à parachever la
construction de l'État enlisée dans les méandres du
néo-patrimonialisme et à moderniser des structures
étatiques en appuyant sur la démocratie et la
décentralisation. Dans la même ligne, Charles L. Cadet
(cité dans Valmera, 2021) a écrit que : « la période
qui s'ouvre avec la loi constitutionnelle de 1987 constitue
théoriquement une rupture dans l'évolution
108 Ces informations sont fournies dans le décret du
décret du 16 Février 2005 faisant office de loi organique sur la
préparation et l'exécution des lois de finances suivant ses
articles 79, 80 et 82. Même si le texte ne renferme pas des
précisions sur le concept de faute de gestion.
109
institutionnelle et politique du pays en tant qu'elle inaugure
des types de démarche pouvant rapprocher l'État le plus que
possible d'un idéal de modernité ». Et dans ses propos,
Doré (2002) considère que cette loi mère met fin au
corporatisme d'État (p. 108).
L'institution internationale de dénonciation de la
corruption TI (2002) précise que « c'est tout un système de
contre-pouvoirs et de garde-fous qu'il s'agit de mettre en place pour s'assurer
que les organismes et les institutions publiques rendront comptes et garantir
le respect des principes fondamentaux contenus dans la loi et dans la
Constitution. » (p. 65).
Le résultat d'une bonne gestion financière
dépend des institutions de contrôle. Le contrôle permet de
mesurer l'efficacité d'une institution. À cet égard,
Haïti accuse toutes ses faiblesses. Les différentes institutions
telles que : CSCCA, ULCC, UCREF, IGF, etc. ont montré des manquements
évidents dans le contrôle des deniers de l'État. La
justice, dans son appareillage n'a pas su non plus manifester ses
capacités pour réprimer systématiquement les actes de
corruption. D'où s'ensuit un cycle infernal d'impunité qui
s'érige en système en Haïti.
4.3.-Organisation de l'administration centrale de
l'État
Les articles 234 et 234 al.1 de la Constitution de 1987
définissent l'administration publique comme l'instrument par lequel
l'État concrétise ses missions et objectifs. Elle est
constituée de l'administration d'État et de l'administration des
collectivités territoriales. Pour garantir sa rentabilité, elle
doit être gérée avec honnêteté et
efficacité. Ce qui rejoint un point fort de l'approche normative de la
décentralisation.
La loi constitutionnelle a consacré la question de la
décentralisation comme une stratégie de développement
économique collaboratif avec les différentes entités
régionales et locales qui s'alignent dans les efforts à divers
niveaux sous l'auspice du pouvoir central. La décentralisation apparait
à la fois comme une technique et un enjeu sociétal. Cette
Constitution contraint aussi à la marche de pair la
déconcentration administrative et la décentralisation. Ainsi, les
articles 85 et 86 de la section E se réfèrent à la
délégation au niveau départemental et aux vices
délégations dans les Arrondissements comme représentants
de l'administration centrale ; 61 à 87 définissent des
collectivités territoriales, de leurs représentants, de la
décentralisation et l'article 217 des finances locales.
110
4.3.1.-Finance dans le processus de la
décentralisation
La Constitution de 1987 stipule que les collectivités
territoriales jouissent de l'autonomie, administrative et financière
(art. 66). L'État fournit un cadre structurel de formation sociale,
économique, civique et culturelle dans les Sections communales (art.
64). Dans les rapports entre l'État central et les collectivités
territoriales, le principal se matérialise par la question
d'intérêt général signifiant la gestion des
ressources au niveau administratif et politique (art. 74, 81, 87.2 et 87.4). En
cela, Mordacq (2011) soutient que la finance publique est une question centrale
dans le pilotage des politiques publiques quant à la
soutenabilité des modes appropriés de la bonne gouvernance (p.
41).
En appréciation du partage, du transfert, de l'octroi
de pouvoir ou compétence que confère l'État central via la
décentralisation aux collectivités territoriales, le principe de
subsidiarité109 trouve un canal privilégié pour
la consécration de la gestion de proximité en toute connaissance
de cause des subtilités culturelles des affaires d'intérêt
local dans le souci du bien de la collectivité. Mais la question de
fonds fiduciaire demeure un défi à l'effet de la
décentralisation. Car, l'administration publique et celle des
collectivités territoriales ne suscitent pas de confiance dans la
gestion de fonds. Elles ont du mal à émettre des obligations qui
les permettront d'attirer des investisseurs. Ainsi, Philippes Bezes et Michel
Bouvier (cités dans Valmera, 2021), ont beau essayer de démontrer
combien la consolidation financière est importante. Sans elle,
l'État (dans le cadre des États unitaires et
décentralisés) et les collectivités locales sont en fait
des acteurs inactifs du développement. Cette conception trouve une large
adhésion. À propos, Alexandre Desrameaux (cité dans
Valmera, 2021), accentue son analyse sur les finances publiques qui occupent
une place de plus en plus conséquente dans les débats publics. Il
avance que sans moyens financiers « appliquer et faire respecter les
décisions publiques demeure voeux pieux ». Aussi,
109 Le principe de subsidiarité se précise en
importance capitale comme technique de transfert de compétences aux
collectivités territoriales à côté des principes de
dévolution et de progressivité. Elle constitue essentiellement
une technique de répartition temporelle par la division de tâches
étatiques attestant l'inefficience dûe à la lourdeur de
l'appareil politico-administratif de l'Etat unitaire centralisé,
intervient l'action des entités locales disposant d'un délai au
cours duquel celles-ci ont été autonomes dans la gestion des
attributions de leurs compétences. En effet, la subsidiarité
impose une condition à l'attribution de la compétence en assurant
la transition entre deux compétences, dans le sens de continuité
de service public. Elle se manifeste, en général, lorsqu'un
composant n'est pas en mesure de remplir sa mission, un autre palliera son
absence ou son échec. L'efficience est une des causes qui peut, en
effet, provoquer l'actualisation de la compétence subsidiaire. «
Ainsi dans le cas qui concerne essentiellement Haïti, la
décentralisation par le principe de subsidiarité répond
à un besoin de régionaliser [Privert, Jocelerme. (2006),
Décentralisation et collectivités territoriales. Contraintes,
enjeux et défis. Editions le béréen, Québec]
la gouvernance qui découle par le transfert de compétences aux
collectivités territoriales dont leurs capacités sont
évaluées par l'Etat central afin de leur permettre d'exercer des
attributions que leurs capacités se révèlent suffisantes
à remplir. »
111
indique-t-il dans la même veine que « les
décisions financières et budgétaires doivent être
prises en tenant compte de données politiques, économiques et
sociales, nationales et internationales, qu'elles contribuent en même
temps à faire évoluer » (p. 38). Les recettes fiscales et
les autres ressources propres constituent une part de ressources
déterminantes pour les collectivités territoriales.
Enfin, en Haïti, face à la lourdeur
administrative qui bloque toute avenue économique de l'État
unitaire centralisé, la décentralisation devient un
impératif qui pourra - avec les effets probants du principe de
subsidiarité - permettre aux collectivités territoriales
d'exploiter leurs ressources potentielles et spécifiques pour leur
développement. Aussi, s'agit-il d'envisager la décentralisation
dans ses dimensions : politique (transfert de fonctions dévolutives
à des collectivités), administratives (fourniture de services
publics de biens) et fiscales (génération de revenus). En
matière de décentralisation, le principe de subsidiarité
conduit l'État à déléguer certains de ses pouvoirs
aux collectivités territoriales lorsqu'il considère qu'elles sont
mieux à même de les assumer, compte tenu de leur proximité
aux citoyens. À l'inverse, certaines missions remontent ou restent
naturellement au niveau de l'État : diplomatie, défense, police,
justice, recherche fondamentale, infrastructures de base, solidarité et
cohésion nationale110...
En allant sucer la roue de ces idées, nous pouvons
remarquer que la répartition des compétences n'est pas la
condition suffisante pour prétendre que l'agent de la
collectivité territoriale est le seul responsable du
développement de son espace territorial. Donc, l'aide du pouvoir central
demeure un outil très utile pour soutenir les efforts des agents locaux
(Baguenard, 1980/2006, p. 41).
TABLEAU 2 : TYPOLOGIE DE
DÉCENTRALISATION
ILLUSTRATION DES DIFFÉRENTES TYPOLOGIES QUI
CARACTÉRISENT LA
DÉCENTRALISATION
|
Types
|
Responsables politiques
|
Responsables de
l'exécution
|
Provenance du
financement
|
Déconcentration (Ce
n'est pas la
décentralisation)
|
Élus nationaux
|
Agents du
gouvernement central
|
Budget national
|
Délégation (Subsidiarité)
|
Élus nationaux et élus locaux
|
Agents locaux sont
supervisés par des
|
Budget local avec ou sans paiements contractuels de
|
|
110Ces informations ont été fournies
sur le site de
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Subsidiarite.htm,.
112
|
employés du
gouvernement central
|
l'État, venant du budget national ou local
|
Dévolution (la
forme la plus
avancée dans le
processus de la
décentralisation)
|
Élus locaux
|
Agents locaux de la collectivité territoriale
(incluant des corps
d'employés nationaux)
|
Budget local : impôt et transfert de l'État
central venant du budget national en appui aux collectivités
|
Source : Ce tableau est complété suivant le
modèle tiré du texte de mémoire de Fils-Aimé
(« s.d. »)
|
|
La complexité de l'adoption du modèle de
gestion décentralisée implique différents acteurs. Il
s'agit de mettre en évidence l'importance des efforts de
prélèvement de ressources fiscales. Des actions qui doivent
être engagées par l'initiative des agents locaux. Cette attitude
est déterminante dans la responsabilité des dirigeants nationaux
ou locaux. Ils ont des tâches à remplir qui dépendent d'une
bonne gestion des deniers de l'État. À rendre possible la lutte
contre la corruption, l'État crée des institutions de
prévention et de répression de telles infractions.
4.4.- Rôle de l'État dans la mise en
place de la décentralisation : dotation des collectivités
territoriales des moyens de concevoir de véritables politiques
publiques
Le rôle fondamental de l'État dans la
construction sociale peut s'établir dans la décentralisation.
Cette oeuvre traduit l'appui nécessaire aux collectivités
territoriales dans la capacité de développer des politiques
publiques de développement local. Elle s'accentue aussi sur le
rôle structurant de l'État dans le processus de la
décentralisation. Dans une démarche concrète de
décentralisation nous pouvons entreprendre les chantiers
d'implémentation du principe de subsidiarité (légitimant
les transferts de compétences) puis arriver à la
dévolution. Les collectivités territoriales auront connu des
étapes qui partent du droit à
l'expérimentation111, la
péréquation112 pour aboutir à
l'autonomie financière, etc. C'est ainsi que le processus de
décentralisation doit pouvoir tenir compte de : la
spécificité des localités, la diversité dans
l'apport des valeurs anthropologiques des groupes sociaux et la rationalisation
dans les décisions à adopter.
111 L'expérimentation est un dispositif
créé en France consistant à autoriser une loi à une
collectivité territoriale d'adapter une politique publique qui ne
ressort pas de ses attributions légales pour une période
donnée. Cf [
www.vie-publique.fr, « En
quoi consiste l'expérimentation législative locale ? » |En
ligne en date du 22/02/2021, page consultée 07/03/2023]
112 La péréquation tend à trouver
l'égalité dans les ressources des collectivités. Du sens
horizontal, elle permet de partager les ressources des collectivités
territoriales les plus riches aux plus démunies. Dans le sens vertical,
il s'agit à l'État de donner aux collectivités
territoriales. Cf [
www.vie-publique.fr, « En
quoi consiste l'expérimentation législative locale ? », en
ligne le 9/01/2023].
113
Dans cette même veine, Baguenard (1980/2006, p. 23)
estime que la décentralisation se mesure à la marge de manoeuvre
dont dispose les collectivités territoriales dans l'État
unitaire. Elle caractérise une balance sensible qui résulte d'un
compromis dynamique entre, d'un côté, des forces
centripètes tendant au renforcement de l'unité nationale, et, de
l'autre, des forces centrifuges incitant à l'épanouissement de la
diversité locale. Sa survie dépend de la vigueur des
collectivités territoriales et de la contribution du pouvoir central.
Sinon, la décentralisation reste un voeu pieu. La fusion des actions de
l'État et des agents de la collectivité territoriale a
particulièrement motivé ce travail de recherche dans la mesure
où des questions du questionnaire d'entretiens revenaient à
détecter l'intervention de l'administration de l'État par le
traitement accordé à la 2e Section Lociane dans les
différents services publics fournis aux membres de cette population.
4.4.1.-Définition du concept de la
collectivité territoriale
Il reste cependant très rare de trouver une
définition bien précise du concept de collectivité
territoriale. Une tournée est faite vers le professeur Prophète
(cité dans Dorisca, 2010, p. 86) décrivant trois conceptions
différentes qui ressortent de l'approche de collectivités
territoriales :
? Avec la conférence de Rio au Brésil en 1992,
elles s'entendent une unité de gestion qui s'imbrique dans des
activités économiques, sociales et écologiques.
? Un point de vue sociogéographique s'en dégage
avec une société de personnes rassemblées par des
filiations sociologiques dans l'occupation d'un espace territorial physique
déterminé dont les limites relèvent d'un ordre
juridique.
? L'aspect purement juridique démontre la
collectivité territoriale comme une entité publique distincte de
l'État et dotée de la personnalité morale disposant un
territoire. En principe, l'État détient exclusivement de la
personnalité morale à travers son espace propre.
Issus de suffrage direct des collectivités
territoriales, les membres des collectivités territoriales subjuguent la
gestion des collectivités territoriales avec le conseil municipal qui se
charge principalement du développement socio-économique de la
Commune113. Les administrateurs locaux assurent la
garantie de la personnalité morale dans l'autonomie administrative avec
la disposition d'un personnel propre et d'un budget propre de la
collectivité territoriale. D'où s'ajoutent, selon Boeuf et Magnan
(2006, p.7), des compétences propres et l'exercice de pouvoir
113 Le conseil municipal se charge des missions qui se
rapportent :1) urbanisme et aménagement du territoire et les services
des travaux publics (construction de marchés publics, édifices
municipaux, les services d'incendie et de police) ;2) aménagement urbain
qui consacre l'embellissement des espaces publics, infrastructure
routière, eau potable, politique d'hygiène.
114
de décision délibérative. Ces
tâches fondamentales rendent les administrateurs locaux responsables par
devant leur électorat de leur gestion locale (Dumornay, 1995, p. 6).
Force de l'abstraction faite de la décentralisation territoriale qui
s'applique aux collectivités territoriales. La décentralisation
s'applique sur l'espace territorial, comme nous l'avons déjà
précisé, de la République d'Haïti, instituée
à travers la mise en place de trois niveaux de collectivités
territoriales y compris leurs nombres (10 Départements, 146 Communes,
571 Sections communales) sur l'étendue géographique de 27,750
km2. Ledit espace géographique est
territoire114.
Mais, comme but visé à l'objectif du projet
d'étude, l'horizon général de la limite frontalière
du territoire de l'État est d'abord considéré. Et puis,
toute l'attention est fixée sur la spécificité de la zone
frontalière de la 2e Section communale de Lociane, dans ses
dimensions socio-économiques et la gestion territoriale. Selon Mathelier
et al. (2004) précisant que le territoire, espace sur lequel s'exerce
une autorité - celle de l'État - et dont les limites sont
fixées par les frontières, est à la fois support et levier
du développement. Ce qui conduit à des modes particuliers
d'appropriation et de gestion. La composante du territoire se
réfère alors à une dimension de limites fixées par
les frontières d'un autre État qui se définit avec Max
Weber (cité dans Etienne, 2007) :
« [...] il faut concevoir l'État contemporain
comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire
déterminé- la notion de territoire étant une de ses
caractéristiques-, revendique avec succès pour son propre compte
le monopole de la violence physique légitime. Ce qui est en effet le
propre de notre époque, c'est qu'elle n'accorde à tous les autres
groupements, ou aux individus, le droit de faire appel à la violence que
dans la mesure où l'État le tolère : celui-ci passe donc
pour l'unique source du «droit» à la violence. »
D'où résulte l'importance de la compréhension de
l'État dans sa définition et sa conception.
4.4.2.-Définition fondamentale dans la conception
de l'État
Diverses définitions essayent de saisir le concept de
l'État. Ce travail se réfère à l'Encyclopaedia
Universalis(1989) pour utiliser certaines d'entre elles : « selon
Hans Kelsen, l'État est comme un système de normes. Pour
Friedrich Hegel, l'État est la substance consciente d'elle-même.
C. Frédéric Bastiat, économiste, conçoit
l'État comme une grande fiction à travers laquelle tout le monde
s'évertue à vivre aux dépens de tout le monde. Raymond
Carré de Malberg, dans`Contribution à la théorie
générale de l'État' en 1921, pense que l'État est
une communauté d'hommes, fixée sur un territoire propre
et
114 Dans ses cours en DSD, le professeur Jean Maxius Bernard
enseigne que c'est le modèle de subdivision de territoire de l'Italie
qui a prédominé dans le monde occidental. En effet, en 1790, les
pouvoirs publics français ont imité les circonscriptions
ecclésiastiques, établies depuis le IVe siècle à
Rome, pour adopter la commune et le département.
115
possédant une organisation d'où
résulte pour le groupe envisagé dans des rapports avec ses
membres une puissance suprême d'action, de commandement et de
coercition.» Cp. 844).
Dans sa réalité conceptuelle, l'État est
une idée. C'est qu'il est pensé. D'où résulte son
essence. Encore dans l'Encyclopaedia Universalis, est-il
précisé que « L'homme a inventé l'État
pour ne pas obéir à l'homme. L'État n'est pas un
phénomène naturel, comme le clan, la tribu ou la nation. Il est
construit par l'intelligence humaine à titre d'explication et de
justification du fait social qu'est le pouvoir politique ». Ce
pouvoir politique est la consécration d'une mission exercée sur
le corps social. L'État est l'une des institutions qui assure l'ordre
dans la société. Il se retrouve dans la superstructure politique
et juridique (Louis, 2019).
Selon Braud (2004, p. 7) l'État désigne d'une
part, une société politiquement organisée, et d'autre
part, un pouvoir qui s'exerce en son sein à partir d'un noyau. Encore
Hegel voyait-il dans l'État, le triomphe progressif de la Raison dans
l'Histoire. Il faisait référence certainement à l'histoire
des origines115 de l'État qui remontent aux bouleversements
des sociétés occidentales au cours du XVIe siècle.
L'État s'inscrit dans l'ordre des
réalités sensibles quoique disparates lorsqu'il s'exerce dans la
substance officielle, la sécurité nationale ou l'injonction
fiscale. En substance territoriale, il s'incline dans le fait de
spatialité agissant par des symboles aux frontières. Des acteurs
politiques dirigent l'État. Il est visible à travers des domaines
tels que l'éducation, l'infrastructure, la sécurité, la
santé, etc. Mais le symbolisme de l'État est plus fort dans les
représentations mentales. L'État s'établit dans un ordre
constant d'indépendance par rapport à des puissances
extérieures. Il s'agit donc de la souveraineté qui s'exerce dans
les limites d'un territoire. Selon Foucault (2004, p. 13), la
sécurité s'exerce sur l'ensemble d'une population qui a
institué un État. L'important est tout aussi le branchement de
l'efficacité politique de la souveraineté sur une distribution
spatiale.
115 L'histoire des origines de l'Etat est l'objet de bien de
controverses. Pour l'essentiel, trois étapes ont été
produites à l'engendrement de la forme d'organisation des
sociétés humaines : première étape, les groupements
des premiers humains caractérisent un besoin de sécurité
contre les autres clans ou autres groupes. Par l'ensemble, les décisions
sont prises pour organiser la vie de leur groupement ; deuxième
étape, quand les membres du groupement deviennent trop nombreux, les
liens familiaux se dissolvent ou se disloquent au fur et à mesure que
les individus se séparent. L'ensemble pose un nouveau problème
dans la prise de décision. Il s'avère donc nécessaire de
déléguer un individu ou un petit groupe pour décider pour
l'ensemble. C'est la délégation de pouvoir. Mais les
règles d'attributions du pouvoir ne sont pas définies. Ce qui
occasionne une situation d'instabilité ; troisième étape,
à la recherche d'une base stable, permanente et abstraite,
l'institutionnalisation du pouvoir s'impose. D'où le dicton : `le
roi est mort vive le roi '. La continuité du pouvoir s'organise
dans l'Etat. Mais les règles d'attributions du pouvoir posent encore des
problèmes.
En marge des connaissances anthropologiques et historiques,
les philosophes du XVIIe siècle interrogèrent sur les
raisons qui ont poussé à la création de l'Etat. La
volonté divine est la réponse facile qui demeurait pendant
longtemps. Mais en se distanciant de la métaphysique, cette croyance ne
tenait plus avec le temps. Trois théories vont concourir à
clarifier l'interrogation : 1) les théories du contrat, 2) les
théories du conflit, 3) les théories de la
fondation-adhésion.
116
Mais selon l'approche marxiste, L'État sert de support
à l'infrastructure économique caractérisant la base de
l'activité humaine au profit de groupes détenteurs des moyens de
production. Ces derniers dominent l'appareil de l'État au
détriment des classes non possédantes par l'exploitation.
Revenons-nous en au monopole de souveraineté de l'État qu'il
détient et remplit exclusivement dans les attributions souveraines de la
contrainte légitime, de la fiscalité et du crédit. Car la
souveraineté est un attribut d'État. L'État en Haïti
[dit unitaire se définit comme la structure comportant un État
sur un territoire à organisation juridique, politique et
économique lui conférant l'ensemble des attributions de la
souveraineté nationale dans un gouvernement116 (trois
pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire)].
Par gouvernement, selon Boyard (2010, p. 31), nous entendons
une administration politique qui bénéficie de la puissance
publique et de la capacité de commander et de se faire obéir. Et
la population est représentée par l'ensemble des nationaux de
l'État, c'est-à-dire, par tous les individus jouissant de la
nationalité de l'État.
C'est en vertu de telles substantivités que nous
pouvons signifier ainsi l'État : diplomatie, défense, police,
justice, recherche fondamentale, solidarité, infrastructures de base et
cohésion nationale117. Ce sont des champs où
interviennent ses actions monopolistiques. Entre autre monopole de
l'État, s'inscrivent la dynamique et la complexité des
transformations sociales et politiques ainsi que l'articulation du politique et
du social, du global et du local dans une perspective de gestion de la
sécurité nationale qui connait plusieurs théories
notamment celle qui est classique, s'étendant de l'extérieur vers
l'intérieur à partir des services diplomatiques externes et des
systèmes traditionnels de protection des espaces frontaliers avec des
services douaniers et ceux des aéroports et des côtes
maritimes.
Entre-temps, des conceptions modernes se développent
en la matière avec des mécanismes économiques y compris
des outils de technologies de l'information et de la communication. Par
l'approche de la sécurité nationale, Joseph (2005) explique que
la notion évolue avec le temps pour sortir du clivage classique des
notions d'équilibre inter-étatique de rapports de force, de
souveraineté et de respect des frontières étatiques. Le
paradigme économique a surgit depuis peu. Mais le tiers-monde fait
exception aux théories nouvelles de la sécurité nationale.
En ce sens, le danger y est de plus de l'intérieur qu'à
l'extérieur à cause de l'instabilité politique qui y
règne.
116 Voir les articles 59 et 59.1 de la Constitution d'Haïti
de 1987.
117 Ces informations ont été fournies sur le site
de
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Subsidiarite.htm,.
117
Ainsi, le clivage classique inter-étatique y
subsiste-t-il. En ce qui concerne la frontière dont fait l'objet cette
étude, elle se définit, selon Acloque (2022), dans un sens
restreint, comme une limite fixée par traité entre deux
États. En substance, elle a caractérisé l'apparition des
États modernes qu'Etienne(2007) suppose « une rationalisation de
domination politique, grâce à l'institutionnalisation de la
participation des citoyens à la gestion de la chose publique.
»(p.30). Charles Tilly (cité dans Bonazzi, 2009) pense que
l'État moderne représente un processus historique de formation
d'un noyau autonome. La société féodale s'embourbait dans
une crise de structure sociale qui favorisa l'émergence de
l'État.
À la fin du moyen âge, l'Europe a connu des
transformations socio-économiques qui ont largement contribué
à l'apparition de l'État. C'est ainsi qu'il s'opère une
mise en relation entre la construction de l'État et la modification de
la structure sociale. Il résulte bien une désintégration
de la société traditionnelle qui assume beaucoup de
résistance d'ailleurs. Un nouveau modèle d'échange
s'entend avec l'État qui s'impose avec la division du travail social
engendré par le développement économique. Très
tôt déjà, l'État se confronte à la limite de
la frontière qui détermine la discontinuité entre deux
foyers différents d'appropriation territoriale. Alors, la limologie ou
science des frontières est, à cet égard, d'un appui
très précieux pour la géographie politique. Elle touche au
droit, à l'histoire, à la science politique. Mais la
frontière, renvoie à une réalité concrète
qui en fait un cas intéressant à la géographie qui en
étudie donc les conséquences du phénomène
`frontière' (Sanguin, 1974).
4.4.3.-Définition des choix
stratégiques de développement économique en matière
de politiques publiques
L'État se doit de prioriser la définition des
instruments qui encouragent des investissements dans des domaines qui
relèvent de trois ordres : premier ordre, des investissements sont
réservés essentiellement à l'intervention des entreprises
privées ; deuxième ordre, ceux qui reçoivent
l'intervention des entreprises privées sous la supervision des
structures étatiques ; et troisième ordre, ceux qui se
réservent dans l'espace de souveraineté nationale. En tout cas,
le mécanisme de définition des instruments nécessaires au
développement socio-économique et politique ne doit pas
échapper à la compétence de l'État.
Ensemble, l'État et le secteur privé doivent
s'incliner devant les prérogatives de l'État de droit
régissant des rapports de progression dans l'orientation de
développement. Cela traduit un
118
processus qui tient ses lignes directives dans la concertation
des forces antagoniques interagissant dans la défense de
l'intérêt collectif, dans une logique continue de dialogue, de
concertation et de consensus. À l'effet d'un tel modus
operandi, nous attendons que l'État dégage assez de
ressources de toutes sortes qui lui permettront de contribuer à
réorganiser la dynamique des structures socio-économiques et
politiques au niveau interne. Et, à l'évidence
d'implémentation de nouvelles orientations socio-économiques.
Haïti tendra ainsi à insuffler une autre dynamique dans ses
relations avec les autres pays, en particulier la République
Dominicaine. Ces considérations lient intimement la dynamique interne
dans les relations avec l'extérieur. Celle-ci se manifeste
véritablement par le besoin d'adopter de nouveau paradigme dans la
définition de lignes directrices et de priorités comme vecteur de
développement.
4.4.4.-Politique publique : de la naissance à
l'acception moderne
À l'origine, les politiques publiques ressortent du
renforcement des pouvoirs du roi avec la monopolisation sur la
fiscalité, la monnaie, la police ou la guerre. Ces fonctions
régaliennes vont constituer le socle inébranlable de
l'État moderne. Michel Foucault développe la conception de
savoirs de gouvernement pour montrer l'ensemble des technologies qui permettent
à l'État de gouverner les territoires et les populations.
À travers cette gouvernementalisation118, l'État
impose sa légitimité par la capacité de faire
régner l'ordre, de maitriser les connaissances nécessaires au
contrôle de l'espace territorial et d'apporter des services de base
indispensables à la population. Le développement fulgurant connu
aux États-Unis au cours des années 1950 a essentiellement
marqué l'origine de la notion de politique publique. Elle a eu son
acception moderne par l'utilisation du mot Gouvernment pour
désigner les actions publiques du gouvernement américain.
En Europe, les penseurs tels que Hegel, Marx et Weber ont
pourtant bien longtemps mis en exergue le concept de l'État comme
institution qui domine la société, la façonne et la
transcende. Mais, particulièrement en France et en Angleterre, c'est au
cours du XIXe siècle que l'État a commencé à se
pencher sur les activités qui entrent dans le cadre de politiques
publiques. Les interventions de l'État qui caractérisaient des
politiques publiques étaient marquées surtout par la lutte contre
les effets du marché capitaliste. Ainsi, Karl Polanyi (cité dans
Muller, 2009, pp. 6-8) souligne-t-il
118 Gouvernementalisation est une notion utilisée par
Michel Foucault pour désigner la superstructure équipée de
l'État qui, dès XVIIIe siècle, se charge de
résoudre tous les défis auxquels la population fait face tout en
assurant le contrôle sécuritaire sur celle-ci.
119
que les effets de dislocation que l'extension du marché
et l'industrialisation entrainent sur la société ont permis
à ce que les premières politiques publiques visaient
essentiellement le secteur social. Aussi la société de salariat
créée par le capitalisme a-t-elle occasionné les
interventions de l'État dans le secteur de l'assistance sociale avec
l'État Providence.
4.4.4.1.-Caractéristique de politiques
publiques
Les politiques publiques ont un caractère sectoriel.
Chaque politique publique intervient dans un secteur découpé de
manière spécifique de la société pour constituer un
objet d'action publique. Deux situations engendrent l'action de politique
publique. Dans un cas, le secteur préexiste à la politique. Il
s'agit d'une fonction de structuration verticale des rôles sociaux par la
définition des règles de fonctionnement, de sélection,
d'élaboration des normes et des valeurs spécifiques, de fixation
de champ. Dans un autre, la politique provoque un problème dans un
secteur d'intervention, il renvoie à ce qui s'est produit avec les
politiques sociales.
De toute façon, les politiques publiques ont pour
objectif de gérer les déséquilibres provenant de la
sectorisation et dans la complexification des sociétés modernes.
De même, un secteur peut produire ses propres objectifs de politiques
publiques. En ce qui a trait au processus de décentralisation, il
participe largement dans la mise en oeuvre de projet de société.
Cela implique une administration de l'État définissant les
règles et les règlements. Et les acteurs des collectivités
territoriales gèrent les objectifs visés par
l'implémentation de politiques publiques pour les différents
secteurs à divers niveaux.
4.5.-Condition nécessaire à
l'implémentation de la décentralisation
La décentralisation prônée dans
l'État moderne est considérée par l'assimilation de la
logique de Aron (1965, p. 66) à une organisation administrative. C'est
d'abord avec des dispositions légales qu'il convient d'envisager sa
réalisation. Néanmoins, l'arsenal juridique haïtien en
contient un grand nombre de textes. Il faut avoir des cadres théoriques
pour orienter le processus de décentralisation. C'est ce dont le travail
retient, selon l'auteur, pour réaliser la décentralisation :
? la détermination d'une sphère de
compétences spécifiques au profit des collectivités
territoriales ;
? l'autonomie d'action des autorités locales par
rapport au pouvoir central, tant pour leur nomination que pour leur
révocation ;
·
120
l'autonomie de gestion des affaires119 locales par
les collectivités territoriales (Baguenard, 1980/2006, p. 24).
Dans l'interprétation de la Constitution de 1987,
Léger(2000) se réfère aux enjeux globaux du processus de
la décentralisation sur le plan : administratif, juridique et
institutionnel. Il s'agit d'entreprendre un cadre de transfert de
compétences du pouvoir central vers des collectivités
territoriales et établir un canal de participation de la
société civile. À cet égard, des lois et
règlements doivent, souligne-t-il, compléter la prescription
constitutionnelle pour fixer la répartition des acteurs et leurs
attributions. Il est entendu que la participation de la société
civile constitue un aspect crucial dans la définition des enjeux et
l'édification de la réglementation qui doit désigner entre
autres :
· Les compétences administratives de chaque
acteur qui distingue l'intérêt général étant
du ressort de l'État central et les affaires locales relevant des
collectivités territoriales ;
· Le degré d'autonomie à accorder à
chaque niveau de collectivité ainsi que les ressources correspondantes
à transférer : humaines, financières et matérielles
;
· Le type de contrôle à exercer par
l'administration centrale suivant qu'il s'agit de déconcentration, de
délégation ou de dévolution ;
· La tutelle est exercée par le pouvoir central,
étant donné l'inexistence de hiérarchie entre les
collectivités territoriales ;
· Les relations entre les autorités locales
élues et la délégation ;
· Les modes de résolution des conflits entre
différents paliers de gouvernement local ;
· Les modalités d'implication de la population et
de la société civile (p. 95).
Mais ce qui caractérise une partie de la faiblesse de
ces théories dans le contexte de la 2e Section Lociane, c'est
qu'elles ne tiennent pas en compte des conditions socio-économiques
précaires qui ne puissent permettre de disposer des ressources humaines
efficaces à même de représenter dignement des
collectivités territoriales. Alors, il revient à l'État
via le ministère de tutelle à savoir le MICT de se charger de la
formation des agents locaux à côté des différentes
associations où ils s'affilièrent. Toute la littérature
sur cette matière porte à convaincre de l'importance de la
compétence et la disposition des ressources humaines dans la
défense des intérêts de la collectivité
territoriale. Car il est impérieux que les agents locaux soient bien
imbus de l'objet sur lequel ils
119 Les affaires locales c'est une notion qui, reposant sur des
choix politiques, se révèle tout à fait subjective et
complexe à maitriser.
121
doivent se baser pour diriger leur communauté. Ce qui
conduira à pouvoir identifier les affaires locales et les distinguer des
intérêts généraux.
4.5.1.-Distinction entre intérêt
général et affaires locales
L'intérêt général que nous
évoquons ci-dessus s'appréhende comme critère transversal
et finalisé, déterminé à un but précis. Le
corps social, constitué en groupement d'individus,
déléguant la souveraineté au gouvernement qui doit assurer
l'ordre social et politique. Le but implique à satisfaire les
préoccupations des citoyens. Mais entre l'intérêt public
qui ressort des compétences de l'État et les affaires locales
qu'il délègue aux collectivités territoriales dans des
choix politiques, il y a une distinction. La notion des affaires locales est
subjective et complexe. Assimilée à une tranche localisée
de l'intérêt général. « Les affaires
locales n'ont traditionnellement pas d'existence juridique objective. Le
critère territorial n'étant d'aucun secours, dès lors
qu'il permet seulement de déterminer la sphère
géographique d'intervention des autorités
administratives.» (Baguenard, 1980/2006, p. 26). La distinction
surgit avec l'intervention de l'État qui se fait uniquement dans
l'intérêt général.
4.5.2.-Question de l'autonomie de gestion des
collectivités territoriales
Sur le plan de leur existence, les organes de pouvoir local
s'exercent de manière indépendante du pouvoir central dans une
société à organisation politique
décentralisée. L'approche de l'autonomie de gestion est donc
fonctionnelle. Les organes locaux jouissent d'une indépendance
fonctionnelle leur permettant une libre gouvernance (administration) des
affaires locales.
Alors la question de la garantie juridique cristallise la
reconnaissance de la qualité des collectivités territoriales.
Comme personnes morales, les collectivités territoriales
représentent un acte de vie juridique. Elles ont des droits et
obligations qui leur permettent d'agir en leur qualité d'entité
proprement autonome. Qu'il s'agisse de patrimoine et d'engager leur
responsabilité. Elles peuvent user des prérogatives de puissance
publique. Mais cependant, cette qualité juridique ne garantit pas
totalement une réelle autonomie de gestion des collectivités
territoriales qui ont obligation de se soumettre aux injonctions des
intérêts généraux dans leur ensemble de
décisions. Et ces intérêts généraux sont
définis par l'État. Néanmoins, les acteurs locaux ont une
responsabilité qui les habilite à investir la gestion des
collectivités territoriales. Ce qui caractérise encore une plus
grande importance dans l'objectif d'une démonstration magistrale de leur
utilité dans la dynamique des rapports dans la frontière entre
Haïti et la République Dominicaine
122
4.5.3.- Organisation de la Section communale Lociane sur
le plan politique
La Section communale est organisée par la loi. Elle est
administrée par un organe exécutif : le CASEC assisté d'un
organe délibératif : l'ASEC. Ces organes sont élus pour
quatre ans avec pour attributions entre autres sanctionner et ratifier la
politique de développement de la Section communale
préparée et présentée par le
CASEC120.
D'après l'article 66 al. 2 du décret
électoral 2015. Pour les Sections communales ayant moins de 10,000
électeurs, 5 représentants sont élus. C'est le cas pour la
première Section de Matelgate. Pour les Sections de plus de 20,000
électeurs, 9 représentants sont élus. C'est le cas pour la
2e Section Lociane qui avait autant d'élus membres ASEC aux
dernières élections sous l'égide dudit décret.
À signaler que ses premiers élus CASEC et ASEC ressortirent des
élections de 1990.
Par ailleurs, les CT souffrent du manque de dispositions
légales qui établissent des appuis formels aux actions des
décideurs étatiques dans les milieux ruraux dans le cadre du
développement local. Sur ce, nous concluons ce chapitre qui a permis
d'élucider les différentes conceptions de l'État.
D'où relèvent ses responsabilités de rechercher
l'efficacité de son fonctionnement administratif dans le choix de la
décentralisation. Cette dernière est assimilée à
une côte de la colonne vertébrale de l'étude. Elle implante
sa fonction en agrémentant les fondements légaux du processus.
Elle agite le rôle prépondérant de l'État qui tient
son fondement dans la raison des Hommes, selon Hegel. La
décentralisation implique l'orientation dans une nouvelle gestion des
espaces territoriaux avec l'accentuation des responsabilités des agents
locaux dans l'implémentation de politiques publiques. La capacité
dont les autorités locales font montre pour concevoir des politiques
publiques de développement local et plus particulièrement pour le
développement de la zone frontalière de la 2e Section
Lociane signifie une avancée dans notre problématique.
L'enchevêtrement des forces agissant sur le terrain de la recherche
enjoint le choix théorique de notre approche globale d'analyse. Ainsi,
est-ce en fonction du prisme analytique structuro-fonctionnaliste que nous
évaluons les résultats de terrains. Pour le prochain chapitre,
cette phase traduit les résultats analysés des entretiens
semi-dirigés réalisés dans l'étude. Ce qui
caractérise également l'étape représentant la
structure empirique de l'opération de la recherche.
120 La loi du 4 avril 1996 sur l'organisation de la
collectivité territoriale de Section communale fixe à 3 membres
de Casec. Et les ASEC dépendent de l'importance démographique
soit 7 représentants élus pour un nombre inférieur ou
égal à 5000 habitants, 9 pour 5001 à 14999 habitants et 11
représentants élus pour les Sections communales ayant 15000
habitants et plus.
123
Chapitre V. Résultat de l'étude
La présentation des résultats, à partir
des données obtenues des séances d'observation et d'entretiens en
situation dans la 2e Section Lociane, signifie une partie
déterminante dans la présente recherche qui initie la situation
particulièrement concrète de l'unité d'étude. Toute
proportion considérée, il s'agit d'essayer de comprendre la
situation globale des habitants vivant autour des 380 km qui constituent la
ligne frontière entre Haïti et la République Dominicaine.
À priori, l'analyse tend cependant à éviter de permettre
de projeter une idée qui transcende le problème dans la recherche
des liens de causalité en vue de soutirer des pistes de solution.
D'où, par l'effet induit, le dynamisme transposera un
phénomène de changement de vision sur le reste du territoire qui
abrite la population entière. Sur ce point, il s'agit de rechercher la
justification de la pertinence des instruments de mesure et validité de
l'étude qui s'accentue dans la confrontation de données
significatives qui ressortent de la collecte de données sur le terrain
de la recherche. La démarche est orientée par la
problématique de l'étude qui évoque les
corrélations possibles entre des faits, des acteurs et les composantes
des conditions socio-économiques des paysans de la 2e Section Lociane
dans la dynamique de la décentralisation prônée par la
Constitution de 1987.
La recherche par méthodes mixtes à conception de
systèmes embarqués121 permet de collecter et
d'analyser des données qualitatives et quantitatives
simultanément au sein de cette étude pour répondre
à la question de recherche. Une grande préoccupation est donc
portée sur la présentation de tableaux chiffrés qui
serviront d'indicateurs quantitatifs d'une situation qui garde en
considération, avant tout, ses aspects qualitatifs dans la
représentation des conditions socio-économiques des paysans de la
2e Section Lociane. L'accent mis sur les données
concrètes démontre un paramètre important des indices ou
des tendances caractérisant le fondement de la recherche à la
fois quantitative et qualitative à vocation objective.
C'est ainsi que nous nous référons à des
illustrations dans des tableaux à chiffres pour permettre une plus
grande précision de rigueur dans l'énonciation des
appréciations analytiques. Cependant, il faut signaler que les chiffres
ne permettent pas de saisir toutes les réalités sensibles
à la qualité de vie et du vécu des gens.
121 En vue d'acquérir une compréhension approfondie
et étendue des conditions socio-économiques des paysans de
Lociane, cette conception de recherche se révèle une option bien
logique par rapport surtout à la problématique en
question. www.
voxco.com.Qu'est-ce-que la recherche par méthodes mixtes ? Site
consulté en juin 2023.
124
Le tableau ci-dessous affiche la présentation de la
répartition des cinquante-et-une (51) personnes qui ont répondu
aux questions de nos entretiens. Chaque localité contient un nombre de
répondants qui ont participé au travail de recherche. Cela
constitue l'échantillon de la population de la recherche à partir
des séances d'entretiens semi-dirigés conduits sur le terrain
(constitué de sept localités) de cette recherche au cours de la
semaine du 26 au 30 décembre 2022.
TABLEAU 3 : PRÉSENTATION DE LA
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS AUX ENTRETIENS
|
Présentation de la répartition des
répondants aux entretiens
|
|
Localités (terrains)
|
|
Nombre de répondants
|
|
Savane Mulâtre
|
|
9
|
|
Carrefour Suzely
|
|
8
|
|
Malary
|
|
7
|
|
Terre Blanche
|
|
9
|
|
Nan Croix
|
|
8
|
|
Boc Banic
|
|
5
|
|
Don Diègue 2
|
|
5
|
|
Total : sept (7) localités
|
|
51
|
|
Source : Frantz Isidor dans le cadre de ce travail de
recherche
|
5.1.-Rapport de proximité des autorités de
la collectivité territoriale avec la population
Les autorités locales contribuent fortement à la
gestion de proximité qui s'établit dans la fourniture de services
de base aux populations. Le rapport de proximité est une valeur
indicatrice de la prise de connaissance des besoins en vue d'apporter des
réponses nécessaires. Cela entraine la mise en application de la
théorie des parties prenantes qui s'applique dans la vigueur des agents
locaux et la volonté politique des gouvernants centraux.
Le tableau ci-dessous (présenté à la page
suivante) essaie de démontrer le sens de responsabilité que les
autorités de la collectivité territoriale manifestent envers la
population qui est leur mandant. L'enjeu est que par l'entremise des agents
locaux, l'État accentue sa présence de proximité qui est
à même de mieux permettre la satisfaction des besoins des couches
de base. D'ailleurs, c'est un moyen privilégié de partager des
informations. L'information un outil essentiel dans l'implémentation du
processus de décentralisation. Elle doit être envisagée
sous tous les angles : information technique, économique, politique,
juridique, commerciale, fiscale.
125
C'est pour cela que Beaudoux(2000) estime que tous les moyens
sont à mettre à disposition des paysans et des acteurs locaux
pour établir des canaux de transmission d'information : radio, presse,
technicien de contact, réunion d'information122, les NTIC et
même des centres d'information (p. 31). Cette démarche renvoie
à l'expression de la manifestation d'une volonté politique de
l'inclusion des paysans. Mais, malgré l'absence à l'infini de
volonté qui puisse exister, les contraintes des possibilités de
l'économie discursive sont évidentes pour ce qui concerne les
autorités locales de la 2e Section Lociane. Les instances
locales ne montrent pas l'évidence de la capacité d'action dans
la recherche de la complémentarité des forces actives pour
établir des rapports directs de discussions sur les conditions
socio-économiques des paysans. Les réactions révoltantes
des paysans de Savane Mulâtre vis-à-vis des autorités
locales démontrent clairement le bien-fondé de cette
interprétation analytique.
TABLEAU 4 : TENDANCE DE RAPPORT ENTRE LES PAYSANS ET
LES AUTORITÉS DE LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
|
Tendance de rapport entre les paysans de Lociane et les
autorités de la collectivité territoriale
|
|
Localité
Proximité des paysans
avec les instances locales
|
Boc Banic
|
Savane Mulâtre
|
Carrefour Suzely
|
Terre Blanche
|
Nan Croix
|
Malary
|
Don Diègue 2
|
|
% de répondants ayant constaté la présence
des agents locaux
|
20%
|
0%
|
11.11%
|
37.5%
|
12.5%
|
0%
|
0%
|
|
% de répondants ayant jugé qu'ils sont parfois
présents pour eux
|
40%
|
0%
|
22.22%
|
25%
|
25%
|
42.85%
|
0%
|
|
% de répondants
reconnaissant la présence des agents communaux pour
capture d'animaux
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
0%
|
14.28%
|
40%
|
|
% de répondants avouant leur déception des
agents locaux qui sont toujours absents
|
40%
|
100%
|
66.66%
|
37.5%
|
66%
|
42.85%
|
60%
|
|
Total
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Source : Frantz Isidor dans le cadre de l'étude
|
122 La rencontre avec les mandants est une méthode que les
élus doivent tenir compte suivant la logique de Beaudoux Etienne, dans
son papier intitulé Accompagner les ruraux dans leurs projets.
Éditions L'Hermattan, Paris, France, 2000.
126
Le tableau ci-dessus contient une double entrée qui
comprend en horizontale les localités incluses dans le champ
d'étude et en verticale, la tendance de rapport de proximité que
les autorités locales développent avec la population.
Cette présentation fait état de la relation que
les autorités locales étant les maires, les membres de Casec et
Asec développent avec leurs mandants. La logique active de
l'empowerment qui embrasse toute la spécificité du
développement local exige de l'inclusion des paysans. D'ailleurs, c'est
en établissant des ponts de dialogue que le processus
d'intégration se renforce.
Suivant les données disposées au cours du
travail, dans toutes les localités, une énorme déception
de la population se dégage vis-à-vis des agents locaux qui ne
manifestent pas grand intérêt à rester en contact avec la
population. Le rapport de ces données interprétées
confirme les propos des paysans qui ont dit que les agents locaux ne se
soucient pas d'eux. La totalité des répondants à Savane
Mulâtre avouent que les autorités locales ne sont pas disponibles
pour eux. À Don Diègue 2, la déception par l'absence des
agents locaux est à 60% des répondants, et les 40% ont fait
état de la présence des employés du service de capture
d'animaux de la Mairie qui interviennent au cas échéant. Terre
Blanche reste l'endroit où il y a moins de déception sur la
présence des agents locaux avec 37.5%, suivi de Boc Banic qui est le
lieu natif natal du dernier maire principal, devenu agent exécutif
intérimaire depuis 2020. Les 40% des répondants de la population
interrogée à Boc Banic ont pourtant avoué leur
déception des rapports que les agents locaux ont
développés avec la population après leurs
élections. Les 42.8% des répondants dans la localité de
Malary ont aussi évoqué le sentiment de déception.
À Carrefour Suzely et à Nan Croix, les
répondants, respectivement à 66.6% et 62.5% ont exprimé le
niveau de déception qu'ils éprouvent à l'égard des
autorités locales. Les 14.28% des répondants de Malary ont fait
état de la présence des agents communaux de capture dans la
localité. Et 42.8% des répondants de Malary admettent qu'ils ont
parfois contact avec les autorités locales. Les 40% des
répondants de Boc Banic ont admis le même jugement.
À égalité parfaite de 25% des
répondants, des localités de Terre Blanche et de Nan Croix ont
manifesté leur indulgence envers des agents locaux qui sont parfois
disponibles pour eux. À Carrefour Suzely, 22.22% des répondants
éprouvent un bon sentiment pour les élus locaux qui sont parfois
disponibles pour eux.
Dans la pleine satisfaction de contact avec les agents locaux,
Terre Blanche détient 37.5% de répondants qui avouent garder de
bon sentiment dans ce sens. Pour sa part, Boc Banic compte 20%
127
des répondants qui abondent dans le même courant
de satisfaction. 12.5% de répondants de Nan Croix portent un élan
élogieux des rapports développés avec les agents de la
collectivité territoriale. Enfin, 11.11% des répondants de
Carrefour Suzely partagent l'enthousiasme sur les bons rapports avec les agents
locaux qui se montrent présents pour eux. Mais le nombre de
répondants affichant leur insatisfaction est largement supérieur
par rapport à cette portion de gens montrant une certaine satisfaction
dans leur relation avec les élus locaux.
Le constat des observations nous amène à
questionner comment des paysans de la 2e Section Lociane peuvent-ils
établir de bonnes relations avec leurs élus locaux ? Dans la
foulée de ses mécontents de la gestion catastrophique des
autorités locales, il y a une remise en question de la
décentralisation dans cette Commune et ses Sections subséquentes.
Est-ce que la décentralisation est-elle déjà en train
d'être implémentée dans cette circonscription ? Autrement
dit, est-ce que c'est la mauvaise gestion des dirigeants locaux qui
caractérise une telle insouciance ? Lorsque les autorités des
collectivités territoriales ne se sentent pas obligées de marquer
une présence soutenue auprès de leurs mandants qui sont
majoritairement des paysans comment arrivent-elles à planifier des
projets de développements pour ces derniers ? Ces données
évoquées ci-dessus démontrent toutes les
difficultés de la possibilité d'accorder des acteurs locaux dans
une dynamique de conjonction de la force indispensable au développement
local.
5.2.-Certains aspects anthropologiques du
politique
L'analyse anthropologique du comportement du dirigeant
politique présente toutes les difficultés qu'il y ait pour
établir de bons rapports entre les gouvernants et les gouvernés
en Haïti. Entre une foule de promesses farfelues des campagnes
électorales et la gouvernance politique après les
élections il y a un fossé abyssal. Le dirigeant politique
haïtien n'a jamais manifesté une grande culture relationnelle et
communicationnelle avec leurs mandants dans l'expression de la
vérité. Le souci de dire la vérité est une
manifestation de responsabilité. Il ne s'agit pas d'interdir de donner
de l'espoir. Mais il est nécessaire de faire des promesses
réalistes. En ce sens, Habermas(1988), pense qu'on peut vouloir penser
une issue, mais on ne peut l'imaginer à n'importe quel prix.(p. ii).
C'est pour cela qu'il est indispensable d'avoir une société
civile qui s'engage dans les affaires publiques pour servir de contre-pouvoirs
aux pouvoirs publics. Les paysans de la 2e Section Lociane expriment
largement leur déception vis-à-vis des élus locaux. Elle
dérive des diverses promesses non tenues, de l'abandon des
localités.
128
Le devoir d'informer de tout ce qui se fait et
d'enquérir des données sur les conditions de vie de la population
est du ressort de la collectivité territoriale et d'autres instances
concernées. Cette pratique permet de prendre des décisions qui
répondent aux besoins réels de la population concernée.
Dans la 2e Section Lociane, l'agent communal de capture d'animaux
intervient pour sanctionner dans certains endroits comme à Don
Diègue 2. C'est un rapport vertical qui exprime le sentiment de
l'État de chef haïtien sans redevance envers la population.
L'auteure Donner(1998) eut à dire que le « chef de section est
l'image du souverain qui fait et défait de ses propres volontés.
» Cette caricature semble être bien incarnée dans la
psyché de l'agent communal et d'autant plus dans le milieu rural.
Ces données analysées et
interprétées ont démontré dans une logique
quantifiée d'une vision du comportement de l'autorité en
Haïti à l'aide de l'état des lieux dans la 2e
Section Lociane dans la période donnée. C'est ainsi qu'il
s'avère très important d'essayer de pénétrer le
fonds de la manifestation de la responsabilité que le paysan s'attribue
dans la démarche naturelle de la production de facteur de
développement local.
5.3.- Responsabilité manifestée par le
paysan dans la sphère du développement local
Le développement, comme objectif et processus
présente une forte incarnation de la vie sociale. Depuis l'adoption de
la Constitution de 1987, les acteurs locaux s'entendent davantage à se
réunir dans la défense d'un objectif précis pour leur
communauté. Cette nouvelle approche est à même de
créer le leadership nécessaire qui puisse conduire à faire
émerger l'intérêt commun pour des activités de
développement local. La transcendance de la conduite dans le sens de la
responsabilité renforce les instruments de confiance. De là,
ressort la vision stratégique qui dépend de l'autorité
d'organisation. Les paysans de Lociane se proposent d'assumer leurs
responsabilités dans leur devoir de citoyen pour vivre dans leurs
localités. La plupart de ces localités évoluent en dehors
des soucis des autorités de la collectivité territoriale. Les
récits de certains leaders communautaires expriment fort
éloquemment l'état mental du paysan. En appréciant les
propos de Dérévil, 45 ans, natif natal de Savane Mulâtre,
il convient de maitriser la psychologie sociale du paysan qui est
déterminé à affronter son destin. Ce paysan s'entend de
toutes ses forces pour dire « qu'il lui importait avant tout de
s'organiser pour vivre dans sa localité ». C'est un symbolisme de
conviction dans la combativité nécessaire à tout patriote.
Peut-il s'agir d'un sentiment d'éveil et de vigilance ? Ces propos
insinuent aussi combien les liens du terroir sont forts dans les
129
représentations mentales et sociales. C'est la
démonstration des caractéristiques essentielles de la vie
collective selon Aron(1965). Le paysan essaie à sa manière
d'orienter les phénomènes politiques en attirant le regard des
agents locaux sur les problèmes auxquels il est confronté. Par la
même occasion, il espère soutirer un engagement de la part de
l'État par l'effet d'un soin plus attentif sur la paysannerie.
La vigilance du paysan est une preuve qui signifie que leur
situation ne les affaiblit pas. Jean-François (2021, p.114) a repris la
grille de lecture de Roger C. Mill à propos du leadership dans les
communautés pauvres. Il s'agit d'un paradigme qui met en évidence
des efforts cérébraux qui permettent de transformer en
énergies positives toutes les mauvaises perceptions qui tendent à
compliquer la réalité. Il importe de dominer les forces vibrantes
qui cristallisent l'engagement des citoyens en interaction avec la
communauté dans une induction de propagation de la confiance et de
l'équité dans la revitalisation des stratégies de
développement.
Cette approche s'avère intéressante à
prendre en compte dans le contexte de la 2e Section Lociane qui,
plongée dans l'atmosphère de réflexion de
développement local, a besoin d'activités économiques
substantielles pour intégrer les masses paysannes dans
l'implémentation des décisions qui les concernent à cet
égard. Néanmoins, des encadreurs techniques qui maitrisent le
monde rural seraient aptes à stimuler les leaders paysans dans un apport
méthodique d'organisation communautaire participative. Bien
évidemment, plusieurs résultats y seraient attendus. En effet,
cela pourrait commencer par aider les producteurs agricoles à
rééquilibrer les rapports d'échanges commerciaux sur la
frontière.
Dans ce registre, nous pouvons signaler que le fond du rapport
commercial que les paysans de Lociane entretiennent avec les Dominicains est
très désavantageux pour les producteurs agricoles haïtiens.
D'où résulte toute l'importance du besoin de regrouper les forces
dans des structures organisationnelles pour permettre de mieux défendre
des intérêts communs. C'est ainsi que nous avons pensé
à saisir la tendance à l'organisation sociale dans cette zone.
L'organisation est cette forme de regroupement social d'individus qui sont en
interaction. Un même but collectif y est fixé en dépit des
divergences des individus sur des choix préférentiels, des
informations, des intérêts et des connaissances dont ils peuvent
disposer personnellement.
130
5.4.- Organisation sociale à Lociane
L'organisation est une structure capitale dans la
détermination des objectifs clairs et précis à atteindre
ou à réaliser. La définition des règles
impersonnelles valables pour tous est une force pour assurer la cohésion
et la fonctionnalité d'une organisation. L'adhésion des
participants à une organisation dépend largement des objectifs
visés, des personnes porteuses de la parole dans la direction de
l'organisation et le mode de fonctionnement qui trouvera un écho dans la
population. Les propos tirés des entretiens avec les paysans de la
2e Section Lociane, nous enseigne aussi de l'importance de la
capacité de la régénération en permanence d'une
organisation. C'est ainsi que comprendre la participation de ces paysans dans
des structures organisationnelles revient à considérer certains
de ces facteurs intrinsèques de l'organisation en question
elle-même.
TABLEAU 5 : TENDANCE DE PARTICIPATION DES PAYSANS DANS
LA VIE ORGANISATIONNELLE
|
Tendance de participation des paysans dans la vie
organisationnelle
|
|
Localité
Participation
à la vie
organisationnelle
|
Nan Croix
|
Terre Blanche
|
Savane Mulâtre
|
Carrefour Suzely
|
Malary
|
Boc Banic
|
Don Diègue 2
|
|
% de répondants
étant membres
d'une organisation
|
37.5%
|
11.11%
|
11.11.%
|
12.5%
|
14.28%
|
0%
|
0%
|
|
% de répondants
ayant été
membres
d'une organisation
|
0%
|
0%
|
22.22%
|
12.5%
|
0%
|
20%
|
0%
|
|
% de répondants
ne faisant pas
partie d'une
organisation
|
62.5%
|
88.88%
|
66.66%
|
75%
|
85.71%
|
80%
|
100%
|
|
Total
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
Source : Frantz Isidor
|
131
Le tableau ci-dessus contient une double entrée qui
comprend en horizontale les localités incluses dans le champ
d'étude et en verticale, la tendance de participation à la vie
des activités des organisations. Elles peuvent être de n'importe
quelle nature : politique, sociale et communautaire.
Ce tableau exprime en gros l'état de non
adhésion de la totalité de la population de répondants de
Don Diègue 2 à la vie d'organisation. Plusieurs raisons peuvent
se prêter à des hypothèses pour comprendre le pourquoi de
cette tendance allant dans la même direction pour toutes les autres
localités, quoique dans des proportions moindres. 88.88 % des
répondants de Terre Blanche, 85.71% à Malary, 80% de ceux de Boc
Banic, 66.66% de Savane Mulâtre et 62.5% de ceux de Nan Croix expriment
leur état de personnes n'ayant pas fait partie d'une structure
organisationnelle. C'est une donnée assez évocatrice lorsque l'on
sait ce que représente l'organisation dans la vie collective.
Pour des répondants qui ont été membres
d'une organisation, 22.22% en sortent de Savane Mulâtre. S'ensuivent Boc
Banic avec 20%, et enfin, Carrefour Suzely comptant 12.5% des répondants
qui ne manifestent plus d'intérêt pour faire partie des structures
organisées. Du côté de la vie idéale de
l'évolution organisée des membres de la communauté, Nan
Croix compte 37.5% de paysans répondants qui ressentent plus
d'importance à ce sujet. Dans cette catégorie, Malary compte
14.28% de répondants, et 12.5% pour Carrefour Suzely. À
proportion relative, Terre Blanche et Savane Mulâtre affichent
également 11.11% de répondants dans ce travail. Les
répondants attestant qu'ils sont membres d'organisation partagent les
deux structures organisationnelles qui sont parmi les plus influentes dans la
zone, à savoir : MPP et OJUDT.
Il faut remarquer que l'intégration des structures des
organisations communautaires ne relève pas de la volonté du
paysan en soi. C'est un travail qui concerne les leaders communautaires qui
doivent sensibiliser les paysans sur cette nécessité. Et
l'adhésion des paysans se fera en fonction de la confiance que lui
inspire les objectifs de l'organisation et surtout les qualités du
leader dans ses pratiques. C'est pour dire que le besoin, même s'il se
fait sentir, il est difficile de demander au paysan de le combler. Toutefois,
il ne faut pas écarter des possibilités d'expérimentation.
Ainsi, avons-nous trouvé l'initiative de Pierre Onès, dans la
localité de Nan Croix, avec une Organisation pour le
Développement des Paysans de la 2e Section Lociane (ODPSL).
L'esprit de regroupement est présent, mais que dire de la
capacité de management. Pour ce qui concerne des organisations
coopératives, nous n'avons pas relevé de cas de leur existence.
Avec quelles compétences les leaders communautaires pourront-ils
s'organiser pour forcer l'État et les agents locaux à assumer
132
leurs responsabilités vis-à-vis de leurs milieux
? À propos, Mengin(1989) souligne que les populations vivant dans les
milieux marginalisés, comme acteurs, ont grand intérêt
à saisir la dimension du processus de développement local en vue
de prendre leur destin en mains (p. 24). Aussi en ajoute-t-elle, c'est un
important outil politique en termes de moyen de mobilisation des ressources
locales matérielles et humaines (p. 22).
La plus forte proportion de répondants qui ne participe
pas aux activités organisationnelles est une démonstration assez
significative. Cela prouve qu'il y a une certaine difficulté pour
compter sur la seule capacité des paysans de cette Section communale
pour tout réaliser en matière d'organisation sociale. Or, le
développement local compte beaucoup sur l'organisation sociale. Cette
situation conforte une raison qui corrobore l'intérêt que nous
avons démontré tantôt pour que des agents des le
caractère difficile du contact entre le paysan et les institutions de
développement. Néanmoins, le milieu d'intersection recoupe dans
une stratégie participationniste123 qui dépend de
l'objectif poursuivi dans la relation acceptant l'apport réflexif du
paysan dans l'instance décisionnelle. Par ailleurs, l'une des meilleures
façons permettant de manifester la force dans les affaires publiques
d'une communauté est la teneur du niveau d'organisation sociale. C'est
pour cela que collectivités territoriales, aidés des
spécialistes de développement, puissent se mettre en portefaix du
poids de la cause du développement des localités qui se trouvent
dans cet état. Cependant, Olivier de Sardan (1995, p. 165) tente de
démontrer que les structures organisationnelles constituent des outils
importants pour la mise en place ou le montage des pièces essentielles
du fonctionnement de la vie collective. Le rapport de dépendance
existant entre vie collective et structures organisationnelles est la base sur
laquelle puisse être construit l'édifice de la force des acteurs
paysans pour déterminer leur capacité de participation.
Mais le paysan de la 2e Section Lociane est
livré à lui-même. Cette situation ne fructifie pas le temps
qu'il consacre dans son projet de vie. Une collaboration s'avère
nécessaire. Subissant unilatéralement le poids de
l'infrastructure économique prédatrice, le paysan admet que
l'heure d'un dialogue s'impose pour une conjonction d'intérêt. Le
besoin d'organisation de la force paysanne est pressant. Il est tant
espéré que des coopérations puissent s'établir avec
des organes extérieurs pour implémenter des projets de
développement local en appui à des filières agricoles
123 C'est une expression utilisée par Sardan pour
signifier l'intégration du paysan dans le noyau décisionnel.
133
et même en appui à des organisations rurales
autonomes. Notre propos tient fortement à Engels (1998, p. 50)
évaluant que la force de production dont dispose l'humanité est
immense. Cette considération optimise la possibilité
d'accroître indéfiniment le rendement du sol en y combinant
l'apport du capital, du travail et de la science. Cette approche a
trouvé une relance systématique dans la théorie de
développement économique de Robert Solow démontrant que
les facteurs : capital (investissement), le travail (main-d'oeuvre, population)
et le progrès technologique permettent aux pays de croître
à un taux élevé à long terme. Ainsi, c'est l'oeuvre
de la force conjuguée qui doit s'appliquer pour changer la dynamique
dans les termes d'échanges dans la zone de frontière de la
2e Section de Lociane.
5.5.-Représentation du commerce des produits
agricoles dans la frontière de la 2e Section Lociane par
rapport à la dynamique interne
La frontière est considérée par la
majorité des paysans de cette Section communale comme une
opportunité majeure de développer des affaires commerciales. Elle
caractérise, en un sens, un territoire entrepreneur pris dans le
contexte de la 2e Section Lociane, étant organisé et
exploité uniquement pour ses ressources où les seules
potentialités économiques y sont prises en charge, selon l'avis
de Dorvilier (2011, p. 33).
Pour les paysans de la 2e Section Lociane, la
frontière est une notion que l'on désigne de `nan
fwontyè ' ou ` fwontyè a '. La frontière est
atteinte par plusieurs passes. Les débouchés commerciaux
représentent une grande opportunité et intéressent
beaucoup les Haïtiens de cette zone. La frontière, selon les
réflexions de Sodner Pierre, 42 ans, paysan de Nan Croix, est un espace
d'opportunités pour développer les activités commerciales
». L'activité commerciale relève d'échange de
produits. Dans ce cas-là, nous avons vu que le paysan de la
2e Section de Lociane ne produit pas beaucoup pour échanger.
Et d'autant plus que ses moyens de négociation dans les termes
d'échanges commerciaux sont très limités.
Les principaux produits agricoles qu'il vend aux Dominicains
sont le pois congo, la pistache et le maïs. L'activité commerciale
relève d'échange de produits. Ces derniers doivent être
engendrés dans les conditions favorables à un rendement maximum
par le rapport de production et les ressources engagées. Même pour
considérer le secteur agricole qui concerne la 2e Section
Lociane. Mais la production agricole de cette zone dépend des
aléas de la pluviosité annuelle. Donc, elle accuse une grande
fébrilité qui engendre sa diminution constante au fur et à
mesure que les
134
problèmes environnementaux exposent un régime
climatique qui allonge la saison de sécheresse. D'ailleurs, la
2e Section Lociane est l'objet de la pratique d'abattage
systématique des arbres pour le commerce de charbon. Sans aucune
intervention de l'État en matière de reboisement ou de protection
de l'environnement, la frontière reste la seule solution de survie pour
la majorité des paysans. Raymond, 54 ans, paysans de Boc Banic, «
regrette que les paysans haïtiens ne disposent pas d'accompagnement
nécessaire dans le crédit agricole pour pouvoir financer l'achat
de matériels agricoles plus ou moins modernes tels que pompe
d'irrigation, tracteur agricole, etc. Ce qui leur permettrait d'intensifier la
production agricole. Cela permettrait également la rentabilité
économique dans la vente aux Dominicains et au marché
intérieur ». Mais pour le moment, ajoute-t-il, nous faisons le jeu
des Dominicains qui contrôlent presque tout, le prix d'achat et le prix
de vente de tous les produits qui viennent dans le marché124
binational. Il en rajoute pour dire « Nous les Haïtiens qui venons
vendre sur le marché binational, nous avons parcouru un long chemin
difficile à mototaxi ou à dos d'âne. Il n'y a pas moyen de
conserver nos produits périssables. Il n'y a pas d'autres moyens que de
vendre si nous ne voulons pas tout perdre. »
Cependant, une chose attire notre attention dans les propos de
Raymond. Ce n'est pas tant l'aspect de rentabilité qui le pousse dans la
relation commerciale avec les Dominicains, c'est en réalité une
obligation. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il y a aussi une impuissance
face à une situation qu'il ne contrôle pas. Une rage
intérieure le ravage dans le fait qu'il doit vendre ses produits aux
prix imposés par les Dominicains sur les marchés de la
frontière. Par contre, les Dominicains vendent
généralement les leurs aux prix qu'ils veulent eux-mêmes.
Les conditions en place ne permettent pas aux Haïtiens de pouvoir trop
jouer sur la loi de l'offre et de la demande. Les Dominicains savent bien que
les Haïtiens sont dans des conditions précaires. Raymond insinue
que « c'est l'augmentation de sa production qui peut lui permettre de
vendre plus pour pouvoir entrer beaucoup plus d'argents qui permettront de
subvenir à ses besoins familiaux ». Mais ce n'est pas sa condition
de vente qui va être améliorée pour autant. Au prix de 650
à 700 pesos le quintal du pois congo, il n'y a pas un
bénéfice tiré par rapport au travail consenti dans les
champs d'exploitation agricole.
124 Le marché facilite la
commercialisation des denrées agricoles et les produits
manufacturés. Il constitue un ordre organisationnel plus ou moins
rigoureux. Les évantaires et les tonnelles se rangent par niveau de
spécialisation. Ainsi nous avons des jours de marché dans la
2e section de Lociane et dans la zone frontalière : Jeudi,
Hato Viejo ; Mercredi, Boc Banic ; Dimanche, Banica.
135
Le paysan va vendre personnellement ses produits agricoles sur
le marché frontalier. Il n'y a pas une instance intermédiaire qui
pourrait permettre de tenir le cours du marché. Si une organisation de
type de coopérative est disponible à pouvoir intervenir dans le
marché intermédiaire dans l'objectif de procéder à
l'achat des produits des paysans et qu'elle allait en revendre aux Dominicains,
peut-être arriverait-elle à jouer sur l'offre et la demande, parce
qu'elle serait en situation de monopole. Nous savons bien la force de
l'organisation dans le marché économique. Mais lorsque plusieurs
petits paysans vont peser à la vente125, il n'y a pas une
force réelle pour tenir le cours du prix des produits. La division fait
l'affaire des Dominicains. Le faible niveau d'organisation des paysans dans ce
milieu démontre toutes les difficultés qu'ils éprouvent
pour contrebalancer l'influence des Dominicains dans les échanges
commerciaux. Bien entendu, ce n'est pas le principal facteur explicatif de
cette problématique, mais il va de soi que l'organisation joue un grand
rôle de nos jours dans le marché de l'offre et de la demande.
5.6.-Impact de l'importation des produits agricoles sur
la production du paysan haïtien
La paysannerie recoupe de facteurs économiques
systémiques à une typologie d'organisation sociale. L'espace
qu'occupe le paysan est façonné par son rapport avec ses
obligations envers ses membres de famille et les détenteurs des pouvoirs
qui l'entourent. Le paysan haïtien est livré à
lui-même depuis l'indépendance. Bastien (ibid.) souligne
qu'il n'attend rien de l'État. Il est un auto-employeur qui dirige ses
affaires agricoles et y réalise les travaux avec ses proches. Il est
aussi institué la pratique du coumbite126 qui
facilite le partage de la force de travail. À partir de ses
expériences, il développe un savoir-faire, des moeurs et coutumes
qui intègrent son propre être dans son naturel état. Cet
être travailleur, économe et sobre dont la diminution de la
rentabilité de sa production agricole entraine de plus en plus sa
dépendance vis-à-vis de l'étranger.
La production diminuant accentue l'importation qu'entraine
l'inflation accusant la régression de la qualité de vie des
paysans. À ce propos, nous relevons, selon Paul (2016, p.13),
l'accentuation de l'inflation qui s'accroit avec l'importation des biens et
services résultant de l'adoption du
125 Il y a un autre problème d'ailleurs relatif au
statut du paysan qui n'est commerçant. En aucun cas, il ne saurait
être capable de participer à un appel d'offre de l'État. En
fait, c'est une autre paire de manche que cette étude ne traite pas.
126 Rémy Bastien désigne en l'expression coumbite
ou combite, la forme d'entraide communautaire de travail sans
rémunération qui implique des voisins non apparentés. Mais
André-Marcel d'Ans considère que de nos jours, le paysan assimile
le combite comme un ensemble de manouvriers de statut socio-économique
inférieur qu'on rassemble à l'influence plus ou moins de force
pour aller travailler gratis, simplement en échange de sa nourriture.
136
système de change flexible127 en Haïti
au cours des années 1990. En ce sens, O. Deshommes (2014,
p.18), souligne que les paysans sont submergés par l'invasion des
produits importés des pays qui pratiquent souvent une politique de
dumping commercial. Ils meurent tranquillement et constatent avec impuissance
l'anéantissement de leurs facteurs de production locale.
Aucune politique publique en vue d'augmenter la production du
pays n'a été conduite pour juguler le phénomène de
cherté de la vie qui affecte considérablement la population et
particulièrement les paysans des zones reculés. La
dépréciation de la monnaie nationale est aussi
caractérisée face au peso dominicain qui s'applique dans les
échanges sur les marchés des zones frontalières.
Selon l'analyse de Paul (2016, p. 13), les facteurs
contributifs à une telle situation résident surtout dans : le
déséquilibre de la balance des paiements, le financement du
déficit budgétaire, etc. À cet égard, nous avons
tantôt souligné la pertinence de la nécessité de
définir des priorités en disposant des allocations
budgétaires en vue d'exécuter des politiques publiques
productives de développement. Mais en réalité, Haïti
se confronte à de graves difficultés à la consolidation
budgétaire. Cela signifie qu'elle n'arrive pas à réduire
son déficit budgétaire. Un véritable gâchis
réside dans la dépense publique, la collecte des recettes et la
valorisation des ressources publiques. En nous référant aux
raisonnements de Laleau (2020, p. 85), nous nous accordons sur le fait
qu'Haïti s'attache prioritairement à financer les importations au
lieu de disposer ses ressources à la propulsion de l'investissement
privé où la création d'emploi et de richesse dans les
secteurs productifs jouent le rôle prépondérant à
travers les petites et moyennes entreprises dans les milieux ruraux. Ces
préoccupations correspondent bien à la théorie de la
dépendance dans les stratégies de développement qui fixe
un rôle prépondérant de l'État dans la production de
facteurs de fourniture des biens et services afin de réduire la
dépendance sur les marchés extérieurs.
Concernant la 2e Section Lociane, les paysans
possèdent des stratégies économiques qui
s'établissent sur la petite production marchande128 et les
mécanismes sociaux répondant aux mutations sociales et
économiques. Mais cependant, l'espace vide dans lequel ils
évoluent exige
127 Paul, J E., La décote de la gourde face au
dollar. Quelques pistes pour sortir du marasme économique actuel.
Editions C3, Delmas, Port-au-Prince, Haïti, 2016.
128 Le concept de petite production marchande est
l'émanation de Marx qui décrivait la condition des paysans
français après la révolution de 1789. Karl Marx
considérait les petits lots privés que les paysans exploitent en
fonction de leurs moyens de production. Cf [Gabriel Gbénou, Le
revenu paysan.Entre la logique sociale et la raison utilitaire, Editions
Presses de l'Université Laval, Québec, Canada, 2010, op. cit.,
138].
137
bien des services qu'ils ne peuvent pas se procurer dans les
meilleures conditions sans l'intervention de l'État.
5.7.-Accès aux services vitaux
5.7.1.-Eau
L'accès à l'eau potable est le problème
majeur auquel est confrontée presque toute la population qui vit dans la
2e Section Lociane. Les propos de la majorité des personnes
avec qui nous avons eu des entretiens dans la quasi-totalité des
localités abondent dans le même sens que Solage, habitante de Don
Diègue 2 relatant que « la ravine de Don Diègue où la
population savait aller puiser de l'eau dans les trous de sable est
pratiquement tarie ». Elle poursuit en ce sens que « c'est à
une heure et demie de marche que nous allons en chercher à Lociane
». Toutes les autres localités souffrent énormément
des difficultés de l'accès à l'eau potable dans une
proportion exagérée qui caractérise une violation
flagrante des droits de l'homme. Le cas de Savane Mulâtre est
évocateur. Diéné Hyacinthe, âgé de 35, natif
natal du lieu, eut à nous dire en ces termes : « se men'm kote
ak bèt nap pran dlo pou nou bwè nan twou sab nan rivyè
Lociane nan ». Il en rajoutait : « se depi'm piti map tande
paran m yo ap reve yon jou pou nou ka bwè dlo tiyo nan Savann milat
tankou tout moun nan lot kote yo. Helas ! Nap mouri nou pap janmè jwen n
yon bagay konsa isit la».
Depuis 2017, l'ONG chrétienne GVCM a construit le seul
puits artésien que dispose Malary. Losqu'il est tombé en panne,
c'est à plus de 5 à 7 km que des habitants de cette
localité doivent se rendre pour chercher de l'eau. Bien entendu, s'ils
ne veulent pas en puiser à la source de terre dans le lagon. Pour se
rendre à Garde Salnave ou à Savane Plate, on doit payer une
course de moto-taxi jusqu'à cinq cents gourdes pour vous conduire
à remplir 5 ou 6 récipients. Ils sont généralement
de gros gallon de couleur jaune équivalent de 5 petits gallons de 4.5
litres par unité de gallon. Il est fort à parier que la
population ne peut pas tenir un tel coût de revient de 83 gourdes pour un
gros gallon d'eau. À défaut de disposition de moyens pour pouvoir
consentir de tel sacrifice pécuniaire, les habitants utilisent l'eau de
la rivière Loratoun, Don Diègue ou la Lociane pour la boisson, la
cuisine et tout. Seule la localité de Boc Banic accuse d'une
disponibilité minimale d'eau potable. Les paysans de Terre Blanche ne
disposent de l'eau sur place, ils doivent se rendre soit à Garde Salnave
pour plus près ou soit à Savane Plate un petit peu plus loin. Ces
endroits sont situés sur la route nationale qui revient de Los
Posos129 où est placé depuis 1978 un système
d'adduction
129 Los Posos est une localité qui se trouve dans la
section Acajou-Brûlé 1 de la Commune de
Cerca-la-Source.
138
d'eau potable pour alimenter le milieu urbain de Thomassique.
La plupart des localités ont été créées
après cette date. Elles n'ont pas encore fait l'objet de projet
d'adduction d'eau potable. Cependant, il est essentiel de rappeler que
l'approvisionnement en eau potable est étroitement lié aux droits
à la vie, à la nourriture et à la santé (Levin,
2009, p. 9).
5.7.2.-Soin de santé
La santé est l'état complet de bien-être
physique, psychique et mental. C'est un droit garanti par l'article 25 al. 1 de
la déclaration universelle des droits de l'homme. Comme droit,
l'engagement est nécessaire pour permettre d'atteindre cet état
de bien-être. Selon Amartya Sen (cité dans Mathon, 2012), le
développement et la formation du capital humain sont fortement
imprégnés dans la distribution des services de santé
(p.16). Cette affirmation insinue la préoccupation majeure qui devrait
engager les autorités dirigeantes d'un pays pour caractériser des
mesures qui puissent fixer des capacités en vue d'atteindre des
objectifs dans la fourniture équitable de la santé à la
population. Mais, il est un fait que ces préoccupations restent encore
un défi pour Haïti. Dans le cas particulier de la 2e
Section Lociane, toutes les localités souffrent énormément
de la difficulté d'accéder aux soins de santé. La distance
à parcourir à bord d'une motocyclette ou à dos d'âne
pour une personne malade de trouver un centre de santé à
près de 15 kilomètres au moins demeure une réalité
démontrant tous les retards qui restent encore à combler pour
respecter l'engagement pris dans l'application des mesures en faveur des ODD
formulés en 2015.
Cependant, la marche à pied reste le moyen
généralement utilisé par la majorité des paysans.
La dame Solage, de Don Diègue 2 eut à se plaindre pour les
problèmes de santé. Très inquiète, elle s'indigne
en disant « qu'il vaut mieux de ne pas y penser parce que le centre
médical de Boc Banic ne fournit que certains soins primaires. Pour toute
autre complication la mort est presque assurée pour la personne qui est
malade. » Dérivil de Savane Mulâte, ajoute en ce sens :
« se bondye kap gade moun isit pou yo pa malad grav. Depi ka a yon
moun grav nan tan pou nou rive ak li nan lopital ki Boc Banic ou Thomassique ou
Cerca-la-Source ou Banica, gen anpil fwa nou pèdi moun nan ».
Cette situation explique que la distance est trop longue en plus de la mauvaise
qualité de la route. Par ailleurs, la saison pluvieuse
caractérise la forte crue de la rivière Lociane qui rend quasi
impossible tout déplacement. À un certain niveau, seule la
localité de Boc Banic dispose du minimum de service de santé. Il
n'est pas évident d'en rechercher la qualité. Il est facile de
comprendre que les conditions de pauvreté dans lesquelles
évoluent ces paysans peuvent
139
occasionner beaucoup de maladies. Les risques de maladies
représentent une menace pour la santé publique. Il est fort
à parier sur la frontière pour pallier au grand manque de service
santé qui caractérise la 2e Section de Lociane. Mais
les difficultés viennent de la volonté des Dominicains de bloquer
la frontière assez souvent pour d'autres cas en dehors de l'aspect
commercial, c'est-à-dire il est plus facile qu'ils vous laissent entrer
dans les jours de marché que d'autres jours. M. John Hodgson et Joseph
R. Oppong (cités dans Mathon, 2012) soulignent des modalités de
mesure sur les effets des frontières sur l'accès aux soins de
santé. Une frontière ouverte offre plus d'opportunité pour
bénéficier des services de base que le pays voisin dispose.
5.7.3.-Éducation
Ne disposant pas assez de moyens pour se payer une course de
400 gourdes aller-retour de mototaxi, un effort de près de deux heures
de marche est consenti par les enfants de Malary qui doivent se rendre à
l'école à Thomassique. Trois structures scolaires, à
savoir : une école nationale, une école de la mission
d'église conservatrice et une école communautaire accueillent les
élèves de niveau primaire de la localité de Nan Croix.
L'école nationale n'a pas son local proprement disponible, c'est dans
l'après-midi qu'elle fonctionne à l'abri de l'église
conservatrice. Les écoles de Nan Croix accueillent des
élèves d'autres localités proches telles que Matelag, Fon
Davi et Monbin Trou qui n'ont pas assez de structures scolaires capables
d'accueillir tous leurs postulants. Cette situation explique combien
l'éducation occupe une place prépondérante pour les
parents des localités évoquées dans la recherche.
Malgré le fait que certains parents de Don Diègue 2 se plaignent
de l'augmentation d'un millier de gourdes du frais scolaire qui devient au
montant annuel de trois mille gourdes. La proximité des structures
scolaires peut favoriser une plus grande possibilité de
fréquentation. C'est la logique qui est démontrée dans la
plaidoirie de Michelle Blanchard, fille de 20 ans de Terre Blanche qui «
estime que la distance de plus de 4 kilomètres à parcourir est
une des causes principales de la non scolarité de nombreux enfants dans
sa localité ». Parce que c'est à dos d'âne ou à
pied que des petits enfants ont l'habitude de se rendre à
l'école. Les élèves de Terre Blanche ont la
possibilité de se rendre à l'École Nationale de Hatonuevo
ou à l'École Nationale Saint-Jean de Savane Plate dans une
distance d'à peu près 5 km. À Boc Banic, le niveau
scolaire atteint la 9e A.F. Les résultats officiels de la
9e pour l'exercice 2021-2022 ont enregistré la
réussite de trois élèves de l'école nationale de
3e cycle de Boc Banic sur onze y ayant participé. Cette
donnée signifie la faiblesse de la qualité d'enseignement
dispensé dans cette zone.
140
C'est au MENFP que revient l'attribution de la gestion de la
formation. Il dispose de la latitude de former un modèle de citoyen
à travers le contenu de la formation qu'il lui enseigne. Parce que
l'éducation engendre des bénéfices économiques
individuels et sociaux. C'est à ce niveau que nous rejoignons la mission
transcendantale de l'État dans le sens prôné par Hegel,
Weber et Marx.
5.7.4.-Encadrement agricole
Les moyens de relever les données sur la dynamique
agraire de la zone justifient les questions sur l'encadrement technique au
niveau agricole dont dispose le paysan. Cette démarche vise à
relever la vision politique qui constitue la base tangible pour augmenter les
connaissances scientifiques des paysans. Il est admis normal de penser à
professionnaliser l'agriculture pour permettre à ce que le paysan
haïtien devienne un exploitant agricole. En ce qui concerne le paysan de
la 2e Section Lociane, ces considérations vont lui permettre
de tirer avantage dans les rapports des échanges commerciaux de produits
agricoles avec les Dominicains.
Une partie importante du problème des paysans de cette
zone réside dans la non-prise en compte de la question de la dynamique
agraire par des autorités avec les paysans. Il s'agit d'un constat de
l'absence de politiques publiques visant à définir une dynamique
agraire. Cette notion concerne les modes d'exploitation, la politique agricole,
les systèmes agraires et l'ouverture des marchés. Mais en fait,
la problématique persiste dans le fait que la plupart des paysans de
cette zone ne dispose pas d'encadrement agricole. Les paysans de la
2e Section Lociane s'en plaignent beaucoup. Pour la majorité
d'entre eux, le fait d'aller travailler en République Dominicaine
pendant une partie de l'année répond aux contraintes de la
dépendance de la pluie dans l'agriculture dans cette zone. En effet, il
y a une nécessité pour établir la cohérence dans
l'accès à la terre et l'exploitation de la terre. Cela traduit
intrinsèquement à un mode de gestion des intrants
nécessaires à la dynamique agraire dans le cadre de la production
agricole. Il s'ensuit aussi un besoin d'implanter des moyens de
développement d'une agriculture intensive où se pratique la
jachère ou l'utilisation d'engrais. Cela nécessite au
préalable de la disponibilité d'un système d'irrigation en
vue de permettre de réaliser le rendement maximum dans la production
agricole.
La pertinence du produit intérieur par tête dans
cette Section communale de 37,467 habitants est un indicateur du niveau de
développement économique qui peut nous permettre de saisir
141
approximativement le phénomène. Parce qu'en
fait, il reste difficile de vivre sans revenu130. Le paysan de la
2e Section Lociane en est bien conscient de tout cela comme
l'ensemble de la paysannerie haïtienne. Par ailleurs, c'est pour cette
raison que le paysan développe une approche socio-psychologique tendant
à se mettre au travail pour être responsable de soi-même.
Cette approche a toujours prédominé en dépit de toute
circonstance. Par exemple, la garde d'un cabri exige d'aller l'amarrer, le
faire nourrir, le changer de place, le surveiller, etc. Le travail dans le
champ agricole est comme une obligation naturelle à laquelle tout le
monde y participe. Cette situation présente toutes les
difficultés de considérer le chômage dans son sens
étymologique par rapport à ce milieu rural. La plupart des
activités évolue dans un cadre purement informel.
L'économie informelle est souvent mal organisée et, par
conséquent, l'anarchie qui y règne la rend non rentable à
tout le monde.
Ce qui prouve encore toute la difficulté de mesurer le
revenu personnel de chacun. Puisque la tendance à l'entraide reste
fortement enracinée dans les mentalités. Mais en fait, à
la lumière des raisonnements de Mengin(1989), nous pouvons
considérer que les paysans sont liés à la création
ou recréation des activités économiques (p. 26).
Même si le taux de chômage peut-être considéré
très faible, mais, rien ne prouve pour autant que le travail des paysans
rapporte beaucoup en termes de revenus résultés du rendement et
de la productivité du travail. L'esprit débrouillardiste est bien
présent chez ses paysans. D'après Pierre-Charles (1967/1993), il
y a donc une nécessité urgente d'intervention sur
l'implémentation de politiques publiques et de réalisation des
projets d'accompagnement pour maximaliser les rendements de l'économie
populaire qui peut être véritablement vitale et dynamique dans
l'emploi, dans la production de biens et services, dans l'agriculture et
l'artisanat (p. 16).
Mais une constante revient sans cesse dans toutes les
expressions des personnes interrogées, c'est que les conditions de vies
sont devenues très difficiles dans l'exploitation agricole des petites
propriétés. Leurs superficies tendent d'ailleurs à
diminuer au fil du temps c'est-à-dire de génération en
génération avec le morcellement en héritage.
130 Le revenu est un terme qui renvoie implicitement à la
provenance des revenus. Dans le cas de la 2e Section Lociane, les
revenus des paysans proviennent de différentes sources qui vont de la
vente des produits agricoles et des transferts des proches évoluant
généralement en République Dominicaine. Avec la vague de
la migration haïtienne dans de nombreuses contrées
sud-américaines ces derniers temps, il n'est pas de doute qu'il y ait
d'autres sources des transferts. Pour les transferts en provenance de la
République Dominicaine, il y a l'aspect de commission donnée
à une personne en voyage qui va livrer à la personne
destinataire. Cette réalité traduit un mode de fonctionnement
traditionnel qui tend à disparaitre avec les services des maisons de
transfert qui commencent à s'implanter un peu partout dans le pays de
nos jours.
142
Le cycle infernal de pauvreté absolue des paysans est
aussi constaté par Via Campesina(2002). Ses propos indiquent que
l'exploitation agricole strictement manuelle non chimisée
pratiquée sur des superficies réduites de l'ordre d'un
hectare131 (ha) fournit des rendements en équivalent-grain
à peu près de 10 quintaux (qx). Ce qui produit un rapport de
productivité du travail du paysan d'une valeur de 10 qx par actif. Dans
le contexte de la 2e Section Lociane, cette modélisation
permet d'apprécier la mesure d'exploitation agricole
généralement inférieure à 1 ha n'atteignant pas 10
qx en termes de productivité du travail. Ce qui équivaut à
1000 kg de grain. De nos jours, la forte baisse du prix du grain fait
évaluer à moins de 10 dollars pour 100 kg de grain.
C'est dans cette même logique que Raymond nous a
renseigné que le quintal du pois congo se vend au prix maximum de 700
pesos. Le mode de production agricole donne un seuil de productivité ne
dépassant pas 1000 kg de grain net. Dans cette optique,
l'IHSI132 fournit le PIB réel en 2021 à 614.3
milliards de gourdes soit l'équivalent de 8,190,666,666.67 dollars au
taux de change de 75 gourdes pour un dollar. Avec une population de 11,905,892
habitants, la déduction pour le nombre de 37,467 habitants de la
2e Section Lociane donne une valeur du PIB réel de 25,
775,448.66 dollars. En substance, le PIB réel par tête d'habitant
de la 2e Section Lociane atteint la valeur de 687.95 dollars pour
l'année 2021. Cette valeur équivaut à 1.88 $ us par jour.
Ainsi, dans le classement défini par Jeffrey D. Sachs (cité dans
Jean-François, 2021, p. 36), un revenu de moins $3 par jour
caractérise la pauvreté endémique. Ce qui prouve bien la
corrélation qui existe entre certains indicateurs économiques et
l'état des conditions socio-économiques des habitants de cette
zone rurale allant dans une baisse continue du PIB par tête d'habitant.
D'où résulte le faible pouvoir d'achat qui se justifie
automatiquement avec une telle faiblesse au niveau du PIB.
Comme nous l'avons dit tantôt, le milieu rural subit un
fort taux d'inflation démontrant toutes les difficultés des
moyens de communication qui font en partie augmenter les coûts des
produits industriels dont les paysans ne peuvent pas s'en passer.
5.8.-Perception de l'État haïtien dans son
abandon du monde paysan dans l'opinion des paysans.
La dégradation drastique de la vie paysanne est une
conséquence directe de la politique gouvernementale et de son
incapacité à établir un contrat socio-économique et
politique qui offre
131 Un hectare est l'unité de mesure agraire
équivalant à 100 ares. Cela constitue une superficie de
100m*100m, soit 10,000 mètres carrés.
132 Rapport/IHSI: l'économie haïtienne en chute
libre, des économistes haïtiens restent « pessimistes »
pour 2022 | Gazette Haiti.[En ligne] http :www.gazettehaiti.com,
consultation de juillet 2023.
143
des garanties viables dans la justice sociale comme base d'une
nation. C'est sur cette finalité que les masses, devenues conscientes de
la réalité sociale, s'attèlent à identifier et
analyser, selon Jean-François (2021), les causes de leur situation et
comprendre leur condition de vie de manière non fataliste. Certainement,
Bastien (1951/1985) lui aussi, bien avant, a compris qu'une évolution
s'est produite dans la mentalité des paysans. Ils deviennent donc moins
fatalistes dans l'appréciation des difficultés auxquelles ils
sont confrontés. L'organisation sociale est mise en cause. C'est le
processus qui a conduit à ce que la plus grande partie des richesses
créées par les paysans est accaparée par une
minorité urbaine (F. Deshommes, 2006, p. 222). La bourgeoisie
embryonnaire, prédatrice dans la logique de Joachim (1979/2014, p.
206), s'est confondue dans l'État tout en accaparant des domaines
publics pour exploiter les paysans. Les dirigeants de l'État qui, dans
la crise aiguë des années 1980, encore sous les recommandations de
l'USAID, selon Gilles (2008), se sont engagés dans la production de
produits agricoles destinés à l'exportation en vue de
générer des devises étrangères qui, en
complément de la part de l'industrie d'assemblage, serviront à
financer l'importation des biens alimentaires. C'est à cet état
des choses que la masse paysanne attribue les causes de la
détérioration de ses conditions socio-économiques. C'est
aussi bien entendu le système néocolonial implanté par
l'occupation américaine avec des institutions qui, selon Pierre-Charles
(2013, p. 99), défendent exclusivement les intérêts des
puissants secteurs des classes dirigeantes et des classes moyennes des villes.
Donc, ce système agit au détriment des masses paysannes. Aussi,
Alexis (1955), dans son roman Compère Général
Soleil, souligne-t-il que : « l'État haïtien n'est pas
l'État du peuple.» (p. 157).
L'expression des ressentiments des paysans de la 2e
Section Lociane ne saurait être plus illustrative quand nous entendons le
jeune Pierre, 30 ans, vivant à Savane Mulâtre en ces mots : «
Leta pa itil nou anyen isit la, nou livre ak nou men'm epi nan men bondye
». De poursuivre Tote Mati, 42 ans, paysan de Malary nous a
déclaré que : « l'État n'existe pas pour les pauvres.
De pauvres habitants que nous sommes dans cette région ne
bénéficient d'aucuns services publics qui puissent soulager nos
souffrances. Tout ce dont nous avons besoin, en termes d'éducation, de
santé et d'eau potable nous devons parcourir plus de deux heures de
marche à pied pour l'obtenir aux frais exorbitants que nos faibles
ressources ne permettent pas d'assumer. Au fait, il y a environ trois mois, des
voleurs venaient bien armés nous dépouiller de nos animaux en
plein jour. Malgré les appels de secours adressés aux forces de
l'ordre étant à Thomassique, elles n'intervenaient jamais. »
Aussi
144
en a-t-il renchéri en ces propos : « si leta
egziste pou moun lot kote mwen pa konnen, men pou nou men'm bò isit la
nou poko jan m santi egzistans leta sa a ».
À Nan Croix, les remarques gardant les mêmes
plaintes de l'abandon de l'État font l'avis de nombreux paysans qui
s'indignent du cercle vicieux de la pauvreté les liant dans le sens
qu'ils ne trouvent pas de supports pour augmenter la production agricole. Il y
a un besoin d'irrigation. Les animaux sont très exposés à
des maladies qui les tuent. Les écoles que la communauté dispose
n'atteignent que le niveau de la 6e année fondamentale. Pour
permettre à ses enfants d'avancer à l'école, il faut avoir
beaucoup de moyens financiers. Ce dont ils ne disposent pas avec la
dégradation de leurs moyens de production agricole comme principale
activité économique. Pierre Onès, un professeur
d'école primaire, avance que « les enfants de la communauté
continueront toujours à se rendre en République Dominicaine ou
ailleurs tout étant faiblement instruits et dépourvus de
connaissances professionnelles. Et dans ces conditions-là, Nan Croix
n'aura pas la chance d'avoir des fils et filles qui puissent atteindre les
milieux sociaux élevés, c'est-à-dire ils ne connaitront
jamais de la mobilité sociale ». C'est le même raisonnement
qui a aussi traversé le jeune Alpha Pierre, 30 ans, de Savane
Mulâtre qui eut à dire que : « nou pap janm ka rive gen
anpil konesans pou nou ka defan n interè kominote nou an. Paske pa gen
posibilite pou pitit soyet rive lwen lekol. Lakoz nou pa gen lajan pou nou
pemèt pitit nou ale lekol tomasik ou lot kote yo, se konsa se sèl
moun lot kote kap toujou nan pozisyon pou yo dirije nou. »
La gravité de la détérioration des
conditions socio-économiques des paysans résulte de plusieurs
facteurs, notamment de l'anéantissement de la production agricole, de
l'insuffisance d'initiatives dans l'industrie embryonnaire133,
l'inconsistance dans l'application de directives intelligentes. En fait, ces
choix stratégiques permettraient d'exploiter les potentialités de
développement des secteurs de l'industrie touristique134
(Rouzier, 2015). Mais pratiquement, nous nous perdons dans l'incohérence
des politiques publiques qui n'arrivent pas à définir les
priorités des politiques sectorielles de développement. L'auteur
F. Deshommes (2006) a démontré les conséquences
133 L'industrie en Haïti reste au stade embryonnaire. Ce
n'est pas le problème fondamental. Il reste un fait que l'Haïtien
n'a pas suffisamment développé la culture de prise du risque pour
investir dans l'innovation. Or le risque participe dans la dynamique du
capitalisme qui exige de l'innovation selon Joseph Alois Shumpeter (1939).
134 Haïti a un potentiel touristique énorme qui
résulte des particularités uniques et exceptionnelles pouvant
être à la base des avantages concurrentiels inégalables
dans la région'.Cf [Rouzier, Daniel-Gérard, Praxis,
propositions de gouvernance pour une autre Haïti, Editions Kiskeya
publishing co, Port-au-Prince, Haïti, 2015, op.cit., p75]. Mais sur ce
propos, il est intéressant de cogiter sur le tourisme de mémoire
qui est une forme de connexion historique qui pourrait nous rapprocher des
Africains. Il s'agit de les inciter à renouer les liens ancestraux avec
Haïti par le souvenir de la traite négrière.
145
interminables du déclin de la production agricole sur
des plans qui rejoignent à : l'autosuffisance et la
sécurité alimentaire, la balance commerciale agricole, l'emploi
agricole, la déforestation, la migration et la pauvreté
générale (p.155). Franck Laraque (cité dans Dorisca, 2010,
p.110), eut à préciser dans sa thèse sur le défi
à la pauvreté que parmi les paysans qui ont été
chassés des plaines et des collines beaucoup d'entre eux se sont
rabattus sur les terres dans les mornes. Loin des infrastructures
socio-économiques de l'État qui comprennent : école,
hôpital, encadrement technique, crédit agricole, irrigation, etc.
Dans la privation totale de tous ses moyens, ils ont inventé des moyens
parallèles de subsistance par des pratiques rudimentaires. À
l'insuffisance de rendement agricole, ils coupent des bois pour faire du
charbon en vue de commercialiser.
La démonstration du modèle particulier de
l'état de subsistance caractérisant le monde rural est
incriminée au faible investissement humain consacré dans la
paysannerie. Avec quelles ressources humaines le monde rural arrivera-t-il
à mobiliser un discours pour renverser les mentalités en vue d'en
finir avec la destruction de l'environnement ? Des questionnements insinuant et
assimilant le rôle des ressources humaines dans la défense des
intérêts locaux en vue de contribuer au développement. Dans
le cas de la 2e Section Lociane, comment la gestion des ressources
humaines est-elle caractérisée ?
5.8.1.-Ressources humaines
En fait, les localités n'arrivent toujours pas à
retenir les jeunes qui ont réussi à décrocher leurs
certificats de fin d'études classiques. Aussi faible que soit la
quantité de ceux-là qui y parviennent c'est à Savane
Mulâtre que nous trouvons beaucoup plus de gens diplômés au
baccalauréat qui essayaient d'y construire une vie avant de tirer
l'éponge. Boc Banic demeure la localité qui attire plus de
diplômés. D'autres localités comme Terre Blanche et
Carrefour Suzely connaissent de très faible part de jeunes qui y
accèdent voire qu'ils y resteraient. Les ressources humaines
éduquées sont extrêmement difficiles à être
retenues par ces milieux ruraux. Ceux-ci caractérisent tout de
même, selon Dorvilier (2012), des sociétés à passion
égalitaire qui ne confèrent pas à l'individu toute la
latitude d'affirmation personnelle comme signe intrinsèque lié
à la modernité (p. 33).
Pour cause de précarité des conditions de
travail, les champs agricoles n'attirent pas forcément des jeunes un peu
cultivés. Ils entreprennent d'autres types d'activités
parallèlement à cette agriculture de subsistance. Par exemple,
ils se lancent dans la conduite de mototaxi, l'enseignement, le petit
146
commerce, la vente de borlette135, etc. Mais, pour
la plupart d'entre eux, l'option de la migration est la plus facile à
prendre. En général, ils traversent la frontière avant
d'envisager d'autres cieux plus cléments. C'est que la condition de
production n'engage pas l'intérêt de l'État dans la
création d'emploi. Tandis que les besoins de l'État sont toujours
un facteur incitatif à la production. La comptabilité publique
haïtienne accuse des comptes qui démontrent que l'État
jusqu'en 2019, selon Laleau (2020), consentait des dépenses annuelles
pour l'acquisition de biens et services s'élevant à près
de soixante-dix milliards de gourdes. Cette importante demande en biens est une
opportunité d'incitation à la production locale pour offrir
à l'utilisation de la main-d'oeuvre locale le travail nécessaire
à l'amélioration des conditions de vie (pp. 85, 86).
Cette idée s'apparente bien à la logique
keynésienne qui concevait le rôle majeur de l'État dans la
relance économique à court terme. Le temps imparti dans un
programme est important dans la projection économique. Il faut donc
réaliser l'urgence dans l'élaboration des mécanismes de
financement du développement local. C'est par l'utilisation de la
main-d'oeuvre généralement marginalisée136 de
la paysannerie que ressort une possibilité d'accroître la
production de biens industriels pouvant entrainer significativement des
retombées positives par l'augmentation de revenus. D'où
résultera l'épargne nécessaire qui servira à
investir dans la logique des étapes de la croissance linéaire de
Walt W. Rostow. Mais, nous n'allons pas gober toute la pensée de cet
économiste américain parce que le développement ne saurait
suivre une droite linéaire. D'autant que les pays industrialisés
dits développés n'ont jamais eu à suivre des étapes
prônées par Rostow.
Notre démarche part de la conception de Barbara Ingham
(cité dans Jean-François, 2021, p. 16) concevant que le
développement est à la fois un objectif et un processus dans une
caractéristique spécifique à chaque pays : au niveau
national, régional ou local. À propos, cela implique une
projection faite par des acteurs sociaux qui s'activent dans des discussions
constructives en vue de trouver des ressources suffisantes et
nécessaires sur les plans financiers et humains. Ces ressources
permettront d'envisager une solution de développement de la
capacité de production agricole et d'introduction d'un foyer industriel
de transformation agricole pour la substitution à l'importation
135En Haïti, la loterie est une institution
privée appelée couramment borlette. Mais l'Etat essaie encore de
réguler le secteur des jeux de hasard et d'argent à travers une
institution dénommée la Loterie de l'État
Haïtien(LEH), malgré sa création depuis 1927 et sa
reconnaissance officielle en septembre 1958. Voir le site
www.
Communication.gouv.ht.
136 Il est admis que l'agriculture de subsistance en Haïti
retient un excédent de main-d'oeuvre marginalement non-productif qui
peut être converti dans le secteur industriel pour répondre
à la théorie de changement structurel dans les stratégies
de développement. L'industrie constitue donc une étape importante
du développement.
147
face au problème donné dans la
détérioration des conditions socio-économiques des paysans
de la 2e Section Lociane.
Dans un second scénario, nous pouvons essayer la
solution de l'approche de changement structurel qui déterminera les
moyens nécessaires d'une passation de la masse de main-d'oeuvre du
secteur agricole vers l'industrie. Tout ce dont de véritable politique
publique pourrait en tenir compte dans une construction
décentralisée de la gouvernance.
Une véritable implémentation de la
décentralisation pourrait conduire à promouvoir l'investissement
productif dans les différentes régions du pays. Le motif premier
de la décentralisation est l'économique. Il est donc de tout
avantage que cette motivation anime les décisions politiques pour
pouvoir concrétiser les mécanismes d'implémentation de la
décentralisation. Alors, il est admis que le principe d'autonomie reste
théorique. L'enjeu se situe dans la manière dont le contexte de
la 2e Section Lociane peut favoriser un cas pratique de
l'application des règles fondamentales de la gestion axée sur la
décentralisation par les agents locaux. Il s'agit pour les
différents acteurs de se verser dans la créativité dans
leurs initiatives locales (Moise, 2013, p. 369). Mais bien entendu, il leur
faut une aptitude à l'innovation comme preuve de capacité
politique.
148
Conclusion
L'histoire transversale et multidisciplinaire de la ligne
frontière entre la République d'Haïti et la
République Dominicaine sur l'île Hispaniola recoupe un
tréfonds de particularités dans l'évolution de deux
peuples qui sont voués à un destin commun dans le cadre du besoin
de la défense des intérêts géopolitique et
économique. Cependant, chaque État confronte une
réalité sociale propre qui détermine sa structure
politique et économique. Des rapports de coopération tentent de
prédominer sur la tendance traditionnelle anti-haïtianiste qui
sous-tend à demeurer en force résiduelle dans les camps des
extrémistes. Un temps révolu qu'Haïti démontra
très tôt dans la reconnaissance de l'autre.
La particularité de l'altérité constitue
l'axe prédominant de la détermination des actions de la
diplomatie politique haïtienne. C'est la perception de cette
réalité que notre analyse relève dans l'orientation du
Président Fabre Nicolas Geffrard (1859-1867), au tournant de 1861 dans
une nouvelle dynamique de traitement de la question de l'Est.
Il s'agit alors de considérer la révolution
conceptuelle de la complicité existentielle des deux Républiques.
L'heure du renforcement des garanties de l'indépendance d'Haïti
sonne à travers l'existence de la République Dominicaine libre et
indépendante des puissances esclavagistes. Un changement significatif de
paradigme se produit dans l'enterrement de la hache de guerre pour emprunter
une ligne directrice moderne de la dialectique. Elle marquera la
réalité géopolitique de la région
caribéenne. Désormais, le peuple dominicain devient un partenaire
du peuple haïtien qui se réconcilie pour le progrès de
l'île d'Haïti, peu importe les différences
considérées.
La frontière s'apparente à une fatalité
historique dont l'accord de 1874 entre les deux Républiques faisait
abstraction des contraintes substantielles qu'elle impose. L'acte porte la
force de la rationalité humaine qui devait conduire à surmonter
les brèches tangibles de toutes les difficultés quelles qu'elles
soient.
Le revers de la tendance révolue des Haïtiens dans
la relation avec la République Dominicaine vient de
l'appréhension des faits historiques et sociologiques que les
Dominicains ont très mal digéré. Une logique
cartésienne allait connaitre sa terminologie dans la complexité
de la géopolitique que le Président Fabre Nicolas Geffrard devait
initier dans sa problématique à un moment aussi crucial pour la
diplomatie haïtienne. Il interpelle les autres aspects qui engendrent le
mode d'organisation sociale du développement économique dans
l'appropriation territoriale.
149
La société haïtienne, étant
rattrapée par les contradictions internes exacerbées où le
paysan ayant subi toutes les contraintes sociales, a perdu de vue l'importance
de se tenir sur ses pieds fermes. La base agricole permet de marcher comme dans
une approche biologique du social assimilée au fonctionnalisme. Au fait,
cette société a vécu un grave handicap aux cours de deux
siècles d'existence dont les conséquences résonnent dans
son improductivité économique et une instabilité politique
chronique. S'y ajoutent, pour certains, en guise d'explication justificative,
l'insouciance des dirigeants haïtiens, la revanche réactionnaire de
l'impérialisme occidental néo-colonialiste et l'héritage
de l'inadéquation des éléments fonctionnels de
l'organisation sociale inégalitaire de Saint-Domingue.
Ces trébuchements vont être suivis et
analysés de près par l'autre (la République Dominicaine)
dans un souci d'une part, de caractériser un levier d'animosité
et, d'autre part, de se dégager des ornières haïtiennes pour
profiter de prendre l'avantage. Celui-ci est largement aidé et
supputé par le favoritisme raciste occidental afin d'asseoir une
position hégémonique des Dominicains sur Haïti. À
l'ère de Rafael Trujillo, le drame culmine en désastre
exterminateur naziste avec le génocide de 1937137 sur les
Haïtiens et Dominicains noirs qui vivaient dans la région
frontalière. La tendance raciste s'enracine dans toute la
société dominicaine et s'enchaine dans des divers
évènements regrettables dont l'un se révèle dans
l'arrêt TC : 0168/13 de la Cour constitutionnelle dominicaine en date du
23 septembre 2013. La communauté internationale a toujours pesé
de tout son poids pour concocter une atmosphère de paix fragile en
défaveur de l'histoire qui s'indigne de la non-vérité et
de l'injustice. Bref. La frontière est délimitée.
Le cours du temps ne remédie pas à l'élan
fragile du fondement de la structure sociale haïtienne qui engendre
à priori la production du sous-développement et
l'incapacité de l'imposition d'un État de droit. Tous les efforts
s'inclinent à la réflexion constructiviste d'un nouveau paradigme
que nous appuyons dans la participation active des forces sociales dynamiques
dans les divers foyers décisionnels. Les masses paysannes
s'ébranlèrent pour l'intégration avec l'innovation de
certaines structures économiques : Lakou, coumbite, etc. Les
communautés revendicatives ecclésiastiques ont sonné le
glas de la mobilisation politique des masses paysannes. Vents débours
contre l'exclusion, elles défient les frontières du monde
occidental et exposent le cas d'Haïti : il faut développer les
localités en Haïti. La décentralisation s'entend donc un
projet structurel de
137 Certains auteurs parlent de massacre de Persil
perpétré en date du 2 octobre 1937, coûtant la vie à
près 20000 personnes, sous les ordres du président Rafael
Trujillo.
150
gouvernance qui offre des opportunités à
exploiter dans une nouvelle gestion de société. Mais la
responsabilité des autorités locales doit être
assumée pour viser les objectifs de l'amélioration des conditions
socio-économiques de la population paysanne.
Des auteurs comme Guy Alexandre, Dilla Alfonso Haroldo et
Pierre-Joseph Lamothe font partie du courant qui milite pour un
véritable rapprochement entre les deux Nations. Ce courant de
pensée a pesé de tout son poids pour considérer le
côté positif dans les relations entre les deux pays. Ces
intellectuels privilégient l'atmosphère de bonne entente pour
bâtir un grand optimisme dans le renforcement des relations. En ce sens,
Lamothe (2008, p. 146) s'est montré très enthousiaste des bons
rapports que les deux peuples entretiennent. Il a même
considéré que la frontière est une fiction. Mais, ce que
l'auteur a omis de dire dans son analyse c'est que les Haïtiens subissent
beaucoup d'humiliations dans la plupart des espaces publics où ils vont
chercher des services que leur propre pays ne leur offre pas.
De toute façon, Haïti a intérêt
à développer des échanges commerciaux avec la
République Dominicaine. L'essentiel c'est de rechercher des accords
commerciaux très équilibrés. Cela traduit la logique
qu'Haïti doit nécessairement repenser ses stratégies pour
accroître ses capacités de production pour pouvoir balancer ses
relations commerciales avec la République voisine. Le problème de
la production économique du pays est capital. Mais, c'est l'ensemble de
la force des collectivités territoriales qui doit s'en charger dans la
répartition des responsabilités de gestion et
d'aménagement du territoire.
Cette démarche renvoie à la recherche des
facteurs qui sont à même de pouvoir contribuer à apporter
un schéma d'éclairage dans l'optique de définition d'un
ensemble de choix par ordre de priorité. Entre les actions de
l'État à travers les politiques publiques de développement
qui aperçoivent, d'une part, les desiderata d'une faible part de la
population par l'axe hiérarchique commandant des directives d'en haut.
Cette formule est adoptée depuis des lustres. Elle accuse un constat
d'échec patent. Et, d'autre part, l'action de l'État dans un
consensus jouant sur la stratégie participationniste. Elle offre un
nouveau paradigme qui permet à l'acteur local paysan d'intégrer
la sphère décisionnelle.
L'acte d'appui étatique consiste au strict
contrôle et à la définition de grandes orientations
(règles et règlement de gouvernance) pour le renforcement de la
puissance de la Nation qui se concilient dans les pratiques gouvernantes des
collectivités territoriales. Ces dernières s'impliquent dans les
tâches de développement local qui accompagne la promotion de la
solidarité nationale.
151
C'est dans cette logique que s'inscrit la
décentralisation qui renvoie à la contribution des acteurs
paysans s'appropriant des atouts du transfert de pouvoir dans le renforcement
de l'autonomie des collectivités territoriales. Cette contribution
s'entend à l'ultime recours comme planche de salut pour parvenir au
développement local qui doit tenir compte des facteurs essentiels de
l'amélioration des conditions de vie de la majorité de la
population dans toutes les dimensions spatiales de la ligne
frontalière.
La région centrale gagne en importance croissante sous
plusieurs angles de vue partant du tactique de proximité et
stratégique qui couvrent les potentialités économiques et
culturelles. L'évolution actuelle des échanges commerciaux sur la
frontière de la 2e Section Lociane interpelle l'urgence de
gestion plus rationnelle par l'implication d'une nouvelle dynamique de vision
politique qui se dessine dans l'effectivité de la
décentralisation qui confrontera les autorités locales dans la
responsabilité directe du service public.
Pour déceler le poids de l'intervention de
l'État et des autorités locales dans l'évolution des
conditions socio-économiques, il était important de regarder des
aspects significatifs du niveau de proximité entretenu par les
autorités locales avec les populations et la sensibilité au point
de vue d'engagement social des paysans. Ces considérations renvoient
normalement aux questions y relatives formulées dans les entretiens
tenus avec des paysans de différentes localités
considérées dans l'étude du milieu. À la
première approche, la relation de proximité fait grandement
défaut pour presque toute la population de Savane Mulâtre. Cette
tendance exprime la forte déception des paysans de la 2e
Section Lociane vis-à-vis de la non-présence des agents locaux
dans la communauté. Dans le cas où les autorités des
collectivités territoriales ne se sentent pas obligées de marquer
une présence soutenue auprès de leurs mandants, il est difficile
de concevoir par quel moyen elles projettent d'impliquer toutes les parties
prenantes dans le développement local. Il y a risque de
méconnaissance des véritables besoins de la population. La
négligence des rapports de proximité des agents locaux avec les
paysans constitue le fossé établi pour exclure le savoir-faire de
ces derniers dans le processus de discussion et réalisation des projets
de développement local. C'est aussi dans l'optique de rechercher la
motivation des différents acteurs que nous avons
privilégié l'approche globale structuro-fonctionnaliste dans
cette étude.
Et parallèlement, en fonction des considérations
socio-historiques dans les rapports entre les Haïtiens et les Dominicains,
cette étude de recherche s'attachait également à
l'idée de comprendre les facteurs déterminants des conditions
socio-économiques des paysans de la 2e Section Lociane
152
en vue de réfléchir sur les moyens qui
permettraient de parvenir à une amélioration de ces conditions.
Ainsi, la solution hypothétique de la décentralisation a-t-elle
été soutenue dans la mesure où la volonté politique
de l'État existe pour encourager son implémentation. À
cela, s'ajoute l'engagement par action dans les politiques publiques des agents
locaux. Ce qui requiert au préalable une démarche de connexion
avec la majorité de la population. Et, cette dernière doit
s'organiser davantage en vue de participer activement aux efforts de
développement local. Bien entendu, la démarche consiste à
intégrer le paysan dans le champ du pouvoir local des enjeux
réels des politiques publiques.
Dans le cas de la 2e Section Lociane, les
défis de la gouvernance sont majeurs. L'amélioration des
conditions socio-économiques de ses paysans a servi de pivot de
réflexions qui s'évertuent essentiellement à rejoindre
toutes les préoccupations de cette étude de recherche. Elle
rejoint également l'inclinaison à la problématique des
actions visant à déterminer les facteurs essentiels de la
décentralisation tendant à corroborer les efforts de
définition de politiques publiques pour affecter les indicateurs
économiques. Parce que les paysans de la 2e Section Lociane,
dans un milieu où le PIB per capita est à 1.88$ par jour,
constituent les couches les plus défavorisées. Tandis qu'ils
exécutent des tâches coutumières dans l'agriculture de
subsistance, leurs conditions de vie confrontent aux difficultés les
plus terribles qui affectent considérablement leur niveau de
consommation. L'écart se creuse même au niveau des
différentes localités. Ce qui démontre d'autant plus le
besoin d'intervention des autorités locales dans la
péréquation des ressources.
Aussi, la gestion des espaces frontaliers dans le contexte de
la 2e Section Lociane de par ses opportunités impose-t-elle,
en priorité, une dimension contraignante de réalisation des
objectifs d'amélioration des conditions socio-économiques des
paysans par la relance de la production de toute sorte : agricole et
industrielle. L'option de la décentralisation définit un
schéma sociétal qui interpelle la responsabilité directe
de divers acteurs dans les différentes sphères de la
région dans des objectifs spécifiques sous l'impulsion d'une
vision commune.
Les paysans de la 2e Section Lociane agitent un tel
besoin dans les considérations de leurs situations. Celles-ci
étalent des carences criantes de la présence de l'État
n'intervenant pas dans les services de base qui caractérisent la
fourniture de : l'eau potable, la santé, l'infrastructure
routière, la sécurité publique, l'encadrement de la
production agricole et la protection et la réhabilitation de
l'environnement, etc. Cette situation accuse des caractéristiques
d'espaces vides qui se livrent à la rupture de l'ordre social en dehors
de toute structure possible de développement.
153
La décentralisation et le développement se
révèlent deux opérations qui sont à
schématiser en fonction de la bonne mesure des réalités
concrètes de l'espace social et territorial. Il s'agit néanmoins
de l'observance de certaines règles de droit qui s'inscrivent
essentiellement dans la définition des pratiques objectives de
gouvernance à priori fortement axé sur la défense de
l'intérêt général de la population.
Et pour pénétrer la réalité de la
dimension socio-organisationnelle des paysans comme facteur agissant sur les
déterminants des conditions socio-économiques. Nous indiquons que
la relation avec les organisations sociales développée par les
paysans de la 2e Section Lociane permet de détecter la force
vibrante qui cristallise leur engagement dans les réseaux
d'échanges dans la communauté. Pour cela, il s'avérait
nécessaire de regarder le niveau d'adhésion des paysans de la 2e
Section Lociane aux structures organisationnelles qu'ils ont à leur
portée d'intégration. Grosso modo, le tableau exprime fortement
l'état de non adhésion de la majorité des paysans des
localités de la 2e Section Lociane à la vie
d'organisation. Plusieurs raisons peuvent toutefois se prêter à
des hypothèses pour comprendre le pourquoi de cette tendance allant dans
la même direction pour toutes les autres localités. C'est une
donnée assez évocatrice lorsque nous considérons ce que
représente l'organisation pour et dans la vie collective.
Dans toutes les localités considérées
dans l'étude, il y a aussi une faible portion de répondants qui
ont été membres d'une organisation. Ce qui caractérise un
désenchantement pour participer aux manifestations des structures
organisées. Cependant, la population de Nan Croix se distingue dans la
participation à la vie d'organisation. L'idéale de
l'évolution organisée des membres de cette communauté a
même poussé un leader communautaire prénommé Pierre
au lancement de l'organisation pour le développement des paysans de la
2e Section Lociane (ODPSL). C'est un cas particulier. Par ailleurs,
le faible pourcentage de paysans attestant qu'ils sont membres d'organisation,
partagent deux structures organisationnelles qui sont parmi les plus influentes
dans la zone, à savoir : MPP et OJUDT (organisation des jeunes pour
l'unité et le développement de Thomassique). En
définitive, les données recueillies sur le terrain de cette
recherche démontrent toutes les difficultés pour accorder des
acteurs sociaux locaux dans une dynamique de conjonction de la force
indispensable au développement local à la confluence des divers
intérêts qui forment l'enjeu de la collectivité
territoriale.
154
D'une manière purement économique, le
développement local participe dans la dynamique de substituer à
l'importation massive en vue de relancer les activités
génératives de production capables de répondre à la
demande interne. Abstraction faite de la priorité des élites pour
le développement des facteurs de production dans une dynamique
économique nationale.
Le cas de la 2e Section Lociane soulève la
question de la prise en compte de la gestion de l'espace territorial où
s'impose un choix de décentralisation soit par le principe de
subsidiarité ou soit par la dévolution. La dynamique de la
décentralisation doit s'enchainer dans la discussion participationniste
qui commande à l'application des dispositions concrètes qui
tiennent compte des réalités socio-anthropologiques et
historiques des collectivités apparaissant dans l'élaboration de
politiques publiques de développement local. Mais en
réalité, les données qui concernent cette Section
communale font état d'une situation très inquiétante.
D'autant que les habitants qui sont éloignés de la
périphérie des grandes villes sont exposés aux conditions
socio-économiques les plus déplorables. Les régions
frontalières demeurent une preuve patente de l'état d'absence de
services publics adéquats qui laisse propager une perception de
délaissement des personnes y demeurant. Le manque d'organisation des
paysans et leur abandon par des agents locaux rendent difficile des
considérations probantes d'une solution avec la décentralisation
par la garantie des actions autonomes des autorités locales.
À la diligence des initiatives des forces vives locales
!
Perspectives propositionnelles
Toute la littérature sur la notion frontière
démontre l'importance de cet espace qui recoupe une
multifonctionnalité dans une multi dimensionnalité. L'État
et les habitants aux environs de la frontière ont intérêt
à développer une synergie d'actions pour maitriser les
différents paramètres de cet espace géoéconomique
et géopolitique.
Cependant, avec la conception de responsabilité de
l'État dans un rôle structurant, créateur,
régulateur du champ économique, il s'agit d'une approche selon
laquelle, Gbénou (2010, p. 93) relève une importance des
institutions politiques comme préalable à la solution des
problèmes de développement. Et cette situation tend à
concourir au rapprochement étroit entre l'État et la
société dans une centralisation. C'est une approche qui s'ouvre
sur la perspective d'une nouvelle étude. La démarche
générale dans cette étude sous-tend à l'idée
que le pouvoir en charge de l'État dans une perspective d'organisation
doit contribuer à établir l'administration locale. Cette
orientation
155
conduit à envisager une action de la mise en
adéquation avec les principes régaliens de l'État. Les
structures locales doivent être plus performantes sous la surveillance
étroite des différentes institutions de contrôle telles que
: CSCCA, ULCC, UCREF, etc. Dans sa pratique de gestion, la collectivité
territoriale entend mettre à profit des moyens adéquats
d'utilisation de ressources nécessaires et suffisantes pour pouvoir
mieux satisfaire les besoins de la population. En ce sens, nous pouvons
proposer à ce que :
? L'autorité des agents de la collectivité
territoriale soit établie, de manière active, dans le
contrôle de l'espace frontalier de la 2e Section Lociane. A
cet égard, le rétablissement du service de la douane y est une
priorité.
? Des négociations soient entreprises pour permettre
qu'une partie conséquente et significative des recettes
douanières soit affectée en surplus du budget communal en faveur
des politiques publiques qui priorisent les besoins urgents pour
améliorer les conditions socio-économiques des paysans dans la
2e Section Lociane.
? Des actions soutenues doivent être envisagées
pour encourager les structures organisationnelles dans la zone en vue d'induire
des effets combien nécessaires de la participation de la population au
processus du développement local.
? Des travaux doivent être impulsés à
rendre possible l'amélioration de la participation à la vie
collective. Il s'agit en premier lieu de faciliter l'accès à
l'information, en second lieu, établir des relations de débats
avec les citoyens.
Limites de l'étude
Le travail n'a pas trop accentué sur les contraintes de
la décentralisation et plus particulièrement sur les contraintes
du développement local des zones frontalières. Aucune analyse
n'est faite sur l'amendement constitutionnel de 2011 où d'énormes
changements ont été opérés dans certaines
attributions des collectivités territoriales pour affaiblir leur
rôle dans certaines fonctions. En somme, pour l'implantation de la
décentralisation, nous admettons qu'il ne s'agit pas d'une bataille
gagnée à l'avance. Car les moyens nécessaires en termes de
ressources : humaines, financières et la volonté politique ne
sont pas mobilisables automatiquement.
Mais cependant, le jeu en valait la chandelle pour essayer
d'apporter quelques éléments de réflexion sur
l'évolution des structures inégalitaires entre les masses
paysannes et les élites haïtiennes. Les distorsions
socio-économiques entre les deux classes caractérisent une
faiblesse
156
dans le ressort fonctionnel qui devait pouvoir absorber les
charges potentielles pour favoriser le développement local. Ce qui nous
a fait interpeller la responsabilité des acteurs sociaux, en
particulier, celle des élites. En fait, nous avons presque laissé
de côté, les différentes théories sur le concept de
responsabilité. Nous nous en sommes contentés justement de peu en
plus de la définition élémentaire de l'obligation de
remplir une charge, un engagement. De la même façon, nous n'avons
pas trop abondamment développé certains aspects quantitatifs du
concept des conditions socio-économiques. Ce qui nous permettrait de
mesurer un plus grand nombre d'indicateurs économiques avec
l'utilisation de logiciels spécialisés en matière
d'économétrie. Toutefois, nous avons effectué une
étude exhaustive consistant à relever des données
qualitatives et quantitatives suffisantes concernant les conditions
socio-économiques des paysans dans les localités ciblées
par la présente étude de la zone frontalière de la
2e Section Lociane. Compte tenu de la contrainte du temps et de la
situation de l'insécurité qui, prévalant dans le pays,
nous empêchent de circuler librement. Au cours d'une seule semaine nous
avons parcouru à pied et à mototaxi avec une maitrise de tous les
risques possibles un nombre de sept (7) localités de la 2e Section
Lociane, à savoir : Malary, Don Diègue 2, Boc Banic, Terre
Blanche, Savane Mulâtre, Carrefour Suzely et Nan Croix.
La diversité était le meilleur moyen de
recueillir des données différenciées qui permettraient la
mise à jour d'un panier, le plus large que possible,
d'éléments pertinents pour la compréhension des facteurs
ayant contribué à expliquer les conditions
socio-économiques des paysans de la 2e Section Lociane sur fonds de
préoccupation de cette recherche.
Références bibliographiques Sites
d'internet
Données Mondiales. République Dominicaine,
[En ligne],
www.donneesmondiales.com,
page consultée le 21/7/2023.
FENAMH [Fédération Nationale des Maires
d'Haïti]. Belladères, [En ligne],
www.fenamh.org.ht/belladere,
site consulté le 12/09/2022.
IHSI (Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique).
Estimation de la population, [En ligne],
www.ihsi.gouv.ht/indicator-population,
page consultée en mai 2023.
La Toupie. Principe de subsidiarité, [En
ligne],
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Subsidiarite.htm,
consultation 02/09/22.
Universalis. Encyclopaedia Universalis, [En ligne],
Http://www.universalis.fr,
consulté le 02/7/2022.
UNESCO Institute for Statistics. Sustainable Development Goal
4, [En ligne],
www.uis.unesco.org,
consultation en date de 14/05/2023.
Les périodiques ou revues
scientifiques
ACLOQUE, Delphine. «Frontière désertique,
front pionnier et territorialisation. Approche à partir du cas
égyptien», Géo confluences, juin 2022, [En ligne],
Url :
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-critique-des-ressources/articles/front-pionnier-delta-nil-egypte,
site consulté le 01/07/2022.
ADELMAN, Irma. « Cinquante ans de développement
économique : les principales leçons », Revue
d'économie du développement, 9e année N°1-2,
2001. Penser le développement au tournant du millénaire.
Sélection des Actes. Conférence ABCDE - Europe. Paris, 26-28 juin
2000. pp. 65-
113;[En ligne], doi :
,
https://doi.org/10.3406/recod.2001.1055
157
https://www.persee.fr/doc/recod_1245-4060_2001_num_9_1_1055,
consultation au cours du mois de mai 2022.
ALEXANDRE, Guy. « Les relations
haïtiano-dominicaines, une conjoncture de tous les dangers »,
Revue Rencontre, numéro 20-21, Publication, 2009, [En
ligne],
www.cresfed-haiti.org,
consultation d'avril 2022.
BESNAINOU, Denis « Programme des Nations unies pour le
développement(PNUD). Rapport mondial sur le développement humain
», Rubrique Politique étrangère, publication de
1991, [En ligne],
www.persee.fr, page
consultée le 02/09/2022.
BONAZZI, Tiziano. « Frederick Jackson Turner's
Frontier Thesis and the Self-Consciousness of America», Cambridge
University Press, 16 January 2009, [En ligne], URL:
www.cambridge.org,
page consultée en date du 02 juillet 2023.
BREUGNOT, Jacqueline. « La construction des espaces
frontaliers européens : entre dynamisme et résistances
». Alterstice, 2(1), 67-77. [En ligne] Publication de
2012 ; URI :
158
https://id.erudit.org/iderudit/1077554ar
/
https://doi.org/10.7202/1077554ar,
page consulté en juin 2022.
DEBERRE, Jean-Christophe. « Décentralisation et
développement local », Afrique contemporaine, no 221,
publication de janvier 2007, [En ligne], www.cairn.info, page
consultée le 5/3/2023.
BERNIS, Gérard de. « Le sous-développement,
analyses ou représentations » in CAIRE, Guy, dir. Pouvoir,
mythes et idéologies, [En ligne] Tiers-monde, tome 15,
no 57, 1974. Pp 103-134. DOI :
https://doi.org/103406/tiers.1974.1990.
DELAS, Jean Pierre Delas et MILLY, Bruno. « Les
fonctionnalismes » in Histoire des pensées
sociologiques, mis à jour 9 mars 2016, [En
ligne], https://
doi.org/10.3917/arco.delas.2015.01.0293,
page consultée le 16 octobre 2022.
DELUZARCHE, Céline. « Combien de pays y a-t-il
dans le monde ? » Futura Géographie, 7 janvier 2023, [En
ligne],
www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/geographie-pays-y-t-il-monde-15126,
page consultée le 20 janvier 2023
DORNER, Véronique. « Les dimensions sociales et
économiques du développement local et la décentralisation
en Afrique au Sud du Sahara », La Décentralisation en
Haïti », publié en 1998, [En ligne], url:
https://doi.org/10.4000/apad.565,
site consulté le 20/08/22.
DUBOIS, Yann et RERAT, Patrick. « Vivre la
frontière : les pratiques spatiales transfrontalières dans l'Arc
jurassien franco-suisse », Revue Belgeo, [En ligne], 1-2 | 2012,
mis en ligne le 15 décembre 2012, Url : https : //
journals.openedition.org/belgeo/6249
; DOI : 10.4000/belgeo.6249, site consulté le 24 Juin 2022.
DRESSLER, Camille. « L'approche des frontières du
point de vue de la sécurité», Revue diogène,
publication du 01/12/2007, [En ligne], www.cairn.info, site
consulté le 14/02/2023.
École Normale Supérieure de Lyon. «
Maritimes (frontières) », Géo confluences/ressources de
géographie pour les enseignants, publication du 12 janvier 2022|
[En ligne],
www.geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/maritimes-frontieres-2013,
site consulté le 24/2/2022.
ENS de Lyon (École Normale Supérieure de Lyon).
« Convention de Montego Bay(CNUDM) et droit de la mer »,
Géo Confluences, Mis à jour mars 2023, [En ligne],
www.geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/montego-bay,
page consultée en avril 2023.
FAUCHER, Michel. « Les frontières » Clio
nautes, Vol no 8133 janvier-février 2020, 27 avril 2020,
[En ligne],
www.clio-cr.clionautes.org,
(page consultée le 20 janvier 2023).
FLEUR-AIME, Thales et THOMAS, Wisner. «
La question de la décentralisation en Haïti :
Contexte historique et perspectives», Office Management et
des Ressources Humaines, 2015, [En ligne], Url :
www.omrh.gouv.ht/decentralisation,
site consulté le 23/08/22.
FREUND, Bill et LOOTVOET, Benoit. « Où le
partenariat public-privé devient l'instrument privilégié
du développement économique local. L'exemple de Durban, Afrique
du Sud » Armand colin/Revue Tiers Monde, 2005, [En ligne], DOI :
10.3917/rtm.181.0045,(Page consultée le 21 juin 2023).
159
GABRIEL, Ambroise Dorino. « Les sous-entendus de
l'Arrêt TC/0168/13 du Tribunal constitutionnel dominicain.
Situations contemporaines de servitude et d'esclavage »,
Anthropologie et sociétés. Volume 41, numéro 1, 2017,
[En ligne], URI :
https://id.erudit.org/iderudit/1040274ar,
DOI :
http://doi.org/10.7002/1040.274ar,
page consultée 11/05/2022.
GASPER, Inès Da Gracia. « Le batey en
République Dominicaine : espace présent d'un temps passé
», Études caribéennes, publication du 1/12/2019,
[En ligne], DOI : http :
doi.org/10.400/etudescaribeennes.17582],
page consultée le 14/03/2023
GRENIER, Fernand. « Dorion Henry, La frontière
Québec-Terre-Neuve, contribution à l'étude
systématique des frontières », Revues d'histoire de
l'Amérique française, 17(4), 601-603 Premier volume des
Travaux et Documents du Centre d'études nordiques, Québec,
Éditions les Presses de l'Université Laval, p14, 1964, [En
ligne],
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/1964-v17-n4,
https://doi.org/10.7202/302330ar
, page consultée le 16/06/2022.
IRAM (Institut de Recherches et d'Applications des
Méthodes de développement). Développement local et
décentralisation, France, [En ligne], URL :
https://www.iram-fe.org>développement-local-et-décentralisation,
page consultée le 6/7/22.
JOSEPH, Maila. « Enjeux et dilemmes de la
sécurité nationale », Erudit/Journals/Etudes
internationales, publication du 12/04/ 2005, [En
ligne], Url :
http://www.erudit.org/en/journals/ei/1987-v18-n4-ei/3031/702258ar,
page consultée le 3/7/2022
JUIGNET, Patrick. « Structuralisme et sciences humaines
» Philo sciences, mis à jour 11 février 2023, [En
ligne],
www.philosciences.com,
page consultée le 28 juin 2023.
KOLOSOV, Vladimir. « Études des frontières
approches post-modernes » Revue Diogène, février
2005, no 210, [En ligne],
https://doi.org/10.3917/doi.210.0013,
page consultée le 20/02/2023.
LEFEBVRE, Henri. « Démocratie locale»,
Dictionnaire des politiques territoriales, publication 2020, [En
ligne], http : www.cairn.info, page consultée le 16/03/2023].
MAROIS, Claude. « Pierre George, un pionnier de la
géographie de la population », Cahiers de géographie
du Québec, Volume 52, Number 146, septembre 2008, p.
295-301, [En ligne], Online
publication:Jan. 7,2009,
RL:
https://id.erudit.org/iderudit/019598ar|DOI:
https://doi.org/10.7202/019598ar,
site consulté en date du 03/7/2022.
MEISEL, Nicolas et OULD AOUDIA, Jacques. «
L'insaisissable relation entre bonne
gouvernance et développement », Revue
économique, juin 2008, vol.59, [En ligne],
http://www.cairn.info , page
consultée en avril 2023.
SANGUIN, André-Louis. « La frontière
Québec-Maine : quelques aspects limologiques et socio-économiques
». Cahiers de Géographie du Québec, Volume 18,
numéro 43, 1974. [En ligne] URI :
https://id.erudit.org/iderudit/021180ar.
DOI
http://doi.org/10.7202/021180ar,
page consultée en mai 2022.
160
THEODAT, Jean-Marie. « Les localités
d'Aménagement Concerté. L'exemple de la Mésopotamie
banicéenne», EchoGéo, [En ligne], 2 | 2007, mis en
ligne le 25 janvier 2010, URL :
http://journals.openedition.org/echogeo/1350,
page consultée le 01 août 2021.
THEODAT, Jean-Marie. « Au-delà de la
frontière, les relations Haïti - République Dominicaine
à l'épreuve du tremblement de terre du 12 janvier 2010 »
Cresfed, publication du 24-25/02/2012, [en ligne],
https://cresfed-haiti.org,
(consultation 10/04/2022).
THELUSME, Tarah Télusma. « Appliquer les lois sur
la décentralisation en Haïti » Haïti
priorise,
publication du 21/04/2017, [En ligne],url :
https://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/haiti_priorise_decentralization-_french.pdf,
site consulté en septembre 2022.
YONKEU, S. et al. « Conditions socio-économiques
des populations et risques de maladies : Le bassin versant du barrage de
Yitenga au Burkina Faso », VertigO - la revue électronique en
sciences de l'environnement, Volume 4 Numéro 1 |
mai 2003, [En ligne], mis en ligne le 01 mai 2003. URL:
https://isidore.science/document/10.4000/vertigo/4778,
consultation du site en juillet 2022.
Articles de Journaux
AFP (Agence France-Presse). «Haïti : L'urbanisation
s'accélère sans créer de richesses »,
L'Express, publication du 24/01/2018 | [En ligne], http :
www.lexpress.fr,
consultation du 14/05/2023
CADET, Calvin. « Les fonds communaux : un
véritable mécanisme de développement », Le
Nouvelliste, publication du 28/01/2014, [En ligne],
www.lenouvelliste.com,
page consultée le 12/09/2022
ISIDOR, Ives. «Thomassique, la ville qui vous
accueille», Le Nouvelliste, édition du 27 janvier 2014,
[En ligne],
www.lenouvelliste.com, site
visité en avril 2022.
Le Monde- AFP. « La République
Dominicaine entame la construction d'un mur à sa frontière avec
Haïti ». Le Monde-AFP, publié le 21 février
2022 à 01h51 - Mis à jour le 21 février 2022 à
07h27, [En ligne],
www.lemonde.fr/international/article/2022/02/21,
(page consultée le 06/07/2022).
Le Monde-AFP. « République Dominicaine le mandat
du président Balaguer est écourté », Le
Monde-AFP, publication du 12 août 1994, [En ligne],
www.lemonde.fr, page
consultée le 25/02/2023
NELSON, Glorieuse. « Un documentaire pour les 70 ans de
Belladère», Le Nouvelliste, publication du 12 octobre
2018, [En ligne],
www.lenouvelliste.com, page
consultée le 12/09/2022.
ODATTE, Ronel. « Plateau Central- Problématiques
frontalières : Les municipalités dominicaines et haïtiennes
en quête de solutions », Alter Presse, publication du 3
octobre. 2012, [En ligne], Url :
https://alterpresse.org,
(page consultée le 08/04/2022).
161
ODATTE, Ronel. « Haïti-économie : des agents
douaniers toujours absents à Thomassique. Plus d'un mois après
l'incendie de la douane », Alter Presse, [En ligne], publication
du 27/01/2016,
www.alterpresse.org, page
consultée le 04/12/2022.
ODATTE, Ronel. « Haïti : Des Communes
frontalières frappées par la sécheresse spécial
» Alter Presse, publié le 29/03/2016, [En ligne], Url :
https://alterpresse.org,
(page consultée le 08/04/2022).
RadioTélévision2000 « Haïti/Education
: République Dominicaine finance la construction d'une université
dans le Nord », Site de la Radio Vision 2000, publication du
2/08/2010, [En ligne],
www.radiovision2000.com,
page consultée le 14/03/2023.
Travaux académiques
DORÉ, Guichard. Problèmes
socio-économiques et démocratie en Haïti (1980-2001).
Mémoire de maîtrise. Port-au-Prince, Faculté d'Ethnologie
de l'Université d'État d'Haïti. 2002, 143 p.
DORISCA, Jean Lucius. Planification
décentralisée et développement socio-économique
à Saint-Louis du Nord, Mémoire de maîtrise, Sciences
du Développement, Faculté d'Ethnologie de l'Université
d'État d'Haïti, 2010, 146 p.
FILS-AIME, Edy. Décentralisation et mise en oeuvre
des stratégies de développement local : Analyse du système
de gouvernance territoriale du cas de la Croix-des-Bouquets,
Mémoire de maîtrise, Sciences du Développement,
Faculté d'Ethnologie de l'Université d'État d'Haïti,
« s.d. », 193 p.
MATHON, Marie J. C. Dominique. L'accès aux services
sociaux santé dans la région du Haut Plateau Central, Haïti.
Étude exploratoire pour l'application d'un modèle de
localisation-affectation en santé, Mémoire de
maîtrise, Urbanisme, Montréal : Université du Québec
à Montréal, 2012, 153 p, [En ligne],
https://espace.inrs.ca, page
consultée en date du 10/04/2022.
SBALLIL, Ibrahim. Le leadership en matière de
justice sociale : cas d'une direction d'école primaire francophone de
milieu défavorisé de Montréal, Mémoire de
maîtrise, sciences de
l'éducation, Montréal : Université de
Montréal, 2015, 215 p, [En ligne],
https://papyrus.bib.umontreal.ca,
consultation mai 2022.
VALMERA, Franceau. Vers une refondation du droit des
finances publiques locales en Haïti. Thèse de doctorat, droit,
Université Rennes 2, 2021, [En ligne],
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03483659,
site consulté en date du 30/08/2022.
Documents officiels
Rapports Techniques publiés par ONG et
institutions internationales
Banque Mondiale. Population, total-Haïti, [En
ligne]
Https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=HT,
page consultée en juillet 2022
Organisation Internationale des Migrations. « Surveillance
des flux sur 20 points de passage
frontalier entre Haïti et la
République Dominicaine : rapport de situation bimensuel »,
Relief Web,
162
no 29 du 1er au 15 février 2021,
publié 15/02/2021, [En ligne], www.reliefweb.int, page consultée
le 02/03/2023
Organisation des Nations-Unies. Convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme, New York, 9
décembre 1999, [en ligne], url :
https://www.iran-resist.org/IMG/pdf/556-j2-p-_09-30_=dim_07-oct=15-mehr_cft-articles.pdf
, site visité en novembre 2023
Organisation des Nations-Unies. La Déclaration des
Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales, New York, 15 décembre 2018, [en ligne], url
:
https://www.fian.be/IMG/pdf/2018_11_ddp_note_comple_mentaire_final-1.pdf.
, site consulté en décembre 2023.
Programme des Nations-Unies pour l'Environnement.
« Haïti-République Dominicaine. Ses
défis environnementaux dans la zone frontalière »
Rapport PNUE, 2013, [en ligne],
https://postconflit.unep.ch et
url :
http://unep.org/haiti, (page
consultée le 08/04/2022).
République française. « En quoi consiste
l'expérimentation législative locale ? », Vie publique,
publication en date du 22/02/2021, [En ligne],
www.vie-publique.fr, page
consultée 07/03/2023.
Publications Gouvernementales
CIAT [Comité Interministériel
d'Aménagement du Territoire], Département du centre. Plan de
développement de la Commune de Thomassique, [En ligne],
publié en 2008,
http://ciat.bach.anaphore.org.
Consulté le 10/05/2022.
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES.
Décret du 16 Février 2005 faisant office de loi organique sur
la préparation et l'exécution des lois de finance, Moniteur,
no 39 du 23 mai 2005.
Roman/société
ALEXIS, Jacques Stephen. Compère Général
Soleil, Paris, Gallimard, 1955, 350 p. Ouvrages
scientifiques
ALEXANDRE, Guy. Pour Haïti. Pour la République
Dominicaine. Interventions, positions et propositions pour une gestion
responsable des relations bilatérales, Delmas, C3 Éditions,
Port-au-Prince, 2013, 331 p.
ANS, André-Marcel d'. Haïti : paysage et
société, Paris, Karthala, 1987, 337 p. ARON, Raymond.
Démocratie et Totalitarisme, Paris, Gallimard, 1965, 370 p.
ARNDT, H W. Développement économique, la
marche d'une idée, Chicago, Nouveaux Horizons, 1987, 199 p.
AZOULAY, Gérard. Les théories du
développement. Du rattrapage des retards à l'explosion des
inégalités. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002,
220 p.
163
BAGUENARD, Jacques. La décentralisation [1980]
,7e éd., Paris, Presses Universitaires de France, 2006, 127
p.
BASTIEN, Rémy. Le pays haïtien et sa famille
[1951], Paris, Karthala, 1985, 217 p.
BARTHÉLEMY, Gérard. Le pays en dehors. Essai
sur l'univers rural haïtien, Port-au-Prince, Henri Deschamps, 1989,189
p.
BEAUDOUX, Etienne. Accompagner les ruraux dans leurs
projets. Paris, L'Harmattan, 2000, 235 p.
BOBEA, Lilian. « Insécurité insulaire
vis-à-vis sécurité régionale » in LOZANO,
Wilfrido et WOODING, Bridget, dir. Les défis du développement
insulaire : Développement durable, migrations et droits humains dans les
relations dominicano-haïtiennes au XXIe siècle, Santo Domingo,
Editora Búho 2008, pp 137-172.
BOEUF, Jean-Luc et MAGNAN, Manuela. Les
collectivités territoriales et la décentralisation, 2e
éd., Paris, La Documentation française, 2006, 154 p.
BOYARD, James. L'ONU et les opérations de maintien
de la paix, Port-au-Prince, Imprimeur II, 2010, 363 p.
BRAUD, Jacques. Penser l'État, Paris, Seuil,
2004, 245 p.
CASTOR, Suzy. L'occupation américaine d'Haïti
[1971], Port-au-Prince, Henry Deschamps, 1988, 272 p.
CASTOR, Suzy. Le massacre de 1937 et les relations
haïtiano-dominicaines [1988], Delmas, C3 Éditions, 2021, 220
p.
CHEVRIER, Jacques. « De la spécification de la
problématique » in GAUTHIER, Benoit, dir. Recherche sociale :
De la problématique à la collecte de données,
5e éd, Québec, Presses de l'Université du
Québec, 2009, pp 65-89.
CHALMERS, A. Francis. Qu'est-ce-que la science
[1976], 3e éd, Australie, Open University (Presses de
l'Université de Queensland), 1999, 237 p.
CORTEN, Andre (dir.). Haiti y Republica Dominicane,
Delmas, C3 Editions, 2013, 219 p.
Compilation deux siècles de constitutions
haïtiennes 1801-1987, Port-au-Prince, Fardin, 2011, 280 p.
DELINCE, Kern. L'insuffisance du développement en
Haïti, USA, Pegasus Books. 2000.
DENIS, Watson (dir.). Haïti, la CARICOM et la
Caraïbe. Questions d'économie politique, d'intégration
économique et de relations internationales, Delmas, C3
Éditions, 2018, 483 p.
DENIS, Watson (dir.). La négation du droit à
la nationalité en République Dominicaine. La situation
d'apatridie des dominicains et dominicaines d'ascendance haïtienne,
Port-au-Prince, Université d'État d'Haïti, 2020, 355 p.
164
Décret électoral 2015, Delmas, C3
Éditions, 2015, 85
p. www.c3editions.com .
Déclaration universelle des droits de l'homme, Paris,
Gallimard/Folio, 2018, 77 p.
DESHOMMES, Fritz. Politique économique en
Haïti. Rétrospectives et perspectives, Port-au-Prince, Cahiers
universitaires, 2005, 233 p.
DESHOMMES, Fritz. Haïti : La nation
écartelée. Entre plan américain et projet national,
Port-au-Prince, Cahiers Universitaires, 2006, 390 p.
DESHOMMES, Oriol. Le développement endogène.
Le cas d'Haïti de 2000 à 2010, Paris, l'Harmattan, 2014, 291
p.
DIAMOND, Jared. Effondrement. Comment les
sociétés décident de leur disparition ou de leur survie.
Paris, Gallimard, Paris, 2006.
DILLA ALFONSO, Haroldo. « La question du
développement de la frontière dominico-haïtienne » in
LOZANO, Wilfrido et WOODING, Bridget, dir. Les défis du
développement insulaire : Développement durable, migrations et
droits humains dans les relations dominicano-haïtiennes au XXIe
siècle, Santo Domingo, Editora Búho 2008, pp 89-109.
DUMORNAY, Jacques. La constitution 1987 :
décentralisation territoriale et gestion municipale,
Port-au-Prince, Les presses de l'imprimeur II, 1993, 105 p.
DIONNE, Bernard. Pour réussir. Guide
méthodologique pour les études et la recherche,
5e éd., Québec, Beauchemin Chenelière
Éducation, 2008, 254 p.
DORVILIER, Fritz. Gouvernance associative et
développement local en Haïti, Port-au-Prince,
Université d'État d'Haïti, 2011, 255 p.
DORVILIER, Fritz. La crise haïtienne du
développement. Essai d'anthropologie dynamique, Port-au-Prince,
Université d'État d'Haïti, 2012, 167 p.
DIEUDONNE, Sadrac. République d'Haïti.
Constitution du 29 mars 1987 amendée le 9 mai 2011. Port-au-Prince,
Imprimerie Média-Texte, 2012, 123 p.
Encyclopaedia Universalis, Egypte-Etrusques, corpus
8, France, Encyclopeadia Universalis, 1989. ELIE, Louis-Émile. La
vie tragique d'Henri Christophe, Delmas, C3 Éditions, 2020, 230
p.
ETIENNE, Sauveur Pierre. « L'arrêt TC : 0168/13 de
la cour constitutionnelle de la République Dominicaine à
l'épreuve de la sociologie historique », in DENIS, Watson, dir.
La négation du droit à la nationalité en
République Dominicaine. La situation d'apatridie des dominicains et
dominicaines d'ascendance haïtienne, Port-au-Prince,
Université d'État d'Haïti, 2020, pp 171180.
ETHEART, Bernard. La problématique foncière en
Haïti, Montréal, CIDIHCA, 2014, 204 p.
ETIENNE, Sauveur Pierre. L'énigme haïtienne.
Échec de l'État moderne en Haïti. Montréal,
Mémoire d'encrier/les Presses de l'Université de Montréal,
2007. [
www.pum.umontreal.ca,
www.memoiredencrier.com].
165
ENGELS, Friedrich. Esquisse d'une critique de
l'économie politique (1843-1844), Paris, Allia, 1998, 77 p.
FOUCAULT, Michel. Sécurité, territoire,
population, Paris, Gallimard/Seuil, 2004, 435 p.
GBENOU, Gabriel. Le revenu paysan. Entre la logique
sociale et la raison utilitaire. Québec, Presses de l'Universitaire
de Laval, 2010, 311 p.
GINGRAS, François-Pierre et COTÉ, Catherine.
« La théorie et le sens de la recherche » in GAUTHIER, Benoit,
dir. Recherche sociale : De la problématique à la collecte de
données, 5e éd, Québec, Presses de
l'Université du Québec, 2009, pp 109-134.
GILLES, Alain. État, conflit et violence en
Haïti. Une étude dans la région de l'Artibonite,
Port-au-Prince, Alain Gilles, 2008, 141 p.
GOUSSE, H. Bernard. La révolution numérique
du droit haïtien, Port-au-Prince, Henry Deschamps, 2012, 225 p.
HABERMAS, Jurgen. Le discours philosophique de la
modernisation, Paris, Gallimard, 1988, 484 p.
HECTOR, Michel. « Les traits historiques d'un
protonationalisme populaire » in Hurbon Laënnec, dir.
L'insurrection des esclaves de Saint-Domingue (22-23 août 1791).
Actes de la ronde internationale de Port-au-Prince du 8 au 10 décembre
1997, 2e éd. Port-au-Prince, Editions de l'Université
d'Etat d'Haïti, 2023, pp 203-218].
HURBON, Laënnec. Le barbare imaginaire, Paris, Les
éditions du Cerf, 2007, 323 p.
JEAN-CHARLES, Enex. Manuel de droit administratif
haïtien, Port-au-Prince, AFPEC, 2002, 408 p.
JEAN-FRANCOIS, N. Raphael. Les défis du
développement durable en pays sous-développés. Analyses,
perspectives et alternatives pour relever les défis d'Haïti.
USA, Columbia SC, 2021, 224 p.
JOACHIM, Benoît. Les racines du
sous-développement en Haïti [1979], Port-au-Prince,
Université d'État d'Haïti, 2014, 345 p.
KRUGMAN, R. Paul et OBSTFELD, Maurice. Économie
internationale, 3e éd, Bruxelles, De Boeck
Université, Belgique, 2001, 872 p.
LALIME, Thomas. « Développement économique
en Haïti : urgente nécessité ou arnaque ? (Économie
politique, Haïti et CARICOM) » in DENIS, Watson, dir. Haïti,
la CARICOM et la Caraïbe. Questions d'économie politique,
d'intégration économique et de relations internationales,
Delmas, C3 Éditions, 2018, pp 85-108.
LALEAU, Wilson. Haïti, pétrocaribe et ses
déraisons. Manifeste pour une éthique de
responsabilité, Delmas C3 Éditions, 2020, 355 p.
166
LAMOTHE, Joseph Pierre. Un monde à part ou
l'Émigré Haïtien en République Dominicaine,
Port-au-Prince, Presses Nationales d'Haïti, 2008, 287 p.
LEGER, J. Robenson. Décentralisation. Enjeux et
défis. Cadre institutionnel et ressources. Port-au-Prince, La
Ruche, 2000.
LESPINASSE, Colette. « Histoire de la migration
haïtienne vers la République Dominicaine » in DENIS, Watson,
dir. La négation du droit à la nationalité en
République Dominicaine. La situation d'apatridie des dominicains et
dominicaines d'ascendance haïtienne, Port-au-Prince,
Université d'État d'Haïti, 2020, pp 67-79.
LESPINASSE, Pierre-Eugène de, PRICE-MARS, Jean et
GUTIERREZ, Augustín Ferrer. Haïti et la restauration de
l'indépendance dominicaine, Delmas, C3 Éditions, 2013, 277
p.
LEVIN, Leah. Droits de l'homme. Questions et
réponses, 5e éd., France, UNESCO, 2009, 239 p.
LOUIS, Ilionor. Manuel de sociologie (Ed. Revue,
Augmentée), Vol. 3, Port-au-Prince, Imprim'Art, 2019, 306 p.
LOZANO, Wilfido et WOODING, Bridget. Dir. Les défis
du développement insulaire : Développement durable, migrations et
droits humains dans les relations dominicano-haïtiennes au XXIe
siècle, Santo Domingo, Editora Búho, 2008, Rép. Dom.
390 p.
LUCIEN, Georges Eddy. Espaces périphériques
et économiques d'archipel. La trajectoire contemporaine de la commune de
Verrettes. Port-au-Prince, Université d'État d'Haïti /
CIDHICA, 2009, 232 p.
MATHELIER, Richard, MATHON, Dominique et CASSEUS, Myrtho.
Entreprise, Territoire et Développement. Compilation 2002-2003,
Port-au-Prince, INESE-Le Nouvelliste, 2004, 222 p.
MEZILAS, Glodel. Critique de la raison dominicaine. La
question de l'antihaïtianisme, Port-au-Prince, Université
d'État d'Haïti, 2021, 204 p.
MENGIN, Jacqueline. Guide du développement local et
du développement social, Paris, l'Harmattan, 1989, 164 p.
MOISE, Claude. Constitution et luttes de pouvoir en
Haïti. De la révolution de 1946 à la Dictature macoute
(1946-1987), Port-au-Prince, Université d'État d'Haïti,
2013, 396 p.
MORDACQ, Frank. Les finances publiques, 3e
éd., Paris, Presses Universitaires de France, 2011, 90 p.
MULLER, Pierre. Les politiques publiques,
2e éd., coll. « Que sais-je ? », Paris, Presses
Universitaires de France, 2009, 129 p., [
www.afsp.msh-paris.fr/les-politiques-publiques.pdf].
OLIUS, Gary. Haïti 1804-2018, 2014 ans de servitude
économique et d'une gouvernance assistée, Delmas, C3
Éditions, 2022, 426 p.
167
OLIVIER DE SARDAN, Jean-Pierre. Anthropologie et
développement. Essai en socio-anthropologie du changement social,
Paris, Karthala, 1995, 221 p.
PAILLANT, Joseph. Code fiscal, Port-au-Prince, Henry
Deschamps, 2015, 734 p.
PAUL, Jean Eric. La décote de la gourde face au
dollar. Quelques pistes pour sortir du marasme économique actuel.
Delmas, C3 Éditions, 2016, 39 p.
PERKINS, H. Dwight, RADELET, S. et LINDAUER, L. David.
Économie du développement [2008], 3e
éd., Bruxelles, De Boeck Supérieur s.a, 2014, [Fond Jean
Pâques, 4 - B-1348 Louvain-la-Neuve 4e tirage 2014, pour la traduction et
l'adaptation française, Belgique], 992 p.
PEREZ, César. « Los origenes de una Alianza
PLD-PRSC y el Frente Patriotico del 1996 » in DENIS, Watson, dir. La
négation du droit à la nationalité en République
Dominicaine. La situation d'apatridie des dominicains et dominicaines
d'ascendance haïtienne, Port-au-Prince, Université
d'État d'Haïti, 2020, pp. 101-126.
PIERRE-CHARLES, Gérard. Radiographie d'une
dictature. Haïti et Duvalier [1969], Port-au-Prince,
Université d'État d'Haïti, 2013, 374 p.
PIERRE-CHARLES, Gérard. Économie
haïtienne et sa voie de développement [1967], Port-au-Prince,
Henri Deschamps, 1993, 262 p.
PLUCHON, Pierre.Toussaint Louverture, un
révolutionnaire d'ancien Régime, Paris, Fayard, 1989, 654
p.
PREPETIT, Claude. « Tremblement de terre en Haïti :
mythe ou réalité» In Revue de la Société
haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, no
241-244, janvier 2011. Séisme, vulnérabilité et
reconstruction, DENIS, Watson, dir. Port-au-Prince, Communication Plus,
2011, pp 21-30.
PRICE-Mars, Jean. La République d'Haïti et la
République Dominicaine [1953], tome 1, coll. « Bicentenaire
Haïti 1804-2004 », Port-au-Prince, Fardin, 1998, 227 p.
PRICE-MARS, Jean. La République d'Haïti et la
République Dominicaine [1953], tome 2, coll. « Bicentenaire
Haïti 1804-2004 », Port-au-Prince, Fardin, 1998, 355 p.
PRICE-MARS, Jean. La vocation de l'Elite [1919],
coll. « Bicentenaire Haïti 1804-2004 » Port-au-Prince, Fardin,
2002, 355p.
PRIVERT, Jocelerme. Décentralisation et
collectivités territoriales. Contraintes, enjeux et défis,
Québec, Le béréen, 2006, 282 p.
ROUZIER, Daniel-Gérard. Praxis, propositions de
gouvernance pour une autre Haïti, Port-au-Prince, Kiskeya publishing
co. , 2015, 209 p.
ROY, N. Simon. « L'étude de Cas » in
GAUTHIER, Benoit, dir. Recherche sociale : De la problématique
à la collecte de données, 5e éd,
Québec, Presses de l'Université du Québec, 2009, pp
200-226.
168
SASSEN, Saskia. Critique de l'État. Territoire,
autorité et droits, de l'époque médiévale à
nos jours, en ligne, 14/05/2009,
https://www.contretemps.eu/wp-contents/uploads/Sassen
ch1.pdf, site visité en janvier 2024.
SAINSINE, Yves. Haïti, État et paysans :
repères pour un développement local, Port-au-Prince,
Imprimerie Media-texte, 2009, 190 p.
SEN, Amartya. Repenser l'inégalité,
Seuil-L'Histoire Immédiate, Canada, 1992.
SEN, Amartya. Un nouveau modèle économique.
Développement, justice, liberté, Montréal, Odile
Jacob, 2000, 356 p.
THEODAT, Jean-Marie. « La frontière
haïtiano-dominicaine: une île dans l'île » in DENIS,
Watson, dir. La négation du droit à la nationalité en
République dominicaine. La situation d'apatridie des dominicains et
dominicaines d'ascendance haïtienne, Port-au-Prince,
Université d'Etat d'Haïti, 2020, pp 81-99.
THEODAT, Jean-Marie. « Frontière et relations
haïtiano-dominicaines » in LOZANO, Wilfrido et WOODING, Bridget, dir.
Les défis du développement insulaire : Développement
durable, migrations et droits humains dans les relations
dominicano-haïtiennes au XXIe siècle, Santo Domingo, Editora
Búho 2008, pp 111-136.
TI (Transparency International). Combattre la corruption.
Enjeux et perspectives, Paris, Karthala, 2002, 356 p. [
http://www.karthala.com].
TOUSSAINT, Hérold. Le métier
d'étudiant. Guide méthodologique du travail intellectuel,
Port-au-Prince, Imprimerie Média-Texte, 2017, 292 p.
Via Campesina. Une alternative paysanne à la
mondialisation néolibérale, Genève, Centre
Europe-Tiers Monde, 2002, 255 p. [
http://www.cetim.ch].
WOODING, Bridget. «Discrimination et
anti-haïtianisme. Les cas des immigrés haïtiens et de leurs
descendants nés en République dominicaine » in DENIS,
Watson, dir. La négation du droit à la nationalité en
République dominicaine. La situation d'apatridie des dominicains et
dominicaines d'ascendance haïtienne, Port-au-Prince,
Université d'État d'Haïti, 2020, pp 136137.
Annexe
169
A
Annexe 1
Appendice de questions dans le cadre d'entretiens
semi-dirigés.
NB : Notre recherche concerne des habitants et paysans qui
habitent une Section rurale frontalière. C'est la langue créole
que pratique cette population tout comme la majorité de la population
haïtienne. C'est la raison principale qui commande de préparer les
méthodes de collecte de données dans la langue de créole
haïtien.
|
Nimewo kod
|
Dat jodia
|
Lè li ye a
|
Remak
Seks moun nap fè dialòg ak li a M F lòt
Non lokalite ya :
|
Boc-Banic
|
Nan Croix
|
Savane Mûlatre
|
Don Diègue 2
|
Malary
|
Carrefour suzely
|
Terre-Blanche
|
|
|
|
|
|
|
|
« Bonjou kompatryòt mwen
Nou se etidyan nan metriz kap fini nan Fakilte Etnoloji nan
Inivèsite Leta Dayiti. Nan kad yon etid nap fè sou zafè
kondisyon sosyal ak ekonomik moun kap viv nan fwontyè a ki gade nan
dezièm seksyon Losyann nan Tomasik.
Nou ap mande w ak sajès pou w ka mete w nan dispozisyon
pou nou boukante pawòl nan kèk kesyon nou ta renmen ou reponn pou
nou. » Nou ap pran nòt de sa nap diskite la yo. Eske ou
pèmèt nou rapòte non ou nan teks kap ekri a ? Wi [ ] ou
non [ ]
1.-Kijan ou rele non ou ?
R :
2.-
Nan ki tranch laj ou : mwens ke 20 lane [ ] ; (20-30) [ ] ;
(30-40) [ ] ; (40-50) [ ]; (50-60) [ ]; (60-70) [ ]; plis ke 70 lane [ ] /
oubyen di nan ki lane ou fèt :
3.- Eske ou se moun ki fèt nan lokalite fwontyè sa
? si wi
Si non Men se depi kilè wap viv nan zòn
fwontyè a ?
R :
4.- B
Eske ou ka di nou ki aktivite ou fè pou ou kapab viv nan
fwontyè a ? R :
4.1.- Si wi se komès wap fè nan ki mache ou konn
al van n ? Sinon al nan kesyon 5 lan.
R : 4.2.- Si wi se nan panyòl
ou al van n machandiz kijan ou viv rapò ak dominiken wap kontre yo ? R :
4.3.- Ki kote ou achte machandiz wap van n yo ?
R :
4.4.- Si wi se nan panyòl ou achete machandiz kijan ou
viv rapò ak dominiken wap kontre yo ?
R :
5.- Si wi se agrikilti wap fè ki sa ou pwodwi plis ?
Sinon al nan kesyon 8 lan.
R :
5.1.- Ki lòt pwodwi nou plante tou ?
R :
5.2.-Nan ki sezon nou fè grand rekòlt nan
zòn sa ?
R :
6.-Ki kantite kòb aktivite sa wap fè a kon n
pèmèt ou antre nan men ou ?
R :
6.1.-Eske aktivite ekonomik wap fè yo pèmèt
ou jwen n kòb ki pemet ou viv ak fanmi ou ?
R :
6.2-Sinon ki kote ou kon jwen lot kòb ki
pèmèt ou repon n ak bezwen ou men m ak fanmi ou ?
R :
7.- Eske nan tè jadin nou yo gen yon sistèm
irigasyon ki pote dlo ladan yo ?
se ki instans ki mete li en plas ?
R :
7.1.-Si wi
R :
7.2.-Ou gen infomasyon depi kilè li ap fonksyone ?
R :
7.3.-Tè wap fè jadin ou an kijan ou genyen li ?
oubyen ou se fèmye yon gran don ki met tè a ?
R :
7.3.1.-Eske ou se fèmye Leta ?
C
7.3.2.-Si se yon gran don ki met tè a kijan yo rele non li
? R :
8-Eske ou fè elvaj tou ak agrikilti ? Si wi ki zannimo nou
gade ?
R :
8.1.- Eske nou gen teknisyen agrikòl ki kon n ban nou
seminè ak lòt enkadreman pou jadin nou?
R :
9.-Eske ou fè elvaj selman ?
R :
9.1.-Eske nou gen veterinè ki kon n bay zannimo nou yo
vaksen ak lòt swen ka yo mande oubyen
kan yo malad?
R:
9.-Ki kote nou al lopital kan nou gen pwoblèm la sante
ki mande nou wè doktè ?
R :
10.-Se yon sant sante pou Leta oubye se yon institisyon
prive
|
R : Sant sante Leta
|
sant sante prive
|
11.-Kijan nou evalye travay fòs lòd yo nan
zòn fwontyè a kap bay nou sekirite ?
R :
12.-Eske nou gen sevis/tiyo dlo potab nan zòn
fwontyè nou ye a bò isit la?
R:
13.-Si wi eske nou bwè dlo sa ?
R :
14.-Sinon ki kote nou jwen n dlo pou nou bwè ?
R :
15.- Ki rapò nou genyen ak asec oubyen casec yo nan
zòn nan ?
R :
16.-Eske gen lòt reprezantan leta ki kon n vini kontre
ak nou nan zòn fwontyè sa ?
R :
17.-Eske ou gentan genyen pitit deja ? Sinon al nan kesyon 24
lan.
R :
18.-Si wi eske pitit ou ap viv ak ou nan fwontyè a ?
Sinon al nan kesyon 24 lan.
R :
D
19.- Si wi Eske se timoun ki gen laj pou li ka al lekòl
? Sinon al nan kesyon 24 lan.
R :
20.-Si wi eske ya l lekòl ? Sinon al nan kesyon 24
lan.
R :
21.- Eske timoun ou nan nivo klas primè oubyen se nan
nivo klas segondè?
klas segondè oubyen ou gen nan tou 2 nivo yo
R : Klas primè
22.- Ki kote yo al lekòl?
R:
23.-Eske se nan yon lekòl Leta oubyen nan yon lekòl
prive yo ye?
R: Lekol leta lekòl prive
24.-Eske ou gen timoun ki fini ak tout klas lekòl yo ki
retounen vini viv isit la nan fwontyè a?
R:
25.-Eske w konn fè lòt aktivite ki oblije w ale
lòt kote ki pou dominiken yo nan fwontyè a?
R:
26.-Eske ou kon n al nan mache binasyonal nan fwontyè
bò isit la?
oubyen òganizasyon politik
R
27.-Eske ou se manb nan yon òganizasyon ?
R:
28. Si wi, eske se yon òganizasyon sosyal
kominotè
oubyen ou se manb nan plizyè òganizasyon
29.- Kijan nou konsidere leta peyi dayiti nan trètman
li bay lokalite a nan fwontyè bò isit la?
R:
30.-Kisa zòn fwontyè sa reprezante pou ou menm
kap viv ladan l?
R :
31.- Ki pwojè ou ta renmen wè ki fèt pou
nou tout kap viv nan zòn fwontyè sa ?
R :
32.-Gen yon kloti dominiken yo ap konstwi nan fwontyè
a, eske ou ka di yon pawòl sou sa ?
R :
33.-Eske ou santi gen kek lòt bagay ou te bezwen ajoute
pou nou fini ak boukante pawòl sa nou soti genyen la nan moman sila ?
R :
Nou di ou yon gran mèsi pou kolaborasyon ou nan
dyalòg sa ki fini la.
Annexe 2
Les photographies présentées ci-dessous illustrent
la situation de quelques rivières dans la 2e Section Lociane. Ces
rivières concernent Loratoun (photo 5) sur la route de Nan Croix.
À Boc Banic, il y a Lociane (photo 6) et l'Artibonite (photo 7). Il n'y
a pas de pont dans cette zone.
PHOTO 5: IMAGE DE LA RIVIÈRE DE LORATOUN DANS LA
PASSE DE NAN CROIX
La passe de la rivière de Loratoun dans la route
de Nan Croix
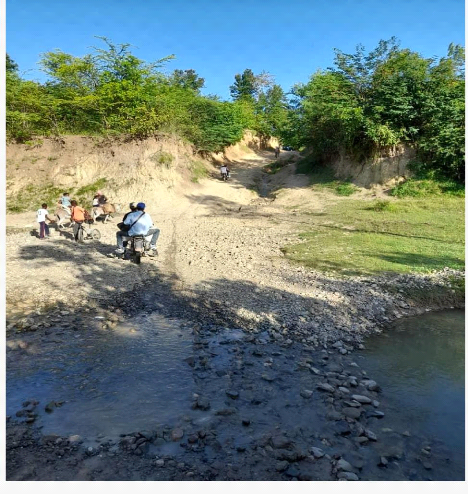
Prise de photo de Frantz Isidor sur le
terrain
E
PHOTO 6: LA PHOTO DE LOCIANE DANS LA PASSE DE BOC
BANIC
La rivière de Lociane du côté de Boc
Banic. La traversée conduit à l'Artibonite.

Photographie de Frantz Isidor en décembre
2022
F
PHOTO 7: ARTIBONITE DANS LA PASSE DE BOC
BANIC
Le fleuve de l'Artibonite dans la zone frontalière
de Boc Banic

Prise de photo par Frantz Isidor au cours de
l'étude
G
H
Annexe 3
Répertoire des tableaux, cartes et photographies
Liste des tableaux
Tableau 2 : Démonstration des indicateurs
socio-économiques de la 2e Section Lociane 38
Tableau 3 : Typologie de décentralisation 111
Tableau 4 : Présentation de la répartition des
répondants aux entretiens 124
Tableau 5 : Tendance de rapport entre les paysans et les
autorités de la collectivité territoriale 125
Tableau 6 : Tendance de participation des paysans dans la vie
organisationnelle 130

Liste des photographies
Photo 1: Illustration de puits artésien de Malary 31
Photo 2: Illustration de source d'eau à Malary 32
Photo 3: Type d'habitat où vivent certains paysans dans
la 2e Section Lociane 40
Photo 4: Illustration de l'état de routes dans la
2e Section Lociane 51
Photo 5: Image de la rivière de Loratoun dans la passe
de Nan Croix E
Photo 6: La photo de Lociane dans la passe de Boc Banic F
Photo 7: Artibonite dans la passe de Boc Banic G
J
Liste des cartes
Carte 1 : Illustration de la situation géographique de
la frontière entre Haïti et la République
Dominicaine 43
Carte 2 : Illustration de la situation géographique de
Thomassique 46
Carte 3 : Illustration de la situation géographique de
la 2e Section Lociane 47
| 


