|
|
UNIVERSITÉ OMAR BONGO
.........................
|
|
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES
..........................
DÉPARTEMENT DES SCIENCES GÉOGRAPHIQUES,
ENVIRONNEMENTALES ET MARINES
Laboratoire d'Analyse Spatiale des Environnements
Tropicaux (LANASPET)
Mémoire de Master Recherche Chaire
CEMAC
Option : Environnement et Développement Durable
THEME :
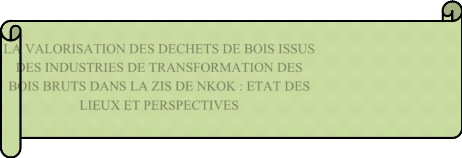
LA VALORISATION DES DECHETS DE BOIS ISSUS
DES INDUSTRIES DE
TRANSFORMATION DES
BOIS BRUTS DANS LA ZIS DE NKOK : ETAT DES
LIEUX ET
PERSPECTIVES
Mémoire présenté et soutenu
publiquement par :
Cécilia Ariane OBONE MBA
Sous la Direction de :
Directeur : Co-Directeur :
Pr. Jean Damien MALOBA MAKANGA Dr. Jérôme MABIKA
Professeur Titulaire (CAMES) Chargé de Recherche
(CAMES)
Année académique : 2023-2024
SOMMAIRE
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES SIGLES iIV
INTRODUCTION GENERALE 5
PREMIERE PARTIE : 17
ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS DE BOIS BRUTS DE LA ZONE
ECONOMIQUE SPECIALE DE NKOK 17
CHAPITRE 1 :
PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE ET DU CADRE
RÈGLEMENTAIRE RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION DE
BOIS
BRUTS 19
CHAPITRE 2 : GESTION DES
DÉCHETS DE BOIS BRUTS DANS LA ZIS DE NKOK
37
DEUXIEME PARTIE : 62
EFFETS ET LIMITES DE LA VALORISATION DES DECHETS DE BOIS BRUTS
DANS
LA ZIS DE NKOK 62
CHAPITRE 3 : IMPACTS DES
ACTIVITÉS DE VALORISATION DES DÉCHETS DE
|
BOIS BRUTS
|
64
|
|
CHAPITRE 4 : LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA
VALORISATION DES
|
|
|
DÉCHETS DE BOIS BRUTS DANS LA ZIS DE NKOK
|
78
|
|
CONCLUSION GENERALE
|
98
|
|
BIBLIOGRAPHIE
|
105
|
|
ANNEXES
|
111
|
|
TABLE DES ILLUSTRATIONS
|
119
|
|
TABLE DES MATIERES
|
..123
|
|
i
|
II
DÉDICACES
Je dédie ce Mémoire à :
Ma mère Sergine ANGUE OBIANG. Qu'elle trouve dans ce
travail, la satisfaction de tous
ses efforts.
Mon oncle Richard ALLOGO MBA, pour les valeurs
inculquées et le regard paternel qu'il ne
cesse d'avoir à notre égard. Je le remercie
infiniment.
III
REMERCIEMENTS
Ce travail de longue haleine a été possible
grâce à une diversité de personnes à qui nous
voudrions témoigner notre gratitude.
En premier lieu, nos encadreurs : le Pr Jean Damien MALOBA
MAKANGA et le Dr Jérôme MABIKA. Vos orientations et votre rigueur
nous ont servi de guide tout au long de ce travail.
Aux enseignants du département des Sciences
Géographiques, Environnementales et Marines (DSGEM) de
l'Université Omar Bongo et aux membres du Laboratoire d'Analyse Spatiale
des Environnements Tropicaux (LANASPET). Vos enseignements ont suscité
et nourri en nous l'intérêt pour les questions d'environnement et
de développement durable.
Au Dr Médard OBIANG EBANEGA qui, à travers l'ONG
WeNeed, a su nous transmettre sa passion pour la protection de l'environnement
et les prérequis en termes de gestion des déchets.
Nos remerciements vont à l'endroit de la Direction
Générale des Industries du Commerce du Bois et de la Valorisation
des Produits Forestiers (DGICBVPF) et aux autorités de la Zone
d'Investissement Spéciale (ZIS) de Nkok. À M. Auguste NDOUNA, M.
Aristide EYI, M. Gustave ALLO'O BIYO'O et M. Roland LENDOYE. Vos
accompagnements ont été d'un grand apport pour la
réalisation de ce travail.
À M. BACKITA MOUSSOUNDA Lewis et à nos amis
MEKAME BIE Kevin, NGOUARA Merlin, METOULOU Larry, AKUE Thibault, MOUSSAVOU
AFANOU Belissa, MALANDZA MBOUMBA Darlyne et BOUKANDOU MBADINGA Loricia. Vos
orientations lors des différentes lectures et votre implication dans la
pratique du terrain nous ont été d'un apport inestimable.
À notre famille, qui a toujours su nous apporter son
soutien multiforme tout au long de notre parcours scolaire et universitaire
pour la réussite de nos études. Nous vous disons
`'Merci».
Que Guy Herod PAMBO MIHINDOU trouve l'expression de notre
profonde gratitude et notre reconnaissance pour son soutien physique et moral
tout au long de ce travail.
Nos remerciements s'adressent également à nos
promotionnaires de Master, ainsi qu'à toute personne ayant
contribué à la rédaction de ce Mémoire.
iv
LISTE DES SIGLES
ARISE IIP : Arise Integrated Industrial
Plateforms
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
CNAMGS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie
et de Garantie Sociale
CNSS : Caisse Nationale de
Sécurité Sociale
CNUCED : Conférence des Nations Unies
pour le Commerce Et le Développement
DGICBVPF : Direction Générale
des Industries du Commerce du Bois et de la Valorisation
des Produits Forestiers
DVRIBPB : Direction de la Valorisation des
Rebuts Industriels de Bois et de la Promotion des
Bioénergies
FCFA : Franc des Colonies Françaises
d'Afrique
GSEZ : Gabon Spatial Economic Zone
IDE : Investissement Direct
Étranger
SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel
Garanti
UTB : Unité de Transformation du
Bois
UVRB : Unité de Valorisation des
Rebuts de Bois
ZES : Zone Économique
Spéciale
ZERP : Zone Économique à
Régime Privilégié
ZIS : Zone d'Investissement
Spéciale
6
1-Objet et champ d'étude
1.1-Objet de l'étude
Dans le monde, les déchets de bois comme d'autres types
de déchets présentent des volumes assez importants qui sont
estimés à des milliers voire des millions de tonnes. Aux
États-Unis et dans l'Union Européenne par exemple, près de
100 millions de tonnes de déchets de bois échappent au recyclage
(Welsch, 2021). Ces déchets ont un fort potentiel de valorisation si les
mesures de réemploi et/ou de recyclage sont mises en place. D'ailleurs,
le bois est considéré comme une ressource renouvelable, durable
et réutilisable jusque dans ses déchets.
Selon Turlan, un déchet est un bien que son
propriétaire destine à l'abandon (Turlan, 2018). C'est ce qui
reste d'une chose dont on ne se sert plus et qui bien souvent, évoque
une valeur nulle ou négative, impropre à l'utilisation.
Toutefois, cette perception des déchets connait des évolutions
car leur réutilisation dans différents domaines est davantage
encouragée. Cela est dû à la vision du développement
durable qui préconise un objectif « zéro déchet
» et encourage la pratique du recyclage dans la mesure du possible
(Objectif n°12 du Développement Durable). Cela découle
aussi, de l'amélioration des techniques qui permettent de traiter les
déchets en quantité et en qualité. Dans la filière
forêt-bois, les rebuts ou déchets de bois désignent
l'ensemble des produits forestiers laissés à l'abandon dans les
forêts, rejetés et/ou déclassés, issus de
l'exploitation forestière ou de la transformation du bois. Dans notre
cas, il s'agit de matériaux résiduels issus de la transformation
du bois dans les industries.
Les déchets de bois s'identifient selon la classe
à laquelle ils appartiennent. Dans ce classement, trois
catégories de déchets de bois sont reconnues : la première
catégorie est celle des déchets de classe A, elle concerne les
bois bruts n'ayant reçu aucun traitement chimique (Dosses, sciure). La
deuxième catégorie est pour la classe B ou AB qui comprend les
bois faiblement traités mais non dangereux (meubles, fenêtre, bois
de coffrage). Et, la troisième catégorie, rassemble les
déchets de bois de classe C ayant reçu différents
traitements chimiques et considérés comme dangereux (poteaux
électriques, traverses de chemin de fer), (ADEME, 2022). De ces
catégories, la classe A est celle qui nous intéresse. Les bois
bruts dont sont issus ces déchets, proviennent pour certains, des
industries de première et deuxième transformation du bois
représentées par les activités de sciage et de
déroulage-placage. Ce sont des bois dit propres : ils ont un aspect
naturel, ils sont non vernis, non peints, et n'ont pas été en
contact avec des matières dangereuses (Dalimier, 2022). La valorisation
des déchets de bois étant
7
fortement dépendante de la classe à laquelle ils
appartiennent, le potentiel de valorisation est plus élevé et
diversifié dans les deux premières classes : les classes A et B
(Ordeco, 2023).
Parlant de valorisation, c'est une notion polysémique
qui s'emploie dans des domaines autres que celui des déchets. Valoriser
c'est augmenter la valeur d'un objet, c'est le présenter de façon
plus avantageuse en lui accordant une importance plus grande (Robin, 2017).
Dans le cas des déchets, la valorisation fait partie intégrante
du système de gestion et intervient dans la phase de traitement des
déchets. Elle permet de reconsidérer le débat sur la
perception des déchets en défendant leur utilité.
D'ailleurs, la loi française portant sur l'élimination des
déchets la définie par opposition à l'élimination
ou la mise en décharge. Elle consiste dans toutes les activités
ayant trait au « [...j réemploi, recyclage ou toute autre
action visant à obtenir, à partir des déchets, des
matériaux réutilisables ou de l'énergie. » (Loi
Française, 1992). De ce fait, la valorisation industrielle des
déchets de bois bruts est comprise comme un processus de traitement des
restes des matières premières de bois, en vue d'obtenir de
nouveaux produits.
La présente étude porte sur les déchets
de bois bruts industriels dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok
et les impacts des valorisations mises en place. En tant que ressource à
exploiter, les déchets de bois bruts industriels revêtent
plusieurs enjeux qui participent à l'atteinte des objectifs de
développement durable.
1.2-Champ de l'étude
Ce travail s'inscrit principalement dans le champ de la
géographie économique, de la géographie de l'environnement
et de la rudologie.
La géographie économique étudie les
atouts et contraintes spatiales qui influencent l'implantation d'une entreprise
en un lieu donné. « Pourquoi là ? », « Quelles
sont les ressources disponibles ? », il s'agit là de questions qui
influencent la localisation d'une activité économique. Paul
Claval la définit comme « une discipline carrefour
destinée à étudier les aspects spatiaux de la lutte que
les hommes mènent contre la rareté » (Bailly &
Valarché, 1979, p.227). C'est-à-dire qu'au-delà des
aspects de production et de consommation étudiés par
l'économie, d'autres disciplines sociales entrent en ligne pour tenter
d'expliquer le choix de localisation d'une entreprise. Ainsi, l'implantation
d'usines de valorisation des déchets de bois bruts à Nkok tient
compte des facteurs tels que la disponibilité des ressources, leur
coût, l'accès aux voies de communication et aux réseaux de
télécommunication qui sont favorables au développement et
à la pérennisation de l'activité sur le site.
8
La géographie de l'environnement étudie l'impact
des pratiques sociales sur le milieu naturel et les réponses
données par la nature en retour ; elle propose une organisation des
territoires qui limite les atteintes portées à l'environnement
(Veyret, 2017). Dans notre cas, les procédés de valorisation des
déchets de bois bruts doivent avoir un impact positif sur la
réduction des quantités de déchets produites sur le site
de la ZIS de Nkok et réduire le plus possible la pollution de l'air.
Quant à la rudologie, elle est selon le dictionnaire
Larousse (2018) : « l'étude des déchets et de leur
recyclage ou de leur valorisation ». Il s'agit d'une science
novatrice dont le mot a été inventé par le
géographe français Jean Gouhier en 1985, et qui a pour objet :
l'étude systématique des déchets. La rudologie tente
d'analyser les modes de production des déchets et les nuisances
générées afin d'anticiper leur réduction. Elle est
très liée au modèle d'économie circulaire dont le
but est de lutter contre le gaspillage des matières en ciblant les
produits à valeur maximale d'utilisation et de temps d'utilisation, sur
un cycle de vie plus long. Ainsi, la rudologie combinée au modèle
d'économie circulaire, permet de classifier et de caractériser
les déchets de bois bruts. Cela permet d'assurer que les formes de
valorisation pratiquées à dans la ZIS de Nkok, favorisent leur
réinsertion dans la chaîne de production et de consommation et
participent in fine à une meilleure gestion de ces déchets de
bois.
2-Justification du sujet
Dans plusieurs pays comme la France ou le Canada (au
Québec), la valorisation des déchets de bois bruts est un
processus déjà intégré dans la filière
forêt-bois. En Afrique, le bois est une source d'énergie
très importante aussi bien pour les ménages que pour les
commerces, notamment pour la cuisson des repas. De ce fait, la valorisation des
déchets de bois bruts est fortement orientée vers la production
de charbon de bois. À Kinshasa par exemple, la consommation de charbon
de bois est douze fois supérieure à la production nationale ; au
Cameroun la demande atteint les 2,5 millions de m3 par an ; elle est
de 6 millions de tonnes par an au Maroc (Deveaux, 2018)1.
Cette réalité de la valorisation des
déchets de bois bruts en Afrique, n'échappe pas au Gabon. En
effet, la production du charbon de bois est importante et s'accompagne de la
production d'ameublement et d'outils de quincaillerie. En chiffre, c'est 1524
tonnes de charbon qui sont produits par an dans la zone couvrant Libreville et
ses environs et près de 150 dépôts
1 Il faut noter que ces productions de charbon de
bois ne relèvent pas seulement de la valorisation
énergétique du bois sous forme de rebuts.
9
de sciage jumelés à des quincailleries (Mabika,
2021). Aujourd'hui, ces déchets de bois sont une matière
recherchée car leur valorisation génère des revenus
importants (idem). Il faut dire que la valorisation des déchets
de bois bruts industriels relève de la filière artisanale. Les
artisans s'approvisionnent auprès des industries de transformation du
bois et valorisent leurs déchets. Cependant, cette forme de valorisation
ne suffit pas à traiter l'ensemble des résidus produits et
rencontre souvent des difficultés dans la traçabilité de
la production et des retombées socio-économiques (Lescuyer et
al., 2011) et (Kamkuimo et al., 2017).
Au Gabon, le bois est une ressource abondante. La superficie
totale des forêts est estimée à près de 85% du
territoire national, soit 22 millions ha de superficie dont près de 20
millions destinés à la production (Mombo, 2009). D'après
Maloba Makanga, la superficie totale des forêts gabonaises est la
4ème en Afrique centrale après celle de la
République Démocratique du Congo, de la République
Centrafricaine et du Congo. Celles-ci ont des arbres d'une grande taille,
allant jusqu'à 60 m de hauteur, avec d'énormes troncs droits
élargis sur la base (Maloba Makanga, 2011). Les forêts gabonaises
faisant partie du bassin du Congo, second poumon planétaire, leur
préservation est stratégique pour la lutte contre le
réchauffement climatique. Elles nécessitent de ce fait, une
gestion durable de la ressource bois dans tous les segments de la
filière, incluant donc la valorisation des déchets de bois
bruts.
En 2009, lors d'une réunion gouvernementale,
l'État gabonais prend la décision d'interdire l'exportation
totale du bois sous forme de grumes. Cette décision se concrétise
plus tard par l'Ordonnance n°008/PR/2010 du 25 février 2010.
L'objectif étant de permettre une première transformation du bois
brut au niveau local avant exportation. À la suite de cette mesure,
plusieurs conséquences liées les unes aux autres, s'enchainent.
Entre autres, le renforcement des unités de transformation et de la
production de bois bruts transformés qui ont entrainé
l'augmentation du volume des déchets de bois bruts. En effet,
l'année 2022 a comptabilisé deux cents trente-cinq (235)
unités de transformation du bois (UTB) (DGICBVPF, 2022). Contrairement
à l'année 2009, avec quatre-vingt-deux (82) unités
(Kombila Mouloungui, 2019). La Zone Économique à Régime
Privilégié de Nkok (ZERP), aujourd'hui Zone d'Investissement
Spéciale de Nkok (ZIS), est née de cette mesure gouvernementale.
Son caractère industriel majoritairement orienté vers la
transformation locale du bois, participe du taux croissant du volume des
déchets. Sur près de 100 usines installées, les
unités destinées à la transformation du bois comptent pour
85 en 2022 (DGICVBPF, 2022). Dans l'ensemble, les segments de sciage et de
déroulage-placage produisent le maximum de déchets.
10
La valorisation des déchets de bois bruts est une
pratique réelle dans la ZIS de Nkok. Cependant, elle connait quelques
déficits d'organisation qui l'empêchent de satisfaire l'ensemble
des attentes en termes de gestion de ces déchets et de
désengorgement des unités de transformation qui sont à la
source de la production des déchets de bois bruts. Ces
éléments tels que présentés, justifient le choix de
notre sujet.
3-Intérêt du sujet
« Au Gabon, les activités de la filière
bois concernent exclusivement la coupe du bois, la transformation et la
commercialisation f...] Le recyclage des déchets de bois repose souvent
sur des activités informelles et largement ignorées de la
politique forestière. » (Mabika, 2021, pp.69-70). Or, ces
déchets de bois bruts sont des matières secondaires
stratégiques pour lesquelles la valorisation arrive à combiner
les avantages économiques, sociaux et environnementaux qui sont les
piliers du développement durable. Dans ce sens, notre étude
revêt un intérêt scientifique, socio-économique et
environnemental.
? Intérêt scientifique
Sur le plan scientifique, cette étude est un
complément de données statistiques sur la production des
déchets de bois bruts industriels. Ces données pourraient
susciter la recherche sur des projets innovants en termes d'utilisation de ces
déchets. En outre, cette étude propose des modes de valorisation
qui diffèrent des pratiques coutumières de production de charbon
de bois ou de sciage artisanal. Elle est une contribution aux travaux sur la
gestion des déchets de bois et des formes de valorisation applicables
selon les types de déchets.
? Intérêt
socio-économique
Sur le plan socio-économique, cette étude
évalue l'impact économique des activités de valorisation
des déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok, en vue d'améliorer
le rendement matière de la production de bois bruts transformés.
Elle a un impact social dans la mesure où, produire encore plus de
richesse dans la filière bois est source d'emplois, qui concourent
à l'amélioration des conditions de vie des personnes
employées. Cette étude s'intéresse à une forme de
valorisation industrielle qui met en lumière les potentialités de
ces matières résiduelles. Elle propose des produits à fort
potentiel d'exportation, ce qui peut représenter un atout
vis-à-vis des échanges et des partenariats commerciaux avec des
acheteurs étrangers.
11
? Intérêt environnemental
La portée environnementale de ce travail quant à
elle, réside dans la lutte contre le gaspillage des matières qui
peuvent encore servir à d'autres usages et soutenir la gestion
forestière durable. En effet, ce travail s'intéresse à un
modèle d'utilisation durable des déchets de bois bruts qui
évite que ces matières finissent pour beaucoup,
brûlées à l'air libre, participant ainsi à la
pollution de l'air.
4-Revue de la littérature
Les problèmes posés par les déchets dans
la société, ont fait l'objet de plusieurs travaux scientifiques
qui tentent d'améliorer les systèmes de gestion et de pallier les
problèmes environnementaux générés. Concernant les
déchets de bois bruts, plusieurs études sur le sujet attestent de
l'abondance de ces déchets dans les industries de transformation et dans
l'exploitation forestière. Dans l'est du Cameroun, la consommation du
bois est de 820.639 m3 et a généré environ 528.378
m3 de rebuts durant l'année 2016 (Kamkuimo et al., 2017).
À Libreville et ses environs, on compte 444.996 m3 de rebuts
pour une consommation de grumes de 870.163 m3 en 2015 (Mabika,
2021). Ces déchets de bois bruts, issus en grande partie du sciage
(Mabika, 2014), sont de type débités déclassés.
Quant aux déchets tels que les copeaux ou les sciures, ils sont
très souvent restés en marge des études sur les types de
déchets de bois et sont très peu valorisés au niveau du
Gabon.
Les utilisations de ces débités
déclassés ont fait l'objet de nombreuses publications pour la
production de lamellés collés ou croisés (Dalimier, 2022),
de bois de construction (Ekome Mengue, 1997 & Eyi Obame, 2017), ou de
charbon de bois (Ngangori, 2018 et Mabika, 2021). Par exemple, Mabika (2021)
évalue les retombées socio-économiques et
environnementales de ces activités du secteur artisanal-informel et
montre que les procédés de recyclage participent à limiter
le gaspillage des ressources et à garantir des revenus
conséquents qui améliorent les conditions sociales des acteurs.
Dans le même sens, Ekome Mengue (1997) et Eyi Obame (2017), identifient
et estiment les types de résidus de bois issus de l'abatage et du
façonnage en vue de leur valorisation pour la construction. Ils
identifient comme résidus, les rondins et les corsins qui peuvent
être transformés en chevrons, lattes et planches, afin
d'améliorer la qualité des habitations pour les populations
locales.
Malgré l'abondance et la diversité de ces
études, le problème de l'importance des volumes de déchets
de bois bruts persiste et le taux d'utilisation demeure faible. Au regard des
travaux précités, cette étude voudrait approfondir la
réflexion sur l'importance de la valorisation des
12
déchets de bois bruts industriels. Pour ce faire, elle
s'intéresse à une forme de valorisation industrielle qui
diversifie un peu plus les types de déchets valorisés et optimise
les méthodes de traitement de telle sorte qu'elles atténuent
davantage les problèmes d'encombrement et de gaspillage des
résidus de bois. Dans le contexte d'une zone à forte production
des déchets de bois bruts, cette étude évalue les impacts
concrets des dispositifs installés pour valoriser ces déchets.
5-Problématique, Hypothèses et Objectifs
5.1- Problématique
Les déchets de bois bruts produits dans les
unités de transformation connaissent des volumes assez importants et
dont la demande s'accroit au fil du temps. Ils sont créateurs
d'activités économiques et génèrent des gains
conséquents. Notamment, pour la production de charbon de bois (Ngangori,
2018), le fumage de poisson (Nguimbi, 2015) ou encore les activités
artisanales de sciage et menuiserie (Lescuyer et al., 2011). La Zone
d'Investissement Spéciale de Nkok qui est une zone de forte production
des déchets de bois bruts, connait quelques difficultés dans la
gestion de ces déchets. En effet, les déchets de bois sont
brûlés ou stockés à l'air libre dans les
unités de transformation. Cette situation courante dans les
unités de transformation du bois au Gabon (Maloba Makanga, 2022),
entraine le gaspillage des matières qui peuvent encore être
utilisées et participe à la pollution de l'air. Pour pallier ces
problèmes, les autorités de la ZIS ont introduit des
unités de valorisation afin d'assurer la gestion de ces déchets
et permettre une meilleure utilisation de ceux-ci. Cependant, cette initiative
ne suffit pas à régler le problème de gaspillage puisque
les pratiques de brûlage et de stockage des déchets de bois bruts
persistent au sein des unités de transformation.
Au regard de ce qui précède, nous sommes
amenés à nous interroger de la façon suivante :
Comment les déchets de bois bruts sont-ils gérés
dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok ?
Quelle est la place de la valorisation des déchets de bois
bruts ? Quels sont les conditions et procédés de valorisation mis
place ? Quels sont les impacts et limites de cette valorisation ?
5.2-Hypothèses
En guise de réponse provisoire à la
problématique, nous énonçons trois hypothèses
formulées comme suit :
13
- La gestion des déchets de bois bruts dans la Zone
d'Investissement Spéciale de Nkok se fait de diverses manières
suivant les pratiques et orientations des différents acteurs ;
- La valorisation de ces déchets occupe une place
importante avec la mise en place des conditions et procédés de
valorisation qui ont un impact économique, social et environnemental
positif ;
- Bien que dans la ZIS de Nkok il y ait des industries de
valorisation des déchets de bois bruts, de nombreux manquements sont
observables. Ce qui limite l'efficacité de la valorisation de ces
déchets de bois.
5.3-Objectifs
L'objectif de ce travail est d'examiner le système de
gestion des déchets de bois de la ZIS de Nkok et de vérifier
l'efficacité des processus et procédés de valorisation mis
en place. Il se décline autour de trois objectifs spécifiques qui
sont :
- Recenser les limites du système de gestion des
déchets de bois dans la ZIS ;
- Quantifier les volumes des déchets de bois bruts
produits dans les unités de transformation et ceux collectés par
les unités de valorisation des déchets du bois ;
- Évaluer l'impact socio-économique et
environnemental de la valorisation des déchets de bois bruts.
6-Cadre méthodologique
6.1-Présentation de la
démarche
La méthode scientifique est la procédure logique
d'une science, c'est l'ensemble des pratiques particulières qu'elle met
en oeuvre pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses
théorisations soit clair, évident et irréfutable (Aktouf,
1987). L'approche méthodologique de ce travail s'appuie sur les
enseignements tirés de la recension des documents consultés et
des observations directes lors des sorties de terrain (Juin-Juillet
2023/Février-Avril 2024).
Pour mener à bien ce travail, nous avons opté
pour une approche mixte : la démarche
hypothético-déductive. Cette approche à la fois
descriptive et causale, combine les méthodes de collecte et d'analyse de
données propres aux approches qualitative et quantitative. Elle consiste
à émettre des hypothèses, à recueillir des
données puis à tester les résultats obtenus pour
réfuter ou confirmer les hypothèses. Elle nous a permis de faire
un état des lieux sur la gestion des déchets de bois bruts dans
la ZIS de Nkok et d'établir les faits sur les pratiques de valorisation
exercées. Elle nous a également permis de mesurer l'apport de la
valorisation sur
14
le plan social, à travers les emplois
générés par ces activités qui permettent
d'améliorer le quotidien des bénéficiaires. La
documentation sur les déchets de bois au Gabon étant peu fournie,
cette approche permet de rendre compte des faits et perceptions entourant la
valorisation de ces déchets dans cette zone de forte production.
? Recherche documentaire
Cette étude a été possible grâce
à une diversité de documents consultés en
bibliothèque (Institut Français, LANASPET,
Médiathèque et Bibliothèque Universitaire). Sur les
différents sites académiques d'internet (Érudit,
Googlescolar, researchgate et Cairn info) et via les medias nationaux et
internationaux en ligne (Le Nouveau Gabon, Gabon actualité, Gabon
médias times, France infos etc.). L'ensemble de ces documents
étant directement ou indirectement lié à notre sujet, a
permis de mieux le cerner et de nous informer des aspects qui ont
déjà été développés sur la question
des déchets de bois bruts aussi bien au Gabon qu'à
l'extérieur. Il a également permis de nous situer sur ce que nous
pouvons réaliser comme apport à la science. Aussi, un stage de
deux mois a été effectué pour la collecte des
données. Il s'est déroulé au sein de la Direction
Générale des Industries du Commerce du Bois et de la Valorisation
des Produits Forestiers (DGICBVPF), du Ministère des Eaux et
Forêts. Précisément à la Direction de la
Valorisation des Rebuts Industriels du Bois et de la Promotion des
Bioénergies (DVRIBPB). Ce stage a consisté à rassembler
l'ensemble des informations sur les activités de transformation du bois
au Gabon et particulièrement dans notre zone d'étude au cours des
années antérieures.
? Méthodes et outils de recherche
Cette section traite des méthodes mobilisées
pour élaborer ce mémoire. Elle articule respectivement les
entretiens, l'exploitation d'un questionnaire et l'observation directe.
La collecte de données sur le terrain s'est faite au
travers de divers entretiens avec les personnels administratifs des
autorités de la ZIS et des unités de valorisation des
déchets de bois. Ces entretiens ont consisté d'une part à
mieux comprendre le fonctionnement de la zone en matière de gestion des
déchets de bois et d'avoir une idée des mesures prises en interne
pour accompagner les unités de valorisation. D'autre part, les
entretiens avec les unités de valorisation nous ont permis de nous
enquérir de leurs activités, d'avoir une visibilité sur
les types de déchets collectés, les produits qui en ressortent et
d'avoir un avis objectif sur les quantités de déchets
collectés.
Le questionnaire a été réalisé
auprès des unités de transformation du bois (sciage et
déroulage-placage uniquement). En tant que productrices des
déchets de bois bruts, nous avons tenté de comprendre leur
rôle dans la gestion mais surtout dans la valorisation de ces
déchets.
15
Mais encore, avoir une idée approximative de la
quantité de déchets produite dans chaque unité selon le
segment d'activité. Ce questionnaire a été établi
grâce au logiciel Sphinx puis administré de façon manuelle,
dans le but de mettre les enquêtés en confiance. Nous avons
interrogé trente unités de transformation, ce qui est
légèrement en dessous de nos estimations initiales. Par ailleurs,
la réalité sur le terrain nous a révélé que
certaines unités répertoriées comme opérationnelles
ne le sont plus. D'autres, listées comme des entités distinctes,
appartiennent en réalité à une seule entreprise mais
opèrent sous des appellations différentes.
Les observations directes sur le terrain ont permis de
confronter les propos des personnes entretenues à la
réalité des pratiques en matière de gestion des
déchets de bois bruts dans les unités de transformation et
même de valorisation. Ces observations nous ont permis d'avoir un
jugement propre de la gestion des déchets de bois dans la ZIS de
Nkok.
Plusieurs outils et techniques d'analyse ont été
nécessaires pour la collecte des informations, le traitement et
l'analyse des données (Tableau 1). Nous distinguons parmi ces outils :
les outils de collecte et les outils de traitement de données.
Tableau 1 : Les outils de recherche
|
Outils
|
Types
|
Utilité
|
|
Plan de la ZIS et liste des Industries (tous secteurs
confondus)
|
Outils de
collecte
|
Faciliter le repérage et identifier les unités
cibles.
|
|
Smartphone
|
Outil de
collecte
|
Prendre des photos afin d'illustrer le travail.
Enregistrer les points GPS des
entreprises
enquêtées et points phares de la zone
|
|
Ordinateur Portable
|
Outil de
traitements
|
Support des logiciels de traitement de texte, de calculs et de
cartographie
|
|
Logiciel Microsoft Word 2013
|
Outil de
traitements
|
Rédaction et traitement général du texte
|
|
Logiciel Microsoft Excel 2013
|
Outil de
traitements
|
Traitement des données et réalisation des
graphiques présentés dans le travail
|
|
Logiciel cartographique
QGIS (version3.28.15)
|
Outil de
traitements
|
Réalisation des cartes, permettant ainsi d'illustrer
spatialement la ZIS de Nkok et ses différentes activités.
|
Source : OBONE MBA Cécilia A, 2024
16
La figure 1 ci-dessous reconstitue la méthodologie
adoptée pour la réalisation de ce travail. Elle débute
avec la présentation de la démarche, des méthodes et
outils de collecte des données, la présentation des outils de
traitements et d'analyse avant d'aboutir aux résultats. Figure 1
: Méthodologie de la recherche
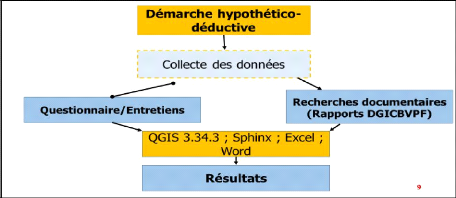
Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024
7-Difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées lors de la
rédaction de ce travail ont été :
- La possibilité d'estimer les volumes des
déchets de bois produits lors des opérations de transformation de
la grume et ceux brûlés ;
- L'absence de données antérieures sur les
activités de transformation du bois au Gabon ; - La réticence de
certaines unités de transformation à participer à
l'enquête.
8-Articulation du mémoire
Le présent travail est divisé en deux grandes
parties comprenant chacune deux chapitres. La première partie
intitulée, organisation et gestion des déchets de bois bruts de
la zone économique spéciale de Nkok, donne un aperçu
global du fonctionnement de la zone et de la gestion des déchets de bois
bruts. Par conséquent, le premier chapitre de cette partie traite de la
présentation de la zone d'étude et des cadres légaux qui
définissent la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok et ses
activités. Le second chapitre, aborde de la gestion des déchets
de bois bruts dans ladite zone. Dans la seconde partie de ce travail
intitulée effets et limites de la valorisation des déchets de
bois bruts dans la ZIS de Nkok, nous abordons d'une part, des impacts des
activités de valorisation des déchets de bois bruts. D'autre
part, nous montrons les limites de ce système de gestion au sein de la
ZIS.
17
PREMIERE PARTIE :
ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS DE BOIS
BRUTS DE
LA ZONE ECONOMIQUE SPECIALE DE
NKOK
18
Introduction de la première partie
La première partie de ce travail vise à faire
une présentation générale de la zone d'étude.
Partant de l'analyse du cadre spatial et de la règlementation à
laquelle sont soumis les investisseurs de la ZIS de Nkok (chapitre 1) ;
à la description du système de gestion des déchets de bois
et des modes de valorisation exercés (chapitre 2). Elle met en
évidence tous les aspects liés à la compréhension
du fonctionnement des entreprises dans une Zone d'Investissement
Spéciale en l'occurrence celle de Nkok. Les critères de
définition et d'implantation de ces entreprises y sont décrits.
Il s'agit également de faire une présentation des
activités de valorisation des déchets de bois bruts au sein de
ladite zone.
19
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE
LA ZONE D'ÉTUDE ET DU CADRE RÈGLEMENTAIRE RÉGISSANT LES
ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION DE BOIS BRUTS
L'étude sur la valorisation des déchets de bois
bruts dans la ZIS de Nkok nécessite de mettre en avant ses atouts
géographiques, organisationnels et juridiques. Cela permet de mieux
cerner cet espace et de comprendre le développement d'activités
en lien avec la valorisation des déchets de bois bruts.
1.1-Présentation de la zone d'étude et
de ses activités de transformation de bois bruts
La localisation d'une industrie dépend d'un ensemble de
critères qu'il est impératif de remplir pour garantir la
rentabilité de celle-ci et permettre qu'elle se pérennise dans le
temps et dans l'espace. Selon Jean Labasse, il s'agit de : l'abondance et la
régularité de l'approvisionnement, le prix des matières
premières, le milieu physique et humain, les impôts et la main
d'oeuvre (Derruau, 2012). La présentation de la situation
géographique et de ses caractéristiques permet d'apprécier
la prise en compte ces critères de localisation dans l'implantation de
la ZIS de Nkok et celle des usines de transformation du bois et
particulièrement de valorisation des déchets de bois bruts.
1.1.1-Situation géographique et
caractéristiques de la ZIS de Nkok
Située dans le département du Komo-Mondah
à 0°23'38»Nord et 9°36'58»Est, c'est au village Nkok
que se trouve la Zone d'Investissement Spéciale qui lui vaut son nom.
À l'exemple de Shenzhen en Chine2, la Zone d'Investissement
Spéciale de Nkok bénéficie d'une situation
géographique favorable. Elle est proche de la capitale Libreville soit
à 27 kilomètres, et est au passage de trois moyens de
communication majeurs que sont la route nationale 1, le chemin de fer et le
quai d'embarcation situé dans la zone multimodale qui donne accès
au port commercial d'Owendo (cf. Carte 1).
2 Shenzhen se situe à la frontière de
Hong-Kong de part et d'autre de la voie ferrée qui relie Hong-Kong
à Canton. Elle bénéficie d'un approvisionnement
électrique mais surtout de la proximité des sources
d'investissement et de débouchés économiques.
20
Carte 1 : Localisation de la zone
d'étude
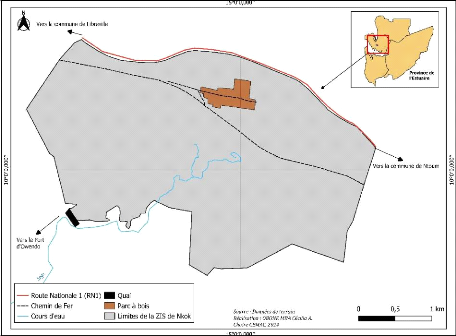
Cette proximité à la capitale est
favorisée par les voies de communications qui permettent la mise en
relation entre la ZIS de Nkok et différents points de l'espace. Il faut
dire que le rôle prépondérant des transports dans le
processus industriel a longtemps été démontré par
les théoriciens de la géographie économique. De Von
Thünen en passant par Weber et Lösch pour ne citer que
ceux-là. Ces derniers ont montré que, selon les circonstances, il
est possible de réduire les coûts de production en localisant
l'entreprise près du marché (John Heinrich Von Thünen), en
l'établissant là où la matière première est
abondante (Alfred Weber) ou en plaçant l'unité de production dans
une région où la main-d'oeuvre est largement disponible (August
Lösch). La Zone d'Investissement Spéciale de Nkok n'échappe
pas à cette réalité géoéconomique. Elle
bénéficie de sa proximité avec la plus grande ville du
pays qui lui fournit une partie importante de la main d'oeuvre. Elle
bénéficie également de son emplacement à la
confluence de trois moyens de transport qui facilitent l'acheminement des
matières premières dans les unités de transformation et
l'expédition des produits vers les marchés internationaux. Comme
l'énonce Dunlop (2016), le choix du site s'opère également
en tenant compte de son accessibilité aux ressources à exploiter
et de sa bonne insertion dans le réseau de circulation. Dans ce
sens, le choix du site de Nkok n'est pas fortuit. Nonobstant les bourbiers que
l'on
21
observe sur certains axes, les voies de communication au
passage de la ZIS, facilitent d'une certaine façon les
approvisionnements en matières premières, par le canal du train
et des gros porteurs. Elles permettent également de réduire les
délais d'acheminement de la production vers le port commercial d'Owendo,
à travers le quai. D'augmenter l'efficacité du transport des
marchandises et rendent la zone plus accessible et plus attractive.
Il faut dire que la ZIS de Nkok représente à la
fois, une porte d'entrée vers l'arrière-pays pour les
investisseurs revenant de Libreville et une porte de sortie vers la mer pour
les produits à exporter. C'est donc une position stratégique pour
elle car elle reçoit la ressource d'un côté, de l'autre les
investisseurs et exporte les produits transformés. Comme le dit Fischer
: « Tout processus industriel implique en effet, mais à des
degrés divers, l'intervention du transport. D'abord pour réunir
en un même lieu des produits et matériaux bruts devant subir une
transformation, ensuite pour acheminer les produits finis vers les lieux
d'utilisation et de consommation.» (1978, p.35). Par le canal du
train, des gros porteurs et des bateaux, ce sont de grandes quantités de
ressources et de marchandises qui sont transportées et acheminées
vers les lieux de production et de commercialisation.
1.1.2-L'organisation de la zone économique
spéciale de Nkok
Les zones économiques spéciales (ZES) sont des
zones franches3 à l'échelle d'un port, d'un quartier,
d'une ville, fonctionnant comme des enclaves économiques et fiscales
(Géo confluences, 2015). Elles sont apparues en Chine en 1978 et se
définissent comme de très vastes territoires au sein desquels les
entreprises agréées peuvent s'implanter librement, soit dans des
zones industrielles et des parcs d'activités, soit sous la forme de
points francs (Bost, 2007). Elles bénéficient
d'infrastructures de qualité, d'un régime fiscal et/ou douanier
particulier, parfois de régimes dérogatoires aux
législations sur l'accès à la terre ou sur l'emploi. Leur
rôle est de développer une industrie pour l'exportation,
principalement en attirant les investisseurs étrangers (CNUCED, 2021).
Selon la conférence des nations unies pour le commerce et le
développement (CNUCED), il existe en 2019, 5383 zones économiques
spéciales dans le monde dont 237 en Afrique (CNUCED, 2021). La
multiplication de ces ZES dans le monde est alimentée par la
volonté des décideurs politiques d'améliorer la situation
économique de leur pays, confronté à un retard de
croissance.
3 Zone Franche : espace de libéralisation
des échanges, d'ouverture à l'économie de marché.
Ils sont destinés à attirer les entreprises et activités
exportatrices grâce aux avantages qui leurs sont accordés.
22
Les objectifs de développement d'une ZES sont
définis par l'augmentation des taux d'investissements directs
étrangers (IDE), du taux d'exportation et du taux de création
d'emplois. Elles visent aussi le développement de
l'écosystème industriel local vers des capacités de
production plus élevées (CNUCED, 2021). Selon le rapport ZESS
Afrique « Des Zones Économiques Spéciales
Sécurisées », les zones économiques spéciales
se caractérisent par leur taille, le modèle de gouvernance, le
nombre et la propriété des entreprises, le nombre d'emplois
générés et les secteurs cibles (Pommier et al., 2021).
Initiée à la suite de la mesure gouvernementale
de 2009 interdisant l'exportation complète des grumes, la Zone
Économique à Régime Privilégié (ZERP) de
Nkok a été établie par le décret
n°0461/PR/MPITPTHAT du 10 octobre 2012. Elle s'étend sur 1127 ha de
superficie et est la première zone économique spéciale au
Gabon, créée en vue de dynamiser le secteur industriel du bois.
Elle est issue d'un partenariat public-privé entre l'État
gabonais et le groupe ARISE IIP afin d'installer au sein du territoire
national, un écosystème adapté et des infrastructures
favorables à l'industrialisation de la filière bois. Cependant,
au fil du temps, d'autres secteurs de transformation s'y sont installés,
à savoir : la sidérurgie, l'agro-industrie, le BTP, la chimie et
l'industrie pharmaceutique. Toutefois, dans cet espace, la transformation du
bois reste l'activité majeure. Le secteur mobilise 80 % des
activités, pour une production des bois de qualité (GSEZ-Nkok,
2022). En 2022, la ZES de Nkok compte plus de 80 entreprises exerçant
dans la transformation du bois et génère près de 4517
emplois directs et indirects dans l'industrie du bois (Mouissi, 2023). La carte
2 ci-dessous fait une présentation des infrastructures qui composent la
ZIS de Nkok, en distinguant les unités de transformation du bois des
autres industries, les bâtiments administratifs et autres infrastructures
présentes dans la ZIS (cf. Carte 2).
23
Carte 2 : Occupation du sol de la ZIS de Nkok
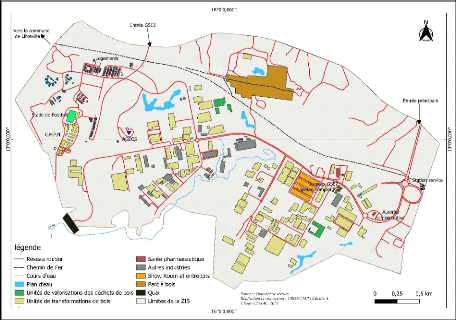
À l'instar d'autres pays africains, la création
de la zone économique spéciale de Nkok par l'État
gabonais, procède d'une volonté de s'industrialiser à
partir des matières premières locales. Ceci, dans le but de
satisfaire le marché intérieur et d'assurer la
souveraineté de son développement en créant de la valeur
ajoutée aux produits exploités localement. Notons que la zone
économique spéciale de Nkok est à l'origine de près
de 40 % des exportations hors pétrole (PIA Africa, 2021), et a acquis
une réputation internationale comme en témoigne les prix qu'elle
a reçu pour diverses raisons. En 2020 par exemple, elle a reçu le
prix « Woods products » à l'édition 2020 des
« Global Free Zone of the Year » récompensant la
promotion de la transformation locale du bois (Mabimba, 2020). Elle s'identifie
également comme une zone à économie verte qui essaie tant
bien que mal de préserver l'environnement.
Le 20 janvier 2023, sur décision gouvernementale, la
ZERP de Nkok change de statut juridique pour devenir la Zone d'Investissement
Spéciale de Nkok (ZIS de Nkok). Le décret n°0018/PR/MIPPPAEA
du 07 mars 2023 portant création de la ZIS, confirme le changement de
statut juridique. Il s'agit selon les articles 1 et 2 de ce décret,
d'une réorganisation qui porte sur la redéfinition du statut
juridique, des activités, du cadre institutionnel et des
régimes
24
applicables à la Zone Économique à
Régime Privilégié (Décret N° 0018, du
07/03/2023). Contrairement à la ZERP qui était axée sur la
transformation du bois, c'est désormais une zone beaucoup plus ouverte
aux autres activités industrielles et de recherche. Les investisseurs,
détenteurs d'un agrément prévu par la loi
n°0036/2018, bénéficient ou non du régime
privilégié.
1.1.3-Les conditions fiscales et douanières des
entreprises dans la ZIS de Nkok
Les conditions fiscales et douanières dans la ZIS de
Nkok, permettent aux investisseurs d'évoluer dans un climat
économique assez favorable au développement de leurs
activités. En effet, dans la Zone d'Investissement Spéciale de
Nkok, les entreprises bénéficient des avantages selon le
régime auquel elles sont inscrites. Il ne s'agit plus de donner de facto
à toutes les entreprises, les mêmes privilèges comme ce fut
le cas dans la ZERP. Les avantages sont définis en fonction des
dispositions légales prévues pour chaque sous zone. Le tableau 2
ci-après définit les avantages fiscaux et douaniers des
entreprises dans la ZIS de Nkok.
Tableau 2 : Avantages fiscaux et douaniers dans la ZIS de
Nkok
|
Avantages fiscaux
|
Avantages douaniers
|
|
Exonération de la retenue à la source de 20%
|
Exonération des droits, taxes, redevances de
|
|
sur les paiements au profit des prestataires ;
|
douanes pour les commodités importées du
|
|
Exonération de toutes les retenues à la source
|
territoire douanier national ou non par les
|
|
pour 25 ans ; Exonération de la Taxe sur la
|
investisseurs des ZIS à régime
privilégié et leurs
|
|
Valeur Ajoutée (TVA) sur 25 ans pour les ventes faites
à l'intérieur de la ZIS et à l'exportation
|
sous-traitants
|
|
Exonération totale de l'impôt sur les
sociétés
|
Exonération de tous les impôts, droits et taxes
|
|
ou sur les bénéfices industriels et commerciaux
|
indirects, dont la TVA à la sortie du territoire
|
|
pendant 10 ans ; Exonération de l'impôt
|
national ou à l'entrée de la ZIS à
régime privilégié
|
|
minimum
|
pour 25 ans
|
Source : Loi N°036/2018 du 08/02/2019 Réalisation :
OBONE MBA Cécilia A, 2024
De ce tableau, il faut noter que les dispositions
évoquées ne concernent que les entreprises enregistrées au
régime privilégié de la ZIS. Pour ce qui est de
l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés, il
est mentionné dans l'article 67 de la loi n°036/2018 qu'à
partir de la onzième année, les entreprises paieront 10% durant
les cinq années à venir. Soit pratiquement 15 ans
d'exonération totale d'impôt sur les sociétés. La
particularité de la ZIS-ZERP est qu'elle doit toujours exporter au moins
75% de sa production, les 25% restant peuvent être écoulés
sur
25
le territoire national sans perdre le bénéfice
des exonérations et avantages prévues par la loi sur les ZIS en
République Gabonaise (Loi n°36/2018, art. 69). Les conditions
douanières évoquées dans ce tableau concernent entre
autres, les dispositions sur les importations et exportations des entreprises
ZIS et affiliées. Elles déterminent si les droits et taxes seront
acquittés ou non, si les contrôles de commerce extérieurs
seront réalisés ou non vis-à-vis des marchandises. Ainsi,
comme nous montre le tableau 2 ci-dessus, les entreprises installées
dans la ZIS sont exonérées de nombreuses taxes et redevances
fiscales en lien avec leurs activités, à l'import comme à
l'export. Tous ces avantages fiscaux et douaniers accordés aux
investisseurs bénéficiant du régime
privilégié sont censés représenter un manque
à gagner pour l'État, qui, en permettant aux entreprises de faire
des économies d'argent sur le long terme, attire dans la zone plus
d'investisseurs.
Concernant les entreprises ne disposant pas du régime
privilégié, elles sont soumises aux règles de droit commun
pour tous les aspects fiscaux et douaniers. En s'installant dans la ZIS, elles
bénéficient des conditions pratiques (espace pour exercer leurs
activités, sécurité, facilité de créer d'une
entreprise etc.).
1.2-Les activités de transformation des bois
bruts
De la forêt à sa présence dans nos foyers,
il y a un important processus de transformation du bois qui est
réalisé ; les activités de transformation du bois se
répartissent selon des niveaux de transformation. Ceux-ci sont
très variables selon les régions car cela implique des
conséquences en termes de traçabilité, de
déclaration, de statistiques et de fiscalité. De ce fait, chaque
pays détermine dans un cadre réglementaire ses niveaux de
transformation (Martin & Vernay, 2016). Au Gabon, le Code forestier
identifie trois niveaux de transformation du bois, avec à
l'intérieur de chaque niveau, différentes étapes
permettant d'identifier le type de transformation et les produits obtenus (Code
forestier, 2001). Dans la ZIS Nkok comme dans l'ensemble du pays, la
répartition des segments d'activités dans les niveaux de
transformation diffère quelque peu de celle mentionnée dans le
Code forestier. En effet, selon les rapports d'activités de la Direction
Générale des Industries du Commerce Bois et de la Valorisation
des Produits Forestiers (DGICBVPF), le premier niveau de transformation ne
concerne que le sciage. Le deuxième niveau, est pour les segments
d'activités de déroulage, tranchage et de séchage. Quant
à la troisième transformation, elle concerne la fabrication des
panneaux, contreplaqués, produits finis de menuiserie et
ébénisterie. On compte aussi parmi les activités de
transformation, d'autres activités dites connexes telles que la
fabrication du charbon de bois et la valorisation des rebuts (DGICBVPF,
2020-2022).
26
Dans la ZIS de Nkok, la transformation des bois bruts concerne
les deux premiers niveaux de transformation qui utilisent la grume comme
matière première. La transformation d'une bille de bois
dépend de ses caractéristiques physionomiques que sont : la
circonférence, le diamètre, la nature du bois et la
nodosité (Kombila Mouloungui, 2019). Selon cet auteur, la qualité
du bois est le facteur dominant en matière de rendement puis vient la
performance de l'outil. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les
unités de transformation. Si d'un côté la qualité du
bois est bonne, le problème peut venir de l'outil de transformation qui
est rudimentaire et non adapté pour tirer le maximum de profit de la
grume et inversement. De ce fait, pour améliorer leur rendement, les
industriels augmentent souvent leur consommation de grumes ce qui engendre un
gaspillage de la ressource (Mabika, 2014).
1.2.1-Le premier niveau de transformation
Il concerne le segment du sciage dont l'opération
consiste à transformer les bois ronds en bois sciés. Le sciage
est une activité destinée à l'obtention des produits de
menuiserie, du mobilier ou de construction. Il comprend toutes les
étapes de découpe du tronc d'arbre qui, à la fin des
processus, permettent d'avoir des avivés, des poutres, des planches,
chevrons, lattes etc. (Fibois, 2023). Le sciage industriel se fait avec des
machines sophistiquées, permettant non seulement d'avoir au plus vite
une production rentable mais également de produire des bois sciés
qui présentent des formes largement appréciables. Pour ce faire,
le scieur élimine les parties impropres de la grume et atténue
les malformations, notamment les effets de courbures et de décroissances
trop prononcées. Le découpage des grumes se fait en fonction de
leur diamètre et de leur qualité. Durant toutes les étapes
de transformation du bois, le scieur évalue la matière par son
savoir et son expérience, il détermine les découpes
à appliquer et les débuts les plus appropriés (ATIBT,
2023).
L'activité de sciage produit assez de déchets,
80% du volume des déchets de bois sur le territoire national provient du
sciage (Mabika, 2021). Cela est dû à la qualité des
produits recherchés qui doit éliminer le maximum d'imperfections.
Par conséquent, les déchets issus du sciage sont de plusieurs
natures.
Sur l'ensemble du territoire national, le sciage industriel
compte cent vingt-trois (123) unités de transformation pour seulement
quinze (15) dans la ZIS de Nkok (cf. Graphique 1).
27
Graphique 1: Le segment du sciage au Gabon
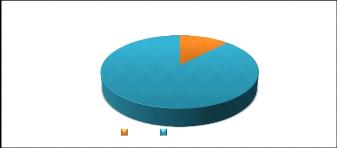
Nkok Hors Nkok
108; 88%
15; 12%
Source : DGICBVPF, 2022 Réalisation : OBONE MBA
Cécilia A, 2024
Ce graphique montre une prédominance de
l'activité de sciage à l'extérieur de la ZIS de Nkok. Il
en ressort que le nombre d'unités de sciage hors de la ZIS est
estimé à 108 représentant 88% des unités de ce
segment, contrairement au nombre d'unités de sciage présentes
dans la ZIS de Nkok qui est de 15 unités représentant 12% des
activités à l'échelle nationale. On peut déduire
que le segment du sciage est quasi-inexistant dans la ZIS de Nkok, au regard
des écarts avec les unités situées hors ZIS de Nkok. Dans
la zone, cette activité est exercée en quasi-totalité par
des investisseurs venus d'Asie, dont les plus importants viennent de l'Inde et
de la Chine (cf. Tableau 3).
Tableau 3 : Les UTB de sciage dans la ZIS de
Nkok
|
N°
|
SOCIETES
|
CAPITAUX
|
ETAT REEL
|
|
1
|
Akachi Wood Gabon
|
Inde
|
En activité
|
|
2
|
Compagnie Dan Gabon
|
Chine
|
En activité
|
|
3
|
Fortune Lumber Sarl Zerp
|
Inde
|
En activité
|
|
4
|
Gabon Meubles Modernes
|
Chine
|
En activité
|
|
5
|
Gabon Shengda Investments Co Ltd
|
Chine
|
En activité
|
|
6
|
Gabon Wood Industries
|
Malaisie
|
En activité
|
|
7
|
Khll Forestry
|
Chine
|
En activité
|
|
8
|
Pride Wood Gabon
|
Inde
|
En activité
|
|
9
|
Reeddhi International Gabon
|
Inde
|
En activité
|
|
10
|
Resurgent
|
Inde
|
En activité
|
|
11
|
Somivab
|
Italie
|
En activité
|
|
12
|
Rain Forest Management
|
Malaisie
|
En activité
|
|
13
|
Wood Pro Industries
|
Inde
|
En activité
|
|
14
|
Wood Tech
|
France
|
En activité
|
|
15
|
Wood Value Gabon
|
Inde
|
En activité
|
Source : DGICBVPF, 2022 Réalisation : OBONE MBA
Cécilia A, 2024
28
1.2.2-Le deuxième niveau de transformation
Le deuxième niveau de transformation est
dédié aux activités de déroulage, de tranchage et
de séchage. Pour ce qui est du déroulage, c'est une
opération qui consiste à produire un ruban de placage à
partir de la périphérie d'une bille, alors que cette
dernière est animée d'un mouvement de rotation (cf. Photo 1). Le
couteau lui, est animé d'un mouvement de translation (ATIBT, 2023). Le
placage est le nom donné aux feuilles de bois d'une épaisseur
inférieure à 6mm, obtenues par les opérations de
déroulage, de tranchage ou de sciage (Martin & Vernay, 2016).
Les feuilles de placage issues du déroulage sont
principalement destinées à la fabrication de
contre-plaqués, mais peuvent avoir d'autres utilisations telles que la
fabrication des allumettes et des emballages.
Photo 1: Le déroulage
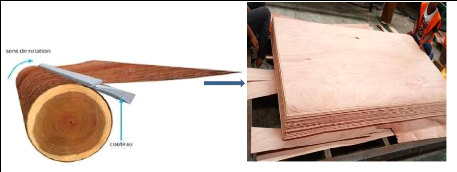
Source :
www.fnbois.com ,
Modifiée par OBONE MBA Cécilia A, 2024
Le tranchage consiste à ôter à l'aide
d'une trancheuse, une feuille de bois d'épaisseur variable (comprise
entre 0,3 et 0,8 mm) à partir d'une bille équarrie (ATIBT, 2023).
À la différence du déroulage, les dimensions des feuilles
brutes de placage obtenues ne sont pas « illimitées », mais
correspondent en fait à celle de l'équarri dont elles sont
issues. Le déroulage et le tranchage permettent de produire du placage.
Quant au séchage, il consiste à diminuer au maximum le taux
d'humidité du bois.
Le deuxième niveau de transformation du bois
représenté par le segment du déroulage-placage occupe une
place importante dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok. Il
enregistre quarante-neuf (49) unités de transformation contre vingt-neuf
(29) unités hors ZIS de Nkok. En pourcentage, ce segment
représente 63% des activités dans la ZIS contre 37% hors ZIS de
Nkok (cf. Graphique 2).
29
Graphique 2: Le segment du déroulage au
Gabon
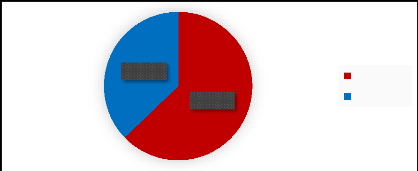
29; 37%
49; 63%
Nkok
Hors Nkok
Source : DGICBVPF, 2022 Réalisation : OBONE MBA
Cécilia A, 2024
Ceci s'explique par le fait que la ZIS de Nkok a
été créée à priori pour la fabrication du
contreplaqué. De ce fait, le bois déroulé sert en partie
à la confection de contre-plaqués. En effet, le placage est l'une
des activités majeures dans la ZIS de Nkok. Entre 2018 et 2022, la
production de placage des UTB installées dans la ZIS est passée
de 135.710 m3 (environ 35% de la production nationale de placage)
à 360.775 m3, soit 61% de la production nationale (Mouissi,
2023). En 2018, le Gabon occupait la 11ème place mondiale
dans la production de feuilles de placage, en 2022 il s'est hissé
à la 6ème place mondiale et au 1er rang en
Afrique (op.cit., p.20).
Globalement, en 2022, le nombre total d'unités de
transformation du bois sur le territoire national est estimé à
deux cent trente-cinq (235), et la Zone d'Investissement Spéciale de
Nkok en possède quatre-vingt-cinq (85), selon la DGICBVPF. Le graphique
3 ci-joint fait une répartition des activités de transformation
du bois dans la ZIS de Nkok, en y ajoutant les activités de
valorisation.
30
Graphique 3 : Part de chaque activité dans la
transformation du bois à Nkok
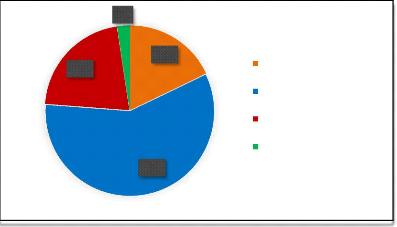
22%
2%
58%
18%
Valorisation des rébuts
2ème Niveau (
Déroulage,placage)
3ème Niveau (Contre plaqué)
1er Niveau (Sciage)
Source : DGICBVPF, 2022 Réalisation : OBONE MBA
Cécilia A, 2024
À la lecture de ce graphique, il ressort que la
deuxième transformation représente 58% des activités de
transformation du bois dans la ZIS, la troisième transformation
enregistre 22% et la première transformation 18% des activités
liées à la transformation du bois. La valorisation des
déchets de bois bruts représente 2% des activités de
transformation du bois. Aussi, l'activité de tranchage n'est pas
pratiquée dans la ZIS de Nkok.
1.3-Cadres juridique, institutionnel et
règlementaire régissant les activités de transformation
des bois bruts dans la ZIS de Nkok
1.3.1-Le Cadre juridique et institutionnel
? Le Cadre juridique
Les normes de transformation du bois au Gabon sont contenues
dans la loi n°16/2001 portant Code forestier en République
Gabonaise. Ce Code définit les attentes des politiques en matière
de transformation du bois et les différents niveaux de transformation
rencontrés dans les industries. Comme susmentionné, la
législation forestière distingue trois niveaux de transformation
du bois : la première transformation comprend le sciage, le
déroulage, le tranchage et le séchage ; la deuxième
transformation, inclut la production de panneaux et la fabrication de produits
standards tels que les moulures et les parquets ; et la troisième
transformation concerne les produits et les articles finis de menuiserie et
d'ébénisterie (Code forestier, 2001, art. 223, 224, 225).
À ces trois niveaux de transformation, on pourrait y ajouter
31
un quatrième niveau dédié à la
valorisation des rebuts ou déchets de bois. La figure 2
représente notre perception des niveaux de transformation au Gabon.
Figure 2 : Les niveaux de transformation du
Bois
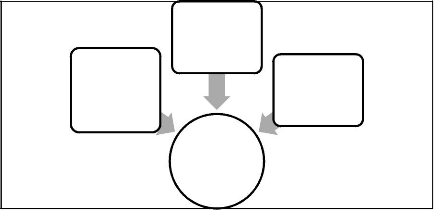
Première
transformation
( Sciage,
Déroulage,
Tranchage
et
séchage)
Deuxième
transformation
(Panneaux,
moulures
parquets)
Valorisation des rebuts
Troisième
transformation
(produits de
menuiserie et
ébénisterie)
Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Cette figure montre que les déchets issus de tous les
niveaux de transformation devraient faire l'objet de valorisation. La
priorité des entreprises exerçant dans l'industrie de la
transformation du bois, est d'améliorer leur rendement matière en
atteignant un taux de transformation qui évolue jusqu'à 75% (Code
forestier, 2001, art. 227). Dans cette optique, la valorisation des
déchets de bois bruts représente une alternative
intéressante. D'ailleurs, le Code forestier reconnait de façon
implicite cette valorisation. En effet, l'article 220 dispose que : «
L'industrialisation de la filière bois est l'ensemble des
activités pratiquées au moyen d'outils simples ou de
chaînes complexes de production en vue de la transformation du bois ou de
« ses sous-produits » en produits semi-finis ou finis. ».
L'article 221 renchérit en indiquant que l'industrialisation de la
filière bois vise la promotion de l'utilisation rationnelle des produits
ligneux, le financement de la gestion durable des forêts ; la
création de la valeur ajoutée. Ces spécifications des
attentes peuvent être comblées par le secteur de la valorisation
qui tente de minimiser le gaspillage des matières en favorisant la
transformation du bois sous diverses formes.
Toutefois, il faut signaler l'absence de textes juridiques
proprement dits sur la valorisation des déchets de bois, inscrits dans
le Code forestier. De même, bien qu'il y ait au sein du ministère
des eaux et forêts, une direction technique de la valorisation des rebuts
industriels du bois et de la promotion des bioénergies (DVRIBPB), il y a
un vide juridique sur la question des
32
déchets industriels de bois en matière de
gestion, de classification des rebuts ou d'orientation sur la valorisation.
Pour ce qui est de l'interdiction aux entreprises de
brûler leurs déchets de bois, cette décision a
été prise sans une large consultation des opérateurs qui
exercent dans le domaine. Elle résulte exclusivement de la
volonté du gouvernement et n'est pas réglementée par des
textes de loi. L'objectif est d'inciter les entreprises à adopter un
comportement plus respectueux de l'environnement dans la zone concernée.
L'absence de législation apparaît comme un inconvénient,
car la simple volonté gouvernementale ne pourrait suffire à
contraindre les entreprises à changer de méthodes dans la gestion
de leur déchet de bois. Il aurait été
préférable de s'appuyer sur des lois interdisant la combustion
des déchets de bois et favorisant leur valorisation, ce qui aurait
représenté une méthode plus efficace pour encourager leur
participation à la politique de protection de l'environnement
désirée par le gouvernement gabonais. Néanmoins, il faut
noter que les aspects liés à la valorisation des déchets
sont déjà évoqués dans le code de l'environnement
à travers l'article 97 qui dispose que « Le traitement des
déchets est prioritairement opéré par réduction
à la source, et ce, de manière à réduire le
gisement global. À cet effet, les déchets produits doivent
être réutilisés ou recyclés [...] » (Loi
N°007/2014).
? Le Cadre Institutionnel
Les activités de transformation du bois dans la ZIS de
Nkok sont encadrées par un ensemble d'organes parmi lesquels : l'Organe
d'Aménagement et de Gestion, l'Autorité Administrative et le
Comité de Suivi. Ces organes dont la définition des statuts et
l'attribution des rôles sont mentionnés dans la loi
n°0036/2018 du 08 février 2019, portant réglementation des
zones d'investissement spéciales et le décret
n°0018/PR/MPIPPPAEA du 07/03/2023 portant réorganisation de la Zone
Économique à Régime Privilégié de Nkok,
fonctionnent comme suit :
? L'Organe d'Aménagement et de Gestion
L'Organe d'Aménagement et de Gestion de la ZIS de Nkok
est en réalité la société Gabon Spécial
Economic Zone, en abrégé GSEZ S.A. C'est une entité de
droit privé en charge de l'aménagement, l'organisation, la
promotion et la gestion de la ZIS de Nkok. Il fonctionne sur la base d'un
cahier de charge définissant les droits et obligations du
concessionnaire. Cet organe détient en pleine propriété,
l'assiette foncière de la ZIS ainsi que le terrain constituant son
33
périmètre ; les servitudes créées
sur les terrains de la ZIS et les propriétés adjacentes
définies dans le plan cadastral et le titre foncier n°16767.
De façon pratique, l'Organe d'Aménagement et de
Gestion assure la réalisation et l'entretien des infrastructures et
commodités nécessaires aux industries et services (voie de
circulation, télécommunications, réseaux d'adduction d'eau
et d'électricité etc.). À l'intérieur de la zone,
il a en charge la location ou la vente de terrain, maisons, locaux commerciaux,
de même que la surveillance et la sécurité des parties
communes et des accès à la ZIS. La gestion des mouvements de
marchandises au sein de la Zone d'Investissement Spéciale (ZIS),
relèvent de sa compétence. Il est aussi chargé de la
promotion commerciale et industrielle de la ZIS, de l'accueil des investisseurs
et de l'aide à la formulation des demandes d'agréments.
? L'Autorité Administrative
L'Autorité Administrative de la Zone d'Investissement
Spéciale de Nkok est un service public à autonomie de gestion,
constitué par le regroupement géographique et fonctionnel de
l'ensemble des administrations et services de l'État. Elle intervient
dans le processus de création, de supervision, de contrôle et de
gestion de la zone. Elle est chargée de délivrer des
agréments, de s'assurer du respect du cahier de charges signé par
l'Organe d'Aménagement et de Gestion.
L'Autorité Administrative est placée sous
tutelle d'un Administrateur Général nommé par
décret pris en conseil des Ministres. C'est un agent public de
première catégorie ou un cadre du secteur privé,
justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans
les domaines tels que l'économie, la gestion, le droit ou
l'administration. Il représente l'Autorité Administrative dans
tous les actes de la vie civile. L'Autorité Administrative comprend : le
service d'appui, le guichet unique et l'agence comptable.
Le service d'appui est un ensemble des services
nécessaires à la mise en oeuvre des missions de l'Autorité
administrative. Quant au guichet unique, il regroupe toutes les administrations
(23 pour être plus précise) auprès desquelles les
entreprises effectuent les formalités et démarches en vue
d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à leur
installation ou à leur maintien dans la ZIS de Nkok. À titre
exclusif, ce service est chargé de l'accomplissement de l'ensemble des
formalités administratives relatives à l'implantation et à
l'exploitation des investissements dans la zone. De veiller, en matière
sociale au respect des lois et règlements en vigueur en
République Gabonaise. De délivrer l'ensemble des permis, visas et
toutes autres autorisations nécessaires au bon fonctionnement des
entreprises. De recevoir, traiter et contrôler
34
l'ensemble des déclarations en matière fiscales
douanières et sociales ainsi que toutes autres communications
imposées aux entreprises. Enfin, l'agence comptable quant à elle
s'occupe du versement financier d'octroi d'agrément par les
investisseurs.
? Le Comité de Suivi
Il est l'organe chargé du contrôle des avantages
consentis aux investisseurs installés dans la ZIS de Nkok. Il veille
également aux impacts des investissements sur la politique industrielle,
économique et sociale du pays, conformément aux dispositions de
l'article 27 de la loi n° 036/2018 du 08 février 2019
susvisée.
Pour une meilleure visibilité du cadre institutionnel
de la ZIS, cet organigramme a été réalisé (cf.
Figure 3).
Figure 3 : Organigramme des entités de gestion de
la ZIS de Nkok
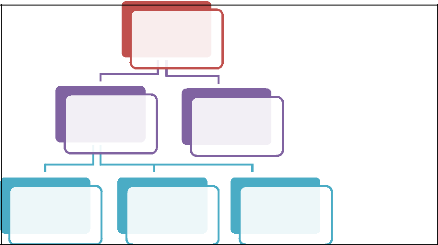
service d'appui
Autorité
Administrative
Guichet Unique
Organe
d'Aménagement et de Gestion
Comité de Suivi
Agence
Comptable
Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Sur cette figure apparait l'ordre de commandement des
entités de la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok avec en
tête l'Organe d'Aménagement et de Gestion.
1.3.2-Le Cadre Réglementaire
Le cadre réglementaire des entreprises définit
les règles auxquelles elles doivent se conformer. Il détermine
les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent exercer leurs
activités, les obligations qu'elles ont envers les gestionnaires de la
ZIS ainsi que leurs responsabilités en cas de non-respect des
règles.
35
? Les conditions d'exercice dans la Zone
d'Investissement Spéciale de Nkok
Les entreprises qui souhaitent intégrer la Zone
d'Investissement Spéciale de Nkok sont soumises à
différents types d'agréments qui sont fonctions des
activités envisagées. Cet agrément est un document
administratif qui donne aux entreprises l'habilité à exercer et
reconnait leur implantation dans la ZIS. Il fixe les délais dans
lesquels doivent être réalisés les projets, ainsi que les
conditions particulières de réalisation de l'investissement (Loi
n°0036/2018, art. 47). On distingue notamment l'agrément ZERP en
abrégé AZ ; l'agrément industriel à régime
privilégié en abrégé AIRP, et l'agrément de
recherche et éducation en abrégé ARE pour ne citer que
ceux-là (Loi n°0036/2018, art. 30). Les investisseurs doivent
également : respecter les lois et règlements en matière
d'environnement et de sécurité industrielle ; disposer d'un
savoir-faire avéré, présenter l'impact de l'investissement
en termes de développement industriel, de création d'emplois et
de diversification de l'économie ; présenter les capacités
de production pour le marché local et pour l'exportation selon
l'agrément souhaité etc. (loi n°0036/2018, art. 32).
Outre les dispositions de l'article 32, l'obtention de
l'agrément ZERP, suppose de pouvoir exporter au moins 75% des
marchandises transformées par l'usine. Pour ce qui est de
l'agrément industriel, l'investisseur est tenu de justifier d'un
investissement dans un secteur industriel prioritaire, identifié parmi
les axes de développement du pays, en particulier ceux relatifs à
la transformation industrielle dans les secteurs comme la santé ou de
l'industrie pharmaceutique (loi n°0036/2018, arts. 34,37).
? Des devoirs des investisseurs
Les entreprises admises au sein de la ZIS sont soumises
à la signature d'un cahier de charges fixant les engagements qu'elles
doivent respecter, en contrepartie des dépenses fiscales consenties par
l'État. L'entreprise signataire de ce cahier des charges s'engage donc
pour elle et l'ensemble de ses sous-traitants. La signature du cahier de
charges dépend de l'octroi effectif du bénéfice du
régime privilégié (Loi n°0036/2018, art.48). De
même, les investisseurs sont tenus de satisfaire les obligations
administratives prévues par décret n°0018/PR/MPIPPPAEA du
07/03/2023 portant réorganisation de la Zone Économique à
Régime Privilégié de Nkok. Les obligations sont :
- Informer l'Organe d'Aménagement et de Gestion sur le
niveau de réalisation de son programme d'investissement à la fin
de chaque semestre et lui fournir à la fin de chaque année
civile, un rapport du programme d'investissement et son activité.
36
- Déposer sans délai, auprès de
l'Autorité Administrative, leurs comptes sociaux à chaque fin
d'exercice et en communiquer immédiatement la copie à l'Organe
d'Aménagement et de Gestion.
? Des droits des investisseurs à Nkok
Les entreprises installées dans la ZIS de Nkok
bénéficient des avantages fiscaux et douaniers sus
mentionnés dans le tableau (2, p.24). Le bénéfice du
régime privilégié est octroyé pour une durée
variable de 10 à 25 ans, en fonction du secteur d'investissement, du
montant de l'investissement et de l'impact sur l'emploi. Les entreprises ne
disposant pas d'un projet industriel entrant dans les conditions
d'éligibilité au régime privilégié, peuvent
s'installer dans la zone industrielle sans bénéficier de ce
régime. Elles bénéficient dans ces conditions, de
l'agrément industriel tel que prévu par la présente loi
ainsi que des commodités administratives et foncières offertes
par la ZIS.
Retenons que la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok
bénéficie d'une situation géographique favorable à
la confluence de trois moyens de communication majeurs. Elle a
été créée dans l'optique de renforcer le secteur
industriel de la transformation du bois et a étendu son champ d'action
en permettant l'accès à d'autres secteurs d'activités.
C'est un territoire soumis à des législations fiscales et
douanières particulières.
37
CHAPITRE 2 : GESTION DES DÉCHETS DE BOIS BRUTS
DANS LA ZIS DE NKOK
Comprendre la gestion des déchets de bois bruts dans la
ZIS de Nkok nécessite de dresser un tableau de la production de ces
déchets, des modes de gestion développés, avant d'arriver
aux formes de valorisation pratiquées par les entreprises
dédiées.
2.1-État des lieux de la production des
déchets de bois bruts
2.1.1-Les acteurs de la gestion des déchets de
bois dans la ZIS de Nkok
La gestion des déchets est l'ensemble des
opérations et moyens mis en oeuvre pour réduire les
quantités de déchets produites à travers les
procédés de valorisation et/ou d'élimination de ces
déchets (Ada Nzoughé, 2021). Elle suppose des équipements
de collecte, des missions sur le terrain, des traitements des matières
collectées, un suivi d'évaluation des opérations de
collecte mais surtout de garantir l'assainissement total du milieu
impacté par les résidus (idem). Dans la ZIS de Nkok, la gestion
des déchets de bois implique quatre principaux acteurs. Bien que leurs
rôles ne soient pas clairement définis et
réglementés, ils contribuent tout de même à
l'identification de solutions palliatives pour l'élimination des
déchets et la maitrise les impacts environnementaux négatifs. En
nous appuyant sur la loi n°0036/2018 fixant la création de la ZIS,
nos entretiens et les observations sur le terrain, nous avons identifié
les acteurs suivants :
? L'Organe d'aménagement et de
gestion
Rappelons que le rôle de cet organe dans la zone est :
« f...] l'aménagement, l'organisation...la gestion et la
maintenance des infrastructures et équipements communs des ZIS. Ainsi,
il assure la réalisation et l'entretien d'assainissement f...] »
(Loi n°0036/2018, art.12). Selon Pierre Merlin, l'aménagement
est l'action volontaire de disposer avec ordre, dans le temps et dans l'espace
tout ce qui influe sur les activités (Merlin, 1990). Quant à la
gestion, elle désigne l'ensemble des directives, des décisions
à prendre en vue d'une meilleure organisation d'un espace ou autre
élément. Par ces explications, nous pouvons dire que la gestion
des déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok relève de la
responsabilité de l'organe d'aménagement et de gestion. Il se
doit de mettre à disposition des unités de transformation du
bois, un espace aménagé et contrôlé pour
l'évacuation de leurs déchets. En plus de cela, il doit fournir
aux entreprises, un service de collecte des déchets de bois pour les
débarrasser de ces encombrements. Conscient de cette
responsabilité, l'organe d'aménagement et de gestion a pris des
mesures pour tenter de pallier les problèmes posés par les
déchets de bois bruts. La première
38
des initiatives mises en place a été la
recherche puis l'implantation des unités de valorisation des
déchets de bois. La seconde est la mise à disposition d'un site
de dépôt des déchets.
? L'Autorité administrative
L'autorité administrative par le biais de
l'administrateur général, intervient dans la gestion des
déchets de bois à travers des communications incitatives aux
unités de transformation. En effet, depuis l'installation des
unités de valorisation des déchets de bois dans la ZIS, deux
notes d'information signées par les administrateurs
généraux sortant et entrant ont fait l'objet d'une interpellation
aux UTB. La première note invite les industriels à approvisionner
en priorité les unités de valorisation des déchets de bois
installées à l'intérieur dans la ZIS, afin de leur
garantir un approvisionnement régulier de ces déchets (cf. Annexe
5). La deuxième note plus récente, est signée par le
nouvel administrateur général. Elle désigne le bureau
industrie comme mandataire des transferts externes et internes des
déchets de bois dans la zone. Ces dispositions sont prises dans
l'optique d'un meilleur encadrement en interne de la gestion des déchets
de bois et du suivi des activités liées aux rebuts.
? Les unités de transformation du Bois
Dans une certaine mesure, les unités de transformation
qui sont les productrices des déchets de bois bruts interviennent dans
la gestion de leurs déchets puisqu'elles sont propriétaires et
décident de leur usage. Elles développent donc des moyens de
désencombrement ou d'élimination de ces déchets.
? Les unités de valorisation des déchets
de bois
Les unités de valorisation des déchets de bois
sont en réalité mandatées par les autorités de la
ZIS pour assurer la gestion des déchets de bois bruts produits dans les
unités de transformation. Dans la pratique, elles
récupèrent les déchets auprès des UTB et les
traitent afin de les réintégrer dans les cycles de consommation.
Ces déchets sont en réalité une matière
première pour les unités de valorisation. Il s'agit de
l'unité Huaxing Environnement Gabon SARL,
spécialisée dans la production du charbon actif de bois, de
Tropical Forest Product qui exerce dans la production de meubles en
panneaux de particules et de l'unité Gabon Pellets qui
malheureusement fermait son usine au moment de notre enquête. Elle
produisait les pellets de bois pour les cheminées. Ces unités de
valorisation ont été mises en place pour réduire les
coûts additionnels que ces entreprises pourraient encourir pour
l'élimination, le transport et le traitement de ceux-ci.
39
2.1.2-Caractérisation des déchets de
bois bruts dans la ZIS de Nkok
Les déchets de bois bruts se caractérisent par
leur aspect physique, la qualité des matériaux, mais surtout la
quantité de matière résiduelle produite. Selon les
segments d'activités, on distingue divers types de rebuts de bois (cf.
Tableau 4 ci-dessous). Ces résidus de matières issus des
activités de transformation, ne peuvent à priori servir en
l'état actuel au processus de transformation mis en place. Dans la
première transformation qui concerne le sciage, on identifie les
déchets tels que : la sciure, les copeaux, les débités
déclassés ou encore les dosses. La deuxième transformation
qui comprend le déroulage-placage, produit des déchets tels que
les extrémités des grumes, les chutes de placage et les rondins.
Selon Ada Sara, responsable logistique de Tropical Forest Product, «
Il n'est pas possible de déterminer avec exactitude les quantités
produites pour chaque type de rebuts car les entreprises ne disposent pas
d'outils permettant d'évaluer les volumes de déchets produits.
Toutefois, on peut donner une information globale de la production des
déchets en les mesurant au tonnage des camions de transport »
(ZIS de Nkok, entretient du 09/02/2023). Pour avoir une idée plus
précise des caractéristiques des déchets de bois bruts
produits, nous les avons classés selon leurs caractères
qualitatifs et quantitatifs.
? Caractérisation qualitative des déchets
de bois bruts
Les caractères qualitatifs des déchets de bois
rassemblent tous les aspects liés à la configuration physique et
leurs composés biochimiques. La qualité du bois peut
dépendre de l'état dans lequel il a été
conservé ; le bois peut subir des coups, s'user ou être
exposé à l'humidité, ce qui peut fortement le
détériorer (Van Pottelsberghe de la Potterie, 2018). Le tableau 3
donne un aperçu des types de déchets de bois bruts
identifiés dans les industries de transformation et ce, selon les
niveaux de transformation. La caractéristique de la qualité du
bois évoquée ci-dessus concerne la distinction entre bois tendres
et les bois durs, entre Okoumé et bois divers. En effet, il faut dire
que l'activité de déroulage utilise les bois tendres dont
l'Okoumé, qui est plus favorable à la confection du
contreplaqué.
40
Tableau 4 : Caractéristiques des déchets de
bois bruts
|
Niveau de
transformation
|
Types de déchets
|
Description
|
|
Première
transformation
(sciage)
|
Sciure et copeaux
|
Ce sont des fragments de bois issus du sciage et dont le
diamètre mesuré au millimètre, varie selon qu'il s'agisse
de la sciure ou du copeau.
|
|
Débités déclassés
|
Ce sont des chutes de bois produits lors des
différentes étapes du sciage et qui sont impropres au produit
final. On compte divers types de chutes de bois qui se distinguent par leur
taille et leurs formes.
|
|
Dosses
|
Ce sont les parties rondes de la grume qui sont
enlevées lors des opérations de sciage.
|
|
Deuxième
transformation
(déroulage-placage)
|
Extrémités
|
Comme l'indique leur nom, ce sont les bouts de la grume
enlevés avant le déroulage. Ces parties sont de trop par rapport
au cubage recherché.
|
|
Chutes de placage
|
Il s'agit de fines feuilles souples, comprises entre 0.5 et
3mm. Elles sont produites lors des processus de déroulage et de placage.
De mauvaise qualité, elles ne présentent pas encore la couleur
recherchée au début du déroulage ; ou elles sont mal
déroulées et ne peuvent utilisées en l'état.
|
|
Rondins
|
C'est le coeur du bois qui reste à la fin du
déroulage, car ne pouvant plus être déroulé.
|
Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024
À côté des types de déchets
présentés dans ce tableau, les écorces de bois sont l'un
des premiers déchets de la production industrielle. Lors du sciage, ils
sont directement enlevés avec les dosses ; et lors du déroulage,
ils sont enlevés avant la récupération des
premières feuilles déroulées.
Aussi, l'activité de déroulage-placage produit
de la sciure et du copeau lorsque les extrémités de la grume sont
sciées pour obtenir les dimensions favorables au déroulage. Pour
une meilleure perception des déchets présentés dans le
tableau 4 ci-dessus, nous avons réalisé une planche-photo de ces
déchets (cf. Planche 1).
41
Planche 1: Les Déchets de bois bruts dans la ZIS
de Nkok
|
Photo 1 : Débités
déclassés
|
Photo 2 : Copeaux
|
|
|
|
|
|
Photo 3 : Sciure
|
|
Photo 4 : Rondins
|
|
|
|
|
Photo 5 : Extrémités des grumes
|
Photo 6 : Chutes de déroulage-placage
|
|
|
|
|
Clichés : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Cette planche illustre les types de déchets de bois
bruts produits par les unités de sciage et
de déroulage présentes dans la Zone
d'Investissement Spéciale de Nkok. À travers chaque photo
42
et selon l'indication du nom, il est possible de distinguer
par exemple, la sciure du copeau et ainsi identifier ce qui constitue les
déchets de première et de deuxième transformation.
La granulométrie nous permet de distinguer de
façon objective les déchets de bois ayant de gros
diamètres (extrémités des grumes, rondins et
débités déclassés) et les déchets plus fins
(sciure, copeaux, chute de placage). Quant aux composés chimiques de ces
déchets, comme il s'agit de déchets de bois bruts, les
matières dont ils sont issus n'ont pas encore été en
contact avec des produits de traitements du bois (colle, additifs). De ce fait,
ils ne contiennent que les composés chimiques naturels du bois notamment
le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote.
? Caractérisation quantitative des déchets
de bois bruts
En plus des caractères qualitatifs, les déchets
de bois bruts industriels de la ZIS de Nkok se distinguent par leur volume.
Selon le tableau 5, la production des déchets de bois bruts connait une
légère évolution, avec des volumes cumulés assez
importants. On peut voir que la production annuelle des déchets pour les
deux segments (sciage et déroulage), dépasse les 350.000
m3, et la production totale atteinte au cours des trois
dernières années connait un volume de 1.176.208 m3
(cf. Tableau 5).
Tableau 5 : Évolution du volume des déchets
de bois bruts dans la ZIS de Nkok
|
Année
|
Sciage
|
Déroulage
|
Total (m3)
|
|
2020
|
91311
|
294765
|
386076
|
|
2021
|
57091
|
319720
|
376811
|
|
2022
|
55013
|
358308
|
413321
|
|
Total
général
|
203.415
|
972.793
|
1.176.208
|
Source : DGICBVPF 2020-2022 Réalisation : OBONE MBA
Cécilia A, 2024
De plus, l'analyse comparative entre le rendement
matière et les volumes de déchets produits par chaque segment
d'activité au fil du temps, permet également d'apprécier
la production des déchets de bois bruts au sein de la ZIS de Nkok (cf.
Graphiques 4 et 5).
43
Graphique 4 : Évolution du rendement
matière par segment
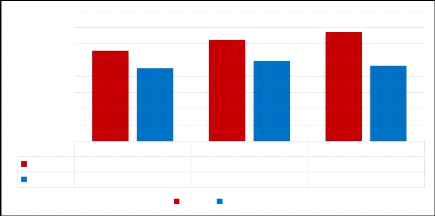
80,00%
70,00%
sciage Déroulage
0,00%
2020
sciage
62,41%
67,25%
55,72%
Déroulage
49,55%
46,38%
44,87%
2021
2022
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
Source : DGICBVPF, 2020-2022 Réalisation : OBONE MBA
Cécilia A, 2024 raphique 6 : Évolution du vume
des déchets de boi
Selon ce graphique, le rendement matière dans le
segment du sciage connait une évolution beaucoup plus importante que
celui du déroulage. En effet, en 2020 l'activité du sciage
enregistre un rendement de 55,72% et en 2022 un pourcentage de 67,25%. Quant au
déroulage, il a connu une évolution plus timide, soit 44,87% en
2020 et 46,38% en 2022 ; avec un pic en 2021 de 49.55%. Cette comparaison du
rendement matière entre production de bois transformés dans le
sciage et dans le déroulage permet de dire qu'au cours des trois
dernières années, l'activité de sciage a produit moins de
déchets contrairement au déroulage.
Ces résultats tels que présentés
concordent avec le graphique 5 ci-dessous, qui nous fait constater une baisse
de la production des déchets de bois dans le segment du sciage
contrairement au segment du déroulage qui en produit davantage.
Graphique 5 : Évolution du volume des
déchets de bois bruts par segment
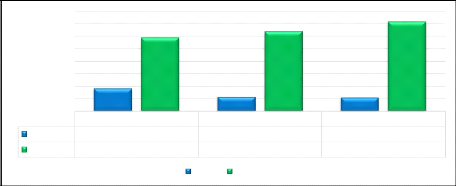
en m3
2020 2021 2022
Sciage 91311 57091 55013
Déroulage 294765 319720 358308
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Sciage Déroulage
Source : DGICBVPF 2020-2022 Réalisation : OBONE MBA
Cécilia A, 2024
44
De manière concrète, on a en 2020 près de
91.311 m3 de volume de déchets produits par le segment du
sciage contre 55.013 m3 en 2022, soit une production des
déchets en moins, estimée à 36.298 m3. Or, dans
le segment du déroulage, l'année 2020 a produit 294.765
m3 de déchets contre 358.308 m3 produits en 2022 ;
ce qui représente 63.443 m3 de matière en plus.
Cette situation s'explique par le fait que le segment du
déroulage-placage consomme de gros volumes de grumes en usines
contrairement au sciage. Cela en raison du nombre important des unités
installées dans la zone (49 dans le déroulage contre 15 dans le
sciage). Le déroulage-placage est une activité plus dynamique que
celle du sciage et cela pourrait justifier l'importance des volumes de
déchets produits par rapport au segment du sciage. C'est du moins ce que
nous montre le tableau 6 ci-après.
Tableau 6: Consommation totale de grumes par
segment
|
Année
|
Consommation de grumes (m3)
|
|
Sciage
|
Déroulage
|
|
2020
|
206.204
|
534.688
|
|
2021
|
151.859
|
633.754
|
|
2022
|
167.997
|
668.277
|
|
Total
|
526.060
|
1.836.719
|
Source : DGICBVPF 2020-2022 Réalisation : OBONE MBA
Cécilia A, 2024
Il apparait dans ce tableau que la consommation totale de
grumes dans le déroulage est trois fois supérieure à la
consommation totale de grumes dans le sciage au cours de la période de
2020-2022. En effet, le segment du déroulage consomme plus 500.000
m3 de bois par an tandis que celui du sciage ne dépasse pas
200.000 m3 de grumes. En combinant les volumes de bois
consommés par chaque segment, on estime à 526.060 m3
la consommation totale du sciage durant cette période et à
1.836.719 m3 la consommation totale du déroulage. Soit un
volume de 1.310.659 m3 consommé en plus par le segment du
déroulage durant les années 2020, 2021 et 2022.
Aussi, la consommation de grumes dans ces segments
d'activité nous fait constater une légère baisse de la
consommation dans le sciage contrairement au segment du déroulage qui
est en augmentation (cf. Graphique 6).
45
Graphique 6 : Consommation annuelle de grumes par
segment
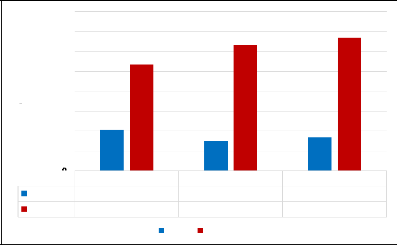
668277
633754
700000
600000
500000
en m3
400000
800000
534688
300000
206204
151859
200000
100000
|
0
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Sciage
|
206204
|
151859
|
167997
|
|
Déroulage
|
534688
|
633754
|
668277
|
Sciage Déroulage
167997
Source : DGICBVPF 2020-2022 Réalisation : OBONE MBA
Cécilia A, 2024
On est passé d'une consommation de plus 200.000
m3 de bois dans le segment du sciage en 2020 à 151.859
m3 en 2021 et à 167.997 m3 de volume de grumes en
2022. Ce qui représente une baisse de la consommation de grumes d'au
moins 38.207 m3 au cours de trois dernières années. Le
segment du déroulage quant à lui a consommé en 2020 un
volume de 534.688 m3 de grumes, en 2021, 633.754 m3 et en
2022, 668.277 m3 de grumes. Ce qui représente une
augmentation de 133.589 m3 de grumes consommées.
2.2-Les modes de gestion des déchets de bois
bruts dans les unités de transformation
La gestion des déchets de bois dans la Zone
d'Investissement Spéciale de Nkok a connu bien des changements au cours
des cinq dernières années. En effet, avant l'année 2019,
les déchets de bois issus des unités de transformation de la
zone, ne faisaient pas l'objet de contrôle ou de valorisation comme c'est
le cas aujourd'hui. Selon un des responsables de l'administration de la ZIS
: « f...] les déchets de bois étaient soit
données aux populations voisines pour le chauffage, soit revendus aux
grossistes de la filière artisanale par les industriels eux-mêmes
ou simplement brûlés. » (Entretient du 26/02/2023 ZIS de
Nkok, Guichet Unique). Il faut dire qu'à Nkok, les investisseurs sont
propriétaires et responsables de leurs déchets ; ils
décident donc de leur devenir. Toutefois, le brûlage des
déchets de bois, qui entraîne leur gaspillage et contribue
à l'émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère,
ne
46
correspond pas aux ambitions écologiques de la ZIS qui
aspire à être une industrie respectueuse de l'environnement. Pour
limiter cette pratique, l'administration de la ZIS de Nkok a due interdire le
brûlage des déchets de bois et encourager leur valorisation.
Cependant, malgré ces nouvelles directives, il s'avère que les
pratiques désormais prohibées, continuent d'être
appliquées par certaines unités de transformation à
l'intérieur de la ZIS de Nkok.
À ce jour, il est pratiqué dans la ZIS de Nkok,
six modes de gestion des déchets de bois bruts par les unités de
transformation du bois. D'abord le brûlage à l'air libre, ensuite
la décharge, la réutilisation, le stockage, la vente des rebuts
et enfin la cession sous la forme de dons aux unités de valorisation
présentes dans la zone.
? Le brûlage
Dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok, le
brûlage des déchets de bois à l'air libre est une pratique
courante. En effet, pour répondre au problème d'encombrement, les
UTB brûlent une partie de leurs déchets de bois à l'air
libre, afin de réduire les stocks accumulés. Bien que cette
pratique soit censurée par le Code de l'environnement (Loi
n°007/2014, art. 95), cette forme d'élimination des déchets
des bois bruts est très répandue. Lors de nos sorties de terrain,
nous avons constaté qu'au sein de chaque unité de transformation,
un espace est dédié au brûlage des déchets à
ciel ouvert (cf. Planche 2).
Concernant l'activité de déroulage-placage, les
déchets brûlés sont pour la plupart des chutes de placage.
Dans le sciage, ce sont la sciure et le copeau qui sont fréquemment
brûlés. Toutefois, il nous est arrivé de rencontrer des
unités telle que Africa Elephant qui disent brûler tous
les types de déchets de bois, sans distinction aucune.
47
Planche 2: Déchets de bois brûlés
à l'air libre

Photo 1 : Extrémités
brûlées
Photo 2 : Chutes de placages
brûlées
Clichés : OBONE MBA Cécilia A, 2024
? La décharge
Aussi, pour aider les industriels à se
débarrasser de leurs déchets, un espace dans la zone a
été dédié pour le dépôt des
déchets. Mais, cet espace n'est pas un endroit aménagé ;
c'est une décharge à ciel ouvert où les déchets de
bois et autres sont brûlés à l'air libre (Photo 2).
Photo 2: Décharge à ciel ouvert de la ZIS
de Nkok

Cliché : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Cette pratique n'est pas très différente de ce
qui se fait dans les entreprises puisqu'au final, les déchets sont
brûlés à ciel ouvert et les gaz s'évaporent
librement dans la nature. Durant nos enquêtes, nous avons constaté
que la majorité des déchets qui y sont déversés
sont : la sciure, le copeau et quelque peu les débités
déclassés. Malgré la présence de cette
décharge, les
48
entreprises peinent à venir y déposer leurs
déchets de bois car elles ne disposent pas de camions
d'évacuation et cela nécessite un coût financier
supplémentaire.
? La réutilisation
Afin de réduire le gaspillage, les usines de
transformation du bois réutilisent leurs déchets de bois de
différentes manières. Plusieurs d'entre elles incinèrent
les résidus de bois dans des chaudières pour produire de
l'énergie (Photo 3). En effet, le séchage du bois est
réalisé grâce à des chaudières
mécaniques qui sont alimentées par les déchets de bois,
tant dans les unités de sciage que dans les unités de
déroulage. Il s'agit d'une récupération d'énergie
encore appelée système de cogénération. C'est une
combinaison d'énergie thermique et mécanique à partir d'un
seul combustible, destinée à produire de
l'électricité (Mérenne-Schoumaker, 2017).
Concrètement, les matières résiduelles sont
utilisées en complément du courant électrique pour
alimenter les chaudières. Les déchets favorables à
l'incinération sont généralement ceux ayant de gros
diamètres tels que : les extrémités des grumes, les
rondins et les débités déclassés. Ils sont fendus
ou découpés en petits morceaux puis envoyés dans les
chaudières.
Photo 3: Chaudière mécanique

Cliché : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Une autre forme de réutilisation consiste à
fabriquer des palettes de bois à partir de rondins qui ne peuvent plus
être déroulés. Ces palettes sont utilisées pour
supporter les feuilles de placage déroulées et les
contreplaqués. De plus, dans le processus de déroulage et de
placage, les chutes de placage sont parfois réutilisées pour la
confection des contreplaqués de moindre qualité.
49
? Le stockage
Il s'agit d'un autre mode de gestion de déchets de bois
bruts par les UTB. Pour éviter de brûler leurs déchets, les
unités de transformation stockent les déchets de bois dans une
partie de l'entreprise. Ce stockage se fait en plein air (cf. Planche 3). Par
conséquent, ces matériaux, qui peuvent encore être
utilisés pour fabriquer d'autres produits, sont exposés aux
intempéries et aux variations de température. Il faut noter que
la ZIS de Nkok est située dans un espace du territoire national
très arrosé, avec une moyenne pluviométrique annuelle de
2870 mm pour la ville de Libreville (Maloba Makanga, 2010). Aussi, du fait de
la position du Gabon sur l'équateur, le pays connait un climat tropical
chaud et humide, avec des moyennes mensuelles de température entre 23 et
29°C (Maloba Makanga, 2004). Ces conditions de stockage ont un impact sur
la qualité des déchets car elles les dégradent davantage
et réduisent les probabilités d'utilisation de ces
matières pour la valorisation ou autres utilisations.
Planche 3: Stockage des déchets de bois à
l'air libre

Photo 1 : Rondins stockés
Photo 2 : Débités en
décomposition
Clichés : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Sur la photo 2 de cette planche, on observe des déchets
de débités déclassés qui ont perdu leur
éclat en raison de l'exposition quotidienne aux éléments
météorologiques.
? La vente des rebuts
La vente des rebuts de bois est une autre alternative
utilisée par les UTB pour réduire les stocks de déchets
produits. Cette vente se fait de deux manières, la première est
un commerce de gré à gré entre unités de
transformation. En effet, pour alimenter les chaudières ou pour la
confection de palettes, les UTB s'approvisionnent entre-elles, en
déchets (rondins), moyennant des sommes presqu'insignifiantes. Le prix
de la bille varie entre 250 et 300 F CFA voir 400 F
50
CFA maximum. Cette vente n'est pas déclarée car
elle est considérée comme un don entre unités. En plus des
ventes qui s'effectuent entre UTB, il y a aussi celles qui s'opèrent
entre les UTB et des opérateurs artisanaux qui sont situées
à l'extérieur de la ZIS. Il s'agit pour l'essentiel d'entre elles
des structures qui fabriquent des meubles ou autres produits
dérivés du bois. Certaines unités de transformation ont
des contrats d'approvisionnement avec ces unités artisanales. Pour
s'approvisionner en déchets de bois auprès des UTB, ces
unités artisanales justifiaient d'une autorisation douanière qui
leur permettait de collecter les déchets de bois dans les UTB.
Aujourd'hui, cette activité de transferts des rebuts entre UTB et
unités artisanales est désormais sous le contrôle direct du
bureau industrie qui a compétence à gérer les
avivés dans toutes leurs formes.
? Le don aux unités de valorisation
Compte tenu de la note officielle signée par l'ancien
administrateur général, demandant aux UTB d'approvisionner en
priorité les unités de valorisation installées dans la
ZIS, la cession gratuite à ces unités de valorisation est un
autre mode de gestion des rebuts que l'on peut désormais observer dans
la ZIS de Nkok. Bien que peu nombreuses, certaines unités de
transformation du bois (UTB) acceptent de céder leurs déchets de
bois aux unités de valorisation. Il faut dire que cette pratique pose
parfois un souci d'approvisionnement pour les unités de valorisation qui
doivent compter sur le bon vouloir des unités de production pour obtenir
de la matière première. D'un autre côté, certaines
unités de transformation disent ne pas avoir été
approchées par les unités de valorisation pour
récupérer leurs déchets alors que celles-ci sont
prêtent à les céder gratuitement.
Le graphique 7 ci-dessous est une présentation
générale des modes de gestion des déchets de bois bruts
par les unités de transformation dans la ZIS de Nkok.
51
Graphique 7 : Modes de gestion des déchets de bois
bruts dans les UTB
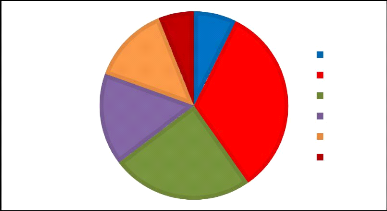
14%
16%
6%
24%
7%
33%
Stockage Brulés Chaudière Vente
Don
Décharge
Source : Données de terrain, mars 2024
Dans l'ordre des pratiques on a : le brûlage à
l'air libre (33%), la chaudière (24%), la vente des rebuts (16%), le don
(14%), le stockage (7%) et la décharge (6%). De tous, le brûlage
en plein air est la méthode la plus répandue pour se
défaire les déchets de bois produits dans les industries ; c'est
la quasi-totalité des entreprises qui pratique ce mode
d'évacuation des déchets. Toutefois, il faut préciser que
pour beaucoup d'entreprises, les déchets brûlés sont ceux
dont elles ne se servent pas ou qui n'ont pas été
récupérés par les unités de valorisation.
2.3-L'approvisionnement en déchets des unités
de valorisation
L'approvisionnement en déchets de bois bruts se fait
grâce à des opérations de collecte qui lient les
unités de production des déchets aux unités de
valorisation. En amont, on retrouve les unités de transformation du bois
(sciage et déroulage) qui produisent les déchets lors des
processus de transformation des grumes. En aval, les unités de
valorisation des rebuts qui réceptionnent les déchets produits
dans l'optique de leur traitement.
En accord avec la note officielle de l'ancien administrateur
général, et qui à ce jour n'a pas été
révoquée, toutes les unités de première et de
deuxième transformation de bois installées dans la ZIS, devraient
approvisionner en priorité les unités de valorisation des rebuts
de bois dans l'optique de leur garantir les matières premières.
Cet approvisionnement est gratuit. Il se fait en fonction du type de
déchet dont a besoin chaque unité de valorisation et de la
production des unités de transformation qui détermine la
quantité de déchets produite et qui peut être
collectée. La collecte se fait au moyen des camions benne ou à
cage. Ils vont récupérer les déchets dans les
unités production, ceci en fonction de la demande mais surtout de la
52
disponibilité en déchets (cf. Planche 4). Par
conséquent, la fréquence journalière de collecte est
fonction de la production des UTB.
Planche 4: Camions de collecte des
déchets
|
Photo 1 : Camion collectant les
déchets
|
Photo 2 : Camion venant décharger les
déchets collectés
|
|
|
|
|
Clichés : OBONE MBA Cécilia A,
2024
Aussi, nous avons observé durant nos enquêtes,
des différences dans les types de déchets collectés par
chaque unité de valorisation. Il en ressort que l'unité de
fabrication de charbon actif, utilise presqu'uniquement les déchets de
sciage (les débités déclassés
précisément). Quant à l'unité de fabrication des
panneaux de particules, elle a une plus large gamme de déchets et
utilise ceux issus des deux niveaux de transformation. Le tableau 7 fait
état des types de déchets collectés par chaque
unité de valorisation.
Tableau 7: Caractéristiques de la collecte des
déchets de bois des UVRB
|
Unités de valorisation
|
Type de déchets
|
Segments
|
Type de bois
|
|
Huaxing
Environnement
|
-Débités déclassés
|
-Sciage
|
- Bois divers 80%
- Okoumé 20%
|
|
Tropical Forest Products
|
-Débites déclassés
-
Rondins
-Extrémités des
grumes
- Sciures et copeaux
|
- Sciage
- Déroulage
|
-Okoumé 85%
-Bois divers 15%
|
Source : Données de terrain, mars 2024
À partir de ce tableau, on peut dire que la collecte des
déchets des unités de valorisation est sélective. Un tri
des déchets est opéré lors des opérations de
collecte, ceci en fonction des
53
besoins des unités de valorisation. De plus, la carte 3
suivante présente les lieux d'approvisionnement des unités de
valorisation des rebuts de bois dans la ZIS de Nkok.
Carte 3 : Lieux d'approvisionnement des unités de
valorisation
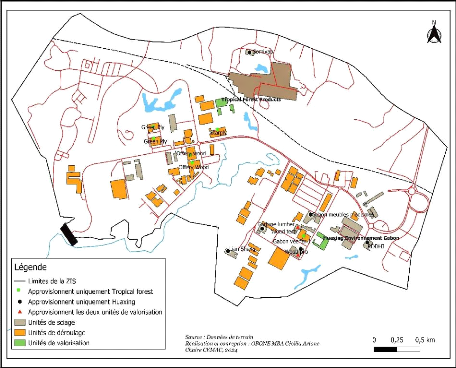
Sur cette carte on peut voir que les unités de
déroulage qui approvisionnent les unités de valorisation sont peu
nombreuses bien qu'elles soient plus présentes dans la ZIS que les
unités de sciage. À l'inverse, les unités de sciage
approvisionnement majoritairement les unités de valorisation. Comme
indiqué dans la légende, on peut distinguer selon la
signalisation, les unités de transformation qui approvisionnent chaque
unité de valorisation ou les deux. Dans l'ensemble, le nombre
d'unité de transformation qui approvisionne les unités de
valorisation est relativement faible par rapport au nombre d'UTB
présentent dans la ZIS.
2.3-La valorisation des déchets de bois brut dans
la ZIS de Nkok
Comme il a été mentionné en introduction,
la valorisation des déchets désigne les différents
traitements effectués sur les déchets en vue de leur donner de la
valeur, de les rendre utiles à l'usage. D'après Mayster (1994),
« Valoriser un déchet recoupe toute action qui permet
54
d'en tirer de l'énergie, de trouver un nouvel usage
à la matière qui le compose, de tirer une matière
première secondaire utile à la fabrication du même bien et
de trouver un nouvel usage qui permet à un déchet de redevenir
utile pour d'autres. » (Brik & Guerriche, 2021, p.14). Par cette
définition, il apparait que la valorisation des déchets en
l'occurrence des déchets de bois bruts, revêt plusieurs
dimensions. Elle procède de diverses manières selon les
applications qu'on souhaite donner aux déchets. La valorisation peut
relever de la simple vente du déchet dans son état initial
à un prestataire qui souhaite le traiter. En matière de
traitement à effectuer, on peut parler de la réutilisation ou du
réemploi dans le cadre d'un déchet qui n'est pas totalement
altéré et dont la forme initiale peut servir au même usage
que le produit dont il est issu. C'est le cas des bouteilles plastiques qui
sont réutilisés dans les ménages ou dans les commerces de
rues pour l'approvisionnement en eau. Elles ne subissent aucun traitement
particulier si ce n'est leur nettoyage pour les désinfecter.
Dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok, il
existe deux formes valorisation des déchets de bois bruts. La
première est la production de charbon actif de bois et la
deuxième, la production de meubles en panneaux de particules. Ces deux
procédés de valorisation s'inscrivent dans la valorisation
mécanique en ce sens que les déchets subissent différents
broyages lors des processus de production.
2.3.1-La production de charbon actif de bois
Le charbon actif est une forme poreuse de carbone qui peut
être fabriquée à partir d'une variété de
matières solides ayant une grande proportion de carbone (la noix de
coco, le bois, ou encore les os d'animaux). C'est un matériau adsorbant
qui se caractérise par sa grande surface spécifique, sa structure
poreuse et sa thermostabilité (Chen et al., 2011 cité par Trachi
et al., 2014). Ce charbon possède de nombreuses propriétés
grâce à sa structure physique microporeuse et se présente
sous forme de poudre ou de granules de faibles volumes. Grâce à
l'effet d'adsorption4, le charbon actif permet la purification des
eaux potables (robinet) et usées, la purification de l'air ou des gaz.
C'est aussi un excellent digestif et un produit cosmétique prisé
notamment pour l'utilisation sous forme de masque ou dans la fabrication de
dentifrice. L'activation du charbon peut se faire thermiquement ou
chimiquement, à de hautes températures.
Dans la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok, c'est
l'entreprise chinoise Huaxing Environnement Gabon qui réalise
ce produit via la valorisation des déchets de bois bruts issus
4 Rétention des impuretés et toxiques
à la surface du charbon actif
55
des unités de sciage (débités
déclassés, dosses). Pour ce faire, les déchets de bois
vont passer par différentes étapes de combustion et de broyage
avant l'obtention du produit final. En effet, la production du charbon actif
débute par une première combustion des matières
premières dans des fours adaptés (cf. Photo 4). Pour sa
production, l'entreprise dispose de 52 fours d'une capacité de 25 tonnes
chacun et utilise 4 à 7 fours par jour.
Photo 4: Fours de combustion du bois

Cliché : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Cette carbonisation aussi appelée thermolyse est
réalisée sans oxygène ; elle se fait lentement et dure 3
à 4 jours, avec des températures entre 600 et 900°C. Elle
est réalisée dans l'optique d'obtenir du charbon naturel tel que
produit couramment par les unités artisanales de production du charbon
de bois. Il faut dire que ce charbon dit naturel est légèrement
poreux et ne permet pas de capter toutes les propriétés du
charbon lorsqu'il est activé. La planche 5 ci-après, montre le
processus de fabrication du charbon naturel.
56
Planche 5: Production du charbon naturel

Photo 1 : Ouvriers chargeant les fours
Photo 3 : Ouvrier déchargeant un four
Photo 4 : Charbon naturel
Photo 2 : Fours fermés avec des briques de terre
puis de la boue
Clichés : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Comme le montre cette planche, la production du charbon
naturel débute par le chargement des déchets de bois dans les
fours (photo 1), ces déchets sont brûlés durant plusieurs
jours avant d'obtenir du charbon de bois naturel tel que nous le connaissons et
nous l'utilisons dans nos ménages pour la cuisson des repas (photo
4).
Après la première combustion, le charbon est
broyé puis tamisé avant de subir une deuxième
carbonisation. C'est à cette étape que le charbon est
activé, c'est-à-dire qu'il est brûlé à de
plus hautes températures, mais cette fois-ci avec de l'oxygène et
du gaz. L'activation du charbon est en réalité la recherche d'un
produit plus poreux, capable de répondre aux attentes telles que
mentionnées plus haut. La fin du processus de production du charbon
actif se fait par un dernier broyage de la matière qui permet d'obtenir
de la poudre qui est la forme du produit à commercialiser (cf. Planche
6). Il faut préciser que l'activation du charbon est physique. Le
matériau carbonisé est traité avec un mélange de
gaz de combustion et la vapeur d'eau à une température
élevée, qui permettent de l'activer.
57
Planche 6: Production du charbon actif de
bois
Clichés : OBONE MBA Cécilia A, 2024

Photo 1 : Four activateur brûlant à plus
de 1000°C
Photo 3 : Machine de broyage
Photo 2 : Refroidissement et oxygénation du
charbon
Photo 4 : Charbon actif
Sur la photo (2) de cette planche, la boite blanche
présentée contient de l'oxygène et sous le cylindre, il y
a comme une forme de cuvette qui contient de l'eau. Elle permet de refroidir le
charbon activé.
Pour réaliser sa production, l'entreprise utilise
toutes les essences de bois produites par les unités de transformation.
Mais dans les taux d'utilisation, l'Okoumé est utilisé à
20% tandis que les bois divers le sont à 80%. Cela s'explique par le
fait que l'Okoumé soit un bois plus tendre ; il n'est pas assez
résistant à la combustion et se carbonise rapidement. En effet,
lorsque les mélanges ne sont pas biens faits, c'est-à-dire
lorsque l'Okoumé représente le maximum de bois à
brûler, la récupération des matières
transformées est faible « [...j seulement 6% des
matières récupérées lors de la première
combustion » (entretient du 29/01/2024, ZIS de Nkok). La figure 4 est
une reconstitution de la production de charbon actif dans la ZIS de Nkok.
58
Figure 4 : Schéma de reconstitution de la
production de charbon actif de bois
chargement des déchets de bois dans les fours pour
combustion entre 600900°C
déchargement des fours et
broyage du bois
brulés
(obtention du charbon
naturel)
|
|
combustion du
charbon naturel à plus
de 900°C
et activation
par l'eau et le gaz
|
|
Production du charbon activé
|
|
|
|
broyage charbon
activé
Charbon actif sous
forme de poudre
Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Ce schéma nous fait constater que la production de
charbon actif de bois nécessite deux étapes de combustion et deux
étapes de broyage. Elle semble être moins complexe à
réaliser et ne nécessite pas des traitements chimiques qui
pourraient s'avérer dangereux pour la consommation.
2.3.2-La production de meubles en panneaux de
particules
La valorisation mécanique dans ce cas précis,
consiste à broyer les déchets pour obtenir de fines particules de
bois. Elle est appliquée pour la confection des produits
granulés, qui à la fin, seront compactés. L'unité
de valorisation Tropical Forest Product, spécialisée
dans la production des panneaux de particules, réalise cette forme de
valorisation à partir des déchets de bois bruts collectés.
Cette entreprise est le fruit d'un partenariat public-privé entre la
société Gabon Special Economic Zone (GSEZ) et la
Société Nationale de Bois du Gabon (SNBG).
Les panneaux de particules aussi appelés panneaux
agglomérés, sont un assemblage de particules de bois issus des
processus de transformation du bois. Ils servent à la confection de
meubles (bureau, tables, living etc.).
L'entreprise utilise comme matière première les
débités déclassés, les copeaux, la sciure, les
rondins et extrémités de grumes issus du déroulage. La
production de panneaux de particules
59
de bois consiste en majorité à broyer les
déchets pour obtenir des fragments de bois de diverses épaisseurs
(cf. Planche 7).
Planche 7: Les différents niveaux de broyage des
déchets de bois
|
Photo 1 : Morceaux de bois
|
Photo 2 : Copeaux moyens
|
|
|
|
|
Photo 3 : Copeaux plus fins
|
Photo 4 : Sciure
|
|
Clichés : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Pour arriver au produit final qui est le meuble en panneaux de
particules, les déchets de bois sont séparés en fonction
de leur taille, où ils subiront différents broyages. Les plus
gros diamètres de broyage se situent entre 25 et 30 mm (photo 1) et les
plus petits ont un diamètre de 9 mm (photo 4), ils sont appelés
flakers. À préciser que le broyage est fonction du type
de déchet. Par conséquent, seuls les débités
déclassés, les rondins et les extrémités des grumes
subissent la découpe et le broyage. La sciure et le copeau ne
connaissent pas ces étapes puisqu'ils sont déjà des
particules de bois. Les déchets ainsi broyés seront
compactés avec de la colle en machine sous l'effet de la chaleur et de
la pression afin d'obtenir les panneaux de particules de bois. Ces panneaux de
particules peuvent être des substituts du contre-plaqué ou
simplement du bois et peuvent être utilisés dans le domaine du
mobilier. La planche 8, présente les panneaux de particules en
question.
60
Planche 8: Prototypes des panneaux de
particules

Photo 1 : Produit semi-fini
Photo 2 : Produits finis
Clichés : OBONE MBA Cécilia A, 2024
La première photo de cette planche montre le produit
déjà compacté. Il présente une surface lisse mais
est encore à l'état brut. L'unité de panneaux de
particules à l'avantage de trouver cette colle au sein même de la
ZIS qui enregistre deux unités de production de résine. Il s'agit
de : Hexel Gabon et Windson Resins and Chemicals. Sur la
deuxième photo, du parquet a été rajouté pour
apporter plus de design au produit. C'est cet échantillon qui constitue
le produit fini de l'unité de valorisation de panneau de particules.
En somme, la gestion des déchets de bois bruts dans la
ZIS de Nkok fait intervenir différents acteurs mais dont les UTB sont au
centre. C'est dans ces entreprises que la gestion a véritablement lieu
puisque les déchets sont utilisés à plusieurs fins. Ces
unités de valorisation s'approvisionnent gratuitement et produisent le
charbon actif et les panneaux de particules qui sont les
débouchés de la valorisation des déchets de bois bruts.
61
Conclusion de la première partie
La première partie de ce travail a permis de comprendre
l'organisation de la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok et les
avantages qui motivent les unités de valorisation des déchets de
bois à s'y installer. Parmi ces avantages, nous pouvons évoquer
les conditions fiscales et douanières dont bénéficient les
entreprises ayant un statut privilégié (exonération de la
retenue à la source ou de la taxe sur la valeur ajoutée) et dont
les unités de valorisation en font partie. Il y a également
l'abondance des déchets de bois, leur accès gratuit et la
proximité avec les unités d'approvisionnement pour ces
unités de valorisation. Dans la ZIS, le segment du déroulage est
largement représenté par rapport à celui du sciage. Le
chapitre 2, fait un état des lieux de la gestion des déchets de
bois bruts dans la ZIS de Nkok en identifiant les acteurs de la gestion et en
caractérisant les types déchets de bois selon leurs aspects
physiques et quantitatifs. Dans les quantités, le segment de sciage
produit moins de déchets que celui du déroulage cela en raison de
sa faible représentation en unités de transformation et de sa
faible consommation en grumes. Ce chapitre identifie les produits issus de la
valorisation des déchets de bois bruts que sont le charbon actif de bois
et les panneaux de particules.
62
DEUXIEME PARTIE :
EFFETS, LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA
VALORISATION
DES DECHETS DE BOIS BRUTS DANS
LA ZIS DE NKOK
63
Introduction de la deuxième partie
La seconde partie de ce travail consiste à montrer les
effets positifs que génèrent les activités de la
valorisation des déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok. Autant sur
le plan économique que sur le plan environnemental (chapitre 3). Dans le
chapitre 4, cette étude fait état des difficultés que
rencontrent les unités de valorisation des déchets de bois. Ces
difficultés menacent la bonne marche de leurs activités qui sont
dépendantes de la production des déchets issus des industries de
transformation du bois. Elles pourraient à long terme représenter
un frein à la pérennité des activités de
valorisation des déchets de bois au sein de la Zone d'Investissement
Spéciale de Nkok.
64
CHAPITRE 3 : IMPACTS DES ACTIVITÉS DE
VALORISATION DES DÉCHETS DE BOIS BRUTS
De nos jours, la valorisation des déchets mobilise
l'attention des personnes de tous bords, en vue de trouver des solutions
palliatives et efficaces contre les nuisances générées par
ces déchets. Les intérêts prônés sur la
valorisation des déchets en général et plus
spécifiquement celle des déchets de bois bruts industriels sont
d'ordre économique, social et environnemental.
3.1-Impacts économique et social de la
valorisation des déchets de bois bruts
3.1.1-La valorisation : une contribution à la
production de bois transformés
L'industrialisation modifie la structure économique
primaire vers des activités modernes, elle permet d'augmenter la
croissance potentielle de l'économie et facilite le
développement. Ce développement peut être fait de
manière vertueuse en mettant en place une économie circulaire.
C'est pourquoi, il y a dans la stratégie de la ZIS de Nkok, le besoin
et/ou le souci de maximiser l'utilisation du bois en favorisant le
développement des activités de valorisation des déchets de
bois. Tout ceci, dans l'optique d'augmenter le taux de rendement matière
de bois transformés et de créer de la richesse.
Le rendement matière est le rapport entre le volume de
produit transformé et le volume de bois brut nécessaire à
sa transformation (Karsenty, 1999). C'est la quantité de production, le
pourcentage d'utilisation que l'on tire d'une ressource après
transformation et qui peut s'exprimer en capacité, en masse, ou en
pourcentage. Dans la ZIS de Nkok, la valorisation des déchets de bois
bruts participe à améliorer le rendement matière de la
production de bois transformés à travers la production des
déchets de bois valorisés. Ceux-ci représentent des
volumes supplémentaires pour la production générale de
bois transformés dans la ZIS (cf. Tableau 8).
Tableau 8: Production annuelle des déchets de bois
bruts valorisés
|
Unités de valorisation
|
Année
|
Volumes de déchets valorisés
|
|
Huaxing Environnement Gabon
|
2021
|
692 m3
|
|
2022
|
-
|
|
2023
|
1930, 24 m3
|
|
Tropical Forest Product
|
2023
|
8536, 693 m3
|
Source : DGICBVPF, 2021 et données de terrain, mars
2024
65
À la lecture de ce tableau, il apparait que
l'unité de charbon actif Huaxing Environnement Gabon connait
une évolution de sa production. En 2021, le volume de déchets
valorisés est estimé à 692 m3 et en 2023, la
production est de 1930,24 m3 de charbon actif produits. Il faut
rappeler que cette unité de valorisation est plus ancienne dans la zone
par rapport à l'unité de fabrication de panneaux de particules
qui n'est opérationnelle que depuis février 2023. C'est cette
raison qui explique l'absence de données antérieures la
concernant. La production de cette unité en 2023 est estimée
à 8536, 693 m3 soit 161.743 panneaux de particules, toutes
épaisseurs confondues. Pour établir un lien entre consommation et
production, un tableau a été réalisé. Ce tableau
présente les moyennes mensuelles et le total annuel de la production de
l'unité de panneaux de particules qui offre une meilleure
traçabilité de ses activités (cf. Tableau 9).
Tableau 9 : Production de panneaux de particules en
2023
|
Réception des
déchets de bois
(en
tonne)
|
Consommation
(en tonne)
|
Nombre de
panneaux
|
Production
(en m3)
|
|
Moyenne Mensuelle
|
761, 775
|
560,215
|
13.479
|
711,39
|
|
Total annuel
|
9141,3
|
6722,58
|
161.743
|
8536,693
|
Source : Données de terrain, mars 2024
La proportion de gaspillage évitée réside
dans les quantités de déchets collectées par
l'unité de valorisation, soit une moyenne mensuelle de 761,775 tonnes de
déchets collectés et un total annuel de 9141,3 tonnes. Ces
déchets collectés ont permis de produire en moyenne 711,39
m3 de panneaux de particules soit 13.479 panneaux par mois. C'est
bien la preuve que la valorisation des déchets de bois bruts dans la ZIS
de Nkok contribue à la production de bois transformés.
? De la commercialisation des produits
finis
Les produits issus de la valorisation des déchets de
bois bruts sont essentiellement destinés au marché international.
Concernant le charbon actif, la production est majoritairement destinée
au marché chinois mais l'entreprise écoule également une
partie de sa production en Europe, précisément en France. En
effet, ce pays comme beaucoup d'autres pays d'Asie, d'Afrique ou d'Europe a une
forte demande en charbon. Pour conserver et évacuer sa marchandise,
l'entreprise utilise des sacs de 500 Kg soit une demi-tonne (cf. Photo 5)
contenant chacun 1,2 m3 de charbon actif. Ce charbon actif est vendu
à la tonne. En Chine par exemple, le prix fixé est 500 $
la tonne soit 305.250 F CFA ; en France il est de 1630 € la
tonne, soit
66
1.066.720 F CFA. On constate que le marché
français est plus rentable que le marché chinois car celui-ci
enregistre des gains plus conséquents. Cependant, la décision de
l'entreprise de vendre une part significative de ses produits en Chine pourrait
être attribuée à une demande qui semble être plus
constante dans ce pays ainsi qu'à des partenariats établis avec
les acheteurs, contrairement au marché français.
Photo 5 : Sacs de charbon actif

Clichés : OBONE MBA Cécilia A, 2024
En 2023, l'entreprise a réalisé une vente
d'environ 360 tonnes de charbon actif soit 864 m3, pour la plupart
à destination de la Chine. Dans le stock vendu, un conteneur de 40 pieds
contenant 44 sacs a été vendu à destination de la France.
À partir de nos calculs et sachant qu'un sac de charbon actif plein vaut
500 kg, nous estimons que l'entreprise a vendu au moins 22 tonnes de charbon
actif, soit 35860 €, ce qui donne un montant de 23.467.859 F CFA.
Quant à l'unité de panneaux de particules, elle
n'effectue pas encore de vente à l'extérieur. Elle prospecte ses
zones de vente et recherche des acheteurs. La plupart des ventes
réalisées se font au niveau local avec de petites
quantités puisque l'entreprise a le droit d'écouler 25% de sa
marchandise sur le territoire national (Loi n°0036/2018 du 08
février 2019). La photo 6 ci-dessous présente les
différentes teintes des panneaux de particules fabriqués au sein
de l'unité de valorisation Tropical Forest Products.
67
Photo 6 : Différentes teintes des panneaux de
particules

Cliché : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Il apparaît à travers cette photo, une
diversité des teintes des panneaux de particules qui sont
proposées aux potentiels acheteurs. Ces panneaux peuvent être
vendus en l'état ou assemblés pour la confection de meubles,
selon la demande du client. La vente locale des panneaux de particules se fait
à la pièce, en fonction de l'épaisseur et du niveau de
transformation. Dans les faits, un panneau de 9 mm d'épaisseur à
l'état brut (1ère transformation) coûte 5.350 F
CFA. Lorsqu'il est verni de couleur blanche (3ème
transformation), il coûte 7.000 F CFA. De même, un panneau de 22 mm
d'épaisseur est vendu 12.050 F CFA à l'état brut. Verni de
blanc, il vaut 18.800 F CFA (cf. Annexe 3).
3.1.2-La valorisation : créatrice
d'activités économiques et d'emplois
La collecte des déchets de bois bruts, le traitement et
enfin la fabrication des nouveaux produits permettent la mise en place d'une
chaine d'acteurs qualifiés ou non. En effet, les processus de
valorisation des déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok ont permis de
créer de nouvelles activités économiques qui sont peu
présentes au niveau du Gabon, du moins dans le cas des traitements
effectués avec les déchets de bois. Concernant l'unité de
fabrication de panneaux de particules, elle est la première et la seule
actuellement dans la sous-région Afrique Centrale à pratiquer
cette activité (Magoum, 2023). De même, la fabrication du charbon
actif, et de pellets de bois, sont des innovations dans notre pays. Ces
activités se distinguent des activités courantes de menuiserie et
quincaillerie artisanale que nous connaissons. Notamment, par la qualité
des produits qu'elles proposent, les procédés de traitement
(broyage et compactage des déchets de bois) et les types de
déchets valorisés (sciure et copeau) (cf. Planche 9).
68
Planche 9: Produits issus de la valorisation

Photo 1 : Panneaux de particules
Photo3 : Pellets
Photo 2 : Charbon actif
Clichés : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Cette planche montre les types de produits issus de la
valorisation des déchets bois bruts dans la ZIS de Nkok. Bien que
l'unité de fabrication de pellets ne soit plus opérationnelle,
nous avons tenu à présenter ce produit pour une meilleure
visibilité.
La création d'activités économiques a des
effets d'entrainement liés aux besoins de la main d'oeuvre
(qualifiée ou non), à la création d'emplois et à
l'amélioration des conditions sociales des personnes employées.
Ainsi, pour arriver à la confection des produit finis, la valorisation
des déchets de bois bruts réunit divers acteurs de tous bords qui
concourent tous mais à différents niveaux, à la
réalisation de ces produits. Il faut dire que la valorisation des
déchets de bois bruts est plus organisée dans le secteur
industriel contrairement au secteur artisanal. Les tâches sont assez bien
réparties en fonction des compétences et capacités de
chacun. Les uns s'occupant de la partie administrative et comptabilité,
les autres étant à l'oeuvre
69
dans la fabrication du produit. Même si dans les faits,
les entreprises déplorent très souvent le problème de
qualification de la main d'oeuvre ouvrière. Dans les tâches
à réaliser, les types d'emplois retrouvés dans ces
unités sont : opérateurs (chaudière, lamination et
imprégnation, machine à presse, machine à sécher,
machine à flocon), chauffeurs, coliseur, broyeur, mécanicien et
électricien.
Pour ce qui est des conditions salariales, les traitements
varient d'une entreprise à une autre. En effet, dans l'unité de
charbon actif, les ouvriers sont payés à la journée et
à la tâche réalisée dans l'entreprise. La
rémunération journalière étant fixée
à 7000 F CFA, ils travaillent 5 à 6 jours sur 7. Pour un ouvrier
régulier, travaillant 22 jours sur 30 (non compris le samedi), son
salaire mensuel est de 154.000 F CFA soit 4000 F CFA au-dessus du Salaire
Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG). S'il travaille le samedi, on estime
le salaire mensuel à 182.000 F CFA. Le tableau 10 suivant renseigne
quelque peu sur le salaire mensuel des ouvriers dans les unités de
valorisation de la ZIS de Nkok.
Tableau 10 : L'emploi dans les unités de
valorisation
|
Entreprises
|
Nombres d'employés
|
Salaire net de l'ouvrier
|
|
Huaxing Environnement Gabon
|
42
|
182.000 F CFA
|
|
Tropical Forest Product
|
98
|
187.000 F CFA
|
|
Total
|
140
|
-
|
Source : Données de terrain, mars 2024
De ce tableau, il est évident que la valorisation des
déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok contribue à la
création d'emplois et dans une moindre mesure, à
l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. Dans
l'ensemble, les deux unités de valorisation comptent 140 travailleurs
avec des salaires assez importants pour les ouvriers des plus basses
catégories. D'ailleurs, concernant l'unité de panneaux de
particules, le personnel bénéficie de 35.000 F CFA de prime de
transport ainsi que des indemnités de logement perçues et
fixées en fonction des catégories. Les salariés sont
également immatriculés à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) et à la Caisse Nationale
d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS). Bien que les conditions de
travail ne soient pas toujours bonnes, surtout dans l'unité de charbon
actif (absence d'EPI adaptés à l'activité) et les salaires
journaliers bas (7000 F CFA la journée pour un travail assez rude), on
ne peut négliger l'impact positif de ces activités en termes de
création d'emplois et d'amélioration des conditions sociales des
travailleurs.
70
Le graphique 8 donne un aperçu de la structure des
employés dans les entreprises de valorisation des déchets de bois
de la ZIS de Nkok.
Graphique 8: La structure des employés des
unités de valorisation
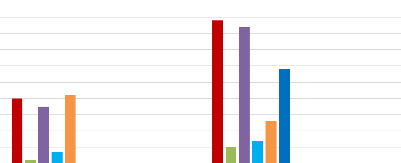
42
40
88
84
58
10
14
26
35
7
2
Huaxing Environnement Tropical forest
Homme Femme Gabonais Expatriés direct
indirect
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Source : Données de terrain, mars 2024
Ce graphique est une présentation
générale de la structure des travailleurs dans les unités
de valorisation des déchets de bois bruts de la ZIS de Nkok. Comme on
peut le voir, l'unité de fabrication de panneaux de particules
Tropical forest products compte le plus d'employés
répartis selon le genre, la nationalité et le type de contrat.
Dans les détails, le nombre d'hommes dans les deux entreprises est bien
plus élevé que celui des femmes. En effet, sur un total de 42
employés, l'entreprise Huaxing Environnement compte 40 hommes contre
seulement 2 femmes et l'entreprise Tropical Forest compte 88 hommes pour 10
femmes. Les travailleurs gabonais sont assez bien représentés
dans les deux entreprises soit au nombre de 35 pour la première
unité et 84 pour la seconde. Concernant les emplois direct et indirect,
l'entreprise de panneaux de particules ne compte que 26 personnes en emploi
direct. C'est-à-dire que ces personnes bénéficient de
contrat de travail direct avec l'entreprise et de toutes les commodités
qui y sont rattachées (paiements de congés, indemnités de
licenciement, paiement de cotisations patronales etc.). Les 58 autres personnes
exercent avec des contrats indirects, c'est-à-dire en sous-traitance.
Quant à l'entreprise de charbon actif, elle dit avoir des contrats
directs de travail avec tout son personnel.
71
3.2-Impacts environnementaux de la valorisation des
déchets de bois bruts
3.2.1-La lutte contre le gaspillage des ressources
L'un des enjeux de la valorisation des déchets est
d'améliorer la performance environnementale et de préserver les
ressources. C'est donc un élément clé pour réduire
la mise en décharge et/ou le brûlage des déchets de bois et
d'économiser les ressources naturelles. Bien évidemment, la
valorisation des déchets de bois n'a pas la prétention de pouvoir
tout éliminer ou tout retransformer. Car, même le déchet
produit du déchet qui peut ne pas être revalorisé, du moins
dans les capacités des unités de valorisation de la ZIS.
La Zone d'Investissement Spéciale de Nkok prône
une gestion optimisée. C'est-à-dire qu'on réduit les
quantités produites par des traitements optimaux pour l'environnement,
grâce aux savoir-faire des unités de valorisation. Par
conséquent, la gestion et particulièrement la valorisation des
déchets de bois bruts contribuent à limiter le gaspillage des
matières (cf. Photo 7).
Photo 7 : Déchets collectés par une
unité de valorisation

Clichés : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Cette photo a été prise devant l'unité de
production de panneaux de particules de bois. Elle nous donne une idée
subjective des quantités de déchets collectés. Avec
l'accumulation, ces déchets de bois forment des amas dans les
unités de valorisation, leurs collectes régulières
permettent de désencombrer les unités de transformation et de
satisfaire l'approvisionnement en matières premières pour les
unités de valorisation. Surtout que le stockage est l'un des
problèmes majeurs que rencontrent les industriels. « Lorsque la
production est forte, nous avons
72
des difficultés pour continuer à stocker nos
déchets de bois... sachant qu'il est interdit de brûler.
», nous a rapporté le responsable de l'usine de sciage RDDHI
(Shinago). Le graphique 9 ci-après fait état des
difficultés rencontrées par les UTB pour la gestion de leurs
déchets.
Graphique 9 : Difficultés rencontrées par
les UTB
|
14
|
|
12
|
13
|
|
|
|
10
|
10
|
|
8
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
4
|
|
|
|
2
|
|
2
|
|
0
|
|
|
|
1
|
|
|
Aucune Stockage Démarche d'acquisition
Evacuation
Source : Données de terrain, mars 2024
De ce graphique, il ressort que l'espace de stockage est l'un
des problèmes majeurs dans les industries de transformation du bois. En
effet, ne voulant pas systématiquement brûler tous leurs
déchets ou n'ayant pas trouvé de preneur, certains industriels
les stockent en attendant de trouver quoi en faire ou simplement pour
éviter de les brûler. Quant à ceux qui disent n'avoir
aucune difficulté avec la gestion de leurs déchets, ils ont
très souvent recours au brûlage systématique pour se
débarrasser des résidus non utilisés. Or, céder ces
matières aux unités de valorisation, c'est résoudre en
partie les problèmes d'encombrement et donner de la valeur aux
déchets pour de meilleurs usages. C'est le cas des débités
déclassés qui sont très prisés par les deux
unités de valorisation de la zone ; leur approvisionnement intensif
permet d'éviter une accumulation trop importante dans les unités
de sciage.
Le modèle d'économie circulaire de la ZIS
participe à réduire la proportion de gaspillage des
déchets de bois issus des processus de transformation de la grume ainsi
que la dépendance aux matières premières de bois. La
production totale des deux unités de valorisation en 2023 estimée
à 10466,893 m3 doit augmenter, afin de garantir une
transformation du bois qui atteint le taux de 75% prévu par le Code
forestier et au-delà. Lorsque les unités de valorisation
utilisent les déchets de bois comme matières premières,
elles limitent la pression sur l'extraction du bois en forêts et
participent à l'innovation technique. « La valorisation des
déchets est vue comme
73
un évitement de l'élimination notamment la
mise en décharge, mais également comme le moyen de produire des
coproduits à partir des déchets. C'est-à-dire sans avoir
recours à des ressources naturelles » (Ventura et al., 2022,
p.7).
De plus, la collecte des déchets destinée
à la valorisation, limite dans une certaine mesure
l'insécurité liée au brûlage en plein air dans les
unités de transformation. Durant nos enquêtes de terrain, nous
avons constaté au sein de certaines unités à l'exemple de
Sen Jun que le lieu où les déchets sont brulés
n'est pas très souvent éloigné de l'entrepôt
où travaille et circule le personnel (cf. Photo 8).
Photo 8 : Lieu de brûlage non
aménagé

Cliché : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Cette photo met en évidence les déchets de bois
brûlés au sein d'une usine, prêt d'un bâtiment. Elle
révèle l'absence de mesure de sécurité quant au
lieu de brûlage des déchets et qui peut avoir de graves
conséquences.
3.2.2-Réduction de la pollution de l'air
Parler de réduction de la pollution de l'air suppose
qu'au départ, la qualité ne soit pas bonne, qu'il y a eu une
dégradation, une contamination de l'atmosphère et que des mesures
ont été prises pour limiter les effets pervers. La pollution de
l'air peut être la conséquence des processus de combustion, elle
est due à l'accumulation de substances nocives qui proviennent de
sources diverses et se répandent dans l'atmosphère. Dans la ZIS
de Nkok, en plus de l'élimination des déchets de bois par le
brûlage en plein air, d'autres industries comme la métallurgie, la
chaudronnerie ont recours à la combustion, ce qui libère des gaz
dans l'atmosphère. Pour lutter contre la pollution de l'air, Nino
Künzili (2020) propose cinq méthodes :
74
- Identifier ce qui est brûlé (ce qui est contenu
dans les matières brûlées) ;
- Limiter les émissions ;
- Fixer les valeurs des limites qui définissent les
objectifs à atteindre pour préserver la
qualité de l'air ;
- Mettre en oeuvre des mesures pour atteindre les valeurs limites
;
- Connaitre les concentrations de polluants et publier les
tendances.
Appliquées à la ZIS de Nkok et par rapport
à notre étude, nous identifions le dioxyde de carbone (CO2) comme
l'un des principaux gaz produits lors de la combustion des déchets de
bois. Par conséquent, l'introduction d'unités de valorisation de
ces déchets est un moyen d'éviter leur combustion massive dans
les UTB. La production de panneaux de particules notamment, n'a pratiquement
pas recours au brûlage des déchets si ce n'est pour l'alimentation
de la chaudière. Toutefois, l'obtention d'un air pur ou faiblement
pollué dans la ZIS reste à ce jour un objectif à
atteindre. En effet, comme les mesures de protection environnementale sont
récentes, il n'est pas objectif de se prononcer sur les retours positifs
de ces actions. Surtout qu'en face, les déchets de bois sont
brûlés en permanence dans les unités de transformation.
Rappelons que le brûlage des déchets représente 33% des
pratiques d'élimination de ceux-ci par les entreprises. Si l'on ajoute
ceux qui sont conduits à la décharge et qui finissent
brûlés soit 6% (voir. Graphique 7, p.51), cela fait un total de
39% des pratiques de brûlage des déchets de bois en plein air. De
plus, la perception des résultats d'une amélioration de la
qualité de l'air nécessite des études plus
poussées. Concernant notre étude, il serait prétentieux de
lier directement la réduction de la pollution de l'air à la
présence d'unités de valorisation des déchets de bois
bruts au regard des éléments évoqués plus hauts.
? Neutralité carbone et pollution de l'air dans la
ZIS de Nkok
Afin de connaitre son impact écologique et de mieux
contrôler ses émissions de CO2, la Zone d'Investissement
Spéciale de Nkok a effectué un bilan carbone et a
été certifiée ISO 14064-15 en neutralité
carbone par la Société Générale de Surveillance
Suisse (SGS). Ce bilan a été réalisé pour le compte
des années 2019, 2020 et 2021 (GSEZ, 2023). Il renforce le marketing de
la zone dans son engagement pour la protection de l'environnement, et
améliore davantage son image face aux potentiels investisseurs et
partenaires commerciaux.
5 Norme environnementale décernée aux
entreprises ou organismes qui souhaitent réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre et atteindre une neutralité carbone.
75
Le mot neutralité dans son étymologie provient
du mot neutre, du latin neuter qui ne signifie « ni l'un ni
l'autre » (Dictionnaire Larousse, 2018). « La neutralité
définit l'attitude d'une personne ou d'un organisme qui ne prend pas
parti dans un conflit ou une discussion » (ADEME, 2022, p.7).
Appliquée à la lutte contre le changement climatique, ce terme
laisse penser que le territoire, l'entreprise ou le produit ne contribue pas au
problème, qu'il est transparent face aux émissions de gaz
à effet de serre constatées (idem). Ce concept en vogue est un
objectif de l'accord de Paris. Dans l'accord de Paris (2015), il est
indiqué que pour limiter le réchauffement climatique en
deçà de 2°C, il est nécessaire d'atteindre la
neutralité carbone d'ici la deuxième moitié du
21ème siècle. Cette neutralité carbone vise
à équilibrer « toute émission » de gaz
à effet de serre issue de l'activité humaine par des
séquestrations anthropiques des quantités d'équivalentes
de CO2 (Nations Unies, 2015). Selon le parlement Européen, « La
neutralité carbone implique un équilibre entre les
émissions de carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère
par les puits de carbone » (Fournier, 2021). Toutes ces
définitions semblent conduire à un « équilibre
arithmétique » difficilement réalisable.
En nous appuyant sur les définitions
précédentes, nous avons représenté la
neutralité carbone tel un idéal d'équilibre (cf. Figure
5).
Figure 5 : Neutralité carbone
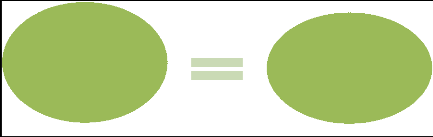
Emissions des gaz à effet de serre (GES)
Séquestration des GES par les puits de carbone
Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024
À ce jour, il est clair que la neutralité
carbone est un concept redondant, ambivalent et imprécis que
s'approprient pourtant de nombreuses entités (pays, entreprises,
organismes, marques de produits) pour afficher leur solidarité et leur
implication dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon
l'ADEME : « Pour atteindre la neutralité carbone, il faut
réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter
les séquestrations de CO2 dans les puits biologiques et technologiques
» (ADEME, 2022, p.6). En d'autres termes, la ZIS de Nkok dans le cas
actuel augmente ses capacités de séquestration de CO2 et
réduit ses activités polluantes ce qui lui permet de continuer
à revendiquer cette neutralité carbone.
76
Pour arriver à la conclusion qu'une entité est
neutre en carbone, il faut réaliser un bilan carbone pour
déterminer le niveau de pollution de celle-ci. Ce bilan permet in fine
d'identifier les efforts à fournir pour mieux orienter les objectifs et
la politique de réduction de l'emprunte carbone (carbo academy, 2023).
De plus, la neutralité carbone ne concerne que la réduction des
émissions de dioxyde de carbone car c'est le principal gaz à
effet de serre d'origine anthropique ; ses émissions sont facilement
comptabilisées et il est le plus absorbé par les puits de carbone
naturels (forêts, océans) (Fournier, 2021).
L'inventaire des émissions des gaz à effet de
serre réalisé ainsi que l'indique le tableau 11 ce qui suit.
Tableau 11 : Bilan carbone de la ZIS de Nkok
|
Années
|
Quantité de tonnes métriques
d'équivalents CO2
|
|
2019
|
50,037
|
|
2020
|
45,73
|
|
2021
|
57,987
|
|
Total
|
153,754
|
Source :
www.gsez.com Réalisation :
OBONE MBA Cécilia A, 2024
Il est indiqué dans ce tableau que le bilan carbone de
la ZIS de Nkok a été réalisé pour le compte des
années 2019, 2020 et 2021. On peut y voir que l'empreinte carbone de
l'année 2020 est faible par rapport aux années 2019 et 2021. Ceci
est peut-être lié à la pandémie de Covid-19 qui a
sévi le monde durant cette année, ralentissant la production dans
la ZIS et par conséquent le rythme d'émissions de gaz à
effet de serre. Dans le même élan, l'augmentation des
émissions durant l'année 2021 peut être liée
à la reprise des activités après la pandémie.
D'où l'on estime que les entreprises ont tenté de rattraper le
temps perdu en accélérant les activités. Ce qui a
favorisé l'augmentation des émissions de CO2 durant cette
année, soit 57,987 tCO2e contrairement à l'année 2020
où elles sont de 45,73 tCO2e, soit une quantité de
12,257 tCO2 e en plus.
L'inventaire du bilan carbone a concerné les
émissions directes et indirectes globales des champs d'application 1 ; 2
et 36. Par conséquent, les émissions des types
d'espaces, des bâtiments, des espaces de bureaux et des salles de
spectacle ont été mesurées (Our sustainability Legacy,
2023). Les émissions liées à la production, notamment de
bois transformés et à la gestion des déchets ne sont pas
mentionnées. Cette certification de la ZIS a été
octroyée en
6 Ce sont des sources d'émission de CO2,
classées selon le niveau d'émission des éléments
qui les constituent.
77
raison des efforts déployés pour réduire
son empreinte environnementale. Il s'agit de l'installation de l'unité
de valorisation du plastique Jia Ming Plastics Manufacturing et de la
société de conseil en qualité, hygiène et
sécurité, environnement SAFER. Par la suite, d'autres
unités de valorisation se sont installées, dont les unités
de valorisation des déchets de bois bruts que nous étudions. Des
mesures de compensation environnementale ont également été
prises (la monétisation des services et actifs environnementaux).
L'amélioration de la qualité de l'air par la
valorisation des déchets de bois bruts reste discutable en l'absence de
données statistiques qui sous-tendent cet argument. Car si les volumes
de déchets valorisés évitent le recours au brûlage,
nous ne saurions dire s'ils suffisent à compenser ceux
brûlés. Toutefois, les activités de valorisation sont
à encourager dès l'instant où les processus et
procédés de valorisation ne contribuent pas à accentuer le
problème.
La valorisation des déchets de bois bruts a un impact
positif certain sur le plan économique, social et environnemental. Elle
contribue à la production de bois transformés et
génère de la richesse. Elle est également un moyen
efficace de lutte contre le gaspillage des matières. Toutefois, son
impact sur la pollution de l'air est encore moindre.
78
CHAPITRE 4 : LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA
VALORISATION DES DÉCHETS DE BOIS BRUTS DANS LA ZIS DE NKOK
Comme toute activité économique, la valorisation
des déchets de bois connait quelques difficultés qui tendent
à freiner son dynamisme et menacent l'efficacité du processus
d'économie circulaire mis en place. Ces difficultés incluent les
irrégularités des activités, les modes d'acquisition des
déchets et les problèmes d'approvisionnement en
déchets.
4.1-Irrégularités des activités de
valorisation des déchets de bois
4.1.1-Dispositions légales défaillantes
Les dispositions légales dont il est question dans
cette partie concernent principalement les vides juridiques constatés
dans le Code de l'environnement et le Code forestier. En droit, le vide
juridique fait référence à « f...] un espace dans
lequel il n'y a pas de droit, il renvoie à une notion de lacune de droit
et de non-droit f...] » (HO DINH, 2007, p.420). Autrement dit, les
dispositions sur la gestion des déchets de bois et toutes les
étapes qu'elle englobe dont la valorisation, manque de précision,
de détails qui permettraient d'orienter les actions en termes de
gestion. D'ailleurs, le Code de l'environnement donne des orientations
générales qui sont appliquées sur tous les types de
déchets considérés comme non dangereux. La valorisation
des déchets est présentée comme une option à
envisager et non pas comme une activité à part entière
devant être pratiquée en fonction du déchet. De même,
dans le Code forestier, il n'y a pas de statut juridique qui définit les
déchets de bois. Pourtant, de nombreuses industries artisanales
utilisent ces résidus en tant que matière première, sans
pour autant déclarer leurs activités comme étant de la
valorisation, bien qu'elles le fassent en pratique. Dans le sciage artisanal ou
les petites menuiseries par exemple, les déchets de bois bruts
industriels constituent une partie importante des matières
premières (Lescuyer et al., 2011).
De plus, l'absence de marché formel des déchets
de bois qui permet de fixer les prix des déchets, selon les types ou les
essences de bois est une autre entorse à la traçabilité
sur les gains générés par cette activité. Pour
aider dans ce sens, en 2022, la Direction de la Valorisation des Rebuts
Industriels de Bois et de la Promotion des Bioénergies (DVRIBPB) a
soumis pour examen, un projet de texte fixant les modalités de gestion
des rebuts de bois et un projet d'arrêté portant commercialisation
de ces rebuts. De même, les approvisionnements des unités
artisanales extérieures sont moins réguliers du fait du protocole
administratif lourd qui exige certains critères pour collecter les
déchets de bois au sein de la zone. Si d'une part, ces mesures
79
assurent à l'administration une
traçabilité des mouvements de déchets et limitent
l'accès aux entités extérieures, d'autre part, elles
ralentissent la collecte et le désengorgement des unités de
transformation.
4.1.2-Mode d'acquisition des déchets de bois
bruts
Le mode d'acquisition des déchets de bois bruts par les
unités de valorisation pose un problème pour leur
activité. Les unités de transformation qui sont les productrices
de ces déchets de bois, ont été invitées à
les donner gratuitement aux unités de valorisation situées dans
la ZIS. Or, pour certaines unités de production, ces rebuts de bois
constituent un marché informel avec des artisans hors zone. La
valorisation des déchets de bois générant des
activités et des revenus significatifs, elle intéresse de plus en
plus les unités de transformation du bois. Ces UTB, propriétaires
des rebuts, voient dans leur collecte une source de profit économique.
Par exemple, chez Somivab, les revenus de la vente des déchets de bois
servent à verser des primes aux ouvriers.
De plus, si l'on tient compte des coûts que supportent
ces unités pour l'abatage de l'arbre en forêt et le transport de
la grume jusque dans le parc à bois de la ZIS, on comprend la
réticence de certaines UTB à vouloir céder gratuitement
leurs déchets. Ces déchets de bois bruts sont des matières
premières précieuses. De ce fait, l'acquisition gratuite des
déchets de bois bruts par les unités de valorisation de la zone
ne leur garantit pas toujours un approvisionnement régulier. Au
contraire, elle fait en sorte que les unités de valorisation se
retrouvent parfois avec des périodes de faible production puisque
l'approvisionnement dépend du bon vouloir des UTB à céder
leurs déchets. Surtout qu'en face, les unités artisanales paient
pour l'octroi de ces déchets. Le graphique 10 suivant recense les avis
des industriels sur le choix de cession gratuite ou non de leurs déchets
de bois aux unités de valorisation.
Graphique 10 : Choix de cession des déchets de
bois
|
16
|
|
14
14
|
|
12
|
|
|
|
10
|
10
|
|
8
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
4
|
|
4
|
|
2
|
|
|
|
0
|
|
|
|
OUI NON SANS
|
Source : Données de terrain, mars 2024
80
Il semble que le plus grand nombre d'unités de
transformation soit prêt à céder gratuitement leurs
déchets de bois (14 avis sur 10). Quant à ceux qui ont
répondu par la négation, ils ont évoqué la
nécessité de fixer un coût, même faible, pour
l'acquisition des déchets de bois. Surtout qu'ils sont
récupérés pour produire de la richesse, ils ne constituent
donc plus totalement des déchets au sens propre du terme. À
l'usine Somivab, 30% des déchets produits (débités
déclassés, dosses) sont donnés aux ouvriers sous forme de
prime. À leur tour, ils les revendent aux unités artisanales pour
49.000 F CFA le camion. Dans cette somme, il faut compter 20.000 F CFA pour la
location du camion, 3000 F CFA pour les frais de douane, 1000 F CFA pour
l'environnement, ce qui fait un total de 24.000 F CFA. Les 25.000 F CFA restant
sont reversés à l'entreprise qui, après accumulation des
ventes, les redistribue en complément du salaire de chacun. Le nombre de
camions de déchets de bois vendus chaque jour varie entre 3 et 5
camions. Les 70% de déchets restants sont collectés gratuitement
par l'unité de valorisation de charbon actif.
De ce qui suit dans la figure 6 ci-dessous, il apparait que
les déchets de bois bruts industriels sont des matières
très convoitées.
Figure 6: Demande en déchets de bois
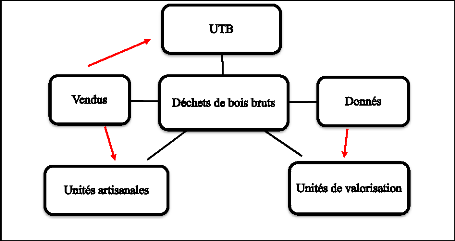
Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Cette figure présente les demandeurs des déchets de
bois bruts produits dans les unités de transformation et les modes
d'acquisition de chacun :
81
- Les industriels (UTB) qui s'approvisionnent entre eux pour
le chauffage, ou pour dérouler davantage la bille, achètent ces
matières ;
- Les unités artisanales extérieures pour qui
les rebuts industriels constituent une part importante de leurs matières
premières achètent également leurs déchets de bois
;
- Enfin les unités industrielles de valorisation
installées dans la ZIS pour qui ces déchets sont exclusivement
des matières premières pour leurs activités, les
acquièrent gratuitement.
À travers cette figure, on peut voir toute la
mobilisation qu'il y a autour des déchets de bois bruts issus des
industries de première et deuxième transformation de la ZIS de
Nkok. Ce sont des matières très convoitées qui
méritent que les pouvoirs publics s'y intéressent un peu plus.
Cette figure interroge également le mode d'acquisition pratiqué
par les unités de valorisation.
D'après les échanges avec un responsable de
l'unité de charbon actif, cette attitude des unités de
valorisation s'explique par le fait que : « f...] en s'installant dans
la ZIS de Nkok, les unités de valorisation ont eu à passer des
accords en termes d'approvisionnement avec le groupe
GSEZ.SA qui leur a garanti des
approvisionnements gratuits auprès des UTB ». (ZIS de Nkok, le
19/02/2024). Toutefois, hormis la note administrative signée par
l'ancien Administrateur Général, il n'existe pas de disposition
juridique contraignant les UTB à céder leurs déchets de
bois, ni ne déterminant les modalités d'accès aux
déchets de bois bruts. Au contraire, l'article 93 du Code de
l'environnement dispose que : « Toute personne physique ou morale,
publique ou privée, qui produit ou détient des déchets,
est tenue d'en assurer la gestion ». Cela signifie que les
procédés d'élimination des déchets de bois produits
dans les entreprises relèvent de la responsabilité de celles-ci,
ceci dans le respect de l'environnement.
4.2-Les difficultés en matière
d'approvisionnement des déchets de bois bruts
L'installation des industries de transformation du bois dans
la ZIS de Nkok garantit leur approvisionnement en matières
premières. Pour les unités de première et de
deuxième transformation, l'approvisionnement se fait au parc à
bois de la ZIS. Les unités de valorisation des déchets de bois
s'approvisionnent auprès des UTB. Cependant, cette disposition prise en
faveur des unités de valorisation semble insuffisante pour satisfaire
les approvisionnements sur les plans quantitatif et qualitatif.
82
4.2.1-Sur le plan quantitatif
L'une des préoccupations évoquées par les
deux unités de valorisation des déchets de bois encore en
activité au sein de la ZIS de Nkok est l'approvisionnement quantitatif
des matières premières. En effet, étant dans le processus
industriel, l'activité de valorisation ne doit pas à priori,
connaitre d'interruption. Or, l'approvisionnement en quantité de
déchets est une limite à la valorisation pour diverses raisons.
D'abord, le nombre d'unités de production qui alimente les unités
de valorisation est relativement faible ; ensuite se pose le problème de
fréquence des approvisionnements et enfin celui des volumes de
déchets collectés.
? L'insuffisance des unités
d'approvisionnement
Rappelons que l'acquisition des déchets de bois bruts
pour les unités de valorisation installées dans la ZIS, se fait
gratuitement. Ainsi, parmi les 41 unités identifiées dans la
première et deuxième transformation, seulement 12 fournissent
régulièrement des matières aux unités de
valorisation (voir. Tableau 12). Cela indique que les 29 unités
restantes ne contribuent pas effectivement au processus d'économie
circulaire.
Tableau 12 : Les unités d'approvisionnement en
déchet de bois bruts
|
N°
|
Nom des
unités
d'approvisionnement
|
Situation Géographique
|
Segment d'activité
|
|
1
|
Fortune Lumber
|
Nkok
|
Sciage
|
|
2
|
Gabon Meubles Modernes
|
Nkok
|
Sciage
|
|
3
|
Gabon Veneer
|
Nkok
|
Placage
|
|
4
|
Green Ply
|
Nkok
|
Placage
|
|
5
|
Lian Sheng
|
Nkok
|
Sciage
|
|
6
|
Offeri
|
Nkok
|
Placage
|
|
7
|
RDDHI (Shinago)
|
Nkok
|
Sciage
|
|
8
|
Somivab
|
Nkok
|
Sciage
|
|
9
|
Star Ply
|
Nkok
|
Placage
|
|
10
|
Wood Pro
|
Nkok
|
Sciage
|
|
11
|
Wood Tech
|
Nkok
|
Sciage
|
|
12
|
Wood Value
|
Nkok
|
Sciage
|
|
13
|
TBNI
|
Kango
|
Sciage
|
|
14
|
Gahodi
|
Okolassi
|
Sciage
|
Source : Données de terrain, mars 2024
83
Ce tableau nous renseigne sur les entreprises qui
approvisionnent régulièrement les unités de valorisation
de la zone. Au nombre de 14, il en ressort que les unités de sciage sont
les plus sollicitées, comptant 10 entreprises sur le total cité.
Les quatre (4) autres unités s'inscrivent dans la pratique du
déroulage-placage. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'unité
de charbon actif n'utilise que les déchets de sciage
(débités déclassés). De même, l'unité
de panneaux de particules a également recours à ces
déchets de sciage (débités, sciure, copeau) en plus de
ceux du déroulage.
On remarque également dans ce tableau que deux des
unités d'approvisionnement citées ne sont pas installées
dans la zone. Il s'agit de l'entreprise TBNI situé à Kango et de
Gahodi située à Okolassi. Ces deux entreprises renforcent les
approvisionnements en déchets de bois bruts de l'unité de charbon
actif qui rencontre très souvent des difficultés dans
l'approvisionnement de ses matières premières au niveau de la
ZIS. En effet, le nombre d'unités de sciage dans la ZIS est relativement
faible. Sachant que la production de charbon actif n'utilise qu'une infime
gamme des déchets de sciage, ces unités viennent en appui sur le
plan quantitatif et même qualitatif pour la collecte des déchets
de bois dont l'entreprise a besoin pour sa production. Cependant, lorsque la
collecte est faite dans ces unités, l'entreprise paie le camion des
déchets à 20.000 F CFA et les camionneurs peuvent mettre
jusqu'à deux jours sur le lieu de collecte avant de revenir à
l'usine.
Les unités de sciage étant sollicitées
par les deux unités de valorisation, le problème
d'approvisionnement quantitatif se pose car ces unités sont peu
nombreuses et ne fonctionnent pas toutes correctement (cf. Graphique 11).
Graphique 11: État réel des UTB
|
35
|
|
|
|
|
30
|
|
|
|
|
25
|
25
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
10
|
7
|
|
|
|
|
5
|
|
3 3
|
|
2
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
En activité Fermée
|
Baisse d'activité
|
En construction
|
Etat réel
Sciage Déroulage
30
Total
Source : Données de terrain, mars 2024
84
De ce graphique, on retient d'abord que le nombre
d'unités de sciage a baissé par rapport à l'année
2022 où l'on comptait 15 unités, toutes en activité (cf.
Tableau 3, p.27). Aujourd'hui, nous les évaluons à onze (11). De
ces onze, on constate que seules sept (7) sont en activité
régulière ; trois (3) en fermeture temporaire et une (1) en
baisse d'activité. Ce qui réduit considérablement le
nombre d'unités d'approvisionnement pour les unités de
valorisation. Dans le déroulage, le nombre d'unités a
légèrement baissé. Sur un total de trente (30)
unités, on compte vingt-cinq (25) qui sont en activité, trois (3)
qui sont en fermeture temporaire et deux (2) en construction. Il est à
noter que certaines scieries se sont transformées en entrepôts de
stockage et ne procèdent plus ou procèdent peu à la
transformation du bois sur site. Celle-ci est réalisée hors de la
zone. Par ailleurs, les unités de déroulage, bien que
répertoriées comme des entités séparées,
appartiennent en fait à une seule et même société et
fonctionnent sous des noms différents. Cela a conduit à une
diminution du nombre d'unités de déroulage-placage
enquêtées dans notre étude, en comparaison avec les
données du rapport de la DGICBVPF en 2022.
? La fréquence des approvisionnements
L'approvisionnement étant tributaire de la production
de chaque unité de transformation du bois (UTB), il en résulte
que toutes les unités ne fournissent pas leurs résidus avec la
même régularité, entraînant des problèmes de
constance dans les approvisionnements. Le graphique 12 suivant illustre la
fréquence mensuelle des approvisionnements de certaines unités de
transformation.
85
Graphique 12: Fréquence mensuelle des
approvisionnements
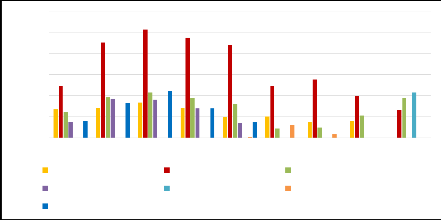
Nombre de tours
200
150
100
50
0
300
250
Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Novembre Décembre
Wood Pro Gabon Meubles Modernes RDDHI
(Shinago)
Lian Shen Olam Fortune Lumber
Somivab
Source : Données de terrain, mars 2024
Ce graphique ne concerne que l'unité de charbon actif
Huaxing Environnement Gabon. Il fait état de la fréquence des
collectes de déchets effectuées dans les unités de
production de la zone, durant la période allant des mois d'avril
à décembre 2023. Cette fréquence fait
référence au nombre de tours que les camions des unités de
valorisation ont effectués au cours de l'année dans les
industries de transformation. D'après ce graphique, on observe de
manière générale que l'unité Gabon Meuble Modernes
se distingue par ses approvisionnements qui sont plus ou moins
réguliers. En effet, cette entreprise réalise des
approvisionnements mensuels d'au moins 50 rotations de camion, pouvant
atteindre un maximum de 250 rotations de collecte. Les approvisionnements ont
été constants, bien que la tendance ait diminué
progressivement avec le temps.
On peut également lire sur le graphique que les mois
les plus productifs en déchets de bois dans ces entreprises
correspondent à la période qui va de mai à août
2023, pour l'ensemble des unités d'approvisionnement. Quant aux mois les
moins productifs, ils se situent dans la période de septembre à
décembre 2023. En outre, le nombre d'unités de transformation
fournissant les unités de valorisation a diminué. Il est
passé de six à quatre unités entre septembre et octobre,
puis à trois en novembre et décembre. Durant le mois de
décembre, c'est l'entreprise Olam (GSEZ) qui a partiellement
approvisionné l'unité de charbon actif. De plus, le nombre de
rotations réalisées par les entreprises a chuté, passant
de plus de 200 rotations mensuelles à moins de 150 pour la
majorité des unités.
86
Le graphique 13 nous permet de mieux apprécier les
tendances des approvisionnements mensuels dans les UTB.
Graphique 13 : Tendance des fréquences mensuelles
des approvisionnements
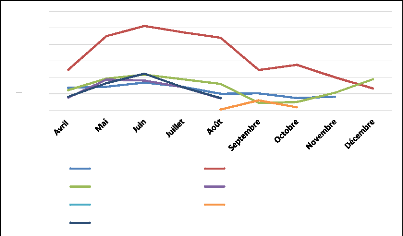
Nombre de tours
300
250
200
150
100
50
0
Wood Pro Gabon Meubles Modernes
RDDHI (Shinago) Lian Shen
Olam Fortune Lumber
Somivab
Source : Données de terrain, mars 2024
Ces courbes confirment nos analyses précédentes,
montrant les évolutions des approvisionnements de chaque entreprise. De
plus, l'analyse des courbes de tendance des fréquences
d'approvisionnement en déchets de bois est un indicateur clé qui
nous permet d'évaluer le dynamisme des unités de sciage. À
la lecture de celles-ci, les unités telles que Gabon Meubles Modernes,
RDDHI (Shinago) et Wood Pro sont les plus dynamiques et les plus constantes.
? Les quantités de déchets
collectés
La fréquence des approvisionnements est liée
à la quantité de déchets collectés par les
entreprises. Le graphique 14 ci-dessous donne un aperçu des
quantités de déchets collectés mensuellement auprès
de chaque unité d'approvisionnement.
87
Graphique 14 : Quantités de déchets
collectés par l'unité de charbon actif
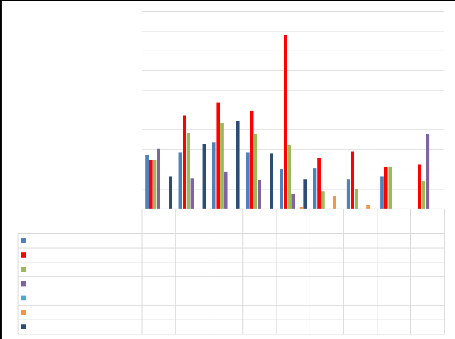
en tonnes
600
500
400
300
200
100
0
1000
900
800
700
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
Juillet
|
Août
|
Septe mbre
|
Octobr
e
|
Novem bre
|
Décem bre
|
|
Wood Pro/4t
|
272
|
284
|
336
|
284
|
200
|
204
|
148
|
164
|
|
|
Gabon Meubles Modernes/2t
|
246
|
472,5
|
537,6
|
497
|
880
|
256,2
|
289,8
|
210
|
224
|
|
RDDHI (Shinago)/4t
|
244
|
384
|
432
|
376
|
320
|
88
|
100
|
212
|
138,6
|
|
Lian Shen/2t
|
304
|
153,3
|
189
|
147
|
75,6
|
|
|
|
376
|
|
Olam
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fortune Lumber/4t
|
|
|
|
|
8
|
63
|
18,9
|
|
|
|
Somivab/4t
|
164
|
328
|
444
|
280
|
148
|
|
|
|
|
Source : Données de terrain, mars 2024
Pour collecter les déchets, l'unité de charbon
actif utilise des camions de 2 et 4 tonnes. Les quantités de
déchets collectés mensuellement varient d'une entreprise à
une autre, selon le dynamisme et la régularité de chacune. Comme
constaté avec la fréquence des approvisionnements, c'est
l'entreprise Gabon Meubles Modernes qui est en tête des
approvisionnements sur le plan quantitatif. Les quantités de
déchets collectés mensuellement dans cette entreprise varient
entre 200 et 880 tonnes de déchets de bois bruts. Mais, d'une
manière générale, nous constatons dans ce graphique deux
faits concernant les quantités de déchets collectés dans
les UTB. Le premier fait concerne l'évolution des quantités de
déchets collectés par l'ensemble des entreprises, allant d'avril
à août. Les quantités de déchets collectés
fluctuent entre 153 et 880 tonnes pour toutes les entreprises, à
l'exception de Fortune Lumber qui a fourni 8 tonnes à l'unité de
charbon.
88
À partir du mois de septembre jusqu'à
décembre 2023, l'unité de charbon actif a fait face à une
baisse importante de ses approvisionnements quantitatifs pour l'ensemble des
entreprises. Dans les faits, les quantités de déchets
collectés varient entre 18,9 et 376 tonnes de déchets. On
pourrait supposer que le contexte politique du pays à cette
période de l'année 2023 (coup d'état, nouvelle
équipe dirigeante), a eu une incidence sur la production des
unités de transformation et par ricochet sur la production des
déchets de bois. L'incertitude des liaisons et partenariats avec le
pouvoir actuel a pu freiner les industriels dans la continuité normale
de leurs activités.
Le graphique 15 qui suit présente les quantités
de déchets collectées par les deux unités de valorisation
au cours de l'année 2023 et vient renforcer l'argument du
problème d'approvisionnement que rencontre particulièrement
l'unité de production de charbon actif.
Graphique 15: Quantités de déchets
collectés par les deux unités de valorisation
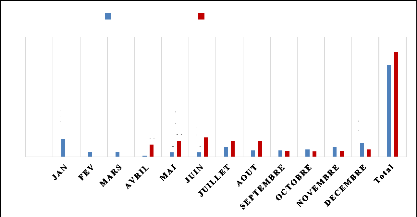
Tropical Forest Huaxing Environnement
9141,3
10498,5
1792,21
508,11
513,81
102,52
1230
459,9
1621,8
450,61
1938,6
957,5
1584
645
1631,6
645,25
611,2
747,12
556,7
960,7
586
1358,57 738,6
En Tonne
Source : Données de terrain, mars 2024
L'approvisionnement de Tropical Forest débute en
Janvier contrairement à celle de Huaxing Environnement qui a
débuté en avril. Cette unité a collecté des
quantités de déchets inférieurs à l'unité de
charbon actif, soit 9141,3 m3 pour l'unité Tropical Forest
contre 10498,5 m3 pour Huaxing. Mais, dans la production cette unité a
une production supérieure (voir. Tableau 7, p.65). Ceci montre que la
production de charbon actif consomme beaucoup plus de déchets que la
production de panneaux de particules et confirme le problème
d'approvisionnement quantitatif pour l'unité de charbon actif.
Bien que ses données soient peu analysées dans
ce pan du travail, l'entreprise de panneaux de particules dit rencontrer
quelques difficultés d'approvisionnement en déchets de bois,
en
89
raison de la concurrence pour l'acquisition des
déchets. Elle envisage s'orienter vers les scieries industrielles
situées à l'extérieur de zone, précisément
à Owendo, si le problème persiste.
4.2.2-Sur le plan qualitatif
Le problème d'approvisionnement qualitatif concerne les
types d'essences dont les unités de valorisation ont besoin pour
réaliser leur production. Dans le cas précis, il s'agit
spécifiquement de l'unité de production de charbon actif qui
rencontre des difficultés dans l'approvisionnement qualitatif de sa
matière première. En effet, l'un des principaux critères
pour la production de charbon de bois est la dureté. Plus le bois est
dur, plus la combustion est lente, il a du mal à s'effriter et ceci
permet un bon rendement. De ce fait, pour produire du charbon actif, la
qualité de l'essence est primordiale pour garantir la qualité du
produit et assurer sa rentabilité. Au Gabon, on distingue parmi les
essences de bois, l'Okoumé et les bois divers. Cette distinction se fait
sur la base des propriétés des bois et des usages auxquels ils
sont favorables. Le tableau 13 ci-dessous renseigne quelque peu sur les
caractéristiques de ces bois qui permettent cette distinction.
Tableau 13: Caractéristiques de l'Okoumé et
des bois divers
|
Essences
|
Caractéristiques
|
Domaines d'usage
|
|
Okoumé
|
Léger, très disponible, bonne densité,
favorable
au déroulage, peu onéreux et de
faible
concurrence sur le marché international.
|
Déroulage,
construction navale, contre-plaqués.
|
|
Bois divers
|
Durs, lourds, peu disponibles, abatage et sciage très
onéreux, forte concurrence
|
Production de Charbon, chemin de fer, mobilier
|
Source : LASSERRE, 1955 et EDOU, 2004 Réalisation : OBONE
MBA Cécilia A, 2024
L'examen des données du tableau 13 indique que les
propriétés de l'Okoumé ont longtemps suscité un
intérêt particulier pour ce bois, contrairement aux autres
essences du Gabon. Malgré une estimation de soixante essences
exploitables, l'Okoumé demeure le bois le plus récolté et
le plus vendu. Ce bois a su se maintenir dans le temps depuis 1889 à nos
jours (EDOU, 2004). D'ailleurs, « La dichotomie dans l'utilisation des
termes (Okoumé/ Bois divers), f...] rend bien compte de la place et du
rôle moteur joué par l'Okoumé dans l'économie du
pays mais aussi à l'échelle internationale. » (Kombila
Mouloungui, 2019, p.58). La carte suivante donne un aperçu de sa
répartition géographique de cette essence au niveau du Gabon.
90
Carte 4 : Aire de répartition géographique
de l'Okoumé
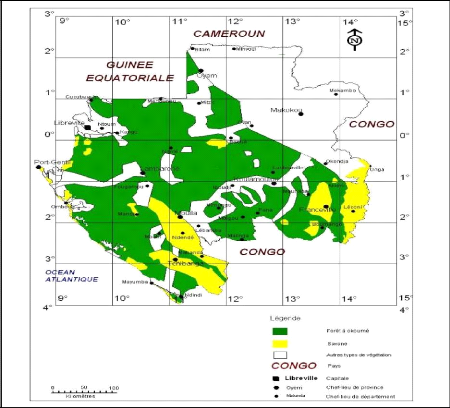
Source : MALOBA MAKANGA, 2011
En termes de répartition géographique,
l'Okoumé représente les trois quarts des essences du pays. En
dehors de quelques zones où il est quasi absent (zone du Nord et de
l'Est, une infime partie du Nord-ouest, du Sud et du Sud-est), l'Okoumé
est réparti dans l'ensemble du territoire national. Cette
répartition géographique au niveau du Gabon peut s'expliquer par
le fait que la croissance de l'Okoumé nécessite des milieux ayant
une pluviométrie et un taux d'humidité élevé
(Maloba Makanga, 2011). Ce bois est également l'essence la plus
exploitée du pays. Selon la DGICBVPF (2022), le volume d'exportation de
l'Okoumé s'élève à 857.239,47 m3 suivi
du Beli rouge 45.511,94 m3. Aussi, l'étude d'impact
économique portant sur l'industrie du bois au Gabon montre que cette
essence reste à ce jour l'essence de bois la plus exploitée.
Même si on note une diminution relative du taux d'exploitation durant les
six dernières années, passant de 63% en 2017 à 57% en 2022
(Mouissi, 2023).
91
Quant aux bois divers, ils rassemblent les bois dont les
caractéristiques physionomiques sont plus ou moins rugueuses. Les bois
divers sont des bois durs. Leur exploitation a souvent été
difficile compte tenu de leur densité qui n'était pas favorable
au flottage et rendait l'évacuation difficile (Lasserre, 1955). Les bois
divers sont dispersés à travers un peuplement forestier
hétérogène ; leur densité à l'hectare est de
5 à 8 pieds contrairement à l'Okoumé dont la
densité est de 10 à 30 pieds l'hectare (Missang Mi-Ndong, 2006).
Leur production est complémentaire car ils sont exclusivement
destinés à un marché de niche. Ces bois sont plus
favorables au sciage, ils ont une qualité esthétique et durable.
Selon Ngangori (2018), les principaux critères de
préférence pour la production du charbon de bois sont la
dureté, la combustibilité et la disponibilité du bois. De
ce fait, les essences les plus utilisées par les producteurs de charbon
de bois sont les bois divers tels que : l'Azobe, le Béli, l'Okan, et le
Tali. Le tableau 14 ci-après identifie les essences de bois divers les
plus exploitées au Gabon.
Tableau 14 : Les essences de bois divers les plus
exploitées
|
Essences
|
Noms scientifique
|
|
Le Niové
|
Staudtia spp
|
|
Le Beli rouge
|
Julbernardia pellegriniana
|
|
Le Dabema
|
Piptadeniastrum africanum
|
|
L'Okan
|
Cylicodiscus gabunensis
|
|
L'azobe
|
Lophira alata
|
|
Le padouk
|
Pterocarpus soyauxii
|
|
Le Tali
|
Erythrophleum ivorense
|
Source :
www.timbertradeprtal.com
Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Dans la ZIS de Nkok, l'Okoumé est très
présent, autant dans les unités de déroulage que les
scieries. Cela signifie que la majeure partie des déchets de bois
produits dans les unités de transformation, sont des déchets
d'Okoumé. Or, cette essence de bois n'est pas la plus prisée pour
la production de charbon actif. Elle ne réagit pas favorablement
à une combustion trop élevée car elle s'effrite
facilement. D'ailleurs, lors du chargement des fours pour la première
combustion, l'entreprise utilise 80% de bois divers et 20% d'Okoumé. Le
graphique 16 donne une idée du pourcentage d'utilisation de ces essences
de bois par les UTB.
92
Graphique 16 : Utilisation des essences de bois dans la
ZIS de Nkok
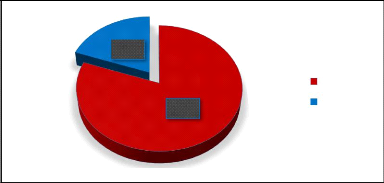
19%
81%
Okoumé Bois divers
Source : Données de terrain, mars 2024
Il apparait à la lecture de ce diagramme que
l'utilisation de l'Okoumé dans la ZIS, dépasse de loin celle des
bois divers (81% pour l'Okoumé contre 19% pour les bois divers). Ceci
s'explique par l'importance du segment de déroulage qui utilise
exclusivement l'Okoumé comme essence de bois. Ce problème
d'approvisionnement qualitatif est l'autre raison qui a conduit l'unité
de charbon actif à s'orienter vers les usines de sciage TBN et Gahodi
situées à l'extérieur de la ZIS.
4.3-Orientations pour une meilleure gestion et une
valorisation plus efficiente des déchets de bois bruts dans la ZIS de
Nkok
Améliorer les impacts de la valorisation des
déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok nécessite certains
préalables. Bien que les pratiques de valorisation de ces déchets
soient récentes (2019), les déficits relevés devraient
interpeller le plus tôt possible les autorités de la zone. Cela
afin qu'elles prennent les mesures adéquates pour mieux orienter ces
activités qui participent au rayonnement de la ZIS. Pour ce faire, il
faut agir en premier sur les textes juridiques. Il y a aussi la
nécessité d'attirer des investisseurs capables de traiter les
déchets peu valorisés (chutes de placage, sciure, copeaux et
écorces) et de développer un marché de vente des rebuts de
bois avec des prix fixes.
Le graphique 17 ci-dessous rend compte des suggestions
apportées par les unités de transformation pour améliorer
la gestion de leurs déchets de bois.
93
Graphique 17 : Suggestions des UTB
|
Interconnexion Révision procédure
Unité Supl Gestion com
|
|
|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Source : Données de terrain, mars 2024
Il apparait que l'insertion d'une unité
supplémentaire de valorisation, la révision des procédures
de collecte pour les unités artisanales extérieures et la gestion
commune soient les recommandations les plus relevées. À partir de
ces recommandations, nous formulons notre vision de la gestion des
déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok.
4.3.1-Orientations juridiques
Les dispositions prises en interne par les organismes de
gestion et administratif sont des mesures compensatoires pour tenter de limiter
le gaspillage des matières, au regard des nombreux usages que l'on peut
en faire. Par contre, l'amélioration du cadre légal sur la
gestion des déchets au Gabon et du Code forestier permettrait de
renforcer ces dispositions. C'est sans doute le moment de prêter
attention au projet de texte fixant les modalités de gestion des rebuts
de bois et au projet d'arrêté portant commercialisation des rebuts
de bois soumis par la Direction de la Valorisation des Rebuts Industriels de
Bois et de la Promotion des Bioénergies (DVRIBPB) du Ministère
des Eaux et Forêts.
4.3.2-Recherche d'investisseurs
Il est important de rechercher des opérateurs
économiques capables de valoriser les déchets de bois peu
prisés par les unités de valorisation actuelles (chutes de
placage, sciure, copeaux et écorces). L'entreprise Gabon Pellets
qui a fermé ses portes il y a peu, valorisait uniquement les
déchets de sciure, copeaux et les chutes de placage pour la production
de pellets. En raison de nombreuses pannes des machines et de fonds
insuffisants, l'entreprise a dû fermer
94
ses portes. À défaut, l'État gabonais
doit financer des projets de recherche ou de valorisation de ces déchets
de bois. L'objectif n'est pas de multiplier les unités de valorisation
au sein de la ZIS car cela poserait des problèmes en matière
d'approvisionnement pour chaque unité. Mais, il est nécessaire
d'avoir une unité supplémentaire qui valorise les déchets
de fragments à l'exemple de Gabon Pellets. D'ailleurs, des études
ont montré le potentiel des déchets de sciures et de copeaux pour
l'agriculture à travers la production de compost (Lumpungu et al, 2016)
et la fabrication de briques en terre cuite (Abjaghou, 2020).
Sur la photo 9 ci-dessous, nous observons ce qui s'apparente
à un bloc de terre allongé au bord d'un cours d'eau. Pourtant, ce
bloc n'est autre que la sciure et le copeau stockés depuis des
années par l'usine de sciage Somivab.
Photo 9 : Mur de déchets de sciure et copeaux
à Somivab

Cliché : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Cette photo traduit la prise de conscience de l'entreprise
face à la valeur de ces déchets. Lors de nos échanges avec
une des responsables de l'entreprise, il nous a été confié
que l'entreprise envisage valoriser ces déchets elle-même ou
rechercher un partenariat avec une unité capable de les valoriser.
En outre, pour que la gestion des déchets de bois dans
la ZIS de Nkok soit plus structurée, il faut créer ou installer,
une unité de collecte générale des déchets de bois.
À la manière d'un « écocentre » ou d'un
centre de dépôt des déchets, cette entité se
chargera de récupérer tous les déchets de bois dans les
UTB et à partir d'elle, les unités de valorisation pourront
s'approvisionner. Cela permettra de véritablement désencombrer
les unités de production et
95
d'éviter le recours au brûlage des déchets
en plein air. Cette unité se chargera également des
procédés d'élimination des déchets ayant une
dégradation trop avancée.
4.3.2-Fixation des coûts des rebuts
Si la valorisation des déchets de bois bruts augmente
leur valeur en générant de la richesse, il est normal que leur
acquisition représente des coûts qui inciteront davantage leurs
propriétaires (les UTB) à les céder. De ce fait, d'un
commun accord entre UTB et UVRB, il serait intéressant de fixer des prix
pour l'achat de ces déchets, afin que toutes les parties trouvent
satisfaction. Ces tarifications doivent tenir compte du type de déchets
(sciure, dosse, rondins) et du type d'essence (Okoumé, bois divers) dont
les propriétés n'orientent pas nécessairement vers les
mêmes procédés de valorisation.
Concernant les rondins par exemple, nous signalions plus haut
dans le texte que ces déchets sont vendus entre UTB au prix variant
entre 250 et 400 F CFA la bille. Cette tarification peut être
appliquée ou revue à la baisse pour les unités de
valorisation des déchets de bois. Notons que la vente des déchets
doit être assurée par l'unité de collecte
générale. Elle établira des contrats d'approvisionnement
avec les unités désireuses d'acquérir les déchets
de bois dans la ZIS. Pour mieux présenter notre vision de la gestion des
déchets de bois dans la ZIS de Nkok, nous avons réalisé la
figure 7 qui suit :
Figure 7: Modèle de gestion des déchets de
bois bruts dans la ZIS de Nkok
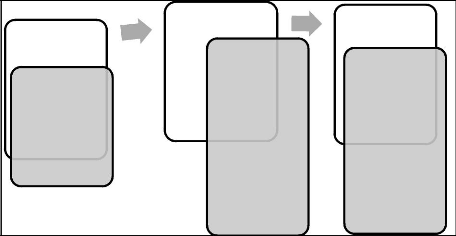
Unités de production des déchets
(UTB)
· - assurer l'approvisionn ement en déchets de
bois.
Centre de gestion et d'achat des
rebuts
· - assurer la collecte de tous déchets
de bois
· assurer la vente des rebuts
· - éliminer les déchets défectueux
Unités de valorisation
· - acheter les matières
premières à valoriser au centre de gestion
· - valoriser les déchets de bois
Réalisation : OBONE MBA Cécilia A, 2024
Cette figure met un accent particulier sur le centre de
gestion et d'achat des déchets de bois. Ce centre pourrait favoriser une
gestion coordonnée des déchets de bois bruts collectés
96
dans les unités de transformation du bois et faciliter
la chaine des approvisionnements pour les unités de valorisation. Le
centre de collecte et d'achat des rebuts de bois est également
dédié au stockage et au tri des déchets collectés
qui seront classés selon leur état de délabrement, leur
forme et le type d'essence de bois. Ceci, dans l'optique d'une meilleure «
gestion des stocks et des approvisionnements » (Van Pottelsberghe
de la Potterie, 2018). Le rôle de chaque entité étant bien
défini, le respect de ce processus permettrait de mieux organiser la
gestion des déchets de bois au sein de la ZIS de Nkok et de renforcer
les effets de la valorisation de ces déchets sur les plans
économique et environnemental. Il est inspiré de Van
Pottelsberghe de la Potterie (2018), qui met un accent sur l'utilité des
centres de collecte pour la valorisation et le développement de
l'économie circulaire des déchets de bois de construction.
Quant à la question sur l'achat de ces rebuts
auprès des unités de production, nous proposons que le centre
paie à coûts réduits, une partie des déchets
collectés. Car, il faut tout de même signaler qu'il les
désencombrera de la totalité de leurs déchets. Cet achat
partiel est en quelque sorte une compensation pour la collecte
effectuée. Ce schéma propose une gestion commune des
déchets de bois bruts industriels qui, sur le plan théorique,
s'avère efficace pour satisfaire les deux parties. D'une part, les
unités de transformation de bois en leur évitant d'investir de
l'argent pour la gestion de leurs déchets mais d'en tirer profit.
D'autre part, les unités de valorisation des déchets de bois, en
leur facilitant et leur les approvisionnements de ces matières.
De ce chapitre, l'on retient que la valorisation des
déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok est confrontée à
des problèmes d'ordre juridique, d'acquisition et d'approvisionnement
aussi bien quantitatif que qualitatif. Ces manquements sont une entrave pour la
valorisation mais également pour la gestion. Ayant cerné ces
limites, nous avons soumis des orientations pour une meilleure organisation de
la gestion des déchets de bois bruts au sein de la ZIS de Nkok.
97
Conclusion de la deuxième partie
La deuxième partie de ce travail a consisté
à montrer les impacts de la valorisation des déchets de bois
bruts dans la ZIS de Nkok (chapitre 3) ainsi que les limites de ces
activités (chapitre 4). Concernant les impacts, ils
révèlent que la valorisation des déchets de bois bruts
contribue à améliorer la production de bois transformés.
En effet, ce sont 1930,24 m3 de charbon actif et 8536,693
m3 de panneaux de particules qui ont été produits
durant l'année 2023. Ces déchets valorisés sont
destinés à priori au marché international asiatique
(Chine) et européen (France) pour le charbon actif. Pour les panneaux de
particules, 25% de la production est destinée au marché local et
75% au marché international. L'entreprise écoule sa marchandise
en Afrique centrale (Cameroun), de l'Ouest (Togo, Benin) et en Asie (Inde). De
plus, la valorisation des déchets de bois participe à la
création d'emplois et à l'amélioration du cadre
environnemental, à travers la lutte contre le gaspillage. Toutefois, ces
activités font face à des difficultés en termes de
reconnaissance juridique, de mode d'acquisition des déchets et
d'approvisionnement aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif.
99
Les volumes des déchets de bois bruts produits dans les
industries de transformation au Gabon sont assez importants et
présentent de nombreux enjeux qu'il est nécessaire de prendre en
compte. Ces déchets de bois bruts désignent toutes les
matières résiduelles issues des processus de première et
deuxième transformation de la grume, qui n'ont pas été en
contact avec des produits dangereux. La Zone d'Investissement Spéciale
de Nkok qui est une zone industrielle, compte à son actif plusieurs
unités évoluant dans la transformation du bois. La
présente étude avait pour objectif d'examiner le système
de gestion des déchets de bois de la ZIS de Nkok et de vérifier
l'efficacité des processus et procédés de valorisation mis
en place.
Pour mener à bien cette étude, nous l'avons
divisée en deux parties. La première partie a consisté
à faire un état des lieux du fonctionnement de la zone et de la
gestion des déchets de bois bruts produits. Il en ressort que la ZIS de
Nkok présente de nombreux atouts liés à son site, à
sa situation que nous qualifions de stratégique et à son statut
de zone économique spéciale, qui attirent les investisseurs
étrangers du secteur bois en particulier. En effet, la Zone
d'Investissement Spéciale de Nkok est construite à la confluence
de trois voies de communication majeures que sont : la route nationale 1, le
chemin de fer et le bras de mer Sogo qui débouche sur le port
commercial d'Owendo. Toutes ces voies de communication participent au dynamisme
de la zone en facilitant l'accès aux matières premières de
grumes et l'évacuation des produits transformés vers le port.
Aussi, les entreprises inscrites au régime privilégié
(ZIS-ZERP) bénéficient de nombreux avantages fiscaux et douaniers
dont les exonérations de l'impôt sur les sociétés et
bénéfices industriels pendant 10 ans, les exonérations de
tous les impôts, droits et taxes indirects, dont la TVA pendant 25
ans.
La gestion des déchets de bois bruts dans la Zone
d'Investissement Spéciale de Nkok est individuelle. C'est-à-dire
que chaque unité de transformation décide des orientations
qu'elle donne à l'utilisation de ses déchets. De ce fait, les
déchets de bois ne font pas l'objet une valorisation directe dans les
unités de valorisation. Les entreprises peuvent utiliser ces
déchets pour alimenter les chaudières, les vendre, les
brûler à l'air libre, les stocker, les mettre en décharge,
ou les donner aux unités de valorisation. Toutefois, dans l'optique de
limiter le gaspillage en ce qui concerne les déchets de bois
brûlés, l'organe d'aménagement de la ZIS qui n'est autre
que le groupe GSEZ S.A, a recherché des investisseurs capables de
collecter les déchets de bois dans les UTB et de les valoriser. Ces
unités de valorisation s'approvisionnent gratuitement auprès des
unités de transformation qui veulent bien céder leurs
déchets de bois. La collecte est sélective. Elle se fait en
fonction du type d'essence et de la morphologie des déchets. Les
déchets de bois bruts produits dans les unités de transformations
sont : les écorces,
100
les chutes de placage, la sciure, les copeaux, les rondins,
les dosses et les débités déclassés. Les
déchets valorisés dans l'ensemble sont : la sciure, les copeaux,
les rondins, et les débités déclassés.
Quantitativement, le segment de déroulage
génère la majorité des déchets. Cela est
probablement dû au fait qu'il est le plus répandu ; il compte 30
entreprises et a une consommation plus élevée de grumes par
rapport au sciage qui n'en compte que 11. En effet, au cours de la
période 2020-2022, le segment du déroulage a consommé plus
500.000 m3 de grumes par an tandis que celui du sciage ne
dépasse pas 200.000 m3. En combinant les volumes de grumes
consommées par chaque segment, on a estimé à 1.836.719
m3 la consommation totale de grumes dans le déroulage et
à 526.060 m3 la consommation totale de grumes par le segment
du sciage. Soit une consommation du segment de déroulage trois fois
supérieure à celle du sciage et dont le volume de
différence est de 1.310.659 m3 pour l'ensemble des
années 2020, 2021 et 2022. De même, dans la production des
déchets de bois, les volumes produits par le segment du déroulage
sont élevés par rapport à ceux du sciage. En 2020, les
volumes des déchets issus du déroulage ont produit 294.765
m3 de déchets contre 358.308 m3 produits en 2022 ;
ce qui représente 63.443 m3 de matière en plus. Or,
dans le segment du sciage, la production des déchets est estimée
à près de 91.311 m3 en 2020 contre 55.013
m3 en 2022, soit une production des déchets en moins,
estimée à 36.298 m3. La valorisation des
déchets de bois bruts est assurée par deux entreprises, jadis au
nombre de trois. Il s'agit de l'entreprise chinoise Huaxing environnement
Gabon installée depuis la fin de l'année 2019 et qui
réalise la production de charbon actif. Et de l'entreprise gabonaise
Tropical Forest Products opérationnelle depuis février
2023, qui produit des panneaux de particules. Chacune de ces unités
utilise différents types de déchets et d'essences de bois.
L'unité de charbon actif utilise les bois divers à 80% et
l'Okoumé à 20% ; elle n'a recours qu'aux déchets de sciage
notamment les débités déclassés. Quant à
l'unité de fabrication des panneaux de particules, elle utilise une plus
large gamme de déchets de bois composés de sciures, copeaux,
rondins et débités déclassés. Comme essence, cette
unité utilise essentiellement l'Okoumé.
La deuxième partie de ce travail a consisté
à montrer les impacts des activités de valorisation des
déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok, ainsi que les
difficultés rencontrées par les unités de valorisation.
Ces difficultés limitent la réalisation de leurs
activités. Il apparait dans le chapitre 3 sur les impacts des
activités de la valorisation que ces orientations contribuent à
l'augmentation des bois transformés à travers la production de
bois valorisés. Par exemple, la production de charbon actif pour
l'année 2023 est estimée à 1930,24 m3 ; celle
des panneaux de
101
particules est de 8536,693 m3. Ce qui
représente un surplus pour la production de bois transformés dans
la ZIS de Nkok. Ces produits sont majoritairement destinés au
marché international. Concernant les ventes, le charbon actif est vendu
en Chine à 500 $ la tonne soit 305.250 F CFA. En France, il est vendu
à 1630 € ce qui équivaut à 1.066.720 F CFA la tonne.
Aussi, la valorisation des déchets de bois permet la création
d'emplois et donc l'amélioration des conditions de vie pour les
personnes employées. À cet effet, l'unité de charbon actif
compte 42 employés dont 35 gabonais et 7 étrangers. Le salaire de
l'ouvrier varie entre 154.000 et 182.000 F CFA, selon qu'il travaille 5 ou 6
jours dans la semaine, à raison de 7000 F CFA le paiement journalier.
Dans l'unité de fabrication de panneaux de particules, les
employés estimés au nombre de 98 dont 84 gabonais,
bénéficient d'une prime de transport évaluée
à 35.000 F CFA et d'une immatriculation à la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS). Le salaire net de l'ouvrier est de
187.000 F CFA. Sur le plan environnemental, la valorisation des déchets
de bois bruts participe à la lutte contre le gaspillage des
matières qui peuvent encore faire l'objet d'autres usages. En
réutilisant ces déchets de bois, on augmente leur valeur et cela
permet d'utiliser la ressource bois sous une autre forme, et ce, plus
longtemps. La lutte contre la pollution de l'air dans la ZIS de Nkok est
à ce jour un objectif à atteindre. Les effets de
l'amélioration de la qualité de l'air en lien avec les
activités de valorisation des déchets de bois ne peuvent
être perceptibles à ce jour car ce sont des activités
récentes. Toutefois, il est clair que la production de panneaux de
particules permet de stocker plus longtemps le dioxyde de carbone. La
production de charbon actif quant à elle connait une combustion
contrôlée qui limite l'échappement de fumées noires
dans l'air. Aussi, la ZIS de Nkok a été certifiée neutre
en carbone pour le compte des années 2019, 2020 et 2021. Cette
neutralité lui a été reconnue après l'installation
de l'unité de recyclage des déchets plastiques Jia Ming
Plastics et de la société de conseil en environnement
SAFER. Pour continuer à revendiquer cette neutralité et
montrer son implication dans la lutte contre le réchauffement
climatique, la ZIS de Nkok met en oeuvre des stratégies de compensation.
Il s'agit notamment de l'insertion d'activités de valorisation des
déchets de bois, des pneus, de plastics et de financements
octroyés dans des projets de protection environnementale.
Le chapitre 4 sur les limites et perspectives des
activités de valorisation des déchets de bois bruts identifie
l'absence de régularisation et les difficultés
d'approvisionnements comme des obstacles au bon fonctionnement et à la
pérennité de ces activités dans la ZIS de Nkok.
L'irrégularité des activités de valorisation concerne les
vides juridiques dans le Code de l'environnement relatifs à la gestion
et à la valorisation des déchets. L'absence de statut
juridique
102
des déchets de bois dans le Code forestier. Ces
manquements affaiblissent le contrôle des bénéfices
économiques. L'irrégularité de cette activité pose
aussi un problème dans l'acquisition des déchets de bois par les
centres de valorisation. Étant donné que cette acquisition est
gratuite, certaines unités de transformation hésitent à
céder leurs déchets de bois bruts, d'autant plus que les ateliers
artisanaux doivent payer pour obtenir ces déchets.
Les problèmes d'approvisionnement se posent sur les
plans quantitatif et qualitatif, surtout pour l'unité de charbon actif.
Sur le plan quantitatif, la production de charbon actif est confrontée
à un faible nombre d'unités d'approvisionnement et de faibles
quantités par rapport à ses besoins. Sur les 41 unités
recensées dans la zone, seulement 12 unités approvisionnent les
unités de valorisation. Ajouté à cela les 2 unités
de transformation qui viennent de l'extérieur, cela nous donne un total.
De ces unités d'approvisionnement, 10 sont des unités de sciage
et 4 des unités de déroulage-placage. Les unités de sciage
approvisionnent les deux unités de valorisation ; quant aux
unités de déroulage, elles approvisionnent uniquement
l'unité de production de panneaux de particules. N'utilisant que les
déchets de sciage (débités déclassés) et
comme essence principale les bois divers, l'unité de charbon actif a un
approvisionnement réduit en déchet de bois. Elle s'est
orientée vers deux autres unités de sciage situées
à l'extérieur de la ZIS pour renforcer ses approvisionnements.
Notons que le nombre d'unités de sciage a considérablement
baissé en 2024 par rapport à l'année 2022, où l'on
recensait 15 unités de sciage, toutes en activité. À ce
jour, la ZIS n'en compte plus que 11 dont 7 sont fonctionnelles, 3 en fermeture
temporaire et 1 en baisse d'activité. À cette difficulté
s'ajoutent la fréquence des approvisionnements et les quantités
de déchets collectés qui ont baissés au fil du temps,
surtout durant la période de septembre à décembre 2023.
Sur le plan qualitatif, l'importance de l'utilisation de l'okoumé dans
la ZIS par rapport aux bois divers (19% d'utilisation de bois divers et 81%
pour l'okoumé), réduit les approvisionnements de l'unité
de charbon actif. Ce bois est très prisé par le segment du
déroulage car il sert pour la confection de contre-plaqués. De
même, certaines unités de sciage utilisent cette essence en plus
des bois divers.
À la question de savoir comment les déchets de
bois bruts sont-ils gérés dans la ZIS de Nkok, il ressort que les
trois hypothèses énoncées ont été
vérifiées. Ceci grâce à la méthode mixte de
collecte de données qualitatives et quantitatives. La première
hypothèse qui est : la gestion des déchets de bois bruts dans
la Zone d'Investissement Spéciale de Nkok se fait de diverses
manières suivant les pratiques et orientations des différents
acteurs, a été confirmée. Nous avons identifié
plusieurs modes de gestion des déchets de bois et comme acteurs les
autorités administratives et d'aménagement, les unités de
transformation et les unités de
103
valorisation des déchets de bois. La deuxième
hypothèse : la valorisation des déchets de bois bruts occupe
une place importante avec la mise en place des conditions et
procédés de valorisation qui ont un impact
socio-économique et environnemental, est partiellement
confirmée. Les activités de valorisation des déchets de
bois bruts sont créatrices d'emploi. La production de charbon actif pour
l'année 2023 est de 1930,24 m3 et le produit est
commercialisé en Chine et en France. Celle des panneaux de particules
est estimée à 8536,693 m3. Ces résultats
témoignent de l'importance de la valorisation des déchets de bois
dans la ZIS et de l'efficacité des procédés de
valorisation. Ce qui voudrait dire que la proportion de gaspillage des
matières a été réduite. Toutefois, la
récurrence des pratiques de brûlage contribue encore à la
pollution de l'air. La troisième hypothèse : de nombreux
manquements observables limitent l'efficacité de la valorisation des
déchets de bois, est confirmée. L'absence de cadre
légal sur l'activité de valorisation, l'acquisition gratuite des
déchets, les difficultés d'approvisionnement sur les plans
quantitatif et qualitatif sont un frein à la valorisation des
déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok.
Cette étude contribue à renforcer les
connaissances sur les potentialités des déchets de bois bruts
produits dans les industries de transformation du bois au Gabon. Elle a permis
d'avoir une idée de l'évolution des volumes de déchets
produits dans les unités de transformation de la ZIS et d'évaluer
les quantités de matières valorisées. Malheureusement,
nous n'avons pas pu établir un lien direct entre les deux points. Cela
aurait permis de vérifier si les quantités produites dans les UTB
sont majoritairement destinées à la valorisation. Axée sur
le secteur industriel, cette étude rend compte des potentialités
qu'il y a autour de ces déchets et dont l'acquisition suscite des
rivalités. Même en étant dans le secteur industriel, la
valorisation des déchets de bois reste une activité «
informelle » puisque n'étant pas encadrée par des textes de
droit. Ce travail apporte un regard nouveau sur les produits issus de la
valorisation des déchets de bois dans notre pays. Il invite à une
diversification des outputs, à travers l'innovation des
matières à valoriser qui peuvent faire l'objet d'une
commercialisation à l'échelle internationale. Il y a
également la nécessité de créer un marché
formel autour des activités de collecte et de valorisation des
déchets de bois pour bien mesurer les bénéfices
générés.
Aucune oeuvre humaine n'étant parfaite, ce travail
connait quelques limites. Entre autres, l'absence de données
numériques issues des capteurs supposés installés dans la
ZIS et les détails du rapport final sur le bilan carbone
effectué. Ces données auraient permis de mieux étayer
l'aspect sur la réduction de la pollution de l'air par les
activités de valorisation et de nous donner un aperçu plus
poussé des champs d'applications pris en compte par l'évaluation
des émissions
104
de CO2 de la zone. De plus, les données de statistiques
précises sur le tonnage de chaque type de déchets de bois aurait
permis de comparer les quantités produites et de mieux orienter les
décisions en matière de valorisation.
De notre point de vue, les opérations
réalisées dans la ZIS de Nkok par les unités de
valorisation ne peuvent être assimilées à la gestion des
déchets de bois bruts. Les processus de collecte sont guidés par
les besoins de chacun et ne permettent pas de totalement désengorger les
unités de transformation. Nous pouvons qualifier ces opérations
de collecte comme étant ponctuelles et intéressées. Tout
ceci amène à s'interroger sur la nécessite d'une
unité de gestion des déchets de bois au sein de la ZIS de Nkok
qui établirait un lien entre les unités de transformation des
déchets de bois et les unités de valorisation. De plus, si les
activités de valorisation des déchets de bois dans le secteur
industriel venaient à s'étendre à l'échelle du
pays, ne devrait-on pas craindre pour l'avenir des unités artisanales
qui utilisent une partie de ces déchets comme matière
première ?
105
106
Ouvrages
- DERRUAU, M. (2012). La Géographie Humaine.
Paris, Armand Colin, 447 p.
- DUNLOP, J. (2016). Les 100 Mots de La
Géographie. Paris, Presses Universitaires de France. 128 p.
- KARSENTY, A. (1999). Les instruments économiques
de la forêt tropicale. Le cas de l'Afrique centrale. Paris,
Maisonneuve et Larose. 125 p.
- KOMBILA MOULOUNGUI, A.G. (2019). La filière bois
au Gabon : Exporter avec de la valeur ajoutée. Paris : L'Harmattan,
407 p.
- MALOBA MAKANGA, J.D. (2010). Les précipitations
au Gabon : climatologie analytique en Afrique. Paris : L'Harmattan,
143p.
- MALOBA MAKANGA, J.D. (2022). Degradation of the coastal
fringe south of Libreville.Generis Publishing, 79 p.
- MARTIN, P., & VERNAY, M. (2016). Guide d'utilisation
des bois africains éco-certifiés en Europe. Tome1. ATIBT,
97p.
- TURLAN, T. (2018). Les déchets : Collecte.
Traitement. Tri. Recyclage. Dunod, 287p.
- VEYRET, Y., LAGANIER, R., & SCARWELL, H. (2017).
L'environnement Concepts, enjeux et territoires. Paris : Armand Colin,
265 p.
Articles scientifiques
- ADA NZOUGHE, C. (2021). « La gestion des déchets
solides à Libreville : état des lieux et perspectives ». In
NGUEMA, R.-M & NDONG MBA, J.-C (Dirs.). De la ville non pensée
à la ville pansée. Réflexions et critiques
géographiques sur Libreville, Paris : L'Harmattan, pp.45-65
- BAILLY, A., & VALARCHÉ, J. (1979). «
Éléments de Géographie économique de Paul CLAVAL
». L'Espace géographique, tome 8(3), pp. 227-228
- BOST, F. (2007). « Les zones franches, interfaces de la
mondialisation ». Annales de Géographie, (658),
pp.563-585
- EDOU EBOLO, C.M. (2004). « Économie
forestière ». Atlas de l'Afrique-Gabon. In POURTIER, R
(Dir.), Paris, Éditions J.A, pp.36-37
- FISCHER, A. (1978). « Transport et localisation
industrielle ». Annales de Géographie, tome
87(483), pp. 545-559
- HO DINH, A.-M. (2007). « Le vide juridique et le besoin
de loi. Pour un recours à l'hypothèse du non-droit ».
Presses Universitaires de France. (vol.57), pp419-453
107
- KAMKUIMO, P., AYOUBA, S., & MBARGA, A. (2017). «
Étude sur la situation de référence de valorisation des
rebuts de l'exploitation forestière et de scierie dans la région
de l'Est-Cameroun ». ASD.71p.
- KÜNZILI, N. (2020). « Lutter contre la pollution
de l'air et les inégalités ». Actualité
environnement. Hommes et libertés N°189, 23p. En ligne :
www.ldh.france.org
- LASSERRE, G. (1955). « Okoumé et chantiers
forestiers du Gabon ». Cahiers d'outre-mer, (30),
8èmeannée, pp.119-160
- LESCUYER, G., CERUTTI, P.O., MANGUIENGHA, N (2011). «
Le marché domestique du sciage artisanal à Libreville, Gabon.
État des lieux, opportunités et défis ». Document
Occasionnel 63. CIFOR, Bogor, Indonésie.36p.
- LUMPUNGU, C.K, BIENAYAKU, V., MUFWAYA, C.K & FALASI N.
(2016). « La sciure des bois, un déchet à valoriser pour
l'agriculture en R.D. Congo ». Congo sciences, Volume 4.
N°1, pp.57-60. En ligne :
www.congosciences.org
- MABIKA, J. (2014). « Enjeux et Défis de
l'industrialisation de la filière bois ». In LOUNGOU, S (Dir.).
Les Enjeux et défis du Gabon au XXIème
siècle Réflexions critiques et prospectives des
géographes, Paris, Connaissances et Savoirs. pp. 331-357
- MABIKA, J. (2021). « De la marge au centre d'une
activité en pleine mutation : le recyclage des déchets de bois
à Libreville et ses environs ». In NGUEMA, R.-M & NDONG MBA,
J.-C (Dirs.). De la ville non pensée à la ville
pansée. Réflexions et critiques géographiques sur
Libreville, Paris : L'Harmattan, pp.68-85
- MALOBA MAKANGA, J.D. (2004). « Climat ». Atlas
de l'Afrique-Gabon. In POURTIER, R (Dir.), Paris, Éditions J.A,
pp.12-13
- MALOBA MAKANGA, J.D. (2011). « Mosaïque
forêt-savane et exploitation des ressources forestières du Gabon
». Géo-Eco-Trop, n°35 pp. 41-50
- MERLIN, P. (1990). « Géographie et
Aménagement ». Travaux de l'Institut de Géographie de Reims,
n°79-80, pp.21-28
- MOMBO, J.B. (2009). « La ressource forestière au
Gabon : une économie de rente en quête d'industrialisation et de
gestion durable ». In enjeux Géopolitique en Afrique
Centrale. Paris, L'Harmattan, pp.125-142
- NAWROCKI, J. (2020). « Carte à la une. Shenzhen au
coeur d'un corridor d'innovation dans le Delta de la rivière des perles
», Géoconfluences 6p. En ligne :
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a/-la-une/carte-a-la-une/shenzen-delta-riviere-perles
108
- POMMIER, P., HAUMESSER, M-C., LO, M. (2021). « Des
Zones Économiques Spéciales Sécurisées. Le
rôle des ZES africaines dans l'accélération du
co-développement avec l'Europe ». In GUIDOU, J-L (Dir). Africa
Economic Zones Organization, 88p.
- ROBIN, A. (2017). « La définition de la notion
de valorisation dans le contexte de la recherche scientifique ».
Lex-Electronica.org,
pp.137-152
- TRACHI, M., BOURFIS, N., BENAMARA, S., & GOUGAM, H.
(2014). « Préparation et caractérisation d'un charbon actif
à partir de la coquille d'amande (Prunus amygdalus) amère ».
Biotechnol. Agron.Soc.Environ. 18 (4), pp.492-502
- VENTURA, A., QUEHELLE, E., DAUVERGNE, M., LE GUEN, L.,
ANTHEAUME, N., & BOURGEOIS, F. (2022). « Valorisation des
déchets et bénéfices environnementaux : un long fleuve pas
si tranquille ». Academic Journal pf Civil Engineering, Special issue
.
· Journées thématiques. 40(2), pp.1-10
Travaux académiques
- ABJAGHOU, H. (2020). Valorisation des déchets de
bois pour l'amélioration des performances thermiques de briques en terre
cuite, Thèse de Doctorat en sciences et ingénieure de
matériaux, Université de Limoges.
- BRIK, L., & GUERRICHE, A. (2021). La valorisation
des déchets, Mémoire de Master, Université des
Frères Mentouri Constantine.
- DALIMIER, T. (2022). Valorisation du bois A et B en bois
lamellé-collé et lamellé croisé,
Mémoire de Master, Université de Liège.
- EKOME MENGUE NGOUA, N. (1997). Valorisation des
résidus de coupe issus de la récolte sélective de bois
dans la région du Haut-Ogooué au Gabon, Mémoire de
Maitrise, Université Laval.
- EYI OBAME, A. (2017). Niveau de valorisation des
déchets d`exploitation forestière .
· identification et
estimation des rebuts de bois dans l'AAC 2014 de la SEEF à
Nzamaligué, Mémoire de Master, École Nationale des
eaux et forêts.
- MISSANG MI-NDONG, M. (2006). La transformation du bois
dans les communes de Libreville et Owendo .
· enjeux et perspectives,
Mémoire de Maitrise, Université Omar Bongo.
- NGANGORI, K.D. (2018). Étude sur la production et
la commercialisation du charbon de bois à Libreville et ses
environs, Mémoire de Master, École Nationale des eaux et
forêts.
109
VAN POTTELSBERGHE DE LA POTTERIE, S. (2018).
Économie circulaire et valorisation du bois dans le secteur de
l'ameublement . analyse des facteurs de réussite, des freins et de la
chaine d'approvisionnement, Mémoire de Master, Université de
Louvain.
Rapports
- Conférence des Nations Unies sur le Commerce Et le
Développement (CNUCED). (2021). Guide sur les zones
économiques spéciales en Afrique . Vers une diversification
économique à travers le continent. 241 p.
- Ministère des Eaux et Forêts. Rapports
d'activité . Direction Générale des Industries du Commerce
du Bois et de la Valorisation des Produits Forestiers. (2019-2022)
- MOUISSY, M. (2023). Impact du secteur bois sur
l'économie du Gabon entre 2018 et 2022. EY& Mays Mouissy
consulting.
Références règlementaires
- Loi n°2001-16 du 31 décembre 2001 portant Code
forestier en République gabonaise
- Loi n°2014-007 du 01 aout 2014 portant Code de
l'environnement en République Gabonaise
- Loi n°0036/2018 du 08 février 2019 portant
réglementation des Zones d'Investissement Spéciales
- Décret N°0018/PR/MPIPPPAEA du 07/03/2023 portant
réorganisation de la Zone Économique à Régime
Privilégié de Nkok
- Ordonnance n°008/PR/2010 du 25 février 2010
Webographie
- Agence de la transition écologique (ADEME). (2022).
Utilisation de l'argument de « neutralité carbone » dans les
communications. Les recommandations de l'ADEME. pp.7-10
- Agence de la transition écologique (ADEME). 2022.
Référentiel de classification des déchets bois - Version
05/2022. 13 pages.
- Association Technique Internationale Des Bois Tropicaux
(ATIBT). (2016). Les niveaux de transformation du bois, consulté le
12/09/2023)
- BRUNEAU, J., & Martin, A. (2021). La
récupération des déchets d'entreprise : un facteur
déterminant de viabilité et d'harmonie environnementale.
110
- DEVEAUX, J. (13/12/2018). En Afrique, le charbon de bois reste
le combustible des familles. Consulté le 08 janvier 2024. En ligne :
www.francetvinfo.fr
- FIBOIS (2023). Les étapes de la première
transformation, consulté le 12/09/2023
- FOURNIER, C. (2021). Neutralité carbone : le grand
n'importe quoi des allégations climatiques. Mis à jour le 26
avril 2023. En ligne : www.youmatter.world
- Géoconfluences. (2015). Zones économiques
spéciales (ZES ou SEZ). En ligne :
www.geoconfluences.com
- GSEZ (Avril, 2023). Notre parcours en matière de
développement durable. En ligne :
www.gsez.com
- MABIMBA, J.K. (2020). Performance : La ZES de Nkok
reçoit le prix « Woods products »
aux Global Free Zones of the year édition 2020. En ligne
:
www.convergenceafrique.net
- Observatoire Régional des déchets et de
l'économie circulaire en Occitanie (ORDECO).
Bois et sous-produits non traités, consulté le
17/08/2023). En ligne :
www.ordeco.org
- T.P DEMAIN. (Aout 2023). Les enjeux généraux
autour de l'activité de recyclage dans les
travaux publics. consulté le 13 février 2024. En
ligne :
www.tpdemain.com
112
Annexe 1 : Questionnaire auprès des UTB
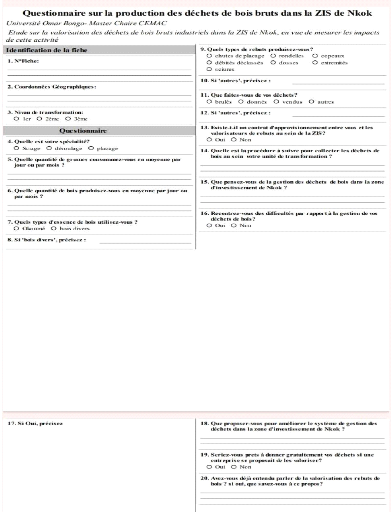
113
Annexe 2 : Guide d'entretien auprès des
unités de valorisation
Guide d'entretien
Ce guide d'entretien concerne uniquement les unités de
valorisation des déchets de bois bruts, en vue de connaitre le
procédé d'acquisition des rebuts et de comprendre le processus de
valorisation des rebuts au sein de la ZIS.
Identification de l'entreprise
Nom de l'entreprise : Type de valorisation :
Coordonnées géographiques : Produit
valorisé :
|
N°
|
Questions
|
Réponses
|
|
1
|
Quels types de déchets utilisez-vous ?
|
|
|
2
|
Quelle essence de bois (s) utilisez-vous ?
|
|
|
3
|
Combien d'entreprises vous livrent-elles leurs déchets
de bois ?
|
|
|
4
|
À quelle fréquence journalière?
|
|
|
5
|
Avez-vous des sources extérieures à la ZIS ? Si oui
où se situe-t-elle ?
|
|
|
6
|
Quels les volumes de déchets recevez-vous en moyenne par
jour?
|
|
|
7
|
Quels sont les volumes de déchets valorisés en
moyenne par mois ?
|
|
|
8
|
Quel est le processus de valorisation mis en place pour
obtenir le produit ?
|
|
|
9
|
Que faites-vous des déchets non valorisés et ceux
issus de la valorisation ?
|
|
|
10
|
Les produits réalisés sont-ils pour la production
nationale ou pour l'exportation ?
|
|
|
11
|
Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre
activité ?
|
|
I
Annexe 3 : Grille tarifaire pour la vente locale des
panneaux de particules
|
AUTORTTE ADMINISTRATIVE DE L\ ZONE ECONO\QQUE SPECLALE DE NKOK
GUICIIIT UNIQUE
|
see
aA.rt
|
RF PUBLIQUE G.1BON.USE Unlnn
·Tnvul
Jutr
|
|
BUREAU CONCURRENCE, CONSOMMATION ET
REPRESSION DES FRAC:DES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
O 0 6
a.U.F.RP
·`hok,cuat.c:ni
RAISON SOCIALE : TROPICAL FOREST PRODUCT
SUARL.
N° STATISTIQUE :202101008330
C
QUARTIER : Z1S DE NKOK, Parcelle N°13-2./C1 SECTEUR
; TRANSFORMATION DU ROIS
B.P: 1024 LIBREVILLE TEL :062001086/066212994 GERANT:
Kamaluddin KHAN
Prix Homologués 2023
LES TARIFS SUIVANTS SONT EN FCFA/PIECE.
|
|
|
Désigna non
PANNE'', DF
PARTICULES
|
Longueur (mcn)
24440
|
Largeur (mcn)
|
Epaisseur
()
|
Prix 1`R
transformation
(état
brut)
|
Prix 2é
transform
arion
|
Prix 3é
transfotmati
on (verni
dc
blanc)
|
|
1220
|
4
|
5-350
|
6.500
|
-.000
|
|
12
|
6.800
|
5.350
|
8.900
|
|
15
|
8.350
|
10.301)
|
11.000
|
|
16
|
8.750
|
10.800
|
11.500
|
|
18
|
9.500
|
11.800
|
. 2.300
|
|
22
|
12.050
|
[4.850
|
15.800
|
|
25
|
13.950
|
17.150
|
19.200
|
Prix 4è
transformati
on
(granulé)
-.200
9.250
11.500
11.950
13.000
16.400
18.950
Fait à Nkok,19.1191.2023..
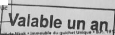

114
LV 9 : L'affichage du présent barcme sur les
lieux où 5'esécutenr la ou les
presranoos commerciales, ainsi que la MI-WC d'un facruner
indiquant ses noms er prénoms er évenrucllement l'adresse du
client sont obligatoires (art.19 de la Loi N°29/63 du 15 Juin 1963 portant
reglcmenrannn des pnx en Républiq Gabonaise).
ZENT DE NKOK
· Zoo. irana "'qa
· a
R
·qua
· erird
n r
·,~,
W
·
·
·
·
·.
·
·fRle
l.b
·
·
·.U
·
o
·ban
·..
·w
·a.
·
·o
g
·
115
Annexe 4 : Liste des industries de la ZIS de Nkok (tous
secteurs confondus)
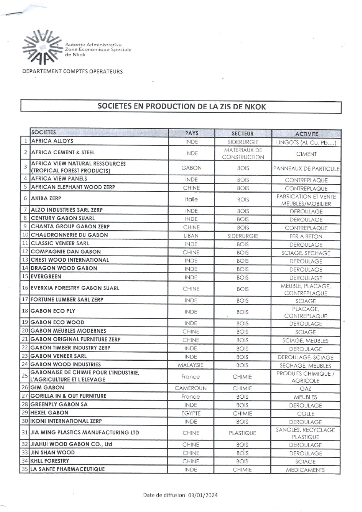
|

35
|
LES ACIERIES DU GABON
|
CAMEROUN
|
SIDÉRURGIE
|
FER A BETON
|
|
37
|
LI DA BOIS INTERTIONAL DU GABON
|
CHINE
|
BOIS
|
DEROULAGE, SCIAGE
|
|
38
|
LIAN SHENG WOOD GABON
|
CHINE
|
BOIS
|
SECHAGE. PANNEAUX
|
|
39
|
MENUISERIE LBTP (CLUSTER)
|
GABON
|
BOIS
|
MEUBLES
|
|
40
|
METAL CO
|
LIBAN
|
SIDERURGIE
|
LINGOTS (AI, Cu, Pb,...)
|
|
41
|
OFFERY WOOD GABON
|
CHINE
|
BOIS
|
DEROULAGE
|
|
42
|
ORIGEN EAU PURE
|
CHINE
|
AGRO-INDUSTRIE
|
EAU
|
|
43
|
PRIME WOOD SARL
|
AUSTRALIE
|
BOIS
|
DEROULAGE
|
|
44
|
RAIN FOREST MANAGEMENT
|
MALAYSIE
|
BOIS
|
SÉCHAGE
|
|
45
|
RDDHI INTERNATIONAL GABON
|
INDE
|
BOIS
|
SCIAGE
|
|
46
|
SAVITRI NATURE WOOD INDUSTRIES SARL
|
INDE
|
BOIS
|
DEROULAGE
|
|
47
|
SEN JUN WOOD GABON
|
CHINE
|
BOIS
|
DEROULAGE
|
|
48
|
SOCIETE HUAXING ENVIRONNEMENT DU GABON SUARL
|
CHINE
|
BOIS
|
CHARBON
|
|
49
|
SOGAMETAL GSEZ
|
INDE
|
SIDERURGIE
|
LINGOTS (AI, Cu. Pb,...)
|
|
50
|
SOLID WOOD GABON SUARL.
|
INDE
|
BOIS
|
DEROULAGE
|
|
51
|
SOMIVAR
|
' Italie
|
BOIS
|
SCIAGE
|
|
52
|
STARPLY GABON SARL
|
INDE
|
BOIS
|
DEROUI AGE. PLACAGE
|
|
53
|
STR AFRICA
|
GABON
|
COMMUNICATION
|
RÉSEAU
TELECOMMUNICATION
|
|
54
|
SUN VENEER
|
INDE
|
SOIS
|
DEROULAGE
|
|
55
|
SUPREME VENEER SARL
|
INDE
|
BOIS
|
DEROULAGE
|
|
56
|
TIMBERWORKZ GLOBAL SARL
|
INDE
|
BOIS
|
DEROULAGE
|
|
57
|
WINDSON RESINS AND CHEMICALS
|
INDE
|
CHIMIE
|
COLLE
|
|
58
|
WOOD PRO INDUSTRIES
|
INDE
|
BOIS
|
SCIAGE, SECHAGE
|
|
59
|
WOOD VALUE GABON
|
INDE
|
BOIS
|
SCIAGE
|
|
60
|
WOODLAND GABON SARL
|
INDE
|
BOIS
|
DEROULAGE
|
|
51
|
WOODS INTERNATIONAL SARL
|
INDE
|
BOIS
|
DEROULAGE
|
|
62
|
WOODTECH
|
France
|
BOIS
|
SCIAGE, RABOTAGE
|
|
63
|
WOODVILLE FURNITURE (CLUSTER)
|
INDE
|
BOIS
|
MEUBLES
|
|
64
|
XIN TA WOOD ZERP GABON
|
CHINE
|
BOIS
|
Deroulage, Trenchage
|
116
Date de diffusion. 03/01/2024
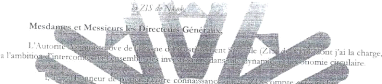
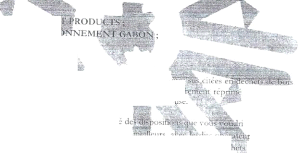
Annexe 5 : Note de cession des déchets aux
unités de valorisation
AULORiTE ADMINISTRATIVE DE LA ZONE REPUBLIQUE GABONAISE
D'INVESTISSEMENT SPECIAJDE NKOK
GUICHET UNIQU ~
tillefkr UNION -TRAVAIL -JUSTICE
|
BUREAU ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA Tiptr
NATURE K5
|
Nkak. le 0,, DEC. 2023
|
|
|
|
|
N/Réf n 2 2 3 04
AA-ZIS-NKOKTGU:BEPN
|
|
A
Mesdames et ;Messieurs les Directeurs Généraux
des Entreprises
du Secteur Bois de la Zone d'Investissement Spéciale de
Nkok
Objet: (,o/In, Jrr ,lr,l rL ,Ir llnrr ,lugs
Auss
quatre (04)
cntreptves qui s t la .on dcs déchets de odui F space
industriel.
Il s'agit de
· TROP 1-,-1,üft1S
· I it-TATT.7G,
· L'AN: I1- NG ,
· i l,.I_(3 I ti UISTRY
as 1ncn~ si'ïiïg., t n : , rn priorité, lc7
nct
plutilr
par la len 607/2I1I4
ez bien prendre afin
s, aux fins de leur
dans votre cycle de
t'II'a prr,cédr au b1-
poljuan+ ast, :tlr r1 )'âtsnu,.:; e ët s vr
relative à hi Protes: r nrtr,
·i,;
tcIrteuat cti IZç ubli
:s
Fu égard .t cc - - éL'c1 31 S o'les
derocéder :t la co i ;
P
· alisatt~xt. r :tt: r y ~ 11c1at, lr ,
fournir cette matière.pi-'emu
·rc
dnl,i ,.I
·
·;c < 1 etre, : n; 0,1111 It-.r
. rC
production. - -_
117
Je vous prie d'agréer. Mesdames et= .'ssietri§'les
Directeurs Générawc, l'assurance de ma parfaite
considération.
·

IS rE NKOK
· Zone d
·,rt,gsti
emPr ç,trFclak d. Nkpk
|
I,,meuble d. Curci+e[ unpue
· P. 19134
Lbremp t.aCue
|
wwx daierO ga ® -w
·
·rn+n: w...ni.e...;w
ris w 41.44
· r"»"^°
t
· ~.~ra.a ..aa
|
|
118
Annexe 6 : Statistiques mensuelles de production
(Tropical Forest Product)
Direction Generale des Industries du Bois et de la
Valorisation des Produits Forestiers
FICHE TECHNIQUE
STATISTIQUES MENSUELLES (m3) DE CONSOMMATION
-PRODUCTION STOCKS
Nom de la sodete: Tropical Forest Product
SUARL
Periode de declaration de production (mois):de JAN
à MAI 2023
Segment d'activites: Particule de Bois
Localisation: NICER N° B-2/C1
Province: Estuaire
|
PRODUCTION
|
|
Stock fin du mois
|
M
c
W
|
|
|
Ql
---I
|
N
mi
|
N
mi
|
01
N
|
4
m
|
4
un
|
4M
m
4
|
com
- N-
|
LO
rn N-
|
~r
M CO
|
Ln.
EYS W
|
NB: REBUTS DE BOIS : stock debut du mois + reception
débuts du mois - consommation do mois = stock de fin du mois
N B: PRODUCTION: Stock débuts mois + production -
vente locale - utilisé en interne - export - retour = stock fin du
mois
|
|
X
|
O
|
N
N
|
m
4
|
m
4
|
o~p
|
V
|
,
4
|
r
4
|
v~i
|
m
|
p~1
|
."'-i
|
|
0
N CC
|
M
E
C
W
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
4
|
|
X
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
o a
|
m
C
w
|
|
O
|
O
|
O
VL
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
Q
|
`mp
[ Y1
|
O
|
O
|
|
X N
= â
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Coo
4
|
Q
|
Q
|
Q
|
Q
|
|
4
|
4
|
|
W
|
M Ep
|
4
|
N
W
N
|
rg-1
M
,
|
p 4V
4
|
4
f~
f~
|
,_,L n"
|
un
.q
V
|
-
0
r-
|
1.
N-
[-.7
|
O1
-
oc'
|
O
C- f~
|
p 4V
N]
|
|
4
|
N
|
Lin4
|
|
N
N
|
413
|
01
400
|
N
V r1
|
Lrf
|
L I
|
L.,-,un
L6T
|
|
|
0
T
O
0./
C
>
|
M
W
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
X
n'
E
C.
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
Q
|
4
|
4
|
|
C
W
|
|
'='
|
M !y
|
`~
4
|
ELO
4
|
RI- f~
i--I
4
|
n
O'1
|
h-
y~~l~-~
.--1
p hl
|
.-1
f~
|
n
9--1
Q f~
|
OC
n
OO
|
N
V
|
Q
|
|
X
W C
~
|
Q
|
N
|
GV1
.--I
|
4
|
OO r - 1
m
|
Cor1
.--1
|
Op
lD n rrn
|
OO
m
.--1
|
OO I.~~-1
|
m4
N
.--1
|
OO
|
4
|
|
M
W
|
|
4
|
4
|
q VM
|
M - - -
|
M
-
|
L1
4
N
|
Ca
l
m
|
on p
un
|
CO
M LW
|
co
N]
· 4
N.
|
4
r
01 f-
|
,
_
|
|
|
2
|
X
C ryCfp
o.
|
4
|
4
|
N
|
p
4
N
|
p
4
N
|
LNff
|
N
,
|
O^
4
|
N-
.N-1
|
un
|
CO
.-I
|
op
n
.,-I
|
|
REBUTS DE BOIS
|
LIVRAISON REBUTS DE BOIS
|
L'A
|
~
d
C C
.1 E
|
|
~~yy
N
mi
|
pppp m N
N
|
lpp m
--
|
mi4
Ji O1
|
ryry lA r----.
i---I
|
Lh
un.-
f~
|
V
lqqO
Q
|
lL] u9
lmB
|
1~ u'f
|
u9
p~Q11 O'1
|
|
6
|
|
E
C
o
CJ
|
E
F
C c
m
|
|
4
|
f~
mi mi
|
W
ce
n
|
Q
|
N .mi
|
n
N
|
N mi
|
m Op N LNa
|
N
V
4
|
N N
n
|
pppp lD
M
M
|
4
|
|
C.
d K
|
Ln
0J
Ln r
u =
u
NN
|
|
n
|
mi L~i
|
CO
L~n
|
nn
4
|
V
|
rnLD pr
|
u'] rn
|
4
|
N
|
·
|
4
o
|
r~
11]
|
|
aJ
d
û
O
N
|
=g I-
CCn
C
0
-I
|
|
cc
M
|
N
M
N M
|
COM
N N
|
r- M
|
2019,88
|
4 r-
|
MV
S'SLL
|
V l~
|
cL] u']
lmO
|
r-. u']
|
un V1
O'1
|
n
|
|
Ln
O
|
|
IJAN
|
|
|
j
|
|
2
|
T
|
AUGUST
|
SEPTEMBER
|
I OCTOBER
|
NOVEMBER
|
DECEMBER
|
|
TABLE DES ILLUSTRATIONS
|
120
Liste des cartes
Carte 1 : Localisation de la zone d'etude 20
Carte 2 : Occupation du sol de la zis de nkok 23
Carte 3 : Lieux d'approvisionnement des unites de valorisation
53
Carte 4 : Aire de repartition geographique de l'okoume 90
Liste des figures
Figure 1 : Méthodologie de la recherche 16
Figure 2 : Les niveaux de transformation du bois 31
Figure 3 : Organigramme des entités de gestion de la ZIS
de Nkok 34
Figure 4 : Schéma de reconstitution de la production de
charbon actif de bois 58
Figure 5 : Neutralité carbone 75
Figure 6: Demande en déchets de bois 80
Figure 7: Modèle de gestion des déchets de bois
bruts dans la ZIS de Nkok 95
Liste des graphiques
Graphique 1: Le segment du sciage au Gabon 27
Graphique 2: Le segment du déroulage au Gabon 29
Graphique 3 : Part de chaque activité dans la
transformation du bois à Nkok 30
Graphique 4 : Évolution du rendement matière par
segment 43
Graphique 5 : Évolution du volume des déchets de
bois bruts par segment 43
Graphique 6 : Consommation annuelle de grumes par segment 45
Graphique 7 : Modes de gestion des déchets de bois bruts
dans les UTB 51
Graphique 8: La structure des employés des unités
de valorisation 70
Graphique 9 : Difficultés rencontrées par les UTB
72
Graphique 10 : Choix de cession des déchets de bois
79
Graphique 11: État réel des UTB 83
Graphique 12: Fréquence mensuelle des approvisionnements
85
Graphique 13 : Tendance des fréquences mensuelles des
approvisionnements 86
Graphique 14 : Quantités de déchets
collectés par l'unité de charbon actif 87
Graphique 15: Quantités de déchets
collectés par les deux unités de valorisation 88
121
Graphique 16 : Utilisation des essences de bois dans la ZIS de
Nkok 92
Graphique 17 : Suggestions des UTB 93
Liste des photos
Photo 1: Le déroulage .. 28
Photo 2: Décharge à ciel ouvert de la ZIS de Nkok .
47
Photo 3: Chaudière mécanique 48
Photo 4: Fours De combustion du bois 55
Photo 5 : Sacs de charbon actif 66
Photo 6 : Différentes teintes de panneaux de particules ..
67
Photo 7 : Déchets collectés par une unité de
valorisation 71
Photo 8 : Lieu de brûlage non aménagé 73
Photo 9 : Mur de déchets de sciure et copeaux à
Somivab .
94
Liste des planches
Planche 1: Les déchets de bois bruts dans la ZIS de Nkok
.. 41
Planche 2: Déchets de bois brûlés à
l'air libre . 47
Planche 3: Stockage des déchets de bois à l'air
libre 49
Planche 4: Camions de collecte des déchets 52
Planche 5: Production du charbon naturel 56
Planche 6: Production du charbon actif de bois 57
Planche 7: Les différents niveaux de broyage des
déchets de bois .. 59
Planche 8: Prototypes des panneaux de particules 60
Planche 9: Produits issus de la valorisation .68
Liste des tableaux
Tableau 1 : Les outils de recherche 15
Tableau 2 : Avantages fiscaux et douaniers dans la ZIS de Nkok
24
Tableau 3 : Les UTB de sciage dans la ZIS de Nkok 27
Tableau 4 : Caractéristiques des déchets de bois
bruts 40
Tableau 5 : Évolution du volume des déchets de bois
bruts dans la ZIS de Nkok 42
122
Tableau 6: Consommation totale de grumes par segment 44
Tableau 7: Caractéristiques de la collecte des
déchets de bois des UVRB 52
Tableau 8: Production annuelle des déchets de bois
bruts valorisés 64
Tableau 9 : Production de panneaux de particules en 2023 65
Tableau 10 : L'emploi dans les unités de valorisation
69
Tableau 11 : Bilan carbone de la ZIS de Nkok 76
Tableau 12 : Les unités d'approvisionnement en
déchets de bois bruts 82
Tableau 13: Caractéristiques de l'Okoumé et des
bois divers 89
Tableau 14 : Les essences de bois divers les plus
exploitées 91
123
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
LISTE DES SIGLES IV
INTRODUCTION GENERALE 5
1-Objet et champ d'etude 6
1.1-Objet de l'etude 6
1.2-Champ de l'etude 7
2-Justification du sujet 8
3-Intérêt du sujet 10
4-Revue de la littérature 11
5-Problématique 12
5.1-Hypothèses 12
5.2-Objectifs 13
6-Cadre méthodologique 13
6.1-Présentation de la démarche
13
Recherche documentaire 14
Méthodes et outils de recherche 14
7-Difficultés rencontrées 16
8-Articulation du mémoire 16
124
PREMIERE PARTIE : 17
ORGANISATION ET GESTION DES DECHETS DE BOIS BRUTS DE LA
ZONE
ECONOMIQUE SPECIALE DE NKOK 17
CHAPITRE 1 :
PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE ET DU CADRE RÈGLEMENTAIRE
RÉGISSANT LES ACTIVITÉS DE TRANSFORMATION DE BOIS
BRUTS 19
1.1-Présentation de la zone d'étude et de ses
activités de transformation de bois bruts 19
1.1.1-Situation géographique et caractéristiques de
la ZIS de Nkok 19
1.1.2-L'organisation de la zone économique spéciale
de Nkok 21
1.1.3-Les conditions fiscales et douanières des
entreprises dans la ZIS de Nkok 24
1.2-Les activités de transformation des bois bruts 25
1.2.1-Le premier niveau de transformation 26
1.2.2-Le deuxième niveau de transformation 28
1.3-Cadres juridique, institutionnel et règlementaire
régissant les activités de transformation des
bois bruts dans la ZIS de Nkok 30
1.3.1-Le Cadre juridique et institutionnel 30
1.3.2-Le Cadre Réglementaire 34
CHAPITRE 2 : GESTION DES DÉCHETS DE BOIS BRUTS
DANS LA ZIS DE NKOK 37
2.1-État des lieux de la production des déchets de
bois bruts 37
2.1.1-Les acteurs de la gestion des déchets de bois dans
la ZIS de Nkok 37
2.1.2-Caractérisation des déchets de bois bruts
dans la ZIS de Nkok 39
2.2-Les modes de gestion des déchets de bois bruts dans
les unités de transformation 45
2.3-L'approvisionnement en déchets des unités de
valorisation 51
2.3-La valorisation des déchets de bois brut dans la ZIS
de Nkok 53
2.3.1-La production de charbon actif de bois 54
2.3.2-La production de meubles en panneaux de particules 58
DEUXIEME PARTIE : 62
EFFETS , LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA VALORISATION DES
DECHETS
DE BOIS BRUTS DANS LA ZIS DE NKOK 62
CHAPITRE 3 :
IMPACTS DES ACTIVITÉS DE VALORISATION DES DÉCHETS
DE BOIS BRUTS 64
3.1-Impacts économique et social de la valorisation des
déchets de bois bruts 64
3.1.1-La valorisation : une contribution à la production
de bois transformés 64
3.1.2-La valorisation : créatrice d'activités
économiques et d'emplois 67
3.2-Impacts environnementaux de la valorisation des
déchets de bois bruts 71
3.2.1-La lutte contre le gaspillage des ressources 71
3.2.2-Réduction de la pollution de l'air 73
CHAPITRE 4 : LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA VALORISATION
DES
DÉCHETS DE BOIS BRUTS 78
4.1-Irrégularités des activités de
valorisation des déchets de bois 78
4.1.1-Dispositions légales défaillantes 78
4.1.2-Mode d'acquisition des déchets de bois bruts 79
4.2-Les difficultés en matière d'approvisionnement
des déchets de bois bruts 81
125
4.2.1-Sur le plan quantitatif 82
4.2.2-Sur le plan qualitatif 89
4.3-Orientations pour une meilleure gestion et une valorisation
plus efficiente des déchets
de bois bruts dans la ZIS de Nkok 92
4.3.1-Orientations juridiques 93
4.3.2-Recherche des investisseurs .93
4.3.3-Fixation des coûts des rebuts 95
CONCLUSION GENERALE 98
BIBLIOGRAPHIE 105
ANNEXES 111
TABLE DES ILLUSTRATIONS 119
126
Résumé
Les industries de première et deuxième
transformation de la ZIS de Nkok génèrent une quantité
considérable de déchets de bois bruts, estimée à
près de 300.000 m3 par an. Ces déchets sont
valorisés sous forme de charbon actif et de panneaux de particules par
les unités de valorisation de la ZIS avec des retombées
socio-économiques et environnementales positives. Ils permettent
notamment d'augmenter les volumes de bois transformés, créer de
l'emploi et aider à réduire le gaspillage de ressources encore
utilisables. Cependant, les unités de valorisation des déchets de
bois bruts font face à des difficultés d'acquisition et
d'approvisionnement en déchets de bois, tant en quantité qu'en
qualité. La gestion des déchets de bois bruts est actuellement
menée de manière individuelle par chaque unité, qui
décide de l'utilisation de ses déchets, y compris leur transfert
aux unités de valorisation. Par conséquent, la création
d'une unité centralisée de gestion et de commercialisation des
déchets de bois issus des unités de transformation semble
essentielle pour répondre aux besoins des deux parties.
Mots clés : ZIS, Nkok, Déchets,
Bois-bruts, Valorisation
Abstract
The primary and secondery processing industries of the Nkok
ZIS generate a considerable quantity of rawwood waste, estimatedat nearly
300,00m3 per year. This waste is recoverd in the form of activated
carbon and particle boards by the ZIS recovery units and with positive
socio-economic and environmental impacts. In particular, they make it possible
to increase the volumes of processed wood, create jobs and help reduce the
waste of resources that can still be used. However, raw wood waste recovery
units face difficulties in acquirind and supplying wood waste, both in quantity
and quality. The management of raw wood waste, is currently carried out
individually by each unit, which decides on the use of its waste, including its
transfer to recovery units. Consequently, the creation of a centralized unit
for the management and marketing of wood waste from processing units seems
essential to meet the needs of both parties.
Keywords : ZIS, Nkok, Waste, Raw wood,
valorization
| 


