I.1.2. Composant du Système immunitaire
Le système immunitaire est constitué d'un
ensemble complexe d'organes individualisés et de tissus entre lesquels
circulent en permanence des cellules de l'immunité innée et de
l'immunité adaptative. Le système immunitaire à trois
propriétés essentielles : une importante capacité
d'échange d'informations, par contacts membranaires intercellulaires ou
par libération de médiateurs solubles. Ces échanges ont
lieu entre des acteurs du système immunitaire (par exemple des
interactions entre les cellules de l'immunité innée et celles de
l'immunité adaptative), mais également avec d'autres
systèmes (par exemple des échanges neuro-immuno-endocriniens) ;
un bras effecteur performant, capable de protéger
l'intégrité de l'organisme ; une forte régulation qui est
cruciale pour préserver, à tout moment et à tout endroit,
l'équilibre du système immunitaire ou homéostasie et
garantir une réponse immunitaire adaptée (Jonathan et al., 2018).
Le système immunitaire comporte deux types de défense :
l'immunité innée ou naturelle et l'immunité acquise ou
adaptative (Olivier, 2005).
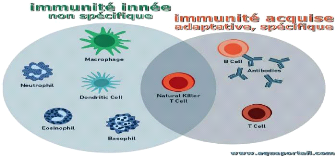
Figure 2 : les composants du système
immunitaire.
I.1.2.1. Immunité innée ou naturelle
Cellule immunitaire innée conditionnelle et
système de capteurs métaboliques. L'immunité
innée est la première ligne de défense de l'hôte,
fournissant une défense initiale non-spécifique contre les
signaux de danger. Les cellules immunitaires innées professionnelles
comprennent les cellules dendritiques (DC), les monocytes, les macrophages et
les lymphocytes B (Lizhe et al., 2020).
Des structures moléculaires communes à de
très nombreux microorganismes vont interagir avec des molécules
complémentaires préformées de l'hôte (en solution ou
à la surface de cellule) pour déclencher un signal de «
danger » conduisant à l'exclusion du pathogène. Lors de
l'infection d'une cellule par des virus, des modifications membranaires (telles
que la diminution de l'expression des molécules de classe I du complexe
majeur d'histocompatibilité [CMH]) vont permettre la destruction de la
cellule infectée par des lymphocytes cytotoxiques NK (« natural
killer » : cellules tueuses de l'immunité naturelle). Au total,
l'immunité naturelle est caractérisée par sa mise en jeu
rapide et par le développement de réactions inflammatoires
(bactéries, parasites) ou cytotoxique (virus) conduisant souvent
à l'exclusion du pathogène (Kouassi et al., 2003). Lizhe et al.,
(2020) ajoute que, l'inflammation est un processus pathologique tissulaire dont
le but principal est de résoudre l'infection et de réparer les
tissus.
En outre, Débora et al., (2020) à leurs tours,
on dit que « Les cellules tueuses naturelles et les phagocytes, y compris
les neutrophiles, les monocytes et les macrophages, représentent la
première ligne du système immunitaire inné contre les
infections virales et sont très sensibles à l'exercice
aérobie aigu ».
Cavaillon (2010) a aussi ajouté l'inflammation et
l'immunité innée sont deux processus qui se chevauchent et, qui,
depuis la découverte des récepteurs des pathogènes et des
signaux endogènes de danger, ont reçu une attention nouvelle. En
effet, notre vision de la réponse immunitaire a évolué, et
la recherche sur l'immunité innée est dans une période de
renaissance. Pendant de nombreuses années, l'immunologie était
divisée en deux grands thèmes : l'immunité «
spécifique » et l'immunité « non-spécifique
», avec forcément moins d'attention pour l'immunité qui
était définie par une négation. Depuis que l'expression
« immunité non-spécifique » a été
remplacée par le concept d'immunité innée ou
d'immunité naturelle, celle-ci est maintenant sous les projecteurs. Avec
la découverte des toll-like receptors (TLRs). Les TLRs reconnaissent
spécifiquement des déterminants microbiens nommés pathogen
associated molecular patterns (PAMPs). Il est clair que l'immunité
innée n'est certainement pas un processus non spécifique de
défense de l'hôte.
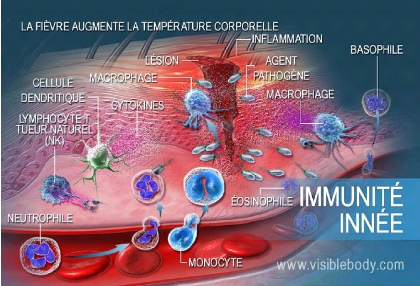
Figure 3 : l'immunité innée.
| 


