|
ESGCI
Paris Graduate School of Management
242, RUE DU FAUBOURG
ST ANTOINE
75012 PARIS 4ème année
(MC2)
Tél. : 01 43 48 63 36 LABOIZI
Badr
Fax : 01 43 70 65 36 SMADJA Alexandra
MEMOIRE DE FIN D'ETUDES
« Les conséquences négatives de
l'adhésion de la Chine à l'Organisation Mondiale du Commerce, sur
le secteur textile au Maroc. »
Maître de Mémoire : M. François
Lafargue
Année : 2005 - 2006
SOMMAIRE
INTRODUCTION
I. Présentation
générale
A. Le Maroc : Etat des lieux
1. Présentation de l'environnement.
2. Le secteur textile Marocain : Première ressource
du pays
3. Les points fort et les points faible.
B. La Chine : Premier producteur et exportateur mondial
de textile
1. Malgré quelques points faibles, la Chine conserve des
atouts de premier plan
2. les Accords Multifibres
3. Une croissance accélérée par
l'adhésion à l'OMC et Les Accords sur les textiles et les
Vêtements (ATV)
II. Reconfiguration totale du secteur textile dans
le Monde
A. L'attitude de la Chine face à ce changement majeur
1. Les principaux impacts en Asie
2. La restructuration du secteur textile Chinois
B. Les conséquences directes au Maroc
1. La chute des investissements dans le secteur textile
2. Une crise prévisible :
C. Perspectives et recommandations
1. Les solutions apportées par l'OMC
2. La reconversion du Maroc est-elle possible ?
CONCLUSION
INTRODUCTION
D'une manière générale, le secteur du
textile et des vêtements est entré depuis le 1er
janvier 2005 dans une nouvelle ère. C'est en effet à cette date,
que le système des quotas a été aboli.
Celui-ci avait pour objectif principal de contenir les
exportations de vêtements et de textiles d'un nombre important de pays
producteurs vers les plus grands marchés du Monde, notamment les
Etats-Unis et l'Union Européenne. Suite à une décision
prise il y a dix ans dans le cadre de l'Uruguay Round (cycle de
négociations commerciales mondiales menées de 1986 à
1994), plus aucun quotas n'existe entre les pays membres de l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC).
Le secteur textile génère un commerce de plus de
395 milliards de dollars par an (plus de 7% du commerce mondial) et emploie
plus de 40 millions de personnes dans le Monde, principalement dans les pays du
Sud. Selon la grande majorité des études réalisées
sur ce sujet, « il faut s'attendre à une restructuration
importante dès la levée des quotas ».
Les grandes multinationales, qui jusqu'alors avaient pour
habitude de s'approvisionner dans plusieurs dizaines de pays (situés
pour la plupart dans des régions en développement), vont
s'adapter, au fur et à mesure à cette nouvelle configuration.
L'Association Américaine des Importateurs affirme que « de
manière à rationaliser leur réseau de fournisseurs, la
plupart des grands acheteurs ne prendront pas le risque de placer toutes leurs
commandes dans un seul pays, mais entendent plutôt réduire ce
nombre. » Celui-ci devrait donc passer de 50 à cinq ou six
pays d'ici 2007.
Alors que ce changement brutal de stratégie va de toute
évidence nuire à des pays comme le Bangladesh, la Turquie,
l'Indonésie, le Maroc, le Mexique et d'autres, dont il faut signaler
qu'une large part de leurs exportations dépend très fortement de
ce secteur, il va toutefois très certainement profiter à la
Chine.
En effet, devenue membre de l'OMC en 2001, la Chine est
déjà dotée de nombreux atouts comme sa main d'oeuvre bon
marché et ses faibles coûts de production, dus principalement
à une absence totale de syndicats facilitant ainsi l'exploitation des
travailleurs. De plus, ses économies d'échelles, ainsi que ses
investissement récents dans le secteur textile n'ont eu de cesse de
rendre ce pays très compétitif. La Banque Mondiale estime que 50%
des exportations mondiales de vêtements viendront de Chine en 2010, alors
que cette part n'est aujourd'hui que d'un quart.
A cela s'ajoute le fait que certaines questions primordiales
restent à ce jour sans réponse : En effet, la Chine est-elle
en train de s'octroyer un quasi-monopole mondial au détriment des pays
les plus pauvres ? Faut-il réellement craindre de voir les
productions chinoises supplanter ou même éliminer toutes les
autres dans les magasins de vêtements du monde entier ? Enfin,
existe-t-il des moyens fiables, pour les pays dépendants de ce secteur,
de contourner la concurrence chinoise ?
Autant d'interrogations auxquelles nous essaierons de
répondre à travers cette étude, en prenant pour exemple le
Maroc, qui tire sa principale recette du secteur textile et habillement.
Nous aurions tout aussi bien pu parler d'autres pays où
l'inquiétude quant à la fin du système des quotas, est de
niveau similaire, comme le Mexique, le Honduras, le Népal, les
Philippines, le Bangladesh, l'Indonésie ou encore le Vietnam. Celui-ci
ne faisant toujours pas partie de l'OMC, il continue d'être limité
par le système des quotas, et à, du fait de ses deux millions de
travailleurs dans le secteur textile et confection, de nombreuses raisons de
s'inquiéter.
Toujours est -il que du fait de ses importantes relations avec
l'Europe et la France, notamment dans le secteur textile, le Maroc nous
apparaît comme étant un sujet d'analyse significatif et
représentatif de la situation de l'après 1er janvier
2005 pour bon nombre de pays dans le Monde. Le Maroc sera d'ici peu l'une des
principales victimes de l'ouverture des quotas et de l'expansion terrifiante du
secteur textile chinois.
Nous tenterons donc, tout au long de ce rapport, et
après avoir dressé un état des lieux des secteurs textiles
Marocains et Chinois, d'appréhender la métamorphose du secteur
textile Chinois et ses conséquences directes sur ce pays en
développement qu'est le Maroc. Enfin nous examinerons les
différentes perspectives qui s'offrent à ce pays tant du point de
vue du contournement de cette nouvelle concurrence chinoise mais aussi
concernant ses possibilités de modernisation ou encore de reconversion.
I. Présentation générale
A. Le Maroc : Etat des lieux
1.Présentation de l'environnement :
Le Maroc est un pays qui compte une population d'un peu plus
de 30 millions d'habitants (incluant les territoires du Sahara occidental).
De plus, même si on remarque une baisse de la
démographie au Maroc depuis ces dernières années, la
population marocaine reste une population jeune et majoritairement urbaine. En
effet, 33% de cette population a moins de 15 ans, et, plus de 58% habite en
ville.
Par ailleurs, il existe un grand contraste entre le niveau de
vie dans les villes et celui dans les campagnes. En ville, tous les habitants
ont accès à l'électricité, l'eau potable et
à l'évacuation des eaux usées. Tandis qu'à la
campagne, seulement 20% des habitants ont accès à
l'électricité et 10% à l'eau potable.
Le PNB par habitant est de 1200$ avec une répartition
également très inégale :
- 10% de la population la plus riche réalise 31% des
richesses
- 10% de la population la plus pauvre réalise 2,6% des
richesses.
Le chômage atteint 25% de la population (en
majorité les jeunes). Le taux d'analphabétisme touche 38% de la
population et 63,9% des femmes.
L'économie marocaine se caractérise surtout par
une dépendance excessive au secteur agricole qui dépend
lui-même de la clémence du climat.
De plus, ce secteur emploie 46% de la population et apporte
15% du PIB du pays. C'est pourquoi il est difficile de maintenir une croissance
suffisante et soutenue dans le temps, pour créer des emplois et
combattre la pauvreté.
La priorité du gouvernement est donc claire :
développer un tissu industriel, même à partir de
l'agriculture (agro-industrie) afin de contrebalancer le poids de ce secteur et
de diversifier l'économie. Ce programme à débuté
dès la mise en place, en 1983, du plan d'ajustement structurel.
1. Le secteur textile Marocain :
Première ressource du pays
Le secteur du textile et de la confection est aujourd'hui l'un
des secteur les plus important dans le commerce mondial de marchandises.
En 2001, les exportations du secteur textile-habillement ont
atteint 342 000 millions d'Euros, c'est-à-dire presque 6% du total des
exportations mondiales. L'importance du textile est de plus
particulièrement accrue dans les pays en voie de
développement.
Au Maroc, le secteur du textile et de la confection constitue
l'un des piliers fondamentaux de la transformation industrielle. Avec 210
000 travailleurs en 2001, ce secteur est le premier employeur du pays (40%
de la main d'oeuvre industrielle) et la production de ces quelques 1 814
entreprises a atteint, en 2001, les 3,4 millions d'Euros (dont 81% restent
destinés à l'exportation).
De plus, le secteur est récemment passé à
une organisation par filières (Chaîne et Trame ;
Maille ; Jean & Sportwear ; Textile de Maison) dans un but
stratégique qui témoigne de la volonté de mettre à
profit les synergies du secteur. (Tableau 1).
Tableau 1 : Répartition par
filières
|
Année 2000
|
MAILLE
|
CHAÎNE ET TRAME
|
JEAN & SPORTWEAR
|
TEXTILE DE MAISON
|
|
Nombre d'unités
|
27%
|
32%
|
32%
|
9%
|
|
Effectifs
|
22%
|
41%
|
31%
|
6%
|
|
Production
|
27%
|
36%
|
29%
|
8%
|
|
Export
|
24%
|
38%
|
32%
|
6%
|
|
Investissements
|
29%
|
12%
|
51%
|
8%
|
Source : Ministère du Commerce et de
l'Industrie
L'offre marocaine :
En 2002, le secteur du textile et de la confection disposait
d'environ 1600 entreprises, et d'après l'association AMITH (Association
Marocaine du Textile et de l'Habillement) il y avait plus de 1814
unités. Il s'agissait à 85% de Petites et Moyennes
Entreprises.
De ces entreprises, un peu plus de 50% sont destinées
à la confection ; 27% à la fabrication de mailles et les 30%
restants se répartissent entre les activités de la branche
« textile de base » (filage, tissus, teinture, finissage et
impression). Donc, l'industrie textile marocaine est principalement
constituée par la confection d'articles d'habillement et la fabrication
de mailles.
La production du secteur textile-habillement en 2001 a atteint
les 2,8 milliards d'euros, soit une augmentation de presque 17% par rapport
à l'année 1999.
De ce volume, les trois quarts correspondent à la
branche « textile de base » et le reste à la
confection de l'habillement et de la maille (Tableau 2).
De plus, la valeur ajoutée de cette activité en
1999, a rapporté 9 048 millions de dirhams (904,8 millions d'euros),
soit une amélioration de 35% par rapport à l'année 1993
(Tableau 3).
Enfin, en ce qui concerne la productivité de la main
d'oeuvre, il est évident que celle-ci est liée à son
niveau de formation. Le Maroc est dans ce sens quelque peu handicapé,
mais la situation semble s'améliorer légèrement, notamment
dans le cas des 15-24 ans.
A cela s'ajoute le fait que la formation de techniciens et
d'ingénieurs hautement qualifiés pose moins de problème au
Maroc qui, à l'instar de la Tunisie ou de la Turquie, a investi dans des
centres spécialisés pour ce genre de formation dans l'industrie
textile.
Tableau 2 : Les principaux produits du secteur
textile et confection
|
Textile de base
|
Confection et genre de mailles
|
|
Tissu de coton
|
22%
|
Pantalons, shorts et bermudas
|
29%
|
|
Filage de coton
|
15%
|
Lingerie et corsets
|
16%
|
|
Fil synthétique et artificiel
|
10%
|
Chemises
|
15%
|
|
Teinture et finissage
|
9%
|
T-shirts, sweat-shirts
|
10%
|
|
Tissu d'ameublement
|
9%
|
Jupes et robes
|
8%
|
|
Filage de laine
|
5%
|
Manteaux et vestes
|
8%
|
|
Imprimés
|
4%
|
Pulls
|
7%
|
|
Tapis et moquettes
|
4%
|
Lingerie
|
5%
|
|
Passementerie et corderie
|
3%
|
Pyjamas
|
2%
|
Tableau 3 : Production et valeur ajoutée du
secteur textile et confection
|
1993
|
|
1995
|
|
1997
|
|
1999
|
|
|
Prod
|
V A
|
Prod
|
VA
|
Prod
|
VA
|
Prod
|
VA
|
|
Textile de base
|
9 672
|
2 964
|
8 892
|
3 272
|
9 828
|
3 120
|
9 048
|
3 432
|
|
Confection et genre de maille
|
10 296
|
3 744
|
12 168
|
4 524
|
14 040
|
5 460
|
15 132
|
5 616
|
|
Total
|
19 968
|
6 744
|
21 060
|
7 800
|
23 868
|
8 580
|
24 180
|
9 048
|
Source : AMITH
Néanmoins, il faut tenir compte de l'existence de
certaines unités de production informelles, c'est-à-dire
employant un personnel non-déclaré. Malheureusement, nous ne
disposons que de très peu de données.
Ainsi, dans le secteur du textile et de la confection, 22,67%
des unités déclarées à la CNSS (soit 665 sur un
total de 2927) n'ont signalé aucun salarié en 2001 ; et,
31,33% de ces mêmes entreprises ont employé seulement entre 1 et 5
personnes.
En fait, seulement 0,98% (environ 28 unités) avaient un
effectif compris entre 500 et 1000 personnes.
Ces indicateurs donnent une idée de la situation de
l'emploi au Maroc, mais ne reflètent pas complètement la
réalité dans sa diversité et sa complexité. En
effet, ce secteur regroupe des caractéristiques qui lui sont propres,
comme la prédominance du travail à façon, ou la forte
dépendance à la saisonnalité, etc....Autant
d'éléments que l'on ne retrouve que très peu ou
même pas du tout dans d'autres parties du Monde.
La destination de la production :
L'AMITH chiffre le nombre d'entreprises exportatrices à
1260 : ceci représente presque 70% du total des unités.
Quant au volume des exportations marocaines, (Tableau 4) nous constatons une
croissance plus qu'importante en 2000, avec un chiffre atteignant les 28 006
millions de dirhams, dont 34,2% correspondent aux produits de textiles et de
bonneterie.
Tableau 4 : L'évolution des exportations
marocaines entre 1993 et 2000 (en millions de dirhams)
|
1993
|
1995
|
1997
|
1999
|
2000
|
|
Total des exportations
|
17 628
|
20 904
|
24 960
|
27 300
|
28 006
|
Les entreprises du « textile de base »
(fils, tissus, teintures, finissage et impression) exportent approximativement
le tiers de la production totale, et réalisent environ 4,5% des ventes
à l'extérieur de l'industrie marocaine. Seulement 4,5%, dans le
sens où, ces entreprises s'occupent principalement des besoins de
l'industrie locale.
Par ailleurs, les entreprises de confection et de mailles
destinent leur production exclusivement à l'exportation, soit environ
34,5% des exportations totales de l'industrie marocaine. Dans la
majorité des cas seule une petite partie de ces entreprises travaille
pour couvrir la demande locale, cela se fait en général sous des
marques propres qui n'ont aucune répercussion à
l'étranger.
C'est en 1976 qu'un Accord de préférence
à été signé entre le Maroc et la Communauté
Européenne de manière a éliminer complètement les
droits de douane concernant l'entrée des produits fabriqués au
Maroc, ceci, en établissant des contingents pour quelques produits dits
« sensibles ». Mais ces limitations ont été
supprimées en 1994.
Cet accord a eu une influence décisive pour l'industrie
marocaine et surtout pour le secteur du textile et de la confection, ainsi que
pour son adaptation à un profil profondément exportateur et
tourné vers l'extérieur.
· Les principaux produits exportés par le Maroc
sont :
- les produits de confections : vêtements de sport
et de ville pour homme, femme et enfant (pantalons, chemises, t-shirt...)
- les articles en maille : lingerie,
sous-vêtements, pulls, vêtements de sport...
- les tissus et la lingerie d'ameublement : draps,
nappes...
· Les marchés de l'exportation marocaine
sont :
- l'Union Européenne,
- les Etats-Unis,
- le Canada,
- les pays africains
- le Moyen Orient.
· Les principaux pays destinés à
l'exportation des produits marocains sont :
- la France : 41%,
- la Grande Bretagne : 20%,
- l'Espagne : 17%,
- l'Allemagne : 8%,
- le Benelux : 3%,
- l'Italie : 4%.
Actuellement le Maroc se situe à la
6ème place en tant que fournisseur de produits textiles
à l'Union Européenne, avec 4% du total des importations, et est
le premier fournisseur d'articles de confection pour la France (Tableaux 5 et
6).
Tableau 5 : La participation du Maroc à
l'importation (textile et confection) de l'Union Européenne
|
PAYS
|
% à l'importation de l'UE
|
|
Chine
|
11,7
|
|
Turquie
|
11,5
|
|
Inde
|
5,8
|
|
Hong-Kong
|
5
|
|
Tunisie
|
4,4
|
|
Maroc
|
4
|
|
Pologne
|
3,9
|
|
Indonésie
|
3,7
|
|
Roumanie
|
3,7
|
|
EU
|
3,3
|
Tableau 6 : La destination des exportations
textiles marocaines (2000)
|
France
|
Espagne
|
G-B
|
Allemagne
|
Italie
|
UEBL
|
Arabie saoudite
|
|
Confection
|
36,9%
|
14,9%
|
23,9%
|
7,8%
|
-
|
3,4%
|
-
|
|
Bonneterie
|
45,1%
|
9,5%
|
24,8%
|
10,6%
|
1,2%
|
1,2%
|
-
|
|
Textile de Base
|
33,7%
|
28,2%
|
4,7%
|
3%
|
-
|
-
|
13,4%
|
La localisation de l'industrie :
Même si les entreprises de textile et de confection sont
présentes sur presque tout le territoire marocain, environ 81% de
celles-ci, se situent dans les régions de Casablanca (59%),
Tanger-Tetouan (16%) et Rabat-Salé (6%). (Tableau 7).
L'ensemble de ces entreprises réalise environ 75% de la
production et des exportations du secteur.
Tableau 7
|
REGION
|
PRODUCTION %
|
EXPORTATION %
|
N°D'UNITES %
|
EMPLOYES %
|
INVESTISSEMENT %
|
|
Casablanca
|
54
|
50
|
59
|
53
|
30
|
|
Tanger-Tetouan
|
11
|
12
|
16
|
17
|
15
|
|
Rabat-Salé
|
10
|
13
|
6
|
12
|
12
|
|
Fés-Taza Meknés
|
11
|
12
|
13
|
12
|
12
|
|
Marrakech
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Autres
|
12
|
11
|
3
|
3
|
28
|
La dynamique régionale : (Tableau 8)
Le secteur textile et de la confection relève d'une
grande importance dans l'activité industrielle des différentes
régions marocaines ; À noter le cas de la Région Nord
(Tanger-Tetouan) où ce secteur emploie à lui seul, 61% de la
population active.
Tableau 8
|
REGIONS
|
NB d'unités en %
|
Effectifs en %
|
Production en %
|
Export en %
|
|
Casablanca
|
36
|
45
|
16
|
50
|
|
Tanger-Tetouan
|
45
|
61
|
18
|
51
|
|
Rabat-Salé
|
20
|
58
|
26
|
65
|
|
Fés-Taza Meknés
|
21
|
55
|
20
|
70
|
|
Marrakech
|
16
|
25
|
8
|
31
|
La demande marocaine :
· Confection et maille :
Autant que pour l'offre disponible, la production marocaine
des articles de confection et de mailles reste principalement destinée
à l'exportation. La demande locale est couverte par l'industrie
domestique. Et, même si nous ne disposons pas de chiffres, la
consommation interne est résiduelle par rapport au total des ventes du
secteur.
· Matériaux textiles (« textile de
base ») :
Le Maroc ne dispose pas de matières premières en
grande quantité comme la laine ou le coton. De ce fait, le pays se voit
dans l'obligation de les faire importer de l'étranger. Néanmoins,
le Maroc tente de mettre en place un programme efficace dans le but de produire
de manière autonome une quantité massive de coton.
La demande de matériaux textiles des entreprises
marocaines ainsi que celle d'articles de mailles et de confection, est
partiellement satisfaite par la branche « textile de
base » locale ; elle-même productrice fondamentale de fils
et de tissus en coton (tissus synthétiques, artificiels et tissus pour
l'ameublement).
Les importations de tissus en général
représentent une part conséquente dans la balance commerciale
marocaine : en valeur, ce sont les tissus de fibres synthétiques et
artificiels qui se trouvent au premier plan (90% en régime d'admission
temporaire), suivis des tissus de coton (presque 70% en régime
d'admission temporaire), les tissus de laine, poils et crins (90% de
régime d'admission temporaire), enfin, le velours (70% en régime
d'admission temporaire). (Tableau 9)
Nous pouvons signaler également le pourcentage
élevé des importations en régime temporaire ce qui
explique clairement le poids de la sous-traitance dans l'industrie de la
confection textile marocaine.
Tableau 9
|
En provenance de l'U.E.
|
U.E. + reste du monde
|
Admission temporaire
|
|
Produits
|
2000
|
2000
|
|
|
Poids
|
Valeur
|
Poids
|
Valeur
|
%AT
|
|
1000T
|
Millions DHS
|
1000T
|
Millions DHS
|
%
|
|
Tissus de fibres synthétiques et
artificielles
|
29.5
|
3 335.8
|
39.3
|
4 069.9
|
90.8
|
|
Tissus de coton
|
42.5
|
4 285.6
|
54.9
|
4 828.6
|
68.4
|
|
Tissus de laine, poil et crin
|
3.3
|
653.4
|
3.4
|
680.3
|
93.3
|
|
Velours
|
2.2
|
246.6
|
2.7
|
277.3
|
71.3
|
En ce qui concerne l'importation de fils, mais
également de fibres synthétiques et artificielles, ceux-ci
occupent la première place et sont suivis par le coton puis par les fils
de laine (Tableau 10).
Tableau 10
|
En provenance de l'UE
|
UE + reste du monde
|
|
Produits
|
Valeur en DHS Année 2000
|
Poids en KG
|
Valeur en DHS Année 2000
|
Poids en Kg
|
|
Fils de fibres synthétiques et artificielles pour
tissage
|
619 275 691
|
15 416 543
|
847 361 691
|
27 870 835
|
|
Fils de coton pour tissage
|
152 941 514
|
4 006 828
|
324 677 555
|
9 439 103
|
|
Fils de laine
|
32 675 096
|
351 460
|
37 976 590
|
395 520
|
Ces importations proviennent de l'Union Européenne avec
les proportions suivantes :
- 70 % dans le cas des fils de fibres synthétiques,
- de 30 à 40 % pour les fils de coton,
- 100% en ce qui concerne les fils de laine.
De forme plus concrète, les principaux produits
importés par le Maroc sont les suivants :
Tissus finis pour la confection
Tissus de fantaisie
Accessoires pour vêtements
Fils métalliques, d'acétate, de rayon, de
soie...etc.
L'Espagne est le premier fournisseur du Maroc dans le domaine
du textile-confection, avant la France, l'Italie, L'Allemagne et la Grande
Bretagne. Les achats du Maroc envers l'Espagne représentent un 15 % des
importations totales dans le secteur du textile-confection et les 80 % de ces
achats sont intégrés par les matériaux suivants :
Matière première textile
Fils
Tissus de mailles
Les investissements étrangers et la
coopération des entreprises :
· Cadre général :
Depuis 1983, un programme de réforme visant à
asseoir l'économie sur des bases libérales a été
mis en place. Il s'appuie sur la promulgation d'un ensemble de mesures
d'encouragement à l'investissement privé, national ou
étranger, et opte pour la liberté d'entreprendre.
Ceci, de manière à ce que les investisseurs
étrangers, résidents ou non résidents, puissent investir
librement dans tous les secteurs d'activités et détenir ainsi la
totalité du capital social d'une entreprise.
· Avantages fiscaux :
- Droit d'enregistrement
Exonération pour les actes d'acquisition de terrain
destiné à la réalisation d'un projet d'investissement.
- Droits de douane
Ils concernent l'importation de biens d'équipement,
matériels, outillages, pièces détachées et
accessoires, considérés comme nécessaires à la
promotion et au développement de l'investissement.
Le droit d'importation se situe entre 2,5% et 10% (tout
dépend du lieu de fabrication du produit).
- Taxes sur la valeur ajoutée
Exonération ou remboursement pour les biens
d'équipement, matériels et outillages acquis localement ou
importés.
- Impôts des patentes
Exonération pendant les 5 premières
années d'exploitation, pour une personne physique ou morale,
exerçant une activité professionnelle ou commerciale.
- Taxe urbaine
Exonération pendant 5 ans pour les nouvelles
constructions, les additions de construction ainsi que pour les machines et
appareils faisant partie intégrante des établissements de
production.
- Impôt sur les sociétés et impôt
général sur le revenu
Les entreprises exportatrices bénéficient de
l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés ou
l'impôt général sur le revenu pendant 5ans. Ceci,
uniquement pour le montant de leur chiffre d'affaires réalisé
à l'exportation. Au-delà de cette période, ces deux
impôts seront réduits de 50%.
Actuellement, 25% des entreprises du secteur
textile-habillement établies au Maroc ont un capital totalement ou
partiellement étranger. En général, ces entreprises
travaillent en majorité pour elles-mêmes, et se consacrent
à la fabrication d'articles de vêtements et de mailles
confectionnés. Ceci, à la différence des unités
marocaines qui travaillent pour des clients souvent occidentaux et aussi en
grande partie pour des entreprises de grande distribution.
La délocalisation des entreprises au
Maroc :
Le mouvement de délocalisation des entreprises du
secteur textile-habillement au Maroc, vient principalement d'Europe, mais
également des Etats-Unis dès les années 1980. Nous pouvons
d'ailleurs citer comme exemples, plusieurs groupes internationaux connus, ayant
des unités au Maroc: Courtaulds, Triumph, Jordache, Zara Lee ou encore
Fruit of the Lum, Lacoste, Burberry's, El Corte Inglés, Diesel, Liberto,
Carrefour.
L'Espagne, comme l'Italie et le Portugal se sont
également incorporés à cette tendance, mais, avec un
certain décalage par rapport aux pays du nord de l'Europe.
En effet, la procédure d'implantation des entreprises
du secteur textile-habillement espagnol, ne commencera qu'à partir des
années 1990 et actuellement on estime qu'il n'y a qu'une cinquantaine
d'unités espagnoles sur le sol marocain.
D'après l'AMITH, ces entreprises réalisent 6% du
total des ventes du secteur et elles représentent 5% des
investissements et exportations de textile au Maroc. La plupart appartiennent
aux branches de la confection et des articles de maille, mais on peut aussi
mentionner des entreprises au capital social exclusivement espagnol qui
opèrent dans la branche « textile de base », comme
par exemple :
- PANTCO : entreprise implantée
à Casablanca, spécialisée en confection de tenues de
ville.
- IBERMODE : entreprise espagnole
implantée à Tanger qui fabrique des genres de mailles.
- CONFECCIONES AN-YO : entreprise
implantée à Tanger, spécialisée en
prêt-à-porter pour femmes.
- BRAVO TEXTILLES : entreprise
implantée à Tanger, spécialisée en confection de
prêt-à-porter et tissus d'ameublement.
- SELTAVEX : entreprise installée
à Settat, spécialisée en production de
« demin »
Quand on parle de la présence étrangère
dans le secteur textile-habillement marocain on ne peut pas se limiter aux
unités de productions à capitaux étrangers. En effet, on
ne peut négliger le poids de la sous-traitance de marques
internationales, surtout que celle-ci se fait en majorité pour des
chaînes de grande distribution ; mais, on trouve aussi des marques
qui correspondent à des produits de haute et moyenne gamme.
Ainsi, il se fabrique au Maroc des articles pour de
très grands noms de la mode : Daniel Hechter, Chevignon, Pierre
Cardin...
Cette relation de sous-traitance entre les entreprises
marocaines et leurs clients étrangers peut se faire de trois
manières différentes :
1. Le travail dit « à
main » : c'est le client étranger qui fournit en
tissus l'atelier marocain de manière à concevoir le
produit.
2. La sous-traitance : les ateliers
s'approvisionnent eux-mêmes en tissus tout en recevant les
« patrons » par leurs clients.
3. La pleine production : l'atelier
s'occupe de toutes étapes du processus de production (approvisionnement
tissus, coupe et confection), jusqu'à la pose de la marque du client sur
le produit fini. Cette dernière possibilité de sous-traitance
n'est pratiquée que par une infime partie des unités marocaines
de production.
Les opportunités d'investissement :
Les opportunités d'investissement au Maroc dans le
secteur textile-habillement peuvent s'envisager de deux façons :
- Tout d'abord, la possibilité pour une entreprise de
ne s'occuper que des demandes en matériel de textile, mais aussi de
l'approvisionnement de celui-ci, à destination de l'industrie
locale : fils, tissus, accessoires de confection, emballages, etc....
- Ensuite, la possibilité pour ces entreprises
d'utiliser le Maroc comme plateforme de production, tout en profitant de prix
beaucoup plus compétitifs. Ceci, à travers une unité de
confection ou tout simplement, à travers des entreprises de
sous-traitance locale.
Enfin il nous faut signaler que le secteur textile-habillement
marocain a connu une période difficile notamment lors de l'exercice
1999/2000 ; en effet plusieurs facteurs internes et externes doivent
être pris en compte quant il s'agit d'appuyer l'investissement :
- L'appréciation de la monnaie nationale (Dirham)
- L'augmentation du salaire minimum (environ 10%)
- Les coûts élevés de
l'électricité
- La compétitivité des autres pays de la
méditerranée (Tunisie, Turquie...) ainsi que celle du Sud-est
asiatique.
Cepandant, l'administration marocaine est consciente de
l'importance de l'appui à un secteur clef d'une part pour la main
d'oeuvre qu'il embauche et d'autre part à la contribution des
exportations. C'est pour cela que diverses mesures ont été prises
pour pallier à ces difficultés :
- dévaluation du dirham de 5% en avril 2001.
- Réduction de 50% des cotisations sociales por les
entreprises exportatrice en 2000.
- Instauration en aout 2000 du régime de
« drawback » : remboursement des taxes payées
pour l'éléctricité.(l'énérgie
éléctrique représente environ 25% du coût du
produit.
- Réduction de 17% du coût moyen de
l'éléctricité en 2000 pour 3 ans (notons que cet
engagement n'a été restpecter qu'une année seulement.
- Financement d'une partie des projets à travers les
fonds HassanII pour le développement économique et social des
branches de textile de base.
- 50% du financement du terrain avec une limitation de
250dhs/metre carré.
- 30% du financement de la construction avec une limitation
à 1500dhs/mettre carré
- 100% du coût du terrain, avec une limitation maximum
de 250dhs/metre carré, si l'aide demandée est seulement le
terrain.
Toutes ces aides sont demander au département de
l'industrie au Ministère du Commerce, de l'Industrie et de
l'Enérgie.
4. Les points fort et les point faible :
Les points faibles :
Ø Une faible production des matières
premières
Ø Le poids de la sous traitance.
Ø Manque d'intégration du secteur.
Ø Coût de transport élevé.
Ø Coût d'énérgie
élevé.
Ø Faible pouvoir d'achat du marché local.
Ø Poids de la sous traitance.
Points fort :
Ø Proximité géographique et culturel des
marchés européens.
Ø Identité culturel forte basé sur une
culture commune avec les pays du bassins méditéranéen.
Ø Bonne connaissance du marché européen
et de ses normes.
Ø Bonne connaissance des marchés Arabes et
Africains.
Ø Grande capacité de production.
Ø Production diversifié.
Ø Bonne réactivité face aux nouveaux
comportement de la grande distribution.
Ø Volonté politique pour développer ce
secteur.
Ø Associassion représentative, organisé
et active AMITH (Association Marocaine Industrielle de Textile et de
l'Habillement).
Ø Une législation favorable à
l'investissement étranger.
Ø Implantation facile et encourager des entreprise
étrangère.
Ø Des procédure douanière simple et
rapide.
Ø Infrastructure de base performante.
Ø Moyen de transport moderne, développer et
adapter aux transport international.
Ø Formation adapté et aux
nécessités des entreprises.
Ø Savoir faire reconnue.
Ø Formation financer à hauteur de 80% par
l'Etat.
Ø Fonds Hassan II pour le développement qui
finance les aides.
Ø Main d'oeuvre expérimenté et
récéptive aux nouvelles technologies.
Ø Supression des droits de douanes des produits
marocains à l'entré de l'Union Européenne.
Ø Accord de libre échange signé en 2004
avec les Etats-Unis.
Ø Possibilité d'utiliser le Maroc comme une
plate-forme pour exporter dans différents pays Arabe, Africains du fait
des accords signés. Membre de l'Uma (Union du Maghreb Arabe) (notons que
cette union n'est pas très active).
Ø Exonération fiscal de l'impot sur les
sociétés lmes 5 prmières annés et de 50%
après ces 5 ans.
Ø Coût de la main d'oeuvre compétitif.
Ø Stabilité politique.
Ø Paix social.
B. La Chine : Premier producteur et exportateur
Mondial de textile
1.Malgré quelques points faibles, la Chine conserve
des atouts de premier plan
D'après un rapport de l'OMC, publié durant
l'été 2004, « la part de la Chine dans les importations
de vêtements devrait passer à 50% aux Etats-Unis après la
fin des quotas (pour 16% en 2002), et 29% en Europe (pour 20% en
2002). »
Le seul exemple des Etats-Unis (et de l'Union
Européenne, où la même tendance à été
constatée), est significatif de la force chinoise dans le secteur
textile. En effet, concernant les produits déjà
libéralisés avant le 1er janvier 2005, les exportations de la
Chine ont augmentées de 10 à 20 fois, occupant ainsi entre 40 et
60% de parts de marché selon les produits.
Les deux exemples suivants semblent représentatifs de
la situation : pour les sous-vêtements, les importations en provenance de
Chine sont passées de 16% du marché de l'Union Européenne
en 2001 à 42% en 2003 ; Aux Etats-Unis, les importations de
vêtements pour bébés de la Chine ont plus que triplé
en 2002.
Fort d'une population de plus d'un milliard d'habitants lui
permettant de bénéficier d'un réservoir de main d'oeuvre
illimité et de bas salaires, le pays a ainsi l'opportunité de
défier toutes les concurrences. La Chine est également le premier
employeur mondial avec 15 millions de travailleurs dans la filière
Par ailleurs, les entreprises qui s'approvisionnent en Chine
se heurtent à quelques imperfections. (graphique 1)
Celles-ci sont politiques : en effet, le pays
reste principalement marqué par la corruption, et les principaux pays
importateurs comptent mettre en place, pour pallier au mécanisme
irréversible de la fin des quotas, une sorte de riposte pouvant affecter
la croissance chinoise ;
Elles sont aussi techniques : les grandes zones
industrielles sont parfois sujettes à de lourdes pannes d'eau et
d'électricité, retardant ainsi les productions des usines ;
Ou encore sociales et salariales : malgré
les dizaines de millions de chinois en situation de sous-emploi, des
régions comme Shanghai ou le delta de la rivière Perle peinent
à trouver de nouveaux travailleurs notamment dans le secteur textile.
Cette difficulté est expliquée par la faiblesse des salaires
souvent payés avec des mois de retard, les conditions de travail
désastreuses, et l'amélioration toutefois légère
des revenus des paysans. Ceux-ci, au lieu de se transformer en ouvriers
d'usines à vêtements, continuent donc l'exploitation agricole des
terres. Ainsi il nous faut noter que la Chine se trouve à l'avant
dernier rang mondial concernant le salaire/horaire dans l'industrie de la
filature et du tissage. (graphique 2)
Le ministère chinois du Travail et de la
Sécurité Sociale pourrait donc finalement obliger les
sociétés chinoises à augmenter sensiblement les salaires
et améliorer les conditions de travail dans ces usines, de
manière à relancer l'affluence des travailleurs venus de la
campagne.
Néanmoins, ces augmentations seront de toute
évidence freinées, voire même inexistantes de par l'absence
de syndicats libres, aptes à revendiquer une hausse des salaires
significative.
Graphique 1 : les obstacles à
l'implantation des entreprises en Chine
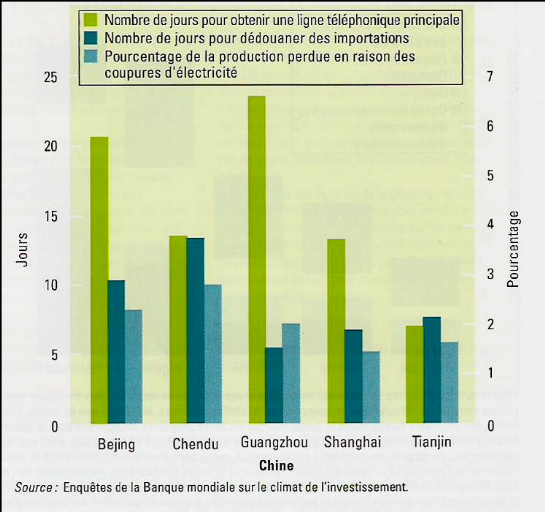
Graphique 2 : comparaison mondiale du coût du
travail dans l'industrie de la filature et du tissage (en dollars par
heure)
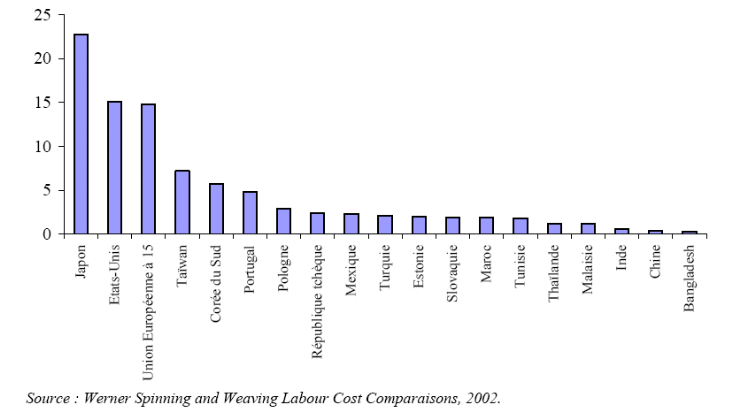
De toute évidence, la Chine apparaît comme
étant le « grand bénéficiaire » de
l'après 2005, et l'avantage compétitif du pays, découlant
principalement des violations des droits des travailleurs, est un moyen
évident de capter les investissements des grandes multinationales dans
le secteur textile-habillement.
En fait, et malgré ces quelques points faibles, les
grands acheteurs restent attirés par l'élément
décisif qu'est le prix dans le processus de production, ainsi que par
d'autres critères que la Chine maîtrise de mieux en mieux :
les délais de livraison, la qualité de production, les tarifs
douaniers, le taux de change, le niveau de la corruption, les infrastructures
de transport, l'état des communications et l`efficacité de
l'administration.
Il nous faut ajouter que la Chine se démarque surtout
par sa présence et sa diversité industrielle dans le secteur avec
une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production. Elle produit
elle-même la matière première et a ses propres ateliers de
confection : elle balaie ainsi l'ensemble de la chaîne de
production.
Elle a, de plus, su anticiper le démantèlement
de l'Accord Multifibres en augmentant sa capacité de production. Elle
dispose également d'ingénieurs performants et ainsi elle pourrait
presque rivaliser avec les pays développés qui « ont
été forcés » de se réfugier dans le haut
de gamme.
En fait, et de manière à maintenir des prix
attractifs et donc les plus bas possibles, les chinois ont recours à une
« stratégie d'intégration des industries du coton,
du textile et du vêtement ». En d'autres termes, les
exportateurs chinois ne consentent à importer qu'une très faible
partie des matières premières nécessaires à la
fabrication des vêtements.
Toutefois, la Chine n'aura pas attendu la levée des
quotas pour être performante dans la plupart de ces critères, et
les grands importateurs en sont conscients : ceux-ci sont loin
d'être avares de compliments lorsqu'il s'agit de la fiabilité de
leurs fournisseurs, de leur attitude
dite « pro-business », ou de leur grande
facilité à comprendre les attentes et les besoins du client.
Le récent développement du secteur textile,
à destination des marchés occidentaux (moins de 10 ans), permet
à ces fournisseurs de disposer d'usines équipées de
machines modernes. La Chine bénéficie également du
rayonnement financier mondial et des possibilités qui l'accompagne, de
certains centres d'affaires, comme Hong-Kong.
Enfin, de nombreuses critiques sont émises au regard
des aides apportées par le gouvernement chinois, dans le but d'optimiser
au maximum les exportations du pays. Celles-ci prennent par exemple la forme du
maintien intentionnel d'une monnaie sous-évaluée (cela facilite
les exportations), ou encore de prêts accordés par les Banques
d'Etat à quelques industriels, dont on sait d'avance qu'ils ne seront
jamais remboursés.
La Chine, et malgré les quotas qui ont longtemps
pénalisé ses exportations vers les marchés occidentaux,
reste donc et depuis plusieurs années, le premier producteur et
exportateur mondial de textile et d'habillement.
Ceci est en grande partie dû au fait que la Chine
possède certains atouts majeurs, autres que ceux déjà
cités précédemment, et que nous pouvons subdiviser en deux
catégories.
Ils sont d'abord internes : en effet, la masse critique
du pays et ses économies d'échelle ont permis la création
d'un véritable marché unifié, cela suppose en d'autres
termes, une réglementation relativement homogène ainsi que des
infrastructures de communication de part et d'autre du pays.
De plus, le paradoxe connu et vérifié dans un
grand nombre de parties du monde, du contraste entre l'élargissement des
échelles économiques (des firmes de plus en plus
mondialisées) et le rétrécissement des échelles
politiques (des pouvoirs locaux de plus en plus autonomes, des revendications
locales à l'indépendance et un intense mouvement de fragmentation
politique), n'a pas été constaté en Chine.
Le pays a su préserver les atouts de sa grande taille,
même si c'est au prix d'une puissante centralisation du pouvoir.
Enfin, la Chine est considérée comme un pays
unifié tant du point de vue de la langue que du point de vue
administratif : le Parti Communiste a joué un rôle clé
dans la mise en oeuvre de la réforme économique et même si
les règles administratives restent nombreuses, cela ne constitue en rien
un frein au développement. Selon les études de la Banque
Mondiale, « les obstacles au développement sont plutôt
moindres que dans les autres PED ».
Ces atouts sont aussi externes : la Chine appartient
à une région très dynamique du monde (l'Asie orientale et,
au-delà, le monde Pacifique). La diaspora chinoise a su en tirer parti.
En effet, au cours des quinze dernières années, les chinois de la
diaspora ont assuré 70% des Investissements Directs Etrangers en Chine.
Ainsi nous pouvons donner l'exemple de Macao et Hong-Kong, Taiwan
(première source des IDE en Chine), mais aussi celui des chinois de
Singapour, de Malaisie, ou des Etats-Unis. Ce sont ces populations qui
organisent les réseaux socio-économiques de cette vaste
région.
1.les Accords Multifibres
L'étonnante différence de coûts de main
d'oeuvre entre les pays développés et les pays en
développement, a eu pour principal résultat la mise en place de
restrictions concernant le commerce de produits textiles et de vêtements,
et ceci, dès les années 1930.
La crainte était alors pour les pays les plus
industrialisés, la concurrence de ceux encore en développement.
Ainsi, les Etats-Unis ont pris l'une des décision les plus importantes
pour l'époque: celle de réguler leurs importations de coton.
Cette forme d'accord bilatéral entre le pays
importateur et le pays exportateur a été accompagnée par
la mise en place d'instruments de protection et notamment de quotas
d'importations afin de défendre et de protéger leur industrie
nationale.
Plus précisément, le commerce du textile et de
l'habillement ne commencera à être réglementer qu'à
partir de 1974, avec la mise en place de l'Arrangement Multifibres
(AMF), signé sous l'égide du GATT (General Agreement on Tarif
and Trade, soit l'accord général sur le commerce et les
tarifs).
Cette institution internationale, ancêtre de
l'Organisation Mondiale du Commerce, a pour principal objectif, celui de
favoriser la stabilité des relations commerciales au niveau mondial,
tout en maintenant la transparence des échanges ; et l'AMF, celui
de parvenir à leur libéralisation progressive et
contrôlée. Ceci, dans le but d'éviter les chocs trop
importants sur les marchés. L'apparition de quotas, en d'autres termes
de mesures fixées par un pays importateur afin de limiter ses
importations, pouvant avoir comme conséquence une concurrence d'autant
plus déloyale que brutale.
De nombreuses critiques ont été émises
quant à cet Arrangement Multifibres dans le sens où il
« constituait une dérogation importante aux règles
fondamentales du GATT ». Nous pouvons citer à titre d'exemple,
le non respect du principe de transparence, la pratique de restrictions
quantitatives ainsi qu'une certaine forme de discrimination à
l'égard des pays en développement et donc les plus pauvres.
Ceux-ci ont donc militer, même si le système des
quotas n'a pas toujours été rigoureusement respecté par
tout les acteurs du marché (principalement par les pays en
développement), en vue de mettre fin à ce système,
estimant qu'il s'agissait avant tout d'une mesure protectionniste de la part
des pays développés.
Au cours des négociations de l'Uruguay Round (de 1986
à 1994), les participants ont alors accepté d'éliminer
progressivement les restrictions quantitatives exercées sur leurs
importations de textiles et de vêtements, en contrepartie de l'accord sur
la protection de la propriété intellectuelle (les TRIPS :
Trade-Related Intelectual Property) de la part des pays en
développement.
En effet, les TRIPS ainsi que les TRIMS (Trade-Related
Investment Measures, soit les accords sur les investissements en relation avec
le commerce), ont été deux cycles de négociations
liés de près à l'Uruguay Round. Il s'agissait, pour les
pays occidentaux industrialisés, de faire pression sur de nombreux pays
du Sud, de manière à ce qu'ils reconnaissent les droits
liés à ces accords. La suppression de l'Accord Multifibres ainsi
que celui sur les Textiles et les Vêtements (ATV), leur permettant alors
d'obtenir des avancés non négligeables sur les TRIPS et les
TRIMS.
Ce système de contingents ayant incité les
importateurs de vêtements à se déplacer dans le monde
entier à la recherche de quotas disponibles, a néanmoins
contribué à la création de millions d'emplois, surtout
dans des zones souvent dépourvues d'industrie textile comme le Cambodge,
l'île Maurice ou le Bangladesh.
Il a également quelque peu compliqué la
chaîne de production : les entreprises ont en effet
été contraintes de répartir les différentes
étapes de fabrication dans plusieurs usines de pays
différents ; « Ainsi, il arrive fréquemment que
les textiles soient achetés dans un pays, coupés dans un autre et
cousus dans un troisième. »
Enfin, il nous faut constater que bien que prorogé
à trois reprises (la dernière en 1991), l'AMF a
profondément bouleversé la configuration du secteur textile tant
dans les pays en développement que dans les pays industrialisés,
ainsi que les conditions de la concurrence.
Une croissance accélérée par
l'adhésion à l'OMC et Les Accords sur les textiles et les
Vêtements (ATV)
Lors des Accords de Marrakech, qui ont eu lieu en 1994,
l'Organisation Mondiale du Commerce a estimé qu'il était grand
temps de démanteler tout accord impliquant des restrictions
quantitatives sur le secteur textile-habillement (Accords à Long Terme
Coton (1963), Accords Multifibres (depuis 1974), Accords Autonomes :
Chine, Vietnam, Taiwan...). Ce secteur a en effet eu, en vingt ans, la
possibilité de se restructurer de manière efficace.
Et, même si les six principales régions membres
de l'OMC (les Etats-Unis, le Canada, l'Union Européenne, la
Norvège, la Suède et l'Autriche), utilisaient encore, à
cette période, ces dispositifs de contingentement, il a
été décidé de supprimer en dix ans les Accords
Multifibres.
Ainsi, tous les pays participants se sont entendus sur la
réintégration progressive du secteur textile-habillement dans les
règles de non-discrimination du GATT, par la signature de l'Accord sur
les Textiles et les Vêtements (ATV), le 1er janvier 1995.
Ce dernier constitue de ce fait un régime transitoire
étalé sur une période longue de dix ans, amenant ainsi
à l'intégration complète des produits textiles et
d'habillement dans le système d'échange mondial et permettant
d'éviter une transition quelque peu brutale. Il s'est effectué en
quatre étapes :
- 1er janvier 1995 : libéralisation de
16% du commerce textile-habillement
- 1er janvier 1998 : libéralisation de
17% du commerce textile-habillement
- 1er janvier 2002 : libéralisation de
18% supplémentaires
- 1er janvier 2005 : libéralisation
finale de tous les produits encore contingentés.
Cependant, le texte des ATV a toutefois donné aux pays
membres importateurs, une certaine « marge de manoeuvre »
de manière à ce qu'ils puissent choisir la nature des produits
à intégrer à chacune des étapes, tout en respectant
l'évolution suivante :
- Janvier 1995 : 16%
- Janvier 1998 : 33%
- Janvier 2002 : 51%
- Janvier 2005 : 100%
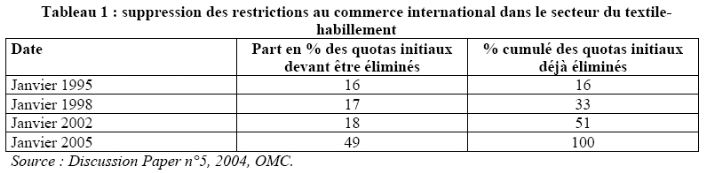
En réalité, ces « marges de
manoeuvre » ce sont avérées être bien trop
importantes. En effet, pendant une période de dix ans, les pays
importateurs n'ont levé leurs quotas que sur des catégories de
produits où la concurrence était moindre. Les plus efficaces et
les plus compétitifs sont restés contingentés :
«Ils n'ont fait que retarder le processus d'intégration, et la
transition a été d'autant plus abrupte le 1er janvier
dernier ».
Les deux plus grands marchés du Monde, à savoir
les Etats-Unis et l'Europe, se sont contentés du « minimum
légal », pendant les trois premières étapes de
la libéralisation, tout en sachant que ce sont eux qui absorbent
l'essentiel des importations mondiales de vêtements ; ils ont
procédés de la manière suivante : laisser sous le
régime des quotas près de la moitié de leurs importations
en volume, dont les plus sensibles ; et surtout, ne rien faire pour
accélérer le calendrier de libéralisation du commerce
textile-habillement.
Mais, depuis le 1er janvier 2005, les 50% de quotas
restants ont été supprimé, obligeant ainsi tout les
signataires de l'Accord de libéraliser leurs produits les plus
sensibles : pantalons, vestes, jupes, robes, manteaux, chemises,
chemisiers, pulls, etc.
Parallèlement à cela, les droits de douanes ont
été quelque peu réduits. Nous pouvons donner l'exemple des
tarifs douaniers communautaires actuellement à un niveau bas :
- 5,3% pour les fils et les fibres
- 6,3% en moyenne pour les tissus
- 11,2% pour les vêtements.
A noter également que certains des Pays les Moins
Avancés (PMA) ont pu bénéficier de droits nuls, au titre
des « Préférences Tarifaires ». Ainsi ce
fût le cas d'un pays comme le Bangladesh, premier exportateur mondial de
chemises.
Durant la signature des Accords de Marrakech, et suite
à la décision de l'OMC de supprimer le système des quotas
dans le cadre de l'ATV, « personne ne concevait que la Chine
deviendrait un tel concurrent et se développerait aussi
rapidement ».
L'échéance du 1er janvier 2005 aura en fait
permis à la grande majorité des pays Asiatiques, dont la Chine du
fait de son accession l'OMC, d'obtenir un accès totalement libre au
marché Européen.
La Chine, qui a adhéré à l'OMC le 11
décembre 2001 après plus de quinze années de
négociations (depuis juillet 1986), est donc, ainsi que tous les autres
membres, signataire de l'Accord Multifibres et bénéficie à
ce titre des dispositions de l'Accord de Marrakech : « En
qualité de membre de l'OMC, la Chine a désormais contracté
sur le plan international des droits et des obligations découlant de ces
différents accords ».
Selon M. Huang Rengang, Conseiller auprès de la Mission
Permanente de la République Populaire de Chine auprès de l'OMC
à Genève, « le processus d'accession reste
marqué par sa longueur et sa complexité ».
Un Groupe de Travail, alors composé de
représentants de 37 différents pays membres de l'OMC, s'est
entièrement consacré au programme de candidature chinoise. Ce
dernier a été présidé par l'ambassadeur suisse
Pierre-Louis Girard du SECO (secrétariat d'État à
l'économie), et aura aboutit à la rédaction d'un dossier
de plus de 1000 pages notifiant les modalités d'adhésion de la
Chine à l'OMC.
D'un point de vue chronologique, et de manière à
mieux se rendre compte de la lenteur du processus d'accession de la Chine
à l'OMC, voici quelques éléments
d'appréciation :
- juillet 1986 : candidature de la Chine
auprès du GATT
- février 1987 : mémorandum sur le
régime commercial en vigueur
- mars 1987 : mise sur pied du Groupe de Travail
- octobre 1987 : première rencontre du Groupe de
Travail
- décembre 1994 : premier Draft du rapport du
Groupe de Travail
- septembre 2001 : rapport adopté par le Groupe de
travail
- novembre 2001 : rapport adopté par la
Conférence ministérielle
- décembre 2001 : adhésion
L'adhésion à l'OMC ne signifie pas seulement
pour la Chine, la possibilité, à terme, de s'ouvrir à
l'international et celle de pouvoir entrer librement sur les marchés du
Monde entier, mais également un nombre de défis importants
à relever. La Chine se doit en effet, selon le Conseiller Huang,
« d'équilibrer les droits et obligations
contractés », ainsi que de préserver le niveau
élevé de confiance instauré au sein de la
communauté internationale. Le pays doit par ailleurs
« surmonter les problèmes posés par les
différences culturelles ainsi que par les tensions entre nationalisme et
internationalisme ».
' ' '. ' ' ' ,
.
II. Reconfiguration totale du secteur textile dans le
Monde
A. L'attitude de la Chine face à ce changement
majeur
1.Les principaux impacts en Asie
Impact volumétrique :
La fin des Accords Multifibres est loin de marquer la victoire de
tous les pays d'Asie. Certains subiront un impact négatif sur le volume
de leurs exportations, comme le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la
Malaisie, Le Népal, les Philippines, la Corée du Sud, Taiwan, et
la Thaïlande. Ceci reste principalement dû à leur manque de
compétitivité.
D'autres, à l'inverse, seront les grands gagnants de cette
nouvelle configuration, notamment grâce au fait que ce sont les pays dont
les quotas sont très fortement utilisés. Nous pouvons citer
essentiellement, la Chine, Hong-Kong, l'Inde, et le Pakistan (tableau 2). A
noter qu'un quota est dit atteint s'il est rempli à 90%.
Tableau 2 : quotas atteints en 2001
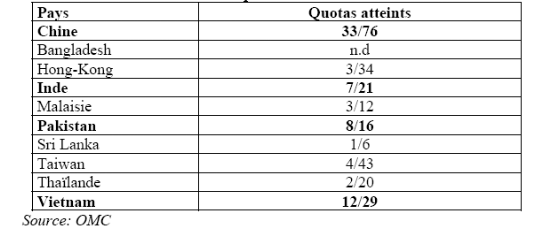
Il nous apparaît ici évident que ce nouvel
équilibre asiatique, au profit de la zone chinoise (Chine - Hong-Kong -
Macao), va se faire au détriment d'autres pays producteurs pour deux
raisons :
1. la perte de la protection apportée par le
système des quotas
2. le manque d'effort de compétitivité
Par ailleurs, notons que pour des pays comme le Bangladesh ou le
Sri Lanka, le démantèlement des Accords Multifibres n'aura aucun
impact.
Enfin, nous pouvons également constater les quelques
prévisions de l'OMC concernant l'évolution des parts de
marchés de la Chine dans le secteur textile, avant et après la
fin du système des quotas, sur les deux principaux marchés
mondiaux (graphiques 3 et 4).
Graphique 3 : part de marché de la Chine avant et
après le démantèlement des quotas, dans l'Union
Européenne
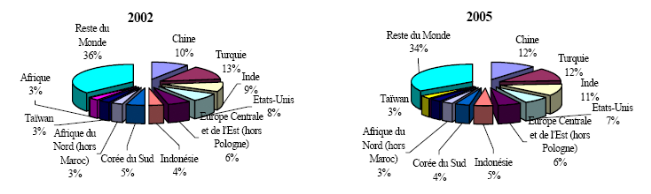
Graphique 4 : part de marché de la Chine avant et
après le démantèlement des quotas, aux Etats-Unis
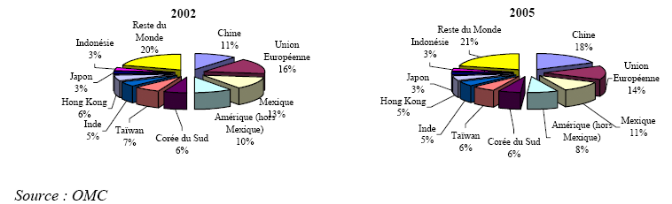
Ainsi, sur le marché européen du textile, la
Chine verra sa part de marché augmenter de 2 points, tandis que les
Etats-Unis et la Turquie n'en perdront qu'un.
Sur le marché américain, l'abolition des quotas
aura un impact beaucoup plus marqué du fait que les barrières
à l'importation soient plus nombreuses. Et, même en supposant
qu'il n'y ait plus aucune barrière à l'importation de produits
asiatiques, les parts de marché de la Chine augmenteraient de 7 points,
tandis que celles de l'Union Européenne et du Mexique seraient
réduites de 2 points (respectivement à 14% et 11%).
Impact sur les catégories de
produits :
Il est intéressant de remarquer que tous les types de
produits ne sont pas touchés par la fin du système des quotas.
- les principaux produits concernés sont : les
pull-overs, sous-pulls, chandails, pantalons, et les T-shirts.
- Les produits peu ou pas affectés sont : les
chemises, chemisiers, lingerie féminine, vêtements de travail,
costumes, vestes, manteaux pour hommes, tailleurs, ensembles, robes, jupes,
parkas, blousons, anoraks, blousons, imperméables pour femmes, linges de
maison et de lit...
Impact sur les prix et les marges :
De manière générale, l'augmentation non
négligeable de la part des produits importés de la zone Asie,
aura pour première conséquence, de redynamiser la consommation du
Monde entier et notamment de l'Europe et des Etats-Unis.
En effet, selon une étude faite en janvier 2004 par
l'Association Américaine des Industries de l'habillement/chaussures
(AAMA), les prix des vêtements sur le marché Américain
devraient baisser de 11% suite à la fin du système des quotas.
En ce qui concerne le marché Européen,
l'élément suivant est à noter : entre 2002 et 2003,
les prix moyens à l'importation des vêtements tissés de
l'Union Européenne, en provenance de Chine, ont été
divisés par deux.
Selon certains spécialistes, « les prix chinois
vont ainsi devenir la norme des marchés, entraînant dans leur
baisse tous les niveaux de gamme ».
Enfin, suite à la croissance de l'offre sur le
marché de l'Union Européenne, due essentiellement au processus de
libéralisation de la concurrence, les producteurs vont être en
quelque sorte « obligés » de revoir leurs marges
à la baisse.
Impact sur la structure de la
distribution :
Depuis le 1er janvier 2005, nous assistons à
une restructuration progressive mais néanmoins rapide de la distribution
textile dans le Monde. Celle-ci s'opère en deux
étapes indissociables l'une de l'autre :
- tout d'abord, les grandes enseignes développent des
stratégies de sourcing vers l'Asie. Elles ont dorénavant
la possibilité de trouver dans cette partie du Monde des prix bas, de la
qualité, une offre de plus en plus diversifiée, de la
créativité et des délais de plus en plus courts.
- puis, c'est la grande distribution du secteur
textile-habillement, notamment en Europe, qui s'en trouvera touchée. A
terme, les stratégies des grandes enseignes auront pour but
« d'hypertrophier » cette grande distribution, au
détriment des distributeurs traditionnels.
Impact sur les stratégies
marketing :
En Asie, le démantèlement des Accords Multifibres
aura également un impact sur le développement de nouvelles
stratégies dites « de valeur ajoutée ».
La grande majorité des entreprises chinoises souhaite
« s'affranchir de leur unique rôle de sous-traitant »
en se dirigeant vers le produit fini et les marques. Elles se sont en effet
très rapidement aperçues, qu'elles ne tiendraient pas longtemps
face à la concurrence de l'après 1er janvier
2005 ;
Ainsi, une étude réalisée par le Hong-Kong
Trade Council en janvier 2004, a montré que « environ 40%
des entreprises se sont engagées dans le développement de leurs
propres marques pour cesser d'être de simples poseurs d'étiquettes
pour le compte de donneurs d'ordres étrangers ».
1.La restructuration du secteur textile Chinois
En novembre 2001, la Chine est donc parvenue à entrer dans
l'OMC. Cela lui a permis de bénéficier de la levée des
quotas sur 11 catégories de produits (dont 8 concernent les
vêtements) en Europe et 23 aux Etats-Unis.
Ainsi nous pouvons remarquer l'évolution des exportations
chinoises comme premier élément
d'appréciation (graphique 5 ; tableau 3) :
- Les exportations chinoises de textile entre 2001 et 2003 ont
fortement augmenté (53% en valeur) et leur part dans les importations
mondiales a progressé de 5,4 points, passant de 10,5% à 15,9%
entre 2000 et 2003.
- La valeur des exportations chinoises, sur le marché de
l'habillement, a accéléré de 39% entre fin 2001 et 2003.
Le poids de la Chine dans les exportations mondiales a ainsi augmenté de
4,2 points.
Graphique 5 : Evolution des exportations chinoises de
produits textile et habillement (en milliards de dollars)
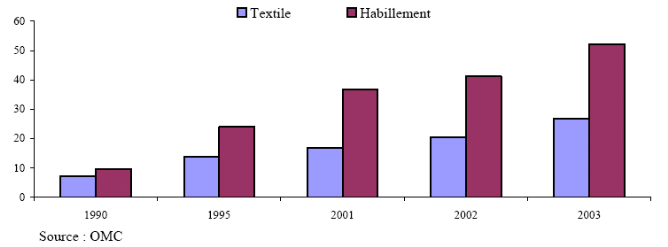
Tableau 3 : valeur et variation annuelle des
exportations chinoises de produits textiles et d'habillement
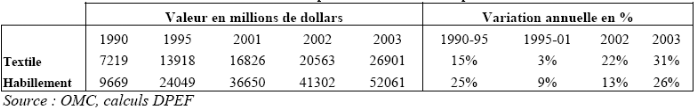
Malgré les nombreux dispositifs de contingentement qui
ont, pendant plus de quarante ans, lourdement pénalisés les
exportations de la Chine, le pays a donc su rester un acteur de premier plan.
Il est, en effet, le premier producteur et le premier exportateur
mondial de textile et d'habillement.
Sa seule part dans le marché communautaire
s'élève à plus de 22% pour l'habillement ; et,
grâce au rôle non négligeable de Hong-Kong
(réintégré à la Chine depuis juillet 1997), la
Chine a été à même de réaliser le quart des
importations Européennes en 2004 (soit environ 25,8% du total des
importations).
Depuis le 1er janvier 2005, le gouvernement chinois
ainsi que les entreprises sont entrés dans une phase de
diversification.
La tendance aurait été, si nous prenons l'exemple
d'autres pays jusqu'alors pénalisés par les quotas, d'entrer dans
un processus de progression du volume des exportations.
Mais, la Chine à préférer miser sur des
produits à forte marge, positionnés sur le moyen/haut de gamme.
Ceci, en augmentant de manière considérable, ses dépenses
en recherche et développement et en formation. Le secteur
textile-habillement chinois, qui compte près de 20 millions de
salariés, entend consentir à de très gros efforts dans les
domaines suivants : la création, l'organisation, et
l'investissement dans les nouvelles technologies, surtout celles touchant au
tissage.
Très prévoyante quant à son entrée
dans l'Organisation Mondiale du Commerce, la Chine avait d'ailleurs inscrit
dans son dixième plan quinquennal de l'industrie textile (2001-2005),
« le renouvellement de son appareil industriel et des
avancées technologiques pour une meilleure qualité des
produits ». Le gouvernement chinois ajoute de plus que
« ces conditions doivent contribuer pour plus de 60% à la
croissance de la valeur ajoutée produite par la
filière ».
D'un point de vue géographique, c'est tout le pays
qui se réorganise en fonction d'une logique extrêmement bien
définie :
- les entreprises situées près des
côtes, produisent pour l'exportation ;
- celles situées à l'intérieur des
terres, se destinent au marché intérieur ;
- enfin, les entreprises situées à l'ouest du pays,
développent des activités de partenariat avec des investisseurs
étrangers (Italiens, américains, taiwanais, japonais,
coréens et allemands).
Enfin, il est important de signaler que lors du cycle de
négociation de l'Uruguay Round, c'est-à-dire au moment où
il était question d'un changement majeur dans la configuration du
secteur textile-habillement dans le Monde, aucun pays membre de l'OMC ne s'est
soucié des travailleurs et des nombreuses pertes d'emplois qui en
découleraient. La suppression des quotas aura certes été
bénéfique aux entreprises mais elle aura fait de ces travailleurs
les « grands perdants » de ce processus.
A aucun moment, la Chine ne s'est posée la question du
devenir de ses millions d'employés, lors de sa décision de
restructuration du secteur. Seule la rentabilité importe, le
travailleur, lui, continue d'être exploité.
B. Les conséquences directes au Maroc :
1. La chute des investissements dans le secteur textile :
Evolution des investissements dans le secteur textil habillement
au Maroc :
Au premier trimestre 2005 on note un recul de 16
% des exportations marocaines de textile-habillement.
On remarque en fait une condamnation du sécteur par les
banquiers marocains et européens, qui selon eux le secteur est
voué à une mort certaine venant de l'explosion du textile
Chinois.
Selon l'OMC le poids du Maroc dans les importations
Européennes noterai un recul de 1 point passant de 5% à 4% suite
à la suppression des quotas.
Le cas du Mexique :
Le Mexique jusqu'en 2004 était la base d'exportation des
marques américaines, mais aujourd'hui c'est la Chine qui prends sa place
sur le marché Américain.
Le cas du Mexique est très illustratif car on remarque que
malgré la proximité géographique, Cette menace est
d'autant plus réelle que sur le marché des T-shits et des
tricots, deux famille d'articles qui assurent plus de la moitié des
exportations marocaines de la maille vers l'union Européenne qui sont
aussi une des spécialité de la Chine.
La part du Maroc dans le commerce mondiale est passée de
1,35% à1,20% entre 1999 et 2003 dans le secteur.
Les exportations marocaine de vêtements à
destination de l'Union Européenne ont augmentés de 27% entre 1998
et 2002, mais ce chiffre reste faible comparé aux exportations des PECO
qui ont augmentés de 34%, celles des autres pays
méditerranéens de 40%, et celles de la Chine de 65 %.
2. Une crise prévisible :
« Après quatre décennies de quotas,
l'ouverture des marchés en 2005 constituera pour le Maroc un choc
concurrentiel majeur » propos du premier ministre Driss Jettou lors
de la journée internationale du textile à Marrakech en Octobre
2003.
Selon le ministère du commerce et de l'industrie qui suit
l'emploi à travers la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité
Sociale), le secteur aurait perdu au premier trimestre 2005 4000 emploies.
D'après le haut commissariat au plan ce serait plus 95000 emploies de
perdu.
Coûts de main d'ouvre trop élevé :
Au Maroc le salaire moyen dans le secteur textile est de 210
euros en moyenne contre 30 euros en Chine
Le Maroc a commencé à sentir les effets de la
concurrence asiatique dès la fin des années quatre-vingt-dix.
L'ensemble de la profession au Maroc voit les grands d'onneurs d'ordre se
tourner vers la Chine, l'Inde, Pakistan,etc...
Ce qui avait permis au Maroc de construire son sercteur textil au
détriment des emploies européen se retourne aujourd'hui contre le
Maroc.
Settavex est une filiale du producteur de toile de jean espagnol
Tavex. Cette dernière produisait au début des années
quatre-vingt-dix 80 % de toile basic au Maroc pour passé à 60% en
1996 et plus que 15 % aujourd'hui.
C. Perspectives et recommandations
1. Les solutions apportées par
l'OMC
La fin du système des quotas en janvier 2005 a donc eu
pour principale conséquence de reconfigurer le secteur
textile-habillement dans le Monde, au bénéfice de pays comme la
Chine ou l'Inde, et au détriment des pays les plus pauvres.
De nombreuses demandes émanant principalement des pays du
Sud, ont été faites à l'OMC, dans le but de prolonger ce
système de contingentement des exportations.
En effet, les conséquences pour ces pays sont lourdes et
ne vont qu'empirer au fur et à mesure des années, tant du point
de vue économique que du point de vue social. Toutefois, la
probabilité pour qu'un accord de prolongation des quotas soit
signé par l'OMC reste mince dans le sens où cela
nécessiterait la signature des 148 pays membres, dont la Chine et
l'Inde.
Par ailleurs, lors de la signature de l'Accord sur les Textiles
et les Vêtements, il a été prévu une sorte de clause
impliquant « un mécanisme de sauvegarde
transitoire », en faveur des pays pouvant subir un
préjudice grave suite à la fin des quotas.
De ce fait, un pays qui considère que la très forte
croissance des importations provenant d'un pays plus compétitif aura un
effet dévastateur sur sa propre industrie (celle-ci fabriquant des
produits similaires ou concurrents), aura la possibilité de limiter le
pourcentage de ces importations.
Cette limitation ne pourra être effective qu'en fonction de
certains critères ; voici, de manière exacte, ce que stipule
l'OMC :
« Cette mesure de sauvegarde peut être
appliquée sur une base sélective, pays par pays, par accord
mutuel ou, si aucun accord n'est intervenu au cours de consultations dans un
délais de 60 jours, de manière unilatérale. Cette
limitation ne peut pas être inférieure au niveau des importations
en provenance du pays exportateur au cours des douze derniers mois et ne peut
être maintenue que pendant trois ans au maximum. »
Ce recours au contournement des quotas aura attiré les
Etats-Unis et l'Union Européenne, qui craignent tout deux, pour leurs
emplois (environ 2,7 millions de travailleurs dans le secteur dans l'Europe des
25). Ainsi, ayant constaté une hausse de 1000% des importations de
certains produits par la Chine (robes de nuit, soutien-gorge et robes), les
Etats-Unis ont donc décidé d'utiliser leur possibilité de
limitation des importations. Cette clause de sauvegarde aura également
été utilisée par l'Union Européenne dès que
celle-ci a constaté qu'entre 2001 et 2003, la valeur des importations en
provenance de Chine avait presque doublé.
C'est pour faire face à cette situation que la
Commission européenne, au nom de tous les États membres, a conclu
le 10 juin dernier un accord avec la Chine qui permettra de contrôler et
de limiter les importations de certains textiles chinois vers l'UE
jusqu'à la fin 2008.
2. La reconversion du Maroc est-elle
possible ?
Les quatres filières sur lesquelles le Maroc doit
miser :
Maille :
Une des spécialités marocaine est la maille
circulaire (T-shirts et polos). Mais aujourd'hui la production est trop basique
et il faut faire des adaptations pour faire évoluer la production vers
des produits à forte valeur ajoutée.
L'industrie doit tisser des cotons plus élaorés
pour se démarquer par rapport à la production asiatique. Le parc
de métiers circulaires est puissant, mais doit bénéficier
d'une forte adaptation pour satisfaire l'évolution souhaitée vers
la mode.
C'est ce même shéma d'évolution que doit
suivre le tricotage réctiligne (pulls) en changeant son parc de
machine pour monter en gamme.
Chaîne et trame :
Les vêtements chîne et trame ont une marge de
progression importante. Le chaîne et trame souffre d'un manque de tissu
locaux, tournés vers le denim et le tissu d'ameublement : on
éstime la production de tissu vestimentaire à 15 millions de
mètres, alors que les besoins découlant de la production de
vêtement atteingnet 300 millions de mètres. Dans ces conditions il
ne serait pas dérésonnable que le Maroc envisage de produire
jusqu'à 100 millions de mètres de tissus vestimentaires. C'est en
effet sur le tissu et l'ennoblissement que se jouera la capacité du
Maroc à monter en gamme.
Jean et Sportswear :
Le Jean est cité en premier par les donneurs d'ordre
internationnaux comme spécialité marocaine. Pourtant, le volume
exporté en Europe est aujourd'hui très largement surpassé
par les livraisons Turques et Tunisiennes. Le potentiel est donc très
important, d'autant plus que le Jean entraine avec lui dans son sillage un
chiffre d'affaires de vêtements sportswear estimé à deux
fois celui du pantalon jean proprement dit. Ce segment qui inclut des
vêtements de chaîne et trame et de maille, progresse au
détriment du vêtement plus formel. On peut donc dire que le Jean
est une locomotive pour tout le secteur.
Tissu d'ameublement et linge de maison :
Le textile de maison est lui aussi un vecteur potentiel
identitaire fort pour le Maroc, très clairement relié au
« salon marocain » et à l'artisanat. L'avenir de ce
secteur requiert une réfléxion pointue sur la distrribution qui
permettrait de déféndre le marché intérieur et de
construire l'exportation. La valeur ajoutée est rechercher d'abord dans
le produit fini avant de songer à des dévelopements importants de
production textile (tissage, filature). Le choix d'une création
étayée par un marketing lucide est la seule voie de survie.
Les entreprises doivent se regrouper :
La taille des entreprises est un handicap. Elles restent au Maroc
encore trop petites, alors que pour satisfaire les besoins de plus en plus
grands et diversifiés, la grande distribution préfère les
grands fabriquants et disposant de capacités de productions de plusieurs
produits.
Le secteur doit diversifier ses
débouchés :
Aujourd'hui 90% de la production marocaine du textile habillement
est exportée vers l'Europe ce qui rends le Maroc particulièrement
sensible aux variations conjoncturelle de la demande de l'Europe. Il faudrait
donc avoir de nouveau clients. Aujourd'hui le marché Américain
semble très ouvert suite à la signature de l'accord de libre
échange entre le Maroc et les Etats-Unis. La signature de cet accord
donne en effet un avantage aux produit marocains d'environ 30 % sur leurs
concurrents Chinois. De plus le savoir faire acquis par les marocains au
contact de l'Europe semble intéresser les Etats-Unis.
Le Maroc pourrai aussi jouer une autre carte celle des pays
Arabes, notament ceux du Moyen-Orient, dont il dispose d'une bonne connaissance
et proximité linguistique.
Be the « second Best »:
On remarque que sur les produits non soumis aux quotas,
l'évolution des importations américaines des produits chinois est
passée de 9% à 70% entre 2001 et 2004, et qu'elle se stabilise
à 70%. On peut donc imaginer que la Chine et l'Inde ne pourront pas
aller aux delà des 70 % observer aux Etats-Unis. Il faut donc que le
Maroc se positionne comme le « deuxième
meilleur ».Le Maroc pourra par exemple récupéré
les parts de marché que la Pologne laissera quand se salaires
augmenteront.
Le Maroc a besoin de tissu :
L'étude de l'institut français de la mode
commandée par l'AMITH en 2003 révèle que l'insuffisance de
matière première sur place a fragiliser la confection.
Le textile et la confection n'ont jamais avancés
ensemble.
L'industrie textile locale s'est contenté d'un lucratif
marcé intérieur à l'abri des barrière
douyanière. Son faible développement, tant quantitatif que
qualitatif, a contraint la confection locale et les donneurs d'ordre à
faire leur sourcing à l'extérieur.
Recevoir les nouvelles délocalisations :
Les délocalisation industrielles sont inéluctables
en Europe et le Maroc aspire à les recevoir. C'est ainsi que le Maroc
éspère développer entre autre son industrie textile.
De la survie du textile européen dépend
étroitement celle de toute la filière confection marocaine car
faute de tissus à proximité, le Maroc serait obligé
d'aller les chercher plus loin et perdrait son avantage compétitif
fondé sur la réactivité.
Réduire les délais de livraisons :
Aujourd'hui les grandes distributions préfère
travailler en flux tendu. Notre proximité géographique devrait
favoriser les séries courtes et permettre un achalandage réactif
aux variations de la demande. En effet Zara par exemple suit les ventes
grâce à l'informatique. Lorsqu'un modèle marche il faut en
produire très rapidement.
Il faut donc arrivé à produire les produits en sous
traitance en 15 jours et 4 semaines pour les produits fini.
Le sourcing extérieur :
D'après l'institut français de la mode il serait
trop tard pour développer le textile et il serai
préférable de faire ses courses ailleurs pour chercher des
matières à traiter par une industrie d'ennoblissement, de
« converters » ou de « marketers ».
Délavage, grattage, flammage, teinture,etc. ; tous ces
« mauvais traitements» que l'on fait subir au Jeans et dont les
jeunes sont si friands en Europe.
Vu que le Maroc a signé un accord de libre échange
avec la Turquie, qui a développé un secteur textile solide, le
Maroc entend bien s'appuyer sur eux pour la fourniture des tissus.
Sortir par le haut en montant en gamme :
Il faut investir dans les circuits de distribution dans les
nouvelles technologie de l'information pour optimiser les moyens et permettre
une meilleur gestion des commandes et délais d'exécution, le B to
B, le design, la mode. Passer de la sous traitance (qui bride les initiatives
des producteurs) à la co-traitance (relation plus
équilibrée entre l'acheteurs et confectionneurs qui laisse plus
de place à la qualité, la créativité et la
recherche de valeur ajoutée) et la production de produits fini remonter
en gamme et différencier l'offre ceci passe par des activités
« d'ennoblissement », il faut investir dans R&D et
mettre en oeuvre des cycles de formation aux différents niveau de
qualification.
Des considérations éthique et
environnementale :
D'importante mesures ont été prise par les
producteurs marocains ces dernières années concernant les
considérations éthiques, social et environnementale. Les grandes
marques devrait être sensible à ça.
Constitution d'un pôle et d'un marché
pan-euroméditerranéen :
La constitution d'un tel pôle ( composé de l'UE,
Roumanie, Bulgarie, Afrique du nord et de la Turquie) permettreait des
échanges plus fluide et plus performant. Cette fluidité devrait
permettre d'apporter une réponse plus adaptée aux exigences du
circuit court, tandis que l'harmonisation des règles d'origine serait de
nature à privilégier les approvisionnements de proximité
ce qui prolongera les systèmes de protection après les quotas en
quelques sorte.
CONCLUSION
L'après 1er janvier 2005 est donc loin
d'être sans conséquence. Bien au contraire, il aura eu pour effet
principal celui de faire évoluer les industries textiles du Monde
entier. De manière positive dans un premier temps, comme pour la Chine,
qui apparaît comme étant le grand bénéficiaire de ce
remaniement ; puis, dans un second temps, de manière plutôt
néfaste, pour des pays déjà touchés par la
pauvreté et le sous-emploi, comme le Maroc.
Ce qui reste assez surprenant, c'est qu'après toutes les
études réalisées sur le sujet ainsi que toutes les
prévisions établies par les differentes agences (comme ici, l'OMC
où tous les membres sont donc au courant !), la Chine ne se
préoccupe aucunement des conséquences sociales et humaines
désastreuses que son quasi-monopole va provoquer sur les
économies des pays les plus pauvres.
Peut-être s'est elle, elle-même, trop longtemps
retrouvée dans une situation où la législation de l'OMC,
totalement consciente de son avantage compétitif, n'a fait que l'obliger
à se contenir, qu'elle ne tolère aujourd'hui plus aucun obstacle
sur le chemin de son expansion ?
Pour faire face à cette menace de plus en plus
réelle, tous les agents économiques et politiques (fournisseurs,
acheteurs, distributeurs, gouvernements, instances internationales...), doivent
se mobiliser d'urgence, et intervenir le plus rapidement possible de
manière à éviter de trop lourdes pertes d'emplois, surtout
dans les zones déjà très touchées.
Selon Jean-François Limantour, Président du Cercle
Euroméditérranéen des Dirigeants Textile-Habillement
(CEDITH), « l'Union Européenne serait bien avisée,
après des années d'atermoiements et d'inaction, de passer des
discours aux actes pour construire un véritable espace
Euroméditérranéen textile-habillement ».
SOURCES D'INFORMATION
AMITH Association Marocaine des Industries du Textile et de
l'Habillement
www.amith.org.ma
Ministère de l'Industrie, Commerce et Mise à Niveau
de l'Economie
www.mcinet.gov.ma
Le secteur textile et de la confection au Maroc
Chambre de commerce de l'ambassade d'Espagne à Tanger
La fin des accords multi fibres (doc pdf)
www.ethique-sur-etiquette.org
Dossier Textile Habillement (doc pdf)
Magazine Conjoncture N°862 Juillet août 2005
www.ccife.org
Les relations Maroc Europe à l'ère de la
globalisation
www.trade-info.cec.eu.int
Le Textile Habillement en Méditéranée etat
des lieu et enjeux
www.commerce-exterieur.gouv.fr
Enjeux pour le Maroc du démantèlement des AMF
www.leconomiste.com
Plus plusieurs articles de presse. Mais les principales sources
sont ci-dessus.
| 


