|


Congo
UNIVERSITÉ MARIEN NGOUABI
ÉCOLE
NORMALE SUPÉRIEURE
Année académique : 2021 -2022 N°
d'ordre :
MÉMOIRE
Pour l'obtention du diplôme de Master
Mention : Sciences humaines
Parcours : Master
Option : Histoire-Géographie
Spécialité : Géographie
physique (Climatologie)
Présenté et soutenu
publiquement
par
Maketo Cris Chesnel
Titulaire de Licence en Histoire-Géographie en Juin
2020
Titre :
Les enjeux d'adaptation de la ville de Pointe-Noire
au
climat
Directeur de mémoire
Samba Gaston, Maitre de Conférences,
CAMES, Université Marien Ngouabi, Congo
Jury
Président : Moundza Patrice,
Professeur Titulaire, CAMES, Université Marien Ngouabi, Congo
Membres : Ndzani Ferdinand, Maitre-Assistant,
CAMES, Université Marien Ngouabi, Congo
Samba Gaston, Maitre de Conférences,
CAMES, Université Marien Ngouabi,
Page | 1
Dédicaces
Je dédie la présente étude à :
? mon père Maketo Jean Bertin ; ? ma mère Massala
Christine.
Page | 2
Remerciements
La présente étude est le résultat de
nombreux échanges scientifiques et collaborations avec des personnes
à qui j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance. Mes sincères
remerciements s'adressent à Monsieur Samba Gaston, Maitre de
Conférences CAMES, pour avoir accepté de diriger ce travail. Son
éternelle bonne humeur lors des séances de travail, sa
responsabilité, ses conseils, ses remarques, ses corrections et ses
suggestions nous ont été d'une extrême utilité.
J'exprime ma gratitude à Monsieur le Professeur Moundza
Patrice, président du jury et Monsieur Ndzani Ferdinand qui a
examiné ce travail.
À ces remerciements, j'associe :
+ Monsieur Massouangui-Kifouala Martin, Maitre-Assistant, CAMES.
Son aide a été
précieuse pour l'aboutissement de ce travail ;
+ Monsieur Loemba André Guy Edmond, Secrétaire
général de la Commune de Pointe-
Noire ;
+ Madame Eouani Rita Aimée Liliane, Directrice
Départementale de l'Environnement de
Pointe-Noire ;
+ Monsieur Itsouhou Désiré, chef de service du
développement touristique et de
l'écotourisme de Pointe-Noire ;
+ Madame Breheret Natalie, Directrice de l'ONG Rénatura
Congo,
+ Monsieur Marsac Rubin, chef de service de l'Océan
durable à Rénatura Congo ;
+ Madame Mboumba Sichelle, secrétaire comptable à
Rénatura Congo ;
+ Messieurs Bayoundoula Noel et Athel Melchisédek ;
+ les agents de la Direction de l'Aménagement , de
l'Urbanisme, de la Construction, de
la Gestion Foncière (M. Missima Nziengui Nicodème
et Madame Tsila née Moukoko
Kititi Chantal) ;
+ Monsieur Toli Ghislain ;
+ les membres du Centre de Recherche et d'Études sur
l'Environnement (CREE) ;
+ les agents du service de la Météorologie
Nationale ;
+ Monsieur Miouidi Georges, le chef de service du Centre
d'Assistance Météorologique
aux Activités Maritimes (CAMAM) ;
+ Monsieur Dilou Ogoto Frédi ;
+ Monsieur Mobeke Rock ;
+ Mabiala Massouangui ;
+ Monsieur Loemba Jean Hubert ainsi que tous les agents du
service de Documentation
de l'Office de Recherches Scientifique et Technique d'Outre-Mer
(ORSTOM).
Une pensée fraternelle à mes condisciples de la
promotion de Maters notamment Mamadou Jucélie Mariame, qui m'a toujours
considéré comme son cadet, Boucka Ilama Chardenne Providence,
Mabial'Ma-Limingui Charles Benhazin, Bouesso Nsayi Bourges, Moundaga-Oumba
Marlyse et Mobeke Matondo Stévia pour nos échanges au
quotidien.
Je profite de cette occasion pour remercier :
+ mes tantes Ndedi Marie, Tsimba Boukondolo Sylvie, Hokabakila
Pélagie, Dianzambi Badiabo Aphonsine, Ndende Marianne et Mongongo
Brigitte Sylvie, Samba Diambou Chancelle, Mahoungou Ninon Flore ;
+ mes oncles Mianzitoukoulou Gervais, Mounoki Jean Claude et
Matoungoussi Igor ;
Page | 3
? mes frères et soeurs Maketo : Omné Lucres,
Drely Dieu-Le-Veu, Pretty Samuel et Mpolo Daniella ;
? mes cousins et cousines : Ouenadio Jos Chardin, , Nkaya
Mercia Reine, Dib Deboukondololo Dasy, Bassakinina Prince Côme, Mabiala
Mondésir, Yébas Ngouala Brehl, Mayoukou Gloire, Kalanzaya Jean
Chrispin, Makola Matondo Gladman, Pouabou Aldonove, Mombo Siloulou Gad, Mombo
Safou Mirina et Kiminou Stéphanie Steyne.
Page | 4
Liste des acronymes et abréviations
ADEME : Agence de l'Environnement et de la
Maitrise de l'Énergie ;
AEA : Afrique Équatoriale Atlantique
;
AFD : Agence Française de
Développement ;
AIC : Association Internationale de
Climatologie ;
ALUCONGO : Aluminium du Congo ;
ANAC : Agence Nationale de l'Aviation Civile
;
BOPLAC : Bois et Placages du Congo ;
BRASCO : Brasserie du Congo ;
CAMAM : Centre d'Assistance
Météorologique des Activités Maritimes ;
CAMES : Conseil Africain et Malgache de
l'Enseignement Supérieur ;
CCNUCC : Convention-Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques ;
CEREG : Centre d'Études et de
Recherches Éco-Géographiques ;
CFA : Communauté Financière
Africaine ;
CFCO : Chemin de Fer Congo-Océan ;
CFHBC : Compagnie Française du Haut et
du Bas-Congo ;
CNI : Communication Nationale Initiale ;
CNRS : Centre National de Recherche
Scientifique ;
CO2 : Dioxyde de Carbone ;
COPE : Congolaise de Peinture ;
CORAF : Congolaise de Raffinage ;
CPKN : Compagnie Propriétaire du
Kouilou-Niari ;
CRCRT : Centre de Recherche sur la
Conservation et la Restauration des Terres ;
CREE : Centre de Recherche et d'Études
sur l'Environnement ;
CV : Coefficient de Variation ;
DAUCGF : Direction de l'Aménagement,
de l'Urbanisme, de la Construction et de la Gestion Foncière ;
DJF : Décembre-Janvier-Février
;
ECO S.A : Eucalyptus du Congo
Société Anonyme ;
EFC : Eucalyptus Fibre Congo ;
ENS : École Normale Supérieure
;
FLASH : Faculté des Lettres, Arts et
Sciences Humaines ;
GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental
sur l'Évolution du Climat ;
GT II : Groupe de Travail II ;
GUMAR : Guichet Unique Maritime ;
ha : hectares ;
IAU : Institut d'Aménagement et
d'Urbanisme ;
ICU : Ilôt de Chaleur Urbain ;
IFC : Institut Français du Congo ;
JFMA : Janvier-Février-Mars-Avril ;
JJA : Juin-Juillet-Août ;
LREE : Laboratoire de Recherche et
d'Études de l'Environnement ;
MAB : Minoterie Alimentaire de Bétail
;
MAM : Mars-Avril-Mai ;
MINOCO : Minoterie du Congo ;
MW : Méga Watt ;
ND : Novembre-Décembre ;
OFEV : Office Fédéral de
l'Environnement ;
OMD : Objectifs du Millénaire pour le
Développement ;
ONERC : Observatoire National sur les Effets
du Réchauffement Climatique ;
ONG : Organisation Non Gouvernementale ;
ONU : Organisation des Nations-Unies ;
ONU-HABITAT : Programme des Nations-Unies
pour les Établissements Humains ;
ORSTOM : Office de Recherches Scientifique et
Technique d'Outre-Mer ;
PAPN : Port Autonome de Pointe-Noire ;
Page | 5
PDU : Plan Directeur d'Urbanisme ;
PEDU : Projet Eau et Développement Urbain
; PIB : Produit Intérieur Brut ;
RDC : République Démocratique du
Congo ;
RE4 : Quatrième Rapport
d'Évaluation ;
RE5 : Cinquième Rapport
d'Évaluation ;
SCB : Société de Construction des
Batignolles ;
SDU : Schéma Directeur d'Urbanisme ;
SNPC : Société Nationale des
Pétroles du Congo ;
SOCOMAB : Société Congolaise de
Manutention des Bois ;
SOCOPEC : Société Congolaise de
Pêche ;
SOFAPRAL : Société de Fabrication
des Produits Alimentaires ;
SON : Septembre-Octobre-Novembre ;
TNn : Température Minimale la plus basse
;
TNx : Température Minimale la plus
élevée ;
Total E&P Congo : Total Exploration et
production Congo ;
TRABEC : Transformation des Bois Exotiques du
Congo ;
TXx : Température Maximale la plus forte
;
UAIC : Unité d'Afforestation Industrielle
du Congo ;
UE : Union Européenne ;
UICN : Union Internationale pour la Conservation
de la Nature ;
UMNG : Université Marien Ngouabi ;
UQAM : Université du Québec
à Montréal ;
ZIT : Zone Inter Tropicale ;
Page | 6
Sommaire
Dédicaces 1
Remerciements 2
Liste des acronymes et sigles utilisés 4
Sommaire 6
Introduction générale 7
Chapitre 1 : Présentation de la zone d'étude
15
Chapitre 2 : Climat de Pointe-Noire 32
Chapitre 3 : Impacts, vulnérabilité et enjeux
d'adaptation 47
Conclusion générale 64
Références bibliographiques 65
Sites web consultés 68
Liste des figures 69
Liste des tableaux 70
Liste des photos 71
Table des matières 72
Page | 7
Introduction générale
La présente étude sur le climat et
l'environnement de Pointe-Noire contribue à la compréhension du
climat urbain et de ses impacts dans un pays en développement. Selon
Dimon R. (2008, p. 3), chaque pays doit faire du dérèglement
climatique un sujet de préoccupation et développer des
stratégies qui lui sont propres pour faire face aux mutations induites
par ce phénomène. La partie introductive de notre travail
d'étude présentera le contexte et la justification, la
problématique, l'état de connaissances sur la question, la
clarification des concepts, l'approche méthodologique et l'articulation
du travail.
Contexte et justification
Le changement climatique est annoncé comme l'un des
plus grands défis auxquels les sociétés humaines
contemporaines se trouvent désormais confrontées (Rocle N., 2017,
p. 17). Le dérèglement climatique se caractérise par
l'augmentation de la température moyenne, la recrudescence des
précipitations, l'élévation du niveau de la mer, le
phénomène d'Ilot de Chaleur Urbain (ICU) et les inondations des
zones côtières. Dans son quatrième rapport de
synthèse, le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution
du Climat (GIEC, 2007) montre que malgré les efforts de réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES), certains impacts des
changements climatiques seront inévitables. Les études
menées par le Programme des Nations-Unies pour les Établissements
Humains (ONU-HABITAT, 2010, p. 27) montrent que les villes sont les moteurs de
la prospérité économique et du bien-être social.
Suivant l'évolution climatique, ces zones urbanisées seront
d'autant plus vulnérables. Nous nous interrogeons alors sur l'adaptation
des villes congolaises face aux changements climatiques. Pour ce faire, nous
avons jugé bon de mener une réflexion sur les « enjeux
d'adaptation de la ville de Pointe-Noire au climat ». Cette
étude revêt un double intérêt :
l'intérêt scientifique parce qu'elle contribue à la
climatologie urbaine et l'intérêt social en ce qu'elle analyse la
gestion de l'environnement urbain dans le cadre du changement climatique.
Problématique
Les travaux de la Communication Nationale Initiale (CNI, 2001,
p. 43) admettent que l'évolution climatique est tenue pour l'une des
menaces les plus sérieuses pesant sur la durabilité de
l'environnement. Les scientifiques s'accordent en général
à admettre que le climat de la terre se trouve affecté par
l'accumulation des gaz à effet de serre (GES). Étant donné
que le climat se réchauffe, les villes présentent un aspect
particulier : elles subissent fortement ses effets. Suivant l'évolution
climatique, les espaces urbains surtout en zones côtières seraient
vulnérables en raison de la forte concentration de population et du
regroupement d'infrastructures. La ville de Pointe-Noire offre aux chercheurs
des objets d'étude importants
Page | 8
du fait des multiples mutations qu'elle connait au fil des
années. Cette étude suscite plusieurs questions :
Question de recherche principale
Comment la ville de Pointe-Noire assure-t-elle sa
résilience face à l'évolution du climat ?
Questions secondaires
- Comment évolue le climat de la ville de Pointe-Noire
?
- Quels sont les effets induits par le climat sur la ville de
Pointe-Noire ?
- Quelles sont les mesures et stratégies d'adaptation
de l'agglomération de Pointe-Noire au climat ?
Objectifs
Notre travail aborde une question d'actualité dans une
ville côtière du Congo. Plusieurs objectifs ont été
fixés dans la présente étude.
Objectif principal
- Apprécier la résilience de l'agglomération
de Pointe-Noire face au changement climatique.
Objectifs secondaires
- Analyser l'évolution du climat de Pointe-Noire ;
- Répertorier les effets du climat sur la ville de
Pointe-Noire ;
- Recenser les mesures et stratégies d'adaptation de
l'agglomération de Pointe-Noire au climat.
Hypothèses
Hypothèse principale
- L'agglomération de Pointe-Noire présente une
faible résilience face au changement climatique.
Hypothèses secondaires
- Le climat de Pointe-Noire connait de profondes modifications
au niveau des précipitations.
- La ville de Pointe-Noire subit de plein fouet les effets
pervers du changement climatique.
- Pour rendre résiliente la ville de Pointe-Noire,
plusieurs mesures et stratégies ont été mises en place.
Page | 9
État de connaissances sur la question
L'analyse des enjeux d'adaptation au climat sur le plan
international a fait l'objet de bon nombre de travaux dont ceux de
Mansanet-Bataller Maria (2010), du GIEC (2007), de l'Union Mondiale pour la
Conservation de la Nature (UICN, 2016), de l'Agence de l'Environnement et de la
Maitrise de l'Énergie (ADEME, 2020), de l'Institut d'Aménagement
et d'Urbanisme (IAU, 2014) et de World Agroforestry Center (2012).
Toutefois, sur le plan national, la littérature sur
l'étude fondamentale du climat et des enjeux d'adaptabilité
à l'évolution climatique est très pauvre. Quelques travaux
abordent la question. On peut citer entre autres :
? Samba Gaston (2020) a rédigé sur Le climat
du Congo-Brazzaville. Il montre que le Congo présente deux nuances
climatiques : le climat équatorial et tropical humide, puis
énumère les impacts et la vulnérabilité de ce
territoire face au changement climatique. La question d'adaptation au climat
est également abordée par l'auteur ;
? Le Ministère de l'Environnement, du
Développement durable et du Bassin du Congo (2021) a publié un
ouvrage intitulé Contribution déterminée au niveau
national de la République du Congo. Il montre l'évolution
des émissions des gaz à effet de serre (GES) au Congo
accélérant ainsi le processus du changement climatique. Aussi, il
évalue les impacts et la vulnérabilité de ce territoire au
climat. Les secteurs ciblés sont l'énergie, la santé de la
population des établissements humains. Les stratégies
d'adaptation au climat ont été évoquées afin de
renforcer la résilience du Congo aux aléas climatiques. Enfin,
les besoins d'adaptation au climat sont mentionnés ;
S'agissant des villes congolaises, les études
récentes sont celles de :
? Massouangui-Kifouala M. et al. (2021) qui ont
travaillé sur la Vulnérabilité et la résilience
des quartiers précaires à Brazzaville (République du
Congo) face au changement climatique : cas de Soukissa et
Moukondzi-Ngouaka. Dans cet article, les auteurs montrent qu'aucun pays au
monde n'échappe aux changements climatiques. Ses conséquences
sont très dramatiques dans les villes des pays en voie de
développement. Ces modifications se traduisent par une augmentation des
totaux pluviométriques et des jours extrêmement pluvieux. Les
populations superposent des sacs remplis de sables au-dessus d'un talus des
ordures ménagères, des carcasses des voitures et des pneus hors
d'usage pour contrecarrer l'action des eaux pluviales et d'autres ayant des
moyens financiers plus ou moins acceptables se permettent de clôturer
leurs parcelles par des murs assez élevés. Les populations
surélèvent les fondations de leurs maisons. Cependant, ces
stratégies manquent d'efficacité en ce que les populations ne
bénéficient d'aucune assistance devant ces problèmes.
Page | 10
? Nzoussi H. K. et Feng Li Jiang (2014) ont apporté une
réflexion sur La gestion de l'environnement urbain à
Brazzaville : problèmes et perspectives. Dans cet article, ils
présentent les facteurs liés à l'accroissement de la
population dans l'agglomération de Brazzaville. La croissance
démographique, la demande citadine des services et des biens voire des
pressions environnementales. En effet, l'environnement urbain de Brazzaville
est sujet à plusieurs problèmes dont la mauvaise gestion des
déchets. La dégradation de son environnement est le corollaire de
plusieurs facteurs qui nécessitent des moyens adéquats pour y
faire face ; ce qui suppose la mise en place d'une politique environnementale
nécessaire afin d'épargner les populations des dangers
liés à l'environnement.
? Moundza P. (2014) a rédigé un article sur
L'habitat urbain et le réchauffement climatique à
Brazzaville. L'auteur fait mention de la notion d'adaptabilité de
l'habitat urbain face au changement climatique dans une ville congolaise. Il
analyse la croissance spatiale et démographique de Brazzaville, la
typologie de l'habitat urbain face au réchauffement climatique. La
plupart des cases en parpaing (briques agglomérées) couvertes de
toits de tôles et des baraques en tôles sont mal ventilées.
La nature des matériaux utilisés pour la construction des maisons
favorise le réchauffement de l'habitat à Brazzaville. Les
constructions de manière désordonnée entraînent une
densification de l'habitat et l'orientation des bâtiments, de même,
affecte l'atmosphère intérieure. L'augmentation de
températures à Brazzaville s'accompagne surtout d'une mauvaise
aération de la ville.
? Maléké S. P. L. (2007) a réalisé
des travaux sur Brazzaville, son environnement face aux changements
climatiques. L'auteur aborde la question de l'évolution du climat
(précipitations et températures). Le test de Mann Kendall a
été appliqué aux séries de ces deux principaux
paramètres climatiques de la capitale congolaise (1932-1998). Le climat
futur de l'agglomération de Brazzaville montre son devenir si le climat
venait à changer. Les problèmes environnementaux seront nombreux
dont l'érosion à Talangai, les inondations à Ouenzé
et Moungali.
Concernant la ville de Pointe-Noire, les rares travaux
abordent l'analyse climatique notamment ceux du Programme des Nations-Unies
pour les Établissements Humains (ONU-HABITAT, 2012), du Ministère
de la Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du Cadre de Vie (2016)
apportent une compréhension sur l'évaluation des problèmes
environnementaux dans cette ville. Ces réflexions ont contribué
à la compréhension sur l'analyse du climat d'une ville d'un pays
en développement. Cependant, ces travaux n'abordent pas de
manière raffinée la question liée aux effets du
dérèglement climatique, aux mesures et stratégies
d'adaptation au climat dans cette ville congolaise.
Page | 11
Clarification des concepts
Pour mieux comprendre la problématique liée aux
« enjeux d'adaptation de la ville de Pointe-Noire au climat, il
serait judicieux de clarifier les mots clés dans cette étude :
Adaptation est l'accommodation des
systèmes naturels ou des systèmes humains aux stimuli
climatiques, afin d'en atténuer les inconvénients ou d'en
exploiter les avantages (GIEC, 2007, p. 102). Autrement dit, c'est l'action de
faire face au dérèglement climatique.
Changement climatique est la «
variation de l'état du climat, qu'on peut déceler
par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses
propriétés et qui persiste pendant une longue période,
généralement pendant des décennies ou plus »
(GIEC, 2014, p. 5). Elle représente l'évolution du climat en
rapport avec les activités exercées par l'homme.
Résilience est la capacité des
systèmes sociaux, économiques ou écologiques à
faire face aux événements dangereux, tendances ou perturbations,
à y réagir et à se réorganiser de façon
à conserver leurs fonctions essentielles, leur identité et leur
structure, tout en maintenant leurs facultés d'adaptation,
d'apprentissage et de transformation (GIEC, 2014, p. 5).
Variabilité climatique « peut
être due à des processus internes naturels au sein du
système climatique ou à des variations des forçages
externes naturels ou anthropiques » (GIEC, 2007, p. 114).
Vulnérabilité est la «
mesure dans laquelle un système est sensible ou incapable de faire
face aux effets défavorables des changements climatiques, y compris la
variabilité du climat et les phénomènes extrêmes
» (GIEC, 2007, p. 114).
Approche méthodologique
Pour élaborer la présente étude, plusieurs
données et méthodes ont été utilisées.
Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé
:
? les données climatiques
utilisées dans cette étude sont fournies par le service
de la Météorologie Nationale du Congo (ANAC). Les valeurs de
l'insolation, quant à elles, concernent la période allant de 1961
à 1990. Après leur collecte, elles ont été
intégrées dans la base des données du Centre de Recherche
et d'Études sur l'Environnement
(CREE). Il s'agit des données journalières des
précipitations et des températures de l'air allant de 1932
à 2004.
? les données démographiques
sont issues des travaux de l'Institut National de Statistique (INS,
2020), de l'Organisation des Nations Unies (ONU, 2019), du Ministère de
la Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du Cadre de vie (2016) et de
Keios (2016).
? les données économiques sont
également issues des travaux du Programme des Nations-Unies pour les
Établissements Humains (ONU-HABITAT, 2012) et de
l'Institut National de Statistique (INS, 2020). Les réflexions
précitées concernent sur la ville de Pointe-Noire.
? les données cartographiques ont
été établies par le service du Laboratoire de Recherche et
d'Études de l'Environnement (LREE). Il s'agit des cartes administratives
et du relief de la ville de Pointe-Noire.
? les données d'observation directe
concernent les photos prises sur la ville de Pointe-Noire notamment
sur le zone côtière, les activités économiques, les
équipements collectifs et services sociaux urbains.
? Les entretiens ont été
effectués pour recueillir des informations auprès des
enseignants-chercheurs de l'Université Marien Ngouabi et du personnel
administratif de la ville de Pointe-Noire. Leurs noms et prénoms des
personnes interrogées sont reportés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Entretiens réalisés par Maketo Cris
(septembre 2021 ; juin-septembre 2022)
|
N°
|
Noms et prénoms
|
Fonctions
|
Dates
|
|
1
|
Monsieur Diela
|
Directeur Départemental de l'Habitat et
de
l'Urbanisme du Département de Pointe-Noire
|
10/09/2021
|
|
2
|
Monsieur
Massouangui-Kifouala Martin
|
Maitre-Assistant, CAMES, Université Marien
Ngouabi
|
15/06/2022
|
|
3
|
Madame Eouani Rita Aimée Liliane
|
Directrice Départementale de l'Environnement de
Pointe-Noire
|
30/08/2022
|
|
4
|
Monsieur Itsouhou
Désiré
|
Chef de service du développement touristique
et de
l'écotourisme de Pointe-Noire
|
05/09/2022
|
|
5
|
Madame Breheret
Natalie
|
Directrice de l'ONG Rénatura Congo
|
07/09/2022
|
|
6
|
Monsieur Missima
Nziengui Nicodème
|
Agent de la Direction de l'Aménagement,
de
l'Urbanisme, de la Construction et de la
Gestion Foncière
(DAUCGF)
|
09/09/2022
|
|
7
|
Madame Tsila née
Moukoko Kititi
Chantal
|
Agent de la Direction de l'Aménagement,
de
l'Urbanisme, de la Construction et de la
Gestion Foncière
(DAUCGF)
|
09/09/2022
|
Page | 12
Source : enquête personnelle, 2022
Les méthodes utilisées sont les suivantes :
+ La recherche documentaire était
axée sur les connaissances théoriques liées aux
changements climatiques et aux les enjeux d'adaptation au climat. À cet
effet, des centres de documentation ont été consultés au
fur et à mesure du déroulement de la recherche. Il s'agit de la
bibliothèque de l'École Normale Supérieure (ENS), du
Centre de Documentation de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences
Humaines (FLASH), du service de documentation de l'Office de Recherches
Scientifique et Technique d'Outre-Mer (ORSTOM) de Pointe-Noire, de l'Institut
Français du Congo (IFC) ainsi que du service d'archives et de
documentation de la Mairie centrale de Pointe-Noire. Par ailleurs, la
consultation des sites internet a été d'un précieux
secours.
+ La collecte des données a
été réalisée au moyen des entretiens, des
données d'observation directe, du dépouillement des archives
météorologiques et démographiques.
+ Le traitement et l'analyse des données
ont été faits à travers des logiciels tels que
Word pour la saisie et le traitement du texte. Excel a permis de
réaliser des graphiques des données climatiques, de calculer les
paramètres statistiques (moyenne, écart- type et coefficient de
variation, anomalies et moyennes mobiles), des données
démographiques et économiques.
Pour compléter cette étude, nous avons
utilisé des méthodes statistiques notamment le calcul de la
moyenne arithmétique, de l'écart-type et du coefficient de
variation (CV). Samba G. (2014, p. 21) décrit ces méthodes
statistiques susmentionnées.
+ La moyenne arithmétique d'une
série statistique est le rapport de la somme des valeurs
observées sur le nombre d'observation. Elle permet de déterminer
la valeur centrale de la série pluviométrique et thermique. Sa
formule est la suivante :
??
1
?? =
= ????(????)
?? ? ??
??=1
Page | 13
+ L'écart-type est utilisé pour
fixer les seuils caractéristiques au sein d'une distribution
statistique, donc d'estimer la dispersion statistique à l'échelle
annuelle et saisonnière. Il est calculé à partir de la
formule suivante :
?? =
v? ?? (???? - ??)22
??=1
??
+ Le coefficient de variation (CV) a permis
d'apprécier la variabilité pluviométrique et thermique. Il
exprime le rapport entre l'écart-type et la moyenne. Il est l'outil
idéal pour comparer les dispersions. Toutefois, il tend à croitre
de manière outrancière lorsque la moyenne est proche de
zéro.
??
CV=
??
Page | 14
? Des valeurs centrées réduites
ont permis de dégager l'évolution des séries
climatiques. La détermination de ces valeurs consiste à
soustraire la normale de chaque valeur observée et de diviser par la
suite l'ensemble des données centrées par l'écart-type de
la série. L'anomalie présente deux caractéristiques fixes
: moyenne nulle et écart-type égal à un.
(????-??)
?=
??
? La moyenne mobile est un paramètre
très important aboutissant à une certaine réduction de la
variance et à la perte d'un certain nombre des points et de
degrés de liberté. Associée aux anomalies, la moyenne
mobile permet de déterminer la tendance générale de
l'évolution des précipitations et des températures. Chaque
valeur observée est remplacée par une valeur arithmétique
calculée à partir des valeurs voisines qui l'encadrent. Dans le
cadre de cette étude, nous avons calculé ces moyennes sur la
période de 72 ans. Ainsi Xi est remplacé dans la série par
:
MM =????-2 +
????-1 + ???? + ????+1 + ????+2
72
Articulation du travail
Notre travail d'étude s'articule autour de trois chapitres
:
- Le premier chapitre situe la zone
d'étude et présente l'histoire de la ville de Pointe-Noire. Il
analyse les éléments du milieu physique (géologie,
pédologie, relief, hydrographie et végétation) et leur
influence sur cet espace urbain et énumère les aspects humains et
économiques ;
- Le deuxième chapitre analyse les
éléments climatiques dans leur état moyen dans
l'agglomération de Pointe-Noire ;
- Le troisième chapitre
répertorie les impacts que le changement climatique a induits
sur la ville de Pointe-Noire et les enjeux d'adaptation de
l'agglomération qu'ils suscitent.
Page | 15
Chapitre 1 : Présentation de la zone
d'étude
La ville de Pointe-Noire (figure 1) est située au
Sud-ouest Congo sur la façade atlantique plus précisément
entre les latitudes 4° 47' 36" Sud et les longitudes 11° 53' 20" Est.
Grâce aux activités industrielles et à son port, elle
représente la principale plate-forme économique du pays. Elle est
limitée :
? Au Nord par la Rivière Rouge ;
? Au Sud par le village Ndjemo et l'Océan Atlantique ; ?
À l'Est par le département du Kouilou ;
? À l'Ouest par l'Océan Atlantique.
La ville de Pointe-Noire couvre une superficie d'environ 1.144
km2. Son découpage administratif lui confère six
arrondissements. Il s'agit de l'arrondissement 1 Lumumba (19 quartiers), de
l'arrondissement 2 Mvoumvou (11 quartiers), de l'arrondissement 3
Tié-Tié (17 quartiers), de l'arrondissement 4 Loandjili (13
quartiers), de l'arrondissement 5 Mongo-Mpoukou (14 quartiers) et de
l'arrondissement 6 Ngoyo (10 quartiers).
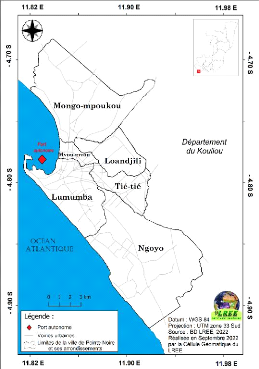
Figure 1 : Découpage administratif de la ville de
Pointe-Noire par arrondissement
Page | 16
Le présent chapitre porte sur la présentation de
cette agglomération du point de vue historique, physique, humain et
économique.
1.1. Cadre historique
Bien que l'histoire des régions côtières
situées entre le Cap Lopez et l'estuaire du Congo, au cours des derniers
siècles qui précédèrent l'installation
française, soit fort mal connue (Vennetier P., 1968, p. 69), le
passé de la ville de Pointe-Noire remonte au XVIe
siècle. En effet, les navigateurs Portugais sont à la recherche
de la route des Indes. Ceux-ci découvrent sur la zone
côtière de l'Afrique équatoriale une partie de terre
s'avançant dans l'Océan Atlantique et terminée par un
rocher bitumeux en forme d'éperon. Ils la baptisent « Punta
Negra ». Le 13 juillet 1914 est signé un décret
autorisant la construction du Chemin de Fer et deux ports dont celui de
Pointe-Noire sur le Golfe de Guinée. Le site de Punta Negra est choisi
pour abriter le port en mer. Selon Tsondabeka F. et al. (non
daté, p. 62), les compagnies concessionnaires à Loango migrent
à Pointe-Noire près du port. Cette option va faciliter
l'évacuation des produits vers l'Europe. L'activité commerciale
se développe à Pointe-Noire : la Compagnie Propriétaire du
Kouilou-Niari (CPKN) et la Compagnie Française du Haut et du Bas-Congo
(CFHBC) installent leurs factoreries dans cette ville côtière.

Photo 1 : Gare centrale du CFCO (prise de vue, Maketo, 2022)
Photo 2 : Une des premières locomotives du CFCO (prise de vue,
Maketo,
2022)
En 1921, deux chantiers majeurs se profilent à
l'horizon : la construction du Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO) et du
port maritime. Le 11 mai 1922, un décret crée officiellement la
ville de Pointe-Noire. Césaire J. M. (2009, p. 128) montre que son
premier plan directeur date de 1932. Il prévoit la réalisation
des principales infrastructures dont le port, le chemin de fer (photos 1 et 2),
l'aéroport, l'hôpital, le village, le terrain militaire, le
quartier industriel, l'électrification et le réseau de collecte
des eaux de pluies. En juillet 1922, la construction du chemin de fer est
confiée à la Société de Construction des
Batignolles (SCB). Finalement, la ligne ferroviaire est inaugurée par le
gouverneur Raphael Antonetti le 10 juillet 1934.
Page | 17
L'ouverture au trafic maritime interviendra en 1939.
L'achèvement de sa digue intérieure en 1942 accentuera la
croissance urbaine. Un premier paquebot accoste dans cette
agglomération. Grace à ce port, Pointe-Noire reste le point de
départ et d'arrivée du réseau de communication vers
l'hinterland et les pays enclavés d'Afrique centrale comme la RDC, la
Centrafrique et le Tchad). De 1950 à 1959, la ville devient la capitale
administrative du Moyen-Congo. Elle abrite le siège du gouvernement, du
chef du territoire et de l'assemblée territoriale. C'est à
Pointe-Noire que fut proclamée la République du Congo le 28
novembre 1958. Les travaux de Tsondabeka F. et al. (non daté,
p. 16) montrent que le siège de l'Assemblée territoriale du
Moyen-Congo était l'actuelle école paramédicale Joseph
Loukabou. À partir de 1959, la capitale politique congolaise est
transférée à Brazzaville. Ayant cessé d'être
la capitale, elle garde sa place de première ville économique du
pays.
En 1960, la ville connait une croissance démographique
considérable. Elle compte plus de 70.000 habitants. C'est bien
évidemment le pétrole qui avec l'arrivée des
multinationales à la fin des années 1960 a transformé la
ville. La production pétrolière va alors supplanter celle du bois
; ce qui fait que l'or noir devienne la première ressource
exploitée dans cette agglomération congolaise. La ville connait
un boom économique et démographique de 1970 à 1985. Cette
croissance est liée aux découvertes pétrolières et
minières. Sous l'impulsion de « Moho-Bilondo », Pointe-Noire
connait aujourd'hui un dynamisme qu'elle avait connu en 1996 avec la mise en
production du gisement de « N'kossa ».
Dans les années 1990, le Congo a connu des crises
provoquant ainsi d'importants flux migratoires vers les villes où il
fait bon vivre. L'agglomération de Pointe-Noire est comptée parmi
les villes qui ont accueilli des populations congolaises.
Le toponyme Pointe-Noire dérive du nom portugais Punta
Negra qui apparait pour la première fois sur une carte de 1848 en
référence d'une proéminence rocheuse sombre (
mairiedepointe-noire.cg
consulté le Jeudi 25 août 2022).
1.2. Cadre physique
Le cadre physique renvoie à l'étude de
l'environnement urbain de Pointe-Noire du point de vue géologique,
pédologique, géomorphologique, de l'hydrographie et de la
végétation.
1.2.1. Géologie et pédologie
Du point de vue géologique, l'agglomération de
Pointe-Noire appartient au bassin côtier. Les roches de ce bassin se sont
formées pendant le Mésozoïque et le Cénozoïque.
Il s'agit des
Page | 18
alluvions, des sables, des marnes, des grés, des
calcaires et des argiles bariolées. Selon Roques M. (2013, p. 8), les
sables proviennent des apports alluvionnaires quaternaires du fleuve Congo plus
au Sud. Les études menées par Moukandi N. G. D. (2012, p. 21)
montrent que des rares alluvions en bordure de quelques rivières
complètent la couverture de ce bassin. Dans ses travaux, Sitou L. (1992,
pp. 44-45) montre que les formations argilo-sableuses du Miocène sont
surmontées par 150 à 200 m de dépôts de graviers et
de sables. Ces dépôts sont cartographiés sous le vocable de
"série des cirques" à cause des énormes cavités qui
s'y sont creusées. Cette série est constituée par
plusieurs couches dont :
? une couverture gris-jaunâtre à ocre-jaune ;
? un horizon cuirassé ;
? une succession de strates d'épaisseur, de couleur et de
texture variables.
L'espace urbain de Pointe-Noire s'organise autour des sols
ferralitiques. Ceux-ci présentent une forte acidité, de faibles
teneurs en matière organique (Nzila J. D., 2013, p. 13). Les sols que
l'on rencontre dans cette ville sont essentiellement faits de sables. Les sols
influencent peu le climat en ce qu'ils s'échauffent puis cèdent
sa chaleur à l'atmosphère.
1.2.2. Relief et hydrographie
La ville de Pointe-Noire (figure 2) présente deux
unités orographiques. Il s'agit de la plaine côtière et
d'un rempart de plateaux. La plaine côtière borde l'Océan
Atlantique sur 150 km de long et 50 km de large. Les altitudes moyennes de
cette plaine dépassent rarement 100 m. Les plateaux sont situés
dans la zone périphérique de la ville. Ses hauteurs atteignent
parfois 100 m d'altitude. Le littoral favorise la pénétration des
influences océaniques vers l'intérieur du territoire. Le relief
de Pointe-Noire influence peu son climat en raison de sa faible altitude.
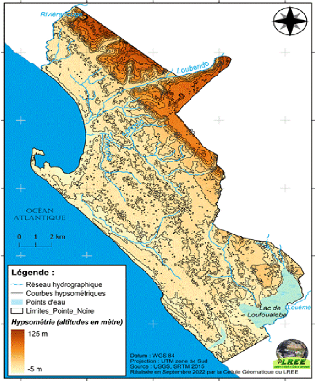
Page | 19
Figure 2 : Carte du relief et de l'hydrographie de la ville de
Pointe-Noire
Du point de vue hydrographique, plusieurs cours d'eau drainent
la ville de Pointe-Noire. Il s'agit des rivières Tchinouka, Songolo
(photo 3) et Patra. La Tchinouka prend sa source vers la plaine de
l'aéroport, puis se jette dans la Songolo. La Songolo, quant à
elle, prend sa source vers le quartier Voungou. La Patra prend sa source
à Ngondji. À cela s'ajoutent des lacs comme Tchimpounga,
Ngwambussi, Cayo, Dinga et Tchilenda. Par ailleurs, nous rencontrons à
Pointe-Noire des lagunes Mvassa, Loya et Kufoli. Le réseau
hydrographique contribue à une évaporation de la surface des
eaux, la condensation et les ascendances génératrices des
pluies.
Par ailleurs, l'agglomération de Pointe-Noire s'ouvre
sur l'Océan Atlantique, longue de quelques kilomètres formant
ainsi sa façade maritime. La ville est constituée de la baie de
Pointe-Noire. La côte sauvage offre des possibilités de
pêche et d'autres activités économiques. La présence
de l'Océan Atlantique joue un rôle déterminant sur cette
ville à travers ses courants
Page | 20
marins. M. Itsouhou Désiré nous rapporte que
« l'Océan Atlantique est la porte ouverte de Pointe-Noire au
monde ».

Photo 3 : Rivière Songolo (prise de vue, Maketo,
2022)
1.2.3. Végétation
Dans la ville de Pointe-Noire, on rencontre des formations
végétales comme la forêt du littoral et la savane. La
forêt du littoral comprend des lambeaux forestiers en îlots
résiduels sur les bas plateaux, une formation semi marécageuse le
long des vallées (Ministère de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation Technique de la République du Congo, 2007, p. 15). À
cela s'ajoute la mangrove qui pousse le long de la baie de Pointe-Noire.
Rhizophora Racemosa est le genre de mangrove le plus dominant.
L'écosystème de mangrove réduit les inondations et
contribue à éviter l'érosion côtière.
La végétation exerce une influence sur le climat
parce qu'elle réduit la température de l'air pendant le jour et
le refroidissement du sol pendant la nuit. Elle augmente
l'évapotranspiration tout en fournissant de l'humidité à
l'atmosphère et en accentuant les précipitations.
1.3. Cadre humain
Le cadre humain renvoie à l'étude de la
croissance démographique et spatiale, l'évolution projetée
ainsi que de la structure de la ville de Pointe-Noire.
Page | 21
1.3.1. Croissance démographique et spatiale
récente
Depuis les années 1950, la population urbaine de
Pointe-Noire connait une évolution considérable. Entre 1954 et
1974, elle est passée de 30000 à 144000 habitants (ONU, 2019).
Son taux de croissance démographique est évalué à
4,6 % entre 2007 et 2016 (Keios, 2016). La croissance démographique fait
de Pointe-Noire l'une des villes les urbanisées du Congo-Brazzaville
(figure 3). La croissance démographique urbaine présente bon
nombre d'origines dont l'exode rural. La ville de Pointe-Noire concentre
beaucoup d'emplois salariés et de nombreuses possibilités de gain
d'argent. C'est dans cette agglomération que s'offrent les plus grandes
possibilités de scolarisation, donc de promotion sociale et
économique. Au cours des années 1990, le département du
Pool a connu une instabilité causant le déplacement des
populations vers des centres urbains dont Pointe-Noire. En fait, l'exode rural
se profile pendant la période de crise politique. Les populations
arrivent massivement à Pointe-Noire durant cette période. Ces
néo-citadins préfèrent vivre dans des zones
périphériques. Ce qui génère des extensions des
arrondissements de la ville. On y compte désormais six arrondissements.
Le phénomène migratoire explique également la croissance
démographique dans cette ville. À cela s'ajoutent des facteurs
comme l'urbanisation anarchique, son statut économique et la
présence des voies de communications. Les faits susmentionnés ne
suffisent pas pour justifier la croissance démographique de
l'agglomération de Pointe-Noire. L'urbanisation non
contrôlée (photo 4) s'explique par le fait que les populations
occupent des espaces périphériques. Celles-ci construisent leurs
habitats de manière désordonnée et selon leurs moyens
financiers. Les normes de l'aménagement et d'urbanisation ne sont pas
prises en compte. Ceci occasionne l'extension de la ville de manière
anarchique. « La ville est aménagée en raison de
l'absence des infrastructures liées à l'aménagement
urbain. On observe un manque de canalisation. Les voies sont mal
organisées. Étant donné que les égouts manquent,
les eaux débordent lorsqu'il pleut dans la ville. Ce qui conduit
à l'inondation des bâtis et à l'érosion. Le quartier
Foukou-Soungou connait le phénomène lié à
l'inondation » (entretien avec Monsieur Missima Nziengui
Nicodème du 09 septembre 2022).

Photo 4 : Urbanisation non contrôlée
observée au quartier Louéssi (prise de vue, Maketo, 2022)
La figure 3 montre l'évolution de la population de
Pointe-Noire allant de 1950 à 2020. Sa tendance est à la hausse
depuis les années 1950.
1400000
Population de Pointe-Noire de 1950 à 2020 1254000
1138000
964000
816000
691000
585000
496000
423000
363000
312000
246000
189000
|
116000144000
|
|
|
16000 30000 55000 76000 94000
|
|
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998
2002 2006 2010 2014 2018 2020
Page | 22
Figure 3 : Évolution démographique de la ville de
Pointe-Noire de 1950 à 2020 (INS, 2020)
La croissance de la population de Pointe-Noire présente
son corollaire. Il s'agit de l'extension spatiale de la ville. Sa surface a
pratiquement triplé en 30 ans, passant de 5 500 hectares (ha) en 1974
à près de 14 800 ha en 2014. L'extension annuelle est de 300 ha
pendant la période allant de 1974 à 2014 (Ministère de la
Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du Cadre de Vie, 2016, p. 6). Ceci
entraîne un étalement urbain de manière continue.
1.3.2. Évolution démographique future
La conjugaison d'une multitude de facteurs montre que la
population urbaine de Pointe-Noire connaitra une croissance
démographique considérable dans les années à venir.
D'après les dernières perspectives urbaines des Nations-Unies
(2019), la ville de Pointe-Noire comptera 1937000 d'habitants en 2035 (figure
4). Son extension géographique se poursuivra et la protection de
l'environnement sera de plus en plus difficile à Pointe-Noire.
L'agglomération franchira sans tarder ses frontières
naturelles.
Page | 23
Nombre d'habitants
|
2500000 2000000 1500000 1000000 500000
0
|
Population projetée de la ville Pointe-Noire
|
|
|
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
2035
|
Années
Figure 4 : Projection de la population urbaine de Pointe-Noire
de 2023 à 2035 (ONU, 2019)
1.3.3. Répartition de la population
Lors du recensement de 2018, la ville de Pointe-Noire comptait
1.006.611 habitants (INS, 2020, p. 68). Sa densité est de 879,9
habitants par km2. Cette population est inégalement
répartie. Parce que les arrondissements présentent des
disparités en termes d'habitants et de superficie (tableau 1). Le
tableau 2 indique la répartition démographique et spatiale de la
ville de Pointe-Noire par arrondissement. Loandjili constitue l'arrondissement
le plus peuplé de l'agglomération, suivi de
Tié-Tié. Concernant la superficie, Ngoyo vient en premier
couvrant 70,309 km2. Il est secondé par Tié-Tié
(51,248 km2).
Tableau 2 : Répartition démographique et spatiale
de la ville de Pointe-Noire par
arrondissement en 2018
|
Arrondissements
|
Population
|
Superficie
|
|
Lumumba
|
154.025
|
28,012 km2
|
|
Mvou-Mvou
|
123.405
|
5,163 km2
|
|
Tié-Tié
|
362.007
|
51,248 km2
|
|
Loandjili
|
367.174
|
36,738 km2
|
|
Mongo-Mpoukou
|
-
|
48,483 km2
|
|
Ngoyo
|
-
|
70,309 km2
|
Source : INS, 2020, p. 68.
1.3.3.1. Répartition par âge
L'étude sur la répartition par âge nous
renseigne sur trois catégories d'âges : les jeunes, les adultes et
les vieux. D'une manière générale, la population de la
ville de Pointe-Noire présente une proportion des jeunes au
détriment des adultes et des vieux. Le pourcentage est
évalué à 86,2%. Ce sont des jeunes de moins de moins de 35
ans (Ministère de la Construction, de l'Urbanisme, de la Ville et du
Cadre de Vie, 2016, p. 7). La pyramide des âges de la population urbaine
de Pointe-Noire présente une base élargie. Cette base
dénote une forte proportion des
jeunes dans la population. Le corps de la figure
représente une population active assez importante. Son sommet est
effilé montrant un faible taux des personnes âgées.
1.3.3.2. Répartition par genre
Dans la ville océane, il y a une forte
prédominance des femmes sur les hommes. Cela peut se justifier par le
fait que les hommes exercent des travaux intenses, se livrent à la
toxicomanie. Ce qui réduit ainsi l'espérance de vie masculine.
1.4. Cadre économique
1.4.1. Secteurs d'activités économiques
Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire
représentent des secteurs d'activités économiques à
Pointe-Noire. En effet, le secteur primaire regroupe les activités
économiques utilisant directement les matières premières.
Il s'agit de l'agriculture et de l'élevage. Ces activités
s'exercent dans la zone périphérique de Pointe-Noire. Le secteur
secondaire, quant à lui, rassemble les activités industrielles se
pratiquant en zone urbaine et au centre-ville. Enfin, le secteur tertiaire
réunit en zone urbaine centrale le commerce, l'administration publique
et les services marchands.
La figure 5 désigne la répartition de
l'économie de la ville de Pointe-Noire par secteur d'activités.
Le secteur secondaire représente un pourcentage élevé soit
47%. Les populations urbaines de Pointe-Noire exercent plus les
activités industrielles. Tout ceci fait de la ville, un milieu
attractif. La main d'oeuvre y est considérable.
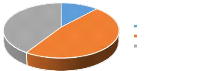
12,00%
41% Secteur primaire
Secteur secondaire Secteur tertiaire
47%
Page | 24
Figure 5 : Répartition de l'économie de la ville
de Pointe-Noire par secteur d'activités (ONU-HABITAT, 2012)
L'économie de la ville de Pointe-Noire repose sur des
activités comme l'exploitation forestière et
pétrolière, la pêche, l'agriculture, l'élevage, les
activités industrielles et portuaires. Elle est beaucoup liée
à l'histoire de la ville. Les activités économiques ont
connu une évolution considérable faisant d'elle la principale
plateforme du pays.
Page | 25
1.4.2. L'exploitation forestière
À partir des années 1940, les populations de
Pointe-Noire exploitaient du bois traditionnellement. Les techniques les plus
usuelles sont la carbonisation et la coupe du bois de chauffe. Le bois de
chauffe est utilisé à l'échelle familiale. La pression sur
cette ressource forestière est faible au cours de cette période.
Les habitants fabriquaient du charbon avec le bois du manguier. Au début
des années 1960, plusieurs industries de transformation de bois vont
s'installer à Pointe-Noire permettant à la ville de connaitre un
essor économique. Parmi ces industries, nous mentionnons la concession
Eucalyptus Fibre Congo (EFC). S'étendant sur 68.000 hectares, elle
emploie 17.000 personnes. Cette filière bois-forêts a toujours
contribué à la richesse de Pointe-Noire (Césaire J. M.,
2009, p. 129). Dans la même période, plusieurs
sociétés voient le jour comme SIDETRA et PLACONGO. Cependant,
l'exploitation forestière présente des incidences sur
l'environnement de Pointe-Noire. La déforestation a contribué
à un peu plus du tiers des émissions de gaz carbonique. Elle
provoque la diminution de la pluviosité à plus ou moins longue
distance de la zone déboisée, la diminution de l'humidité
de l'air, l'augmentation de la température de l'air et de la vitesse du
vent. Le Tacon F. (2021, p. 78) montre que la déforestation entraine une
augmentation de la température de l'air en surface, une réduction
de l'évapotranspiration, une réduction de la formation des
nuages, une augmentation de la radiation solaire arrivant au sol et surtout une
réduction des précipitations et une augmentation de la teneur de
gaz carbonique de l'atmosphère contribuant ainsi à
l'accélération du processus climatique.
1.4.3. L'exploitation
pétrolière
À la fin des années 1960, l'exploitation
pétrolière va supplanter celle du bois. À cet effet, bon
nombre de multinationales s'implantent dans la ville de Pointe-Noire. Elle se
transforme attirant ainsi nombre des populations. Parmi les firmes
pétrolières implantées à Pointe-Noire, nous
énumérons Total E&P, Eni, la Société Nationale
des Pétroles du Congo (SNPC). Ces entreprises pétrolières
émettent des gaz à effet suite à la combustion des
combustibles fossiles. Ces gaz séjournent longtemps dans
l'atmosphère. À titre d'exemple, le gaz carbonique peut rester de
50 à 200 ans dans l'atmosphère ; ce qui contribue à
l'accélération du processus climatique à Pointe-Noire.
1.4.4. La pêche
En 1940, Pointe-Noire ne représentait qu'une bourgade
de pêcheurs de 33.000 habitants principalement constitués des
Vilis. Cette activité économique se pratiquait d'une
manière traditionnelle dans divers cours d'eau de ce territoire. Les
caractéristiques sont l'utilisation de la ligne, des filets. Cette
activité se faisait dans l'Océan Atlantique ainsi que dans des
lagunes
Page | 26
de Mvassa et de Loya. Les espèces pêchées
sont les sardinelles, les requins, les sardinelles, les tilapias, les crevettes
et les silures (photo 5).

Photo 5 : Quelques acheteurs des ressources halieutiques (prise
de vue, Maketo, 2022)
Le secteur de la pêche maritime joue également un
rôle non négligeable. Il est assuré à la fois par
des industriels et par des artisans. La production totale annuelle est
estimée à moins de 30.000 tonnes. Elle porte principalement sur
des espèces pélagiques côtières et
déversages, ainsi que sur des crevettes. Les travaux du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD, 2012, p. 69) montrent que la
pêche industrielle est réalisée par environ sept
sociétés d'armement dont la Société Congolaise de
Pêche (SOCOPEC) et comprend l'exploitation des fonds proches par des
bateaux basés à Pointe-Noire (chalutiers-poissonniers,
crevettiers et sardiniers). Cette pêche produit par an environ 10.000
tonnes de poissons débarqués frais ou congelés, qui
approvisionnent principalement le marché de Pointe-Noire.
1.4.5. L'agriculture
L'agriculture pratiquée dans la ville de Pointe-Noire
(photo 6) est de type traditionnel. Elle se caractérise par
l'utilisation des outils utilisés sont rudimentaires. Il s'agit
essentiellement de la hache, de la houe, de la machette, de la brouette, de la
pelle et de la faucille. Tous ces outils exigent un effort musculaire important
pour un rendement faible. Les techniques sont essentiellement archaïques :
agriculture sur brûlis, polyculture jachère, écobuage.
L'agriculture pratiquée est essentiellement pluviale. Elle est
extrêmement sensible aux fluctuations saisonnières et
intra-saisonnières des précipitations (Massouangui-Kifouala M.,
2021, p. 84). L'espace est réduit. Les cultivateurs sont en
majorité des femmes. Les populations cultivent du maïs, de
l'arachide, du taro, de l'igname, du manioc, de la banane plantain, des
courges, de l'aubergine, de la tomate et du haricot. Le niveau de production
est faible et destiné à
l'autoconsommation. Cependant, l'agriculture contribue aux
émissions de gaz à effet de serre. En utilisant les engrais
chimiques, les paysans polluent les rivières et nappes souterraines.
Parce que ces produits phytosanitaires peuvent ruisseler dans un cours
d'eau.

Photo 6 : Quelques cultures maraichères au quartier
N'djéno (prise de vue, Maketo, 2022)
1.4.6. L'élevage
La ville de Pointe-Noire couvre une étendue
considérable de savanes, offrant d'énormes potentialités
en élevage. Cette activité est dite traditionnelle à
travers ses aspects. Elle se pratique autour des maisons. Les animaux sont en
semi-liberté ou encore en liberté totale. Ils ne sont pas
nourris, ni soignés. Le rendement demeure faible et destiné
à l'autoconsommation ainsi qu'aux cérémonies
traditionnelles. Les principales espèces animales élevées
sont les moutons, les cabris, les chèvres, les canards, les poules, les
cochons ainsi que les pigeons.
1.4.7. Les activités industrielles
Pointe-Noire constitue une zone dominée par les
activités industrielles. La fonction industrielle de la ville date de la
colonisation et demeure un facteur crucial de la croissance urbaine. En effet,
elle a tiré profit de l'implantation des sociétés
industrielles dans bon nombre de secteurs. Nous citons ainsi des industries
extractives, de transformation de bois, chimiques et agro-alimentaires. Mais,
ces industries sont peu diversifiées.
- Les industries extractives
Page | 27
Les industries extractives sont :
Page | 28
+ La Congolaise de Raffinage (CORAF) est une filiale de la
Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC).
Fondée en décembre 1982, la Coraf produit du gaz butane, du
supercarburant, du gasoil, etc. à Pointe-Noire.
+ Total Exploration et Production Congo (Total E&P Congo),
s'implante au Congo en 1969 exploitant du pétrole brut et du gaz
naturel.
+ Eni Congo s'est implantée depuis 1968, assurant la
production du pétrole et du gaz naturel. Cette firme
pétrolière a permis la mise en place de deux centrales à
gaz à Pointe-Noire dont celle de N'djéno (50 MW).
- Les industries de transformation de bois
Elles transforment le bois en diverses formes.
+ La Société Congolaise de Manutention des Bois
(SOCOMAB) est une société privée qui détient le
monopole de la manutention des bois au Port de Pointe-Noire. Elle a
été implantée en 2020.
+ La société des Bois et Placages du Congo
(BOPLAC) est créée en 1995 et exerce les activités
suivantes : exploitation forestière, sciage et déroulage. L'usine
est quant à elle implantée à Pointe-Noire. Cette usine est
fermée depuis 1999 à cause des difficultés
d'approvisionnement en bois en grumes.
+ La Transformation des Bois Exotiques du Congo (TRABEC) a
été créée en 1990 à Pointe-Noire où
se trouvent son siège social et son site industriel. Cette entreprise
appartenant à des industriels des bois italiens est l'unique
unité industrielle de bois non intégrée à une
exploitation forestière. Elle a pour objet le sciage et la production
des moulures et des parquets. Elle a fermé ses portes.
+ Eucalyptus du Congo (ECO. S.A.) est une
société anonyme de droit congolais créée en 1997
sous les cendres de l'ancienne société Unité
d'Afforestation Industrielle du Congo (UAIC). Implantée à
Pointe-Noire, elle réalise des plantations industrielles dans les
savanes sableuses de la région côtière de Pointe-Noire.
- Les industries agro-alimentaires
Elles transforment les ressources agricoles en produits
alimentaires. Nous pouvons citer :
+ La Minoterie Alimentaire de Bétail (MAB) est
créée en 1997. Elle devient la Minoterie du Congo (MINOCO) en
2000. Elle est basée sur la transformation de la maïserie et
production d'aliments de bétail ;
+ La Société du Grand Moulin du Phare (SGMP)
fabrique de la farine de blé.
+ La Société de Fabrication des Produits
Alimentaires (SOFAPRAL) fabrique des vins ;
Page | 29
? La Brasserie du Congo (BRASCO) représente l'industrie
fabrication de boissons à Pointe-Noire. Elle est créée en
1952 ;
? L'usine Bayo produit de l'eau minérale et fabrique du
jus. Elle est fondée il y a un plus de trente ans.
- Autres industries
La ville dispose aussi des industries comme :
? L'Aluminium du Congo (ALUCONGO) est remplacé par
Bernabé en 2011. Cette nouvelle société vend et distribue
des produits de quincaillerie professionnelle, des équipements
industriels et des produits métallurgiques ;
? La Congolaise de Peinture (COPE) fabrique de la peinture, du
vernis, de l'enduit mastic, du ciment-colle et du diluant.
Cependant, les industries à Pointe-Noire provoquent
l'accélération du processus climatique. Elles induisent diverses
pollutions dans cette ville. Les usines polluent les cours d'eau par leurs
rejets industriels. Ce qui met en péril les espèces halieutiques
et la santé de la population. Les études menées par
Wenclawliak B. (2005, p. 4) montrent les impacts pervers de la pollution de
l'air à Pointe-Noire notamment leurs effets sur la santé humaine.
Les populations sont exposées à des maladies respiratoires comme
l'asthme. Par exemple, dans la ville de Pointe-Noire, les déchets
industriels sont déversés directement ou indirectement dans
l'Océan Atlantique à partir des rivières Songolo et
Tchinouka.
1.4.8. Les activités portuaires
Ville riche et dynamique, Pointe-Noire joue un rôle
important dans le tissu économique du pays et de la sous-région.
Son activité portuaire en témoigne. 90 % des échanges
entre le Congo et ses partenaires commerciaux s'effectuent par voie maritime.
Une convention de mise en concession du terminal à containers du PAPN
(photo 7) a été signée avec Bolloré Africa
Logistics le 23 décembre 2008. D'un montant de 374 milliards de francs
CFA et d'une durée de 27 ans, cette mise en concession s'accompagne d'un
plan d'investissements permettant d'améliorer les performances
opérationnelles du port. Parallèlement, la création d'un
guichet unique maritime (GUMAR) devrait en simplifier les procédures
administratives (Césaire J. M., 2009, p. 129). Revêtant un
caractère industriel et commercial, le PAPN est le seul port en eaux
profondes d'Afrique centrale.

Page | 30
Photo 7 : Vue aérienne du port de Pointe-Noire (prise de
vue, Mombo, 2022)
1.4.9. Les activités informelles
Depuis le début des années 1990,
l'économie informelle s'est développée en réponse
au taux de chômage de sa population. En effet, les activités
informelles désignent les processus, les activités et les
potentiels qui échappent à tout contrôle des
autorités. La route apparait comme le centre de toute activité
formelle mais surtout des activités informelles. Dans ce paysage urbain,
les activités qualifiées d'informelles sont diverses : les
vendeurs ambulants (fruits et légumes, appareils électroniques,
boissons, articles divers, trottoirs), les motos-taxis, les concessions
automobiles dans les rues. L'agglomération de Pointe-Noire assure 83 %
des recettes budgétaires du Congo-Brazzaville (ONU-HABITAT, 2012, p. 7).
Représentant la principale plate-forme économique du pays,
Pointe-Noire est une ville dynamique et très attractive.
Conclusion partielle
Fondée le 11 mai 1922, la ville de Pointe-Noire
représente la capitale économique du Congo. Couvrant une
superficie de 1.144 km2, cette agglomération se situe au
Sud-Ouest Congo. Du point de vue géologique, l'agglomération de
Pointe-Noire appartient au bassin côtier avec des roches comme les
alluvions, les sables, les marnes, les grés, les calcaires et les
argiles bariolées. Elle s'organise autour des sols ferralitiques. Deux
unités orographiques se partagent l'agglomération de
Pointe-Noire. Il s'agit de la plaine côtière et d'un rempart de
plateaux. Plusieurs cours d'eau drainent cette ville dont la Tchinouka, la
Songolo et la Patra. L'Océan Atlantique borde son littoral sur des
kilomètres de long. La ville connait une évolution rapide de sa
population liée à l'exode rural, à une forte
natalité, à son statut économique et d'importants
mouvements migratoires. Ceci occasionne des poussées spatiales
considérables dépassant ainsi
Page | 31
les limites administratives de la ville. Aussi,
s'impose-t-elle comme la capitale économique du Congo. Sa population
exerce une multitude d'activités économiques.
Page | 32
Chapitre 2 : Climat urbain de Pointe-Noire
Pour mieux gérer un environnement, l'Homme est
censé comprendre le fonctionnement du climat. Celui-ci présente
des éléments comme les précipitations, les
températures, l'insolation et les vents. Le présent chapitre se
propose d'analyser ces éléments climatiques de la ville de
Pointe-Noire dans leur état moyen.
2.1. Climat moyen
2.1.1. Précipitations
Les précipitations représentent l'un des
éléments importants dans l'analyse du climat de la zone
intertropicale (ZIT). Elles déterminent le rythme des saisons. À
Pointe-Noire, les précipitations présentent un régime
bimodal : on distingue deux maxima et un minima. Les précipitations
atteignent leur pic maximum aux mois de Mars et celui d'Octobre. Les mois les
moins pluvieux sont ceux de Juin et Juillet, correspondant à la saison
non pluvieuse. Le régime pluviométrique (figure 6) a
été déterminé à partir des anomalies
centrées réduites. Deux périodes de fortes pluies de
novembre à décembre et de janvier à avril sont
identifiées. Celles-ci sont séparées par une
période de ralentissement pluvieux en février, suivies d'une
période moins pluvieuse (de mai à septembre).
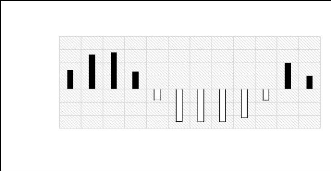
Anomalies moyennes mobiles
-0,5
-1,5
0,5
1,5
-1
0
2
1
J F M A M J Jt A S O N D
Mois
Régime pluviométrique
Figure 6 : Régime pluviométrique à
Pointe-Noire (1932-2004)
2.1.2. Températures
Comme les précipitations, les températures
jouent un rôle déterminant dans l'étude climatique dans la
ZIT. À Pointe-Noire, les températures présentent un
régime bimodal : on observe deux maxima et un minima. Les
périodes pendant lesquelles il faut beaucoup chaud sont Janvier-
Page | 33
Février-Mars-Avril-Mai et celles
d'Octobre-Novembre-Décembre. Les mois durant lesquels on enregistre un
minimum de températures sont Juin-Juillet-Aout-Septembre. Les
températures maximales, quant à elles, connaissent leur pic au
cours de Janvier jusqu'en Mai et de Novembre à Décembre. Les
faibles valeurs thermiques sont celles des mois de
Juin-Juillet-Aout-Septembre-Octobre. La figure 7 montre le régime des
températures minimales à Pointe-Noire (1932-2004). Celles-ci
varient entre 18 ° et 23,7 ° C. Les fortes valeurs thermiques sont
souvent centrées entre le mois de Mars et celui d'Avril. Il fait plus
chaud pendant ces deux mois cités. La température minimale la
plus basse s'observe au mois de juillet. La figure 8 indique le régime
des températures maximales à Pointe-Noire (1932-2004). Ses
valeurs maximales les plus importantes sont celles de 25,3° et 30,5°
C. Les grandes saisons thermiques sont Février-Mars-Avril et
Novembre-Décembre. La température maximale la plus
observée est celle du mois d'Août.
Régime des températures
minimales
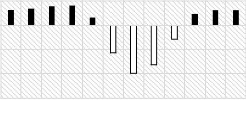
j f m a m j jt a s o n d
1
0
-1
-2
-3
Figure 7 : Températures minimales à Pointe-Noire
(1932-2004)
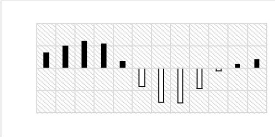
Régime des températures
maximales
j f m a m j jt a s o n d
2
1
0
-1
-2
Figure 8 : Températures maximales à Pointe-Noire
(1932-2004)
2.1.3. Vents
Les vents les plus dominants à Pointe-Noire sont les
alizés. Ils provoquent le déplacement des masses d'air. En effet,
le régime des vents est assez régulier. Cela s'explique par la
dominance des courants atmosphériques et marins. Le Sud et l'Ouest sont
les directions des vents qui dominent plus dans cette agglomération.
Page | 34
2.1.4. Insolation
L'isolation journalière est faible à cause de la
forte nébulosité dans cette agglomération congolaise. Les
valeurs maximales, quant à elles, dépassent 240 heures. Le
tableau 3 présente la durée d'insolation journalière de la
station synoptique de Pointe-Noire. Cela concerne la période allant de
1961 à 1990. Deux tendances peuvent être observées
notamment les maximas et les minimas.
Tableau 3 : Durée d'insolation (en heures et
dixième) de la station synoptique de Pointe-Noire de 1961 à
1990
|
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
Total
|
|
Moyenne minimale
|
122,4
|
120,2
|
139,7
|
143,1
|
92,3
|
86,2
|
68,6
|
52
|
23
|
56,4
|
81,3
|
93,3
|
122,4
|
|
Moyenne maximale
|
248,2
|
221
|
253,2
|
248,8
|
239,4
|
193,6
|
188,1
|
144,4
|
117,4
|
177,8
|
192,7
|
185,8
|
248,2
|
Source : ANAC, 2010
2.2. Évolution climatique
L'évolution climatique dans le cadre de notre
étude est souvent appréciée à travers les
précipitations et les températures.
2.2.1. Évolution des précipitations
L'augmentation des précipitations est
considérée comme l'un des effets du dérèglement
climatique sur un espace. L'analyse climatique dans la ZIT passe par les
précipitations. Celles-ci présentent une tendance à la
hausse au cours des années. L'analyse des précipitations est
faite au pas de temps interannuel et saisonnier.
2.2.1.1. Évolution des précipitations
interannuelles
L'évolution pluviométrique interannuelle montre
une alternance des périodes déficitaires et excédentaires.
D'une manière générale, Les précipitations
(1932-2004) présentent une tendance légèrement à la
baisse jusqu'en 2004. Les précipitations se caractérisent par une
tendance évolutive à la hausse jusqu'à la fin de la
décennie 1940 (figure 9). Toutefois, des années
déficitaires peuvent s'observer. Vers la fin des années 1956, on
observe un cumul pluviométrique jusqu'en 1962. Puis en 1968, elle
décroit jusqu'en 1980. À partir de 1983, la courbe exprime une
stabilité pluviométrique jusqu'en 2004.
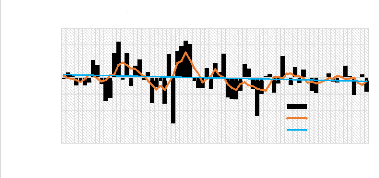
Anomales moyennes mobiles
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
3,000
0,000
2,000
1,000
1932 1935 1938 1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968
1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004
Précipitations interannuelles
Années
an
mm Linéai
re (mm)
Page | 35
Figure 9 : Évolution pluviométrique interannuelle
à Pointe-Noire (1932-2004)
2.2.1.2. Évolution saisonnière des
précipitations ? Évolution des précipitations de la saison
DJF
La saison DJF présente des périodes
pluviométriques excédentaires et déficitaires (figure 10).
La première période montre une évolution des
précipitations à la hausse. Elle inclue les années 1930
jusqu'aux années 1940. La courbe décroit jusqu'en 1956, puis
connait une évolution significative jusqu'en 1962. Dès 1962, la
courbe baisse jusqu'à la fin des années 1970. Dès le
début des années 1980, la tendance pluviométrique est
à l'augmentation jusqu'en 2004.
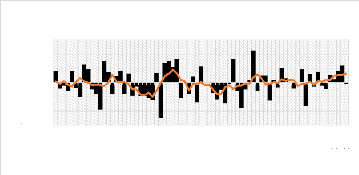
Anomalies moyennes mobiles
-1
-2
-3
3
0
2
1
1932 1935 1938 1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968
1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004
Précipitations DJF
Années
Figure 10 : Évolution pluviométrique de la saison
DJF (1932-2004)
? Évolution des précipitations de la saison
MAM
L'évolution pluviométrique de la saison MAM se
caractérise par des périodes excédentaires et
déficitaires. De 1932 à 1940, la courbe pluviométrique
montre une tendance à la hausse. Puis, elle décroit jusqu'en 1956
pour ensuite augmenter jusqu'au début des années 1960. À
partir de
Page | 36
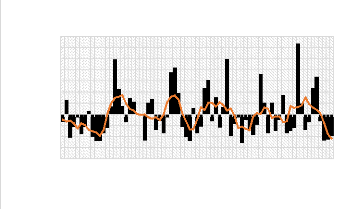
Anomalies moyennes mobiles
-0,5
-1,5
3,5
0,5
2,5
1,5
-1
-2
3
0
2
1
1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980
1984 1988 1992 1996 2000 2004
Précipitations SON
Années
Page | 37
1968, la tendance est à la baisse jusqu'en 2004
malgré quelques périodes de cumul pluviométrique (figure
11).
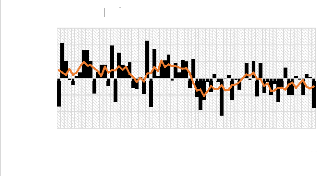
Anomalies moyennes mobiles
-1
-2
-3
3
0
2
1
1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980
1984 1988 1992 1996 2000 2004
Précipitations MAM
Années
Figure 11 : Évolution pluviométrique de la saison
MAM (1932-2004)
? Évolution des précipitations de la saison
JJA
La saison JJA (figure 12) désigne une saison de
récession pluviométrique de 1932 à 1984. Cependant, on
observe une tendance à la hausse de 1984 à 1988. Elle
décroit à nouveau pour connaitre une tendance excédentaire
des précipitations dans les années 2000.
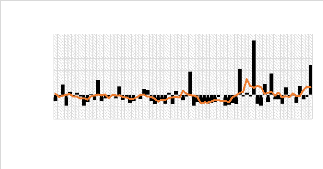
Anomalies moyennes mobiles
-1
-2
4
5
3
0
2
1
1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980
1984 1988 1992 1996 2000 2004
Précipitations JJA
Années
Figure 12 : Évolution pluviométrique de la saison
JJA (1932-2004)
? Évolution des précipitations de la saison
SON
La saison SON (figure 13) se caractérise par une
période de récession pluviométrique jusque dans les
années 1940 malgré une hausse pluviométrique
observée en 1947 puis de 1968 à 1971. Celle-ci est sans
importance du point de vue pluviométrique. Toutefois, des
périodes pluviométriques excédentaires peuvent
s'observer.
Figure 13 : Évolution pluviométrique de la saison
SON (1932-2004)
2.2.2. Évolution des températures
Bien que les précipitations soient
l'élément climatique fondamental de notre zone d'étude,
elles ne peuvent, à elles seules, définir le climat bas-congolais
(Samba-Kimbata M. J., 1978, p. 120). Les températures connaissent une
évolution significative sur cette longue série (1932-2004).
Celles-ci se distinguent par des valeurs maximales et minimales.
2.2.2.1. Évolution interannuelle des
températures
La figure 14 montre l'évolution interannuelle des
températures de l'espace urbain de Pointe-Noire. En effet, celle-ci se
caractérise par deux périodes : la première se
caractérise par la baisse des températures jusqu'aux
années 1980. La seconde marque la tendance des températures
à la hausse jusqu'en 2004. Les températures se situent au-dessus
de la moyenne annuelle de 28,3° C. La figure 15 montre que les
températures minimales annuelles à Pointe-Noire connaissent une
évolution à la baisse jusqu'aux années 1980. Puis, la
tendance thermique devient à la hausse dès le début des
années 1980. Cette tendance à la hausse semble aller dans le sens
du réchauffement global. Deux tendances de températures
s'observent à Pointe-Noire. Il s'agit des températures minimales
et maximales allant de 1932 à 2004. Faut-il préciser que les
températures se caractérisent par une tendance à la hausse
jusqu'en 2004.
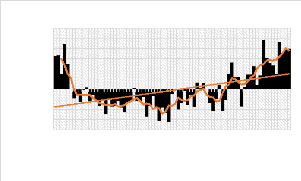
Anomalies moyennes mobiles
-0,5
-1,5
0,5
2,5
1,5
-1
-2
3
0
2
1
1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980
1984 1988 1992 1996 2000 2004
Températures maximales
Années
Page | 38
Figure 14 : Évolution interannuelle des
températures maximales (1932-2004)
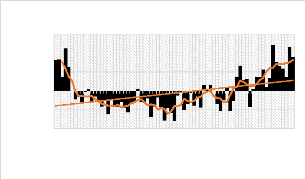
Anomalies moyennes mobiles
-1
-2
3
0
2
1
1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980
1984 1988 1992 1996 2000 2004
Températures minimales
Années
Figure 15 : Évolution interannuelle des
températures minimales (1932-2004)
2.2.2.2. Évolution des températures
saisonnières
- Évolution des températures de la saison
DJF
La figure 16 montre l'évolution des températures
maximales de la saison DJF. De 1932 à 1950, les températures
restent élevées. Elles connaissent une baisse à partir des
années 1950, puis évoluent à la hausse jusqu'en 2004. La
figure 17 montre que la saison DJF présente deux périodes : une
période de hausse des températures de 1932 à 1944 puis de
1995 à 2004. La période où les températures
baissent de 1944 à 1977 en deçà de la valeur normale de
saison.
Températures maximales de
DJF
Années
Page | 39
Figure 16 : Évolution des températures maximales
DJF (1932-2004)
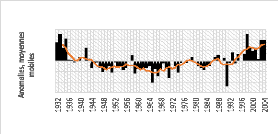
- 1
- 2
- 3
3
0
2
1
Températures minimales DJF
Années
Figure 17 : Évolution des températures minimales
DJF (1932-2004)
- Évolution des températures de la saison
MAM
yLes températures maximales de la
saison MAM sont presque similaires à celles de DJF (figure
y
18). Cependant, une différence s'observe entre 1956
à 1980, période à laquelle les températures
connaissent une baisse. À partir des années 1980, elles
connaissent une tendance à la hausse jusqu'en 2004. Les
températures minimales de la saison MAM (figure 20) sont presque
similaires à celles de DJF. On observe une augmentation
remarquable des températures de 1980 à 2004.
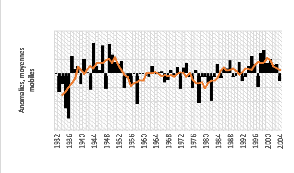
-1
-2
-3
-4
3
2
0
1
Températures maxi MAM
Années
Page | 40
Figure 18 : Évolution des températures maximales
MAM (1932-2004)
Températures minimales
MAM
Années
Figure 19 : Évolution des températures minimales
MAM (1932-2004)
- Évolution des températures de la saison
JJA
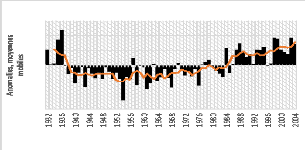
- 1
- 2
- 3
0
W
65
3
2
1
Températures minimales de
JJA
Années
obile
32
136
40
144
84
25
156
60
164
168
27
76
180
84
188
921
96
00
04
Les températures maximales de la saison JJA (figure 20)
sont à la hausse au cours de la période de 1932 à 1952.
Elles décroissent de 1952 à 1984. Puis, une période de
hausse des températures maximales s'observe à partir des
années 1980 jusqu'en 2004. La figure 21 montre que de 1932 à
1980, les températures de la saison JJA restent faibles. À partir
de 1986, elles connaissent une hausse dépassant la valeur normale de
saison 19° C jusqu'en 2004.
men mas,
mas, men
1 1 1 1 1 1 1 1
Page | 41
Figure 20 : Évolution des températures maximales
JJA (1932-2004)
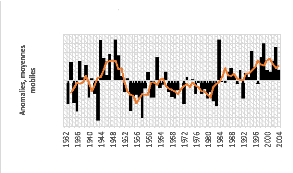
Températures de JJA
Années
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
Figure 21 : Évolution des températures minimales
JJA (1932-2004)
- Évolution des températures de la saison
SON
Les températures maximales de SON (figure 22)
connaissent trois périodes : pendant la première période
(1932-1950), les températures restent élevées. La
deuxième période allant de 1952 à 1980, se
caractérise par une baisse des températures. Enfin, la
troisième période va de 1986 à 2004 ; elle est
marquée par l'augmentation des températures. Les
températures minimales de la saison SON (figure 23) connaissent une
baisse considérable allant de 1929 à 1984. Puis, elles
présentent une tendance à la hausse de 1984 à 2004.
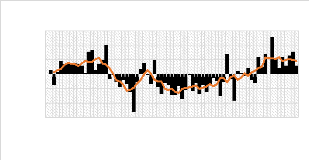
Anomalies, moyennes
1
mobiles
1960
64
2
1
0
1-
2-
-1
-2
-3
64
0
3
2
1
1932 1935 1938 1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968
1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004
Températures maxi de SON
Années
Figure 22 : Évolution des températures maximales
SON (1932-2004)
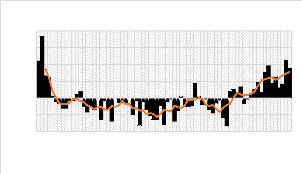
Anomaies, moyennes mobiles
-1
-2
4
3
2
0
1
1932 1935 1938 1941 1944 1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968
1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004
Températures minimales SON
Années
Page | 42
Figure 23 : Évolution des températures minimales
SON (1932-2004)
Discussion des résultats
Située au Sud-ouest du Congo, l'agglomération de
Pointe-Noire appartient au climat tropical humide ou bas congolais. Telle est
la conclusion à laquelle étaient parvenus Samba G. (2020, p. 99)
et Samba-Kimbata M. J. (1978, p. 260).
? Régime pluviométrique
Les résultats obtenus montrent que les
précipitations à Pointe-Noire présentent un régime
bimodal : on distingue deux maxima et un minima. Les précipitations
atteignent leur pic maximum aux mois de Mars et celui d'Octobre. Les mois les
moins pluvieux sont ceux de Juin et Juillet, correspondant à la saison
non pluvieuse. Les études récentes d'Ibiassi Mahoungou G. (2019,
p. 48) aboutissent aux mêmes résultats que les nôtres au
sujet du régime pluviométrique de Pointe-Noire. L'auteur soutient
que cette agglomération congolaise a un régime bimodal
(1960-2019). Une première saison pluviométrique de quatre mois
(JFMA) est observée, avec deux maximas pluviométriques en
février et mars. Une deuxième saison pluviométrique de
deux mois (ND) apparaît avec un maximum pluviométrique en
novembre.
Comme la ville de Pointe-Noire, la partie congolaise du Bassin
du Congo présente un régime de type bimodal avec une alternance
des saisons sèches et humides. À titre illustratif, la station
d'Impfondo présente 8 mois humides (d'Avril à Novembre) contre 4
mois secs (de Décembre à Mars). Au niveau de la station de
Ouesso, le panorama est différent, car elle a enregistré 6 mois
humides (Mai-Juin et Août-Novembre) contre 6 mois secs
(Décembre-Avril et Juillet). On note une première saison
pluvieuse de Mai à Juin et une deuxième d'Août à
Novembre. Toutefois, la première saison sèche reste très
marquée, car elle va de Décembre à Avril et la seconde se
situe au mois de Juillet. La station de Makoua présente 6 mois humides
et 6 mois
Page | 43
secs avec une alternance des saisons. La première
saison humide va de Mars à Mai (MAM) et la seconde va de Septembre
à Novembre (SON). On note également deux saison sèches :
de Décembre à Février (DJF) et de Juin à Août
(G. Toli et G. Samba, 2022, p. 185).
Au niveau du Congo, il est indiqué que le régime
bimodal prédomine sur l'analyse des régimes
pluviométriques du pays. Les maximas s'étalent de mars à
mai (MAM) ou de septembre à novembre (SON) et les minima de
décembre à février (DJF) ou de juin-à-août
(JJA). Au cours de la saison SON, on observe un maximum récurrent
à toutes les stations en novembre pour l'ensemble du territoire
congolais (Samba G., 2014, pp. 29-30). En Afrique Équatoriale Atlantique
(AEA), Les précipitations sont dominées par un régime
bimodal caractérisé par un maximum centré sur les mois de
mars, avril, mai (MAM) et les mois de septembre, octobre et novembre (Samba
G.et Nganga D., 2013, p. 59).
? Régime des températures
À Pointe-Noire, les températures
présentent un régime bimodal : on observe deux maxima et un
minima. Les périodes auxquelles il fait beaucoup chaud sont
Janvier-Février-Mars-Avril-Mai et celles
d'Octobre-Novembre-Décembre. Les mois auxquels on enregistre un minimum
de températures sont Juin-Juillet-Aout-Septembre. Les
températures maximales, quant à elles, connaissent leur pic au
cours de Janvier jusqu'en Mai et de Novembre à Décembre. Les
faibles valeurs thermiques sont celles des mois de
Juin-Juillet-Aout-Septembre-Octobre.
Au Sud-Congo, les régimes des températures
présentent des variations moins accentuées. La moyenne annuelle
varie entre 22° et 25° C. Les températures sont suffisamment
élevées, pour permettre le développement de la plupart des
cultures tropicales. Les saisons les plus pluvieuses (MAM et SON) sont
également les saisons les plus chaudes. Les températures varient
par jour entre 29 et 31°C, et peuvent exceptionnellement atteindre
35° voire 37°C, surtout dans la région côtière.
Bien que celle-ci soit bordée par l'Océan Atlantique, elle ne
bénéficie pas d'effets régulateurs que devrait jouer
l'Océan Atlantique. En effet, l'amplitude thermique annuelle, qui varie
entre 4 et 6°C, est plus forte à Pointe-Noire (5,8° C) ; par
contre, elle n'est que de 4,9° C à Dolisie et de 4.5° C
à Brazzaville. Pendant la saison froide, les remontées d'eau
profonde empêchent l'océan d'être un réservoir de
chaleur, pour le continent. On assiste partout, sur l'ensemble du Sud-Congo
à une baisse de température, pendant la saison sèche.
Mais, ces dernières années, on constate une légère
élévation des températures (Nsiloulou M. V. D., 2020, pp.
55-56).
Page | 44
? Tendances des précipitations
- Tendances des précipitations
interannuelles
Les résultats obtenus sur l'évolution du climat
(1932-2004) traduisent une tendance à la hausse des
précipitations moyennes (saisonnières et interannuelles). Les
travaux effectués dans la région de Pointe-Noire par Moukandi
N'kaya G. D. (2012, pp. 27-28) ont abouti à ces résultats.
Celui-ci conclue à une modification des tendances
pluviométriques.
Par ailleurs, dans la partie congolaise du Bassin du Congo, on
observe une absence de tendance significative dans la série des
précipitations annuelles. La p-value calculée, sur 41
observations et pour chaque station, est largement au-dessus du seuil de
signification (0,05). Les précipitations annuelles à Impfondo ont
présenté une évolution assez constante avec une tendance
non significative. Ici, la p-value calculée (0,69) est supérieure
au seuil alpha (0,05) ; ce qui fait que l'hypothèse d'absence tendance
dans la série peut être acceptée. Cependant, la tendance
linéaire montre une légère tendance à la baisse,
mais non significative (Toli G. et Samba G., 2022).
- Tendances des précipitations
saisonnières
La saison DJF présente des périodes
pluviométriques excédentaires et déficitaires. La
première période montre une évolution des
précipitations à la hausse. Elle inclue les années 1930
jusqu'aux années 1940. La courbe décroit jusqu'en 1956, puis
connait une évolution significative jusqu'en 1962. Dès 1962, la
courbe baisse jusqu'à la fin des années 1970. Dès le
début des années 1980, la tendance pluviométrique est
à l'augmentation jusqu'en 2004.
Au Nord-Congo, les précipitations de la saison de MAM
connaissent une absence de tendance significative dans la partie congolaise du
Bassin du Congo. Étant donné que les valeurs de P (p-value) sont
largement supérieures au seuil alpha, l'hypothèse d'une absence
de tendance a été retenue. Cependant, on note une absence de
tendance significative pour la saison SON. Toutefois, la régression
linéaire a identifié d'une part, des tendances
légèrement à la baisse dans la plupart des stations se
situant au sud (Gamboma et Djambala) et d'autre part, des tendances assez
constantes et en nette progression dans les stations du nord notamment
Impfondo, Ouesso et Makoua (Toli G. et Samba G., 2022, pp. 186-187).
Au niveau du Congo-Brazzaville, la décennie 1980 est
marquée par le début d'un déficit
généralisé des pluies. La moyenne mobile montre une
évolution pluviométrique à la baisse ces dernières
décennies, jusqu'en 2010. Le déficit est bien prononcé au
Nord-Congo où il est de l'ordre 10-12%. L'évolution des
précipitations interannuelles à la baisse n'est pas
systématique dans toutes les stations du pays. Après 1980, la
tendance générale est restée à la baisse,
même
Page | 45
si dans le milieu des années 1990, les
précipitations sont marquées par des années
excédentaires. Dans l'ensemble, la séquences des années
1940-1970 a été excédentaire dans toutes les stations. Les
années 1950 se caractérisent par une pluviométrie
excédentaire, donc une décennie humide. Par contre, les
années 1970 marquent le début d'un déficit
pluviométrique. On observe la baisse de la pluviométrie à
partir des années 1980, sur le territoire congolais. On note un
décalage d'une décennie au cours de la fin de la décennie
1960 (Samba G., 2020, pp. 133-134).
? Tendances des températures
- Températures interannuelles
Les températures interannuelles de l'espace urbain de
Pointe-Noire connaissent une évolution à la hausse. En effet,
celle-ci se caractérise par deux périodes : la première
période est marquée par la baisse des températures
jusqu'aux années 1980. La seconde période présente la
tendance des températures à la hausse jusqu'en 2004. Les
températures se situent au-dessus de la moyenne annuelle de 28,3°
C. La figure 18 montre que les températures minimales annuelles à
Pointe-Noire connaissent une évolution à la baisse jusqu'aux
années 1980. Puis, la tendance thermique devient à la hausse
dès le début des années 1980. Cette tendance à la
hausse semble aller dans le sens du réchauffement global. Deux tendances
de températures s'observent à Pointe-Noire. Il s'agit des
températures minimales et maximales allant de 1932 à 2004. Les
travaux réalisés au Sud-Congo par Nsiloulou M. V. D. (2020, pp.
55-56) confirment les résultats que nous avons obtenus.
Au Congo, l'évolution des anomalies de la
température moyenne annuelle indique deux périodes sur tout le
pays. Les années 1950 et 1960 sont marquées par des anomalies
négatives partout au Congo. Les années 1980, quant à
elles, sont positives. La décade 1990 est marquée par des
anomalies positives significatives. Les températures indiquent une
augmentation (significative avec 95 % niveau confidence) dans tout le pays.
Généralement, la chaleur semble commencer dans les années
1980 (Samba G. et al., 2008, p. 94).
- Températures saisonnières
La saison DJF présente des températures
maximales élevées de 1932 à 1950. Elles connaissent une
baisse à partir des années 1950, puis évoluent à la
hausse jusqu'en 2004. Quant aux températures minimales, on observe une
période de hausse des températures de 1932 à 1944 puis de
1995 à 2004. Les températures maximales de la saison MAM sont
presque similaires à celles de DJF. Cependant, la différence
s'observe entre 1956 à 1980, période à laquelle les
températures connaissent une baisse. À partir des années
1980, elles connaissent une tendance à la hausse jusqu'en 2004. Les
températures minimales de la saison MAM sont presque similaires à
celles de DJF. On observe une augmentation remarquable des températures
de 1980
Page | 46
à 2004. Les températures maximales de la saison
JJA sont à la hausse au cours de la période de 1932 à
1952. Elles décroissent de 1952 à 1984. Puis, une période
de hausse des températures maximales s'observe à partir des
années 1980 jusqu'en 2004. De 1932 à 1980, les
températures de la saison JJA restent faibles. À partir de 1986,
elles connaissent une hausse dépassant la valeur normale de saison
19° C jusqu'en 2004. Les températures maximales de SON connaissent
trois périodes : pendant la première période (1932-1950),
les températures restent élevées. La deuxième
période allant de 1952 à 1980, se caractérise par une
baisse des températures. Enfin, la troisième période va de
1986 à 2004, est marquée par l'augmentation des
températures. Les températures minimales de la saison SON
connaissent une baisse considérable allant de 1929 à 1984. Puis,
elles présentent une tendance à la hausse de 1984 à
2004.
Les villes de Brazzaville et celle de Pointe-Noire connaissent
des températures extrêmes n'ayant pas les mêmes tendances.
Les températures minimales présentent une tendance à la
hausse. Les températures maximales, quant à elles, accusent une
augmentation significative à 95% comme seuil de confiance. Le
réchauffement est de 0,030°C par an pour les températures
maximales les plus basses (TXn) de l'année contre 0,042°C pour les
températures maximales les plus fortes (TXx) au cours de l'année.
L'année de rupture entre la première sous-période et la
deuxième est fixée en 1972 pour les TXn et en 1977 pour les TXx
(Massouangui-Kifouala M. et al., 2021, p. 111).
Conclusion partielle
La connaissance du climat revêt une importance
fondamentale notamment dans son fonctionnement. La ville de Pointe-Noire est
sous l'influence d'un climat tropical humide. Son un régime
pluviométrique est de type bimodal : on observe deux maxima (MAM et SON)
et un minima (JJA). Aussi, le régime des températures est
bimodal. Comme les précipitations, les températures à
Pointe-Noire présentent une tendance à la hausse. L'analyse
climatique à Pointe-Noire (1932-2004) s'est faite au pas du temps annuel
et saisonnier.
Page | 47
Chapitre 3 : Impacts, vulnérabilité et
enjeux d'adaptation de la ville de Pointe-Noire
L'évolution climatique représente l'une des
menaces les plus sérieuses pesant sur la durabilité de
l'environnement, surtout en zones côtières. Les impacts du
dérèglement climatique sont très alarmants surtout dans
les villes des pays en développement. Face à ce défi,
plusieurs mesures et stratégies d'adaptation sont prises en compte
à Pointe-Noire. Dans ce chapitre, il est question d'évaluer les
effets du climat sur la ville de Pointe-Noire et d'analyser ses enjeux
d'adaptation aux perturbations climatiques.
3.1. Impacts du climat sur la ville de Pointe-Noire
Les impacts du changement climatique indiquent les
dégâts actuels que le climat laisse dans un espace. Dans l'espace
urbain de Pointe-Noire, ils sont visibles sur le littoral, la mangrove,
l'agriculture, les établissements humains, le port et la santé de
la population.
3.1.1. Impacts du changement climatique sur la baie de
Pointe-Noire
Le dérèglement climatique affecte la baie de
Pointe-Noire (photo 8). Parmi les effets de ce phénomène, nous
citons l'élévation du niveau de la mer. Celle-ci entraine
l'intrusion d'eau saline à Pointe-Noire, la submersion des terres et le
recul du trait de côte. Étant donné que la zone
côtière constitue un environnement naturel fragile, elle subit
l'érosion côtière (entretien avec Madame Eouani Rita
Aimée Liliane du 30 août 2022). Avec une façade à
l'Océan Atlantique et ses kilomètres de plage, la ville de
Pointe-Noire est particulièrement exposée aux aléas
climatiques malgré les efforts consentis par les autorités de la
capitale économique (
https://www.eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville/beach-clean-à-pointe-noire-
amplifier-le-mouvement-mondial.fr
consulté le Vendredi 02 septembre 2022).

Photo 8 : Baie de Pointe-Noire menacée par les eaux
océaniques (prise de vue, Maketo, 2022)
Page | 48
3.1.2. Impacts du climat sur la mangrove
Les impacts du climat comme l'élévation du
niveau de la mer et l'acidité de l'océan entrainent la
disparition des mangroves. La Rhizophora Racemosa est l'espèce
la plus exposée à ce risque. La destruction de cette
espèce est à l'origine de l'érosion côtière.
Le phénomène lié à l'inondation des zones
côtières s'avère fatale aux palétuviers. Tel est le
cas de l'espèce Crinium natans, ne supportant pas
l'augmentation de la teneur importante en sel des eaux océaniques, qui
disparait. Les réflexions menées par Samba G. (2020) approuvent
ces résultats.
3.1.3. Impacts du climat sur l'agriculture
Le secteur agricole à Pointe-Noire ressent
également les effets du changement climatique. Il s'agit de la
modification du calendrier agricole, la présence des
phénomènes extrêmes comme les sécheresses, la
diminution de la pluviométrie, la diminution de la disponibilité
et de la qualité de l'eau. Une baisse des rendements moyens des cultures
est signalée par les producteurs. Le retard dans l'arrivée des
pluies est à l'origine d'un décalage du cycle cultural. Madame
Eouani Rita Aimée Liliane nous rapporte que « le changement
climatique est à l'origine du bouleversement du rythme des
précipitations à Pointe-Noire ». L'arrêt
précoce des précipitations présente alors des impacts sur
la production agricole.
3.1.4. Impacts du climat sur les établissements
humains
Les écosystèmes humains sont affectés par
les aléas climatiques à Pointe-Noire. Il peut s'agir du pic de
chaleur et de l'inconfort thermique. En fait, le climat urbain se
caractérise par une couche limite atmosphérique
particulière, engendrant ainsi l'Ilôt de Chaleur Urbain (ICU).
Dans les zones urbaines, les températures moyennes annuelles sont
supérieures de 0,5 à 1,5 °C à celles des zones
rurales avoisinantes. À croire Jouzel J. (2019, pp. 42-43), les vagues
de chaleur progressent à peu près deux fois plus rapidement que
la température moyenne c'est-à-dire qu'un réchauffement
climatique moyen de 2° C entrainerait des vagues de chaleur de près
de 4° C plus importantes.
Les fluctuations climatiques entrainent les inondations (photo
9) des habitations situées près des berges des rivières et
des zones marécageuses. Rappelons qu'à Pointe-Noire, on distingue
trois types d'habitations : modernes, traditionnelles et précaires
(tableau 4). Chacun de ces habitats présente des aspects particuliers en
milieu urbain. L'habitation moderne se caractérise par des maisons
à matériaux durables.

Page | 49
Photo 9 : Inondation d'une artère urbaine au quartier
Tchiali (prise de vue, Mombo, 2022)
Il s'agit des habitations en dur faits de briques
agglomérées ainsi que des tôles. Cela s'explique par le
fait que les murs absorbent de l'énergie solaire pendant la
journée. Puis, cette énergie solaire va être ressentie la
nuit à travers l'ICU (entretien avec Monsieur Diela du 10 septembre
2021). L'habitation traditionnelle se singularise par la présence des
maisons non durables. Il peut s'agir des habitations en planches et en
tôles. Les matériaux n'absorbent pas assez d'énergie. Ils
assurent une ventilation naturelle. L'habitation précaire (photo 10),
quant à elle, est constituée des maisons en tôles. Leurs
matériaux de construction ne sont pas durables en raison de l'air humide
à Pointe-Noire. Pendant la journée, un pic de chaleur est
ressenti dans ces écosystèmes humains. Ses habitants sont
contraints de passer assez de temps à l'extérieur. Ceux-ci sont
à la recherche du confort thermique. La nuit apparait fraiche.

Photo 10 : Habitation précaire au quartier
Louéssi (prise de vue, Maketo, 2022)
Page | 50
Dans le tableau 4, il est reporté les statistiques sur
la typologie des habitats à Pointe-Noire. Il s'agit des habitats en
matériaux durables, des habitats en matériaux précaires et
des habitats reflétant la pauvreté. Les habitations en
matériaux durables présentent un pourcentage élevé
soit 52,40%.
Tableau 4 : Statistiques sur la typologie de l'habitat à
Pointe-Noire
|
Habitat en matériaux durables
|
52,40
|
%
|
|
Habitat en matériaux précaires
|
34,78
|
%
|
|
Habitat reflétant la pauvreté
|
12,82
|
%
|
Source : ONU-HABITAT, 2012, p. 13.
3.1.5. Impacts du changement climatique sur le port
maritime
Le port maritime de Pointe-Noire subit les fluctuations
climatiques dont l'élévation du niveau de la mer ainsi que les
inondations marines et pluviales. Il sera alors difficile de concrétiser
bon nombre d'objectifs de développement comme celui de
l'amélioration des performances opérationnelles du port autonome
de Pointe-Noire afin de simplifier les procédures administratives.
3.1.6. Impacts du changement climatique sur la santé
de la population
La santé de la population urbaine de Pointe-Noire
ressent les effets du changement climatique. Ce phénomène se
caractérise par la présence des maladies d'origine hydrique comme
la déshydratation et les éruptions cutanées. La hausse des
températures moyennes peut se traduire par une recrudescence de
certaines maladies vectorielles telle que le paludisme. Pendant la saison
pluvieuse, les rivières débordent et les eaux envahissent des
habitats. Aussi, par manque d'eau de qualité, les populations utilisent
ces mêmes eaux contaminées. Ce qui entraine la propagation des
maladies liées à la ressource en eau comme le Choléra dans
l'environnement urbain.
3.2. Vulnérabilité de l'espace urbain de
Pointe-Noire 3.2.1. Vulnérabilité de la baie de Pointe-Noire
La baie de Pointe-Noire présente un profil
topographique qui la rend de plus en plus exposée à
l'érosion marine maximale. Ses altitudes basses augmentent sa
sensibilité aux risques climatiques. Avec les projections à
venir, le littoral congolais serait de plus en plus exposé aux
inondations à cause de l'élévation du niveau de la mer.
Globalement, l'augmentation du niveau de la mer provoquerait la montée
d'eau et des marées. Par ailleurs, les populations les plus
Page | 51
démunies vivant sur la zone côtière seront
les plus affectées. Celles-ci seraient sujettes aux déplacements
suite aux inondations. Le tableau 5 indique la valeur estimée des
populations menacées sur le littoral congolais par l'érosion
côtière aux horizons 2050 et 2100. Celles-ci vivent dans un
environnement fragile en raison de l'évolution climatique.
Tableau 5 : Estimation des populations menacées à
Pointe-Noire
|
Localité
|
Populations menacées
|
|
2050
|
2100
|
|
Pointe-Noire
|
750.000
|
1.200.000
|
Source : Système des Nations Unies, 2010, pp. 69-70
3.2.2. Vulnérabilité des
mangroves
L'élévation du niveau de la mer à
l'horizon 2035 pourrait entrainer des inondations accompagnées de
l'érosion des côtes. Cette montée des eaux marines
entrainerait la disparition de la mangrove. L'intrusion d'eaux salées
provoquerait le recul du trait de côte affectant les
écosystèmes des mangroves (photo 11).

Photo 11 : Mangroves menacées par les eaux marines au
quartier Songolo (prise de vue, Maketo, 2022)
3.2.3. Vulnérabilité de l'agriculture
Les projections de température du GIEC indiquent une
augmentation de 1,5°C à l'horizon 2040 et de 2°C à
3,5°C à l'horizon 2070 (GIEC, 2013), le réchauffement
climatique entrainerait le bouleversement du calendrier cultural, le
décalage des dates du semis, une évapotranspiration massive de
l'eau au niveau des planches de cultures en raison des pics de chaleur, les
brûlures au niveau des feuilles dans le maraîchage, des pertes de
rendement pour des cultures comme les légumes, le maïs et la banane
plantain.
Page | 52
3.2.4. Vulnérabilité des
établissements humains
La vulnérabilité des habitats à
Pointe-Noire serait plus remarquable si les projections climatiques se
confirment. Aux horizons 2040 et 2070, les maisons connaitraient une hausse de
température ; d'où l'inconfort thermique. Lorsque ces maisons
sont bâties, les conditions climatiques ne sont pas prises en compte.
Avec la conjonction de la modification des sols par des dallages et des
activités thermiques, il faut s'attendre à un
réchauffement artificiel de la ville de Pointe-Noire.
3.2.5. Vulnérabilité du port
L'infrastructure portuaire joue un rôle essentiel pour
la croissance et le développement économiques.
Néanmoins, il pourrait exprimer sa vulnérabilité au
contrecoup du changement climatique à l'horizon 2050. L'ensablement
progressif provoquerait des dégâts futurs sur le commerce et les
perspectives de développement concernant la ville de Pointe-Noire.
3.2.6. Vulnérabilité de la santé de la
population
Le changement climatique accentuerait une baisse de la
qualité de l'eau, ce qui pourrait dégrader directement la
santé humaine à Pointe-Noire, alors que le déficit
hydrique est déjà ressenti par cette population. L'augmentation
de la température pourrait accroitre la présence de certaines
maladies vectorielles telle que le paludisme. Ainsi, les risques de maladies
liées à l'eau se développeraient. Tel est le cas du
Choléra qui sévit dans cette agglomération.
3.3. Mesures d'adaptation
Les mesures d'adaptation impliquent des investissements
importants dans les secteurs les plus vulnérables comme l'eau, la
santé et l'agriculture afin d'éviter ou de réduire les
impacts du changement climatique. Faut-il préciser qu'il existe
plusieurs sortes d'adaptations : anticipative ou réactive, de
caractère privé ou public, autonome ou planifié.
En effet, les mesures d'adaptation représentent des
règlementations prises par les pouvoirs publics pour rendre un
environnement résilient au changement climatique. Les mesures concernent
la planification, l'urbanisme, les réglementations vertes, bleues,
liées aux bâtiments et aux transports. Elles sont
élaborées dans le Schéma Directeur d'Urbanisme (SDU) de la
ville de Pointe-Noire et dans le « Programme spécial
d'aménagement urbain ».
Page | 53
3.3.1. Mesures de planification et d'urbanisme
Elles impliquent bon nombre de réglementations dont :
? La gestion des ordures ménagères et des
déchets (photo 12) qui est cruciale pour l'assainissement de
l'environnement. Cette mesure implique le ramassage, le traitement et le
recyclage des déchets, en particulier, sur les plages publiques de
Pointe-Noire. L'élevage des cochons est encouragé, parce que ces
espèces animales contribuent à faire disparaitre les
matières organiques. Tout ceci doit être assuré par la
population et les collectivités administratives locales. Les pouvoirs
publics doivent mettre en place une politique d'utilisation des
matériaux issus du compost afin de diminuer des déchets sortant
des ménages.

Photo 12 : Décharges de poubelles au marché Fond
Tié-Tié (prise de vue, Maketo, 2022)
? La lutte contre la pollution constitue une mesure efficace
pour rendre la ville de Pointe-Noire résiliente au climat. Elle passe
par la réalisation des contrôles systématiques des rejets
industriels, de la fumée et des eaux usées. La ville dispose de
plusieurs types d'industries.
? Le recensement systématique des zones à risque
constitue une mesure remarquable. Parce que ces zones sont interdites à
la construction. Un code de construction a été adopté en
mars 2016 (Loi n° 6-2019 du 5 mars 2019, p. 5) spécifie que «
les constructions ou installations sont interdites le long du littoral sur
une bande d'une largeur de cent mètres (100 m) à compter de la
limite haute de rivage ou de plus hautes eaux du domaine public maritime, telle
que définie par la règlementation en vigueur ». Tout
ceci permet de sécuriser les zones à fort risque et de
gérer des risques environnementaux comme l'érosion hydrique
(photo 13).

Page | 54
Photo 13 : Un ravin au quartier André Jacques (prise de
vue, Maketo, 2022)
3.3.2. Mesures vertes
Parmi les mesures vertes, nous citons l'aménagement et
la mise en valeur d'espaces verts à Pointe-Noire. Ces espaces sont
censés être protégés en ce qu'ils présentent
une valeur écologique et économique. Selon la Loi n° 6-2019
du 5 mars 2019, « les espaces boisés doivent être
préservés, aménagés et entretenus ». Tout
ceci s'inscrit dans le cadre de la sauvegarde des espaces verts et sites
naturels dans cette agglomération congolaise.
3.3.3. Mesures bleues
Elles consistent à mieux conserver et gérer les
eaux pluviales. Les populations peuvent s'en servir pour humidifier l'espace
urbain de Pointe-Noire par évaporation. Etant donné que les cours
d'eau présentent une valeur économique et écologique,
ceux-ci sont censés être protégés. Les pouvoirs
publics doivent réhabiliter et conserver les lacs et les lagunes en
associant la population. Tel est le cas des lacs Cayo, Ngwabussi et
Tchimpounga. L'élaboration d'un plan participatif d'aménagement,
de valorisation et de gestion des cours d'eau constitue une mesure
considérable pour la ville.
Les résultats des récentes études
urbaines menées par l'Office Fédéral pour l'Environnement
(OFEV, 2018, p. 34) concluent à la nécessité de l'eau
surtout en milieu urbain. La ressource en eau contribue considérablement
à la régulation thermique et au bien-être des populations.
Il est question de l'eau de qualité. Le SDU envisage la
récupération de toutes les rivières de la ville à
travers le développement d'un « Plan bleu participatif » qui
va rétablir la relation entre les
Page | 55
citoyens de Pointe-Noire et ses cours d'eau dans la ville.
Dans les actions prioritaires voire urgentes, le Schéma Directeur
d'Urbanisme (SDU) prévoit le nettoyage des cours d'eau pour les
débarrasser des déchets. Par rapport à la remontée
des eaux salées, les mesures d'adaptation consisteraient à
construire des stations de traitement des eaux afin d'améliorer la
gestion de l'eau potable à Pointe-Noire.
3.3.4. Mesures d'adaptation liées aux
bâtiments
Comme mesures d'adaptation liées aux bâtiments,
nous pensons l'orientation des bâtiments est le premier
élément qui permet d'améliorer le confort thermique tout
en diminuant les consommations énergétiques de chauffage et de
climatisation. Les populations pensent qu'il faut appliquer les normes
liées à la construction des bâtis (photo 14). Aussi, le
contexte du changement climatique doit-il être intégré par
les promoteurs immobiliers et les populations.

Photo 14 : Habitation moderne au quartier Tié-Tié
(cliché, Maketo, 2022)
3.3.5. Mesures d'adaptation liées aux transports
Les mesures d'adaptation liées aux transports
concernent la réduction du phénomène de smog et de la
consommation d'énergie automobile. En réalité, le trafic
automobile est la principale source de pollution de l'air urbain. Les pouvoirs
publics doivent interdire la circulation des véhicules les plus
polluants et limiter l'âge des véhicules en circulation.
Page | 56
3.4. Stratégies d'adaptation au climat
Les stratégies d'adaptation désignent des plans
d'action pour résoudre durablement le problème lié au
changement climatique. Ici, il est question de renforcer la résilience
de l'agglomération de Pointe-Noire au climat. Chacune de ces
stratégies nécessite une gestion raisonnable de cette ville.
3.4.1. Stratégies de planification et
d'urbanisme
Les stratégies de planification et d'urbanisme passent
par la formation des cadres et la sensibilisation des citadins sur les
questions liées à l'environnement. Certaines populations urbaines
de Pointe-Noire maitrisent peu les phénomènes environnementaux.
Pour limiter ses effets, les citadins doivent posséder des savoirs
requis. Pour éviter la submersion des zones côtières, les
digues de protection (photo 15) doivent être construites sur le long du
littoral. La formation périodique de comités de plage est
également évoquée.

Photo 15 : Digue sur la côte sauvage (prise de vue,
Maketo, 2022)
À titre illustratif, le 1er octobre 2019,
une opération de salubrité sur la plage de Pointe-Noire a
été réalisée par la Délégation de
l'Union Européenne (UE) en République du Congo et le conseil
municipal de Pointe-Noire. Elle était dénommée «
Beach clean up », le nettoyage de plage. La collecte des déchets
(photo 16) notamment des plastiques est également effectuée.
Cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale du
nettoyage de la planète célébrée le 21 septembre
2018 (
https://www.eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville/beach-clean-à-pointe-noire-amplifier-le-mouvement-mondial.fr
consulté le Vendredi 02 septembre 2022).

Page | 57
Photo 16 : Les bouteilles plastiques à Songolo (prise de
vue, Maketo, 2022)
3.4.2. Stratégies vertes
Pour rendre résiliente la ville de Pointe-Noire, les
populations pensent que la végétalisation de l'environnement est
prometteuse. En effet, les espaces verts deviennent de véritables oasis
de fraîcheur, particulièrement lors des vagues de chaleur. Aussi,
les arbres assurent l'ombrage au sol permettant aux habitats d'avoir une
aération naturelle. En rejetant de la vapeur d'eau dans l'air, les
arbres contribuent à atténuer les effets de l'ICU sur la
population urbaine. Alors, un questionnement se pose : quels types d'arbres
doit-on planter à Pointe-Noire ? Il s'agit de la Rhizophora, de
l'Acacia, des bambous de Chine et du Menthelys. « Le planting de ces
plantes a été réalisé le 05 juin 2019 par la
société Bos Congo en collaboration avec la fondation Avsi, les
autorités municipales et le personnel de la Direction
Départementale de l'Environnement de la ville de Pointe-Noire. L'action
a été menée à l'école de Vindoulou
auprès des élèves du Primaire et du Secondaire. En effet,
les arbres ont un effet positif sur l'environnement : les feuilles d'arbres
absorbent le CO2 et assurent l'ombrage. Les racines, quant à elles,
servent à stabiliser le sol. » (entretien avec Madame Eouani
Rita Aimée Liliane du 30 août 2022). Les réflexions
réalisées par J. Emond (2017, pp. 14-15) confirment ces
résultats.
Monsieur Missima Nziengui Nicodème nous rapporte que
« la ville de Pointe-Noire présente plusieurs enjeux. Elle est
à la fois une ville portuaire et industrielle. Son statut portuaire
s'explique par le fait qu'elle exerce le trafic maritime. Plusieurs sortes de
voitures foulent le sol de cette agglomération. Ces voitures
émettent des fumées, des gaz. Ce qui entraine les pollutions. Son
statut industriel montre qu'elle abrite une multitude d'industries. Par leur
réalisation, ces sociétés industrielles émettent
des gaz à effet de serre accélérant ainsi le
Page | 58
processus climatique. Pour en limiter, le planting des
arbres est une initiative prometteuse pour la ville ».
Faut-il ajouter que les plantes aident à la
dépollution de l'air et du sol. Elles retiennent l'eau. Les arbres
représentent des « giga puits de carbone » en ce sens
qu'ils peuvent retenir jusqu'à 5,4 tonnes de gaz carbonique par an et 20
kilogrammes de poussière. Les feuilles d'arbres captent les particules
fines et empêchent propager les polluants atmosphériques
(Damblé O., 2020, p. 103).
Aussi, il faut sensibiliser la population sur la protection et
la conservation des écosystèmes. Ceci constitue l'une des
missions de l'ONG Rénatura Congo. La sensibilisation concerne le grand
public tout au long de l'année. « Les émissions radios,
les stands sur les marchés ou lors des événements
culturels sont des moyens utilisés par ladite association pour faire
émerger une prise de conscience citoyenne sur ces questions. Plus de 40
enfants sont sensibilisés chaque année. Les animateurs visitent
des écoles publiques et privées de Pointe-Noire et celles du
Kouilou » (entretien Madame Breheret Natalie du 07 septembre 2022).
Le reboisement de la mangrove sur le littoral de Pointe-Noire représente
une stratégie déterminante, parce que la mangrove protège
les estuaires contre l'intrusion des eaux marines. Cette espèce doit
être restaurée pour satisfaire les besoins des populations en bois
de chauffe. Ses pépinières existent réellement.
Comme stratégies pour l'agriculture urbaine, les
paysans doivent utiliser des semences améliorées s'adaptant au
climat. Il faut trouver des variétés culturelles s'adaptant
à la durée des saisons pluvieuses. Le maïs doit être
planté pendant la première saison des pluies (OND) vers la fin du
mois d'Octobre ou le début du mois de Novembre. La promotion de cette
agriculture est également prise en compte. Aussi, les paysans doivent
être assistés par les pouvoirs publics (entretien avec Monsieur
Massouangui-Kifouala Martin du 25 juin 2022).
3.4.3. Stratégies bleues
Les stratégies bleues impliquent l'approvisionnement de
l'eau de qualité. L'eau est un élément essentiel dans les
mécanismes de rafraîchissement de la ville. Les populations
urbaines de Pointe-Noire connaissent un déficit hydrique. Tel est le cas
des habitants de Louéssi et de Ngoffo qui font usage de l'eau de forage,
parce que la santé de la population en dépend. L'eau contribue
à l'évapotranspiration des plantes. Ainsi, les études
menées par l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme (IAU, 2010, p.
45) concluent les résultats obtenus sur le rôle crucial de l'eau
en ville. Par ailleurs, il est proposé « la mise en place d'une
canalisation fiable dans la ville de Pointe-Noire. En effet, ces eaux doivent
être drainées jusque dans l'Océan Atlantique. Lorsque des
pluies diluviennes s'abattent sur la ville, ces eaux pluviales manquent de
système de drainage. Raison pour laquelle ces eaux submergent des
maisons. La vie des
Page | 59
populations vivant dans ces zones est en danger
» (entretien avec Madame Tsila née Moukoko Kititi Chantal).
3.4.4. Stratégies liées aux
bâtiments
Les stratégies d'adaptation liées aux
bâtiments contribuent à réduire l'ICU à
Pointe-Noire. Il s'agit du choix des matériaux de construction des
écosystèmes humains. 60 % des personnes interrogées
pensent qu'il faut privilégier l'utilisation des matériaux locaux
(planches) pour bâtir des maisons. Lors de la journée
internationale de l'environnement (5 juin 2019), M. Kando Jean François,
Maire de la ville de Pointe-Noire fait la promotion de
l'écoconstruction. Elle est un système par lequel les populations
utilisent des matériaux écologiques comme les briques locales.
Ces plans d'action contribuent à l'aération naturelle des maisons
et au confort thermique des populations qui y vivent.
3.4.5. Stratégies liées aux transports
Comme stratégies d'adaptation, le développement
des transports en commun doit être envisagé afin de réduire
l'usage des voitures personnelles. La promotion de ce type de transport permet
donc de lutter intensément contre la pollution de l'air. À en
croire Delmas F. (2020, p. 140), la voiture individuelle représente 62%
des émissions de gaz à effet de serre. Aussi, un vaste espace
doit être réservé aux piétons. La promotion de la
circulation par vélo et le privilège des voitures
électriques sont également encouragés. À titre
illustratif, la firme Bolloré Logistic contribue à vulgariser les
voitures électriques au Congo-Brazzaville. Ces voitures circulent
à Pointe-Noire comme dans toutes les grandes villes congolaises.
Discussion des résultats
? Impacts du changement climatique sur la ville de
Pointe-Noire
Le changement climatique constitue une menace réelle
pour l'environnement, surtout pour les villes côtières. Ces
dernières provoquent les modifications du climat. Bordée par
l'Océan Atlantique, la ville de Pointe-Noire subit à la fois les
effets du climat global et local. Cette agglomération congolaise est
profondément influencée par les courants marins et nombre de
problèmes environnementaux sévissent à Pointe-Noire. Les
plus récurrents sont l'érosion côtière, les
inondations et les vagues de chaleur. Les phénomènes
d'érosions et d'inondations sont enregistrés non seulement
à Pointe-Noire mais également à Brazzaville.
Page | 60
La ville de Nouakchott, en Mauritanie connait les mêmes
faits environnementaux. Les zones habitées les plus menacées par
la submersion sont principalement les quartiers de Sebkha, d'El Mina-nord et de
Riyad, ainsi que la partie occidentale de Tévragh Zeina. On remarque que
les quartiers périphériques gagnent de plus en plus sur le
domaine côtier, ce qui augmente encore les risques littoraux (A. J.
Niang, 2014, p. 166).
La ville de Sfax en Tunisie fait face à de graves
inondations notamment celles du 23 septembre 2009. Les effets des averses
torrentielles sont vraiment destructeurs, paralysant le centre-ville de cette
agglomération pendant plusieurs heures (Abdelkarim D. et Salem D., 2012,
p. 15). Dans la ville de Montréal, au Canada, l'environnement est soumis
à l'accumulation de la chaleur engendrant ainsi le
phénomène d'ICU. Parmi les effets anticipés des
changements climatiques, la hausse des températures prévues
amplifiera le phénomène d'ilôts de chaleur urbain
(Filiatreault Y., 2015, p.1).
La ville de Ouagadougou - au Burkina-Faso -, où vit
près d'un quart de la population de ce pays, est édifiée
sur un site sensible au climat. Cette ville connait aujourd'hui une
recrudescence des inondations urbaines. À titre d'exemple, une pluie
diluvienne s'abat dans la capitale burkinabè le 1er septembre
2009 engendrant 150.000 sinistrés. Près de 25000 habitations ont
été détruites par cette pluie (Z. Nouaceur et S. Gilles,
2013, p. 8).
? Vulnérabilité de l'agglomération
de Pointe-Noire au climat
Suivant l'évolution climatique, la ville de
Pointe-Noire est vulnérable au climat. Ayant un profil topographique de
plus en plus menacé par les courants marins, la baie de Pointe-Noire
sera de plus en plus exposé aux inondations. À l'horizon 2035,
l'élévation du niveau de la mer et l'intrusion d'eaux
salées causant le recul du trait de côte pourront entrainer la
disparition des écosystèmes des mangroves. À l'horizon
2070, le réchauffement climatique entrainerait une
évapotranspiration massive de l'eau au niveau des planches de cultures
en raison des pics de chaleur, les brûlures au niveau des feuilles dans
le maraîchage, des pertes de rendement agricole (légumes,
maïs et banane plantain). Les maisons connaitront une hausse de
température voire l'inconfort thermique. Le réchauffement
artificiel de la ville de Pointe-Noire est également attendu.
L'infrastructure portuaire exprimera sa vulnérabilité au climat
à travers l'ensablement progressif du site et des dégâts
futurs pour le commerce maritime. Le changement climatique accentuerait une
baisse de la qualité de l'eau et la dégradation de la
santé de la population de Pointe-Noire. La hausse de la
température pourra accroitre la présence de certaines maladies
vectorielles telle que le paludisme. Aussi, les risques de maladies
liées à l'eau se développeraient.
Étant donné qu'un territoire au monde
n'échappe au réchauffement climatique, la ville de Paris connait
également ce phénomène. Le volume de précipitations
cette ville devrait légèrement
Page | 61
augmenter. Aux horizons 2030 et 2085, le cumul
pluviométrique passerait de 633 à 721 mm d'eau. Les inondations
connaitront une tendance à l'augmentation à cause des crues.
Rappelons que le risque d'inondation figure en tête des
préoccupations des populations parisiennes. Aussi, le ruissellement des
eaux pluviales lors de pluies torrentielles sera considérable. La
fréquence et l'intensité des épisodes de fortes chaleurs
et canicules vont s'élever dans le futur. Ainsi, la rapidité avec
laquelle la biodiversité décline en fait un enjeu majeur pour les
années à venir (S. Emery et Y. Françoise, 2021, pp.
6-7).
Au Mali, le changement climatique fera ressentir les impacts
potentiels sur son environnement. Il ressort alors que les températures
seront en hausse sur l'ensemble du pays de plus de 2° C avec une
perception de chaleur forte. Aussi, il est prévu un déficit
pluviométrique à l'horizon 2025. Le couvert végétal
se dégradera suite à l'aridité du climat, aux
sécheresses successives et surtout aux activités humaines. Leur
dégradation s'est accentuée avec l'accroissement de la population
urbaine qui engendre une demande plus élevée des villes en bois
énergie. Les sécheresses fréquentes ont contribué
à fragiliser davantage les écosystèmes, les rendant plus
vulnérables à la moindre perturbation et accélèrent
le rythme de dégradation des ressources biologiques. Les déficits
hydriques ont entraîné une réduction de la production
primaire, une modification de la structure du couvert végétal et
une réduction massive de la faune sauvage et du cheptel. Sur le secteur
agricole, le pire des scénarios imaginés prévoit la baisse
drastique de la production des céréales (D. Z. Diarra, 2013, pp.
13-23).
Sur le littoral de Tétouan au Maroc, les risques
d'inondations pourraient engendrer des dégâts considérables
et des effets socio-économiques néfastes sur la santé et
le bien-être communautaire qu'elles peuvent entraîner. Parmi ces
conséquences on peut citer les pertes d'habitas, de revenu et de
productivité, la perturbation sociale. La faim et la pauvreté
seront largement dévoilées, car de nombreuses activités
économiques telles que l'agriculture et la pêche seront gravement
affectée par les aléas climatiques. À ceci s'ajouterait la
raréfaction de l'eau douce voire l'eau de la nappe phréatique.
Les intrusions d'eau saline seront inévitables et l'eau sera impropre
à tous les usages et au bien-être humain. Une grande partie de la
population de ce littoral risque de subir de fortes agressions des
phénomènes (S. Niazi, 2007, p. 148).
? Mesures et stratégies d'adaptation au
climat
Les mesures et stratégies d'adaptation au climat de
l'agglomération de Pointe-Noire sont applicables dans les villes des
pays en développement. Cela concerne les domaines de planification et
d'urbanisme, vert, bleu, lié aux bâtiments et aux transports. Les
mesures d'adaptation liées à l'aménagement urbain qui
servent à diminuer l'effet d'ICU sont principalement la plantation
d'arbres, la végétalisation, la diminution des surfaces de
revêtement bitumineux ou la mise en place du revêtement de surface
à albédo élevé (Y. Filiatreault, 2015, p.1).
Page | 62
Pour la ville de Brazzaville, il est proposé aux
pouvoirs publics d'élaborer une bonne politique ainsi qu'une loi de
l'aménagement du territoire. L'importation des voitures d'occasion en
mauvais état ne doit plus être acceptée, parce que les
fumées de ces voitures contribuent au réchauffement du climat.
Les voiries urbaines répondant aux normes internationales doivent
être construites. Mettre sur pied une bonne politique de la gestion des
déchets en y consacrant de budgets importants est une perspective
efficace pour la gestion urbaine. Le budget alloué à la mairie de
la ville de Brazzaville doit être rehaussé afin que
l'agglomération soit assainie. Tout ceci implique une gestion
rationnelle des ressources humaines bien formées et dynamiques (Nzoussi
H. K. et Feng Li Jiang, 2014, p. 216). Les mesures susmentionnées
peuvent être appliquées pour les villes des pays en
développement comme de Pointe-Noire. Étant donné que le
réchauffement climatique menace la viabilité des villes, les
autorités parisiennes prévoient le planting de 170 000 arbres. La
ville de Paris va assurer de l'ombre considérable (S. Emery et Y.
Françoise, 2021, p. 15).
Les stratégies d'adaptation liées aux
bâtiments renvoient au choix des matériaux de construction des
écosystèmes humains. M. Diela, Directeur Départemental de
l'Urbanisme et de l'Habitat de Pointe-Noire, nous rapporte que « les
maisons bâties avec des briques locales n'absorbent pas beaucoup
d'énergie. Pendant la nuit, il fait bon vivre dans ces habitations de
briques locales ». M. Jean François Kando, Maire de la ville
de Pointe-Noire fait la promotion de l'écoconstruction, un
système par lequel les populations utilisent des matériaux
écologiques comme les briques locales.
Les pouvoirs publics de la ville de Montréal - au
Canada - mettent en place les stratégies vertes. Celles-ci impliquent la
plantation d'arbres afin d'améliorer le climat urbain. La forêt
urbaine apporte plusieurs bénéfices tels que
l'amélioration de la qualité de l'air, l'absorption d'eau de
ruissellement, l'amélioration du paysage urbain. Les feuilles des arbres
utilisent des rayons infrarouges pour assurer la photosynthèse (Y.
Filiatreault, 2015, p. 27).
Dans cette même optique, la ville de Ouagadougou
(Burkina-Faso) a été mobilisée pour un projet de «
ceinture verte » dans les années 1970. Ce programme vise la
protection urbaine des assauts répétés de sable
(Harmattan), la limitation de l'expansion urbaine non contrôlée et
la création d'une réserve forestière. Environ 1032
hectares de bois ont été plantés en 1980. Les espaces
verts génèrent les écosystèmes naturels et de la
biodiversité et favorisent le développement durable (Z. Nouaceur
et Gilles S., 2013, p. 7).
Conclusion partielle
Comme tout autre territoire, la ville de Pointe-Noire
réagit positivement à l'évolution du climat. Autrement
dit, elle n'échappe pas au défi lié au changement
climatique. Étant une ville des pays en voie de développement,
Pointe-Noire subit les effets pervers de ce phénomène. Suivant
les
Page | 63
projections climatiques, cet environnement urbain serait
d'autant vulnérable aux aléas climatiques. Les effets actuels et
attendus du réchauffement climatique sont pris en compte. Pour renforcer
sa résilience, l'option efficace est celle de s'adapter au climat. Lors
de la 12ème Conférence des parties à la
Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CNUCC) en
novembre 2006 à Nairobi, Koffi Annan pense que « l'adaptation
est une question de survie, rien de moins ».
Page | 64
Conclusion générale
La présente étude contribue à la
connaissance des enjeux d'adaptation d'une ville des pays en
développement aux aléas climatiques. Confronté à
d'énormes difficultés, l'espace urbain de Pointe-Noire doit
recourir à l'adaptation. Les objectifs fixés ont
été atteints et les hypothèses formulées
vérifiées. L'agglomération de Pointe-Noire est
influencée par un climat tropical humide. L'analyse des
précipitations et des températures montre que la ville de
Pointe-Noire présente un régime bimodal : deux maxima et un
minima. Les résultats obtenus sur l'évolution du climat
(1932-2004) montrent que les précipitations présentent une
tendance légèrement à la baisse jusqu'en 2004. Les
températures, quant à elles, se caractérisent par une
tendance à la hausse jusqu'en 2004.
Étant donné qu'aucun territoire n'échappe
au dérèglement climatique, la ville de Pointe-Noire ne fait
exception. Les conséquences du changement climatique sont
identifiées dans plusieurs secteurs comme la baie de Pointe-Noire. Parmi
les effets, nous citons l'élévation du niveau de la mer,
l'intrusion d'eau saline, la submersion des terres, l'élévation
du niveau de la mer l'acidité de l'océan et le recul du trait de
côte. Avec les projections climatiques à venir, la baie de
Pointe-Noire connaitra des inondations et les populations les plus
démunies vivant de la zone côtière seront les plus
affectées.
Les résultats obtenus sur les enjeux
d'adaptabilité au climat indiquent qu'il faut prendre en compte des
mesures et stratégies d'adaptation. Ces enjeux d'adaptation sont
structurés dans des domaines de planification et d'urbanisme, vert,
bleu, lié aux bâtiments et aux transports. Des plans d'action sont
développés pour résoudre durablement les problèmes
environnementaux dans la ville de Pointe-Noire. Il s'agit des stratégies
d'adaptation au climat. Les stratégies de planification et d'urbanisme
passent par la formation des cadres, la sensibilisation des citadins sur le
changement climatique, la relocalisation des populations et la construction des
digues de protection le long du littoral. La formation périodique de
comités de plage est également évoquée. Les
stratégies vertes renvoient à la végétalisation de
l'environnement urbain. Ce sont des arbres halophiles qui doivent être
plantés. Aussi, il faut sensibiliser la population sur la protection et
la conservation des écosystèmes des mangroves. Pour l'agriculture
urbaine, les paysans doivent trouver des variétés culturelles et
utiliser des semences améliorées. Les stratégies bleues
impliquent l'approvisionnement de l'eau de qualité. Les
stratégies d'adaptation liées aux bâtiments
représentent le choix des matériaux de la construction des
maisons et la promotion de l'écoconstruction. Comme stratégies
inhérentes aux transports, nous citons le développement des
transports en commun, la promotion de la circulation par vélo, le
privilège des voitures électriques et la réservation d'un
vaste espace pour les piétons.
À l'issue de cette recherche, de nombreuses
perspectives scientifiques se dégagent de réaliser. Il s'agira
d'analyser la perception du climat par les populations, les enjeux d'adaptation
de la zone côtière au climat. Il sera aussi intéressant de
mener des études sur la vulnérabilité
socioéconomique de l'agglomération de Pointe-Noire aux
aléas climatiques.
Page | 65
Références bibliographiques
Abdelkarim D. et Salem D., 2012 : Résilience de
l'agglomération de Sfax (Tunisie méridionale) face au changement
climatique : essai d'évaluation, Revue Association Internationale
de Climatologie (AIC), 18 p. 109-127.
Abdoul Jelil Niang, 2014 : La résilience aux
changements climatiques : cas de la ville de Nouakchott, Revue
Géo.Eco.Trop, 13 p., 155-168.
ADEME, 2018 : Diagnostic de la surchauffe urbaine,
Méthodes et applications territoriales, Angers, 64 p.
ADEME, 2020 : Enjeux, Savoir s'adapter au changement
climatique, Agir pour mieux anticiper mes évolutions du climat,
Angers, 19 p.
Césaire Jean Marc, 2009 : République du
Congo, Guide d'affaires et d'investissements 2009, Brazzaville, Éd.
Les Manguiers, Première édition, 276 p.
Damblé Ophélie, 2020 : Manifeste pratique de
végétalisation urbaine, Cinquante actions coups de Green pour
changer la ville sans la quitter, Paris, Éd. Solar, 179 p.
Delmas Florian, 2020 : Planète A plan B, Faire
société pour l'essentiel, Paris, Coup de coeur
Éditions, 191 p.
Dimon Rodrigue, 2008 : Adaptation aux changements
climatiques : perceptions, savoirs locaux et stratégies d'adaptation
développées par les producteurs des communes de Kandi et de
Banikoara au Nord du Bénin, Thèse de Doctorat,
Université d'Abomey-Calavi (Benin), Option : économie,
socio-anthropologie et communication pour le développement rural, 209
p.
Emond Julie, 2017 : Les espaces verts urbains et leur
contribution à l'amélioration de la qualité de vie des
résidents de la petite-patrie, Mémoire de Master,
Spécialité Géographie, Université du Québec
à Montréal (UQAM), 223 p.
Filiatreault Ysabelle, 2015 : Changements climatiques et
îlots de chaleur : indicateurs de performance pour les mesures
d'adaptation, Essai de Maitrise en environnement, Université de
Sherbrooke (Montréal), 84 p.
GIEC, 2007 : Bilan 2007 des changements climatiques,
Conséquences, adaptation et vulnérabilité,
Contribution du Groupe de travail II (GT II) au quatrième Rapport
d'évaluation (RE4) du GIEC, 116 p.
GIEC, 2014 : Changements climatiques, Incidences,
adaptation et vulnérabilité, Résumés, foire aux
questions et encarts thématiques, Contribution du groupe de travail
II, Cinquième rapport d'évaluation (RE5), 201 p.
IAU, 2014 : Territoires urbains durables et adaptation aux
changements climatiques, Rapport d'étude, Île-de-France, 28
p.
Ibiassi Mahoungou Geoffroy, 2021 : Diagnostic de
l'évolution actuelle (1960-2019) et future (20402070 et 2100) des
facteurs d'exposition climatique à Pointe-Noire (République du
Congo), in Revue Espace géographique et société
marocaine, n° 52, 21 p. 43-64.
INS, 2020 : Annuaire statistique de Pointe-Noire
2018, Pointe-Noire, 309 p.
Jouzel Jean, 2019 : Climats passés ; climats
futurs, Paris, Éd. CNRS, Coll. « Les Grandes Voix de la
Recherche », 57 p.
Le Tacon François, 2021 : La déforestation,
Essai sur le problème planétaire, Versailles, Éd.
Quae, 118 p.
Maléké Sheley Pépys Lydie, 2007 :
Brazzaville, son environnement face aux changements climatiques,
Mémoire de Master en Climatologie, FLASH (UMNG), 53 p.
Mansanet-Bataller Maria, 2010 : Les enjeux de l'adaptation
aux changements climatiques, Rapport d'étude, 27 p.
Massouangui-Kifouala Martin, Moutakala Mounsounou Cyril
Chriché, Batchi Mav Achille Patrick et Michellon Benjamin, 2021 :
Vulnérabilité et la résilience des quartiers
précaires à Brazzaville (République du Congo) face au
changement climatique : cas de Soukissa et Moukondzi-Ngouaka, Revue
Ivoirienne des Sciences et Technologies, 30 p. 251-281.
Ministère de l'Environnement, du Développement
durable et du Bassin du Congo, 2021 : Contribution déterminée
au niveau national de la République du Congo, Brazzaville, 49 p.
Page | 66
Ministère de la Construction, de l'Urbanisme, de la
Ville et du Cadre de Vie, 2016 : Schéma Directeur d'Urbanisme (SDU)
de Pointe-Noire, Rome, 88 p.
Ministère de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation Technique de la République du Congo, 2007 :
Deuxième rapport sur l'état des ressources
phylogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture au
Congo, 49 p.
Moukandi N'kaya Guy Dieudonné, 2012 : Étude
hydrogéologique, hydro chimique in situ et modélisation
hydrodynamique du système aquifère du bassin sédimentaire
côtier de la région de Pointe-Noire, Thèse de
Doctorat, Spécialité Hydrogéologie et Hydrologie
Environnementales, Brazzaville, Université Marien Ngouabi
(Faculté des Sciences et Techniques), 141 p.
Moundza Patrice, 2014 : L'habitat urbain et le
réchauffement climatique à Brazzaville, in Climat et
environnement du Congo-Brazzaville, Paris, Éd. L'Harmattan, 37 p.
65-102.
Niazi Saida, 2007 : Évaluation des impacts des
changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer sur
le littoral de Tétouan (Méditerranée occidentale du Maroc)
: Vulnérabilité et Adaptation, Thèse de Doctorat en
Changements Climatiques et Zones Côtières, Faculté des
Sciences, Mohammed V - Agdal (Rabat), 296 p.
Nouaceur Zeineddine et Gilles Sandrine, 2013 : Changements
climatiques et inondations urbaines dans le Sahel : Étude cas de
Nouackchott (Mauritanie) et Ouagadougou (Burkina-Faso), Revue GeoSuds, 10
p.
Nsiloulou May Verylove Destinée, 2020 : Bilan
hydrique et besoins en eau des cultures d'arachide et de maïs dans le
Sud-Congo, Mémoire de Master en Géographie physique, FLASH
(UMNG), 101 p.
Nzila Jean de Dieu, 2013 : État, Besoins et
priorités pour une gestion durable des sols au Congo-Brazzaville,
Accra, Centre de Recherche sur la Conservation et la Restauration des Terres
(CRCRT), 27 p.
OFEV, 2018 : Quand la ville surchauffe Bases pour un
développement urbain adapté aux changements climatiques,
Berne, 109 p.
ONU-HABITAT, 2010 : L'état des villes africaines
2010, Gouvernance, inégalités et marchés fonciers
urbains, Nairobi, 256 p.
ONU-HABITAT, 2012 : République du Congo : profil
urbain de Pointe-Noire, Nairobi, Éd. Onu-Habitat, 18 p.
PNUD, 2012 : Étude sur la
vulnérabilité de l'économie congolaise et ses perspectives
de diversification, Brazzaville, 226 p.
Ringard J., Dieppois B., Rome S., Dje Kouakou B.,
Konaté D., Katiellou G. L., Lazoumar R., Bouzou-Moussa I., Konaré
A., Diawara A., Ochou A.D., Assamoi P., Camara M., Diongue A., Descroix L. et
Diedhiou A., non daté : Évolution des pics de
températures en Afrique de l'Ouest : étude comparative entre
Abidjan et Niamey, 6 p.
Rocle Nicolas, 2017 : L'adaptation des littoraux au
changement climatique : une gouvernance performative par
expérimentations et stratégies d'action publique,
Thèse de Doctorat, Spécialité Sociologie,
Université de Bordeaux, 452 p.
Samba Gaston et Nganga Dominique, 2013 :
Variabilité pluviométrique dans le Bassin du Congo,
Éd. L'Harmattan, 19 p., 53-72.
Samba Gaston, 2014 : Le Congo-Brazzaville, Climat et
environnement, Paris, Éd. L'Harmattan, 155 p. Samba Gaston, 2020 :
Le climat du Congo-Brazzaville, Paris, Éd. L'Harmattan, Coll.
« Études africaines », 241 p.
Samba Gaston, Nganga Dominique et Mpounza Marcel, 2008 :
Rainfall and temperature variations over Congo-Brazzaville between 1950 and
1998, Revue Theoretical and applied Climatology, 13 p. 85-97.
Samba-Kimbata Marie Joseph, 1978 : Le climat du
Bas-Congo, Thèse de Doctorat du 3e cycle,
Université de Dijon, Centre de Recherches de Climatologie (CRC), 281
p.
Page | 67
Sébastien Emery et Yann Françoise, 2021 :
Paris face aux changements climatiques, Paris, Agence
Giboulées, 24 p.
Sitou Léonard, 1994 : Les cirques d'érosion
dans la région de Pointe-Noire (Congo) : étude
géomorphologique, Thèse de Doctorat de l'Université
Louis Pasteur (Strasbourg 1), Mention Géographie physique, 240 p.
Système des Nations Unies, 2010 : Des
progrès vers l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), Rapport national, Brazzaville, 81 p.
Toli Ghislain et Samba Gaston, 2022 : Tendances et
ruptures des précipitations sur la partie congolaise du Bassin du
Congo, Revue Espace Géographique et Société
marocaine, n° 60, 17 p., 181-197.
Tsondabeka Ferdinand, Bemba Bantsimba Germain, Poaty Marcel,
Tchicaya Telliane Vincent, Massamba Bruno Raphael et Lyoumba Albert, non
daté : Ville de Pointe-Noire, 90e anniversaire (11 mai
1922-11 mai 2012), Livre d'or, Pointe-Noire, 208 p.
Vennetier Pierre, 1968 : Pointe-Noire et la façade
maritime du Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Centre ORSTOM, 485 p.
Wenclawliak B., 2005 : Évaluation environnementale
de la pollution due aux hydrocarbures sur le littoral Kouilou (Congo),
Rapport d'étude, Brazzaville, 6 p.
World Agroforestry Center, 2012 : Analyse participative de
la vulnérabilité et de l'adaptation aux changements climatiques :
un guide méthodologique, Nairobi, 21 p.
Zan Diarra Daouda, 2013 : Impacts des changements
climatiques en Afrique de l'Ouest, Bamako, Mali Météo, 35
p.
Page | 68
Sites web consultés
www.graie.com consulté le 24
février 2022
www.leséchos-congobrazza.com
consulté le 14 juillet 2022
www.fr-academic.com
consulté le 29 juin 2022
https://www.eeas.europa.eu/delegations/congo-brazzaville/beach-clean-à-pointe-noire-amplifier-le-mouvement-mondial.fr
consulté le Vendredi 02 septembre 2022).
mairiedepointe-noire.cg
consulté le Jeudi 25 août 2022
Page | 69
Liste des figures
Figure 1 : Découpage administratif de la ville de
Pointe-Noire par arrondissement 16
Figure 2 : Relief de la ville de Pointe-Noire 19
Figure 3 : Évolution démographique de la ville
de Pointe-Noire de 1950 à 2020 (INS, 2020) 23
Figure 4 : Projection de la population urbaine de Pointe-Noire
de 2023 à 2035 (ONU, 2019) 23
Figure 5 : Répartition de l'économie de la ville
de Pointe-Noire en 2012 (ONU-HABITAT, 2012) 25
Figure 6 : Régime pluviométrique à
Pointe-Noire (1932-2004) 32
Figure 7 : Températures minimales à Pointe-Noire
(1932-2004) 33
Figure 8 : Températures maximales à Pointe-Noire
(1932-2004) 33
2
Figure 9 : Évolution pluviométrique
interannuelle à Pointe-Noire (1932-2004) 35
Figure 10 : Évolution pluviométrique de la
saison DJF (1932-2004) 35
Figure 11 : Évolution pluviométrique de la
saison MAM (1932-2004) 36
Figure 12 : Évolution pluviométrique de la
saison JJA (1932-2004) 36
Figure 13 : Évolution pluviométrique de la
saison SON (1932-2004) 37
Figure 14 : Évolution interannuelle des
températures maximales à Pointe-Noire (1932-2004) 38
Figure 15 : Évolution interannuelle des
températures minimales à Pointe-Noire (1932-2004) 38
Figure 16 : Évolution des températures maximales
de la saison DJF (1932-2004) 39
Figure 17 : Évolution des températures minimales
de la saison DJF (1932-2004) 39
Figure 18 : Évolution des températures maximales
de la saison MAM (1932-2004) 40
Figure 19 : Évolution des températures minimales
de la saison MAM (1932-2004) 40
Figure 20 : Évolution des températures maximales
de la saison JJA (1932-2004) 40
Figure 21 : Évolution des températures minimales
de la saison JJA (1932-2004) 41
Figure 22 : Évolution des températures maximales
de la saison SON (1932-2004) 41
Figure 23 : Évolution des températures maximales
et minimales de la saison SON (1932-2004) 42
Page | 70
Liste des tableaux
Tableau 1 : Entretiens réalisés par Maketo Cris
(enquête personnelle, 2022) 12
Tableau 2 : Répartition démographique et
spatiale de la ville de Pointe-Noire par arrondissement en
2018 d'après INS (2020, p. 68) 23
Tableau 3 : Durée d'insolation (en heures et
dixième) de la station synoptique de Pointe-Noire de 1961
à 1990 d'après ANAC (2010) 34
Tableau 4 : Statistiques sur la typologie de l'habitat
à Pointe-Noire d'après ONU-HABITAT (2012, p.
13) 50
Tableau 5 : Estimation des populations menacées
d'après Système des Nations Unies (2010, pp. 69-70)
51
Page | 71
Liste des photos
Photo 1 : Gare centrale du CFCO (prise de vue, Maketo, 2022)
16
Photo 2 : Une des premières locomotives du CFCO (prise
de vue, Maketo, 2022) 16
Photo 3 : Rivière Songolo (prise de vue, Maketo, 2022)
20
Photo 4 : Urbanisation incontrôlée
observée au quartier Louéssi (prise de vue, Maketo, 2022) 21
Photo 5 : Quelques acheteurs des ressources halieutiques
(prise de vue, Maketo, 2022) 26
Photo 6 : Quelques cultures maraichères au quartier
N'djéno (prise de vue, Maketo, 2022) 27
Photo 7 : Vue aérienne du port de Pointe-Noire (prise
de vue, Mombo, 2022) 30
Photo 9 : Baie de Pointe-Noire menacée par les eaux
océaniques (prise de vue, Maketo, 2022) 47
Photo 10 : Inondation d'une artère urbaine au quartier
Tchiali (prise de vue, Mombo, 2022) 49
Photo 12 : Habitation précaire au quartier
Louéssi (prise de vue, Maketo, 2022) 49
Photo 13 : Mangroves menacées par les eaux
océaniques au quartier Songolo (prise de vue, Maketo,
2022) 51
Photo 14 : Décharges de poubelles au marché Fond
Tié-Tié (prise de vue, Maketo, 2022) 53
Photo 15 : Un ravin au quartier André Jacques (prise de
vue, Maketo, 2022) 54
Photo 16 : Habitation au quartier Tié-Tié (prise
de vue, Maketo, 2022) 55
Photo 18 : Digue de protection sur la côte sauvage
(prise de vue, Maketo, 2022) 56
Photos 16 : Quelques bouteilles plastiques à Songolo
(prise de vue, Maketo, 2022) 57
Page | 72
Table de matières
Dédicaces 1
Remerciements 2
Liste des acronymes et sigles utilisés 4
Sommaire 6
Introduction générale 7
Chapitre 1: présentation de la zone d'étude
15
1.1. Cadre historique 16
1.2. Cadre physique 17
1.2.1. Géologie et pédologie 17
1.2.2. Relief et hydrographie 18
1.2.3. Végétation 20
1.3. Cadre humain 20
1.3.1. Évolution démographique et spatiale
récente 21
1.3.2. Évolution future de la population 22
1.3.3. Répartition de la population 23
1.4. Cadre économique 24
1.4.1. Secteurs d'activités 25
1.4.2. Activités économiques 25
Conclusion partielle 31
Chapitre 2 : Climat de Pointe-Noire 32
2.1. Climat moyen 32
2.1.1. Précipitations 32
2.1.2. Températures 32
2.1.3. Insolation 33
2.1.4. Vents 34
2.2. Évolution climatique à Pointe-Noire 34
2.2.1. Évolution des précipitations 34
2.2.2. Évolution des températures 37
Discussion des résultats 46
Page | 73
Conclusion partielle 46
Chapitre 3 : Impacts, vulnérabilité et enjeux
d'adaptation 47
3.1. Impacts du climat sur l'environnement de Pointe-Noire
47
3.2. Vulnérabilité du climat 50
3.3. Mesures d'adaptation 52
3.4. Stratégies d'adaptation 56
Discussion des résultats 59
Conclusion partielle 62
Conclusion générale 64
Références bibliographiques 65
Sites web consultés 68
Liste des figures 69
Liste des tableaux 70
Liste des photos 71
Table des matières 72
Page | 74
Résumé

L'objectif de ce travail est d'analyser les enjeux
d'adaptation de la ville de Pointe-Noire au climat. Pour y parvenir, nous avons
utilisé des données climatiques (1932-2004),
démographiques, économiques, cartographiques et celles de
l'observation directe. Comme approche méthodologique, nous avons
utilisé la recherche documentaire, la collecte des données, le
traitement et l'analyse des données. Les résultats montrent que
les précipitations à Pointe-Noire connaissent
légèrement une baisse et les températures sont à la
hausse. Cette agglomération
ressent les effets du climat dont l'élévation du
niveau des eaux océaniques, les inondations et
les vagues de chaleur. Les mesures d'adaptation doivent
être prises en compte pour renforcer
sa résilience au climat. Ces règlementations
sont accompagnées par des plans d'action durables
dont la sensibilisation des citadins sur le changement
climatique, la construction des digues, la
végétalisation urbaine, l'approvisionnement de
l'eau de qualité, le choix des matériaux de
construction et le développement des transports en
commun.
Mots clés : adaptation, changement
climatique, résilience et Pointe-Noire.
Abstract
The objective of this work is to analyze the challenges of
adaptation of the city of Pointe-Noire to the climate. To achieve this, we used
climate data over a period from 1932 to 2004, demographic, economic and direct
observation. As a methodological approach, we used literature search, data
collection, data processing and analysis. The results show that precipitation
in Pointe-Noire is experiencing a sight decrease and temperature are on the
rise. The city of Pointe-Noire is feeing the effects of climate, incuding
rising sea levels, floods and heat waves. The adaptation measures must be taken
into account to strengthen her resilience. These regulations are accompanied by
sustainable action plans including raising awareness among city dwellers about
climate change, the construction of dikes, urban greening, the supply of
quality water, the choice of building materials and the development of public
transport.
Keywords : adaptation, climate change,
resilience and Pointe-Noire.
Centre de Recherches et d'Études sur l'Environnement
(CREE), École Normale Supérieure
Université Marien
Ngouabi, Brazzaville, République du Congo
| 


