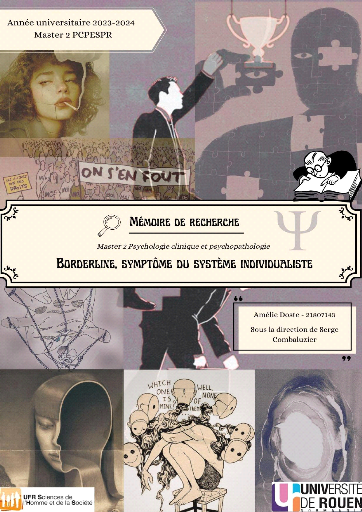
Année universitaire 2023-2024 Master 2 PCPESPR
MÉMOIRE DE RECHERCHE
Master 2 Psychologie clinique et psychopathologie _ _
BORDERLINE, SYMPTÔME DU SYSTÈME
INDIVIDUfLISTE
1k f~
UFR Sciences de
II'Homme et de la Societe
if
PUN IVERSITE
DERRDUES
Amélie Doste - 21807143
Sous la direction de Serge Combaluzier
't
2
Remerciements
Je tiens à adresser mes sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont contribué et aidé à
la rédaction de ce mémoire.
En premier lieu, je remercie Serge Combaluzier
d'avoir accepté d'être mon directeur de mémoire.
Vous avez su me rassurer et m'aider grandement dans la construction de ce
mémoire, merci pour votre bienveillance, vos conseils, et mention
spéciale à la transmission de votre grande maîtrise des
statistiques.
Je désire remercier Jean-Michel Coq et
Teresa Rebelo d'avoir accepté d'évaluer ce
travail en participant au jury de soutenance et de prendre le temps pour ce
travail universitaire.
Un remerciement particulier à ma brillante amie
Alice Lemarchand, pour son immense soutien et ces
échanges autour du sujet de ce mémoire. Sans elle, beaucoup des
réflexions présentes dans ce mémoire n'auraient pas
émergé. Merci pour ces précieux partages de tes
pertinentes connaissances de psychologie sociale et politique.
Je souhaite remercier Pierre-Yves Carpentier,
qui n'as jamais cessé de croire en moi et pour son soutien
inestimable. Merci pour ton aide et ton partage de connaissance en psychologie
sociale, mention spéciale à la notion de « pouvoir »
ainsi que sur l'individualisme. Merci infiniment mon ami.
Merci à toi Marie-Hélène,
pour m'avoir offert un espace de travail paisible, pour ton optimisme
sans faille et ton admirable tranquillité générale sur la
vie. Merci pour cette sagesse qui a apporté beaucoup d'apaisement
à cette période déterminante de ma vie.
Je remercie ma mère et mon frère
de m'avoir autant soutenu et toujours encouragé dans cette
recherche, dans cette voie, de m'avoir redonné la motivation dans les
moments de doute les plus difficiles, d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir
toujours poussé vers le haut. Merci de votre écoute active,
même si parfois vous ne compreniez rien à ce que je racontais.
Je remercie finalement mes ami.e.s ainsi que
toute la promotion de PCP, pour leur soutien, leur
écoute, et les échanges et conseils qu'ils m'ont apporté
tout au long de ces intenses années universitaires.
MERCI
3
Sommaire
I. Revue de la littérature 6
1. Le trouble de la personnalité borderline 6
1.1 L'apport de la psychanalyse : les états limites 7
1.1.1 Adolf Stern 7
1.1.2 Otto Kernberg 8
1.1.3 Jean Bergeret : Etat limite et Idéal du Moi 9
1.2 Le concept de limite dans la psychanalyse contemporaine
10
1.2.2 Les mécanismes de défenses de la
personnalité limite 12
1.3 Le modèle alternatif de la personnalité (MATP)
18
1.3.1 Le trouble de la personnalité borderline selon le
MATP 20
1.3.2 Critères diagnostiques proposés avec le MATP
20
2. Le système de valeurs 22
2.1 Shalom Schwartz 23
2.2 La définition des valeurs selon Schwartz et all 23
2.2.1 Les dix valeurs universelles selon la théorie de
Schwartz 24
3. L'individualisme 28
3.1 Un peu d'histoire... 28
3.2 Le concept d'individualisme d'un point de vue sociologique :
Réflexion et liens 31
3.3 Lien entre la personnalité borderline et
l'individualisme 33
II. Problématique de recherche
34
2.1 Objectif de la recherche 34
2.2 Hypothèses 34
III. Méthodologie 35
3.1 Populations de l'étude 35
3.2 Opérationnalisation des variables 35
3.3 Protocole 41
3.4 Aspects déontologiques 41
3.5 Hypothèses opérationnelles 42
3.6 Traitement statistique des données 42
IV. Analyse des résultats 43
Analyse factorielle confirmatoire 43
4.1 Description des scores obtenus aux différents outils
44
4.1.1 Description des scores du groupe significatif au BSL 45
4.1.2 Test de Student 46
4.2 Analyse des médiations 48
4
4.2.1 Rôle médiateur du trouble de la
personnalité borderline (BSL) 48
V. Discussion 51
5.1 Les objectifs de la recherche 51
5.2 Discussions des résultats 51
5.3 Borderline et la valeur « Pouvoir » 53
5.3.1 Pouvoir et Identité 53
5.3.2 Pouvoir et Intimité 54
5.3.3 Pouvoir et psychoticisme 54
5.3.4 Le pouvoir : la quête idéalisée des
borderlines ? 55
5.3.5 Borderline et Individualisme 57
5.4 Principales limites 58
VI. Conclusion 59
VII. Annexes 62
5
Introduction
Le quotidien « Le monde » publiait
déjà en 2012 un article intitulé « Les borderlines,
ces écorchés vifs » et concluait son analyse ainsi : «
Notre société moderne hyperconnectée, boulimique d'images,
individualiste, favoriserait-elle l'émergence de ce type de
personnalité ? »
C'est un constat moderne, présent de plus en plus dans
l'actualité psychologique. Sur les réseaux sociaux, cette
étiquette psychopathologique du « Borderline » très
répandue et utilisée, marque une prédominante quête
identitaire de l'être humain et questionnant... les
limites.
Quel individu n'a pas été amené, à
un moment donné de sa vie, à réfléchir à la
question des
limites subjectives et intersubjectives ? Dépassant la
stricte définition psychopathologique des
états limites, la problématique des limites ouvre
un champ d'investigations passionnant tant sur
le plan théorique que clinique.
Cette étude part de ces constats sociaux, de
réflexions, d'échanges, autour de l'impact de la
société sur la santé mentale générale d'un
individu, puis sur ce trouble de la personnalité limite. Assez
présent dans le champ de la psychiatrie, débordant de
différentes théorisations, difficile à étiqueter...
Cette pathologie interroge,
En effet, l'individu n'est pas dissociable de son
environnement, et son tempérament, sa personnalité,
résulte de ce dernier, sans compter les facteurs
génétiques. Une vulgarisation et généralisation l'a
emporté sur le versant psychopathologique, avec le trouble de la
personnalité borderline. En étudiant cette pathologie, j'ai pu
faire de nombreux liens entre notre société actuel, dîtes
individualiste et ce trouble de la personnalité.
Mais la tâche n'est pas aisée, l'individualisme
étant un large paradigme, nous avons dû centrer sur les outils
existants et pouvant être lié à la personnalité : le
système de valeurs. Nous avons donc centré notre recherche
à visée exploratoire, sur l'existence d'un lien par le biais d'un
système de valeurs intériorisé d'un individu, de
l'individualisme et du trouble de la personnalité borderline.
6
I. Revue de la littérature
1. Le trouble de la personnalité borderline
Le mot borderline signifie « limite » et plus
littéralement « ligne frontière ».
Métaphoriquement, il peut vouloir dire « à cheval » ou
« entre deux » c'est à dire à l'intermédiaire de
deux pathologies. Il évoque tout à la fois les notions de
frontières entre le normal et le pathologique, entre la névrose
et la psychose. Difficile de définir un trouble par un terme qui
déjà, ne souhaite pas rentrer dans une catégorisation
précise. C'est assez représentatif de ce qu'est l'organisation
borderline : complexe à définir, parallèlement à la
complexité à SE définir pour le sujet.
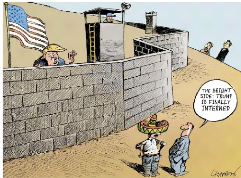
« Qu'est-ce qu'une limite pour l'être humain ?
» un bord, une frontière, un passage, une enceinte... L'origine
étymologique du verbe « limiter » (limitare, -iter)
désigne un sentier (limes, -itis) séparant deux
étendues. Fin d'un territoire, début d'un autre, la limite permet
la définition d'un écart, d'un intervalle, rendant possible
l'organisation des éléments pour sortir du confus.
(Estellon, V. (2023). Figures et formes des états limites.
Le Carnet PSY, H-, 17-24.)
Sur le plan géopolitique, l'image des "territoires
occupés" illustre un espace aux frontières changeantes,
divisé entre différentes forces et constamment exposé
à des menaces, ce qui ne permet pas aux habitants de s'y sentir en
sécurité de manière durable. L'histoire démontre
également que lorsque les frontières deviennent
perméables, poreuses les individus érigent des murs ; des murs
défensifs, des murs de la peur.
Mais pour l'être humain, où se situent les limites
?
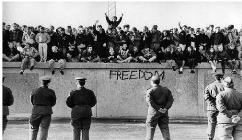
7
1.1 L'apport de la psychanalyse : les états
limites
C'est vers la fin du XIX -ème siècle, que la
notion d'état limite se développe dans la littérature
psychanalytique. En effet, de nombreuses qualifications ont été
donné à cette configuration pathologique par de nombreux auteurs,
en voici quelques-unes : d'abord considéré comme des «
prépsychoses » utilisé par Diatkine, qui renvoie à
l'organisation psychique de ce trouble utilisant des mécanismes de
défenses psychotiques comme le clivage et la projection sans être
psychotique. Guex parlera de « syndrome d'abandon », faisant
référence à la peur de l'abandon, l'un des principales
critères diagnostique et moteur de cette pathologie. L'appellation la
« personnalité as if » de Deutsch est
intéressante, donnant la personnalité « faux self »
en français, notion de Donald Winnicott. Elle résonne avec
la perturbation de l'image de soi du borderline, de leur identité, ainsi
que de leurs relations ainsi qu'à la soumission à son
environnement. Puis vient les appellations « limites » comme «
l'aménagement limite » de Bergeret, « l'organisation limite
» de Kernberg ainsi que Widlöcher et « le fonctionnement limite
» par Chabert.
De manière paradoxale et débordante, cette
pathologie refuse catégoriquement de se conformer aux modèles qui
lui sont présentés, interrogeant ainsi les liens entre la norme
et la folie, la vérité et le mensonge, l'amour et la haine, la
vie et la mort.
1.1.1 Adolf Stern
La première référence importante, car
considéré comme le père du trouble borderline, est
l'auteur Adolf Stern. Il publie un article s'intitulant « Psychoanalytic
Investigation of and Therapy in the Border Line Group of Neuroses »
traduit en français sous le titre « Les mouvements
transférentiels atypiques chez des névrosés. »
Pour expliciter ces propos, nous nous appuierons sur cet
article ainsi que sur l'ouvrage de Vincent Estellon « Des névroses
aux états limites » qui nous parle de ces travaux.
En effet, dès 1938, Stern étudie des sujets qui
présentent des troubles narcissiques et identitaires. Stern
s'aperçoit que certains sujets ne peuvent se réclamer franchement
de la famille psychopathologique des névroses ni de celle des psychoses.
(Estellon, V. (2015). Chapitre 2. Premières descriptions des
états limites.)
En effet, Stern exprime dans son article « qu'un certain
flou est à présent inévitable, parce que le
matériel que ce groupe offre à étudier débouche
nettement dans deux directions précises :
8
vers le pôle psychotique et vers le pôle
névrotique [...] » (Stern, Adolph. « Psychoanalytic
Investigation of and Therapy in the Border Line Group of Neuroses ».
The Psychoanalytic Quarterly)
Pour ce qui est de la description symptomatologique de cette
pathologie, Stern insistera sur l'impulsivité et l'anxiété
importante chez ces sujets, présentant une insécurité
intérieure quasi permanente. Selon lui, les personnalités
borderlines se définissent par une idéalisation et une
dévalorisation des proches ainsi que de l'analyste lors d'une
psychothérapie.
1.1.2 Otto Kernberg
L'organisation de la personnalité borderline :
la personnalité limite
Pour l'auteur Kernberg (1967) la personnalité limite
est une névrose à expression psychotique. Il considère que
c'est une organisation stable et spécifique de la personnalité de
type névrotique, mais qu'elle s'en distingue par une expression
pulsionnelle archaïque, des mécanismes de défense
organisés autour du clivage, de l'idéalisation primitive, de
l'identification projective, de l'omnipotence, de la dévalorisation et
du déni.
Le modèle original de Kernberg combine les options
catégorielles et dimensionnelles de la personnalité et comporte
cinq axes. (Kernberg, O. F. (1989). Les Troubles limites de la
per-sonnaliteì.)
1 - Le degré d'intégration du Moi : le
syndrome d'identité diffuse est la dimension fondamentale ;
elle conditionne la gravité des distorsions du fonctionnement mental du
patient.
2 - Le degré de développement du Surmoi : il est
une conséquence du recours à des modes de défense
archaïques centrés sur le clivage. Il constitue
l'élément pronostique majeur.
3 - La gravité du traumatisme ou de l'agression : il
s'agit des dysfonctionnements familiaux sévères ainsi que des
sévices physiques et sexuels particulièrement graves chez les
patients borderline.
4 - L'axe dimensionnel extraversion/introversion : proche de
la notion de tempérament, il serait de nature essentiellement
génétique, influençant un mode général des
conduites et l'établissement des relations objectales au début de
la vie. Il permettrait de définir le seuil des réactions
affectives.
5 - La dysrégulation entre euphorie et
dépression : elle serait également une disposition
9
d'origine génétique.
Dans ce modèle, Kernberg a cherché à
synthétiser l'ensemble des courants actuels de pensée en
matière de trouble de la personnalité. Cela lui permet de classer
les différents registres de personnalité sur un continuum
dimensionnel allant des prépsychoses au fonctionnement névrotique
et d'y intégrer les hypothèses étiopathogéniques
classiquement retenues dans la littérature. (Kernberg, O. F. (1989).
Les Troubles limites de la personnalité.)
1.1.3 Jean Bergeret : Etat limite et Idéal du Moi
Pour le psychanalyste français Jean Bergeret (1975),
cette pathologie correspond au contraire à une absence de structuration
psychique. Dans son ouvrage « La dépression et les états
limites: Points de vue théorique, clinique et thérapeutique.
», cet auteur met en lumière les repères de deux
lignées :
· La lignée génitale :
OEdipe - Surmoi - conflit génital - culpabilité - angoisse de
castration - symptômes névrotiques
· La lignée narcissique :
narcissisme - idéal du Moi - blessure narcissique - honte - angoisse de
perte d'objet - dépression.
Alors que le Surmoi s'exprime par menace de punitions et
interdictions, l'Idéal du Moi exerce ses pressions par des
promesses d'un avenir meilleur. Pour exemple l'auteur Zucker (2012)
explique que cet Idéal du Moi pourrait être le discours parental
introjecté du type : « Fais encore plus et peut-être
mériteras-tu mon amour. »
Le désir est continuellement stimulé
mais l'accès au plaisir est interdit. Il agit pour se sentir
aimé, sa plus grande terreur étant de ne plus être
aimé. (Zucker, D. (2012). Faux self, borderline, personnalité
narcissique, personnalité schizoïde)
L'Idéal du Moi règne par son
insatiabilité et le « Surmoi » n'est pas
véritablement le sien mais celui de l'autre. L'idée de
grandiosité est liée à l'Idéal du Moi, même
si d'après Zucker (2012) J. Bergeret n'en fait pas mention
explicitement. Cette oscillation entre la grandiosité et la
nullité, il la rend admirablement dans cet exemple : « Comme
l'avait déjà fait remarquer J. Mallet, le sujet sain, devant la
non-réalisation des buts (élevés mais non messianiques) de
son Idéal du Moi normal, manifeste un sentiment de modestie, alors que
le genre de patients qui nous intéresse ici, devant la déception
narcissique ressentie en n'arrivant pas à satisfaire un Idéal du
Moi aussi naïf que prétentieux, entre, lui, dans la voie
dépressive (...)
(ibid., p. 100). (Zucker, D. (2012). Faux self, borderline,
personnalité narcissique, personnalité schizoïde)
Pour résumé...
Toutefois, n'en déplaise à Mr Bergeret, nous
avons une structuration psychique qui se dessine, avec des instances en
conflit, ici entre le Moi et l'Idéal du Moi (archaïque) et un
Surmoi insuffisamment intériorisé, carencé.
1.2 Le concept de limite dans la psychanalyse
contemporaine
C'est avec le psychanalyste André Green
que le concept de limite a pris toute son importance théorique.
Pour lui : « Il nous faut donc considérer la limite comme une
frontière mouvante et fluctuante dans la normalité comme dans la
pathologie. La limite est peut-être le concept le plus fondamental de la
psychanalyse moderne. » (Green A. (1999), « Genèse et
situation des états limites », in Les états
limites, Jacques André et all, Paris, P.U.F., Petite
Bibliothèque de Psychanalyse, page 56.)
Penser une configuration clinique à partir de la
problématique de la limite autorise à considérer comment
la porosité des limites du Moi se répercute dans la
difficulté de ces sujets à distinguer le Moi de l'objet, le
dedans du dehors, l'intériorité de l'extériorité.
(Estellon, V. (2023). Figures et formes des états limites. Le Carnet
PSY, H-, 17-24.)
Si les frontières de son identité sont
poreuses, l'état limite - tel un « écorché
vif » - en vient à se construire des murs
défensifs. (Estellon, V. (2023). Figures et formes des états
limites. Le
Carnet PSY, H-, 17-24.)
La porosité des limites du Moi sous-tend les
mécanismes de défenses utilisés ainsi que toute la
symptomatologie psychopathologique secondaire polymorphe (autrement dit, une
présentation clinique variée et complexe de symptômes
psychopathologiques qui résultent de divers facteurs sous-jacent...).

· Didier Anzieu explicite un « Moi passoire »
(issu de son ouvrage « Le Moi-peau »
publié en 1985) c'est-à-dire, de la
porosité, perméabilité, des limites entre le dedans et
10
1.2.1 Porosité et précarités des
limites du Moi
11
le dehors du Moi qui est à la source d'une
désorganisation, de débordements divers, d'hémorragies
émotionnelles qui caractérisent ces sujets.
La porosité des limites de l'identité
privilégie la construction d'un certain nombre de murs défensifs
: l'angoisse d'empiétement ou celle d'être deviné
conduisent souvent à élever des murs de mensonges, murs de la
peur, murs d'images stéréotypées qui emprisonnent peu
à peu ces sujets dans un fonctionnement radical,
manichéen, répétitif. (Estellon, V. (2023).
Figures et formes des états limites. Le Carnet PSY, H-,
17-24.)
En flirtant régulièrement avec la mort à
travers des comportements à risque tels que l'automutilation, les
comportements destructeurs, et les tentatives de suicide, les individus
souffrant de troubles de la personnalité limite tentent de fuir leur
désespoir lié à un sentiment de manque, tant sur le plan
de l'être que de la possession, deux dimensions qu'ils ont tendance
à confondre. De nombreux contenus psychiques, habituellement maintenus
dans l'inconscient par le mécanisme de refoulement chez les
névrosés, peuvent surgir à la conscience chez ces
individus, générant ainsi des angoisses
insupportables. (Estellon, V. (2023). Figures et formes
des états limites. Le Carnet PSY, H-, 17-24.)
Les fonctions psychiques de contenance fixées à
des modalités infantiles dominées par l'impuissance et
l'immaturité n'aident en rien, et l'on retrouve souvent chez ces adultes
des phénomènes rappelant parfois les caprices d'enfant
marqués par la temporalité de l'urgence. Sur fond
d'insécurité intérieure quasi permanente, une
grande dépendance vis-à-vis des autres peut être
observée tandis que la conscience de cette même dépendance
se trouvera déniée sinon contre-investie par des attaques
constantes du lien. (Estellon, V. (2023). Figures et formes des
états limites. Le Carnet PSY, H-, 17-24.)
Hantés par des angoisses
relationnelles contradictoires - l'angoisse d'intrusion
(pénétration) et l'angoisse d'abandon (castration) -
obsédés par la menace d'effondrement consécutive à
la perte, la problématique du lien devient complexe, douloureuse, sinon
invivable. (Estellon, 2023)
12
Stern et la notion d'hémorragie
psychique
Stern a également abordé ce concept de
porosité, permettant d'expliciter le fonctionnement borderline avec la
notion d'hémorragie psychique.
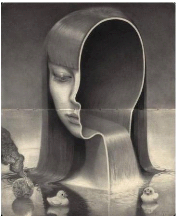
En effet, l'auteur insiste sur la sensibilité
exacerbée que peuvent ressentir ce type de personnalité, qui se
sentent très facilement blessé et donc vulnérable en
permanence, comme si la peau psychique n'était pas suffisamment
développée pour les protéger de la moindre blessure
provenant de l'extérieur les amenant à se « vider ».
(Estellon, V. (2014). « Origine et évolution de la notion
d'état limite dans le champ psychopathologique »). Stern
parlera donc d'hémorragie psychique. Cette enveloppe psychique ne
pouvant fonctionner de manière contenante, les sujets ayant un trouble
borderline peuvent avoir l'impression de se vider, de ne rien pouvoir garder
pour eux, de ne pas être capable de tenir les secrets. Ces angoisses de
vidage donnent un cercle vicieux, car ayant l'impression de se vider, leur
demande augmente, rendant encore plus complexe et dépendante leur
relation aux autres. (Estellon, V. (2014). Origine et évolution de la
notion d'état limite dans le champ psychopathologique.)
1.2.2 Les mécanismes de défenses de la
personnalité limite
« Les mécanismes de défense sont des
stratégies inconscientes mises en place afin de protéger le Moi
contre l'envahissement par l'angoisse et/ou la souffrance dépressive.
» (Estellon, V. (2011). Les mécanismes de
défense)
Si ces stratégies adaptatives ont pu être utiles
à un moment donné, elles peuvent parfois persister même
lorsque le contexte qui les a suscitées n'est plus présent. Cela
peut conduire à une rigidification de la
personnalité.
En ce qui concerne les troubles limites, identifier ces
mécanismes revêt une grande importance à la fois pour le
thérapeute et pour le patient. Alors que cela fournit au
thérapeute des informations diagnostiques précieuses, un travail
dynamique visant à explorer consciemment ces modes de fonctionnement
peut aider le patient à éviter les pièges posés par
ces mécanismes rigides devenus incapacitants. (Estellon, V. (2011).
Les mécanismes de défense.
Dans : Vincent Estellon éd., Les états limites
(pp. 55-63))
Dans son ouvrage, l'auteur Estellon
évoque plusieurs mécanismes de défense : 1. Le
clivage
Le clivage est l'opération défensive essentielle
utilisée par les états limites. Son but principal est
d'éviter la confrontation du sujet face à son ambivalence
affective et à la souffrance dépressive. Heinz Kohut, dans ses
travaux sur les pathologies narcissiques, distingue le clivage
horizontal et le clivage vertical. (Estellon, V. (2011). Les
mécanismes de défense)
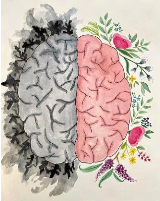
J'aimerais porter une attention particulière au clivage
horizontale, qui expose la particularité de la pathologie limite. Ayant
un narcissisme défaillant, lui aussi, poreux, ce dernier blessé,
provoque une diminution de l'énergie narcissique qui a comme effets
directs une faible estime de soi, une tendance à la honte, et aux
inhibitions. Ce clivage de type qualitatif amènera cette propension
pathologique aux pensées et affects manichéens.
Ce clivage opère avec la même force sur le Moi qui va tantôt
être idéalisé, tout-puissant, omnipotent, puis tout
à coup assimilé au déchet, au rien, au vide, proche de
l'idée de ruine mélancolique. (Estellon, V. (2011). Les
mécanismes de défense)
13
2. Le Déni
|
En complément du clivage et étayé par
lui, le déni permet de retirer de la conscience et de maintenir
isolés certaines pensées ou émotions qui ne correspondent
pas à la position affective, thymique dans laquelle le sujet
préfère se situer. Tout ce qui pourrait fragiliser
l'équilibre psychique par son caractère contradictoire ou ambigu
est écarté de la conscience. Le sujet refuse de reconnaître
une dimension traumatisante de la réalité. (Estellon, V.
(2011). Les mécanismes de défense)
|
|
3. L'identification projective
|
Cette défense est très utilisée par les
pathologies limites, elle s'exprime par des fantasmes inconscients permettant
au sujet d'introduire des parties de sa propre personne dans l'autre dans le
but de le contrôler, le posséder ou le détruire.
(Estellon, V. (2011). Les mécanismes de défense)
|
|
14
Il s'agirait de pouvoir faire de l'autre un double imaginaire
garant de l'identité de soi.
L'association de l'identification et de la projection peut
sembler complexe car ces mécanismes impliquent
généralement des mouvements opposés. En effet,
l'identification permet au sujet d'adopter certaines qualités de
personnalité de l'autre (comme le système de valeurs par exemple,
au hasard...) tandis que la projection consiste à rejeter et à
expulser certaines qualités personnelles sur autrui : tout ce que je
considère comme négatif et dont je veux me débarrasser est
projeté sur quelqu'un d'autre.
· Ces deux mécanismes participent au
développement psychique normal de l'individu : faire
sien ce qui apparaît bon et attrayant et jeter à
l'extérieur ce qui semble menaçant et dangereux.
(Estellon, V. (2011). Les mécanismes de défense)
15
Melanie Klein met en évidence l'importance de la
projection des aspects "bons" pour favoriser le développement de
relations d'objets saines et l'intégration du Moi, facilitant ainsi
l'empathie. (Klein, M. (1984). Love, guilt, and reparation, and other
works)
De même, W. R. Bion a mis en lumière que ces
mécanismes sont fondamentaux pour la structuration de la psyché,
car ils permettent à la pensée d'accéder à la
symbolisation et de se détacher de l'objet. (Bion, W. R. (1989).
Elements of psycho-analysis.)
L'identification projective devient pathologique
lorsqu'elle cesse d'être transitoire, lorsqu'elle devient un
moyen de dénier la réalité. Le sujet, en
s'identifiant aux parties de l'objet contenant ses propres parties
clivées/projetées, se perd dans une perception confuse où
l'autre c'est lui. (Estellon, V. (2011). Les mécanismes de
défense)
4. L'idéalisation primitive, l'omnipotence et la
dévalorisation

Le mécanisme d'idéalisation, fonctionne aussi de
manière complémentaire avec le clivage. L'objet, est fortement
idéalisé, idolâtré. Ne présentant aucune
faille, ne pouvant décevoir, paré de toutes les qualités,
cet objet est présenté comme « parfait ». Ce « bon
objet » idéalisé est censé protéger le sujet
contre les « mauvais objets ». (Estellon,2011)
L'idéalisation peut s'envi-sager comme le pendant du rejet :
tandis que celui-ci s'ap-plique à tout ce qui est exclu, celle-là
aspire à la prise de puissance et à la jouissance.
Kernberg la qualifie de « primitive » pour l'opposer
aux formes plus tardives d'idéalisation telles qu'on les rencontre chez
les dépressifs qui idéalisent les objets pour se protéger
du sentiment de culpabilité
Pierre Auguste Cot (French, 1837-1883) Spring
étroitement lié à leur agissement envers l'objet.

16
Dans l'idéalisation primitive, bien que le bon objet
soit sollicité pour protéger le Moi des objets mauvais dans le
monde environnant, il n'y a pas de véritable considération pour
l'objet idéal lui-même. Cet objet rêvé, protecteur,
doit donc lui-même être préservé des lacunes et des
fluctuations inhérentes à la condition humaine. L'identification
omnipotente contribuera à maintenir cette magnificence de l'objet.
(Estellon, 2011)
Le clivage permettra, lorsque des déceptions ou des
frustrations auront entaché la perfection de cet objet, de le
dénigrer, de le mépriser et de le désinvestir « aussi
facilement que les doigts de la main sont capables en un clin d'oeil de zapper
à l'aide de la télécommande un programme ennuyeux à
la télévision. » (Estellon, V. (2011). Les
mécanismes de défense)
Vincent Estellon a connu une patiente qui
changeait ainsi régulièrement d'amis et d'amants : dès
qu'ils devenaient frustrants, ils étaient « gommés »
selon son expression. C'est le phénomène de
dévalorisation.
= Résultat direct de l'omnipotence, le sentiment de
toute puissance, cela offre la possibilité de se détacher de
l'objet sans ressentir de souffrance lorsque celui-ci ne procure pas la
satisfaction attendue.
Le clivage garantit qu'une partie du Moi demeure
idéalisée (le Soi grandiose), de sorte que les
sentiments de souffrance, de frustration, de déception, de désir
ou de haine, lorsqu'ils sont éprouvés, sont toujours
attribués à l'action d'un autre malveillant. Ces réactions
exagérées permettent au Moi, dont les frontières sont
floues, de ne pas s'effondrer.
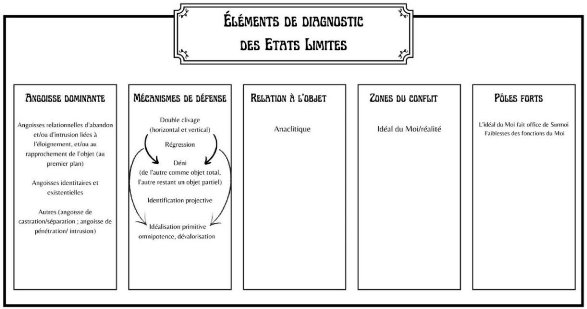
17
Tableau réalisé grâce
aux données du chapitre IV « Les mécanismes de
défenses » de Vincent Estellon (2019) Dans :
Vincent Estellon éd., Les états limites (pp.
54-62). Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France.
L'histoire du trouble de la personnalité borderline
est complexe et peut être considéré comme chaotique,
inclassable, un fourre-tout inépuisable...
Néanmoins, de grandes lignes se dessinent. En effet,
il s'agit initialement d'une pathologie ou de symptômes n'entrant pas
dans les cadres classiques de la typologie freudienne, répartissant les
structures de la personnalité entre les structures psychotique,
névrotique et perverse.
A partir des travaux psychanalytiques vu plus haut,
au-delà de sa simple définition en psychopathologie, la question
des limites offre un domaine d'étude large mais riche en analyse.
Pour terminer cette revue clinique intense autour de cette
pathologie, nous allons exposer la définition qu'en donne l'organisation
mondiale de la santé, dans sa version la plus récente, avec le
DSM-V, selon son modèle alternatif des troubles de la
personnalité.
18
1.3 Le modèle alternatif de la personnalité
(MATP)
Cette partie provient entièrement du Manuel de
Diagnostique et statistique des troubles mentaux. (American Psychiatric
Association et American Psychiatric Association, éditeurs.
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,
American Psychiatric Association, 2013)
|
|
|
L'approche actuelle des troubles de la personnalité
figure dans la
section II du DSM-5 et un modèle alternatif
développé pour le DSM-5 est présenté ici dans la
section III. L'inclusion de ces deux modèles dans le DSM-5 correspond
à la décision du Conseil d'administration de l'Association
américaine de psychiatrie (APA Board of Trustees) d'assurer la
continuité avec la pratique clinique actuelle tout en introduisant une
nouvelle approche destinée à pallier les nombreux défauts
de l'approche traditionnelle des troubles de la personnalité. (American
Psychiatric Association et American Psychiatric Association, éditeurs.
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,
American Psychiatric Association, 2013)
Dans le modèle alternatif du DSM-5 qui suit, les
troubles de la personnalité sont caractérisés par des
altérations du fonctionnement de la personnalité et par des
traits de personnalité pathologique. Les diagnostics spécifiques
de troubles de la personnalité qui peuvent ressortir de ce modèle
sont les personnalités antisociale, évitante, borderline,
narcissique, obsessionnelle-compulsive et schizotypique. (American Psychiatric
Association et American Psychiatric Association, éditeurs.
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed,
American Psychiatric Association, 2013)
Les altérations du fonctionnement de la
personnalité et l'expression des traits de personnalité ne sont
pas mieux comprises comme faisant partie d'un stade normal du
développement ou d'un environnement socioculturel normal. Un diagnostic
de trouble de la personnalité nécessite deux conditions :
1) une évaluation de l'altération du niveau de
fonctionnement de la personnalité, nécessaire pour le
critère A
19
2) une évaluation des traits de personnalité
pathologique, nécessaire pour le critère B
· Critère A : niveau de
fonctionnement de la personnalité Le noyau de la
psychopathologie de la personnalité réside dans
les perturbations du fonctionnement de la personnalité au niveau du soi
(Bender et al., 2011) et de la sphère interpersonnelle
évaluées dans ce modèle alternatif sur un continuum. Le
fonctionnement du soi comprend l'identité et l'autodétermination
; le fonctionnement interpersonnel comprend l'empathie et l'intimité.
L'altération du fonctionnement de la
personnalité est un élément de prédiction de
l'existence d'un trouble de la personnalité et la
sévérité de l'altération prédit si
l'individu a plus d'un trouble de la personnalité ou l'une des formes
typiquement graves de troubles de la personnalité (Morey et al., 2011).
Un niveau d'altération du fonctionnement de la personnalité
d'intensité au minimum moyenne est requis pour le diagnostic de trouble
de la personnalité. Ce seuil diagnostique repose sur des bases
empiriques ; c'est en effet ce niveau qui correspond de façon optimale
à la capacité du clinicien à identifier de façon
adéquate et efficace une pathologie de la personnalité (Morey et
al., submitted for publication). (American Psychiatric Association et American
Psychiatric Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual
of mental disorders: DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association,
2013)
· Critère B : Les traits
pathologiques de personnalité appartiennent à cinq grands
domaines : l'affectivité négative, le détachement,
l'antagonisme, la désinhibition et le psychoticisme. Vingt-cinq facettes
de traits sont réparties dans ces cinq grands domaines. Ces facettes
proviennent initialement d'une revue des modèles de traits de
personnalité existants et des recherches répétées
effectuées chez des patients faisant appel à des services de
santé mentale (Krueger et al. 2011a ; Krueger et al. 2011b ; Krueger et
al. 2012). Les critères B pour les différents troubles de la
personnalité comprennent des sous-ensembles de ces 25 facettes de traits
issus de revues avec méta-analyses (Samuel et Widiger 2008 ; Saulsman et
Page 2004) et de données empiriques sur les relations entre les traits
de personnalité et les diagnostics de troubles de la personnalité
selon le DSM-IV.
20
1.3.1 Le trouble de la personnalité borderline selon
le MATP
Selon le DSM-V, les caractéristiques typiques de la
personnalité borderline sont l'instabilité de l'image de soi, des
objectifs personnels, des relations interpersonnelles et des affects,
associée à l'impulsivité, à la prise de risque
et/ou à l'hostilité. . (American Psychiatric Association et
American Psychiatric Association, éditeurs. Diagnostic and
statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5th ed, American
Psychiatric Association, 2013)
Les difficultés caractéristiques
sont apparentes au niveau de l'identité, de l'autodétermination,
de l'empathie et/ou de l'intimité, comme cela est décrit
ci-après, avec des traits mal adaptés spécifiques dans le
domaine de l'affectivité négative, de l'antagonisme et/ou de la
désinhibition.
1.3.2 Critères diagnostiques proposés avec
le MATP
· Pour les critères A :
Altération d'intensité au minimum moyenne du fonctionnement de la
personnalité comme en témoignent des difficultés
caractéristiques dans au moins deux des quatre domaines suivants :
1. Identité : Image de soi appauvrie de
façon marquée, peu développée ou instable, souvent
associée à une autocritique excessive, à des sentiments
chroniques de vide et à des états dissociatifs sous l'influence
du stress.
2. Autodétermination :
Instabilité des objectifs, des aspirations, des valeurs ou des plans de
carrière.
3. Empathie : Incapacité de
reconnaître les sentiments et les besoins d'autrui associée
à une hypersensibilité personnelle (c.-à-d. prêt
à se sentir blessé ou insulté), perception d'autrui
sélectivement biaisée vers des caractéristiques
négatives et des fragilités ou « points faibles ».
4. Intimité : Relations proches
intenses, instables et conflictuelles, avec manque de confiance, besoins
affectifs excessifs et préoccupations anxieuses concernant un abandon
réel ou
imaginé ; relations proches souvent extrêmes,
soit idéalisées, soit dévalorisées, alternant entre
implication excessive et retrait.
(American Psychiatric Association et American Psychiatric
Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual of mental
disorders: DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association, 2013)
· Pour les critères B : Au moins
quatre des sept traits pathologiques de personnalité suivants, au moins
l'un d'entre eux devant être : impulsivité, prise de risque ou
hostilité :
1. Labilité émotionnelle (un aspect de
l'affectivité négative) : Expériences
émotionnelles instables ou changements d'humeur fréquents,
émotions facilement réveillées, intenses et/ou hors de
proportion avec les événements et les circonstances.
2. Tendance anxieuse (un aspect de l'affectivité
négative) : Sentiments intenses de nervosité, tension ou
panique, souvent en réaction à des stress interpersonnels,
préoccupations par les effets négatifs d'expériences
passées et d'éventualités futures négatives ; se
sent craintif, inquiet, menacé par l'incertitude ; peurs de s'effondrer
ou de perdre le contrôle.
3. Insécurité liée à la
séparation (un aspect de l'affectivité
négative) : Peur d'être rejeté par des gens qui
comptent ou d'être séparé(e) d'eux, associée
à des peurs d'une dépendance excessive et d'une perte
complète d'autonomie.
4. Dépressivité (un aspect de
l'affectivité négative) : Sentiments
fréquents d'être au plus bas, misérable, sans espoir,
difficultés à se remettre de tels états d'âme,
pessimisme à propos du futur, sentiments envahissants de honte,
sentiments d'infériorité, idées de suicide et conduite
suicidaire.
5. Impulsivité (un aspect de la
désinhibition) : Agit sur un coup de tête en
réponse à des stimuli immédiats, dans l'instant, sans plan
ou considération pour les conséquences, difficulté
à élaborer ou à suivre des plans, vécu d'urgence et
comportement d'auto-agressions dans les situations de détresse
émotionnelle.
21
6. Prise de risque (un aspect de la
désinhibition) : Engagement dans des
activités
dangereuses, risquées, potentiellement auto-dommageables
et superflues, sans penser aux conséquences ; ne se soucie pas de ses
propres limitations et dénie la réalité d'un danger
personnel.
7. Hostilité (un aspect de
l'antagonisme) : Sentiments de colère persistants ou
fréquents, colères ou irritabilité en réponse
à des insultes et des affronts mineurs.
(American Psychiatric Association et American Psychiatric
Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual of mental
disorders: DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association, 2013)
· Spécifications : Des spécifications
concernant les traits de personnalité et le niveau de fonctionnement de
la personnalité peuvent être utilisées pour enregistrer des
caractéristiques additionnelles de personnalité qui peuvent
être présentes dans la personnalité borderline mais qui ne
sont pas exigées pour le diagnostic. Par exemple, des traits de
psychoticisme (p. ex. une dysrégulation cognitive et
perceptuelle) ne sont pas des critères diagnostiques de la
personnalité borderline (cf. critère B) mais peuvent
être spécifiés lorsque cela paraît
approprié. (American Psychiatric Association et American Psychiatric
Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual of mental
disorders: DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association, 2013)
22
2. Le système de valeurs

Nous allons nous intéresser au système de valeur
d'un individu pour permettre de faire le lien entre le trouble de la
personnalité borderline et une société individualiste.
En effet, les valeurs sont utilisées pour
caractériser les individus ou les sociétés, pour suivre le
changement au cours du temps, et pour expliquer les motivations de base qui
sous-tendent attitudes et comportements. (Schwartz, S. (2006). Les valeurs de
base de la personne : théorie, mesures et applications. Revue
française de sociologie)
23
Pour Durkheim (1893,1897) comme pour Weber (1905/1958), les
valeurs sont fondamentales pour expliquer l'organisation et le changement, au
niveau de la société comme à celui des individus. C'est un
concept central des sciences sociales depuis leur origine.
Pour introduire la notion de valeur, nous nous orienterons
vers les travaux de Shalom Schwartz qui a
théorisé sur les valeurs universelles correspondant aux diverses
cultures de notre civilisation. Cette théorie aborde des valeurs de base
que les individus reconnaissent en tant que tel dans toutes les cultures.
2.1 Shalom Schwartz
Dans un premier temps, une brève présentation de
cet auteur s'impose.
Shalom Schwartz est professeur de Psychologie Sociale à
l'Université Hébraïque de Jérusalem. En 2007, il
obtient le prix d'Israël dans le domaine des sciences humaines et
sociales. Pendant 40 ans, il a dirigé des recherches approfondies au
sujet des valeurs personnelles et culturelles. Son approche en collaboration
avec Wolfgang Bilsky, perçu dans Toward an Universal Structure of
Human Values, in Journal of Personnality and Social Psychology
(1987) est explicité en s'appuyant principalement sur les travaux de
Rokeach (1918-1988), psychologue et professeur de psychologie sociale à
l'université du Michigan, pionnier de cette approche.
2.2 La définition des valeurs selon Schwartz et
all
La théorie des valeurs de Schwartz adopte une conception
des valeurs qui leur attribue six caractéristiques principales,
s'inspirant des apports de nombreux auteurs et que nous avons ci-dessous
résumé (Allport (1961) ; Feather (1995) ; Inglehart (1997) ; Kohn
(1969) ; Kluckhohn (1951) ; Mor ris (1956) ; Rokeach (1973) ; Schwartz et
Bilsky (1987)) :
1. Les valeurs sont des croyances liées aux affects. Les
personnes attachées à la tradition réagissent fortement
à sa préservation ou à sa menace.
2. Les valeurs motivent l'action vers des objectifs
souhaitables tels que l'ordre social ou la justice.
3. Les valeurs expriment des motivations pour atteindre des
buts comme l'autonomie ou la
24
bienveillance.
4. Les valeurs orientent les choix et jugements, même si
leur influence est souvent inconsciente. Les valeurs deviennent
conscientes quand les actions que l'on envisage conduisent
à des conflits entre différentes valeurs que l'on aime.
5. Les valeurs sont hiérarchisées selon leur
importance personnelle.
6. Les valeurs guident l'action en fonction de leur pertinence
et de leur importance dans le contexte.
(Schwartz, S. (2006). Les valeurs de base de la personne :
théorie, mesures et applications. Revue française de
sociologie)
Ces caractéristiques concernent toutes les valeurs. Ce
qui distingue une valeur d'une autre est le type d'objectif ou de motivation
que cette valeur exprime. La théorie des valeurs définit dix
grands groupes de valeurs selon la motivation qui sous-tend chacune d'entre
elles. On peut supposer que ces valeurs englobent le champ des
différentes valeurs reconnues par toutes les cultures. Selon la
théorie, il est probable que ces valeurs soient universelles parce
qu'elles trouvent leur source dans au moins une des trois
nécessités de l'existence humaine, auxquelles elles
répondent. Ces nécessités sont : satisfaire les
besoins biologiques des individus, permettre l'interaction sociale, et assurer
le bon fonctionnement et la survie des groupes. (Schwartz, S. (2006).
Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications.
Revue française de sociologie)
2.2.1 Les dix valeurs universelles selon la théorie de
Schwartz
1. Autonomie : Objectif :
indépendance de la pensée et de l'action - choisir, créer,
explorer. (Les items utilisés pour approcher cette valeur de base sont :
créativité, liberté, choisissant ses propres buts,
curieux, indépendant ainsi qu'amour propre, intelligent, droit à
une vie privée).
2. Stimulation. Objectif : enthousiasme,
nouveauté et défis à relever dans la vie. Les valeurs de
stimulation découlent du besoin vital de variété et de
stimulation ; elles permettent de maintenir un niveau d'activité
optimal et positif.
3. Hédonisme. Objectif : plaisir ou
gratification sensuelle personnelle. Les valeurs
25
d'hédonisme proviennent des besoins vitaux de
l'être humain et du plaisir associé à leur satisfaction.
(Items associés : plaisir, aimant la vie, se faire plaisir)
4. Réussite. Objectif : le
succès personnel obtenu grâce à la manifestation de
compétences socialement reconnues. Telles qu'on les définit ici,
ces valeurs de réussite concernent principalement le fait d'être
performant au regard des normes culturelles dominantes, et d'obtenir ainsi
l'approbation sociale. (Items associés : ambitieux, ayant du
succès, capable, ayant de l'influence ainsi que [intelligent,
amour-propre, reconnaissance sociale).
5. Pouvoir. Objectif : statut social
prestigieux, contrôle des ressources et domination des personnes. (Items
associés : autorité, richesse, pouvoir social ainsi que
[préservant mon image publique, reconnaissance sociale]).
6. Sécurité. Objectif :
sûreté, harmonie et stabilité de la société,
des relations entre groupes et entre individus, et de soi-même. (Items
associés : ordre social, sécurité familiale,
sécurité nationale, propre, réciprocité des
services rendus ainsi qu'en bonne santé, modéré, sentiment
d'appartenance).
7. Conformité. Objectif :
modération des actions, des goûts, des préférences
et des impulsions susceptibles de déstabiliser ou de blesser les autres,
ou encore de transgresser les attentes ou les normes sociales. Les valeurs de
conformité proviennent de la nécessité pour les individus
d'inhiber ceux de leurs désirs qui pourraient contrarier ou entraver le
bon fonctionnement des interactions et du groupe. De fait, tous les auteurs
traitant des valeurs mentionnent la conformité (par exemple Freud, 1930
; Kohn et Schooler, 1983 ; Morris, 1956 ; Parsons, 1951). (Items
associés : obéissant, autodiscipliné, politesse, honorant
ses parents et les anciens ainsi que [loyal, responsable]
8. Tradition. Objectif : respect, engagement
et acceptation des coutumes et des idées soutenues par la culture ou la
religion auxquelles on se rattache. Partout, les groupes développent des
pratiques, des symboles, des idées et des croyances qui
représentent leur expérience et leur destin commun et deviennent
ainsi les coutumes et les traditions du groupe, qui leur accorde beaucoup de
valeur (Sumner, 1906). (Items associés : respect de la tradition,
humble, religieux, acceptant ma part dans la vie ainsi que
[modéré, vie spirituelle]).
9. Bienveillance. Objectif : la
préservation et l'amélioration du bien-être des
26
personnes avec lesquelles on se trouve fréquemment en
contact (l'« endogroupe »). Les valeurs de bienveillance proviennent
de la nécessité pour le groupe de fonctionner de manière
harmonieuse (voir, par exemple, Kluckhohn, 1951 ; Williams, 1968) et du besoin
d'affiliation de l'individu en tant qu'organisme biologique (voir, par exemple,
Korman, 1974 ; Maslow, 1965). (Items associés : secourable,
honnête, indulgent, responsable, loyal, amitié vraie, amour adulte
ainsi que [sentiment d'appartenance, un sens dans la vie, une vie
spirituelle]).
10. Universalisme. Objectif :
compréhension, estime, tolérance et protection du bien-être
de tous et de la nature. Les valeurs d'universalisme proviennent du besoin de
survie des individus et des groupes. Mais ce besoin n'est pas identifié
tant que l'individu n'a pas été en contact avec d'autres groupes
que celui de ses proches, et tant qu'il n'a pas pris conscience du
caractère limité des ressources naturelles. (Items
associés : large d'esprit, justice sociale, égalité, un
monde en paix, un monde de beauté, unité avec la nature, sagesse,
protégeant l'environnement ainsi que [harmonie intérieure, une
vie spirituelle]).
(Schwartz, S. (2006). Les valeurs de base de la personne :
théorie, mesures et applications. Revue française de
sociologie)
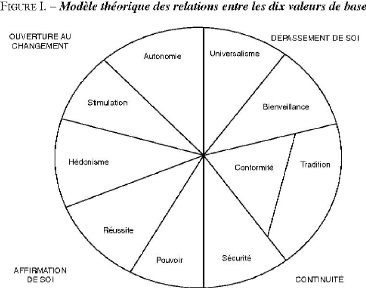
27
(Schwartz, S. (2006). Les valeurs de base de la personne :
théorie, mesures et applications. Revue française de
sociologie, 47, 929-968.)
Avec cet apport de Schwartz et d'autres auteurs, nous voyons
l'importance du système de valeurs chez l'individu. Elles permettent
d'expliquer les comportements, les attitudes et motivations de chaque individu
et donc, ont une influence sur la personnalité. En effet, Bilsky
& Schwartz (1994) constatent que les valeurs et la personnalité
peuvent s'influencer mutuellement. Pour exemple, les valeurs peuvent
influencer les traits de personnalité car les individus cherchent
généralement à se conduire de manière harmonieuse
avec leurs valeurs, évitant une dissonance cognitive.
A l'inverse, les traits de personnalité
peuvent influencer les valeurs : les personnes qui adoptent un
comportement de façon récurrente sont plus enclin d'augmenter
leur accord avec la valeur concernée et donc, peuvent justifier leur
comportement. (Roccas et al., 2002).
Le travail de Schwartz et Bardi (1997) ont analysé la
vie sous le régime communiste, et montre ainsi comment l'adaptation
à des circonstances a influencé la priorité de la valeur
« autonomie », qui est l'une des valeurs dites « individualistes
».
Enfin pour terminer, l'auteur met en lumière les
différentes dynamiques entres les valeurs et les
|
relations.
|
Les valeurs pouvoir, réussite, hédonisme,
stimulation et autonomie traitent
|
principalement de la façon dont on exprime les
intérêts individuels.
Ce sont ces valeurs, lors de notre recherche auquel nous
porterons le plus notre attention.
28
3. L'individualisme
« La société occidentale se fonde sur les
principes de l'individualisme, conception structurante dans laquelle la
liberté individuelle est considérée comme un droit que les
institutions doivent protéger. » (Blaha Stephen, 2002 The
rhythms of history: a universal theory of civilizations, Pingree-Hill
Publishing)
3.1 Un peu d'histoire...
Après les guerres, la révolution, il y a eu un
réel désir d'émancipation à l'égard de ce
passé intolérable. Passant par la dénonciation des abus de
pouvoir de l'Etat et de la religion, l'écriture des droits de l'homme et
du citoyen... la liberté est plus qu'une valeur, elle devient l'essence
même de l'Homme. (Rosanvallon P., Le modèle politique
français. La société civile contre le jacobinisme de 1789
à nos jours, Le Seuil, 2004.)
En France, la révolution de 1789 a marqué
l'avènement d'un « individualisme citoyen » (Ro-sanvallon P.,
Le modèle politique français. La société civile
contre le jacobinisme de 1789 à nos jours, Le Seuil, 2004) qui a
refondé les relations traditionnelles entre l'autorité publique
et ses administrés.
Pierre Le Coz dirige notre attention sur la liberté qui
est la première valeur citée dans la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen. Mieux qu'une valeur, la liberté devient
l'essence même de l'homme : « Tous les hommes naissent libres
(...) ».
Avec l'octroi de ses nouveaux droits, le citoyen
français devient le fondement de la légitimité politique,
en choisissant ses dirigeants et en dictant les lois par le biais de ses
représentants.
Mais « la liberté à un prix »
: en effet, à la suite de ces événements, de nouveaux
droits émergent dont celui de ne pas participer aux affaires de la
cité. Ce droit, aussi juste soit-il, encourage un
désintérêt du bien commun, du collectif ainsi qu'une
poursuite des intérêts privés, individuels.
29

|
· C'est cette "désertion des affaires publique"
qui est désigné pour parler de l'individualisme.
« Un nouvel idéal se fait jour qui réside
dans l'affirmation « sur le plan moral et politique » de l'être
humain particulier comme indépendant et se suffisant idéalement
à lui-même. » (Dumont L., Essais sur
l'individualisme, op. cit)
|
|
· Si cet idéal d'indépendance et
d'autosuffisance deviennent la norme sociale, alors il entre en conflit avec
les difficultés rencontrés par les personnes souffrant de trouble
de la personnalité borderline. En effet, leur fonctionnement
étant centré sur un Idéal du moi fort ces sujets pourront
avoir tendance à fortement intériorisé cette norme et donc
être en quête d'indépendance et d'autosuffisance de
manière extrême ou du moins déconnectés de la
réalité. Cependant, leurs instabilités
émotionnelles, relationnelles et identi-taires, ainsi que leur peur de
l'abandon, rendent cet objectif difficile à atteindre. La tension entre
le désir d'indépendance et la dépendance
émotionnelle et psychique, caractéristique des personnes
borderline, est perceptible en raison du besoin de combler tous ces
manquements. Cette tension reflète les efforts constants des personnes
borderline pour concilier leurs besoins d'autonomie avec leurs besoins
affectifs et relationnels.
Cette ère contemporaine abolie l'autorité du
passé, les individus, avide de nouveauté, se donne le droit
d'innover, d'inventer. Les valeurs telles que l'autonomie, la
créativité, l'indépendance, le droit à
l'intimité ainsi que le droit au pouvoir, ou du moins son
accessibilité étaient promues.
De plus, cette dynamique individualiste pris une tournure
qualifiée d'hédoniste, c'est-à-dire dans la valorisation
du plaisir, la promotion des loisirs et du divertissement.
Les années 60 résonne avec cette période
d'émancipation des corps, de la libération des moeurs, du sexe et
des affects avec mai 68. C'est aussi à cette période où
une extension du consumérisme s'opère, augmentant toujours plus
le choix du matériel, on bascule dans le cycle de la production et des
échanges marchands. Parallèlement au désir de vivre pour
soi qui n'a cessé de s'affirmer et de se déculpabiliser.
(Lipovetsky G., Les temps hypermodernes, Paris, Grasset,
2004.)
30
Pierre Le Coz attire notre attention un changement dans les
stratégies de mobilisation pour le don de sang, passant d'un appel
basé sur le devoir à un message mettant en avant le pouvoir de
chacun et la reconnaissance personnelle. Il cite le cas de l'Etablissement
français du sang qui fait appel à des professionnels de la
communication et de la psychologie sociale.
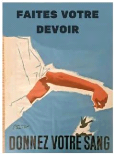
Le slogan incitatif tel que « Faites votre devoir, donnez
votre sang ! » n'éveille plus d'écho. Il a fait place
à un nouveau message plus gratifiant : « partagez votre pouvoir,
donnez votre sang ! »

(Le Coz, P. (2019). Le soin à l'épreuve de
l'individualisme contemporain. Laennec, 67, 6-19.)
Traditionnellement fondée sur le devoir
désintéressé, la pratique du don de sang évolue
pour répondre à une sensibilité dominante axée sur
la gratification personnelle et la reconnaissance individuelle.
Cela ne signifie pas la disparition de toute éthique,
mais plutôt un déplacement vers une éthique plus
axée sur les sentiments et la spontanéité, où les
individus sont motivés par la compassion et le coup de coeur
plutôt que par un sens du devoir. En résumé, la
générosité persiste comme une valeur sociale, mais elle
est désormais influencée par des motivations plus personnelles et
émotionnelles, reflétant un changement vers un individualisme
ambiant.
« L'homme de l'hypermodernité individualiste est
en quête de reconnaissance de ses mérites et de gratifications
narcissiques. Il ne va plus de soi de donner de soi, de consacrer son
énergie et son temps à une cause universelle, impersonnelle et
collective. » (Le Coz, P. (2019). Le soin à l'épreuve de
l'individualisme contemporain. Laennec, 67, 6-19.)
Evidemment l'auteur souligne que l'évolution vers
l'individualisme ne conduit pas nécessairement au nihilisme ou à
la perte totale des normes éthiques. Il est erroné de penser que
le cynisme prévaut et que les relations interpersonnelles deviennent de
plus en plus déshumanisées. La générosité
reste une valeur essentielle dans la société.
L'éthique n'a pas disparu, mais elle est moins
sacrificielle et plus affective.
31
3.2 Le concept d'individualisme d'un point de vue
sociologique : Réflexion et liens
L'individualisme est une conception philosophique, politique,
morale et sociologique où l'individu occupe la place centrale. Il s'agit
donc d'une primauté de l'identité personnelle par rapport
à l'identité collective. Cette notion peut être
étudié sous plusieurs perspectives distinctes, ici nous
l'analyserons principalement en tant que phénomène
sociologique.
Norbert Elias, sociologue, analyse l'individualisme comme
coexistant à une intensification des interdépendances sociales
entre individus, qui pousserait l'individu à se construire un «
refuge intérieur. » L'auteur dit que l'individu garde ses pulsions
et ses émotions dans la sphère privée et évite de
les dévoiler à autrui. Il les contient et les transforme,
accentuant ainsi les différences de comportements, de sensations, de
pensées, d'objectifs et d'apparence physique entre les individus.
(Elias, N. (2018). La société des individus. Pocket)
Dans une conférence de Xavier Coton, psychiatre, et
Raphaël Gazon, psychologue et psychothérapeute, ces professionnels
explicitent que dans notre société occidentale, le mouvement
individualiste valorise plutôt le contrôle des émotions et
la maîtrise comme critères de succès. Les comportements des
personnes matures sont supposés être contrôlés par
des forces internes. Si la personne se définit par ses relations aux
autres, elle est considérée comme immature et donc se retrouve en
marge de la norme, rejeté et jugé négativement (les
valeurs sociales étant des jugements sur ce qui est juste et injuste
dans les relations sociales). (Conférence : Mieux comprendre le
trouble de la personnalité « borderline » (état limite)
de mon proche. Quand les émotions perturbent la vie, 2012)
Paradoxalement, le sociologue français Ehrenberg
explique dans son article « La société du malaise : Une
présentation pour un dialogue entre clinique et sociologie. »
(2011) que tout ce qui concerne les émotions, les affects, les
sentiments moraux, la subjectivité individuelle, est passé au
coeur de la vie sociale des sociétés dites
développées. Ce déplacement s'explique par la valeur
grandissante accordée à la santé mentale et à la
souffrance psychique.
Ce changement a accompagné les transformations des
manières de « faire société », que rassemble la
notion d'autonomie. Celle-ci désigne de prime abord deux types de
valeurs intriquées de l'individualisme : le choix personnel et
l'initiative individuelle. Elles se donnent dans trois aspects de la
compétition, de la coopération et de l'indépendance. Le
point crucial est alors la place de la responsabilité personnelle dans
la vie sociale. Selon cet auteur, ces trois éléments, choix,
initiative et responsabilité, forment le tournant personnel de
l'individualisme.
32
(Ehrenberg, A. (2011). La société du malaise
: Une présentation pour un dialogue entre clinique et sociologie.
Adolescence, 293, 553-570)
· Nous pouvons remarquer que les valeurs qu'engagent le
processus de l'individualisme pose une certaine ambivalence avec le fait de
vivre en communauté : l'autonomie (quête d'indépendance),
l'individu au centre d'intérêt plutôt que le collectif, les
affects et émotions, pris en compte mais seulement individuellement et
la coopération elle, pour arriver à des fins individuelles.
Et c'est que souligne les auteurs Nisbet & Azuelos, qu'en
effet, l'individualisme montre le processus de distanciation de l'individu par
rapport à ses groupes d'appartenance, au sein d'une
société où s'établit progressivement la
primauté de l'individu sur le collectif ; c'est en ce sens que
l'individualisme est souvent assimilé à un égoïsme
croissant, dans un rapprochement péjoratif. (Nisbet, R. A., &
Azuelos, M. (2011). La tradition sociologique (5e éd). Presses
universitaires de France.)
Ehrenberg va dans ce sens également que d'après
lui, on ne peut pas avoir de société individualiste,
c'est-à-dire de société qui donne la même valeur
à tout être humain, si on ne brise pas les liens de
dépendance entre les gens. (Ehrenberg, A. (2011). La
société du malaise : Une présentation pour un dialogue
entre clinique et sociologie. Adolescence, 293, 553-570.)
Borderline, une dissonance de la personnalité
?
· Finalement, ce qu'il ressort de l'individualisme dans
la société occidentale, c'est que la dépendance aux
autres, aux groupes n'est pas acceptée (acceptable ?...) Comme l'a dit
le philosophe Aristote, repris par la suite dans le champ de la psychologie
sociale, nous sommes des animaux sociaux vivant en société donc
en collectif, un système de valeurs prônant des
intérêts individuels et non collectifs, pourrait provoquer des
dissonances dans les comportements et donc dans la personnalité, comme
vu précédemment avec Bilsky & Schwartz, (1994) qui constatent
que les valeurs et la personnalité peuvent s'influencer mutuellement.
Or, les valeurs sont conçues comme consensuelles et
éminemment prosociales : provenant d'un consensus, elles
régulent les rapports sociaux (Moscovici et Doise, 1992).
En effet, d'après Morchain, l'organisation du
système de valeurs est en lien direct avec les groupes sociaux. L'auteur
explique que les valeurs s'inscrivent dans un processus de comparaison sociale
: les personnes comparent leurs perceptions, sensations, croyances, à
celles
33
des autres personnes. Une des conséquences de la
comparaison est un clivage net entre les groupes (« Ils n'ont pas les
mêmes valeurs que nous ! »). Toutefois ce clivage n'est pas
forcément le produit biaisé des évaluations :
l'organisation des valeurs est bien sûr différente d'un groupe
social à un autre. (Morchain, P. (2009). Chapitre 1. Que sont les
valeurs ? Tentative de définition(s). Dans :, P. Morchain,
Psychologie sociale des valeurs (pp. 7-27). Paris : Dunod.)
· Un système de valeurs qui prônent des
comportements individualistes pourrait donc être un non-sens
entraînant des mouvements dissonants chez les individus
par rapport aux groupes. Mais si les rapports sociaux régulent les
comportements des individus afin de créer un corps social
coordonné, ces valeurs peuvent être « antisociales » et
tout de même partagées dans un groupe.
3.3 Lien entre la personnalité borderline et
l'individualisme
Comme vu précédemment, les personnalités
borderline sont des individus qui éprouve une forte dépendance
à l'autre, et qui ont de grande difficulté à gérer
leurs émotions. Le système de valeurs de l'individualisme,
valeurs majoritairement présentent dans la société,
prônant l'inverse de ces comportements, les rejetant donc, pourrait
accentuer l'insécurité générale qu'éprouve
un sujet autour de la question identitaire, de l'estime de soi, de la peur de
l'abandon, du rejet ... principales critères diagnostiques de cette
pathologie.
Avec un Idéal du Moi au centre du
conflit avec la réalité, maîtrisant avec force, ses
comportements, en remplaçant le Surmoi, le sujet borderline va avoir
tendance a fortement intériorisés les normes, et donc les valeurs
de son environnement. Comme vu précédemment, quête vaine
dû à sa forte dépendance à l'autre.
Pour reprendre ce nous disions plus haut, nous pouvons voir
cette ambivalence avec l'apport du sociologue Norbert Élias. La
primauté de l'individuel donne à une personne un « refuge
intérieur » amenant à contenir ses émotions et
pulsions, ce qui est l'inverse du sujet borderline qui lui, ne peut contenir
ses émotions, au contraire il les dévoile, il se « vide
», comme vu précédemment avec la notion d'hémorragie
psychique explicité par Adolph Stern.
Nous nous demandons donc quels valeurs les
personnalités borderlines intériorisent, et ce que nous pouvons
en conclure avec l'individualisme.
C'est ce nous allons explorer et découvrir...
34
II. Problématique de recherche
2.1 Objectif de la recherche
L'objectif premier de cette recherche à visé
exploratoire est de voir si le trouble de la personnalité borderline est
symptomatique du système individualiste valorisé dans notre
société actuelle. Pour se faire, nous avons trouvé
pertinent de mesurer le système de valeurs d'un échantillon de
sujet, ainsi que leur seuil de souffrance du trouble de la personnalité
borderline pour voir ce qui se rencontre et voir quelles valeurs les individus
avec cette tendance intériorisent pouvant ainsi comparer avec
l'individualisme, qui rassemble un ensemble de valeurs caractéristique.
Autrement dit, nous essayons de voir dans un premier temps, si une mesure du
système de valeurs rencontre la personnalité borderline pour
ensuite comparer avec les valeurs de l'individualisme pour voir s'il y a des
liens entre ces deux variables ou non. Nous avons trouvé pertinent
d'inclure le modèle alternatif de la personnalité pour mesurer
plus largement la personnalité, enrichissant cette recherche ainsi que
son étude.
2.2 Hypothèses
Plusieurs hypothèses se sont dégagées
à la suite de cette revue.
· Certaines valeurs du système de valeurs sont
associées significativement au trouble de la personnalité
borderline. Selon les valeurs internalisées, positive ou
négative, nous pourrons faire lien avec le système individualiste
sociétal actuel ou non.
· Les valeurs pouvoir, réussite,
hédonisme, stimulation et autonomie peuvent être significatives
avec les personnalités borderline.
· Le modèle alternatif de la personnalité
est associé positivement et significativement au trouble de la
personnalité borderline.
· Le trouble de la personnalité borderline joue
un rôle médiateur entre le modèle alternatif de la
personnalité et le système de valeurs, dans le sens où la
pathologie borderline impacte, modifie, le système de valeur d'un
individu.
35
III. Méthodologie
3.1 Populations de l'étude
Cette étude est réalisée auprès
de la population générale majeurs, tout venant, qui consentiront
librement à répondre à un questionnaire
auto-administré. Nous avons un échantillon de 143 sujets
composé de 40,6% d'hommes et 59,4% de femmes dont 21 sont significatif
au BSL.
3.2 Opérationnalisation des variables
· Les valeurs auquel adhère le sujet
seront ainsi mesuré par le questionnaire des valeurs de
Schwartz sous le nom de « Schwartz Value Survey » (SVS) . (cf
Annexe I).
Ce modèle comporte 57 valeurs, regroupées en 10
« domaines motivationnels ». Il se présente sous la forme de
deux listes de valeurs. La première comprend 30 items qui
décrivent des buts potentiellement désirables sous forme de
substantifs ; la seconde comprend 27 items qui décrivent des
manières d'agir potentiellement désirables sous forme
d'adjectifs. Chaque item exprime un aspect de la valeur de base auquel il
appartient. Une phrase entre parenthèses, à la suite de chaque
item, en précise la signification. Par exemple, l'item «
égalité (chances égales pour tous) » est un item du
type universalisme. L'item « plaisir (satisfaction des désirs)
» est un item du type hédonisme. Les personnes questionnées
notent l'importance de chaque item « en tant que principe qui guide MA vie
» sur une échelle en 9 points : 7 (d'importance suprême), 6
(très important), 5,4 (sans précision), 3 (important), 2,1 (sans
précision), 0 (sans importance), -1 (opposé à mes
valeurs). (Shalom Schwartz, Les valeurs de base
de la personne : théorie, mesures et applications, traduction
Béatrice Hammer et Monique Wach, Revue française de sociologie,
Ed Ophrys, 2006/4 - Volume 47, pages 929 à 968.)
La plupart des valeurs sont perçues comme variant de
« moyennement » à « très » importantes. Cette
échelle non symétrique, dilatée vers le haut et
condensée vers le bas, permet de rendre compte de la façon dont
les gens conçoivent les valeurs. Cette échelle permet aussi aux
personnes interrogées de rendre compte de leur opposition aux valeurs
qu'elles essaient d'éviter de promouvoir ou d'exprimer. Ceci est
particulièrement nécessaire pour les études
transculturelles, parce que les personnes appartenant à une culture ou
une subculture peuvent rejeter les valeurs d'autres cultures. Le SVS a
été traduit en 47 langues. (Shalom
Schwartz, Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et
applications, traduction Béatrice Hammer et Monique Wach, Revue
française de sociologie, Ed Ophrys, 2006/4 - Volume 47, pages 929
à
36
968.)
Pour calculer l'importance accordée à une
valeur de base, on fait la moyenne des notes mises aux différents items
que l'on pense a priori constitutifs de cette valeur. Le nombre d'items
permettant de mesurer chaque valeur varie de trois (hédonisme) à
huit (universalisme), ce qui reflète la largeur du champ conceptuel
associé à chaque valeur de base. Seuls les items dont on a pu
démontrer la quasi-équivalence en termes de signification d'une
culture à l'autre, grâce à des analyses utilisant
l'échelonnement multidimensionnel (Smallest Space Analysis [SSA] ;
Schwartz, 1992,1994,2005a) et l'analyse factorielle confirmatoire (Confirmatory
Factoriel Analaysis [CFA] ; Schwartz et Boehnke, 2004) sont conservés
pour le calcul de la moyenne. (Shalom Schwartz,
Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications,
traduction Béatrice Hammer et Monique Wach, Revue française de
sociologie, Ed Ophrys, 2006/4 - Volume 47, pages 929 à 968.)
La valeur de Cronbach
Sur 212 échantillons (échantillons nationaux
représentatifs, échantillons de professeurs, échantillons
d'étudiants) la valeur moyenne des alphas de Cronbach pour les dix
valeurs est de 0,68 (ils varient de 0,61 pour la tradition
à 0,75 pour l'universalisme) (Schwartz, 2005).
Validité de l'échelle
La structure du modèle de Schwartz a été
validée dans de nombreuses études utilisant aussi bien des
analyses d'échelles multidimensionnelles et d'autres méthodes
exploratoires sur des étudiants universitaires et des enseignants
provenant de 68 nations [Bardi & Schwartz, 2003 ; Fontaine et al., 2008 ;
Schwartz, 2006] ou sur des professionnels de l'administration provenant de 50
nations [Ralston et al., 2011]. Elle a aussi été validée
par une analyse factorielle confirmatoire en utilisant des échantillons
provenant de 27 pays [Schwartz & Boehnke, 2004]
Les données obtenues ont été recueillies
entre 1988 et 2002 dans 233 échantillons de 68 pays appartenant à
tous les continents (au total 64 271 personnes)
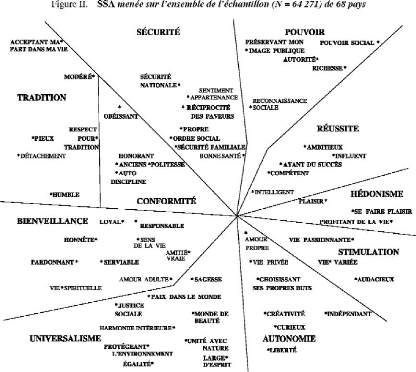
37
La SSA donne des résultats graphiques qui confirment la
validité de la théorie à travers différentes
cultures. Ces données montrent donc que, dans la plupart des cultures,
on peut distinguer les dix valeurs de base, et que les types de valeurs plus
larges constitués par le regroupement de valeurs adjacentes peuvent,
eux, être distingués de manière presque universelle.
(Shalom Schwartz, Les valeurs
de base de la personne : théorie, mesures et applications, traduction
Béatrice Hammer et Monique Wach, Revue française de sociologie,
Ed Ophrys, 2006/4 - Volume 47, pages 929 à 968.)
·
38
Le trouble de la personnalité borderline
sera quant à lui mesurer par la BSL-23
(Borderline Symptom List 23) la liste des symptômes borderline,
traduit par P. Prada & N. Perroud. (cf Annexe IV). La
Borderline Symptom List 23 a été développée en 2009
pour fournir un moyen de quantifier les symptômes ressentis par les
personnes diagnostiquées avec un trouble de la personnalité
borderline d'une manière rapide et efficace (Bohus et al., 2009). Il a
été créé à partir du BSL-95 original qui a
été développé en 2007, sur la base d'un
échantillon de 379 patients borderline (Bohus et al., 2007). Il s'agit
d'un questionnaire d'auto-évaluation utilisant une échelle de
Likert (0 = "pas du tout", 1 = "un peu", 2 = "plutôt", 3 = "beaucoup" et
4 = "très fort"). Il demande au patient d'évaluer ses
symptômes pour la semaine écoulée dans une série de
23 questions. Bien que le BSL-95 original ait de très bonnes
propriétés psychométriques, il a été
estimé que le nombre de questions de la liste n'était pas
pratique dans certains contextes. Afin d'accroître la volonté des
cliniciens et des chercheurs d'utiliser l'outil, une forme brève a
été créée (Bohus et al., 2009). C'est celle que
nous utiliserons.
Le BSL-23 est côté en additionnant les valeurs
des items. Les patients doivent remplir au moins 90% du questionnaire pour que
les scores soient évalués (Mannheim, 2007). Pour permettre la
comparaison avec le BSL-95 original, le score doit comparer les valeurs
moyennes des échelles. Le supplément Items for assessing
Behaviour est évalué de la même manière, les scores
étant ajoutés pour obtenir le score réel de comportement
dysfonctionnel. Les deux scores sont utilisés pour surveiller la
sévérité des symptômes du TPL et suivre
l'évolution dans le temps du patient. Il ne permet pas de diagnostiquer
le trouble de la personnalité borderline mais bien de calculer un seuil
de souffrance et de sévérité.
Propriétés psychométriques et alpha
de Cronbach
Les résultats des recherches menées par Bohus
et al. (2009) ont révélé de bonnes
propriétés psychométriques pour le BSL-23, comparables
à celles du BSL-95. Il existe également une forte
corrélation entre les scores du BSL-23 et du BSL-95 pour tous les
échantillons testés (fourchette : 0,958-0,963). La
cohérence interne est également élevée avec un
coefficient á de Cronbach compris entre 0,935-0,969.
L'outil a été écrit à l'origine
en allemand et a été traduit dans plusieurs langues
différentes, outre l'anglais, et les propriétés
psychométriques des outils traduits sont valides et ont
été publiées (Nicastro et al., 2016 ; Soler et al.,
2013).
39
Ensuite, nous avons trouvé pertinent d'intégrer
les outils de mesure du modèle alternatif pour les troubles de la
personnalité afin d'apporter plus de poids au BSL, dans l'étude
du trouble de la personnalité : le PID 5- BF ainsi que le LPFS-BF.
· Nous utiliserons donc le PID 5-BF (Annexe
II), qui est la forme brève du PID 5. C'est une échelle
d'évaluation des traits de personnalité de 25 items
auto-évalués pour les adultes âgés de 18 ans et
plus.
Il évalue 5 domaines de traits de personnalité :
l'affect négatif, le détachement, l'antagonisme, la
désinhibition, et le psychoticisme, chaque domaine de trait étant
composé de 5 items. Pour chaque élément du PID-5-BF, il
est demandé à la personne recevant les soins d'évaluer
dans quelle mesure l'item la décrit de manière
générale. (Krueger R. F., Derringer J., Markon K. E., Watson D.,
Skodol A. E. (2013a). The Personality Inventory for DSM-5-Brief Form
(PID-5-BF)-Adult. American Psychiatric Association.)
Notation et interprétation
Chaque élément de la mesure est
évalué sur une échelle de 4 points (0 = très faux
ou souvent faux ; 1 = parfois ou assez faux ; 2=parfois ou un peu vrai ;
3=très vrai ou souvent vrai). L'échelle de mesure globale va de 0
à 75, les scores les plus élevés indiquant un
dysfonctionnement global de la personnalité. Les scores dge chaque
domaine de traits vont de 0 à 15, les scores les plus
élevés indiquant un dysfonctionnement plus important de la
personnalité.
· Enfin, nous utiliserons le LPFS-BF
2.0. (cf Annexe III) Le « Level of Personality
Functioning Scale-Brief Form 2.0 » est un inventaire
d'auto-évaluation fréquemment utilisé pour dépister
les dysfonctionnements personnels et interpersonnels selon le modèle
alternatif des troubles de la personnalité (AMPD) du DSM-5 et la
classification des troubles de la personnalité de la CIM-11. Le LPFS-BF
et les mesures de déficience pertinentes ont été
administrés à un échantillon stratifié
socio-démographiquement de 2 002 adultes issus de la population
générale danoise, dont 713 ont finalement fourni des
données à inclure dans la présente étude.
L'unidimensionnalité des scores du LPFS-BF a été
établie à l'aide d'une analyse factorielle confirmatoire (AFC).
L'analyse de la
40
théorie des réponses aux items (IRT) a
indiqué un fonctionnement satisfaisant des 12 items et a
suggéré des seuils de scores normatifs observés à
différents niveaux de gravité latente. Des associations
significatives ont été trouvées entre les seuils normatifs
du LPFS-BF, la qualité de vie et le fonctionnement social et
professionnel. (Weekers, L. C., Hutsebaut, J., & Kamphuis, J. H. (2019).
The Level of Personality Functioning Scale-Brief Form 2.0: Update of a brief
instrument for assessing level of personality functioning. Personality and
Mental Health, 13(1), 3-14.)
Ces 12 items évalue 4 niveaux de personnalité :
l'identité (expérience de soi en tant
qu'être unique, stabilité de l'estime de soi et capacité
à s'engager dans la vie) l'autodétermination
(poursuite d'objectifs cohérents et significatifs, normes
internes de comportement constructives et prosociales et autoréflexion),
l'empathie (compréhension et appréciation des
expériences et motivations d'autrui, tolérance à
l'égard des différences de comportement), et
l'intimité (profondeur et durée des liens avec
les autres, désir et capacité de proximité et de
réciprocité des relations). (Weekers, L. C., Hutsebaut, J., &
Kamphuis, J. H. (2019). The Level of Personality Functioning Scale-Brief Form
2.0: Update of a brief instrument for assessing level of personality
functioning. Personality and Mental Health, 13(1), 3-14.)
Pour améliorer le fonctionnement
psychométrique, une échelle de réponse a été
opté au lieu d'un format de réponse binaire oui/non. Cette
modification est liée à un objectif d'élargir
l'utilisation du LPFS-BF 2.0 en tant qu'outil de dépistage pour en faire
un outil d'évaluation de la santé.
Notation
Ces 12 items, sont regroupés en deux domaines d'ordre
supérieur : le fonctionnement personnel et le fonctionnement
interpersonnel.
Les participants sont invités à évaluer
les 12 éléments sur une échelle de Likert en 4 points
allant de 1 (complètement faux) à 4 (complètement vrai).Le
tableau ci-dessous montre la distribution des réponses à tous les
items dans l'échantillon actuel.
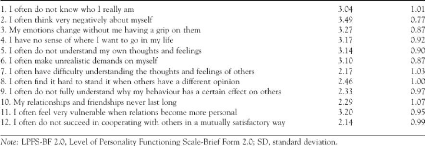
41
Weekers, L. C., Hutsebaut, J., & Kamphuis, J. H. (2019).
The Level of Personality Functioning Scale-Brief Form 2.0: Update of a brief
instrument for assessing level of personality functioning. Personality and
Mental Health, 13(1), 3-14.
· Enfin, les données
sociodémographiques telles que la tranche d'âge et le
sexe seront recueillies.
3.3 Protocole
Le protocole consiste en un questionnaire
auto-évalué sur LimeSurvey. Ce dernier sera diffusé sur
les réseaux sociaux. Le questionnaire sera publié sur diverses
plateformes afin de limiter le biais de sélection et d'obtenir un
échantillon le plus représentatif possible de la population
réelle ciblée.
3.4 Aspects déontologiques
Le questionnaire sera réalisé en ligne sur
LimeSurvey afin d'assurer l'anonymisation et la protection des données.
De même aucune donnée ne permet d'identifier les participants
puisqu'aucune information relative à l'identité de la personne ou
relative à l'adresse IP n'a été demandée ou
enregistrée. (Article 26 des conditions de l'exercice de la profession,
Article 51 du Code de déontologie ; CNIL, 1978 ; RGPD, 2016).
Réaliser cette étude en ligne et non en format papier parait plus
adapté afin de rassurer la personne sur la confidentialité et
l'anonymisation de l'étude. (Naus, 2009).
42
Avant la passation du questionnaire, une lettre
d'information (Annexes) énoncera le contexte, le sujet et
l'objectif de l'étude ainsi qu'une indication sur le temps
nécessaire pour la réaliser (Article 54 du Code de
déontologie). Dans cette lettre d'information seront également
explicités les droits de la personne comme notamment celui de pouvoir
interrompre la passation à tout moment, et ce, sans avoir à se
justifier. (Déclaration d'Helsinki, 2013). Nous fournirons
également une adresse électronique afin de pouvoir
répondre aux éventuelles questions soulevées à
l'issue de l'étude. Des numéros verts ont également
été joints à la lettre d'information (SOS suicide) dans le
but de guider les participantes vers une aide psychologique si cela est
nécessaire (Article 53 du code de déontologie). De plus, il sera
demandé à chaque participant d'attester du consentement libre et
éclairé avant de pouvoir participer à l'étude (Chap
II, art 9 conditions de l'exercice de la profession).
3.5 Hypothèses opérationnelles
· Certaines valeurs en tant que variable
indépendante évalués par le SVS seront associées
significativement aux scores significatifs obtenus au BSL-BF évaluant le
seuil de souffrance et de sévérité du trouble de la
personnalité borderline en tant que variable dépendante.
· Le modèle alternatif de la personnalité
évalué par le PID-5 et le LPFS-BF est associé positivement
et significativement aux scores obtenus au BSL-BF.
· Le BSL en tant que variable explicative, joue un
rôle médiateur entre le SVS et le MATP (PID et LPFS).
3.6 Traitement statistique des données
Le traitement des données obtenues a été
réalisé par le biais du logiciel Jamovi version 2.3 et SPSS
version 28.0.1.1. Dans un premier temps, nous avons calculé les alphas
de Cronbach pour nous assurer de la validité interne de chaque
questionnaire puis réaliser une analyse factorielle confirmatoire.
Pour cette étude, nous avons réussi à
obtenir 143 participants dont 21 sujets significatifs au seuil de souffrance de
la personnalité borderline. (BSL)
IV. Analyse des résultats
Analyse factorielle confirmatoire
Nous avons commencé par une analyse factorielle
confirmatoire (AFC) sur Jamovi pour confirmer la structure de nos
différents facteurs. Elle permet de tester si un modèle
théorique correspond bien aux données observées.
· SVS : ?=0.894
Le tableau ci-dessous nous montre que les facteurs du SVS sont
significatifs. (p < 0,05)
Contributions des facteurs
Facteur
|
Indicateur
|
Estimation
|
Erreur standard
|
Z
|
p
|
Facteur 1
|
AUTONOMIE
|
1.606
|
0.248
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 2
|
STIMULATION
|
1.822
|
0.281
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 3
|
HEDONISME
|
1.708
|
0.264
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 4
|
ACCOMPLISSEMENT
|
1.087
|
0.168
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 5
|
POUVOIR
|
1.304
|
0.201
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 6
|
SECURITE
|
1.394
|
0.215
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 7
|
CONFORMITE
|
1.569
|
0.242
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 8
|
TRADITION
|
0.913
|
0.141
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 9
|
BIENVEILLANCE
|
1.345
|
0.207
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 10
|
UNIVERSALISME
|
1.705
|
0.263
|
6.48
|
< .001
|
|
PID5 :?=0.806
Le tableau ci-dessous nous montre que les facteurs du PID sont
significatifs. (p < 0,05)
Contributions des facteurs
Facteur
|
Indicateur
|
Estimation
|
Erreur standard
|
Z
|
p
|
Facteur 1
|
AFFECT NEGATIF
|
0.484
|
0.0748
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 2
|
DETACHEMENT
|
0.482
|
0.0743
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 3
|
ANTAGONISME
|
0.514
|
0.0794
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 4
|
DESINHIBITION
|
0.686
|
0.1058
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 5
|
PSYCHOTISME
|
0.631
|
0.0974
|
6.48
|
< .001
|
|
43
Contributions des facteurs
Facteur Indicateur Estimation Erreur standard Z
p
· LPFS-BF-12 ?=0.842
Le tableau ci-dessous nous montre que les facteurs du LPFS sont
significatifs. (p < 0,05)
Contributions des facteurs
Facteur
|
Indicateur
|
Estimation
|
Erreur standard
|
Z
|
p
|
Facteur 1
|
Identité
|
0.484
|
0.0747
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 2
|
Auto-détermin
|
0.760
|
0.1173
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 3
|
Empathie
|
0.848
|
0.1308
|
6.48
|
< .001
|
Facteur 4
|
Intimité
|
0.670
|
0.1035
|
6.48
|
< .001
|
|
BSL : ?=0.943
4.1 Description des scores obtenus aux différents
outils
Statistiques descriptives
Intervalle de confiance à
Shapiro-Wilk
95%
|
N
|
Moyenne
|
Borne inf
|
Supérieur
|
Mé-
diane
|
Ecart-
type
|
W
|
p
|
BSL
|
143
|
0.745
|
0.636
|
0.855
|
0.484
|
0.665
|
0.848
|
< .001
|
Moyenne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOY SVS
|
143
|
3.653
|
3.516
|
3.790
|
3.573
|
0.826
|
0.992
|
0.566
|
MOY LPSF
|
143
|
1.226
|
1.125
|
1.328
|
1.214
|
0.614
|
0.982
|
0.055
|
MOY PID
|
143
|
1.085
|
1.017
|
1.154
|
1.040
|
0.415
|
0.991
|
0.515
|
|
44
Notre échantillon est composé de 40,6% d'hommes et
59,4% de femmes.
45
Moyennes globales de chaque échelle
· Les participantes de notre étude ont obtenu les
scores suivants à l'échelle BSL [m = 0,745 ; SD
= 0,665] Le test de Shapiro-Wilk révèle que les données ne
suivent pas une loi normale (W = 0.848 ; p < 0.05).
· Concernant, le système de
valeurs, les participants ont obtenu une moyenne de 3,65 (SD = 0.82).
Le test Shapiro met en avant qu'il s'agit d'une loi normale (W = 0.99 ;
p=0.566).
· Le score moyen obtenu à l'échelle
du PID est de 1,09 (SD = 0,415), Cela suit une loi normale
(W=0.99 ; p=0.515).
· Enfin, pour l'outil évaluant le
différent niveau de fonctionnement de personnalité, les
participantes ont obtenu une moyenne de 1,23 (SD = 0,614). Ces données
suivent une loi normale (W=0.982 ; p = 0,055)
4.1.1 Description des scores du groupe significatif au BSL
Statistiques descriptives
Intervalle de con-Shapiro-Wilk fiance
à 95%
|
|
GrBor-
der/non N
border
|
Moyenne
|
Borne
inf
|
Supé-
rieur
|
Mé-
diane
|
Ecart-
type
|
W
|
p
|
BSL
|
0
|
122
|
0.522
|
0.452
|
0.592
|
0.403
|
0.390
|
0.885
|
< .001
|
Moyenne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
21
|
2.045
|
1.874
|
2.215
|
1.968
|
0.375
|
0.883
|
0.017
|
MOY SVS
|
0
|
122
|
3.690
|
3.543
|
3.837
|
3.606
|
0.819
|
0.981
|
0.087
|
|
1
|
21
|
3.437
|
3.047
|
3.827
|
3.433
|
0.857
|
0.976
|
0.851
|
MOY LPSF
|
0
|
122
|
1.117
|
1.018
|
1.216
|
1.086
|
0.554
|
0.986
|
0.241
|
|
1
|
21
|
1.863
|
1.607
|
2.118
|
1.829
|
0.562
|
0.940
|
0.219
|
MOY PID
|
0
|
122
|
1.013
|
0.944
|
1.082
|
1.000
|
0.384
|
0.990
|
0.552
|
|
1
|
21
|
1.505
|
1.352
|
1.658
|
1.440
|
0.336
|
0.968
|
0.697
|
|
· Les participantes significatif au BSL (>ou=
à 1,5) de notre étude ont obtenu les scores suivants à
l'échelle BSL [m = 2,045 ; SD = 1,968 ] Le test de
Shapiro-Wilk révèle que les données ne suivent pas une loi
normale (W = 0.883 ; p < 0,05).
·
46
4.1.2 Test de Student
Test t pour échantillons
indépendants
Test t pour échantillons indépendants
Taille de
Statistique ddl p l'effet
Identité t de Student -10.432 ? 140 < .001 d de
Cohen -1.9182
Auto-détermi t de Student -5.262 140 < .001 d de
Cohen -0.9676
Empathie t de Student -3.659 140 < .001 d de Cohen
-0.6729
intimité t de Student -6.014 140 < .001 d de Cohen
-1.1058
Affect neg t de Student -4.580 140 < .001 d de Cohen
-0.8421
detachm t de Student -4.754 140 < .001 d de Cohen
-0.8741
antago t de Student -2.363 140 0.020 d de Cohen -0.4344
deshinib t de Student -3.839 140 < .001 d de Cohen
-0.7059
psychotis t de Student -6.985 140 < .001 d de Cohen
-1.2844
Autonomie t de Student 0.639 140 0.524 d de Cohen 0.1174
Stiumulation t de Student -0.286 140 0.775 d de Cohen
-0.0526
Hédonisme t de Student 1.406 140 0.162 d de Cohen
0.2585
Accomplissement t de Student 1.085 140 0.280 d de Cohen
0.1995
Pouvoir t de Student -2.177 140 0.031 d de Cohen -0.4004
Sécurité t de Student 0.593 140 0.554 d de
Cohen 0.1090
Conformité t de Student 0.533 140 0.595 d de Cohen
0.0980
Tradition t de Student 0.491 140 0.624 d de Cohen 0.0903
"BIENVEILLANCE" t de Student 0.842 140 0.401 d de Cohen
0.1548
UNIVERSALISME t de Student 0.413 140 0.680 d de Cohen
0.0760
Note. Ha A 0 ? A 1
? Le test de Levene est significatif (p<0.05),
suggérant une violation de la condition d'égalité des
variances
Dans ce tableau, nous pouvons observer les
résultats du test t de Student pour comparer les moyennes des
différents traits de personnalité et des différentes
valeurs entre les individus avec un score élevé de
personnalité borderline et ceux avec un score plus bas.
Les résultats montrent que la différence de
moyenne pour la variable "Pouvoir" est statistiquement significative (t =
-2.177, p = 0.031), ce qui suggère qu'il existe une différence
significative dans la perception du pouvoir entre les deux groupes. Cependant,
la taille de l'effet (d de Cohen = -0.4004) est relativement petite, ce qui
indique que bien que la différence soit statistiquement significative,
elle peut ne pas être cliniquement significative.
Ces résultats suggèrent que les individus
présentant des traits de personnalité borderline ont une
perception du pouvoir différente de ceux ayant des scores plus bas en
personnalité borderline. Cependant, étant donné la taille
relativement petite de l'effet pour la variable "Pouvoir", des
analyses supplémentaires sont nécessaires pour
confirmer ces résultats et en comprendre les implications cliniques.
Dès lors, nous nous demandons si les sujets ayant un
score significatif au BSL ont une incidence sur la valeur Pouvoir.
· Ce tableau d'analyse de régression
linéaire met en évidence que les sujets
borderline est positive
significative. (p < 0,05) C'est
donc un bon indicateur pour la valeur pouvoir. Plus les scores au BSL sont
élevés plus les scores obtenus à la valeur pouvoir est
élevé.
Coefficients du modèle - Pouvoir
Prédicteur
|
Estimation
|
Erreur standard
|
t
|
p
|
Ordonnée à l'origine
|
1.8254
|
0.26070
|
7.002
|
< .001
|
Identité
|
-0.0110
|
0.05940
|
-0.186
|
0.853
|
Auto-détermi
|
0.0215
|
0.06274
|
0.343
|
0.732
|
Empathie
|
0.0391
|
0.05041
|
0.776
|
0.439
|
intimité
|
-0.0677
|
0.06204
|
-1.091
|
0.277
|
BSL
|
0.0184
|
0.00734
|
2.512
|
0.013
|
Affect neg
|
0.0405
|
0.03572
|
1.133
|
0.259
|
detachm
|
-0.0605
|
0.05236
|
-1.155
|
0.250
|
antago
|
0.0955
|
0.03558
|
2.684
|
0.008
|
deshinib
|
-0.0121
|
0.03762
|
-0.322
|
0.748
|
psychotis
|
-0.0602
|
0.03600
|
-1.673
|
0.097
|
|
47
Mesures de l'ajustement du modèle
Modèle R R2
1 0.386 0.149
· 14,9 % de la variance, c'est-à-dire du score
obtenu à la valeur Pouvoir est expliqué par le BSL.
· Comme le BSL est sous tendu par le modèle
alternatif des troubles de la personnalité, le PID et le LPFS, nous
pouvons étudier les effets de médiation.
4.2 Analyse des médiations
4.2.1 Rôle médiateur du trouble de la
personnalité borderline (BSL)
Pour ce modèle nous avons utilisé le
modèle linéaire de médiation général
(General Linear Model Mediation Analysis), il permet de tester si notre
variable BSL, (si les sujets avec une personnalité borderline) explique
ou transmet les effets du modèle alternatif de la personnalité
sur la variable dépendante, la valeur pouvoir.
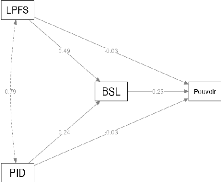
Dans sa globalité, ce premier tableau ci-dessous
révèle principalement des effets directs significatifs entre nos
variables (voir les composants) : Le PID sur le BSL (3 = 0,24 ; p < 0,05),
le BSL sur Pouvoir (3 = 0,25 ; p < 0,05), le LPFS sur BSL (3 = 0,49 ; p <
0,05).
Néanmoins il existe une médiation indirect
positive significative du BSL sur notre modèle, expliquant les effets du
LPFS sur la valeur pouvoir. (3 = 0,12 ; p < 0,05).
Indirect and Total Effects
Type
|
Effect
|
Estimat
e
|
|
95% C.I. (a)
|
|
â
|
z
|
p
|
|
Lower Upper
|
|
PID BSL
|
|
|
-
|
|
|
|
|
Indirect
|
Pouvoir
|
0.00656
|
0.00401
|
0.00131
|
0.0144
|
0.0596
|
1.6341
|
0.102
|
|
LPFS BSL
|
0.01852
|
0.00915
|
5.89e-4
|
0.0364
|
0.1248
|
2.0244
|
0.043
|
|
Pouvoir
|
|
|
|
|
|
|
|
Component
|
PID BSL
|
0.45526
|
0.18725
|
0.08826
|
0.8223
|
0.2366
|
2.4313
|
0.015
|
|
BSL Pouvoir
|
0.01441
|
0.00653
|
0.00161
|
0.0272
|
0.2521
|
2.2068
|
0.027
|
|
LPFS BSL
|
1.28533
|
0.25275
|
0.78995
|
1.7807
|
0.4949
|
5.0854
|
< .001
|
|
· La présence significative d'une
médiation indirecte impliquant la personnalité borderline
suggère que cette variable joue un rôle important dans le lien
entre les variables intimité, identité, psychoticisme et la
valeur pouvoir.
Nous allons donc tester en détails les facteurs
influençant le BSL avec une régression linéaire.
· Ce tableau d'analyse de régression
linéaire met en évidence que les variables
Identité, Intimité et
Psychoticisme sont
positives significatives. (p < 0,05)
Ce sont donc de bons indicateurs pour le BSL. Plus leurs scores sont
élevés plus les scores obtenus au BSL sont
élevés.
Coefficients du modèle - BSL
Prédicteur
|
|
Estimation
|
Erreur
standard
|
t
|
p
|
Ordonnée à l'origine Identité
Auto-détermi Empathie
intimité Affect neg
detachm
antago deshinib
psychotis 1.360
|
0.410
|
3.315
|
-7.647
3.716
-1.213
-0.753
2.697
0.605
-1.258
0.388
0.701
0.001
|
3.019
0.626
0.736
0.594
0.697
0.420
0.611
0.421
0.442
|
-
2.533
5.939
-
1.648
-
1.268
3.869
1.440
-
2.059
0.923
1.586
|
0.012
< .001
0.102
0.207
< .001
0.152
0.051
0.358
0.115
|
|
49
Mesures de l'ajustement du modèle
Modèle R R2
1 0.779 0.606
· 60,6% de la variance,
c'est-à-dire du score obtenu au BSL est expliqué par les
variables identité, intimité et psychoticisme.
Un lien significatif est retrouvé entre le BSL et
Identité, intimité et psychoticisme, nous pouvons donc
réaliser le modèle de médiation suivant :
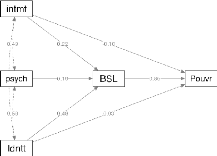
50
Ce dernier modèle révèle des interactions
positives et significatives entre nos variables, confirmant les facteurs
influençant notre modèle de médiation.
Il existe une médiation indirecte positive significative
du BSL sur notre modèle.
En effet nous avons Identité -> BSL -> Pouvoir (3 =
0,17 ; p < 0,05), Intimité -> BSL -> Pouvoir (3 = 0,08 ; p <
0,05) et psychoticisme -> BSL -> Pouvoir (3 = 0,06 ; p < 0,05).
· Ce modèle montre que ces 3 facteurs
indépendants influencent la personnalité borderline, qui à
son tour par sa médiation, peut influencer la perception de la valeur
pouvoir.
Indirect and Total Effects
|
Type
|
Effect
|
Estimate
|
SE
|
95% C.I. (a)
|
â
|
z
|
p
|
|
Lower
|
Upper
|
|
Identité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indirect
|
BSL
|
0.0685
|
0.02654
|
0.01644
|
0.12049
|
0.1664
|
2.579
|
0.010
|
|
Pouvoir psychotis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BSL
|
0.0198
|
0.01008
|
3.01e-5
|
0.03954
|
0.0662
|
1.963
|
0.050
|
|
Pouvoir intimité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BSL
|
0.0425
|
0.01988
|
0.00349
|
0.08142
|
0.0770
|
2.136
|
0.033
|
|
Pouvoir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Identité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Component
|
|
3.4514
|
0.51723
|
2.43765
|
4.46516
|
0.4793
|
6.673
|
< .001
|
|
BSL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BSL
|
0.0198
|
0.00709
|
0.00594
|
0.03374
|
0.3471
|
2.797
|
0.005
|
|
Pouvoir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
psychotis
BSL
|
0.9973
|
0.36192
|
0.28799
|
1.70670
|
0.1907
|
2.756
|
0.006
|
|
intimité
|
2.1403
|
0.64714
|
0.87195
|
3.40870
|
0.2218
|
3.307
|
< .001
|
|
BSL
|
|
|
|
|
|
|
|
51
V. Discussion
5.1 Les objectifs de la recherche
Cette étude a pour objectif de voir si la
personnalité borderline était symptomatique d'un système
sociétal individualiste par le biais d'un système de valeurs.
L'étude a permis d'élaborer un modèle de médiation
permettant une meilleure compréhension de la relation entre le
système de valeurs, le modèle alternatif des troubles de la
personnalité et du trouble borderline.
5.2 Discussions des résultats
Dans un premier temps, nos résultats de cette recherche
montrent qu'il existe bien un lien significatif entre la personnalité
borderline, le modèle alternatif de la personnalité, ainsi que le
système de valeurs.
En reprenant nos hypothèses, nous constatons que seule
la valeur pouvoir est significative avec notre
échantillon de sujet borderline. Ce qui valide partiellement nos
hypothèses. Néanmoins, la valeur pouvoir se situe dans les
valeurs dîtes à intérêt individuel. (Bilsky &
Schwartz, 1994) Etant associé positivement, nos résultats
montrent donc une intériorisation d'une valeur dite individualiste chez
nos sujets borderline.
Nous pouvons aussi confirmer le lien significatif entre le
modèle de la personnalité et la personnalité borderline.
De plus, les résultats ont révélé les facteurs les
plus déterminant qui influencent le niveau de gravité du trouble
de la personnalité borderline. Ce sont les facteurs Identité,
Intimité et Psychoticisme.
· Il n'y a pas de lien direct entre le modèle
alternatif de la personnalité et le système de valeurs. Or, il
existe un lien indirect, par le biais de la personnalité borderline.
Ce qui nous a amené à modéliser nos
résultats, avec un modèle à médiation. Le trouble
de la personnalité borderline en tant que médiation, entre le
modèle alternatif de la personnalité avec trois facteurs :
Identité, intimité et psychoticisme et, la valeur pouvoir. Ce qui
confirme notre dernière hypothèse.
52
5.2.1 Analyse de notre modèle
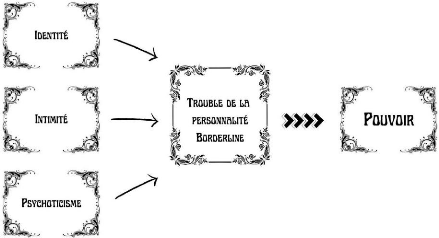
La présence significative d'une médiation
indirecte impliquant la personnalité borderline suggère que cette
pathologie joue un rôle crucial dans le lien entre les traits de
personnalité intimité, identité, psychoticisme et la
valeur pouvoir. Elle explique l'effet de ces traits sur la valeur pouvoir.
· En d'autres termes, les résultats de notre
recherche révèlent que le trouble de la personnalité
borderline modifie, influence la perception de la valeur pouvoir, en augmentant
son intériorisation dû à d'importantes
problématiques identitaires, relationnelles et de perception du
réel.
L'apparition du trait psychoticisme est intéressante
dans ce modèle. D'après le DSM-V, il n'est pas un critère
diagnostic fondamentale pour ce trouble de la personnalité. En revanche
nous pouvons l'interpréter ainsi : le psychoticisme se manifeste par des
croyances ou des pensées atypiques, ainsi que des difficultés
à percevoir la réalité de manière stable. En
reprenant les autres critères de notre modèle et les termes du
DSM-V, ce qui influe sur la gravité de ce trouble c'est une faible
estime de soi, peu développée ou instable, des sentiments
chroniques de vide, des relations proches intenses, instables et
conflictuelles, des besoins affectifs excessifs et préoccupations
anxieuses concernant un abandon réel ou imaginé et des relations
proches souvent extrêmes, soit idéalisées, soit
dévalorisées, alternant entre implication excessive et retrait.
(American Psychiatric Association et American Psychiatric Association,
éditeurs. Diagnostic and statistical manual of mental disorders:
DSM-5. 5th
53
ed, American Psychiatric Association, 2013.)
Nous pouvons dire que le trait psychoticisme ici
représente simplement les croyances ou les pensées traumatiques
affective extrême de nos sujets impactant/altérant sa perception
de la réalité. En effet selon Kernberg, les individus qui
présentent ce type de structure percevraient adéquatement la
réalité
et préserveraient une pensée logique et
cohérente. Cependant, ils pourraient présenter des distorsions
dans la perception de soi et des autres lorsqu'ils sont
confrontés à des facteurs de stress qui
submergent leurs capacités adaptatives et ainsi avoir le
sentiment que leur rapport à la réalité est
variable (O. Kernberg, 2004).
5.3 Borderline et la valeur « Pouvoir »
Afin de comprendre le lien entre le trouble de la
personnalité borderline et la valeur pouvoir, nous vous proposons un
argumentaire clinique, psychanalytique et social sur la base des apports de
notre revue de littérature ainsi que de cet article de psychologie
sociale : Guinote, A. (2017). How power affects people : Activating, wanting,
and goal seeking. Annual Review of Psychology, 68(1),
353-381.
En psychologie, la recherche sur le pouvoir social s'est
considérablement développée depuis l'étude de
Keltner et al. (2003), selon laquelle le pouvoir active le système
d'approche comportementale (BAS ; voir Gray 1990, Gray & McNaughton 2000).
Cette activation peut entraîner de nombreuses répercussions sur
les pensées, les émotions et les comportements des individus
ayant du pouvoir, ce qui confère à cette théorie un fort
pouvoir explicatif. Cet article examine les études publiées
depuis Keltner et al. (2003) qui explorent l'impact du pouvoir sur les
individus. (Guinote, 2017)
5.3.1 Pouvoir et Identité
D'après Guinote le pouvoir affecte la façon
dont les individus perçoivent leurs attributs, la façon dont ils
s'évaluent eux-mêmes et la façon dont ils se
perçoivent indépendamment des autres. Ces effets du pouvoir sur
le soi facilitent la prise de décision rapide et l'action, permettant
aux individus de réagir de manière autonome. Le pouvoir augmente
également l'estime de soi (Fast et al. 2009, Hofstede et al. 2002,
Wojciszke & Struzynska-Kujalowicz 2007). Dans cet article, l'auteur
énonce l'exemple d'une étude portant sur 1 814 participants
occupant des postes d'encadrement dans 15 pays a révélé
que les cadres s'évaluaient mieux en termes de caractéristiques
managériales positives que la moyenne des cadres de leur pays (Hofstede
et al. 2002). (Guinote, A, 2017, How power affects people: Activating, wanting,
and goal seeking).
·
54
Comme vu dans la littérature, le trouble de la
personnalité borderline est caractérisé par une estime de
soi faible et instable, l'adhésion à la valeur du pouvoir peut
donc servir de mécanisme compensatoire. En s'identifiant à des
attributs associés au pouvoir, les individus borderline peuvent
renforcer leur image de soi et leur sentiment de compétence. Par
conséquent, cette adhésion à la valeur du pouvoir peut
être perçue comme une tentative de renforcement de soi, visant
à consolider un moi actif et positif face aux défis de la vie
quotidienne.
5.3.2 Pouvoir et Intimité
Le pouvoir amène des relations de coopérations
afin d'arriver à des fins individuelles. (Bilsky & Schwartz, 1993).
Les individus borderline sont prédominés par des angoisses
relationnelles, caractérisé par des préoccupations
anxieuses concernant un abandon réel ou imaginé ainsi que des
relations proches souvent extrêmes, soit idéalisées, soit
dévalorisées, alternant entre implication excessive et retrait.
(Estellon, 2017) Intérioriser cette valeur, permettrait une mise
à distance suffisante de l'autre, en le contrôlant afin de pouvoir
combler ses manques affectifs. En effet d'après Guinote, les
détenteurs de pouvoir ont un sentiment de contrôle
élevé, même dans des domaines qui ne sont pas liés
à leur rôle (Scholl & Sassenberg 2014). Van Dijke & Poppe
(2006) et Lammers et al. (2016) ont constaté que les gens recherchent le
pouvoir principalement pour accroître le contrôle qu'ils exercent
sur leur propre vie. (Guinote, A, 2017, How power affects people: Activating,
wanting, and goal seeking).) Ce qui nous renvoie au mécanisme de
défense principale des pathologies limites dans sa relation à
l'autre : l'identification projective. En effet, nous
rappelons que cette défense est très utilisée par
les pathologies limites, et qu'elle s'exprime par des fantasmes
inconscients permettant au sujet d'in-
troduire des parties de sa propre personne dans l'autre dans le
but de le contrôler, le posséder ou le
détruire. (Estellon, V. (2011). Les mécanismes
de défense)
· Ici, le pouvoir renvoie un reflet miroir de ce
mécanisme défensif.
5.3.3 Pouvoir et psychoticisme
D'après l'auteur, le pouvoir affecte également
les croyances que les gens ont d'eux-mêmes. Il renforce la confiance ou
la conviction dans leurs capacités et leurs opinions, ainsi que d'autres
croyances valorisantes, qui sont des mécanismes de niveau
intermédiaire facilitant la prise de décision rapide et
l'exercice de l'influence. Des études sur le terrain et des
études expérimentales ont révélé une
55
augmentation de la confiance chez les personnes puissantes
(Brinol et al. 2007, Fast et al. 2012, Scholl & Sassenberg 2014). (Guinote,
A, 2017, How power affects people: Activating, wanting, and goal seeking).
·
Dans le modèle alternatif des troubles de la
personnalité du DSM-V, il est décrit que le psy-choticisme
regroupe une large gamme de cognitions et de comportements culturellement
excentriques ou inhabituels à la fois en ce qui concerne les croyances,
le mécanisme de perception du réel et la dissociation. Nous avons
exploré que les individus présentant un trouble de la
personnalité borderline ont des mécanismes défensifs
provoquant une altération de la perception du réel, notamment en
la déniant. Le sujet, en s'identifiant aux parties de l'objet contenant
ses propres parties clivées/projetées, se perd dans une
perception confuse où l'autre c'est lui. Intérioriser la valeur
pouvoir, conforterait ces personnalités dans leur croyance leur
apportant une valorisation de leurs comportements et pouvant garder l'autre
comme étant un objet partiel. (Estellon, V. (2011). Les
mécanismes de défense)
· Cela nous renvoie au modèle d'Otto Kernberg
(1989) vu précédemment notre revue. Ces résultats montrent
une concordance avec les trois critères fondamentaux de ce
modèle, soit le degré d'intégration de l'identité,
les mécanismes de défense prédominants et la
capacité de l'individu à maintenir la fonction d'épreuve
de la réalité. (Kernberg, O. F. (1989). Les
Troubles limites de la personnaliteì.)
5.3.4 Le pouvoir : la quête idéalisée
des borderlines ?
? Idéal du Moi, Soi grandiose : quête
d'autosuffisance et d'autonomie
Nous allons nous pencher sur le conflit dominant de cette
structure psychique où prédomine l'idéal du Moi en conflit
avec le Moi.
Pour rappel dans notre revue de la littérature, nous
avons vu avec l'auteur Jean Bergeret que l'Idéal du Moi chez les
personnalités limites exerce ses pressions par des promesses d'un avenir
meilleur. Cet idéal peut être perçu comme une croyance
selon laquelle une personne doit être parfaite et ne peut pas se
permettre d'échouer entraînant une anxiété et une
insécurité extrême, car la personne se sent incapable de
satisfaire ses propres attentes. Le désir est continuellement
stimulé mais l'accès au plaisir est interdit. Il agit pour se
sentir aimé, sa plus grande terreur étant de ne plus être
aimé. (Zucker, D. (2012). Faux self, borderline, personnalité
narcissique, personnalité schizoïde)
Ainsi, le pouvoir apportera aux personnalités
borderline la clarté de l'objectif et l'ardeur du désir, ainsi
que la volonté de travailler à la réalisation des
désirs et des objectifs (chercher à atteindre un but). (Guinote,
2017)
56
En effet, dans notre article sur la question du pouvoir, les
auteurs Van Dijke & Poppe (2006) et Lammers et al. (2016) ont
constaté que les gens recherchent le pouvoir principalement pour
accroître le contrôle qu'ils exercent sur leur propre vie. Ce
sentiment de contrôle accru joue un rôle causal dans l'optimisme et
l'orientation vers l'action des détenteurs de pouvoir (Fast et al.
2009). En outre, avec une perception accrue du contrôle, les personnes
puissantes se perçoivent comme une entité
indépendante et autosuffisante (concept de soi
indépendant). (Guinote, 2017)
· L'Idéal du Moi règne par son
insatiabilité, la valeur pouvoir pourrait alors nourrir
perpétuellement ce pôle dominant chez cette structure.
En reprenant notre théorisation lors de notre revue, la
valeur pouvoir renvoie à l'intériorisation des normes
sociétales et surtout, il est la principale dynamique de
l'individualisme (concept de soi indépendant, d'après Guinote,
2017). Nous disions précédemment que si cet idéal
d'indépendance et d'autosuffisance est la norme sociale, alors il entre
en conflit avec les difficultés rencontrés par les personnes
souffrant de trouble de la personnalité borderline. Leur
fonctionnement étant centré sur un Idéal
du moi fort ces sujets ont tendance à fortement
intériorisé cette norme et donc sont en quête
d'indépendance et d'autosuffisance. Cependant, leurs
instabilités émotionnelles, relationnelles et
identitaires, ainsi que leur peur de l'abandon, rendent cet objectif difficile
à atteindre. La tension entre le désir d'indépendance et
la dépendance émotionnelle et psychique, caractéristique
des personnes borderline, est perceptible en raison du besoin de combler tous
ces manquements.
Or grâce à cette recherche nous voyons que
l'intériorisation de la valeur Pouvoir pourrait être
le compromis de ces individus pour avoir le contrôle sur
leurs symptômes. Avoir le pouvoir serait un moyen défensif de
maintenir leur système, à la limite.
·
·
Finalement, nous voyons avec cette lecture psychanalytique, que
l'adhésion à la valeur pouvoir chez
les personnalités borderline permet un contrôle de
ses angoisses relationnelles et identitaires et ainsi
que le maintien d'une certaine stabilité psychique.
Adhérer à la valeur Pouvoir, est une tentative de
maîtrise de leurs symptômes.
· La valeur pouvoir résonne avec la quête
idéale : l'omnipotence sans failles, un contrôle absolu sur ses
émotions, avec un garanti de réussite et
d'épanouissement.
57
5.3.5 Borderline et Individualisme
« Si le pouvoir facilite l'affirmation sociale et la
recherche de priorités, il le fait souvent au risque de négliger
des objectifs secondaires, en particulier les besoins et les perspectives
d'autres personnes. » (Fiske & Berdahl 2007, Galinsky et al. 2006).
En conclusion de cette analyse des résultats, nous
pouvons dire qu'en partie, l'individualisme a un impact sur ce trouble de la
personnalité. En effet, il semble que le trouble de la
personnalité borderline est le reflet d'une dissonance entre
émancipation individuel et dépendance à l'autre. Avec
notre recherche, nous voyons que des individus ayant un seuil de souffrance
élevé vers cette personnalité, intériorisaient de
manière positive l'une des valeurs principales de ce système.
Néanmoins, bien que nous ayons identifié des
associations entre l'individualisme et la personnalité borderline, nous
ne pouvons pas conclure que l'un cause directement l'autre. Les relations
observées peuvent être influencées par d'autres variables
non mesurées ou par des facteurs externes. Par conséquent, il est
important de rester prudent dans l'interprétation des résultats
et de reconnaître que nos analyses fournissent des indications sur les
relations entre les variables, mais ne permettent pas d'établir des
conclusions définitives sur les causes sous-jacentes de ces
relations.
58
5.4 Principales limites
· Notre recherche questionne autour de l'individualisme qui
est un paradigme très large et plutôt flou, dans la mesure
où il n'existe pas d'échelle spécifique permettant
d'évaluer directement l'individualisme ou un système de valeurs
individualiste. Nous avons dû nous appuyer sur la littérature
existante pour tirer des conclusions hypothétiques sur la relation entre
l'individualisme et la personnalité borderline. Cette approche indirecte
peut présenter des limites en termes de précision et de
validité des résultats.
· De plus, notre échantillon d'individus
présentant des scores significatifs au BSL (Borderline Symptom List)
pourrait être considéré comme relativement restreint (21).
Cette taille d'échantillon réduite peut limiter la
généralisabilité de nos résultats et la robustesse
de nos conclusions. Une étude avec un échantillon plus vaste
pourrait permettre de mieux saisir la nature et l'ampleur des relations entre
les variables étudiées.
· Un autre point à considérer est que les
sujets évalués au BSL présentent des
caractéristiques qui suggèrent une souffrance et des traits
associés à la pathologie borderline, mais ils ne
bénéficient pas nécessairement d'un diagnostic formel de
trouble de la personnalité borderline. Cette distinction pourrait avoir
des implications importantes pour la validité externe de notre
étude et pour la généralisation de nos résultats
à une population présentant un diagnostic clinique
confirmé.
· En outre, malgré nos efforts pour prendre en
compte différentes dimensions de la personnalité borderline et de
l'individualisme, d'autres variables potentiellement pertinentes pourraient ne
pas avoir été prises en compte dans notre étude. Par
exemple, des facteurs environnementaux, sociaux ou culturels pourraient jouer
un rôle dans la relation entre ces deux variables et mériteraient
d'être explorés dans des recherches futures.
· Enfin, nos conclusions sont basées sur des
analyses statistiques qui ne permettent pas d'établir des relations
causales entre les variables étudiées. Des études
longitudinales ou expérimentales pourraient être
nécessaires pour mieux comprendre la nature et la direction des liens
entre l'individualisme et la personnalité borderline.
59
VI. Conclusion
Cette recherche offre un aperçu significatif des
relations complexes entre la personnalité borderline et
l'individualisme. En explorant ces dimensions à travers une approche
multidisciplinaire, pluri factorielle, nous avons pu identifier des liens
significatifs entre les variables étudiées, offrant ainsi de
nouvelles perspectives sur la compréhension de la personnalité
borderline dans le contexte de notre société contemporaine.
Nos résultats suggèrent que les individus
présentant des traits de personnalité borderline ont une
propension significative à adhérer à la valeur du pouvoir.
Cette adhésion peut être interprétée à la
lumière de l'idéal du Moi et de la quête
d'indépendance dans un contexte social marqué par
l'individualisme. En intégrant des perspectives psychanalytiques et
sociologiques, nous avons pu mettre en évidence l'impact de ces
dynamiques sur la symptomatologie et les comportements des individus
présentant des traits de personnalité borderline.
Cependant, il convient de reconnaître les limites de
notre étude, notamment en ce qui concerne la nature
corrélationnelle de nos analyses et la taille restreinte de notre
échantillon. Ces limites soulignent l'importance de poursuivre les
recherches dans ce domaine, en mettant l'accent sur des méthodologies
longitudinales et des échantillons plus diversifiés.
Malgré ces limites, notre étude offre des
implications significatives pour la pratique clinique et la recherche future.
En comprenant mieux les mécanismes sous-jacents à la relation
entre la personnalité borderline, l'individualisme et la valeur du
pouvoir, les cliniciens peuvent mieux adapter leurs approches
thérapeutiques et leurs interventions pour répondre aux besoins
spécifiques de cette population. Cela peut inclure des approches de
traitement axées sur la régulation des émotions, la
gestion des relations interpersonnelles et le renforcement de l'estime de
soi.
De plus, nos résultats soulignent l'importance de
poursuivre les recherches sur les facteurs sociaux et culturels qui influencent
le développement et la manifestation de la personnalité
borderline.
En conclusion, cette étude contribue à enrichir
notre compréhension de la personnalité borderline dans le
contexte de notre société contemporaine, en mettant en
lumière les liens complexes entre les dimensions individuelles et
sociales. En intégrant des perspectives multidisciplinaires, nous
espérons ouvrir de nouvelles voies de recherche et de pratiques
cliniques pour améliorer la prise en charge des individus touchés
par ce trouble.
60
Bibliographie
American Psychiatric Association et American Psychiatric
Association, éditeurs. Diagnostic and statistical manual of mental
disorders. DSM-5. 5th ed, American Psychiatric Association, 2013. Bardi
A., Schwartz S. H., 2003. - « Values and behavior : strength and structure
of relations », Personality and social psychology bulletin, 29, 10, pp.
1207-1220.
Beauvois, Jean-Léon. Les illusions libérales,
individualisme et pouvoir social. petit traité des grandes
illusions. Presses universitaires de Grenoble, 2005.
Benedetto, P. (2008). Chapitre 11. Les valeurs. Dans : , P.
Benedetto, Psychologie de la personnalité (pp. 125-132).
Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.
Bergeret, J. (1995). La dépression et les états
limites: Points de vue théorique, clinique et thérapeutique.
Payot.
Blaha Stephen, (2002) The rhythms of history . a universal
theory of civilizations, Pingree-Hill Publishing
Bion, W. R. (1989). Elements of psycho-analysis.
Maresfield library.
Bohus, M., Kleindienst, N., Limberger, M. F., Stieglitz, R.-d.,
Domsalla, M., Chapman, A. L., . . . Wolf, M. (2009). The Short Version of the
Borderline Symptom List (BSL-23): Development and Initial Data on Psychometric
Properties. Psychopathology, 42(1), 32-39.
Bohus, M., Limberger, M. F., Frank, U., Chapman, A. L.,
Kühler, T., & Stieglitz, R.-D. (2007). Psychometric Properties of the
Borderline Symptom List (BSL). Psychopathology, 40(2), 126-132. Codou,
O., Priolo, D., Camus, O., Schadron, G., Morchain, P. & Denis-Rémis,
C. (2012). Ideological priming and normative dimensions of individualism.
Revue internationale de psychologie sociale, 25, 59-71.
Dumont, Louis. Essais sur l'individualisme: une perspective
anthropologique sur l'idéologie moderne. Texte ... augmenté
en 1985, .. ... Revu et Corrigé à l'occasion de la
présente éd, Éd. du Seuil, 1991.
Durkheim. Revue internationale de philosophie, 280,
157-180.
Elias, N. (2018). La société des
individus. Pocket
Ehrenberg, A. (2010). Chapitre 5. De l'autonomie comme aspiration
à l'autonomie comme condition. Dans :, A. Ehrenberg,
Société du malaise (pp. 189-219). Odile Jacob.
Estellon, V. (2014). Origine et évolution de la notion
d'état limite dans le champ psychopathologique. Dans : Vincent Estellon
éd., Les états limites (pp. 33-44). Paris cedex 14:
Presses Universitaires de France.
Estellon, V. (2015). Chapitre 2. Premières descriptions
des états limites. Dans :, M. de Luca & V. Estellon (Dir), Des
névroses aux états limites (pp. 30-47). Paris: Armand
Colin.
61
Estellon, V. (2019). Chapitre III. Les états limites :
isolation et définition du syndrome psychopathologique. Dans : Vincent
Estellon éd., Les états limites (pp. 43-53). Paris cedex
14: Presses Universitaires de France.
Granger B. |Karaklic . Les Borderlines. Odile Jacob,
2012.
Green A. (1999), « Genèse et situation des
états limites », in Les états limites, Jacques
André et all,
Paris, P.U.F., Petite Bibliothèque de Psychanalyse, page
56
Guinote, A. (2017). How power affects people: Activating,
wanting, and goal seeking. Annual
Review of Psychology, 68(1), 353-381
Guigou, Jacques. La cité des ego. l'Harmattan,
2008.
Kernberg, O. F. (1989). Les Troubles limites de la
personnaliteì.
Klein, M., & Klein, M. (1984). Love, guilt, and
reparation, and other works, 1921-1945 (Free Press ed). Free Press.
Mesure, S. (2017). Le lien social à l'épreuve de
l'individualisme Le « culte de l'individu » chez Millon T. The
borderline personality : a psychosocial epidemic. In : Borderline personality
disorder, etiology and treatment. Washington : American Psychiatric Press, 1993
: 197-210
Morchain, P. (2009). Chapitre 1. Que sont les valeurs ?
Tentative de définition(s). Dans : , P. Morchain, Psychologie
sociale des valeurs (pp. 7-27). Paris: Dunod.
Stern, Adolph. « Psychoanalytic Investigation of and
Therapy in the Border Line Group of Neuroses ».
The Psychoanalytic Quarterly, vol. 7, no 4, octobre
1938, p. 467-89.
Stone M. Etiology of BPD : psychosocial factors contributing
to an underlying irritability. In : Borderline personality disorder, etiology
and treatment. Washington : American Psychiatric Press, 1993 : 87-101
(Tocqueville A., De la démocratie en
Amérique, OEuvres complètes, Paris, PUF, 1983, p. 217.)
Van Laethem, N. & Josset, J. (2020). Outil 15. Le
système de valeurs. Dans : , N. Van Laethem & J. Josset (Dir),
La boîte à outils des soft skills (pp. 52-55). Paris:
Dunod.
Weekers, L. C., Hutsebaut, J., & Kamphuis, J. H. (2019).
The Level of Personality Functioning Scale- Brief Form 2.0: Update of a brief
instrument for assessing level of personality functioning. Personality and
Mental Health, 13(1), 3-14.
Widlöcher D. Les états-limites : discussion
nosologique ou réflexion psychopathologique ? Perspectives
Psychiatriques 1979 ; n° 70 : 7-11
Zucker, D. (2012). Faux self, borderline, personnalité
narcissique, personnalité schizoïde.... Dans : , D.Zucker,
Penser la crise: L'émergence du soi (pp. 47-59).
Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur.
VII. Annexes
62
I. Le SVS
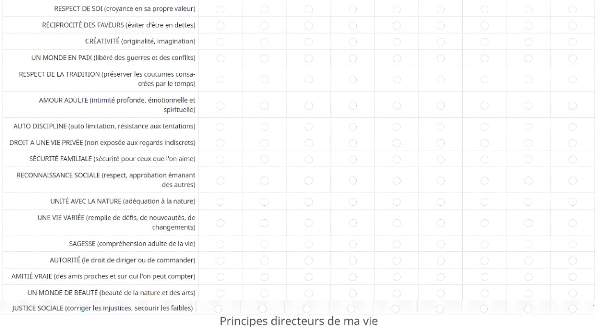
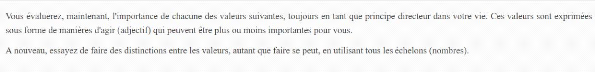
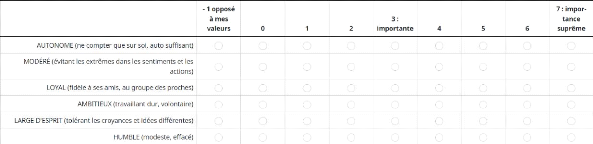
63

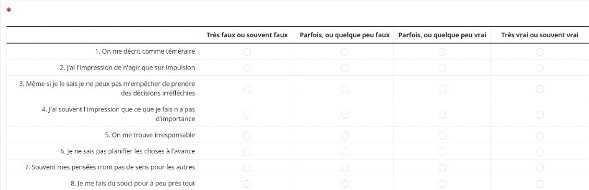
64
II. Le PID 5 BF
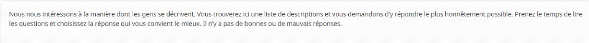
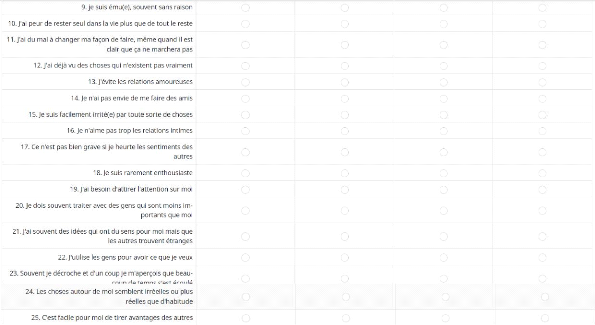
65
III. LPFS-BF 2.0
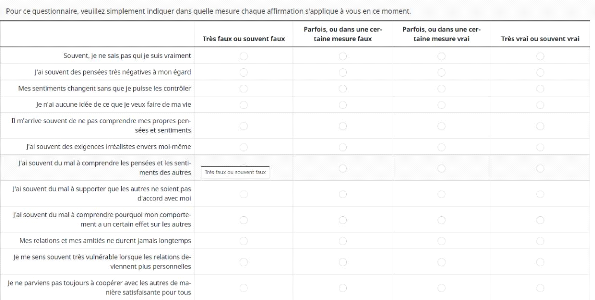
66
IV. BSL 23
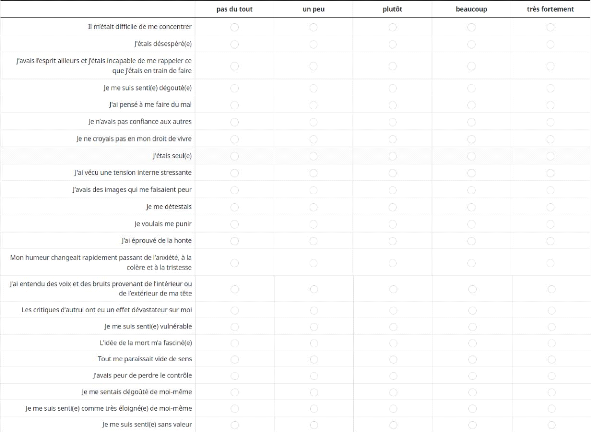
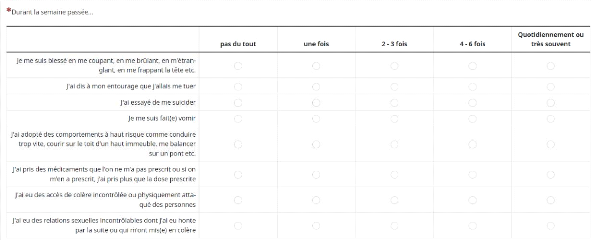
67
V. Communication de la recherche sur les
réseaux sociaux
68
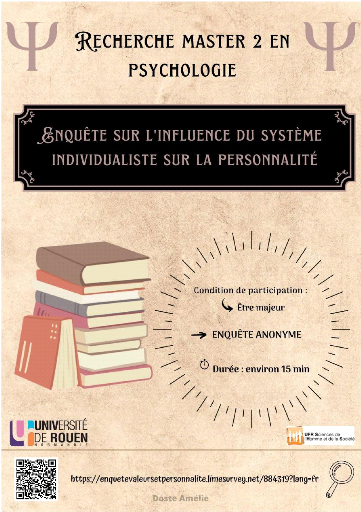
69
VI. Lettre d'information de la recherche
Enquête concernant le système
individualiste et la personnalité
Bonjour à toutes et tous.
Cette lettre d'information a pour but de vous aider
à comprendre exactement ce qui
implique votre éventuelle
participation à la recherche de sorte que vous puissiez prendre
une
décision éclairée à ce sujet. Prenez donc le
temps de la lire attentivement, et n'hésitez pas à
poser
toutes questions que vous jugerez utiles.
Dans le cadre de mon mémoire de recherche en
sciences humaines, nous menons une enquête visant à explorer le
système de valeurs et la personnalité de chacun.
Quel est l'objectif de cette étude ?
Dans un premier temps, elle a pour but d'étudier
l'influence du système de valeur
d'un individu sur sa
personnalité. Il s'agit plus précisément d'en apprendre
plus
sur la manière dont vous vous décrivez avec les valeurs
qui guident
votre vie quotidienne, ainsi que vos comportements.
Dans un second temps, cette étude a pour
objectif d'étudier le lien
entre l'individualisme et la
personnalité borderline.
En effet, nous nous demandons si le trouble
de la personnalité borderline
est symptomatique de la doctrine
individualiste, mise en avant dans notre société
actuelle.
4 La personnalité borderline se définit
par une attitude générale d'instabilité, impactant le
domaine émotionnel, les relations sociales et l'image de
soi.
4 L'individualisme est une conception philosophique,
politique, morale et sociologique qui privilégie la valeur et les droits
de l'individu par rapport à ceux de la
société.
Ce qui vous sera demandé :
Dans cet objectif, il vous sera demandé de
répondre à plusieurs affirmations questionnant vos valeurs, votre
personnalité ainsi que les difficultés et/ou souffrances que vous
pouvez éprouver, en cochant la réponse qui vous paraît
correspondre le mieux à ce que vous pensez.
? TW ? : Certaines affirmations évoquent la
question des automutilations, du suicide de la mort.
? La passation peut être compliqué pour vous
si vous êtes sensible à ces questions.
4 SOS Suicide : Si vous êtes en détresse
et/ou avez des pensées suicidaires, ou si vous voulez
aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter
le 3114, numéro vert d'aide psychologique et de soutien.
/! \ Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses,
il s'agit simplement de recueillir vos impressions.
??Durée :
La durée du questionnaire est d'environ 15
minutes.
Les réponses à ce questionnaire se font
sur la base du volontariat.
Aussi, vous êtes libre d'interrompre
l'étude à tout moment.
Les données recueillis sont anonymes et
confidentielles.
Par conséquent, il nous sera impossible de
retrouver
votre identité à partir de vos
réponses.
Qui peut répondre ?
70
Pour participer à cette étude, la seule
condition est d'être majeur.
71
Responsable de la recherche
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour
toute(s) question(s), remarque(s)
concernant ce projet de recherche, vous pouvez
communiquer avec :
L'étudiante : Doste Amélie, Master 2
Psychologie Clinique Psychopathologie, Université de Rouen Normandie :
amelie.doste@.univ-rouen.fr
Le directeur de recherche : Combaluzier Serge, Maitre de
Conférences en Psychologie, Psychologue et docteur en Psychologie,
Université de Rouen
Normandie :
serge.combaluzier@univ-rouen.fr
Répondre à ce questionnaire implique que
vous acceptiez que nous traitions vos réponses et les intégrions
à notre recherche. Pour cela, cliquez sur le bouton
"Suivant".



