|
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (BENIN)
*=*=*=*=*=*=*=*
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES
*=*=*=*=*=*



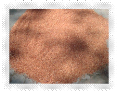
DEPARTEMENT D'ECONOMIE, DE SOCIO-ANTHROPOLOGIE ET
DE COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
Prédisposition à adopter le
décorticage mécanique et la fortification en fer du sorgho :
cas des ménages consommateurs de dibou du village Thian,
commune de Parakou.
THESE
Pour l'obtention du
Diplôme d'Ingénieur Agronome
Option : Economie, Socio-Anthropologie et
Communication
Présentée et soutenue
par :
Monyévèdo Tamingnon Morest
AGOSSADOU
Le mardi 15 Février 2011
Superviseur : Dr. ir. Anselme
ADEGBIDI
Co- Superviseur : Dr. ir. Polycarpe A. P.
KAYODE
Composition du Jury
Président : Prof. Valentin
AGBO
Rapporteur : Dr. ir. Anselme ADEGBIDI
Examinateur : Dr. ir. Pascaline
BABADANKPODJI
Examinateur : Dr. ir. Evariste
MITCHIKPE
UNIVERSITY OF ABOMEY-CALAVI (BENIN)
*=*=*=*=*=*=*=*
FACULTY OF AGRONOMY SCIENCES
*=*=*=*=*=*
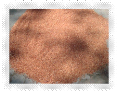



DEPARTEMENT OF ECONOMY, SOCIO-ANTHROPOLOGY AND
COMMUNICATION FOR RURAL DEVELOPMENT
Predisposition to adopt the mechanical dehulling and
iron fortification of sorghum: case of household consumers of dibou of
Thian village, Parakou township.
THESIS
Submitted for the Agricultural Engineer
Graduation
Option: Economy, Socio-Anthropology and
Communication
Presented and defended by
Monyévèdo Tamingnon Morest
AGOSSADOU
Tuesday, Febrary 15th,
2011
Supervisor: Dr. ir. Anselme
ADEGBIDI
Co- Supervisor: Dr. ir. Polycarpe A. P.
KAYODE
Jury composition
Chairman: Prof. Valentin AGBO
Reporter: Dr. ir. Anselme ADEGBIDI
Examinator: Dr. ir. Pascaline
BABADANKPODJI
Examinator: Dr. ir. Evariste MITCHIKPE
CERTIFICATION
Je certifie que ce travail a été
entièrement conduit et réalisé par Morest M. T.
AGOSSADOU, étudiant à la Faculté des Sciences
Agronomiques (FSA) de l'Université d'Abomey Calavi (UAC) au
Département d'Economie, de Socio-Anthropologie et de Communication pour
le développement rural (DESAC), sous ma supervision.
Le Superviseur
Dr. ir. Anselme ADEGBIDI
Agro-économiste,
Enseignant-chercheur au DESAC /FSA/UAC
La présente thèse a été
entièrement réalisée avec le soutien financier du Centre
Régional de Nutrition et d'Alimentation Appliquées (CERNA) de la
Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université
d'Abomey-Calavi.
« La crise de la nutrition ... c'est avant
tout le décès et l'invalidité des enfants, à vaste
échelle, ce sont les femmes qui entrent dans les statistiques de la
mortalité maternelle suite partiellement aux carences nutritionnelles et
ce sont les coûts sociaux et économiques qui obèrent le
développement et éteignent l'espoir. »
UNICEF (1998).
DEDICACES
A
Mon père Maurice Codjo AGOSSADOU et
à ma mère Romaine Assiba ZINSOU
pour tous les efforts consentis pour mon bien-être, depuis mon
enfance jusqu'à ce jour. Recevez ce travail en signe de ma profonde
gratitude et de la fierté que j'éprouve d'être votre
fils.
REMERCIEMENTS
Je remercie sincèrement :
G Docteur ingénieur Anselme ADEGBIDI qui, en
dépit de ses multiples occupations, n'a ménagé aucun
effort pour encadrer jusqu'au bout ce travail. Esprit d'analyse, rigueur,
équité et travail bien fait sont les principales leçons de
vie que j'ai pu tirer de ma collaboration avec vous. Vous demeurez pour moi un
modèle à suivre ;
G Docteur ingénieur Polycarpe A. P. KAYODE qui a
initié cette étude et qui, malgré ses multiples
occupations a pu la co-superviser jusqu'au bout. Votre rigueur et votre
dynamisme font de vous un homme qui force l'admiration. Recevez ici
l'expression de notre profonde reconnaissance ;
G Centre Régional de Nutrition et d'Alimentation
Appliquées (CERNA) pour avoir financé la réalisation de
cette recherche ;
G Professeur Rigobert C. TOSSOU, Docteur ingénieur
Houinsou DEDEHOUANOU et Docteur ingénieur GANDONOU Esaïe qui nous
ont toujours marqué par leur simplicité et leur constante
disponibilité à nous écouter et conseiller afin
d'améliorer notre travail ;
G tout le corps professoral de la FSA et
particulièrement celui du DESAC. Sans vous, nous ne saurions nous
prévaloir d'une formation agronomique. Infiniment merci ;
G Monsieur André HESSOUH, Administrateur adjoint de
l'Institut International d'Agriculture Tropicale (IITA), qui nous a permis
d'entrer en contact avec la Section des Etudes Socio-économiques de
ladite institution afin de recevoir des conseils pour l'amélioration de
la qualité scientifique de notre travail ;
G toute l'équipe de Section des Etudes
Socio-économiques de l'IITA et particulièrement à Monsieur
Razak ADEOTI ;
G Ingénieurs Johanès U. A. AGBAHEY, Augustin
AOUDJI, Désiré AGOSSOU, Qawiyy AHOUNDE, Claude Agossou HONFO,
Déo-Gracias HOUNDOLO, Armand YEVIDE et Gisèle DENOU pour avoir
pleinement joué votre rôle d'ainé. Vos aides et conseils
ont été d'une grande utilité ;
G Monsieur Serge GBEGAN et sa femme pour leur appui
inconditionnel ;
G Romuald DJEGBENOU qui n'a jamais hésité
à nous consacrer son temps quand il était
nécessaire ;
G tous mes camarades de la 34ème promotion
de la FSA, particulièrement ceux du DESAC, pour les agréables
moments passés ensemble durant cinq années ;
G les membres de mon groupe d'étude `'KNOWLEDGE IS A
REAL POWER'', ANAGO V. Mélain, DEGUENONVO Nicaise, GBEDOMON R. Castro,
IDOHOU F. A. Rodrigue et SALAKO K. Valère pour ces moments de passion
passés ensemble ;
G tous mes amis de la 35ème promotion,
particulièrement Massihoundath O-K. L. SANNI, Indira M. NONFON. Vous
avez été une seconde famille pour moi ;
G toutes les personnes qui ont facilité ce travail sur
le terrain, en particulier Monsieur Ayouba G. KOURA et sa famille, Kader SAKA,
Adam B. SUANON et Joseph BEKOUROU ;
G tous mes chers frères et soeurs pour le soutien
indéfectible dont vous avez toujours fait preuve à mon
égard chaque fois que j'étais dans le besoin ;
G mes cousins Euloge, Hervé et Didier AGOSSADOU et mes
oncles Théophile et Paul AGOSSADOU qui ont suscité mon
entrée à la FSA et qui n'ont jamais cessé de me soutenir
moralement ;
G Mademoiselle Sandrine S. S. L. SEGLA et toute sa famille.
Des mots ne suffiront pas pour vous exprimer ma gratitude ;
G toutes les personnes qui ont contribué d'une
manière ou d'une autre à ma formation depuis la maternelle
jusqu'à l'aboutissement de cette thèse ;
1.
RESUME
L'anémie ferriprive est un réel problème
de santé publique en Afrique sub-saharienne. Le Borgou est l'un des
départements touchés au Bénin par ce mal. La principale
raison qui explique la prévalence de l'anémie ferriprive dans ce
département est la faible biodisponibilité du fer contenu dans le
sorgho, une des céréales les plus consommées dans le
milieu. Un des moyens utilisés pour lutter contre cette maladie est le
décorticage et la fortification en fer du sorgho, avant sa mouture. Dans
cette optique, et dans le cadre d'un projet, une plate-forme de
décorticage mécanique et de fortification en fer a
été installée dans Thian, un village de la commune de
Parakou, département du Borgou. La présente étude,
réalisée dans ce village, a porté sur 120 `'chefs
cuisine'' issues de 120 ménages consommateurs de dibou
(pâte de sorgho) et consistait à analyser les déterminants
de la prédisposition de ces ménages à l'adoption de cette
innovation, les déterminants de leurs consentements à payer (CAP)
pour les opérations de décorticage mécanique et de
fortification en fer du sorgho, et à évaluer la
rentabilité financière de cette activité de
décorticage et de fortification. L'outil utilisé pour l'analyse
des déterminants de la prédisposition est le modèle Logit.
Celui utilisé pour analyser les déterminants du consentement
à payer est le modèle de régression linéaire. Pour
l'évaluation de la rentabilité financière, la
méthode des cash-flows a été utilisée.
Les résultats ont montré que les principaux
déterminants de la prédisposition à adopter le
décorticage mécanique et la fortification en fer du sorgho sont
le revenu de l'enquêtée, son appartenance à la phase pilote
du projet, la complexité perçue de la procédure de
décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho, la
compatibilité de l'innovation avec les normes et valeurs de son
ménage et la perception qu'elle a de son statut social après
l'adoption de l'innovation. Quant au CAP, il est principalement
influencé par l'appartenance de l'enquêtée à la
phase pilote du projet et la quantité moyenne de sorgho consacrée
à la consommation au sein du ménage. La VAN calculée en
appliquant un taux d'actualisation de 12 % s'est révélée
négative. L'activité de décorticage mécanique et de
fortification en fer du sorgho n'est donc pas financièrement rentable.
Toutefois, le TRI s'élevant à 9 % montre qu'avec un coût
d'opportunité du capital inférieur à 9 %, on peut
rentabiliser financièrement cette activité en l'absence de toute
autre perturbation de l'environnement économique.
Mots
clés : adoption, innovation,
consentement à payer, modèle Logit, modèle de
régression linéaire, VAN, TRI.
2.
ABSTRACT
Iron
deficiency anemia is a real public health problem in sub-Saharan Africa. Borgou
department is one which is touched in Benin by this disease. The main reason
for the prevalence of iron deficiency anemia in this department is the low
bioavailability of iron in sorghum which is one of the most widely consumed
grain in the middle. To fight against this disease, we must dehull and iron
fortified sorghum prior to milling. In this context and as part of a project, a
platform of mechanical dehulling and iron fortification has been installed in
Thian, a village in the Parakou township, Borgou department. This study,
conducted in this village, was made on 120 ''kitchen responsible'' from 120
households consuming dibou (sorghum paste) and was to analyze the
determinants of willingness of households to the adoption of this innovation,
determinants of their willingness to pay (WTP) for operations of mechanical
dehulling and iron fortification of sorghum and to evaluate the financial
profitability of this dehulling and fortification activity. The tool used to
analyze the determinants of predisposition is the Logit model. The one used to
analyze the determinants of willingness to pay is the linear regression model.
To evaluate the financial profitability, the cash flow method was used.
The results showed that the main determinants of willingness
to adopt the mechanical dehulling and iron fortification of sorghum are the
income of the respondent, his membership in the pilot phase of the project, the
perceived complexity of the procedure of mechanical dehulling and of iron
fortification of sorghum, the compatibility of the innovation with the norms
and values of his household and the perception she has of her social status
after the adoption of innovation. As for the WTP, it is mainly influenced by
membership of the respondent in the pilot phase of the project and the average
amount of sorghum dedicated to consumption in the household. NPV calculated
using a discount rate of 12 % was negative. The activity of mechanical shelling
and iron fortification of sorghum is not financially viable. However, the IRR
amounting to 9 % shows that with an opportunity cost of capital less than 9 %,
this can be financially profitable activity in the absence of any disturbance
of the economic environment.
Keywords: adoption, innovation,
willingness to pay, Logit model, linear regression model, NPV, IRR.
LISTE DES ABREVIATIONS
BIDOC : Bibliothèque Centre de
Documentation
BIT : Bureau International du Travail
CAP : Consentement A Payer
CAPOD : Projet de Renforcement des
Capacités en Conception et Analyse des Politiques de
Développement
CeCPA : Centre Communal pour la Promotion
Agricole
CERNA : Centre Régional de Nutrition
et d'Alimentation Appliquées
CHD : Centre Hospitalier
Départemental
CMRP : Centre Médical
Régional de Parakou
CNLS : Comité National de Lutte
contre les IST/VIH/SIDA
CRTA : Centre de Recherche en Technologie
Alimentaire
DDSP : Direction Départementale de
la Santé Publique
EDSB : Enquête Démographique
et de Santé au Bénin
FAN : Facteurs Antinutritionnels
FAO : Food and Agriculture Organisation
FCFA : Franc de la Communauté
Financière Africaine
FSA : Faculté des Sciences
Agronomiques
IITA : Institut International d'Agriculture
Tropicale
INRAB : Institut National des Recherches
Agricoles du Bénin
INSAE : Institut National de la Statistique
et de l'Analyse Economique
MCO : Moindres Carrés Ordinaires
OMS : Organisation Mondiale de la
Santé
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PPR : Peste des Petits Ruminants
RESET : Regression Specification Error
Test
RGPH : Recensement Général de
la Population et de l'Habitation
SIDA : Syndrome Immuno-Déficitaire
Acquis
TRI : Taux de Rentabilité Interne
UAC : Université d'Abomey-Calavi
UNICEF : Organisation des Nations Unis pour
l'Enfance et l'Education
VAN: Valeur Actuelle Nette
VIH : Virus d'Immunodéficience Humaine
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Schéma d'adoption d'un nouveau
produit alimentaire selon Rogers.
1
Figure 2 : Carte du département du
Borgou mentionnant la commune de Parakou.
16
Figure 3: Structure du revenu des `'chefs cuisine''
enquêtés.
39
Figure 4: Périodes de consommation et
fréquences absolues des ménages consommateurs des principaux
repas.
43
Figure 5: Les facteurs d'anémie selon les
enquêtées.
46
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Echantillonnage
1
Tableau 2 : Noms, types, codes, modalités et
signes attendus des coefficients des variables du modèle Logit
.............................................................................................
25
Tableau 3 : Caractéristiques des
différents modes de révélation de la valeur
27
Tableau 4 : Noms, types, codes,
modalités et signes attendus des coefficients des variables du
modèle de régression linéaire multiple.
31
Tableau 5 : Hypothèses à
vérifier, problèmes liés à leur violation et
méthodes/tests utilisés pour leur détection.
32
Tableau 6 : Caractéristiques
démographiques des ménages enquêtés
36
Tableau 7 : Répartition des `'chefs
cuisine'' enquêtées en fonction de leurs caractéristiques
sociales
37
Tableau 8 : Résultats de la
régression logistique binomiale
49
Tableau 9 : Matrice de corrélation
entre les variables explicatives du modèle de régression
linéaire.
57
Tableau 10: Résultats de la
régression linéaire multiple.
58
Tableau 11 : Résultats du test RESET de
Ramsey.
59
Tableau
12 : Analyse financière de l'activité de décorticage
mécanique et de fortification en fer du sorgho
64
Tableau 13 : Réaction de l'activité de
décorticage et de fortification en fer du sorgho dans trois situations
différentes
..............................................................................63
SOMMAIRE
CERTIFICATION
i
DEDICACES
iv
REMERCIEMENTS
v
RESUME
vii
ABSTRACT
viii
LISTE DES ABREVIATIONS
viii
LISTE DES FIGURES
xi
LISTE DES TABLEAUX
xi
Première PARTIE : INTRODUCTION GENERALE,
CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE L'ETUDE
1
CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE
2
CHAPITRE II : CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE
L'ETUDE
7
CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
13
Deuxième partie : RESULTATS, ANALYSES ET
DISCUSSIONS
35
CHAPITRE IV : CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET
SOCIOECONOMIQUES DES UNITES D'ENQUETE.
36
CHAPITRE V : HABITUDES ALIMENTAIRES,
CONNAISSANCES ET ATTITUDES DES ENQUETEES RELATIVES A L'ANEMIE FERRIPRIVE.
42
CHAPITRE VI : ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA
PREDISPOSITION DES MENAGES A ADOPTER LE DECORTICAGE MECANIQUE ET LA
FORTIFICATION EN FER DU SORGHO.
48
CHAPITRE VII : ANALYSE DES DETERMINANTS DU
CONSENTEMENT A PAYER DES MENAGES `'CONSOMMATEURS'' DE DIBOU POUR LE
DECORTICAGE MECANIQUE ET LA FORTIFICATION EN FER DU SORGHO
56
CHAPITRE VIII : EVALUATION DE LA RENTABILITE
FINANCIERE DE L'ACTIVITE DE DECORTICAGE MECANIQUE ET DE FORTIFICATION EN FER DU
SORGHO.
62
Troisième PARTIE : CONCLUSION ET
SUGGESTIONS
65
CHAPITRE IX : CONCLUSION ET SUGGESTIONS
67
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
70
ANNEXES
Première PARTIE
INTRODUCTION GENERALE, CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE
DE L'ETUDE
3. CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE
3.1.1. 1.1. Introduction
L'amélioration de l'alimentation des adultes
entraîne une plus grande productivité physique et des taux de
croissance économiques plus élevés (Inwent, 2006). La
sous-alimentation a par contre des conséquences graves sur le
développement économique et social des individus et des pays. Il
a été constaté qu'au moins 50% des maladies sont
attribuables à la malnutrition qui est un état physiologique,
pouvant devenir pathologique, dû à une carence ou à une
consommation excessive d'un ou de plusieurs éléments nutritifs
(Inwent, 2006). Les carences sont le plus souvent associées à une
déficience en vitamines ou en sels minéraux. Leurs
conséquences sont très sérieuses et influencent de
manière considérable les taux de morbidité et de
mortalité. On les rencontre très rarement dans les pays
développés où on constate plutôt, et plus souvent,
des problèmes dus à des apports excessifs.
Les carences en vitamines ou en sels minéraux peuvent
avoir plusieurs origines. Mais, la plupart du temps, elles proviennent d'une
alimentation pauvre en éléments nutritifs. Ainsi, dans les
régions où la nourriture de base est le maïs, une
déficience en niacine, une vitamine B, peut survenir, favorisant
l'apparition d'affections telles que la pellagre ; dans les régions
où la nourriture de base est le sorgho, une carence en fer peut
prévaloir. Dans le dernier cas, le déficit est dû à
la présence dans la céréale (précisément
dans le péricarpe) de facteurs qualifiés d'antinutritionnels. Il
importe donc de réduire le taux de ces facteurs antinutritionnels (FAN)
par élimination du péricarpe du grain : on parle de
décorticage. Ce décorticage, pendant qu'il permet
d'éliminer les FAN, contribue à la réduction de la
quantité de fer disponible dans le grain. Il faut donc penser à
un enrichissement en fer du produit décortiqué : on parle de
fortification.
Dans le Nord-Bénin, où le sorgho constitue la
base de l'alimentation, une plate-forme de décorticage et fortification
a été installée dans un village, dans le cadre du projet
`'Introduction of a mechanical dehuller and iron fortification in the
traditional processing of sorghum in Benin to improve the iron status of rural
consumers of porridge'' initié par le Centre Régional de
Nutrition et d'Alimentation Appliquées (CERNA), afin d'éradiquer
de ce milieu l'anémie martiale. Pour la phase d'expérimentation
de ce projet, seule une portion de la population du village a été
associée. Cette portion de la population est composée de 26
enfants et 16 femmes provenant de 24 ménages pour les besoins de cette
étude. Ces 24 ménages ont bénéficié
gratuitement des services de la plate-forme, car les charges liées
à cette offre de service sont supportées par le projet. La phase
d'expérimentation est en finalisation et la phase d'exécution
proprement dite du projet doit voir le jour. Pour le compte de cette phase
d'exécution, l'information relative à la plate-forme et
l'accès à ses services seront donnés à toute la
population du village. A partir de ce moment, les ménages qui
désirent bénéficier de ces services doivent contribuer
à supporter les charges y afférentes.
La présente étude, initiée dans le but
d'identifier les caractéristiques des ménages qui
désirent, non seulement, bénéficier des services de la
plate-forme, mais aussi contribuer à supporter les charges liées
à l'offre de ces services s'inscrit dans le cadre des travaux de
recherche de fin de formation requis pour l'obtention du Diplôme
d'Ingénieur Agronome à la Faculté des Sciences
Agronomiques (FSA) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC). Le
présent document s'articule autour de trois points. Le premier point
aborde l'introduction, la problématique de la recherche, les cadres
conceptuel, théorique et méthodologique. Le second point expose
les résultats auxquels nous sommes parvenus et les analyses et
discussions qu'ils ont suscitées et le troisième point prend en
compte la conclusion et les suggestions.
3.1.2. 1.2.
Problématique et justification de la recherche
La carence en fer touche 4 à 5 milliards de personnes
soit 66 à 80% de la population mondiale (OMS, 2003). L'anémie
quant à elle affecte environ 2 milliards de personnes (soit 30% de la
population mondiale). D'après les chiffres de l'OMS, l'anémie en
Afrique toucherait 45 millions d'enfants de moins de 5 ans, 58 millions de
femmes en âge de procréer et 11 millions de femmes enceintes. En
Afrique sub-saharienne, la carence en fer est la principale cause
d'anémie. Cette forme d'anémie, causée par la carence en
fer, est désignée sous le vocable d'anémie martiale (ou
ferriprive). Les femmes en âge de procréer et les enfants
constituent les groupes les plus vulnérables. Les conséquences de
cette maladie sur ces groupes vulnérables sont énormes.
L'anémie ferriprive provoque des dégâts
irréversibles au niveau du cerveau, une diminution de la réponse
immunitaire et donc une augmentation de la fréquence des infections chez
les enfants en bas âge. Chez l'adulte, elle provoque de la fatigue et une
capacité au travail réduite. Plus de naissances
prématurées et d'enfants mort-nés sont les
dégâts de ce mal chez la femme enceinte (Franziska, 2000).
La carence en fer est principalement liée au fait que
le fer alimentaire absorbé ne permet pas de couvrir les besoins
élevés des populations à risques (Berger et Dillon,
2002 ; Franziska, 2000). Ceci est dû soit à la consommation
d'aliments pauvres en fer, soit à la non ou faible disponibilité
du fer contenu dans les aliments consommés. Pour faire face à ce
problème, diverses stratégies existent comportant chacune des
avantages et des inconvénients (Dillon, 2000). Il s'agit de la
diversification alimentaire, de la supplémentation en fer, des mesures
de santé publique et de l'enrichissement (ou fortification) en fer des
aliments (Inwent, 2006 ; Alaoui, 2005 ; Berger et Dillon, 2002;
Dillon, 2000). Dans les pays en développement, la fortification est de
plus en plus, souvent, reconnue comme une approche efficace, à moyen et
à long termes pour améliorer l'état en micronutriments de
larges couches de la population (Inwent, 2006). Elle est
considérée comme l'un des moyens les moins coûteux pour
surmonter la malnutrition en micronutriments (Banque mondiale, 1994 ;
Unicef, 1998). Elle consiste à ajouter du fer dans un aliment de
consommation courante, afin d'augmenter le niveau de consommation de ce
nutriment par la population (Inwent, 2006 ; Berger et Dillon, 2002).
L'aliment qui transporte le nutriment est appelé véhicule ou
vecteur.
Au Bénin, selon les statistiques de l'EDSB-III1(*) (2006), l'anémie
ferriprive touche respectivement 78 % et 61 % d'enfants de 6 à 59 mois
et de mères de 15 à 49 ans. Quatre vingt deux pour cent (82 %)
des enfants anémiés se situent en milieu rural, contre 70 % en
milieu urbain. Chez les enfants, les taux d'anémie ferriprive les plus
élevés se retrouvent dans les départements de l'Alibori
(89,7 %), de la Donga (88,1 %) et les plus faibles dans les départements
du Littoral (60,3 %) et du Borgou (69,6%). Chez les mères, les taux
d'anémie ferriprive sont les plus élevés dans les
départements de l'Ouémé (75 %), l'Alibori (67 %),
l'Atlantique (65 %), le Plateau (63 %) et le Mono (61 %). Les taux les plus
faibles se retrouvent dans les autres départements et sont compris entre
50 % et 57 %. Ces statistiques montrent que l'anémie ferriprive est un
réel problème de santé publique au Bénin. Des
actions concrètes doivent, de ce fait, être menées pour
l'éradication de ce mal. Cet objectif ne peut être atteint sans
l'identification des causes réelles de cette forme d'anémie dans
ces milieux touchés. Il faut donc identifier le repas le plus
consommé, voir sa composition chimique (notamment en fer) et
évaluer la biodisponibilité de ce fer afin de savoir si
l'anémie ferriprive, dans ces milieux, est liée à
l'insuffisance de fer dans les repas consommés ou à la non
disponibilité pour l'organisme du fer contenu dans les aliments
consommés. Dans le premier cas, une fortification serait suffisante,
mais dans le second, une amélioration de la biodisponibilité sera
plus raisonnable.
Dans cette optique, une étude a été
conduite dans le nord-Bénin par Kayodé et al
(2005). Cette étude a révélé que le sorgho est une
céréale qui occupe une place importante dans les habitudes
alimentaires des populations concernées. Cette place importante
qu'occupe cette céréale est imputable à la
diversité d'aliments qui en sont issus, et à leur importance
respective dans l'alimentation des ménages. Il s'agit des pâtes
(dibou, sifanou, foura), des bouillies (koko, sorou,
kamanguia) et des boissons (tchoukoutou, chakpalo). Selon ces
mêmes auteurs, seulement 2 à 6 % des 4 mg/100g2(*) du fer contenu dans le sorgho
est disponible aux consommateurs de ces types d'aliments. Ce faible niveau de
disponibilité du fer est dû à son inhibition par les
facteurs antinutritionnels (FAN), c'est-à-dire les tannins, le
calcium/phosphore, les phytates et fibres et les oxalates, qui
sont principalement localisés dans le péricarpe des graines
(Kayodé et Denou, 2007). A partir de ce moment, la cause de
l'anémie ferriprive dans le nord du Bénin n'est pas une
insuffisance de fer dans les repas consommés, mais plutôt une
faible disponibilité du fer contenu dans les aliments
consommés.
Pour améliorer la biodisponibilité du fer
contenu dans le sorgho, il convient, logiquement, de réduire, voir
supprimer, les facteurs antinutritionnels qui y sont contenus et ce, par
l'enlèvement du péricarpe des graines.
Il y a quelques décennies, les consommateurs du sorgho
se livraient chaque jour à un travail manuel d'enlèvement du
péricarpe et de pulvérisation des grains avant de pouvoir
préparer le repas quotidien (Bassey et Schmidt, 1990). Les
difficultés inhérentes à ces activités ont conduit
ces consommateurs à désormais pulvériser directement les
grains (de sorgho) avec l'apparition du moulin. A partir de ce fait, il ne
serait plus raisonnable de proposer à ces consommateurs de sorgho
d'enlever manuellement (ou traditionnellement) le péricarpe des grains.
Il faut donc penser à une technologie pouvant jouer ce rôle. Mais
l'enlèvement du péricarpe du sorgho, dans le but de
réduire ou éliminer les facteurs antinutritionnels, n'est pas
sans conséquences.
En effet, les 4mg/100g de fer contenu dans le grain de sorgho
se localisent au même endroit que les facteurs antinutritionnels, i.e.
dans le péricarpe. La réduction ou l'élimination des
facteurs antinutritionnels par enlèvement du péricarpe entraine
alors une réduction ou une élimination du fer contenu dans le
sorgho. Pour ne pas revenir à la situation de départ où
les consommateurs du sorgho entier présentent une carence en fer, un
enrichissement des graines ou de la farine doit être effectué
après l'enlèvement du péricarpe.
Ainsi, par le biais du projet intitulé `'Introduction
of a mechanical dehuller and iron fortification in the traditional processing
of sorghum in Benin to improve the iron status of rural consumers of porridge''
initié par le Centre Régional de Nutrition et d'Alimentation
Appliquées (CERNA) de la Faculté des Sciences Agronomiques de
l'Université d'Abomey-Calavi, une plate-forme de décorticage
mécanique et de fortification en fer du sorgho est installée dans
Thian, un village de la commune de Parakou, département du Borgou. Le
décorticage ou l'enlèvement du péricarpe se fait de
façon mécanique à l'aide d'un décortiqueur de type
Engelbert3(*) et la
fortification en fer est manuelle (voir le processus en annexe 1).
Le caractère nouveau de cette plate-forme et des
services qu'elle offre fait d'elle une innovation. Une phase
d'expérimentation de l'innovation a été effectuée
entre octobre 2009 et juin 2010 dans le but d'évaluer son adaptation aux
réalités alimentaires du village. Pour cette raison, vingt-quatre
ménages contenant au moins un individu anémié4(*) ont été retenus
pour décortiquer mécaniquement et fortifier en fer gratuitement
le sorgho avant de préparer le repas. Avant le démarrage de la
phase d'exécution proprement dite du projet, au cours de laquelle les
services offerts par la plate-forme seront désormais payants et son
accès sera donné à toute la population, quelques questions
méritent d'être posées. Tous les ménages du village
accepteront-ils décortiquer mécaniquement et fortifier leur
sorgho avant de préparer le repas, dans le but d'améliorer leur
statut en fer ? Accepteront-ils payer pour le décorticage
mécanique et la fortification en fer du sorgho ? Et quels
montants sont-ils prêts à payer pour ? Quels sont les
facteurs qui influencent cette décision de décortiquer, fortifier
le sorgho et payer pour cela ? Quels sont les facteurs qui influencent le
montant que les ménages se proposent de payer ? Ces montants
suffiront-ils pour couvrir les charges de fonctionnement de la
plate-forme ?
C'est dans la perspective de contribuer à
répondre à ces questions, que la présente étude
intitulée « Prédisposition à adopter le
décorticage mécanique et la fortification en fer du sorgho :
cas des ménages consommateurs de dibou du village Thian,
commune de Parakou. » a été initiée.
4. CHAPITRE II :
CADRES CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE L'ETUDE
4.1.1. 2.1. Cadre conceptuel
Un concept est une représentation mentale, abstraite et
générale d'une catégorie de phénomènes. Un
même concept peut alors avoir plusieurs sens, d'où la
nécessité de bien définir le concept utilisé et le
sens qui lui est donné dans l'étude (Daane et
al. 1992). Les divers concepts utilisés dans le cadre de cette
étude sont : l'innovation, la prédisposition à
l'adoption d'une innovation, le consentement à payer et la
rentabilité financière.
Ø Innovation
Le terme innovation a bénéficié de
nombreuses définitions dans la littérature et ceci selon le
contexte dans lequel il est utilisé. Le contexte le plus proche de celui
qui est le notre est celui agricole où Chantran (1972) conçoit
l'innovation comme l'introduction d'une pratique agricole nouvelle, parfois une
modification d'une pratique traditionnelle et plus rarement l'adoption d'un
comportement socio-économique nouveau. Adams (1982) définit
l'innovation comme une nouvelle idée, une méthode pratique ou
technique permettant d'accroître de manière durable la
productivité et le revenu agricole.
Dans le contexte qui est le notre, ces définitions du
concept d'innovation ne sont pas tout à fait compatibles. La
définition du terme innovation qui nous semble le plus proche de notre
contexte d'étude nous vient du Glossaire pour le développement
durable (Agora 21). Selon Agora 21 (2001), « l'innovation peut
être définie comme la réalisation de la nouveauté.
Alors que l'invention se limite à l'idée nouvelle sans
réelle confrontation au besoin qu'elle entend satisfaire, l'innovation
franchit ce pas considérable qui va de l'idée à sa
réalisation concrète et à la satisfaction du besoin.
L'innovation, c'est le changement réalisé, qu'il soit
limité ou radical, qu'il porte sur le concept de produit, sur le
procédé de fabrication ou sur l'organisation,...». Cette
définition a retenu notre attention parce qu'elle contient trois notions
assez importantes : changement, produit et procédé.
Aujourd'hui, les femmes, pour obtenir la farine de sorgho qui
servira à la préparation du dibou emmène
directement le sorgho dans une minoterie pour la mouture, après
nettoyage et séchage de celui-ci. L'innovation dont il s'agit dans le
cadre de cette étude est une décortiqueuse jumelée
à un équipement de fortification qui permettra aux femmes, avant
la mouture, de décortiquer et en même temps de fortifier le sorgho
qui donnera la farine à utiliser pour la préparation du
dibou. Ce dibou, de type nouveau, obtenu
après décorticage et fortification n'aura plus les mêmes
propriétés organoleptiques et nutritionnelles que celui obtenu
sans décorticage et fortification. L'innovation alors, dans notre cas,
est un « changement » intervenu dans le
« procédé » de `'fabrication'' d'un
« produit » de type nouveau qui est le dibou
amélioré.
Ø Prédisposition à l'adoption d'une
innovation
Selon Rogers (1983), l'adoption d'une innovation est un
processus mental à travers lequel une unité décisionnelle,
quelle soit un individu ou une organisation, passe par la simple connaissance
d'une innovation, à la formation d'une attitude à l'égard
de celle-ci, à la décision d'adoption ou de rejet, et, enfin
à la confirmation de cette décision. Cette définition
cadre parfaitement avec notre cadre d'étude. Cependant, nous nous
arrêterons à la phase de prise de décision d'adoption ou de
rejet de l'innovation. La décision d'adoption ou de rejet ne se limite
pas uniquement, dans notre cas, à l'acceptation ou non de
décortiquer et de fortifier le sorgho mais plutôt à
l'acceptation ou non de décortiquer, fortifier le sorgho et payer une
somme d'argent pour ces opérations.
On dira qu'un individu est prédisposé à
adopter l'innovation lorsqu'au bout de ce processus mental, il décide
d'adopter, du moins de l'essayer au moins pour une première fois. Dans
une autre situation, l'individu est considéré comme non
prédisposé.
Ø Consentement à payer
Selon Robin et al. (2008), le consentement
à payer se définit comme le prix maximum que nous serions
prêts à payer, dans des conditions normales de marché, pour
acquérir un bien ou un service, une caractéristique
spécifique d'un produit ou encore une information. C'est donc une mesure
de la valeur économique que nous accordons à un bien ou à
un service. Cette valorisation économique des biens ou des services,
selon Terra (2005), se fait de deux manières : la participation qui
désigne la propension de l'enquêté à répondre
oui ou non à la question de savoir s'il consent
à payer pour obtenir un bien ou un service donné et la
valorisation qui représente le montant que l'enquêté, ayant
accepté participer, décide de payer. La participation, comme nous
l'avons vu précédemment, s'est effondrée dans le concept
d'adoption. Chaque fois que nous parlons alors de consentement à payer,
nous faisons référence à la valorisation.
Ø Rentabilité
financière.
Le dictionnaire économique définit la notion de
rentabilité comme la « capacité » d'un
capital placé ou investi à procurer des revenus exprimés
en termes financiers. On distingue cependant deux sortes de rentabilité
: la rentabilité financière et la rentabilité
économique. La notion de rentabilité paraît en
première analyse très simple : le capital génère un
profit, et donc le rapport entre le capital et le profit se traduit par un taux
de rentabilité. Elle traduit de ce fait le rapport entre le revenu
obtenu ou prévu et les ressources employées pour l'obtenir. La
notion de rentabilité s'applique non seulement aux entreprises mais
aussi à tout autre investissement. Elle représente alors
l'évaluation de la performance de ressources investies par des
investisseurs (FAO, 2005). Lorsque l'évaluation de la performance est
faite du point de vue d'un agent particulier, on parle de rentabilité
financière (Commission Européenne, 2004). Mais lorsque
l'évaluation de la performance est faite du point de vue de la
collectivité, on parle de rentabilité économique
(Commission Européenne, 2004). Dans le cadre de cette étude,
seule la rentabilité financière nous importe.
4.1.2. 2.2. Cadre théorique
L'adoption et la diffusion des nouvelles technologies tiennent
une place importante dans la littérature économique en
général (Geroski, 2000) et dans les domaines particuliers de
l'économie agricole (Sunding et Zilberman, 2001). Depuis très
longtemps, les chercheurs, dans ces domaines particuliers, ont reconnu que les
adoptions ne sont pas des événements instantanés mais le
résultat d'un processus de décision consistant en des
séquences d'actions et de décisions (Rogers, 1995; Robertson,
1971; Zaltman et Stiff, 1973). Plusieurs différentes séquences
ont été proposées dans les études empiriques. Elles
sont souvent fonction de la nature de l'innovation en question.
Probablement, la séquence la plus connue et la plus
utilisée est celle proposée par Rogers (1962), surtout celle
basée sur les innovations agricoles. Elle se résume à cinq
étapes : la prise de conscience ou la connaissance,
l'intérêt, l'évaluation, l'essai et l'adoption. Dans le cas
de la présente étude, rappelons-le, l'innovation est un ensemble
d'équipements visant un changement dans le processus de transformation
du sorgho en dibou et une amélioration de la qualité
nutritionnelle de ce repas. La finalité est donc l'obtention d'un repas
(nouveau) avec des caractéristiques différentes de celles de
l'ancien. Dans ce cadre, Rogers (1971) propose un cycle d'adoption se
résumant aux cinq étapes précédemment citées
que nous présentons sur la figure 1 :

Figure 1 : Schéma d'adoption d'un nouveau
produit alimentaire selon Rogers.
Dans cette étude, seules les étapes 1, 2 et 3
nous intéresse car c'est à ces niveaux que le processus de
décision d'essayer la technologie ou non par les `'chefs cuisine'' a
lieu. Dans l'optique de la compréhension de ce processus d'adoption ou
non d'une nouvelle technologie, Richefort (2008) fait référence
à deux modèles : le modèle de diffusion
épidémiologique et le modèle des choix rationnels
d'adoption.
Le modèle de diffusion épidémiologique
fut, à l'origine, développé pour étudier la
dissémination des maladies et des épidémies au sein de la
population. En économie, ce modèle permet d'évaluer la
dynamique de la probabilité d'adoption agrégée d'une
innovation par l'ensemble de ses usagers potentiels. Elle ne retiendra donc pas
notre attention, car dans cette étude il ne s'agit pas d'évaluer
la dynamique de la probabilité d'adoption de l'innovation mais
plutôt de la compréhension du processus de décision de
l'adopter ou non.
Le modèle des choix rationnels d'adoption, qui est
aussi appelé modèle de choix discret ou modèle de seuil,
permet d'évaluer les probabilités d'adoption des nouvelles
technologies par un individu (ou une firme) représentatif. Ce
modèle fait l'hypothèse qu'un raisonnement économique
rationnel, fondé sur la maximisation d'une fonction objectif sous
contraintes, guide le timing des choix individuels. Théoriquement,
l'individu (représentatif) adoptera une nouvelle technologie s'il est
rationnel d'agir comme cela, c'est-à-dire si son utilité
espérée avec l'adoption est supérieure a son
utilité sans adoption. L'occurrence de l'adoption technologique est
alors expliquée en croisant les réalisations de la variable
discrète à expliquer avec celles d'un certain nombre de variables
explicatives dont les réalisations peuvent être
indifféremment de nature qualitative ou quantitative. Ces variables
explicatives peuvent concerner à la fois des caractéristiques de
la nouvelle technologie à adopter ainsi que des caractéristiques
des adopteurs potentiels et de leur contexte d'adoption. Comme il s'agit d'une
probabilité, elle doit être comprise entre 0 et 1 et ne peut
être spécifié de façon linéaire. Le choix de
la relation entre la variable à expliquer et les variables explicatives
se porte alors sur deux types de fonction : la fonction de répartition
de la loi normale (modèle Probit) et la fonction de répartition
de la loi logistique (modèle Logit). Ce modèle des choix
rationnels, dont les principes répondent à ceux de la
théorie de la maximisation de l'utilité (Adesina et Seidi, 1995;
Adesina, 1996 ; Rahm et Huffman, 1984), est celui qui a été
retenu pour servir de fil conducteur de notre étude.
Plusieurs variables explicatives ont été
retenues pour expliquer la décision d'adoption ou non du
décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho.
Ces variables sont pour la plupart tirées de la littérature
existante en matière d'adoption d'innovation. Les autres émanent
d'une intuition ou d'observations faites sur le terrain. Par exemple, les
variables telles que complexité et compatibilité nous ont
été inspirées de la théorie de la diffusion des
innovations de Rogers (1983) pour qui, cinq facteurs
déterminent l'adoption d'une nouvelle technologie : avantage
relatif, complexité, compatibilité, testabilité,
observabilité. Par ailleurs les variables telles que l'âge, le
capital humain et le revenu sont largement rencontrées dans la
littérature existante sur le sujet.
4.1.3. 2.3. Objectifs
et hypothèses de recherche
Ø Objectifs
Cette étude vise globalement à évaluer la
prédisposition des ménages `'consommateurs'' de dibou du
village Thian à adopter le décorticage mécanique et la
fortification en fer du sorgho.
De façon spécifique, il s'agit de :
OS1- analyser les déterminants de la
disposition des ménages `'consommateurs'' de dibou à
adopter le décorticage mécanique et la fortification en fer du
sorgho ;
OS2- analyser les déterminants du
consentement à payer des ménages `'consommateurs'' de
dibou pour le décorticage mécanique et la fortification
en fer du sorgho ;
OS3- évaluer la rentabilité
financière de l'activité de décorticage mécanique
et de fortification en fer du sorgho.
Ø Hypothèses
H1 : Des facteurs d'ordre
socio-économiques déterminent la disposition des `'chefs
cuisine'' à adopter le décorticage mécanique et la
fortification en fer du sorgho ;
H2 : Le consentement à payer des
`'chefs cuisine'' pour le décorticage mécanique et la
fortification en fer du sorgho est influencé par leurs conditions
socio-économiques ;
H3 : L'activité de décorticage
mécanique et de fortification en fer du sorgho est financièrement
rentable.
5. CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE
Cette partie expose les diverses démarches
adoptées pour aboutir à la collecte des données et les
méthodes et outils utilisés pour leur analyse.
5.1.1. 3.1. Phases de
déroulement de l'étude
Les données exploitées dans la présente
étude ont été collectées et analysées en
quatre (4) phases : la phase préparatoire, la phase exploratoire, la
phase approfondie de collecte des données et la phase d'analyse des
résultats.
Ø La phase préparatoire ou phase de
documentation
C'est la phase au cours de laquelle la documentation existante
sur l'anémie ferriprive, l'adoption de nouvelles technologies,
l'évaluation du consentement à payer et de la rentabilité
financière, a été consultée. Ceci a permis de faire
le point des recherches antérieures sur les causes principales de
l'anémie ferriprive, les stratégies habituellement
utilisées pour l'éradiquer, la perception et les réactions
des populations cibles face à ces stratégies afin de
définir les grandes lignes de notre problématique de recherche.
Ceci a permis également de préciser les objectifs et de formuler
les hypothèses de recherche, afin de retenir les méthodes et
outils de collecte des données, de même que les outils d'analyse
à utiliser. Cette phase de documentation s'est étalée sur
toute la durée de la recherche.
Ø Phase exploratoire
Elle a été destinée à
l'appréhension du niveau de connaissance des populations du milieu sur
l'anémie ferriprive, sur l'existence et les attributs de l'unité
de décorticage et de fortification. Par ailleurs, cette phase nous a
donné une première idée de la valeur que les populations
accordent à une amélioration de leur situation sanitaire à
travers une évaluation des montants qu'ils sont prêts à
payer pour réduire le taux de FAN tout en maintenant le taux de fer
à un niveau intéressant dans leurs repas. Pour atteindre ces
objectifs, deux discussions de groupe ont été
organisées : une avec les femmes `'chef cuisine'' des
ménages retenus pour la phase pilote du projet et une autre avec les
femmes `'chef cuisine'' des ménages non retenus pour la phase pilote.
Les informations ont été recueillies à l'aide d'un guide
d'entretien semi-structuré. Ce guide d'entretien avec les principaux
résultats obtenus sont présentés en annexe 3. Des
observations participantes ont été aussi effectuées.
Un test du questionnaire qui sera utilisé pour la phase
d'enquête fine a été fait sur une quinzaine de
ménages afin de mieux l'affiner.
Des entretiens ont été tenus avec les
autorités locales et personnes ressources du village pour partager avec
elles les objectifs de notre étude et avoir les informations et conseils
nécessaires pour son bon déroulement. Nous nous sommes
également entretenus avec les agents du Centre Communal pour la
Promotion Agricole (CeCPA), les agents du Centre Médical Régional
de Parakou (CMRP) et les agents du Centre de Recherche en Technologie
Alimentaire (CRTA). En effet, l'équipement de décorticage a
été fabriqué par le CRTA. Nous nous sommes alors
rapprochés de son responsable pour avoir une estimation de son
coût d'acquisition, de son coût d'installation, de sa durée
d'amortissement et éventuellement d'autres frais y afférents. Ces
informations nous ont été utiles lors de l'analyse de la
rentabilité financière de l'unité. Les entretiens avec les
agents du CeCPA nous ont aidés à avoir des informations d'ordre
général sur la commune de Parakou et sur le village de travail.
Les entretiens avec les agents du CMRP nous ont permis d'avoir des informations
sur la prévalence de l'anémie ferriprive dans la commune de
Parakou.
Rappelons, pour finir, que c'est au cours de cette phase
d'exploration que le sous-échantillon des ménages non
sélectionnés pour la phase pilote du projet
(sous-échantillon 2) a été constitué.
Ø Phase d'enquête fine
Elle a consisté en la collecte des données
nécessaires au test des hypothèses à travers des
entretiens structurés à l'aide du questionnaire affiné
(annexe 5) après la phase exploratoire. La technique d'observation
participante et les entretiens non formels nous ont permis d'obtenir des
informations complémentaires pour comprendre certaines tendances
obtenues à travers les questionnaires.
Ø Traitement des données et analyse des
résultats
Cette phase a été consacrée au traitement
des données collectées et à l'analyse des
résultats, en vue de la rédaction du rapport final.
5.1.2. 3.2. Choix et présentation du milieu
d'étude
Ø Choix du milieu d'étude
L'étude s'est déroulée dans la commune de
Parakou (nord-Bénin) et plus précisément dans le village
Thian. Il s'agit du village retenu pour la phase pilote du projet dans lequel
s'insère notre étude. C'est dans ledit village qu'est
installé l'équipement dont notre recherche envisage
d'évaluer la prédisposition des populations locales à
l'adopter.
Ø Présentation du milieu
d'étude
Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest couvrant
une superficie de 114 763 kilomètres carrés avec une population
estimée à 7 198 618 habitants en 2004 (CNLS, 2006)
répartie en 12 départements dont le Borgou qui abrite le village
d'étude. Situé dans le nord du pays, le département du
Borgou compte à son actif huit communes :
Bembèrèkè, Kalalé, N'Dali, Nikki, Parakou,
Pèrèrè, Sinendé et Tchaourou. Parmi elles, seule
Parakou retiendra notre attention car c'est elle qui abrite Thian, le village
d'étude.
La commune de Parakou est située au nord de la
République du Bénin à environ 407 km de Cotonou. Elle
constitue un important carrefour des grands axes routiers (Cotonou-communes et
pays de l'hinterland) ; c'est surtout le terminus de la voie ferrée qui
quitte Cotonou, capitale économique du Bénin.
L'ensemble de la commune jouit d'un climat de type tropical
humide (climat Sud soudanien). Il se caractérise par l'alternance d'une
saison de pluies (Mai à Octobre) et d'une saison sèche (Novembre
à Avril). C'est en Décembre-Janvier que l'on enregistre les
températures les plus basses à Parakou. La précipitation
moyenne annuelle est de 1200 mm. Le maximum survient entre juillet, août
et septembre.
Les sols pour la plupart sont à texture
légère, avec une épaisseur importante due à la
faiblesse de l'érosion. Le couvert végétal observé
à Parakou est dominé par la savane arborée. Elle se
caractérise par la présence du néré (Parkia
biglobosa), du faux acajou (Blighia sapinda), de bois
d'ébène (Diospyros mespilifounis), du
karité (Butyrosperum paradoxum). Les bas-fonds sont
des prairies marécageuses de savanes, des buissons de bambous
(Bambusa arundinacca). Les jachères sont envahies par
des graminées et des arbustes assez divers.
La population de la commune de Parakou est passée de
103 577 habitants en 1992 à 149 819 habitants en 2002 (RGPH3), soit un
taux d'accroissement inter censitaire de 3,76%. Les trois quarts de cette
population sont installés dans la zone véritablement
urbanisée, le reste se retrouvant dans les périphéries.
Parmi les 149 819 habitants, 75 080 sont de sexe masculin et 74 739 de sexe
féminin. Le rapport de masculinité est ainsi de 100,45 hommes
pour 100 femmes. A l'instar des autres communes du département du
Borgou, la population de la commune de Parakou est extrêmement jeune,
plus de la moitié de cette population a moins de 15 ans.
La commune de Parakou compte 16 142 ménages dont 5 189
ruraux, soit 32,14 %. La taille moyenne des ménages est de 6,4
personnes. La taille des ménages ruraux est de 8,6 personnes.
Les différents groupes socioculturels qui y sont
rencontrés sont : Batonou (29,4 %), Fon (18,7 %), Dendi (15,4 %),
Yoruba (14,9 %), Otamari (5,4 %), Yom et Lokpa (5,1 %), peuhls (4,4 %), Adja
(2,9 %) et autres (3,8 %).
La religion dominante est l'islam avec 52,4 % d'adeptes. Les
autres religions pratiquées par la population sont : les religions
traditionnelles (5,2 %), le catholicisme (30,1 %), le protestantisme (3,3 %) et
autres religions (9,0 %).
Les activités économiques menées par les
habitants de la commune s'inscrivent pour l'essentiel dans les secteurs de
l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la pisciculture, de
l'artisanat, du commerce et du transport.
La figure 2 présente la carte du Département du
Borgou mentionnant la commune d'étude, la commune de Parakou.
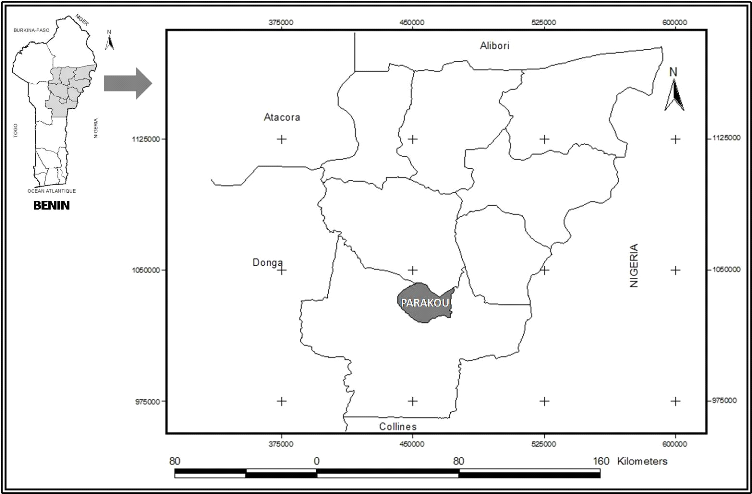
Figure 2 : Carte du
département du Borgou mentionnant la commune de Parakou.
5.1.3. 3.3. Choix des unités d'observation et
d'enquête
L'unité d'observation, dans le cadre de cette
étude est le ménage `'consommateur'' de dibou issu de
sorgho. Le dibou a été retenu dans la gamme des produits
dérivés du sorgho, car constitue le repas le plus consommé
et pour lequel le sorgho n'est pas décortiqué.
Le ménage est défini comme un groupe de
personnes apparentées ou non répondant à plusieurs
critères que sont : le fait de vivre sous un même toit, de
reconnaître l'autorité d'un même individu appelé chef
de ménage, de partager les repas, d'avoir une source commune de revenu
ou de mettre en commun les moyens permettant de satisfaire les besoins
essentiels du ménage (PNUD, 1997). Nous définissons le
ménage `'consommateur'' de dibou issu de sorgho comme tout
ménage qui transforme le sorgho en dibou et le consomme au
moins une fois par an.
Un grand nombre d'études ont montré qu'une
amélioration du bien-être des ménages ne dépendait
pas seulement de leur niveau de revenu, mais aussi de la personne qui gagne ce
revenu. Les femmes tendent à dépenser leur revenu plus que
proportionnellement par rapport aux hommes pour nourrir leur famille. En effet,
les revenus des femmes sont plus fortement associés aux
améliorations de la santé et de l'état nutritionnel de
leurs enfants que ceux des hommes (Quisumbing et al, 1995). Et puisque
la technologie installée dans le village vise l'amélioration de
la santé et de l'état nutritionnel des populations et que les
groupes les plus vulnérables à l'anémie ferriprive sont
les enfants (de moins de 5 ans surtout) et les femmes (en particulier lors de
la grossesse), nos entretiens ont été menés avec les
femmes en charge de la préparation du repas dans les ménages
(`'chefs cuisine''). Elles constituent de ce fait les unités
d'enquête.
5.1.4. 3.4. Echantillonnage
L'unité d'échantillonnage est le ménage
`'consommateur'' de dibou. L'univers de l'échantillonnage est
l'ensemble des ménages `'consommateurs'' de dibou du village
Thian. Pour constituer notre échantillon, nous avons
procédé par le mode d'échantillonnage aléatoire
stratifié. Le critère de stratification étant
l'appartenance ou non à la phase pilote du projet. Nous avons alors deux
strates : les ménages `'consommateurs'' de dibou retenus
pour la phase pilote du projet (strate 1) et les ménages
`'consommateurs'' de dibou non retenus pour la phase pilote (strate
2). L'effectif de la strate 1 est de 24 ménages. Pour obtenir l'effectif
de la seconde strate, nous avons procédé à un recensement
quasi-exhaustif de tous les ménages susceptibles de la constituer. Nous
avons dénombré 118 ménages `'consommateurs'' de
dibou non retenus pour la phase pilote du projet. Le cardinal de
l'univers d'échantillonnage est donc de 142 ménages
`'consommateurs'' de dibou.
Les moyens mis à notre disposition et le temps dont
nous disposions pour réaliser l'étude nous avaient amenés
à retenir 120 ménages comme effectif de notre échantillon.
Pour déterminer l'effectif des sous-échantillons
1 et 2, respectivement issus des strates 1 et 2, nous avons utilisé la
méthode de proportionnalité, ce qui confère à notre
échantillonnage le qualificatif « stratifié
représentatif » ou « stratifié
proportionnel ». Pour ce faire, nous avons calculé un
coefficient k, appelé taux de sondage ou
d'échantillonnage, tel que :   (où (où   est l'effectif de l'échantillon et est l'effectif de l'échantillon et   celui de la population). Ce coefficient multiplié par les
effectifs des strates 1 et 2 donne respectivement les effectifs des sous
échantillons 1 et 2 présentés dans le tableau 1. celui de la population). Ce coefficient multiplié par les
effectifs des strates 1 et 2 donne respectivement les effectifs des sous
échantillons 1 et 2 présentés dans le tableau 1.
Tableau 1 :
Echantillonnage.
|
Taux de sondage Strates Nombre total de
ménages Nombre de ménages enquêtés
par strate par strate
|
|
1 24
20
|
|
2 118
100
|
|
Somme
142
120
|
Une fois les effectifs des sous-échantillons connus,
nous avons procédé à un échantillonnage
aléatoire simple sans remise au sein de chaque strate pour retenir les
ménages pour l'enquête approfondie.
5.1.5. 3.5. Nature, sources et outils de collecte des
données
Les données collectées ont principalement trait
aux caractéristiques socio-économiques des enquêtés,
à leurs habitudes alimentaires, leurs perceptions sur les risques
d'anémie ferriprive liés à la consommation d'aliments
issus de sorgho non décortiqué, leurs connaissances sur les
attributs de l'unité de décorticage et de fortification, leur
prédisposition à adopter le décorticage mécanique
et la fortification en fer du sorgho et leurs consentements à payer pour
ces opérations. Les données nécessaires à l'analyse
de la rentabilité financière de l'unité ont
été également collectées. Ces données sont
primaires, à la fois quantitatives et qualitatives. La nature, les
sources et les outils de collecte utilisés sont présentés
de façon spécifique par objectif.
OS1- analyser les
déterminants de la disposition des ménages `'consommateurs'' de
dibou à adopter le décorticage mécanique et la
fortification en fer du sorgho : il s'est agit de présenter,
à travers un scénario adéquat, la technologie, les
avantages et inconvénients qui y sont liés et de demander aux
`'chefs cuisine'' si elles sont disposées à l'adopter,
c'est-à-dire décortiquer, fortifier et payer pour ces
opérations. La réponse à cette question nous a permis de
savoir si l'enquêtée est prédisposée ou non à
adopter la technologie. Les informations relatives aux facteurs susceptibles
d'influencer cette prédisposition ont été également
collectées, notamment à travers la méthode de rappel, la
technique de cailloux et les histoires de vie. Ces données ont
été collectées à l'aide de notre questionnaire et
parfois d'entretiens non structurés. Il faut préciser que lors de
la présentation du scénario, des photos des instruments
utilisés pour le décorticage mécanique et la fortification
en fer du sorgho ont été montrées aux
enquêtées afin de rapprocher le plus possible le scénario
de la réalité.
OS2- analyser les
déterminants du consentement à payer des ménages
`'consommateurs'' de dibou pour le décorticage mécanique
et la fortification en fer du sorgho : il s'agissait de demander aux
`'chefs cuisine'' prédisposées à adopter la technologie de
proposer une contribution financière qui permettra d'assurer les charges
de fonctionnement de l'unité. Ces contributions financières
(consentement à payer) ont été recueillies et ont
été utilisées pour identifier leurs
déterminants.
OS3- évaluer la
rentabilité financière de l'unité de décorticage
mécanique et de fortification en fer du sorgho : il sera question,
dans cette partie, de faire une analyse de rentabilité financière
de l'unité à partir du consentement à payer moyen (CAPm).
Ceci dans l'intention de voir l'éventualité de la
viabilité de cette unité de décorticage et de
fortification, après retrait du projet. Pour ce faire, les coûts
relatifs au fonctionnement de l'unité (rémunération du
minotier et de l'agent qui fortifie le sorgho décortiqué, achat
de gaz-oil, de fer pour la fortification, réfection du bâtiment,
achat du décortiqueur, entretien et réparation, etc.) et les
bénéfices réalisables par l'unité (revenu brut de
décorticage et de fortification et les valeurs résiduelles des
investissements fixes.) ont été évalués. Ces divers
coûts et bénéfices ont été
évalués à l'aide d'entretiens semi-structurés
menés avec le minotier, l'agent qui fortifie le sorgho et le responsable
du CRTA.
En dehors de ces données primaires, les données
secondaires relatives aux environnements biophysique et institutionnel,
à la prévalence de l'anémie dans le monde, en Afrique et
au Bénin, aux théories économiques et
économétriques ont été collectées à
travers la documentation dans différentes structures telles que
BIDOC-FSA, CAPOD, CHD-Borgou/Alibori, DDSP-Borgou/Alibori, IITA, INRAB-Parakou,
INSAE. La technique de la triangulation a prévalu tout au long de la
collecte pour s'assurer de la fiabilité des données.
5.1.6. 3.6. Outils et méthodes d'analyse des
données.
Afin d'atteindre les objectifs fixés et de tester les
hypothèses formulées, différents outils
et méthodes ont été utilisés. Ces outils
et méthodes d'analyse sont présentés par
hypothèse.
Hypothèse 1 : Des
facteurs d'ordre socio-économiques déterminent la disposition des
`'chefs cuisine'' à adopter le décorticage mécanique et la
fortification en fer du sorgho.
Il a été question ici de mesurer l'influence des
caractéristiques socioéconomiques et des opinions des personnes
interrogées sur les attributs de l'unité sur leur disposition
à adopter la technologie. En d'autres termes, nous recherchons les
variables socioéconomiques qui réduisent ou augmentent la
probabilité d'adopter le décorticage mécanique et la
fortification en fer du sorgho. A cet effet, les outils d'analyse les plus
appropriés sont ceux de la régression. Mais, la difficulté
majeure reste au niveau du choix du modèle de régression
approprié. N'importe quel modèle de régression ne peut
être utilisé pour n'importe quelle régression (Maddala,
1983 ; Gourieroux, 1989; Pindyck et Rubinfeld, 1991; Doucouré, 2002).
C'est d'abord la nature continue ou discontinue des variables qui
déterminent le choix du modèle de régression. Ici, la
variable dépendante qui est la prédisposition des ménages
à adopter le décorticage mécanique et la fortification en
fer du sorgho est dichotomique (ou binaire). Une variable dichotomique est une
variable qui ne peut prendre que deux modalités exclusives l'une de
l'autre, comme «Oui/Non» ou «Inférieur ou égal
à/Strictement supérieur à». Dans le cas de notre
étude, soit l'enquêtée est prédisposée
à adopter la technologie soit elle ne l'est pas ; il faut donc
recourir à des modèles économétriques
appropriés.
Les modèles analytiques les plus largement
utilisés dans ces types d'étude sont les modèles Probit
(ou Normit), Logit et Tobit. Le modèle Tobit ou modèle de
régression à variable dépendante limitée s'utilise
lorsque nous avons des informations sur l'adoption ou non d'une technologie et
mieux, si nous avons des informations sur le niveau d'utilisation de la
technologie. De plus, il fait appel à des calculs mathématiques
assez complexes. Pour ces raisons, ce modèle d'analyse ne sera pas
utilisé dans le cadre de cette étude. Les modèles Probit
et Logit ont des caractéristiques proches (Amemiya, 1981). Il faut
toutefois noter une différence majeure entre ces deux modèles. En
effet, le modèle Logit se base sur la loi logistique de distribution de
probabilité tandis que le modèle Probit se base sur la loi
normale. Ces deux modèles aboutissent à des résultats
similaires (Amemiya, 1981 ; Maddala, 1983). Dès lors, il n'y a pas
de raison persuasive de choisir l'un plutôt que l'autre. Pratiquement,
beaucoup de chercheurs adoptent le modèle Logit parce qu'il est
mathématiquement plus simple (Gujarati, 2004 ; p.612). Au regard de
ce qui précède, le modèle Logit est retenu pour le test de
cette première hypothèse. Etant donné que la variable
dépendante dans notre cas ne peut prendre que deux valeurs (1 pour la
prédisposition à adopter le décorticage mécanique
et la fortification en fer du sorgho et 0 pour le cas contraire), nous avons
utilisé le Logit binomial. Le modèle se présente comme
suit:
  Avec, Avec,
  = variable dépendante = variable dépendante
  = matrice des variables susceptibles d'expliquer la variation de Y = matrice des variables susceptibles d'expliquer la variation de Y
  = erreur logistique de la distribution = erreur logistique de la distribution
L'estimation de notre modèle Logit est basée sur
la méthode de maximum de vraisemblance. L'analyse des résultats
de ce modèle porte essentiellement sur les points suivants :
· La qualité du modèle
La qualité du modèle peut être
appréciée en utilisant la vraisemblance du modèle qui suit
une loi de Khi-deux. Le modèle est dit globalement significatif, lorsque
la valeur de la vraisemblance est supérieure à celle du Khi-deux
au même degré de liberté, à un seuil donné
(1%, 5% ou 10%). De façon plus directe, le modèle est dit bon
lorsque la probabilité du ratio de vraisemblance est inférieure
au seuil de signification choisi.
· Le pouvoir de prédiction du
modèle
Le pouvoir de prédiction du modèle permet de
confirmer l'adéquation du modèle pour l'étude. Il est
donné par le pourcentage de fausses ou vraies prédictions. Plus
il y a de vraies prédictions, mieux les résultats du
modèle peuvent être utilisés pour faire des estimations.
· Les signes des coefficients
estimés
La valeur numérique des coefficients estimés n'a
pas vraiment d'intérêt en soi. Par contre, les signes de ces
coefficients sont importants. Ils indiquent si la variation associée
influence la probabilité à la hausse ou à la baisse.
Autrement dit, ces signes indiquent dans quel sens la variation de la variable
explicative influence la variation de la variable expliquée. A chaque
signe des coefficients est associée une significativité qui
revêt une grande importance. Elle est donnée par une
probabilité qui indique dans quel intervalle de confiance le signe peut
être utile. Cet intervalle peut être de 90%, 95% ou 99% selon que
la probabilité associée au signe est respectivement
inférieure à 10%, 5% ou 1%.
Spécification du modèle
Soit   la probabilité qu'associe le Logit à l'unité
d'enquête la probabilité qu'associe le Logit à l'unité
d'enquête   : :
 
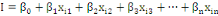 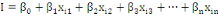
  est un vecteur qui représente les caractéristiques de
l'unité d'enquête, de son environnement et de l'objet de son
choix. est un vecteur qui représente les caractéristiques de
l'unité d'enquête, de son environnement et de l'objet de son
choix.
Les   représentent les coefficients des variables explicatives. représentent les coefficients des variables explicatives.
Les   représentent les variables explicatives. représentent les variables explicatives.
La décision de décortiquer, fortifier son
sorgho et payer pour ces opérations intervient seulement lorsque l'effet
combiné des facteurs atteint une valeur critique, à partir de
laquelle l'individu choisit. En supposant que l'effet est mesuré par un
indice non observable   pour l'individu, et pour l'individu, et   la valeur critique de l'indice à partir de laquelle il
décide de décortiquer, fortifier son sorgho et payer pour ces
opérations, on a : la valeur critique de l'indice à partir de laquelle il
décide de décortiquer, fortifier son sorgho et payer pour ces
opérations, on a :
si   est supérieur à est supérieur à   , alors l'individu choisit de décortiquer, fortifier son sorgho
et payer pour ces opérations et la variable de choix , alors l'individu choisit de décortiquer, fortifier son sorgho
et payer pour ces opérations et la variable de choix   prend la valeur 1 ; dans le cas contraire, Y est égale à
0. Plus prend la valeur 1 ; dans le cas contraire, Y est égale à
0. Plus   est supérieur à la valeur critique, plus la
probabilité est forte que l'individu choisisse de décortiquer,
fortifier son sorgho et payer pour ces opérations. Le modèle
empirique peut s'écrire de la manière suivante : est supérieur à la valeur critique, plus la
probabilité est forte que l'individu choisisse de décortiquer,
fortifier son sorgho et payer pour ces opérations. Le modèle
empirique peut s'écrire de la manière suivante :
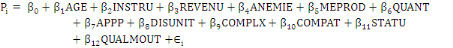
Les   représentent les coefficients des variables explicatives. représentent les coefficients des variables explicatives.
  est le terme de l'erreur. est le terme de l'erreur.
AGE : cette variable désigne
l'âge de l'enquêtée. On s'attend à un effet
négatif. En effet, plus le répondant prend de l'âge, moins
elle est apte à se reproduire puisque proche de la ménopause ou
déjà en ménopause. De plus, dans ces conditions, la
probabilité est faible qu'elle ait à sa charge des enfants de
moins de 5 ans. Sachant que les enfants de moins de 5 ans et les femmes
enceintes sont la principale cible de l'anémie ferriprive, on pourrait
donc s'attendre à ce que les `'chefs cuisine'' âgées soient
moins prédisposées que les jeunes.
INSTRU :
représente l'instruction ou non du répondant. Nous nous attendons
à un signe positif de cette variable car, instruit, le répondant
comprendra plus le scénario auquel il sera soumis et donc, plus il sera
ouvert aux initiatives visant à améliorer son état
sanitaire et celui de ses proches.
REVENU : désigne
le revenu de l'enquêtée. Nous nous attendons à un signe
positif de cette variable, car plus le revenu est élevé, plus
l'individu est favorable aux innovations, car il pourra supporter les charges
qui y sont liées.
ANEMIE : indique le passé du
ménage par rapport à l'anémie. L'idée ici est que
les ménages ayant au moins un membre qui a déjà souffert
de l'anémie seront plus prédisposés à adopter la
technologie qui leur est proposée pour justement l'éradiquer.
Nous nous attendons donc à un signe positif.
MEPROD : indique si le
sorgho fait partie des spéculations agricoles produites au sein du
ménage. Nous nous attendons, pour cette variable, à un effet
positif, car, nous présumons que le ménage producteur de sorgho
sera un ménage qui dépense moins pour se procurer du sorgho
à consommer, et pourra donc être plus disposé à
adopter la technologie.
QUANT : représente la
quantité moyenne de sorgho que le ménage consacre à la
consommation de dibou. Un effet positif est attendu. En effet, plus
grande est la quantité de sorgho moulu chaque fois que
l'enquêtée va au moulin, plus élevé sera le taux des
FAN dans la farine et plus exposés en seront les consommateurs.
APPP : cette variable désigne
l'appartenance ou non de l'enquêtée à la phase pilote du
projet. Il est attendu un signe positif, car on estime que les
répondants ayant participé à la phase pilote ont une bonne
connaissance des risques d'anémie ferriprive liés à la
consommation du dibou issu de sorgho non décortiqué, et
ont également une bonne connaissance des attributs de l'unité de
décorticage et de fortification.
DISUNIT : distance entre le
ménage et l'unité. On s'attend ici à un signe
négatif. Plus élevé est la distance qui sépare la
demeure du répondant de l'unité de décorticage et de
fortification, moins il se donnera la peine d'y aller. Il
préfèrera aller moudre directement son sorgho dans une minoterie
plus proche de chez lui.
COMPLX : complexité perçue
de la procédure de décorticage mécanique et de la
fortification en fer du sorgho. Plus la procédure de
décorticage et de fortification est perçue comme complexe par
l'enquêtée, moins elle sera disposée. Un effet
négatif est attendu.
COMPAT : compatibilité de la
technologie avec les normes et valeurs du ménage. Un effet positif est
attendu lorsque la technologie est compatible avec les normes et valeurs du
ménage ou de l'enquêtée.
STATU : statut social de
l'enquêtée après l'adoption de la technologie. Un effet
positif est attendu lorsque l'enquêtée perçois la
technologie comme pouvant améliorer son statut social.
QUALMOUT : qualité de la mouture
de la minoterie qui se situe dans le même local que la
décortiqueuse. En effet, les enquêtées ont
été informées du fait qu'elles ont la possibilité
de décortiquer et fortifier leur sorgho au sein de l'unité, et
moudre dans la meunerie de leur choix. Cependant, plus la qualité de la
mouture de la minoterie qui se situe dans le même local que la
décortiqueuse est meilleure, plus les `'chefs cuisine'' seront
prédisposées à adopter l'innovation, car cela leur
éviterait de faire beaucoup de mouvements avant d'avoir la farine
améliorée.
La nature des variables, leurs codes, modalités et les
signes attendus sont résumés dans le tableau 2.
Tableau 2 : Noms, types, codes, modalités
et signes attendus des coefficients des variables du modèle
Logit.
|
Nom de la variable
|
Type
|
Code
|
Modalités
|
Signe
attendu
|
|
Variable de réponse
|
|
Prédisposition à l'adoption du
décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho
|
Nominal
|
ADDMFFS
|
1 = enquêtée prédisposée à
adopter le décorticage mécanique et la fortification en fer du
sorgho ; 0 autrement.
|
/
|
|
Régresseurs
|
|
Age de l'enquêtée.
|
Continu
|
AGE
|
/
|
-
|
|
Instruction de
l'enquêtée.
|
Nominal
|
INSTRU
|
0= sans instruction ; 1= avec instruction.
|
+
|
|
Revenu de l'enquêtée.
|
Continu
|
REVENU
|
/
|
+
|
|
Passé du ménage par rapport à
l'anémie.
|
Nominal
|
ANEMIE
|
0= jamais d'anémié dans le ménage ;
1= au moins un membre du ménage déjà anémié.
|
+
|
|
Production du sorgho par le ménage.
|
Nominal
|
MEPROD
|
0= ménage non producteur; 1= ménage
producteur.
|
+
|
|
Quantité moyenne de sorgho consacrée à la
consommation de dibou.
|
Continu
|
QUANT
|
/
|
+
|
|
Appartenance de l'enquêtée à la phase
pilote du projet.
|
Nominal
|
APPP
|
0= n'a pas appartenu; 1= a appartenu
|
+
|
|
Distance entre l'unité de décorticage et de
fortification et le ménage de l'enquêtée
|
Continu
|
DISUNIT
|
/
|
-
|
|
Complexité perçue de la procédure de
décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho
|
Nominal
|
COMPLX
|
0= procédure non complexe ;
1= procédure complexe.
|
-
|
|
Compatibilité de la technologie avec les normes et
valeurs du ménage
|
Nominal
|
COMPAT
|
0= technologie non compatible ; 1= technologie
compatible
|
+
|
|
statut social de l'enquêtée après
l'adoption de la technologie
|
Nominal
|
STATU
|
0= pas d'amélioration ; 1= amélioration.
|
+
|
|
qualité de la mouture au sein de l'unité
|
Ordinale
|
QUALMOUT
|
0= mauvaise ; 1= acceptable ; 2= bonne.
|
+
|
Note : (/) est mis pour la non
disponibilité de modalités particulière
Hypothèse 2 : Le consentement
à payer des `'chefs cuisine'' pour le décorticage
mécanique et la fortification en fer du sorgho est influencé par
leurs conditions socio-économiques.
Il a été question, à ce niveau, de
mesurer l'influence des conditions socioéconomiques des personnes
prédisposées à adopter la technologie sur leur
consentement à payer. Rappelons que le consentement à payer peut
être vu sous deux angles : participation (probabilité
d'accepter ou non de payer) et valorisation (montant consentit à payer).
La participation a été prise en compte par l'hypothèse
1 ; pour le compte de cette deuxième hypothèse, seule la
valorisation est considérée. Pour ce faire, les montants que les
`'chefs cuisine'' prédisposées à adopter la technologie
sont prêtes à payer pour le décorticage mécanique et
la fortification en fer du sorgho sont recueillis en utilisant la
méthode d'évaluation contingente, puis les facteurs qui
pourraient les influencer sont identifiés en utilisant une
régression linéaire.
Méthode d'évaluation
contingente
L'évaluation contingente est une méthode
d'enquête conçue dans le but d'amener les individus à
révéler leurs préférences, afin de donner une
valeur à des biens publics qui n'ont pas de prix sur le marché
(Maresca et al, 2006). Pour Johansson (1987) cité par
Blanchemanche et al. (2009), la méthode
d'évaluation contingente consiste à collecter des informations
sur les préférences des consommateurs, en leur demandant ce
qu'ils consentiraient à payer pour un changement de dotation en bien ou
service non-marchand, ou bien la compensation minimum qu'ils exigeraient si le
changement n'a pas lieu. Elle a beaucoup servi dans le domaine de
l'environnement (gestion des déchets, amélioration de la
qualité de l'air, dommages causés par des marées noires,
etc.) qui est d'ailleurs son premier champ d'application. Elle a
été utilisée par Ouedraogo et al. (2007)
dans la gestion des risques en agriculture urbaine irriguée, notamment
pour évaluer le consentement à payer pour une amélioration
de la qualité de l'eau pour le maraîchage dans les villes de
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso au Burkina-Faso. En 2007, Monsi Agboka s'est
servie d'elle pour évaluer la valeur économique des plantes
utilisées pour les soins gynécologiques dans les terroirs autour
de la Réserve de Biosphère de la Pendjari au Bénin. En
2010, cette méthode a été utilisée par l'Agence de
l'Eau Rhin-Meuse dans le cadre d'une étude
coûts-bénéfices de l'amélioration de la
qualité d'un cours d'eau dans la région de la Bouvade en
France.
La méthode d'évaluation contingente
procède par interrogation directe des individus. Elle conduit les
individus à déclarer des intentions de paiement quant à
une modification de la quantité (ou de la qualité) d'un bien
environnemental particulier.
Cette méthode s'est révélée
incontournable plus tard dans beaucoup de pays, et dans beaucoup d'autres
domaines que l'environnement, notamment dans les domaines de l'alimentation
(Blanchemanche et al. (2009)), de la santé (Le Goff et
Nassiri (2005)), de la télécommunication, etc. bien qu'elle
expose le chercheur (s'il n'y prend garde) à des biais tels que le biais
stratégique, le biais de l'information et le biais hypothétique.
Tout ceci nous a amené à retenir cette méthode pour
déterminer la valeur que les ménages `'consommateurs'' de
dibou accordent à une amélioration nutritionnelle de
leur repas. Pour arriver à cette fin, des modèles ou combinaisons
de modèles économétriques sont utilisés. Mais, le
choix du modèle ou de la combinaison de modèles
économétriques dépend du mode de révélation
de la valeur utilisé.
Terra (2005) identifie cinq (5) modes de
révélation de la valeur. Ces différents modes de
révélation avec leurs caractéristiques respectives sont
présentés dans le tableau 3.
Tableau 3:
Caractéristiques des différents modes de révélation
de la valeur.
|
Méthode
|
Incitation à la révélation
|
|
Effort cognitif
|
|
Risque d'ancrage
|
|
Taille d'échantillon (relative) requise
|
|
Question ouverte
|
Faible
|
|
Elevé
|
|
Aucun
|
|
La plus faible
|
|
Question fermée
|
Très élevée
|
|
Très faible
|
|
?
|
|
La plus élevée
|
|
Double question
Fermée
|
?
|
|
Modéré
|
|
Elevé
|
|
Elevée
|
|
Système d'enchères
|
Faible
|
|
Modéré
|
|
Elevé
|
|
Modérée
|
|
Carte de paiement
|
Elevée
|
Modéré
|
|
?
|
|
Faible
|
Source : Terra, 2005
Note : ( ?) est mis pour les cellules
où l'information n'est pas connue.
D'après l'analyse de ce tableau, la question ouverte
nous semble plus adéquate et sera donc retenue pour l'évaluation
monétaire du bien qui est la farine issue de sorgho
décortiqué et fortifié avec du fer, vu le niveau d'effort
cognitif, le niveau du risque d'ancrage et la taille de l'échantillon
requise. Le faible niveau d'incitation observé chez les
enquêtés est dû au fait que la plupart des enquêtes
qui ont conduit à la réalisation de ce tableau sont faites par
téléphone, e-mail ou la poste. Nous espérons donc que ce
niveau d'incitation à la révélation sera stimulé
avec notre moyen d'enquête qui est direct (enquêté face
à enquêteur).
Lorsque l'option est faite d'utiliser la question ouverte
comme mode de révélation de la valeur du bien, Terra (2005)
recommande l'utilisation du modèle de Heckman (ensemble modèle
Probit et regression linéaire) lorsque le pourcentage de
« vrais zéro » est inférieur à 10 % et
l'utilisation du modèle Tobit autrement. On parle de « vrais
zéros » lorsque la valeur 0 du CAP correspond réellement
à la valeur que le répondant accorde au bien ou service, les
« faux zéro » étant les valeurs nulles
déclarées par l'enquêtée mais ne correspondant pas
à la vraie valeur accordée au bien ou au service. Dans le cadre
de cette étude, l'hypothèse 1 nous a amené à faire
un tri qui a permis d'identifier les personnes prédisposées (i.e.
oui au décorticage, fortification et payement des frais y
afférents) et les personnes non prédisposées (i.e. oui au
décorticage et fortification mais non au payement des frais y
afférents ou bien non au décorticage, fortification et payement
des frais y afférents). Ce qui a fait que les valorisations retenues
pour le test de l'hypothèse 2 sont celles qui sont strictement
supérieures à zéro. Les vrais et faux zéros ne sont
donc pas considérés dans le test de cette hypothèse 2. Et
puisque les modèles de Heckman et Tobit ont besoin de ces
« zéros » pour être estimés, notre
choix a porté sur un modèle de régression linéaire
par la méthode des moindres carrés pour le test de notre
deuxième hypothèse. Ce modèle se présente comme
suit :
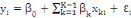 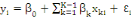  
Avec :
K= nombre de variables explicatives
  = variable dépendante ou de réponse = variable dépendante ou de réponse
  = =   ème variable explicative ou régresseur ème variable explicative ou régresseur
  = résidu (ou erreur non observée) = résidu (ou erreur non observée)
L'estimation de ce modèle est basée sur la
méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). L'analyse des
résultats du modèle porte essentiellement sur les
points suivants :
· La signification globale du
modèle
Il s'est agit de tester l'hypothèse 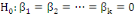 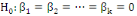 . Pour ce faire, la statistique . Pour ce faire, la statistique   de Ficher a été calculée et les
interprétations ont été effectuées en
conséquence. de Ficher a été calculée et les
interprétations ont été effectuées en
conséquence.
· La qualité de l'ajustement du
modèle
Il s'agit de la proportion (pourcentage) de la variation
totale de la variable dépendante   expliquée conjointement par les variables explicatives expliquée conjointement par les variables explicatives  . La grandeur qui mesure cette information est le coefficient de
détermination multiple . La grandeur qui mesure cette information est le coefficient de
détermination multiple   . .
· Les signes et leur signification
Comme dans le cas du premier modèle, les signes des
coefficients sont importants. Ils indiquent dans quel sens la variation de la
variable explicative influence la variation de la variable expliquée. A
chaque signe des coefficients est associée une significativité
qui revêt une grande importance. Elle est donnée par une
probabilité qui indique dans quel intervalle de confiance on peut
compter sur le signe. Cet intervalle peut être de 90%, 95% ou de 99%
selon que la probabilité associée au signe est respectivement
inférieure à 10%, 5% ou 1%.
Spécification du modèle
Le modèle empirique peut s'écrire :
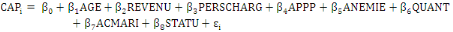
Avec,
  = consentement à payer de l'individu = consentement à payer de l'individu  
  = coefficient du régresseur = coefficient du régresseur  
  = résidu = résidu
AGE : variable désignant
l'âge de l'enquêtée. On s'attend à un effet
négatif. En effet, plus le répondant prend de l'âge, moins
elle est apte à se reproduire puisque proche de la ménopause ou
déjà en ménopause. De plus, dans ces conditions, la
probabilité est faible qu'elle ait à sa charge des enfants de
moins de 5 ans. Sachant que les enfants de moins de 5 ans et les femmes
enceintes sont la principale cible de l'anémie ferriprive, on pourrait
donc s'attendre à ce que plus l'âge des `'chefs cuisine''
augmente, plus leurs CAP seront faibles.
REVENU : désigne
le revenu de l'enquêtée. Nous nous attendons à un signe
positif de cette variable, car plus le revenu de l'enquêtée est
élevé, plus elle pourra en utiliser pour améliorer la
qualité nutritionnelle de son repas.
PERSCHARG : désigne le nombre
total de personnes à charge de l'enquêtée. Il est attendu
un effet négatif. En effet, plus le répondant a de personnes
à sa charge, plus il aura d'individus à nourrir et plus grandes
seront les dépenses du ménage. N'ayant donc plus assez
d'excédents de ressources, son consentement à payer est
susceptible de diminuer.
APPP : cette variable désigne
l'appartenance ou non de l'enquêtée à la phase pilote du
projet. Il est attendu un signe positif car nous présumons que les
répondants ayant participé à la phase pilote ont une bonne
connaissance des risques d'anémie ferriprive liés à la
consommation du dibou issu de sorgho non décortiqué et
ont également une bonne connaissance des attributs de l'unité de
décorticage et de fortification. Leurs consentements à payer
devrait être plus élevés.
ANEMIE : indique le passé du
ménage par rapport à l'anémie. L'idée ici est que
les ménages ayant au moins un membre qui a déjà souffert
de l'anémie seront prêts à donner `'tout'' ce qu'ils
peuvent pour ne plus côtoyer ce mal car les dépenses liées
à son traitement seraient outrancières. Nous nous attendons donc
à un signe positif.
QUANT : représente la
quantité moyenne de sorgho que le ménage consacre à la
consommation de dibou. Un effet négatif est attendu. En effet,
plus grande est la quantité de sorgho moulu chaque fois que
l'enquêtée va au moulin, plus élevé seront les
charges liées à la mouture. Elle ne sera donc plus en mesure de
consacrer un montant assez important pour le décorticage et la
fortification. Son consentement à payer sera donc `'petit''.
APMARI : désigne la disposition
du mari de l'enquêtée à l'appuyer. Cet appui est soit
financier (augmentation de l'argent de popote) soit en nature (augmentation de
la quantité de sorgho). Un effet positif de cette variable est attendu.
En effet, le décorticage du sorgho réduit la quantité de
farine et par conséquent diminue soit le nombre de jours que doit faire
le contenu du grenier du ménage, soit le niveau de satisfaction. Pour
faire face à ces difficultés, les ménages seront
obligés d'augmenter la contenance de leurs greniers. Les `'chefs
cuisine'' qui bénéficieront de l'appui de leur mari dans ce sens
auront un consentement à payer élevé.
STATU : statut social de
l'enquêtée après l'adoption de la technologie. Un effet
positif de cette variable sur le CAP est attendu lorsque
l'enquêtée perçois la technologie comme pouvant
améliorer son statut social.
La nature des variables, leurs codes, modalités et les
signes attendus sont résumés dans le tableau 4.
Tableau 4 : Noms, types,
codes, modalités et signes attendus des coefficients des variables du
modèle de régression linéaire multiple.
|
Nom de la variable
|
Type
|
Code
|
Modalités
|
Signe
attendu
|
|
Variable de réponse
|
|
Consentement à payer de l'enquêtée
|
Continu
|
CAP
|
/
|
/
|
|
Régresseurs
|
|
Age de l'enquêtée.
|
Continu
|
AGE
|
/
|
-
|
|
Revenu de l'enquêtée.
|
Continu
|
REVENU
|
/
|
+
|
|
Nombre de personnes à charge
|
Continu
|
PERSCHARG
|
/
|
-
|
|
Passé du ménage par rapport à
l'anémie.
|
Binaire
|
ANEMIE
|
0= jamais d'anémié dans le ménage ;
1= au moins un membre du ménage déjà anémié.
|
+
|
|
Quantité moyenne de sorgho consacrée à la
consommation de dibou.
|
Continu
|
QUANT
|
/
|
-
|
|
Appartenance de l'enquêtée à la phase
pilote du projet.
|
Binaire
|
APPP
|
0= n'a pas appartenu; 1= a appartenu
|
+
|
|
statut social de l'enquêtée après
l'adoption de la technologie
|
Binaire
|
STATU
|
0= pas d'amélioration ; 1= amélioration.
|
+
|
|
Disposition du mari de l'enquêtée à
l'appuyer
|
Binaire
|
APMARI
|
0= pas disposé ; 1= disposé
|
+
|
Note : (/) = pas d'informations.
L'utilisation des MCO ne serait pas raisonnable si certaines
conditions/hypothèses ne sont pas
réunies/vérifiées. Ces hypothèses
« simplificatrices » sont au nombre de onze (Gujarati,
2004). En pratique, certaines de ces hypothèses (par exemple   est aléatoire, est aléatoire,   est normal, E( est normal, E(  ) = 0) peuvent être violées ou supposées
vérifiées. Mais celles relatives à la
non-colinéarité des régresseurs, à
l'homoscédasticité de la variance de l'erreur, à l'absence
d'autocorrélation des termes d'erreur et à la bonne
spécification du modèle de régression doivent être
testées et corrigées au cas où elles ne seraient pas
vérifiées. Puisque nos données sont en coupes
instantanées, il ne serait pas pertinent de tester
l'autocorrélation. Aussi, puisque le modèle de régression
linéaire a été estimé à l'aide du logiciel
STATA, l'option robust (ou ro) associée à la
commande reg (commande pour la régression linéaire) a
été utilisée pour corriger automatiquement les t
de Student de l'hétéroscédasticité par la
méthode de Withe. Le tableau 5 présente les hypothèses
restantes à vérifier, les problèmes liés à
leur violation et les méthodes/tests utilisées pour les
détecter. ) = 0) peuvent être violées ou supposées
vérifiées. Mais celles relatives à la
non-colinéarité des régresseurs, à
l'homoscédasticité de la variance de l'erreur, à l'absence
d'autocorrélation des termes d'erreur et à la bonne
spécification du modèle de régression doivent être
testées et corrigées au cas où elles ne seraient pas
vérifiées. Puisque nos données sont en coupes
instantanées, il ne serait pas pertinent de tester
l'autocorrélation. Aussi, puisque le modèle de régression
linéaire a été estimé à l'aide du logiciel
STATA, l'option robust (ou ro) associée à la
commande reg (commande pour la régression linéaire) a
été utilisée pour corriger automatiquement les t
de Student de l'hétéroscédasticité par la
méthode de Withe. Le tableau 5 présente les hypothèses
restantes à vérifier, les problèmes liés à
leur violation et les méthodes/tests utilisées pour les
détecter.
Tableau 5: Hypothèses
à vérifier, problèmes liés à leur violation
et méthodes/tests utilisées pour leur
détection.
|
Hypothèses
|
Problèmes
|
Méthodes/tests de détection
|
|
Non colinéarité des régresseurs
|
Multicolinéarité
|
Analyse de la matrice de corrélation des
régresseurs.
|
|
Spécification « correcte » du
modèle
|
Erreur (ou biais) de spécification du modèle
|
Test RESET de Ramsey
|
Hypothèse 3 :
L'activité de décorticage mécanique et de fortification en
fer du sorgho est financièrement rentable.
Plusieurs méthodes existent pour le test de cette
hypothèse. Il s'agit entre autre de la méthode de
trésorerie prévisionnelle, de la méthode
d'établissement des comptes d'exploitation générale
prévisionnels et de la méthode des cash-flows.
La méthode de trésorerie prévisionnelle
consiste à prévoir période5(*) par période, les recettes totales et les
dépenses totales liées à l'exercice d'une activité
donnée. La différence entre recettes totales et dépenses
totales permet de prévoir la situation de la trésorerie en fin de
chaque période. La limite de cette méthode est qu'elle ne prend
pas en compte les amortissements. Elle ne s'intéresse donc pas au
renouvellement des biens immobilisés. Elle ne sera pas utilisée
dans le cadre de notre étude.
L'établissement des comptes d'exploitation
générale prévisionnels consiste à prévoir
période par période les produits totaux et les charges totales
liés à l'exercice d'une activité donnée. La
différence entre produits totaux et charges totales permet de calculer
les résultats de l'activité à la fin de chaque
période. Cette méthode prend en compte les amortissements, mais
ne prévoit pas de la liquidité pour leur renouvellement. C'est en
cela que réside sa limite. Elle ne sera donc pas utilisée dans le
cadre de notre travail.
La méthode des cash-flows est semblable aux deux
précédentes. Elle prévoit également période
par période, les coûts totaux et les bénéfices
totaux liés à l'exercice d'une activité
donnée : on parle d'analyse coûts-bénéfices. La
différence entre cette méthode et les deux autres est qu'elle
tient compte automatiquement de l'amortissement puisqu'elle prévoit une
année zéro au cours de laquelle les biens immobilisés sont
acquis, le renouvellement des immobilisations en fonction de leur durée
de vie et l'inscription de leurs valeurs résiduelles dans les
bénéfices à la fin de l'exercice. Elle prévoit
également en année zéro le capital de
fonctionnement6(*) (ou fond
de roulement) qui est la somme totale nécessaire à
l'autofinancement quotidien de l'exécution de l'activité. Cette
méthode des cash-flows vient combler les lacunes
présentées par les autres. Elle est donc celle qui a
été retenue et utilisée dans le cadre de cette
étude.
ECOFIN (2004) propose quatre critères pour
déterminer la durée de l'analyse financière d'un projet.
Parmi ces critères, figure la durée de vie du point de vue
technique/économique des biens les plus coûteux du projet. Dans
notre cas, l'analyse a été effectuée sur une
période équivalente à la durée de vie de la
décortiqueuse qui est le bien le plus coûteux. Les coûts
d'existence et de fonctionnement et les bénéfices de la
plate-forme ont été ensuite calculés par année. Les
cash-flows ont été également calculés par
année suivant la formule :
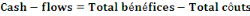
En nous servant des cash-flows par années, nous avons
calculé la Valeur Actuelle Nette (VAN) du profit
généré par l'investissement et le Taux de
Rentabilité Interne (TRI) de l'activité. La VAN a
été calculée après application d'un taux
d'actualisation égal à 12 % correspondant au taux commercial
généralement utilisé au Bénin. Si elle est
supérieure à zéro, cette activité est
considérée comme financièrement rentable. Il faut
préciser que le test de cette hypothèse 3 s'est basé sur
l'hypothèse de stationnarité des coûts et des
bénéfices durant la période d'analyse. On parle de
scénario « normal ». Lorsque le scénario
« normal » se révèle favorable (VAN
positive), on passe à au moins un scénario
« pessimiste » (baisse des bénéfices et/ou
augmentation des coûts), puis à au moins un scénario
« optimiste » (baisse des coûts et/ou augmentation
des bénéfices) pour voir la réaction de l'activité.
Mais, lorsque le scénario « normal » est
défavorable (VAN négative), on ne prévoit que des
scénarii « optimistes ». Cette analyse qui consiste
à prévoir des scénarii lors d'une analyse de
rentabilité financière est appelée analyse de
sensibilité. Elle a été réalisée dans le
cadre de notre étude.
Après la collecte, les données ont
été saisies dans le logiciel ACCESS 2007 et traitées
à l'aide des logiciels STATA/SE 10.0 pour l'estimation du modèle
de régression linéaire, SPSS 16.0 pour l'estimation du
modèle de régression logistique et le calcul des statistiques
descriptives et EXCEL 2007 pour la réalisation des graphiques et
l'évaluation de la rentabilité financière. Le traitement
de texte a été effectué avec le logiciel Word 2007.
5.1.7. 3.7. Limites
de la recherche : difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées lors du
déroulement de cette étude se situent essentiellement au niveau
de la phase de collecte des données.
Au cours de l'enquête, certaines unités
d'observation échantillonnées à partir de la
méthode d'échantillonnage n'ont pas pu être
enquêtées. Il a donc fallu procéder à leur
remplacement. A ceci s'ajoute l'indisponibilité des femmes
enquêtées qui, le matin, doivent s'occuper des travaux domestiques
ou d'autres petits travaux, à midi et le soir doivent préparer
à manger pour les membres du ménage. Pour contourner cette
difficulté, nous avons procédé à la prise de
rendez-vous.
La deuxième difficulté a résidé
dans le fait que les données aient été collectées
en un seul passage. Nous avons donc faire appel à la mémoire des
enquêtées pour avoir des informations sur leurs conditions
socio-économiques et sur les autres caractéristiques de leurs
ménages.
La dernière difficulté rencontrée
était la non-maitrise des principales langues parlées par nos
interlocuteurs. Nous avons donc recouru aux services d'interprètes.
Deuxième PARTIE
RESULTATS, ANALYSES ET DISCUSSIONS
6. CHAPITRE IV : CARACTERISTIQUES
DEMOGRAPHIQUES ET SOCIOECONOMIQUES DES UNITES D'ENQUETE.
6.1.1. 4.1.
Caractéristiques démographiques des ménages
Il s'agit de la taille moyenne et de la taille moyenne par
tranche d'âge des ménages enquêtés. Ces
caractéristiques sont présentées dans le tableau 6.
Tableau 6:
Caractéristiques démographiques des ménages
enquêtés
|
Tranche d'âge (en années)
|
Taille moyenne
|
Proportion (en %) de ménages avec des membres de ces
âges
|
|
0 - 5
|
1,2
|
58,3
|
|
6 - 10
|
1,4
|
71,7
|
|
11 - 15
|
1,1
|
63,3
|
|
16 et plus
|
3,5
|
100
|
|
Tout âge confondu
|
7,2
|
100
|
De ce tableau, il ressort que la taille moyenne des
ménages du village d'étude est de 7,2 membres. Cette moyenne est
de 1,2 pour les enfants de moins de 5 ans, 1,4 pour ceux de 6 à 10 ans,
1,1 et 3,5 respectivement pour les enfants de 11 à 15 ans et de plus de
15 ans ; ce qui laisse voir que lorsque nous prenons au hasard un
ménage de la zone d'étude, il contient plus de membres ayant un
âge supérieur à 15 ans que de membres de chacune des autres
tranches d'âge. Ce tableau nous montre également que 41,7 %, 28,3
% et 36,7 % des ménages du milieu ne possèdent respectivement
aucun membre des tranches d'âge 0 à 5 ans, 6 à 10 ans et 11
à 15 ans. Ce qui n'est pas le cas pour les membres ayant un âge
supérieur à 15 ans. Ces derniers, appelés personnes
actives selon le Bureau International du Travail (BIT)7(*), se retrouvent dans tous les
ménages enquêtés et sont d'ailleurs au minimum au nombre de
deux (2). Le ratio C/W (nombre de consommateurs8(*) C par rapport au nombre d'actifs W) moyen par
ménage nous donne 2,05   ce qui signifie qu'un actif de notre zone d'étude supporte 2,1
consommateurs. ce qui signifie qu'un actif de notre zone d'étude supporte 2,1
consommateurs.
6.1.2. 4.2.
Caractéristiques socio-économiques des unités
d'enquête
Ø Caractéristiques
sociales
Il s'agit du sexe, de l'âge, du statut matrimonial, de
l'appartenance ethnique, de la religion du `'chef cuisine''. Ces
différentes informations relatives aux ménages
enquêtés sont consignées dans le tableau 7.
Tableau 7: Répartition
des `'chefs cuisine'' enquêtées en fonction de leurs
caractéristiques sociales
|
Variables
|
Modalités
|
Fréquences
|
|
Age
|
20 - 45 ans
|
79 (65,8 %)
|
|
Plus de 45 ans
|
41 (34,2 %)
|
|
Statut
Marital
|
Vivre avec conjoint
|
97 (80,8 %)
|
|
Vivre sans conjoint
|
23 (19,2 %)
|
|
Niveau d'instruction
|
Sans
instruction
|
77 (64,2 %)
|
|
Primaire
|
31 (25,8 %)
|
|
Secondaire
|
12 (10 %)
|
|
Supérieur
|
0 (0 %)
|
|
Religion
|
Islam
|
71 (59,2 %)
|
|
Christianisme
|
39 (32,5 %)
|
|
Animisme
|
9 (7,5 %)
|
|
Athéisme
|
1 (0,8 %)
|
|
Groupes socioculturels
|
Batonou
|
45 (37,5 %)
|
|
Ditamari
|
17 (14,2 %)
|
|
Dendi
|
4 (3,3 %)
|
|
Kotocoli
|
8 (6,7 %)
|
|
Yom et Lokpa
|
7 (5,8 %)
|
|
Nago
|
13 (10,8 %)
|
|
Fon et apparentés
|
9 (7,5 %)
|
|
Autres
|
17 (14,2 %)
|
L'âge moyen des `'chefs cuisine'' enquêtées
est de 42 ans. De façon plus détaillée, on peut voir
à partir du tableau que 65,8 % des `'chefs cuisine'' ont un âge
compris entre 20 et 45 ans et que les 34,2 % restantes ont un âge
supérieur à 45 ans. On peut dire que la population
féminine du village d'étude est relativement jeune.
Par rapport à la situation maritale des `'chefs
cuisines'', 80,8 % des enquêtées vivent sous le toit de leurs
conjoints et avec ceux-ci tandis que 19,2 % des `'chefs cuisines'' vivent
seules. Trois raisons pourraient justifier la solitude de ces 19,2 % : le
célibat, le divorce et le veuvage. Mais aucune des femmes
enquêtées n'est célibataire ; ceci s'explique par le
fait que la responsabilité de `'chefs cuisine'' n'est confiée
qu'à une femme mariée ou ayant été mariée
une fois. Aussi, aucune des `'chefs cuisine'' enquêtées n'est
divorcée ; ceci témoigne de l'importance que les populations
du milieu accordent à l'institution de mariage. Ces 23 `'chefs cuisine''
qui vivent seules sont donc des veuves. A défaut d'avoir des
informations sur l'âge de leur veuvage, nous pouvons dire que ces veuves
ne se sont pas remariées en raison de leurs âges
déjà trop avancés (55 ans comme moyenne).
Concernant la variable "Niveau d'instruction", 64,2 % des
`'chefs cuisine'' enquêtés n'ont aucune instruction ; 25,8 % ont
un niveau d'instruction primaire et 10 % ont un niveau d'instruction
secondaire. On remarque qu'aucune des enquêtées n'a un niveau
d'instruction supérieur. En somme, le niveau d'instruction au sein des
personnes enquêtées est relativement bas ; en témoigne le
pourcentage élevé de non instruits.
Pour la variable "Religion", il est à noter que 59,2 %
des enquêtées sont des musulmanes, 32,5 % chrétiennes et
7,5 % animistes. Soulignons qu'une des enquêtées a, jusque
là, refusé toute croyance en un dieu quelconque. Cette structure
religieuse du milieu, bien qu'elle soit observée uniquement au niveau
des femmes, est semblable à celle de l'ensemble de la commune de
Parakou. A travers ces statistiques, nous comprenons que l'islam est la
principale religion du milieu, suivi du christianisme.
Du point de vue "caractéristiques socioculturelles" des
`'chefs cuisine'' enquêtées, les batonou comptent pour
37,5 %, les ditamari pour 14,2 %, les nago pour 10,8 %, les
fon et apparentés pour 7,5 %, les kotokoli pour 6,7 %,
les yom et les lokpa comptent pour 5,8 % et les
dendi pour 3,3 %. Les autres groupes socioculturels, composées
de berba, d'ani, de pila-pila, de natimba,
de wama et de sèmèrè, comptent pour 14,2
% dans la sphère socioculturelle des enquêtées. Ces
résultats laissent voir que le milieu d'étude est doté
d'une richesse ethnique assez remarquable.
Ø Caractéristiques
économiques
Il s'agit des diverses activités économiques
menées par les `'chefs cuisine'' de Thian et de leur importance
respectives dans la constitution du revenu monétaire de ces femmes.
Les données collectées ont montré que le
revenu moyen par année des `'chefs cuisine'' enquêtées est
de 187 550 FCFA, avec un minimum de 0 FCFA (10,8 % des enquêtées)
et un maximum de 1 630 000 FCFA par an. Ces revenus proviennent de plusieurs
sources à savoir : l'agriculture, l'élevage, le commerce et
la transformation des produits agricoles, et accessoirement d'autres sources de
revenu comme le transfert d'autres membres, les prestations
réalisées pour le compte d'autrui, etc. Ces revenus sont
monétaires ou non monétaires (autoconsommation, transferts
reçus en nature). La Figure 3 illustre la contribution
de chaque domaine d'activité (ou source) au revenu total de
l'enquêtée.
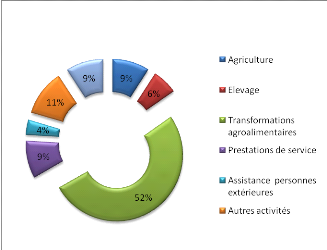
Figure 3: Structure du revenu des `'chefs cuisine''
enquêtés.
· Les transformations
agroalimentaires
Les transformations agroalimentaires constituent la principale
source de revenu des `'chefs cuisine'' enquêtées. Elles y
contribuent à hauteur de 52 % et sont pratiquées par 57,5 % des
enquêtées. Les transformations agroalimentaires, dans le village
Thian, regroupent essentiellement les transformations du sorgho en bière
locale (tchoukoutou) et en bouillie (koko), du maïs en
acassa (mombou) et en bouillie (koko), du soja en fromage
(soja gassarou) et du niébé en gâteau
(kiyarou). Cette part importante de la contribution de ces
activités au revenu total des enquêtées et le taux
élevé d'exercice de celles-ci dans ce domaine s'explique d'une
part, par le fait que les produits transformés intéressent toutes
les catégories de personnes du milieu, puisqu'il s'agit de nourritures
et de boissons et d'autre part, par le fait que l'art gastronomique est le
propre des femmes.
· L'agriculture
Elle est pratiquée par la plus grande majorité
des `'chefs cuisine'' enquêtées (77,5 %). En effet, Thian est un
village à habitats dispersés ; ce qui offre la
possibilité aux agriculteurs n'exploitant pas une grande superficie de
terre (les femmes surtout), de trouver un lopin de terre et d'y pratiquer les
spéculations telles que les légumes (crincrin, gombo, tomate,
piment, grande morelle) et les racines (manioc, patate douce). De plus, la
plupart des enquêtées ont leurs époux agriculteurs ;
ces derniers leur donnent, souvent, une portion de terre, à
proximité des leurs, afin qu'elles puissent exercer leurs propres
activités.
Bien que l'agriculture soit le domaine d'activité le
mieux exploré, elle contribue très peu (à hauteur de 9 %)
à la constitution du revenu monétaire des `'chefs cuisine''. Ceci
s'explique par le fait que la plupart des cultures faites sont destinées
à la consommation domestique.
· Vente de produits manufacturés et
prestations de service
La vente de produits manufacturés (tomate en boite,
cube, lait concentré, etc.), à l'instar de l'agriculture,
contribue au revenu des enquêtées à hauteur de 9 %. Cette
activité est exercée par 17,5 % des `'chefs cuisines''. La faible
proportion d'enquêtées exerçant dans ce domaine s'explique
simplement par le faible revenu qu'il génère.
Les prestations de service regroupent la coiffure, la couture,
le ramassage de sable et le remplissage de récipients d'eau pour la
construction d'habitations en dur. Ces activités sont, à l'instar
de la vente de produits manufacturés, menées par 17,5 % des
enquêtées et comptent, également, pour 9 % dans la
constitution de leur revenu. Beaucoup de femmes ne s'adonnent pas à
cette activité car, d'une part, elle est un peu difficile et d'autre
part s'organise en `'circuit fermé''. Sa faible contribution au revenu
total s'explique essentiellement par sa sporadicité.
· Elevage
Dans le village Thian, l'élevage occupe une place non
moins importante. Quarante cinq pour cent (45 %) des `'chefs cuisine''
enquêtées le pratiquent. Les espèces animales
élevées regroupent les petits ruminants (ovins, caprins), la
volaille (poules, canards) et les porcins. Les animaux sont souvent
élevés par leur propriétaire. Mais, il arrive que l'animal
élevé soit le fruit d'un contrat de confiage. Ce type de contrat
d'élevage concerne surtout les petits ruminants et les poules dont
l'élevage est confié à un proche parent ou un ami. Ce
dernier est chargé de leur multiplication et est, en retour,
rémunéré en nature (le tiers des nouveaux nés).
Le système d'élevage est de type extensif, ce
qui favorise l'émergence de certaines épizooties telles que la
peste porcine, la peste aviaire, le charbon bactéridien, la peste des
petits ruminants (PPR) etc. De ce fait, les principales contraintes
liées à l'élevage sont les pathologies diverses, le vol et
les actes de vandalisme. Ces contraintes associées à la
réticence des ménages à vendre leur cheptel si ce n'est en
situations de crises, sont les principales raisons de sa faible contribution au
revenu du ménage (6 %).
· Transfert de la part des parents vivant en
dehors du village ou assistance de personnes extérieures
Il s'agit des dons que les enquêtées
reçoivent de leurs proches, parents, amis et alliés vivant dans
d'autres localités, le plus souvent plus développées. Ces
personnes extérieures sont soit des migrants ou des personnes qui sont
toujours restées dans ces localités plus
développées et qui (re)viennent au village pour une
cérémonie ou une autre raison. 31.7 % des enquêtées
reçoivent ces dons qui comptent pour 4 % dans la constitution de leur
revenu.
· Les autres activités
D'autres activités occupent également les
`'chefs cuisine''. Il s'agit de la revente de produits agricoles, de pain, de
charbon, de bois de chauffe, de balai, etc. Ces activités sont
exercées par 17.5 % des enquêtées et participent pour 11 %
à la constitution du revenu de celles-ci.
CHAPITRE V :
HABITUDES ALIMENTAIRES, CONNAISSANCES ET ATTITUDES DES ENQUETEES RELATIVES A
L'ANEMIE FERRIPRIVE.
6.1.3. 5.1.
Habitudes alimentaires des ménages enquêtés
Il s'agit dans cette partie du travail de présenter les
principaux repas consommés par les ménages qui ont fait objet
d'enquête, les principales céréales consommées et
les diverses périodes de consommation de ces repas.
Les repas essentiellement consommés dans le milieu
d'étude sont les pâtes de sorgho, de maïs et de riz, l'igname
pilée, le riz simplement préparé ou associé au
niébé (waké). Pour 77,9 % des `'chefs cuisine'',
la pâte de maïs apparaît comme le repas le plus
consommé. La pâte de sorgho, quant à elle, constitue en
matière d'alimentation le premier choix pour 17,2 % des
enquêtées. Pour les 4,9 % restantes, le repas le plus
consommé est partagé entre le riz, l'igname pilée et le
niébé. En termes de deuxième repas le plus
consommé, la pâte de sorgho occupe la première place (74,2
% des enquêtées) ; elle est suivie de la pâte de
maïs (16,1 % des enquêtées) et de l'igname pilée, du
riz, du niébé (9,7 % des enquêtées). Ces
statistiques montrent que le maïs est la principale céréale
du milieu d'étude, en matière de consommation alimentaire. Il est
directement suivi du sorgho qui occupe également une place assez
importante dans l'alimentation de ces populations.
Il y a environ deux décennies, au dire des
enquêtées et quelques personnes ressources du milieu
d'étude, la pâte de sorgho était le repas le plus
consommé et de ce fait, le sorgho la céréale la plus
consommée. Le maïs ne figurait même pas parmi les cultures
faites dans le milieu. La tendance s'est inversée avec le temps, pour la
raison que le sorgho a commencé par prendre de la valeur sur le
marché des produits vivriers. Alors, les ménages, producteurs,
pour la plupart à la recherche du profit, ont commencé à
préférer vendre leurs stocks de sorgho et acheter une autre
céréale pouvant leur permettre d'avoir de la pâte pour la
consommation domestique. C'est ainsi que le choix a porté sur le
maïs qui, au fil des années a remplacé le sorgho et est
devenu la céréale la plus consommée à Thian.
La figure 4 présente les
périodes de consommation et les fréquences absolues des
ménages consommateurs des principaux repas consommés à
Thian.
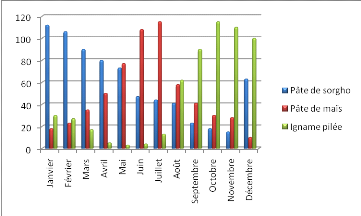
Figure 4: Périodes de consommation et
fréquences absolues des ménages consommateurs
des principaux repas.
De l'analyse de cette figure, il ressort que
le nombre de ménages consommateurs de la pâte de sorgho diminue
entre les mois de janvier et de novembre et recommence sa croissance à
partie de décembre. Cet état de chose s'explique par le fait que
le sorgho, dans le milieu, est récolté dans le mois de
décembre. Juste après la récolte, certains ménages
commencent à le consommer mais d'autres se servent de ce mois pour le
sécher. Ces derniers ménages commencent la consommation
proprement dite du sorgho à partir du mois de janvier, ce qui explique
le pic de consommateurs observé en cette période.
La figure 4 nous montre également que
le nombre de ménages consommateurs de la pâte de maïs
croît de janvier à juillet et décroît d'août
à décembre. Dans un milieu où la récolte de
maïs se fait essentiellement dans le mois d'octobre, le grand nombre de
ménages consommateurs de la pâte de maïs observés
entre mai et juillet pourrait inquiéter. Mais, ceci s'explique par le
simple fait que les ménages stockent d'abord le maïs et mangent
l'igname (novembre et décembre surtout) et le sorgho (janvier à
mai). C'est en période de pénurie de sorgho et d'igname que la
consommation du maïs devient intense.
Enfin, la figure 4 nous montre que la
période de grande consommation de l'igname pilée va du mois
d'août au mois de décembre. En effet, l'igname précoce
appelée gangni est récoltée dans le mois
d'août ou de septembre tandis que l'igname tardive appelée
kokoro est récoltée en une seule fois de novembre
à décembre ; ce qui rend disponible l'igname dans cette
période.
Les trois séries de la figure 4, observées
simultanément, montrent que la décroissance du nombre de
ménages consommateurs de la pâte de sorgho va de paire, entre
janvier et juillet, avec l'augmentation du nombre de ménages
consommateurs de la pâte de maïs et va de paire, entre juillet et
octobre, avec l'augmentation du nombre de ménages consommateurs d'igname
pilée. Ce qui montre que le vide créé par la diminution du
sorgho est comblé par, d'abord le maïs et ensuite l'igname.
6.1.4. 5.2.
Connaissances et attitudes des enquêtées relatives a
l'anémie
Dans ce paragraphe, nous allons évaluer les diverses
connaissances que les `'chefs cuisines'' ont de l'anémie.
L'anémie, rappelons-le, se manifeste sous trois
formes : sévère, modérée et
légère. En dehors des examens cliniques qui le prouvent,
l'anémie n'est généralement pas détectable par les
individus qui en souffrent ou par leurs proches. Dans le village
d'étude, 40 % des enquêtées ont connu au moins un cas
d'anémie dans leur ménage. Parmi ces 40 %, 14,1 % appartiennent
à la phase pilote du projet qui a conduit à l'installation de
l'unité de décorticage mécanique et de la fortification en
fer du sorgho. Ces 14,1 % ont donc été informées par les
promoteurs du projet suite à l'analyse au centre de santé de
leurs prélèvements sanguins. En dehors de ces
enquêtées retenues pour le compte du projet, dont les membres
anémiés souffraient de l'anémie légère ou
modérée, les autres enquêtés (25,9 %) qui nous ont
confié des cas d'anémie au sein de leurs ménages l'ont
appris à l'hôpital par l'entremise d'un médecin. Il
s'agissait donc pour ces individus de l'anémie sévère.
Rapportons ici, les propos d'une femme nous relatant le cas d'anémie
qu'elle a connu dans son ménage, il y a deux années environ.
|
ENCADRE N°1
Oui j'ai un enfant qui à souffert d'anémie.
Malheureusement il en est mort à l'âge de 15 mois  ; c'était mon ainée. Quelques mois après sa
naissance, elle a commencé par avoir de la fièvre de façon
régulière. Inquiets, mon mari Louis et moi l'avions emmené
à l'hôpital et le médecin, après des analyses de son
sang, nous a dit que c'était de l'anémie due à un
problème de malnutrition. Il lui a fait une transfusion de sang.
Ensuite, il nous a prescrit des médicaments à acheter et nous a
surtout conseillés de changer immédiatement le régime
alimentaire de l'enfant et le mien également. Il a recommandé un
régime alimentaire constitué de fruits, d'oeufs et de toute sorte
d'aliments riches en vitamines. De retour au village, nous avons emmené
l'enfant au centre de promotion sociale pour un suivit nutritionnel, car nous
avons appris que ce centre aide les enfants à améliorer leur
état nutritionnel, par des conseils et des dons d'aliments riches en
vitamine. Arrivés au centre de promotion sociale, ils ont pesé
l'enfant et m'ont demandé sa date de naissance. Après cela, ils
m'ont dit, tout comme le médecin, que l'enfant souffrait d'une
malnutrition sévère et nous ont conseillés presque les
mêmes aliments que le médecin. ils nous ont aussi donné de
la farine améliorée et nous ont dit comment la préparer
pour l'enfant. On a suivi leurs conseils mais finalement, l'enfant a
trépassé. ; c'était mon ainée. Quelques mois après sa
naissance, elle a commencé par avoir de la fièvre de façon
régulière. Inquiets, mon mari Louis et moi l'avions emmené
à l'hôpital et le médecin, après des analyses de son
sang, nous a dit que c'était de l'anémie due à un
problème de malnutrition. Il lui a fait une transfusion de sang.
Ensuite, il nous a prescrit des médicaments à acheter et nous a
surtout conseillés de changer immédiatement le régime
alimentaire de l'enfant et le mien également. Il a recommandé un
régime alimentaire constitué de fruits, d'oeufs et de toute sorte
d'aliments riches en vitamines. De retour au village, nous avons emmené
l'enfant au centre de promotion sociale pour un suivit nutritionnel, car nous
avons appris que ce centre aide les enfants à améliorer leur
état nutritionnel, par des conseils et des dons d'aliments riches en
vitamine. Arrivés au centre de promotion sociale, ils ont pesé
l'enfant et m'ont demandé sa date de naissance. Après cela, ils
m'ont dit, tout comme le médecin, que l'enfant souffrait d'une
malnutrition sévère et nous ont conseillés presque les
mêmes aliments que le médecin. ils nous ont aussi donné de
la farine améliorée et nous ont dit comment la préparer
pour l'enfant. On a suivi leurs conseils mais finalement, l'enfant a
trépassé.
Aujourd'hui, comme vous-même vous le voyez, je suis
encore enceinte et si tout va bien dans deux mois je vais accoucher. Ma plus
grande peur c'est de voir partir encore ce deuxième enfant. Mais, je
crois que grâce à Dieu, cela n'arrivera pas car non seulement je
ferai tout ce que le médecin et les gens du centre de promotion social
m'ont dit, mais aussi j'irai chaque fois décortiquer et fortifier mon
sorgho avant de le moudre.
|
De façon globale, 56,9 % des `'chefs cuisine''
enquêtées ont affirmé que l'anémie était un
problème de santé publique dans le village car, soit un membre du
ménage en a souffert, soit des individus proches en ont souffert. Mais
pour 15,4 % des enquêtées, cette maladie n'existe pas dans Thian,
car ils n'en ont jamais entendu parler. Le reste (27,7 %) a
préféré être moins strict en affirmant son ignorance
de l'existence ou non de cette maladie dans le village.
La figure 5 présente les causes de l'anémie
selon les `'chefs cuisine'' enquêtées.
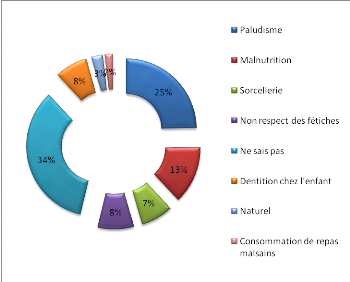
Figure 5: Les facteurs
d'anémie selon les enquêtées.
Cette figure nous montre que les causes de l'anémie,
selon les enquêtées, sont diverses. La plupart d'entre elles (34
%) ignorent les réelles causes de l'anémie. Mais dans le groupe
de celles qui lui connaissent au moins une cause, 25 % pensent que le paludisme
est le principal facteur d'anémie. Selon ces enquêtées, le
fait pour un individu de s'exposer aux piqûres régulières
de moustiques ou de s'exposer de façon régulière au soleil
le rend vulnérable au paludisme. Et c'est le paludisme non ou mal
traité qui conduit à l'amenuisement du sang dans
l'organisme ; d'où l'anémie. Pour les autres, les facteurs
d'anémie sont : la malnutrition (13 % des enquêtées),
la dentition chez l'enfant (8 % des enquêtées), le non respect des
fétiches (8 % des enquêtées), la sorcellerie (7 % des
enquêtées), la consommation de repas malsains (2 % des
enquêtées). La nature, pour 3 % des enquêtées, est
à la base de l'anémie chez un individu. L'encadré N°2
rapporte les propos d'une enquêtée pour qui l'anémie est
causée par les fétiches.
|
ENCADRE N°2
Aucun membre de mon ménage n'a jamais souffert de
cette maladie. Il y a déjà des années, j'ai vu une femme
très riche souffrir de ça. Les gens l'on amenée à
l'hôpital et malgré tous les soins qu'elle y a reçu, la
maladie n'a pas cessé ; elle manquait cruellement de sang. Cela a
commencé par inquiéter ses proches qui ont commencé par
chercher dans la tradition les causes du mal. Ils ont découvert que
c'est un fétiche9(*)
qui est à la base de la maladie.
En fait, la dame a vendu son âme au diable, à
travers ce fétiche, pour que ces activités tournent très
bien afin, d'avoir beaucoup d'argent. Naturellement, il y a des sacrifices
qu'elle doit faire périodiquement. Il s'agissait de donner du sang de
mouton au fétiche suivant une périodicité bien
précise. Et il paraîtrait que c'est pour le fait qu'elle ait
manqué de faire ce sacrifice une fois, que le fétiche s'est mis
en colère contre elle. Cette colère s'est manifestée par
l'extinction de son sang en remplacement du sang du mouton. C'est le seul cas
que j'ai connu ; et c'est pourquoi je dis que c'est le non respect des
promesses faites à un fétiche qui est à la base de
l'anémie.
|
7. CHAPITRE VI : ANALYSE DES
DETERMINANTS DE LA PREDISPOSITION DES MENAGES A ADOPTER LE DECORTICAGE
MECANIQUE ET LA FORTIFICATION EN FER DU SORGHO.
D'après notre revue de littérature, dans les
milieux où la consommation de sorgho domine, le risque d'anémie
martiale est élevé, en raison du fort taux de facteurs
antinutritionnels retrouvés dans les aliments. Aussi, les
résultats présentés dans le chapitre V nous ont
révélé que 40 % des enquêtées ont connu au
sein de leurs ménages au moins un cas d'anémie
sévère, sans compter les cas d'anémie
modérée et légère qui ne sont pas décelables
par les populations. Toujours dans le chapitre V, nous avons vu que la
pâte de sorgho occupait une place de choix dans l'alimentation des
ménages enquêtés.
A partir de ce moment, il était important de proposer
à ces ménages consommateurs un procédé de
transformation du sorgho qui les exposera moins aux risques de contracter cette
maladie qui est l'anémie. Une fois ce procédé, qui est une
innovation, proposé, il faudra identifier et analyser les facteurs qui
influenceront, positivement et/ou négativement son adoption. C'est
justement ce qui est fait et les résultats sont présentés
dans ce chapitre. Nous avons, pour ce faire, utilisé un modèle
Logit binomial dont les résultats sont consignés dans le tableau
8. Seules les variables significatives y sont présentes.
Tableau 8: Résultats
de la régression logistique binomiale.
Variable dépendante :
prédisposition à adopter le décorticage et la
fortification du sorgho.
|
Variables
explicatives
|
Définition de la
variable
|
Signes
Attendus
|
Coefficients
|
Probabilités
|
Degré de
signification
|
|
Constante
|
/
|
/
|
-8,280
|
0,0001
|
***
|
|
REVENU
|
Revenu de l'enquêtée.
|
+
|
0,0001
|
0,044
|
**
|
|
APPP
|
Appartenance de l'enquêtée à la phase
pilote du projet.
|
+
|
-3,974
|
0,022
|
**
|
|
COMPLX
|
Complexité perçue de la procédure de
décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho
|
-
|
-5,801
|
0,024
|
**
|
|
COMPAT
|
Compatibilité de la technologie avec les normes et
valeurs du ménage
|
+
|
8,481
|
0,020
|
**
|
|
STATU
|
statut social de l'enquêtée après
l'adoption de la technologie
|
+
|
5,616
|
0,029
|
**
|
|
Nombre d'observations = 120 ; Nombre de
prédisposées = 90 ; Nombre de non prédisposées
= 30.
|
|
-2Log vraisemblance = 28,134
Khi-deux = 58,853
Significativité du modèle: 0,0001 ***
|
|
Pouvoir de prédiction: 54,4 % (Cox et Snell); 79,2 %
(Nagelkerke)
|
|
* * * = Significatif à 1%; * * = Significatif à
5%; ns = Non significatif.
|
7.1.1. 6.1.
Qualité, pouvoir de prédiction et variables déterminantes
du modèle
· Qualité du modèle
Le ratio de vraisemblance s'est révélé
significatif à 1% après le test de khi-deux. Par
conséquent, le modèle est globalement significatif à 1%.
Les résultats du modèle (notamment les signes des coefficients)
peuvent être valablement pris en compte. Les variations de la variable
indépendante sont alors expliquées par les variables
dépendantes de manière acceptable.
· Pouvoir de prédiction
Les estimations du modèle de régression ont
donné le pseudo-R2 de Nagelkerke égal à 0,792.
On peut donc, à partir du modèle, faire des prévisions sur
les modalités de la variable dépendante, connaissant celles des
variables indépendantes avec une probabilité allant à 79,2
% d'avoir une prédiction juste.
· Variables déterminantes
Les résultats obtenus indiquent que les variables qui
déterminent l'adoption du décorticage mécanique et de la
fortification en fer du sorgho sont : le revenu de l'enquêtée
(REVENU), son appartenance à la phase pilote du projet (APPP), la
complexité perçue de la procédure de décorticage
mécanique et de la fortification en fer du sorgho (COMPLX), la
compatibilité de l'innovation avec les normes et valeurs du
ménage de l'enquêtée (COMPAT) et la perception de
l'enquêtée de son statut social après l'adoption de la
technologie (STATU).
7.1.2. 6.2. Analyse
et discussion des résultats
Les résultats issus de la régression logistique
portant sur les déterminants de l'adoption du décorticage
mécanique et de la fortification en fer du sorgho dans le village Thian,
révèlent l'existence de cinq variables significatives que nous
nous devons d'analyser et discuter.
· Le revenu de
l'enquêtée
Il s'agit du revenu des femmes à charge de la
préparation de la pâte du sorgho dans les ménages
enquêtés. Dans le modèle, le signe du coefficient de cette
variable est le signe plus (+) ; il correspond au signe attendu. Il
indique que la décision d'adopter le décorticage mécanique
et la fortification en fer du sorgho est positivement influencée par le
revenu de l'enquêtée. En d'autres termes, plus le revenu de
l'enquêtée est élevé, plus grande est sa
probabilité de décider d'adopter l'innovation. Ce résultat
s'explique par le fait que les `'chefs cuisine'' qui ont un revenu
élevé se sentent en mesure de faire face aux coûts
liés à l'adoption de l'innovation. En effet, avant l'obtention du
sorgho décortiqué et fortifié, diverses opérations
sont effectuées par le minotier et l'agent qui assure la fortification.
Il s'agit dans cet ordre de :
ü la pesée du sorgho à l'aide d'une balance
mécanique
ü l'humidification du sorgho ;
ü le décorticage proprement dit du sorgho à
l'aide d'un décortiqueur ;
ü la pesée du sorgho décortiqué
à l'aide de la même balance mécanique ;
ü la pesée de la quantité de fer
nécessaire à la fortification du sorgho décortiqué
à l'aide d'une balance électrique ;
ü la fortification proprement dite du sorgho
décortiqué.
L'enquêtée ayant pris conscience de ce que toutes
ces opérations ont un coût, fait référence à
son niveau de revenu et se prononce sur sa décision d'adopter ou de
rejeter l'innovation.
Ce résultat est conforme à celui obtenu par
Agbahey (2007). Dans sa recherche sur la prédisposition des
ménages du département du Couffo (Sud-Bénin)
affectés par le VIH/SIDA à adopter les systèmes de
production basés sur les variétés
améliorées, cet auteur trouve que le niveau de revenu influence
positivement la décision d'adopter ou de rejeter les
variétés améliorées. Il montre ainsi que les
producteurs à haut niveau de revenu sont plus prédisposés
à adopter les variétés améliorées que ceux
à faible niveau de revenu.
· L'appartenance de l'enquêtée
à la phase pilote du projet
Cette variable désigne l'appartenance ou non de
l'enquêtée à la phase pilote du projet qui a conduit
à l'installation de l'unité de décorticage et de
fortification. Les résultats obtenus à partir de la
régression logistique montrent que cette variable influence
négativement la décision d'adopter le décorticage
mécanique et la fortification en fer du sorgho. L'appartenance à
la phase pilote du projet est donc négativement corrélée
à la disposition de l'enquêtée à adopter le
décorticage mécanique et la fortification en fer du sorgho.
Autrement dit, lorsqu'on va des `'chefs cuisines'' n'ayant pas appartenu
à la phase pilote du projet à celles ayant appartenu à la
phase pilote, nous avons une diminution du nombre des
prédisposées. Cet effet négatif de cette variable sur la
prédisposition de l'enquêtée à adopter l'innovation
est contraire à celui que nous avions prédit. Selon Evenson
(1992) et Ogunlana (2003), le contact de l'enquêté avec la
`'vulgarisation'' devrait faciliter l'accès à l'information et
favoriserait l'adoption des innovations. Mais, l'effet contraire observé
au cours de notre étude pourrait s'expliquer par les multiples plaintes
de ces femmes qui ont appartenu à la phase pilote du projet, et donc
expérimentées la technologie. En effet, pendant les huit mois
d'expérimentation de la technologie par les femmes
sélectionnées, elles ont relevé plusieurs insuffisances.
Il s'agit de :
ü la non-permanence de l'agent qui effectue la
fortification : en fait, pour le compte du projet, un agent a
été recruté pour assurer la fortification du sorgho,
après le décorticage par le minotier. Cet agent, dans une
journée, n'arrive dans le village pour faire son travail, qu'en fin
d'après-midi (17 heures). A son arrivée, dès qu'il finit
de fortifier le sorgho déjà décortiqué, il
rebrousse chemin. Alors, les femmes qui amènent du sorgho dans
l'unité avant 17 heures ou après son départ et qui sont
dans un besoin pressant de farine pour préparer la pâte ne peuvent
pas voir leur sorgho fortifié. Cette situation n'est pas du goût
des `'chefs cuisines'' qui ont déjà expérimenté la
technologie.
ü l'impossibilité de conserver la farine pendant
un bon moment. Selon les enquêtées, la farine qu'elles obtenaient
avec le sorgho non décortiqué se conservait pendant plus de deux
semaines, alors que celle améliorée (issus de sorgho
décortiqué et fortifié) ne se conserve pas pendant plus de
3 ou 5 jours. Ceci est certainement dû, selon ces `'chefs cuisine''
à l'humidification que subit le sorgho avant son décorticage.
Cette humidification augmente le taux d'humidité de la farine favorisant
ainsi l'activité des micro-organismes, et conduisant à son
altération précoce. Cette situation n'avantage guère les
enquêtées.
ü la diminution de la quantité de farine
après décorticage : même si les enquêtées
ont reconnu qu'il ne peut en être autrement, elles ont tout de même
mentionné cet état de chose, lors des discussions que nous avons
menées avec elles. Cela pourrait les amener à
préférer moudre leur sorgho sans forcément passer par le
décorticage.
Cette influence négative de la variable `'appartenance
ou non à la phase pilote du projet'', bien que les
enquêtées sélectionnées aient reconnu la
supériorité des qualités organoleptiques et
nutritionnelles du dibou issue de sorgho décortiqué et
fortifié, s'explique par le fait que tout individu opère un choix
en fonction des coûts et des avantages qu'il en tire ou qu'il
espère en tirer. C'est d'ailleurs ce qui a justifié le choix du
modèle des choix rationnels pour servir de fil conducteur de notre
recherche.
La prévision d'une phase pilote ou
d'expérimentation de l'innovation n'est donc pas une mauvaise
idée. Elle permet de relever les insuffisances liées au
fonctionnement de la technologie, afin de proposer des solutions
adéquates pour une meilleure adoption par toute la population.
· La complexité perçue de la
procédure de décorticage mécanique et de la fortification
en fer du sorgho
Il s'agit de la perception de l'enquêtée sur la
complexité ou non de la procédure de décorticage et de
fortification. Cette perception était évaluée à
l'aide de deux critères : le niveau de facilité de
compréhension de la procédure de décorticage et de
fortification et l'idée que l'enquêtée se fait du temps que
prendra ces opérations. Ainsi, la procédure est qualifiée
de complexe lorsque l'enquêtée affirme qu'elle est difficile
à comprendre, ou lorsque l'enquêtée juge la
procédure trop longue.
A travers le modèle, nous voyons que cette variable
influence négativement la prédisposition des `'chefs cuisine''
à adopter l'innovation. Cette influence négative, conforme
à nos prévisions, indique que la probabilité de rejet de
l'innovation augmente lorsque l'enquêtée juge la procédure
de décorticage et de fortification complexe.
Un résultat semblable a été obtenu par
Ogunlana (2003) lorsqu'elle conduisait son étude sur les comportements
d'adoption de la culture en couloir par les agricultrices du Nigéria.
Cet auteur a montré que la complexité, définie dans le
cadre de son étude comme le degré auquel une innovation est
perçue comme étant difficile à comprendre et à
utiliser, influençait négativement l'adoption de la culture en
couloir. Par ailleurs, Bendana et Sadok (2005) ont aboutit à cette
même conclusion dans leur étude sur les facteurs explicatifs des
intentions d'adoption du gouvernement électronique par les petites et
moyennes entreprises tunisiennes.
· Compatibilité de la technologie avec les
normes et valeurs du ménage de l'enquêtée
Cette variable a été introduite dans le
modèle de régression logistique pour voir l'influence des normes
et valeurs du groupe social qu'est le ménage auquel
l'enquêtée appartient, sur la prédisposition à
adopter l'innovation. Ces normes et valeurs peuvent être liées
à la tradition, à la religion, etc.
Les résultats du modèle révèlent
un effet positif de cette variable sur la prédisposition des `'chefs
cuisine'' à adopter le décorticage mécanique et la
fortification en fer du sorgho. Cette variable est donc positivement
corrélée avec la prédisposition à adopter
l'innovation. Cet effet positif est celui qui est attendu. Il indique que la
probabilité d'acceptation de l'innovation augmente lorsqu'elle est
compatible avec les normes et valeurs de l'enquêtée.
· Statut social de l'enquêtée
après adoption de l'innovation
Il s'agit ici de l'idée que l'enquêtée se
fait de son statut social, une fois qu'elle aura adopté l'innovation.
Dans le modèle, le signe du coefficient de cette variable est le signe
plus (+) ; il correspond au signe attendu. Il qui indique que la
décision d'adopter le décorticage mécanique et la
fortification en fer du sorgho est positivement influencée par le statut
social de l'enquêtée. Autrement dit, la probabilité
d'acceptation de l'innovation augmente lorsque l'enquêtée est
convaincue qu'elle améliorera son statut dans le village. Le statut
social de l'enquêtée est amélioré, lorsque celle-ci
est mieux `'regardée'' que par le passé. En effet, l'adoption du
décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho est
source de prestige car, d'une manière ou d'une autre, implique des
charges financières supplémentaires. Une femme qui adopte cette
innovation est une femme qui est en mesure de dépenser plus d'argent que
par le passé. Etre capable de sortir de son portefeuille plus d'argent
que par le passé, fait de cette femme et de son époux, des
personnes qu'on peut qualifier d'aisées. En dehors de cela, un
ménage qui accepte décortiquer et fortifier chaque fois le sorgho
avant de le moudre, pourra être vu comme un ménage exemplaire, car
ayant le souci de contribuer à l'éradication d'une maladie. Tout
ceci contribuerait à l'amélioration du statut social des `'chefs
cuisine'' qui adopteraient l'innovation. Celles qui sont convaincues de cela
ont une grande probabilité d'adoption du décorticage et de la
fortification.
Un résultat similaire a été trouvé
par Ogunlana (2003) lorsqu'elle conduisait son étude sur les
comportements d'adoption de la culture en couloir par les agricultrices
nigérianes. Cet auteur a, en fait, montré qu'il existait une
corrélation positive entre le niveau d'adoption de la culture en couloir
et le prestige social qui en dérive.
De tout ce qui précède, nous pouvons dire que le
revenu de l'enquêtée, son appartenance à la phase pilote du
projet, sa perception de la complexité de la procédure de
décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho, la
compatibilité de l'innovation avec les normes et valeurs de son
ménage et la perception qu'elle a de son statut social après
l'adoption de l'innovation influencent sa décision de décortiquer
de façon mécanique et de fortifier en fer son sorgho. Les
variables telles que le niveau de revenu, la compatibilité de
l'innovation avec les normes et les valeurs des ménages des
enquêtées et le statut social des enquêtées
après l'adoption de l'innovation ont une influence positive sur la
décision des `'chefs cuisine'' à décortiquer de
façon mécanique et fortifier en fer leur sorgho. Ainsi, la
probabilité de répondre « oui » à la
question de savoir si l'enquêtée acceptera décortiquer,
fortifier et payer un montant pour ces opérations augmente lorsque
l'enquêtée à un niveau de revenu élevé, juge
compatible le décorticage et la fortification avec les normes et les
valeurs de son ménage, et perçoit ces opérations comme
capables d'améliorer son statut social. Par contre, les variables telles
que l'appartenance de l'enquêtée à la phase pilote du
projet et la complexité perçue de la procédure de
décorticage mécanique et de la fortification en fer du sorgho
influencent négativement la décision des `'chefs cuisine''
à adopter l'innovation. Autrement dit, la probabilité de
répondre « non » à la question de savoir si
l'enquêtée acceptera décortiquer, fortifier et payer un
montant pour ces opérations augmente lorsque l'enquêtée a
appartenu à la phase pilote du projet qui a conduit à
l'installation de la plate-forme de décorticage et de fortification et
lorsque l'enquêtée juge la procédure de décorticage
mécanique et de la fortification en fer du sorgho complexe.
A partir de ce moment, nous acceptons la première
hypothèse de notre étude, et concluons que les facteurs d'ordre
socio-économique que sont le niveau de revenu, l'appartenance à
la phase pilote du projet, la complexité perçue de la
procédure de décorticage et de fortification, la
compatibilité de l'innovation avec les normes et valeurs du
ménage de l'enquêtée et le statut social de
l'enquêtée après l'adoption de l'innovation
déterminent la décision des `'chefs cuisine'' du village Thian
à décortiquer de façon mécanique et fortifier en
fer le sorgho.
8. CHAPITRE VII : ANALYSE DES
DETERMINANTS DU CONSENTEMENT A PAYER DES MENAGES `'CONSOMMATEURS'' DE DIBOU
POUR LE DECORTICAGE MECANIQUE ET LA FORTIFICATION EN FER DU SORGHO
Nous présentons dans ce chapitre les facteurs qui
influencent le consentement à payer des `'chefs cuisine''
prédisposées à décortiquer et fortifier leur sorgho
avant sa mouture. Le consentement à payer, dans le cadre de cette
étude, désigne la valeur (en FCFA) accordée à une
unité de sorgho décortiqué et fortifié. Cette
unité est la « grande boite de tomate » ; c'est
elle qui est la plus utilisée dans le milieu. Elle correspond à
1,85 (  kg10(*) pour le
sorgho. kg10(*) pour le
sorgho.
Ce consentement à payer a été recueillie
à l'aide de la méthode d'évaluation contingente. Le mode
de questionnement utilisé pour cette valorisation est le questionnement
ouvert qui a consisté à demander aux `'chefs cuisines'' de
proposer volontairement et honnêtement un montant qu'elles pourront payer
pour décortiquer et fortifier une boite de tomate de sorgho. Certaines
enquêtées se sont prononcées aisément sur la
question, mais d'autres pensaient que c'étaient à nous de
proposer un prix, quitte à elles de se conformer. Mais avec nos
explications, elles ont compris que notre souhait était de fixer un prix
qui arrangerait presque tout le monde, et pour ce faire il fallait recueillir
le consentement à payer de toutes les enquêtées. Elles se
sont donc honnêtement prononcées sur la question.
Une fois ces valorisations recueillies, nous avons
utilisé un modèle de régression linéaire multiple
pour identifier les facteurs qui l'influencent positivement et/ou
négativement. La variable de réponse, le consentement à
payer des `'chefs cuisine'', est une variable continue et les
régresseurs sont une combinaison de variables qualitatives et de
variables quantitatives. Les tableaux 9 et 10 présentent respectivement
les corrélations entre les variables explicatives et les
résultats de l'estimation du modèle de régression
linéaire à l'aide du logiciel STATA.
Tableau 9 : Matrice de
corrélation entre les variables explicatives du modèle de
régression linéaire.
|
AGE
|
REVENU
|
PERSCHARG
|
ANEMIE
|
QUANT
|
APPP
|
STATU
|
APMARI
|
|
AGE
|
1,0000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REVENU
|
0,0334
|
1,0000
|
|
|
|
|
|
|
|
PERSCHARG
|
0,0556
|
0,1426
|
1,0000
|
|
|
|
|
|
|
ANEMIE
|
0,1104
|
0,0508
|
0,2174*
|
1,0000
|
|
|
|
|
|
QUANT
|
-0,0104
|
0,0598
|
-0,0294
|
-0,1243
|
1,0000
|
|
|
|
|
APPP
|
0,1002
|
0,1564*
|
0,1618*
|
-0,0000
|
-0,0362
|
1,0000
|
|
|
|
STATU
|
-0,0638
|
0,0449
|
0,0032
|
0,1256
|
-0,0689
|
0,1180
|
1,0000
|
|
|
APMARI
|
-0,0368
|
0,1543*
|
0,0979
|
-0,0953
|
0,0230
|
-0,0149
|
0,2581*
|
1,0000
|
De l'analyse de ce tableau, il ressort que parmi les
coefficients de corrélation qui sont significatifs à un seuil de
10 %, le plus élevé est 0,2581. Cette valeur du coefficient de
corrélation le plus élevé s'est
révélé « faible » car inférieur
à 0,8 ; la multicolinéarité n'est, de ce fait, pas un
sérieux problème (Gujarati, 2004). Mais attention, « de
fortes corrélations d'ordre zéro sont une condition
nécessaire mais non suffisante pour qu'il existe une
multicolinéarité car elle peut exister même si les
corrélations d'ordre zéro ou simples sont comparativement faibles
(par exemple inférieur à 0,50) » (Gujarati, 2004).
Tableau 10 :
Résultats de la régression linéaire multiple.
Variable de
réponse : Consentement à payer.
|
Variables
|
Signes attendus
|
Coefficients
|
Erreurs standards robusts
|
Statistiques t de Student
|
Significativité
|
|
Constante
|
/
|
22,1097
|
8,151705
|
2,71
|
0,008 ***
|
|
Quantité moyenne de sorgho consacrée à la
consommation (QUANT).
|
-
|
-0,9860733
|
0,4017155
|
-2,45
|
0,016 **
|
|
Appartenance de l'enquêtée à la phase
pilote du projet (APPP).
|
+
|
-13,95706
|
2,772587
|
-5,03
|
0,0001 ***
|
|
R2 = 0,183
Prob > F = 0,0005 ***
Nombre d'observations = 96
|
|
* * * = Significatif à 1%; * * = Significatif à
5%; ns = Non significatif.
|
8.1.1. 7.1. La
signification globale, qualité de l'ajustement, variables
déterminantes et test de spécification
« correcte » du modèle.
· La signification globale du
modèle
La p-value du modèle est sensiblement nulle
(inférieure à 1 %) ; cela signifie que l'on prend un risque
de se tromper de moins de 1 % en concluant que les variables explicatives
sélectionnées apportent une quantité d'information
significative au modèle. Le modèle est donc globalement
significatif au seuil de 1 %.
· La qualité de l'ajustement du
modèle
Le coefficient de détermination multiple R2
du modèle est égal à 0,183 ; ce qui signifie que 18,3
% des variations du consentement à payer sont expliquées par les
régresseurs du modèle. Au plan statistique, ce coefficient de
détermination est faible. Toutefois, Gujarati (2004) avait relevé
que dans les études en coupe instantanée comprenant plusieurs
observations, on obtient généralement un faible
R2, en raison de la diversité des
unités dans ce type d'études. Une telle valeur du R2
est donc acceptable.
· Les variables déterminantes
Les variables qui influencent le consentement à payer
des `'chefs cuisine'' pour les opérations de décorticage
mécanique et de fortification en fer du sorgho sont :
l'appartenance de l'enquêtée à la phase pilote du projet
(APPP) et la quantité moyenne de sorgho consacrée à la
consommation (QUANT).
· Spécification
« correcte » du modèle.
Il s'agit de voir si des variables explicatives pertinentes
ont été omises lors de l'estimation du modèle. A cet
effet, le test RESET (Regression specification error test) de Ramsey a
été utilisé. Les résultats obtenus sont
présentés dans le tableau 11.
Tableau 11 :
Résultats du test RESET de Ramsey.
|
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of cap
|
|
Ho: aucune variable pertinente n'est omise
|
|
F (3, 84) = 0,86
Prob > F = 0,4673
|
La probabilité du test est 0,4673. Nous ne pouvons donc
pas rejeter l'hypothèse Ho au seuil de 10 %. Nous acceptons alors
l'hypothèse qu'il n'y a pas omission de variables importantes dans la
spécification du modèle et concluons que le modèle a
été bien spécifié. Ceci confirme
l'acceptabilité de son coefficient de détermination et par
conséquent la bonne qualité de son ajustement.
8.1.2. 7.2. Analyse
et discussion des résultats
Les résultats issus de la régression
linéaire portant sur les déterminants du consentement à
payer des `'chefs cuisine'' pour le décorticage mécanique et de
la fortification en fer du sorgho révèlent l'existence de deux
variables significatives à analyser et discuter.
· L'appartenance de l'enquêtée
à la phase pilote du projet
Contrairement à nos prévisions, cette variable
à une influence négative sur le montant que les
enquêtées consentent payer, pour bénéficier d'une
farine de sorgho améliorée. Autrement dit, lorsqu'on va des
enquêtées n'ayant pas appartenu à la phase pilote du projet
à celles ayant appartenue à cette phase du projet, la valeur
accordée à la farine de sorgho améliorée diminue.
Ceci vient confirmer l'influence de cette même variable sur la
décision des enquêtées à décortiquer et
à fortifier le sorgho. En effet, le modèle de régression
logistique estimé dans le chapitre précédent a
révélé une influence négative de cette variable sur
la décision des enquêtées à décortiquer et
fortifier leur sorgho. Un certain nombre de facteurs ont été
identifiés comme étant à l'origine de cet état de
chose. Il s'agissait de la non-permanence de l'agent qui effectue la
fortification, l'impossibilité de conserver la farine pendant un
long moment et la diminution de la quantité de farine après le
décorticage. Nous retenons ces mêmes facteurs comme étant
à la base de la faible valorisation accordée à la farine
de sorgho améliorée. Le fait qu'elles aient été
habituées à un service gratuit pourrait s'ajouter à ces
facteurs.
· La quantité moyenne de sorgho
consacrée à la consommation de dibou
Cette variable désigne la quantité moyenne de
sorgho que l'enquêtée emmène à la minoterie, chaque
fois qu'elle est dans le besoin de farine pour préparer la pâte.
Elle a également une influence négative sur le consentement
à payer des `'chefs cuisine''. Ce résultat correspond à
notre prévision. Il indique que plus grande est la quantité
moyenne de sorgho consacrée à la consommation de dibou,
plus faible est le consentement à payer pour décortiquer et
fortifier cette quantité de sorgho. En effet, le prix de la mouture
d'une boite de tomate de sorgho dans le village Thian est de 75 FCFA. Il est
imposé à tous les minotiers par leur association, et s'applique
donc dans toutes les minoteries. Pour les `'chefs cuisine''
enquêtées, ce prix de mouture est élevé, mais
puisqu'elles n'ont pas le choix elles essaient de se conformer ou de s'adapter.
Les ménages qui consacrent une quantité élevée de
sorgho à la consommation de dibou dépenseront davantage
dans la mouture. Ces dépenses relatives à la mouture du sorgho,
ajoutées à celles qui seront liées à son
décorticage et sa fortification se révèleront très
élevées pour ces ménages. Et puisqu'ils ne peuvent pas
choisir l'option de réduire la quantité moyenne de sorgho
consacrée à la consommation de dibou, ils ont
préféré diminuer le montant qu'ils désirent payer
pour le décorticage et la fortification. D'où, l'influence
négative de la variable `'quantité moyenne de sorgho
consacrée à la consommation de dibou'' sur le
consentement à payer.
En somme, deux (2) variables se sont
révélées significatives par le modèle de
régression linéaire. Il s'agit de l'appartenance de
l'enquêtée à la phase pilote du projet et la
quantité moyenne de sorgho consacrée à la consommation de
dibou. Ces deux variables ont toutes une influence négative sur
le consentement à payer des `'chefs cuisines'' enquêtées.
Aussi, ces deux variables caractérisent les
enquêtées sur les plans social et économique. Dès
lors, nous acceptons la deuxième hypothèse de notre étude
et concluons que le consentement à payer des individus pour le
décorticage mécanique et la fortification en fer du sorgho est
influencé par leurs conditions socio-économiques.
9. CHAPITRE VIII : EVALUATION DE LA
RENTABILITE FINANCIERE DE L'ACTIVITE DE DECORTICAGE MECANIQUE ET DE
FORTIFICATION EN FER DU SORGHO.
Il s'agit, dans ce chapitre, de faire une analyse
financière de la plate-forme de décorticage mécanique et
de fortification en fer du sorgho.
A cet effet, les différents coûts liés
à son existence et à son fonctionnement ont été
calculés. Ils regroupent les dépenses d'investissements fixes, le
capital de fonctionnement et les dépenses courantes.
Les dépenses d'investissement fixes sont les
dépenses consenties pour acquérir les immobilisations. Elles
regroupent, dans le cadre de notre travail, les dépenses
effectuées pour l'achat du décortiqueur et le crépissage
du planché du local qui l'abrite.
Le capital de fonctionnement, rappelons-le, désigne la
somme totale nécessaire à l'autofinancement quotidien de
l'exécution de l'activité. Il a été calculé
à partir de l'estimation des coûts et bénéfices
liés au fonctionnement quotidien de l'activité.
Les dépenses courantes sont la somme nécessaire
au financement quotidien de l'exécution de l'activité pendant une
année. Elles concernent la rémunération du minotier et le
loyer qui lui est payé pour la location de son moteur, les frais
d'entretien du décortiqueur, les dépenses d'achat d'une boite
vide de tomate qui servira d'unité de mesure du sorgho à
décortiquer, les dépenses d'achat de 7,2 kg tous les ans du
produit Ferrazone pour la fortification et le transport du produit Ferrazone
depuis la société de fabrication, localisée aux Pays-Bas,
jusqu'à Thian.
Les bénéfices prennent en compte les
entrées d'argent liées aux activités de décorticage
et de fortification. Ces entrées sont calculées à partir
de l'estimation de la quantité totale de sorgho à
décortiquer par les ménages prédisposés au cours
d'une année, et du consentement à payer moyen des `'chefs
cuisine'' enquêtées. Le consentement à payer moyen a
été évalué à partir du modèle de
régression linéaire (chapitre précédent) ; il
est égal à 24,4 FCFA. Nous avons utilisé pour des raisons
de simplicité 25 FCFA dans les calculs. La quantité totale de
sorgho à décortiquer au sein de la plate-forme est
calculée à partir de la quantité totale de sorgho
susceptible d'être décortiquée par les 96 ménages
prédisposés puis d'une extrapolation de cette quantité de
sorgho sur l'univers de l'échantillonnage. Les bénéfices
prennent également en compte les valeurs résiduelles des
immobilisations et la valeur résiduelle du capital de fonctionnement.
Le tableau 12 présente les résultats de
l'analyse financière de l'activité de décorticage
mécanique et de fortification en fer du sorgho dans le village Thian.
Tableau 12 : Analyse financière de
l'activité de décorticage mécanique et de fortification en
fer du sorgho.
|
|
|
|
|
|
|
|
COUTS
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Achat du décortiqueur
|
350000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crépissage du planché du local abritant le
décortiqueur
|
20000
|
|
|
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
Total Investissements
|
370000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Fond de roulement
|
891272,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rémunération du minotier+location moteur
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
|
Entretien décortiqueur
|
0
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
Achat d'une boite vide de tomate
|
0
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
Gaz-oil
|
0
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
|
Achat d'une bassine
|
0
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
Achat du produit Ferrazone pour la fortification
|
0
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
|
Transport du produit Ferrazone (7,2kg)
|
0
|
53910
|
53910
|
53910
|
53910
|
53910
|
53910
|
53910
|
53910
|
53910
|
53910
|
|
Totale dépenses courantes
|
0
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
|
Total coûts
|
1261272,4
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
317090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
297090,8
|
|
BENEFICES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Décorticage sorgho
|
0
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
|
Valeur résiduelle du décortiqueur
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Valeur résiduelle du planché
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Valeur résiduelle du fond de roulement
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
891272,4
|
|
Total bénéfices
|
0
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
1323617,4
|
|
Cach flow = Total bénéfices - Total
coûts
|
-1261272
|
135254,2
|
135254,2
|
135254,2
|
135254,2
|
115254,2
|
135254,2
|
135254,2
|
135254,2
|
135254,2
|
1026526,6
|
|
VAN
|
-197713,11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRI
|
9%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De ce tableau, il ressort que la VAN du profit
généré par l'investissement, après application d'un
taux d'actualisation égal à 12 %, est inférieure à
zéro. Nous rejetons donc la troisième hypothèse de notre
étude et concluons de ce fait que l'activité de
décorticage mécanique et de fortification en fer du sorgho n'est
pas financièrement rentable.
Cependant, le taux de rentabilité interne égal
à 9 % révèle qu'en absence de toute autre perturbation
dans l'environnement économique, l'activité de décorticage
mécanique et de fortification en fer du sorgho serait
financièrement rentable (VAN supérieure à zéro)
lorsqu'on applique au capital investi un taux d'intérêt
inférieur à 9 %.
Le scénario
« normal » étant défavorable, notre analyse
de sensibilité a porté sur trois scénarii
optimistes :
·
scénario 1 : la demande des services de décorticage
mécanique et de la fortification en fer du sorgho augmente de 5 % tous
les ans ;
· scénario 2 : la demande
des services de décorticage mécanique et de la fortification en
fer du sorgho augmente de 10 % tous les ans ;
· scénario 3 : le transport
du produit Ferrazone est assuré par une ONG, le gouvernement ou une
organisation multinationale.
Le tableau 13 présente la réaction de
l'activité dans chaque cas.
Tableau 13 : Réaction de l'activité
de décorticage et de fortification en fer du sorgho dans trois
situations différentes.
|
Scénarii
|
VAN
|
TRI
|
|
Scénario 1
|
157223,77
|
14 %
|
|
Scénario 2
|
787515,48
|
25 %
|
|
Scénario 3
|
74254,32
|
13 %
|
Ce tableau montre que, lorsque la demande des services de
décorticage mécanique et de fortification en fer du sorgho
augmente de 5 % ou de 10 % tous les ans, l'activité est
financièrement rentable. Il en est de même, lorsque les frais de
transport du produit Ferrazone sont assurés par une ONG, le gouvernement
ou une organisation multinationale.
Troisième PARTIE
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
10. CHAPITRE IX : CONCLUSION ET
SUGGESTIONS
10.1.1. 9.1. Conclusion
Pour Bassey et Schmidt (1990), un processus réussi de
recherche axée sur le développement comporte
généralement les quatre étapes suivantes :
o identifier ou reconnaitre un problème ou une
possibilité ayant une large extension : il s'agit dans notre cas de
la prévalence de l'anémie ferriprive dans le milieu
d'étude ;
o réaliser une technologie (par invention, adaptation
ou adoption) susceptible de résoudre le problème : la
technologie dans notre cas est la plate-forme de décorticage et de
fortification ;
o confirmer, en consultant les bénéficiaires
prévus, que cette technologie est techniquement valable,
économiquement viable et socialement acceptable ;
o prendre les dispositions nécessaires pour que la
solution (la technologie) soit largement utilisée.
Notre étude intitulée
« Prédisposition à adopter le décorticage
mécanique et la fortification en fer du sorgho : cas des
ménages consommateurs de dibou du village Thian, commune de
Parakou. » intègre parfaitement ce
schéma et se situe au niveau de la troisième étape du
processus de Bassey et Schmidt.
Elle a consisté, dans un premier temps, en
l'identification et l'analyse des déterminants de la disposition des
ménages `'consommateurs'' de dibou à adopter le
décorticage mécanique et la fortification en fer du sorgho. A cet
effet, il a été constaté que les variables telles que le
revenu de l'enquêtée, son statut social après l'adoption de
l'innovation et la compatibilité des opérations de
décorticage et de fortification avec ses normes et valeurs influencent
positivement la décision de décortiquer et fortifier son sorgho.
Par contre, les variables telles que l'appartenance de l'enquêtée
à la phase d'expérimentation du projet et sa perception de la
complexité de la procédure de décorticage et de
fortification influent négativement sur sa décision d'adopter
l'innovation.
Dans un deuxième temps, notre étude a
consisté en l'identification et l'analyse des déterminants du
consentement à payer des ménages `'consommateurs'' de
dibou pour le décorticage mécanique et la fortification
en fer du sorgho. Deux variables, toutes deux influant négativement sur
le montant consentit à payer par l'enquêtée, ont
été identifiées. Il s'agit de l'appartenance de
l'enquêtée à la phase pilote du projet et de la
quantité moyenne de sorgho consacrée à la consommation.
Dans un troisième temps, notre étude
s'est penchée sur l'évaluation de la rentabilité
financière de l'activité de décorticage mécanique
et de fortification en fer du sorgho dans le milieu. Le scénario
« normal » mis en évidence a montré que la
VAN du profit généré par l'investissement est
inférieur à zéro ; ce qui indique que cette
activité n'est pas financièrement rentable.
10.1.2. 9.2. Suggestions
Au vu des résultats obtenus, nous pouvons faire des
suggestions qui, suivies, non seulement maintiendraient le nombre d'adoptants
réels au nombre de ménages prédisposés, mais aussi
conduirait à la reconversion des personnes réfractaires en des
adoptants. Elles permettront également de rentabiliser
financièrement l'activité de décorticage mécanique
et de fortification en fer du sorgho. Ces suggestions vont :
Ø A l'endroit du CERNA. Il s'agit de :
G améliorer le pouvoir de conservation de la farine
obtenue à partir du sorgho décortiqué et fortifié.
Ceci se fera de commun accord avec le CRTA ;
G revoir les étapes qui prennent trop de temps afin de
rendre le processus de décorticage et de fortification plus rapide et
optimum ;
G renforcer les capacités du meunier afin qu'il soit en
mesure d'assurer la fortification du sorgho décortiqué. Cela
pallierait le problème de non-permanence de l'agent qui assurait la
fortification ;
G améliorer le rendement du décortiqueur afin
de pallier le problème de la réduction de la farine après
décorticage. Ceci se fera en synergie avec le CRTA ;
G initier une campagne d'information, d'éducation et de
communication afin de lever les contraintes sociales liées à
l'acceptation de l'innovation. Cette campagne devrait se faire en collaboration
avec le centre de promotion social du village. En effet, pour certaines
enquêtées, le décorticage du sorgho est comparable à
la dépigmentation chez l'humain qui est un acte contraire à leurs
valeurs. Il n'est donc pas question de `'dépigmenter'' le sorgho. De
plus, le fer apporté pour fortifier le sorgho n'est plus le fer de DIEU,
mais celui de l'homme. C'est alors une manière de défier le
créateur ;
G réduire les coûts de certains inputs. Cela
augmentera le niveau de rentabilité de l'activité et offrirait la
possibilité de réduire le prix à payer pour le
décorticage et la fortification du sorgho. On pourrait par exemple
substituer le gaz-oil (550 FCFA le litre) au biocarburant diesel obtenu avec
l'huile de Jatropha curcas (325 FCFA le litre). Dans les mêmes
conditions, ce biocarburant fait tourner le moteur pendant environ le double de
l'unité de temps pendant laquelle le gaz-oil le fait tourner. en plus,
il a été démontré que le biocarburant entretien
plus le moteur que le gaz-oil ;
G instaurer un bon système de suivi-évaluation
de l'activité de décorticage mécanique et de fortification
en fer du sorgho ;
G initier des activités de recherche sur la
possibilité de substitution du produit Ferrazone par un produit
endogène capable de jouer le même rôle (la gaine de sorgho
colorant par exemple).
Ø A l'endroit de tout autre entrepreneur social qui
s'engagerait dans l'exercice de cette activité. Il s'agit
de :
G défendre le caractère social de cette
entreprise afin de bénéficier du soutien (subvention) d'ONGs, du
gouvernement ou d'organisations multinationales. Les opérations de
décorticage mécanique et de fortification en fer du sorgho
étant une innovation destinée à aider les pauvres ruraux
à lutter contre un problème social, l'anémie ferriprive,
elles peuvent être qualifiées d'innovation sociale. En effet,
selon Badu (2010), une innovation sociale est un ensemble de stratégies,
concepts, idées et organisations répondant aux besoins sociaux.
Les personnes qui constatent la présence d'un problème social et
font appel à l'esprit d'entreprise pour organiser, créer et
gérer un projet de changement social sont des entrepreneurs sociaux. En
tant qu'innovation sociale, l'activité de décorticage
mécanique et de fortification en fer du sorgho peut
bénéficier du soutien d'ONGs, du gouvernement, d'organisations
multinationales pour sa survie.
G tenir compte des suggestions faites à l'endroit du
CERNA.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Adams, M. E. (1982) Agricultural Extension in
Developing Countries. Longman Harlow.
2. Adesina, A. A. & Seidi, S. (1995) Farmers' perceptions
and adoption of new agricultural technology: Analysis of modern mangrove rice
varieties in Guinea Bissau. Quarterly Journal of International
Agriculture 34, 35-85.
3. Adesina, A. A. (1996) Factors affecting the adoption of
fertilizers by rice farmers in Côte d'Ivoire: Nutrient cycling.
Agroecosystems 46, 29-39.
4. Agbahey, J. U. I. (2007), Interface Agriculture -
Santé : relations entre le VIH/SIDA et la production agricole dans les
ménages ruraux : cas du département du Couffo au Sud
Bénin. Mémoire d'ingénieur agronome FSA/UAC.
Abomey-Calavi.
5. Agence de l'Eau Rhin-Meuse (2010) Etude
coûts-bénéfices de l'amélioration de la
qualité d'un cours d'eau : Le cas de la Bouvade. Document de
synthèse, Analyse statistique et économétrique, 92 p.
6. Agora 21 (2001) Glossaire pour le développement
durable. p. 62.
7. Alaoui, L. (2005) Prévenir la carence en fer au
Maroc. Bulletin Mensuel d'Information et de liaison du PNTTA,
MADRPM/DERD.
8. Amemiya, T. (1981) Qualitative Response Model: A survey.
Journal of Economic Literature, 19, 481-536.
9. Arrow, K., Solow, R., Portney, P.R., Leamer, E.E., Radner,
R. & Schuman, H. (1993) Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation.
Technical Report, 58, 1601-1614.
10. Badu, S. C. (2010) Innovations et entreprenariat
social : une alliance puissante. Journal international du
développement rural, 2, 32-35.
11. Bassey, M.W. & Schmidt, O.G. (1990) Les
décortiqueurs à disques abrasifs en Afrique : de la
recherche à la diffusion. Ottawa, Ont., CRDI, p. 106.
12. Bendana, M. et Sadok, M. (2005) Facteurs explicatifs
des intentions d'adoption du gouvernement électronique par les PME.
Tunisie.
13. Berger, J. & Dillon, J-C. (2002) Stratégies
de contrôle de la carence en fer dans les pays.
14. Berger, J. (2003) Enrichissement des aliments en
micronutriments: élément d'une stratégie
intégrée de lutte contre les carences en micronutriments, en
particulier en fer, dans les pays en développement. 2nd
International Workshop, Food-based approaches for a healthy nutrition.
Ouagadougou.
15. Bishop, R.C. & Heberlein, T.A. (1979) Measuring Values
of Extra-Market Goods: Are Indirect Measures Biased? American Journal of
Agricultural Economics, 61, 926-930.
16. Blanchemanche, S., Treich, N. & Tello, R. (2009)
Evaluation socio-économique en appui à la gestion des risques
alimentaires. Volet I - Méthodes d'évaluation
socio-économique appliquées aux risques alimentaires. Rapport
d'activité. MAP & INRA. 69 p.
17. Bonnieux, F. (1998) Principes, mise en oeuvre et limites
de l'évaluation contingente, Études et Recherches en
Économie Publique, 1, 54-115.
18. Chantran, P. (1972) La Vulgarisation Agricole en
Afrique et à Madagascar. Maisonneuve, Paris. p. 277.
19. Comité National de Lutte contre le Sida CNLS (2006)
Cadre stratégique national de lutte contre le VIH/SIDA/IST
(2006-2010). Cotonou.
20. Daane, J., Mongbo, R., & Schamhart, R. (1992)
Méthodologie de la recherche socioéconomique en milieu rural
africain. Polycopié de cours, FSA/UNB. Abomey-calavi.
21. Davis, R.K. (1963) Recreation Planning as an Economic
Problem. Natural Resources Journal, 3, 239-249.
22. Desvouges, W.S., Smith, V.K. & McGivney, M.P. (1983)
Comparison of Alternative Approaches for Estimating Recreation and Related
Benefits for Water Quality Improvements. U.S. Environmental Protection
Agency.
23. Dillon, J-C. (2000) Prévention de la carence en fer
et des anémies ferriprives en milieu tropical. Médecine
Tropicale, 60, 1.
24. Doucouré, F. B. (2002) Econométrie des
variables qualitatives binaires (Probit, Logit, Gombit,...) In
séminaire sur les techniques économétriques
avancées, CODESRIA, 18/02 1er/03/2002
CODESRIA/Université d'été Sénégal.
25. ECOFIN (2004) Analyse Financière et Economique
des Projets. Syllabus Cours de Base.
26. Engel, J., Blackwell, R. & Miniard (1995) Consumer
Bihavior. The Druden Press, Harcourt Brace College Publishers.
27. Evenson R. E. (1992) Research and
Extension in Agricultural Development. In: Occasional pa
pers, n° 25. International Center For Economic Growth, University of
Yale Connecticut.
28. FAO (1995) Le sorgho et les mils dans la nutrition
humaine. Collection FAO: Alimentation et nutrition, no 27.
29. FAO (2000) The state of food insecurity in the world
2000. Rome.
30. FAO (2005). L'approche filière - Analyse aux
prix de référence. Rome. 36p.
31. Foster, P. (1992) The world food problem: Tackling the
causes of under nutrition, in the Third World. Boulder.
32. Franziska, S. A. (2000) Development of a food
fortification strategy to combat iron deficiency in the Ivory Coast. Diss.
ETH No. 13730.
33. Geroski, P. A. (2000) Models of Technology Diffusion.
Research Policy, 29, pp. 603-625.
34. Gourieroux, C. (1989) Econométrie des Variables
Qualitatives, 2nd edn, Economica, Paris.
35. Gouriéroux, C. (1998) Aspects statistiques de la
méthode d'évaluation contingente. Études et
Recherches en Économie Publique, 1, 91-124.
36. Gujarati, D. N. (2004) Econométrie.
Traduction de la 4è édition américaine par B. Bernier.
37. Hausman, J.A. (1993) Contingent Valuation: A Critical
Assessment. North-Holland.
38. Hounhouigan, J., Bassa, S., Michodjèhoun-Mestres,
L. & Anihouvi, V. (2003) Prévention de l'anémie dans les
zones rurales au Bénin: aspects technologiques de la fortification en
fer de la farine fermentée de maïs. 2nd International Workshop
- Food-based approaches for a healthy nutrition. Ouagadougou.
39. InWEnt (2006) Assurer la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle : Actions visant à relever le
défi global. Manuel de référence. 258p.
40. Kayodé, A. P. P., Adégbidi, A., Linnemann,
A. R., Nout, M. J. R. & Hounhouigan, J. D. (2005) Perception par les
consommateurs de la qualité des variétés de sorgho
paysannes en usage au Bénin et de leurs produits dérivés.
Ecology of Food and Nutrition 44, 271-294.
41. Kayodé, A.P.P & Denou, G. (2007)
Introduction du décorticage mécanique et de la fortification
en fer dans les processus de transformation du sorgho au Bénin pour
améliorer le statut en fer des consommateurs des farines de
céréales. Rapport d'étude. 8p.
42. Le Goff-Pronost, M. et Nassiri N. (2005) Deux
approches nouvelles dans l'évaluation de la
télémédecine : l'évaluation contingente et
l'analyse multicritère. Cahier de recherche, N°7.
43. Luchini, S. (2002) De la singularité de la
méthode d'évaluation contingente. Economie et
statistique N° 357-358.
44. Maddala, G. S. (1983) Limited dependent and qualitative
variables. in econometrics. Cambridge University Press, Cambridge.
45. Maresca, B., Ranvier, M. & Dujin, A. (2006)
Valoriser l'action publique : Le "consentement à payer", un
outil au service de la LOLF. Cahier de recherche n° 224. CREDOC. 126
p.
46. Monsi Agboka, F (2007) Estimation de la valeur
économique des biens `non commercialisés' : cas des plantes
utilisées pour soins gynécologiques dans les terroirs autour de
la Réserve de Biosphère de la Pendjari. Mémoire
d'ingénieur agronome FSA/UAC. Abomey-Calavi.
47. Ogunlana, E. A. (2003) The technology adoption behavior of
women farmers: The case of alley farming in Nigeria, Renewable Agriculture
and Food Systems, 19; 57-65.
48. OMS (2003) Régime alimentaire, nutrition et
prévention des maladies chroniques. Rapport d'une Consultation
OMS/FAO d'experts. OMS, Série de Rapports techniques 916. Organisation
Mondiale de la Santé. Genève. Suisse.
49. Ouedraogo, D. et al. (2007) Gestion des
risques en agriculture urbaine irriguée et consentement à payer
pour une amélioration de la qualité de l'eau pour le
maraîchage dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso au
Burkina. Université polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB), Institut
du développement rural (IDR), Burkina-Faso.
50. PNUD (1997) Manuel d'analyse de la pauvreté,
Applications au Bénin. Canada.
51. Portnay, P. R. (1994) The Contingent Valuation Debate: Why
Economists Should Care? Journal of Economic Perspective, 8,
3-17.
52. Quisumbing, A.R. & al. (1995) Women: The
key to food security. IFPRI Food Policy Report. Washington.
53. Rahm, M. R. & Huffman, W. E. (1984) The Adoption of
Reduced Tillage: The Role of Human Capital and Other Variables. American
Journal of Agricultural Economics 66, 405-413.
54. Rainelli, P. (1993) Évaluation contingente et
contexte institutionnel. in Point, P., Bonnieux, F. & Meullat, G.
(éds.), La valeur économique des
hydrosystèmes : apports et limites de l'approche
contingente, pp. 85-87, INRA, Actes du séminaire
Hydrosystèmes et sociétés.
55. Richefort, L. (2008) Processus de sélection des
technologies d'irrigation par les agriculteurs : entre interactions sociales et
choix rationnels. Thèse pour le doctorat en Sciences Economiques,
Université de la Réunion, France.
56. Robertson, T. S. (1971) Innovative Behavior and
Communication. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
57. Robin, S., Rozan, A. & Ruffieux, B. (2008) Mesurer les
préférences du consommateur pour orienter les décisions
des pouvoirs publics : l'apport de la méthode expérimentale,"
Economie et Prévision, 182, 113-127.
58. Rogers E. M. (1983) Diffusion of innovations. 2nd
edition, New York, Free Press.
59. Rogers, E. M. (1962) Diffusion of Innovations.
The Free Press, New York.
60. Rogers, E. M. (1971) The Diffusion of
Innovations. 4th Edition, Free Press, New York.
61. Rogers, E. M. (1995) The Diffusion of
Innovations. 4th Edition, Free Press, New York.
62. Rogers, E.M., (1983) Diffusion of Innovations.
3éme edition, The Free Press, New York.
63. Sunding, D.& Zilberman, D.(2001) The agricultural
innovation process: research and technology adoption in a changing agricultural
sector. In: Gardner, B., Rausser, G. (Eds.), Handbook of Agricultural
and Resource Economics. Elsevier Science, Amsterdam, pp. 207 261.
64. Terra, S. (2005) Guide de bonnes pratiques pour la
mise en oeuvre de la méthode d'évaluation contingente. Paris
: Ministère de l'écologie et du développement durable, 83
p.
65. Tversky, A. & Kahneman, D. (1981) The Framing of
Decisions and the Psychology of Choice. Science, 211, 453-458.
66. Unicef (1998) The state of the world's children: Focus
on nutrition. Oxford University Press.
67. World Bank (1994) Enriching Lives, Overcoming Vitamin
and Mineral Malnutrition in Developing Countries. World Bank
Publication.
68. Zaltman, G. & Ronald Stiff (1973) Theories of
Diffusion. in Consumer Behavior: Theoretical Sources, edited by Scott
Ward and Thomas S. Robertson. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. pp.
416-68.
11. ANNEXES

12. ANNEXE 1: Processus de
décorticage mécanique et de fortification en fer du sorgho.
Peser le sorgho entier à l'aide d'une balance
mécanique.

Humidifier le sorgho.

Fortifier le sorgho décortiqué avec le produit
Ferrazone.
Peser la quantité du produit Ferrazone nécessaire
à la fortification à l'aide d'une balance électronique.
Peser le sorgho décortiqué (ou gritz).



Décortiquer le sorgho à l'aide du
décortiqueur.

13. ANNEXE 2: Effets du
décorticage et de la fortification sur la qualité sensorielle du
dibou
Les principaux critères dans l'appréciation de
la qualité sensorielle du dibou sont : (1) la texture, (2)
la couleur, (3) le goût et (4) l'odeur. La texture comprend
l'élasticité et la consistance. L'appréciation
comparée du dibou à base de sorgho entier (DSE) et du
dibou à base de sorgho décortiqué (DSD) par
rapport à ces critères a été effectuée par
24 individus (22 femmes et 2 hommes), tous consommateurs de dibou. Les
résultats sont les suivants :
L'élasticité
C'est la propriété du dibou à
reprendre sa forme initiale après étirement. La figure suivante
montre l'appréciation comparée des deux types de dibou
à partir de ce critère.
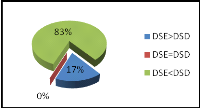
Cette figure montre que tous les individus se sont
accordés sur le fait qu'il y a une différence nette entre le DSE
et le DSD du point de vue élasticité. Pour 83 % de ces individus,
le DSD est plus élastique que DSE, tandis que, pour les 17 % restants,
c'est le DSE qui est plus élastique.
La consistance
C'est l'aptitude du dibou à apaiser
pleinement la faim du consommateur. La figure suivante montre
l'appréciation comparée des deux types de dibou à
partir de ce critère.
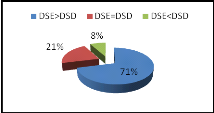
Pour 71 % des individus, le DSE apaise mieux la faim que le
DSD. Tandis que pour 8 %, c'est plutôt le DSD qui est plus consistant.
Pour le reste, il n'a aucune différence en le DSE et le DSD.
La couleur
La figure 3 montre l'appréciation comparée des
deux types de dibou à partir du critère couleur.
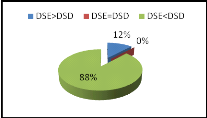
D'après la figure, tous les individus se sont
accordés sur le fait qu'il y a une différence entre le DSE et le
DSD du point de vue de la couleur. Pour 88 % des individus ayant donnés
leur appréciation, la couleur du DSD est meilleure à celle du
DSE. Mais les 12 % restant pensent le contraire.
Le Goût
Le goût du dibou est la saveur perçue
à la consommation de ce repas. La figure suivante montre
l'appréciation comparée des deux types de dibou à
partir du critère couleur.
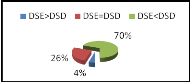
La figure montre que la majorité des individus (70 %)
trouvent que le DSD est meilleur que le DSE quand on raisonne sur la base du
goût. Pour 26 % des individus, c'est plutôt le DSE qui a meilleur
goût. Il faut souligner que parmi les 24 individus qui ont donné
leur appréciation, un (1) pense qu'il n'y a aucune différence
entres les goûts des deux types de dibou.
L'odeur
L'odeur du dibou est la sensation produite sur
l'organe de l'odorat par les émanations volatiles de q ce repas. La
figure suivante montre l'appréciation comparée des deux types de
dibou à partir du critère odeur.
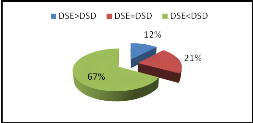
Soixante-sept pour cent (67 %) des individus perçoivent
l'odeur du DSD meilleure à celle su DSE. L'avis contraire est
noté chez 12 % de ces individus. Pour le reste (21 %), aucune
différence n'existe entre les odeurs des deux types de
dibou.
Ces différentes statistiques, relatives aux
appréciations des deux types de dibou par 24 de ses
consommateurs, ont montrées que, pour la majorité, le dibou
préparé à base de sorgho décortiqué a une
meilleure élasticité, une meilleure couleur, un meilleur
goût et une meilleure odeur que celui préparé avec du
sorgho non décortiqué. Seul le critère consistance va en
faveur du dibou à base du sorgho entier. Sachant que ces
critères sont déterminants dans le choix du type de
dibou à consommer et qu'ils vont pratiquement tous en faveur du
dibou à base de sorgho décortiqué et
fortifié, nous pouvons dire que le décorticage et la
fortification ont un effet positif sur la qualité sensorielle du
dibou.
14. ANNEXE 3 : Procédure
d'identification des anémiés dans le village Thian.
Les sujets retenus sont d'une part les femmes en âge de
procréer, résidant en permanence dans leur concession, faisant
partie des femmes qui y préparent le repas, apparemment en bonne
santé physique et mentale et d'autre part les enfants de un (1) à
onze (11) ans.
Afin de mieux apprécier les changements dans le temps
et dans l'espace, deux échantillons ont été
constitués. Le premier dans le village où se déroulera
l'intervention, le village de Thian. Le second dans un village témoin,
le village d'Orou N' Gourou. Le diagramme n°1 présente
l'évolution de l'échantillon d'étude. L'échantillon
primaire a été constitué de 236 sujets de manière
aléatoire. De cet échantillon, un échantillon secondaire
composé de sujets anémiés et non anémiés a
été constitué, échantillon à partir duquel
les données de consommation alimentaire et celles
anthropométriques ont été collectées.
L'échantillon final a été ensuite constitué
à partir des résultats des analyses des taux
d'hémoglobine, de CRP et de ferritine. Ainsi, de l'échantillon
initial de 114 enfants et 122 femmes, il est ressorti un échantillon
final de 39 enfants et 29 femmes anémiés dont 26 enfants et 16
femmes dans le village de Thian. Ces sujets seront soumis plus tard à la
phase d'intervention. Le diagramme suivant présente le
récapitulatif de l'évolution de l'échantillon des
anémiés.
Diagramme : Récapitulatif de
l'évolution de l'échantillon des
anémiés
16 femmes avec taux Hb = 120 g/l et soumises à la
ferritine, CRP et enquêtées en consommation et
anthropométrie
37 femmes avec taux Hb > 120 g/l dont 16
enquêtées en consommation alimentaire et anthropométrie
52 femmes avec taux Hb > 120 g/l dont 15 femmes
enquêtées en consommation alimentaire et anthropométrie
32 Enfants avec taux Hb > 115 g/l dont 6
enquêtées en consommation alimentaire et anthropométrie
28 Enfants dont taux Hb = 115 g/l et soumis à la
ferritine, CRP et enquêtés en consommation alimentaire et
anthropométrie
35 Enfants avec taux Hb > 115 g/l dont 10
enquêtés en consommation alimentaire et anthropométrie
19 Enfants avec taux Hb = 115 g/l et soumis à la
ferritine, CRP et enquêtés en consommation alimentaire et
anthropométrie
6 Enfants dont CRP >10 mg/l
236 femmes et enfants ayant subi les analyses de taux de Hb
54 Enfants
53 Femmes
60 Enfants
69 Femmes
17 femmes avec taux Hb = 120 g/l dont 15 soumises à la
ferritine, CRP et enquêtées en consommation alimentaire et
anthropométrie
Village de Orou N'Gourou
Village de Thian
1 Femme avec Ferritine>150ug/l et 2 avec CRP >10 mg/l
1 Femme dont CRP >10 mg/l
2 Enfants dont CRP >10 mg/l
13 femmes dont taux de ferritine = 150 ug/l et CRP = 10
mg/l
16 femmes dont taux de ferritine = 150 ug/l l et CRP = 10
mg/l
13 Enfants dont taux de ferritine = 120 ug/l et CRP = 10
mg/l
26 Enfants dont taux de ferritine = 120 ug/l l et CRP = 10
mg/l
68 femmes et enfants atteints d'anémie d'origine
nutritionnelle
68 femmes et enfants atteints d'anémie d'origine
nutritionnelle
ANNEXE 4 : Guide des entretiens menés avec
les `'chefs cuisine'' ayant appartenu à la phase pilote du projet et les
femmes n'ayant pas appartenu à la phase pilote du projet.
GUIDE D'ANIMATION DU FOCUS GROUP DISCUSSION / Thian
2010
IDENTIFICATION
Département
_________________________________________________
Commune______________________________________________________
Village ____________________________________
Sexe des
participants_______________________________________
Situation maritale des participants 11(*)_________________________________ /__
/
Nom de
l'animateur_________________________________________
Nom du preneur de
notes____________________________________
Date de réalisation de la discussion de
groupe..................................
Nombre de participants à la discussion de
groupe.............................
Heure de
début-----------------------------------------------------------------------
__H __mn
Heure de
fin----------------------------------------------------------------------------
__H __mn
Langue utilisée lors de la discussion de
groupe_________
CARACTERISTIQUES DES PARTICIPANTS
|
N°
|
Nom et prénoms
|
Age
|
Niveau
d'instruction
|
Groupe
socio
culturel
|
Activités
exercées12(*)
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
|
|
|
GUIDE D'ANIMATION DU FOCUS GROUP DISCUSSION
Bonjour, Soyez les bienvenus à cette discussion de
groupe. Mon nom est AGOSSADOU Morest. Mon (Ma) collègue qui est ici avec
moi a pour nom __________________________ Nous travaillons pour le compte du
projet qui a installé dans votre village une unité de
décorticage et de fortification de sorgho qui permettra
d'éradiquer de votre village l'anémie ferriprive. Nous vous
remercions beaucoup d'avoir accepté de participer à cette
séance d'échange malgré vos multiples occupations.
On discutera à propos de l'anémie ferriprive et
de l'unité de décorticage et de fortification de sorgho. Vous
êtes priés de parler librement mais l'un après l'autre. Il
n'y a pas de réponses justes ou fausses, toutes les réponses sont
les bienvenues. Les informations que vous allez fournir sont importantes. C'est
la raison pour laquelle nous vous prions de répondre honnêtement
et franchement aux questions.
Au cours de la discussion, mon (ma) collègue essaiera
de prendre des notes avec votre permission.
|
Thèmes
|
Questions
|
|
1. Enquête sur l'habitude alimentaire de
l'enquêté
|
1.1 Quel est le repas le plus consommé dans vos
différents ménages ?
|
|
1. 1.2 Quel est la céréale la plus consommée
dans vos différents ménages ?
|
|
1. 1.3 Sous quelles formes cette céréale est
généralement consommée dans le village ?
|
|
1. 1.4 Décortiquez-vous de façon traditionnelle la
céréale avant de la consommer ? Pourquoi ?
|
|
1. 1.5 Pouvez-vous nous décrire brièvement la
procédure du décorticage traditionnel ?
|
|
1. 1.6 Décortiquez-vous la céréale dans une
quelconque unité de décorticage avant de la consommer ?
Pourquoi ?
|
|
2. Connaissance s et attitudes relatives à
l'anémie ferriprive
|
2.1 Quels sont les principaux problèmes de santé
auxquels les gens sont souvent confrontés dans votre village ?
|
|
1. 2.2 Pensez-vous que l'anémie ferriprive est un
problème majeur de santé dans votre village ?
|
|
1. 2.3 Quelles sont les causes que vous connaissez à cette
maladie ?
|
|
1. 2.4 Savez-vous que la consommation de repas issus de sorgho
non décortiqué est la cause majeure de la prévalence de
l'anémie ferriprive dans votre village ?
|
|
|
1. 3. Perception de l'enquêté sur
l'unité et ses attributs
|
3.1 Etes-vous au courant de l'existence d'une unité de
décorticage et de fortification dans votre village ?
|
|
3.2 Faites-vous parti des personnes sélectionnées
pour appartenir à la phase pilote de ce projet ?
|
|
3.3 Savez-vous que des gens ont été
sélectionnés pour appartenir à la phase pilote de ce
projet?
|
|
Comment comprenez-vous le fait que d'autres aient
été choisi pour la phase pilote et pas vous ?
|
|
Avez-vous connaissance des rôles ou des attributs de
l'unité ?
|
|
Quelle appréciation faites-vous de la qualité de la
mouture qui se fait au sein de l'unité ?
|
|
4. Consentement à payer pour le décorticage
et la fortification
|
EXPLICATION DU SCENARIO
|
|
4.1. A la fin du projet, lorsque l'accès sera donné
à tout le monde, iriez-vous décortiqué et fortifié
votre sorgho afin de contribuer à l'éradication de
l'anémie ferriprive dans votre village ?
|
|
· Si non, pourquoi ne voulez pas contribuer ?
|
|
Si non toujours, que voudriez-vous que les promoteurs du projet
fassent pour que vous acceptiez décortiquer et fortifier votre
sorgho ?
|
|
Si oui, combien seriez-vous prêt à payer pour
décortiquer et fortifier 1 ..........................
(mettez le nom de l'unité de mesure locale habituellement
utilisée dans la meunerie) de
sorgho ?
|
|
Vos maris vous donnent-ils habituellement de l'argent pour faire
la cuisine ? si oui suivant quelle périodicité ?
|
|
Accepteront-ils augmenter l'argent de popote pour acheter plus de
sorgho et décortiquer ?
|
|
Les enfants consomment-ils aussi le dibou ?
|
NB : ce guide d'entretien sera
utilisé pour les deux focus group discussion que nous ferons sur le
terrain. Le premier aura lieu avec les individus appartenant à la phase
pilote du projet et le second avec les individus n'appartenant pas à la
phase pilote. Selon le cas, des questions de ce guide seront posées ou
non.
ANNEXE 5 : Guide des entretiens menés avec
le responsable du CRTA, le minotier et l'agent fortificateur.
GUIDE D'ENTRETIEN RELATIF A L'EVALUATION DE LA
RENTABILITE FINANCIERE DE LA PLATE-FORME DE DECORTICAGE ET DE
FORTIFICATION.
Ce guide d'entretien sera adressé soit au minotier, soit
à l'agent qui assure la fortification, soit au responsable du CRTA.
1. Les investissements fixes (à adresser au CRTA et au
minotier)
|
Liste des investissements fixes
|
Coût d'acquisition
|
durée d'utilisation rentable
|
Date d'installation
|
|
Décortiqueuse
|
|
|
|
|
Moteur
|
|
|
|
|
Balance électrique
|
|
|
|
|
Bâtiment
|
|
|
|
|
Baril contenant de l'eau
|
|
|
|
|
La parcelle d'installation de l'unité
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
2. Les charges variables (à adresser au minotier et
à l'agent qui assure la fortification)
|
charges
|
Volume d'activité correspondant
|
Coûts associés
|
|
Gas-oil
|
|
|
|
essence
|
|
|
|
Sachet de fer
|
|
|
|
...
|
|
|
|
...
|
|
|
|
...
|
|
|
|
...
|
|
|
|
...
|
|
|
|
...
|
|
|
3. Charges fixes (à adresser au minotier et à
l'agent qui assure la fortification)
|
charges
|
Coûts associés
|
|
Salaire du minotier
|
|
|
Salaire de l'agent qui assure la fortification
|
|
|
Entretien de l'unité
|
|
|
Location de la parcelle d'installation
|
|
|
...
|
|
|
...
|
|
|
...
|
|
4. Quelle quantité de sorgho moulez-vous en moyenne par
jour ?
Nous sommes à la fin de notre entretien.
Merci de m'avoir accordé un peu de votre précieux temps. A
très bientôt.
ANNEXE 6 : Questionnaire
d'enquête.
QUESTIONNAIRE/PREDISPOSITION A ADOPTER/ THIAN
2010
Enquête
N°..........................................................Date..................................
Commune........................Arrondissement.....................Village..........................
Nom de
l'enquêteur.......................................................................................
Bonjour/bonsoir `'Maman''. Je suis Morest AGOSSADOU,
étudiant à la Faculté des Sciences Agronomiques de
l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis devant vous ce matin/soir parce
que je suis entrain de faire une étude portant sur l'unité de
décorticage et de fortification installée dans votre village
depuis Octobre 2009. Les résultats de cette étude permettront
d'une part aux responsables du projet grâce auquel l'unité est
installée de s'informer de votre perception de l'unité et de ces
attributs afin de définir les stratégies nécessaires
à l'avenir et d'autre part à moi même de soutenir un
mémoire afin d'obtenir le diplôme d'ingénieur agronome qui
marquera la fin de ma formation dans ma faculté.
Cet entretien prendra une quarantaine de minutes. Vu
l'importance des enjeux de notre étude, nous aimerions savoir si vous
êtes prêtes à nous accorder votre précieux temps et
à nous donner que des informations sérieuses et fiables ?
· d'accord ;
· d'accord, mais revenez plus tard ;
· pas d'accord.
Section 1 :
Identification de l'enquêté
|
N°
|
Questions
|
Codes
|
|
1.1
|
Nom (en majuscule) et
prénom.........................................................................................................................................
|
|
|
1.2
|
Sexe.....................................................................
(0=masculin, 1=féminin).
|
|
|
1.3
|
Age..................
|
|
|
1.4
|
. Ethnie..............................1= Bariba ; 2=
Dendi ; 3= Berba ; 4= Kotokoli ; 5= Yoruba ; 7= Fon ;
8= autre ethnie à préciser
|
|
|
1.6
|
Niveau d'instruction.................................1= sans
instruction ; 2=alphabétisé 3= primaire ; 4= secondaire ; 5=
universitaire ;
|
|
|
1.7
|
Religion.................................... (0=islam,
1=christianisme, 2=animisme, 3=autres à préciser)
|
|
|
|
|
|
1.8
|
Situation maritale...................... 1= vit avec son
conjoint ; 2= ne vit pas avec son conjoint.
|
|
|
1.9
|
Nombre total d'enfants à
charge............................
|
|
|
1.10
|
Nombre d'enfants de moins de 5 ans (5 ans y compris) à
charge................
|
|
|
1.11
|
Nombre d'enfants entre 5 et 10 ans à charge (10 ans y
compris)................
|
|
|
1.12
|
Nombre d'enfants entre 10 et 15 ans à charge (15 ans y
compris)..............
|
|
|
1.13
|
Nombre d'enfants de plus de 15 ans à
charge............................
|
|
|
1.14
|
Est-ce qu'un membre de votre ménage a déjà
souffert de l'anémie ferriprive ?......................
(1=oui ; 2=non ; 3=ne sais pas)
|
|
|
1.15
|
Avez-vous ou avez-vous eu des contacts avec des institutions tels
que le CeCPA, les ONGs, les Projets ou les Structures de
Recherche ?....................
(1=oui ; 2=non).
|
|
|
Avez-vous accès facile au
crédit ?...........................1=oui ; non
Pourquoi ?......................................................................................................
...........................................................................................
|
|
|
Avez-vous reçu une fois ces 5 dernières
années de crédit d'une IMF ? si oui laquelle et quel
montant et quelle était sa
destinée ?......................................
............................................................................................
|
|
|
1.16
|
Etes-vous membre d'un groupement ou d'un groupe de production, de
commercialisation, de tontine, etc. existant dans votre village ?
...............
1=oui ; 2=non.
Si oui lequel ?.......................................
quelle activité vous y faites ?..............
............................................................................................
|
Section 2 : Evaluation du revenu de
l'enquêté
2.1. Année 2008 (campagne 2008-2009)
|
Sources de revenu
|
Produits
|
Quantité produite
|
Dépenses effectuées (MO., engrais, pesticides)
|
Quantité consommée et donnée (%)
|
Quantité vendue
|
Prix de vente unitaire
|
Marge brute
|
|
Agriculture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elevage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transformations agroalimentaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artisanat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vente de nourriture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vente de produits manufacturés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverses prestations de services
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loyer perçu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pension de retraite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance financière par une personne vivant hors du
ménage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres activités économiques (à
préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Année 2007 (campagne 2007-2008)
|
Activités économiques
|
Produits
|
Quantité produite
|
Dépenses effectuées (MO., engrais, pesticides)
|
Quantité consommée et donnée (%)
|
Quantité vendue
|
Prix de vente unitaire
|
Marge brute
|
|
Agriculture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elevage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transformations agroalimentaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Artisanat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vente de nourriture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vente de produits manufacturés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverses prestations de services
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loyer perçu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
salaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pension de retraite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assistance financière par une personne vivant hors du
ménage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres activités économiques (à
préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N°
|
Questions
|
Codes
|
|
2.3
|
Investissez-vous dans la conservation de vos
produits?.................... 1=oui ; 2=non
|
|
|
2.4
|
Si oui, combien ?
Sorgho ..............; Maïs............ ;
Igname............... ; Mil.............. ;
............ ; ............. ;
............... ; ...............
|
|
|
2.2
|
Votre époux vous donne-t-il de l'argent pour la
popote ?................................... (1=oui, 2=non)
|
|
|
2.2.1
|
· Si non
pourquoi ?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
|
|
|
2.2.2
|
Si oui combien et suivant quelle
période ?......................................................................................................
..........................................................................................
|
|
Section 3 : Enquête sur l'habitude
alimentaire de l'enquêté
|
N°
|
Questions
|
Codes
|
|
3.1
|
Quel est le repas le plus consommé dans votre
ménage ?................................
1= dibou ; 2= igname pilée ; 3=riz ; 4=
pâte de maïs ; 5= autres à préciser.
|
|
|
3.2
|
Quel est la céréale la plus consommée dans
votre ménage ?.......................................... (1=
sorgho, 2= maïs, 3= niébé, 4= riz, 5=autre à
préciser)
|
|
|
3.3
|
Sous quelles formes cette céréale est
généralement consommée dans le
village ?.................................................................
(1=dibou ; 2= bouillie ; 3=autres à préciser)
|
|
|
Sous quelles formes cette céréale est
consommée dans votre ménage les 5 derniers jours ? (remplir
le tableau suivant)
|
|
|
Les différents jours (à compter de la veille du
jour de l'entretien avec l'enquêté)
|
Formes de consommation de la céréale
(1=dibou ; 2= bouillie ; 3=autres repas à
préciser ; 4= céréale pas consommée)
|
|
Jour 1
|
Petit déjeuner
|
|
|
Déjeuner
|
|
|
goûter
|
|
|
Diner
|
|
|
Jour 2
|
Petit déjeuner
|
|
|
Déjeuner
|
|
|
goûter
|
|
|
Diner
|
|
|
Jour 3
|
Petit déjeuner
|
|
|
Déjeuner
|
|
|
goûter
|
|
|
Diner
|
|
|
Jour 4
|
Petit déjeuner
|
|
|
Déjeuner
|
|
|
goûter
|
|
|
Diner
|
|
|
Jour 5
|
Petit déjeuner
|
|
|
Déjeuner
|
|
|
goûter
|
|
|
Diner
|
|
|
N°
|
Questions
|
Codes
|
|
3.4
|
Vos parents ou grands parents décortiquaient-ils le
sorgho ?..............1=oui ;
2=non ; 3=ne sais pas
Si oui ou non,
pourquoi ?.............................................................................
..........................................................................................
|
|
|
3.5
|
Décortiquez-vous actuellement de façon
traditionnelle la céréale avant de la
consommer ?........................ (0=non ; 1=oui)
Si oui ou non
pourquoi ?................................................................................
...........................................................................................
(1=car ça améliore les qualités
organoleptiques du repas ; 2=car ça éradique l'anémie
ferriprive ; 3=car c'est fastidieux ; 5=interdits de ma famille ou de
la famille de mon mari ou du village ; 6=autres à
préciser.)
|
|
|
|
3.6
|
Avez-vous au moins une fois décortiqué
traditionnellement le sorgho ? 1=oui ; 2=non
|
|
|
3.7
|
Pouvez vous nous décrire brièvement la
procédure du décorticage
traditionnel ?.........................................................................................................................................................................................................................................................................
|
|
|
3.8
|
Décortiquez-vous la céréale dans une
quelconque unité de décorticage avant de la
consommer ?........................ (0=non ; 1=oui)
|
|
|
3.9
|
Pourquoi ?.....................................................................................................................................................................................................................................
(1= car ce n'est pas gratuit pour moi ; 2=car c'est
gratuit pour moi; 3=car le coût de décorticage n'est pas
élevé ; 4=car ça améliore les qualités
organoleptiques du repas ; 5=car ça éradique l'anémie
ferriprive ; 5= car c'est fastidieux ; 6=autres à
préciser.).
|
|
|
3.10
|
Quelle est la quantité minimale de sorgho que vous
moulez chaque fois quand vous allez au
moulin ?.............................
|
|
|
3.11
|
Quelle est la quantité maximale de sorgho que vous
moulez chaque fois quand vous allez au
moulin ?.............................
|
|
|
3.12
|
Combien de fois allez-vous au moulin par jour de
marché/semaine/2
semaines/mois ?.......................................
|
|
Section 4 : Connaissances et attitudes
relatives à l'anémie ferriprive
|
N°
|
Questions
|
Codes
|
|
4.1
|
Pensez-vous que l'anémie ferriprive est un problème
majeur de santé dans votre village ?...............................
(1=oui ; 2=non ; ne sais pas)
|
|
|
4.2
|
·
pourquoi ?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
|
|
|
4.3
|
Quelles sont les causes que vous connaissez à cette
maladie ?
1-.......................................
2-.......................................
|
|
|
4.4
|
Savez-vous que la consommation de repas issus de sorgho non
décortiqué est la cause majeure de la prévalence de
l'anémie ferriprive dans votre
village ?........................................ (1=oui ; 2=non)
|
|
|
4.5
|
· Si oui par quels moyens l'avez-vous
su ?.......................................................................
1= par des ami (e)s
2= à la télévision
3= à la radio
4= par les promoteurs du projet
5= par l'agent qui assure la fortification dans l'unité de
décorticage
|
|
|
4.6
|
Savez-vous que vous risquez vous aussi d'attraper l'anémie
ferriprive si vous continuez à consommer des repas issus de sorgho non
décortiqué ?.....................
................................ (1= oui, 2= non).
|
|
Section 5 : Perception de
l'enquêté sur l'unité et ses attributs
· Appartenance à la phase pilote du
projet
|
N°
|
Questions
|
Codes
|
|
5.1
|
Etes-vous au courant de l'existence d'une unité de
décorticage et de fortification dans votre
village ?.............................................. (0=non, 1=oui)
|
|
|
5.2
|
Savez-vous que des gens ont été
sélectionnés pour appartenir à la phase pilote de ce
projet? ............................................. (0=non, 1=oui)
|
|
|
5.3
|
Faites-vous parti des personnes sélectionnées pour
appartenir à la phase pilote de ce
projet?.............................................. (0=non, 1=oui)
|
|
|
5.4
|
Comment comprenez-vous le fait que d'autres aient
été choisi pour la phase pilote et pas vous ?
....................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
|
|
· Connaissances de l'enquêté des
attributs de l'unité
|
N°
|
Questions
|
Codes
|
|
5.5
|
Quelle est la distance (en
mètre) qui sépare votre domicile de
l'unité ?.............
|
|
|
5.6
|
Quelle appréciation faites-vous de la qualité de la
mouture qui se fait au sein de
l'unité ?................................ (1=bonne
qualité ; 2=qualité moyenne ; 3=mauvaise
qualité ; 4= ne sais pas).
|
|
|
5.7
|
Le prix de la mouture dans cette unité est-elle abordable
à votre connaissance ?........................ (1=abordable, 2=non
abordable ; 3= ne sais pas)
|
|
|
5.8
|
Avez-vous connaissance des rôles ou des attributs
ci-dessous de l'unité ? (remplir le tableau suivant)
|
|
|
Attributs de l'unité
|
Connaissance ou non (1=connais ; 2= ne connais pas)
|
Appréciation par l'enquêteur du niveau global de
connaissance des attributs (ne pas remplir sur le terrain)
|
|
Contient un décortiqueur qui permet d'enlever le
péricarpe de la graine
|
|
|
|
Contient une unité de fortification de la farine
|
|
|
|
Permet d'éradiquer l'anémie ferriprive
|
|
|
|
Permet d'augmenter la qualité nutritionnelle de la
farine
|
|
|
|
L'amélioration des qualités organoleptiques du
dibou issu de sorgho décortiqué par rapport à celles du
dibou issu de sorgho non décortiqué
|
|
|
Section 6 : Consentement à payer
pour le décorticage et la fortification
Présentation du
scénario
L'anémie ferriprive est aujourd'hui la maladie
nutritionnelle la plus répandue dans le monde spécialement en
milieu tropical où elle touche surtout les femmes, en particulier lors
de la grossesse, et les jeunes enfants. L'anémie ferriprive provoque des
dégâts irréversibles au niveau du cerveau chez les enfants
en bas âge, de la fatigue et une capacité au travail
réduite, plus de naissances prématurées et d'enfants
mort-nés. La carence martiale serait responsable de 500.000
décès annuels chez des femmes au cours de la grossesse et lors de
l'accouchement. Chez l'enfant, elle entraîne une diminution de la
réponse immunitaire et donc une augmentation de la fréquence des
infections. Elle est la cause de retards de développement, tant physique
que mental. Que de dégâts importants n'est-ce pas ?
Il y a environ deux ans, dans le cadre du
projet`'Introduction of a mechanical dehuller and iron fortification in the
traditional processing of sorghum in Benin to improve the iron status of rural
consumers of porridge'' initié par le Centre Régional de
Nutrition et d'Alimentation Appliquées (CERNA), un diagnostic sanguin a
été effectué sur les habitants de votre village pour voir
la prévalence de cette maladie. Ce diagnostic a
révélé que beaucoup des femmes et enfants du village en
souffraient sans s'en rendre compte. La prévalence de cette maladie dans
votre village a été imputée à la consommation de
repas (dibou, bouillie, etc.) issus de sorgho non décortiqué.
Mais comment cela s'explique ? En fait, le péricarpe de la graine
de sorgho contient des éléments nutritifs (dont le
fer) et en même temps des facteurs anti-nutritionnels
(phytates et composés phénoliques). Lorsque vous faites la
mouture de ce sorgho sans enlever le péricarpe, le fer et les facteurs
anti-nutritionnels (FAN) se retrouvent tous dans la farine que vous obtenez et
se retrouvent également dans votre organisme lorsque vous consommez le
repas issus de ce sorgho non décortiqué. Le problème qui
se pose est que, une fois dans l'organisme, les FAN empêchent
l'assimilation du fer qui est finalement rejeté. Alors que c'est ce fer
qui est en grande partie responsable de la disponibilité du sang dans
notre organisme.
Pour éradiquer ce mal dangereux qui existe dans votre
village, le projet y a installé une unité de décorticage
et de fortification. La décortiqueuse a permis d'enlever le
péricarpe de la graine et de réduire les FAN, mais
malheureusement réduit également la quantité de fer
contenu dans la graine, et l'opération de fortification en fer a permis
de restaurer le fer perdu par décorticage.
Au cours de cette phase pilote du projet, l'accès aux
opérations de décorticage et de fortification est gratuit et
donné seulement à une quarantaine d'enfants et de femmes, ceux
qui présentaient des signes graves d'anémie ferriprive. Une
étude réalisée auprès de ces femmes en Mars 2010 a
révélé que le décorticage améliore les
qualités organoleptiques du dibou (à l'exception de la
consistance) et la fortification améliore leur Etat
nutritionnel et celui de leurs enfants. On aurait pu donner l'accès
libre à tout le village, mais les moyens du projet sont très
limités.
Dans quelques semaines, le projet prendra fin. Vu la
gravité de la maladie et sa prévalence dans votre village,
nous souhaitons vivement que les opérations de
décorticage et de fortification continuent et que l'accès soit
donné à tout le monde. Mais vous n'êtes pas sans
savoir que le fonctionnement de l'unité nécessite quelques
coûts à savoir : vidange, essence pour le groupe
électrogène, achat du fer pour la fortification, frais
d'entretien, salaire du minotier, salaire de l'agent qui fortifie, etc. qui
étaient normalement pris en charge par le projet. A la fin donc
du projet, ces coûts doivent être supportés par les
populations du village qui iront décortiquer leur sorgho. Pour
ce faire, il sera demandé à chaque individu qui va
décortiquer et fortifier son sorgho de payer une somme d'argent pour ces
opérations. Et par rapport à cela, j'ai un certain nombre de
questions à vous poser. Mais avant de poser les questions, je vous
rappelle la procédure pour décortiquer et fortifier votre
sorgho :
1. Vous emmenez une quantité de votre choix de sorgho
au sein de l'unité ;
2. Votre sorgho est pesé à l'aide d'une balance
mécanique et ensuite humidifié ;
3. Le sorgho pesé et humidifié est
décortiqué à l'aide du décortiqueur ;
4. Le sorgho décortiqué est pesé à
l'aide de la même balance mécanique ;
5. On pèse ensuite la quantité de fer
nécessaire à la fortification du sorgho décortiqué
à l'aide d'une balance électrique ;
6. Votre sorgho peut être moulu au sein de la même
unité ou dans un autre moulin.
|
N°
|
Questions
|
Codes
|
|
6.1
|
Selon vous, la procédure de décorticage et de
fortification est-elle complexe?................. (1=oui ; 2=non)
|
|
|
6.2
|
Si oui pourquoi ?...............................
(1=difficile à comprendre ; 2=la procédure est longue ;
3= cela prendra trop de temps)
|
|
|
6.3
|
Pensez-vous que l'adoption de ce système de production va
améliorer votre statut social dans votre milieu de vie ?
............................1= oui 2= non
|
|
|
6.4
|
Pensez-vous que cette technologie est compatible avec vos
valeurs, vos besoins et vos expériences passées ?
.................................... 1= oui 2= non
|
|
|
6.5
|
Pensez-vous que cette technologie vous permettra
d'améliorer votre alimentation ?
..........................................1= oui 2= non
|
|
|
6.6
|
A la fin du projet, lorsque l'accès sera
donné à tout le monde, iriez-vous toujours décortiquer,
fortifier votre sorgho et payer un montant afin de contribuer à
l'éradication de l'anémie ferriprive dans votre
village ?..................... (1=oui ; 2=non ; 3=ne
sais pas)
|
|
|
6.7
|
Si non, pourquoi ne voulez pas
contribuer ?................................................
1- Parce que la quantité minimale de sorgho
exigée est supérieure à celle que j'alloue habituellement
à la consommation dans mon ménage.
2- Parce que je n'ai pas participé à la phase
pilote du projet
3- Parce que la consommation de repas issus de sorgho non
décortiqué ne cause aucun problème ni aucune maladie
à aucun membre de mon ménage
4- Parce que ce n'est pas à moi de payer
5- Parce que je n'ai pas les moyens financiers de cela
6- Autres raisons à
préciser.............................................
.......................................................................................
|
|
|
6.8
|
Si non toujours, que voudriez-vous que les promoteurs du
projet fassent pour que vous acceptiez décortiquer et fortifier votre
sorgho ?.................................................
.............................................................................................1=accès
au crédit ; 2=possibilité de tester la technologie ; 3=
autres
|
|
|
6.9
|
Si oui, combien seriez-vous prêt à payer pour
décortiquer et fortifier 1........................
(mettez le nom de l'unité de mesure locale habituellement
utilisée dans la meunerie) de
sorgho ? (« nous parlons bien d'une contribution
volontaire unique, c'est à vous de décider ce que vous voulez
donner. Soyez donc honnête dans votre réponse svp »).
.............................. FCFA
|
|
|
6.10
|
Votre mari acceptera-t-il manger le dibou issu de sorgho
décortiqué et
fortifier ?..........................1=oui ; 2=non ; 3= ne sais
pas
Pourquoi...............................................................................
|
|
|
6.11
|
Pensez-vous qu'il acceptera mettre à votre disposition
plus de sorgho ou plus d'argent pour acheter du sorgho en
supplément ? 1=oui ; 2=non
Pourquoi ?
|
|
Nous sommes à la fin de notre entretien.
Merci de m'avoir accordé un peu de votre précieux temps. A
très bientôt.
ANNEXE 7 : Analyse de sensibilité avec la
demande augmentant de 5% tous les ans
Coûts
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Décortiqueur
|
350000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crépissage du planché du local abritant le
décortiqueur
|
20000
|
|
|
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
Total Investissement fixes
|
370000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Fond de roulement
|
891272,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salaire du minotier+location moteur
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
|
Entretien décortiqueur
|
0
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
Boite de tomate
|
0
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
Gaz-oil
|
0
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
|
Bassine
|
0
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
Fer pour la fortification
|
0
|
30700,8
|
32235,84
|
33847,63
|
35540,01
|
37317,01
|
39182,86
|
41142
|
43199,11
|
45359,06
|
47627,017
|
|
Transport du produit (7,2kg)
|
0
|
53910
|
56605,5
|
59435,78
|
62407,56
|
65527,94
|
68804,34
|
72245
|
75856,78
|
79649,62
|
83632,104
|
|
Totale dépenses courantes
|
0
|
297090,8
|
301321,3
|
305763,4
|
310427,6
|
315325
|
320467,2
|
325867
|
331535,9
|
337488,7
|
343739,12
|
|
Total coûts
|
1261272,4
|
297090,8
|
301321,3
|
305763,4
|
310427,6
|
335325
|
320467,2
|
325867
|
331535,9
|
337488,7
|
343739,12
|
|
Bénéfices
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Décorticage sorgho
|
0
|
432345
|
453962,3
|
476660,4
|
500493,4
|
525518
|
551794
|
579384
|
608352,8
|
638770,5
|
670709
|
|
Valeur résiduelle du décortiqueur
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Valeur résiduelle du planché
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Valeur résiduelle du fond de roulement
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
891272,4
|
|
Total bénéfices
|
0
|
432345
|
453962,3
|
476660,4
|
500493,4
|
525518
|
551794
|
579384
|
608352,8
|
638770,5
|
1561981,4
|
|
Cach flow = Total bénéfices - Total
coûts
|
-1261272,4
|
135254,2
|
152640,9
|
170897
|
190065,8
|
190193,1
|
231326,7
|
253517
|
276816,9
|
301281,8
|
1218242,3
|
|
VAN
|
157223,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRI
|
14%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNEXE 8 : Analyse de sensibilité avec la
demande augmentant de 10% tous les ans
Coûts
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Décortiqueur
|
350000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crépissage du planché du local abritant le
décortiqueur
|
20000
|
|
|
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
Total Investissement fixes
|
370000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Fond de roulement
|
594181,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salaire du minotier+location moteur
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
|
Entretien décortiqueur
|
0
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
Boite de tomate
|
0
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
Gaz-oil
|
0
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
|
Bassine
|
0
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
Fer pour la fortification
|
0
|
30700,8
|
33770,88
|
37147,97
|
40862,76
|
44949,04
|
49443,95
|
54388,34
|
59827,17
|
65809,89
|
72390,88
|
|
Transport du produit (7,2kg)
|
0
|
53910
|
59301
|
65231,1
|
71754,21
|
78929,63
|
86822,59
|
95504,85
|
105055,3
|
115560,9
|
127116,96
|
|
Totale dépenses courantes
|
0
|
297090,8
|
305551,9
|
314859,1
|
325097
|
336358,7
|
348746,5
|
362373,2
|
377362,5
|
393850,8
|
411987,84
|
|
Total coûts
|
964181,6
|
297090,8
|
305551,9
|
314859,1
|
325097
|
356358,7
|
348746,5
|
362373,2
|
377362,5
|
393850,8
|
411987,84
|
|
Bénéfices
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Décorticage sorgho
|
0
|
432345
|
475579,5
|
523137,5
|
575451,2
|
632996,3
|
696295,9
|
765925,5
|
842518,1
|
926769,9
|
1019446,9
|
|
Valeur résiduelle du décortiqueur
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Valeur résiduelle du planché
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Valeur résiduelle du fond de roulement
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
594181,6
|
|
Total bénéfices
|
0
|
432345
|
475579,5
|
523137,5
|
575451,2
|
632996,3
|
696295,9
|
765925,5
|
842518,1
|
926769,9
|
1613628,5
|
|
Cach flow = Total bénéfices - Total
coûts
|
-964181,6
|
135254,2
|
170027,6
|
208278,4
|
250354,2
|
276637,6
|
347549,4
|
403552,3
|
465155,6
|
532919,1
|
1201640,7
|
|
VAN
|
787515,48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRI
|
25%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNEXE 9 : Analyse de sensibilité avec le
transport du produit Ferrazone pris en charge par ONG, gouvernement ou
institution multinationale
|
|
|
|
|
|
|
|
Coûts
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Décortiqueur
|
350000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réfection bâtiment
|
20000
|
|
|
|
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
Total Investissement fixes
|
370000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Fond de roulement
|
891272,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salaire du minotier+location moteur
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
120000
|
|
Entretien décortiqueur
|
0
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
|
Boite de tomate
|
0
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
Gaz-oil
|
0
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
81180
|
|
Bassine
|
0
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
|
Fer pour la fortification
|
0
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
30700,8
|
|
Transport du produit (7,2kg)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Totale dépenses courantes
|
0
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
|
Total coûts
|
1261272,4
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
263180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
243180,8
|
|
Bénéfices
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Décorticage sorgho
|
0
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
|
Valeur résiduelle du décortiqueur
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Valeur résiduelle bâtiment
réfectionné
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Valeur résiduelle du fond de roulement
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
891272,4
|
|
Total bénéfices
|
0
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
432345
|
1323617,4
|
|
Cach flow = Total bénéfices - Total
coûts
|
-1261272,4
|
189164,2
|
189164,2
|
189164,2
|
189164,2
|
169164,2
|
189164,2
|
189164,2
|
189164,2
|
189164,2
|
1080436,6
|
|
VAN
|
74254,32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRI
|
13%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABLE DES MATIERES
CERTIFICATION
i
DEDICACES
iv
REMERCIEMENTS
v
RESUME
vii
ABSTRACT
viii
LISTE DES ABREVIATIONS
viii
LISTE DES FIGURES
xi
LISTE DES TABLEAUX
xi
Première PARTIE : INTRODUCTION GENERALE ET
CADRES DE L'ETUDE
1
CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE
2
1.1. Introduction
2
1.2. Problématique et Justification de la
recherche
3
CHAPITRE II : CADRES DE L'ETUDE
7
2.1. Cadre conceptuel
7
2.2. Cadre théorique
9
2.3. Objectifs et hypothèses de
recherche
12
CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
13
3.1. Phases de déroulement de
l'étude
13
3.2. Choix et présentation du milieu
d'étude
15
3.3. Choix des unités d'observation et
d'enquête
17
3.4. Echantillonnage
17
3.5. Nature, sources et outils de collecte des
données
18
3.6. Outils et méthodes d'analyse des
données.
20
3.7. Limites de la recherche : difficultés
rencontrées
34
Deuxième partie : RESULTATS, ANALYSES ET
DISCUSSIONS
35
CHAPITRE IV : CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET
SOCIOECONOMIQUES DES UNITES D'ENQUETE.
36
4.1. Caractéristiques démographiques
des ménages
36
4.2. Caractéristiques
socio-économiques des unités d'enquête
37
CHAPITRE V : HABITUDES ALIMENTAIRES,
CONNAISSANCES ET ATTITUDES DES ENQUETEES RELATIVES A L'ANEMIE FERRIPRIVE.
42
5.1. Habitudes alimentaires des ménages
enquêtés
42
5.2. Connaissances et attitudes des
enquêtées relatives a l'anémie
44
CHAPITRE VI : ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA
PREDISPOSITION DES MENAGES A ADOPTER LE DECORTICAGE MECANIQUE ET LA
FORTIFICATION EN FER DU SORGHO.
48
6.1. Qualité, pouvoir de prédiction
et variables déterminantes du modèle
49
6.2. Analyse et discussion des résultats
50
CHAPITRE VII : ANALYSE DES DETERMINANTS DU
CONSENTEMENT A PAYER DES MENAGES `'CONSOMMATEURS'' DE DIBOU POUR LE
DECORTICAGE MECANIQUE ET LA FORTIFICATION EN FER DU SORGHO
56
7.1. La signification globale, qualité de
l'ajustement, variables déterminantes et test de spécification
« correcte » du modèle.
58
7.2. Analyse et discussion des résultats
59
CHAPITRE VIII : EVALUATION DE LA RENTABILITE
FINANCIERE DE L'ACTIVITE DE DECORTICAGE MECANIQUE ET DE FORTIFICATION EN FER DU
SORGHO.
62
Troisième PARTIE : CONCLUSION ET
SUGGESTIONS
65
CHAPITRE IX : CONCLUSION ET SUGGESTIONS
67
9.1. Conclusion
67
9.2. Suggestions
68
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
70
ANNEXES
ANALYSE DE SENSIBILITE TRANSPORT=0
* 1 Troisième
Enquête Démographique et de Santé réalisée au
Bénin
* 2 La composition en fer :
sorgho 4mg/100g ; maïs 3mg/100g ; blé
4mg/100g ; riz brun 3mg/100g (tiré du cours de chimie des
céréales donné par Kayodé dans le
département de nutrition et sciences alimentaires.
* 3 Fabriqué au
Bénin par le Centre de Recherche en Technologie Agricole (CRTA).
* 4 : La procédure
d'identification des anémiés se trouve en annexe 2
* 5 :
Généralement l'année
* 6 : Dedehouanou
définit le capital de fonctionnement comme la somme totale
nécessaire au financement quotidien de l'exécution d'un
projet.
* 7 : Selon le Bureau
International du Travail (BIT), une personne active est toute personne ayant
plus de 15 ans, exerçant une activité économique ou
disponible pour travailler.
* 8 : Consommateurs =
ensemble des membres du ménage.
* 9 : Nous connaissons le
nom du fétiche mais nous avons fait l'option de le taire pour
éviter d'éventuelles frustrations.
* 10 : Mesure prise au
sein du Laboratoire d'analyse des sols de la FSA/UAC
* 11 a=Vit avec son
conjoint ; b= ne vit pas avec son conjoint
* 12 a'=Agricole,
b'=Commerciale, c'=Transformation Agro-alimentaire, d'=Artisanale,
e'=Fonctionnaire, f'=Autre
| 


