|
DEDICACE
Nous dédions ce travail de mémoire à
tous ceux qui se sont approchés de nous pour sa réalisation.
Que notre chère épouse ainsi que les fruits de
nos entrailles trouvent dans cette oeuvre scientifique notre souci le plus
profond pour leur avenir.
Que le Bon Dieu trouve ici notre gratitude pour son amour
incomparable et inconditionnel.
Merci
REMERCIEMENTS
Avec ce présent travail de mémoire, fruit de
nos efforts et qui sanctionne la fin de nos études du second cycle
à l'Institut Polytechnique de Byumba, force est de témoigner
chaleureusement notre sincère gratitude à l'égard de tous
ceux qui nous ont assistés.
En premier lieu, nous disons merci à Dieu, le Tout
Puissant, notre bouclier, pour nous avoir préservé de tout mal.
C'est grâce à sa bonté que ce travail a été
réalisé.
Grand merci aussi à notre Chère épouse
MUKESHIMANA Germaine. En effet, sans sa compagnie, ce travail ne
connaîtrait pas de beau succès.
Nous remercions aussi le Gouvernement du Rwanda pour sa
politique en faveur de l'éducation par son encouragement au secteur
privé à la création non seulement des écoles tant
primaires que secondaires mais encore des instituts supérieurs et
universités.
Nos vifs remerciements d'adressent au Recteur Professeur
Docteur NYOMBAYIRE Faustin. En effet, grâce à son leadership,
l'Institut Polytechnique de Byumba a franchi un pas très important dans
son histoire vers un agrément officiel. De là, un grand merci
à tous les professeurs pour nous avoir tenu compagnie. Nous sommes
également reconnaissants à tous nos condisciples avec qui nous
avons partagé la soif d'apprendre tout au long de notre séjour
à l'Institut.
Par la suite, nous remercions Monsieur MWERINDE Joseph et
Monsieur NZABARA Pierre Célestin qui, de bon coeur, ont
accepté de diriger ce travail de recherche.
Il sied d'exprimer nos remerciements les plus sincères
à notre mère MUKAMAJORO Thérèse pour toutes les
peines qu'elle a supportées pour notre avenir et au Frère Cyrille
WIEME pour son soutien incomparable et inconditionnel à notre faveur.
Enfin, que tous ceux qui, de loin ou de près, ont
contribué d'une façon ou d'une autre, à la
réalisation de ce travail, trouvent ici notre reconnaissance.
SAFALI Evariste
SIGLES ET ABREVIATIONS
|
% : Pourcentage
$ : Dollar américain.
|
|
|
|
|
|
|
B.A.I.L. : Bureau d'Appui aux Initiatives Locales
|
|
|
|
|
B.A.I.R. : Bureau d'Appui aux Initiatives Rurales
|
|
|
|
|
B.M. : Banque Mondiale
C.A. : Conseil d'Administration
|
|
|
|
|
|
C.D.C. : Comité de Développement
Communautaire
|
|
|
|
|
C.D.F. : Community Development Fund
|
|
|
|
|
|
C.D.L.S. : Commission du District de Lutte contre le SIDA.
|
|
|
|
C.E.E. : Communauté Economique
Européenne
|
|
|
|
|
C.F.J. : Centre de Formation des Jeunes.
|
|
|
|
|
C.I.C.R. : Comite International de la Croix Rouge.
|
|
|
|
|
C.N.D.H. : Commission Nationale de Droit de l'Homme.
|
|
|
|
C.N.L.S. : Commission Nationale de Lutte contre le Sida.
|
|
|
|
C.S.R. : Caisse Sociale du Rwanda
|
|
|
|
|
|
C.T.B.: Coopération Technique Belge.
COSYLI: Conseil de Consultation des Syndicats Libres
|
|
|
|
|
|
D.C.D.P. : Decentralization and Community Development
Project
|
|
|
|
E.D.P.R.S. : Economic Development and Poverty Reduction
Strategy
|
|
|
|
Etc : Etcetera
E.U.A. :Etats-Unis d'Amérique
|
|
|
|
|
|
|
F.A.R.G. : Fonds d'Assistance aux Rescapés du
Génocide.
|
|
|
|
F.E.D. : Fond Européen de Développement.
|
|
|
|
|
FRW : Franc Rwandais
|
|
|
|
|
|
|
G.T.Z. : Coopération Allemande de
Développement
|
|
|
|
|
H.I.M.O. : Haute Intensité de Main d'oeuvre
|
|
|
|
|
I.CH.A. : Impôt sur le Chiffre d'Affaire
|
|
|
|
|
I.P.B : Institut Polytechnique de Byumba
|
|
|
|
|
I.R. : Impôt sur les Revenus
|
|
|
|
|
|
I.S.C. : Institut Supérieur de Commerce de
Kinshasa
|
|
|
|
|
J.O.: Journal Officiel
I.C.K. : Institut Catholique de Kabgayi
L.D.G.L. : Ligue des Droits de la personne dans la
Région des grands Lacs
|
|
|
|
|
|
|
M.P.G.R. : Micro Projets Générateurs des Revenus
N.T.B. : National Tender Board
|
|
|
|
|
M.T.E.F : Medium Term Expenditure Frame work
|
|
|
|
|
MINAGRI : Ministère de l'Agriculture
|
|
|
|
|
|
MINALOC : Ministère de l'Administration locale
|
|
|
|
|
MINECOFIN : Ministère des Finances et de la Planification
Economique.
|
|
|
MINIFINECO : Ministère des Finances et de
l'Economie
O.N.G. : Organisations Non Gouvernementales
|
|
|
|
|
O.N.U. : Organisation des Nations Unies
Op. Cit. : Opere Citato : article ou ouvrage
cité
O.R.P.I.E.: Office Rwandais de la Promotion des Investissements
et de l'Exportation
|
|
O.R.R. : Office Rwandais des recettes
|
|
|
|
|
|
ORINFOR : Office Rwandais d'Information
|
|
|
|
|
P.A.D.C. : Projet d'Appui au Développement
Communautaire
|
|
|
|
P.A.FO.R. : Projet d'Appui aux Forets au Rwanda
|
|
|
|
|
P.D.D. : Plan de Développement de District
|
|
|
|
|
P.D.L. H.I.M.O. : Projet de Développement Local de Haute
Intensité de Main d'Oeuvre.
|
|
P.I.P.O. : Planification des Interventions Par Objectif
|
|
|
|
|
P.M. : Personnes Morales
|
|
|
|
|
|
P.N.R.P. : Programme National de Réduction de la
pauvreté.
|
|
|
|
P.N.U.D. : Programme des Nations Unies, pour le
Développement.
P.P. : Personnes Physiques
|
|
|
|
R.A.M.A. : Rwandaise d'Assurance Maladie
|
|
|
|
|
R.I.A.M. : Rwandese Institute for Administration and
Management
|
|
|
|
R.I.TA. : Rwanda Information and Technology Agency
|
|
|
|
R.S.S.P. : Rural Sector Support Project
|
|
|
|
|
|
S.I.S. : Système National d'Information Sanitaire
|
|
|
|
|
T.P.R. : Taxe Professionnelle sur les
Rémunérations
|
|
|
|
|
T.V.A. : Taux sur la Valeur Ajoutée
|
|
|
|
|
|
U.B.P.R. : Union des Banques Populaires du Rwanda.
U.L.K. : Université Libre de Kigali.
LISTE DES TABLEAUX
Tableau n° 1 : Couverture des
dépenses du Gouvernement Rwandais par les recettes
fiscales et non fiscales de
2001 à 2006 (en milliards de FRW).......................6
Tableau n° 2 : Domaines d'interventions
du district de GICUMBI.......................................... 7
Tableau n°3 : Extrait de recettes et
dépenses de l'Etat dans les pays d'Afrique de l'Est,
1950-1965 en 106 de
$.........................................................................................20
Tableau n° 4 : Contribution des recettes
propres aux recettes ordinaires de l'Etat
dans les pays d'Afrique de l'Est, 1950-1965 en 106
de $.....................................21
Tableau n° 5 : Tableau des impôts
en vigueur au Rwanda..............................................J
Tableau n° 6 : Extrait de
l'opération financière du Rwanda (1987-1992) en 106de
FRW.........23
Tableau n° 7 : Partenaires du
Gouvernement Rwandais en 2003....................................26
Tableau n° 8 : Structure administrative
du District de Gicumbi.....................................K
Tableau n° 9 : Répartition de la
population par secteur.............................. .................L
Tableau n° 10 : Produits imposés
et recettes fiscales 2006 - 2008 en FRW...................38
Tableau n°11 : Services taxés
et recettes non fiscales 2006 - 2008 en FRW......................M
Tableau n° 12 : Bailleurs/ Intervenants
et leurs contributions : 2006 - 2008 en FRW.............O
Tableau n° 13 : Revenu propres du
district de Gicumbi : 2006 - 2008 en RWF..................39
Tableau n° 14 : Répartition des
enquêtés selon la perception des recettes non
fiscales.........43
Tableau n ° 15 : Liste des recettes non
fiscales perçues par les
enquêtés...........................44
Tableau n° 16 : Conscience de la
population sur le payement des recettes non fiscales..........44
Tableau n° 17 : Encaissement des recettes
non fiscales par le district...............................45
Tableau n°18 : Existence probable du
contrôle des recettes non fiscales par le district.........46
Tableau n°19 : Sensibilisation de la
population aux recettes non fiscales..........................46
Tableau n° 20 : Tendance de l'assiette
des recettes non fiscales....................................47
Tableau n° 21 : Doléances de la
population sur les impôts à soumettre
aux dirigeants du
district.............................................................. 47
Tableau n° 22 : Payement probable des
recettes non fiscales ou autres frais administratifs ...48
Tableau n° 23 : Liste des recettes et
actes administratifs taxable.....................................48
Tableau n° 24 : Utilité probable
des recettes non fiscales ou autres frais administratifs .......49
Tableau n° 25 : Education probable sur
les recettes non fiscales et
autres frais
administratifs.............................................................
49
Tableau n° 26 : Avis sur l'assiette des
recettes non fiscales ou
autres frais
administratifs..............................................................
50
Tableau n° 27 : Doléances de la
population au sujet des coûts des recettes non fiscales
et autres fais
administratifs ...........................................................50
Tableau n°28 : Poids des recettes non
fiscales en 2006..............................................51
Tableau n°29 : Poids des recettes non
fiscales en 2007........................... .................52
Tableau n°30 : Poids des recettes non
fiscales en 2008..............................................53
Tableau n°31 : Poids synthétique
des recettes non fiscales en 2006-2008.......................54
LISTE DES
GRAPHIQUES
Graphique n°1 : Dépenses des E.U.A. en 1960
...................................................... 15
Graphique n°2 : Revenus fiscaux des E.U.A. en
1960 ................................. .... ......15
Graphique n°3 : Fonds des bailleurs/Intervenants en
2003.............................................26
Graphique n°4 : Comparaison des recettes fiscales
2006-2008.....................................38
Graphique n°5 : Comparaison des recettes non
fiscales 2006-2008.................................N
Graphique n°6 : Comparaison des fonds de
bailleurs/intervenants 2006-2008.....................P
Graphique n°7 : Comparaison des recettes propres
du district de Gicumbi 2006-2008.........40
Graphique n°8 : Recettes non fiscales par rapport
aux recettes totales 2006....................51
Graphique n°9 : Recettes non fiscales par rapport
aux recettes totales 2007......................52
Graphique n°10 : Recettes non fiscales par rapport
aux recettes totales 2008....................53
Graphique n°11: Synthèse des recettes non
fiscales en 2006-2008................................54
|
|
|
|
LISTE DES ANNEXES
Annexe n°1 : Questionnaire destiné aux
fonctionnaires du district de Gicumbi...................A
Annexe n°2 : Questionnaire destiné aux
contribuables du district de Gicumbi....................E
Annexe n°3 : Carte administrative du district de
Gicumbi..........................................G
Annexe n°4 : Organigramme schématique du
district de Gicumbi..................................H
Annexe n°5 : Organigramme schématique de
l'O.R.R................................................I
Annexe n°6 : Tableau n°5 : Impôts en
vigueur au Rwanda ........................................J
Annexe n°7 : Tableau n°8 : Structure
administrative du District de Gicumbi.....................K
Annexe n°8 : Tableau n°9 : Répartition
de la population par secteur ..............................L
Annexe n°9 : Tableau n°11 :
Services taxés et recettes non fiscales 2006 - 2008 ..........M
Annexe n°10 : Graphique n°5 : Comparaison des
recettes non fiscales 2006-2008..............N
Annexe n°11 : Tableau n° 12 : Bailleurs/
Intervenants et leurs contributions : 2006 - 2008...O
Annexe n°12 : Graphique n°6 :Comparaison des
fonds de bailleurs/intervenants 2006-2008.. P
TABLE DE MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
SIGLES ET ABREVIATIONS
III
LISTE DES TABLEAUX V
LISTE DES GRAPHIQUES VII
LISTE
DES ANNEXES VIII
TABLE
DE MATIERES IX
SOMMAIRE...................................................................................................................XIII
ABSTRACT....................................................................................................................XIV
CHAPITRE
1. INTRODUCTION GENERALE 1
1.1.
HISTORIQUE DU PROBLEME 1
1.2.
MOTIF DU CHOIX ET INTERET DU SUJET 3
1.2.1.
MOTIF DU CHOIX DU SUJET 3
1.2.2.
INTERET DU CHOIX DU SUJET 4
1.2.2.1.
INTERET PERSONNEL 4
1.2.2.2.
INTERET SCIENTIFIQUE ET ACADEMIQUE 4
1.2.2.3.
INTERET SOCIAL 4
1.2.2.4.
INTERET POLITIQUE 5
1.3.
DELIMITATION DU SUJET 5
1.4.
PROBLEMATIQUE 5
1.5.
HYPOTHESE 7
1.
6. OBJECTIFS DE L'ETUDE 8
1.6.1.
OBJECTIF GENERAL 8
1.6.2.
OBJECTIFS SPECIFIQUES 8
1.7.
DIVISION DU TRAVAIL 8
CONCLUSION
PARTIELLE 9
CHAPITRE
2. CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTERATURE 11
2.1.
DEFINITION DES CONCEPTS-CLES 11
2.1.1.
POIDS 11
2.1.2.
RECETTES ET REVENUS 11
2.1.3.
PUBLIC 11
2.1.4.
FISC 11
2.1.5.
RECETTES PUBLIQUES ET REVENUS PUBLICS 12
2.1.6.
RECETTES NON FISCALES 12
2.1.7.
RECETTES PARAFISCALES 13
2.1.8.
RECETTES FISCALES 13
2.2.
REVUE DE LA LITTERATURE 13
2.2.1.
SOURCES DE FINANCEMENT DES GOUVERNEMENTS DANS LE MONDE 14
2.2.1.1.
REVENUS FISCAUX 14
2.2.1.2.
REVENUS NON FISCAUX 16
2.2.1.2.1.
REVENUS COMMERCIAUX 16
2.2.1.2.2.
REVENUS ADMINISTRATIFS 16
2.2.1.3.
REVENUS PARAFISCAUX 17
2.2.1.4.
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 18
2.2.1.4.1.
SUBVENTIONS 18
2.2.1.4.2.
EMPRUNTS 18
2.2.2.
SOURCES DE FINANCEMENT DES ETATS DE LA SOUS RÉGION DE L'AFRIQUE DE
L'EST 20
2.2.2.1.
REVENUS FISCAUX 21
2.2.2.2.
REVENUS NON FISCAUX 21
2.2.2.3.
REVENUS PARAFISCAUX 22
2.2.2.4.
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 22
2.2.3.
SOURCES DE FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT RWANDAIS 23
2.2.3.1.
REVENUS FISCAUX 23
2.2.3.2.
REVENUS NON FISCAUX 24
2.2.3.3.
REVENUS PARAFISCAUX 24
2.2.3.4.
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 25
2.2.4.
SOURCES DE FINANCEMENT DU DISTRICT DE GICUMBI 27
CONCLUSION
PARTIELLE 27
CHAPITRE
3. METHODOLOGIE 29
3.
1. TECHNIQUES 29
3.1.1.
TECHNIQUE DOCUMENTAIRE 29
3.1.2.
TECHNIQUE D'ENTRETIEN (ENTREVUE, INTERVIEW) 29
3.1.3.
TECHNIQUE D'ECHANTILLONNAGE 30
3.1.4.
TECHNIQUE DE QUESTIONNAIRE 32
3.2.
METHODES 33
3.2.1.
METHODE ANALYTIQUE 33
3.2.2.
METHODE COMPARATIVE 33
3.2.3.
METHODE STATISTIQUE OU QUANTITATIVE 34
CONCLUSION
PARTIELLE 34
CHAPITRE
4. PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNEES 35
4.1.
PRESENTATION DU DISTRICT DE GICUMBI 35
4.1.1.
SITUATION GEOGRAPHIQUE. 35
4.1.2.
SITUATION DEMOGRAPHIQUE 36
4.1.3.
HISTORIQUE DU DISTRICT GICUMBI 36
4.1.4.
CADRE LEGAL DU BUDGET DU DISTRICT 36
4.1.5.
REVENUS PUBLICS DANS LE DISTRICT DE GICUMBI 37
4.1.5.1.
RECETTES PROPRES: 2006 - 2008 37
4.1.5.1.1.
PRESENTATION DES RECETTES FISCALES 37
4.1.5.1.2.
PRESENTATION DES RECETTES NON FISCALES 38
4.1.5.3.
RECAPITULATION DES REVENUS DU DISTRICT DE GICUMBI : 2006 - 2008.
39
4.2.
ANALYSE DES DONNÉES 40
4.2.1.
ANALYSE QUALITATIVE 40
4.2.2.
ANALYSE QUANTITATIVE 40
4.2.2.1.
ANALYSE PRIMAIRE 41
4.2.2.2.
ANALYSE SECONDAIRE 41
4.3.
INTERPRETATION DES RESULTATS DE RECHERCHE 41
4.3.1.
CHAMPS D'ACTION 41
4.3.2.
CONTENU DU QUESTIONNAIRE 41
4.3.3.
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'ENQUÊTE
41
4.3.3.1.
ENQUETE EFFECTUEE AUPRES DES TECHNICIENS DU DISTRICT ET DES FONCTIONNAIRES DES
INSTANCES DE BASE 43
4. 3.3.1.1.
PERCEPTION PROBABLE DES RECETTES NON FISCALES 43
4.3.3.1.2.
SOURCES DE RECETTES NON FISCALES 44
4.3.3.1.3.
CONSCIENCE DE LA POPULATION SUR LE PAYEMENT DES RECETTES NON FISCALES
44
4.3.3.1.4.
MODALITÉ D'ENCAISSEMENT DE CES RECETTES PAR L'OFFICIER DU DISTRICT
45
4.3.3.1.5.
EXISTENCE DU CONTRÔLE DES RECETTES NON FISCALES
46
4.3.3.1.6.
EXISTENCE DE LA SENSIBILISATION DE LA POPULATION SUR LES RECETTES NON
FISCALES......... 46
4.3.3.1.7.
APPRÉCIATION DE L'ASSIETTE DES RECETTES NON FISCALES
47
4.3.3.1.8.
SOUHAITS À SOUMETTRE AUX OFFICIERS DU DISTRICT.
47
4.3.3.2.
ENQUÊTE EFFECTUÉE AUPRÈS DE LA POPULATION
48
4.3.3.2.1.
PAYEMENT PROBABLE DES RECETTES NON FISCALES OU AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS
48
4.3.3.2.2.
SERVICES ET ACTES ADMINISTRATIFS TAXABLES 48
4.3.3.2.3.
UTILITE DES RECETTES NON
FISCALES..................................................................49
4.3.3.2.4.
EDUCATION SUR LES RECETTES NON FISCALES 49
4.3.3.2.5.
APPRÉCIATION SUR L'ASSIETTE DES RECETTES NON FISCALES
50
4.3.3.2.6.
SOUHAITS À SOUMETTRE AUX DIRIGEANTS DU DISTRICT.
50
4.3.4.
PRÉSENTATION DU POIDS DES RECETTES NON FISCALES SUR LE REVENU PUBLIC
51
4.3.4.1.
EXERCICE BUDGETAIRE 2006 51
4.3.4.2.
EXERCICE BUDGETAIRE 2007 52
4.3.4.3.
EXERCICE BUDGETAIRE 2008 53
4.3.4.4.
RÉCAPITULATION DU POIDS DES RECETTES NON FISCALES 2006-2008
54
4.4.
VALIDATION DES HYPOTHÈSES 54
4.4.1.
AU NIVEAU DES RÉPONSES AUX QUESTIONS SOUMISES AUX
ENQUÊTÉS 54
4.4.2.
AU NIVEAU DES RÉSULTATS DE L'ANALYSE DU RAPPORT FINANCIER DU DISTRICT
DE GICUMBI (2006-2008) 55
CONCLUSION
PARTIELLE 55
CHAPITRE
5. CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 57
5.1.
CONCLUSION GENERALE 57
5.2.
RECOMMANDATIONS.................................................................................................60
5.2.1.
AU GOVERNEMENT RWANDAIS 60
5.2.2.
AUX AUTORITES DU DISTRICT DE GICUMBI 60
5.2.3.
A LA POPULATION DU DISTRICT DE GICUMBI 60
5.2.3.
A LA POPULATION DU DISTRICT DE GICUMBI 60
5.2.4.
PERSPECTIVES DES RECHERCHES ULTERIEURES 61
BIBLIOGRAPHIE
62
ANNEXES.................................................................................................................................................66
SOMMAIRE
Notre travail de recherche intitulé « Le
poids des recettes non fiscales sur les revenus publics au Rwanda »
a été effectué dans le district de Gicumbi pour une
période allant de l'an 2006 à 2008.
L'objectif général de ce travail était
la mise en exergue des sources de financement du district de Gicumbi. La
question de savoir si il existe des recettes non fiscales et leur contribution
éventuelle aux revenus publics dans le district de Gicumbi constituent
le pilier de ce mémoire. Les techniques documentaires, d'entretien et
d'interview, d'échantillonnage et de questionnaire ainsi que les
méthodes analytiques, comparatives et statistiques ont été
mises en jeu pour la vérification des hypothèses de la perception
des recettes non fiscales sous diverses sources et de leur importante
contribution aux revenus publics du district.
L'articulation autour de cinq chapitres a été
conçue : le premier s'intitulait « Introduction
Générale » et traitait du déroulement du
travail de recherche en général ; le second
« Cadre conceptuel et revue de la littérature »
définissait les concepts-clés et circonscrivait l'étude
dans un cadre théorique de référence ; le
troisième « Méthodologie » présentait
les techniques et les méthodes mises en oeuvre pour la collecte des
données et leurs analyses ; le quatrième
« Présentation, analyse des données et
interprétation» contenait l'originalité du travail alors
que le dernier intitulé « Conclusion générale
et recommandations » est intervenu pour la clôture.
Les objectifs de recherche ont été tous atteints
avec succès et toutes les hypothèses ont été
vérifiées : la première a été
confirmée étant donné que les recettes non fiscales
existent dans le district de Gicumbi sous différentes sources au moment
où la deuxième à été infirmée parce
que leur contribution aux revenus publics est très minimes à
l'ordre de 7%. De finir, quelques recommandations aux différents
partenaires ont été formulées en vue de la promotion et
de l'augmentation du volume des recettes non fiscales dans le district de
Gicumbi.
ABSTRACT
Our research task entitled «the weight of the non tax
receipts on the public incomes in Rwanda» was carried out in the district
of Gicumbi for the period going from 2006 to 2008.
The general objective of this research work was the forward
setting of the funding sources of the district of Gicumbi. A question of
checking out the existence of non tax receipts and their contribution to the
public incomes constituted the pillar of this research. The documentary,
interview, sampling and questionnaire techniques but still the analytical,
comparative and statistical methods have been used to check up the research
assumptions. Those were the perception of non tax receipts perceived under
various sources and their big part to the public incomes of Gicumbi
district.
An articulation around five chapters was set up: the first
entitled «General Introduction» deals with unfolding of this work in
general; the second «Conceptual framework and literature review»
deals with key words definition and theoretical reference framework; the third
«Methodology» presents techniques and methods used for data
collection and analysis. The fourth «Presentation, data analysis and
interpretation» contains the originality of the work whereas the last one
«General conclusion and recommendations» ends this work.
The research objectives have been achieved successfully and
all hypotheses have been verified: the first has been confirmed since the non
taxes receipts exist in Gicumbi district under various sources whereas the
second has been unconfirmed because those non taxes receipts' contributions on
public incomes represent only 7%. Finally, some recommendations to different
partners have been formulated to promote the non taxes receipts in Gicumbi
district.
CHAPITRE 1. INTRODUCTION GENERALE
1.1. HISTORIQUE DU
PROBLEME
Dès sa création, l'homme est appelé
à faire régner le nom du Seigneur dans le monde entier en
consacrant les prémices de ses produits. L'Eglise aussi, quant à
elle, interpelle tous les fidèles non seulement à faire
régner le Royaume de Dieu, mais aussi à bâtir le monde et
à le rendre meilleur par leurs contributions1(*).
Les Gouvernements, de part le monde entier, ont suivi le
modèle biblique pour financer leurs budgets : l'article 1 de la
constitution des E.U.A. confère au Congrès le droit
d'établir et de collecter les impôts et taxes pour payer ses
dettes et payer le coût de la défense et du bien être
social2(*). Il est
évident que les recettes fiscales, parafiscales et recettes non
fiscales existent depuis longtemps comme source de financement et dans toutes
les sociétés. Il serait inimaginable de penser à une
société sans de telles recettes vu leurs contributions
importantes et irréversibles à leurs revenus pour une autonomie
financière.
L'Etat a ainsi forcément besoin des moyens
financiers provenant principalement des impôts et taxes qui lui
permettent de financer son budget afin de mener à bon terme sa mission
d'assurer la souveraineté nationale, la sécurité des
biens et des personnes ainsi que le bien être social3(*). Moyennant aussi ces fonds, il
doit promouvoir le développement économique et se faire une
bonne image aux yeux de la communauté internationale. Pour assurer
l'efficacité de recouvrement des entrées, l'autorité
politique les a institutionnalisées afin qu'aucune force
n'échappe à la construction de la Nation et une série de
mesures a été mise à place4(*).
Au Rwanda, le problème de recherche de financement
date de longtemps. L'histoire de la fiscalité remonte de
l'époque coloniale. La première réglementation de
l'impôt date de 1912 : l'ordonnance du 23/08/1912 portant
instauration de l'impôt sur les maisons. L'ordonnance du 15/11/1925
portant application du décret du Congo Belge du 1/6/1925 instituant
l'impôt sur les revenus a été modifiée par le
décret du 25/03/1960 sur l'orientation de l'économie vers le
développement.
La première loi fiscale mise en place par les Rwandais
fut du 02/06/1964 après l'accession du pays à
l'indépendance et une évolution a été
importante : La fiscalité Rwandaise en matière
d'impôts sur les revenus reposait depuis plus de trente ans sur la loi du
2 juin 1964, laquelle loi a subi une réforme en profondeur par
l'avènement des lois n° 8 et 9/1997 portant respectivement la
fiscalité professionnelle directe en procédures fiscales. Cette
réforme a été conditionnée par les multiples
imperfections contenues dans la loi du 2 juin 1964 qui affectait
négativement l'élasticité du système fiscal
rwandais. Ici, il y a lieu de citer parmi ces imperfections :
Ø Les exonérations et immunités fiscales
de toutes sortes dont le recours abusif sapait des règles de la
concurrence, et partant, rétrécissaient la base imposable,
Ø Le taux d'impôts très
élevés qui favorisaient l'évasion et la fraude fiscale,
Ø La double imposition d'un même revenu dont le
chef de l'entreprise en premier lieu (Impôt sur les revenus I.R.) et une
seconde fois dont le chef du bénéfice des revenus
distribués (impôt mobilier I.M.),
Ø Le manque de clarté de certaines dispositions
légales qui avaient pour conséquence une confrontation permanente
entre l'administration fiscale et les contribuables.
Cependant, une amélioration fut apportée par la
confection des lois n°8 et 9/97 et on peut citer :
Ø La fiscalisation minimum du secteur informel,
Ø Le rapprochement de la loi fiscale et la loi
comptable,
Ø L'unification des procédures et voies de
recours,
Ø L'amélioration des entrées
fiscales,
Ø La résolution du problème de
réévaluation des actifs,
Ø La défiscalisation des provisions sur
créances douteuses et litigieuses constituées par les entreprises
bancaires,
Ø La défiscalisation des revenus
distribués (impôt mobilier),
Ø L'élimination de la législation de
toutes dispositions discriminatoires,
Ø La possibilité pour les entreprises
naissantes de recourir à la méthode d'amortissement
dégressif,
Ø La simplification des obligations des
contribuables5(*).
Pour la maximisation des recettes, le Rwanda a mis sur pied
l'Office Rwandais des Recettes chargé d'établir les contributions
en matière fiscale et douanière, de les percevoir, d'en faire
l'administration et d'en rendre compte au Ministère des Finances et de
la Planification Économique. Cet organisme étatique,
créée par la loi n°8/97 du 26 juin 1997, porte le Code des
impôts directs sur les bénéfices divers et revenus
professionnels. Cette loi a également prévu des incitants aux
investisseurs, notamment l'exemption de certaines taxes, primes
d'investissements, la création de zones économiques franches
telles que prévues par la législation fiscale et
douanière. Des renseignements plus détaillés peuvent
être obtenus auprès de l'Office Rwandais pour la Promotion des
Investissements et des Exportations (ORPIE ou RIEPA en anglais).
Cet organe qui a été mis en place en 1998 par
la loi n° 15/07 du 8 novembre 1997 est dirigé par un conseil
d'Administration dont le président est nommé par le Premier
Ministre sur recommandation du Conseil de Ministres. Le C.A. est chargé
de la formation et de la mise en application des politiques fiscales de
l'O.R.R. La gestion quotidienne est assurée par une équipe
dirigée par le Commissaire Général6(*). Pour plus de détail sur
l'O.R.R. (l'annexe n°3).
1.2. MOTIF DU CHOIX ET
INTERET DU SUJET
Le budget est un aspect intéressant
et indispensable pour toutes les entreprises tant publiques que
privées. Ainsi, il est connu de tous qu'aussi bien le Gouvernement
Local que Central vivent des recettes fiscales, recettes parafiscales,
recettes non fiscales et même des fonds de bailleurs /Intervenants.
Ils ont eu une mission d'accroître leurs activités pour le
bien être des citoyens et cela doit aller de paire avec l'accroissement
des revenus.
1.2.1. Motif du choix du
sujet
Le district et la ville sont des entités
administratives dotées de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière. Pour s'assurer de l'effectivité de
cette autonomie, ces entités administratives disposent d'un budget et
d'un patrimoine propre. Les recettes non fiscales sont l'une des sources de
financement auxquelles le district de Gicumbi fait recours7(*). Le souci de connaître
combien le district profite de ces recettes a fortement attiré notre
attention et a motivé le choix de ce sujet.
1.2.2. Intérêt du
choix du sujet
1.2.2.1.
Intérêt personnel
Cette étude a été pour nous un moyen
par excellence d'approfondir nos connaissances d'abord en matière de
sources de financement des pays de part le monde en général et en
suite en matière de recettes non fiscales dans le district de
Gicumbi en particulier.
1.2.2.2.
Intérêt scientifique et académique
C'est une obligation pour tous les étudiants
finalistes de faire des recherches en vue d'une élaboration d'un
mémoire. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'initier ces
derniers à apporter une contribution à l'évolution de la
science ou à la résolution d'un problème. En plus de cela,
ce travail doit servir d'un outil de référence pour d'autres
chercheurs en matière de recettes non fiscales et de sources de
financement des districts en général.
1.2.2.3.
Intérêt social
Le résultat de cette recherche constitue un point de
référence pour tous les contribuables8(*). En fait, se basant
là-dessus, ils peuvent évaluer leurs apports en les
comparant aux bénéfices qu'ils tirent de la consommation de
biens et services mis à leurs dispositions par l'Etat et par
conséquent, se rendre conscients de leurs contributions au budget du
district. Dorénavant, ils changent d'attitudes et s'acquittent
volontiers de cette obligation civique et le fardeau fiscal est par la suite
réduit à un simple acte patriotique.
1.2.2.4.
Intérêt politique
Le résultat de ladite étude sert d'un outil
important pour les dirigeants de ce pays et ceux du district de Gicumbi en
particulier. Ils n'épargneront plus aucun effort en matière de
la sensibilisation et de la motivation du public à propos du payement
des recettes non fiscales et des impôts en général.
1.3. DELIMITATION DU
SUJET
Notre travail de recherche a été fait dans le
district de Gicumbi de la Province du Nord pour une période allant de
2006 à 2008 dans le domaine des recettes non fiscales.
PROBLEMATIQUE
La problématique est définie comme étant
l'ensemble des questions qu'une science ou une philosophie se pose relativement
à un domaine particulier. C'est la préoccupation même de la
recherche et de l'analyse9(*). Elle serait encore un ensemble construit autour d'une
question principale, des hypothèses de recherche et des lignes
d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi10(*).
En rapport avec notre travail, il convient de faire observer
que ce sujet nous pousse à nous investir dans le domaine de la finance
publique et plus précisément dans le domaine des recettes non
fiscales.
Les Etats et Gouvernements de part le monde ont
institutionnalisé les taxes et impôts pour se pérenniser,
pour assurer le bien être de leurs citoyens et enfin pour financer
leurs dépenses. Le rôle primordial des impôt et des taxes
est de financer le budget (très souvent déficitaire) de l'Etat
et des collectivités locales11(*) . Pour une maximisation nette des revenus
publics, la fiscalité s'est vue dotée de privilège
d'être une matière carrefour dans ce sens qu'elle touche sur le
droit, la comptabilité et l'économie. C'est ainsi que pour son
aspect social et économique, la fiscalité est divisée en
deux sections : impôts ou recettes fiscales et taxes ou
recettes non fiscales. C'est cette dernière section qui a
attiré notre attention tout au long de ce travail.
Pour le Gouvernement Rwandais, les recettes fiscales et non
fiscales financent le budget à hauteur d'un peut plus de 50%. Ce
pourcentage infime explique pour quoi le Gouvernement contracte surtout des
emprunts, des dons et même des subventions12(*).
Tableau n° 1 : Couverture
des dépenses du Gouvernement Rwandais par les recettes fiscales et
recettes non fiscales de 2001 à 2006 (en milliards de FRW).
|
Impôts
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Total des recettes fiscales et non fiscales
|
88.2
|
101.2
|
122.4
|
147.0
|
180.3
|
208.9
|
|
Total des dépenses
|
158.1
|
191.6
|
216.2
|
274.9
|
340.7
|
379.0
|
|
Taux de couverture des dépenses en %
|
54.5
|
52.8
|
56.6
|
53.5
|
52.9
|
55.1
|
Source : MINECOFIN, Direction du
budget,www.bnr.rw/ consulté le 26/03/2010
De ce tableau, on remarque que le budget est
déséquilibré quand bien même les recettes fiscales
et recettes non fiscales y concourent. Ici, il y'a lieu d'émettre
une grande inquiétude: pour l'atteinte des objectifs, le Gouvernement
Central du Rwanda engage ses recettes propres. Malgré tout, les
dépenses ne sont pas couvertes et le Gouvernement est contraint
à recourir à d'autres sources de financement (aides,
emprunts,...). Quelle sera alors sa situation budgétaire et
naturellement déficitaire au cas où les recettes non fiscales
n'existaient pas ? La promotion des recettes non fiscales ne
serait-elle pas une solution efficace pour l'indépendance
budgétaire du Gouvernement Rwandais ?
Pour les districts et les villes du Rwanda, la
personnalité juridique et l'autonomie financière leur ont
été accordées. Ils ont des objectifs à atteindre et
des performances à mener à bon terme. Pour ce faire, ils se
fixent des domaines d'interventions et des montants respectifs à y
allouer ; ce qui requiert des fonds. C'est dans ce cadre que le district
de Gicumbi, dans son plan quinquennal (2008 - 2012), un montant d'un peu plus
de quatre vingt - dix milliards de francs rwandais est requis.
Tableau n° 2 : Domaines d'interventions du
district de GICUMBI
|
Domaines d'interventions
|
Montant en FRW
|
|
Développement social
|
29 713 613 685
|
|
Bonne gouvernance
|
9 904 538 562
|
|
Développement économique
|
50 167 863 305
|
|
Total
|
90 041 259 650
|
Source : PDD de Gicumbi 2008-20012,
juillet 2007, p. V
De ce tableau, une question se pose : d'où est ce
que le district de Gicumbi doit tirer ce financement ? Pour cet
interventionnisme, les recettes propres du district sont requises et sont
valables même pour assurer l'effectivité de cette autonomie. Ce
district dispose d'un budget et d'un patrimoine propre. Ses ressources
proviennent entre autre des impôts et des recettes non fiscales et sont
portées annuellement au budget. Cela suscite une deuxième
question de savoir combien est la contribution de ces recettes non
fiscales.
Le conseil du district ou de la ville a eu le privilège
d'instituer les taxes sur les services rendus à la population et cela
avec un souci d'augmenter le volume des recettes publiques13(*). Il est donc d'un grand
intérêt de prendre en considération le district de Gicumbi
pour une analyse profonde des composantes de revenus.
En ce qui concerne le cas de notre étude, nous nous
sommes posé des questions suivantes :
Ø Quelles sont les sources des recettes non
fiscales dans le district de Gicumbi ?
Ø Quelle est la contribution des recettes non fiscales
aux revenus publics du district de Gicumbi ?
1.5. HYPOTHESE
L'hypothèse de recherche est définie comme
étant une proposition résultant d'une observation et que l'on
soumet au contrôle de l'expérience ou que l'on vérifie par
la méthode de déduction14(*). L'hypothèse est aussi définie comme
étant une proposition de réponse à la question que se
pose le chercheur et qui doit être vérifiée
(confirmée, infirmée ou nuancée) par
l'expérience »15(*).
Selon la tâche que nous nous sommes assignée dans
la problématique, les hypothèses suivantes sont
émises :
Ø Les recettes non fiscales sont perçues sous
diverses sources dans le district de Gicumbi.
Ø les recettes non fiscales constituent une part
importante des revenus publics du district de Gicumbi.
1. 6. OBJECTIFS DE
L'ETUDE
1.6.1. Objectif
général
L'objectif général de ce travail est la mise
en exergue des sources de financement du district de Gicumbi.
1.6.2. Objectifs
spécifiques
Les objectifs spécifiques de notre étude se
focalisent sur le recueil des données et informations
nécessaires dont l'analyse nous permet de:
Ø Connaître les constituants des revenus
publics du district de Gicumbi.
Ø Distinguer différentes sources des recettes
du district ;
Ø Comparer des recettes non fiscales au reste des
revenus publics du district de Gicumbi afin de ressortir leurs forces.
1.7. DIVISION DU
TRAVAIL
Notre travail de recherche est structuré en cinq
chapitres :
Le premier chapitre
intitulé : « Introduction
Générale » parle de façon globale du
déroulement du présent travail. Il traite de l'historique du
problème, du motif et du choix du sujet, de la problématique et
des hypothèses posées ainsi que de la subdivision du travail.
Le deuxième chapitre : « Cadre
conceptuel et revue de la littérature » définit
certains concepts-clés et circonscrit notre étude dans un cadre
théorique de référence.
Le troisième chapitre :
« Méthodologie » s'intéresse à
l'aspect méthodologique. Il expose des techniques utilisées pour
la collecte des données et des méthodes mises en oeuvre pour
l'analyse des résultats de recherche.
Le quatrième chapitre :
« Présentation, Analyse des données et
interprétation» contient l'originalité du travail. Il
présente les revenus publics dans le district de Gicumbi et met en
exergue leurs constituants tout en mettant en évidence le pourcentage
des recettes non fiscales. C'est dans ce chapitre que des commentaires sur
les résultats de recherche et la validation des hypothèses ont
lieu.
Le cinquième chapitre : « Conclusion
générale et recommandations »
sanctionne ce travail de recherche par une conclusion générale,
par des recommandations et par des sujets aux chercheurs éventuels.
CONCLUSION PARTIELLE
Ce premier chapitre avait pour but d'apporter une introduction
générale à ce travail de recherche et
différents points on été abordés :
Dans l'historique du problème, nous avons montré
combien l'homme est au centre de tout et qu'il a été
appelé par le Bon Dieu à construire sa société par
sa propre contribution. Non seulement l'histoire de la fiscalité au
Rwanda et son évolution ont été évoquées,
mais encore la mise en place de l'O.R.R. en vue de la gestion et de
l'administration des recettes publiques a été
soulevée.
Nous avons aussi exprimé non seulement le motif du
choix du sujet qui est le souci de connaître combien le district de
Gicumbi profite des recettes non fiscales pour son budget mais encore
l'intérêt tant personnel, académique, social que
politique.
La soif de connaissances qui nous a poussés à
nous investir dans le domaine de la finance publique et plus
précisément en matière des recettes non fiscales a
été délimitée dans le district de Gicumbi de la
Province du Nord pour une période allant de 2006 à 2008.
Ce travail de recherche a mené une réflexion
de ce qu'aura été la situation budgétaire du district de
Gicumbi (qui est naturellement déficitaire) lorsque les recettes non
fiscales avaient été omises. Pour cela non seulement deux
questions ont été posées à savoir :
« Quelles sont les sources des recettes non fiscales dans le
district de Gicumbi ? » et, « Quelle est la
contribution des recettes non fiscales aux revenus publics du District de
Gicumbi ? » mais encore deux hypothèses ont
été formulées : « Les recettes non fiscales
sont perçues sous diverses sources dans le district de
Gicumbi » et « les recettes non fiscales constituent une
part importante des revenus publics dans district de Gicumbi ».
L'objectif général de ce travail de recherche
était la mise en exergue des sources de financement du district de
Gicumbi alors que les objectifs spécifiques étaient :
Ø Distinguer les constituants des revenus du district
de Gicumbi,
Ø Distinguer différentes sources des recettes
du district ;
Ø Comparer des recettes non fiscales au reste des
revenus publics du district de Gicumbi afin de mettre en exergue leurs
forces.
Quant à sa structure, cinq chapitres ont
été conçus : « Introduction
Générale » parlait de façon globale du
déroulement du présent travail ; le deuxième
chapitre « cadre conceptuel et revue de la littérature
» définissait certains concepts-clés et circonscrivait
notre étude dans un cadre théorique de
référence ; le troisième chapitre :
« Méthodologie » présentait des techniques
et des méthodes utilisées ; le quatrième :
« Présentation , analyse des données et
interprétation» contenait l'originalité du travail et
enfin le dernier : « Conclusion
générale et recommandations », a mis fin à ce
travail de recherche.
CHAPITRE 2. CADRE
CONCEPTUEL ET REVUE DE LA
LITTERATURE
2.1. DEFINITION DES
CONCEPTS-CLES
Dans le souci d'éviter l'obscurantisme
sémantique et de parler le même langage avec tous nos lecteurs,
nous avons d'abord défini les concepts fondamentaux qui seraient
repris tout au long du travail.
2.1.1. Poids
Le mot « poids » vient du latin
« pensum »signifiant ce qu'une chose pèse. Dans le
cadre de notre sujet de recherche, le mot « poids »
intervient pour signifier « l'importance » ou encore
« l'influence »16(*).
2.1.2. Recettes et
Revenus
Ces deux termes sont parfois confondus. Le mot «
recette » vient du mot latin « recepta, de recipere,
recevoir ». Il signifie un montant total des sommes reçues,
gagnées, qui sont entrées en caisse à un moment
donné alors que « revenu » signifie une valeur
nette des biens économiques produits par la nation17(*).
2.1.3. Public
L'adjectif « public » vient du latin
« publicus » et signifie ce qui concerne la
collectivité dans son ensemble ou qui en émane (par opposition
à privé)18(*).
2.1.4. Fisc
Le mot « fisc » vient du latin
« fiscus, panier ». Il signifie l'administration
chargée de calculer et de percevoir l'impôt19(*).
2.1.5. Recettes publiques
et revenus publics
Déduction faite des explications données ci-
haut, les recettes publiques font référence à un montant
total des sommes reçues, gagnées et qui sont entrées en
caisse de la collectivité à un moment donné alors que
les revenus publics signifient une valeur nette des biens économiques
produits par la nation pour elle-même.
Les revenus publics peuvent signifier aussi toutes les
entrées de la finance publique que le Gouvernement peut s'assurer pour
une période donnée. Au sens figuré ce terme veut dire des
ressources publiques. Ils sont principalement composées des taxes et
impôts, des prix de biens et services offerts par des entreprises
publiques, des dons, des subventions, des emprunts et des revenus provenant
des activités administratives : frais des services publics, etc.
Dans les Etats du bien être social moderne, les revenus publics sont
composés de deux éléments : revenus fiscaux
(impôts) et revenus non fiscaux (taxes) et proviennent de la
propriété en possession des habitants du pays20(*).
2.1.6. Recettes non
fiscales
Les recettes non fiscales sont des contributions causales.
Elles constituent une contribution publique spéciale qu'une
autorité publique exige des administrés soit en échange
d'un service rendu ou d'un avantage procuré ou en contre partie d'une
dépense publique provoquée. Elles constituent une prestation
pécuniaire, conditionnelle et un payement définitif. Les
recettes non fiscales constituent des prélèvements non
obligatoires et peuvent provenir de la part de l'Etat dans les
bénéfices annuels de la Banque Nationale, de la
part de l'Etat dans les bénéfices de certaines
sociétés, des revenus de
propriétés foncières et des ventes de
biens et services21(*).
Elles sont connues généralement sous le nom de
« taxes ».
2.1.7. Recettes
parafiscales
Ce sont des cotisations sociales payées de
façon obligatoire par les employeurs et les travailleurs et même
par la population pour le financement de la sécurité sociale.
Elles permettent l'accès aux soins médicaux, les allocations de
chômage, la pension, etc. 22(*).
2.1.8. Recettes
fiscales
Cette appellation tient du terme
« fiscalité ». La fiscalité vient du latin
« FISCUS » (panier) qui est un ensemble des mécanismes dont
tout pays au nom de sa souveraineté et au nom de sa politique fiscale
met en branle des techniques pour drainer vers le Trésor Public le
maximum des ressources financières dont il peut disposer pour
répondre aux objectifs dévolutifs à l'impôt.
En somme, la fiscalité est définie comme étant un
ensemble des prélèvements pécuniaires obligatoires
effectués par l'administration publique à titre définitif
et sans contrepartie immédiate ou directe pour l'équilibre du
budget23(*).
Ces recettes sont généralement connues sous le
nom « impôts ». Elles poursuivent un bon nombre
d'objectifs: l'augmentation du revenu national, la régulation, le
contrôle et la réduction des consommations inutiles, la
réduction de l'inégalité, la stabilité
économique et la maintenance des conditions de travail ainsi que les
objectifs politiques24(*) . Enfin pour clore cette section, soulignons
que les impôts se présentent sous différents types
classiques à savoir: l'impôt direct et indirect, l'impôt
général et l'impôt spécial, l'impôt
général ou l'impôt universel, l'impôt sur les
revenus, sur la dépense ou sur la facture, l'impôt
spécifique et l'impôt ad valorem25(*).
2.2. REVUE DE LA LITTERATURE
Dans ce sous point du deuxième chapitre, nous avons
brossé de manière globale les sources de financement des
Gouvernements dans le monde entier comme premier niveau ; au second
niveau, nous avons parlé de l'Afrique et plus
particulièrement de la sous région de l'Afrique de l'Est et au
troisième niveau, nous avons exposé de manière beaucoup
plus détaillée les sources de financement du Gouvernement
Rwandais. En dernier lieu, nous avons parlé des sources de
financement du district de Gicumbi. Chaque fois, une attention
particulière a été portée aux taxes (recettes non
fiscales).
2.2.1. Sources de
financement des Gouvernements dans le monde
Les revenus publics sont principalement composés des
taxes et impôts, des prix de biens et services offerts par des
entreprises publiques, des revenus provenant des activités
administratives ( frais des services publics), des dons, des subventions, des
emprunts, etc.
2.2.1.1. Revenus
fiscaux
Les définitions de l'impôt sont nombreuses et
mettent l'accent sur la caractéristique en omettant sa fonction
essentielle qui est « d'assurer la couverture des dépenses
publiques ». L'impôt qui doit sa légitimité des
dispositions régissant l'existence même de la nature des
contributions trouve son origine dans les textes législatifs et
réglementaires, ainsi que dans les décisions de jurisprudence.
L'impôt est un prélèvement opéré par voie
de contrainte par la puissance publique, et ayant pour objectif essentiel de
couvrir les charges publiques et de les répartir en fonction des
facultés contributives des citoyens26(*).
Dans les Etats du bien être social moderne, les revenus
publics sont composés de deux éléments : revenus
fiscaux (impôts) et revenus non fiscaux (taxes). Ils proviennent
de la propriété en possession des habitants du pays et de la
propriété en possession de l'Etat.
On distingue différents types de revenus
publics :
Ø des revenus directs : ceux provenant des
terrains publics, des entreprises publiques comme chemin de fer, route,
autoroute, poste, télégraphie ;
Ø des revenus dérivatifs : ceux qui
viennent des citoyens tels que les impôts, les amendes et
pénalités ;
Ø des revenus anticipatoires : ceux qui
proviennent de la vente des biens de trésor, et autres crédits
commerciaux ;
Ø des revenus gracieux : des dons,... ;
Ø des revenus contractuels : ceux provenant des
contrats conclus entre l'Etat et les particuliers. (Exemples : revenus sur
la terre, les mines et les entreprises publiques) et
Ø des revenus obligatoires : ceux qui proviennent
de l'autorité de l'Etat pour l'administration, la justice ou des
impôts27(*).
En E.U.A., une grande partie des revenus publics provient des
impôts : impôts sur les revenus des personnes, impôts
sur les revenus des sociétés et biens d'autres
impôts28(*). Les
recettes non fiscales ne contribuent qu'à 4%. La grande partie du
budget national américain est financée par les revenus
propres, le déficit étant financé par le concourt
à d'autres sources29(*).
Graphique n°1 : Dépenses des E.U.A. en
1960 Graphique n°2 : Revenus fiscaux des E.U.A. en 1960
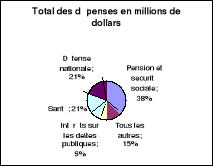 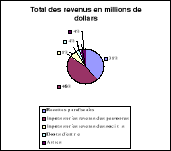
Source: CAMPBEL R. Mc COLONNEL, STANLEY L.
ECONOMOCS: Source : CAMPBEL R.
McCOLONNEL, STANLEY L. ECONOMICS :
Principals, Problems and Policies, 16eme éd. New
York Brue, 1960, p.86 Principals, Problems and Policies,
16eme éd. New York Brue, 1960, p.86
Pour l'équilibre budgétaire, les Etats peuvent
entre autre instaurer de nouveaux impôts et taxes, contracter des
emprunts tant internes qu'externes, ... et c'est toute cette
procédure qu'on appelle la politique fiscale30(*). Cette terminologie est
définie différemment par les pays selon qu'ils s'alignent dans
la catégorie des pays développés, pays moins
développés ou pays sous développés30(*).
2.2.1.2. Revenus non
fiscaux
Les recettes non fiscales constituent des
prélèvements non obligatoires et peuvent provenir de la part
de l'Etat dans les bénéfices annuels de la Banque
Nationale, de la part de l'Etat dans les
bénéfices de certaines sociétés,
des revenus de propriétés foncières et
des ventes de biens et services. Ces recettes existent sous des
catégories suivantes31(*) :
2.2.1.2.1. Revenus
commerciaux
Les revenus commerciaux sont des revenus perçus sous
forme de prix des biens et services offerts par le Gouvernement. Ils
constituent donc de prix payé par le public pour les biens et services
produits par les entreprises appartenant au Gouvernement. Ils
incluent :
Ø Les frais de poste,
Ø Frais de péage routier,
Ø Intérêts sur les fonds et mobiliers de
l'Etat prêtés aux institutions de crédit,
Ø La location des mines et carrières,
Ø Frais sur électricité et eau
distribués par le Gouvernement,
Ø Frais sur le transport, sur les chemins de fers et
autres entreprises de l'Etat.
2.2.1.2.2. Revenus
administratifs
Ce sont des revenus provenant des services rendus par
l'administration. Ils se présentent sous forme de :
Ø Frais (exemple : notification,...),
évaluation spéciale, amende, pénalités et frais
de tribunaux,
Ø Somme d'argent qui est déposé en banque
et quand le propriétaire est mort et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre
qui la réclame revient nécessairement à l'Etat
après deux ou trois ans.
Le Gouvernement Américain inclut dans cette
catégorie tous les frais payés pour avoir exploité
même des services sociaux offerts à la population : les
frais de minerval des grandes universités, les hôpitaux publics,
les chemins de fer,...
En France, en plus des impôts, l'État dispose
aussi des recettes non fiscales. Elles occupent une place secondaire dans le
budget de l'État : 27,9 milliards d'euros pour 2008, soit
12,6 % de ses recettes budgétaires nettes, fonds de concours
compris.
Il s'agit principalement :
Ø Des revenus du patrimoine de l'État :
prélèvements versés par des organismes publics (ex :
Banque de France, Caisse des dépôts et consignations), dividendes
versées par des entreprises dont l'État est actionnaire, revenus
du domaine de l'État et des résultats d'opérations
de trésorerie, etc.
Ø Des revenus des activités industrielles et
commerciales de l'État, et des rémunérations pour services
rendus. Ainsi, l'État conserve plus de 3 milliards d'euros du produit
des impôts locaux au titre des frais de recouvrement de ces
impôts.
Ø Des retenues pour pensions sur les traitements des
agents publics et de contributions de divers organismes aux pensions
versées par l'État à leurs anciens fonctionnaires et des
ressources diverses comme : le produit des jeux, le produit des amendes et
des condamnations pécuniaires, les dons et legs, etc. Enfin, des "fonds
de concours" ou subventions intérieures comme la construction d'une
université par exemple.
2.2.1.3. Revenus parafiscaux
Ce type de revenus constitue une part importante pour certains
pays : en E.U.A. les revenus parafiscaux rapportent au Gouvernement un
pourcentage de 38% des recettes totales. Les revenus parafiscaux proviennent
des taxes sur les rémunérations et indemnités32(*).
2.2.1.4. Autres sources
de financement
2.2.1.4.1.
Subventions
La subvention est une aide financière versée par
l'Etat ou une personne publique à une personne privée dans le
but de favoriser l'activité d'intérêt général
à laquelle elle se livre33(*). Ce sont des recettes venant des pays riches aux
pauvres pour leurs développements. Elles s'inscrivent dans le cadre de
la coopération. La subvention est aussi définie comme une aide
financière à
partir de fonds publics ; une définition plus précise est
difficile. []Le bénéficiaire de la subvention peut
être quelconque : public ou privé, entreprise, association,
ou personne ; etc. La subvention peut porter sur un projet, sur un type de
bien, sur une situation... et elle permet d'apporter un soutien financier
à des activités d'intérêt général.
On peut distinguer différents types de subventions :
les subventions de fonctionnement, les concours en nature et les subventions
d'équipement destinées au financement de biens durables et de
travaux. Une subvention n'est jamais attribuée spontanément :
elle constitue un objet de demande et il n'y a aucun droit à la
subvention34(*). Dans les
pays riches, ce type de revenu constitue une portion très
négligente : en 1968, le Gouvernement Fédéral
Américain a fait un transfert de dollars aux Etats et Gouvernements
Locaux pour des activités spécifiques telles que la gestion des
ressources naturelles et l'environnement35(*).
2.2.1.4.2.
Emprunts
Un emprunt est une
dette financière
à long terme, alors que les dettes à moyen et court terme sont
habituellement appelées «
crédits ».
Un emprunt est une dette résultant de l'octroi de
prêts remboursables
à terme (fonds versés en vertu de dispositions contractuelles
à l'exception des concours bancaires courants) qui participent,
concurremment avec les capitaux propres, à la couverture des besoins de
financement durable de l'entreprise. Il est possible de distinguer deux types
d'emprunt :
Ø Un emprunt indivis qui est effectué
auprès d'un unique préteur (généralement un
établissement financier). Le remboursement suit des modalités
d'amortissement et de paiement d'intérêt stipulées dans le
contrat. Ce type enregistre trois types de remboursement : remboursement
in fine, amortissement constant et annuité constante
Ø Un emprunt obligataire qui naît de
l'émission d'
obligations qui
sont réparties entre de nombreux prêteurs. C'est donc un emprunt
réservé aux entreprises importantes qui peuvent rassurer les
investisseurs.
Les traits suivants caractérisent l'emprunt :
Ø L'emprunt n'est pas obligatoire
Le souscripteur n'est jamais obligé de prêter. La
contrainte n'est pas mise en oeuvre dans ce type d'opération puisque
c'est par contrat que l'Etat et le souscripteur s'engagent mutuellement.
Toutefois on cite quelques exemples d'emprunts obligatoires: ils sont
particulièrement rares et liés à des situations tout
à fait exceptionnelles. Ils sont aussi singuliers que le sont les
contributions volontaires.
Ø L'emprunt n'est pas
définitif
Les sommes prêtées par le souscripteur lui seront
restituées après un laps de temps variable en fonction de
l'emprunt. La réalisation effective du remboursement est souvent
garantie par des techniques variables.
Ø L'emprunt a une contrepartie
Non seulement le souscripteur récupère le
capital prêté, mais en plus il perçoit en échange
des coûts des services financiers qu'il rend : les intérêts
dont le taux a été prévu à l'avance36(*).
Les Gouvernements des pays tant pauvres que riches
s'endettent pour faire face à leurs budgets déficitaires.
L'exemple donné est celui du Gouvernement Américain : en
2009, il a contracté des dettes aussi bien à l'intérieur
(secteurs publics et privés) qu'à l'extérieur. La
dette publique de ce
pays était de plus de 12 000 milliards de dollars. Elle a
été supportée par des créanciers principalement
japonais, chinois, européens et arabes37(*).
2.2.2. Sources de
financement des Etats de la sous région de l'Afrique de
l'Est
Tableau n° 3 : Extrait de recettes et
dépenses de l'Etat dans les pays d'Afrique de l'Est, 1950-1965 en
106 de $
|
|
Recettes
|
Dépenses
|
|
Pays
|
Années
|
Ordin
|
Autres
|
Total
|
Ordin
|
Autres
|
Total
|
|
Ethiopie
|
1955
|
47
|
1.4
|
48.4
|
45.4
|
5
|
49.4
|
|
1961
|
73.5
|
10.1
|
83.6
|
71.1
|
14.7
|
85.8
|
|
Kenya
|
1955
|
77.8
|
31.4
|
109.2
|
110.3
|
20.2
|
130.5
|
|
1960
|
103
|
8.1
|
111.1
|
107.2
|
22.7
|
139.9
|
|
Madag
|
1955
|
57.7
|
25.7
|
83.4
|
67.4
|
25.7
|
93.1
|
|
1960
|
62.8
|
3.2
|
66
|
68.5
|
3.6
|
72.1
|
Source : Nations Unies, Etude sur la
situation économique de l'Afrique, New York, 1970, p. 15
Légende :- ordin.: Ordinaire
-Madag. : Madagascar
Comme le montre le tableau précédent, les
Gouvernements de la sous région de l'Afrique de l'Est parviennent
à financer leurs budgets par les recettes ordinaires (communément
appelées recettes propres qui comprennent les recettes fiscales et les
recettes non fiscales) ainsi que par les autres recettes (les recettes
parafiscales et autres recettes provenant de l'extérieur)38(*).
2.2.2.1. Revenus
fiscaux
Tableau n° 4 : Contribution des recettes
fiscales aux recettes ordinaires de l'Etat dans les pays d'Afrique de l'Est,
1950-1965 en 106 de $
|
Pays
|
Années
|
Recettes fiscales
|
Recettes
Non fiscales
|
Recettes
ordinaires
|
|
Impôts indirects
|
Impôts directs
|
|
Ethiopie
|
1955
|
31.2
|
10.4
|
5.4
|
47
|
|
1965
|
49.8
|
29.3
|
47.6
|
126.7
|
|
Kenya
|
1955
|
34.7
|
28
|
15.1
|
77.8
|
|
1960
|
72.2
|
38.1
|
33.9
|
144.2
|
|
Somalie
|
1955
|
5.1
|
0.6
|
2.1
|
7.8
|
|
1960
|
20.5
|
1.8
|
1.3
|
23.6
|
Source : Nations Unies, Etude sur la
situation économique de l'Afrique, New York, 1970, p. 17
Comme le met en évidence le tableau
précédent, les impôts indirects et directs constituent la
principale source de recettes ordinaires des pays de la sous région de
l'Afrique de l'Est. Par recettes ordinaires, il faut entendre recettes propres.
Si nous prenons la pays d'Ethiopie, en 1955, les recettes fiscales
étaient évaluées à 41.6 106 de $ contre
47 106 de $ de recettes propres, soit 88.5%.
2.2.2.2. Revenus non
fiscaux
Référence faire au tableau
précédent, nous apprenons que les Etats de la sous
région de l'Afrique de l'Est encaissent une portion de recettes non
fiscales qui n'est pas négligeable. Cette source de recettes s'ajoute
aux recettes fiscales pour former ensemble une partie intégrante du
budget national. Ces recettes non fiscales sont composées des revenus
commerciaux ainsi que des revenus administratifs. Si nous prenons l'exemple de
la Somalie, en 1960, les recettes non fiscales étaient
évaluées à 1.8 106 de $ contre 23.6
106 de $ de recettes propres, soit 7.63%.
2.2.2.3. Revenus
parafiscaux
Les Etats de la sous région de l'Afrique de l'Est
bénéficient des recettes parafiscales en augmentation du volume
de leurs revenus. L'exemple donné est celui du Kenya. Les compagnies
d'assurance et les agences de sécurité sociale sont tenues de
verser des shillings à la caisse de l'Etat chaque année39(*).
2.2.2.4. Autres sources de
financement
Les Etats de la sous région de l'Afrique de l'Est
comme d'ailleurs bien d'autres pays en voie de développement doivent se
tourner vers l'extérieur à la rechercher des fonds sous forme de
dons ou aides internationales, d'emprunts ou de subventions40(*).Ce sont des contributions
volontaires provenant des individus, des organismes non gouvernementaux tant
nationaux qu'étrangers, des organismes multinationaux ou des
Gouvernements étrangers pour des raisons spéciales.
Exemples : en cas de guerre, d'inondation, de sécheresse,...
Les grandes organisations économiques internationales,
dont les plus connues sont le
Fonds
monétaire international (F.M.I.) et la
Banque mondiale
(B.M.), proposent des financements aux
pays en
développement. Les prêts du F.M.I. visent à assurer la
stabilité du système monétaire international, alors que
ceux de la B.M. concernent plutôt des projets de développement, du
micro crédit
aux projets d'infrastructure.
Les prêts des institutions internationales, même
celles de développement, ne sont pas sans contrepartie. Les pays
emprunteurs sont mis au banc des circuits traditionnels de prêt en raison
de leurs problèmes de solvabilité, et sont donc presque
obligés de passer par ces organismes afin d'obtenir des fonds. Les taux
d'intérêt proposés par les institutions économiques
internationales sont en principe relativement bas, mais les prêts sont
conditionnels. Les gouvernements emprunteurs créent, conjointement avec
les organisations de prêt, des programmes de réformes
économiques et financières destinés à assurer la
solvabilité future du pays. En effet, les institutions de prêt
entendent récupérer les sommes engagées, ainsi que les
intérêts associés.
A titre d'exemple, un bon nombre de pays en voie de
développement ont bénéficié d'une aide du F.M.I.:
Albanie, Arménie, Cap-Vert, Estonie, Ghana, Mongolie, Pakistan,
Azerbaïdjan, Bolivie, Burkina Faso, Cameroun, Lettonie,
Guinée-Bissau, Argentine,
Sénégal,
Guinée-Bissau,
,
Côte
d'Ivoire,
Ghana41(*),...
2.2.3. Sources de
financement du Gouvernement Rwandais
L'Etat Rwandais, comme bien d'autres pays du monde
élabore son budget qu'il doit à tout prix chercher à
équilibrer. Son budget existe sous trois types : le budget
ordinaire (qui enregistre les ressources et dépenses courantes), le
budget de développement (qui enregistre les opérations
sensées d'augmenter le capital national) et le budget pour ordre (qui
enregistre les opérations pour les comptes des tiers et pour les comptes
spéciaux)42(*).
Pour cet effet, le Rwanda recourt aux fonds propres et aux fonds de
l'extérieur.
2.2.3.1. Revenus fiscaux
Le Gouvernement Rwandais bénéficie des recettes
fiscales. Le tableau n°5 en annexe nous donne plus d'informations sur les
types d'impôts en vigueur.
Tableau n° 6 : Extrait de l'opération
financière du Rwanda (1987-1992) en 106de FRW
|
Sources
|
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
|
Recettes fiscales
Recettes non fiscales
Dons
|
19.893
3.277
10246
|
19.733
3.127
10.668
|
20.889
3.553
5.291
|
18.768
2.815
5.071
|
21.702
3.212
13682
|
24.157
3.320
N .D.
|
|
Total
|
33.535
|
33.527
|
29.732
|
27.454
|
38.676
|
N.D.
|
Source : PNUD : Coopération
au développement : Rwanda, rapport 1991, juin 1993, p.35
Légende : N.D. : Non Disponible
De ce tableau, nous constatons qu'une moyenne de 20.197
106de FRW de recettes fiscales a été
perçue par an pour une période de cinq ans allant de 1987
à 1991.
2.2.3.2. Revenus non
fiscaux
De part ce tableau, nous constatons que le Gouvernement
Rwandais perçoit des recettes non fiscales pour ses opérations
financières. Elles sont composées des recettes commerciales et
administratives. Leur part est moins importante par rapport au total des
recettes : Exemple : 9.77% en 1987.
2.2.3.3. Revenus
parafiscaux
Au Rwanda, ce sont des prélèvements
effectués et alloués aux institutions
paraétatiques43(*).
Les fonds détenus par ces institutions avant d'être alloué
aux bénéficiaires peuvent être incorporés au budget
national. Nous avons des institutions tout paraétatiques et d'autres
qui sont privées. Nous nous sommes intéressés aux
premières.
La Caisse Sociale du Rwanda (C.S.R.) : C'est un
établissement public doté d'une autonomie financière et
qui est chargé de l'administration du régime de la
sécurité sociale. Il a été institué par la
loi du 11/5/1962. Sa gestion est l'affaire du Conseil d'Administration
composé par les représentants de l'Etat, des employés et
ceux des employeurs. La gestion quotidienne est assurée
par le Directeur Général nommé par le Premier Ministre.
Il est organisé en départements suivants :
département de l'administration des ressources humaines,
département des finances, département des pensions et
bénéfices, département de l'éducation et des
relations avec les contribuables, département de la planification, de
recherches et statistiques, département des investissements,
département de l'assurance et audit, ainsi que département de
l'ICT. Parmi les activités principales de la C.S.R., on peut citer
à titre d'exemple : la collection et la gestion des contributions
telles que déterminées par la loi ainsi que la procuration des
fonds aux bénéficiaires.
Quant au financement, la C.S.R. est totalement
financée par la contribution des employés et employeurs, les
intérêts de retard et ceux provenant des fonds investis44(*). L'âge officiel
d'entrée en retraire est fixé à 65 ans et à 55 ans
sur demande du bénéficiaire. Les contributions ne sont en aucun
cas une propriété de travailleurs, elles contribuent
plutôt un fonds de solidarité pour tout le monde enregistré
à cette solidarité.
Les mutuelles de Santé: Une mutuelle est une
société
de personnes à but non lucratif organisant la
solidarité
entre ses membres et dont les fonds proviennent des cotisations des membres.
Des schémas d'assurance maladie, basés sur la communauté
ont été instaurés au Rwanda en 1999 et couvrent en ce
moment 27% de la population. Le Rwanda en compte actuellement trois
institutions publiques : la R.A.MA., M.M.I. (créé le
10/07/2008 par la loi n°23/2005 du 12/12/2005 déterminant son
organisation et son fonctionnement45(*)) et le Fonds d'Assistance aux Rescapés du
Génocide (F.A.R.G.) : Il fut fondé par un
groupe qui consistait des rescapés du génocide, des Rwandais
basés au Royaume-Uni (qui avaient perdu leurs familles et leurs amis
pendant cet événement tragique) et des individus britanniques
concernés. Bien que le soutien pour les rescapés commence depuis
1995, le F.A.R.G. fut établi et reconnu
d'utilité publique en 1997. Il fournit du soutien à une gamme
répandue de services pour ses bénéficiaires.
Cette dernière organisation est financée par
des associations et des individus variés, et elle-même sert de
filière pour distribuer l'appui financier aux groupes, individus et
organisations charitables au Rwanda. Il vise à apporter de l'espoir, de
la sécurité et d'un bon niveau de vie aux rescapés dans
une manière efficace. En plus il fournit du soutien technique et
mène des activités de sensibilisation aux circonstances
auxquelles font face les rescapés.
2.2.3.4. Autres sources de
financement
A l'instar d'autres pays africains, pays pauvres aux
ressources propres limitées rendant ainsi le budget déficitaire,
des autres sources de financement sont requises. Le Gouvernement Rwandais fait
recours à l'aide extérieure fournie par des institutions
multilatérales principalement de l'O.N.U., de la C.E.E., de l'I.D.A.,
et des banques de développement régional ou par des O.N.Gs. Ce
sont des transferts sous formes de dons ou d'emprunts. Il fait aussi recours
aux investissements directs étrangers46(*).
Tableau n°7 : Partenaires du Gouvernement
Rwandais en 2003
|
FINANCEMENT
|
DOMAINES D'INTERVENTION
|
TOTAL
|
|
FOURNITURES
|
SERVICES
|
TRAVEAUX
|
|
1. BANQUE MONDIALE
|
1 244 687 803
|
289 789 772
|
1 647 538 735
|
3 182 016 310
|
|
2. BAD
|
1 107 283 818
|
595 828 397
|
3 148 491 454
|
4 851 603 669
|
|
3. BDEA
|
520 970 338
|
-
|
5 179 386
|
526 149 724
|
|
4. COOPERATION BELGE
|
162 915 175
|
8 162 616
|
54 333 650
|
225 411 441
|
|
5. DFID
|
388 038 698
|
960 156 426
|
-
|
1 348 195 124
|
|
6. FIDA
|
169 972 000
|
2 743 000
|
-
|
172 715 000
|
|
7. FIODA/OPEC
|
-
|
-
|
1 074 092 124
|
1 074 092 124
|
|
8. FED
|
5 474 210 190
|
1 451 856 403
|
10 053 304 687
|
16 979 371 280
|
|
9. KFW/Allemagne
|
548 123 448
|
2 520 000
|
2 927 792 932
|
3 478 436 380
|
|
10. .PNUD
|
13 580 012
|
50 284 860
|
-
|
63 864 872
|
|
11. UNION EUROPEENNE
|
416 496 298
|
1 226 564 156
|
30 855 971 037
|
32 499 031 491
|
|
12. ACDI
|
-
|
-
|
186 578 769
|
186 578 769
|
|
13. AMF
|
-
|
-
|
37 525 000
|
37 525 000
|
|
14. COOPERATION LUXEMBOUROISE
|
-
|
-
|
136 684 780
|
136 684 780
|
|
15. USAID/IRC
|
-
|
-
|
13 294 269
|
13 294 269
|
|
TOTAL
|
10 046 277 780
|
4 587 905 630
|
50 140 786 823
|
64 774 970 233
|
Source : République Rwandaise,
N.T.B. rapport annuel 2003, p.5
Graphique n°3 : Fonds des
bailleurs/Intervenants en 2003
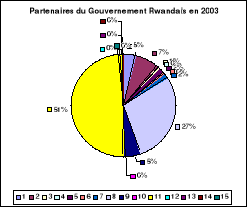
Source : Tableau n°5 :
Partenaires du Gouvernement Rwandais en 2003
C'est ainsi que par la loi n° 20/2002 du 21/05/2002, le
Gouvernement Rwandais a mis en place le Fonds Commun de Développement
(C.D.F.) ayant pour mission primordiale de financer les projets de
développement des districts, des villes et de la ville de Kigali et
d'assurer le suivi de l'utilisation des fonds avancés. A part cela, le
C.D.F. sert d'intermédiaire entre districts, villes et ville de Kigali,
d'une part, et les bailleurs de fonds d'autre part, qui financent
particulièrement les projets de développement dans ces
entités. Ces entités peuvent avoir des relations directes avec
les bailleurs de fonds47(*).
2.2.4. Sources de
financement du district de Gicumbi
Le district de Gicumbi, en tant qu'entité
administrative dotée d'une personnalité juridique et de
l'autonomie financière, doit son financement non seulement des recettes
propres mais encore des fonds des bailleurs et intervenants48(*). Il bénéficie
d'un concours d'un bon nombre de partenaires49(*).
CONCLUSION PARTIELLE
Au terme de ce
deuxième chapitre qui avait pour objet de définir les concepts de
base et de produire la revue de la littérature, nous affirmons que
l'objectif a été atteint et que donc nos lecteurs ont
été situés et que nous sommes désormais sûr
qu'il n'y a pas eu d'obscurantisme, ni de confusion quant à la lecture
et la compréhension de ce chapitre.
En premier lieu, nous avons
donné la définition des termes clés suivants :
poids, recettes et revenus, public, fisc, recettes et revenus publics, recettes
non fiscales (taxes), recettes parafiscales et recettes fiscales
(impôts).
En deuxième lieu, la partie de la revue de la
littérature a été entamée : c'est ainsi que
nous avons présenté :
Ø les sources de financement des Gouvernements riches
au monde à savoir les revenus fiscaux, les revenus non fiscaux, les
revenus parafiscaux et la subvention ou l'emprunt en cas du déficit
budgétaire. Un exemple donné est celui de la France et des
Etats-Unis d'Amérique.
Ø les sources de financement des Gouvernements pauvres
de la sous région de l'Afrique de l'Est. Ils suivent le modèle
des pays riches et leurs budgets sont toujours déficitaires. Ils
sont toujours demandeurs d'aides, de subventions et d'emprunts.
Ø les sources de financement du Gouvernement
Rwandais. Son économie est marquée en quelque sorte de
l'identité des pays du Tiers Monde. Elle est toujours
dépendante : elle se finance en petite partie par des revenus
propres et le déficit est financé par l'extérieur.
Ø les sources de financement du district de Gicumbi.
Son financement est tourné vers l'extérieur. Une liste de ses
partenaires a été libérée.
CHAPITRE 3. METHODOLOGIE
La méthodologie est une théorie au sens large.
C'est-à-dire un ensemble de propositions ou de règles portant
sur la façon de traiter une réalité sociale, sur la
manière dont le chercheur doit procéder pour construire une
théorie visant à expliquer tel ou tel aspect de la
société. Elle est aussi définie comme étant une
approche méthodologique qui se réfère à l'ensemble
des méthodes et des techniques d'un domaine particulier50(*).
3. 1. TECHNIQUES
« Les techniques sont des instruments dont se
servent les méthodes pour atteindre un but précis, pour trouver
une réponse à un comment, un moyen d'atteindre une fin
préméditée, mais qui se situent au niveau des
étapes pratiques »51(*). La technique est aussi définie comme
« l'ensemble des moyens et des procédés qui permettent
au chercheur de rassembler les données et les
informations. »52(*). Dans le cadre de notre étude nous avons fait
recours aux techniques suivantes :
3.1.1. Technique
documentaire
« La technique documentaire est la fouille
systématique de tout ce qui est écrit et ayant une liaison ave
le domaine de recherche »53(*). Ainsi nous avons consulté des ouvrages, des
articles et archives publics, des lois et décrets lois, des sites
Internet, des mémoires et d'autres publications à rapport avec
notre sujet d'étude.
3.1.2. Technique d'entretien
(entrevue, interview)
Le terme « entrevue »
semble représenter en français la traduction littérale de
l'anglo-saxon « interview », mais dans la langue
française, il a un sens différent. Il comporte donc une nuance
utilitaire, un élément d'arrangement en tout cas d'exception dont
rend compte l'expression « ménager une entrevue ».
Dans ce contexte, l'entretien correspond mieux à la notion anglaise
d'interview qui, dans le langage courant, revêt un aspect journalistique
souvent spectaculaire, au moment où l'entretien concerne un aspect plus
sérieux et confidentiel. A toutes fins utiles bien sûr,
l'élément commun ressort de cette nuance : « le
tête- à- tête et le rapport oral entre deux personnes dont
l'une transmet les informations à l'autre »54(*) . L'interview est quant
à elle défini comme « l'entretien avec une personne
pour l'interroger sur ses actes, ses idées, ses projets, afin d'en
publier ou d'en diffuser le contenu, soit de l'utiliser à des fins
d'analyse (enquête d'opinion)55(*) ».
L'entretien nous a été utile dans la mesure
où elle nous a permis de tirer un échantillon
représentatif de la population à laquelle nous avons soumis le
questionnaire. Nous nous sommes servi aussi dans notre cas, de l'entretien
semi directif qui consiste à annoncer le thème de l'entretien.
Quant l'interview, elle nous a surtout servi à recueillir les
informations auprès des différents cadres du district de Gicumbi
ayant à faire avec les finances. C'est ainsi que, munis d'un guide
d'interview, nous avons abordé le Secrétaire Exécutif du
district, le vice maire chargé des affaires économiques et le
Directeur Administratif et Financier.
3.1.3. Technique
d'échantillonnage
« Echantillonner, c'est choisir un nombre
limité d'individus, d'objets ou d'événements dont
l'observation permet de tirer des conclusions ou des inférences
applicables à la population entière à l'intérieure
de laquelle le choix est fait »56(*). Il est aussi défini comme « un
ensemble d'individus choisis comme représentatifs d'une
population ». Ce terme désigne aussi « une petite
quantité d'un produit qui permet d'en apprécier ou d'en faire
connaître les qualités ». C'est aussi « une
fraction représentative d'une population ou d'un univers
statistique »57(*).
On peut dire encore que l'échantillon est la partie de
l'univers à laquelle on limitera l'observation.
Généralement, on parle d'échantillon
représentatif : c'est une partie de l'univers ayant la même
composition que l'univers, c'est à dire présentant dans les
mêmes proportions les différentes caractéristiques de
l'univers.
Pour arriver aux résultats escomptés, et compte
tenu des moyens dont nous disposions et du type d'informations dont nous
avions besoin, il a fallu identifier des sujets en fonction de la
probabilité qu'ils offraient pour fournir l'information
recherchée.
Il s'agit de 264 employés du district,
c'est-à-dire 21 Secrétaires Exécutifs et 21
Secrétaires Comptables de 21 secteurs ainsi que 109 Secrétaires
Exécutifs et 109 chargés du développement
socio-économique de 109 cellules qui composent le district de Gicumbi.
A ceux - là s'ajoutent quatre techniciens du district.
Il s'agit ensuite de la population totale du district qui
s'élève à 362 331 personnes. Cette population a
été choisie car c'est elle qui est supposée
bénéficiaire de tous les services taxables qu'offre le district
de Gicumbi. Les percepteurs sont inclus dans cette catégorie.
Pour déterminer la taille de l'échantillon, nous
nous sommes servi de la règle générale qui stipule que
l'échantillon valable est celui compris entre 10 et 15% de la population
cible58(*). Et vu qu'aucun
échantillon ne devrait compter moins de 30 individus et compte tenu de
l'insuffisance de temps et de moyens tant financiers que matériels, nous
avons opté pour l'échantillonnage au jugé ou
raisonné.
Calcul de l'échantillon : 264 fonctionnaires x 13%
= 34.32 soit 34 personnes à qui nous avons ajouté 4 techniciens
pour faire un total de 38 personnes. Pour le calcul de l'échantillon
dans la population de 362 331 habitants du district, la formule de
BOUCHARD Alain est intervenu: nc = (N*n) : (N+n) = (362331*96) :
(362331 + 96) = 96.95 personnes soit 96 personnes ; où N est la
taille du nombre univers statistique, n est la taille de l'échantillon
pour l'univers statistique infini : 96 et nc est la taille de
l'échantillon corrigé (pour l'univers statistique fini) 59(*) . En somme, la population
à enquêter était 38 + 96 = 134 personnes qui ont
été réparties en trois secteurs : Secteur Byumba,
urbain et par conséquent sensé d'avoir beaucoup
d'activités assujetties aux taxes et les Secteurs de Miyove et Rubaya
en campagne ayant moins d'activités taxables.
3.1.4. Technique de
questionnaire
« Le questionnaire est un instrument de mise en
forme de l'information fondée sur l'observation des réponses
à un ensemble de questions posées à un échantillon
d'une population »60(*). C'est aussi « un moyen de communication
entre l'enquêteur et l'enquêté et elle comporte une
série de questions concernant les problèmes sur lesquels on
attend une information de l'enquête »61(*).
Le questionnaire est d'une grande importance : il a
pour fonction principale de donner à l'enquête une extension plus
grande et de vérifier statistiquement jusqu'à quel point les
informations et hypothèses préalablement constituées sont
généralisables. A la différence de l'entretien semi
directif, il pose à tous les mêmes questions formulées
exactement dans les mêmes termes et présentées dans le
même ordre62(*).
On distingue le questionnaire auto administré et le
questionnaire - interview. Le premier consiste à distribuer des
questionnaires, c'est-à-dire à donner à chaque informateur
un formulaire de questions à remplir. Le deuxième consiste
à poser verbalement les questions et à noter les
réponses63(*).
Cette technique nous a permis de formuler deux types de questionnaires
dont certaines questions étaient fermées et d'autres
ouvertes :
:
Ø Un questionnaire destiné non seulement aux
techniciens du district en matière des impôts : le Comptable, le
Gestionnaire de Crédit, le Vérificateur, et le Receveur
d'impôts, mais encore aux fonctionnaires des secteurs et cellules du
district de Gicumbi ayant à faire avec les finances et ceci en vue de
recueillir des informations nécessaires à la rédaction de
notre travail de recherche. Les informations attendues se rapportaient sur la
réalité du terrain quant à la perception des recettes
non fiscales.
Ø Le second questionnaire a été
conçu pour les contribuables que sont la population du district de
Gicumbi en général. Ces contribuables nous ont livré
leurs impressions sur ce qu'ils payent comme impôts ou taxes.
La manière dont le questionnaire a été
administré et récupéré : pour les
fonctionnaires, nous sommes passés aux bureaux et leur distribuer les
questionnaires ; pour la population, nous sommes passés aux
centres de négoce, aux marchés, aux boutiques et magasins, et les
questionnaires ont été distribués seulement aux personnes
sachant lire et écrire. Une semaine après, nous avons
été retrouver les mêmes personnes pour
récupération des questionnaires. Pour les hauts cadres, nous les
avons joints à leurs bureaux.
3.2. METHODES
La méthode est définie comme «une
procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre
des stades de la recherche »64(*). Elle est aussi définie comme étant
les moyens systématiques pour parvenir aux aspects de la
vérité des conceptions intellectuelles coordonnant un ensemble
d'opérations destinées à obtenir, comprendre et analyser
les vérités découvertes »65(*).Pour l'analyse de nos
données, nous avons utilisé les méthodes
suivantes :
3.2.1. Méthode
analytique
Après avoir eu des résultats chiffré,
bien quantifiés, c'était le tour de les analyser et de les
interpréter, d'où l'intervention de la méthode analytique
qui normalement « consiste à décomposer une oeuvre, un
texte, en ses éléments essentiels, enfin d'en saisir les rapports
et de donner un schéma de l'ensemble »66(*). Pour notre cas, les rapports
annuels financiers ont été décomposés afin d'en
dégager les différents constituants. Nous avons fait attention
à chaque élément et cette méthode a permis
d'étudier chaque élément dans l'ensemble.
3.2.2. Méthode
comparative
Comparer, c'est confronter deux ou plusieurs choses pour
déceler les ressemblances et les différences qui existent entre
elles. Toute comparaison suppose qu'il existe entre les choses à
comparer à la fois des ressemblances et des dissemblances67(*). Elle nous a aidés
à ressortir le poids ou la force entre les figures comparées.
Nous avons comparé les recettes non fiscales aux recettes
fiscales ; les recettes non fiscales aux fonds provenant des bailleurs et
autres intervenants ; les recettes non fiscales aux revenus propres du
district et enfin les recettes non fiscales au total des revenus publiques.
3.2.3. Méthode
statistique ou quantitative
C'est une méthode qui a pour objet de recueillir les
données mesurables. Cette méthode nous a permis de quantifier et
chiffrer des résultats de la recherche afin de les présenter sous
forme de graphiques et de tableaux pour faciliter la lecture et la
compréhension des résultats. Nous avons jugé bon
d'utiliser la méthode statistique descriptive parce qu'elle
précise des résultats au moyens des effectifs ou des
fréquences des répondants ce qui renforce le caractère
scientifique d'un travail68(*).
CONCLUSION PARTIELLE
Ce chapitre avait pour objectif d'indiquer la
méthodologie dont nous nous sommes servi lors de la réalisation
de ce travail de recherche. Un bon nombre de techniques est intervenu pour
la collecte des données. Nous avons utilisé la technique
documentaire, d'entretien et d'interview, d'échantillonnage et de
questionnaire. Pour l'analyse des données, nous avons fait recours aux
méthodes analytiques, comparatives et statistiques quantitatives.
CHAPITRE 4. PRESENTATION, ANALYSE DES DONNEES ET
INTERPRETATION
4.1. PRESENTATION DU
DISTRICT DE GICUMBI
4.1.1. Situation
géographique.
Le district de Gicumbi est l'un des cinq districts de la
Province du Nord. Il est situé à l'Est de cette province et
comprend les grandes parties des anciens districts de Rwamiko, Rebero, Rushaki,
Bungwe, Kisaro et la Ville de Byumba. Sa superficie est 829 km2. Il
comprend 21 secteurs, 109 cellules et 630 villages (voir le tableau n°8
en annexe).
Le district de Gicumbi comprend les limites suivantes:
Ø Au nord: de l'Ouest à l'Est, le district de
Gicumbi est respectivement délimité par le district de Burera, la
frontière rwando-ugandaise et le district de Nyagatare.
Ø A l'Est: du Nord au Sud, le district de Gicumbi est
limité par les districts de Nyagatare, Gatsibo et Rwamagana.
Ø Au Sud : de l'Est à l'Ouest, le district de
Gicumbi fait la frontière avec les districts de Rwamagana et Gasabo.
Ø A l'Ouest: du Sud au Nord, le district touche sur les
districts de Gasabo, Rulindo et Burera.
Le relief du district de Gicumbi est très
accidenté, avec des pentes raides où l'altitude culmine à
2 500 mètres. Les vallées sont profondes et étroites. A
l'Est, on trouve plutôt des plaines dont l'altitude varie entre 1 500 et
1 800 mètres. Le climat du district de Gicumbi alterne entre les saisons
sèches et pluvieuses avec les vents alizés venant des tropiques
et les moussons venant de l'Océan Indien et du lac Victoria. La zone de
l'Est du district jouit d'un climat tempère de type équatorial
avec une température moyenne annuelle de 20°C.
4.1.2. Situation démographique
La population totale du district de Gicumbi
s'élevé à 362 331 habitants dont 172 144, soit 47% sont
des hommes et 190 187 soit 53% sont des femmes. La densité moyenne
est de 437 habitants au kilomètre carré69(*) (voir le tableau
n°9 en annexe).
4.1.3. Historique du district
GICUMBI
Le district de Gicumbi est un nouveau district
créé par la loi n° 29/2005 du 25 décembre 2005. Ses
fonctions sont régies par la loi n° 08/2006 du 24 février
2006 portant organisation et fonctionnement des districts, le décret
ministériel n° 002/07.01 du 23/06/2006 régissant les
responsabilités du Conseil du district et le Comité du district
ainsi que le décret ministériel n° 004/07.01 du 23/06/2006
établissant les fonctions du Conseil du district et de la Ville de
Kigali. Le mot « District » a
remplacé le mot « Commune » conformément
à la loi n° 47/2000 du 19/12/2000 modifiant et complétant la
loi du 15 Avril 1963, portant organisation administrative du territoire de la
République du Rwanda tel que modifié et complété
jusqu'à ce jour. Il a été énoncé comme
suit : La dénomination « Commune » change
en « District »70(*).
4.1.4. Cadre légal du
budget du district
Toutes les recettes du district
sont prévues chaque année dans le budget du district. Ce budget
est constitué par le budget ordinaire et le budget de
développement71(*).
Le budget ordinaire provient :
Ø des recettes commerciales : les recettes issues
des entreprises du district, des établissements publics, des produits
de vente des biens du district et des intérêts des capitaux
placés, des dividendes provenant des actions du district dans les
entreprises commerciales,...
Ø des recettes administratives : des
entités administratives autonomes,
Le budget de développement provient surtout des fonds
des bailleurs et intervenants.
4.1.5. Revenus publics dans le district de Gicumbi
Le district de Gicumbi a eu un privilège d'avoir une
autonomie financière. C'est ainsi que le conseil du district institue
les taxes sur les services rendus à la population (taxes
rémunératoires). Ces taxes ne peuvent pas excéder le
coût réel ou estimatif des services rendus. Cette
indépendance économique lui a été
conférée par la loi72(*).
Les revenus du district de Gicumbi proviennent des recettes
fiscales et des recettes non fiscales. Ces dernières sont perçues
des attestations délivrées par les autorités, des
recettes provenant de biens meubles et immeubles publics, des revenus provenant
des intérêts des investissements effectués par ce
district, des revenus provenant des activités génératrices
des revenus, des frais d'amendes, de justice, des dons et même des
legs.
A part ces revenus propres, le district de Gicumbi
contracte des emprunts tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays. Il bénéficie aussi des subventions
éventuelles de l'Etat et cela en nature ou en espèce en vue de la
promotion du développement. L'Etat peut aussi se porter garant et
solliciter en étranger des aides pour ce district73(*). Le tout est alors
porté à son budget annuel.
4.1.5.1. Recettes
propres: 2006 - 2008
4.1.5.1.1.
Présentation des recettes fiscales
Pour le fonctionnement du district de Gicumbi, une
série de mesures a été mise en place par le
Gouvernement : les impôts qui relevaient du pouvoir communal sont
maintenant de son pouvoir, les impôts qui relevaient du pouvoir de
l'Administration Centrale lui sont cédés
(L'impôt personnel, le droit de patente et l'impôt
sur le revenu locatif)74(*). Cependant les indigents en sont
exemptés75(*).
Tableau n°10 : Produits imposés et
recettes fiscales 2006 - 2008 en FRW
|
Type d'impôt
|
2006
|
2007
|
2008
|
Total
|
|
Patente
|
23 033 835
|
30 715 998
|
32 241 787
|
85 991 620
|
|
Impôt location
|
5 688 554
|
3 283 740
|
1 342 756
|
10 315 050
|
|
Panneaux publicitaires
|
1 193 508
|
207 960
|
-
|
1 401 468
|
|
Location parcelle
|
6 291 236
|
4 808 745
|
10 640 166
|
21 740 147
|
|
Location maisons du district
|
-
|
698 900
|
1 393 720
|
2 092 620
|
|
Terrains
|
-
|
-
|
3 087 130
|
3 087 130
|
|
Total
|
36 207 133
|
39 715 343
|
48 705 559
|
124 628 035
|
Source : District de Gicumbi, Bureau du
Receveur, rapport 2006 - 2008.
Graphique n°4 : Comparaison des recettes
fiscales
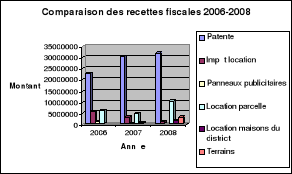
Source : Tableau n°10 : Produits
imposés et recettes fiscales 2006 - 2008 en FRW
4.1.5.1.2.
Présentation des recettes non fiscales
Les recettes non fiscales du district de Gicumbi sont
perçues en échange des services qu'il offre à ses
clients. Le Conseil du district a le droit d'instituer les taxes sur ces
services mais elles ne peuvent pas excéder leurs coûts
réels ou estimatifs76(*). Les recettes non fiscales provenant des recettes du
marché, des frais d'amendes et des taxes mensuelles occupent les trois
premières positions. (Voir le tableau n°11 et son graphique
n°5 en annexe)
4.1.5.2. Présentation
des fonds des bailleurs /intervenants : 2006 - 2008
Le district de Gicumbi profite énormément de
cette section. Il s'agit des emprunts contractés tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, des dons, des legs
et des subventions. Chaque fois, le conseil du district doit décider sur
chaque élément77(*). Les transferts cibrés, ceux du Gouvernent
Central, les fonds provenant du CDF FENU et CDF occupent les quatre
premières positions. (Voir le tableau n°12 et son graphique
n°6 en annexe)
4.1.5.3.
Récapitulation des revenus du district de Gicumbi : 2006 -
2008.
La grande partie des revenus de trois exercices
budgétaires du district de Gicumbi est composée de fonds des
bailleurs/Intervenants à raisons de 92.0%. Les recettes
propres y contribuent à 8 % : la part des
recettes fiscales se chiffre à 1.14 % alors que les
recettes non fiscales se lèvent à 6.86 %.
Tableau n° 13 : Revenus du district de
Gicumbi : 2006 - 2008 en FRW
|
Types de recettes
|
2006
|
2007
|
2008
|
Total
|
|
Recettes fiscales
|
36 207 133
|
39 715 343
|
48 705 559
|
124 628 035
|
|
Recettes non fiscales
|
132 230 627
|
247 538 825
|
366 847 688
|
746 617 140
|
|
Bailleurs/intervenants
|
6 825 329 918
|
1 456 209 744
|
1 743 817 308
|
10 025 356 970
|
|
Total
|
6 993 767 678
|
1 743 463 912
|
2 159 370 555
|
10 896 602 145
|
Source : Notre analyse, Avril 2010
Graphique n°7 : Comparaison des revenus du
district de Gicumbi : 2006-2008
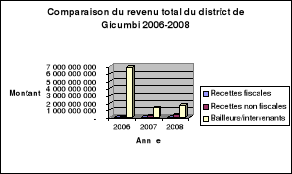
Source : Tableau n° 13 :
Revenus du district de Gicumbi : 2006 - 2008 en FRW
4.2. ANALYSE DES
DONNEES
De manière globale, nous pouvons dire qu'il y a deux
grands types d'analyse des données : l'analyse qualitative ainsi
que l'analyse quantitative, chacune impliquant des techniques et des exigences
particulières.
4.2.1. Analyse qualitative
Ce peut être une simple description, un simple
dénombrement avec quelques ratios plus ou moins
élémentaires, soit une analyse en profondeur d'ordre
psychologique, sociologique avec interprétation des résultats et
extrapolations. Nous avons aussi cherché à mettre en
évidence des faits nouveaux, inattendus, qu'à dégager des
tendances globales ou des indices généraux qui indiqueraient des
distinctions au sein de la population soumise à la recherche. En aucun
cas, l'analyse qualitative ne peut se faire sur base de simples croyances, ou
encore de simple bon sens78(*).
Analyse quantitative
Il existe globalement deux types d'analyse quantitative. On
les distingue par leur degré de sophistication et on les désigne
par les qualificatifs « primaire» et
« secondaire». Cet type d'analyse est intervenu pour
l'analyse les données des questionnaires.
4.2.2.1. Analyse
primaire
Il s'agit d'effectuer, assez globalement, la confirmation ou
l'infirmation des hypothèses, de vérifier la façon globale
et directe dont se comportent les variables retenues comme explicatives (par
hypothèse) des variations de la variable dépendante. Nous avons
analysé ici les relations directes, établies par simple
sommation et regroupements entre les facteurs, les variables
indépendantes et les variables dépendantes.
4.2.2.2. Analyse secondaire
Ici, nous avons fait appel à un outillage statistique
plus sophistiqué appartenant aux domaines de la statistique
mathématique et de l'interférence. Nous avons effectué
des calculs de second degré sur les chiffres bruts obtenus par simples
regroupements et par recoupements directs. Dans ce sens, nous avons pu
établir des traitements plus abstraits et plus fins tels que les
corrélations, les régressions, l'analyse factorielle, l'analyse
de variances.
Tous ces traitements relèvent de techniques de la
statistique mathématique et sont, pour la plupart, dès que les
données atteignent un seuil acceptable en nombre d'observations (50
sujets et 20 questions, par exemple), pratiquement irréalisables
manuellement. Ils nécessitent soit un calculateur électronique
pour les analyses relativement modestes, soit un travail sur ordinateur avec
l'aide des innombrables programmes de tests et d'analyses statistiques
disponibles79(*). Notre
analyse s'est limitée aux rapports financiers du district de Gicumbi de
2006 à 2008 tels qu'établit par le bureau du receveur.
4.3. INTERPRETATION DES RESULTATS DE
RECHERCHE
Interpréter des résultats, c'est faire parler
des données et des coefficients tirés de leurs traitements. C'est
mettre du sens dans les chiffres, donner des significations concrètes,
opérationnelles (et rattachées au terrain particulier de la
recherche) à tous les indices et ratios élaborés par le
calcul statistique. Cette interprétation devait apporter l'essentiel de
ce que nous aurions mis en évidence de façon spécifique.
Mais encore une fois, cela ne se faisait pas à partir de simples
préjugés ou de croyances plus ou moins entachées de bon
sens. L'interprétation devait s'inscrire dans au moins trois niveaux
qui nous serviraient de cadres de référence et d'appui
théorique80(*).
Enfin, le contexte même de l'enquête et les
spécificités de l'univers observé devait constituer la
base primordiale de la mise de sens dans les relations entre les faits
analysés. Autrement, l'interprétation aurait une allure abstraite
et désincarnée ; chaque explication- interprétation
devait montrer comment elle s'appuyait sur le terrain et comment elle en
puisait concrètement son sens.81(*) L'objectif de cette partie consistait à
approfondir le sens des résultats de l'enquête en les confrontant
surtout à la théorie. Aussi, c'était dans cette partie
que nous devrions donner des réponses aux questions de recherche.
4.3.1. Champs
d'action
Notre enquête s'est limitée aux hauts
techniciens du district et aux fonctionnaires des instances de base par le
fait que ce sont eux offreurs et en même temps percepteurs des
services et actes taxables. Elle s'est limitée aussi à la
population du district de Gicumbi par ce que c'est bien elle clients,
clientes et en même temps contribuables.
4.3.2. Contenu du
questionnaire
Le questionnaire adressé aux techniciens et aux
fonctionnaires des instances de base contenait huit questions : six
questions fermées et deux questions ouvertes. Pour ce qui est du
questionnaire distribué à la population, il était
constitué de huit questions dont six fermées et deux
ouvertes.
Le premier questionnaire distribué
aux techniciens du district et aux fonctionnaires des instances de base avait
des questions se rapportant sur :
Ø La perception probable des recettes non
fiscales ;
Ø Les types des recettes non fiscales ;
Ø La conscience de la population sur le payement des
recettes non fiscales ;
Ø La modalité d'encaissement de ces recettes par
l'officier du district ;
Ø L'existence du contrôle des recettes non
fiscales ;
Ø L'existence de la sensibilisation de la population
sur les recettes non fiscales ;
Ø L'appréciation de l'assiette des recettes non
fiscales ;
Ø Les souhaits à soumettre aux officiers du
district.
Pour la population, nous avons élaboré un
deuxième questionnaire qui contenait huit questions. Les questions
portaient sur :
Ø Le payement probable des recettes non fiscales ou
autres frais administratifs ;
Ø L'acte ou services taxables ;
Ø L'utilité des recettes non fiscales ;
Ø L'éducation sur les recettes non
fiscales ;
Ø L'appréciation sur l'assiette des recettes
non fiscales ;
Ø Les souhaits à soumettre aux officiers du
district.
4.3.3.
Présentation des résultats d'enquête
Cette partie avait pour but de présenter les
résultats de recherche pour analyse et interprétation. Pour les
rapports financiers, nous avons utilisé les techniques de tableaux et
de graphiques (histogramme et secteurs) alors que pour l'analyse des
données recueillies sur terrain, nous avons utilisé non
seulement la technique de tableau mains encore celle des effectifs.
L'interprétation s'est basée sur le calcul des pourcentages.
4.3.3.1. Enquête
effectuée auprès des techniciens du district et des
fonctionnaires des instances de base.
4. 3.3.1.1.
Perception probable des recettes non fiscales
Question 1 : Est-ce qu'il vous arrive de
percevoir des recettes non fiscales ?
Tableau n°14 : Répartition des
enquêtés selon la perception des recettes non
fiscales
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
%
|
|
Oui
|
35
|
92.86
|
|
Non
|
3
|
7.14
|
|
TOTAL
|
38
|
100
|
Source : Notre enquête sur
terrain, Avril 2010.
A partir de ce tableau, nous voyons que 92.86% des
enquêtés perçoivent des recettes non fiscales. Cela se
comprend du fait que le receveur au niveau du district, le secrétaire
comptable au niveau des secteurs et l'agent chargé du
développement socio économique au niveau des cellules ont dans
leurs attributions la perception des impôts.
4.3.3.1.2. Sources de
recettes non fiscales
Question 2 : Quels types de recettes
non fiscales percevez- vous ?
Tableau n °15 : Liste des recettes non
fiscales perçues par les enquêtés
|
Les frais de marchés, les taxes sur vélos, les
frais d'abattage, les frais d'amande, les frais sur les attestations, les
frais sur les mines et carrières, les frais sur les attestations, les
frais de tribunaux, les frais sur les ventes aux enchères, les frais sur
achat de DAO, frais de location des marins, les taxes sur les panneaux
publicitaires,...
|
Source : Notre enquête sur
terrain, Avril 2010.
Un bon nombre de types de recettes non fiscales a
été perçu pendant toute la période de cette
étude. Etant donné que les cellules, les secteurs et bien
sûr le district sont des entités qui offrent des services
taxables, rien n'est étonnant de constater l'existence des
différentes sources de recettes pour le compte du district.
4.3.3.1.3. Conscience de
la population sur le payement des recettes non fiscales
Question 3 : La population sait pourquoi
paye-t- elle des recettes non fiscales ?
Tableau n°16 : Conscience de la population
sur le payement des recettes non fiscales
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
%
|
|
Consciente
|
20
|
53.57
|
|
Non consciente
|
18
|
46.43
|
|
TOTAL
|
38
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
De part ce tableau, 53.57% des enquêtés affirment
que les recettes non fiscales sont payées de façon
consciencieuse. Cependant, Ces recettes non fiscales constituent un fardeau
et un appauvrissement de la part de la population raison pour laquelle 46.43 %
s'acquittent de cette action par force. Ce phénomène s'explique
par la nature des impôts et taxes : « payement obligatoire
et définitif ».
4.3.3.1.4. Modalité
d'encaissement de ces recettes par l'officier du district
Question 4 : Les recettes non fiscales
perçues et collectées, comment est-ce qu'elles parviennent
à la caisse du district ?
Tableau n°17 : Encaissement des recettes non
fiscales par le district
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
0%
|
|
Remis au compte bancaire
|
29
|
75
|
|
Remis au receveur
|
5
|
14.28
|
|
Autres moyens
|
3
|
7.14
|
|
Neutres
|
1
|
3.58
|
|
Total
|
38
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
Une grande partie (75%) des recettes non fiscales est
perçue, collectée et directement versée aux comptes
indiqués et les bordereaux de versement sont présentés au
receveur pour enregistrement. Une petite partie (14.28%) de ces recettes est
remise directement au receveur du district. Dans ce cas elle sont
accompagnées des souches de carnets de reçus. 7.14% des recettes
non fiscales perçue au niveau des cellules est remise aux
secrétaires comptables des secteurs. 3.58% de ces recettes ne laissent
pas voir leurs sorts selon les enquêtés.
4.3.3.1.5. Existence du
contrôle des recettes non fiscales
Question 5 : Y'a-t-il un
contrôle ?
Tableau n°18 : Existence probable du
contrôle des recettes non fiscales
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
0%
|
|
Oui
|
37
|
96.43
|
|
Non
|
-
|
-
|
|
Nulles
|
1
|
3.57
|
|
Total
|
38
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
Le contrôle des recettes non fiscales existent à
96.43%. Cela s'explique par l'existence des techniciens en matière
comptable. Ici, soulignons la présence d'un receveur mais aussi celle
d'un auditeur interne. Il y'a aussi des contrôles externes par l'auditeur
général que nous pouvons mentionner.
4.3.3.1.6. Existence de la
sensibilisation de la population sur les recettes non fiscales
Question 6 : Est-ce qu'il vous arrive de
sensibiliser la population sur les recettes non fiscales ?
Tableau n°19 : Sensibilisation de la
population aux recettes non fiscales
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
0%
|
|
Oui
|
30
|
78.57
|
|
Non
|
7
|
17.86
|
|
Neutre
|
1
|
3.57
|
|
Total
|
38
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
78.57% des enquêtés évoquent le bien
fondé de l'éducation sur les recettes non fiscales lors des
réunions avec la population. 17.86% ne disent rien. Ils nous ont
laissés savoir qu'il n'y a pas un mécanisme mis à place
pour cet effet.
4.3.3.1.7.
Appréciation de l'assiette des recettes non fiscales
Question7 : Comment jugez-vous
l'importance des recettes non fiscales au point de vue de leurs
assiettes ?
Tableau n° 20 : Tendance de l'assiette des
recettes non fiscales
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
0%
|
|
La restreindre
|
4
|
14.28
|
|
La laisser comme telle
|
31
|
82.14
|
|
L'élargir
|
3
|
3.58
|
|
Total
|
38
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
Comme le montre le tableau, 82.14% les enquêtés
ne voudraient pas voir l'assiette des recettes non fiscales changées.
Ils trouvent que c'est déjà assez.
4.3.3.1.8. Souhaits
à soumettre aux officiers du district.
Question : Quels souhaits à
formuler à l'endroit des autorités du district de
Gicumbi ?
Tableau n°21 : Suppositions sur les
impôts à soumettre aux dirigeants du district
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
0%
|
|
Création des activités
génératrices
de revenus dans la population
|
34
|
89.28
|
|
Neutres
|
4
|
10.72
|
|
Total
|
38
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
89.28% des enquêtés prônent la
création des activités génératrices des revenus et
la création de l'emploi en général. Le motif avancé
est que si la population est économiquement forte, elles payeront
librement et facilement les services octroyés par l'administration. Par
ailleurs, 10.72% des enquêtés n'ont rien répondu à
la question.
4.3.3.2.
Enquête effectuée auprès de la population
4.3.3.2.1. Payement
probable des recettes non fiscales ou autres frais administratifs
Question 1 : Aurais-tu
déjà payé des recettes non fiscales ou autres frais
administratifs dans le district de Gicumbi ?
Tableau n°22 : Payement probable des
recettes non fiscales ou autres frais administratifs
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
%
|
|
Oui
|
80
|
83.33
|
|
Non
|
11
|
11.47
|
|
Neutre
|
5
|
5.20
|
|
TOTAL
|
96
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
Comme le montre le tableau précédent, beaucoup
de gens ont demandé et réçu au moins un service taxable
(83.33%). Celui qui n'a pas été pour un service utile, il a
été amendé (11.47) et ainsi de suite. Une part minime
(5.20) n'a jamais bougé.
4.3.3.2.2. Services et
actes administratifs taxables
Tableau n°23 : Services probables et actes
administratifs taxables
Question 2 : Pour quels services ou
actes aurais-tu payé ?
|
Le marché, le vélos, l'abattage, l'amande, les
attestations, les mines et carrières, la notification, l'accès
aux tribunaux, les ventes aux enchères, l'achat de DAO, la location des
marins, les panneaux publicitaires,...
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
Il est clair que la population a demandé ou a eu l'un
ou l'autre des services ou actes taxables.
4.3.3.2.3.
Utilité des recettes non fiscales
Question 3 : Savez-vous à quoi
servent les recettes non fiscales ou autres frais administratifs ?
Tableau n°24 : Utilité probable des
recettes non fiscales ou autres frais administratifs
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
%
|
|
Oui
|
95
|
98.96
|
|
Non
|
1
|
1.04
|
|
Neutre
|
-
|
-
|
|
TOTAL
|
96
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
En partant des réponses données à cette
question, il est visible de tout le monde que la population du district de
Gicumbi connaît le bien fondé des recettes non fiscales et autres
frais administratifs.
4.3.3.2.4. Education sur
les recettes non fiscales
Question 4 : Y'auraient-ils des
informations sur les recettes non fiscales que vous détenez ?
Tableau n°25 : Education probable sur les
recettes non fiscales et autres frais administratifs
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
%
|
|
Oui
|
95
|
98.96
|
|
Non
|
1
|
1.04
|
|
Neutre
|
-
|
-
|
|
TOTAL
|
96
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
La population du district de Gicumbi est informée
à 98.96%. Beaucoup de canaux sont intuitivement mis en place : la
famille, les écoles, les réunions, les journaux, les
émissions radio et télédiffusées,...
4.3.3.2.5.
Appréciation sur l'assiette des recettes non fiscales
Question 5 : Comment jugez-vous
l'assiette des recettes non fiscales ?
Tableau n°26 : Avis sur l'assiette des
recettes non fiscales ou autres frais administratifs
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
0%
|
|
La restreindre
|
78
|
81.3
|
|
La laisser comme telle
|
14
|
14.9
|
|
L'élargir
|
4
|
3.8
|
|
Total
|
96
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
L'avis de la population sur cette question est tout à
fait opposé à celui des techniciens du district et celui des
fonctionnaires des secteurs et cellules. Bien qu'informée, bien que
sachant l'utilité des recettes non fiscales et autres frais
administratifs, la population veut payer très peu d'argent que cela
pouvait être.
4.3.3.2.6. Souhaits
à soumettre aux dirigeants du district.
Question 6 : Quelles suggestions
à formuler à l'endroit des autorités au sujet des
coûts des recettes non fiscales et autres frais administratifs ?
Tableau n° 27 : Doléances de la
population au sujet des coûts de recettes non fiscales et autres frais
administratifs
|
REPONSES
|
EFFECTIF
|
0%
|
|
Réduction des coûts
|
94
|
97.91
|
|
Augmentation des coûts
|
0
|
0
|
|
Gratification
|
2
|
2.09
|
|
Total
|
96
|
100
|
Source : Notre enquête sur terrain,
Avril 2010.
Comme le montre le tableau, personne ne veut jamais que les
coûts des services et amendes soient augmentés. Non plus,
très peu de gens n'en voudraient pas la gratification (2.09%). Presque
tout le monde veut plutôt payer le coût réduit. Cette
attitude démontre le patriotisme de la part de la population.
4.3.4.
Présentation du poids des recettes non fiscales sur le revenu
public
4.3.4.1. Exercice
budgétaire 2006
Tableau n°28 : Poids des recettes non fiscales
en 2006
|
TYPES DE RECETTES
|
MONTANT
|
%
|
|
Recettes fiscales
|
36207133
|
2%
|
|
Recettes non fiscales
|
132230727
|
8%
|
|
Fonds bailleurs/Intervenants
|
1456209744
|
90%
|
|
REVENU TOTAL
|
1724647604
|
100%
|
Source : Notre analyse du rapport financier
du district de Gicumbi, 2006
Graphique n°8 : Recettes non fiscales par
rapport au revenu total 2006
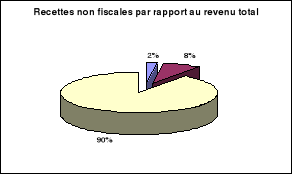
Source : Notre analyse du rapport financier
du district de Gicumbi, 2006
A partir du tableau et du graphique ci haut, nous voyons
que les recettes non fiscales constituaient une petite partie du revenu
total du district de Gicumbi en 2006 à raison de 8%. Les recettes
fiscales étaient évaluées à 2%. Les recettes
propres du district s'élevaient à 10% ; pratiquement un
dixième des fonds des bailleurs et intervenants. Le budget du district
était à ce moment là déficitaire et tout à
fait dépendant de l'extérieur (90%).
La situation est facile à être
appréhendée et les raisons en sont multiples : Les recettes
fiscales sont très peu parce que d'une part leurs assiettes
étaient très restreintes
étant donné qu'une grande partie d'impôts
devait aller à la caisse de l'Etat, et d'autre part par ce que la
population dispose de très peu de revenus imposables. Le volume des
recettes non fiscales était petit suite entre autre aux conditions
socio- économiques des habitants : la mentalité, le niveau
économique encore très bas, ICT, la politique économique
actuelle de la privatisation,...Les fonds de bailleurs et des intervenants
étaient volumineux car le district devait à tout prix faire
équilibrer son budget.
4.3.4.2. Exercice
budgétaire 2007
Tableau n°29 : Poids des recettes non fiscales
en 2007
|
TYPES DE RECETTES
|
MONTANT
|
%
|
|
Recettes fiscales
|
39 715 343
|
1%
|
|
Recettes non fiscales
|
247 538 825
|
9%
|
|
Fonds bailleurs/Intervenants
|
2383429145
|
90%
|
|
TOTAL
|
2 670 683 313
|
100%
|
Source : Notre analyse du rapport financier
du district de Gicumbi, 2007
Graphique n° 9: Recettes non fiscales par
rapport au revenu total 2007
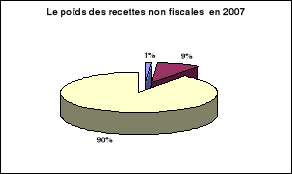
Source : Notre analyse du rapport financier
du district de Gicumbi, 2007
Comme le laissent visualiser le tableau
précèdent et son graphique, il y'a eu une petite augmentation des
recettes non fiscales. Elles ont passé de 8 à 9% soit une
augmentation de 1%. Cette augmentation était due au fait qu'il y'a eu
élargissement de l'assiette taxable. Cela a été rendu
possible par le privilège détenu par le district d'instaurer de
nouvelles taxes. Nous pouvons donner un exemple de la gare qui a
été taxée en 2007 alors que ce n'était pas le cas
en 2006.
4.3.4.3. Exercice
budgétaire 2008
Tableau n°30 : Poids des recettes non fiscales
en 2008
|
TYPES DE RECETTES
|
MONTANT
|
%
|
|
Recettes fiscales
|
48 705 559
|
0%
|
|
Recettes non fiscales
|
366 847 688
|
4%
|
|
Fonds bailleurs/Intervenants
|
9 882 806 967
|
96%
|
|
TOTAL
|
10 298 360 214
|
100%
|
Source : Notre analyse du rapport financier
du district de Gicumbi, 2008
Graphique n°10 : Recettes non fiscales par
rapport au revenu total 2008
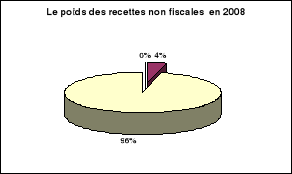
Source : Notre analyse du rapport financier
du district de Gicumbi, 2008
Pour l'année 2008, la situation s'est empirée.
Le volume des recettes non fiscales a chuté de 9 à 4%.
C'était le même cas pour les recettes fiscales (de 1 à
0%). Les recettes propres du district se sont élevées à
4%, ce qui a entraîné le district à faire recours aux
fonds des bailleurs et intervenants à raison de 96%.
L'analyse approfondie des rapports financiers établis
par le receveur du district nous a laissés constater qu'il y'a eu
diminution sur chaque rubrique. Cela est dû non seulement au niveau
économique de la population mais encore et surtout à la
défaillance du système de recouvrement du district.
4.3.4.4.
Récapitulation du poids des recettes non fiscales pour la
période 2006-2008
Tableau n°31 : Poids synthétique des
recettes non fiscales en 2006-2008
|
Types des recettes
|
2006
|
2007
|
2008
|
Total
|
%
|
|
Recettes fiscales
|
36 207 133
|
39 715 343
|
48 705 559
|
124 628 035
|
1%
|
|
Recettes non fiscales
|
132 230 627
|
247 538 825
|
366 847 688
|
746 617 140
|
7%
|
|
Bailleurs/intervenants
|
6 825 329 918
|
1 456 209 744
|
1 743 817 308
|
10 025 356 970
|
92
|
|
Total
|
6 993 767 678
|
1 743 463 912
|
2 159 370 555
|
10 896 602 145
|
100
|
Source : Notre analyse du rapport financier
du district de Gicumbi, 2006-2008
Graphique n°11: Synthèse des
recettes non fiscales en 2006-2008
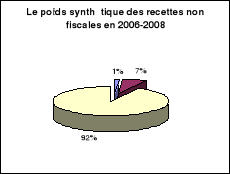
Source : Notre analyse du rapport financier
du district de Gicumbi, 2006-2008
Pendant la période sous notre étude (2006-2008),
l'économie du district de Gicumbi a été toujours
dépendante. Les recettes non fiscales ont toujours constitué une
part infime. Cette situation non voulu a contraint le district à se
tourner vers l'extérieur pour l'équilibre de son budget.
4.4. VALIDATION DES HYPOTHESES
4.4.1. Au niveau des réponses aux questions
soumises aux enquêtés
Dans tout travail scientifique, les hypothèses sont
posées au début et doivent être vérifiées
tout au long du travail de recherche. Pour notre cas, tout au départ,
nous nous sommes donné deux hypothèses :
Ø Les recettes non fiscales sont perçues sous
diverses sources dans le district de Gicumbi, et
Ø les recettes non fiscales constituent une part
importante des revenus publics dans le district de Gicumbi.
En partant des résultats obtenus dans les tableaux
n° 14 ; 15 ; 19 ;20 ;22 ; 23 ;26 et 27 qui
portaient sur la perception, le payement et les types probables des
recettes non fiscales, la sensibilisation des contribuables sur ce type des
recettes et leurs assiettes ainsi que leurs appréciations, nous avons
constaté que les enquêtés avaient déjà
payé et ou reçu des recettes non fiscales. Leurs
réponses nous ont permis de confirmer notre première
hypothèse.
4.4.2. Au niveau des
résultats de l'analyse du rapport financier du district de Gicumbi
(2006-2008)
Au vu des résultats obtenus, consignés dans les
tableaux n° 28 ; 29 ; 30 ; 31 et qui étaient
à rapport avec le poids des recettes non fiscales pour la période
2006-2008, nous avons constaté que les recettes non fiscales
constituaient 7% du revenu total, une part donc très minime. Ce constat
nous a permis d'infirmer notre deuxième hypothèse.
CONCLUSION PARTIELLE
Dans ce chapitre, nous avons réussi à
présenter le district de Gicumbi : c'est un des cinq districts de
la Province du Nord situé à l'Est et composé des grandes
parties des anciens districts de Rwamiko, Rebero, Rushaki, Bungwe, Kisaro et la
ville de Byumba. Il s'étend à une superficie de 829
km2. Son relief est très accidenté avec une altitude
de 2500 mètres. Son climat alterne entre les saisons sèches et
pluvieuses.
Il a été créé par la loi n°
29/2005 du 25 décembre 2005 et est peuplé par 362 331
habitants.
Ses recettes sont prévues
chaque année dans le budget ordinaire provenant des recettes, des
dons et legs, des subventions de l'Etat, des entités administratives
autonomes et dans le budget de développement provenant des fonds de
bailleurs et intervenants. Son budget est
déficitaire. Les fonds propres sont évalués à
8% (dont 7% des recettes non fiscales) contre
92% des fonds des bailleurs/intervenants.
En deuxième lieu, nous avons analysé et
interprété les résultats des questionnaires
adressés aux techniciens, aux fonctionnaires des instances de base
ainsi qu'à la population du district de Gicumbi. Nous avons aussi
analysé et interprété les données de l'analyse des
rapports financiers annuels 2006 - 2008 de ce même district.
Nos deux hypothèses de recherche ont été
vérifiées : la première hypothèse qui portait
sur la perception des recettes non fiscales sous différentes sources a
été confirmée alors que la deuxième qui prétendait que les
recettes non fiscales constituent une part importante des revenus publics dans
le district de Gicumbi a été infirmée.
CHAPITRE 5. CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
5.1. CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre travail de recherche que nous
avions intitulé : « Le poids des recettes non fiscales
sur les revenues publics au Rwanda, cas du district de Gicumbi de 2006
à 2008 ». Notre étude s'était fixé des
objectifs à atteindre : l'objectif général
était la mise en exergue des sources de financement du district de
Gicumbi alors que les objectifs spécifiques étaient la
connaissance des constituants des revenus publics dans district de
Gicumbi, la distinction des différentes sources des recettes du
district et la comparaison des recettes non fiscales aux revenus
publics du district de Gicumbi. Nous affirmons que tous ces objectifs
assignés à notre travail ont été atteints avec
succès.
Notre analyse a couvert une période allant de 2006
à 2008, soit trois ans ; une période que nous avons
jugée suffisante pour pouvoir tirer des conclusions sur base des
éléments vraiment fiables et consistants. Pour mieux atteindre
nos objectifs, nous nous sommes posé des questions suivantes qui
constituaient d'ailleurs notre problématique : « Quelles
sont les sources des recettes non fiscales dans le district de
Gicumbi ? » et « Quelle est la contribution des
recettes non fiscales aux revenus publics dans le district de
Gicumbi ? ».Les résultats obtenus sur terrain nous ont
rendus capables d'y répondre : les recettes non fiscales y sont
perçues sous différentes sources et constituent une part
très minime aux revenus du district.
C'est un travail qui a été doté de deux
hypothèses : « Les recettes non fiscales sont
perçues sous diverses sources dans le district de Gicumbi »
et « Les recettes non fiscales constituent une part importante des
revenus publics dans le district de Gicumbi ».
Notre travail s'est articulé autour de cinq
chapitres :
Le premier chapitre intitulé :
« Introduction Générale » avait pour but
d'introduire ce travail de recherche et comprenait différents points
qui ont été fort développés.
Dans l'historique du problème, nous avons montré
que l'homme a été créé et appelé par le
bon Dieu à parfaire la société et à continuer ses
oeuvres par sa propre contribution. Nous avons évoqué
l'histoire de la fiscalité rwandaise et la création du Rwanda
Revenue Autority qui a eu une mission de gérer et d'administrer des
recettes publiques. Le motif du sujet à savoir le souci de
connaître combien le district de Gicumbi profite des recettes non
fiscales et l'intérêt tant personnel, scientifique et
académique, social que politique ont été
développés à long et à large.
La délimitation du sujet dans le domaine, dans le
temps et dans l'espace a été respectée : c'est
ainsi que nous nous sommes investis dans la finance du district de Gicumbi pour
la période allant de 2006 à 2008. Une réflexion de ce que
serait la situation budgétaire déficitaire du district de
Gicumbi au cas où les recettes non fiscales étaient omises a
été développée.
Le deuxième chapitre intitulé :
« cadre conceptuel et revue de la littérature »
avait pour objet de définir les concepts de base et de produire la
revue de la littérature. Nous avons défini tous les concepts
clés à rapport avec notre sujet de recherche et la
littérature nécessaire a été
exploitée. Nous avons situé nos lecteurs et nous sommes
sûr qu'il n'y a pas eu d'obscurantisme, ni de confusion quant à
la lecture de ce chapitre. Ainsi, les termes suivants : poids, recettes
et revenus, public, fisc, recettes et revenus publics, recettes non fiscales
(taxes), recettes parafiscales et recettes fiscales (impôts) ont
été définis.
Pour la revue de la littérature, nous avons
abordé et présenté les différentes sources de
financement des Gouvernements riches au monde, celles des Gouvernements
pauvres d'Afrique de l'Est, celles du Gouvernement Rwandais et enfin celles
du district de Gicumbi. En général, tous ces gouvernements et
même le district de Gicumbi se financent par les revenus fiscaux, les
revenus non fiscaux, les revenus parafiscaux, les aides, les subventions et
les emprunts, et cela à des pourcentages différents.
Le troisième chapitre intitulé :
«Méthodologie » nous a permis de présenter les
techniques et les méthodes utilisées comme le préconise
la rigueur scientifique : c'étaient des techniques documentaires,
d'entretien et d'interview, d'échantillonnage et de questionnaire qui
nous ont été beaucoup utiles en matière de la collecte
des données de recherche. C'étaient aussi des méthodes
analytiques, comparatives et statistiques qui ont été
utilisées et ont rendu possible l'analyse de ces données.
Le quatrième chapitre a été
intitulé : « Présentation, analyse des
données et interprétation». Nous avons situé
géographiquement le district de Gicumbi. C'est un des cinq districts
de la Province du Nord. Il en est situé à l'Est et
s'étend à une superficie de 829 km2 et compte 21
Secteurs, 109 Cellules et 630 Villages. Le relief y est très
accidenté, aux pentes raides et aux vallées profondes et
étroites avec un climat aux saisons sèches et pluvieuses. Il est
habité par 172 144 hommes et 190 187 femmes.
Ce chapitre a
présenté aussi les revenus publics dans le district de Gicumbi.
Ils viennent des recettes fiscales, recettes non fiscales et des fonds des
bailleurs et intervenants. Deux types de budget y existent : un budget
ordinaire financé par des recettes propres, des dons et legs, des
subventions de l'Etat et des entités administratives autonomes,... et le
budget de développement financé par des fonds de bailleurs et
intervenants.
L'analyse et l'interprétation des réponses aux
questions soumises aux techniciens du district et aux fonctionnaires des
instances de base et même à la population ont permis de confirmer
la première hypothèse selon laquelle les recettes non fiscales
sont perçues sous différentes sources.
Ce chapitre a été clôturé avec
l'infirmation de la deuxième hypothèse selon laquelle les
recettes non fiscales perçues dans le district de Gicumbi constituent
une part importante de ses revenus. Cette infirmation a été le
fruit de l'analyse des rapports financiers annuels 2006 - 2008 qui ont
démontré que la part des recettes non fiscales est très
infime à l'ordre de 7% contre 1% des recettes fiscales et 92% des fonds
des bailleurs et intervenants.
Le cinquième chapitré intitulé :
«Conclusion et recommandations », est intervenu pour mettre fin
à ce travail.
5.2. RECOMMANDATIONS
Au terme de notre travail, il est indispensable de formuler
quelques recommandations en guise de contributions à la promotion des
recettes non fiscales dans le district de Gicumbi.
5.2.1. Au gouvernement Rwandais
L'Etat Rwandais doit assurer au district de Gicumbi
l'effectivité de la décentralisation qui lui a été
conférée par la loi. Pour cela, l'Etat doit faire plus de
concessions en matière non seulement de l'assiette d'imposition mais
encore de l'assiette taxable. De cette façon, le district bâtira
ses capacités, s'assurera d'une autonomie financière et verra son
budget moins dépendant de l'extérieur.
5.2.2. Aux Autorités du district de
Gicumbi
Ø Profiter au maximum de toutes les
potentialités : l'existence des contribuables et le
privilège que lui confère la loi n° 17/2002 du 10/05/2002,
et cela en vue de la maximisation des
recettes non fiscales ;
Ø Promouvoir la sensibilisation et l'encouragement
de la population ;
Ø Etudier et recenser les patrimoines propres du
district et en siéger une gestion efficace ;
Ø Rendre un service impeccable à la
population ;
Ø Mettre en place un système efficace de
recouvrement.
5.2.3. A la population du district de
Gicumbi
C'est une invitation au patriotisme. La population doit
comprendre que c'est sa force qui doit bâtir le pays du Rwanda et le
district de Gicumbi en particulier. Elle doit supporter volontiers et
librement le fardeau qu'engendre le payement des recettes non fiscales.
5.2.4. Perspectives des recherches
ultérieure
Nous ne prétendons pas avoir tout épuisé
sur les recettes non fiscales. Beaucoup de pistes restent ouvertes aux
éventuels chercheurs. C'est pourquoi, nous nous sommes permis de
suggérer quelques sujets de recherche :
Ø La potentialité du district de Gicumbi en
matière des recettes non fiscales ;
Ø L'évaluation du service d'audit dans le
district de Gicumbi ;
Ø Le comportement de la population du district de
Gicumbi face aux recettes non fiscales.
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages généraux
1. BRADLEY R. SCHILLER, The Economy today, 10
éd. New York, McGraw- Hill,
American, 1980
2. CAMPBEL R. Mc COLONNEL, STANLEY L. ECONOMOCS:
Principals, Problems and
Policies, 16ème éd.
Brue, New York, 1960
3. CARLS. S. Houp, Fiscal harmonisation in common
markets, volume II, Colombia
University Press, 1967
4. CROS, Robert, Finances publiques : institutions et
mécanismes économiques, édition
CUJAS, Paris 1994
5. CZIAN, Maurice, Précis de fiscalité des
entreprises, édition LITEC, Paris, 2001
6. DAFFLON, Bernard, Le financement du secteur
public, cours enseigné à la chaire de
finances publiques et de Gestion des finances publique
de l'Université de Fribourg
(SUISSE), année académique 2003-2004
7. DE LANDSHEERE, G., Introduction à la recherche
pédagogique, éd. G., Liège, 1974
8. DISLE, Emmanuel et SARAF, Jacques, Droit fiscal :
Manuel et application, éd. DECEF,
Dunod, Paris 2002
9. GAUTIER, B., Recherche Sociale. De la
problématique à la collecte des données, P.U.Q,
Québec, 1984
10. GIANI Bernard, Statistiques appliqué,
éd ECONOMIA, 3ème éd Paris, 1990
11. GRAWITZ, M., Méthodes des Sciences
sociales, 11ème éd., Dalloz, Paris, 2001
12. John B. TAYLOR, Principles of Microeconomics, 4th
ed. USA, Houghton Mifflin
Company, 2004
13. M.GRAWITZ, Méthodes des sciences Sociales,
Paris, Dalloz 4ème éd, 1996
14. MOREL, Gervais, Fiscalité des
entreprises, éditions CFPB, Paris, 2001
15. MUCHIELLI, R., Le questionnaire dans l'enquête
psychosociale, Bruxelles, 1984
16. PINTO et Madeleine GRAWITZ, Méthodes des
Sciences Sociales, Paris, Dalloz 1971
17. Richard A. MUSGAVE, Fiscal Systems, New haven and
London Yale University Press,
1969
18. RONGERE, P., Méthodes des sciences
sociales, Dalloz, Paris, 1971
19. Stéphanie BEAUD et Florence WEBER, Guide De
L'Enquête De Terrain, Paris, la
découverte 2003
II. Textes légaux et
réglementaires
1. Décret - loi N°19/78 du
14/8/1978 portant création du plan comptable National/OCAM
et Arrêté Ministériel
n°006/FIN 10.07du 22/6/1983 portant mesure d'exécution du
décret- loi susdit.
1. Loi N° 06/2001 du 20/01/2001
portant instauration de la taxe sur la valeur ajoutée
2. Loi N° 17/2002 du 10/5/2002 portant Finances des
Districts et Villes et régissant leurs utilisations
3. Loi N° 16/2005 du 18/08/2005 relative aux impôts
directs sur le revenu
4. Loi N° 08/2006 du 24/02/2006 portant l'organisation et
fonctionnement du district, Kigali 2006
III. Revues et publications
1. Annual Economic Report 2007, Ministère des Finances
et de la Planification Économique,
République du Rwanda, Juillet 2008
2. EDPRS 2008-2012, Ministère des Finances et de
la Planification Économique, République
du Rwanda, Septembre 2007
3. Examen de la politique d'investissement au Rwanda,
Conférence des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement/Nations Unies, New
York et Genève, 2006
4. Fond Monétaire International,
Rapport
annuel, période 1997/1998
5. Fond Monétaire International, Selected issues and
statistical Appendix, Mars 2004
6. GICUMBI : Rapport du receveur d'impôts,
2006
7. GICUMBI : Rapport du receveur d'impôts,
2007
8. GICUMBI : Rapport du receveur d'impôts,
2008
9. Guide sur les sources et les conditions de financement des
petites et moyennes entreprises
au Rwanda, RIEPA et CAPMER, Novembre 2005
10. Nations Unies, Etude sur la situation économique de
l'Afrique, volume III Sous région de
l'Afrique de l'Est.
11. PNUD, Coopération au développement, Rwanda,
rapport 1991, juin 1993
12. Rapport du Séminaire- atelier organisé par la
LDGL en collaboration avec COSYLI sur
l'appui financier du ACIPA. Kigali, du 2 au 3 Mars
2004
13. Rwanda: Country strategic opportunities programme,
International Fund for Agricultural
Development, Rome, September 2007
14. République Rwandaise, Ministère de finances
et de l'économie, tableau des opérations
15. République Rwandaise, Ministère du Plan,
Evaluation 1982-1984, janvier 1985
financières du Rwanda (1982-1986) ? Aout
1988
16. République Rwandaises, MINIFINECO, tableau des
opérations financières du Rwanda,
Août 1988
17. République du Rwanda, fonds commun de
développement, rapport annuel 2004, Mars
2005
18. Vision 2020, Ministère des Finances et de la
Planification Économique, République du
Rwanda, Novembre 2002
IV.WEB SITES
1.
http://www.csr.gov.rw/spip.php?article1
2.
http://www.rama.gov.rw/spip.php?article35
3.
http://www.santetropicale.com/rwanda/marc0207.htm
4.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutuelle_de_sant%C3%A9_en_France
5.
http://www.syfia-grandslacs.info/index.php5?view=articles&action=voir&idArticle=962
6.
http://www.grandslacs.net/doc/4061.pd
7.
http://survivors-fund.org.uk/en-francais.php
8. http://
www.avega.org.rw.
9. http://
www.solacem.org
10.
info@survivors-fund
11.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emprunt_(finance)
12. http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnalit%C3%A9
13.
http://www.grandslacs.net/doc/4061.pdf
14. http://
www.primature.gov.rw
15. http://
www.minicom.gov.rw
16. http://
www.minecofin.gov.rw
17. http://
www.rwandainvest.com
18. http://
www.rpsf.org.rw
19. http://
www.rra.gov.rw
20. http://
www.bnr.rw
21. http://
www.moh.gov.rw
22.
http://www.memoireonline.com
V. Memoires
1. MUKAKARISA, N., Le rôle de crédit dans le
financement des activités économiques,
Mémoire inédit, U.L.K. 2005.
2. N'TAMBWE,J.P., Analyse et évaluation du
système éducatif appliqué au centre de jeunes
de Gatenga de 2004 à 2008,
Mémoire inédit, I.C.K., Kabgayi, 2008.
3. UMBA DI MAMONA, A., L'incidence de l'inflation sur la
fiscalité congolaise de 1995 à
2004, Mémoire inédit, I.S.C.,
Kinshasa, 2005.
VI. Dictionnaire
MAUBOURGUET, P., Le petit Larousse illustré,
Paris, 1994
ANNEXES
ANNEXE 1
QESIONNAIRE (version française)
Questionnaire destiné aux techniciens du district, aux
Secrétaires Exécutifs et aux Secrétaires comptables des
secteurs ainsi qu'aux Secrétaires Exécutifs et charges du
développement socio économique des cellules du district de
Gicumbi.
Instructions
Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre de
préparation du travail de fin du cycle de licence à l'Institut
Polytechnique de Byumba. Les réponses que vous donnez sont
confidentielles, raison pour laquelle la mention de l'identification sur
cette fiche est facultative. Sentez-vous libre dans vos réponses.
Nous vous prions de bien lire les questions et de les
comprendre avant d'y répondre.
Certaines questions sont fermées. Pour y
répondre, mettez une croix dans la case placée devant votre
meilleure réponse. S'il y a d'autres solutions qui ne sont pas
données, écrivez-les dans la place réservée
à cet effet. Pour les questions ouvertes qui requièrent des
explications, mettez-les dans la rubrique appropriée.
I. Identification de
l'enquêté
1. Nom........................... ................
....................................................................
2.
Prénom............................................................
..............................................
3. Fonction : Techniciens du district
Secrétaire Exécutif de
secteur
Secrétaire Comptable de secteur
Secrétaire Exécutif de
cellule
Chargé du développement
socio-économique de cellule
1. Cellule.............................................
..............................................................
2. Secteur...........................
.................................................
..............................
II. Questionnaire
1. Est-ce qu'il vous arrive de percevoir des recettes non
fiscales ?
A) Oui
B) Non
2. Quels types de recettes non fiscales percevez-
vous ?
...........................
.................................................................
.........................................................
.............................................................. ............
3. La population sait pourquoi paye-t- elle des recettes non
fiscales ?
A) Oui B) Non
4. Les recettes non fiscales perçues et
collectées, comment est-ce qu'elles parviennent à la caisse du
district ?
A) Versées au compte bancaire du district
B) Remises au Receveur du district
C) Autres moyens :.......................................
...................................
5. Y'a-t-il un contrôle ?
A) Non
B) Oui
6. Est-ce qu'il vous arrive de sensibiliser la population sur
les recettes non fiscales ?
A) Non
B) Oui
7. Comment jugez-vous l'importance des recettes non fiscales
au point de vue de leurs assiettes ?
A) Faut- il la restreindre ?
B) la laisser comme telle ?
C) l'élargir ?
8. Quels souhaits à formuler à l'endroit des
autorités du district de Gicumbi ?
QESIONNAIRE (version kinyarwanda)
Ibibazo by' ubushakashatsi bigenewe abayobozi, abanyamabanga
n'ababitsi b'imirenge ndetse n'abayobozi n'abashinzwe iterambere ku tugari mu
karere ka gicumbi.
Amabwiriza
Ibibazo bikurikira byateguwe mu rwego rwo gutegura igitabo
kirangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishuri rikuru rya Byumba.
Ibisubizo muzatanga ni ingenzi kandi ni ibanga. Niyo mpamvu umwirondoro atari
ngombwa. Musubize mubwisanzure. Subiza ibibazo byose kandi ushyire
akamenyetso cyangwa igisubizo ahabugenewe.
I. Umwirondoro w `ubazwa
1. Amazina..................................
................................................................
2. Umurimo: Umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge
Umubitsi w'umurenge
Umunyamabanga nshingwa bikorwa w'akagari
Ushinzwe amajyambere ku kagali
3. Akagari...............................
.....................................................................
4. Umurenge..................
...............................................................................
II. Ibibazo
1. Hari amahoro mujya mwakira?
A) Yego
B) Oya
2. Ni ayahe moko y'amahoro mwakira?
..............................................................................................................................................................................................................................
3. Abaturage bazi impamvu bishyura amahoro ?
A) Yego
B) Oya
4. Amahoro mwakira agezwa ate mu isanduku y'akarere?
A) Ashyirwa kuri konti y'akarere
B) Ashyikirizwa umwakirizi w'amahoro w'akarere
C) Ubundi buryo:
..............................................................................................................................................................................................................................
5. Hari igenzura rikorwa ku imisoro mwakira
A) Oya
B) Yego
6. Mujya se mwigisha abaturage ku itangwa ry'amahoro ?
A) Oya
B) Yego
7. Mubona mute ibikorwa, ibintu cyangwa serivisi zitangirwa
amahoro ?
A.Byagabanwa
B.Byaguma uko biri
C.Byakongerwa
8. Ni ikihe cyifuzo mwageza ku buyobozi bw'akarere ka
Gicumbi ?
................................................
.................................................................................
........................... .....................
.....................................................................
............................................................
.............................
ANNEXE 2
IBIBAZO BIGENEWE ABASORESHWA B'AKARERE KA GICUMBI
AMABWIRIZA
Ibibazo bikurikira byateguwe mu rwego rwo gutegura igitabo
kirangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu ishuri rikuru rya Byumba.
Ibisubizo mutanga ni ingenzi kandi ni ibanga. Niyo mpamvu umwirondoro atari
ngombwa. Musubize mubwisanzure. Subiza ibibazo byose kandi ushyire
akamenyetso k'umusaraba ahabugenewe.
I Umwirondoro w `ubazwa
1.
Amazina..................................................................................................
2.
Akagali....................................................................................................
3.
Umurenge.................................................................................................
4. Igitsina GaboGore
5.
Imyaka.....................................................................................................
6.
Umurimo..................................................................................................
II Ibibazo
1. Wigeze utanga amahoro mu karere ka Gicumbi?
A) Yego
B) Oya
2. Ni ikihe gikorwa cyangwa serivisi watangiye ayo mahoro?
A) Yego
B) Oya
3. Hari se andi mafaranga waba waratanze mu nzego z'ubuyobozi
bw'ibanze?
A) Yego
B) Oya
4. Ni ikihe gikorwa cyangwa serivisi watangiye ayo
mafaranga?
...................................
..................................... .................... ................
............................................
........................................................................................
.........................
5. Uzi akamaro k'amahoro?
A) Yego B) Oya
6. Hari se amakuru cyangwa inyigisho ku mahoro mwaba
mwarahawe?
A) Yego
B) Oya
7. Mubona mute ibikorwa, ibintu cyangwa serivisi zitangirwa
amahoro ?
A. Byagabanwa
B. Byaguma uko biri
C. Byakongerwa
8. Ni ikihe cyifuzo mwageza ku bayobozi b'akarere ka Gicumbi
ku birebana n'amahoro yakwa abaturage?
..................
...................................................
............................... ..........................................
....................................................................
............................ .............................................
..........................................
...............................................................
..........................................................
.....................................................
ANNEXE N° 3 : CARTE ADMINISTRATIVE DU
DISTRICT DE GICUMBI
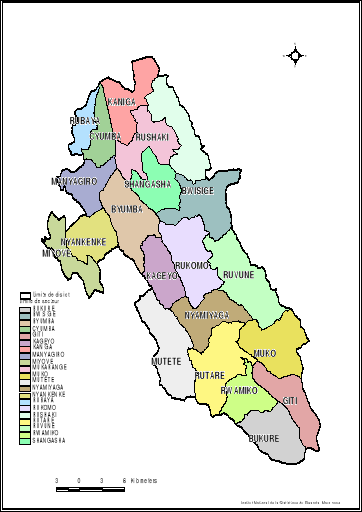
Source : PDD de Gicumbi 2008-2012
ANNEXE N° 4 : OGANIGRAMME SCHEMATIQUE DU
DISTRICT DE GICUMBI
District Council CouncilCouncil
Auditor
HRD
and
Support Services
Unit
Mayor
Vice mayor in charge
Of finance and economic development
Vice Mayor for
Social Affaires
Labor Inspector
Executive Secretary
UNIT :
Taxa
Tion
and resour
ce Mobili
zation
UNIT :
Plann
ing
and Project Coordi
nation
UNIT :
Area Develo
pment
UNIT :
Economic Development
UNIT :
Health and Promo
tion
Family
UNIT :
Education, youth, Sport
and Culture
UNIT :
Admininistra
tion, Good Governance and Social Affaires
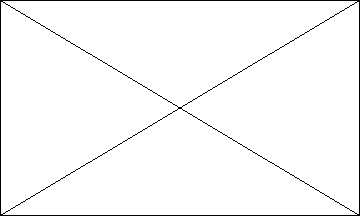 Source : PDD de Gicumbi 2008-2012 Source : PDD de Gicumbi 2008-2012
ANNEXE N°5 : OrGANIGRAMME SCHÉMATIQUE DE
L'O.R.R.
Minecofin
Boad of Directors
Commissioner General
Deputy Commissioner General & Commissioner for
Customs& Excise
Quality Assurance
Human Ressources
Customs&Excise
Domestic Taxes
Large Taxpayer office
Small & Medium Taxpayer office
Revenue protection
Finance
Information& Technology
Planning& Reaserh
Legal& Board Secretary
Taxpayers Services
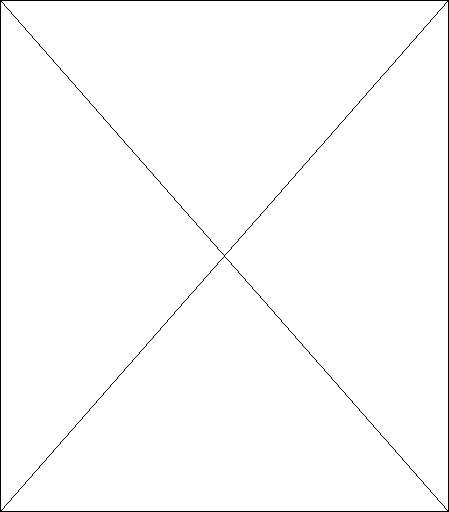 Source : Cours inédit de
Principes de fiscalité, Licence I, IPB, mai 2008 Source : Cours inédit de
Principes de fiscalité, Licence I, IPB, mai 2008
ANNEXE N°6 : Tableau n°5 : Impôts
en vigueur au Rwanda
|
Types d'Impôts en Vigueur au Rwanda
|
Taux d'imposition
|
|
1.1. Impôt sur le Bénéfice des
Sociétés
|
35%
|
|
1.2. Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
|
Taux progressif avec 30% comme taux maximum. Le revenu est
catégorisé en 3 seuils avec des taux proportionnels allant de
0%, 20% à 30%.
Un taux forfaitaire de 4% est applicable au chiffre d'affaires
annuel des petites entreprises.
|
|
1.3.1. Taxe Professionnelle sur les
Rémunérations (TPR)
1.3.2. Retenue à la source sur les Revenus des
Investissements (paiement sous forme de Dividendes, Intérêts,
Redevances, etc.)
Frais de Services Techniques et de Gestion,
Rémunération des prestations d'un artiste, Gains de Loteries,
etc
1.3.3. Retenue à la source opérée sur les
Importations
1.3.4. Retenue à la source opérée sur les
Marchés Publics
1.3.5. Acomptes trimestriels
|
-Taux progressif avec 3 seuils de revenus pour les
employés à temps plein (voir 1.2)
15% pour les travailleurs occasionnels
-30% pour un 2ème employeur différent du
principal employeur.
Taux forfaitaire de 15% sur les paiements faits par des
résidents à des résidents (art. 32) et aux non
résidents (art. 51)
-5% de la valeur CIF des biens importés destinés
à un usage commercial
3% du montant de la facture
-Acomptes de 25% du montant de l'impôt dû tel
qu'il ressort de la déclaration fiscale de l'exercice fiscal
précédent
|
|
1.4. Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.)
|
18% sur les biens et services taxables.
Taxe à l'inverse sur les services importés et 0%
sur les exportations de biens et services.
|
|
1.5. Droits d'Accises
|
1. Jus: 39%
2. Limonades: 39%
3. Eau minérale: 10%
4. Bières: 60%
5. Vins & Liqueurs: 70%
6. Cigarettes: 120%
7. Communications téléphoniques : 3%
|
Source : Rapport du Séminaire-
atelier organisé par la LDGL en collaboration avec Cosyli sur l'appui
financier de l'Action Citoyenne pour la Paix - ACIPA. Kigali, du 2 au 3 Mars
2004
ANNEXE N°7 : Tableau n°8 : Structure
administrative du District de Gicumbi
|
Secteurs
|
Nombre de cellules
|
Nombre de villages
|
|
Bukure
|
4
|
23
|
|
Bwisige
|
4
|
32
|
|
Byumba
|
9
|
51
|
|
Cyumba
|
6
|
28
|
|
Giti
|
3
|
19
|
|
Kageyo
|
5
|
27
|
|
Kaniga
|
5
|
34
|
|
Manyagiro
|
6
|
36
|
|
Miyove
|
3
|
29
|
|
Mukarange
|
6
|
30
|
|
Muko
|
5
|
26
|
|
Mutete
|
5
|
38
|
|
Nyamiyaga
|
7
|
27
|
|
Nyankenke
|
7
|
37
|
|
Rubaya
|
5
|
18
|
|
Rukomo
|
6
|
39
|
|
Rushaki
|
3
|
24
|
|
Rutare
|
6
|
30
|
|
Ruvune
|
6
|
36
|
|
Rwamiko
|
3
|
19
|
|
Shangasha
|
5
|
27
|
|
District
|
109
|
630
|
Source : PDD de Gicumbi 2008-2012,
juillet 2007, p.29
ANNEXE N°8: Tableau n°9 :
Répartition de la population par secteur
|
Secteurs
|
Hommes
|
Femmes
|
Total
|
|
Bukure
|
7 637
|
8 408
|
16 045
|
|
Bwisige
|
14 517
|
15 925
|
30 442
|
|
Byumba
|
14 517
|
15 925
|
30 442
|
|
Cyumba
|
5 579
|
5 970
|
11 549
|
|
Giti
|
6 840
|
7 245
|
14 085
|
|
Kageyo
|
9 108
|
9 515
|
18 623
|
|
Kaniga
|
7 601
|
8 320
|
15 921
|
|
Manyagiro
|
9 579
|
8 506
|
18 085
|
|
Miyove
|
3 121
|
4 379
|
7 500
|
|
Mukarange
|
7 350
|
9 488
|
16 838
|
|
Muko
|
7 925
|
10 034
|
17 959
|
|
Mutete
|
9 871
|
11 192
|
21 063
|
|
Nyamiyaga
|
-
|
-
|
15 486
|
|
Nyankenke
|
-
|
-
|
18 445
|
|
Rubaya
|
4 487
|
5 185
|
9 672
|
|
Rukomo
|
11402
|
10 525
|
21 927
|
|
Rushaki
|
6 916
|
7 754
|
14 670
|
|
Rutare
|
11 522
|
12 682
|
24 204
|
|
Ruvune
|
8 509
|
9 022
|
17 531
|
|
Rwamiko
|
5 323
|
5 910
|
11 233
|
|
Shangasha
|
-
|
-
|
15 865
|
|
District
|
151 804
|
165 985
|
368 585
|
Source : PDD de Gicumbi 2008-2012,
juillet 2007, p.7
ANNEXE N°9 : Tableau n°11 :
Services taxés et recettes non fiscales 2006 - 2008 en
FRW
|
Type de services
|
2006
|
2007
|
2008
|
Total
|
|
taxes mensuelles
|
19 375 880
|
18 750 550
|
58 259 022
|
96 385 452
|
|
Marchés
|
58 762 832
|
87 447 501
|
90 662 141
|
236 872 474
|
|
taxes vélos
|
1 549 290
|
1 333 620
|
-
|
2 882 910
|
|
Abattage
|
2 707 450
|
227 800
|
-
|
2 935 250
|
|
Amendes
|
7 958 660
|
31 525 820
|
163 500 159
|
202 984 639
|
|
Attestations
|
13 798 494
|
27 756 511
|
-
|
41 555 005
|
|
Chargement et déchargement
|
529 180
|
-
|
-
|
529 180
|
|
mines et carrières
|
872 900
|
-
|
-
|
872 900
|
|
Arrières
|
1 735 080
|
-
|
-
|
1 735 080
|
|
Notification
|
2 518 100
|
5 646 500
|
6 432 476
|
14 597 076
|
|
vente aux enchères
|
1 305 000
|
6 110 500
|
-
|
7 415 500
|
|
frais de tribunaux
|
15 100
|
6 600 950
|
-
|
6 616 050
|
|
transfert (6%)
|
4 677 088
|
7 938 550
|
-
|
12 615 638
|
|
Fôrets
|
11 240 534
|
9 781 113
|
-
|
21 021 647
|
|
achat dao
|
1 247 504
|
4 799 250
|
3 971 610
|
10 018 364
|
|
taxes sur thé vert
|
1 979 935
|
3 492 076
|
-
|
5 472 011
|
|
Location des marins
|
1 957 600
|
4 345 565
|
-
|
6 303 165
|
|
Mines et carrières
|
-
|
4 455 895
|
2 911 120
|
7 367 015
|
|
Acte de notoriété
|
-
|
1 996 780
|
-
|
1 996 780
|
|
Café
|
-
|
337 080
|
-
|
337 080
|
|
location salle polyvalente
|
-
|
900 000
|
-
|
900 000
|
|
Remboursement prêt blé
|
-
|
313 000
|
-
|
313 000
|
|
Impôt sur les immobiliers
|
-
|
1 118 582
|
-
|
1 118 582
|
|
location bateau
|
-
|
83 000
|
-
|
83 000
|
|
location gare
|
-
|
670 000
|
-
|
670 000
|
|
vaccination vache
|
-
|
1 764 460
|
-
|
1 764 460
|
|
Intérêts reçus
|
-
|
58 266
|
-
|
58 266
|
|
Briques
|
-
|
1 222 000
|
-
|
1 222 000
|
|
Divers
|
-
|
18 863 456
|
38 106 350
|
56 969 806
|
|
Taxes sur les panneaux
|
-
|
-
|
3 004 810
|
3 004 810
|
|
Total
|
132 230 627
|
247 538 825
|
366 847 688
|
746 617 140
|
Source : District de Gicumbi, Bureau du
Receveur, rapport 2006, 2007 et 2008.
ANNEXE N°10 : Graphique n°5 :
Comparaison des recettes non fiscales 2006-2008
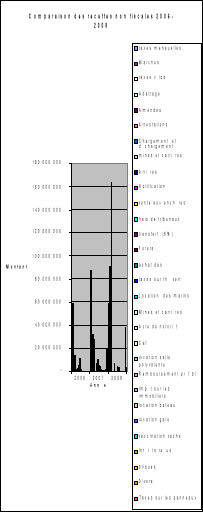
Source : Tableau n°11 : Services
taxés et recettes non fiscales 2006 - 2008 en FRW
ANNEXE N°11 : Tableau n° 12 :
Bailleurs/ Intervenants et leurs contributions : 2006 - 2008 en FRW
|
Nom
|
2006
|
2007
|
2008
|
Total
|
|
MINECOFIN
|
-
|
521 323 580
|
-
|
521 323 580
|
|
MINALOC
|
-
|
200 166 453
|
525 000
|
200 691 453
|
|
MINALOC VIUPI
|
-
|
-
|
20 000 000
|
20 000 000
|
|
MINEFRA
|
-
|
-
|
696 000
|
696 000
|
|
CDF FENU
|
-
|
339 360 944
|
314 531 095
|
653 892 039
|
|
CDF
|
-
|
-
|
820 844 839
|
820 844 839
|
|
FHI/RWANDA
|
-
|
-
|
100 000
|
100 000
|
|
UBUDEHE
|
-
|
-
|
1 842 000
|
1 842 000
|
|
FARG
|
-
|
955 928
|
25 080 172
|
26 036 100
|
|
FONDS DE L EDUCATION
|
-
|
60 889
|
-
|
60 889
|
|
MINISANTE
|
-
|
18 000 000
|
-
|
18 000 000
|
|
PAEGELAC
|
-
|
-
|
37 448 124
|
37 448 124
|
|
RITA
|
-
|
-
|
1 178 288
|
1 178 288
|
|
CDLS
|
-
|
-
|
68 082 996
|
68 082 996
|
|
MINEDUC
|
-
|
20 653 800
|
97 828 772
|
118 482 572
|
|
MINITERE
|
-
|
69 942 473
|
-
|
69 942 473
|
|
MINAGRI
|
-
|
5 826 250
|
25 750 000
|
31 576 250
|
|
PADC GR
|
-
|
19 475 000
|
6 284 757
|
25 759 757
|
|
MUTUELLE DE SANTE
|
-
|
3 413 262
|
67 000 000
|
70 413 262
|
|
SAVE THE CHRILDRE
|
-
|
-
|
100 000
|
100 000
|
|
ANCIENS COMPTES DES DSTRCT
|
-
|
11 293 680
|
-
|
11 293 680
|
|
MOMM NAT UNITE ET RECONCILIAT
|
-
|
1 500 000
|
6 957 700
|
8 457 700
|
|
DCDP
|
|
5 040 000
|
13 121 220
|
18 161 220
|
|
GTZ
|
-
|
4 000 000
|
30 525 054
|
34 525 054
|
|
AUTRES
|
-
|
235 287 485
|
-
|
235 287 485
|
|
TRANSFERT DU GVT CENTRAL
|
3 412 664 959
|
|
-
|
3 412 664 959
|
|
TRANSFERT NON CIBLES
|
476 975 908
|
-
|
-
|
476 975 908
|
|
TRANSFERTS CIBRES
|
2 935 689 051
|
-
|
|
2 935 689 051
|
|
UNICEF
|
-
|
-
|
196 408 171
|
196 408 171
|
|
CNLS
|
-
|
-
|
2 629 900
|
2 629 900
|
|
RARDA
|
-
|
-
|
4 000 000
|
4 000 000
|
|
INTRAHEALTH
|
-
|
-
|
2 883 220
|
2 883 220
|
|
Total
|
6 825 329 918
|
1 456 209 744
|
1 743 817 308
|
10 025 356 970
|
Source : District de Gicumbi, Bureau du Receveur, rapport
2006 - 2008
ANNEXE N°12 : Graphique
n°6 : Comparaison des fonds de bailleurs/intervenants
2006-2008
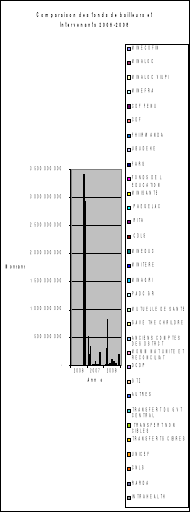
Source : Tableau n° 12 :
Bailleurs/ Intervenants et leurs contributions : 2006 - 2008 en
FRW
* 1 Abbé de Maredsous,
La Sainte Bible, Namur, F. Toussaint, vic.
gen. , mars 1968, p.1350 ; 1390.
* 2 BRADLEY R. SCHILLER, The
economy today, 10ème éd, New York, American
University, McGraw-
HILL/Irwin, 1980, p. 224.
* 3 Rapport du Séminaire-
atelier organisé par la LDGL en collaboration avec COSYLI, Kigali,
Mars 2004, p. 19.
* 4 Loi n° 25/2005 du 4
décembre 2005 portant création des procédures fiscales, p.
18.
* 5 Idem, p. 22.
* 6
Http://www.rwandainvest.com
(Consulté le 5/4/2010).
* 7 Loi n° 17/2002 du
10/05/2002 portant finances des districts et villes et régissant leur
utilisation, p. 18.
* 8 Loi n° 25/2005 du
4/12/2005, Op. Cit. , p. 1.
* 9 N'TAMBWE,
J.P. Analyse et évaluation du système éducatif
appliqué au centre de jeunes de Gatenga de 2004 à 2008,
Mémoire inédit, I.C.K., Kabgayi, 2008, p.2.
* 10 Stéphanie BEAUD et
Florence WEBER, Guide De L'Enquête De Terrain, Paris, La
Découverte 2003, p 187.
* 11 John B. TAYLOR,
Principles of Microeconomics, 4ème ed. USA,
Houghton Mifflin Company, 2004, p.342
* 12 Loi n°17/2002 du
10/5/2002, Op. Cit. p. 33 ; 34.
* 13 Idem,
Op. Cit., p.32.
* 14 PINTO et Madeleine
GRAWITZ, Méthodes des Sciences Sociales, Paris, Dalloz, 1971,
p.129.
* 15 MUCHIELLI, R., Le
questionnaire dans l'enquête psychosociale, Bruxelles, 1984, p.
78.
* 16 MAUBOURGUET, P., Le
petit Larousse illustré, Paris, 1994, p. 796.
* 17 Idem, p.862 ; 888.
* 18 Idem, p. 834.
* 19 Idem, p. 441.
* 20 BASTABLE, Public
finance. p.46.
* 21 Ibidem
* 22
http://concoursattache.canalblog.com/docs/recettes.pdf
(consulté le 27/03/2010).
* 23 UMBA DI MAMONA, A.,
L'incidence de l'inflation sur la fiscalité congolaise de 1995
à 2004, Mémoire inédit,
I.S.C, RDC, 2007.
* 24 BASTABLE, Op.
Cit. p. 56-57.
* 25John B. TAYLOR. Op.
Cit. p. 343.
* 26 UMBA DI MAMONA, A.,
Op. Cit., p .17.
* 27 BASTABLE, Op.
Cit., p.46.
* 28 BRADLEY R. SCHILLER,
The Economy today, 10 éd. McGraw-Hill: Irwin, 1980, p.82.
* 29 CAMPBEL R. Mc COLONNEL,
STANLEY L. ECONOMOCS: Principals, Problems and Policies, 16ème
éd. New York Brue, 1960, p. 86.
* 30 Idem, p. 120.
30 Richard A. MUSGRAVE. , Fiscal System, New
Haven and London Yale University Press, 1969.
* 31 BASTABLE, Op.
Cit. p. 47-48
* 32 CAMPBEL R. Mc COLONNEL,
STANLEY L., Op. Cit. , p.86.
* 33 MAUBOURGUET, P.,
Op.Cit., p. 969.
* 34
http://fr.wikipedia.org/wiki/Subvention
(consulté le 26/04/2010).
* 35 CAMPBEL R. Mc COLONNEL
STANLEY L. Op. Cit. p.86
* 36
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emprunt_(finance)
(consulté le 27/03/2010).
* 37 CAMPBEL R. Mc COLONNEL,
STANLEY L. Op. Cit. p.256.
* 38 Nations Unies,
Etude sur la situation économique de l'Afrique, New York, 1970,
p. 15
* 39 Fonds Monétaire
International, Selected issues and statistical Appendix, Mars
2004.
* 40
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnalit%C3%A9
(aide internationale) (consulté le 27/03/2010).
* 41 Fonds Monétaire
International,
Rapport
annuel, période 1997/1998.
* 42 République
Rwandaises, MINIFINECO, tableau des opérations financières du
Rwanda, Août 1988, p 24-26.
* 43
http://concoursattache.canalblog.com/docs/recettes.pdf
(consulté le 27/03/2010).
* 44 Loi n° 60/2008 du
10/09/2008 déterminant la responsabilité, l'organisation et le
fonctionnement de la CSR et
la Loi n°6/2003 du 2/2003 sur la
réintégration active des politiciens dans la
sécurité sociale.
* 45 SCHMIDT, J.O., et
al. Les seuils de l'assurance maladie au Rwanda : Qui paie quoi et
combien ?, 2006.
* 46 République
Rwandaise, Ministère du plan, Evaluation 1982-1984, janvier
1985, p.38.
* 47 République du
Rwanda, fonds commun de développement, rapport annuel 2004,
Mars 2005.p.4.
* 48 District de Gicumbi,
Bureau du Receveur, rapport annuel 2006-2008.
* 49 PDD de Gicumbi 2008-2012,
juillet 2007, p. 36-39.
* 50 MAUBOURGUET, P., Op.
Cit, p.652.
* 51 GIANI Bernard,
Statistiques appliqué, éd ECONOMIA,
3ème éd, Paris, 1990, p.149 ; 152.
* 52 GRAWITZ, M.,
Méthodes des Sciences sociales, 11ème
éd., Dalloz, Paris, 2001, p. 352.
* 53 GAUTIER, B.,
Recherche Sociale. De la problématique à la collecte des
données, PUQ. Québec, 1984, P. 17.
* 54 M. GRAWITZ, Op. Cit.,
p.586.
* 55 MAUBOURGUET, P.,
Op. Cit. p 560.
* 56 DE LANDSHEERE, G.,
Introduction à la recherche pédagogique, éd. G.,
Liège, 1974, p. 178.
* 57 MAUBOURGUET, P.,
Op.Cit., p.298.
* 58 M.GRAWITZ, Op. Cit.
p.586.
* 59MUKAKARISA, N., Le
rôle de crédit dans le financement des activités
économiques, Mémoire inédit, U.L.K. 2005.
* 60 GAUTIER, B.,
Op.cit, P.18.
* 61 M. GRAWITZ, Op. Cit. p.
87.
* 62 Ibidem.
* 63 N'TAMBWE, J.P. Op. Cit.
p. 49.
* 64 RONGERE, P.,
Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p.
18.
* 65 GIANI Bernard, Op.
Cit. p.149.
* 66 Ibidem.
* 67 N'TAMBWE,
J.P. Op. Cit. p. 5
* 68 Ibidem.
* 69 PDD de Gicumbi 2008-2012,
Juillet 2007.
* 70 Loi n°47/2000 et
Journal Officiel n° spécial de la République du Rwanda du
19/12/2000.
* 71 Loi n°17/2002,
Op. Cit. p.2
* 72 Idem p.19.
* 73Ibidem.
* 74 Loi n° 07/2001 du 15
Novembre 2001 portant organisation et fonctionnement de la Ville de Kigali,
p.19.
* 75 Idem. p.20.
* 76 Idem. p.32.
* 77 Idem, p.33-34.
* 78 N'TAMBWE, J. P. Op.
Cit. p. 4.
* 79 Idem, p. 50.
* 80 Ibidem
* 81 Idem, p.47.
| 


