|
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE
MÉMOIREDE RECHERCHE
MASTER II
OPTION : RESSOURCES, ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT(RED)
PARCOURS :GÉOMORPHOLOGIE
THEME :
DYNAMIQUE DES UNITES MORPHOLOGIQUES LE LONG DE
L'ILE DE DIAMNIADIO A FAOYEDE1970 A2020
   Présentée par : Sous la
direction de : Présentée par : Sous la
direction de :
Serigne Aziz Diouf Dr Cheikh Ahmed TidianeFaye
Maître de Conférences Titulaire
Année Académique : 2022-2023
Sommaire
Sommaire
I
Avant-propos
IV
Remerciements
V
Dédicaces
VI
Introduction
1
Chapitre 1 : Présentation du milieu
d'étude
2
1.1. Situation du milieu d'étude
2
1.2. Le cadre physique
4
1.3. L'aspect humain
38
Chapitre 2 : Etat de la question, fondement
théorique et conceptuel
46
2.1. Synthèse bibliographique
46
2.2. Problématique de recherche
65
2.3. Analyse conceptuelle
70
Chapitre 3 : Approche méthodologique
72
3.1. Apport de la bibliographie
74
3.2. Collecte et acquisition de
données complémentaires
74
3.3. Les travaux de terrain
78
3.4. Les analyses de laboratoire
85
3.5. L'analyse de cartes diachronique
90
Chapitre 4 : Analyses, interprétations et
discussions des résultats
93
4.1. Analyse et interprétation des
mesures de suivi de la dynamique de l'érosion
93
4.2. Analyse et interprétation des
mesures de profondeurs des cours d'eau
96
4.3. Analyse et interprétation des
paramètres physico-chimiques des sédiments et eau
98
4.1. Analyse et interprétation de
l'évolution des unités paysagères
125
4.5. Analyse et interprétation des
impacts de la dynamique et stratégies de gestions
149
4.6. Discussion des résultats
161
Conclusion générale
164
Liste des références
167
Annexes
173
Liste des illustrations
180
Table des matières
184
Liste des acronymes et des sigles
ADG : Automated Deduction in Geometry
AFNOR : Association Française de Normalisation
ANACIM : Agence National de l'Aviation Civile
Internationale et de la Météorologie
ANAT : Agence National de l'Aménagement du
Territoire
ANSD : Agence National de la Statistique et de la
Démographie
BMVE : Basses mers moyennes de vive-eau
BP :Before Present (Après 1950)
BPIT : Basses Pressions Intertropicales
BU : Bibliothèque Universitaire de l'Ucad
Ce : Conductivité électrique
CSE : Centre de Suivi Ecologique
DEFCCS : Direction des Eaux,
Forets, Chasse et de la Conservation des Sols
DGPRE : Direction de la Gestion et de la Planification
des Ressources en Eau
DTGC : Direction des Travaux Géographiques et
Cartographiques
DTS : Quantité en matières Dissoutes (Total
Dissolved Solids)
GPS: Global Positioning System
EM: Equateur Météorologique
ENVI :Environment for Visualizing
Images
E.P.E.E.C : Equipe Pluridisciplinaire d'Etude des
Ecosystèmes Côtiers
GREEN : Groupe de Recherche et d'Etude
Environnementales
HPT : Hauts Pressions Tropicales
IGN : Institut nationale de l'information
géographique et forestière
INP : Institut National de la Pédologie
ISRA : Institue Sénégalaise de la Recherche
Agricole
MAB: Programme sur l'Homme et la Biosphère
ONG : Organisation Non Gouvernementale
pH : Potentiel Hydrogène
PMME : Pleine mers moyennes eau
PMVE : Pleines mers moyennes de vive-eau
PNLB : Parc National de la Langue de Barbarie
RBDS : Reserve Biosphère du Delta du Saloum
SIG : Système d'Information Géographique
UCAD : Université Cheikh Anta Diop de Dakar
UGB : Université Gaston Bergé de
Saint-Louis
UICN : Union Internationale pour le Conservation de la
Nature
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture
USAID : Agence Americaine pour le Development International
uS/cm :Micro Siemens/Centimétre
UTM :Universal Transverse Mercator
WAAME: West African Association for Marine Environment
Avant-propos
Ce document est un mémoire de recherche de master
portant sur la dynamique des unités morphologiques le long de l'ile de
Diamniadio à Faoye (Saloum- Sénégal) de 1970 à
2020.
En effet, les milieux humides côtiersouest africainsen
général subissent depuis des décennies les effets des
modifications récentes du climat etde la dynamique marine.A l'image de
la sècheresse des années 1970, que le déficit
pluviométrique qu'en est suiviainsi que l'augmentationde la
température notée à l'actuel, bouleversent l'environnement
des milieux lagunaires, deltaïques et estuariens en particulier des
côtes sénégalaises.Ces milieux côtiers, à
l'égard de l'estuaire du Saloum, connaissent une disparition importante
desbandes sableuses côtières et littoralesdue essentiellement
à l'érosion côtièreet une dynamique progressive et
accélérée des terres salées. Ils voient aussi le
bouleversement de leur écosystème marinetde leur système
de production qui se manifestenotamment par la dégradation de la
végétation mangrove, des terres arables et des ressources
hydriques. Ainsi, minutieux de l'équilibre écologique, du
développement durable etdu bien-être de la société,
ce mémoireessaye d'analyser les facteurs et les impacts de la dynamique
des unités paysagères de la ligne Diamniadio Faoye depuis les
années de sècheresse (1970) à l'actuel (2020). Il revient
plus précisémentd'analyser, d'une part, les effets de la
péjoration climatique et de la dynamique marine sur l'évolution
progressive ou régressive des unités de paysage du milieu ainsi
que les actions anthropiques qui concourent à cette dynamique, d'autre
part, voir les impacts de ce phénomène sur l'homme, que ses
activités ainsi que son environnement avant d'énumérer les
stratégies développées face à cette dynamique.
Pour effectuer un tel travail, nous avons subdivisésce
mémoire en quatre axesprincipaux.Nous débutons par une
présentation du cadre physique et d'aspect humain du milieu
d'étude. Nous traitons par la suite l'état de la question,
fondement théorique et conceptuel du thème à
étudier. Nous allons détailler l'approche méthodologique
adoptée pour la réalisation de ce travail dans le
troisième axe avant de voir l'analyse, l'interprétation et la
discussion des résultats issues des données traitées.
Ce travail n'aurait pas pu s'effectuer rigoureusement et
sereinementsans de nombreuses collaborations et d'échanges
précieux effectuésavec de plusieurs structures et de personnes
à qui nous voulons exprimer toute notre profonde gratitude.
Remerciements
Il revientde remercier tout d'abord à notre très
généreux professeur Guilgane Faye de son soutien, sa
disponibilité et de la qualité des enseignements
dispensés.
Nos profonds remerciements s'adressent aussi à notre
professeur encadreur, un bon amimonsieur Cheikh Ahmed Tidiane Fayepour le
rôle unique et précieux qu'il a eu à jouer dans le cadre de
la préparation, le suivi et de la réussite de ce
mémoire.
Notre reconnaissanceva à l'endroitdes enseignants de la
géomorphologie du département de géographie de l'UCAD.
Nous désignons:messieurs Amadou Abou Sy, Seydou Alassane Sow et Mamadou
Thior.
Notre profonde gratitude à monsieur Mar Gueye, un
véritable tremplin dans la réussite de ce travail.
Notre reconnaissanceà l'ensemble du corps professoral
et du personnel du département de géographie ainsi qu'aux
personnes qui ont marqué leurs empreintes dans ce mémoire.
Notre reconnaissance s'adresse à mes camarades de la
deuxième année de Master géographie : Saye Ndiaye,
Aliou Sané et Amédée Balbine Ndeye, à toute ma
promotion et à tous les étudiants du département de
géographie de cette ladite université.
Notre reconnaissance à l'endroit du Doctorat Yatte, le
gérant du laboratoire du département de géographie de
l'UGB de toute sa contribution.
Nous remercions vivement les habitants des localités de
Diamniadio, Faoye et des iles du Saloum. Nous désignons : Maman
Fatou Sarr, Khassim Thiam, Diomaye Diome, Youssou Ndour, Tata Seynabou Diouf,
maman Khady Thiam, maman Awa Ndiaye, Père Moussa Sarr et Père
Doudou mais aussi à Aminata Ba et Diarra Diop de tout leur apport.
Toute notre profonde reconnaissance, notre gratitude
àtoute notre famille.
Dédicaces
Nous rendons grâce à Allah le Tout Puissant, le
Tout Clément, l'Unique et l'Eternel
A Cheikh Ahmadou Bamba notre guide.
Nousdédions ce mémoire :
A notrechèremèreNagoya Thiaw et notremaman Rokya
Sène
A notrepère Daouda Diouf, grand-mère Dieynaba
Ngom
A notregrand-mère Penda Diopet notre jumeau Abdou
Diouf
Sachant que nulle dédicacene puisseexprimer mes
sentiments, pour leur amour et leur soutien.
A tous mes frères et toutes mes soeurs : Papa
Diouf, Adama Diouf, Fatou Diouf, Mame Diarra Diouf, Ibrahima Diouf, etc.
A nos beaux pères et belles mèrespour l'amour,
l'éducation et le soutien qu'ils nous ont accordés.
A nos très chers Mbaye Fall, Madiao DieyeFallou Nayel et
Mbade Faye.
A nos tantes et oncles, à tous nos cousins et toutes nos
cousines pour leur amour et leur confiance envers nous.
A notre maman Ndoumbé Ndiaye ainsi que toute la
famille
A toute notre famille et tous nos proches
En leur souhaitant une longue et heureuse vie.
Enfin,
Nousrendons hommagenotre grand-frère (Ousmane Diouf) et
notre grand-père Madiouf Diouf.
Que le paradis soit votre éternelle demeure.
Introduction
Les oscillations récentes du climat et les
perturbations océanographiques affectent rigoureusement et
continuellement les milieux estuariens et deltaïques du domaine
intertropical. A l'image de la sècheresse des années 1970 et du
déficit pluviométrique durant ces dernières années,
combinés à la dynamique marine, modifient l'état naturel
des Rivières du Sud et celui des régions deltaïques des
côtes sénégalaises. Le delta du Saloum, érigé
en réserve biosphère en 1981 par l'UNESCO, puis en site
d'importance international en 1984 par la convention de RAMSAR (UICN, 2003),
s'étend sur plus de 90000 ha (DIARA, M. 1999) n'en reste pas
écarter. Ces conditions combinées, influent sur l'état
actuel de l'estuaire du Saloumentrainant ainsi une salinisation des terres et
des cours- d'eau, une érosion assez significative le long du rivage mais
aussi une évolution progressive ou régressive des
différentes unités paysagères qui y retrouvent. Cette
dynamique des unités a fait l'objet de plusieurs études
scientifiques : (Faye, G. 2016), (Faye, B. 2017), (Sow, E. H. 2019), ...
car constitue l'une des problématiques majores actuels de la
région du Saloum. Elle se manifeste dans la quasi-totalité par
une régression de l'écosystème marin et continental et une
perte de terres arables au profit des terres salées. La dynamique des
unités de paysage bouleverse alors l'équilibre écologique
et la biodiversité de la région du delta en favorisant la
disparition de certaines espèces marines et côtières et la
dégradation des terres et des eaux surfaciques. Et cela
représente un frein pour le développement de l'économie du
milieu sachant quel'agriculture (au sens large) occupe près de 90% de la
population totale du milieu (UICN,2003). Dès l'or, l'évolution
régressive des unités de vasières à mangrove, des
terres cultivables et de la végétation continentaleaux
dépens de l'extension très rapidedes terres salées(tannes)
ont occasionné des initiatives de restauration qui sont malheureusement
très limitées (Sow, E. H. 2019). C'est dans cet
intérêt que nous étudions la dynamique des unités
morphologiques le long de l'île de Diamniadio à Faoye. L'objet de
ce travail est donc d'expliquer la dynamique et ses facteurs afin d'analyser
ses impacts sur l'environnement et sur les activités
socio-économiques dans le milieu et les stratégies mises en place
par la population locale, l'Etat et les ONG. De ce, plusieurs méthodes
de collecte, de traitement (cartographique et statistique) et d'analyse de
données (quantitative et qualitative) sont adoptées afinde mieux
appréhender ce phénomène.
Pour mener à bien notre travail, nous allons d'une part
présenterles aspects physique et humaindu milieud'étude.En outre,
voirl'état de laquestion, fondement théorique et conceptuel du
thème. D'autre part, détaillerl'approcheméthodologique
adoptéepour établir ce travailavant de voirenfin l'analyse,
l'interprétation et la discussion des résultats obtenus.
Chapitre 1 :
Présentation du milieu d'étude
Ce premier chapitre est consacré à la
présentation du milieu. Il se débute par une fine
présentation géographique générale
c'est-à-dire la situation du milieu dans l'espace géographique.
Nous avons par la suite décrit son cadre physique et par la fin, voire
son aspect humain.
1.1. Situation du milieu d'étude
Notre milieu d'étude est le long de l'île de
Diamniadio à Faoye. Il se situe à cheval entre le
Département de Fatick et celui de Foundiougne de la Région de
Fatick (Sénégal). Il occupe une partie de la Commune de Djirnda,
une bonne partie de la Commune de Fimela et celle de Djilasse et une petite
portion de la Commune de Loul Sessene. Notre milieu d'étude est
constitué principalement de deux (2) localités. Le village de
Diamniadio au Sud avec1265 habitants en 2023 et la localité de Faoye au
Nord (1316 habitants). Il est parcouru du Sud au Nord par un cours
d'eauméandrique permanant, long de plus de 30 km, appelé bolong
ou marigot de Faoye. Le milieu d'étude s'étend sur une superficie
de 172,22 km² et comporte plusieurs unités
morphologiques telles que : les tannes, la vasière nue, la
vasière à mangrove, les chenauxde marée et les
cordons sableux. Il est limité au Nord et au Nord-est par les villages
de Ndoff et Sakhor Tocan et le marigot de Silif. Il est parcouru du Sud au
Sud-est par le fleuve Saloum. Il est limité au Sud-ouest par les
îles de Mar et à l'Ouest par le marigot de Simal. Avec une
altitude qui varie entre -4 et 11m, ce milieu d'un relief très base est
compris entre les latitudes 14°3'0'' et 14°13'30'' Nord et les
longitudes 16°31'0'' et 16°37'0'' Ouest.
Carte 1:Situation du milieu
d'étude
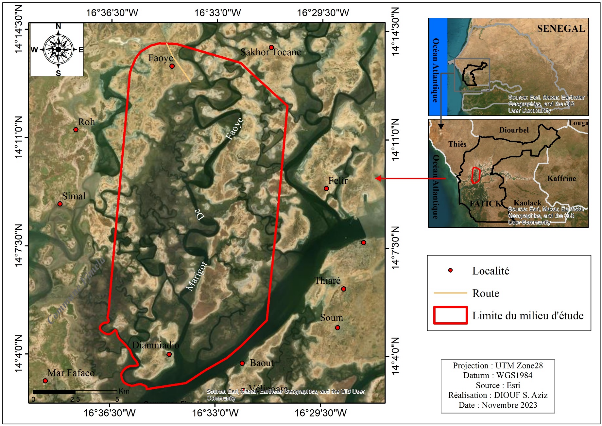
1.2. Le cadre physique
Il s'agit de l'étude de la géologie, la
géomorphologie, la pédologie, de la végétation, de
l'hydrologie et des conditions climatiques du milieu d'étude.
1.2.1. Géologie
Du point de vue géologique, le delta du Saloum s'est
développé vers 5500 BP sur la partie ouest du bassin
sédimentaire sénégalo-mauritanien ou bassin
secondaire-tertiaire, qui lui-même, recouvert par les dépôts
récents du Quartenaire.
1.2.1.1 Le bassin
sédimentaire secondaire et tertiaire
Un vaste bassin sédimentaire dont les sédiments
et les roches sédimentaires datent du Crétacé à
l'époque récente occupe plus des deux tiers du
Sénégal. Ce bassin est désigné sous le nom du
bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien, Stancoff A et al
(1985). Il s'étant au plus de 500 kilomètres depuis, la
côte jusqu'au bouclier du Sénégal oriental et se repose sur
un substratum d'âges plus anciens dont le sommet correspond aux
formations de l'ère primaire. On considère que toute la
séquence repose sur des sédiments et des roches
sédimentaires datant du Précambrien au Dévonien, Stancoff
A et al (1985). Mais seules les formations du Crétacé
Supérieur et du Tertiaire affleurent dans les régions
occidentales du Sénégal, Michel P (1973). Les terrains anciens,
birimiens à paléozoïques, n'affleurant qu'au Sud-est du pays
à la frontière avec la Guinée et le Mali, Faye B (2017).
Le bassin secondaire-tertiaire est largement recouvert par des
dépôts récents allant du Pliocène (sommet du
Tertiaire) au quaternaire. Il est composé principalement en surface par
des sédiments et des roches sédimentaires tertiare-quarternaires,
à l'exception d'une petite enclave de sédiments du
Crétacé Supérieur dans le Cap Vert. L'histoire structurale
du bassin n'est pas aussi simple. Il est largement faillé en particulier
dans la direction NE/SW et il est ou légèrement plissé ou
il est simplement affaissé par endroit, Stancoff A et al (1985). Le
bassin sénégalo-mauritanien est largement ouvert à l'Ouest
sur l'atlantique. Il serait né au mésozoïque pendant la
transgression Atlantique naissante. Lors de l'ouverture de l'Atlantique, c'est
lerejet de failles transformâtes qui provoque l'effondrement de la marge
et la mise en place desbassins sédimentaires côtiers (Jacobi et
Hayes, 1982 ; cité par Mariline Diara en 1999). Son histoire remonte du
Crétacé au Tertiaire. Au Crétacé, le bassin est
bien développé sur l'arrière-pays, Diara M (1999). A l'Est
et au Sud-est, il est limité par la chaîne hercynienne des
Mauritanides et le bassin de Taoudéni. Au Sud par le bassin de
Bové et au Nord et au Nord-Est par le bassin d'Aaiun et la dorsale de
Reguibat.
1.2.1.2
Paléogéographie du delta du Saloum
Le delta du Saloum s'est mis en place dans une marge
atlantique passive caractérisée par une relativestabilité
tectonique (Diara M. 1999). Il serait développé pendant le
Quaternaire en général et le Quaternaire Récent en
particulier. Cet épisode géologique est marqué par de
variations du niveau marin et de fluctuations climatiques c'est-à-dire
par des successions de séquences d'intrusion et d'extrusion de la mer et
de périodes sèche et humide. Sa configuration actuelle
résulte de l'histoire quaternaire de cette région, marquée
par des variations du niveau marin et des changements climatiques (Diarra M.
1999). Le Quaternaire ancien est probablement constitué par des niveaux
transgressifs très faiblement étagés, disposés le
long des rivages des anciens golfes (Barusseau el al. 1999 ; cité
par Diarra M. 1999). Selon le même auteur (Mariline), c'est au
Quaternaire récent (postglaciaire et Holocène) que la
morphogenèse littorale des systèmes estuariens est
déterminante ; confirmé par Guilgane Faye lorsqu'il disait en
2016 que : « Le Quaternaire Récent est le principal
vecteur de la mise en place du réseau hydrographique du
Saloum ».
*Au début de l'Holocène, notamment à la
pluvial Tchadien (10000 ans - 6800 ans BP), les réseaux hydrographiques
du Sine, du Saloum et du Khombole seraient mise en place. Cette période
humide a suivi une longue séquence très aride, remontant à
13000 ans BP, marquée par une intensification des actions
éoliennes : c'est l'Ogolien ou la phase ogolienne. Les
réseaux hydrographiques du Sénégal se constituent de la
fin du Pléistocène au début de l'Holocène
après plusieurs phases d'entailles dans les basses terrasses (Diara M.
1999). Dans le milieu, ces phases de creusement se manifestent par le marigot
de Faoye qui était la partie la plus en aval du réseau
hydrographique du Khombole. Le Khombole serait probablement comblé
durant les grandes périodes arides qui ont suivi le Nouakchottien
(Tafolien, 4000 ans, Dakarien, 2000 ans). A l'actuel, cette partie avale reste
toujours témoin et constitue aujourd'hui le marigot de Faoye. Les
réseaux hydrographiques encadrés en rouge, présents dans
la figure 8, illustrent le paléo cours-d `eau de Khombole : Sa
partie en amont, actuellement meurt, la portion en aval marque l'actuel Marigot
de Faoye.
Figure
1: Le Paléo réseau du Sine/Saloum/Khombole
Actuel Marigot de Faoye
LE KHOMBOLE
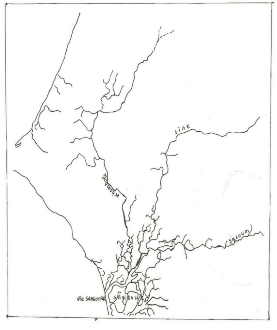
Sall MM et Diop E S (1977) échelle 1/1000000.
*A l'Holocène moyen, une période humide
généralisée en Afrique de l'Ouest (Barbey, 1982, Diara M.
1999), la remontée marine crée des golfes. Période pendant
laquelle, la mer a avancé jusqu'à plus de 200 km de la côte
actuelle. Le plus haut niveau marin (1,5 à 2 m I.G.N) est atteint vers 5500 ans B.P. ; c'est le
maximum transgressif du Nouakchottien. Selon Guilgane (2016), cette
transgression remonte, dans le Saloum, les réseaux hydrographiques
déjà constitués et favorise une sédimentation
marine et un colmatage dont la terrasse de Djirnda est le témoin.
*Au Tafolien (4000 - 3000 ans B.P), correspondant à
l'épisode semi-aride survenu au cours de la période
postnouakchottienne au Subactuel. Le climat devient plus sec au Dakarien (3000
ans à 2000 ans BP). Selon Mariline Diara (1999), dans la partie
septentrionale de l'Afrique de l'Ouest, l'aridification croissante a, d'une
part, inversé le fonctionnement du système estuarien du Saloum
et, d'autre part, favorisé une sédimentation plus
grossière ; la formation de cordons littoraux dans les anciens
golfes, tandis que des sédiments vaseux se déposent dans les
zones abritées, en arrière des cordons. Ces deux formations
recouvrent exclusivement la totalité de la surface de notre milieu
d'étude (Cf. Carte 2).
*Le subactuel est marqué par une dynamique qui se
manifeste par une extension des vasières à mangroves et une
variation de la forme des chenaux à marée par recoupement de
méandres. Selon Bineta Faye (2017), leur dynamique actuelle est
consécutive aux déficits pluviométriques marquant les
années 1970. Ces fluctuations climatiques ont favorisé aussi la
dynamique des terrains salés, constitués le plus souvent
d'anciennes vasières.
1.2.1.3 Formations
géologiques du milieu d'étude
Les formations géologiques qui affleurent dans notre
milieu d'étude datent du Quaternaire récent, notamment à
l'Holocène. Ils se manifestent largement par les formations
deltaïques et légèrement par les formations littorales.La
formation deltaïque se caractérise par des vases et sables
coquilliers des slikkes, schorres et lagunes inters distributaires. Cette
formation, plus ancien que la formation littorale, est le substratum de la
localité de Faoye.La formation littorale est représentée
par les sables des plages et des cordons dunaires : barrières
littorales. Cette formation est piégée entre les formations
deltaïques et correspond à la plus récenteempreinte marine
post-transgressive régularisant le littoral.
1.2.2. Géomorphologie
Cette partie consiste à voir la topographie, la
morphométrie et la morphologie du milieu. Il s'agit alors de la
présentation du relief et des unités morphologiques de notre
milieu d'étude.
1.2.2.1 Topographie et
Morphométrie
Le delta du Saloum est un domaine margino-littoral à
topographie basse. Il se subdivise en trois grandes iles telles que les iles de
Fataya, Betanti et les iles Gandoul, séparées 3principaux
cours-d'eau: le Bandiala au sud, le Diomboss au milieu et le Saloum au nord.
Ces cours-d'eau se différencient clairement mais interconnectés
par plusieurs cours-d'eau secondaires appelés bolong ou chenaux à
marée. Notre milieu d'étude se localise dans la région
nord des iles Gandoul. Le relief du milieu est essentiellement plat et compris
entre les altitudes - 4 et 11m. Les partiesles plus élevées
correspondent aux cordons sableux. Leur altitude varie de 5 à 11 m. Ils
se localisent généralement au nord-est de la localité de
Faoye et à l'est de son marigot. La partie comprise entre 2 et 4 m
corresponde aussi visiblement aux barrières sableuses et parfois aux
tannes herbues. Les zones les plus basses constituent les milieux submergeant
fréquemment tels que les vasières, les tannes vives inondables et
les chenaux. Leur élévation est inférieure au niveau de la
mer (-4m). Le milieu se situe alors dans une plaine alluviale à
très basse altitude. La vallée est drainée par un lacis de
bolong anastomosés c'est-à-dire qui se divisent et se rejoignent
fréquemment, tronçonnant les cordons mais aussi par un
réseau principal sinueux et permanant : le chenal de Faoye.
Carte 2:Topographie de l'espace
étudié
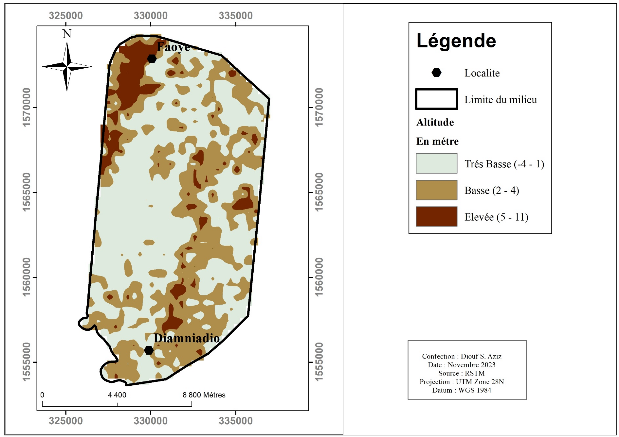
1.2.2.2 Unités
morphologiques
Du point de vie de la morphologie, le domaine se voit par les
formes principales telles que : les vasières, les tannes, les
cordons sableux, les amas coquilliers et les
chenaux. Elles se sont mises en place depuis le quaternaire récent et
obéissent aux fluctuations du niveau de la mer.
1.2.2.2.1 Les chenaux
Les chenaux à marée, appelés aussi
bolong, constituent les ramifications généralement sous forme de
méandres des bras de mer. Dans le milieu, Ils correspondent aux milieux
les plus bas (-4m) et obéissent à l'influence marine. Les chenaux
se voient par de lacis de bolong (petits bolong) anastomosés,
tronçonnant les cordons et d'un chenal principal : le marigot de
Faoye. Au bord des chenaux se fixent les vasières.
1.2.2.2.2 Les vasières
Elles sont retrouvées au long du bolong de Faoye et un
peu partout au niveau des lacis de chenaux de marée dispersés
dans le milieu. Les vasières ourlent les chenaux de marée et
correspondent sur le plan morphologique aux parties basses couvertes ou
découvertes par les pleines mers moyennes de vive-eau (PMVE) et les basses mers moyennes de vive-eau (BMVE).
Malgré leur topographie assez monotone, on peut les subdiviser en basse slikke (basses vasières), correspondant
à la vase nue découverte à marée basse,
situées entre BMVE et la haute mer de marée moyenne (PMME) et
enhaute slikke (hautes vasières), couverte
de mangrove, situées parfois entre les BMVE et les PMVE, ou dans des
étendues plus restreintes entre les PMME et les PMVE. Du point de vue de
la végétation, on retrouve les vasières nues
dépourvues de végétations et les vasières à
mangrove constituées des espèces du genre Rhizophora et
Avicennisa. Les vasières sont
constituées de matières organiques, de vase le plus souvent en
association avec des sables très fins à débris calcaires.
Elles correspondent alors à l'actuelle slikke et comprise entre
marée haute et marée basse quotidiennes. Entre les
vasières et les cordons sableux se trouvent des terrains nus connus sur
le nom de Tanne.
Planche de photos 1:Vasière
nue et vue de la mangrove au village de Diamniadio
Vue de la vasière à mangrove
Vasière nue
 
Crédits photos : Diouf S. A., 2023
1.2.2.2.3 Les
tannes
Les tannes correspondent à des étendues
salées, à très faible altitude, qui s'étendent
entre les vasières et les cordons sableux. Elles peuvent être
subdivisées en deux unités sue le plan
phytogéographique : les tannes nues, bordant justement la zone de
la vasière, constituées de terrains salés dépourvus
de végétation et couverts par les PMME et les tannes herbues,
généralement entre les tannes nues et le pied des
barrières sableuses. Les tannes sont souvent d'anciennes vasières
et correspondent, en milieu tempéré, au schorre. Elles occupent
la quasi-totalité de la partie nord, une bonne partie à l'Est et
au Sud du milieu. Les tannes s'étendent alors sur les zones extra et
supra tidale. A l'arrière des tannes se localisent des barrières
sableuses : les cordons sableux et parfois les amas coquillers.
Photo 1:Séquence de Tanne nue
et Tanne herbue à Faoye
Tanne nue
Tanne herbacée à arbustive

Crédit photo : Diouf S. A., 2023
1.2.2.2.4 Les
cordons sableux
Les cordons sableux délimitent le domaine marin
proprement dit du domaine fluvio - marin soumis à la déflation
éolienne et parfois colonisé par une végétation
pionnière. Ils constituent les unités géomorphologiques
les plus élevées du delta du Saloum. Les cordons sont parfois
piégés entre les chenaux de marée. Ils constituent de ce
fait de petits iles (ilots) ou de barrière simple. Les cordons se
retrouvent au Sud, en particulier au village de Diamniadio et au Nord-est du
milieu, notamment à Faoye. Ils se localisent à l'Est du marigot
de Faoye, constituant le foret de Mbolongass et de Niax Niaxal. Selon Mariline
Diara, (1999), les cordons sableux au nord du delta sont très
dégradés. Ils ne montent pas de géométrie
particulière ni de direction privilégiée. Leur altitude
est faible. Les tannes, au contraire, sont bien développées et
séparent les vasières aux cordons.
Cordon sableux au nord-est de la localité de
Diamniadio-forêt de Mbolongass
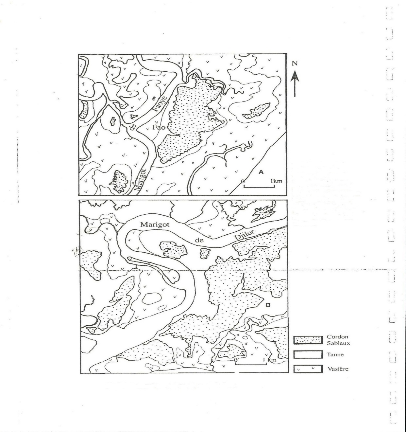
Figure
2:Les cordons sableux du Nord du delta du Saloum (Diarra M., 1999)
1.2.2.2.5 Les amas
coquilliers
Les amas coquilliers, aussi appelés kioekkenmoeddings,
sont des formes d'origine humaine liées à l'exploitation de deux
mollusques : Anadara senilis et Gryphea gasar (Thiam M. Demba, 1986). Au
total 96 accumulations ont été recensées dans le secteur
deltaïque du Sine et Saloum. On leurs a donné plusieurs noms,
notamment ceux de tumulus coquilliers, faluns et sambaqui ; parce
qu'après leur édification, ils ont servi de monuments
funéraires selon Mame Demba Thiam (1986). Il y ajoute que la chronologie
de leur mise en place présente plusieurs inconnues. Dans le milieu,
cette forme unité morphologique se voit aux bords des chenaux à
marée et spécifiquement aux alentours de la localité de
Diamniadio. Elle constitue alors les bergs de ces cours d'eau et recouverte
pour la plus part par les sables des cordons dunaires où elle est
piégée (Cf. Photo 3).
Photo 2: Amas coquilliers au nord-est
de Diamniadio
Amas coquilliers dans le berg droit du marigot de Faoye, à
la forêt de Mbolongass (nord-est de Diamniadio)

Crédit photo : Diouf S. A., 2023
La carte d'occupation du sol (données issues du CSE,
2021) de la zone d'étude illustre nettement ces différentes
unités morphologiques qui y sont retrouvées. Elles constituent
des unités de tannes, de la vasière nue, de la vasière
à mangrove, de la végétation continentale, des terres de
cultures (terres cultivées + bâtis) et des chenaux à
marée. Les eaux de surfaces constituent l'unité la plus
importante et représentent les 39% de la surface du milieu. La
vasière nue venue en deuxième place et occupe les 24% de la
surface totale, elle est suivie par les tannes (nue et herbue) qui se voient
avec 17%. La végétation continentale qui renferme la prairie, le
couvert arboré et la végétation arbustive, ne regroupe que
13%. La vasière à mangrove et les terres cultivables sont les
unités les moins importantes et représentent respectivement 5% et
2% de la surface du milieu d'étude. Cette disparité, entre les
unités, constitue l'une des problématiques
géomorphologiques majores des milieux humides côtières.
Carte 3:Occupation du sol dans le
milieu d'étude
Légende
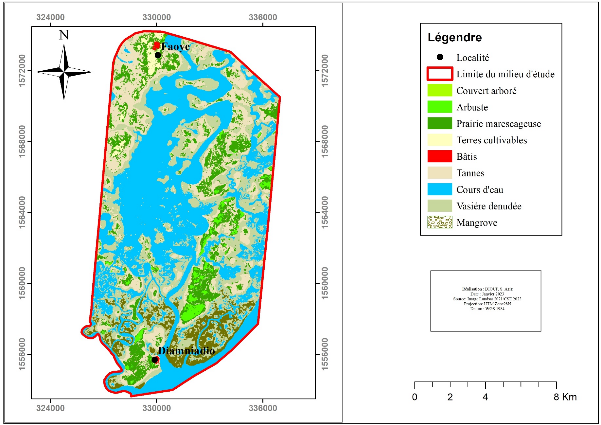
1.2.3. Les sols
Le sol du delta du Saloum se caractérise en
générale par la présence de sel due à la dynamique
marine du milieu, très diversifié suivant les unités
morphologiques du Delta. Notre milieu d'étude présente une
pluralité pédologique suivant principalement les unités
morphologiques du milieu. Il s'agit les sols
ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés, les sols halomorphes salins
acidifiés et sols hydromorphes organiques, les sols hydromorphes Gley
salé et sols halomorphes salins hydromorphes et enfin, les sols
halomorphes salins hydromorphes moyennement salés.
1.2.3.1 Les sols ferrugineux tropicaux non ou peu
lessivés
Les sols ferrugineux non ou peu lessivés,
appelés aussi sols Dior, occupent une petite surface dans le milieu et
correspondent aux parties les plus élevées. Leur topographie
varie entre 5 et 11 m et se voientnettement dans les dunes de
l'intérieur ou dans cordons sableux. Selon Bineta Faye (2017), ce sont
des sols profonds, bien drainés, perméables, faiblement
structurés. Ils sont riches en matière organique et très
aptes à la culture de l'arachide et du mil, telles en sont les
principales cultures de la localité de Faoye. Ces sols sont cependant
très vulnérables face à la pression humaine et à la
dynamique progressive du sel frappant dans le milieu.
1.2.3.2 Les sols halomorphes salins hydromorphes moyennement
salés
Les sols halomorphes salins hydromorphes moyennement
salés correspondent nettement, dans le milieu, aux cordons sableux. Ce
sont des sols assez élevés, très riches en matière
organique et faible en matière chimique. Ils sont constitués par
le foret de Mbolongass et de Niax Niaxal à l'est du chenal principal et
à la savane de Diamniadio au sud du milieu. Ils sont alors de sols
cultivables et occupent les parties dont la végétation est
très évoluée.
1.2.3.3 Les sols hydromorphes gley salé et sols
halomorphes salins hydromorphes
Les sols hydromorphes gley salé et les sols halomorphes
salins hydromorphes renferme la quasi-totalité de la partie nord et de
l'ouest du milieu. Ce type de sol occupe le deuxième rang dans le milieu
en termes de surface. Ce sont de sols à topographie basse et
correspondent morphologiquement aux tannes et parfois à la
vasière ancienne. Leur évolution est essentiellement
affectée par la forte présence de sel. Ce sont des sols
très riches en matière chimique.
1.2.3.4 Les sols halomorphes salins acidifiés et sols
hydromorphes organiques
Les sols halomorphes salins acidifiés et les sols
hydromorphes organiques correspondent au type de sol le plus fréquent
dans le milieu d'étude. Ils sont retrouvés au centre le long du
bolong de Faoye, au sud, entourant la localité de Diamniadio et à
l'extrême est du milieu. Ce sont des sols à relief très bas
et correspondent aux vallées sèches anastomosées (à
l'ouest du marigot) et aux zones de vasière. Ce sont des sols dont
l'évolution et les propriétés physico-chimiques sont
affectées par la dominance de sel. Ils constituent le type de sol
où s'est développée la végétation de
mangrove.Carte 4:Types de sols du milieu
d'étude
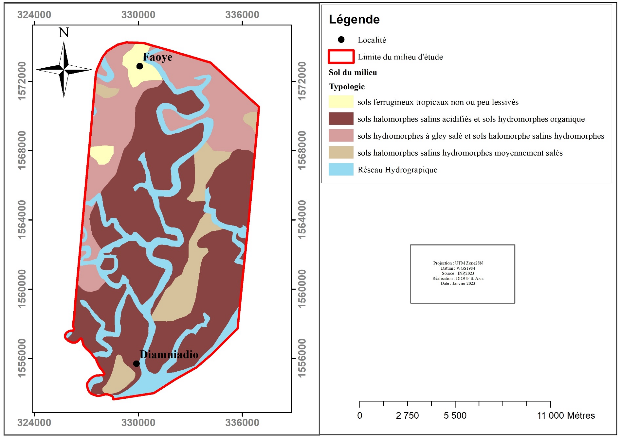
1.2.4. La
végétation
Levégétation du milieu n'est pas uniforme. Il
s'est très distribué dans l'espace suivant les différentes
unités morphologiques du milieu. Il est principalement constitué
de mangrove, de la savane arborée et arbustive et de la prairie
marécageuse (Cf. carte 6).
1.2.2.1 Les formations de mangrove
Les formations de mangrove constituent la principale formation
végétale des zones submersibles. Elle est la
végétation caractéristique des domaines estuariens et est
retrouvée spécifiquement au sud du milieu d'étude, au tour
de la localité de Diamniadio. Elle se localise essentielles entre les
chenaux de marée et les tannes ou les anciennes vasières. Elle
est la bordure immédiate des bolong et la formation typique poussant sur
la vase (vasière). La mangrove est constituée des espèces
du genre Rhizophora et Avicennisa. Les principales essences de mangroves
peuvent être représentées par six (6) espèces :
Avicennisa germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, Rhizophora
harrisonii, Rhizophora mangle et Rhizophora racemosa. Elle a un rôle
capital sur la reproduction des poissons et d'autres espèces marines en
leurs fournissant de refuges, d'habitats et d'aliments. La mangrove offre aussi
une protection forte contre les conditions géomorphologiques
extrêmes du milieu à l'image de l'avancée de la langue
salée et l'érosion des côtes. Elle est utilisée dans
de nombreux domaines tels que : le chauffage, la construction comme
poteaux et couvertures de toit, etc. Cet ensemble d'atouts la confère
une place incontournable dans la stabilité de la biodiversité et
développement économique et sociale du milieu. Par contre, ces
qualités sont également un inconvénient majeur car, de ce
fait, la mangrove subit de pression de toute nature (anthropique, naturelle,
écologique, etc.). Et cela entraine sa réduction voire sa
disparition dans le milieu.
1.2.2.2 Les formations continentales
- La végétation arborée, la
végétation arbustive et la prairie marécageuse constituent
les formations végétales des zones immersibles. La
végétation arborée est la moins représentatif dans
le milieu. Elle se voit principalement au Nord et est constituée des
espèces hautes comme le Kadd, le Baobab, le Tamarinier, le Darkase et le
Nima, le Soum, le Manguier et le Ndoff. La végétation arbustive
est la plus rependue. Elle se retrouve au sud dans la localité de
Diamniadio, une bonne partie à l'Est le long du marigot de Faoye. Cette
formation se voit sur les parties les plus hautes du milieu, correspondant aux
cordons sableux. Elle regroupe les plus grandes formations
végétales du milieu comme le foret de Mbolongass et de Niax
Niaxal à l'Est du chenal principal. Les espèces arbustes
rencontrées sont essentiellement le Prosopis africana à
l'arrière-pays de Diamniadio, l'Acacia seytal (Suruur) majoritairement
dans la forêt de Mbolongass et celle de Niax Niaxal au Nord et l'Arbre
à sel quasiment partout dans le milieu. D'autres espèces comme le
Baobab y sont retrouvés. Ces deux grandes formations s'interposent donc
dans les parties les plus hautes.
Planche de photos 2 :
Végétation arbustive du foret de Mbolongass (gauche) /
Interposition entre couvert arboré et arbustif à Faoye
(droite)
 
Crédits photos : Diouf S. A., 2023
La prairie marécageuse est la plus repartie dans la
zone. Elle se retrouve dans la quasi-totalité du milieu. Le couvert
végétal consiste en un tapis herbacé à base de
Cypéracées et Graminées. Elle constitue de zones assez
basses et souvent submergées par l'eau pluviale. Les prairies
marécageuses sont des espaces humides et parfois inondables
présentant des cortèges floristiques trèsriches. Elles ont
une donc très grande quantité de biomasse, très
précieuse pour l'alimentation du bétail.
Planche de photos 3: prairie
marécageuse à Diamniadio à gauche et à Faoye
à droite
 
Crédits photos : Diouf S. A., 2023
La végétation s'est très répartie
dans l'espace suivant les différentes unités morphologiques du
milieu. La végétation de mangrove constitue la principale
formation végétale des zones submersibles et les couverts
arboré et arbustive et la prairie marécageuse, les formations
végétales des zones immersibles.
Carte 5:végétation
du milieu d'étude
Légende
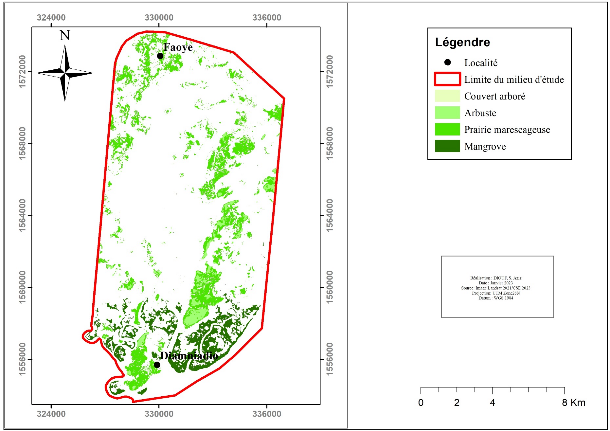
1.2.5. Les
ressources hydriques
Les ressources hydriques du milieu comprennent à la
fois les nappes d'eau souterraines et les eaux de surface.
1.2.5.1 Les eaux souterraines
Les eaux souterraines sont composées de trois
formations aquifères distingues selon leur profondeur. Elles constituent
de la nappe profonde, les semi-profondes et la nappe superficielle.
1.2.5.1.1 La nappe
profonde
L'aquifère le plus profond est celle du Maestrichtien.
C'est une nappe très épaisse avec une épaisseur qui varie
entre 200 et 250 m (Faye Bineta, 2017). Elle se localise à des
profondeurs supérieures à 200 m en moyenne et fournit des
débits très élevés. Cette nappe est captée
par des forages entre 200 et 450 m dans la moitié de la région du
Sine. Selon Faye Bineta (2017), in Ndoye S. 2003, les forages bien que captant
les niveaux supérieurs du réservoir donnent facilement des
débits de 150 à 250 m3/h. L'aquifère est
constitué de sables avec des intercalations d'argiles et parfois
à des formations marneuses.
1.2.5.1.2 Les
nappes semi-profondes
Les nappes semi-profondes constituent la nappe du
Paléocène, du Miocène et la nappe du Continental
Terminal.
1.2.5.1.2.1. La
nappe du Paléocène
La couche aquifère du Paléocène devient
aquifère dans le Département de Fatick plus
particulièrement dans les Arrondissements de Fimela, Niakhar et
Tattaguine (Faye B. 2017). Elle est captée par des forages de 50
à 200 m avec des débits généralement moins de 50
m3/h. De 55 à 63 m dans la Commune de Loul Sessene et de 50
à 191 m dans la Commune de Tattaguine, la nappe est presque partout
saumâtre (1 500 à 2 000 mg/l), à salée (10 000
mg/l à Samba Dia et 3000mg/l à Djiffer (Faye B. 2017, in Conseil
Régional de Fatick 2001).
1.2.5.1.2.2. La
nappe du Miocène
Le réservoir est constitué de sable
Miocène. C'est une nappe assez profonde (-150 m de profondeur) et peu
productive. Selon le Conseil Régional de Fatick (2001), cité par
Bineta Faye en 2017, sur les sept reconnaissances effectuées, seul le
puits de Gawane dans l'Arrondissement de Mbadakhoune donne un débit
intéressant avec 22 m3/h. c'est une nappe douce mais
salée dans la frange maritime.
1.2.5.1.2.3. La
nappe du Continental Terminal
La nappe du Terminal Continental est constituée des
dépôts de sable de cet épisode géologique. C'est une
nappe peu profonde (ne dépassant pas 100 m de profondeur) avec des
débits très favorables où l'eau est de très bonne
qualité. Selon Faye Bineta (2017), la nappe du Continental Terminal est
rencontrée dans les sables entre 30 et 70 m de profondeur. Les
débits obtenus (30 à 75 m3/h) suffisent largement
à la couverture des besoins de l'hydraulique villageoise.
1.2.5.1.3 La nappe
superficielle
La nappe superficielle, appelée aussi nappe
phréatique, est l'aquifère la plus superficielle. Sa profondeur
est faible et ne dépasse généralement pas 50 m de
profondeur. Elle se voit dans les alluvions du quaternaire. Elle est
captée par des puits à de faibles profondeurs. Dans la
localité de Faoye, la profondeur de la nappe varie de moins 5 à
20 m et est captée par des puits de 5 m de profondeur (Faye B. 2017).
Par contre, de par sa faible profondeur, la nappe est très
menacée dans le milieu et cela due particulièrement par
l'intrusion de l'eau des chenaux de marée du Saloum. La nappe est
presque partout salée, ce qui constitue un frein pour la consommation
paysanne. Selon Bineta Faye (2017) les conductivités électriques
de la nappe varient de moins 750 uS/cm à plus de 3 000 uS/cm dans les villages du Département de
Fatick. Selon les enquêtes effectuées par Guilgane Faye (2016) sur
l'eau des puits, les puits d'eau saumâtre sont rencontrés à
Faoye à des profondeurs qui varient entre 6 à 7 m. Dans la
localité de Diamniadio, les puits sont fermés, ce qui fait
qu'elle est alimentée en eau depuis le Lac de Guiere.
1.2.5.2 Les eaux de surfaces
Les eaux surfaciques renferment toutes les eaux
retrouvées à la surface du sol du milieu. Elles sont
constituées de la ria du Saloum et ces défluents (le marigot de
Faoye) qui sont permanentes et les eaux temporaires regroupant les plans d'eau
temporaires.
1.2.5.2.1 Les eaux
temporaires
Les plans d'eau tempérais sont des surfaces inondables
temporairement. Elles se localisent essentiellement à l'Ouest le long du
marigot de Faoye. Ces plans d'eau correspondent aux vallées
sèches au pied de ce marigot. Ils sont pour la plupart submergés
pendant la période des hautes eaux. Ils sont alimentés
majoritairement par le marigot de Faoye et ses défluents. Leur eau
temporaire peut être aussi saisonnière et cela, pendant la saison
pluvieuse. Ils constituent des parties basses correspondant au niveau du
drainage des eaux pluviales ou d'étendues à quelques
mètres de profondeur où stagne l'eau de la pluie pour un certain
temps.
Planche de photos 4:Plans d'eau
à Faoye
Plan d'eau à l'intérieur de la localité
A l'arrière nord de Faoye
 
Crédits photos : Diouf S. A., 2023
1.2.5.2.2 Les eaux
permanentes
Les eaux permanentes sont constituées essentiellement
par le marigot de Faoye. Il parcourt le milieu du sud au nord et le divise en
deux parties quasiment égales. C'est un cours d'eau de forme
méandreuse long environ plus de 30km tenant compte des méandres.
Ces eaux sont aussi représentées dans le milieu par les
défluents du bolong. Ces défluents se voient entièrement
à l'ouest, constitués de petits chenaux anastomosées
formant un lacis de chenaux. A ceux-là, s'ajoutent quelques
défluents à l'Est et principalement, ceux du marigot de Silif. La
partie sud est parcourue par la ria du Saloum.
- Carte 6:Les eaux surfaciques du
milieu
Légende
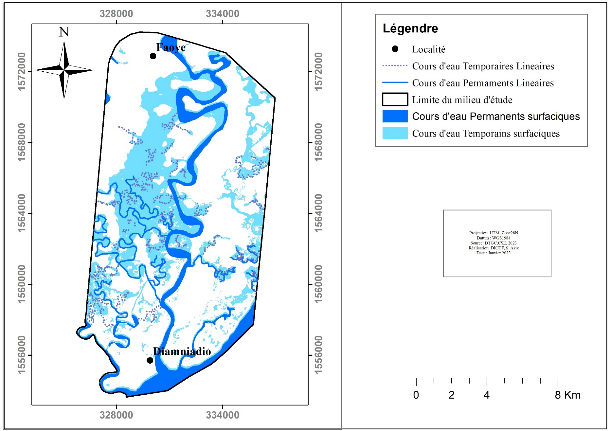
1.2.6. Le
climat
Il s'agit de la présentation des facteurs
généraux de la circulation atmosphérique intertropicale et
des différents paramètres du climat.
1.2.6.1 Les facteurs généreux
Notre milieu d'étude se trouve à l'ouest
africain, appartient alors à la zone intertropicale. Comprise entre les
deux tropiques, elle est influencée de part et d'autre par les hautes
pressions tropicales nord et sud, entourant les basses pressions
intertropicales. Le transfert d'énergie ou la circulation des flux
s'effectue, en surface, des HPT vers les BPIT, inversement en altitude. Les
circulations atmosphériques, sur l'ouest africain, est commandée,
comme l'ensemble de la zone intertropicale par la double ceinture des hautes
pressions qui séparent, à la latitude des 30 à 40
-ème parallèles, les domaines intertropical et extratropical,
Jean Le BORGENE (1987). Les hautes pressions sont d'origine dynamique et
thermique. Elles sont constituées par la cellule anticyclonique
permanente des Açores et celle semi-permanente libyenne de
l'hémisphère nord et celles de Sainte-Hélène de
l'hémisphère sud. Ces cellules organisent la circulation ouest
africain en général et du milieu d'étude en particulier.
Comme l'ensemble du domaine climatique nord-soudanien, le milieu se
caractérise par deux saisons, induites par le mouvement zénithal
du soleilselon Pascal Sagne (1988), avec des précipitations variantes
entre 1 000 et 600 mm. Cela est soutenu par A. T. Diaw et al. (1992),
lorsqu'ils disaient qu'on retiendra la partition de l'année en deux
saisons dans la zone tropicale, sèche et humide, allant respectivement
de novembre à mai et de juin à octobre, avec l'alternance de
l'influence des anticyclones des Açores et la cellule saisonnière
maghrébine d'une part, et d'autre part celui de
Sainte-Hélène. En Janvier, correspondant à l'hiver
boréal, les anticyclones de l'hémisphère nord ont leur
maximum de puissance due au refroidissement du stratum et à leur
renforcement par les expulsions polaires. La cellule des Açores migre
vers l'équateur géographique et celle de Maghreb apparait. Les
flux NW et NE ou d'alizé dominent et poussent l'équateur
météorologique plus proche de l'équateur
géographique. En Juliet, été boréal,
l'intensité de ces cellules diminue, ce qui signifie leur
décalage vers les pôles. L'anticyclone de Saint
Hélène reprend le relais et repousse l'EM au-delà au nord
de l'équateur géographique. La région passe au
régime de mousson, flux chaud et humide et porteur de
précipitation. Ces flux sont toujours séparés par l'EM. Sa
migration de part et d'autre de l'équateur géographique
révèle les caractéristiques du climat du milieu. Selon
Jean Le Borgne (1987), ce sont les migrations de l'équateur
météorologique, au cours de l'année, qui expliquent donc
les profonds contrastes saisonniers et spatiaux qui caractérisent les
climats de l'Afrique de l'Ouest et celui de la Sénégambie en
particulier.
1.2.6.2 Les éléments du climat
Les éléments du climat sont des grandeurs
physiques mesurables ou des phénomènes repérables qui
caractérisent l'état de la basse et moyenne atmosphère.
Chaque zone climatique présente des spécificités qui
découlent de la combinaison de plusieurs éléments. Il
s'agit principalement des vents, de la température, des
précipitations, de l'évaporation, de l'insolation et de
l'humidité relative. Leur variabilité peut être horaire,
journalière, mensuelle ou annuelle.
1.2.6.2.1 Les
Vents
Le vent est de l'air en mouvement dans l'atmosphère,
animé d'une direction et d'une vitesse. Ces caractéristiques du
vent varient selon les saisons. Le tableau 1 et le figure 3 illustrent cette
situation.
*De Novembre à Mai, la direction des vents est en
dominante N. Les vents soufflent essentiellement du N à E durant les
mois de Novembre, Décembre et Janvier. Et de direction N à NW, en
dominante NNE en Février, du N à W (Mars, Avril), de N à
SW, durant les mois de Mai et d'Octobre. Ces flux sont ceux des alizés.
L'alizé maritime continentalisé souffle de Novembre à
Janvier. Ce vent est sec et chaud et très rapide. Sa vitesse est
très grande, avec un maximum de 2,8m/s en Janvier, ce qui traduit son
port de brume sèche. De direction NW, l'alizé maritime
océanique souffle, principalement dans le milieu, pendant les mois qui
viennent juste avant et après la saison de la pluie (Avril, Mai et
Octobre). Il est frais et humide et peut être porteur de la rosée
et parfois de brouillards. Les deux alizés sont présents,
à la fois dans les mois de Février et d'Octobre. Le mois de
Février constitue le passage d'un alizé maritime
continentalisé à un alizé maritime océanique et
inversement pour le mois d'Octobre.
*Le mois de Mai, où les vents sont orientés du N
au SW, en dominante N et NW, constitue la transition entre la saison
sèche et cellepluvieuse. La mousson, extrêmement faible durant
cette période, souffle en même temps que l'alizé.
*De Juin à septembre, la direction dominante est celle
SW. Cette période correspond à l'été
c'est-à-dire à la saison pluvieuse. La mousson prend le relais
sur les alizés. Elle est de direction S à W, chaud et humide et
est porteur de précipitation. C'est le flux qui arrose donc le milieu
due à l'émigration de l'équateur
météorologique au nord de la zone. Sa vitesse est très
faible avec un minimum de 2,1m/s en Aout et Septembre et un maximum de 2,4 en
Juillet.
*Le mois d'octobre est également une phase de
transition entre la saison pluvieuse et la
saison sèche,
annonçant le retour des alizés. Sa direction est du S au N avec
une dominante NW. L'alizé et la mousson soufflent aussi en même
temps durant cette période.
Le milieu est donc parcouru par différents types de
vents selon les saisons tels que les alizés (Novembre à Janvier)
et la mousson (Juin à Septembre). Avec des directions nord-est,
nord-ouest et sud-ouest en générale et des vitesses minimale de
2,1m/s et maximale de 3,1m/s, leur vitesse moyenne est de 2,6m/s de 1991
à 2020.
Tableau 1:Moyenne inter-mensuelle
de la vitesse des vents dans la station de Fatick en m/s (1991-2020)
Vitesse
|
Mois
|
Jan
|
Fév.
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
Juill.
|
Août
|
Sept
|
Oct.
|
Nov.
|
Déc
|
Moy
|
|
Vitesse en m/s
|
2,8
|
3,1
|
3,0
|
3,1
|
2,9
|
2,8
|
2,4
|
2,1
|
2,1
|
2,2
|
2,2
|
2,5
|
2,6
|
Source : (ANACIM, 2023)
Direction
Figure
3:Directions dominantes du vent à la station de Fatick en pourcentage
(moyenne 1991-2020) ; ANACIM, 2023
1.2.6.2.2
L'insolation
L'insolation désigne la durée de
l'ensoleillement mesurée en heures. La moyenne annuelle de l'insolation
est de 7,6 heures de 1991 à 2020. Les valeurs sont très
importantes et varient entre 6,1 à 12,8 heures. Cela variation montre
nettement une double séquence par rapport à la moyenne de la
série qui mesure 7,6 heures. Il s'agit de la période où
les valeurs sont inférieures à la moyenne de 1991 à 2020
et la séquence où ses valeurs sont supérieures à
cette moyenne. A cela s'ajoute la période où les valeurs sont
égales à la moyenne de la série. Cette
différenciation, en deux séquences principales, ne
révèle pas une homogénéité des
périodes de part et d'autre, l'évolution est très
contrastée dans la série.
*La première séquence, où les valeurs
sont déficitaires, est enregistrée dans les années ayant
de 1997 à 2015, exceptés 5 années seulement contre 18,
où supérieures ou égales à la moyenne. Ces
exceptions sont les années 2000, 2006 et 2008, qui mesurent
respectivement 7,6 ; 7,7 et 12,8 heures et l'année 2011 (7,7h) et
celle de 2014 (8,2h). Les valeurs de celle séquence sont essentiellement
faibles, avec le minimale de la série 6,1 heures, enregistré en
2015.
*La séquence où l'insolation est
excédentaire, par rapport à la moyenne de la série (7,6h),
correspond à la période qui va de 1991 à 1996. D'autres
années excédentaires sont notées comme le pic
relevé en 2008 avec 12,8 h et les années 2016 et 2017, qui se
voient respectives avec 8,1 et 8,5 heures. Le maximale de la série est
relevé en 2008 avec 12,8 heures. A l'arrière de ces années
excédentaires, se voient encore une petite phase déficitaire,
correspondant aux années 2019 (7,3) et 2020 (6,3h).
*L'évolution moyenne de l'insolation est donc
très contrastée de 1991 à 2020 dans le milieu
d'étude. Avec une moyenne de 7,6 heures, elle se manifeste avec 16
années déficitaires contre seulement 10 années
excédentaires et 04 années dont les valeurs sont égales
à la moyenne de la série. Le minimale, relevé en 2015, est
égal à 6,1 heures. Le maximal est de 12,8 heures en 2008.
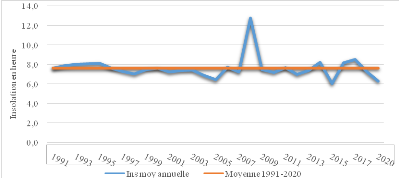
Figure
4:Variabilité moyenne annuelle de l'insolation dans la station de Fatick
de 1991 à 2020 en heure (ANACIM, 2023)
1.2.6.2.3 Les
températures
Les fluctuations du climat du milieu d'étude
obéissent aux conditions climatiques de la zone tropicale. Les
températures élevées, enregistrées dans le milieu,
sont dues essentiellement au bilan excédentaire du rayonnement solaire,
des masses d'air, ... caractéristique de la zone tropicale. La
température est exprimée en degré Celsius (°C). Leur
variation peut être journalière, mensuelle et annuelle. La figure
3 illustre la variation bimodale de la température selon les mois de
1991 à 2020. Elle est modérément élevée
avec une moyenne de 28,7°C. En Janvier, est enregistré le premier
minimum de température avec 25,5°C. Il correspond en plein hiver
boréal. Le second minimum est au mois de Septembre (24,5°C), en
plein saison pluvieuse. Ces diminutions de température peuvent
être liées aux précipitations fortes mais aussi à la
forte nébulosité régnant durant cette période. Pour
les maximales, le premier maximum de température est de 39,4°C et
correspond au mois d'Avril. Le second est enregistré en Novembre, avec
36,7°C. Ces températures maximales sont donc mesurées durant
les mois qui viennent avant le début et après la fin de
l'hivernage. Elles peuvent être dues aux masses d'air (alizés) qui
soufflent durant ces mois, à l'arrêt des précipitations et
à la forte insolation.
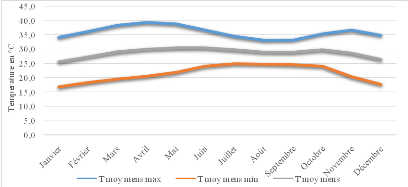
Figure
5:Evolution de la Température moyenne inter-mensuelle de 1991 à
2020 dans la station de Fatick (ANACIM, 2023)
1.2.6.2.4
L'évaporation
L'évaporation est le passage d'un liquide (eau) de
l'état liquide à l'état gazeux à partir de la
surface libre d'une étendue d'eau, d'un sol ou d'un
végétal mesuré en millimètre (mm). De 1991 à
2020, l'évaporation moyenne annuelle est de 5,8 mm. Durant cette
série, se voit nettement deux périodes distingues : une
courte période excédentaire et une très longue
période déficitaire.
*La période excédentaire, où les valeurs
dépassent la moyenne, va de 1991 à 1998. Les valeurs varient
entre 6,6 et 7,9 mm avec les plus élevées au début de la
série (1991 à 1995). Le maximale de la série est
enregistré durant cette période et précisément en
1991 avec 7,9 mm
*La période où les valeurs sont
inférieures à la moyenne de la série, la séquence
déficitaire, elle est la plus longue et va de 1999 à 2020 sauf
les années excédentaires 2002, 2006, 2016 et 2019. Ces
années qui se contrastent dans cette période, mesurent
respectivement 6,6 ; 6,0 ; 6,0 et 5,9 mm Le minimale de la
série est relevé durant cette période en 2001 avec une
valeur de 2,8 mm.
*De 1991 à 2020, l'évaporation se varie entre
2,8 mm et 7,9 mm dans la station de Fatick. Le minimale de la série (2,8
mm) est relevé en 2001 et le maximale (7,9 mm) en 1991.
L'évaporation moyenne de la série est de 5,8 mm.
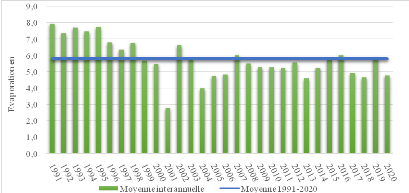
Figure
6:Variabilité moyenne annuelle de l'évaporation dans la station
de Fatick de 1991 à 2020 en mm (ANACIM, 2023)
1.2.6.2.5
L'humidité relative
L'humidité relative ou l'humidité de l'air est
la teneur en vapeur d'eau de l'air ambiant, fonction de la température
de l'air mesurée en pourcentage (%). L'air est saturé en eau si
humidité est égale à 100%. De 1991 à 2020, le
milieu enregistre des maximales très élevées, avec des
valeurs qui varient entre 72 et 86,7 %. L'humidité relative maximale la
plus éminente est notée en 2013 avec 86,7% alors que la minimale
des maximales intervient en 1997 avec 72%. Pour les minimales, elles varient
entre 30% et 43,5%. La minimale des minimales est relevée en 2007 Avec
30% et l'humidité relative minimale la plus élevée est
enregistrée en 2020 avec 43,5%. L'humidité relative moyenne
interannuelle tourne autour des valeurs de 51 et 64%. L'année 2020 se
voit avec l'humidité relative moyenne la plus importante avec 64%. La
plus faible intervient en 1997 (51,5%). L'humidité relative moyenne
de la série 1991-2020 est de 57,9%. Son importance dépend de la
température, du vent et de l'importance des pluies. Cela montre que les
conditions de ces éléments sont plus favorables en 2020 et plus
précaires en 2007 dans le milieu depuis 1991 à 2020.
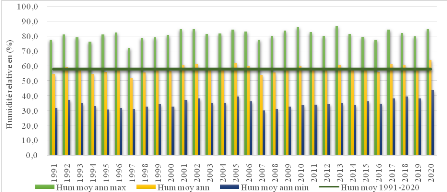
Figure
7:Variabilité moyenne annuelle de l'humidité relative dans la
station de Fatick de 1991 à 2020 en % (ANACIM, 2023)
1.2.6.2.6 La
pluviométrie
La pluviométrie est mesurée en
millimètre. Sa quantité peut connaitre des variations
mensuellement ou annuellement.
§ La variabilité mensuelle de la
pluviométrie divise l'année en deux séquences : une
séquence pluvieuse et une séquence non pluvieuse. La figure
montre que les précipitations interviennent essentiellement pendant
l'hivernage, correspondant à la séquence pluvieuse, qui va de
Juin à Octobre. Durant cette période, la pluviométrie
tourne autour de 23 mm et 238 mm en moyenne. Les mois de Juillet, Août et
septembre, se voient avec l'essentiel des précipitations où le
maximum de ces dernières est relevé pendant le mois d'août
avec 238mm. La séquence qui va de novembre à Mai, n'enregistre
pas de précipitations à l'exception des pluies deheug ou les
pluies de hors saison. Cela est due de l'équateur
météorologique qui se situe trop loin de la zone Nord-soudanienne
durant cette période. Ces deux saisons, bien distinguées, font
que la station de Fatick à un régime pluviométrique
unimodal dont l'essentiel des précipitations tombe entre Juin et
Octobre.
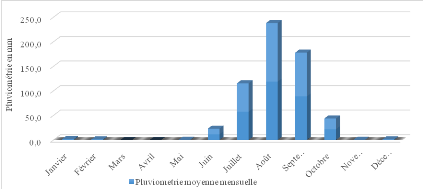
Figure
8:Variabilité moyenne mensuelle de la pluviométrie dans la
station de Fatick de 1991 à 2020 en mm (ANACIM, 2023)
§ Variabilité interannuelle
Les cumules de la pluviométrie illustrent que les
précipitations sont marquées par une variabilité
interannuelle depuis 1991 à 2020. Les cumules pluviométriques
varient entre 359 et 940 mm.
La moyenne des cumuls pluviométriques de la
série 1991-2020 est de 600,9 mm. La valeur minimale est relevée
en 2007 avec 359,6 mm soit un déficit de 241,3 mm par rapport
à la moyenne de la série. La maximale est enregistrée en
2012 avec un cumul de 940,3 mm soit un excèdent de 339,4 mm par rapport
à la moyenne 1991-2020. L'écart entre le maximum et le minimum
des cumuls pluviométriques est très important (580,7 mm) entre
1991 et 2020. Et cela montre la variabilité interannuelle remarquable
qu'a connue le milieu durant cette trentaine.
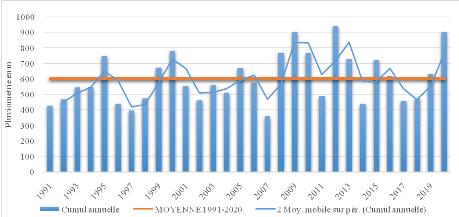
Figure
9:Variabilité moyenne annuelle de la pluviométrie dans la station
de Fatick de 1991 à 2020 en mm (ANACIM, 2023)
§ Les écarts à la moyenne 1991 à
2020
La figure 3 révèle une parfaite
irrégularité des précipitations annuelle de 1991 à
2020 dans la station de Fatick. Les écarts par rapport à la
moyenne pluviométrique de la série 1991-2020 font ressortir
nettement deux séquences distingues : la séquence 1991-2007
et la séquence 2008-2020.
*La séquence qui va de 1991 à 2007 est
sèche. C'est la période la plus longue (17 années)
renfermant 13 années déficitaires contre quatre années
excédentaires que sont 1995,1999, 2000 et 2005. Durant ces 13
années négatives, les écarts pluviométriques
varient entre -3 et -21%. L'année la plus déficitaire est
l'année 2007 où l'écart à la moyenne 1991-2020 est
de -21,1%.
*La séquence 2008-2020 est une phase humide. Elle
referme 12 années dont seulement 4 déficitaires. Les valeurs
varient entre 1 et 40%. Les années où la pluviométrie est
plus importante sont celles de 2009, 2012 et 2020. Cette dernière
enregistre la valeur la plus élevée avec un surplus de 39,1%.
La courbe linéaire et la moyenne mobile montrent que la
pluviométrie qui était essentiellement déficitaire de 1991
à 2007 avec cette dernière la plus déficitaire de la
série, a connu une vaste période excédentaire qui va de
2008 à 2013 avant de subir un redressement de 2014 à 2019 puis
une hausse en 2020 où se relève la plus excédentaire. A
l'état actuel, la tendance est à la hausse par rapport aux
années précédentes.
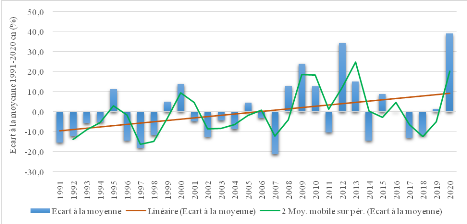
Figure
10:Evolution des écarts à la moyenne de la pluviométrie de
1991 à 2020 à Fatick en % (ANACIM, 2023)
D'une manière générale, l'analyse du
cadre naturel du milieu est donc importante pour comprendre l'état
physique et l'évolution de ses différents paramètres. Elle
révèle, sur le plan géologique, que les formations
géologiques qui affleurent dans le milieu datent du Quaternaire
récent, notamment à l'Holocène. Elles sont
constituées par les formations deltaïques et par les formations
littorales. Sur le plan pédologique, les sols sont constitués par
les sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés, les sols halomorphes
salins acidifiés et sols hydromorphes organiques, les sols hydromorphes
gley salé et sols halomorphes salins hydromorphes et par les sols
halomorphes salins hydromorphes moyennement salés. C'est un milieu
à altitude très base (-4 à 11m) et dont le couvert
végétal est constitué de mangrove, de la savane
arborée et arbustive et de la prairie marécageuse. Le relief et
la végétation varient constamment selon les unités
morphologiques. Ces dernières sont les vasières, les tannes, les
cordons sableux, les amas coquilliers et les chenaux. Les chenauxde
marrée constituent essentiellement les ressources surfaciques du milieu
(le marigot de Faoye par exemple), excepté cette petite portion
drainée par la ria du Saloum. Les eaux souterraines vont de la nappe du
Maestrichtien à la nappe phréatique, passant par les nappes du
Paléocène et Miocène. Par contre, elles sont parfois
menacées surtout dans ce contexte où la variabilité
climatique alimente le milieu (la variabilité pluviométrique est
une belle illustration) : elle a connu 17 années
déficitaires contre 12 excédentaires durant la série
1991-2020 ; mais aussi où l'homme évolue et y exerce sa
pression pour dérouler ses activités sociales et
économiques.
1.3. L'aspect humain
Il s'agit dans cette partie de la présentation de la
démographie et des activités sociale et économique. C'est
plus spécifiquement la description de l'historique du peuplement, de
l'évolution et la répartition de la population et d'une vue
d'ensemble sur les activités socio-économiques du milieu.
1.3.1 La démographie
C'est la présentation de l'historique du peuplement du
milieu, de l'évolution et la répartition de la population dans le
milieu d'étude.
1.3.1.1 Historique du peuplement
L'occupation humaine de la région du Sine-Saloum est
très ancienne. Le peuplement de cette région remonte bien
qu'avant l'histoire. Il est au moins 2000 ans avant J.C pendant la
préhistoire et la période de la protohistoire d'après C.
Descamps, cité par Diouf Fatou (2013). Cette occupation ancienne peut
êtrejustifiée dans le milieu par la présence des amas
coquillers qui sont, d'après Mame Demba Thiam (1986), des formations
d'origine humaine liées à l'exploitation de deux mollusques comme
le pagne (Anadara senilis) et l'huitre (Gryphea gasar). Ces amas coquillers se
voient au niveau de l'ile de Diamniadio et à ses alentours. Ils sont le
plus souvent couverts par des dépôts plus récents
(terrasses sableux), toutefois, visibles au niveau des flancs des rives. Ce qui
justifie l'occupation très ancienne du milieu d'étude.
1.3.1.2 Evolution et répartition de la population
Il s'agit de suivre l'évolution de la population
à partir des données issues de l'ANSD et de voir la
répartition de la population dans le milieu d'étude. Ce dernier
se localise administrativement dans la Région de Fatick, sa population
totale passée de 575063 à 906922 habitants de 2013 à
2023.Le Département de Fatick enregistre 233824 habitants en 2013 contre
442919 en 2023. Le Département de Foundiougne passe de 269195 à
375388 habitants durant ces dix dernières années. Quant au
Département de Gossasse, sa population quitte de 72044 hbts en 2013 pour
arriver à 88615 hbts en 2023. Cela monte une croissance très
rapide de la population du Département de Fatick notamment qui à
doubler au cours de 10 années. Les localités du milieu se
situent dans les Communes de Djillasse et de Djirnda.La population totale de la
Commune de Djillasse et de celle de Djirnda connait une
évolutiontrès importante au cours de cette
dernièredécennie. Elle passe de 8 299 hbts en 2013 à
10418 hbts en 2023 dans la Commune de Djirnda et de 9 703 à 11106
hbts à Djillasse durant la mêmepériode. La population du
village de Faoye occupe les 12,01% de la population totale de la Commune de
Djillasse en 2013 et les 11,84% en 2023, soit 1166 hbts en 2013et 1316 en 2023.
Avec un gain de 150 habitants entre2013et2023, la population de la
localité de Faoye voit une croissance de 12,86% durant cette
période. La population totale du village de Diamniadio passe de 1071
à 1265 habitants en 2013 et 2023, soit un accroissement de 18,11%. Elle
représente les 12,90% et les 12,14% de la population totale de la
Commune de Djirnda respectivement en 2013 et en 2023. Cela monte une croissance
assez lente durant cette dernière décennie, notée aussi
bien à Faoye que à Diamniadio. La population de ces
localités du milieu d'étude est entièrement
constituée de Sérères. La langue couramment parlée
dans le milieu est le Sérère.
1.3.2 Les activités sociales et
économiques
Les activités socio-économiques le long de l'ile
de Diamniadio à Faoye sont nombreuses et très diversifiées
selon les localités. Sont présentées dans cette
étude l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'exploitation du
sel, le commerce et le tourisme. Les données de terrain sont
utilisées pour cette analyse. La pèche est la plus importante
suivie de l'élevage. L'agriculture est peu fréquente dans le
village de Faoye et non pratiquée dans la localité de Diamniadio.
Cela est lié principalement à la salinisation excessive des
terres.
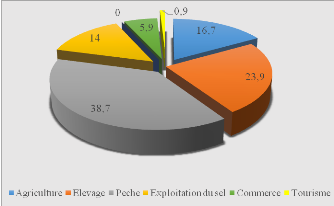
Figure
11:répartition par secteur des activités socio-économiques
du milieu d'étude en (%) ; Diouf S. Aziz(Enquête 2023).
1.3.2.1 L'agriculture
L'agriculture occupe la troisième activité
principale (16%) du milieu derrière la pêche et l'élevage
(Cf. Figure 12). Elle n'est pratiquée qu'au nord du milieu
d'étude, dans la localité de Faoye. Plus de 90% de la population
agricole pratique l'agriculture pendant la saison des pluies. Cela montre que
l'agriculture dépend largement de l'eau de la pluie. L'agriculture de
contre-saison (le maraichage) n'est pas fréquente (-5%). Les
spéculations cultivées par la population sont principalement le
mil, l'arachide et le niébé. Le mil et l'arachide sont les
spéculations les plus cultivées avec un taux de 30% chacune.
Elles sont suivies par le niébé (24,5%) et du maïs (9,1%).
D'autres cultures comme la culture du sorgo, d'oseille et des légumes
sont aussi faits. Elles ne sont pas importantes et représentent
respectivement 0,9% et 4,5% pour les légumes.
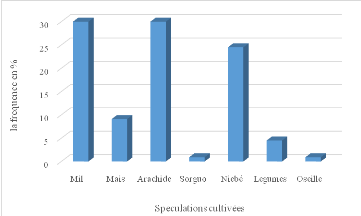
Figure
12:Spéculations cultivées dans le milieu en (%) ; Diouf S.
Aziz(Enquête 2023).
L'agriculture reste toujours traditionnelle. La population
utilise leur force ainsi que celle des animaux pour exploiter leurs champs. Par
contre, divers outils agraires tels que les hilaires, le semoir, les animaux de
traction, la charrette, les houes et les dabas sont à la portée
des agriculteurs. Mais ces outils restent très limités car plus
de 50% des agriculteurs n'ont pas leurs propres outils. La superficie des
terres agricoles n'est pas très importante. Elle varie entre 0,5
à 5 ha par ménage dans la localité de Faoye.
Néanmoins, la plupart adoptent des techniques de fertilisations pour au
moins gagner plus de revenus. Les types de fertilisations les plus
adoptés sont les utilisations de l'engrais organique et de l'engrais
chimique. La rotation de culture et la jachère sont les moins
adoptées. Malgré ces efforts, cette activité reste de
moins en moins rentable. Plus de 50% de la population agricole
perçoivent que les rendements sont faibles, très faibles pour
plus de 30% des cultivateurs. Cela montre que l'agriculture rencontre beaucoup
de problèmes qui l'empêchent de se développer.
D'après les paysans, les problèmes principaux qui affectent
l'agriculture sont la salinisation des terres, la dégradation des
terres, le déficit pluviométrique, le manque de semence, de
matériel agraire et de main d'oeuvre (Cf. Figure 14).
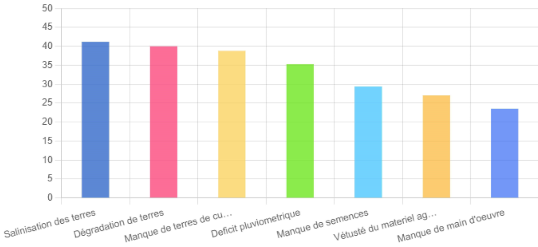
Figure
13:principaux problèmes liés à l'agriculture dans le
milieu durant ces 30 dernières années ; Diouf S.
Aziz(Enquête 2023).
1.3.2.2 L'élevage
L'élevage constitue l'activité la plus
pratiquée dans le milieu d'étude derrière la pêche.
Elle représente les 23,9% des activités principales du milieu.
C'est une activité pratiquée dans tous les villages du milieu.
Elle est de type traditionnel sédimentaire pour la plupart et parfois
transhumant. L'élevage sédimentaire est surtout pratiqué
par les ménages disposant d'un petit nombre de têtes de
bétail. Les animaux élevés dans le milieu sont divers. Ce
sont surtout les volailles, les moutons, le cheves, les chevaux, les boeufs et
les ânes. La transhumance, le système le moins utilisé,
s'effectue surtout en début de saison pluvieuse. Les animaux sont
amenés loin des cultures et surtout dans des milieux où les
ressources pastorales sont très importantes.
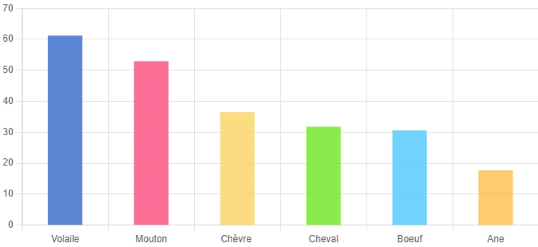
Figure
14:Principaux animaux élevés dans le milieu ;Diouf S.
Aziz(Enquête 2023).
Néanmoins, cette activité se voit très
menacée depuis des décennies par plusieurs
phénomènes. Le manque de nourritures est le problème qui
affecte plus l'élevage dans le milieu. Ce manque est entrainé par
le déficit pluviométrique mais surtout intensifié par la
salinisation des terres qui dégrade ou détruit même le
tapis herbacé des zones couverts de végétation. A cette
dynamique saline s'ajoute le manque de moyens pour assurer la survie des
animaux, le manque d'espaces propices à l'élevage ou des
problèmes de santé lié à l'eau.
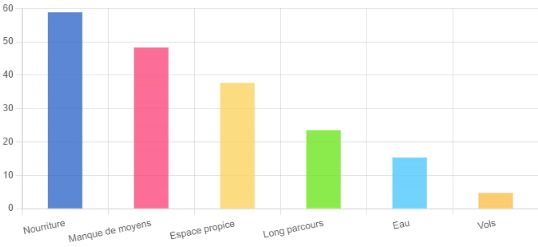
Figure
15:Problèmes principaux liés à l'élevage durant ces
30 dernières années dans le milieu ;Diouf S. Aziz(Enquête
2023).
1.3.2.3 La pêche
La pêche constitue l'activité principale du
milieu d'étude. Elle est la plus pratiquée dans tous les villages
du milieu et regroupe les 38,7% des activés totales. La pêche est
de type artisanal. Les lieux de pèches sont surtout les bolong, les rias
comme le Saloum mais aussi en haut mer. La pêche artisanale englobe les
activités de cueillette des arches et des huîtres. L'exploitation
d'huitres est généralement assurée par les femmes. A
Diamniadio, sur 1071hbts en 2013, plus de 340 personnes s'activent dans la
pêche artisanale, avec environ 48 équipements des sites de
transformation artisanale et 328 matériaux de pêche, selon
l'enquête effectuée par l'USAID/COMFISH Plus en 2017 (Cf. Tableau 2).
Tableau 2:Catégories
socio-économiques, infrastructures et matériels liés
à la pêche à Diamniadio en 2017
|
Catégories socio-économiques
|
Pêcheurs
|
Transformateurs
|
Mareyeur
|
Exploitants Mollusques
|
Prestataires de service
|
Total
|
|
191
|
22
|
7
|
105
|
20
|
345
|
|
Equipements des sites de transformation artisanale
|
Claies de séchage
|
Fours de fumage
|
Aire de repos
|
Magasin de stockage
|
Total
|
|
32
|
14
|
1
|
1
|
48
|
|
Outils de pêche
|
Engins de pêche
|
Pirogues de pêche
|
Total
|
|
271
|
57
|
328
|
Source : USAID/COMFISH Plus (enquête, Mai 2017)
Cependant, l'activité de la pêche est de plus en
plus en chute. Etant la principale activité du milieu, elle subit de
forte pression anthropique combinée au manque de moyens de pêche
et surtout la rareté des espèces (Cf. Figure17). Cela constitue
un problème major de développement économique et social au
moment où l'activité première du milieu est de moins en
moins rentable.
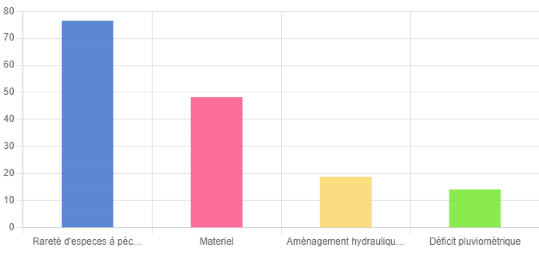
Figure
16:principaux problèmes liés à la pêche dans le
milieu durant ces 30 dernières années ; Diouf S.
Aziz(Enquête de terrain, 2023)
1.3.2.4 L'exploitation du sel
L'exploitation du sel, comme l'agriculture, est
spécifiquement pratiquée au nord du milieu. Il constitue l'une
des activités principales de la localité de Faoye. Elle
représente 14% des activités de la zone d'étude et la
deuxième activité derrière l'agriculture de ce village.
L'exploitation du sel est pratiquée à la fois par les hommes et
les femmes de cette localité. La méthode d'exploitation la plus
fréquente est l'aménagement des caisses (puits). Peu de personnes
pratiquent le ramassage de sel. Les puits de sel se trouvent dans le village et
s'activent durant toute la saison sèche. Cette activité constitue
une importante source de subsistance pour le village de Faoye. La production
par ménage peut aller jusqu'à plus 30 tonnes par an. C'est donc
une activité en grande partie productive.
Toutefois, l'exploitation du sel est affectée par un
jeu de problèmes réduisant parfois sa rentabilité. Les
problèmes le plus récurrents sont la commercialisation et la
conservation. Parfois la quantité exploitée n'est pas facile
à vendre et puis la plupart n'ont pas des endroits où
conservé le sel. Ce qui favorise sa dégradation. Le manque de
moyens et le manque de main d'oeuvre ne sont pas à négliger.
Planche de photos 5:Exploitation du
sel dans la localité de Faoye
 
Crédit photo : Diouf S. A., 2023
1.3.2.5 Le commerce et le tourisme
Le commerce et le tourisme sont les activités les plus
faiblement pratiquées dans le milieu d'étude. Le commerce est
lié principalement à la commercialisation du sel, des poisons,
des huitres ou le commerce en détail. Le tourisme est la moins
pratiquée de toutes les activités socio-économiques du
milieu. Cela est dû essentiellement à la rareté de
touristes dans cette zone, principalement liée selon la population, par
le désagrément des voies de communication.
En somme, les activités socio-économiques du
milieu sont très diversifiées. La pêche reste
l'activité la plus importante, suivie de l'élevage et vient
l'agriculture en troisième position. Le commerce et le touriste se
voient comme les activités les moins pratiquées et les moins
productives dans le milieu. L'exploitation du sel, qui n'est pas
appliquée à Diamniadio, constitue un part très important
dans l'économie de la localité de Faoye. Toutefois,
l'avancée de la langue salée, la dynamique des terres
salées, le déficit pluviométrique, la rareté
d'espèces marins et le manque de moyens propices, menacent en
majorité le développement de ces activés. L'analyse de ces
activés socio-économiques est important pour évaluer les
impacts de la dynamique des unités morphologiques sur le volet social et
économique.
Dans l'ensemble, le milieu a connu de 1991 à 2020 des
variabilités climatiques principalement péjoratives. A l'image de
celle de la pluviométrie qui est essentiellement déficitaire
durant cette trentaine. Avecaltitude très basse (-4 à 11m), il
estdominé par de chenaux de marée entièrement
salées et de tannes. Ces phénomènescombinés,
influent négativement sur le couvert végétal, les terres
de cultures, les ressources hydriques et surtout les ressources halieutiques
constituant la source principale de vie des paysans. Ce qui fait qu'un tel
effet néfaste sur ces ressources naturelles, affecte négativement
les activités socio-économiques du milieu. Cela impose une bonne
maitrise de l'évolution de ces unités dans le temps et dans
l'espace et des problèmes qui en découlent d'où
l'idée de voir l'état de la question, le fondement
théorique et l'analyse conceptuel dans le chapitre suivant.
Chapitre2: Etat de la question,
fondement théorique et conceptuel
Il
s'agit de la synthèse des études précédentes en
rapport avec le thème, le dégagement de la problématique
et l'analyse des concepts clés du thème de recherche.
2.1. Synthèse bibliographique
Le nombre considérable de références
bibliographiques révèle que les milieux estuariens et
deltaïques d'une manière générale ont fait l'objet de
plusieurs études en particulier sur l'aspect de la dynamique des
unités morphologiques. Cette dynamique, influencée
essentiellement par la péjoration climatique, les mouvements
océanographiques ainsi que la pression anthropique, bouleverse en grande
partie l'équilibre écologique et les activités
économiques voire sociales des zones de contact entre l'océan
(mers) et le continent (fleuves).
DIARA. Marlin (1999), dans sa
thèse intitulée : « Formation et évolution
fini-holocène et dynamique actuelle du Delta Saloum-Gambie
(Sénégal-Afrique de l'Ouest) », soutenue le 16
Décembre 1999 à l'université de Perpignan, décrit
le caractère morphologique, stratigraphique et sédimentologique
des différentes unités et les facteurs physiques
déterminant la dynamique sédimentaire actuelle et la
quantification des stocks sédimentaires déplacés du Delta
Saloum-Gambie.L'auteur s'est basé sur l'analyse topo
bathymétrique, des prélèvements, la marnage et Zéro
de référence, la télédétection pour
l'identification des unités ainsi que des analyses de laboratoire. Ce
travail révèle que le Delta du Saloum, qui se situe entre mer et
continent, un domaine margino-littoral à topographie très basse,
est bordé par la formation du continental terminal. Il s'étend sur plus de 90000 ha et constitué principalement de trois cours-d `eau
tels que le Saloum, le Diomboss et le Bandiala de direction nord-est, sud-ouest
(NE-SW). Et les différentes unités morphologiques sont : les
chenaux, les cordons sableux, les vasières à mangrove, les tannes
et le littoral. Ainsi, les cordons sableux du Delta sont des iles littorales,
des flèches en construction ou de barrières simples. Les
vasières s'étendent le long des bolong et jamais au front de la
mer. Les tannes se situent en arrière des vasières ou ils
s'étendent entre la mangrove et les barrières sableuses. Quant au
littoral, il est le rivage actuel qui subit directement l'influence de la mer
sans être abrité par quelque formation que ce soit. Les
unités morphologiques retrouvées dans le Delta du Saloum-Gambie
sont donc multiples. Et sont essentiellement : la vasière, les
tannes, les barrières sableux, les chenaux et le littoral.
DIAGNE. Soda (2012), dans son mémoire intitulé
: « Impacts de la dynamique des unités morphologiques
dans les iles du Gandoul (Niodior, Dionewar et
Falia) :(Saloum du Sénégal) », s'intéresse
à la dynamique des unités morphologiques dans les iles de Gandoul
et leurs impacts sur le milieu.Sa méthodologie se base sur l'implantation des piquets dans la plage
des trois iles et l'analyse de cartes diachroniques à partir d'images
satellitaires des années 1984, 1992, 2003 et 2011.Il ressort de
l'analyse de ces données une dynamique positive des tannes, des bancs
sableux et des eaux de surface et une évolution négative de la
mangrove et de la savane entre 1984 et 2011 dues aux facteurs naturels et
anthropiques. En effet cette situation qui se justifie en grande partie par la
rupture de la flèche de Sangomar, la forte salinisation et
l'acidification des sols, la topographie, la faiblesse des volumes d'eau des
pluies surtout dans les années 1980. De 1984 à 2011, les iles de
Niodior, Dionewar et Falia ont donc connu une évolution de ses
différentes unités paysagères liée aux facteurs
naturels et anthropiques. Cette dynamique qui se
manifeste par une régression continue de la savane et de la mangrove au
profit des tannes, banc de sable et eau de surface a des répercussions
néfastes sur l'environnement du milieu.
DIATTA. Seynabou (2012), dans son mémoire
intitulé : « Dynamique des unités
morphologiques de Betanti à la frontière de la »,
soutenue en 2012 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar,
étudie la dynamique des unités morphologiques le long du littoral
Ouest sénégalais au delta du Sine-Saloum de Betanti à la
frontière de la Gambie.Seynabou se base surle travail de terrain
à l'aide des piquets pour mesurer le degré d'engraissement ou de
dégraissement par piquets et d'images satellitaires pour l'analyse de
cartes diachroniques. On note ainsi qu'avant 1987 (la rupture de la
flèche de Sangomar), les paysages littoraux situes au Sud de l'ile de
Gandoul représentaient un visage diffèrent de ce qui est
observé après la rupture. En 1986, les zones inondables
représentaient 4124,07 ha bordant les bolong. La savane arborée
avec 2068,44 ha, la mangrove est plus représentative estimée
à 14277,94 et les sols nus estimés à 7235,06 ha. La
situation en 2002 révèle une accrétion de 1619,14 ha pour
la mangrove, 3761,05 ha pour la végétation et une
régression de 1569,84 ha pour les zones inondables et de 4798,38 ha pour
les sols nus. Cette régression des sols nus qui occupaient la presque
totalité du littoral de ce secteur se traduit par la brèche de
Sangomar. Cette rupture a entrainé aussi la disparition des ilots de
sables aux bords de Betanti laissant en place des crochets littoraux qui
s'allongent davantage. La situation en 2011 est l'inverse de cette notée
en 2002. Les résultats des mesures d'engraissement montent une forte
érosivité notamment dans les iles Betanti et Fathala qui se
manifeste par un recul du trait de côte. La dynamique
géomorphologique pour la période 1986 à 2011 est alors
très sensible du fait de la vitesse progressive concernant
l'évolution spatio-temporelle des unités paysagères de
Betanti à la frontière de la Gambie.
NIANE. K (2012), dons mémoire
intitulé : « Dynamique des unités
morphologiques le long du Sine des années 1960 aux années
2010 : Cas de la communauté rurale de Mbellacadio (région de
Fatick) », aborde les caractères physiographiques et les
processus morpho-dynamiques qui marquent les unités
géomorphologiques de Mbellacadio. L'approche méthodologique
emprunté est la revue documentaire, les travaux de terrain tels que les
enquêtes et l'analyse de cartes diachroniques à partir d'images
satellitaires et de photos aériennes des années 1979, 1985, 1992,
2006, 2011.Ces résultats révèlent une importante
évolution morpho-dynamique des différentes unités entre
1979 et 2012. Ainsi, on note une progression de la surface des terres de
cultures de 1887,5 ha en 1985 à 11844,66 ha en 2006 et une
légère régression en 2011 avec une superficie de 10509,36
ha. Quant aux tannes et la vasière les résultats montent une
régression continue depuis 1985 à 2011 soit : 7729,33 ha
à 2863,72 ha de 1885 à 2011 pour les tannes et de 1887,5 ha
à 983,48 ha pour la vasière nue. L'auteur en déduit que
cette dynamique spatio-temporelle des unités est à grande partie
liée à la péjoration climatique, à la salinisation
et aux mauvaises pratiques de récupération des sols
affectés par cette salinisation.
BADJI. B (2014), dons son mémoire intitulé :
« Dynamique des unités morphologiques des iles Karones et
Bliss de 1980 à 2010 », évalue le
phénomène de l'érosion côtière et
l'évolution des unités morphologiques dans les iles de Karones et
Bliss entre 1980 et 2010. Son travail de terrain consiste à
l'installation de piquets, disposés sous forme de triangle pour les
mesures altimétriques età des analyses diachroniques de 1980
à 2014.Ces dernières s'avèrent une mutation
morpho-dynamique des unités de 1980 à 2014. En effet, entre 1980
et 1990, les résultats montent que les eaux de surface et les sables ont
connu une forte progression soit respectivement à une superficie de
1364,80 km² et de 432,47 km² et une régression de 84,21
km² pour la végétation et 208,40 km² pour la mangrove.
Ce qui se justifie par le recul des normales pluviométriques
significatif passant de 1522 mm en 1969 à 114,9 mm en 2000 et de
l'avancée de la mer à l'intérieur des terres. La situation
de la période 1990 à 2005 révèle une
régénération de la mangrove et de la
végétation continentale et représentent respectivement de
284,60 km² et 133,98 km² en 2001. Cette réservation s'explique
par l'accroissement de la pluviométrie entre 1990 et 2001 qui en moyenne
étaient de 1364,5 mm. Cependant, l'érosion reste très
vivace qui se manifeste par des pertes de sable énorme (154,47 km²
entre 1986 à 2005) et une extension du réseau hydrographique qui
représente 1401,54 km² en 2001. Cet évènement
s'explique par la dynamique marine très fréquente sur la
côte et surtout à l'extraction abusive des sables par l'homme.
Enfin, entre 2005 et 2014, on note une dégradation de la mangrove qui
baisse jusqu'à 169,80 km². Cette situation alarmante est
influencée par les actions anthropiques qui conduisent à une
coupe des palétuviers pour la récolte d'huitre, la construction
et l'utilisation en bois de chauffage. A cela s'ajoutent la forte
évaporation et l'acidification des sols. Cette régression de la
mangrove s'additionne à la réduction de la superficie de la
végétation continentale qui passe de 133,98 km² en 2001
à 63,54 km² en 2014 et favorisant ainsi l'augmentation nette des
sables et des eaux de surface. Cette dynamique qui se manifeste au cours de ces
dernières décennies par la réduction des
végétations de mangrove et de la savane, a d'énormes
impacts néfastes sur l'environnement et la vie socio-économique
du milieu.
DIONE. K (2014), dans son mémoire
intitulé : « Impact de la dynamique des
unités morphologiques dans l'aire marine protégée de
Bamboung (Iles du Saloum/Sénégal) », aborde les impacts
de la dynamique régressive des écosystèmes de mangroves
sur les aires marines protégées de Bamboung.L'auteur s'est
basé sur la recherche documentaire, le travail de terrain qui repose sur
la télédétection pour l'analyse de cartes diachroniques de 1984 à
2011, l'utilisation du GPS de type Magellan ou Garmi. Après l'analyse
des données recueillies, les résultats montent que la dynamique a
eu beaucoup d'impacts sur la mangrove. D'abord, de 1984 à 1992, on note
une augmentation de la superficie de la mangrove de 50,75% à 61% au
détriment des tannes qui voient la réduction de sa superficie
passant de 22,27% à 4,6%. Enfin, entre 2003 et 2011, la situation s'est
inversée et cela se manifeste par une forte progression de la surface
occupée par les tannes passant de 8,4% en 2003 à 24,54% en 2011
et une régression signifiante de la mangrove de 58,34% à 43,44%
au cours de la même période. Cette régression de
l'écosystème mangrove et le hausse de la superficie des tannes
sont liées essentiellement à la baisse de la pluviométrie
et à la salinité notées surtout en 2011. Cette dynamique a
entrainé dans l'aire protégée de Bamboung la mortalité des essences comme le genre
rhizophora qui a une faible résistance à la salinité, la
pollution de l'eau, la régression des palétuviers, la disparition
de certaines espèces marines. A cela s'ajoutent les impacts sur le
tourisme, ainsi que celui entrainant la fermeture de l'aire pour le besoin de
conservation et de revalorisation.
GOUSSOT. E (2014), dans son article intitulé :
« Dynamique de l'occupation du sol et statistique agricoles sur le
bassin versant du Bouregreg au Maroc », publié le 02 novembre
2014 dans European Journal of Scientific Research s'intéresse à
la dynamique de l'occupation du sol dans l'ensemble du bassin du Bouregreg
(9970 km²) entre les années 1985 aux années 2007.Il s'appuie
sur l'utilisation des SIG et de la télédétection à
partir d'images Landsat afin d'obtenir des résultats sur la dynamique
des unités morphologiques du milieu. Il ressort de ce travail une
régression des surfaces forestières avec une baisse de 5% entre
les années 1985 aux années 2007 et unehausse de 4% de la
superficie des surfaces agricoles. Ces dernières sont localisées
à 45% sur les pentes topographiques forts. Les sols nus ont connu une
augmentation de 4% entre 1985 et 2007. Cette unité paysagère se
localise sur des pentes fortes favorisant ainsi les risques d'érosion
hydrique des versants de la vallée. Enfin, l'espace urbanisé a
connu aussi une croissance de 1% de 1985 à 2007. La diminution de la
superficie des forêts est en grande partie liée à la
topographie étant donné que plus de 45% des surfaces
forestières disparues sont situées sur des pentes de plus de 10%
mais aussi à la variation pluviométrique et aux pressions
anthropiques. L'analyse des statistiques agricoles montent une chute notable
des rendements due essentiellement à la dégradation de la
productivité des sols et à la forte variation de la
pluviométrie, dans un bassin ou l'agriculture est principalement
pluviale. L'auteur confirme qu'entre les années 1985 aux années
2007, le bassin versant du Bouregreg a connu une chute remarquable de ses
rendements et de la superficie des espaces forestiers en faveur de l'espace
urbanisé et des sols nus. Cette dynamique s'explique nettement par la
topographie du milieu, la péjoration climatique ainsi que par la
croissance urbaine et la déforestation.
NDAW. Fatma (2014), dans son mémoire
intitulé : « Dynamique des unités
morphologiques dans les îles de Mar
(Saloum-Sénégal) », étudie les différents
paramètres des unités morphologiques du point de vue de leur
configuration et de leur évolution dans les iles de Mar.Pour
étudier l'évolution des unités paysagères dans les
îles de Mar, Fatma s'appuie sur la revue documentaire, les observations
et mesures in situ et de la télédétection à partir
d'images satellitaires des années 1992, 2003 et 2011. Le traitement de
ces données est mis en oeuvé grâce aux logiciels
suivants : ERDAS 9.1, et Arc gis 9.3. Cette étude monte une
diminution de la superficie de la mangrove et des terres de cultures au profit
des tannes de 1992 à 2011 et que les facteurs responsables sont d'ordre
naturels et anthropiques. En effet, en 1992, on note une domination des eaux de
surface avec un taux de 49,95% et de la mangrove (22,45%) au détriment
des tannes qui représentaient 16,09% et des terres cultivables (9,43%).
En 2011, on note une forte progression des tannes qui passent de 16,09%
à 44,07 de 1992 à 2011 et une réduction prodigieuse de la
mangrove qui chute de plus 24,25%, des terres cultivables de 3,31% et des eaux
de surface. La végétation continentale quant à elle, est
l'unité la moins importante dans le milieu (1,07% en 2011). Cette
dynamique, en faveur des tannes aux dépens des autres unités de
paysages, s'explique par le déficit pluviométrique entre 1968 et
1990, l'intrusion marine, la rupture du Lagoba ainsi que les activités
anthropiques comme : le déboisement et les constructions sur la
ligne de la mangrove. Et cela constitue un danger pour l'environnement et les
activités économiques du milieu.
DIONE. M (2015) : « Dynamique des unités
morphologiques dans la commune de Diembering de 1980 à 2010 »,
est un mémoire de recherche qui étudie l'évolution des
différentes entités morphologiques et leurs facteurs dans la
commune de Diembering entre 1980 et 2010.La méthodologie abonnée
par l'auteur s'articule autour des travaux de terrain à l'aide des
outils comme les piquets pour mesurer le degré d'engraissement ou de
démaigrissement, et de la télédétection pour faire
l'analyse de cartes diachroniques. Ce travail déduit une
évolution spatio-temporelle des différentes unités
morphologiques entre les années 1986et 2014. En effet, la situation en
1986 révèle un forte représentatif de la mangrove avec un
taux de 29,01% suivie des tannes qui représentent 24,01%. La plage est
la moins importante avec un taux de 1,1% derrière les sols nus (14,01%),
la savane arbustive (15,01%) et les cours d'eau qui représentent 16,05%.
Cette situation se justifie par le déficit pluviométrique
enregistré depuis les années 1970. En 1999, on note une
progression continue da la mangrove qui se retrouve avec un taux de 30,34% et
un ralentissement des tannes passant de 24,01% en 1986 à 17,01% en 1999.
Cela s'explique par la reprise des précipitations qui influe d'une
façon positive sur les nappes phréatiques et les eaux. Cependant,
l'érosion reste très importante qui se caractérise par des
pertes de sable et une extension continue du réseau hydrographique. De
la même année, on note une diminution de la savane et une
augmentation des sols nus liées à l'avancée de la mer
à l'intérieur des terres. La situation en 2014
révèle toujours une évolution positive de la mangrove qui
représente 33,88% et une évolution négative des tannes qui
se retrouvent à 16,41%. Cela se traduit par la dynamique
excédentaire de la pluviométrie allant de 2000 à 2011. De
la même manière, les sols nus voient leur superficie diminuer au
profit de la savane qui connait un hause de 3892,83 ha et de la plage gagnant
28,41 ha en 2014. Cette augmentation continue de la superficie de la mangrove,
de la savane et de la plage au détriment des tannes et des sols nue, est
due à la forte pluviométrie notée durant cette
dernière décennie mais également à la pratique des
techniques de lutte contre la déforestation et l'avancée de la
salinisation menées par la population en collaboration avec les pouvoirs
publics et les ONG.
DIOP. S (2015), dans son mémoire
intitulé : « Dynamique des unités
morphologiques dans l'arrière-pays du Sud-Ouest de Sokone et ses impacts
des années 1980 aux années 2010 », traite
l'évolution des différentes unités paysagères, les
facteurs d'origines et leurs impacts à Sokone de 1980 à 2010.Ces
travaux consistent à prendre les coordonnées des unités
par le GPS et à l'analyse diachronique à partir des images
satellitaires des années 1986, 1999, 2006 et 2014 à l'aide de la
télédétection. Ces résultats révèlent
une régression continue de la mangrove et des bancs sableux passant de
22,09% à 17,53% pour la mangrove, soit un taux de diminution de 4,56% et
de 4,1% à 0,5% pour les bancs sableux soit une perte de 3,6% de sa
superficie en 2014. Quant aux autres unités, les résultats
indiquent une évolution positive à l'image des tannes qui passent
de 13,81% en 1986 à 23,42% en 2014 soit une progression de 9,61%, les
cours d'eau comme les sols nus. Soda précise enfin que la progression
significative des tannes, des cours-d `eau et des sols nus et
l'évolution régressive de la mangrove et des champs, a des
impacts néfastes sur l'économie et l'environnement du milieu. Et
ceux-là se manifestent par la salinisation de l'eau et des terres,
l'acidification des terres, l'ensablement et la dégradation des terres
cultivables. L'arrière-pays Sud-Ouest de Sokone a connu donc une
dynamique considérable de ses différentes unités
morphologiques. Influencée notamment par les activités de l'homme
et des facteurs naturels, cette dynamique menace l'état
économique et environnemental du milieu depuis les années
1986.
DIOUF. Fatou (2015), dans son mémoire
intitulé : « Dynamique des unités
morphologiques le long du bolong de Guilor-Bagal dans l'estuaire du Saloum
(Sénégal) », étudie l'évolution des
unités morphologiques et les facteurs d'origines.La méthodologie
utilisée par l'auteur se base la télédétection
à partir d'images satellitaires des années 1979, 1989, 1999, 2009
et 2014 pour l'analyse de cartes diachroniques et sur la numérisation du
milieu d'étude et le traitement des données par les outils comme
ERDAS, Arc gis et Excel. En termes de résultats, on note une dynamique
considérable des différentes unités paysagères du
milieu liée essentiellement au changement climatique. De 1979 à
2014, un note une extension passant de 7,05% à 42% de la mangrove et une
régression des tannes passant de 34,05% en 1979 à 33% en 2014, de
la savane de 11% à 5% alors que la superficie des cours d'eau varie
d'une année à l'autre. Le long du bolong de Guilor-Bagal a connu
donc une transformation spatio-temporelle des différentes unités
morphologiques qui le constituent. Cette dynamique est le résultat de
plusieurs facteurs tels que : la désertification, la
sècheresse, les perturbations pluviométriques, la salinisation,
l'érosion éolienne, les conditions océanographiques et les
activités anthropiques à l'image du déboisement de la
végétation.
FAYE. P (2015), dans son mémoire intitulé :
« Etude comparative de la dynamique des unités
géomorphologiques dans les iles du Saloum et de la Casamance : Cas
de Bassoul/Bassar et Niomoune (région de Fatick et de
Ziguinchor) », s'inscrit sur une étude comparative des
différentes unités morphologiques des communes de Bassoul et
Kafountine.La méthodologie adoptée comprend : la revue
documentaire, l'analyse de cartes diachroniques des images satellitaires des
années 1984, 1994, 2004 et 2013, l'utilisation du GPS pour identifier
les coordonnées géographiques des unités et le traitement
des données à l'aide des logiciels tels que : Excel, Quantum
gis et Arc gis pour recourir aux résultats. Les résultats obtenus
après l'analyse des données montent que les différentes
(Tannes, cordon sableux, vasière à mangrove et plage) ont connu
une forte évolution entre 1984 et 2013. Ainsi, les Tannes herbus et la
végétation continentale connaissent une augmentation en
superficie dans la commune de Kafountine passant respectivement de 11,81% et
7,52% en 1984 à 19,17 et 7,60% en 2013. La vasière à
mangrove, la végétation continentale et les sols nus à
Bassoul ainsi que la plage à Kafountine voient une régression de
leur superficie soit respectives 48,25%, 7,04%, 19,52% et 0,92% en 1994
à 45,74%, 3,91%, 6,47%, et 0,75% en 2013. Les Tannes herbus à
Bassoul, les eaux, les sols nus et la mangrove à Kafountine passent de
6,95%, 29,53%, 8,82% et 33,46% en 1984 successivement à 10,79%, 31,81%,
9,31% et 32,81% en 2013. Cette dynamique des unités paysagères
est due à Bassoul par le climat, la dynamique de la mer et à la
topographie. Quant aux changements d'état physique des unités
dans la commune de Kafountine, sont influencés à grande partie
par la forte salinisation des eaux. Prospert estime enfin que les unités
morphologiques diffèrent d'un milieu à l'autre aussi bien de leur
évolution qu'aux facteurs qui façonnent cette
évolution.
SAGNA. Mme T. A. A (2015) : « La dynamique des
unités morphologique le long de la Casamance : de Ziguinchor
à Adéane (1980-2014) », est un mémoire de
recherche qui étudie l'impact du changement climatique sur la dynamique
des unités morphologiques de Ziguinchor à Adéane entre
1980 et 2014.L'approche méthodologique emprunté se fond sur la
revue documentaire, le travail de terrain et l'analyse de cartes diachroniques
de 1984 à 2014. Cette étude monte une forte dynamique entre les
années 1984et 2014 des différentes unités morphologiques
du milieu. En 1984, la végétation continentale a occupé
les 49,91% de la superficie totale suivie des sols nus estimés à
26,84%, de l'eau de surface avec 8,41% et des champs (7,18%). La mangrove est
la moins représentative avec un taux de 3,29% dernière les tannes
(4,35%). En 2014, on note une augmentation de la superficie des champs, des
eaux de surfaces et des sols nus et une diminution d'importante de la mangrove,
des tannes etde la végétation continentale. Les facteurs
explicatifs de cette dynamique sont notamment la péjoration du climat,
le déficit pluviométrique des années 1968 aux
années 1998, le relief qui est essentiellement plat,
l'évaporation relative élevée de 1983 à 2013, les
brames sèches, la dynamique des nappes et la marée. A
ceux-là, s'ajoutent les facteurs anthropiques telles que le
déboisement, la transformation des produits halieutiques et les
constructions, surtout les barrages hydro-agricoles comme celui de Guidel. De
1984 à 2014, la végétation continentale reste la plus
importante. Mais le fait le plus marquant est l'augmentation de la mangrove et
des tannes surtout en 2006 et cela dégrade les sols cultivables, la
végétation et les ressources hydriques et favorise ainsi
l'importance la salinisation dans le milieu.
DJOHY. G. L et al (2016), dans son article
intitulé : « Dynamique de l'occupation du sol et
évolution des terres agricoles dans la commune de Sinende au
Nord-Benin », publié le 2 avril 2017 par HAL open science
analyse la dynamique de l'occupation du sol et l'évolution des espaces
agricoles afin de caractériser la variation du couvert
végétal dans le milieu d'étude.L'auteur se basse sur
l'analyse des images satellitaires prises en 1990,2000 et 2010 et des
données statistiques des espaces agricoles de 1995 à 2012. En
termes de résultats, cette étude monte une évolution
négative du foret galerie, de la forêt dense semi-décidue
et de la savane saxicole et une dynamique positive de la superficie des
agglomérations et des espaces de culture et jachères. Ainsi,
entre 1990 et 2010, la superficie du foret galerie a connu une
régression de - 97,28% et celle de la forêt dense
semi-décidue, une chute de - 99,61%. La savane saxicole quant à
elle, voit une réduction de - 79,32% de leur superficie. Par contre,
s'oppose la situation de la superficie des agglomérations avec
progression de 97,01% et celle des espaces de culture et jachères qui
gagnent 51,31% entre les années 1990 aux années 2010.
L'évolution réversive de la végétation est due
à l'extension des espaces agricoles, aux pressions démographiques
et aux techniques culturales et traditionnelles. Cette situation alarmante est
d'autant plus inquiétante du fait des conditions climatiques. La commune
de Sinende au Nord-Benin est donc exposée aux risques de disparition de
son foret galerie. Cette tendance de disparition, observée entre 1985 et
2010, s'explique non seulement par l'extension de la ville et des espaces de
cultures et jachères mais aussi par les conditions climatiques non
favorables dans le milieu.
FAYE. Guilgane (2016), dans sa thèse
intitulée : « Impacts des modifications
récentes des conditions climatiques et océanographiques dans
l'estuaire du Saloum et ses régions de bordures
(Sénégal) », aborde les impacts du changement
climatique et de la dynamique marine dans l'estuaire du Saloum et ses
bordures.Sa méthodologie comprend plusieurs étapes allant des
travaux de terrain et de laboratoire à leur traitement. La collecte de données est faite grâce
aux outils tels que la tarière, le GPS type Magellan et Garmi 76 CXS en
couleur, un appareil photographique, un décamètre, des piquets de
1cm chacun, un disque de Secchi et une corde avec un poids de 5kg pour mesurer
la profondeur des cours d'eau. L'échantillonnage se fait selon la nature
du terrain. Les images Landsat des années 1979, 1984, 1996, 1986, 2003
et de 2011 sont utilisées pour la réalisation de cartes
diachroniques. Les travaux de laboratoire se portent sur la
granulométrie et le calcul des paramètres texturaux et des
indices. Le traitement des données est fait par les logiciels Word, Arc
gis, Excel, Map info et ERDAS Imagine. Les résultats obtenus
révèlent une évolution considérable des
différentes unités morphologiques du milieu entre 1980 et 2010.
En effet, en 1986, la savane arbustive représentait 46,32%. La
superficie des sols nus estimés à 17,04% et à 9,28% de
celle des eaux permanentes. La superficie de la vasière à
mangrove couvrait les 11,85% de la superficie totale et celle des tannes
12,23%. En fin, la superficie boisée dans les forêts
classées et les marais salants représentaient respectives 3,10 et
0,18% environ. La situation en 2014 monte une évolution
régressive da la savane, de la superficie boisée des forêts
classées et des eaux permanentes et une dynamique positive de la
vasière à mangrove, des sols nus, des tannes et des marais
salants. Ainsi, la savane arbustive a connu une chute de - 17,92%. La
superficie boisée dans les forêts classées a subi une
réduction de - 0,23% et les eaux permanentes quant à elles,
connaissent un recul de - 0,09% entre 1986 et 2014. Par contre, on note
unehausse de 1,15% de la superficie de la vasière à mangrove, une
augmentation de 3,02% de celle des tannes et une avancée de 14% de la
surface occupée par les sols nus. Concernant les marais salants, ils ont
connu une progression de 0,03% entre les années 1986 aux années
2014. Les facteurs explicatifs généraux de la dynamique des
différentes unités paysagères dans l'estuaire du Saloum de
1980 aux années 2014 sont les modifications récentes du climat et
la dynamique de l'océan. A ceux-là, s'ajoutent les
activités anthropiques par exemple le reboisement, l'une des
caractéristiques de l'évolution positive de la superficie de la
vasière à mangrove dans le milieu.
NDIONE. Omar (2016) : « Dynamique des
unités morphologiques le long du Saloum de Palmarin-Diakhanor à
Ndangane de 1960 aux années 2010 », est un mémoire de
recherche qui met l'accent sur l'évolution des différentes
unités morphologiques de Palmarin-Diakhanor à Ndangane et les
facteurs qui la façonnent.L'auteur a utilisé plusieurs
méthodes de collecte, de traitement et d'analyse de données
telles que la recherche de document, le travail de terrain à l'aide des
outils comme le GPS de type Magellan ou Garmi, d'un appareil numérique
pour la mise en oeuvé des données qualitatives et
l'identification des différentes unités paysagères et la
télédétection à partir d'images satellitaires des
années 1986, 1999, 2006 et 2014. Les résultats s'avèrent
que les facteurs explicatifs de l'évolution des unités
morphologique sont d'ordre naturels et anthropique, et que le facteur le plus
influent est la rupture de la brèche de Sangomar en 1987. En effet, la
disparition de 2,67% de le mangrove et de 0,14% de la végétation
continentale entre 1986 et 1999 et la présence considérable des
tannes en 1986 (30,58%) est due au déficit pluviométrie
annonçant la rupture de la flèche de Sangomar. De 1999 à
2006, on note une régénération de la mangrove et de la
végétation continentale passant respectivement de 27,23% et
19,33% à 30,04% et 20,51% au détriment des tannes qui voient une
réduction de leur superficie de 25,05% en 1999 à 24,94% en 2006.
Cette situation est liée à la quantité importante de la
pluviométrie enregistrée entre 1999 et 2006. La baisse plus ou
moins important de la pluviométrie, favorisant l'évaporation et
la salinisation des eaux a occasionné le recul de la mangrove jusqu'
à 24,14% et de la végétation qui ne représente que
19,16% en 2014 et l'extension des tannes de 24,94 en 2006 à 34,37% en
2014. L'auteur déduit que la dynamique des unités morphologique
de Palmarin-Diakhanor à Ndagane, des années 1960 aux
années 2010 est liée à la rupture de la brèche de
Sangomar, aux processus de remontée au niveau des nappes, à la
variation pluviométrique et aux activités de l'homme. Cette
situation alarmante a des impacts négatifs sur l'environnement et sur
les activités socio-économiques du milieu tels que la
salinisation des eaux et des terres et la réduction des terres
cultivables et de la végétation.
TOURE. M. A el al (2016) « Dynamics, Analysas and
Factors in Landscape Units `Evolution in Sénégal River Delta
Ecosystems », est un article publié dans le Journal of
Geographic, Environment and Earth Sciences en 2016, volume7, Issue1 qui
étudie la dynamique et les facteurs de l'évolution des
unités paysagères dans les écosystèmes du delta du
fleuve Sénégal.Cette étude se basse sur la
télédétection et des SIG à partir d'images Landsat
des années 1977,1988, 1999, 2006 et 2014. Le traitement des
données consiste à une classification supervisée par
maximum de vraisemblance sur des néo canaux (ACP et NDVI). Elle
résulte que les facteurs justificatifs aussi bien d'ordre naturels
qu'anthropiques sont à l'origine de la dynamique des différentes
unités morphologiques du milieu. Cette évolution se voit par un
taux d'extension de 64% du couvert végétal, 6,77% des zones de
cultures et 4% des eaux de surfaces et une régression des terres
salées de 74,69% et des surfaces dunaires de 15,62% entre 1971 et 2014.
Le delta du Sénégal a connu généralement une
évolution positive des différentes unités morphologiques
présentes dans le milieu et cela est influencé à la fois
par les facteurs naturels et anthropiques. Les aménagements
hydroagricoles, la croissance démographique et les politiques de
protection et de conservation ont entrainé la progression du couvert
végétales, des terres cultivables et des eaux de surface.
Toutefois, la régression des tannes ainsi que de la surface des dunes
est due à l'extension des terres arables et à l'importance de la
pluviométrie dans le delta du fleuve Sénégal des
années 1971 aux années 2014.
FAYE. Bineta (2017), dans sa thèse
intitulée : « Dynamique de la salinisation des
terres de 1971 à 2010 et variation climatique le Nord de l'estuaire du
Saloum (Sénégal) », s'intéresse à la
relation entre la variation climatique et la dynamique des terres salées
dans le Nord de l'estuaire du Saloum.La méthodologie adoptée par
Bineta s'est basée sur l'analyse de la
variation climatique, le traitement de données satellitaires de 1973
à 2014, les analyses physiques et chimiques des sols, et la
méthode statistique de régression Linéaire. Les
résultats montent que la variation climatique est à plus de 90%
le facteur déterminant de la dynamique des terres salées. Cette
variation se caractérise par une augmentation de la vitesse du vent de
0,7m/s à la fin des années 2000, une hausse de la
température de 0,3°C à la fin des années 1990, un
déficit de la pluviométrie de plus de 30% dans toutes les
stations à la fin des années 1960 et au retour de la
pluviométrie à partir des années 2000, à
ceux-là s'ajoutent la déforestation, l'hydrologie et la
topographie du milieu. Ainsi, en 1973, les terres salées occupaient
29,2%, l'espace agraire 34,6%, la mangrove 12,6%, la végétation
19,3 et l'eau 4,1% de la surface totale. Arrivée en 2014, toutes les
unités, excepté les terres salées et l'espace agraire ont
connu une très forte régression de leur superficie soit un taux
de - 79% pour la mangrove, - 9% pour la végétation et - 3,6% pour
l'hydrologie. La superficie des terres salées n'a cessé
d'augmenter jusqu'à 56171,3 ha soit un taux de progression de 39,4%.
Cette dynamique se manifeste dans la quasi-totalité du milieu à
l'image de Faoye et dans l'ile de Diamniadio. Quant à l'espace agraire,
le taux d'évolution tourne autour de 2,9%. Ces terres salées
gagnent chaque année 995,7 ha en moyenne au détriment des autres
unités morphologiques du milieu. L'analyse physique et chimique
résulte que les sols des tannes sont dans l'ensemble très acides
en faveur des tannes nues au détriment des tannes herbacées et
arbustives. Cela a en trainé la réduction de la surface des
terres agricoles, de la végétation ainsi que la surface de la
mangrove. L'analyse diachronique des cartes entre 1973 et 2014
révèle alors une évolution ascendante des terres
salées par rapport aux autres entités morphologique due à
grande partie à l'évolution climatique.
SY. Mamadou (2017) : « Dynamique des
unités de paysages entre le marigot de Tabor et la bouche de
Soungroungrou des années 1980 à 2010 », est un
mémoire de recherche. Dans ce travail, Amadou cherche à analyser
la dynamique des unités paysagères, leurs facteurs et impacts
entre le marigot de Tabor à la bouche de Soungroungrou entre 1980 et
2010.L'approche méthodologique de l'auteur s'inscrit sur la revue
préliminaire de documents, la collecte de données
d'enquêtes sur les activités socio-économiques (5 villages
choisis sur 13) et l'analyse de cartes diachroniques pour visualiser la
dynamique des unités de paysages au sein du milieu d'étude. Cela
résulte que la mangrove, la végétation continentale, les
tannes, les terres de cultures ainsi que les eaux permanentes, constituants les
différentes unités morphologiques du milieu, ont toutes connu une
dynamique considérable. En effet, en 1984, les tannes
représentaient 39,1%, les eaux permanentes, 23,4% et la
végétation continentale occupaient les 23,5% de la superficie
totale. Les terres de culture et les mangroves étaient les moins
représentatives, respectivement avec 13,9% et 0,02%. Arrivée en
2016, les résultats montent une augmentation de 29,58% de la mangrove et
de 14,9% de la superficie des terres de culture de 1984 à 2016. Quant
aux autres unités, on note une évolution régressive avec
un recul de - 27,3% pour les tannes, de - 14,2% pour la
végétation continentale et de - 3% de la superficie des eaux
permanentes. Cette dynamique s'explique par les fluctuations climatiques telles
que les variations de la pluviométrie, l'évaporation et le vent
mais aussi par la salinisation et l'érosion hydrique qu'éolienne.
A ceux-là s'ajoutent les activités anthropiques comme le
déboisement de la végétation continentale qui engendrent
des effets négatifs sur l'écologie et les activités
socio-économiques du milieu d'étude.
AGBANAU. B. T (2018) : « Dynamique de
l'occupation du sol dans le secteur Natitingou-Boukombé (nord-ouest Benin) :
De l'analyse diachronique à une modélisation
prospective », est une thèse de doctorat soutenue le 16
octobre 2018 à l'université de Toulouse. L'objectif de cette
étude est de quantifier la dynamique paysagère et d'explorer les
futurs possibles de l'occupation du sol dans le secteur
Natitingou-Boukombé, un milieu couvrant les 6% du territoire national du
Benin.L'auteur s'appuie sur des outils de télédétection,
de SIG et de la modernisation spatio-temporelle. Les données
utilisées sont des images satellitaires Landsat TM de 1987, ETM+ de
2000, OLIR TIRS de 2016, et des séries d'images Modis VCF et NDVI de
2000 à 2016 pour quantifier les changements des unités
morphologiques du milieu d'étude. Il ressort des résultats de
cette analyse une dynamique remarquable des unités paysagères du
milieu due à des facteurs climatiques ainsi qu'aux activités
anthropiques. En effet, en 1987, le milieu est largement dominé par les
forêts classées et savanes boisées qui couvrent une
superficie de 38,81%, les savanes arborée et arbustive occupent 25,82%
et les mosaïques de culture et jachères qui représentent les
24,33% de la superficie totale. Tandis que les autres unités, elles ne
sont pas très représentatives et sont en proportion
inférieur à 6%. L'analyse de la situation en 2016 indique un
hause des mosaïques de culture et jachères passant de 38,19% en
2000 à 50,61% en 2016. Ensuite, viennent les savanes arborée et
arbustive qui couvent 40,53% contre 36,74% de 2000 à 2016, les savanes
saxicoles qui représentent 3,84% et les agglomérations qui
occupent 2,19%. Les autres unités paysagères occupent moins de 1%
de la superficie totale. La dynamique progressive des mosaïques de culture
et jachères surtout en 2016 s'explique par la croissance
démographique observée ces dernières années dans le
secteur. Par contre, l'évolution régressive des forêts
claires et savanes boisées et l'état du couvert
végétal est influencée par les feux de
végétation souvent provoqués par les populations en
période de sècheresse et aux perturbations du climat. Ces
facteurs ci-dessus combines à l'analyse prospective a permis à
Bidossessi Thierry d'explorer trois scenarios prospectives possibles à
l'horizon 2031. Ainsi, le dernier scenario, le scenario Durabilité
Environnement Coordonnée ( DEC) qui intègre la
présentation de l'environnement, présente un paysage
essentiellement composé 69,97% de mosaïques de culture et
jachères, de 22,06% de savane arborée
et arbustive, de 3,07% de savane saxicoles, d'agglomération(2,03%), de forets claires et savanes boises ( 1,07%) et de
plantation ( 1,05%) en 2031 d'où un effort de restauration des savanes
arborée et arbustive, des forêts claires et savanes boises et des
plantations.
KANE. Modou (2018) : « Dynamique des
unités de paysages le long du marigot de Baila des années 1980
aux années 2010 », est un mémoire de recherche qui
revient à titre d'analyser les facteurs et impacts de la dynamique des
unités morphologiques et les stratégies de lutte contre la
dégradation des ressources naturelles le long du marigot de Baila entre
1980 et 2010.Modou s'appuie sur la revue documentaire au sein des
bibliothèques et le travail de terrain par des visites et observation
directs,des enquêtes et de l'analyse diachroniqueentre les années
1980 aux années 2017. Il monte que les différentes unités
morphologiques du milieu ont connu de mutations considérables. Ainsi,
entre 1980 et 2017, cette évolution se manifeste par une dynamique
positive de 1004,8 ha soit 0,61% pour la mangrove et de 6677,4 ha pour la
végétation continentale soit environ 4,30% de la superficie
totale. Durant cette même période, on note une dynamique
négative des autres unités de paysages. Ainsi, les terres
salées ont connu une régression de - 3156,2 ha soit un taux de -
1,9%. La superficie des cours d'eau a légèrement baissé
avec un déficit de - 278,7 ha soit - 0,14%. Quant à la superficie
des sols nus, elle a connu un recul de - 4805,5 ha estimée à une
perte de - 2,86%. L'évolution progressive de la superficie de la
mangrove et celle de la végétation continentale et les
changements régressifs des terres salées, des eaux de surface et
des sols nus, s'expliquent par le retour progressif de la pluviométrie
au cours de ces dernières décennies et de la mise en place des
techniques de lutte pour la conservation des ressources naturelles du milieu.
Les unités paysagères le long du marigot de Baila, à
l'image de la végétation continentale et la mangrove, ont connu
une évolution favorable. A cela s'oppose la situation des terres
salées, des sols nus et des eaux de surface qui connaissent une
dynamique régressive de leur superficie entre 1980 et 2017.
SY. A (2018), dans son mémoire
intitulé : « Dynamique morpho-sédimentaire de
l'ile Doune Baba Dieye de 1971 aux années 2010 »,
étudie l'évolution morpho-sédimentaire de l'ile de Doune
Baba Dieye et déduit les processus de la dynamique actuelle ainsi que
ses conséquences socio-spatiales.Plusieurs technique et démarche
d'acquisition de données ainsi que des systèmes de restitution
des informations sont utilisés par l'auteur au cours de cette recherche.
Il s'agit du suivie topographiquepar des piquets, l'utilisation du GPS pour la
prise de coordonnées et le suivi du recul du cordon à partir d'un
repère fixe et l'analyse diachronique des années 2003,1011 et
2019 et le travail de laboratoire pour l'analyse granulométrique par le
laboratoire de l'INP. Le traitement des données est effectué
grâce aux logiciels comme : ENVI, ERDAS Image, Arg gis, Arc view,
pour le traitement cartographique et GRADISTAT pour tracer une courbure pour
chaque échantillon afin déterminer les paramètres
texturaux. Les résultats sur l'évolution morpho-dynamique de
l'ile de Doune Baba Dieye, de 2003 à 2009 montent que depuis
l'aménagement de la brèche sur la langue de Barbarie, en Octobre
2003, l'ile a connu d'importantes modifications de l'extension de ses
unités morphologiques. En effet, la situation en 2003 indique que la
vasière à mangrove représentait 15,4%, les tannes et les
marais occupaient 29,4%. Quant aux cordons sablonneux, les champs et les
habitations, ils représentaient les 55,2% de la superficie totale. En
2011, on note une régression de - 3,6% de la superficie des tannes et du
marais et une augmentation de 2,7% de celle de la mangrove ainsi que de 0,9% de
la superficie des cordons sablonneux. La situation en 2019 monte une
évolution négative des cordons sablonneux avec 47,6% contre 56,1%
en 2011, soit une régression de 8,5%. Cette perte s'explique par du fait
que l'essentiel de l'érosion sur l'ile s'effectue sur cette
unité. A celle-là s'oppose l'évolution positive de la
vasière à mangrove. Elle gagne une superficie de 13,4% soit 31,5%
en 2019 contre 18,1% en 2011. Cette dynamique progressive de la
végétation mangrove est influencée en grande partie par
les campagnes de reboisement entrepris par Ahmed Sène Diagne, Chef du
village de Baba Dieye Diagne en compagnie du GIE Bokk Jom de Doune Baba Diagne.
La brèche d'Octobre 2003 a stimulé une forte dynamique des
différentes unités de paysages de l'ile de Doune Baba Diagne
entre 1971 et 2010. Cette évolution, en faveur de la vasière
à mangrove, s'explique essentiellement par les techniques de lutte pour
la conservation de cet écosystème.
TOURE. M. Aissatou (2018), dans sa thèse de doctorat
intitulée : « Variation climatique et dynamique des
écosystèmes du delta du fleuve Sénégal des
années 1950 aux années 2010 », soutenue le 10 novembre
2018, tente à analyser la variation climatique et à
évaluer ses effets sur la dynamique des écosystèmes dans
le delta du fleuve Sénégal.Le travail méthodologique
consiste aux relevés de pont de GPS des différentes unités
de paysages, à la prise de photos et aux enquêtes de terrain. Des
analyses de données climatiques, de granulométrique et de
sédimentologique sont aussi effectuées. Des images satellitaires
et photos aériennes sont utilisées pour effectuer l'analyse
diachronique. Le traitement des données est réalisé avec
les logiciels comme : ENVI, Arc gis et Excel pour obtenir des
résultats sur la dynamique du milieu. Les résultats obtenues,
basées sur l'analyse des données montent que le facteur principal
de la dynamique des changements d'état des unités morphologiques
est la variation pluviométrique qui est l'élément
caractéristique de la variation climatique du sahel. En effet, entre
1977 et 2014, on note un gain de la superficie des eaux, des
végétations aquatique et continentale et de la zone de culture et
une perte de l'unité des terres salées et de la dune. Ainsi, la
végétation aquatique a passé de 4,4% en 1977 à
11,2% en 2014, soit une accrétion de 6,8%. La végétation
continentale représente 27,1% en 2014 contre 2,1% en 1977 soit un taux
de progression de 25%. La superficie de la zone de culture passe de 3,0%
à 12,0% entre 1977 et 2014. Quant aux eaux, elles ont connu une
augmentation de 0,3%. Durant ce même intervalle, la surface des terres
salées a connu un recul de - 35,2% et celle de la dune, une
réduction de - 5,7%. Cette dynamique de gain et perte de la superficie
des unités paysagères, s'explique par le retour de la
pluviométrie qui se traduit par une période d'abondance de 1998
à 2014 suites d'une longue période déficitaire des
années 1970 aux années 1997. En plus de cet impact naturel, la
dynamique du milieu est aggravée par les actions anthropiques telles que
les aménagements hydrauliques et les constructions hydroagricoles. La
variation de la pluviométrie et les activités anthropiques sont
donc en grande partie les facteurs explicatifs de la dynamique des
unités morphologiques dans le delta du fleuve Sénégal des
années 1950 aux années 2010. Du point de vue environnemental et
socio-économique, cette évolution est à l'origine de
plusieurs impacts entre autres nous pouvons citer : la salinisation des
terres et des eaux, l'amplification de l'érosion côtière et
la menace sur les aires protégées telles que le Parc National de
la Langue de Barbarie (PNLB).
SOW. E. H (2019), dans sa thèse de doctorat
intitulé : « Dynamique de l'écosystème
mangrove de la réserve de biosphère du Delta du Saloum
(RBDS) », Sénégal, de 1965 à 2017 et analyse des
politiques de restauration », soutenue le 31 Octobre 2019 à
l'UGB, aborde la dynamique de la mangrove de la RBDS entre 1965 et 2017 et une
analyse des facteurs et les effets de faiblesse des mesures de
restauration.L'approche méthodologique utilisé intègre le traitement des photographies aériennes, des
images satellitaires Landsat et Sentinel, des méthodes statistiques et
des mesures in situ. Différents outils sont utilisés pour le
traitement des données à l'image de : Arc gis10.2 et Excel.
Les résultats sur la dynamique des unités morphologiques
relèvent une dynamique à tendance négative de la mangrove,
du foret galerie et de la savane et une évolution à tendance
positive des tannes, des sols nus et de la culture pluviale. Ainsi, la
situation de la mangrove se traduit comme suite : 55831,03 ha en 1965,
53533,70 ha en 1984, puis 54135,86 ha en 1999 et 53691,69 ha en 2017 soit une
perte de 2139,34 ha entre 1965 et 2017. Quant aux tannes, un note une
progression de 1,27% entre 1965 et 2017, de 2,29% pour la culture pluviale et
de 0,17% pour les sols nus. En conclusion, la dynamique régressive de la
mangrove, dans la réserve biosphère du Delta du Saloum, de 1965
à 2017, liée aux facteurs naturel et anthropique, a
occasionné des initiatives de restauration qui sont malheureusement
très limitées.
Ces références consultées abordent
essentiellement des thèmes tournant autour de la dynamique des
unités morphologiques, les facteurs d'origines ainsi que leurs impacts
sur l'écologie et sur les activités économique et sociale
en particulier dans les milieux estuariens et deltaïques. Elles adoptent
des approches scientifiques tels que la télédétection, les
méthodes de piquets, l'utilisation des outils tels que la
tarière, le GPS, ... et les analyses de laboratoire. Les
résultats obtenus montent que l'évolutiondes unités
paysagères, liée essentiellement aux conditions climatiques,
océanographiques et anthropiques, a des répercussions
considérables sur l'environnement et sur les activités
socio-économiques des milieux humides. Dès l'or, ce milieu
constitue un espace géographique pertinent quipermet d'expliquer sans
équivoque la dynamique en cours, la relation entre condition climatique,
activité anthropique et dynamique des unités de paysage, les
impacts sur le milieu et les stratégies d'adaptations mises en oeuvre.
Cela justifie l'intérêt du choix de notre thème
d'étude et permet d'aborder la problématique suivante.
2.2. Problématique de recherche
2.2.1 Contexte
Les sécheresses des années 1970 et le
déficit pluviométrique qui s'en est suivi ont favorisé
dans le domaine intertropical, précisément dans les zones
estuariennes, lagunaires et deltaïques, une diminution des apports d'eau
douce (FAYE, G. 2016). En effet, ces modifications climatiques et
océanographiques récentes ont entrainé un stress hydrique,
une salinisation des terres et des cours d'eau, une perte significative de
terres arables et un bouleversement de l'écosystème de l'estuaire
du Saloum. Ainsi, ce dernier où se localise notre milieu d'étude,
voit une régression sans cesse des végétions continentale
et mangrove. Cette dernière, qui joue un rôle d'importance
économique ainsi que protectrice contre l'avancée de la langue
salée sur les terres de culture, disparait de plus en plus au profit des
terres salées.
Cette régression de la végétation
mangrove s'amplifie en grande partie par le déficit de la
pluviométrie noté durant ces dernières décennies.
En effet, l'apport faible en eau pluviale facilite la remontée des eaux
salées de la mer sur les eaux douces. Ainsi, cette intrusion marine
entraine l'avancée du biseau salé et rend la
végétation mangrove plus vulnérable. Le facteur
déterminant de la dynamique de la mangrove dans l'estuaire du Saloum est
la pluviométrie (DIEYE et al, 2013). A ce bouleversement
écologique s'ajoute la perte des terres cultivables. Quels est le
facteur principal de la disparition de la végétation mangrove
?
L'agriculture est le secteur source économique du
Saloum et l'activité principale de revenue et de subsidence de la
population qu'y vit. On y pratique de l'agriculture et l'élevage qui
occupent près de 90% de la population totale (UICN, 2003). Cependant,
cette source vitale qui dépend quasiment de la fertilité du sol
est devenue de moins en moins rentable à l'instant où ce sol
subit d'énormes pressions à la fois naturelles qu'anthropiques.
De ce fait, pour assurer leur survie, beaucoup s'adonnent à d'autres
activités plus rentables, certains abandonnent leurs terres pour aller
installer ailleurs tandis que d'autres développent des stratégies
bien qu'insuffisantes pour conserver leurs champs. Cette perte de terre est
liée essentiellement au déficit pluviométrique et à
la dynamique progressive des tannes. Cette progression se manifeste par une
salinisation et une acidification forte des terres et des cours-d `eau. Ce
phénomène très fréquent dans le milieu se justifie
globalement par l'apport faible en eau douce et l'augmentation de la
température. Ceux-ci en complémentarité avec
l'augmentation de l'évaporation et les conditions
océanographiques et estuarienne du milieu. La dynamique de
l'océan se justifie par l'incursion marine dans les terres, les courants
et masses d'eau, la houle, l'érosion, etc. Cette dernière
(érosion) est un phénomène très remarquable dans le
milieu. En effet, elle se justifie en partie par la rupture du 27
février 1987 de la flèche de Sangomar au niveau du Lagoba, l'un
des facteurs justifiant le visage actuel de l'estuaire du Saloum et le
principal facteur de l'évolution progressive de la salinisation des
cours d'eau et des terres arables du milieu. L'ouverture de la brèche a
favorisé l'avancée du biseau salé sur les terres arables
et même dans le domaine continental. Quels sont les impacts de la
dégradation des terres arables sur le milieu ?
Cette dynamique de l'état physique du milieu est
amplifiée par la pression humaine. Le littoral, milieu dynamique sur
lequel les installations humaines sont de plus en plus nombreuses, est soumis
à de fortes pressions naturelles et anthropiques (JABBAR, 2016). En
effet, l'accroissement significatif de la population noté ces
dernières décennies le long des littoraux
sénégalais est de pair avec le besoin sans faille de nouveaux
habitats et de survie. Ainsi, y découlent la surexploitation des
ressources, la déforestation de la mangrove et la pression sur les
terres agricoles. A ceux-là, s'ajoutent les aménagements humains
tels que les hôtels, les campements, les quais de transformations de
produits halieutiques, la surpêche, la cueillette des produits
forestiers, l'extraction dévaste du sel, la surexploitation des
coquillages, ... qui modifient l'état normal de l'environnement et
l'écosystème de l'estuaire du Saloum en général et
celui de notre milieu d'étude en particulier. L'homme à travers
ses activités n'est-il pas un agent qui accélère le
bouleversement de l'environnement du milieu ?
Plusieurs tentatives de conservation de la
végétation mangrove et de pratiques de récupération
des terres arables ont été mises en oeuvre à la fois par
la population et les institutions. Ainsi, des pratiques de reboisement, de
sensibilisation et de construction de digue et de barrage, ... sont
adoptées par la population locale, les ONG ainsi que l'Etat. Cependant,
ces initiatives de restauration sont malheureusement très
limitées (SOW E. H, 2019). Face à ces destructions, est-il
possible de protéger et de restaurer l'écosystème marin et
de récupérer les terres arables prises par le sel ?
Cet ensemble de questions préoccupe depuis des
décennies les chercheurs d'études environnementales,
écologiques, géomorphologiques, climatiques, ... ainsi que la
société civile (le paysan), l'Etat, les Organisations Non
Gouvernementales, ... car constitut l'une des problématiques actuelles
et alarmantes de l'environnement, l'économie et de la
société.
De ce, notre thème de recherche a alors un
intérêt qui se justifie sur plusieurs plans.
2.2.2 Justification du choix du
sujet
L'étude de la dynamique des unités
morphologiques de 1970 à 2020 est un thème de recherche dont
l'intérêt est aussi bien écologique,
socio-économique que scientifique.
Sur le plan écologique, notre milieu d'étude se
situe au nord du delta du Saloum. Ce dernier, qui s'entend environ à
500000ha, concentre une part remarquable des ressources faunique et floristique
du Sénégal. Il est à la fois une réserve de biosphère en 1981 par le
programme de l'UNESCO sur l'Homme et la Biosphère (MAB) et une zone
humide d'importance international en 1984 par la convention de RAMSAR (UICN,
2003). La réserve biosphère du delta du Saloum (RBDS) est
notamment le premier site mondial de production de la sterne royale (Sow E.
H,2019), troisième site d'importance ornithologique de l'Afrique de
l'Ouest après le Banc d'Arguin au Mauritanie et le Djoudj au
Sénégal (UICN,2003) et le sixième estuaire mondial en
termes de diversité ichotyofaunique (Sow,2019). Le delta du Saloum est
composé d'un parc national, de forêts classées et d'une
aire marine protégée et des réserves naturelles. On y
retrouve 95 espèces d'oiseaux, 114 espaces de poissons appartenant en 52
familles, 80 espèces de poissons cartilagineux, 470 espèces de
poissons osseux, des mammifères marins, des invertébrés
destinés essentiellement à l'exploitation et 188 espèces
ligneuses regroupées dans 50 familles (UICN, 2003). Il est une zone
humide constituée d'un écosystème de mangrove, de foret
clair et d'une multitude d'ilots et de chenaux appelés bolong servant
sources de nombreuses ressources naturelles, de reproduction de nombreuses
espèces halieutiques, de reposoirs et dortoirs de plusieurs
espèces d'oiseaux ainsi que d'une multitude d'activités
économique et sociale. Cependant, ce milieu d'importance
écologique est de plus en plus vulnérable face au changement
climatique et à la pression anthropique qui entrainent en partie une
dynamique progressive des terres salées et une régression des
écosystèmes marin et continental du milieu.
Sur le plan socio-économique, l'activité sociale
et économique du delta du Saloum repose essentiellement sur les
ressources naturelles du milieu. On y pratique de l'agriculture et
l'élevage qui occupe près de 90% de la population totale (UICN,
2003) et de la pèche grâce à la diversité des bras
de mer retrouvés dans le milieu. Le delta du Saloum est l'une des zones
touristiques les plus importantes du Sénégal. Le tourisme
constitue l'une des activités majores de l'estuaire du Saloum. Ce
dernier accueille des milliers de touristes venant de la sous-région et
du monde entier de par son climat spécifique, sa nature fluorescente, la
richesse de sa biodiversité, son patrimoine culturel et historique, sa
situation géographique, ainsi que son nombre d'importants
aménagements pour l'accueil et le séjour des visiteurs. On
dénombrait en 1998 neuf établissements hôteliers pour une
capacité totale d'accueil de 484 lits, auxquels il faut y ajouter 22
campements touristiques pour environ 250 lits (UICN, 2003). On y retrouve
d'autres activités comme la cueillette des produits forestiers,
l'extraction du sel, l'exploitation des coquillages, la transformation des
produits halieutiques, la chasse et le commerce. C'est une zone très
humide, calme, et moins couteuse propice au bien-être et à la
jouissance de la communauté. Ce bon nombre activité et avantage
que fournit le delta du Saloum, dépendent essentiellement de la
stabilité et de la conservation des ressources naturelles du milieu.
Sur le plan scientifique, la question sur la dynamique des
unités paysagères, les facteurs qui la façonnent ainsi que
leurs impacts sur l'homme et son environnement, a toujours fait l'objet de
nombreuses études dans le monde entier et en particulier dans le delta
du Saloum. Ce thème est abordé exclusivement par Diagne S.
(2012), Dione K. (2014) et par Faye P. (2015) ; partiellement par Faye G.
(2016), Faye B. (2017) et Sow E. H. (2019). En effet, les travaux de Diagne S.
(2012) s'appuient sur l'implantation des piquets sur la plage des trois iles
(Niodior, Dionewar et Falia) et de la télédétection
à partir des images satellitaires de 1984 à 2011. Cette approche
lui a permis d'affirmer que la dynamique des unités morphologiques de
l'estuaire du Saloum, qui se manifeste par une régression continue des
végétations savane et mangrove au profit des tannes, est
liée à la rupture de la flèche de Sangomar et à la
chute de la pluviométrie surtout en 1980. Dione K. (2014) a
utilisé le GPS de type Magellan ou Garmi, un appareil numérique
et des cartes diachroniques de 1984 à 2011 pour étudier
l'évolution des unités de paysage dans l'aire marine
protégée de Bamboung. Ainsi, ses résultats lui ont permis
de confirmer que cette dynamique affecte les aires marines du Saloum qui voient
la mortalité des essences comme le genre rhizophora, la pollution de
l'eau, la disparition de certaines espèces marines. On retrouve cette
même approche méthodologique dans les études de Faye P.
(2015) à la différence que dans ce travail, les images de 1984
à 2013 sont utilisées. Ainsi, l'auteur conclu que les facteurs
explicatifs de la dynamique des unités morphologiques varient d'un
milieu à l'autre. Les travaux de Faye G. (2016) se basse sur la collecte
de données par la tarière, le GPS type Magellan et Garmi 76 CXS
en couleur, un appareil photographique, un décamètre, des piquets
de 1cm chacun, un disque de Secchi et une corde avec un poids de 5kg,
l'échantillonnage et l'utilisation d'images Landsat d'une durée
de 32 ans et sur les analyses de laboratoires. Ainsi, ses conclusions affirment
que les modifications récentes du climat et la dynamique
océanographique sont les facteurs d'origines de la dynamique des
unités paysagères dans l'estuaire du Saloum. Les études de
Faye B. (2017) s'appuient sur l'analyse de la variation climatique, le
traitement de données satellitaires de 40 ans, les analyses physiques et
chimiques des sols. En définitive, ses travaux prouvent que
l'évolution des unités de paysage du delta du Saloum et des
terres salées en particulier est due à l'évolution
climatique. Les travaux de Sow E, H. (2019) se basse sur le traitement des
photographies aériennes, des images satellitaires Landsat et Sentinel,
des méthodes statistiques et des mesures in situ. Ainsi, ils confirment
que certains politiques de restauration des unités paysagères
comme la mangrove sont inefficaces face aux menaces faites par la dynamique.
Ces travaux utilisent des approches scientifiques tels que les
méthodes des piquets, de la statistique de régression
Linéaire, et de la télédétection et des outils de
la tarière, d'un GPS type Magellan et Garmi 76 CXS, d'un appareil
numérique, d'un décamètre, d'un disque de Secchi et d'une
corde avec un poids de 5kg et des analyses de variations physiques et chimiques
des sols et des eaux, ainsi que leur traitement pour suivre la dynamique des
unités morphologiques dans l'estuaire du Saloum.
Dès l'or, ce mémoire participe à la
compréhension de la dynamique des unités morphologiques de
l'estuaire du Saloum. Cela permet d'appréhender les facteurs de
l'évolution des unités paysagères le long de l'île
de Diamniadio à Faoye des années de forte sècheresse
(années 1970) aux années 2020 afin de voir leur impact sur
l'environnement et sur les activités socio-économiques du milieu
et les stratégies mises en place. Et cela suscite de poser les questions
suivantes :
2.2.3 Questions de
recherche
- Comment se manifeste la dynamique des différentes
unités de paysage le long de la ligne Diamniadio Faoye ?
- Quels sont les mécanismes naturels et anthropiques
qui commandent la dynamique des unités morphologiques ?
- Quels sont les impacts de la dynamique surl'environnement et
sur les activités socio-économiques du milieu ?
Pour répondre à ces
interrogations, les objectifs spécifique et secondaire suivants sont
fixés.
2.2.4 Objectifs de recherche
Les objectifs visés par ce travail sont
subdivisés en objectif général et en objectifs
secondaires.
2.2.4.1 Objectif général
L'objectif principal de notre étude vise à
comprendre la dynamique des unités morphologiques le long de l'ile de
Diamniadio à Faoye depuis les années 1970 aux années
2020.
Cet objectif général est détaillé
en trois objectifs spécifiques énumérés
ci-après.
2.2.4.2 Objectifs spécifiques
- Objectif spécifique 1 : analyser la dynamique
des unités morphologiques le long de l'ile de Diamniadio à Faoye
et ses facteurs.
- Objectif spécifique 2 : analyser les impacts de
la dynamique sur l'environnement et sur les activités
socio-économiques du milieu.
- Objectif spécifique 3 : caractériser les
stratégies de gestions préconisées par les
autorités compétentes.
Pour atteindre ces objectifs, les hypothèses suivantes
ont été avancées :
2.2.5
Hypothèses de recherche
Les hypothèses sont subdivisées en
hypothèses principale et secondaires.
2.2.5.1 Hypothèse principale
La péjoration climatique modifie l'état naturel
des unités morphologiques le long de l'ile
de Diamniadio à Faoye et cela rend la biodiversité et les
activités sociales et économiques du milieu plus
vulnérable. Cette hypothèse principale peut s'avérer
à travers d'hypothèses secondaires.
2.2.5.2 Hypothèses secondaires
- Hypothèse secondaire 1 : la variabilité
pluviométrique depuis les années 1970 est le facteur principal de
la dynamique des unités morphologiquele long de l'ile de Diamniadio
à Faoye.
- Hypothèse secondaire 2 : la dynamique des
unités paysagères se répercute négativement sur les
ressources naturelles et sur les activités économique et sociale
du milieu.
- Hypothèse secondaire 3 : malgré les
mesures de protection mises en place, les végétations mangrove et
continentale ne cessent de diminuer au profit des terres salées.
Pour mener à bien notre travail, nous allons
définir les concepts clés suivants :
2.3. Analyse conceptuelle
Une bonne compréhension de notre thème
nécessite au préalable une bonne maitrise de ses
différents concepts clés. De ce, les concepts à
définir par-là sont : dynamique, unités
morphologiques et le long de l'ile de Diamniadio à Faoye.
2.3.1 Dynamique
Le terme dynamique est selon Brunet (1992) un « changement résultant
d'un jeu de forces ».
La notion de dégradation ou de péjoration ne
peut concevoir que par la comparaison d'un état ou stade B avec un stade
A antérieur, une simple description de B, sans référence
à A n'ayant pas de signification dynamique et historique selon Monod. T
(1973), cité par Faye. P (2015).
Selon Ramade F. (2008), le terme dynamique désigne
«l'évolution dans le temps de la structure d'une communauté
induite par une variation de certains facteurs écologiques ou encore par
une perturbation endogène ou exogène provoquant l'apparition
d'une succession régressive ou progressive à partir du climax ou
vers ce dernier selon la période à laquelle on examine la
communauté à partir du temps initial ».
Selon Diatta. S (2012), la dynamique est « un
changement, une évolution, un ensemble de mouvants coordonnés,
suite à de transformations successives. (...) ici la notion de dynamique
désigne l'évolution des unités morphologiques dans
l'espace insulaire ».
La dynamique est un ensemble de processus ou de mouvements
provoquant une transformation ou une évolution d'un milieu bien
déterminé. Elle est dans le temps et dans l'espace des formes
géomorphologiques selon Maguette Ndione (2015).
La dynamique est un ensemble de processus d'évolution,
que les facteurs d'originesainsi que le résultat de cette
évolution d'état naturel d'un phénomène ou d'un
milieu donnéentre deux ou plusieurs dates. Elle renvoi donc à une
série de changements observés sur un ensemble d'unité
morphologique d'un milieu donné.
2.3.2 Unités morphologiques
Selon Breman. H et Rider.N (1999) cité par Ndione. M
(2015), les unités morphologiques peuvent (...) être
repartagées en unités de paysages, le critère
utiliséétant la capacité d'infiltration du sol en fonction
de la texture et relief.
Thiam Mame Demba, 1986 a fait une description plus globale du
concept. Selon lui, « les différentes descriptions retiennent
un schéma morphologique présentant :
- Les cordons littoraux et les plages anciennes
- Les amas coquilliers d'origine humaine
- Les vasières à mangroves (actuelles =
slikke)
- Les "tannes" (souvent anciennes vasières =
schorres).
Il ressort de cette classification une volonté de voir
correspondre des types de formes du milieu tropical à ceux du milieu
tempéré ».
Les unités morphologiques sont des formes
paysagères ayant des caractéristiques géographiques voire
géomorphologiques spécifiques observées dans un milieu
bien déterminé. Elles renvoient ici à la vasière
à mangrove, au cordon sableux, à la tanne et aux chenaux.
2.3.3 Le long de
l'ile de Diamniadio à Faoye
C'est le milieu physique où porte notre travail. C'est
donc l'unité géographique où s'effectuent les travaux de
mesures, d'enquête, d'entretien, ... tout au long de notre travail de
recherche.
Dans l'ensemble, laproblématiquede la dynamique des
unités morphologiques dans les milieux deltaïque, lagunaire et
estuarien a longtemps fait l'objet d'étudesassez multiples chez les
scientifiques. Ces recherches scientifiques ont cherché à
analyser le comportement de la dynamique, les facteurs explicatifs, les effets
sur l'environnement et sur les activités menées dans ces milieux
humides mais aussi les politiques d'adaptions mises en place. Pour mener
à bien ces recherches, ils adoptent des méthodes scientifiques et
des outils de mesures appropriés pour parvenir aux résultats. Ce
qui rend utile l'adoption d'une approche méthodologique solide et
adéquat dans le chapitre suivant pour mieux comprendre la dynamique des
unités morphologique le long de l'ile de Diamniadio à Faoye.
Chapitre 3 : Approche méthodologique
La méthodologie est définie comme
étant un ensemble de méthodes et techniques utilisées
d'une part, pour traiter les résultats des investigations et d'autre
part, pour rassembler les données (Goma Ndama. 1993). Ainsi, notre
approche méthodologique s'articule autour de cinq (5) étapes que
sont :
ü La revue bibliographique
ü Le recueil et le traitement des données
complémentaires
ü Les travaux de terrain
ü Les analyses de laboratoire
ü L'analyse de cartes diachronique
ALLER à la ligne
s
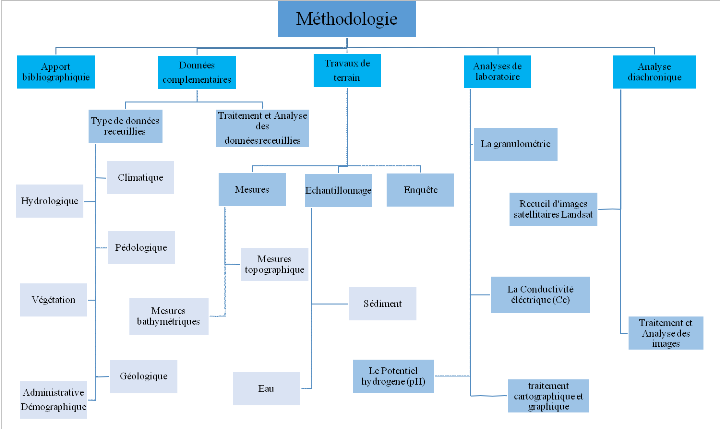
ü
Figure17 : Les grandes lignes d'approche méthodologique
adopté, Diouf S. Aziz, 2023
3.1. Apport de la bibliographie
Une multitude de documents est consultée pour avoir une
aperçue globale sur la dynamique des unités paysagères.
Ces productions littéraires sont à la fois de livres, de
mémoires, de thèses, des articles, de rapports de recherches
scientifiques, etc. Plusieurs sources de recherches telles que la
bibliothèque numérique de l'Ucad (https// : www.bibnum.ucad.sn),
mémoire online (https// : www.memoireonline.com), European Journal of
Geography, European Journal of Scientific Research et des encyclopédies
en ligne, ...sont consultées. Mais aussi des centres de documentations
comme la bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop
de Dakar (BU), la bibliothèque de la faculté des lettres et
sciences humaines, la salle de travail du département de
Géographie. La revue documentaire nous a permis de comprendre ainsi la
dynamique des unités morphologiques des estuaires qui se manifeste en
grande partie par une évolution régressive des
écosystèmes de mangrove et des cordons sableux et par
l'avancée des tannes. Elle nous a également permis d'avoir une
aperçue sur les facteurs d'origines, que sont essentiellement, la
péjoration climatique (déficit pluviométrique et
température élevée) et la pression de l'homme sur
certaines unités. Elle nous a enfin renseignés sur les impacts de
cette dynamique sur les activités socio-économiques et sur les
ressources naturelles des milieux estuariens et deltaïques. Ces
données bibliographiques sont renforcées par les données
de terrain. Les travaux de terrain vérifient l'ensemble des informations
recueillies par exploitation de document et étudient les
phénomènes qui ne sont pas mis en oeuvre dans le passé.
3.2. Collecte et acquisition de données
complémentaires
Il s'agit des données préexistantes
collectées au niveau des institutions nationales.
3.2.1 Le recueil des données
C'est l'ensemble des données obtenues au niveau des institutions et
agences nationales ou internationales telles que :
3.2.1.1 Les données climatiques :
Les données climatiques sont collectées au
niveau de l'ANACIM (Agence National de l'Aviation Civile Internationale et de
la Météorologie) ou au niveau de la station de Fatick. Elles
concernent les paramètres climatiques telles que : le vent
(directions et vitesse), la température, l'humidité relative,
l'insolation, l'évaporation et la précipitation pour mettre en
évidence les relations entre la variation climatique et les changements
d'états des unités paysagères du milieu. Des
données hydrodynamiques (houle, marée et vague) sont aussi
nécessaires.
3.2.1.2 Les données pédologiques
Les données sur la pédologie du milieu sont
recueillies au sein de l'INP (Institut National de la Pédologie) ou
à l'ISRA (Institue Sénégalaise de la Recherche Agricole).
Ces types de données concernent particulièrement le type de sol
du milieu.
3.2.1.3 Les données sur la
végétation
Les données les formations végétales sont
obtenues au niveau de la CSE (Centre de Suivi Ecologique) ou à laDEFCCS
(Direction des Eaux, Forets, Chasse et de la Conservation des Sols) pour mettre
entre évidence le type et la répartition de la
végétation dans le milieu.
3.2.1.4 Les données hydrologiques
Les données hydrologiques sont collectées au
niveau de la DGPRE (Direction de la Gestion et de la Planification des
Ressources en Eau) pour étudier les ressources hydriques
c'est-à-dire les eaux souterraines et surfaciques du milieu.
3.2.1.5 Les données administratives,
cartographiques
Les données administratives et cartographiques sont
recueillies au niveau de l'ANAT (Agence National de l'Aménagement du
Territoire) ou à la DTGC (Direction des Travaux Géographiques et
Cartographiques) ou au niveau de la Mairie pour voir les limites des villages,
des communes, l'occupation du sol, etc. Des données géologiques
et géomorphologiques sont aussi collectées pour l'étude
géologique et topographique du milieu.
3.2.1.6 Les données démographiques et
socio-économiques
Les données démographiques et
socio-économiques sont collectées au niveau de l'ANSD (Agence
National de la Statistique et de la Démographie). Ces données
concernent le nombre de concessions et de ménages et la population
totale de chaque village du milieu d'étude ainsi que la situation
économique et sociale de chacun de ces villages.
3.2.2 Traitement et
analyse des données issues des institutions
Les données collectées sont enfin
traitées et analysées. Le traitement est à la fois
cartographique et statistique à l'aide de plusieurs outils et logiciels
tels que Excel, Arc gis et Word, etc. L'analyse est aussi bien quantitative que
qualitative dont la représentation se fait sous forme tableur, de
graphiques et de cartes.
3.2.2.1 Données climatiques
Les paramètres climatiques tels que la
température, le vent, l'humidité relative, l'insolation,
l'évaporation et la pluviométrie, collectées au niveau de
l'ANACIM sont relatives à la normale 1991- 2020.
La température : pour connaitre la
variabilité de la température (en °C), nous avons
calculé la moyenne interannuelle minimale et la température
moyenne interannuelle maximale puis en déduire la température
moyenne interannuelle. Les résultats sont ensuite
représentés dans une courbe d'évolution dont les
températures en °C sur l'axe des ordonnées et le temps (les
années) sur l'axe des abscisses pour suivre la variabilité
interannuelle de la température de 1991 à 2020. Ce travail est
aussi effectué mensuellement pour voir la température moyenne
inter-mensuelle dans la station de Fatick de 1991 à 2020,
exprimée en degré Celsius (°C).
Le vent : Deux paramètres (vitesse, direction)
sont nécessaires pour l'étude du vent. Nous avons calculé
d'abord la moyenne interannuelle de la vitesse du vent qui s'exprime en m/s.
Les résultats sont concrétisés dans une courbe
d'évolution dont les vitesses en m/s sur l'axe des ordonnées et
les mois et années sur l'axe des abscisses pour voir la
variabilité entre 1991 et 2020 de la vitesse du vent. Pour la direction,
nous avons relevé les différentes directions dans chaque mois et
pour chacun des mois les directions N, NE, E, SE, S, SW, W et NW de 1991
à 2020. Les directions sont représentées dans des roses
des vents pour montrer les différentes directions inter mensuelle du
vent de 1991 à 2020.
L'insolation : durée de l'ensoleillement
mesurée en heures. L'insolation moyenne interannuelle est
calculée et représentée dans une courbe d'évolution
pour mesurer la variation interannuelle de l'ensoleillement en heures du milieu
de 1991 à 2020.
La pluviométrie et l'évaporation : elles
s'expriment en millimètre (mm). Nous avons calculé, pour
l'évaporation, la moyenne interannuelle depuis 1991 à 2020. Les
résultats sont concrétisés dans une courbe
d'évolution pour montrer la variabilité interannuelle de
l'évaporation de 1991 à 2020. Nous avons cherché ensuite
les cumuls inter mensuels et interannuels de la pluviométrie pour voir
la variabilité pluviométrique mensuelle,
caractérisé l'hivernage ainsi qu'analyser la variabilité
interannuelle de la pluviométrie de 1991-2020. L'indice de
Précipitations Standardisé est aussi calculé afin de
caractériser les années sèches et les années
humides. Il se calcule selon la formule : SPI = I = (Xi-Xm) /
Si ; Xi = cumul de la pluie pour une année i ;
Xm = moyenne annuelle des pluies sur la période 1971-2020
;
Si = écart type des cumuls annuels sur la même
période.
L'humidité relative : teneur en vapeur d'eau de
l'air ambiant, fonction de la température de l'air s'exprimant en
pourcentage (%). Pour l'étude de la variation de l'humidité
relative entre 1991 et 2020, nous avons cherché d'abord les moyennes
interannuelles minimale et maximale et en déduire l'humidité
relative moyenne interannuelle. La représentation graphique est faite
dans un diagramme en barre.
L'outil Excel est utilisé pour faire le calcul et la
représentation graphique des différents paramètres
climatiques.
3.2.2.2 Autres types de données
Les données hydrologiques collectées au niveau
de la DGPRE, celles biographiques recueillies à la CSE ou à la
DEFCCS ainsi que les données pédologiques prises au niveau de
l'INP ou bien à l'ISRA. Elles sont traitées par Arc gis 10.8 et
Excel pour représenter respectivement les eaux souterraines et
surfaciques, le type de végétation et la nature du sol du milieu
dans des tableaux ainsi que pour leur cartographie.
Les données géologique et
géomorphologique issues de la DTGC sont traitées par Arc gis.
Leur analyse permet des voir l'âge géologique des terrains du
milieu ainsi que l'élévation et la morphologie paysagère
du milieu.
Enfin, le traitement des données
socio-économiques et démographiques collectées à
l'ANSD se fait par le logiciel Excel. Leur traitement ont permis de savoir le
nombre de ménages en fonction des villages et d'établir un plan
d'échantillonnage pour l'enquête de terrain. Leur analyse permet
d'apprécier le niveau de vie et de l'économie pour chaque
localité.
Tableau 3:plan de collecte, de
traitement et d'analyse de donnéescomplémentaires.
|
Données
|
Types de données
|
Types de traitement
|
Lieux de collecte
|
Logiciels et outils
|
|
Climatiques
|
Pluviométrie, Température
Vent (vitesse etdirection)
Insolation, Evaporation
Humidité relative
|
Statistique
|
ANACIM
|
Excel
|
|
Hydrologiques
|
Eaux de surface
Eaux souterraines
|
Cartographique
Statistique
|
DGPRE
|
Arc gis 10.8
Excel
|
|
Biogéographiques
|
Type de végétation
|
Cartographique
|
CSE
|
Arc gis
10.8
|
|
Pédologique
|
Nature des sols
|
Cartographique
|
INP
|
Arc gis10.8
|
|
Géomorphologiques
Géologiques
|
Couches géologiques
Relief du milieu
|
Cartographiques
|
DTGC
|
Arc gis 10.8
|
|
Socio-
économiques et démographiques
|
Situation économique et sociale
Nombre de ménages, de concessions et de la population
totale
|
Statistiques
|
ANSD
|
Excel
|
Diouf Serigne Aziz, Décembre
2022.
Il est résumé dans ce tableau subdivisé
en cinq (5) colonnes (les données collectées, leur type, Le type
de traitement, les lieux de collecte de ces données et les logiciels
utilisées) le plan de collecte, de traitement et d'analyse des
données.
3.3. Les travaux de terrain
Les travaux de terrainconcernent les observations directes,
les mesures bathymétriques, la méthode de suivi par piquets,
l'échantillonnage d'eau et de sédiment ainsi que
l'enquête.
3.3.1 Les
prospections de terrain
Les prospections de terrainpermettent d'observer les terrains
les plus affectés par les tannes, que la végétation
dégradée ainsi que les actions de l'homme sur les ressources
naturelles du milieu. Ces prospections sont faites à l'aide d'un
appareil numérique pour la prise de photosd'illustratives.
3.3.2 Les
enquêtes
Les enquêtes sont effectuées à base d'un
questionnaire posé à la population des différentes
localités du milieu. La méthodologie de l'enquête
s'articule autour de trois axes que sont : les objectifs, le choix
d'échantillonnage, le protocole de collecte et le traitement des
données d'enquêtes.
3.3.2.1 Objectifs
Les questions sont posées à la population de
Diamniadio et de Faoye pour :
* Obtenir une aperçue sur la vision de la population
par rapport à la variabilité du climat et à
l'évolution des unités paysagères.
*Obtenir des informations sur l'ampleur des impacts de la
dynamique des unités sur les activités économique et
sociale du milieu.
*Avoir des renseignements sur les politiques de restaurations
mises en place par la population locale et institutions.
3.3.2.2 Choix d'échantillonnage
L'échantillon peut être définit comme un
sous-ensemble d'une population donnée, considéré comme un
véritable modèle réduit de la population
étudiée. Sur la base de la formule d'échantillonnage de
BERNOUILLI (n= (1,96)2Xn/ (196) +I2x(N-1))1(*) de la population, 97
ménages ont été enquêtés sur un total 290
(tableau 3). Le village de Diamniadio représente les 47 ménages
sur les 97, soit 48% de la taille de l'échantillon. Le village de Faoye
représente les 50 ménages de l'échantillon, soit les 52%.
Le choix des ménages a été fait selon la méthode
aléatoire lors de l'enquête (choix au hasard).
Tableau 4: Population à
enquêter en fonction des ménages.
|
Communes
|
Villages
|
Nombre de
Concessions
|
Nombre de
Ménages
|
Nombre de ménages enquêtés
|
Pourcentage des ménages enquêtés
|
|
Djirnda
|
Diamniadio
|
109
|
141
|
47
|
48
|
|
Djilasse
|
Faoye
|
130
|
149
|
50
|
52
|
|
Total
|
2
|
239
|
290
|
97
|
100
|
Source : ANSD, 2023
3.3.2.3 Outils,
protocoles de collecte et traitement des données d'enquête
Le questionnaire est créé et enregistré
dans le logiciel Kobotoolbox. Ce dernier a permis la collecte, le stock, le
déploiement et le traitement des données issues de
l'enquête. L'outil Excel et Google Earth sont aussi utilisés pour
retravailler certaines données de sorte statistique et cartographique
déjà traitées par l'outil Kobo Collect.
Les analyses qualitative et
quantitative des informations issues de l'enquête et des entretiens ont
permis de connaitre la perception paysanne de la dynamique des unités et
du changement climatique mais aussi des effets climatiques sur ces
unités. Elles ont aussi permis de quantifier les impacts de la dynamique
des entités paysagers sur les activités sociales et
économiques et sur l'environnement. Elles ont fourni enfin des
informations sur les politiques de restaurations ou de lutte contre les effets
de cette dynamique. Ces informations sont renforcées par les
données physiques telles que les suivistopographique et
bathymétrique et les échantillons sédiments eau.
3.3.3 La méthode de suivi
topographique par piquets
La méthode des piquets s'agit des mesures de suivi
d'engraissement ou de démaigrissement à la surface de la
vasière en amont et en aval (Faoye et Diamniadio) du milieu
d'étude. Ces suivis sont renforcés par le suivi diachronique de
la dynamique des bergs (érosion/dépôt) à base
d'imagerie satellitaire.
Tableau 5 : Sites
d'implantations des piquets
|
Sites
|
Situation/Marigot de Faoye
|
Coordonnées géographiques
|
|
Site 1, Diamniadio
|
Aval
|
14°07,0N/ -16°57,66W
|
|
Site 2, Faoye
|
Amont
|
14°22,6N/-16°57,02W
|
3.3.3.1 Protocole et outils de mesures
On procède à des Suivis topographiques par
piquets.Le dispositif est constitué de trois bâtons de 1m de
hauteur chacun. Les 50cm sont enfoncés dans la vase et les 50cm
restants, représentent la hauteur de référence pour
mesurer les variations topographiques (érosion /
dépôt) à la surface des vasières. Ainsi, la
disposition des piquets en forme de triangle permet d'avoir trois valeurs par
relevé et par station et de faire une moyenne.Une station est
installée en amont du milieu c'est-à-dire près du village
de Faoye et une autre en aval du chenal près du village de Diamniadio.
Cela pour poursuivre l'intensité d'érosivité ou
d'engraissement à la surface des vasières de la ligne Diamniadio
Faoye. Les relevés se font à des intervalles réguliers
(tous les 30 jours).
Photo 3:Installation de piquets
à Faoye

Crédit photo : Diouf S. Aziz, 2023
3.3.3.2 Traitement et analyse des piquets
La réalisation de techniques de piquets permet
déterminer le degré d'engraissement ou de dégraissement
à la surface de la vasière. La disposition des piquets en forme
de triangle permet d'avoir trois valeurs par relevé et par station et de
faire une moyenne. La moyenne annuelle est enfin cherchée à
partir des moyennes mensuelles obtenues.
*Notons bien que le nombre de référence 50, dont
l'unité de mesure est le centimètre, indique les 50 cm sur le
sol.
Si la valeur obtenue est
supérieure à 50 cm, c'est un milieu oùl'érosion
domine, il y a démaigrissement.
Si cette valeur est inférieure à 50cm, c'est
l'accrétion qui domine et il y a érosion.
Si la valeur est égale à 50 cm, il n'y a ni
d'engraissement ni de démaigrissement. Le bilan est
équilibré.
3.3.4 Le suivi de mesures de profondeur
des cours d'eau
Les mesures de profondeursont effectuées suivant le
long du chenal principal du milieu d'étude (marigot de Faoye).
Carte 7 : Sites de mesures des
profondeurs suivant le long du Marigot de Faoye
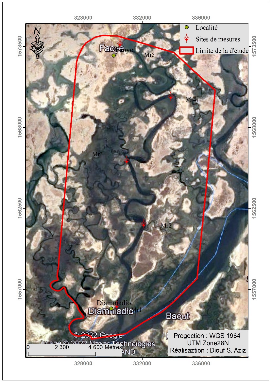
3.3.4.1 Technique et outils de mesure
Les mesures de bathymétrie sont effectuées pour
connaitre la profondeur moyenne du bras de mer de l'aval vers l'amont
(Diamniadio à Faoye) et d'apprécier son comportement actuel par
rapport à l'inversion du l'estuaire. Le bolong est divisé en 5
sections et une mesure est effectuée au début de chaque section.
Ce qui fait au totale 5 mesures allant de l'aval vers l'amont du bolong. Les
mesures bathymétriques sont effectuées pendant les marées
hautes (14h-16h). Ces mesures se font en saison sèche comme en saison
humide pour voir la variation de la bathymétrie des cours d'eau selon
les saisons. Une pirogue nous a permis de parcourir le trajet, l'ancre de la
pirogue et un décamètre sont utilisés pour mesurer la
profondeur des cours d'eau et un GPS pour prendre les coordonnées
géographiques des sites de mesure.
Photo 4: Mesure de profondeur dans
le marigot de Faoye

Crédit photo : Diouf S. Aziz, 2023
3.3.4.2 Traitement
et analyse des mesures bathymétriques
Pour le traitement et l'analyse des mesures de profondeur du
cours d'eau principal du milieu d'étude, la profondeur moyenne annuelle
de chaque site de mesure est déterminée. De ce, pour chaque site,
la profondeur obtenue en saison sèche est additionnée à la
profondeur mesurée en saison humide. La valeur issue de cette somme est
par la suite divisée par deux (2) pour obtenir la profondeur moyenne
annuelle pour chaque site.Ensuite, on a cherché la moyenne des 5 mesures
obtenues en saison sèche d'une part et de celles des résultats
obtenus en saison humide d'autre part pour déterminer la
bathymétrie moyenne du cours d'eau selon les saisons.Et enfin, la
profondeur moyenne en saison sèche est cumulée à la
profondeur moyenne obtenue en saison humide. La valeur obtenue de cette
addition est divisée par (2) deux pour connaitre la bathymétrie
moyenne du marigot de Faoye.
3.3.5
L'échantillonnagede sédiments et eau
Des échantillons de sédiments et de l'eau sont
prélevés pour ce travail.
3.3.5.1 Techniques et outils d'échantillonnage de
sédiments et eau
L'échantillonnage des sédiments se fait par
unité simple c'est-à-dire selon la topo-séquence recoupant
plusieurs unités (chenal, tanne, vasière, cordon sableux). Pour
effectuer les prélèvements de sédiments (sable), un tube
en PVC transparent de 50cm à 1m et 15cm de diamètre est
utilisé. Nous avons utilisé des sachets plastiques pour contenir
les échantillons de sédiments prélevés. Le
décamètre pour mesurer la profondeur des trous creusés
pour les prélèvements de sédiments.Ces
prélèvements de sédiments sont faits en surface (0
à 20 cm) comme en profondeur (20 à 40cm) pour analyser les
paramètres physico-chimiques selon le gradient vertical
c'est-à-dire entre les niveaux de profondeur. Ils sont effectués
en deux temps (saison sèche et saison humide). Ainsi, deux sites de
prélèvements sont préconisés : l'un en aval
(Diamniadio) et l'autre en amont (Faoye). Cela, pour voir la variation
saisonnière des paramètres physique et chimique des
sédiments mais aussi selon le gradient amont-aval du chenal principal du
milieu.
L'échantillonnage de l'eau est fait suivant le long du
bolong de Faoye. Le bolong est divisé en cinq sites dont le premier en
aval, le troisième au milieu et le dernier site en amont. Des
prélèvements d'eau sont faits de l'aval vers l'amont suivant le
bolong mais aussi en saison sèche comme en saison humide. Cela pour
analyser les paramètres chimiques de l'eau de façon longitudinale
(amont-aval) et saisonnière. Des bouteilles en plastique sont
utilisées pour contenir l'eau prélevée. La bouteille est
noyée dans l'eau et fermée de l'intérieur après
remplissage afin d'éviter tout apport extérieur. L'outil Mobile
Topographer est utilisé pour repérer les sites de
prélèvements. Des étiquettes autocollantes pour la
distinction descontenus des échantillons. Ces prélèvements
(sable et eau) sont enfinamenés au laboratoire pour effectuer l'analyse
de leurs paramètres physiques et chimiques.
Carte 8 : Plan
d'échantillonnage des sédiment et eau dans le milieu
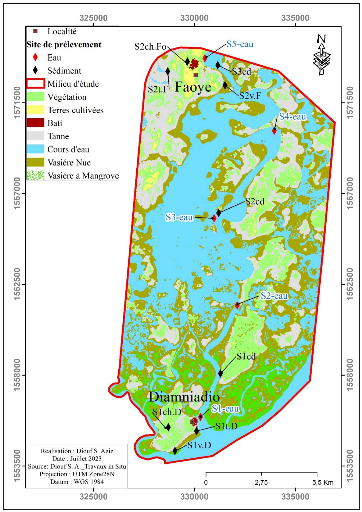
Il s'agit, dans cette carte, plan d'échantillonnage de
sédiment et de l'eau selon les sites de Diamniadio et de Faoye.
Planche de photos
6:prélèvement de sédiments à Faoye (à
gauche) et à Diamniadio (à droite)


Crédits photos : Diouf S. Aziz, Mars 2023
Le traitement des échantillons prélevés
(sédiments et eau) se fait au laboratoire. Il constitue alors les
travaux de laboratoire. Ces travaux permettent de mettre en évidence les
variations des taux des paramètres physique et chimique des
échantillons de sédiment et de l'eau prélevés. Ils
permettent aussi de mesurer la topographie à la surface des
vasières mais aussi connaitre la bathymétrie des cours d'eau.
3.4. Les analyses de laboratoire
Les analyses de laboratoire constituent l'analyse des
échantillons desédiment et eau prélevés afin
d'évaluer la qualité des sol et eau. Les paramètres
analysés pour cette étude sont la Conductivité
électrique (Ce) qui
détermine le degré de salinité du sol et de l'eau, le pH
(potentiel Hydrogène) qui décrit le degré acido-basique et
la granulométrie pour la taille, la distribution et la texture des
sédiments. Pour les échantillons d'eau, seulement le potentiel
hydrogène et la conductivité électrique sont
déterminés.
3.4.1 Préparation des
sédiments
Les échantillons sont étalés et
séchés à l'air libre dans une salle deux jours à
une semaine selon leurs degrés d'humidité, et sans risque de
contamination par la poussière ou par d'autres facteurs.
Les échantillons sont ensuite soigneusement
broyés dans un mortier avant d'être passés au tamis de 2mm.
Les composantes de diamètre supérieur à 2mm (ou refus) ne
sont pas conservées. La fraction de sable qui est passée par les
mailles de 2mm (tamisât ou « terre fine ») est bien
mélangée et stockée dans des sachets en plastique.
Cette partie est destinée aux analyses
physico-chimiques (pH, conductivité, granulométrie).
Photo 5: Etalement et
séchage des sédiments prélevés
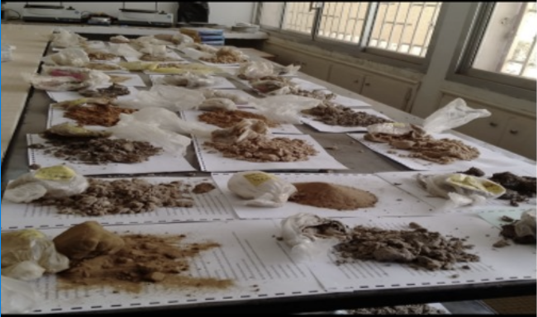
Crédit photo : Diouf S. Aziz, 2023
3.4.2 L'analyse
granulométrique
L'analyse granulométrique a pour but de
déterminer la répartition centésimale des particulesdu sol
dans les limites conventionnelles : Argiles : inférieur à
0.002 mm ; Argiles et Limons : 0.02-0.002 mm ; Limons :
0.05-0.02 mm ; Sables très fins : 0.1-0.05 mm ; Sables
fins : 0.25-0.1 mm ; Sables moyens : 0.5-0.25 mm ; Sables
grossiers : 1-0.5 mm ; Sables très grossiers : 2-1 mm.Elle
porte sur la terre fine (éléments de taille inférieure
à 2 mm). Elle sert à indiquer la nature du matériel
déposé, l'évolution de sa sédimentation, sa
provenance, à renseigner du processus d'ensablement. Les
différentes fractions obtenues sont classées selon les normes
AFNOR (Association Française de Normalisation).
3.4.2.1 Outils et techniques
L'analyse granulométrique des
prélèvements de sable se fait suivant les méthodes
classiques. Il est effectué par une tamiseuse- analysette avec une
colonne de 6 tamis. 100g est prélevé sur l'échantillon et
est versé sur l'agitateur tournant avec tamis de taille adapté
pour les différentes fractions avec fond et couvercle de tamis
adapté. Dans notre cas les tamis utiles sont : Argiles :
inférieur à 0.002 mm ; Limons : 0.05-0.02 mm ;
Sables fins : 0.25-0.1 mm ; Sables moyens : 0.5-0.25 mm ;
Sables grossiers : 1-0.5 mm ; Sables très grossiers : 2-1
mm. Après 15 min d'agitation à 80 tours par min les contenus des
tamis sont pesés et cumulés. Après les données de
fraction sont traités pour la détermination de la texture.
Photo 6:Colonne de tamis et balance
électronique

Colonne
De tamis
Balance
Électrique
Crédit photo : Diouf S. Aziz, 2023
3.4.2.2 Traitement et analyse granulométrique des
sédiments
Le traitement et l'analyse de la granulométrie des
sédiments déterminent le calcul des paramètres texturaux
par l'outil Gradistat et la représentation sous forme graphique des
résultats afin de déterminer la dimension, la distribution, la
provenance et les conditions de dépôt des sédiments. Pour
déterminer la texture des sédiments, le grain moyen, le
coefficient de dispersion, le coefficient d'asymétrie et le kurtosis
sont calculés.Les fractions utilisées pour le classement
granulométrique de ces particules sont 1000-450 um (sables très
grossiers), 450-200 um (sables grossiers), 200-25 um (sables moyens),
(25-15,6 um) sables fins, (15,6-11 um) limon et (11-0 um)
argile. Ainsi,
- Le calcul du grain moyen (MZ) reflète la taille
moyenne du sédiment total et permet d'approcher les conditions diverses
propres aux dépôts. Cette valeur se détermine graphiquement
sur une courbe cumulative de fréquence des poids :
- Le coefficient de dispersion (SI), encore appelé
écart - type, est la principale mesure de dispersion et permet de
mesurer l'indice du tri du sédiment.Si le SI est inférieur
à 1,0 le sédiment très bien classé ; Etant
entre 1,0 et 2,5 signifie un sédiment bien classé ;
Normalement classé si la valeur varie entre 2,5 et 3,0 ; Et enfin
mal classé 3,0 et 4,0.
- Les coefficients d'asymétrie (Ski) permettent de
quantifier les sens et la magnitude de l'écart à la normale. Ski
varie entre + 1 et - 1. Ainsi, pour une courbe symétrique, Ski =
0 ; Il tend vers + 1 lorsqu'il y a excès en particules
fines et vers - 1 lorsqu'il y a excès en éléments
grossiers.Quant au Kg, sa valeur est égale à 1 quand la
courbe est normale, supérieure à 1quand le sédiment est
bien trié dans la partie centrale et inférieure à 1
quand il y est mal trié.
- En fin, la valeur du Kurtosis permet de mesurer le
degré d'aplatissement de la distribution pour les sédiments. Le
Kurtosis est compris entre 1 et l, 5, la distribution est mésokurtique,
platikurtique si le KG< 0,6, et leptokurtique si le KG> 1,5 pour une
distribution qui s'élève assez haut puis retombe assez
brutalement.
3.4.3 La conductivité
électrique
La conductivité électrique (Ce) est
l'aptitude d'un matériau ou d'une solution à propager la chaleur
ou le courant électrique. Elle est par ailleurs fonction de la
concentration en sels du milieu. En effet, la
mesure de la conductivité est un moyen d'apprécier le niveau de
salinité d'une eau ou d'un sol. Plus la solution est chargée en
sel, plus le courant passe facilement. D'après la norme AFNOR [norme
AFNOR (Association Française de Normalisation) NF X-31-103, 1998
(rapport sol/solution 1/2,5], pour déterminer la conductivité
électrique de l'échantillon du sol, la suspension doit être
au 1/5, soit 10g de « terre fine » (séchée
puis tamisée selon le protocole de préparation d'un
échantillon) mélangée à 50mL d'eau distillée
puis bouillie et refroidie. Elle est déterminée par une mesure
directe à l'aide d'un conductimètre. Son unité de mesure
est le micro siémens par centimètre (uS/cm).
3.5.1 Outils et Techniques
La mesure de la conductivité électrique se fait
avec un conductimètre muni d'une électrode. Pour le protocole de
traitement de la conductivité électrique, nous avons pesé 10g de « terre
fine », puis ajouté 50mL d'eau distillée, bouillie et
refroidie. Ensuite, agité pendant environ 1 à 2 mn et
laissé reposer pendant 30mn avant de mesurer la conductivité
de l'échantillon. Enfin, nous avons rincé la cellule de mesure
avec de l'eau distillée et sécher au papier Joseph et fait
de même pour les autres échantillons.
Photo 7:Conductimètre

Crédit photo :Faye Bineta, 2017
3.5.2 Analyse et interprétation
de la conductivité électrique
Elle permet de déterminer la teneur en sel d'un sol. Si
la conductivité électronique est inférieure à
250 uS/cm, le sol est non salé. Le sol est extrêmement
salé si cette valeur est supérieure à 2000uS/cm. Un sol
est considéré comme salé si dans un de ses horizons
situés à une profondeur inférieure à 60 cm, la
conductivité électrique de l'extrait 1/10 à 25°C est
supérieure ou égale à 500 uS/cm(Mathieu C. et Pieltain F.,
2009. Faye B., 2017). L'interprétation des valeurs de (Ce)
obtenues est faite suivant les normes présentées dans le tableau
7.
Tableau 6:Interprétation de la
CE (Bocoum M., 2004)
|
CE en us/cm-1
|
< 250
|
250-500
|
500-1000
|
1000-2000
|
>2000
|
|
Degré de salinité
|
Non salin
|
Légèrement salin
|
Salin
|
Très salin
|
Extrêmement salin
|
3.4.4 Méthode d'analyse du pH
Le pH (potentiel hydrogène)
est la mesure de l'acidité, de la basicité ou de la
neutralité d'un sol.Le pH influence directement la vie microbienne du
sol et les formes chimiques des éléments nutritifs. Le pH
conditionne d'autre part l'assimilabilité et la bonne
disponibilité des éléments minéraux. Il est
déterminé électroniquement sur un pH-mètre à
lecture directe.
3.5.3 Outils et Techniques
Pour déterminer le pH eau
(ou pH de la solution du sol), la suspension doit être au 2/5 : soit
10g de « terre fine » mélangée à 25mL
d'eau distillée, bouillie et refroidie en se référant
à la norme AFNOR, (rapport sol/solution 1/2,5). Pour se faire, nous
avons pesé 10g de « terre fine » (selon le
protocole de préparation des échantillons) et ajouté
25mL d'eau distillée, bouillie et refroidie. Puis, mis un barreau
aimanté dans le bécher et agité pendant 1mn à
l'aide d'un agitateur magnétique. Enfin, nous avons laissé
reposer la suspension pendant 30mn avant de plonger les électrodes
dans le bécher pour lire la valeur du pH.
Photo 8: pH-mètre

Crédit photo : Faye Bineta, 2017
3.5.4 Analyse et interprétation
du pH
Le potentiel hydrogène
permet de déterminer le degré d'acidité d'un sol. Si le pH
est inférieur à 4,5, le sol est extrêmement acide ;
légèrement acide s'il est compris entre 6,1 et 6,6. Le sol est
très alcalin si le pH est supérieur à 8,5.Les normes
présentées dans le tableau 8 permettent l'interprétation
des valeurs de pH de sols obtenues.
Tableau 7:Interprétation du
pH des sols (Bocoum M., 2004)
|
Degré
|
Extrêmement acide
|
Très acide
|
Acide
|
Modérément acide
|
Légèrement acide
|
Neutre
|
Légèrement alcalin
|
Alcalin
|
Très alcalin
|
|
pH
|
<4,5
|
4,6-5,2
|
5,3-5,5
|
5,6-6,0
|
6,1-6,6
|
6,7-7,2
|
7,3-7,9
|
8,0-8,5
|
>8,6
|
3.5. L'analyse de cartes diachronique
L'analyse diachronique procède par le traitement multi
temporel de l'état naturel de l'entité paysagère du
milieu. Ainsi, pour étudier la dynamique des unités
morphologiques le long de Diamniadio à Faoye de 1970 à 2020 et du
comportement morpho-dynamique des berges, les images satellitaires Landsat sont
utilisées. L'analyse de cartes est fixée à un intervalle
de 12 ans pour déterminer l'évolution progressive ou
régressive des unités paysagères du milieu.
Pour le suivi de la dynamique de l'érosion des berges,
les séquences 1972-1995, 1995-2020 et 1972-2020 sont analysées.
Cela permet de quantifier en hectare les sédimentsdéposés
ou érodésle long des bergesentre 1972 et 2020 et de renforcer les
mesures topographiques par piquets.
3.5.1 Les images utilisées
Les images satellitaires Landsat sont utilisées pour
l'étude de la dynamique des unités morphologiques dans notre
milieu d'étude de 1970 à 2020 (Tabl.9). Leur choix se basse sur
la disponibilité de la donnée mais aussi pour mieux
apprécier le comportement des unités paysagères pendant
les années de haute sècheresse (1970, 1980) et d'humidité
très forte (2000, 2020). Les images satellitaires Landsat de 1972, 1984,
1995, 2007 et 2020 sont doncutilisées pour suivre l'évolution des
unités paysagères et la dynamique de l'érosion des
bergs.
Tableau 8:Les données
satellitaires utilisées, Diouf Serigne Aziz, 2023.
|
Satellite
|
Capteurs
|
Heure
|
Date
|
Résolution (m)
|
|
Landsat 1
|
MSS
|
10 :57 :16
|
1972-11-05
|
50
|
|
Landsat 5
|
TM
|
10 :57 :32
|
1984-10-17
|
30
|
|
Landsat 5
|
TM
|
10 :35 :20
|
1995-05-09
|
30
|
|
Landsat 7
|
ETM+
|
11 :22 :11
|
2007-04-24
|
30
|
|
Landsat 8
|
OLI et
TIRS
|
11 :27 :47
|
2020-11-21
|
30
|
3.5.2 Protocole de Traitement et
d'analysedes images satellitaires
Il désigne du traitement des images pour suivre la
dynamique des unités d'occupation du sol et de l'érosion des
bergs entre 1970 et 2020.
3.5.2.1 Suivi de la dynamique des unités
morphologique
Il s'agit de faire le traitement des images satellitaires puis
l'estimation des superficies des différentes classes(unités)
obtenues par le logiciel Arc gis. Elle constitue le prétraitement,
laclassification, le calcul statistique des unités et l'habillage de la
carte.
- La combinaison des bandes consiste à créer un
fichier qui regroupe toutes les bandes formant ainsi une seule image ou
composite prête à être utiliser.
- L'extraction du milieu d'étude qui consiste à
extraire uniquement notre milieu d'étude. Elle est rendue possible
grâce à la limite du milieu sous forme de polygone obtenue par
digitalisation.
- La classification de l'image est faite selon la
classification supervisée, c'est-à-dire celle basée sur la
reconnaissance des différentes unités qui se trouvent dans
l'image et classer par thème. Pour ce faire, les différentes
unités telles que la vasière nue, la mangrove, la savane
arborée, la savane arbustive, la prairie marécageuse, les bolong,
les plans d'eau libres, la tanne nue, la tanne herbue, l'habitat et les terres
cultivables, sont classées en 6 unités morphologiques. Elles
s'agissent de : la vasière nue, la vasière à
mangrove, les cours d'eau, les tannes, la végétation continentale
et les terres cultivables. Ces deux dernières unités constituent
les subdivisions des cordons sableux. Et cela, pour mieux évaluer les
impacts de la dynamique sur la végétation, l'agriculture et
l'habitat. Ainsi, la vasière nue représente les vasières
dépourvues de végétation. La vasière à
mangrove constitue la zone de mangrove. Les cours d'eau regroupent l'ensemble
des eaux surfaciques du milieu. Les tannes referment la tanne nue et la tanne
couvert de végétation. La végétation continentale
regroupe toute la végétation immersible (la savane
arborée, la savane arbustive, la prairie marécageuse). Et enfin,
les terres cultivables renferment les champs et l'habitat. La classification
consiste à assigner un de ces 6 unités à chacun des pixels
de l'image.
3.5.2.2 Traitement du suivi de l'érosion des bergs
Pour la cartographie de la dynamique des bergs, les images des
années 1972, 1995 et 2020 sont utilisées. Le réseau
hydrographique des images déjà classifiées est extraite
puis classé en trois séquences (1972-1995, 1995-2020 et
1972-2020).L'outil `Intersect' est utilisé pour obtenir la surface qui
n'a pas subi de changement entre ces séquences. Le résultat
désigne la surface non changée ou la ligne de
référence. Puis les intersections du réseau de
l'année de départ et de la ligne de référence sont
écrasées par l'outil `Ecrase' (Arctoolbox-AnalysisTools-Overlay)
pour obtenir l'accrétion et celui de l'année d'arrivée et
cette même ligne de référence pour obtenir la surface
érodée. La formule utilisée alors est:
? Accrétion : Année de
départ - Surface non changée
- Erosion : Année
d'arrivée - surface non changée
Le calcul statistique et l'habillage : le calcul
statistique consiste à calculer les valeurs des unités en hectare
(h). L'habillage consiste à ajouter les éléments de la
carte.
Cela permet d'analyser alors l'évolution des
unités morphologique dans le milieu mais aussi de suivre la dynamique de
l'érosion des bergs entre les années 1970 aux années
2020.
Dans l'ensemble, l'approche méthodologique
adopté pour effectuer ce travail se basse sur la recherche documentaire,
le recueil de données complémentaires au niveau des institutions,
les travaux de terrain, les analyses de laboratoire et l'analyse des cartes
diachroniques ainsi que le traitement et leur analyse. Cela pour obtenir des
résultats relatifs à la dynamique des unités
morphologiques du milieu d'étude.
Chapitre 4 : Analyses,
interprétations et discussions des
résultats
Il s'agit de l'analyse et de
l'interprétation des résultats des mesures topographiques,
bathymétriques des cours d'eau, de l'analyse des paramètres
physico-chimiques des échantillonssédiments et eau, des cartes
diachroniques et des résultats d'enquêtes.
4.1. Analyse et interprétation des mesures de suivi de
la dynamique de l'érosion
Il s'agit de l'analyse des résultats de suivis
topographiques par piquets et de la dynamique des berges par la
télédétection ainsi que leur interprétation.
4.1.1 Analyse des résultats
4.1.1.1 Résultats de suivi topographique par
piquets
L'analyse des piquets consiste à apprécier le
degré d'engraissement ou de démaigrissement à la surface
des vasières. C'est plus nettement de voir s'il a érosion
(creusement) ou accrétion (accumulation) à la surface des
vasières. Ainsi, les résultats de suivi par piquets, issus des 10
mesures faites, révèlent que le milieu est dominé par
l'accumulation dans sa partie sud c'est-à-dire en aval du marigot de
Faoye plus précisément à Diamniadio. Et par
l'érosion dans sa partie nord (Faoye), en amont du chenal principal. En
effet, nous avons une moyenne qui est égale à 43 cm soit 7 cm de
sédiments déposés à Diamniadio et 56 cm à
Faoye, soit un dégraissement de 6 cm durant les 10 mois.
Tableau 9 :
Résultats des suivis topographiques par piquets
|
Sites
|
Largueur en cm
|
Dynamiques
|
Coordonnées géographiques
|
|
Site 1, Diamniadio
|
43 cm
|
+7cm
|
Accrétion
|
14°,070N/ -16°,5766W
|
|
Site 2, Faoye
|
56 cm
|
-4cm
|
Erosion
|
14°,226N/-16°,5702W
|
4.1.1.2 Résultats de la dynamique des berges par
télédétection
L'analyse diachronique de la dynamique des barges permet de
caractériser le rapport entre l'érosion et l'accrétion au
niveau des berges afin de quantifier le volume de
sédimentdéplacés ou déposés en hectare (ha).
Ainsi, entre les séquences 1972-1995, 1995-2020 et 1972-2020, le milieu
est dominé par un érosion immense des berges. -1011 ha
arrachés contre 311 ha déposés entre 1972 et 1995, soit
une perte de 700 ha, puis -1896 ha érodés entre 1995 et 2020
contre 236, soit un déficit de 1660 ha et -2522 ha de sédiments
détachés des berges contre 162 accumulés entre 1972 et
2020. Le bilan sédimentaire des berges est donc déficitaire avec
un débit de - 2360 ha entre 1972 et 2020. Toutefois, cette
érosion forte des berges n'est pas globale. Le milieu se voit par la
prédominance de l'accrétion en aval (île de Diamniadio) et
de l'érosion des berges de plus en plus vers l'amont (Faoye). Cette
accumulation au niveau des berges est même devenue plus marquante durant
ces dernières années comme l'illustre la situation 1995-2020.(Cf.
Carte9).Du coup, les résultats de suivi de la dynamique des berges
rejoignent ceux du topographique par piquets qui révèlent tous la
prédominance de l'érosion en aval et de l'accrétion en
amont du marigot de Faoye.
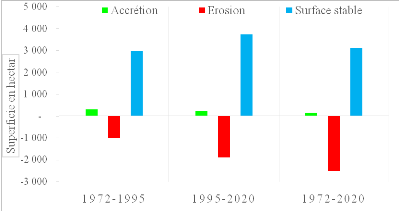
Figure
18 :Résultats de la dynamique de l'érosion des berges entre
1972 et 2020 en hectare
Dans l'ensemble, la localité de Diamniadio qui se
localise en aval du marigot est dominée par l'ensablement de ces
vasières contrairement à Faoye c'est-à-dire en amont qui
se caractérise par le creusement de ces bas-fonds.
Carte 9 : Résultats de la
dynamique de l'érosion des berges entre 1972 et 2020.
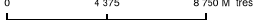
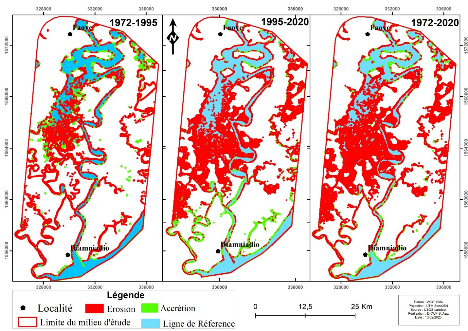
4.1.1 4.1.2 Interprétation des
résultats de suivi de l'érosion
Les suivis topographiques par piquets et diachronique de la
dynamique des berges révèlent que le milieu est dominé par
l'accrétion en aval et par l'érosion en amont.Cette situation se
justifie essentiellement par la dynamique marine qui dépose
continuellement sa charge à la rentrée des bolong. Mais aussi par
les sédiments issus des bancs sableux entrainés et
déposés au niveau des unités de vasière et tanne et
au fond des chenaux (Cf. Figure 46, annexe). Cet ensablement quasiment à
l'île de Diamniadio diminue le lit du cours d'eau en aval (Cf. Carte11),
ce qui favorise au réseau hydrographique de gagner de plus en plus
d'espace latéralement mais aussi vers amont d'où l'importance de
l'érosion de plus en plus vers l'amont du marigot.
4.2. Analyse et interprétation des mesures de
profondeurs des cours d'eau
Il s'agit d'apprécier les résultats des mesures
de la profondeur du marigot de Faoye, l'analyse et l'interprétation de
ces résultats.
4.2.1.
Résultats des mesuresde profondeurs
Les résultatsdes mesures de profondeurs obtenues
montent qu'elles du cours d'eau s'augmentent de l'aval vers l'amont
contrairement à un cours d'eau normal où les points les plus bas,
plus profonds se repèrent vers l'aval. La carte 8 illustre nettement ces
variations de profondeurs de l'aval vers l'amont. La profondeur moyenne du
cours d'eau, en saison sèche, est égale à 9,02m et
10,53m en saison humide. La profondeur moyenne du marigot est alors
égale à 9,78m. Sa profondeur maximale est de 17,30m, la minimale
du marigot 2,93m annuellement.
Carte 10: Résultats des
mesures de profondeurs le long du marigot de Faoye en mètre (m)
Réalisation : Diouf S. Aziz
Date : Juin 2024
Source : Mesure de profondeurs
Diouf S. Aziz 2023
Projection : UTM Zone28N
Datum : WGS 1984
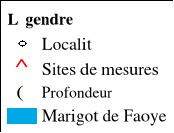
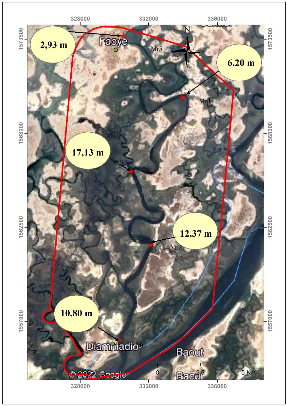
4.2.2.
Interprétation des résultats de profondeurs des cours d'eau
La variationde la profondeur, qui s'accroit de plus en plus
vers l'amont du bolong, depuis Diamniadio à plus de 15km vers Faoye,
peut avoir une double explication.
D'une part, notons bien que le milieu est dans un estuaire
inverse où la dynamique ne dépend pas des apports
extérieurs : pluvial et fluvial, mais de celui de la Mer. L'eau qui
alimente le Saloum et ses défluents, chargée de particules depuis
sa source à plus de 100km (Mer), dépose à l'entrée
des bolong les plus grossiers. Seuls les plus fins peuvent aller
jusqu'au-delà (point d'arrivé). Ces dépôts
répétitifs s'accumulent au fur et à mesure sur les portes
des bolong et favorisent ainsi leur ensablement. Dans le milieu, cela justifie
les faibles profondeurs obtenues au niveau du premier site (en aval) et les
fortes profondeursobservées autroisième (le plus profond) qui se
trouve à plus de 15 km de l'aval.
En d'autre part, cela se justifie par l'entaille des bas-fonds
par l'eau de la mer en créant une pente inclinée vers le sens
inverse de l'ancien affluent. Le cours d'eau étant très long,
parcourant plus de 20km du domaine insulaire jusqu'au domaine continental
(Faoye) draine sur une surface à topographie très variante. Cette
topographie décroît d'amont en aval, de Faoye vers Diamniadio. Ce
qui favorisait l'écoulement normal de l'affluent qui déversait
dans le Saloum. Mais à l'actuel où l'apport provient là
où la pente est plus faible, il faut forcement des pentes beaucoup plus
faibles que celles-ci pour qu'il est drainage. Cette fabrication de pentes
entraine ainsi le creusement du lit du marigot de plus en plus vers
l'intérieur car l'eau draine suivant la pente. Cette entaille, due
à inversion du delta, justifie en d'autre part l'inversion de la pente
du marigot et donc l'augmentation de la profondeur de l'aval vers l'amont.
C'est donc l'inversion du delta par l'intrusion marine dans
les fleuves et leurs affluents qui expliquent les profondeurs des cours d'eau
qui augmentent au fur et à mesure vers l'intérieur des bolong.
Cette inversion se manifeste par l'ensablement de l'entrée des bolong en
aval et le creusement des bas-fonds en amont (à Faoye).
4.3. Analyse et interprétation
des paramètres physico-chimiques des sédiments et eau
Il s'agit de l'analyse des résultats des
paramètres physiques et chimiques des échantillons d'eau et de
sédiments prélevés et de l'interprétation, selon
les normes AFNOR, des résultats obtenus pour
chaque paramètre. Ces paramètres concernent la
conductivité électrique (Ce), le potentiel hydrogène (pH) et
la granulométrie.
4.3.1. Analyse
et interprétation des paramètres chimiques de l'eau
Les échantillons d'eau sont entièrement issus du
marigot de Faoye, cours d'eau principale parcourant la zone du sud au nord. En
effet, 5 échantillons d'eau sont prélevés suivant le long
du chenal afin d'apprécier la qualité de l'eau suivant le gardien
aval- amont (Diamniadio Faoye).Les paramètres chimiques analysés
sont le potentiel hydrogène (pH) et la conductivité
électrique (Ce) de l'eau (voir tableau 10). Par contre, les
valeurs de mesures du conductimètre sont limitées à
3999mS/cm. Ce qui fait que certains sites peuvent même avoir une
conductivité électrique dépassant cette limite.
Tableau 10: Résultats des
paramètres physico-chimiques du marigot de Faoye
|
Sites de prélèvements
|
Conductivité électrique (Ce) en
mS/cm
|
Potentiel hydrogène (pH) = -log (H+)
|
|
Saison sèche
|
Saison humide
|
Saison sèche
|
Saison humide
|
L'année
|
|
Site1 (s1)
|
3999
|
3999
|
8,30
|
8,12
|
8,21
|
|
Site2 (s2)
|
3999
|
3999
|
8,25
|
8,15
|
8,20
|
|
Site3 (s3)
|
3999
|
3999
|
7,93
|
7,79
|
7,86
|
|
Site4 (s4)
|
3999
|
3999
|
8,15
|
8,38
|
8,27
|
|
Site5 (s5)
|
3999
|
3999
|
7,85
|
7,91
|
7,88
|
Source : Diouf S. Aziz, 2023
4.3.1.1. Interprétation de la
conductivité électrique (Ce) de l'eau
Ce tableau ci-dessus révèle que la
conductivité électrique (Ce) du marigot de Faoye
dépassent largement la conductivité d'une eau non salée
(<250) dans tous les sites et pendant toutes les saisons. De l'aval
à l'amont (Diamniadio à Faoye), l'eau enregistre les mêmes
valeurs de conductivité électrique (3999mS/cm). La saison
sèche comme la saison pluvieuse, la conductivité est toujours
extrême 3999mS/cm. Elle est de l'ordre de 3999mS/cm annuellement. Cela
monte que le marigot de Faoye en particulier et l'eau surfacique du milieu en
générale sontextrêmement salées, avec une
concentration excessive en sels minéraux (calcium,
magnésium, sodium, potassium).
4.3.1.2. Interprétation du
potentiel hydrogène (pH) de l'eau
Selon les normes AFNOR, une eau avec un pH entre 6,3 et 7,2
est neutre, acide entre 5,3 et 5,5 et alcaline s'il varie entre 8,2 et 8,5.
*Suivant les saisons, l'eau du marigot est aussi bien alcaline
en saison sèche qu'en saison pluvieuse en moyenne. Toutefois, le pH
enregistré en saison sèche est plus élevé que celui
relevé pendant la saison pluvieuse même si l'écart n'est
pas trop important. Ce qui montre que l'eau est plus acide en saison pluvieuse
que pendant la saison non pluvieuse, Cela peut être dû à
l'eau de pluie qui, avec un pH plus acide que le marigot (6 à 6,1),
vient s'ajouter à un pH alcalin (8,10). Et c'est probablement ce qui
réduit l'alcalinité du marigot et favorise son état moins
alcalin en saison pluvieuse que pendant la saison sèche.
*Suivant le gradient aval-amont ou du site (s1) vers le site
(s5), le marigot de Faoye est alcalin dans sa partie aval et
légèrement alcalin en amont. Cela monte que le sous-sol du cours
d'eau est plus très riche en matières minérales telles que
le calcium, le magnésium, le potassium à l'entrée des
bolong qu'à l'intérieur vers l'amont.
Carte 11:Variation saisonnière
du pH dans le marigot de Faoye
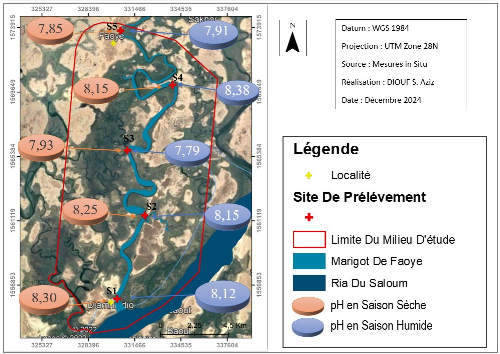
Le marigot se voit avec un pH de l'ordre de 8,08 en moyenne.
Cela conclue que l'état de l'eau du milieu est alcalin. La concentration
en calcium, en magnésium, en potassium, en bicarbonate, ... y est
très élevée due naturellement à leur richesse dans
le sous-sol où draine le bolong.
4.3.2. Analyse
et interprétation des paramètres chimiques des
sédiments
Les paramètres chimiques concernent le potentiel
hydrogèneet la conductivité électrique.
4.3.1. Le
potentiel hydrogène (pH)
Le pH mesure le degré d'acidité ou
d'alcalinité d'un sol.
Au niveau du site 1 (à Diamniadio), les sols se
caractérise par un pH neutreà légèrement alcalin et
légèrement alcalin (inférieur à 8,0) à
alcalin (entre 8,0 et 8,5) au sein du site 2 (Faoye).
Le pH des unités morphologiques dans le milieu augmente
en saison humide en surface (0-20 cm) et diminue en profondeur (20-40 cm),
Fig.6. Il est neutre à légèrement alcalin
pendant l'hiver en surface (6,9 à 7,9) et neutre à alcalin vers
la profondeur (7,2 à 8,2). Tous les formations pédologiques ont
un pH légèrement alcalin en surface pendant cette période
sauf les terres cultivables localisées en aval (Diamniadio) qui sont
neutres. Cette alcalinité légère persiste en profondeur
sauf au niveau de Faoye où les terres agricoles ont un pH alcalin (8,0
à 8,2). Pendant l'hivernage, l'acidité des sols diminue en
surface mais augmente en profondeur dans le fond des cours d'eau. Cela due
à l'eau de pluie qui s'accumule dans ces entités
dépressionnaires. Toutefois, les autres unités se voient par un
pH accroit de la surface vers la profondeur. Ce qui justifie leur degré
d'alcalinité plus élevé dans l'horizon 20-40 cm.
Le site 1 et le site 2 ont donc presque les mêmes
caractéristiques de sols qui sont légèrement alcalins.
Toutefois, les terres de culture à Faoye sont alcalines à la
différente des terres qui se trouvent à Diamniadio qui sont
neutres en surface pendant la saison sèche et en profondeur durant
l'hivernage. Le pH dans le fond du marigot de Faoye est plus en plus alcalin de
Diamniadio vers Faoye. L'acidité (pH) des sols du milieu suit donc un
gradient aval-amont, plus acide en aval et légèrement alcalin
à alcalin de plus en plus vers l'amont du milieu d'étude sauf au
niveau des tannes (inversement).
Carte 12:Distribution du potentiel
hydrogène (pH) dans le milieu
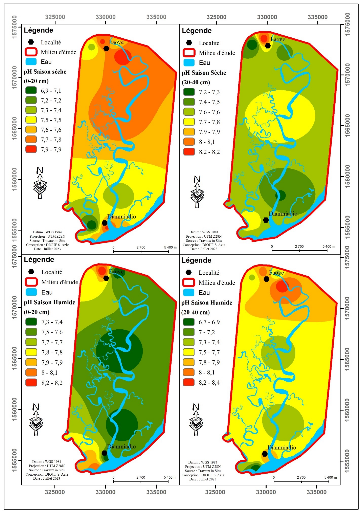
4.3.2. La
conductivité électrique (Ce)
La conductivité électrique mesure le
degré de salinité d'un sol en micro siémens par
centimètre.
Les résultats obtenus révèlent que les
sols du milieu d'étude n'ont pas la même teneur en sels solubles.
Cette variabilité de la conductivité fait que nous avons des sols
non salés, des sols légèrement salés à des
sols extrêmement salés (Carte15). Ces sols se répartissent
selon les unités morphologiques du milieu, les horizons mais aussi
suivant les saisons. En saison sèche, les horizons 0-20cm et 20-40cm ont
quasiment le même comportement chimique. La conductivité
électrique est supérieure à 2000 ìS/cm dans les
tannes, les vasières et dans le fond des chenaux. Elle varie de 2455
à plus de 3999 ìS/cm dans ces unités. Dans les terres de
culture, le sol est extrêmement salé à Diamniadio avec une
conductivité de 3999 ìS/cm et légèrement
salé à salé à Faoye (394 à 962 ìS/cm)
dans tous les horizons. Par contre, pendant la saison humide, on note une
diminution de la salinité des sols dans tous les niveaux de profondeurs.
Toutefois, elle reste plus importante en profondeurs qu'en surface dans les
vasières, tannes et fond des chenaux. Leur conductivité
électrique varie de 1759 à 3999 ìS/cm en surface contre
2340 à 3999 ìS/cm en profondeur. Au niveau des terres
cultivables, le sol est non salé en saison humide dans tous les
horizons sauf dans le niveau 20-40 cm en aval où il est
extrêmement salé. Dans le fond du chenal principal, les sols sont
extrêmement salés mais plus salés en amontqu'enaval. La
conductivité est de 3626 ìS/cm à Diamniadio et plus de
3999 ìS/cm à Faoye. La salinité du cours d'eau diminue
pendant la saison pluvieuse. La conductivité passe de 3934 ìS/cm
en saison non pluvieuse à 3235 ìS/cm en saison humide. Les sols
du milieu sont extrêmes salés sauf au niveau des terres de culture
à Faoye même si cette salinité extrême voit une
légère réduction en saison humide.
Carte 13:Distribution
saisonnière de la conductivité électrique (Ce) dans le
milieu d'étude
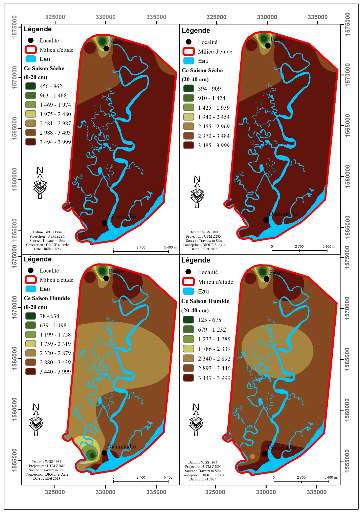
Les analyses chimiques des sédiments et de l'eau du
milieu montrent donc que les eaux surfaciques et les sols du milieu sont
essentiellement extrêmement salés, très
minéralisés et légèrement alcalins à
alcalins. Elles se manifestent plus à Diamniadio qu'à Faoye et
durant la saison sèche que pendant la saison humide d'une manière
générale. Ces analyses chimiques sont renforcées par
celles des paramètres physiques afin d'apprécier la
granulométrie de ces sédiments.
4.3.3. Analyse
granulométrique des sédiments
Il s'agit de l'analyse de la distribution des
sédiments prélevés et de leurs paramètres
texturaux. Le prélèvement s'effectue suivant la
topo-séquence c'est-à-dire du fond du chenal aux cordons en
passant par les vasières et les tannes. La texture du sol est
définie par les proportions relatives de particules argileuses,
limoneuses (silteuses) et sableuses qui constituent la terre fine = 2
000 um. Les fractions utilisées pour le classement
granulométrique de ces particules sont 1000-450 um (sables très
grossiers), 450-200 um (sables grossiers), 200-25 um (sables moyens),
(25-15,6 um) sables fins, (15,6-11 um) limon et (11-0 um)
argile. Deux sites sont à analyser : le site de Diamniadio en aval
et le site de Faoye en amont du marigot de Faoye.
4.3.3.1. Analyse
granulométrique à Diamniadio
Les échantillons de sédiments
prélevés et analysés sur les différentes
unités morphologiques du site de Diamniadio fournissent les
résultats ci-dessous sur chacune des unités. En effet, ces
fractions prélevées suivant la topo-séquence (Fond du
chenal, vasière, tanne et cordon), montre qu'elles sont essentiellement
modérément triées, avec un coefficient de dispersion (So)
qui est généralement partout inférieur à 1, sauf
dans le fond du chenal où les sédiments sont mal triés
avec un sorting supérieur à 1 durant toutes les saisons. Cela se
voit nettement sur la figure 7 où l'allure de la courbe est très
oblique dans sa partie centrale pour les unités tanne, vasière et
cordons sableux, définissant une concentration des sédiments de
la fraction 25um et 200um qui correspond au sable moyen. Par contre, l'allure
de la courbe granulométrique est verticale dans sa partie centrale pour
le fond du chenal, montrant la concentration des sédiments de la
fraction 15,6um et 25um (sable très fin). Ces disparités sur la
concentration des sédiments selon les unités sont
confirmées par le Mz qui est le sable très fin dans le fond du
chenal (Mz > 3) et le sable moyen pour les autres unités où le
Mz < 2.
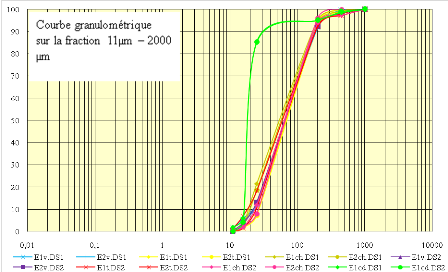
Figure
19:Courbe granulométrique des fractions sableuses de Diamniadio ; Diouf
S. Aziz, 2023
4.3.3.1.1. La distribution des sédiments sur la
vasière à Diamniadio
Les sédiments prélevés et analysés
sur la vasière de Diamniadio montrent que cette unité,
très frappée par l'ensablement, reste essentiellement sableuse
(91,9%). Les silts ne représentent que les 8,1% restants. Toutefois, les
sables qui représentent à eux seuls cette majorité sont de
dimensions différentes. Le sable moyen est le plus fréquent avec
58%, suivi du sable fin (23%). Les sables très grossier et grossier et
les sables très fin ne dépassent pas 5,1% chacun. Les silts se
répartissent entre les très grossiers (4,7%) et les grossiers
(0,3%). Les vases sont donc peu fréquents, dans tous les horizons et
pendant les deux saisons, dans la vasière de Diamniadio. Cela est
dû par l'ensablement très significatif dominant cette unité
dont les sables représentent plus de 91 % des sédiments
prélevés. Les graviers et les argiles sont absolument absents
dans la vasière de Diamniadio.
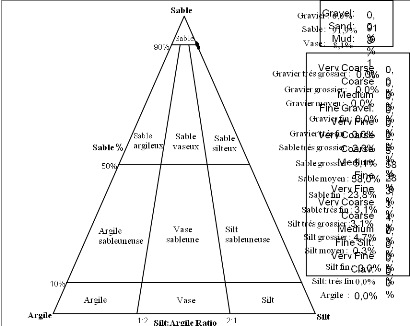
Figure
20:Fréquence des sédiments sur la vasière de Diamniadio ;
Diouf S. Aziz, 2023
Les paramètres texturaux des sédiments de la
vasière de Diamniadio sont illustrés dans le tableau 12. En
effet, sur l'ensemble des échantillons prélevés et
analysés au laboratoire, le grain moyen ou le Mz est partout compris
entre 1,763 et 1,778. Cela justifie nettement la prédominance du sable
moyen dans la vasière de Diamniadio. Le coefficient de dispersion (So)
est partout inférieur à 1 mais très proche à cette
valeur (plus de 0,880) qui illustre que les sédiments sont
modérément triés et modérément
classés. Le coefficient d'asymétrie qui tend vers +1 (0,2) montre
qu'il a excès en particules fines et que la courbe
granulométrique est bien asymétrique. En ce qui concerne le
coefficient d'acuité ou le Kurtosis qui est partout supérieur
à 1,5, témoigne une distribution très pointue qui
s'élève assez haut puis retombe assez brutalement. Le Kg est
très leptokurtique indique que la variance est principalement due
à des déviations peu fréquentes mais extrêmes.
Tableau 11:Paramètres
texturaux des sédiments de la vasière à Diamniadio
|
Echan
tillons
|
Paramètres texturaux
|
Méthode de FOLK & WARD
|
|
Géométrique
|
Logarithmique
|
Description
|
|
(mm)
|
(f)
|
|
|
E1v.DS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
294,6
|
1,763
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,935
|
0,952
|
Modérément trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,267
|
0,267
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
2,600
|
2,600
|
Très leptokurtique
|
|
E2v.DS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
291,7
|
1,778
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,947
|
0,961
|
Modérément trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,285
|
0,285
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
2,642
|
2,642
|
Très leptokurtique
|
|
E1v.DS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
291,7
|
1,777
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,843
|
0,882
|
Modérément trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,216
|
0,216
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
2,299
|
2,299
|
Très leptokurtique
|
|
E2v.DS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
291,7
|
1,777
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,895
|
0,922
|
Modérément trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,233
|
0,233
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
2,446
|
2,446
|
Très leptokurtique
|
Source : Diouf S. Aziz, 2023
4.3.3.1.2. La distribution des sédiments sur les
tannes à Diamniadio
Les tannes localisées dans la localisé de
Diamniadio abrite une double facie de caractéristiques
granulométriques différentes. En effet les sédiments
prélevés et analysés sur les tannes sont
entièrement constitués de sables et de silts. Les sables sont
plus fréquents 88% mais à des dimensions très
différentes. Tout comme la vasière, les tannes sont
dominées par le sable moyen qui occupe 54,3%, suivi du sable fin
(22,9%). Le sable très grossier, le sable grossier et le sable
très fin sont très peu fréquents. Les 12% restants sont
représentés par les silts, notamment le silt grossier (7,2%), le
silt très grossier et le silt moyen. La vase ne se retrouve qu'en
profondeur (20-40cn) pendant la saison pluvieuse. Les graviers et les plus fins
(argile) ne sont pas présents dans la distribution des sédiments
dans les tannes de Diamniadio.
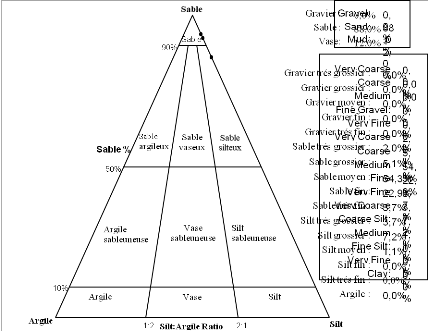
Figure
21:Fréquence des sédiments sur les tannes de Diamniadio ;
Diouf S. Aziz, 2023
Le tableau 13 illustre les paramètres texturaux des
sédiments issus des tannes de Diamniadio. En effet, le grain moyen est
le sable moyen sauf en profondeur pendant la saison humide où le grain
moyen est marqué par le sable fin. Le Mz de l'échantillon
(E2tDS2) qui est supérieur à 2 la confirme. Le So qui est partout
inférieur à 1 sauf en profondeur pendant la saison pluvieuse
monte que les sédiments sont modérément bien triés
à mal triés, modérément classés à mal
classés. En ce qui concerne SKg ou le coefficient d'asymétrie,
qui tend vers +1 témoigne qu'il y a excès en particules fines et
que la courbe granulométrique est bien asymétrique. Quant au
Kurtosis qui est partout supérieur à 1,5 illustre que la
distribution est très leptokurtique.
Tableau 12:Paramètres
texturaux des sédiments des tannes à Diamniadio
|
Echan
tillons
|
Paramètres texturaux
|
Méthode de FOLK & WARD
|
|
Géométrique
|
Logarithmique
|
Description
|
|
(mm)
|
(f)
|
|
|
E1t.DS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
298,1
|
1,746
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,534
|
0,617
|
Modérément bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,211
|
0,211
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,569
|
1,569
|
Très leptokurtique
|
|
E2t.DS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
300,1
|
1,736
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,585
|
0,664
|
Modérément bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,151
|
0,151
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,706
|
1,706
|
Très leptokurtique
|
|
E1t.DS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
295,3
|
1,760
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,733
|
0,793
|
Modérément trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,167
|
0,167
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
2,085
|
2,085
|
Très leptokurtique
|
|
E2t.DS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
248,2
|
2,010
|
Sable fin
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
2,240
|
1,164
|
Mal trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,427
|
0,427
|
Très bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
2,568
|
2,568
|
Très leptokurtique
|
Source : Diouf S. Aziz, 2023
4.3.3.1.3. La distribution des sédiments sur les
cordons sableux à Diamniadio
Ces prélèvements sont faits plus exactement au
niveau des terres cultivables de Diamniadio. Les sédiments issus des
cordons sableux à Diamniadio abritent de facies sablo-silteux. Les
sables, de proportions et de taille variables, sont les plus fréquents
(95%). Les silts ne représentent que les 4,8%. Les plus grossiers
(graviers) et les plus fins (argile) sont absents dans la distribution des
sédiments. Le sable moyen et le sable fin sont plus fréquents
avec des taux de 64,4 et 25,6% respectivement. Les sables très fin et
grossier sont peu représentatifs. Cette prédominance du sable
moyen témoigne une concentration des sédiments de la fraction
25um et 200um. Les sils se voient par les limons très grossier, grossier
et fin.
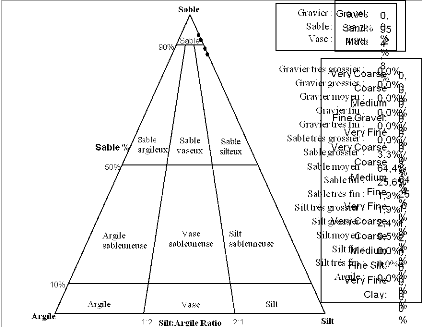
Figure
22:Fréquence des sédiments sur les cordons sableux de
Diamniadio ; Diouf S. Aziz, 2023
Les paramètres texturaux des sédiments
prélevés et analyses au laboratoire sont illustrés par le
tableau 14. D'après la méthode de Folk et Ward, le grain moyen
des cordons de Diamniadio est essentiellement le sable moyen avec un Mz
inférieur à 2. Le coefficient de dispersion qui détermine
l'indice du tri du sédiment monte que les sédiments sont
modérément classés ou modérément
triés. Cela explique le So qui varie entre 0,5 et 1. Pour ce qui est du
coefficient d'asymétrie qui tend vers +1, illustre qu'il y a
excès en particules fines et que la courbe granulométrique est
très bien asymétrique. Quant au Kurtosis, partout
supérieur à 1,5 témoigne une distribution très
pointue appelée très leptokurtique.
Tableau 13:Paramètres
texturaux des sédiments des cordons sableux à Diamniadio
|
Echan
tillons
|
Paramètres texturaux
|
Méthode de FOLK & WARD
|
|
Géométrique
|
Logarithmique
|
Description
|
|
(mm)
|
(f)
|
|
|
E1ch.DS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
227,1
|
2,139
|
Sable fin
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
2,078
|
1,055
|
Mal trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,528
|
0,528
|
Très bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,989
|
1,989
|
Très leptokurtique
|
|
E2ch.DS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
253,4
|
1,981
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,942
|
0,958
|
Modérément trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,410
|
0,410
|
Très bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
2,039
|
2,039
|
Très leptokurtique
|
|
E1ch.DS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
291,5
|
1,778
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,732
|
0,792
|
Modérément trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,221
|
0,221
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
2,082
|
2,082
|
Très leptokurtique
|
|
E2ch.DS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
294,4
|
1,764
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,556
|
0,638
|
Modérément bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,280
|
0,280
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,680
|
1,680
|
Très leptokurtique
|
Source : Diouf S. Aziz, 2023
4.3.3.1.4. La distribution des sédiments dans le fond
des chenaux à Diamniadio
Au niveau de la localité de Diamniadio, le fond du
marigot de Faoye a un facies sablo-silteux. Les sables sont néanmoins
les plus fréquents et représentent 60% des sédiments
prélevés. Les 40% sont remportés par les silts. Le sable
très fin et les silts très grossiers sont les plus
fréquents 27% pour chacun. Le sable fin 21% et le silt grossier 12,8%.
Cela montre la prédominance des particules fines dans les
sédiments du fond du chenal. La figure 38 témoigne nettement
cette situation où l'allure de la courbe des sédiments dans le
fond des cours d'eau est verticale dans leur partie centrale, manifestant la
concentration des sédiments de la fraction 15, 6um et 25um.
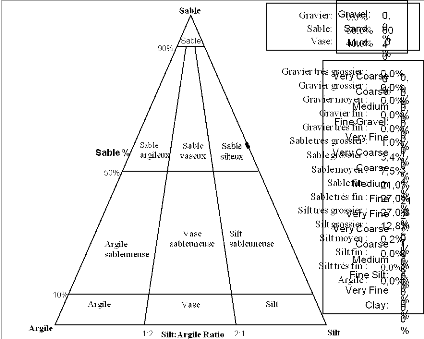
Figure
23:Fréquence des sédiments dans le fond du chenal principal
à Diamniadio ; Diouf S. Aziz, 2023
Les paramètres texturaux des sédiments dans le
fond du chenal de Faoye à Diamniadio sont illustrés dans le
tableau 15. En effet, le grain moyen est le sable très fin, s'explique
par le Mz qui est partout supérieur à 3. Le So qui est entre 1 et
2 (1,301 et 1,257), témoigne les sédiments qui sont mal
classés ou mal triés. Le coefficient d'asymétrie ou le
SKg, tendant vers - 1 (-0,074 et -0,919), illustre qu'il y a excès en
particules grossiers, donnant ainsi à la courbe sa forme
symétrique. Cela témoigne en quelle sorte les dépôts
des particules grossiers déposées juste à l'entrée
du bolong par la ria de Saloum. Parcourant une très longue distance
depuis l'embouchure, l'eau perd sa vitesse lorsqu'elle prend une autre allure
permettant recharger ses défluents. Cette faible déviation de
l'eau la fait perd sa vitesse et favorise alors le dépôt des plus
grossiers à la porte du marigot de Faoye. La distribution n'est ni
plate, ni pointue. Le Kurtosis inférieur à 1 détermine une
distribution mésokurtique.
Tableau 14:Paramètres
texturaux des sédiments du fond du marigot de Faoye à
Diamniadio
|
Echan
tillons
|
Paramètres texturaux
|
Méthode de FOLK & WARD
|
|
Géométrique
|
Logarithmique
|
Description
|
|
(mm)
|
(f)
|
|
|
E1cd.DS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
2,464
|
3,653
|
Sable très fin
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
0,074
|
1,301
|
Mal trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
0,074
|
-0,074
|
Symétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
0,933
|
0,933
|
Mésokurtique
|
|
E1cd.DS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
2,390
|
3,632
|
Sable très fin
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
0,099
|
1,257
|
Mal trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
0,099
|
-0,099
|
Symétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
0,919
|
0,919
|
Mésokurtique
|
Source : Diouf S. Aziz, 2023
Les échantillons prélevés à
Diamniadio suivant les différentes unités morphologiques et
analysés au laboratoire révèlent dons que ces
unités ont essentiellement les mêmes caractéristiques
granulométriques sauf ceux dans le fond des chenaux. Ils se voient par
la prédominance du sable moyen, d'une dispersion modérée,
d'une allure bien asymétrique et par la prédominance d'une
distribution très pointue. Toutefois, se rencontrent des cas où
le Mz correspond au sable très fin, la courbe symétrique, le
classement mal trié et le Kurtosis Méso. Les unités
morphologiques au sein du village de Diamniadio sont donc de faciès
à dominants sableux et parfois de sable silex.
4.3.3.2. Analyse
granulométrique à Faoye
Les échantillons de sédiments
prélevés et analysés sur les différentes
unités morphologiques du site de Faoye fournissent les résultats
ci-dessous au niveau de chaque unité. En effet, ces sédiments
prélevés suivant la topo-séquence montre qu'ils sont
essentiellement modérément triés sur les vasière et
tanne, bien triés sur les cordons sableux et mal triés dans le
fond des chenaux. Cela se voit par le coefficient de dispersion qui est
généralement partout inférieur à 1, sauf dans le
fond du chenal où le sorting varie entre 1 et 2 partout. Cela se voit
nettement sur la figure 7 où l'allure de la courbe est très
oblique dans sa partie centrale pour les unités de tanne, vasière
et des cordons sableux, définissant ainsi une concentration des
sédiments de la fraction 25um et 200um. Toutefois, l'allure de la courbe
granulométrique est verticale dans sa partie centrale pour le fond du
chenal, montrant la concentration des sédiments de la fraction 15,6um et
25um. Ces disparités sur la concentration des sédiments selon les
unités sont confirmées par le Mz qui est le sable très fin
dans le fond du chenal (Mz > 3,5) et le sable moyen pour les autres
unités où le Mz < 2.
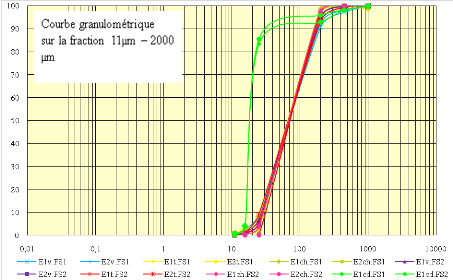
Figure
24: Courbe granulométrique des fractions sableuses de Faoye ; Diouf
S. Aziz, 2023
4.3.3.2.1. La distribution des sédiments sur les
vasières à Faoye
Les sédiments prélevés et analysés
sur la vasière de Diamniadio montrent que cette unité,
très frappée par l'ensablement, reste essentiellement sableuse
(97,3%). Les limons ne représentent que les 2,7% restants. Par contre,
les sables qui représentent à eux seuls cette majorité
sont de proportions et de tailles différentes. Le sable moyen est le
plus fréquent avec 65,8%, suivi du sable fin (25,7%). Les sables
très grossier et grossier et les sables très fin ne
dépassent pas 6%. Les silts se répartissent entre les limons
très grossiers (1,4%) et les grossiers (1,2%) et les limons moyens
(0,1). Les vases sont donc peu fréquents, dans tous les horizons et
pendant les deux saisons, dans la vasière de Faoye (2,7). Les graviers
et les argiles sont absolument absents dans cette unité.
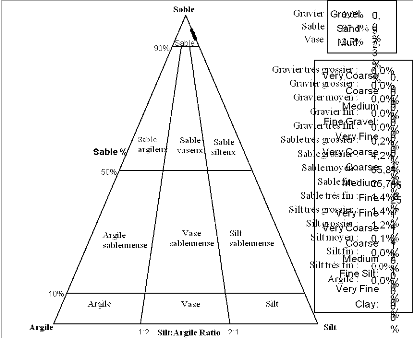
Figure
25:Fréquence des sédiments sur la vasière de Faoye ;
Diouf S. Aziz, 2023
Les paramètres texturaux des sédiments de la
vasière de Faoye sont illustrés dans le tableau 16. En effet, sur
l'ensemble des échantillons prélevés et analysés au
laboratoire, le grain moyen ou le Mz est partout inférieur à 2.
Cela justifie nettement la prédominance du sable moyen dans la
vasière de Faoye. Le coefficient de dispersion (So) est inférieur
à 1 pendant la saison sèche et en surface pendant la saison
humide, illustre les sédiments bien à modérément
triés. Le coefficient d'asymétrie qui tend vers +1 montre qu'il y
a excès en particules fines explique la courbe granulométrique
qui est symétrique à bien asymétrique. En ce qui concerne
le coefficient d'acuité ou le Kurtosis qui est partout supérieur
à 1,5 pendant la saison non pluvieuse, témoigne sa distribution
très pointue mais plate durant la saison humide où il est
inférieur à 1. Le Kg est donc très leptokurtique pendant
l'hiver et platikurtique pendant l'été sur la vasière de
Faoye.
Tableau 15:Paramètres
texturaux des sédiments de la vasière à Faoye
|
Echan
tillons
|
Paramètres texturaux
|
Méthode de FOLK & WARD
|
|
Géométrique
|
Logarithmique
|
Description
|
|
(mm)
|
(f)
|
|
|
E1v.FS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
301,2
|
1,731
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,705
|
0,770
|
Modérément trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,113
|
0,113
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,995
|
1,995
|
Très leptokurtique
|
|
E2v.FS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
298,5
|
1,744
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,733
|
0,793
|
Modérément trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,184
|
0,184
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
2,129
|
2,129
|
Très leptokurtique
|
|
E1v.FS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
297,6
|
299,9
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,488
|
1,326
|
Modérément bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,207
|
-0,018
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,404
|
0,771
|
Leptokurtique
|
|
E2v.FS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
1,748
|
1,737
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
0,573
|
0,407
|
Bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
0,207
|
0,018
|
Symétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,404
|
0,771
|
Platikurtique
|
Source : Diouf S. Aziz, 2023
4.3.3.2.2. La distribution des sédiments sur les
tannes à Faoye
Les tannes localisées dans la localisé de Faoye
abrite des facies de caractéristiques granulométriques
différentes. En effet les sédiments prélevés et
analysés sur les tannes de Faoye sont entièrement
constitués de sables et de silts. Les sables sont plus fréquents
95,3% mais à des dimensions très variées. Tout comme la
vasière, les tannes sont dominées par le sable moyen qui occupe
plus de la moitié des sédiments prélevés (61,7%),
suivi du sable fin (24,9%). Les sables très grossiers, grossiers et
très fin sont très peu fréquents. Les 5,1 % restants sont
représentés par les limons, notamment le silt grossier, le silt
très grossier et le silt moyen. Les graviers et les plus fins (argile)
ne sont pas présents dans la distribution des sédiments dans les
tannes de Faoye.
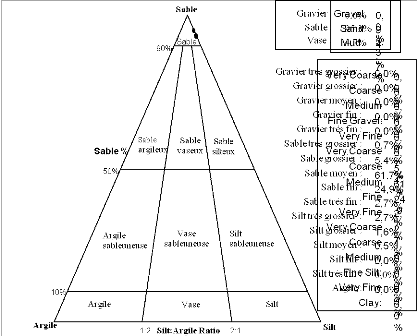
Figure
26:Fréquence des sédiments sur les tannes de Faoye ; Diouf
S. Aziz, 2023
Le tableau17 illustre les paramètres texturaux des
sédiments issus des tannes de Faoye. En effet, le grain moyen est le
sable moyen sauf en profondeur pendant la saison humide où le grain
moyen est marqué par le sable moyen contrairement à Diamniadio
dominé par le grain fin. Le Mz partout inférieur à 2
confirme cette prédominance. Le So qui est partout inférieur
à 1 monte que les sédiments sont bien à
modérément triés c'est-à-dire bien classés
à modérément classés. En ce qui concerne SKg ou le
coefficient d'asymétrie, qui tend vers +1 pendant la saison
sèche, témoigne qu'il y a excès en particules fines. Par
contre, il tend vers -1 pendant la saison humide justifiant l'excès en
particules grossières. Ce qui ce qui fait que la courbe
granulométrique est bien asymétrique pendant la saison
sèche et symétrique pendant la saison humide. Quant au Kurtosis,
qui varie entre 1 et 2, illustre que la distribution est très pointue
(leptokurtique) sauf en surface et pendant la saison pluvieuse où la
distribution est mésokurtique.
Tableau 16:Paramètres
texturaux des sédiments des tannes à Faoye
|
Echan
tillons
|
Paramètres texturaux
|
Méthode de FOLK & WARD
|
|
Géométrique
|
Logarithmique
|
Description
|
|
(mm)
|
(f)
|
|
|
E1t.FS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
296,6
|
1,754
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,507
|
0,591
|
Modérément bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,258
|
0,258
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,523
|
1,523
|
Très leptokurtique
|
|
E2t.FS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
294,2
|
1,765
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,569
|
0,650
|
Modérément bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,286
|
0,286
|
Bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,721
|
1,721
|
Très leptokurtique
|
|
E1t.FS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
302,0
|
1,727
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,395
|
0,481
|
Bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
0,039
|
-0,039
|
Symétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,037
|
1,037
|
Mésokurtique
|
|
E2t.FS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
296,7
|
1,753
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,630
|
0,705
|
Modérément trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
-0,194
|
0,194
|
Très bien asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
1,817
|
1,817
|
Très leptokurtique
|
Source : Diouf S. Aziz, 2023
4.3.3.2.3. La distribution des sédiments sur les
cordons sableux à Faoye
Ces prélèvements sur les cordons sableux sont
issus plus exactement des terres cultivables de Faoye. Les sédiments
issus des cordons sableux à Faoye abritent un facie sableux (99,9 %).
Les sables, de proportions et de taille variables, sont dominés par le
sable moyen 70,5 % et le sable fin (26,6 %). Les silts ne représentent
que les 0,1%. Les plus grossiers (graviers) et les plus fins (argile et silts
très fin à grossier) sont absents dans la distribution des
sédiments. Les sables très fin, grossier et très grossier
sont peu représentatifs (-3%). Cette prédominance du sable moyen
témoigne une concentration des sédiments de la fraction 25um et
200um. Contrairement aux terres cultivables de Diamniadio, le facies des terres
de culture de Faoye n'est pas sablo-silteux mais sableux. Ce qui fait
probablement ces terres toujours aptes à l'agriculture à la
différence de celles à Diamniadio marquées par un taux
très élevé de limons.
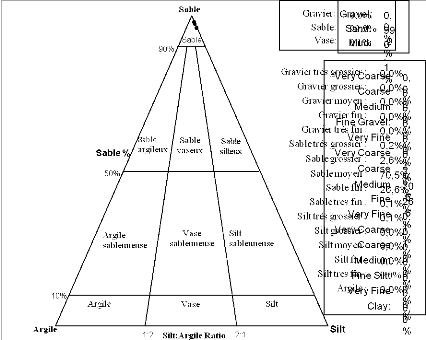
Figure
27:Fréquence des sédiments sur les cordons sableux de
Faoye ; Diouf S. Aziz, 2023
Les paramètres texturaux des sédiments
prélevés des champs de Faoye et analysés au laboratoire
sont illustrés par le tableau 18. D'après la méthode de
Folk et Ward, le grain moyen des cordons de Faoye est essentiellement le sable
moyen avec un Mz inférieur à 2. Le coefficient de dispersion,
déterminant l'indice du tri des sédiments, monte que les
sédiments sont bien classés ou bien triés. Cela explique
le So qui varie entre 0, et 0,5. Pour ce qui est du coefficient
d'asymétrie qui est partout nul, illustre qu'il n'y a ni excès en
particules fines ni excès en particules grossières,
c'est-à-dire que les particules grossière et fine sont
égales dans la distribution. Ce qui que la courbe granulométrique
est partout symétrique. Quant au Kurtosis, partout inférieur
à 1, témoigne une distribution très plate appelée
platikurtique.
Tableau 17:Paramètres
texturaux des sédiments des cordons sableux à Faoye
|
Echan
tillons
|
Paramètres texturaux
|
Méthode de FOLK & WARD
|
|
Géométrique
|
Logarithmique
|
Description
|
|
(mm)
|
(f)
|
|
|
E1ch.FS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
297,9
|
1,747
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,296
|
0,375
|
Bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
0,000
|
0,000
|
Symétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
0,738
|
0,738
|
Platikurtique
|
|
E2ch.FS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
301,8
|
1,728
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,292
|
0,369
|
Bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
0,000
|
0,000
|
Symétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
0,738
|
0,738
|
Platikurtique
|
|
E1ch.FS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
298,0
|
1,747
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,303
|
0,382
|
Bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
0,000
|
0,000
|
Symétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
0,738
|
0,738
|
Platikurtique
|
|
E2ch.FS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
303,7
|
1,719
|
Sable moyen
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
1,293
|
0,371
|
Bien trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
0,000
|
0,000
|
Symétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
0,738
|
0,738
|
Platikurtique
|
Source : Diouf S. Aziz, 2023
4.3.3.2.4. La distribution des sédiments dans le fond
des chenaux à Faoye
Au niveau de la localité de Faoye, le fond des chenaux
a de facies sablo-silteux. Les sables sont néanmoins les plus
fréquents et représentent 61% des sédiments
prélevés. Les limons renferment les 39%. Le sable très fin
et le silt très grossier sont les plus fréquents et
représentent chacun 26,4% pour chacun. Le sable fin 20,5% et le silt
grossier 11,8% sont modérément fréquents. On note une
légère présence des sables moyen, grossier et très
grossier et l'absence totale des graviers. Cela montre la prédominance
des particules fines dans les sédiments du fond du chenal. La figure 43
témoigne nettement cette situation où l'allure de la courbe
granulométrique des échantillons dans le fond des cours d'eau est
verticale dans leur partie centrale, manifestant ainsi la concentration des
sédiments de la fraction 15, 6um et 25um.
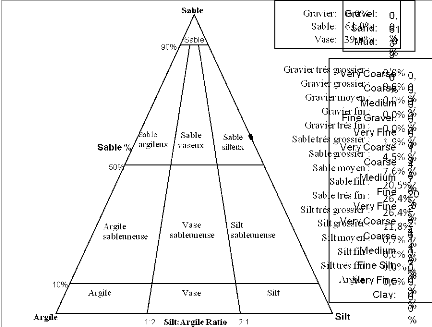
Figure
28:Fréquence des sédiments dans le fond du chenal principal
à Faoye ; Diouf S. A. 2023
Les paramètres texturaux des sédiments dans le
fond du marigot de Faoye à Faoye sont illustrés dans le tableau
19. En effet, le grain moyen est le sable très fin, s'explique par le Mz
qui est partout supérieur à 3. Le So qui est entre 1 et 2,
témoigne les sédiments qui sont mal classés ou mal
triés. Le coefficient d'asymétrie ou le SKg, tendant vers - 1
(-0,089 et -0,140), illustre qu'il y a excès en particules grossiers,
donnant ainsi à la courbe granulométrique sa forme
symétrique pendant la saison sèche et grossièrement
asymétrique (presque symétrique) en saison pluvieuse. Cela
témoigne en quelle sorte le creusement des bas-fonds noté
à Faoye où les cordons sableux sont remportés vers
l'intérieur du chenal. Le Kurtosis partout inférieur à 1
détermine une distribution platikurtique (saison sèche) à
mésokurtique (saison humide).
Tableau 18:Paramètres
texturaux des sédiments du fond du marigot de Faoye à Faoye
|
Echan
tillons
|
Paramètres texturaux
|
Méthode de FOLK & WARD
|
|
Géométrique
|
Logarithmique
|
Description
|
|
(mm)
|
(f)
|
|
|
E1cd.DS1
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
81,29
|
3,621
|
Sable très fin
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
2,346
|
1,230
|
Mal trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
0,089
|
-0,089
|
Symétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
0,897
|
0,897
|
Platikurtique
|
|
E1cd.DS2
|
Grain moyen MZ (Mg)
|
84,38
|
3,567
|
Sable très fin
|
|
Coefficient de dispersion (So)
|
2,554
|
1,353
|
Mal trié
|
|
Coefficient d'asymétrie (SKg)
|
0,140
|
-0,140
|
Grossièrement asymétrique
|
|
Kurtosis (Kg)
|
0,996
|
0,996
|
Mésokurtique
|
Source : Diouf S. Aziz, 2023
Les échantillons prélevés à Faoye
suivant les différentes unités morphologiques et analysés
au laboratoire révèlent dons que ces unités n'ont pas les
mêmes caractéristiques granulométriques. Ils se voient par
la prédominance du sable moyen, d'une dispersion
modérément classée, d'une allure bien asymétrique
et par la prédominance d'une distribution très pointue dans les
unités de tanne et vasière. Au niveau des cordons de Faoye, le
sable moyen est le facies dominant, le classement bien trié, la
distribution plate et l'allure de la courbe symétrique. Par contre, dans
le fond des chenaux, le Mz correspond au sable très fin, la courbe
symétrique à grossièrement symétrique, le
classement mal trié et le Kurtosis plat à mésokurtique.
Les unités morphologiques au sein du village de Faoye sont donc à
faciès sableux et parfois sable-silteux notamment dans le fond de son
marigot.
Dans l'ensemble, les sédiments rencontrés dans
les unités morphologiques de notre milieu d'étude sont à
99,9 % constitués du sable. Le sable moyen, le plus fréquent,
représente les 70,5 % de l'ensemble des échantillons
prélevés dans le milieu et analysés au laboratoire. Le
sable fin se voit avec les 26,6 %. Les limons ne font que 0,1 % des
sédiments (Cf. Figure 53, annexe). Le milieu a donc un facies sableux
modérément classé, dont le Mz est le sable moyen mais
tendant vers les particules plus fines (ce qui détermine l'allure des
courbes le plus souvent bien asymétrique) avec une distribution
essentiellement pointue. Par contre, dans le fond des chenaux, les
caractéristiques granulométriques sont assez
particulières. Concernant les conditions de dépôt, les deux
courbes granulométriques, en faciès sigmoïde,
caractérisent d'une accumulation sélective : les particules de
dimensions moyennes se sont déposées, alors les plus grosses se
sont arrêtées en première et que les plus petites ont
été entraînées plus loin. Ces dernières se
sont entrainées et déposées au fond des chenaux ce qui
déterminent la concentration importante des sables fin et très
fin (plus de 50%). Concernant la provenance des sédiments, ces formes de
faciès montent que les particules proviennent des dunes, des bancs
fluviaux, des plages marines, et cordons sableux ou sablo-coquillers. Dans le
milieu, les sédiments proviennent des cordons et bancs sableux,
flèches et barrières littoralesdont les particules moyennes
transportées et déposées dans les tannes et
vasières et les plus fines au fond des chenaux.
En résumé, les analyses des paramètres
physico-chimiques des sédiments et de l'eau du milieu montrent que les
eaux surfaciques et les formations morpho-pédologiques du milieu sont
essentiellement extrêmement salés, très
minéralisés et légèrement alcalins à
alcalins. Avec un facies sablonneux, les vasières, chenaux et les tannes
surtout, subissent fortement le phénomène d'ensablement par ce
sable issu grandement des bancs sableux. Cela génère le plus
souvent l'extension ou le recul de la surface occupée par ces
unités d'où l'étude de leur évolution spatiale et
temporaire dans les lignes suivantes.
4.1. Analyse et interprétation
de l'évolution des unités paysagères
Il s'agit de la caractérisation des unités
paysagères dans le milieu d'étude. Ensuite, du suivi de la
dynamique des unités et de l'analyse des facteurs qui la
façonnent. En outre, de l'analyse des impacts de l'évolution des
unités et des stratégies mises en place. Et enfin, de la
discussion des résultats.
4.4.1. Les unités
morphologiques
Les unités morphologiques désignent l'ensemble
des entités de paysages ou d'occupation de sol retrouvées dans
cet espace géomorphologique. Selon Mame Demba Thiam (1986), Mariline
Diara (1999) et Guilgane Faye (2016), ces unités sont
constituées, dans le delta du Saloum, par la vasière à
mangrove, les tannes, les amas coquillers, les chenaux à marée,
les cordons sableux et les barrières littoraux. Dans cette palette, les
différentes unités retrouvées dans le milieu
d'étude sont : la vasière à mangrove, les tannes, les
amas coquillers, les chenaux à marré et les cordons sableux.
Cette dernière unité (les cordons sableux) est divisée en
deux sous unités telles que la végétation continentale et
les terres cultivables car, étant ces dernières, les deux
thèmes retrouvés sur tous les cordons du milieu
c'est-à-dire là où on a de cordon sableux, on y a
forcément soit la végétation continentale, soit les terres
cultivables (champs + habitat). L'autre paramètre nous poussant à
faire cette répartition est pour mieux évaluer l'impact de la
dynamique des unités sur le couvert végétal, les champs et
le bâti. Nous avons enfin, pour cette étude 6 unités
morphologiques. Elles sont : la vasière nue, la vasière
à mangrove, les tannes, les chenaux à marré (cours d'eau),
la végétation continentale et les terres cultivables. Toutes ces
unités subissent des modifications dans le temps et dans l'espace et
celles-là, impactent non seulement l'environnement, mais aussi les
activités menées par la population paysanne. De ce fait, analyser
la dynamique et ses facteurs devient une nécessité.
4.4.2. La dynamique des unités
paysagères de 1970 à 2020 et ses facteurs
Il s'agit du suivi de l'évolution des
différentes unités morphologiques retrouvées dans le
milieu d'étude depuis les années 1970 aux années 2020 et
de l'analyse des facteurs principaux entrainant cette dynamique.
4.4.2.1. La dynamique des
unités morphologiques de 1970 à 2020
La dynamique des unités morphologiques désigne
l'évolution progressive ou régressive de la superficie d'une
entité paysagère à 2 ou n dates différentes. Il
s'agit de suivre l'évolution de la surface occupée par la
vasière nue, celle occupée par la vasière à
mangrove, par les tannes, les cours d'eau et la végétation
continentale, et enfin, la surface des terres cultivables de 1970 à
2020. Cette analyse de la dynamique est appréciée grâce aux
cartes diachroniques, au calcul statistique et à sa
représentation sous forme graphique et tableur. En fonction de la
disponibilité des données, les images satellitaires Landsat des
années 1972, 1984, 1995, 2007 et 2020 sont utilisées pour cette
étude.
4.4.2.1.1. La situation de 1972
La carte nous montre la répartition des unités
morphologiques dans le milieu en 1972. Le milieu est marqué par la
prédominance des tannes et de la vasière à mangrove qui
représentent respectivement 5447,01 et 4251,13 ha soit les 31,63 et
24,69% de la superficie totale. La vasière à mangrove se localise
particulièrement au sud et au centre tandis que les tannes, se situent
essentiellement au nord du milieu même si sont retrouvées partout
dans le milieu d'étude. Les cours d'eau se voient l'unité la plus
importante derrière les tannes et la vasière à mangrove.
Ils sont plus importants au nord et occupent une superficie qui est
égale à 3279,72 ha, soit 19,05% en 1972. Les unités telles
que la végétation continentale et les terres cultivables sont les
moins représentatives. La végétation continentale se voit
au sud et à l'est le long du marigot de Faoye. Les terres cultivables
occupent la partie nord du milieu et une petite portion au sud. Elles occupent
1796,73 et 706,22 ha respectives, soit des pourcentages de 10,43 et 4,10. Cela
montre nettement une forte concurrence entre les tannes au nord et les
mangroves au sud mais aussi l'unité des cours d'eau qui occupe la
troisième place en période de début sècheresse
depuis 1968.
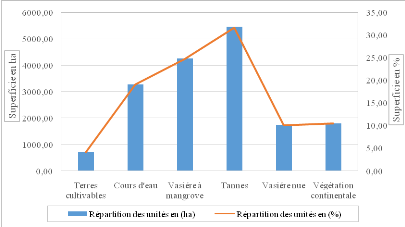
Figure
29:Superficie des unités morphologiques en 1972 en (ha) et en (%) ;
Diouf S. Aziz (2023)Carte 14:Occupation du sol en
1972
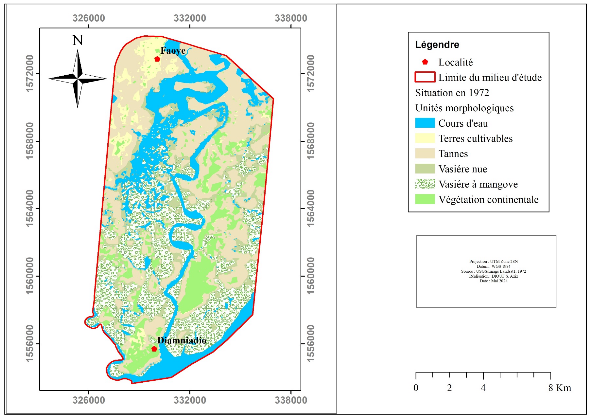
4.4.2.1.2. La situation de 1984
La situation de 1984 montre l'évolution des
unités au cours de 12 années, couvrant la période allant
de 1972 à 1984. Pendant cette période, frappée
particulièrement par une longue période de sécheresse, on
note une évolution remarquable au sein de toutes les unités
morphologiques du milieu. Cette dynamique très rapide est marquée
par une évolution progressive de certaines unités et une
évolution régressive des autres entités. La vasière
nue se voit avec une augmentation de sa superficie occasionnée par la
réduction de la mangrove et des cours d'eau. Elle connait une dynamique
positive en passant de 1739,30 ha en 1972 à 6124,22 ha en 1984 soit un
hause de 4384,92 ha en 1984. La vasière à mangrove et les cours
d'eau qui voient la diminution de leur superficie, connaissent une
réduction de 2658,78 et de 713,07 ha respectivement en 1984 au profit de
la vasière nue. Ces unités passent de 24,9% à 9,25% pour
la mangrove et de 19,05 à 14,90% pour les cours d`eau de 1972 à
1984. Cette période se caractérise aussi par une
légère extension des terres cultivables, due au fin recul de la
végétation continentale au sud et à l'est du chenal
principal. Les terres cultivables gagnent 475,73 ha, passent de 706,22 ha
à 1181,95 ha, tandis que la végétation continentale, elle
perd 187,99 ha de 1972 à 1984. Quant aux tannes, qui viennent en
deuxième place derrière la vasière nue, passent de 5447,01
à 4146,70 ha, soit un recul de 1300,31 ha durant cette période.
La période 1972-1984 se caractérise essentiellement par une
dynamique progressive des terres cultivables et de la vasière nue aux
dépens des cours d'eau, de la vasière à mangrove et de la
végétation continentale qui se voient leur superficie
régressée. Les tannes restent toujours importantes (24,08% de la
superficie totale). Cette situation due probablement à la
sécheresse, l'élément caractéristique du sahel
durant, durant cette période.
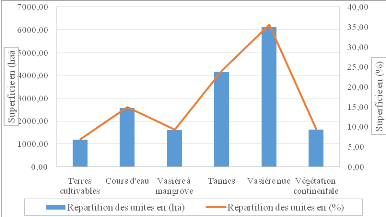
Figure
30:Superficie des unités morphologiques en 1984 en (ha) et en (%) ;
Diouf S. Aziz (2023)
Carte 15:Occupation du sol en
1984
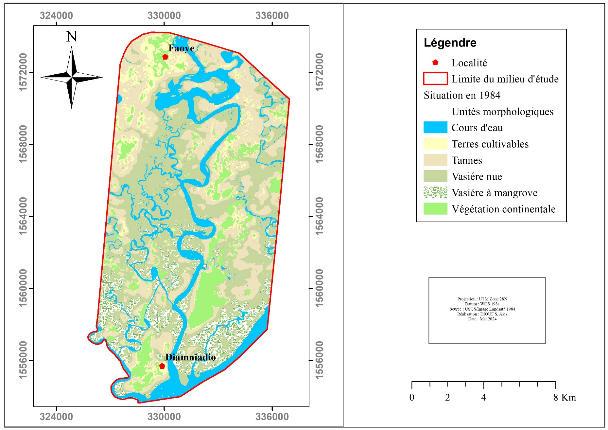
4.4.2.1.3. La situation de 1995
La situation de 1995 analyse l'évolution des
unités paysagères durant la période allant de 1984
à 1995. Cette période est marquée par une forte extension
des cours d'eau et des tannes au détriment de la vasière nue et
des terres cultivables. Les cours d'eau qui représentent les 23,11% de
la superficie totale, passent de 2566,65 à 3979,79 ha, soit un gain de
1413,14 ha de 1984 à 1995, de même que les tannes, ils connaissent
une hausse de 221,59 ha durant cette période. Cette dynamique des tannes
montre qu'ils augmentent si les cours d'eau débordent et diminuent au
moment où les eaux se retirent. Et cela accuse l'avancée marine
comme étant l'un des facteurs déterminants de la dynamique.
Contrairement à ces unités, les terres cultivables et la
vasière nue voient respectivement une baisse de 155,10 et de 1780,60 ha
entre 1984 et 1995. Cela est peut-être favorisé par l'intrusion
marine dans les bolong et le débordement de ces derniers sur les terres
de cultures après la rupture à Sangomar en 1986. Durant cette
même période, les unités telles que la vasière
à mangrove et la végétation continentale, se
caractérisent par une très faible
régénération. Ce qui entraine leur accotement en 1995 ou
on note une progression de 245,62 ha pour la vasière à mangrove
et 55,09 ha pour la végétation continentale. La période
1984-1995 est donc marqué par une évolution régressive de
la vasière nue et des terres cultivables et une dynamique positive des
unités telles que les cours d'eau, les tannes et les
végétations. Cette régénération de la
mangrove et de la végétation continentale se justifie
peut-être par l'importance des pluies enregistrée en 1995 qui
constitue l'année la plus humide depuis 1970.
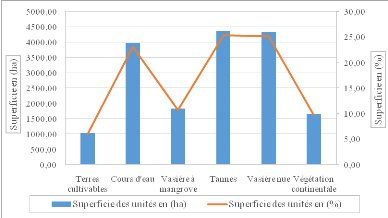
Figure
31:Superficie des unités morphologiques en 1995 en (ha) et en (%) ;
Diouf S. Aziz (2023)Carte 16:Occupation du sol en
1995
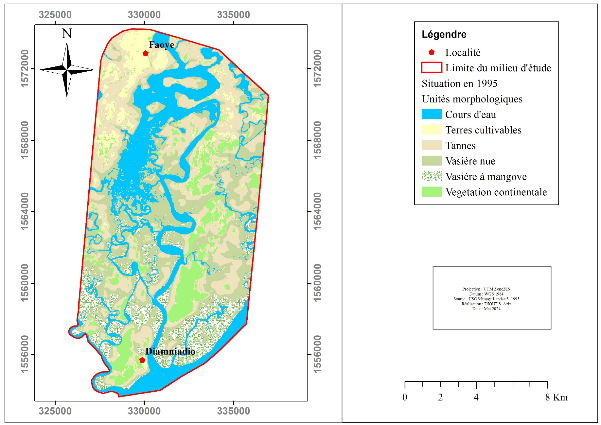
4.4.2.1.4. La situation de 2007
La situation de 2007 illustre la dynamique des unités
de paysages entre 1995 et 2007. Cette dynamique se caractérise par une
extension des cours d'eau aux dépens du reste des unités
morphologiques. Cette unité à elle seule renferme les 42,20% de
la superficie totale, soit un gain de 3288,24 ha entre 1995 et 2007. Les
vasières nue et à mangrove se voient respectivement avec une
perte de 1609,81 ha et de 481,53 ha durant cette période. Les tannes et
les terres cultivables connaissent d'une manière respective un recul de
1033 et de 395,42 ha de leur superficie entre 1995 et 2007. Toutefois, la
végétation continentale connait une légère
progression occasionnée par le retrait des terres de culture de part et
d'autre au nord du marigot de Faoye et gagne 231,82 ha en 2007. La
période allant de 1995 à 2007 se caractérise donc par une
augmentation de la superficie occupée par les cours d'eau au
détriment de l'espace constituée par les autres unités
rencontrées dans le milieu d'étude.
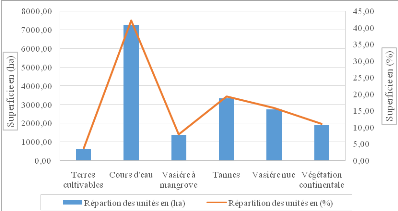
Figure
32:Superficie des unités morphologiques en 20007 en (ha) et en (%) ;
Diouf S. Aziz (2023)Carte 17:Occupation du sol en
2007
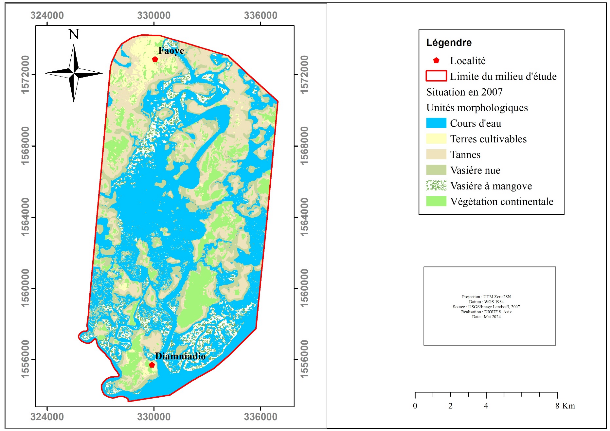
4.4.2.1.5. La situation de 2020
La situation de 2020 analyse la dynamique des unités
morphologiques le long de l'ile de Diamniadio à Faoye de 2007 à
2020. Elle se caractérise avec l'importance des unités de tannes
et de cours d'eau et de la vasière nue. L'unité des cours d'eau
est la première avec 32,75% de la superficie totale. Elle est suivie par
les tannes qui représentent les 25,99% et par la vasière nue avec
un taux de 23,87% en 2020. Durant cette période, la vasière
à mangrove passe de 7,88 à 6,31%, quant à la
végétation continentale, elle occupe les 11,01% de la superficie
en 2007 pour chuter jusqu'à 6,79% en 2020. Ce recul de la
végétation continentale a favorisé une avancée de
0,62% de la superficie des terres cultivables. Cela montre la pression que
subissent les végétations immersible et submersible du milieu
d'étude.
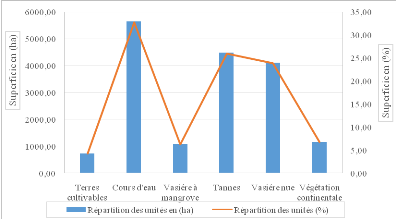
Figure
33:Superficie des unités morphologiques en 2020 en (ha) et en (%) ;
Diouf S. Aziz (2023)Carte 18:Occupation du sol en
2020
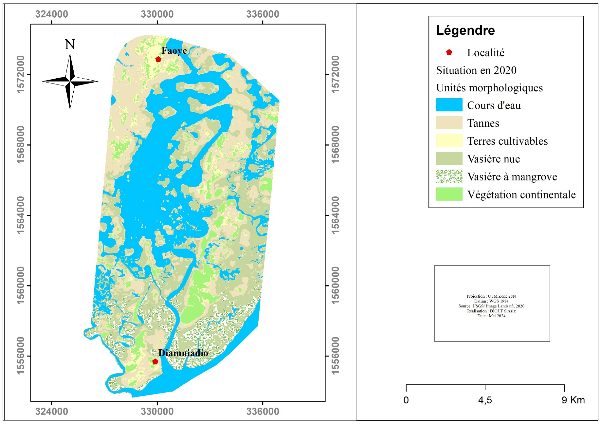
4.4.2.1.6. La situation de 1972 à 2020
La situation de la période allant de 1972 à 2020
résume l'évolution qu'a connue les unités durant ces
différentes séquences. Les cours d'eau et la vasière nue
ont connu des taux de croissance positive de 71,95 et de 136,29% respective
entre 1972 et 2020. Les terres cultivables se voit avec un taux de 4,63% durant
cette période, tandis que les végétations et les tannes,
leur taux de croissance est négatif. Moins 17,82% pour les tannes,
-74,43% pour la vasière à mangrove et -34,94% pour la
végétation continentale. Toutefois, les tannes restent
très importantes et occupent la deuxième place derrière
les cours d'eau en 2020. Cette dynamique s'apprécie beaucoup plus
nettement par les matrices de changements qui montent les situations de
stabilités, de modifications et de conversions de la superficie des
unités de 1970 à 2020.
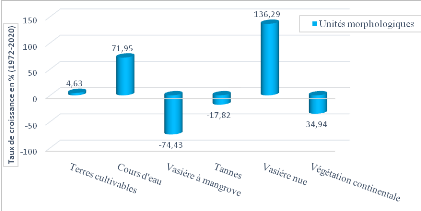
Figure
34:Taux de croissance des unités morphologiques de 1972 à 2020 ;
Diouf S. A. (2023)
Cettefigure illustre les taux de croissance de la superficie
des unités morphologiques du milieu de 1970 à 2020.
Carte 19: Situation de la dynamique
des unités morphologiques entre 1972 et 2020
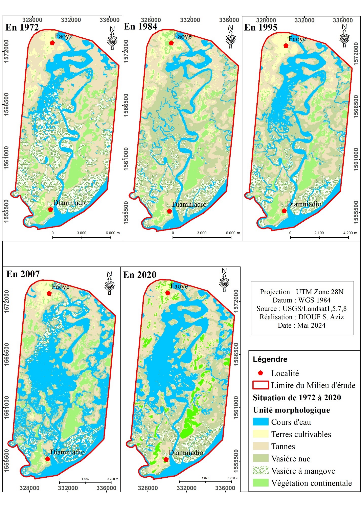
4.4.2.2 Changements spatio-temporels des unités
morphologiques entre les séquences 1972-1995, 1995-2020 et 1972 et
2020
Les cartes de changements, résultant de la combinaison
des cartes des unités d'occupation du sol, a mis en exergue les
changements spatio-temporels des unités morphologues entreles
séquences 1972-1995, 1995-2020 et 1972-2020. Le choix de ces
séquences a pour but d'apprécier le comportement entre les
unités pendant les années de sècheresses (1970-1990) mais
aussi au moment des années humides 2000 et après la rupture de la
flèche de Sangomar. Ces changements se traduisent par des modifications
dans la vasière (vasière nue et vasière à
mangrove), des conversions c'est-à-dire de la transformation d'une
unité à une autre et des stabilités (surface qui n'a pas
subi de changement entre les deux dates).
§ Séquence 1972-1995
|
Classe d'occupation du sol
|
Superficie en 1995
|
Total général
|
|
Cours d'eau
|
Tannes
|
Terre de culture
|
Vasière a mangrove
|
Vasière nue
|
Végétation continentale
|
|
Superficie en 1972
|
Cours d'eau
|
3015
|
9
|
0
|
23
|
264
|
3
|
3313
|
|
Tannes
|
61
|
3973
|
374
|
2
|
790
|
236
|
5435
|
|
Terre de culture
|
0
|
59
|
524
|
1
|
0
|
120
|
705
|
|
Vasière a mangrove
|
752
|
3
|
0
|
1780
|
1693
|
10
|
4237
|
|
Vasière nue
|
182
|
47
|
1
|
22
|
1463
|
22
|
1737
|
|
Végétation continentale
|
6
|
266
|
125
|
7
|
124
|
1266
|
1794
|
|
Total général
|
3970
|
4357
|
1023
|
1834
|
4334
|
1657
|
17222
|
La matrice de changement des unités d'occupation du sol
de 1972-1995 est marquée par une diminution de la vasière
à mangrove, de la végétation continentale et des tannes.
1693 ha de la vasière à mangrove sont modifiés en
vasière nue et 752 ha convertis en cours d'eau. Pour les tannes, 374 ha
sont transformés en terres de culture et 790 ha en vasière nue.
Par ailleurs, 266 ha de la végétation continentale sont convertis
en tannes et 125 ha en terre de culture. La séquence 1972-1995 est donc
marquée par la régression de la superficie des unités
vasière à mangrove et de la végétation continentale
au profit de la vasière nue, des tannes et des terres de culture. Cela
s'explique par la sècheresse des années 1970 aux années
1990 et peut-être au reboisement à des fins agricole. La
modification de la vasière à mangrove en vasière nue est
la plus remarquable pendant cette période (1693 ha).
Tableau
19 : Matrice de changement des unités d'occupation du sol entre
1972 et 1995
|
|
Stabilité
|
|
Conversion des terres de culture en vasière
|
|
|
Modification dans la vasière
|
|
Conversion des terres de culture en végétation
continentale
|
|
|
Conversion des cours d'eau en tannes
|
|
Conversion de la vasière en cours d'eau
|
|
|
Conversion des cours d'eau en vasière
|
|
Conversion de la vasière en tanne
|
|
|
Conversion des cours d'eau en végétation
continentale
|
|
Conversion de la vasière en terres de culture
|
|
|
Conversion des tannes en cours d'eau
|
|
Conversion de la vasière en végétation
continentale
|
|
|
Conversion des tannes en terre de culture
|
|
Conversion de la végétation continentale en eau
|
|
|
Conversion des tannes en vasière
|
|
Conversion de la végétation naturelle en tannes
|
|
|
Conversion des tannes en végétation continentale
|
|
Conversion de la végétation continentale en terre
de culture
|
|
|
Conversion des terres de culture en tannes
|
|
Conversion de la végétation continentale en
vasière
|
§ Séquence 1995-2020
Le changement le plus marquant entre 1995 et 2020 est le recul
de la superficie de la vasière nue au profit des cours d'eau (1594 ha).
Toutes les autres unités, exceptés les cours d'eau et les tannes
se voient par la diminution de leur superficie durant cette période
humide. Cette situation est essentiellement liée au retour
pluviométrique mais aussi surtout à l'intrusion marine
après la rupture de la flèche de Sangomar. La progression des
tannes est au détriment de la vasière nue, des terres de culture
et de la végétation continentale. Toutefois, même si la
vasière nue a connu une conversion très forte, elle a
gagné 1426 ha de la superficie des tannes et 568 ha de la vasière
à mangrove. La séquence 1995-2020 est donc marquée par
l'avancée des cours d'eau et des terres salées au
détriment des autres unités d'occupation du sol.
Tableau 20: Matrice de changement des
unités d'occupation du sol entre 1995 et 2020
|
|
Stabilité
|
|
Conversion des terres de culture en vasière
|
|
|
Modification dans la vasière
|
|
Conversion des terres de culture en végétation
continentale
|
|
|
Conversion des cours d'eau en tannes
|
|
Conversion de la vasière en cours d'eau
|
|
|
Conversion des cours d'eau en vasière
|
|
Conversion de la vasière en tanne
|
|
|
Conversion des tannes en cours d'eau
|
|
Conversion de la vasière en végétation
continentale
|
|
|
Conversion des tannes en terre de culture
|
|
Conversion de la végétation continentale en eau
|
|
|
Conversion des tannes en vasière
|
|
Conversion de la végétation naturelle en tannes
|
|
|
Conversion des tannes en végétation continentale
|
|
Conversion de la végétation continentale en terre
de culture
|
|
|
Conversion des terres de culture en tannes
|
|
Conversion de la végétation continentale en
vasière
|
|
Classe d'occupation du sol
|
Superficie 2020
|
Total général
|
|
Cours d'eau
|
Tannes
|
Terre de culture
|
Vasière a mangrove
|
Vasière nue
|
Végétation continentale
|
|
Superficie en 1995
|
Cours d'eau
|
3762
|
40
|
|
31
|
162
|
|
3995
|
|
Tannes
|
8
|
2868
|
45
|
|
1426
|
16
|
4363
|
|
Terre de culture
|
|
467
|
361
|
|
3
|
195
|
1026
|
|
Vasière a mangrove
|
287
|
27
|
|
953
|
568
|
1
|
1835
|
|
Vasière nue
|
1594
|
698
|
|
100
|
1942
|
6
|
4340
|
|
Végétation continentale
|
3
|
373
|
5
|
1
|
5
|
949
|
1663
|
|
Total général
|
5654
|
4472
|
738
|
1085
|
4106
|
1168
|
17222
|
§ Séquence 1972-2020
La matrice de changement de la séquence 1972-2020 est
marquée par le recul de la vasière à mangrove, la
végétation continentale et des terres salées. Le
changement le plus marquant entre 1984 et 1994 est le recul de la superficie de
la vasière à mangrove au profit de la vasière nue et des
cours d'eau. 1720 ha de la vasière à mangrove sont convertis en
eau et 1308 ha sont modifiés en vasière nue, soit un total de
3038 ha.Le recul des tannes est essentiellement au bénéfice de la
vasière nue avec 1912 ha qui ont connu de conversion. Quant à la
réduction de la végétation continentale, elle est au
profit des tannes (518 ha) et des terres de culture (298 ha). La
séquence 1972-2020 est donc marquée par l'extension de la
vasière nue, des terres de culture et des cours d'eau au
détriment des autres unités morphologiques dans le milieu.
Tableau 21 : Matrice de
changement des unités d'occupation du sol entre 1972 et 2020
|
Unité
|
Superficie en 2020
|
Total général
|
|
Cours d'eau
|
Tannes
|
Terre de culture
|
Vasière a mangrove
|
Vasière nue
|
Végétation continentale
|
|
Superficie en 1972
|
Cours d'eau
|
3162
|
52
|
|
12
|
86
|
1
|
3312
|
|
Terre salée
|
111
|
3198
|
131
|
4
|
1912
|
79
|
5436
|
|
Terre de culture
|
|
188
|
307
|
1
|
1
|
209
|
705
|
|
Vasière a mangrove
|
1720
|
177
|
|
1027
|
1308
|
5
|
4238
|
|
Vasière nue
|
667
|
332
|
|
34
|
699
|
5
|
1737
|
|
Végétation continentale
|
15
|
518
|
298
|
6
|
94
|
863
|
1794
|
|
Total général
|
5674
|
4465
|
737
|
1084
|
4100
|
1162
|
17222
|
|
|
Stabilité
|
|
Conversion des terres de culture en vasière
|
|
|
Modification dans la vasière
|
|
Conversion des terres de culture en végétation
continentale
|
|
|
Conversion des cours d'eau en tannes
|
|
Conversion de la vasière en cours d'eau
|
|
|
Conversion des cours d'eau en vasière
|
|
Conversion de la vasière en tanne
|
|
|
Conversion des cours d'eau en végétation
continentale
|
|
Conversion de la vasière en végétation
continentale
|
|
|
Conversion des tannes en cours d'eau
|
|
Conversion de la végétation continentale en eau
|
|
|
Conversion des tannes en terre de culture
|
|
Conversion de la végétation naturelle en tannes
|
|
|
Conversion des tannes en vasière
|
|
Conversion de la végétation continentale en terre
de culture
|
|
|
Conversion des tannes en végétation continentale
|
|
Conversion de la végétation continentale en
vasière
|
|
|
Conversion des terres de culture en tannes
|
Dans l'ensemble, la dynamique actuelle des formations
morpho-pédologique du milieu est marquée par l'extension de la
vasière nue, des cours d'eau et des bancs sableux. Et cela s'explique
par de nombreux facteurs tels que le déficit pluviométrique des
années 1970, l'intrusion marine, la faible topographie du milieu et la
pression exercée par l'homme sur les unités comme les
végétations.
4.4.2.3. Les Facteurs de la dynamique
des unités de paysage dans le milieu
La dynamique des unités morphologiques du milieu n'est
pas aussi simple comme on l'on perçoit suivant les cartes diachroniques.
La dynamique est beaucoup plus complexe, étant donné que de
phénomènes aussi nombreux que divers, la commandent. Ces
phénomènes peuvent d'être d'ordre climatique, géomorphologique, hydrologique,
anthropique, etc. Ils occasionnent une évolution progressive de la
superficie des unités ou une dynamique régressive de cette
superficie d'une année à une autre, désignés sous
le nom de facteurs.
4.4.2.2.1. Les facteurs naturels
Les facteurs naturels désignent l'ensemble des
facteurs, façonnant la dynamique, liés auclimat, à la
géomorphologie, à l'hydrodynamique, ... du milieu. Nous pouvons
en apercevoir le déficit de la pluviométrie, la rupture de la
flèche de Sangomar et la topographie du milieu.
4.4.2.2.1.1. La
variabilité pluviométrique
Le climat est le principal facteur qui commande les
modifications récentes et actuelles des milieux humides côtiers.
Sa variabilité, dans le long terme, entraine le plus souvent des
changements dans l'état naturel de ces mieux. Dans notre milieu
d'étude la pluviométrie constitue essentiellement
l'élément climatique le plus manifestant, qui a surement
donné le milieu son visage actuel. Son importance de même que son
déficit affectent en grande partie toutes les unités
retrouvées dans le paysage, pourquoi elle est accusée comme
principal facteur de la dynamique des unités dès
l'hypothèse, et en particulier son déficit noté depuis
1970. Cette variabilité pluviométrique est marquée par de
périodes humides et de périodessèchesentre 1971 et 2020.
Cette appréciation se base sur l'analyse de l'indice standardisé
de précipitations (SPI).
Tableau 22 : Classes degrés de la sécheresse
par rapport à la valeur du SPI (McKee et al., 1993)
|
2,0 et plus
|
1,5 à 1,99
|
1,0 à 1,49
|
-0,99 à 0,99
|
-1,0 à -1,49
|
1,5 à -1,99
|
-2 et moins
|
|
Extrêmement humide
|
Très humide
|
Modérément humide
|
Proche de la normale
|
Modérément sec
|
Très sec
|
Extrêmement sec
|
En effet, de 1971 à 2007 (30 années de
pluviométrie), le milieu a connu une longue période
déficitaire qui se manifestent essentiellement par 23
annéesmodérément sèches à très
sèches contre 13 années modérément humide.
L'année 1972 constitue, après l'année très humide
de 1971, le début de cette phase sèche qui à durée
plus de 40 ans, entrainant ainsi des modifications significatives sur la
superficie occupée par les unités du milieu. Pendant cette
année, les unités les plus importantes sont les tannes, la
vasière à mangrove et les cours d'eau qui représentent
respectivement 31,63, 24,69 et 19,05% de la superficie totale. Notons bien
qu'on somme au début d'une nouvelle phase annoncée depuis 1968,
la sécheresse des années 1970, frappant toute la zone sahel. En
1984, pendant 12 ans de déficit pluviométrique, la vasière
à mangrove a disparue et ne représente que -7% en faveur de la
vasière nue qui passe de 10,10 à 35,56 % de 1972 à 1984.
Les cours d'eau (-15%) qui n'ont plus une source d'alimentation suffisante se
rétrécirent, la végétation continentale se
régresse aux bénéfices des terres agricoles.). Cette phase
sèche (surtout l'année 1983 la plus sèche de 1971 à
2020 (-1,69), entrainant l'asséchement progressif des cours d'eau,
favorise la mer plus fort, plus dynamique, avec un niveau plus
élevé, que les cours d'eau. Permettant ainsi dès le
début de l'année 1987 l'envahissement de l'estuaire d'une
manière générale par l'eau de la mer. Cette
dernière commande la plupart la dynamique à cet instant jusqu'aux
années 2000 marquées par le retour progressive de la
pluviométrie. En 1995, le milieu connait une modérément
humide (1,16) Cette année excédentaire, combinée à
l'intrusion massive de l'eau de la mer depuis la rupture (1987), ont
favorisé le renforcement des cours d'eau et une légère
régénération des végétations marine et
continentale du milieu au détriment de la vasière nue.
L'année 1995, la plus excédentaire depuis 1972, annonce alors le
retour de la pluviométrie noté depuis les années 2000. La
période de 2008 à 2020 se caractérise, contrairement
à la série 1971-2007, par des années très humide
à extrêmement humide. Les années 2008, 2009, 2010, 2012 et
2020 sont les plus humides avec des valeursqui varient entre 1, 30
à 2,36. Cette longue phase humide a favorisé le recul des tannes
et l'extension des terres de culture. Ces modifications que connaissent toutes
les unités morphologiques du milieu, pendant la période
1972-2020, se voient nettement liéesaux modifications de la
pluviométrie. Toutefois, la période qui est la plus
impactée par la variabilité pluviométrique est celle
allant de 1971 à 1984 marquée une longue phase
déficitaire, entrainant ainsi un recul remarquable des cours d'eau, de
la mangrove et de la végétation continentale. Depuis les
années 1990, un autre facteur entre en jeu et renverse
complétementla situation en faveur des eaux surfaciques et de la
vasière nue,avec le retour de la pluviométrie des années
2000: c'est la rupture à Sangomar (1987).
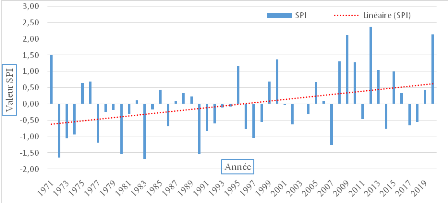
Figure
35:Variation du SPI de 1971 à 2020; Le BORGNE (19), ANACIM, 2023.
4.4.2.2.1.2. La
dynamique marine
La dynamique marine se manifeste par l'intrusion massive de
l'eau de la Mer dans les cours d'eau et dans les terres cultivées
modifie l'état naturel des unités morphologiques du milieu. Elle
participe généralement au débordement des cours d'eau qui
s'accouple avec l'extension des tannes et des vasières nue au
détriment des autres unités. L'avancée de la Mer
entraîne la salinisation et l'acidification des terres agricoles, de la
végétation et des cours d'eau. Les nappes souterraines
connaissent aussi leur dégradation avec l'avancement du biseau
salé. Ces changements au niveau des unités morphologiques du
milieu, liés à la dynamique marine, se perçoit nettement
entre les années 1984 et 1995 (Cf. Cartes 9 et 10). L'influence marine
était moins forte avant les années 1980 mais depuis la
dernière rupture de Sangomar en 1987, elle est devenue un facteur
incontournable. Avant la rupture, les eaux passent de 3279,72 ha en 1972
à ha en 1984 justifiant l'intrusion faible de la Mer dans les cours
d'eau et les bas-fonds. Mais depuis 1995, huit années après la
rupture, nous assistons à un envahissement très agressif des
bas-fonds par l'eau de la Mer, modifiant ainsi la morphologie du milieu. Ce qui
explique le passage de 2566,65 ha 1984 à 3979,79ha 1995, puis à
7268,03 ha en 2007 pour les cours d'eau et de 4146,70 ha 1984 à 4368,29
ha 1995 pour les terrains salés. Cela justifie l'ampleur de la dynamique
marine dans la zone, essentiellement après la rupture de Sangomar, ce
qui fait que cette rupture accusée comme l'un des facteurs
déterminants de la dynamique des unités morphologiques du milieu
d'étude. Elle continue essentiellement le facteur
géomorphologique de l'estuaire du Saloum de par son intensité et
son ampleur d'érosivité, que son degré dégradation
des eaux surfacique et souterraines, son degré destruction et de
salinisation des terres cultivables ainsi que son pouvoir d'extension des
tannes et des cours d'eau. La dynamique marine, se justifie par l'intrusion
massive d'eau de la Mer dans le delta et les régions du bas-fond,
constitue dès lors un facteur clé de l'évolution des
unités paysagères de notre milieu d'étude et depuis la
formation de la brèche à Logoba.
4.4.2.2.1.3. La
topographie
La topographie dans le milieu constitue un facteur favorisant
l'évolution de certaines unités au-dessus des autres
unités. Elle est essentiellement faible voire nulle et dicte la
répartition des unités dans le milieu d'étude. Les chenaux
drainent les topographies les plus basses, les vasières et les tannes
occupent celles moins basses et les cordons sableux, dans les hautes altitudes.
La faiblesse de la topographie, combinée au régime hydrodynamique
actuel de l'estuaire, facilite l'intrusion massive de l'eau de la mer dans les
terres. Ce qui implique la réduction des terres saines, l'extension des
terres salées et l'évolution progressive des cours d'eau. Des
lors, la topographie, extrêmement faible dans le milieu, se
perçoit comme l'un des facteurs imminents de l'évolution des
unités d'occupation du sol de notre milieu d'étude.
La variabilité pluviométrique, la rupture de la
flèche de Sangomar en 1987 et la faiblesse de la topographie du milieu
sont alors conçues comme étant les facteurs naturels principaux
de la dynamique des unités morphologiques le long de l'île de
Diamniadio à Faoye de 1970 à 2020. Toutefois, d'autres facteurs
secondaires d'ordre aussi naturel à l'image de la dynamique du vent, les
marées ascendantes en particulier, la nature et la composition du sol,
... peuvent accélérer ou atténuer l'évolution de
ces unités. Se voit aussi toujours de près l'homme qui vit dans
le milieu et y exerce sa pression.
4.4.2.2.2. Les facteurs anthropiques
Il s'agit des pratiques qui participent à
l'évolution progressive ou régressive des unités
morphologiques du milieu faites par l'homme à travers ses
activités. La déforestation, l'exploitation du sel, la
construction et les pratiques agricoles constituent, pour plus de 90 % de la
population locale, essentiellement les facteurs anthropiques de la dynamique
des unités.
4.1. La déforestation
La coupure de la végétation sans
préoccupation de son renouvellement constitue l'un des facteurs
principaux de l'évolution régressive de la
végétation continentale mais aussi de la mangrove. C'est la plus
forte pression faite par l'homme sur les unités morphologiques selon les
paysans. De nouvelles parcelles agricoles, le bois de chauffage, l'alimentation
du bétail et les besoins de construction, se voient comme causes
principales de la déforestation dans le milieu. En effet, la destruction
des arbres rend le sol plus pauvre, plus vulnérable à la
dégradation chimique, l'expose de plus en plus à l'érosion
hydrique que par le vent. Elle entraine aussi un déséquilibre sur
l'écosystème marin en favorisant la réduction voire la
disparition de l'écosystème mangrove qui constitue un endroit
très propice pour la vie aquatique. Ceux-là montrent que le
déboisement n'affecte pas seulement les végétations qui
sont détruites mais favorise aussi la dégradation des terres et
accélère la dynamique des terres salées. Elle entraine,
d'une part, la réduction de la superficie de la végétation
immersible, celle de la végétation submersible et parfois la
surface occupée par les terres cultivables au moment où elles ne
sont plus protégées contre l'avancée des tannes et des
cours d'eau. Et d'autre part, favorise l'avancée des tannes, des chenaux
à marais sur ces terrains et le déblaiement de ces terres nus,
n'ont plus fixé par une végétation, vers les milieux les
plus bas par les agents géomorphologiques. Cette pression anthropique
sur les végétations est clairement visible dans
l'évolution des unités entre 1972 et 2020. La mangrove passe de
24,69 à 6,31 % et la végétation continentale 10,43
à 6,79% durant cette période. Le déboisement de la
mangrove est plus significatif à Faoye pendant que la coupure de la
végétation continentale à Diamniadio.
Figure
36: Evolution de la végétation (1972-2020)
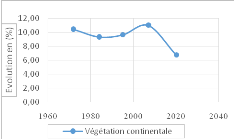 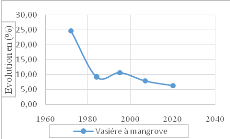
Figure
37: Evolution de la mangrove (1972-2020)
Planche de photos 7 : Débris
de végétation à Diamniadio (déboisement du couvert
boisé)
 
Crédits photos : Diouf S. Aziz, 2023
4.2. L'extraction de sable pour besoin de constructions
La construction constitue un facteur qui participe à la
dynamique régressive des formations végétales du milieu
mais aussi à la réduction des terres cultivables. Cette double
échéance la confère comme l'un des facteurs
déterminants du changement d'état des entités
paysagères retrouvés dans notre milieu d'étude. En effet,
les besoins de construction de campements, de murs, de bâtiments, ...
font que la population coupe la végétation du milieu mais
exploite aussi le sable pour la fabrication de briques par exemple. Cette
exploitation progressive sur ces unités, sans préoccupation de
leur renouvellement, les rend nettement plus vulnérables voire de plus
en plus rares. Elle favorise l'érosion hydrique, l'ablation des sols
dénudés, l'avancée des chenaux sur ces terres et donc
l'accélération de la salinisation de ces dernières. Ce
phénomène d'exploitation du sable des terrains agricoles est plus
fréquent à Faoye où la population est plus importante et
exerce en grande partie sa force sur cette unité.
Planche de photos 8 :
Exploitation du sable pour la construction à Faoye
 
Crédits photos : Diouf S. Aziz, 2023
4.3. L'exploitation du sel
L'exploitation du sel se fait uniquement au niveau de la
localité de Faoye. Elle constitue l'une des activités majores de
ce village. Par contre, cette exploitation peut être un facteur de
l'évolution des unités morphologiques du milieu. Le sel
piégé dans les terres augmente sa concentration sur celles-ci.
Son déplacement de ces lieux de fabrications vers d'autres sites affecte
souvent les unités rencontrées sur sa route en les donnant un
visage salé. Cette exploitation qui nécessite le creusement de
grandes espaces (puits de sel), permet aussi à l'eau salée
d'avancée et de gagner de nouvelles parcelles. Des lors, l'exploitation
du sel participe à la dynamique des unités en favorisant
l'extension des eaux de surface, des terres salées et entrainant parfois
la morte de certaines espèces de végétation et la
dégradation des terres de culture.
Planche de photos 9: Des puits de sel
inondés pendant saison pluvieuse à Faoye
 
Crédits photos : Diouf S. Aziz, 2023
4.4. Pratiques agricoles
Les pratiques agricoles sont des techniques utilisées
parfois par la population paysanne pour assurer la culturation de leurs champs.
Le défrichement et l'utilisation de l'engrais chimique constituent
principalement ces pratiques agricoles. En effet, le défrichement qui
consiste à couper la végétation des parcelles à des
fins agricoles, entraine la destruction du couvert végétal et
l'appauvrissement des sols en matières organiques. Ces sols
déjà dégradé, se voient plus vulnérables aux
substances chimiques (phosphates, nitrates) retrouvées dans les engrais.
Cette double dégradation ne se limite pas afin à la surface du
sol mais affecte aussi le sous-sol (nappe phréatique) par l'infiltration
de ces matières chimiques. Ces pratiques participent alors à la
réduction du couvert végétal, à la
dégradation des terres agricoles et parfois des eaux surfaciques. Ce qui
fait que l'utilisation excessive de ces pratiques peut entrainer, à
longue terme, le recul de ces unités d'occupation du sol.
Dans l'ensemble, le milieu a connu entre 1970 et 2020
l'évolution de toutes ses unités morphologiques. Cette
évolution, qui se manifeste par la réduction de la superficie de
certaines unités en faveur de l'extension des autres entités, est
engendrée par de nombreux facteurs aussi bien d'ordre naturel que de
l'oeuvre anthropique. Le déficit pluviométrique, que la rupture
de la flèche de Sangomar, la faiblesse de la topographie, la
déforestation, les besoins de construction, l'exploitation du sel ainsi
que les pratiques agricoles, commandent l'essentiel du changement de
l'occupation du sol dans le sens horizontal, pour reprendre les mots de
Seynabou Thior Diop (2012), de notre milieu d'étude. Toutefois, la
dynamique de ces unités n'est pas une simple variabilité de
surface d'une année à l'autre mais s'accompagne avec une large
gamme de nouveautés qui affectent ainsi l'environnement et les
activités socio-économiques du milieu.
4.5. Analyse et interprétation des impacts de la dynamique et stratégies de
gestions
Il s'agit, d'une part, de l'analyse des impacts de
l'évolution des tannes, des cours d'eau, de la vasière nue, la
vasière à mangrove, de la végétation continentale
et des terres cultivables sur l'environnement du milieu mais aussi sur les
activités principales de l'homme qui vit dans ce milieu. Et d'autre
part, d'évaluer les stratégies mises par la population paysanne,
l'Etat et les ONG pour faire face à la dynamique de ces unités de
paysages.
4.5.1. Impacts de la dynamique des
unités paysagères
L'évolution complexe qu'ontconnue les
différentes unités morphologiques a entrainé
d'énormes contraintes sur le plan environnemental qui ont compromis les
activités socio-économiques de la population de notre milieu
d'étude.
4.5.1.1. Impacts environnementaux
La dynamique des unités a entrainé dans le
milieu des impacts sur les ressources naturelles tels que la salinisation des
eaux souterraine et surfacique, la dégradation des terres, la
mortalité de la mangrove et le recul du couvert de la
végétation continentale.
4.5.1.1.1. Les impacts sur les ressources en eau
Le déficit pluviométrique accentué depuis
les années 1970 a entrainé l'affaissement du niveau de la nappe
phréatique et des cours d'eau, favorisant ainsi l'intrusion massive de
l'eau de la mer. Cette intrusion saline souterraine que surfacique,
combiné à l'évaporation importante et le manque d'apport
pluviale, ne favorisent pas le lessivage des sels déposés dans
les eaux de l'intérieur. Cela augmente le taux de salinité des
eaux surfaciques de plus en plus vers l'amont et les rend ainsi très
vulnérables face à la contamination par le sel. L'augmentation
progressive de la salinisation de la nappe phréatique et des bolong
contamine alors les eaux douces, ce qui rend sa disponibilité plus rare.
En effet, la remontée capillaire de ces eaux salines souterraines
dégrade les eaux surfaciques y compris les puits qui constituent la
principale source d'approvisionnement des paysans. Cela a pour
conséquence la sur-salure des puits de Faoye et la fermeture des puits
retrouvés à Diamniadio car impropres à l'utilisation. Ces
impacts sur les ressources hydriques du milieu sont donc essentiellement dus
à la dynamique progressive des chenaux à marées qui sont
devenus extrêmement salées envahissant ainsi les eaux souterraines
que celles surfaciques.
4.5.1.1.2. Les impacts sur les sols
La dynamique positive des tannes et des cours d'eau a
entrainé dans le milieu la dégradation des terres notamment par
le sel. Cette salinisation des terres est l'une des conséquences de
l'évolution des unités paysagères les plus visibles dans
le milieu d'étude. En effet, le sel attaque la vitalité du sol
qu'elle réduit en néant en long terme. Et cela réduit la
capacité de production et de reproduction des terres. Cette salinisation
progressive de ces terres, qui ne sont pas suffisamment lessivées
pendant la saison pluvieuse, favorise l'extension des tannes modifiant
carrément le facies des sols qui se retrouvent plus acides et plus
salées. Ce qui fait, dans le milieu, les terres anciennement
destinées à la culture du riz sont actuellement
abandonnées à Diamniadio par leur sur-salureinadaptée
à toute forme de culture. Les mesures des paramètres
physico-chimiques des échantillons prélevés au niveau de
ces rizières révèlent cette salinité extrême
(pH : 7,4 ; Ce : 2801 ìS/cm). Cette
salinisation et l'acidification très fortes des sols, principalement
liées à l'extension des eaux marines et des tannes et de la
régression de la mangrove, sont donc des phénomènes
capables d'entrainer une catastrophe écologique en réduisant la
vitalité des sols en néant. Ce qui fait de ces sols
dépourvus de végétation et inaptes à
l'agriculture.
Photo 9:Polygonisation des argiles
à l'intérieur des habitations du village de Diamniadio

Crédit photo : Diouf S. Aziz, 2023
4.5.1.1.3. Les impacts sur les végétations
Les végétations dans le milieu sont de deux
types : la végétation submersible (la mangrove) et la
végétation immersible (le couvert continental). La dynamique
progressive des unités morphologiques, notamment les tannes, la
vasière nue et les cours d'eau, a entrainé d'une part la
mortalité de la mangrove et de l'autre part le recul
végétation continentale. En effet, d'une part, la concentration
du sel dans le sol rend non seulement difficile l'absorbation de l'eau par la
végétation continentale mais aussi le sel est très
néfaste pour la majorité des plantes. Cette dégradation
chimique, conjuguée avec la pression anthropique sur cette formation
continentale, font que la végétation du milieu se disparait
progressivement. Selon la population paysanne, plus de 70% de la disparition de
plantes (les grandes plantes essentiellement), est l'oeuvre de la dynamique
saline qui se manifeste par la croissance des tannes dans le milieu. Les
plantes les plus touchées sont le Baobab, le Guitakh, le Cocotier et le
Sidem d'après les paysans. Cette dégradation de la
végétation continentale se voit nettement par l'analyse des
cartes diachroniques qui montre une décroissance de -34,94% entre 1972
et 2020 de cette unité d'occupation du sol. De l'autre part, la
mortalité de la mangrove se manifeste par la disparition des
palétuviers, laissant sur place le développement de la
vasière nue et des tannes. En effet, même si la mangrove est une
formation très résistante à la salinité, son
degré de résistivité à une limite. Elle ne peut
voir son développement que si la teneur en sel est de 60g/l pour le
genre Rhizophora et 80g/l pour le genreAvicennisa (ADG, 2012, cité par
Mamadou Sy en 2017) au moment où le taux de salinité est de 57g/l
à Diamniadio selon l'EPEEC (1982), cité par Ndaw Fatou (2014).
Cette salinité qui accroit de l'embouchure vers l'amont, est de 62,7 %
à Ndagane, 64,4 % à Foundiougne et 82,2 % à Kaolack
d'après l'EPEEC (1982). Ce qui fait que le taux de salinité est
forcément plus important à Faoye, peut-être même
supérieur à 65 %. Et c'est justement ce qui justifie la
mortalité du genre Rhizophora de Faoye vers Diamniadio. Jusqu'à
2007, la mangrove qui est complètement disparue à Faoye en 2020,
se voyait le long du marigot de Faoye près de cette localité.
Elle a passé de 7,88 à 6,31 % entre 2007 et 2020 au moment
où les tannes passent de 19,36 à 25,99 % et la vasière nue
de 15,87 à 23,87 % pendant cette période. Cette mortalité
de la mangrove, laissant la place à la vasière nue et plupart aux
tannes, a à son tour des effets négatifs sur la faune marine mais
aussi sur les activités économiques menées par l'homme. La
rareté voire même l'extinction de certaines espèces marines
comme les poisons par exemple qui se reproduits essentiellement au niveau de
cet écosystème marin.
Carte 20:Evolution de la mangrove et
de la végétation continentale de 1972 à 2020
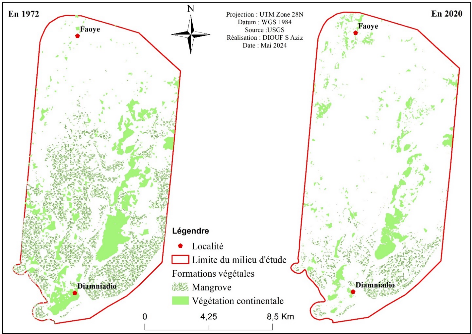
La dynamique régressive des unes et progressive des
autres unités paysagères a donc des effets
généralement nuisibles sur l'écologie du milieu
d'étude. Ils se traduisent en grande partie la dégradation des
terres, que la salinisation extrême des ressources en eau, la
mortalité de la mangrove ainsi que la régression de la
végétation continentale. Ces contraintes écologiques
freinent le plus souvent le développement économique et le
bien-être de la population paysanne.
4.5.1.2. Impacts
socio-économiques
Les impacts sociale et économique de la dynamique des
unités morphologiques sont l'ensemble des retombés de cette
évolution sur les activités principales de l'homme et sur son
bien-être. Selon les paysans, le secteur les plus touchées sont
essentiellement le secteur agricole, le secteur de l'élevage, le secteur
de la pèche et l'habitat.
4.5.1.2.1. Impacts sur le secteur de l'agriculture
Plus de 92 % de la population paysanne apprécie que la
dynamique des unités affecte très gravement l'agriculture du
milieu d'étude. D'après les enquêtes effectuées, le
secteur agricole se voit comme le plus touché dans la zone. Et cela est
due essentiellement par l'appauvrissement des terres par le sel,
l'infertilité du sol voire la disparition même des terres aptes
à agriculture. Ces phénomènes combinés, impactent
négativement le secteur agricole en entrainant la baisse des rendements
agricoles, le déficit de terres cultivables ainsi que l'abandon des
terres précédemment cultivées mais aussi en faisant que
les terres agricoles soient plus éloignées des localités.
L'abandon des terres de culture est le phénomène le plus
illustrant les effets nuisibles de l'évolution des entités de
paysages selon plus de 90 % de la population du milieu. La culture du riz
constitue le plus reculée. Les impacts de la dynamique des unités
sur le secteur agricole sont plus amples au niveau de la localité de
Diamniadio où la culture du riz et toute autre sorte de cultures ne sont
plus pratiquées à l'actuel. L'abandonnement de l'agriculture
constitue un frein de développement pour ces paysans, favorisant
l'insuffisance alimentaire et augmentant ainsi la pression que subissent les
autres secteurs comme la pêche qui est l'activité la plus
pratiquée dans le milieu d'étude.
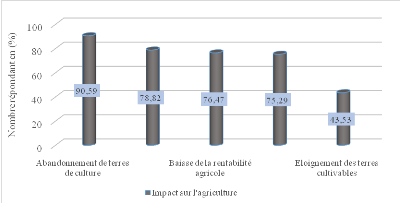
Figure 38:Les impacts de la dynamique des
unités sur l'agriculture d'après la population paysanne
(enquête 2023, Diouf S. Aziz)
4.5.1.2.2. Impacts sur le secteur de la pêche
La pêche constitue la source principale de revenus pour
la population du milieu (38,7%). Néanmoins elle subit de nombreuses
menaces liées à la dynamique des unités d'occupation du
sol. La régression significative de la mangrove et l'extension des
tannes et de vasière nue, due particulièrement à la
salinisation extrême et à l'acidification du sol des mangroves,
ont des impacts négatifs sur le secteur de la pêche du milieu.
Cette végétation marine constitue un site d'importance capitale
pour la reproduction des espèces marines. Sa disparition,
conjuguée avec la salinité très élevée,
entrainent la fruite des poisons vers les bolong moins salés mais aussi
le manque d'espaces propices pour la reproduction de certaines espèces
de la mer. Selon les paysans, la rareté des espèces constitue la
contrainte majore, entrainant même parfois la fermeture des espaces de
pêche pour leurs permettre de se reproduire. Les espèces les plus
rares sont les poissons et les huitres par manque de mangroves mâle
(grand porteur d'huitres). Cela affaiblit de plus en plus le secteur et rend la
vie de la population plus difficiles, plus chère et plus appauvrit
d'après les habitants des localités de la zone d'étude.
4.5.1.2.3. Impacts sur le secteur de l'élevage
L'élevage est le deuxième secteur du milieu
derrière la pêche. Elle constitue alors un part très
important sur l'économie les populations de Diamniadio et Faoye. Par
contre, elle est très affectée par l'évolution des
unités morphologiques du milieu. La régression remarquable du
couvert végétal et la croissance continue des tannes et des eaux
salées, entrainent dans ce secteur la réduction continue des
zones de pâturage, le manque cruel d'aliments de bétail pendant la
saison sèche, l'abandon de l'élevage extensif. Ces effets de la
dynamique entrainent même parfois la morte des animaux, d'après
les éleveurs, par manque de force pour résister pendant la longue
saison non pluvieuse.
4.5.1.2.4. Impact sur l'habitat
Les impacts de l'évolution des unités
paysagères sur le bâti ne sont pas à
négligés. Ils constituent une vraie menace pour
l'épanouissement de la population paysanne. En effet, l'extension des
terres salées ainsi que la progression continue des cours d'eau,
détruisent le plus souvent les constructions d'habitations. Cette
destruction est favorisée par l'intrusion des eaux salées
à l'intérieur des ménages surtout pendant les
marées hautes (à Diamniadio par exemple), laissant sur place le
sel pendant leur retour. Cette accumulation progressive du sel dans les
habitations rend les terres des maisons beaucoup plus salées mais aussi
mange de plus en plus les briques des bâtiments. Pourquoi les
constructions ne peuvent pas être durables, certaines sont même
jusqu'à être abandonnées d'après les habitants.
Photo 10:habitation
abandonnée à Diamniadio

Crédit photo : Diouf S. Aziz, 2023
Les activités économiques du milieu et la vie
sociale de la population paysanne sont actuellement largement perturbées
par la dynamique des unités morphologiques. Le secteur agricole,
l'élevage et le secteur de la pêche ainsi que l'habitat en sont
les plus soufferts.
En résumé, les impacts de l'évolution des
unités sont très visibles dans le milieu d'étude.
L'écologie comme les formations végétales, le sol et les
ressources hydriques, ainsi que l'homme de par ses activités
économiques et sa vie sociale, subissent grandement les effets
néfastes de cette évolution. C'est ce qui a poussé la
plupart de la population paysanne d'apprécier la dynamique des
unités de paysages comme étant très grave dans le milieu.
Néanmoins, les habitations n'ont pas resté sans ripostes, ils ont
développé un certain nombre de stratégies pour essayer
s'adapter à ce phénomène.
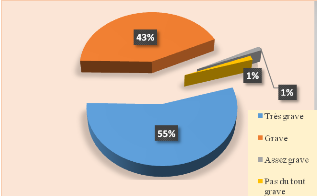
Figure
39:Perception paysanne de la dynamique des unités morphologiques
(enquête 2023, Diouf S. Aziz)
4.5.2. Stratégies de
gestions
La dynamique des unités morphologiques le long de l'ile
de Diamniadio à Faoye, favorisée en grande partie par le
déficit pluviométrique, la dynamique marine ainsi que certaines
activités de l'homme, affectent très gravement l'écologie
et la vie dans milieu d'étude. Toutefois, la population paysanne, le
plus souvent en partenariat avec les ONG et l'Etat, n'a pas resté les
mains croisées mais développe plutôt de stratégies
aussi diverses que nombreuses pour s'adapter. Ces stratégies varient le
plus souvent suivant les acteurs : population locale, ONG et l'Etat.
4.5.2.1. Acteurs
Les acteurs de lutte contre les effets néfastes de la
dynamique des unités de paysages dans le milieu d'étude sont
essentiellement la population paysanne, les ONG et l'Etat. Les
stratégies les plus souvent menées exclusivement par la
population locale sont généralement celles traditionnelles. Le
reboisement est quasiment animé par les ONG. En ce qui concerne l'Etat,
les barrages anti-sel et antiérosif sont généralement
leurs ouvrages. Les stratégies animées par ces acteurs sont donc
diverses et d'ordres généralement physique mais aussi sociale et
économique.
4.5.2.2. Stratégies de
gestions
De nombreuses stratégies sont menées par les
acteurs pour essayer d'adapter aux impacts néfastes de la dynamique des
unités morphologiques dans le milieu. La lutte contre la
dégradation des terres cultivables, la dégradation des ressources
hydriques, de la végétation continentale et celle maritime, mais
aussi contre la dynamique des terres salées et de l'avancée des
eaux salées, en sont les principaux défis entrainant leurs mises
en place. Pour la plupart de la population enquêtée, ces
stratégies d'adaptations sont : la jachère, le paillage, les
digues, le reboisement de mangrove et les barrages. Elles peuvent être
regroupées en méthodes traditionnelle et moderne.
4.5.2.2.1. Les méthodes traditionnelles
Les méthodes traditionnelles renferment la
jachère, le paillage et les digues traditionnelles.
4.5.2.2.1.1. La
jachère
La jachère est une forme de lutte contre la
dégradation des terres cultivables. Elle est donc une technique qui
favorise à lutter contre le recul ou la régression de
l'unité des terres agricoles. Elle consiste à laisser une bonne
partie des terres de se reposer pendant un certain moment (un an le plus
fréquent) afin s'enrichir en matières organiques, plus être
donc en bon état. La jachère est essentiellement pratiquée
à Faoye et concerne le plus souvent les parcelles les plus proches des
terres salées (tannes). Elle peut-être donc conçue comme
une méthode de récupération et de fertilisation des terres
les plus vulnérables à la dynamique saline.
Photo 11:Jachère ligneuse
bordant les terres cultivées à Faoye

Crédit photo : Diouf S. Aziz, septembre 2023
4.5.2.2.1.2. Le
paillage
Elle consiste à laisser une bonne partie des
débris des cultures (tiges de mil surtouts) sur le sol. Dans le milieu
d'étude, il est plus fréquent sur les sols nus moins fertiles. Il
sert à rendre ces sols plus riches en matières organiques mais
aussi diminue la quantité de sel qui s'y trouve. C'est une
méthode exclusive à Faoye là où l'agriculture se
pratique toujours. Une technique de récupération de terres
salées mais aussi de protection des non salées.
Photo 12:Reste de tiges de mil
à l'arrière des champs de Faoye

Crédit photo : Diouf S. Aziz, septembre 2023
4.5.2.2.1.3. Les
digues artisanales
Les digues sont le plus souvent des rangées en sacs de
sables, de barrages de déchets ou de murs trop petits afin de lutter
contre l'avancée des eaux des bolong. Elles sont des digues
antiérosives d'une manière générale. C'est pourquoi
se sont des formes construites majoritairement entre les habitations et les
cours d'eau. Elles sont pour objectif de limiter l'eau de la mer et de
protéger donc le bâti. Toutefois, ces digues restent très
limitées car remontées ou même détruites par les
eaux qu'elles censées arrêter.
4.5.2.2.2. Les méthodes modernes
Les méthodes modernes sont essentiellement les barrages
anti-sel et antiérosif et le reboisement de mangrove dans le milieu.
4.5.2.2.2.1. Le
reboisement de mangrove
Le reboisement de mangrove est la stratégie la plus
pratiqué dans le milieu selon les paysans. On la retrouve au niveau de
toutes les localités du milieu, mais aussi le long du marigot de Faoye.
L'implantation de cette végétation submersible permet de stopper
l'avancer très rapide de l'eau des chenaux sur les terres arables,
diminue la salinisation extrême des zones de vasières en captant
à son maximum le sel. Elle constitue alors une politique de lutte
très efficace contre la dégradation des terres de culture, des
ressources en eau mais aussi protège les habitations contre
l'érosion ou la submersion marine. D'après la
quasi-totalité de la population paysanne, cette forme de politique est
entièrement initiée et financée, dans le milieu, par les
organisations non gouvernementales (ONG), mais non par l'Etat. Ces
organisations et projets sont le plus souvent étrangers, en partenariat
avec les paysans ou des organisations sénégalaises ou de la
sous-région. Nous pouvons notons SOLSOC, une organisation belge en
partenariat avec GREEN SENEGAL (Groupement de la recherche et d'études
environnementales en 1999) et OYOFAL PAJ, OCEANIUM qui est une organisation de
protection de l'environnement a initié notamment dans la localité
de Diamniadio une vaste campagne de reboisement de mangrove, WAAME, SELPIA,
etc.Ces reboisements dans le milieu sont débutés depuis les
années 2002 et vise à la restauration des ressources naturelles
de mangrove.
Planche de photos 10:Reboisement de
mangrove le long du marigot de Faoye (gauche) et à Diamniadio
(droite)
 
Crédit photo : Diouf S. Aziz, 2023 Dieye E. H.
Ballaet al, 2013
4.5.2.2.2.2. Les
barrages
Les barrages sont le plus souvent des politiques de protection
contre l'avancé de la mer sur les terres de culture ainsi que sur le dos
du bâti. Ils sont en général financés et
réalisés par l'Etat. Ces barrages, en limitant l'intrusion
marine, participent aussi à la récupération des terres
regagnées par le sel. Ils barrent sur son dos l'eau saline et
stockentsur son devant le maximumde l'eau de la pluie et le plus long possible
pour la régénération du ce sol. Dans le milieu, ces
barrages se retrouvent uniquement à Faoye où l'activité
agricole se fait encore ressentir.
Planche de photos 11:Vue du barrage
antiérosif et de récupération des terres salées
à Faoye
 
Crédits photos : Diouf S. Aziz, septembre 2023
Celles-ci constituent alors un ensemble de stratégies
d'adaptation des effets nuisis de la dynamique des unités morphologiques
le long de l'ile de Diamniadio à Faoye. A la fois d'ordre traditionnelle
que moderne, les digues et les barrages anti-sel et antiérosif, le
paillage, la jachère et le reboisement de mangrove, constituent ces
politiques majores. Ces dernières sont animées par la population
paysanne, les ONG mais aussi par l'Etat. D'autres politiques telles que le
reboisement de plantes épineuses,la fermeture périodique de la
mer pour la reproduction des espèces marines et l'interdiction de la
déforestation non autorisée (un ticket de 1000f/autorisation) par
les eaux et forêts et l'installation de tuyaux d'eau potable par les
techniciens d'Etat.
Dans l'ensemble, la morpho-dynamique des unités
d'occupation du sol touche sévèrement la durabilité de
l'écologie, que la vie sociale mais aussi le
développementéconomique du milieu d'étude. Les impacts de
cette dynamique sont plus notables sur les ressources en eau, le sol et la
végétation en entrainant le plus souvent leur dégradation.
Ils sont encore très visibles sur les habitations et sur les
activités économiques menées par la population paysanne.
Néanmoins, cette dernière combinée aux ONG et à
l'Etat, ont développé un grand nombre de politiques d'adaptions
face à ce phénomène. Ces stratégies, aussi
nombreuses que déverses, sont entre autres la jachère, le
paillage, les digues et barrages anti-sel et antiérosif et les
reboisements de végétation. L'insuffisance de ces pratiques, leur
très courte durée d'efficacité, le manque de financement,
la faible intervention de l'Etat et le manque de la maitrise du
phénomène font que ces stratégies de lutte sont
très limitées.
4.6. Discussion des résultats
L'étude de la dynamique des
unités morphologiques de la ligne Diamniadio Faoye se voit comme une
problématiquetrès complexe dans ce cas où elle renferme un
certain nombre de problèmes, suscitant de nombreux questionnements
à savoir : qu'est-ce que la dynamique des unités
morphologiques, quel est son comportement dans le milieu, quels sont les
facteurs d'origines, quels sont ses impacts sur l'environnement, sur
l'économie et sur la vie sociale, quels sont les stratégies mises
en oeuvre face à cette dynamique, etc. Dès lors, nécessite
une approche méthodologique très efficace et adéquate pour
répondre à de telles questions.
L'analyse de la dynamique des unités morphologiques
dans le milieu nous a permis d'obtenir des résultats sur ses facteurs,
son évolution et ses impacts ainsi que les stratégies
d'adaptations.
Nos résultats ont montré que la dynamique des
unités morphologiques se manifeste par l'avancée de la surface
des cours d'eau, des terres cultivables et de la vasière nue et un recul
des tannes, de la vasière à mangrove et de la
végétation continentale. Ils sont confirmés par les
résultats de SOW. E. H (2019)lorsqu'il affirme que la dynamique des
unités morphologiques se voit par une évolution à tendance
négative pour la superficie de la mangrove, du foret galerie et de la
savane et une évolution à tendance positive des tannes, des sols
nus et de la culture pluviale, dans sa thèse intitulée
« Dynamique de l'écosystème mangrove de la
réserve de biosphère du Delta du Saloum (RBDS),
Sénégal, de 1965 à 2017 et analyse des politiques de
restauration ». Nos résultats infirment ceux de Guilgane FAYE
(2016) lorsqu'il soutient que l'évolution des unités se manifeste
par une augmentation de la superficie de la vasière à mangrove,
des tannes et des sols nus et une réduction de la surface des eaux de
surface permanentes. En effet, il note une hausse de 1,15% de la superficie de
la vasière à mangrove, une augmentation de 3,02% de celle des
tannes et une avancée de 14% de la surface occupée par les sols
nus entre 1980 et 2010 et une chute de - 17,92% de la savane arbustiveet de -
0,09% des eaux permanentes.
Nous avons montré que le facteur principal de
l'évolution des unités paysagères est la
variabilité pluviométrique. A cela s'ajoutent des facteurs
secondaires comme la faiblesse de la topographie, la dynamique de
l'érosion côtière (la rupture de la flèche de
Sangomar), la déforestation, les besoins de constructions et les
pratiques agricoles. Nos résultats sont donc soutenus par les travaux
deSAGNA. Mme T. A. A (2015) qui révèlent que facteurs
explicatifs de cette dynamique des unités sont notamment la
péjoration du climat, le déficit pluviométrique des
années 1968 aux années 1998, le relief qui est essentiellement
plat, l'évaporation relative élevée de 1983 à 2013,
les brames sèches, la dynamique des nappes et la marée. Par
contre, nos résultats infirment ceux de NDIONE. Omar (2016), qui
soutient que le facteur principal est la rupture de la flèche de
Sangomar.
Nous avons montré que l'évolution des
unités a des effets nuisibles dans le milieu en entrainant la
disparition des végétations, la dégradation des terres et
des ressources en eau mais aussi le recul du développement des secteurs
de l'agricole, de la pêche et de l'élevage et l'habitat. Ces
résultats sont confirmés par la quasi-totalité des
études antérieures. C'est le cas d'Omar NDIONE (2016)qui affirme
que l'évolution des unités a des impacts négatifs sur
l'environnement et sur les activités socio-économiques du milieu
tels que la salinisation des eaux et des terres et la réduction des
terres cultivables et de la végétation. Mais aussi de Bineta FAYE
(2017) lorsqu'il détruit que la dynamique progressive des terres
salées, au détriment des autres unités paysagères
du milieu, a trainé la réduction de la surface des terres
agricoles, de la végétation ainsi que la surface de la
mangrove.
Nos résultatsmontrent aussi que les stratégies
menées par la population, l'Etat et les ONG sont peut-être
nombreuses mais très insuffisantes et inefficaces. Ces résultats
confirment ceux de SOW. E. H (2019) lorsqu'il détruit que la dynamique
régressive de la mangrove, dans la réserve biosphère du
Delta du Saloum de 1965 à 2017, a occasionné des initiatives de
restauration qui sont malheureusement très limitées.
Nous avons obtenu des mesures bathymétriquesqui sont de
plus importantes vers l'intérieur du marigot de Faoye quittant
Diamniadio. Et cela est dû essentiellement à l'ensablement de la
rentrée des bolong et à l'inversion du pendage du Delta. Ces
résultats de mesures de plus en plus profondes de l'embouchure vers
l'amont confirment le caractère inversé de l'estuaire du Saloum
soutenu par BARUSSEAU et al (1986).
Nos résultatsbasant sur l'analyse
granulométrique révèlent que le milieu a unfacies à
dominante sableux de dimension moyen, modérément classé et
tendant vers les plus fins avec une distribution trèspointue. Et ceux
sur l'analyse des paramètres chimiques (pH et Ce), réduisent que
les eaux surfaciques ainsi que le sol du milieu sont
extrêmementsalées, trèsminéralisés et
légèrement alcalins et parfois alcalins. Les résultats des
analyses chimiques infirment ceux de Faye Bineta (2017) lorsqu'ils
révèlent que les tannes du milieu sont très acides. Par
contre, les résultats sur la texture des sédiments sont
confirmés par ses résultats lorsque Bineta déduit que les
tannes arbustivessont de texture limono sableuse et herbacés et limon
sablo-argileuse dans les tannes nues.Ces résultats nous ont
renseignés sur le mode d'érosion du milieu, la taille et les
proportions des particules, les types de sédiments et leur provenance,
le degré de salinité et d'acidité des unités, donc
la compréhension de l'état physique, chimique et
sédimentologique de notre milieu d'étude.
C'est pourquoi nous suggérons que l'analyse de ces
paramètressoitprise en compte dans des études comme la dynamique
actuelle des milieux humides, l'étude des ravins, de la dynamique
fluviatile, les inondations, etc.
Nous suggérons aussi de bien valoriser le suivi des
mesures de bathymétriques des cours d'eau et diachronique de la
dynamique des berges car renseignent sur le comportement actuel des estuaires
comme le caractère inversé du Saloum.
Cette étude permet alors de mieux maitriser la
dynamique des unités morphologiques afin de mener à bien
destratégies d'adaptation meilleures car le manque de la maitrise du
phénomène constitue d'après la population paysanne un gros
obstacle pour mener des stratégies très efficaces, plus
adéquates et durables. Et celles-là pour promouvoir une
écologie plus durable, une économie soutenue et une vie plus
prospère.
Conclusion
générale
En guise de conclusion, l'étude de la dynamique des
unités morphologiques dans le milieu humide côtières
constitue une problématique immense dans le domaine de la
géomorphologie dynamique. De ce, cette étude portant sur la
morpho-dynamique des unités d'occupation du sol le long de l'ile de
Diamniadio à Faoye nous a permis d'abord de localiser le milieu
d'étude mais aussi de voir son comportement après une longue
présentation dans le premier chapitre. Ce chapitre 1 décrit le
cadre physique et l'aspect humain du milieu. Ce travail nous a permis ensuite
d'énumérer l'état de la question, fondement
théorique et conceptuel dans le deuxième chapitre. Ce dernier
présente la synthèse bibliographique, la justification du choix
du sujet, la problématique ainsi que l'analyse conceptuelle. Enfin, de
détailler l'approche méthodologique dans le troisième
chapitre avant de dégager l'interprétation et la discussion des
résultats. Le chapitre 3 aborde l'apport de la bibliographie, la nature
des données complémentaires, les outils et techniques de mesures
in situ, les matériels et protocoles de collecte des données
socio-économiques, les analyses de laboratoire et enfin le traitement et
l'analyse des données recueillies. Le dernier chapitre renseigne sur
l'évolution des unités paysagères du milieu depuis 1970
à 2020, les facteurs d'origines, les impacts et les stratégies
d'adaptations préconisées.
En effet, tout d'abord la présentation monte que le
milieu repose sur des formations géologiques qui datent du Quaternaire
récent, notamment à l'Holocène. Elles sont
constituées par les formations deltaïques et par les formations
littorales. Sur le plan pédologique, les sols sont constitués par
les sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés, les sols halomorphes
salins acidifiés et sols hydromorphes organiques, les sols hydromorphes
gley salé et sols halomorphes salins hydromorphes et par les sols
halomorphes salins hydromorphes moyennement salés. C'est un milieu
à altitude très base (-4 à 11m) et dont le couvert
végétal est constitué de mangrove, de la savane
arborée et arbustive et de la prairie marécageuse. Le relief et
la végétation varient constamment selon les unités
morphologiques que sont les vasières, les tannes, les cordons sableux,
les amas coquilliers et les chenaux. Les eaux souterraines vont de la nappe du
Maestrichtien à la nappe phréatique, passant par les nappes du
Paléocène et Miocène. Les activités
socio-économiques du milieu sont très diversifiées. La
pêche reste l'activité la plus importante, suivie de
l'élevage et l'agriculture en troisième position. Le commerce et
le touriste se voient comme les activités les moins pratiquées et
les moins productives dans le milieu développement de ces
activés.
Ensuite, d'après les mesures physiques
effectuées dans le milieu, les résultats des mesures de piquets
effectuées montrent que la vasière de Diamniadio (en aval) gagne
7cm d'altitude chaque année, à la différence de Faoye (en
amont) où elle perd 4cm. Ce suivi est renforcé par le suivi
diachronique de la dynamique des berges qui révèle la même
tendance. Par contre, le bilan sédimentaire des berges est
déficitaire entre 1972 et 2020 avec un débit de - 2360 ha. Quant
aux mesures de bathymétriques, elles montent que la profondeur moyenne
du bolong de Faoye est égale à 9,78m. Elle augmente de l'aval
vers l'amont où sont enregistrées des profondeurs allant
jusqu'à 17,30m. Ces résultats de mesures obtenus sont
essentiellement liés à l'inversion du delta par l'intrusion
marine dans les fleuves et leurs affluents.
En outre, les analyses chimiques des sédiments et eau
du milieu montrent que les eaux surfaciques et les sols du milieu sont
essentiellement extrêmement salés, très
minéralisés et légèrement alcalins à
alcalins. Le pH augmente de l'amont vers l'aval du marigot de Faoye, du chenal
vers le cordon sableux suivant le gradient horizontal mais aussi de la surface
vers la profondeur, surtout à Diamniadio. Ces paramètres sont
plus extrêmes à Diamniadio qu'à Faoye et durant la saison
sèche que pendant la saison pluvieuse.
Plus loin, les analyses granulométriques
effectuées montrent que les sédiments rencontrés dans les
unités morphologiques de notre milieu d'étude sont
essentiellement de sables (99,9 %). Le sable moyen, le plus fréquent,
représente les 70,5 % de l'ensemble des échantillons
prélevés dans le milieu. Le sable fin se voit avec les 26,6 %.
Les limons ne font que 0,1 % des sédiments. Ce qui fait que le milieu a
un facies sableux modérément classé, dont le Mz est le
sable moyen mais tendant vers les particules plus fines avec une distribution
essentiellement pointue. Ces sédiments proviennent des bancs sableux et
de la flèche de Sangomar dont les plus fins sont entrainés et
déposés au fond des chenaux.
Pour ce qui concerne l'analyse des unités morphologique
allant de la période 1972 à 2020, elle monte une évolution
progressive des unités de cours d'eau, vasière nue et des terres
cultivables et un recul de la vasière à mangrove, des tannes et
de la végétation continentale. En effet, les cours d'eau et la
vasière nue ont connu des taux de croissance de 71,95 et de 136,29%
respective entre 1972 et 2020. Les terres cultivables se voit avec un taux de
4,63% durant cette période, tandis que les végétations et
les tannes, leur taux de croissance est négatif. Moins 17,82% pour les
tannes, -74,43% pour la vasière à mangrove et -34,94% pour la
végétation continentale. Toutefois, les tannes restent
très importantes et occupent la deuxième place derrière
les cours d'eau en 2020. Cette dynamique actuelle, marquée par
l'extension des cours d'eau, de la vasière nue et des terres de culture,
est engendrée par de nombreux facteurs aussi bien d'ordre naturel que de
l'oeuvre anthropique. Le déficit pluviométrique, que la rupture
de la flèche de Sangomar, la faiblesse de la topographie, la
déforestation, les besoins de construction, l'exploitation du sel ainsi
que les pratiques agricoles en sont les plus remarquables.
Enfin, l'analyse des impacts de la dynamique des unités
et des stratégies d'adaptation montre d'une part que cette
évolution a généralement des effets nuisibles sur
l'écologie, l'économie et sur la vie sociale du milieu
d'étude. Ils se traduisent non seulement par la dégradation des
terres, que la salinisation extrême des ressources en eau, la
mortalité de la mangrove ainsi que la régression de la
végétation continentale mais aussi par le freine du secteur
agricole, l'élevage et le secteur de la pêche ainsi que l'habitat.
Et c'est ce qui a poussé la plupart de la population paysanne
d'apprécier la dynamique des unités de paysages comme
étant très grave dans le milieu. D'autre part, cette analyse
révèle que même si face à une telle situation des
stratégies telles que les digues et les barrages anti-sel et
antiérosif, le paillage, la jachère et le reboisement de
mangrove, entre autres sont préconisées par cette population,
l'Etat et les ONG, ces efforts restent très limités face à
l'ampleur de la dynamique des unités morphologiques.
Pour d'éventuelles perspectives concernant les
recherches post-mémoire, il nous est intéressant d'étudier
si l'évolution des unités morphologiques de la ligne
Diamniadio-Faoye reste pareil sur toute la partie Nord-Est de l'estuaire du
Saloum ; Etudier aussi la relation entre les variations climatiques
récentes et la dynamique des terres salées dans l'ensemble de la
région Nord-Est du Saloum ; et enfin s'intéresser sur
l'évolution des écosystèmes côtière dans le
contexte de perturbation des paramètres climatiques et des conditions
hydrodynamiques dans la partie Nord-Est de l'estuaire du Saloum.
Liste des références
Monod Théodore, 1973, La dégradation du monde
vivant : flore et faune, in Désertification au sud du Sahara.
Colloque de Nouakchott : 17 - 19 Décembre. Nouvelles
éditions africaines, Dakar, Abidjan, pp 91-102.
MICHEL Pierre, 1973, Les bassins des fleuves
Sénégal et Gambie : étude géomorphologique,
Mémoire ORSTOM n°63, Tome 1, ORSTOM, Paris, 810 pages.
STANCOFF Andrew et al, 1985, Projet de cartographie et de
télédétection des ressources de la république du
Sénégal : Etude de la géologie, de l'hydrologie, des
sols, de la végétation et des potentiels d'utilisation des sols,
république du Sénégal, 674 pages.
Thiam Mame Demba, 1986, Géomorphologie,
évolution et sédimentologie des terrains sales du sine Saloum
(Sénégal), thèse de doctorat, université de Paris
I, 189 pages.
Le BORGNE Jean 1987, La pluviométrie au
Sénégal et en Gambie, livre, Laboratoire de climatologie,
Géographie, UCAD, 96 pages.
SAGNA Pascal, 1988, Etude des lignes de grains en Afrique de
l'Ouest, Tome 1, thèse de 3e cycle, UCAD, 295 pages.
Brunet Roger, et al, 1992, Les mots de la géographie,
dictionnaire critique. Montpellier/Paris/Reclus/La Documentation
Française, 470 p. (ISBN 2-11-002852-1).
DIAW Amadou Tahirou et al. 1992, Gestion des ressources
côtières et littorales du Sénégal : actes de
l'atelier de Gorée, IUCN, 502 pages.
Goma Ndama, 1993, initiation
à la recherche Scientifique, notes de cours inédites, UPC,
Kinshasa.
DIARA Marlin, 1999, Formation et évolution
fini-holocène et dynamique actuelle du Delta Saloum-Gambie
(Sénégal-Afrique de l'Ouest), thèse de doctorat,
université de Perpigna, 161 pages.
BOCOUM M. 2004, Méthodes d'analyses des sols, Doc de
travail, Institut National de Pédologie, Dakar - Sénégal,
55 pages.
UICN Sénégal, 2003, Elaboration et mise en
oeuvre d'un plan de gestion intégrée La Réserve de
biosphère du delta du Saloum, Gland, Suisse et Cambridge, Royaume-Uni.
Xiv + ,130 pages.
RAMADE François, 2008, Dictionnaire
encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité,
Dunod, Paris, 737 pages.
DIAGNE Seynabou, 2012, Impacts de la dynamique des
unités morphologiques dans les iles du Gandoul (Niodior, Dionewar et
Falia) :(Saloum du Sénégal), mémoire, Ucad, Dakar, 97
pages.
DIATTA Seynabou, 2012, Dynamique des unités
morphologiques de Betanti à la frontière de la Gambie,
mémoire, Ucad, Dakar, 102 pages.
DIOP Seynabou Thioye, 2012, Dynamique de l'occupation du sol
dans la région de Dakar de 1954 à 2009 par approche SIG : Exemple
de la communauté d'arrondissement de Medina, mémoire, Ucad,
Dakar, 66 pages.
FOVET-RABOT C, 2012, Rédiger les sections discussion et
conclusion de l'article scientifique, en 7 point, Montpellier (FRA) :
CIRAD, 4 pages.
NIANE Koumah, 2012, Dynamique des unités morphologiques
le long du Sine des années 1960 aux années 2010 : Cas de la
communauté rurale de Mbellacadio (région de Fatick),
mémoire, Ucad, Dakar, 106 pages.
ADJIBODOU Adémonla Gratien, 2013, La
problématique genre et profession : cas de l'université
d'Abomey-Calavi (UAC), mémoire de maitrise en psychologie, FLAHS/UAC, 87
pages.
DIEYE El Hadji Balla et al, 2013, « Dynamique
de la mangrove de l'estuaire du Saloum (Sénégal) »,
article, in Cybergeo : European Journal of Geography, 22 pages.
DIOUF Fatou, 2013, Dynamique des unités morphologiques
dans l'ile de Fayako, mémoire, Ucad, 103 pages.
BADJI Bineta, 2014, Dynamique des unités morphologiques
des iles Karones et Bliss de 1980 à 2010, mémoire, Ucad, Dakar,
101 pages.
DIONE Khadim, 2014, Impact de la dynamique des unités
morphologiques dans l'aire marine protégée de Bamboung (Iles du
Saloum/Sénégal), mémoire, Ucad, 93 pages.
GOUSSOT Emmanuelle, 2014, « Dynamique de l'occupation du
sol et statistique agricoles sur le bassin versant du Bouregreg au Maroc
», article, in European Journal of Scientific Research,ISSN 1450-216X /
1450-202X Vol. 126 No 2, 15 pages.
NDAW Fatma, 2014, Dynamique des unités morphologiques
dans les iles de Mar (Saloum-Sénégal), mémoire, Ucad, 84
pages.
DIONE Maguette, 2015, Dynamique des unités
morphologiques dans la commune de Diembering de 1980 à 2010,
mémoire, Ucad, 118 pages.
DIOP Soda, 2015, Dynamique des unités morphologiques
dans l'arrière-pays du Sud-Ouest de Sokone et ses impacts des
années 1980 aux années 2010, mémoire, Ucad, 105 pages.
DIOUF Fatou, 2015, Dynamique des unités
morphologiques le long du bolong de Guilor-Bagal dans l'estuaire du Saloum
(Sénégal), mémoire, Ucad, 109 pages.
FAYE Prospert, 2015, Etude comparative de la dynamique des
unités géomorphologiques dans les iles du Saloum et de la
Casamance : Cas de Bassoul/Bassar et Niomoune (région de Fatick et
de Ziguinchor), mémoire, Ucad, 124 pages.
SAGNA Mme THIARE Aïda Aïssatou, 2015, La
dynamique des unités morphologique le long de la Casamance : de
Ziguinchor à Adéane (1980-2014), mémoire, Ucad, 102
pages.
DJOHY Gildas Luis et al, 2016, « dynamique de
l'occupation du sol et évolution des terres agricoles dans la commune de
Sinende au nord-bénin », article, cahiers du CBRST, centre
béninois de la recherche scientifique et technique, ffhal-01567316ff, 22
pages.
FAYE Guilgane, 2016, Impacts des modifications récentes
des conditions climatiques et océanographiques dans l'estuaire du Saloum
et ses régions de bordures (Sénégal), thèse de
doctorat, Ucad, 598 pages.
Jabbar Marie, 2016, Dynamiques morpho-sédimentaires des
avant-plages et impact sur les stocks sableux : vers une meilleure
stratégie de gestion des risques côtiers, thèse de
doctorat, Géographie. Université de Bretagne occidentale - Brest,
349 pages.
NDIONE Omar, 2016, Dynamique des unités morphologiques
le long du Saloum de Palmarin-Diakhanor à Ndangane de 1960 aux
années 2010, mémoire, Ucad, 83 pages.
TOURE Mame Aïssatou et al, 2016, « Dynamics,
Analysas and Factors in Landscape Units `Evolution in Sénégal
River Delta Ecosystems », article, publié dans le Journal of
Geographic, Environment and Earth Sciences, volume7, Issue1, 12 pages.
FAYE Bineta, 2017, Dynamique de la salinisation des
terres de 1971 à 2010 et variation climatique le Nord de l'estuaire du
Saloum (Sénégal), thèse de doctorat, Ucad, 354 pages.
SY Mamadou, 2017, Dynamique des unités de paysages
entre le marigot de Tabor et al bouche de Soungroungrou des années 1980
à 2010, mémoire, Ucad, 121 pages.
AGBANAU Bidossessi Thierry, 2018, Dynamique de
l'occupation du sol dans le secteur Natitingou-Boukombé (nord-ouest
Benin) : De l'analyse diachronique à une modélisation
prospective, thèse de doctorat, université de Toulouse le
Mirail-Toulouse II et Université nationale du Bénin, 271
pages.
GAYE Mar, 2018, Evolution morpho-sédimentaire des
plages de la langue de Barbarie sur l'axe Goxxumbacc-Guet-Ndar, mémoire,
Ucad, 149 pages.
KANE Modou, 2018, Dynamique des unités de paysages le
long du marigot de Baila des années 1980 aux années 2010,
mémoire, Ucad, 107 pages.
SY Amadou, 2018, Dynamique morpho-sédimentaire de l'ile
Doune Baba Dieye de 1971 aux années 2010, mémoire, Ucad, 153
pages.
TOURE Mame Aïssatou, 2018, Variation climatique et
dynamique des écosystèmes du delta du fleuve
Sénégal des années 1950 aux années 2010,
thèse de doctorat, Ucad, 483 pages.
SOW El Hadji, 2019, Dynamique de l'écosystème
mangrove de la réserve de biosphère du Delta du Saloum (RBDS),
Sénégal, de 1965 à 2017 et analyse des politiques de
restauration, thèse de doctorat, UGB, 245 pages.
KALIKA Michel et al, 2021, La discussion et la conclusion, in
Le mémoire de Master, pages 127 à 132, mise en ligne sur
Cairn.info le 09/06/2022.
JAILLET Alain et MABILON-BONFILS Béatrice, 2021,
Chapitre 3 : Présenter et discuter ses résultats, in Je
réussis mon mémoire de Master MEEF, pages 119 à 120,
mise en ligne sur Cairn.info le 06/02/2023.
Webographie
Https://
www.bibnum.ucad.sn
Https://
www.memoireonline.com
Https://
www.physicalgeography.net
Https://
www.theses.hal.science
Https://
www.tel.archives-ouvertes.fr
Https://
www.bu.univ-perp.fr
Https://coop-ist.cirad.fr
Https://
www.scrib.fr
Https://www.cairn.info
Annexes
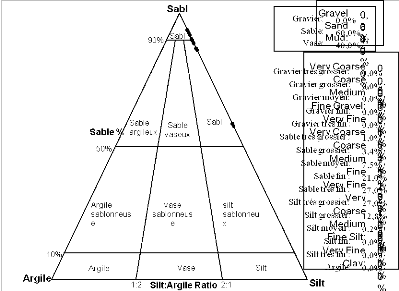
Figure
40 : Distribution des sédiments dans les unités
morphologiques de Diamniadio
* 1 n = taille de
l'échantillon
N = taille de l'univers investigué
I = largeur de fourchette exprimant la marge d'erreur (ici
10%)
|
|



