REPUBLIQUE DU SENEGAL
UnPeuple-
UneFoi
UnBut-

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
(MFP)
DIRECTION DES EXAMENS, CONCOURS PROFESSIONNELS
ET CERTIFICATIONS (DEFCPC)
INSTITUT SUPERIEUR D'INGENIERIE TERRITORIALE EN AFRIQUE

Siège : Sicap Sacré Coeur 3, Dakar
(Sénégal)
Tel : +221771169165
Email :
Isitafrique@gmail.com
PROJET INTEGRATEUR SOUMIS EN VUE L'OBTENTION DU BREVET DE
TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS)
THEME :
UTILISATION DES OUTILS DE LA GEOMATIQUE SUR L'ETUDE DE LA
DYNAMIQUE DES TERRES SALEES DANS LA COMMUNE DE GANDON DES ANNEES 1970 A 2024
OPTION : GEOMATIQUE
Présenté par : Sous la direction de :
Serigne Aziz DIOUFM. Amadou MBAYE
M. Babacar FALL
Année Académique 2024-2025
Sommaire
Sommaire
I
Avant-propos
II
Remerciements
II
Dédicaces
III
Liste des abréviations
IV
Liste des illustrations
V
Introduction
1
Chapitre 1 : Fondement théorique et
conceptuel
2
1.1. Problématique
2
1.2. Analyse des concepts
4
Chapitre 2 : Présentation du milieu
d'étude
7
2.1. Le cadre physique
8
2.2. Le cadre humain
12
Chapitre 3 : Approche
méthodologique
15
3.1. La revue documentaire
15
3.2. Acquisition de données
complémentaires
15
3.3. Recueil et acquisition de
données satellitaires
16
3.4. Traitement et analyses des
données recueillies
20
Chapitre 4 : Analyse et interprétation
des résultats
40
4.1. Variation du degré de
salinité des sols
40
4.2. Evolution spatio-temporelle des
unités d'occupation du sol
42
4.3. Approche géomatique de l'analyse
de la dynamique des terres salées
45
4.4. Approche géomatique de la
caractérisation des zones vulnérables aux terres salines
51
Conclusion
55
Bibliographie
57
Table des matières
58
« Une nation qui détruit ses sols, se
détruit elle-même » (Franklin D. Roosevelt, 1937)
Avant-propos
Ce document est un projet d'intégrateur soumis en vue
l'obtention du brevet de technicien supérieurportant sur l'utilisation
des outils de la géomatique sur l'étude de la dynamique des
terres salées dans la Commune de Gandon des années 1970 à
2024.En effet, la Commune de Gandon à l'instar des milieux du domaine
littoral, se voit par une dégradation très significative des
terres arables liée essentiellement à la salinisation. Cette
dernière originaire naturellement de l'élévation du niveau
de la Mer, accentuée dans un contexte de changement climatique
marqué par des sécheresses comme celle des années 1970.
Cette longue périodesèche, favorisant le manqued'apports
fluvio-pluviométriques, le tarissement de la nappe et l'avancée
du biseau salée, augmente le niveau salinité et l'extension des
tannes sur les terres agricoles dans le delta du fleuve Sénégal
et dans le Commune de Gandon en particulier.Cette dégradation chimique
rend le sol infertile et impropre à agro-sylvo-pastoral affectant ainsi
l'écologie et la vie socio-économique de la population
riveraine.Ainsi, minutieux de l'équilibre écologique, du
développement durable et du bien-être de la société,
cette contribution essaye d'analyser la dynamique des terres salées et
la vulnérabilité de la population grâce aux outils de la
géomatique pour une gestion meilleure et durable de l'extension des
terres salées.
Pour effectuer un tel travail, nous allons débutons par
une présentation du cadre physique ethumain du milieu d'étude.
Nous allons ensuite détailler l'approche méthodologique
adoptée avant de voir l'analyse, l'interprétation des
résultats issues des données traitées.
Ce travail n'aurait pas pu s'effectuer rigoureusement et
sereinement sans de nombreuses collaborations et d'échanges
précieux effectués avec de plusieurs structures et de personnes
à qui nous voulons exprimer toute notre profonde gratitude.
Remerciements
Il revient tout d'abord de remercier vivement M. Cheikh Diouf,
Directeur général de l'institut Isit/Afrique pour tout son
accompagnement le long de ce parcours de BTS géomatique.
Nos profonds remerciements s'adressent aussi à nos
très généreux encadreurs messieurs Amadou Mbaye et Babacar
Fall de leur soutien, leur disponibilité et de la qualité de
leurs orientations.
Nos reconnaissances à l'ensemble des enseignants de
l'établissement à l'image de messieurs Khole, Niang pour le
rôle unique et précieux qu'ils ont eu à jouer pour la
réussite de ce projet.
Nous remercions l'ensemble du personnel de l'institut
supérieur d'ingénierie territoriale de l'Afrique pour toute leur
dévouement, leur accompagnement et leur excellence.
Notre reconnaissance s'adresse à mes camarades de la
deuxième année de BTS géomatique : Saye Ndiaye, Aliou
Sané,Aminata Ba, ainsi qu'à toute notre promotion.
Toute notre profonde reconnaissance, notre gratitude à
notre très chère maman Ndoumbé Ndiaye et à toute
notre famille pour leur dévouement envers nous, que Dieu vous
protège.
Dédicaces
Nous rendons grâce à Allah le Tout Puissant, le
Tout Clément, l'Unique et l'Eternel
A Cheikh Ahmadou Bamba notre guide.
Nous dédions ce travail :
A notre frère-jumeau Abdou Diouf et notre
grand-mère Dieynaba Ngom
A notre chère mère Nogoye Thiaw et notre maman
Rokya Sène
A notre père Daouda Diouf
A notre grand-mère Penda Diop et notre ami Mbaye Fall
A notre très maman Ndoumbé Ndiaye ainsi que toute
la famille
Sachant que nulle dédicace ne puisse exprimer nos
sentiments, pour leur amour et leur soutien.
A tous nos frères et toutes nos soeurs : Papa
Diouf, Adama Diouf, Fatou Diouf, Mame Diarra Diouf, Ibrahima Diouf,
Déguene Diouf, etc.
A nos beaux pères et nos belles mères pour
l'amour, l'éducation et le soutien qu'ils nous ont accordés.
A nos très chers Awa Fall, Mar Gaye, Rokhaya Sagna
A nos tantes et oncles, à tous nos cousins et toutes nos
cousines pour leur amour et leur confiance envers nous.
A toute notre famille et tous nos proches
En leur souhaitant une très longue et merveilleuse
vie.
Liste des abréviations
ANACIM : Agence National de l'Aviation
Civile Internationale et de la Météorologie
ANAT : Agence Nationale de
l'Aménagement du Territoire
ANSD : Agence National de la Statistique et
de la Démographie
CE : Conductivité Electrique
CSE : Centre de Suivi Ecologique
FAO : Organisation du Font Alimentaire
GPS : Système de Positionnement
Géographique
IPS : Indice de Précipitations
standardisé
ISRIC : Centre International de
Référence et d'Information sur les Sols
MCD : Model Conceptuel de Données
MLD : Model Logique de Données
MPD : Model Physique de Données
MNT : Model Numérique de Terrain
NDSI : Normalized Differencial Salinity
index / Indice différentiel de salinité
normalisé
ONG : Organisation Non Gouvernementale
pH : Potentiel Hydrogène
SIG : Système d'Informations
Géographique
SGBD : Système de Gestion de Base de
Données
UCAD : Université Cheikh Anta Diop
de Dakar
Liste des illustrations
Carte
Carte 1: Situation du
milieu d'étude
2
Carte 2: typologie des formations
pédologiques du milieu
9
Carte 3: occupation du sol du milieu
d'étude
10
Carte 4: Répartition de la population de la
Commune Gandon en 2023
13
Carte 5 : Densité de la population du
milieu d'étude
13
Carte 6 : Distribution horizontale de la
salinité des sols (NDSI
41
Carte 7 : Cinématique de terres salines
entre 1972 et 2024
48
Carte 8 : Distribution spatiale des
catégories de tannes dans le milieu entre 1972 et 2024
49
Carte 9 : Répartition spatiale des
localités selon le degré d'exposition aux terres salines
52
Carte 10 : Degré de
vulnérabilité des zones selon la méthode AHP
53
Figure
Figure 1 : Courbe ombrothermique mensuelle de
la station de Saint-Louis de 1991 à 2022
2
Figure 2 : Courbe ombrothermique annuelle de la
station de Saint-Louis de 1991 à 2022
12
Figure 3 : évolution de la population de la
Commune Gandon de 2013 à 2023
12
Figure 4 : Procédures de
téléchargement des images Landsat
17
Figure 5 : Méthode Merise (Source :
http://tecfaetu.unige.ch/)
21
Figure 6 : Schéma d'un MCD
21
Figure 7 : Modèle conceptuel de
données
22
Figure 8 : Modèle logique de
données
23
Figure 9 : Modèle physique de
données
23
Figure 10 : Organigramme de l'étude de
la dynamique des terres salées, Diouf S. Aziz, Juin 2025
26
Figure 11 : Procédures de la
combinaison des Bandes
27
Figure 12 : A et B : Procédures
d'ajout de la métadonnée (image regroupée)
28
Figure 13 : C, D et E : Procédures
d'ajout de la limite du milieu d'étude
29
Figure 14 : F et G : Procédures de
découpage de l'image dans notre milieu d'étude ; H :
l'Extraction
30
Figure 15 : Classe thématique et Pixel
correspondant
32
Figure 16 : Méthode de la
classification supervisée
33
Figure 17 : Valeurs de l'Indice de Kappa et
Matrice de confusion de Landsat 8
34
Figure 18 : Traitement par AHP dans Arcgis
38
Figure 19 : Schéma
méthodologique
39
Figure 20 : Degré de salinité
des terres du milieu d'étude en hectare (ha), Diouf S. Aziz, Juin
2025
40
Figure 21 : Superficie (%) de la
conductivité électriques des sols selon les horizons
41
Figure 22 : Superficie en hectare (ha) des
unités paysagères entre 1972 et 2024, Diouf S. Aziz2025
43
Figure 23 : Transformation des unités
d'occupation du sol de 1972 à 2024, Diouf S. Aziz, Juin 2025
44
Figure 24 : Indice de Précipitations
Normalisé (IPS) de la station de Saint-Louis de 1971 à 2020
45
Figure 25 : Répartition de la surface en %
de la texture des sols selon les horizons
46
Figure 26 : Superficie des terres
salées en pourcentage (%) entre 1972 et 2024
47
Figure 27 : Superficie des catégories
de terres salées en pourcentage de 1972 à 2024
49
Figure 28 : Catastrophes susceptibles
d'être entrainées par la dynamique saline
50
Figure 29 : Répartition de la Population
selon le niveau de vulnérabilité à la dynamique saline
52
Figure 30 : Model de gestion des terres
salées par approche géomatique
54
Planche cartographique
Planche cartographique 1 : Caractéristiques
topographiques du milieu
2
Planche cartographique 1 : Caractéristiques
topographiques du milieu
2
Planche cartographique 2: Bassin versant et
densité de drainage
9
Planche cartographique 3 : Distribution
verticale de la conductivité électrique (CE) des sols
45
Planche cartographique 5 : Situation des
unités d'occupation du sol entre 1972 e 2024
47
Planche cartographique 6 : Distribution
verticale de la texture des sols
50
Tableau
Tableau 1: Les types de données
complémentaires utilisées
2
Tableau 2: Données d'imagerie satellitaire
utilisées
20
Tableau 3 : Caractéristique des bandes
spectrales du capteur MSS (Faye B., 2017
20
Tableau 4 : Caractéristique des bandes
spectrales du capteur TM (Faye B., 2017)
21
Tableau 5 : Caractères des bandes de
Landsat-8/LDCM (Landsat Data Continuity Mission)
21
Tableau 6 : Classes degrés de la
sécheresse par rapport à la valeur du IPS (McKee et al.,
1993)
26
Tableau 7 : Appréciation de la
salinité du sol selon la conductivité électrique selon la
FAO
27
Tableau 9 : Grille d'identification et
d'interprétation des principaux types d'unités
33
Tableau 10 : Les classes thématiques
retenues pour l'étude
34
Tableau 11 : Classification de la population selon
le degré d'exposition aux terres salines
38
Tableau 12 : Echelle de pondération des
couches
39
Tableau 13 : Matrice de pondération des
facteurs selon l'échelle de Saaty (1977)
39
Tableau 14: Calcul du poids relatifs aux
différents facteurs après comparaison deux à deux.
40
Tableau 15 : Superficie (ha) et (%) des
unités d'occupation du sol entre 1972 et 2024
46
Tableau 18 : Superficie en hectare (ha) des terres
salines entre 1972 et 2024
51
Tableau 19 : Classification des
localités selon le degré d'exposition aux terres
salées
55
Introduction
Le sol constituel'une des composantes essentielles des
ressources terrestres. Il assure le bon fonctionnement de la
biodiversité et le développement de la vie
socio-économique. Cependant, cette ressource naturelle très
précieuse est de plus en plus vulnérable face aux
phénomènes climatiques extrêmes et aux conditions
océanographiques récentes liés à la
salinisation.D'un milliard d'hectare dans le monde (FOA, 2015), prés 1
000 000 ha au Sénégal et 30000 ha entre le delta et la moyenne
valléedu fleuve Sénégal (CSE, 2010), la salinisation des
terres se voit comme un défis majeur pour l'équilibre
écologique et la sécurité alimentaire dans le delta du
fleuve Sénégal en particulier. En effet, cette salinisation
significative des terres a entrainé un bouleversement de
l'écosystème et du système de production dans les
régions du Delta.Cela se manifeste notamment par la dégradation
de la végétation, des ressources hydrique et des terres arables
entrainant ainsi une toxicité pour les cultures, une diminution des
rendements, une disparition du couvert végétal et une
contamination des ressources hydriques. Et ceux-ci constituent un frein au
développement économique et à la promotion de la vie
sociale communautés en aval du fleuveétant donné que les
stratégies de gestion souvent mises en place sont très
limitées (Sow E. H., 2019). C'est dans cet intérêt que nous
étudions la dynamique des terres salées dans la Commune de Gandon
des années 1970 à 2024 grâce aux outils de le
géomatique. L'objet de ce travail est donc d'analyser la dynamique des
terres salines, ses facteurs, ses impacts environnementaux et
socio-économiques et de caractériser les populations
vulnérables en utilisant les composants de la géomatique afin de
permettre aux décideurs une maitrise et une gestion meilleures du
phénomène.De ce fait, plusieurs méthodes de collecte, de
traitement (cartographique et statistique) et d'analyse de données
(quantitative et qualitative) sont adoptées afin de mieux
appréhender la dynamique des terres salées dans la Commune de
Gandon.
Pour mener à bien notre travail, nous allons d'une part
voirl'état de laquestion, fondement théorique et conceptuel du
thème. En outre, présenter les aspects physique et humain du
milieu d'étude. D'autre part, détailler
l'approcheméthodologique adoptée pour établir ce travail
avant de voir enfin l'analyse, l'interprétation et la
discussion des résultatsobtenus.
Chapitre 1 : Fondement
théorique et conceptuel
Il s'agit dans ce chapitre l'énumération de la
problématique, les questions, objectifs et hypothèses de
recherche et l'analyse des concepts clés du thème de recherche
1.1. Problématique
1.1.1. Contexte
Le sol, constitut une source vitale et indispensable pour les
êtres vivants. Il est le fondement de la durabilité de
l'écologie, de la production agricole et sylvicole et de la
sécurité alimentaire. Les sols constituent alors une composante
essentielle des ressources terrestres et assurent quasiment le bon
fonctionnement de la biodiversité et le développement de la vie
socio-économique. Cependant, cette ressource naturelle très
précieuse est de plus en plus vulnérable face aux changements
climatiques extrêmes et aux conditions océanographiques
récentes.
Actuellement, plus de 33 % de ces terres sont
modérément à extrêmement dégradées du
fait de l'érosion, du compactage, de la pollution chimique, de
l'acidification et de la salinisation selon le FAO (2015). Cette
dernière constitut l'une des plus grandes menaces des terres arables.
Elle se manifeste par la concentration des particules de sels dans le sol.
D'après les estimations de la FAO, plus d'un milliard d'hectare de
terres est touché par la salinisation soit 8,5 % des superficies
arables, équivaux à une perte économique mondiale de 21,3
milliards chaque année.
Au Sénégal, la situation actuelle de la
salinisation est très alarmante selon les appréciations faites
par le Centre de Suivi Ecologique (CSE, 2010). Il estime la superficie des
terres salées à près de 1 000 000 ha. Prés 58000 ha
sur la grande côte, 230 000 ha dans le Sine-Saloum, 400000 ha dans bassin
du fleuve Casamance et 400000 ha de terres salées au niveau du fleuve
Sénégal où 30000 ha entre le delta et la moyenne
vallée. Comment se manifeste la dynamique des terres
salées ?
Cette extension significative des terres salées est
liée essentiellement à la péjoration climatique
récente et à la dynamique marine. En effet, la sécheresse
des années 1970 a entrainé, dans ces milieux humides, une
diminution des apports d'eau douce. Cela a favorisé une baisse du niveau
des fleuve et une remontée des eaux marines sur ces cours d'eau et les
terres, notamment dans la région du delta du Sénégal.
Cette fréquence de sécheresses contribue à
l'accélération du phénomène de la salinisation des
sols à travers une insuffisance du drainage des eaux pluviales pour
lessiver le sel mais aussi de l'évaporation liée à la
rudesse des températures engendrant une précipitation des sels
Gaye M. et al. (2024). En plus, la dynamique des vents, les mauvaises pratiques
d'irrigations, la texture limoneuse des sols constituent aussi un ensemble de
facteurs qui accélèrent l'avancée de la salinisation sur
les terres dans le milieu. Quels sont les facteurs récurrents de
l'avancée des terres salées ?
Cette avancée remarquable a entrainé un
bouleversement de l'écosystème marin et du système de
productionqui se manifeste notamment par la dégradation de la
végétation, des ressources hydrique et des terres arables (FAYE
C.A.T. et al., 2023). Elle provoque ainsi une toxicité pour les
cultures, une diminution des rendements, une disparition des plantes non
halophytes et du tapis herbacé, un affaiblissement de l'élevage
mais aussi une nocivité de la promotion de la vie sociale dans la
Commune. Et ceux-ci constituent un frein au développement
économique et fragilisent la communauté des régions du
delta du fleuve Sénégal et de la Commune de Gandon en particulier
étant donné que l'agriculture au sens large constitue
l'activité principale source de revenus de cette communauté.
Quels sont les impacts liés à l'extension des terres
salées dans le milieu ?
Par contre, plusieurs tentatives de conservation des
ressources marines et de pratiques de récupération des terres
arables ont été mises en oeuvre à la fois par la
population et les institutions. Ainsi, des pratiques de reboisement, de
sensibilisation et de construction de digue et de barrage, ... sont
adoptées par la population locale, les ONG ainsi que l'Etat. Cependant,
ces initiatives de restauration sont malheureusement très
limitées (SOW E. H, 2019). Face à ces destructions, est-il
possible de restaurer les terres arables prises par le sel ?
L'utilisation des outils de la géomatique constitut un
moyen fondamental pour le suivi de la dynamique des tannes et
l'appréciation de son comportement actuel ainsi que ses effets sur la
vie écologique et socio-économique. Un outil d'identification des
populations vulnérables et celles en risques afin d'assurer une
orientation décisionnelle d'une bonne gestion des terres salines. La
géomatique constitue dès l'or un domaine nécessaire et
très essentiel pour la bonne maitrise de l'évolution des terres
salées afin de promouvoir à une gestion meilleure et la
conservation de cette ressource vitale. Quel apport géomatique de la
gestion de l'extension des terres salées ?
1.1.2. Objectifs et
hypothèses de recherche
? Objectifs de recherche
Pour étudier la dynamique des terres salées, les
objectifs général et spécifique suivant
sontfixés.
Ø Objectif général
Ce travail vise à comprendre la dynamique des terres
salées dans le Commune de Gandon et la vulnérabilité de la
population par approche de la géomatique. Il s'agit alors :
Ø Objectifs spécifiques
Os1 : Analyser les changements spatio-temporels des
terres saléesdans le milieu d'étude
Os2 : Caractériser les facteurs et les
catastrophes susceptibles d'être entrainées par la dynamique
Os3 : Evaluer le degré de
vulnérabilité de la population à la dynamique des terres
salines
? Hypothèses de recherche
Pour atteindre ces objectifs, les hypothèses suivantes
sont énumérées.
Ø Hypothèse principale
La dynamique des terres saléesa une tendance extensive
dans le Commune de Gandon et cela affecte négativement la
biodiversité et les activités sociales et économiques du
milieu. Cette hypothèse principale peut s'avérer à travers
les hypothèses secondaires suivantes :
Ø Hypothèses secondaires
Hypothèse secondaire 1 : La dynamique des terres
salées se manifeste par l'extension des tannes sur l'agrosystème
dans la Commune de Gandon.
Hypothèse secondaire 2 : Cette extension est
liée à la variabilité pluviométrique et cela
freineconsidérablement le système agro-sylvicoledu milieu
d'étude.
Hypothèse secondaire 3 : L'essentiel de la
population paysanne est extrêmement affecté par l'extension des
terres salines.
1.2. Analyse des concepts
Il s'agit de la définition des concepts mots
clés en rapport avec notre thèmes. Nous pouvons noter :
Ecologie : L'écologie, au sens
premier du terme, est une science dont l'objet est l'étude des
interactions des êtres vivants (la biodiversité) avec leur
environnement et entre eux au sein de cet environnement (l'ensemble
étant désigné par le terme écologie »).
Il permet alors de mieux comprendre comment les êtres vivants vivent et
interagissent au sein d'un milieu.
Sol : Pour JOFFE, «
le sol est un corps naturel, de constituants organiques et
minéraux, différencié en horizons d'épaisseur
variable, qui diffèrent du matériau sous-jacent par leur
morphologie, constitution physique, propriétés chimiques et
composition des caractères biologiques ».
Dynamique : La dynamique est un ensemble
de processus d'évolution, que les facteurs d'origines ainsi que le
résultat de cette évolution d'état naturel d'un
phénomène ou d'un milieu donné entre deux ou plusieurs
dates selon Diouf S. A. (2023).
Salinisation : Selon Lozet J. et Mathieu
C. (2002) la salinisation est l'ensemble des mécanismes suivant lesquels
le sol s'enrichit en sels solubles et acquiert, à un degré plus
ou moins fort, le caractère salé. La salinisation se
réalise principalement dans les régions semi-arides et dans les
milieux côtiers ou déprimés dans lesquels la teneur en
argile est assez élevée et la perméabilité faible,
ce qui réduit le lessivage. Les sulfates et les chlores sont les sels
dominants alors que les nitrates et les borates sont beaucoup plus rares.
« La salinisation est
l'augmentation de la teneur en sel d'un sol ou d'une eau. Elle est visible dans
les parties superficielles, contribue en majeur partie à la
dégradation des terres ainsi que le couvert végétal des
milieux », Ndiaye S. (2023).
Acidification : Augmentation de
l'acidité d'un sol, d'un cours d'eau ou de l'air en raison des
activités humaines. Ce phénomène peut modifier les
équilibres chimiques et biologiques et affecter gravement les
écosystèmes.
Terres salées : Les terres
salées, désignées « tannes » en
géomorphologie, correspondent à des étendues
salées, à très faible altitude, qui s'étendent
entre les vasières et les cordons sableux. Elles peuvent être
subdivisées en deux unités sue le plan
phytogéographique : les tannes nues, bordant justement la zone de
la vasière, constituées de terrains salés dépourvus
de végétation et les tannes herbues, généralement
entre les tannes nues et le pied des barrières sableuses, Diouf S. A
(2023).
Commune de Gandon : C'est notre milieu
d'étude, l'espace de travail.
Géomatique : « La
géomatique est une discipline regroupant les pratiques, méthodes
et technologies qui permettent de collecter, analyser et diffuser des
données géographiques. L'objectif final de la géomatique
est la représentation spatiale des données
récoltées pour identifier, représenter et démontrer
les résultats d'analyses statistiques, ... », (Esri).
La géomatique est très présente dans
plusieurs activités quotidiennes et est au coeur des nouveaux
défis en matière d'aménagement durable du territoire, de
sécurisation des droits immobiliers, de protection de l'environnement,
de sécurité civile, de construction d'ouvrages
d'ingénierie, de transformation numérique et de changement
climatique. Ses racines sont « géo », qui veut
dire Terre, et « matique » vient de : informatique,
soit le traitement automatique de l'information géographique, aussi
nommée information
« géospatiale ». Cette discipline associe
disciplines techniques très variées.
Carte : Une carte est une
représentation géométrique plane simplifiée et
conventionnelle de tout ou partie de la surface terrestre, et cela dans un
rapport de similitude convenable qu'on appelle échelle." F.
JOLY (1976).
Le Comité Français de
Cartographie définit la carte comme " ...une
représentation géométrique conventionnelle,
généralement plane, en positions relatives, de
phénomènes concrets ou abstraits, localisables dans l'espaces ;
c'est aussi un document portant cette représentation ou une partie de
cette représentation sous forme d'une figure manuscrite, imprimée
ou réalisée par tout autre moyen."
Cartographie : La cartographie est
l'ensemble des études et des opérations scientifiques et
techniques intervenant dans l'établissement des cartes ou plans,
à partir des résultats d'observations directes ou de
l'exploitation d'une documentation préexistante. Elle a pour but la
conception, la préparation et la réalisation des cartes. Sa
vocation est la représentation du monde sous une forme graphique et
géométrique, (
https://www.universalis.fr/encyclopedie/cartographie/).
Système d'Information Géographique
(SIG) : Un SIG est une technologie servant à créer,
gérer, analyser et cartographier tout type de données. Le SIG
associe les données à une carte et intègre des
données de localisation (endroit où se trouvent les choses)
à toutes sortes d'informations descriptives (état des choses
à cet endroit). Il constitue ainsi un socle pour la cartographie et
l'analyse dans le domaine des sciences et dans presque tous les secteurs. Le
SIG aide les utilisateurs à comprendre les modèles, les relations
et le contexte géographique des données. Ses avantages sont
nombreux et incluent notamment une amélioration de la communication, de
l'efficacité, de la gestion et de la prise de décision (Esri).
Télédétection :
Technique d'acquisition à distance d'informations sur la
surface terrestre, principalement fondée sur l'analyse d'images obtenues
dans différentes gammes de longueurs d'onde à partir
d'aéronefs ou de satellites (Dictionnaire Larousse).
Topographie :
La topographie est la science qui étudie l'ensemble
de la représentation graphique de la surface terrestre, avec ses formes
et ses détails. Elle permet la cartographie par arpentage.
Elle aboutit à une description détaillée ou une
représentation sur une carte des caractéristiques naturelles et
artificielles d'une zone (Aqua portail).
Photogrammétrie : science et art
dont le sujet d'étude est de déterminer la forme et la position
d'un objet dans l'espace à partir des mesures faites sur des photos.
Basse de données : Une base de
données est un ensemble de données qui sont structurées,
organisées et stockées dans un support de stockage. Elle est
conçue pour enregistrer des faits, des opérations au sein de
l'organisme (administration, banque, université, hôpital...).
Ainsi, la base de données rentre dans la cadre d'un système
d'information qui a quatre fonctions essentielles : la collecte, la
numérisation, le traitement et la diffusion de l'information.
Outils : les outils regroupent
l'ensemble des moyens ou logiciels qui servent de collecte, d'acquisition,
stock et de traitement de données. Nous pouvons retenir : Arc gis,
Q gis, Envi, Power AMC, Google Earth, GPS, Excel et Word.
Chapitre 2 :
Présentation du milieu d'étude
Ce premier chapitre est consacré à la
présentation du milieu. Il se débute par une fine
présentation géographique générale
c'est-à-dire la situation du milieu dans l'espace géographique,
puis une description de son cadre physique avant de voir son aspect humain.
? Situation du milieu d'étude
Notre milieu d'étude correspond à la Commune de
Gandon. Cette dernière se localise dans le delta du fleuve
Sénégal entre les méridiens 340100 et 360100W et les
latitudes 1750000et 1780000N. Elle couvre une superficie de 403,22 km²,
71,080 hbts en 2023 et une densité de 176 hbts/km². La Commune est
limitée à l'Ouest par l'océan atlantique et la Commune de
Ndiebene Gandiol, au Nord par les Communes Diama et Ndialame Bambara, à
l'Est par les Communes de Nguith et Fass Ngom et au Sud par les Communes de
Leona et Sakal (Carte 1).
Carte1: Situation
du milieu d'étude
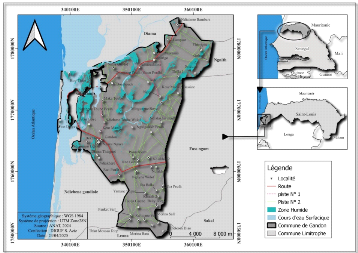
2.1. Le cadre physique
Il s'agit de l'étude de la géologie, la
géomorphologie, la pédologie, de la végétation, de
l'hydrologie et des conditions climatiques du milieu d'étude.
2.1.1 La topographie
Les caractéristiques topographiques de notre milieu se
manifestent par des altitudes et des pentes très faibles, un relief
essentiellement plat. Les altitudes varient de -3m au niveau des
dépressions, plus de 4,7m au pied des dunes jaunes à l à
plus de 9m au sein des dunes rouges. Le milieu se singularise par des coteaux
et une cuesta. Les coteaux avec une structure aclinale dans les
dépressions inter-dunaires, le pendage varie de 0 à 0,5°. La
cuesta se localise vers le plateau avec une très faible inclinaison de
l'interland vers le fleuve (2 à 8°). Cela monte que le milieu est
à topographie basse dont les altitudes et le pendage tributaires au
unités d'occupation du sol.
Planche cartographique 1 :
Caractéristiques topographiques du milieu
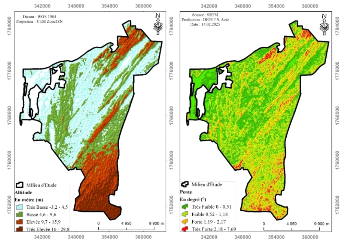
2.1.2 L'Hydrologie
Les caractéristiques hydrologiques du milieu
s'individualisent avec deux bassins versants voisins séparés par
une crête ou ligne de partage des eaux. Le Bv1 couve une superficie de
159 km² et un périmètre de 80 km avec une importante
densité de drainage allant jusqu'à 30. Le Bv2 est le moins large
(64 km²) légèrement drainé en termes de
densité que le Bv1 (0 à 22) avec un périmètre de 65
km. Les ordres d'écoulements des réseaux hydrographiques varient
du niveau 1 au niveau 5 dans le Bv1 et de 1 à 3 ordres dans le
deuxième bassin versant.
Bv2
Planche cartographique 2: Bassin versant et
densité de drainage
Bv1
Bv2
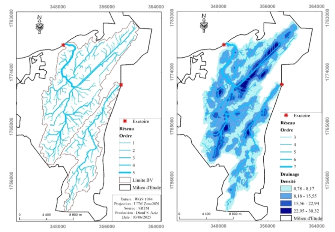
2.1.3 La pédologie
La pédologie du milieu est très
diversifiée. Nous avons les sols ferrugineux non ou peu lessivés,
appelés aussi sols Dior, profonds, bien drainés,
perméables, faiblement structurés. Ils sont riches en
matière organique et très aptes à la culture de l'arachide
et du mil selon Bineta Faye (2017). Les sol brun rouge subarides integrades
ferrugineux et les sols minéraux bruts. Les sols halomorphes salins
acidifiés avec sols peu évolués hydromorphes etles sols
halomorphes salins acidifiés sont des sols dont l'évolution et
les propriétés physico-chimiques sont affectées par la
dominance de sel.
Carte 2: typologie
des formations pédologiques du milieu
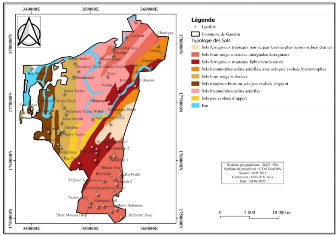
2.1.4 L'occupation du sol
La surface de notre milieu d'étude est
structurée spatialement par la végétation, les tannes, la
vasière, l'espace agraire et l'eau.
? La végétation arborée, la
végétation arbustive et la prairie marécageuse constituent
les formations végétales des zones immersibles. Les prairies
marécageuses sont des espaces humides et parfois inondables
présentant des cortèges floristiques très riches. Elles
ont une donc très grande quantité de biomasse, très
précieuse pour l'alimentation du bétail.
? Les vasières renferment 2 groupes : les
vasières nues dépourvues de végétations et les
vasières à mangrove d'espèces du genre Rhizophora et
Avicennisa. Elles sont constituées de
matières organiques, de vase le plus souvent en association avec des
sables très fins à débris calcaires. Elles correspondent
à l'actuelle slikke et comprise entre marée haute et marée
basse quotidiennes.
? Les tannes correspondent à des étendues
salées, à très faible altitude, qui s'étendent
entre les vasières et les dunes. Elles peuvent être
subdivisées en deux unités sue le plan
phytogéographique : les tannes nues, constituées de terrains
salés dépourvus de végétation et les tannes
herbues, généralement entre les tannes nues et le pied des
barrières sableuses.
? L'espace agraire regroupe les champs et l'habitat. Les eaux
renferment le réseau hydrographique du fleuve Sénégal et
l'un de ses défluents : le Ngalam.
Carte 3:
occupation du sol du milieu d'étude
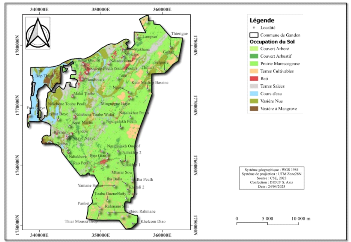
2.1.5 Le climat
Les éléments du climat sont des grandeurs
physiques mesurables ou des phénomènes repérables qui
caractérisent l'état de la basse et moyenne atmosphère.
Chaque zone climatique présente des spécificités qui
découlent de la combinaison de plusieurs éléments. Les
précipitations et la température sont analysées de ces
éléments pour ce travail.
? Caractérisation mensuelle de la
pluviométrie et la température
La pluviométrie est mesurée en millimètre
(mm) et la température en degré Celsius (°C). la figure5
révèle deux séquences : une période pluvieuse
allant de Juin à Octobre et une période sèche de Novembre
à Mai déterminant les deux saisons de la zones intertropicale.
Les mois d'Août et septembre enregistrent les plus fortes pluies avec des
moyennes de 96,3 et 97,9mm respectivement. La moyenne pluviométrique est
inférieure à 50 mm pour tous les autres mois de l'année.
Ce qui monte que le milieu est très faiblement arrosé et cela le
rend plus hostile à la salinisation des terres.
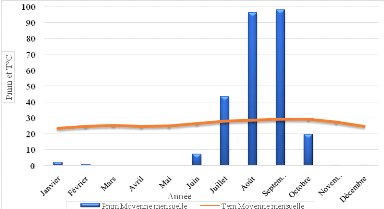
Figure 1 :
Courbe ombrothermique mensuelle de la station de Saint-Louis de 1991
à 2022
? Caractérisation annuelle de la
pluviométrie et la température
La figure 6 illustre les cumuls annuels pluviométriques
et la moyenne annuelle de la température de 1991 à 2022 de la
station de Saint-Louis. La moyenne de la série des cumuls de la
pluviométrie est de 268 mm. L'année 2010 la plus
excédentaire (593,6mm), celle de 1992 reste la plus déficitaire
pendant toute la série (58,6mm) soit un écart de -209,4mm par
rapport à la moyenne 1991-2022. Dans l'ensemble, la série compte
16 année déficitaires et 16 année excédentaires
avec un point culminant en 2010, puis une rupture de 2013 à 2019 et une
reprise pluviométrique depuis 2020. Concernant les températures,
elles varient de 25 à 28 °C de 1991 à 2020. Les
années 2008 et 2020 enregistrent les plus fortes températures
durant la série (28°C) à la différente des
années 2000 (26°C) et 2018 (25°C) les plus faibles
températures (figuere5).
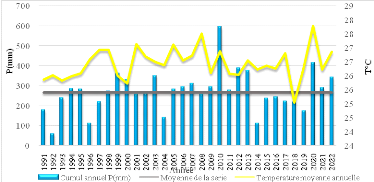
Figure 2 : Courbe
ombrothermique annuelle de la station de Saint-Louis de 1991 à 2022
2.2. Le cadre humain
Il s'agit dans cette partie de la présentation de la
démographie et des activités socio-économiques. C'est plus
spécifiquement la description de l'historique du peuplement, de
l'évolution et la répartition de la population et d'une vue
d'ensemble sur les activités socio-économiques du milieu.
2.2.1. La
démographie
C'est la présentation de l'évolution et de la
répartition de la population dans le milieu d'étude ainsi que des
activités socio-économiques.
? L'évolution de la population
Notre milieu d'étude se voit avec une taille
démographique assez importante. Cela peut être lié à
sa position géographique et son climat très propice à la
promotion de la communauté. Ainsi, la population globale de la Commune
de Gandon a passé de 33751 hbts en 2013 à 71080 hbts en 2023 soit
une augmentation de 37329 hbts pendant 10 années. Toutefois, la
population est à majorité masculine avec 36654 d'hommes contre
344426 de femmes en 2023.
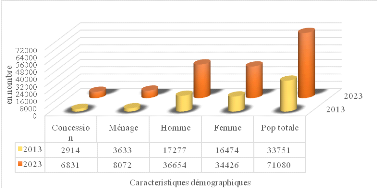
Figure 3:
évolution de la population de la Commune Gandon de 2013
à 2023
Carte 4:
Répartition de la population de la Commune Gandon en 2023
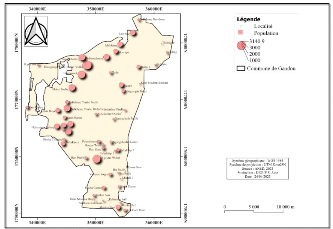
? La densité de la population
La carte 4 monte que la densité de la population est
plus est plus élevée dans la partie ouest du milieu
d'étude. Elle est décroissante de la cote vers l'intérieur
de la Commune où nous avons une densité très
élevée supérieur à 6887 à -1500 hbts vers
l'Est. La population est plus dense dans les localités de Boudiouck,
Sanar Wolof, Sanar Peulh, puis les localités de Rao Peulh, Ndiaoudoune,
Ndiaoussir Lebou, ... et moins dense pour plus de 70% des villages de la
Commune.
Carte 5 :
Densité de la population du milieu d'étude
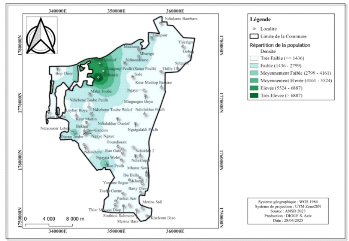
2.2.2. Les activités socio-économiques
Les activités socio-économiques
présentent dans notre milieu sont nombreuses et très
diversifiées selon les localités. Sont présentées
dans cette étude l'agriculture et l'élevage.
? L'agriculture
Elle est très diversifiée dans le delta, elle
occupe plus de 60 % de la population active et participe à
16,7 % du PIB en 2012 (ANSD/SRSD Saint-Louis, 2015, in Touré M. A.,
2018). Il se distingue une agriculture sous pluie, une agriculture
irriguée, une agriculture de décrue et le maraîchage. La
position géographique du delta lui confère des conditions
favorables au développement de cette activité. L'agrobusiness est
en pleine expansion depuis l'installation d'aménagements hydrauliques
pour la maîtrise des eaux (Touré M. A., 2018).Les principales
spéculations de cette activité concernent le riz, la canne
à sucre, la tomate, le mil, les haricots, l'oignon, etc. Ces cultures
sont destinées à l'exportation, à la consommation et
à la vente.
La culture irriguée est l'agriculture est le plus
développé dans le milieu. Elle occupe les zones
dépressionnaires (Waalo). La culture sous pluie est pratiquée
dans la partie Sud-est du milieu dans la partie dunaire (Diéri). Elle
concerne essentiellement l'arachide, le mil et la pastèqueet
dépend essentiellement de la pluviométrie. La culture de
décrue est pratiquée le long du fleuve Sénégal
durant la période de son retrait. Les spéculations qui concernent
cette pratique agricole sont le manioc, la patate, etc.
Le secteur agricole est affecté par différentes
contraintes, telles que la faiblesse des rendements et la salinisation et
l'acidification des sols et de la nappe phréatique.
? L'élevage
Cette activité constitue une des bases du
développement économique de la région. L'élevage
est pratiqué par plus de 350 000 ménages et contribuant
ainsi à 1/3 du PIB. (ANSD, 2015, par Touré M. A., 2018). Le delta
du fleuve Sénégal renferme une vaste aire agropastorale qui est
le Diéri. Le delta est lié à une longue tradition
d'élevage découlant de la disponibilité des ressources en
eau (cours d'eau, forages et puits) et de résidus agricole. Il y est
très développé est constituée essentiellement de
bovins (32 %) et de petits ruminants (35 %) selon Touré M. A.,
2018.
Chapitre 3 : Approche
méthodologique
La méthodologie est définie comme
étant un ensemble de méthodes et techniques utilisées
d'une part, pour traiter les résultats des investigations et d'autre
part, pour rassembler les données, Goma Ndama (1993) in Diouf S. A.
(2023). Ainsi, l'approche méthodologique adopté pour mener
à bien ce travail s'articule autour de quatre axes à
savoir :
La revue documentaire
Le recueil et l'acquisition de données
complémentaires
Le recueil et l'acquisition de données
satellitaires
Le traitement et l'analyse des données
recueillies
3.1. La revue documentaire
Une recherche préliminaire de documents est
effectuée afin d'avoir une aperçue globale sur la dynamique des
terrains salés, les facteurs d'origines ainsi que leurs impacts,
notamment dans les humides côtières. Ces productions
littéraires sont à la fois de livres, de mémoires, de
thèses, des articles scientifiques consultées par plusieurs
sources de recherche telles que :
https://www.universalis.fr,
https//:
www.bibnum.ucad.sn, https//:
www.memoireonline.com, et de
centres documentaires comme la bibliothèque universitaire de Cheikh
Anta Diop de Dakar et la bibliothèque de la faculté des lettres
et sciences humaines de l'Ucad.
3.2. 3.3.
Acquisition de données complémentaires
Il s'agit de l'ensemble des données collectées
au niveau des institution nationales et/ou internationales. Ce sont de
données préexistantes de diverse formes. Nous avons :
Les données climatiques
(pluviométrie et température) ont été
collectées à l'ANACIM (Agence Nationale de l'Aviation Civile et
de la Météorologie). Ces données caractérisent
l'évolution du climat de notre milieu d'étude à partir des
paramètres climatiques. Pour cette étude, nous avons mis l'accent
sur la pluviométrieet la température afin de mettre en
évidence le rapport entre variabilité climatique et dynamique des
terres salées.
Les données démographiques de
la commune de Gandon sont collectées à l'ANSD (Agence Nationale
de la Statistique et de la Démographie). Ces données nous ont
permis de déterminer la densité de la population et de suivre
l'évolution de la démographique dans l'espace communale.
Le Model Numérique de Terrain (MNT) de
résolution 30m couvrant la région de Saint-Louis a permis
d'établir la carte du relief, celle des pentes et la carte des bassins
versants la zone d'étude.
Les données spatialesvectorielles
issues de l'ANAT, nous ont permis de décrire le
contexte physique de la Commune de Gandon afin de situer la zone d'étude
en délimitant ses contours et aussi de caractériser la
pédologie, la localisation, l'occupation du sol de la Commune.
Les données physico-chimiques des sol
issues de ISRIC (Centre International de Référence et
d'Information sur les Sols), ont permis la caractérisation de la teneur
en sels dissous (CE) et de la texture (facies) des sols de la Commune de Gandon
dans les horizons 0-5 cm et 5-15 cm. Elles sont sous format raster traiter par
le logiciel Arcgis.
Tableau 1: Les
types de données complémentaires utilisées
Source : Diouf S. Aziz, Juin
2025
|
Type de données
|
Nature des données
|
Format
|
Résolution
|
Date
|
Source
|
|
Climatiques
|
Pluviométrie (mm)
Température en °C
|
Excel
|
-
|
1971-2022
1991-2022
|
ANACIM
|
|
Socio-économique
|
Démographie
|
Excel
|
-
|
2013, 2023
|
ANSD
|
|
Spatiales
|
Limite administrative
|
Vecteur
|
-
|
2014
|
DTGC
|
|
Pédologie
|
Vecteur
|
-
|
2023
|
INP
|
|
Hydrologie
|
Vecteur
|
-
|
2014
|
DGPRE
|
|
Occupation du sol
|
Raster
|
-
|
2023
|
CSE
|
|
Model Numérique de Terrain
|
Raster
|
30m
|
-
|
SRTM
|
|
Conductivité électrique (CE), Texture du sol
(0-5 et 5-15cm)
|
Raster
|
250m
|
-
|
ISRIC
|
3.4. Recueil et acquisition de données
satellitaires
Pour suivre l'évolution des unités d'occupation
du sol ainsi que la dynamique des terres salines, des images satellitaires
Landsat des années 1972, 1985, 1998, 2011 et 2024 sont
utilisées.
3.3.1. Mode d'acquisition des données satellitaires
Landsat
Les images satellitaires de Landsat 1-4 ; 4-5 et 8 de
résolution 30m ont été téléchargées
sur le site de la NASA Earth Explorer à l'adresse :
https://earthexplorer.usgs.gov.
Elles nous ont permis d'établir des cartes diachroniques suivant
l'évolution de l'occupation du sol de 1972 à 2024 et d'en
extraire les terres salines afin de caractériser leur dynamique.
Une fois sur le site, nous avons d'abord créer un
compte d'utilisateur en suivant respectivement toutes les étapes
nécessaires. Ensuite, nous avons répertorié des images qui
couvent notre milieu d'étude en choisissant 4 points de
coordonnées géographiques et une période donnée.
Enfin, nous avons sélectionner une donnée Landsat, puis passer
aux résultats et choisir une image de bonne qualité avant
d'effectuer le téléchargement.
Choix de la période
Téléchargement
D
Figure 4 :
Procédures de téléchargement des images
Landsat
B
C
A
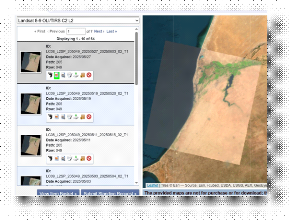
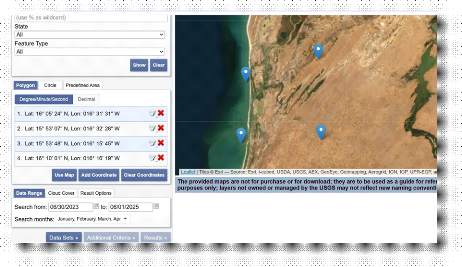
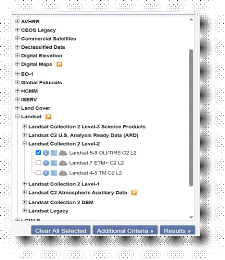
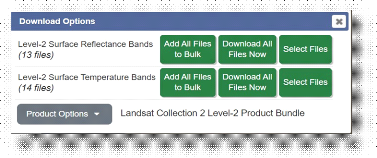 t
t
3.3.2. Les données Landsat utilisées
Les images satellitaires Landsat des années1972, 1985,
1998, 2011 et 2024 sont utilisées pour caractériser la dynamique
des tannes dans la Commune de Gandon des années 1970 aux années
2020. Le choix des années s'est basé sur le besoin d'une approche
comparative de l'état des terres salées pendant les
périodes en début et pleine sècheresse (1972 et 1985) et
les période en début et pleine phase humide (1998 et 2011) et
enfin leur état actuel tel justifie l'année de 2024. Et cela afin
de mettre en évidence le rapport entre changement climatique et
dynamique des terres salines.
Tableau 2:
Données d'imagerie satellitaire utilisées
|
Satellite
|
Capteurs
|
Heure
|
Date
|
Résolution (m)
|
|
Landsat 1
|
MSS
|
10 :57 :16
|
1972-11-05
|
30
|
|
Landsat 5
|
TM
|
10 :57 :29
|
1985-02-06
|
|
Landsat 5
|
TM
|
10 :37 :36
|
1998-03-23
|
|
Landsat 5
|
TM
|
11 :14 :35
|
2011-11-13
|
|
Landsat 8
|
OLI et
TIRS
|
11 :26 :09
|
2024-06-09
|
Source : Diouf S. Aziz, Juin 2025
3.3.3. Caractérisation des bandes spectrales des
Capteurs satellitaires
Le capteur MSS de Landsat 1 compte 4 bandes de
résolution 60 m. Sa résolution est moins précise par
rapport aux capteurs de Landsat 4-5 ou 8 (Tab.3).
Tableau 3 :
Caractéristique des bandes spectrales du capteur MSS (Faye B.,
2017
|
Multi spectral
|
Landsat
|
Landsat
|
Wavelength
|
Résolution
|
|
Scanner
|
01-mars
|
04-mai
|
(Micrometers)
|
(Meters)
|
|
(MSS)
|
Band 4
|
Band 1
|
0,5-0,6
|
60
|
|
Band 5
|
Band 2
|
0,6-0,7
|
60
|
|
Band 6
|
Band 3
|
0,7-0,8
|
60
|
|
Band 7
|
Band 4
|
0,8-1,1
|
60
|
Source : Narimène I.,
2012
Les images TM sont beaucoup plus précises que les
images MSS de Landsat 1 grâce à leur résolution spatiale et
au nombre de bandes plus élevé. Le capteur TM de Landsat 4-5
compte 7 bandes spectrales (tab.4).
Tableau 4 :
Caractéristique des bandes spectrales du capteur TM (Faye B.,
2017)
|
Bande
|
Couleur
|
Domaine spectrale
|
Résolution (m)
|
|
TM 1
|
Bleu
|
0,45-0,52
|
30
|
|
TM 2
|
Vert
|
0,52-0,60
|
30
|
|
TM 3
|
Rouge
|
0,63-0,69
|
30
|
|
TM 4
|
Proche infrarouge (IR)
|
0,76-0,90
|
30
|
|
TM 5
|
Infrarouge de courte longueur d'onde
|
1,55-1,75
|
30
|
|
TM 6
|
Infrarouge thermique
|
10,4-12,5
|
120
|
|
TM 7
|
Infrarouge de courte longueur d'onde
|
2,08-2,35
|
30
|
Source : Narimène I.,
2012
Landsat-8/LDCM (Landsat Data Continuity
Mission) compte 11 bandes (tab.5). Les bandes 1
à 9 sont acquises par des opérations terrain
Imager (OLI) et les Bandes 10/11 sont acquises par le capteur
infrarouge thermique (TIRS). OLI est similaire à Landsat ETM +,
toutes les bandes ont une résolution de 30 m, sauf pour ce qui est de la
bande 8 (panchromatique) à résolution 15 m. TIRS acquiert
deux bandes à une résolution de 100 m.
Tableau 5:
Caractères des bandes de Landsat-8/LDCM (Landsat Data Continuity
Mission)
|
Bande 1 - Aérosols
|
0,433 - 0,453 um
|
30 m
|
|
Bande 2 - Bleu
|
0,450 - 0,515 um
|
30 m
|
|
Bande 3 - Vert
|
0,525 - 0,600 um
|
30 m
|
|
Bande 4 - Rouge
|
0,630 - 0,680 um
|
30 m
|
|
Bande 5 - Infrarouge proche
|
0,845 - 0,885 um
|
30 m
|
|
Bande 6 - Infrarouge moyen 1
|
1,560 - 1,660 um
|
30 m
|
|
Bande 7 - Infrarouge moyen 2
|
2,100 - 2,300 um
|
30 m
|
|
Bande 8 - Panchromatique
|
0,500 - 0,680 um
|
15 m
|
|
Bande 9 - Cirrus
|
1,360 - 1,390 um
|
30 m
|
|
Bande 10 - Infrarouge moyen
|
10,30 - 11,30 um
|
100 m
|
|
Bande 11 - Infrarouge moyen
|
11,50 - 12,50 um
|
100 m
|
3.5. Traitement et analyses des données
recueillies
Pour le traitement des données, nous avons tout d'abord
utilisé plusieurs logiciels et matériels, ensuite choisir des
méthodes pour leur traitement et enfin expliquer la méthodologie
adoptée pour chaque traitement.
3.4.1
Matériels et Logiciels
Les matériels et logiciels utilisés pour
réaliser notre projet sont les suivants :
? Un ordinateur portable HP EliteBook 840 d'une
capacité 1 terra Intel(R) Core (TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz, d'un
mémoire de 8G, et d'un système d'exploitation de 64bits.
? ArcGIS 10.8 pour le traitement cartographique des
informations géographiques ainsi que la conception de la geodatabase.
v Q gis 3.28 Pour la réalisation de la mise en page des
cartes
? Envi 5.3 : utilisé pour le traitement des images
satellitaire Landsat
? Excel : utilisé pour le traitement statistique des
données recueillies.
? Sybase Power AMC : utilisé pour modéliser
notre base de données
? Mobile Topographer pour la prise de coordonnées
géographiques des unités paysagères lors de la prospection
de terrain.
? Microsoft Word : Pour rédiger notre projet
? Microsoft Power Point : pour faire la présentation du
projet
3.4.2 La
modélisation des données
Toutes les données collectées (statistiques et
spatiales) ont été regroupées, ou intégrées
dans une base de données relationnelle à l'aide de la
méthode MERISE. C'est une méthode d'analyse et de conception des
systèmes d'information développée dans les années
1970 par Hubert Tardieu. Dans le cadre de notre projet, nous allons utiliser
les trois modèles (conceptuel, logique et physique) de MERISE permettant
la conception d'une base de données relationnelle puis sa
réalisation sur un SGBDR (système de gestion de base de
données relationnelle) pour concevoir un système d'information
relatif à la gestion des terres salées.
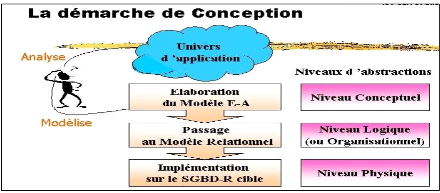
Figure 5:
Méthode Merise (Source :
http://tecfaetu.unige.ch/)
? Le Modèle Conceptuel de Données (MCD)
C'est la représentation la plus abstraite des
données d'un système d'information, la représentation
schématique des données et des liens entre elles. Les
données sont représentées sous forme : d'entités,
propriétés de l'entité, associations qui expliquent et
précisent comment les entités sont reliées entre elles et
les cardinalités qui permettent de caractériser le lien qui
existe entre une entité et la relation à laquelle elle est
reliée.
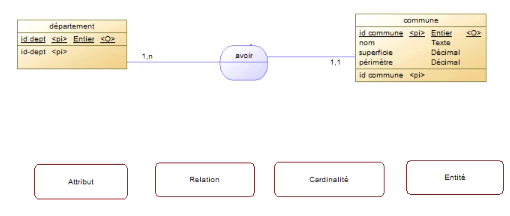
Figure 6:
Schéma d'un MCD
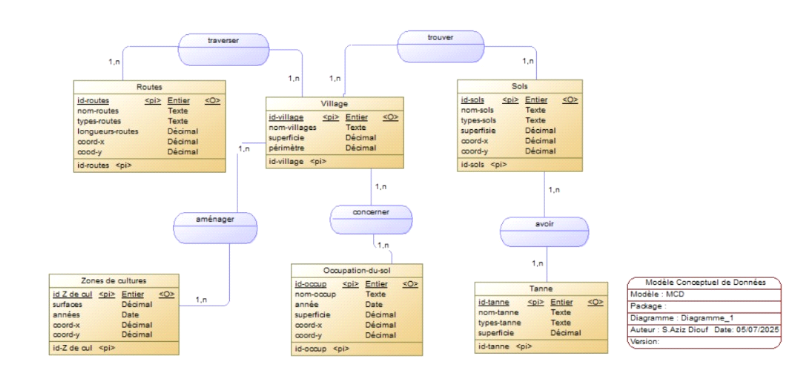
Figure 7:
Modèle conceptuel de données
? Le Modèle Logique des Données (MLD)
Le modèle logique permet de représenter les
données obtenues à la transcription d'un MCD en modèle
relationnel selon quelques règles :
- Les entités deviennent des tables et chaque case
d'une table prend une unique valeur dans un domaine prédéfini
;
- Chaque propriété d'une entité devient
un Attribut.
- L'identifiant de l'entité devient la clé
primaire exemple : village (entité) et id village (identifiant).
- La clé faisant référence d'une autre
table dans une autre devient la clé secondaire ou la
clé étrangère, exemple : id_ village est
la clé primaire du table village et si id_ routesmigre vers cette table,
elle devient une clé étrangère.
C'est la transformation des entités et associations
sous forme de tables. Il s'agit du passage entre le Modèle Conceptuel de
Donnée et l'implémentation physique de la base.
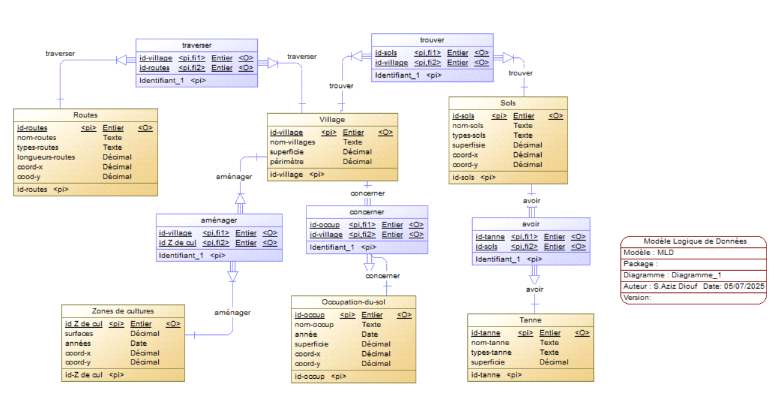
Figure 8:
Modèle logique de données
? Le Modèle Physique des Données (MPD)
C'est l'implémentation logique des données
organisées et intégralement gérées par le SGBD
(système de gestion de base de données). C'est la dernière
étape de l'analyse de Merise, un formalisme de précisiondu
système de stockage employé pour un SGBD.
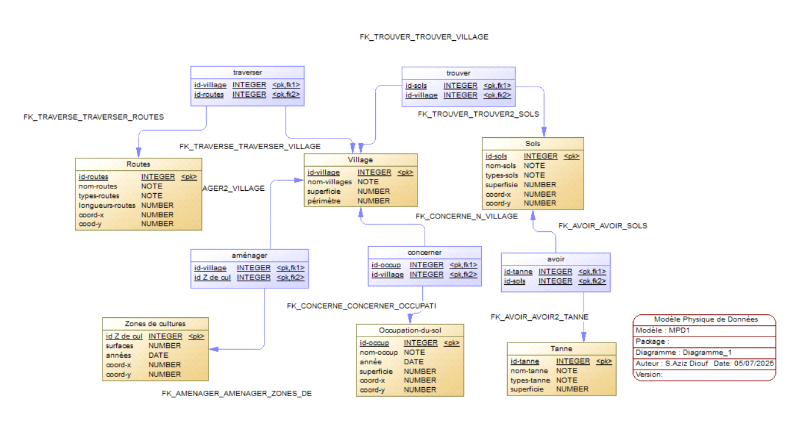
Figure 9:
Modèle physique de données
3.4.3
Méthodologie appliquée au traitement des données
3.4.3.1 Attributaires
Les données climatiques de la station de Saint-Louis de
1991-2022, recueillies à l'ANACIM, nous ont servi de base pour
caractériser le climat de la Commune de Gandon. Pour ce travail,
l'analyse porte sur trois paramètres telles que la température et
la pluviométrie. Le traitement statistique et la représentation
graphique sont faits par l'outil Excel.
ü La température : Pour
connaitre la variabilité mensuelle de la température (en
°C), nous avons calculé la moyenne inter-mensuelle minimale et la
température moyenne inter-mensuelle maximale puis en déduire la
température moyenne inter-mensuelle de 1991 à 2022. Les
résultats sont ensuite représentés dans une courbe
d'évolution dont les températures en °C sur l'axe des
ordonnées et le temps (les années) sur l'axe des abscisses pour
suivre la variabilité interannuelle de la température de 1991
à 2022.
ü La pluviométrie s'exprime en
millimètre (mm). Nous avons cherché les cumuls inter-mensuels et
interannuels pour déterminer la variabilité pluviométrique
mensuelle, caractérisé l'hivernage ainsi qu'analyser la
variabilité interannuelle de la pluviométrie de 1991-2022.
L'indice de Précipitations Standardisé
(IPS) est aussi déterminé afin de caractériser
les années sèches et les années humides et
d'apprécier son rapport avec la dynamique des terres salées. Les
données pluviométrique de 1971 à 2022 de la station de
Saint-Louis sont utilisées pour déterminer l'IPS. Il se calcule
selon la formule : IPS = I =
(Xi-Xm) / Si ;
Xi = cumul de la pluie pour une année i ;
Xm = moyenne annuelle des pluies sur la période 1971-2022
;
Si = écart type des cumuls annuels sur la même
période.
Calcul sur Excel: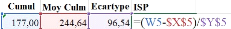
Les valeurs du IPS sont appreciés selon le tableau
d'interpretation de Mckee el al. en 1993.
Tableau 6:
Classes degrés de la sécheresse par rapport à la
valeur du IPS (McKee et al., 1993)
|
2,0 et plus
|
1,5 à 1,99
|
1,0 à 1,49
|
-0,99 à 0,99
|
-1,0 à -1,49
|
1,5 à -1,99
|
-2 et moins
|
|
Extrêmement humide
|
Très humide
|
Modérément humide
|
Proche de la normale
|
Modérément sec
|
Très sec
|
Extrêmement sec
|
3.4.3.2 Les données physico-chimiques
Les données physico-chimiques des sol sont issues de
ISRIC. Elles sont sous forme raster et renferment une paramètre chimique
telle quela conductivité électrique (CE) et une paramètre
physique à savoir la texture du sol. Elles sont obtenues en horizons
différentes : de 0 à 5 cm et de 5 à 15 cm. Le
traitement de ces images est fait à l'aide du logiciel Arc gis 10.8 et
Excel. Après avoir ajouté l'image dans l'espace du travail du
logiciel, nous avons d'abord extraire notre milieu d'étude en passant
par `Data menegament tools', raster puis raster to prossessing et enfin par
`clip'. Ensuite, nous avons vectorisé les images découpées
pour chaque paramètre (raster to polygon) afin de les reclassifier
`Field Calcutor' et calculer les superficies occupées (Calcutate
Geometry) pour chaque classe. L'outil Excel nous a permis de traitement
graphiquement les pourcentages des classes en termes de superficies. La
reclassification des images se base sur les valeurs ci-dessous :
? La Conductivité Electrique (CE) :
la reclassification des valeurs de la conductivité
électrique de l'mage s'est basée sur le tableau
d'interprétation de la CE de la FAO.
Tableau 7 : Appréciation de la
salinité du sol selon la conductivité électrique selon la
FAO
|
CE en dS/m
|
EC < 4
|
4 > EC < 8
|
8 > EC < 16
|
EC > 16
|
|
Degré de salinité
|
Non salin
|
Légèrement salin
|
Modérément salin
|
Hautement salin
|
Source : FAO (2024)
? La Texture des sols
Concernant la texture, chaque classe ou faciès dans
l'image est codée avec un chiffre dont leur significations dans un
fichier Word téléchargé avec l'image.
Ces traitements physico-chimiques permettent de
caractériser le degré de salinité (CE) et la texture
(facies) des sols de la Commune de Gandon dans les horizons 0-5 et 5-15 cm.
3.4.3.3 Traitement des images satellitaires
L'analyse des images satellitaires nécessite
l'identification des différentes unités qui se trouvent dans
l'image. La reconnaissance des cibles est la clé de
l'interprétation et de l'extraction de l'information. En plus, des
vérification numériques de validation sont effectuées afin
s'assurer un échantillonnage excellent et un classement rigoureux
(indice de Kappa et matrice de confusion). L'interprétation des images a
fait recours à divers procédés, dont le
prétraitement et le traitement numérique.
Dynamique des terres salées de 1972 à
2024
Calcul des statistiques des unités en ha
Images satellitairesLandsat
ENVI 5.3
Combinaison des bandes
Corrections radiométriques
Extraction du milieu d'étude
Vectorisation des unités
Reclassification des unités
ArcGIS 10.8
Agrégation des unités
Habillage des cartes
Sélection de la couche des terres salées
Export de la couche des terres salées
1972
1985
2011
2024
Dynamique des unités de paysages de 1972 à
2024
Classification Supervisée
1998
Images satellitaires Landsat
QGis 3.2
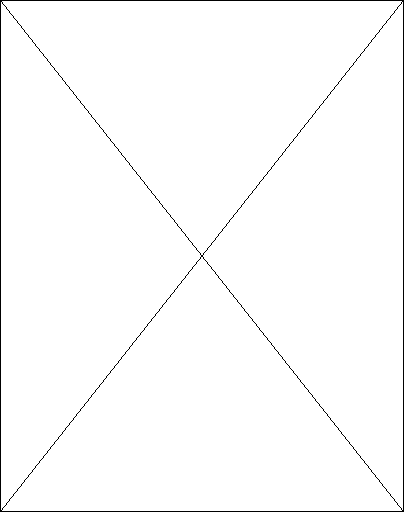
Figure 10 : Organigramme de l'étude de la
dynamique des terres salées, Diouf S. Aziz, Juin 2025
? Le prétraitement
Le prétraitement constitue toutes les opérations
qui sont indispensables avant l'analyse des images. Les opérations de
prétraitement faites dans ce document sont la combinaison des bandes,
les corrections radiométriques, l'extraction du milieu d'étude et
la composition colorée des bandes spectrales.
- Combinaison des bandes
Cette étape consiste à construire un fichier qui
regroupe toutes les bandes ajoutées (métadonnée) en
remplaçant `Landsat' par `L1' dans le fichier texte MTL afin de pouvoir
l'utiliser dans ENVI. Pour Landsat 8, en plus de cette correction, il faut
supprimer les caractéristiques du groupe `Level 1' pour son
intégration dans le logiciel. Ce fichier est ajouté dans ENVI et
utilisé pour le traitement.
Ouvrir
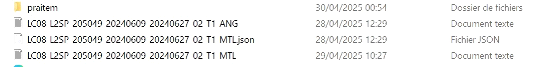
Remplacer
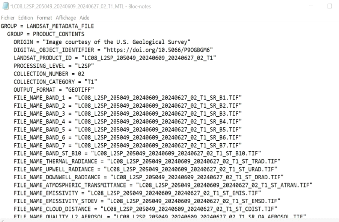
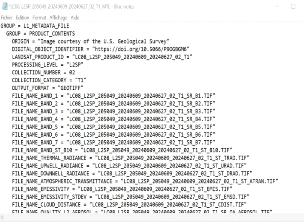
Figure 11 :
Procédures de la combinaison des Bandes
Enregistrer (ctrl+s)
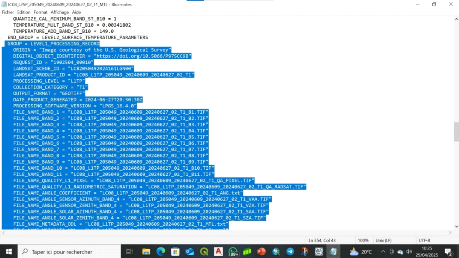
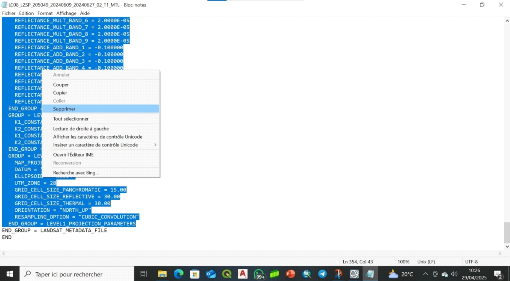
- L'extraction du milieu d'étude
L'extraction du milieu d'étude sur une palette
entière consiste à découper la partie qui concerne
uniquement l'espace d'étude. Cet exercice est effectué à
l'aide de la limite du milieu d'étude sous format polygone
correspondant à la limite administrative de la Commune de Gandon issue
de l'ANAT.Procedures :
Clic
B
Figure 12 : A et
B : Procédures d'ajout de la métadonnée
(image regroupée)
A&& :
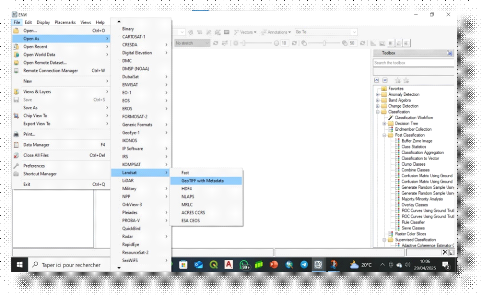
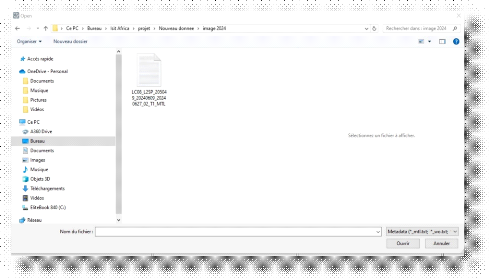
Figure 13 : C, D et
E : Procédures d'ajout de la limite du milieu
d'étude
C
D
E
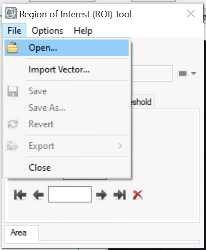

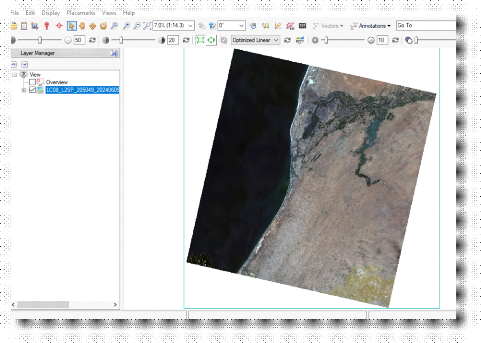
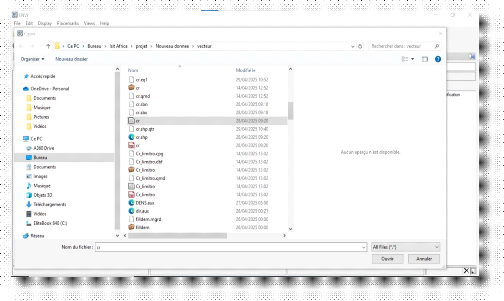
Figure 14 : F et
G : Procédures de découpage de l'image dans
notre milieu d'étude ; H : l'Extraction
H
F
G

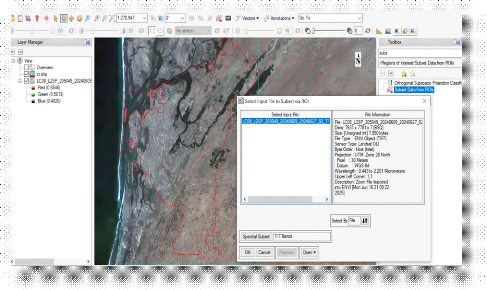
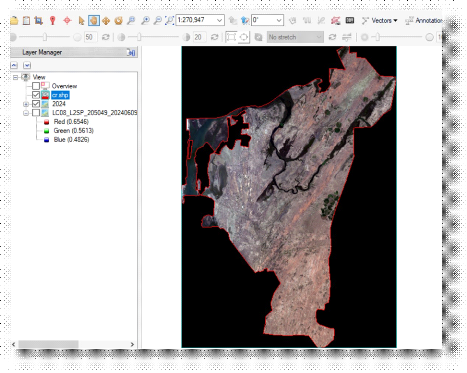
- Les correction radiometriques
Les corrections effectuées dans ce travail sont la
correction atmospherique consite àcorriger les effets de
l'atmosphère (absorption et diffusion du rayonnement) qui modifient la
quantité de lumière atteignant le capteur.Et la calibration
radiométrique est un processus qui permet de transformer les
valeurs numériques (numéros de pixel ou DN) enregistrées
par un capteur en valeurs physiques, telles que la réflectance ou le
rayonnement, dans une échelle absolue. En d'autres termes, elle
assure que les données d'image sont précises et fiables, en
tenant compte des variations instrumentales et atmosphériques
- La composition colorée des bandes
spectrales
Le principe des compositions colorées consiste à
affecter les trois couleurs primaires (Rouge, Vert, Bleu) aux trois bandes
spectrales de l'image. Dans cette étude où nous voulons mettre en
évidence l'évolution des terres salées, la composition
colorée utilisée et qui semble être la mieux adaptée
pour l'étude est la composition colorée 543 (Landsat 8), 432
(Landsat 5) et 421 pour Landsat 1. Schematiquement nous avons : 5 R, 4 V,
3 B pour OLI ; 4 R, 3 V, 2 B pour TM ; 4 R, 2 V, 1 B pour MSS. L'eau
apparaît en bleu, la végétation en rouge vif et plus terme,
les terres cultivables en rouge-rosé et les terres salées quant
à elles apparaissent dans des teintes qui vont du blanc au gris.
Tableau 8: Grille
d'identification et d'interprétation des principaux types
d'unités
|
Image
|
Couleurs
|
Types d'unités
|
|
Landsat
|
(Rouge)
|
(Vert)
|
(Bleu)
|
Eau
|
Végétation
|
Terres cultivables
|
Terres salées
|
|
OLI/TIRS
|
5
|
4
|
3
|
Bleu foncé (eau profonde ou peu turbide)
Bleu-vert (faible profondeur ou forte turbidité)
|
Vert vif (foret) Vert plus terne (mangrove)
|
Rouge-rogé
|
Blanc
gris
|
|
Bandes
|
|
TM
|
4
|
3
|
2
|
Vert vif (foret) Vert plus terne (mangrove)
|
Rouge-rogé
|
Blanc
gris
|
|
Bandes
|
|
MSS
|
4
|
2
|
1
|
Vert vif (foret) Vert plus terne (mangrove)
|
Rouge-rogé
|
Blanc
gris
|
|
Bandes
|
- Definition des classes thematiques
L'objectif de notre classification est de mettre en exergue la
dynamique de la superficie des terres salées de 1971 à 2010.
C'est pourquoi les différentes unités telles que le couvert
vegetal et arbustif, les prairies et la mangove, les tannes herbus et nus, les
reseaux hydrographique, que le bati ainsi que les champs et autres sols nus non
salés sont regroupées en quatres (4) classes : la
vegetation, les terres cultivables, les terres salées et l'eau. La
vegetation regroupe toutes les formations vegetales, les terres salées
les tannes herbus et nus, les terres cultivables renferment le bati, les champs
et sols nus non salés et enfin l'eau regroupes toutes les eaux
surfaciques (Tableau).
Tableau 9: Les
classes thématiques retenues pour l'étude
|
Unités d'occupation du sol
|
Classes thématiques
|
|
Végétation aquatique
|
Végétation
|
|
Végétation continentale
|
|
Réseau hydrographique
|
Eau
|
|
Mares
|
|
Tanne nu
|
Terre salée
|
|
Tanne herbu
|
|
Champs de culture
|
Terres cultivables
|
|
L'habitat
|
Terre salée
Terre cultivable
Terre cultivable
Landsat 8
Landsat 1
Landsat 5
Eau
Végétation
Terre salée
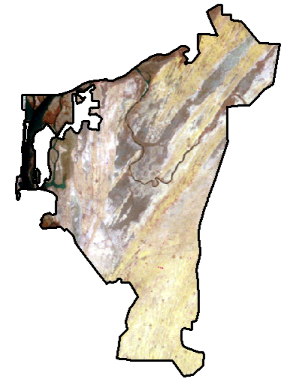
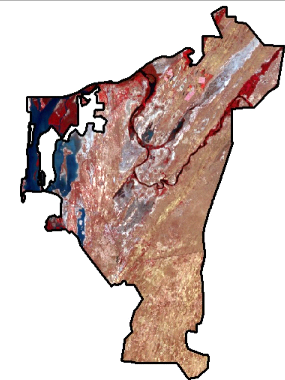
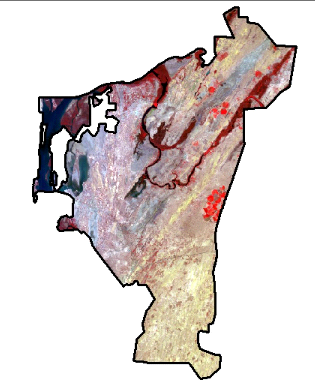
Figure 15 :
Classe thématique et Pixel correspondant
? La classification
La classification des images est faite selon la classification
supervisée, c'est-à-dire celle basée sur la reconnaissance
des différents pixels qui se trouvent dans l'image et classer selon les
unités. Elles s'agissent l'eau, les terres salées, la
végétation et les terres cultivables. La classification consiste
tout simplement à assigner un de ces 4 unités à chacun des
pixels de l'image. Apres avoir ajouter des `ROI' et
d'échantillons pour chacune des 4 thèmes, l'extension Maximum
Likelihood Classification est utilisée pour classifier les
échantillons de pixels numérisés. La sélection de
ces informations est fondée sur une connaissance du milieu grâce
à un déplacement sur le terrain octobre 2024, le grilles
d'identification des unité (Tabl.9) et les
données d'occupation du sol du CSE sur la site
https://www.geosenegal.gouv.sn/-base-de-donnees-geographiques-.html(Carte3).
Echantillon Eau
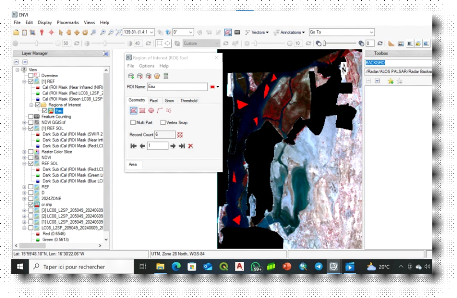
Figure 16 :
Méthode de la classification supervisée
? Validation de la
classification
La validation des résultats obtenus par la
classification supervisée s'est faite par détermination des
matrices de confusion et du calcul des coefficients Kappa.
La matrice de confusion doit présenter un tableau
croisé des classes réalisées (y compris des pixels non
classés) et le pourcentage effectif des pixels bien, mal classés
ou non classés. Chaque colonne de la matrice représente le nombre
d'occurrences d'une classe estimée, tandis que chaque ligne
représente le nombre d'occurrences d'une classe réelle (ou de
référence). Dans l'idéal nous devons trouver une diagonale
de 100%, c'est-à-dire que tous les pixels doivent être
effectivement classés dans leur thème d'origineet uniquement. En
dessous de 95 %, nous estimons que la classification n'est pas bonne.
- L'indice de Kappa évalue dans la matrice de confusion
l'accord entre les résultats obtenus et la vérité
surterrain. Il s'étend de 0 à 1 et se divise en cinq
catégories : Excellent quand sa valeur = 0,81 ; bon compris entre
0,80 = Kappa = 0,61 ; modéré entre 0,60 et 0,21 ; mauvais
comprise entre 0,20 et 0,0 et très mauvais <à 0,0 (Tchibozo E.
A. et Toundoh O. P., 2014 in Faye B., 2017).
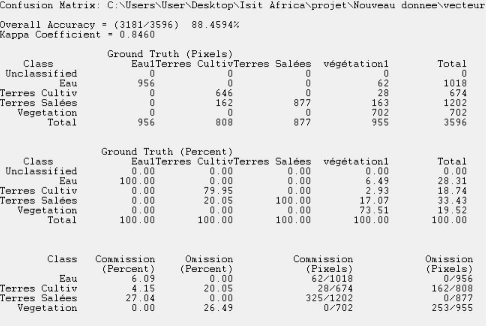
Figure 17 :
Valeurs del'Indice de Kappa et Matrice de confusion de Landsat 8
La figure 17 révèle une excellente classification
car l'Indice de kappa est supérieur 81, tous les pixels sont
classés et la précision globale est de 88,45%.
? La cartographie et la statistique des unités
d'occupation du sol
Après la classification, nous avons importé les
images classifiées dans le logiciel ArcGis 10.8 pour faire le traitement
et dans Qgis 3.2 pour l'habillage des cartes. Pour ce faire, les données
sont reclassifiées et converties en format Shape à l'aide de
`Raster to polygon' de l'extension Spatial Analyst
qui se trouve dans le logiciel ArcGis puis les polygones regroupées en
classe à l'aide de `Dissolve'. Le
calcul des statistiques consiste à déterminer les valeurs des
unités en hectares selon la formule garce à
Geometry Calculator.
Le taux de croissance de chaque unité est
déterminé selon la formule : 

SAa= Superficie de l'année
d'arrivée
SAd= Superficie de l'année de
départ
Apres ces calculs, les images sont ajoutées dans Qgis
pour afin procéder à l'habillage des différentes
cartes.
? La détection des changements
Les vecteurs issus de la classification sont combinés
deux à deux pour obtenir une matrice de changement. Les valeurs de la
matrice de changement proviennent de la superposition des deux cartes
grâce au logiciel ArcGIS à partir de Intersect,
résumées par suite dans un tableau grâce à Excel.
Les colonnes de la matrice représentent la superficie de chaque classe
de l'année d'arrivée alors que les lignes représentent
celle de l'année de départ. Les cellules de la matrice
contiennent la valeur d'une variable ayant passé d'une classe initiale
à une classe finale pendant la période allant de
l'année 0 à l'année 1. Les séquences
1972-1998, 1998-2024 et 1972-2024 sont choisies pour ce travail et cela met en
lumière trois catégories de changements spatio-temporels
:
- stabilité : se rapporte
à l'ensemble des classes qui sont restées dans la même
classe entre les deux dates de l'étude, c'est-à-dire n'ayant
été affectées ni par les modifications, ni par les
conversions.
- modification : le mode d'occupation de
l'espace a changé d'une classe à l'autre, mais en restant dans la
même catégorie (exemple : terres cultivables qui deviennent
terres salées).
- conversion : le mode d'occupation de
l'espace d'une classe passé à une autre classe dans une
catégorie différente (exemple : végétation qui
devient terres salées).
3.4.3.4 La cartographie des terres salées
Les images vecteurs issues de la classification sont
utilisées pour cartographier uniquement les terres salines d'une part et
de suivre d'une autre part la dynamique.
Pour leur cartographie, la couche des terres salées est
sélectionnée et exportée pour chaque image. Puis les
Shapes `terre salée' des différentes images des années
regroupés dans une seule carte sert de leur cinématique. Leur
surface en hectare (ha) présentée graphiquement grâce
à Excel.
Le suivi de la dynamique des terres salines porte sur la
séquence 1972-2024. Le traitement met en en lumière trois (3)
catégories de terres salées : les terres salées
constantes (non changée entre la période), les terres
salées disparues et celles apparues entre 1972 et 2024. En effet, les
couches des terres salées de ces deux années (1972 et 2024) sont
sélectionnées et exportées à l'aide de ArcGis 10.8.
Puis leur intersection avec l'outil Intersect dont le
résultat constitut les terres salées constantes. Pour ressortir
les terres salées disparues, la couche de celle de 1972 est
écrasée des terres salées constantes et celle de 2024 pour
les terres salines apparues.
Terre salée constante (Tc) :
Intersect Ad+Aa
Terre disparue (Td) : Terre salée Ad
- Tc
Terre apparue (Ta) : Terre salée Aa
- Tc
Ce traitement résume comme suite :
|
Aa =
|
Année d'arrivée
|
|
Ad =
|
Année de départ
|
|
Tc =
|
constante de la période
|
3.4.3.5 Calcul de l'Indice de Salinité par Difference
Normalisée (NDSI)
Pour détecter la salinité à la surface du
sol, nous allons calculer un certain nombre d'indices mathématiques sur
les images satellitaires. Ces indices résultent de la combinaison de
plusieurs bandes de même spectre et qui ont été
développés par Abbas et Khan en 2007. Ils sont fondés sur
l'hypothèse que cette transformation rendrait l'information
demandée de salinité plus proéminente tout en supprimant
les effets d'autres utilisation et occupation des sols (Abbas et al.,
2013).L'indice utilisé dans le cadre de cette étude
est celle de salinité par différence normalisée
(NDSI). Ilest appliqué sur les images de Landsat 8.Il exploite
essentiellement la différence de réponse spectrale de la
végétation et des sols dans la bande rouge ® qui est
liée à l'absorption de la lumière par la chlorophylle et
la bande proche infrarouge (PIR) qui est liée à la densité
de la végétation verte. Cet indice permet de différencier
les zones de salinité, il est calculé par le PIR
et le Rougesous la formuleNDSI : (RED-PIR) /
RED+PIR).
Landsat 8 : NDSI = (B4 - B5) / (B4 +
B5)
Avec B4 la bande Rouge et B5 la bande Proche Infrarouge.
Les valeurs obtenus sont des nombres réels allant de -1
à 1.
3.4.3.6 Cartographie des zonesaffectées par la
dynamique saline
Il s'agit de l'identification et de l'estimation des zones
vulnérables face aux terres salines.
? Méthodologie de classification des zones
vulnérables par analyse de proximité
La répartition de la population en 2023, la
distribution des terres salées constante et apparue en 2024 sont
combinées afin de cartographier la population touchée par la
dynamique des terres salées. A partir de la sélection par
emplacement `select by location' par rapport aux terres salées, nous
avons ressortir cinq (5) catégories de populations de la plus
affectée à la moins touchée.
Tableau 10:
Classification de la population selon le degré d'exposition aux
terres salines
|
Catégories populations
|
Emplacement/Terres salées
|
Durée séjour dans terres
salées
|
|
Population extrêmement affectée
|
Intérieur des tannes constantes
|
52 ans
|
|
Population affectée
|
Intérieur des tannes apparues
|
-30 ans
|
|
Population à risque forte
|
A 50 m des tannes récentes
|
0
|
|
Population à risque faible
|
A 100 m des tannes récentes
|
0
|
|
Population sans risque
|
A plus 100 m des tannes récentes
|
0
|
Source : Diouf S. Aziz, Juin
2025
? Méthodologie de classification des zones
vulnérables par analyse multicritère
La cartographie des zones exposées à la
dynamique des terres salines a été obtenue par le processus
d'analyse hiérarchique (AHP). En effet, il s'agit d'une analyse
multicritère basée sur la pondération des facteurs
contribuant aux risques de la salinisation (pluviométrie, topographie,
le sol, texture, etc.). La méthode d'analyse hiérarchique
multicritère (AHP) développée par le mathématicien
Thomas Saaty (1977) est utilisée pour cartographier la
vulnérabilité liée aux terres salées dans la
Commune de Gandon. Sa méthode repose sur certains principes dont la
structuration hiérarchique selon les classes, les critères et
poids définis, la structuration des priorités selon les sous
critères, les rangs et la cohérence logique selon l'indice de
cohérence (IC) et le ratio de cohérence (RC) de la matrice de
comparaison par paire. Elle consiste à comparer les critères deux
à deux en termes d'importance relative par rapport à l'objectif
défini sur la base d'une échelle de pondération. Cette
échelle d'évaluation mesurant l'importance d'un
élément sur un autre.
Tableau 11 :
Echelle de pondération des couches
|
Comparaison d'un critère par rapport à un autre
|
Intensité de l'importance
|
|
Même importance que
|
1
|
|
Modérément plus important que
|
3
|
|
Fortement plus important que
|
5
|
|
Très fortement plus important que
|
7
|
|
Extrêmement plus important que
|
9
|
|
Modérément moins important que
|
1/3
|
|
Fortement moins important que
|
1/5
|
|
Très fortement moins important que
|
1/7
|
|
Extrêmement moins important que
|
1/9
|
Il convient d'abord de définir les facteurs relatifs
à l'extension des terres salées qui constituent en effet les
critères à prendre en considération. Les critères
choisis sont : la pluviométrie, la topographie, le pente, les types de
sol, la texture, les tannes, la densité de la population et le
réseau hydrographique. En fonction de l'échelle numérique,
les facteurs cités ci-dessus sont pondérés par comparaison
binaire.
Tableau 12 :
Matrice de pondération des facteurs selon l'échelle de
Saaty (1977)
|
Facteurs
|
P(mm)
|
Réseau Hydrographie
|
Texture
|
Sol
|
Topographie
|
Pente
|
Densité population
|
|
Pmm
|
1
|
1
|
3
|
3
|
5
|
7
|
9
|
|
Réseau Hydrographie
|
1
|
1
|
3
|
3
|
5
|
5
|
7
|
|
Texture
|
1/3
|
1/3
|
1
|
3
|
5
|
7
|
7
|
|
Sol
|
1/3
|
1/3
|
1/3
|
1
|
3
|
3
|
5
|
|
Topographie
|
1/5
|
1/5
|
1/5
|
1/3
|
1
|
3
|
5
|
|
Pente
|
1/7
|
1/5
|
1/7
|
1/3
|
1/3
|
1
|
3
|
|
Densité population
|
1/9
|
1/7
|
1/7
|
1/5
|
1/5
|
1/3
|
1
|
Le tableau ci-dessus nous a permis de définir les
vecteurs propres pour chaque facteur. Par la suite, le total des lignes pour
chaque facteur est calculé ainsi que la somme totale des lignes avant de
calculer les poids selon la formule: Poids du critère = Total ligne
facteur / Somme des lignes.
Tableau 13:
Calcul du poids relatifs aux différents facteurs après
comparaison deux à deux.
|
Facteurs
|
P(mm)
|
Réseau Hydrographie
|
Texture
|
Sol
|
Topographie
|
Pente
|
Densité population
|
Total Ligne
|
Poids
|
Poids %
|
|
Pmm
|
1
|
1
|
3
|
3
|
5
|
7
|
9
|
29,00
|
0,27
|
27
|
|
Réseau Hydrographie
|
1
|
1
|
3
|
3
|
5
|
5
|
7
|
25,00
|
0,23
|
23
|
|
Texture
|
1/3
|
1/3
|
1
|
3
|
5
|
7
|
7
|
23,67
|
0,22
|
22
|
|
Sol
|
1/3
|
1/3
|
1/3
|
1
|
3
|
3
|
5
|
13,00
|
0,12
|
12
|
|
Topographie
|
1/5
|
1/5
|
1/5
|
1/3
|
1
|
3
|
5
|
9,93
|
0,09
|
9
|
|
Pente
|
1/7
|
1/5
|
1/7
|
1/3
|
1/3
|
1
|
3
|
5,15
|
0,05
|
5
|
|
Densité population
|
1/9
|
1/7
|
1/7
|
1/5
|
1/5
|
1/3
|
1
|
2,13
|
0,02
|
2
|
|
Total
|
|
107,88
|
1,00
|
100
|
L'utilisation d'un SIG permet de spatialiser la
pondération de ces facteurs afin de cartographier les zones
vulnérables. Les facteurs convertis en format raster sont reclassifier.
Ensuite des indices statistiques ont été obtenue suite à
la combinaison de ces différents facteurs effectués avec l'outil
"Overlay_Weighted Overlay" du logiciel ArcGIS en attribuant chaque facteur son
poids en %.
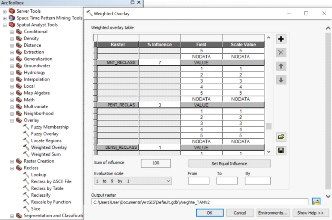
Figure 18 :
Traitement par AHP dans Arcgis
Ce traitement multiple permet d'obtenir des intervalles
d'indices auxquels des classes de vulnérabilité sont
attribuées. Les résultats de l'analyse d'exposition aux terres
salées obtenue par l'AHP mettent en avant 4 classes hiérarchiques
de susceptibilité (très faible, faible, fort, très fort)
sur les facteurs contribuant aux risques d'atteintes par la salinité.Le
résultat est enfin converti en vecteur afin de calculer la part de
chaque classe en ha et sa représentation sous forme graphique.
DonnéesDémographiquesClimatiques
Images Satellitaire Landsat
Base de Données Spatiale
Localisation/Pédologie/Occupation sol
Correction, Calcul d'indices, classification
BV, Relief, Pente
Reclassification
QGIS
ArcGIS
Validation
ArcGIS
CE/pH/Texture (ISRIC)
Données vectorielles
Excel, ArcGIS
ArcGIS
ENVI
Image SRTM MNT
Calcul statistique

QGIS, Excel
ENVI
Classes thématiques
MCD, MLD, MPD
Analyse et visualisation
Cartes
Graphiques
Figure
19 :Schéma méthodologique
Chapitre 4 : Analyse et
interprétation des résultats
Il s'agit de l'analyse et de l'interprétation des
résultats de la variation spatiale de la salinité des sols, que
ceux des unités d'occupation du sol, de la dynamique des terres
salées ainsi que de l'évaluation de la
vulnérabilité paysanne à la dynamique des terres
salines.
4.1. Variation du degré de salinité des
sols
Il s'agit de l'analyse de la répartition en surface et
en profondeur de la salinité à partir de la conductivité
électrique (CE) de sol mais aussi de l'indice de salinité
normalisé.
4.1.1 Distribution
horizontale de l'indice de la salinité normalisé (NDSI)
L'indice différentiel de salinité
normalisé est obtenu à partir de la combinaison des bandes 4 et 5
de Landsat 8 afin de ressortir la variation horizontale de la salinité
de notre milieu d'étude. La carte 6 monte que le degré de
salinité diminue du fleuve vers l'interland. Le fleuve et ses bordures
ont une salinité très forte contrairement aux dunes de
l'intérieur où la salinité est très faible voire
nulle. Cette distribution du degré de salinité se perçois
plus nettement sur la carte 6. En effet, 23920 ha de la Commune de Gandon ont
une salinité faible, 11022 ha une salinité forte et 1632 ha se
voient par une salinité très forte. Seules -4000 ha sur 40322 ha
ont une salinité très faible voire nulle.
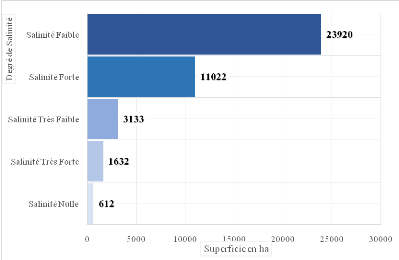
Figure
20 :Degré de salinité des terres du milieu
d'étude en hectare (ha), Diouf S. Aziz, Juin
2025
Carte 6 :
Distribution horizontale de la salinité des sols (NDSI
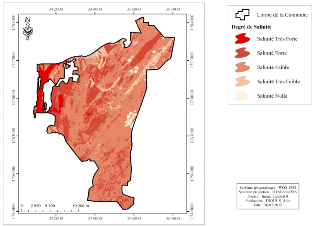
4.1.2 Distribution
verticale du degré de la salinité des sol (CE)
La conductivité électrique mesure le
degré de salinité d'un sol. Les données du ISRIC sont
utilisées dans ce projet pour évalue la salinité des sols
dans les horizons 0-5 cm et 5-15 cm. Cette analyse révèle que les
sols sont non salés à hautement salés avec une CE de 1,5
à 149 dS/m. Par contre, la salinité est ascendante, diminue de la
surface (0-5cm) vers la profondeur (5-15cm). L'horizon 1 est
prédominé par des sols modérément salés
(36%) et hautement salés (50,96%). Et le second par la
prédominance des sols légèrement salés (30,22%) et
hautement salés (50,43%). Cette salinité plus forte en surface
peut-être liée à la texture du sol dominée par du
limon-argileux et sableux dans ce niveau (Planche cart.3). Ces
faciès ne facilitent pas l'infiltration, le lessivage du sol. Cela
favorise le maintien des cristaux de sels en surface, accentué souvent
par l'évaporation.
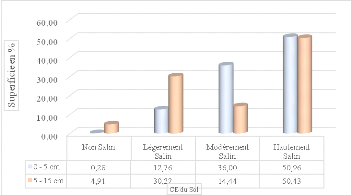
Figure
21 :Superficie (%) de la conductivité électriques
des sols selon les horizons
Planche cartographique 3 : Distribution
verticale de la conductivité électrique (CE) des sols
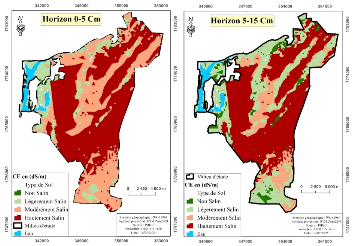
Dans l'ensemble, l'analyse de la variation de la
salinité des sols de la Commune de Gandon révèle des sols
hautement salins à non salins. Toutefois, ces indicateurs varient de la
surfaces vers la profondeur mais aussi de la berge vers l'interland. Le
degré de salinité diminue du fleuve vers la dune et de la surface
vers la profondeur (Carte 2&5) et cela modifie l'état naturel des
unités d'occupation du sol dans le milieu d'étude.
4.2. Evolution spatio-temporelle des unités
d'occupation du sol
Il s'agit de l'analyse diachronique par
télédétection des unités d'occupation du sol de la
Commune de Gandon à partir d'images satellitaires Landsat des
années 1972 à 2024 et des matrices de changement afin
d'appréhender l'influence des tannes sur les autres unités de
paysage.
4.2.1 Dynamique des
unités d'occupation du sol
L'analyse de la dynamique unités paysagères
porte sur les années 1972, 1985, 1998, 2011 et 2024.
Tableau 14 :
Superficie (ha) et (%) des unités d'occupation du sol entre
1972 et 2024
|
Classe d'occupation sol
|
1972
|
1985
|
1998
|
2011
|
2024
|
|
ha
|
(%)
|
ha
|
(%)
|
ha
|
(%)
|
ha
|
(%)
|
ha
|
(%)
|
|
Eau
|
1588
|
4
|
2197
|
5
|
1688
|
4
|
2601
|
6
|
1639
|
4
|
|
Terres Cultivables
|
18960
|
47
|
18064
|
45
|
19828
|
49
|
17446
|
43
|
17203
|
42
|
|
Terres Salées
|
13874
|
34
|
16664
|
41
|
14151
|
35
|
12143
|
30
|
12740
|
35
|
|
Végétation
|
5900
|
15
|
3396
|
8
|
4655
|
12
|
8132
|
20
|
8740
|
19
|
|
Total
|
40322
|
100
|
40322
|
100
|
40322
|
100
|
40322
|
100
|
40322
|
100
|
La situation de 1972 à 2024 résume
l'évolution des unités d'occupation du sol entre 1972 et 2024. Au
cours de ces 52 années, les terres cultivables restent l'unité la
plus importante suivies des terres salées. Par contre, elles voient leur
superficie régressée depuis 2011 à la même
période où celle des terres salée progresse. La
végétation qui occupe la troisième place connait un essor
de sa superficie depuis 1998, quant à l'eau, sa superficie diminue
depuis 2011. Les taux de croissance illustrent ainsi une dynamique positive de
l'eau (3,22%) et de la végétation (48,15%) et négative des
terres cultivables (-9,27%) et des tannes (-8,17%) entre 1972 et 2024
(Fig.26).
|
Unité
|
Tc
(%)
|
|
1 =
|
3,22
|
|
2 =
|
-9,27
|
|
3 =
|
-8,17
|
|
4 =
|
48,15
|
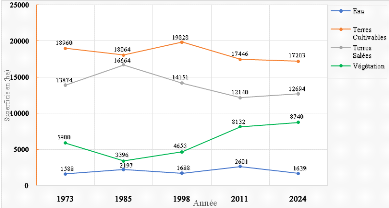
Figure 22 :
Superficie en hectare (ha) des unités paysagères entre 1972 et
2024,Diouf S. Aziz2025
Planche cartographique 4 : Situation des
unités d'occupation du sol entre 1972 e 2024
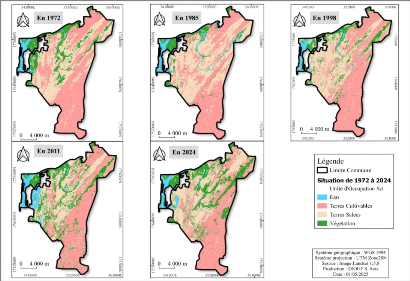
En somme, les unités d'occupation du sol dans la
Commune de Gandon ont toutes connu leur surface évoluée entre
1972 et 2024. Cette évolution se manifeste par une avancée du
couvert végétal et de l'eau et un recul des terres cultivable et
salée. Toutefois, depuis cette dernière décennie, les
terres salées ont une dynamique à tendance positive et
peut-être au détriment des terres cultivables ou de la
végétation d'où l'intérêt de l'analyse des
matrices de changement qui détaillent les transformations entre
unités.
4.2.2 Changement
spatio-temporel des unités entre 1972 et 2024
Les changements spatio-temporels se traduisent par des
modifications (terre culture enterres salée exemple), des conversions
(végétation en eau par exemple) et des stabilités (surface
constante). L'analyse s'est focalisée sur les changements qui sont
intervenus dans la dynamique spatio-temporelle des terres salées au
cours de la séquence1972-2024.
? Séquence 1972-2024
La matrice 1972-2024 se particularise par la réduction
des terres salées. elles ont connu une perte de 1178 ha au
bénéfices de la végétation et de l'espace
cultivable. 2718 ha transformés en végétation, 3472 ha de
terres salées modifiés en terres cultivables. Ces
dernières ont connu une conversion de 2473 ha en
végétation et une modification de 3096 ha en tannes. Toutefois,
elles se singularisent par une stabilité très marquante (13351
ha) en 52 ans.
TC :Terres cultivables
TS :Terres salées
EA :Eau
VG :Végétation
Surface (ha)
3000
5000
100
1000
2000
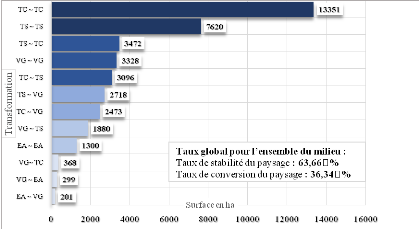
Figure
23 :Transformation des unités d'occupation du sol de 1972
à 2024,Diouf S. Aziz, Juin 2025
Dans l'ensemble, les matrices de changement sont
marquées par la hausse de la superficie du couvert végétal
au détriment des tannes et des terres cultivables même si ces deux
unités restent les plus importantes. Toutefois, elles
révèlent de modifications significatives dans les terres
cultivable et salée. Le comportement de cette dernière est
à énumérer dans la partie suivante.
4.3. Approche géomatique de l'analyse de la dynamique
des terres salées
Il s'agit dans cette partie de l'analyse de la dynamique des
terres salées, les facteursd'origines et ses impacts
environnemento-socio-économiques dans la Commune de Gandon entre 1972 et
2024.
4.3.1 Facteurs de
la dynamique des terres salées
Les facteurs qui commandent la dynamique de terres
salées peuvent êtres d'ordres naturels et anthropiques. Nous
retenons le climat, la texture et la topographie et les pratiques agricoles.
? La variation pluviométrique
Le changement climatique, notamment les fluctuations
pluviométrique, constitue le facteur principal de la dynamique des
terres salées dans la Commune de Gandon. Et cela se voit par les valeurs
du IPS en corrélation avec celles de l'évolution des
unités d'occupation du sol. L'analyse de cette indicateur monte quele
milieu est dominé par une longue période sèche allant de
1971 à 1997 suivie d'une phase humide de 1998 à 2022. En effet,
de 1971 à 2022 (51 années), la Commune de Gandon a connu 28
années de sècheresse contre 23 années humides.
L'année 1971 constitue le début de la sécheresseoù
les terres salées représentent les 34% de la surface des
unités (Tab.12). Après plus d'une dizaine
années desécheresses, (1985 milieu de cette phase), les terres
salines se retrouvent à41% soit une hause de 7% (Tab.12)
avant de diminuer jusqu'à 35% en 1998, le début la
période humide 1998-2022, puis à 30% en 2011 après
l'année de 2010 (extrêmement humide)et13
annéesd'humidité (Fig. 23). Par contre,
elles ont connu une légère hausse de 1% en 2024 due
essentiellement à la petite phase sèche notée de
2014à 2019. Cela justifie que la dynamique des terres salées est
tributaire à la variabilité pluviométrique.
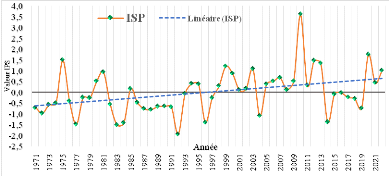
Figure 24: Indice
de Précipitations Normalisé (IPS) de la station de Saint-Louis de
1971 à 2020
? La texture du sol
La texture des sols constitue aussi un facteur qui peut
influencer sur la dynamique saline. En effet, les sols en faciesargileux et
limoneux ont tendance à avoir une conductivité électrique
plus élevée que les sols sableux, car ils retiennent plus d'eau
et de sels solubles.Ces types de sols constituent la couche la plus importante
de notre milieu d'étude. Les sols est essentiellement
limono-argilo-sableuse, avec prédominance de limonet d'argile, de 0
à 5 cm et de 5 à 15 cm (Fig.24).
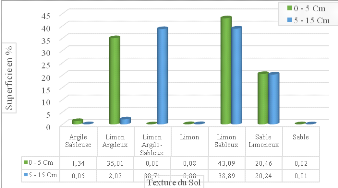
Figure 25 :
Répartition de la surface en % de la texture des sols selon les
horizons
Ces sols en dominante limono-argileux favorisent la
persistance de la salinité sur la zone racinaire mais aussi le non
lessivage du sel car retiennent une quantité d'eau très
élevée dans cette zone où la pluviométrique reste
très précaire. De ce, la texture des sols de la Commune de Gandon
constitue un facteur déterminant de l'accélération de la
salinisation des terres, de leur dynamique en résumé.
Planche cartographique 5 : Distribution
verticale de la texture des sols
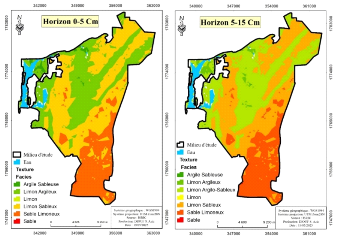
? L'ouverture de la langue de Barbarie en 2003
L'ouverture de la brèche sur la langue de Barbarie en
2003 pour la lutte contre les inondations dans la ville de Saint-Louis a des
effets directs sur la morpho dynamique des unités du milieu. Cette
brèche entraine la réduction des apports fluviaux en favorisant
l'intrusion de la Mer ainsi que l'avancée de la langue salée.Et
cela accélère la salinisation des terres dans les régions
du Delta.
? Les pratiques agricoles
Les pratiques agricoles peuvent favoriser la régression
des terres salées comme les techniques de paillage, de la jachère
ou l'utilisation de matières organiques. Ces techniques agricoles
peuvent améliorer la structure du sol et réduire la
salinité dans les premiers horizons. Par contre, certaines
pratiques agricoles à savoir l'application excessive d'engrais, la
mauvaise gestion de l'irrigation ou une eau d'irrigation salée et le
manque de drainage peuvent contribuer à l'augmentation de la
salinité des sols.D'autres facteurs contribuent à la dynamiques
des terres salées dans notre milieu (barrage de Diama), l'intrusion
marine, la topographie, le déboisement et l'exploitation du sel.
4.3.2
Caractérisation de la dynamique de terres salines de 1972 à
2024
Il s'agit de la cinématique et de l'analyse de la
dynamique des terres salées dans le milieu d'étude.
? Détection des terres salées de 1972 à
2024
La cinématique des terres salines révèle
leur prédominance en 1985 avec 16663,5 ha soit un taux de 23,97% des
tannes totales. Ce pic enregistré en 1985 se justifie par la
récurrence de la sécheresse1970 à 1997. Ces tannes ont
connu une régression en 1998 de -3,62% et continue en 2011 avec 12139,9
ha (17,46%). Toutefois, les terres salines ont connu un redressement en 2024 de
plus de 500 ha contre 2011. Cette situation progressive des tannes depuis 2011
monte que leur dynamique actuelle est à tendance extensive dans la
Commune de Gandon.
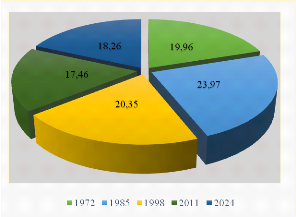
Figure 26 :
Superficie des terres salées en pourcentage (%) entre 1972 et 2024
La figure ci-dessus résume les taux de la superficie des
tannes 1972, 1985, 1998, 2011 et 2024.
Tableau 15:
Superficie en hectare (ha) des terres salines entre 1972 et 2024
|
Années
|
1972
|
1985
|
1998
|
2011
|
2024
|
Moyenne
|
|
Superficie(ha)
|
13874,1
|
16663,5
|
14150,6
|
12139,9
|
12693,9
|
13904,4
|
Le tableau ci-dessus résume la superficie qu'occupe les
terrains salées par rapport à la superficie totale de la Commune
de Gandon en ha (40322 ha) entre 1972 et 2024.
Carte 7 :
Cinématique de terres salines entre 1972 et 2024
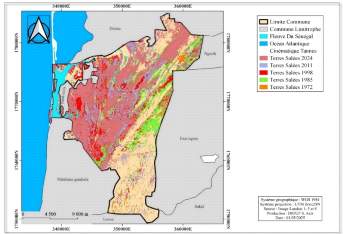
? Dynamique de terres salines de 1972 à 2024
Le suivi de la dynamique de terres salines met en exergue leur
tendance (recul ou avancée) mais aussi permet de localiser avec
exactitude les terres salées disparues, celles apparues et les terres
salées constantes entre 1972 à 2024. Au cours d'une
période de 52 années de suivi, les terres salines ont connu une
dynamique à tendance négative (-1160,17 ha). Cela s'explique par
ses 6253,70 ha disparues contre seulement 5073,53 ha apparues en 2024. La
terres salées constantes ou stables, représentent 7620,36 ha
entre 1972 et 2024 Entre 1972 et 2024, les tannes ont donc perdu 33% de leur
superficie contre 27% de gain et 40% de superficie stable. Soit une chute de 6%
en 52 années.
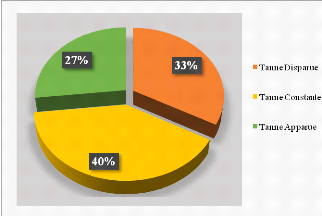
Figure 27 :
Superficie des catégories de terres salées en
pourcentage de 1972 à 2024
Néanmoins, depuis 2011, les tannes ont une tendance
extensive. Elles évoluent de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire du
jeri vers le milieu insulaire (l'embouchure du Delta du Fleuve
Sénégal). Cela se voit plus nettement par la carte 15 où
les tannes disparues se situent dans la partie Est, celles constantes au milieu
et les tannes apparues dans la partie ouest de la commune de Gandon.
Carte 8 :
Distribution spatiale de la dynamique des tannes dans le milieu entre
1972 et 2024
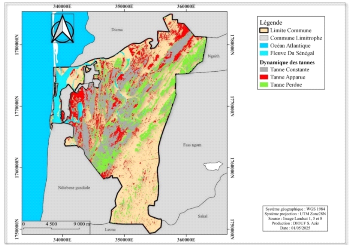
Dans l'ensemble, les terres salées ont connu une
dynamique régressives de 1972 à 2024 avec une perte de 34 % de
leur superficie contre un gain de 27 % en 2024. Les 40 % de leur surface n'ont
pas subi de changements durant ces 52 dernières années.
Malgré, cette régression, leur comportement actuel à
tendance à avancer depuis 2011 et cela peut entrainer de lourds
dégâts.
4.2.3 Catastrophes
susceptibles liées à la dynamique des terres salées
Plusieurs impacts négatifs peuvent être
liés à la dynamiques des terres salées dans le milieu.
Nous pouvons retenir entre autres ceux énumérés dans
le schéma ci-dessous.
Reduction croissance
Dégradation structurale
Imperméabilisation
Infertilité do sol
Stress osmotique
Augmentation densité apparente
Sur le sol
Mort de plantes
Sur la végétation
Manque d'eau propre
Toxicité ionique
Mort de bétails
Rareté de nourriture
Extension des terres salées
Reduction productivité
Sur l'élevage
Infertilité du sol / Perte de terres arables
Disparition biomasse
Abadon de l'agriculture
Impropre à la consommation
Modification chimique
Baisse rendements Incultivable du sol
Sur l'agriculture
Alteration de la qualité
Sur l'eau potable
Alteration du goût
Déshydratation/ Flétrissement de la culture
Surla société
Migration forcée
Insécurité alimentaire
conflits ressources
Essor de la pauvreté
Problèmes de santé
Figure 28 :
Catastrophes susceptibles d'être entrainées par la
dynamique saline
Une vie saine et durable incertaine pour les
générations futures
4.4. Approche géomatique de la caractérisation
des zones vulnérablesaux terres salines
L'identification des zones susceptibles d'être
affectées par les terres salées est primordiale pour une gestion
meilleure. Pour délimiter les zones exposées, deux approches ont
été utilisés : l'analyse multicritère basée
sur les facteurs majeurs et l'analyse de proximité sur l'emplacement de
localités.
4.4.1
Identification des populations vulnérables par approche SIG (analyse de
proximité)
En se focalisant sur l'emplacement et l'ancienneté de
séjour des localités par rapport aux catégories de terres
salées (Cf. Carte 15), nous avons pu ressortir les populations plus
vulnérables à la dynamique des tannes. Ainsi, nous avons les
localités les extrêmement touchées et les localités
modérément touchées par les tannes. Ensuite, les
localités à forte risque et celle à risque faible
d'être affectées par les terres salées et enfin les
localités qui ne courent aucun risque.
Tableau 16 :
Classification des localités selon le degré d'exposition aux
terres salées
|
Bop Thior
|
Plus touchée
|
Keur Martin
|
Risque forte
|
Selguire
|
Risque faible
|
|
Diama Toube
|
Plus touchée
|
Maka Toube
|
Risque forte
|
Thierigne
|
Risque faible
|
|
Gandon
|
Plus touchée
|
Makhana
|
Risque forte
|
Yamane Sogue
|
Risque faible
|
|
Ndiakhere
|
Plus touchée
|
Mbarar Sow
|
Risque forte
|
Baity Dieye
|
Risque aucune
|
|
Ndialakhar Ouolof
|
Plus touchée
|
Mbarigo
|
Risque forte
|
Gouye Toure
|
Risque aucune
|
|
Tode
|
Plus touchée
|
Merina Bara
|
Risque forte
|
Keur Madiop Bassine
|
Risque aucune
|
|
Bekhar
|
Touchée
|
Ndiakhip 2
|
Risque forte
|
Khatali 2
|
Risque aucune
|
|
Sanar Peulh
|
Touchée
|
Ndiaoudoune
|
Risque forte
|
Khelcom Diao
|
Risque aucune
|
|
Lampsar
|
Touchée
|
Ndiebene Toube Peulh
|
Risque forte
|
Minguegne Boye
|
Risque aucune
|
|
Leybar Boye
|
Touchée
|
Ngaye
|
Risque forte
|
Ndiakhip 1
|
Risque aucune
|
|
Ndiaoussir Lebou
|
Touchée
|
Ngaye
|
Risque forte
|
Ngayna Wolof
|
Risque aucune
|
|
Ndiebene Toube Wolof
|
Touchée
|
Thilla 1
|
Risque forte
|
Nguigalakh Ouolof
|
Risque aucune
|
|
Nguigalakh Peulh
|
Touchée
|
Iba Balla
|
Risque faible
|
Panket Sarr
|
Risque aucune
|
|
Rao Peulh
|
Touchée
|
Iba Peulh
|
Risque faible
|
Poundioum
|
Risque aucune
|
|
Sanar Ouolof
|
Touchée
|
Merina Sall
|
Risque faible
|
Rahmane Sall
|
Risque aucune
|
|
Boudiouck
|
Risque Forte
|
Ndialakhar Peulh
|
Risque faible
|
Sinthiou Rahmane
|
Risque aucune
|
|
Diama Thiaguel
|
Risque Forte
|
Ndialame Bambara
|
Risque faible
|
Thiar Moussa Diop
|
Risque aucune
|
|
Fass Dieye
|
Risque Forte
|
Rao Gare
|
Risque faible
|
Touba Guene
|
Risque aucune
|
|
Gobag
|
Risque Forte
|
Nombre de localité : a = 6 ; b = 9 ; c = 16 ; d
= 9 ; e =15
|
|
|
a) Intérieur des tannes constantes
|
|
b) Intérieur des tannes récentes
|
|
c) A 50 m des tannes
|
|
d) A 100 m des tannes
|
|
e) A plus de 100 m
|
En effet, les localités extrêmement
affectées par les terres salines sont au nombre de 6, occupent 7% de la
population totale de la Commune et correspondent à celle qui ont
séjourné pendant 52 années à l'intérieur des
terres salées (1972 à 2024). Les localités touchées
correspondent à celles séjournant à l'intérieur des
terres salines récentes ou apparues entre 2011 et 2024 (- 20 ans),
comptent 9 localités et regroupent 26534 hbts, soit 39% de la population
totale. Les localités à forte risque d'être
affectées sont l'ensemble des localités situées à
50 m des terres salines actuelles. Elles sont au nombre de 16 et renferment
25223 hbts en 2023 soit les 37% de la population de Gandon. A la
quatrième position se voient les localités à risque faible
d'atteinte par les terres salées. Ces localités qui comptent 9 et
regroupent 6% de la population, représentent celles qui se situent
à 100 m des terres salines actuelles. Enfin, les localités sans
risque d'atteinte par les terres salées correspondent aux villages
localisés à plus de 100 m des terres salines. Ces
localités sont au nombre de 15 et leur population est estimée
à 7694 hbts soit les 11% (Fig.33).
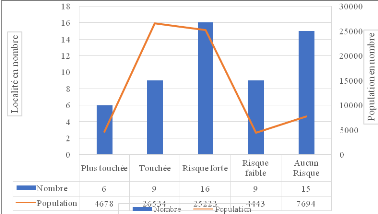
Figure 29:
Répartition de la Population selon le niveau de
vulnérabilité à la dynamique saline
Cette analyse de proximité (Emplacement) par rapport
aux terres salines renseigne alors sur le comportement actuel de la population
face à la dynamique des tannes dans la Commune de Gandon. La carte
ci-dessous illustre parfaitement ces degrés de sensibilités.
Carte 9 :
Degré d'exposition des localités aux terres salines par approche
SIG (proximité)
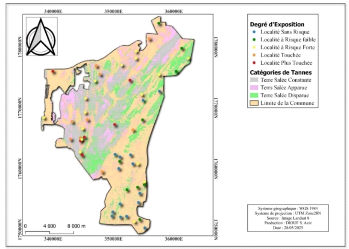
Dans l'ensemble, 33712 hbts sur 71080 soit un taux de 47%(15
localités/55) sont affectés par les terres salées en 2024.
25223 hbts dans 16 localités, soit 35%, courent un très grand
risque d'être atteints par l'extension des terres salées. Par
contre, seuls 18% de la population sont sans risque.
4.4.2
Détermination des zones vulnérables par approche analyse
multicritère (AHP)
L'identification des zones vulnérables aux terres
salées (carte 10) a été faite selon l'approche
multicritère de SAATY (voir méthodologie).En effet, 43% de zones
de la surface totale du milieu est fortement à très fortement
vulnérable à terres salées, 46% d'une
vulnérabilité très faible et 11% de zones avec une
très faible vulnérabilité de salinisation des terres.
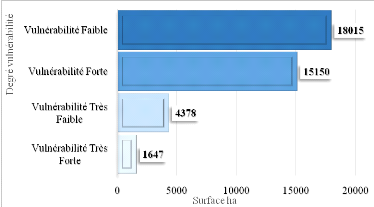
Figure :Répartition de la
superficie du degré de vulnérabilité en hectare (ha)
La figure 34 ci-dessus représente la répartition de
la superficie du degré de vulnérabilité en (ha).
Carte
10 :Degré de vulnérabilité des zones selon
la méthode AHP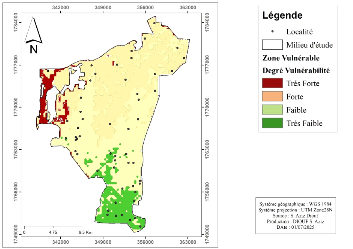
La carte 10 monte que les zones le long du fleuve
Sénégal sont plus exposées aux terres salées par
rapport à celles à l'intérieur des terres.Nous
avons les 4 classes suivantes:
? Une très forte vulnérabilité dans les
zones bordant les cours d'eau ;
? Une forte vulnérabilité le long du marigot de
Ngalam et au centre ;
? Une faible vulnérabilité du centre vers le sud
du milieu ;
? Une très faible vulnérabilité dans les
zones au Sud du milieu d'étude.
4.4.3 Proposition
d'un modèle de gestion des terres salines par apport
géomatique
Conscientisation
Stratégie prévention
Stratégie remédiation
Stratégie d'adaptation
Pour une bonne gestion des terres salées, la maitrise
de leur dynamique, les facteurs liés et l'identification des zones
vulnérables sont primordiales. Ces critères combinées nous
ont permis d'établir cette proposition pour une gestion équitable
et durable de l'extension des terres salines.
Sans risque
Peu affectées
A risque
Extrêmement affectées
A l'intérieur
A l'intérieur
Loin
Proche
Terres salées apparues&constante
Terres salées apparues
Terres salées Constante
Emplacement
Zones/ Populations
Sens
Catégories
Tendance
Vulnérabilité population
Dynamique terres salées
Maîtrisedes terres salées
Figure 30 :
Model de gestion des terres salées par approche géomatique
Facteurs
Impacts
Conclusion
Ce projet intégrateur vise à étudier la
dynamique des terres salées dans la Commune de Gandon grâce aux
outils à la géomatique. Il s'agit notamment de la
caractérisation de la dynamique des terres salées et ses facteurs
mais aussi de l'identificationdes populations affectées par cette
dynamique.Ainsi, l'approche méthodologique adopté pour la
réalisation d'un tel travail s'est basée sur une analyse
diachronique de l'évolution des unités d'occupation du sol de
1972 à 2024 à partir d'images satellitaires Landsat.Puis, la
cartographie des terres salées et de la distribution verticale et
horizontale du degré de salinité des sol (CEet NSDI) ainsi que
l'analyse de vulnérabilité de la population face à la
dynamique saline des terres.
Les résultats issus de l'analyse de la
répartition horizontale du degré de salinité des sols
(NDSI) montent queseules -4000 ha sur les 40322 ha de la Commune de Gandon ont
une salinité très faible voire nulle. 23920 ha ont une
salinité faible et 12654 ha une salinité forte à
très forte. Ces résultats sont appuyés par ceux de la
variation verticale révélant que la salinité des sols est
ascendante, diminue de la surface (0-5cm) vers la profondeur (5-15cm) avec des
sols sont non salés à hautement salés. La CE de 1,5
à 149 dS/m. En outre, l'analyse diachronique des unités
d'occupation du sol illustre une dynamique positive de l'eau (3,22%) et de la
végétation (48,15%) et négative des terres cultivables
(-9,27%) et des tannes (-8,17%) entre 1972 et 2024. Ce recul de la superficie
des terres salées est aux bénéfices de la
végétation et de l'espace cultivable d'après la matrice de
changement 1972-2024 où 2718 ha transformés en
végétation, 3472 ha de terres salées modifiés en
terres cultivables.Ces résultats sont accentués par ceux obtenus
sur l'analyse de la dynamique des terres salées qui
révèlentune perte de 34 % de leur superficie contre un gain de 27
% de1972 à 2024. 40 % de la surface des tannes n'ont pas changés
durant ces 52 dernières années. Toutefois, malgré, cette
régression notable, leur dynamique actuelleest à tendance
extensive depuis 2011 et cela affecte la population riveraine. En effet, 33712
hbts sur 71080 soit un taux de 47% (15 localités/55) de la population
gandonoise sont très affectés par les terres salées depuis
plus de 30 années. Et 25223 hbts dans 16 localités, soit 35%,
courent un risque très grand d'être atteints par l'extension des
terres salées. Seuls 18% de la population qui vivent dans 24
villagesrestentactuellement sans aucun risque face à la dynamique saline
des terres.
Face à cette situation très alarmante, il est
urgent de vulgariser les recommandations ci-après pour une gestion
meilleure et une restauration efficace des terres salées dans la Commune
de Gandon.
Recommandations
Nous recommandons aux acteurs de l'Etat, du privé et la
population riveraine de mettre en place ensemble des stratégies de
résiliencesefficaces afin de mieux gérer les terres
salées. Ainsi :
Pour la prévention:
La surveillance la qualité de l'eau d'irrigation.
L'amélioration efficience de l'utilisation de l'eau,
surtout si elle est de mauvaise qualité, pour apporter le moins de sels
possible sur les parcelles.
L'apport sur le long terme plus d'eau douce (d'irrigation et de
pluie) que ce qui estévapotranspiré et la drainer, afin de
lessiver suffisammentles parcelles agricoles.
Pour tentatives de remédiation :
Lessiver les parcelles avec de l'eau douce et bien drainer pour
emporter les sels en dehors de la zone racinaire.
Améliorer la structure des sols et l'infiltration de l'eau
par des apports de matière organique.
Restaurer la fertilité des sols par des amendements
organiques et chimiques.
Limiter l'évaporation au profit de l'infiltration
(mulching, goutte-à-goutte).
Drainer en profondeur pour maintenir une nappe d'eau saline
superficielle en dehors de la zone racinaire.
De digues et barrages anti-sels afin de réduire
l'avancée de l'eau salée sur les terres arables.
Pour l'adaptation :
Le nivellement qui consiste à l'application uniforme de
l'eau, ce qui entraine un meilleur lessivage. Un contrôle uniforme de la
salinité.
Le travail du sol par la préparation du lit de semence
afin d'augmenter sa perméabilité.
Le labour profond dans le cas d'une couche imperméable
profonde afin d'améliorer son état physique et ses
capacités d'infiltration.
Le semis sur lits en pente ou sillons surélevés
pour limiter l'accumulation de sel autour des semences.
Le reboisement d'espèces végétales
très résistantes au sel : mangrove, arbre à sel,
filao, ... dans la zone de la vasière ou sur les tannes vifs afin de
réduire leur progression.
Bibliographie
Lozet J. et Mathieu C. (2002), Dictionnaire de Science du sol.
Edition TEC et DOC, 11, Paris, Londres-Paris-New York, 575 p
FAO, 2015,Les sols sont une ressource non renouvelable, Leur
préservation est essentielle pour garantir la sécurité
alimentaire et un avenir durable, Journée Internationale des Sols,
en ligne : fao.org/soils-2015
Centre de Suivi Ecologique (CSE), 2010, Rapport sur
l'état de l'environnement au Sénégal, Dakar, 266p.
FAYE Bineta, 2017, Dynamique de la salinisation des
terres de 1971 à 2010 et variation climatique le Nord de l'estuaire du
Saloum (Sénégal), thèse de doctorat, Ucad, 354p.
SOW El Hadji, 2019, Dynamique de
l'écosystème mangrove de la réserve de biosphère du
Delta du Saloum (RBDS), Sénégal, de 1965 à 2017 et analyse
des politiques de restauration, thèse de doctorat, UGB, 245 p.
DIOUF Serigne Aziz, 2023, Dynamique des unités
morphologiques le long de l'île de Diamniadio à Faoye de 1970
à 2020, mémoire de recherche, Ucad, 184p.
NDIAYE Saye, 2023, Impacts de la salinisation dans les
îles de Mar de 1961 à 2020, memoire de recherche, Ucad,
155p.
GAYE Mar et al., 2024, « Influences chimiques des eaux
estuariennes du fleuve Casamance sur l'agrosystème de la commune de
Karantaba (région de Sédhiou, sud du Sénégal)
», DaloGéo, N° 1, 17p.
FAYE Cheikh Ahmed Tidiane et al., 2024 «
Dégradation chimique des terrains agricoles du bassin versant de
Soungroungrou (moyenne Casamance, Sénégal) », Les
Cahiers de l'Acaref, Vol.6, No 18, pp.197-211.
FAYE Cheikh Ahmed Tidiane, GAYE Mar, DIOUF Serigne Aziz, 2024
« La salinisation des unités morpho-pédologiques le long du
marigot de Faoye (Delta du Saloum, Centre-Ouest du
Sénégal) », in Journal International des Sachants,
Vol.1, N°1, ISSN-P: 3079-3009, 17p.
TOURE Mame Aissatou, 2018, « Variabilité
climatique et dynamique des écosystèmes du Delta du fleuve
Sénégal des années 1950 aux années
2010 », thèse de doctorant, UCAD, 483p.
Web graphie
https// :
www.bibnum.ucad.sn
https://earthexplorer.usgs.gov
https// :
www.memoireonline.com
https://www.universalis.fr
http://tecfaetu.unige.ch
https://www.geosenegal.gouv.sn
Table des matières
Sommaire
I
Avant-propos
II
Remerciements
II
Dédicaces
III
Liste des abréviations
IV
Liste des illustrations
V
Introduction
1
Chapitre 1 : Fondement théorique et
conceptuel
2
1.1. Problématique
2
1.1.1. Contexte
2
1.1.2. Objectifs et hypothèses de
recherche
3
? Objectifs de recherche
3
? Hypothèses de recherche
4
1.2. Analyse des concepts
4
Chapitre 2 : Présentation du milieu
d'étude
7
? Situation du milieu d'étude
7
2.1. Le cadre physique
8
2.1.1 La topographie
8
2.1.2 L'Hydrologie
9
2.1.3 La pédologie
10
2.1.4 L'occupation du sol
10
2.1.5 Le climat
11
2.2. Le cadre humain
13
2.2.1. La démographie
13
? L'évolution de la population
13
? La densité de la population
14
2.2.2. Les activités
socio-économiques
15
? L'agriculture
15
? L'élevage
16
Chapitre 3 : Approche
méthodologique
16
3.1. La revue documentaire
16
3.2. Acquisition de données
complémentaires
17
3.3. Recueil et acquisition de
données satellitaires
18
3.3.1. Mode d'acquisition des données
satellitaires Landsat
18
3.3.2. Les données Landsat
utilisées
20
3.3.3. Caractérisation des bandes
spectrales des Capteurs satellitaires
20
3.4. Traitement et analyses des
données recueillies
22
3.4.1 Matériels et Logiciels
22
3.4.2 La modélisation des
données
22
? Le Modèle Conceptuel de
Données (MCD)
23
? Le Modèle Logique des
Données (MLD)
24
? Le Modèle Physique des
Données (MPD)
25
3.4.3 Méthodologie appliquée
au traitement des données
25
3.4.3.1 Attributaires
25
3.4.3.2 Les données
physico-chimiques
27
? La Conductivité Electrique
(CE) :
27
? La Texture des sols
27
3.4.3.3 Traitement des images
satellitaires
27
? Le prétraitement
28
? La classification
34
? Validation de la classification
35
? La cartographie et la statistique des
unités d'occupation du sol
36
? La détection des changements
37
3.4.3.4 La cartographie des terres
salées
37
3.4.3.5 Calcul de l'Indice de
Salinité par Difference Normalisée (NDSI)
38
3.4.3.6 Cartographie des zones
affectées par la dynamique saline
38
? Méthodologie de classification des
zones vulnérables par analyse de proximité
38
? Méthodologie de classification des
zones vulnérables par analyse multicritère
39
Chapitre 4 : Analyse et interprétation
des résultats
43
4.1. Variation du degré de
salinité des sols
43
4.1.1 Distribution horizontale de l'indice
de la salinité normalisé (NDSI)
43
4.1.2 Distribution verticale du degré
de la salinité des sol (CE)
44
4.2. Evolution spatio-temporelle des
unités d'occupation du sol
45
4.2.1 Dynamique des unités
d'occupation du sol
46
4.2.2 Changement spatio-temporel des
unités entre 1972 et 2024
47
? Séquence 1972-2024
47
4.3. Approche géomatique de l'analyse
de la dynamique des terres salées
48
4.3.1 Facteurs de la dynamique des terres
salées
48
? La variation pluviométrique
48
? La texture du sol
49
? L'ouverture de la langue de Barbarie en
2003
50
? Les pratiques agricoles
50
4.3.2 Caractérisation de la dynamique
de terres salines de 1972 à 2024
50
? Détection des terres salées
de 1972 à 2024
51
? Dynamique de terres salines de 1972
à 2024
52
4.2.3 Catastrophes susceptibles liées
à la dynamique des terres salées
54
4.4. Approche géomatique de la
caractérisation des zones vulnérables aux terres salines
55
4.4.1 Identification des populations
vulnérables par approche SIG (analyse de proximité)
55
4.4.2 Détermination des zones
vulnérables par approche analyse multicritère (AHP)
57
4.4.3 Proposition d'un modèle de
gestion des terres salines par apport géomatique
58
Conclusion
59
Bibliographie
61
Table des matières
62



