|
Adresses
Adresse
agororachid@yahoo.fr
www.agororachid.blogspot.com
Dédicace
Dédicace
Je dédie ce travail à :
~ Dieu être éternel, unique, Tout Puissant et
Miséricordieux, Créateur et Juge des révélations
Islamique et Biblique,
~ Mon Papa Mr OURO-AGORO Tchadikêni pour son soutien moral
et financier,
~ Ma maman Mme OURO-AGORO Ramatou, qui m'a engendré,
nourri et éduqué au prix du sacrifice, dont le soutien moral et
matériel m'a conforté dans l'élaboration de ce travail.
~ Mr et Mme TCHADJEI qui, non seulement m'ont offert une
hospitalité mais aussi m'ont permis tant bien matériellement que
financièrement de travailler dans un environnement décent,
~ Mr TELOU Balakinèbawi Ingénieur des travaux
à Togo Telecom,
~ Mr OURO - BAWINAY Taïrou et ADELON F. Nouk pour leur
soutien,
~ Mes frères et soeurs qui ont toujours eu confiance en ma
réussite,
~ Tous les parents et amis dont le soutien a permis de finaliser
ce travail,
Que tous retrouvent ici l'expression de notre profonde
gratitude pour leur disponibilité et leurs conseils avisés pour
l'aboutissement de ce travail que nous avons l'honneur de présenter.
Remerciement
Remerciement
Nos vifs remerciements à :
~ Mr NOUPOUKOU Damipi
Directeur Général de la Compagnie Energie
Electrique du Togo (CEET) qui nous a offert ce stage,
~ Mr Abass ABOULAYE qui a mis à notre disposition son
temps, des documents et sa personne pour la réalisation et la
réussite de ce travail,
~ Mr OURO YONDOU Essowavana Chef Service Exploitation à la
CEET pour l'intérêt qu'il a accordé à ce travail,
~ Mr TOVIAWOU Koffi Chef Service Maintenance à la CEET,
~ Mr DJOSSA pour m'avoir donné des conseils,
~ Mr KPOGNON Adadé, Enseignant à l' ENSI
Université de Lomé ; pour sa disponibilité.
Nos remerciements vont également à l'endroit :
De tous les enseignants de l'Institut Supérieur de
Management et de Développement, (ISMAD)
Et de tout le personnel de L'ISMAD.
Table des matières
Dédicace
. i
Remerciement ii
Table des matières .. iii
Table des figures . vii
Liste des abréviations . viii
Introduction générale . .... 1
Chapitre 1 : Présentation du réseau HTA et
BTA de Lomé .. 2
Introduction . 3
1.1 Classification des tensions 3
1.2 Le réseau HTA ... 4
1.2.1 Les postes de répartition . 4
1.2.2 Le réseau aérien 5
1.2.3 Le réseau souterrain 5
1.3 Le réseau BTA ... 8
1.3.1 Les postes de transformation HTA/BTA 8
1.3.1.1 Les postes cabines 8
1.3.1.2 Les postes H61 . 9
1.3.2 Le réseau aérien . 9
1.3.2.1 Les supports . 10
1.3.2.2 Les armements . 10
1.3.3 Le réseau souterrain 10
1.4 Le branchement . 10
1.4.1 Le branchement aérien 11
1.4.2 Le branchement aéro-souterrain . 11
1.4.3 Le branchement souterrain .. 11
1.5 La télé-conduite du réseau 12
Conclusion 12
Chapitre 2 :
Généralités sur la sous-traitance et le
contrôle des travaux de construction de réseau . 13
Introduction 14
2.1 La sous-traitance 14
2.1.1 Notion générale .. 14
2.1.2 Les différents types de la sous-traitance . 14
2.1.2.1 La sous traitance de spécialité .. 15
2.1.2.2 La sous traitance de capacité ... 15
2.1.2.3 La sous traitance de marché . 15
2.1.3 Procédure d'exécution des travaux par les
sous-traitants 15
2.1.3.1 Travaux sous-traités par la CEET . 15
2.1.3.2 Travaux traités et réalisés par les
sous-traitants 17
2.2 Le contrôle 18
2.2.1 Connaissances des équipements électriques
rentrant dans la
construction de réseau électrique aérien
HTA/BTA .. 18
2.2.1.1 Les câbles . 19
2.2.1.2 Les armements . 19
2.2.1.3 Les isolateurs 20
2.2.1.4 Les supports . 21
2.2.1.5 Le parafoudre ... 21
2.2.1.6 L'éclateur . 22
2.2.1.7 Le transformateur . 23
2.2.1.8 Les interrupteurs aériens .. 24
2.2.1.9 Le disjoncteur haut du poteau (DHP) ... 25
2.2.1.10 La console .. 26
2.2.1.11 La pince de suspension 27
2.2.2 Les phases actuelles de contrôles des travaux . 27
2.2.2.1 La phase préparatoire du chantier 27
2.2.2.2 La phase de pose des équipements 28
2.2.2.3 La phase d'essais et mesures 30
Conclusion 30
Chapitre 3 : Diagnostic et approches de solutions
31
Introduction 32
3.1 Diagnostic 32
3.2 Approches de solutions .. 33
3.2.1 Solutions pour
l'amélioration de la qualité de service
et de réduction des pertes sur le réseau 33
3.2.1.1 Réhabilitation et renforcement des composants du
réseau 34
3.2.1.2 Ramener la chute de tension dans les limites
prescrites par les normes 34
3.2.2 Solutions pour l'amélioration du contrôle des
travaux 34
3.2.2.1 La mise sur pied d'une équipe d'inspection
périodique
des réseaux électriques 35
3.2.2.2 Amélioration de la performance des équipes
de contrôle 35
3.2.3.3 La maîtrise des équipements
électriques du réseau . 35
3.2.3.4 La maîtrise du facteur temps ... 36
3.2.3.5La maîtrise des appareils de contrôle
37
3.2.3.6 Quelques valeurs admissibles des terres des ouvrages neufs...
37
Conclusion .. 37
Chapitre 4 : Présentation du logiciel GESATCRE
39
Introduction 40
4.1 Accès aux bases de données avec Visual Basic
40
4.2 Les fonctions du logiciel . 40
4.3 Présentation du logiciel .. 40
4.4 Présentation des menus et sous-menus de GESATCRE
43
4.4.1 Le menu `Traitement' . 44
4.4.1.1 Le sous-menu `Enregistrement des travaux' 44
4.4.1.2 Le sous-menu `Réception définitive' 46
4.4.2 Le menu `Consulter' 48
4.4.2.1 Le sous-menu `Travaux effectués' .. 48
4.4.2.2 Le sous-menu `Travaux définitivement clos' ..
48
4.4.3 Le menu `Administrateur' .. 49
4.4.3.1 Le sous-menu `Utilisateur' .. 49
4.4.3.2 Le sous-menu `Société' 50
4.4.4 Le menu `Etat' 51
4.4.4.1 Le sous-menu `Etat récapitulatif des Travaux
effectués' 51
4.4.4.2 Le sous-menu `Etat récapitulatif des Dossiers' ...
52
4.4.4.3 Le sous-menu `Etat récapitulatif des Courriers' .
52
4.5 Configuration matérielle et logicielle 53
4.6 Installation de `GESATCRE' 53
4.7 Les avantages qu'offre l'application .... 54
Conclusion 54
Conclusion générale .. 56
Bibliographie 57
Annexe 58
Tables des figures
Table des figures
Figure 1.1 : Schéma du réseau HTA de Lomé ..
7
Figure 2.1 : Les différents types de câbles 19
Figure 2.2 : Un armement dans un réseau électrique
. 20
Figure 2.3 : Les Isolateurs fixés sur les ferrures 21
Figure 2.4 : Les Parafoudres dans un réseau
électrique . 22
Figure 2.5 : Un Ensemble d'éclateur dans un réseau
électrique . 23
Figure 2.6 : Un transformateur H61 dans un réseau
électrique .. 24
Figure 2.7 : Vue de dessous d'un IACM et ses accessoires ...
25
Figure 2.8 : Un Disjoncteur Haut du Poteau .. 26
Figure 2.9 : Console et Pince de suspension .. 27
Figure 4.1 : Interface d'accueil . 41
Figure 4.2 : Boite de connexion à `GESATCRE' .. 42
Figure 4.3 : Boite de message de la connexion à `GESATCRE'
42
Figure 4.4 : Interface d'entrée 43
Figure 4.5 : Le sous menu du menu `Traitement' .. 44
Figure 4.6 : Interface `d'enregistrement des Travaux' 45
Figure 4.7 : Interface de la `Réception
définitive'. 46
Figure 4.8 : Boite de dialogue permettant de
confirmer la suppression. 47
Figure 4.9 : Les sous-menus du menu `Consulter' 48
Figure 4.10 : Interface de la liste des `Travaux
effectués' . 49
Figure 4.11 : Les sous-menus du menu `Administrateur' .. 49
Figure 4.12 : Interface `Utilisateur' 50
Figure 4.13 : Interface `Société' 51
Figure 4.14 : Les sous-menu du menu `Etat' . 51
Figure 4.15 : Interface `Etat des dossiers' . 52
Figure 4.16 : Interface de la copie des fichiers .. 53
Figure4.17 : Interface d'installation de `GESATCRE' . 54
Liste des abréviations
Liste des abréviations
HTA : Haute Tension Catégorie A
BTA : Basse Tension Catégorie A
BCC : Bureau Central de Commande
CEB : Communauté Electrique du Bénin
CEET : Compagnie Energie Electrique du Togo
F24C Modè : e Modèle de fabrication de l'ouvrage de
l'entreprise MERLIN GERIN
DHP : Disjoncteur Haut du Poteau
CPI : Câble Papier Imprégné
HN33S23 : Nomenclature de la composition du câble
synthétique ALU : Aluminium
IACM : Interrupteur Aérien à Commande
Mécanique
IAT2 : Interrupteur Aérien Télécommande type
2
SF6 : Hexafluorure de souffre (gaz)
HPC : Haute Pouvoir de Coupure
CCP : Coupe Circuit Principal
Introduction générale
Introduction générale
Concevoir un réseau électrique, c'est
prévoir son développement et décider des modifications
à apporter au moment opportun.
La CEET ayant pour mission principale la distribution de
l'énergie électrique, elle entreprend sans cesse aussi les
travaux de construction et d'extension de réseaux électriques.
Malgré les efforts faits par la CEET dans la construction de
réseau électrique, on note des insuffisances dans les travaux de
construction de réseaux électriques d'une part et dans la
qualité de service du réseau d'autre part.
C'est pour pallier ces défauts que nous nous sommes vus
confiés l'étude sur « La sous-traitance et le
contrôle des travaux de construction de réseau électrique
aérien HTA/BTA ».
Les objectifs suivants nous ont été assignés
:
- Analyser les travaux de construction de réseau
électrique,
- Faire des propositions de solutions visant à
améliorer les insuffisances constatées.
Cette étude est spécifique au bureau d'Etude et
Contrôle conformément au cahier des charges qui nous a
été dressé.
Ainsi, pour atteindre les objectifs précités, notre
document s'axera successivement sur les points suivants.
- La présentation du réseau électrique HTA
et BTA,
- Les généralités sur la sous-traitance et
le contrôle des travaux de construction de réseau
électrique,
- Le diagnostic et les approches de solutions,
- La présentation du logiciel GESATCRE.
Chapitre 1 :
PRESENTATION DU RESEAU
ELECTRIQUE HTA et BTA DE
LOME
Introduction
Dans ce chapitre est abordé la présentation du
réseau électrique HTA et BTA de la CEET ; principalement la
structure du matériel électrique et mécanique entrant dans
la composition des deux réseaux.
1.1 La classification des tensions
Les ouvrages, installations et équipements de toute
nature, quelque soit leur destination, sont classés en fonction de la
plus grande des tensions nominales (valeur efficace en courant alternatif)
existant :
- entre deux quelconques de leurs conducteurs,
- ou entre l'un quelconque des conducteurs et la terre (ou les
masses).
En exploitation normale, la tension réelle d'un ouvrage
ou d'une partie d'ouvrage peut excéder sa valeur nominale de 10 % au
maximum sans que cela entraîne une modification du domaine de tension. La
classification des tensions est effectuée en domaine de tension comme
l'indique le tableau 1.1.
Tableau 1.1 : Classification des tensions
|
Domaine de Tension
|
Valeur de la Tension nominale Un
exprimée en
volts (V)
|
|
En courant alternatif
|
En courant continu
|
|
Très Basse Tension
(domaine TBT)
|
Un = 50 V
|
Un = 120 V
|
|
Basse Tension
(domaine BT)
|
Domaine BTA
|
50 V< Un = 500 V
|
120 V< Un = 750 V
|
|
Domaine BTB
|
500 V< Un = 1000 V
|
750 V< Un = 1500 V
|
|
Haute Tension (domaine HT)
|
Domaine HTA
|
1000 V< Un = 50000 V
|
1500 V< Un = 75000 V
|
|
Domaine HTB
|
Un > 50000 V
|
Un > 75000 V
|
1.2 Le réseau HTA
Le réseau électrique HTA de Lomé est
exploité en 20 kV. Il comprend deux postes de repartions situés
respectivement à Lomé A et Lomé B et un poste
d'éclatement à Lomé siège. C'est un réseau
composé de 33 départs au total avec 5 départs
aériens dont 3 départs à Lomé A et deux (2)
départs à Lomé B ; 27 départs souterrains dont 13
départs à Lomé A, 7 départs à Lomé B
et 7 départs à Lomé siège et 1 départ
aéro-souterrain. Les 3 postes sont connectés entre eux par cinq
départs qui sont :
- Départ câble direct reliant Lomé B et
Lomé siège en câble papier
imprégné (CPI) en aluminium de 150 mm2
et en câble synthétique
HN33S23 en aluminium de 240 mm2,
- Départ CEET1 qui relie Lomé A et Lomé
siège en CPI HN33S23 alu 240 mm2,
- Départ CEET2 en câble synthétique HN33S23
Alu 240 mm2 et almélec 117 mm2,
- Départ SOTOTOLES entre Lomé A et Lomé B en
CPI 150 mm2 et HN33S23 alu 240 mm2,
- Départ câble LAB entre Lomé A et
Lomé B en aluminium de 240 mm2.
On note également que l'exploitation du réseau
HTA est rendue complexe dans la zone des lignes aériennes avec leurs
antennes et leurs parcours dans la brousse.
1.2.1 Les postes de répartition
Le réseau HTA de Lomé comprend deux (2) postes de
répartition à Lomé A, Lomé B et un poste
d'éclatement à Lomé siège. Les deux postes de
répartition sont équipés d'un même type de tableau
HTA Merlin Guérin
Fluair F24C à coupure dans le gaz SF6 tandis que le poste
d'éclatement est équipé d'un tableau HTA à coupure
dans le vide de type Vercors.
Chaque départ est protégé par un
disjoncteur, un ensemble de protection contre les défauts
triphasés, biphasés et de terre.
1.2.2 Le réseau aérien
Le réseau aérien HTA de Lomé est
constitué de cinq (5) départs dont :
- Trois (3) départs pour le poste de répartition
de Lomé A à savoir le
départ d'Adidogomé, le départ
d'Agoegnivé, et le départ de Tsévié.
- Deux (2) départs pour le poste de répartition de
Lomé B à savoir le
départ Moyennes Entreprises et le départ
Kagomé.
Les câbles sont en Almélec et ont des sections
suivantes : 54.6 mm2 ; 75.5 mm2 et 117 mm2.
Ces câbles se reposent sur divers armements.
Ainsi on rencontre les armements en nappe voûte suspendue,
nappe voûte horizontale, drapeau, drapeau alterné, fixé sur
des supports.
Les supports sont en bois, en béton et métallique.
Mais ces derniers sont en disparition.
Les interrupteurs aériens à commande manuels
(IACM) et les interrupteurs aériens télécommandés
type 2 (IA2T) permettent d'effectuer les manoeuvres d'isolement pour les
recherches de pannes et des entretiens de type E2 (Entretien des Equipements),
E3 (Entretien des Equipements plus amélioration des Mises à la
terre).
C'est un réseau qui fait la grande partie de son chemin en
pleine brousse compliquant la recherche de pannes ; d'où son
exploitation complexe.
1.2.3 Le réseau souterrain
Le réseau souterrain est constitué de
départs HTA desservant la
presque totalité de la ville de Lomé. Les
câbles utilisés dans ce réseau sont les câbles
imprégnés (CPI) ou synthétique (HN33S23) renfermant les
sections suivantes : 70 mm2, 150 mm2, 240 mm2
en aluminium et 50 mm2, 90 mm2 en cuivre. Mais pour des
raisons d'exploitation (densité de charge et bouclage de réseau),
les sections retenues sont les suivantes: 150 mm2, 240
mm2 en aluminium.
L'exploitation du réseau souterrain est aisée
sauf sur les départs entre Lomé A et Lomé siège
où toute situation anormale doit être résolue le plus vite
possible afin d'éviter toutes absences prolongées de tension.
Aujourd'hui le réseau souterrain dessert plus de 80%
des postes HTA/BTA et la tendance est à l'élimination du
câble papier imprégné (CPI) au profit du câble
synthétique qui est beaucoup plus stable, moins coûteux et
s'adapte mieux au relief contrairement au CPI.
La figure 1.1 résume les cinq principaux départs
qui relient les trois postes en vue de garantir les mouvements de charge en
situation de secours.
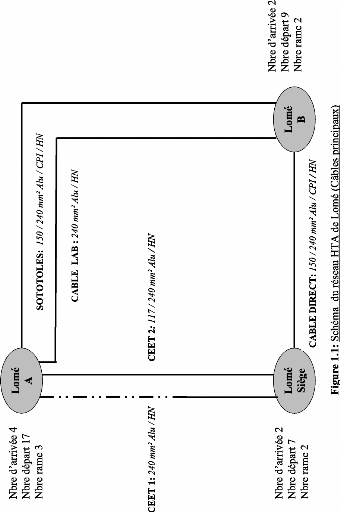
1.3 Le réseau BTA
Le réseau BTA de Lomé se présente en
conducteurs isolés pré assemblé torsadé en
aluminium de section 70 mm2. Ces conducteurs sont maintenus à
une hauteur du sol par des supports de 9 à 10 m de hauteur.
1.3.1 Les postes de transformation HTA/BTA
Le poste de transformation est un ensemble d'appareillages haute
et basse tension. Les postes de transformation HTA/BTA sont
équipés de :
- un tableau HTA de distribution ;
- un transformateur HTA/BTA dont le rôle est de transformer
la moyenne tension en basse tension;
- un tableau BTA (tableau urbain réduit TUR)
constitué d'un ensemble de départs monoblocs ;
- un ensemble de protection assuré en amont du
transformateur par des
fusibles HTA 24KV et en aval par les fusibles HPC du TUR.
On distingue à cet effet deux (2) catégories de
poste de transformation :
- les postes cabines maçonnés
- les postes H61
1.3.1.1 Les postes cabines
Ce sont des postes de transformation dont la puissance est
comprise entre 160 KVA et 2500 KVA. Ils sont destinés à desservir
les milieux urbains et existent sous deux types à savoir :
> les postes classiques : ils sont composés des
conducteurs, d'un sectionneur et présentent un degré minimum de
sécurité ;
> les postes modernes : ils sont composés d'un tableau
HTA, d'un
transformateur et d'un tableau BTA placés en bloc pour
les postes préfabriqués ; des jeux de barre, le sectionneur, des
conducteurs pour les postes sous enveloppe métallique. Les postes
modernes présentent l'avantage d'une meilleure sécurité et
d'une mise en place rapide. Ils sont plus utilisés sur le réseau
électrique de la CEET.
1.3.1.2 Les postes H61
Ce sont des postes dont la puissance est comprise entre 50 KVA
et
160 KVA et desservent les milieux ruraux. Ils sont
installés sur des supports en bois ou en béton et sont
alimentés par un réseau aérien leur conférant ainsi
le nom de «transformateur haut de
poteau».
Le transformateur est alimenté en aérien et le
départ basse tension s'effectue soit en aérien ou en souterrain.
La protection contre la foudre coté moyenne tension est assurée
par un éclateur et coté basse tension par un disjoncteur qui,
protége le transformateur contre les surintensités.
A part le transformateur, le poste H61 comporte un disjoncteur
appelé disjoncteur haut de poteau (DHP). Les sections de ces
câbles sont fonction de la puissance du transformateur H61 et se
présentent comme suit :
- Pour les transformateurs de puissance égale 50 KVA ou
100 KVA, on utilise un câble pré assemblé en cuivre de 70
mm2 ;
- Pour les transformateurs de 160 KVA, on utilise un HGE de 95
mm2.
1.3.2 Le réseau aérien
Le réseau électrique aérien est construit en
câble torsadé
3x70 mm2 + 54,6 mm2. Les conducteurs de
phase sont en aluminium protégés par une gaine isolante en
polyéthylène réticulé tandis que le neutre est en
almélec sans gaine isolante et est mise à la terre afin
d'éviter les
surtensions en cas de rupture du neutre. Le réseau
aérien est construit à partir de câbles, de supports et
d'armements.
1.3.2.1 Les supports
Selon leur constitution, les supports utilisés dans le
réseau BTA présentent une hauteur de 9 à 10 m et se
classent en trois (3) catégories. Les supports en bois, en béton,
et métallique. Les supports peuvent être simples, jumelés,
contrefichés ou haubanés.
1.3.2.2 Les armements
Les supports maintiennent le câble suspendu par
l'intermédiaire de l'armement. Le neutre porteur est pincé dans
une pince d'alignement puis ancré dans une pince d'ancrage. Ces pinces
sont respectivement suspendues à des consoles d'alignement et
d'ancrage.
1.3.3 Le réseau souterrain
Le réseau souterrain est en câble HGE 3x95
mm2+50 mm2. Les départs BTA provenant des postes
de transformation sont interrompus par un coffret de lotissement à
partir desquels sont branchés les clients. Pour les départs vers
d'autres destinations, ils sont raccordés à partir des grilles de
fausse coupure.
1.4 Le branchement
Le branchement est la structure électrique destinée
à relier le réseau de distribution à l'installation
intérieure de l'abonné. Il comprend :
- une liaison réseau en câble aérien ou
souterrain,
- une protection par fusible CCP pour la protection du
réseau de distribution,
- un compteur d'énergie électrique pour enregistrer
la consommation du client,
- un disjoncteur pour isoler l'installation et limiter la
puissance souscrite et le protéger contre les surintensités.
On distingue trois (3) types de branchements à savoir :
Les branchements aériens ; souterrains et
aéro-souterrain
1.4.1 Le branchement aérien
Il est délimité par les connecteurs de
raccordement au réseau et les bornes amont du CCP du panneau de
comptage. Les câbles de branchement utilisés sont en aluminium de
section 16 mm2 et 25 mm2.
1.4.2 Le branchement aéro-souterrain
Il est aussi délimité par les connecteurs de
raccordements au réseau et les bornes amont du CCP du panneau de
comptage.
Les câbles de branchement sont en :
- cuivre de section 10 mm2, 16 mm2, 25
mm2
- aluminium de section 16 mm2, 25 mm2, 35
mm2.
1.4.3 Le branchement souterrain
Il est délimité par un coffret de distribution
basse tension et les bornes amont du CCP du panneau de comptage. Les
câbles de branchement sont en aluminium de section :
- 16 mm2 ; 25 mm2 ; 35 mm2
pour le branchement individuel
- 50 mm2 ; 95 mm2 ; 100
mm2 pour le branchement collectif.
1.5 La télé-conduite du
réseau
Le Bureau Central de Commande (BCC) est une salle de commande
qui, par un système informatique permet d'envoyer par onde radio ou par
faisceau hertzien des ordres en direction de trois (3) postes. A ces trois (3)
postes s'ajoutent les dix (10) postes HTA/BTA et deux appareils de coupures
aériens IA2T (Interrupteur Aérien
Télécommandé type2).
Conclusion
Dans l'ensemble, la structure en boucle du réseau haute
tension catégorie A, radiale du réseau basse tension
catégorie A et surtout du système de télé-conduite,
offrent une grande facilité d'exploitation au réseau
électrique de la CEET. Mais la maîtrise de tout doit passer par la
connaissance des différents ouvrages qui le constituent et
l'accomplissement de tout acte dans les règles de l'art et la
sécurité.
Chapitre 2 :
GENERALITES SUR
LA SOUS-TRAITANCE ET LE
CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE RESEAU
Introduction
Dans la construction du réseau électrique
rentrent de nombreux équipements notamment les équipements de
distribution, de contrôle qui, sont régulièrement
utilisés pour maîtriser la qualité sous toutes ses
formes.
Pour une bonne gestion des travaux de construction de
réseau électrique, il est nécessaire d'élaborer des
principes sur lesquels nous allons nous baser pour coordonner ces
activités.
C'est ainsi que dans ce chapitre seules les
généralités sur la sous-traitance et le contrôle des
travaux de construction de réseau électrique sont
abordées.
2.1 La sous-traitance
2.1.1 Notion générale
La sous-traitance est une opération par laquelle un
entrepreneur (donneur d'ordre) confie à un autre entrepreneur
(sous-traitant, sous-entrepreneur) le soin de réaliser, pour son compte
et selon ses directives, tout ou partie d'un travail destiné à
ses propres clients.
Le recours à la sous-traitance est une pratique
largement utilisée par les grandes et moyennes entreprises. Sous-traiter
une partie de ses activités pour se concentrer sur son corps de
métier est une opération délicate ; mais en
connaître tous les aspects peuvent éviter bien de mauvaises
surprises aux entreprises qui souhaitent s'engager dans cette aventure.
2.1.2 Les différents types de la sous-traitance
Nous distinguons trois (3) types de sous-traitance à
savoir: - La sous-traitance de spécialité,
- La sous-traitance de capacité, - La sous-traitance de
marché.
2.1.2.1 La sous-traitance de spécialité
C'est une opération par laquelle une entreprise estime ne
pas disposer du savoir-faire adéquat pour réaliser une
prestation.
2.1.2.2 La sous-traitance de capacité
Cette opération consiste à faire appel à
un sous-traitant lorsque l'entreprise est dans l'incapacité de
répondre au flux de demandes dans les délais impartis.
2.1.2.3 La sous-traitance de marché
C'est une opération par laquelle l'entreprise confie
à une autre entreprise l'exécution d'un marché qu'elle a
conclu avec un maître d'ouvrage.
2.1.3 Procédure d'exécution des travaux par
les sous-traitantes
La construction d'un réseau électrique est une
opération qui se fait dans une suite d'actions organisées toutes
indispensables.
La CEET dans le souci de satisfaire toutes les demandes,
surtout vite et bien, confie certains de ses travaux de construction de
réseau électrique aux entreprises sous-traitantes
compétentes. Ces travaux sont soit sous-traités par la CEET ou
traités et réalisés par les sous-traitants.
2.1.3.1 Travaux sous-traités par la CEET
Dès la réception de la demande par la CEET pour
la construction du réseau électrique, le bureau d'Etude et
Contrôle envoie successivement une équipe sur le chantier pour les
opérations suivantes :
La préparation du chantier,
La réalisation des travaux,
La réception.
a) La préparation du chantier
Elle consiste à faire l'état des lieux pour
déterminer :
A partir des données électriques :
- la tension et la puissance à transporter ;
- la nature du courant électrique ;
- le type de conducteur et leur section ;
- les supports et leurs accessoires.
A partir des données environnementales :
- le lieu à raccorder ;
- le milieu urbain ou rural ;
- obstacle naturel ;
- les lignes existantes ;
- route.
Ainsi un ordre de travail (OT) est ouvert en tenant compte de
tous ses paramètres précités. Il précise la
situation géographique des travaux (Agence, référence,
quartier, rue, N°de porte, départ, dérivation, poste), la
liste de matériels prévisibles. L'ordre de travail est suivi d'un
bon de sortie magasin (BSM) qui autorise le retrait du matériel au
magasin général de la CEET. Cet ensemble est envoyé au
service des travaux de la CEET ; ou à un sous-traitant.
b) La réalisation des travaux
Pour la réalisation des travaux, le sous-traitant peut
être autorisé à faire usage de son propre matériel.
Dans ce cas, à la fin des travaux le sous- traitant passe au magasin
muni de l'OT pour la restitution du matériel. Cet ordre de travail (OT)
sera régularisé par le bon de sortie magasin (BSM)
délivré par le bureau d'Etude et Contrôle. Au terme des
travaux le sous- traitant signal au bureau d'étude et contrôle
pour la réception des travaux.
c) La réception
La réception consiste à contrôler les travaux
réalisés conformément aux exigences
spécifiées et aux normes de la CEET. Elle peut faire l'objet de
:
- un rejet conduisant à la reprise des travaux.
- une acceptation conduisant à l'établissement
d'un procès verbal (PV) portant la signature du chef d'équipe de
l'entreprise sous-traitante et du réceptionnaire.
Apres la réception, le sous-traitant envoie la facture
au bureau d'Etude et Contrôle pour vérification. Celui ci transmet
une copie de cette facture au Département Approvisionnement et Gestion
des Stocks (DAGS) en suite la demande d'achat, le bon de sortie magasin, le
procès verbal, l'ordre de travail, la facture, le plan de situation et
de masse, à la Direction Financière et Comptable (DFC). Cette
direction envoie à son tour une équipe pour le dernier
contrôle des travaux en vue de la validation des travaux
réalisés.
2.1.3.2 Travaux traités et réalisés
par les sous-traitants
La démarche logique qui accompagne la réalisation
des travaux par les sous-traitants se résume comme suit :
A la réception de la demande d'un client, le
sous-traitant effectue la préparation du chantier. Elle adresse en suite
une demande à laquelle les documents suivants sont joints: Le plan de
masse et de situation du
chantier, le plan de piquetage, la carte d'identité
nationale du client, à la direction générale de la CEET en
vue d'obtenir une autorisation pour réaliser les travaux. La direction
générale saisie le bureau d'Etude et Contrôle qui
étudie la demande, suivie du contrôle des normes du
matériel que le sous-traitant aura à utiliser avant qu'un accord
ne lui soit donner.
A la fin des travaux, une demande est adressée au
bureau d'étude et contrôle pour la réception des travaux.
Cette réception peut également faire l'objet d'un rejet
conduisant à la reprise des travaux ou d'une acceptation
entraînant l'établissement d'un procès verbal (PV). Ce PV
permettra au client de bénéficier d'un taux forfaitaire au cas
où il demanderait de branchement.
2.2 Le contrôle
Le contrôle est une opération qui correspond
à des vérifications de conformité par rapport à des
données préétablies suivi d'un jugement.
Le jugement peut comporter :
- une activité d'information
- une décision (acceptation, rejet et ajournement)
- une mise en réparation.
Comme tous travaux, la construction d'un réseau
nécessite une bonne connaissance et un suivi permanent des travaux afin
d'assurer une production d'une qualité constante. Pour atteindre cet
objectif, il est important de suivre rigoureusement non seulement ces travaux
mais surtout connaître parfaitement les équipements
électriques rentrants dans sa construction.
2.2.1 Connaissance des équipements rentrants
dans la construction de réseau électrique aérien HTA/BTA
Ces équipements sont utilisés dans la construction
de réseau électrique de la CEET et se présente comme suit
:
2.2.1.1 Les Câbles
C'est un ensemble de conducteurs électriquement
distinct mais comportant une ou plusieurs protections communes. Ils sont
représentés à la figure 2.1
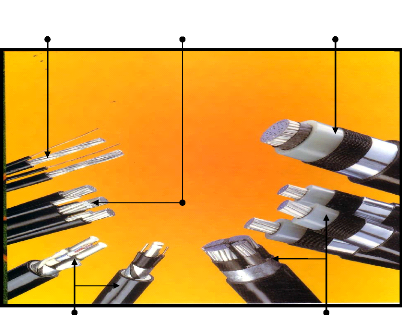
Câble aérien
de
branchement
monophasé
Câble de réseau aérien
3 Phases
avec EP
Bout de câble
HTA
Câble de réseau souterrain monophasé
Câble de réseau souterrain triphasé
Figure 2.1 : Les différents types de
câbles
2.2.1.2 Les armements
C'est un ensemble constitué des ferrures, isolateurs et
les vis de fixation destinés à suspendre les lignes
électriques. Ils sont caractérisés par la
désignation et le type. Il est représenté à la
figure 2.2.
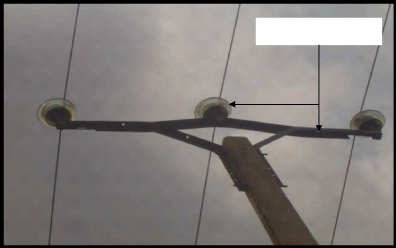
Un Armement
Figure 2.2 : Un armement dans un
réseau électrique
2.2.1.3 Les isolateurs
Ils servent à amarrer les conducteurs et à les
isoler par rapport aux ferrures. Ils sont réalisés en verre ou en
porcelaine. Leurs formes et caractéristiques sont fonction de la
tension, du mode de pose et des efforts demandés. On distingue :
- les isolateurs rigides (BTA),
- les isolateurs montés en chaîne (HTB).
Ils sont caractérisés par la désignation et
le type et sont représentés à la figure 2.3.

Un Isolateur
Figure 2.3 : Les Isolateurs fixés sur
les ferrures
2.2.1.4 Les supports
Encore appelé poteaux, ils maintiennent les isolateurs
et ferrures à une certaine hauteur du sol. Ils sont en bois, en
béton, et métallique. Ils présentent les
caractéristiques suivantes :
- la désignation ;
- la nature ;
- la hauteur.
2.2.1.5 Le parafoudre
C'est un dispositif de protection des transformateurs H61 contre
les décharges d'origines atmosphériques qui transitent par les
conducteurs des lignes aériennes. Il est caractérisé par
:
- la désignation ;
- la nature ;
- le type.
La figure 2.4 nous montre les parafoudres dans un réseau
électrique.
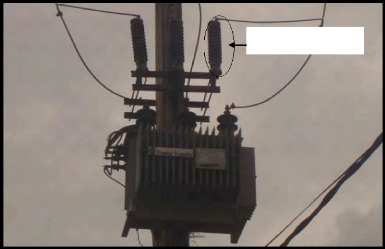
Le parafoudre
Figure 2.4 : Les parafoudres dans un
réseau électrique
2.2.1.6 L'éclateur
C'est un dispositif de protection destiné à
protéger les transformateurs. Il a pour rôle de limiter les
surtensions.
Il présente les caractéristiques suivantes :
- la charge de rupture ;
- le type ;
- la norme.
La figure 2.5 présente les éclateurs fixés
sur les isolateurs dans un réseau électrique.

Un éclateur
Figure 2.5 : Un ensemble d'éclateur
dans un réseau électrique
2.2.1.7 Le Transformateur
Un transformateur est une machine statique à induction
destinée à modifier l'amplitude des signaux tel que la tension et
le courant tout en conservant la fréquence.
Selon leur puissance nous distinguons :
> les petits transformateurs (1 KVA< S < 25 KVA), >
les transformateurs de distribution ou de puissance (25 KVA < S < 2000
KVA),
> les transformateurs pour le transport de l'énergie
électrique (S >2000 KVA).
Un transformateur présente les caractéristiques
suivantes :
- la tension primaire et secondaire en Volt ou Kilovolt ;
- la puissance apparente en Voltampère ou Kilo
voltampère ;
- la fréquence de fonctionnement en Hertz
généralement 50 Hz ;

Un IACM
- la tension de court-circuit ;
- la chute de tension ;
- le couplage des enroulements.
La figure 2.6 présente le transformateur H61
alimenté par un réseau.

Un transformateur H61
Figure 2.6 : Un transformateur H61 dans
réseau électrique 2.2.1.8 Les interrupteurs
aériens
Les plus utilisés sont les IACM. Ils sont placés
en extrémité de ligne pour les IACM de 50 A et
généralement à l'origine des dérivations pour les
IACM de 100 A. Ils permettent d'effectuer les manoeuvres d'isolement afin
d'assurer le sectionnement, le bouclage et les recherches de pannes.
Ils sont caractérisés par :
- la tension assignée ;
- le courant assigné ;
- le pouvoir de coupure ;
- le pouvoir de fermeture.
La figure 2.7 nous montre un IACM dans un réseau
électrique.
Figure 2.7 : Vue de dessous d'un IACM et
ses accessoires dans un réseau
électrique
2.2.1.9 Le disjoncteur haut du poteau
(DHP)
C'est un appareil tétra polaire destiné à la
gestion et à la protection du transformateur H61. Il permet
l'exploitation facile du réseau.
Il est caractérisé par :
- la tension assignée ;
- le courant assigné ;
- le pouvoir de coupure ;
- le pouvoir de fermeture ;
- le nombre de pôles.
Le disjoncteur haut du poteau est représenté
à la figure 2.8.
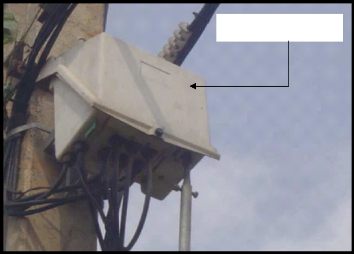
Un DHP
Figure 2.8 : Un disjoncteur Haut du Poteau
(DHP)
2.2.1.9 La console
Elle est en alliage d'aluminium et permet d'éviter le
retournement possible de la pince. Elle est caractérisée par :
- la désignation ;
- la nature ;
- le type.
Elle est représentée à la figure 2.9.
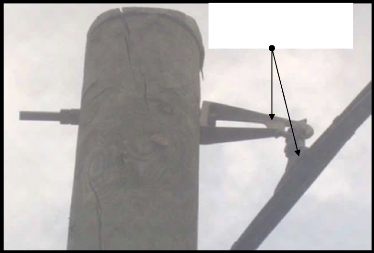
Console et pince de
suspension
Figure 2.9 : La console et pince de
suspension
2.2.1.11 La pince de suspension
Elle permet le verrouillage et le blocage du neutre porteur. Elle
est caractérisée par la désignation et la nature.
2.2.2 Les phases actuelles de contrôle des
travaux Elles se subdivisent en trois :
2.2.2.1 La phase préparatoire du chantier
Dans cette phase l'opération consiste à
contrôler :
a) Toutes les ressources humaines, matérielles et
financière qui se résument par les étapes suivantes :
- la visite du chantier pour définir tous les contours du
chantier ; - inventaire du matériel ;
- l'ouverture de l'ordre de travail (OT) qui donne accès
aux matériels ; - l'émission d'un bon de sortie magasin ;
- l'émission de l'ordre de coupure qui est adressé
au chef d'exploitation.
b) Le piquetage qui consiste à reporter l'emplacement des
supports sur le terrain.
c) La fouille qui consiste à faire les trous pour
l'implantation des supports des lignes aériennes.
Le diamètre et la profondeur des trous doivent être
proportionnels à la hauteur et à la forme du support à
implanter.
· Diamètre Ø
- Pour les supports cylindriques en bois et en béton, le
diamètre est égal à deux (2) fois le diamètre du
support.
- Pour les supports parallélépipédiques en
béton le diamètre du trou est égal à deux (2) fois
le périmètre de base parallélépipédique.
· Profondeur (P)
Pour tout type de supports la profondeur est donnée par la
formule 2.1.
Avec
P = la profondeur (m)
H = la hauteur du support (m).
2.2.2.2 La phase de pose des
équipements
Dans cette phase l'opération consiste à s'assurer
de :
- la bonne implantation, la verticalité et l'alignement
des supports car ces derniers supportent les équipements du
réseau notamment le transformateur H61, le disjoncteur haut du poteau,
les armements et les câbles.
- le réglage de la flèche qui consiste à
régler les conducteurs aériens accrochés au réseau.
Ce réglage se fait au moyen des palans à corde placée
à une extrémité sur la portée la plus longue.
D'abord sur la phase du milieu par rapport aux deux nivelettes
accrochées aux supports servant de repère ; puis sur les deux (2)
phases extrêmes simultanément pour éviter la
déformation de l'armement.
Cette même opération peut se faire visuellement par
visé du point le plus bas des conducteurs.
Le calcul de la flèche est donné par la formule
2.2.
Avec :
F = flèche (m)
A= Portée réelle (m)
P = Poids linéique (daN/m)
T = Traction mécanique (daN)
- la disposition du transformateur, des équipements
HTA, des équipements BTA et la connexion entre ses principaux
éléments pour les postes intérieurs, la pose du
transformateur H61 (il s'accroche au support en forme de croix) et ses
différents accessoires pour les postes haut de poteau.
2.2.2.3 La phase d'essais et mesures
C'est une phase qui sanctionne la fin des travaux. Elle
s'effectue comme suit :
- l'essai : c'est une opération destinée
à vérifier le fonctionnement ou l'état électrique,
mécanique ou autre d'un ouvrage qui reste alimenté par le
réseau ou par l'installation.
- mesures : c'est une opération permettant de faire le
mesurage des grandeurs électriques (tension, le courant la
puissance...), mécaniques et thermiques.
Lors de cette dernière phase de contrôle, on doit
s'assurer du bon fonctionnement du réseau par la vérification des
tensions simples, composées et surtout la résistance des prises
de terres.
Conclusion
Bien contrôler les travaux de construction de
réseau électrique, c'est diminuer le plus possible les
coûts de maintenance tout en maintenant le maximum de qualité de
service. C'est réduire au minimum les temps d'interruption de la
fourniture de l'énergie électrique, réduire les temps
d'intervention (réduire le coût direct), répondre aux
besoins de la clientèle (qualité des prestations),
améliorer les mesures de sécurité.
Chapitre 3 :
DIAGNOSTIC ET APPROCHES DE
SOLUTIONS
Introduction
Au cours de notre stage et suite aux contrôles
effectués sur les travaux de construction de réseau
électrique, nous avons constaté divers problèmes. Ainsi
dans ce chapitre nous allons les évoquer et proposer des approches de
solutions pour pallier ces problèmes.
3.1 Diagnostic
Si aujourd'hui la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET)
peut s'en réjouir, c'est grâce en partie à certains de ses
objectifs qu'elle a pu atteindre. Néanmoins certains restent à
atteindre notamment :
- l'amélioration de la qualité de service ;
- le contrôle rigoureux des travaux sur le réseau
;
- réduction des pertes sur le réseau ;
- réduction du nombre de clients subissant la chute de
tensions hors normes.
Etant donné que la tension est une qualité de la
desserte en énergie électrique, nous nous sommes rendus compte
qu'un certain nombre de clients reste confronté au problème de
baisse de tension.
Généralement ces baisses de tension sont dues :
- aux raccordements de nouveaux abonnés sur des lignes BTA
de longueurs excessives ;
- au déséquilibre du réseau ;
- aux raccordements des câbles coupés par les
connecteurs
branchement ;
- au rupture du neutre et de sa mise à terre.
Outre ces causes, il faut également noter que la baisse de
tension apparaît lorsque le réseau est soit purement inductif ou
lorsque l'offre de la puissance électrique est inférieure
à la demande. Cette baisse a pour
conséquence immédiate l'augmentation de
l'intensité du courant traversant les récepteurs. Ce
phénomène ne permet pas aux équipements de tourner
à leur vitesse nominale de rotation par conséquent entraîne
leur baisse de régime.
Ainsi, pour atteindre les objectifs cités plus haut, nous
suggérons les solutions suivantes.
3.2 Approches de solutions
Les approches de solutions visant à combler les
insuffisances constatées seront scindées en deux (2) :
- solutions pour l'amélioration de la qualité de
service et de réduction de pertes sur le réseau
électrique,
- solutions pour l'amélioration du contrôle des
travaux.
3.2.1 Solutions pour l'amélioration de la
qualité de service et de réduction des pertes sur le
réseau
Pour remédier aux problèmes auxquels sont
confrontés les clients, nous avons après étude et analyse
penser à ramener la chute de tension dans les limites prescrites par les
normes.
Les chutes de tension admissibles dans les réseaux HTA et
BTA se présentent comme suit :
- pour les lignes HTA aériennes et souterraines 7.5%
- pour les lignes BTA aériennes zones urbaines 7%
- pour les lignes BTA aériennes zones rurales 11%
- pour les lignes BTA souterraines 3.5%
Ainsi pour rester dans cette limite prescrite par les normes, les
dispositions suivantes doivent être prises :
3.2.1.1 Réhabilitation et renforcement des
composants du réseau
Les mesures spécifiques sont les suivantes :
- renforcement des liens de secours HTA entre les trois postes de
répartition Lomé A, Lomé B et Lomé siège
;
- création de nouveau postes HTA/BTA pour permettre le
raccordement de nouveaux clients sur les lignes BTA de longueur
excessives cause des chutes de tension.
- remplacement des éclateurs par des parafoudres sur les
tronçons exposés à une fréquence
élevée des foudres.
3.2.1.2 Ramener la chute de tension dans les limites
prescrites par les normes
Les mesures spécifiques sont les suivantes
- réduction des longueurs excessives de certaines
lignes BTA en implantant de nouveaux postes BTA pour augmenter les
capacités de distribution de réseau et soulager les charges des
postes environnants et réduire en même temps les pertes en ligne
;
- l'amélioration de la Haute tension catégorie A
par l'utilisation des condensateurs HTA destinés à corriger les
chutes de tension HTA et éventuellement BTA. Ils permettront de
supprimer l'utilisation des transformateurs à prises multiples plus
coûteux ;
- équilibrer les phases lors des branchements ;
- utilisation des manchons pour raccorder les câbles
coupés.
3.2.2 Solutions pour l'amélioration du
contrôle des travaux
Le contrôle est un volet important dans la
réalisation des travaux de
construction de réseau électrique.
Pour contribuer à l'amélioration du contrôle
des travaux de construction de réseau électrique, nous
suggérons les solutions suivantes :
3.2.2.1 La mise en place d'une équipe
d'inspection périodique des réseaux électriques
Cette équipe aura pour mission de vérifier les
réseaux, chaque trois et six mois selon le type de réseau.
3.2.2.2 Amélioration de la performance des
équipes de contrôle
Les mesures spécifiques sont les suivantes :
- équipements des équipes de contrôle
d'outils collectifs et personnels appropriés et suffisants pour leur
permettre d'effectuer le contrôle des travaux de façon efficace,
rapide et en toute sécurité.
- développement de la formation du personnel en technique
moderne d'intervention sur les lignes, postes et en normes de
sécurité.
3.2.2.3 La maîtrise des équipements
électriques du réseau
Sa maîtrise passe par une bonne connaissance de ces
équipements. Pour ce faire il faut :
- disposer des informations relatives aux différents
équipements du réseau ;
- disposer du manuel d'utilisation ;
- les documentations techniques et si possibles se former sur
chaque matériel qui vient d'apparaître sur le marché.
3.2.2.4 La maîtrise du facteur temps
Le temps est un facteur déterminant dans tous travaux.
Il permet à tout travailleur de s'affirmer, de satisfaire le client et
de poser son diagnostic final aussi prompte que possible. Pour cela il convient
de savoir des opérations qui sont possibles en un temps record et de
savoir abandonner dès que les moyens sont limités ou les
interventions sont impossibles.
3.2.2.5 La maîtrise des appareils de
contrôle
Pour réaliser un bon travail, il est indispensable de
disposer tous les appareils de contrôle nécessaire. Ces appareils
doivent être surtout lier au travail qu'on aura à effectuer. Une
bonne connaissance des appareils de contrôle permettra de maîtriser
les équipements adéquats pour le travail à
réaliser.
En dehors de leur maîtrise il est indispensable que ses
équipements de contrôle soient maintenus afin qu'ils puissent
démontrer la conformité aux exigences spécifiées et
afficher les résultats avec exactitude.
3.2.2.6 Quelques valeurs admissibles des terres des
ouvrages neufs
La valeur de la prise de terre a une influence directe sur le
nombre des incidents qui peuvent apparaître sur les réseaux et sur
les conséquences. Il est impossible de parer à tout incident en
particulier en cas de coup de foudre direct ; mais les valeurs proposées
ci-dessous permettent de les éviter avec une bonne probabilité.
La prise de terre étant la base de la sécurité d'une
installation électrique, son efficacité peut être
réduite à néant si elle n'est pas correctement
réalisée. La qualité d'une prise de terre dépend de
sa résistance électrique. Les valeurs admissibles sont :
- Poste HTA/BTA terre des masses :
La norme est de :
1 Ç~ pour les réseaux HTA souterrains
interconnectés sans discontinuité depuis le poste source pour une
valeur limite du courant de défaut phase terre de 1000 A.
30 ~ pour les réseaux HTA souterrains issus d'un
réseau aérien pour une valeur limite du courant de défaut
phase terre de 300 A et 10 ~ pour une valeur limite du courant de défaut
phase terre de 1000 A.
- Interrupteurs aériens (IACM, IAT)
La norme est de :
60 ~ pour les interrupteurs aériens à commande
manuelle (IACM) et les interrupteurs aériens
télécommandés (IAT).
- Terre du neutre Basse Tension
Cas des postes ruraux
La norme est de :
15 ~ pour la terre globale (toutes terres des neutres
interconnectés) 60 ~ à 100 ~ pour chaque terre prise
individuellement.
Cas des zones urbaines
La norme est de :
5 ~ pour la terre globale
20 ~ à 30 ~ pour chaque terre prise individuellement.
Conclusion
Les approches de solutions proposées dans ce chapitre
permettent à la
CEET d'améliorer la qualité de service
à la clientèle et de réduire les pertes
de distribution sur le réseau.
Dans le souci d'améliorer la gestion des travaux de
construction de réseau électrique, nous avons pensé
à la conception d'un logiciel dont le nom est GESATCRE.
Chapitre 4 :
Présentation du logiciel GESATCRE
Introduction
`GESATCRE' est un logiciel dont le but est d'améliorer la
gestion des travaux de construction de réseau électrique.
La conception d'un tel logiciel suppose non seulement
l'existence d'une base de données informatique conçues à
partir de Microsoft Access, mais surtout l'interface utilisateur conçu
à partir de Visual Basic 6.0.
4.1 Accès aux bases de données avec Visual
Basic
Visual basic et Access s'échangent des informations
grâce à la liaison établie au moyen du contrôle DAO
(Data Access Objects ou Objet d'Accès aux Données) de Visual
Basic.
Access est une base de données qui offre une grande
souplesse de travail et cadre aussi bien pour un usage professionnel que pour
les applications de loisir. Les tables créées pour le compte de
ce logiciel sont destinées à recevoir les informations des
différents enregistrements.
.
4.2 Les fonctions du logiciel
`GESATCRE' est un logiciel de gestion automatisée des
travaux de construction de réseau électrique. Les
opérations suivantes résument son utilisation :
- l'enregistrement des informations,
- la consultation des informations enregistrées,
4.3 Présentation du Logiciel
GESATCRE' se démarre par son icône de raccourci
placé sur le bureau. Dès l'ouverture de l'application,
l'interface d'accueil s'affiche
Premièrement. Sur cette interface on voit le nom du
logiciel. C'est ce que nous présente la figure 4.1.
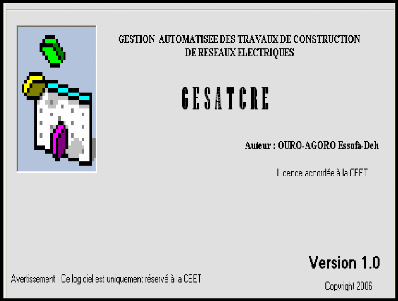
Figure 4.1 : Interface d'accueil
Cette interface s'incline quatre (4) secondes après
pour faire place à la boite de connexion à `GESATCRE'. Celle-ci
comporte les champs de saisie suivant :
Le Nom d'utilisateur et le mot de passe. Outre ces champs de
saisie, la boite de connexion à `GESATCRE' comporte aussi le bouton `Ok'
qui permet de valider le nom d'utilisateur et le mot de passe ; et un bouton
`Annuler' qui permet d'annuler tout ce qui a été saisi dans les
champs. Cette boite de connexion est présentée à la figure
4.2.
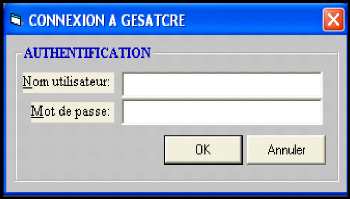
Figure 4.2 : Boite de `Connexion à
GESATCRE'
A l'affichage de cette boite, l'utilisateur doit saisir son nom
d'utilisateur et le mot de passe puis valider les deux par un clic sur le
bouton `Ok '.
Si les deux sont corrects, l'utilisateur peut en ce moment
avoir accès à l'interface d'entrée. Dans le cas
échéant `GESATCRE' lui informe par un message que :
«Le nom et / ou mot de passe incorrect, et l'invite
à ressaisir». C'est ce que nous montre la figure
4.3.
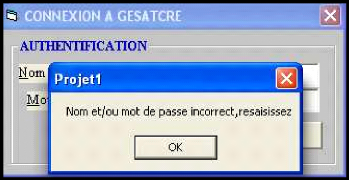
Figure 4.3 : Boite de message de la
`Connexion à GESATCRE'
Apres la validation du nom et du mot de passe on accède
à l'interface d'entrée. La figure 4.4 illustre cette interface
d'entrée de l'application.
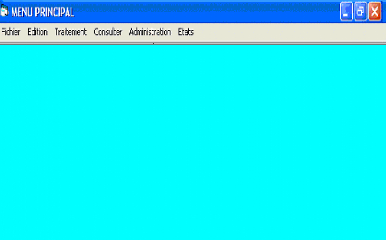
Figure 4.4 : Interface d'entrée
4.4 Présentation des menus et sous-menus de
`GESATCRE '
Pour une insertion totale dans l'environnement de
l'application nous allons dans cette partie du chapitre faire une
démonstration de l'utilisation de l'application à travers une
présentation des menus et sous-menus.
L'appel des menus et sous-menus se fait à partir de
l'interface d'entrée de l'application qui comporte deux (2) barres :
- la barre des menus : rassemble toutes les opérations
données par l'application.
- la barre d'état : elle est située en bas de
l'interface d'entrée et
affiche la date ; l'heure.
La barre des menus comporte six (6) menus. Outre les menus
ordinaires (Fichier, Edition), `GESATCRE ' présente les principaux menus
suivants :
- menu `Traitement' : Ce menu gère l'enregistrement des
informations sur les travaux de construction de réseau Electrique.
- menu `Consulter' : Il gère la lecture et la consultation
des informations enregistrées.
- menu `Administration' : Ce menu gère toute
l'application de façon à empêcher les utilisateurs à
avoir accès à certains paramètres.
- menu `Etats' : Il gère les impressions de
l'application.
Les principaux menus comportent des sous-menus qui guident
l'utilisateur de cette application.
L'accès aux sous-menus se fait par un clic sur le menu.
Le déplacement dans le menu s'effectue à l'aide des touches de
directivités sur le clavier ou, par la souris. L'appui sur la touche
entrée ou un clic sur le sous menu affiche la fenêtre
correspondante à l'écran.
4.4.1 Le menu Traitement
C'est le menu principal de l'application. Il est constitué
de deux (2) sous menu comme l'indique la figure 4.5.
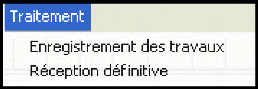
Figure 4.5 : `les sous-menus du menu
Traitement'
4.4.1.1 Le sous menu `Enregistrement des travaux'
Son interface est obtenue par un clic sur le sous menu
`Enregistrement des travaux'. Il permet d'enregistrer les informations sur les
travaux de construction de réseau électrique depuis la
réception d'une demande de construction ou d'extension de réseau
électrique jusqu'à l'exécution des
Travaux en passant par les dossiers. Ce passage est
résumé à la figure 4.6.
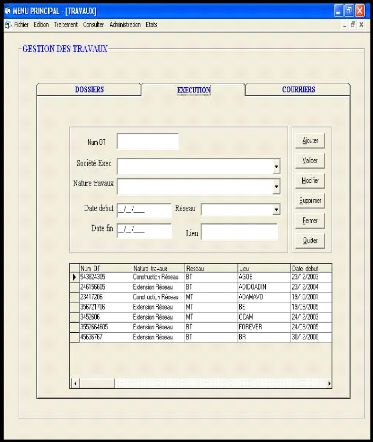
Figure 4.6 : Interface `Enregistrement des
travaux'
Comme le montre la figure 4.6, nous constatons que c'est la
page
`Exécution' qui est
sélectionnée ; par conséquent c'est elle qui est
affichée.
Ainsi un clic sur l'un quelconque des deux autres boutons
(Dossiers et Courriers) nous affichera également leur page.
4.4.1.2 Le sous menu `Réception définitive'
Tout comme le sous menu précédent, le sous-menu
`Réception définitive' permet d'enregistrer les informations
concernant la réception des travaux.
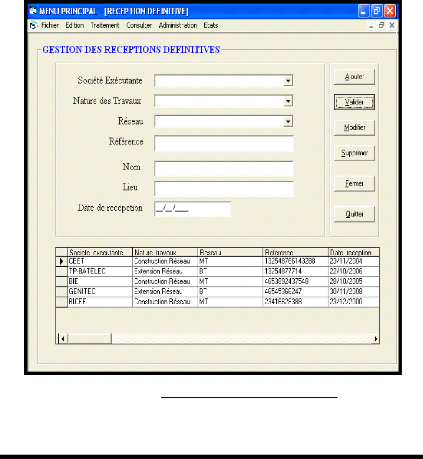
Figure 4.7 : Interface `Réception
définitive'
La particularité de celle-ci est qu'elle a lieu trois
ou six mois après la fin des travaux (la réception provisoire)
selon le type de réseau. Son interface est présentée
à la figure 4.7.
Son objectif est de permettre à la hiérarchie de
contrôler non seulement les travaux de construction de réseau mais
aussi de suivre la prestation des entreprises sous-traitantes.
Sur les interfaces des deux sous menu, les boutons :
- `Ajouter' permet d'activer les champs avant la saisie des
informations ;
- `Valider' permet d'enregistrer les informations saisies ;
- `Modifier' permet de modifier un enregistrement existant en cas
d'une éventuelle modification;
- `Supprimer' permet de supprimer un enregistrement ;
- `Fermer' permet de quitter l'interface sans toute fois quitter
l'application ;
- `Quitter' permet à l'utilisateur de fermer
l'application.
A propos des boutons `Valider' ; `Modifier' ; `Supprimer', un
clic sur un des trois boutons permet à l'utilisateur d'effectuer
respectivement un enregistrement ; une modification et une suppression selon
son désire. Dans ce cas si l'utilisateur doit supprimer un
enregistrement, il convient d'empêcher toute suppression accidentelle.
Ainsi, avant toute suppression, `GESATCRE' envoi un message à
l'utilisateur présenté à la figure 4.8, pour lui donner
l'occasion de changer d'avis.
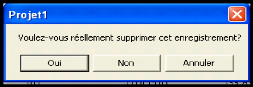
Figure 4.8: Boite de dialogue permettant de
confirmer la suppression La même boite de dialogue est
affichée pour un quelconque clic sur les boutons `Valider' ou
`Modifier.
Ce pendant si l'utilisateur clic sur le bouton `Oui' l'action est
prise en compte et supprime l'enregistrement. Mais s'il clic sur le bouton
`Non', rien ne se passe.
4.4.2 Le menu `consulter'
Ce menu gère la lecture et la consultation des
informations enregistrées. Il est constitué des sous-menus
suivant comme l'indique la figure 4.9.
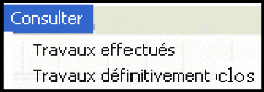
Figure 4.9 : `les sous-menus du menu
Consulter'
4.4.2.1 Le sous-menu `Travaux effectués'
Il affiche la liste des travaux exécutés. Son
interface est présentée à la figure 4.10.
4.4.2.2 Le sous-menu `Travaux définitivement
clos
Tout comme les travaux effectués, le sous menu `Travaux
définitivement clos' affiche la liste des travaux définitivement
réceptionnés. Les deux sous-menus permettent à
l'utilisateur de consulter les enregistrements effectués.
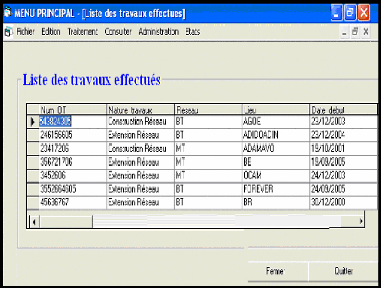
Figure 4.10 : Interface `Liste des travaux
effectués'
4.4.3 Le menu `Administration'
Ce menu gère l'application de façon à ce
que les utilisateurs aient un accès limité à
l'application. Ce menu n'est uniquement réservé qu'à
l'administrateur de cette application. Il est constitué des sous-menus
que nous indique la figure 4.11.

Figure 4.11 : `les sous-menus du menu
Administration' 4.4.3.1 Le sous-menu `Utilisateur'
Ce sous-menu permet à l'administrateur d'attribuer un nom
et un mot
de passe à toute personne désireuse de faire usage
de cette application. La figure 4.12 représente l'interface
utilisateur.
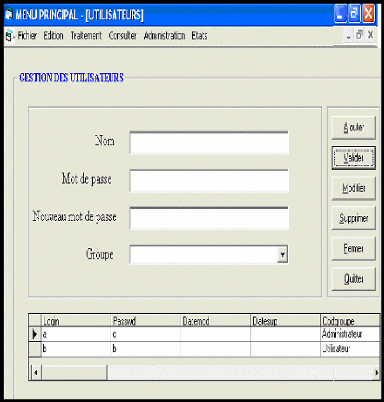
Figure 4.12 : Interface `Utilisateur'
4.4.3.2 Le sous-menu `Société
A partir de ce sous-menu, l'administrateur peut modifier
certains
paramètres de l'application. Son interface est
présentée à la figure 4.13.
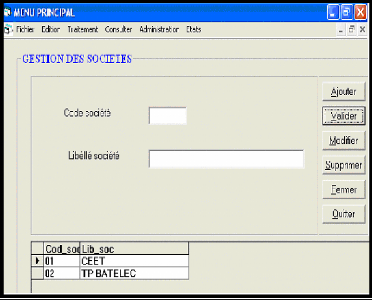
Figure 4.13 : Interface
`Société' 4.4.4 Le menu
`Etat'
Ce menu est destiné à gérer les impressions
des différentes listes. Ces sous-menus sont représentés
sur la figure 4.14.
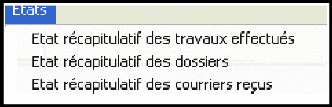
Figure 4.14 : `Les sous-menus du menu
Etats
4.4.4.1 Le sous-menu Etat récapitulatif des
`Travaux effectués'
Ce sous-menu affiche la liste récapitulative des Travaux
effectués pour l'impression.
4.4.4.2 Le sous-menu Etat récapitulatif des
`Dossiers'
Il affiche la liste récapitulative des dossiers pour
l'impression. Son interface est présentée à la figure
4.15.
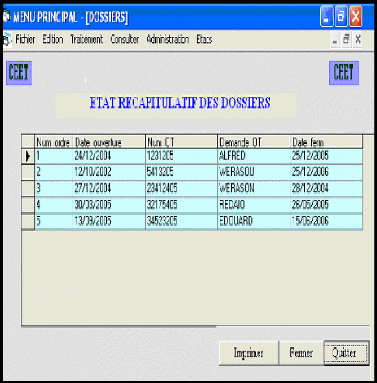
Figure 4.15 : Interface `Etat
récapitulatif des dossiers' 4.4.4.3 Le sous-menu Etat
récapitulatif des `Courriers'
Ce sous-menu affiche la liste récapitulative des Courriers
reçus pour
l'impression. Dans les trois sous-menus, les boutons imprimer,
fermer, quitter jouent les rôles suivants :
- le bouton `Imprimer' permet d'envoyer les valeurs
enregistrées dans la base de données vers l'imprimante ;
- le bouton `Fermer' permet de fermer cette interface ;
- le bouton `Quitter' permet de quitter l'application.
4.5 Configuration minimale matérielle et
logicielle
`GESATCRE' fonctionne sous l'environnement Windows 95 et toute
autre version supérieure à Windows 95 à l'exception de
Linux. Il a une capacité de 16 Mo et est disponible sur CD ROM. GESATCRE
peut être installé sur tout ordinateur doté au minimum
d'une capacité de 64 Mo de mémoire RAM et d'une vitesse de
processeur d'au moins 166 Mhz. Son installation est facilement
réalisable.
4.6 Installation de `GESATCRE'
Pour l'installer, il suffit de lire son CD ROM sur un
ordinateur puis cliquer sur SETUP. Il commence par copier les fichiers sur
votre disque dur comme l'indique la figure 4.16.
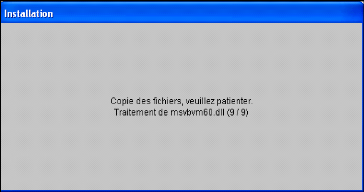
Figure 4.16 : Interface de copie des fichiers
A la fin de la copie des fichiers il vous présente
l'interface de l'installation proprement dite que nous illustre la figure
4.17.
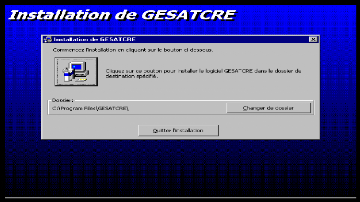
Figure 4.17 : Interface d'installation de
`GESATCRE'
Toute fois un clic sur le bouton `Ok' vous permet de terminer
l'installation. Par ailleurs si vous cliquer sur le bouton `Quitter
l'installation', l'installation s'annule et procède à la
suppression des fichiers déjà installés.
4.7 Les Avantages qu'offre l'application
Cette application permet de :
- Améliorer le contrôle des travaux de construction
de réseau électrique, - Suivre la prestation des sous-traitants
;
- Diminuer les risques de pertes d'informations relatives aux
courriers ; dossiers et aux travaux effectués ;
- Archiver les dossiers.
Conclusion
`GESATCRE 'de part sa composition et son fonctionnement, est
un
logiciel de gestion des travaux de construction de
réseau électrique. Il permet non seulement de gérer les
informations sur le contrôle des travaux de construction de réseau
électrique mais aussi de suivre la prestation des sous-traitants et
d'assurer par conséquent la qualité et la continuité de
service à la clientèle.
Conclusion générale
Conclusion générale
Le projet de fin de formation que nous venons d'achever a
été fait pour permettre à la CEET de faire face à
des besoins en construction et d'extension de réseau électrique
qui de nos jours sont sans cesse croissante.
Nous espérons qu'avec nos approches de solutions notre
travail servira de document de base à la CEET dans l'élaboration
des travaux de construction de réseau électrique en vue d'une
amélioration de la qualité de service à la
clientèle.
Nous pouvons oser croire que notre logiciel contribuera
à la gestion efficace des travaux de construction de réseau
électrique pour la CEET et qu'il pourra s'adapter la où le besoin
se ferra sentir.
Concernant notre stage à la CEET nous pouvons dire
qu'il a été positif car il nous a permis de nous familiariser
avec le monde du travail et surtout avec des réalités techniques
sur le terrain, d'accroître nos connaissances dans le domaine et
d'acquérir les aptitudes pouvant nous aider à accomplir nos
tâches dans l'exercice de notre fonction.
Bibliographie
Bibliographie
[1] AUTHERMUHL Frank: Access 97, Edition Micro application,
1997; (Pages 41, 70, 87,106).
[2] OURO-YONDOU : Caractéristiques du réseau de
distribution 20 kV de Lomé ; 1998 ; (Pages 10-14).
[3] BLEUX J.M. ; FANCHON J.L.: Maintenance : Systèmes
Automatisés de production, Edition NATHAN 1997 ; (Pages 295, 363-365,
387).
[4] BOURGEOIS R. ; COGNIEL D. : Mémotech
Electrotechnique, Edition Casteilla 5eme Edition (Educalivre) 2004 ;
(Page 54)
[5] DEGLA Essenouwa: Mémoire de fin de formation en
BTS Electrotechnique ; Organisation de la maintenance des ouvrages
électrique HTA aérien ; Lomé, Togo ; 2002 ; (Pages 29-30,
33, 35).
[6] GOUTENI Kalimou : Mémoire de fin de formation en
BTS Electrotechnique ; Réorganisation de la maintenance Basse Tension de
Togo Electricité ; Lomé, Togo ; 2006 ;( Pages 8, 15,18, 20).
[7] HARTMAN Patricia: Visual Basic 6.0 (formation visuelle),
First interactive; 2000; (Pages 63 - 69, 75 - 78, 112).
[8]
http://www.acheteursinfo.com/actualites
sous-traitance.html
ANNEXE
Présentation du cadre de
stage
Ce document est réalisé à la suite d'un
stage effectué à la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET).
Il est le résultat d'une étude menée en vue de faire une
analyse sur les travaux de construction de réseaux électriques et
donner des approches de solutions afin d'améliorer la qualité de
service du réseau d'une part et le contrôle des travaux de
construction de réseau électrique d'autre part.
La CEET est une société d'état
créée le 20 mars 1963 et a son siège au 426 avenue
Léopold Sedar Senghor à Lomé. Elle avait pour mission
principale la production, le transport et la distribution de l'énergie
électrique sur tout le territoire togolais. Le 27 juillet 1968 suite
à un accord signé entre le Togo et le Bénin, est
née une institution publique internationale qui a pour nom CEB (la
communauté électrique du Bénin). Les deux états
confièrent désormais la production et le transport de
l'énergie électrique à la CEB sur les deux territoires. Ce
n'est qu'à partir de ce moment que la CEET est devenue essentiellement
la société de distribution de l'électricité ne
disposant que de quelques moyens de production dans les localités qui ne
sont pas raccordées sur le réseau interconnecté de la CEB
ou comme secours.
En septembre 2001 à l'issu d'un appel d'offre
international, l'état Togolais confie la distribution de
l'électricité à la filiale du groupe SUEZ dont Elyo le
principal actionnaire pour une durée de cinq ans renouvelable. Ainsi
Elyo signe une convention de concession avec l'Etat Togolais le 5 septembre de
la même année donnant naissance à Togo
Electricité.
Suite à la résiliation de la convention de
concession avec Elyo, l'Etat Togolais confie à nouveau la gestion de
l'électricité à la CEET pour une durée de six mois
renouvelable à compter du 22 février 2006. Pour une gestion
efficace, le comité de gestion provisoire de la CEET a
approuvé
outre la Direction Générale et la Direction
Générale Adjointe, l'organigramme suivant :
· La Direction de la Planification et des Investissements
(DPI)
· La Direction des Exploitations (DEX)
· La Direction Région Nord (DRN)
· La Direction Commerciale et de la Clientèle
(DCC)
· La Direction Financière et Comptable (DFC)
· La Direction des Affaires Générales et de
la Communication (DAGC)
· La Direction de l'Informatique (DI)
· La Direction des Ressources Humaines (DRH)
Les départements sont placés sous certaines
directions comme suit :
A la Direction Générale
- Le Département Audit,
- Le Département Contrôle,
- Le Département Approvisionnement et Gestion des
Stocks,
A la Direction des Exploitations
- Le Département de la production,
A la Direction Commerciale et de la
clientèle
- Le Département Opération
Clientèle,
- Le Département Coordination Sud, - Le Département
Grand Compte,
A la Direction Région Nord
- Le Département Coordination Nord.
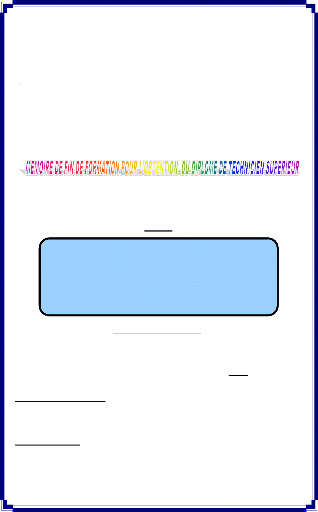
Ministère de l'Enseignement Technique
République Togolaise
Et de la Formation Professionnelle Travail
Liberté
Patrie
(METFP) ********
Office du Brevet de Technicien Supérieur
(OBTS)
Institut Supérieur de Management Et de
Développement
(ISMAD)
(BTS)
OPTION : ELECTROTECHNIQUE
Thème
LA SOUS-TRAITANCE ET LE CONTROLE
DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE
RESEAU ELEC TRIQUE AERIEN
HTA / BTA de la CEET
:
Diagnostic et Approches de Solutions
Présenté et soutenu par : Essofa-Deh
OURO-AGORO
Jury:
Directeur de Mémoire : Président :
M. GNARO Aouissi
M. François BENISSAN, Chef Division Technique au CNPP
Ingénieur Génie Electrique
Maître de Stage : Membre : M. BOKOVI
Yao
M. Abass ABOULAYE, Enseignant Chercheur à l' ENSI
Ingénieur Génie Electrique,
CEET
| 


