|
Année académique : 2014 / 2015
REPUBLIQUE DU
CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
UNIVERSITE DE NGAOUNDERE
FACULTE
DES SCIENCES
|
|
REPUBLIC OF
CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
THE UNIVERSITY OF
NGAOUNDERE
FACULTY OF SCIENCES
|
DEPARTEMENT DES SCIENCES BIOMEDICALES DEPARTMENT OF
BIOMEDICAL SCIENCES
FILTRATION GLOMERULAIRE CHEZ DES
PATIENTS
DIABETIQUES ET /OU HYPERTENDUS SUIVIS A L'HOPITAL DE
DISTRICT DE
LA CITE VERTE: DETERMINATION DE LA
CREATINEMIE, PROTEINURIE ET
UREMIE
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme de Master en Biologie Clinique par :
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE (10A798FS)
Licenciés ès
sciences
Sous la direction de:
Pr. TCHIEGANG CLERGE
Enseignant à
l'IUT
Université de Ngaoundéré
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
DEDICACE
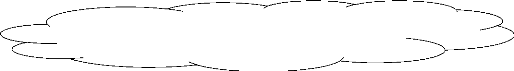
Je dédie ce travail à mon feu père
BILONGO ABESSOLO
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page i
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail a été rendue
possible grâce au concours de plusieurs personnes, nous remercions ainsi
:
Le Directeur de l'Hôpital de district de la
Cité Verte, Docteur MENDIMI NKOLO Joseph, pour nous avoir
permis de réaliser cette étude dans sa structure
hospitalière ;
Le Docteur SEYDI Fatoumata, pour l'aide
précieuse dans la sélection des patients; nous vous devons une
sincère reconnaissance ;
Les techniciens du laboratoire de
l'Hôpital de district de la Cité Verte, pour votre appui technique
et votre disponibilité ;
Le Professeur TCHIEGANG Clergé,
malgré vos multiples occupations, vous avez accepté de
diriger notre travail et surtout pour toutes vos critiques mélioratives
et corrections apportées à ce travail ;
Le Docteur ATEBA MINFOUMOU Ghislaine, pour avoir
accepté de diriger ce travail vos remarques et vos conseils auront
été très bénéfiques ;
Le Recteur de l'université de
Ngaoundéré, Professeur AVAM ZOLLO Paul Henry, pour avoir
permis la création de la filière Science Biomédicale au
sein de son institution ;
Le Doyen de la Faculté des Sciences,
Professeur BITOM Dieudonné Lucien, pour nous avoir
accompagnés dans notre cursus ;
Le Chef de Département des Sciences
Biomédicales, Docteur MBO AMVENE Jérémie, pour
son management au sein du département ;
Tous les enseignants du Département des Sciences
Biomédicales, pour tous les efforts fournis en vue de nous
offrir une formation de qualité ;
Le Docteur GHOMDIM NZALI, pour votre
disponibilité incommensurable ; La famille BILONGO,
pour m'avoir toujours soutenu au cours de mon cursus ; Mes camarades et
amis, pour leur solidarité ;
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page ii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
LISTE DES ABREVIATIONS vii
CARTE viii
LISTES DES FIGURES ix
LISTE DE PLANCHES x
LISTE DES TABLEAUX xi
RESUME xii
ABSTRACT xiii
INTRODUCTION 1
Partie I : REVUE DE LA LITTERATURE 4
I. GENERALITES 4
I.1 Généralités sur le diabète
sucré et l'hypertension 5
I.1.1 Diabète sucré 5
I.1.1.1 Le diabète de type 1 (DT1) 5
I.1.1.2 Le diabète de type 2 (DT2) 5
I.1.2 Hypertension artérielle (HTA) 5
I.2 Répartition épidémiologique du
diabète, de l'hypertension artérielle et de la
néphropathie. 6
I.2.1 Répartition épidémiologique du
diabète. 6
I.2.2 Répartition épidémiologie de
l'hypertension artérielle. 7
I.2.3 Répartition épidémiologique de la
néphropathie. 8
I.3 Influence de l'alimentation sur le diabète
sucré et sur l'hypertension artérielle. 8
I.3.1 Influence de l'alimentation sur le diabète
sucré. 9
I.3.1.1 les glucides 9
I.3.1.2 Les fibres alimentaires 9
I.3.1.3 Les lipides et vitamines liposolubles 10
I.3.1.4 Les oligoéléments 11
I.3.2 Influence de l'alimentation sur l'hypertension
artérielle 11
I.3.3 Diabète, hypertension artérielle et
antioxydant 13
II. RAPPEL ANATOMIQUE ET FONCTIONNEL DU REIN
14
II.1 Rappel anatomique 14
II.2 Rappel fonctionnel 15
II.2.1 Fonction excrétoire 15
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page iii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
II.2.1.1 Filtration glomérulaire 16
II.2.1.2 Réabsorption tubulaire 16
II.2.1.3 Sécrétion tubulaire. 17
II.2.2 Les autres fonctions du rein 17
III. ORGANES ATTEINTS PAR DES COMPLICATIONS DU DIABETE ET DE
L'HYPERTENSION.
18
III.1 Organes atteints par des complications du
diabète 18
III.1.1 Le rein (mécanisme d'atteinte du rein par le
diabète). 18
III.1.2 Les autres organes atteints par les complications du
diabète 19
III.2 Organes atteints par des complications de
l'hypertension 20
III.2.1 Le rein (mécanisme d'atteinte du rein par
l'hypertension) 20
III.2.2 Les autres organes atteints par les complications de
l'hypertension artérielle. 20
IV. ATTEINTES GLOMERULAIRES DUES AU DIABETE ET A
L'HYPERTENSION :
NEPHROPATHIES DIABETIQUE ET HYPERTENSIVE. 21
IV.1 Mécanisme de la néphropathie
diabétique. 21
IV.1.1 Mécanisme génétique. 21
IV.1.2 Mécanismes métaboliques moléculaires
21
IV.1.2.1 Stress oxydatif 21
IV.1.2.2 Voie des polyols 22
IV.1.2.3 Produits terminaux de la glycation avancée (AGE)
23
IV.2 Néphropathie hypertensive. 24
V. PARAMETRES BIOCHIMIQUES D'EXPLORATION FONCTIONNELLE DU
GLOMERULE. 26
V.1 Créatinine plasmatique. 26
V.1.1 Rôle. 26
V.1.2 Mode de formation 26
V.2 Urée sanguine. 27
V.3 Protéinurie 28
V.3.1 Rôle 28
V.3.2 Protéinurie sur bandelette urinaire (BU) et
dépistage en néphrologie 28
Partie II : MATERIEL ET METHODES 29
I. MATERIEL. 31
I.1 Lieu et population d'étude. 31
I.2 Matériel de récolte des données.
31
I.3 Documents administratifs. 31
I.4 Matériel pour l'examen clinique. 31
I.5 Matériel de prélèvement.
32
I.6 Matériel biologique 32
I.7 Matériel pour diverses explorations biologiques
32
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page iv
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
II. METHODOLOGIE. 33
II.1 Echantillonnage: Critères d'inclusion et
d'exclusion. 33
II.2 Les prélèvements. 34
II.2.1 Préparation du malade et Prélèvement
de l'échantillon biologique Sanguin. 34
II.2.2 Préparation du malade et Prélèvement
de l'échantillon biologique Urinaire. 34
II.2.3 Analyse des liquides biologiques. 34
II.2.3.1 Analyse qualitative et semi-quantitative par bandelettes
urinaires réactives. 34
II.2.3.2 Dosage de la créatinine sérique 36
II.2.3.3 Détermination de la Clairance de la
Créatinine (ClCr). 38
II.2.3.4 Dosage de l'urée (méthode enzymatique
à l'uréase) 39
III. ANALYSE DES DONNEES 40
Partie III : RESULTATS ET DISCUSSION 42
I. DONNEES CARACTERISTIQUES SUR LA POPULATION D'ETUDE
43
I.1 Répartition de la population
générale en fonction du sexe et des tranches d'ages. 43
I. 2 Répartition des patients en fonction du type de
pathologie. 44
II. PARAMÈTRES BIOLOGIQUES. 45
II.1 Créatinémie. 45
II.1.1 Répartition de la Créatinémie en
fonction des sous-groupes. 45
II.1.2 Répartition de la créatinémie en
fonction des tranches d'âges des patients. 46
II.2 Urémie 47
II.2.1 Répartition de l'Urémie en fonction des
sous-groupes des patients 47
II.2.2 Répartition de l'urémie en fonction des
tranches d'âges des patients 48
II.3 protéinurie sur bandelette urinaire 49
II.4 Glycosurie sur bandelette urinaire 50
II.5 Débit de Filtration Glomérulaire
51
II.5.1 Répartition du Débit de Filtration
Glomérulaire en fonction des sous-groupes des
patients 51
II.5.2 Répartition du Débit de Filtration
Glomérulaire en fonction des tranches d'âges 52
II.5.3 Corrélation entre la créatinémie
et le débit de filtration glomérulaire en fonction des
sous groupes de patients et les tranches d'âge. 54
III. INFLUENCE DES ALIMENTS CONSOMMÉS CHEZ LES
MALADES NON SUIVIS ET LES
MALADES SUIVIS. 54
CONCLUSION 57
PERSPECTIVES 58
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 59
i
ANNEXES
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page
v
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
ANNEXES 1 : FICHE DE COLLECTE DES DONNEES
ii
ANNEXES 2 : LES TABLEAUX v
Tableau 1A : Répartition de la
population en fonction des tranches d'âges dans les différents
sous-groupes (MS, MNS, PS). v
Tableau 2A : Répartition de la
population en fonction du type de pathologie. v
Tableau 3A : Variation de la
créatinémie dans les différents sous-groupes de
patients. v
Tableau 4A : Variation de la
Créatinémie en fonction des tranches d'âges.
vi
Tableau 5A : Variation de l'urémie
dans les différents sous-groupes de patients. vi
Tableau 6A : Variation de l'Urémie en
fonction des tranches d'âges. vi
Tableau 7A : Moyenne du Débit de
Filtration Glomérulaire dans les différents sous-groupes
de patients. vii
Tableau 8A : Variation du Débit de
Filtration Glomérulaire en fonction des tranches
d'âges.
vii
ANNEXES 3 : LES ATTESTATIONS viii
Attestations 1A : Attestation de recherches
viii
Attestations 2A: Autorisation de recherches
ix
ANNEXES 4: FICHE DES DIFFERENTS ALIMENTS AUTORISES OU
PROSCRITS AU DIABETIQUE x
ANNEXES 5 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE
xiii
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page vi
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
LISTE DES ABREVIATIONS
ATP: Adénosine Tri Phosphate AVC
: Accident Vasculo-Cérébral BU :
Bandelette Urinaire
CML : N-Carboxyméthyl-Lysine DAG:
Diacylglycérol
DID : Diabète Insulino -
Dépendant
DT1 : Diabète De Type 1
DT2 : Diabète De Type 2
DFG : Débit de Filtration
Glomérulaire FADH2 : Flavine Adénine
Dinucléotide FID : Fédération
Internationale de
Diabétologie
GE: Advanced Glycation End - product
GLUT : Glucose Transporter
GSH : Glutathion Forme Réduite
GSSG : Glutathion Forme Oxydée
HTA : Hypertension Artérielle
HVG : Hypertrophie Ventriculaire Gauche
IEC : Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion de
l'angiotensine
IRCT : Insuffisance Rénale Chronique
Terminale
MRC : Maladie Rénale Chronique
NADH: Nicotinamide Adénosine
Déshydrogénase
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PA : Pression Artérielle
ROS : Reactive Oxygen
Species
SDH : Sorbitol Déshydrogénase
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page vii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
CARTE
Carte 1: Nombre de personnes atteintes de
diabète (20-79 ans), en 2013 et 2035, dans le monde (FID,
2013) 7
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page viii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
LISTES DES FIGURES
Figure 1: Les différentes
réactions de la voie des polyols suite à une
hyperglycémie, se déroulant dans
la cellule (WOLF, 2005). 22
Figure 2: Equation de la glycation
avancée (GILLERY, 2014) 24
Figure 3: Physiopathologie de la
néphropathie hypertensive (KESSLER, 2000). 25
Figure 4: Etape de la formation de la
créatinine (ZINSOU, 2010). 26
Figure 5: Cycle de l'urée (ZINSOU, 2010)
27
Figure 6: Schéma synoptique pour
l'étude transversale, analytique et comparative des patients
Diabétiques et/ou Hypertendus suivis à
l'Hôpital de district de la Cité Verte. 30
Figure 7: Méthode glucose-oxydase /
peroxydase (FAURE, 2012). 35
Figure 8 : Réaction de Jaffé
(CABE, 2006). 37
Figure 9 : Répartition des
différents sous-groupes de patients en fonction des tranches
d'âges 43
Figure 10 : Répartitions des patients
recrutés en fonction de leur statut. 44
Figure 11 : Comparaison de la
créatinémie dans les trois sous-groupes (MS, MNS, PS) 45
Figure 12: Répartition des moyennes de la
créatinémie en fonction des tranches d'âges des patients.
46
Figure 13: Comparaison de l'urémie dans
les trois sous-groupes (MS, MNS, PS). 47
Figure 14: Répartition des moyennes de
l'urémie en fonction des tranches d'âges des patients. 48
Figure 15 : Proportions de positivité de
la protéinurie en fonction des trois sous-groupes (MS, MNS,
PS). 49
Figure 16 : Comparaison de la glycosurie dans
les trois sous-groupes (MS, MNS, PS). 50
Figure 17 : Comparaison du débit de la
filtration glomérulaire dans les trois sous-groupes (MS, MNS,
PS) 52
Figure 18 : Répartition du
Débit de Filtration Glomérulaire en fonction des tranches
d'âges des
patients. 53
Figure 19 : Aliments les plus
consommés en fonction des sous-groupes (Malades Non Suivis,
Malades Suivis). 55
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page ix
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
LISTE DE PLANCHES
Planche 1: Présentation anatomique
interne d'un rein (MARIEB, 2008). 14
Planche 2: Structure du néphron
(GODIN, 2011). 15
Planche 3: Fonctionnement du néphron
(GODIN, 2011). 16
Planche 4: Réabsorption par les
cellules du tubule contourné proximal (SHERWOOD, 2006). 17
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page x
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Quelques exemples d'aliments
à indice glycémique bas, moyen et élevé 9
Tableau 2 : Les différents stades
évolutifs de la néphropathie diabétique 19
Tableau 3: Mode opératoire du dosage
de la créatinémie (BIOLABO, 2011). 37
Tableau 4 : Mode opératoire du dosage
de l'Urémie (BIOLABO, 2011). 40
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page xi
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
RESUME
Le Diabète et l'Hypertension Artérielle (HTA)
constituent deux des facteurs de risque majeurs de Maladies Rénales
Chroniques (MRC). Ce sont des pathologies en pleine croissance et aux lourdes
conséquences aussi bien humaines que socio-économiques.
L'objectif de cette étude transversale, analytique et comparative qui
s'est déroulée de Juin 2015 à Août 2015 était
d'explorer la filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis médicalement à
l'Hôpital de district de la Cité Verte de Yaoundé.
Après accueil des patients, l'identification de ceux répondant
aux critères de sélection était faite par le remplissage
de la fiche de collecte de données qui permettait par ailleurs d'obtenir
des informations sur leur alimentation. L'échantillon était
constitué de 99 personnes soit 30 (30%) de sexe masculin et 69 (70%) de
sexe féminin. Spécifiquement il a été
recruté 33 malades souffrant du Diabète de Type 2 (DT2) + HTA
(34%), 31 Patients Sains (31%), 29 malades souffrant de DT2 uniquement (29%), 5
malades souffrant d'HTA uniquement (5%) et 1 malade souffrant du Diabète
de Type 1 (DT1) uniquement (1%). L'évaluation de la fonction
rénale a été faite grâce aux dosages des
paramètres biochimiques que sont: l'urémie, la
créatinémie et la protéinurie. L'analyse des
données a montré que la moyenne de la créatinémie
est élevée dans le sous-groupe des Malades Non Suivis (13,21
#177; 6,75 mg/dl) et que la moyenne de l'urémie est normale (0,20 #177;
0,10 g/dl) dans le sous-groupe des Patients Sains, mais considérablement
élevée dans le sous-groupe des Malades Non Suivis (1,15 #177;
4,17 g/dl); la différence est significative avec un seuil de P? 0,05.
Par ailleurs, la protéinurie est plus marquée chez les Malades
Non Suivis (34,4%) comparativement au sous-groupe de Malades Suivis (16,66%),
chez les Patients Sains, aucune positivité n'est observée.
L'étude a montré que la moyenne du débit de filtration
glomérulaire est normale (103 #177; 22,91 ml/min/1,73 m2)
chez les Patients Sains, basse chez les Malades Suivis (86 #177; 20,63
ml/min/1,73 m2), et encore plus basse chez les malades non suivis
où une différence très significative a été
observée (65,87 #177; 23,19 ml/min/1,73 m2). Entre autre, une
enquête alimentaire faite a révélé que les Malades
Suivis avaient un régime alimentaire qui correspond mieux à leur
profil pathologique comparé aux Malades Non Suivis. Le calcul de la
clairance de la créatinine et la détermination du débit de
filtration glomérulaire ont montré que le suivi médical
ralentit la survenue de la néphropathie.
Mots clés: Hôpital de district
de la Cité Verte, Diabète, HTA, Filtration glomérulaire,
néphropathie.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page xii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
ABSTRACT
Diabetes and Arterial Hypertension (HTA) constitute two major
risk factors for Chronic Kidney Disease (CKD). These are growing pathologies
with serious consequences both human and socio-economic. The aim of this
cross-sectional, analytical and comparative study, which ran from June 2015 to
August 2015, was to explore the glomerular filtration rate in patients with
diabetes and / or hypertension followed medically in the 'Cité Verte'
District Hospital Yaounde. After reception of patients, identification of those
that met the selection criteria was made by filling the data collection sheet
which also allowed the obtention of information on patient diet. The sample
consisted of 99 persons; 30 (30%) males and 69 (70%) females. Specifically 33
patients were recruited with type 2 diabetes (T2D) + HTA (34%), 31 healthy
patients (31%), 29 patients with T2DM only (29%), 5 patients suffering from
hypertension only (5%) and 1 patient with type 1 diabete (T1D) only (1%).
Assessment of renal function was made through assays of biochemical parameters
which are: blood urea, blood creatinine and proteinuria. Data analysies showed
that the mean serum creatinine is elevated in the subgroup of Patients without
subscriptions (13.21 #177; 6.75 mg/dl) and the average of uraemia is normal
(0.20 #177; 0.10 g/dl) in the subgroup of healthy patients, but considerably
higher in the subgroup of Patients without subscriptions (1.15 #177; 4.17
g/dl); the difference is significant with a threshold of P? 0.05. Furthermore,
proteinuria is greater for patients without subscriptions (34.4%) compared to
the subgroup of Patients that are Followed-up (16.66%) among healthy patients,
no positivity was observed. The study showed that the average rate of
glomerular filtration is normal (103 #177; 22.91 ml / min / 1.73 m2)
in healthy patients, low in Patients Followed-up (86 #177; 20.63 ml / min /
1.73 m2), and more in non-monitored patients where a very
significant difference was observed (65.87 #177; 23.19 ml / min / 1.73
m2). Amongst others, a food survey conducted revealed that patients
that were followed-up had a diet that is best for their pathological profile
compared to patients without subscription. The determining glomerular
filtration rate showed that the medical monitoring slows the onset of
nephropathy.
Keywords: 'Cité Verte' District
Hospital, Diabetes, Arterial Hypertension, glomerular filtration, renal
disease.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page xiii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
INTRODUCTION
Le diabète est un ensemble de pathologies
métaboliques caractérisé par une hyperglycémie
secondaire chronique, suite à une difficulté de l'organisme
à produire de l'insuline ou son incapacité à l'utiliser
convenablement (FID, 2013). L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
classe le diabète sucré selon son étiologie en deux formes
(DT1 et DT2) et définie l'HTA comme étant une
élévation anormale, permanente ou paroxystique de la tension
artérielle au repos. L'HTA et le diabète sucré coexistent
fréquemment dans la population générale (KRZESINSKI et
WEEKERS, 2005). Ces pathologies représentent toutes deux des facteurs
majeurs de risque cardio-vasculaire et rénal.
Dans le monde, un adulte sur trois est atteint d'HTA et un
adulte sur dix souffre de diabète (OMS, 2012). En Afrique, plus de 40 %
d'adultes seraient hypertendus (OMS, 2012). Au Cameroun, la prévalence
de l'hypertension est de 24% dans la population générale
(BITA-FOUDA et al., 2011), celle du diabète est de 6 à
8% en zone urbaine et de 2 à 3 % en zone rurale (SHEMA, 2014).
Les atteintes rénales (néphropathies) sont des
complications majeures de ces deux pathologies. En effet, Environ 25 à
30% des sujets diabétiques de type1 développent une
néphropathie diabétique tandis que la prévalence serait
plus faible, de l'ordre de 10 à 20% chez les diabétiques de type
2 (COULIBALY, 2008). la néphropathie diabétique est actuellement
la première cause d'insuffisance rénale dans la plupart des pays
occidentaux. Entre 10 à 50% des patients selon les pays (MOGENSEN et
al., 1983). Avec 40% des causes d'insuffisance rénale chronique
terminale, la néphropathie diabétique se place au premier plan
des préoccupations en néphrologie (LASARIDIS et SARAFIDIS,
2005).
Les travaux antérieurs menés sur l'atteinte
rénale par le diabète et/ou l'HTA ont porté sur le
dépistage de la néphropathie diabétique
avérée dans la région de Fes-Boulemane en Algérie
(EL FADL, 2010), sur l'étude de quelques paramètres biologiques
et physiologiques de la néphropathie diabétique au Centre
Hospitalier Universitaire de Constantine en Algérie (REDOUANE-SALAH,
2011), sur l'étude de l'alimentation des diabétiques à
Ouagadougou au Burkina Faso (OUEDRAGO, 2002), sur la prise en charge
nutritionnelle du patient hypertendu en France (VANHOUETE, 2013). Le
diabète est une affection qui en cas de non suivi thérapeutique,
cause d'énormes conséquences sur la santé, entrainant
l'installation d'autres maladies non transmissibles telles que l'HTA, la
néphropathie diabétique et la neuropathie. Les patients
hypertendus non suivis quant à eux ont un risque accru de
présenter
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 1
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
un infarctus du myocarde, une insuffisance cardiaque, un
accident vasculaire cérébral ou encore une insuffisance
rénale (BLACHER et al., 2013). Le diabète
s'améliore généralement avec un régime alimentaire.
La diétothérapie favorise la régression d'un
diabète récent à travers un apport nutritionnel
équilibré et adapté, une minimisation des fluctuations
glycémiques, une participation au contrôle des facteurs de risque
(diminution de la masse grasse sans fonte musculaire (APPELBAM et al.,
1989)) et une réduction de l'évolution vers les complications
micro et macro vasculaires (OUEDRAGO, 2002). L'alimentation joue un rôle
majeur dans l'HTA, en effet la pression artérielle ne
s'élève pratiquement pas au cours de la vie dans les populations
à faible consommation sodée (2g/24h de chlorure de sodium) et
s'élève par contre dans celles ayant une forte consommation
sodée (ADAMA-TIEFING, 2006).
Etant donné que le diabète et l'HTA entrainent
une baisse de la filtration glomérulaire et par conséquent une
atteinte de la fonction rénale, nous nous sommes donc posés la
question de savoir si le suivi médical réduirait ou retarderait
la survenue de cette dernière d'où l'intérêt d'une
étude sur les patients diabétiques et /ou hypertendus suivis
à l'Hôpital de district de la Cité Verte (ancien centre
national de diabétologie).
L'objectif général de cette étude
était de contribuer à l'exploration de la fonction rénale
chez les patients diabétiques et/ou hypertendus suivis à
l'Hôpital de district de la Cité Verte. Spécifiquement, il
était question :
- D'évaluer la protéinurie chez les patients
diabétiques et/ou hypertendus médicalement suivis ;
Hypothèse I : chez les patients diabétiques
et/ou hypertendus médicalement suivis, la protéinurie est
normale.
- D'évaluer la créatinémie et
l'urémie chez les patients diabétiques et/ou hypertendus
médicalement suivis ;
Hypothèse 2 : chez les patients diabétiques
et/ou hypertendus médicalement suivis, la créatinémie et
l'urémie sont normales.
- D'évaluer le Débit de Filtration
Glomérulaire chez les patients diabétiques et/ou hypertendus
médicalement suivis;
Hypothèse 3 : chez les patients diabétiques
et/ou hypertendus médicalement suivis, la filtration glomérulaire
est normale.
- D'évaluer l'importance de la
diétothérapie chez les patients diabétiques et/ou
hypertendus médicalement suivis.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 2
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Hypothèse 4 : l'alimentation joue un rôle
important dans la thérapie des patients diabétiques et/ou
hypertendus médicalement suivis.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 3
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Partie I : REVUE DE LA LITTERATURE
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 4
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
I. GENERALITES
I.1 Généralités sur le diabète
sucré et l'hypertension
I.1.1 Diabète sucré
Le diabète sucré est défini par un
désordre métabolique d'étiologies diverses,
caractérisé par la présence d'une hyperglycémie
chronique, accompagné d'une perturbation des métabolismes
glucidiques, lipidiques et protéiques, résultant d'un
défaut de la sécrétion d'insuline, de son activité
ou des deux associées (CHEVENNE et FONFREDE, 2001). Selon l'OMS, le
diabète sucré regroupe le diabète de type1 et le
diabète de type2.
I.1.1.1 Le diabète de type 1 (DT1)
Anciennement appelé diabète
insulinodépendant, ce dernier correspond à la destruction des
cellules f3 des ilots de Langerhans, que l'origine soit idiopathique ou
auto-immune (GOURDI, 2011). La conséquence est un
déficit en insuline. La destruction des cellules f3 est essentiellement
due à une infiltration des îlots par des lymphocytes T Helper et
des lymphocytes T Cytotoxiques. Ce processus se déroule en silence
pendant plusieurs années et à ce moment, des auto-anticorps
dirigés contre certains antigènes pancréatiques sont
produits (GRIMALDI, 2000 ; DUBOIS, 2010).
I.1.1.2 Le diabète de type 2 (DT2)
Anciennement appelé diabète non
insulinodépendant, il correspond à l'insulinorésistance
périphérique ou à la diminution de
l'insulinosécrétion. Ce type de diabète résulte de
la conjonction de plusieurs gènes de susceptibilité, dont
l'expression dépend des facteurs environnementaux. Il s'accompagne comme
le diabète de type1 d'un risque de complications micro- vasculaires et
rénales (BUSH et PIGNET, 2001).
I.1.2 Hypertension artérielle (HTA)
Selon l'OMS, l'HTA est définie comme une pression
artérielle au-dessus de 140 mmHg pour la pression artérielle
systolique et de 90 mm Hg pour la pression artérielle diastolique (OMS,
1999). Toutefois, le seuil réel de définition de l'hypertension
doit être considéré comme variable, plus ou moins
élevé en fonction du risque cardiovasculaire global de chaque
individu (ANONYME, 2012).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 5
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
I.2 Répartition épidémiologique du
diabète, de l'hypertension artérielle et de la
néphropathie.
I.2.1 Répartition épidémiologique du
diabète.
Au niveau mondial, le nombre de diabétiques
était estimé à 366 millions en décembre 2011 et
passera à 552 millions d'ici 2030 si rien n'est fait. L'essentiel de cet
accroissement se produira dans les pays en développement (FID, 2011).
Selon les informations relayées lors du deuxième congrès
africain de diabétologie, tenu à Yaoundé du 25 au 28
février 2014, l'on apprend que 75 à 80% de personnes dans le
monde vivent avec le diabète sans le savoir (SHEMA, 2014). On estime
qu'il y aurait 14 à 16 millions de diabétiques type 1 et 2 aux
USA, soit 5% de la population totale. La prévalence du diabète en
Europe est estimée à 4% de la population totale, soit 10 à
20 % de la population de 60 ans et plus (FID, 2011).
En Afrique, ils sont 15 millions de diabétiques. Selon
l'Atlas (2012) de la FID, l'augmentation la plus importante de la
prévalence du diabète durant les deux prochaines décennies
se fera dans le continent Africain avec une augmentation estimée
à plus de 90% d'ici 2030.
Au Cameroun, 6,15% de la population sont atteints de
diabète avec 520 000 personnes de 20-79 ans diagnostiquées du
diabète (FID, 2012). Dans les zones rurales, 2 à 3% de personnes
vivraient avec le diabète, tandis que ce chiffre oscillerait entre 6 et
8% dans les zones urbaines. Ce qui représente sur l'effectif de la
population du Cameroun, 900 000 personnes. Les chiffres sont d'une source
institutionnelle proche du ministère de la Santé publique du
Cameroun (SHEMA, 2014).
La carte 1 montre les régions de la FID et les
projections mondiales concernant le nombre de personnes atteintes par le
diabète.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 6
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
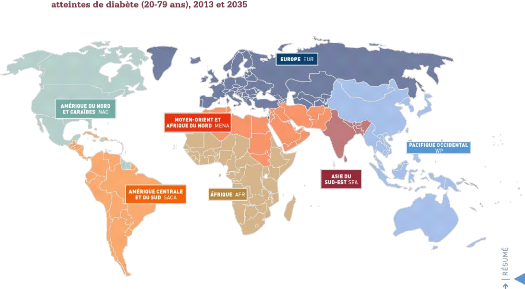
|
RÉGION DE LA FID
|
ANNEE 2013
(MILLIONS)
|
ANNEE 2035 (MILLIONS)
|
|
Afrique
|
19 , 8
|
41 , 4
|
|
Moyen-Orient et Afrique du Nord
|
34 , 6
|
67 , 9
|
|
Asie du Sud-est
|
72 , 1
|
123
|
|
Amérique centrale et du Sud
|
24 , 1
|
38 , 5
|
|
Pacifi que occidental
|
138,2
|
201,8
|
|
Amérique du Nord et Caraïbes
|
36 , 7
|
50 , 4
|
|
Europe
|
56 , 3
|
68 , 9
|
Monde 381,8 591,9
Carte 1: Nombre de personnes atteintes de
diabète (20-79 ans), en 2013 et 2035, dans le monde (FID, 2013).
I.2.2 Répartition épidémiologie de
l'hypertension artérielle.
On estime que plus du quart de la population adulte mondiale
(26,4%), soit près d'un
milliard de personnes souffraient d'une HTA en l'an 2000, cette
proportion va augmenter pour atteindre 29% en l'an 2025, soit 1,56 milliard de
personnes (DZUDIE et al., 2012). Si
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 7
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
l'HTA est plus fréquente dans les pays
développés (37,3% versus 22,9%), elle touche plus de personnes
dans les pays en développement du fait d'une population plus importante.
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que, dans le monde,
l'HTA causerait 7,1 millions de décès, soit 13% de la
mortalité globale. La prévalence de l'hypertension a sensiblement
augmenté au cours des deux ou trois dernières décennies.
Dans la région africaine, 40% des adultes seraient affectés (OMS,
2012). En Afrique subsaharienne, environ 80 millions d'adultes souffraient
d'hypertension à l'an 2000 et les prévisions fondées sur
les données épidémiologiques actuelles suggèrent
que le nombre atteindra 150 millions à 2025 (UNION AFRICAINE, 2014). Au
Cameroun, cette prévalence est estimée à 24% dans la
population générale (BITA-FOUDA et al., 2011).
I.2.3 Répartition épidémiologique de
la néphropathie.
La néphropathie diabétique est actuellement la
première cause d'insuffisance rénale dans la plupart des pays
occidentaux. Entre 10 à 50% des patients selon les pays.
Environ 25 à 30% des sujets diabétiques de type1
développent une néphropathie diabétique tandis que la
prévalence serait plus faible, de l'ordre de 10 à 20% chez les
diabétiques de type 2, en raison du nombre très important des
sujets diabétiques (COULIBALY, 2008). Avec 40% des causes d'insuffisance
rénale chronique terminale, la néphropathie diabétique se
place au premier plan des préoccupations en néphrologie
(LASARIDIS et SARAFIDIS, 2005).
I.3 Influence de l'alimentation sur le diabète
sucré et sur l'hypertension artérielle.
La ration alimentaire est la quantité d'aliments
permettant de satisfaire les besoins en énergie, en macronutriments
(protéines, lipides, glucides), en micronutriments (vitamines, sels
minéraux) et en eau d'un individu ou d'un groupe de personnes
(MAKRELOUF, 2011).
Chez un individu sain, l'établissement d'une ration
alimentaire tient compte de la répartition souhaitable des
macronutriments : 15 % environ de l'apport énergétique doit
être fourni par les protéines (viandes, poissons, laitages, soja,
légumes secs), 30 % par les lipides (beurre, margarine, huile) et 55 %
par les glucides, dont 10 % au maximum par les glucides rapides (aliments
sucrés). Les rations alimentaires sont établies à partir
des différents groupes d'aliments (fruits et légumes, corps gras,
produits laitiers, céréales, viandes, poissons, etc...) et
comptabilisent l'apport éventuel fourni par des boissons
alcoolisées idéalement inférieur à 10 % de l'apport
énergétique total (MAKRELOUF, 2011).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 8
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
I.3.1 Influence de l'alimentation sur le diabète
sucré.
L'alimentation joue un rôle majeur dans le
bien-être et la santé des diabétiques, car elle permet de
combler ses besoins nutritionnels, de contrôler le glucose sanguin,
d'atteindre un poids et des taux de lipides sanguins adéquats, de
contrôler la pression artérielle et de prévenir les
complications de la maladie (BRAND-MILLER, 2003).
I.3.1.1 les glucides
Il est important de limiter l'hyperglycémie post
prandiale en palliant à l'insuffisance régulatrice de
l'activité pancréatique par la consommation d'aliments qui ne
provoquent pas une brusque montée de la glycémie, donc qui sont
lentement absorbés au niveau intestinal. Cette capacité est
représentée par l'index glycémique des différents
aliments (échelle qui classe les aliments riches en glucides en fonction
de leur effet sur l'augmentation de la glycémie par rapport à un
aliment de référence, soit le glucose ou le pain blanc) (GUILBERT
et al., 2003). Le tableau 1 répertorie quelques aliments en
fonction de leurs indices glycémiques.
Tableau 1 : Quelques exemples d'aliments
à indice glycémique bas, moyen et élevé
|
Indices
glycémiques faibles
(inférieur à
39)
|
Indices glycémiques
moyens (compris entre 40 et 59)
|
Indices glycémiques
élevés (supérieur à
60)
|
|
Carottes crues
|
Bananes vertes
|
Bananes mures
|
|
Avocats
|
Blé, céréales complètes
sans sucre
|
Farine de maïs, farines de riz
|
|
Aubergine
|
Mangues
|
Confitures
|
|
Haricot blanc,
noir ou rouge
|
Macaroni
|
Barres de chocolats
|
|
Lait de soja
|
Riz complet brun
|
Melon
|
|
Mandarines
|
Noix de coco
|
Miel
|
|
Epinard
|
Patates douces
|
Dattes
|
|
|
|
I.3.1.2 Les fibres alimentaires
Des études ont révélé que les
fibres alimentaires, surtout d'origine céréalière,
pourraient réduire le risque de DT2. Une fois le diabète
déclaré, un apport élevé en fibres semble
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 9
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
favoriser la diminution des lipides sanguins. Les fibres
solubles en particulier, ralentissent la vidange gastrique et retarde
l'absorption du glucose dans l'intestin grêle, ce qui améliore la
glycémie après les repas (ANONYME, 2008).
Ainsi, les produits riches en fibre solubles (haricots,
lentilles, pois) ont un faible indice glycémique car leurs fibres
freinent le passage du glucose dans le sang. La consommation de fruits,
légumes, légumineuses et céréales n'ayant pas subi
de traitements renforçant leur index glycémique (raffinage)
exerce ainsi une bonne incidence sur l'état du diabétique. Il
faut privilégier les aliments contenant des glucides présents
naturellement comme des fruits (GUILBERT et al., 2003).
I.3.1.3 Les lipides et vitamines liposolubles
Le risque de développer le diabète est de 55 %
plus élevé chez les sujets consommant beaucoup de lipides
(GUNNARSDOTTIR et al., 2008). Il est donc nécessaire de
réduire l'apport en lipides et privilégier les bons acides gras.
Il est primordial, lorsque l'on est diabétique, de réduire la
quantité totale d'acides gras ingérée; surtout ceux de
type saturés et trans. Puisque le risque de maladies cardiovasculaires
est de 2 à 3 fois plus élevé en présence qu'en
l'absence de diabète, les gras saturés (crème fraiche,
graisse de boeuf, huile de palme, huile de cocco) doivent représenter
moins de 7 % de l'apport énergétique quotidien et l'apport en
acides gras trans doit être aussi faible que possible. Les aliments
riches en acides gras polyinsaturés (w3, w6) dits « essentiels
» car l'organisme ne sait pas les fabriquer, doivent être
apportés quotidiennement par l'alimentation pour couvrir nos besoins
physiologiques. Les acides gras polyinsaturés (w3, w6) possèdent
de nombreuses propriétés: participent à la constitution de
la membrane cellulaire, protègent la fonction cardiovasculaire,
interviennent dans le contrôle de l'inflammation. Les aliments riches en
acides gras polyinsaturés (w3, w6) tels que l'huile de tournesol,
l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de soja, huile de pépin de
raisin, l'huile de maïs, l'huile de sésame sont par
conséquent à privilégier (ROS, 2003). Ceux riches en acide
gras mono-insaturés ou acide oléique ou w9 (huile d'olive,
avocat, margarine non hydrogénée, noix et graines, beurre
d'arachide naturel, huile d'arachide) sont à consommer parce qu'ils
maintiennent le taux de bon cholestérol (HDL), augmente la
sensibilité à l'insuline et réduit le taux de
triglycérides sanguins dans l'organisme (ROS, 2003). Il est
recommandé de consommer également les aliments riches en w3
d'origine marine (maquereau bleu). Ces w3 peuvent réduire le risque de
maladies cardiovasculaires chez les diabétiques (ANONYME, 2008).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 10
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
L'apport en vitamines E (antioxydant), A (vision) et D
(fixation du calcium) doit être privilégié (ANONYME,
2013).
I.3.1.4 Les oligoéléments
Les oligoéléments jouent un rôle très
important dans le diabète ; nous pouvons citer :
- Le zinc qui joue un rôle considérable pour la
circulation de l'insuline. Il est un composant de l'insuline et
nécessaire à son stockage, mais aussi à l'impact de cette
hormone. Les diabétiques sont plus souvent atteints d'une carence en
zinc que les non-diabétiques. C'est la raison pour laquelle on observe
chez les diabétiques une dégradation de la synthèse
d'insuline (GUILBERT et al., 2003). Les meilleures sources de zinc
sont : la germe de blé, la viande et les abats (foie de veau, boeuf
haché, agneau), les légumineuses.
- Le magnésium interagit avec les glucides et
l'insuline. Il est notamment essentiel à l'action de l'insuline. Les
meilleures sources de magnésium sont : les noix et les graines, les
épinards, le cacao, les légumineuses, le thé et certains
fruits (ananas, raisin, framboise). (GUILBERT et al., 2003).
- Le Nikel, le Cobalt et le Chrome
Le nickel a un rôle digestif, car il potentialise
l'activité de l'insuline. Tandis que le cobalt potentialise l'action du
zinc et a une action neurovégétative. Le chrome régule le
taux de sucre dans le sang pendant 24 heures. Il est indispensable au
métabolisme des glucides, réduit le taux de cholestérol et
protège les artères (GUILBERT et al., 2003).
I.3.2 Influence de l'alimentation sur l'hypertension
artérielle
I.3.2.1 Influence des minéraux sur
l'hypertension
Plusieurs études suggèrent l'importance de
l'alimentation dans la régulation de la pression artérielle. En
cas d'hypertension, il convient de veiller à un apport suffisant en
sodium, calcium, potassium, magnésium. Des études ont
démontré qu'une simple augmentation de l'apport en potassium
pouvait abaisser sensiblement la tension artérielle, car le potassium et
le calcium semblent être des adversaires du sodium (MELANDER et
al., 2007).
- Le sodium est à consommer avec beaucoup de
modération. Il est retrouvé dans le sel de cuisine NaCl (sel
visible) et existe parfois naturellement dans l'aliment consommé ou on
l'ajoute au cours de la fabrication de ce dernier. Il s'agit des produits
courants comme le
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 11
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
fromage, le pain, les charcuteries, les condiments (moutardes,
bouillons) (VANHOUETE, 2013). En effet, le mécanisme d'action exact du
sel sur la pression artérielle est encore inconnu, il semble illusoire
de penser qu'un seul mécanisme en soit la cause. Plusieurs
mécanismes ont été proposés mais ils restent encore
controversés entre autres, il agirait par vasoconstriction et
augmenterait par conséquent la pression artérielle. La
consommation à long terme d'une trop grande quantité de sel peut
être un facteur de risque important dans le vieillissement
prématuré du système circulatoire et dans l'apparition de
la rigidité vasculaire. Ceci pourrait être la cause de
l'activation du système rénine angiotensine aldostérone
(VANHOUETE, 2013). Aussi, le sodium contribuerait au vieillissement
rénal; le rein est l'organe essentiel à la régulation du
sel présent dans notre organisme. Le vieillissement du rein est normal
au cours du temps et se caractérise le plus souvent par une insuffisance
rénale plus ou moins importante. Cependant, la consommation excessive de
sel pour le rein peut conduire à un vieillissement
prématuré et donc aggraver cette insuffisance rénale
(VANHOUETE, 2013).
- Le calcium : couvrir son apport alimentaire quotidien est
nécessaire (400-500 mg/jr), le calcium joue un grand rôle dans
l'hypertension artérielle. En effet, au niveau cellulaire, le calcium
est un médiateur de la vasoconstriction ou de la vasodilatation. Des
canaux calciques voltage dépendants présents dans les membranes
cellulaires participent à l'activité des muscles (coeur) et des
cellules nerveuses. Il a donc un rôle dans la transmission de l'influx
nerveux (VANHOUETE, 2013).
Les sources de calcium sont : lait et dérivés,
jus d'orange, chou vert, haricots rouges, épinards (WEAVER et
al., 1999).
- Le potassium devrait être apporté en
quantité suffisante, la survie des cellules et le maintien du
système cardiaque en état de fonctionnement nécessitent un
apport quotidien d'au moins 2g de potassium à travers notre
alimentation. Il va intervenir à 3 niveaux différents : au niveau
cellulaire (joue un rôle essentiel dans la régulation de
l'équilibre ionique entre le liquide intracellulaire et extracellulaire
mais aussi dans le maintien de l'équilibre des fluides du corps), de
l'activité nerveuse (en association avec le sodium, le potassium permet
la transmission de l'influx nerveux), dans le système cardiovasculaire
en abaissant la pression artérielle (VANHOUETE, 2013).
Les sources de potassium sont : avocats, bananes, carottes
(WEAVER et al., 1999).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 12
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
- La consommation d'aliments riches en magnésium est
indispensable, son apport journalier est de 300 mg/jr au minimum chez les
patients hypertendus. Le magnésium permet le transport des ions
potassium et calcium à travers la membrane cellulaire et donc influe
dans l'homéostasie des ions. Il est aussi indispensable au
fonctionnement d'un certain nombre de pompes de transports (pompe Na+/K+). Par
ailleurs, l'action du magnésium sur la pression artérielle
pourrait être en partie due à son action antioxydante et
anti-inflammatoire sur le système vasculaire. La présence
d'espèces réactives de l'oxygène au niveau vasculaire peut
endommager la contraction des cellules musculaires lisses vasculaires, ainsi
que leur croissance (VANHOUETE, 2013).
Les sources de magnésium sont : fruits de mer, cacao,
amandes, pain complet, choux (WEAVER et al., 1999).
Il est par ailleurs recommandé de :
- Consommer de préférence les acides gras
oméga-3 qui abaissent la tension artérielle
(MORI, 2006).
- Limiter sa consommation d'alcool (TOBE et al,
2006).
- Limiter la consommation d'excitants tels que le thé, le
café et les drogues
- Augmenter son activité physique.
I.3.3 Diabète, hypertension artérielle et
antioxydant
Il est conseillé d'augmenter la consommation
d'antioxydants car toute maladie chronique accroit le stress oxydatif qui
vieillit prématurément l'organisme. Il s'agit de fruits et
légumes (oseille, citron, orange, papaye) surtout ceux riches en
vitamine c et les polyphénols (huile d'olive, noix) ; aussi il a
été prouvé qu'une personne qui mange 06 portions de fruits
et légumes par jour réduirait le risque de DT2 de 21%
comparativement à ceux qui n'en mange que deux. Ceux qui consomment une
grande variété de fruits baissent encore ce risque de 19%.
(ANONYME, 2015).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 13
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
II. RAPPEL ANATOMIQUE ET FONCTIONNEL DU REIN
II.1 Rappel anatomique
Les reins sont deux organes quelque peu aplatis en forme de
haricot situés en arrière du péritoine, de part et d'autre
de la colonne vertébrale, contre la paroi abdominale
postérieure.
Sur une coupe frontale d'un rein, on distingue trois parties
comme le montre la planche 1. La partie la plus externe : le cortex
rénal, est de couleur pâle, d'une épaisseur d'1cm environ,
recouvre la médulla rénale de couleur rouge brun. La
médulla rénale présente 8 à 18 régions
à peu près triangulaires et d'aspect strié qui portent le
nom de pyramide rénale ou pyramide de Malpighi. La base de la pyramide
rénale est orientée vers le cortex rénal tandis que son
sommet, appelé papille rénale, est tourné vers
l'intérieur du rein. Les pyramides sont séparées par des
prolongements du tissus cortical appelé colonne rénale (MARIEB,
2008). Chaque rein est vascularisé à partir d'une artère
qui naît de l'aorte, au-dessous de l'artère
mésentérique supérieure et des artères
surrénales moyennes (MARIEB, 2008). Les veines rénales rejoignent
la veine cave inférieure. La planche 1 présente la face interne
d'un rein.
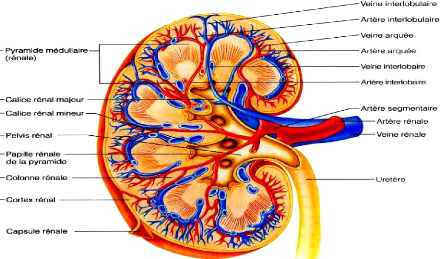
Planche 1: Présentation anatomique
interne d'un rein (MARIEB, 2008).
Chaque rein est constitué d'environ un million de
néphron ; le néphron est l'unité fonctionnelle du rein, il
comprend le glomérule et le tubule (MARIEB, 2008).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 14
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Le glomérule a la forme d'une sphère limitée
par une enveloppe, la capsule de Bowman, constituée par des cellules
épithéliales reposant sur une membrane basale qui se prolonge
avec celle du tube contourné proximal et avec celle du floculus (MARIEB,
2008).
Le glomérule présente 2 pôles :
- un pôle urinaire où s'insère le tube
contourné proximal
- un pôle vasculaire où pénètre
l'artériole afférente et d'où sort l'artériole
efférente au contact de l'appareil juxta glomérulaire.
On distingue dans les tubules : un tube proximal, une anse de
henlé, un tube distal, un tube collecteur (MARIEB, 2008). La planche 2
présente le néphron et ses composantes.
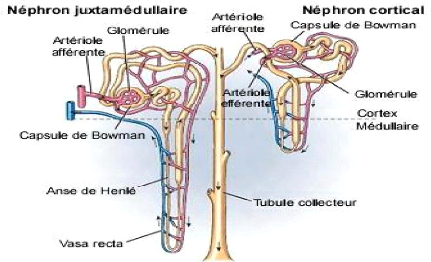
Planche 2: Structure du néphron (GODIN,
2011).
II.2 Rappel fonctionnel
II.2.1 Fonction excrétoire
L'élaboration de l'urine et l'ajustement simultané
de la composition du sang dépendent
de 3 processus :
- la filtration glomérulaire (au niveau des
glomérules) ;
- la réabsorption tubulaire (au niveau des tubules des
néphrons) ;
- la sécrétion tubulaire (au niveau des tubules des
néphrons) (SHERWOOD, 2006).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 15
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
La planche 3 montre ces 3 processus.
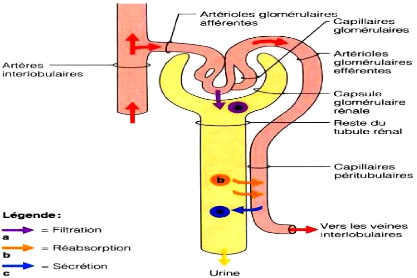
Planche 3: Fonctionnement du néphron
(GODIN, 2011).
II.2.1.1 Filtration glomérulaire
Le glomérule est un filtre mécanique. La
filtration glomérulaire est un processus unidirectionnel, et passif sous
l'effet de la pression glomérulaire. Le filtrat glomérulaire est
constitué d'un ultra filtrat formé de tous les
éléments du sang hormis les éléments figurés
tels que globules sanguins, plaquettes, Protéines rénales (GODIN,
2011). Le débit de filtration glomérulaire est la quantité
de filtrat formé par les 2 reins par unité de temps et est
sensiblement égal à la pression nette de filtration ce qui
équivaut à un intervalle de 120 à 125 ml/ min (GODIN,
2011).
II.2.1.2 Réabsorption tubulaire
La réabsorption tubulaire est le processus qui permet
aux cellules tubulaires du néphron de retirer du filtrat
glomérulaire les substances nécessaires à l'organisme, de
renvoyer ces substances dans le sang des capillaires péri tubulaires.
Suivant les substances transportées, la réabsorption tubulaire
est : passive (ne nécessite pas d'ATP) d'une part et active
(nécessite de l'ATP) d'autre part (GODIN, 2011).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 16
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Les reins sains réabsorbent complètement presque
tous les nutriments organiques comme le glucose et les acides aminés
afin d'en maintenir les concentrations plasmatiques normales.
La planche 4 présente la réabsorption des
nutriments par les cellules des tubules contournés proximal et les
échanges d'ions tels que le sodium, le potassium dans l'espace
interstitiel.
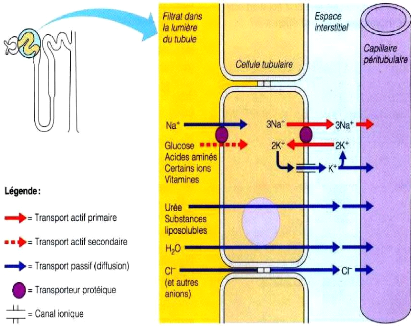
Planche 4: Réabsorption par les cellules
du tubule contourné proximal (SHERWOOD, 2006).
II.2.1.3 Sécrétion tubulaire.
La sécrétion tubulaire est en quelque sorte
l'inverse de la réabsorption. Les ions hydrogènes, les ions
potassiums et la créatinine passent des capillaires péri
tubulaires au filtrat en traversant les cellules tubulaires ou passent
directement des cellules tubulaires au filtrat pour être
éliminées dans l'urine (MARIEB, 2008).
II.2.2 Les autres fonctions du rein
Les reins remplissent quatre autres fonctions principales :
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 17
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
- Fonction de régulation de l'homéostasie hydro
électrolytique et acido-basique. Les reins sont impliqués dans le
métabolisme de l'eau, du sodium, du potassium, du calcium et du
phosphore, des ions hydrogènes et des bicarbonates. Le rein est le seul
organe à assurer la régulation de la kaliémie en tenant
compte à la fois des apports alimentaires en potassium et des pertes
digestives (DAROUX et al., 2009).
- Participation à la régulation de la pression
sanguine artérielle, le rein assure à lui seul la
régulation lente de la pression artérielle grâce à
la régulation de la volémie (ADER et al., 2003).
- Fonction endocrine (MARIEB, 2008).
- Fonction métabolique (MARIEB, 2008).
III. ORGANES ATTEINTS PAR DES COMPLICATIONS DU DIABETE ET
DE L'HYPERTENSION.
III.1 Organes atteints par des complications du
diabète.
III.1.1 Le rein (mécanisme d'atteinte du rein par le
diabète).
Si l'on a un temps pensé que les néphropathies
dues au diabète de type 1 et au diabète de type 2 étaient
des entités distinctes, on dispose aujourd'hui d'éléments
convaincants selon lesquels les mécanismes physiopathologiques
fondamentaux qui finissent par conduire à la néphropathie
diabétique sont similaires dans les deux types (WOLF et al.,
2003).
L'atteinte rénale par l'hyperglycémie est une
atteinte spécifique due à la destruction des petits vaisseaux des
glomérules du rein qui est le centre stratégique où se
produit la filtration du sang. Une élévation du taux de glucose
sanguin due à un diabète chronique entraine une hyper filtration
glomérulaire dans le but d'éliminer l'excès de sucre et de
corriger l'hyperglycémie (WOLF, 2005). Les différents stades de
la néphropathie diabétique sont résumés dans le
tableau 2.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 18
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Tableau 2 : Les différents stades
évolutifs de la néphropathie diabétique
|
1
|
Diagnostic
|
· Hypertrophie (gros rein)
· Hyperfonction (hyper filtration glomérulaire)
|
2
|
2-5 ans
|
Silencieux
|
3
|
5-10 ans
|
Néphropathie débutante
· Microalbuminurie (30 à 300 mg/24h)
· Pression artérielle normale-haute
|
4
|
10-20 ans
|
Néphropathie avérée
· Protéinurie (albuminurie > 300 mg/24h)
· HTA chez 75% des patients
· Syndrome néphrotique dans 10% des cas
· Progression de l'insuffisance rénale
|
5
|
20 ans et plus
|
Insuffisance rénale terminale
· Nécessité de dialyse et/ou transplantation
rénale (+/-
pancréatique)
|
|
Lorsque l'excrétion urinaire d'albumine atteint des
niveaux détectables par de simples bandelettes urinaires, on parle de
macro albuminurie ou protéinurie (WOLF, 2005).
III.1.2 Les autres organes atteints par les complications
du diabète
- L'athérosclérose est une complication
macro-vasculaire ; une atteinte des artères de calibre supérieur
à 200 ìm (CHEVENNE ET FONFREDE, 2001).
- La rétinopathie diabétique après 20 ans
de diabète, est présente chez 90% des diabétiques,
proliférative chez 50 à 60 % des diabétiques de type 1, et
moins fréquente, selon les enquêtes, chez les diabétiques
de type 2 (CHEVENNE ET FONFREDE, 2001).
- La neuropathie diabétique est une des complications
très fréquentes (80% des diabétiques dont la durée
de la maladie est supérieure à 15 ans (GOURDI, 2008).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 19
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
III.2 Organes atteints par des complications de
l'hypertension
III.2.1 Le rein (mécanisme d'atteinte du rein par
l'hypertension)
La néphropathie hypertensive (ou
néphroangiosclérose bénigne) se définit comme toute
insuffisance rénale survenant chez un sujet hypertendu de longue date
sans qu'aucune étiologie n'ait fait ses preuves (FAUVEL et LAVILLE,
2001). La néphroangiosclérose peut évoluer vers
l'insuffisance rénale par réduction néphronique qui
à son tour aggrave l'HTA. Un signe précoce est l'apparition d'une
Microalbuminurie (>30 mg/24 h) (ANONYME, 2012). Les lésions typiques
de la néphropathie hypertensive comportent un épaississement de
la paroi des artères inter lobulaires et une réduction de la
lumière de l'artériole afférente par des
dépôts hyalins sous-endothéliaux. Les artères de
plus gros calibre sont le siège d'un athérome variable.
L'intensité de ces lésions est proportionnelle au niveau moyen de
la pression artérielle (FAUVEL et LAVILLE, 2001).
III.2.2 Les autres organes atteints par les complications
de l'hypertension artérielle.
Les autres complications de l'hypertension artérielle sont
:
- Les complications neurosensorielles, parmi lesquelles
l'accident ischémique transitoire ou constitué et
l'encéphalopathie hypertensive (ANONYME, 2012).
-Les complications cardiovasculaires : l'insuffisance
cardiaque systolique, l'insuffisance ventriculaire gauche et les cardiopathies
ischémiques telles que l'angor et l'infarctus du myocarde (ANONYME,
2012).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 20
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
IV. ATTEINTES GLOMERULAIRES DUES AU DIABETE ET A
L'HYPERTENSION : NEPHROPATHIES DIABETIQUE
ET
HYPERTENSIVE.
Les néphropathies sont des maladies qui atteignent le
rein plus précisément le néphron qui est l'unité
fonctionnelle du rein.
IV.1 Mécanisme de la néphropathie
diabétique.
IV.1.1 Mécanisme génétique.
Le risque de néphropathie est fortement
déterminé par des facteurs génétiques et seuls 40
à 50% environ des diabétiques de type 1 ou 2 développeront
finalement une néphropathie (BERGER et al., 2003).
Les facteurs génétiques peuvent influencer
directement le développement de la néphropathie
diabétique. Le problème majeur réside dans un mode
complexe d'hérédité mendélienne avec implication
probable de plusieurs gènes (BERGER et al., 2003).
IV.1.2 Mécanismes métaboliques
moléculaires
IV.1.2.1 Stress oxydatif
Le stress oxydatif encore appelé stress oxydant est un
déséquilibre de la balance pro-oxydant/antioxydant en faveur des
pro-oxydants qui entraine les dommages oxydatifs des biomolécules
(CILLARD, 2011). Plusieurs grands mécanismes moléculaires sont
impliqués dans les lésions vasculaires et rénales
activées par l'hyperglycémie: l'augmentation du flux de la voie
des polyols, l'augmentation de la production de produits terminaux de glycation
avancée (AGE), la stimulation de la synthèse de l'angiotensine
II.
L'hyperglycémie entraîne une augmentation de la
production de ROS (Reactive Oxygen Species) mitochondriale (BROWNLEE, 2001). La
première étape de ce processus correspond au transport cellulaire
du glucose par des transporteurs spécifiques du glucose (HANEDA et
al., 2003). Les cellules mésangiales par exemple, expriment les
transporteurs du glucose sensibles à l'insuline (GLUT-4) ainsi que les
transporteurs du glucose de type cérébral (GLUT-1) par
l'intermédiaire desquels l'excès de glucose extracellulaire peut
aisément entrer dans la cellule de manière non
insulinodépendante. Une augmentation de la capture du glucose conduit
à une surproduction de donneurs d'électrons (NADH et FADH2)
provenant de l'accélération de la glycolyse et du cycle de Krebs
(BROWNLEE, 2001). Au niveau de la membrane interne mitochondriale, dans
laquelle se trouve la chaîne de transport d'électrons,
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 21
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte: dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
l'augmentation des donneurs d'électrons (NADH, FADH2)
génère un potentiel de membrane élevé en pompant
les protons au travers de la membrane interne. Le transport d'électrons
se trouve ainsi inhibé au niveau du complexe III, ce qui augmente la
demi-vie des intermédiaires radicalaires du coenzyme Q qui réduit
finalement l'O2 en superoxyde (O2-) (BROWNLEE, 2001). Et enfin, une
réduction des antioxydants tels que le glutathion contribue au stress
oxydatif dans le diabète (MORRISON et al., 2004).
IV.1.2.2 Voie des polyols
Dans la voie des polyols, le glucose est transformé en
sorbitol par l'aldose réductase et ensuite en fructose par le sorbitol
déshydrogénase. Une augmentation de la capture cellulaire du
glucose pourrait dévier une partie du glucose dans cette voie. Le taux
de production du sorbitol dépend principalement de la
disponibilité intracellulaire du glucose.
L'activation de la voie des polyols pourrait avoir plusieurs
effets délétères (BROWNLEE, 2001). D'une part, la
réduction du glucose en sorbitol consomme du NADPH, et appauvrit ainsi
les cellules en un substrat important pour la régénération
du glutathion ce qui aggrave encore plus le stress oxydatif intracellulaire ;
et d'autre part, l'augmentation de la production de l'intermédiaire
3-désoxyglucosone qui est un précurseur des produits terminaux de
la glycation avancée : AGE (Advanced Glycation End-product) (BROWNLEE,
2001).
La figure 1 montre comment l'excès de glucose
intercellulaire est métabolisé en sorbitol et par la suite en
fructose.
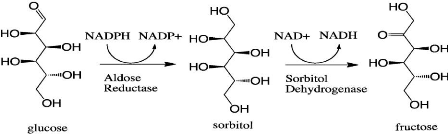
Figure 1: Les différentes
réactions de la voie des polyols suite à une
hyperglycémie, se déroulant dans la cellule (WOLF, 2005).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 22
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Les effets combinés de l'activité de l'aldose
réductase et du sorbitol en présence de sorbitol
déshydrogénase conduit à une altération de
l'état d'oxydo-réduction des couples NADP+/NADPH et
NAD+/NADH, avec pour conséquence l'activation de la voie des
pentoses phosphates et une diminution de la glycolyse. Le changement
d'état redox du couple NAD+/NADH vient de l'activité
du sorbitol déshydrogénase (BRON et al., 1993). Il est
lié à une diminution de la glycolyse et à l'augmentation
de la formation de glycérol 3-P. Ces deux phénomènes
contribuent à la diminution de la formation d'ATP au stade de
glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase. Ensuite,
le glycéraldéhyde 3-P peut aussi servir de substrat à
l'aldose réductase, avec réduction de NADPH. Il y a donc une
déplétion en NADPH et en ATP. Cette déplétion en
NADPH conduira à une déplétion en antioxydant, ce qui va
favoriser le stress oxydatif.
IV.1.2.3 Produits terminaux de la glycation avancée
(AGE)
Les Produits terminaux de la glycation avancée (AGE)
constituent un groupe complexe et hétérogène de
composés impliqués dans les complications liées au
diabète, y compris la néphropathie diabétique (SINGH
et al., 2001).
Le glucose réagit de manière non enzymatique
avec les groupements aminés des protéines. Cette fixation
aboutira d'abord à la formation de la base de Schiff et des produits
d'Amadori et finalement aux AGE (HEIDLAND et al., 2001). Ces
réactions se déroulent sur plusieurs semaines, affectant ainsi
les protéines à longue durée de vie. Les composantes
structurelles de la matrice tissulaire, tels que les membranes basales,
constituent des cibles importantes. Par exemple, la glycation inhibe les
interactions nécessaires à l'auto assemblage du collagène
de type IV et de la Laminine. La glycation des protéines peut
s'accompagner d'un processus d'oxydation particulier appelé «
gly-coxydation », qui est manifestement accentué par le stress
oxydatif (HEIDLAND et al., 2001). La figure 2 illustre les
étapes de la glycation aboutissant à la formation des AGE.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 23
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
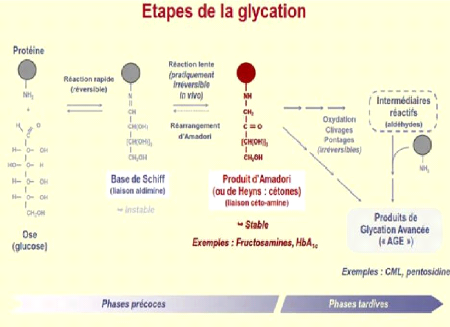
Figure 2: Equation de la glycation
avancée (GILLERY, 2014)
Légende : CML :
N-carboxyméthyl-lysine, HbA1c : hémoglobine glyqué
A1c.
L'angiotensine II pourrait ensuite stimuler la formation des
AGE. Certains des AGE les mieux caractérisés, comme la
pentosidine et la N-carboxyméthyl-lysine (CML), sont des exemples de ce
type de produits glycoxydés.
IV.2 Néphropathie hypertensive.
IV.2.1 Mécanismes physiopathologiques
La néphropathie hypertensive est la conséquence
de l'Hypertension à long terme. En théorie, le
déséquilibre pressionnel devrait être normalisé par
la correction soit de la sténose, soit de l'activation secondaire du
système rénine -angiotensine ; ce qui n'est souvent pas obtenu en
pratique (sténoses athéromateuses) (ZAOUI et al.,
2003).
Son diagnostic est plus souvent clinique et sa
physiopathologie repose sur des modèles expérimentaux.
Expérimentalement, le fonctionnement néphronique est
autorégulé pour
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 24
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
permettre de maintenir une filtration glomérulaire et
des processus tubulaires adaptés aux besoins de l'organisme (ZAOUI
et al, 2003).
Cliniquement on distingue :
- La néphroangiosclérose maligne : c'est la
présentation clinique avec des valeurs élevées de pression
diastolique (>130mmHg) et atteinte des petits vaisseaux identifiable au fond
d'oeil.
- La néphroangiosclérose bénigne
: les lésions vasculaires caractéristiques de la
néphrosclérose bénigne (hypertrophie myo-intimale des
artères interlobulaires, hyalinose / sclérose des
artérioles afférentes) ne semblent pas précoces au cours
de l'HTA essentielle, et sont volontiers associées à une atteinte
glomérulaire hétérogène d'allure ischémique
et une fibrose (RIBSTEIN, 1999).
Ainsi, l'HTA est la cause principale mais non exclusive des
néphropathies hypertensives. La figure 3 présente les
étapes de l'installation de la néphropathie hypertensive.

Ichémie glomérulaire + élévation de
la pression intra glomérulaire
ischémie glomérulaire
plus
élévation de la pression intra
glomérulaire
HTA+(lésions microvasculaire, facteurs
génétiques, race noire, oligonéphronie)
HTA +(vieillissement, maladies
athéromateuses)

Ischémie glomérulaire plus? pression intra
glomérulaire
Lésions des gros vaisseaux artériels
rénaux.
Néphroangiosclérose
néphroangiosclérose
Figure 3: Physiopathologie de la
néphropathie hypertensive (KESSLER, 2000).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 25
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
V. PARAMETRES BIOCHIMIQUES D'EXPLORATION FONCTIONNELLE DU
GLOMERULE.
La fonction rénale peut être explorée par
des examens biochimiques divers telles que l'urémie, la
créatinémie, la clairance de la créatinine et la
protéinurie.
V.1 Créatinine plasmatique.
V.1.1 Rôle.
La détermination de la créatinémie est le
moyen d'évaluation le plus fiable de la fonction rénale. Son
élimination dans l'urine constitue un paramètre biologique
remarquablement fixe et le reflet de la valeur de la fonction rénale
(VALDIGUIE, 2000).
V.1.2 Mode de formation
La créatine est synthétisée dans le foie
à partir de trois acides aminés : Arginine (Arg.), Glycine (Gly),
Méthionine (Met). Une fois en circulation sanguine, elle va au sein des
muscles, subir une phosphorylation sur le NH2 de l'ex Arginine (Arg) et la
créatine~P est cyclisée en créatinine par
déshydratation entre Arginine (Arg) et Glycine (Gly) (ZINSOU, 2010).
Cette phosphorylation est réalisée par la créatine-P
kinase (CPK) selon la réaction suivante décrite dans la figure
4.
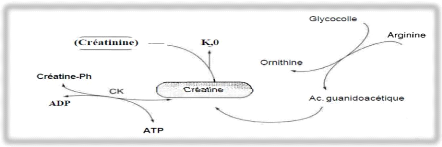
Figure 4: Etape de la formation de la
créatinine (ZINSOU, 2010).
La créatinine est excrétée par les reins
dans l'urine. Son élimination est exclusivement rénale. Une
élévation de la créatinémie témoigne donc
d'une altération de la fonction rénale. Cependant, elle peut
s'avérer trompeuse dans certains cas :
- chez les sujets âgés, elle est relativement
basse en raison d'une baisse de sa production;
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 26
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
- elle est d'autant plus élevée que la masse
musculaire est importante, elle sous-estime donc la fonction rénale des
jeunes athlètes musclés (CANAUD, 2008).
Les valeurs normales sont chez l'adulte:
Homme: 62 - 120 umol/l de sang Femme: 52 - 100 umol/l de sang
V.2 Urée sanguine.
V.2.1 Rôle et mode de formation.
La détermination de l'urémie est un moyen
d'évaluation de la fonction rénale (VALDIGUIE, 2000).
L'urée est l'ultime produit du catabolisme azoté des acides
aminés exogènes et endogènes. Dans le foie, on observe la
synthèse de l'urée à partir de NH3 par le cycle de
l'uréogenèse dans lequel on retrouve l'ornithine, la citrulline
et l'arginine (ZINSOU, 2010). Formée dans le foie, elle passe dans la
circulation sanguine, et est éliminée essentiellement par le
rein. Le taux d'urée plasmatique dépend à la fois de la
fonction rénale, de la production hépatique, des apports
azotés alimentaires et du catabolisme protidique (ATEBA, 2012). La
figure 5 illustre les étapes de la formation de l'urée.
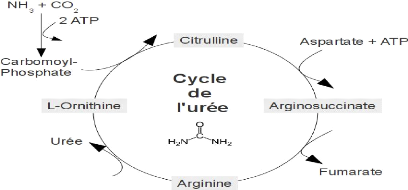
Figure 5: Cycle de l'urée (ZINSOU,
2010)
Les valeurs usuelles sont les même chez l'homme tout comme
chez la femme : Urée : 2,5 à 10 mmol/l de sang
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 27
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Des valeurs plus basses sont trouvées chez l'enfant et
la femme enceinte. Les facteurs pouvant influencés l'urémie sont
:
- le contenu du régime en protéines car un
régime riche en protéines entraîne une
élévation de l'urémie ;
- le volume de la diurèse : la réabsorption
tubulaire d'urée dépend de la réabsorption d'eau (DUSSOL
et JOURDE-CHICHE, 2009).
V.3 Protéinurie
V.3.1 Rôle
La protéinurie constitue un marqueur sensible et
précoce de toute affection rénale. La nature et la proportion des
protéines éliminées renseignent sur la localisation de
l'atteinte rénale (VALDIGUIE, 2000). La protéinurie est
définie comme signe pathologique lorsque l'excrétion urinaire de
protéines est supérieure à 300 mg/L.
V.3.2 Protéinurie sur bandelette urinaire (BU) et
dépistage en néphrologie
La bandelette urinaire permet le dépistage à
grande échelle d'une atteinte rénale en raison de sa
sensibilité, sa simplicité et son coût relativement modeste
(IZZEDINE, 2003). Elle permet une mesure semi-quantitative de la concentration
en protéines.
En présence d'une protéinurie persistante
à la BU, une mesure quantitative doit être réalisée
(BOURQUIN et GIOVANNI, 2007). En effet, lorsque les protéines se lient
au colorant (bleu de bromophénol), la modification du potentiel
d'hydrogène (PH) est responsable d'un changement de sa
couleur dont l'intensité est grossièrement proportionnelle
à la quantité de protéines (BOURQUIN et GIOVANNI,
2007).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 28
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Partie II : MATERIEL ET METHODES
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 29
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
La méthodologie du travail effectué est
résumée à la figure 6.
|
- Accueil des patients diabétiques et/ou hypertendus
reçus au service de diabétologie de l'Hôpital de
district de la Cité Verte.
- Remplissage de la fiche de renseignement permettant la
sélection des patients répondant aux critères
d'inclusion.
|
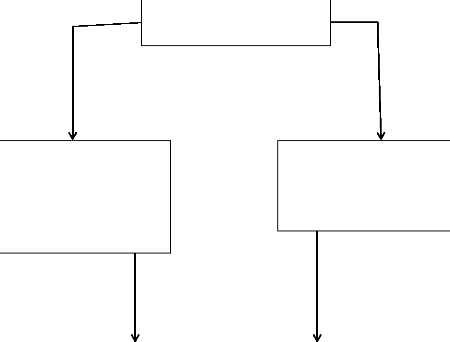
- Dosage de l'urémie par la méthode enzymatique.
- Dosage de la créatinémie par la méthode
colorimétrique, cinétique (réaction de jaffé).
Prélèvements sanguin et urinaire
L'évaluation de la protéinurie et
de la
glycosurie par bandelette
urinaire
(méthode
colorimétrique).
Analyse des résultats et interprétation
Figure 6: Schéma synoptique pour
l'étude transversale, analytique et comparative des patients
Diabétiques et/ou Hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 30
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
I. MATERIEL.
I.1 Lieu et population d'étude.
Notre étude a été menée à
l'Hôpital de district de la Cité Verte situé dans
l'arrondissement de Yaoundé II ;
Les analyses ont été effectuées au sein du
Laboratoire dudit Hôpital ;
L'étude a porté sur les patients
diabétiques et/ou hypertendus reçus en consultation à
l'Hôpital de district de la Cité Verte.
I.2 Matériel de récolte des
données.
Le matériel administratif utilisé était
constitué:
- Du registre de prise en charge des patients
diabétiques et/ou hypertendus reçus au service de
diabétologie de l'Hôpital de district de la Cité Verte. On
y trouvait comme information l'identification du patient et son adresse, ses
paramètres anthropométriques (poids, tension artérielle),
le type de pathologie et le traitement.
- De la fiche de collecte des données (questionnaire)
qui permettait d'identifier les patients respectant les critères
d'inclusion, de rassembler des informations précises sur chaque patient
notamment les paramètres anthropométriques (poids, tension
artérielle), les paramètres épidémiologiques,
d'évaluer l'observance managériale (sur le plan alimentaire) et
de reporter les résultats des examens biochimiques qui étaient
faits. La fiche comportait vingt-quatre (24) questions dont 14 fermées
et 10 ouvertes. L'annexe 1 présente l'exemplaire de la fiche de collecte
des données.
I.3 Documents administratifs.
Les documents administratifs regroupent :
- La demande d'autorisation d'enquête ;
- La Fiche de consentement éclairée ;
- L'autorisation de recherche délivrée par
l'Université de Ngaoundéré.
I.4 Matériel pour l'examen clinique.
- Un pèse-personne de marque SECA (Allemagne)
pour la prise du poids en kilogramme
(Kg) ;
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 31
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
- Un stéthoscope de marque SPENGLER (France)
pour la prise de la pression artérielle (mmHg);
- Un tensiomètre de marque SPENGLER (France)
pour la prise de la pression artérielle (mmHg).
I.5 Matériel de prélèvement.
- Gangs de soins
- Tubes secs et stériles pour prélèvement
sanguin ;
- Garrot ;
- Aiguilles Vacutainer ;
- Flacon d'alcool à 9Ø°;
- un rouleau de coton ;
- Pots stériles pour urine.
I.6 Matériel biologique Il s'agissait des
échantillons:
- De sang capillaire prélevé au pli du coude et
recueilli à l'aide de tube sec pour le dosage de la
créatinémie et de l'urémie.
- D'urines prélevées par le patient lui-même
dans un pot stérile à urines.
I.7 Matériel pour diverses explorations
biologiques
- Boîtes de bandelettes urinaires réactives pour 2
paramètres (Glucose, Protéine) avec
son échelle colorimétrique COOMBI 2
(Angleterre) pour l'exploration de la glycosurie et de
la protéinurie ;
- Kits de marque BIOLABO (France) pour le dosage de la
créatinémie et de l'urémie ;
- Centrifugeuse de marque FLETA5 (Allemagne), pour la
centrifugation des
échantillons biologiques ;
- Spectrophotomètre de marque KENZAMAX-240X BIOLABO
(France), pour la lecture
de l'absorbance de la créatinine et de l'urée des
échantillons biologiques ;
- Micropipettes de marque EPPENDORF (Angleterre) ;
- Portoirs ;
- Cupules ;
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 32
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
II. METHODOLOGIE.
L'étude était de type transversal, analytique et
comparatif. Elle s'est déroulée de Juin 2015 à Août
2015. Les patients ont été recrutés à
l'Hôpital de district de la Cité Verte de Yaoundé.
Cette étude a été approuvée par le
comité éthique de l'Hôpital de district de la Cité
Verte et une autorisation d'enquête a été
délivrée par le directeur dudit Hôpital. En outre, le
consentement éclairé a été signé par chaque
patient participant à l'étude. L'annexe 3 présente le
formulaire de consentement éclairé, une copie de l'autorisation
d'enquête et les autorisations de recherche signées par
l'université de Ngaoundéré.
II.1 Echantillonnage: Critères d'inclusion et
d'exclusion.
Les patients ont été recrutés chaque
semaine, du lundi au vendredi entre 8h et 12h, puis soumis à une
interrogation permettant d'acquérir les informations recherchées.
L'accueil et le consentement du patient étaient suivis du remplissage de
la fiche de collecte, de la prise de ses paramètres
anthropométriques (poids (Kg) et tension artérielle (mmHg)) et du
dosage de ses paramètres biochimiques (créatinémie,
protéinurie, urémie).
Nous avons inclus dans cette étude et
indépendamment du sexe:
- Tout patient diabétique consentant
médicalement suivi à l'Hôpital de district de la
Cité Verte ;
- Tout patient hypertendu consentant médicalement suivi
à l'Hôpital de district de la Cité Verte ;
- Tout patient consentant présentant les deux
pathologies médicalement suivi à l'Hôpital de district de
la Cité Verte ;
- Tout patient consentant ne présentant aucune
pathologie chronique médicalement suivi à l'Hôpital de
district de la Cité Verte.
Nous avons exclus de cette étude :
- Tout patient ayant des néphropathies d'origine autre
;
- Tout patient non consentant ;
- tout patient âgé de moins de 20 ans et de plus de
80 ans.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 33
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
II.2 Les prélèvements.
II.2.1 Préparation du malade et
Prélèvement de l'échantillon biologique Sanguin.
Elle consistait à l'installation du patient, le
rassurant en lui donnant des informations et explications sur le pourquoi de
l'examen. Il était préférable que le patient soit à
jeun (12h de jeun depuis la veille au soir).
Le patient installé, nous prélevions le sang
après désinfection à l'alcool d'un bras ayant
préalablement un garrot; un prélèvement de 4-5ml de sang
veineux était effectué au pli du coude avec une aiguille à
vacutainer dans un tube sec. Ce sang était acheminé au
laboratoire où sont effectués les dosages par la méthode
enzymatique pour l'urée et le dosage par la méthode
colorimétrique cinétique pour la créatinine.
II.2.2 Préparation du malade et
Prélèvement de l'échantillon biologique Urinaire.
Le prélèvent urinaire se faisait à la
suite du prélèvement sanguin. Un pot sec et stérile
était remis au patient et ce dernier était conduit aux toilettes.
Il prélevait 20 à 30 ml d'urines dans ce pot. Les urines
prélevées étaient celles du milieu du jet et
étaient immédiatement acheminés au laboratoire où
était effectué les analyses qualitatives et semi-quantitatives de
glycosurie et de protéinurie sur bandelettes urinaires
réactives.
II.2.3 Analyse des liquides biologiques.
II.2.3.1 Analyse qualitative et semi-quantitative par
bandelettes
urinaires réactives.
II.2.3.1.1 Principe
Le test se compose d'une bandelette présentant des
zones réactives de chimie sèche permettant de rechercher dans
l'urine la présence qualitative et/ou semi-quantitative de
protéines et de glucose (BORGHINI et al., 2013).
La protéine mise en évidence est l'albumine
grâce au virage de couleur d'un indicateur de PH. Cet
indicateur coloré vire au jaune-vert en présence de
protéines. Une échelle de couleur permet une estimation
semi-quantitative de la protéinurie. La bandelette urinaire est plus
sensible à l'albumine qu'aux autres protéines (immunoglobulines,
hémoglobine); et
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 34
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
contribuera donc surtout au diagnostic des protéinuries
glomérulaires (BORGHINI et al., 2013).
Le glucose est mis en évidence par la méthode
glucose-oxydase / peroxydase (BORGHINI et al., 2013). En
présence de glucose oxydase (GOD), le glucose en solution aqueuse est
oxydé par le dioxygène dissout, en acide gluconique avec
formation de peroxyde d'hydrogène Cette réaction est
illustrée dans la figure 7.
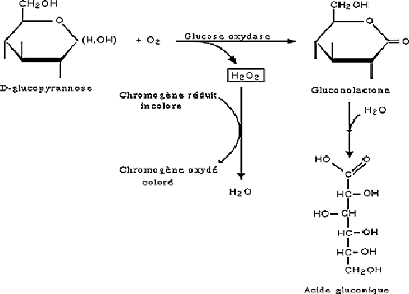
Peroxydase
H2O2 + Phénol + 4-Amino-Antipyrine Quinonéimine
rose + 4 H2O
Figure 7: Méthode glucose-oxydase /
peroxydase (FAURE, 2012).
L'intensité de la coloration rose développée
est proportionnelle à la concentration en glucose.
La mesure de la concentration de peroxyde d'hydrogène
se fait par l'intermédiaire d'une réaction faisant intervenir une
peroxydase et un chromogène donneur d'hydrogène pour donner
naissance à un composé coloré dont l'absorbance est
mesurée par spectrophotométrie.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 35
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
II.2.3.1.2 Mode opératoire (BORGHINI et al., 2013)
:
- Homogénéiser (mélanger) correctement
l'urine en tournant lentement, à plusieurs reprises, le pot.
- Après avoir sortie la bandelette de son étui
sans toucher les zones réactives, l'immerger 1 seconde (au maximum) dans
l'urine en humectant entièrement toutes les zones réactives. Ne
jamais verser l'urine avec une pipette sur la bandelette.
- Egoutter rapidement en passant la tranche de la bandelette
sur un papier absorbant afin de supprimer l'excédent d'urine.
- Enclencher le chronomètre.
La lecture est faite dans les 1 min qui suivent le retrait de
la bandelette de l'urine par comparaison par rapport à l'échelle
colorimétrique, matérialisée par des croix.
L'échantillon urinaire de choix est la seconde miction du
matin;
Le seuil de détectabilité pour les
protéines est de 60 mg/l (albumine) et ne peut donc pas
révéler une micro albuminurie et celui des glucides est de 0,4
g/l (2,2 mmol/l).
On peut observer des faux positifs si les urines sont trop
alcalines (pH supérieur à 7,5) ou trop concentrées, ou si
elles contiennent des agents désinfectants (ammoniums quaternaires,
Chlorhexidine).
Chaque résultat était obtenu par
détermination de la moyenne après deux essais.
II.2.3.2 Dosage de la créatinine sérique
La créatinine est un composé que l'on dose dans
le sang, et parfois dans l'urine pour évaluer la fonction
rénale.
La créatinémie est dosée selon la
méthode de Jaffé, décrite par DELATOUR et al.,
(2011). Une fois les échantillons de sang prélevés,
le dosage de la créatinine se fait dans le sérum, qui est obtenu
après centrifugation du sang total.
II.2.3.2.1 Principe
Le dosage de la créatinine respecte la méthode
colorimétrique cinétique à deux points, basée sur
la réaction de Jaffé. La méthode consiste à mesurer
à 510 nm l'intensité de la coloration du complexe
rouge-orangé formé par la créatinine et l'acide picrique
en milieu alcalin ; la vitesse de formation de la coloration étant
proportionnelle à la concentration en créatinine dans
l'échantillon (DELATOUR et al., 2011).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 36
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
L'équation de la figure 8 illustre la réaction qui
se produit au cours du test.
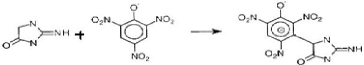
Créatinine Acide picrique Complexe coloré rouge -
orangé
Figure 8 : Réaction de Jaffé
(CABE, 2006).
II.2.3.2.2 Mode opératoire.
Les réactifs et les échantillons sont maintenus
à la température ambiante pendant 10 à 20 min avant la
manipulation:
Flacon 1 (R1) : il est constitué d'hydroxyde de
sodium de concentration égale à 0.2mol/l
Flacon 2 (R2) : il est constitué d'acide picrique de
concentration égale à 20mmol/l.
Flacon 3 (Std) : le standard est constitué de
créatinine à une concentration de 2mg/dl.
(BIOLABO, 2011).
Le dosage nécessite :
- Le Blanc du réactif constitué de 500ul de R1
+ 500ul de R2 ,
- Le Standard, constitué de (500ul de R1 + 500ul de
R2) + 100ul d'Etalon ,
- L'Echantillon, constitué de (500ul de R1 + 500ul
de R2) + 100ul de Sérum
Le tableau 3 montre les volumes indiqués pour le
dosage.
Tableau 3: Mode opératoire du dosage de
la créatinémie (BIOLABO, 2011).
|
Blanc réactif
|
Standard
|
Echantillon
|
|
Soude 0,75 N (R1)
|
500ul
|
500 ul
|
500 ul
|
|
Acide picrique (R2)
|
500 ul
|
500 ul
|
500 ul
|
|
Etalon
|
-
|
100ul
|
-
|
|
Sérum
|
-
|
-
|
100ul
|
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 37
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Après calibration, par l'étalon du coffret (R3)
ou tout calibrant traçable sur une méthode standardisée et
introduction du sérum de contrôle fourni par le fabriquant ; les
échantillons homogénéisés sont passés au
spectrophotomètre en deux essais et lues à 520 nm (BIOLABO,
2011).
II.2.3.3 Détermination de la Clairance de la
Créatinine (ClCr).
La clairance de la créatinine est le volume virtuel de
sang ou de plasma complètement épuré de la
créatinine par unité de temps ; c'est un volume théorique
(120ml/min) qui permet de d'apprécier la filtration glomérulaire
(TRAWALE, 2013).
Le Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) est le
volume de liquide filtré par le rein par unité de temps. C'est la
valeur qui permet de quantifier l'activité du rein.
Le DFG en ml/min standardisé pour 1,73m2 de
surface corporelle a été estimé par la clairance (Cl)
calculée de la créatinine (Cr) sanguine (ClCr), obtenue à
partir de la formule MDRD (Modification of the Diet in Renal Disease),
simplifiée et proposée par LEVEY et al (2000). Celle-ci
tient compte de la créatinine sérique, de l'âge, du sexe et
de la race du patient. Elle a été calculée automatiquement
grâce au logiciel eGFR calculator et consignée par de
nombreux laboratoires chaque fois que la mesure du taux de créatinine
sérique est demandée (TSINALIS et BINET, 2006 ; LEVEY et al.,
2000).
DFG (ml/min/1,73m2) = 186,3 x
(créatinémie / 88,4) -1,154 x (âge)
-0,203x (0,742 si femme) x (1,212 si sujet noir)
- Age en année, poids en Kg, créatinémie en
umol/l.
- Pour convertir la créatinine plasmatique de umol/l en
mg/dl, il est nécessaire de diviser par 88,4 qui est le facteur de
conversion.
- Si créatinémie en mg/l, diviser la
créatinémie par 10.
Trois groupes de patients ont été définis
selon le DFG comme suit :
Groupe 1 : DFG abaissé ClCr< 90ml/min/1,73m2
;
Groupe 2 : DFG normal 90 = ClCr = 140
ml/min/1,73m2;
Groupe 3 : Hyper filtration glomérulaire ClCr>
140ml/min/1,73m2
L'insuffisance rénale est définie par une ClCr<
60ml/ min / 1,73m2 (ATEBA, 2012).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 38
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
II.2.3.4 Dosage de l'urée (méthode
enzymatique à l'uréase)
II.2.3.4.1 Principe
C'est une méthode enzymatique et colorimétrique
basée sur l'action spécifique de l'uréase qui hydrolyse
l'urée en carbonate et en ions ammonium. Les ions ammonium forment
ensuite avec le chlore de salicylate un complexe coloré bleu-vert.
L'intensité de coloration, proportionnelle à la concentration en
urée dans le spécimen est mesurée à 600nm (BIOLABO,
2011).
CO (NH2)2 + H2O
--uréase----> 2NH3 + CO2
Urée Eau Ammoniac Dioxyde de carbone
L'Urée présent dans le sang est dosée
à partir de l'Uréase contenue dans le réactif.
IV.2.3.4.2 Mode opératoire
L'urée sanguine est réalisée chez les
sujets à jeûne depuis 10 heures environ. Le dosage de
l'urée se fait sur le sérum non hémolysé, non
contaminé ou ayant subi plus d'une décongélation. Le
sérum doit être séparé du culot globulaire dans les
2 heures qui suivent le prélèvement.
Les réactifs
Les réactifs et les échantillons doivent
être équilibrés à la température ambiante
pendant 10 à 20 min avant usage:
Flacon R1 : il est constitué du salicylate de
concentration égale à 31mmol /l et du nitroprussiate à
concentration égale à 1.67mmol/l.
Flacon R2 (Urease) : il est constitué d'urease
à une concentration = 15KU/l. Flacon R3 (étalon) : notre
étalon est l'urée à une concentration égale
à 0.40 g /l.
Pour préparer la solution de travail, il est
nécessaire d'ajouter le contenu du flacon R2 dans le flacon R1 puis,
homogénéiser l'ensemble par retournements lents. Le contenu peut
rester stable jusqu'à 1 mois en absence de toute contamination à
une température comprise entre 2 et 8°C. Il est nécessaire
de transvaser dans un récipient la quantité nécessaire du
flacon R3 à utiliser afin de ne pas risquer de la contaminer. Utiliser
le blanc et l'étalon pour une série d'analyse. Ainsi, pour le
premier échantillon à doser, pipeter dans chacun des trois tubes
à essai différents (blanc, étalon, et le premier
échantillon) 1ml de la
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 39
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
solution de travail (R1+R2). Ensuite, ajouter 10ul d'eau
distillée dans le tube du blanc, 10ul de l'étalon (R3) dans le
tube du standard et 10ul de notre spécimen dans le troisième tube
puis, lire l'absorbance à 546nm. La concentration de l'urée
contenue dans le sérum sera calculée automatiquement (BIOLABO,
2011). Le tableau 4 présente les volumes requis pour le dosage.
Tableau 4 : Mode opératoire du dosage de
l'Urémie (BIOLABO, 2011).
|
Blanc réactif
|
Standard
|
Echantillon
|
|
Salicylate + Urease (R1 + R2)
|
1000ul
|
1000 ul
|
1000 ul
|
|
Etalon
|
-
|
10ul
|
-
|
|
Sérum
|
-
|
-
|
10ul
|
Après calibration par l'étalon du coffret (R4)
ou tout calibrant traçable sur une méthode standardisée et
introduction du sérum de contrôle fourni par le fabriquant ; les
échantillons homogénéisés sont passés au
spectrophotomètre en deux essais et lues à 600 nm (BIOLABO,
2011).
III. ANALYSE DES DONNEES
Le pack Microsoft office 2013 ; la saisie du mémoire
dans Microsoft office Word 2013 et la réalisation des graphes
(histogramme, camembert) dans Microsoft office Excel 2013;
Le logiciel Epi-info (version 7) qui est un logiciel
statistique d'enquête
épidémiologique a servi à
la création de la base de données ;
Le logiciel R dont les fonctions ont permis le traitement des
données et la réalisation d'analyses statistiques telles que la
statistique descriptive, tests d'hypothèses, analyse de la variance et
les méthodes de régression linéaire.
Les données descriptives de l'échantillon ont
été rapportées sous forme de moyennes #177;
écarts-types, de fréquences et de pourcentages.
Les tests statistiques tels que le test d'Analyse de la
Variance ou ANOVA a été utilisé pour la comparaison de la
créatinémie dans les différents sous-groupes de patients
ainsi que l'estimation du DFG dans les différents sous-groupes de
patients.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 40
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Le test Kruskal Wallis qui est la composante non
paramétrique d'ANOVA a été utilisé pour la
comparaison de l'urémie dans les différents sous-groupes de
patients.
Le test de Fisher a été utilisé pour le
calcul de la P-value de la glycosurie et celle de la protéinurie.
Le test de chi-squared a été utilisé pour
determiner la p-value de l'urémie.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 41
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Partie III : RESULTATS ET DISCUSSION
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 42
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
I. DONNEES CARACTERISTIQUES SUR LA POPULATION D'ETUDE
I.1 Répartition de la population
générale en fonction du sexe et des tranches d'ages.
Sur les 99 patients recrutés, 30 étaient de sexe
masculin (30%) et 69 de sexe féminin (70%). Notre population
générale était marquée par une prédominance
féminine. Le sexe- ratio de cette population était de 0,43 en
faveur des femmes ; ce ratio est proche de celui de EL FADL (2010) qui avait
également trouvé un sexe-ratio en faveur des femmes dans le
même service (service de diabétologie). Cette prédominance
féminine peut être dû au fait que, d'une part les femmes
fréquentent plus les hôpitaux que les hommes (FAO, 2002) et
d'autre part que les femmes sont plus exposées à faire les
maladies métaboliques à cause de leur disposition hormonale
corrélée à la prise d'oestroprogestatifs (ANONYME,
2009).
L'histogramme de la figure 9 présente les effectifs (%)
en fonction des tranches d'âges (années) dans les
différents sous-groupes d'étude. Les données brutes ayant
permis son tracé sont retrouvées dans le tableau 1A de l'annexe
2.
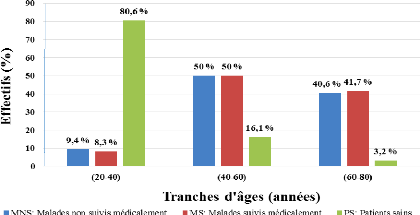
Figure 9 : Répartition des
différents sous-groupes de patients en fonction des tranches
d'âges. Légende : MNS : Malades Non
Suivis médicalement; MS : Malades Suivis
médicalement ; PS : Patients Sains.
Il se dégage que dans le sous-groupe des Patients Sains
(PS), la tranche d'âge la plus représentée est de (20-40)
ans tandis que dans les sous-groupes des Malades Suivis (MS) et
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 43
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
des Malades Non Suivis (MNS) la tranche d'âges la plus
représentée est de (40-60) ans, cet intervalle constituant la
classe d'âge modale. Ceci pourrait se justifier par le fait que
l'âge avancé représente un facteur favorisant l'apparition
du diabète, de l'HTA et des complications vers l'insuffisance
rénale. L'augmentation de l'incidence de la néphropathie est
alors attribuée au vieillissement de la population à risque qui
sont les personnes âgées (STENGEL et al., 2003).
I. 2 Répartition des patients en fonction du type de
pathologie.
La figure 10 montre la répartition des patients en
fonction du type de pathologie: Diabète de type 1 (DT1), Diabète
de type 2 (DT2), Personne Saine (PS), Hypertension Artérielle (HTA) et
Diabète de type 2 plus Hypertension Artérielle (DT2 + HTA). Les
données brutes ayant permis son tracé sont retrouvées dans
le tableau 2A de l'annexe 2.
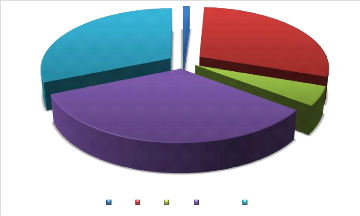
31%
DT1 DT2 HTA DT2+HTA PS
34%
1%
29%
5%
Figure 10 : Répartitions des patients
recrutés en fonction de leur statut.
Légende : DT1 :
Diabète de type 1 ; DT2 :
Diabète de type 2 ; HTA : Hypertension
artérielle ; PS : Patients sains.
L'échantillonnage montre que le DT1 représente
1% (1 cas), et le DT2 29 % (29 cas). Ces résultats se rapprochent des
données internationales où le DT2 est le plus fréquemment
rencontré (CHEVENNE et FONFREDE, 2001). La coexistence DT2+HTA
représente 34% (33cas) et les patients hypertendus 5%. Ceci peut
s'expliquer par le fait que l'hypertension artérielle est
généralement secondaire au DT2 à la longue. ZEMMOUR et
al., (2008) dans une
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 44
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte: dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
étude menée en Algérie ont montré que
le diabète est précédé par l'HTA chez 45% des
diabétiques qui avaient seize ans en moyenne d'évolution du
diabète.
II. PARAMÈTRES BIOLOGIQUES.
II.1 Créatinémie.
La créatinine est considérée depuis
longtemps comme le meilleur marqueur endogène de la filtration
glomérulaire (TSINALIS et BINET, 2006).
II.1.1 Répartition de la Créatinémie
en fonction des sous-groupes. L'histogramme de la figure 11
présente les moyennes de la créatinémie en fonction des
différentes catégories des patients. Les données brutes
ayant permis son tracé sont retrouvées dans le tableau 3A de
l'annexe 2.
Borne supérieure Homme
Borne supérieure Femme Borne inférieure Homme
Borne inférieure Femme
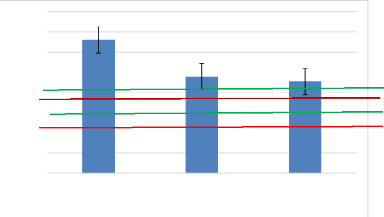
Moyenne de la créatinémie(mg/l)
16
14
12
10
4
2
8
6
0
MNS MS PS
Catégories des patients
b
a
a
Figure 11 : Comparaison de la
créatinémie dans les trois sous-groupes (MS, MNS, PS)
Valeurs normales de la
créatinémie: Hommes : 9-13 mg/l ; Femmes : 6-11
mg/l (BIOLABO, 2011) Légende : MNS : Malades Non Suivis
médicalement; MS : Malades Suivis médicalement
; PS : Patients Sains.
Les résultats de la créatinémie ont
permis de constater une corrélation entre le taux de
créatinémie, le niveau d'atteinte glomérulaire et le suivi
médical. Chez les Malades suivis, les valeurs de
créatinémie sont dans les normes physiologiques : (9,6 #177; 2,1
mg/l), cela traduit que
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 45
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte: dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
la fonction rénale n'est pas atteinte chez ces derniers
(REDOUANE-SALAH, 2011) ce qui se rapproche des données de BOUATTAR
et al. (2009) qui ont trouvé un taux de
créatinémie de 8,2#177; 2,1 mg/l chez un groupe de malades
diabétiques. Chez les Malades Non Suivis, une hyper
créatinémie est observée ; (13,2 #177; 6,8 mg/l) cela
signe selon la littérature une atteinte de la fonction
glomérulaire (TSINALIS ET BINET, 2006). Une étude de la NATIONAL
KIDNEY FONDATION (2006) soutient que sensiblement le tiers des
diabétiques finissent par faire une maladie rénale chronique
(MRC) lorsque le suivi n'est pas effectif.
II.1.2 Répartition de la
créatinémie en fonction des tranches d'âges des
patients.
La valeur de la créatinémie varie en fonction de
l'âge de l'individu d'où la nécessité du calcul de
la clairance de la créatinine et la détermination du DFG pour une
meilleure exploration de la fonction rénale (VALDIGUIE, 2000). Les
données brutes qui ont permis le tracé de cette figure sont
résumées dans le tableau 4A de l'annexe 2.
La figure 12 présente les moyennes de
créatinémie en fonction des tranches d'âges des patients.
Il ressort que dans les tranches d'âges de (20-40) ans et celles de
(40-60) ans les moyennes de la créatinémie sont normales
respectivement 8 mg /l et 10,5 mg/l, tandis que dans la tranche d'âge de
(60-80) ans la moyenne de la créatinémie est très
élevée 15, 4 mg/l.
Borne supérieure Homme
Borne supérieure Femme Borne inférieure Homme
Borne inférieure Femme
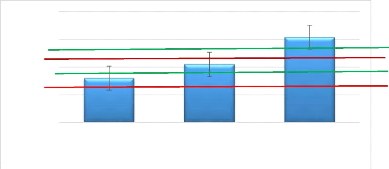
Moyenne s de la créatinémie
(mg/l)
20
15
10
5
0
20-40 40-60 60-80
Tranches d'âges (années)
8
10,5
15,4
Figure 12: Répartition des moyennes de
la créatinémie en fonction des tranches d'âges des
patients.
Valeurs normales de la créatinémie
: Hommes : 9-13 mg/l ; Femmes : 6-11mg/l (BIOLABO,
2011).
Il se dégage que la moyenne de la
créatinémie dans la tranche d'âges de (60-80) ans est
anormale (15,4 #177; 6,9 mg/l) ; le vieillissement entraine physiologiquement
une diminution de
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 46
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte: dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
la fonction rénale et l'état pathologique
métabolique (HTA, Diabète) l'aggrave encore plus. Par
conséquent, avec le temps le rein excrète moins la
créatinine et cela favorise son accumulation dans le sang. Une
étude menée par YTHURBIDE et HERTIG (2012) a montré que la
créatinémie est influencée par des facteurs extra
rénaux comme l'âge, le sexe et le métabolisme
musculaire.
II.2 Urémie
Plus de 90% de l'urée est éliminée par
les reins dans les urines. Le dosage de l'urémie est souvent
considéré comme un indicateur de la fonction rénale.
(BIOLABO, 2011).
II.2.1 Répartition de l'Urémie en fonction
des sous-groupes des patients
L'histogramme de la figure 13 qui présente la variation
de la moyenne de l'urémie dans les différents sous-groupes des
patients a été réalisée à partir des
données contenues dans le tableau 5A de l'annexe 2.
La moyenne de l'urée est normale dans le sous-groupe de
Patients Sains (0,2 #177; 0,1 g/l ), élevée dans le sous-groupe
de Malades Suivis (0,4 #177; 0,2 g/l) et encore plus dans le sous-groupe de
Malades Non Suivis (1,2 #177; 4,2 g/l ): la différence est très
significative avec un seuil de P ? 0,05.
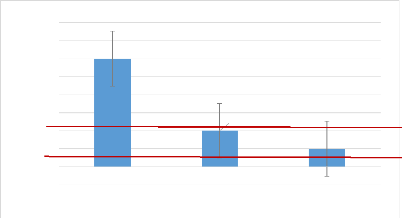
1,6
Valeurs moyenne (g/dl) de l'
uremie
0,8
0,6
0,4
0,2
1,4
1,2
0
1
MNS MS PS
1,2
0,4
0,2
-0,2
Catégories des patients
Borne supérieure
Borne inférieure
Figure 13: Comparaison de l'urémie dans
les trois sous-groupes (MS, MNS, PS).
p-value = 2,966e-06
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 47
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte: dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Valeurs normales de l'urée : 0,13-0,43 g/l
Légende : MNS : Malades Non
Suivis ; MS : Malades Suivis ; PS : Patients Sains.
La moyenne de l'urée sérique est très
élevée (1,2 #177; 4,2 g/l) chez les Malades Non Suivis
comparée aux deux autres sous-groupes. Elle augmente proportionnellement
au degré d'atteinte rénale (Figure 13). Ces résultats
mènent à conclure que le suivi médical retarde dans le
temps l'altération de la fonction rénale. Il est évident
qu'une augmentation de l'urée sanguine traduit un déficit de la
fonction d'excrétion des reins (RICHET, 2005). Plus la fonction
rénale est altérée, plus l'urée s'accumule dans le
sang et devient un facteur toxique du fait que l'insuffisance rénale par
acidose métabolique qu'elle induit. Elle est responsable d'un
catabolisme musculaire exagéré (VANHOLDER, 2003, MITCH et
al., 1994). Néanmoins, il est observé quelques cas
d'augmentation d'urée plasmatique chez les Malades Suivis sans impact
sur la fonction rénale car ces sujets ont une créatinémie
et une filtration glomérulaire normale. Il s'agit sans doute d'une hyper
urémie d'origine alimentaire due à une consommation
exagérée de produits carnés (viandes et
dérivées) qui augmentent fortement l'urémie dans
l'organisme (ATEBA, 2012).
II.2.2 Répartition de l'urémie en fonction
des tranches d'âges des patients
Les résultats de la répartition de
l'urémie en fonction des tranches d'âges des patients sont
présentés par l'histogramme de la figure 14. Les données
brutes qui ont permis son tracé sont résumées dans le
tableau 6A de l'annexe 2.
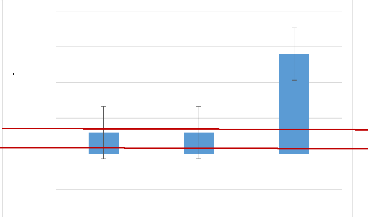
2
Moyenne de l'urémie (g/l)
0,5
1,5
0
1
20-40 40-60 60-80
0,3
0,3
1,4
-0,5
Tranche d'âge (Années)
Borne supérieure
Borne inférieure
Figure 14: Répartition des moyennes de
l'urémie en fonction des tranches d'âges des patients.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 48
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Valeurs normales de l'urée : 0,13-0,43 g/l.
Dans la tranche d'âges de (20-40) ans et celle de
(40-60) ans les moyennes de l'urémie sont normales (0,3 g/l), tandis que
dans la tranche d'âges de (60-80) ans la moyenne de l'urémie est
très élevée (1,4g/l) ; la différence de moyenne par
rapport aux moyennes des deux autres tranches d'âges est significative
avec un seuil de P < 0,05.
La moyenne de l'urée sérique est très
élevée dans la tranche d'âge de (60-80) ans (1,4 #177; 4,8
g/l) comparée aux deux autres tranches d'âges. Cette augmentation
traduit une accumulation de l'urée dans l'organisme. Plus la fonction
rénale est altérée plus l'urée s'accumule dans le
sang et devient un facteur toxique (VANHOLDER, 2003). Ces résultats
mènent à dire que l'âge avancé est un facteur qui
favorise l'apparition des complications qui évoluent vers l'insuffisance
rénale. Il est évident qu'une augmentation de l'urée
sanguine traduit un déficit de la fonction d'excrétion des reins
(RICHET, 2005).
II.3 protéinurie sur bandelette urinaire
La protéinurie sur bandelette permet la
détection de macro albuminuries. La protéinurie est
négative chez les Patients Sains, positive chez les Malades suivis
à un pourcentage de 16,66% et chez les Malades Non Suivis à un
pourcentage de 34,4%. La différence de valeurs est très
significative avec un seuil P < 0,05.
La figure 15 montre la répartition de la
protéinurie en fonction des trois sous-groupes de patients
recrutés.
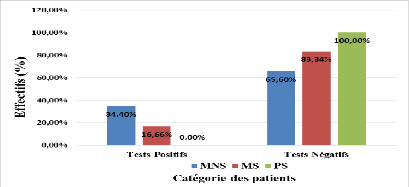
Figure 15 : Proportions de positivité de
la protéinurie en fonction des trois sous-groupes
(MS, MNS, PS). P-value=
4,44e-09 .
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 49
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
A l'état normal : aucun virage de couleur (pas
d'albumine dans l'urine).
Légende : MNS : Malades Non
Suivis ; MS : Malades Suivis ; PS : Patients Sains.
La protéinurie est plus marquée chez les Malades
Non Suivis par rapport aux Malades Suivis. La modification de la filtration
glomérulaire entraîne une excrétion urinaire d'albumine,
qui témoigne une atteinte rénale (FAUVEL et LAVILLE, 2006). Le
suivi médical ralentit la survenue d'une atteinte rénale car le
traitement est néphroprotecteur; une glycémie mal
contrôlée aura un effet délétère sur les
petits vaisseaux d'où la protéinurie à long terme (WEEKERS
et KRZESINSKI, 2005). Il est maintenant bien établi que le mauvais
équilibre chronique du diabète et de l'HTA est le principal
déterminant du développement de la néphropathie et qu'un
bon contrôle du diabète retarde son apparition ou sa progression
(RUDBERG et DAHLQUIST, 1996).
II.4 Glycosurie sur bandelette urinaire
La glycosurie sur bandelette renseigne sur le reflet du
glucose dans le sang. Elle est positive chez 10 Malades Non Suivis ce qui
équivaut à 31,25%, tandis que 04 Malades Suivis ont une
glycosurie positive soit (11,11%); chez les Personnes Saines aucune glycosurie
n'est relevée. La Figure 16 présente la répartition de la
glycosurie en fonction des catégories de patients.
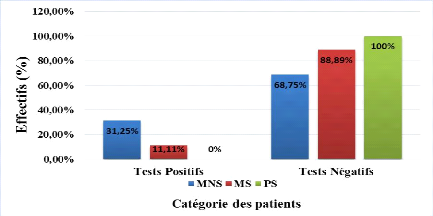
Figure 16 : Comparaison de la glycosurie dans
les trois sous-groupes (MS, MNS, PS). P-value =
2,596e-7
A l'état normal : aucun virage de couleur (pas de
glucose dans l'urine).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 50
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Légende : MNS : Malades Non
Suivis ; MS : Malades Suivis ; PS : Patients Sains.
La glycosurie est plus accentuée chez les Malades Non
Suivis comparée aux Malades Suivis cette disproportionnalité des
résultats peut s'expliquer par le fait que chez les Malades Non Suivis
l'absence de prise d'un traitement médicamenteux maintiendrait une
glycémie élevée car des valeurs glycémiques
supérieures à 1,8g/l entrainent une glycosurie. Sur le plan de la
pathogenèse, de nombreuses études observationnelles et
interventionnelles tant dans le diabète de type 1 que de type 2, ont
montré que l'hyperglycémie jouait un rôle causal dans la
physiopathologie des étapes initiales de la néphropathie
diabétique (ROUSSEL, 2011) et aggrave l'atteinte rénale, ceci
doit inciter à poursuivre les efforts pour maintenir un contrôle
optimal de la glycémie même en cas de néphropathie
diabétique avancée (WEEKERS et al., 2003).
II.5 Débit de Filtration Glomérulaire
Le Débit de Filtration Glomérulaire renseigne
sur le bon fonctionnement du rein et permet de définir le degré
d'atteinte rénal (YANNOUTSOS et al.,2012).
II.5.1 Répartition du Débit de Filtration
Glomérulaire en fonction des sous-groupes des patients
Le DFG renseigne sur le bon fonctionnement du rein et permet
de définir le degré d'atteinte rénale. Les données
brutes qui ont permis le tracé de la figure 17 sont rassemblées
dans le tableau 7A de l'annexe 2.
Il ressort que la diminution du DFG est plus importante chez
les Malades Non Suivis (65,87 ml/min/1,73m2) ; que chez les Malades
Suivis (86.5 ml/min/1,73 m2) alors qu'elle est normale chez les
Patients Sains. La différence est significative respectivement dans
chacun de ces sous-groupes avec un seuil de P ? 0,05. Les résultats du
DFG exprimés en ml/min/1,73m2 (calcul par la formule du MDRD)
sont présentés à la figure 17.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 51
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte: dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
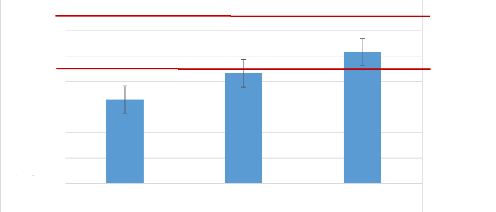
Moyenne du Debit de Filtration Glomérulaire
(ml/min/1,73 m2)
120
100
40
20
80
60
0
65,87
MNS MS PS
Catégorie des patients
a
86,5
b
103,19
c
Borne supérieure
Borne inférieure
Figure 17 : Comparaison du débit de la
filtration glomérulaire dans les trois sous-groupes (MS, MNS, PS)
Valeurs normales : 90-140 ml
/min/1,73m2
Légende : MNS : Malades Non
Suivis ; MS : Malades Suivis ; PS : Patients Sains.
Le DFG lorsqu'il est abaissé témoigne d'une
atteinte de la fonction glomérulaire et le niveau de baisse du DFG
renseigne physiologiquement sur le stade de l'altération
glomérulaire.
La filtration glomérulaire chez les Malades Suivis
(86,5 ml /min/1,73m2) est abaissée par rapport à la
normale (90-140 ml /min/1,73m2), cette détérioration
est encore plus poussée (65,87 ml /min/1,73m2) chez les
Malades Non Suivis. Le suivi retarde la détérioration du rein et
réduit considérablement la survenue des néphropathies dans
le temps. YANNOUTSOS et al. (2012) ont montré le rôle
central d'une intervention multifactorielle (médicamenteuse et
hygiéno-diététiques) précoce dans la prise en
charge du Diabète et de l'HTA.
II.5.2 Répartition du Débit de Filtration
Glomérulaire en fonction des tranches d'âges
La Clairance correspond à la quantité de plasma
épurée d'une substance par min. Le calcul de la clairance de la
créatinine permet d'estimer le Débit de Filtration
Glomérulaire.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 52
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte: dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
La répartition du Débit de Filtration
Glomérulaire en fonction des tranches d'âges est
présentée par l'histogramme de la figure 18. Les données
brutes qui ont permis son tracé sont résumées dans le
tableau 8A de l'annexe 2.
Des résultats de la répartition du DFG en
fonction des tranches d'âges, il ressort que la moyenne du DFG est
normale dans la tranche d'âges de (20-40) ans soit (102,9 ml/min/ 1,73
m2), légèrement basse dans la tranche d'âges de
(40-60) ans (81,6 ml/min/ 1,73 m2 ), tandis qu'une baisse
considérable est observée dans la tranche d'âges de (60-80)
ans (56,9 ml/min/ 1,73 m2): la différence est très
significative avec un seuil de P ? 0,05.
Moyenne du Débit de (ml/min/1,73
Filtration
Glomérulaire m2 )
|
Borne supérieure
|
|
120
|
|
102,9
|
|
|
100
|
Borne inférieure
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81,6
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56,9
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
20-40 40-60 60-80
Tranches d'âges (Années)
Figure 18 : Répartition du
Débit de Filtration Glomérulaire en fonction des tranches
d'âges des patients.
Valeurs normales : 90-140 ml
/min/1,73m2
D'après nos résultats, le DFG diminue avec
l'âge concordant aussi avec les données de FROISSART et ROSSERT
(2005) qui ont montré que physiologiquement, le DFG baisse avec
l'âge jusqu'à une valeur minimale seuil de 60
ml/min/1,73m2. Toute baisse du DFG en dessous de cette valeur quel
que soit l'âge est pathologique. En effet, la filtration
glomérulaire diminue avec l'âge par décade (10ml/min). Le
rein connait des modifications anatomiques en fonction de l'âge qui
altèrent le DFG : diminution du poids du rein (diminution d'environ 20%
entre 50-80 ans), diminution du volume et de la taille du rein (20-30%),
diminution du parenchyme cortical, diminution de la longueur et du volume des
tubules (ANONYME, 2011).
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 53
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
II.5.3 Corrélation entre la
créatinémie et le débit de filtration glomérulaire
en fonction des sous-groupes de patients et les tranches d'âge.
Le coefficient de corrélation permet de donner une
mesure synthétique de l'intensité de la relation entre deux
variables et de son sens lorsque cette relation est monotone.
Le calcul du coefficient de corrélation entre le DFG et
la créatinémie dans les différents sous-groupes de
patients a donné les valeurs suivantes :
- Chez les malades non suivis -0,73
- Chez les patients sains -0,76
- Chez les malades suivis -0,43.
Chez les Malades non suivis (-0,73) et les patients sains
(-0,76), la corrélation est dite
linéaire négative et forte car elle est comprise
entre (-1) et (-0,5). Nous déduisons qu'une augmentation de la
créatinémie qui est maintenue dans des proportions étroite
dans notre organisme et essentiellement filtrée par le rein, traduit une
diminution de la filtration glomérulaire.
Le calcul du coefficient de corrélation entre la
créatinémie et le DFG en fonction des différentes tranches
d'âge a donné les valeurs suivantes :
- Dans la tranche d'âge de 20-40 ans une valeur de -0,76 a
été obtenue
- Dans la tranche d'âge de 40-60 ans une valeur de - 0,85 a
été obtenue
- Dans la tranche d'âge de 60-80 ans une valeur de - 0,74 a
été obtenue
Toutes ces valeurs se rapprochent fortement de - 1 et
mènent à conclure qu'il existe
une relation linéaire négative entre le DFG et
la créatinémie. Il en découle qu'une augmentation de la
créatinémie implique une baisse de la filtration
glomérulaire indépendemment de la tranche d'âge ; bien que
l'âge constitue un facteur influencant l'état de la fonction
rénale. En effet il a été démontré que le
DFG diminu fortement avec l'âge (FROISSART et ROSSERT, 2005).
III. INFLUENCE DES ALIMENTS CONSOMMÉS CHEZ LES
MALADES NON SUIVIS ET LES MALADES SUIVIS.
Dans le Diabète et l'HTA, la nutrithérapie en
association au traitement médicamenteux constitue
l'élément central de la prise en charge. Le suivi alimentaire du
diabétique et de l'hypertendu vise à surveiller les
quantités et les fréquences d'aliments ingérés
ainsi que leur teneur en macro et micronutriments afin d'éviter des
fluctuations glycémiques, tensionelles et par conséquent des
complications liées à ces deux pathologies. Sur la figure 19
sont
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 54
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
répertoriés les aliments les plus
consommés dans chaque sous-groupe des patients en fonction des
effectifs.
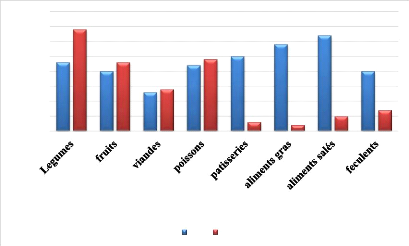
Effectifs
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Aliments les plus consommés
MNS MS
Figure 19 : Aliments les plus
consommés en fonction des sous-groupes (Malades Non Suivis, Malades
Suivis).
Légende : MNS : Malades Non
Suivis ; MS : Malades Suivis.
Les résultats de l'enquête alimentaire attestent
que le sous-groupe des Malades Suivis consomme beaucoup plus les légumes
et fruits qui sont riches en éléments antioxydants et inhibent
ainsi le stress oxydatif. Par ailleurs, les fruits et légumes ont un
index glycémique faible et sont mieux tolérés par les
patients diabétiques et/ou hypertendus. Le sous-groupe de malades suivis
consomme assez de poisson qui de part leur richesse en w3 et w9 fluidifient le
cholestérol dans l'organisme. La consommation de viande dans le
sous-groupe de malades suivis est moyenne ; l'excès doit être
évité pour ne pas élever l'acide urique. Il est
remarqué que les malades suivis réduisent considérablement
les aliments salés, les féculents, les pâtisseries et les
aliments gras. Le sous-groupe des Malades Non Suivis consomment beaucoup plus
les aliments salés, les aliments gras, les pâtisseries, les
féculents et consomme moyennement le poisson, les légumes et
fruits et enfin de la viande.
Il est constaté au vu des aliments les plus
consommés par chaque sous-groupe des patients que les Malades Suivis
s'efforcent de respecter le régime alimentaire préconisé
par le
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 55
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Ministère de la Santé Publique du Cameroun
(annexe 2) contrairement aux Malades Non Suivis qui n'en sont même pas
informés. Une étude menée par GILBERT et al.,
(2002) montrent qu'en cas de diabète et d'HTA, il faut limiter la
consommation d'aliment sucrés, de matières grasses et de sel.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 56
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
CONCLUSION
Au terme de notre étude dont le but était
d'évaluer la filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis médicalement à
l'Hôpital de District de la Cité Verte, nous pouvons dire que des
observations ont été notées suivant les différents
objectifs. Pour les 99 patients recrutés, il ressort que :
L'évaluation de la protéinurie dans les
différents sous-groupes a permis de constater qu'elle est plus
marquée chez les Malades Non Suivis que chez les Malades Suivis. La
modification de la filtration glomérulaire entraîne une
excrétion urinaire de l'albumine, qui signe une néphropathie.
34,4% de Malades Non Suivis présentent une protéinurie positive,
contrairement aux Malades suivis.
Les dosages de la créatinine et de l'urée ont
permis de constater que comparé aux sous-groupes des Malades Suivis, le
sous-groupe des Malades Non Suivis présentent les moyennes de
créatinémie et d'urémie supérieures aux normes du
fait que la maladie commence à détériorer le rein. Le
suivi médical retarde dans le temps l'altération de la fonction
rénale.
Le débit de filtration glomérulaire
révèle une baisse considérable de ce dernier dans le
sous-groupe des Malades Non Suivis comparé aux sous-groupes des Malades
Suivis. Le suivi médical améliore le débit de filtration
glomérulaire et réduit considérablement la survenue des
néphropathies.
L'enquête alimentaire montre que les Malades suivis
s'efforcent de respecter le régime alimentaire (consommation des fruits,
des légumes, le poisson, les féculents en petites
quantité) qui leur est soumis durant le suivi médical à la
différence des Malades Non Suivis.
Le suivi médical et un régime alimentaire
retarde la survenue des néphropathies diabétiques et/ou
hypertensives dans le temps. Malgré toutes ces mesures, on aboutira
toujours à des néphropathies qui représentent la
première cause de l'insuffisance rénale terminale dans le monde.
Il a été également constaté qu'un contrôle
régulier et permanant de la glycémie, de la tension
artérielle, du régime alimentaire ainsi qu'une prise en charge
thérapeutique adéquate est une solution pour mieux vivre avec le
diabète et l'hypertension artérielle. Cette étude reste
préliminaire et superficielle, elle nécessite donc d'autres
études approfondies.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 57
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
PERSPECTIVES
Cette étude indique une incontournable
nécessité de l'intervention multifactorielle (la
nutrithérapie, l'hygiène et le suivi médical) dans le
dépistage précoce, le suivi et la prise en charge du
diabète et/ou de l'hypertension.
Pour se faire :
- Poursuivre cette étude en intégrant un plus
grand nombre de patients dans d'autres structures en incluant d'autres
régions pour un meilleur équilibre alimentaire.
- Evaluer l'implication d'une ration alimentaire de base riche
en anti-oxydant dans la diminution de la part du stress oxydatif
présente dans la complication du diabète et de l'HTA dans le but
d'optimiser la prise en charge.
- faire une prescription au moins semestrielle de la recherche
d'une microalbuminurie dans le but de détecter à temps des
dérèglements rénaux et anticiper une insuffisance
rénale.
- évaluer le suivi alimentaire à travers le
dosage de l'hémoglobine glyquée et ainsi contrôler
d'éventuels dérapages des patients médicalement suivis.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 58
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ADAMA TIEFING D. (2006). Apport du
régime hygiéno-diététique dans le traitement de
l'hypertension artérielle au service de cardiologie de l'Hôpital
Gabriel Touré. Thèse médecine, Bamako (Mali) : 59
Pages.
ADER J.L., CARRE F., DINH-XUAN A.T., DUCLOS M., KUBIS
N., MERCIER J. (2003). Physiologie rénale. Edition
Elsevier-Masson, 2eme édition: 182- 229.
ANONYME (ASSOCIATION CANADIENNE DU DIABETE) (2008).
Prévention et traitement du diabète au Canada.
Canadian Journal of Diabete, (32) suppl : S139-S147.
ANONYME (2011). www. CHU-
besancon.fr rein_ sujet_
âgé.
ANONYME (COLLEGE DES ENSEIGNANTS DE CARDIOLOGIE ET
MALADIES VASCULAIRES). (2012). Hypertension artérielle de
l'adulte. Support de cours, université médicale virtuelle
francophone, 29 Pages.
ANONYME (2013). VITAMINES-STUDIOS -FRDBT
00495, compring lilly.
ANONYME (2015). Diabète épices
et aromates vos meilleurs alliés, Top santé.com/ nutrition et
recette- contre le diabète. Mis à jour le 06 avril 2015 à
15h.
ATEBA G. (2012). Exploration de la
fonction glomérulaire chez les drépanocytaires homozygotes
(SS). Thèse de Médecine, Faculté de Médecine
Université de Yaoundé 1, 72 pages.
APPELBAM M., FORRAT C., NILLLUS P. (1989).
Diététique et nutrition. 2ed, édition
Masson paris (France), 473 pages.
BERGER M., MÖNKS D., WANNER C. (2003).
Diabetic nephropathy: an inherited diseases or just a diabetic
complication? Kidney Blood Press Res. 26: 143-154.
BITA FOUDA A.A., LEMOGOUM D., DISSONGO J., OWONA MANGA
J., TOBBIT R., NGOUNOU MOYO D.F., ETAPELONG SUME G., KOLLO B. (2011).
Etude épidémiologique de l'hypertension artérielle chez
les travailleurs à Douala, Cameroun. Journal Home, 1 (1):
1-2.
BIOLABO (2011). Réactif pour dosage
quantitative de la créatinine dans le sérum, le plasma humain, ou
les
urines. www.biolabo.fr
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 59
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
BIOLABO (2011). Réactif pour dosage
quantitative de l'urée dans le sérum, le plasma humain, ou les
urines. www.biolabo.fr
BLACHER J., HALIMI J.M., HANON O., MOURAD J.J., PATHAK
ATUL., SCHNEBERT B., GIRERD X. (2013). Prise en charge de l'HTA de
l'adulte. Société Française d'Hypertension
Artérielle, 1: 1-4.
BORGHINI T., SCHENKER M., KESSELER D. (2013).
Fiche technique bandelette reactive urinaire. Rev. Med.
Suisse., 5 : 1870-1875.
BOUATTAR T., AHID S., BENASILA S., MATTOUS M., RHOO H.
(2009) : .Les facteurs de progression de la néphropathie
diabétique : prise en charge et évolution.
Néphropathie et Thérapeutique, 5 :181-87.
BOURQUIN V. et GIOVANNI M. (2007).
Protéinurie 1ère partie : physiopathologie,
détection et quantification. Forum. Méd. Suisse, 7:
708-712.
BRAND-MILLER J. (2003). Low-glycemic index diets
in the management of diabetes. A meta-analysis of randomized controlled trials.
Diabetes Care, 26(8): 2261-2267.
BROWNLEE M. (2001). Biochemistry and molecular
cell biology of diabetic complications. Nature, 414: 813-820.
BRON A., SPARROW J., BROWN N., HARDING J-J. (1993).
The Lens in diabetes. Journal Home, 7: 260-275.
BUSCH B.M. et PIGNET M. (2001). Le
diabète de type 2. Médecine Nucléaire. Imagerie
Fonctionnelle et Métabolique, 25 (2): 103-14.
CABE E. (2006). Variabilité de la
mesure dela créatinémie du chien dans les cliniques
vétérinaires. Thèse de médecine
vétérinaire, université Paul Sabatier de Toulouse
(France), 75 pages.
CANAUD B. (2008). Elévation de la
créatininémie - Orientation diagnostique. Revue du
Praticien, 58: 1837-1846.
CHEVENNE D et FONFREDE M. (2001).
Actualité sur les marqueurs biologiques du diabète.
Immuno. Anal. Biol. Spec., 16: 215-229
CILLARD J. (2011). Physiopathologie du
stress oxydant. Support de cours, Faculté de pharmacie
université de rennes (France): 27pages.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 60
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
COULIBALY D. (2008). Etude
épidémio-clinique de la néphropathie diabétique au
CHU de Gabriel Toure. Thèse de Médecine, faculté de
médecine Bamako université de Bamako (Mali), 112 pages.
DAROUX M., GAXATTE C., PUISIEUX F., CORMAN B. (2009).
Vieillissement rénal : facteurs de risque et
néphroprotection. Presse Méd., 38: 1667-1679.
DELATOUR V., LALERE B., DUMONT G., HATTCHOUEL J-M.,
FROISSART M., VASLIN- REIMANN S. (2011). Développement d'une
méthode de référence pour le dosage de la
créatinine pour améliorer le diagnostic et le suivi de
l'insuffisance rénale. Revue Française de
Métrologie, 2 (26) : 21-31.
DUBOIS L.D. (2010). Progrès
physiopathologiques dans le diabète de type1. Revue du
Praticien, 60: 165-69.
DUSSOL B., JOURDE-CHICHE N. (2009). Fonction
rénale : comment la mesurer? Comment interpréter les mesures?.
Encyc. Méd. Chir., Elsevier Masson (Paris): 1-6.
DZUDIE A., KENGNE A.P., MUNA W.F.T., HAMADOU B.A.,
MENANGA A., KOUAM KOUAM C. (2012). Prevalence, awareness,
treatment and control of hypertention in a self-selected sub-saharan African
urban population: a cross-sectional study. B.M.J Open., 2 (4) :
12-17.
EL FADL Y. (2010). Dépistage de la
néphropathie diabétique avérée dans la
région FES-BOULEMANE. Thèse de Médecine,
faculté de médecine et de pharmacie d'Algérie,
128pages.
FAO. (2002). Département du
développement durable: contraintes socioculturelles et besoin
d'information sur la santé; archive de la FAO :15 pages.
FAURE P. (2012). Méthode
d'étude du glucose en biologie. Support de cours, université
Joseph Fourier (France) : 21 pages.
FAUVEL J.P et LAVILLE M. (2001). La
néphropathie hypertensive: une cause croissante d'insuffisance
rénale. La presse Médicale, 30: 81-86.
FID : FEDERATION INTERNATIONALE DE DIABÈTE
(2011). Atlas du Diabètes de la FID:
www.idf.org/diabetesatlas,
Sixième édition.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 61
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
FID : FEDERATION INTERNATIONALE DE DIABÈTE
(2012). Atlas diabète :
www.idf.org/diabetesatlas,
cinquième édition.
FID : FEDERATION INTERNATIONALE DE DIABÈTE
(2013). Atlas du Diabètes de la FID:
www.idf.org/diabetesatlas,
Sixième édition.
FOSTER-POWEL K., HOLT S.H., BRAND-MILLER J.C. (2002).
International table of glycemic index and glycemic load, values.
Am. J. Clin. Nutr., 76 (1): 5-56.
FROISSART M et ROSSERT J. (2005). Comment
estimer la fonction rénale des sujets âgés. Revue du
praticien, 55 (20) : 2223-2229.
GILLERY P. (2014). Dosage de l'HbA1c et des
produits d'Amadori en biologie humaine. Support de cours, Faculté
de Médecine université de Reims (France): 26-27.
GODIN R.D. (2011). La filtration
glomérulaire et sa régulation, Physiologie rénale.
Support de cours, Université Joseph Fourier (France): 34 pages.
GOURDI P. (2011). Diabète de type 2 et
insuffisance rénale : une situation à haut risque
cardiovasculaire. Médecine des maladies métaboliques, 5,
suppl 1: 31-37.
GRIMALDI A. (2000). Questions d'internat,
Diabétologie. Support de cours, Faculté de médecine
Pierre Marie Curie Paris (France): 15-19.
GUILBERT P., DELAMAIRE K., ODDOUX B. (2003).
Baromètre santé nutrition : premiers résultats.
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, 18 (19): 78-81.
GUNNARSDOTTIR I. (2008). Inclusion of fish or
fish oil in weight-loss diets for young adults: effects on blood lipids.
Int. J. Obes., 32(7): 1105-1112.
HANEDA M., KOYA D., ISONO M., KIKKAWA R. (2003).
Overview of glucose signaling in mesangial cells in diabetic
nephropathy. J. Am. Soc. Nephrol., 14: 1374-1382.
HEIDLAND A., SEBEKOVA K., SCHINZEL R. (2001).
Advanced glycation end products and the progressive course of renal
disease. Am. J. Kidney. Dis., 38 suppl 1: S100-S106.
IZZEDINE M. (2003). Néphrologie
pratique : comment interpréter une protéinurie, une
hématurie, une anomalie de la natrémie?. Encyc. Méd.
Chir., Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS : 8-10.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 62
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
KESSLER M. (2000). Hypertension essentiel et
risque rénal. Support de cours université de Toulouse (France):
32 pages.
KRZESINSKI J.M., WEEKERS L. (2005). Hypertension
et diabète. Rev. Med. Liège, 60: 572-577.
LASARIDIS A.N et SARAFIDIS P.A. (2005).
Néphropathie diabétique et traitement antihypertenseur :
quelles sont les leçons des essais chimiques ? E.M.C-
Néphrologie, 2: 182193.
LEVEY A.S., GREENE T., KUSEK J.W., BECK G. (2000).
MRDR study group: a simplified equation to predict glomerular
filtration rate from serum creatinine. J. Am. Soc. Nephrol., 11 :
461-470.
MAKRLOUF H. (2011). Cours de biochimie :
ration alimentaire. Support de cours, faculté de médecine
université d'ORAN (Algérie): 14-15.
MARIEB E.N. (2008). Biologie humaine
principe d'anatomie et de physiologie. Edition du renouveau
pédagogique, 8eme édition: 545-548.
MELANDER O., VON WOWERN F., FRANDSEN E., BURRI P.,
WILLSTEEN G., AURELL M., HULTHEN U. (2007). Moderate salt restriction
effectively lowers blood pressure and degree of salt sensitivity is related to
baseline concentration of renin and N-terminal atrial natriuretic peptide in
plasma. J. Hypertens., 25(3): 619-627.
MENSINK R. (2003). Effects of dietary fatty
acids and carbo-hydrates on ratio of serum total lipids and apolipoproteins: a
meta-analysis 60 controlled trials. Am. J. Clin. Nutr., 77(5):
1146-1155.
MITCH W.E., MEDINA R., GREIBER S. (1994).
Metabolic acidosis stimulates muscle protein degradation by activating the
ATP-dependent parthway involving ubiquitin and proteasome. J. Clin.
Invest., 93: 2127-2133.
MOGENSEN C.E., CHRISTENSEN C.K., VITTINGHUS E. (1983).
The stages in diabetic renal disease; with emphasis on stages of
incipient diabétic nephropathy. Diabetes, 32 suppl 2: 64-78.
MORI T.A. (2006). Omega-3 fatty acids and
hypertension in humans. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., 33(9):
842-846.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 63
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
MORRISON J., KNOLL K., HESSNER MJ. (2004).
Effect of high glucose on gene expression in mesangial cells: up
regulation of thiol pathway is on adaptational response. Physiol
Genomics., 17: 271-282.
NATIONAL KIDNEY FOUNDATION (2006). Clinical
practice guideline and clinical practice recommendations for anemia in chronic
kidney disease. Am. J. Kidney. Dis., 47, suppl 3: S1-S147.
OMS: ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. (1999).
International society of hypertension, Guidelines for the management
of Hypertension. Guidelines Subcommittee. J. Hypertens, 17(2):
151-83.
OMS: ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. (2012).
Rapport statistique sanitaire mondiale. Report of a WHO
consultation Geneva (Suisse); publié le 16 mai 2012.
OUEDRAOGO A. (2002). Etude l'alimentation
des diabétiques : résultats d'une enquête qualitative et
semi-quantitative à Ouagadougou. Thèse médecine,
université Ouagadougou (Burkina Faso), 83 pages.
REDOUANE SALAH A. (2011). Etude de
quelques paramètres biologiques et physiologiques de la
néphropathie diabétique. Master 2 en biologie cellulaire,
université mentouri (Algérie), 99 pages.
RIBSTEIN J. (1999). Néphropathie
vasculaire. Support de cours de l'université Grenoble (France),
19pages.
RICHET G. (2005). Introduction du dosage de
l'urée sanguine en pathologie rénale. J.
Néphrologie, 1 (4): 265-268.
ROS E. (2003). Dietary cis-monounsaturated
fatty acids and metabolic, control in type 2 diabetes. Am. J. clin. Nutr.,
78 suppl1: 617 - 625.
ROUSSEL R. (2011). Histoire naturelle de la
néphropathie diabétique. Médecine des maladies
métaboliques, 5, Suppl : S18-S13.
RUDBERG S., DAHLQUIST G. (1996). Determinants
of progression of microalbuminuria in adolescents with IDDM.
Diabètes Care, 19 : 369-371.
SHEMA E.C. (2014). 900.000 diabétiques
dénombrés au Cameroun. Journal du
Cameroun. Com,
Édition du 04 mars 2014.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 64
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
SHERWOOD L. (2006). Appareil urinaire:
Physiologie humaine. Edition de Boeck supérieur Amazon (France):
405-442.
SINGH R., BARDEN A., MORI T. (2001). Advanced
glycation end-products: a review. Diabetologia, 44: 129-146.
STENGEL B., BILLONS S., DIJK P.C., JAGER K.J. (2003).
Trends in the incidence of renal replacement therapy for end-stage
renal disease in Europe 1990-1999. Nephrol Dial Transplant, 18(9):
1824-33.
TOBE S.W. (2006). The effect of alcohol and
gender on ambulatory blood pressure: results from the Base-line double Exposure
study. Am. J. Hypertens, 19(2): 136-139.
TRAWALE J-M. (2013). Physiologie
rénale. Support de cours, université Poirier (France) :
50pages.
TSINALIS D. et BINET I. (2006).
Appréciation de la fonction rénale :
créatininémie, urée et filtration glomérulaire.
Forum. Med. Suisse, 6 : 414-419.
UNION AFRICAINE (2014). Incidence des maladies
non transmissibles, et les maladies tropicales négligées sur le
développement en Afrique : Conférence des ministres de la
santé. Ethiopie, 20 mars 2014, 14 pages.
VALDIGUIE P. (2000). Biochimie
clinique. Support de cours, Faculté de médecine de Rangeuil
(France): 304-307.
VANHOLDER R. (2003). Uremic toxins.
Nephrologie, 24 (07): 373-376.
VANHOUETTE E.L. (2013). Prise en charge
nutritionnelle du patient hypertendu. Thèse en sciences
pharmaceutique, université Joseph Fourier (France), 161 pages.
WEAVER C., PROULX W., HEANEY R. (1999).
Choices for achieving adequate dietary calcium with a vegetarian diet.
Am. J. Clin Nutr., 70: 543-548.
WEEKERS L., SCHEEN A.J., RARIVE G. (2003).
Prévention de la néphropathie diabétique: de la
microalbuminurie à l'insuffisance rénale terminale. Rev. Med.
(Liege), 58(5): 297-306.
WEEKERS L., KRZESINSKI J-M. (2005).
Néphropathie diabétique. Rev. Med. (Liege), 60:
479-486.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 65
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
WOLF G., BUTZMAN V., WENZEL V.O. (2003). The
rennin-angiotensin system and progression of renal disease: From hemodynamics
to cell biology. Nephron. Physiol., 93: 313.
WOLF G. (2005). Mécanismes
moléculaires de l'atteinte rénale d'origine diabétique.
Flammarion-Médecine-Science. Actualités néphrologiques
: 1-12.
YANNOUTSOS A., KRETZ S., SLAMA S., BLACHER J. (2012).
Hypertension artérielle et diabète: quelle cible
thérapeutique et que choix de traitement? Revue generale, 41:
33.
YTHURBIDE G. et HERTIG A. (2012). Augmentation
de la créatinémie. Revue du Praticien, 26 : 152-153.
ZAOUI P., JANBON B., THONY F. (2003).
Néphropathie vasculaire. Support de cours,
faculté de médecine Grenoble (France), 12 pages.
ZEMMOUR D., OUADAHI N., BENSALAH D., HAKEM D., BERRAH A.
(2008). HTA chez les diabétiques hospitalisés. Revue
de médecine interne, 3 : 77.
ZINSOU C. (2010). Métabolisme d'azote
et d'ammoniac. Cours de métabolisme, chapitre 14.
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page 66
ANNEXES
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page i
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
ANNEXES 1 : FICHE DE COLLECTE DES DONNEES
N° :
Section1 : Identification du patient,
caractéristiques Socioprofessionnelles
1. Catégorie du patient : MNS MS PS
2. Type de diabète : 1 2 Hypertendu
3. Age : 20-40 40-60 60-80 (ans)
4. Sexe : Masculin Féminin
5. Quel est votre statut matrimonial : Marié
Célibataire Veuf (veuve)
6. Quelle est votre profession :
7. Quartier de résidence : .
Section 2
: Etat physique et profil pathologique des patients
8. Poids : kg
9. Tension artérielle (TA) : / .mmHg
10. Depuis combien de temps êtes- vous diabétique
ou hypertendu ? (Jr/Sem./Ms/A.)
11. Avez- vous des membres de familles qui souffrent ou ont
souffert d'une maladie
chronique?
a. Diabète
b. Hypertension artérielle
c. Les deux
d. Autres précisés
Mémoire de Master en Biologie Clinique
rédigé par: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Page ii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
12. Suivez-vous un traitement : oui non
13. Ancienneté du traitement (temps) : (Jr/Sem./Ms/A.)
14. Dans quelle structure sanitaire votre pathologie a
été dépistée :
a) Dans un hôpital de district
b) Dans une clinique
c) Dans un hôpital général
d) Autres précisés
15. Quelle est votre fréquence de suivis ?
a) Une fois/ mois
b) Une fois tous les deux mois
c) Une fois tous les trois mois
16. Présence des complications :
a) Néphropathie
b) Neuropathie
c) rétinopathie
d) Autres précisés
17. Suivez-vous un régime diététique : oui
non
Si oui lequel ?
Section 3 : Evaluation de
l'observance managériale
- Sur le plan alimentaire
18. Le personnel en charge de votre alimentation vous donne-t-il
des conseils alimentaire
et nutritionnel ?
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page
iii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
a) Jamais
b) Parfois
c) Toujours
19. Vous a-t-il demandez de vous abstenir de certains
aliments? oui non
Lesquels
20. Suivez-vous un régime alimentaire particulier
hormis celui prescrit par le diététicien ?
Oui non
Si oui lequel ?
21. Rencontrez-vous des difficultés liés au
régime alimentaire ? oui non
22. Si oui ces difficultés sont-elles liées
à la quantité d'aliments
consommés ?
- Fréquences de consommations
alimentaires
23. Quelles sont vos habitudes alimentaires ?
24. Quels types d'aliments consommez-vous de
préférence lors de vos repas ?
Section 4 : Paramètres Biologiques
- Sang :
Créatininémie: mg/l
Urémie : g/l
Clairance de la créatinine calculée (MDRD) .
(ml/min/1 ,73m2)
Glucose
Protéine
- Urine :
Bandelette urinaire à 2 paramètres :
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page iv
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
ANNEXES 2 : LES TABLEAUX
Tableau 1A : Répartition de la
population en fonction des tranches d'âges dans les différents
sous-groupes (MS, MNS, PS).
|
TRANCHES D'ÂGES (ANNEES)
|
Effectif de
MNS (%)
|
Effectif de
MS (%)
|
Effectif de
PS (%)
|
|
[20-40[
|
9,4
|
8, 3
|
80,6
|
|
[40-60[
|
50,0
|
50,0
|
16,1
|
|
[60-80]
|
40,6
|
41,7
|
3,2
|
|
TOTAL
|
100,0
|
100,0
|
99,9
|
Tableau 2A : Répartition de la population
en fonction du type de pathologie.
|
Types de pathologies
|
Moyenne
|
|
DT1
|
1
|
|
DT2
|
29
|
|
HTA
|
5
|
|
DT2+HTA
|
34
|
|
PS
|
31
|
Légende : DT1 :
Diabète de type 1 ; DT2 :
Diabète de type 2 ; HTA : Hypertension
artérielle ; PS : Patients sains.
Tableau 3A : Variation de la
créatinémie dans les différents sous-groupes de
patients.
|
Catégories de patients
|
Moyenne #177; écart type
|
|
MNS
|
13,2#177; 6,8 mg/l
|
|
MS
|
9,6 #177; 2,1 mg/l
|
|
PS
|
9,1 #177; 1,7 mg/l
|
Légende : MNS : Malade Non
Suivis, MS : Malade Suivi, PS : Patients Sains.
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page v
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Tableau 4A : Variation de la
Créatinémie en fonction des tranches d'âges.
|
Tranches d'âges (Années)
|
Moyenne #177; écart type
|
|
[20-40[
|
8,0 #177; 0,9 mg/l
|
|
[40-60[
|
10,5 #177; 0,5 mg/l
|
|
[60-80[
|
15,4 #177; 6,9 mg/l
|
Tableau 5A : Variation de l'urémie dans
les différents sous-groupes de patients.
|
Catégories de patients
|
Moyenne #177; écart type
|
|
MNS
|
1.2#177; 4.2 g/l
|
|
MS
|
0.4 #177;0.2 g/l
|
|
PS
|
0.2 #177;0.1 g/l
|
Légende : MNS : Malade Non
Suivis, MS : Malade Suivi, PS : Patients Sains.
Tableau 6A : Variation de l'Urémie en
fonction des tranches d'âges.
|
Tranches d'âges (Années)
|
Moyenne #177; écart type
|
|
[20-40[
|
0,3
|
#177; 0,2
|
|
[40-60[
|
0,3
|
#177; 0,1
|
|
[60-80[
|
1,4
|
#177; 4,8
|
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page vi
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Tableau 7A : Moyenne du Débit de
Filtration Glomérulaire dans les différents sous-groupes de
patients.
|
Catégories de patients
|
Moyenne #177; écart type
|
|
MNS
|
65,87#177; 23,19 ml/min/1,73 m2
|
|
MS
|
86,50 #177; 20,63 ml/min/1,73 m2
|
|
PS
|
103,00 #177; 22,91 ml/min/1,73 m2
|
Légende : MNS : Malade Non
Suivis, MS : Malade Suivi, PS : Patients Sains.
Tableau 8A : Variation du Débit de
Filtration Glomérulaire en fonction des tranches
d'âges.
|
Tranches d'âges (Années)
|
Moyenne #177; écart type
|
|
[20-40[
|
102,9 #177; 20,4 ml/min/1,73 m2
|
|
[40-60[
|
81,6 #177; 18,5 ml/min/1,73 m2
|
|
[60-80[
|
56,9 #177; 18,4 ml/min/1,73 m2
|
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page
vii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
ANNEXES 3 : LES ATTESTATIONS
Attestations 1A : Attestation de recherches
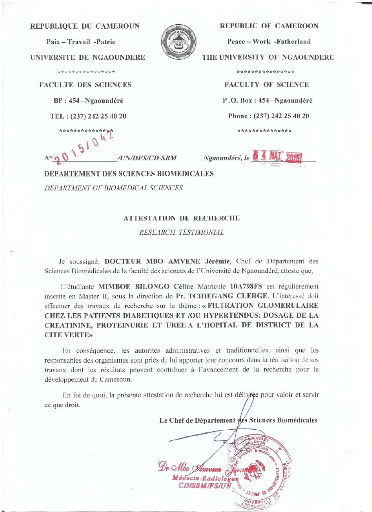
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page
viii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Attestations 2A: Autorisation de recherches
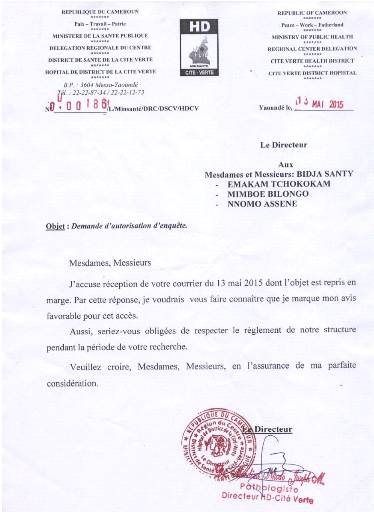
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page ix
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
ANNEXES 4: FICHE DES DIFFERENTS ALIMENTS AUTORISES OU
PROSCRITS AU DIABETIQUE
|
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
****************
|
REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie
**********
|
REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland
**********
CENTRE NATIONAL D'HYPERTENSION ET DE DIABETOLOGIE
NATIONAL CENTER FOR HYPERTENTION AND DIABETES
P.P 1707 YAOUNDE
N° . Yaoundé le
TABLEAU DES DIFFERENTS
ALIMENTS AUTORISES OU PROSCRITS AU
DIABETIQUE
Ceci est une liste d'aliments proposés au régime
diabétique mais attention, si vous
devez suivre un régime dont le taux calorique a
été déterminé, veuillez respecter les
quantités des aliments permis prescrits dans votre régime
calculé.
|
GROUPE
D'ALIMENTS
|
AUTORISE
|
A LIMITER
|
PROSCRITS
|
|
VIANDES
|
Toute viande maigre sans graisse visible
|
Les abats (foie, tripe,
cervelle, rognon...)
|
-Viandes grasses -Viande en conserve -Charcuterie
|
|
POISSONS
|
Tous les poissons frais ou fumés
|
|
Poissons en conserve
sauf les conserves au naturel
|
|
OEUFS
|
|
Maximum 3 à 4 par semaine à cuire sans
matière grasse
|
|
|
|
|
|
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page x
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
|
GROUPE
D'ALIMENTS
|
AUTORISE
|
A LIMITER
|
PROSCRITS
|
|
LAIT ET
PRODUITS LAITIERS
|
Lait écrémé ou demi-
écrémé, yaourt maigre,
non sucré, fromage
maigre (moins de 30% M.G)
|
|
-Lait concentré, sucré
-Lait entier, yaourt
sucré ou aux fruits, -fromage
gras
|
|
FECULENTS : TUBERCULES
|
2 à 3 morceaux par repas
|
Macabo, manioc,
igname, plantain, taro,
pomme de terre (les
faire bouillir tous,
attention aux quantités)
|
Plantain mur, couscous,
fritures, aliments
rappés, pilés, en
purée, bâton de manioc
|
|
LEGUMINEUSES
|
|
Arachide, ndjansan,
grain de courge,
amande de mangue
sauvage, haricots sec
(voir quantité matière grasse autorisée)
|
Pâtes d'arachide, mets d'arachide ou grain de courge
|
|
MATIERES GRACES
|
Très peu
|
Huile de palme, de
coton, de soja,
d'arachide, de
tournesol, de mais,
d'olive (attention, voir quantité
autorisée)
|
-Graisse animales -Graisses trop cuites
|
|
BOISSONS
|
Eau naturelle, eau
minérale, eau gazeuse,
chicorée, tisanes,
infusion non sucrées
|
Thé, café, jus de fruit nature (voir
quantité de fruit autorisée)
|
Jus de fruit de
commerce, boissons
gazeuses sucrées : top,
coca, Fanta, tonic,
malta
Vin de palme, vin
rouge, vin blanc,
whisky)
|
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page xi
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
|
CEREALES
|
Très peu ou moyen
|
Riz, pâte alimentaire
(attention aux
quantités)
|
Semoules ou couscous de mais, de riz, de mil
|
|
PATISSERIES
|
|
Pain (attention aux
quantités)
|
-Brioche, croissant - Pain au chocolat - Gâteau,
baigné
|
|
FRUITS
|
Pastèques, papaye,
pamplemousse, ananas,
mangue, mandarine,
goyave, pomme, poire (1 à 2 fruits /jr)
|
|
-Avocat, prune
-Banane douce, canne à
sucre, fruits en
conserve, fruits sec
(noix, noisettes, dattes, corossol)
|
|
LEGUMES
|
Tous les légumes feuilles
(salade, choux, zoom,
Folon, feuille de manioc, de courge, de
Macabo...)
Haricot verts, poivron,
aubergine, tomate,
concombre, melon
(courge), gombo,
champignon
|
Petit pois
|
|
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page
xii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
ANNEXES 5 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE
UNIVERSITE de Ngaoundéré
Département des Sciences Biomédicale
Thème: Filtration
Glomérulaire chez les patients diabétique et/ou hypertendus
suivis à l'Hôpital de la Cite Verte (Yaoundé-
Cameroun)
Protocole de recherche du mémoire de Master II EN
Biologie Clinique menés par l'étudiante MIMBOE BILONGO CELINE
SYLVIE sous la supervision de Pr TCHIEGANG CLERGE et l'encadrement du Dr ATEBA
GHISLAINE tous deux Biochimistes.
Investigateur: MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE
Institution: Université de Ngaoundéré
Département: Sciences Biomédicales
Niveau d'étude: Master II
GENERALITES
Site d'étude :
L'étude s'est déroulée à
l'Hôpital de la Cité Verte de Yaoundé, sur la
période allant du 15 JUIN au 28 AOUT 2015
Informations
généralisées
Ce document de consentement éclairé est
subdivisé en deux parties : la première partie contient la fiche
d'information qui vous donne une idée sur le contenu de ce projet de
recherche, et la deuxième partie est l'attestation de consentement pour
les signatures de ceux qui auront accepté de participé au
projet.
PARTIE I : fiche d'information
Nous aimerons vous inviter à participer à une
étude dont le but est de déterminer l'impact du diabète
et/ou de l'hypertension sur la filtration glomérulaire des patients
suivis à l'Hôpital de la Cité Verte de Yaoundé. Les
résultats permettront l'amélioration des connaissances sur la
filtration glomérulaire desdits patients. Avant d'accepter de participer
à l'étude, nous vous demandons de bien lire ce formulaire, ou
à défaut, nous allons passer en
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page
xiii
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
revue avec vous toutes les informations contenues dans ce
formulaire de consentement éclairé qui décrit l'objectif
de l'étude les risques, les Avantages et vos options de participer
à l'étude.
PARTICIPATION : volontaire
Votre participation est entièrement volontaire et vous
avez le droit de refus er et même si vous accepter, vous êtes libre
de vous retirer de l'étude à tout moment et sans donner de
raison. Votre refus d'y participer n'affectera pas votre accès aux soins
médicaux.
DEROULEMENT DE LA PARTICIPATION :
La procédure consiste à vous poser un certains
nombres de questions sur votre traitement, votre mode de vie et vos habitudes
alimentaires. Des prises de sang vous seront effectuées dans le but de
faire les examens suivants : UREMIE, CREATINEMIE. Nous allons par la suite
relever dans votre carnet de soins les valeurs de ces examens et enfin
rechercher la présence des protéines dans les urines.
AVANTAGES
Pour cette étude, vous bénéficierez
gratuitement des résultats de cette recherche et votre participation
permettra l'amélioration de la prise en charge. Les informations
fournies permettront de mieux orienter les interventions nutritionnelles
auprès de cette population.
RISQUES / INCONFORTS
Il n'ya pas de risques pour cette études. Le seul
inconvénient est le temps (environ 10 min) que vous allez consacrer aux
questionnements.
INCITATION /COMPENSATION
Aucune incitation ou rémunération ne vous sera
versé pour votre participation à cette étude.
CONFIDENTIALITE
Les informations recueillies lors de cette étude seront
conservées de manière confidentielle. Seul un code permettra de
vous identifier et sera sécurisée lequel sera remis au
médecin en charge de votre suivi.
PROBLEMES OU QUESTIONS : qui contacté
?
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page
xiv
Filtration glomérulaire chez des patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de
district de la Cité Verte:
dosages de la créatinémie,
protéinurie et urémie
Ce projet a été présenté et
approuvé par le ministre de la santé de votre pays par
l'intermédiaire du comité national d'éthique de
l'Hôpital de la Cité Verte. Ce comité est en charge de la
protection des personnes qui y participent. Si vous avez des questions
maintenant ou après, vous pouvez contacter le médecin de
l'Hôpital qui vous prend en charge ou les personnes ci-dessous :
- Pr TCHIEGANG CLERGE professeur à
l'UIT/ ENSAI de l'université de Ngaoundéré, TEL :
677112217
- Dr ATEBA GHISLAINE de l'Hôpital JAMOT
à Yaoundé TEL :
- MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE,
Département des Sciences Biomédicales,
Faculté des sciences, Université de
Ngaoundéré, TEL : 690551236/670913827
PARTIE II : CERTIFICAT DE CONSENTEMENT DU PATIENT
Je soussigné Mr, Mme,
Accepte librement et volontairement de participer à la
recherche médicale intitulée :
Filtration glomérulaire chez les patients
diabétiques et/ou hypertendus suivis à l'Hôpital de la
Cité Verte Yaoundé
Etant entendu que :
- Les investigateurs m'ont informé des avantages et
risques liés à cette étude et ont répondu à
toutes mes questions.
- Les investigateurs m'ont précisé que ma
participation est libre et non rémunéré.
J'accepte que les données enregistrées à
l'occasion de cette recherche puissent faire l'objet d'un traitement
informatisé.
Fait le à Yaoundé
Signature des investigateurs Signature du patient ou de l'ayant
droit
Mémoire rédigé par:
MIMBOE BILONGO CELINE SYLVIE Page xv
| 


