|
Les opinions émises dans le présent
mémoire sont propres à son auteur et ne sauraient
en aucun cas
engager l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques
DEDICACE
A la mémoire de mon grand père, feu Raymond
Nébongnè BADOLO,
Il m'a tout donné sans rien recevoir
en retour,
Il a su semer sans penser à celui qui va
récolter,
A tous ceux qui me sont chers,
A tous ceux qui oeuvrent
à petite ou à grande échelle pour un monde
plus juste
et humain
Je vous dédie ce travail de recherche.
REMERCIEMENTS
Le mémoire de fin d'études sanctionne deux ans
de formation à l'Institut de Formation et de Recherche
Démographiques (IFORD). C'est, d'une part, l'une des conditions à
remplir pour l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées en Démographies (DESSD), et d'autre part, il
est destiné, à l'initiation des étudiants à la
recherche démographique.
Cette recherche a été menée sous la
direction du Pr Evina Akam que nous tenons ici à remercier pour sa
disponibilité, sa rigueur aussi bien dans la méthode que dans la
rédaction. Nous remercions également :
> La direction de l'Institut National de la Statistique et
de la Démographie (INSD) du Burkina Faso, ainsi que la direction du
Projet de Développement du Système Statistique National (PDSSN)
qui ont tous mis en oeuvre pour nous permettre de suivre cette formation.
> La Direction de l'IFORD et la Coordination de la
formation de longue durée, qui n'ont pas ménagé leurs
efforts pour que la formation arrive à terme, en dépit de
nombreuses difficultés.
> Mr Léon Mudubu, Dr Hélène Kamdem, Pr
Jean Wakam, Dr Gervais Beninguisse, pour leur disponibilité, leur
collaboration et leurs conseils tout au long de notre formation et dans la
conduite de cette recherche.
> Tous les camarades de la 27eme promotion et
tous les étudiants de la 28eme promotion de l'IFORD.
Nos remerciements vont à l'endroit de Mr Savadogo qui
nous a fournis les statistiques du ministère de la santé.
A nos tantes Mme Bambara Agnès et Mme Zigani Madeleine
et notre cousin Olivier Badolo qui ont toujours cru en nous, pour leurs
conseils et leurs soutiens de tout ordre durant notre formation.
TABLE DE MATIERES
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
TABLE DE MATIERES vii
LISTE DES TABLEAUX ix
LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES x
RÉSUMÉ xi
INTRODUCTION 12
CHAPITRE I: CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE 17
1.1. Contexte culturel 18
1.1.1 Des sociétés majoritairement rurales et
agricoles 18
1.1.2 Des traditions 18
1.1.3 Des mutations en cours 19
1.2 Situation démographique 20
1.3 Situation sanitaire 24
1.4 Grandes orientations politiques pour la population
28
CHAPITRE II: CADRE THERIQUE 30
2.1. Revue de la littérature 30
2.1.1 Facteurs de la mortalité des enfants 30
a) Variables liées à la mère 31
b) Variables liées à l'enfant 36
c) Variables liées au contexte 38
2.1.2. Théories de la baisse de la mortalité 39
a) Technologie sanitaire ou révolution de la
médecine 40
b) Développement économique 41
c) Amélioration de l'état nutritionnel 42
d) Culture et comportement en matière de santé
42
2.2. Cadre conceptuel 43
2.2.1 Hypothèses 45
a) Hypothèse générale 45
b) Hypothèses spécifiques 46
2.2.2 Définition des concepts 46
a) Mortalité infantile 46
b) Les caractéristiques d'identification sociale de la
mère 47
c) Comportements des mères 47
d) Pratiques préventives en matière de soins de
santé 47
2.2.3 Variables utilisées dans l'étude 47
a) Variable dépendante 47
b) Variables indépendantes 47
CHAPITRE III : METHODOLOGIE 49
3.1. Présentation des sources de données
utilisées 49
3.1.1. Objectifs des trois enquêtes EDS 49
3.1.2. Plan de sondage 50
3.1.3. Questionnaires 50
3.2. Méthodes d'analyse 51
3.3. Evaluation de la qualité des données
utilisées 53
3.3.1 Evaluation de l'âge déclaré des
mères 54
a) Indice de Whipple 55
b) Indice de Myers 56
3.3.2 Evaluation des déclarations de la parité
moyenne 58
3.3.3 Evaluation de la qualité de l'âge au
décès 61
a) Evolution des proportions des décès d'enfants
selon l'âge déclaré des mères 61
b) Evaluation de la qualité des données à
partir de la distribution par âge des enfants
décédés 63
CHAPITRE IV: PRATIQUES
PREVENTIVES DES MERES EN MATIERE DE
SOINS DE SANTE ET MORTALITE INFANTILE 65
4.1 Pratiques des mères en matière de suivi
médical de la grossesse et de
l'accouchement et risque de mortalité infantile
65
4.1.1 Age de la grossesse au moment de la première visite
prénatale 65
4.1.2 Nombre de visites prénatales 68
4.1.3 Injection antitétanique reçue par la
mère pendant la grossesse. 70
4.1.4 Lieu et assistance à l'accouchement 72
4.2. Vaccination des enfants et mortalité
infantile 76
4.2.1 Vaccination BCG 77
4.2.2 Vaccination DTP 78
4.2.3 Vaccination rougeole 80
4.2.4 Vaccination poliomyélite 82
4.3. Pratiques nutritionnelles des mères et
mortalité infantile 83
4.3.1 Durée d'allaitement 83
4.3.2 Poids de l'enfant à la naissance 85
4.4 Variation de la mortalité infantile selon les
pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère
87
4.4.1 Variation de la mortalité infantile selon les
pratiques en matière de soins préventifs
et les caractéristiques d'indentification sociale de la
mère entre 1998 et 2003 87
4.4.2 Variation de la mortalité infantile selon les
pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1993
et 1998 90 4.4.3 Variation de la mortalité infantile selon les
pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1988
et 1993 91
CONLUSION GENERALE 93
BIBLIOGRAPHIE 97
ANNEXES xiv
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1.1: Principaux indicateurs démographiques
d'après RGPH de 1996 21
Tableau 1.2 : Évolution des accouchements assistés
entre 1993 et 2003 (en %) 28
Tableau 3.1: Indices de Myers 56
Tableau 3.2: Répartition des femmes au cours des trois EDS
et du RGPH-1996 57
Tableau 3.3 : Les taux de fécondité
général obtenus méthodes indirectes d'estimation de Rachad
et Brass 59
Tableau 3.4: Répartition des enfants nés vivants
et des enfants décédés selon le groupe d'âges
de la mère 61
Tableau 3.5 : Proportions des âges au décès
non déclarés 63
Tableau 3.6: Proportion des décès néonatals
parmi les décès infantiles selon les EDS 64
Tableau 4.1: Evolution de la variation du risque de
mortalité infantile selon l'âge de la grossesse au moment de la
première visite prénatale 66
Tableau 4.2: Evolution de la
variation du risque de mortalité infantile selon le nombre de
visites prénatales effectuées par la mère
durant la grossesse. 69
Tableau 4.3: Evolution de la variation du risque de
mortalité infantile selon le nombre
d'injections antitétaniques reçues par la
mère durant la grossesse 71
Tableau 4.5: Evolution de la variation du
risque de mortalité infantile selon l'assistance à
l'accouchement 75
Tableau 4.6 : Evolution de la variation du
risque de mortalité infantile selon la vaccination
contre la tuberculose 78
Tableau 4.7: Evolution de la
variation du risque de mortalité infantile selon la vaccination
contre la diphtérie 79
Tableau 4.8: Evolution de la
variation du risque de mortalité infantile selon la vaccination
contre la rougeole 81
Tableau 4.9: Evolution de la variation
du risque de mortalité infantile selon la vaccination
contre la poliomyélite 82
Tableau 4.10: Evolution de la
variation du risque de mortalité infantile selon la durée
d'allaitement 84
Tableau 4.11: Evolution de la variation du
risque de mortalité infantile selon le poids à la
naissance 86
LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES
Figure1.1: Evolution de la mortalité infantile et
infanto-juvénile entre 1960 et 2003 22
Figure1.2: L'évolution de l'espérance de vie
à la naissance entre 1985 et 1996 22
Figure 1.3 : Structure des soins de santé au Burkina Faso
en 2001 26
Figure1.4. : Évolution de la couverture vaccinale des
enfants de 0 à 11 mois (en %) entre
1997 et 2003 27
Figure 2.1 : Schéma conceptuel de l'étude 45
Figure 2.7: Schéma d'analyse de l'étude 48
Figure 3.1: Diagramme de Lexis montrant la période
quinquennale précédant les enquête 52
Graphique 3.1 : Répartition des mères selon leur
âge 54
Graphique3.2 : Répartition des femmes
enquêtées et des femmes recensées selon le groupe
d'âges 57
Graphique3.3 : Evolution des parités moyennes selon
l'âge de la mère 59
Graphique3.4: Evolution des parités moyennes selon le
groupe d'âge de la mère 60
Graphique 3.5: Evolution des proportions des décès
selon le groupe 'âges 62
Graphique3.6: Evolution des proportions des décès
selon le groupe 'âges 62
Graphique4.1: Répartition des enfants de moins d'un an
selon l'âge de la grossesse au
moment du premier contrôle prénatale 66
69
Graphique4.3: Répartition des enfants de mois d'un an
selon le nombre d'injections
antitétaniques reçues par la mère au cours
de la grossesse 71
Graphique4.4: Répartition des enfants de moins d'un an
selon le lieu de l'accouchement 73
Graphique4.5: Répartition des enfants selon la
qualité du personnel ayant assisté à l'accouchement
73
Graphique4.7: Répartition des enfants de moins d'un an selon la
vaccination contre la
diphtérie 79
Graphique4.8: Répartition des
enfants de moins d'un an selon la vaccination contre la
rougeole 81
81
Graphique4.9: Répartition des enfants selon la vaccination
contre la poliomyélite 82
Graphique4.10: Répartition des enfants selon la
durée d'allaitement au sein 84
Graphique4.11 : Répartition des enfants de moins d'un an
selon le poids à la naissance 86
Graphique4.12: Variation de la mortalité infantile selon
les pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1998
et 2003 89
Graphique4.13: Variation de la mortalité infantile selon
les pratiques en matière de soins
préventifs et les caractéristiques
d'indentification sociale de la mère entre 1993 et 1998
91
Graphique4.14: Tendance de la mortalité infantile selon les
pratiques en matière de soins
préventifs et les caractéristiques
d'indentification sociale de la mère entre 1993 et 1998 92
RÉSUMÉ
Dans tous les pays en développement, notamment en
Afrique de l'Ouest et particulièrement au Burkina Faso où le
niveau de mortalité infantile reste très élevé,
l'amélioration de la santé infantile dépend autant, sinon
plus, de l'application de connaissances acquises à travers l'utilisation
des centres de santé que de nouvelles découvertes de la
médecine.
Cette étude explore les influences des pratiques des
soins préventifs en matière de santé sur la baisse de la
mortalité infantile au Burkina Faso. Elle a ainsi été
réalisée à partir des données des trois EDS
réalisées au Burkina Faso en 1992, 1998/99 et en 2003.
L'analyse des données de ces enquêtes montre que
malgré une baisse, la mortalité infantile au Burkina reste
élevée: sur 1000 enfants nés vivants au cours de la
période 1998- 2003, 81 sont morts avant leurs premiers anniversaire.
Durant la période 1988-2003 le pays a connu une amélioration de
la couverture vaccinale (en ce qui concerne les vaccins tels que le BCG, le
DTP, Le vaccin anti rougeoleux et le vaccin contre la poliomyélite) et
de la fréquentation des centres de santé par les femmes pendant
la grossesse. Parmi les vaccins délivrés aux enfants avant leur
premier anniversaire et les soins médicaux reçus par la
mère pendant la grossesse, le vaccin contre la rougeole et les
injections antitétaniques reçues par la mère pendant les
visites prénatale, paraissent être les principaux responsables de
la baisse de la mortalité infantile. L'état nutritionnel fournit
un bon pronostic de la survie. L'indicateur nutritionnel utilisé ici (la
durée d'allaitement au sein maternel) est fortement
corrélé avec la survie de l'enfant. Le risque de
décès infantile diminue régulièrement lorsque la
durée d'allaitement au sein augmente.
INTRODUCTION
Dans les pays développés, le déclin de la
mortalité était déjà visible à la fin du
XIXe siècle ; dans les pays en développement, une baisse
importante de la mortalité n'a été enregistrée que
peu après la fin de la deuxième guerre mondiale. L'ampleur de la
baisse initiale dans les pays en développement a été si
impressionnante qu'on s'est demandé au cours des années 60 et 70
si l'écart de mortalité entre pays développés et
pays en développement n'allait pas se réduire
considérablement d'ici à la fin du siècle. La tendance
à la baisse de la mortalité semblant être un
phénomène mondial, on ne s'est pas beaucoup penché sur
l'analyse critique des facteurs qui en étaient précisément
responsables. Les ressources nationales et celles provenant de donateurs ont
ainsi été plus largement utilisées, à travers les
programmes de santé, pour obtenir des baisses encore plus importantes.
Par exemple, divers programmes axés sur la survie de l'enfant, tels que
le Programme Elargi de Vaccination (PEV), ont élaboré des
stratégies assez souples pour atteindre certaines cibles de
mortalité de l'enfant dans les pays participants. Pour y parvenir, les
efforts ont surtout porté sur l'amélioration de la couverture
vaccinale, le recours généralisé à la
thérapie par réhydratation orale en cas de diarrhée,
l'amélioration de l'état nutritionnel de la mère et de
l'enfant et la diminution du nombre de grossesses à haut risque. Les
stratégies précises permettant d'atteindre cette série
d'objectifs ont été laissées à
l'appréciation de chaque pays.
La baisse de la mortalité est consécutive
à l'amélioration des conditions de vie, d'hygiène et
à la mise en place des soins de santé primaires, en particulier
la nutrition et le logement. Les politiques de santé publique ont
été appliquées dans le monde entier. Elles étaient
ciblées sur l'eau potable, l'assainissement, l'hygiène, les
vaccinations, la santé maternelle, l'alimentation des enfants etc. Ces
politiques se poursuivent avec la mise au point et la distribution des
médicaments modernes ainsi qu'avec l'application de diverses actions de
médecine. Toutes ces actions se sont traduites par une baisse
significative de la mortalité des jeunes enfants et des jeunes adultes.
L'espérance de vie à la naissance en Afrique, qui était
estimée à 37 ans en 1950-1955, atteint 53 ans dans les
années 1990 (Akoto, 1994), soit un gain de 16 ans en 45 ans. Cette
baisse était surtout due à la diminution de la mortalité
par maladies infectieuses et celle des autres causes de mortalité, dont
certaines étaient ellesmêmes des conséquences lointaines
des infections antérieures (Preston, 1980).
Durant les cinq dernières décennies, la
mortalité en général et celle des enfants en particulier a
connu un recul important en Afrique. Malgré cette baisse
enregistrée, le niveau de mortalité infantile et juvénile
du continent reste encore le plus élevé au monde. Le taux de
mortalité infantile et juvénile est maintenant proche de 89 pour
mille en Afrique alors qu'il est de 23 pour mille en Amérique Latine, 29
pour mille en Asie de l'Est et de 62 pour mille en Asie du Sud1. La
baisse continue de la mortalité en général et celle de la
mortalité des jeunes enfants en particulier, reste l'objectif
unanimement visé par tous les gouvernements de tous les Etats africains.
Pour ce faire, ces derniers mettent l'accent sur l'élaboration et la
mise en oeuvre de politiques de santé efficaces afin de réduire
davantage ces niveaux et les disparités existantes entre les
différentes couches sociales de la population. Or ces politiques ne
peuvent produire les résultats attendus que si les facteurs qui sont
à l'origine de cette baisse sont bien appréhendés et que
les actions entreprises les cibles.
S'il est aisé d'identifier les facteurs associés
à la mortalité, une approche explicative ou la mise en oeuvre des
programmes susceptibles d'agir favorablement sur le phénomène
étudié, nécessite d'identifier non seulement les relations
existantes entre celui-ci et les facteurs de risque qui lui sont
associés (effets directs ou indirects), mais aussi les interactions
existantes entre ces derniers, en tentant de les ordonner selon leur
proximité. Aussi l'analyse de la mortalité, ne doit-elle pas
nécessairement tenir compte du temps et du lieu. Outre ces facteurs
contextuels, il est important de tenir compte de toute une série de
caractéristiques individuelles, appelées souvent
caractéristiques socio-démographiques dans les études de
mortalité et de santé. Ces caractéristiques
présentent fréquemment des différentiations
systématiques de mortalité (ou de morbidité) et exercent
soit un effet direct ou indirect sur la mortalité.
A l'instar d'autres pays africains, le Burkina Faso
connaît un niveau élevé de mortalité en
général et celui de la mortalité infantile en particulier.
Selon les résultats de l'Enquête Démographique et de
Santé réalisée en 2003 (EDSBF-III), près d'un
enfant sur cinq (195%o) meurt avant l'âge de cinq ans et parmi mille
naissances vivantes, 81 n'atteignent pas leur premier anniversaire. Les
données disponibles montrent que la mortalité infantile
connaît une tendance à la baisse depuis les années 1960. Le
taux de mortalité infantile (TMI) est passé
1 UNFPA, State of world population 2007
182%o en 1960-61 à 107%o en 1996 et à 81%o en
2003. Malgré cette baisse, le niveau de mortalité infantile reste
encore élevé.
La mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des
programmes de santé nécessaires pour réduire la
mortalité infantile exigent la détermination et la
compréhension des facteurs responsables du niveau élevé de
ce phénomène, car comme le fait remarqué Barbieri (1991),
« l'efficacité des programmes de santé dépend en
grande partie de la capacité à comprendre les processus
responsables des niveaux élevés de la mortalité des
enfants dans le tiers monde ». En outre, l'accent souvent mis sur les
maladies évitables grâce à la vaccination et la
thérapie en cas de diarrhée, par opposition à un ensemble
plus vaste et plus complet de programmes de santé communautaires, avait
entraîné des effets de substitution en matière de
morbidité et de mortalité. En d'autres termes, on sauvait des
enfants de la rougeole ou de la diarrhée pour les laisser mourir
d'autres causes que ne couvraient pas ces interventions. Lorsqu'ils
étaient importants, ces effets de substitution étaient
susceptibles d'avoir une forte incidence sur le rythme auquel s'effectuait la
baisse de la mortalité. Ces préoccupations ont conduit à
entreprendre des recherches sur la nature, les caractéristiques et les
déterminants de la baisse de la mortalité chez l'enfant. Certains
auteurs, comme Younoussi (1997), ont tenté d'expliquer ce
phénomène au niveau individuel en examinant les
caractéristiques biologiques, comportementales, démographiques et
socioéconomiques. D'autres ont élucidé les
mécanismes par lesquels divers déterminants modifient la
mortalité des enfants. D'autres encore ont cherché à
expliquer les écarts observés en tenant compte des
différences d'environnement, de culture et de conditions de vie
matérielles des enfants et des familles. L'impossibilité de
préciser les relations de cause à effet reliant la
mortalité de l'enfant à ses déterminants proches ou
lointains a conduit à une multiplication d'initiatives axées sur
la survie de l'enfant. Il est donc nécessaire et urgent de
connaître les facteurs qui déterminent le plus ce
phénomène afin d'identifier ou d'orienter les actions sanitaires
déjà mises en oeuvre pour améliorer davantage la situation
et réduire les inégalités flagrantes en matière de
santé persistantes entre les enfants des différentes couches
sociales.
En dehors des inégalités face aux risques de
décès, les enfants sont exposés en amont aux
inégalités face aux recours aux soins. Ces
inégalités résultent de plusieurs facteurs d'ordre
institutionnel, économique et culturel. Les comportements des
mères en matière de soins préventifs constituent l'un des
déterminants directs.
En premier lieu, les mères sont les premières
responsables des soins accordés aux enfants. Elles sont garantes du
maintient de la santé des enfants en leurs assurant les conditions de
prévention de la maladie, l'alimentation et l'hygiène corporelle
des enfants et le cas échéant, les amener dans les centres de
santé pour les soins, (Ouédraogo. C, 1994). En second lieu, dans
les schémas explicatifs de la mortalité des enfants, les
comportements sanitaires des mères constituent des variables
intermédiaires par lesquelles les facteurs socioéconomiques et
culturels agissent en partie sur ce phénomène.
Dans un contexte de changement institutionnel et de lutte
contre la pauvreté impliquant, l'amélioration du système
sanitaire, les comportements des mères ont un impact important sur la
survie de leurs enfants. La meilleure stratégie pour améliorer la
survie des enfants serait un développement durable permettant une
amélioration du niveau de vie. Celle proposée ici est une
stratégie possible au niveau individuel. Elle consiste à
mobiliser les femmes et les amener à adopter des comportements
favorables à la survie des enfants. Leur capacité à mieux
tirer profit des services de santé mis à leur disposition et
d'assumer leur responsabilité dans la gestion des problèmes
sanitaires est importante pour améliorer la survie des enfants.
Fort de ces considérations, nous nous proposons dans
cette étude de répondre à la question suivante: « les
soins préventifs que les femmes apportent à leurs enfants
contribuentils significativement à l'amélioration de la survie
des enfants de moins d'un an au Burkina Faso? ». Ainsi, nous nous
intéressons aux soins préventifs pour identifier parmi eux les
variables qui sont à l'origine de la baisse de la mortalité
infantile au Burkina Faso.
Cette étude a pour objectif de mettre en
évidence les facteurs de la baisse du niveau de la mortalité
infantile, facteurs sur lesquels les actions des décideurs politiques
devraient porter afin d'améliorer davantage la survie des enfants de
moins d'un an au Burkina Faso.
Plus spécifiquement, cette étude veut :
+ Etudier l'évolution des principaux facteurs
préventifs entre 1992 et 2003.
+ Identifier les principaux facteurs préventifs
associés à la baisse de la mortalité infantile. Autrement
dit, nous cherchons à savoir si les pratiques en matière de suivi
médicale de la grossesse, de vaccination et de nutrition ont
contribué à la baisse de la mortalité infantile au Burkina
Faso.
Pour atteindre ces objectifs, ce travail est articulé
en quatre chapitres. Le premier chapitre présente l'intérêt
et le contexte général de l'étude. Le cadre
théorique fait l'objet du deuxième chapitre. C'est ici que
l'état des connaissances sur les facteurs de la mortalité des
enfants et sur les théories explicatives de la baisse de la
mortalité sont exposés. Partant de ces éléments, un
cadre conceptuel de l'étude est élaboré ainsi que quelques
hypothèses de recherche à tester. Le troisième chapitre
porte sur la présentation de la méthodologie. Il présente
les données utilisées, en fait une évaluation de la
qualité et présente les méthodes d'analyse à
utiliser. Le dernier chapitre est consacré aux analyses de l'incidence
des comportements préventifs des mères sur la mortalité
des enfants de moins d'un an.
Cette étude se termine par une conclusion
générale qui rappelle les points saillants des différentes
sections de cette étude. Quelques recommandations pour l'action et une
piste d'ouverture dans les perspectives de recherche dans le futur sont
formulées à la lumière des résultats.
CHAPITRE I: CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE
Pays situé dans la boucle du Niger au coeur de
l'Afrique occidentale, le Burkina Faso est un pays enclavé couvrant une
superficie de 274 200 km2. Il partage ses frontières avec six
pays : le Mali au nord et à l'oust, le Niger à l'est, la
Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana et le Bénin au sud. Le relief du
Burkina est principalement constitué d'un plateau d'une altitude moyenne
de 250 à 350 mètres, qui s'effondre brutalement dans le sud-ouest
(falaises et chutes de Banfora) et s'abaisse dans le nord en direction de la
vallée du Niger. Le pays est drainé par trois fleuves : le
Mouhoun, le Nazinon et le Nakambé. Le Burkina est soumis à la
sécheresse et aux vents secs. Le point le plus proche de l'océan
Atlantique en est distant de 500 km. Ouagadougou, la capitale du pays est
située à 1 200 km du port d'Abidjan (Côte d'Ivoire),
à 980 km du port de Téma (Ghana) et à 970 km du port de
Lomé (Togo). Faisant partie des pays sahéliens, le Burkina Faso
connaît un climat tropical de type soudanien rude et sec à deux
saisons : une longue saison sèche (neuf mois) et une courte saison
pluvieuse (trois mois).
Le pays est divisé en treize régions (La Boucle
du Mouhoun, le Centre, Le CentreSud, Le Plateau Central, Le Centre-Ouest, Le
Centre Est, Le Centre Nord, L'Est, Le Nord, Les Cascades, Les Hauts Bassins, Le
Sahel et le Sud-ouest) placées sous l'autorité des gouverneurs.
Ces dernières sont constituées de 45 provinces (placées
sous l'autorité des hauts commissaires). Les provinces sont
divisées en départements qui sont constitués de villages.
Le département est placé sous l'autorité d'un
préfet. Les services de santé sont calqués sur cette
structure administrative.
L'économie du Burkina Faso repose essentiellement sur
l'agriculture et l'élevage qui occupent plus des trois quarts de la
population active et contribuaient pour 37,2 % au PIB du pays en 1998.
L'agriculture emploie 75 % de la population active du Burkina, mais la
production ne permet pas de nourrir tous les habitants (le pays n'est pas
autosuffisant sur le plan alimentaire). L'inégale répartition de
la pluviométrie conjuguée à la pauvreté
différentielle des sols au plan interne constitue un facteur
d'inégalité entre les régions Sud et Ouest du pays
comparativement à celles du Nord et de l'Est. Les premières (Sud
et Ouest), aux sols riches sont les mieux arrosées également. Le
sous-sol, en revanche, possède certaines richesses dont le
manganèse, le cuivre, le fer ou encore le phosphate.
1.1. Contexte culturel
1.1.1 Des sociétés majoritairement rurales
et agricoles
Au Burkina Faso, la population rurale représente 85% de
la population totale (CONAPO, 2000). L'économie est
caractérisée par l'existence d'un secteur traditionnel de
subsistance encore très répandu et d'un secteur moderne
d'échanges tourné vers l'extérieur. Les
familles vivent surtout de l'agriculture et de l'élevage. Le climat
soudano-sahélien, avec une seule saison des pluies ne permet qu'une
récolte annuelle compromise souvent par la pauvreté des sols et
la pluviométrie irrégulière et mal répartie.
Pendant une bonne partie de l'année, le sol reste complètement
sec et exposé à des phénomènes d'induration. Les
populations vivent ainsi dans une insécurité alimentaire
permanente. La persistance des pratiques ancestrales d'élevage et
d'agriculture (cultures itinérantes sur brûlis, feux de brousse,
coupe abusive du bois...) est préjudiciable à l'environnement et
entraîne une désertification avancée dans certaines zones.
A ces contraintes naturelles, s'ajoutent des obstacles sociaux. Les
sociétés burkinabés se composent de collectivités
rurales dont les pratiques ne préparent pas toujours l'individu à
accepter facilement les changements qu'impose aujourd'hui la vie moderne. Si
ces collectivités rurales aspirent à une descendance nombreuse,
c'est que l'agriculture extensive qu'elles pratiquent exige un fort apport de
main-d'oeuvre.
1.1.2 Des traditions
Le Burkina Faso compte une multitude de groupes ethniques
ayant des cultures différentes. Ces groupes constituent souvent des
sociétés structurées en villages. Par ailleurs, les
sociétés burkinabé, malgré leur diversité,
partagent un fond démo-culturel commun. Les traditions renfermaient un
certain nombre d'atouts et de valeurs socio-culturelles positives. En effet,
les sociétés burkinabés étaient régies par
les principes de respect de la vie, de solidarité, d'échanges et
de réciprocité qui cimentaient la vie sociale et assuraient une
totale intégration des individus dans la société. L'esprit
communautaire y était aussi développé, basé sur la
subordination de l'individu au groupe et à la famille. Toutefois,
certains aspects de ces traditions constituent des préoccupations de
premier ordre dans les questions de population et développement.
D'abord au sein de chaque groupe, le mariage apparaît
comme une institution obligatoire, qui mobilise l'ensemble de la
communauté lignagère. Il est un signe de maturité sociale
et de responsabilité. Les stratégies matrimoniales ont en
général pour fondement de
« disposer » de plusieurs femmes, d'avoir une
descendance nombreuse, d'étendre plus loin les réseaux
d'alliance. Elles visent à renforcer le clan sur les plans
démographique, économique et social. La femme apparaît
ainsi comme un capital qu'il faut acquérir, conserver et rentabiliser.
Sa fonction la plus valorisée est celle de la reproduction qui, en
donnant à l'homme une descendance nombreuse, lui permet d'accéder
à une plus grande considération sociale. Il s'ensuit que la
quasi-totalité de ces groupes privilégie le mariage par alliance.
Ils ont une préférence pour les mariages précoces.
L'âge idéal souhaité à la primo nuptialité se
situe au seuil de la puberté et de l'adolescence pour les filles (11
à 19 ans).
Ensuite, les sociétés burkinabés, de
manière générale, sont pro-natalistes. La
préoccupation fondamentale de chaque groupe demeure sa
perpétuation et tous les moyens économiques, culturels,
spirituels et idéologiques sont mis en oeuvre à cet effet. Il y a
pour les hommes et les femmes une justification pour une progéniture
nombreuse : le don de la vie et sa conservation constituent un devoir
sacré ; la famille nombreuse constitue un facteur important de
production économique et de prestige social ; les enfants sont un
véritable capital car ils constituent une sécurité sociale
pour leurs parents pendant leurs vieux jours.
Enfin, les sociétés burkinabés, à
des degrés divers, conservent encore des pratiques traditionnelles
néfastes et préjudiciables à la santé des femmes et
des petites filles. Ce sont notamment les mutilations génitales
féminines (excision), les interdits alimentaires et tabous
nutritionnels, le mariage forcé, le mariage précoce et le
lévirat.
1.1.3 Des mutations en cours
Les sociétés burkinabés ont subi et
continuent de subir un certain nombre de transformations depuis la
période coloniale. Sur le plan économique, la diffusion de la
monnaie a rompu un certain nombre d'équilibres anciens. L'introduction
des cultures de rente par exemple a eu un impact sur les cultures
vivrières et a modifié les rapports de production dans le sens
d'une industrialisation et d'une autonomie des exploitations agricoles dans
leur gestion et dans la jouissance de leurs produits.
Sur le plan social, les mutations sont allées de pair
avec la dislocation des institutions et l'affaiblissement des valeurs
traditionnelles (famille, groupe de pairs, etc.), sans que l'éducation
scolaire ne puisse les remplacer valablement dans leur rôle de
socialisation. L'effritement de la famille africaine en général
et burkinabé en particulier, amorcé depuis la
période coloniale par des facteurs tels que les
migrations, les travaux forcés et autres déportations, s'est
poursuivi après 1960 par des éléments récurrents ou
aggravés de ces facteurs (la migration extérieure et l'exode
rural par exemple) et a sérieusement affecté les valeurs qui
s'enseignaient dans ce cadre social de base et qui soutenaient et entretenaient
la cohésion sociale.
La promotion de la femme a connu une intensification à
partir de 1984, notamment avec l'avènement de la Révolution
Démocratique et Populaire. Il s'agit au niveau national de l'adoption
d'un certain nombre de textes, de plans et de programmes d'action. On citera
entre autres l'adoption d'un plan d'action en matière de planification
familiale en 1986, ainsi que l'adoption de stratégies de renforcement du
rôle de la femme dans le processus de développement en 1992.
Toutes ces actions, renforcées par la ratification au niveau
international de la convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'encontre des femmes ont été rendues
possibles grâce à un environnement favorable marqué par la
modernisation de l'économie, l'engagement politique et la mobilisation
sociale, notamment des femmes et des associations.
1.2 Situation démographique
Estimée à 4 349 600 résidents en 1960, la
population burkinabé est passée de 5,6 millions en 1975 à
près de 8 millions en 1985 puis à 10 312609 en 1996. Elle est
aujourd'hui estimée à plus de 13 millions (en 2006). Cette
évolution de l'effectif global est due essentiellement à
l'accroissement démographique. Le taux d'accroissement naturel est
estimé à 3,1 % et le taux de fécondité à 6,8
enfants par femme en 1996 (tableau 1.1). Le taux de croissance annuel moyen est
de l'ordre de 2,4 %. A ce rythme la population doublera en 29 ans. La
population burkinabé est extrêmement jeune. En 1996, les moins de
15 ans représentaient 47,9 % de la population et les plus de 65 ans 3,7
% seulement. Cette situation se traduit par un rapport de dépendance
assez élevé de 107,8% et pose le problème de la prise en
charge et de la satisfaction des besoins sociaux de base (éducation,
santé, emploi...) des jeunes.
L'état de la population (volume, structure, niveau de
mortalité et de fécondité) et sa dynamique ont un impact
sur la réalisation des objectifs de développement humain durable.
En effet, les variables démographiques déterminent les besoins
sociaux de base à satisfaire en termes de santé,
d'éducation, d'alimentation etc.
Tableau 1.1: Principaux indicateurs démographiques
d'après RGPH de 1996
|
Indicateurs du RGPH 1996
|
Valeurs
|
|
Population totale
|
10 312 609
|
|
Densité (habitants/km2)
|
37,6
|
|
Population urbaine (en %)
|
15,5
|
|
Taux d'accroissement naturel (en %)
|
3,1
|
|
Indice Synthétique de Fécondité
(enfants/femme)
|
6,8
|
|
Taux brut de natalité (pour mille)
|
48,2
|
|
Taux de mortalité infantile (pour mille)
|
107
|
|
Espérance de vie a la naissance (en années)
|
53,8
|
Source: RGPH 1996
La mortalité a connu une baisse très sensible au
Burkina Faso depuis 1960. De 32%o en 1960, le taux de mortalité est
tombé a 17,5%o en 1985 et 14,8%o en 1996. On observe cependant que la
mortalité masculine est relativement plus importante que celle des
femmes, même si elle accuse une légère baisse. De 1985 a
1996, le taux de mortalité masculine est passé de 17,9%o a 16,3%o
contre respectivement 17,1%o a 13,5%o chez les femmes au cours de la même
période. Cela traduit bien une surmortalité masculine dont le
rapport est de 120,7% en 1996. Ainsi, pour 100 décès de femmes on
enregistre environ 121 décès d'hommes ce qui a pour
conséquences entre autres, l'accroissement du nombre de femmes chefs de
ménage (avec a charge leurs enfants).
Le taux de mortalité infantile (0-1 an révolu)
est passé de 182%o en 1960 a 134%o en 1985, puis a 107,1%o en 1996. La
mortalité juvénile (mortalité des enfants de 1 a 5 ans), a
suivi la même tendance que la mortalité infantile. En effet, de
217%o en 1960, le quotient de mortalité juvénile est passé
a 75,1%o en 1996, soit une baisse relative de 65,4 % en 36 ans. De même,
la mortalité infanto-juvénile (mortalité des enfants de 0
a 5 ans) a été marquée par une baisse relative de plus de
50% entre 1960 et 1996. Le quotient de mortalité infanto-juvénile
est passé de 360%o en 1960 a 174,2%o en 1996.
La baisse de la mortalité et notamment celle des
enfants de 0 a 5 ans s'est traduite par une amélioration de
l'espérance de vie a la naissance qui est passée de 32 ans en
1960 a 48,5 ans en 1985 et a 53,8 ans en 1996. Entre 1985 et 1996 le gain
annuel moyen en espérance de vie est de 0,56 an, ce qui paraît
raisonnable par rapport a la moyenne mondiale qui est de 0,5. Toutefois, ce
gain est plus faible par rapport a celui de la période (1976 -1985) qui
était de 0,65 an par an. Cette situation pourrait en partie s'expliquer
par l'apparition de la pandémie du SIDA a partir de 1986.
Figure1.1: Evolution de la mortalité infantile et
infanto-juvénile entre 1960 et 2003
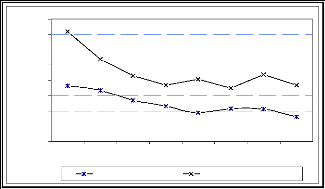
1960 1975 1985 1991 1993 1996 1998 2003
400
350
300
250
Quotient
200
150
100
50
0
Mortalité infantile Mortalité
Infanto-Juvénile
La baisse du taux de mortalité relève notamment
de l'introduction de la médecine moderne. Avant la diffusion
générale de cette médecine, la situation était
caractérisée par une croissance démographique
modérée, avec des taux bruts de natalité et de
mortalité élevés avoisinant 50%o. Mais depuis une
cinquantaine d'années, grâce aux progrès de la
médecine, la mortalité a fortement baissé tandis que la
fécondité se maintient à un niveau élevé. Le
déclin de la mortalité est aussi lié à une
série de transformations économiques, sociales et mentales
à savoir l'amélioration du niveau de vie, l'amélioration
du niveau d'instruction, la prise de conscience des besoins de l'enfant,
l'esprit de maîtrise de la nature, etc. (CONAPO, 2000).
Figure1.2: L'évolution de l'espérance de vie
à la naissance entre 1985 et 1996
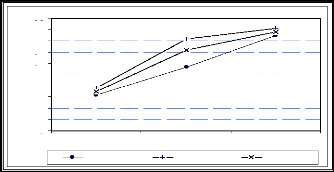
55
54
53
Esperance de vie
52
51
50
49
48
47
46
45
1985 1991 1996
Hommes Ensemble
Année
Femmes
Le taux de mortalité maternelle au Burkina Faso est
passé de 566 pour 100 000 naissances vivantes en 1991 (Enquête
Démographique de 1991) à 484 en 1998 (EDS 98).
Cependant, quoiqu'en baisse constante, ce taux reste tout de
même un des plus élevés de l'Afrique. Cette situation
s'explique par le faible niveau de développement socio-économique
du pays (insuffisance et éloignement des formations sanitaires), la
faible accessibilité des soins obstétricaux aggravée par
des facteurs liés aux comportements procréateurs à risque
(maternités précoce et/ou tardive, naissances
rapprochées), et à des attitudes et pratiques culturelles
néfastes à la santé des femmes et des enfants (interdits
alimentaires, excision, etc.). A cela s'ajoutent le faible taux d'utilisation
des services, le faible statut social de la femme et la faible implication des
hommes dans la résolution des problèmes.
Le Burkina Faso est depuis toujours un pays de migration. Au
cours de la période 1988/92, environ 602 000 personnes ont
été touchées par la migration internationale dont 273 000
immigrés et 329 000 émigrés. Ces échanges
s'opèrent essentiellement avec la Côte d'Ivoire. Avec la crise
sociale qu'a connue ce pays en 1999 et celle plus récente de 2002 qui se
poursuit de nos jours, les mouvements migratoires dans ce sens se sont
considérablement modérés et modifiés.
En outre, en milieu urbain, depuis le début des
années 1980, les conditions économiques très difficiles et
les compressions du personnel dans le secteur public, combinées à
une croissance rapide de la population active qualifiée semblent
favoriser la migration vers l'étranger des cadres et des professionnels
de haut-niveau, à la fois hommes et femmes. Le niveau d'éducation
est alors souvent rapporté comme facteur déterminant dans
l'émigration internationale.
Tous les indicateurs permettant de mesurer l'accès
à l'enseignement se sont sensiblement améliorés au cours
des quinze dernières années au Burkina. L'amélioration du
niveau d'instruction se reflète, entre autre, dans l'augmentation
régulière de la proportion des adultes sachant lire et
écrire et du taux de scolarisation au primaire. Le taux brut de
scolarisation au primaire est passé de 30% en 1991 à 52.2% en
2003. Entre 1985 et 2003, le taux d'alphabétisation est passé de
12,5% à 21,8% (CONAPO, 2000). Ce chiffre reste assez faible lorsqu'on le
compare aux taux d'alphabétisation des autres pays en
développement. En 1995, le taux d'alphabétisation des Pays les
moins avancés était de 49% et celui des pays d'Afrique du Nord et
du Moyen-Orient de 62%.
Par delà les bénéfices individuels que
les hommes et les femmes tirent de l'accès à l'enseignement
(développement personnel, accès à de meilleurs
emplois...), tout porte à
croire que l'élévation du niveau d'instruction
entraîne pour l'ensemble de la société des effets positifs
supérieurs à la simple somme des bénéfices
individuels. Ces effets, sont connus sous le terme d'effets externes. Par
exemple, on a observé dans de nombreux pays que l'amélioration du
niveau d'éducation des mères permet d'améliorer
significativement la santé des enfants et de réduire le taux de
mortalité infantile. Or, l'amélioration de la santé
individuelle des enfants permet d'enrayer la propagation, à l'ensemble
de la société, des maladies transmissibles - principales causes
d'invalidité dans les pays du Sahel. De ce fait, l'amélioration
de l'éducation d'une partie de la population bénéficie au
reste de la société.
1.3 Situation sanitaire
La santé est un élément fondamental du
bien-être des populations et un facteur de développement
économique et social. En termes économiques, une politique
efficace de santé publique permet de .limiter l'incidence de la
morbidité sur la main d'oeuvre, les femmes et les enfants.
D'une manière générale, la situation
sanitaire est déplorable. Elle est caractérisée par une
morbidité et une mortalité générale
élevées qui sont imputables aux facteurs suivants :
+ La fréquence des endémies (paludisme,
affections respiratoires, diarrhées ...) et des épidémies
meurtrières (méningite cérébro-spinale, rougeole,
choléra). La méningite cérébrospinale a
présenté des pics épidémiques au cours des
dernières années : 42 000 cas en 1996 et 22 200 cas en 1997.
Quant à la rougeole, elle a connu des poussées
épidémiologiques importantes depuis 1993 (14.445 cas) pour
atteindre 17 848 cas dans le premier trimestre de 19962.
+ L'apparition du VIII et l'augmentation des porteurs
asymptomatiques et des cas de SIDA. Les premiers cas de SIDA ont
été diagnostiqués en 1986 et depuis lors le nombre de
personnes infectées se multiplie malgré les efforts fournis
à divers niveaux. En 1999, on estimait le taux de
séroprévalence du VIII à 7,17 % de la population. Le taux
de séropositivité est plus élevé chez les personnes
de 20 à 39 ans (plus de 50 % des cas). Les hommes sont les plus
touchés (60 % des cas) que les femmes. On compte aujourd'hui au Burkina
Faso 370 000
2 Tous ces chiffres sont issus du rapport 2000 du
Conseil National pour la Population (CONAPO, 2000).
personnes vivant avec le VIH et 200 000 orphelins du
SIDA3. Cette situation fait du Burkina Faso le deuxième pays
le plus touché de l'Afrique de l'Ouest (après la Côte
d'Ivoire).
+ L'insuffisance du personnel médical tant du point de
vue quantitatif que qualitatif. En 1998, on comptait 7 078 agents toutes
catégories confondues (médical et paramédical). Il existe
une disparité notoire dans la répartition du personnel entre zone
urbaine et zone rurale. Les deux principales villes (Ouagadougou et Bobo
Dioulasso) regroupent à elles seules 53,7 % des médecins, 57,3 %
des sages femmes, 59 % des pharmaciens et le tiers des infirmiers4.
Le ratio personnel de santé/population reste nettement en
deçà des normes préconisées par l'OMS pour la
région Afrique de l'Ouest (un médecin pour 10 000 habitants, une
sage-femme pour 5 000 habitants et un infirmier pour 5 000 habitants). En 1995,
on comptait un médecin pour 29 250 habitants, un pharmacien pour 188 498
habitants, une sage-femme pour 28 512 habitants, un infirmier d'Etat pour 8 143
habitants, ce qui traduit un déséquilibre notoire entre le rythme
d'accroissement du personnel soignant et celui de la population5.
+ L'inaccessibilité et la faible performance des
formations sanitaires. En 1998, il existait 1 022 formations sanitaires dont
deux Centres Hospitaliers Nationaux (CHN), 9 Centres Hospitaliers
Régionaux (CHR), 30 Centres Médicaux avec Antennes chirurgicales
(CMA), 784 Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), 144
dispensaires isolés et 17 maternités isolées6.
Il faut en moyenne parcourir 8,5 Km pour accéder à une formation
sanitaire contre 5 km préconisé par l'Initiative de Bamako.
Seulement 51 % des populations urbaines et 48 % des populations rurales ont
accès aux formations sanitaires. Ces contraintes expliquent en partie la
baisse du taux de fréquentation des services de santé en
général et de Santé Maternelle et infantile en
particulier. Ainsi, le taux de fréquentation des formations sanitaires
est passé de 31,95% en 1986 à 18 % en 1996. Le pourcentage des
enfants de moins d'un an inscrits en consultation infantile est
inférieur à 40 %, et, en 1999, seulement 60 % des enfants de 0
à 11 mois avaient reçu le vaccin BCG contre 71 % en 1990. Le taux
de fréquentation des services de santé par les femmes est
passé de 19 % en 1991 à 16 % en 19957.
3 Tous ces chiffres sont issus du rapport 2000 du
Conseil National pour la Population (CONAPO, 2000).
4 Tout ces chiffres sont issus du rapport 2001 de la
Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de la
Santé.
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
Figure 1.3 : Structure des soins de santé au Burkina Faso
en 2001
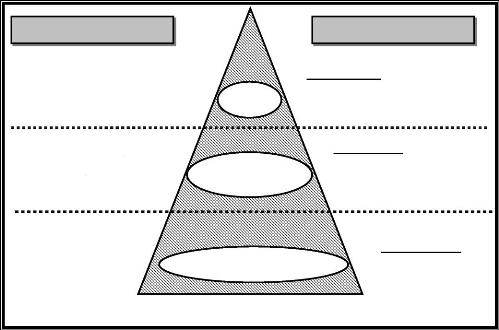
- 2 Centres Hospitaliers Nationaux (CHN)
- 3 Maternités de
référence
- etc.
- 784 Centres de santé et de promotion sociale
(CSPS)
- 144 Dispensaires isolés - 17 Maternités
isolées
- 9 Centres hospitaliers régionaux
-30 Centres médicaux avec antennes chirurgicales
(CMAC)
Structures de soins
Niveau périphérique
Niveau
intermédiaire
Niveau
tertiaire
Appui stratégique :
Ministère de la Santé Publique
Appui technique :
Directions Régionales de la Santé
Publique
Structures d'appui
Appui opérationnel :
Districts
sanitaires
+ La faible accessibilité des médicaments et des
consommables médicaux. Seulement 30% de la population peuvent s'offrir
les médicaments essentiels, et la production pharmaceutique nationale
moderne ne couvre que 2 % des besoins nationaux. Les besoins en santé de
la population restent donc insatisfaits. Cependant, bien qu'encore
insuffisants, les efforts fournis dans ce secteur comme dans d'autres ont
néanmoins abouti à une réduction sensible du taux de
mortalité générale et celui de la mortalité
infantile en particulier. Il en résulte un accroissement
considérable de la population totale et de la population la plus
vulnérable (femmes en âge de procréer et enfants de 0-5
ans). Etendre les services de santé à toute la population sera
encore plus difficile si le taux de croissance démographique reste aussi
élevé et si les ressources disponibles demeurent à leur
niveau actuel.
Les retombées économiques de
l'amélioration de la santé sont particulièrement
élevées pour les couches pauvres de la population, habituellement
plus sujettes que les autres à la maladie.
Mais depuis la dernière décennie, on assiste
à une amélioration des conditions générales de
santé dans le pays qui s'explique notamment par l'amélioration de
l'accès de la population aux services de santé. Les services de
santé publique interviennent auprès de la population de deux
façons : à travers les programmes de santé publique
(vaccination, salubrité de l'environnement) qui visent la population
dans son ensemble d'une part et d'autre part, à travers les services
cliniques qui répondent aux besoins de santé particuliers des
individus.
Le taux de couverture vaccinale du pays reste très
insuffisant puisque moins d'un enfant sur deux de moins d'un an serait
convenablement vacciné : 78,3 % contre la diphtérie, le
tétanos et la poliomyélite (DTP) et 71,1% contre la rougeole en
20038. Ces taux de couverture sont bien inférieurs au niveau
de couverture de 95% préconisé par l'OMS pour ces deux
vaccins.
Figure1.4. : Évolution de la couverture vaccinale des
enfants de 0 à 11 mois (en %) entre 1997 et 2003
|
|
100
|
|
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Couverlure vaccinale
Iv w 41, cm 0 -si co o C
)000000000c 0
|
|
|
|
|
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
|
|
BCG DTC polio3 Rougeole
|
|
|
Source de données: Direction des Etudes et de la
Planification / Ministère de la Santé
Néanmoins, on observe une augmentation
régulière de la couverture vaccinale concernant la vaccination
contre la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie, le
tétanos, la tuberculose et même la fièvre jaune sur la
période 1997-2003 (cf. figure 1.3.).
En ce qui concerne la santé maternelle et infantile,
l'examen de la proportion des accouchements assistés montre une
amélioration entre 1993 et 2003, même si cette proportion a connu
une certaine baisse en 1998 (41,5% en 1993 contre 40% en 1998) (Cf. tableau
1.2.).
8 INSD, Enquêtes démographiques et de
santé 2003
Tableau 1.2 : Évolution des accouchements assistés
entre 1993 et 2003 (en %)
|
Année
|
1993
|
1998
|
2003
|
|
Proportion des accouchements assistés
|
41,5
|
40
|
56,5
|
Source : INSD, EDS 1993, 1998 et 2003
Parmi les programmes de santé publique visant à
améliorer la salubrité de l'environnement, l'accès
à l'eau potable est essentiel. En effet, les affections
diarrhéiques et les infections parasitaires véhiculées par
l'eau insalubre sont à l'origine de près de 17 % des maladies
transmissibles. Or, on estime que seulement 60,5% de la population
burkinabé a accès à de l'eau potable (EDS, 2003).
1.4 Grandes orientations politiques pour la
population
La population constituant la première richesse d'une
nation, les questions de population et de développement
préoccupent tout pays. En effet, au plan international, les trois
conférences mondiales sur la population tenues à Bucarest (1974),
à Mexico (1984) et au Caire (1994), traduisent bien ces
préoccupations en reconnaissant explicitement l'importance des relations
entre Population et Développement. La Conférence des Nations
Unies sur l'Environnement et le Développement tenue en 1992 à Rio
témoigne d'une prise de conscience de la Communauté
Internationale sur les problèmes d'environnement en reconnaissant que la
résolution de ceux-ci est le garant d'un développement
durable.
Au plan africain, la tenue de trois conférences (Accra
en 1971, Arusha en 1984 et Dakar en 1992) a permis d'examiner la situation
démographique du continent. Le programme d'action de Kilimandjaro issu
de la deuxième conférence africaine reconnaît que les Etats
membres partagent un certain nombre de préoccupations communes en ce qui
concerne les problèmes démographiques et le développement,
et réaffirme «leur volonté collective d'assurer un
développement social économique, autosuffisant et
accéléré dans l'intérêt des populations
africaines ». Cette volonté a été
réaffirmée par les pays membres du Comité
Interétats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)
dans le programme d'action de N'Djamena, en décembre 1988 et de
Ouagadougou en octobre 1997.
Le Burkina Faso a souscrit à différentes
recommandations issues aussi bien des conférences africaines que des
conférences mondiales. Convaincu que la population est un
facteur essentiel de développement, et soucieuse de lui
assurer la satisfaction de ses besoins fondamentaux le gouvernement a mis en
place une politique de la population qui a pour but de contribuer à la
lutte contre la pauvreté par la recherche d'un équilibre entre
population et ressources. Il a élaboré à cet effet, en
2000, un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP).
Une des préoccupations majeures de ce cadre de référence
est la promotion des secteurs sociaux de base (éducation, santé y
compris la santé de la reproduction, eau potable, hygiène et
assainissement). Concernant particulièrement la santé de la
reproduction, le gouvernement a déterminé les composantes
prioritaires en la matière à savoir la maternité sans
risque, la santé des enfants, les changements sociaux pour
accroître le pouvoir de décision de la femme.
Synthèse partielle
En somme, le Burkina Faso est un pays pauvre en ressources
naturelles et physiques. Par ailleurs, les conditions économiques et
sanitaires qui prévalent dans ce pays laissent à désirer.
Ainsi, malgré les efforts déployés par le gouvernement,
à travers les multiples politiques, programmes et politiques sanitaires,
la situation sanitaire de la population, notamment celle des enfants et des
femmes reste précaire même si cette situation a connu une nette
amélioration.
Ce chapitre nous aidera à mieux comprendre les
résultats des analyses qui feront l'objet des chapitres suivants. Mais
avant les analyses, il conviendra d'abord de faire la revue de la
littérature sur les facteurs de la mortalité des enfants et sur
les théories explicatives de la baisse de la mortalité et
présenter le cadre conceptuel ainsi que les hypothèses de cette
étude. Ces deux points feront l'objet du chapitre suivant.
CHAPITRE II: CADRE THERIQUE
Toute recherche en sciences sociales exige
l'élaboration d'un cadre théorique. Ce dernier permet d'expliquer
la démarche scientifique à suivre dans la conception
(problématique, hypothèses de recherche,
opérationnalisation des concepts, cadre d'analyse).
Ce chapitre présente la synthèse de la
littérature sur les facteurs de la mortalité des enfants et sur
les théories explicatives de la baisse de la mortalité. Le cadre
conceptuel et les hypothèses de recherche sont également
exposés dans ce chapitre.
2.1. Revue de la littérature
Les travaux de recherche sur la mortalité des enfants
sont relativement abondants en Afrique. En faire une synthèse est utile
car elle guidera dans la définition des hypothèses, dans le choix
des variables pertinentes pour l'étude et dans la description des
mécanismes selon lesquels ces variables influencent la mortalité
des enfants en Afrique en général. Dans les paragraphes qui
suivent nous exposerons les facteurs de la mortalité des enfants qui ont
déjà fait l'objet d'étude par certains auteurs et les
différentes théories qui ont été
élaborées pour expliquer la baisse de la mortalité.
2.1.1 Facteurs de la mortalité des
enfants
La mortalité est un phénomène complexe
qui dépend d'une variété de facteurs, et les cadres
conceptuels élaborés pour tenter de les ordonner montrent la
diversité des chemins possibles. Les modèles explicatifs de la
mortalité des enfants distinguent, d'une part, les variables dites
intermédiaires (les caractéristiques de l'enfant, les
comportements procréateurs et les comportements en matière de
soins et de nutrition) qui agissent directement sur les chances de survie de
l'enfant et, de l'autre, les variables exogènes (économiques,
socioéconomiques, culturels et environnementaux) dont l'influence est
médiatisée par les variables intermédiaires (Mosley et
Chen, 1984).
Nous distinguons ici, les variables liées à la
mère des variables liées à l'enfant et des variables
contextuelles. Nous présentons ci-dessous les relations
générales entre ces variables et la mortalité des enfants
rencontrées dans la littérature.
a) Variables liées à la
mère
a1) Comportements de la mère en matière de
soins
Selon l'OMS, la manière dont la famille contribue
à l'amélioration de la santé des enfants constitue ce
qu'on appelle « les principales pratiques familiales ». Les
comportements des mères en matière de soins de santé
regroupent les pratiques en matière de la qualité des soins et de
la qualité de la nutrition qui peuvent favoriser la croissance physique
et le développement mental et prévenir la maladie. Par exemple
lorsqu'un enfant est malade, sa mère doit se rendre compte qu'il y a un
problème, dispenser les premiers soins, présenter l'enfant
à un personnel de santé, élaborer avec celui-ci une ligne
de conduite appropriée. Ces pratiques de la mère sont souvent
ignorées, ce qui entraîne des décès chez les
enfants.
a11) Qualité des soins
Les soins apportés à l'enfant commencent depuis
la conception (les soins prénatals) jusqu'à après la
naissance (les soins postnatals). La grossesse et l'accouchement constituent
des périodes à risque pour la femme et l'enfant à
naître. Ces risques peuvent être maîtrisés par des
mesures de surveillance prénatale, une assistance qualifiée au
moment de l'accouchement et de suites de couches. Les soins prénatals,
l'assistance à l'accouchement et les soins postnatals réduisent
significativement le risque de décès des enfants (les
décès néonatals en particulier) du fait que s'ils sont
détectés à temps, les soins accordés pendant ces
phases permettent d'éliminer ou de diminuer leur impact sur
l'état de santé de la mère et de l'enfant.
· Visites prénatales
Durant les premières années de vie, la
santé de l'enfant dépend des conditions de grossesse; le
régime de la mère pendant sa grossesse est important pour la
santé de l'enfant. Les affections telles que le paludisme,
l'anémie (causes déterminantes du faible poids de l'enfant
à la naissance) sont facilement dépistées et
traitées lors des visites prénatales. Lors de ces visites, on
peut assurer l'immunisation de la mère contre le tétanos et
fournir des suppléments nutritionnels à la femme
présentant des signes de malnutrition (Dackam, 1987).
Selon Grenier et Gold (1986, cité par Harouna, 1998),
à travers le cordon ombilical, la mère transmet au foetus
certaines substances immunitaires au moment de la grossesse. La
sécrétion de la plupart de ces substances est assurée par
la qualité de son alimentation et
l'administration de certains produits médicaux pendant
la grossesse. Au fur et à mesure que la grossesse avance, l'organisme de
la mère s'affaiblit et la sécrétion des substances
immunitaires baisse en quantité et en qualité. Le suivi
médical de la grossesse permet de pallier ces insuffisances et de
maintenir la sécrétion à un niveau constant et
nécessaire pour la protection future du nouveau né.
· Vaccination antitétanique
La vaccination antitétanique vise à immuniser
les mères contre le tétanos et surtout à prévenir
le tétanos qui menace les enfants nés à domicile sans
précaution d'asepsie en particulier. Le nombre de doses de vaccins
antitétaniques et le respect du calendrier de la vaccination ont une
influence sur la protection du foetus et du nouveau-né. Ils permettent
de réduire la part des facteurs endogènes dans la
mortalité des enfants. Pour une protection complète, une femme
enceinte devrait recevoir deux doses de vaccin. Dans une étude
menée en Inde, Venkatacharya et Tesfay (1986) ont constaté que
les décès néonatals attribuables au tétanos par
exemple représentent 60% de tous les décès de cet
âge. Une autre étude menée au Sénégal par
Leroy et Garenne (1989) a montré que le tétanos était
responsable de 31% des décès néonatals entre 1983 et
1986.
· Lieu et assistance à
l'accouchement
Plusieurs études, notamment celles menée par
Venkatacharya et Tesfay en 1986 en Inde et par Desgrées Du Loû en
1996 au Sénégal montrent que la mortalité néonatale
diminue lorsque la mère sont assistées par des sages femmes ou
des agents médicaux compétents au moment de l'accouchement. Ces
mêmes constats ont été faits au Sénégal par
Garenne et Leroy (1989). Parmi les avantages d'un accouchement en milieu
médical, on peut relever les conseils pratiques donnés à
la femme pendant le travail pour assurer un meilleur accouchement, la
réduction au minimum du risque de contamination de l'enfant, par le
tétanos par exemple, au cours du travail à travers
l'administration des soins adéquats et de l'accouchement. Selon Grenier
et Gold (1986), l'enfant court un risque très élevé
d'infection par les maladies telles que le tétanos au moment du passage
dans la filière génitale maternelle. Des soins particuliers sont
administrés contre ces types d'infections pour les accouchements qui ont
eu lieu dans les centres de santé. Le personnel de santé
administre les premiers soins médicaux postnatals à l'enfant qui
sont très déterminants pour l'état de santé de
l'enfant.
· Vaccination de l'enfant
Après leur naissance, les enfants doivent
bénéficier de soins qui permettront de préserver leur
santé contre un certain nombre de maladies. Cette préservation se
fait sous forme de vaccination. En effet, l'OMS recommande un programme
élargi d'immunisation des enfants avant leur premier anniversaire contre
les différentes maladies de l'enfance. Ce programme recommande
essentiellement la vaccination contre la rougeole, la poliomyélite, la
diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la tuberculose dans des
pays comme le Burkina Faso.
On observe une relation négative entre la vaccination
et la mortalité des enfants. Aux enfants ayant reçu des
vaccinations correspond un faible risque de décès. Une
étude réalisée au Sénégal sur l'impact de la
vaccination a montré que la vaccination contre la rougeole est
très indiquée pour la survie de l'enfant; elle souligne que la
réduction de la mortalité entre six mois et trois ans du fait de
la vaccination contre la rougeole serait de 30,9% (Garenne; Cantrelle, 1985
cité par Dackam, 1987). Dans une autre étude de Desgrées
Du Loû dans la zone rurale de Bandafassi au Sénégal, il a
été relevé le rôle déterminant qu'a pu jouer
le Programme Elargi de Vaccination dans les régions du
Sénégal éloignées de la capitale et pauvres en
équipements sanitaires. Dans cette dernière étude, non
seulement la mortalité des enfants a baissé brutalement dans la
zone étudiée après l'introduction des vaccinations mais en
plus la poursuite de la baisse a été étroitement
liée au niveau de couverture vaccinale.
a12) Qualité de la nutrition
La nutrition est un élément très
important pour préserver les maladie et les décès chez les
enfants dans les pays en développement. En matière de nutrition,
l'information la plus disponible concerne la malnutrition des jeunes enfants.
Celle-ci contribue pour plus d'un tiers à la mortalité infantile
et juvénile dans de nombreux pays africains (Banque Mondiale 1994) et
pour 20 à 80% à la mortalité maternelle.
· Allaitement de l'enfant
Parmi les mesures concernant la préservation de la
santé du nouveau-né, l'allaitement maternel est probablement le
plus universellement encouragé. Il est aussi celui dont
l'évolution pourrait remettre en cause la santé des mères
et des enfants. L'effet positif de l'allaitement sur la survie des enfants
n'est plus à démontrer et constitue l'argument sur lequel on se
base pour organiser la lutte contre la tendance à le remplacer par une
alimentation
artificielle. En effet, le lait maternel
secrété par la mère pendant les premiers jours qui suivent
la naissance de l'enfant protège le nourrisson contre les infections les
plus courantes surtout celles des appareils respiratoires et digestifs (Akoto,
1993). Un bébé alimenté avec le lait maternel est moins
souvent malade et de moins en moins malnutri qu'un bébé nourri au
biberon avec d'autres aliments. Dans une collectivité pauvre, un enfant
de moins de six mois nourri au biberon court 3 fois plus de risque de mourir
qu'un enfant nourri au sein. Le mode d'allaitement et la durée
d'allaitement contribuent à la mortalité des enfants à
travers la prédisposition de l'enfant aux risques d'infection et de
malnutrition (Dackam, 1987). Le sevrage partiel ayant lieu avant quatre mois ou
après six mois peut augmenter le risque de décès des
enfants. Après six mois, le lait maternel seul ne suffit plus pour
assurer une nutrition adéquate (Akoto, 1990).
· Aliments de complément
L'OMS recommande que tous les enfants de 4-6 mois
reçoivent des aliments de complément en plus du lait maternel
car, à ce âge, le lait maternel n'est plus suffisant à lui
seul pour couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant pour lui assurer une
croissance optimale. Pour la mère n'ayant pas la possibilité
d'allaiter exclusivement ses enfants au sein, l'allaitement mixte permet de
prolonger la plupart des bénéfices de l'allaitement maternel.
D'un autre côté, c'est au moment du sevrage que l'enfant risque de
ne plus se trouver dans des conditions nutritionnelles et sanitaires optimales.
Lorsque l'alimentation de complément est pauvre, l'enfant est
exposé à des risques élevés d'infection. La sous
nutrition et la malnutrition affectent le système immunitaire et
engendre le marasme et le kwashiorkor (Harouna, 1998). Ces derniers s'associent
à un déficit immunitaire pour rendre l'enfant
particulièrement sensible à certaines maladies infectieuses et
parasitaires comme la rougeole.
a2) Caractéristiques d'identification
sociale
Les caractéristiques d'identification sociale de la
mère sont l'ensemble des caractéristiques et des conditions qui
déterminent et modulent à des degrés divers les valeurs,
les normes et les comportements propres à celle-ci. Ce sont des
variables qui affectent la mortalité à travers les variables
intermédiaires.
· Age de la mère à
l'accouchement
La procréation précoce ou tardive influe
négativement sur la survie de l'enfant. En effet, les études sur
les facteurs de la mortalité infantile et juvénile montre une
corrélation entre l'âge de la mère à l'accouchement
et le niveau de la mortalité des enfants. Le risque de
décès des enfants nés des femmes âgées de
moins de 20 ans ou de plus de 35 ans est relativement plus élevé
que celui des enfants nés des mères des autres groupes
d'âges (Akoto et Hill, 1988). A Bamako (Mali) et Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso), ce risque est de 45% plus élevé chez les enfants
nés des mères âgées de moins de 18 ans, de 15% plus
élevé chez ceux des mères âgées de 18-20 ans
par rapport à celui des enfants nés des mères
âgées de 20 à 34 ans (Legrand et Mbacké, 1992,
cité par Rakotodrabé, 1996).
Le risque de décès infantile et juvénile
est lié à l'âge de la mère à l'accouchement
pour des raisons physiologiques et comportementales. En général,
les femmes qui accouchent très jeunes au moment où leur propre
développement n'est pas encore achevé, ont plus de chance de
mettre au monde un enfant de faible poids, ce qui augmente son risque de
décès (Akoto et Hill, 1988). Ces femmes ne sont pas
expérimentées et peuvent avoir des comportements
inappropriés en matière de soins et de nutrition (en cas de non
assistance) pour les enfants ce qui augmenterait le risque de
décès (Legrand et Mbacké, 1992, cité par
Rakotodrabé, 1996). En ce qui concerne les femmes ayant un âge
élevé (35 ans et plus), elles courent des risques divers (fausses
couches, malformation congénitale) liés au vieillissement
(syndrome d'épuisement maternel) et peuvent connaître des
difficultés d'allaitement pour le dernier-né, ce qui diminue sa
"protection maternelle" (Akoto, 1985). En outre, ces femmes sont plus sensibles
aux maladies telles que le diabète ou l'hypertension, maladies qui
affectent la santé de l'enfant (Echarri, 1994).
· Instruction de la mère
L'éducation de la mère est de première
importance. Elle a des conséquences sociales profondes. Elle fournit
à la femme un large réseau social, de nouveaux groupes de
référence, des modèles d'autorité et une plus
grande identification au monde moderne (Tabutin, 1992). Ainsi l'instruction de
la mère est sans doute une des variables auxquelles les auteurs se sont
le plus intéressé dans l'analyse des déterminants de la
mortalité des enfants. Plusieurs études empiriques ont mis en
évidence le rôle de l'instruction de la mère sur les
chances de survie de leurs enfants dans toutes les grandes régions du
monde (Banza, 1998). Elle influence la mortalité infantile à
travers la conscientisation à l'importance de l'hygiène
individuelle et
collective et des soins médicaux qui, à son
tour, influence la fréquence des consultations prénatales (Akoto,
1985). L'instruction de la mère peut en même temps refléter
le niveau économique du ménage et agir a travers celui-ci, tout
comme elle peut représenter une rupture avec la tradition (croyances sur
la pratique contraceptive, tabous et régimes alimentaires, recours aux
sages femmes traditionnelles...) qui agit négativement sur la survie de
l'enfant (Akoto, 1985).
· Activité économique de la
mère
La relation entre l'activité économique de la
femme et la mortalité des enfants dépend de la nature et des
conditions de travail. Par exemple, quand la femme travaille hors de la maison,
l'enfant est le plus souvent confié à d'autres membres de la
famille ou à des frères et soeurs. Certains auteurs ont
pensé que l'activité économique de la mère
réduit le temps nécessaire aux soins de l'enfant. Mais une
activité rémunérée de la mère peut
constituer une source de revenu supplémentaire pour le ménage ou
pour la femme, nécessaire à l'achat des biens et services
relatifs aux soins de santé. En effet, l'occupation de la femme peut
influencer la mortalité des enfants à travers l'alimentation des
jeunes enfants (allaitement, sevrage) ou l'attention et les soins qui leurs
sont accordés (Akoto et Tabutin, 1987, Noumbissi, 1993). Dans une
étude des Nations Unies (1985), faite sur six pays africains, dans
quatre pays sur six, l'activité de la mère semblait plus nuisible
à l'enfant que sa non-activité. Mais cela dépendait du
type d'activité, puisque les travailleuses familiales
présentaient presque partout une nette surmortalité, alors que
les mères se déclarant "employées" avaient un gros
avantage par rapport aux non-actives ou à celles exerçant
d'autres activités (Nations Unies, 1985 cité par Akoto et
Tabutin, 1987).
b) Variables liées à l'enfant
· Sexe de l'enfant
Le Burkina est un pays où la procréation est
valorisée et ce, quel que soit le sexe du nouveau-né. Au moment
où dans les pays développés la surmortalité
féminine a disparu à tous les âges, toute
surmortalité féminine observée est en soi un signe de
différence ou de discrimination entre les deux sexes. En effet, la
recherche des différences de mortalité selon le sexe a
montré que le désavantage féminin à partir de
l'âge d'un an, des jeunes filles pendant la période de
puberté, et des femmes aux âges de reproduction qui a
caractérisé l'ensemble des pays de l'Europe dans le passé,
n'a complètement disparu que vers les années 1920. Ce
même désavantage féminin est encore
présent dans de nombreux pays en voie de développement en
particulier chez les petites filles (1-4 ans) ou aux âges de
reproduction.
Toutefois, dans la plupart des pays on observe une
surmortalité infantile des personnes de sexe masculin (Dackam, 1987).
Dans les pays en développement la mortalité infantile masculine
est près de 16% plus élevée que celle des petites filles
(Rustein, 1984 cité par Dackam, 19987). Akoto (1985) a noté que
les garçons sont plus vulnérables à la naissance alors
qu'une fois les premiers mois franchis, la résistance des enfants aux
agressions extérieurs dépend en grande partie du comportement
social à l'égard des garçons et filles.
Au Burkina Faso la surmortalité des petites filles et
des jeunes filles peut s'expliquer à la fois par la
préférence accordée aux garçons dans la culture
burkinabé (la culture mooga par exemple) et par un mode de socialisation
sexuellement différencié entre garçons et filles les
préparant à assumer les statuts qui leur sont destinés.
Certes, ce mode est encore plus accentué dans le milieu rural que dans
le milieu urbain mais il subsiste encore (CONAPO, 2000).
· Rang de naissance
Beaucoup d'études montrent qu'il existe une relation
étroite entre le risque de décès avant le premier
anniversaire et/ou le cinquième anniversaire de l'enfant et le rang de
naissance de celui-ci. Le rang de naissance de l'enfant influe sur la
mortalité des enfants de façon similaire à l'âge de
la mère à l'accouchement. Les enfants de rang 1 courent un risque
de mortalité plus élevé. Ce risque diminue pour les
enfants de rang 2 et 3, et commence à s'accroître pour les enfants
de rang 4 et plus.
Les différents auteurs ne donnent pas clairement les
raisons qui sont à la base de cette relation, mais ils admettent en
général qu'elle résulte d'une combinaison de facteurs
d'ordre physiologique et comportemental.
Notons qu'il existe une forte interaction entre l'âge de
la mère à l'accouchement et le rang de naissance: en Afrique, la
précocité du premier mariage, et partant, de la première
naissance rend les enfants de rang 1 plus exposés à
l'insuffisance pondérale ou au prématuré (Venkatacharya et
Teklu, 1986 cité par Mudubu, 1996). Ces enfants soufrent aussi bien de
l'immaturité biologique de la mère au moment de l'accouchement
que de la non-maîtrise par les mères des techniques en
matière de soins et de nutrition à apporter aux
nouveau-nés.
Quant aux enfants de rang élevé, ils subissent
les conséquences d'un état de santé médiocre de la
mère (épuisement maternel provoqué par les grossesses
successives) (Akoto, 1985). De même le rang de naissance
élevé correspond généralement à une famille
nombreuse, donc à un grand nombre d'enfant qui peuvent contribuer
à l'appauvrissement de cette famille. D'où les nouveaux
nés dans ces types de famille (famille nombreuse) sont exposés
à un risque de mortalité plus élevé que ceux
nés d'une famille réduite, toute chose étant égale
par ailleurs. En outre, pour une mère ayant eu une naissance de rang
élevé, il y a non seulement concurrence entre ce dernier et les
premiers concernant les soins, mais aussi, la mère à tendance
à se fier à son expérience en matière de soins, en
ce qui concerne le dernierné. Ce qui peut augmenter le risque de
mortalité des enfants (Rakotodrabé, 1996).
c) Variables liées au contexte
·
Milieu de résidence
Les plus notables divergences en matière de
mortalité se trouvent entre le milieu urbain et le milieu rural.
L'urbanisation et les conditions de vie qu'elle induit, constituent l'un des
facteurs essentiels de divergence en matière de mortalité. En
effet, dans toute analyse descriptive, on observe en général dans
le tiers monde actuel des niveaux de mortalité plus faible en milieu
urbain qu'en milieu rural, plus faible dans les grandes villes que dans les
villes moyennes (Hobcraft et al, 1984 cité par Akoto et Tabutin,
1987).
De même Evina (1990) affirme que « dans la
plupart des analyses univariées des phénomènes
démographiques tels que la fécondité et la
mortalité, on observe en général des niveaux plus faibles
en milieu urbain qu'en milieu rural ». Ces résultats ne sont
guère surprenants, dans la mesure où dans la plupart des pays en
voie de développement, le milieu urbain et le milieu rural sont
totalement différents, voir même opposés en ce qui concerne
les modes de vie, les types d'activités et les infrastructures sociales
de base (santé et éducation).
Dans une étude sur le Burkina Faso, Lachaud (2001)
souligne qu'il existe de fortes variations des taux de mortalité
infantile selon le milieu de résidence. En moyenne, le taux de
mortalité infantile est deux fois plus élevé en milieu
rural qu'à Ouagadougou la capitale. On peut faire les mêmes
observations pour le taux de mortalité infanto-juvénile bien que
les écarts entre la capitale et le milieu rural soient moins
marqués.
En définitive, et les analyses explicatives le
confirment bien, la variable "milieu de résidence" demeure une
variable-clé dans l'étude de la mortalité des enfants
(Akoto et Tabutin, 19987). Au Sénégal la situation peut
être extrême, c'est la variable la plus discriminante parmi toutes
les variables socio-économiques envisagées (Cantrelle et al, 1986
cité par Akoto et Tabutin, 1987).
· Région de résidence
La variation de la mortalité selon la région de
résidence résulte des effets combinés des
différences dans les conditions climatiques, démographiques,
géographiques, socioéconomiques et sociales (rythme de
vaccination, manque d'infrastructures et absence de personnel, manque de
médicaments et des ressources alimentaires).
Akoto et Tabutin (1987) souligne que les quelques analyses
explicatives menées au niveau national en Afrique sub-saharienne (sur le
Sénégal et le Kenya par exemple) dégagent toutes
l'importance de la variable "région de résidence" parmi les
variables "explicatives" de la mortalité des enfants. En termes de
politiques d'action et de planification sanitaire, c'est évidemment un
résultat important. Les changements de répartition
géographique de la population doivent ainsi être pris en compte
dans l'effet de la dynamique de la population sur les besoins de santé.
Si certaines régions croissent plus rapidement que d'autres en raison
d'une croissance naturelle plus rapide ou de l'immigration, ce
phénomène affectera clairement la répartition
géographique des besoins de services sanitaires et doit être pris
en compte dans la politique de la santé.
2.1.2. Théories de la baisse de la
mortalité
Dans la littérature, plusieurs théories ont
été proposées pour aider à comprendre les raisons
qui sont à la base de la baisse de la mortalité. Plusieurs
auteurs ont eu à développer des théories explicatives de
cette baisse.
D'après la synthèse développée par
Vallin (1989), la théorie initiale et dominante jusqu'à la fin
des années soixante met en avant le rôle majeur des technologies
sanitaires, en déniant toute importance dans la diminution de la
mortalité à la croissance économique et à la
progression des revenus individuels. Une deuxième théorie s'est
située dans une perspective rigoureusement inverse en affirmant que
seule l'élévation du niveau de vie pouvait déterminer une
diminution de la mortalité ; le modèle le plus achevé de
cette théorie se trouvant
développé par certains auteurs instituant les
progrès dans l'alimentation comme source essentielle de l'augmentation
de l'espérance de vie. Une autre théorie qui soutient fortement
l'impact des changements d'ordre socio-culturel a été
également développée. Le radicalisme de ces thèses
est apparu dépassé dès les années 1980, et
l'articulation de plusieurs facteurs est devenue l'idée dominante et
inspiratrice de nombreux travaux où se trouvent
privilégiées certaines variables clés (revenu,
alimentation, instruction, développement de la santé publique,
transfert technologique, urbanisation).
a) Technologie sanitaire ou révolution de la
médecine
Depuis la mise au point des médicaments
antibactériens et des nouveaux vaccins, la médecine s'est
dotée de moyens qui ont permis de lutter efficacement contre la plupart
des maladies transmissibles. Ainsi la victoire sur la variole est aujourd'hui
totale, et grâce, dans une large mesure, au programme Elargi de
Vaccination (PEV) lancé conjointement par l'OMS et l'UNICEF environ 50%
des enfants du monde entier sont désormais vaccinés contre les
principales maladies infectieuses. Grâce aux insecticides, le paludisme a
pu être marginalisé dans un certain nombre de pays. Des
progrès ont été aussi réalisés grâce
à des mesures curatives telles que la réhydratation par voie
orale, qui permet de sauver les malades atteints d'affections
diarrhéiques.
Dans les pays en développement, l'importation des
médicaments et des antibiotiques en particulier, les campagnes
d'éradication de quelques endémies (paludisme, variole,
rougeole), les programmes nationaux verticaux (Programmes Elargies de
Vaccination (PEV)) d'interventions et de contrôle des grandes maladies
vont être considérés comme facteurs essentiels de la baisse
de la mortalité. Jusqu'aux années 60, la thèse dominante
attribuait l'essentiel de la baisse de la mortalité dans les pays en
développement à la révolution de la médecine. A ce
sujet Tabutin (1995, p.272) note:
« Des organismes internationaux et bien de
scientifiques accorderont une grande confiance à ces programmes de
santé publique, en démontrant notamment qu'il n'est guère
de relation entre les déclins de mortalité et les rythmes de
croissance économique ou d'augmentation du niveau de vie; en
résumé, la mortalité baisse- et baissera- quelle que soit
la situation économique et sociale ».
Même dans les pays développés, la mise au
point des techniques de prévention ou de traitement
particulièrement efficaces et relativement peu couteux a conduit
à imaginer que la baisse de la mortalité a été
réalisée indépendamment du développement
économique et social.
Des recherches récentes relativisent le rôle de
la technologie sanitaire dans le tiers monde. Par exemple Preston (cité
par Younoussi, 1997) l'estime à 50% pour l'ensemble du tiers monde.
Par ailleurs, Mosley (1985, p.122, cité par Younoussi,
1997) écrivait : « La stagnation récente de la
diminution de la mortalité à des niveaux assez bas de
l'espérance de vie incite à revoir la thèse de la
prédominance de la technique médicale dans la diminution de la
mortalité. »
Dans presque tous les pays, on note une surmortalité
rurale par rapport au milieu urbain. Il est donc certain que des pays ont su
mieux tirer parti des moyens offerts par la médecine moderne. Ceci
montre clairement que l'incidence des progrès de la médecine sur
la santé dépend aussi d'autres facteurs tels que le
progrès de la scolarisation et le développement
économique.
b) Développement économique
Les défenseurs de la théorie du "
développement économique" rangent de ce côté tout ce
qui a trait aux facteurs économiques, notamment le revenu qui permet aux
individus et aux ménages d'acquérir les biens et services
favorisant la santé (nourriture, soins de santé, logements,
etc.). Certains auteurs, considérant la relation mortalité-niveau
de vie très importante, sont arrivés à considérer
les indices de mortalité infantile et juvénile ou
infantojuvénile comme indicateurs de niveau de développement
économique et social.
Sur un échantillon de 58 pays en développement,
une hausse du revenu par habitant de 10% réduit les taux de
mortalité infantile et juvénile dans une proportion allant de 2
à 3,5% et allonge l'espérance de vie d'un an (Banque Mondiale,
1995). Mais depuis le début des années 1970, on assiste à
un ralentissement du déclin de la mortalité dans les pays du
tiers monde notamment en Afrique Subsaharienne qui n'ont que entre 56 et 43 ans
de vie moyenne (Tabutin, 1995).
Dans la grande partie des pays en développement, le
niveau de vie des populations stagne parfois et baisse le plus souvent depuis
une quinzaine d'années. La pauvreté rurale et
de nos jour urbaine, s'étend considérablement.
Le budget de consommation des ménages est en baisse et l'alimentation
d'une bonne partie de la population se dégrade. En définitive,
loin de disparaitre la malnutrition (considérée comme cause et
conséquence morbidités infectieuses et parasitaires chez les
enfants) est toujours là. Tant pour le passé occidentale que pour
le tiers monde aujourd'hui ce facteur est d'une importance considérable
pour la santé.
c) Amélioration de l'état
nutritionnel
Les tenants de cette approche pensent que l'accroissement du
niveau de vie qui permet une amélioration de l'alimentation des
individus et donc de la diminution de leur risque aux infections, conduit
à la baisse de la mortalité. C'est donc une théorie
basée essentiellement sur l'économie qui n'accorde pas
d'importance aux facteurs médicaux. Dans les pays du tiers monde et
particulièrement en Afrique au Sud du Sahara, on a souvent
considéré que la forte mortalité qui sévit
était essentiellement due à la malnutrition des enfants qui
affaiblit leur système immunitaire (Desgrées Du Loû, 1996).
La malnutrition favorise les infections qui elles-mêmes aggravent la
malnutrition et c'est la synergie des deux causes qui conduirait à la
mort. Cette théorie a eu le mérite de "réveiller" tant les
chercheurs travaillant sur les déterminants de la mortalité que
les décideurs politique qui croyaient fermement à la suffisance
de l'action médicale (vaccination).
d) Culture et comportement en matière de
santé
Les préjugés sociaux, en particulier la
disparition des éléments de comportement traditionnel
préjudiciable à la santé (discrimination selon le sexe
dans le traitement des enfants, résistance traditionnelle à
utiliser les moyens de la médecine moderne...) jouent un rôle
déterminant dans la baisse de la mortalité. C'est ce qui justifie
le fait que plusieurs chercheurs ont tenté de dissocier les facteurs
culturels et sociologiques des facteurs essentiellement économiques.
L'étude de la mortalité infantile et
juvénile selon l'accès différentiel aux services de
santé et au revenu requiert la prise en compte de chaque
catégorie sociale. Pour chacune d'elles l'accès peut être
considérer sous trois aspects : institutionnel (ou juridique),
matériel et culturel.
Il peut exister des services de santé dans une
région sans que les différentes couches de la population les
utilisent de la même façon et avec la même intensité.
VIMARD (1980)
montre qu'au Togo, une ethnie située à plus
d'une heure de marche d'un dispensaire a plus recours à ce dernier pour
les soins préventifs et curatifs qu'une autre située à
proximité. Ceci montre que la distance physique ou matérielle qui
sépare la population des services de santé est beaucoup moins
importante que la distance culturelle. Pour certains des tenants de cette
approche, l'éducation en matière de santé, les changements
en matière d'hygiène personnelle et collective ont
été nettement plus importants que le revenu ou l'alimentation.
Actuellement, la démarche de la plupart des auteurs
s'inscrit dans le cadre d'une reconnaissance de la multiplicité et de la
complexité des facteurs qui entrent en jeu dans la détermination
du niveau de la mortalité.
2.2. Cadre conceptuel
Les études sur la mortalité des enfants montrent
que l'Afrique au Sud du Sahara forme un ensemble à la fois
homogène et varié. La région présente une
homogénéité relative, caractérisée par une
forte mortalité infantile et juvénile. Un autre point commun
à tous ces pays est leur appartenance au groupe des pays
sous-développés. Du fait cependant de sa diversité
géographique et de son morcellement politique, l'Afrique subsaharienne
est très diversifiée, notamment sur le plan humain et culturel,
entraînant ainsi des variations importantes des déterminants
(écologiques, économiques, sociaux et culturels) de la
mortalité des enfants. Malgré l'existence de nombreuses
études sur les facteurs de la mortalité des enfants dans cette
partie du monde, il y a des lacunes à combler dans la connaissance de
ces facteurs. Les contextes politique, socio-économique et culturel
n'étant pas les mêmes dans tous les pays, l'influence de chaque
facteur sur la mortalité des enfants peut varier d'un pays à
l'autre. Le phénomène ne se manifeste pas avec la même
ampleur d'un pays à un autre et, au sein d'un même pays, les
disparités sont constatées entre les différentes couches
sociales (Dackam, 1987). Une analyse spécifique sur chaque pays
s'avère ainsi indispensable.
Au Burkina Faso, l'exploitation des données issues de
l'enquête démographique et de santé réalisée
en 2003 (EDSBF-III) a montré un taux de mortalité infantile et
juvénile relativement élevé (EDSBF-III relève un
taux de mortalité infantile de 81%o et un taux de mortalité
infanto-juvénile de 195%o). Les données disponibles montrent que
la mortalité infantile connaît une tendance à la baisse
depuis les années 1960 (le taux de mortalité infantile (TMI) est
passé de 182%o en 1960-61 à 107%o en 1996 et à 81%o en
2003). En dépit de cette baisse le niveau reste encore très
élevé.
La mortalité dépend d'une variété
de facteurs aussi bien économiques, politiques, et sanitaires que
sociaux, culturels et biologiques. Nombre de cadres analytiques essayent de
classer et de relier les types de variables selon leur nature (sociale,
économique, environnementale, biologique, etc.) ou selon le niveau
d'analyse (macro, méso et micro). Beaucoup ont un point commun. Ils
partent du niveau le plus macro-sociétal (politique, économie,
développement, etc.) avant de passer par une série de variables
intermédiaires et d'arriver à la morbidité et la
mortalité. Mais les chemins (variables intermédiaires) varient en
fonction de la mortalité privilégiée (infantile,
juvénile, tous âges), des contextes étudiés, et
aussi des mécanismes ou des variables privilégiées par le
chercheur, enfin en fonction du niveau d'analyse retenue (on va d'approches
globales à des analyses de risques purement individuels) (Tabutin,
1976).
Pendant longtemps, dans la recherche des facteurs explicatifs
du déclin de la mortalité (au niveau macro), on s'est
limité à la dichotomie « développement
économique et politique de santé » ; récemment, on
s'est intéressé à des éléments plus
culturels. Actuellement, on est à la recherche, d'une vision
multisectorielle évitant tout cloisonnement entre la démographie,
l'épidémiologie, la médecine ou la sociologie
médicale et ce en encourageant la réflexion interdisciplinaire et
intersectorielle sur la causalité du phénomène.
En effet, différents courants explicatifs ont
été développés pour l'explication du déclin
de la mortalité. On distingue quatre grands courants: le courant
médico-technologique, le courant économique, le courant
nutritionnel, et enfin le courant socioculturel. Ces courants montrent
l'évolution de la connaissance des déterminants de la baisse de
la mortalité et les expériences vécues. Ces divers
courants vont et viennent dans le temps et dans l'espace. Certains dominants
à une époque ne le sont plus à une autre, d'autres
émergent pour quelque temps, puis disparaissent avant, peut-être,
de renaître. Tabutin ne disait-il pas en 1992 que:
«Une chose est certaine: la relation simple et le
facteur unicausal ne sont plus de mise; l'interdépendance entre
l'économique, le social, le sanitaire et le culturel s'impose dans les
faits et dans la réflexion, l'approche systémique devient une
nécessité».
Le cadre conceptuel adopté pour cette étude
s'inspire de celui de Barbieri (1991). Il se présente
schématiquement comme à la figure 2.1.
Le contexte socio-sanitaire influence les
caractéristiques d'identification sociale de la mère. Il
détermine non seulement la disponibilité des soins
médicaux adéquats, mais agit également sur les
comportements des mères en matière d'utilisation des services de
santé.
En ce qui concerne les caractéristiques
d'identification sociale et les comportements de mères, ils
déterminent les représentations sociales de la santé ainsi
que les moyens nécessaires des services médicaux. Ils agissent
ainsi sur le suivi médical de la grossesse, de l'accouchement et de
l'enfant et impriment à la mère son comportement nutritionnel.
2.2.1 Hypothèses a) Hypothèse
générale
Nous postulons que la baisse de la mortalité infantile
au Burkina Faso découle de l'amélioration des pratiques des soins
préventifs et des pratiques nutritionnelles que les femmes adoptent
pendant la première année de vie de l'enfant.
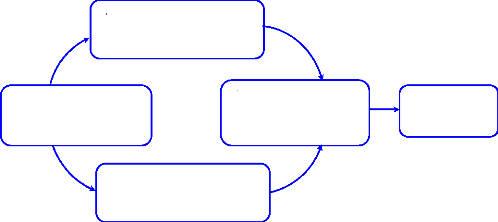
Mortalité
infantile
Comportements des mères en
matière de soins de
santé
Contexte socio-sanitaire
Pratiques préventives et
curatives en matière
de
soins santé
Caractéristiques individuelles
d'identification
sociale de la
mère
Figure 2.1 : Schéma conceptuel de l'étude
b) Hypothèses spécifiques
Les hypothèses simples suivantes découlant de
l'hypothèse sont testées:
H1: La baisse de la mortalité infantile découle
d'une amélioration des soins prénataux et d'accouchement. On
s'attend à ce que les enfants nés de mères ayant
effectué un suivi médical régulier au cours de la
grossesse, ayant été assisté à l'accouchement
courent moins de risque de mourir avant leur premier anniversaire que les
autres.
H2: Plus la mère adopte un comportement nutritionnel
adéquat, plus élevée est la
probabilité de survie entre la naissance et le premier
anniversaire de son enfant. On s'attend à ce que :
- les mères allaitant leurs enfants exclusivement au sein
durant les six premiers mois de vie connaissent un risque de mortalité
de leurs progénitures moins élevé que les autres.
- les enfants ayant un poids moyen à la naissance courent
moins de risque de décéder avant le premier anniversaire que les
autres.
H3: Plus les enfants bénéficient des doses
normales de vaccination, moins ils courent le risque de mourir avant leur
premier anniversaire.
2.2.2 Définition des concepts
Par souci de clarté, nous allons définir les
quelques concepts utilisés dans cette étude avant de
présenter les variables retenues.
a) Mortalité infantile
La mortalité infantile, encore appelée
mortalité de la première année de naissance, est l'action
de la mort sur une population depuis la naissance jusqu'au premier
anniversaire. Elle peut être décomposée en mortalité
néonatale ou mortalité du premier moi (entre 0 et 27 jours
révolus) et en mortalité post-néonatale (entre l moi et le
premier anniversaire). Elle sera mesurée par la variable DECE qui prend
la modalité 1 si l'enfant est décédé avant le
premier anniversaire et prend la modalité 0 si l'enfant a survécu
à cet âge. Il s'agit des enfants nés au cours des quatre
dernières années précédant l'année de la
date de l'enquête.
b) Les caractéristiques d'identification sociale
de la mère
Elles sont d'ordre économique (type d'activité
économique exercée, revenu) et socioculturels (appartenance
religieuse, groupe ethnique, niveau d'instruction). Ces caractéristiques
déterminent les pratiques de la mère en matière
d'hygiène, de santé, de procréation et à
l'égard de l'enfant.
c) Comportements des mères
Il s'agit des comportements en matière
d'hygiène et de santé. Ils désignent les attitudes des
mères face aux soins de santé pendant la grossesse et
l'accouchement et après l'accouchement.
d) Pratiques préventives en matière de
soins de santé
Les pratiques préventives en matière de soins de
santé désignent les visites prénatales, le lieu et
l'assistance à l'accouchement, la nutrition de la mère pendant la
grossesse et de l'enfant et la vaccination.
2.2.3 Variables utilisées dans
l'étude
a) Variable dépendante
La variable dépendante est le décès des
enfants de moins d'un an (la mortalité infantile). Il s'agit des enfants
nés au cours des quatre dernières années
précédant l'année de la date des différentes
enquêtes utilisées dans cette étude. La question relative
à l'état de survie de chaque enfant né vivant a permis de
distinguer les enfants survivants et ceux décédés. Pour
chaque enfant, l'âge au décès a été saisi.
b) Variables indépendantes
Les variables indépendantes sont celles qui rendent
compte des pratiques des mères en matière de soins
préventifs et des caractéristiques individuelles d'identification
sociale des mères.
Concernant les soins préventifs, nous avons retenu les
variables relatives aux consultations prénatales (durée de la
grossesse à la première consultation prénatale, nombre de
visites prénatales au cours de la grossesse, nombre d'injections
antitétaniques reçues au
cours de la grossesse), au lieu et à l'assistance
à l'accouchement, au poids de l'enfant à la naissance et aux
soins postnatals (nombre et type de vaccins reçus pour protéger
l'enfant contre les maladies) et à la durée d'allaitement au
sein.
En ce qui concerne les caractéristiques individuelles
d'indentification sociale de la mère (utilisées comme variables
de contrôle), cette étude retient l'âge, le niveau
d'instruction, et l'occupation. Afin de mieux déterminer l'impact du
milieu social environnant, nous avons retenu l'appartenance ethnique et
religieuse et le milieu de résidence de la mère.
Le cadre d'analyse Figure 2.7: Schéma
d'analyse de l'étude
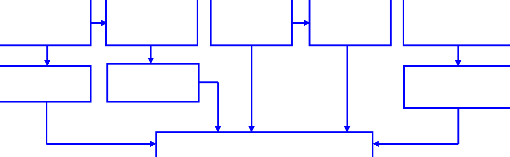
Comportement en
matière de santé
vis-à-
vis de l'enfant
Vaccination
Poids de l'enfant à
la naissance
Comportement
nutritionnel de la
mère
Comportement nutritionnel vis-à-vis de l'enfant
Durée
d'allaitement
Suivi médical
de la grossesse
Décès infantile
Assistance à l'accouchement
Synthèse partielle
Dans ce chapitre nous avons passé en revue les
connaissances sur les facteurs de la mortalité des enfants et
également sur les théories explicatives de la baisse de la
mortalité. La littérature ayant trait à ces deux points
est relativement abondante. Cependant, cela n'est pas le cas en ce qui concerne
les facteurs explicatifs de la baisse de la mortalité des enfants. En se
référant à la revue de la littérature, nous avons
proposé un cadre conceptuel pour expliquer la baisse de la
mortalité infantile. A partir de ce cadre, nous avons posé
quelques hypothèses que nous tenterons de vérifier dans le
contexte particulier du Burkina Faso, a partir des données empiriques
des EDS réalisés en 1992, 1998 et 2003.
Avant de passer à la vérification proprement
dite des hypothèses, nous allons présenter dans le chapitre
suivant les données utilisées dans cette étude, en faire
une évaluation de la qualité et présenter en fin les
méthodes d'analyse qui seront mises en oeuvre dans cette
étude..
CHAPITRE III : METHODOLOGIE
L'étude des facteurs de la mortalité des enfants
dans les pays en développement comme le Burkina Faso rencontre un
certain nombre de difficultés liées d'une part à la
démarche conceptuelle suivie et d'autre part à la nature et
à la qualité des données disponibles.
Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés, les hypothèses que nous avons formulées doivent
être soumises à l'épreuve des données empiriques. Ce
chapitre présente les données utilisées, en fait une
évaluation critique et décrit les méthodes d'analyses
retenues.
3.1. Présentation des sources de données
utilisées
Les données que nous allons utiliser dans le cadre de
cette étude proviennent de la première, de la deuxième et
de la troisième Enquêtes Démographiques et de Santé
du Burkina Faso (EDSBF-I, EDSBF-II et EDSBF-III), réalisées
respectivement en 1992/1993, en 1998/1999 et en 2003 par l'Institut Nationale
de la Statistique et de la Démographie (INSD) avec l'assistance
technique de Macro International. Ces trois enquêtes fournissent des
informations détaillées sur la fécondité, la
planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant, les
soins prénatals et postnatals, les vaccinations, la mortalité
infanto-juvénile, l'état nutritionnel des enfants de moins de
cinq ans et des mères et l'excision. En plus de cela l'EDSBF-III
fournissait des informations sur les infections sexuellement (IST) et
VIH/SIDA.
3.1.1. Objectifs des trois enquêtes EDS
Ces trois enquêtes poursuivaient plusieurs objectifs, entre
autres :
v' recueillir les données au niveau national permettant
de calculer des taux démographiques et plus particulièrement des
taux de mortalité infantile, juvénile, infant-juvénile, et
de fécondité.
v' analyser les facteurs associés au niveau et tendance de
la mortalité infantile et juvénile. v' analyser les facteurs
associés au niveau et tendance de la fécondité.
v' évaluer la santé de la mère et de
l'enfant : vaccination, soins prénatals, traitement de la fièvre
et de la diarrhée, l'état nutritionnel de la mère et de
l'enfant.
v' Mesurer les taux de connaissance et de pratique contraceptive
par méthode, par milieu d'habitat et selon les secteurs de distribution
de la contraception.
v' Mesurer l'état nutritionnel des mères et des
enfants de moins de cinq ans (mesures anthropométriques : taille et
poids).
3.1.2. Plan de sondage
Le plan de sondage adopté pour les enquêtes
EDSBF-I, EDSBF-II et EDSBF-III consiste à un sondage stratifié
par grappes à deux degré, pondérée et
représentative au niveau national, au niveau des milieux de
résidence et des régions de résidence. La base de sondage
utilisée est la liste des Zones de Dénombrement du Recensement
Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 1996 pour
EDSBF-II et EDSBF-III et RGHPH 1985 pour l'EDSBF-I.
3.1.3. Questionnaires
Les trois enquêtes ont été
réalisées à l'aide de trois types de questionnaires afin
d'atteindre les objectifs fixés. Il s'agit du questionnaire
ménage, du questionnaire individuel femme et du questionnaire individuel
homme.
Le questionnaire ménage a permis d'enregistrer tous les
membres du ménage et les visiteurs ; de collecter un certain nombre
d'informations tels que l'âge, le sexe, le milieu de résidence,
l'éducation, l'état matrimonial et enfin les
caractéristiques socio-économiques et environnementales dans
lesquelles vivent les enquêtés. Il a également permis
d'établir l'éligibilité des personnes à interviewer
individuellement et de déterminer les populations de
référence pour le calcul de certains indicateurs
démographiques.
Le questionnaire individuel femme s'adresse uniquement aux
femmes en âge de procréer (15-49 ans) éligibles dans les
ménages enquêtés. A ce niveau, le critère de
sélection est essentiellement fondé sur l'âge de la femme.
Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans de tous les
ménages enquêtés ont été
sélectionnées. Il offre plusieurs variables relatives à la
procréation, à la connaissance et à l'utilisation de la
contraception, à la grossesse et à l'allaitement, à la
vaccination et à la santé des enfants, à la
nuptialité, à la préférence en matière de
fécondité, à la mortalité maternelle, à
l'état nutritionnel des mères et des enfants de moins de cinq ans
et enfin aux caractéristiques socio-économiques et culturelles de
la femme et du conjoint. Des informations détaillées ont
été recueillies sur les enfants nés vivants, les
enfants survivants et les enfants
décédés, sur le sida et autres infections sexuellement
transmissibles et enfin sur l'excision.
Le questionnaire individuel homme s'adresse à un
échantillon d'hommes sélectionnés parmi les maris des
femmes éligibles au questionnaire individuel femme. Il vise à
collecter des informations sur la connaissance et l'utilisation de la
contraception et sur les opinions des maris en matière de
fécondité, de taille de la famille et planification familiale.
Des informations détaillées ont été recueillies sur
le sida et autres infections sexuellement transmissibles, sur l'excision et la
circoncision des hommes.
Les fichiers d'analyse ont été constitués
à partir du questionnaire ménage et du questionnaire individuel
femme. Le questionnaire ménage a permis d'avoir certaines informations
relatives aux caractéristiques du milieu de vie des
enquêtés alors que le questionnaire individuel femme fournit les
détails liés à la santé familiale en
générale et à la santé des enfants en particulier
et à l'état nutritionnel de la mère et de l'enfant.
3.2. Méthodes d'analyse
La plupart des informations recueillies lors de trois EDS du
Burkina Faso (EDSBF-I, EDSBF-II et EDSBF-III) sur la mortalité des
enfants portent sur les évènements survenus au cours des cinq
dernières années précédant la date des
différentes enquêtes. Les variables qui opérationnalisent
le comportement des mères en matière de soins préventifs
et curatifs (allaitement, vaccination, consultations prénatales, lieu et
l'assistance à l'accouchement, etc.) n'ont été saisies que
pour les enfants nés vivants au cours des cinq dernières
années précédant les trois enquêtes.
Le diagramme de LEXIS ci-dessous (Figure 3.1) illustre bien cette
situation.
Figure 3.1: Diagramme de Lexis montrant la période
quinquennale précédant les enquête
Ages
5
Temps t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t
Pour l'étude de la mortalité infantile, tous les
enfants nés au cours de la période annuelle [t-1, t] ne sont pas
exposés au même risque de décéder que les autres
nés au cours de la période [t-5, t-1] car à la date t
certains d'entre eux n'ont pas encore atteint leur premier anniversaire, alors
que ceux des générations [t-5, t-1] ont été
totalement exposés au risque.
Compte tenu de ce problème et du fait du faible
effectif de décès enregistrés dans les
générations totalement exposées au risque de
décéder si nous considérons une période annuelle,
nos analyses porteront sur la cohorte d'enfants de la période [t-5,
t-1].
En l'absence des variables susceptibles de rende compte des
comportements de mères en matière de santé telles que la
vaccination et la nutrition pour les enfants décédés, nous
allons retenir les comportements des mères pour les enfants survivants.
Ce faisant, nous supposons que les femmes ont eu les mêmes comportements
pour les enfants survivants que pour les enfants
décédés.
Cette démarche pose un problème. En effet, il
est impossible d'associer les variables relative aux comportements de la
mère en matière de santé à un enfant
décédé si sa mère n'a eu que lui seul au cours de
la période retenue pour l'enquête ou si les autres enfants
nés avant ou après lui au cours de la période de
l'enquête sont aussi décédés.
Du fait de la nature des données (recueillies a partir
des enquêtes rétrospectives) que nous allons utilisées dans
cette étude, deux approche d'analyse peuvent être utilisées
: une analyse transversale ou une analyse longitudinale. L'analyse transversale
se base sur les indices calculés pour une période donnée,
toutes cohortes confondues (période d'un an ou de cinq ans avant
l'enquête). Par contre l'analyse longitudinale rend compte de
l'évolution du risque de décès d'une
génération ou d'un groupe de générations. Son
postulat de base est fondé sur le fait que les enfants nés au
cours d'une même période donnée sont sensés
connaître les mêmes conditions qui les exposent de façon
indifférenciée au risque de mourir. Compte tenu des objectifs de
notre étude, nous allons adopter cette dernière approche.
Pour cette étude les analyses seront essentiellement
descriptives. Dans un premier temps les analyses consisteront à faire
une analyse différentielle des variables liées à la
mortalité infantile. Elles seront menées grâce aux tableaux
croisés. A l'aide de la statistique de Khi-deux, nous
apprécierons l'existence ou non de relation entre chacune des facteurs
préventifs et le risque de mortalité infantile. Dans un
deuxième temps, nous recourons à l'Analyse Factorielle des
Correspondances Multiples (AFCM) pour saisir l'association entre ces
différents facteurs et la mortalité infantile selon chaque
période d'étude. Il s'agit de mettre en évidence une
modification ou une conservation de la structure d'une telle association
à travers le temps.
3.3. Evaluation de la qualité des données
utiisées
D'importantes précautions ont été prises
lors de l'exécution des trois enquêtes démographiques et de
santé au Burkina en 1992, en 1998 et en2003 pour s'assurer de la
représentativité de toutes les couches sociales dans
l'échantillon. Cependant, cela ne peut que minimiser les erreurs de
conception; il reste à maîtriser les erreurs liées à
la collecte des données sur le terrain pour avoir des données de
meilleure qualité. Ce deuxième type d'erreurs peut provenir de la
nature de l'enquête, du comportement des agents enquêteurs et/ou de
la capacité des enquêtés à fournir des
réponses fiables. Dans le cadre de l'analyse de la mortalité
infantile, nous essayerons de vérifier la qualité des
données collectées à partir de l'âge
déclaré des enquêtées de la parité moyenne et
de la structure par âge et par sexe des enfants
décédés.
3.3.1 Evaluation de l'âge déclaré des
mères
Une distribution par âge des femmes
enquêtées permet d'apprécier, en partie, la qualité
des données recueillies. Comme la souligné Gilles Roger et al
(1981), une structure par âge enregistrée à l'occasion
d'une enquête est la résultante de l'histoire passée des
générations concernées et des conditions de la collecte.
La première composante de cette relation est déterminée
par les lois de la fécondité de la mortalité et de la
migration tandis que la seconde (condition de la collecte) dépend
surtout de la nature de la question sur l'âge, du niveau de la formation
des enquêteurs, des coutumes du milieu de la collecte et enfin du niveau
d'instruction des enquêtés. Les lois régissant les
phénomènes démographiques (fécondité,
mortalité et migration) présentent des effets moindre sur la
perturbation de la structure par âge; par contre les effets liés
à la déclaration d'âge peuvent entrainer d'importantes
distordions. L'importance de l'effectif des enquêtés n'ayant pas
déclaré leur âge (modalité
indéterminée) au moment de l'enquête et la forme de la
structure par âge (creux) permettent de se rendre compte des
défauts de déclarations d'âge des enquêtés.
Les indices de Whipple et de Myers permettent également
d'apprécier l'importance des mauvaises déclarations
d'âge.
Graphique 3.1 : Répartition des mères selon leur
âge
|
700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
300
200
100
0
Effeciff
-. NJ C ..3 A
0 0 0 0
7 0 0 0
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1998
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 16
|
17
|
18 19
|
20 21
|
22 23
|
24 25
|
26 27
|
28 29
|
30 31
|
32
|
33 34
|
35 36
|
37
|
38 39
|
40 41
|
42
|
43 44
|
45 46
|
47 48
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Age
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La structure par âge des femmes enquêtées
(figure 3.2), laisse apparaître beaucoup d'irrégularités.
On observe des pics particulièrement aux âges ronds (se terminant
par 0) et semi-ronds (se terminant par 5). Le calcule des indices de Whipple et
Myers va nous permettre de confirmer ou d'infirmer cette
préférence des âges se terminant par les chiffres 0 et
5.
a) Indice de Whipple
L'indice de Whipple (Iw) permet de mesurer le
degré de préférence des âges se terminant par 0 ou
5. Le calcul de cet indice consiste à prendre l'effectif total des
femmes âgées de 23 à 62 ans, et à calculer la somme
des effectifs des femmes de cet intervalle dont les âges se terminent par
les chiffres 0 ou 5; puis on fait le rapport de cette dernière somme au
un cinquième de l'effectif total. L'indice ainsi obtenu varie entre
zéro et cinq. Mais pour les données issues des EDS, la formule
est la suivante :
I w
P + P + +
... P
20 25 45
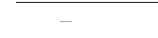
=
1
47
Pi
?
5 i =18
Lorsque sa valeur est égale à 1, il n'y a pas de
préférence pour les âges se terminant par zéro et
par cinq. Par contre pour une valeur inférieure à un, il y a
répulsion tandis que pour une valeur comprise entre un et cinq il y a
attraction (Roger et al, 1981). Les valeurs proposées par les Nations
Unies pour apprécier la qualité des données sur
l'âge à partir de cet indice sont:
v' Si Iw= 0, il y a répulsion total des
âges terminés o et 5.
v' Si Iw= 5, tous les âges enregistrés se
terminent par 0 ou 5.
v' Si Iw < 1, il y a répulsion pour les
âges terminés par 0 et 5.
v' Si Iw = 1, il n'y a aucune préférence
pour les âges terminés par 0 ou 5. v' Si 1 < Iw <
5, il y a attraction d'autant plus forte que Iw est proche de 5.
Le calcul de l'indice de Whipple pour les données des
EDS de 1993 de 1998 et 2003 (1,31 pour 2003, 1,33 pour 1998 et 1,26 pour 1993)
montre qu'il y a une attraction pour les âges se terminant par 0 ou 5. On
peut donc dire que les femmes ont mal déclaré leurs âges
lors de chacune des trois enquêtes. Cependant, l'indice de Whipple
présente certaines limites. Il ne permet de se prononcer que sur la
préférence des âges se terminant par zéro ou
cinq.
b) Indice de Myers
Contrairement à l'indice de Whipple, celui de Myers
mesure la répulsion ou l'attraction de chacun des chiffres compris entre
zéro et neuf. Il permet aussi de se prononcer de façon globale
sur l'ensemble des chiffres. Cet indice présente aussi l'avantage
d'éliminer, au moins en partie, la diminution des chiffres entre les
âges en se servant des effectifs pondérés. Cet indice varie
entre 0 et 180. Plus il est proche de zéro, meilleure est la
déclaration des âges. Pour chaque chiffre, le signe négatif
du coefficient indique une répulsion, tandis que le signe positif
traduit une attraction. La valeur absolue du coefficient renseigne sur
l'ampleur de préférence.
Tableau 3.1: Indices de Myers
|
2003
|
1998
|
1992
|
|
0
|
14,2
|
17,1
|
15,7
|
|
1
|
-4,3
|
-4,7
|
-4,5
|
|
2
|
-2,4
|
-2,7
|
-2,6
|
|
3
|
-3,0
|
-3,9
|
-3,5
|
|
4
|
-4,7
|
-5,3
|
-5,0
|
|
5
|
8,7
|
8,8
|
8,8
|
|
6
|
-3,3
|
-3,9
|
-3,6
|
|
7
|
-0,8
|
-0,4
|
-0,6
|
|
8
|
-3,1
|
-3,3
|
-3,2
|
|
9
|
-2,9
|
-2,5
|
-2,7
|
Le calcule de l'indice de Myers pour l'EDS 1993, l'EDS de 1998
et celui de 2003 montre qu'il y a une préférence pour les
chiffres se terminant par 0 et 5, dans la déclaration de l'âge
pour chacune des trois enquêtes (ce qui confirme les résultats
obtenus par l'indice de Whipple), et une répulsion pour les autres. Ce
résultat est également confirmé par la figure 3.2
(représentant la répartition des mères selon leurs
âges). En considérant les déclarations d'âge des
femmes enquêtées lors des trois EDS, on constate que les
données recueillies sur l'âge sont entachées d'erreurs. Le
regroupement des effectifs en groupes d'âge quinquennaux permet de
corriger les biais constatés en lissant la structure initiale (Roger et
al, 1981).
Tableau 3.2: Répartition des femmes au cours des trois
EDS et du RGPH-1996
|
Groupe
d'âges
|
RGPH-1966
|
EDS-2003
|
EDS-1998
|
EDS-1993
|
|
Effectif
|
Pourcentage
|
Effectif
|
Pourcentage
|
Effectif
|
Pourcentage
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
15-19
|
550 596
|
23,6
|
2777
|
22,3
|
1474
|
22,9
|
1480
|
23,3
|
|
20-24
|
428 963
|
18,4
|
2243
|
18,0
|
1183
|
18,4
|
1221
|
19,2
|
|
25-29
|
382 837
|
16,4
|
1988
|
15,9
|
1045
|
16,2
|
1142
|
18,0
|
|
30-34
|
323 952
|
13,9
|
1600
|
12,8
|
849
|
13,2
|
914
|
14,4
|
|
35-39
|
262 931
|
11,3
|
1535
|
12,3
|
816
|
12,7
|
723
|
11,4
|
|
40-44
|
218 161
|
9,3
|
1257
|
10,1
|
600
|
9,3
|
507
|
8,0
|
|
45-49
|
167 181
|
7,2
|
1077
|
8,6
|
478
|
7,4
|
367
|
5,8
|
|
Total
|
2 334 621
|
100
|
12477
|
100
|
6445
|
100
|
6354
|
100
|
Les courbes obtenues à partir de la répartition
des femmes enquêtées selon le groupe d'âges (cf. figure
3.3), montre une décroissance régulière des proportions
des femmes en âge de procréer au fur et à mesure que
l'âge augmente. Les allures générales de ces distributions
sont semblables à celles obtenue à partir des données du
RGPH de 1996 (Figure3.3). Par exemple, pour le groupe d'âges 20-24 ans,
les proportions observées sont de 18,0% pour l'EDSBF-III, 18,4% pour
l'EDSBF-II et 19,2% pour l'EDSBF-I contre 18,4% pour le RGPH de 1996
(Tableau3.2). Ce constat permet d'affirmer que les erreurs des
déclarations d'âge ne sont pas assez importantes pour remettre en
cause la qualité des données des trois EDS utilisées dans
cette étude.
Graphique3.2 : Répartition des femmes
enquêtées et des femmes recensées selon le groupe
d'âges
|
|
25
|
|
20
15
10
5
0
Struclure par age (%)
_, _, rs.) r,
D C11 0 C11 0 C
|
|
|
|
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
|
|
RGPH-1966 EDS-2003 EDS-1998 EDS-1993
G
|
|
|
3.3.2 Evaluation des déclarations de la
parité moyenne
La parité moyenne est le nombre moyen d'enfants
nés vivants par femme. En supposant que la structure de la
fécondité ne souffre pas d'une mauvaise déclaration de
l'âge de la mère, le nombre d'enfants nés vivant par femme
devrait croître avec l'âge de la mère. Une baisse de la
parité pourrait dénoter soit une omission d'enfants nés
vivants, soit une sous représentativité des mères aux
âges élevés, ou encore soit une mauvaise déclaration
de l'âge de la mère. Effet de mémoire, lieu de
résidence de la mère, influence des traditions, us et coutumes
sont des raisons avancées pour expliquer un tel phénomène
(Roger et al, 1981). Au cours des opérations de collecte, les omissions
d'enfants nés vivants touchent le plus souvent les enfants nés
des mères non instruites, résidant en milieu rural ou n'ayant pas
accouché dans les centres de santé qui délivrent
directement une pièce d'identité à l'enfant, etc. (Roger
et al, 1981). Les omissions introduisent non seulement un biais dans le calcul
des indices de la mortalité des enfants, mais rendent également
difficile l'analyse des facteurs qui conduisent à la mort de
façon différentielle car les enfants déclarés sont
le plus souvent ceux qui ont bénéficié de contacts avec
les services de santé au moment de la grossesse, de l'accouchement et/ou
de la période postnatale.
La figure3.4 montre que les parités augmentent presque
régulièrement jusqu'à 46 ans pour les trois
enquêtes. Des petites anomalies sont observées entre 46 et 49
ans. L'omission de quelques enfants (enfants vivant hors du
ménage ou confiés à d'autre personnes) et le faible
effectif des femmes âgées de 46-49 ans expliqueraient ces
anomalies. Par ailleurs, la baisse observée à 49 ans en 1998 peut
être due à une omission de naissances due à la
déficience de mémoire, à un rajeunissement ou un
vieillissement fictif des femmes (dans le premier cas, la femme baisse son
âge pour se montrer encore jeune et, dans le deuxième cas,
l'enquêteur estime l'âge de la femme à un âge
élevé pour éviter certaines questions). Le rajeunissement
de la femme fait augmenter les parités moyennes trouvées pour les
âges inférieurs et le vieillissement soustrait ces femmes dans le
calcule de la parité moyenne.
Graphique3.3 : Evolution des parités moyennes selon
l'âge de la mère
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1992
|
Age
1998
|
2003
|
|
Les méthodes indirectes d'estimation du taux de
fécondité général (TFG) permettent de se prononcer
sur la qualité des déclarations du nombre d'enfants nés
vivants par femmes. Soient P2, P3 et P4 les parités moyennes des femmes
âgées respectivement de 20-24 ans, 25-29 ans et 30-34 ans
révolus. On estime le taux de fécondité
général de deux manières différentes: TFG=
(P3)2/P2 ou TFG = P2(P4/P3)4. Selon Rachad et Brass
(1979) si la valeur minimale du taux de fécondité global (TFG)
obtenu à partir de ces deux formules est supérieure à la
parité moyenne des femmes âgées de 45-49 ans, on peut
conclure que les femmes ont probablement omis des enfants dans leurs
déclarations.
Tableau 3.3 : Les taux de fécondité
général obtenus méthodes indirectes d'estimation de Rachad
et Brass
|
EDS
|
(P3)2/P2
|
P2(P4/P3)4
|
Min ((P3)2/P2, P2(P4/P3)4)
|
Parités déclarées des femmes
de
45-49ans
|
|
EDSBF-III
|
5, 40
|
6,39
|
5, 40
|
6,04
|
|
EDSGF-II
|
5, 76
|
6,51
|
5, 76
|
6,47
|
|
EDSBF-I
|
5, 52
|
6,27
|
5, 52
|
6,29
|
Les valeurs minimales étant (5,40, 5,76 et 5,52)
étant inférieures aux parités déclarées par
les femmes âgées de 45-49 ans (respectivement 6,04, 6,47 et 6,29),
on peut conclure que la déclaration des enfants nés vivants est
relativement bonne comme l'atteste d'ailleurs la figure 3.4.
Graphique3.4: Evolution des parités moyennes selon le
groupe d'âge de la mère
|
|
Parités moyennes selon le groupe d'âges de la
mère
|
|
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
llubSs moyeonek
) .- N La A ln Cl 1 OD D C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Groupe d'âge de la mère
|
|
2003 1998 1992
|
|
|
Le tableau ci-après donne le nombre d'enfants nés
vivants par groupes d'âges quinquennaux de la mère.
Tableau 3.4: Répartition des enfants nés vivants et
des enfants décédés selon le groupe d'âges de la
mère
|
Période
|
Groupe
d'âges
|
Effectifs
des mères
|
Nombre
d'enfants né
vivants
|
Nombre
d'enfants
décédés
|
Parité
atteinte
|
Proportion
des décès
|
|
1999-2003
|
15-19
|
2777
|
538
|
61
|
0,19
|
0,11
|
|
20-24
|
2243
|
2467
|
317
|
1,29
|
0,13
|
|
25-29
|
1988
|
2686
|
333
|
2,64
|
0,12
|
|
30-34
|
1600
|
2084
|
216
|
3,94
|
0,10
|
|
35-39
|
1535
|
1611
|
189
|
4,99
|
0,12
|
|
40-44
|
1257
|
905
|
113
|
5,71
|
0,12
|
|
45-49
|
1077
|
354
|
51
|
6,04
|
0,14
|
|
Total
|
12477
|
10645
|
1280
|
|
|
|
1994-1998
|
15-19
|
1474
|
321
|
57
|
0,22
|
0,18
|
|
20-24
|
1183
|
1396
|
225
|
1,4
|
0,16
|
|
25-29
|
1045
|
1505
|
210
|
2,84
|
0,14
|
|
30-34
|
849
|
1125
|
157
|
4,17
|
0,14
|
|
35-39
|
816
|
991
|
120
|
5,38
|
0,12
|
|
40-44
|
600
|
466
|
82
|
6,16
|
0,18
|
|
45-49
|
478
|
149
|
26
|
6,47
|
0,17
|
|
Total
|
6445
|
5953
|
877
|
|
|
|
1988-1993
|
15-19
|
1480
|
362
|
58
|
0,24
|
0,16
|
|
20-24
|
1221
|
1391
|
181
|
1,38
|
0,13
|
|
25-29
|
1142
|
1576
|
187
|
2,76
|
0,12
|
|
30-34
|
914
|
1163
|
110
|
4,03
|
0,09
|
|
35-39
|
723
|
811
|
91
|
5,15
|
0,11
|
|
40-44
|
507
|
393
|
59
|
6,93
|
0,15
|
|
45-49
|
367
|
132
|
22
|
6,29
|
0,17
|
|
Total
|
6354
|
5828
|
708
|
|
|
3.3.3 Evaluation de la qualité de l'âge au
décès
a) Evolution des proportions des décès
d'enfants selon l'âge déclaré des mères
On s'attendrait à ce que les naissances qui surviennent
aux jeunes et aux âges élevés donnent lieu à des
risques de décès plus élevés que ceux des
âges intermédiaires. En effet comme l'indique la revue de la
littérature, le risque de décès est élevé
chez les enfants issus de mères jeunes et mères
âgées du fait non seulement de l'immaturité (mères
moins de 20 ans) et de la fatigue biologique (mères âgées
de plus de 35 ans), mais aussi et surtout à cause des comportements
différentiels en matière de suivi médical de la grossesse,
de l'accouchement et du nouveau-né. Tout écart par rapport
à ce constat peut traduire une mauvaise déclaration des enfants
décédés.
On remarque (Figure3.6) que l'évolution des proportions
ne suit pas cette règle. On observe que la courbe des proportions des
décès présente une allure irrégulière pour
les trois sources de données. Ce qui montre une mauvaise
déclaration des décès surtout chez les femmes ayant un
âge élevé qui présentent souvent un déficit
de mémoire.
Graphique 3.5: Evolution des proportions des décès
selon le groupe 'âges
|
|
|
3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50
|
|
|
0,00
|
|
2003 1998 Ag 1992
|
|
|
Mais en regroupant les femmes par tranche d'âges
quinquennaux, observe une allure assez régulière des courbes des
proportions des décès (Figures 3.7). Ce qui montre que
malgré les distordions observées dans la déclaration des
décès quand on considère les unités d'âges,
celle-ci a été dans l'ensemble satisfaisante.
Graphique3.6: Evolution des proportions des décès
selon le groupe 'âges
|
|
Proportion des enfants décédés par groupe
d'âges de la mère
3
|
|
2,5
2
1,5
1
0,5
R-opertion des erfaols decedi
0N.)
) in .-2(:)," N.) In u
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Groupe d'âges
|
|
2003 1998 1992
|
|
|
b) Evaluation de la qualité des données
à partir de la distribution par âge des enfants
décédés
Pour évaluer la qualité des données sur
l'âge, nous allons commencer par évaluer les taux de non
réponse. Ainsi, nous avons trouvé des taux de non réponse
(cf. Tableau 3.5) qui ne sont pas de nature à influencer
significativement la déclaration des âges au
décès.
Tableau 3.5 : Proportions des âges au décès
non déclarés
|
Année
|
Effectifs
|
Proportions (%)
|
|
2003
|
9
|
0,1
|
|
1998
|
1
|
0,01
|
|
1992
|
2
|
0,03
|
L'analyse biométrique de la mortalité des
enfants postule que la distribution des décès est uniquement
fonction de l'âge (Akoto, 1996). Dans les pays en développement,
l'insuffisance du suivi médical de la grossesse, de l'accouchement et du
nouveau-né, joint à d'autres facteurs culturels, entraînent
le plus souvent un nombre important de décès au cours du premier
moi de vie. Ce nombre de décès diminue
régulièrement au fur et à mesure que les enfants avancent
en âge. Cette tendance est confirmée par la proportion des
décès néonatals dans la mortalité infantile qui ne
devrait pas s'écarter de un tiers (Akoto, 1985). Le calcul de la
proportion des décès néonataux dans la mortalité
infantile, à partir des données de l'EDSBF-III, de l'EDSBF-II et
de l'EDSBF-I donne respectivement les valeurs suivantes 0,40, 0,42 et 0,48
(tableau3.6). Les proportions ainsi trouvées sont supérieures
à un tiers, on peut donc dire que la déclaration des
décès selon l'âge au décès n'est pas de
très bonne qualité. Cependant on remarque une déclaration
relativement bonne pour l'EDS de 2003 par rapport à l'EDS de 1993. Par
ailleurs, il existe des enfants dont leur âge au décès n'a
pas été déclaré (tableau 3.5). Mais ces proportions
sont faibles pour compromettre l'utilisation des ces données.
Tableau 3.6: Proportion des décès néonatals
parmi les décès infantiles selon les EDS
|
Age au décès
|
2003
|
1998
|
1992
|
|
0-28 jours
|
306
|
238
|
225
|
|
0-11 mois révolus
|
772
|
569
|
466
|
|
Proportion des décès néonatals dans
la
mortalité infantile
|
0,40
|
0,42
|
0,48
|
Synthèse partielle
En définitive, nous avons pu évaluer la
qualité des données permettant d'étudier la
mortalité des enfants au Burkina. L'enregistrement des naissances et des
décès est relativement fiable en raison du type d'enregistrement
(EDS). Les données anciennes (1998- 1993) et les données
récentes sont de qualité équivalente et, bien que ne
couvrant pas exactement les mêmes femmes, fournissent des
résultats comparables.
Malgré les insuffisances liées à la
méthodologie des trois enquêtes (indisponibilité des
informations sur les enfants dont les mères sont
décédées à la date de l'enquête par exemple)
et à la qualité des données sur l'âge, la
parité et les décès, les données utilisées
dans cette étude permettent de faire une analyse sans s'éloigner
de la réalité. En effet, après regroupement des âges
en des groupes d'âges d'amplitude cinq, les données se sont
révélées de qualité satisfaisante pour mener une
étude de qualité acceptable.
Dans ce chapitre, nous avons essayé de présenter
et d'évaluer la qualité des données des Enquêtes
Démographiques et Santé (EDS) de 1993, 1998 et de 2003 qui
constituent nos sources de données utilisées dans cette
étude. Les informations recueillies lors de ces trois enquêtes
sont relativement de bonne qualité malgré l'existence de quelques
imperfections. La présentation des méthodes d'analyse qui seront
utilisées dans les analyses a clôturé ce chapitre.
Après avoir présenté et
évalué la qualité des données utilisées et
choisit la méthode d'analyse appropriée, nous allons entrer dans
les analyses proprement dites. Ce dernier chapitre aura pour objectif de
vérifier empiriquement les hypothèses de cette étude. Les
résultats obtenus vont permettre de formuler par la suite des
suggestions que se soient au niveau de la perspective de recherche ou au niveau
des stratégies en matière de santé.
CHAPITRE IV: PRATIQUES PREVENTIVES DES MERES
EN
MATIERE DE SOINS DE SANTE ET MORTALITE INFANTILE
Le présent chapitre s'attelle à l'analyse des
données des trois enquêtes utilisées dans cette
étude. Il s'agit essentiellement d'une analyse descriptive des facteurs
de la mortalité infantile liés aux pratiques préventives
des mères en matière de soins de santé.
L'exploitation des données porte sur une cohorte de
8994 enfants pour l'EDS-III (2003), de 5886 enfants pour l'EDS-II (1998) et de
5688 enfants pour l'EDS-I (1992), nés vivants dont l'âge varie
entre zéro et onze mois révolus. L'analyse est menée selon
les groupes de variables relatives au suivi médical de la grossesse et
de l'accouchement (soins prénatals), à la vaccination des enfants
et enfin à la nutrition. Les variables d'identification sociale de la
mère et les variables liées au contexte nous servent de variables
de contrôle des différentes relations éventuelles entre le
risque de décès infantile et les facteurs préventifs
susénumérés.
4.1 Pratiques des mères en matière de suivi
médical de la grossesse et de l'accouchement et risque de
mortalité infantile
La grossesse et l'accouchement sont des périodes
à risque pour la femme et l'enfant à naître. Ces risques
sont en grande partie maîtrisés par des mesures de surveillance
prénatale, une assistance qualifiée au moment de l'accouchement
et de suites de couches. Les soins prénatals le lieu et l'assistance
à l'accouchement diminuent le risque de décès des enfants
et/ou de la mère en détectant les grossesses à risques. Le
comportement des mères en matière de suivi médical de la
grossesse et de l'accouchement est approché ici à travers la
durée de la grossesse au moment de la première visite
prénatale, le nombre de visites prénatales, le nombre
d'injections antitétaniques reçues par la mère au moment
de la grossesse, le lieu et l'assistance à l'accouchement.
4.1.1 Age de la grossesse au moment de la première
visite prénatale
Au cours de chacune des trois enquêtes, il a
été demandé à chacune des femmes
enquêtées ayant eu au moins un enfant au cours des cinq
dernière années précédents l'enquête, le
temps qui s'est écoulé entre la conception de la grossesse et le
moment de la première visite prénatale (les réponses ont
été enregistrées en nombre de mois). En se
référant à la revue de la littérature et à
la répartition des effectifs, nous avons été amené
à crée un indicateur à trois
modalités. Il s'agit notamment des enfants n'ayant
bénéficié d'aucune visite prénatale, de ceux dont
les mères ont effectué la première consultation au cours
des trois premiers mois de la grossesse, et enfin de ceux pour lesquels la
première visite a eu lieu a partir de trois mois ou plus après la
conception.
On constate que pour l'EDSBF-III (2003), près d'un
enfant sur quatre n'a bénéficié d'aucune visite
prénatale (figure 4.1). Parmi les enfants qui en ont
bénéficié 29,67% des enfants proviennent des mères
ayant effectuées leur premier contrôle au cours des trois premiers
mois de la grossesse.
Graphique4.1: Répartition des enfants de moins d'un an
selon l'âge de la grossesse au moment du premier contrôle
prénatale
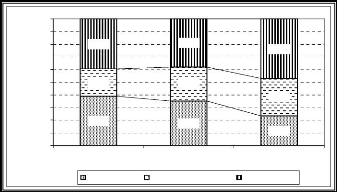
1992 1998 2003
|
39,36
|
|
38,24
|
|
|
46,73
29,67
|
|
|
|
26,39
|
|
|
21,85
38,79
|
|
|
|
|
35,37
|
|
23,60
|
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Aucune visite Au cours des 3 mois Après 3 mois
Tableau 4.1: Evolution de la variation du risque
de mortalité infantile selon l'âge de la grossesse au moment de la
première visite prénatale
|
Période
|
Durée de la grossesse au moment de la
première
visite
|
Risque de
décéder (%o)
|
Probabilité
du Khi-deux
|
|
2003
|
Aucune visite prénatale
|
122,57
|
0,003***
|
|
Visite au cours des 3 premiers mois
|
63,92
|
|
Visite prénatale après 3 mois
|
76,58
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
Aucune visite prénatale
|
130,45
|
0,00***
|
|
Visite au cours des 3 premiers mois
|
86,86
|
|
Visite prénatale après 3 mois
|
95,53
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
Aucune visite prénatale
|
123,95
|
0,001**
|
|
Visite au cours des 3 premiers mois
|
98,32
|
|
Visite prénatale après 3 mois
|
71,90
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
*** Significatif au seuil de 1%
|
Pour l'EDSBF-II (1998), 35,37% des enfants n'ont
bénéficié d'aucune consultation prénatales et parmi
ceux qui ont bénéficié d'au moins une visite
prénatale, 26,4% appartiennent aux femmes ayant effectuée leurs
premiers contrôles au cours des trois premiers mois de la grossesse
contre 38,24% dont les mères ont attendu quatre mois ou plus avant de
contacter un personnel de santé. Enfin, pour l'EDSBF-I (1993), 38,8% des
enfants sont issus des mères qui n'ont eu recours à aucune visite
prénatale au cours de la grossesse contre 61,45% qui ont
bénéficié d'au moins une consultation.
On remarque que la proportion des enfants n'ayant
bénéficié d'aucune visite prénatale va
décroissant de l'EDSBF-I à l'EDSBF-III. Cette proportion est
passée de 38,8% en 1992 à 23,6% en 2003. Ainsi, les femmes
recourent de plus en plus aux visites prénatales même si cela se
fait un peu tardivement. Par ailleurs, on remarque que ces proportions sont
très variables suivant le niveau d'instruction de la mère et le
milieu de résidence. En effet, les enfants qui n'ont
bénéficié d'aucune visite prénatale proviennent des
mères vivant en milieu rural (98,24% entre 1999 et 2003, 98,97% entre
1994 et 1998 et 96,09% entre 1988 et 1993), sans niveau d'instruction (97,54%
entre 1994 et 1998 et entre 1988 et 1993, 97,17% entre 1999 et 2003) et sont
généralement agricultrices (84,76% 1999 et 2003, 51,63% 1994 et
1998 et 33,92% 1988 et 1993) (annexe 3).
Ce comportement des mères n'est pas sans
conséquence sur la survie des enfants. Comme on s'y attendait, on
remarque, sur les trois périodes, une association significative entre
l'âge de la grossesse au moment de la première visite et le risque
de décès infantile (Tableau4.1).
La différence est nette entre les enfants dont les
mères ont effectué au moins une visite prénatale et ceux
dont les mères n'ont effectué aucune visite, et cela se
vérifie quelque soit la durée de la grossesse et quelque soit la
période d'étude. Le risque de décès des enfants qui
n'ont bénéficié d'aucune visite est plus de 1,5 fois
élevé que celui de ceux dont les mères ont effectué
au moins une consultation et cela pour les trois périodes
d'études. On constate en outre, pour toute la période
d'études qu'il n'existe pas de différence significative de risque
de décès entre les enfants dont les mères ont
effectué au moins une visite prénatale quelle que soit la
durée de la grossesse.
Cependant, le risque de décès infantile
lié à ce comportement de la mère a considérablement
diminué entre 1988 et 2003. Pour les enfants dont les mères n'ont
eu
recours à aucune consultation prénatale, ce
risque a suivi une baisse de 5% entre 1988 et 1993 et une baisse encore
importante entre 1999 et 2003 (6,1%).
La variation du risque de décès infantile en
fonction du moment de la première visite prénatale pourrait
s'expliquer par la relation que celui-ci entretient avec le nombre de visites
prénatales effectuées et le nombre d'injections
antitétaniques reçues par la mère pendant la grossesse. En
effet, les femmes ayant débuté tôt leurs consultations
prénatales ont plus de chance (sous les conseils des personnels de
santé) d'effectuer le nombre adéquat de visites médicale
de la grossesse et d'injections antitétaniques pour protéger le
foetus et accoucher dans de meilleures conditions. Cela se justifie par le fait
que les visites médicales sont régulièrement
espacées dans le temps et que les injections antitétaniques sont
administrées, dans la plus part des cas, au cours des contrôle de
la grossesse.
4.1.2 Nombre de visites prénatales
Tout comme la durée de la grossesse au moment de la
première visite prénatale, les EDS de 1993, 1998/99 et de 2003
ont également saisi les informations sur le nombre de visites
prénatales effectuées par les femmes ayant eu des naissances au
cours des cinq dernières années qui ont
précédées les différentes enquêtes. Nous
avons constitué, à partir de ces informations, un indicateur
mesurant le nombre de visites prénatales.
On remarque que jusqu'en 2003, près d'un enfant sur
quatre n'a bénéficié d'aucune visite prénatale. Ce
nombre était presque de deux enfants sur cinq entre 1988 et 1993 et
entre 1994 et 1998 (figure 4.2). Les femmes ont de plus en plus recourt aux
visites prénatales pendant la grossesse. Comme l'indique la figure4.2,
la proportion des femmes ayant eu recourt à plus de trois visites
prénatales pendant la grossesse a augmenté entre 1992 et 2003.
On remarque également que ces proportions sont
très variables suivant le milieu de résidence et le niveau
d'instruction de la mère (le même constat que la durée de
la grossesse au moment de la première visite).
Graphique4.2: Répartition des enfants de moins d'un an
selon le nombre de visites prénatales
effectuées pendant la
grossesse
|
47,43
|
|
|
|
50,83
|
|
|
52,61
|
|
|
|
15,84
36,73
|
|
15,99
33,19
|
|
24,09
|
|
23,30
|
1992 1998 2003
Aucune visite 1 è 2 visites Plus de 3 visites



100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Tableau 4.2: Evolution de la variation du risque de
mortalité infantile selon le nombre de visites prénatales
effectuées par la mère durant la grossesse.
|
Période
|
Nombre de visites prénatales
|
Risque de
décéder (%o)
|
Probabilité du
Khi-deux
|
|
2003
|
Aucune visite prénatale
|
122,57
|
0,005***
|
|
Une à deux visites prénatales
|
89,36
|
|
Plus de trois visites prénatales
|
71,74
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
Aucune visite prénatale
|
136,36
|
0,00***
|
|
Une à deux visites prénatales
|
100,02
|
|
Plus de trois visites prénatales
|
86,48
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
Aucune visite prénatale
|
127,37
|
0,009***
|
|
Une à deux visites prénatales
|
67,61
|
|
Plus de trois visites prénatales
|
85,55
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
*** Significatif au seuil de 1%
|
On constate une association significative entre le nombre de
visites prénatales effectuées par la mère et la
mortalité des enfants des moins d'un an (Tableau 4.2). Les enfants dont
les mères n'ont effectué aucune visite médicale courent
presque 1,7 fois plus de risque de décès que les autres ayant
bénéficié d'au moins trois contrôles de la grossesse
et cela pour les trois périodes considérées.
Comparé aux enfants dont les mères n'ont effectué aucune
visite prénatale, on observe, pour les trois périodes
d'étude, un écart de l'ordre 27,1% de risque de mortalité
en faveur de ceux qui ont bénéficié d'un à deux
contrôles prénataux.
Par ailleurs, pour les enfants nés en milieu urbain,
ceux dont les mères n'ont eu recours à aucune visite
prénatale cours en moyenne 2,5 fois plus de risque de
décéder que
leurs camarades qui ont bénéficié d'au
moins trois visites prénatales par contre pour ceux nés en milieu
rural l'écart de risque entre les deux groupes est en moyenne de 1,25
(Annexe 1) Concernant le niveau d'instruction, les enfants nés des
mères sans niveau, ceux qui n'ont bénéficié d'aucun
suivi médical de la grossesse ont environ 1,6 fois moins de chance de
survivre que les autres qui ont bénéficié de trois visites
au moins. Par contre, les enfants dont les mères ont un niveau
d'instruction primaire et secondaire ou plus le risque de décès
ne varie pas beaucoup entre les différentes modalités de la
variable "nombre de visites prénatales".
Ces résultats semblent confirmer les observations
faites par Grenier et Gold (1986), qui stipulent que le contrôle
médical permet d'éviter, sinon de réduire, le risque de
malformation du foetus conduisant le plus souvent au décès des
enfants en bas âge, de moitié. Tout comme la durée de la
grossesse au moment de la première visite, les écarts de risque
de mortalité infantile entre les différents groupes se sont
réduits au cours du temps. Cette réduction pourrait s'expliquer
par le recours de plus en plus aux visites prénatales. Plusieurs
facteurs entre en jeux pour expliquer cette situation. Elle dépendrait
non seulement, de leur perception du système traditionnel de soins, mais
également de leur capacité de se détacher des rites ou des
habitudes traditionnelles ainsi que de leur situation économique.
4.1.3 Injection antitétanique reçue par la
mère pendant la grossesse.
Les informations contenues dans les trois enquêtes nous
ont permis de constituer un indicateur répartissant les enfants
nés au cours des cinq dernières années qui ont
précédées chacune des trois EDS, selon le nombre
d'injections antitétaniques reçues par la mère au cours de
la grossesse. La vaccination antitétanique vise à immuniser les
mères contre le tétanos et surtout à prévenir le
tétanos qui menacerait les enfants nés à domicile sans
précaution d'asepsie.
Pour une protection plus ou moins complète, une femme
enceinte devrait recevoir deux doses de vaccin. Selon Letonturier (1996), la
réception de quatre doses d'injections antitétaniques par la
mère au moment de la grossesse immunise l'enfant contre les infections
tétaniques qui peuvent l'affecter au cours de l'accouchement.
On remarque qu'entre 1988 et 1992 près deux enfant sur
cinq (44,30%) sont nés des mères qui n'ont reçu aucune
injection antitétaniques au cours de la grossesse contre un sur
trois dont la mère n'a reçu aucune injection
antitétanique (Figure 4.3) entre 1999 et 2003. Les proportions des
mères ayant reçu une ou deux injections antitétaniques au
cours de la grossesse sont respectivement de 44,13% entre 1988 et 1993, de
54,37% entre 1994 et 1998 et de 59,76% entre 1999 et 2003. La proportion des
femmes ayant reçu au moins une injection antitétanique au cours
de la grossesse a augmenté au cours du temps même si la proportion
de celles qui ont reçus plus de trois injections a diminué en
2003. Cela traduit la faiblesse du pourcentage de femmes enceintes
protégées contre le tétanos néonatal au Burkina
Faso au cours des périodes 1988-1993 et 1994-1998, ce qui n'est pas sans
conséquence sur la survie des enfants en bas âge.
Graphique4.3: Répartition des enfants de mois d'un an
selon le nombre d'injections antitétaniques reçues par la
mère au cours de la grossesse
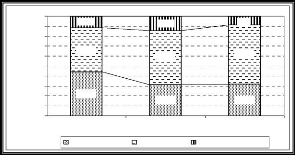
1992 1998 2003
|
11,56
|
|
14,43
|
|
8,42
|
|
|
44,13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,37
|
|
59,76
|
|
|
44,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31,20
|
|
31,81
|
|
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Aucune injection 1_2 injections Plus de 3 injections
Tableau 4.3: Evolution de la variation du risque de
mortalité infantile selon le nombre d'injections antitétaniques
reçues par la mère durant la grossesse
|
Période
|
Nombre de vaccins antitétaniques reçus par
la
mère au cours de la grossesse
|
Risque de
décéder (%o)
|
Probabilité du
Khi-deux
|
|
2003
|
Aucune injection antitétanique
|
116,86
|
0,0013***
|
|
une ou deux injections antitétaniques
|
89,51
|
|
Au moins 3 injections antitétaniques
|
66,96
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
Aucune injection antitétanique
|
135,07
|
0,006***
|
|
une ou deux injections antitétaniques
|
100,35
|
|
Au moins 3 injections antitétaniques
|
83,70
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
Aucune injection antitétanique
|
126,36
|
0,00***
|
|
une ou deux injections antitétaniques
|
80,75
|
|
Au moins 3 injections antitétaniques
|
88,37
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
*** significatif au seuil de 1%
|
On remarque une forte corrélation entre le nombre
d'injections antitétanique reçues par la mère au cours de
la grossesse et la mortalité des enfants de moins d'un an (tableau 4.3).
Les enfants dont les mères n'ont reçu aucune injection
antitétanique au cours de la grossesse courent presque deux fois plus de
risque de mortalité que ceux dont les mères ont eu au moins trois
injections et cela quelque soit la période d'étude. Ce risque va
en diminuant dans le temps, il était de 126,36(%o) entre 1988 et 1993 et
atteint 116,86(%o) entre 1999 et 2003. Par contre, il n'existe, quelque soit la
période d'étude que nous avons considéré ici,
presque pas de différence significative de mortalité entre les
enfants dont les mères ont reçu respectivement une ou deux
injections antitétaniques et au moins trois injections
antitétaniques. Ce qui importe plus pour la survie des enfants, c'est de
tout faire pour recevoir au moins une injection antitétanique au cours
de la grossesse.
Toutes choses étant égale par ailleurs,
l'injection antitétanique permet de faire face aux facteurs
endogènes de la mortalité des enfants en bas âge. Le vaccin
antitétanique réduit donc le risque d'infection par certaines
maladies tel que le tétanos au cours de l'accouchement et durant les
premiers mois de vie de l'enfant. Dans les milieux ruraux où les
pratiques dominants prônent l'accouchement à domicile favorisant
ainsi l'infection par le tétanos néonatal, il parait important de
développer des campagnes de sensibilisation des femmes enceintes afin
qu'elles se fassent vacciner au moment de la grossesse.
4.1.4 Lieu et assistance à
l'accouchement
Les trois EDS réalisé au Burkina ont
enregistré des informations détaillées sur le lieu et
l'assistance à l'accouchement, à partir desquelles nous avons
constitué les indicateurs du lieu et d'assistance à
l'accouchement. Les effets négatifs de l'insuffisance des soins
précédemment énumérés peuvent être
atténués par un choix adéquat des conditions de
l'accouchement. Ces conditions dépendent essentiellement du lieu et de
l'assistance à l'accouchement. Le lieu de l'accouchement permet d'avoir
une idée des conditions d'hygiènes dans lesquelles a eu lieu la
naissance. Ainsi, à partir de l'indication du lieu de l'accouchement, on
distingue les enfants nés à domicile de ceux qui ont vu le jour
dans un centre de santé.
On constate que jusqu'à récemment (entre 1999 et
2003) plus de deux enfants sur cinq (45,94%) sont nés à domicile.
Cette proportion était de 63,71% entre 1988 et 1993 et de 58,78% entre
1994 et 1998. Parmi les enfants nés au cours des différentes
périodes de référence un peu plus de trois enfants sur dix
ont vu le jour dans un centre de santé entre 1988
et 1992 (32,4%) et quatre sur dix entre 1994 et 1998 et plus
d'un enfant sur deux, entre 1999 et 2003. Ces proportions ont peu varié
dans le temps. Néanmoins, on constate que les femmes accouchent de plus
en plus dans les centres de santé.
Graphique4.4: Répartition des enfants de moins d'un an
selon le lieu de l'accouchement.
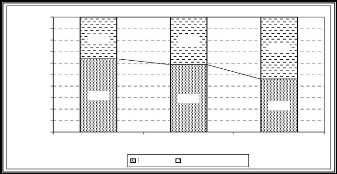
|
36,29
|
|
41,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,06
|
|
|
63,71
|
|
58,78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45,94
|
|
1992 1998 2003
Domicile Centre de santé
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Graphique4.5: Répartition des enfants selon la
qualité du personnel ayant assisté à l'accouchement
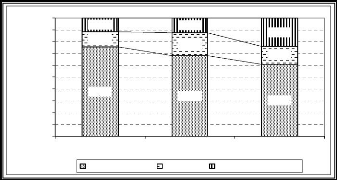
100%
40%
20%
90%
80%
70%
60%
50%
30%
10%
0%
75,53
Autre personne Personne Personnel de santé
11,67
12,80
1992 1998 2003
68,30
12,43
19,27
23,74
60,68
15,58
En ce qui concerne l'assistance à l'accouchement, on
remarque que seulement un enfant sur dix (11,67%) a
bénéficié de la supervision d'un personnel de santé
entre 1988 et 1993 contre près d'un sur quatre (23,74%) entre 1999 et
2003. La majorité des femmes qui ont une naissance entre 1988 et 1993 et
entre 1994 et 1998 ont préféré être seule au moment
de la délivrance (12,80% entre 1988 et 1993 et 19,27% entre 1994 et
1998) ou être assistées par d'autres personnes telles que les
accoucheuses traditionnelles et leurs parents ou amis
(75,53% entre 1988 et 1993 et 68,30% entre 1994 et 1998). La
pratique dominante est alors l'assistance d'autres personnes telles que les
accoucheuses traditionnelles, les parents et amis de la parturiente. Tout comme
le lieu de l'accouchement, les femmes ont recourt de plus en plus aux
personnels de santé pendant l'accouchement.
On remarque une forte corrélation entre le lieu de
l'accouchement et la mortalité infantile (Tableau 4.4). Les enfants
nés a domicile cours plus de risque de décès que ceux
nés dans un centre de santé cela quelque soit la période
d'étude considérée. Ce constat confirme les observations
faites par plusieurs études menées en Afrique et mettant l'accent
sur l'efficacité des centre de santé à réduire, en
dépit de leurs insuffisance, le risque d'infection par certaines
maladies au cours de l'accouchement. On remarque par ailleurs, que les
écarts de risque de décès ne se sont pas significativement
réduits au cours du temps.
On note également qu'en contrôlant le milieu de
résidence, les enfants qui ont vu le jour à domicile courent plus
de risque de décéder en milieu rural qu'en milieu urbain (74,06%
contre 101,34% en 2003 par exemple) (Annexe 2). On fait également le
même constat en ce qui concerne le niveau d'instruction. En effet, on
remarque que les enfants né à la maison et des mères sans
niveau courent plus de risque (100,88% en 2003) que ceux issus des mères
de niveau primaire ou plus (96,69% pour le niveau primaire et 51,91% pour le
niveau secondaire ou plus en 2003) (Annexe 2).
Tableau 4.4: Evolution de la variation du risque
de mortalité infantile selon le lieu d'accouchement
|
Période
|
Lieu d'accouchement
|
Risque de
décéder (%)
|
Probabilité
du Khi-deux
|
|
2003
|
Domicile
|
105,57
|
0,001***
|
|
Centre de santé
|
82,54
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
Domicile
|
119,48
|
0,0031***
|
|
Centre de santé
|
88,10
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
Domicile
|
110,57
|
0,02**
|
|
Centre de santé
|
83,90
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
*** significatif au seuil de 1% ** significatif au seuil de 5%
|
L'effet positif de l'accouchement dans les services de
santé sur la chance de survie des enfants de moins d'un an pourrait
s'expliquer par les conditions hygiéniques et la qualité du
personnel superviseur du travail d'accouchement, toutes choses étant
égales par ailleurs. En effet, dans les établissements de
santé, la plupart des pratiques traditionnelles utilisées pour
extraire l'enfant au moment de l'accouchement et pour couper le cordon
ombilicale sont interdites à cause justement de la
légèreté des soins y afférents. Le personnel de
santé suit de près l'évolution de la grossesse et de
l'accouchement et administre les différents soins nécessaires au
bon déroulement de toutes les opérations ayant trait à
l'accouchement
Tableau 4.5: Evolution de la variation du risque de
mortalité infantile selon l'assistance à l'accouchement
|
Période
|
Assistance à l'accouchement
|
Risque de
décéder (%o)
|
Probabilité
du Khi-deux
|
|
2003
|
Personne
|
100,82
|
0,23 (ns)
|
|
Autre personne
|
92,96
|
|
personnel de santé
|
89,50
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
Personne
|
138,53
|
0,17 (ns)
|
|
Autre personne
|
105,07
|
|
personnel de santé
|
98,09
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
Personne
|
113,82
|
0,71 (ns)
|
|
Autre personne
|
111,69
|
|
personnel de santé
|
95,72
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
Ns non significatif au seuil de 10%
|
Concernant l'assistance à l'accouchement, on remarque
une corrélation non significative entre cette variable et le risque de
mortalité infantile. On constate un écart de risque de
décès entre les enfants nés dans un centre de santé
sous la supervision probable d'un personnel médical et les autres.
En définitive, l'explication qu'on serait tenté
de donner à la baisse de la mortalité infantile est la
vaccination antitétanique des femmes enceintes à travers les
visites prénatales. En effet, les pratiques d'accouchement et
d'assistance à l'accouchement n'ont pratiquement pas changé
depuis 1988 au Burkina Faso. La grande majorité des femmes accouchent
toujours dans leur domicile (toujours 56,5% entre 199 et 2003), sans aucune
aide médicale ou paramédicale (toujours 61% ont
préféré être seule au moment de la délivrance
ou être
assistées par d'autres personnes telles que les
accoucheuses traditionnelles et leurs parents). Il est donc peu probable que
les décès néonatals dus aux difficultés de la
grossesse ou de l'accouchement aient diminuées. Le principal changement
a été le recours massif à au moins une consultation
médicale au cours de la grossesse qui a probablement induit un recours
massif à la vaccination antitétanique chez les femmes enceintes.
Cette situation dépendrait non seulement, de leur perception du
système traditionnel de soins, mais également de leur
capacité de se détacher des rites ou des habitudes
traditionnelles ainsi que de leur situation économique. Ces derniers,
eux-mêmes, pourraient dépendre de l'amélioration de
l'instruction des femmes et la promotion des valeurs modernes.
4.2. Vaccination des enfants et mortalité
infantile
Hormis les soins prénatals, la vaccination constitue un
élément prépondérant pour la préservation de
la santé et de la réduction du risque de mortalité des
enfants. Après leur naissance, les enfants doivent
bénéficier de soins qui permettront de préserver leur
santé contre un certain nombre de maladies. Cette préservation se
fait sous forme de vaccination. En effet, l'OMS recommande un programme
élargi d'immunisation des enfants avant leur premier anniversaire contre
les différentes maladies de l'enfance. Ce programme élargi de
vaccination (PEV) de l'organisation Mondiale de la Santé, simple et
efficace, programme qui a débuté au Burkina Faso en juin 1980,
permet de tenir en échec six maladies infectieuses meurtrières
(tuberculose, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite
et rougeole) et par conséquent de réduire d'une façon
significative la mortalité des enfants. La vaccination des enfants en
bas âge contre les six principales maladies de l'enfance constitue un
pilier majeur de l'action entreprise en faveur de la santé de
l'enfant.
Nous appréhendons ici, l'effet de la vaccination
à travers les types de vaccins et le nombre de vaccins reçus
avant le premier anniversaire. L'enquête a permis de connaître les
différents types de vaccins reçus par les enfants nés au
cours des cinq dernières années ayant
précédées les trois enquêtes
considérées. Nous avons crée, à partir de ces
informations, un indicateur relatif au statut vaccinal de l'enfant pour chaque
type de vaccin. Les principaux types de vaccins retenus sont le BCG, le DTP, la
rougeole et la poliomyélite. Nous avons constitué ces
différentes variables en tenant compte du fait que l'enfant ait
reçu ou non le vaccin en question, quel que soit le nombre d'injections
administrées.
4.2.1 Vaccination BCG
Les nouveaux nés sont susceptibles de recevoir le BCG
et bénéficier éventuellement de la vaccination
antitétanique de leur mère. On remarque que la couverture
vaccinale en BCG a peu varié entre 1988 et 2003. Cependant, en moyenne
quatre enfants burkinabés sur cinq nés entre 1988 et 2003 ont
été vaccinés contre la tuberculose (81,14% entre 1988 et
1992, 74,46% entre 1994 et 1998, 81,77% entre 1999 et 2003). La proportion
d'enfants vaccinés contre la tuberculose varie selon le milieu de
résidence et le niveau d'instruction de la mère. Les pourcentages
des enfants vaccinés passent de 94,6% en ville à 79,4% en milieu
rural, entre 1999 et 2003, de 95,3% à 66,1% entre 1994 et 1998, enfin de
81,8% en ville à 53.2% en milieu rural entre 1988 et 1993. Il en est de
même pour le niveau d'instruction de la mère. Plus de neuf enfants
sur dix (97,1%) nés des mères ayant le niveau secondaire ou plus
ont été vaccinés contre six enfants sur dix (61.2%)
nés des mères sans niveau au cours de la période
1999-2003. Le constat est pratiquement le même pour les autres
périodes. Cette situation peut s'expliquer par d'une part la
disponibilité des infrastructures sanitaires en milieu urbain et d'autre
part, par le fait que non seulement les femmes instruites (du fait de
l'instruction) prennent conscience de la santé de leurs enfants mais
aussi par le fait que la majeure partie des femmes instruites vivent en milieu
urbain.
Graphique4.6 : Répartition des enfants selon la
vaccination contre le BCG
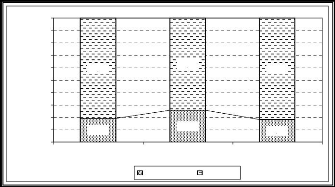
100%
40%
90%
80%
70%
60%
50%
30%
20%
10%
0%
81,14
18,86
1992 1998 2003
Non vacciné Vacciné
25,54
74,46
81,77
18,23
Le tableau 4.6 semble donner raison aux mères ayant
vacciné leurs enfants contre la tuberculose avant le premier
anniversaire. On remarque une forte association entre la vaccination contre la
tuberculose et le risque de mortalité infantile. L'écart de
risque de
mortalité entre les enfants vaccinés et ceux non
vaccinés va en diminuant dans le temps. Toutes choses égales par
ailleurs, entre 1988 et 1993, les enfants non vaccinés avaient
près de six fois plus de risque de décéder que ceux
vaccinés (303,28%o contre 44,5%o) (Tableau 4.6). Ce désavantage
était près trois fois entre 1994 et 1998 et seulement de 1,5 fois
entre 1999 et 2003.
Tableau 4.6 : Evolution de la variation du
risque de mortalité infantile selon la vaccination contre la
tuberculose.
|
Période
|
Vaccination BCG
|
Risque de
décéder (%o)
|
Probabilité du
Khi-deux
|
|
2003
|
non vacciné
|
114,55
|
0,00***
|
|
vacciné
|
78,36
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
non vacciné
|
133,28
|
0,00***
|
|
vacciné
|
49,07
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
non vacciné
|
303,28
|
0,0001***
|
|
vacciné
|
44,50
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
*** significatif au seuil de 1%
|
Par ailleurs, on constate qu'en contrôlant le milieu de
résidence, en milieu rural, les enfants qui ont reçu le vaccin
contre la rougeole courent plus de risque que les enfants non vaccinés.
Le constat est le même pour les enfants nés de mères sans
niveau, quand on contrôle le niveau d'instruction (Annexe 5). En outre,
lorsqu'on contrôle la religion, on remarque que les enfants non
vacciné nés des mères musulmanes ont plus de risque de
décéder avant le premier anniversaire que les autres. Cette
situation peut s'expliquer par le fait que les femmes sans niveau vivant pour
la plupart du temps en milieu rural ont des comportements en matière
d'hygiène qui ne favorise pas l'effet bénéfique de la
vaccination.
4.2.2 Vaccination DTP
Tout comme la vaccination contre la tuberculose, la couverture
vaccinale de la vaccination contre la diphtérie n'a pas varié
significativement entre 1988 et 2003. La proportion des enfants vaccinés
varie entre 76,62% entre 1999 et 2003 et 72,71% entre 1988et 1993.
Graphique4.7: Répartition des enfants de moins d'un an
selon la vaccination contre la diphtérie.
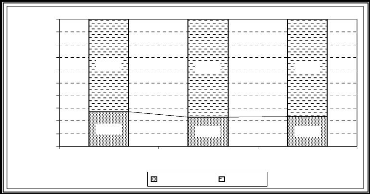
100%
40%
20%
90%
80%
70%
60%
50%
30%
10%
0%
27,29
72,71
1992 1998 2003
Non vaccine Vaccine
23,18
76,82
23,38
76,62
On remarque une forte corrélation entre la vaccination
contre la diphtérie et le risque de mortalité infantile.
L'écart de risque de mortalité entre les enfants vaccinés
et ceux non vaccinés va en diminuant dans le temps. Toutes choses
égales par ailleurs, entre 1988 et 1993, les enfants non vaccinés
avaient près de huit fois plus de risque de décéder que
ceux vaccinés (256,45%o contre 33,41%o) (Tableau 4.7). Ce
désavantage était de 1,6 fois entre 1994 et 1998 (114,44%o contre
90,86%o) et près de 1,7 fois entre 1999 et 2003 (124,02%o contre
74,36%o).
Tableau 4.7: Evolution de la variation du risque de
mortalité infantile selon la vaccination contre la diphtérie
|
Période
|
vaccination DTP
|
Risque de
décéder (%o)
|
Probabilité
du Khi-deux
|
|
2003
|
non vacciné
|
124,02
|
0,00'K'K'K
|
|
vacciné
|
74,36
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
non vacciné
|
114,44
|
0,00'K'K'K
|
|
vacciné
|
90,86
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
non vacciné
|
256,45
|
0,00'K'K'K
|
|
vacciné
|
33,41
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
'K'K'K significatif au seuil de 1%
|
4.2.3 Vaccination rougeole
La vaccination contre la rougeole, disponible depuis 1963,
constitue l'une des actions les plus efficaces moins onéreuses pour
réduire la morbidité et la mortalité infantile. C'est l'un
des constats du programme élargi de vaccination (PEV), initié en
1974 sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Dans le cadre du PEV, d'énormes efforts ont été
déployés au cours de ces vingt dernières années,
notamment par l'UNICEF, en vue de vacciner les enfants avant leur premier
anniversaire et augmenter la couverture vaccinale mondiale.
La vaccination contre la rougeole semble être moins
répandue que celles contre la tuberculose et la diphtérie au
Burkina Faso. Un peu plus d'un enfant sur deux a été
vacciné contre la rougeole entre 1988 et 1993 (54,08%) et entre 1994 et
1998 (57,25%), trois enfants sur cinq l'ont été entre 1999 et
2003 (62,25%) avant leur premier anniversaire (figure4.8). On remarque
également une variation importante des proportions des enfants
vaccinés contre la rougeole parmi les enfants nés entre 1988 et
2003 comparativement aux vaccins contre la tuberculose et la
diphtérie.
Cette situation peut s'expliquer par le fait que dès
que la vaccination contre la rougeole a été proposée pour
la première fois dans une population en Afrique (au Burkina Faso en
1961), elle a été acceptée sans réserve, car au
niveau des mères comme de la communauté, tous avaient
éprouvé la gravité de cette maladie. Au constat de son
efficacité, la vaccination contre la rougeole a été
considéré comme un nouveau pouvoir protecteur, à
l'instar des «protecteurs» traditionnels (amulettes, etc.) et
sans doute plus puissant (Cantrelle.P et Locoh.T, 1990). En plus, les essais
actuels en situation d'un vaccin précoce chez l'enfant de 4 mois au lieu
de 9 mois, peut également permettre d'améliorer la couverture
vaccinale. Ces essais laissent espérer la possibilité d'une
nouvelle étape dans la lutte contre cette affection.
Graphique4.8: Répartition des enfants de moins d'un an
selon la vaccination contre la rougeole
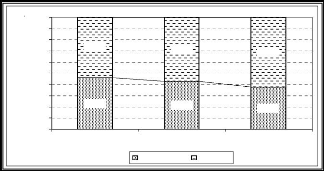
1992 1998 2003
|
54,08
|
|
57,25
|
|
62,36
|
|
|
45,92
|
|
42,75
|
|
37,64
|
|
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Non vaccine Vaccine
Tableau 4.8: Evolution de la variation du risque de
mortalité infantile selon la vaccination contre la rougeole
|
Période
|
Vaccination contre la
rougeole
|
Risque de
décéder (%o)
|
Probabilité du
Khi-deux
|
|
2003
|
non vacciné
|
116,43
|
0,00***
|
|
Vacciné
|
80,16
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
non vacciné
|
133,16
|
0,00***
|
|
Vacciné
|
93,54
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
non vacciné
|
200,41
|
0,00***
|
|
vacciné
|
16,98
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
*** significatif au seuil de 1%
|
Le tableau 4.8 montre une forte corrélation entre la
vaccination contre la rougeole et la mortalité des enfants en bas
âge (mortalité infantile).Entre 1988 et 1993, les enfants non
vaccinés contre la rougeole avaient près de douze fois plus de
risque de décéder que ceux vaccinés (200,41%o contre
16,98%o) (Tableau 4.8). Ce désavantage était de 1,4 fois entre
1994 et 1998 (133,16%o contre 93,54%o) et entre 1999 et 2003 (7,3 contre 2,8).
Ce constat amène à penser qu'une vaccination massive des enfants
contre la rougeole pourrait améliorer positivement la survie des enfants
avant le premier anniversaire.
Toutes choses égales par ailleurs, la vaccination contre
la rougeole semble contribuer de façon sensible à la baisse de la
mortalité infantile au Burkina Faso.
4.2.4 Vaccination poliomyélite
La figure 4.9 montre que plus de huit enfants sur dix ont
été vaccinés contre la poliomyélite entre 1999 et
2003 (85,57%), contre huit enfants sur dix entre 1994 et 1998 (79,24%) et sept
enfants sur dix entre 1988 et 1993 (73,72%). On remarque en plus que les
enfants non vaccinés proviennent majoritairement des mères
résidents en milieu rural et sans niveau d'instruction. On devrait
pourtant s'attendre à ce que le taux de couverture en
poliomyélite ne soit pas tellement fonction de ces variables
précitées car l'administration de ce vaccin est assurée
par des équipes mobiles au Burkina Faso. Cette stratégie devait
permettre de mieux répondre aux besoins en vaccination des enfants en
milieu rural et des enfants dont les mères sont réfractaires
à l'utilisation des services de santé.
Graphique4.9: Répartition des enfants selon la vaccination
contre la poliomyélite
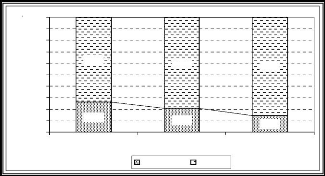
100%
40%
90%
80%
70%
60%
50%
30%
20%
10%
0%
|
73,72
26,28
|
|
79,24
20,76
|
|
85,57
14,43
|
|
1992 1998 2003
Non vaccine Vaccine
Tableau 4.9: Evolution de la variation du risque
de mortalité infantile selon la vaccination contre la
poliomyélite
|
Période
|
Vaccination contre la
Poliomyélite
|
Risque de
décéder (%o)
|
Probabilité du
Khi-deux
|
|
2003
|
non vacciné
|
131,63
|
0,00***
|
|
Vacciné
|
77,53
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
non vacciné
|
113,99
|
0,00***
|
|
Vacciné
|
89,86
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
non vacciné
|
264,16
|
0,00***
|
|
vacciné
|
33,27
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
*** significatif au seuil de 1%
|
Le tableau 4.9 montre une association significative entre la
vaccination contre la poliomyélite et la mortalité infantile. Les
enfants non vaccinés contre la poliomyélite présentent un
risque de mortalité plus élevé que leurs camarades qui ont
reçu ce vaccin. En effet, le risque de décédés est
de 33,27%o pour les enfants vaccinés contre 264,16%o entre 1988 et 1993,
ce risque est de 89,86%o contre 133,99%o entre 1994 et 1998 et de 77,53%o
contre 131,63%o entre 1999 et 2003.
En définitive, la couverture vaccinale varie selon le
milieu de résidence et le niveau d'instruction de la mère. Ces
résultats confirment les conclusions avancées par plusieurs
études en matière de fréquentation des services de
santé par les femmes. Le niveau d'instruction imprime à la femme
un comportement favorable à l'utilisation des services de santé
modernes et le milieu de résidence influence l'accessibilité
géographique des centres médicaux. L'accès
différentiel des enfants à la vaccination semble induire une
nette discrimination en matière de mortalité. Mais la vaccination
reste un moyen efficace de lutte contre la mortalité infantile. Quelque
soit le milieu de résidence et le niveau d'instruction de la
mère, la vaccination reste efficace pour réduire le risque de
mortalité des enfants. Son association avec une nutrition saine et
complète est encore plus bénéfique pour assurer la survie
des enfants.
4.3. Pratiques nutritionnelles des mères et
mortalité infantile
Outre les pratiques des mères en matière de
soins prénatals et de vaccination de l'enfant, les pratiques
nutritionnelles des mères sont également importantes pour la
survie de l'enfant. Les variables retenues pour appréhender l'effet de
la nutrition sur la mortalité infantile concernent la durée
d'allaitement et le poids de l'enfant à la naissance.
4.3.1 Durée d'allaitement
Parmi les risques concernant la préservation de la
santé, l'allaitement au sein maternel est probablement le plus
universellement encouragé. Il est aussi celui dont l'évolution
pourrait remettre en cause la santé des enfants. L'effet positif de
l'allaitement sur la survie des enfants n'est plus à démontrer et
constitue l'argument sur lequel on se base pour organiser la lutte contre la
tendance à le remplacer par une alimentation artificielle. L'allaitement
maternel protège l'enfant contre la malnutrition et les agressions du
milieu pathogène au cours du premier semestre de la vie.
Graphique4.10: Répartition des enfants selon la
durée d'allaitement au sein
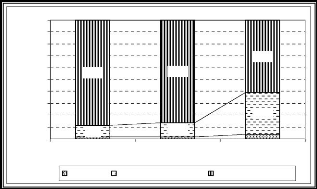
1992 1998 2003
|
|
88,39
|
|
|
|
86,67
|
|
|
|
60,66
|
|
|
|
35,79
|
|
11,60
|
|
9,85
|
|
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Non allaité Allaité moins 6 de mois Allaité
plus de 6mois
Tableau 4.10: Evolution de la variation du
risque de mortalité infantile selon la durée d'allaitement
|
Période
|
Durée de l'allaitement au sein
|
Risque de
décéder (%o)
|
Probabilité
du Khi-deux
|
|
2003
|
Non allaités
|
819,64
|
0,00***
|
|
Allaités pendant moins de 6 mois
|
83,16
|
|
Allaités pendant plus 6 mois
|
54,23
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
Non allaités
|
939,25
|
0,00***
|
|
Allaités pendant moins de 6 mois
|
758,19
|
|
Allaités pendant plus 6 mois
|
3,59
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
Non allaités
|
866,04
|
0,00***
|
|
Allaités pendant moins de 6 mois
|
792,82
|
|
Allaités pendant plus 6 mois
|
7,81
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
*** significatif au seuil de 1%
|
On remarque que l'allaitement exclusif au sein maternel est
très répandu au Burkina. En moyenne neuf enfants sur dix ont
été allaité au sein pendant plus de six mois entre 1988 et
1998 (86,67% entre 1994 et 1998, 88,39% entre 1988 et 1993) et seulement six
enfants sur dix l'ont été entre 1999 et 2003 (60,66%). Ceci
montre que les femmes allaitent de moins en moins pendant longtemps leurs
enfants au Burkina Faso.
On constate une forte association entre la durée
d'allaitement et la mortalité infantile. On remarque que les enfants non
allaités présentent un risque de mortalité, avant le
premier
anniversaire, plus important que ceux qui ont
bénéficié du lait maternel pendant moins de six mois
(819,64%o) pour les enfants non allaités contre 83,16%o pour ceux qui
ont été allaité pendant moins de six mois, pour la
période de 1999-2003). Par contre, une durée d'allaitement de six
mois ou plus est associée à un risque de mortalité
très réduit (54,23%o entre 1999 et 2003, 3,59%o entre 1994 et
1998 et 7,81%o entre 1988 et 1993).
4.3.2 Poids de l'enfant à la naissance
Comme pour la vaccination, le poids de l'enfant à la
naissance est un indicateur de santé de l'enfant et de l'état de
la nutrition de la mère pendant la grossesse. En effet, une mère
qui a eu une alimentation adéquate pendant sa grossesse est susceptible
d'avoir un enfant de poids normal (poids moyen) à la naissance. Il est
également probable qu'un enfant de faible poids à la naissance
soit perçu par sa mère comme étant relativement fragile et
bénéficie de ce fait d'une durée d'allaitement plus
longue.
Lors des trois enquêtes, il a été
demandé aux femmes ayant accouché au cours de la période
d'étude de donner une estimation du poids à la naissance de leurs
enfants. Faute de pouvoir estimer le poids de la mère au moment de la
grossesse, nous avons constitué un indicateur de la qualité de la
nutrition de la mère à partir des informations recueillies sur le
poids de leurs enfants à la naissance.
On constate qu'au cours des trois périodes, en moyenne
sept enfants sur dix son nés avec un poids moyen (72,9% entre 1988 et
1992, 70,4% entre 1994 et 1998, 72,98% entre 1999 et 2003) (Figure4.11), contre
en moyenne 14% présentant un poids élevé et un faible
poids. Se référant aux études mettant en évidence
les effets de la nutrition de la mère sur le poids à la naissance
des enfants, on peut dire que qu'une forte proportion des femmes enceintes
(72,9% entre 1988 et 1992, 70,34% entre 1994 et 1998, 72,98% entre 1999 et
2003) présentent une bonne nutrition pendant la grossesse.
Graphique4.11 : Répartition des enfants de moins d'un an
selon le poids à la naissance
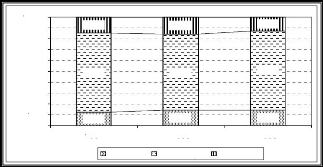
100%
40%
90%
80%
70%
60%
50%
30%
20%
10%
0%
|
14,68
|
15,65
|
|
12,67
|
|
|
72,90
|
|
70,34
|
|
72,98
|
|
|
12,42
|
|
14,01
|
|
14,35
|
|
1992 1998 2003
Petit poids Poids moyen Gros poids
Tableau 4.11: Evolution de la variation du
risque de mortalité infantile selon le poids à la naissance
|
Période
|
Poids à la naissance
|
Risque de
décéder (%o)
|
Probabilité
du Khi-deux
|
|
2003
|
Petit poids
|
129,48
|
0,00***
|
|
Poids moyen
|
57,13
|
|
Gros poids
|
37,89
|
|
Ensemble
|
81,01
|
|
1998
|
Petit poids
|
89,69
|
0,00***
|
|
Poids moyen
|
67,76
|
|
Gros poids
|
62,86
|
|
Ensemble
|
105,18
|
|
1992
|
Petit poids
|
147,88
|
0,00***
|
|
Poids moyen
|
40,96
|
|
Gros poids
|
36,47
|
|
Ensemble
|
95,11
|
|
*** significatif au seuil de 1%
|
On constate que le poids à la naissance est
significativement associé au risque de mortalité infantile
(Tableau4.11). Notre hypothèse concernant le poids de l'enfant à
la naissance était que les parents auraient tendance à donner
plus de soins, donc à réduire le risque de mortalité,
à un enfant né avec un petit poids afin de compenser dans une
certaine mesure son désavantage pondéral. En fait, les
résultats semblent indiquer exactement le contraire. Les naissances
hypotrophiques sont significativement moins susceptibles de survivre que les
enfants de poids normal à la naissance, toutes choses étant
égaies par ailleurs. En effet, durant la période de
référence, les enfants de faible poids présentent le
risque de mortalité plus élevé. Le risque de
mortalité des enfants né avec un faible poids est de deux
fois plus élevé que celui de leurs
congénères ayant un poids moyen, entre 1999 et 2003, de 1,3 fois
plus élevé entre 1994 et 1998 et de 3,6 fois plus
élevé entre 1988 et 1992. Il existe également une
légère différence de risque de mortalité entre les
enfants présentant un poids élevé et ceux nés avec
un poids moyen en faveur des derniers.
Plusieurs raisons peuvent expliquer le risque de
mortalité élevé chez les enfants de faible poids. Non
seulement ces enfants sont fragile, mais il est possible, par exemple, que la
crainte des effets secondaires parfois observés à la suite d'une
vaccination, amène les parents à remettre à plus tard la
vaccination de l'enfant qu'ils considèrent comme étant
relativement fragile. On peut se demander si ce comportement à l'endroit
des naissances de petit poids n'accroît pas dans une certaine mesure
leurs risques de décès.
4.4 Variation de la mortalité infantile selon les
pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère
Dans ce paragraphe nous nous proposons d'étudier les
tendances de la mortalité infantile en fonction des pratiques
préventives en matière de soins de santé, des
caractéristiques d'identification sociale de la mère et de
quelques variables liées au contexte. Ainsi, nous allons identifier les
tendances de la mortalité infantile, c'est-à-dire les relations
qui existeraient entre certaines variables relatives aux pratiques en
matière de soins préventifs, les caractéristiques de la
mère et la mortalité infantile. L'analyse factorielle des
correspondances multiples va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les
relations entre ces différentes variables selon les trois
périodes d'étude retenues.
Brièvement, l'analyse factorielle des correspondances
multiples est une technique d'analyse d'interdépendances entre des
variables qu'on veut analyser simultanément. Cette technique n'impose
aucune contrainte au niveau de la taille de l'échantillon et du nombre
de variables.
4.4.1 Variation de la mortalité infantile selon
les pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1998
et 2003
Les résultats de l'analyse factorielle des
correspondances multiples (AFCM) montrent une concentration relative des
variables relatives à la vaccination. On note que ces dernières
avec l'injection antitétanique pendant la grossesse (auij : aucune
injection), le milieu
résidence (rur : milieu rural), le niveau d'instruction
(auin : sans niveau d'instruction), la durée d'allaitement (nall : non
allaités), l'ethnie (peul et mossi) et l'occupation (travaillant hors du
domicile sont plus proches des décès (dec). Le rapprochement de
ces variables montre une forte association entre celles-ci et le
décès infantile
Il s'en suit que ces variables influencent la survie des
enfants de moins d'un an au Burkina Faso entre 1999 et 2003. Ainsi, les
décès sont plus important chez les enfants qui ne sont pas
vaccinés contre la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie
et la tuberculose, non allaités, nés des mères qui n'ont
reçu aucune injection antitétanique pendant la grossesse, sans
niveau d'instruction et/ou vivant en milieu rural, appartenant à
l'ethnie peul, mossi ou lobi et travaillant hors du domicile. Par contre les
enfants dont les mères vivent en milieu urbain (urb), ayant le niveau
d'instruction secondaire et plus (seco) et même primaire, travaillant
pour son propre compte ou à domicile (elme, fami) sont moins
exposés au risque de mortalité.
Graphique4.12: Variation de la mortalité infantile selon
les pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1998
et 2003
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
+ 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 1
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
AGE1! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
FAMI ! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 1
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 1
|
01
|
|
!
|
|
|
PERS
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
AGE2
|
|
VI12
|
|
! 3
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
----
|
|
|
|
|
|
|
|
+ 0 0
|
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
PLU6
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
ELME
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
AGE3
|
|
|
|
|
|
AUCV
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
DOME
|
|
|
AUTR
|
|
|
! 1
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
!
|
|
|
|
|
|
|
|
! 0
|
01
|
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
+ 0
|
01
|
SECO
!
!
!
!
!
!
!
!
URB
!
!
PPOI
MPOI
!
!
PRIMCENT
!
!
!
VIA3
BODI
! P3VI
!
!
IN12
!
!
MUSU
! GOUR
ROUG
!
POLICHRE
MOSI
! MOI6
!
! AURL HORS
! AUIN

NALLRUR DEC-
! AUIJ !
! PEUL
!
! GOUM
! NSPA
!
!
!
SANT
!
!
!
!
!
!
!
! AUCM
+
NOMBRE DE POINTS SUPERPOSES : 7
GPOI(PPOI) IN3P(IN12) VIP3(MUSU) BCG (ROUG) DTP (ROUG) AETH(ROUG)
LOBI(PEUL)
4.4.2 Variation de la mortalité infantile selon
les pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1993
et 1998
L'examen du plan factoriel montre une forte association entre
le risque de décès et le fait de vivre en milieu rural (du fait
de la superposition de rur et dec). Sur le plan factoriel, on peut noter une
répartition concentrée des variables relatives aux soins
prénataux, à la vaccination, au niveau d'instruction et à
l'ethnie. Ainsi les variables modalités rur (pour milieu rural), aucv
(pour aucune visite prénatale), nall (pour non allaité), auin
(pour sans niveau d'instruction), aurl (pour autre religion) sont plus proches
de la variable décès. Cela traduit une mortalité infantile
élevée en milieu rural, chez les enfants dont les mères
n'ont eu recours à aucune visite prénatale pendant la grossesse.
Le fait que la mère soit sans niveau d'instruction et appartiennent
à d'autres religions traduit le même constat. En d'autres termes,
les enfants dont les mères n'ont eu recours à aucune visite
prénatale et ceux qui n'ont pas été vaccinés contre
la rougeole, la diphtérie, le BCG sont soumis un risque de
mortalité infantile élevé. Il en est de même pour
les enfants non allaités et dont les mères sont sans niveau
d'instruction et vivent en milieu rural.
Graphique4.13: Variation de la mortalité infantile selon
les pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1993
et 1998
+---SECO----+ + 0 01
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 1
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 1
|
|
!
|
|
|
|
HORS! 0
|
|
!
|
|
|
P3VI CENT
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 1
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
AGE2
|
ELME
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 1
|
|
!
|
|
|
|
! 3
|
|
!
|
|
|
|
! 1
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
|
|
|
+ 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 1
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 1
|
|
!
|
|
|
|
AGE1! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 1
|
|
!
|
|
|
AGE3
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
FAMI
|
! 0
|
|
!
|
|
|
PERS
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 0
|
|
!
|
|
|
|
! 1
|
|
+
|
|
|
|
+ 0
|
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
! ! ! ! URB
! MPOI
PLU6
PPOI
! ! ! PRIM
! ! MOI6
IN3P
IN12
VI12
MUSU
! CHRE
SANT
DTP
POLI
+
MOSI AUCV !
AURL

! RUR
! PEUL
! NSPA
DOME
! AUIJ
! ! ! ! LOBI
! AUCM
+
NOMBRE DE POINTS SUPERPOSES : 12
GPOI(PPOI) VIA3(PRIM) VIP3(IN3P) BODI(CHRE) ROUG(SANT) BCG (SANT)
AETH(SANT) GOUR(DTP) AUIN(AURL) DEC (RUR) GOUM(PEUL) NALL (poli)
4.4.3 Variation de la mortalité infantile selon
les pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1988
et 1993
Le plan factoriel montre que les variables modalités
proches de la variable décès sont rur (pour milieu rural), auin
(aucune instruction), auij (aucune injection antitétanique pendant la
grossesse), peul, goum, aeth (pour respectivement peul, gourmantché et
autre ethnie). Ce
rapprochement de ces modalités avec le décès
infantile renseigne que le risque de décès est
élevé dans ces modalités.
Graphique4.14: Tendance de la mortalité infantile selon
les pratiques en matière de soins préventifs et les
caractéristiques d'indentification sociale de la mère entre 1993
et 1998
+ HORS + + 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! SECO ! 0 01
! ! GPOI ! 0 01
! ! PPOI ! 0 01
! ! MPOI ! 2 01
! ! PLU6 ! 0 01
! CENT ! PRIM ! 0 01
! P3VI ! MOI6 ! 0 01
! ELMEAGE2! VI12 ! 1 01
! ! IN3P ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! IN12 ! 1 01
! ! ! 0 01
! ! LOBIROUG! 3 01
! ! BODIPERS! 0 01
+ ---- GOUR+ 0 0
! ! MUSU! 1 01
! ! AETH ! 0 01
! ! AUIN! 0 01
! ! GOUM! 0 01
! ! ! 0 01
! ! PEUL! 1 01
! AGE3 ! RUR! 0 01
! ! AUIJ ! 0 01
! ! ! 0 01
AGE1 ! ! 0 01
! Sant ! ! 0 01
! ! NSPA! 0 01
! ! DOME ! 0 01
! ! ! 1 01
! ! ! 0 01
FAMI ! ! 0 01
! ! AUCV ! 0 01
! ! AUCM! 1 01
+ + + 0 01
NOMBRE DE POINTS SUPERPOSES : 11
URB (MPOI) VIA3 (MPOI) VIP3 (VI12) CHRE (IN12) BCG (ROUG) POLI
(ROUG) DTP (ROUG) MOSI (MUSU) DEC (PEUL) AURL (AUIJ) NALL (AUCM)
Synthèse partielle
Dans ce chapitre, nous avons évalué
l'évolution et le lien entre certaines pratiques préventives en
matière de soins de santé et le risque de mortalité
infantile. Nous avons dégagé les tendances
générales du phénomène étudié. A ce
niveau, les variables proches telles que les soins prénataux, la
nutrition et la vaccination semblent être les médiateurs par
lesquels s'effectue l'action des caractéristiques d'identification
sociale de la mère (milieu de résidence et niveau d'instruction
de la mère, l'ethnie, l'occupation).
CONLUSION GENERALE
A la fin de cette étude, nous ne prétendrons pas
avoir relevé tous les facteurs de risque pour la mortalité
infantile, ni avoir soulevé toutes les inégalités sociales
en matière mortalité des enfants, mais nous avons essayé
de contribuer à la connaissance du phénomène. Il
apparaît alors que l'amélioration des soins préventifs
contribue pour une large part dans la baisse du niveau de mortalité
infantile. De prime abord, cela parait évident pour l'observateur de
santé, mais il demeure essentiel pour le planificateur de la
santé publique de bien cibler les types d'actions à entreprendre
pour atteindre ses objectifs.
Certes, la connaissance des facteurs de risque de
mortalité infantile est pertinente pour elle-même mais elle doit
l'être aussi pour l'action qu'elle induit. La connaissance nous situe au
niveau de la population et de la santé, alors que l'action nous situe au
niveau de l'élaboration d'une politique de santé visant
l'amélioration de l'état de santé de la population et la
réduction des disparités et des inégalités entre
les différentes couches sociales.
L'objectif de cette étude était d'abord
d'identifier, dans l'environnement économique et culturel, les
principaux facteurs préventifs en matière de santé qui
sont à l'origine de la baisse de la mortalité infantile au
Burkina Faso. La question principale que nous sommes posée a
porté sur le rôle des soins préventifs qui ont dans la
baisse de la mortalité infantile. Il s'agissait pour nous de savoir en
quoi les comportements des mères en matière de soins
prénatals, de nutrition et de vaccination ont influencé à
la baisse la mortalité infantile au Burkina Faso.
Pour répondre à cette question, nous avons d'une
part présenté le contexte générale de
l'étude en particulier la situation sanitaire au Burkina et d'autre part
nous avons parcouru un certain nombre d'études portant sur les
différents facteurs (les soins prénataux, la nutrition, la
vaccination, les facteurs socio-économiques et démographiques) de
la mortalité des enfants et nous avons fait un tour d'horizon sur les
différentes théories explicatives de la baisse de la
mortalité. Cette revue de la littérature nous a permis
d'élaborer notre cadre conceptuel qui se réfère au
modèle mis en oeuvre par Barbieri (1991) et de formuler les
hypothèses de cette étude. Nous avons postulé que la
baisse de la mortalité infantile au Burkina Faso découle de
l'amélioration des pratiques nutritionnelles et des pratiques des soins
préventifs que les femmes apportent à leurs enfants. De
manière générale, Les femmes utilisent de plus en plus les
infrastructures de santé mises à leur disposition pour les soins
de la grossesse,
l'accouchement et la vaccination de leurs enfants. Leur
comportement nutritionnel s'est également amélioré. Ce
serait donc ces principaux changements qui expliqueraient la baisse de la
mortalité infantile au Burkina Faso. De cette hypothèse
principale nous avons déduit trois hypothèses secondaires :
H1: La baisse de la mortalité infantile découle
d'une amélioration des soins prénataux et d'accouchement. On doit
s'attendre à ce que les enfants nés de mères ayant
effectué un suivi médical régulier au cours de la
grossesse, à l'accouchement courent moins de risque de mourir avant leur
premier anniversaire que les autres.
H2: Plus la mère adopte un comportement nutritionnel
adéquat, plus élevée est la
probabilité de survie entre la naissance et le premier
anniversaire de son enfant. On s'attend à ce que :
- les mères allaitant leurs enfants exclusivement au sein
durant les six premiers mois de vie connaissent un risque de mortalité
de leurs progénitures moins élevé que les autres.
- les enfants ayant un poids moyen à la naissance courent
moins de risque de décéder avant le premier anniversaire que les
autres.
H3: Plus les enfants bénéficient des doses
normales de vaccination, moins ils courent le risque de mourir avant leur
premier anniversaire.
Nous avons utilisé les données des
Enquêtes Démographiques et de santé réalisées
en 2003, 1998 et 1992 au Burkina Faso dans cette étude. Ces trois
enquêtes ont accordé une importance particulière à
la santé familiale en général et celle des enfants en
particulier. Des questions sur le suivi médical de la grossesse et
l'accouchement, la nutrition et la vaccination des enfants ont
été posées aux femmes en âge de procréer. Ces
trois EDS ont également saisi des informations détaillées
sur les caractéristiques d'identification sociale de la femme et du
conjoint. Ces données présentent cependant quelques limites.
L'évaluation de la qualité des données nous a permis de
nous rendre compte de certaines insuffisances relatives à la
déclaration des âges de la mère, des âges au
décès des enfants et des omissions d'évènements
portant sur les naissances et les décès. Nous avons
procédé à des regroupements des femmes en des groupes
d'âges quinquennaux pour mieux évaluer la qualité des
données des trois EDS. Nous nous sommes rendu compte que les erreurs
observées ne sont de nature à empêcher l'utilisation de ces
données pour notre étude.
Les conclusions auxquelles nous avons aboutit dans cette
étude ne sont peut être pas nouvelles, mais elles apportent une
contribution complémentaire sur les variables sur lesquelles on pourrait
agir pour réduire davantage le risque de décès des enfants
de moins d'un an au Burkina Faso. Il s'agit notamment de la durée
d'allaitement, des soins prénatals et de la vaccination.
Nous avons observé dans nos analyses dans un premier
temps une corrélation entre le nombre d'injections antitétaniques
et le risque de décès des enfants avant le premier anniversaire.
Dans un deuxième temps les analyses nous ont révélé
une corrélation parfaite entre d'une part le nombre de visites
prénatales et d'autre part le lieu et l'assistance à
l'accouchement et le risque de décès infantile. Ces
présomptions de relation de causalité paraient très
plausibles. Il serait donc intéressant de mener une campagne de
sensibilisation pour amener les femmes à mieux suivre leurs grossesses
et accoucher dans les centres de santé et/ou sous la supervision d'un
personnel de santé.
Les analyses (analyses descriptives) ont montré que les
différents types de vaccins concourent énormément à
l'atténuation du risque de décès des enfants de moins d'un
an au Burkina Faso. La vaccination est une arme fondamentale contre la maladie.
Elle favorise l'acquisition d'un système immunitaire performant dans la
lutte de l'organisme de l'enfant contre les germes. Il est donc
nécessaire et urgent d'amener les parents et notamment les femmes en
âge de procréer à faire vacciné leurs enfants le
plus tôt possible.
Nous avons constaté que les enfants qui ont
bénéficié du lait maternel pendant plus de six mois
courent moins de risque de décès avant le premier anniversaire
que les autres. L'allaitement maternel procure des avantages énormes
à l'enfant. Cependant, l'action du lait maternel est surtout efficace
lorsque l'enfant est né avec un poids satisfaisant (poids moyen). A cet
effet, il est essentiel de continuer à mettre un accent particulier sur
la qualité de la nutrition de la femme pendant l grossesse et au cours
de l'allaitement.
En dépit des résultats intéressants que
nous avons obtenus, ce travail présente certaines limites qu'il convient
de souligner :
L'échantillon des femmes éligibles pour le
questionnaire individuel femme ne prend en compte que les femmes
âgées de 15 à 49 ans révolus. A supposer même
que les déclarations des âges soient exactes, on peut affirmer que
les informations saisies sur les
comportements en matières de fécondité et
de mortalité sont incomplètes car, au Burkina Faso, un nombre
important de femmes commencent leur vie procréative à moins de 15
ans. Il aurait fallut tenir compte de cette réalité sociologique,
car les indicateurs de mortalité des enfants en général et
celles de la mortalité infantile en particulier peuvent être
sous-estimés du fait de la prise en compte des enfants nés de
mères de moins de 15 ans dans cette étude.
Une autre limite provient de l'hypothèse sur les
comportements en matière de vaccination concernant les enfants
décédés. C'est vrai que la mère peut avoir le
même comportement pour les enfants survivants que pour les enfants
décédés, néanmoins, il peut arriver que du fait du
décès de l'enfant précédent, elle change de
comportement en matière de vaccination pour l'enfant survivant. Donc, le
fait d'assimiler le statut vaccinal de l'enfant survivant à l'enfant
décédé peut introduire un biais.
Les résultats de ce travail nous amènent à
formuler quelques recommandations.
Au plan politique, nous recommandons l'éducation et la
sensibilisation des femmes en âge de procréer, à travers
les CCC et la mobilisation sociale, sur les avantages du suivi médical
de la grossesse et de la vaccination de l'enfant et ceux d'une bonne nutrition
de l'enfant et de la mère. A défaut de pouvoir rehausser
rapidement le taux de scolarisation des femmes à cause peut être
de l'insuffisance des moyens disponibles, il nous semble opportun de mettre
l'accent sur la sensibilisation par les moyens moderne d'information de masse.
Les enfants doivent être vaccinés contre toutes les maladies
meurtrières de l'enfance en général et en particulier
contre la rougeole.
Au plan scientifique :
v' Il serait intéressant de mener une étude
approfondie sur le rôle des soins préventifs dans la baisse de la
mortalité infantile au Burkina Faso
v' Il serait également plus judicieux de recueillir les
informations sur les pratiques des mères en matière de
vaccination pour les enfants décédés
BIBLIOGRAPHIE
AKOTO.E.M (1985) : Mortalité infantile et
juvénile en Afrique . Niveau et caractéristiques ;
causes et déterminants. Louvain-La-Neuve. CIACO. Editeur.
Département de démographie, 237 p.
AKOTO E.M (1993): Déterminants socio-culturels de la
mortalité des enfants en Afrique noire. Hypothèses et recherche
d'explication. Louvain-La-Neuve, Academia, 269 p.
AKOTO E. M. et TABUTIN D (1989): << Les
inégalités socio-économiques et culturels devant la mort
», dans «Mortalité et Société en Afrique au
Sud du Sahara«. Ed par Pison G., Van de Walle et Sala-Diakanda. Paris,
INED, PUF, pp 35-63.
AKOTO E.M. et A. HILL (1988): << Morbidité,
malnutrition et mortalité des enfants », dans "Population et
Société en Afrique au Sud du Sahara". Ed par D. Tabutin, Paris,
Harmattan, pp 309-329.
BANQUE MONDIALE (1993) : Rapport sur le
développement dans le monde, investir dans la santé, 339
p.
BANQUE MONDIALE (1994) : Pour une meilleure santé en
Afrique, les leçons de l'expérience, Washington DC, 283 p.
BAYA BANZA (1993): Les déterminants de la
mortalité en milieu urbain au Burkina Faso : cas de Bobo-Dioulasso,
dans collection de thèse et mémoire et mémoires sur le
Sahel, 33, Université de Montréal, département de
Démographie, 295p.
BAYA BANZA (1998): Instruction des parents et survie de
l'enfant au Burkina Faso : cas de Bobo-Dioulasso, Les Dossiers du CEPED
n° 48, Paris, 27 p.
BARBIERI M. (1991): les déterminants de la
mortalité des enfants dans le tiers monde. Dossier du CEPED n°
18, Paris, 40 p.
BEGHIN (1987) : << Santé et mortalité
aux jeunes âges dans les pays en développement : les leçons
d'un colloque ». Dans << Santé et mortalité aux
jeunes âges dans les pays en développement ». Annales de la
société Belge de médecine tropicale. Vol 67, pp 31-51.
BENINGUISSE (1993) : Approvisionnement en eau et
assainissement. Effet sur la mortalité des enfants par maladies
diarrhéiques : le cas du Cameroun. Mémoire de fin
d'études, IFORD, Yaoundé, 89 p.
DACKAM R.N (1987): Causes et déterminants de la
mortalité des enfants de moins de cinq ans en Afrique tropicale.
Thèse de doctorat en démographie, Université de Paris I,
Panthéon Sorbonne, 448 p.
DACKAM N.R. (1986): « Niveau et déterminants
de la mortalité infanto-juvénile à Yaoundé »,
dans «Estimation de la mortalité du jeune enfant« (0-5
ans) ». Edition INSERM, vol n°145, pp 355-369.
DACKAM N.R. (1990): Education de la mère et la
mortalité des enfants en Afrique, Les cahiers de l'IFORD n°2,
mars 1990, 160 p.
DEGREES DU LOU A. (1996), Sauver les
enfants : le rôle de la vaccination, les études du CEPED,
n°12, Paris, 1996, 261p.
ECHARRI CANOVAS C.J (1994): Famille Statut de la femme et
santé des enfants au Mexique. Thèse de Doctorat,
Université Catholique de Louvain-La-Neuve, Juin 1994.
EVINA AKAM. (1990): Infécondité et
sous-fécondité: évaluation et recherche de facteurs. Le
cas du Cameroun, Les cahiers de l'IFORD n°1, 281 p.
GARENNE M., MAURE.B., FONTAINE.O., DIENG K et BRIEND A.
(1987): Risque de décès associés à
différents états nutritionnels chez les enfants d'âge
préscolaire, Etude réalisée à Niakhar
(Sénégal), 1983-1986, les études du CEPED n°17, 286
p.
GARENNE M. et LEROY O., (1989) << La
mortalité par tétanos néonatal: la situation à
Niakhar au Sénégal » dans : "PISON G, VAN DE WALLE,
SALA DIAKANDA.D., Mortalité et Société en Afrique au Sud
du Sahara", Travaux et documents n°124, INED, PUF, Paris, 1989,
pp153-166.
GBENYON K.J. et LOCOH T. (1989): <<
Différence de mortalité selon le sexe dans l'enfance en
Afrique au Sud du Sahara », dans "Mortalité et
société en Afrique au Sud du Sahara". Ed par Pison G., Van de
Walle et Sala-Diakanda. Travaux et Documents, cahier 124Paris, INED, PUF, pp
221-243.
GENDREAU F. et al. (1985) : Manuel de Yaoundé.
Estimations indirectes en démographie Africaine,
UIESP-IFORD-GDA, Liège, Ordisna Edtions, 276 p.
GRENIER B. et F.GOLD (1986) : << Développement et
maladies de l'enfant », Masson, Paris, 1986, 634p.
GOUJARD J. (1986): << Etude des déterminants
et facteurs de risque de la morbidité et de la mortalité
infantile. Introduction ». Dans "Estimation de la mortalité du
jeune enfant (0-5 ans)". Edition INSERM, vol n°145, pp 233-240.
HAROUNA.S. (1998) : Incidence du comportement des
mères en matière de soins préventifs sur la
mortalité des enfants au Niger Les cahiers de l'IFORD n° 22,
123p
HILL A. (1989): <<La mortalité des enfants :
niveau actuel et évolution depuis 1945 ». Dans
"Mortalité et société en Afrique au Sud du Sahara".
Travaux et Documents, cahier 124, Paris, INED, PUF, pp13-34.
LACHAUD J-P (2001): << Les déterminants de
l'évolution de la survie des enfants et la pauvreté au Burkina
Faso : une approche micro-économétrique », CED,
Pessac.
LETONTURIER P. (1996) : Immunologie
générale, Masson, Paris, 160 p.
MBACKE C. et VAN DE WALLE. (1989): << Les facteurs
socio-économiques et l'influence de la fréquentation des services
de santé ». Dans "Mortalité et société en
Afrique au Sud du Sahara". Ed par Pison G., Van de Walle et Sala-Diakanda.
Travaux et Documents, cahier 124, Paris, INED, PUF, pp 67-83.
MICHEL GARENNE et ENÉAS GAKUSI: <<
Reconstruction des tendances de la
mortalité des jeunes enfants en Afrique sub-saharienne
de 1950 à 1999 à partir des données d'enquêtes
démographiques », 20 p.
MUDUBU KONADE L. (1996): Mortalité infantile et
juvénile au Togo: contribution des facteurs socio-économiques et
culturels Les cahiers de l'IFORD n° 11, 85p.
NOUMBISSI A (1996): Méthodologie d'analyse de la
mortalité des enfants: Application au Cameroun. Université
Catholique de Louvain, Département des Sciences de la Population et du
Développement, Ed Academia-Bruylant, 305 p.
NOUMBISSI A. (1993): <<
mortalité infantile et juvénile au Cameroun: une baisse
différentielle au cours des années 70 et 80, hypothèses
d'explication », juillet 1993. (Communication du séminaire
international sur la mortalité infantile et juvénile tenu
à Yaoundé du 19 au 23 juillet 1993).
OMS (1981) : « Les modes actuels de
l'allaitement maternel », Genève, OMS, 1981.
OUEDRAOGO C. (19994) : Education de la
mère et soins aux enfants à Ouagadougou, les
Dossiers du CEPED, n°27, Août 1994, Paris, 37p.
ROGER G., WALTISPERGER D., CORBILLEG.C (1981) : Les
structure par sexe et âge en Afrique, Groupe de démographie
africaine (IDP-INED-INSEE-MICOOP-ORSTOM), Imprimerie JOUVE, Paris, 1981, 556
p.
TABUTIN D. (1995): << Transition et théories
de la mortalité », dans La Sociologie des Populations »,
Les Presses de l'Université de Montréal, Aupelf/Uref,
pp.257-288.
VANKATACHARYA, K., TEKLU, TESFAY (1986) : << Cadre
conceptuel pour l'étude de la santé et des soins des enfants
». Dans "Problèmes liés à la recherche sur la
santé et les soins infantiles. Compte rendu de l'atelier d'Acra 22-26
septembre 1986" CRDI.
VIMARD P. (1984) : << Tendances et facteurs de la
mortalité dans l'enfance sur le plateau de Dayes (Sud-ouest Togo)
», dans cahier "ORSTOM, série Science Humaines",
vol xx,2, pp 186-206.
YOUNOUSSI ZOURKALÉINI (1997): Les
déterminants socio-démographiques et contextuels de la
mortalité des enfants au Niger", Université
de Montréal, Collection de Thèses et Mémoires n°49,
Montréal, 1997, 360p.
ANNEXES
Annexe 1 :
|
Variables de contrôle
|
Nombre de visites prénatales
|
2003
|
1998
|
1992
|
|
Risque de
décéder
(%o)
|
Risque de
décéder
(%o)
|
Risque de
décéder (%o)
|
|
Milieu de
résidence
|
Urbain
|
Aucune visite prénatale
|
114,96
|
162,74
|
163,63
|
|
Une à deux visites prénatales
|
58,44
|
43,75
|
69,74
|
|
Plus de trois visites prénatales
|
42,50
|
59,29
|
59,93
|
|
Ensemble
|
47,37
|
59,85
|
66,70
|
|
Rural
|
Aucune visite prénatale
|
121,68
|
136,15
|
126,73
|
|
Une à deux visites prénatales
|
67,11
|
106,72
|
67,24
|
|
Plus de trois visites prénatales
|
74,38
|
92,16
|
94,81
|
|
Ensemble
|
86,64
|
113,41
|
105,56
|
|
Niveau
d'instruction
|
Sans
niveau
|
Aucune visite prénatale
|
124,38
|
135,15
|
129,83
|
|
Une à deux visites prénatales
|
71,33
|
98,57
|
64,82
|
|
Plus de trois visites prénatales
|
74,44
|
89,50
|
84,87
|
|
Ensemble
|
88,10
|
109,98
|
101,78
|
|
Primaire
|
Aucune visite prénatale
|
51,33
|
190,81
|
60,83
|
|
Une à deux visites prénatales
|
51,41
|
116,40
|
116,94
|
|
Plus de trois visites prénatales
|
58,56
|
67,34
|
100,38
|
|
Ensemble
|
56,41
|
95,88
|
96,42
|
|
Secondaire
et plus
|
Aucune visite prénatale
|
|
|
|
|
Une à deux visites prénatales
|
35,07
|
123,04
|
103,12
|
|
Plus de trois visites prénatales
|
43,66
|
68,64
|
58,82
|
|
Ensemble
|
42,79
|
70,67
|
53,32
|
Annexe 2
|
Variables de contrôle
|
Lieu d'accouchement
|
2003
|
1998
|
1992
|
|
Risque de
décéder (%o)
|
Risque de
décéder (%o)
|
Risque de
décéder (%o)
|
|
Milieu de
résidence
|
Urbain
|
Domicile
|
74,06
|
90,33
|
80,10
|
|
Centre de santé
|
67,22
|
56,05
|
62,40
|
|
Ensemble
|
68,09
|
59,35
|
63,90
|
|
Rural
|
Domicile
|
101,34
|
119,90
|
111,25
|
|
Centre de santé
|
89,03
|
100,35
|
93,30
|
|
Ensemble
|
97,39
|
114,84
|
104,91
|
|
Niveau
d'instruction
|
Sans niveau
|
Domicile
|
100,88
|
119,06
|
111,09
|
|
Centre de santé
|
86,62
|
92,53
|
84,98
|
|
Ensemble
|
95,98
|
111,38
|
100,85
|
|
Primaire
|
Domicile
|
96,69
|
129,74
|
107,37
|
|
Centre de santé
|
64,90
|
68,12
|
93,57
|
|
Ensemble
|
74,87
|
94,31
|
97,58
|
|
Secondaire
et plus
|
Domicile
|
51,91
|
122,81
|
31,43
|
|
Centre de santé
|
75,56
|
67,42
|
45,96
|
|
Ensemble
|
74,51
|
70,03
|
47,34
|
Annexe 4
|
Variables de contrôle
|
Vaccination Rougeole
|
2003
|
1998
|
1992
|
|
Risque de
décéder (%o)
|
Risque de
décéder (%o)
|
Risque de
décéder
(%o)
|
|
Milieu de
résidence
|
Urbain
|
Non vacciné
|
73,50
|
63,16
|
163,40
|
|
Vacciné
|
65,84
|
59,41
|
13,89
|
|
Ensemble
|
68,58
|
60,61
|
65,76
|
|
Rural
|
Non vacciné
|
91,14
|
144,31
|
205,11
|
|
Vacciné
|
87,33
|
95,84
|
17,75
|
|
Ensemble
|
89,21
|
120,65
|
105,64
|
|
Niveau
d'instruction
|
Sans niveau
|
Non vacciné
|
131,58
|
138,63
|
201,97
|
|
Vacciné
|
45,98
|
93,84
|
15,11
|
|
Ensemble
|
89,04
|
116,91
|
101,40
|
|
Primaire
|
Non vacciné
|
63,16
|
78,74
|
36,30
|
|
Vacciné
|
76,02
|
105,69
|
193,24
|
|
Ensemble
|
68,54
|
96,51
|
100,00
|
|
Secondaire et
plus
|
Non vacciné
|
85,92
|
121,95
|
148,94
|
|
Vacciné
|
92,19
|
50,00
|
15,27
|
|
Ensemble
|
72,00
|
70,92
|
50,56
|
Annexe 5
|
Variables de contrôle
|
Vaccination BCG
|
2003
|
1998
|
1992
|
|
Risque de
décéder (%o)
|
Risque de
décéder (%o)
|
Risque de
décéder (%o)
|
|
Milieu de
résidence
|
Urbain
|
Non vacciné
|
84,34
|
74,07
|
300,48
|
|
Vacciné
|
66,72
|
60,98
|
41,62
|
|
Ensemble
|
67,88
|
61,56
|
67,19
|
|
Rural
|
Non vacciné
|
83,50
|
48,77
|
45,02
|
|
Vacciné
|
90,55
|
143,90
|
342,11
|
|
Ensemble
|
88,65
|
115,69
|
106,68
|
|
Niveau
d'instruction
|
Sans niveau
|
Non vacciné
|
80,60
|
47,47
|
43,50
|
|
Vacciné
|
91,30
|
138,38
|
301,93
|
|
Ensemble
|
88,49
|
112,45
|
102,91
|
|
Primaire
|
Non vacciné
|
368,42
|
96,88
|
308,64
|
|
Vacciné
|
63,03
|
93,75
|
58,82
|
|
Ensemble
|
71,05
|
96,35
|
97,51
|
|
Secondaire
et plus
|
Non vacciné
|
98,21
|
250,00
|
363,64
|
|
Vacciné
|
55,40
|
72,46
|
29,94
|
|
Ensemble
|
67,80
|
77,46
|
50,56
|
Annexe 6 : Dictionnaire des variables utilisées dans
l'analyse des correspondances multiples
|
Variables
|
Variable
modalités
|
Description des variables modalités
|
|
Nombre de Visites prénatales
|
Aucv
|
Aucune visite prénatale
|
|
Vi12
|
Une à deux visites prénatales
|
|
P3vi
|
Plus de trois visites prénatales
|
|
Moment de la première visite
|
Aucm
|
Aucune visite prénatale
|
|
Via3
|
Avant trois mois
|
|
Vip3
|
Après trois mois
|
|
Lieu d'accouchement
|
Dome
|
Domicile
|
|
Cent
|
Centre de santé
|
|
Assistance à l'accouchement
|
Pers
|
Personne
|
|
Autr
|
Autre personne
|
|
Sant
|
Personnel de santé
|
|
Injection antitétanique
|
Auij
|
Aucune injection
|
|
In12
|
Une à deux injections
|
|
In3p
|
Plus de trois injections
|
|
Durée d'allaitement
|
Nall
|
Non allaité
|
|
Moi6
|
Allaité moins de 6 mois
|
|
Plu6
|
Allaité plus de 6 mois
|
|
Poids de l'enfant à la
naissance
|
Ppoi
|
Petit poids
|
|
Mpoi
|
Poids moyen
|
|
Gpoi
|
Gros poids
|
|
Nspa
|
Poids inconnu
|
|
Vaccination
|
Roug
|
Vaccination contre la rougeole
|
|
Bcg
|
Vaccination BCG
|
|
Poli
|
Vaccination poliomyélite
|
|
Dtp
|
Vaccination DTP
|
|
Religion
|
Chre
|
Chrétienne
|
|
Musu
|
Musulmane
|
|
Aurl
|
Autre religion
|
|
Niveau d'instruction
|
Auin
|
Aucune instruction
|
|
Prim
|
Primaire
|
|
Secon
|
Secondaire et plus
|
|
Ethnie
|
Bodi
|
Bobo/Dioula
|
|
Peul
|
Peul
|
|
Goum
|
Gourmantché
|
|
Gour
|
Gourounsi
|
|
Lobi
|
Lobi
|
|
Mosi
|
Mossi
|
|
Aeth
|
Autre ethnie
|
|
Milieu de résidence
|
Urb
|
Urbain
|
|
Rur
|
Rural
|
|
Occupation
|
Fami
|
Travail en famille
|
|
Hors
|
Travail hors de la famille
|
|
Elme
|
Travail pour son propre compte
|
|
Age
|
Age1
|
15-19 ans
|
|
Age2
|
20-34 ans
|
|
Age3
|
35-49 ans
|
|
Décès infantile
|
Dec
|
Décès infantile
|
|
|



