INTRODUCTION GENERALE
Devant les contraintes économiques
que subissent les agriculteurs villageois en territoires de Mambasa et de Wamba
ces dernières décennies1(*), plusieurs stratégies de réponses sont
déployées par ceux-ci pour faire face à la situation.
L'exploitation des ressources naturelles telles que le bois et l'or est l'une
de ces stratégies. Le constat est plus manifeste quand on doit
considérer ce que l'on a appelé depuis le
XIXe siècle la « ruée vers
l'or »2(*). Nous
avons voulu étudier ce phénomène socio- économique
en relation avec le développement en territoires de Mambasa et de Wamba.
Mais avant tout qu'ont dit les autres chercheurs à ce sujet ?
1. Etat
de la question
L'histoire des mines d'
or qui a pendant longtemps
mobilisé des millions d'orpailleurs, ces creuseurs d'or attirés
par la moindre rumeur, a intéressé beaucoup de chercheurs. Les
thématiques développées peuvent être
regroupées en trois optiques: 1) l'exploitation artisanale de l'or
occasionne des changements socio- économiques énormes, 2)
l'orpaillage est un élément critique dans les abus contre les
droits humains et 3) l'extraction de l'or, comme toute activité
minière, fait partie du régime juridique particulier, celui de la
séparation du sol et du sous sol, dénommé «
régime du domaine éminent de l'état ».
Se situant dans la première
optique, dite optique des sociologues, Kouasi Nicolas KOUADIO, dans
Exploitation artisanale de l'or dans le processus de mutation socio-
économique à Hire (Sud Bandama, Côte
d'Ivoire)3(*), aboutit
au résultat selon lequel la pratique de l'or a occasionné des
changements dans la structure sociale et économique par son adoption au
sein de la population de Hire. Ces changements sont constatés au niveau
de rapports de production économique au sein de l'unité familiale
et se manifestent par des contestations de l'autorité ou par des
conflits d'autorité entre aînés et cadets sociaux.
Plus proche de nous, MULULU MUGINIBWA Jean
Marie, traitant de L'exploitation minière artisanale et
l'amélioration des conditions socio-économiques des exploitants
et des habitants de l'hinterland minier à Likasi4(*), abonde
dans le même sens. Il conclut que l'exploitation minière
artisanale, en diminuant le nombre des sans emplois à Likasi, contribue
l'amélioration, donc au changement, des conditions
socio-économiques des exploitants et des habitants de cette ville. Elle
constitue également une activité de sauvegarde à la
situation de manque d'emploi liée aux difficultés conjoncturelles
que connaissent la plupart d'entreprises du pays en général et de
la province du Katanga en particulier.
La deuxième optique, celle des
activistes des droits humains, apparaît dans les rapports de HUMAN
RIGHITS WATCH et de CENADEP. Le rapport de HUMAN RIGHTS WATCH5(*), publié en 2005, avait
révélé que l'attrait de l'or fut au coeur de très
nombreuses atrocités commises contre les droits humains dans la
région du Nord-Est de la RD Congo. Des seigneurs de guerre locaux et des
compagnies internationales comptaient parmi les bénéficiaires de
l'accès aux régions riches en or alors que les gens sur place
étaient soumis à des massacres ethniques, des actes de torture et
des viols. Au lieu d'apporter la prospérité aux populations de la
Province Orientale, l'or s'est révélé être un
« fléau » pour les populations qui ont eu la
malédiction de vivre sur cette partie du pays. Publié en 2009, le
rapport de CENADEP6(*)
confirme cette situation. En effet, l'or a été un
élément critique dans les abus contre les droits humains
étant donné la cruauté avec laquelle les populations se
sont entretuées pour le contrôle des mines d'or en Province
Orientale.
Une étude menée en 2003 au
Sud- Kivu par Koen VLASSENROOT et Timothy RAEYMAEKERS, intitulée
Conflit et minage artisanal à Kamituga (Sud- Kivu), et
publiée en 2004 comme Cinquième chapitre de l'ouvrage de Koen
VLASSENROOT et Timothy RAEYMAEKERS, Conflit et transformation sociale
à l'Est de la RDC, allait déjà dans le même
sens. Selon cette étude, dans un contexte de conflit et donc d'isolement
socio-économique, le minage artisanal de l'or constitue à la fois
la stratégie de survie pour la population locale mais surtout le moyen
de financement des conflits armés avec tout ce que cela comporte comme
violation des droits humains7(*).
La thèse de NDELA KUBOKOSO Jivet,
Les activités minières et la fiscalité (Cas de la
République Démocratique du Congo), aborde cette question
dans une optique purement juridique. Il s'agit d'une étude du
régime juridique des activités minières en RD Congo. Pour
NDELA KUBOKOSO Jivet, l'exploitation de l'or, en tant qu'activité
minière, fait partie du régime de la séparation du sol et
du sous sol, c'est un régime juridique particulier dénommé
« régime du domaine éminent de l'état ».
Ceci est à l'origine de plusieurs incompréhensions du code minier
et du code foncier8(*).
La lecture de ces études sur
l'exploitation minière en général et sur l'exploitation
artisanale de l'or en particulier nous a permis de préciser d'avantage
notre propre problématique.
2.
Problématique
Nous avons abordé la question
d'orpaillage dans une optique différente de trois
premières : c'est une optique
« développementaliste ». La particularité de
notre travail est cet effort de montrer les incidences de la pratique de cette
activité sur le développement des populations locales. Nous
nous sommes proposé d'aborder cette problématique sous
l'intitulé : « Exploitation artisanale de
l'or et développement en territoires de Mambasa et de Wamba (Province
Orientale, RD Congo) ». Il s'agit de s'interroger si
l'exploitation artisanale de l'or qui tend à dépeupler les
villages de ses forces vives contribue au développement de ces derniers
ou ne contribue qu'à en faire des riches d'une nuit et d'un jour avant
de les jeter dans la misère après une aventure qui ne profite
qu'aux trafiquants rusés venus de loin. Cette interrogation constitue le
problème de développement que ce travail s'est proposé
d'aborder.
Ainsi la question centrale qui guide cette
recherche est la suivante : Quel est l'impact de l'exploitation artisanale
de l'or sur le développement en territoires de Mambasa et de Wamba ?
Cette question centrale peut être éclatée à trois
sous- questions :
- L'exploitation artisanale de l'or favorise-t-elle
l'éclosion des petites initiatives locales de développement (ILD)
et la cohésion sociale qui manifestent un développement
local ?
- Qu'est-ce qui explique cette
« ruée » de la population vers
l'orpaillage ?
- Quelle est l'incidence de l'activité aurifère
sur l'environnement et la santé des populations, gages d'un
développement durable?
A ces questions correspondent les trois
hypothèses de cette étude.
3.
Hypothèses provisoires
La thèse provisoire de la recherche
est la suivante : la pratique de l'exploitation artisanale de l'or aurait
beaucoup plus d'impacts négatifs que positifs pour le
développement en territoires de Mambasa et de Wamba. De cette
thèse provisoire, nous avons déduit trois hypothèses pour
ce travail :
- Hypothèse 1 : L'exploitation
artisanale de l'or viderait les villages de leurs populations actives, ce qui
induirait par voie de conséquence, à l'absence des petites
initiatives de développement (à vocation agro-pastorale par
exemple) et à la fragilisation de la cohésion sociale par des
conflits d'autorité.
- Hypothèse 2 : Il semble que
l'exploitation artisanale de l'or procure un revenu rapide et
élevé permettant de satisfaire les besoins fondamentaux des
exploitants artisanaux.
- Hypothèse 3 : L'orpaillage
aurait des conséquences néfastes sur l'environnement et sur la
santé des hommes.
4.
Objectifs de recherche
Cette étude a pour objectif
général de montrer comment l'exploitation artisanale de l'or en
territoires de Mambasa et de Wamba a une incidence sur le développement
local. De cet objectif général, on peut déduire trois
objectifs spécifiques, à savoir:
- déterminer l'incidence de l'exploitation artisanale
sur les petites initiatives de développement (à vocation
agro-pastorale par exemple) et sur la cohésion sociale;
- identifier les raisons de l'orientation de la population
vers l'orpaillage ;
- montrer les risques environnementaux et sanitaires
occasionnés par l'orpaillage.
5.
Méthodes et techniques utilisées
Etant donné que l'usage d'une
méthode est tributaire de la nature de l'objet d'étude et des
objectifs poursuivis par le chercheur, pour comprendre la problématique
de l'exploitation artisanale de l'or en territoires de Mambasa et de Wamba,
nous avons préconisé le recours aux méthodes à la
fois qualitatives et quantitatives.
a) Une
méthode qualitative : le fonctionnalisme9(*)
Pour bien mener notre recherche, nous
avons utilisé la méthode fonctionnelle ou le fonctionnalisme.
Inventée par le sociologue français BROMSLAV MALINOWSKI, la
méthode fonctionnelle, comme toutes les autres méthodes
qualitatives, privilégie le tout ou la totalité par rapport aux
éléments. En effet, l'exploitation artisanale, de l'or en tant
que fait socio- économique, ne peut pas se comprendre de façon
isolée. Ainsi, la méthode fonctionnaliste nous a permis de
ressortir les différents rôles de tous les acteurs ou intervenants
de cette activité et les différentes fonctions de toutes les
autres activités en relation avec l'orpaillage.
Aussi avons-nous recouru à
plusieurs techniques pour collecter les données qualitatives. En effet,
nous avons pratiqué :
- l'observation directe basée
sur l'observation visuelle qui a pour avantages la saisie de comportements et
des événements sur le vif, le recueil d'un matériau
d'analyse non suscité par le chercheur mais relativement
spontané, la relative authenticité des comportements par rapport
aux paroles et aux écrits10(*) ;
- le recueil des données
existantes : nous avons fait donc un usage intensif des
informations indirectes contenues dans diverses sortes de documents tels
que des rapports, des documents personnels, des sources journalistiques et
d'autres sources publiées ou non ;
- l'entretien : il s'agissait
d'entretiens individuels, mais parfois d'entretiens de groupe semi- directifs
(nécessitant des réponses ouvertes) ou non directifs (en laissant
place aux digressions et à la conversation spontanée) ;
- et enfin, nous avons aussi obtenu des informations de
première main auprès d'informateurs divers (exploitants
artisanaux, négociants, services étatiques, etc.).
b) Une
méthode quantitative : l'induction statistique
Nous avons aussi utilisé
la méthode quantitative qu'est l'induction statistique.
L'induction statistique est une méthode d'analyse statistique des
données. Elle nous a permis de présenter une grande
quantité de données statistiques descriptives et d'utiliser des
techniques d'estimation en vue de généraliser les
résultats obtenus sur l'échantillon à toute la
population11(*).
La collecte des données
quantitatives nous a forcé d'utiliser la technique
d'enquête par questionnaire, qui a pour principal avantage
« la possibilité de quantifier de multiples données et
de procéder des lors a de nombreuses analyses de
corrélation »12(*).
Dans l'analyse de données
quantitatives proprement dite (âge, revenu, épargne), nous nous
sommes attelés surtout au calcul de :
- la tendance centrale, particulièrement la moyenne
arithmétique, appelée plus simplement moyenne (un nombre qui
résume à lui seul l'ensemble des données).
La médiane et le mode sont deux autres mesures de la
tendance centrale. La médiane d'une distribution est égale au
nombre réel qui sépare l'effectif total en deux parties
égales. Le mode correspond à la valeur de la variable qui
apparaît le plus souvent dans la distribution ;
- la dispersion quand on cherche à savoir si les
mesures sont étroitement regroupées autour de la moyenne ou si
elles sont dispersées. L'écart- type est une mesure de dispersion
que nous avons le plus utilisé. Si l'écart-
type est faible, les valeurs de l'échantillon sont
regroupées autour de la moyenne ; s'il est important, elles sont en
revanche très dispersées.
Pourquoi le choix de ce sujet et quel
intérêt revêt cette étude ?
6. Choix
et intérêt du sujet
Notre choix pour ce sujet a
été motivé par le fait que c'est depuis les années
1980 que les populations de territoires de Mambasa et de Wamba pratiquent
l'exploitation artisanale de l'or. Il est temps de se demander si cette
activité a aidé à impulser le développement en
territoires de Mambasa et de Wamba. Si tel n'est pas le cas, faut-il continuer
cette activité de la même manière qu'elle se déroule
aujourd'hui ?
Ce sujet est intéressant sur trois
aspects. Il faut d'abord savoir que depuis l'époque coloniale, le
secteur minier a contribué considérablement au
développement du pays. En effet, pendant cette époque coloniale,
le secteur minier a fonctionné comme un véritable chantier de
production des matières premières destinées à
l'exportation ; qu'à cela ne tienne, ce secteur a jeté le
jalon de l'équipement du pays. Malgré la crise multiforme
qui a frappé le pays durant les années 1990, l'on a noté
cependant que le secteur minier a contribué à soutenir
l'économie nationale13(*). Nous avons ainsi essayé de comprendre et
d'analyser cette relation entre l'exploitation minière, en particulier
de l'or, et le développement local en territoires de Mambasa et de
Wamba.
Cependant, il faut ensuite
reconnaître que l'exploitation d'importantes ressources minières
(uranium, or, diamant, cuivre, etc.) que renferme la RD Congo engendre une
multitude d'impacts sur la faune, la flore, les milieux naturels, aquatiques et
terrestres. Aussi, certains projets d'exploitation des ressources
minières alimentent la polémique et suscitent de vives
inquiétudes. Dans les territoires de Mambasa et de Wamba en Province
Orientale, l'exploitation artisanale, par exemple, entraîne de graves
préjudices à l'équilibre de l'écosystème de
plus en plus précaire dans le pays. Les principaux problèmes
environnementaux qui en résultent sont la forte concentration des
orpailleurs qui entraîne le déboisement anarchique des ressources
végétales pour la satisfaction des besoins
énergétiques (bois de chauffage) et d'habitation (bois de
service); et l'accumulation des rejets d'exploitation du minerai, les
déchets et ordures ménagères de toutes sortes constituent
des éléments de pollution et de dégradation de la
diversité biologique. Ce sont ces genres de problèmes que nous
avons aussi essayé d'aborder dans le dernier chapitre de ce
mémoire.
Enfin ce sujet nous parait
intéressant dans la mesure où il essaie d'apporter quelques
informations aux praticiens, aux enseignants, aux étudiants et au public
sur l'exploitation artisanale de l'or en territoires de Mambasa et de Wamba.
7.
Délimitation du sujet
« L'exploitation artisanale de
l'or et le développement» est un sujet vaste. Ainsi pour ce qui
nous concerne, nous n'avons traité que de l'exploitation artisanale de
l'or en territoires de Mambasa et de Wamba, en Province Orientale, dans la
partie Nord-Est de la RD Congo, et aussi dans une optique de futur
économiste de développement. L'exploitation industrielle qui a
commencé récemment par KILO GOLD, particulièrement en
territoire de Mambasa, ne fait pas partie de ce mémoire. Notre recherche
porte précisément sur les activités artisanales
d'orpaillage dans l'axe Bafwabango - Bafwambaya - Bafwanekengele, appelé
respectivement 51 km - 47 km - 25 km, en territoire de Mambasa, et dans l'axe
Gbonzunzu - Bolebole - Mambati, en territoire de Wamba. Les données y
relatives ont été récoltées dans l'intervalle
d'août 2010 à mai 2011.
Toute fois, dans le souci de bien
circonscrire le sujet, le cadre conceptuel, théorique et juridique de la
recherche déborde cet espace géographique et va aussi
au-delà de la période concernée par le sujet. On
remarquera aussi ici et là quelques allusions en dehors de l'espace et
du temps délimités pour illustrer certains faits
observés.
8.
Subdivision du travail
Ce mémoire présente trois
chapitres qui sont : le premier traite des considérations
générales sur l'exploitation artisanale de l'or et le
développement; le deuxième de l'activité aurifère
en territoires de Mambasa et de Wamba et le troisième de la place de
l'orpaillage dans le processus de développement en territoires de
Mambasa et de Wamba.
Dans le premier chapitre, il est question
de présenter les considérations conceptuelles, théoriques
et juridiques sur l'exploitation artisanale de l'or et le développement.
Nous définissons d'abord des concepts clés et connexes du sujet
abordé. Ensuite, nous présentons les théories du
développement qui sous-tendent notre réflexion. Enfin, nous
exposons le cadre juridique de l'orpaillage en RD Congo.
Le deuxième chapitre porte sur la
description du milieu et des différents sites d'exploitations sur
lesquels s'est réalisée l'enquête. Dans ce chapitre, nous
présentons aussi les différents acteurs qui interviennent dans
cette activité. Un accent particulier est mis sur la présence de
la femme de l'enfant dans les carrières d'or. Le chapitre traite enfin
des modes et types d'exploitation, du circuit de commercialisation et de
l'attrait pour l'activité aurifère.
Le troisième et dernier chapitre
s'articule autour de trois points. Il s'agit de montrer les externalités
positives et negatives de l'exploitation artisanale de l'or, d'analyser les
conditions de l'émergence du développement à partir de
l'orpaillage et de proposer les pistes vers un plan stratégique de
l'exploitation artisanale de l'or.
9.
Difficultés rencontrées
Pendant la durée de notre
enquête, nous avons rencontré quelques difficultés
majeures :
- une difficulté d'ordre linguistique : cette
difficulté est due à l'élaboration du questionnaire qui
s'était faite en français, par conséquent, nous
étions obligé de le traduire nous-mêmes en Swahili ou en
Lingala pour nos enquêtés qui ne comprenaient pas le
français ;
- une difficulté d'ordre technique : nous avons
été pris pour un agent judiciaire qui menait une enquête
policière afin de découvrir les fauteurs de troubles, d'où
la méfiance dans le chef de certains de nos
enquêtés ;
- une difficulté relative à la distance :
les sites d'exploitation minière étant éloignés,
nous étions obligés de parcourir de longues distances à
pied pour les atteindre ;
- une difficulté d'ordre matériel : la
documentation nous a été insuffisante.
Malgré les difficultés
auxquelles nous avons été confronté, nous ne nous sommes
pas laissé faire. Nous les avons surmonté, par exemple, en
persuadant nos enquêtés que nous n'étions pas de
détective. Quant à la distance, nous recourions parfois aux gens
de bonne foi qui nous donnaient du carburant que nous mettions dans notre moto
pour atteindre les sites miniers. Quant à la documentation, nous avons
contacté les gens de bonne volonté qui nous ont aidé avec
les documents intéressant notre sujet qu'ils gardaient dans leurs
bibliothèques privées.
CHAPITRE PREMIER :
LES CONSIDERATIONS
GENERALES SUR L'EXPLOITATION ARTISANALE DE L'OR ET LE DEVELOPPEMENT
Ce chapitre traite des
généralités jugées importantes pour la
compréhension du sujet abordé. Il a pour objectif de
présenter les considérations conceptuelles, théoriques et
juridiques sur l'exploitation artisanale de l'or et sur le
développement. Il s'agit de « retenir un cadre
théorique consistant, adapté au problème
étudié et dont on a bien saisi les concepts et les idées
principales »14(*).
1.1.
DEFINITION DES CONCEPTS
Commençons par préciser les
contenus sémantiques des concepts-clés et connexes avant de nous
employer à présenter le cadre théorique de notre
étude.
1.1.1. Les
concepts- clés
La compréhension du sujet
abordé nécessite la compréhension de certains concepts-
clés, à savoir l'exploitation minière artisanale et le
développement.
a) Exploitation minière
artisanale
L'ONU distingue trois types d'exploitation
minière : grandes mines (exploitation industrielle ou à
grande échelle), petites mines (exploitation semi- industrielle ou
à petite échelle) et les mines artisanales (exploitation
artisanale ou traditionnelle)15(*). C'est cette dernière qui concerne notre
mémoire.
Selon le code minier
congolais16(*), en son
article premier, l'exploitation traditionnelle ou artisanale est toute
activité par laquelle une personne physique de nationalité
congolaise se livre, dans une zone d'exploitation artisanale
délimitée en surface et en profondeur jusqu'à trente
mètres au maximum, à extraire et à concentrer des
substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des
procédés non industriels. Un article du Département des
Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies ajoute que, l'exploitation
artisanale c'est l'utilisation directe de l'énergie humaine dans
l'extraction des minerais17(*). Le terme orpaillage est souvent utilisé pour
désigner l'exploitation traditionnelle ou artisanale de l'or.
Le code minier congolais dans son article
109 précise que lorsque les facteurs techniques et économiques
qui caractérisent certains gîtes d'or, de diamant ou de toute
autre substance minérale ne permettent pas d'en assurer
une exploitation industrielle ou semi- industrielle, mais permettent une
exploitation artisanale, de tels gîtes sont
érigés, dans les limites d'une aire géographique
déterminée, en zone d'exploitation artisanale.
L'institution d'une zone d'exploitation artisanale est faite par voie
d'Arrêté du Ministre après avis de la Direction des Mines
et du Gouvernement de la province concernée.
L'exploitation minière artisanale
est parfois confondue à l' « exploitation minière
à petite échelle ». Le législateur
congolais définit l'exploitation à petite échelle
comme étant toute activité par laquelle une personne se livre
à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum
d'installations fixes en utilisant des procédés semi- industriels
ou industriels, après la mise en évidence d'un gisement. Ainsi la
définition adoptée par l'ONU tient compte
du nombre d'employés (moins de 40), du tonnage exploité (moins de
50.000 tonne par an) et du chiffre d'investissement (moins de 1 million
d'Euros) et de sa durée de vie (généralement de moins de 5
ans)18(*).
Ainsi dit, les éléments de
distinction entre l'exploitation à petite échelle et
l'exploitation artisanale peuvent être synthétisés dans le
tableau ci-après, du point de vue de la nature des installations
autorisées, de la nature des procédés d'exploitation admis
ainsi que de la nature du gisement sur lequel chacun de ces formes peut
être développée19(*).
Tableau N° 1 :
Différences entre les formes d'exploitation
minière
|
RUBRIQUES
|
EXPLOITATION A PETITE ECHELLE
|
EXPLOITATION ARTISANALE
|
|
Nature des installations
|
Permanent mais minimum
|
Non permanente
|
|
Nature des procédés
d'exploitations
|
Semi- industrielle
|
Non industrielle
|
|
Nature du gisement autorisée
|
Faibles réserves mais bien mises en évidence
|
Gisement pauvre et mise en place non établie
|
Source : Congo- Afrique XLVIIIe année,
N° 425, mai 2008
Bien qu'il ressorte de cette distinction
une grande proximité entre la mine à petite échelle et la
mine artisanale, deux formes souvent rassemblées dans la doctrine sous
le vocable de « Small Scale Mining », telles
qu'elles sont organisées dans la loi congolaise, elles couvrent
néanmoins deux réalités très différentes.
En RD Congo, les orpailleurs continuent
d'utiliser les moyens et les méthodes anciens. Le terme d'orpaillage ou
d'exploitation artisanale trouve donc ici tout son sens. On retient donc que
l'exploitation artisanale de l'or est une activité qui se fait sans
l'utilisation de moyens techniques (machines) ou du moins à un
degré moindre. Dans le cas des carrières d'or en territoires de
Mambasa et de Wamba, la grande partie des orpailleurs n'utilise pas de
machines, seules quelques unités de production possèdent des
moto- pompes.
Quel sens peut alors prendre le concept
« développement » ?
b)
Développement
La notion de développement reste
floue car elle recouvre une large complexité. Aussi, vu la
complexité du terme, nous avons voulu privilégier les concepts de
développement local, de développement socio- économique et
de développement durable étant donné leurs liens
étroits avec le problème étudié.
1° Développement
local
Le développement local, aussi
appelé développement à la base, est un processus utilisant
les initiatives locales au niveau des petites collectivités comme moteur
du
développement
économique. Il est prôné dans les
pays en
développement en complément des mesures
macroéconomiques et des grands projets. Le concept est apparu en France
au milieu des années 1960 en réaction aux pratiques dirigistes de
l'
aménagement
du territoire fondées sur des logiques sectorielles de
filière. Le développement local n'est donc « (...) ni
le fruit des décisions des pouvoirs publics ni le produit des
mécanismes du marché, il s'enracine dans un terreau de plus en
plus fertile, celui du monde associatif, qui bouillonne et canalise
progressivement le flot de l'engagement citoyen, effrayé par
l'irresponsabilité des marchés et découragé par
l'apathie des élus »20(*).
Pour MUSONGORA SYASAKA21(*), avec la faillite de l'Etat en
RD Congo, les initiatives de prise en charge de tout genre ont gagné du
terrain. Les populations elles-mêmes cherchent à trouver des
solutions alternatives à leurs problèmes. Ces initiatives sont
considérées comme du développement local dont parle le
Professeur KAMBALE MIREMBE dans sa thèse22(*). Pour ce dernier, c'est de
préférence au niveau local qu'il y a lieu de mieux
considérer les individus et les groupes sociaux comme des acteurs
à part entière de leur développement, tirant part des
opportunités à leur disposition, essayant de maîtriser leur
destin et non comme des destinataires passifs d'un développement offert
par l'Etat ou les projets.
Tout compte fait, nous pensons que le
développement local, une des dimensions du développement, se
manifeste à travers les petites initiatives locales entreprise par la
population autochtone qui doit être active et vivant dans une
cohésion sociale acceptable. Ces initiatives locales de
développement, ILD en sigle, ne sont rien d'autre que des
« petits projets dont le bénéfice peut revenir à
ses membres et à la communauté. Par exemple une banque de
céréales, un moulin a manioc, une forge, une pharmacie
villageoise, un jardin, une pisciculture, un programme
d'alphabétisation, un creusage des puits, (...) »23(*).
2° Le développement
socio-économique
Le développement économique
et social fait référence à l'ensemble des mutations
positives (techniques,
démographiques,
sociales, sanitaires, ...)
que peut connaître une zone
géographique (
monde,
continent,
pays, région...). Ainsi,
selon J. A. SCHUMPETER, dans son livre L'analyse du développement
économique, le développement (socio- économique) est
présenté comme « la mise en oeuvre des nouvelles
combinaisons de moyens de production de telle façon que les conditions
anciennes soient modifiées, que de nouvelles combinaisons créent
de nouveaux produits, que de nouveaux marchés s'ouvrent, que la
structure de marché se modifie. Ces diverses possibilités
créent des révolutions productives »24(*).
Le développement socio-
économique ne doit pas donc être confondu avec la
croissance
économique. Celle-ci est habituellement nécessaire ou
consécutive au développement mais elle n'en est qu'un aspect. La
volonté de concilier développement socio- économique et
croissance a mené le
PNUD (Programme des Nations
Unies pour le Développement) à forger, à côté
des
indicateurs
de développement traditionnels (produit national brut,
PNB en sigle
et produit intérieur brut,
PIB en sigle), d'autres
indicateurs,
tels que l'
indice
de développement humain (IDH), qui prend en compte la
santé, l'
éducation, le
respect des
droits de
l'homme (dont font partie, depuis
1966, les
droits
économiques et sociaux), etc. Quand les membres d'une
collectivité locale exercent les activités qui
génèrent un revenu leur permettant de satisfaire les besoins
fondamentaux tels que la nourriture, l'habillement, la santé,
l'éducation, ... on peut donc dire qu'ils sont sur la voie du
développement socio- économique, une deuxième dimension du
développement que nous abordons dans ce travail.
Tout développement,
économique ou social, doit tenir compte aussi bien des
générations actuelles que des générations futures
pour qu'il soit durable.
3° Le développement
durable
Selon le Professeur MAFIKIRI
TSONGO25(*), le
développement durable, en tant que la traduction actuellement la plus
courante des termes anglais « sustainable
development », a été défini en 1987 dans le
Rapport « Word Conservation Strategy » comme un
développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette
notion : 1) le concepts de « besoins », et plus
particulièrement des besoins essentiels de plus démunis, à
qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et 2) l'idée
de limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation
sociale impose sur la capacité de l'environnement à
répondre aux besoins actuels et avenir.
En citant un article de R. LELE, paru en
1991, le Professeur MAFIKIRI TSONGO énumère quelques objectifs
principaux du développement durable :
- la reprise de la croissance ;
- la modification de la qualité de la
croissance ;
- la satisfaction des besoins essentiels en ce qui concerne
l'emploi, l'alimentation, l'énergie, l'eau, la
salubrité ;
- la maîtrise de la démographie ;
- la préservation et la mise en valeur de la base de
ressources ;
- la réorganisation des techniques et gestion des
risques ;
- rendre le développement plus participatif.
Le concept de développement durable se fonde donc sur la
mise en oeuvre d'une utilisation et d'une gestion rationnelles des ressources
(naturelles, humaines et économiques), visant à satisfaire de
manière appropriée les besoins fondamentaux des
générations actuelles en tenant compte des
générations futures. Le développement durable tient compte
à la fois de la rationalité économique (norme
économique), de l'équité sociale (norme socio-
éthique) et de la contrainte des milieux physiques (norme scientifique).
Il existe d'autres concepts, pas de
même importance, mais qui nécessitent aussi d'être
définis pour bien comprendre les pourtours de notre sujet.
1.1.2. Les
concepts connexes
Nous nous limiterons seulement à
définir quatre concepts étant donné leur lien avec notre
travail. Il s'agit de la mine, la carrière, le creuseur et le travail
des enfants.
a)
Mine
Selon le Code minier congolais26(*), la mine est tout gisement
artificiel des substances minérales classés en mine, exploitable
à ciel ouvert ou en souterrain, et/ou toute usine de traitement ou de
transformation des produits de cette exploitation se trouvant dans le
périmètre minier, y compris les installations et les
matériels mobiliers et immobiliers affectés à
l'exploitation.
Somme toute, une mine est un gisement
exploité de matériaux (par exemple d'or, de charbon, de cuivre,
de diamants, de fer, d'uranium, etc.). Elle peut être à ciel
ouvert ou souterraine. Il existe de gisements de forme
tabulaire, d'origine non sédimentaire et montrant souvent une forte
inclinaison, des gisements tabulaires se conformant à la stratification
des roches encaissantes ; et dans des amas, de grands ensembles de minerai
de forme irrégulière et d'inclinaison quelconque. On trouve
souvent l'or dans des placers, des gisements alluviaux de sable et de
gravier27(*).
b) Carrière
Le mot carrière est défini
dans le Code minier congolais comme : « tout gisement des
substances minérales classé en carrière exploitable
à ciel ouvert et/ou toute usine de traitement de produit de cette
exploitation se trouvant dans le périmètre de carrière
pour réaliser leur transformation en produits marchands, y compris les
installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés
à l'exploitation »28(*). Pour ce qui concerne notre décente sur
terrain, il a été constate qu'une carrière est tout
simplement un gisement a ciel ouvert ou souterrain et le camp qui abrite les
creuseurs.
c)
Creuseur
En République Démocratique
du Congo, le terme creuseur est utilisé couramment pour désigner
l'exploitant minier artisanal. Il s'agit d'un travailleur qui exploite des
gisements avec des procédés manuels, rudimentaires ou non
industriels. Dans la suite, nous utilisons donc indifféremment les
termes exploitants miniers artisanaux, creuseurs et orpailleurs. Ces derniers
sont souvent de tout âge, y compris des enfants. Ceci nous amène
à définir ce qu'on entend par travail des enfants, de plus
à plus fréquent dans les mines.
d)
Travail des enfants
Le travail des enfants est, selon la
Banque Mondiale, « celui exécuté par des enfants qui
sont trop jeunes au sens qu'en le faisant ils réduisent indûment
leur bien-être économique présent ou leurs capacités
futures à se faire un revenu, soit par le rétrécissement
de leur horizon en matière de choix ou à travers la
réduction de leurs propres capacités individuelles de production
dans le futur »29(*). Le code du travail congolais
qualifie le travail des enfants des pires formes de travail30(*).
Selon l'UNICEF31(*), le
travail des enfants est caractérisé par l'âge
précoce au travail, une rémunération insuffisante,
l'entrave de l'accès à l'éducation, l'exercice des
contraintes physiques, sociales et psychologiques excessives, trop d'heures
consacrées au travail, des atteintes à la dignité et au
respect de soi des enfants, comme l'esclavage ou la servitude et l'exploitation
sexuelle, l'obligation à une vie dans des conditions peu salubres ou
dangereuses, etc.
On estime aujourd'hui à environ
245,5 millions d'enfants qui exercent le pénible métier de
mineur ou de creuseur. En RD Congo, par exemple, au
moins 50000 enfants sont impliqués dans des activités
d'exploitation artisanale des mines, dont des enfants autrefois associés
aux forces et groupes armés. Parmi ces enfants, près de 20000 se
trouvent au Katanga, environs 12000 en Province Orientale et au moins 11800 au
Kasaï oriental32(*).
Après ce bref parcours de
définitions des concepts, présentons à présent les
théories économiques sur lesquelles peuvent se fonder nos
réflexions.
1.2.
CONSIDERATIONS THEORIQUES
Cette section présente deux
théories économiques en rapport avec notre travail : la
théorie des externalités et la théorie des besoins
fondamentaux.
1.2.1. La
théorie des externalités33(*)
La théorie des externalités
fait allusion une situation dans laquelle l'action d'un
agent
économique influe, sans que cela soit le but de l'agent, sur la
situation d'autres agents économiques, alors même qu'ils n'en sont
pas partie prenante : ils n'ont pas été consultés et
n'ont reçu (si l'influence est négative) ni versé (si elle
est positive) aucune compensation. Pour ce qui concerne notre travail,
l'activité d'un orpailleur peut influer sur l'activité d'un
agriculteur (et éleveur), d'un pêcheur, d'un artisan, voire
même d'un écolier.
Selon les effets économiques, on
distingue les externalités positives (ou économies externes) qui
désignent les situations où un acteur est favorisé par
l'action de tiers sans qu'il ait à payer ; et les
externalités négatives (ou déséconomies externes)
qui désignent les situations où un acteur est
défavorisé par l'action de tiers sans qu'il en soit
compensé.
Selon l'acte économique, on
a les externalités de production et les externalités de
consommation.
a) Les
externalités de production
Les externalités de production
désignent l'amélioration ou la détérioration du
bien-être ressenti par l'agent B, non indemnisée, suite à
une production de l'agent A. Il s'agit en particulier des externalités
techniques, pécuniaires et technologiques.
On parle d'externalité technique
dans la production lorsque la
fonction de
production d'un acteur est modifiée par l'action d'un tiers. Un
exemple célèbre est celui de l'
apiculteur et de l'
arboriculteur
développé par
James MEADE en
1952. L'apiculteur profite de
la proximité de l'arboriculteur et obtient un
miel de meilleure
qualité qu'il pourra vendre à meilleur prix et cela gratuitement.
L'arboriculteur ne sera pas payé pour le service indirect qu'il a rendu
à l'apiculteur. Il s'agit dans ce cadre d'une externalité
positive. Mais l'arboriculteur profite aussi gratuitement de la
pollinisation de ses
arbres, ce qui améliore son rendement sans faire recours à de
coûteuses méthodes manuelles, et la pollinisation aléatoire
des abeilles enrichit aussi la diversité génétique qui
permet aux plantations de mieux résister à d'autres affections ou
maladies. L'externalité est positive dans les deux sens.
Il y a externalité
pécuniaire lorsque les coûts d'achat ou de vente d'un acteur est
modifiée par l'action d'un tiers. En ce qui concerne la production, on
dira qu'une externalité pécuniaire modifie non pas la
fonction de
production, mais la fonction de coûts. Ce type d'externalités
est très courant et peut être illustré par les
investissements dans un secteur, par exemple l'acier, qui ont pour effet de
diminuer le prix du bien produit et donc de diminuer les coûts d'un autre
secteur, par exemple les constructeurs de chemin de fer, ce qui peut en retour
augmenter sa demande d'acier qui amènera de nouveaux investissements et
ainsi de suite. Les économistes du développement industriel se
sont beaucoup interrogés sur ce type de dynamique dans le choix des
investissements dans les pays en développement.
Proches des externalités
techniques, les externalités technologiques ont pour effet de modifier
la
productivité
totale des facteurs et donc de modifier potentiellement la fonction de
production individuelle de chaque firme. Les apports du
progrès
scientifique global sont des externalités censées profiter
à tous sans qu'ils en aient à subir directement les frais. Le
logiciel libre par
exemple est aussi une externalité positive. Qu'en est-il des
externalités de consommation ?
b) Les
externalités de consommation
Les externalités de consommation,
quant à elles, désignent l'amélioration ou la
détérioration du bien-être ressenti par l'agent B, non
indemnisée, suite à une consommation de l'agent A. On subdivise
souvent les externalités de consommation en externalité de
position et en externalité d'adoption.
On parle d'externalité de position
lorsque l'
utilité que
l'acteur tire d'un bien dépend de l'utilité que les autres
consommateurs tirent du même bien, et surtout de la position de l'acteur
par rapport aux autres dans la possession du bien. L'exemple des
externalités de position le plus classique est celui des biens de luxe,
pour lesquels la satisfaction tirée de la possession dépend en
grande partie du fait que les autres possèdent ou non le même
bien, le fait d'être le seul augmentant le plaisir retiré.
Il y a externalité d'adoption, ou
effet de réseau, quand le fait que d'autres personnes font la même
action accroît l'utilité/valeur de l'action, autrement dit, la
valeur du produit dépend de son nombre d'utilisateurs. Un bon exemple
d'externalités de réseau réside dans l'adoption d'un
standard informatique, par exemple un système d'exploitation. Plus il y
a d'utilisateurs d'un système d'exploitation, plus il y a de programmes
et de documentation faits pour ce système, ce qui amène d'autres
utilisateurs, et ainsi de suite. On a là une logique de
cercle vertueux.
Ce phénomène
d'externalité d'adoption permet d'expliquer le fait que le produit le
plus utilisé sur un marché ne soit pas le plus utilisé
parce qu'il est le meilleur en comparaison de ses concurrents, mais simplement
parce qu'il regroupe plus d'utilisateurs. Plusieurs auteurs, ARTHUR en
particulier, relève que dans une situation pareille le marché ne
conduit pas forcément à la meilleure solution, et que dès
lors l'intervention de l'État peut être légitime.
Qu'en est-il maintenant de la
théorie des besoins fondamentaux ?
1.2.2. La
théorie des besoins fondamentaux34(*)
L'échec des politiques
fondées sur une vision mécaniste du développement, le
renforcement des inégalités, y compris celles engendrées
par la croissance économique dans certains pays en voie de
développement, contribuèrent à réorienter la
réflexion en la matière. À partir des années 1970,
les programmes de développement, sous l'impulsion du PNUD, prirent
davantage en considération les spécificités culturelles et
sociales des pays concernés ainsi que leurs structures
institutionnelles.
L'accent fut mis sur la satisfaction des besoins
fondamentaux des populations. Il ne pouvait y avoir de développement
sans que fût résolu le problème de
l'insécurité alimentaire et sanitaire, sans
élévation du niveau d'éducation des hommes et des femmes,
acteurs du développement local. À la notion d'un modèle
imposé de l'extérieur se substitua l'idée que le
développement devait être un processus endogène,
favorisé par la mise en place d'un cadre politique, financier et
juridique favorable à l'initiative économique. Les populations
devaient être plus étroitement associées aux projets de
développement : leur participation fut notamment encouragée
par les organisations non gouvernementales (ONG), de plus en plus
impliquées sur le terrain.
La mise en oeuvre des politiques d'ajustement
structurel, à partir des années 1980, a cependant marqué
un retour à la primauté de l'économie. Elle a eu pour
conséquence immédiate de renforcer l'influence des institutions
financières intergouvernementales au détriment des organismes
spécialisés des Nations unies. Ces politiques ont
incontestablement contribué, en Amérique latine et en Asie,
à rétablir les grands équilibres financiers, et partant,
à restaurer la confiance des investisseurs et prêteurs
étrangers. Mais elles ont eu un coût social extrêmement
élevé. Leur efficacité est davantage contestée dans
les pays les moins avancés, notamment africains. Là, le processus
d'industrialisation et de diversification de l'économie est à
peine amorcé. Les possibilités de croissance sont
hypothéquées par l'existence de multiples goulets
d'étranglement (infrastructures inconsistantes ou défaillantes,
segmentation des marchés internes et absence d'intégration
régionale), handicaps aggravés par la corruption, la bureaucratie
et l'instabilité politique.
En fait, ces facteurs de
blocage sont désormais mieux intégrés aux
stratégies de développement et au cours des années 1990,
les approches de la Banque mondiale, voire du Fonds monétaire
international, ont tendu à rejoindre celles d'organismes tels que le
PNUD. Un consensus tend à se dégager quant aux
priorités : la transformation des modes de production, que doivent
accélérer les transferts de technologie, doit s'accompagner d'une
réforme de l'État et d'un changement des structures sociales. Il
n'en demeure pas moins que l'évolution des pays en voie de
développement dépend étroitement du contexte
international, à plus forte raison lorsque s'opère une
mondialisation de l'économie.
En bref, la théorie des besoins
fondamentaux prend en considération les spécificités
culturelles et sociales des pays concernés ainsi que leurs structures
institutionnelles. Ceci nous permet d'aborder la question du cadre juridique de
l'orpaillage en RD Congo.
1.3.
CADRE JURIDIQUE DE L'ORPAILLAGE EN RD CONGO
Nous étudions le cadre juridique de
l'exploitation artisanale de l'or car c'est un aspect important qui peut
favoriser ou défavoriser le développement des populations
riveraines. Nous partons de l'historique du droit minier congolais.
1.3.1.
Historique du droit minier congolais
Le droit minier congolais a subi plusieurs
influences. NDELA KUBOKOSO35(*) regroupe ces influences en trois grandes parties :
une partie qui concerne la période allant de l'époque coloniale
à la prise du pouvoir par Mobutu, ensuite, il y a eu la période
de la deuxième République et enfin la période de
l'après- chute du président Mobutu, c'est-à-dire de 1997
à nos jours.
a) De
la période coloniale à la Première République
(1885-1965)
Le droit minier Congolais a pour origine
primaire, le droit indigène. Ce droit était simple : les minerais
appartenaient au souverain. Tout produit émanant d'une exploitation
minière sur le territoire dont il régnait, lui était
apporté. En sa qualité de souverain, c'est lui qui
procédait à la redistribution. Ce système a
fonctionné jusqu'à l'arrivée des colonialistes.
Avec la colonisation, le droit minier
Congolais a été influencé, par le droit occidental,
notamment le droit minier français qui prônait la
séparation ente la propriété du sol et celui du sous sol,
et le système anglais qui prônait la propriété du
sol emportait la propriété du sous sol et parallèlement,
la propriété du sous sol appartenait au souverain.
C'est le roi Léopold II qui a
été vraiment à l'origine du droit minier Congolais actuel.
A l'époque, les concessions minières ainsi que le territoire du
Congo, étaient sa propriété personnelle. La
stratégie du roi consistait à donner l'exploitation de ces
concessions aux sociétés privées qui l'exploitaient, en
contrepartie, celles-ci versaient des impôts à « l 'Etat
Colonial du Congo » qui était également sa
propriété. Les recettes réalisées par le
système mis en place a permis au roi de prendre des participations dans
les sociétés qui avaient des concessions.
Et par la suite, afin de pouvoir
contrôler l'économie congolaise, le roi créa une holding
« société générale de Belgique » qui
créa des filiales dans les différents domaines de
l'activité du pays dont une de ses filiales était
spécialisée dans l'activité minière : « le
comité spéciale de Katanga » l'ancêtre de la fameuse
GECAMINES.
b) La
Deuxième République (1965-1997)
Avant 1965, il n'existait pas de droit et
de fiscalité minière comme tels. Le droit minier était
détenu par trois sociétés coloniales : le comité
spéciale de Katanga (CSK), le comité national de Kivu, la
compagnie des chemins de fer de grands lacs.
De 1965 à 1969 c'est la
genèse du droit minier congolais avec plusieurs ordonnances lois. Avec
l'arrivée de la junte militaire au pouvoir en 1965, il y a eu une vraie
volonté de créer un droit et une fiscalité minière
au Congo. Avec différentes ordonnances lois, on a abouti à un
système à double régime d'imposition : un régime de
droit commun, et un régime spécial pour les
sociétés bénéficiaires des conventions
d'établissement (à savoir un régime dérogatoire, au
droit commun).
De 1970 à 1997 il y a eu plusieurs
autres textes dont notamment, le système de Contribution
Générale Forfaitaire (CGF). Par ce système, les
sociétés minières pouvaient opter pour payer mensuellement
un montant de l'impôt ; à la fin de l'année, une
évaluation était réalisée par rapport au vrai
montant de l'impôt à payer. Comme on peut bien s'en douter,
à la fin de l'année, la plupart des sociétés
minières avaient trop versé d'impôt, donc disposaient d'un
crédit d'impôt à valoir sur les impôts futurs.
C'était la perversité du système.
c) La
Troisième République (depuis 1997)
Depuis la chute du régime du
président MOBUTU, et l'arrivée au pouvoir de Laurent
Désiré KABILA, il y a eu deux périodes :
- la période de 1997 à 2002 (date de la
promulgation du code minier). Pendant cette période, il y a eu plusieurs
lois et décrets dont les objectifs essentiels étaient la
modification des taux des impôts ;
- et la période actuelle après 2002 (juillet
2002), c'est le nouveau code minier qui régit le droit et la
fiscalité minière actuels.
Que pense alors ce nouveau code minier
congolais de l'exploitation artisanale de l'or ?
1.3.2. Le
Code minier congolais et l'exploitation artisanale36(*)
Le nouveau code minier organise
l'exploitation artisanale des minerais de la manière suivante :
a) De
l'autorisation d'exploitation artisanale
L'article 111 du nouveau code minier
stipule que dans les zones d'exploitation artisanale, seuls les
détenteurs des cartes d'exploitant artisanal en cours de validité
pour la zone concernée sont autorisés à
exploiter l'or, le diamant ou toute autre substance minérale qui est
exploitable artisanalement. Les cartes d'exploitant artisanal
sont délivrées par le Chef de Division Provinciale des Mines du
ressort aux personnes éligibles qui les demandent et
qui s'engagent à respecter la réglementation en matière de
protection de l'environnement, de l'hygiène et de la
sécurité dans les zones d'exploitation
artisanale, conformément aux modalités qui sont fixées par
le Règlement Minier après en avoir pris connaissance.
b) Des
obligations du détenteur de la carte d'exploitant artisanal
D'après l'article 112,
le détenteur d'une carte d'exploitant artisanal doit respecter
les normes en matière de sécurité, d'hygiène,
d'utilisation de l'eau et de protection de l'environnement qui s'appliquent
à son exploitation conformément à la réglementation
en vigueur. Il doit indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage
engendré par son activité. Le Règlement Minier fixe les
modalités d'exécution des normes en matière de
sécurité publique, de santé publique et
d'environnement37(*).
c) De
la transformation des produits de l'exploitation artisanale
Le Code minier, en son Article 113, dit
que la carte d'exploitant artisanal n'autorise pas son
détenteur de transformer les produits de l'exploitation artisanale.
Toutefois, la transformation des produits par l'exploitant artisanal ne peut se
faire que moyennant une autorisation préalable accordée par le
Ministre.
d) Du
retrait de la carte d'exploitant artisanal
L'article 114 du Code minier
précise que la carte d'exploitant artisanal peut
être retirée par le Chef de Division Provinciale des Mines ou par
son représentant local qui l'a émise après une mise en
demeure de trente jours sans remédier à la situation par la
personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations
prévues à l'article 112 du présent Code.
Le cas échéant, la personne
à laquelle la carte a été retirée n'est pas
éligible pour obtenir une nouvelle carte d'exploitant artisanal pendant
trois ans, à moins qu'il complète un stage de formation en
technique d'exploitation artisanale appropriée, organisé ou
agréé par l'administration des mines. Le retrait de la carte
d'exploitant artisanal donne droit aux recours prévus dans les
dispositions des articles 315 et 316 du présent code. Le
règlement minier fixe les modalités d'organisation de stage de
formation en techniques d'exploitation artisanale.
Le règlement miner qui
complète le nouveau code minier définit le régime
juridique et fiscal pour l'exploitation artisanale des minerais en RD
Congo.
1.3.3. Le
régime juridique et fiscal pour l'exploitation artisanale
A propos du régime juridique et
fiscal pour l'exploitation artisanale en RD Congo, il faut encore rappeler que
c'est un régime juridique particulier dénommé «
régime du domaine éminent de l'état » qui
consacre la prééminence du code minier sur la loi
foncière. A ce propos, nous nous limitons seulement à
dégager les droits et les obligations des différents acteurs
concernés : l'exploitant artisanal, les négociants et les
comptoirs agréés.
a)
L'exploitant artisanal
L'exploitant artisanal est toute personne
physique ou morale de nationalité congolaise qui se livre, dans une zone
d'exploitation artisanale délimitée en surface et en profondeur
jusqu'à trente mètres au maximum, à extraire et à
concentrer des substances minérales en utilisant des outils, des
méthodes et des procédés non industriels. Avant de
commencer son activité, il doit supporter :
- le droit d'entrée et l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICA) à l'importation pour le matériel,
équipement, liés à l'exploitation artisanale ;
- le droit d'entrée pour les réactifs ;
- la taxe rémunératoire pour la carte
d'exploitant artisanal;
- l'impôt professionnel sur les
rémunérations ;
- l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICA) à
l'intérieur.
b) Le
négociant
Un négociant est toute personne
physique de nationalité congolaise qui se livre aux opérations
d'achat et de vente des substances. Selon le règlement miner38(*) qui complète le nouveau
code minier, tous les négociants doivent supporter la taxe
rémunératoire annuelle :
- l'équivalent de USD 500 pour les négociants de
catégorie A ;
- l'équivalent de USD 3 000 pour les négociants
de catégorie B ;
- les impôts professionnels sur les
rémunérations ;
- l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICA) à
l'intérieur.
c) Les
comptoirs agréés
Ce sont des personnes physiques ou morales
autorisées à acheter des substances minérales
d'exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants
artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter
conformément aux dispositions du Code minier. Les comptoirs
agréés paient :
- la redevance annuelle lors de l'octroi ou du renouvellement
de l'agrément : un montant d'environs USD 200 000;
- la caution lors de l'agrément qui
s'élève à peu près USD 50 000;
- la taxe sur la carte d'acheteurs : plus ou moins USD 3 000;
- la taxe sur la carte d'acheteurs supplémentaire
(à partir de la 11ème carte) : environs USD 15 000;
- la taxe d'intérêt commun : 1% sur les
transactions d'or et de diamant ;
- la taxe rémunératoire sur la carte de travail
des étrangers ;
- les impôts réels (impôts fonciers,
impôts sur véhicules, taxes spéciales de circulation
routière, l'impôt sur les concessions minières et
hydrocarbures) ;
- l'impôt cédulaire sur les revenus.
1.3.4.
Critique du code minier congolais
Le code minier congolais appelle de notre
part, trois principales remarques. En premier lieu, dans ce code minier, tout
l'accent est porté sur la rentabilité du projet minier et
très peu sur le développement national.
Ensuite, l'Etat est complètement
affaibli au bénéfice d'une libéralisation à
outrance - il manque d'objectif de développement. Le titre I chapitre 2
alinéa 1 du code minier indique : « l'Etat n'a pour rôle que
la promotion et la régulation du secteur minier ». Ce qui l'exclut
donc de bon nombre de décisions importantes sur l'activité. Cette
situation est dommageable à notre avis, voir même catastrophique,
car l'Etat est garant de la richesse du pays, et doit être présent
dans un secteur essentiel des activités du pays. La multiplication des
acteurs dans l'activité minière constitue également un
frein pour réduire le rôle de l'Etat.
Enfin, le manque d'objectifs de
développement social des populations locales. Sur les 941 articles du
code et de règlement minier, un seul article traite de la mise en place
des infrastructures locales. C'est l'article 242 du code minier qui traite de
la répartition de la redevance minière. Le paragraphe 2 de cet
article indique : « les fonds résultant de la répartition
dont il est question à l'alinéa précédent en faveur
des entités administratives décentralisées (EAD) sont
affectés exclusivement à la réalisation des
infrastructures de base d'intérêt communautaire ». Rien n'est
prévu pour la formation des agents qui interviennent dans
l'administration du code miner. Il n'existe non plus aucun dispositif pour la
négociation des conventions minières pour des gisements de grande
ampleur.
L'application des dispositions du nouveau
Code minier pose donc beaucoup de problèmes, notamment par rapport aux
droits des occupants de sol. Sur ce point, il y a de plus en plus du mal
à convaincre les populations autochtones de la différence entre
le droit minier et le droit foncier. A notre avis, la raison se trouve dans la
faible vulgarisation du Code minier. En effet, la faible vulgarisation du Code
minier a conduit plusieurs interprétations erronées de ses
dispositions, surtout en ce qui concerne la cohabitation des droits miniers
avec les occupants des sols et l'exclusion des communautés de base de la
jouissance des produits du sous-sol.
Somme toute, le cadre juridique de
l'exploitation artisanale de l'or en RD Congo pose problème. En effet,
le nouveau code minier ne constitue pas un environnement favorable au
développement des communautés locales. L'exploitation artisanale
de l'or ne semble pas être intégrée dans les politiques de
développement du gouvernement de la République.
Conclusion partielle
Durant ce chapitre relatif aux
considérations conceptuelles, théoriques et juridiques sur
l'exploitation artisanale de l'or et sur le développement, nous avons eu
à définir, dans un premier temps, deux concepts clés de
notre sujet, à savoir l'exploitation artisanale et le
développement. . On retiendra donc que l'exploitation artisanale de l'or
est une activité qui se fait sans l'utilisation de moyens techniques
(machines) ou du moins à un degré moindre.
Le concept de développement, plus
précisément de développement durable se fonde sur la mise
en oeuvre d'une utilisation et d'une gestion rationnelles des ressources
(naturelles, humaines et économiques), visant à satisfaire de
manière appropriée les besoins fondamentaux des
générations actuelles en tenant compte des
générations futures.
En second lieu, nous avons
distingué deux théories de développement qui fondent notre
réflexion : la théorie des externalités et la
théorie des besoins fondamentaux. De la théorie des
externalités (
James MEADE), il est
ressorti que l'activité d'un agent économique (l'exploitation
artisanale de l'or, pour ce qui nous concerne) peut avoir des effets externes,
positifs ou négatifs, sur les activités des autres agents
(agriculture, éducation ou scolarisation, par exemple). Pour les tenants
de la théorie des besoins fondamentaux (PNUD),
l'accent est mis sur la satisfaction des besoins
fondamentaux des populations.
Enfin, nous avons clôturé ce
chapitre en étudiant le cadre juridique de l'exploitation artisanale de
l'or en RD Congo. L'exploitation artisanale de l'or peut constituer un facteur
de développement qui relève d'un processus d'accumulation - et
non des seuls comportements de survie - mais à la seule condition que le
cadre juridique crée un environnement favorable au développement
des communautés locales. Cela ne semble pas être le cas pour notre
pays. Nous le verrons dans le chapitre suivant qui est consacré à
l'exploitation artisanale de l'or dans les territoires de Mambasa et de
Wamba.
CHAPITRE
DEUXIEME :
L'ACTIVITE AURIFERE EN
TERRITOIRES DE MAMBASA ET DE WAMBA
Ce chapitre a pour objet à la fois
l'étude du milieu de la recherche, l'étude de la
caractérisation des acteurs de l'activité aurifère qui y
opèrent, l'étude des types d'exploitation artisanale qui s'y
pratiquent et l'étude des raisons de l'attrait de la population pour
cette activité aurifère. Ce chapitre nous permettra ainsi de
vérifier les deux premières hypothèses de ce travail.
2.1.
PRESENTATION DU MILIEU DE RECHERCHE
Nous présentons ici le milieu de
notre recherche en trois points : son contexte socio-économique et
politique, la Réserve de Faune à Okapi (RFO) qui s'y trouve et
les carrières d'or opérationnelles dans ce milieu.
2.1.1.
Contexte socio-économique et politique des territoires de Mambasa et de
Wamba en Province Orientale
Les territoires de Mambasa et de Wamba,
comme tant d'autres territoires de la RD Congo, ont été
frappés durement par les conflits armés qui ont endeuillé
la population congolaise entre 1997 et 2008, année officielle de la
réunification politique. Ces conflits armés qui ont
enrôlés volontairement ou de force des milliers d'enfants et
adultes ont eu un impact négatif sur la situation
socio-économique de ces territoires : la persistance des certaines
maladies (l'onchocercose, la trypanosomiase, le goitre, ...), la consommation
exagérée de la drogue et de l'alcool par les jeunes, l'habitat
rudimentaire, le revenu très faible des habitants, etc39(*).
L'environnement économique de ces
deux territoires est cependant marqué par des potentialités
naturelles et du sous-sol énormes (or, diamant, fer,
pétrole, bois, cours d'eau, etc.) et des potentialités
touristiques importantes (les vestiges du champ de Stanley (Ford-Boolo)
à Mambasa, la station de capture des Okapis à Epulu, les
sanctuaires de la Bienheureuse Sr. Anoalite à Wamba et à
Bafwabaka) capables de propulser la croissance économique et le
développement des populations locales. Malheureusement, toutes ces
richesses ont toujours été spoliées et n'ont jamais
profité suffisamment à la population.
Le territoire de Mambasa, situé au
Nord de l'
équateur
entre 1°00' et 1°30' latitude Nord et 29°00' et 29°30
longitude Est, possède un sol fertile favorisé par un climat
tropical humide fortement influencé par l'altitude. Cette
fertilité du sol favorise la production de différents
produits :
manioc,
haricot,
igname,
patate douce,
riz,
ail,
banane,
soja,
choux et d'autres
légumes. Les activités économiques du territoire de
Mambasa sont, pour la plupart, à caractère individuel et
familial. La population autochtone vit principalement de travaux agricoles,
d'élevage et de commerce. De nombreux jeunes s'orientent vers les
travaux d'
orpaillage ou de
moto- taxi . Les personnes
originaires des autres provinces du pays sont venues habiter Mambasa pour y
exercer des activités d'agriculture, de commerce ou d'employés de
l'administration publique40(*).
Quant au territoire de Wamba qui a une
superficie de 10305 km2, il est situé à 02°09' latitude Nord
et à 28°00' longitude Est. La température moyenne varie
entre 28° et 30° C. Dans l'ensemble du territoire, le relief du sol est
accidenté par de grandes et petites collines dont
l'élévation peut atteindre 300 à 400 m, puis par des
grosses pierres. Le sol est sablonneux, surtout aux endroits se trouvant
près de rivières et dans d'autres endroits le sol est argilo
-sablonneux. Cette entité administrative se distingue par ses vocations
agro-pastorale, forestière et minière41(*). A cause de son enclavement,
le moyen de transport longtemps utilisé a été le
vélo. Cela n'a pas favorisé les activités commerciales.
Les problèmes majeurs communs aux
deux territoires de Mambasa et de Wamba et qui constituent la manifestation
même de la pauvreté généralisée qui
sévit dans le pays sont la pauvreté intellectuelle
(analphabétisme42(*)), la pauvreté socio-économique (manque
d'eau potable43(*),
inexistence des marchés agricoles, impraticabilité des routes de
desserte agricole, ...) et la pauvreté sécuritaire (conflits
sociaux). Parmi les déterminants de la pauvreté en territoires de
Mambasa et de Wamba, le DSCRP provincial cite principalement l'absence des
services d'encadrement des paysans, d'intrants agricoles et des marchés
des produits agricoles44(*).
Bref, les guerres à
répétition, particulièrement depuis 1996, le morcellement
de la province entre les belligérants, les conflits interethniques
à l'Ituri et l'insécurité persistante ont détruit
le tissu socio-économique des territoires de Mambasa et de Wamba et
réduit les populations locales à une grave misère. Une
autre conséquence des ces conflits armés est la
dégradation avancée et en voie de disparition de plusieurs
espèces animales de la réserve de faune à Okapis d'Epulu,
habitat d'Okapis, une espèce unique au monde.
2.1.2. La
Réserve de Faune à Okapis (RFO) à Epulu45(*)
La Réserve de Faune à Okapis
est un site de patrimoine mondial créé pour la conservation de la
richesse biologique de la foret de l'Ituri et du Haut- Uélé afin
d'assurer l'utilisation durable de ses richesses naturelles par la population
locale.
a) Son
historique
Après la deuxième guerre
mondiale, vers 1944, Mr. PUTNAM de nationalité américaine, est
venu s'installer à Epulu comme hôtelier. Entre-temps, il capturait
les singes et okapis à montrer aux visiteurs. En 1952, Mr. DE MEDINA, un
portugais, crée officiellement la station de capture et
d'hébergement de beaucoup d'espèces animales, à savoir les
okapis, les éléphants, les crocodiles, les chimpanzés,
etc. Pendant la rébellion de 1964, tous les animaux en captivité
furent massacrés, dont 28 okapis. Après la rébellion, la
station de capture d'Epulu reprit ses activités avec le soutien de
plusieurs partenaires étrangers : le Wildlife Conservation
Society46(*) (W.C.S.)
depuis 1982, le projet Gilman International Conservation Inc (G.I.C.) depuis
1987, le Word Wildlife Funds47(*) (W.W.F.) depuis 1987, le projet Frankfurt Zoological
Society48(*) (S.Z.F),
etc.
Le 2 mai 1992 fut créée la
Réserve de Faune à Okapis (R.F.O.) par l'arrêté
ministériel n°045/CM/ECN/92. Elle s'étend sur une superficie de
1372625 hectares soit environs 40862 km2 dont la gestion est confiée
à l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (I.C.C.N.).
Elle est à cheval sur trois territoires administratifs : Mambasa
(90%), Wamba et Watsa (10%)49(*).
b) Ses
richesses
Du point de vue végétation,
la R.F.O. couvre trois types principaux de forêts de terre ferme et un
type de forêts riveraines:
- les forêts mixtes avec « cynometra
alexandri » et « julbernadia
seretii » (appelés localement
« Tuna » et
« Alambi ») comme espèces d'arbres
dominantes ;
- les forêts mono- dominantes avec
« gilbertiodendron dewevrei » (appelé
localement « Mbau ») comme espèce d'arbre
dominante ;
- les forêts sèches des hautes collines ;
- les forêts riveraines ou les forêts
marécageuses.
Du point de vue faune, l'inventaire
mammalien a donné un chiffre de plus ou moins 5000 okapis. A part cette
espèce, il existe 2000 léopards, 4700 éléphants de
forêts, 7500 chimpanzés à face claire, 6 espèces de
céphalophes, 3 espèces de crocodiles, 13 espèces de
primates, 327 espèces d'oiseaux, les buffles de la foret, la genette
aquatique,le chevrotain aquatique, divers insectes, reptiles et amphibiens,
etc. La plupart de ces espèces sont reprises dans la liste des
espèces animales totalement ou partiellement protégées en
RD Congo50(*).
Parmi les problèmes qui menacent
aujourd'hui la RFO, on note l'exploitation artisanale de l'or qui crée
des grands foyers de chasse commerciale dans la réserve et qui
altère l'habitat des animaux51(*).
2.1.3. Les
carrières d'or dans les territoires de Mambasa et de Wamba
En Province Orientale, l'or a
été découvert pour la première fois dans la
rivière Agola au Nord-Est de la RD Congo en 1903 par les prospecteurs
australiens. Ils ont baptisé la zone du nom de chef local Kilo. Une
autre découverte a été faite par eux dans la
rivière Moto, un peu plus au Nord. D'où le nom de l'Office de
mines d'or de Kilo- Moto (OKIMO), devenu actuellement la Société
de mines d'or de Kilo- Moto (SOKIMO). Les carrières d'or en territoires
de Mambasa et de Wamba ne font pas partie de ces mines. Elles se trouvent entre
les mines de Kilo et de Moto comme l'indique la carte en annexe (Annexe
N°4).
Les territoires de Mambasa et de Wamba
regorgent plusieurs carrières d'or concentrées autour des grandes
agglomérations comme Mambasa, Niania, Wamba, Gbonzunzu, Bolebole et
Mambati. Mais nos enquêtes se sont déroulées seulement sur
quelques carrières regroupées en deux zones d'orpaillage. Ce sont
les zones de Bafwabango - Bafwambaya - Bafwanekengele (territoire de Mambasa)
et de Gbonzunzu - Bolebole - Mambati (territoire de Wamba). Le choix de ces
deux zones se justifie par le fait qu'elles sont les plus connues et les plus
fréquentées.
a) La
zone de Bafwabango - Bafwambaya - Bafwanekengele
Cette zone comprend trois sites ou
agglomérations importantes (Bafwabango, Bafwambaya et Bafwanekengele)
autour desquels s'organisent une trentaine des carrières d'or. Il s'agit
des carrières suivantes : Santa Maria, Mopa, Libre -ville, Camp
Base, Malekesa, Kazania, Lisala, Adombi, Vatican, Canon, Monde Arabe,
Mbuji-Mayi, Mambo Bado, Mabele Mokonzi, Tindika Longindo, Dieu- Merci, La
Grâce, Kputuka, Mangenengene, Yindi, Kanana, Singa Muambe, Manzedaka,
Potopoto, Etoile, Tika Muana, Landa Bango, Akili Nyuma, Tokobika, Maroc, Senke
Bisengo, Maka, Lisala, Tokomeka, etc.
Les sites de Bafwabango et de Bafwambaya,
situés respectivement à 51 km et 47 km de Niania sur l'axe Niania
- Wamba - Isiro et séparés seulement de 3 km entre eux, sont
caractérisés à la fois par des exploitations à ciel
ouvert et des exploitations souterraines. Pour ce qui concerne les
exploitations souterraines, les orpailleurs de ces deux sites descendent dans
des puits antérieurement creusés lors du premier orpaillage
à l'époque coloniale. La profondeur de ces puits peut atteindre
parfois 20 à 25m. Il existe des tunnels qui relient les puits entre eux
de sorte que l'ensemble constitue un réseau souterrain dense. L'une des
particularités de ces exploitations souterraines, est sa richesse en or.
Mais s'il est possible d'avoir un rendement élevé d'or sur ces
exploitations, leur fréquentation est redoutée par la plupart des
orpailleurs parce qu'elles présentent des risques d'éboulement.
Situé aussi sur l'axe Niania -
Wamba - Isiro, à environ 25 km de la cité de Niania, le site de
Bafwanekengele est un site d'exploitation a ciel ouvert. Du fait de sa
proximité à la cité de Niania par où passe la route
nationale n°4 réhabilitée en 2008, il se développe aussi
sur ce site, des activités économiques importantes. Il y a
notamment le commerce de médicaments, de produits cosmétiques, de
vêtements, de produits vivriers et surtout de la restauration (vente de
bières et de différents mets).
b) La
zone de Gbonzunzu - Bolebole - Mambati
Cette zone comprend aussi une trentaine
des carrières d'or opérationnelles reparties inégalement
dans trois sites importants (Gbonzunzu, Bolebole et Mambati). Ces
carrières d'or portent des noms évocateurs et qui font l'objet de
l'attirance des jeunes en quête d'une vie meilleure :
|
1.
|
Bawakawaka
|
|
11.
|
Jaribu
|
|
21.
|
Arete
|
|
31.
|
Mapenzi
|
|
2.
|
Jehova Juré
|
|
12.
|
Lisanga
|
|
22.
|
Bon marché
|
|
32.
|
Bon samaritain
|
|
3.
|
Makapela
|
|
13.
|
Ndoka Juu
|
|
23.
|
Bon voyage
|
|
33.
|
Makasi
|
|
4.
|
Sele Sele
|
|
14.
|
Barrage
|
|
24.
|
Bande d'Azu
|
|
34.
|
Sina makosa
|
|
5.
|
Central
|
|
15.
|
Kitona
|
|
25.
|
Pas à pas
|
|
35.
|
Kobe
|
|
6.
|
Makambo
|
|
16.
|
Natho
|
|
26.
|
Disco
|
|
|
|
|
7.
|
Malekesa
|
|
17.
|
Baweza Te
|
|
27.
|
Makosemane
|
|
|
|
|
8.
|
Alléluia
|
|
18.
|
Gbado
|
|
28.
|
Keba
|
|
|
|
|
9.
|
Bruxelles
|
|
19.
|
Bamako
|
|
29.
|
Esui yo wapi
|
|
|
|
|
10.
|
Mbongo
|
|
20.
|
Geneve
|
|
30.
|
Empire
|
|
|
|
Le site de Gbonzunzu, situé
à une centaine de kilomètres du chef-lieu du territoire de Wamba,
a un statut de poste d'encadrement administratif et se présente comme un
grand centre commercial qui ravitaille les carrières d'or environnantes.
On y compte une quarantaine de boutiques, une dizaine d'officines
pharmaceutiques et un marché hebdomadaire d'une centaine
d'étalages. A coté des activités aurifères, il se
développe tout de même des activités agricoles pour des
finalités commerciales.
Le site de Bolebole, situé au bord
de la rivière Nepoko, affluent de l'Aruwimi qui est lui-même
affluent du fleuve Congo, est caractérisé à la fois par
les exploitations à ciel ouvert et les exploitations souterraines. A
coté des activités minières, il se pratique dans ce site
plusieurs autres activités liées à l'exploitation
fluviale : l'exploitation du beach pour la traversée des biens et
des personnes, la pêche à petite échelle, la fabrication
des radeaux pour la circulation des marchandises par la voie fluviale, etc. Il
faut noter déjà que ces exploitations sont à l'origine de
plusieurs conflits qui vont de simples disputes à des batailles
rangées par familles.
Le site de Mambati, situé à
plus de 150 km de Wamba sur l'ancienne route qui reliait le territoire de Wamba
au territoire de Bafwasende, est caractérisé
particulièrement par des exploitations souterraines où les
orpailleurs descendent dans des puits antérieurement creusés par
les sociétés minières qui y ont travaillé à
l'époque coloniale. Ce site a toujours eu une grande importance depuis
l'époque coloniale quant à sa production en or. On sait encore
voir aujourd'hui les vestiges des grandes sociétés
minières qui y ont travaillé : les vieux bâtiments
administratifs, les camps des ouvriers, les ateliers, etc.
Apres cette présentation du milieu
de recherche, parlons aussi des différents acteurs qui oeuvrent dans ce
milieu.
2.2.
CARACTERISATION DES ACTEURS DE L'ACTIVITE MINIERE
L'analyse de la caractérisation des
acteurs de l'activité minière en territoires de Mamba et de Wamba
nous permet de dégager l'âge et l'origine socio- professionnelle
de ces derniers. Mais avant tout, qui sont-ils ?
2.2.1. Les
acteurs de l'activité minière
Les différents acteurs qu'on
rencontre dans les carrières d'or en territoires de Mamba et de Wamba
agissent chacun suivant ses règles et motivations propres.
L'intérêt de l'examen de ces acteurs permet de comprendre leurs
rôles, leurs motivations, leurs stratégies, leurs points forts et
faibles pour l'activité aurifère.
a) Les
services de l'Etat52(*)
L'Etat joue un rôle
réglementaire, notamment dans l'institution d'une zone d'exploitation
artisanale qui est faite par voie d'Arrêté du Ministre
après avis de la Direction des Mines et du Gouvernement de la province
concernée. Comme stratégie, l'Etat, le premier acteur, devrait
être présent dans toutes les carrières d'or à
travers ses différents services et administrations.
1° Le cadastre minier
(CAMI)
Le cadastre minier a été
créé en 2003. En 2004 il a dû interrompre ses
activités à la suite d'une décision du Gouvernement, il a
re- ouvert ses portes en juin 2005. Le CAMI est responsable de l'octroi et du
renouvellement des concessions et des droits miniers pour la recherche et
l'exploitation des minerais. Il est prévu un cadastre
électronique. Le CAMI gère à ce jour près de 2500
licences, il se finance par l'intermédiaire des taxes sur les gisements
et 50 % de celle-ci lui étant destinés. Sur terrain, ce service a
connu des hauts et des bas dictés par des interférences
intempestives des autres services de l'Etat dans le secteur.
2° La direction des
mines
La direction des mines est chargée
de l'inspection et du contrôle des activités minières et
des travaux de carrières en matières de sécurité,
d'hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de
commercialisation et en matière sociale. Elle est chargée aussi
de la compilation et de la publication des statistiques et informations sur la
production et la commercialisation des produits des mines et de
carrières. Elle est seule habilitée à contrôler et
à inspecter l'exploitation minière industrielle, l'exploitation
minière à petite échelle et l'exploitation artisanale.
Elle reçoit et instruit les demandes d'agrément au titre des
comptoirs d'achat. Ce service est représenté dans chaque
territoire.
3° Service d'assistance et
d'encadrement des Small Scale Mining (SAESSCAM).
Fondé en 1999, ce service est
subordonné au ministère des mines seulement depuis 2003. Il est
chargé de l'organisation et de surveillance du secteur minier de type
artisanal. De nombreux bureaux de SAESSCAM se mettent progressivement en place
depuis 2005. Il est prévu d'organiser des coopératives
modèles sur l'ensemble des provinces minières. On a
constaté que le SAESCAM manque des capacités de
déploiement sur l'ensemble du pays et ne dispose pas des moyens de
travail conséquent. Sa présence n'a pas été
manifeste dans les carrières où nous sommes passé.
4° Le service chargé de la
protection de l'environnement minier
Le service chargé de la protection
de l'environnement minier au sein du Ministère des mines exerce, en
coordination avec les autres organismes de l'Etat chargés de la
protection de l'environnement, les prérogatives qui lui sont
dévolues par le Code minier et par toute autre réglementation en
matière de protection de l'environnement, notamment la définition
et la mise en oeuvre de la réglementation minière en
matière de protection de l'environnement en ce qui concerne le
régime pour la prospection, le régime pour les exploitants
artisanaux, les directives pour les opérations de recherches et
d'exploitation des mines et des carrières et les modalités de
contrôle des obligations en matière de protection de
l'environnement.
Qu'en est-il des exploitants miniers
proprement dits ?
b) Les
exploitants miniers artisanaux
Sur terrain, nous avons aussi
constaté que les exploitants artisanaux se repartissent en deux
catégories : les grands exploitants et les petits exploitants. A
ces deux catégories, nous y avons ajouté les ouvriers
journaliers qui sont associés d'une façon ou d'une autre au
travail de ces deux premières catégories. Tous ne
possèdent aucune structure de leur encadrement ni de défense de
leurs intérêts.
1° Les grands
exploitants
Ce sont des orpailleurs qui sont les
détenteurs des cartes d'exploitant artisanal en cours de validité
pour la zone concernée et sont ainsi appelés propriétaires
de la carrière ou PDG (Président Délégué
Général). Ils possèdent généralement les
facteurs de production et un fond de roulement plus ou moins
élevé. Ce capital leur permet d'engager dans leur unité de
production de la main d'oeuvre. Ces grands orpailleurs possèdent souvent
des motopompes qui les aident à vider les puits pendant les travaux de
creusage.
Une grande partie de cette
catégorie d'acteurs n'est pas novice dans l'activité. Ils ont
déjà exercé ailleurs et leur ancienneté dans
l'activité leur permet d'acquérir le fond de roulement, les
moyens de production et les connaissances pratiques dans le lavage du fond
limoneux contenant les particules d'or. En réalité, ces grands
exploitants ont commencé pour certains en tant que petits exploitants,
pour d'autres en tant que ouvriers ou même main-d'oeuvre gratuite au
près de leurs parents. Dans tous les cas, ces grands exploitants ne sont
pas venus sans avoir appris quelque part.
A coté des grands exploitants, il
existe aussi les petits exploitants dans les mêmes carrières
d'or.
2° Les petits
exploitants
Ils sont les plus nombreux. C'est parfois
même toute la famille au complet qui s'engage à l'exploitation de
l'or. Pour la plupart, l'orpaillage se présente comme une
stratégie de survie, « (...) un marché
self -service et anarchique, à la limite de l'informel et duquel le
pays ne tire en réalité aucun profit substantiel. Tout au plus
permet-il aux masses désoeuvrées de s'assurer une certaine
survie »53(*).
La quasi-totalité de petits
exploitants n'a pas d'autorisation d'exploitation. Ils exploitent soit dans la
clandestinité (illégalité) soit dans des zones
gérées par les grands exploitants qui ont des cartes
d'exploitation artisanale. Dans l'incapacité de se procurer les moyens
de productions de masse, ils se contentent de creuser la terre à la
recherche de pierres ou encore de ramasser celles rejetées par les
grands exploitants.
Les grands exploitants et même
quelques petits exploitants se font souvent aider par les ouvriers
journaliers.
3° Les ouvriers
journaliers
Ce sont des jeunes, voire des enfants
(filles et garçons) sans emploi. Ils offrent leur force de travail aux
grands exploitants et aux petits exploitants moyennant une
rémunération journalière. Leur travail consiste à
creuser la terre, à transporter jusqu'au bassin où se fait le
lavage et enfin à laver la terre. Les tâches des ouvriers sont
souvent classifiées en fonction du genre. Les hommes sont
affectés aux tâches qui nécessitent beaucoup de forces
physiques. Ainsi, ils s'occupent du creusage de la terre et du lavage. Les
filles quant à elles s'occupent du transport de la terre creusée
et aussi à servir l'eau pour le lavage. Cependant, l'attribution de ces
postes n'est pas figée. Il arrive que des filles lavent la terre ou
encore que des hommes assurent le transport de la terre jusqu'au lavage.
c) Les
négociants
Nos enquêtes ont montré que
ce sont les négociants ont le monopole d'achat dans les milieux
étant donné l'absence des comptoirs agréés sur
place. Ceci signifie qu'ils sont les seuls à fixer le prix de l'or aux
exploitants artisanaux qui ne sont pas d'ailleurs organisés en
associations. La plupart des négociants n'ont même pas de carte de
négociant. De façon générale, tout
commerçant oeuvrant dans les zones aurifères achètent de
l'or.
Un autre acteur important dans les
carrières d'or demeure la femme qui entreprend une multitude
d'activités surtout dans le domaine de la restauration populaire et de
buvettes ou « Nganda ».
d) Les
femmes
Les femmes jouent de façon
générale un rôle reproductif. Ce sont elles qui
gèrent la production alimentaire, l'approvisionnement en combustible du
foyer, en eau potable et le commerce des produits de base. Mais de plus en
plus, les femmes entreprennent des activités commerciales informelles.
Cet esprit d'entreprise chez les femmes est dû à leur
« aspiration à l'indépendance économique et
à la conquête vers l'autonomie »54(*). En effet,
« entreprendre, dit Philippe DE WOOT, consiste à changer un
ordre existant »55(*).
Ainsi les femmes sont aussi
embauchées pour des tâches connexes à l'orpaillage comme le
transport d'eau et de pierres (voir Photo N°3 en annexe). L'étude
menée à Kamituga, au Sud Kivu, confirme cette situation. En
effet, après la procédure de creusage, le minerai d'or doit
être transporté, pilé, nettoyé et tamisé.
Généralement ces taches sont réservées aux filles
ou aux femmes. Le transport consiste à déplacer les roches de
quartz de la mine vers l'outra. Le tamisage consiste à casser les roches
de quartz en une poussière plus malléable, qui est alors
nettoyée et tamisée dans les outrans environnants. Comme le font
remarquer Koen VLASSENROOT et Timothy RAEYMAEKERS56(*), ce pilage quotidien - qui se
fait au moyen d'une frappe répétitive de la roche dans un
récipient de métal (comme l'écrasement de racines de
manioc) - est surtout la prérogative de femmes.
Plusieurs femmes rencontrées dans
les sites d'orpaillage travaillent comme tenancières des restaurants
populaires. Elles sont ainsi appelées « mamans
restaurants ». Ces « mamans restaurants » se font
aider par des filles qui sont employées dans les bars et les restaurants
destinés à la communauté minière. On y a
trouvé même des filles, âgées de 10 à 12 ans,
travaillant jusqu'à 12 heures par jour. Et dans beaucoup de cas, ce
travail peut mener à la prostitution ou aux abus sexuels imposés
par des clients ou des employeurs.
A propos de la qualification des femmes
tenancières des restaurants populaires, nos enquêtes ont
montré que sur 40 d'entre elles que nous avons rencontré, aucune
n'a attestée avoir un diplôme scolaire ou académique (D4,
D6, G3, L2) comme l'indique ce tableau :
Tableau N° 2 : Niveau d'instruction des
tenancières des restaurants
|
N.
|
NIVEAU D'ETUDES
|
EFFECTIFS
|
%
|
|
1
|
Primaire
|
15
|
37,5
|
|
2
|
Secondaire
|
19
|
47,5
|
|
3
|
Alphabétisée
|
6
|
15
|
|
4
|
Diplômée (D4, D6, G3, L2)
|
0
|
0
|
|
TOTAL
|
40
|
100
|
Source : Données d'enquête de janvier
2011.
On comprend donc que les facteurs
principaux de leur succès ne résident pas dans une qualification
scolaire ou académique mais aussi dans leurs qualités
d'entrepreneurs : la confiance en soi, la persévérance,
voire la ténacité ou l'obstination face aux innombrables
obstacles qui parsèment la route de l'entrepreneur, la
flexibilité ou la capacité de faire évoluer son projet en
fonction des contingences locales ou externes souvent imprévisibles,
leur potentiel créatif, leur enthousiasme, leur charisme, leur
capacité de diriger et de gérer57(*).
Les petites entreprises
gérées par ces femmes ont besoin d'un financement. L'apport
personnel est en général la règle au démarrage de
ces micro- entreprises. L'enquête menée sur 40 femmes donne les
résultats suivants :
Tableau N° 3 : Sources de financement des
tenancières des restaurants
|
N°
|
SOURCES DE FINANCEMENT
|
EFFECTIFS
|
%
|
|
1
|
Apport personnel
|
20
|
50
|
|
2
|
Emprunt de la famille
|
9
|
22,5
|
|
3
|
Tontine
|
6
|
15
|
|
4
|
Crédit fournisseur
|
4
|
10
|
|
5
|
Epargne traditionnelle
|
1
|
2,5
|
|
TOTAL
|
40
|
100
|
Source : Données d'enquête de janvier
2011.
Au regard de ce tableau, on peut affirmer
que :
- 50% des « mamans restaurants » ont
démarré leur activité grâce à leur apport
personnel. Cet apport personnel a parfois pour origine une
décapitalisation (vente de produits agricoles ou des biens de valeur),
mais plus souvent une épargne cumulée au cours des
années ;
- 22,5% des ces femmes ont financé leur activité
par des emprunts contractés dans la famille (mari, grand frère,
oncle, cousins, etc.). Les conditions de remboursement restent floues, les
prêts devenant souvent des dons qui, dans le contexte familial, sont
néanmoins remboursés en nature ou en services ;
- 15% des tenancières des restaurants financent leurs
micro- entreprises par une forme d'épargne collective en Afrique qu'est
la tontine ;
- 10% financent leurs restaurants par le crédit
fournisseur, considéré ici comme source informelle de financement
car il dépend autant des relations personnelles (et du capital
confiance) que des liens commerciaux classiques entre ces femmes entrepreneurs
et leurs fournisseurs ; et
- 2,5% de ces entrepreneurs financent leur activité par
l'épargne traditionnelle qui consiste souvent à transformer de
l'argent en biens (bétail, terres, immeubles, bijoux, etc).
Ces différents acteurs que nous
venons d'analyser, à savoir les services de l'Etat, les exploitants
artisanaux, les négociants et les femmes, proviennent de diverses
origines socio- professionnelles et sont de différents âges.
2.2.2. Age
et origine socio- professionnelle des acteurs
Commençons par l'analyse de
l'âge des exploitants artisanaux et des femmes tenancières des
restaurants.
a) Age
des acteurs
Les enquêtes menées au cours
de nos recherches ont montré aussi que l'âge moyen pour les
acteurs qui travaillent dans les carrières d'or est de 25 ans pour les
femmes et 35 ans pour les hommes, comme l'indiquent les calculs de moyenne
d'âge suivants :
Pour les femmes, on
a :
1° Détermination de nombre de classes k, de
l'étendue d, de l'amplitude a et de la borne
inférieure de la première classe 
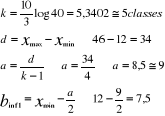
2° Tableau de calculs intermédiaires
Tableau N° 4 : Tableau de distribution
du caractère age des femmes
|
N°
|
CLASSE
|
CENTRE DE CLASSE Xi
|
EFFECTIF ni
|
xini
|
FREQUENCE fi
|
fi %
|
fi %
croissant
|
fi % décroissant
|
|
1
|
[7,5; 16,5[
|
12
|
7
|
84
|
0,175
|
17,5
|
17,5
|
100,0
|
|
2
|
[16,5;25,5[
|
21
|
18
|
378
|
0,450
|
45,0
|
62,5
|
82,5
|
|
3
|
[25,5;34,5[
|
30
|
7
|
210
|
0,175
|
17,5
|
80,0
|
37,5
|
|
4
|
[34,5;43,5[
|
39
|
6
|
234
|
0,150
|
15,0
|
95,0
|
20,0
|
|
5
|
[43,5;52,5[
|
48
|
2
|
96
|
0,050
|
5,0
|
100,0
|
5,0
|
|
TOTAL
|
-
|
40
|
1002
|
1,000
|
100,0
|
-
|
-
|
Source : Nos calculs à partir des données
d'enquête de janvier 2011.
3° Calcul de la moyenne d'age des femmes tenancières de
restaurants
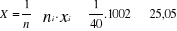
A partir de cette moyenne de
l'échantillon, nous pouvons estimer la moyenne de toute la population
concernée par l'intervalle de confiance a 95%, avec un écart type
de 9,373.
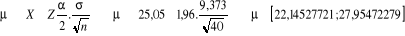
L'âge moyen de la population, ici l'age moyen des femmes
vivant dans les carrières d'or, se situe donc entre 22 ans et 27 ans.
Pour les creuseurs d'or
proprement dits, on a :
1° Détermination de nombre de classes k, de
l'étendue d, de l'amplitude a et de la borne
inférieure de la première classe 

2° Tableau de calculs intermédiaires
Tableau N° 5 : Tableau de distribution
du caractère âge des creuseurs
|
N
|
CLASSE
|
CENTRE DE CLASSE Xi
|
EFFECTIF
ni
|
xini
|
FREQUENCE fi
|
fi %
|
fi % croissant
|
fi % décroissant
|
|
1
|
[16;23[
|
19,5
|
17
|
331,5
|
0,157
|
15,74
|
15,54
|
100,00
|
|
2
|
[23;30[
|
26,5
|
25
|
662,5
|
0,232
|
23,15
|
38,89
|
84,26
|
|
3
|
[30;37[
|
33,5
|
16
|
536,0
|
0,148
|
14,81
|
53,70
|
61,11
|
|
4
|
[37;44[
|
40,5
|
30
|
1215,0
|
0,278
|
27,78
|
81,48
|
46,30
|
|
5
|
[44;51[
|
47,5
|
8
|
380,0
|
0,074
|
7,41
|
88,89
|
18,52
|
|
6
|
[51;58[
|
54,5
|
7
|
381,5
|
0,065
|
6,48
|
95,37
|
11,11
|
|
7
|
[58;65[
|
61,5
|
5
|
307,5
|
0,046
|
4,63
|
100,00
|
4,63
|
|
TOTAL
|
-
|
108
|
3814,0
|
1
|
100,00
|
-
|
-
|
Source : Nos calculs à partir des données
d'enquête de janvier 2011.
3° Calcul de la moyenne d'âge des creuseurs

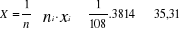
A partir de cette moyenne de
l'échantillon, nous pouvons aussi estimer la moyenne de toute la
population concernée par l'intervalle de confiance a 95%, avec un
écart type de 12.
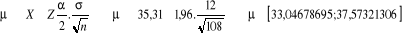
L'âge moyen de la population se situe donc entre 33 ans
et 38 ans.
C'est ici pour nous le moment de confirmer
la première hypothèse selon laquelle « L'exploitation
artisanale de l'or viderait les villages de leurs populations actives, ce qui
induirait par voie de conséquence, à l'absence des petites
initiatives de développement (à vocation agro-pastorale par
exemple) et à la fragilisation de la cohésion sociale par des
conflits d'autorité».
En effet, le centre d'intérêt
des populations actives étant désormais tourné vers
l'orpaillage, il y a non seulement un transfert de la main-d'oeuvre agricole
à la main d'oeuvre minière mais aussi un déplacement, une
« ruée », une sorte d'exode des villages vers les
carrières d'or. Ceci a eu des conséquences néfastes sur le
dynamisme de plusieurs villages. Dans ces villages vidés de leurs
populations actives, on a constaté la diminution de la production agricole,
notamment vivrière, l'absence de petites initiatives de
développement comme un grenier, une boutique, une
décortiqueuse à riz, un moulin à manioc, une forge, une
pharmacie villageoise, un programme d'alphabétisation,
l'aménagement d'une source d'eau potable, etc. Selon un rapport de la
FEC Wamba58(*), dans tout
le territoire, on compte seulement 338 boutiques et 57 officines
pharmaceutiques reparties comme suit :
Tableau N° 6 : Boutiques et officines
pharmaceutiques en Territoire de Wamba
|
WAMBA
|
MATETE
|
MAMBATI
|
BOLEBOLE
|
GBONZUNZU
|
IBAMBI
|
BABONDE
|
TOTAL
|
|
BOUTIQUES
|
60
|
55
|
50
|
50
|
50
|
30
|
10
|
305
|
|
OFFICINES
|
10
|
5
|
4
|
7
|
8
|
7
|
3
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASESE
|
LASA
|
BAYENGA
|
BAKPAU
|
PAWA
|
LEGU
|
BETONGWE
|
TOTAL
|
|
BOUTIQUES
|
10
|
6
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
33
|
|
OFFICINES
|
3
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
13
|
Source : Rapport 2009 de la FEC Wamba
Sur le plan social, cette situation ne
favorise pas une cohésion sociale. En effet, des époux
abandonnent leurs épouses pendant des longues années et cela
génère des divorces. Les activités d'exploitation
artisanale de l'or ont aussi détourné les enfants du
contrôle parental. Ces conflits se manifestent par des querelles qui
amènent parfois les enfants à quitter a jamais le domicile
familial.
b)
Origine socio- professionnelle
L'étude de l'origine socio-
professionnelle des orpailleurs permet d'analyser les fonctions que joue
l'orpaillage sur les autres activités socio- économiques.
D'après nos enquêtes, les orpailleurs et les autres acteurs
oeuvrant dans les carrières d'or sont d'origines socio- professionnelles
diverses. En effet, avant d'exercer l'activité aurifère, ils
étaient soit agriculteurs (39,82%), soit élèves (26,85%),
soit commerçants (17,59%), soit artisans (11,11%), soit enseignants
(3,7%) soit encore petits fonctionnaires de l'Etat (0,93%) comme l'indique le
tableau ci-dessous.
Tableau N° 7 : Origine socio professionnelle des
acteurs
|
N°
|
ORIGINE SOCIO PROFESSIONNELLE
|
EFFECTIFS
|
%
|
|
1
|
Agriculteurs
|
43
|
39,82
|
|
2
|
Elèves
|
29
|
26,85
|
|
3
|
Commerçants
|
19
|
17,59
|
|
4
|
Artisans
|
12
|
11,11
|
|
5
|
Enseignants
|
4
|
3,70
|
|
6
|
Fonctionnaires de l'Etat
|
1
|
0,93
|
|
TOTAL
|
108
|
100,00
|
Source : Données d'enquête de janvier
2011.
Ce tableau confirme d'avantage la
première hypothèse, car il indique le transfert de la
main-d'oeuvre agricole (39,82%) et artisanale (11,11%) à l'orpaillage.
Il indique aussi l'abandon du petit commerce (17,59%), des études
(26,85%), de l'enseignement (3,7%) et de la fonction publique (0,93%) au
profit de l'exploitation artisanale de l'or.
Bref, tous les acteurs intervenant dans
l'activité aurifère sont en interactions. L'ensemble forme tout
un système. La compréhension du rôle des uns dépend
de la compréhension du rôle des autres comme l'indique cette
figure ci-dessus :
Figure N° 1 : Les acteurs de l'activité
aurifère.
2
Exploitants artisanaux
Rôle d'exploitation: sans structures d'encadrement et de
défense de leurs intérêts
3
Négociants
Rôle d'achat: tenant lieu des comptoirs
agréés inexistants sur terrain
1
Services de l'Etat
Rôle réglementaire: institution d'une zone
d'exploitation artisanale
![]()
2.3.
MODES, TYPES D'EXPLOITATION ET CIRCUIT DE COMMERCIALISATION DE L'OR
L'analyse de modes et types d'exploitation
artisanale de l'or et même de son circuit de commercialisation nous
permet de juger de la rapidité et de la suffisance du revenu de
l'orpaillage par rapport aux autres activités économiques telles
que l'agriculture, le commerce, l'artisanat, etc. Retenons toutefois que le
choix d'un mode et d'un type d'exploitation souterraine dépend de
plusieurs facteurs : la forme du gîte (régulière ou
irrégulière), la dimension du gîte, les conditions du
gisement, les propriétés du minerai et de gangues et la
répartition des minéraux de valeur qui conditionne le choix entre
une exploitation sélective ou une exploitation globale59(*).
2.3.1.
Modes d'exploitation artisanale de l'or
Selon MULLER60(*), on peut distinguer deux modes
d'exploitation : exploitation à ciel ouvert et exploitation
souterraine. Tous ces deux modes se pratiquent dans l'ensemble de sites de
notre étude : la recherche de roche à ciel ouvert à
92,59% et exploitation souterraine à 7,41% comme l'indique le tableau
suivant :
Tableau N° 8 : Répartition
selon les modes d'exploitation
|
N°
|
TYPES D'ACTIVITES
|
EFFECTIF
|
%
|
|
1
|
Recherche de roche à ciel ouvert
|
100
|
92,59
|
|
2
|
Exploitation souterraine
|
8
|
7,41
|
|
TOTAL
|
108
|
100,00
|
Source : Données d'enquête de janvier
2011.
a) La
recherche de roche à ciel ouvert (« durba »)
Cette exploitation à ciel ouvert
(voir Photo N°4 en annexe) est définie comme toute exploitation qui met
à nu le gisement à exploiter en enlevant les terrains de
couverture et extrait ensuite le minerai. Donc, dans ce mode d'exploitation,
appelé localement « durba », tous les terrains
stériles qui recouvrent la substance à exploiter sont
enlevés, permettant ainsi un accès facile à celle-ci. On distingue deux phases dans ce mode
d'exploitation :
- le décapage ou découverture ;
- l'extraction du minerai.
Ces deux opérations sont, le plus
souvent effectuées simultanément sur les chantiers. Ce type
d'exploitation présente du point de vue sécurité, des
avantages certains sur l'exploitation souterraine. Par contre, il peut poser de
gros problèmes d'environnement car il se fait sur des gradins à
front vertical. On met en place une mine à ciel ouvert lorsque le
minerai se trouve relativement proche de la surface.
Cette méthode consiste donc
à creuser la terre pour rechercher des roches. Ces roches sont à
la suite lavées et examinées minutieusement en vu de
détecter à la surface, des palettes d'or. Les roches
présentant les palettes d'or sur leurs surfaces sont mises de
côté puis concassées par la suite à l'aide d'un
marteau. Après avoir rendu ces roches en petits morceaux, elles sont
pilées dans un mortier en fer avec un pilon également en fer. Les
roches rendues en poudre sont à la suite lavées et
tamisées à l'aide d'un tamis et d'une calebasse selon la
même approche que le lavage simple. Cette opération permet de
séparer les particules d'or de la poudre de roche.
Cette méthode est très
utilisée. Le jour comme la nuit, on entend à travers les sites,
dans chaque concession, des bruits de mortiers métalliques. Toutes les
couches sociales sont représentées dans cette méthode
(jeunes, élèves, sans emplois, commerçants, femmes au
foyer, hommes adultes, vieux, etc).
b) La
recherche souterraine (« djogo »)
Le mode d'exploitation souterraine,
appelé localement « djogo », est utilisé pour
les gisements en profondeur, c'est-à-dire pour les
minéralisations se trouvant à plus d'une dizaine de mètres
de profondeur. Dans les mines souterraines, il faut veiller à l'exhaure,
l'éclairage, l'aérage, le soutènement pour la
sécurité et la santé des travailleurs.
La recherche souterraine consiste donc
à entrer dans des puits antérieurement creusés par les
premiers orpailleurs avant l'indépendance du pays. L'orpailleur, une
fois dans les tunnels, procède au sondage de la terre pour voir sa
teneur en or. L'échantillon est prélevé sur les piliers du
tunnel. L'orpailleur fait sortir cet échantillon qui est traité
dans la rivière à proximité du site. Une fois
l'échantillon testé positif dans sa teneur en or, l'exploitation
proprement dite commence. L'exploitation souterraine se fait par groupe d'au
moins quatre personnes.
C'est un travail à la chaîne
qui est fait à ce niveau. Il y a une personne qui se trouve au fond du
puits dans les tunnels. Celle-ci creuse la terre avec une barre de mines,
remplit le seau de terre et le remet à une autre qui l'évacue
vers la sortie du puits dans la partie verticale. Une autre est chargée
de faire sortir le seau chargé de terre à l'aide d'une corde. Une
fois sortie, la terre creusée est transportée vers les femmes
pour le traitement.
Ce mode d'exploitation présente des
inconvénients car le risque d'accident est élevé. Et les
accidents qui se produisent sur ce site sont très souvent graves et
mortels. C'est ce qui explique une faible pratique de cette méthode.
2.3.2.
Types d'exploitation artisanale de l'or
On trouve l'or sous forme de
pépites, de flocons ou de poussières dans du gravier ou du sable,
le long des ruisseaux et des rivières. Il se présente aussi sous
forme de métal dans des minerais de roches (quartz) et de métaux
de la famille du platine. Les types d'exploitation dont il est question ici ne
sont rien d'autres que des méthodes de traitement pour l'obtention de
l'or. Il se pratique deux types d'exploitation ou mieux de traitement de l'or
en territoires de Mambasa et de Wamba : le lavage à la batée
(91,67%), et le lavage simple (8,33%).
Tableau N° 9 : Répartition
selon les types d'exploitation
|
N°
|
TYPES D'ACTIVITES
|
EFFECTIF
|
%
|
|
1
|
Lavage à la batée
|
99
|
91,67
|
|
2
|
Lavage simple
|
9
|
8,33
|
|
TOTAL
|
108
|
100,00
|
Source : Données d'enquête de janvier
2011.
a) Le
lavage à la batée (« d'origine »)
Le lavage à la batée (voir
Photo N°1 en annexe) est une méthode qui consiste à
séparer les graviers du sable fin par lavage à l'aide de jet
d'eau afin de récupérer l'or contenu dans le sédiment de
sol. Cette méthode nécessite l'intervention de plusieurs
personnes à différents niveaux suivant une division du
travail : il y a une personne qui met la terre dans la pirogue, une autre
qui met l'eau sur le sable par jet et le lavage est assuré par une autre
par des mouvements circulaires de la main. Le gravier séparé du
sable fin est récupéré à l'autre bout de la pirogue
pour être jeté plus loin et permettre de la sorte la circulation
de l'eau. Le sable fin retenu dans la pirogue sous forme de sédiment et
contenant les papilles d'or est recueilli par le propriétaire de
l'unité de production à la fin de la journée pour le
lavage final.
A la fin de la journée, on peut
donc avoir l'or prêt pour la vente chez le négociant. Il ne suffit
pas d'attendre les semaines ou des mois voire des années comme le ferait
un agriculteur, un artisan, etc. pour profiter du fruit de son travail.
b) Le
lavage simple
Le lavage simple (voir Photo N°2 en
annexe) consiste à séparer le gravier du sable fin par le
procédé de lavage à l'aide d'un bassin métallique
appelé « karay ». Cette opération se fait
dans un petit barrage construit par les orpailleurs eux-mêmes à
cet effet. Il y a ici manipulation du mercure pour permettre de recueillir l'or
en dessous du bassin plein du sable préalablement pillé.
Le lavage simple est même
pratiqué par les enfants et les femmes, cela pour plusieurs raisons,
notamment parce qu'il ne nécessite pas beaucoup d'effort physique,
ensuite parce que la méthode est la même que lorsque les femmes
lavent le riz pour le séparer des grains de sables. Les femmes en
particulier ont donc une connaissance pratique de cette méthode et sont
donc aisées à cette activité. Cette méthode se fait
en quelques heures seulement.
On note que les
différents modes et types d'exploitation sont diversement
appréciés et utilisés. Ainsi le lavage à la
batée et la recherche de roche à ciel ouvert par exemple sont les
plus pratiqués.
2.3.3. Le
circuit de commercialisation de l'or
Pour comprendre combien les services de
l'Etat perdent comme recettes dans cette partie du pays longtemps
enclavée, nous avons reconstruit les circuits de commercialisation en
utilisant bien sur les informations du terrain et les informations
publiées par rapport de HUMAN RIGHTS WATCH en 2005.
Le commerce de l'or des territoires de
Mambasa et de Wamba se fait essentiellement via Butembo. Le comptoir Congo Com
de Dr KAMBALE KISONI (KIDUBAI), assassiné en juillet 2007, est reconnu
comme le plus grand des comptoirs d'or de Butembo. Ce comptoir disposait, avant
l'assassinat du propriétaire, d'une fonderie qui lui permettait de
fondre l'or en lingots. Congo Com était alors l'une des plus grandes
compagnies d'exportation de l'or de la RD Congo et de la région des
grands lacs. Il existe une multitude d'autres petits comptoirs d'or qui ont
pris la relève après la chute de Congo Com. Selon HUMAN RIGHTS
WATCH, on estimait en 2005 entre 20 a 60 kgs d'or par jour quittent la Province
Orientale pour Butembo. Cela équivaut a environs 600000 à 1800000
dollars américains par jour qui sort de la Province Orientale pour
Butembo. En effet, sur place en carrières un gramme d'or coûte
environs 30 dollars américains.
Tous les comptoirs de Butembo vendent de
l'or en Ouganda ; les ougandais le revendent à des compagnies en
Suisse ou en Afrique du Sud, parfois à Dubaï. La plus grande partie
de cet or est exporté de la RD Congo illégalement par des
commerçants sans licences d'exportation, ni des documents de change,
sans autorisation de fonctionnement comme comptoir ou maison d'achat, sans
comptes bancaires ouverts à la banque centrale du Congo et ne
s'acquittant d'aucune taxe comme l'exige le code minier congolais. Ainsi,
pendant la période de 1998 - 2004, l'exploitation illégale de
l'or de la RD Congo a amené une amélioration significative dans
la balance de paiement de l'Ouganda, ceci a ensuite donné aux bailleurs
de fonds multilatéraux et en particulier le FMI qui suivaient la
situation du trésor ougandais, une confiance accrue dans
l'économie ougandaise61(*).
Les principaux comptoirs qui
achètent de l'or congolais en Uganda sont :
- MACHANGA LTD : c'est le 2ème exportateur de l'or de
l'Ouganda. D'après Human Rights Watch, les responsables de cette
compagnies affirment que pratiquement tout l'or qu'ils exportent provient de la
RDC à destination de la Suisse, chez Metallor technologie SA. Ces propos
de Human Rights Watch sont confirmées par les déclarations de nos
enquêtés. En effet, l'entreprise Machanga achète de l'or
dans le cadre d'une relation commerciale régulière avec des
négociants en RD Congo ;
- UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD: cette entreprise UCI
achète aussi de l'or de manière régulière à
des négociants en RD Congo. Pendant les rébellions, ces
négociants étaient étroitement liés à des
milices. Cela a constitué pendant longtemps une « fourniture
d'assistance » à des groupes armés illégaux en
violation de l'embargo sur les armes établi par les résolutions
1493 (en 2003) et 1596 (en 2005).
Le circuit de commercialisation de l'or
peut être schématisé comme suit :
Figure N° 2 : Circuit de commercialisation de
l'or
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Suisse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mambasa- Wamba
|
|
Butembo
|
|
|
|
|
|
Exploitants
|
|
(ConcoCom)
|
|
Ouganda
|
|
Afrique du Sud
|
|
Négociants
|
|
Comptoirs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dubaï
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mais qu'est-ce qui justifie au juste
l'engouement de la population active vers l'orpaillage au point même
d'abandonner d'autres activités telles que l'agriculture, le commerce,
l'artisanat, les études, etc.
2.4.
ATTRAIT POUR L'ACTIVITE AURIFERE
Plusieurs raisons, aussi bien
économiques que sociales, justifient l'attrait des populations des
territoires de Mambasa et de Wamba pour l'activité aurifère.
2.4.1.
Raisons économiques
Nous entendons par raisons
économiques les motivations purement économiques,
c'est-à-dire le gain, le profit et qui sont les facteurs incitatifs
à cette activité. Les différentes raisons
économiques à la base de la motivation des acteurs sont ici
regroupées dans un tableau. Le calcul des pourcentages est fait selon
les réponses des enquêtés.
Tableau N° 10 : Facteurs économiques de
motivation à l'orpaillage
|
N°
|
FACTEUR DE MOTIVATION
|
EFFECTIFS
|
%
|
|
1
|
Revenu rapide et élevé
|
31
|
28,70
|
|
2
|
Activité circonstancielle
|
28
|
25,92
|
|
3
|
Activité de soudure
|
26
|
24,09
|
|
4
|
Opportunités d'affaires
|
21
|
19,44
|
|
5
|
Soutien aux parents
|
2
|
1,85
|
|
TOTAL
|
108
|
100,00
|
Source : Données d'enquête de janvier
2011.
a) Un revenu rapide et élevé
Contrairement aux activités
champêtres, artisanales et commerciales, l'orpaillage permet aux acteurs
d'avoir rapidement de l'argent. C'est ce qui motive une grande partie de la
population qui se rue sur les sites d'orpaillage. En effet, pour chaque type ou
mode d'exploitation, l'or peut être recueilli sur place le même
jour ou quelques jours après, en tout cas au plus deux semaines. Quand
on a déjà le sable fin, le lavage à la batée ou le
lavage simple ne prend qu'un jour ; la production est vendue sur place au
soir même du lavage.
Cette activité génère
aussi un revenu élevé par rapport aux activités
socio-économiques. Les enquêtes menées au cours de nos
recherches ont montré que le revenu moyen des orpailleurs
s'élève à environs 245 dollars américains par mois,
comme l'indiquent les calculs suivants62(*) :
1° Détermination de nombre de classes k, de
l'étendue d, de l'amplitude a et de la borne
inférieure de la première classe 

2° Tableau de calculs intermédiaires
Tableau N° 11 : Tableau de
distribution du caractère revenu des creuseurs
|
N°
|
CLASSE
|
CENTRE DE CLASSE Xi
|
EFFECTIF ni
|
xini
|
FREQUENCE
fi
|
fi %
|
fi % croissant
|
fi % décroissant
|
|
1
|
[20;189[
|
104,5
|
57
|
5956,5
|
0,528
|
52,8
|
52,8
|
100
|
|
2
|
[189;358[
|
273,5
|
38
|
10393
|
0,352
|
35,2
|
88
|
47,2
|
|
3
|
[358;527[
|
885
|
5
|
4425
|
0,046
|
4,6
|
92,6
|
12
|
|
4
|
[527;696[
|
611,5
|
5
|
3057,5
|
0,046
|
4,6
|
97,2
|
7,4
|
|
5
|
[696;865[
|
780,5
|
2
|
1561
|
0,019
|
1,9
|
99,1
|
2,8
|
|
6
|
[865;1034[
|
949,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
99,1
|
0,9
|
|
7
|
[1034;1203[
|
1118,5
|
1
|
1118,5
|
0,009
|
0,9
|
100
|
0,9
|
|
SOMME
|
|
108
|
26511,5
|
1
|
100
|
|
|
Source : Nos calculs à partir des données
d'enquête de janvier 2011.
3° Calcul de la moyenne de revenu mensuel des creuseurs

A partir de cette moyenne de
l'échantillon, nous pouvons estimer la moyenne de toute la population
concernée par l'intervalle de confiance à 95%, avec un
écart type de 185,697212.

Le revenu moyen de la population se situe
donc entre 210 et 280 dollars américains. Un orpailleur peut donc gagner
entre 210 et 280 par mois, ce qui n'est pas le cas d'un agriculteur ou d'un
petit fonctionnaire de l'Etat qui ne gagne pas plus de 100 dollars selon le
minimum légal (SMIG) de 3 dollars par jour. Cependant, 12,52% seulement
de ce revenu (245 dollars américains) soit 30,674 dollars
américains est consacré à l'épargne et 87,48% soit
214,326 dollars américains à la consommation. La propension
marginale à consommer est très élevée (0,87), elle
approche l'unité. Cette consommation consiste plus à la
satisfaction des besoins alimentaires et vestimentaires. D'autres besoins
fondamentaux comme les soins de santé, l'éducation, le transport,
l'eau, l'énergie, ... restent non satisfaits.
La deuxième hypothèse selon
laquelle « Il semble que l'exploitation artisanale de l'or procure un
revenu rapide et élevé permettant de satisfaire les besoins
fondamentaux des exploitants artisanaux» est à nuancer. Le revenu
nominal des creuseurs est élevé mais étant donné la
cherté de la vie dans les carrières d'or, il ne parvient pas
à couvrir tous les besoins fondamentaux. Il y a illusion
monétaire car ce revenu n'a pas un pouvoir d'achat correspondant.
b)
D'autres raisons économiques
En plus de la motivation d'un revenu
élevé, il y a d'autres raisons qui poussent les gens à
devenir orpailleurs. Il s'agit de :
- une activité de soudure : selon
certains orpailleurs, en attendant que les activités économiques
reprennent leur rythme normal, il est judicieux pour eux d'exploiter
artisanalement l'or en vu de faire face aux charges familiales qui leur
incombent ;
- une activité
circonstancielle et un soutien aux parents : une grande
partie des acteurs ne pense pas exercer cette activité pour toujours.
Ils sont là juste pour avoir de l'argent pour faire face à des
besoins urgents. C'est le cas des élèves qui sont massivement
présents sur les sites pendant les vacances. Ils disent être
là pour avoir un fond et aider leurs parents dans le financement de leur
scolarité. Ces élèves prétendent soutenir leurs
parents en préparant ainsi leur rentrée scolaire ;
- des opportunités d'affaires : les sites
d'orpaillage sont pour certaines personnes une occasion de faire du commerce vu
le nombre important de population qui s'y trouve. Plusieurs produits sont
offerts aux orpailleurs. Il s'agit du commerce de produits vivriers mais aussi
de médicaments. Notons aussi la croissance de la vente des instruments
d'orpaillage notamment les bêches, les pioches, etc. Ce commerce,
d'ailleurs informel, se fait sur les sites d'orpaillage et n'a rien à
voir avec celui pratiqué pour les besoins ordinaires des paysans
agriculteurs.
2.4.2. Raisons sociales
Certains facteurs sociaux sont à la
base de la motivation des populations vers l'orpaillage : effet de mode
(47,22%), contrainte familiale (43,52), le silence administratif (2,78%), etc.
Tableau N° 12 : Facteurs sociaux de motivation
à l'orpaillage
|
N°
|
FACTEUR DE MOTIVATION
|
EFFECTIFS
|
%
|
|
1
|
Effet de mode
|
51
|
47,22
|
|
2
|
Contrainte familiale
|
47
|
43,52
|
|
3
|
Silence administratif
|
3
|
2,78
|
|
4
|
Autres
|
7
|
6,48
|
|
TOTAL
|
108
|
100,00
|
Source : Données d'enquête de janvier
2011.
A propos de l'effet de
mode, un enquêté justifiait sa présence à
l'orpaillage en ces termes : «On parle trop de ça. Il faut que
je vienne voir ce qu'on gagne réellement. Quand les gens font il faut
faire aussi, on ne sait jamais où se trouve la chance... ». La
diffusion de ces informations plus ou moins fondées est donc un facteur
déterminant dans la croissance et la persistance de l'orpaillage.
Certains justifient leur
pratique de l'orpaillage par la contrainte familiale. En effet, certaines
familles ont pour activité principale l'orpaillage. Les chefs de ces
groupes domestiques mobilisent toutes les personnes à leur charge dans
cette activité. Un autre groupe d'orpailleurs justifient leur
présence par les besoins sociaux de la famille. D'autres encore disent
qu'ils pratiquent l'orpaillage parce que la famille toute entière s'y
est tournée pour assurer sa survie.
L'orpaillage dans
l'ensemble de sites de notre recherche se déroule aussi dans des
conditions d'illégalité. En effet, selon le Code minier
congolais, il faut une autorisation délivrée par les services de
l'administration minière pour toute exploitation artisanale. Le constat
que nous avons fait sur le terrain c'est que presque tous les petits
orpailleurs (ou petits exploitants) n'ont pas la connaissance de cette loi. Ils
n'ont donc pas d'autorisation d'exploitation. Aucune action contraignante n'est
aussi menée en vu de régulariser le secteur. Ce mutisme des
autorités compétentes sur l'illégalité des
orpailleurs est ainsi un des facteurs de la croissance de l'exploitation
artisanale de l'or dans la contrée.
Parmi toutes ces raisons,
économiques comme sociales, qui expliquent l'attrait des populations des
territoires de Mambasa et de Wamba vers l'exploitation artisanale de l'or, la
principale demeure le revenu rapide et élevé.
Conclusion partielle
En guise de conclusion de ce chapitre, il
convient de dire que l'environnement économique des territoires de
Mambasa et de Wamba est vraiment marqué par des potentialités
naturelles, touristiques et du sous-sol énormes. Ceci justifie la
présence d'une multiplicité de carrières d'or dans ces
territoires.
Les différents acteurs, à
savoir les services de l'Etat, les exploitants artisanaux, les
négociants et les femmes entrepreneurs, qui vivent dans ces
carrières d'or proviennent de diverses origines socio- professionnelles
et sont de différents âges. L'âge des exploitants
artisanaux, par exemple, se trouve dans l'intervalle de 33 et 38 ans et celui
des femmes entrepreneurs entre 22 et 27 ans. Cette situation a confirmé
notre première hypothèse selon laquelle «L'exploitation
artisanale de l'or viderait les villages de leurs populations actives, ce qui
induirait par voie de conséquence, à l'absence des petites
initiatives de développement (à vocation agro-pastorale par
exemple) et à la fragilisation de la cohésion sociale par des
conflits d'autorité ».
Il se pratique dans l'ensemble de sites de
notre étude deux modes d'exploitation de l'or, la recherche de
roche à ciel ouvert (92,59%) et la recherche souterraine (7,41%), et
deux types d'exploitation de l'or, le lavage à la batée (91,67%)
et le lavage simple (8,33%). Plusieurs raisons, aussi bien économiques
que sociales, justifient l'attrait des populations des territoires de Wamba et
de Mambasa pour cette pratique. Mais la raison principale est le fait que
l'orpaillage génère un revenu rapide et élevé. En
effet, le revenu mensuel des orpailleurs varie entre 210 et 280 dollars
américains. Ceci a confirmé notre deuxième
hypothèse selon laquelle « L'engouement de la population vers
l'orpaillage s'expliquerait par la capacité de cette activité
à fournir un revenu rapide et élevé».
CHAPITRE
TROISIEME :
LA PLACE DE L'ORPAILLAGE
DANS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Ce chapitre tente de montrer la place que
peut occuper l'orpaillage dans le processus de développement en
territoires de Mambasa et de Wamba. Mais avant d'y arriver, nous analysons
d'abord les conséquences environnementales et sanitaires de cette
activité dans la première section. Nous posons ensuite dans la
deuxième section les conditions de l'émergence du
développement à partir de l'orpaillage. Nous proposons enfin dans
la dernière section les pistes vers un plan stratégique national
de l'orpaillage.
3.1.
ANALYSE AVANTAGES - COUTS
L'analyse avantages - coûts consiste
généralement à :
- identifier les avantages (externalités positives) et
tous les coûts (directs, indirects, externalités négatives,
etc.) ;
- chiffrer ces avantages et tous ces coûts ; et
enfin
- les comparer.
Etant donnée les difficultés
d'évaluation chiffrée des conséquences environnementales
et sanitaires, nous nous limiterons à identifier les avantages et les
coûts et à les comparer en termes d'importance des
bénéficiaires des avantages et des victimes des coûts
provoqués par la dégradation de l'environnement et de la
santé publique.
3.1.1. Les
externalités positives : avantages
Les externalités positives peuvent
être regroupées en trois catégories : le revenu
généré par l'orpaillage, l'émergence des centres
commerciaux autour des carrières d'or et l'importance de l'or dans la
finance informelle.
a) Le
revenu généré par l'orpaillage
Dans le chapitre précédent,
nous avons trouvé que l'orpaillage génère un revenu rapide
et élevé. En effet, le revenu mensuel des orpailleurs varie entre
210 et 280 dollars américains. Bien que ce revenu soit globalement
affecté à la consommation alimentaire et vestimentaire, quelques
rares enquêtés nous ont témoigné avoir acheter des
tôles de leurs maisons en semi durables par le revenu issu de
l'orpaillage. D'autres se sont procurés des parcelles dans les chefs
lieux des territoires (Mambasa et Wamba) grâce au revenu tiré de
l'orpaillage. D'autres encore ont acheté des biens d'équipement
domestiques, des vélos voire des motos.
Au niveau provincial (Province Orientale),
20 à 60 kilogrammes d'or estimés à environs 600000
à 1800000 dollars américains par jour quittent la Province
Orientale en direction de Butembo. Il y a quand même un flux financier
très important à l'origine duquel il y a l'exploitation
artisanale de l'or. Le rapport de HUMAN RIGHTS WATCH avait déjà
publié l'évolution plus ou moins de la production de l'or en
Province Orientale en valeur (dollars américains) comme l'indique le
tableau suivant :
Tableau N° 13 : Evolution de la production
artisanale de l'or en Province Orientale
en valeur (dollars américains)
|
ANNEE
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
|
EXPORT
|
18.600.000
|
38.360.000
|
55.730.000
|
50.350.000
|
59.900.000
|
45.760.000
|
45.590.000
|
Source: Rapport de HUMAN RIGHTS WATCH
Comme le disent Koen VLASSENROOT et
Timonthy RAEYMAEKERS63(*),
les mineurs sont quelques fois confrontés à des grandes
quantités d'argent, surtout lorsqu'ils attirent une quantité
équivalente d'or. La découverte d'une pépite ou d'une
veine d'or signifie souvent l'avènement rapide d'une fortune. Ainsi,
dans les carrières, les orpailleurs dépensent souvent leur argent
pour de la bière et de « lotoko » (l'alcool
local fait de mais et de manioc) dans des
« nganda » locaux.
b)
L'émergence des centres commerciaux autour des carrières d'or
L'exploitation artisanale de l'or en
territoires de Mambasa et de Wamba a attiré un nombre important de
paysans et des chômeurs urbains en quête de fortune ou simplement
de survie économique. Ces migrations ont eu des effets importants sur le
paysage socio- économique des centres miniers ruraux
périphériques aux centres
« urbanisés » d'accumulation informelle et de
survie. Ainsi, dans ces centres, on trouve des marchés des produits
vivriers, des boutiques et officines pharmaceutiques, la naissance du secteur
tertiaire en campagne où sont organisés certains services tels
que les restaurants populaires, les bars, le transport (vélo ou moto
taxi), la multiplicité des groupes des prières, etc.
c)
L'importance de l'or pour la finance informelle
L'or joue un rôle important
d'épargne et de transfert dans la finance informelle. En effet, dans les
carrières d'or, les gens ont pris l'habitude d'épargner leur
argent (les francs congolais) en le convertissant en or. Ainsi, pour quelques
paysans qui pratiquent encore des activités agricoles et vendent leurs
produits vivriers dans les centres miniers, la vente de produits vivriers
s'accompagne toujours par l'achat de l'or si les produits eux-mêmes ne
sont pas achetés en or. Il n'est pas donc étonnant que certains
prix soient directement fixés en or. Lors de nos enquêtes par
exemple un kilogramme de riz blanc coûtait une
« tige » d'or (l'équivalent de un dixième du
gramme et pèse comme une tige d'allumette).
L'or sert de plus en plus comme
intermédiaire dans les opérations de transfert d'argent. Les
parents ou les petits entrepreneurs qui veulent transférer l'argent a
Butembo par exemple pour l'une ou l'autre raison, le déposent
auprès des négociants qui ont des liens d'affaires a Butembo. Ces
négociants achètent de l'or avec cet argent pendant que
l'équivalent de cette somme d'argent est servi à Butembo. C'est
la l'un des principaux avantages de l'orpaillage dans un milieu où il
n'existe pas un système formelle de micro finance.
Quelles sont donc les conséquences
de l'orpaillage sur l'environnement et la santé.
3.1.2. Les
externalités négatives : conséquences
environnementales et sanitaires
Si l'exploitation artisanale de l'or peut
jouer un rôle important dans le processus de développement en
territoires de Mambasa et de Wamba, il faut cependant avoir à l'esprit
que cette activité s'accompagne aussi des conséquences
néfastes sur l'environnement et la santé.
a) Les
problèmes environnementaux
L'exploitation artisanale de l'or
entraîne de graves préjudices à l'équilibre de
l'écosystème. Les principaux problèmes environnementaux
qui en résultent sont la pollution des eaux (32,41%), la destruction de
la faune (25,93%), la dégradation des sols (21,29%) et la
déforestation (6,48%).
Tableau N°14 : Problèmes
environnementaux de l'orpaillage
|
N°
|
TYPES DE PROBLEMES
|
EFFECTIF
|
%
|
|
1
|
Pollution des eaux
|
35
|
32,41
|
|
2
|
Destruction de la faune
|
28
|
25,93
|
|
3
|
Dégradation des sols
|
23
|
21,29
|
|
4
|
Déforestation
|
15
|
13,89
|
|
5
|
Autres (pollution sonore, dévastation de l'aire
protégée, ...)
|
7
|
6,48
|
|
TOTAL
|
108
|
100,00
|
Source : Donnée d'enquête de janvier
2011.
1° La pollution des eaux
L'activité d'orpaillage cause des
dommages réels aux eaux. Il s'agit de la modification du tracé
originel des cours d'eaux, de la pollution des cours d'eau et de l'intoxication
de leurs habitants, la pollution des nappes phréatiques. Les
éléments chimiques produits par l'orpaillage ont un effet
très nocif sur les eaux. On utilise souvent des quantités
excessives de substances chimiques, par exemple du mercure, au détriment
de l'environnement (déchets extrêmement polluants). On a tendance
à croire que plus on utilise des produits chimiques, mieux cela vaut.
Notre étude n'est pas allée
jusqu'à analyser le degré de pollution des cours d'eau en
éléments chimiques produits par l'orpaillage. Cependant, d'autres
dégâts causés à l'eau sont visibles. L'eau retenue
pour laver l'or est à la suite de son usage déversée
directement dans la rivière qui passe tout juste à
côté. Le drame, c'est que ce geste inconsidéré met
en danger la vie des ressources halieutiques et même des vies humaines,
car l'eau, de cette rivière polluée par le fait de l'orpaillage,
est souvent consommée par des paysans dans leurs champs.
2° La destruction
de la faune
L'orpaillage dans les territoires de
Mambasa et de Wamba, avec toutes ses activités connexes telles que la
chasse intensive et commerciale, le braconnage armé et l'exploitation
intensive du charbon du bois, contribue à l'altération rapide du
biotope et à la destruction massive de la faune. Selon un rapport de la
Réserve de Faune à Okapis (RFO Epulu), la présence des
carrières minières sur l'axe Badengaido- Bafwanekengele-
Bafwambaya- Bafwabango, un des deux axes de notre recherche, favorise la chasse
intensive et commerciale ainsi que le braconnage64(*).
3° La dégradation des
sols
La dégradation des sols par les
activités d'orpaillage est parmi les conséquences les plus
visibles dans les conséquences environnementales. Le couvert
végétal des sites est dégradé par l'action des
fouilles. Les orpailleurs dégagent la végétation avant de
creuser la terre. Dans cette logique, toutes les herbes et les arbres sont
coupés. Ainsi, les sites d'orpaillage sont des terrains rendus nus sur
des centaines de mètres.
Les trous creusés par les
orpailleurs, les pierres infertiles en or rejetées à la surface
rendent les sites irrécupérables pour l'agriculture. Dans un
premier temps, les trous rendent les sites d'accès dangereux et dans un
second temps ils ne disposent pas les sites à une activité
agricole. Les champs proches des sites d'exploitation sont quotidiennement
détruits par l'action des orpailleurs. Aussi, les dégâts
causés au sol sont-ils un problème pour l'aménagement de
ces carrières.
4° Les autres externalités
négatives
Parmi les autres externalités
négatives environnementales, il faut citer notamment les
suivantes :
- la déforestation très avancée : la
forte concentration des orpailleurs, parfois spontanée sur les sites,
entraîne le déboisement anarchique des ressources ligneuses
végétales pour la satisfaction des besoins
énergétiques (bois de feu) et d'habitation (bois de service);
- la non évacuation des déchets solides et
dangereux : l'accumulation des rejets d'exploitation du minerai et les
déchets et ordures ménagères de toutes sortes constituent
des éléments de pollution et de dégradation de la
diversité biologique ;
- la dévastation de l'aire protégée
(RFO) ;
- la pollution sonore;
- etc.
b) Les
problèmes sanitaires
Pour ce qui concerne les
conséquences sanitaires de l'orpaillage, les enquêtes du terrain
nous ont permis de les regrouper en quatre catégories : les risques
sanitaires proprement dits, les risques d'accidents, les risques
d'éboulement et l'insalubrité.
Tableau N°15 : Les externalités
sanitaires de l'orpaillage
|
N°
|
TYPES D'EXTERNALITES
|
EFFECTIF
|
%
|
|
1
|
Risques sanitaires
|
52
|
48,15
|
|
2
|
Risques d'accidents
|
28
|
25,93
|
|
3
|
Risques d'éboulement
|
14
|
12,96
|
|
4
|
Insalubrité
|
8
|
7,41
|
|
5
|
Autres (diarrhée, « filaire », ...)
|
6
|
5,55
|
|
TOTAL
|
108
|
100,00
|
Source : Donnée d'enquête de janvier
2011.
1° Risques sanitaires proprement
dits
Les effets délétères
de l'orpaillage sont nombreux. Ils sont pour la plupart liés à
l'hygiène des sites d'exploitation et la poudre de poussière
dégagée par la pierre pilée. Les orpailleurs les plus
exposés sont ceux qui pratiquent le lavage simple, le lavage à la
batée et le broyage des pierres.
Dans le cas du lavage simple et le lavage
à la batée, la présence des orpailleurs dans l'eau
insalubre tout le temps de leur activité est un risque potentiel
d'infections. Ils sont vulnérables à plusieurs maladies
cutanées et sexuelles à court et à long terme. Pour ceux
qui broient les pierres, ils sont exposés à des infections
cérébrales.
Selon les médecins des zones de
santé environnantes, plusieurs consultations ont un rapport direct avec
l'orpaillage. Il s'agit des maladies comme la bilharziose, les infections
vaginales, la fièvre typhoïde, les infections cutanées, la
méningite, la tuberculose, la malaria, la dysenterie, etc.
Au-delà de ces maladies, les
orpailleurs sont exposés à d'autres maladies liées
à l'intoxication au mercure. Les études de l'O.I.T65(*)., en 1999, ont
démontré que la vapeur de mercure, qui se dégage lorsque
l'amalgame de mercure et d'or est chauffé en cycle ouvert, est
ingérée par voie pulmonaire, ce qui entraîne des coliques,
des vomissements, des gastro-entérites, des maladies des reins et des
voies urinaires, des entérites aiguës, une ulcération des
gencives et une sensibilité extrême à la lumière.
Par ailleurs, l'accent a été
mis dans de nombreuses réponses sur l'importance de la santé
communautaire. Les installations sanitaires insuffisantes, le manque d'eau
saine, le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la tuberculose, les
maladies sexuellement transmissibles (notamment le SIDA), la malnutrition et la
consommation abusive d'alcool et d'autres drogues constituent des
problèmes fréquents qui s'accentuent, prenant parfois des
proportions d'épidémie lorsque des petites exploitations
s'établissent dans une nouvelle région et que leurs travailleurs
doivent s'installer dans des logements précaires.
2° Risques d'accident, notamment
d'éboulement
Bien qu'on manque de données sur
les accidents dans les petites exploitations minières, on doit affirmer
que les accidents sont légions sur les différents sites
d'orpaillage. Ces accidents partent des plus bénins au plus graves,
aboutissant parfois à la mort.
Les accidents sont souvent causés
par l'imprudence des orpailleurs. Pour la plupart des cas par exemple, c'est
parce que les victimes ont taillé les piliers permettant de soutenir la
partie supérieure des tunnels. Cette imprudence conduit à des
accidents causant la mort des personnes.
Parfois, les accidents sont causés
par la chute de portions de terre. En effet, les orpailleurs à la
recherche de roches creusent la terre de façon verticale et à une
certaine profondeur (2 à 3 mètres). Ils font des lobes.
Même si ces trous ne sont pas suffisamment profonds, la partie
supérieure des lobes constituent un danger permanent pour les
orpailleurs. Car la partie supérieure n'est pas soutenue par des
piliers, et l'action de la pluie provoque des éboulements.
Un autre risque d'accident est non
négligeable. Il s'agit des particules de roche qui sautent lors du
concassement du broyage des roches. Selon les informations reçues,
beaucoup d'orpailleurs perdent leurs yeux par des fragments de roches.
Les accidents sont donc liés aux
méthodes d'exploitation. Ainsi, les méthodes d'exploitation
souterraine et la recherche de roche sont particulièrement les plus
risquant.
3° Insalubrité
Dans tous les sites de notre recherche, de
nombreuses ressources en eau sont polluées et on a remarqué une
absence quasi-totale d'installations sanitaires. L'eau propre est devenue rare.
Cette situation de mauvaises conditions sanitaires et d'hygiène
constitue des vecteurs de maladies d'origine hydrique. D'ailleurs selon une
étude commandée par le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) à l'occasion de la Journée mondiale de
l'eau en mars 2010, l'eau souillée et l'absence d'installations
sanitaires sont responsables de plus de morts que toutes les formes de
violences y compris les guerres66(*).
En grosso modo, l'analyse avantages -
coûts de l'activité aurifère en territoires de Mambasa et
Wamba peut être résumé dans un tableau :
|
AVANTAGES
|
COUTS
|
|
1. Revenu issu de l'orpaillage:il est plus au profit des
négociants, aucun impact sur les infrastructures d'intérêt
communautaire
|
1. Problèmes environnementaux: pollution des eaux,
destruction de la faune, dégradation de sols, etc.
|
|
2. Emergence des centres commerciaux avec développement
du secteur tertiaire
|
2. Problèmes sanitaires:risques sanitaires, d'accident,
d'éboulement
|
|
3. Rôle important dans la finance informelle: l'or sert a
l'épargne et au transfert
|
|
|
BENEFICIAIRES:
|
VICTIMES:
|
|
Une partie de la population présente de ces 2
territoires
|
Toute la population présente et future de 2 territoires
|
|
Les négociants
|
|
|
Les comptoirs des villes (Butembo, ...)
|
|
|
L'Ouganda
|
|
Tableau N°16 : Analyse avantages - coûts de
l'orpaillage
L'activité aurifère telle
qu'il se fait actuellement en territoires de Mambasa et de Wamba s'accompagne
donc des conséquences néfastes sur l'environnement et la
santé. Ceci confirme notre troisième hypothèse selon
laquelle « L'orpaillage aurait des conséquences
néfastes sur l'environnement et sur la santé des
hommes ». Que faut-il donc faire pour que l'orpaillage
présente plus des avantages que des conséquences
néfastes ?
3.2.
LES CONDITIONS NECESSAIRES DE L'EMERGENCE DU DEVELOPPEMENT A PARTIR DE
L'ORPAILLAGE
Pour que l'orpaillage puisse contribuer a
l'émergence du développement local en territoires de Mambasa et
de Wamba, il faut entre autre 1) réviser le cadre juridique de
l'orpaillage en RD Congo, 2) résoudre le problème des
externalités négatives de l'exploitation artisanale de l'or et 3)
encadrer les différents acteurs intervenant dans ce domaine.
3.2.1. La révision du cadre juridique de
l'orpaillage en RD Congo
Cette révision ne mettra pas
l'accent seulement sur le Code minier mais concernera tout l'ensemble du cadre
juridique : le code minier, les orientations stratégiques, les
mesures particulières, etc.
a) Du
Code minier proprement dit
La révision du Code minier pourrait
concerner trois aspects. En premier lieu, au lieu de mettre tout l'accent
seulement sur la rentabilité du projet minier, il faut aussi mettre
l'accent sur le développement national.
Ensuite, à la place d'une
libéralisation du secteur minier à outrance jusqu' à
manquer d'objectifs de développement, l'Etat doit devenir de plus en
plus garant de la richesse du pays et doit être présent dans ce
secteur essentiel à tous les niveaux.
Enfin, le cadre juridique de l'orpaillage
en RD Congo doit viser aussi des vrais objectifs de développement social
des populations locales, en plus de la réalisation des infrastructures
de base d'intérêt communautaire. Il faut par exemple
prévoir la formation des différents acteurs qui interviennent
dans le secteur miner, un dispositif participatif pour la négociation
des conventions minières pour des gisements de grande ampleur, etc.
b) Des
orientations stratégiques précises
Le cadre juridique de l'orpaillage pouvait
donner de façon explicite, par exemple les orientations
stratégiques suivantes :
- minimisation des impacts négatifs de l'exploitation
artisanale de l'or sur l'environnement en général et sur la
diversité biologique en particulier ;
- développement des exploitations minières
conservatrices de la diversité biologique ;
- élaboration d'un programme de surveillance
environnementale et de contrôle dans les zones d'exploitation
minière ;
- restauration des écosystèmes
dégradés, création des périmètres de
reboisement autour des carrières et des mines ;
- promotion d'une analyse comparative des avantages et des
inconvénients, pour toute exploitation des ressources
minières.
Ces orientations peuvent être
coulées dans un document sous forme d'un plan stratégique
national de l'exploitation artisanale de l'or. Somme toute, l'exploitation
artisanale de l'or doit être intégrée dans des politiques
de développement du gouvernement de la RD Congo.
c) Des
mesures de lutte contre le travail des enfants dans les mines
Ces mesures que l'Etat doit prendre
peuvent tourner autour de la sensibilisation/mobilisation de l'opinion, de
l'éducation des enfants, de la réinsertion sociale des enfants
« mineur » grâce à des services de soutien
et de la promotion d'activités génératrices de
revenus pour les parents.
La sensibilisation et la mobilisation
de l'opinion sont de précieux outils de prévention et
d'élimination du travail des enfants. Le premier pas dans la bonne
direction est de faire connaître au public les conséquences du
travail des enfants dans les petites exploitations minières. Il est
désormais admis qu'à partir du moment où la
société tout entière prend conscience du problème,
la situation est mûre pour stigmatiser et éradiquer les formes les
plus abusives et les plus dangereuses de travail des enfants.
Le moyen le plus efficace pour
endiguer l'afflux des enfants d'âge scolaire vers les formes abusives
d'emploi et de travail est d'élargir et d'améliorer la
scolarisation de ces enfants, de manière à les attirer à
l'école et à les y maintenir. L'éducation de
qualité est un élément essentiel de la solution. A tout le
moins, l'école doit être présente et accessible; elle doit
être ouverte à plein temps ou du moins une bonne partie de la
journée. Son coût doit être modéré, pour un
enseignement de qualité acceptable et adapté au contexte
socio-économique. Il est impératif que les enfants soustraits au
travail bénéficient d'un suivi et d'un soutien
supplémentaire lorsqu'ils sont placés dans des écoles
traditionnelles.
Lorsqu'un enfant est retiré du
travail, il doit bénéficier de toute une série de mesures
de soutien. Cela est particulièrement important lorsque son
développement a été compromis par le travail. Il aura
besoin non seulement d'une instruction et d'une formation professionnelle, mais
aussi de services médicaux, d'une alimentation adaptée, d'une
formation professionnelle, de loisirs et de jeux et d'un suivi intensif.
De nombreux enfants sont
obligés de travailler pour suppléer au revenu familial. Lorsqu'on
les retire de leur travail à plein temps ou à temps partiel, il
importe le plus souvent de prévoir une autre activité
génératrice de revenus pour les parents et/ou les enfants.
3.2.2. La
gestion des externalités négatives : quelques solutions
Le concept d'externalités a
trouvé un intérêt accrû aux yeux des
économistes de l'environnement, parce qu'il permet de formaliser le
problème de pollution. Cette section propose des solutions en
présence d'externalités négatives principalement.
a) Le
laissez- faire
La solution du
laissez- faire peut
paraître triviale et inopérante, mais il ne faut pas
s'arrêter à cette première impression. Il s'agit de laisser
faire mais en intégrant les coûts de pollution dans les frais de
permis d'exploitation artisanale et dans les autres frais d'installation dans
une zone minière. Les externalités, notamment négatives,
sont internalisées sous forme du prix des logements et terrains dans les
sites d'orpaillage. Seuls, les habitants avant l'installation de sites
d'orpaillage sont fondés à se plaindre, pas ceux qui se sont
installés après et donc en toute connaissance de cause.
b) La
fusion
C'est une solution simple : les
petites exploitations minières rachètent, par exemple, les champs
des populations riveraines. L'externalité est internalisée par
les petites exploitations minières. Les petites exploitations
minières, restant seules, maximiseront leur profit global : elles
seront alors obligées de tenir compte de l'effet néfaste de leur
exploitation minière sur sa production agricole. De manière
naturelle, elles seront conduites à trouver l'optimum de production.
c) La
négociation
C'est solution à l'amiable entre
les différents agents économiques, entre par exemple des
orpailleurs et les agriculteurs. Si les petites exploitations minières
et les populations riveraines parviennent à un accord, il n'est nul
besoin d'une intervention extérieure, et ce quelle que soit la
répartition des droits de propriété, selon le
théorème
de COASE.
Ronald COASE (
1960)67(*) a montré que les
conditions pour qu'un tel accord soit possible sont assez restrictives. Il faut
en effet que les droits de propriété soient parfaitement
définis, les
coûts de
transaction entre pollueurs et pollués soient inférieurs aux
bénéfices de l'entente, la transaction soit plus favorable, aux
exploitants miniers comme aux populations riveraines, que l'entente, les
coûts de transaction recouvrent les coûts de prospection (qui
pollue ?), de négociation (trouver les termes d'une
éventuelle entente), et d'exécution (veiller à
l'application de l'accord).
d)
L'intervention des pouvoirs publics
Il existe de multiples situations
où les solutions précédentes ne sont pas suffisantes (ou
ne sont pas considérées comme admissibles). Par exemple, en
l'absence de droits de propriété (cas de pollution d'une
rivière par exemple), ou lorsque l'externalité est diffuse, avec
un montant faible par agent mais touchant un très grand nombre d'agents
(ce qui rend impossible tant la fusion que la négociation).Une
intervention des pouvoirs publics est alors possible, sous certaines
conditions, avec trois outils de base : la norme, la taxe et le
marché des droits à polluer.
Le principe de la norme consiste à
fixer un plafond (pour une externalité négative) ou un plancher
(pour une externalité positive) sur une variable représentative
de l'externalité. On fixera par exemple des limites à des niveaux
de pollution, en volume (exemple : quantité maximale de mercure
produite par une petite exploitation minière) ou en proportion
(exemple : limite de mercure par km pour une petite exploitation
minière).
La notion de taxe visant à mener
les pollueurs à internaliser les externalités est due à
l'économiste britannique
Arthur Cecil
Pigou, d'où son nom de taxe pigouvienne. Il s'agit de mesurer le
niveau de production du pollueur si celui-ci prenait en compte le coût de
l'externalité :
- Coût marginal privé + Coût marginal de
l'externalité = Coût marginal social ; ou
- Coût moyen privé + Coût moyen de
l'externalité = Coût moyen social.
La valeur du Coût de l'externalité correspondant
à l'optimum social fournit la valeur de la taxe pigouvienne à
appliquer (ou, si l'externalité est positive, de la subvention à
accorder), afin que la production corresponde à l'optimum social.
La solution du marché des droits
à polluer fut proposée pour la première fois par
John
DALES en
196868(*). Dans ce cadre, l'
État fixe, en
fonction des contraintes qu'il s'est choisi (
traités
internationaux, comme ceux du type du
protocole de
Kyoto par exemple), la quantité maximale de polluants qu'il souhaite
émettre. Puis, il distribue ou vend des «
droits à
polluer » de façon
« équitable » aux pollueurs. Les
entreprises polluant
moins que prévu par l'
État (ou ayant
dépollué) sont alors gagnantes : elles peuvent revendre ou
louer leurs
droits à
polluer inutilisés à d'autres entreprises qui polluent plus
que prévu, et perçoivent donc une récompense pour leur
«
civisme ».
Symétriquement, les entreprises polluant plus sont perdantes, ce qui
satisfait au «
principe
pollueur- payeur ».
3.2.3.
L'encadrement des acteurs intervenant dans l'orpaillage
Cet encadrement peut se faire d'une part
par les pouvoirs publics, à travers le Service d'Assistance et
d'Encadrement du Small Scale Mining, SAESSCAM, et d'autre part par les acteurs
non étatiques de ce secteur.
a)
Encadrement institutionnel par le SAESSCAM
Le Service d'Assistance et d'Encadrement du
Small Scale Mining, SAESSCAM, est un service technique spécialisé
de l'Etat dans les zones d'exploitation minière artisanale. Il s'occupe
principalement de l'encadrement technique des creuseurs. C'est ainsi que les
orpailleurs artisanaux exploitant dans les concessions de l'OKIMO (Office de
mines de Kilo- Moto) en Ituri et dans le Haut- Uélé sont
désormais encadrés par le SESSCAM au terme d'un protocole
d'accord signé à Bunia et à Watsa , respectivement le 14
et le 16 août 200869(*). Cette initiative doit être étendue sur
toutes les zones d'exploitation artisanale, notamment dans les territoires de
Wamba et de Mambasa.
En effet, les objectifs poursuivis par le
SAESSCAM sont les suivants :
- assainir le secteur minier d'exploitation artisanale et de
la petite mine par l'assistance et l'encadrement, en vue de promouvoir
l'émergence d'une classe moyenne congolaise;
- canaliser les productions des exploitations minières
artisanales et de la petite mine vers les circuits officiels de
commercialisation afin de lutter contre la fraude des substances
minérales et de percevoir les recettes dues à l'Etat;
- préparer l'après mine par la mise en oeuvre
des projets de développement intégré en faveur des
communautés locales de base vivant dans les zones où se
déroulent les activités minières artisanales et/ou de
petite mine.
Pour que cet encadrement institutionnel
soit efficace, il faudra ainsi renforcer les capacités des agents et
cadres de ce service technique de l'Etat, les équiper et les motiver par
des bons salaires. Il faut ici de la coopération
décentralisée pour que ce service de proximité soit
effectivement opérationnel. Le Cadastre minier devra travailler en
collaboration avec le SAESSCAM dans son travail d'attribution des concessions
minières aux communautés locales pour l'exploitation artisanale
en vue de réduire le potentiel des conflits locaux.
Il faudra ensuite créer un corps
d'inspecteurs des mines chargés de vérifier
régulièrement la conformité des activités
d'exploitation artisanale et semi- industrielle au code minier et
règlement minier, et renforcer les contrôles aux
frontières.
Il faudra enfin décentraliser mais
coordonner certes, les services des recouvrements des redevances et droits
superficiaires du secteur minier. Car depuis la mise en oeuvre par le
Ministère des finances du principe de l'unicité de la caisse de
l'Etat sur recommandation du FMI (Fonds Monétaires Internationales), les
autres services techniques de l'Etat sont affaiblis. On peut s'attendre
à moins de ressources générées. Le SAESSCAM ne sait
plus rétrocéder aux communautés locales leur 10%. Ceci
nous parait évidemment une violation des dispositions du code minier.
b)
Encadrement technique, financier et en formation par les partenaires non
étatiques
Pour atteindre ses objectifs, le SAESSCAM
devra collaborer avec les différents partenaires non étatiques
dans le secteur minier. En effet, les orpailleurs et autres acteurs qui
interviennent dans le secteur de l'orpaillage ressentent un besoin
d'encadrement à divers niveaux, notamment au niveau de la formation et
au niveau de l'accès au financement.
Il y a un fort déficit en formation
technique, l'essentiel de l'apprentissage se faisant sur le tas sans aucun
bagage théorique. Ceci est vrai aussi bien pour les creuseurs que pour
les femmes associées plus ou moins directement aux travaux d'orpaillage.
La formation technique est donc indispensable pour améliorer la
qualité de la production et même pour éviter les accidents.
En vue de préparer l'après mine, on peut commencer aussi à
initier des petits programmes d'apprentissage des métiers en vue de
diversifier les activités des acteurs dans ce secteur.
Le besoin en formation peut être
aussi résolu par l'alphabétisation fonctionnelle (en langue
locale), notamment pour les femmes (0% des diplômées D4, D6, G3,
L2). Elle a pour objectif de donner des notions de base en lecture,
écriture et calcul. Les villageois eux-mêmes savent que les
alphabétisés se débrouillent mieux, que leur cour est plus
propre, qu'ils se font moins rouler par les commerçants, etc.
D'ailleurs, il est très difficile à ceux qui ne sont pas
alphabétisés de suivre des formations, qu'elles soient
données en gestion ou dans d'autres domaines.
On peut aussi organiser de temps à
temps des formations en gestion et en management. Les orpailleurs, en
particulier, après des exercices de comptabilité
élémentaire se rendent compte du coût très
élevé de leurs dépenses sociales (funérailles,
fêtes religieuses, visites des parents, etc.). L'initiation à la
gestion (cahier d'entrée- sortie, estimation des coûts de
production) et au management est indispensable, même si beaucoup
prétendent avoir leurs comptes dans la tête. Cependant s'il faut
initier ces acteurs à la gestion, il faut tenir compte de
l'environnement et formaliser cette comptabilité avec des outils
facilement compréhensibles.
Selon nos enquêtes, 50% des
« mamans restaurants » dans les carrières d'or ont
démarré leur activité grâce à leur apport
personnel, 22,5% grâce aux emprunts contractés dans la famille,
15% grâce à la tontine, 10% grâce au crédit
fournisseur et 2,5% grâce à l'épargne traditionnelle
qui consiste souvent à transformer de l'argent en biens. Le besoin de
financement de leurs activités se fait donc sentir avec acuité.
Il en va de même des creuseurs proprement dits qui ont d'énormes
difficultés pour payer les permis d'exploitation et pour se procurer des
outils de travail.
La propension marginale à
épargner étant très faible (1,3) dans ces carrières
d'or, l'encadrement financier peut se faire donc en créant les caisses
d'épargne et de crédit (argent chaud) et en organisant le
crédit direct (argent froid) dans les milieux. Les coopératives
d'épargne et de crédit mutualistes insistent sur la
nécessité d'une épargne préalable (argent chaud)
avant l'octroi d'un crédit. Le crédit direct (argent froid) peut
se faire soit sous forme du modèle Grameen Bank (crédit
solidaire) ou les sommes prêtées sont garanties par des groupes de
caution solidaire soit sous forme des IMF (Institutions de Micro Finance)
spécialisées dans l'offre de crédit aux petites et micro-
entreprises.
3.3.
LES PISTES VERS UN PLAN STRATEGIQUE NATIONAL DE L'EXPLOITATION ARTISANALE DE
L'OR
Nous proposons ici des indications pour la
mise en oeuvre d'un plan stratégique national afin d'améliorer
les pratiques et conditions de travail dans le secteur de l'extraction
minière artisanale et à petite échelle de l'or et
d'atténuer ses incidences sur l'environnement et la santé. Nous
nous referons principalement au Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), dans sa décision 24/3 IV,
priant le Directeur exécutif du PNUE, de concevoir un document
d'orientation pour l'élaboration d'un plan stratégique national
pour l'exploitation minière artisanale et à petite échelle
de l'or70(*).
3.3.1. But
et avantages du plan
Le plan stratégique national permet
de fournir une base et des orientations précises pour l'exécution
d'activités destinées à surmonter les problèmes
posés par l'extraction minière artisanale et à petite
échelle de l'or. Ce type d'outil de planification est
particulièrement utile pour tirer parti des activités existantes,
mobiliser des ressources, unir des parties prenantes qui ne sont pas
nécessairement habituées à travailler ensemble ainsi que
pour représenter des approches et des intérêts
divergents.
L'élaboration d'un plan
stratégique national pour l'exploitation minière artisanale et
à petite échelle de l'or est l'occasion de mettre en place une
base claire et transparente pour l'appui à la mise au point et à
la mise en oeuvre d'activités durables pour aborder le problème
au niveau national. Le plan devrait s'efforcer de coordonner et de mobiliser
les capacités nationales en vue de prévenir la pollution, de
réduire et d'éliminer les risques associés à ce
secteur d'activités.
La mise en oeuvre d'un plan
stratégique national pour l'extraction minière artisanale et
à petite échelle de l'or présente de nombreux
bénéfices et avantages potentiels :
- amélioration de la santé et de la
qualité de l'environnement des communautés d'orpailleurs, y
compris réduction des rejets de mercure ;
- renforcement des liens avec l'ensemble des programmes de
développement et de ceux relatifs aux droits de l'homme et à
l'environnement ;
- meilleur accès aux ressources
nécessaires ;
- intensification de la coopération et de la
collaboration ;
- durabilité à long terme du secteur de
l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de
l'or
3.3.2.
Contenu du plan
Le pour un plan stratégique
national d'exploitation minière artisanale et à petite
échelle de l'or peut comprendre sept parties :
1. Résumé analytique
2. Introduction et informations
générales ;
3. Aperçu national
4. But et objectifs prioritaires ;
5. Stratégies de mise en oeuvre ;
6. Mécanisme d'évaluation ;
7. Annexes.
3.3.3. Les
étapes du plan
Nous mettons en avant une proposition de
processus en six étapes pour utilisation par les autorités
nationales lors de l'élaboration du plan stratégique national.
a)
Première étape : Mise en place d'un mécanisme de
coordination
L'élaboration
d'un plan peut constituer une occasion intéressante d'acquérir de
nouvelles expériences, de nouvelles compétences et connaissances,
et d'apporter une contribution positive au secteur de l'exploitation
minière artisanale et à petite échelle de l'or. Une
partie de l'élaboration du plan s'appuiera sur la création d'un
groupe de travail.
Le groupe de travail supervisera le projet
étape par étape et veillera à la bonne planification et
gestion de celui-ci tout au long du processus. Même si toutes les
parties intéressées ne peuvent faire partie du groupe de travail,
il est important d'assurer un équilibre représentatif de tous les
intérêts pour contribuer au processus.
Les membres comprennent des
représentants nationaux et/ou régionaux chargés des divers
aspects concernés notamment environnementaux, financiers,
exploitation minière, santé publique et
éducation.
b)
Deuxième étape : Collecte d'informations de
référence
Avant d'élaborer le plan, il
convient de rassembler des informations de référence qui
constituent la base de « l'aperçu de la situation au niveau
national ». Cet aperçu expose brièvement la
portée et l'ampleur de la situation ainsi que des activités
nationales d'exploitation minière artisanale et à petite
échelle de l'or et devrait donc comprendre des informations
sur :
- la situation juridique, y compris un examen des conditions
juridiques et réglementaires de ce type d'exploitation ;
- les aspects géographiques et les statistiques
pertinentes ;
- les données économiques, telles que le revenu
par habitant, l'approvisionnement, l'utilisation et la demande en mercure, des
informations sur le commerce et l'exportation de l'or ;
- les exploitations minières, y compris des
informations sur les corps minéralisés, les
procédés utilisés, le nombre de personnes participant
directement ou indirectement à l'exploitation minière artisanale
et à petite échelle de l'or (y compris des informations par sexe
et âge) ;
- l'environnement, en détaillant des informations
connues telles que la destruction de l'environnement, les sites
contaminés, les rejets de mercure dans le sol, l'air et l'eau ;
- des informations sanitaires sur les incidences pour la
santé et le développement, les divers types d'exposition au
mercure ;
- l'encadrement et l'organisation de l'exploitation
minière artisanale et à petite échelle de l'or aux niveaux
national et local ;
- les derniers enseignements pour aborder les problèmes
posés par ce secteur.
c)
Troisième étape : Définition d'un but et d'objectifs
Avant d'élaborer le plan, il est
utile d'énoncer le problème. Il s'agit de décrire
brièvement le problème particulier que le plan devra aborder. En
s'appuyant sur l'énoncé du problème, il devrait être
possible de définir un but pour le plan : un énoncé
concis qui décrit le but du plan. Les buts doivent être
réalistes et définis sur la base de la situation
particulière du pays. Dans certains cas, la définition d'un but
général concernant le mercure peut être une approche
concrète qui pourrait être considérée comme un bon
premier point d'accès. Par exemple : protéger la
santé humaine contre les pratiques de l'exploitation minière
artisanale et à petite échelle de l'or en réduisant au
minimum, voire en éliminant l'utilisation du mercure et ses rejets pour
ce secteur.
Les objectifs indiquent, de
manière plus détaillée que pour le but, les
résultats particuliers que le plan d'action doit atteindre, en
répondant à la question « Que faut-il faire pour
atteindre les résultats escomptés à partir de la situation
présente? ». Les questions relatives à l'exposition du
mercure peuvent constituer une première approche des questions
environnementales. Par exemple : la réduction de 70 % de
l'utilisation du mercure d'ici 2020 grâce à l'élimination
des principales pratiques inefficaces et dangereuses utilisant du mercure.
d)
Quatrième étape : Formulation de la stratégie de mise en
oeuvre
La stratégie de mise en oeuvre est
une partie importante du plan stratégique national pour l'exploitation
minière artisanale et à petite échelle de l'or. Il
jettera les bases des activités de suivi et précisera les
responsabilités des agences nationales et autres partenaires et parties
prenantes. Le plan, bien qu'élaboré à un niveau national,
devrait être adapté aux conditions et besoins locaux et, de ce
fait, il devrait être mis au point en consultation avec toutes les
parties prenantes et tous les partenaires potentiels aux niveaux national,
régional et local.
La stratégie devrait comprendre les
éléments suivants : le programme de travail à l'appui des
objectifs du plan stratégique national, le plan de sensibilisation,
l'échéancier et le budget global.
e)
Cinquième étape : Mécanisme d'évaluation
Des critères spécifiques
devraient être définis pour évaluer l'efficacité
globale de la mise en oeuvre du plan stratégique national pour
l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de
l'or. Ce faisant, le plan sera conçu de façon à permettre
de mesurer et de suivre les progrès et les résultats.
Il peut être utile d'utiliser des
critères d'évaluation tels que l'efficience et
l'efficacité des mesures, l'accessibilité économique, la
rentabilité fondée sur une analyse coût-
bénéfices, la possibilité de réalisation y compris
les aspects socio-économiques, les besoins urgents dans les domaines de
la santé et/ou de l'environnement, etc.
f) Sixième
étape : Adoption du plan stratégique national
Afin d'assurer l'appui des institutions,
il est indispensable que les décideurs prennent des engagements à
différentes étapes du processus d'élaboration du plan : au
début, à des points critiques identifiés au cours du
processus et, à la fin, lorsque le plan a été
définitivement mis au point. Il y a différentes formes
d'engagement, par exemple des accords formels et des directives
ministérielles. Un travail de sensibilisation dès le
départ est un bon moyen d'obtenir leur appui.
Une activité essentielle consiste
à distribuer un modèle du plan en temps opportun et de
façon appropriée, sous une forme approuvée au
préalable, à ceux qui ont une influence sur son approbation. Il
est important d'adapter la documentation aux différents publics en
associant les activités à d'autres priorités
gouvernementales plus générales. Il peut également
être nécessaire d'obtenir un engagement des décideurs
extérieurs au processus national d'approbation.
Conclusion partielle
Abordant la question des
conséquences négatives de l'orpaillage, ce chapitre a
relevé sur le plan environnemental la pollution des eaux (32,41%) et sur
le plan sanitaire les risques sanitaires proprement dits (48,15%).
Pour que le développement en
territoires de Mambasa et de Wamba émerge à partir de
l'orpaillage, il faut d'une part bien gérer les externalités
négatives et d'autre part encadrer les acteurs intervenant dans le
secteur artisanal de l'orpaillage. Cet encadrement pourra se faire et par les
pouvoirs publics, a travers le SAESSCAM, et par les autres partenaires non
étatiques de ce secteur. Tout cela ne peut être possible que s'il
existe un cadre juridique favorable au développement local et
durable.
Ce chapitre s'est clos par la proposition
de quelques éléments d'un plan stratégique national de
l'exploitation artisanale de l'or. Ceci est important car la mise en oeuvre
d'un plan stratégique national pour l'extraction minière
artisanale et à petite échelle de l'or présente de
nombreux bénéfices et avantages potentiels, notamment
l'amélioration de la santé et de la qualité de
l'environnement des communautés d'orpailleurs, y compris la
réduction des rejets de mercure.
CONCLUSION GENERALE
Ce travail intitulé,
« Exploitation artisanale de l'or et développement
en territoires de Mambasa et de Wamba (Province Orientale, RD
Congo) », est parti de cette question de départ
« Quel est l'impact de l'exploitation artisanale de l'or sur le
développement en territoires de Mambasa et de Wamba ? »
et s'est assigné comme objectif de montrer comment l'exploitation
artisanale de l'or en territoires de Mambasa et de Wamba a une incidence sur le
développement. Il fallait ainsi déterminer l'incidence de
l'exploitation artisanale de l'or sur les initiatives locales de
développement et sur la cohésion sociale, identifier les raisons
de l'orientation de la population vers l'orpaillage artisanal, et montrer
les risques environnementaux et sanitaires occasionnés par
l'orpaillage artisanal.
Pour atteindre l'objectif qu'on s'est
fixé au départ, nous avons adopté une démarche
méthodologique appropriée. A partir de l'exploration au tour de
la question du départ, nous avons circonscrit notre
problématique. Cela nous a permis, dans le premier chapitre, à
construire notre analyse sur le modèle de la théorie des
externalités (James MEADE), selon laquelle l'activité d'un agent
économique (l'exploitation artisanale de l'or, pour ce qui nous
concerne) peut avoir des effets externes, positifs ou négatifs, sur les
activités des autres agents (les initiatives locales de
développement à vocation agro-pastorale, par exemple) et sur le
modèle de la théorie des besoins fondamentaux (PNUD) qui met
l'accent sur la satisfaction des besoins fondamentaux des populations.
Pour l'analyse des informations de terrain
obtenues par l'utilisation de plusieurs techniques telles que la technique
d'enquête, le questionnaire, l'observation participante, les entretiens,
et la technique documentaire (exploitation des rapports, des documents
personnels, ...), nous avons recouru à la méthode fonctionnelle
(méthode qualitative) et à l'induction statistique
(méthode quantitative). Cette dernière nous a poussé
à constituer, par la technique de boule de neige, un échantillon
de 148 individus, dont 40 femmes et 108 hommes. Cette analyse nous a permis
d'aboutir à trois résultats qui constituent d'ailleurs les
apports de ce travail contenus dans le deuxième et le troisième
chapitre.
Primo. L'exploitation artisanale de l'or
vide les villages de leurs populations actives. En effet, il s'est
révélé que l'âge des exploitants artisanaux se
trouve dans l'intervalle de 33 et 38 ans pour les hommes et dans l'intervalle
de 22 et 27 ans pour les femmes. Cet exode des villages vers les
carrières a eu des conséquences néfastes sur le dynamisme
et la cohésion sociale de plusieurs villages : la diminution de la
production agricole, l'absence de petites initiatives de développement,
des époux abandonnent leurs épouses pendant des longues
années aboutissant souvent aux divorces, les enfants sont
détournés du contrôle parental et donc de
l'éducation formelle, etc. Cette situation a donc confirmé notre
première hypothèse selon laquelle «L'exploitation artisanale
de l'or viderait les villages de leurs populations actives, ce qui induirait
par voie de conséquence, à l'absence des petites initiatives de
développement (à vocation agro-pastorale par exemple) et à
la fragilisation de la cohésion sociale par des conflits
d'autorité».
Secundo. Parmi les multiples raisons de
l'attrait de la population pour l'activité aurifère, l'obtention
d'un revenu rapide et élevé reste la raison principale (28,70%).
Pour le lavage à la batée et le lavage simple, les types
d'exploitation les plus pratiquées, la production est vendue sur place
au soir même de l'exploitation alors qu'il faut attendre 6 mois ou plus
pour avoir la production agricole (riz, bananes). De plus, le revenu mensuel
d'un orpailleur varie entre 210 et 280 dollars américains. Il est
élevé par rapport à celui d'un fonctionnaire (enseignant)
qui n'atteint pas 100 dollars américains même en respectant le
SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti). Mais, nous avons
constaté que la propension marginale à consommer est très
élevée (0,87), elle approche l'unité. Cette consommation
consiste plus à la satisfaction des besoins alimentaires et
vestimentaires. D'autres besoins fondamentaux comme les soins de santé,
l'éducation, le transport, l'eau, l'énergie, ... restent non
satisfaits. La deuxième hypothèse selon laquelle « Il
semble que l'exploitation artisanale de l'or procure un revenu rapide et
élevé permettant de satisfaire les besoins fondamentaux des
exploitants artisanaux» doit être nuancée.
Tertio. L'orpaillage a cependant des
conséquences néfastes sur l'environnement et sur la santé.
Abordant la problématique des conséquences négatives, nous
avons relevé sur le plan environnemental la pollution des eaux (32,41%)
et sur le plan sanitaire les risques sanitaires proprement dits (48,15%). La
troisième hypothèse selon laquelle « L'orpaillage
aurait des conséquences néfastes sur l'environnement et sur la
santé des hommes» a donc été confirmée.
Somme toute, pour que le
développement en territoires de Mambasa et de Wamba émerge
à partir de l'orpaillage artisanal, nous pensons qu'il faut, d'une part,
bien gérer les externalités négatives et, d'autre part,
encadrer les acteurs intervenant dans ce secteur. Cet encadrement pourra se
faire et par le pouvoir public (par le biais du SAESSCAM) et par les autres
partenaires non étatiques de ce secteur. Tout cela ne peut être
possible que s'il existe un cadre juridique favorable au développement
et un plan stratégique national de l'exploitation artisanale de l'or. A
la fin de ce travail, nous avons proposé quelques éléments
d'un plan stratégique national de l'orpaillage, un des aspects que
d'autres recherches ultérieures peuvent approfondir.
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
I. OUVRAGES
1. BABOYA ILUNGA L., Le territoire de Wamba,
Kinshasa, 2000.
2. BAUMOL W.J., Théorie économique et
analyse opérationnelle, Ed. Dunod, Paris 1963 (Traduit de l'anglais
par P.PATREL). 474 pages.
3. BARIAND et al., Les minéraux. Leurs gisements,
leurs associations, Ed. Minéraux et fossiles, Meung-sur-Loire,
1972. 490 pages.
4. BERZOSA C. et al., Comment se construit la
pauvreté, Ed. L'Harmattan, Paris, 2000. 250 pages.
5. CAMILLERI J.-L., La petite entreprise africaine. Mort
ou résurrection, L'Harmattan, Paris, 1996. 304 pages.
6. CENTRE DE VULGARISATION AGRICOLE, La gestion des
initiatives locales de développement, Ed. Centre de Vulgarisation
Agricole, Kinshasa 2, 1991. 142 pages.
7. GOULD J.-P. & FERGUSON C.E., Théorie
Microéconomique, Ed. Economica, Paris, 1982 (Traduit de
l'américain par J.-M. LAPORTE & J.-M. SIX). 592 pages.
8. HENAULT G. et M'RABET R. (sous la direction de),
L'entrepreneuriat en Afrique francophone : culture, financement et
développement, Ed. AUPELF - UREF, John Libbey Eurotext, Paris 1990.
332 pages.
9. HOCHLEITNER R., Les minéraux, Ed. Nathan,
Paris, 1994. 240 pages.
10. LATAPIE D., La Fabuleuse Histoire de la ruée
vers l'or, Californie - XIXe siècle, Mémoire
vive. Privat, 2001.
11. MULLER, Y., Mines, Tome II, Ed. Dunod, Paris,
1964.
12. PROVINCE ORIENTALE, Document de la Stratégie de
Croissance et de Réduction de la Pauvreté, Kisangani, 2007.
80 pages.
13. QUIVY R. et VAN CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en
sciences sociales, Ed. Dunod, 2eme édition, Paris, 2001. 290
pages.
14. VLASSENROOT K. et RAEYMAEKERS T., Conflit et
transformation sociale à l'Est de la RDC, Bruxelles, 2004 ;
particulièrement le Chapitre V : Conflit et minage artisanal
à Kamituga (Sud- Kivu), pp. 117-150.
II. ARTICLES
1. ELENGE MOLAYI, « Législation
minière, environnement et protection de la santé du travail des
artisans miniers en RD Congo », in Congo -Afrique XLVIIIe
année, N° 425, Mai 2008.
2. LANCELIN M., « Quelques éléments de
réflexion sur les problèmes d'épargne et de
crédit », in Technique financière et
développement dans l'esprit d'entreprise, Ed. AUPELF - UREF, John
Libbey, Paris, 1993.
III. TRAVAUX, MEMOIRES ET
THESES
1. KAMBALE MIREMBE O., Echanges transnationaux,
réseaux informels et développement local. Une étude au
Nord-Est de la République Démocratique du Congo,
Thèse de doctorat en sciences sociales : développement,
population et environnement, UCL, Presses Universitaires de Louvain,
Louvain-la-Neuve, 2005.
2. KOUADIO KOUASSI N., Exploitation artisanale de l'or
dans le processus de mutation socio- économique à Hire (Sud
Bandama Côte d'Ivoire), D.E.A (diplôme d'études
approfondies) Sociologie, Université de Bouaké (Côte
d'Ivoire), Bouaké 2003.
3. MULULU MUGINIBWA, L'exploitation minière
artisanale et l'amélioration des conditions socio-économiques des
exploitants et des habitants de l'hinterland minier de Likasi (cas du site de
SHAMITUMBA), Mémoire de licence en sciences sociales, ISES-
Lubumbashi, Septembre 2000.
4. MUSONGORA SYASAKA E., Mouvement associatif et dynamique
de développement au Nord Kivu. Cas des associations de tendance
religieuse en territoire de Beni et Lubero, Mémoire
présenté en vue de l'obtention du diplôme de Master
complémentaire en développement, environnement et
sociétés, ULC, Louvain, 2007-2008.
5. NDELA KUBOKOSO J., Les activités minières
et la fiscalité (Cas de la République Démocratique du
Congo), Thèse de doctorat en Droit, Administration et Secteur
Public, Université Paris I Panthéon - Sorbonne,
Paris, 2008.
IV. TEXTES LEGAUX
1. Code du travail, in Journal officiel,
Numéro spécial du 25 octobre 2002.
2. Code minier congolais, in Journal officiel,
Numéro spécial du 15 juillet 2002.
3. Le règlement minier, in Journal
officiel, Numéro spécial du 1er avril 2003.
V. COURS
1. KATSUVA MUHINDO, Cours de Méthodes de recherche
en sciences sociales, G2 Economie, UCG, Butembo, 2008-2009
(inédit).
2. MAFIKIRI TSONGO A., Cours d'Economie
d'environnement, L2 Faculté des Sciences Economiques (Options
Economie rurale et Economie de développement), UCG Butembo, 2010-2011.
176 pages.
3. MAFIKIRI TSONGO A., Cours de Théorie de
développement, L1 Faculté des Sciences Economiques
(Option : Economie de développement), UCG Butembo, 2009-2010. 262
pages.
VI. AUTRES DOCUMENTS
1. BANQUE MONDIALE, « Le travail des enfants en
Afrique : problématique et défis », Novembre 2001,
disponible sur www. worldbank. org/childlabor.
2. FEC WAMBA, Rapport annuel 2009, Wamba, 2010
(inédit).
3. HUMAN RIGHTS WATCH, Le Fléau de l'or,
Kinshasa, 2005.
4. I.C.C.N, Ce qu'est la Réserve de Faune à
Okapis, Kinshasa, 2006.
5. I.C.C.N, Protection du paysage forestier Ituri - Epulu
- Aru et notion de site du patrimoine mondial, Kinshasa, 2006.
6. KABUYA MUYEBA A. (CENADEP), Impact de l'exploitation de
diamant et de l'or dans la reconstruction socio-économique de la
Province Orientale. Rapport, Anvers, 2009. 20 pages.
7. KABWELULU M.,
Le secteur minier
congolais, 50 ans après, toujours porteur d'espoir.
Discours du ministre des Mines à l'occasion de la clôture des
journées minières, organisées par le Ministère des
Mines à la FIKIN (Foire Internationale de Kinshasa) du 5 au 19
août 2010, disponible sur
http:
//www.digitalcongo.net /article /69426 ##.
8. Le Quotidien kinois Le potentiel, dans son Edition
3679 du samedi 18 mars 2006.
9. LUTETE C., «
Le gouverneur Médard
Autsaï déterminé à accompagner l'encadrement des
exploitants miniers artisanaux en RDC », disponible sur
http://www.digitalcongo.net/article/53570##,
Kinshasa, 12/09/2008, consulté le 20 mars 2011.
10. O.I.T., Les problèmes sociaux et de travail
dans les petites exploitations minières. Rapport soumis aux fins de
discussion à la Réunion tripartite sur les problèmes
sociaux et de travail dans les petites exploitations minières,
Bureau International du travail, Genève, 17-21 Mai 1999
(inédit).
11. O.I.T., « Mines et carrières :
l'autre calvaire des enfants au travail », disponible sur
http://www.africk.com/Niger.
12. OMS & UNICEF,
Rapport conjoint de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds
des Nations unies pour l'enfance, Mars 2010, disponible sur
http://www.planetsave.
com/blog/2010/03/24/unsafe-water-kills-more-people-than-war-study.
13. PIRRONE N. et MASON R., Rapport intérimaire du
Partenariat mondial du PNUE pour la recherche sur le transport
atmosphérique et le sort du mercure ; disponible sur le
site
http://www.chem.unep.ch/mercury/Sector-SpecificInformation/Fate%20and%
20Transport(1).htm.
14. PNUE, Document d'orientation : Elaboration d'un
plan stratégique national pour l'exploitation minière artisanale
et à petite échelle de l'or, 7 mai 2009.
15. PNUE, Rapport du Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) à l'occasion de la Journée mondiale de
l'eau, Mars 2010, disponible sur
http://www.humains-associes.org/blog/2010/04/27/choses-vues-040410/.
16. UNICEF, Rapport sur la situation des enfants dans le
monde en 1997.
TABLE
DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Etat de la question
1
2. Problématique
3
3. Hypothèses provisoires
4
4. Objectifs de recherche
5
5. Méthodes et techniques
utilisées
5
a) Une méthode qualitative : le
fonctionnalisme
5
b) Une méthode quantitative :
l'induction statistique
6
6. Choix et intérêt du sujet
7
7. Délimitation du sujet
8
8. Subdivision du travail
9
9. Difficultés rencontrées
10
CHAPITRE PREMIER :
LES CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'EXPLOITATION
ARTISANALE DE L'OR ET LE DEVELOPPEMENT
11
1.1. DEFINITION DES CONCEPTS
11
1.1.1. Les concepts- clés
11
a) Exploitation minière artisanale
11
b) Développement
13
1.1.2. Les concepts connexes
17
a) Mine
17
c) Creuseur
18
d) Travail des enfants
18
1.2. CONSIDERATIONS THEORIQUES
19
1.2.1. La théorie des
externalités
19
a) Les externalités de production
20
b) Les externalités de consommation
21
1.2.2. La théorie des besoins
fondamentaux
22
1.3. CADRE JURIDIQUE DE L'ORPAILLAGE EN RD
CONGO
23
1.3.1. Historique du droit minier congolais
24
a) De la période coloniale à la
Première République (1885-1965)
24
b) La Deuxième
République (1965-1997)
25
c) La Troisième République (depuis
1997)
25
1.3.2. Le Code minier congolais et l'exploitation
artisanale
26
a) De l'autorisation d'exploitation artisanale
26
b) Des obligations du détenteur de la carte
d'exploitant artisanal
26
c) De la transformation des produits de
l'exploitation artisanale
26
d) Du retrait de la carte d'exploitant
artisanal
27
1.3.3. Le régime juridique et fiscal pour
l'exploitation artisanale
27
a) L'exploitant artisanal
27
b) Le négociant
28
c) Les comptoirs agréés
28
1.3.4. Critique du code minier congolais
29
Conclusion partielle
30
CHAPITRE DEUXIEME :
L'ACTIVITE AURIFERE EN TERRITOIRES DE MAMBASA ET DE
WAMBA
32
2.1. PRESENTATION DU MILIEU DE RECHERCHE
32
2.1.1. Contexte socio-économique et
politique des territoires de Mambasa et de Wamba en Province Orientale
32
2.1.2. La Réserve de Faune à Okapis
(RFO) à Epulu
34
a) Son historique
34
b) Ses richesses
35
2.1.3. Les carrières d'or dans les
territoires de Mambasa et de Wamba
36
a) La zone de Bafwabango - Bafwambaya -
Bafwanekengele
36
b) La zone de Gbonzunzu - Bolebole - Mambati
37
2.2. CARACTERISATION DES ACTEURS DE L'ACTIVITE
MINIERE
39
2.2.1. Les acteurs de l'activité
minière
39
a) Les services de l'Etat
39
b) Les exploitants miniers artisanaux
41
c) Les négociants
43
d) Les femmes
43
2.2.2. Age et origine socio- professionnelle des
acteurs
46
a) Age des acteurs
46
b) Origine socio- professionnelle
49
2.3. MODES, TYPES D'EXPLOITATION ET CIRCUIT DE
COMMERCIALISATION DE L'OR
51
2.3.1. Modes d'exploitation artisanale de l'or
51
a) La recherche de roche à ciel ouvert
(« durba »)
52
b) La recherche souterraine (« djogo
»)
53
2.3.2. Types d'exploitation artisanale de l'or
54
a) Le lavage à la batée
(« d'origine »)
54
b) Le lavage simple
55
2.3.3. Le circuit de commercialisation de l'or
55
2.4. ATTRAIT POUR L'ACTIVITE AURIFERE
57
2.4.1. Raisons économiques
57
a) Un revenu rapide et élevé
58
b) D'autres raisons économiques
60
2.4.2. Raisons sociales
61
Conclusion partielle
62
CHAPITRE TROISIEME :
LA PLACE DE L'ORPAILLAGE DANS LE PROCESSUS DE
DEVELOPPEMENT LOCAL
64
3.1. ANALYSE AVANTAGES - COUTS
64
3.1.1. Les externalités positives :
avantages
64
a) Le revenu généré par
l'orpaillage
64
b) L'émergence des centres commerciaux
autour des carrières d'or
65
c) L'importance de l'or pour la finance
informelle
65
3.1.2. Les externalités
négatives : conséquences environnementales et sanitaires
66
a) Les problèmes environnementaux
66
b) Les problèmes sanitaires
68
3.2. LES CONDITIONS NECESSAIRES DE L'EMERGENCE DU
DEVELOPPEMENT A PARTIR DE L'ORPAILLAGE
72
3.2.1. La révision du cadre juridique de
l'orpaillage en RD Congo
72
a) Du Code minier proprement dit
72
b) Des orientations stratégiques
précises
73
c) Des mesures de lutte contre le travail des
enfants dans les mines
73
3.2.2. La gestion des externalités
négatives : quelques solutions
74
a) Le laissez- faire
74
b) La fusion
75
c) La négociation
75
d) L'intervention des pouvoirs publics
75
3.2.3. L'encadrement des acteurs intervenant dans
l'orpaillage
77
a) Encadrement institutionnel par le
SAESSCAM
77
b) Encadrement technique, financier et en formation
par les partenaires non étatiques
78
3.3. LES PISTES VERS UN PLAN STRATEGIQUE NATIONAL
DE L'EXPLOITATION ARTISANALE DE L'OR
80
3.3.1. But et avantages du plan
80
3.3.2. Contenu du plan
81
3.3.3. Les étapes du plan
81
a) Première étape : Mise en place
d'un mécanisme de coordination
81
b) Deuxième étape : Collecte
d'informations de référence
82
c) Troisième étape :
Définition d'un but et d'objectifs
83
d) Quatrième étape : Formulation de
la stratégie de mise en oeuvre
83
e) Cinquième étape :
Mécanisme d'évaluation
84
CONCLUSION GENERALE
86
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
89
TABLE DES MATIERES
93
* 1 Il s'agit surtout de
l'absence des services d'encadrement des paysans, d'intrants agricoles, des
marchés des produits agricoles et de l'enclavement des villages et des
entités administratives. La population ne sait plus vendre sa production
pour obtenir de l'argent et payer d'autres services.
* 2 Didier LATAPIE, La
Fabuleuse Histoire de la ruée vers l'or, Californie -
XIXe siècle, Mémoire vive. Privat, 2001, p. 10.
* 3KOUADIO KOUASI N.,
Exploitation artisanale de l'or dans le processus de mutation socio-
économique à Hire (Sud Bandama Côte d'Ivoire),
D.E.A (diplôme d'études approfondies) Sociologie,
Université de Bouaké (Côte d'Ivoire), Bouaké
2003.
* 4 MULULU MUGINIBWA,
L'exploitation minière artisanale et l'amélioration des
conditions socio-économiques des exploitants et des habitants de
l'hinterland minier de Likasi (cas du site de SHAMITUMBA), Mémoire
de licence en sciences sociales, ISES- Lubumbashi, Septembre 2000.
* 5 HUMAN RIGHTS WATCH, Le
Fléau de l'or. Rapport, Kinshasa, 2005.
* 6 KABUYA MUYEBA A.
(CENADEP), Impact de l'exploitation de diamant et de l'or dans la
reconstruction socio-économique de la Province Orientale. Rapport,
Anvers, 2009.
* 7 VLASSENROOT K. et
RAEYMAEKERS T., Conflit et transformation sociale à l'Est de la RDC,
Bruxelles, 2004 ; particulièrement le Chapitre V :
Conflit et minage artisanal à Kamituga (Sud- Kivu).
* 8 NDELA KUBOKOSO J.,
Les activités minières et la fiscalité (Cas de la
République Démocratique du Congo), Thèse de doctorat
en Droit, Administration et Secteur Public, Université Paris I
Panthéon - Sorbonne, Paris, 2008.
* 9 KATSUVA MUHINDO,
Cours de méthodes de recherche en sciences sociales, G2
Economie, UCG, Butembo, 2008-2009 (inédit).
* 10 QUIVY R. et VAN
CAMPENHOUDT L., Manuel de recherche en sciences sociales, Ed. Dunod,
2eme édition, Paris, 2001, pp.201-202.
* 11 QUIVY R. et VAN
CAMPENHOUDT L., Op.cit., pp.225-226.
* 12 QUIVY R. et VAN
CAMPENHOUDT L., Op.cit., p. 191.
* 13 KABWELULU M.,
Le secteur minier
congolais, 50 ans après, toujours porteur
d'espoir . Discours du ministre des Mines à
l'occasion de la clôture des journées minières,
organisées par le Ministère des Mines à la FIKIN (Foire
Internationale de Kinshasa) du 5 au 19 août 2010, disponible sur
http:
//www.digitalcongo.net /article /69426 ##, consulté le
5 janvier 2011.
* 14 QUIVY R. et VAN
CAMPENHOUDT L., Op.cit., p. 98.
* 15 UNCTAD, 1997
cité par ELENGE MOLAYI, « Législation minière,
environnement et protection de la santé du travail des artisans miniers
en RD Congo », in Congo -Afrique XLVIIIe année, N°
425, Mai 2008, p. 376.
* 16 Pour plus de
détails, lire Loi N° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code
Minier, en ses articles 1er ; 109 et 111.
* 17 Département des
Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies cité par KOUADIO KOUASI N.,
Op. cit., p. 10.
* 18 ELENGE MOLAYI, Op.
cit., p. 377.
* 19 ELENGE MOLAYI, Op.
cit., p. 376.
* 20 BERZOSA C. et al.,
Comment se construit la pauvreté, Ed. L'Harmattan, Paris, 2000,
pp. 27-28.
* 21 MUSONGORA SYASAKA E.,
Mouvement associatif et dynamique de développement au Nord Kivu. Cas
des associations de tendance religieuse en territoire de Beni et Lubero,
Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de
Master complémentaire en développement, environnement et
sociétés, ULC, Louvain, 2007-2008, pp. 22-23
* 22 KAMBALE MIREMBE O.,
Echanges transnationaux, réseaux informels et développement
local. Une étude au Nord-Est de la République Démocratique
du Congo, Thèse de doctorat en sciences sociales :
développement, population et environnement, UCL, Presses Universitaires
de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2005, p.84
* 23 CENTRE DE VULGARISATION
AGRICOLE, La gestion des initiatives locales de développement,
Ed. Centre de Vulgarisation Agricole, Kinshasa 2, 1991, p.101.
* 24 SCHUMPETER J. A.,
L'analyse du développement économique, cité par
MAFIKIRI TSONGO, Cours de Théorie de développement, L1
Faculté des Sciences Economiques (Option : Economie de
développement), UCG Butembo, 2009-2010, pp. 49-50.
* 25 MAFIKIRI TSONGO,
Cours d'Economie d'environnement, L2 Faculté des Sciences
Economiques (Options Economie rurale et Economie de développement), UCG
Butembo, 2010-2011, p.6.
* 26 Loi N° 007/2002
du 11 Juillet 2002 portant Code Minier, en son titre premier, chapitre
premier, article premier.
* 27 HOCHLEITNER R., Les
minéraux, Ed. Nathan, Paris, 1994, p.14.
* 28 Loi N° 007/2002
du 11 Juillet 2002 portant Code Minier, en son titre premier, chapitre
premier, article premier.
* 29 BANQUE MONDIALE,
« Le travail des enfants en Afrique : problématique et
défis », in www. worldbank. org/childlabor, Novembre
2001.
* 30Code du
travail, in Journal officiel, No spécial du 25 octobre
2002.
* 31 Rapport de
l'Unicef sur la situation des enfants dans le monde en 1997.
* 32 OIT, « Mines
et carrières : l'autre calvaire des enfants au travail »,
in
http://www.africk.com/Niger,
consulté le 19 Mars 2011.
* 33 Nous avons conçu
ce paragraphe à partir de deux ouvrages principaux : BAUMOL W.J.,
Théorie économique et analyse opérationnelle, Ed.
Dunod, Paris, 1963, pp. 281-285 (Traduit par P.PATREL); GOULD J.-P. &
FERGUSON C.E., Théorie Microéconomique, Ed. Economica,
Paris, 1982, pp. 528-533 (Traduit de l'américain par J.-M. LAPORTE &
J.-M. SIX).
* 34 Pour ce paragraphe, nous
nous referons principalement de BERZOSA C. et al., Op. cit., pp. 59-60
et pp. 190-191.
* 35 Cf. NDELA KUBOKOSO J.,
Les activités minières et la fiscalité (Cas de la
République Démocratique du Congo), Thèse de doctorat
en Droit, Administration et Secteur Public, Université Paris I
Panthéon - Sorbonne, Paris, 2008.
* 36 Pour plus de
détails, lire Loi N° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code
Minier, en ses articles 111, 112 et 114.
* 37 Décret
N°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier.
* 38 Décret
N°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier.
* 39 PROVINCE ORIENTALE,
Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la
Pauvreté, Kisangani, 2007, pp. 11-12.
* 40 PROVINCE ORIENTALE,
Op.cit., p. 13.
* 41 BABOYA ILUNGA L.,
Le territoire de Wamba, inédit, Kinshasa, 2000, p.4.
* 42 Selon les
données de l'enquête MICS 2 (Enquête par Grappes à
Indicateurs Multiples), dans cette contrée, le taux net de la
scolarisation au primaire est de 49,5% contre 51,7% pour le pays.
* 43 Une enquête
menée par le District sanitaire de l'Ituri et couvrant 36 aires de
santé en Ituri (donc y compris les aires de santé du territoire
de Mambasa, voisin au territoire de Wamba) a montré que 65% des sources
et puits utilisés par la population n'étaient point
protégés.
* 44 PROVINCE ORIENTALE,
Op. cit, p.23.
* 45 Pour constituer ce
paragraphe, nous nous sommes référés aux documents
suivants : I.C.C.N, Ce qu'est la Réserve de Faune à
Okapis, Kinshasa, 2006, pp. 3-8; I.C.C.N, Protection du paysage
forestier Ituri - Epulu - Aru et notion de site du patrimoine mondial,
Kinshasa, 2006.
* 46 Société
pour la Conservation de la Nature.
* 47 Fonds Mondial pour la
Nature.
* 48 Société
Zoologique de Francfort.
* 49 Arrêté
ministériel n°045/CM/ECN/92 du 2 mai 1992 portant
Création et délimitation d'une réserve naturelle
dénommée « Réserve de Faune à
Okapis », cité par I.C.C.N, Op. cit., pp.
3-8.
* 50Arrêté
ministériel n°020/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 20 mai 2006 portant
agrément de la liste des espèces animales protégées
en République Démocratique du Congo, cité par I.C.C.N,
Op. cit., pp. 3-8.
* 51 Un rapport de la RFO
fait état de 27 carrières d'or identifiées et
évacuées en 2006 de l'étendu de la RFO.
* 52 Cette section s'inspire
abondamment de la Loi N° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code
Minier.
* 53 Le Quotidien kinois Le
potentiel, dans son Edition 3679 du samedi 18 mars 2006.
* 54 LANCELIN M.,
« Quelques éléments de réflexion sur les
problèmes d'épargne et de crédit », in
Technique financière et développement dans l'esprit
d'entreprise, Ed. AUPELF - UREF, John Libbey, Paris, 1993, p.4.
* 55 HENAULT G. et M'RABET
R. (sous la direction de), L'entrepreneuriat en Afrique francophone :
culture, financement et développement, Ed. AUPELF - UREF, John
Libbey Eurotext, Paris 1990, p. 299.
* 56 VLASSENROOT K. et
RAEYMAEKERS T., Op cit., pp. 132-133.
* 57 CAMILLERI J.-L., La
petite entreprise africaine. Mort ou résurrection ?,
L'Harmattan, Paris, 1996, p. 209.
* 58 FEEC WAMBA, Rapport
annuel 2009, Wamba, 2010 (inédit).
* 59 BARIAND et al., Les
minéraux. Leurs gisements, leurs associations, Ed. Minéraux
et fossiles, Meung-sur-Loire, 1972, p. 425.
* 60 MULLER, Y.,
Mines, Tome II, Ed. Dunod, Paris, 1964, p. 140.
* 61 Pour plus de
renseignements, lire HUMAN RIGHTS WATCH, Le Fléau de l'or.
Rapport, Kinshasa, 2005, cité par KABUYA MUYEBA A. (CENADEP),
Op. cit., pp. 10-13.
* 62 Les données
relatives a ces calculs sont en annexe : ANNEXE 3 : DONNEES BRUTES
SUR LES EXPLOITANTS ARTISANAUX DANS LES CARRIERES D'OR EN TERRITOIRES DE
MAMBASA ET DE WAMBA.
* 63 VLASSENROOT K. et
RAEYMAEKERS T., Op. cit., p. 135.
* 64 ICCN, Op. cit.,
p. 7.
* 65 O.I.T., Les
problèmes sociaux et de travail dans les petites exploitations
minières. Rapport soumis aux fins de discussion à la
Réunion tripartite sur les problèmes sociaux et de travail dans
les petites exploitations minières, Bureau International du
travail, Genève, 17-21 Mai 1999.
* 66 PNUE, Rapport du
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) à l'occasion de
la Journée mondiale de l'eau, Mars 2010, disponible sur
http://www.humains-associes.org/blog/2010/04/27/choses-vues-040410/,
consulté le 5 mars 2011.
* 67 COASE, R., «The
problem of social cost», in Journal of law and economics, 1960,
Vol. 3, pp. 1-44, cité par J.-P. GOULD & C.E. FERGUSON, Op.
cit., p. 531.
* 68 Cf. GOULD J.-P. &
FERGUSON C.E., Op. Cit., pp. 528-533
* 69 LUTETE C., «
Le gouverneur Médard
Autsaï déterminé à accompagner l'encadrement des
exploitants miniers artisanaux en RDC », in
http://www.digitalcongo.net/article/53570##,
Kinshasa, 12/09/2008, consulté le 20 mars 2011.
* 70 Cette section s'inspire du
document du PNUE, Document d'orientation : Elaboration d'un plan
stratégique national pour l'exploitation minière artisanale et
à petite échelle de l'or, 7 mai 2009.


