|

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON Paix -
Travail - Patrie
Peace - Work - Fatherland
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
MINSTRY OF HIGHER
SUPERIEUR
EDUCATION
UNIVERSITE DE YAOUNDE II
UNIVERSITY OF YAOUNDE II
UNITE DE FORMATION DOCTORALE
DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES
(DESS)
EN GESTION URBAINE
PHILANTHROPIE ET DEVELOPPEMENT LOCAL A YAOUNDE :
CAS DES ASSOCIATIONS DES QUARTIERS
MELEN 4 ET MELEN 8 ONANA MEUBLE
Mémoire présenté et soutenu publiquement
en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées (DESS) en Gestion Urbaine
Option : Gestion de l'habitat et environnement urbain
Par :
KAMGA KAMGA Chrysleine Chantale
Maître ès sciences sociales
Sous la direction académique du :
Dr H.D.R. ESSOMBE EDIMO Jean Roger
Chargé de cours à l'Université de
Yaoundé II - Soa
Année académique 2008-2009
« L'Université de Yaoundé II
n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises
dans ce mémoire, ces opinions doivent être
considérées comme propres à leurs
auteurs »
SOMMAIRE
Pages :
Sommaire
..........................................................................................iii
Dédicace...........................................................................................V
Remerciements..................................................................................Vi
Liste des
abréviations.........................................................................
Vii
Liste des cartes, des schémas et
tableaux.......................................................Viii
Avant
propos....................................................................................iX
Résume............................................................................................X
Abstract..........................................................................................Xi
Introduction
générale............................................................................1
PREMIERE PARTIE : La philanthropie des organismes
à but non lucratif et le développement
local............................................................................13
Introduction de la première
partie.................................................................14
Chapitre 1 : La philanthropie des Organismes
à but non lucratif....................15
Introduction.....................................................................................15
Section 1 : Les sources de la
philanthropie................................................15
Section 2 : Typologie des organismes à but
non lucratif et leurs moyens
d'actions..........................................................................................25
Conclusion du premier
chapitre................................................................................33
Chapitre 2 : Les différentes approches
du développement local .....................34
Introduction.......................................................................................34
Section 1 : Le développement local, un
phénomène émergent ........................35
Section 2 : Le développement local
à Melen 4 et Melen 8 OM.........................44
Conclusion du deuxième
chapitre..............................................................56
Conclusion de la première
partie...............................................................56
DEUXIEME PARTIE : L'action philanthropique des
associations au développement de Melen 4 et Melen 8
OM.................................................58
Introduction de la deuxième
partie................................................................59
Chapitre 3 : Présentation
socio-économique de Melen 4 et de Melen 8 OM.......60
Introduction.....................................................................................60
Section 1 : Caractéristiques physiques et
démographiques de Melen 4 et Melen 8 OM
................................................................................................60
Section 2 : Aspects socio-économiques de
Melen 4 et Melen 8 OM..................71
Conclusion du troisième
chapitre.................................................................75
Chapitre 4 : L'action des associations en faveur
du développement de Melen 4 et de Melen 8
OM.................................................................................76
Introduction.......................................................................................76
Section 1 : Les formes de participations des
associations de Melen 4 et Melen 8
OM................................................................................................77
Section 2 : Les différentes
réalisations et l'appréciation des
populations..........82
Conclusion du quatrième chapitre
...............................................................88
Conclusion de la deuxième
partie.................................................................89
Conclusion
générale...........................................................................90
BIBLIOGRAPHIE.............................................................................93
ANNEXES.......................................................................................99
TABLE DES
MATIERES..................................................................110
A mes enfants,
A mon époux,
A mes parents.
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail, nos remerciements vont en premier lieu
à notre directeur de recherche, le Docteur H.D.R. Jean Roger
Essombè Edimo qui a accepté de nous accorder de son
précieux temps et de ses conseils judicieux, afin que nous menions ce
travail à son terme.
Nous remercions également le Docteur Isaac Tamba,
coordonnateur de notre formation, qui n'a ménagé aucun effort
pour rendre notre formation plus opérationnelle.
Notre gratitude s'adresse également à tous les
enseignants, qui nous ont dispensé sans relâche des enseignements
afin de parfaire notre formation en Gestion Urbaine.
Nous n'oublions pas le Docteur Benoît Mougoué,
Responsable de la Division Sociale à ERA-Cameroun, pour son encadrement
technique et pratique.
Une pensée va aussi à tous les animateurs ainsi
qu'à tout le personnel d'ERA-Cameroun et ISF d' Espagne pour leur bonne
collaboration et leur soutien.
Nous pensons particulièrement à Monsieur Ngadjou
Dominique qui nous a orientés et guidés dans la recherche
documentaire et à Amadifo Caroline pour la relecture de ce travail.
Nos remerciements vont aussi à l'endroit du Colonel
Youssa Gédéon, pour son encadrement et son soutien permanent.
Des remerciements particuliers vont à mes parents,
Monsieur et Madame Kamga Jonathan, à mes frères et soeurs et
leurs conjoints pour leur soutien affectif depuis notre tendre enfance.
Nous voudrions également remercier notre belle maman,
Madame Djientcheu Victorine pour son sens affectif et sa présence
effective pendant cette formation.
Une pensée va aussi à tous nos amis et camarades
de la promotion pour leur collaboration permanente pendant cette formation.
Des remerciements sincères vont à mon
époux le Docteur d'Etat Gérard Tchouassi qui m'a orientée
vers cette formation, m'a soutenue financièrement et, surtout, pour
toute son affection et sa disponibilité tout au long de mon
apprentissage.
Nous finissons par nos enfants qui ont été les
plus sacrifiés : nos filles Tchouassi Tchouassi Paule
Gérarde, Tchouassi Kamga Joanes Géraude, Tchouassi Djientcheu
Victorienne Eralde et notre bébé Djomani Tchouassi Joël
Gérardin, non seulement pour leur tendresse de tous les jours, mais
aussi pour avoir pu supporter toutes nos absences le long de cette
formation.
Liste des abréviations
|
BM
|
:
|
Banque Mondiale
|
|
CAD
|
:
|
Comité d'animation au développement
|
|
CADEM 4
|
:
|
Comité d'animation au développement de Melen 4
|
|
CADEM 8 OM
|
:
|
Comité d'animation au développement de Melen 8 Onana
Meuble
|
|
CL
|
:
|
Collectivités locales
|
|
CREDDA
|
:
|
Centre de recherche pour le développement durable en
Afrique
|
|
CNUCED
|
:
|
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement
|
|
CTD
|
:
|
Collectivité Territoriale Décentralisée
|
|
CUY
|
:
|
Communauté urbaine de Yaoundé
|
|
EES
|
:
|
Economie sociale et solidaire
|
|
ERA-Cameroun
|
:
|
Environnement- Recherche et Action au Cameroun
|
|
GIC
|
:
|
Groupement d'Intérêt Commun
|
|
ISF d'Espagne
|
:
|
Ingénierie sans frontières d'Espagne
|
|
IST
|
:
|
Infections sexuellement transmissibles
|
|
LESEAU
|
:
|
Laboratoire Environnement et Sciences de l'eau
|
|
MINATD
|
:
|
Ministère de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation
|
|
ONG
|
:
|
Organisation Non Gouvernementale
|
|
OSC
|
:
|
Organisation de la société civile
|
|
PME
|
:
|
Petites et Moyennes entreprises
|
|
SIDA
|
:
|
Syndrome Immuno-Déficience Acquis
|
|
WINGS
|
:
|
Worldwide Initiatives for Global Support
|
Liste des CARTES, DES schemas et tableaux
|
Carte n°1
|
:
|
Le Monde de la philanthropie
|
|
Carte n°2
|
:
|
La carte de Melen 4
|
|
Carte n°3
|
:
|
La carte de Melen 8 OM (Onana Meuble)
|
|
Carte n°4
|
:
|
Représentation schématique des réalisations
des acteurs locaux à Melen 4
|
|
Carte n°5
|
:
|
Les différentes réalisations des acteurs locaux
à Melen 8 OM (Onana Meuble)
|
|
|
|
|
|
Schema n°1
|
:
|
Caractérisation du rôle des Collectivités
dans le développement local
|
|
Schema n°2
|
:
|
La relation entre les acteurs du développement local
à Melen 4 et Melen 8 OM (Onana Meuble)
|
|
|
|
|
|
Tableau n°1
|
:
|
Les associations ciblées de Melen 4
|
|
Tableau n°2
|
:
|
Les associations ciblées de Melen 8 OM (Onana Meuble)
|
AVANT PROPOS
La rédaction de ce mémoire vient conclure la
formation en « Gestion Urbaine » qui a débuté
depuis plusieurs mois par des enseignements théoriques et s'est
poursuivie dans le cadre d'un stage académique pratique.
L'incapacité de l'Etat à subvenir au
problème de développement de toutes les régions a
poussé plusieurs personnes à prendre en main
l'amélioration des conditions de vie des populations dans leurs
localités. C'est ainsi que l'esprit de donner, de partager, etc....,
pour permettre le bien-être de tous a vu le jour. C'est ce constat qui a
suscité en nous l'idée d'étudier l'action philanthropique
des associations dans le développement local.
Dans cette étude nous avons examiné, tour
à tour, le concept de philanthropie au travers des organisations de la
société civile, le développement local dans son ensemble,
et l'impact positif des associations de Melen 4 et Melen 8 Onana Meuble dans
l'amélioration de la qualité de vie dans ces localités.
L'analyse des actions menées dans ces quartiers par ces organisations de
la société civile nous a permis de comprendre que ces
dernières peuvent apporter un début de solution au
développement local.
RESUME
L'objectif de cette recherche est d'analyser la contribution
philanthropique des associations des quartiers Melen 4 et Melen 8 Onana Meuble
au développement de ces localités.
Pour cela, la question majeure de notre travail est celle de
savoir si les populations, regroupées en associations, oeuvrent
volontairement à l'amélioration de la qualité de vie dans
les quartiers à habitat spontané en général et,
particulièrement, à Melen 4 et Melen 8 Onana Meuble, deux
quartiers de l'arrondissement de Yaoundé VI.
Pour mener à bien cette recherche, ce travail est
organisé autour de deux parties composées chacune de deux
chapitres. La première partie intitulée la philanthropie des
organismes à but non lucratif et le développement local, et la
deuxième partie est intitulée l'action philanthropique des
associations locales pour le Développement des quartiers Melen 4 et
Melen 8 Onana Meuble.
Au vu des nombreuses réalisations effectuées
dans les quartiers du champ de l'étude, la philanthropie des populations
regroupées en associations est primordiale pour le développement
en général et le développement local en particulier.
L'Etat en effet, n'est plus en mesure de financer toutes ces
réalisations et de s'occuper de l'amélioration de la
qualité de vie de ces populations.
ABSTRACT
This study aims to analyse the philanthropic contribution of
Melen 4 and Melen 8 Onana Meuble's Associations to the development of their
respective areas.
The research question of our study is to understand and know
whether or not, shanty towns Associations of residents in general and those of
Melen 4 and Melen 8 Onana Meuble in particular voluntary undertake works aiming
to improve the quality of their leaving.
The study is presented in two main parts of two chapters each.
Part one, focuses on the « Philanthropy of non profit institutions
and Local development », while part two deals with « The
philanthropic contributions of Melen 4 and Melen 8 Onana Meuble's local
associations' to the development of their areas ».
Considering the numerous achievements in the areas of study,
it appears that the philanthropy of residents gathered in associations is
essential to the development in general and to the «local
development» in particular. This is particularly true in a context of
financial drought whereby the government has given up from his responsibility
to secure the welfare of some of its citizens.
I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L'entrepreneurship, les PME1(*) et le développement local sont devenus dans nos
sociétés des concepts à la mode. Non pas qu'ils soient
nouveaux, au contraire, ils recouvrent des phénomènes
identifiés depuis déjà fort longtemps (Dupuis, 1998).
Toutefois, c'est leur importance stratégique dans le
développement de l'emploi qui l'est. En effet, jusqu'à la fin des
années 1970, les grandes entreprises et les gouvernements étaient
considérés comme les seuls leviers économiques importants
ou intéressants de la société. Les choses se sont
toutefois considérablement modifiées dans les années 1980.
Sur fond de mondialisation des marchés et d'accentuation de la
concurrence internationale, deux crises majeures et l'endettement croissant de
nos gouvernements ont provoqué une réorganisation en profondeur
de nos grandes structures. Cette crise est diversifiée et a des
implications majeures sur le développement, sur l'économie du
monde en général et sur celle des pays du Sud en particulier, sur
les pauvres chez nous et à l'étranger ainsi que sur l'aide
étrangère.
Les Etats, garants de la société, deviennent
incapables de mener tous seuls les actions indispensables au
développement de leur territoire. Tous les aspects sont touchés
au point que, dans un discours prononcé en novembre 2008, le
Secrétaire général de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) observait que :
« Nous pouvons déjà prédire
que le développement chez les populations les plus pauvres pourrait
être considérablement affecté. Selon l'OIT, la crise
financière réduira 20 millions de travailleurs au chômage,
pendant que 40millions de personnes franchiront le seuil de la pauvreté
extrême »2(*).
Dans cette situation, les gouvernements sont de plus en plus
incapables de remplir leur devoir auprès des populations. Avec une crise
alimentaire, une crise pétrolière et une crise financière,
l'on se retrouve face à une « triple crise » qui
pourrait anéantir tout le travail fait jusqu'ici. Globalement, les
dépenses en aide publique stagnent. C'est pourquoi les Amis de
l'Humanité, ou encore les philanthropes oeuvrent pour réduire les
dégâts. A l'heure où les dépenses gouvernementales
en matière sociale ont fondu comme neige au soleil, les apports tant en
nature qu'en numéraires pourraient constituer la plus grande force de
changement sociétal de notre monde.
En général au Cameroun, l'Etat s'occupe du
développement de toutes les régions. Mais, depuis la
décentralisation, le développement local est à la charge
des collectivités territoriales décentralisées (ou CTD)
que sont les communes. La Loi de l'orientation de la décentralisation du
22/07/2004 stipule que cette dernière consiste en un transfert par
l'Etat aux collectivités territoriales décentralisées, des
compétences et surtout des moyens appropriés, contrairement
à la déconcentration qui consiste à transférer les
pouvoirs aux unités administratives inférieures sans aucun dans
le domaine financier. Nous avons aussi dans le même cadre, la
communauté urbaine composée d'un minimum de deux communes. Ces
unités sont les plus petites représentations administratives de
l'Etat au Cameroun. La charge leur revient donc d'améliorer la
qualité de vie dans leurs localités respectives.
Mais le constat sur le terrain montre qu'avec l'aggravation de
la crise, cette institution ne peut plus à elle seule parvenir à
l'amélioration du bien-être des populations,
particulièrement dans les quartiers à habitat spontané.
Elles ont besoin d'être assistées et secourues. C'est ce qui a
favorisé le partenariat entre les associations de développement,
aidées par des ONG3(*), et la commune. Aussi, avec cette incapacité
à gérer seuls le problème du développement,
plusieurs organismes nationaux et internationaux se sont proposés
volontaires pour aider les populations à la base à prendre en
charge le développement de leurs localités. C'est ce constat qui
nous a poussés à étudier le degré de philanthropie
de ces organismes : jusqu'où sont-ils prêts à aller
dans leur aide et, surtout, quelle est la relève, ou encore qu'apportent
réellement les associations sur le terrain ?
Pour ce travail, nous avons effectué un stage
académique à ERA4(*) - CAMEROUN. Cette Organisation Non Gouvernementale
travaille en relation avec une autre basée en Espagne appelée
« ISF - Ingénierie sans frontières
Catalogne », et elles oeuvrent dans des projets tels que
« le Programme Quartier », « le programme
AQUA », etc.
Le premier programme mis sur pied en 2002, est né de
la volonté d'améliorer la qualité de vie des populations
dans les localités qui donnent au bassin versant de la Mingoa, dans la
commune d'arrondissement de Yaoundé VI. Au début, ce
« programme quartier » a précisément pris en
compte cinq quartiers. Ces derniers étaient des quartiers qui avaient
déjà commencé à se prendre en main à travers
des travaux d'aménagement de la localité. Pour sa part, le second
programme prendra en charge quinze quartiers pour l'assainissement en eau
potable. Notre étude se fera dans l'Arrondissement de Yaoundé VI,
dans les quartiers Melen 4 et Melen 8 OM. Ces deux localités ont suivi
les deux programmes.
II - ANALYSE CONCEPTUELLE
Pour une meilleure compréhension de notre travail, il
est important d'en définir les mots-clés.
La philanthropie est un concept qui impose une
générosité désintéressée. Du grec
philos (ami) et anthropos (homme), la philanthropie est la
philosophie ou la doctrine qui met l'humanité au premier plan de ses
priorités. C'est un sentiment qui pousse les hommes à venir en
aide aux autres. Le philanthrope n'aime pas voir son prochain souffrir, aussi
il lui apporte son aide sans contrepartie. Il cherche à améliorer
le sort de ses semblables par de multiples moyens et ce, de manière
désintéressée. Par opposition à la misanthropie
dans laquelle l'on manifeste de l'aversion pour son semblable ou encore,
où l'on éprouve de la haine pour le genre humain, le Micro Robert
définit la philanthropie comme l'amour de l'humanité5(*), c'est un acte moral, celui de
donner, de partager. Sa spécialité réside dans le fait que
le philanthrope est désintéressé et n'attend rien en
retour, elle est aussi un acte volontaire et bénévole. Elle
permet du moins à son donateur de laisser son nom à la
prospérité, de constituer un réseau de relation et
d'acquérir une notoriété dans le monde des affaires. Elle
renvoie à des concepts d'altruisme, de bonté, de bienfaisance, de
don, de générosité, de charité, etc.
Pour sa part, l'altruisme est une disposition à
s'intéresser et à se dévouer à la cause
d'autrui ; contrairement à l'égoïste, l'altruiste
travaille non pour son propre intérêt, mais pour le
bien-être de tout le monde. Et la bienfaisance est l'action de faire du
bien dans un intérêt social. Traditionnellement, la philanthropie
était l'oeuvre des riches qui donnaient d'importantes sommes à
des causes sociales. Aujourd'hui, elle se fait plus englobante et se traduit,
outre les dons d'argent, par le don de biens, de compétences, de
services et de temps utilisés à favoriser le mieux-être des
populations (OCDE, 2003). Au niveau international, nous avons la philanthropie
mondiale qui renvoie au nombre grandissant d'organisations philanthropiques et
de philanthropes dans le monde, ainsi qu'à la tendance de ces derniers
à s'attaquer toujours davantage à des enjeux mondiaux tels que la
pauvreté et le changement climatique.
Elle comprend les dons majeurs de particuliers mais aussi les
dons plus modestes versés par de très nombreux individus. En
fait, la philanthropie provient surtout des particuliers. Au-delà des
donateurs traditionnels, elle s'étend à de nouveaux pays, ainsi
qu'à de nouvelles populations à travers le monde.
Le secteur de la philanthropie dans le monde (Carte
1) regroupe d'un certain nombre de concepts voisins :
économie sociale, économie solidaire, secteur coopératif,
secteur du volontariat, etc.
Carte 1 : Le secteur de la philanthropie
dans le monde%
Sources : carte
concoctée à partir de Tsafack Nanfosso et Tchouassi (2009)
De son côté, le développement local est un
mot composé qui laisse apparaître deux termes : le
développement et la localité.
Le Lexique d'économie définit le
développement comme l'évolution des mentalités et des
institutions qui permettent l'apparition de la croissance et sa prolongation
sur une longue période6(*). Il se présente comme une cause en même
temps une conséquence de la croissance. Car pour obtenir cette
dernière, il faut qu'il y ait des mentalités prêtes
à accepter le changement. C'est pourquoi, dans le parler populaire, on
mêle souvent croissance et développement. Or, ce ne sont pas des
synonymes. Le développement implique accroissement de bien-être et
changement dans la structure économique et sociale. Il engage une
société sous tous ses aspects. La croissance est une notion plus
simple. Elle se réfère à un accroissement des
activités de production de biens et services mais n'implique pas
nécessairement des changements dans la structure, ni n'engage une
société sous tous ses aspects. Ainsi, la notion de
développement englobe une multitude de composantes économiques,
sociales et politiques et doit tenir compte des valeurs et attitudes d'une
population. Certains parlent donc de croissance pour les pays
industrialisés et de développement pour les pays pauvres, ceci en
insistant sur le caractère quantitatif du premier et le caractère
qualitatif du second.
Quant à elle, la localité se définit
comme un lieu déterminé, une petite ville, un village, ou encore
un quartier. L'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE, 1990) définit le niveau local comme:
« l'environnement immédiat dans lequel la
plupart des entreprises (et en particulier les petites) se créent et se
développent, trouvent des services et des ressources, dont dépend
leur dynamisme et dans lequel elles se raccordent à des réseaux
d'échange d'information et de relations techniques ou commerciales... Le
niveau local, c'est-à-dire une communauté d'acteurs publics et
privés offre un potentiel de ressources humaines, financières et
physiques, d'infrastructures éducatives et institutionnelles dont la
mobilisation et la valorisation engendrent des idées et des projets de
développement. »
Loin d'être un espace abstrait, la localité
renvoie donc à cet espace-plan sur lequel les acteurs locaux,
mus par la volonté de s'en sortir, développent quotidiennement
des stratégies spécifiques de production ou de survie et,
même, d'adaptation à la mondialisation (Essombè Edimo,
2007a) Il serait aisé de conclure que le développement local est
celui qui s'exprime sur un territoire donné, en l'occurrence ici, le
niveau local. Le phénomène est toutefois plus complexe. Le
développement local est un concept relativement nouveau dans le
vocabulaire. Il est né de la prise de conscience des insuffisances des
politiques d'aménagement du territoire, des déséquilibres
géographiques et socio-économiques ne pouvant trouver un plein
épanouissement qu'en s'appuyant sur une structure organisationnelle des
volontés locales. En effet, ce concept repose sur deux dimensions :
la correction du déséquilibre géographique et
socio-économique (logique du marché) et les volontés
locales (logique territoriale). Par ailleurs, en empruntant la
définition de Xavier Greffe (1994) pour qui :
« Le développement local est un processus
de diversification et d'enrichissement des activités économiques
et sociales sur un territoire à partir de la mobilisation et de la
coordination de ses ressources et de ses énergies. Il sera donc le
produit des efforts de sa population. Il mettra en cause l'existence d'un
projet de développement intégrant ses composantes
économiques, sociales et culturelles. Il fera d'un espace de
contiguïté, un espace de solidarité
active »7(*).
On constate qu'un projet de développement local est un
projet « Botton up » c'est-à-dire
pensé à la base. Au vu de ces différentes
définitions, nous pouvons donc définir le développement
local comme la faculté de créer des richesses à la base
dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations dans un
territoire bien circonscrit : un quartier, un village, ou une commune.
Cette notion de développement local est également celle
effectivement visée au Cameroun avec la décentralisation.
La décentralisation suppose une coopération, un
partenariat entre le gouvernement central et les collectivités locales.
La commune constitue le premier maillon des collectivités territoriales
décentralisées; c'est l'échelon de base. Nous pouvons la
classer comme suite :
· la communauté urbaine (qui correspond au
département entier),
· la commune urbaine (renvoie à l'arrondissement,
avec chef lieu de province ou de département),
· la commune urbaine d'arrondissement (arrondissement
des départements du Wouri et du Mfoundi)
· la commune rurale (correspond à
l'arrondissement ou au district en zone rurale).
III - PROBLEMATIQUE
Avec le système de la décentralisation, chaque
localité camerounaise est appelée à s'unir à l'Etat
pour mettre en place son développement. Le développement est donc
devenu un processus à caractère social. Améliorer la
situation économique et le bien-être des populations dans nos
localités constitue de ce fait une tâche complexe impliquant de
nombreux acteurs. Les populations sont donc appelées à travailler
dés la base, et à oeuvrer en partenariat pour faciliter ce
processus, ceci sans contrepartie, ou encore de façon totalement
désintéressée. Pour cela elles doivent se mettre en
association. Le cadre de l'intervention publique en matière de
regroupement des personnes est défini par les lois n° 77/495 du 7
décembre 1977 et n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant
respectivement création et fonctionnement des oeuvres sociales
privées et liberté d'association au Cameroun. L'association est
ainsi au sens de ces lois « une convention par laquelle des
personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans
un but autre que de partager des bénéfices ».
Alors, si la philanthropie est l'action de donner, de partager
ceci de façon désintéressée et sans contrepartie et
pour le bien-être de plusieurs personnes, participe-t-elle au
développement local de Melen 4 et de Melen 8 OM8(*) au travers des associations ? En
d'autres termes, les habitants de ces localités posent-ils des actes
philanthropiques ou attendent-ils toujours l'aide de l'extérieur ?
Pour le développement de leurs quartiers, sont-ils prêts à
s'organiser en comité d'animation au développement et à
mettre leur temps, leur expérience, leur expertise, leur personne, ou
encore leur argent au service du bien-être collectif ?
V - QUESTION DE RECHERCHE
Notre attention est focalisée ici sur la contribution
des associations philanthropiques des quartiers Melen 4 et Melen 8 Onana Meuble
à Yaoundé VI, au développement local et, plus
exactement, sur la participation philanthropique des populations de ces
localités à leur bien-être. La question majeure de notre
travail est donc celle de savoir si les populations regroupées en
associations oeuvrent volontairement à l'amélioration de la
qualité de vie dans les quartiers à habitat spontané en
général et, particulièrement, à Melen 4 et Melen 8
Onana Meuble, deux quartiers de l'arrondissement de Yaoundé VI.
Cette question principale suscite elle-même des
interrogations secondaires notamment :
· Comment reconnaît-t-on un organisme
philanthropique, ou encore quels sont les caractéristiques de la
philanthropie ?
· Quelle est la particularité du
développement local, en d'autres termes, comment se déroule-t-il
concrètement ?
· Comment se passe la participation des associations sur
le terrain ; les populations sont-elles assez mobilisées pour cette
cause ?
· Quel est le degré d'appréciation des
travaux par le reste de la population?
VI - OBJECTIF GENERAL
Notre souci dans ce travail est de montrer l'implication des
associations des quartiers dans l'amélioration des conditions de vie des
populations, d'encourager l'entraide et le partage, le don de soi, l'esprit de
participation dans les travaux dans nos régions respectives.
De ce fait, l'objectif principal de notre étude est
d'analyser la contribution philanthropique des associations des quartiers Melen
4 et Melen 8 OM au développement de la localité.
VII - OBJECTIFS SECONDAIRES
A la fin de ce mémoire nous voulons être en
mesure de cerner la différence entre la philanthropie et les aides au
gouvernement.
Nous aimerions déterminer ce que sont le
développement local et ses défis pour mettre en place le
développement en général.
Nous voudrions aussi présenter l'apport sans
contrepartie des associations locales au développement de leur
localité et la réaction des populations dans nos
quartiers-cibles.
VIII - HYPOTHESES DE RECHERCHE
H 1: L'Etat ne peut tout seul amener
le développement dans les quartiers, il a besoin de la population
c'est-à-dire, d'un développement pensé à la
base.
H 2 : Les associations et les
comités d'animation au développement des quartiers Melen 4 et
Melen 8 OM mènent des actions philanthropiques respectives pour
contribuer au développement dans leur localité. Ces associations
sont les agents de l'économie sociale et solidaire. Ils ont par
conséquent des activités multiples qui peuvent jouer sur le
développement local.
IX - METHODOLOGIE
Pour traiter notre thème intitulé
« Philanthropie et Développement Local : Cas des
associations des quartiers Melen 4 et Melen 8 Onana Meuble à
Yaoundé VI. », nous nous sommes inspirées de la
littérature existante sur le sujet (ouvrages, articles, rapports,
mémoires, lois, journaux, etc.)
Sur le plan législatif, nous avons parcouru plusieurs
lois :
· loi n° 77/495 du 7 décembre 1977 fixant
les conditions de création et fonctionnement des oeuvres sociales
privées,
· loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant
liberté d'association au Cameroun,
· loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution du 2 juin 1972,
· loi n° 99/014 du 22 décembre 1999
relatives aux Organisations Non Gouvernementales,
· loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles de la décentralisation applicables aux communes,
· loi n° 2004/17 du 22 juillet 2004 portant
relative à l'orientation de la décentralisation au Cameroun.
Sur le plan pratique, nous nous sommes inspirées du
cadre juridique et des principes d'administration d'une organisation de la
société civile, réalisés par le Centre de Recherche
pour le Développement Durable en Afrique (CREDDA) en 2004. Nous nous
sommes également appuyées sur le guide des relations entre les
institutions et les organisations de développement local
rédigé par ERA-Cameroun. De même que nous nous sommes
appuyées sur les Actes de la Journée Annuelle de l'O.S.C, sur les
programmes Municipaux intégrés de lutte contre la pauvreté
dans la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé VI, nous avons
utilisé les dossiers du comité d'aide au développement
portant sur les « Fondations Philanthropiques et Coopération
pour le Développement » de l'Organisation de
Coopération et de Développement économiques (OCDE, 2003),
nous avons aussi utilisé, le guide des tendances et enjeux pour le
conseil canadien pour la coopération internationale, portant sur la
philanthropie mondiale et la coopération internationale (Décembre
2008) et, également, le rapport de la conférence publique sur le
volontariat. Nous avons, en plus, effectué des recherches sur
l'Internet.
Sur le plan de la recherche, un certain nombre de travaux nous
ont permis d'avoir quelques pistes d'orientation. Parmi ceux-ci, nous
citons : Essombé Edimo (2005a, 2005b, 2007a et 2007b), Fondo et
Tchouassi (2007), Greffe (1992), Tamba (2004), Tchouassi (2004, 2005, et 2007),
Tsafack Nanfosso (2007), Tsafack Nanfosso et Tchouassi (2009), Pecqueur (2002),
etc.
Pour mener à bien notre recherche et atteindre les
objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons commencé par
présenter la philanthropie et son impact sur le développement en
général à travers les organismes à but non
lucratif, puis leurs mécanismes de financement du développement
local et une vision synoptique des associations dans nos quartiers
cibles : Melen 4 et Melen 8 OM. Ensuite, avant de dégager la
participation de manière philanthropique des associations dans le
développement local, nous avons présenté notre cadre de
travail. Pour réussir ce travail, la collecte des données sur le
terrain était une étape fondamentale.
Pour obtenir les informations nécessaires dans le cadre
de notre recherche, nous avons collecté des informations sur les
données primaires auprès des dirigeants, membres des
différentes associations et bénéficiaires des
différentes réalisations. Nous les avons soumis à des
questionnaires (voir Annexes 1 et 2) visant à
identifier la contribution réelle des associations philanthropiques des
quartiers Melen 4 et Melen 8 OM à la construction des ouvrages (pistes,
routes, caniveaux, point d'eau, etc.), leur participation réelle au
développement, et nous avons analysé leurs réponses tout
au long de notre travail.
Ce travail est organisé autour de deux parties
composées chacune de deux chapitres. La première partie
intitulée « la philanthropie des organismes à but non
lucratif et le développement local », comporte deux
chapitres : la philanthropie des organismes à but non lucratif
(Chapitre 1) et les différentes approches du
développement local (Chapitre 2). La deuxième
partie intitulée « l'action philanthropique des associations
locales pour le développement des quartiers Melen 4 et Melen 8
OM » est aussi composée de deux chapitres:
présentation socioéconomique de Melen 4 et de Melen 8 OM
(Chapitre 3) et l'action des associations au
développement de Melen 4 et Melen 8 OM (Chapitre 4).
PREMIERE PARTIE :
LA PHILANTHROPIE DES ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF ET LE DEVELOPPEMENT
LOCAL
|
INTRODUCTION DE LA PREMIERE PARTIE
Chez les néoclassiques et les classiques,
l'économie était fondée sur
l'homoéconomicus. Cette expression forgée par Adam Smith
(1776), désignait l'agent typique de la théorie économique
libérale. Un être libre doté d'une rationalité
parfaite qui cherche toujours, à travers ses décisions, à
maximiser ses satisfactions. L'homoéconomicus est un
« calculateur général de plaisirs et de peines qui,
comme une sorte de globule homogène fait de désir, de bonheur,
aussi sous l'impulsion de stimulant qui le promène un peu partout sans
le déformer. Il n'a ni passé, ni avenir, il est un fait humain
isolé, immuable en équilibre stable sauf sous le contre coup de
certaines forces agissantes qui le déplacent dans un sens ou dans
l'autre »9(*)
Cet être est guidé par l'appât du gain et il est, du reste,
toujours prêt à maximiser. L'homoéconomicus
apparaît ainsi comme « un être sans âme,
uniquement intéressé par les mobiles
élémentaires »10(*).
Avec la pauvreté et la crise économique, cet
être égoïste et calculateur a laissé la place à
l'homosociologius c'est-à-dire, un être social,
doté d'une rationalité limitée. Au lieu d'être
égoïste, il est altruiste. Pendant que le premier recherche le
profit calculé avec une centralisation maximale des entreprises, le
second recherche le profit social basé sur l'entraide, la
solidarité, le partage, la générosité, sur le
développement à la base qui profite à tous. C'est donc un
philanthrope qui oeuvre sans contrepartie afin de participer au bien-être
de ses semblables.
Dans cette première partie, nous présenterons
cet être généreux, altruiste et
désintéressé à travers la philanthropie et le
développement local. Nous commencerons par l'historique de la
philanthropie, ses défis et ses caractéristiques. Puis, nous
terminerons par les approches conceptuelles du développement local, afin
d'en extraire des éléments permettant la comparaison avec la
réalité des comportements des acteurs des localités de
notre champ d'analyse.
CHAPITRE I : LA PHILANTHROPIE DES ORGANISMES A BUT
NON LUCRATIF
Introduction
Ces dernières années, l'arrivée d'acteurs
nouveaux et les façons différentes d'approcher la lutte contre la
pauvreté dans le monde ont changé l'allure du
développement. Dans la seconde moitié du XXème
Siècle, le développement était principalement
financé par les pays membres de l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE). Aujourd'hui, avec la crise
économique, plusieurs acteurs, touchés par la misère de
leurs semblables, ont décidé de partager, afin de permettre aux
uns et aux autres de s'en sortir. Certains qui n'ont pas assez de moyens
financiers, se sont mis aux services des autres en les assistant tout
simplement. Alors, comment cet esprit de partage et de soutien a-t-il
débuté ? Comment cela se manifeste-t-il et quels sont ses
fondements théoriques et son organisation ?
SECTION 1 : LES SOURCES DE LA PHILANTHROPIE
Historiquement, la philanthropie est beaucoup plus d'origine
religieuse. Mais ses caractéristiques sont d'autant plus nombreuses
qu'on la retrouve chez les non religieux et au sein des organisations à
but non lucratif oeuvrant pour le développement local.
I - HISTORIQUE DE LA PHILANTHROPIE
.
Selon l'Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique (2003), on distingue deux grandes formes de
philanthropie :
- La première est essentiellement d'origine religieuse
et a pour objectif premier d'atténuer les souffrances des pauvres.
- La seconde est laïque. Elle vient de la bienfaisance.
C'est l'action de faire du bien à quelqu'un, une inclination au bien.
1 - LES ORIGINES RELIGIEUSES DE LA PHILANTHROPIE
Les origines de la philanthropie sont très anciennes.
Pour être philanthrope, il faut connaître, aimer et accepter son
prochain, ou encore son semblable. L'altruisme trouve ses racines dans les
liens familiaux et de parenté, avec l'obligation de protéger les
siens et d'offrir l'hospitalité aux étrangers. Ces comportements
s'inscrivent dans le prolongement de certains réflexes fondamentaux,
comme l'instinct de conservation et la protection par tout un chacun de sa
progéniture, l'amour de sa personne et de son prochain, le rejet de la
souffrance d'autrui ; il n'est donc pas surprenant que les habitudes
altruistes constituent un aspect quasi-universel des sociétés
humaines (OCDE, 2003). Seulement, ces facteurs instinctifs ou
émotionnels n'apportent qu'une explication hypothétique de
l'action philanthropique.
Le motif le plus visible et le plus direct est le devoir
religieux. Fréquemment assimilée à la notion de
charité, elle s'inscrit dans l'histoire, depuis les premiers textes
éthiques jusqu'aux oeuvres caritatives que nous connaissons aujourd'hui,
en passant par l'assistance qu'apportent les Eglises au fil des siècles.
On considère généralement qu'il repose à la fois,
sur le désintéressement et l'égoïsme, puisqu'il
associe la notion de sacrifice personnel et la perspective d'une
récompense ultérieure. Les principales religions du monde
demandent à leurs membres de faire des dons aux oeuvres caritatives, de
lutter contre la souffrance et la pauvreté, d'ouvrir leur porte à
« l'étranger ». Le religieux est toujours prêt
à faire des dons parce qu'il espère avoir une récompense
dans l'au-delà. Dans le christianisme qui est l'une des religions les
plus répandues dans le monde et dans le judaïsme, il y a la
pratique de la dîme, qui consiste à consacrer un dixième de
ses revenus aux dons caritatifs. Ceci est la condition pour un pratiquant de
montrer qu'il est engagé.11(*) Cette dîme signifie un dixième de tous
ses biens, sans distinction de qualité ou de quantité. Chaque
croyant donne cette dîme pour dire merci à son créateur
pour tous les biens qu'il lui procure. Ce don permet aux pasteurs et
prêtres de vivre aisément, et de venir en aide aux pauvres. C'est
dans ce sens que l'Eternel demande aux hommes de partager ce qu'ils
possèdent avec les démunies, afin de recevoir beaucoup de
bénédictions.
Quant à l'Islam, il impose aux Musulmans de consacrer
2,5 % de leurs biens, chaque année aux oeuvres de bienfaisance. C'est
pourquoi les premiers grands hôpitaux ont été fondés
par les chefs musulmans du Moyen-âge. Lors d'une conférence
organisée au Pakistan en 2000, l'Aga Khan a
déclaré :
« La philanthropie et le don caritatif occupent une
place centrale dans les enseignements du Coran, dans les écrits des
penseurs musulmans, ainsi que dans l'histoire des Musulmans, dans toutes les
régions et toutes les cultures du monde islamique ... Très
tôt, les donateurs musulmans fortunés ont conçu un
système spécial - les dotations (Awqaf) -- afin que les
activités caritatives puissent acquérir une certaine autonomie.
Le financement du développement social par des organismes
philanthropiques (qu'il ne faut pas confondre avec les oeuvres de bienfaisance)
est un phénomène un peu plus récent. Il a d'abord pris la
forme d'un soutien financier aux écoles et aux hôpitaux, le plus
souvent au moyen de donations. »12(*)
En ce qui concerne les textes sacrés de l'hindouisme,
ils prônent la charité : les pratiquants doivent savoir
partager, venir au secours des autres sans toutefois en attendre de
contrepartie, ils doivent pouvoir répondre présent si l'on a
besoin d'eux. Et les Bouddhistes sont exhortés à suivre l'exemple
du Bodhisattva, qui « laisse le meilleur de sa nourriture aux
affamés,... protège ceux qui ont peur, ... soulage les maux de
ceux qui souffrent, ... [et] partage ses richesses avec les
pauvres»13(*) (OCDE,
2003, op. Cit.).
Bien que les sociétés laïques aient donc
tendance à mettre de côté la religion, et à faire
abstraction de son pouvoir de modeler les institutions et les comportements, la
religion reste la « mère de la philanthropie ... en termes de
concepts et de procédures»14(*). Les missionnaires chrétiens ont toujours
été actifs dans certaines parties du monde figurant parmi les
moins développées et les plus dangereuses. Leurs efforts pour
améliorer le bien-être matériel des populations, servent de
modèle et d'inspiration aux programmes de bénévolat
parrainés par les pouvoirs publics. Aussi, il est manifeste que les
préceptes bibliques sous-tendent les initiatives philanthropiques dans
les pays occidentaux. Plusieurs oeuvres caritatives sont faites par les
communautés religieuses. Ainsi, il importe de préciser que la
chrétienté a toujours eu une influence majeure sur les politiques
et les programmes officiels en matière d'aide aux nécessiteux,
d'acte de générosité et de charité.
Toutefois, parler de la religion comme source unique de
philanthropie serait nier l'existence des autres actions menées par
certains acteurs de la société. En effet, la philanthropie tire
ses sources dans des croyances religieuses et non religieuses. La preuve en est
qu'au Cameroun, avant l'arrivée des courants religieux, nos
ancêtres pratiquaient des actions philanthropiques. Ces dernières
étaient basées sur l'entraide, la solidarité, etc. Il
reste alors à présenter dans un cadre général la
conception laïque de la philanthropie.
2 - LES ORIGINES LAÏQUES DE LA PHILANTHROPIE
La philanthropie est aussi en effet d'origine non religieuse.
Elle relève de la fierté personnelle, car plusieurs donateurs
veulent se faire connaître de la descendance future. Ce sont des gens qui
aimeraient que la progéniture future reçoive ou garde des
souvenirs marquant leur présence. C'est pourquoi, ils créent des
institutions qui deviendront, par la suite, autant de « monuments »
commémoratifs de leur générosité et de leur
volonté de contribuer au bien-être de l'humanité. Ils
mettent leur fortune à la disposition de leur fondation, afin de limiter
les souffrances de leurs semblables.
Le plus grand philanthrope des temps modernes est Andrew
Carnegie. C'est un homme d'affaires américano-écossais
autodidacte qui, à l'âge de soixante cinq ans, s'est retiré
de la vie active pour se consacrer à l'action philanthropique. Ce
philanthrope avait un objectif précis : « installer des
échelles afin de favoriser l'ascension de tous ceux qui le
désirent »15(*). Pour atteindre son objectif, il avait dressé
la liste des améliorations souhaitables à l'échelle
communautaire, classées par ordre de priorité décroissant.
La liste de Carnegie énumérait en fait les oeuvres de
bienfaisances classiques. Des philanthropes à l'instar de Carnegie,
insistaient sur la nécessité d'aider les gens à s'aider
eux-mêmes, au lieu d'accepter qu'ils se conduisent comme des
bénéficiaires passifs.
Un autre facteur qui favorise la philanthropie, peut
être la recherche de l'intérêt personnel. Cette recherche
peut prendre des formes diverses. Les dons caritatifs sont
généralement exonérés d'impôts, y compris
ceux que chacun peut faire à sa propre oeuvre de bienfaisance. C'est
pourquoi, certains ont affirmé que Henry Ford avait créé
la fondation qui porte son nom avec les biens de sa société, afin
de soustraire sa fortune à l'impôt. Mais, quel que soit le
bien-fondé de ces accusations (que les fondations se sont
employées à réfuter) la marge est étroite entre les
incitations fiscales à la philanthropie et les possibilités
d'évasion fiscale et les conflits d'intérêts.
La philanthropie du XXI ème Siècle
est beaucoup plus diversifiée et peut compter sur l'apport des hommes et
des femmes. Elle n'est plus réservée aux riches à la
retraite, ou encore aux pays dits développés. Elle s'est rajeunie
et est de moins en moins la préparation d'un legs à la
postérité que l'on réserve pour la retraite16(*). Bien que l'on associe souvent
la philanthropie aux pays industrialisés du Nord, il y a des traditions
de sollicitude, de don et de soutien communautaires dans le monde entier. On
observe aujourd'hui une augmentation de la philanthropie formelle et informelle
dans les pays du Sud, où le nombre des particuliers philanthropes et des
nouveaux projets et institutions augmentent.
Les travailleurs migrants sont une source philanthropique
à ne pas négliger (Fondo et Tchouassi, 2007). Ils ont toujours
envoyé de l'argent pour aider leurs familles. Or, le nombre de migrants
allant croissant, la technologie facilitant les transferts financiers et la
collecte des données, on note un intérêt grandissant pour
les envois de fonds comme moyen potentiel de développement. Les
principaux pays à recevoir les envois de fonds sont les pays du Sud.
Car, l'argent va du Nord et de l'Amérique Centrale vers les pays
défavorisés. L'argent va principalement aux familles, mais aussi
aux Etats, car des montants toujours plus élevés sont
versés collectivement pour la résolution de problèmes
communautaires. Les gouvernements de ces pays y trouvent aussi une source
importante de devises. Dans les pays de résidence, les
collectivités de migrants ont formé des associations dont l'une
des finalités est souvent de fournir un appui à leur ville, ou
région d'origine. En 2004, par exemple, plus de six cent de ces
associations réparties dans trente villes étasuniennes ont mis en
commun des fonds pour des activités diverses dans le pays d'origine, et
elles ont obtenu l'appui financier des Etats et du gouvernement
fédéral Américain17(*). Le lien entre les diasporas et leur
communauté d'origine va au-delà des envois de fonds et englobe
d'autres formes d'investissement économique et social. Des particuliers
ont, en outre, créé des ONG qui s'occupent de
problématiques plus larges dans leurs pays.
Avant de demander de l'aide aux autres, les populations
doivent faire des efforts pour sortir de la misère. Il est vrai que
certains reçoivent l'appui de fondations privées du Nord, ou du
réseau en expansion des fondations communautaires, mais d'autres sont
mis sur pied par les entreprises et les populations locales. Ce sont les
organisations de la société civile. Ces dernières sont les
agents de l'économie sociale et solidaire (ESS). L'économie
sociale et solidaire désigne l'ensemble des activités
économiques qui, dans une économie développée ou en
développement, n'ont pas pour motif principal le profit. L'ESS recouvre
des ensembles de tailles différentes, et la nature de leurs
activités se caractérise également par une grande
diversité.
Elle est constituée pour répondre à des
besoins peu ou mal pris en compte par les institutions conventionnelles,
notamment par l'Etat ou par le marché, tant au niveau national qu'au
niveau international (Tsafack Nanfosso, 2007). Cette dernière est
née dans les années 1830 et 1840, à travers un
véritable fourmillement associatif (Tchouassi, 2007). Toutefois, pour
mieux comprendre la philanthropie, nous devons connaître ses défis
et ses caractéristiques.
II - DEFIS ET CARACTERISTIQUES MAJEURS DE LA PHILANTHROPIE
Pour parvenir à leur but, les philanthropes ont des
défis à surmonter. C'est ainsi que les actions philanthropiques
ont des caractéristiques spécifiques.
1 - LES MULTIPLES DEFIS DE LA PHILANTHROPIE
Traditionnellement, la philanthropie était l'oeuvre des
riches qui donnaient d'importantes sommes pour des causes sociales.
Aujourd'hui, elle se fait plus englobante et se traduit, outre les dons
d'argent, par le don de biens, de compétences, de services et de temps
utilisés à favoriser le mieux-être des populations. Elle
comprend les dons majeurs de particuliers mais aussi les dons plus modestes
versés par de très nombreux individus. Pour le philanthrope, le
développement est un processus à caractère social ;
aussi participer à l'amélioration de la qualité de vie de
ses semblables lui est normal et très important.
Seulement, améliorer la situation économique et
le bien-être général des populations constitue une
tâche complexe. Il est donc nécessaire de travailler en
partenariat, ceci en implique plusieurs acteurs. En s'associant, ils forment
des organisations qui s'attellent à améliorer le mieux possible
les conditions de vie de populations en difficulté. Confrontés
pour cela à plusieurs défis dans la sélection et le suivi
des projets, ils doivent ménager des efforts pour concilier les
réalisations immédiates et le développement des
capacités sur le long terme. Ils doivent aussi prendre en compte le
développement durable. Cette notion apparue en 1980 dans un ouvrage
intitulé, « la stratégie mondiale de protection de
l'environnement » et présenté par l'Union
Internationale pour la conservation de la nature, se définit comme un
développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Les philanthropes qui veulent changer en bien la
qualité de vie de leurs semblables, ont donc le devoir de
développer l'humanité, tout en respectant l'environnement et les
équilibres écologiques fondamentaux. Sous l'impulsion de
puissants facteurs internes et externes, la philanthropie opère
actuellement une triple révolution placée sous le sceau de la
transparence, de l'efficacité et de la coordination. Cette « grande
transformation » n'est pas achevée et doit encore surmonter
plusieurs défis, dont celui d'une légitimité
renforcée dans l'espace social. Cette évolution constitue
néanmoins une réelle opportunité, afin que les fondations
puissent jouer un rôle plus important dans le paysage de l'aide au
développement et pour amorcer une phase de coopération
renforcée avec les bailleurs de fonds institutionnels du
développement. S'ils constituent toujours une référence
importante pour la communauté philanthropique, les Objectifs du
Millénaire pour le développement ne semblent pas
véritablement appelés à jouer un rôle unique dans
cette coordination.
Il émerge partout dans le monde de nouvelles
fondations. En Colombie, la fondation Alvar Alice finance l'organisme
« Paz y Bien », qui accompagne les jeunes
victimes de la violence urbaine et des déplacements forcés. Dans
le Sud, le réseau des fondations communautaires grandit aussi, notamment
en Afrique et en Thaïlande où l'on note une croissance de
l'activité philanthropique. Cette émergence est possible
grâce à la contribution des Worldwide Initiatives for Global
Support (WINGS), avec les fonds de la Banque mondiale (BM) et de fondations
étasuniennes. Celle-ci est complétée par les dons
versés par des gens de classe moyenne et de riches particuliers de
chaque pays18(*).
Pour ne pas rester en dehors de ce changement, plusieurs
organisations ont vu le jour en Afrique. Ce sont les Organisations non
gouvernementales (ONG) qui se concentrent généralement sur les
activités liées à l'amélioration du bien-être
et à l'allègement des souffrances des populations. Les fondations
quant à elles, ont le plus souvent des objectifs de développement
à long terme, ou s'emploient à éliminer les causes
profondes du dénuement. Ces observations n'ayant cependant qu'une
portée très générale, il va de soi qu'il existe des
exceptions. Les contributions apportées au développement par les
fondations sont aussi nombreuses et variées que celles des ONG ou des
agences gouvernementales : elles peuvent aller de bourses d'études
individuelles et de subventions destinées à la sauvegarde de
l'héritage naturel et humain à des projets de
développement dans pratiquement tous les domaines économiques et
sociaux (OCDE, 2003, op. Cit.).
L'argent n'est donc pas la seule chose reconnue en
philanthropie. Les préoccupations des organisations à but non
lucratif ont évolué au fil du temps. Il est à noter que
l'activité philanthropique actuelle met l'accent sur le soutien à
la démocratie, à la participation de la société aux
décisions, à l'amélioration de la qualité de vie
des individus et à l'établissement de la paix. Tout ceci est
primordial en philanthropie car, le maintien de la cohésion sociale
permet la collaboration des acteurs sociaux et la mise en place d'un
développement durable. La fondation Soros, l'une des principales qui
soit de création récente, s'est spécialisée dans ce
domaine (OCDE, 2003, Ibidem.).
D'autre part, Bill Clinton n'a pas une grande fortune, mais il
a un pouvoir de convocation. En septembre dernier, l'assemblée annuelle
de la « Clinton Global Initiative » a attiré
quarante cinq Présidents directeurs généraux des
entreprises mondiales, soixante chefs d'Etat, de très nombreux leaders
de causes diverses et même quelques personnalités de Hollywood et
qui ont engagé, au final, près de huit Milliards de dollars pour
de nouveaux projets19(*).
Bill Clinton fait partie de ces personnes, qui peuvent convaincre beaucoup
d'acteurs, capables d'amener un grand nombre à prendre conscience de la
nécessité d'améliorer les conditions de vie des individus
démunis.
Dans le domaine du développement, la philanthropie
n'oeuvre pas seule, il y a aussi des programmes d'aide gouvernementaux. Pour
qu'une action soit reconnue philanthropique, ou encore pour qu'une oeuvre soit
perçue comme une oeuvre philanthropique, elle doit respecter plusieurs
caractéristiques.
2 - LES CARACTERISTIQUES DE L'OEUVRE PHILANTHROPIQUE
La philanthropie regorge de caractéristiques
aujourd'hui largement reconnues. Les principales sont : le volontariat, le
bénévolat, le désintéressement, etc.
Pour ce qui est du volontariat : c'est un statut
juridique sous lequel des personnes engagent un travail, le plus souvent
à vocation humanitaire, sociale, sportive, culturelle, etc. Ici, les
tâches accomplies sont sans compensation pécuniaire. Le service
volontaire est un échange entre une personne qui offre : son temps,
son travail, son énergie au bénéfice d'un projet
d'intérêt général. Pour cela, il suppose un
engagement réciproque et formalisé, libre,
désintéressé, au service de la collectivité, avec
un horaire par semaine et une durée précise. Le service
volontaire peut être une activité à plein temps. Cependant,
les volontaires ne sont pas des employés, ils ne reçoivent pas de
salaire.
Le service volontaire n'est donc pas un moyen de gagner sa vie
au sens financier du terme, mais de s'enrichir d'une autre manière tout
en apportant sa contribution concrète à un projet
d'utilité collective. En effet, un volontaire est une personne, (homme
ou une femme), majeure. Fortement motivée, la personne volontaire met
bénévolement ses compétences au service de partenaires ou
de populations qui en ont exprimé le besoin (avis du Conseil Economique
et Social du 24 février 1993). L'interpellation d'un citoyen non
indifférent, qui croise un problème, est toujours à
l'origine de l'initiative qui va devenir une « cause ». La non
indifférence est la principale caractéristique du volontariat, et
c'est elle qui suscite les motivations.
En matière de bénévolat
ensuite : Le bénévolat est une activité de
service non rétribuée et choisie volontairement. Cette
activité s'exerce en général au sein d'une association.
C'est une activité qui consiste, pour un individu à offrir pour
contribuer au fonctionnement d'une organisation sans exiger aucune
rémunération. Le statut
de bénévole n'existe pas de façon légale,
toutefois il se distingue de façon claire. Le bénévole est
celui là qui « fournit à titre gratuit une
prestation de travail par sa participation au fonctionnement et à
l'animation de l'association de son plein gré et d'une manière
désintéressée »20(*).
Pour ainsi dire, un bénévole est
« une personne qui s'engage librement à mener une action
non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel
et familial » (avis du Conseil Economique et Social du 24
février 1993). On peut donc dire sans risque qu'un
bénévole est un citoyen engagé qui place son temps libre
au service de toute la communauté.
Enfin, en ce qui concerne le
désintéressement : C'est la qualité de celui qui
est désintéressé, c'est le détachement de tout
intérêt propre. Dans l'engagement
désintéressé, je donne mon temps et rien n'est attendu en
échange d'équivalence, rien n'est prévu, rien n'est
négocié. Et pourtant un retour important se réalise
souvent : « je reçois plus que je n'ai
donné » ! Mais ce retour ne s'effectue pas par un
transfert de valeurs au départ du projet, de la cause, mais bien par un
échange interne, une transformation interne : « je transforme
le contenu de mon temps en lui donnant du sens ». On
retrouve d'ailleurs ici également la réciprocité
fréquemment rencontrée dans l'usage et le recours au don que
connaissaient déjà, jadis, les sociétés africaines
(Meillassoux, 1975).
Ici donc, le désintéressement se transforme en
échange. Le don de temps, de sa personne, de son argent ne
peut en aucun cas être assimilé à une vente,
même si la production est la même. La joie d'avoir permis
à un grand nombre de personnes de sortir de la misère, nous donne
la force de continuer. Les règles dans ce domaine sont celles de la vie
en commun, les règles de bon sens ; celles qui sont d'application
pour bien faire fonctionner une organisation.
Encore qu'il faille préciser, par ailleurs, que les
termes de volontariat et de bénévolat sont souvent
utilisés indifféremment même si seul le volontariat est
encadré par un statut juridique et réglementaire. Au sens
juridique du terme, le volontariat est à distinguer du
bénévolat. Car en effet, le bénévole donne
une fraction de son temps variable à tout moment, et n'a d'autre
engagement que moral. Le plus souvent disposant d'un statut par ailleurs
(salarié, étudiant, retraité, demandeur d'emploi, etc.),
le bénévole n'est pas rémunéré, même
si la structure qui bénéficie de son aide peut notamment lui
rembourser des frais engagés.
Quant au volontaire, il est engagé à
plein temps, pour une durée définie, en général
dans un milieu différent, et sur une mission précise. Il est
nécessaire de lui donner un statut et de subvenir à ses besoins,
ce qui se traduit le plus souvent par un contrat qui précise notamment
ses conditions d'accueil (logement, nourriture, éventuelle
indemnité...). Ces deux notions sont réunies dans certaines
langues pourtant, la langue française utilise deux termes
différents pour la situation.21(*)
Toutefois, pour mieux cerner la notion de philanthropie et sa
concrétisation sur le terrain, nous devons également nous
attarder sur la typologie des organismes à but non lucratif. Car, ce
sont eux qui permettent l'effectivité des actions philanthropiques.
SECTION 2 : TYPOLOGIE DES ORGANISMES A BUT NON
LUCRATIF ET LEURS MOYENS D'ACTIONS
Les organismes à but non lucratif sont des organismes
qui ne génèrent pas de profits. Ces organisations sont les agents
de l'économie sociale et solidaire (ESS) et ont chacun leurs
spécificités, de même qu'ils regorgent de principes parmi
lesquels :
- Servir la collectivité plutôt que rechercher le
profit ;
- Prendre des décisions démocratiques ;
- Donner une priorité aux usagers et aux
travailleurs.
Lorsqu'on parle de ces organismes à but non lucratif,
on voit de prime abord, les organisations de la société
civile.
I- LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
Selon Tamba (2004), les organisations de la
société civile (OSC) peuvent être considérées
comme des structures d'individus en vue de promouvoir des fins qui ne
correspondent pas nécessairement à des intérêts
personnels : protection de l'environnement, lutte contre la
pauvreté, défense des droits de la personne, lutte contre les
violences faites aux femmes22(*).
Ces organisations sont différentes des mouvements
sociaux, car les premières sont des entités structurées et
institutionnalisées et les seconds sont spontanés. Les OSC
regorgent plusieurs organisations qui sont : les fondations, les
organisations non gouvernementales (ONG), les associations, les groupes
d'intérêt communautaire (GIC), les groupes d'intérêt
économique, pour ne citer que ceux-là. Nous allons
présenter quelques unes.
1 - LE CAS DES FONDATIONS
D'après Emerson Andrews (1967), il y a des
critères qu'un organisme doit remplir pour être
considéré comme une fondation. Il doit :
- être non gouvernemental,
- avoir un but non lucratif,
- être géré par ses propres
administrateurs et responsables, et
- promouvoir des activités sociales, éducatives,
caritatives, religieuses, ou autres, permettant d'améliorer le bien
collectif.23(*)
Ces critères définis par Andrews s'appliquent
aujourd'hui aux fondations que l'on qualifie de
« privées ». Les fondations privées
s'attachent à améliorer les conditions de vie de populations en
difficulté, ainsi qu'à élargir leurs opportunités
en la matière. Confrontées à des défis similaires
en ce qui concerne la sélection et la supervision des projets, elles
doivent également concilier la réalisation d'objectifs
immédiats et la nécessité d'un développement des
capacités sur le long terme. La notion de « fondation privée
» suppose qu'il existe des fondations d'un autre type, dites «
publiques ». Pourtant celles-ci, n'appartiennent pas au secteur public :
elles se distinguent des fondations privées par le fait qu'elles ne
disposent d'aucune dotation privée importante, mais collectent
progressivement des fonds auprès de différentes sources, y
compris des fondations privées, des particuliers et des organismes
officiels, ou grâce à la rémunération de services
rendus.
Par rapport aux organismes bilatéraux d'aide, et qui
ont des comptes à rendre à l'Etat, ces dernières
présentent une plus grande
hétérogénéité. Elles ne sont pas
appelées à rendre compte aux parlements et leurs bienfaiteurs
peuvent demander une certaine discrétion quant à leur
générosité. Contrairement aux programmes d'aide
gouvernementaux qui évoluent progressivement en fonction de la situation
de leurs bénéficiaires et qui peuvent subitement changer
d'orientation avec un changement de gouvernement, les programmes des fondations
sont plus stables et plus subtiles. Ici, le conseil d'administration est auto
renouvelable, et ceci assure une parfaite continuité, surtout permet la
réalisation des projets à long terme. Indépendantes des
gouvernements, les fondations sont également plus libres de prendre des
risques, de s'intéresser à des programmes dont les
bénéfices ne seront perceptibles qu'à long terme et
d'expérimenter des structures organisationnelles très
décentralisées.
Les résultats de leurs expériences peuvent alors
suggérer des innovations intéressantes pour les organismes
officiels, et fournir des mises en garde utiles à propos de
conséquences jusqu'alors imprévues. Les fondations
épousent les idées de leurs fondateurs, mènent des actions
sur le terrain en choisissant eux-mêmes leur population cible. Leurs
contributions vont des bourses d'études individuelles aux projets de
développement sociaux, en passant par des subventions destinées
à la sauvegarde de l'héritage naturel et humain. En plus de cette
diversité, les fondations possèdent des caractéristiques
spécifiques qui leur font occuper une place à part dans le
domaine du développement. Elles sont suffisamment dotées pour se
lancer dans des activités à long terme innovants, non
dénués de risques et parfois à contre courant de certaines
opinions ; (OCDE, 2003). Qu'en est-il des associations et des ONG, surtout
dans le cadre camerounais ?
2 - LES ASSOCIATIONS ET LES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES
Les associations font partie des organisations de la
société civile et sont régies au Cameroun par la loi
N° 90/053 du 19 décembre 1990. Cette loi marque la
libéralisation et, surtout, concrétise la liberté
d'association proclamée par le préambule de la constitution de
1972, entérinée par la loi N° 96-06 du 18 janvier 1996,
portant constitution de la République du Cameroun24(*). Une association se
définit comme une convention par laquelle des personnes mettent en
commun leurs connaissances ou leurs activités dans le but autre que de
partager des bénéfices. L'association n'est pas une entreprise
capitaliste, elle peut plutôt être vue comme une entreprise
sociale, c'est-à-dire qui n'a pas pour objectif de réaliser des
bénéfices. Au Cameroun, la loi requiert deux régimes de
création des associations :
- le régime de la déclaration : ici, il
s'agit pour les fondateurs de porter à la connaissance des
autorités sa création et son existence sous le régime
légal en vigueur.
- le régime d'autorisation : l'autorisation est
une permission accordée par l'autorité compétente à
une personne ou groupe de personnes d'accomplir un acte juridique qui, dans ce
cas précis, est la création d'une association25(*).
Par ailleurs, l'on dénombre plusieurs types
d'associations :
- les associations religieuses (tout regroupement de
personnes vivant en communauté conformément à une doctrine
religieuse);
- les associations étrangères (association
dont le siège est basé à l'étranger) ;
- les associations amicales (ici, les membres sont des amis
ayant quelques objectifs communs, elles servent plus à l'entraide des
membres) ;
- les associations de villages (ressortissant d'un
village)...
D'autres associations aussi prennent le statut
d'utilité publique. Une association est ainsi dite
« d'utilité publique » quand elle joue un
rôle considérable dans le développement des
communautés, en rapport avec les orientations et les stratégies
arrêtées par le gouvernement. Pour cela, elle doit contribuer
à la réalisation des objectifs du gouvernement dans le cadre du
développement. L'avantage ici pour l'association déclarée
d'utilité publique est qu'elle aura la possibilité de recevoir
les financements du gouvernement et des bailleurs de fonds. Tandis que les
autres qui ne sont pas reconnues d'utilité publique n'ont pas d'autres
sources que leurs cotisations, leurs frais d'adhésion...
Après un certain temps d'existence, une association
peut se transformer en ONG. Pour cela, il lui suffit de faire la demande
d'autorisation pour les ONG. Il faut néanmoins signaler qu'aujourd'hui,
avec la loi sur les ONG, ces dernières ne sont plus obligées de
passer par la dénomination des associations.
Une Organisation Non Gouvernementale (ou ONG) est donc une
association déclarée ou une association étrangère
autorisée conformément à la législation en vigueur,
et agréée par l'administration en vue de participer à
l'exécution des missions d'intérêt général.
Elle a pour particularité de s'occuper des intérêts des
autres. Elle est réglementée au Cameroun par deux textes en
vigueur :
- La loi n°99/014 du 22 décembre 1999 qui
régit spécifiquement les ONG ;
- La loi n°90/053 du 19 décembre 1990 sur la
liberté d'association, qui est une loi générale pour
toutes les associations.
Il en résulte qu'il ne suffit pas d'une disposition
légale pour être une ONG. Il faut en plus que l'association
déclarée, soit sous l'égide de la loi de 1990 et obtienne
un agrément de l'administration. En ce qui concerne une association
étrangère, elle doit obéir, selon la loi sur les
associations, au régime de l'autorisation. De même qu'elle doit
aussi être agréée, conformément à la loi de
1999, pour jouir du statut d'ONG26(*). L'agrément est accordé par
arrêté du MINATD, dans un délai de 75 jours à
compter de la date de dépôt auprès du Gouverneur.
Enfin, une ONG peut aussi être dissoute. Au Cameroun, la
loi prévoit deux types d'initiatives de dissolution d'une ONG :
- l'initiative de l'organisation, c'est-à-dire la
volonté de ses membres, sous réserve de respecter les statuts
alors librement constitués lors de la création ; et
- l'initiative judiciaire. Celle-ci est la résultante
d'une décision rendue par la juridiction compétente.
En dehors de ces initiatives, le MINATD peut, par
arrêté, dissoudre toute ONG dont les activités portent
atteinte à l'ordre public et à la sécurité de
l'Etat27(*).
Les ONG n'ont pas suffisamment de moyens pour mener à
terme leurs projets. Elles bénéficient, le plus souvent, de la
philanthropie internationale, des bailleurs de fonds et même des
populations. Les ONG camerounaises n'ont pas la liberté d'action, car
elles peuvent être dissoutes. Elles ont donc des comptes à rendre
à l'Etat. Quels sont cependant les moyens mis en oeuvre par ces
organisations sur le terrain ?
II-LES MECANISMES DE FINANCEMENT MIS EN OEUVRE SUR LE
TERRAIN
La philanthropie requiert non seulement de la volonté,
mais surtout les moyens financiers pour déployer son action de
manière efficace et pérenne. Le financement peut être
défini comme étant la recherche des ressources pouvant financer
un projet. Il existe des mécanismes mis sur pied pour aider à
mener à bien le développement. Toutefois conscients de
l'incapacité de l'Etat à parvenir à tout cet
aménagement, les organismes de la société civile et les
populations se sont mis à l'oeuvre de façon informelle pour
améliorer leurs conditions de vie. Alors quels peuvent être, dans
l'ensemble, les moyens de financement de leurs activités ?
1 - LE FINANCEMENT DES ACTIVITES
Les fondations sont des institutions privées et il
arrive qu'elles préfèrent opérer dans la
discrétion. Certains philanthropes pensent qu'il n'est pas convenable de
faire connaître publiquement leurs bonnes oeuvres. Par ailleurs, il est
possible qu'un certain nombre de fondations craignent qu'une éventuelle
notoriété de leurs activités ne les expose à
l'ingérence des groupes de pression. Aujourd'hui, bon nombre de
donateurs ne se contentent plus de faire un legs testamentaire, ou simplement
un chèque, à une organisation caritative. Plus proactifs, ils
repèrent les enjeux auxquels ils veulent s'associer, partent visiter les
régions où ils pensent pouvoir faire changer des choses, et
demandent conseil dans le but de prendre des décisions plus
stratégiques. Les intérêts des donateurs sont de plus en
plus ciblés; leur désir de s'engager, plus manifeste et plus
urgent. En fait, on trouve chez eux de nombreux traits qui sont
caractéristiques de l'approche d'entreprise.
En général, la vocation des fondations est plus
spécifique que celle des organismes publics responsables de l'aide
bilatérale, mais moins que celle des ONG qui se consacrent au
développement. Cela s'explique par la différence de dimension
ainsi que par les objectifs et les centres d'intérêt de leurs
bienfaiteurs. Ainsi, les fondations portent un grand intérêt
à l'action sociale et aux projets concernant l'environnement En
même temps, de nombreuses fondations privilégient le
contrôle des naissances dans l'action à l'égard des
populations. Les fondations continuent aussi à prendre des initiatives
notables en faveur du développement dans les domaines traditionnels de
la recherche agricole et médicale. Ce sont les fondations
américaines qui jouent de loin le rôle le plus important au
service du développement. Elles le doivent en premier lieu à leur
dimension et à leur expérience (OCDE, 2003, op. Cit.).
Les ONG travaillent dans le même sens que les
fondations. Leurs activités ne doivent pas être menées en
vue de générer des profits. Elles oeuvrent plutôt dans
l'optique de réduire la pauvreté des bénéficiaires,
d'améliorer leurs conditions de vie. Contrairement aux fondations qui
supportent toutes seules leurs décisions et leurs réalisations
sur le terrain, les bénéficiaires des ONG doivent être
étroitement associés. Leur participation débute dés
la sélection des projets, jusqu'à sa réalisation
proprement dite.
Le financement des opérations à l'échelle
des quartiers est stratégique pour l'accès aux logements et aux
multiples services de base. Dans le cadre de l'amélioration et de
l'assainissement des infrastructures de certains quartiers urbains, les
financements octroyés ne transitent pas nécessairement par les
caisses des organismes publics ou par les caisses des organismes bis ou
multilatéraux. Quelques fois des fonds sont reçus par les
associations nationales des associations soeurs implantées à
l'étranger ou des élites intérieures ou extérieures
des quartiers urbains. Ces fonds, le plus souvent considérés
comme des aides, sont utilisés pour la viabilisation des pistes des
quartiers ou pour l'entretien et le curage des caniveaux. Pour que des travaux
soient effectifs, les populations doivent s'associer et participer aux travaux,
car ils sont les premiers bénéficiaires.
En ce qui concerne les associations rotatives d'épargne
et de crédit (ou AREC)28(*), les tontines permettent à plusieurs de se
développer et de développer leur localité, car
l'environnement est un facteur important au développement. Les tontines
sont des regroupements informels de personnes qui mobilisent leurs
épargnes dans le but de s'entraider mutuellement (Tchouassi, 2004). Au
Cameroun, il existe plusieurs variantes de tontines selon la destination des
fonds. Lorsque l'on constate par exemple que dans la localité, il y'a
beaucoup de chômeurs et que ces derniers ne peuvent pas facilement avoir
accès à un crédit, l'association peut décider de
permettre aux membres d'avoir un capital. Cela se passe beaucoup plus dans les
associations féminines. Au terme de la tontine, chaque membre doit
être capable d'être au moins « bayam Sellam29(*) ».
Dans tous les cas la tontine constitue un des moyens de
financement du développement personnel ou des infrastructures urbaines.
Les fonds octroyés sont remboursés à court, moyen et long
termes. L'inconvénient est que ces fonds sont réservés
à une catégorie de personnes et aux participants des associations
tontinières.
En ce qui concerne les associations caritatives, elles
constituent un trait d'union entre l'église et les populations et
continuent de favoriser à leur façon l'amélioration,
l'assainissement et le développement des infrastructures urbaines
(Tchouassi, 2004).
Ce type de financement doit toutefois être relayé
par des cotisations des populations bénéficiaires des ouvrages
construits ou entretenus pour leur pérennité.
2 - LES CONTRIBUTIONS DES POPULATIONS
A Yaoundé au Cameroun, le développement urbain
comme local se fait à tous les niveaux. Tous les maillons de la
chaîne se mettent ensemble pour améliorer la qualité de vie
des populations ceci, en commençant par les populations elles
mêmes. Et l'apport de ces dernières peut se faire de plusieurs
manières.
A l'échelle du quartier, les comités d'animation
au développement réalisent de nombreux microprojets
communautaires qui ont un impact positif sur l'amélioration des
conditions de vie des populations. Ces microprojets vont de l'éducation
à la citoyenneté, en passant par la réalisation des
infrastructures de base. Le mouvement associatif joue un rôle important
dans la lutte contre la pauvreté. De nombreuses associations se
déploient pour résoudre des problèmes aussi divers que
l'entraide, l'insalubrité, les routes, l'eau potable et dans certains
cas, de l'insécurité et de l'amélioration des revenus.
Pour cela, il doit exister un plan de développement local (PDL). Un plan
de développement local peut être défini comme
« un cadre retraçant l'ensemble des programmes et projets
cohérents et concertés de développement à
exécuter en adéquation avec les orientations nationales,
régionales et communales. Il précise le but, les objectifs, les
stratégies et les résultats à atteindre dans un temps
donné et éclaire sur les moyens nécessaires, etc. en
fonction des potentialités et contraintes du milieu, des choix
effectués par le conseil municipal, la société civile et
les partenaires au développement, etc. »30(*). Aussi une collaboration
est-elle nécessaire entre les associations à la base et les
communes.
En finançant sur leurs fonds propres la construction ou
l'amélioration des infrastructures notamment les logements, les pistes
piétonnières, les ponts, les populations jouent un rôle
très important dans le développement local au Cameroun. Ces
dernières financent sur leurs fonds propres la construction d'ouvrages
d'assainissement (égouts, puisards, caniveaux, puits, sources, etc.),
les branchements aux réseaux d'eau potable et
d'électricité. Néanmoins, cette forme de financement reste
très limitée au Cameroun à cause de la pauvreté et
de la précarité des ressources financières (Tchouassi,
2005).
Lorsque les populations n'ont pas les moyens de financer
certains travaux, elles s'organisent pour le faire elles-mêmes (notamment
par un investissement humain). Les populations à la base n'aiment pas
rester inactives quand leur environnement est sale. Elles commencent parfois
à rendre l'espace propre et salubre en attendant le secours du
gouvernement ou des bailleurs de fonds. On ne peut aider que celui qui
travaille déjà. Dans certains quartiers à habitat
spontané, l'extension de ces infrastructures de base se fait
individuellement ou en groupe. Dans certaines zones, la société
HYSACAM, chargée du ramassage et de la traitance des déchets au
Cameroun ne peut pas y accéder. Pour ne pas transformer le quartier en
poubelles, les populations se regroupent et passent dans les ménages
récupérer ces ordures qu'ils apportent ensuite dans les
dépôts de la société. Cela permet aux familles de ne
pas verser les ordures dans des rivières, ce qui créerait des
problèmes de santé.
Pour résoudre les problèmes de
sécurité il a été créé, dans certains
quartiers, des comités de vigilance composés de jeunes
désoeuvrés opérant avec une efficacité plus ou
moins bonne selon les localités. Ces jeunes veillent la nuit, afin de
repousser des bandits dans la zone. Dans d'autres localités, les
habitants qui désirent le passage d'une route commencent à
creuser eux-mêmes les caniveaux, afin de prouver à tous leur
volonté d'oeuvrer pour leur bien-être. De même, pour pouvoir
circuler dans le quartier sans affronter la boue en saison de pluies, la
population s'organise de façon à faire des séances de
travaux manuels pour arranger la route. On peut aussi parler des habitants des
bas fonds qui vivent les inondations pendant les saisons de pluies, l'apport
non numéraire des populations est la canalisation des eaux, le curage
des zones à risque. Il reste néanmoins vrai que l'apport
financier est important pour apporter des solutions durables mais l'apport en
nature peut amener les bonnes volontés à financer l'ouvrage.
Conclusion du Premier Chapitre
Ce premier chapitre portait sur la philanthropie des
organisations à but non lucratif. Après avoir
présenté les sources de la philanthropie et ses
caractéristiques, nous avons montré la spécificité
de chaque organisation dans le développement local. Nous avons
précisé que les organismes à but non lucratif font
beaucoup de la philanthropie, parce que leur but n'est pas de
générer de profits, mais de faire du social. Parlant de leurs
moyens de financement, nous avons indiqué que les philanthropes
n'attendent pas l'aide du gouvernement. Ils se donnent des moyens, ou encore
créent des moyens pour financer leurs différentes
réalisations. Hors d'Afrique, ils ont plus de moyens parce que des
hommes, parmi les plus riches du monde, créent des fondations afin de
partager leur richesse avec les démunis. C'est pourquoi, ils oeuvrent de
façon internationale. Mais en Afrique, par contre, force est de
constater qu'il y a aujourd'hui encore peu de financements.
CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTES APPROCHES DU
DEVELOPPEMENT LOCAL
Introduction
Face à la montée conséquente du
chômage, aux problématiques d'exclusion et de pauvreté, les
initiatives se sont multipliées pour minimiser les effets pervers des
modifications profondes en cours. Aux initiatives de développement
communautaire se sont ainsi ajoutées des préoccupations pour
l'entrepreneurship, les PME et le développement de milieux dynamiques
capables de les soutenir de façon cohérente (Prévost,
1993). Les gouvernements, les municipalités, les groupes
intermédiaires, les universitaires ont tous tenté de comprendre
le phénomène, de développer des réponses, des
politiques et des initiatives pour relancer le développement de l'emploi
et réduire la pauvreté. On a, de plus, assisté à la
multiplication des organismes de support au développement et à
l'épanouissement d'une nouvelle classe d'acteurs. C'est ainsi qu'on a
pensé au développement local c'est-à-dire, celui qui vient
d'en bas. Alors, qu'est-ce effectivement que « le
développement local »?
SECTION 1 : LE DEVELOPPEMENT LOCAL : UN
PHENOMENE EMERGENT
Le développement local apparaît comme une
démarche novatrice de développement. Pour bien en cerner toutes
les dimensions et saisir l'intérêt qu'il suscite, il faut tout
d'abord analyser les facteurs ayant conduit à son émergence,
ainsi que les facteurs de son assise théorique. Avant de montrer ensuite
que, dynamique émergente, le développement local demeure
néanmoins aussi et surtout un phénomène endogène
c'est-à-dire, qui provient exclusivement de l'intérieur et qui
est effectué par des acteurs précis.
I - L'EMERGENCE DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Le développement local est la résultante d'une
dynamique initiée et sans cesse entretenue par les acteurs locaux bien
précis. Il a une inscription essentiellement territoriale
(Essombè Edimo, 2005a et 2005b, pp. 112/13). Cette vision rompt avec le
rôle centralisateur de l'Etat, auquel il revenait d'organiser le
territoire et d'en régenter les modalités de
développement. Quels sont son historique et ses caractéristiques
dans sa réalisation.
1- CONDITIONS D'EMERGENCE DU « DEVELOPPEMENT
LOCAL »
Depuis la fin des années 1970, on assiste à
travers le monde à l'abandon d'un développement économique
exclusivement centrifuge (Essombè Edimo, 2007b). Pendant cette
même période, les stratégies de développement
menées sous l'égide des Etats manifestent leurs limites. La
concentration des pouvoirs économiques, culturels, techniques dans leurs
mains ne permet plus d'assurer la cohérence nécessaire pour
soutenir les processus de développement : c'est la crise de la
centralisation à outrance, suite logique du fordisme. En ayant
cultivé une organisation industrielle et du développement
basée à la fois, sur le gigantisme des entreprises, au sein
desquelles par ailleurs règne le Taylorisme, et une conception de
l'espace fondée sur deux idées-forces à savoir, la
polarisation et la domination, le fordisme avait en effet fini par conduire
à l'idée que le développent « venait
exclusivement d'en haut » (Pecqueur, 1992).
Dans les pays du Sud, les efforts des ONG et aussi ceux de
très nombreux autres opérateurs, comme les sociétés
de développement pour « organiser les populations »,
conduisent à l'apparition d'organisations réellement
représentatives qui acquièrent des capacités de
négociation avec le pouvoir central. Au Cameroun, comme dans de nombreux
pays d'Afrique, la pauvreté ambiante ouvre un espace aux organisations
de proximité. L'activité économique se spatialise. Plus
généralement, responsables politiques et opérateurs de
développement sont de plus en plus convaincus qu'il n'y a pas de
développement possible sans prise en compte des références
sociales et culturelles des populations concernées. Chaque
région, chaque terroir même, a des traits qui lui sont
spécifiques dont il faut tenir compte dans l'élaboration des
processus de développement et, plus encore, dans leur conduite. Il
s'agit dès lors de revitaliser des formes de solidarités locales
face aux contraintes imposées par les mécanismes
économiques (prix des matières premières, logique
techniciste du développement, etc.) et par les instances politiques
nationales (parti unique, remontées de toutes les décisions au
niveau central, etc.).
Par ailleurs l'émergence des questions locales porte
à un niveau politique des débats antérieurement
limités aux techniciens. "Penser global, agir local" rend compte de la
demande des acteurs locaux d'être partie prenante des décisions
qui les concernent. Pendant des années, le fordisme a poussé
à « la normalisation et à l'uniformisation des
trajectoires de développement, tandis que les pratiques de
développement local valorisent la richesse des différences comme
facteur de développement (...).L'agent économique devient
acteur... »31(*). Et, sous l'effet de plusieurs facteurs (comme les
innovations technologiques, des attraits environnementaux particuliers, ou des
externalités des collectivités territoriales organisées,
voire de l'implication volontariste de celles-ci), on note qu'une nouvelle
interaction apparaît désormais entre « le
global » et « le local ». Puisqu'au fond, le
développement local décrit finalement les différentes
modalités d'adaptation des acteurs, des citoyens et autres producteurs
locaux aux « forces hétéronomes extérieures et,
surtout, à la mondialisation »32(*).
De même, l'action locale apparaît d'autant plus
indispensable que les efforts demandés aux populations pour assurer le
développement leur semblent sans résultat sur leur niveau de
consommation et sur leurs conditions de vie. Il faut aussi préciser
qu'en pratique, les réflexions sur le développement local
naissent dans les territoires ruraux, marginalisés, enclavés,
oubliés par les mesures nationales de soutien à la croissance et
d'aménagement. Les démarches du développement local
visaient donc à préserver ces territoires d'une destruction
éventuelle. C'est dire, comme l'observe avec pertinence Gouttebel
(2005), que c'est à la fois la crise du système d'organisation
industrielle et spatiale fordiste, l'accélération de la
mondialisation, ainsi que le développement des mouvements de
décentralisation et le besoin des populations d'avoir une certaine
autonomie et de se prendre en charge localement qui sont autant de facteurs
ayant conduit à l'émergence des démarches de
« développement local ».
Ces démarches suscitent d'ailleurs un certain
enthousiasme et la compréhension nécessite une étude
véritable des caractéristiques du
« développement local ».
2 - LES CARACTERISTIQUES DU « DEVELOPPEMENT
LOCAL »
Le développement local doit prendre en compte à
la fois, les théories du développement « par en
haut » (les choix économiques sont décidés
au sommet de l'Etat selon une logique sectorielle fondée sur la dotation
inégale en facteurs de production des territoires) et du
développement « par en bas » (les
ressources d'un territoire, les besoins ressentis par sa population et les
initiatives qu'elle prend, combinées aux ressources disponibles, sont
à l'origine d'une dynamique de développement) pour être
crédible (Greffe, 1988). En poursuivant son raisonnement, ce même
auteur parvient à isoler quelques caractéristiques relatives au
concept de développement local, à savoir que :
- un projet de développement local est
transversal : il doit intégrer les domaines économique,
social et culturel pour que les représentations du territoire et les
réalisations économiques interagissent les unes avec les
autres,
- les territoires susceptibles de mettre en place un projet
de développement local peuvent avoir des tailles et statuts
diversifiés : l'important est qu'ils soient des « [...] espaces
vécus [...] où l'on peut associer une identité culturelle
et une originalité économique [...] »,
- un projet de développement local est une
démarche collective nécessitant la mise en synergie de tous les
acteurs du territoire (élus, entrepreneurs, associations, institutions,
travailleurs ...),
- le développement local se fonde en priorité
sur les capacités endogènes de production d'un territoire, ce qui
n'implique pas une fermeture sur l'extérieur mais au contraire une
ouverture propice à des échanges multiples.
Cette position est également défendue par
Pecqueur (1992, op. Cit.) pour qui :
« En réalité, le développement
local n'est pas « localiste », il propose une grille de lecture du
développement qui a vocation à embrasser sous un même
regard l'organisation des hommes en vue de produire et de répartir les
biens matériels dans une perspective d'évolution mondiale.
» 33(*)
De ce fait, il est nécessaire que l'information circule
bien tant au sein du territoire en développement qu'à
l'extérieur, pour que les initiatives des différents acteurs du
développement s'enrichissent au contact les unes des autres. Par
ailleurs, la formation est un enjeu décisif pour la réussite du
projet, puisqu'elle permet de maintenir un niveau de savoir-faire tout en
favorisant l'émergence de nouvelles compétences au sein de la
population. Enfin, les pouvoirs publics locaux doivent participer au projet de
développement local en facilitant les différentes interventions
des acteurs locaux, ainsi d'ailleurs que ses différentes
modalités d'expression industrielle. A ce sujet, en partant des
« districts industriels », jadis, initiés par Alfred
Marshall (1890), les économistes s'accordent en effet pour dire que les
différentes manifestations industrielles du
« développement local » représentent une
organisation industrielle essentiellement bâtie sur des entreprises de
petite taille et qui intègrent des processus de coopération
localisée (ou organisation en réseaux).
On y distingue, notamment, les
« clusters 34(*)», les « systèmes productifs
localisés ou locaux 35(*)», les « espaces
serviciels 36(*)», les « technopôles »,
les « pôles de compétitivité », etc.
II - LE DEVELOPPEMENT LOCAL : UNE DYNAMIQUE
INITIEE PAR DES ACTEURS LOCAUX
Le développement local apparaît comme un pacte
scellé entre les différents acteurs (Etat, Collectivités
locales, ONGs, populations, etc.) impliqués dans l'amélioration
des conditions de vie des habitants. En milieu rural, par exemple, il se fait
à plusieurs niveaux :
- au niveau des entreprises rurales et de leurs
entrepreneurs;
- au niveau des agents de développement qui
accompagnent les porteurs de projets ;
- au niveau des municipalités rurales elles-mêmes
qui doivent devenir des milieux innovateurs et entreprenants, et même,
- au niveau des populations à la base.
Pour le moment, nous allons présenter les cas de
l'entrepreneur et des collectivités locales.
1- L'ENTREPRENEUR : UN ACTEUR DU DEVELOPPEMENT
LOCAL
Le développement local est la résultante d'un
dialogue permanent des acteurs divers (entreprises, producteurs locaux,
individus, etc.) avec le territoire, ou encore des politiques
territorialisées des grandes entreprises. Ici, chaque entrepreneur veut
et peut maîtriser une part de son environnement. A telle enseigne que la
région, la ville et la commune deviennent des territoires pertinents
pour redécouvrir, ou renouveler, une identité collective ou pour
développer des solidarités (Essombè Edimo, 2005b, op.
Cit., pp. 116/17). On remarque que l'économie locale et spatiale est
aujourd'hui le fait d'entrepreneurs bien identifiés c'est-à-dire
des entreprises (souvent de petite taille, respectant la situation locale,
géographique, sociale des territoires concernés) et des
partenaires divers. Ces éléments se conjuguent alors dans un jeu
dans lequel le système productif local n'est plus une simple
juxtaposition d'unités de production, mais un système
d'articulation entre les instances politiques et économiques. Ceci
montre donc que l'entrepreneur n'est pas passif, il contribue activement
à l'amélioration du niveau de vie des populations. Lorsque les
entreprises s'implantent dans une région, c'est la garantie que
plusieurs chômeurs pourront avoir un métier, mais quand elles
délocalisent, plusieurs citoyens deviennent des chômeurs. Le
développement local lutte contre la délocalisation des
entreprises. Les entrepreneurs sont donc importants, car ils peuvent jouer sur
le changement économique dans une localité.
Loin d'être un « être passif »
et uniquement mu par la recherche du profit, comme le suggérait jadis
les théories néoclassiques, l'entrepreneur du
développement local est un acteur qui, avec d'autres, cherchent avant
tout les modalités d'adaptation du territoire à l'économie
globale. Il s'agit pour lui, comme pour tous les autres acteurs locaux, de
résoudre leurs problèmes spécifiques de production de
manière à s'insérer le mieux possible dans la
globalisation. Cette question renvoie d'ailleurs à celle, sous-jacente,
de la localisation des entreprises et, surtout, à celle aujourd'hui
béante de l'interprétation de la mondialisation. Puisqu'en effet,
une des interprétations met en évidence la dimension globale de
l'économie et où les spécificités locales des
territoires sont supprimées par la mobilité des entreprises au
niveau mondial. Alors que l'autre considère qu'un avantage concurrentiel
des entreprises repose plutôt sur l'insertion locale des firmes sur la
spécificité du territoire d'implantation37(*). L'entrepreneur du
« développement local » ne choisit pas le milieu de
localisation de sa firme en fonction des seuls critères de
rentabilité. Sa localisation n'est pas non plus provisoire du fait, par
exemple, de la plasticité des territoires. Car, ces derniers ne sont pas
non plus de simples supports de facteurs de production. Mais le territoire,
construit historique et de longue maturation, possède aussi des
externalités créées par des acteurs. Il devient un espace
central de coordination des acteurs cherchant à résoudre des
problèmes de production inédits. De sorte qu'on est bien
« en présence d'une double combinaison entre activité
ancrée et activité nomade des firmes »38(*).
Il reste certain cependant aussi que l'entrepreneur local ne
pourrait pas grand chose sans l'efficacité des collectivités
territoriales.
2 - LES COLLECTIVITES LOCALES
Traditionnellement, le rôle des instances municipales
locales était voué à fournir les services de base aux
populations. Aujourd'hui, les municipalités sont interpellées
afin d'assurer un leadership dans l'animation du développement
économique de la communauté. Les municipalités sont
conviées à devenir entreprenantes, à entreprendre leur
propre développement. Cette mobilisation des collectivités
locales se caractérise à la fois, par la fourniture de services
aux entreprises et par l'adaptation de l'organisation administrative de ces
collectivités afin de promouvoir des structures directement
chargées d'apporter ces services aux créateurs locaux de
richesses (Essombè Edimo 2005b, op. Cit.). La municipalité a le
devoir d'entreprendre un ensemble d'actions visant à
l'amélioration de la qualité de vie des habitants.
Dans la ville de Yaoundé, par exemple, nous ne pouvons
pas faire un inventaire de toutes les actions entreprises par la
communauté urbaine de Yaoundé (CUY), et des communes
d'arrondissement. Néanmoins, nous pouvons retenir :
· l'amélioration des conditions de
développement des entreprises pour réduire le chômage,
· le bitumage des routes afin de permettre la bonne
circulation des personnes et des biens,
· l'éclairage public pour réduire le
banditisme et instaurer le sécurité, et autres.
Cette dynamique sert, entre autres, à la
réhabilitation de l'environnement des entreprises, à la
qualité des services et des équipements. C'est dans ce sens que
l'on dit que l'action des collectivités locales dans l'animation
économique est déterminante. Elles doivent prouver aux
entreprises que leur territoire est meilleur que d'autres, et qu'elles peuvent
y prospérer sans encombre en participant, comme les autres acteurs
locaux (population, ONG, etc.) à la mise en place de ces
« ressources territorialement construites » qui,
avec l'innovation et le capital humain compétent, permettent aujourd'hui
aux territoires d'avoir des « avantages
différenciatifs » (Pecqueur, 2007, op. Cit., p. 50)
capables de se construire une insertion optimale dans la globalisation.
Sous d'autres cieux encore, les collectivités locales
pour y parvenir, ont eu recours à des interventions directes
auprès des entreprises pour faciliter leur installation ou pour
permettre la pérennité de leur activité sur son territoire
(Essombé Edimo, 2005b, idem, pp. 117/18). Toutefois dans
l'optique du développement local, et pour tenir compte des contraintes
imposées par la mondialisation notamment, on se soucie plus de nos jours
de l'environnement de l'entreprise. Ce rôle des collectivités
locales peut d'ailleurs être matérialisé de la
manière suivante.
Sources : J.R. Essombè Edimo (2007b) :
p. 46.
Responsables
Politiques
Locaux
(ou C.L.)
Entreprises ou PME
Politiques d'implantation pour aménagement du
territoire
Services aux entreprises
Schéma 1 : Caractérisation
du rôle des C.L. dans le développement local
Pour le développement local :
Mobilisation des institutions diverses
c'est -à dire :
§ Création en leur sein de services chargés
des affaires économiques avec des missions de développement
précises, ...
§ Mise en place des « comité
d'expansion » ou des « agences de
développement »,
§ Promotion des « pépinières et/ou
hôtels d'entreprises »,
§ Promotion des observatoires économiques locaux,etc.
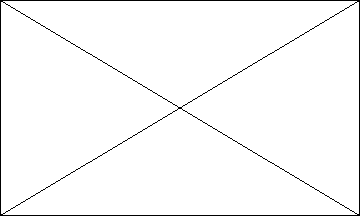
Ainsi, le résultat de l'action des acteurs locaux
(Collectivités locales, entrepreneurs, ONG, etc.), le
« développement local » est donc aussi un construit
rendu possible par la proximité vécue et entretenue par ces
différents acteurs sur un espace-plan. A cet égard, l'on doit
à deux approches la formalisation précise des dynamiques du
développement local, à savoir :
- « l'économie de la
proximité » (M. Bellet et al, 1993 ; B.
Pecqueur et J.B. Zimmermann, 2004, entre autres), et qui analyse les
modalités d'interaction entre les agents, et
- « l'économie du capital
social » (N. Lin, 2001, par exemple) et qui, quant à
elle, met l'accent sur l'ensemble des facteurs intangibles qui structurent les
relations entre les individus (réseaux sociaux et professionnels, us,
coutumes, etc.) et qui leur permettent d'accéder aux ressources
révélées ou existant dans la structure sociale locale.
Pour tout dire, la proximité
(organisée, matérielle ou géographique, sociale ou
relationnel, etc.) des acteurs, leur permet de développer les logique
d'appartenance et de similitude qui sont un puissant stimulant pour la
construction d'un vécu et d'un avenir communs, mais aussi pour
développer un projet de territoire commun pour les dynamiques locales de
développement et de production (V. Angéon et J.M. Callois, 2005,
P32). Qu'en est-il alors des quartiers-cibles de notre travail ?
SECTION 2 : LE DEVELOPPEMENT LOCAL A MELEN 4 ET
MELEN 8 OM
Dans les quartiers suscités, plusieurs acteurs se sont
mis ensemble pour améliorer la qualité de vie des habitants.
Toutefois, pour réussir, le développement local doit respecter
certaines conditions.
I - LES CONDITIONS D'UN DEVELOPPEMENT LOCAL APPROPRIE
Le développement local ne saurait s'épanouir
sans un minimum de consensus entre les différents partenaires de
l'espace socio-économique local, sans une mobilisation en vue
d'objectifs précis et cohérents. Aussi, le développement
local doit reposer sur la conscience que les acteurs concernés peuvent
former un groupe cohérent, les rendant unis pour des objectifs communs
et, surtout, liés par l'appartenance à la même unité
spatiale : d'où l'importance des notions de partenariat et de
participation.
1 - LA NOTION DE PARTENARIAT
Le développement local fait aujourd'hui l'objet de
multiples discours. Des organisations sociales, des opérateurs
économiques, des institutions publiques décentralisées y
font régulièrement référence. Il n'est plus un
programme d'actions initié uniquement par des collectivités
territoriales. Des Etats eux-mêmes en font aujourd'hui un
élément de leur politique de développement. Le
développement local est avant tout une dynamique économique et
sociale, voire culturelle, plus ou moins concertée, impulsée par
des acteurs individuels et collectifs sur un territoire donné.
En allant plus loin, on peut le définir comme un
processus qui permet de faire mûrir des priorités, de choisir des
actions à partir de savoirs et propositions des groupes de populations
habitant un territoire donné, et de mettre en oeuvre les ressources
disponibles pour satisfaire à ces dites propositions. Par temps de
mondialisation d'ailleurs, il apparaît même comme une
réponse, formulée par les acteurs d'un territoire et pour
répondre à la nécessité d'une insertion optimale,
en vue de proposer de formes adaptées de la production de leur
territoire. Résultat d'une solidarité et d'une proximité
agissante, le développement local incite à privilégier les
acteurs plus que les infrastructures, les réseaux plus que les
institutions établies, pour donner aux hommes et aux groupes directement
intéressés une fonction de décision sur les actions qu'ils
mènent.
Ces acteurs doivent se comporter en partenaires, ce qui veut
dire qu'ils doivent pouvoir se faire confiance sans laquelle toute
collaboration est voué à l'échec. Les cohésions des
hommes entre eux et des hommes avec les lieux sont très importantes, car
ce sont des supports actifs du développement local. Le
développement local est donc une pratique du développement, une
méthode de travail, non une nouvelle théorie qui
compléterait ou se substituerait aux précédentes au
prétexte qu'elles auraient échoué. Il ne vise pas à
identifier les divers obstacles au développement ni à rechercher
la combinaison optimale des ressources, rares par définition, mais
à s'interroger sur les moyens de parvenir à leur combinaison ceci
en s'unissant pour oeuvrer ensemble. Le développement local est donc de
prime abord un processus décisionnel. Ce qui limite les actions, ce ne
sont pas les pénuries elles-mêmes (capital, formation,
énergie, etc.) mais les imperfections dans les processus de
décision, dans la maîtrise de l'harmonie sur le terrain ; la
difficulté majeure dans ce développement est la gestion de la
complexité.
Ceci exige un partenariat sérieux et responsable, car
la méfiance ou encore une erreur de la part d'un acteur peut causer la
faillite de tout le processus. Dans cette perspective, la proximité est
un atout essentiel parce qu'elle s'appuie sur une bureaucratie
allégée, et permet l'implication d'un nombre élargi de
groupes de population ; ce qui favorise des synergies entre eux. Les
partenaires du développement local doivent pouvoir se faire confiance et
travailler main dans la main. Mais, pour que ce partenariat soit possible, il
doit encore pouvoir être participatif.
2 - LE CONCEPT DE LA PARTICIPATION
A l'aube du présent millénaire le
développement, et particulièrement le développement local,
est devenu participatif. Il réclame l'apport constructif de plusieurs
intervenants dont l'Etat, les collectivités locales
décentralisées, les organisations non gouvernementales, les
associations communautaires de développement, les bailleurs de fonds,
les églises, les populations, etc. Ces différents acteurs doivent
tisser et entretenir entre eux des rapports d'entraide, de solidarité,
de synergie pour que leurs efforts conjugués portent des fruits.
Participer, c'est associer et ceci, dès la base. Et associer dès
la base, c'est mettre ensemble sur pied un projet (comme un projet de
territoire), le concevoir ensemble et le réaliser ensemble. Dans le
système participatif, personne ne doit être lésée,
que ce soit les bénéficiaires, ou que ce soit les
réalisateurs.
Avec la participation de tous, le développement local
n'est plus la conséquence d'une coopération entre des
institutions détentrices de ressources financières et de
compétences techniques avec des instances locales qui leur
présentent des programmes à soutenir. Mais il apparaît
davantage comme le résultat d'une coopération élargie
entre groupes de population habitant un espace donné en vue de
coordonner et de rationaliser l'emploi de leurs ressources pour construire un
devenir commun. Lorsque l'on veut mettre sur pied un projet ou programme, la
norme demande que tous les acteurs soient concertés ainsi que les
bénéficiaires afin que chacun se sente concerné. La notion
de participation impose donc la mise en place des dispositifs permettant aux
populations concernées de débattre et conduire leur projet
d'avenir.
Pour être participatif, le développement local
doit reposer sur plusieurs propositions telles que :
- créer, revitaliser ou vivifier les solidarités
réelles ou présumées pour organiser un débat autour
d'un projet d'avenir ;
- considérer les groupes de population de l'espace de
développement comme des ensembles humains multiformes, capables de
s'organiser entre eux et non comme des ensembles isolés, disponibles
lorsqu'ils sont sollicités ; et
- susciter la mise en place de structures de médiation
et de négociation entre ces groupes pour que chacun exprime son point de
vue et participe à la définition des priorités de
développement. Le consensus à rechercher n'est pas un accord
unanime de tous sur toutes les priorités, mais tous doivent trouver une
part d'intérêt à leur réalisation.
La participation est donc plurielle et diverse. Elle ouvre la
voie à la réalisation des oeuvres de grande importance. Elle
possède ses tares et porte des germes de l'émulation ou de
l'échec. La participation doit être fondée sur la
transparence. Elle apparaît comme une étape, certes, difficile
à franchir mais indispensable pour permettre une mobilisation autour
d'une oeuvre collective ou d'un objectif commun fixé par les parties
prenantes. Sa réussite dépend totalement des acteurs en
présence.
II- LES DIFFERENTS ACTEURS DU DEVELOPPEMENT LOCAL A MELEN 4
ET MELEN 8 OM
Aujourd'hui, l'Etat tout seul ne peut plus subvenir à
tous les besoins d'amélioration du cadre de vie des citoyens. Dans les
quartiers de nos villes, des organisations se mettent en place. Ce sont des
associations qui travaillent en partenariat avec des ONG ou encore des
bailleurs de fonds. A Melen 4 et Melen 8 OM, on dénombre ainsi des
associations mixtes et d'autres spécifiques de femmes, de jeunes, etc.
Mais, il existe surtout le regroupement des habitants dans un organe unique
dénommé Comité d'Animation au développement (CAD).
Les CAD de nos villes, naissent, grandissent ou s'étiolent. De
même, ceux qui subsistent, regorgent de grandes potentialités.
Cependant, ils ne peuvent jouer leur rôle d'organe d'émulation des
populations que s'ils sont soutenus et accompagnés. Dans nos quartiers
suscités, une ONG camerounaise nommée Environnement, Recherche et
Action en collaboration avec une autre qui, elle, est espagnole et se
dénomme « Ingénieur sans frontières
(ISF) », travaillent ensemble afin d'améliorer effectivement
la qualité de vie des populations.
1 - L'ACTION DU TANDEM « ERA-CAMEROUN/ISF
D'ESPAGNE »
.
Nous le disions précédemment, une ONG est une
organisation qui travaille pour les autres39(*). Sa vocation première est d'oeuvrer pour les
intérêts autres que ceux de ses membres. C'est le cas de
« ERA-Cameroun » et de « ISF
d'Espagne » à Yaoundé VI en général et
à Melen en particulier. Avec l'appui d'ERA- Cameroun, les populations
ont compris qu'ils pouvaient parvenir au développement de leur
localité et ainsi, vivre dans la sécurité et dans la
propreté. Pour cela « ERA-Cameroun » en partenariat
avec « ISF » s'est engagé à s'associer aux
quartiers organisés dans :
- la gestion et la valorisation des déchets solides et
liquides,
- la promotion des techniques appropriées
d'assainissement et d'approvisionnement en eau,
- l'électrification rurale
décentralisée,
- les infrastructures de base dans les quartiers
défavorisés,
- l'appui et l'accompagnement des populations dans les projets
de développement, et
- l'éducation rurale et sanitaire...
« ERA-Cameroun » travaille dans les
quartiers avec le consentement de la mairie de Yaoundé VI, dans le cadre
du programme d'amélioration du cadre de vie des habitants des quartiers
défavorisés ; c'est un programme dénommé en
abrégé « Programme Quartier ». Mis
sur pied par « ERA-Cameroun », il a pour principal objectif
de susciter chez les populations, des actions philanthropiques dont la
finalité est d'améliorer la qualité de vie dans la
localité. Dans ce programme d'amélioration des conditions de vie
des habitants des quartiers à habitat spontané de la ville de
Yaoundé, des actions diverses et multiples ont été
réalisées au cours des années 2005-2006 par les CAD, avec
le concours technique et financier de « ERA-Cameroun/ISF
d'Espagne ».
Ces différentes actions concernent des domaines aussi
divers que l'ingénierie sociale, la réalisation des
infrastructures communautaires, la construction des ouvrages individuels et
l'encadrement des activités génératrices de revenus.
Aujourd'hui, un autre projet est mis sur pied, c'est « le projet
AQUA ». Ce dernier a pour objectif de permettre à
plusieurs ménages d'avoir l'eau potable à domicile, afin
d'éviter les maladies liées à l'eau. C'est donc un projet
qui rentre dans le cadre de l'assainissement en eau potable. Ce partenariat des
quartiers avec « ERA/ISF » a permis de constater que les
relations entre les associations de développement à la base et
les institutions publiques étaient indolentes, timides et mal
cernées. Cette ONG est devenue l'intermédiaire entre les deux,
afin de rétablir le dialogue.
2 - LES ASSOCIATIONS DE MELEN 4 ET DE MELEN 8 OM
Dans ces deux quartiers, il y a plusieurs associations.
Certaines ne sont pas légalisées et, surtout, travaillent en
partenariat avec les CAD qui sont légalisés. Les unes sont des
associations au développement, les autres sont des associations des
ressortissants indifféremment de leur quartier de résidence ou
encore des GIC. Nous nous sommes rapprochés particulièrement des
premières, qui oeuvrent pour le développement. Nous allons
présenter quelques unes d'entre elles sous formes de tableaux. Par
ailleurs, notre présentation ne concerne que les associations que nous
avons rencontrées dans le cadre de notre travail (Tableau
n°1 et Tableau n° 2). Précisons enfin, que nos
enquêtes de terrain menées dans le cadre du présent travail
de recherche se sont déroulées du 20 Janvier au 20 Mars 2009,
dans les quartiers de Melen 4 et Melen 8 OM.
Tableau n°1 : Les associations
ciblées de Melen 4
|
Dénominations
|
Typologie
|
Typologie II
|
Observations
|
|
Comité d'Animation au Développement de Melen 4
(CADEM 4)
|
Mixte
|
CAD
|
Ils rassemblent toute la population et coordonnent les
initiatives au développement.
|
|
Amicale des Chefs de blocs et Notables de Melen 4
|
Mixte
|
Association de la chefferie
|
Ce sont les initiateurs du CAD, et oeuvrent
particulièrement pour le développement
|
|
Amies Sincères
|
Femmes
|
Association
|
Ce sont des femmes qui s'entraident entre elles, et sensibilisent
la jeune fille contre la prostitution
|
|
Cercle des Jeunes actifs de Melen 4
|
Jeunes
|
Association
|
Ils sensibilisent les jeunes contre le grand banditisme et
pratiques les séances de travaux manuels
|
Sources : nos enquêtes
menées sur le terrain dans le cadre de notre étude.
Pour plus amples explications, nous allons les
présenter sous formes littéraires. A Melen 4 nous avons :
· Le comité d'animation de développement
de Melen 4 (CADEM 4). C'est la structure qui sert de relais entre les habitants
du quartier et les partenaires pour le développement ERA/ISF.
C'est une association légalisée et composée d'un bureau
électif et représentatif. Car elle regroupe les membres de
toutes les associations de développement. Le CADEM 4 a pour rôle
de sensibiliser et de mobiliser la population autour des initiatives de
développement du quartier. Il recueille les fonds versés pour le
développement local dans les autres associations. Ses membres passent de
porte en porte pour sensibiliser la population sur la nécessité
de participer aux initiatives pour le développement.
En partenariat avec la population, il détermine les
besoins des habitants. Et en partenariat avec « ERA - Cameroun et ISF
d'Espagne », il détermine la participation de chaque partie (8
à 10 pour cent du montant des travaux à réaliser sont
versés par les populations bénéficiaires et 90 à 92
pour cent par les partenaires ERA/ISF). Par la suite, les réalisations
sont effectuées pour le grand bien des populations (voir ANNEXE
3). On peut dire qu'il y a la transparence dans la collecte des fonds.
Parce qu'en effet, la liste de toutes les personnes qui ont contribué,
est affichée sur un tableau public, afin que chaque habitant puisse
faire les comptes.
· Amicale des chefs de blocs et notables de Melen 4. La
localité de Melen 4 comprend six blocs dirigés par six chefs de
blocs, et il existe à la tête du quartier, un Chef de
troisième degré. Ici chaque bloc rassemble ses populations et
rend compte à l'Amicale. C'est la première association de
la localité à avoir pour objectif de base, le
développement du quartier. Elle est à l'origine de la
création du CAD et des définitions des orientations du
développement du quartier. Avant la création du CAD, cette
association effectuait déjà les travaux dans la localité.
Elle participait au curage d'eau au niveau du versant Mingoa, au maintien de la
sécurité, à l'hygiène et à l'assainissement,
à la réalisation des pistes piétonnes.
De nos jours, son objectif est l'établissement de la
paix et de la sérénité dans le quartier, l'hygiène
et la salubrité ; etc. Pour avoir le financement de leurs
activités et participer aux travaux dans le quartier, les membres font
des cotisations, des tontines... Entre eux aussi, il y a un esprit d'entraide,
certaines personnes qui ne peuvent ouvrir un compte à la banque peuvent
aussi y épargner un peu d'argent.
· Les Amis sincères de Melen4 : dans cette
association, les membres sont particulièrement les femmes. Cette
association a pour but de sensibiliser les femmes par rapport aux fléaux
qui existent de nos jours. Ce sont : les IST et le SIDA, la prostitution,
le banditisme, etc. Cette sensibilisation est importante dans ce quartier,
parce que son îlot dit « Mini ferme », par exemple,
est reconnu comme un lieu de prostitution. Cette association essaye donc de
préparer la femme en général et la jeune fille en
particulier à affronter la vie sans s'adonner à la
facilité. Pour prospérer, les membres font des entraides entre
eux, des tontines, ou encore des cotisations. C'est ainsi qu'elles se sont
constituées une caisse d'épargne. En plus de la sensibilisation
de la jeune fille, ces femmes contribuent au développement du quartier
en faisant des cotisations et en assistant à la réunion du CADEM
4.
· Le cercle des jeunes actifs de Melen 4. Pour
être membre de cette association, il faut être jeune (7-77 ans),
être habitant du quartier et participer régulièrement aux
activités de l'association, il faut aussi avoir sa carte de membre.
L'objectif de ces jeunes est de promouvoir une jeunesse mobile,
éduquée, responsable. Elle sensibilise aussi les jeunes pour une
contribution au développement effectif du quartier. Les membres
s'occupent donc de la salubrité et de l'assainissement
général du quartier (investissement humain, sensibilisation),
etc. Sur le terrain, les aînés rassemblent les cadets, pour les
sensibiliser contre les fléaux tels que le grand banditisme, la
délinquance sexuelle : tout ceci est mené à travers
des séances d'éducation. Leur force repose sur les anciens, car
en effet, les jeunes qui ont quitté le quartier demeurent membres de
l'association.
Tableau 2 : Les associations
ciblées de Melen 8 OM.
|
Dénominations
|
Typologie
|
Typologie II
|
Observations
|
|
Comité d'Animation au Développement de Melen 8
Onana Meuble (CADEM 8 OM)
|
Mixte
|
CAD
|
Siège tous les Lundis soir chez le chef de la
localité, dans le but de discuter des problèmes du quartier. Il
rassemble tous les sous CAD des 5 blocs.
|
|
L' Association des Femmes de Melen 8 OM
|
Femmes
|
Association
|
Rassemble les femmes unies auprès des associations de
femmes de chaque bloc, essaye de résoudre les problèmes
liés aux femmes et participe ainsi au développement.
|
|
Rassemblement des Associations de Jeunes de Melen 8 OM
|
Jeunes
|
Association
|
Sensibilise les jeunes à plus de responsabilité,
regroupe les autres associations des jeunes et participe aux travaux dans le
quartier.
|
Sources : nos enquêtes
menées sur le terrain dans le cadre de notre étude
La présentation sous forme littéraire nous
permettra de mieux les connaître :
· Le CADEM 8 OM ; c'est une association
légalisée. Elle siège une fois par semaine pour
réfléchir aux problèmes du quartier. Chaque chef de bloc
est aussi président du « sous-CAD » et
représente son bloc au niveau du CADEM 8 OM. Melen 8 OM est
composé de cinq blocs dirigés chacun par un chef de bloc. Chaque
bloc forme un sous-comité d'animation au développement. Les chefs
de blocs sont les membres du CAD du quartier et sont placés sous la
responsabilité d'un Chef traditionnel de troisième degré.
Après les réunions au niveau du sous CAD, les chefs de blocs
rendent compte au CAD. Chaque sous CAD pose ici les problèmes
rencontrés dans son bloc et les solutions sont trouvées en
commun. Ils gèrent les litiges à l'échelle de leur bloc
respectif. Un litige n'est porté à la connaissance du chef de
quartier que si les partis en conflit ne sont pas satisfaits du verdict
prononcé au niveau du chef de bloc. Ceci permet de garder la paix et la
sérénité dans le quartier. Ces chefs de blocs sont non
seulement les personnes ressources du quartier, mais aussi les initiateurs de
grands projets de développement de la localité.
Les fonds collectés dans les sous CAD sont remis au
CADEM8 OM qui le dépose dans un compte ouvert au nom de la
localité. Par souci de transparence, chaque sous CAD a un carnet de
reçu qu'il remet à chaque participant et le double est remis au
CAD avec la somme exacte encaissée. L'objectif recherché par tous
les acteurs est l'amélioration de la qualité de vie de tous,
dans la localité. Est membre du CAD tout propriétaire du
quartier ou toute personne ayant un quelconque intérêt à
oeuvrer dans le quartier. La composition de son bureau est aussi
représentative que celle du CADEM 4.
· L'association des femmes de Melen 8 OM rassemble les
associations des femmes des cinq blocs existant dans le quartier. Elle se
réclame du CAD. Pour en être membre, il faut naturellement
être femme, et résider dans la localité de Melen 8 OM.
Cette association regroupe les femmes autour des actions du
développement, l'amélioration de leur cadre de vie, et leur
formation en activités génératrices de revenus. Les femmes
peuvent apprendre des petits métiers ou la confection de certaines
petites choses pouvant les aider au quotidien. Le financement est autonome et
provient de la cotisation des membres. Pour gérer cet aspect financier
dans la transparence, elles ont pour projet d'ouvrir un compte afin de
bénéficier aussi des crédits. Pour le développement
de la localité, les femmes contribuent au niveau du CAD et participent
ainsi à la réfection du quartier.
· Le rassemblement des associations des jeunes de Melen 8
OM. Il regorge toutes les associations de jeunes du quartier. Il travaille dans
la sensibilisation des jeunes sur les différents fléaux du
siècle : le grand banditisme, la criminalité ambiante, la
prostitution, le SIDA et les IST. Les jeunes participent aussi aux travaux dans
la localité, en assistant au curage d'eau afin d'empêcher les
inondations, en assistant les parents dans les séances de travaux
pratiques volontaires dans le quartier.
Enfin, une représentation plus succincte permet de
mieux cibler les relations entre les différents acteurs impliqués
dans la collaboration avec les ONG concernées par le
développement participatif en cours à Melen 4 et Melen 8 OM
(Schéma 2).
Schéma 2 : les relations entre les acteurs
du développement local à Melen 4 et Melen 8 Onana
Meuble
Associations des femmes par bloc
Associations des jeunes
ERA-Cameroun/ ISF Espagne
Légende
Relation d'information
Relation de financement
Relation participative
Relation de regroupement
Sources : nos enquêtes menées sur le
terrain dans le cadre de notre étude
Comité d'Animation au Développement
Collectivités locales
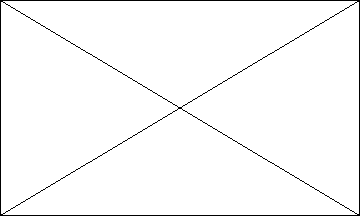
Amicale des chefs de blocs
Sous comité d'animation au développement par
bloc
Rassemblement des associations Jeunes
Rassemblement des associations
Femmes
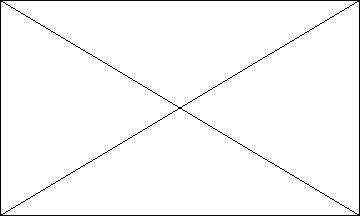
Conclusion du deuxième Chapitre
Dans ce second chapitre, il était question du
développement local, dont il fallait analyser l'assise théorique
et en présenter la concrétisation sur le terrain et, plus
précisément, à Melen 4 et Melen 8 OM. Nous avons
constaté que le développement local est un
phénomène qui grandit tous les jours et qui nécessite le
partenariat, la participation et la collaboration de plusieurs acteurs
dynamiques. Le développement local entraîne un changement positif
des quartiers à habitat spontané. En effet, on constate que les
associations de ces quartiers pauvres font des efforts pour créer et
encourager les relations de proximité génératrices de
citoyenneté. Ceci étant, le regroupement des habitants en petits
groupes, sous forme d'associations, crée la cohésion sociale
entre les membres et change le cadre de vie de la population.
Conclusion de la première partie
Cette première partie nous a permis de connaître
la notion de philanthropie, à partir des organisations à but non
lucratif et les approches du développement local. Ainsi, l'historique de
la philanthropie nous aura-t-elle éclairé à la fois, sur
ses origines très anciennes et, sur le fait qu'elle comporte des
caractéristiques très particulières. Cette analyse de la
philanthropie la présente comme un phénomène important
voire, indispensable dans le développement en général et
le développement local en particulier.
Pour sa part, l'analyse théorique du
développement local nous a montré qu'ici, l'on recherche
l'amélioration de la qualité de vie des habitants d'un territoire
spécifique qui peut être soit un quartier, soit une ville, soit
encore une région. Nous avons précisé l'incapacité
des institutions de l'Etat à satisfaire les besoins de tous ses
habitants et de toutes ses régions. D'où la
nécessité des âmes généreuses pour palier ce
manque, et aider ainsi à l'oeuvre de développement dans les
localités qui en ont le plus besoin. Ce changement ou
cette amélioration de la qualité de vie des populations n'est
vraiment efficace que si tous les acteurs en jeu, se mettent
véritablement ensemble dans les réalisations.
On peut donc aussi conclure à ce niveau que la
philanthropie est très importante dans le cadre du développement
local. Car en considérant l'impossibilité de l'Etat à
satisfaire les besoins de tous et, surtout, à améliorer la
qualité de vie dans tous les coins et recoins de la nation, des bonnes
âmes, individuellement ou en groupes, sont appelées à
mettre la main à la pâte pour le bien-être de tous et, plus
spécialement, des plus démunis vivant dans les bidonvilles.
Ceci étant, il convient de voir à présent
les actions philanthropiques des associations de Melen 4 et Melen 8 OM pour le
bien-être des populations dans ces localités.
DEUXIEME PARTIE :
L'ACTION PHILANTHROPIQUES DES ASSOCIATIONS AU DEVELOPPEMENT DE MELEN 4 ET MELEN
8 OM
|
INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PARTIE
La deuxième partie de notre travail porte sur l'action
philanthropique des associations au développement de Melen 4 et Melen 8
OM. Cette partie a pour objectif de présenter la situation actuelle de
ces deux quartiers et les activités qui y sont menées. Elle est
subdivisée en deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous exposerons
la présentation socioéconomique des quartiers Melen 4 et Melen 8
Onana Meuble. Cette analyse spatio-économique permet un recueillement de
données dont le but est alors double, à savoir nous permettre de
connaître les lieux en vue de mieux cerner les difficultés des
populations de ces localités, et également nous conduire à
mieux mettre à jour l'importance de ces actions philanthropiques pour
l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers
concernés.
Dans le deuxième chapitre enfin, nous montrerons la
participation des associations et des CAD de ces localités au
développement de leur quartier. A partir du dépouillement des
questionnaires, et des entretiens menés sur le terrain, nous
répondrons ainsi à la question première de notre travail
à savoir si les associations oeuvrent de façon philanthropique
pour le développement local dans leur secteur.
CHAPITRE 3 : PRESENTATION SOCIOECONOMIQUE DE MELEN
4 ET DE MELEN 8 OM.
Introduction
Melen 4 et Melen8 OM sont deux quartiers de la ville de
Yaoundé, situés dans la commune d'arrondissement de
Yaoundé VI. Cette commune de Yaoundé VI est née par
décret n°93/321 du 25 Novembre 1993, suite à la
réorganisation administrative de la communauté urbaine de
Yaoundé, dont le nombre est passé de 4 à 6
arrondissements. Elle est composée de 24 quartiers au poids
démographique variable. Melen 4 et Melen 8 OM sont deux quartiers
à habitat spontané d'où notre choix de ces quartiers, afin
de montrer leurs difficultés réelles et ainsi, percevoir les
besoins sensibles des habitants et les essais de solutions qu'ils apportent par
eux-mêmes, notamment en se mettant en groupes et de façon
désintéressée pour l'amélioration de leur site.
Avant d'y arriver toutefois, il nous semble utile de voir d'abord quels sont
les aspects géographiques et démographiques de ces zones.
SECTION 1 : CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET
DEMOGRAPHIQUES DE MELEN 4 ET MELEN 8 OM
A Melen 4 tout comme à Melen 8 OM, les
caractéristiques physiques et démographiques sont
déterminantes dans toutes études. Car ce sont ces données
qui précisent les difficultés rencontrées par les
habitants, en même temps d'ailleurs qu'elles montrent leur besoin de s'en
sortir.
I- LE QUARTIER DE MELEN 4
Melen 4 est l'un des quartiers les plus vastes du VIème
arrondissement de la ville de Yaoundé. De part son îlot
surnommé « Mini ferme », il est aussi un quartier
très bouillant. Quelles sont ses spécificités ?
1 - DE « LA ROUTE DES PALMIERS » A
MELEN 4
Avant l'arrivée des allemands, la zone s'appelait ELIG
MEBAMA. L'origine du nom date de l'époque allemande. La route centrale
qui traversait cette localité était bordée de
palmiers ; Les Ewondo la baptisèrent « Djong
melen » qui signifie « route des
palmiers », ce qui servit d'inspiration aux colons. Plus tard,
les autorités administratives le baptiseront du nom de
« quartier Melen 4 ». De leur côté d'ailleurs,
les citadins de la ville l'appellent aussi « mini ferme »,
en référence à la ferme avicole qui existait juste en
face de l'hôtel Feuguif.
Avant 1974, il y avait un seul Melen. On parlait de
« Djong melen », et qui allait de Ngoa Ekelle à
Obili. Ce territoire était occupé par la famille Mvog Atemengue
et dirigé par un seul Chef Traditionnel. Après
l'indépendance il y a eu l'éclatement de Djong melen par
l'administration pour créer Melen 1, 2, 3, 4... La première
famille qui s'est installée sur le site actuel de Melen 4 est la famille
Fouda, une descendance des Mvog Atemengue. Cette grande famille est
propriétaire de tout le terrain à Melen 4 sur lequel elle a un
titre foncier.
Aujourd'hui, la population du quartier est
hétérogène. On y retrouve des ressortissants de toutes les
provinces camerounaises et des étrangers. Ici, il y a très peu
d'autochtones. La localité est située au centre ville, et attire
beaucoup de locataires. Dans chaque domicile, il y a au moins une chambre
à louer malgré la promiscuité.
2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HUMAINE
Sur le plan géographique, Melen 4 est
situé sur le versant du plateau Atemengue au centre de la ville de
Yaoundé (Carte 2 infra). Les quartiers
limitrophes sont : Melen 3, Elig Effa 2, Melen 7A et Melen 7B.
Melen 4 peut être divisé en trois zones :
une zone de bas fonds, où les habitations sont
régulièrement inondées par les eaux en saison des pluies
à cause, notamment, de la mauvaise canalisation. Cette zone est à
pente nulle. Ensuite, nous avons la zone à pente faible où les
terrains sont stables et bons, ici les bâtiments ne sont pas à
risque. Et enfin la zone à forte pente. Les terrains situés dans
cette zone sont accidentés. Pour y construire, des travaux de drainage
et de terrassement sont nécessaires au préalable. Pendant les
saisons des pluies, les habitations situées dans les bas fonds sont
inondées, tandis que celles situées sur les pentes, subissent
l'érosion. Les occupants des bas fonds s'organisent de façon
individuelle ou collective pour limiter les inondations. Pour permettre la
circulation, sept principales voies desservent le quartier. Les unes sont des
voies carrossables, tandis que les
autres sont des
chemins piétons. La majorité des habitations n'est accessible
qu'à pied. Les autres voies d'accès sont de petits sentiers qui
se terminent généralement devant un domicile ou des impasses. Les
routes sont très étroites pour les véhicules.
Le climat de Melen 4 est celui de la ville de Yaoundé.
Il est marqué par l'alternance des saisons. Une petite saison des
pluies, qui va de mars à juin, puis une petite saison sèche, qui
va de juillet à août. Ensuite arrivent, tour à tour, une
grande saison des pluies, qui couvre la période de septembre à
novembre, puis une grande saison sèche qui va de novembre à
février.
A Melen 4, il y a très peu d'espaces pour
l'agriculture. Comme, par ailleurs, le quartier se situe désormais en
plein centre-ville, les populations construisent même sur les zones
accidentées. Presque dans la rivière Mingoa (qui arrose la zone),
on peut observer quelques plantes vertes, mais elles restent néanmoins
rares. Toutefois aussi, quelques personnes sèment des condiments et des
pieds de maïs dans leur cour et qui, souvent, fait ici office de
« potager familial ». La principale rivière de la
zone (appelée « Mingoa ») constitue la limite
naturelle avec le quartier Elig effa. La rive est occupée par des
constructions : habitations, latrines ou de petites fermes
(particulièrement des porcheries). En réalité, la
rivière Mingoa (Carte 2) n'est plus sur son lit
naturel. Les habitants du quartier l'en ont en effet déviée avec
les maisons et autres constructions.
Pour ce qui est de la Situation humaine ensuite : la
population du quartier Melen 4 est estimée à 3095 habitants,
répartis dans 844 ménages d'après le recensement
réalisé en 2007 par le LESEAU40(*)de l'école nationale polytechnique pendant un
projet portant sur « La maîtrise da l'assainissement dans un
écosystème urbain et impacts sur la santé des enfants
âgés de moins de cinq ans », mis en oeuvre dans le
bassin versant de la Mingoa à Yaoundé. Cette
population est composée beaucoup plus des membres de l'armée et
des étudiants. Néanmoins, l'on y retrouve aussi quelques
fonctionnaires, des sans emplois fixes, des commerçants, des artisans,
etc. Cette importante présence des hommes en tenue et des
étudiants se justifie par le fait que le quartier est proche des
casernes militaires (Gendarmerie Nationale, Garde Présidentielle,
l'Ecole Militaire Interarmées et quartier général de
l'armée, etc.), de l'Université et des grandes écoles,
notamment, l'Université de Yaoundé I, l'Ecole Nationale
Supérieure Polytechnique, le Centre Universitaire Biomédicale, ,
l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, l'Ecole Nationale
d'Administration et de Magistrature, l'Ecole Normale Supérieure, l'Ecole
Nationale Supérieure des Travaux Publics, bref, pratiquement toutes les
grandes écoles de la ville.
C'est aussi pourquoi, le quartier regorge plus de locataires
que de propriétaires. Et, presque dans chaque domicile, on compte au
moins un locataire. Par ailleurs, de nombreuses personnes parmi les
étrangers, se comportent comme des passants. Elles se soucient peu de la
qualité de l'environnement dans lequel elles vivent. La chefferie fait
des efforts dans ce sens pour les intégrer et ainsi les amener à
avoir un sentiment d'appartenance au quartier. Pour se faire la nomination des
chefs de blocs, par exemple, est faite indifféremment de leur
appartenance ethnique. Les sans emplois font de petits jobs pour survivre et
quand ils n'ont rien à faire, ils jouent aux cartes pendant la
journée. Ceux qui ont reçu une formation, et qui ne sont pas
intégrés dans la fonction publique, s'installent dans le secteur
privé. Par exemple, les personnes qui ont suivi la formation des
infirmiers diplômés d'Etat et qui ne sont pas recrutées
dans un hôpital ou un établissement hospitalier font des soins,
des consultations, de la petite chirurgie et autres prestations à
domicile. Ceci est parfois illégal, mais leur permet de subsister. Il en
est de même des autres secteurs d'activités.
En ce qui concerne l'habitat, il est le plus souvent fait de
« poto-poto »41(*) et regorge de familles nombreuses. On y trouve ici
peu de maisons en produits finis. La manière de se loger importe peu.
Pour les habitants du coin, l'important est de trouver une place pour chaque
membre de la famille. La maison est peu aérée. Pour loger tout le
monde, l'on est d'ailleurs souvent obligé d'utiliser toute la surface
du terrain. L'accès au domicile est impossible aux voitures, car les
maisons sont très serrées les unes aux autres. Ainsi, les
propriétaires de voitures sont obligés de laisser leur
véhicule dans des garderies.
Parlant de l'approvisionnement en eau potable, le
réseau de l'Ex Société Nationale des Eaux du Cameroun
(SNEC) devenue CAMWATER existe dans le quartier Melen 4. Mais peu de
ménages y ont accès. En effet, moins de 20% des ménages
sont branchés au « réseau SNEC ». Nombreux
sont ceux qui se ravitaillent aux bornes fontaines à gérance
libre au prix de 20 Francs CFA les 10 litres, ou qui puisent l'eau chez le
voisin le plus proche (et qui, lui, est client de CAMWATER), contre une
rétribution mensuelle négociée. Les habitants peu
fortunés se ravitaillent aux sources telles que celle de "Tap Tap" (voir
ANNEXE 3, Photo 2), ou encore aux puits, malgré le fait
que cette eau soit impropre à la consommation.
Pour l'éclairage aussi, tous les ménages du
quartier ne disposent pas d'un compteur AES-SONEL. Certains prennent
l'électricité chez le voisin, suivant des conditions
négociées au cas par cas et au moyen d'un compteur divisionnaire.
Il existe peu d'éclairage public dans le quartier, car les lampadaires
existants sont, de temps en temps, vandalisés ou volés par les
bandits.
En matière de couverture sanitaire, celle-ci demeure
à proprement parler inexistante dans le quartier, même si l'on
dénombre la présence de plusieurs établissements
sanitaires à la périphérie. Néanmoins, il est
à noter la présence, dans Melen 4, des petits centres de soins,
ou encore des GIC santé, ouverts par des agents de la santé.
En ce qui concerne les établissements scolaires, le
quartier n'a aucune école. Les enfants du quartier se rendent dans les
établissements situés à la périphérie. Il
n'existe non plus de terrains de jeux pour la détente des jeunes, ces
derniers sont appelés à demander un site de jeu à la
périphérie. De même, il n'y a non plus de salles de
cinéma ou de loisirs à Melen 4. Les seuls pôles
d'attraction dans cette localité fonctionnent de nuit et ne sont
pas conseillés aux individus de bonne moralité. Ici en effet,
prostitution et banditisme vont de pair. C'est pourquoi, il y a plus de snack
bars, de bars dancings, de restaurants, de boites de nuit, d'hôtels, de
motels, et autres, le long de l'axe principal.
Carte n°2 : Présentation de
Melen 4
Sources : ERA- Cameroun, 2009,
Yaoundé
Toutefois, ayant effectué le tour de Melen 4, il
convient également de présenter l'autre quartier du champ de
notre analyse, à savoir Melen 8 OM.
II-PRESENTATION DE MELEN 8 OM
Tout comme Melen 4, le quartier dit Melen 8 OM est un quartier
à habitat spontané de la ville de Yaoundé. Pour cerner ses
problèmes, nous devons au préalable connaître son histoire
et sa géographie.
1 - BREF APERÇU DE L'ORIGINE DU QUARTIER
Le quartier Melen 8 OM est issu de l'éclatement de
Melen 8B qui était composé des familles Mvog Atemegué et
Ndong. Avec la création de l'arrondissement de Yaoundé VI, le
quartier Melen 8B qui comptait sept blocs s'est éclaté en deux
parties. La première partie constituée de deux blocs s'est
rattachée au quartier Obili dans la commune de Yaoundé III. La
seconde constituée de cinq blocs s'est rattachée à
l'arrondissement de Yaoundé VI. Le siège de l'ancienne chefferie
de Melen 8B étant resté dans l'arrondissement de Yaoundé
III, la plus grande partie a donc obtenu son autonomie et a pris le nom de
Melen 8 OM. Aujourd'hui, elle a un chef de troisième degré qui
dirige la localité et elle garde ses cinq blocs.
Tout comme Melen 4, son nom date de l'époque allemande
et est dérivé de « Djong melen », car elle
fait partie du grand quartier Melen avant son éclatement en 1974.
« Djong melen » qui veut dire rue des palmiers, a
inspiré les colonisateurs, car dans le but de prononcer le nom de ce
quartier comme les autochtones, il est devenu Melen. Certes, de nos jours, il
n'y a plus beaucoup de palmiers dans ces rues, mais le quartier garde son nom.
Avec l'exode rural, les premiers allogènes arrivèrent dans ce
quartier vers 1950. Ils étaient Béti mais non originaires de
Yaoundé. Ils seront suivis, plus tard, par des ressortissants des
provinces de l'Ouest et du Nord Ouest. A présent, on distingue par ordre
d'importance les groupes ethniques suivants : les Bamiléké, les
Anglophones, les Bassa et les Bétis.
Les autochtones sont aujourd'hui minoritaires par rapport aux
allogènes. Ces derniers se retrouvent dans tous les blocs. Seulement,
les terres appartiennent toujours aux autochtones, et ils sont les seuls
à pouvoir les vendre. Si l'on achète une parcelle de terrain sans
passer par ces derniers, cela veut dire que « c'est une vente de
seconde main »42(*)
2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HUMAINE
Au niveau géographique, le quartier
Melen 8 OM est situé à l'Ouest de la ville de Yaoundé,
entouré des quartiers Obili, Melen 8 C, Eba et le camp de la Garde
présidentielle (GP) (Carte 3 infra). Le relief
dans son ensemble est accidenté. On y dénote des zones à
accès difficile qui ne permettent pas la communication entre les
habitants des blocs voisins. Pour permettre la circulation, plusieurs pistes
desservent le quartier. Auparavant, les pistes étaient accessibles par
saison. Elles étaient boueuses et les difficultés d'accès
étaient multiples. Car, elles étaient très
dégradées et dépourvues de rigoles. Il fallait de ce fait
sortir de sa maison avec deux paires de chaussures pour se rendre au
centre-ville. Mais aujourd'hui, elles ont été
aménagées et sont devenues carrossables. Les véhicules y
circulent avec plus de facilité, mais il leur reste impossible d'aller
plus loin, car en dehors des pistes centrales, il n'y a plus d'accès
(existence de nombreux « culs de sacs »).
Plus de la moitié des ménages du quartier
accèdent à leur parcelle en circulant autour des habitations.
Dans cette localité beaucoup de terrains sont accidentés. Pour y
construire, des travaux de drainage et de terrassement sont nécessaires
au préalable. Aussi, les fondations doivent être solides surtout
dans les bas fonds du quartier et qui sont aussi, les lieux les plus
exposés aux inondations. Pendant les saisons des pluies, les habitations
situées dans ces bas fonds sont en effet inondées, tandis que
celles situées sur les pentes subissent l'érosion. D'où la
nécessité, pour les occupants des bas fonds, d'oeuvrer de
façon individuelle ou collective pour limiter les inondations. Comme
à Melen 4, on retrouve ici aussi des voies carrossables et des chemins
piétons.
La végétation est essentiellement artificielle.
Elle est faite d'arbres fruitiers, de quelques tiges de cacaoyers et des
plantes vivrières. Elle devient aussi rare parce que, les populations
transforment les champs en habitations afin de les mettre en location.
Comme à Melen 4 également, le climat de Melen 8
OM est le même que celui de la ville de Yaoundé en
général. On remarque néanmoins que ce climat change de
temps en temps, certainement à cause du changement climatique mondial.
Bien entendu toutefois, l'on ne dispose pas encore suffisamment de
données scientifiques pour soutenir « mordicus »
cette dernière hypothèse.
Enfin, les principales rivières de cette
localité sont la « Mingoa » et le
« Biyeme » (Carte 3, infra).
Elles sont cependant très mal entretenues. Car, les déchets des
ménages sont le plus souvent déversés dans les cours
d'eau, et nous pouvons dire que cela augmente également les risques
d'inondations du quartier.
Pour ce qui est de la situation humaine, la
population de Melen 8 OM est cosmopolite. Aujourd'hui, ce quartier compte
d'après le recensement effectué par ERA-Cameroun dans le cadre du
Programme quartier, environ 6.052 habitants répartis dans 1.678
ménages inégalement répartis dans les cinq blocs. Le
nombre des ménages des quatre derniers blocs est plus important. Le
statut socioprofessionnel des populations est diversifié. Il va des
cadres de l'administration aux étudiants, en passant par les artisans,
les commerçants, les fonctionnaires de l'Armée, etc. Comme
à Melen 4, ce quartier regorge de locataires. Car plusieures
écoles supérieures se trouvent à la
périphérie. Cependant, le quartier Melen 8 OM n'a pas
d'établissements scolaires : les élèves (de la
maternelle, du primaire comme du secondaire) doivent se rendre à
l'école à la périphérie.
Melen 8 OM n'a pas non plus de structures sanitaires
publiques. La « SPERANDIO Maternity Clinic » qui s'y
trouve, est une clinique privée. Plusieurs « GIC
santé » permettent néanmoins, à plusieurs
habitants démunis, de se soigner. Mais ceux des habitants qui ont
quelques moyens peuvent se rendre à la périphérie
où l'on trouve soit le centre universitaire hospitalier soit, un peu
plus loin, l'hôpital d'arrondissement de Biyem-Assi. En outre, Melen 8 OM
abrite aussi sur son sol des infirmiers qui opèrent clandestinement en
clientèle privée.
En ce qui concerne les espaces et loisirs, il faut dire que
Melen 8 OM ne dispose pas de bibliothèques ni d'aires de jeux. Ce
quartier compte quand même, un vidéo club situé en
contrebas de l'agence de voyage « Patience Express », au
lieudit « carrefour Obili ». Il ouvre ses portes tous les
jours à dix heures et recrute ses clients particulièrement parmi
les enfants en âge scolaire. Beaucoup d'enfants manqueraient les classes
pour visionner les films dans ce vidéo club. Il convient de noter que
les films que l'on y présente sont plus ou moins critiqués par
les parents.
L'approvisionnement en eau demeure très insuffisant.
Puisque près de 31,29% de la population seulement sont connectés
au réseau SNEC ou CAMWATER. Plusieurs personnes achètent l'eau au
prix exorbitant de 25 Francs CFA les 10 litres. Par contre plus de 96% de
ménages s'éclairent au moyen de l'électricité. Cet
« exploit » est réalisé grâce à
la solidarité entre les habitants. Car les ménages qui disposent
d'un compteur AES-SONEL fournissent l'énergie aux populations
dépourvues de branchement. Mais les conditions de revente
d'énergie ne sont pas toujours connues du grand public. Elles
relèvent en effet des contractants. Notons que le reste des
ménages, soit 4%, s'éclaire à l'aide de la
lampe-tempête. Comme au bon vieux temps ! Mais en plein
XXIème Siècle. Avec ce que cela comporte en termes de
risques d'incendie et d'embrasement, notamment à cause de la
manipulation du pétrole lampant en pleine zone résidentielle.
En ce qui concerne l'habitat, les maisons situées dans
les bas fonds sont faites de « poto poto », et sont du
reste à moitié détruites. Elles manquent de s'effondrer
complètement parce que retenues pas des piquets. Toutefois, en bordure
de route, les maisons sont bien construites, ce qui contribue à rendre
les lieux plus accueillants.
Carte 3 : présentation du
quartier Melen 8 OM de Yaoundé
.
Sources : ERA-Cameroun, 2009,
Yaoundé
Quelles sont les principales activités des
différents quartiers du champ de notre analyse ? Par ailleurs,
leurs habitants entretiennent-ils des interrelations avec les localités
voisines ? Au-delà de tout, y aurait-il une sorte de dynamique ou
« d'effet territoire43(*) » ayant abouti à la prise en
charge de la nécessité du changement de leur milieu de vie par
les habitants eux-mêmes ?
SECTION 2 : ASPECTS SOCIOECONOMIQUES DE MELEN 4 ET
MELEN 8 OM
Avec la crise économique ambiante, la fonction publique
recrute peu. Raison pour laquelle plusieurs personnes s'auto-emploient, afin
de subvenir à leurs besoins de première
nécessité.
I- LES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MELEN 4
De nombreuses activités génératrices de
revenus s'exercent dans le quartier. Elles peuvent être regroupées
en deux catégories : Les activités commerciales et, les
activités artisanales.
1 - LES ACTIVITES COMMERCIALES
Le petit commerce est l'activité dominante dans le
quartier. On part de la vendeuse des beignets au petit boutiquier en passant
par la tenancière d'une gargote ou d'un call-box.
Généralement leur bureau ou entreprise n'est rien d'autre qu'une
petite tablette posée devant la cour ou en bordure d'une piste sur
laquelle, par ailleurs, ils exposent des produits de premiers
nécessité : piments, savons, tomates, pétrole, sucre,
cigarettes, pain huiles, etc. Il peut également s'agir d'un sac ou
plastique étalé à même le sol sans soin particulier
et sur lequel sont exposées les marchandises de toutes sortes telles les
vêtements, les chaussures... Les activités s'exercent de jour
comme de nuit. Certaines activités sont exercées par des femmes
d'autres par des hommes.
Les activités de femmes, par exemple,
comprennent entre autres :
- La vente des beignets avec la bouillie et le haricot.
Elle se fait généralement le matin ou le soir,
en particulier lorsqu'il ne fait pas chaud, les femmes préfèrent
le plus souvent les faire sur place, afin que les clients les mangent encore
chauds. Cependant il y a des enfants qui se baladent avec des seaux de beignets
sur la tête, ces enfants peuvent venir de partout.
- La vente des fruits
Elle se fait dans la journée. Les fruits
généralement exposés sont la banane mure, la pomme, les
oranges, la papaye, les avocats.
- Le poisson braisé
Certaines exercent cette activité, le jour d'autres la
nuit. Elles se placent généralement à coté des bars
ou autres endroits de forte concentration humaine afin d'accueillir beaucoup de
personnes venues se rafraîchir.
- La grillade de plantain, du macabo, du maïs et des
prunes
Ces femmes permettent à plusieurs individus de calmer
leur famine en attendant un repas plus lourd.
- La vente de la nourriture, etc.
En fait, il s'agit d'un ensemble de petits boulots ou petites
activités informelles et dont le but est d'assurer la survie de ceux qui
les pratiquent. Les activités ne permettent pas forcément une
accumulation, à proprement parler du capital, pouvant
générer ensuite le passage à une exploitation
« moderne »44(*).
Dans le quartier, on retrouve beaucoup d'étudiants.
Très souvent, ces derniers n'ont pas les moyens ni le temps de se faire
la cuisine. Ils se rabattent donc auprès de ces mamans pour se
nourrir. Ils ne sont cependant pas les seuls à s'approvisionner ainsi
auprès de ces vendeuses. Puisqu'en effet, même les clients des
bars voisins ont coutume de d'y servir.
Les activités des hommes sont
également nombreuses et permettent surtout, là encore, de
survivre. On y recense, entre autres fournitures de produits et
prestations comme :
-La viande braisée
Pendant que les femmes braisent le poisson, les hommes
braisent la viande de porc ou du poulet ou autres viandes encore. Leurs clients
viennent de partout et emportent souvent à domicile.
-La vente des médicaments (produits
pharmaceutiques)
Malgré le danger que l'on court en achetant les
remèdes en bordure de la route, ce commerce reste florissant, car les
populations sont démunies.
-La vente des produits de l'alimentation et de
quincaillerie porte sur tout.
Ceci concerne particulièrement les produits de
premières nécessités.
-La vente de boisson
Melen 4 est un quartier très brouillant dans la
soirée, raison pour laquelle les propriétaires des bars ne sont
jamais en repos...
2 - LES ACTIVITES ARTISANALES
Le quartier regorge en effet des artisans qui rendent des
services à la population. Parmi les prestations ainsi proposées
et métiers concernés, on peut citer :
- les coiffeurs : ils ont le devoir d'embellir les
habitants de la localité, et des localités environnantes,
- les tailleurs : ils sont des deux sexes, et permettent
aux uns et aux autres de s'habiller autrement qu'avec la friperie,
- les menuisiers : ce sont généralement les
hommes. Ils fabriquent, à partir du bois, de nombreux produits comme des
lits, des canapés, des chaises, des fauteuils, etc.
Mais, on y retrouve également :
- les cordonniers : ce sont encore des hommes. Ils
cousent les chaussures déchirées, fabriquent aussi d'autres
prêts-à-porter,
- les horlogers : ce sont ceux qui arrangent les montres
et les réveils,
- les mécaniciens : pour les réparations
automobiles et, parfois, des motos,
- les plombiers : ces derniers débloquent les
tuyaux d'eau permettant ainsi l'évacuation des eaux usées.
- les réparateurs d'appareils électro
ménagers : ceux-ci dépannent les appareils en panne,
permettant ainsi aux ménages d'acheter les appareils neufs plus tard
quand ils auront des moyens financiers.
- les tapissiers : travaillent dans le recouvrement des
chaises et la confection des tapis et autres mobiliers et objets divers,
- les établissements d'épargne et de
crédits : ce sont, généralement, des
coopératives qui permettent aux petits commerçants
d'épargner un peu d'argent pour les jours futurs, ou encore
- des stations services, etc.
La proximité de nombre de ces stations services
avec les habitations pose d'ailleurs, depuis peu, des problèmes
supplémentaires de pollutions (sonores, atmosphérique, etc.), et
qui aujourd'hui apparaissent aussi désormais comme une
problématique environnementale essentielle pour le cadre de vie des
habitants45(*).
De manière générale, tous ces artisans
recherchent la proximité de l'axe bitumé pour l'installation de
leurs activités. Mais les tailleurs, les coiffeurs femmes et hommes, les
plombiers, les cordonniers et les réparateurs d'appareil électro
ménagers exercent à l'intérieur du quartier. L'essentiel
ici est que leur atelier soit repérable grâce à une petite
plaque publicitaire. Notons, par ailleurs, qu'en l'absence de toutes
statistiques de la part de l'Institut National de la Statistique, il demeure
encore difficile d'estimer ou de connaître la part de ces
activités dans le produit intérieur de la ville de
Yaoundé, par exemple.
II- LES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MELEN 8 OM
Tout comme à Melen 4, celles-ci sont multiples et
permettent aux habitants de s'occuper soit dans le commerce, soit dans des
activités artisanales.
1 - LES ACTIVITES COMMERCIALES
Dépourvue de marché, La localité de Melen
8 OM est située à 4 km environ du marché Mokolo et
à, environ, 2 km du marché de Biyem-Assi. Ces deux marchés
sont les principaux points de ravitaillement des ménages de Melen 8 OM.
Cependant, on peut aussi se ravitailler au bord de la route pour le repas d'une
journée. Ces petits marché ne sont pas très
développés mais permettent néanmoins aux populations de
subvenir à certains besoins rapides. Ce sont : des bars - alimentations
; des pâtisseries, des boulangeries, des comptoirs de « bayam sellam
» ou revendeuses des vivres de première nécessité
(les tomates, les bananes-plantains, les légumes, le riz, les
condiments, la farine ; etc.). Ici, aussi il y a des activités pour
hommes et des activités pour femmes comme à Melen 446(*).
En plus de ces activités commerciales, on retrouve
aussi celles suscitées à Melen 4. Comme dans le quartier
précédemment étudié, par ailleurs, les
activités s'exercent de nuit comme de jour. Il est vrai qu'avec la
multitude de prostituées et autres dames et demoiselles de
« petite moralité » qu'on trouve à Melen 4,
le commerce des aliments tels que le poisson braisé, la viande
braisée, etc., demeure florissant dans le quartier. A Melen 8 OM, par
contre, c'est un autre genre de marché qui est plus prisé,
à savoir celui des chaussures. Des commerçants installent de
petites ampoules en bordure de route, et où ils proposent des souliers
de tous genres. Ce petit commerce de nuit s'installe un peu de partout dans le
quartier. La Communauté Urbaine de Yaoundé détruit
actuellement toutes les petites cases qui longent les trottoirs, dans le souci
d'une ville plus propre. Les commerçants en tous genres profitent donc
de la tombée de la nuit (et en l'absence des agents de la Mairie et
autres personnels des impôts) pour étaler leurs marchandises sur
les trottoirs.
2 - LES ACTIVITES ARTISANALES
Les activités artisanales dans cette localité ne
sont pas très développées. Il en existe néanmoins
quelques-unes en bordure des routes. Mais au vrai, Melen 8 OM n'en fourmille
cependant pas comme c'est le cas dans Melen 4. On peut retenir ici, entre
autres :
- des librairies tant formelles qu'informelles encore
appelées le « poteau ». Ici, on retrouve des livres et
documents, du neuf et de seconde main.
- des merceries : les habitants du quartier peuvent
s'approvisionner en boutons et en aiguilles de toutes sortes, ...pour
raccommoder les habits usagés,
- des quincailleries pour la vente des tôles et autres
produits de construction, etc.
Bref l'on peut y trouver pratiquement les mêmes
activités suscitées dans le cas de Melen 4. Même si, il est
vrai, elles ne sont pas aussi nombreuses et aussi développées
que leurs semblables de Melen 4.
Conclusion du troisième
chapitre
Le troisième chapitre de notre travail portait sur la
présentation socioéconomique de Melen 4 et Melen 8 OM. Cette
présentation nous a confirmé que dans ces quartiers de
Yaoundé, il y a beaucoup à faire pour faciliter la qualité
de vie des habitants. Il en ressort que, ces localités à habitat
spontané ont plusieurs problèmes tels que l'excès de boue
en saison des pluies, la géographie accidentée, la prostitution
ambiante, des problèmes d'alimentation en eau et
électricité, d'inondation, etc.
On peut donc aussi parler d'une sorte « d'effet
territoire », en ce sens que c'est, précisément,
l'existence de ces différents problèmes sur ces quartiers qui
conduit leurs habitants à « se retrousser les
manches » pour trouver des solutions et participer à
l'amélioration de leur propre cadre de vie. La crise économique
aidant, l'Etat ne peut en effet, à lui tout seul, s'occuper de ces
problèmes dans tous les quartiers du pays. Il convient, de ce fait, de
voir à présent l'apport des associations des quartiers, en
partenariat avec le tandem ERA-Cameroun/ISF d'Espagne, dans la lutte pour
l'amélioration du cadre de vie des populations concernées.
CHAPITRE 4 : L'ACTION DES ASSOCIATIONS EN FAVEUR
DU DEVELOPPEMENT DE MELEN 4 ET MELEN 8 OM
Introduction
Le développement a été longtemps
pensé par les institutions nationales et/ou internationales. Mais
aujourd'hui, avec le « développement local », les
populations à la base ont compris la nécessité pour elles
de se mettre en groupes, pour se prendre en main. Pour apprécier ceci,
nous avons fait une descente sur le terrain, afin d'aller à la rencontre
des associations et des habitants des deux quartiers. Nous avons
préparé un questionnaire pour les associations, et un autre pour
les habitants.
Comme méthodologie, nous avons utilisé la
méthode dite des « entrevues » en combinant les
variables qualitatives et quantitatives. Cette méthode consiste à
monter un questionnaire semi-ouvert et semi-fermé c'est-à-dire,
ayant des questions ouvertes et des questions fermées (voir
ANNEXES 1 et 2). Cette méthode permet à
l'enquêteur de faire en même temps un entretien, car il doit en
effet expliquer des questions. Ce qui lui permet de faire parler son
interlocuteur, et de recueillir les informations sur les interrogations sur
lesquelles l'enquêté aura été réticent. Le
questionnaire n'a été pour nous qu'un guide d'entretien.
L'analyse de ces données recueillies nous montre d'un côté,
les formes de participation et, de l'autre, l'appréciation de la
base.
SECTION 1 : LES FORMES DE PARTICIPATION DES
ASSOCIATIONS DE MELEN 4 ET MELEN 8 OM
Cette participation présente de nombreuses facettes.
Dans le cadre de notre travail, nous allons les grouper en deux formes
c'est-à-dire, la participation non monétaire et la participation
monétaire et financière.
I - LA PARTICIPATION NON MONETAIRE DES ASSOCIATIONS
La plupart de gens en sont encore à penser que le
développement se limite aux activités comme la construction des
routes, des ponts, des usines, des entreprises, etc. Dans cette optique aussi,
l'on balaie alors du revers de la main l'action sociale qui, pourtant,
encourage et sensibilise les populations et concerne aussi bien la
nécessité du changement des mentalités que des
réalisations précises.
1 - LA SENSIBILISATION DES POPULATIONS
L'implication des uns et des autres débute par la
sensibilisation, car c'est ici que l'on éduque les populations. Comme
l'observe Kamga (2008), le développement authentique est d'abord celui
de la personne, il est spirituel. La sensibilisation se fait de plusieurs
manières. Et on y relève, par exemple, la sensibilisation contre
divers fléaux ou contre des maladies de toutes sortes.
Pour ce qui est de la sensibilisation contre les
différents fléaux : les associations des jeunes ont
des objectifs précis comme, par exemple, lutter contre le grand
banditisme dans leur quartier et la prostitution des jeunes filles de la
localité. Ils font donc des séances d'éducation, pour
montrer aux uns et aux autres les méfaits de ces derniers dans la
société. Ils présentent à ces derniers les
dégâts causés par ces différents fléaux tels
que les maladies sexuellement transmissibles, la prison, etc.
En ce qui concerne la sensibilisation contre les
maladies de toutes sortes : en effet, la santé est un
aspect primordial de la vie, sans celle-ci, l'on ne peut rien faire. Les
associations sensibilisent aussi les parents contre les maladies facilement
évitables grâce à certaines règles pratiques. Des
actions sont donc entreprises pour éveiller la conscience des
populations sur les conséquences du manque d'hygiène de vie, de
l'environnement et de la mauvaise gestion de l'eau. Ceci est la
conséquence des maladies telles que : la diarrhée, le
paludisme, le choléra, etc. Pour les maladies liées à
l'eau sale, l'on présente aux populations les diverses attitudes et
manières permettant d'éviter ces maladies. De même qu'on
leur explique pourquoi éviter de boire telle ou telle eau,... Pour le
paludisme, des leçons sont données dans le sens de la
propreté, tout comme des plaques sont posées pour sensibiliser
(ANNEXE 3, photo n°10). Car les moustiques se
reproduisent, le plus souvent, quand il y a beaucoup d'herbes, d'où
l'importance des séances de travaux manuels dans le quartier,
d'où l'importance des latrines ventilées ou encore
améliorées, mais également la nécessité des
actions comme le curage d'eau (ANNEXE 3, photo n°11) etc.
Pendant un projet portant sur « La maîtrise da l'assainissement
dans un écosystème urbain et impacts sur la santé des
enfants âgés de moins de cinq ans », que met en oeuvre
le LESEAU47(*) dans le
bassin versant de la Mingoa à Yaoundé, l'on constate que
plusieurs pathologies et la prévalence des maladies suscitées
sont dues à l'eau de la consommation, aux aliments souillés, aux
mauvaises conditions d'hygiène et de salubrité et à
l'ignorance des populations qui ont peu de connaissances sur le mode de
transmission et de prévention des maladies, le cycle de l'eau et les
facteurs pouvant la détériorer. Nous voyons donc que cette
sensibilisation est indispensable pour le développement de la
localité, car seuls les hommes en santé peuvent oeuvrer.
Du côté de l'apprentissage des petits
métiers : dans les réunions des jeunes et des
femmes, l'on apprend souvent les petits métiers afin de contourner la
pauvreté et le manque d'emploi. Pour leur usage personnel ou commercial,
les femmes apprennent comment confectionner les savons, comment arranger les
jus naturelles, comment faire de la teinture, etc. Ainsi, certaines peuvent
nourrir leurs familles et aussi participer financièrement au
développement de la localité, grâce à ces
activités. D'autres peuvent finir par créer une PME, qui sortira
plusieurs personnes du chômage.
Enfin, on note aussi la sensibilisation pour la collecte de
fonds. En effet, avant une collecte de fonds, les chefs de blocs et le bureau
du CAD descendent sur le terrain, pour sensibiliser les populations et leur
montrer le bien-fondé des quêtes. Pendant ces descentes, les chefs
de blocs et le CAD font souvent du porte-à-porte, afin de conscientiser
le plus de personnes. Mais pour que ces personnes soient ouvertes au dialogue
avec les associations, il faut qu'elles participent à
l'élaboration des projets.
2 -L'ELABORATION DES PROJETS ET SUIVIS DIVERS
Un projet se fait en trois phases :
-l'expertise sociale et participative pour la conception et la
mise en oeuvre du projet,
-la réalisation et l'évaluation du projet,
-l'appropriation ultérieure qui garantie l'entretien et
la pérennisation du projet.
Premièrement, personne ne doit se sentir exclu du
projet. Dans nos deux quartiers, le projet se fait sous forme de consensus. Le
CAD discute avec les populations à la base à partir des
associations. Ensuite, il discute avec les partenaires qui sont ERA-Cameroun
et ISF d'Espagne. La deuxième phase, est la réalisation et
l'évaluation du projet. Après les collectes de fonds, les
populations attendent que les travaux soient faits. Le plus souvent, elles
participent même en amenant la main-d'oeuvre attendue. Le travail est
ensuite évalué pour déterminer si les attentes sont
comblées. Enfin, les populations une fois de plus, ont le devoir de
veiller sur la pérennisation du projet. Si un ouvrage n'est pas
entretenu, il se détériore, c'est pourquoi, les travaux faits
doivent être bien gardés pour que cela puisse durer.
Nous constatons donc qu'à tous les niveaux, tous les
acteurs du développement local, à Melen 4 et Melen 8 OM, sont
présents, afin que le projet réussisse. C'est ainsi qu'en ce qui
concerne les finances aussi, ils sont toujours ensemble.
II- LA PARTICIPATION MONETAIRE ET FINANCIERE
Les associations à la base peuvent participer
financièrement au développement local. Ceci se fait, le plus
souvent, par les cotisations des membres. Un compte est
généralement ouvert dans un établissement
financier48(*) au nom de
l'Association. Ce compte, différent de ceux du président et des
membres du bureau de l'Association, est la plupart du temps alimenté de
plusieurs manières.
1 - LES COTISATIONS DES POPULATIONS DU QUARTIER
A Melen 4 comme à Melen 8 OM, après la phase de
sensibilisation auprès des populations, il y a une phase de collecte de
fonds. Contrairement aux associations qui font des cotisations sous forme de
tontine et dont le bénéfice de la cagotte est rotative, les
cotisations sont faites ici pour le développement. Les cotisations sont
dont faites ici pour que le CAD, en partenariat avec les associations à
la base c'est-à-dire tous les habitants, le reverse ensuite à
ERA-Cameroun pour le développement de la localité.
Ici, chaque épargnant dépose à sa guise
un montant quelconque. Chaque personne donne ce qu'il peut et ce qu'il veut
à chaque séance. La collecte de fonds se fait en plusieurs
séances. Tous ces dépôts, du reste non remboursables,
seront effectués dans le compte du CAD. Les fonds recueillis sont
gérés dans la transparence pour le bien-être de tous. La
liste des personnes qui ont contribué est généralement
affichée sur un tableau public, afin que chaque habitant puisse faire
les comptes.
Pendant cette collecte de fonds qui se fait sous forme de
cotisations, tous les habitants du quartier sont conviés. Nous avons
assisté à une collecte de fonds à Melen 8 OM pendant nos
descentes sur le terrain. Elle se fait en plein air, éclairée par
la lune et quelques ampoules installées pour la circonstance. Les bancs
sont installés sur la piste. Le début des
cérémonies est fixé à 17 heures. Cependant, comme
on le dit en Afrique, 17 heures égales 19 heures voire, 20 heures.
Pendant l'attente des populations, le chef de bloc est en place, avec son micro
à la main. Il incite la population à venir à la
séance de réunion. Les populations arrivent à comptes
gouttes, mais arrivent quand même pour la collecte. Certaines personnes
occupées envoient des membres de leur famille pour les remplacer ou pour
verser directement leur participation. Elles reçoivent un reçu en
contre partie, ce qui prouve qu'elles ont participé
financièrement. Souvent, les parents cotisent et donnent même
l'occasion à leurs enfants de cotiser.
Les enfants qui reçoivent l'argent de poche le divisent
et, volontairement, ils participent aux travaux dans leur localité. Le
jour suivant la collecte, le chef de bloc ou le trésorier du bureau du
sous-CAD du bloc se rend à la chefferie, siège du CAD pour y
reverser les fonds recueillis en échange d'un reçu. Ces fonds
sont déposés par le CAD dans un compte ouvert pour la
circonstance. Ces séances se font de façon
répétée dans tous les blocs, pour que le quota du
quartier, qui est de 8 à 10%, soit respecté. Mais tout seul, il
ne peuvent atteindre ce quota. C'est pourquoi, ils font recours aux
aînés qui ont résidé dans le quartier, ou encore
à tous ceux qui y sont propriétaires fonciers ou bailleurs.
2 - LA PART DES ELITES
La plupart des habitants de ces quartiers ayant migré,
se sont toujours montrés généreux en ce qui concerne le
dévelopement de leur ancienne localité. Ils ont le plus souvent
envoyé de l'argent pour aider les familles restées sur place dont
le but est d'améliorer leur qualité de vie. Ces migrants,
considérés par les habitants restés comme des
élites, constituent des donateurs philanthropes, dont les parts de
financements assez importantes participent à l'amélioration des
conditions de vie des populations.
C'est ainsi que les aînés qui sont passés
dans l'association des jeunes dans ces quartiers sont toujours des membres
actifs du groupe, et surtout participent au financement des activités de
façon constante. Ils permettent de ce fait aux cadets restés au
quartier de résoudre les problèmes liés à la
jeunesse et, ainsi, améliorer la qualité de vie des uns et des
autres.
Nous avons aussi le soutien ou l'appui multiforme des
institutions publiques locales d'encadrement de la population, aux projets
réalisés dans les quartiers. Avant de réaliser un projet
dans ces quartiers d'investigations, le CAD écrit une lettre de demande
d'aide à la mairie d'arrondissement de Yaoundé VI, qui peut
répondre favorablement ou négativement. Dans chacune de ces
localités, la commune a déjà eu à participer
financièrement aux réalisations. A Melen 8 OM
particulièrement, il y a une piste totalement faite avec le concours de
la mairie. Elle porte le nom de la rue du Maire, en récompense à
leur don.
Parfois, l'on a aussi des dons de matériels et
matériaux offerts par les bonnes volontés habitant ou non le
quartier. Lorsque quelqu'un sait qu'il a un profit quelconque à tirer
d'un investissement dans le quartier, soit qu'il est propriétaire, soit
qu'il y a grandi, soit que ses parents y vivent, il participe volontairement au
développement local.
En bref, on observe donc une participation sollicitée
auprès de divers autres acteurs comme, par exemple :
- des bailleurs de fonds nationaux et internationaux, ou
encore,
- le soutien des opérateurs économiques aux
projets réalisés dans les quartiers, ou enfin,
- les dons de matériels et matériaux offerts par
les bonnes volontés habitant ou non le quartier,
- l'appui multiforme des institutions publiques locales
d'encadrement de la population (communes et autres),
Concrètement dans la suite de ce travail, nous allons
parler des réalisations et de leur amélioration dans la vie des
populations.
SECTION 2 : LES DIFFERENTES REALISATIONS ET
L'APPRECIATION DES POPULATIONS CONCERNEES
La participation de tous ces acteurs se vérifie sur le
terrain, par des réalisations concrètes. Seulement, ces
réalisations se concrétisent par une appréciation ou une
indifférence des bénéficiaires.
I - LA DIVERSITE DES REALISATIONS
A Melen 4 et Melen 8 OM, on décompte plusieurs
réalisations. Elles sont diversifiées et se retrouvent dans tous
les cadres.
1 - LE CAS DES REALISATIONS A MELEN 4
Les principales réalisations à Melen 4 sont les
latrines améliorées. Après le constat que les latrines
traditionnelles étaient sources de plusieurs maladies telles que les
diarrhées, à cause de la proximité de celles-ci avec les
puits d'eau, ou du paludisme à cause de l'abondance des mouches, il y a
eu nécessité d'apporter un changement. La différence entre
les latrines améliorées et les latrines traditionnelles est
énorme. Les latrines traditionnelles dégagent de mauvaises
odeurs, elles attirent les mouches, elles polluent la nappe souterraine,
etc...., alors que les latrines améliorées (encore
appelées latrines à doubles fosses) ne dégagent pas de
mauvaises odeurs, n'attirent pas les mouches, n'hébergent pas les
cafards et les petits rongeurs. Ceci, parce qu'elles sont ventilées et
ne condensent par l'air. Elles ne reçoivent pas d'eau, vu qu'un tuyau
sert à rejeter les eaux sales dans les caniveaux (eau de toilette et
autres). De plus, elles sont économiques pour la famille, car une
famille qui choisit une latrine améliorée peut la conserver
à vie si elle l'utilise dans les normes. Et ceci permet aussi au
ménage de stabiliser la latrine dans un coin de la parcelle
(voir ANNEXE 3 Photo 1).
Ensuite, nous avons la source « Tap-Tap ».
Celle-ci existait déjà depuis longtemps. Mais, elle
n'était ni construite, ni canalisée. Avec l'appui de
« ERA-Cameroun » et des associations, elle est aujourd'hui
bien canalisée et coule de façon ininterrompue pendant toute la
journée. Malgré le fait qu'une inscription interdise la
consommation de cette eau, elle sert à désaltérer
certaines personnes démunies (voir ANNEXE 3 Photo 2)
Nous avons aussi les chemins piétons
bétonnés. Ils sont étroits, car les maisons sont trop
serrées, mais ils desservent quand même le quartier, et permettent
aux uns et aux autres de sortir sans se faire salir par la boue. Des caniveaux,
construits à côté des passages piétons, permettent
en effet l'écoulement des eaux usées (voir ANNEXE 3 Photo
3). Pour bien présenter ces réalisations à Melen
4, voici une carte représentative des réalisations sur le terrain
(carte n°3).
Carte n° 3 : Représentation
schématique des réalisations des acteurs locaux à Melen
4
Sources : Era-Cameroun, 2009,
Yaoundé
2 - LES REALISATIONS EFFECTUEES A MELEN 8 OM
Les réalisations faites à Melen 8 OM sont
beaucoup plus nombreuses. Elles partent des pistes aux ponts, en passant par
l'adressage des maisons.
- La piste « Poulet » est la
première entrée de Melen 8 OM (voir ANNEXE 3, photo
4), lorsque nous partons du carrefour Biyem-assi. Elle est
rechargée et compactée sur 286 mètres. Elle se termine par
un pont qui facilite la traversée de la rivière Biyeme. Ce pont
mesure 5 mètres de portée et 4 mètres de large (voir
ANNEXE 3, photo 5). De part et d'autre de la piste, des
caniveaux en béton armé assurent l'écoulement des eaux.
- La piste « Major » est la seconde
entrée et est, rechargée, compactée, et pavée de
pierres maçonnées, sa longueur est de 342 mètres (voir
ANNEXE 3, photo 6). Elle se termine par un pont sur la
rivière Biyeme, suivi d'une plate forme faite en pavée de pierre
(voir ANNEXE 3, photo 7).
- La piste « Mvé », se situe
juste au carrefour Obili, et sépare le quartier Melen 8 OM de la garde
présidentielle. Elle est pavée de pierres
maçonnées, son emprise moyenne est de 6 mètres et sa
longueur est de 265 mètres. De part et d'autres aussi, il y a les
caniveaux en pierres maçonnées (voir ANNEXE 3, photo
8). Elle se termine par un petit pont (voir ANNEXE 3, photo
9).
En dehors de ces ouvrages, nous avons l'adressage du quartier,
permettant d'identifier chaque maison par un numéro.
Les réalisations effectuées à Melen 8 OM
sont représentées ci-après (Carte
n°4)
Carte n°4 : Les différentes
réalisations des acteurs locaux à Melen 8 OM :
Sources : Era-Cameroun, 2009,
Yaoundé
II-L'APPRECIATION DES POPULATIONS CONCERNEES
On distingue généralement deux types d'attitudes
de la part de la population concernée, face aux réalisations
effectuées et dont elles doivent en principe pouvoir en
bénéficier. Il s'agit d'une part, des réactions positives
(ou d'approbation) et, d'autre part d'un sentiment d'indifférence. Ce
dernier sentiment peut d'ailleurs amener à se questionner, dès
lors qu'il s'agit pourtant des réalisations qui, au préalable,
avaient été initiées par ces mêmes populations.
1 - LES REACTIONS POSITIVES
Plusieurs personnes apprécient les travaux
réalisés dans leur quartier. Ces personnes sont principalement
des propriétaires qui participent à tous le processus dès
l'élaboration du projet, au suivi après réalisations. Ces
habitants trouvent que les réalisations effectuées par l'appui
des associations améliorent leur qualité de vie et participent au
bien-être de tous. Pour eux, l'on peut désormais sortir de la
maison sans problème quelque soit la saison, car il n'y a plus de boue.
Ces gens sont contents de pouvoir conduire leurs malades dans les
hôpitaux de la périphérie, avec plus de facilités,
car les voitures peuvent venir en urgence les chercher à domicile (Melen
8 OM).
Aussi dans les quartiers, il y a moins de maladies. Ce qui
permet aux uns et aux autres de faire un peu d'économie et de rallonger
leur espérance de vie. Les latrines améliorées et la
réfection de la source « Tap-Tap » sont d'un
très grand appui pour toute la population, ceci parce que les maladies
causées par l'eau deviennent de plus en plus rares. En plus, avec le
projet AQUA, plusieurs ménages qui ont contribué,
bénéficieront des bornes-fontaines à domicile. Les
habitants se réjouissent car pour les moins nantis, les bornes-fontaines
publiques seront installées, avec la participation de
« ERA-Cameroun », des CAD et d'autres partenaires.
En ce qui concerne les ordures ménagères,
plusieurs ménages sont contents de l'opportunité que leur donnent
les associations de vider leur poubelle. Car, la modique somme perçue
n'est qu'une contribution de ceux-ci pour un quartier propre, et les
populations en sont conscientes. Nous ne pouvons pas oublier la joie de
celles-ci, par rapport à la diminution des inondations. Car, avec le
curage d'eau, plusieurs maisons sont à l'abri (voir ANNEXE 3
photo 11).
L'adressage des maisons réjouit aussi les populations,
parce que les visiteurs peuvent retrouver la maison, uniquement avec le
numéro qui y est indiqué. En somme, il y a beaucoup de motifs de
réjouissances, de la part des populations bénéficiaires,
des réalisations mais certaines personnes réussissent quand
même, à être indifférentes. Il faut dire, dans ce cas
d'ailleurs aussi, qu'il s'agit de ceux qui ne voudraient aucunement
financièrement participer aux projets locaux.
2 - l'INDIFFERENCE D'UNE CERTAINE PARTIE DE LA
POPULATION
Pour confirmer la règle qui voudrait qu'il y ait
toujours des mécontents, ou encore des indifférents, certaines
personnes (surtout les locataires qui ne voudraient pas financièrement
participer aux programmes locaux) dans nos quartiers ciblés, trouvent
qu'ils n'ont rien à faire des travaux effectués dans le quartier.
Après 13 ans dans la localité, quelqu'un déclare :
« ça ne me concerne pas », ceci tout simplement
parce qu'il est un locataire. Certes, la population à la base participe
de manière philanthropique au projet dès son élaboration.
Mais à ce niveau déjà, certains locataires sont
indifférents. Ceci nous montre que ces locataires ne peuvent être
comptés parmi les philanthropes, parce qu'ils ne font rien pour rien.
Ils calculent tous les contours de leur don.
Ces derniers ne participent pas le plus souvent car,
disent-ils, ils sont des « passants » dans la
localité, et peuvent d'un moment à l'autre s'installer ailleurs.
Ils estiment donc ne pas devoir participer au développement, partout
où ils s'installent. Rien ne les attache au quartier.
Conclusion du chapitre quatre
Dans ce chapitre, il était question de l'action
philanthropique des associations de Melen 4 et Melen 8 OM. Nous avons
présenté les différentes formes de participation, que les
divers acteurs du développement local dans nos localités
ciblées mettent sur pied pour mener à bien le changement dans le
quartier. Ensuite, nous avons montré que certaines populations se
réjouissent de leurs efforts partagés et d'autres s'en moquent.
Néanmoins , tout au long de cette analyse, nous avons compris que,
le développement local dans les quartiers se présente comme une
oeuvre lente, mais une oeuvre positive qui fait penser à un
développement durable, une oeuvre qui allie la modicité des
moyens aux aspirations légitimes, grandioses, mais non
démesurées des populations.
Conclusion de la deuxième partie
Cette partie nous a montré les contributions
philanthropiques des associations au développement local de Melen 4 et
Melen 8 OM.
Nous sommes parties, des données
socio-économiques de ces localités pour cerner les
différents problèmes de ces quartiers. Cette présentation
nous a permis de constater que, les quartiers spontanés de la ville de
Yaoundé sont des quartiers à problèmes. Ici, les
constructions sont anarchiques, d'où la nécessité pour les
différents acteurs (populations des quartiers, associations,
collectivités territoriales, Etat) de s'organiser pour son
développement.
Nous avons présenté dans cette partie les
différentes formes de participation, qu'emploient les populations
regroupées en associations pour le développement des leurs
quartiers. Les différentes réalisations déjà
effectuées dans ces localités pour le bien-être des
habitants, aussi appréciées par les uns et les autres, sont
présentées sur des photos en annexes.
Il était question dans ce travail de montrer la
relation entre la philanthropie et le développement local. Nous avons en
particulier montré l'action philanthropique des associations de Melen 4
et Melen 8 OM, deux quartiers de l'arrondissement de Yaoundé VI au
Cameroun, à leur développement.
Pour cela, la question majeure de notre travail était
celle de savoir si les populations regroupées en associations oeuvrent
spontanément et de façon volontaire à
l'amélioration de la qualité de vie dans leurs quartiers. cette
question a trouvé une réponse dans l'analyse de la participation
de ces dernières dans l'amélioration des conditions de vie des
populations résidentes. En effet, avec la crise économique et la
fin du fordisme, l'Etat n'est plus capable d'oeuvrer au développement de
toutes les localités du pays, d'où l'émergence des
comportements charitables, altruistes, philanthropiques, volontaires des
populations que l'on retrouve au sein des associations de développement
local.
Nous nous sommes inspirés de la littérature
existante sur le sujet (ouvrages, articles, rapports, mémoires, lois,
journaux, etc.), du cadre juridique et des principes d'administration des
organisations de la société civile. Sur le plan de la recherche,
un certain nombre de travaux scientifiques nous a permis d'avoir quelques
pistes d'orientation. Nos multiples descentes sur le terrain (avec deux
questionnaires) nous ont permis de comprendre le lien entre la philanthropie et
le développement local.
Ce travail est organisé autour de deux grandes parties
composées chacune de deux chapitres. La première partie
intitulée la philanthropie des organismes à but non lucratif et
le développement local nous a plongé dans la philanthropie et le
développement local, dès leurs racines originelles jusqu'à
nos jours. Surtout nous avons présenté le lien indispensable qui
se trouve entre ces deux concepts et donc le seul but est l'amélioration
des conditions de vie des populations. La deuxième partie,
intitulée l'action philanthropique des associations locales pour le
développement des quartiers Melen 4 et Melen 8 OM a permis de montrer
l'apport des populations regroupées en associations au
développement dans ces localités. Nous avons pour cela
apprécié leur sens de charité, philanthropique, de
partenariat et de participation volontaire dont la seule contrepartie est
l'amélioration des conditions et de la qualité de vie.
Au vu des nombreuses réalisations (les ponts, les
pistes carrossables, les chemins piétons bétonnés, les
caniveaux, les latrines améliorées, les points d'eau)
effectuées dans ces différents quartiers, la philanthropie des
populations regroupées en associations est quasi importante pour le
développement local. L'Etat n'étant plus le seul acteur de
développement ; il n'est plus en mesure de financer toutes ces
réalisations et de s'occuper de l'amélioration de la
qualité de vie de ces populations.
Dans la conduite de ce travail, nous avons connu quelques
difficultés :
- Difficultés de rencontrer les leaders des
associations qui n'étaient pas toujours accessibles malgré les
rendez-vous fermes obtenus.
- Difficultés d'interroger les populations qui nous
suspectent toujours d'espions, pensant que nous sommes envoyées par la
Communauté Urbaine.
Ainsi donc, il en ressort après cette étude que,
la philanthropie, acte d'échanger, de donner, de recevoir, de l'argent,
du temps, etc. reste « encastrée » dans la culture
des associations des quartiers Melen 4 et Melen 8 OM. A travers les actes
altruistes et de charité, les associations des quartiers Melen 4 et
Melen 8 OM contribuent à développer leur localité en
participant à la construction des ouvrages.
1-OUVRAGES ET ACTES DE
COLLOQUES
Actes de la Journée Annuelle de l'O.S.C
(Juillet 2004) : Projet d'appui aux Organisations de la
société civile au Cameroun (Pro-OSC), 1ére édition,
Yaoundé.
Actes de colloque (2005) :
Séminaire International Villes et territoires (SiViT),
Mutations et enjeux actuels, PUVIT, Sétif.
Albou P. (1984) : Les psychologues
économiques, PUF, Paris.
Courlet C. (2007) (sous la dir.
de) : Territoire et développement économique au
Maroc : le cas des systèmes productifs localisés, Ed.
L'Harmattan, Paris.
Emerson Andrews F. (1967) : cité
par Weaver W. (1967) : U.S.
Philanthropic Foundations - Their History, Structure, Management and
Record (Les fondations philanthropiques aux
Etats-Unis - Histoire, structure, gestion et palmarès), New York.
Infra.
Essombè Edimo J.R. (1995) : Quel
avenir pour l'Afrique?...., Ed ? Silex/Nouvelles du Sud, Paris
Essombè Edimo J.R. (2007b) :
Spatialité et développement économique à
Douala : entre le hasard et la nécessité, L'Harmattan,
Paris.
Gouttebel J.Y. (2001) :
Stratégie de développement territorial, Economica,
Paris.
Greffe X. (1984) :
Territoires en France, les enjeux économiques de la
décentralisation, Economica, Paris.
Greffe X. (1988) :
Décentraliser pour l'emploi, les initiatives locales de
développement, Economica, Paris.
La Bible : Genèse 28:22;
Deutéronome 14:28-29 et 26:12f.
LIN N. (2001) Building a theory of
social capital, dans N. LIN, K.S. Cook et R.S. Burt (eds) : «Social
capital, theory and research, Eds. Paperback.
Marshal A. (1890): Principles of
economics, Trad. Française de la 4ème édition, 1871,
LGDJ, Paris.
Meillassoux J.C. (1975) :
Anthropologie des sociétés africaines
précapitalistes, Ed. Ouvrières, Paris.
Nihan G. E. Demol et Bodo Tabi (1979) :
Le secteur non- structuré moderne de Yaoundé, OIT,
Genève.
Tsafack Nanfosso R.A. (Sous
la direction de) (2007) : L'Economie Solidaire dans
les pays en voie de développement, Edition Harmattan, Paris.
Pecqueur B. (1992) : Le
développement local, Syros, Alternatives, Paris.
Pecqueur B. et J.B. Zimmerman (2004) :
Economie de proximités, Ed. Hermès, Paris
Plewes B. (Préparé par)
(2008) : La philanthropie mondiale et la
coopération internationale, Guide des tendances et enjeux, Pour le
conseil canadien pour la coopération internationale.
Porter M. E. (2004) : La
concurrence selon Porter, Village Mondial, Paris.
Prévost P.
(1993) : Entrepreneurship et développement
local: quand la population se prend en main, Ed. Transcontinentales inc.
Proulx M.A. (sous la direction de)
(1998) : Territoire et Développement
Économique, Harmattan.
Smith A. (1776) :
Recherches sur les causes de la richesse des Nations,
Gallimard, Paris
UICN (1980) : la stratégie
mondiale de protection de l'environnement, Gland, Suisse.
Weaver W. (1967) :
U.S. Philanthropic Foundations - Their History, Structure, Management and
Record (Les fondations philanthropiques aux
Etats-Unis - Histoire, structure, gestion et palmarès), New
York.
2- ARTICLES
Angéon V. et J.M. Callois (2005) :
« Fondements théoriques du développement local
: quels apports du capital social et de l'économie de
proximité ? », in Revue Economie et Institutions, n°
6 et 7, Second Semestre.
Bellet M. et al. (1993) :
« Economie des proximités », in R.E.R.U.,
n° Spécial, n° 3,
Bouman F.J.A. (1979) : « The
ROsCA ; financial technology of an informal savings and credit institution
in developing countries », dans Revue Savings and Development,
n°4.
Dupuis J.P. (1998) :
« Le Rôle des Acteurs Locaux et Régionaux dans la
Construction du modèle québécois de Développement
Économique », in Proulx M.A. (sous la
direction de) Territoire et Développement Économique,
Harmattan. p. 129-142.
Essombè Edimo J.R.
(2005a) : « Le développement
territorialisé à Douala : le projet de création des
« jardins d'entreprises », étude d'expertise, CUD,
sept.
Essombè Edimo J.R.
(2005b) : « Le développement
territorialisé à Douala : fondements et modalités
institutionnelles d'une dynamique nouvelle », in Monde en
développement, n° 130, vol.33.
Essombè Edimo J.R. (2007a) :
« Localisation des entreprises industrielles et création de
nouvelles centralités à Douala », dans la Revue Monde
en développement, n° 137, vol.35-2007/1.
Favreau L. et Saucier C.
(1996) : « Economie sociale et développement
économique communautaire : de nouvelles réponses à la
crise économique de l'emploi, Economie et
solidarités », vol 28, no 1, p. 5-19, PUQ.
Fondo S. and G. Tchouassi
(2007): « Diaspora Remittances and the Financing of
Basic Social Services and Infrastructure in Francophone Africa South of the
Sahara », in Rubin Patterson, (ed), African brain circulation: beyond
the drain-gain debate, Leiden, Boston: Brill.
Moe H. A. (1961):
« Notes on the Origin of Philanthropy in Christendom »,
Proceedings of the American Philosophical Society.
Pecqueur B. (2007) :
« L'économie territoriale : une autre analyse de la
globalisation », in Revue l'Economie Politique, n° 33.
Nihan G. (1980) : « Le secteur
non-structuré moderne : signification, aire d'extension du concept
et application expérimentale », in Revue Tiers-Monde, n°
82, avril-juin.
Tamba I. (2004) :
« La société civile : Des débats
théoriques aux enjeux socio politiques et
économiques », in Actes, Journée annuelle de
l'O.S.C. (JANOSC), CREDDA, Pages 53-66.
Tchouassi G. (2004) :
« Mécanismes et stratégies de financement des actions
en faveur des individus, des groupes d'individus ou des municipalités
urbaines dans les domaines suivants : logements urbains, accès aux
services urbains de base, protection des groupes vulnérables en milieu
urbain, activités génératrices de revenu en milieu
urbain », Rapport d'expertise, Environnement, Recherche - Action
(ERA), Yaoundé, 19 pages.
Tchouassi, G. (2005) :
« Opportunités et contraintes actuelles des sources de
financement des projets urbains au Cameroun », in Séminaire
international Villes et territoires (SiViT) : Mutations et enjeux
actuels, PUVIT, Sétif, Pages 26-32.
Tchouassi G. (2007) :
« L'entrepreneuriat social et solidaire : cas du
commerce équitables entre le Nord et le Sud », in Tsafack
Nanfosso R. A. L'Economie Solidaire dans les pays en voie de
développement, Edition Harmattan, Paris, Pages 61-84.
Tsafack Nanfosso R. A. (2007) :
« La culture africaine et l'économie sociale et
solidaire », in Tsafack Nanfosso R. A. L'Economie Solidaire dans
les pays en voie de développement, Edition Harmattan, Paris, Pages
37-60.
Tsafack Nanfosso R. A. et Tchouassi G.
(2009) : « De la marginalisation économique de
l'Afrique », in L'Afrique dans un monde en mutation, (sous
presse).
3-MEMOIRES ET THESES
Etoundi L. P. (2008) : Participation
des habitants et développement des quartiers à habitat
spontané : Le cas de la commune d'arrondissement de Yaoundé
VI, Mémoire de DESS en Gestion urbaine, Université de
Yaoundé II.
Feugang N. (2008) :
Proximité des activités et des zones d'habitation : cas
des stations service dans l'arrondissement de Yaoundé VI,
Mémoire de DESS « gestion Urbaine », Yaoundé
II-Soa.
Kamga Kamga Ch. C. (2008) :
L'Ethique du développement dans « De la
médiocrité en excellence d'Ebenezer Njoh-Mouelle »,
Mémoire de maîtrise en philosophie.
Ngadjou D. (2007) : Les foyers
communautaires dans la ville de Yaoundé et le développement
périurbain, Mémoire de DESS et MASTER II en Evaluation des
projets.
4-DOSSIERS ET RAPPORTS
- CCCI (2008) : La Philanthropie Mondiale et la
coopération internationale, guide des tendances et enjeux pour le
conseil canadien pour la coopération internationale, Décembre
.
-CREDDA (2004) : Créer et Administrer une OSC au
Cameroun, cadre juridique et principes d'administration.
- OCDE (1990) : Réussir le changement :
Entrepreneuriat et initiatives locales, Organisation de coopération et
de développement économiques, Paris.
- OCDE (2003) : Fondations Philanthropiques et
coopération pour le développement, dossiers du comité
d'aide au développement, Organisation de Coopération et de
Développement économiques.
5- JOURNAUX DE VULGARISATIONS DES ACTIVITES DES
ASSOCIATIONS
- Alliance Magazine.
- Démarche méthodologique pour la planification
locale, SNV, 2000
- Le guide des relations entre les institutions et les
organisations de développement local rédigé par ERA
Cameroun
- La gazette du quartier, L'authentique du
développement local, ERA Cameroun / ISF d'Espagne, N° 11, 12, 13,
etc.
- Revue Agridoc n°1, juillet 2001
6- LOIS ET REGLEMENTS
- La loi n°2004/17 du 22 juillet 2004 portant relative
à l'orientation de la décentralisation au Cameroun.
- La loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les
règles de la décentralisation applicables aux communes,
- La loi n° 99/014 du 22 décembre 1999 relatives
aux Organisations Non Gouvernementales,
- La loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution du 2 juin 1972,
- La loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant
liberté d'association au Cameroun,
- La loi n° 77/495 du 7 décembre 1977 fixant les
conditions de création et fonctionnement des oeuvres sociales
privées,
- Décret n° 98/263/PM du 12 août 1998
portant système de répartition des centimes additionnels
communaux,
- Décret n°93/321 du 25 Novembre 1993 portant
réorganisation administrative de la communauté urbaine de
Yaoundé.
7- ETUDES ET PROGRAMMES
- Monographie de Melen 4 (ERA-Cameroun)
- Monographie de Melen 8 Onana Meuble (ERA-Cameroun).
- Plan d'actions prioritaires de Yaoundé VI.
-Programme quartier (ERA-Cameroun)
-Projet AQUA (ERA-Cameroun)
- Projet de La maîtrise da l'assainissement dans un
écosystème urbain et impacts sur la santé des enfants
âgés de moins de cinq ans », dans le bassin versant de
la Mingoa à Yaoundé (LESEAU, Polytechnique)
8-WEBOGRAPHIE
http://www.justanotheremperor.org/edwards_WEB.pdf
http://
www.unification /net/ws/theme141htm
http://www.alliancemagazine.org/node/967
http://causeglobal.blogspot.com/
www.akdn.org/agency/philanthropy/ingphilHHADD.htm
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2004_Nov_10/ai_n6340602
www.prosport69.com/documents/foire_aux_questions/le_volontariat.pdf
fr.wikipedia.org/wiki/Bénévolat
http://fr.wikipedia.org/wiki/D(c)veloppement_local
www.chru-lille.fr/assochru/associations/Definitions/65701.shtml -
21k
ANNEXE 1 :
QUESTIONNAIRE PORTANT SUR LA PHILANTHROPIE ET LE
DEVELOPPEMENT LOCAL A YAOUNDE : CAS DES QUARTIERS DE MELEN 4 ET MELEN 8
ONANA MEUBLE
Réservé aux associations
La philanthropie est un acte moral, celui de donner, de
partager sans contrepartie et de façon
désintéressée. L'on peut donner, sans contreparties, de
son temps, de son expérience, de son expertise, de sa personne, ou
encore de son argent.
Le développement local porte sur l'amélioration
des conditions de vie des populations dans la localité.
Ce questionnaire est confectionné pour les membres des
associations et des comités d'animation au développement des
quartiers retenus.
I - IDENTIFICATION DE L'ASSOCIATION
* Nom de
l'association :............................................................................................
* Date de création de l'association :
..................................................................
* Quelle est la structure de votre association ?
(composition du bureau).......................
.............................................................................................................
* Association légalisée : Oui
Non
* Membre du bureau :
Oui
Non
* Membre actif : Oui
Non
* Genre : Féminin
Masculin
* Age : 20-25 ans ; 25-30 ans ;
30-35 ; 35-40 ; 40-45 ; 45-50 ;
50 et plus.
*Nombre de membres ou d'adhérants de
l'association :
Hommes...............................................................
Femmes...............................................................
II - VIE DE L'ASSOCIATION
*Quelle est la procédure d'adhésion à
l'association.............................................
...........................................................................................................
*Quels sont les objectifs de
l'association ?.........................................................
............................................................................................................
* Combien de fois vous réunissez-vous ?
Une fois par mois
Deux fois par mois
Plus de deux fois par mois
* Les membres font-ils : du
volontariat
du bénévolat
reçoivent-ils un revenu
* Vous considérez vous comme une association
philanthropique ?
Oui
Non
*Si oui
pourquoi...........................................................................................
*Si non
pourquoi ?...................................................................................................................
*Entretenez-vous des relations avec d'autres
associations ?
Oui
Non
Si oui
lesquelles......................................................................................
..........................................................................................................
III - ASSOCIATION ET DEVELOPPEMENT
LOCAL
* Quelles sont vos actions concrètes sur le
terrain ?...............................................................
.............................................................................................................
*Faites-vous des propositions de projets ? Donnez
quelques exemples.........................
............................................................................................................
............................................................................................................
*Quels sont les difficultés rencontrées .sur le
terrain ?...........................................
...........................................................................................................
* Comment est géré l'aspect
financier ?...............................................................................
.............................................................................................................
* Participez-vous au financement de vos actions ? De
quelle manière ?.............................
.............................................................................................................
* Avez-vous d'autres sources de financement ? (Citez
quelques unes)................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
*Quels sont les motifs de vos
interventions ?........................................................................
............................................................................................................
..........................................................................................................
* Donner quelques exemples de vos réalisations sur le
terrain ..................................
..............................................................................................................
*Quelle est la population cible de votre
intervention ?.........................................................
.................................................................................................................................................
* Participez-vous réellement à
l'amélioration des conditions de vie ou au développement de votre
localité ?
Oui
Non
* Pensez-vous que votre intervention dans les quartiers
améliore la qualité de vie des populations ? (donner des
explications).............................................................
............................................................................................................
Nous vous remercions pour votre compréhension et
pour votre disponibilité !!!
ANNEXE 2 :
QUESTIONNAIRE PORTANT SUR LA PHILANTHROPIE ET LE
DEVELOPPEMENT LOCAL A YAOUNDE : CAS DES QUARTIERS DE MELEN 4 ET MELEN 8
ONANA MEUBLE
Réservé aux populations
La philanthropie est un acte moral, celui de donner, de
partager sans contrepartie et de façon
désintéressée. L'on peut donner, sans contreparties, de
son temps, de son expérience, de son expertise, de sa personne, ou
encore de son argent.
Le développement local porte sur l'amélioration
des conditions de vie des populations dans la localité.
Ce questionnaire est confectionné pour les populations
des quartiers précités afin d'apprécier leur jugement et
leur participation dans les actions menées dans leur localité.
I - IDENTIFICATION
*Nom du
quartier..........................................................................................
* Genre : Féminin
Masculin
* Age : 20-25 ; 25-30 ans ;
30-35 ; 35-40 ; 40-45 ; 45-50 ;
50 et plus.
*situation familiale : Marié
Célibataire
*Etes-vous propriétaire
locataire
*Depuis combien d'années vivez-vous dans ce
quartier ?....................................................
II - POPULATION ET DEVELOPPEMENT
LOCAL
*Comment se passe le développement local dans votre
localité ?.......................................
...........................................................................................................
*Participez- vous au développement de votre
quartier ?........................................
Si oui de quelle
manière ?.........................................................................
............................................................................................................
Si non
pourquoi ?......................................................................................
*Que pensez-vous des associations et du CAD de votre
quartier ?..............................
..........................................................................................................
............................................................................................................
*Mènent-ils des actions pour le développement du
quartier ?...................................
Si oui,
lesquelles ?.....................................................................................
........................................................................................................
*Comment trouvez-vous les actions menées sur le
terrain : sont-elles bien réalisées ?.....
.........................................................................................................
.........................................................................................................
*Pensez-vous que ces réalisations améliorent votre
qualité de vie ? Expliquez-vous ....
.........................................................................................................
.........................................................................................................
*Votre quartier est-il de plus en plus propre et
accessible ?...................................
Nous vous remercions pour votre compréhension et
pour votre disponibilité !!!
TABLE DES MATIERES
Sommaire......................................................................................iii
Dédicace.......................................................................................V
Remerciements...............................................................................Vi
Liste des
abréviations......................................................................Vii
Liste des cartes, des schémas et
tableaux................................................Viii
Avant
propos..................................................................................iX
Résumé.........................................................................................X
Abstract........................................................................................Xi
Introduction
générale.........................................................................1
PREMIERE PARTIE : La philanthropie des organismes
à but non lucratif et le développement
local.........................................................................13
Chapitre 1 : La philanthropie des Organismes
à but non lucratif.................15
Introduction...................................................................................15
Section 1 : Les sources de la
philanthropie.............................................15
I- Historique de la
philanthropie .........................................................15
1 - Les origines religieuses de la
philanthropie........................................16
2 - Les origines Laïques de la
philanthropie...........................................18
II- Défis et
caractéristiques majeurs de la
philanthropie...........................20
1 - Les multiples défis de la
philanthropie..............................................20
2 - Les caractéristiques de l'oeuvre
philanthropique.................................23
Section 2 : Typologie des organismes à but
non lucratif et leurs moyens
d'actions.......................................................................................25
I- Les organisations de la société
civile...................................................26
1 - Le cas des
fondations....................................................................26
2 - Les associations et les organisations non
gouvernementales...................27
II- Les mécanismes de financement mis en oeuvre
sur le terrain...................30
1 - Le financement des
activités...........................................................30
2- Les contributions des populations
...................................................32
Conclusion du premier
chapitre..........................................................33
Chapitre 2 : Les différentes approches
du développement
local .............................................................................................34
Introduction...................................................................................34
Section 1 : Le développement local, un
phénomène émergent .....................35
I -L'émergence du développement
local................................................35
1 - Conditions de l'émergence du
développement local..............................36
2 - Les caractéristiques du
développement local ..................................37
II - Le développement local, une dynamique
initiée par des acteurs locaux ....39
1- L'entrepreneur : un acteur du
développement local..............................39
2- Les collectivités
locales..................................................................41
Section 2 : Le développement local
à Melen 4 et Melen 8 OM......................44
I - Les conditions d'un développement local
approprié..............................44
1- La notion du
partenariat...............................................................45
2- Le concept de la
participation.........................................................46
II- Les différents acteurs du
développement local à Melen 4 et Melen 8 OM...47
1 - L'action du tandem « ERA-Cameroun/ISF
d'Espagne »........................48
2 - Les associations de Melen 4 et Melen 8
OM.......................................49
Conclusion du deuxième
chapitre........................................................56
Conclusion de la première
partie.........................................................56
DEUXIEME PARTIE : L'ACTION PHILANTHROPIQUE DES
ASSOCIATIONS AU DEVELOPPEMENT DE MELEN 4 ET MELEN 8
OM.............................................................................................58
Introduction de la deuxième
partie.......................................................59
Chapitre 3 : Présentation
socio-économique de Melen 4 et de Melen 8 OM.....60
Section 1 : Caractéristiques physiques et
démographiques de Melen 4 et Melen 8 OM
...........................................................................................60
Introduction...................................................................................60
I- Le quartier de Melen
4..................................................................60
1 - De « la route des palmiers »
à Melen 4..............................................60
2 - Situation démographique et
humaine...............................................61
II- Présentation de Melen 8
OM...........................................................66
1 - Bref aperçu de l'origine du
quartier.................................................66
2 - Situation géographique et
humaine...................................................67
Section 2 : Aspects socio-économiques de
Melen 4 et Melen 8 OM................71
I - Les activités économiques de Melen
4...............................................71
1 - Les activités
commerciales.............................................................71
2 - Les activités
artisanales.................................................................72
II - Les activités économiques de Melen
8 OM.........................................74
1 - Les activités
commerciales.............................................................74
2 - Les activités
artisanales.................................................................75
Conclusion du troisième
chapitre.........................................................75
Chapitre 4 : L'action des associations en faveur
du développement de Melen 4 et de Melen 8
OM...............................................................................76
Introduction...................................................................................76
Section 1 : Les formes de participations des
associations de Melen 4 et Melen 8
OM..............................................................................................77
I- Participation non monétaire
............................................................77
1 - La
sensibilisation.........................................................................77
2 - L'élaboration des projets et autres
formes..........................................79
II- Participation monétaire et
financière................................................79
1 - Les cotisations des populations du
quartier........................................80
2 - La part des
élites.........................................................................81
Section 2 : Les différentes
réalisations et l'appréciation des
populations.........82
I - La diversité des
réalisations............................................................82
1 - Le cas réalisations à Melen
4..........................................................82
2 - Les réalisations effectuées à
Melen 8 OM..........................................84
II - L'appréciation des populations
concernées.......................................86
1 - Les réactions
positives..................................................................87
2 - L'indifférence d'une certaine partie de la
population...........................88
Conclusion du quatrième chapitre
.......................................................88
Conclusion de la deuxième
partie.........................................................89
Conclusion
générale.........................................................................90
BIBLIOGRAPHIE...........................................................................93
ANNEXES.....................................................................................99
TABLE DES
MATIERES................................................................110
* 1 Petites et Moyennes
Entreprises
* 2 Déclaration du
Secrétaire général de la CNUCED, Conseil sur le commerce
et le développement, Exécutif, 13 novembre2008.
* 3 Organisations non
Gouvernementales
* 4 Environnement - Recherche
et Action
* 5 Alain Rey (dirigé
par), (1998) : Dictionnaire Micro Robert, Dicorobert, Canada, p 980.
* 6Silem et Albertini (Sous
la direction), (1987) : Lexique d'Economie, Dalloz, Paris, P 182.
* 7 Greffe Xavier,
(1994) : Les enjeux économiques de la décentralisation,
2ème édition.
* 8 Dans la suite de notre
travail, Melen 8 OM veut dire Melen 8 Onana Meuble.
* 9 Albou P. (1984) :
Les psychologues économiques, PUF, Paris, p.123.
* 10 Essombè Edimo
(2005b) : Op. Cit. p. 116.
* 11 Genèse 28:22;
Deutéronome 14:28-29 et 26:12f.
* 12
www.akdn.org/agency/philanthropy/ingphilHHADD.htm.
* 13 Commandements religieux
en matière de charité et d'hospitalité :
www.unification
net/ws/theme141htm.
* 14 Moe H. A. (1961) :
«Notes on the Origin of Philanthropy in Christendom», Proceedings
of the American Philosophical Society 105:2, p. 141.
* 15« Fondations
philanthropiques et coopération pour le
développement », in Comité d'aide au
développement, OCDE, 2003 p15.
* 16
http://www.alliancemagazine.org/node/967
* 17
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2004_Nov_10/ai_n6340602
* 18 Betty Plewes,
(2008) : La philanthropie mondiale et la coopération
internationale, Guide des tendances et enjeux, Pour le conseil canadien
pour la coopération internationale, p7.
* 19
http://causeglobal.blogspot.com/
* 20
www.chru-lille.fr/assochru/associations/Definitions/65701.shtm
* 21
www.prosport69.com/documents/foire_aux_questions/le_volontariat.pdf
* 22 Tamba I. (2004) :
« La société civile : Des débats
théoriques aux enjeux socio politiques et
économiques », in Actes, Journée annuelle de
l'O.S.C. (JANOSC), CREDDA, Yaoundé, P55.
* 23 F. Emerson Andrews
Cité par Warren Weaver (1967): U.S. Philanthropic Foundations -
Their History, Structure, Management and Record (Les fondations
philanthropiques aux Etats-Unis - Histoire, structure, gestion et
palmarès, New York, p39.
* 24 Créer et
Administrer une OSC au Cameroun, cadre juridique et principes d'administration,
p. 45.
* 25 Idem p53.
* 26 Créer et
Administrer une OSC au Cameroun, cadre juridique et principes d'administration,
p. 22.
* 27 Créer et
Administrer une OSC au Cameroun, cadre juridique et principes d'administration,
p28.
* 28 Ce que les Anglo-Saxons
appellent aussi ROsCA (Rotative Savings and Credit Association), pour
désigner également les tontines. Voir à cet effet, F.J.A.
Bouman (1979) : The ROsCA ; financial technology of an informal
savings and credit institution in developing countries, dans Revue Savings and
Development, n°4. Cité par Essombè Edimo J.R. (1995) : Quel
avenir pour l'Afrique?...., Ed ? Silex/Nouvelles du Sud, p. 62.
* 29 Acheteurs-Revendeurs
à la sauvette
* 30 Démarche
méthodologique pour la planification locale, SNV, 2000.
* 31 Pecqueur (1992) :
Le développement local, Syros, Paris, op. Cit., pp. 137/38.
* 32 Essombè Edimo,
2007b, op. Cit.
* 33 Pecqueur,(1992), Le
développement local, Syros, Paris, p. 138.
* 34 Le cluster
est définit par M. Porter (2004, p. 207), comme « un groupe
géographiquement proche d'entreprises liées entre elles et
d'institutions associées relevant d'un domaine donné, entre
lesquelles existent des relations et des éléments communs et des
complémentarités »
* 35 Courlet C. (2007) (sous
la dir. de) : Territoire et développement économique au
Maroc : le cas des systèmes productifs localisés, Ed.
L'Harmattan, Paris.
* 36 Pecqueur B. (2007) :
L'économie territoriale : une autre analyse de la globalisation, in
Revue l'Economie Politique, n° 33, p. 47.
* 37 Dans un article de
vulgarisation intitulé « Douala et l'attractivité
territoriale en zone CEMAC à l'heure de l'économie
globale », in Revue ENJEUX, n° 34-35, Jan-Juin 2008, pp. 40-51,
J.R. Essombè Edimo montrait également que ces deux
interprétations de la mondialisation traduisaient d'ailleurs une
opposition entre deux logiques précises qui sont, la logique de
nomadisme des entreprises et celle d'ancrage des firmes dans leur espace
d'implantation.
* 38 B. Pecqueur
(2007) : op. Cit. p. 51 .
* 39 Cf PREMIERE PARTIE du
présent Mémoire infra.
* 40 Laboratoire Environnement
et Sciences de l'eau
* 41 ce sont des maisons
faites de bambous et de terres battues : La terre est au préalable
mélangée sous forme de boue, avec laquelle l'on recouvre les
bambous.
* 42 « Vente de
seconde main », ici signifie que c'est un premier acheteur qui remet
son terrain à la vente pour la seconde fois.
* 43 Expression
empruntée à Essombè Edimo (2007b), op. Cit. et qui
signifie dynamique d'un territoire, indépendamment de celle des acteurs
qui le composent, et qui peut être la résultante d'un construit
socioéconomique, infrastructurel, ... acquis le long de l'histoire du
territoire, et facilite l'action des hommes installés sur ledit
territoire.
* 44 On peut aussi voir, sur
ce sujet du secteur informel, G. Nihan, E. Demol et Bodo Tabi (1979) : Le
secteur non- structuré moderne de Yaoundé, OIT, Genève.
Mais également G. Nihan (1980) ; le secteur non-structuré
moderne : signification, aire d'extension du concept et application
expérimentale, Revue Tiers-monde, n° 82, Paris.
* 45 On peut
également se référer ici, notamment à Feugang N.
(2008) : Proximité des activités et des zones
d'habitation : cas des stations service dans l'arrondissement de
Yaoundé VI, Mémoire de DESS « gestion
Urbaine », Yaoundé II-Soa.
* 46 Cf partie
précédente intitulée « les activités
économiques de Melen 4 », infra.
* 47 Laboratoire
Environnement et Sciences de l'Eaux de l'Ecole Polytechnique de
Yaoundé.
* 48 Les banques publiques,
parapubliques ou privées
| 


