|
UNIVERSITE PARIS-DESCARTES
MASTER 2 « Expertise
en Population et Développement »
2010-211
U.E. Cartographie
Vietnam (2009)
Les facteurs de santé : accès aux
services de base
Aurélie PIECHAUD
Décembre 2010
I. Présentation du Vietnam : contexte
géographique et climatique.
Situé en Asie du Sud-Est, le Vietnam est un pays tout
en longueur. Il s'étire le long de la côte orientale de la
péninsule indochinoise, sur près de 1700 km du Nord au Sud. Sa
largeur qui n'excède pas 300 km, avoisine les 50 km pour la zone la plus
étroite. Le territoire, d'une superficie de 329 314 km2, est
bordé par la mer de Chine à l'Est et au Sud (3260 km de
côtes), le Laos et le Cambodge à l'Ouest, et la Chine au Nord.
Le relief et les paysages du Vietnam sont très
variés. Les zones montagneuses (hauts plateaux, jungles) recouvrent plus
des trois-quarts du territoire. On peut distinguer trois grandes régions
:
1/ le Bac Bô (Nord), comprend une zone montagneuse (le mont
Phan Si Pan culmine à 3142 m), qui entoure la plaine et le delta du
fleuve Rouge.
2/ le Trung Bô (Centre), parcouru par la
Cordillère Annamitique, qui descend en pente douce vers le Sud et le
Sud-Ouest, et de façon plus abrupte à l'Est, laissant place
à une mince bande de terre longeant la côte.
3/ le Nam-Bô (Sud), constitué pour l'essentiel de la
vaste plaine du delta du Mékong.
De façon générale, le Vietnam jouit d'un
climat tropical humide, marqué par le phénomène des
moussons, qui détermine une saison sèche de décembre
à juin, et une saison humide de juillet à fin septembre. Le
fortes précipitations, voire les typhons, sont fréquents de juin
à octobre. Mais de par sa position géographique, et sa forme, le
pays présente une grande variété climatique. Ainsi, au
nord, l'hiver est plus court, mais aussi plus froid, et humide. Au sud, le
climat de mousson est sec entre novembre et avril, puis humide entre mai et
octobre, avec une amplitude thermique moins marquée (les
températures annuelles varient entre 10 et 35°C au nord, et entre
28°C et 30°C au sud). L'humidité est très importante
dans tout le pays, allant du nord au sud de 90 à 100 % durant la majeure
partie de l'année.
II. Organisation administrative.
Au niveau administratif, le pays est composé de 63
provinces, réparties au sein des 6 régions : la région du
delta du Mékong et la région Sud-Est, à
l'extrémité sud du pays, puis au-dessus la région des
Hauts-Plateaux du Centre et la région du Centre-Nord et de la Côte
centrale, et enfin au nord, la région du delta du fleuve Rouge, et celle
des montagnes et plateaux du nord (cf. carte ci-dessous1).
Carte 1 : Régions administratives du Vietnam en
2009.
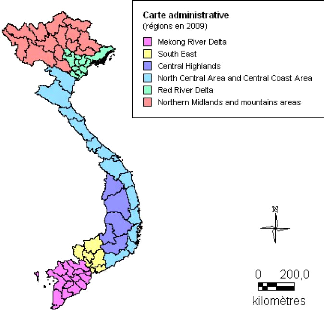
Les deux villes les plus importantes sont Hanoi, la capitale
située dans le delta du fleuve Rouge au nord, et Hô Chi
Minh-Ville, située dans le delta du Mékong au sud.
1 Pour construire cette carte, nous avons simplement
utilisé le code des régions (de 1 à 6) attribué
à chaque province, selon sa région d'appartenance. Puis nous
avons recodé la légende en attribuant à chaque
numéro le nom de région correspondant.
III. Une population importante et inégalement
répartie.
Au dernier recensement (2009), la population totale du
Vietnam, rurale à 70 %, était estimée à 85,8
millions d'habitants, faisant de ce pays l'un des plus peuplés d'Asie du
Sud-Est, après l'Indonésie et les Philippines [d'après les
estimations de G. PISON, 2009]. Rappelons que le Vietnam a une superficie de
329 314 km2 (par comparaison, la France métropolitaine compte 62
millions d'habitants en 2009 pour une superficie de 547 000 km2). Avec 260
hab/km2 en moyenne, la densité de population au Vietnam est donc
relativement élevée [cf. classement par pays, INED, 2010]. Un
chiffre qui recouvre en fait d'importantes variations internes : de 41 hab/km2
pour la province de Lai Chau à 1926 et 3399 hab/km2 respectivement, pour
les provinces de Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.
Carte 2 : Répartition spatiale de la population
en fonction du relief.
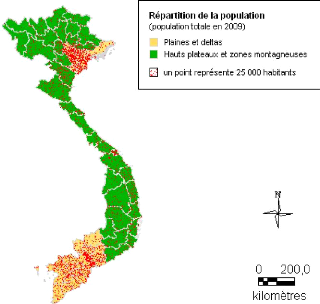
La carte ci-dessus2 met en évidence une
inégale répartition de la population sur le territoire. Il
apparaît que les plaines sont les zones les plus densément
peuplées, et particulièrement les grands deltas. En effet, la
plaine du fleuve Rouge (et Hanoi) au nord et celle du Mékong (et
Hô Chi Minh Ville) au sud, regroupent à elles deux près de
60 % de la population du pays3. En dehors des plaines
deltaïques du nord et du sud, on observe une densité plus
importante le long de la côte que dans les zones intérieures et
montagneuses.
La densité moyenne de population est passée de
170 hab/km2 en 1982, à 229 hab/km2 en 2000, pour atteindre comme nous
l'avons vu, 260 hab/km2 en 2009, avec les valeurs les plus
élevées au niveau des plaines. Mais le surpeuplement des plaines
est-il un phénomène récent ? Il semble que le peuplement
des plaines et deltas du nord et du sud soit en fait relativement ancien.
Commencé à l'âge du bronze, le peuplement ancien du pays va
se faire de façon constante en direction des plaines. D'abord,
l'expansion des Chinois vers le sud au II è siècle avant J-C. (en
réponse à une surpopulation relative, et pour étendre les
routes commerciales). Les populations se dirigent vers le delta du fleuve
Rouge, qui constitue, comme la plaine du Canton, une base stratégique
pour la construction de routes commerciales maritimes. Puis au cours de
l'histoire les populations migrent vers les plaines du sud. Les plaines
deltaïques fertiles sont favorables à la riziculture. Les
régions côtières en revanche ont connu un peuplement plus
récent. L'accroissement naturel a renforcé le peuplement des
plaines et deltas. Et la densité de population n'a cessé d'y
croître, plus vite que dans le reste du pays [cf. Population et
développement au Vietnam, 2000].
2 Pour construire cette carte, nous avons réparti les
régions selon un nouveau code. Les régions formées en
majorité de montagnes et de plateaux (Central Highlands, North Central
Area and central cost area, Northern Midelands and mountains areas) ont
reçu le code 1, les autres régions, essentiellement des plaines
(Mekong River Delta, South East, Red River Delta), ont reçu le code 2.
Puis nous avons recodé la légende, de façon à faire
apparaître le type de relief (zones de plaines ou de montagnes). Il est
évident qu'en utilisant les provinces et non les régions, nous
obtiendrions une carte plus précise, notamment au niveau de la bande
côtière, dont l'altitude est basse. Pour montrer la
répartition de la population, nous avons utilisé le type «
densité » et la population de chaque province en valeur aboslue.
3 Pour obtenir ce chiffre, nous avons calculé la
population totale des plaines, en faisant la somme des populations des
régions 2, 5 et 6 (selon le code utilisé pour le recensement), ce
qui donne 50 782 202 hab., et donc, rapporté à la population
totale, 59 %.
IV. Accès aux services de base : eau potable,
assainissement, et électricité.
1/ Accès à l'eau potable.
L'Objectif 7 des OMD est d'assurer un environnement durable
d'ici 2015. Entre autres, il s'agit de réduire de moitié, d'ici
à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès
à un approvisionnement en eau potable ni à des services
d'assainissement de base. Concernant l'accès à l'eau,
d'importants progrès ont été faits depuis 1990, dans la
plupart des régions du monde. Mais parmi les pays en
développement, c'est en Asie que l'on observe les avancées les
plus importantes. En Asie du Sud-Est, la proportion de la population utilisant
une source d'eau améliorée est passée de 72 % à 86
% entre 1990 et 2008. Le Vietnam n'est, à ce titre pas, en reste. Selon
l'OMS4, la part de la population ayant accès à l'eau
potable est passée de 48 % en 1990 à 56 % en 2000. D'après
le recensement de 2009, 79,8 % des ménages ont aujourd'hui accès
à l'eau potable5. Des progrès considérables ont
donc été réalisés, et l'objectif prévu pour
2015 en matière d'accès à l'eau potable est
déjà atteint. Mais cette fois encore, ces résultats
très positifs recouvrent des inégalités entre les
provinces.
La carte 3 (cf. ci-dessous) nous montre que
c'est au niveau des deux deltas (fleuve Rouge et Mékong) que la part des
ménages utilisant de l'eau potable est maximale (plus de 95 %). C'est le
cas aussi de deux provinces situées à l'extrême sud du pays
(Bac Lieu et Ca Mau), ainsi que d'une petite province urbaine du centre du pays
(Da Nang City). En dehors de quelques provinces situées dans la plaine
du Mékong, c'est dans les zones de hauts-plateaux et de montagnes, et
principalement celle du nord (où vivent les minorités ethniques),
que la part des ménages utilisant une source d'eau
4
http://www.wpro.who.int/vietnam/mdg.htm
5 Plus précisément, la question posée
lors du recensement était la suivante : « Quelle est la source
d'eau principalement utilisée par le ménage pour la cuisson ou la
boisson ? ». Plusieurs réponses étaient possibles : «
robinet intérieur », « robinet public », « puits
foré », « puits creusé protégé »,
« puits creusé non protégé », « fontaine
protégée », « fontaine non protégée
», « eau de pluie », « autre ». L'eau est
considérée comme potable si elle provient d'un robinet
privé ou public, d'un puits foré ou d'un puits creusé
protégé, ou de l'eau de pluie.
potable pour la cuisson ou la boisson est la moins importante
(moins de 65 %). C'est dans la province de Lai Chau que l'accès à
l'eau potable est le plus faible (17,2 % des ménages).
Certains auteurs estiment que plutôt que d'eau «
potable », il faudrait parler d'eau « propre », « dans la
mesure ou, au Vietnam comme dans la majeure partie des pays émergents
d'Asie-Pacifique, il n'existe pas d'eau potable proprement dite. En effet, si
l'eau produite par les compagnies des eaux est d'une parfaite innocuité
au sortir des usines de traitement, son adduction dans un système de
réseau vétuste altère sa qualité. En cela, l'eau
propre répond aux normes de qualité de l'eau pour une utilisation
ménagère. » [DIAZ PEDREGAL, V. et VU, T. B., 2007].
Carte 3 : Des inégalités internes
subsistent dans l'accès à l'eau potable.
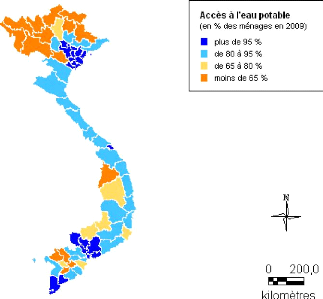
A Hô Chi Minh-Ville notamment, l'amélioration de
l'accès à l'eau semble être le résultat de la
légitimation des petits opérateurs privés (POP), et de
leur prise en compte progressive dans les projets de développement, qui
auparavant octroyaient des subventions à l'Etat uniquement. Les POP ont
dès lors été envisagés comme figures relais des
opérateurs principaux, dans les zones où ces derniers
n'étendaient pas leurs réseaux. Ce changement a pu s'instaurer
dans le cadre du processus de libéralisation de l'économie,
impulsé par la mise en place de la politique du Doi Moi (renouveau)
à la fin des années 80. Cette tentative d'officialisation et
d'insertion des petits opérateurs privés informels dans un cadre
de régulation intégré, semble constitué un exemple
unique, ou du moins très rare [BOTTON, S., BLANC, A., 2010]. Par
ailleurs, Hô Chi Minh-Ville et Hanoi ont bénéficié
de l'aide de l'Agence Française de Développement, dans le cadre
de programmes d'amélioration de la gestion et de l'accès à
l'eau [AFD, 2008].
De façon générale, l'accès
à l'eau potable s'est accru considérablement au cours des vingt
dernières années. Mais une observation détaillée
montre que certaines régions, principalement reculées, demeurent
largement défavorisées. Par ailleurs, le faible coût
relatif de l'eau semble entraîner des pratiques de gaspillage, et la
croissance démographique forte associée à une urbanisation
rapide, qui s'accompagne de modifications des comportements, laissent
présager une augmentation de la demande et une diversification des
usages de l'eau [DIAZ PEDREGAL, V. et VU, T. B., 2007].
2/ Accès à
l'assainissement.
L'accès à l'assainissement demeure quant
à lui faible sur tout le territoire. En effet, plus de la moitié
des ménages (53,8 %) sont encore privés, en 2009, d'un
accès à des installations sanitaires
améliorées6.
6 La question posée lors du recensement était la
suivante : « quelle sorte d'installation sanitaire est utilisée le
plus souvent par le ménage ? ». Plusieurs réponses
étaient possibles : « toilettes intérieures munies d'un
système d'évacuation des eaux usées », «
toilettes extérieures munies d'un système d'évacuation des
eaux usées », « autre »,
Carte 4 : Un accès à l'assainissement
réservé à une minorité dans beaucoup de
provinces.
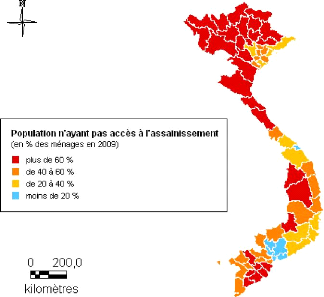
C'est dans les zones montagneuses du nord et du centre, encore
une fois, que l'accès à l'assainissement est le plus faible. Mais
il apparaît bien que la majeure partie du territoire est encore
aujourd'hui privée d'un accès à des installations
sanitaires améliorées. L'amplitude des variations entre les
provinces est considérable. Ainsi, la part des ménages n'ayant
pas accès à l'assainissement passe de 85,7 % pour la province de
Lai Chau (région des hauts plateaux du nord) à 4,3 % et 1,5 %
respectivement, pour Da Nang City et Hô Chi Minh-Ville. On aurait pu
s'attendre à ce que les plaines deltaïques, les grandes villes au
moins, soient les mieux équipées. Si c'est le cas pour quelques
provinces située dans la région Sud-Est, dont Hô Chi
Minh-Ville, ainsi que pour Da Nang City, les provinces du delta du fleuve Rouge
présentent quant à elles des taux d'accès relativement
« pas de toilettes ». Sont considérées
comme installations sanitaires améliorées les toilettes munies
d'un système d'évacuation des eaux usées (fosse scpetique,
égouts).
faibles. Concernant Hanoi, l'explication se trouve
probablement dans l'urbanisation rapide et importante, conduisant à un
« surpeuplement des logis ». Selon René Parenteau [1997],
professeur d'urbanisme à l'Université de Montréal, les
immeubles des vieux quartiers du centre-ville de Hanoi ont été
transformés en habitats collectifs dès les années 50. Au
milieu des années 90, dans ces logements surpeuplés où
vivent plusieurs familles regroupant 18 membres en moyenne (enquête
réalisée entre 1993 et 1996), l'espace dont chacun dispose
n'excède pas les deux mètres carrés. Quant aux
installations sanitaires, elles sont quasi inexistantes : « on estime que
jusqu'à 30 personnes peuvent partager une toilette à Hanoi
»7. Bien que datant quelque peu, ces données pourraient
expliquer en partie les observations. René Parenteau étudie
à la même époque les bidonvilles d'Hô Chi Minh-Ville,
où « des milliers de ménages habitent sur les canaux et
n'ont aucun équipement sanitaire »8. Comme nous le
montre la carte, la part des ménages n'ayant pas accès à
l'assainissement est très faible à Hô Chi Minh-Ville en
2009 (1,5 %). De nombreux projets visaient l'éradication des
bidonvilles, ainsi que l'assainissement de la ville, et d'importants
progrès furent réalisés. Mais dans tous le reste du pays,
et notamment dans les zones reculées, il reste beaucoup à faire
en matière d'assainissement. Dans ces régions, il est plus que
probable que l'OMD visant à réduire de moitié la part de
la population n'ayant pas accès un assainissement de base, ne sera pas
atteint d'ici à 2015.
3/ Accès à
l'électricité.
Le gouvernement du Vietnam a mis en place un programme
d'électrification rurale, qui a fait passer la part des ménages
ruraux ayant accès à l'électricité de 50,7 % en
1996 à 90,7 % en 2005 [Banque Mondiale, 2007]. En 2009, dans la plupart
des provinces du pays, la proportion des ménages ayant accès
à l'électricité est supérieure à 95
%9. Néanmoins, la carte 5 met en
évidences des inégalités
7 René Parenteau (dir.), Habitat et environnement
urbain au Vietnam : Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, Karthala-CRDIACCT,
1997, p. 11.
8 Idem.
9 La question posée lors du recensement était la
suivante : « quelle est la source principale d'énergie
utilisée par votre ménage pour l'éclairage ? ».
Plusieurs réponses étaient possibles : «
électricité », « paraffine », « gaz »,
« charbon »,
persistantes. Les zones de montagnes et de plateaux, et plus
particulièrement celles du nord, demeurent défavorisées,
même si seules trois provinces présentent un taux d'accès
inférieur à 70 %, lesquelles sont Dien Bien, Ha Giang, et Lai
Chau (province où le taux d'accès, égal à 49,7 %,
est le plus faible du pays).
Carte 5 : Les zones montagneuses demeurent
défavorisées concernant l'accès à
l'électricité.
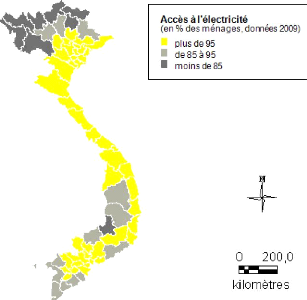
Le programme gouvernemental d'électrification des
campagnes se poursuit. En 2008, la Banque Mondiale a décidé
d'accorder un prêt de 150 millions de dollars, et le programme devait
bénéficier d'un prêt non remboursable de 3 millions de
dollars de la part de l'Agence Australienne pour le Développement
International10. Le pays mise aujourd'hui sur les énergies
renouvelables.
« bois de chauffage », « autre ».
10 MAI, Phuong, « La Banque Mondiale accorde un prêt
[...] », in Courrier du Vietnam, 5 nov. 2008. (
http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?xt=&ct=&page=newsdetail&newsid=46976,
dernière consultation le 5 janvier 2011).
Notamment, le Vietnam bénéficie d'un littoral de
plus de 3000 km, et le développement d'un parc éolien naissant
est envisagé11.
De façon générale, l'accès
à l'électricité est prêt d'être
généralisé au Vietnam puisqu'en 2009, plus de 93 % des
ménages l'utilisent pour s'éclairer. Néanmoins nous
l'avons vu aussi, des inégalités persistent, et quelques
provinces doivent faire l'objet d'une attention particulière.
4/ Des services de base en lien direct avec la
santé.
L'absence d'eau potable et d'assainissement est une des
premières causes de mortalité dans le monde (vecteurs de
maladies). L'amélioration de la santé des population passe donc
par l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène. La
pollution à l'intérieur de l'habitat, résultant de
l'utilisation de bois de chauffage ou d'autres combustibles traditionnels est
responsable de 1,5 millions de décès par an dans le monde [Banque
mondiale]. Si l'accès à l'électricité semble
aujourd'hui presque universel, les efforts doivent être poursuivies, dans
les zones les plus reculées notamment. L'accès à
l'électricité est un facteur de santé, parce qu'il
évite, déjà, le recours à des combustibles nocifs
lorsqu'utilisés dans les logements. D'autre part,
l'électricité est nécessaire au bon fonctionnement des
structures de soins. Le développement du réseau de structures de
soins doit donc s'accompagner du développement
énergétique.
V. Accès au système de soins.
L'OMS effectue des recommandations concernant le personnel de
soin. Ainsi, la norme minimale
admise est de 1 médecin pour 10 000
habitants, 1 hôpital pour 100 000 habitants, 1 centre de
santé
pour 10 000 habitants, 1 infirmier pour 3000, 1 pharmacien pour
15 000. Au Vietnam, on compte en
11 QUANG, Minh, « Parc éolien : investir dans
l'énergie de demain » in Courrier du Vietnam, 5 dec.
2010.
moyenne, en 2009 : 5,6 médecins pour 10 000 habitants,
2,1 infirmiers pour 3000 habitants, 1,1 hôpital pour 100 000 habitants,
1,3 centres de santé pour 10 000 habitants, 2,1 pharmaciens pour 10 000
habitants12. Le pays se situe donc, de manière
générale au-delà des normes édictées par
l'OMS en matière de personnel et de structures de soins, avec des
chiffres élevés au regard du niveau de développmeent
économique du pays. Mais, les cartes suivantes le montre, il existe des
disparités entre régions. Concernant les médecins, la
carte 6 montre une répartition inégale sur le
territoire. Ils semblent concentrés pour l'essentiel dans les plaines et
les grandes villes (Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, et Da Nang City. Mais si
l'on se réfère à ce que nous avons vu plus, cette
répartition suit celle de la population générale.
Carte 6 : Concentration des médecins dans les
plaines et les grandes villes.
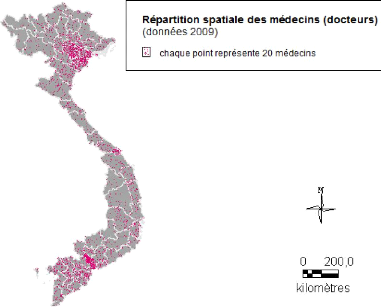
12 Pour obtenir ces données, nous avons utilisé la
base de données relatives à la santé, fournie par
l'institut de statistique du Vietnam. La base a été
exportée sous excel. Puis le nombre de personnel de chaque secteur a
été rapporté à la population.
En fait, il est plus pertinent, à titre comparatif,
d'étudier les différences entre régions ou provinces
relatives à la densité médicale. C'est-à-dire le
nombre de médecin par rapport au nombre d'habitants. C'est ce que montre
la carte 7.
Carte 7 : Densité médicale par
province.
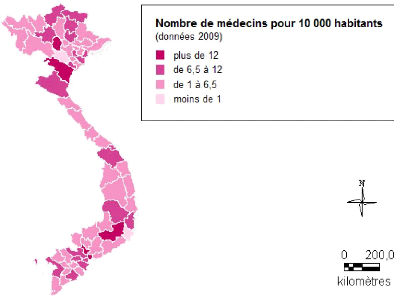
Cette carte montre que quelques provinces sont
avantagées. Seules deux provinces sont en-dessous du seuil reconnu par
l'OMS. La majorité des provinces sont en-dessous ou autour de la moyenne
nationale. La densité médicale semble être plus importante
dans les deux grandes villes. Les médecins étudient dans les
grandes villes, parfois à l'étranger, et lorsqu'ils sont
diplômés, la majorité préfère rester ou
s'installer en ville. La plupart des provinces présentent tout de
même une densité médicale supérieure aux normes
minimales de l'OMS, même si les chiffres, pour tout le pays, demeurent
bien en deça de ce que l'on peut observer dans les pays occidentaux (de
l'ordre de 3 médecins pour 1000 habitants).
Carte 8 : Lits d'hôpitaux en fonction du nombre
d'habitants par province.
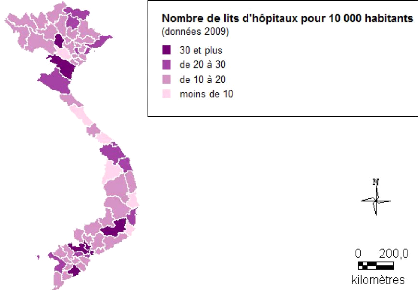
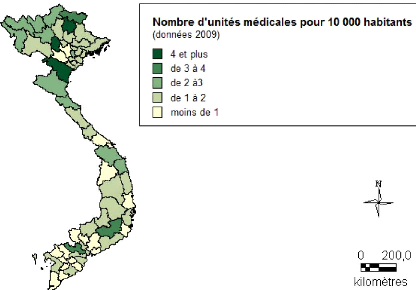
Carte 9 : Unités médicales en fonction
du nombre d'habitants par province.
CONCLUSION
En guise de conclusion, il apparaît que la mise en carte
est intéressante pour donner une image immédiate (beaucoup plus
qu'un tableau) des disparités ou inégalités qui peuvent
exister entre les différentes parties, régions naturelles ou
divisions administratives d'un pays. Très souvent, les moyennes
nationales sont utilisées pour mesurer les avancées dans un
domaines ou un autre, et effectuer des comparaisons internationales. C'est
évidemment la solution la plus adaptée dans ce but. Mais les
moyennes nationales recouvrent trop souvent des disparités internes.
Leur identification est la première étape avant d'en rechercher
les facteurs. Pour cela, des analyses plus poussées sont
nécessaires. Les cartes, en amont, peuvent indiquer où, et quoi
chercher. En aval, après analyse, elles peuvent permettent d'en
illustrer des résultats.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages et articles scientifiques.
BOTTON, Sarah ; BLANC, Aymeric, Accès de tous aux
services d'eau : le rôle des petits opérateurs privés
à Hô Chi Minh-Ville, Vietnam, Focale 01, AFD, Mars 2010, 106
p.
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/PatrickBazin/public/recherche/FocalesN1.pdf
DIAZ PEDREGAL Virginie, VU Trong Binh, « Vers une gestion
durable de l'eau potable dans le Nord Vietnam », Actes des
JSIRAUF, Hanoi, 6-9 novembre 2007, 10 p.
http://www.infotheque.info/fichiers/JSIR-AUF-Hanoi07/articles/AJSIR_2-5_Diaz.pdf
INED, Atlas de la population mondiale (données
2009), 2010.
LANGLETl-QUACH Thanh Tân, « La répartition
spatiale de la population », in GUBRY, Patrick (dir.), Population et
développement au Vietnam, Khartala 2000, 613 p.
PARENTEAU, René (dir.), Habitat en environnement
urbain au Vietnam : Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, Karthala-CRDI-ACCT,
1997, 334 p.
PISON, Gilles, « Tous les pays du monde (2009) », in
Population et Sociétés, n°458, juillet-août
2009, 8 p.
Rapports et documents stratégiques.
AFD, L'AFD et le Vietnam : un partenariat
stratégique, mars 2008, 6 p.
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/users/administrateur/public/plaquettes/AFD-Vietnam-fr.pdf
Banque mondiale, « L'IDA en action : des services
énergétiques pour réduire la pauvreté et stimuler
la croissance économique », juillet 2009, 8 p.
(
http://siteresources.worldbank.org/EXTIDAFRENCH/Resources/2010-Energy.pdf).
Central Population and Housing Census steering Committee, The
2009 Vietnam Population and housing census of 00.00 hours 1st april
2009 : Expanded sample results, Hanoi, 2009, 33 p.
(p. 8).
Committee for Population, Family and Children, Hanoi, Vietnam and
ORC Macro, Calverton, MD, USA, Vietnam : DHS 2002, Final Report,
septembre 2003.
Nations Unies, Objectifs du millénaire pour le
développement : rapport 2010, DAES, juin 2010, 76 p.
Presse
MAI, Phuong, « La Banque Mondiale accorde un prêt
[...] », in Courrier du Vietnam, 5 nov. 2008. (
http://lecourrier.vnagency.com.vn/default.asp?xt=&ct=&page=newsdetail&newsid=46976,
dernière consultation le 5 janvier 2
QUANG, Minh, « Parc éolien : investir dans
l'énergie de demain » in Courrier du Vietnam, 5 dec.
2010.
|
|



