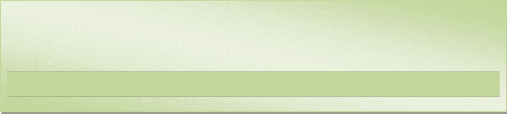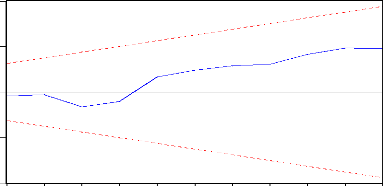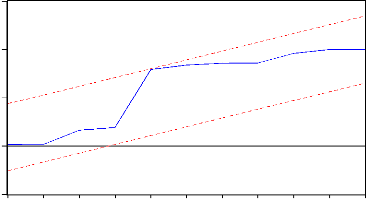|
I
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE




INSTITUT SUPERIEUR PEDAGOGIQUE DE BUKAVU

B.P: 854 BUKAVU

SECTION DES SCIENCES COMMERCIALES, ADMINISTRATIVES
ET
INFORMATIQUE
DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE DE GESTION
ANALYSE DES CONSEQUENCES DE L'ENDETTEMENT PUBLIC EXTERIEUR
SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE DE
LA RDC (1991-2010)
Par AMANI MAISHA Sulutani
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du diplôme de licencié en pédagogie
appliquée.
Option : Informatique de Gestion
Dirigé par NJANGALA CHIBASHIMBA Joël
Chef de Travaux
Co-dirigé par AKILIMALI Pascal
Assistant
II
EPIGRAPHE
Malheur aux jeunes car ce sont eux qui hériterons les
dettes de leurs pays.
III
IN MEMORIAM
En mémoire des feu grands-mères MWAMINI
KISUKUMBA, NDEMESA NAGANYERWA et petit frère Patrick MATIMBU RUDIMA qui
ont quitté la terre de nos anc~tres très tôt sans qu'ils ne
goutent les fruits de leur petit fils et frère.
IV
DEDICACE
A notre père MABANGA MAISHA RUDIMA
A ma mère MAHANO MALIKA Charlotte
A mon grand frère HUZUNI MABANGA Jacques
A toute la famille MABANGA MAISHA et RUDIMA
Je dédie ce travail

REMERCIEMENTS
Notre reconnaissance restera ineffaçable envers Dieu
tout puissant le créateur du ciel et de la terre qui a voulu que
ça soit ainsi.
Nos remerciements s'adressent à nos chers parents
MABANGA MAISHA Rudima et son épouse MAHANO MALIKA Charlotte pour leur
éducation, sacrifice et conseil reçus en vue de la
réalisation de ce travail.
Nous remercions également tout le corps
académique de l'ISP/Bukavu en général et tous les
enseignants de la section des sciences commerciales administratives et
informatique et en particulier le Chef des Travaux NJANGALA CHIBASHIMBA
Joël et l'assistant AKILIMALI Pascal qui, malgré leurs multiples
travaux ont acceptés de diriger et de co-diriger ce travail; leurs
conseils, expérimentations, savoir-faire, dévouements et
disponibilités nous ont été utiles pour la production de
cette édifice.
Nous remercions notre grand frère Jacques MABANGA pour
sont soutien moral matériel et financier. Nous vous resterons à
jamais débiteur.
De mrme nous sommes reconnaissants envers nos
frères et soeurs MEMA MAISHA Lebon, Adolph MAISHA, Ass. Léonce
BASHIKWA, Karim KALUGI, HAMU, Idée B., Consolé R., Lyly, Aziza.,
MACHOZI MWAMINI, BAHATI FURAHA, SHUKURU, KIANA, Erick, SAFI, MENEBYAGE Chance,
Jeanine Gloire MATIMBU, MWAMINI Tantine, KYEUSI, FAILA pour leurs soutient
morale, matériel et financier.
Nos remerciements s'adressent également à
nos oncles, tentes paternelles et maternelles : MATIMBU, NGULWE, KAGANGU,
DJUMA, BUSHOLE, KISHASHA, SALIMA, Jeanne., MUSSA R, MWENDO, MBINGA, SAFARI,
MAHAMUDI pour la chaleur familiale nous assurée volontiers mais surtout
pour leur affabilité et magnanimité.
Qu'il nous soit permis de remercier nos amis et compagnons
des luttes avec qui, nous avons traversé les périodes difficiles
: AMURI IDUMBILLWA, BONGOLA Jean, KABEYA Didier, KABEYA Justin, AMANI Erick,
AMURI Lebon, EKELA Dieudo, ABEDI, MUNYAGA Junior, Paul MWAMBA, Jean Mineur,
MAJALIWA Alain, MASHAURI Bovick, Adelin, MONGANE Blaise, MIKILA Eugénie,
BIDUGU Déborah, MILANGA Stéphane, EYADEMA, KAYEBE
Josué, AMURI Guylain, Jean-Paul, BAHATI, Ami, BAGANDA Marcelin, ZAGABE
Fabrice, NGAKANI Espoir, BUSHIRI, ANIFA, Christine, Judith, FUNDI.
Enfin, que tous ceux auprès de qui nous avons
trouvé réconfort et assurance durant ces cinq ans de formation et
dont les noms n'ont pas été repris ; trouvent dans cette
monographie l'expression de notre reconnaissance.
VI
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE II
IN MEMORIAM III
DEDICACE IIII
REMERCIEMENTS V
TABLE DES MATIERES VI
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES IX
I. TABLEAUX X
II. FIGURES X
SIGLES ET ABREVIATIONS XI
0. INTRODUCTION GENERALE 1
0.1. PROBLEMATIQUE 1
0.2. HYPOTHESE 4
0.3. OBJECTIFS DU TRAVAIL 4
0.4. CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL 4
0.5. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 4
0.5.1. Méthodes 4
0.5.1.1. Méthode statistique 4
0.5.1.2. Méthode descriptive 5
0.5.2. Technique 5
0.5.2.1. Technique documentaire 5
0.6. DELIMITATION DU SUJET 5
0.6.1. Du point de vu temporel 5
0.6.2. Du point de vu spatial 5
0.7. ETAT DE LA QUESTION 6
0.8. PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL 8
CHAPITRE PREMIER: APPROCHE THEORIQUE 10
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS 10
I.1.1. Dette 10
I.1.2. Dette publique 10
I.1.2.1. Dette intérieure 10
I.1.2.2. Dette extérieure 11
I.1.2.2.1. Dette bilatérale 11
I.1.2.2.1. Dette multilatérale 11
I.1.3. Dette odieuse 12
I.1.4. Souténabilité 12
I.1.5. Solvabilité 12
I.1.6. Surendettement 12
I.1.7. Déficit public 13
I.1.8. Schématisation des différentes
catégories d?une dette publique 13
I.2. ANALYSE MACROECONOMIQUE DE LA DETTE PUBLIQUE 14
I.2.1. Approche keynésienne de l?endettement public 14
I.2.2. Approche classique de l?endettement public 15
I.2.3. Approche de l?endettement optimal 16
1.2.3.1. Modèle d?endettement-croissance 16
1.2.3.2. Modèle du cycle de la dette 17
I.2.4. Autres considérations relatives de la dette
publique 18
I.2.4.1. Budget équilibré et politique
budgétaire optimal 18
A. Stabilisation 18
B. Lissage fiscal 18
C. Redistribution intergénérationnelle
18
I.2.4.2. Les effets sur la politique monétaire 19
I.2.4.3. La dimension Internationale de la dette publique 19
I.2.6. La dynamique économique de l'endettement public
20
I.3. LA CROISSANCE ECONOMIQUE 23
I.3.1. Définition 23
I.3.2. Mesure de la croissance 23
I.3.2.1. Le Produit Intérieur Brut (PIB) 24
I.3.3. Les déterminants de la croissance 25
I.3.4. Etapes de La croissance économique 25
CHAPITRE DEUXIEME: GENERALITE DE LA DETTE PUBLIQUE DE LA RD
CONGO 26
II.1. HISTORIQUE DE LA DETTE DE LA RDC 26
II.2. LES ORIGINES DE LA DETTE PUBLIQUE DA LA RD CONGO 27
II.3. EVOLUTION DE QUELQUES AGREGATS DE LA DETTE PUBLIQUE
EXTERIEURES DE LA RDC 29
II.3.1. Stocks dette exterieure de la RDC 29
II.3.2. Service de la dette de la RDC 32
II.4. RELATIONS DE LA RDC AVEC SES BAILLEURS DE FONDS EN 2010
40
II.4.1. Fonds Monétaire International (FMI) 40
II.4.2. Club de Paris 40
II.4.3. Club de Londres 41
II.4.4. Club de Kinshasa 41
CHAPITRE TROISIEME: APPROCHE METHODOLOGIQUE 42
III.1. RECOLTE DES DONNEES 42
III.2.TRAITEMENT DES DONNEES 42
III.3. PRESENTATION DES VARIABLES DU MODELE 42
III.3.1. Variable endogène (Dépendante ou
expliquée) 43
III.3.1.1. Taux de croissance du produit intérieur brut
(TCPIB) 43
III.3.2. Variables exogènes (Indépendantes ou
Explicatives) 45
III.3.2.1. Stock de la dette sur le PIB (STDPIB) 45
III.3.2.2. Stock de la dette sur les exportations des biens et
des services (STDEXP) 49
III.1.2.3. Variable termes de l?échange 50
III.1.2.4. Service de la dette sur les exportations des biens et
des services (SEDEXP) entre 1991 et 2010 en RDC 52
III.1.2.5. Taux de croissance démographique (TCDEM) 54
III.1.2.6. Solde budgétaire primaire sur le PIB (SOBPPIB)
56
III.1.2.7. Balance courante sur le PIB (BCPIB) 55
III.1.2.8. Ratio exportations de biens et de services sur PIB
58
III.2. SPECIFICATION DU MODELE 60
III.2.1. Modèle théorique 60
III.2.2. Modèle mathématique 60
II.3.3. Modèle économétrique 61
III.3. SOURCE DES DONNEES DE L'ETUDE 61
CHAPITRE QUATRIEME : PRESENTATION, ANALYSE ET
INTERPRETATION DES RESULTATS 62
IV.1. PRESENTATION DES RESULTATS ET ESTIMATION DES MODELES 62
IV.1.1. Résultat de la régression de la variable
taux de croissance du PIB (variable dépendante du modèle) 63
IV.2.2. Validité du modèle 63
IV.2.2.1. Validité statistique 63
IV.2.2.2. Validité économétrique 64
a. Test de Ramsey 64
b. Test de Breusch-Godfrey 64
c. Test d'homoscédasticité des
résidus 65
IX
d. Test de ARCH 65
e. Test de normalité des résidus
65
f. Test de multi colinéarité
65
g. Test de CUSUM 66
h. Test de CUSUM au carré 66
IV.2. EVALUATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS 66
IV.2.1. Le ratio stock dette extérieure sur le PIB 66
IV.2.2. Le ratio stock dette extérieure sur les
exportations de biens et de services 67
IV.2.3. Les termes de l?échange 68
IV.2.4. Le ratio du service de la dette sur les exportations de
biens et de services 68
IV.2.5. Taux de croissance démographique 68
IV.2.6. Ratio balance courante de paiement sur le PIB 69
IV.2.7. Ratio solde budgétaire primaire sur le PIB 69
IV.2.8. Ratio exportations de biens et de services sur le PIB
69
IV.2.9. Détermination du seuil d?endettement viable 70
IV.3. IMPACT DE L?INITIATIVE PPTE 71
CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 74
BIBLIOGRAPHIE 77
ANNEXES 81

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES
I. TABLEAUX
Tableau n0 1 :Evolution du stock de la dette
extérieure de la RDC par groupe de créanciers (1991 à
2010)
Tableau n0 2 :Evolution du service de la dette
extérieure de la RDC par groupe de créanciers (1991 à
2010)
Tableau n0 3 :Evolution du service
éffectué de la dette extérieure de la RDC par groupe de
créanciers (1991 a 2010)
Tableau no 4 :Résultat de la régression
par MCO de la variable dépendante TCPIB Tableau no 5 :Niveaux
minimum conseillés
II. FIGURES
Figure no1 : Evolution du stock de la dette publique
extérieure congolaise (montant en millions de USD)
Figure no2 :Evolution du service de la dette publique
exterieure congolaise (montant en millions de USD)
Figure no 3 : Evolution du service de la dette
effectué (montant en millions de USD) Figure no4 : Evolution
du taux de croissance du PIB de la RDC entre 1991 et 2010
Figure no 5: Evolution du ratio stock de la dette sur
le PIB entre 1991 et 2010 en RDC
Figure no6: Evolution du ratio stock dette sur les
exportations de biens et de services entre 1991 e 2010
Figure no 7: Evolution de la variable des termes de
l?échange entre 1991 et 2010
Figure no8: Evolution du ratio service de la dette sur
les exportations de biens et de services
Figure no9: Evolution du taux de croissance
démographique entre 1991 et 2010
Figure no10: Evolution du ratio solde balance courante
en pourcentage du PIB entre 1991 et 2010.
Figure no11: Evolution du ratio solde
budgétaire primaire en pourcentage du PIB entre 1991 et 2010.
Figure no 12: Evolution du ratio exportations
de biens et de services en sur le PIB entre 1991 et 2010
XI
SIGLES ET ABREVIATIONS
1. al. : et alii (et les autres)
2. BAD : Banque Africaine de Développement
3. BCC : Banque Centrale du Congo
4. BM : Banque Mondiale
5. BZ : Banque du Zaïre
6. CDF (CF) : Franc Congolais
7. Cfr : Confert
8. DTS (XDS) : Droit de tirage spécial
9. DSCRP : Document Stratégique de Croissance et de
Réduction de la
Pauvreté10. éd. : Edition
11. E.S.U.R.S : Enseignement Supérieur, Universitaire et
recherche scientifique
12. E-VIEW : Econometric View
13. FMI : Fonds Monétaire International
14. GMM : Méthodes des moments
généralisés
15. I-PPTE : Initiative de Pays Pauvres Très
Endettés
16. I.S.P. : Institut Supérieur Pédagogique
17. MCO : Moindres Carrées Ordinaires
18. ODM : Objectifs du Développement pour le
Millénaire
19. OGEDEP : Office de gestion de la dette publique
20. p. : Renseignement provisoire
21. PAS : Programme d?Ajustement Structurel
22. PIB : Produit Intérieur Brut
23. PNB : Produit National Brut
24. PPTE : Pays Pauvres Très Endettés
25. PVD : Pays en Voie de Développement
26. PUF : Presse Universitaire de France
27. R.D.C. : République Démocratique du Congo
28. USA : United State of American
29. USD ($) : Dollar des Etats unis
30. VAN : Valeur Actuelle Nette
31. % : Pourcentage
0. INTRODUCTION GENERALE
0.1. PROBLEMATIQUE
L?endettement public des pays du Tiers-monde figure
aujourd?hui dans des débats des politiques économiques dans la
majorité de ces pays. On remarque selon ces pays la politique tendant
à accroitre les dettes publiques de l?Etat et d?autres voulant les
ramener à la baisse mais qui pourtant débouchent sur des
obstacles d?ordres structurels et conjoncturels.
Pour la plupart de ces pays leur endettement s?est
accéléré au cours de la période située entre
les années 1973 et 1980. Cette période a été
caractérisée par une abondance des pétrodollars qui
devaient être recyclés.
En effet, après le 1er choc pétrolier
en 1973, les énormes excédents financiers des pays exportateurs
de pétrole, places en dépôt auprès du système
bancaire international, ont été offert en prêt
principalement aux pays du Tiers-monde. Ces prêts comportaient des taux
d?intérêts bas et fixes (de l?ordre de 5%), et de longs
délais de paiement. Ces conditions favorables permettaient aux pays
endettés d?avoir un service de la dette supportable.1
Après la décennie soixante dix
caractérisée par une gestion économique prudente et
rigoureuse, les années 80 ont démarré avec des chocs
majeurs (faible taux de croissance, accumulation d'importants
arriérés, déficit budgétaire insupportable) qui ont
enfoncé les économies des pays du Tiers-monde dans une crise
sévère. Au milieu des années 80, les difficultés de
trésorerie face aux besoins de financements grandissants ont asservi les
Etats à recourir massivement aux sources de financements
extérieurs.2
Au niveau international, l?environnement s?est
révélé opposé au processus de développement,
de la croissance économique et social avec des déficits
budgétaires insupportables, l?accumulation d?importants
arriérés de paiement, l?alourdissement des taux
d?intérêt réels, la détérioration des termes
de l?échange ainsi que la baisse de prix des matières
premières.
Au niveau intérieur, la mauvaise gestion de la dette
s?est expliqué par le fait qu?il y a eu l?inefficacité et le
faible management de la dette dans les pays en développement signifiant
l?absence d?une capacité élevée pour faciliter les surplus
d?exportations en vue de paiement de la dette extérieure. Les
conséquences qui en résultent sont : un faible taux de
1 BZ, Rapport annuel 1991
2 Christian NDO: Les effets des dettes
extérieurs sur la croissance économique du Gabon,
mémoire online, université de Yaounde2, 2008.
croissance économique, l?affectation des ressources
dans des investissements improductifs et l?absence de discipline
financière rigoureuse, ce qui a également aggravé la crise
de l?endettement avec comme conséquence l?effet « boule de neige
». Plusieurs éléments laissent penser que la très
forte augmentation de la dette publique extérieure au cours des vingt
dernières années au sein des pays de PPTE, a eu des
conséquences défavorisant la croissance économique.
Durant les décennies 70-80, 80-90, l'environnement
économique des pays à faible revenu, particulièrement la
R.D.Congo, n?a pas échappé à cette réalité.
Cette période fut marqué par une crise de la dette
extérieure élevée qui de nos jours, continue à
demeurer un obstacle majeur pour atteindre les Objectifs du
Développement pour le Millénaire (ODM).
Aussi, cette crise de la dette
extérieure élevée comme dit plus haut reste encore dans
les débats des hommes politiques et de l'opinion publique à
travers le monde et comme étant l'un des principaux facteurs contribuant
à restreindre la croissance et/ou le développement
économique des pays pauvres ; vu que la plupart d'entre eux ont
contracté des emprunts élevés au cours des années
passées, souvent avec des taux d'intérêt
élevé sous des conditions avantagées.
En général le déficit de l?Etat est
financé par l'émission d'emprunts d?État (qui donnent lieu
au versement d'intérêts), sous la forme d'obligations ou de bons
du Trésor. Ces emprunts sont émis pour équilibrer le
budget de l?Etat ou pour payer des dépenses non couvertes par les
ressources de l'État, ou encore pour favoriser une relance
économique en créant un déficit budgétaire
destiné à atténuer les effets du chômage ou d'une
dépression (ou les deux à la fois).
L'emprunt extérieur a un effet positif sur la
croissance jusqu'à un certain seuil; audelà de ce seuil, son
effet devient négatif. Ce seuil est estimé à environ 50 %
du PIB pour la valeur nominale de la dette extérieure et à 20-25
% du PIB pour le niveau estimé de sa valeur actuelle nette
(VAN).3
En revanche, il s'est fait constater au début des
années 80 que les ratios d'endettement atteignaient des niveaux
insoutenables à telle enseigne que le remboursement de la dette devenait
pratiquement impossible. En effet, entre 1970 et 1979, la dette totale de PPTE
se chiffrait à 30,92 milliards de dollars américains,
représentant 79 % des exportations et 20,25 % du PNB. Mais, à
partir de 1980, les principaux indicateurs de la dette se sont
détériorés. A cette période, la dette totale de
l?ensemble des PPTE s?est établie à 145,5
milliards de dollars USD, soit un ratio sur le PIB de 195 % et un
coefficient du service de la dette extérieure de 23,5 %.4
Particulièrement la RD Congo malgré la
création des programmes d?ajustement structurel (PAS) qui avaient comme
mission de réduire les déséquilibres de la balance des
paiements et le déséquilibre budgétaire aggravés
essentiellement par les poids de la dette extérieures mis au point par
la Banque mondial (BM) et le Fond monétaire international (FMI) le
fardeau de la dette extérieure de la RD Congo continuait toujours
à grimper et compromettait ainsi la croissance économique d?une
année à une autre. Ainsi, cette dette publique extérieure
de la RD Congo est passée en terme du PIB de 66,19 % en 1982 à
254,579 % en 1998 et a atteint 254,913 % en 2001 avec de taux de croissance
économique négatif.
Pendant ce temps le gouvernement de la RD Congo a cessé
de rembourser le service de sa dette et elle a accumulé des
arriérés de paiement pour tous ses créanciers
extérieurs (qui comprend les intérêts et le remboursement
du principal). Pendant le régime de Mobutu le pays ne parvenait plus
à honorer ses engagements extérieurs et même
intérieurs et ce ci a eu des conséquences néfastes sur
l?économie zaïroise de l?époque, au tant plus que les
intéréts s?accumulaient pour former des nouvelles grosses dettes
publiques. Ces accumulations des intérêts ont fait que la dette
congolaise croisse beaucoup plus rapidement et a compromis sa croissance
économique. Mais aussi l?insouténabilité et la croissance
excessive de la dette congolaise sont aussi dues par les guerres successives
qu?a connue la RD Congo durant les décennies 90 et 2000 et les
rééchelonnements de cette dette vers les années 90.
Pour essayer d?analyser les conséquences de
l?endettement public extérieur de la RD Congo sur sa croissance
économique dans les deux dernières décennies de 1991
à 2010, il nous revient de réfléchir sur les questions de
fond suivantes:
v' La dette publique extérieure a-t-elle contribué
à la croissance économique de la RD Congo pendant les deux
décennies sous étude?
v' La dette publique extérieure congolaise est-elle
soutenable ou viable ?
Ces deux questions constituent le fil conducteur du
présent travail. Ainsi, les propositions des réponses y relatives
nous conduit à formuler les hypothèses suivantes.

0.2. HYPOTHESE
Nos hypothèses sont formulées de la manière
suivante:
v' Considérant le fait que certains pays se sont
développés grâce au recours à
l?emprunt, nous osons croire que la dette publique
extérieure de la RDC aurait contribuée à sa croissance
économique durant les deux dernières décennies.
v' Au vue des potentialités économiques de la RDC,
sa dette serait soutenable et
viable.
0.3. OBJECTIFS DU TRAVAIL
Le présent travail s?assigne comme objectif d?analyser
les conséquences de l?endettement sur la croissance économique de
la RD Congo. Il essaie d?évaluer s?il existe la relation positive ou
négative entre l?endettement public et la croissance économique
en RD Congo. Mais aussi déterminer le niveau à partir duquel la
dette publique est viable ou soutenable.
0.4. CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL
Dans la réalisation de ce travail, nous avons voulu
relever l?impact de l?endettement public extérieur sur la croissance
économique de la RD Congo. Aussi, ce travail présente pour nous
et pour nos lecteurs plusieurs intérêts dont notamment :
v' D?abord un intérêt scientifique qui
est celui de voir tous les étudiants, décideurs et autres
passionnés de la science de s?en inspirer et s?en servir pour une fin
purement scientifique.
v' Aussi, un intérêt économique.
Ici, nous visons un objectif spécifique compte tenu de la conjoncture
purement économique permettant aux dirigeants de connaître les
comportements de certains agrégats macroéconomique et
vérifier leur incidence sur la croissance économique de la
RDC.
v' En définitive, un intérêt pratique
est celui de montrer le lien qui existe entre la dette
extérieure et la croissance économique d?un pays
donné. 0.5. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
0.5.1. Méthodes
0.5.1.1. Méthode statistique
C?est celle qui consiste à grouper des faits qui se
prétent à une évolution numérique. Grâce
à elle, nous avons pu collecter, traiter et présenter les
données économiques
sous forme des listes de tableaux et quantifier les
données recueillies afin de découvrir leurs significations.
0.5.1.2. Méthode descriptive
Cette méthode nous a facilité à
l?élaboration d?une représentation aussi exacte que possible de
la réalité en regroupant dans un état complet et
cohérent les caractéristiques des phénomènes en
étude. Nous avons de ce fait procédé à une
description objective, systématique et quantitative du contenu de
différentes sources d?informations ainsi que l?interprétation des
résultats obtenus par nos analyses.
0.5.2. Technique
0.5.2.1. Technique documentaire
Cette technique consiste à la collecte des
données à partir des sources écrites en rapport avec le
présent travail. C?est avec ces sources que nous sommes parvenus
à établir notre revue de littérature (état de la
question) et accéder aux différentes informations. Nous avons en
effet parcourus une différente documentation et archive donnant la
situation globale de l?économie de la RD Congo. Dans l?ensemble, nous
avons consulté des ouvrages, articles, revues, les rapports de la BCC,
le site de la Banque Mondiale (BM), le site du fonds monétaire
international (FMI), les condensées, les bulletins d?information
statistiques, notes de cours et autres travaux scientifiques se rapportant au
présent travail.
0.6. DELIMITATION DU SUJET
Pour mieux comprendre et cerner notre sujet, il s?avère
nécessaire de le situer dans le temps et dans l?espace.
0.6.1. Du point de vu temporel
La présente étude porte sur une période
de 20 ans, période allant de 1991 à 2010, celle-ci dans le souci
de bien exploiter et relever les conséquences ou les effets de
l?endettement sur la croissance économique et l?application des
politiques publiques en RD Congo.
0.6.2. Du point de vu spatial
Cette étude a comme champ d?action la République
Démocratique du Congo, un pays en développement situé au
milieu de l?Afrique dans la région des pays de grands lacs.

0.7. ETAT DE LA QUESTION
L?élaboration d?un état de la question consiste
à parcourir la littérature déjà consacrée au
sujet choisi car selon Boulanger et Gainier « la lecture in extenso des
ouvrages des chercheurs précédents permet de
pénétrer leur pensée, d?apprécier les
difficultés qu?ils ont rencontrés et les moyens qu?ils ont
utilisés pour les surmonter, de saisir l?originalité de leur
contribution et les lacunes qu?un autre devra combler, elle permet en outre
d?utiliser les résultats déjà acquis afin que la recherche
à entreprendre soit mieux faite et plus utile »5
Il existe des articles et des documents de travail assez
nombreux sur la dette et la croissance. De notre part, il nous revient de
parcourir, fouiller toute littérature déjà existante
pouvant nous éclairer sur le phénomène que nous voulons
étudier. Pour ce faire, nous avons sélectionné les travaux
de NDUGU MUKASA, MUSAFIRI ALUTA, DEDEHOUANOU G. Modeste Arnaud, Christian NDO,
YAPO Léonce et KONSO BOLA Alain. Ces deux premiers ont
travaillé sur l?économie congolaise mais le troisième, le
quatrième et le cinquième ont respectivement travaillé sur
l?économie béninoise, gabonaise, ivoirienne et le dernier a
travaillé sur l?économie des PPTE africains allant de 1980
à 2000.
NDUGU MUKASA6 cherchait à savoir les
principaux facteurs qui expliquent le niveau de la dette extérieure de
la RDC, mais aussi les mesures de politique économique qu?il faudra
envisager pour l?amorce d?un endettement tolérable à long terme.
Les résultats obtenus dans cette recherche montrent qu?il y a un impact
significatif de la part des variables explicatives sur le ratio de la dette
extérieure sur le PIB ou sur les exportations des biens et services. Son
analyse relève qu?il y a l?existence d?une relation bidirectionnelle
significative entre le taux d?endettement et le taux de la croissance du PIB de
la RDC. En effet, ce dernier exerce un effet contradictoire sur le recours au
financement extérieur aussi bien à long terme qu?à court
terme en plus la capacité de mobilisation des ressources
intérieures.
MUSAFIRI ALUTA7 a essayé d?analyser les
déterminants de la cyclicité budgétaire de la RDC en
allant de 1980 à 2009. De son analyse est ressortie la conclusion selon
laquelle qu?il existe une contrainte budgétaire d?équilibre
à long terme impliquant un retour progressif à l?équilibre
c?est-à-dire que la politique budgétaire congolaise en termes des
recettes tend à retourner à l?équilibre à long
terme. Il ajoute en concluant que la dette extérieure contractée
par la RDC finance essentiellement le déficit budgétaire
d?où son impact
5 Boulanger et Guinier, les sciences sociales et
humaines, éd. Dunod, Paris, 1973, p.15.
6 NDUGU MUKASA, Déterminants de
l'endettement extérieur public de la RDC, mémoire,
inédit, UCB, 2008.
7 MUSAFIRI ALUTA, Analyse des déterminants
de la cyclicité budgétaire en RDC : 1980 à 2009. ,
mémoire, inédit, UOB, 2010-2011.

majeur sur le ratio du solde budgétaire, ainsi, il conclut
en disant que la politique budgétaire de la RDC est soumise à la
contrainte de soutenabilité de la dette publique.
Quant à DEDEHOUANOU G. Modeste Arnaud8
cherche à analyser l'effet de la dette extérieure sur la
croissance économique du Bénin. Il cherchait à expliquer
comment la dette peut favoriser ou non une croissance économique d?un
pays. De son analyse, il est ressorti que l'endettement extérieur du
Bénin et son activité économique ont évolué
de manière cyclique depuis 1974 jusqu'à 2008. Dans la
décennie 1974 la dette extérieure, l'investissement et
l'activité économique ont présenté des taux de
croissance élevés. Dans les années quatre-vingt-dix la
croissance économique a décelé avec l'augmentation de
l'investissement public. Dans son étude il tire un principal
enseignement cadrant de ces résultats qui montre que le niveau
d'endettement du pays n'est d'abord qu'une question de solvabilité avant
d'être un besoin de liquidité.
Christian NDO9 a essayé d?analyser les
effets de la dette extérieure sur la croissance économique du
Gabon. Son analyse débouchera à la conclusion selon laquelle la
dette extérieure gabonaise est un frein pour son développement et
les causes sont liées à la structure de son économie et
à la culture de sa population. Le Gabon est un pays à
économie d'endettement évoluant dans un contexte de
répression financière. Les problèmes de finances publiques
sont étroitement liés à la question de gouvernance. Chaque
fois qu'un problème ancien ou nouveau se présente, le pays a
toujours répondu par une dépense supplémentaire, sans
remettre en cause la routine des dépenses engagées
précédemment sur des sujets antérieurs.
Pour YAPO Léonce10 cherchait à
analyser les déterminants de l?endettement extérieur des PPTE cas
de la Cote d?Ivoire. En utilisant une étude empirique, il aboutit aux
résultats selon lesquels le taux de croissance du PIB évolue dans
le sens contraire de l'endettement en Côte d'ivoire. Donc, un taux de
croissance économique assez élevé réduit les
opportunités d'endettement. Sa conclusion est que les performances
macro-économiques ont tendance à limiter les contraintes
liées aux besoins en capitaux extérieurs.
8 DEDEHOUANOU G. Modeste Arnaud, effet de la dette
extérieure sur la croissance économique au Benin,
mémoire online, Université d'Abomey-Calavi,
2009.
9 Christian NDO: Les effets des dettes
extérieurs sur la croissance économique du Gabon,
mémoire online, université de Yaounde2, 2008.
10 YAPO Léonce « Les
déterminants de la dette extérieure des PPTE : cas de la
Côte d'Ivoire », World Institute for Development Economic Research
(WIDER), Discussion paper N°2002/14, 2002

En fin, KONSO BOLA Alain11 a essayé d?analyser
les effets de la dette
extérieure sur la croissance et les investissements
dans les PPTE africains en utilisant la méthode d?analyse par la
méthode des moments généralisés (MMG).
Il a aboutit aux résultats selon lesquels qu?il n'y a pas
forcément une relation non linéaire entre la dette
extérieure et la croissance des pays pauvres. Ce qui implique qu'il est
difficile de déterminer un seuil standard et critique de la dette qui
rendrait la croissance négative pour les PPTE. Mais il est
généralement admis qu'un stock considérable et excessif de
la dette peut entraver l'effort d'une croissance durable à un certain
niveau.
Quant à nous, il nous reviendra d?examiner dans quelle
mesure l?endettement public a exercé une influence défavorable ou
favorable sur la croissance économique de la RD Congo durant les deux(2)
dernières décennies. Cette analyse est plus motivée par le
fait que la crise de l?endettement s?est traduite par la remise en cause de la
crédibilité de l?Etat congolais, l?éviction des
priorités sociales (éducation, santé, infrastructures de
base, le salaire,...) au profit de remboursement du service de la dette mais
aussi la RD Congo éprouve le problème de solvabilité,
souténabilité et de liquidité qui compromettent la
croissance économique. Nous arriverons à proposer des mesures
pour éviter cette situation délicate pour ce pays.
0.8. PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL
Hormis l?introduction générale, le présent
travail s?articule autour de quatre (4) grands chapitres et clôtura par
une conclusion générale et quelques recommandations.
Le premier chapitre va porter sur l?approche
théorique où nous aurons à clarifier les
différents concepts liés à l?endettement mais aussi nous
aurons à sélectionner les éléments
nécessaires pouvant nous faciliter la compréhension afin de bien
analyser les concepts et la revue de la littérature sur les politiques
économiques tout en faisant une analyse macroéconomique de
l?endettement notamment la politique de l?endettement.
Le second chapitre portera sur la
généralité de la dette publique de la RD
Congo. Dans ceci, nous aurons à présenter la
généralité sur l?endettement congolais tout en
présentant l?historique et les origines de l?endettement de la RDC,
quelques agrégats de la dette publique et la relation de la RDC avec ses
partenaires.
Le troisième chapitre portera sur l?approche
méthodologique. Ce chapitre analysera dans une première
étape la récolte et le traitement des données puis les
différentes
11 KONSO BOLA Alain, les effets de la dette
extérieure sur la croissance et investissement dans les PPTE
africains : analyse par la méthode des moments
généralises, mémoire on line, UNIKIN, 2004-2005
9
variables du modèle d?endettement en utilisant les
figures pour mieux ressortir leurs évolutions, en suite il sera question
de développer la spécification et les méthodes
d?estimation pour l?obtention des résultats.
Enfin, le dernier chapitre va porter sur la
présentation, l'analyse et l'interprétation des
résultats obtenus. Celle-ci va se faire économiquement,
statistiquement et économétriquement. Il sera question
d?analyser, de valider et interpréter les résultats obtenus.
CHAPITRE PREMIER: APPROCHE THEORIQUE
L?objet de ce chapitre est de présenter d?une façon
claire, précise et rigoureuse afin de clarifier à peu près
tous les différents concepts liés à l?endettement.
La première partie sera consacrée aux
définitions des concepts, nous aborderons notamment le concept dette,
dette publique, dette intérieure, dette extérieure, dette
multilatérale, dette bilatérale, dette odieuse,
souténabilité, solvabilité,
surendettement, déficit public, et nous finirons par
présenter les différentes catégories de la dette par un
schéma.
Dans la seconde partie, nous allons développer la
littérature sur la dette et faire une analyse macroéconomique de
la dette afin de bien appréhender les réalités de la dette
d?une manière générale.
En fin, nous développerons la notion relative à la
croissance économique en se basant principalement sur la mesure
généralement utilisée: le taux de croissance du PIB
réel. I.1. DEFINITION DES CONCEPTS
I.1.1. Dette
La dette en soit est une somme d?argent empruntée à
rembourser avec intérêt selon les échéances.
I.1.2. Dette publique
Pour financer le déficit budgétaire le
gouvernement doit emprunter. La dette
publique est, dans le domaine des finances publiques,
l'ensemble des engagements financiers pris sous formes d'emprunts par
l'État, les collectivités publiques et les organismes qui en
dépendent directement (certaines entreprises publiques, les organismes
de sécurité sociale, etc.).12
Selon Lexique des sciences économiques et sociales
7e édition, la dette publique n?est pas seulement celle de
l?Etat, mais aussi celle des autres administrations publiques. Elle inclut la
dette extérieure et intérieure d?un pays. La dette publique est,
le plus souvent, mesurée en pourcentage du PIB. Ce ratio est, en effet,
économiquement plus pertinent que le seul encours de la dette
publique13.
I.1.2.1. Dette intérieure
C?est celle que les pouvoirs publics contractent auprès
des institutions financières
du pays, elle est libellée en monnaie nationale et
pèse sur le budget du pays ; c'est-à-dire,
l?état
s?endette auprès de ses propres banques ou des privées.
L'expression « dette intérieure
12
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dette_publique2011.jpg,
le 20/2/2012 à 23h 45min
13 JEAN PAUL PIROU, lexique des sciences
Economiques et sociales 7e édition, Ladécouverte,
Paris, 2004
publique » désigne les instruments de la
dette émis par les pouvoirs publics (Gouvernement central,
autorités régionales et locales et entreprises publiques).
I.1.2.2. Dette extérieure
La dette extérieure est celle assumée par le
pouvoir public à l?égard des créanciers extérieurs
et est généralement libellée dans une ou plusieurs devises
étrangères, quand les moyens nationaux sont insuffisants l?Etat
s?engage à l?extérieur du pays auprès des autres Etats. La
dette extérieure entraine une véritable colonisation
économique. Elle est repartie en dette extérieure publique et en
dette extérieure privée. Plusieurs autres expressions peuvent
être développé concernant la dette extérieure, tel
que :
L?expression la « dette extérieure publique
» est Selon la Banque Mondiale toute dette remboursable en devises
à des créanciers extérieurs dont l'échéance
initiale ou prorogée (renouvelée) dépasse un an et est
soit contractée directement par un organisme public du pays emprunteur,
soit garantie par l'Etat.
Selon la FMI la « dette extérieure brute
» est égale au montant, à une date donnée, de
l'encours des engagements courants effectifs non conditionnels qui comportent
l'obligation pour le débiteur d'effectuer un ou plusieurs paiements pour
rembourser le principal et /ou verser des intérêts à un ou
plusieurs moments futurs et qui sont dus à des non-résidents par
des résidents d'une économie.
La dette extérieure peut être publique ou
privée, bilatérale ou multilatérale; elle peut être
aussi commerciale. Elle est publique quand elle est contractée par
l?Etat ou par une société privée avec la garantie de
l?Etat. Elle est privée lorsque? elle est contractée par une
société privée suffisamment pour inspirer confiance aux
préteurs en dehors de la garantie de l?Etat. Elle est commerciale si
elle concerne les engagements contractés par un Etat auprès des
banques étrangères commerciales.
I.1.2.2.1. Dette bilatérale
C?est un emprunt accordé par des pays donateurs ; club
de PARIS ; Institution fictive qui n?a pas un statut juridique ; c?est une
réunion entre les représentants des pays en développement
composée de 4 à 6 personnes qui désirent renégocier
sa dette publique extérieure. De fois, ces réunions se passent au
ministère des finances de la république française à
BERCY ou à LONDRES ou encore à NEW YORK.
I.1.2.2.1. Dette multilatérale
La dette multilatérale est définie comme
étant une dette accordée par des organismes internationaux par
exemple : Banque Mondiale, Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement, les Fonds
Monétaires International, La Banque Africaine de Développement,
la banque européenne d?investissement.
I.1.3. Dette odieuse
Si un pouvoir autoritaire contracte une dette non pas selon les
besoins et les intérêts
de l'Etat, mais pour consolider son régime autoritaire,
pour étouffer la population qui le combat, cette dette est odieuse pour
la population de l'Etat entier. Cette dette n'est pas obligatoire pour la
nation : c'est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l'a
contractée; par conséquent, elle tombe avec la chute de ce
pouvoir.
Ainsi, les dettes contractées à l'encontre des
intérêts de la population du pays endetté sont
«odieuses» et, en cas de changement de régime, les nouvelles
autorités ne sont pas tenues de les rembourser. La doctrine de la dette
odieuse trouve son origine au 19ème siècle.
I.1.4. Souténabilité
Selon la FMI, la soutenabilité est la situation dans
laquelle un emprunteur est
capable de payer le service de la dette sans avoir à
opérer des corrections irréalistes dans la balance des revenus et
des dépenses, en d?autres termes sans recourir au
rééchelonnement, sans avoir à accumuler les
arriérés et sans compromettre la croissance.
I.1.5. Solvabilité
La solvabilité est une aptitude d?un agent à
rembourser ses dettes à l?échéance
prévue14. Elle caractérise la
situation financière d'un pays capable de faire face à ses
engagements, c'est-à-dire la contrainte budgétaire inter
temporelle est respectée. En d'autres termes, la solvabilité d'un
État est sa capacité à payer totalement sa dette (annuler
sa dette à long terme en respectant les échéances).
I.1.6. Surendettement
Le surendettement est analogue à la situation d'une
entreprise insolvable non
protégée par les lois de la faillite. Dans ce
cas, les créanciers prennent des actions antagoniques pour se servir les
premiers sur la valeur restante des actifs, préjudiciables à la
survie de l'entreprise. Pour lui, il existe un seuil optimal d'endettement pour
lequel tout supplément marginal d'endettement conduit à une
réduction importante de l'investissement et le débiteur aurait
intérêt à ne pas rembourser la dette.15
14 JEAN-PAUL PIRIOU, Lexique de sciences
économique et sociales 7e édition,
Ladécouverte, Paris, 2004.
15
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dette_publique2011.jpg,
le 20/2/2012 à 23h 45min
I.1.7. Deficit public
Le déficit public apparait lorsque les produits (les
recettes fiscales
essentiellement) sont inférieurs aux charges
(dépenses budgétaires essentiellement) des administrations
publiques. Cette différence entre les charges et les produits
s?apprécie sur une période légale,
généralement l'année civile. La dette publique augmente
à chaque fois qu'un déficit public est financé par
l'emprunt. La dette publique représente donc l'accumulation des besoins
de financement des périodes successives de ces
administrations.16
I.1.8. Schématisation des différentes
catégories d'une dette publique
Dette extérieure privée :
l'emprunteur est un organisme privé dont l'Etat ne garantit

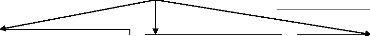
Dette totale
Dette intérieure : le créancier
est a l'intérieure du pays.
Dette publique extérieure : l'emprunteur
est l'Etat ou un organisme dont l'Etat garantie la dette.
Dette extérieure : le créancier
est à l'extérieure du pays.
Part multilatérale : le
créancier est un organisme multilatéral comme le FMI ou la BM.
Part bilatérale : le créancier est
un autre Etat.
Part privée : le créancier est un
organisme privé extérieur.

Source : CADTM « menons l'enquête sur la
dette», 143
De ce diagramme, il ressort que la dette publique est une totale
de la dette ou une
contraction entre la dette intérieure et la dette
extérieure. C?est deux type des dettes forment ce qu?on appelle la dette
publique d?une nation. La dette extérieure publique elle se
décompose en trois parts selon la nature du créancier ; nous
pouvons citer sommairement comme le schéma le montre:
v' la part multilatérale lorsque le créancier est
une institution multilatérale comme le FMI, la BM ou les banque
régionales de développement.
v' la part bilatérale lorsque le créancier est un
autre Etat et
v' la part privée lorsque le créancier est une
institution privée comme une banque quand elle provient des
marchés financiers.
16
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dette_publique2011.jpg,
le 20/02/2012 à 23h 45min
I.2. ANALYSE MACROECONOMIQUE DE LA DETTE PUBLIQUE
Les débats autour de la question d?endettement ont
depuis longtemps divisé les théoriciens économiques,
notamment sur la nécessité du recours à la dette publique
et l?efficacité de la politique d?endettement. La présente partie
replace cette problématique dans sa dimension théorique en
exposant, tour à tour les points de vue de keynésien, de
classique, l?approche de l?endettement optimal après nous aborderons
autres idées relatives en l?endettement public pour finir la partie avec
la dynamique économique de l'endettement public.
I.2.1. Approche keynésienne de l'endettement
public
L?approche keynésienne considère que la politique
gouvernementale
d?endettement a une influence importante sur l?économie
aussi bien à court qu?à long terme. A court terme, le recours
à l?endettement public stimule la demande agrégée et la
croissance économique par les effets multiplicateurs et
accélérateurs. Cela s?expliquerait par la rigidité des
salaires et prix ou des imperfections temporaires qui existent dans la courte
période et qui font que des changements dans la demande
agrégée affecte l?utilisation des facteurs de production de
l?économie. Par contre, à long terme, il entraîne, au
regard de cette approche, une hausse de l?épargne privée moins
importante que la baisse de l?épargne publique, provoquant de ce fait
une diminution de l?épargne nationale. Dans ce cas, l?investissement
domestique déclinera, de même que le revenu national. Avec moins
de capitaux disponibles, la productivité marginale du facteur capital
sera élevée, le taux d?intérêt augmentera ainsi que
le revenu procuré par chaque unité du capital.17
Par ailleurs, cette approche consacre l?implication de l?Etat
dans la vie économique et sociale comme une nécessité
d?efficience globale étant donné que :
1. le marché n?est pas toujours capable d?atteindre le
plein emploi ou de promouvoir une croissance équilibrée et
équitable ;
2. le coüt marginal social d?une activité est
souvent supérieur à son coüt privé ;
3. la myopie inter temporelle dont les agents
économiques sont victimes les conduit à avoir une
préférence pour le présent et partant à
sous-investir dans les domaines de la santé, de l?éducation, des
infrastructures,...
4. tous les biens collectifs ne sont pas productibles par le
marché, y compris certains services collectifs comme la défense
nationale.
Des lors, le budget public devient, pour l?économie
nationale, un stabilisateur conjoncturel qui permet d?intervenir sur la demande
effective : si cette dernière est insuffisante pour assurer le plein
emploi et que l?on se retrouve en récession, l?Etat devra la relever en
augmentant ses dépenses et/ou en prélevant moins d?impôt.
Le déficit qui en résulte pourra etre financé par le
recours à l?emprunt qui devient alors un moyen qui mène à
l?équilibre macroéconomique.
I.2.2. Approche classique de l'endettement public
Selon la tradition classique du 19éme
siècle dont représentée par Adam SMITH, David Ricardo et
John Stuart MILL. Pour le classique, L?Etat a un rôle limité et
doit etre tenu à l?écart des activités économiques
privées ; il ne doit pas intervenir sur le marché car les
déséquilibres se résorbent automatiquement par les forces
du marché. En conséquence, l?Etat n?a qu?un rôle :
préserver la stabilité de l?environnement économique et
garantir le respect des droits de propriété afin d?assurer les
conditions nécessaires au fonctionnement du marché.18
L?emprunt n?est pas vertueux pour les classiques et est à proscrire
(bannir) parce qu?il permet à l?Etat de dépenser plus que ce qui
lui est nécessaire pour assurer sa fonction (NOVARESI, 2001 cité
par NDUGU MUKASA).
Pour BARRO (1974), si le gouvernement finance un accroissement
des dépenses publiques en ayant recours à l?emprunt, le public va
anticiper les augmentations d?impôt nécessaires
ultérieurement pour payer les intérêts de la dette accrue
et pour rembourser le principal. De ce fait, les agents qui développent
des anticipations rationnelles vont se préparer à une
augmentation fiscale future en épargnant une part accrue de leur revenu
disponible et ne vont pas se considérer plus après la mise en
oeuvre de la politique de relance19
Il faut donc remarquer que BARRO expose sa théorie
grâce à un outil appelé fonctions d'utilités inter
temporelles à générations imbriquées, appelé
principe d'équivalence ricardienne. La paternité revient
à Ricardo mais le principe est attribué à BARRO (1974). Il
approfondit la thèse de Ricardo en combinant les thèmes
d'évictions et d'anticipations rationnelles.
La logique de base de
l107uiIalencIRiHICieQne20 étant le
principe général est que la dette publique équivaut
à des impôts futurs et que, si les consommateurs sont suffisamment
fournis vers l?avenir, les impôts futurs équivalent à des
impôts actuels. Financer L?Etat par l?endettement revient donc au
même que financer par les impôts. On appelle cette
18 SEMEDO G., « Economie des finances
publiques » Ellipse, Paris, 2001
19 VAROUDAKIS, « La politique
macroéconomique », Dunod, Paris, 1999
20 GREGORY N.MANKIW, Macroéconomique
7e éd.,Boeck, Bruxelles, 2010. p.596.
interprétation l?équivalence ricardienne,
d?après le nom de célèbre économiste du
19eme siècles, David Ricardo, qui en a le premier
développé l?argumentation théorique. L?implication de
l?équivalence ricardienne est qu?une reduction fiscale financee
par l?emprunt laisse échangée la consommation. Les ménages
épargnent une part accrue de leur revenu disponible pour payer
l?impôt qui leur sera demandé demain. L?approche ricardienne
de la dette publique applique la logique du consommateur tourne vers
l?avenir et l?analyse de l?impact des politique budgétaire.
I.2.3. Approche de l'endettement optimal
Cette approche considère qu?à un certain seuil ;
l?endettement a un effet positif sur l?économie du pays, au-delà
de ce seuil, son effet devient negatif.22 C?est ainsi qu?ils ont
developpe deux modèles dans cette approche : le modèle
d?endettement-croissance et celui du cycle de la dette.
1.2.3.1. Modele d'endettement1WWWW
L?approche d?endettement-croissance montre qu?un pays est
solvable ou peut continuer de s?endetter chaque fois que le taux de croissance
du produit intérieur brut (PIB) est superieur ou egal au coût de
la dette mesure par le taux d?intéret réel.23
De ce fait, il est possible de determiner, pour un pays dont
l?épargne domestique est inferieure au besoin de financement et qui veut
accelerer son processus de croissance, le volume des ressources dont il a
besoin.24
L?objectif est de trouver, à partir d?un taux de
croissance objectif, lui-même determine par les potentialités de
l?économie, un niveau d?endettement optimal. Ce serait l?endettement
juste nécessaire pour combler l?écart entre l?investissement
requis pour atteindre le taux de croissance objectif et l?épargne
domestique disponible.
Pour cette approche, recourir à l?endettement peut etre
profitable pour l?économie jusqu?à un certain seuil. Celui-ci
depasse, la dette publique produit des effets nefastes ou négatifs
susceptibles de compromettre la croissance économique. La
décision d?endettement relève dans ces de la problématique
d?évaluation coit-avantage pour l?Etat.
21 NDUGU MUKASA A., Déterminants de
l'endettement extérieur public de la RDC, memoire, inedit, UCB,
2008.
23 VAROUDAKIS « La politique
macroéconomique », Dunod, Paris, 1999
24 CHEMERY H., « Foreign assistance and
economic development » American Economic Review, 1966.
Certains auteurs, dont ALIDER (1989), appréhendent
l?endettement différemment pour pallier les critiques portées
à l?encontre du modèle de CHEHERY qui repose sur une conception
linéaire du développement économique et considère
le capital comme seul facteur de croissance. Pour CHEHERY, les implications de
la croissance de dette peuvent être analysées
séparément selon qu?il s?agit du problème de
solvabilité ou de liquidité.
Pour assurer la solvabilité à long terme d?un pays
:
1' Les taux de croissance de la dette extérieure en
termes réels doit être égal au taux d?intérêt
réel. La dette croît alors au méme rythme que la
capacité du pays à honorer le service de la dette,
1' le taux d?intérêt réel sur la dette
extérieure additionnelle doit être égal à la
productivité marginale du capital c?est-à-dire à
l?investissement rendu nécessaire grace à l?augmentation de la
dette.
La déamination de la dette optimale en termes de
liquidité revient à choisir un rythme de croissance de la dette
en rapport avec la capacité à assurer le service de la dette.
Le modèle d?endettement-croissance montre que le niveau
d?endettement est positivement corrélé avec le niveau
d?écart entre l?investissement et l?épargne domestique. Cette
approche montre également que la dette extérieure obéit
à un cycle.
1.2.3.2. Modèle du cycle de la dette
La théorie du cycle de la dette est l?aboutissement de
l?approche néo-classique de l?endettement optimal dans la mesure
où elle indique la façon dont devrait normalement étudier
la dette d?un pays.
AVRAMOVIC (1964) cité par NDUGU MUKASA indique à
cet effet qu?un pays qui veut mettre fin à la situation augmente de son
économie et arriver à une croissance auto-entretenu doit
nécessairement passer par certaines étapes qui se traduisent par
le passage de sa position de jeune débiteur, au début de son
processus de croissance, à celui de créancierexportateur des
capitaux.
Pour ce modèle, la justification économique de
l?emprunt extérieur se trouve donc dans la possibilité qu?il
donne au pays de réaliser des investissements, pour lesquels ses
ressources propres sont suffisantes mais sont susceptible de
générer une valeur ajoutée supérieure au moment
où il devra ultérieurement être remboursé.
La durée du cycle varie en fonction des
hypothèses faites sur le taux de croissance que voudrait atteindre le
pays, les taux moyen et marginal de l?épargne intérieure, le taux
d?investissement, le taux d?intérêt moyen et la durée
moyenne des préts.
L?applicabilité du modèle d?AVRAMOVIC ne semble
pas correspondre à l?expérience des pays en voie de
développement où, malgré l?ancienneté du processus
d?endettement, le cycle n?a jamais été clos en raison notamment
d?une épargne initiale faible, d?un bas revenu par tête, d?un
faible taux de rendement du capital et d?un faible rythme de croissance
économique25.
I.2.4. Autres considérations relatives de la dette
publique26
Au-delà de l?opposition entre keynésiens et
classiques sur la question recourir ou
non à la dette publique certains auteurs adoptent une
autre approche pour justifier le recours à l?emprunt public. Les uns
évoquent les effets de la dette publique sur l?équilibre
macroéconomique et le bien-être collectif pour préconiser
le budget équilibré et politique budgétaire optimal.
I.2.4.1. Budget équilibré et politique
budgétaire optimal
En ce domaine, la règle la plus discutée est celle
du budget équilibré. Comme son
nom l?indique, elle voudrait interdire aux gouvernements de
dépenser plus qu?ils ne gagnent. C?est pour trois raisons :
A. Stabilisation Tout d?abord, un
déficit ou un excédent budgétaire peut contribuer à
stabiliser
l?économie. Fondamentalement, la règle du
budget équilibré inhibe l?effet de stabilisation automatique du
système fiscal et des transferts : tout ralentissement de
l?activité économique pèse négativement sur les
prélèvements fiscaux et positivement sur les transferts. Ces
réactions automatiques contribuent certes à stabiliser
l?économie, mais aussi à accroître le déficit
public.
B. Lissage fiscal Deuxièmement, il est
possible d?utiliser un déficit ou excédent budgétaire
pour
atténuer les biais introduits par le système
fiscal. Les impôts élevés constituent un coût pour la
société, dans la mesure où ils découragent
l?activité économique. Plus les impôts sont
élevés, plus l?est également le coüt social du
prélèvement fiscal. Il est possible de minimiser le coüt
social total des impôts en maintenir relativement constant les taux de
prélèvement plutôt qu?en leur permettant de fluctuer
augré de l?activité économique.
C. Redistribution intergénérationnelle
Troisièmement, on peut utiliser le déficit
budgétaire pour transférer la charge
fiscale des générations actuelles vers les
générations futures. Ceci amène certaines
économistes à défendre la thèse
selon laquelle, si les générations actuelles mènent une
guerre au nom de la liberté, les générations futures en
bénéficieront également et doivent, pour cette raison,
partager la charge budgétaire de cette guerre. Ce transfert
intergénérationnel peut se réaliser en finançant la
guerre par un déficit budgétaire : l?Etat résorbera
ultérieurement cette dette en prélevant des impôts sur les
générations futures.
I.2.4.2. Les effets sur la politique
monétaire
L?une de manières de financer le déficit public
est de faire fonctionner la « planche à billet », mais que
cette politique pourrait aboutir à l?inflation et méme à
l?hyperinflation. Certains économistes suggèrent qu?un L?Etat
fortement endetté serait tenté de susciter
délibérément l?inflation. La plupart des dettes publiques
étant libellées en termes nominaux, hausse des prix en
réduit la valeur réelle. C?est là le
phénomène usuel de redistribution entre créanciers (ici le
secteur privée) et le débiteur (l?Etat) suscité par
l?inflation non anticipé. Au contraire des autres débiteurs,
cependant, l?Etat, qui a le pouvoir d?émettre de la monnaie, pourrait
souhaiter le faire dans le but de provoquer une hausse des prix susceptible de
réduire la valeur de sa dette. Cette technique n?est plus
utilisée dans les pays développés depuis des
décennies, où les banques centrales sont indépendantes ou
quasi indépendantes des États.
I.2.4.3. La dimension Internationale de la dette
publique
La dette publique peut également affecter la place d?un
pays au sein de l?économie mondiale. Le déficit public qui
réduit l?épargne national entraine souvent aussi un
déficit commercial qu?il faut à son tour financer par l?emprunt
à l?étranger. Cette liaison entre déficit
budgétaire et déficit commercial induit deux effets
supplémentaires de la dette publique.
Tout d?abord, un degré élevé
d?endettement public accroit le risque de fuit des capitaux, qui traduit une
forte et soudain réduction de la demande de la monnaie du pays
concerné sur le marché financiers internationaux. Certes les
investisseurs internationaux savent qu?un Etat endetté peut toujours, en
dernier ressort avoir recours aux défauts de paiement. Plus est
élevé le degré d?endettement, plus est grande la tentation
de ne pas rembourser. En conséquence, à mesure que croît
l?endettement des Etats, les investisseurs internationaux craignant le
défaut de paiement, sont incités à réduire leurs
prêts.
Deuxièmement, une importante dette publique
financée par l?emprunt à l?étranger peu affecter le poids
du pays concerné dans la concertation internationale. C?est la crainte
qu?exprime l?économiste Ben Friedman dans son livre Day of Reckoming que
l?on pourrait traduire par « le jour où il faudra rendre comptes
», publie en
1988 : « historiquement, les pays créanciers
détiennent pouvoir et influence à l?échelle mondiale. Ce
n?est pas pure coïncidence si les USA ont accédé au statut
de puissance mondiale au moment où, des nations débitrices, ils
se transformaient en créancier fournissant au reste du monde les
capitaux nécessaires à l?investissement.» La comparaison
internationale est une autre manière d?évaluer l?ampleur de la
dette.
I.2.6. La dynamique économique de l'endettement
public27
Dans ce point, nous verrons comment un pays peut financer sa
dette par un solde budgétaire positif.
En effet, la dette publique de l'année est égale
à la dette de l'année passée à laquelle on a
soustrait le solde budgétaire. En effet, d'une année sur l'autre,
la dette diminue si le solde budgétaire est en excédent. Au
contraire, si le solde budgétaire est en déficit, la dette
augmente : le déficit budgétaire de l'année en cours
s'ajoute à la dette publique du passée. La dette est ainsi le
produit de l'accumulation des déficits budgétaires du
passé.
Or, le solde budgétaire se décompose en deux
éléments :
1. le solde primaire, c'est-à-dire la
différence entre les recettes de l'année et les dépenses
de l'année hors paiement des intérêts de la dette.
Si ce solde est négatif, on parle de déficit primaire,
s'il est en excédent, d'excédent primaire.
2. le paiement des intérêts dus sur la dette
publique passée et que l'État doit rembourser l'année en
cours.
Au final on a donc :
Solde budgétaire = solde primaire -
intérêts de la dette et
Dette de l'année = dette passée - solde
budgétaire
D' où l'on déduit : solde budgétaire
< 0 dette de l'année > dette passée.
En notant SPt le solde primaire de
l'année t, r le taux d'intérêt et
Dt - 1 et Dt
les dettes respectivement de l'année t -
1 et de l'année t :
Solde budgétaire = SPt - r
* Dt-1
Dt= Dt-1 - solde budgétaire
Dt = (1+r)*Dt-1-SPt
Cette équation nous permet de voir que la dette
dépend :
· de l'importance de la dette passée ;
· des taux d'intérêt ;
· du solde primaire.
Comme on le voit sur la page précédente, le solde
budgétaire est fonction :
27
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dette_publique2011.jpg,
le 20/2/2012 à 23h 45min
1. du solde primaire, qui résulte directement des
décisions prises par les pouvoirs publics durant l'année en
cours,
2. du paiement des intérêts de la dette, qui
découle des engagements financiers passés. Pour un gouvernement,
il est donc pertinent de connaître quel type de solde primaire il doit
dégager pour maintenir ou diminuer son taux d'endettement.
Ce solde primaire dépend de la différence entre
taux d'intérêt et taux de croissance nominale (ou taux de
progression du PIB en valeur, autrement dit la somme du taux de croissance
réelle et du taux d'inflation).
En effet, à partir de l'équation à
laquelle on avait abouti dans la page précédente, on peut montrer
qu'un État qui souhaite stabiliser son taux d'endettement doit avoir un
solde primaire rapporté au PIB égal à :
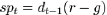
.
Avec spt, le solde primaire par rapport au PIB
(égal à SPt / PIB) ; dt - 1, le taux
d'endettement de l'année t-1 (égal à Dt - 1 /
PIB) ; r le taux d'intérêt réel
et g le taux de croissance nominal (i.e., inflation incluse,
car l'inflation a sur le poids de la dette publique, le même effet que la
croissance réelle).
La dynamique de la dette peut être déduite de la
manière suivante :
On a: Dt = (1+r) * Dt
-1-SPt (1)
Pour obtenir ces grandeur en proportion du PIB, il suffit de les
diviser par le PIB
(Yt):
Dt/Yt = (1+r)
*Dt-1/Yt-SPt/Yt (2)
Puisque Yt=(1+g)Yt-1
(2) ;
On peut donc écrire que:
Dt/Yt = (1 + r) /(1 + g)*
Dt-1/Yt-1-SPt/Yt (3) d
t= (1 + r)/(1 + g)*
dt-1-spt (4)
spt=(1 + r)/(1+ g) * dt
-1-dt (4')
Pour que la dette publique soit stable, on doit avoir
dt = dt - 1.
Par conséquent:
spt = (1 + r) / (1 + g) * dt
- 1 - dt - 1 (5) spt = (r - g) / (1 +
g) * dt - 1 (6)
Dans la mesure où g est petit par rapport
à 1, on peut simplifier (6) en: spt = dt -
1(r - g)
Cette relation signifie que le solde primaire qui stabilise
l'endettement dépend de la différence entre le taux
d'intérêt et le taux de croissance. Plus
précisément, on peut distinguer trois situations :
1. si les taux d'intérêt sont égaux au taux
de croissance nominale (r = g), un solde primaire en
équilibre (spt = 0) maintient la dette publique stable.
2. si les taux d'intérêt sont supérieurs
au taux de croissance nominale (r> g), le solde primaire
doit être en excédent (spt > 0) pour maintenir la
dette stable. Si le solde primaire est simplement à l'équilibre,
alors la dette s'accroît. C'est ce qu'on appelle l'effet « boule de
neige » de l'endettement : d'année en année, l'endettement
va augmenter de plus en plus. Dans la situation où les taux
d'intérêt sont supérieurs à la somme des taux de
croissance réelle et d'inflation, un État qui souhaite stabiliser
son taux d'endettement est donc contraint d'avoir un excédent de son
solde primaire d'autant plus important que l'écart entre taux
d'intérêt et taux de croissance nominale est fort.
3. si les taux d'intérêt sont inférieurs
au taux de croissance nominale (r<g), le solde primaire
peut être en déficit (spt < 0), sans que la dette ne
croisse. Si le solde primaire est simplement à l'équilibre, le
taux d'endettement diminue même d'année en année.
Au final, deux relations sont importantes dans la dynamique de
l'endettement :
1. L'endettement peut être maintenue stable avec des
déficits budgétaires d'autant plus élevés que la
croissance du PIB en valeur est forte.
2. L'endettement peut être maintenu stable même
si les administrations publiques maintiennent en permanence des déficits
primaires, pour autant que le taux de croissance soit supérieur au taux
d'intérêt. Par conséquent, les variations de l'endettement
dépendent très fortement de l'écart entre les taux
d'intérêt et le taux de croissance. Les taux
d'intérêt élevés ont donc un impact négatif
sur l'endettement : s'ils sont supérieurs à la croissance
nominale, ils accroissent mécaniquement la dette publique, même
avec un solde primaire en équilibre. Si l'écart entre les deux
est très grand, cela peut aller jusqu'à un effet « boule
de neige », où l'endettement n'est plus maîtrisable,
sauf à dégager de très importants excédents
budgétaires. Au contraire, la croissance économique réelle
et l'inflation ont un impact positif sur le taux d'endettement : si leur somme
est supérieure au taux d'intérêt, cela permet de diminuer
le taux d'endettement, même avec un solde primaire en
déficit.28
28
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dette_publique2011.jpg,
le 21/2/2012 à 20h 50min
I.3. LA CROISSANCE ECONOMIQUE
I.3.1. Définition 29
Les économistes utilisent le terme de croissance
conventionnellement pour décrire une augmentation de la production sur
le long terme. Selon la définition de François PERROUX, la
croissance économique correspond à « l'augmentation soutenue
pendant une ou plusieurs périodes longues d?un indicateur de dimension,
pour une nation, le produit global net en termes réels. La
définition de Simon KUZNETS va au-delà et affirme qu'il y a
croissance lorsque la croissance du PIB est supérieure à la
croissance de la population.
La croissance économique désigne la
variation positive de la production de biens et de services marchands dans une
économie sur une période donnée,
généralement une période longue. En pratique, l'indicateur
le plus utilisé pour la mesurer est le produit intérieur brut ou
PIB. Il est mesuré « en volume " ou « à prix constants
" pour corriger les effets de l'inflation. Le taux de croissance, lui, est le
taux de variation du PIB. On utilise souvent la croissance du PIB par habitant
comme indication de l'amélioration de la richesse individuelle,
assimilée au niveau de vie. La croissance est un processus
fondamental des économies contemporaines, lié notamment à
la révolution industrielle, à l'accès à de
nouvelles ressources minérales (mines profondes) et
énergétiques (charbon, pétrole, gaz, énergie
nucléaire...) ainsi qu'au progrès technique. Elle transforme la
vie des populations dans la mesure où elle crée davantage de
biens et de services. À long terme, la croissance a un impact important
sur la démographie et le niveau de vie (à distinguer de la
qualité de vie) des sociétés qui en sont le cadre. De
même, l'enrichissement qui résulte de la croissance
économique peut permettre de faire reculer la pauvreté.
A court terme, les économistes utilisent plutôt le
terme d'« expansion ", qui s'oppose à « récession ", et
qui indique une phase de croissance dans un cycle économique.
I.3.2. Mesure de la croissance
La croissance économique est généralement
mesurée par l'utilisation d'indicateurs économiques dont le plus
courant est le produit intérieur brut (PIB). Il offre une certaine
mesure quantitative du volume de la production. Afin d'effectuer des
comparaisons internationales, on utilise également la parité de
pouvoir d'achat, qui permet d'exprimer le
29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique,
le 15/09/2012 à 10h 30min
pouvoir d'achat dans une monnaie de référence. Pour
comparer la situation d'un pays à des époques différentes
on peut également raisonner à monnaie constante.30
I.3.2.1. Le Produit Intérieur Brut (PIB)31
Le PIB étant un élément important dans la
mesure de la croissance économique, il importe que nous approfondissions
cette notion. Il est égal à la somme en valeur de la consommation
privée, de l'investissement, des dépenses de l'État, des
variations des stocks et des exportations, moins celle des importations. Ces
éléments sont appelés « composantes » du PIB.
Mais on peut également le calculer à partir des coûts de
production, en y soustrayant les impôts indirects et en y ajoutant les
subventions, ce qui donne une idée plus précise du revenu
attribuable aux facteurs de production.
Le PIB est généralement calculé à
partir des prix du marché, Produit intérieur brut (PIB),
évaluation monétaire de la somme des valeurs ajoutées
créées en une année par toutes les entreprises nationales
et étrangères, implantées sur le territoire d?un pays. Par
exemple, la production des sociétés américaines
basées au Congo entre dans le PIB du Congo, et non dans celui des
États-Unis.
La plupart des pays considèrent le PIB comme le meilleur
indicateur de l'activité économique et donc de la croissance
économique du pays.
Le PIB peut être exprimé en valeur constante ou
en valeur courante, qui tient compte de l'inflation. On peut mesurer le PIB de
trois façons différentes : en faisant le total de la valeur de
tous les biens et services produits, en faisant le total des dépenses en
biens et en services au moment de leur vente, ou enfin en faisant le total des
recettes des producteurs tirées de la vente des biens et services. En
théorie, ces trois méthodes devraient aboutir au même
résultat, la production étant égale aux dépenses,
elles-mêmes égales au revenu. En réalité, il est
impossible de mesurer le PIB avec précision, notamment à cause de
la présence d'une économie souterraine dans chaque pays. Le
niveau de vie dans un pays a souvent pour indicateur le PIB par habitant, qui
est calculé en divisant le PIB du pays par le nombre d'habitants.
30
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique,
le 15/09/2012 à 10h 30min
31 ?Produit Intérieur Brut [PIB]??,
Microsoft® Encarta® 2009[DVD], Microsoft Corporation, 2008
I.3.3. Les déterminants de la croissance32
On peut distinguer plusieurs types de déterminants de la
croissance :
v' Richesses naturelles,
1' environnement extérieur,
1' population, 1' innovation, 1' investissement,
v' connaissance,
v' cohérence du développement.
I.3.4. Etapes de La croissance économique
La croissance économique se passe sous 5
différentes phases caractérisées par :
10 Société traditionnelle:
caractérisée par la société agricole,
stationnaire, où la terre constitue l?unique source de richesses. Les
perceptives de changement sont inexistantes, la structure sociale est
très hiérarchisée.
20 Phase des conditions préalables au
décollage: les notions de changement et de progrès se
diffusent largement. L?épargne et l?investissement augmentent.
3o Décollage ou « take off »
phase de courte durée au cours de laquelle les branches
motrices émergent. La croissance devient régulière et
crée un processus cumulatif, autoentretenu.
4o Passage à la maturité:
diffusion du décollage à l?économie dans son
ensemble. De nouvelles industries se substituent aux anciennes ; les
productions se diversifient.
5oEre de la consommation de masse :
les besoins essentiels sont satisfaits. La politique sociale de
bien-être ou puissance économique.33
32
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique,
le 15/09/2012 à 10h 30min
33 Microsoft Encarta Corporation [DVD], 2009
26
CHAPITRE DEUXIEME: GENERALITE DE LA DETTE
PUBLIQUE DE
LA RD CONGO
Ce chapitre est réservé à l?historique et
aux origines de la dette extérieure, à l?évolution de
quelques agrégats de la dette publique extérieure de la RDC et la
relation de la RDC avec ses bailleurs de fonds en 2010. Nous aborderons tour
à tour ces quatre notions pour bien appréhender les
réalités de la dette publique extérieure de la RD Congo
depuis sa colonisation jusqu?à nos jours.
II.1. HISTORIQUE DE LA DETTE DE LA RDC34
Historiquement les premiers emprunts émis par le Congo
belge datent de 1936- 1937, bien avant méme que cette colonie
n?accède à l?indépendance. Selon le CADTM, « la dette
publique du Congo belge s?élevait en 1949 à 3,7 milliards de
francs (principalement en francs belges et une petite partie en francs
congolais). En 1950, c?est-à-dire 10 ans avant l?indépendance, le
pouvoir colonial avait adopté un plan décennal ?de
développement?? représentant ses propres intérêts et
comme celui-ci n?avait pu être mené à bien, le pouvoir
colonial cherchait de l?argent partout pour compenser un déficit qui
allait mener à la faillite. Tous ces emprunts faits dans
l?intérêt du pouvoir colonial avaient été
transférés au Congo à peine indépendant, ce qui est
totalement interdit par le droit international.
L?étude minutieuse de la situation comptable congolaise
des 10 dernières années précédentes
l?indépendance montre que le Congo déboursa plus de 64 milliards
de francs pour financer ce plan de ?développement??
dont les résultats furent les suivants : l?augmentation
démesurée de l?endettement public : la dette publique passant en
moins de 10 ans, de 3,7 milliards à 46 milliards; une succession de
budgets ordinaires déficitaires à partir de 1957; une inflation
qui prit des proportions catastrophiques en 1959 entraînant la diminution
progressive de la couverture en or et devises de la monnaie fiduciaire et
aboutissant, le 29 juin 1960, à l?épuisement quasi-total de cette
couverture, ainsi que la dépréciation de la monnaie
représentant une perte de 90% de la valeur du franc congolais; la
faillite totale de la trésorerie; la fuite massive des capitaux vers la
Belgique.
L?accroissement rapide de la dette publique du Congo a donc eu
lieu à partir de 1950 jusqu?en 1960 où elle atteindra 46
milliards de francs. Au 30 juin 1960, la dette publique du Congo
équivalait à 46,1 milliards de francs belges répartis de
la manière suivante :
v' 35 milliards à long terme et moyen terme
34
www.cadtm.org/La-dette-exterieure-de-la-RDC-Une,
le 15/6/2012 à 17h 25min
1' 11 milliards à court terme.
Cette dette n?englobait ni l?emprunt de 1905, ni les soldes en
dollars de trois préts de la Banque mondiale dont la contrevaleur en
francs belges était de 36.744.800 francs.
Le pouvoir colonial belge, qui avait entraîné
pour son propre intérêt le Congo belge dans un plan
décennal incohérent, avait provoqué une hémorragie
financière et un surendettement du Congo belge pour financer ce plan.
Cela avait inévitablement conduit le pays au bord de la faillite. Depuis
son accession à la souveraineté nationale, la République
Démocratique du Congo se trouve enfermée dans le cycle infernal
d?une lourde dette publique extérieure qui s?est greffée sur la
dette coloniale.
En effet, ?les prêts odieux aux
métropoles coloniales ont été légués comme
un boulet aux jeunes nations indépendantes. Dans le cas du Congo Belge,
les millions de dollars qui lui ont été prêtés pour
des projets décidés par le pouvoir colonial ont presque
totalement été dépensés par l'administration
coloniale du Congo sous forme d'achat de produits exportés par la
Belgique. Le Congo Belge a reçu en tout 120 millions de dollars de
prêts (en 3 fois) dont 105,4 millions ont été
dépensés en Belgique??.
Ces préts qui n?ont servi que les intérêts de
la Belgique constituaient un véritable tour de passe-passe aux
dépens du Congo et ses populations.
Voilà comment, lorsque le Congo belge a
accédé à l?indépendance, les principaux
actionnaires s?étaient mis d?accord pour lui transmettre la charge de la
dette contractée par le pouvoir colonial belge auprès de la
Banque mondiale. Ainsi, une fois le Congo devenu indépendant, les
prêts contractés par la Belgique auprès de la Banque
mondiale afin de mieux exploiter le Congo belge et ses ressources sont devenus
une dette du Congo indépendant par simple jeu d?écriture.
II.2. LES ORIGINES DE LA DETTE PUBLIQUE DA LA RD
CONGO35
La dette extérieure de la République
démocratique du Congo, en phase de restructuration depuis 2002, trouve
son origine durant les années de dictature de Mobutu en période
de guerre froide. Plaque tournante de la CIA, le Zaïre de Mobutu a
bénéficié d?une aide extérieure de plusieurs
centaines de millions de dollars annuels de la part de ses parrains
occidentaux. Ces derniers ont laissé se développer un
système de corruption et de détournements de fonds, ainsi que le
financement d?« éléphants blancs » - à commencer
par le barrage d?Inga, à la baise du cycle d?endettement
extérieur qui a conduit le pays à la
banqueroute dans les années 1980. Après une
période d?euphorie (1967-1972), notamment due à la bonne tenue du
cours du cuivre, les nuages économiques se sont en effet vite
amoncelés. Dès 1973, année de la
"zaïrianisation" des entreprises étrangères, les
difficultés financières ont vu le jour et n?ont cessé de
s?aggraver au fur et à mesure des années.
Dès 1976, Mobutu est contraint de
rétrocéder les entreprises étrangères
"zaïrianisées" et de mettre sur pied un Comité de
stabilisation qui supervise l?application de deux programmes successifs (en
1976 et en 1977). Suite à l?échec de ce double programme, un
troisième plan de stabilisation est mis en oeuvre en 1979-1980 sous la
supervision du FMI. La monnaie du pays est dévaluée pas moins de
six fois entre novembre 1978 et février 1980. Cette succession de
mesures ne suffit en rien à enrayer la crise, mais Mobutu sait que son
rôle géostratégique lui assure de bénéficier
d?un flux extérieur continu pour boucler ses fins de mois.
Cependant, la crise de la dette du tiers-monde, dont le
Zaïre est une des principales victimes en Afrique, bouleverse ce
mécanisme bien huilé. Dès septembre 1983, le Zaïre
fait partie des pays pionniers à passer sous la coupe des plans
d?ajustement structurel(PAS) concoctés (dressés) par les
institutions financières internationales. Commencent alors les
années de "traitement de choc" et d?"assainissement" orchestrées
par le Premier ministre Kengo wa Dondo, en étroite collaboration avec le
FMI et la Banque mondiale. Le service de la dette mobilise plus des deux tiers
des dépenses de l?État. Les coupes sombres dans les
dépenses sociales poussent les populations à développer
des stratégies de survie. Les soins de santé deviennent payants
et les emplois de plus de la moitié des enseignants sont
supprimés. Méme Mobutu, habitué à disposer d?un
cinquième des recettes de l?État et inquiet de voir sa cassette
personnelle allégée, exprime alors son désaccord.
Ce régime, agrémenté d?une succession
impressionnante de rééchelonnements de dette (neuf au total !1),
perdure jusqu?à la fin de la guerre froide, qui fait que Mobutu devient
une relique dictatoriale d?un temps désormais révolu. Ses
frasques (écarts) financières et politiques sont de moins en
moins tolérées. Le massacre d?étudiants à
l?université de Lubumbashi, en mai 1990, finit de ternir son image. Le
Zaïre est définitivement lâché par la Belgique, puis
par les États-Unis, ses anciens parrains, avant que la Banque mondiale
et le FMI claquent la porte à leur tour.
Sur fond de pillages et de guerres, dont la première
allait provoquer la chute du dictateur en mai 1997, la décennie des
années 1990 débouche sur une rupture avec les institutions
financières internationales et sur l?arrêt presque total du
paiement de la dette
extérieure - seuls quelques remboursements
d?arriérés ont été opérés par le
gouvernement Kengo wa Dondo au milieu des années 1990, puis par Laurent
Désiré Kabila en juin et juillet 1998, mais ils ont
respectivement cessé dès le début de la première
guerre (1996-1997), puis de la deuxième (août 1998).
Au fur et à mesure que les années ont
passé, les intérêts ont continué de courir et de
gonfler le stock des arriérés, jusqu?à 500 millions de
dollars par an. Au début des années 2000, la dette
extérieure congolaise, qui équivalait une décennie plus
tôt au montant des biens mal acquis par Mobutu et son « clan »
(8 milliards de dollars), atteignait plus de 13 milliards de dollars. Plus de
70% de cette dette était due aux créanciers bilatéraux du
Club de Paris, dont les deux tiers à cinq pays (Etats-Unis, France,
Belgique, Allemagne et Italie).
II.3. EVOLUTION DE QUELQUES AGREGATS DE LA DETTE
PUBLIQUE
EXTERIEURES DE LA RDC
II.3.1. Stocks dette exterieure de la RDC
Le stock de la dette extérieure est constitué de
l?encours de la dette, des intéréts contractuels, des
intérêts de retard et de diverses occasionnées lors des
négociantions pour l?obtension des préts.
Voici comment le stock de la dette de la RDC a
évolué durant les 20 dernières années sous
étude.
Tableau n0 1: Evolution du stock de la
dette extérieure de la RDC par groupe de créanciers (1991
à 2010)
(sommes exprimées en DTS et USD)
|
Créanciers Années
|
Stocks
|
Repartion du stocks de la dette par groupe des
créanciers
|
|
FMI
|
Club de
Paris
|
Club de
Kinshasa
|
Club de
Londres
|
Instistutions Multilaterales
|
Dont BAD
|
Autres
|
Stock en $
|
|
1991(1)
|
6717,6
|
184,8
|
4643,6
|
176,2
|
359,1
|
1214,9
|
0,00
|
139,0
|
8830,29
|
|
1992
|
6864,7
|
186,2
|
4663,0
|
177,2
|
383,0
|
1323,7
|
370,6
|
131,6
|
9023,65
|
|
1993
|
6907,9
|
209,3
|
4663,0
|
178,6
|
383,0
|
1343,0
|
0,00
|
131,0
|
9080,43
|
|
1994
|
6683,6
|
219,6
|
4602,3
|
173,4
|
240,8
|
1343,9
|
0,00
|
141,6
|
8785,59
|
|
1995
|
8672,5
|
370,9
|
5976,1
|
230,6
|
434,7
|
147,2
|
361,1
|
183,6
|
11400
|
|
1996
|
9967,1
|
358,2
|
6874,8
|
67,1
|
452,7
|
1771,2
|
376,0
|
443,9
|
13101,75
|
|
1997
|
9439,84
|
354,7
|
6649,0
|
286,5
|
27,4
|
1652,4
|
626,0
|
469,8
|
12408,67
|
|
1998(2)
|
13292,4
|
518,3
|
9175,6
|
400,4
|
37,2
|
2461,6
|
776,5
|
699,2
|
13292,4
|
|
1999
|
13533,7
|
517,7
|
9385,0
|
393,5
|
37,3
|
2497,2
|
761,6
|
702,9
|
13533,7
|
|
2000
|
12742,9
|
500,8
|
8771,2
|
419,3
|
37,2
|
2271,4
|
697,2
|
743,0
|
12742,9
|
|
2001
|
13573,3
|
509,3
|
9499,0
|
461,4
|
37,2
|
2293,1
|
853,9
|
773,3
|
13573,3
|
|
2002
|
10311,92
|
528,5
|
5998,5
|
449,1
|
57,9
|
2917,7
|
0,00
|
360,2
|
10311,92
|
|
2003
|
10722,6
|
700,7
|
6007,5
|
524,0
|
58,8
|
3048,1
|
0,00
|
383,7
|
10722,6
|
|
2004
|
11186,3
|
815,4
|
6418,8
|
438,6
|
58,1
|
3125,2
|
1041,9
|
330,2
|
11186,3
|
|
2005
|
9999,6
|
792,4
|
5106,0
|
471,6
|
28,6
|
3297,4
|
970,38
|
303,6
|
9999,6
|
|
2006
|
10522,11
|
831,25
|
5349,04
|
612,71
|
28,57
|
3383,29
|
0,00
|
317,25
|
10522,11
|
|
2007
|
10973,25
|
867,2
|
5856,4
|
586,3
|
41,4
|
3446,2
|
978,5
|
175,8
|
10973,25
|
|
2008
|
10878,8
|
653,4
|
5972,3
|
540,3
|
41,4
|
3501,7
|
1070,5
|
168,7
|
10878,8
|
|
2009
|
12467,7
|
1602,4
|
6679,3
|
609,2
|
41,4
|
3371,8
|
2945,0
|
163,7
|
12467,7
|
|
2010(p)
|
3164,5
|
0,00
|
180
|
557,2
|
8,8
|
1873,5
|
0,00
|
545,0
|
3164,5
|
Source : -BZ, Rapports annuels 1991 - 1996 -BCC, Rapports
annuels 1997 - 2010
(1) Montants exprimés en DTS à partir de cette
année
(2) Montants exprimés en USD dépuis la source
à partir de cette année (p)Prévision
Ce tableau nous montre l?évolution du stock de la dette
publique extérieure congolaise et ses créanciers durant les 20
années d?étude.
Il ressort que le potentiel créancier de la RDC est le
Club de Paris pour les deux dernières décennies suivi des
institutions multilatérales sans le FMI, suivie du FMI et puis le Club
Kinshasa suivi du Club de Londres et les autres créanciers prennent une
petite portion de la dette.
Figure no1: Evolution du stock de la
dette publique exterieure congolaise(montant en
millions de
USD)
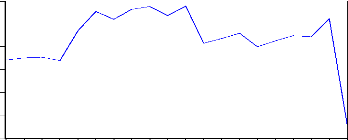
0 Source : -BZ, Rapports annuels 1991-1996 -BCC, Rapports
annuels 1997-2010
Dans cette figure nous pouvons mettre quatre périodes
évidences en vu de bien expliciter ce qu?elle ressort. La
première période va de 1991 à 1994, la seconde
période va de 1995 à 2001, la troisième période va
2002 à 2009 et dernière période couvre seulement
l?année 2010.
De 1991 à 1994 on remarque une croissance
légère du stock de la dette passant ainsi à 8830,29
millions d?USD en 1991, 9023,65 millions d?USD en 1992, 9080,43 millions
9
d?USD en 1993 après avoir connu une légère
régression en 1994 en occurrence de 8785,59
S T OCK DE T T E 02
millions d?USD.
Pour la deuxième phase qui va de 1995 à 2001
où l?on observe une croissance lourde du stock de la dette en occurrence
de 11400,00 millions d?USD en 1995 contre 13101,75 millions en 1996,
après, elle subit une légère diminution en 1997 passant en
12408,67 millions d?USD. En 1998 et 1999, la dette congolaise continue à
croitre passant respectivement de 13292,4 à 13533,7 millions d?USD. En
2000, Il s?observe une légère diminution de la dette par rapport
à l?année passée et estimé à 12742,9
millions d?USD. La
dette prendra encore l?ascenseur en 2001 en occurrence de
13573,3 millions d?USD. Pendant ce temps la dette de la RD Congo augmente de
manière continue. Cette progression de la dette est due aux guerres
successives qu?a connues la RD Congo depuis 1996 car pendant ce temps la RD
Congo n?avait pas pu honorer son service de la dette (cfr Tableau III).
Au fur et à mesure que les années ont
passé, les intérêts ont continué de courir et de
gonfler le stock des arriérés, jusqu?à 500 millions de
dollars par an. Au début des années 2000, la dette
extérieure congolaise, qui équivalait une décennie plus
tôt au montant estimé des biens mal acquis par Mobutu et son
« clan » (8 milliards de dollars), atteignait plus de 13 milliards de
dollars. Plus de 70% de cette dette était due aux créanciers
bilatéraux du Club de Paris, dont les deux tiers à cinq pays
(Etats-Unis, France, Belgique, Allemagne et Italie).
La troisième phase va de 2002 à 2009, cette
période est caractérisée par une régression de la
dette par rapport à la phase précédente. C?est grace aux
annulations obtenues au cours de l?année 2002. Il passe ainsi à
13573,3 millions de USD en 2001 contre 10311,92 millions en 2002, soit une
baisse de 24,0%. En 2003, le stock a enregistré un accroissement
estimé à 16,1% à fin septembre 2003. Il subit une
régression en 2005 où il passe de 11186,3 millions de USD en 2005
contre 9999,6 millions de USD en 2004. S?agissant du stock de la dette
extérieure en 2006 et 2007, ils avaient été respectivement
évalués à 10522,11 millions de USD en 2006 et 10973,25
millions de USD en 2007 soit une légère croissance par rapport
à l?année 2006. Mais ce stock subira une légère
régression en 2008 par rapport à l?année 2007 où il
sera évalué à 10973,25 millions de USD contre 10878,8
millions d?USD en 2008. Cette évolution est due essentiellement à
la baisse de la dette due au FMI, au Club de Paris et au Club de Kinshasa.
L?année 2009, elle a été caractérisée par
une large croissance du stock de la dette en occurrence 12467,7 millions de USD
contre 10878,8 millions d?une année auparavant.
Par contre l?année 2010 a été
caractérisée par une décroissance très aigue du
stock de la dette suite à la faveur d?achèvement de l?initiative
PPTE, le stock de la dette extérieure est passé de 12467,7
millions de USD en 2009 à 3164,5 millions de USD. Il subit ainsi une
décroissance de 293,97%. Cette situation a amélioré
sensiblement les indicateurs de la souténabilité de la dette
congolaise.
II.3.2. Service de la dette de la RDC
Le service de la dette est la somme que l'emprunteur
doit payer chaque année pour honorer sa dette. Il ne faut pas
le confondre avec la charge de la dette, qui ne recouvre que le poids des
intérêts seuls. Il indique la manière dont un pays doit
rembourser sa
dette entre autre le remboursement du principal et des
intérêts et combien il lui restera pour assurer le financement des
importations. Il permet donc de tenir compte de l?effet d?éviction
dü au fait que des ressources sont affectées au service de la dette
plutôt qu?à des investissement ou à des dépenses
intérieures propice à la croissance.
Cette somme comprend deux parties :
· les intérêts qui sont
calculés en appliquant un taux d'intérêt au capital restant
dû (la somme qui n'a pas encore été remboursée). Ce
taux d'intérêt a été fixé au moment de
l'emprunt.
· le principal, c'est-à-dire le
montant du capital emprunté qui est remboursé chaque année
(annuité). Ce montant dépend donc de la durée et du
montant total de l'emprunt (par exemple on peut rembourser un dixième de
la dette pendant dix ans).
Nous présentons ci-dessous dans le tableau II et figure 2
cette évolution.
Tableau n0 2: Evolution du service de la
dette extérieure de la RDC par groupe de créanciers (1991
à 2010)
(Montant en millions DTS et en USD)
1. Service dû
|
Créanciers Années
|
Service dû
|
Repartion du services dû de la dette par groupe des
créanciers
|
|
FMI
|
Club de
Paris
|
Club de
Kinshasa
|
Club de
Londres
|
Instistutions Multilaterales
|
Dont BAD
|
Autres
|
Service dû en $
|
|
1991(1)
|
1673,6
|
125,6
|
1053,2
|
47,0
|
359,1
|
67,5
|
45,1
|
21,3
|
2199,95
|
|
1992
|
2854,7
|
141,2
|
2105,9
|
52,9
|
383,0
|
143,0
|
93,5
|
28,7
|
3752,5
|
|
1993
|
3631,7
|
209,3
|
2678,2
|
144,3
|
383,0
|
185,7
|
144,6
|
31,2
|
4773,87
|
|
1994
|
4032,5
|
267,4
|
2878,9
|
153,9
|
426,3
|
243,4
|
192,0
|
62,6
|
5300,72
|
|
1995
|
4657,6
|
302,9
|
3266,9
|
230,6
|
434,7
|
339,9
|
281,6
|
82,0
|
6122,42
|
|
1996
|
5901,5
|
325,9
|
4593,8
|
67,1
|
436,1
|
478,6
|
376,0
|
0,00
|
7757,52
|
|
1997
|
5880,00
|
328,7
|
4458,0
|
214,7
|
27,4
|
447,4
|
344,6
|
403,8
|
7729,26
|
|
1998(2)
|
8697,4
|
508,2
|
6501,7
|
313,9
|
37,2
|
727,4
|
657,9
|
609,1
|
8697,4
|
|
1999
|
9541,2
|
517,7
|
6977,1
|
316,1
|
37,3
|
1077,1
|
697,3
|
616,0
|
9541,2
|
|
2000
|
9610,5
|
500,7
|
7167,8
|
344,0
|
37,2
|
879,7
|
599,6
|
681,1
|
9610,5
|
|
2001
|
1970,7
|
642,9
|
145,0
|
492,3
|
73,5
|
172,4
|
0,00
|
444,6
|
1970,7
|
|
2002
|
1075,6
|
0,00
|
114,3
|
387,6
|
65,9
|
158,00
|
0,00
|
350,1
|
1075,6
|
|
2003
|
1141,1
|
0,00
|
223,2
|
427,4
|
59,3
|
59,00
|
0,00
|
372,3
|
1141,1
|
|
2004
|
954,6
|
0,00
|
188,0
|
284,2
|
57,9
|
94,3
|
0,00
|
330,2
|
954,6
|
|
2005
|
787,5
|
0,00
|
67,5
|
349,9
|
28,6
|
37,9
|
0,00
|
303,6
|
787,5
|
|
2006
|
931,3
|
3,5
|
142,3
|
402,5
|
28,6
|
24,7
|
0,00
|
329,8
|
931,3
|
|
2007
|
675,3
|
70,3
|
206,3
|
201,3
|
12,8
|
28,1
|
0,00
|
156,5
|
675,3
|
|
2008
|
1751,9
|
146,4
|
807,2
|
400,8
|
41,4
|
186,1
|
0,00
|
169,7
|
1751,9
|
|
2009
|
2538,1
|
156,9
|
1736,2
|
403,3
|
41,4
|
28,9
|
0,00
|
171,4
|
2538,1
|
|
2010(p)
|
192,6
|
66,3
|
33,5
|
36,1
|
0,00
|
56,6
|
0,00
|
0,00
|
192,6
|
Source : -BZ, Rapports annuels 1991-1996 -BCC, Rapports
annuels 1997-2010
(1) Montants exprimés en DTS à partir de cette
année
(2) Montants exprimés en USD dépuis la source
à partir de cette année (p)Prévision
A la lumière de ce tableau, nous constatons que le service
de la dette de la RD Congo peut être mis en deux phases notamment ; la
phase de 1991 à 2000 et de 2001 à 2010.
Dans la première phase nous observons une croissance
continue du service de la
dette.
Pour la deuxième, il y a une régression du service
dû de la dette malgré une moindre croissance constatée en
2008 et 2009.
Le Club de Paris obtient un grand service de la dette depuis
1991 jusqu?en 2000 après ce service baisse pour le Club de Paris au
profit du FMI en 2001 puis il est ramené à 0,00 millions de USD
en 2002 jusqu?en 2005.
Figure no 2: Evolution du service de la
dette publique exterieure congolaise(montant en
millions de
USD)
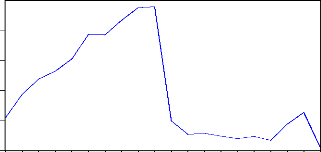
Source : -BZ, Rapports annuels 1991-1996
- BCC, Rapports annuels 1997-2010
Cette figure indique deux principales phases dans
l?évolution du service de la dette de la RDC. La première phase
va de 1991 à 2000 et la seconde de 2001 à 2010.
Pendant la première phase (1991-2000), les services de la
dette croissent avec un taux élevé et d?une manière
continue. Au 31 Décembre 1991, le service de la dette congolaise
8
s?est évaluée à 1673,6 millions de DTS
soit 2199,95 millions d?USD et passe à 2854,7
S E RV ICE D02
millions de DTS soit 3752,5 millions d?USD. Ces services
croissent de l?année en année ce ci montre l?incapacité de
la RDC à honorer ses créanciers.
Evalué à 5880,00 millions de DTS soit 7729,26
millions d?USD en 1997, ce service n?a pas été effectué
alors que 28,8 millions de DTS ont été payés au FMI au
titre du service de la dette de 1996. En 1998, le service de la dette s?est
chiffré à 6168,4 millions
de DTS soit 8697,4 millions d?USD contre 5880 millions d?une
année auparavant. Contrairement à l?année 1997 où
le service de la dette n?a pa été effectué, un montant de
1,5 millions de DTS à été payé au FMI en Juin,
Juillet et Août 1998 en sa qualité de créancier
priviligié et ce conformement à l?engagement pris par le
gouvernement de payer 500.000USD par mois. Mais les paiement ont
été suependus à la suite de l?éclatement de la
guerre (BCC, Rapport annuel 1998). A l?instar de l?année 1999, le
service de la dette n?a pas été effectué en raison des
difficultés économique du pays. Le cumul des
arriérés sur ce service a atteint 7450,00 millions de DTS en 2000
contre les arriérés de 6964,4 millions DTS en 1999.
La seconde phase (2001-2010) correspond à la baisse
continuelle du service de la dette. Evalué à 1970,7 millions
d?USD en 2001 contre 9610,5 d?USD d?une année auparavant. Cette
decroissance continue jusqu?en 2007 après avoir subit une très
légère progression en 2006 en occurrence 931,3 millions de USD
contre 787,5 millions de USD d?une année auparavant. Le service de la
dette congolaise prend encore la droite decroissante en raison de 675,3
millions de USD en 2007. Ce ci signifie qu?il y a retour de la
souténance de la dette extérieure. En 2008, le service de la
dette est évalu à 1751,9 millions de USD contre 2538,1 millions
de USD en 2009. En 2010, ce service avait présenté 192,6 millions
de USD soit une décroissance de 121, 80% par rapport à
l?année 2009. Cette décroissance du service dü de la dette
est le fruit de l?atteinte du point d?achèvement de l?initiative en
faveur des pays pauvres très endettés.
37
Tableau n0 3: Evolution du service
éffectué de la dette extérieure de la RDC par groupe de
créanciers
(1991 à 2010)
(Montant en millions DTS et en
USD)
Service éffectué
|
Créanciers Années
|
Service éffectué
|
Repartion du services éffectué de la
dette par groupe des créanciers
|
|
FMI
|
Club de
Paris
|
Club de
Kinshasa
|
Club de Londres
|
Instistutions Multilaterales
|
Dont BAD
|
Autres
|
Service $
|
|
1991(1)
|
143,5
|
77,7
|
9,50
|
17,6
|
0,00
|
17,4
|
2,10
|
21,3
|
185,115
|
|
1992
|
57,2
|
12,4
|
0,40
|
5,40
|
0,00
|
10,3
|
0,00
|
28,7
|
73,7880
|
|
1993
|
9,9
|
3,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5,60
|
0,00
|
0,70
|
12,7710
|
|
1994
|
9,00
|
9,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11,6100
|
|
1995
|
1,4
|
1,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
1,80600
|
|
1996
|
28,8
|
28,8
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
37,1520
|
|
1997
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
|
1998(2)
|
2,11
|
2,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2,11000
|
|
1999
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
|
2000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00000
|
|
2001
|
508,2
|
506,2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
508,200
|
|
2002
|
32,2
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8,00
|
24,2
|
0,00
|
0,00
|
32,2000
|
|
2003
|
124,4
|
0,00
|
91,8
|
3,5
|
0,50
|
28,7
|
0,00
|
0,00
|
124,400
|
|
2004
|
89,5
|
0,00
|
44,3
|
23,4
|
0,10
|
21,8
|
0,00
|
0,00
|
89,5000
|
|
2005
|
143,5
|
67,45
|
41,10
|
0,00
|
34,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
143,500
|
|
2006
|
142,6
|
3,50
|
66,9
|
45,3
|
0,00
|
15,30
|
4,50
|
12,5
|
142,600
|
|
2007
|
163,00
|
70,3
|
0,00
|
54,9
|
0,00
|
26,5
|
7,90
|
11,4
|
163,000
|
|
2008
|
378,7
|
135,4
|
0,00
|
55,3
|
0,00
|
188,00
|
0,00
|
0,00
|
378,700
|
|
2009
|
208,00
|
134,3
|
0,00
|
15,3
|
0,00
|
51,5
|
0,00
|
6,860
|
208,000
|
|
2010(p)
|
158,9
|
53,2
|
33,5
|
22,2
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
158,900
|
Source : -BZ, Rapports annuels 1991-1996 -BCC, Rapports
annuels 1997-2010
(1) Montants exprimés en DTS à partir de cette
année
(2) Montants exprimés en USD dépuis la source
à partir de cette année (p)Prévision
Ce tableau nous montre que la RD Congo ne parvient pas
à payer son service de la dette. Ce ci s?observe bien en confrontant le
Tableau II (service dû) et le Tableau III ( service effectué). Sur
ces tableaux, le service de la dette prevu n?est pas
éxécuté en totalité et il y a même des
années où la RDC verse rien en qualité de remboursement de
la dette. Ce ci a beaucoup pesé sur l?économie de la RD Congo car
les intérét s?accumulé pour former des lourdes dettes.
Cette situation s?illustre bien dans la figure ci-dessous
présentée.
Figure no3: Evolution du service de la
dette effectué (montant en millions de USD)
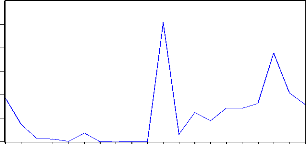
Source : -BZ, Rapports annuels 1991-1996
-BCC, Rapports annuels 1997-2010
Cette figure peut être analysée en 3
séquences. La première va de 1991 à 1996, la seconde de
1997 à 2000 et la dernière va de 2001 à 2010.
La première séquence (1991-1996) est
caractérisée par une décroissance du service de la dette
effectué.
En effet, au 31 Décembre 1991, le service
effectué s?est chiffré 143,5 millions de DTS soit 185,115
millions de USD. Le service de la dette effectué par la RDC
décroit pour toutes les autres années mais il subit une
légère croissance en 1996 en occurrence de 28,8
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 SERVIE_FCT U
millions de DTS soit 37,86 million de USD contre 1,4 million de
DTS soit 1,841 million de USD en 1995.
La deuxième séquence (1997-2000) correspond
à un service effectué presque nul. Pendant cette période
la RDC ne verser rien comme remboursement de sa dette sauf pour l?année
1998. Les services n?ont pas été effectués pour ces
années en raison des guerres successives qu?a connue la RDC mais il a
été effectué avec une faible taux en 1998
présentant 2,11 millions de USD contre 8697,4 millions de USD prevu. Les
deux autres
années soit 1999 et 2000, les service effectués
sont toujours nuls donc zeros million de USD. Ce ci a eu de conséquences
négatives sur l?économie de la RDC car les intéréts
s?accumulés toujours pour former des grosses dettes.
La troisième séquence (2001-2010) ; cette phase
commence par une croissance du service effectué représenté
par 508,2 millions de USD contre une decroissance observée en 2002 en
raison de 32,2 millions de USD. Au 31 Décembre 2003, le service
effectué s?est chiffré à 124,04 millions de USD dont 75,47
millions en principal et 48,97 millions en intérêts. Ces paiements
ont été executé au profit de Club de Paris pour 91,96
millions de USD, des institutions multilatérales pour 28,71 millions du
Club de Kinshasa pour 3,45 millions et Club de Londres pour 0,52 million. Cette
tendance s?inverse en 2004 en occurrence de 89,5 millions de USD. La plus
grande partie de ces paiements ont été fait en faveur du Club de
Paris pour 44,3 millions de USD, le FMI n?a pas été honoré
pour cette année. Le club de Kinshasa, le Cub de Londres et les
instituttions multilarales ont été honorés respectivement
par 23,4, 0,1 et 21,8 millions de USD. En 2005, le service effectué
croit par rapport à l?année précendente on occurrence de
143,5 millions de USD contre 89,5 millions de USD d?une année
auparavant. Ces paiements ont été effectués en faveur du
FMI pour 67,45 millions de USD, Club de Paris pour 41,10 millions de USD, Club
de Kinshasa n?a pas été honoré, le Club de Londres
à la hauteur de 34,96 millions de USD, les autres créanciers
n?ont pas été payés. L?année 2006 a
été céractérisée par un environnement
conjocturel plus dificil, marqué par la suspension du programme avec les
institutions de Bretton Woords, la RDC s?est efforcée d?honorer ses
engagement envers tous les créanciers à l?exception de ceux du
Club de Paris à fin Decembre 2006. A cet effet, le paiement
effectué au titre du service de la dette s?est chiffré à
126,52 millions de USD contre un service previonnel initialement estimé
à 205,3millions de USD. Cette situation est consécutive
essentiellement à l?accumulation des arrierés vis-à-vis du
Club de Paris.
Il importe de noter que les principaux indicateurs de
l?endettement extérieur de la RDC resteraient superieurs aux seuils
acceptables tant que le pays n?a pas atteint le point d?achevément de
l?initiative PPTE renforcé. Ainsi, le service effectué en 2007 a
été évalué à 163,00 millions de USD. Ces
services ont été faits en grande partie en faveur de FMI en
occurrence de 70,3 millions de USD, 0,00 million de USD pour le Club de Paris,
54,9 millions de USD pour le Club de Kinshasa, 0,00 million pour le Club de
Londres, 26,5 millions de USD pour les institutions multilaterales, 7,9
millions de USD pour la BAD et 11,4 millions de USD pour les autres. En
dépit d?un contexte difficile observé en 2008 à la suite
notamment des effets de la crise financière internationale et l?absence
d?un programme
ferme avec le FMI, le service de la dette effectué
s?est établi à 243,4 millions de USD contre une prévision
de 435,9 millions. Un montant de 151,0 millions de USD ont
représenté des paiement en faveur du FMI. L?année 2009 a
été caractérisé par une decroissance du service de
la dette effectué par rapport à l?année précendente
; soit 208,00 millions de USD en 2009 contre 243,4 millions. Le service
effectué a été bénéfique au FMI a 134.3
millions de USD, au Club de Kinshasa 55,3 millions de USD et autres
institutions multilatérales à la hauteur de 188,00 millions de
USD. En fin l?année 2010 correspond a un service effectué
estimé à 158,9 millions de USD reparti comme suit : 53,2 millions
de USD pour le FMI, 33,5 millions de USD pour le Club de Paris, 22,2 millions
de USD pour le Club de Kinshasa et 50,00 millions de USD pour les autres
institutions multilatérales. Cette situation montre que la RDC ne
rembourse pas bien sa dette car les services dûs sont largement
supérieurs aux services effectués. Ceci donne lieu à une
accumulation des arrières et la conséquence est la croissance des
intérêts pour former des grosses dettes.
II.4. RELATIONS DE LA RDC AVEC SES BAILLEURS DE FONDS
EN 201036
II.4.1. Fonds Monétaire International (FMI)
L?année 2010 a été
bénéfique pour la République quant à ses relations
avec les bailleurs de fonds, le FMI notamment. En effet, l?exécution
satisfaisante du Programme Economique du Gouvernement (PEG II) appuyé
par la Facilité Elargie de Crédit, a conduit - dans
l?évaluation de sa première revue - à l?atteinte du point
d?achèvement de l?Initiative en faveur des Pays Pauvres Très
Endettés avec comme conséquence l?annulation de 74,6 % de la
dette. Cette décision a été annoncée le 01 juillet
2010 lors de la tenue conjointe du Conseil d?administration du FMI et de la BM.
En ce qui concerne le FMI, l?annulation bénéficiée a
été de 312,0 millions de DTS, soit 478,1 millions de USD,
représentant 30,0 % de la dette envers cette structure
financière.
II.4.2. Club de Paris
Le Club de Paris a joué un rôle important dans
l?annulation de la dette de la RDC. Son stock arrêté à fin
décembre 2009 à 6.679,3 millions de USD, a connu une
restructuration profonde au terme de l?achèvement de l?I-PPTE. En effet,
cette structure a été la première à mettre en
exécution la résolution d?annulation de la dette de la RDC
à traves sa réunion de Paris du 17 novembre 2010, qui a
consacré l?effectivité de l?effacement de la dette
extérieure, à hauteur de 6.499,3 milliards de USD.
36 BCC, Rapport annuel 2010
II.4.3. Club de Londres
L?impasse, survenu en 2009 pour le rachat de la créance
due à ce Club par la Banque Mondiale s?est poursuivie en 2010, il a
conduit cette dernière à se retirer de la scène. En outre,
à la faveur du point d?achèvement de l?I-PPTE, il a
été levé une autre option, celle d?entrer en
négociation directe avec chaque créancier membre du Club pour
obtenir l?annulation minimum équivalent au facteur commun de
réduction de 82,4 % et maximum de 100,0 %.
II.4.4. Club de Kinshasa
Les créanciers membres de ce Club se sont réunis
à Kinshasa, en septembre 2010, avec le Gouvernement de la RDC afin
d?examiner la demande d?allègement du service de la dette
extérieure lui dû. Les recommandations découlant de ces
assises ont porté sur la date butoir et le paiement de bonne foi.
Concernant la date butoir, les parties ont convenu de retenir comme
échéance, la date du 30 novembre 2003, période à
laquelle la RDC a obtenu du Club de Paris un allègement de dette dans le
cadre de l?accès au Point de décision de l?Initiative en faveur
des Pays Pauvres Très Endettés ; S?agissant du paiement de bonne
foi, la RDC s?est engagée à effectuer un paiement de bonne d?un
montant de 5,0 millions de USD à repartir entre les créanciers
participants selon une règle d?équité, au plus tard le 31
octobre 2010.
CHAPITRE TROISIEME: APPROCHE METHODOLOGIQUE
Dans ce chapitre nous allons présenter la
récolte de donnée, le traitement des données,
décrire les variables retenues et expliciter le modèle
théorique envisagé dans l?étude de la dette sur croissance
économique de la RD Congo. La démarche retenue s?inspire du
travail du modèle analytique proposé par Odjo et Oshikoya (1995)
et repris par plusieurs autres chercheurs tels que Yapo (2002), NDUGU MUKASA
(2008)... Ce modèle fait ressortir les différents canaux par
lesquels la dette extérieure agit sur la croissance économique
d?un pays.
III.1. RECOLTE DES DONNEES
Pour mener ce travail à l?objectif dont il est
fixé, nous procéderons par sélectionner un
échantillon statistique des données brutes sur la RD Congo
couvrant la période de 1991 à 2010. Cet échantillon a
été tiré des données relatives à la
croissance du PIB réel en fréquence annuelle, aux stocks de la
dette extérieure sur le PIB, aux stocks de la dette sur les exportations
de biens et de services, aux services de la dette extérieure sur les
exportations de biens et de services, aux termes de l?échangé, au
taux de croissance démographique, à la balance courante sur PIB,
au solde budgétaire primaire sur le PIB et aux exportations de biens et
de services sur PIB. Nous procéderons par des représentations
graphiques pour illustrer l?évolution de différentes variables
prises en considération.
III.2.TRAITEMENT DES DONNEES
Grace à la modélisation par usage de la
méthode de régression multiple avec l?application des moindres
carrés ordinaires à l?aide du logiciel E-Views, nous avons
procédé à analyser des relations qui existent entre la
variable endogène et les variables exogènes afin de tester notre
première hypothèse.
Pour ce faire, notre analyse portera sur une étude
équationnelle où nous allons régresser la variable
endogène retenue (le taux de la croissance du PIB réel) dans le
cadre du présent travail. En premier temps nous allons décrire
les variables du modèle retenues et voir leurs évolutions en RD
Congo et en fin procéder à l?explication du modèle
théorique.
III.3. PRESENTATION DES VARIABLES DU MODELE
La présentation des variables retenues se fait en deux
étapes. Nous distinguons respectivement les variables endogènes
(dépendantes ou expliquées) et les variables exogènes
(indépendantes ou explicatives). Pour chaque variable nous expliquerons
le choix avant de présenter son évolution sur une figure ou
graphique au cours de notre période d?étude.
III.3.1. Variable endogène (Dépendante ou
expliquée)
Pour analyser les conséquences de l?endettement public
extérieur sur la croissance économique de la RD Congo nous
utiliserons le coefficient de la croissance autrement appelé taux de
croissance du PIB réel (TCPIB).
III.3.1.1. Taux de croissance du produit
intérieur brut (TCPIB)
La croissance du PIB mesure l?évolution quantitative du
développement économique d?un pays. En effet, le taux de
croissance est un rythme auquel le PIB augmente (croissance positive) ou
décroît (croissance négative). Il est
généralement calculé en pourcentage du PIB de
l?année précédente. Le niveau du PIB
dépend positivement du taux d?épargne mais le taux de
croissance du PIB ne dépend que du progrès technique et de
la démographie. Lorsque le PIB croît à taux
supérieur à la croissance démographique, on dit que le
niveau de vie s?élève. Lorsqu?au contraire, la croissance
démographique est supérieure au taux de croissance du PIB, on dit
que le niveau de vie baisse. Un faible taux de croissance reflète les
difficultés d?un pays à mobiliser suffisamment des ressources
pour financer ses besoins d?investissement intérieur et honorer ses
engagements extérieurs. L?estimateur du PIB réel permet de
calculer le taux de croissance économique, c?est-à-dire le
pourcentage de variation de la production de biens et services d?une
année à l?autre.
Ceci est calculé par la formule suivante :
Taux de croissance= *100
Où : PIBt est le produit intérieur
brut de l?année encours et PIBt-1 est le
produit intérieur brut de l?année précédente.
La figure ci-dessous permet de visualiser l?évolution du
taux de croissance du PIB
en RDC.
Figure no4 : Evolution du taux de
croissance du PIB de la RDC entre 1991 et
2010(Annexe
1)
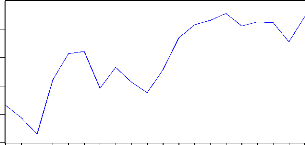
Source : -BZ, Rapports annuels 1991- 1996
-BCC, Rapports annuels 1997- 2010 voir (Annexe 1)
Cette figure peut être analysée en deux (2)
séquences ; la première phase va de 1991 à 2001 et la
seconde de 2002 à 2010.
La première séquence (1991-2001) est
marquée par des taux de croissance de PIB essentiellement
négatifs sauf pour en 1995 et 1996. Le taux de croissance moyen devient
alors négatif précisément de -4,94% avec des pics de
-10,6% et -13,6% entre 1992 et 1993. Ces contre-performances de
l?économie congolaise résultent de la dégradation des
relations entre FMI et le Zaïre (cette dégradation est due
principalement au non respect volontaire par MOBUTU des devoirs conclus avec le
FMI, en augmentant les salaires du secteurs public, en réduisant le
remboursement du service de la dette publique extérieure, en fixant le
taux de
2 98 0 0 4 0 0
change et en contrôlant les prix) et la baisse des
recettes des exportations, des conflits incessants qui ont
agrémenté cette période, des pillages, de la
désagrégation des infrastructures de base, du recours excessif au
financement monétaire, des variations erratiques des prix et taux de
change observés après le lancement de la réforme
monétaire en 1993.37
La deuxième séquence (2002-2010) est
caractérisée essentiellement par un taux de croissance positif
avec des pics 7,8% et 7,2% entre 2005 et 2010. Le taux de croissance moyen se
situe à 5,56%. Cette performance et la reprise économique
observée depuis l?année 2002 peut être attribuée aux
efforts de réunification économique et politique du pays, aux
allégements de la dette et la mise en place de différents
programmes macro-économiques.
37 BZ, Rapport annuel 1992.
Pendant ce temps, le gouvernement congolais a entrepris de
nombreuses réformes structurelles : la création d?un
comité interministériel pour la coordination économique et
financière ECOFIN en mai 2001, adoption d?une nouvelle loi bancaire en
janvier 2002, publication d?un nouveau code des investissements en mars 2002,
audition de la BCC et des banques commerciales depuis 2002... 38
Après avoir connu un ralentissement en 2009, la
croissance économique s?est nettement améliorée en 2010,
se situant à 7,2 % contre 2,8 %. Selon l?approche par la valeur
ajoutée, cette accélération de la croissance a
été rendue possible grâce principalement au dynamisme
affiché par les industries extractives, l?agriculture, le commerce de
gros et de détail ainsi que la construction.39
Pendant plus d'une décennie, la RDC a connu des taux de
croissance négatifs dus essentiellement à la faible contribution
des secteurs porteurs de la croissance. Après une baisse réelle
persistante du PIB de -4,94% en moyenne par an entre 1991 et 2001, le taux de
croissance est devenu positif passant de 3,5% en 2002, 5,7% en 2003, 6,6% en
2004 à 6,5% en 2005,... grace aux réformes structurelles dans
tous les secteurs de l'économie nationale. Le taux de croissance du PIB
annuel moyen pendant les 20 ans d?étude était de -0,125%.
III.3.2. Variables exogènes (Indépendantes ou
Explicatives)
Huit (8) principaux facteurs susceptibles d?influencer la
croissance économique au poids de la dette publique extérieure de
la RD Congo. Les variables retenues sont les suivantes: le stock de la dette
sur PIB (STDPIB), le stock de la dette sur les exportations de
biens et de services (STDEXP), la variable termes
d?échange (VTE), le ratio service dette aux
exportations de biens et de services (SEDEXP), le taux de
croissance démographique (TCDEM), le ratio balance
courante sur le PIB (BCPIB), le ratio solde budgétaire
primaire sur le PIB (SOBPPIB) ainsi que le ratio exportation
de biens et de services sur PIB (EXPPIB).
III.3.2.1. Stock de la dette sur le PIB (STDPIB)
Ce ratio mesure le niveau de la dette publique
extérieure de la RD Congo par rapport à ce qu?il produit et
traduit donc le poids de la dette publique extérieure du pays.
L?évolution de la dette en fonction du PIB mesure le niveau
d?endettement par rapport à l?activité économique du pays.
Il assume implicitement que toutes les ressources du PIB sont disponibles pour
financer le poids de la dette extérieure, ce qui n?est pas toujours
vrai.
38 FMI, 2004.
39 BCC, Rapport annuel 2010.
Cependant, cet indicateur est actuellement
considéré comme le plus important pour mesurer le degré
d?endettement, en indiquant la capacité de solvabilité du
Gouvernement.
La figure ci-dessous, illustre son évolution durant les 20
ans d?études.
Figure no 5: Evolution du ratio stock de
la dette sur le PIB entre 1991 et 2010 en RDC
(Annexe
1)
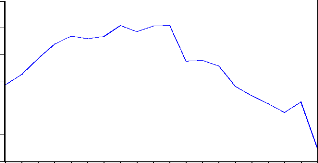
Source: -WORLD BANK Developement Indicators
-- BCC, Rapports annuels (2001-2010) voir
(Annexe 1)
Au vu de cette figure ci-dessus, illustre l?évolution
du ratio de la dette congolaise sur le PIB. Dans cette figure, deux
périodes s?observent ; l?une de l?origine jusqu?en 2001 et la seconde de
2002 en 2010.
Pour la première phase (1991 à 2001), cette
phase a été caractérisée par la hausse du ratio de
la dette sur le PIB mais il croit à des taux faibles. La part de la
dette publique extérieure de la RD Congo thns le PIB a
présenté 143,96% en 1991. Le taux de croissance annuel moyen du
ratio de la dette en pourcentage du PIB se situe à 7,64 % avec une
moyenne annuelle 220,40% pendant la phase sous analyse. Cette situation est due
en raison d?un climat socio-politico-économique mauvais. Les effets
majeurs qui ont marqué cette période sont :
Des pillages des commerces, mutineries de l?armée
à Kinshasa et dans d?autres grandes villes du pays,
désagrégeant ainsi l?appareil productif et commercial du
pays ;
v' Des baisses de la production minière, principalement
du cuivre de la GECAMINES, qui passe de plus de 400.000 tonnes en 150.000
tonnes en 1992 et moins de 50.000 tonnes en 1993;40
v' Des niveaux d?inflation domestique dramatiques : le taux
d?inflation passe de 261,6% en 1990 à 10.000% en 1994 ;
v' La nécessité de financer les guerres à
répétition ; la RDC connut d?abord une première guerre en
Octobre 1996 qui s?acheva en mai 1997 avec le départ du président
MOBUTU. Une deuxième guerre se déclenchant et se terminant en
2002. Pendant cette décennie la RDC n?a pas bien honoré sa
dette.41
Pendant ce temps, les remboursements du principal ont
baissé de 38,7%. En dépit de l?augmentation de l?amortissement de
la dette publique de 109,1%, cette situation incombe essentiellement au
ralentissement observé dans le remboursement du principal de la
dette.42
En 2000 et 2001, rapportés en pourcentage du PIB, les
stocks de la dette publique congolaise représentent respectivement
253,57% et 257,91%. Ces stocks sont constitués essentiellement
d?arriérés des paiements qu?a connus la RDC. Selon les
données disponibles à la Banque Centrale du Congo (Rapport annuel
2001) indique une augmentation de 8,2% du stock de la dette qui se situe
à 13,6 milliards de USD, cet accroissement étant essentiellement
attribuable à l?accumulation d?arriérés liées aux
nouvelles échéances et à la dépréciation du
DTS face au dollar américain (1 DTS passe de 1,29 à 1,27 USD en
2001). 43
La deuxième phase (2002 à 2010), cette phase a
été marquée par la reprise de la coopération
financière avec la communauté internationale, après une
rupture de plus d?une décennie. Au regard des résultats atteints
en matière de stabilisation macroéconomique, la communauté
internationale a décidé d?accompagner les efforts du gouvernement
en vue de consolider la stabilité et de relancer la croissance
économique. Cet appui c?est centralisé notamment à travers
différent mécanismes mis en place pour l?apurement des
arriérés dus aux créanciers multilatéraux, l?octroi
de nouveau financement et la signature d?accord de restriction de la dette
envers le Club de Paris le 13/09/2002. Et aussi le fait majeur dans cette phase
est dans le domaine des relations économique extérieure a
été l?accès de la RDC au point de décision de
l?initiative PPTE renforcée au mois de juillet 2002. Cette
décision a
40 BZ, Rapport annuel, 1995
41 BCC, Rapport annuel 1997
42 BZ, Rapport annuel 1992.
43 BCC, Rapport annuel 2000-2001
permis à la RDC de bénéficier des
annulations de 90% au moins du service de la dette dû entre 31 juillet
2003 et 30 juin 2005.44
En dépit de tout ce qui précédent, le
stock de la dette a progressé de 4,0% au 31 décembre 2003, se
situant à 10722,7 millions de USD contre 10311,9 millions à fin
décembre 2002. Cette évolution s?explique par les nouveaux
crédits obtenus des institutions multilatérales et les
intérêts générés par la dette
rééchelonnée. Ce stock représente 188,8% du PIB.
Par ailleurs, ce stock de la dette est constitué de 97,0% d?encours, de
1,9% d?intérêt et 1,1% d?intérêt de retard. Le Club
de Paris est les institutions multilatérales détiennent
respectivement 56,0% et 35,6% du stock global.45
A la fin décembre 2004, le stock de la dette s?est
accrue de 4,3% se situant à 11186,3 millions de USD contre 10722,9
millions une année plus tôt. Cette évolution s?explique
essentiellement par la dépréciation du dollar américain,
les nouveaux crédits obtenus auprès des institutions
multilatérales et nouvelle échéances en
intérêt.
A la fin décembre 2006, le stock de la dette s?est
situé à 10522,1 millions de USD contre 9999,9 millions une
année auparavant, soit une régression de 5,2%. Rapporté au
PIB, ce stock représente 123,16 % du produit intérieur brut.
A la fin 2007, le stock de la dette a enregistré une
progression de 4,3% par rapport à son niveau de 2006. Il a
représenté 108,3% du PIB contre 121,2% une année
auparavant. Cette situation est attribuable essentiellement à
l?accumulation des arriérés envers le Club de
Paris.46
S?agissant de l?année 2008, le stock de la dette
congolaise représente 91,8% du PIB contre celui de 108,3% en 2007. Ce
stock est en repli de 17,97% par rapport à son niveau de 2007. Cette
évolution est due essentiellement à la baisse de la dette due au
FMI, au Club de Kinshasa et celle de la dette à court terme
respectivement de 24,7%, 7,8% et 20,9% d?une année à l?autre
à la suite des services effectués. Il sied de relever que
l?analyse des indicateurs de soutenabilité de la dette relève une
amélioration du ratio dette sur PIB47.
A la faveur du point d?achèvement de l?initiative du
PPTE, le ratio dette en pourcentage du PIB s?est amélioré en
2010. En effet, ce stock représente 24,146% du PIB contre 111,5% une
année avant. 48 Le taux de croissance annuel moyen du ratio
de la dette en
44 BCC, Rapport annuel 2002-2003
45 IDEM
46 BCC, Rapport annuel 2006
47 BCC, Rapport annuel 2008.
48 BCC, Rapport annuel 2010.
pourcentage du FIB se situe à -16,6% soit une
régression de 16,6% avec une moyenne annuelle de 128,31% pendant cette
phase sous analyse.
III.3.2.2. Stock de la dette sur les exportations de
biens et de services (STDEXP)
La seconde variable retenue dans cette analyse de
l?endettement extérieur de la RDC consiste à prendre comme
variable indépendante le ratio dette publique extérieure sur les
exportations de biens et de services.
Ce ratio fait ressortir, contrairement au premier, le
degré de liquidité de la RDC, celle-ci devant prélever
suffisamment des devises sur ses recettes d?exportations pour rembourser la
dette extérieure. La dette extérieure de la RD Congo est
essentielle libellée en devises étrangères. Celles-ci sont
généralement recueillies par le biais des exportations de biens
et de services et/ou par des transferts de fonds et des flux des capitaux.
Cette relation mesure aussi le niveau de la dette extérieure en fonction
des exportations de biens et de services. Elle montre la charge qui pèse
sur les exportations ou sur la capacité à produire des devises.
Cet indicateur doit être accompagné du montant du service de la
dette en pourcentage des exportations, pour comparer les dépenses non
productives avec le niveau de captation de devises.
La figure suivante nous présente l?évolution du
taux d?endettement sur les exportations de biens et de services en RD Congo de
1991 à 2010.
Figure no6: Evolution du ratio stock
dette sur les exportations de biens et de services PIB
entre 1991 et 2010. (Annexe
1)
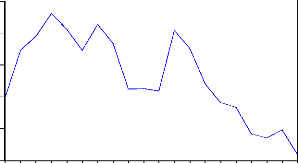
2 94 96 98 00 02 04 06 08
Source: -WORLD BANK Developement Indicators -BCC, Rapports
annuels (2001-2010)
L?observation de cette figure nous permet de mettre trois
phases en évidence. La première phase va de 1991 à 1997,
la deuxième de 1998 à 2001 et la troisième de 2003
à 2010.
A la première phase (1991-1997), le stock de la dette
extérieure absorbe près du triple des exportations de biens et de
services. Il passe à 398,6 % en 1991 et dépasse 900% en 1994, il
passe alors à 923% en 1994. La RD Congo traverse une crise à la
fois économique et politique : les recettes d?exportations
déclinent, les investissements privés et public sont en baisse,
l?inflation domestique atteint quatre chiffres, les crises sociale se
multiplient,... On remarque également la décroissance
légère du ratio pour les autres années par rapport
à l?année 1994. Il se situe donc à 823,68 % en 1995,
691,68 % en 1996 et en fin 853,95% 1997 en raison d?une forte progression de la
dette et d?un rétrécissement des recettes des exportations
à 7% de croissance seulement. Le ratio du stock de la dette
extérieure atteint en moyenne 737,82% des exportations de biens et de
services durant cette phase sous analyse.
La seconde phase (1998-2001) est celle qui est
caractérisée par une tendance baissière du dû ratio.
Le stock de la dette présente 736,12 % des exportations des biens et des
services en 1998. Cette tendance arrive jusqu?en 2002. La décroissance
annuelle moyenne du ratio stock dette en pourcentage des exportations de biens
et de services se situe à -11,1% et une moyenne annuelle de 415,4% pour
la phase sous analyse.
La troisième phase (2002-2010), après avoir subi
une augmentation en 2002 où il a présenté 816,86% des
exportations des biens et des services, les années
précédentes ont été caractérisées par
une baisse du dû ratio. Il présente ainsi 704,43% en 2003 contre
816,86% auparavant, soit une décroissance de 13,73%. Cette tendance
baissière persiste jusqu?en 2010 où il passe 111,5% en 2009
à 37,3% en 2010. Le ratio moyen et la décroissance moyenne du
ratio du stock de la dette en pourcentage des exportations de biens et de
services se situent respectivement à 360,31% et à 5,4%. Ces
performances sont attribuables au point d?achèvement de l?I-PPTE.
III.1.2.3. Variable termes de l'échange
La variable termes de l'échange mesure
l?évolution du rapport entre l?indice des prix à l?exportation et
l?indice des prix à l?importation. Il s?agit de la relation qui existe
entre les importations et les exportations. Cette relation indique si les
importations sur le plan de quantité physique sont en bonne proportion
avec les quantités exportées ; les termes de l?échange
déterminent le taux de change, c?est-à-dire le rapport de
l?indice des valeurs moyennes des exportations à l?indice des valeurs
moyennes de l?importation.
Si le rapport est supérieur à 100, cela signifie
que l?on vend à l?étranger plus cher qu?on ne lui achète.
Si par contre le rapport est inferieur à 100, alors l?on vend à
l?étranger moins cher qu?on ne lui achète.49
La détérioration des termes de l?échange
traduit la diminution de l?assiette en devises dont dispose un pays pour
financer ses importations. Elle indique en outre la baisse de la
quantité des biens qu?un pays peut importer avec des revenus provenant
des exportations. Ce qui pose d?énormes difficultés à la
RD Congo qui dépendent des importations (en biens d?équipement,
en matériels agricoles...) et dont les exportations sont essentiellement
constituées des produits primaires à faible valeur
ajoutée.
Nous présentons graphiquement l?évolution des
termes de l?échange en RD Congo de 1991 à 2010 dans les lignes
ci-dessous :
Figure no 7: Evolution de la variable
des termes de 4'échU4Je entre 1991 et 2010(Annexe
1)
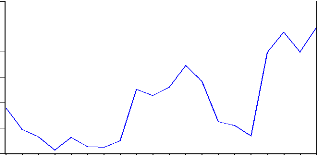
Source: BCC, Rapports annuels (1991-2010)
Au regard de ce graphique, les termes de l?échange
connaissent quatre (4) principales phases dans son évolution : la
première phase de 1991 à 1997, la seconde de 1998 4 à
2002, la troisième de 2003 à 2006 et dernière va de 2007
à 2010.
Au cours des années 1991-1997, les termes de
l?échange connaissent une évolution contrastée, ils
enregistrent une forte dégradation, la moyenne se situe alors à
33,397% avec un taux de décroissance de -11,42% en raison du climat
politico-économique instable du pays.50
49 SONGA MUSIMBI D., Cours d?économie
international, Inédit, ISP/BKV, 2011-2012
50 BCZ, Rapport annuel 1996
La phase 1998-2002, les termes de l?échange
enregistrent une forte croissance ; ils croissent à un taux moyen de
36,68% avec une moyenne de 65,60% pour la phase sous analyse. Cela pourrait
s?expliquer par diversification des sources des recettes entreprises durant
cette période. Ainsi, les exportations des diamants représentent
désormais plus de 50% des recettes en devise.51
Pour la troisième phase (2003-2006), les termes de
l?échange enregistrent une décroissance, ils se situent à
une moyenne de 49,43% et un taux de décroissance de -20,35%.
La dernière phase va de 2007 à 2010 ; dans
celle-ci on observe une amélioration des termes de l?échange. Ils
croient à un taux moyen de 54,16% et avec une moyenne annuelle de
108,70% durant la phase sous analyse. Ceci s?explique par une croissance de la
production du cuivre.
Ainsi, la production totale du cuivre a atteint le niveau le
plus élevé de ces deux dernières décennies. En
effet, elle s?est accrue de 60,9 % en 2010, passant de 309.181,0 tonnes en 2009
à 497.537,0 tonnes durant l?année sous étude.
Rapprochées à l?année 2009, les productions de la
GECAMINES et de ses partenaires ont enregistré des augmentations
significatives de 50,8 % et de 61,4 % à fin décembre 2010, se
situant respectivement à 20.015,0 tonnes et 477.522,0 tonnes contre
13.274,0 tonnes et 295.907,0 tonnes. Cette évolution est
consécutive principalement à l?envolée des cours sur le
marché mondial et à l?incidence cumulée des
investissements réalisés au cours de ces dernières
années52.
III.1.2.4. Service de la dette sur les exportations de
biens et de services (SEDEXP) entre
1991 et 2010 en RDC (Annexe 1)
Le ratio service de la dette sur les exportations des
biens et des services est la somme des remboursements du capital et des
intérêts réellement payés en devises
étrangères en bien ou en services sur la dette à long
terme, les intérêts payés sur la dette à court terme
et les remboursement payés au FMI sur les exportations.
Ce ratio est également appelé taux
ou coefficient du service de la dette. Il indique en outre dans
quelle proportion les revenus d?exploitation dont dispose un pays sont
absorbés par le service de la dette publique extérieure
(remboursement du principal et des intérêts) et combien il lui
restera pour assurer le financement de ses importations. Il permet donc de
tenir compte de l?effet d?éviction dü au fait que des ressources
sont affectées au service de la dette plutôt qu?à des
investissements.
51 BCC, Rapport annuel 2001
52 BCC, Rapport annuel 2010
La figure ci-dessous en fait l?illustration pour la RD Congo
pour l?année 1991 à
2010.
Figure no8: Evolution du ratio service
de la dette sur les exportations de biens et de
services entre 1991 et 201O
en RDC (Annexe 1)
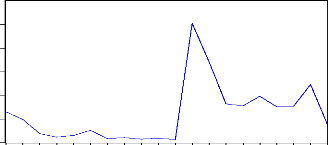
Source: -WORLD BANK Developement Indicators
- BCC,
Rapports annuels (2001-2010)
En observant cette figure, nous pouvons la subdiviser en deux
(2) grandes phases
pour faciliter son analyse. La première phase va
de 1991 à 2001 et la seconde de 2002 à 2010.
La
première phase (1991-2001) correspond à la baisse du ratio
service de la dette
sur les exportations des biens et des services. Il
s?établit à une moyenne de 2,091% ce qui
traduit un
problème de liquidité pour honorer les engagements
extérieurs. Le ratio service de
la dette aux exportations de biens et
de services enregistre une régression moyenne de -
25,74%. Ainsi,
entre 1997 et 2001, les services effectués sont pratiquement
insignifiants
(représentant respectivement 0,87%, 1,08% 0, 7,65%,
0,96% et 0,68% des recettes
EP
d?exploitations). Ces faibles remboursements au titre de la
dette publique extérieure se traduisent durant cette phase par une
accumulation d?importants arriérés de paiement en raison de
difficultés politico-économique du pays.
Durant la seconde phase (2002-2010), les services
effectués sur la dette représentent une grande part des
exportations de biens et de services pour l?année 2002. Il passe 25,3%
en 2002 contre 0,68% en 2001. En 2010, l?allègement de la dette
extérieure a eu pour effet la réduction substantielle
(consistante) du service de la dette. En effet, sur un service
prévisionnel de 291,9 millions de USD, la RDC n?a effectué que
158,9 millions, soit un taux d?exécution de 54,4 %. Le service envers le
FMI s?est établi à 53,2 millions de USD,
dont 51,0 millions en principal et 2,2 millions en
intéréts. S?agissant du service en faveur du Club de Paris,
conformément à l?engagement pris par le Gouvernement de la RDC
envers cette structure, le paiement a bel et bien repris au cours de
l?année sous revue pour un import de 33,5 millions USD.53 La
moyenne de ce ratio est située à 11,07% avec un taux de
croissance de 3,95% pour la phase sous analyse, c?est qui traduit le retour
progressif de la capacité à honorer ces engagements
extérieurs.
III.1.2.5. Taux de croissance démographique
(TCDEM)
Le taux de croissance démographique mesure la
croissance de la population d?un pays. Il est le changement pourcent en moyenne
annuelle dans la population résultant d?un excédent (ou
déficit) des naissances sur le décès et le solde des
migrants qui entrent et sortent d?un pays. Ce taux peut être positif ou
négatif.
Il est supposé avoir influencé positivement le
recours à l?endettement extérieur de la RDC. Ainsi, une
croissance élevée de la démographie impose souvent
l?augmentation des interventions des gouvernants dans le domaine social,
notamment la construction de nouvelles infrastructures sanitaires et scolaires,
la création de nouveaux emplois,... qui nécessitent des
ressources financières suffisantes. En cas d?absence ou d?insuffisance
des ressources intérieures, les dirigeants sont contraints d?emprunter
à l?extérieur, augmentant de ce fait le niveau de son stock de la
dette.54
Voici comment cette variable a évolué pendant les
20 ans d?étude :
Figure no9:Evolution du taux de
croissance démographique 1991 et 2010
enRDC(Annexe1)
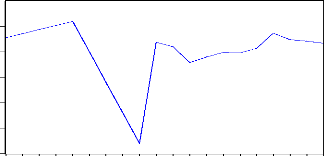
Source: WORLD BANK Developement Indicators
53 BCC, Rapport annuel, 2010
54 NDUGU MUKASA, Déterminants de
l'endettement extérieur public de la RDC, mémoire,
inédit, UCB, 2008 T CDEM
Trois principales phases sont observées dans la
croissance démographique de la RDC entre 1991 et 2010. La
première va de 1991 à 1995, la seconde de 1996 à 1999 et
en fin la troisième de 2000 à 2010.
Entre 1991 et 1995, la population congolaise s?est accrue en
moyenne de
3,4402%.
La deuxième phase (1996-1999),
caractérisée par une décroissance aigue située
à une moyenne de 1,6822% de la population congolaise suite aux guerres
successives occasionnant ainsi une perte des vies humaines estimée
à environs de 4 millions de personnes pendant les deux guerres.
La troisième phase va de 2000 à 2010, dans
celle-ci on observe une stabilité de la croissance démographique.
La moyenne pour ces 11 ans se situe à 3,092%. La population congolaise
croit en moyen à 2,9811% pour les deux décennies sous
étude.
III.1.2.7. Balance courante sur le PIB (BCPIB)
La balance courante est le solde des flux monétaires
d'un pays résultant des échanges internationaux de biens et
services (balance commerciale), revenus, balance des services (balance des
invisibles) et balance des transferts courants. La balance courante est un des
composants de la balance des paiements. On parle aussi de balance des
opérations courantes, de balance des paiements courants ou
encore de (solde des opérations courantes). Traditionnellement,
on considère qu'une balance courante positive permet au pays de
rembourser sa dette ou de prêter à d'autres pays. Une balance
négative (= un déficit courant) doit être
compensée en contractant des emprunts auprès d'agents
extérieurs ou en liquidant des actifs extérieurs55.
Ce ratio capture le degré de
vulnérabilité de l?économie de la RDC aux chocs
extérieurs ainsi que le degré de crédibilité des
politiques économiques entreprises par ses dirigeants.
Voici comment cette variable à évoluer durant les
deux décennies sous études.
55
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Balance
courante 2011.jpg, le 14/08/2012 à 8h 3min
Figure no10: Evolution du ratio solde
balance courante sur le PIB entre 1991 et 2010 en
RDC
(Annexe 1)
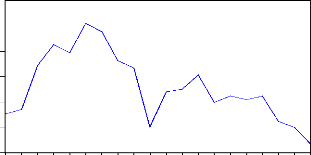
Source : -Fonds monétaire International 2000 -BCC,
Rapports annuels (2001-2010)
Le ratio solde des opérations courantes peut être
analysé en deux phases pour comprendre son évolution. La
première phase va de 1991 à 1996 et la seconde phase de 1997
à 2010.
Au cours de la première phase (1991-1996) on observe un
déficit du solde des opérations courantes aux trois
premières années entre 1991 et 1993 avec une tendance
d?accroissement positif. Ce déficit est dû suite à la
détérioration de la balance commerciale résultant de la
différence entre les exportations et les importations. Les autres
années entre 1993 et 1996 sont caractérisées par une
balance courante positive suite aux augmentations des
8
exportations par rapport aux importations. Le ratio moyen du
solde de la balance courante se
B
situe à 1,76% avec un accroissement moyen de 20,98% du PIB
pour cette phase.
La deuxième phase (1997-2010) est
caractérisée par une décroissance de la balance courante
de paiement jusqu?à atteindre un déficit en 2000. Elle passe
ainsi 10,56 % du PIB en 1996 contre 8,89% une année après. Cette
tendance baissière continue son allure mais elle croit en 2003 où
elle se situe 0,36%. La moyenne du ratio balance courante sur le PIB se situe
à -3,63% avec un décroissement de -168,57 pour des pics -8,89% en
1997 et - 13,33% en 2010 en raison probablement d?un déficit important
de la balance commerciale.
III.1.2.6. Solde budgétaire primaire sur le PIB
(SOBPPIB)
Le solde budgétaire primaire, c'est la
différence entre les recettes de l'année et les
dépenses de l'année hors paiement des
intérêts de la dette. Si ce solde est négatif, on
parle de
déficit primaire, s'il est en excédent,
d'excédent primaire. Cette variable exprime le solde
budgétaire primaire par rapport au produit intérieur brut. La
dette publique de l'année est égale à la dette de
l'année passée à laquelle on a soustrait le solde
budgétaire (s?il est positif).
En effet, d'une année sur l'autre, la dette diminue si
le solde budgétaire est en excédent : l'excédent permet de
réduire la dette. Au contraire, si le solde budgétaire est en
déficit, la dette augmente : le déficit budgétaire de
l'année en cours s'ajoute à la dette publique du passée.
La dette est ainsi le produit de l'accumulation des déficits
budgétaires du passé.
La figure ci-dessous en fait l?illustration :
Figure no11: Evolution du ratio solde
budgétaire primaire sur le PIB entre 1991 et
2010.
(Annexe 1)
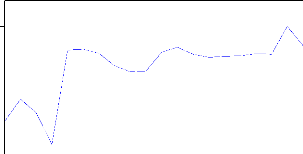
Source : -BZ, Rapports annuels 1991-1996
-BCC, Rapports annuels (1997-2010)
Au vu de cette figure, deux phases peuvent être mis en
évidence en vue de son analyse : la première phase va de 1991
à 2008 et la seconde de 2009 à 2010.
Entre 1991 et 2008 on remarque un ratio solde
budgétaire primaire sur le FIB essentiellement négatif sauf pour
les années 1995, 1996 et 2002 où on observe un ratio positif mais
moindre. Le ratio moyen pour les 18 années sous analyse se situe
à -3,69%. Cette dégradation est due par les pillages, des
mutineries, les conflits armées, les guerres sans cessent (dont les
effets majeurs sont le recul du niveau de l?activité de production,...),
l?agression de la RD Congo par ses voisions, la corruption,~56
La dernière phase (2009-2010), cette phase est
caractérisée par des ratios solde budgétaire primaire
positif. Ainsi, ces ratio passent à 5% en 2009 contre celui de -0.5%
d?une année en avant. Ces ratios sont respectivement 5% et 1,2%. La
moyenne de ce ratio pour les
56 BZ, Rapports annuels 1991-1996 et BCC, Rapports
annuels 1997-2008
deux années sous analyse se situe à 3,1%. Cette
progression est due à la pression fiscale, grace à l?augmentation
des impôts et redevances payés par les pétroliers (suite
à la hausse des cours mondiaux) et la modernisation des régies
financières. Elle a été marquée aussi par la
poursuite de mesures d?ajustement budgétaire prises par le gouvernement
depuis la fin de l?année 2009. Ces mesures ont contribué à
obtenir des résultats satisfaisants en vue de l?atteinte du point
d?achèvement. Malgré ces performances, le niveau des ressources
internes reste faible face aux impératifs de réduction de la
pauvreté. Une des contraintes importantes dans la mobilisation des
ressources est la faible efficacité et de la rentabilité du
système fiscal.57
III.1.2.8. Ratio exportations de biens et de services
sur FIB
Les exportations de biens et de services représentent
la valeur de tous les biens et autres services offerts au reste du monde. Elles
englobent la valeur des marchandises, du fret, de l?assurance, du transport, de
redevances, des frais de licence et d?autres services tels que les
communications, la construction, les services financiers, commerciaux et
personnel ainsi que les services gouvernementaux. Ce taux ne tient pas compte
de la rémunération des employés et revenus
d?investissement (anciennement appelés services des facteurs) et des
paiements de transfert.
Le ratio exportations de biens et de services indique dans
quelle proportion les revenus d?exploitation dont dispose un pays contribuent
dans le produit intérieur brut et donc la croissance
économique.
La figure suivante illustre son évolution pendant les 20
ans d?étude.
57 BCC, Rapports annuels 2010
Figure no12: Evolution du ratio
exportations de biens et de services en sur le PIB entre
1991 et
2010. (Annexe 1)
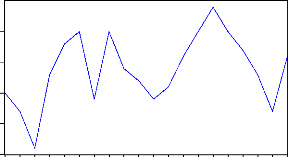
Source: WORLD BANK Developement Indicators 2011
La lecture de cette figure nous montre qu?elle peut etre
analysée sous trois grandes phases: la première phase va de 1991
à 1996, la deuxième va de 1997 à 2002 et la
troisième de 2002 à 2010.
La première phase (1991-1996) a été
caractérisée par un accroissement des
exportations de biens et de services mais il subit un
décroissement 1992 et 1993. Il prendl?ascenseur en 1994
jusqu?en 1996 où il quitte à 11% en 1993 et arrive 23% une
année après.
La moyenne de ce ratio se situe à 21,5 % avec une
croissance moyenne annuelle de 9,057%.
Au cours de la deuxième phase (1997-2002), il s?observe
une baisse de ce ratio en 1997 par rapport à l?année
passée (1996); cette contre-performance ce justifie par le début
de la guerre de libération de 1?AFDL en octobre 1996 car pendant la
guerre les exportations sont indésirables, mais par contre elles
croissent en 1998 puis elles retrouvent son chemin de la décroissance en
1999 jusqu?en 2002. Les raisons majeurs de cette décroissance sont
l?agression en Aout 1998 de la RDC par le Rwanda et l?Ouganda sous forme de la
rébellion du RCD. Ainsi, ce ratio décroit à un taux moyen
annuel de -1,7% avec une moyenne annuelle de 22,5%.
La dernière phase (2003-2010), en dépit du
climat politico-social paisible et favorable les exportations ce sont accrues
pendant cette phase. Cette croissance s?explique par la production du cuivre ;
ainsi la production totale du cuivre a atteint le niveau le plus
élevé de ces deux dernières décennies. En effet,
elle s?est accrue de 60,9 % en 2010, passant de 309.181,0 tonnes en 2009
à 497.537,0 tonnes durant l?année sous étude.
Rapprochées à
l?année 2009, les productions de la GECAMINES et de ses
partenaires ont enregistré des augmentations significatives de 50,8 % et
de 61,4 % à fin décembre 2010, se situant respectivement à
20.015,0tonnes et 477.522,0 tonnes contre 13.274,0 tonnes et 295.907,0 tonnes.
Le ratio exportations de biens et de services sur le PIB subira une croissance
considérable avec un pic de 34% en 2005. Le ratio moyen est de 29,25%
avec un taux de croissance moyen de 5,35%.58
III.2. SPECIFICATION DU MODELE
Au vu de ce que nous venons de développer ci-dessus,
nous présentons théoriquement le modèle susceptible que
nous cherchons à versifier dans le présent travail. La variable
endogène (ou expliquée ou encore dépendante) est
présentée par la variable taux croissance du PIB réel
autrement appelé facteur ou coefficient de croissance économique.
Ce qui nous amène à dire que nous aurons à
spécifier une (1) équation pour essayer d?évaluer la
relation entre nos variables indépendantes sur la variable
dépendante retenue.
III.2.1. Modèle théorique
Ce modèle obéisse à la disponibilité
des données et aux réalités économiques, sociales,
financières et politiques de la RD Congo.
A l?instar du modèle proposé par YAPO (2002),
nous aurons à intégrer d?autres variables qui nous semblent
pertinentes et en enlevant quelque unes, jugées moins pertinentes.
Après la modification, le modèle sous forme équationnel
que nous voulons analyser se présenter comme suit :
TCPIB=f(STDPIBt,,STDEXPt,VT,SEDEXPt, ,TCDEMt,
BCPIBt,,SOBPPIBt, ,EXPPIB, åt)
Avec TCPIB, STDPIB, STDEXP, VTE, SEDEXP, TCDEM, BCPIB,
SOBPPIB, et EXPPIB respectivement taux de croissance du produit
intérieur brut, ratio stock dette sur le produit intérieur brut,
ratio stock dette sur les exportations des biens et des services, variables
termes de l?échange, ratio service dette sur les exportations des biens
et des services, taux de croissance démographique, ratio balance
courante sur le produit intérieur brut, ratio solde budgétaire
primaire sur le produit intérieur brut et ratio exportation de biens et
de services sur le PIB.
III.2.2. Modèle mathématique
En supposant TCPIB comme la variable dépendante, le
modèle mathématique se présente comme suit :
58 BCC, Rapport annuel 2010
61
TCPIB=â0+â1STDPIB+â2STDEXP+â3VTE+â4SEDEXPt+â5TCDEMt+â6BCPIBt+â7SOBPP
IB+ â8EXPPIB
II.3.3. Modèle économétrique
Le modèle économétrique est le modèle
susceptible d?être estimé. Ainsi, sous forme d?une équation
notre modèle se présente comme suit:
TCPIB=â0+â1STDPIB+â2STDEXP+â3VTE+â4SEDEXPt+â5TCDEMt+â6BCPIBt+â7SOBPP
IB+ â8EXPPIB+ åt
Avec â0, â1, â2, â3, â4,
â5, â6, â7, â8, les principaux paramètres
du modèle à estimer par MCO (Moindres Carrées Ordinaires)
et åt erreur de spécification inconnue.
La méthode de spécification retenu ici est celle
des moindres carrées ordinaires (MCO) qui est une méthode
consistant à minimiser les écarts entre les observations et la
droite estimée de moindre carrée. Le logiciel E-Views 3.1 nous
permettra de faire la régression des variables retenues pour
l?aboutissement de cette étude.
Pour s?assurer de la validité statistique,
économétrique et la stabilité du modèle nous
testerons une panoplie de tests tels que : le test de significativité du
modèle celui de Fisher et Student pour voir si le modèle est
globalement et individuellement significatif au seuil de 5 %. Nous testerons en
plus les tests d?autocorélation des erreurs,
d'homoscédasticité et
d?hétéroscédasticité des résidus, de la
normalité des résidus et de la stabilité du modèle,
le test de multiplicateur de Langrage,...
III.3. SOURCE DES DONNEES DE L'ETUDE
Les données utilisées dans cette étude
sont des données annuelles issues de la base de données de la
Banque Mondiale (BM), des rapports de la Banque Centrale du Congo (BCC). Les
données sur la dette publique extérieure (ratio stock dette sur
le PIB) sont tirées dans la basée des données de la Banque
Mondiale et dans divers rapports de la Banque Centrale du Congo. Il en est de
même pour le service effectué sur la dette (ratio service dette
sur les exportations de biens et de services) et stock dette sur les
exportations de biens et de services mais les données sur le taux de
croissance démographique et le ratio exportation de biens et de services
le PIB sont tirées à 100% dans la basée des données
de BM.
Les données sur la balance courante de paiement, le
solde budgétaire primaire, le taux de croissance du PIB, la variable
terme de l?échange proviennent des rapports de la Banque Centrale du
Congo. Ces séries sont chronologiques couvrant la période du 1991
à 2010 (soit 20 observations sous études).
CHAPITRE QUATRIEME : PRESENTATION, ANALYSE
ET
INTERPRETATION DES RESULTATS
Ce chapitre à pour objet de présenter,
d?analyser et interpréter les résultats obtenus. Pour ce faire,
nous subdivisons ce chapitre en trois grandes parties. La première
consistera à la présentation des résultats obtenus et
à l?estimation du modèle grace à la méthode de
spécification de MGO, tandis que la seconde faira l?objet de
l?interprétation des résultats en d?autres termes
l?évaluation des résultats économétriques par
rapport aux réalités du vécu quotidien dans la gestion de
la dette publique extérieure congolaise. En fin, nous aborderons une
autre notion telle que : l?impact de l?initiative PPTE.
IV.1. PRESENTATION DES RESULTATS ET ESTIMATION DES
MODELES
Nous présentons ici les résultats des
régressions de l?équation retenue ainsi que la validation du
modèle afin d?analyser la validité statistique et
économétrique du modèle et analyser l?influence de
l?endettement sur la croissance économique de la RDC pendant les
années d?étude.
Dans le premier temps, nous présenterons les
résultats globaux de la régression, puis évaluer la
signification du modèle et les tests d?hypothèses sur les
paramètres. La méthode des moindres carrés ordinaires est
retenue pour la méthode de spécification avec le logiciel
utilisé est E-Views 3.1. Ainsi, à partir du logiciel Econometric
Views, l?estimation de la relation à long terme du poids de la dette
publique extérieure sur la croissance de la RDG a été
faite.
Nous allons présenter les résultats de la variable
dépendante entre autre taux de croissance du PIB, les analysés
afin de valider le modèle.
IV.1.1. Résultat de la régression de la
variable taux de croissance du PIB (variable
dépendante du
modèle)
Tableau no 4 : Résultat de la
régression par MCO de la variable dépendante TCPIB
|
Variable endogènes Variables
exogènes
|
TCPIB
|
T-statistique
|
Prob. De T
|
|
Constante
|
-22,14222
|
-3,152212*
|
0.0092
|
|
STDPIB
|
-1.605191
|
-1,058488
|
0.3125
|
|
STDEXP
|
-0.198906
|
-0,359290
|
0.7262
|
|
VTE
|
6.502108
|
2,065996**
|
0.0632
|
|
SEDEXP
|
22.98917
|
1,876618**
|
0.0873
|
|
TCDEM
|
1.716289
|
1,655130***
|
0.1261
|
|
BCPIB
|
21.77181
|
1,416184***
|
0.1844
|
|
SOBPPIB
|
27.93033
|
2,305160*
|
0.0417
|
|
EXPPIB
|
70.47399
|
6,175905*
|
0.0001
|
|
R2
|
0,934149
|
|
|
R2- ajusté
|
0,886257
|
|
F-statistique
|
19,50549
|
|
Prob. (F-statistique)
|
0,000018
|
|
D.W
|
1,962157
|
|
*significatif au seuil de 5% (t
/2= 2,201 ; dl= 11) **significatif au seuil de 10% (t /2=
1,796 ; dl= 11) ***significatif au seuil de 20% (t /2= 1,363 ; dl=
11)
|
Source : Nos calculs à l?aide du logiciel Eviews
3.1 (Annexe 2)
Le tableau ci-dessus présente les résultats de la
régression effectuée à niveau de notre variable
expliquée. De ce fait, nous allons analyser afin de découvrir sa
signification.
Le résultat de notre régression nous amène
à écrire sous forme d?équation cette relation reliant la
variable taux de croissance du PIB (TCPIB) avec 8 variables explicatives.
Les résultats synthétiques de notre modèle
estimé se présentent ainsi :
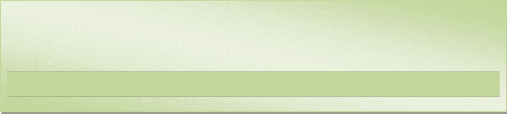
27.930SOBPPIB +70.474EXPPIB
(2.305) (6.175)
TCPIB= -22,142 - 1.605STDPIB -
0.1989STDEXP+6.502VTE+22.989SEDEXP+1.716TCDEM +21.77BCPIB+
(-3.152) (-1.058) (-0. 3592) (2.065) (1.8766) (1.655)
(1.416)
R2 =0.934149; R2-ajusté=
0.886257 ; D.W (Durbin-Watson stat)= 1.962157;
F-statistique=19.50549 (Prob. F-statistique=
0.000018)
Les valeurs entre parenthèse sont des T- de Student
IV.2.2. Validité du modèle
IV.2.2.1. Validité statistique
La lecture des résultats de cette équation mettant
en relation le taux de
croissance du PIB réel par rapport à l?ensemble des
variables exogènes (indépendantes ou
explicatives), il ressort que la variable expliquée ou
dépendante dépend à 93,41% de la variation de variables
explicatives ou indépendantes du modèle ; mais aussi après
ajustement, la variable endogène dépend à 88,62% des
variables exogènes. En plus, on remarque que globalement le
modèle est significatif car la valeur associée à la
probabilité de Fisher (F-statistic = 0,000018) est inférieure
à 0,05. En suite, la valeur de statistique de Fisher nous apprend qu?au
moins l?un de paramètre est significatif car F-calculé est
largement supérieur au F-tabulaire au seuil de 0,05 (Fcal > Ftab :
19,51>3,20).
Avec le test de Durbin-Watson, il s?observe l?absence de
l?autocorélation des résidus (erreurs), car la valeur empirique
est proche de 2 (1,962 2), en d?autres termes le modèle théorique
a été bien spécifiée et le choix de variables
explicatives a été bien effectué.
Le test de paramétrique de Student nous fait voir aussi
que seules la constante, le ratio exportation de biens et de services sur le
PIB et ratio solde budgétaire primaire sur le PIB sont individuellement
significatifs au seuil de 5%. Car leurs probabilités sont
inférieures à 5% voir tableau ci-haut présenté de
la régression générale. Les autres ne les sont pas
individuellement parce que leurs probabilités sont supérieures
à 5%. Ceci étant, le modèle est statiquement
validé.
IV.2.2.2. Validité
économétrique
a. Test de Ramsey
On accepte l?hypothèse nulle si les
probabilités sont supérieures à 0,05 et on rejette
l?hypothèse nulle si les probabilités sont inférieures
à 5% par conséquent on accepte l?hypothèse alternative.
Les valeurs des deux probabilités du test de Ramsey sont
supérieures à 5% en occurrence de 79,22% et 70,25% (Annexe
3). Ceci nous apprend que le modèle est bien spécifié
et il y a l?absence d?autocorélation des erreurs.
b. Test de Breusch-Godfrey
La statistique de Breusch-Godfrey ou test de multiplicateur de
Lagrange (LM) de corrélation sérielle est un test d?absence
d'auto corrélation, qui prend en compte certaines limitations et
insuffisantes du test DW:
v' la variable dépendante peut apparaître comme
variable explicative retardée dans le modèle (modèle auto
régressif) ;
v' l?auto corrélations peuvent être
supérieures à l?ordre 1 ;
v' la possibilité que les résidus soient auto
corrélés.
Si la probabilité est inférieure à 0,05, on
rejette l?hypothèse nulle de non auto corrélation des
résidus (erreurs).
L?analyse de la probabilité du test de Breusch-Godfrey
est ici de 7,6667% qui est supérieure à 5% (0,076667>0,05), ce
qui veut dire qu?on accepte l?hypothèse nulle de non auto
corrélation des termes d?erreurs. Ce résultat confirme ce lui de
D.W d?absence d?auto corrélation des erreurs (Annexe 4).
c. Test d'homoscédasticité des
résidus L?une des hypothèses clés des
modèles linéaires est l?hypothèse
d?homoscédasticité, c?est-à-dire, les
résidus (termes d?erreur) du modèle ont la méme variance.
Le test de White est un test général
d'homoscédasticité, fondé sur l'existence d'une relation
entre le carré du résidu et une ou plusieurs variables
explicatives. L?hypothèse nulle est celle
d'homoscédasticité contre l?hypothèse alternative
d?hétéroscédasticité.
La probabilité du test de White est ici de 0,3889 qui
est largement supérieure à 0,05=5% (0,3889>0,05) (Annexe
5), ce qui veut dire qu?on accepte l?hypothèse nulle
d?homoscédasticité des résidus ou termes d?erreurs.
d. Test de ARCH Ce test vient corroborer
l?homoscédasticité des érreurs, car selon ce test les
erreurs du modèle sont homoscédastiques si les
probabilités sont supérieures à 0,05. Pour ce cas, nous
avons observé que les erreurs sont homoscédastiques car les
probabilités sont supérieures au seuil de 5% en occurrence de
34,45% et 29,74% (0,3445> 0,05 et 0,2974> 0,05) voir (annexe
6).
e. Test de normalité des résidus
Pour vérifier si le processus des résidus suit un bruit
blanc gaussien, il y a
plusieurs tests paramétriques disponibles. En ce qui
nous concerne, nous allons nous limiter aux tests couramment utilisés :
le skewness, le Kurtosis et le test de Jarque-Bera. Ce test nous a permis de
savoir s?il y a la normalité des erreurs.
Observant les résultats sur la figure se trouvant
à l'LttQfQ llh. Dans le tableau de droite, nous avons les trois
statistiques : Skewness, Kurtosis et Jarque-Bera. Le
JarqueBera a une probabilité de 0,8019 soit 80,19% qui
est supérieure à 0,05 soit 5%, ce qui veut dire qu?on accepte
l?hypothèse nulle de normalité des termes d?erreurs ou
résidus.
f. Test de multi colinéarité Ce
test consiste à comparer le R2 du modèle estimé
au coefficient de corrélation
simple des variables explicatives prises 2 à 2. La
matrice de corrélation simple des variables explicatives (Annexe
8) nous montre que tous les coefficients de corrélation entre les
variables réellement explicatives du modèle sont
inférieurs à R2. Ceci signifie que les variables du
modèle retenu ne sont pas colinéaires.
g. Test de CUSUM Le test CUSUM permet
d?étudier la stabilité structurelle du modèle
estimé au
cours du temps. Ce test nous a permis de voir si le
modèle estimé est stable pendant les années
d?étude. L?hypothèse nulle est modèle structurellement
stable contre l?hypothèse altern ative qui stipule modèle
structurellement instable
Si la courbe sort du corridor, il y a instabilité du
modèle. Ici, nous constatons que la courbe ne sort pas de la bande donc
dans le corridor (annexe 9). Ainsi, nous concluons que le
modèle est stable au seuil de 5% sur toute la période.
h. Test de CUSUM au carré La statistique
de CUSUM au carré ou CUSUMSQ teste la stabilité ponctuelle du
modèle. Le modèle est ponctuellement stable car
la courbe ne sort pas du corridor (Annexe 10). Les tests ci-dessus ont
été effectués pour s?assurer de la validité
économétrique du modèle.
Eu égard ceux qui précède le modèle
est statistiquement et économétriquement
validés.
IV.2. EVALUATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Dans cette partie nous allons évaluer et
interpréter les résultats obtenus. Le schéma d?endettement
public extérieur de la RDC est bien expliqué par le
modèle, avec un degré de confiance de 95%. Les pouvoirs
explicatifs sont satisfaisants pour le modèle avec 93,14% pour le taux
de croissance du FIB. Il est question de présenter chaque variable
explicative, voir si elle est significative dans l?équation
spécifiée. En suite nous aurons à apprécier son
signe, ce qui nous amènera à la confrontation des
hypothèses annoncées au début du présent
travail.
IV.2.1. Le ratio stock dette extérieure sur le
PIB
Celle-ci constitue la première variable
d?intérêt de notre étude car c?est à partir de
cette variable que nous aurons à apprécier ou
non le poids de l?endettement extérieur sur la performance
économique de la République Démocratique du Congo. Le
signe espéré est plus (+).
Le résultat de l?équation nous laisse dire que
cette variable est en relation négative avec la variable endogène
(expliquée ou dépendante) car son signe est négatif.
L?amélioration de cette variable tend donc à encourager la
relance économique de la RDC.
De ce fait, le coefficient de cette variable est -1,605
lorsque le stock de la dette est reporté au FIB. Ce ci indique qu?un
accroissement d?un (1) pourcent du stock de la dette
sur le PIB conduit à la baisse de 1,605 % du taux de
croissance économique de la RD Congo. Les performances
économiques de la RDC amélioreraient la liquidité en
rapport avec ses obligations de remboursement des dettes extérieures
contractées.
Ces résultats confirment ceux trouvés par
Christian NDO (2008) qui a trouvé également un impact
négatif de l?endettement public extérieur sur les performances
économiques du Benin.
Ainsi, la lecture des résultats ci-dessus
trouvés dans l?équation, montre que notre variable stock dette
sur PIB (STDPIB) a influencé négativement la croissance
économique de la RDC pendant les 20 ans d?études. Ce qui nous
amène à dire que le recours à l?endettement
extérieur excessif de la RDC durant le 20 ans d?analyse a
lésé sa performance ou sa croissance économique.
IV.2.2. Le ratio stock dette extérieure sur les
exportations de biens et de services
Le ratio stock dette extérieure sur les exportations de
biens et de services est la deuxième variable constituant
l?intérêt de notre étude pour la validation ou la non
validation notre première hypothèse. Cette variable est aussi en
relation négative avec la variable dépendante (TCPIB). Ainsi,
avec comme coefficient de -0,1989; ceci signifie qu?une augmentation d?un point
du stock de la dette sur les exportations de biens et de services induit la
décroissance 0,1989 point de la croissance économique de la RDC.
Un ratio moindre du stock de la dette sur les exportations semblerait donc
élever le taux de croissance économique de la RDC.
Lorsque les ressources issues des exportations sont
insuffisantes pour faire face au remboursement des emprunts contractés
alors le pays accumule des arriérés de payement jusqu'à
une certaine période.
En effet, l?entrée des devises en RDC est
essentiellement basées sur les exportations des produits bruts tels que
: le cuivre, le diamant, café, or,... Les cours mondiaux
défavorable de ces produits se traduit par la baisse des recettes en
devises qui a permis la dégradation des exportations par rapport aux
importation traduisant ainsi la baisse de la capacité de remboursement
de la dette contractées par la RDC au prés de ses bailleurs.
Ainsi, l?on arrive à la conclusion selon laquelle le
recourt aux emprunts extérieurs excessifs restreint la
possibilité de la croissance économique de la RDC pendant les
deux dernières décennies de notre étude.
Les conclusions de ces deux variables nous amène à
infirmer notre première hypothèse annoncée au début
du présent travail.
IV.2.3. Les termes de l'échange
Les résultats de l?équation nous laissent dire que
cette variable n?est pas
statistiquement significative au seuil de 5%. La non
significativite de cette variable nous permet de dire que la variation des
termes de l?échange n?est pas pertinente dans le processus de la dette
et la croissance economique de la RDC pendant les 20 dernières annees de
notre analyse au seuil de 0,05.
Mais par contre, au seuil de 0,1 les termes de
l?échange tendent à encourager la croissance economique de la RDC
car pendant la deuxième decennie les exportations sont accrues au
detriment des importations, ceci a permis l?entrée importante par
rapport au moindres sortie des devises qui traduit le retour progressif de
l?équilibre de la balance commerciale qui a son tours induit la
croissance economique de la RDC.
IV.2.4. Le ratio du service de la dette sur les
exportations de biens et de services
Au vu des resultats obtenus, il ressort que cette variable n?est
pas significative au
seuil de 5% lorsque le service de la dette exterieure de la
RDC est mesure en pourcentage des exportations de biens et de services. Le
service de la dette sur les exportations de biens et de services n?a donc pas
presente une variable pertinente dans l?explication de la croissance
économique et l?endettement durant les 20 dernières annees sous
etude. Mais, son impact est significatif sur la croissance au seuil de 10%.
De ce fait, l?allégement du service de la dette
représente une variable strategique et incontournable dans les
politiques de desendettement et la croissance economique de la RDC.
IV.2.5. Taux de croissance démographique
L?observation des résultats obtenus ci-haut nous laisse
dire que la variable taux
croissance demographique n?est pas significative au seuil de
5% donc n?a pas été pertinente dans l?explication du niveau de la
croissance et la dette extérieure en RDC. Mais, elle présente sa
significativite au seuil de 20%. Pendant la periode sous etude (1991-2010), les
taux de croissance moyen de la population congolaise etait de 2,98% contre un
taux de decroissance du PIB de -0,125%.
Cette non significativite du taux de la croissance
demographique par rapport à la croissance économique s?explique
par le fait qu?un taux de croissance de la population eleve devrait augmenter
les charges sectorielles au gouvernement en matière d?éducation,
de sante, de formation,... ceci obligera le l?Etat à recourir aux
emprunts extérieurs.
IV.2.6. Ratio balance courante de paiement sur le PIB
La lecture des résultats ci-dessus
présentés nous renseigne que cette variable n?est
pas significatif au seuil de 5% mais elle est significative au
seuil de 20%.
La non significativité de cette variable nous permet de
conclure que la balance de paiement n?est pas pertinente dans le processus de
la croissance économique de la République démocratique du
Congo durant le 20 ans sous analyse.
IV.2.7. Ratio solde budgétaire primaire sur le
PIB
Au vu des résultats présentés ci-dessus, on
observe que le ratio du solde
budgétaire primaire sur le produit intérieur
brut possède un signe attendu (positif) et est significatif au seuil de
5% ; par conséquent, il a influencé significativement la
croissance économique de la RDC durant les vingt dernières
années sous étude. Ainsi, il exprime l?existence du retour de la
croissance économique à long terme. L?on peut déjà
dire à partir de ces résultats que le retour progressif de
l?équilibre budgétaire tend à favoriser la croissance
économique de la RDC.
En effet, l?analyse du budget du gouvernement durant la
période sous étude exprime une existence de la contrainte
budgétaire d?équilibre à long terme. En outre, le
financement du déficit budgétaire à été
souvent financé par l?emprunt intérieur (sous forme de
financement monétaire auprès de la BCC sous forme des blanches
à billet: beaucoup plus fréquent pendant le régime de
MOBUTU) alors que le financement par endettement extérieur concernait
plutôt les projets d?investissement qui sont sortis improductifs ou le
remboursement des dettes antérieures. Le gouvernement congolais semble
donc avoir moins recouru au financement extérieur pour pouvoir couvrir
son déficit budgétaire primaire.
IV.2.8. Ratio exportations de biens et de services sur le
PIB
Au seuil de 5%, la variable ratio exportation de biens et de
services au FIB est
statistiquement significatif. Ce qui nous pousse à dire
que les exportations de biens et de services ont contribué à la
croissance économique de la RDC pendant les deux dernières
décennies (1991-2010). Ceci se justifie par le fait que les exportations
permettent :
- La création des emplois par l?entremise des
investissements ;
- Au pays qui les pratique d?obtenir les devises afin d?assurer
les paiements internationaux donc le remboursement de sa dette;
- L?accroissement initial du revenu national.
L?accroissement du volume des exportations est plus que jamais
nécessaire pour la croissance économique et solutionner
durablement les problèmes liés aux questions des
recettes en devises de la RDC. Elle doit chercher à
améliorer significativement sa capacité d?exportation et
renforcer sa compétitive en vue de renforcer ses capacités de
paiement extérieurs et disposer des ressources
supplémentaires.
L?analyse approfondie des biens exportés permet de
constater que l?accroissement des exportations est tiré principalement
par le cuivre et le cobalt dont les progressions ont été
respectivement de 88,6 % et 121,9 % après avoir chuté en 2009 de
32,9 % et 32,7 %. Les exportations de diamant ont repris après deux
années de baisse consécutive (BCC, Rapport annuel 2010).
Bien que la croissance économique soit prometteuse les
dernières années d?analyse, elle n?a pas permis de créer
suffisamment d?emplois et le niveau de pauvreté demeure encore
préoccupant face aux exigences des Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD).
Ainsi, d?après le classement annuel 2010 sur base de
l?Indice de Développement Humain (IDH), publié par le Programme
des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), la RDC occupe la
168ème place sur 169 pays membres des Nations-Unies
classés. La Norvège conserve la tête et le Zimbabwe
clôture cette fois-ci la liste.59
IV.2.9. Détermination du seuil d'endettement
viable
Les indicateurs de la dette publique nous fournissent une
première information sur la vulnérabilité. Ce sont des
indicateurs ex-post, c?est-à-dire qu?ils présentent des
faits confirmés. Il existe en revanche des indicateurs ex-ante,
qui nous donnent des informations sur l?ampleur de l?ajustement fiscal. La
littérature spécialisée propose d?utiliser des indicateurs
qui cherchent à maintenir constant l?indicateur de la dette par rapport
au PIB.
Il faut donc les utiliser conjointement aux ratios de la dette
publique. Ces dernières années, divers facteurs politiques ont
favorisé la conception et l?utilisation d?indicateurs de
viabilité de la dette extérieure. Le poids énorme du
service de la dette sur les exportations de biens et de service, le poids de la
dette sur le PIB, le poids de la dette sur les exportations de biens et de
services de certains pays. La dette publique et le paiement des
intérêts associés sont donc devenus un problème
structurel dans les pays dont le déficit est persistant. Pouvoir compter
sur des indicateurs permettant de contrôler la capacité des pays
à faire front aux engagements acquis au cours du temps avant que ceux-ci
ne deviennent insoutenables est donc devenu de plus en plus indispensable. Les
indicateurs de viabilité d?endettement cherchent à rendre compte
des aspects intemporels des finances publiques.
59 BCC, Rapport annuel 2010
Il n?y a pas de consensus entre les différents organismes
internationaux pour établir les niveaux minimums que ces indicateurs
doivent avoir.
Le tableau suivant montre les niveaux minimums conseillés
par le FMI et la BM pour qu?une dette soit viable ou soutenable.
Selon les études menées conjointement par ces deux
organismes internationaux ; ils proposent ce qui suit :
Tableau no 5 :
Niveaux minimum conseillés
|
Indicateur de vulnérabilité
|
Seuils minimums(en%)
|
|
Stock dette/PIB
|
50-75
|
|
Stock dettes /les exportations
|
250-270
|
|
Service de la dette/les exportations
|
15-25
|
Source : BCC, Rapport annuel 2006
L?examen de ce tableau permet de relever que la dette de la RD
Congo n?est pas soutenable et viable malgré les potentialités
économiques à son actif, car tous les indicateurs sont au-dessus
du seuil de référence sauf pour quelques dernières
années, (Annexe 1). Ainsi, avec l?accession du pays au point de
décision de l?initiative PPTE, ces indicateurs tendent à revenir
sur les seuils minimums exigés par les institutions financières
internationales.
Ces résultats ci-haut observé permet d?infirmer
notre deuxième hypothèse selon laquelle, au vue des
potentialités économiques de la RDC, sa dette serait soutenable
et viable.
Cette situation serait due par une mauvaise gestion de la
dette publique, par injection des emprunts dans des investissements
improductifs, à la corruption et aux détournements de fonds, au
financement d?« éléphants blancs » qui a
commencé par le barrage d?Inga, au non amortissement de la dette,...
IV.3. IMPACT DE L'INITIATIVE PPTE
Pour entrer à l?initiative PPTE, un pays doit
présenter un niveau d?endettement insoutenable, en outre, la valeur
présente nette de la dette sur les exportations doit être
supérieure à 150%. L?objectif de cette initiative est donc de
ramener le service de la dette extérieure à un niveau qui ne
compromet pas la croissance économique des pays endettés.
Cette initiative est caractérisée par 4 grandes
phases :
1ère phase : le pays doit suivre un
programme triennal d?ajustement structurel avalisé par le
FMI et la
BM destiné à la rédaction d?un Document de
Stratégie pour la Réduction de la
Pauvreté (DSRP), il
se focalise sur 3 grands piliers : restauration de la paix et bonne
gouvernance, la stabilisation macroéconomique et la
croissance pro-pauvre, la relance de l?économie national. La RDC a
implanté, lors de cette phase, un Programme Intérimaire
Renforcé (PIR), il était destiné à arrêter la
dégradation de la situation économique et stabiliser l?inflation
et le taux de change, entre juin 2001 et mars 2002 et un Programme
Multisectoriel d?Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction (PMURR)
entre avril 2002 et juillet 2005, il visait un taux de croissance annuel moyen
du PIB de 6 % pour la période 2002-2005, une diminution du taux
d?inflation annuel à 5% à l?horizon 2005 et une augmentation
progressive des réserves internationales.
2ème phase : le pays atteint le point de
décision si le FMI et la BM jugent sa dette extérieure
insoutenable. Dans ce cas, ils définissent le montant intégral et
irrévocable dont bénéficiera le pays au terme de
l?initiative pour atteindre l?objectif de soutenabilité. La RDC atteint
cette phase en juillet 2003 car la valeur actuelle nette de sa dette sur les
exportations s?élevait à 758% la fin de 2002. Ainsi, pour la
dette congolaise, les allégements intérimaires requis devraient
s?élever à 5,3 milliards de USD en valeur actuelle nette.
3ème phase : le pays doit poursuivre les reforme
préconisées par le FMI et de BM et rédiger un DSRP
définitif. Actuellement, la RDC poursuit la Programme économique
du gouvernement et doit achever la rédaction de son DSRP
définitif. Elle doit en outre rembourser ses arriérés
envers ses créanciers bilatéraux du club de Paris. Sur les 9703
millions de USD que la RDC lui devait au 30 juin 2002, plus de 90% sont
constitués d?arriérés.
4ème phase : finalement, le pays atteint le
point d?achèvement. A ce niveau, les allégements calculés
au point de décision sont appliqués au pays. Ce point devrait
être atteint par la RDC en juillet 2006 mais cela n?a été
possible en raison des retards accumulés dans la rédaction de
DSRP intérimaire et définitif.
Toutefois, cette initiative présente un certain nombre
d?inconvénient qui réduisent son efficacité en
manière d?endettement des pays endettés dont la RDC :
1' les étapes pour bénéficier des
allègements sont souvent lentes et exigeantes, ce qui est
susceptible
de décourager l?adhésion et les efforts de la part des pouvoirs
politiques ;
1' le paiement ai titre du service de la dette reste
élevé. En effet, environ 80% de la dette extérieure
congolaise est constituée d?arriérés de paiements. Or, le
critère de conditionnalité est de les rembourser pour
bénéficier des allégements. Cette situation
conduit à un effet « boule neige » et à
l?aggravation de la dépendance extérieure du
pays.60
Le 23 juillet 2003, la RDC a accédé au point de
décision «de l'initiative PPTE». Par ce fait, elle a obtenu le
bénéfice des conditions de Cologne, soit des allégements
supplémentaires de 23% pour un montant total de USD 262 millions. Ainsi,
l'ensemble des allégements obtenu des créanciers membres du Club
de Paris a-t-il atteint 90%. Elle atteint la décision
d?achèvement dans le cadre de l?Initiative en faveur des Pays Pauvres
Très Endettés (I-PPTE) le 01 juillet en 2010. Il a
été caractérisé par une amélioration
significative de l?environnement interne entre autres, la forte croissance
économique, la stabilité du cadre macroéconomique.
74
CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
La présente étude qui s?est proposée
d?analyser les conséquences de l?endettement sur la croissance
économique durant les deux décennies passées avait comme
objectif d?évaluer dans quelle mesure l?endettement peut exercer une
influence positive ou négative sur la relance économique de la RD
Congo.
Les prédictions de notre étude reposait sur les
hypothèses selon lesquelles qu?en considérant le fait que certain
pays se sont développé grace au recours à l?emprunt, nous
osons croire que la dette publique extérieure de la RDC aurait
contribuée à sa croissance économique durant les deux
dernières décennies et la seconde hypothèse
stipulée que : au vue des potentialités économiques de la
RDC, sa dette serait soutenable et viable pendant les années sous
études.
A cet effet, la méthode statistique et descriptive,
l?approche économétrique et la technique documentaire ont
été privilégiées pour confirmer ou infirmer nos
hypothèses. Néanmoins, notre travail a comporté quatre
chapitres :
v' Le premier chapitre a porté sur l'approche
théorique où nous avons fouillé toute la
littérature relative à la dette publique extérieure,
l?analyse macroéconomique de la dette et la notion sur la croissance
économique.
v' Le second chapitre a porté sur
généralité de la dette publique de la RD CONGO. Il a
été question de présenter l?historique et les origines de
la dette de la RDC, quelques agrégats de la dette et la relation de la
RDC avec ses bailleurs de fonds.
v' Le troisième chapitre quant à lui
était consacré à l?approche méthodologique
adoptée par notre étude. Dans ceci, nous avons
présenté la récolte des données, le traitement des
données, en suite nous avons spécifié les variables
où nous avons retenu comme variable dépendante (taux de la
croissance du FIB réel) et huit variables indépendante
(exogènes ou explicatives).
v' En fin, le quatrième chapitre a porté sur
à la présentation, l'analyse et l'interprétation des
résultats où nous avons présenté et
interprété les résultats observés durant la
période sous revue.
Concrètement, nos résultats indiquent
l?existence d?une relation négative entre la dette et la croissance
économique de la RDC pendant les années 1991 à 2010 soit
20ans. En effet, une hausse du ratio stock dette sur le FIB et sur exportations
de biens et de services d?un pourcent, entraine une diminution de 1,605% et de
0,1989% de la croissance économique de la RDC. Ces résultats nous
a permis d?infirmer (rejeter) notre première
hypothèse selon laquelle considérant le fait que
certains pays se sont développé grâce au recours à
l?emprunt, nous osons croire que la dette publique extérieure de la RDC
aurait contribuée à sa croissance économique durant les
deux dernières décennies.
La dette publique extérieure de 1991 à 2010 a donc
été un fardeau pour la RDC dont les conséquences ont
mutilé (handicapé) sa croissance économique.
La variable termes de l?échange et le service de la
dette sur les exportations de biens et de services n?ont pas été
significatifs au seuil de 5% mais leurs significations ont été
observées à 10%. Toutes choses restant égales par
ailleurs, à 10% ces deux variables contribuent à la croissance
économique de la RDC. L?amélioration des termes de
l?échange et le service de la dette amplifierait la croissance
économique de la RDC et le stock de la dette réduirait.
Par ailleurs, le taux de croissance démographique ainsi
que le ratio balance courante sur le PIB, bien qu?ayant conservé leur
signe attendu (positif), ne semblent pas influer significativement sur la
croissance économique de la RDC au seuil de 5%.
En outre, le ratio solde budgétaire primaire sur le PIB
et le ratio exportations de biens et de services semblent influer
significativement sur la croissance économique de la RDC au seuil de
5%.
En effet, un excédent budgétaire implique que le
pays a des ressources pour financer ses projets d?investissement sans recourir
aux fonds extérieurs. Les recettes d?exportations importantes tentent
à réduire la dette et contribue ainsi à la croissance
économique de la RDC.
L?inefficacité de la politique d?endettement
adoptée par l?Etat congolais durant la période sous étude
est l?objet de l?injection des capitaux étrangers dans des
investissements improductifs dont l?impact économique et social
était quasiment nul (diffus), les pillages et la guerre à
répétition seraient autant des facteurs ayant conduit aux
résultats observés pendant la période sous
étude.
De l?autre côté, l?endettement extérieur
stimule la croissance économique et est viable jusqu?à un certain
niveau évalué par le FMI et la BM à 50-75% du PIB, 250-270
des exportations de biens et de services et 15-25% services dette sur
exportations de biens. Audelà de ces seuils, l?impact de l?endettement
extérieur devient globalement négatif sur la croissance
économique et traduit ainsi l?insouténabilité et la non
viabilité de la dette publique extérieure. Ces résultats
nous ont permis d?infirmer notre deuxième hypothèse selon
laquelle qu?au vue des potentialités économiques de la RDC, sa
dette serait soutenable et viable.
Devant cette situation, il est plus qu?impérieux de
maitriser l?évolution du taux d?endettement extérieur en vue de
réduire le risque d?erreur lié à la décroissance
économique de la RDC et aux facteurs qui affectent négativement
la politique d?endettement public sur la croissance économique de la
RDC.
Les recommandations que nous avons formulées se situent
dans cette perspective, il s?agit notamment, pour stimuler la croissance :
v' Le gouvernement congolais doit s?assigner les objectifs
globaux de stabilisation du cadre macro-économique et de
libéralisation de l?économie ;
1' de réhabilitation des infrastructures et de relance des
secteurs productifs.
1' effectuer une politique budgétaire prudente en
réduisant les dépenses
gouvernementales ;
1' Il doit privilégier la transparence dans la gestion
de la dette, en consacrant l?indépendance des exercices publics
chargés de superviser cette gestion en l?occurrence de OGEDEP ;
v' renforcer les capacités de mobilisation des recettes
intérieures, de recourir à la dette
extérieure après analyse des modalités de
remboursement et du niveau de solvabilitéde l?économie nationale
et injecter cette emprunt dans les projets productifs ;
v' d?effectuer des paiements anticipatifs et maintenir le taux de
croissance supérieur au taux d?intérêt de la dette ;
v' faciliter le service de la dette, il s?agit ici de
réduire le stock effectif de la dette,
1' En fin, l?Etat congolais doit réformer son
système de gestion de la dette publique.
Cela étant, nous pouvons dire sans peur d?être
contredit que notre objectif fixé au
début du travail a était atteint.
Nous n?avons nullement prétention d?avoir
épuisé la richesse existentiel de la question de l?endettement
sur la croissance économique tant il est vrai que la
fécondité de la recherche sur le sujet est impressionnante et les
avis toujours partagés, ni d?avoir effectué un travail
irréprochable car les erreurs et omissions peuvent être
découvertes. Cela relève de perceptibilité même de
toute oeuvre humaine. Toute fois, nous espérons que ce travail
rencontrera les besoins consultatif et aidera les lecteurs à le
compléter.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. Bernard et COLI, « Dictionnaire économique et
financier », 2ème éd. du Seuil, Paris,
1996.
2. Bernard GUERRIEN, « Analyse économique
», Ladécouverte, Paris, 2006.
3. Boulanger et Guinier, « les sciences sociales et
humaines », Dunod, Paris, 1973.
4. BOURBONNAIS Régis « Économétrie
», 5ième éd., Dunod, Paris, 2003.
5. CHEMERY H. et al., « Foreign assistance and economic
development » American Economic Review, 1966.
6. Daniel V., « Les théories de la croissance
», éd. DeBoeck, Paris, 2002.
7. François L., « Croissance et Fluctuation
», éd.Dalloz, Paris, 1987.
8. Gregory N. MANKIW, «Macroéconomie»,
7e éd., Boeck, Bruxelles, 2010.
9. Gregory N. MANKIW, «Macroéconomie»,
5e éd., Boeck, Bruxelles, 2010.
10. Grwawitz M., « Les sciences sociales »,
Dalloz, Paris, 1986.
11. HAAVELMO, « Infrastructure publique et croissance
économique », Dalloz, Paris, 2001.
12. Jean-Paul PIRIOU, « Lexique de sciences
économique et sociale »,7e éd.,
Ladécouverte, Paris, 2004.
13. KALDOR N., « Incitation économique
», Dalloz, Paris, 2001.
14. KRUGMAN P., «Financing vs Forgiving a Debt
Overhang» ,NBER Working Paper, 1988.
15. Michael PARKIN ROBIN et al., « Introduction
à la Macroéconomie moderne », ERPI, QUEBEC, 2008.
16. Microsoft Encarta, 2009.
17. MUSTAR P., « Encyclopédie de l'Economie
», Collin Maillard, Paris 1990.
18. Robert BARRO, « La croissance économique
», Mc GrawHill, New York, 1996.
19. Sandrine et al., « Econometrie des series
temporelles macroéconomique et financièr » Economica,
Paris, 2002.
20. Simon K., « Croissance et structure
économique », Colman-Leey, Paris, 1972.
21. SEMEDO G., « Economie des finances publiques
», Ellipse, Paris, 2001.
22. VAROUDAKIS « La politique macroéconomique
», Dunod, Paris, 1999.
II. ARTICLES ET REVUES
1. Arnaud Zacharie, « La dette extérieure et
le financement du développement de la RD Congo défis et
perspectives pour le nouveau gouvernement démocratiquement élu
», CNCD/Bruxelles, Février 2007
2. Arnaud Zacharie, « La stratégie DSRP-PPTE
en RD Congo », Bruxelles, 2009
3. Arnaud Zacharie, « Dette et développement :
Les défis du financement du développement en RDC »,
Conférence du CRE-AC, 2008.
4. Banque mondiale, « L'Afrique subsaharienne, de la
crise à une croissance durabl »e, Étude de prospective
à long terme, Washington D.C., 1989.
5. CLEMENTS, Benedict et al., «L'allègement de
la dette peut-il doper la croissance? », Dossier économique
N°34 du FMI, 2005.
6. Damien Millet, « dette odieuse : fiche du
pays», 2000
7. Imed DRINE et al., « Gestion de la dette
extérieure et efficience productive des pays en développement
», 2007
8. MAMIMAMI KABARE : « Dette
extérieure publique de la RDC : Qui doit à qui ? »,
FODEX - RDC, 2000.
9. Michel MUSIMBI MBU MISCH, « la dette des pays
pauvres très endettés; une menace pour la protection des droits
sociaux à l'ère de la mondialisation : cas RDC », Haute
Ecole Galilée (IHECS), Bruxelles, 2006-2007.
10. PATTILLO C. et al., «External Debt and
Growth», IMF Working-Paper n°02/69, 2002.
11. RAFFINOT Marc, « Budget économique et
endettement extérieur », rapport GTZ FED-MEF, Ouagadougou,
juillet 1996.
12. RAFFINOT M., « Dette
extérieure et ajustement structurel » Universités
francophones, EDICEF/AUPELF, Paris, 1991.
13. RAFFINOT Marc, « Soutenabilité de la dette
extérieure. De la théorie aux modèles d'évaluation
pour les pays à faible revenu », Document de travail du DIAL,
n°1, 1998.
14. RDC-principaux indicateurs Macroéconomique,
2010
15. RDC-document intérimaire de stratégies de
réduction de la pauvreté, Kinshasa, 2002.
16. SACHS J., «The debt overhang of developing
countries», in Debt, Stabilization and developement : essays in memory of
Carlos Diaz Alejandro , Oxford, Basil Blackwell, 1988.
17. SALIOU S., « Impact de la libéralisation
financière sur l'épargne domestique : cas du
Sénégal », Institut Africain de Développement et
de Planification (IDEP), 2003.
18. YAPO Léonce « Les
déterminants de la dette extérieure des PPTE : cas de la
Côte
d'Ivoire », World Institute for Development
Economic Research (WIDER), Discussion paper N°2002/14, 2002.
III. MEMOIRES
1. BISHOGO B., « Analyse comparative de la croissance
économique en RDC : période d'avant et d'après les
éléctions de 2006 », mémoire, inédit,
ISP/BKV, 2010.
2. Christian NDO: « Les effets des dettes
extérieurs sur la croissance économique du Gabon »,
mémoire online, université de Yaounde2, 2008.
3. DEDEHOUANOU G. Modeste Arnaud, « effet de la dette
extérieure sur la croissance économique au Benin »,
mémoire online, Université d'Abomey-Calavi,
2009.
4. KONSO BOLA Alain, « les effets de la dette
extérieure sur la croissance et investissement dans les PPTE
africains : analyse par la méthode des moments
généralises », mémoire on line, UNIKIN,
2004-2005.
5. MUSAFIRI ALUTA, « Analyse des déterminants de
la cyclicité budgétaire en RDC : 1980 à 2000 »,
mémoire, inédit, UOB, 2010-2011.
6. NDUGU MUKASA, « Déterminants de l'endettement
extérieur public de la RDC », mémoire, inédit,
UCB, 2008.
IV. NOTES DE COURS
1. Michel BEINE, « Econométrie approfondie
», Université de Lille2, France et ULB, Belgique, 2010
2. SONGA MUSIMBI D., « Cours d'économie
international », Inédit, ISP/BKV, 2011- 2012.
V. DOCUMENT OFFICIELS
1. Banque du Zaïre : Rapports annuels 1990-1997
2. Banque centrale du Congo : Rapports annuels 1998-2010
3. FMI, Rapport n° 11/190, Juillet 2011
VI. WEBOGRAPHIE
1.
http://banquemondiale.org,
le 15/08/2012 à 20h 25min.
2.
http://www.imf.org, le
15/08/2012 à 21h 30min.
3.
http://www.issai.org, le
16/08/2012 à 7h 2min.
4.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dette_publique2011.jpg,
le 20/2/2012 à 23h 45min.
5.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Balance
courante 2011.jpg, le 14/08/2012 à 8h 3min.
6.
http://www.bcc.cd, le 15/07/2012
à 20h 50min.
7.
www.memoireonline.com/.../m_Effets-de-la-dette-exterieure-sur-la-croissanceeconomique-le-cas-du-Gabon0.html,
le 15/03/2012 à 10h 25min.
8.
www.memoireonline.com/.../m
Effet-de-la-dette-exterieure-sur-la-croissanceeconomique-au-Benin15.html,
le 15/03/2012 à 10h 52min.
9.
www.lexpansion.lexpress.fr/economie/une-dette-publique-elevee-a-un-impact-negatifsur-la-croissance
227041.html, le 26/04/2012 à 18h 33min.
10.
www.congoforum.be/.../Les%20Effets%20de%20la%20Dette%20Extérieure%20sur%20
La%20Cro..., le 30/05/2012 à 19h 47min.
11.
www.illusio.over-blog.com/article-la-dette-publique-nuit-elle-a-la-croissanceeconomique-105701277.html
, le 27/06/2012 à 19h 57min.
12.
www.dial.prd.fr/dial_publications/PDF/Doc_travail/1998-01.pdf,
le 30/03/2012 à 20h 31min.
13.
www.memoireonline.com/.../m_Programme-dajustement-structurel-et-gestion-de-la-dettepublique-en-RDC-0.html,
le 25/07/2012 à 17h 50min.
14.
www.unmondelibre.org/kalonji_IPPTE_RDC_300910,
le 25/07/2012 à 17h 59min.
15.
www.cadtm.org/La-dette-exterieure-de-la-RDC-Une,
le 15/07/2012 à 17h 25min.
16.
www.cd.undp.org/.../Note%20Amélioration%20du%20climat%20des%20
affaires.pdf, le 31/08/2012 à 20h 30min.
17.
www.afdb.org/.../République%20démocratique%20du%20Congo%20Note%20de%20pay
s%..., le 31/08/2012 à 20h 35min.
18.
www.amanileo.net/index.php?...dette...rdc...,
le 17/08/2012 à 19h 53min.
19.
www.afdb.org/.../RDC_FEF_%20éligibilité%20à%20l'appui%20supplémentaire.pdf,
le 18/08/2012 à 18h 45 min.
20.
www.dette2000.org/data/File/detteillegitime/.../fiche
do rdc.pdf, le 18/08/2012 à 18h 57min.
21.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique,
le 15/09/2012 a 10h 30min.

Annexe 1 : Série utilisée dans
l'estimation
|
Anné e
|
T C PI B
|
ST DPI B
|
ST DOG)
|
VT E
|
SEDEXP
|
T C DEM
|
BC PI B
|
S OBPPIB
|
EXPPIB
|
|
1991
|
-8,4
|
1,43961
|
3,98603
|
0,5615
|
0,06523
|
3,28
|
-0,0736
|
-0,1358
|
0,2
|
|
1992
|
-10,6
|
1,62823
|
6,9274
|
0,39052
|
0,04886
|
3,36
|
-0,0649
|
-0,0927
|
0,17
|
|
1993
|
-13,5
|
1,93312
|
7,81057
|
0,33121
|
0,01905
|
3,44
|
0,0225
|
-0,1194
|
0,11
|
|
1994
|
-3,9
|
2,19887
|
9,22996
|
0,22635
|
0,01176
|
3,52
|
0,06331
|
-0,1819
|
0,23
|
|
1995
|
0,7
|
2,34598
|
8,23679
|
0,32632
|
0,01555
|
3,601
|
0,04756
|
0,0034
|
0,28
|
|
1996
|
1,1
|
2,29702
|
6,91681
|
0,25425
|
0,02609
|
3,003
|
0,10556
|
0,0048
|
0,3
|
|
1997
|
-5,4
|
2,34019
|
8,53949
|
0,24761
|
0,00865
|
2,402
|
0,08897
|
-0,0031
|
0,19
|
|
1998
|
-1,7
|
2,54579
|
7,36117
|
0,29938
|
0,01076
|
1,804
|
0,03193
|
-0,0276
|
0,3
|
|
1999
|
-4,3
|
2,43001
|
4,49334
|
0,70639
|
0,00765
|
1,202
|
0,01735
|
-0,0394
|
0,24
|
|
2000
|
-6,2
|
2,53568
|
4,52599
|
0,6574
|
0,0096
|
3,19
|
-0,0995
|
-0,0379
|
0,22
|
|
2001
|
-2,1
|
2,54913
|
4,37154
|
0,72403
|
0,00676
|
3,1
|
-0,0301
|
-0,001
|
0,19
|
|
2002
|
3,5
|
1,87491
|
8,1686
|
0,8929
|
0,253
|
2,79
|
-0,0249
|
0,009
|
0,21
|
|
2003
|
5,8
|
1,8909
|
7,0443
|
0,76898
|
0,171
|
2,9
|
0,0036
|
-0,005
|
0,26
|
|
2004 PIB
|
|
6,6 SEXP
V
|
|
4,8231 SDEXP
|
TEM
BC
|
|
2,99 SBPPIB
|
EIB
|
0,3
|
|
84 2005
|
7,8 1
|
8603
|
5615
|
006523
|
28
|
36
|
1358
|
-0,009 02
|
0,34
|
|
106 2006
|
235,6
|
9274
|
9052
|
004886
|
36
|
49
|
00927
|
017
|
0,3
|
|
135 2007
|
6,3 2
|
057
|
121
|
001905
|
44
|
25
|
01194-0,0386
|
011
|
0,27
|
|
39 2008
|
87
|
2996
|
635
|
01176
|
|
52 031
3,24
|
01819
|
023
|
0,23
|
|
07 2009
|
982,8
|
3679
|
632
|
1
|
|
0,123 01 056
|
00034
|
28
|
0,17
|
|
11 2010
|
7,2 2
|
91681
|
425
|
02609
|
|
03 056
|
00048
|
0,012 03
|
0,26
|
, 2,9 ,99 24761 ,0 ,02 0,088 0,31 0,1
Source : Rapports annuels de la BZ, Rapports annuels de
la BCC, Banque Mondiale et FMI
Ce tableau présente la série utilisée dans
l?estimation et la validation du modèle.
3001 449334 070639 000765 1202 001735 -00394 024
Annexe 2 : Régression générale
par MCO
|
Dependent Variable: TCPIB Method: Least Squares
Date: 08/24/12 Time: 03:50
Sample: 1991 2010
Included observations: 20
|
|
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
|
|
STDPIB -1.605191
|
1.516495
|
-1.058488
|
0.3125
|
|
STDEXP -0.198906
|
0.553608
|
-0.359290
|
0.7262
|
|
VTE 6.502108
|
3.147202
|
2.065996
|
0.0632
|
|
SEDEXP 22.98917
|
12.25032
|
1.876618
|
0.0873
|
|
TCDEM 1.716289
|
1.036951
|
1.655130
|
0.1261
|
|
BCPIB 21.77181
|
15.37357
|
1.416184
|
0.1844
|
|
SOBPPIB 27.93033
|
12.11644
|
2.305160
|
0.0417
|
|
EXPPIB 70.47399
|
11.41112
|
6.175905
|
0.0001
|
|
C -22.14222
|
7.024342
|
-3.152212
|
0.0092
|
|
R-squared 0.934149
|
Mean dependent var -0.125000
|
|
Adjusted R-squared 0.886257
|
S.D. dependent var 6.466991
|
|
S.E. of regression 2.181040
|
Akaike info criterion 4.699644
|
|
Sum squared resid 52.32631
|
Schwarz criterion 5.147724
|
|
Log likelihood -37.99644
|
F-statistic 19.50549
|
|
Durbin-Watson stat 1.962157
|
Prob(F-statistic) 0.000018
|
Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views
3.1
Ce tableau présente la régression
générale de la variable taux de croissance du FIB réel par
les moindres carrés ordinaires (MCO).
Annexe 3 : Test de Ramsey
Ramsey RESET Test:
|
F-statistic 0.073191 Probability 0.792248
Log likelihood ratio 0.145848 Probability 0.702535
|
|
Test Equation:
|
|
Dependent Variable: TCPIB
|
|
Method: Least Squares
|
|
Date: 08/24/12 Time: 03:56
|
|
Sample: 1991 2010
|
|
Included observations: 20
|
|
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
|
|
STDPIB -1.807829
|
1.752822
|
-1.031382
|
0.3267
|
|
STDEXP -0.193514
|
0.578859
|
-0.334302
|
0.7451
|
|
VTE 6.365144
|
3.327538
|
1.912869
|
0.0848
|
|
SEDEXP 22.57015
|
12.89484
|
1.750324
|
0.1106
|
|
TCDEM 1.737920
|
1.086551
|
1.599483
|
0.1408
|
|
BCPIB 22.55928
|
16.32682
|
1.381732
|
0.1971
|
|
SOBPPIB 26.99993
|
13.12033
|
2.057870
|
0.0666
|
|
EXPPIB 68.71192
|
13.58736
|
5.057046
|
0.0005
|
|
C -21.15628
|
8.195275
|
-2.581522
|
0.0273
|
|
FITTED^2 -0.005393
|
0.019936
|
-0.270537
|
0.7922
|
|
R-squared 0.934628
|
Mean dependent var -0.125000
|
|
Adjusted R-squared 0.875792
|
S.D. dependent var 6.466991
|
|
S.E. of regression 2.279169
|
Akaike info criterion 4.792352
|
|
Sum squared resid 51.94611
|
Schwarz criterion 5.290218
|
|
Log likelihood -37.92352
|
F-statistic 15.88551
|
|
Durbin-Watson stat 1.832950
|
Prob(F-statistic) 0.000084
|
Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views
3.1
Le tableau ci-dessus présente le test de Ramsey, ceci
nous a permis de vérifier l?absence d?autocorélation des erreurs.
H0 (absence d?autocorélation des résidus) est acceptée si
les probabilités sont supérieures à 0,05.
Annexe 4 : Test de Breusch-Godfrey
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
|
F-statistic 1.555129 Probability 0.262967
Obs*R-squared 5.136568 Probability 0.076667
|
|
Test Equation:
|
|
Dependent Variable: RESID
|
|
Method: Least Squares
|
|
Date: 08/24/12 Time: 03:54
|
|
Presample missing value lagged residuals set to zero.
|
|
Variable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.
|
|
STDPIB 0.194235
|
1.449500
|
0.134001
|
0.8964
|
|
STDEXP -0.258860
|
0.560241
|
-0.462052
|
0.6550
|
|
VTE 0.148563
|
3.030209
|
0.049027
|
0.9620
|
|
SEDEXP 6.692941
|
12.29040
|
0.544567
|
0.5993
|
|
TCDEM 0.514651
|
1.035090
|
0.497204
|
0.6310
|
|
BCPIB 5.801345
|
15.46907
|
0.375029
|
0.7163
|
|
SOBPPIB 0.899961
|
11.58305
|
0.077696
|
0.9398
|
|
EXPPIB 16.72447
|
15.77383
|
1.060267
|
0.3166
|
|
C -4.907776
|
7.761829
|
-0.632296
|
0.5429
|
|
RESID(-1) -0.517360
|
0.458291
|
-1.128890
|
0.2881
|
|
RESID(-2) -0.775700
|
0.443346
|
-1.749650
|
0.1141
|
|
R-squared 0.256828
|
Mean dependent var -1.50E-15
|
|
Adjusted R-squared -0.568918
|
S.D. dependent var 1.659523
|
|
S.E. of regression 2.078659
|
Akaike info criterion 4.602816
|
|
Sum squared resid 38.88743
|
Schwarz criterion 5.150469
|
|
Log likelihood -35.02816
|
F-statistic 0.311026
|
|
Durbin-Watson stat 2.307947
|
Prob(F-statistic) 0.958499
|
Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views
3.1
Ce tableau présente le test Breusch-Godfrey. Il a
permis de confirmer l?absence d?auto-corélation des erreurs ci-haut
vérifier. Si les probabilités sont inférieures à
0,05, on rejette H0 de non auto corrélation des résidus
(erreurs).
Annexe 5: Test d'homoscédasticité des
résidus
White Heteroskedasticity Test:
|
F-statistic 1.041280 Probability 0.564627
Obs*R-squared 16.94819 Probability 0.388957
|
|
Test Equation:
|
|
Dependent Variable: RESID^2
|
|
Method: Least Squares
|
|
Date: 08/24/12 Time: 03:52
|
|
Sample: 1991 2010
|
|
Included observations: 20
|
|
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
|
|
C -66.95781
|
33.38731
|
-2.005487
|
0.1386
|
|
STDPIB 9.994740
|
16.84427
|
0.593361
|
0.5947
|
|
STDPIB^2 -5.629154
|
5.668238
|
-0.993105
|
0.3939
|
|
STDEXP 10.78392
|
7.549572
|
1.428415
|
0.2485
|
|
STDEXP^2 -0.892668
|
0.607893
|
-1.468462
|
0.2383
|
|
VTE -9.784409
|
38.48448
|
-0.254243
|
0.8157
|
|
VTE^2 16.82434
|
28.68102
|
0.586602
|
0.5987
|
|
SEDEXP -198.9039
|
158.8844
|
-1.251878
|
0.2993
|
|
SEDEXP^2 468.3380
|
446.0078
|
1.050067
|
0.3708
|
|
TCDEM 18.61626
|
15.13952
|
1.229647
|
0.3065
|
|
TCDEM^2 -3.504035
|
3.132709
|
-1.118532
|
0.3448
|
|
BCPIB -0.380841
|
30.21753
|
-0.012603
|
0.9907
|
|
BCPIB^2 -88.94709
|
332.5404
|
-0.267478
|
0.8064
|
|
SOBPPIB 104.2977
|
79.23899
|
1.316242
|
0.2796
|
|
SOBPPIB^2 901.5496
|
483.3530
|
1.865199
|
0.1590
|
|
EXPPIB 228.4820
|
135.3351
|
1.688269
|
0.1899
|
|
EXPPIB^2 -416.2977
|
294.0307
|
-1.415831
|
0.2518
|
|
R-squared 0.847410
|
Mean dependent var 2.616316
|
|
Adjusted R-squared 0.033594
|
S.D. dependent var 3.272927
|
|
S.E. of regression 3.217482
|
Akaike info criterion 4.977955
|
|
Sum squared resid 31.05657
|
Schwarz criterion 5.824328
|
|
Log likelihood -32.77955
|
F-statistic 1.041280
|
|
Durbin-Watson stat 2.952847
|
Prob(F-statistic) 0.564627
|
Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views
3.1
Ce tableau présente le test White, il a permis de savoir
si les résidus (termes
d?erreur) du modèle ont la même variance.
L?hypothèse nulle est celle d'homoscédasticité contre
l?hypothèse alternative
d?hétéroscédasticité. On accepte H0 si la
probabilité du test est supérieure à 0,05.
Annexe 6 : Test d'ARCH
ARCH Test:
|
F-statistic 1.030197 Probability
|
0.324341
|
|
Obs*R-squared 1.085609 Probability
|
0.297446
|
|
Test Equation:
|
|
|
Dependent Variable: RESID^2
|
|
|
Method: Least Squares
|
|
|
Date: 08/24/12 Time: 03:53
|
|
|
Sample(adjusted): 1992 2010
|
|
|
Included observations: 19 after adjusting endpoints
|
|
|
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
|
Prob.
|
|
C 3.026299 0.964850 3.136550
|
0.0060
|
|
RESID^2(-1) -0.231357 0.227941 -1.014986
|
0.3243
|
|
R-squared 0.057137
|
Mean dependent var
|
2.389149
|
|
Adjusted R-squared 0.001675
|
S.D. dependent var
|
3.196520
|
|
S.E. of regression 3.193842
|
Akaike info criterion
|
5.259627
|
|
Sum squared resid 173.4107
|
Schwarz criterion
|
5.359042
|
|
Log likelihood -47.96646
|
F-statistic
|
1.030197
|
|
Durbin-Watson stat 2.030595
|
Prob(F-statistic)
|
0.324341
|
Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views
3.1
Nous avons utilisé ce test vient corroborer
l?homoscédasticité de White des érreurs, car selon ce test
les erreurs du modèle sont homoscédastiques (H0) si la
probabilité de Obs* R-squared est supérieure à 0,05.
Annexe 7: Test de normalité de Jarque et
Bera
|
|
|
Std. R eidua
1991Skewne
20
ations 2
5.51E16 0.
0.060 0.
|
|
Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views
3.1
Ce test présente la normalité des erreurs, il y a
normalité si la probabilité de
Probabity 0.8094
Jarque-Bera est supérieure au seuil de 0,05.
-2 -1 0 1 2 3
Annexe no 8: Test de multicolinéariti
|
TCPIB
|
STDPIB
|
STDEXP
|
VTE
|
SEDEXP
|
TCDEM
|
BCPIB
|
SOBPPIB
|
EXPPIB
|
|
TCPIB
|
1.000000
|
-0.495867
|
-0.490229
|
0.458601
|
0.485308
|
0.032658
|
-0.253572
|
0.682207
|
0.703685
|
|
STDPIB
|
-0.495867
|
1.000000
|
0.736422
|
-0.613269
|
-0.357876
|
-0.371440
|
0.677352
|
-0.196084
|
-0.069008
|
|
STDEXP
|
-0.490229
|
0.736422
|
1.000000
|
-0.723096
|
-0.071932
|
-0.093765
|
0.778054
|
-0.392496
|
-0.166660
|
|
VTE
|
0.458601
|
-0.613269
|
-0.723096
|
1.000000
|
0.415314
|
0.060149
|
-0.693500
|
0.440707
|
-0.123002
|
|
SEDEXP
|
0.485308
|
-0.357876
|
-0.071932
|
0.415314
|
1.000000
|
0.094861
|
-0.283009
|
0.332330
|
0.045721
|
|
TCDEM
|
0.032658
|
-0.371440
|
-0.093765
|
0.060149
|
0.094861
|
1.000000
|
-0.274700
|
-0.190431
|
-0.193468
|
|
BCPIB
|
-0.253572
|
0.677352
|
0.778054
|
-0.693500
|
-0.283009
|
-0.274700
|
1.000000
|
-0.176974
|
0.108833
|
|
SOBPPIB
|
0.682207
|
-0.196084
|
-0.392496
|
0.440707
|
0.332330
|
-0.190431
|
-0.176974
|
1.000000
|
0.355905
|
|
EXPPIB
|
0.703685
|
-0.069008
|
-0.166660
|
-0.123002
|
0.045721
|
-0.193468
|
0.108833
|
0.355905
|
1.000000
|
Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views
3.1
Ce le tableau de la matrice de corrélation simple des
variables explicatives. Il nous montre que tous les coefficients entre les
variables réellement explicatives sont inférieures à
R2. Donc les variables ne sont pas colinéaires.
Annexe 9: Test CUSUM
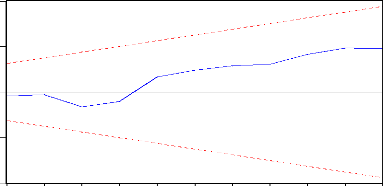
Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views
3.1
La figure ci-haut représente le test de CUSUM qui nous a
permis d?étudier la stabilité structurelle du modèle. Il y
a stabilité si la courbe ne sort pas du corridor.
Annexe 10: Test CUSUM au carré
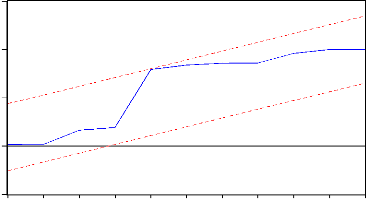

Source : Nos calculs à l?aide du logiciel E-views
3.1
Ce lui-ci test la stabilité ponctuelle du modèle,
il a stabilité ponctuelle si la courbe
ne sort pas du corridor.
|
|