|
UNIVERSITE PARIS1-PAnTHEON-SORBONNE
DEPARTEMENT SCIENCE POLITIQUE
DEA Sociologie Politique
Septembre 2001
Première alternance politique au
Sénégal en 2000:
regard sur la démocratie
sénégalaise.
Sous la direction de Monsieur Denis-Constant Martin
LÔ Abdou
UNIVERSITE PARIS1-PATHEON-SORBONNE
DEPARTEMENT SCIENCE POLITIQUE
DEA Sociologie Politique
Septembre 2001
Première alternance politique au
Sénégal en 2000 :
regard sur la démocratie
sénégalaise.
Sous la direction de Monsieur Denis-Constant Martin
LÔ Abdou
REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer tous mes remerciements à
Monsieur Denis-Contant MARTIN, du CERI - Sciences Po pour avoir accepté
d'encadrer mon mémoire de DEA et pour le précieux soutien
apporté à son élaboration.
Je remercie également Monsieur le professeur Pierre
BIRNBAUM, directeur du DEA de Sociologie Politique de Paris
1-Panthéon-Sorbonne, d'avoir accepté de lire le projet de
mémoire. Son commentaire m'a permis de réorienter ce
mémoire et de lui apporter plus de rigueur.
Enfin, je suis reconnaissant aux journalistes de la Radio
télévision sénégalaise, du Soleil, de Sud
Quotidien, de Wal Fadjri, du Matin, du Témoin, du Cafard
libéré, du Populaire pour le temps qu'ils ont accepté de
m'accorder et pour leurs témoignages.
SOMMAIRE
Introduction...........................................................................9
PREMIERE PARTIE :
LES CADRES POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DE
L'ALTERNANCE
Introduction..............................................................................................18
I / L'évolution institutionnelle et
politique..................................20
A / Le processus
démocratique................................................20
1. Senghor et la peur du
multipartisme..........................................................20
2. Le multipartisme des « trois
courants ».......................................................22
3. Le « multipartisme intégral » de
Diouf........................................................24
4. 1990-2000 : une décennie
déterminante.....................................................27
B / Le rôle de l'ONEL et du
général ministre de
l'Intérieur.............................32
1. La présence d'autres instances
d'arbitrage.................................................32
- Le Conseil constitutionnel
- Le haut conseil de l'audiovisuel
-Quelques observateurs internationaux
2. L'Observatoire national des élections
(ONEL).............................................33
3. L'armée et général ministre de
l'Intérieur....................................................35
C/ Les
candidats......................................................................................41
1. Les principaux
candidats.........................................................................41
- Abdou Diouf, Président sortant et candidat du Parti
socialiste
- Abdoulaye Wade, leader de l'opposition
- Moustapha Niasse et Djibo Leyti KA, les dissidents
socialistes
2. Les autres
candidats..............................................................................43
II / L'implosion du Parti
socialiste...........................................45
1. Le PS de Diouf : une nouvelle
politique.......................................................45
2. La guerre des
chefs................................................................................47
3. L'épreuve du deuxième tour : un
tournant.....................................................49
4. l'équation : crise + départ de cadres =
défaite.................................................52
Conclusion..............................................................................................54
DEUXIEME PARTIE :
LES CONDITIONS SOCIALES DE L'ALTERNANCE
Introduction.............................................................................................58
I / Une forte demande
sociale..................................................59
1. Une population excédée par la corruption...
.............................................60
2. ...Et la
pauvreté...................................................................................64
3. Un vote pour Wade ou contre
Diouf ?......................................................67
II / Une société civile
active....................................................70
- « Ma carte d'électeur, ma
force »...... ........................................................72
III / Le vote massif des
jeune..................................................74
- « L'alternance ou la
mort ».......................................................................76
- « Peu importe les
programmes »...............................................................77
IV / Le rôle des médias
privés................................................79
1. La presse
écrite...................................................................................80
2. Les radios et les langues
nationales.........................................................83
V / Les confréries
religieuses.................................................86
1. Importance de l'Islam dans la vie politique
sénégalaise..................................86
2. La crise du « Ndiguël » (consigne de
vote)................................................89
3. Le « Ndiguël »
timoré et inefficace en
2000................................................90
CONCLUSION..........................................................................................93
Annexes................................................................................................109
Bibliographie.........................................................................................117
INTRODUCTION
« On devrait, par exemple, pouvoir comprendre que les
choses sont sans espoir et cependant être décidé à
les changer."
Francis Scott Fitgerald.
La démocratisation en Afrique noire. Voici un
thème qui dans le cadre d'un mémoire de DEA peut relever d'un
manque d'originalité certain. Un étudiant africain de plus qui
travaille sur le thème de la démocratie en Afrique.
Nous avions le sentiment et la conviction, au moment où
nous arrêtions ce thème de ne pas sortir des sentiers battus.
Comment éviter les risques de répétitions, de redondances
et de reformulations des pensées de beaucoup d'africanistes ?
En vérité cette question importe très peu
dans la mesure où (avouons le d'entrée) cette étude toute
objective et rigoureuse qu'elle se voudra, peut être en définitive
(tout du moins pour nous) une thérapie.
Pourquoi cette propension des étudiants africains
à travailler sur l'Afrique ? Sans essayer d'avancer une quelconque
explication de type analytique, relevons tout simplement que une grande partie
de nos amis étudiants, en sciences sociales, oriente son champs de
recherche vers l'articulation Afrique-Démocratie et
Développement. Cela peut donc effectivement ressembler à de
l'obsession. Mais pour nous, il s'agit aussi et surtout de bon sens.
Comme le dit un proverbe africain : « lorsque
tu vas au marigot et que quelqu'un te laves le dos, tu peux au moins te frotter
le ventre. » En fait, c'est de cela qu'il s'agit ; un
intéressement et une prise en charge de l'Afrique par les africains. Si
ce sont les hommes qui font leur histoire (ce dont nous sommes convaincus)
alors les africains doivent prendre en charge, de façon responsable, la
leur.
Ici, il faut préciser, dès à
présent, qu'il n'est nullement question d'une prise de position
néo-panafricaniste, si ce terme signifie : repli sur soi, appel
à une gestion des affaires africaines exclusivement par les africains,
rejet de toute tentative étrangère de compréhension de
certains problèmes spécifiques à l'Afrique, ou encore
l'assimilation de toute production théorique occidentale sur l'Afrique
à du néo-impérialisme.
Il s'agit ici de nous frotter le ventre nous-mêmes,
c'est-à-dire en tant qu'étudiant d'essayer de mener une
réflexion sur l'Afrique. Même si, comme nous le soulignions plus
haut, cela peut relever du « déjà vu », nous
pensons qu'une multitude d'études et de réflexions sur l'Afrique
peut être tout sauf nuisible à ce continent.
Tenter de comprendre les maux de l'Afrique, c'est
déjà essayer de les résoudre en partie. Aussi, nous
essayons à travers ce mémoire de contribuer très
modestement à la compréhension de ce continent incontestablement
souffrant, pour ne pas dire malade.
C'est parce que nous ne croyons pas que le sort de l'Afrique
soit définitivement scellé que nous nous y intéressons
encore. Ce n'est pas prendre l'afro-pessimisme à contre-pied, par pur
formalisme, ni faire de l'optimisme une sorte de devoir qui s'impose à
nous que de croire que le sort n'en est pas jeté. Nous pensons que si
l'Afrique était mal partie1(*), elle peut toujours se ressaisir.
En effet, si nous vivons à une époque où
la situation politique du continent noir semble caractérisée par
les guerres, les coups d'Etat, les révoltes, les emprisonnements plus
que par la volonté et le désir de garantir aux peuples la
démocratie et la liberté politique, des pays donnent de plus en
plus des signes de volonté de sortie de ces impasses pour s'inscrire
dans le giron de la démocratie. Cette démocratie produite par
l'Occident mais à vocation universaliste. Des volontés mais aussi
et surtout des passages effectifs à la démocratie (au moins
à la démocratie formelle, institutionnelle) ont été
noté dans un cercle croissant de pays africains (Bénin, Cap-Vert,
Ghana, Afrique du Sud, Sénégal...) Chacune de ses nations ayant
eu son processus qui lui est propre car il y a autant de moyens et de
manière de passer à la démocratie qu'il y a de pays.
Comme l'écrit Sémou Pathé Guèye,
« (...) Si la démocratie peut et doit être
considérée comme une exigence universelle tant par ses principes
et les valeurs qui l'inspirent que par sa finalité qui est l'affirmation
pleine et entière de la liberté et de la dignité de
l'homme en tant qu'homme, elle ne se « vit » cependant, et
ne se pratique que dans le contexte de sociétés concrètes
culturellement et historiquement spécifiées, par des hommes
concrets se ressentant, dans leurs comportements comme dans leurs
mentalités, de ces déterminations culturelles et
historiques. »2(*)
Une fois cette précision apportée, il nous faut
aussi souligner que l'homme est certainement un « animal
politique » mais pas forcément « un animal
démocratique ». En effet, nous croyons que chaque
société produit des valeurs en fonction de son histoire
spécifique dont découle une socialisation formant des
régimes politiques différents. Ces valeurs s'incarnent dans les
règles devenant des formes de régulation des systèmes
normatifs et influent sur les aspirations et les désirs des individus
conformément au régime dans lequel ils évoluent.
Nous nous attacherons donc dans ce travail, à chercher
la particularité du Sénégal et surtout les
mécanismes qui lui ont permis de réaliser une alternance
politique démocratique.
Qu'est-ce qui a fait que le Sénégal qui a
été longtemps cité en modèle de démocratie,
dans le continent noir, n'ait réussi une alternance politique que lors
des élections présidentielles de février et mars 2000,
c'est-à-dire quarante ans après son accession à
l'indépendance ?
Pourquoi les élections présidentielles de 1974,
de 1978, de 1983 et de 1988 ou encore celles de 1993 n'ont jamais abouti
à une alternance malgré que les observateurs internationaux
et les partenaires économiques et politiques du pays aient toujours
vanté « le modèle sénégalais »
de démocratie?
Qu'est-ce qui en 2000, a été déterminant
à l'heure où les sénégalais devaient confier les
rênes du pays à l'homme qui doit les amener vers le
troisième millénaire ?
Au seuil du troisième millénaire où l'on
s'accorde à admettre que les Etats africains sont, dans leur grande
majorité, confrontés à des situations de blocage politique
nées d'une lente mais inexorable perversion du pluralisme, l'alternance
politique survenue au Sénégal, après quarante
années de règne socialiste de facto monopartite, est
assurément un événement qui mérite
réflexion.
La victoire de Abdoulaye Wade au second tour du scrutin
présidentiel du 19 mars 2000, est souvent comparée par certains
observateurs, à ce qui s'est passé en France il y a vingt ans,
lors de la présidentielle qui a conduit François Mitterrand au
pouvoir après qu'il eut battu Valéry Giscard d'Estaing.
Que cette comparaison soit naïve ou non, une analyse des
vicissitudes électorales qui ont marqué l'histoire post-coloniale
du Sénégal nous permettra, d'une part, de mesurer l'état
de la démocratie dans ce pays dont l'expérience pluraliste a
longtemps été considérée comme une exception, et
d'autre part, d'évaluer tout justement la portée de la victoire
de Wade.
Certes, l'histoire politique du Sénégal,
même si elle se confond étroitement avec de nombreux
bouleversements sociaux, s'inscrit dans une tradition de pluralisme fortement
enracinée dans le pays. Autrement dit, avec la récente alternance
réussie dans des conditions apparemment normales et
démocratiques, le Sénégal remet à l'honneur son
modèle politique. Mais cela suffit-il à ériger cette
« démocratie sénégalaise » en
modèle à suivre pour tous les autres Etats africains,
malgré toutes les controverses électorales qui ont
empoisonné la vie publique et terni l'image du pays pendant
quarante ans ?
Nous pensons que l'alternance politique au sommet de l'Etat
sénégalais a été possible grâce d'une part
à un jeu politique ouvert assez tôt et d'autre part à la
volonté de la population sénégalaise de participer
activement à ce jeu, pour améliorer son quotidien.
Nous soutenons comme hypothèse de départ que les
mécanismes de la première alternance politique au
Sénégal sont d'une part d'ordre politique et institutionnel,
d'autre part d'ordre social.
L'évolution politico-institutionnelle du pays et la
volonté des populations sénégalaises de peser sur le cours
de la vie politique et par voie de conséquence sur la leur sont,
à notre avis, les soubassements de ce qui a été
salué comme un véritable acte démocratique dans le
continent africain.
Cependant, nous nous garderons bien de préjuger de
l'avenir de ce pays. L'alternance réalisée en mars 2000
l'a-t-elle placé à jamais dans le wagon des pays dits de
véritable démocratie ? L'histoire récente du
Sénégal (les législatives d'avril 2001) plaide pour une
réponse affirmative mais la prudence serait ici la vertu
conseillée. En effet, l'Afrique après avoir donné des
signes de progression vers la démocratie et la stabilité,
déçoit les espoirs qui ont été placés dans
les mouvements du début des années 1990. Mais là ne somme
nous pas déjà entrés dans le vif du sujet ?
Précisons d'abord que dans notre étude, nous
avons préféré recourir à l'entretien qui est de
plus en plus utilisé dans les sciences sociales. En effet, depuis une
cinquantaine d'années, différentes disciplines des sciences ont
constamment recouru à l'entretien pour étudier des faits dont la
parole est le vecteur principal. Ainsi pour avoir le point de vue des
témoins privilégiés de l'alternance démocratique au
Sénégal que sont les journalistes, nous avons voulu utiliser
l'outil que Alain Blanchet3(*) considérait comme étant « le
plus évident ». Nous avons préféré le
qualitatif au quantitatif dans une étude où la
subjectivité des interviewés est inévitablement mise
à contribution. L'emploi de l'entretien (semi-directif) nous
paraît plus judicieux dans le cas présent que toute méthode
quantitative. En effet, utiliser les méthodes quantitatives reviendrait,
pour nous, à faire le choix du « eklaren »
(expliquer) au détriment du « verstehen »
(comprendre) ; or nous ne pouvons pas traiter l'objet de notre
étude comme une chose. Ce serait, mettre la sociologie politique dans
les « naturwissenschaften », c'est-à-dire les
sciences de la nature ou sciences nomothétiques et écarter les
« geisteswissenschaften » ou sciences de l'esprit, sciences
de l'esprit, sciences idiographiques. Aussi préférons-nous ne pas
céder à « l'inhibition
méthodologique » dont parle C. Wright-Mills.
Nous avons donc interviewé des journalistes au
Sénégal car la presse du pays a non seulement assisté
à l'alternance mais aussi et surtout y a joué un rôle non
négligeable.
Nous nous intéresserons dans un premier temps, au
cadre politique et institutionnel et à son évolution continuelle
qui a conduit au changement opéré au Sénégal en
mars 2000. Si beaucoup d'observateurs ont souligné la forte demande
sociale qui a amené le changement à la tête de l'Etat
sénégalais, il faut souligner les modifications intervenus dans
le paysage politique et institutionnel du Sénégal jusqu'à
la veille du second tour.
Ensuite nous analyserons la très forte demande sociale
qui s'est exprimée par la défaite du président Abdou Diouf
au soir du 19 mars 2000 au bénéfice de son opposant historique
maître Abdoulaye Wade. Pourquoi les sénégalais ont-ils
choisi de confier à ce dernier, à sa cinquième tentative
et à 74 ans les reines du pays ? Pourquoi celui qui est
surnommé « le pape du Sopi »
(changement dans la langue Wolof) est-il venu à bout de son adversaire
qui était au pouvoir depuis 19 ans et à la tête d'un parti
qui a dirigé le Sénégal depuis son indépendance en
1960 ? Quelles sont les significations sociales du
« Sopi » ?
Enfin, dans la conclusion, nous aurons une réflexion
sur la « démocratie sénégalaise ». Une
réflexion articulée autour d'axes tels que la personnalisation
des campagnes électorales ; la prolifération des partis
politiques à la veille des élections au
Sénégal et les défections ou phénomènes
de « transhumance » en faveur du parti au pouvoir. Ces
considérations sur le Sénégal nous amènerons
inévitablement à nous interroger sur la nature de la
démocratie en général.
PREMIERE PARTIE
LES CADRES POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DE
L'ALTERNANCE
PLAN
Introduction..............................................................................................18
I / L'évolution institutionnelle et
politique..................................20
A / Le processus
démocratique................................................20
5. Senghor et la peur du
multipartisme...........................................................20
6. Le multipartisme des « trois
courants ».......................................................22
7. Le « multipartisme intégral » de
Diouf........................................................24
8. 1990-2000 : une décennie
déterminante.....................................................27
B / Le rôle de l'ONEL et du
général ministre de
l'Intérieur.............................32
4. La présence d'autres instances
d'arbitrage.................................................32
- Le Conseil constitutionnel
- Le haut conseil de l'audiovisuel
-Quelques observateurs internationaux
5. L'Observatoire national des élections
(ONEL)..............................................33
6. L'armée et général ministre de
l'Intérieur.....................................................35
C/ Les
candidats......................................................................................41
2. Les principaux
candidats.........................................................................41
- Abdou Diouf, Président sortant et candidat du Parti
socialiste
- Abdoulaye Wade, leader de l'opposition
- Moustapha Niasse et Djibo Leyti KA, les dissidents
socialistes
2. Les autres
candidats..............................................................................43
II / L'implosion du Parti
socialiste.............................................45
5. Le PS de Diouf : une nouvelle
politique......................................................45
6. La guerre des
chefs................................................................................47
7. L'épreuve du deuxième tour :
tournant.......................................................49
8. l'équation : crise + départ de cadres =
défaite..............................................52
Conclusion...............................................................................................54
.
Introduction
Pour comprendre le changement intervenu au
Sénégal, le 19 mars 2000, il est nécessaire de prendre en
considération les mutations politiques et institutionnelles survenues
dans le pays, depuis son indépendance. En effet, si le pouvoir politique
a changé de mains à cette date, le lit de l'alternance s'est fait
à travers le temps, depuis son indépendance.
L'indépendance de la République
sénégalaise est acquise en septembre 1960, après trois
siècles de domination française. L'écrivain et
poète Léopold Sédar Senghor devient Président de la
République. Le système politique évolue alors vers un
monopartisme de fait, parachevé en 1966 sous l'égide de l'Union
Progressiste Sénégalaise (UPS), qui donnera naissance plus tard
au Parti Socialiste. En 1976, Senghor installe un système tripartite,
puis quadripartite qui permet à une opposition légale de se
constituer, illustrée par Abdoulaye Wade, candidat aux élections
de 1978 et leader du Parti Démocratique Sénégalais
(PDS).
Le départ volontaire du pouvoir de Senghor, voit
l'avènement de son Premier Ministre, son « dauphin
constitutionnel » Abdou Diouf, qui autorise le multipartisme. Il
sera, avec des scores très larges, régulièrement
réélu (1983, 1988, 1993), tandis que monte la contestation
étudiante, relayée par les manifestations de l'opposition, dont
les leaders sont arrêtés à plusieurs reprises, pour de plus
ou moins courtes périodes ( en 1988 et 1993).
Cependant, l'opposition sénégalaise la plus
visible se manifestera par des entrées et des sorties à ce qu'au
Sénégal, on nomme des « gouvernements de
majorité élargie », sur invitation du Président
de la République.
Malgré ces entrées, l'opposition ne perdit
jamais de sa crédibilité car elle continuait à se battre
pour obtenir des avancées non négligeable. Aussi, pour les
élections présidentielles de février et mars 2000 elle
obtint la création d'un Observatoire indépendant des
élections et la révision du code électoral.
Quant au parti socialiste, ces scores ne cessaient de
s'effriter au fil des différentes élections en même temps
qu'il enregistrait des défections, au conséquences lourdes, de
certains de ces cadres. Le départ le plus significatif étant
sans doute celui de Moustapha Niasse. En effet, en juin 1999, l'ancien ministre
des affaires étrangères, « baron » du PS,
annonce sa candidature aux élections présidentielles de 2000.
Exclu du parti, il forme l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) qui
apportera son soutien à Abdoulaye Wade au second tour de
l'élection présidentielle.
Voilà les quelques repères qui nous permettent
de jeter les bases d'une observation des faits.
I / L'EVOLUTION INSTITUTIONNELLE ET POLITIQUE
A / LE PROCESSUS DEMOCRATIQUE
L'expérience du pluralisme politique
ébauchée par le Président Léopold Sédar
Senghor s'est poursuivie avec son ancien premier ministre, Abdou Diouf, dont la
tâche sera de gérer au mieux l'héritage de son
prédécesseur voire le consolider. Cet héritage se trouve
dans la position hégémonique que le Parti Socialiste a toujours
eue depuis l'accession du pays à l'indépendance et qui s'est
construite soit par interdiction des partis ou leur absorption, soit par
révision de la Constitution pour instaurer par la loi 76-26 du 16 avril
1976, un multipartisme contrôle et limité à trois partis.
Ceci nous amène à faire un détour par l'histoire politique
du Sénégal.
1. Senghor et la peur du multipartisme.
Comme l'a noté le sociologue sénégalais
Mar Fall4(*), le
multipartisme n'est pas une donnée nouvelle au Sénégal.
Déjà, dans la période coloniale, il existait plusieurs
partis politiques affiliés aux partis de la métropole qui
allaient peu à peu devenir des institutions proprement
sénégalaises.
C'est le processus de consolidation de l'Etat post-colonial
sous la présidence de Senghor qui a mis fin à ce pluralisme
existant, soutenu par la thèse de certains politologues de la
modernisation politique, selon laquelle le système du parti unique
aurait été l'élément central de la construction
nationale.
En accédant à l'indépendance, le
Sénégal s'était doté d'un Président de la
République (Léopold. S. Senghor) et d'un Président du
Conseil, Chef du Gouvernement (Mamadou DIA), les deux leaders de l'Union
Progressiste Sénégalaise (UPS) qui deviendra plus tard le Parti
Socialiste.
Senghor se heurta à des oppositions de tous ordres,
parmi lesquelles celle du scientifique Cheikh Anta DIOP 5(*). La concurrence entre ce dernier
dont la réputation égalait celle de Senghor au début des
années 19606(*) et le
Président de la République est bien connue dans l'histoire
politique du Sénégal.
En 1961, quelques mois après l'échec de la
fédération du Mali (qui devait regrouper le Mali et le
Sénégal), Ch. A. DIOP créait le Bloc des Masses
Sénégalaises (BMS), en déplorant à la fois
l'orientation anti-fédéraliste de Senghor et sa soumission aux
influences étrangères dites néocolonialistes. Ce parti
était illégal au regard de la constitution en vigueur, à
l'époque, et n'échappa pas à la dissolution.
En 1963, il crée encore le Front National
Sénégalais (FNS) qui sera à son tour interdit. Cependant,
à chaque fois qu'il dissolvait un parti d'opposition crée par Ch.
A. DIOP, Senghor lui proposait aussitôt, mais en vain, une entrée
au gouvernement. Ce qui signifie qu'il voulait un Etat-parti pluraliste
plutôt qu'un multipartisme en tant que tel.
En interdisant, entre 1960 et 1964, les différents
partis de Cheikh Anta DIOP et le Parti Africain pour l'Indépendance de
Majhemout DIOP (fondé en 1957), l'Union Progressiste
Sénégalais du Président de la République
s'érigea en parti unique de facto, contre la Constitution.
Par ailleurs, Senghor pu aussi gouverner sans concurrence ni
contrôle grâce à l'éviction du Président du
Conseil et Chef du Gouvernement (Mamadou DIA), accusé d'avoir
fomenté un coup d'Etat. Par une révision constitutionnelle
établissant les fondements du présidentialisme au
Sénégal, il mit fin au bicéphalisme de l'exécutif
et remporta les présidentielles de 1963 avec 99% des voix.
La politique de Senghor, dans un contexte certes
différent, rappelle les propos de son homologue tanzanien, J. K.
Nyerere, lorsque ce dernier écrivait : « lorsqu'il existe
un parti, et que ce parti s'identifie à la nation dans son ensemble,
les fondations de la démocratie sont plus solides qu'elles ne le seront
jamais si vous avez deux partis ou plus, chacun représentant seulement
une fraction, de la communauté. »7(*)
De 1963 à 1974, la vie politique
sénégalaise fut marquée par la confiscation du pouvoir au
profit d'un présidentialisme autoritaire.
Le multipartisme des « trois courants de
pensée »
En 1976, lorsque Cheikh Anta DIOP crée le Rassemblement
National Démocratique (RND), en s'appuyant sur l'enthousiasme
grandissant des ouvriers et de la jeunesse, Senghor proclame une loi sur
mesure, dite des « trois courants de
pensée »8(*).
Ce qu'on a appelé le multipartisme limité venait
donc de prendre forme et il faut attendre 1976-1977 pour voir les choses se
préciser, Senghor choisissant trois courants de pensée,
censés incarner la vie politique du pays. Il fallu pour cela la loi
numéro 76-01 du 19 mars 1976 portant révision constitutionnelle
qui modifie en conséquence l'article 3 de la constitution. Ces trois
courants sont :
1°) Le courant social-démocrate que s'attribue
l'Union Progressiste Sénégalaise en se rebaptisant Parti
Socialiste (PS).
2°) Le courant libéral-démocrate sous la
rubrique duquel le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de
maître Abdoulaye Wade, crée en 1974, consent tant bien que mal
à se ranger. En effet, à l'article 1 de ses statuts, le PDS
annonce qu'il représente l'idéologie du libéralisme
démocratique tandis que l'article 2 considère que l'objectif du
parti est la mise en place d'une société socialiste. Wade
considérait que le découpage de Senghor était purement
théorique, ne correspondant aucunement à la réalité
politique du Sénégal.
3°) Enfin, le courant marxiste-léniniste
était censé être attribué au RND. Mais Cheikh Anta
DIOP ne voulait pas accepter cette dernière étiquette dans un
pays musulman à plus de 90%. Aussi, ce courant sera finalement
incarné par le Parti Africain de l'Indépendance (PAI) de Majhmout
Diop.
Face à cette mesure d'ingéniosité, de
nombreuses formations restaient interdites pour n'avoir pas voulu de
l'étiquette imposée par le pouvoir. En tête de ces
formations, le RND ; Senghor allégua comme raison que ce parti qui
refusait aussi bien le marxisme-léninisme que le libéralisme ne
pouvait entrer dans aucune catégorie prévue par la nouvelle
législation d'autant plus que l'adversité de son leader
était vue comme une « opposition
crypto-personnelle ».
En 1978, une révision constitutionnelle permit au
Sénégal de se doter d'un quatrième courant de
pensée. Le courant conservateur représenté par le
Mouvement Républicain Sénégalais (MRS) de Boubacar
Guèye complétait ainsi le paysage politique dessiné par
Senghor.
Officiellement, le législateur voulait par ce
découpage stricte, éviter une anarchie qui découlerait
d'un trop plein de partis ne poursuivant qu'un but électoraliste ou pire
d'intérêts particularistes. Mais il n'échappera pas aux
personnes avisées que le président-poète, grand admirateur
de la France et de la langue française, voulait un paysage politique qui
ressemblait le plus possible au modèle français.
C'était donc là, la vraie image de ce qu'on a
appelé « l'ouverture démocratique »,
orchestrée par Senghor. Malgré cela le
régime de Senghor proclamait surtout à l'étranger, qu'il
adhérait aux principes de la démocratie, mais
« à l'africaine ». Il faudrait peut être plus
parler d'une démocratie tournée vers l'extérieur ou de
propagande. Néanmoins, Senghor apparaissait aux yeux de l'opinion
internationale comme un démocrate et un chef d'Etat
modéré, qui n'avait rien à voir avec la réputation
dictatoriale de la plupart de ses pairs africains.
3. Le « multipartisme intégral »
de Diouf
Sous la présidence de Senghor, le PS a plutôt
fonctionné comme un parti unique de fait, et il faut attendre
l'arrivée de Abdou Diouf au pouvoir, en 1981, pour que le
Sénégal adopte le « multipartisme
intégral ». En effet, le 31 décembre 1980, Senghor
démissionna et en vertu de l'article 35 de la constitution, son Premier
ministre, Abdou Diouf, lui succéda.
Dès son arrivée au pouvoir, Diouf décide,
pour assainir, la vie politique du pays (à commencer par la
transformation du PS plus en parti politique qu'en arène de
rivalités entre barons et distribution des dépouilles) d'adopter
et promulguer la loi numéro 81-16 du 6 mai 1981 relative aux partis
politiques. L'innovation de cette réforme est que désormais le
nombre de partis (dont la plupart existait déjà dans la
clandestinité) n'est plus limité et qu'ils ne sont plus tenus de
se référer à un courant de pensée
déterminé. Mais pour éviter encore une fois l'anarchie,
cette réforme met des garde-fous. Elle réitère le principe
de la souveraineté nationale et de la démocratie et interdit de
facto les partis monarchistes.
Par ailleurs, il est interdit aux partis de se réclamer
de la défense d'une langue, d'une race, d'une ethnie, d'un sexe, d'une
religion, d'une secte, d'une région etc. Depuis cette date, soixante
cinq partis politiques ( nombre recensé aux législatives
anticipées d'avril 2001) se sont crées et tout l'enjeu politique
est d'arriver à faire fonctionner les institutions et à jouer la
règle de l'alternance démocratique dans la transparence.
Ce qui a caractérisé le pouvoir de Diouf, c'est
sa capacité à rebondir pour consolider l'héritage
senghorien lorsqu'il y a péril en la demeure. Il aborde son pouvoir
dans une position de faiblesse : une faiblesse politique car l'opposition
dans son ensemble et son principal rival, maître Abdoulaye Wade en
particulier, contestent sa légitimité ; une faiblesse
économique car, la crise sans précédent renforcée
par les effets pervers des plans d'ajustement structurel (chômage des
diplômés, paupérisation croissante des populations urbaines
et rurales avec la montée de mécontentements sociaux et du
séparatisme casamançais au Sud du Sénégal...)
accroît les attentes des sénégalais.
Abdou Diouf se révèle plutôt un habile
politicien dans le contrôle de l'appareil d'Etat et le renouvellement de
la classe politique. Malgré un contexte défavorable, il remporte
les élections présidentielles de février 1983 avec 83,45%
des voix. Le PS remporte les législatives avec 79,94% et 111 des 120
sièges que compte l'assemblée nationale.
Tableau des résultats des élections
présidentielles et législatives de 1983 :
|
PRESIDENTIELLES
|
|
LEGISLATIVES
|
|
|
Abdou Diouf (PS)
|
83,45%
|
PS
|
79,94% : 111 sièges
|
|
Abdoulaye Wade (PDS)
|
14,79%
|
PDS
|
13,97% : 8 sièges
|
|
Mamadou Dia (MDP)
|
1,39%
|
MDP
|
1,21%
|
|
Oumar Wone (PPS)
|
0,20%
|
PPS
|
0,20%
|
|
Majhemout Diop (PAI)
|
0,17%
|
PAI
|
0,30%
|
|
|
RND
|
2,71% : 1 siège
|
|
|
LD/MPT
|
1,12%
|
|
|
PIT
|
0,55%
|
Diouf n'est plus le successeur du président Senghor,
mais un président à part entière, légitimé
par les urnes avec le soutien des puissantes confréries maraboutiques et
face à une opposition de plus en plus fragmentée.
En 1988 alors qu'il sollicitait un second mandat, le
Président Abdou Diouf est accueilli, lors d'un meeting à
Thiès (deuxième ville du pays) par des cris de
« sopi ! sopi ! »
(changement ! changement !), le slogan de son éternel rival,
et une pierre atteint son cortège. Très mécontent, le
président traita les membres de l'opposition de « bandits de
grand chemin » et les jeunes de « jeunesse
malsaine ». Des mots qu'il traînera longtemps comme un boulet.
Si les présidentielles et les législatives de
février 1988 lui donnent encore la victoire, c'est avec des scores
effrités et surtout, selon l'opposition, grâce à de graves
irrégularités qui loin d'apaiser la vie politique, l'ont
plutôt exacerbée. Paradoxalement c'est le chef de file de
l'opposition Abdoulaye Wade qui sort grandi de ces consultations
électorales.
Résultat des élections de 1988 :
|
PRESIDENTIELLES
|
|
LEGISLATIVES
|
|
|
Abdou Diouf
|
73,20%
|
PS
|
71,30%
|
|
Abdoulaye Wade
|
25,80%
|
PDS
|
24,74%
|
Le climat post-électoral est si explosif qu'il va
entraîner des émeutes et des violences urbaines structurées
autour du slogan « Sopi ». La fermeté du
pouvoir qui arrête et traduit en justice maître Wade rendu
responsable des violences, ne fait que conférer une aura de victime et
de héros à ce dernier. Pour décrisper la situation tendue,
une table ronde est organisée entre le pouvoir et l'opposition dont une
partie ( A. Wade en l'occurrence, contre toute attente) accepte de rentrer dans
ce qui est appelé « un gouvernement
élargi ».
En fait pour comprendre ces retrouvailles entre le pouvoir et
l'opposition, il faut prendre en compte, ce qu'au Sénégal on
appelle le sens du dialogue et du compromis : la démocratie
sénégalaise est une « dissoocratie »
(« dissoo » en Wolof=concertation), une
démocratie d'arrangements, au fond un jeu de ruses. Ce jeu de ruse
incarné dans la mythologie sénégalaise par
Leuk-le-lièvre (rusé et manipulateur)) et
Bouki-l'hyène (gourmand et crétin). Le mythe du dialogue
et de la cohésion sociale !
4. 1990 2000 : Une décennie
déterminante :
S'il faut remonter assez loin pour comprendre le changement de
2000, la dernière décennie a été sans conteste
celle qui a enregistré les évolutions les plus visibles dans le
cadre institutionnel et politique.
En Septembre 1991, l'assemblée
nationale sénégalaise, dans un climat politique apaisé par
les tractations entre le pouvoir et l'opposition et l'entrée de celle-ci
au gouvernement ( en avril), adopte plusieurs amendements au code
électoral.
1°) Les élections ont désormais lieu
à deux tours, le vainqueur étant désigné à
la majorité absolue.
2°) Le mandant présidentiel, limité
à deux exercices, est fixé à sept ans.
3°) L'âge des votants est abaissé à
dix huit ans.
4°) Les élections législatives qui devront
avoir lieu tous les cinq ans et les présidentielles sont
désormais dissociées.
En février 1993, les élections
présidentielles présentent un schéma quasi identique
à celles de 1988 : fraudes électorales, violences,
arrestations de certains chefs de l'opposition (en tête desquels,
Abdoulaye Wade) qui libérés finissent par entrer à nouveau
au gouvernement. Il faut noter que le bon déroulement de la consultation
est entaché par les longueurs et la confusion autour des
procédures de dépouillement. La commission nationale de
recensement des votes suspend ses travaux sur un constat d'échec, le
conseil constitutionnel étant obligé de prendre le relais. La
proclamation des résultats n'intervient que le 13 mars, dans un climat
de contestation.
Ce qui est remarquable, ici, c'est la poursuite de
l'effritement des voix du chef de l'Etat au profit de maître Abdoulaye
Wade.
En mai 1993, les élections
législatives sont remportées par le PS avec 84 sièges sur
120 contre 27 sièges pour le PDS qui a réalisé de bons
scores dans les centres urbains. (Nous reviendrons sur cette présence de
l'opposition dans les centres urbains).
Résultats des élections de
1993 :
|
PRESIDENTIELLES
|
|
LEGISLATIVES
|
|
|
Abdou Diouf (PS)
|
58,40%
|
PS
|
84 sièges
|
|
Abdoulaye Wade (PDS)
|
32,03%
|
PDS
|
27 sièges
|
|
Landing Savané (And-Jëf/ PADS)
|
2,91%
|
LD/ MPT
|
3 sièges
|
|
Abdoulaye Bathily (LD/ MPT)
|
2,41%
|
Jappo ligeyal Sénégal (coalition travaillons
ensemble pour le Sénégal RND ; CDP/ G ; AJ/ PADS)
|
3 sièges
|
|
Iba Der Thiam (CDP/ Garab gui)
|
1,61%
|
|
2 sièges
|
|
Madior Diouf (RND)
|
0,97%
|
|
1 sièges
|
|
Mamadou LÔ (indépendant)
|
0,85%
|
|
|
|
Babacar Niang (PLP)
|
0,81%
|
|
|
La crédibilité de ces résultats, fut
comme d'habitude remise en cause. Le retard dans la proclamation entretenait le
sentiment de la manipulation des suffrages. Les sénégalais
vécurent trois semaines d'attente, de blocage institutionnel des
dépouillements et de guerre de communiqués. Une climat tendu
auquel s'ajoutait la démission de Kéba M'Baye, Président
du conseil constitutionnel ; une démission interprété
par les populations comme un signe de désaveu de la fraude et de la
triche électoral.
La période post-électorale est marquée
par l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel,
maître Babacar Sèye, par l'arrestation de maître Wade, puis
de membres du PDS désignés comme suspects. L'affaire
« Me Seye » empoisonne durablement le climat politique. Le
PDS reste dans l'opposition, mais le nouveau « gouvernement
d'union » formé en juin intègre des membres des partis
de l'opposition tels que le Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT)
et de la Ligue Démocratique.
Abdoulaye Wade entrera à nouveau dans le gouvernement
d'ouverture ( que les sénégalais nomment « gouvernement
de partage du gâteau »), en février 1995.
Cette nouvelle entrée du PDS au gouvernement socialiste
est intéressante, dans la mesure ou elle démontre parfaitement
combien les critères idéologiques traditionnelles des partis
politiques, du gouvernement ou de la politique occidentale en
générale conviennent difficilement à la vie politique
sénégalaise. En effet ici comme ailleurs (nous le verrons
notamment dans le soutien apporté par les partis dits de gauches
à Wade au second tour) les étiquettes classiques ( extrême
gauche, gauche, centre, droite etc.) ne sont point pertinentes.
Il est assez aisé de comprendre que même lorsque
les trois courants de pensées furent établis par Senghor, les
catégories dégagées étaient inappropriées
aux partis politiques sénégalais. Comme le rappelle Antoine Tine,
ces étiquettes choisies et imposées par Senghor furent
reçues « au mieux comme des emblèmes administratives
pour obtenir un récépissé de reconnaissance et au pire
comme des « camisoles de force »9(*).
Aujourd'hui encore, il est très difficile de
délimiter les frontières idéologiques entre les partis
politiques sénégalais. Certes, si l'on se réfère
aux statuts, les différences apparaissent clairement, mais dans la
pratique et l'expérience de la discussion publique (lors des campagnes
électorales) les lignes de démarcation sont assez floues. Le
clivage idéologique n'est pas déterminant pour rendre compte de
la configuration partisane sénégalaise, des pactes, des
réseaux et des complicités clientélaires qui s'y
déploient.
Les clivages qui existent ne s'appuient pas tant sur des
critères d'efficacité clientéliste et de performance
électorale. Du coup, les partis qui ne sont représentés ni
au parlement ni au gouvernement sont absents de la scène politique et
servent plus ou moins de figurants. Ils sont comme des membres sur des bases
relevant plus des relations personnelles ou d'allégeances primordiales
que d'une adhésion réelle à un projet politique commun.
On pourrait dire aussi que ce qui différencie
réellement les partis politiques sénégalais c'est soit la
radicalité de leur opposition soit l'acceptation de la
« solidarité gouvernementale ». L'expérience
des dernières années illustre bien ce propos. Avec l'accession de
Diouf à la magistrature suprême, l'appel au « sursaut
national » et surtout depuis les émeutes
post-électorales de 1988, le Sénégal a connu une
expérience originale de cohabitation gouvernementale : le parti
majoritaire et dominant conviait les autres à se rassembler
derrière lui, non pas parce qu'il n'a pas de mandat électoral
suffisant pour gouverner seul le pays, mais dans le but de calmer la tension
sociale et de briser la contestation politique.
La cohabitation gouvernementale sénégalaise est
une tactique ou une ruse de pacification sociale qui intervient à chaque
fois que les élections sont contestées et que la
légitimité du PS est rudement mise à l'épreuve.
Les partis politiques se distinguant selon qu'ils acceptent ou non
d'intégrer le gouvernement.
En novembre 1996, des élections
régionales, municipales et locales ont lieu. Le PS de Abdou Diouf que
l'on pensait affaibli, remporte très largement ces scrutins avec 300
communautés rurales sur 320, 56 mairies sur 60, l'ensemble des 10
régions, 38 mairies d'arrondissement sur 43 de la communauté
urbaine de Dakar qui est de ce fait dirigé par un maire PS.
Mais ces élections ont eu lieu dans la confusion et
témoignent d'une préparation matérielle insuffisante. Le
scrutin doit être repris dans 100 bureaux de vote sur 1000. Les
accusations de manipulations, les contestations et les recours légaux
(par ailleurs rejetés) n'empêchent pas le PS de conforter ses
positions, y compris dans les zones où le PDS avait
réalisé de bons scores en 1993. Malgré la
polémique, le PDS de Abdoulaye Wade reste au gouvernement, où il
était déjà revenu en février 1995.
En mai 1998, les élections
législatives se tiennent dans le calme, sous l'égide d'un nouvel
organisme, l'Observatoire National des Elections (ONEL), chargé de
garantir la régularité du scrutin. C'est le premier exercice
électoral relativement apaisé que connaît le pays depuis
bien longtemps, malgré les accusations traditionnelles de fraudes. Il
voit la victoire du Parti Socialiste avec 93 sièges sur 140 10(*), contre 23 sièges au
Parti Démocratique Sénégalais et surtout
l'émergence d'une troisième force, L'Union pour le Renouveau
Démocratique (URD) de Djibo Leyti KA (ancien
« baron » du PS ayant occupé plusieurs postes
ministériels) qui emporte 11 sièges. « And
Jëf » (travailler ensemble )/Parti Africain pour la
Démocratie et le Socialisme, un parti d'obédience marxiste
obtient 4 sièges.
Onze partis en tout sont représentés dans la
nouvelle Assemblée au terme d'un processus, une fois de plus,
contesté par l'opposition qui a réclamé son annulation
sans succès.
En janvier 1999, des élections
indirectes au Sénat (récemment institué) sont
convoquées par les membres de l'assemblée nationale et les
conseillers régionaux, municipaux et locaux. L'opposition qui avait
contesté, dans sa majorité, l'élection de ces conseillers,
en novembre 1996 ainsi que les élections de mai 1998, boycotte les
sénatoriales. Grâce à cette politique de chaises vides, le
PS gagne la totalité des sièges mis en compétition, avec
91,3% des voix, c'est-à-dire les 48 sièges, en plus des 12
sièges pourvus par décret du Président de la
République.
Parmi les sénateurs désignés directement
par le chef de l'Etat figurent deux représentants de « petits
partis »11(*) le
Parti libéral Sénégalais du dissident et ancien bras droit
du PDS de Abdoulaye Wade, maître Ousmane Ngom et le Parti Africain de
l'Indépendance (PAI) du doyen des partis marxistes
sénégalais, Majhemouth Diop.
Cependant, ce tableau ne saurait être complet si nous ne
prenons pas en compte les instances qui devaient organiser et surtout veiller
au bon déroulement des opérations électorales. Il s'agit
principalement de l'Observatoire National des Elections (ONEL) et du
Ministère de l'Intérieur à la tête du quel le
président Abdou Diouf avait nommé un Général
d'armée.
B / LE ROLE DE L'ONEL ET DU GENERAL MINISTRE DE
L'INTERIEUR
1. La présence d'autres instances
d'arbitrage.
Si l'ONEL était comme son nom l'indique un
observatoire, le Ministère de l'Intérieur, pour sa part,
était chargé de l'organisation logistique et de la supervision du
dépouillement des bulletins des 2,7 millions d'électeurs (sur les
9,2 millions d'habitants - estimation de 1999 - que compte le
Sénégal) appelés aux urnes le 27 février 2000. Le
coût du scrutin évalué à 4 milliards de francs CFA
(40 millions de francs français) est entièrement pris en charge
par l'Etat.
Mais avant de voir ces acteurs déterminants de
l'élection, il faut souligner la présence des autres instances
d'arbitrage.
n Le Conseil constitutionnel qui
était chargé de la proclamation des résultats en 1993,
après la défection de la commission nationale de recensement des
votes (signalée plus haut) est issu de la réforme
constitutionnelle de 1991. Il est un acteur de poids de la vie politique
sénégalaise car il y est chargé de dire le droit en cas de
contestation de fond ; ce qui est souvent le cas au Sénégal.
Encore une fois saisi par l'opposition, le conseil constitutionnel n'a pas
donné suite aux réclamations des partis à propos des
élections sénatoriales, début 1999.
n Le Haut conseil de l'audiovisuel,
dirigé par le haut magistrat Babacar Kébé, est
chargé, comme les CSA de tous les pays, de veiller à
l'équilibre dans le traitement des élections par les
médias, notamment ceux de l'Etat.
n Quelques observateurs internationaux ont
également voulu veiller au bon déroulement des
présidentielles de 2000. Il s'agit principalement de :
l'Union Economique et Monétaire Ouest-africaine
(UEMOA) ;
la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) ;
l'ONU ;
l'OUA ;
l'Union européenne ;
l'OCDE ;
Le G8 ;
L'Association des Autorités Electorales Africaines
(AAEA) ;
L'Association des juristes africains ;
Le National Democratic Iinstitute (NDI) ;
2. L'Observatoire National des Elections (ONEL).
Les irrégularités de vote ou bien les
accusations d'irrégularité de vote, au Sénégal, ont
souvent eu des conséquences assez graves ; comme au lendemain des
élections présidentielles de 1988, la proclamation de
l'état d'urgence et « l'année blanche »
à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les
présidentielles de 1983 et de 1993 avaient également
été violemment contestées par l'opposition qui avait fait
état de fraudes massives12(*).
Pour parer à toute éventualité, sinon
pour s'acquitter de quelque accusation que se soit, la classe politique s'est
efforcée à plusieurs reprises de trouver des remèdes
institutionnels à des crises électorales qui se
succèdent.
Avec le concours de l'opposition, les autorités ont
progressivement procédé à des modifications du
système électoral, dont la résultat a été
l'adoption du code électoral de 1992.
Grâce à ce nouveau code, jugé
« révolutionnaire » par ses promoteurs, la carte
nationale d'identité est de rigueur depuis 1993 dans les bureaux de
vote. Le pouvoir a également entrepris des modifications de la loi
électorale.
Ainsi en août 1998, par les lois 39/98 et 42/98, la
majorité socialiste à l'assemblée nationale a
modifié le code électoral et a supprimé deux dispositions
constitutionnelles essentielles dans l'optique de l'alternance : celle
(art.21) qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux et
celle du quart bloquant (art. 28) qui impose un deuxième tour, si un
candidat à la présidence de la république dispose de la
majorité absolue au premier tour, sans rassembler un quart des voix des
électeurs inscrits.
Par la suite, le PS fera encore une concession à ses
adversaires : l'organisation des élections était,
naguère, entièrement confiée à l'administration,
mais ce n'est plus le cas depuis les législatives de 1998. En effet,
chargé d'assurer la transparence et la régularité des
élections, l'ONEL, organisme de neuf personnalités venus de
différents secteurs de la société civile, a
été institué en 1997 par l'assemblée nationale
(avec un budget d'un milliard de francs CFA - 10 millions de francs
français- pour les législatives de 1998) après les
demandes répétées de l'opposition de mise en place d'une
commission indépendante des élections.
L'indépendance de l'ONEL n'a cessé, les
années suivantes, d'être mise en question par l'opposition,
même si figuraient au sein de la structure des personnalités
au-dessus de tout reproche. Premier président de l'ONEL, le
général Mamadou Niang a été salué pour sa
rigueur et son impartialité politique. Une polémique
considérable a en revanche suivi la désignation du
général Dieng, en 1999, comme successeur. Le pouvoir a du
finalement reculer pour le remplacer par le juriste Louis Pereira De Carvalho,
ancien président du Conseil d'Etat.
Sources éternelles de réclamations, la
constitution des listes électorales et la délivrance des cartes
d'électeurs figure comme le dossier le plus sensible pour l'ONEL qui a
du reconnaître n'avoir pas été informée de la
fabrication, en Israël, de cartes d'électeurs
réputées infalsifiables. En effet, une vive polémique
naquit de la découverte de deux stocks de cartes d'électeurs, peu
avant le premier tour de la présidentielle 2000, les unes
fabriquées au Sénégal, les autres « en
secret » en Israël, par souci d'efficacité selon le
Ministère de l'Intérieur.
Pour le général Cissé, ministre de
l'intérieur, ces cartes ont été fabriquées en
Israël « parce qu'en Europe, aucun pays ne possède cette
technologie, nous a-t-on dit. Lorsque l'une de ces cartes est
photocopiée apparaît aussitôt la mention
« faux » »13(*).
Cette fabrication des cartes en Israël, un pays qui
paraît trop loin, cacherait quelque chose selon les opposants.
D'ailleurs, certains opposants ne manqueront pas de soupçonner le
ministre de l'intérieur de velléité de fraude en faveur du
PS.
3. L'armée et le général ministre de
l'intérieur.
Contrairement à ce qui s'est passé et qui se
passe encore dans beaucoup d'Etats africains, l'armée
sénégalaise a toujours fait preuve d'un loyalisme absolu à
l'égard du régime en place, en rétablissant l'ordre,
chaque fois que cela a été nécessaire, et en regagnant
ensuite ses casernes sans laisser de traces. Ainsi, lors du conflit entre le
Président de la République Senghor et le Président du
Conseil (Mamadou Dia) en décembre 1962, elle a pris fait et cause pour
le premier14(*).
Aux mois de mai et juin 1968 où la grève
générale a eu lieu en même temps que les troubles
universitaires, elle a encore assuré le maintien de l'ordre
intérieur. Et plus tard, en 1988, aux lendemains des élections
présidentielles, très controversées, suivies de la
proclamation de l'Etat d'urgence, les militaires et les gendarmes ont
été les derniers remparts contre le chaos, avant de retourner
sagement dans leurs casernes.
Cependant, si les opposants sénégalais se
bornaient, avant, à contester les résultats des différents
scrutins en organisant des manifestations de rue ou des opérations de
désobéissance civile, ils étaient conscients que le
scrutin de février 2000 était porteur de plus de dangers que tous
les autres.
Il y avait une détermination inébranlable
des électeurs, qui étaient prêts à toute
éventualité, quand bien même les résultats auraient
été validés par le Conseil constitutionnel.
Djibo Leyti KA, candidat de l'Union pour le Renouveau
Démocratique (URD) et ancien responsable du PS, tenait des propos assez
significatives : « ... nous ne pouvons pas toujours tenir nos
militants. Si Diouf se proclame cette fois-ci élu, il y aura des
émeutes. »15(*)
En effet, au Sénégal d'avant les
élections présidentielles de 2000, l'ambiance était
plutôt exceptionnelle, par rapport à celles des deux
précédentes de 1988 et 1993. Soupçons de fraude, rumeurs
alarmistes, manifestations de protestation et irruptions de violence, autant de
menus habituels de la veille, cependant juxtaposés d'une grande
différence sous-jacente : certains leaders politiques trouvaient
des similitudes avec la situation qui prévalait, juste un an auparavant
, en Côte d'Ivoire avant le putsch du général Robert
Guei.
L'armée sénégalaise a certes
été suspectée à plusieurs reprises, sous les
présidences de Senghor puis de Diouf, de velléités
putschistes. Cependant, en vertu de la Constitution, les militaires
sénégalaises (l'armée avec 11000 hommes et le gendarmerie
avec plus de 5800 hommes) ne peuvent être ni électeurs ni
éligibles. Etant considérés, depuis l'indépendance,
comme le seul garant de la cause républicaine du pays, ils sont à
présent qualifiés d'être professionnels et
expérimentés : formés dans les meilleurs
écoles étrangères, et ayant participé à de
nombreuses opérations onusienne de maintien de la paix, les cadres
compétents sont régulièrement affectés dans la
haute administration, voire à la tête des départements
ministériels.
A ce stade, c'est le rôle du ministre de
l'Intérieur qui retient notre attention. En dehors des interventions
stabilisatrices du pouvoir militaire que nous avons soulignées plus
haut, on a pu remarquer ces dernières années la participation
accrue de personnel militaire dans la vie politique sénégalaise.
Le président Diouf qui a dû avoir recours
plusieurs fois à l'armée pour décrisper le débat
politique, a nommé le général Lamine Cissé, ancien
chef d'état-major de l'armée, au poste de ministre et, à
l'occasion des législatives de mai 1998, le général de
division Mamadou Niang, ancien patron du contre-espionnage, à la
tête de l'ONEL, puis le général Boubacar Wane, ancien aide
de camp du chef de l'Etat, comme gérant de la crise casamançaise.
Il faut noter que théâtre d'une rébellion
indépendantiste depuis près de vingt, la Basse-Casamance est
peuplée des Diola qui résistent farouchement au centralisme de
l'Etat sénégalais. Dirigé par le Mouvement des Forces
Démocratiques de Casamance (MFDC) de l'abbé Augustin Diamacoune
Senghor, le séparatisme casamançais semble être
plutôt d'ordre culturel, car ce qu'il réclame est surtout le
respect du particularisme casamançais16(*). Mais là n'est pas notre centre
d'intérêt.
Cette immixtion plus ou moins indirecte du pouvoir militaire
dans la vie politique suscite de fortes réserves au sein de la
société civile. En imaginant une prise de pouvoir par
l'armée, comme c'était le cas en décembre 1999 en
Côte d'Ivoire, il était légitime de se demandait si
l'armée pouvait jouer un rôle d'arbitre en cas de troubles
majeurs. Les évêques et les imams ont même lancé un
appel à la modération aux responsables politiques, justement pour
conjurer toute dérive grave qui pourrait justifier, à l'instar de
la Côte d'Ivoire, une éventuelle immixtion, directe et brutale, du
pouvoir « kaki » dans l'arène politique.
Cette psychose amena une déclaration commune, entre les
musulmans et les chrétiens publié le 31 janvier, qui
indiquait : « nous demandons de s'imposer le respect des
règles du jeu démocratique et de l'éthique. Qu'ils se
montrent, dans le combat pour le pouvoir, véridiques et dignes,
respectables et respectueux des citoyens, de la réputation et de
l'honneur de notre nation.»17(*)
C'est justement pour éviter tout débordement et
mener à bien les échéances électorales que le
ministre de l'Intérieur, le général Lamine Cissé
dit avoir été nommé. « En 1998, écrit-il,
le Président de la République du Sénégal a
nommé le général que je suis ministre de
l'Intérieur, chargé de la décentralisation. Une
première dans l'histoire politique du Sénégal. Une
première doublée d'une autre, conjoncturelle : durant les
deux années qui allaient suivre, le ministre de l'Intérieur
allait avoir la responsabilité d'organiser trois élections d'une
importance majeure, chacune comportant des enjeux susceptibles de créer
de vives tensions pouvant faire basculer le pays dans un chaos dont il se
serait difficilement remis : élections législatives en mai
1998 ; élections sénatoriales en janvier 1999, qui devaient
pour la première fois instaurer le bicaméralisme au
Sénégal ; élection présidentielle à
deux tours, en février et mars 2000. Cette élection
présidentielle, davantage que toute autre, s'annonçait comme
celle de tous les dangers.»18(*)
Le général précisant ensuite :
« un général à l'ONEL et un autre au
ministère de l'Intérieur ? Cela n'inquiète
guère les sénégalais. Au contraire, cela rassure.
Maître Abdoulaye Wade, l'irréductible opposant promis à la
plus haute destinée, à bien résumé le sentiment
général en déclarant : « celui-là,
il pourra être un arbitre, il n'a aucun lien avec les
partis. »19(*)
Pour le Général Cissé, l'objectif
était de mener à bien la mission qui était la sienne,
celle que lui avait confiée le Président Diouf :
« Des élections impartiales »,
« libres »,
« régulières » et
« transparentes »20(*). Il devait veiller à ce que ces quatre
adjectifs, employés par le Président Diouf, aient leur sens dans
la présidentielle tout en faisant face à la tension palpable.
En effet, les propos tenus par les deux candidats principaux
n'étaient pas de mesure à calmer les esprits. Face à un
Diouf qui relate longuement la cause républicaine de l'armée,
Wade tranche rapidement sa posture devant une éventuelle intervention de
l'armée21(*) :
«... dès lors que certains civils confisquent le pouvoir, il ne
reste pas d'autre solution que les militaires pour débloquer la
situation. Encore une fois, si Diouf se proclame élu, le 27
février, je donnerai une réquisition à l'armée,
à la gendarmerie et à la police pour qu'elles ne le laissent pas
faire. Je prendrai toutes mes responsabilités .»22(*)
Donc malgré tous les efforts consentis pour avoir des
« élections impartiales»,
« libres »,
« régulières »et transparentes » et
tous les observateurs présents à la veille des élections,
la question de la régularité du scrutin est plus que jamais
posée. La question est au coeur de la campagne présidentielle. On
a assisté, au cour des derniers mois précédents
l'élection, à une empoignade entre l'opposition et le
gouvernement sur les moyens d'assurer le bon déroulement et la
transparence du scrutin. Comme nous l'avons déjà
souligné, ce sont les cartes électorales
« israéliennes » qui provoquèrent les plus
sérieuses querelles.
Rappelons que le gouvernement en avait initialement
confié la fabrication à une entreprise nationale, avant de
décider, sans en informer l'opposition, de confier la réalisation
d'un autre lot à une société israélienne. Pour sa
défense, le ministre de l'Intérieur, affirme avoir
découvert que les premières cartes pouvaient aisément
être photocopiées, d'où la commande au prestataire
israélien, de documents infalsifiables censés remplacer les
précédents, destinés à la destruction.
Pour les adversaires du Parti socialiste, regroupés au
sein d'un Front pour la régularité et la transparence des
élections (FRTE), il ne s'agit rien moins que d'une tricherie. Ils
reprochent au gouvernement une opération qualifiée de
« secrète » et assurent qu'elle a
entraîné la radiation des listes électorales de nombreux
électeurs, et notamment de membres de partis d'opposition. Ils tiennent
même en suspicion l'Observatoire National des Elections à qui ils
reprochent de ne pas avoir suffisamment mis son nez dans cette affaire. L'ONEL
n'est certes pas chargé de contrôler la fabrication des cartes
électorales mais, estime-t-on, il ne pouvait être tenu à
l'écart d'une décision aussi essentielle.
Il reste que l'opposition a obtenu certaines garanties
supplémentaires, comme la possibilité d'avoir des
représentants dans tous les bureaux de vote. De plus, les parties ont
fini par tomber sur l'organisation d'un audit concernant l'établissement
du fichier électoral. Par ailleurs, plusieurs organisations non
gouvernementales sénégalaises, dont l'organisation des droits de
l'homme (ONDH) ont formé des observateurs qui devaient surveiller le
déroulement des élections, aux côtés des scrutateurs
internationaux que nous avons déjà cités. Mais au yeux de
nombreux observateurs, le débat sur l'organisation des élections
était définitivement vicié. A ce stade de notre
étude, il nous faut présenter les différents candidats qui
étaient en lice.
C / LES CANDIDATS
1. Les principaux candidats
Huit candidats aux élections présidentielles du
27 février ont finalement été retenus, le 28 janvier, par
le Conseil constitutionnel.
Le président sortant, Abdou DIOUF, 65
ans et au pouvoir depuis 1981, qui a remporté les
précédentes élections de 1993, au premier tour, avec 58,4%
des suffrages exprimés. Il bénéficiait du soutien du Parti
socialiste et de deux autres petites formations, qui ont constitué une
coalition, dite de la « convergence patriotique ». Le P.S.,
parti au pouvoir depuis l'indépendance, avait remporté les
élections législatives de 1998 avec 50,19%, ce qui marquait un
recul sensible (presque 10 points) de ses positions. La capacité de
mobilisation du vieux parti créé par Senghor restait
néanmoins grande, en particulier dans le milieu rural. Les observateurs
s'interrogeaient sur les conséquences de
l'homogénéité des votes socialistes, du départ du
Parti Socialiste, en 1998 de Moustapha Niasse, Après Djibo KA, un autre
haut responsable du parti, entré lui aussi auparavant en
rébellion.
Son principal challenger était Abdoulaye
WADE. Agé de 74 ans il était candidat à toutes
les élections depuis 1978. Le leader du Parti Démocratique
Sénégalais (PDS) avait réuni 32% des suffrages en 1993. Il
a été soutenu, pour les présidentielles de 2000, par huit
partis dans ce qu'ils ont appelé la Coalition Alternance 2000 (CA2000),
dont les trois formations de ce que les sénégalais nomment le
« pôle de gauche ». Un pôle qui réunit
le Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT) d'Amath Dansokho,
ex-parti marxiste, la Ligue Démocratique/ Mouvement pour le Parti du
Travail (LD/MPT) du professeur Abdoulaye Bathily, traditionnellement proche des
milieux étudiants et de la contestation syndicale et
« And-Jef »(travailler ensemble)/Parti Africain pour la
Démocratie et le Socialisme (AJ/PADS) de Landing Savané.
Ces trois partis ont essentiellement animé avec le PDS,
l'opposition sénégalaise depuis vingt ans. La popularité
de Abdoulaye Wade, éternel opposant resté très pugnace, a
encore une fois été démontré lors de son
traditionnel « retour » au Sénégal, en
Octobre 1999, après un an d'absence, tenté de jouer son
« va-tout », car il s'agissait de sa dernière chance
électorale. Abdoulaye Wade s'est déclaré vainqueur avant
les élections, n'hésitant pas, comme nous l'avons vu plus haut,
à lancer un appel à l'armée durant la campagne
électorale. Mais il faut rappeler aussi que Wade est un pragmatique qui
a su à plusieurs reprises négocier sa participation au
gouvernement, pour éviter le chaos politique.
Moustapha NIASSE est, quant a lui, un nouveau
venu dans l'opposition. Agé de 61 ans, l'ancien ministre des affaires
était une figure importante du Parti socialiste. Entré en
dissidence en 1999, il a lui aussi reçu, comme Wade, le soutien formel
de huit partis ligués dans une Coalition De l'Espoir 2000 (CODE 2000),
dont sa propre formation, l'Alliance des Forces de Progrès (AFP).
C'est un homme politique ayant occupé les plus hautes
fonctions dans le gouvernement et dans le Parti socialiste. Il fut directeur de
cabinet de Senghor et ministre des affaires étrangères. Lui
même homme d'affaires prospère, Niasse est apprécié
des milieux économiques, et est bien connu à l'extérieur
du Sénégal où il bénéficie d'un excellent
carnet d'adresse. Une donne qui n'était pas négligeable pour
beaucoup de sénégalais qui voyaient en lui l'homme capable de
faire venir plus facilement les investisseurs étrangers.
Cependant, l'inconnu résidait dans sa capacité
ou non à détourner du PS les réseaux d'amitié et de
clientèle politique qu'il a pu se construire tout au long des
années, bien au-delà de la région (importante
électoralement) de Kaolack (situé au centre du pays)23(*), où il est né et
où il bénéficie de soutiens religieux non
négligeables. Il semblait à la veille des élections que
Niasse voulait surtout se positionner dans la perspective des futures
présidentielles de 2007.
Cette perspective semblait également valable pour
Djibo Leyti KA. Agé de 52 ans et autre
« jeune » cacique du PS grâce auquel il a
occupé, pendant une quinzaine d'année, plusieurs postes
ministériels (dont ceux des Affaires étrangères, de
l'Intérieur, de l'Education nationale ou encore de la Communication)
avant de faire scission pour présenter des candidats aux
législatives de 1998 sous l'étiquette de l'Union pour le
Renouveau Démocratique. Son parti a réalisé à cette
occasion, une belle performance en remportant 11 sièges de
députés. Mais à la veille des présidentielles de
2000, la position médiane « ni PDS, ni PS » de Djibo
KA, qui pouvait compter sur le soutien de la communauté peul, et dont
les bases électorales se situent notamment dans la région du
Fouta 24(*), pouvait
être fragilisée par l'arrivée de Moustapha Niasse sur la
scène ; ce dernier bénéficiant d'un très grand
« capital sympathie » auprès des
sénégalais.25(*)
2. LES AUTRES CANDIDATS
Le professeur Iba der THIAM, historien de
renom, s'était déjà présenté en 1993
après son départ du PS, sans résultat notable.
Mademba SOCK, secrétaire
général de la puissante Union Nationale des Syndicats Autonomes
du Sénégal (UNSAS), se présentait pour la première
fois, à la tête d'un front de rupture pour une alternative
populaire, crée pour l'occasion. Sa lutte de syndicaliste, à la
tête de la grève du secteur de l'électricité, suivie
de son emprisonnement, a interpellé les sénégalais en
1998-99. Populaire et contesté à la fois pour son radicalisme,
Sock à 48 ans ( le plus jeune candidat) se lançait dans la
compétition sans guère de ressources matérielles.
Problème de ressources aussi, et souligne-t-on dans la
presse sénégalaise, « d'absentéisme
politique » pour Cheikh Abdoulaye DIEYE du Front
pour le Socialisme et la Démocratie (FSD).
Dernier concurrent, un autre nouveau venu dont le principal
atout est d'appartenir à une famille maraboutique et d'apparaître
comme un candidat « mouride » (du nom de l'une des deux
grandes confréries musulmanes du pays), Ousseynou Fall,
est le leader du Parti Républicain Sénégalais (PRS).
Si une quarantaine de partis, à la veille des
élections présidentielles ( et 65 aux législatives
anticipées d'avril 2001), animaient la vie politique
sénégalaise, moins d'une vingtaine ont une existence
concrète et suivie et en mesure de présenter des candidats aux
présidentielles.
Maintenant ce qui caractérisait les deux nouveaux
Djibo. L. KA (URD) et Moustapha
NIASSE (AFP), renforcés par quelques
formations récentes, c'étaitt d'apparaître comme deux
dissidents du PS qui avaient tenu tête à Diouf en se
réclamant tous deux de l'héritage senghorien.
Ce qui nous amène à parler de l'implosion du PS,
comme un élément essentiel de la victoire de Wade aux
présidentielles de 2000.
II / L'IMPLOSITION DU PARTI SOCIALISTE
1. Le PS de Diouf : une nouvelle politique
S'il y a un point sur lequel tous nos interviewés ont
bien voulu insister c'est celui de l'implosion du Parti Socialiste.
En effet, que le PS ait aujourd'hui
irrémédiablement perdu sur le plan électoral, la
ville de Dakar, puis une bonne partie des grands centres urbains du
Sénégal n'étonnera guère. Comme nous l'avons vu,
depuis environ une décennie, un glissement s'était
opéré en faveur de l'opposition, les défections depuis
1997 dans les rangs socialistes ayant rendu plus malaisé le maintien de
fortes positions : « la contestation se déploie dans les
villes, où le brassage social, la proximité des milieux plus
ouverts de la classe moyenne, l'information véhiculée par les
médias sont propices à la désaffection du pouvoir en
place » (Boubacar Seck, rédacteur en chef du quotidien Le
Matin)
C'est d'ailleurs une tradition de longue date :
Léopold Sédar Senghor, au temps de l'Union progressiste
sénégalaise, et même avant, se méfiait
déjà de la volatilité de l'opinion dans la capitale, et
s'appuyait volontiers sur ses « braves paysans », les
campagnes l'ayant toujours soutenu dans ses combats électoraux.
« Tout le monde reconnaissait, encore à la veille des
élections que l'implantation du PS dans le milieu rural lui permettait
d'être une formidable machine de guerre, avec laquelle aucun parti ne
pouvait raisonnablement prétendre rivaliser. » (Alioune Fall,
chef du desk politique du quotidien Le Matin).
En fait de Senghor à Diouf, la transition du pouvoir
s'est faite sur des bases inchangées. Les véritables
alliés du pouvoir sont au niveau des sections du parti, qui quadrillent
le territoire, relayent l'administration, servent de bureaux de
doléances et de lieux de résolution des conflits, et permettent
à Dakar de sentir le « pouls » du pays profond,
concurremment avec les autorités traditionnelles, notamment religieuses,
en mesure de dialoguer directement avec le chef de l'Etat.
Rappelons que le principal souci du successeur de Senghor, en
1981, est de gagner son autonomie par rapport à un parti dominé
par la « vieille garde senghorienne ». Abdou Diouf
lui-même n'est pas issu du parti, il a suivi un parcours technocratique
qui l'a mené aux avant-postes, et c'est le cas pour toute une
génération de nouveaux cadres, promus par Senghor, qui vont aider
le nouveau Président de la République à asseoir son
pouvoir.
Pendant les premières années, le compromis
prévaut. Puis c'est une véritable reprise en main à
laquelle on assiste avec le congrès du PS de 1984 : les
« barons » senghoriens quittent le bureau politique du
parti (certains d'entre eux, devenus ministres, quittent aussi le gouvernement,
en compagnie d'un certain Moustapha Niasse, alors ministre des Affaires
étrangères), et le secrétaire général
s'entoure de ces hommes à lui, accordant cependant comme Senghor sa
confiance à Jean Colin (français d'origine), au poste de
secrétaire politique.
Parallèlement on assiste à l'émergence
d'un nouveau phénomène : ce sont les « mouvements
de soutien » (nous le verrons plus loin) qui permettent à
Abdou Diouf de se constituer un réseau, en partie étranger au
parti. Au sein même du PS, les « groupes de
réflexion » sont animés par de jeunes intellectuels de
sa génération, parfois issus de mouvements gauchistes
(maoïstes notamment), naguère actifs à l'université.
Ce sont donc eux qui reprennent peu à peu les commandes, sans toutefois
qu'il puisse être question d'écarter totalement les
« barons », qui se sont taillés des fiefs
électoraux et dont l'expérience politique est
nécessaire.
Dès 1984, un thème domine la vie du PS :
c'est l'existence de ces « tendances » dont on
dénonce la guérilla incessante et qui, s'il n'est pas question de
leur conférer une reconnaissance officielle, font apparaître de
grandes divergences d'intérêts. Les luttes, en particulier, pour
la reconduction à la tête des organisations de base du parti sont
féroces, et font parfois des victimes.
En 1989-90, après le traumatisme des élections
de 1988 et de la contestation urbaine très violente, Abdou Diouf
s'efforce de parachever son entreprise de conquête du parti. Lors du
nouveau congrès, tous les membres du bureau politique sont en effet
désignés par lui, et ne rendent de comptes qu'au
secrétaire général, mais la houle de mécontentement
et les nombreuses résistances dans la préparation d'un
congrès plusieurs fois reporté l'obligent, encore une fois,
à faire une place aux « anciens ».
L'unanimisme de façade ne permet plus de cacher des
divisions. De plus en plus Abdou Diouf gouverne seul, impose le silence au
parti à l'aide de sa garde rapprochée, tout en faisant des gestes
de compris. La désignation en 1991 d'un
« conservateur » du PS, Habib Thiam, comme Premier
ministre, en est un. Mais cette nomination dans le cadre d'un gouvernement
ouvert à l'opposition a certes pour effet d'apaiser la tension
sociale mais elle a surtout pour effet de déstabiliser encore un
peu plus le parti, qui a perdu en 1990 son stratège, Jean Colin,
« sacrifié au désir de changement émanent aussi
bien des socialistes que de l'opinion. » selon Momar. S. N'diaye.
(Ancien rédacteur en chef du quotidien national Le Soleil)
2. La guerre des chefs
La guerre des chefs et des tendances se poursuit d'un
congrès à l'autre. En 1995 l'une de ses principales victimes est
Djibo KA. Il sort du gouvernement et, dans le parti, se livre alors un combat
peu feutré à la tête des
« légitimistes », face aux
« rénovateurs » qui se sont trouvés un leader
en la personne d'Ousmane Tanor Dieng.
Resté discret jusqu'ici, le directeur de cabinet de
Diouf, devenu ministre d'Etat, est ouvertement poussé au devant de la
scène, depuis 1993 par Abdou Diouf, selon un processus qui fait penser
à sa succession de Senghor. Désormais, Ousmane Tanor Dieng sera
l'homme à abattre. Le départ, cette fois-ci du PS, de Djibo KA,
en 1997, après sa tentative de formation d'un courant interne,
étant largement analysé comme la conséquence de cette
guerre de succession. Ou bien, comme le dit Momar Seyni N'diaye (du quotidien
Le Soleil) : « Le PS a implosé parce qu'on a
imposé à des cadres et des militants du parti, des dirigeants
politiques qui ne correspondaient pas à leur choix. Le cas de Ousmane
Tanor Dieng, de même que celui de toute une bande qui sont sortis du
néant ; des gens dont on avait jamais entendu parler dans le parti
est éloquent. Ce sont des gens qui n'avaient aucun passé militant
et qui du jour au lendemain se sont retrouvés au premier plan. C'est
frustrant pour les militants historiques. C'est une pratique qui s'est vu
ailleurs mais pas à ce point.»
Les démissions et passages à l'opposition sont
restés relativement rares jusqu'à cette période. Les
observateurs constatent simplement que les combats sur le terrain deviennent de
plus en plus violents. La vie du parti est ainsi émaillée de
règlements de compte et d'échauffourées dont se
délecte la presse privée. Le départ de Djibo KA et le
recul sensible du PS aux élections législatives de 1998
accélèrent la dégradation. La crise est donc ouverte et la
belle machine électorale semble, à l'approche des
élections de l'an 2000, à bout de souffle.
Selon les interviewés, les
« largesses » des dirigeants régionaux du parti,
qui sont souvent à la tête de sociétés nationales,
et en tant que tels disposent de leviers importants, ont eu souvent raison des
états d'âme des électeurs dans le passé. Or cette
fois-ci le quadrillage du pays et la distribution de cadeaux n'ont plus suffi,
et l'ont voit des bastions entiers du PS passer dans le camp adverse,
principalement dans les régions de Thiès, Kaolack, Kolda, voire
Saint Louis.
3. L'épreuve du deuxième tour : un
tournant.
Malgré les quelques contestations liées aux
préparatifs que nous avons déjà soulignées
(notamment le nettoyage du fichier électoral et les cartes
imprimées en Israël), le scrutin présidentiel du dimanche 27
février 2000 se déroulera dans le calme. Abdoulaye Wade
réitère dès le lundi qu'il est certain de contraindre
Abdou Diouf au ballottage : « selon les résultats que
nous avons à Dakar, Ziguinchor, Kaolack, Bignona ou à Kolda, je
suis en tête »26(*). C'est surtout dans la région de Dakar, qui
représente le quart de l'électorat et vote traditionnellement
pour l'opposition, que Wade a remporté le plus de suffrage. Selon les
chiffres officiels, il y a recueilli 45% des voix contre 20% pour Abdou Diouf
et Moustapha Niasse. Le président sortant a pour sa part confirmé
son bon score traditionnel chez les ruraux. (Nous reviendrons sur ce
découpage plus loin avec la présence des médias dans les
centres urbains). Il faut souligner la mise en garde de Me Wade à son
adversaire, le lendemain du premier tour, « contre l'annonce d'une
victoire prématurée de sa part » lui demandant de se
retirer « pour éviter une humiliation au deuxième
tour »27(*)
Donc, au premier tour, le Président Abdou Diouf du
Parti socialiste, malgré une campagne organisée par le
publicitaire français Jacques Séguéla, ne recueille que
41,3% se trouvant ainsi pour la première fois, à un second tour
contre son rival de toujours Abdoulaye Wade, arrivé second avec 30,1%
des voix.
Ces deux candidats sont suivis par Moustapha Niasse de
l'Alliance des Forces du Progrès, Djibo Leyti KA de l'Union du Renouveau
Démocratique, le professeur Iba Der Thiam de la CDP, Ousseynou Fall du
PRS, Cheikh Abdoulaye Dièye du (FSD/BJ) 28(*) et le syndicaliste Mademba Sock.
Résultats du premier tour de 2000:
|
CANDIDAT
|
SCORE
|
|
Abdou DIOUF
|
41,3%
|
|
Abdoulaye WADE
|
30,1%
|
|
Moustapha NIASSE
|
16,8%
|
|
Djibo Leyti KA
|
7,1%
|
|
Iba Der THIAM
|
1,2%
|
|
Serigne Ousseynou FALL
|
1,1%
|
|
Cheikh Abdoulaye DIEYE
|
1,0%
|
|
Mademba SOCK
|
0,1%
|
Le Président sortant Abdou Diouf et Me Abdoulaye Wade
devaient donc s'affronter pour la première fois de l'histoire du pays,
dans un second tour ; les résultats du premier tour confirmant un
net effritement de l'audience électorale du parti socialiste
sénégalais.
Moustapha Niasse et Djibo KA (dans une moindre mesure) ont
drainé beaucoup de militants et sympathisants du PS. Mais ce qui rendait
encore plus incertaine l'issue du second tour est la déclaration,
à la veille du premier tour, de Moustapha Niasse disant qu'il
demanderait à ses partisans de ne pas voter pour le président
sortant, quel que soit son adversaire.
L'un des principaux constats qui s'imposaient au soir de ce
premier tour était le taux exceptionnel de participation,
supérieur à 60% alors qu'il n'était que de 39% pour les
législatives de 1998. Ce qui, selon l'ONEL confirme la maturité
de l'électorat sénégalais, ainsi que sa
détermination.
Aussi l'Observatoire National des Elections a souhaité
que « le scrutin du 27 février qui s'est passé dans le
calme fasse tache d'huile jusqu'à la fin du
processus »29(*).
Le deuxième tour organisé le 19 mars 2000 voit
le jeu des alliances qui sera décisif dans l'issu du scrutin. Djibo KA
rejoint Diouf, espérant lui apporter ses 7,1% au second tour mais cela
crée une scission au sein de son parti, beaucoup de cadres voulant
suivre la logique de l'alternance jusqu'au bout. Aussi grâce au
ralliement de plusieurs candidats dont Moustapha Niasse avec ses 16,8%,
Abdoulaye Wade est élu Président de La République avec
58,5% des voix contre 41,5% pour Abdou Diouf. C'est la première fois
depuis l'indépendance du Sénégal que l'on assiste à
une alternance démocratique grâce une coalition
dénommée Front de l'Alternance (FAL)30(*).
Le Président Wade nomme Moustapha Niasse au poste de
Premier ministre et approuve un gouvernement composé de tous les partis
qui lui ont apporté leur soutien électoral. Le
« Sopi » (changement) était enfin
réalisé.
Résultats du second tour 2000 :
|
CANDIDAT
|
SCORE
|
|
Abdoulaye WADE
|
58,5%
|
|
Abdou DIOUF
|
41,5%
|
4. L'équation : Crise ouverte +
Défections de cadres = Défaite
Donc le départ de plusieurs de ses responsables
nationaux et régionaux, qui ont suivi Djibo KA en 1998, puis Moustapha
Niasse en 1999, avait montré l'étendue des divisions au sein
d'une formation que l'on savait déchirée par des querelles de
« tendances ».
Seul le maintien d'une position électorale dominante
avait permis jusqu'ici de garder un semblant de consensus. En fait, depuis au
moins la fin des années 1980, la mission essentielle du parti
était, essentiellement, de constituer un relais électoral au
profit d'un leader, lui-même doté des pleins pouvoirs pour faire
et défaire ses équipes dirigeantes.
Le PS avait déjà connu des remous et des
désillusions avant les élections présidentielles de 2000.
Comme nous l'avons vu, dès 1988, après des élections
marquées par l'affermissement de l'opposition derrière Abdoulaye
Wade, et l'irruption d'une contestation urbaine de plus en plus difficile
à circonscrire, le parti socialiste avait dû passer par une
série de remises en question. Elles étaient illustrées par
la difficulté grandissante à tenir les congrès successifs
du PS sans étaler au grand jour les divergences de stratégies. On
peut penser cependant que le plus grand ébranlement pour le PS est venu
de l'expérience des gouvernements de majorité élargie qui,
à partir de 1991, a permis d'associer plusieurs partis d'opposition
à la gestion des affaires.
Habitués à la fusion des pouvoirs entre le parti
et l'Etat, les socialistes sénégalais ont eu du mal à
digérer cet amoindrissement, surtout symbolique, de leur position. Mais
les reculs électoraux successifs ont montré toute la
validité de leurs inquiétudes. La volonté de Diouf,
dès ces années-là, de « prendre de la
hauteur » et de s'écarter de la gestion du parti, a accru la
déstabilisation d'un parti qui supportait dès lors de moins en
moins de se voir considérer comme une simple machine à faire
voter, où un centralisme pesant tuait toute velléité de
débat. Le choix formulé dès 1995 de transmettre les
clés du parti à l'homme de confiance du Président, Ousmane
Tanor Dieng, a cependant été fatal.
Les autres prétendants à la succession, aussi
bien que les « barons » du PS n'ont pas supporté
d'être marginalisés par la faute d'un homme dont la
ténacité et le manque de diplomatie leur semblaient être
les principales caractéristiques. La suite est connue :
tentés de faire apparaître leur différence tout en restant
dans la maison, les chefs de file des courants
« légitimistes » ou
« rénovateurs » étaient
désavoués.
En initiant son
« renouveau démocratique », surtout
dirigé contre les nouvelles instances dirigeantes mises en place par
Tanor Dieng, Djibo Leyti KA s'est vu montré la porte de sortie. Il
entraîna avec lui quelques cadres, et emportait aussitôt un franc
succès aux élections législatives de 1998. La
défection de Moustapha Niasse était encore plus retentissante,
s'agissant d'un des hommes politiques du PS les plus chevronnés,
à la tête de vastes réseaux d'amitié et
d'intérêts au sein du pays.
Nombreux avaient été auparavant les socialistes
à s'inquiéter des conditions dans lesquelles Abdou Diouf avait
procédé, en 1998, à une refonte constitutionnelle qui
l'autorisait à se représenter pour un troisième mandat,
en l'an 2000. Conjugué avec l'adoubement d'Ousmane Tanor Dieng comme
successeur désigné, la décision a paru dangereuse et
inique car Diouf qui se posait lui-même en candidat de transition,
ne laissait dans le même temps aucune chance à la
compétition loyale entre prétendants socialistes. Les
dénonciations devenues criantes, du « centralisme
démocratique », y compris parmi les fidèles de Diouf,
ont montré quel était l'état d'esprit dominant.
Au sortir des élections, les socialistes ne savaient
plus à quoi se raccrocher. « Ils espèrent que la
déroute des présidentielles sera sanctionnée par le
départ de Ousmane Tanor Dieng » (Alioune Fall, du quotidien
Wal Fadri).
Conclusion
Au Sénégal, plus qu'ailleurs, on a le souci de
la convenance institutionnelle, et on a su, bien mieux qu'ailleurs, tirer tous
les fruits diplomatiques d'une excellente image de marque du pays. Une image
qui paraît excessive car Senghor n'a certainement pas inventé le
multipartisme en Afrique. Mais, il a su diffuser, avec élégance,
une belle image doté d'un vrai contenu : le Sénégal
était réputé pour sa culture, pour son enseignement
supérieur, pour sa justice et son administration. Cependant, les
étudiants révoltés de mai 68 à Dakar, aujourd'hui
au pouvoir, le savent bien, il en était tout autrement pour son
libéralisme politique.
Abdou Diouf a créé en 1981 la démocratie
sénégalaise, ou plutôt une forme adaptée de
socio-libéralisme, en instaurant le multipartisme intégral. Mais
le climat libéral ne fut jamais dans les années Diouf le synonyme
d'un jeu démocratique régulier.
Les élections de 1988 (comme nous l'avons
souligné à plusieurs reprises) se sont tenues dans la violence
pour se prolonger dans l'arbitraire avec l'arrestation des leaders
d'opposition. Elles ont surtout permit à Abdou Diouf d'affermir ses
positions au sein du « Parti-Etat » socialiste.
Les « gouvernements de majorité
élargie », ont abusivement été qualifiés
de « gouvernements d'union nationale ». Ils ont surtout
servi au maintien du statu quo, en brouillant aux yeux de l'opinion
les possibilités d'une alternance. Les élections de 1993 ?
Elles sont manifestement « entachées de fraude »
(selon nos interviewés), et donnèrent comme les scrutins suivants
l'exemple d'une faible maîtrise logistique des opérations
électorales. La modification constitutionnelle de 1998 ? Elle parut
« scandaleuse, et ne fut qu'une manipulation institutionnelle aux
seules fins d'ajouter un ultime mandat de sept ans à deux
décennies de règne sans partage de Diouf » (Demba
N'Diaye, rédacteur en chef du journal, Sud Quotidien). A quoi
on ajoutera une tradition de violences pré et post-électorales
endémiques, et surtout cet immobilisme tragique d'un système
socialiste vieux d'un demi-siècle, avec son lot de corruption
régulée et de clientélisme parasitaire, le déclin
économique fournissant une illustration dangereuse de ce blindage
politique. Pendant ce temps, et les intellectuels sénégalais
n'ont cessé de dire, relayés par une presse dont le
professionnalisme est à souligner (nous y reviendrons), que l'Afrique
changeait, quand le Sénégal se banalisait.
Les présidentielles de 2000, même si le recul
manque encore, sont exemplaires et dans la lignée des
législatives de 1998. Elles sont beaucoup plus satisfaisantes que les
précédents exercices.
Pour la première fois un observatoire (l'ONEL) a joui
d'une réelle indépendance. Pour la première fois, un
effort louable de « nettoyage » du fichier électoral
a été entrepris par un ministre de l'Intérieur, dans une
rare transparence (soulignons que le fichier était accessible sur
Internet) malgré la polémique des cartes d'électeurs.
Surtout, pour la première fois, le Parti Socialiste trouvait sur sa
route certains de ses anciens dirigeants, parfaitement conscients des
méthodes et ficelles du passé en matière de manipulation
électorale. Aussi, la fraude a paru spécialement limitée,
malgré quelques accrocs, au moment où la société
civile et les partis politiques montraient un remarquable savoir-faire dans le
quadrillage et le contrôle des procédures de vote sur tout le
territoire.
Tout ceci constitue beaucoup de points positifs. A quoi on
ajoutera le geste de Diouf, saluant la victoire de son adversaire avant la
proclamation officielle des résultats. Un beau geste (politique). Abdou
Diouf désarmait ainsi l'acrimonie et les envies de revanche de ses
ennemis d'hier et coupait court à toutes les velléités de
résistance extra-électorale de son camp. Il se donnait une figure
de digne démocrate au moment du retrait. Les sénégalais
ont fait leurs délices de cet acte politique, en oubliant que d'autres
ont pu l'accomplir, il y a déjà longtemps, en d'autres
circonstances. En 1990, Aristides Pereira, Président du Cap-Vert,
adressait par anticipation ses félicitations à son challenger.
Pour comprendre cet enthousiasme, il faut voir ce que
représente ces élections pour les sénégalais et
surtout, après les cadres politico-institutionnels, les conditions
sociales de cette alternance.
DEUXIEME PARTIE :
LES CONDITIONS SOCIALES DE L'ALTERNANCE.
PLAN
Introduction............................................................................................58
I / Une forte demande
sociale.................................................59
4. Une population excédée par la corruption...
.............................................60
5. ...Et la
pauvreté...................................................................................64
6. Un vote pour Wade ou contre
Diouf ?......................................................67
II / Une société civile
active....................................................70
- « Ma carte d'électeur, ma
force »..............................................................72
III / Le vote massif des
jeune..................................................74
- « L'alternance ou la
mort ».......................................................................76
- « Peu importe les
programmes »...............................................................77
IV / Le rôle des médias
privés................................................79
1. La presse
écrite...................................................................................80
2. Les radios et les langues
nationales.........................................................83
V / Les confréries
religieuses.................................................86
1. Importance de l'Islam dans la vie politique
sénégalaise..................................86
2. La crise du « Ndiguël » ou consigne
de vote................................................89
3. Le « Ndiguël »
timoré et inefficace en
2000................................................90
CONCLUSION..........................................................................................93
Introduction
Si les transformations institutionnelles et politiques ont
été sans conteste déterminantes dans le processus de
l'alternance politique au Sénégal, en mars 2000, les
véritables acteurs de ce changement sont les électeurs
sénégalais. Le chanteur prophétisait « l'an 2000
atoum na tangué la » (en français, l'an 2000
sera l'année de la prospérité) et Senghor, le
Président-poète, promettait : « en 2000 Dakar sera
comme Paris ». Il semble qu'à défaut de faire de Dakar,
un autre Paris, les sénégalais ont voulu faire de l'an 2000,
l'année d'un nouveau départ.
En effet, il faut voir dans l'alternance ou le
« Sopi » de l'an 2000, une forte demande sociale.
Les populations sénégalaises, excédées par la
corruption des dirigeants et la pauvreté ont décidé, pour
entrer dans le troisième millénaire, de remplacer le
régime socialiste après quarante années de règne.
Ce changement n'a été possible que grâce
à un vote massif des jeunes qui ont saisi l'opportunité qui leur
était offerte de voter à partir de dix huit, pour exprimer leur
mécontentement à Diouf et au Parti Socialiste.
Les médias privés ont, pour leur part,
contribué de manière significative à la transparence du
débat politique. En effet, la presse écrite, très critique
et essentiellement présente dans les centres urbains et les radios en
langues nationales permettant à la totalité des
sénégalais d'accéder à l'information ont
joué un rôle prépondérant dans les scrutins de
février et mars 2000.
Enfin, la crise du
« Ndiguël » ou consigne de vote des
confréries religieuses musulmanes du Sénégal est à
prendre en considération pour toute tentative de compréhension de
l'avènement du « Sopi ».
I / UNE FORTE DEMANDE SOCIALE
« Les événements dans les Balkans,
avec la chute de Milosévic, mais également l'évolution
démocratique au Mali et au Bénin ont fait , entre autre, que les
sénégalais avaient un peu honte, d'être les derniers de la
classe. Il y a un orgueil sénégalais qui été
touché car le pays avait toujours été placé en
tête des pays africains et cité en exemple de démocratie,
depuis Senghor. Donc, on a été frustré d'être les
derniers de la classe. C'était un mirage. On avait une démocratie
sans alternance et mieux on avait encore au Sénégal quelques
pratiques anti-démocratiques qui étaient intolérables. Il
s'agissait essentiellement des pouvoirs absolus du Président de la
République et de l'assemblée nationale qui n'était rien
d'autre qu'une chambre d'applaudissement pour les socialistes. Tout cela a
contribué au fait que les sénégalais aient dit
« Basta » à Diouf et au parti
socialiste. » (S. Kanté, journaliste au Cafard
Libéré).
Il faut dire que le Sénégal (plus
particulièrement ses dirigeants politiques) avec son multipartisme assez
précoce s'est toujours targué d'être le chantre de la
démocratie en Afrique et très souvent
célébré comme telle. Cependant, les personnes averties
n'étaient pas dupes, le Sénégal vitrine de la
démocratie n'était qu'un mythe. Toutes les fabrications
idéologiques, initiées par Senghor et consolidées par
Diouf, qui allaient dans le sens du renforcement de cette
légitimité historique de la démocratie
sénégalaise, étaient peut être encore
opérationnelles chez les bailleurs de fonds (ce qui n'est pas certain)
mais étaient devenus tout à fait inefficaces auprès des
sénégalais.
Il y avait chez les sénégalais et plus
particulièrement les jeunes une frustration politique due au sentiment
de vivre dans une démocratie confisquée, sans alternance. La
demande sociale était de changer cet état de fait.
En effet, il apparaissait aux yeux de beaucoup de
sénégalais que leur démocratie, malgré
l'instauration du multipartisme intégral, depuis 1981, participait d'une
logique d'affabulation n'ayant jusque là donné lieu ni à
des élections transparentes et sans contestations, ni à la
possibilité d'une alternance démocratique. Devant les subterfuges
du pouvoir, ce sentiment qui était largement partagé,
ajouté aux difficultés économiques et sociales de ces
dernières années présageait d'une issue politique
très incertaine pour le Parti Socialiste.
1. Une population excédée par la
corruption.
Savoir qui a initié le mouvement de renversement du
pouvoir socialiste, les partis politiques ou bien les populations
sénégalaise, nous semble relever de la même gageure que de
discuter de la question de la primeur de l'oeuf ou de la poule. Il est
cependant évident qu'il y a une forte demande sociale derrière
l'alternance politique sénégalaise. « En 1998,
l'opposition était encore partie aux législatives en ordre
dispersée. A l'époque, on remarquait déjà la
réduction continue de l'électorat socialiste et nous faisions des
projections pour dire que si la tendance se maintenait, le capital socialiste
aurait énormément de difficultés pour les
présidentielles de 2000. De là, il y a eu probablement la
pression de la demande sociale qui s'est fortement accentuée ces
dernières années.» (Alioune Fall, Le Matin).
La pauvreté endémique et la corruption
généralisée, surtout dans l'administration, qui aux yeux
des sénégalais, représente l'Etat, sont des
éléments de compréhension.
« Les sénégalais ont voté pour
Wade pour rompre avec le passé. On avait besoin d'un changement de
système. Moi j'ai été dans l'administration et je sais
comment on s'y enrichit. Vous voyez un agent qui normalement gagne 80 000 F
CFA (800 FF) vivre avec 500 000 F CFA/mois. Un fonctionnaire est puissant dans
ce pays. Il peut bloquer un milliardaire parce que tout simplement il a un
pouvoir de signature. La corruption des policiers et le racket qu'ils exercent
sur les citoyens est un autre fléau dans ce pays. Et cette corruption
est notable à tous les niveaux de l'Etat. Un ministre gagne
normalement 400 000 F CFA mais on leur octroie un million en plus. C'est
lamentable. Moi je veux bien qu'on dise qu'un ministre doit être bien
payé quitte à lui donner 5 millions/mois mais vous n'avez pas le
droit de faire des dessous de table. Et ça c'est le sentiment de
beaucoup de sénégalais.» (M. T, journaliste au quotidien
Le Populaire).
Aussi les sénégalais avait l'impression que leur
démocratie, tant vantée à l'extérieur
était gangrenée de l'intérieur, par quarante années
de pouvoir socialiste. Les performances économiques leur semblaient
dérisoires et Diouf était le coupable désigné.
« Ils voulaient à tout prix faire partir Diouf et le PS parce
qu'ils avaient accaparé l'assemblée nationale. Toutes leurs
décisions passaient comme lettres à la poste. Ils avaient la main
mise sur la justice qui n'osait pas prendre des décisions contraires aux
intérêts des hommes politiques au pouvoir, sans oublier
l'enrichissement illicite, les détournements de fonds etc. »
(Mouhamed. B. Diop, rédacteur en chef du quotidien Le Matin).
En fait, la politique de main basse sur l'économie,
déjà présente sous Senghor, s'est renforcée avec
une plus grande visibilité sous le règne de Diouf. Peut
être que l'accroissement de la pauvreté et la rareté des
ressources l'ont rendu plus inacceptable aux yeux des populations
laissées pour compte. En effet, Senghor avait réussi (grâce
à sa complicité naturelle avec la France), à entretenir,
sans beaucoup de perturbations, l'illusion de la « vitrine
démocratique sénégalaise ». Son successeur,
Abdou Diouf, a eu moins de chance (desservi par le contexte économique),
mais, peut-être aussi, moins de tact. Cela explique le fait que ce soit
sous le règne de Diouf qu'il y a eu les premières
véritables crises de légitimation de type autoritaire. Car
à la fin des années 1980, et surtout à partir de 1988, le
modèle clientéliste sénégalais qui avait si
brillamment réussi, commençait à montrer des signes
d'essoufflement. La situation dans laquelle existait une sorte de contrat
social liant, par des arrangements politiques d'assistance mutuelle, l'Etat
d'un coté les patrons politiques et les marabouts de l'autre
commençait à battre de l'aile.
Pourtant le président Diouf, conscient des
montées de la contestation, avait initié un ensemble de
réformes institutionnelles : un gouvernement de majorité
présidentielle qu'on peut interpréter comme une sorte de
démocratie consensuelle avec des avantages et des inconvénients,
l'élaboration d'un code électoral, la libération de
l'espace radiophonique, la création de l'ONEL, la nomination d'un
ministre de l'intérieur supposé neutre parce que provenant de la
« grande muette » (l'armée), l'adoption d'une option
technocratique qui marquait la volonté de rompre avec le système
du « Parti-Etat ».
Cependant, il est illusoire de croire que les ajustements
introduits par le président Diouf ont réussi à mettre un
terme au clientélisme et à effacer les logiques autoritaires et
néo-patrimoniales. En effet, au même moment où il
procédait aux réformes signalées plus haut et
considérées comme positives pour l'affirmation d'un état
et d'une société démocratique, le pouvoir du P.S renouait
avec la logique néo-patrimoniale, en prenant une série de mesures
consécutives, dont le seul but était d'enrichir les dignitaires
du régime afin de leur donner des moyens suffisants pour l'entretien de
la clientèle électorale.
Il procéda ainsi à l'augmentation de 33% de
l'indemnité journalière des gardes de corps de l'Etat et des
dépenses diplomatiques, à l'augmentation de 34% des salaires des
matérielles de l'Etat et de 33% du budget de l'assemblée
nationale.
Comme dans tout système néo-patrimonial, l'on
préférait assurer la promotion des
« notables » et autres « patrons
politiques », ce qui pourtant annihilait tous les efforts consentis
par les populations dans le cadre du rétablissement des
équilibres macro-économiques visés par les programmes
d'ajustement structurel.
Seulement, la logique néo-patrimoniale fondée
sur la satisfaction des besoins des « parents politiques »
ignorait les solidarités sociales et méconnaissait les
compassions. La preuve la plus éclatante pour le Sénégal,
c'était l'augmentation de députés (de 120 à 140)
à laquelle procéda le PS en 1998 et la création d'une
nouvelle institution (le Sénat) dont certains des membres étaient
nommés directement (donc non élus) par le Président de la
République. La « privatisation » de la politique
était faite que le « prince » (détenteur du
pouvoir exécutif) avait un droit de regard sur le pouvoir
législatif, en ayant la possibilité par exemple, de
désigner des sénateurs qui étaient comme ses
représentants personnels dans les institutions législatives. Il y
avait une véritable absence de distinction entre domaine privé et
domaine public, ce qui caractérise aussi un système
patrimonial.
Pendant que Diouf procédait à l'augmentation du
nombre de députés, malgré la désapprobation
générale, plus d'une centaine de diplômés de l'Ecole
Normale Supérieure de Dakar faisait la grève de la faim pour
réclamer leur recrutement dans un secteur éducatif qui manquait
cruellement de professeurs. Face à l'indignation et à la
colère des populations, la seule réponse de l'Etat a
été : « il faut qu'une majorité serve
à quelque chose ».
Alors, force était de constater que face aux exigences
de la politique locale, les injonctions des institutions financières
internationales et des puissances politiques extérieures, l'Etat
néo-patrimonial sénégalais était en crise. Tout
cela se faisait avec une telle dextérité que les partenaires
stratégiques internationaux ne purent pas (ou ne voulurent pas)
percevoir que la légitimité déjà chancelante de
l'Etat socialiste avait atteint un seuil critique. Seuil d'autant plus critique
que les effets pervers de l'Etat néo-patrimonial étaient
désormais révélés au grand jour par les
médias qui n'ont cesse de contester le modèle étatique
sénégalais et de dénoncer les nouveaux
procédés de légitimation du pouvoir socialiste.
Dès lors, ni le marketing d'Etat savamment
orchestré pour faire effet sur l'extérieur, ni le verrouillage de
l'appareil judiciaire, ni le déploiement du système de
répression policier, ne pouvaient empêcher l'expression des
ressentiments d'une jeunesse en rupture profonde avec le régime
quarantenaire du PS, et qui constituait plus de 40% de l'électorat
sénégalais. Tous les ingrédients du scénarios de
1988 étaient réunis en l'an 2000, prêts à exploser,
sans possibilité d'être contenus cette foi-ci, par un quelconque
leader politique, fut-il charismatique et historiquement légitimé
pour porter la contestation sociale.
2. ...Et la pauvreté
Les électeurs sénégalais en changeant de
gouvernants aspirent à l'arrêt de la gabegie et de la corruption.
Ils appellent une justice pour tous et surtout l'amélioration de leurs
conditions de vie. Au Sénégal, plus d'un tiers de la population
vit encore en dessous du seuil de la pauvreté, et un jeune sur deux n'a
pas d'emploi en zone urbaine31(*). Dans ces conditions, même la crise de
distribution qu'évoquait Lucian W. Pye comme un facteur stimulant de
développement politique32(*), n'aurait aucun sens, tout simplement parce qu'il y a
rien à se distribuer ou à s'approprier. La dégringolade de
l'économie sénégalaise est donc l'un des principaux
éléments, sinon la principale, à l'origine de
l'effondrement du PS.
Depuis la dévaluation du franc CFA en 1994, le produit
intérieur brut (PIB) augmente chaque année de 5% en moyenne, et
après le redressement des finances publiques, le déficit
budgétaire ne dépasse pas 1,2% du PIB. Avec une inflation
enviable de moins de 2%, le Sénégal est aujourd'hui l'un des pays
de l'Union Monétaire Ouest-africaine (UEMOA) à créer le
plus de richesse. C'est justement ce que le PS au pouvoir saluait comme une
« performance », après l'évolution chaotique
des années 1970-1985. Ces performances macro-économiques et le
respect des programmes de réformes structurelles,
préconisés par les bailleurs de fonds, ne servaient cependant
qu'à améliorer l'image externe d'un Sénégal qui
revendique le titre de bon élève des institutions de Brettons
Woods.
S'il est aujourd'hui un pays qui se veut à la fois un
« modèle de démocratie et de
stabilité » et un « défenseur de
l'économie de marché » en Afrique noire, le
Sénégal n'en demeure pas moins extrêmement pauvre. Tout en
recevant chaque année 600 millions de dollars d'aide
étrangère, il manque pourtant de l'essentielle : l'eau et
l'électricité. Et du fait d'une croissance trop faible pour
absorber l'impact de la croissance démographique (2,8% en 1997), de la
rigueur de l'ajustement, et de stratégies erronées, la situation
sociale des sénégalais s'est sensiblement
détériorée au cours des vingt dernières
années, en ville comme dans les campagnes.
La récession économique persistante a pris fin
en 1994. Le déficit de la balance des paiements a atteint son point
culminant en 1993 et le déficit budgétaire en 1994. Dans le
même temps, on a noté comme effets induits de la
dévaluation une augmentation de la dette extérieure et
intérieure ainsi qu'une plus grande accumulation des
arriérés. Le club de Paris a procédé en 1994 et
à nouveau en 1998 à des facilités perceptibles.
L'amélioration stable de la situation budgétaire sans subventions
extérieures pour les dépenses courantes, s'est amorcée
tandis que le déficit budgétaire estimé à 36,8
milliards de F CFA était en 2000 à 25,1 milliards de F CFA.
Mais non seulement l'aide, mais aussi les fruits de la dite
croissance économique, sont très mal répartis. Or, au
sommet de l'échelle, un cinquième de la population s'accapare 58%
des richesses, et au bas de celle-ci, un autre cinquième vit avec
seulement 3% du revenu national. Nous n'allons pas, ici, détailler
toutes les statistiques concernant la situation socio-économique
sénégalaise, qui dépasse largement l'objectif principal de
notre analyse. Nous nous bornerons à l'explication minimale des choses,
indispensablement importantes.
En réalité, les réformes entreprises au
Sénégal ne sont pas mises en oeuvre avec plus de succès
qu'ailleurs. Le prix de l'énergie, bien sûr, mais aussi celui de
la main-d'oeuvre et du transport ne sont pas compétitifs. Autant dire
que la croissance sénégalaise est soutenue, une fois de plus, par
l'aide extérieure33(*). De gré ou de force le Sénégal
participe à ce que le FMI et la Banque mondiale appellent la
« bonne gouvernance », mais son économie
présente encore aujourd'hui, pour les contribuables
sénégalais, les mêmes blocages structurels qu'il y a vingt
ans.
Aussi, pour les électeurs, il s'agissaitt bien d'un
problème de gestion et de transparence, consécutifs à
l'absence de contrepoids au pouvoir socialiste et d'une discipline interne.
Les populations excédées par cette situation
voulaient chan ger les gouvernants en espérant qu'en changeant les
hommes, les nouveaux pourront résorber le chômage des jeunes,
réformer le système éducatif paralysé depuis une
décennie par des grèves et surtout réduire cette
pauvreté, qui a atteint des proportions alarmantes surtout dans
l'agglomération dakaroise.
En effet, l'exode rurale, la migration vers les villes et
principalement la capitale se développe de manière
dramatique ; la pauvreté touchant surtout les habitants des zones
rurales. Mais cela n'exprime que de manière relative la misère
dans les banlieues de Dakar. La situation de pauvreté se reflète
aussi dans la répartition des revenus : les 20% de la population du
bas de l'échelle détiennent 3,6% de la globalité des
revenus, tandis que les 20% du haut de l'échelle détiennent
environ 58% de la globalité des revenus34(*).
La situation socio-économique touche, de manière
particulièrement dure, les femmes et leurs bases économiques,
l'accès à la terre, au travail, à l'éducation, aux
crédits, aux marchés etc. Bien que les femmes représentent
53% de la population, leur part dans la population active est seulement de
39%.
3. Un vote pour WADE ou contre DIOUF?
Au travers des entretiens que nous avons
réalisés, il s'avère que les sénégalais ont
voté pour faire battre Diouf, qui est responsable, à leur yeux,
de la crise économique et du chômage, plutôt que pour
élire Wade. A ce stade de l'analyse, il nous faut revenir sur ce dernier
pour comprendre un peu mieux la situation.
Il faut dire que Abdoulaye Wade est autant un personnage
qu'un phénomène politique pour beaucoup de
sénégalais. A 74 ans il partait avec un certain handicap car pour
certains, il était un homme du passé. Ce à quoi son camp
politique répondait dans la presse, en citant le cas de Nelson Mandela,
devenu président à 72 ans en ayant passé trente ans en
détention.
La comparaison est osée, mais non absurde. Après
trente années dans l'opposition, Wade a montré sa
ténacité et s'est forgé une identité. Ainsi il
apparaissait à l'orée du troisième millénaire comme
un de ceux qui pouvaient incarner le mieux l'alternance ou
« Sopi » (le changement), un slogan magique qu'il avait
trouvé dans ses premières années de campagne.
Aussi, il n'est pas exagéré de dire que le
l'homme s'est identifié à ce slogan, devenu le seul signe de
ralliement pour une jeunesse désenchantée et toute une population
urbaine qui s'est vu rattrapée au fil des années par la
paupérisation.
Si les sénégalais voulaient se
débarrasser de Diouf, « trop éloigné des
réalités du peuple » Wade fait, lui aussi figure de
nanti, dont le style de vie l'éloigne du sénégalais moyen.
Juriste de formation et ancien doyen de la faculté de droit de Dakar,
l'avocat d'affaires aura passé une bonne partie de son existence
politique à l'étranger, d'où il rentrait rituellement
avant chaque période électorale pour un
« retour » au pays soigneusement organisé par ses
sympathisants.
S'il s'est toujours revendiqué libéral, ses
alliances dans l'opposition l'auront toujours porté vers les partis de
gauche, d'obédience marxiste plus ou moins affirmée, qui ont
constitué (comme nous l'avons déjà souligné), le
« noyau dur » de la Coalition Alternance 2000. Wade est un
paradoxe vivant pour beaucoup de sénégalais. Son discours a
souvent été excessif, voire incendiaire, et son goût des
grands effets oratoires est mieux conçu pour électriser les
foules des meetings que pour présenter une programmation politique
mesurée35(*).
Pourtant, derrière les sorties à grand
spectacle, se dissimule un vrai pragmatisme, un « opportunisme de
fond » (que ne cessent de rappeler ces adversaires).
Comme nous l'avons déjà souligné, plus
d'une fois, Abdoulaye Wade, périodiquement arrêté pour
« troubles de l'ordre public », a failli être
éreinté par la toute puissance conjuguée du PS et de
l'administration en place, ses fonds dilapidés, sa machine
électorale en panne et surtout sa réputation en berne
après ses multiples entrées aux « gouvernements de
majorité élargie » ou « gouvernements de
partage du gâteau » pour les sénégalais. Il a
toujours su rebondir, quitte à trahir ses alliés, tout en sachant
faire à ses militants des revirements calculés.
Tout ceci fait que la thèse qui veut que les
sénégalais aient voté plus contre Diouf que pour Wade soit
plausible. D'ailleurs, Abdoulaye Wade ne l'aurait certainement pas
emporté sans l'appui décisif de Moustapha Niasse. L'ancien
« baron » socialiste lui a donné, du moins aux yeux
de beaucoup de sénégalais, la caution d'un homme politique
respecté, désireux par-dessus tout calcul stratégique de
mettre fin à l'immobilisme des années Diouf, même au prix
d'une alliance avec le « diable ».
Donc, les sénégalais voulaient-ils plus le
départ de Diouf que le « couronnement » de
Wade ?
Pour Abdoulaye Barry (journaliste à la RTS), il s'agit
plutôt d'un vote sanction : « Je ne crois pas que ce soit
Wade, en personne, qui a battu Diouf. Les sénégalais avaient
décidé de sanctionner Diouf et je pense qu'ils auraient
voté pour n'importe qui. Le scrutin de février-mars 2000 aura
été un vote sanction. Dans la mesure où il y avait une
réelle possibilité de faire battre le président sortant,
à un second tour inédit, les électeurs se sont rendus dans
leur majorité aux urnes pour le sanctionner. » Un point de
vue que corrobore Boubacar Seck, (rédacteur en chef du Matin).
Pour ce dernier, « Les sénégalais ont senti que
l'opposition était entrain de faire bloc, autour de Wade. C'était
la première fois qu'ils sentaient avec les départs de Niasse et
de Djibo KA, qu'au deuxième tour, il y avait la possibilité de
faire partir Diouf . Le besoin d'alternance a été tellement
fort que la classe politique s'est trouvée prise en otage par cette
pression qui venait des populations. Les électeurs n'auraient jamais
accepté que les idéologies politiques ajournent l'alternance.
Nous en avons un exemple précis. Djibo KA qui choisi au second tour de
soutenir Diouf a aujourd'hui d `énormes difficultés pour
revenir au devant de la scène politique.»
Pour beaucoup d'observateurs, de la politique
sénégalaise, les électeurs ont voté plus pour
le changement que pour Wade. « Avec un autre candidat, ils auraient
fait la même chose. On a voté contre Diouf parce que les gens
avaient soif de changement. Il fallait que ça change. Wade était
celui qui représentait le plus le « sopi » et avait
le plus de chance après quatre tentatives. » (Mamadou. T.
Talla, du quotidien Le Populaire)
Aussi, les bons chiffres de la croissance, la réduction
du déficit budgétaire ou encore l'inflation
maîtrisée que Diouf avait avancés pour se défendre
pendant les campagnes, n'ont pas produit les effets escomptés, car
ceux-là ne sont pas autant synonymes d'amélioration des
conditions de vie de couches de plus en plus importantes de la population. Les
populations excédées par la pauvreté grandissante,
l'insécurité de plus en plus insupportable ont voulu se
débarrasser du régime qui à leur yeux en était
responsable.
Pour l'ensemble des personnes interrogées, les
sénégalais avaient atteint un tel niveau d'exacerbation que la
défaite de Abdou et du Parti Socialiste était inéluctable.
II / UNE SOCIETE CIVILE ACTIVE
« les régimes démocratiques se
distinguent par l'existence, la légalité et la
légitimité d'une variété d'organisations et
d'associations qui sont réellement indépendantes par rapport au
gouvernement aussi que l'une vis-à-vis de l'autre. »36(*)
Bertrand Badie considère qu'une société
civile dans sa construction repose sur trois principes : « La
différenciation des espaces sociaux privés par rapport à
l'espace politique ; l'individualisation des rapports sociaux qui
confère ainsi à l'allégeance citoyenne une valeur
prioritaire ; l'horizontalité des rapports à
l'intérieur de la société qui fait préférer
la logique associative à la structure communautaire et qui, à ce
titre, marginalise les identifications particularistes au profit de
l'identification stato-nationale. »37(*) Cela semble limiter considérablement la
possibilité d'existence de sociétés civiles sous les
tropiques, or, dans le cadre sénégalais, il y a bien eu une
manifestation de la société civile.
Il faut dire que l'effritement progressif du pouvoir
socialiste s'est accompagné, depuis la fin des années 1980, d'une
perte d'influence du mouvement syndical officiel, représenté par
la Confédaration Nationale des Travailleurs Sénégalais
(CNTS), de plus en plus battue en brèche par des syndicats autonomes.
Parmi les secteurs les plus sensibles, le syndicat des travailleurs de
l'électricité, dont est issu Mademba Sock (candidat aux
présidentielles de 2000), ou le Syndicat unique et démocratique
des enseignants du Sénégal (SUDES) ont mené de nombreuses
actions ces dernières années. La grève
générale de juin 1999, la troisième de l'histoire du
Sénégal, suivie très massivement, a montré, dans un
contexte économique déprimé, la force de mobilisation des
travailleurs, qui ont obtenu un certain nombre de concessions du
gouvernement.
Plus ou moins structurée, la contestation
étudiante est aussi une constante du paysage politique
sénégalais, même si sa vigueur est moins grande qu'au
début de la décennie.
La presse, réputée l'une des meilleurs du
continent, a vu sa physionomie se stabiliser ces dernières années
avec plusieurs quotidiens indépendants à la parution
régulière, en plus du quotidien officiel, Le Soleil. Si
la presse écrite touche une élite urbanisée, le
développement de radios FM et la diffusion de programmes en langues
nationales a beaucoup étendu l'influence d'une presse volontiers
critique à l'égard du pouvoir, et constitue désormais un
vecteur du pluralisme non négligeable.
Les changements qui sont intervenus au Sénégal
ont été imposés aux anciens dirigeants du pays car
l'ancien gouvernement ne pouvait pas continuer à tromper le peuple pour
se maintenir au pouvoir. Ce n'était plus possible parce qu'il y avait
une évolution sur le plan international mais aussi et surtout au niveau
local notamment avec l'émergence d'une société civile
consciente à travers les ONG, les syndicats, des groupements de
différentes catégories socio-professionnelles. Il s'agit
principalement des groupements de femmes, d'intellectuels, de journalistes etc.
En fait tout ce qui fait parti, un peu, de la gouvernance locale. Les
différents groupements ont exercé, à un moment
donné, dans un secteur précis, des pressions sur le
gouvernement.
Les intellectuels sénégalais, très
conscients des enjeux politiques, trouvent à s'exprimer dans la presse
et participent à nombre de conférences ou réunions de
réflexions. Certains occupent des postes importants au sein de
l'administration, tout en gardant une certaine liberté de ton. Leur
critique, de plus en plus acerbe, de la démocratie
sénégalaise qu'ils ont longtemps qualifié de
« démocratie sans alternance » est illustrée
par les travaux ou les prises de position d'universitaires comme Mamadou Diouf,
Momar Coumba Diouf, Kader Boye, Amady Ali Dieng, ou encore l'histoirenne Penda
Mbow. Les écrivains et les artistes sont généralement plus
en retrait, à l'exception notable de la valeur montante de la
littérature sénégalaise, Boubacar Boris Diop.
Cependant, il faut relativiser, la force de cette
société civile. Les militants des droits de l'Homme,
réunis notamment au sein de l'ONDH, savent se faire entendre, mais ne
contribuent que marginalement au débat politique, encore largement
assumé, c'est une constante dans ce pays où le multipartisme est
une réalité ancienne, par les partis constitués. En effet,
cette société civile n'est pas très
appréciée par les partis politiques. Un exemple illustre
parfaitement ce dépit des politiciens.
Le 27 juillet 2000, le tribunal correctionnel de Dakar
condamne le directeur de publication d'un quotidien sénégalais
à trois mois de prison avec sursis et 5 millions de F CFA de dommage et
intérêts. Les faits remontent au 17 Septembre 1999, lorsque ce
quotidien titrait : « Les ONG se jettent sur les dollars de
l'Usaid .» (Une agence américaine pour le développement
international). Jean-Paul Diaz, le chef d'un parti politique y faisait une
sortie virulente contre un collectif d'ONG. Onze d'entre elles avaient, en
effet, perçu 160 millions de F CFA de l'Usaid pour mener une campagne
destinée à inciter les sénégalais à
s'inscrire massivement sur listes électorales, en vue de la
présidentielle de février-mars 2000.
« Cet argent, écrivait J.-P Diaz,
également député, sert à enrichir les responsables
de ces ONG, alors que ce travail, les partis politiques le font très
bien. » Se sentant diffamées, les ONG ont porté plainte
mais le député, protégé par l'immunité
parlementaire, ne s'est jamais présenté au tribunal et c'est le
journal qui a été condamné. Cette affaire illustre bien
les relations heurtées entre les partis politiques et les ONG qui font
connaître leurs droits et leurs devoirs aux citoyens.
- « Ma carte d'électeur, ma
force »
Pour ces organisations, l'élection
présidentielle a été un temps fort. Pendant plusieurs
semaines, le collectif a organisé des rencontres dans les quartiers,
notamment populaires. Causeries, débats et sketchs étaient au
menu pour pousser les gens à s'inscrire et à retirer leur carte
d'électeur.
Pour évaluer leurs activités, les ONG avaient
une astuce : contre la présentation de son
récépissé d'inscription, le futur électeur avait
droit à des cadeaux, notamment des tee-shirts sur lesquels on
lisait : « ma carte d'électeur, ma force »,
avec en surimpression le baobab, emblème du Sénégal. Des
millions d'autocollants ont aussi été distribués avec ces
puissants slogans : « s'inscrire, c'est choisir l'avenir de son
pays » ou « je retire ma carte et je vote ».
Collés sur les pare-brise des véhicules, dans les lieux publics
et dans les foyers, ces messages n'ont laissé personne
indifférent. D'autant que ces tee-shirt, épinglettes,
autocollants, affiches didactique ont aussi été distribués
dans les campagnes.
De fait, les électeurs se sont inscrits en masse
d'où le taux de participation record de 61,12% enregistré aux
élections. Ces acteurs de la société civile ne se sont pas
arrêtés là. Le Forum civil, une émanation du
collectif des ONG, a aussi invité les candidats à la
présidentielle à présenter leur programme devant des
experts afin de les mettre devant leur responsabilité et éviter
les sempiternelles promesses politiciennes. Il a combattu pour la transparence
du scrutin dont le fichier électoral, pomme de discorde entre
l'opposition et le parti au pouvoir, constituait le pivot.
Pour éviter les violences post-électorales, ce
collectif a même réussi à décrocher les signatures
d'Abdou Diouf et de son challenger Abdoulaye Wade, les engageant à
accepter le verdict des urnes quelle qu'en soit l'issue. Ce qui fut fait :
vaincu, le président Diouf a félicité Wade ; ceci
à un moment critique où tous les sénégalais
s'attendaient à « un coup de force » d'autant plus
que depuis 1988, ils étaient habitués à ce que des
violences ponctuent toutes les élections au Sénégal.
« Aujourd'hui c'est un sentiment de fierté qui m'anime. Nous
sortons d'élections non contestées et sans
violences... » se glorifiait Mazide N'Diaye, président du
Front d'action de la société civile (FASC), au lendemain des
élections.
III / LE VOTE MASSIF DES JEUNES
Les élections présidentielles des 27
février et 19 mars 2000 auront donc été marquées
par un fort taux de participation (61,12%) contrairement aux
législatives de 1998 qui avaient été boudées par
les électeurs avec seulement 39% de votants.
Les sénégalais ont été
manifestement passionnés par ce scrutin qui a entraîné une
forte mobilisation des militants et sympathisants de l'opposition et du pouvoir
socialiste. D'ailleurs les observateurs avaient noté qu'aux
premières heures des deux dimanches de scrutin, les files
d'électeurs venus accomplir leur devoir civique ne cessaient de
s'allonger. Affichant une sérénité à toute
épreuve et dans une ambiance bon enfant, les électeurs se sont
succédés en grand nombre dans l'isoloir, ensuite devant les
urnes, pour exprimer leur choix. Il faut souligner que si les femmes ont
été très nombreuses à avoir gagné les
bureaux de vote, c'est surtout le déplacement massif des jeunes qui a
été déterminant.
Il faut souligner que les femmes, d'un poids significatif
dans l'électorat, ont aussi commencé à s'éloigner
du PS dont elles constituaient jusqu'ici la principale force. Au vu du
tassement, pour ne pas dire de l'effondrement de l'électorat de Diouf,
dans les principaux centres urbains et dans certaines communes de
l'intérieur du pays, le vote des femmes a basculé au profit de
l'opposition, notamment de son principal chef, Abdoulaye Wade.
Maintenant, le fait nouveau est le vote des jeunes. Bon nombre
d'entre eux n'étaient pas encore nés au moment où le
président Abdou Diouf accédait pour la première fois au
pouvoir en 1981. La conception du pouvoir et de la politique de cette
génération est totalement différente de celle de ces
devancières. Si leurs grand-parents et parents ont vécu les
années de la colonisation et/ou d'indépendance sous Senghor, il
n'en est rien pour cette génération. En effet, leurs
repères politiques et leurs représentations du politique sont
radicalement différents. Si les leurs grands-parents et parents
entretenaient avec le pouvoir et les hommes politiques une relation
distanciée, à la limite de la crainte et/ ou de la
vénération, la « génération Abdou
Diouf » a opéré une rupture avec cette relation
gouvernants intouchables/ gouvernés soumis et fatalistes.
Il faut rappeler que pendant très longtemps,
l'électorat sénégalais était
« vieux » et essentiellement composé de personnes
qui, pour la plupart, ont vécu les dernières années du
système colonial ou du « Sénégal de
Senghor »38(*)et
parlent encore du Président de la République en terme de
« Bour » (roi en Wolof), de
« Boroom Rew Mi » (celui à qui
appartient le pays) ou encore de « Boroom
Ngour Gui » (Celui à qui
appartient le trône).
Le Président de la République est perçu,
aujourd'hui encore, par les plus âgés comme un
« Bour » (roi) ayant, à sa disposition, un
peuple assimilé à des sujets et non pas comme quelqu'un qui
détient sa légitimité de la seule volonté
populaire.
Or plusieurs facteurs ont contribué à ce que la
jeune génération se soit forgée une mentalité
citoyenne. Contrairement à ces devancières, elle a
été bercée par les discours virulents de l'opposition, les
revendications et les émeutes post-électorales.
Beaucoup plus scolarisée et ouverte sur le monde, c'est
une génération qui a grandi dans l'explosion des
télécommunications et des médias privés. De ce
fait, elle a pu assister, sans censure, aux mutations qui sont intervenus sous
des cieux lointains (la chute du mur de Berlin, la dislocation du bloc
soviétique et la démocratisation de ses anciennes
républiques, La rue chassant Milosévic en ex-Yougoslavie, etc)
tout comme celles qui ont eu lieu sur le sol africain (les sorts de Moussa
Traoré, Hussein Abré, Robert Gueï, etc). Donc elle a pu
réaliser que ce sont les hommes qui font leur histoire et que les
peuples pouvaient avoir un certain pouvoir.
Ces jeunes, dits de la génération Abdou Diouf,
auront beaucoup pesé sur l'issue du scrutin. Incarnant le vote
protestataire contre le régime en place, sous le charme constant du
charismatique leader de l'opposition (Abdoulaye Wade), les jeunes ont voulu en
s'inscrivant en grand nombre sur les listes électorales, voter
massivement en faveur de l'opposition et sanctionner le gouvernement socialiste
sénégalais en matière d'emploi et de politique de
jeunesse.
Chaque année, quelques 100 000 jeunes atterrissent sur
le marché de l'emploi avec le maigre espoir d'être
insérés dans le circuit de production. Le camouflet qu'a subit le
président Diouf est en grande partie dû au vote des jeunes qui
tenaient ainsi à exprimer un certain ras-le-bol.
Sans conteste, la mobilisation de cette principale
catégorie de la population sénégalaise (60% de la
population sénégalaise a moins de 20 ans) aura
lézardé la muraille socialiste au premier tour, en plaçant
le candidat Diouf en très mauvaise posture, avant de la démolir
au soir du second tour.
« Entre 1988 et 2000, il s'est passé douze
ans, et ceux qui étaient en 1988 dans la rue à jeter des pierres
ont eu la majorité électoral en 2000. Donc ils étaient
conscients de leur poids. C'est le vote jeune qui a véritablement
amené l'alternance. » (M. B. Diop, Le
Témoin).
- « L'alternance ou la
mort »
Si les sénégalais n'étaient plus
prêts à accepter des élections aux modalités
vaseuses, ils étaient pour beaucoup convaincus, et c'est un fait
nouveau, que l'alternance politique était, en 2000, possible.
C'était un facteur bien évidemment à hauts risques car en
cas de défaite de l'opposition au président Diouf, bon nombre de
ses militants auraient été convaincus que la victoire leur aura
été volée. D'où le slogan,
« l'alternance ou la mort », que l'on a pu voir poindre sur
les affiches du candidat Diouf.
« Il fallait aller s'entretenir avec les jeunes du
Parti démocratique sénégalais (PDS), du côté
de Pikine, pour mesurer leur état d'esprit. Ils n'avaient que faire de
l'âge du capitaine, en l'occurrence, les 73 ans de Wade. Ils n'avaient
strictement plus aucun espoir d'une vie meilleure si rien ne
changeait. » (Abou Abel Thiam, Wal Fadjri).
En effet, diplômés ou non, le lot commun de
beaucoup de jeunes sénégalais, c'est le chômage, avec des
conditions de vie sociale bien difficiles. Et, bien maladroit, le PS,
conseillé par l'éminent Jacques Séguéla, a
donné lui même le bâton à ses adversaires pour se
faire battre, en ayant axé sa campagne électorale sur le
thème du « changement ». Or pour les jeunes, le
changement, le « Sopi » ne pouvait, en aucun cas,
être incarné par Diouf.
Le candidat Diouf ayant déclaré au cours de son
premier meeting de campagne : « Notre peuple aspire à des
changements plus profonds et substantiels, je me suis présenté
pour réaliser ces changements », les jeunes lui
répondent sur les affiches. En effet, là où était
écrit « le siècle change,
signé Abdou Diouf », des mains anonymes avaient
réécrit : « le siècle
change, sans Abdou Diouf ».
Certains responsables PS ont aussi contribué à
cet autodafé. « Quand un ministre annonce que le gouvernement
va créer en l'an 2000 des milliers de points d'alimentation en eau
à Pikine, une grande banlieue déshéritée de Dakar,
c'est mettre le doit où ça fait mal . Diouf était au
pouvoir depuis 1981 et que l'on sache, Pikine n'est pas sorti de terre la
veille au soir. Un autre responsable socialiste, toujours à Pikine, a
cru bon de déclarer en substance, et s'adressant à la
jeunesse : « la solution à vos problèmes,
l'emploi, etc., réside dans la politique d'Abdou Diouf.» Il est
évident que les jeunes pouvaient se demander si Diouf était la
solution ou la cause. » (Abou. A. Thiam, Wal Fadjri).
Aussi, les jeunes disaient-ils, à qui voulait
l'entendre, à la veille du scrutin : « cette
élection est celle de la dernière chance ». Ils ont
beau lire et relire les publi-reportages commandités par la
présidence dans la presse internationale notamment, les pourcentages
ronflants sur le taux de croissance, ça ne leur donnait pas l'eau et
encore moins du travail. Les jeunes avaient compris que
l'arithmétique populaire n'avait que faire des chiffres macro
économiques. Le Parti socialiste avait bien conscience de cela et
promettait, pendant les élections, de redistribuer les dividendes de la
croissance. Ce qui peut paraître comme une étonnante et bien
tardive prise de conscience.
« Peu importe les
programmes »
L'échec socio-économique est tel, à la
veille des élections, que si les sénégalais et surtout sa
frange la plus jeune, veulent le changement, ce n'estt sûrement pas en
fonction des programmes que leur agiteraient sous le nez les opposants. C'est
d'abord et avant tout par rejet de la situation présente, un ras-le-bol
d'un mal de vivre qui dure. Et c'est un état d'esprit bien difficile
à canaliser.
Devant le forum civil, une instance représentant
diverses catégories socioprofessionnelles, qui a auditionné
chaque candidat sur son programme, Abdoulaye Wade a beau dire, tout, n'importe
quoi et son contraire, lorsqu'il expose son programme de gestion s'il est
élu, il est quand même applaudi par la salle. Peu importe s'il
s'englue en voulant concilier son penchant pour le
« libéralisme économique », avec les
exigences de souveraineté et de politique sociale que lui
réclament ses principaux alliés politiques, de gauche. Peu
importe s'il ose dire qu'avec lui, le Sénégal sera sans doute
plus vert que la Suisse, « un point d'eau naturel dans chaque
village », des arbres à n'en plus finir le long des routes, de
quoi attirer des touristes mexicains en manque d'ombre. Peu importe si son
premier programme de gouvernement faisait les yeux doux à la Banque
mondiale et au FMI et envisageait de tailler dur dans la fonction publique. Peu
importe si son second programme de gouvernement, réécrit avec ses
alliés de gauche, dit le contraire.
Quand il affirme être l'un des « presque sous
hommes mal nourris » qu'il dit avoir rencontrés dans l'Est du
pays, ça émeut l'auditoire. Et lorsqu'il enchaîne en
assurant qu'il est capable de doper les exportations agricoles, de faire
construire de gigantesques comptoirs frigorifiques pour l'industrie de la
pêche, ou encore de créer des banques pour divulguer les petits
crédits populaires, le public se mue en carpe, bouche bée. A qui
la faute d'une telle attitude ?
Notre propos n'est pas de répondre à une telle
question. Mais elle permet de voir à quel point la population
sénégalaise semblait prête à accorder plus de
crédit aux opposants (malgré des promesses invraisemblables)
qu'à Diouf qui semblait être gagné par l'usure du
pouvoir.
IV / LE ROLE DES MEDIAS PRIVES
La presse a été, sans aucun doute, avec la
jeunesse, l'un des éléments les plus déterminants dans
l'alternance politique de février-mars 2000. Le rôle des
médias privés a été unanimement reconnu comme
décisif dans la transparence du processus mais aussi et surtout dans la
prise de conscience des citoyens sénégalais. En effet, le
dynamisme de la presse privée relativement récente et
essentiellement composée de jeunes journalistes utilisant les nouvelles
technologies des télécommunications a indéniablement
changé la donne.
Si les journalistes, eux-mêmes, trouvent que leur
rôle dans les élections présidentielles de 2000 a
été très souvent magnifié et exagéré
par la presse internationale, ils reconnaissent l'importance cruciale qu'ils
ont eu dans le cours des événements. « Un
élément qui me semble important, c'est la présence de
très jeunes reporters dans les rédactions de la presse
indépendante. Ces jeunes ont permis aux entreprises de presse, pour la
première fois d'assurer une couverture très dynamique d'une
élection présidentielle. » (Boubacar Seck, Le
Matin).
Par ailleurs, les journalistes ont abondamment utilisé
les téléphones portables qui leur permettaient de communiquer en
temps réel les résultats, ce qui n'autorisait plus certaines
manipulations frauduleuses. Le simple fait de pouvoir divulguer aux populations
les résultats, au fur et à mesure qu'ils tombaient, d'un bureau
de vote à l'autre est extrêmement important dans l'histoire
électorale sénégalaise. Il n'en a pas toujours
été ainsi.
En effet, la soumission des médias d'Etat à la
domination occulte de puissances politiques et financières est un autre
fait du monopole du système électoral par le parti au pouvoir.
Pour le Parti Socialiste dont la culture politique du personnel dirigeant est
bel et bien trempée de l'autoritarisme produit par les réflexes
du parti unique, les pratiques de diffusion ou de rétention
d'informations défavorables, faisaient naturellement partie du mode de
gouvernement.
1. La presse écrite
La presse écrite, qui est plutôt
réservée aux élites instruites et relativement
aisées des centres urbains, semble peu intéresser le pouvoir car,
dans ce domaine, rude est la concurrence entre les organes gouvernementaux
comme Le Soleil, et la presse privée dite indépendante.
Déjà, à partir de 1974, la presse de
l'opposition (Taxaw, Andë Sopi, Le Démocrate,
Vérité, Jaay doole bi, Sopi) avait joué
un rôle important dans le débat politico-idéologique au
Sénégal. Puis, les autres organes indépendants (Sud
Hebdo qui deviendra Sud Quotidien, Le Cafard Libéré, Wal
Fadjri, Le Devoir, Le Témoin, etc.) qui sont nés
après la succession de Senghor par Diouf ont offert aux leaders de
l'opposition, aux élèves et étudiants un moyen
d'expression permettant de maintenir la pression sur les diverses forces
sociopolitiques, gouvernementales et pro-gouvernementales.
Cependant, aujourd'hui encore, il n'est pas aisé dans
le contexte sénégalais d'apprécier l'indépendance
réelle de cette presse dite « indépendante »,
au regard du pouvoir politique ou des puissances d'argent. En effet, les
médias privés sont le plus souvent, la propriété
d'un individu ou d'un groupe. L'indépendance rédactionnelle est
donc confrontée à un perpétuel conflit avec des
propriétaires dont les proclamations publiques de non-ingérence
dans le traitement de l'information sont à prendre avec beaucoup d
prudence. Ils ont des préférences pour l'un ou l'autre candidat
et le font savoir plus ou moins subtilement aux journalistes qu'ils
emploient.
Dans le cas où l'organe de presse est la
propriété d'un seul individu, il n'existe aucune instance, aucune
structure formelle pour pondérer les penchants en question. Il n'y a ni
conseil d'administration ni comité éditorial pour discuter de la
ligne du média. Néanmoins, on devra tout de même souligner
la liberté presque totale de la presse privée du
Sénégal39(*), à laquelle le récent changement de
régime doit beaucoup.
Pour D. N, ancien journaliste à la RTS (radio
télévision sénégalaise), aujourd'hui journaliste
dans un quotidien privé, avant le presse privée, il n'y avait
tout simplement pas de démocratie au Sénégal :
« il y avait une telle soif de connaissance et un tel
discrédit des médias publics que les gens voulaient savoir. Pour
cela, il fallait s'en remettre à des radios telles que RFI et Africa
N°1 qui faisaient de très grandes audiences ;
c'est-à-dire que pour savoir ce qui se passait à Dakar, il
fallait écouter les radios internationales. S'il y avait une grande
manifestation, les médias locaux n'en parlaient pas, ni Le Soleil, ni la
RTS encore moins l'APS (l'agence de presse sénégalaise). Je le
sais parce que j'étais à la RTS, pendant quatre ans, puis j'ai
été viré en 1989. Il s'agissait d'une marche de
l'opposition contre l'apartheid qui avait réuni au moins 25 000
personnes. Le soir, lorsque nous sommes retournés à la radio,
nous recevons un communiqué du ministre de la communication, à
l'époque Djibo Leyti KA, disant en cinq lignes « Une petite
poignée d'agitateur a voulu saboter la visite du maréchal Mobutu
sous couvert d'une manifestation contre l'apartheid ». Nous avons
refusé de lire le communiqué, ou du moins nous pouvions le lire
en précisant que c'était bien une dépêche de l'APS.
Ce qu'ils ont bien entendu refusé. Néanmoins nous avons
apporté la précision et cela nous a valu notre boulot ou des
mutations pour les plus chanceux. Donc j'ai travaillé pour les
médias d'Etat et je n'y ai pas retrouvé ma conception de ce
qu'est un pays démocratique. Il y avait une contradiction entre les
principes affirmés en direction de l'étranger et la
réalité. »
Cette censure permanente des médias d'Etat a
donné dès ses premières heures, à la presse
privée, une grande opportunité. En effet, au milieu des
année 1980, les hebdomadaires tels que Sud Hebdo et Wal
Fadjri, pour leur début, se définissaient comme des concepts
nouveaux : une autre manière de faire de l'information pour le
premier et le support d'une idéologie religieuse pour le second. En
fait, il s'agissait dans une certaine mesure de contourner le contrôle
d'Etat sur les médias existants.
Cette option de rupture inscrite dès le départ
dans la démarche de ces médias privés nous semble
importante car en prenant le contre-pied des médias d'Etat qui faisaient
peu de cas des activités et déclarations de l'opposition, ces
journaux sont devenus objectivement la presse de cette partie de la classe
politique. Non pas par adhésion militante mais parce que d'une part ils
bénéficiaient d'une sorte de concession d'exclusivité sur
un volet important de l'actualité nationale et, d'autre part,
l'opposition est un bon argument de vente.
Il y a donc un compagnonnage objectif et mutuellement
bénéfique entre la presse privée et l'opposition
politique. De fait cette réalité est beaucoup plus riche et
embrasse d'autres secteurs de la vie nationale que la presse d'Etat n'aborde,
lorsqu'elle le fait qu'avec beaucoup de circonspection.
Cette situation est à l'origine de la confusion faite
par un ancien président de l'ONEL qui classait sommairement les
médias sénégalais entre presse d'Etat et médias de
l'opposition. Ce sentiment que les journaux de la presse privée ont bien
des sympathies pour tel ou tel candidat à l'élection
présidentielle de février-mars 2000 est assez vivace chez les
populations sénégalaises.
Il demeure toutefois que l'Etat, le gouvernement et le parti
au pouvoir font l'objet d'un intérêt constant de la part de cette
presse qui regrette seulement de demeurer encore un partenaire suspect.
Les centres urbains, notamment Dakar, sont les lieux où
la presse écrite trouve principalement ses lecteurs. Ceci se comprend
aisément, dans la mesure où les urbains ont un niveau
d'alphabétisation supérieur à celui des ruraux et
accèdent plus facilement aux journaux qui du reste, sont très
rarement acheminés dans les campagnes, par manque de clients et
d'infrastructures.
Donc, Dakar et quelques grandes villes regroupent l'essentiel
du lectorat de la presse nationale. La capitale avec l'essentiel des
fonctionnaires, ses nombreuses écoles et pendant très longtemps,
la seule ville universitaire du pays, est très demandeuse de la presse
privée qui représente un gage de crédibilité, par
opposition au quotidien gouvernemental, Le Soleil. Ce journal
étant considéré pendant les années Diouf comme une
caisse de résonance du parti. Ce qu'un journaliste de ce quotidien
confirme en ces termes : « Beaucoup d'articles publiés au
journal, je veux dire dans le domaine politique, ont été
rédigés par les services du palais ; nous nous ne faisions
qu'apposer notre signature en bas. Combien de fois ai-je
été réveillé parce qu'il fallait qu'apparaissent
dans l'édition du lendemain un article. »
S'ils n'étaient pas au fait de telles pratiques, les
sénégalais n'étaient pas dupes des rapports entre le
pouvoir en place et les organes d'Etat et ne leur accordaient pas beaucoup de
crédit. Aussi les premiers quotidiens privés dits
« indépendants » n'eurent aucun mal à trouver
leur lectorat dans les villes. Nous ne appesantirons pas sur les limites
étroites dans lesquelles elle se trouve confinée du fait du fort
taux d'analphabétisme. Les faibles revenus font par ailleurs que l'achat
et la lecture de la presse quotidienne ou périodique n'est pas une
priorité des dépenses des individus. Mais les radios
interagissent avec la presse écrite pour la rendre accessible à
des secteurs jusque-là non concernés, pour les raisons que nous
venons d'évoquer. On ne peut donc plus se contenter de limiter l'impact
des médias privés en l'expliquant par des réalités
que sont l'analphabétisme et la faiblesse du pouvoir d'achat. Il faut
intégrer désormais le travail de traduction et de large diffusion
que font maintenant les radios.
2. Les radios et les langues nationales
La presse privée s'est enrichie de l'arrivée
des radios à partir de juillet 1994. Ces médias sont jeunes de
par leur âge mais aussi et surtout de par l'âge des personnels
qu'ils emploient. Il faut signaler qu'aucune radio privée n'avait
couvert une élection présidentielle auparavant. La doyenne des
radios privées, Sud FM, est née en 1994,
c'est-à-dire plus de six mois après la dernière
élection présidentielle. Elle n'a connu que les élections
locales de 1996 et les législatives de 1998.
Les radios privées à l'image de la presse
écrite privée sont un phénomène urbain pour
l'essentiel. Elles ont des périmètres de couvertures autour des
villes. Certaines se contentant d'une station unique installée à
Dakar avec des émetteurs-relais dans une ou plusieurs villes. D'autres,
comme Sud FM et Dunya FM disposent à l'instar de la
RadioTélévision Sénégalaise de stations
régionales installées dans la capitale administrative ou dans
des villes telles que M'Bour (sur le littoral) et M'Backé (à
proximité de Touba la ville sainte de la confrérie mouride) qui
polarisent un certain nombre d'activités.
Cette occupation géographique est importante car elle
définit des zones privilégiées de couverture
radiophonique. Avec la possibilité de faire une campagne de
proximité là où existent des stations
décentralisées. Sud FM et Téranga FM,
par exemple, disposent sous cet angle d'une certaine expérience. Dans
certaines villes comme Dakar, Thies ou Saint-Louis il y a une concentration
intéressante de radios privées, auxquelles s'ajoutent le service
public et les radios internationales RFI et Africa N°1.
Maintenant, il est primordial de noter l'usage
généralisé des langues nationales, particulièrement
le wolof, qui a profondément transformé l'attente du public en
matière d'information et de prise de parole. D'après les chiffres
officiels moins de 20% de la population parle français alors que le
wolof serait parlé par plus de 80% des sénégalais.
Pendant que le français continue à dominer
à la télévision, les radios privées accordent une
large part au Wolof. Aujourd'hui cette langue est certainement la plus
utilisée dans les radios. Selon nos interlocuteurs, au moins 70% des
émissions sont transmises en Wolof. Avec l'avènement de ces
radios privées, de nombreux débats publics se passent en Wolof.
Ceci est normal compte tenu du fait que pour être écouté il
faut être compris par la majorité de la population.
En effet, les radios privées ont réalisé
qu'il ne s'agit pas seulement de se soucier de la diffusion des
émissions, mais d'assurer que les auditeurs comprennent la langue dans
la quelle ces émissions sont diffusées. La majorité de la
population sénégalaise a été privée
d'information et avec ces radios privées, ce sont de larges secteurs de
cette population, longtemps sous-informés qui ont basculé dans
des processus de communication. Ils accédaient pour une fois à
des informations très actuelles sur la campagne électorale. Ceci
a été sans aucun doute déterminant dans l'issue des
élections.
Biens informés, dans une langue qu'ils maîtrisent
parfaitement, les sénégalais ont accompli massivement leur devoir
civique. Cette nouvelle donne dans les élections présidentielles
sénégalaises rappelle les propos d'Alain Touraine lorsqu'il
écrit « le champs du libre choix politique n'existe pas si
l'existence d'un espace public, et, plus largement d'une société
politique n'est pas reconnue. L'isolement des personnes, la segmentation de la
société, la faiblesse des communications entre les
catégories sociales sont des obstacles presque incontournables à
la démocratie. »40(*)
Par ailleurs, ces millions d'électeurs se contentaient,
avant, des résultats officiels annoncés par les médias
d'Etat plusieurs jours après le scrutin. Or en 2000, les radios
privées divulguaient, en temps réel, les résultats des
dépouillements de chaque bureau de vote du pays ; ce qui changeait
considérablement la donne. Dans la mesure ou ces résultats
étaient connus de tous, il devenait impossible de les falsifier. Toute
tentative de fraude post-électorale se trouvait du coup anéantie
par cette connaissance des résultats par le plus grand nombre
d'électeurs.
V / LES CONFRERIES RELIGIEUSES
On connaît la grande influence, au
Sénégal, des confréries maraboutiques. Les musulmans
sénégalais qui représentent plus de 90 % de la population
se répartissent pour la plupart entre les deux grandes confréries
des Mourides et des Tidjanes. A côté de ces deux grandes familles
maraboutiques, on ajoutera des confréries numériquement moins
importantes, comme les Layènes, les Niassènes ou les Qadrys.
Le poids des confréries se double d'une influence
économique et sociale considérable, au point de figurer une forme
de hiérarchie sociale parallèle. Au plan politique, les
confréries ont généralement toujours
préféré soutenir le pouvoir en place, jusqu'à
donner, par exemple pour les Mourides, des consignes de vote plus ou moins
explicites..
1. Importance de l'islam dans la vie politique
sénégalaise
La prédominance ancrée du Parti socialiste s'est
basée essentiellement sur la mobilisation de la population rurale et,
à ce propos, les confréries religieuses et leurs marabouts en
tant que guides religieux et sociaux ont joué un rôle important,
même si leur influence est devenue moindre aux présidentielles de
2000.
Le Sénégal est un pays où le
« Ndiguël » (consigne de vote émise
par les chefs religieux) occupe une grande place dans la vie politique. On sait
déjà que l'influence des marabouts avait pesé lourdement
lors du référendum de Septembre 195841(*). Tout comme l'administration
coloniale française, Senghor, pourtant catholique, n'avait pas eu de
difficulté à obtenir le soutien des mourides. La seule
confrérie mouride étant censée être capable de
drainer 500 000 suffrages, l'adhésion du Sénégal à
la Communauté de 1958 a été qualifiée de
« Oui des marabouts ».
Depuis, l'amalgame politico-religieux continue à
prévaloir. Ceci dès les élections du 26 février
1978 qui étaient les premières conformes au nouveau mode de
scrutin concocté par Senghor. Ces élections
générales avec les trois protagonistes de l'époque :
le Parti Socialiste (Senghor), le Parti Démocratique
Sénégalais (Wade) et le Parti Africain de l'Indépendance
(Majmout Diop) furent l'occasion pour le PS de mettre en oeuvre sa machine
électorale, longtemps éprouvée lors des campagnes d'avant
indépendance.42(*)
Le « marketing électoral » du PS
reposait sur le système d'achat des allégeances et sur de
nombreux réseaux clientélistes où le griot et le marabout
occupaient une place de choix. En effet, c'est le monde rural qui
était essentiellement visé. Les ruraux étaient
quadrillés grâce à ces réseaux clientélistes
gérés par les marabouts, qui donnaient des consignes de vote en
faveur du parti de Senghor. Par ailleurs, un autre encadrement politique
s'opérait par le biais d'agences de développement ou de
société de vulgarisation et de commercialisation agricoles.
Là le contrôle se réalisait à travers le gestion
« néo-patrimoniale » des circuits arachidiers.
Senghor fidèle en cela à la tradition coloniale,
avait fait des marabouts des partenaires obligés du pouvoir. Tel est, en
parti l'héritage que Senghor lègue à Abdou Diouf en
quittant le pouvoir. Les élections sous Abdou Diouf s'inspireront
largement de ce modèle.
En 1983, la perspective des élections
présidentielles donna l'occasion de renforcer toutes ces
stratégies d'hégémonie par le contrôle des appareils
politico-bureaucratiques, par la réactivation des réseaux
clientélistes ruraux sous le regard bienveillant des confréries
maraboutiques. Encore une fois, comme c'était le cas en faveur de
Senghor, Diouf était assuré du plébiscite maraboutique. Et
si l'on en croit une anecdote exemplaire, en février 1983, Cheikh Anta
Diop, leader du RND, légalisé trois ans auparavant, ne s'est pas
présenté aux élections présidentielles en
dépit de tous les espoirs partisans. Et la raison de cette abstention
inattendue, vu l'ardeur des actions politiques qu'il avait menées
jusque-là, a été donnée par un journal
sénégalais en ces termes : « parce qu'il suit les
ordres de son marabout, le Khalife général des Mourides qui avait
appelé à voter pour Diouf. (...) Depuis lors, le tournant a
été amorcé vers la modération vis-à-vis du
pouvoir, doublée d'une passivité politique
complète ».43(*)
A ce niveau, faisons une petite digression. En effet, il faut
soulignons que le soutien maraboutique était doublé, sous Abdou
Diouf, d'autres formes de clientélismes. Ce furent les nombreux groupes
de soutien, très actifs et « experts ès
propagande » :
- Le group des 1500 ;
- le GRESEN (Groupe de rencontres et d'échanges pour un
Sénégal nouveau) ;
- Le MNS (Mouvement national de
soutien) ;
- Le CAS (Cercle des amitiés
sénégalaise) ;
- L'ANSAPP (Association nationale de soutien à l'action
des pouvoirs publics) ;
- L'UPD (Union des populations de Ndiambour Doolel Abdou
Diouf)44(*) ;
-L'USAPAD (Union des soeurs unies du plateau pour le soutien
à l'action du Président Abdou Diouf) ;
- Le COSAPAD (Comité de soutien à l'action du
Président Abdou Diouf) ;
- Le CONAGRISAPAD (Comité national des griots du PS
pour le soutien à l'action du Président Abdou Diouf).
Ces associations étaient de compositions diverses.
Certaines d'origine intellectuelle, revendiquaient une adhésion
rationnelle à l'action du Président Abdou Diouf et
prétendaient donc partir d'une analyse de la réalité
sociale, politique et économique. D'autres regroupaient des femmes, des
ruraux, des individus appartenant à la même région que
ABDOU Diouf, des griots etc. Bien que différents, ces groupes
fonctionnaient selon une logique commune celle du « soutien
mercenaire », caractérisée par le courtage politique,
la négociation et l'achat d'allégeances partisanes.
2. La crise du « Ndiguël » ou
consigne de vote.
C'est à partir de l'élection de 1988
qu'apparaît un fait nouveau : La crise du
« Ndiguël ». Pendant ces élections, le
khalife général des Mourides, Serigne Abdou Lahat M'Backé
fit le seul à donner son « Ndiguël ».
En effet, le khalife général des Tidjanes, Abdou Aziz Sy, ne
donna pas de mot d'ordre. Cependant, la puissante confrérie mouride, qui
jusque là soutenait Diouf sans faille connut un mouvement inédit.
En effet, Serigne Dame M'backé, un marabout qui n'est certes pas le
khalife général, se rebiffa en s'inscrivant sur la liste du PDS
tandis qu'un autre, Serigne Khadim M'backé, très connu dans la
communauté intellectuelle sénégalaise fit une
déclaration télévisée la veille des
élections et appela à voter contre Diouf en ces termes :
« Abdou Diouf nous a privé de travail et si Dieu veut le
bonheur du peuple sénégalais, Abdou Diouf ne sera pas
réélu. Inutile de continuer à prier s'il est
réélu puisque Dieu nous aura abandonné. »
Cette déclaration a marqué les esprits de tous
les sénégalais tant elle était inimaginable. La
confrérie Mouride étant surtout connue pour la discipline et le
respect de la hiérarchie qui y règne, aussi bien chez les
« talibés » (les disciples, c'est-à-dire tous
les sénégalais qui se reconnaissent de l'autorité morale
du Khalife général) que chez les
« serignes » (les marabouts qui sont fils ou
petits fils du fondateur du mouridisme, Serigne Ahmadou Bamba M'backé.
Le khalife général étant toujours le fils
aîné de celui-ci).
Ces déclarations ont, par ailleurs conforté tous
les fidèles qui étaient révoltés par la consigne de
vote en faveur de Diouf qu'ils considéraient comme responsable de leurs
difficultés économiques.
Depuis cette épisode, les khalifes
généraux mourides, successeurs de Serigne Abdou Lahat
M'backé, ont été beaucoup plus discrets sur la
scène politique. Cependant, cette discrétion affichée par
le Khalife général n'est pas toujours suivi par tous les
marabouts de la confrérie. En effet, à l'occasion de la
présidentielle de 1993, Abdou Diouf avait bénéficié
du soutien sans réserve de deux influents chefs religieux du mouridisme.
Serigne Kosso M'backé et Serigne Modou Bousso Dieng. Ces incidents
illustrent parfaitement la dimension importante de l'islam et des
confréries dans le champs politique sénégalais.
Le « Ndiguël » timoré et
inefficace en 2000.
Aujourd'hui, au sénégal, le
« Ndiguël » ne fonctionne plus comme par le
passé. En dépit de la place importante de la religion dans leur
vie quotidienne, les électeurs ne suivent plus aveuglement les consignes
des marabouts, ce qui renforce inexorablement la laïcité de l'Etat.
Le « Ndiguël » n'est donc plus ce qu'il
était. Par exemple, les mots d'ordres lancés par quelques
marabouts de moindre importance sont resté sans effet.
Néanmoins, Abdoulaye Wade qui a rendu visite au Khalife
général des mourides à Touba (150 km à l'est de
Dakar et ville sainte de la confrérie dont il est un disciple), le 30
Octobre 1999, soit à peine deux jours après son retour de France
où il était resté plus d'une année, pouvait se
féliciter. En effet, à l'issue du premier tour, il est
arrivé en tête à Touba, ville longtemps
considérée comme un bastion du PS alors qu'il n'a obtenu que 31%
des voix dans l'ensemble du pays.
Les hommes politiques, dans leur ensemble, soignent
particulièrement la confrérie mouride qui à l'occasion du
« Magal » (commémoration du départ
en exil du fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba M'backé) rassemble chaque
année, dans la ville sainte de Touba, environ deux millions de mourides.
D'ailleurs, Abdoulaye Wade a annoncé en priorité des
priorités du Sénégal, la construction d'un aéroport
et d'un héliport pour la ville de Touba.
Pour sa part, ayant, semble-t-il, jugé que les mourides
étaient décidés à prendre une certaine distance
avec les vicissitudes de la politique politicienne nationale, le candidat Diouf
a rendu visite, au cours de la campagne, à Cheikh Tidjane Sy, le
numéro deux de la confrérie tidjane. Ce dernier s'est abstenu,
lors de élections présidentielles, en disputant le leadership
à son frère Serigne Mansour Sy qui est le khalife
général, de toute consigne de vote. Au sein de la
confrérie, il est le guide des moustarchidines, l'un des mouvements
tidjanes, dirigé par son propre fils.
Cette visite impromptue, en vue d'établir une connexion
avec ce deuxième grand groupe religieux du pays, a fait croire à
un accord électoral entre les deux personnalités. Cependant, il
n'en a rien été : après avoir longtemps tenu en
haleine les sénégalais, les responsables du mouvement des
moustarchidines ont fini par laisser leurs fidèles libres de voter selon
leur conscience. Ce qui n'est pas anodin dans la mesure où le khalife
général des tidjanes, lui-même, a donné un
« Ndiguël » en faveur de Diouf. Une consigne
qui d'après les résultats n'a pas été suivi en
masse par les fidèles.
Du côté de la confrérie des
niassènes, considérée comme la troisième du pays,
deux consignes de vote contradictoires ont été
lancées : l'une, émanant du khalife général,
en faveur de Diouf, l'autre par le frère du khalife pour Moustapha
Niasse (qui est disciple de cette confrérie) en faisant de Kaolack, la
région niassène, le fief de ce dernier.
Lors de l'élection présidentielle, le
Président Diouf a tenté par tous les moyens d'arracher des
consignes de vote en sa faveur de la part des différentes
confréries religieuses (le journal Sud Quotidien a noté qu'en
l'espace de six mois, le Président a rendu visite à près
d'une centaine de marabouts). Cela dénote de toute évidence que
l'on a besoin d'autres relais que les cadres et les militants de son parti pour
séduire l'opinion. Et cela dénote aussi, bien au-delà de
l'échec d'une politique, l'échec même de la pratique
politique.
Aussi un certain cafouillage, les hésitations des
intéressés, qui furent aussi soucieux de ne pas se couper de
leurs disciples, la plupart étant acquis à la cause du changement
de régime, ont fait que le vote religieux n'a pu être
véritablement décisif. De manière générale,
le scrutin présidentiel de 2000 a constitué un désaveu
cinglant pour les chefs religieux, habitués, dans un pays
profondément croyant, à indiquer le « bon
choix » à leurs
« talibés » (fidèles). De
même, les candidats qui avaient choisi de placer leur campagne
« sous le signe de Dieu » ont enregistré de cuisants
revers. Ousseynou Fall, frère du khalife général des
Baye Fall, l'une des composantes de la confrérie
mouride, candidat aux élections présidentielles n'a recueilli que
1,1% des suffrages. On peut aussi citer le cas de Abdoulaye Dièye,
également issu de cette famille maraboutique.
Si auparavant, les « talibés » ou
disciples respectaient davantage les mots d'ordre de leurs guides spirituels
que ceux des partis, l'alternance politique a démontré une
certaine détermination des électeurs de faire la distinction
entre leurs « rôle » de
« talibés » (disciples), à l'écoute de
leurs guides religieux dans leur vie spirituelle et leur
« rôle » de citoyens lorsqu'il s'agit de la gestion
politique du Sénégal.
CONCLUSION
Dans cette étude, nous nous posions un certain nombre
de questions sur ce qui, jusqu'ici, est véritablement le fait marquant,
de l'histoire politique sénégalaise d'après
indépendance. En effet, comment ne pas se poser certaines questions sur
ce qui au Sénégal a été vécu comme un fait
historique et salué comme tel en dehors de ses
frontières ?
Qu'est-ce qui a fait que le Sénégal qui a
été longtemps cité en modèle de démocratie,
dans le continent noir, n'ait réussi une alternance politique que lors
des élections présidentielles de février et mars 2000,
c'est-à-dire quarante ans après son accession à
l'indépendance ?
Pourquoi les présidentielles de 1974, de 1978, de 1983
et de 1988 ou encore celles de 1993 n'ont jamais abouti à une
alternance malgré que les observateurs internationaux et les
partenaires économiques et politiques du pays aient toujours
vanté « le modèle sénégalais »
de démocratie?
Qu'est-ce qui en 2000, a été déterminant
à l'heure où les sénégalais devaient confier les
rênes du pays à l'homme qui doit les amener vers le
troisième millénaire ?
Pourquoi ont-ils choisi de porter au pouvoir, le leader
historique de l'opposition sénégalaise, après cinq
tentatives et à soixante quatorze ans ? Telles étaient les
questions auxquelles, il nous semblait important d'essayer d'apporter quelques
élément de réponse.
En définitive, la première alternance politique
ou « Sopi » jamais intervenue au sommet de l'Etat
sénégalais, est tout sauf un phénomène fortuit et
imprévisible. Il ne s'agit absolument pas d'une réaction
spontanée à un régime politique qui serait devenu,
subitement indésirable.
Si tous ceux qui s'intéressent à la
démocratie et à son développement, en Afrique en
particulier, ont salué la passation de pouvoir, sans heurts et par la
voie des urnes, dans ce pays sub-sahérien, il fallait au delà de
ce véritable événement (car une réelle alternance
politique pacifique, consacrée par les urnes est toujours un
événement politique exceptionnel, aujourd'hui encore en Afrique),
essayer de saisir les mécanismes qui ont permis cette alternance.
Deux axes d'étude ont, retenu notre attention. En
effet, il s'agissait de saisir, d'abord, les cadres politique et institutionnel
de l'alternance pour ensuite nous intéresser aux conditions sociales du
« Sopi ».
D'abord, la victoire de Abdoulaye Wade sur
Abdou Diouf a été le fruit d'une longue évolution
institutionnelle et politique. Il aura fallu un processus démocratique
engagé par un - bras de fer entre le Président Senghor et Cheikh.
Anta. Diop et / ou Mamadou Dia qui lui contestaient son
hégémonie sur le pouvoir dès le lendemain des
indépendances. Si Senghor a entrouvert les portes du multipartisme au
Sénégal, les partis d'opposition qui se sont multipliés au
fil des échéances électorales, ont fini par arracher
à son successeur une reconnaissance et un véritable statut.
Par ailleurs, c'est en exerçant une pression continue
sur les autorités que ces partis ont progressivement obtenu des
modifications du système électoral telles que l'adoption d'un
code qui imposera la détention d'une carte nationale d'identité,
pour tout électeur dans les bureaux de vote. Et si ces partis
d'opposition enregistraient, séparément à chaque
élection présidentielle, une réelle percée, l'union
que certaines d'entre elles ont prôné derrière le plus
charismatique de leurs leaders ( Abdoulaye Wade) a sans doute été
décisive.
A cela s'ajoutent le rôle éminent joué par
l'observatoire nationale des élections et la présence d'un
militaire (supposé neutre) au ministère de l'Intérieur.
Pour l'opposition, extrêmement soupçonneux
à l'égard de l'administration, l'ONEL a constitué une
sorte da garantie d'autonomie dans la surveillance des élections.
Même si les leaders des différents partis ont stigmatisé
par la suite, son manque de dynamisme. De même, ils ont vu (avant de le
dénigrer pendant la campagne électorale) dans la présence
d'un militaire au ministère de l'intérieur, une garantie de
neutralité vis-à-vis du PS.
Enfin, la crise ouverte et les défections de certains
cadres éminents du PS pour rallier l'opposition constituent une
dernière évolution politique, non négligeable, quant
à la compréhension des conditions du
« Sopi ». Moustapha Niasse (avec 16,8% des voix au
premier tour) ayant beaucoup pesé sur l'issue du scrutin.
Ensuite, le
« Sopi » doit son avènement à des
facteurs sociaux aussi déterminants sinon plus que cette
évolution institutionnelle et politique.
En effet, la forte demande sociale, le déploiement des
radios privées offrant une meilleure lisibilité et une meilleure
visibilité des erreurs dont était coupable le régime
socialiste ou encore le déclin progressif du
« Ndiguël » sont des éléments qui ont
rendu possible le « Sopi ».
La défaite de Diouf et du Parti socialiste
sénégalais exprime, comme nous l'avons vu, une forte demande
sociale de la population sénégalaise. Plus que le résultat
d'une quelconque pression internationale (le contraire étant même
plus plausible) elle traduit une grande volonté de la population de
changer ses gouvernants après quarante de règne sans partage.
Pour beaucoup d'électeurs, l'année 2000
correspondait à l'année du
« Sopi » ; suite aux nombreuses mutations
politiques et institutionnelles qu'a connu le pays (l'implosion du PS, l'union
d'une parti de l'opposition, la création de l'ONEL...) et les grandes
difficultés économiques auxquelles ils étaient
confrontés.
La volonté de changement était, dans une
certaine mesure, proportionnelle, à l'écart entre la
misère économique des électeurs et l'opulence des
dirigeants politiques et de leurs proches. Les sénégalais
excédés par la corruption dont ils soupçonnaient le
pouvoir socialiste, ont décidé de sanctionner celui qui
l'incarnait le plus, Abdou Diouf, en élisant son opposant de toujours,
Abdoulaye Wade. Ce vote apparaissant comme un voté sanction. Comme
l'exprimait un de nos interviewés, « On ne sait
peut-être pas ce qu'on veut, mais on sait ce dont on ne veut
plus.»
Les organisations non gouvernementales, les groupements de
femmes, certains intellectuels ont exercé une pression sur le
gouvernement de Diouf, dans le sens d'une transparence des élections
tout en essayant de convaincre ceux qui pouvaient considérer que les
dés du jeu politique étaient pipés d'avance et que par
conséquent, se rendre aux urnes était une perte de temps,
d'accorder du crédit à ce scrutin qui s'annonçait
différent des précédents.
Par la surveillance des candidats et la dénonciation de
leurs dérapages idéologiques (religieux) ou démagogiques
ainsi que par le biais d'actions de sensibilisation sur le « devoir
de voter » avec des slogans tels que « ma carte
d'électeur ma force », certaines franges de ce qu'on nomme le
société civile ont joué un rôle non
négligeable dans l'issue du scrutin.
Les jeunes sénégalais ont saisi
l'opportunité qui leur était offerte, par l'abaissement de la
majorité électorale à dix huit ans, pour exprimer leur
volonté de changement, autrement que par l'affrontement des forces de
l'ordre. Ils ont parfaitement assimilé le slogan « ma carte
d'électeur, ma force » pour l'associer à un autre
« l'alternance ou la mort ». Ils ont voulu en s'inscrivant
en grand nombre sur les listes électorales, voter massivement en faveur
de l'opposition et sanctionner le gouvernement socialiste
sénégalais en matière d'emploi et de politique de
jeunesse.
Les médias privés par le biais de la presse
écrite pour les citadins les plus instruits et grâce aux
émissions radiophoniques en langues nationales (plus de 70% en wolof)
ont aussi considérablement changé la donne lors du scrutin 2000.
La population a été informée sur la dernière
élection présidentielle plus qu'elle ne l'a jamais
été auparavant. Ensuite les radios privées se sont
évertuées à communiquer, en temps réels
grâce à l'utilisation (pour la première fois dans la
couverture et le compte rendu du dépouillement des bulletins) des
téléphones portables. Ce qui compromettait toute tentative de
modification des résultats des dépouillements.
Enfin, la perte de vitesse du
« Ndiguël » (ou consigne de vote) des
confréries religieuses est à prendre en considération pour
toute tentative de compréhension de la première alternance
politique, après des élections libres et transparentes au
Sénégal. Les confréries, naguère omnipotentes, ont
perdu de leur influence dans le domaine politique sénégalais.
Certains khalifes généraux, pour éviter de perdre de leur
crédibilité ou par pure neutralité, ont
préféré ne pas donner de
« Ndiguël » tandis que d'autres ont
été désavoués par leurs talibés
(disciples). Aussi la victoire de Abdoulaye Wade s'explique aussi par la crise
du « Ndiguël » qui a atteint son
périgée en 2000.
En réalisant, pour la première fois de son
histoire, une véritable alternance politique que beaucoup d'analystes
considéraient, jusque là, comme étant le chaînon
manquant dans la « démocratie
sénégalaise », ce pays est-il pour autant
définitivement entré dans le cercle très fermé des
pays dits de « grande démocratie » ? Au terme
de cette analyse des conditions qui, à notre sens, ont été
à la base de la première alternance politique au
Sénégal, il importe de souligner les éléments qui
nous semblent être les limites de la « démocratie
sénégalaise ».
En effet, la personnalisation à outrance des campagnes
électorales dépolitisées, la prolifération des
partis politiques à la veille de chaque campagne avec des
« transhumances » opportunistes nous paraissent être
les tares de la « démocratie
sénégalaise ».
La personnalisation des campagnes électorales
dépolitisées
On s'accorde aujourd'hui à admettre que les Etats
africains sont, dans leur grande majorité, confrontés à
des situations de blocage politique nées d'une lente mais inexorable
perversion du pluralisme. Certains d'ailleurs n'ont pas hésité
à réclamer la suppression de l'élection
présidentielle en Afrique, dans la plupart des cas
détournée par les clans tribalistes et les intérêts
privés45(*). Or on
aurait tort de ne voir dans le recours aux urnes qu'une simple mascarade de
dictature, tronquée et ethnicisée. Il faudrait donc aller voter
parce que, même si les élections africaines sont trop souvent
désespérément frauduleuses, c'est justement la concurrence
réelle aux urnes qui fait le progrès, l'absence de concurrence
réelle ne nécessitant aucune fraude.
Dans toute élection présidentielle au suffrage
universel, l'équation personnelle joue un rôle déterminant,
tout en dépolitisant le débat public au profit d'un affrontement
d'hommes. Plus que le programme électoral des candidats, c'est la
relation entre ces derniers et les électeurs qui se révèle
décisive. On sait que l'un des défauts majeurs de
l'élection du président au suffrage universel est la
personnalisation excessive du mécanisme électoral dont l'attribut
essentiel est pourtant la requête de bonnes institutions. Sous cet
aspect, les scrutins présidentiels sénégalais ont toujours
opposé de fortes personnalités dont le charisme ne laisse pas
indifférents leurs partisans respectifs. Cette année encore,
entre Diouf et ses adversaires, il s'agissait donc moins d'un combat politique
de programme que d'une simple bataille d'hommes, exacerbée par de
féroces inimités entre les différents candidats.
Comme toujours, le contenu réel des programmes a
été totalement occulté par le débat politicien.
Diouf proposait d'abord un « pacte de croissance et de
solidarité », un renforcement de la lutte contre la
pauvreté et le chômage, et un référendum pour
asseoir un nouveau cadre constitutionnel. A la veille du second tour, il
annonçait de nouveau « dix mesures immédiates pour
changer le Sénégal », parmi lesquelles la formation
d'un gouvernement de majorité plurielle de gauche, l'organisation d'un
référendum sur la nature du régime, l'effacement de la
dette du monde rural, etc. En bref, un peu plus de concrétisation, mais
en fait, rien de nouveau, que le désir d'attirer l'électorat
transfuge du PS sous l'influence de Moustapha Niasse et de Djibo KA.
De son côté, Wade envisageait de prendre, une
fois élu, plusieurs « mesures de redressement
sectoriel », qui prévoyaient, dans le domaine politique,
notamment la dissolution de l'assemblée nationale, la modification de la
constitution en vue d'instaurer un régime parlementaire, le
démantèlement du sénat et la création d'une
commission électorale nationale indépendante. Ensuite, pour ce
qui est du domaine socioculturel, il se proposait, en sus d'une politique de
« médecins sans blouses blanches », de mettre des
ambulances et le téléphone à la disposition de chaque
communauté rurale, de créer deux nouvelles chaînes de
télévision, etc. Et finalement, dans le domaine
agro-économique, l'installation d'une « Cité des
affaires d'Afrique de l'Ouest » à la place actuelle de
l'aéroport international de Dakar, la construction d'autoroutes et d'une
usine de fabrication de plats préparés, l'aménagement des
grands fleuves et une politique de reboisement. Bref, la campagne
présidentielle sénégalaise est plus souvent l'occasion
d'éliminer l'adversaire, par une surenchère de promesses que
celle de convaincre.
Une pléthore de partis politiques
Samuel. P. Huntington écrivait : « la
démocratie existe quand les principaux leaders d'un système
politique sont sélectionnés au moyen d'élections
concurrentielles auxquelles le gros de la population a la faculté de
participer. »46(*) Selon cette vue, le régime démocratique
est synonyme d'élections et de multipartisme, puisqu'il faut plusieurs
partis pour qu'il y ait concurrence entre eux ; aussi, le
Sénégal mériterait le qualificatif de pays
démocratique depuis bien longtemps.
En effet, de quatre en 1981, le Sénégal est
passé, aujourd'hui, à plus de soixante partis47(*). La réforme
constitutionnelle de Diouf, à son arrivée, sera une
opportunité pour les hommes politiques de toute tendance, de
créer progressivement leurs partis. Dès la promulgation de la
loi, les partis qui étaient dans la clandestinité saisirent
l'opportunité pour demander leur reconnaissance. C'est le cas du
Rassemblement National Démocratique (RND) du professeur Ch. A. DIOP
reconnu le 18 juin 1981. Ensuite le Mouvement Démocratique Populaire
(MDP) recevra son récépissé le juillet de la même
année, tout comme le Parti Africain pour la Démocratie et le
Socialisme (AJ/PADS).
Trois jours après, la Ligue
Démocratique-Mouvement pour le Parti du Travail (LD-MPT) et le Parti
pour l'Indépendance et le Travail (PIT) voient le jour à leur
tour. Ensuite, l'Union pour la Démocratie Populaire (UDP), le Parti
populaire sénégalais (PPS), l'Organisation Socialiste des
Travailleurs (OST) seront reconnus. Les reconnaissances et naissances de partis
vont se poursuivre à ce rythme en 1982. Au total, en plus des quatre
partis du temps du président Senghor, dix autres sont venus
élargir le paysage politique du pays, en l'espace de deux ans. Un nombre
qui ne cessera de croître pour dépasser aujourd'hui la soixantaine
de partis politiques. Rien qu'en 2000, une vingtaine de partis ont vu le jour.
Cette multiplication des partis à la veille des échéances
électorales est parfaitement compréhensible dans la logique
clientéliste de la politique sénégalaise.
Aujourd'hui, il est difficile de délimiter les
frontières idéologiques entre les partis politiques
sénégalais. Certes, si l'on se réfère aux statuts
les différences apparaissent clairement, mais dans la pratique et
l'expérience de la discussion publique (lors des campagnes
électorales), les lignes de démarcation sont assez floues. Le
clivage idéologique n'est pas déterminant pour rendre compte de
la configuration partisane sénégalaise, des pactes, des
réseaux et des complicités clientélaires qui s'y
déploient.
Les clivages entre les partis politiques
sénégalais tiennent moins de l'idéologie que de
critères d'efficacité clientéliste et de performance
électorale. Par ailleurs, ces partis ont en commun de regrouper souvent
une quantité de membres sur des bases relevant plus des relations
personnelles ou d'allégeances primordiales que d'une adhésion
réelle à un projet politique commun.
Le nombre important de partis que compte le
Sénégal (même si on est loin des quelques 400 partis
politiques que compte un pays comme la République démocratique du
Congo, ancien Zaïre) ne traduit point une qualité proportionnelle
du débat démocratique. Dans la plupart des cas, cette
pléthore de partis n'est rien moins qu'un folklore et traduit
l'insignifiance et la légèreté de l'activité
politique.
La création effrénée de partis politiques
à la veille de chaque élection, ne correspond point à une
volonté de présenter des projets alternatifs pour le
développement du pays ou pour exprimer des divergences
idéologiques mais elle correspond le plus souvent, comme partout
ailleurs mais peut-être encore plus qu'ailleurs, à une ambition
personnelle. Un grand nombre de partis n'existent que de nom comme des
fantômes administratifs ou des figurants. Ils n'existent que sous le mode
d'être là seulement et n'agissent pas véritablement comme
des forces de négociation et de discussion, dotées d'une
puissance de négociations alternatives. D'ailleurs les électeurs
ne s'y trompent pas. Ils ne prennent nullement au sérieux tous ces
candidats qui apparaissent comme par enchantement pour chaque élection.
Lors des législatives d'avril 2001, l'apparition
à la télé de certains candidats et leurs discours
déclenchaient moqueries et railleries. Ils amusaient plus la galerie
qu'ils n'apportaient au débat politique.
Il est intéressant de se demander pourquoi autant de
partis politiques dont certains disparaissent au lendemain des
élections? Au Sénégal, les partis politiques se
présentent comme des courtiers politiques. Les élections sont le
moyen privilégié pour obtenir l'investiture, qui permet de
partager le « gâteau national » ou d'accéder
aux ressources sociales et économiques.
Au « pays de Ndoumbélane » (royaume
de la ruse et de la malice), ne tire son épingle du jeu que qui a plus
d'un tour dans son sac.
De ce point de vue, sous Diouf comme sous Wade, opposition et
majorité gouvernante peuvent être logées à la
même enseigne. Il existe entre elles une différence de
degré et non de nature. Ce qui les différencie, ce sont les
positions de pouvoir, l'inégalité dans l'accès aux
prébendes étatiques et à l'argent des milieux d'affaire.
Le parti dominant a beaucoup plus d'opportunités pour contrôler
les richesses, entretenir ses réseaux clientélistes, distribuer
des prébendes. Ceci explique les volte-face et/ou changements d'alliance
les plus inattendus. Au lendemain de la victoire de Wade, des alliés de
longues date de Diouf (des partis alliés ou des
« barons » du PS ont rejoint les rangs de la nouvelle
majorité.
Beaucoup de cadres socialistes qui avaient combattu Abdoulaye
Wade aux deux tours des élections n'ont pas hésité
à rallier le PDS, s'ils ne l'avaient pas fait au soir du premier tour en
anticipant les événements. L'idéologie politique
résiste mal au Sénégal aux intérêts
personnels ce qui explique assez aisément ce phénomène de
« transhumance ».
Pour finir, rappelons que si certains (parmi lesquels les
sénégalais très imbus de leur expérience) disaient
et disent encore que le Sénégal est le premier pays
démocratique d'Afrique, il nous semble qu'il faut éviter ce genre
de raisonnement émanant d'une vision à la fois
développementaliste et afro-pessimiste selon laquelle le multipartisme
serait un luxe pour l'Afrique.
Etant admis qu'un système multipartite sous la
dominance d'un seul parti durant quarante ans, sans aucun changement de
régime et en causant autant de bouleversements sociaux, ne sert jamais
de modèle, l'expérience politique sénégalaise n'est
pas, et ne peut être modèle de démocratie africaine.
Seule l'alternance démocratique survenue le 19 mars
2000, suivie d'élections législatives transparentes le 29 avril
2001 pourrait l'être, comme une gloire entachée de blessures.
La gravité des instabilités sociopolitiques qui
ont jalonné l'histoire post-coloniale sénégalaise, montre
que les quarante années de « stabilité »
politique au Sénégal n'ont été en fait qu'un mythe
à être dorénavant dissipé. Le Sénégal
mérite sûrement d'être un modèle de la
démocratie africaine, mais pas tel qu'il a été.
Les limites de la « démocratie
sénégalaise » nous amènent à nous poser
la question de la nature de ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie.
Pierre Messmer s'adressant au Président Diouf disait :
« (...)les électeurs sénégalais vous
confirmeront leur confiance en 1983 et vous rééliront en 1988 et
en 1993. Ces élections n'ont pas été faciles car vous
êtes un démocrate. Vous avez vous-même défini les
cinq caractères politiques essentiels de la démocratie. Je vous
cite :
«- L'égalité de tous les citoyens devant la
loi et les institutions,
- Une égalité électorale,
- Des élections périodiques de
représentants des citoyens,
- Une législation mise en oeuvre et appliquée
selon la règle majoritaire,
- Une liberté d'action politique et de formulation
d'une politique. »
Et comme vous savez que les règles sans la pratique
sont lettre morte, vous ajoutez : « le premier moyen de
sauvegarde de la démocratie réside dans la capacité des
hommes à réguler le système par une pratique saine et un
aspect scrupuleux de la codification sociale qui le régit
nécessairement. » »48(*)
Ces paroles fort élogieuses de P. Messmer à
l'égard du Président Diouf, semblent soutenir, contrairement
à la population sénégalaise, que le régime de Diouf
était un modèle de démocratie.
Par-delà , les discours flatteurs et les attitudes
conciliantes de la France, se pose la question de la nature de
« la » démocratie.
Pourquoi P. Messmer ne serait-il pas convaincu du
caractère démocratique du régime du
Président Diouf? Après tout, Juan Linz n'écrivait-il
pas : « Un gouvernement est démocratique quand il offre
des opportunités constitutionnelles régulières pour la
compétition pacifique en vue de la conquête du pouvoir politique
à différents groupes, sans exclure par la force aucun secteur
significatif de la population. »49(*) ?
Le pouvoir socialiste n'avait-il pas alors tous les
critères de ce qu'on peut appeler une démocratie ? Ou bien
ne s'agissait-il que d'une démocratie formelle ? Ou se situe la
frontière entre une démocratie dite formelle et celle dite
réelle, effective ?
L'expérience de la démocratie
sénégalaise, nous interpelle au moins sur une chose :
faut-il rejeter la démocratie formelle sous prétexte qu'elle
n'est que mascarade et paravent pour les dictateurs ? La démocratie
dite formelle ne mérite certainement pas les sarcasmes dont on l'a
accablée. Certes, la limitation aux seules formes ou l'imitation pure et
simple des formes comporte le risque non négligeable de n'affecter que
la surface et l'écume des choses. Le danger est de prendre un moyen
pour une fin en soi.
Pour Guy Hermet, les garanties et la dignité
qu'une démocratie formelle confère explicitement aux citoyens
fournissent les conditions d'une démocratie plus réelle. Celle-ci
ne peut exister sans la première, sous peine de déboucher sur les
entraînements révolutionnaires qui asservissent l'homme sous
prétexte de le libérer de ses mauvaises habituels.
« les pratiques formelles de tous ordres, écrit-il, les
élections répétées, la propagande des partis, les
rites même de la compétence politique dessinent le cadre
irremplaçable de l'apprentissage démocratique, en attendant que
la citoyenneté soit vraiment entrée dans les moeurs d'une
population. »50(*)
Peut-être qu'il a fallu au Sénégal
indépendant, quarante années pour parfaire son apprentissage
démocratique. Nul n'est éprouvé, ici, le besoin de
justifier le retard démocratique pris par le Sénégal (et
l'Afrique en générale) mais l'histoire nous apprend que les pays
dits de grande démocratie ont eu besoin de ce travail d'apprentissage.
Bien loin d'offrir un exemple harmonieux de développement
démocratique cohérent, l'Europe a connu cette situation au
siècle dernier ; ainsi quand des paysans français voyaient
dans la République « la dame qui avait remplacé le roi
à Paris », cette vue sommaire ne les empêchait pas de
voter pour élire les amis de cette nouvelle souveraine
République, en apprenant ainsi le rôle qui leur était
désormais imparti.
Il nous semble que la démocratie n'est jamais
donnée mais acquise dans la pratique. Tout comme elle n'est jamais
définitivement acquise mais nécessite un travail de tous les
jours. Même si ce travail est d'autant plus important qu'il s'agit de
pays économiquement à l'agonie.
Dans les Etats africains où le bas niveau de vie des
gens est une des causes principales de l'éclatement plus ou moins grave
du tissu social, les élections constituent, parfois, le fil conducteur
d'un bouleversement social de plus grande envergure. Mais cela suffit-il
à expliquer une telle parade de grèves, d'émeutes et de
crises graves allant jusqu'à l'état d'urgence au
Sénégal, présumé depuis longtemps, pays
modèle de la démocratie ?
Le pluralisme politique n'est pas toujours synonyme de
bouleversements sociaux. Et dire qu'au Sénégal, la tradition
pluraliste, qui date depuis fort longtemps, a été la cause de
toutes ces agitations serait une erreur. Parce que d'après ce genre de
raisonnement quelque peu « afro-pessimiste », n'importe
quel régime soi-disant démocratique, à condition qu'il
n'ait jamais connu de coup d'Etat, ni une dictature, peut se réclamer un
modèle pour l'Afrique. De même, considérer la crise de
distribution due à la faillite économique, selon les doctrines
développementalistes51(*), comme la cause de tout, n'est plus une bonne
réponse.
En effet, au Sénégal, il fallait tout changer,
et ce, à travers le seul moyen de changement total : les
élections, surtout les présidentielles que les
sénégalais considèrent comme une sortie de secours. Cette
sortie semblait être bouchée par « l'immobilisme du
régime socialiste vieillissant, il fallait donc la déboucher
coûte que coûte, soit en manifestant, soit avec des gestes
coercitifs. » (Momar Seni N'diaye, Le Soleil).
Donc, la fameuse thèse selon laquelle la
démocratie postule le développement économique comme un
préalable52(*)est
caduque.
En analysant la corrélation entre le
développement économique et la violence politique, on a
suggéré que le développement économique favorisait
un fonctionnement polyarchique des sociétés en atténuant
les conflits, en modérant l'acuité et la violence de ces
derniers, et en facilitant la réalisation de compromis plus
nombreux53(*).
Or nul ne nie que des régimes non démocratiques
aient réussi à élever le niveau de vie, à
étendre la scolarisation, à faire reculer la mortalité
infantile, et nul ne peut nier qu'une démocratie puisse échouer
et conduire à la crise économique, à la violence sociale
et à l'augmentation des inégalités.
Donc, sans vouloir se placer du côté de
l'afro-pessimisme ou de l'afro-optimisme, nous pensons qu'il faut relativiser
la différence, présentée par certains comme absolue, entre
les élections en Afrique et les élections dans les pays dits de
démocratie. Et ce en changeant notre propre jugement quant à la
démocratie.
La démocratie ne doit pas être
considérée comme un idéal-type, constituant une
norme par rapport à laquelle les phénomènes qui
sont les plus visibles dans les élections africaines (la fraude, le
clientélisme, le vote communautaire, la violence...) seraient des
déviances ; ces déviances seraient
constitutives des procédures électorales en
général.
ANNEXES :
Fiche descriptive du
Sénégal :
|
Population :
|
9 987 494 habitants (est. 2000)
|
Densité :
|
50.91 hab./km²
|
|
Superficie :
|
196 192 km²
|
Capitale :
|
Dakar
|
|
Principales villes :
|
Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Saint Louis, Diourbel
|
Pays voisins :
|
Mauritanie,
Mali,
Guinée
Bissau,
Guinée,
Gambie
|
|
Point culminant :
|
Futa Jaldon Foothills 581 m.
|
Monnaie :
|
Franc CFA
|
|
Langue(s) parlée(s) :
|
Wolof, Tukolor, Serer, Mandinka, Dyola
|
Langue(s) officielle(s) :
|
Français
|
|
|
Statut :
|
République
|
Carte du découpage régional du
Sénégal :
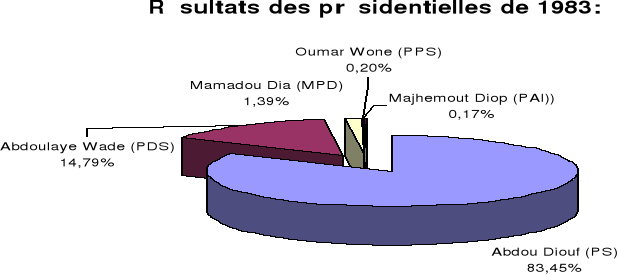
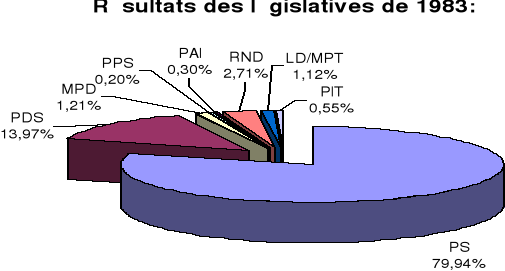 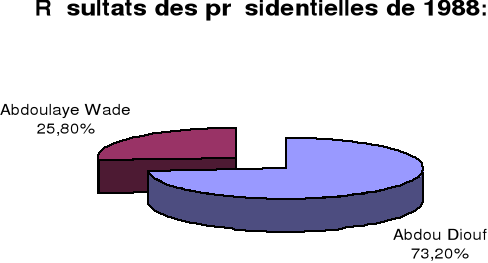
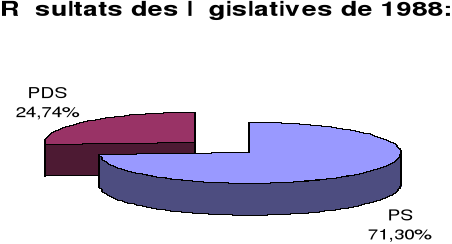
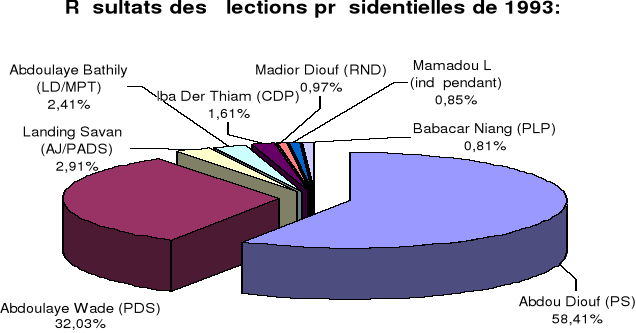

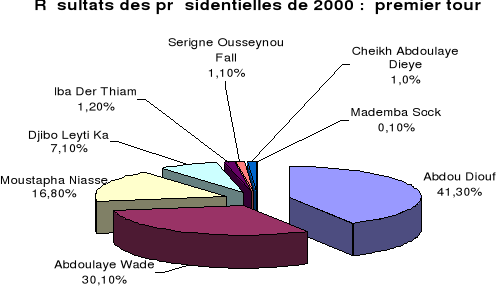
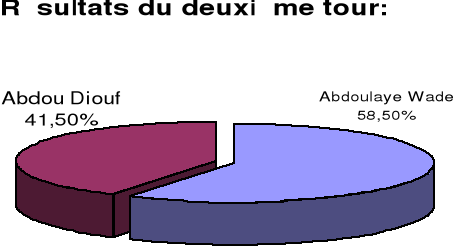
BIBLIOGRAPHIE :
Bibliographie
Badie. Bertrand, L'Etat importé, L'occidentalisation
de l'ordre politique, Fayard, Paris, 1992.
Badie. Bertrand, Le développement politique,
Economica, Paris, 1988.
Blanchet. Alain, L'entretien dans les sciences sociales,
Donold, Paris, 1991
Burdeau Georges, Traité de science politique,
tome1er, 2ème édition, LGDJ, Paris, 1960.
Général Cissé Lamine, Carnets secrets
d'une alternance : un soldat au coeur de la démocratie,
Editions GIDEPPE, Paris, 2001.
Dahl, Robert. A, Polyarchy, New Haven, Yale Univ Press,
1971.
Dahl, Robert. A, in V. Bogdanor (dir Publ), The Blackwell
Encyclopoedia of Political Institutions, Oxford, Blackwell References,
1987.
Decraene. Philippe, Le Sénégal, Que
sais-je ? PUF, Paris, 1985.
Dimitri-G. Lavroffi, La République du
Sénégal, LGDJ, Paris, 1966.
Diop. Momar Coumba et Diouf. M, Le Sénégal sous
Abdou Diouf, Karthala, Paris, 1990.
Dumont. René, Démocratie pour l'Afrique,
Seuil, Paris, 1991.
Fall. Mar, Sénégal, L'Etat Abdou Diouf ou le
temps des incertitudes, Harmattan, Paris, 1986.
Fall Ibrahima, Sous-développement et démocratie
multipartisane : l'expérience sénégalaise,
Nouvelles Editions Africaines, Dakar-Abidjan, 1977.
Gonidec. Pierre-F, Les systèmes politiques
africains, LGDJ, Paris, 1978.
Hermet Guy, Le pasage à la démocratie,
FNSP, Paris,1996.
Hermet Guy, Sociologie de la construction démoratique,
Economica,Paris, 1986.
Juan. J. Linz, in E. Allardt, Y. Littunen (dir Publ),
Cleavages, Ideologies and Party Systems, Helsinki, The Academic
Bookstore, 1964.
M'bokolo. Elikia, L'Afrique au 20ème
siècle, Seuil, Paris, 1985.
N'diaye. Jean-Pierre, Enquête sur les étudiants
noirs en France, Réalités Africaines, Paris, 1962.
Pisani Edgard, Pour l'Afrique, Odile Jacob, Paris,
1988.
Pye, Lucian. W, Aspects of Political development,
Borton, Little Brown, 1967.
Shils. Edward, Political Development, in the New States,
The hague, Mouton and Co, 1960
Périodiques et Journaux
L'annuaire des parties politiques, Partenariat/
Fondation Konrad Adenauerr (FKA)-Centre d'Etude des Sciences et Techniques de
l'Information (CESTI), Graphi Plus, Dakar, avril 2001.
Rapport mondial sur le développement humain,
PNUD, Paris, 1999.
Guy Hermet, « Le temps de la
démocratie », in R.I.S.S, N°128, mai 1991.
Touraine Alain, « Qu'est-ce que la
démocratie aujourd'hui ? », in RI.S.S, N° 128,
mai 1991.
Sémou Pathé Guèye, « Fin de
l'histoire et perspective de développement : l'Afrique dans le
temps du monde », in Afrique 2000 (24), août 1996.
Denis-Constant Martin, « La houe, la maison, l'urne
et le maître d'école : les élections en Tanzanie,
1965-1970 », in, Revue française de science politique,
vol 25, N°4, août 1975.
Zucarrelli. F, « L'évolution récente
de la vie politique au Sénégal », revue
française d'études politiques africaines, juillet 1976.
Sandbrook . Richard, « Personnalisation du pouvoir
et stagnation capitaliste : l'Etat africain en crise »,
Politique Africaine, N°26, 1987.
Discours de réception du Président Abdou Diouf
à l'académie d'Outre mer, 27 mars 1997 par Pierre Messmer,
in Revue juridique et politique indépendance et coopération,
51ème année, N°2, mai-août 1997, N°3,
septembre-décembre, 1997.
Jeune Afrique : N° 2024, 15-21 fev 2000, N° 2036,
18-24 janv 2000, N° 2037, 25-31 janv 2000, N° 2039, 8-14 fev 2000,
N°2044, N° 2045, 21-27 mars 2000.
Taxaw, N°4, juillet 1983.
Michalon Thierry, « Pour la suppression de
l'élection présidentielle en Afrique », le Monde
diplomatique, janv 1998
Matine-Renée Gallois et Marc-Eric Gruénais,
« Des dictateurs sortis des urnes », Le Monde
diplomatique, nov 1997.
* 1 En reprenant le
célèbre ouvrage de R. Dumont, Démocratie pour
l'Afrique, Seuil, Paris, 1991.
* 2 Sémou Pathé
Guéye, Fin de l'histoire et perspective de
développement : l'Afrique dans le temps du monde, in Afrique
2000 (24), août 1996, p.12.
* 3 Blanchet. A, L'entretien
dans les sciences sociales, Donold, Paris, 1985.
* 4 Mar Fall,
Sénégal, L'Etat Abdou Diouf ou le temps des
incertitudes, Harmattan, Paris, 1986, p. 10.
* 5 Dimitri G. Lavroff, La
République du Sénégal, LGDJ, Paris, 1966, pp.
182-239.
* 6 Il exerçait une
réelle fascination sur les jeunes étudiants africains en France
au moment des indépendances. En effet, si on se réfère
à une enquête sélectionnant les personnalités qui
ont travaillé à la réhabilitation des cultures
négro-africaines, le nom de Ch. A. Diop a été cité
(31%), après ceux d'Aimé Césaire (42%) et de Senghor
(38%). Cf. Jean-Pierre N'Diaye, Enquête sur les étudiants
noirs en France, Ed. Réalités Africaines, Paris, 1962.
* 7 Julius. K. Nyerere,
cité par Denis-Constant Martin, « La houe, la maison,
l'urne et le maître d'école. Les élections en Tanzanie
1965-1970. », in Revue française de science politique,
vol 25, N°4, août 1975, p. 680.
* 8Ce pluralisme limité
n'aurait été que « le mystère de la sainte
trinité (3 en 1 et 1 en 3) », selon l'expression de P -F
Gonidec, les systèmes politiques africains, LGDJ, Paris, 1978,
p. 166. Voir aussi F. Zucarelli, « L'évolution
récente de la vie politique au Sénégal »,
Revue française d'études politiques africaines, juillet 1976, pp.
85-102, voir aussi, Ibrahima Fall, sous-développement et
démocratie multipartisane : l'expérience
sénégalaise, Nouvelles Editions Africaines,
Dakar-Abidjan, 1977.
* 9 Cf. l'article de Antoine
Tine, Du multiple à l'un et vice versa ? Essai sur le
multipartisme au Sénégal (1974-1996), Institut d'Etudes
Politiques de Paris, disponible sur Internet, www.Cean-u
bordeaux.fr/polis/vol.3nl/arti4.html.
* 10 L'assemblée
nationale étant passée de 120 députés à 140
en 1998.
* 11 Petits dans
l'échiquier politique sénégalais, c'est-à-dire
obtenant généralement O ou 1 député à
l'Assemblé nationale.
* 12 Pour le resultat officiel
et les conséquences sociales des élections de février
1983, Cf. Mar Fall, Sénégal, l'Etat Abdou Diouf, op.
Cité., pp. 30-37. Pour ceux de l'année 1988, Cf M. C. Diop et M.
Diouf., Le Sénégal sous Abdou Diouf, Karthala, Paris,
1990, pp. 295-386.
* 13 Général
Lamine Cissé, Carnets secrets d'une alternance : Un soldat au
coeur de la démocratie, Editions, GIDEPPE, Paris, 2001, p. 51.
* 14 Mamadou Dia qui tenait
également les portefeuilles de la Défense et de la
Sécurité, essaya, sans succès, l'armée ayant
refusé de le suivre, d'engager une épreuve de force avec Senghor.
Cf. Philippe Decraene, Le Sénégal, Que sais-je ?, PUF,
Paris, 1985, p. 71 : Voir également Elikia M'bokolo, l'Afrique au
20ème siècle, Seuil, Paris, 1985, pp. 165-166.
* 15 Jeune Afrique, N°
2037, 25-31 jan. 2000, p. 19.
* 16 Cf. Mar Fall,
Sénégal, L'Etat sous Abdou Diouf, op. cit., pp.
78-82.
* 17 Jeune Afrique,
N°2024, 15-21 février. 2000, p. 27.
* 18 Général
Lamine Cissé, Carnets secrets d'une alternance, un soldat au coeur
de la démocratie, op. cit, p. 11.
* 19 Général
lamine Cissé, op. cit., p. 23.
* 20 Ibid.
* 21 Jeune Afrique,
N°2039, 8-14 fev. 2000, p. 21.
* 22 Jeune Afrique,
N°2037, 25-31 jan. 2000, p. 19.
* 23 Voir carte en annexe.
* 24 Idem.
* 25 Depuis l'anecdotique gifle
(dans les années 80) qu'il avait assénée à Djibo Ka
que beaucoup de sénégalais jugeaient trop arrogant.
* 26 Propos recuiellis dans le
quotidien Sud Quotidien du 28 février 2000.
* 27 Ibid.
* 28 Ce parti dont le discours
est souvent proche de l'Islam, (d'ailleurs son slogan est « Allahou
Wahidoune » (Dieu est unique) a pour objectif « la
conquête du pouvoir pour gérer autrement ».
* 29 Le Soleil daté du
30 février 2000.
* 30 FAL signifiant aussi
« élire » en Wolof.
* 31 En 1994, la
dévaluation du franc CFA ayant brutalement renchéri le prix des
médicaments, produits alimentaires et vêtements importés,
le secteur informel, déjà pléthorique, n'est devenu qu'un
cache-misère : quelques 400 000 personnes vivaient avec moins de
75F CFA par jour à Dakar. C'est justement le prix de la croissance
soutenue et de l'inflation maîtrisée. Par ailleurs, au
palmarès du développement humain, Sénégal occupe la
153ème place sur 174, après Zambie
(151ème) et Haïti (152ème). Cf.
Rapport mondial sur le développement humain, PNUD, Paris, 1999.
* 32 Cf. Pye, Lucian W.,
Aspects of Political development, Boston, little Brown, 1967.
* 33 Entre 1960 et 1993, les
sénégalais ont reçu des montants plus de quatre fois
supérieurs à l'aide moyenne par habitant accordée aux pays
d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui encore, la France, les Etats-Unis, les
monarchies du Golfe, mais également le FMI et la Banque mondiale ne
refusent quasiment rien au Sénégal. CF. Assou Massou,
« Sénégal Présidentielle 2000 : Ce qui
doit changer », Jeune Afrique, N°2045, 21-27 mars 2000, pp.
22-25.
* 34 Jeune Afrique N°2045,
pp. 22-25.
* 35 La plupart de nos
interlocuteurs n'ont pas manqué d'insister cet aspect du personnage, qui
redevenait flagrant au moment où nous faisions les entretiens, moments
qui coïncidaient avec la campagne pour les législatives
anticipées d'avril 2001.
* 36 Robert. A. Dahl,
in V. Bogdanor (dir. Publ.), The Blackwell Encyclopaedia of Political
Institutions, Oxford, Blackwell Référence, 1987, p. 167.
* 37 Bertrand Badie, L'Etat
importé. L'occidentalisation de l'ordre politique, Fayard,
1992, p. 86.
* 38 Tout jeune
sénégalais a entendu à maintes reprises ses grands-parents
ou parents lui dire « Temps woo Senghor.... (du
temps de Senghor...) ».
* 39
« Presque » : parce que déjà sous
Senghor, des procès ont été intentés contre les
journalistes, parmi lesquels quelque uns, comme Boubacar Diop, directeur du
journal Promotion ont été arrêtés. Cf. M. C.
Diop, Le Sénégal sous Abdou Diouf, op. cit., p. 416.
* 40Touraine. A,
« Qu'est-ce que la démocratie
aujourd'hui ? » in R.I.S.S, N°. 128, mai 1991, p.
277.
* 41 Ce
référendum devait permettre au Sénégal de se
déterminer par rapport à son appartenance à la
communauté française.
* 42 Cf. l'article de Antoine
Tine, Du multiple à l'un et vice versa ? Essai sur le
multipartisme au Sénégal (1974-1996), Institut d'Etudes
Politiques de Paris, disponible sur Internet, www. Cean.u-bordeaux.fr/polis/
vol3n1/arti4.html.
* 43 « Quel
hommage à Cheikh Anta ? », Fernant, N°. 31,
Dakar, avril 1986, p. 18 : la succession Senghor-Diouf ayant ainsi
été assurée, la question est de savoir quels ont
été les rapports du RND de Ch. A. Diop avec le monde Mouride qui
a été censé être la base même du parti. A cet
effet, CH. A. Diop lui-même a expliqué : « le RND
est un parti laïc. Mais chacun est né dans un milieu. Alors tant
mieux si ce milieu l'aide dans le cadre d'une action politique ». Cf.
« La conférence de Ch. A. Diop, Taxaw, N°. 4, juillet
1983, p. 8.
* 44 Le N'diambour (ou Louga)
étant la région natale de Diouf. Voir annexe.
* 45 Thierry Michalon,
« Pour la suppression de l'élection présidentielle
en Afrique », in Le Monde diplomatique, janvier 1998, pp.
24-25 ; Martine-Renée Gallois et Marc-Eric Gruénais,
« Des dictateurs sortis des urnes », Le Monde
diplomatique, novembre 1997.
* 46 Samuel Huntington
cité par Guy Hermet, « Le temps de la
démocratie », in R.I.S.S, N°. 128, mai 1991, p.
269.
* 47 Cf. Annuaire des
partis politiques, CESTI, Graphi Plus, Dakar, avril 2001, p 37.
* 48 Discours de
réception du Président A. Diouf, à l'académie
d'outre-mer, 27 mars 1997, par Pierre Messmer, in Revue Juridique et Politique
Indépendance et Coopération, 51ème
année, N°.2, mai-août 1997, N°. 3, sept-déc 1997,
p. 129.
* 49 Juan. J. Linz, in E.
Allardt, Y. Littunen (dir. Publ.), Cleavages, Ideologies and Party
systems, Helsinki, The Academic Bookstore, 1964, p.295.
* 50 Présentation de Guy
Hermet du thème « Le temps de la
démocratie », in R.I.S.S, N°. 128, mai 1991, p.
267.
* 51 Pye, Lucian W.,
Aspects of political Development, Boston, Little Brown, 1967 ;
recueil des travaux réalisés au début des années
soixante, dont l'analyse de six crises est introduite in Bertrand Badie, Le
développement politique, Economica, Paris, 1988, pp. 57-62.
* 52 Cf. Edward Shils,
Political Development in the New states, The Hague, Mouton and Co.,
1960.
* 53 Dahl, Robert A.,
Polyarchy, New Haven, Yale Univ, Press, 1971. P. 167.
| 


