|
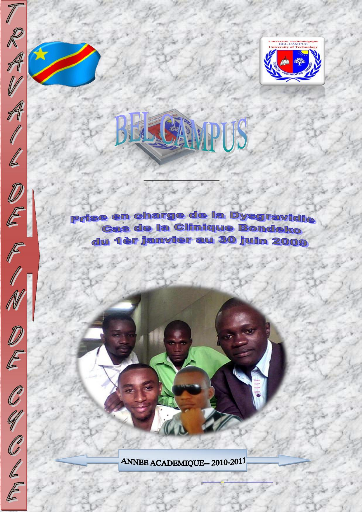
1 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE
8ème rue LIMETE/INDUSTRIEL
Travail de Fin de Cycle dans le but d'obtention d'un
diplôme de graduat EN MEDECINE. Dirigé par : C.T.
Dr. KALONJI Didier
Réalisé par :
MENDE FUDU Cédric
RUDAHINDWA M'PANWI As
LONGILA IKETU Pika
KAMBALE MUSAVULI Monsieur
ELEMBO LIHUTA Blaise
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

2 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
DEDICACE
A nos familles respectives : ELEMBO, LONGILA,
MENDE,
MUSAVULI, RUDAHINDWA et nos connaissances.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
n C.I.V.D. : coagulation intravasculaire
disséminée
n C.P.N. : consultation prénatale
n cmHg : centimètre de mercure
n D.P.P.N.I. : décollement prématuré du
placenta normalement inséré
n H.L.A. : Human leucocyte antigens
n H.R.P. : hématome retro placentaire
n H.T.A. : hypertension artérielle
n L.D.H. : lactate déshydrogénase
n M.I.U. : mort in utero
n mmHg : millimètre de mercure
n N.K. : natural killer
n O.M.S. : organisation mondiale de la santé
n P.A. : pression artérielle
n P.D.G.F. : platelet derived growth factor
n P.E.M. : prééclampsie modérée
n P.E.S. : prééclampsie sévère
n R.C.I.U. : retard de croissance intra-utérin
n R.O.T. : reflexe ostéotendineux
n S.F.A. : souffrance foetale aigue
n S.F.C. : souffrance foetale chronique
n S.N.A. : système nerveux autonome
n T.A. : tension artérielle
n T.F.C. : travail de fin de cycle
n T.N.F. : tumor necrosis factor

A Notre Père Céleste, Dieu ;
A l'université technologique Bel Campus pour sa formation
en science médicale,
A notre Directeur de travail, C.T Dr KALONJI Didier pour sa
disponibilité et sa rigueur dans le travail qu'il n'a cessé au
cours de la réalisation de ce T.F.C.
A nos enseignants de la faculté de médecine d'avoir
contribué indirectement à des connaissances incluses dans ce
travail à travers leurs cours bien dispensés,
particulièrement ceux de G3Bio-médicale notamment Professeur
MPETSHI de la cardio-vasculaire, Dr. LUKUSA de la physiologie, Dr. MALEMBA de
la physiopathologie et Dr. PAKASA de l'anatomopathologie.
Sans oublier le Dr. Alphonse qui a posé sa dernière
touche pour une belle présentation de ce travail.
Et enfin à nos familles respectives qui ont mis des moyens
pour nous permettre d'achever ce premier cycle d'étude en
médecine avec succès et ferme assimilation des différents
cours.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

5 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
INTRODUCTION
Notre travail portera sur un merveilleux sujet qui s'intitule;
la dysgravidie, la toxémie gravidique , l'hypertension
artérielle gravidique ou la gestose éclamptogène, encore
appelée la néprhopathie gravidique qui est une hypertension
artérielle (HTA) survenant chez une femme enceinte, qui trouve
son origine dans un trouble de la placentation.
+ PROBLEMATIQUE
Au cours de notre travail à la clinique BONDEKO, nous
allons décrire a priori les différents points qui feront l'objet
du débat dans le restant de ce travail ; d'abord savoir
définir la dysgravidie ; une hypertension artérielle
gravidique apparaissant à la 20ème semaine
d'aménorrhée et qui trouve son origine dans le trouble de
placentation.
Sur l'épidémiologie, la prévalence
et l'incidence de la dysgravidie dans le monde seront exposées, de
même l'étiologie de cette toxémie gravidique,
entre autres les causes immunologiques, génétiques, etc. Quant
à sa physiopathologie, étant le défaut d'invasion
trophoblastique offrant des calibres vasculaires insuffisants, entrainant une
ischémie en favorisant la hausse de la tension artérielle. En ce
qui concerne les conséquences, elles sont
répercutées à la fois chez la femme et le foetus. La
clinique nous révèle une hypertension artérielle, des
oedèmes, des acouphènes, des phosphènes, des
céphalées et autres, la clinique est complétée par
la paraclinique. Le diagnostic différentielle sont
mises en évidences pour écarter les faux vrais. Les
complications qui en découlent sont d'origine
cérébrale, cardiaque et rénale. Enfin, la sanction se
faite par l de tous a prise ne charge, soit l'avortement volontaire dans les
cas complexes, soit un traitement médical dans les cas aigus.
+ LES OBJECTIFS
> Objectif général :
- Apprendre aux jeunes médecins à avoir des
connaissances approfondies sur la dysgravidie.
> Objectifs spécifiques :
- Déterminer la fréquence des femmes avec
dysgravidie.
- Préciser le profil sociodémographique des femmes
les plus exposées à cette pathologie, la toxémie
gravidique.
- Déterminer les éléments cliniques de la
dysgravidie.
- Relever les issues néonatales effectives pour les femmes
avec dysgravidie.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

6 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
CHAP 1. GENERALITES
1.1. Définitions
Selon Maurice KLAT (XI) dans son précis de
cardiologie, la toxémie gravidique est une condition dont
l'étiologie est inconnue et qui associe une hypertension,
protéinurie et un oedème 1.
Une autre définition plus élargie enrichi en
disant que, l'hypertension artérielle gravidique est une hypertension
artérielle (HTA) survenant chez une femme enceinte, qui trouve
son origine dans un trouble de la placentation. 2
L'HTA (Hypertension artérielle) gravidique autrement
appelée toxémie gravidique, prééclampsie,
dysgravidie ou encore géstose éclamptogène est une
pathologie de la tension artérielle qui touche 10 à 15 % des
femmes enceintes, a définie médicalorama3.
Les hypertensions gravidiques représentent un groupe
d'affections dont la nature et les mécanismes restent imparfaitement
classifiés.
La prééclampsie (appelée aussi
toxémie gravidique) est une hypertension artérielle
gravidique (HTAG) qui apparaît dans la deuxième
moitié de la grossesse. Elle est caractérisée par une
pression systolique supérieure à 140 mm Hg ou une diastolique
supérieure à 90 mm Hg, combinée avec une
protéinurie.
Il ne s'agit pas d'une pathologie anodine puisqu'elle est la
cause premiere de maladie et de mortalité chez le nouveau-né.
Chez des femmes n'ayant jamais eu de problème au niveau de leur tension,
peut survenir au cours de la grossesse ce qu'on appelle l'HTA gravidique. Elle
nécessite une surveillance et une prise en charge stricte de la future
mère. Selon les statistiques, sur la totalité des femmes
enceintes, la moitié souffrirait d'une HTA essentielle parce qu'elle
existe en dehors de la grossesse. L'autre moitié développe une
HTA gravidique. Elle se manifeste généralement au cours de la
vingtième semaine d'aménorrhée alors que la femme n'avait
jamais eu de problème d'hypertension auparavant.
L'HTA gravidique devient la première cause de
mortalité maternelle au cours de la grossesse dans les pays
développés. Le dépistage pourrait être fait
grâce à l'étude indirecte de la placentation par
l'étude des artères utérines par effet
doppler4.
1.2. L'Epidémiologie
1.2.1. Prévalence
La prévalence de la prééclampsie est
estimée entre 5 à 6 % des grossesses. Il s'agit d'une cause
majeure de mortalité maternelle dans les pays en voie de
développement, à l'occurrence la R.D.C.
1 KLAT Maurice, Précis de cardiologie,
Edition la sève, Paris, 1981, p.257.
2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertension_art%C3%A9rielle_gravidique
3
Www.
médicalorama.com.
4 Doppler est un examen par ultrason
souvent appliqué en imagerie médicale.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207
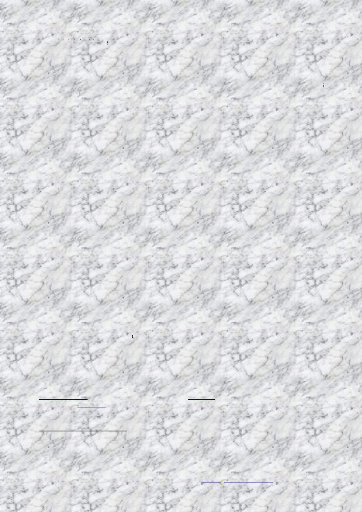
7 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
1.2.2. Incidence
L'incidence de l'hypertension gravidique est estimée
entre 10 et 15 % des grossesses. Elle tend à augmenter dans les pays
développés, probablement en rapport avec les facteurs de risque,
telle que la France, l'Italie...
La fréquence en est voisine dans la plupart des pays
d'Europe et aux États-Unis, hormis quelques études qui
surévaluent cette fréquence du fait d'une définition plus
laxiste.
Quelque 10 % de ces femmes (2 à 3 % de la population) ont
une prééclampsie (selon la définition ci-dessus). Le
pourcentage de prééclampsie, et surtout de
prééclampsie grave, est en fait bien plus variable suivant les
pays, avec une incidence nettement plus élevée dans les pays en
voie de développement.
La prééclampsie est assortie d'une mortalité
maternelle, variable suivant les pays, entre 0,1 et 5 pour 1000 cas, voire
plus. Cette mortalité est largement concentrée chez les patientes
ayant un syndrome HELLP5.
Même si l'éclampsie (crise convulsive) est devenue
un accident rare (0,56%o naissances), du moins sous nos climats, elle reste une
éventualité particulièrement grave. Une mortalité
maternelle de 5 % a été rapportée en Australie en cas
d'éclampsie.
Les hypertensions gravidiques apparaissent volontiers des la
premiere grossesse, l'age de celle-ci n'étant pas fondamentalement
différent de celui des grossesses normales.
La classique distribution en « double-bosse » (un pic
chez les très jeunes femmes de moins de 20 ans, un second pic
au-delà de 37-40 ans) n'est plus observée actuellement sous nos
climats, mais le reste dans certains pays en voie de développement.
Ces faits permettent de supposer que le risque d'avoir une
hypertension gravidique soit plus élevé chez les femmes qui ont
une activité physique ou intellectuelle importante, et/ou une couverture
sociale médiocre.
De même, la fréquence de la
prééclampsie est plus basse chez les fumeuses.
L'explication de ce dernier fait n'est pas connue. La
prééclampsie touche dans plus de 90% des cas des primipares. Chez
ces patientes, 17% restent hypertendues et 12% ont une pression
artérielle limite.
1.3. Les Etiologies
1.3.1. Facteurs de risque
La prééclampsie apparaît
généralement chez des femmes ayant pris beaucoup de poids au
cours de leur grossesse. L'augmentation importante de la masse graisseuse,
comme chez tout individu, perturbe l'équilibre de l'organisme et
provoque de l'hypertension.
L'hypertension artérielle gravidique est une maladie dont
les causes sont à la fois immunologiques (mauvaise
reconnaissance par les anticorps maternels de l'unité
foetoplacentaire), génétique (il existe des formes
familiales de prééclampsie), et mécanique
(morphologie de l'utérus). Les causes principales sont :
5 Syndrome HELLP, décrit pour
la première fois par Weinstein en 1982 ; associe une hémolyse
intra vasculaire modérée, une élévation des
transaminases (le plus souvent modérée, deux à quatre fois
la normale), et une thrombopénie s'aggravant progressivement.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

8 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
la nulliparité (aucune grossesse) ou la première
grossesse (risque multiplié par 3) avec un nouveau partenaire,
des antécédents personnels ou familiaux
d'hypertension (multiplie le risque de survenue par 3 ; de diabète
sucré (multiplie le risque par 3 environ ), de maladie rénale ou
la notion d'une maladie thromboembolique, de lupus, de syndrome des
antiphospholipides (multiplie le risque par 9 environ),
une exposition insuffisante au sperme (qui ne permet pas aux
anticorps maternels de développer une tolérance aux
antigènes paternels) par exemple par utilisation prolongée de
préservatifs,
un âge maternel avancé, au delà de 40 ans
;
l'obésité (multiplie le risque par 1.5 environ),
Le risque est augmenté en cas de grossesse
gémellaire (et plus) avec une multiplication du risque par 3 environ.
1.3.1.1. Facteurs étiologiques de l'insuffisance
placentaire
Son mécanisme a peu de chances d'être univoque. Il
est au contraire hautement probable que ce soit à cette étape que
s'expriment la diversité et
l'hétérogénéité de la maladie
« hypertension gravidique ».
Les hypothèses envisagées ci-dessous ne sont donc
pas exclusives les unes des autres, et d'autres hypothèses encore seront
sans doute formulées dans les années à venir.
1.3.1.1.1. Hypothèse mécanique
Dans cette hypothèse, la plus ancienne et la plus
simple de toutes, l'ischémie placentaire résulterait de la
compression mécanique de l'aorte et/ou des artères
utérines par l'utérus. Le rôle favorisant bien connu de la
gémellarité et de l'hydramnios serait ainsi facilement
expliqué.
La preuve artériographique directe d'une réduction
importante du calibre de l'aorte sousrénale pendant la grossesse a
d'ailleurs été apportée dans quelques cas anecdotiques.
1.3.1.1.2. Pathologie vasculaire préexistante
Nombre de patientes atteintes d'hypertension gravidique sont en
fait porteuses de lourds facteurs de risques vasculaires, au plan
génétique et/ou métabolique, ces patientes ont toutes les
raisons d'avoir des altérations vasculaires préalables à
la grossesse. De fait, des lésions vasculaires rénales, parfois
impressionnantes, ont été trouvées histologiquement, alors
même que les patientes étaient normotendues. On peut
aisément concevoir que de telles lésions vasculaires,
probablement ubiquitaires, soient un obstacle majeur à une placentation
normale, dans ce cas, la répétition des accidents au fil des
grossesses successives se comprendrait sans peine.
1.3.1.1.3. Pathologie thrombophilique préexistante
Certains ont rapporté une fréquence très
accrue de pathologies thrombophiliques chez des jeunes femmes atteintes de
prééclampsie précoce et sévère. Ces
anomalies étaient principalement un anticoagulant circulant ou
antiphospholipide, un déficit en protéine C ou S, une
résistance à la protéine C activée (dite mutation
Leiden du facteur V), ou une hyperhomocystéinémie. Une
mutation du gène codant la prothrombine (facteur II) a
été plus tard ajoutée à la liste. Ces
données ont été assez largement recoupées par
divers auteurs, et certains admettent que plus de 50 % des femmes ayant
présenté une prééclampsie sévère
seraient porteuses d'au moins une de ces anomalies, s'il paraît probable
que ces anomalies peuvent être impliquées dans la genèse
d'une prééclampsie, au moins au titre de facteur aggravant.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

9 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
1.3.1.1.4. Facteurs immunologiques
Le foetus, dont le capital génétique est pour
moitié d'origine paternelle, représente l'équivalent d'une
greffe semi-allogénique, dont la survie requiert un état de
tolérance immunitaire maternelle. Au cours de la grossesse, il existe
une reconnaissance par la mère d'antigenes paternels et une immunisation
contre ces antigènes ; ainsi, 20 % des primipares et 50 % des multipares
ont des anticorps circulants dirigés contre des composants du HLA
paternel.
Un système de facilitation humorale a ainsi
été mis en évidence et largement étudié dans
les années 1970. Ce mécanisme a été trouvé
totalement absent dans les cas d'avortements itératifs et fortement
diminué dans la prééclampsie, un second facteur de
tolérance serait l'induction de cellules T suppressives.
Un rôle supplémentaire pourrait être
joué par le passage de lymphocytes foetaux (probablement T suppresseurs)
dans la circulation maternelle.
Enfin, nous avons évoqué plus haut l'importance
accordée actuellement aux cellules NK et à leur interaction avec
les antigènes HLA I portés par le trophoblaste.
Le HLA G, peu polymorphe et spécifique du placenta,
signalerait la présence de celui-ci et inhiberait la
cytotoxicité.
Le HLA C traduirait surtout un signal allogénique
d'origine paternelle, et le E déclencherait l'effet inhibiteur des
cellules NK. En définitive, la cytotoxicité dépendrait de
la balance et de l'interaction entre ces trois éléments.
Le défaut d'invasion trophoblastique, et donc la
prééclampsie, pourrait être lié à une
agression immune du placenta.
Ce fait expliquerait pour une part la constatation que
l'hypertension gravidique apparaissant pour la première fois chez une
multipare est souvent associée à un changement de partenaire,
et également que des transfusions préalables se soient
montrées douées d'un effet protecteur vis-à-vis de
l'hypertension gravidique.
Le processus d'immunisation antipaternelle est probablement un
peu plus subtil que ce qui était imaginé à
l'époque, mais sa présence et son importance demeurent. Le
degré et le mode d'exposition au sperme semblent y jouer le rôle
prédominant. Des chercheurs ont montré que le risque de
prééclampsie est plus élevé en cas de conception
précoce dans un couple récent qu'en cas de conception plus
tardive dans un couple établi depuis plus longtemps,
phénomène qualifié peu poétiquement de «
durée de la cohabitation sexuelle ».
De même, en cas d'insémination
artificielle, le risque de prééclampsie est plus
élevé si le sperme provient d'un donneur étranger
plutôt que du conjoint.
La pratique de la fellation, selon plusieurs auteurs,
serait associée à une meilleure protection contre la
prééclampsie que les seuls rapports sexuels par voie vaginale.
Selon certains auteurs également, l'usage d'une contraception
barrière telle que des préservatifs serait associé
à une incidence accrue de prééclampsie.
1.3.1.1.5. Aspects génétiques
Une certaine agrégation familiale des cas de
prééclampsie est classiquement admise. Chez certaines patientes
ayant eu une éclampsie, on retrouve des soeurs, la mère, ou une
grandmère ayant eu le même accident. Une analyse soigneuse de ces
familles avait naguère permis d'estimer qu'il s'agirait d'une
transmission monogénique. De nos jours, l'éclampsie se fait
rare.
La maladie « hypertension gravidique » est bien plus
hétérogene qu'on ne le pensait à l'époque, et les
données des études génétiques apparaissent moins
claires. Tout laisse penser au
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

10 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
contraire que divers gènes impliqués dans la
régulation de la Pa, la régulation du volume plasmatique, le
remodelage vasculaire, et divers facteurs plus spécifiquement
placentaires, interviennent à des titres divers comme «
gènes de susceptibilité " de la prééclampsie.
1.3.1.1.6. Aux confins entre immunologie et
génétique : le père
La prééclampsie n'est pas simplement le
problème d'un individu, c'est aussi celui d'un couple. Le père
peut intervenir dans la genèse de cette pathologie de deux
manières : un « conflit " immunologique entre père et mere,
ou la transmission paternelle d'un gene (ou autre facteur) responsable du
dysfonctionnement placentaire. Lorsqu'une grossesse a été
prééclamptique dans un couple, une nouvelle procréation
entre le même père et une femme différente double
pratiquement le risque de prééclampsie pour cette
dernière. Le risque de prééclampsie est également
accru dans les mêmes proportions chez la demi-soeur d'une femme ayant eu
ellemême une prééclampsie, si les deux femmes sont de
même père et de mere différente. D'autres publications
montrent qu'un homme issu d'une grossesse prééclamptique majore
le risque de prééclampsie pour son épouse. La mutation
était présente plus souvent dans l'acide
désoxyribonucléique (ADN) foetale que dans l'ADN maternel,
indiquant clairement que dans certains cas, le gene était d'origine
paternelle (le gene de la région du chromosome 7q36, codant la eNOS).
1.4. La physiopathologie
L'anomalie initiale menant à l'hypertension
artérielle gravidique et ses complications est un trouble
précoce de la placentation (anomalie d'invasion des artères
spiralées utérines ou maternelles, qui sont de calibre
insuffisant et ne perfusent pas correctement le placenta), ceci aboutit
à une ischémie placentaire (le placenta ne reçoit pas
assez de sang, et donc pas assez d'oxygène et de nutriments). L'origine
de manière extensive de la maladie reste inconnue mais comme nous
l'avons signalé précédemment qu'il existait un
défaut de placentation et une mauvaise vascularisation par les
artères spiralées du placenta. L'organisme alors maternel
compense le défaut de vascularisation du placenta par une
hypertension artérielle et une réduction de la perfusion
de tous les organes induisant un risque de défaillance.
1.4.1. Trouble de la placentation
Comment ceci arrive-t-il ?
1.4.1.1. Étapes précoces de la placentation :
Rappel Physiologique. .
La placentation dite « hémochoriale »
telle qu'elle a lieu dans l'espèce humaine requiert une connexion entre
le placenta naissant et les vaisseaux maternels. Ces derniers doivent par
ailleurs acquérir un calibre suffisant pour assurer le débit
sanguin nécessaire à des échanges de bonne
qualité.
Cette connexion s'opere par une invasion des structures
maternelles par le trophoblaste, le spotting6.
L'une des particularités de ce phénomene est
qu'il est normalement autolimité, ce qui suppose des puissants facteurs
de régulation. Les principales exceptions à cette autolimitation
sont les môles hydatiformes et le choriocarcinome.
6 Le spotting :
l'hémorragie de nidation causée par le trophoblaste qui se
comporterait comme un cancer invasif creusant ainsi l'endomètre vers la
13ème semaine.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

11 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
La môle résultant d'une diploïdie pour le
génome paternel induit une prééclampsie et une invasion
trophoblastique agressive, de type néoplasique.
Quelques jours à peine après la fécondation,
le cytotrophoblaste villeux se différencie en
périphérie du blastocyste en syncytiotrophoblaste aux
propriétés très invasives, qui permet la
pénétration et l'ancrage du blastocyste dans l'endomètre.
Puis le cytotrophoblaste extravilleux colonise la masse syncytiale et envahit
la decidua jusqu'aux artères spiralées, c'est la premiere phase,
interstitielle, d'invasion trophoblastique.
La seconde phase, plus tardive, est l'invasion endovasculaire des
artères spiralées du myomètre, qui va remonter jusqu'au
tiers environ de celui-ci.
Durant cette phase, les cellules trophoblastiques subissent une
profonde transformation leur conférant un phénotype de type
endothélial.
Cette invasion est une condition indispensable à
l'établissement d'une circulation maternofoetale convenable. L'invasion
se fait grace à des enzymes protéolytiques, principalement des
métalloprotéases. Sa progression est initiée et
contrôlée par divers facteurs de croissance et cytokines.
Dans tous ces phénomènes, la tension en
oxygène ainsi que la production de NO semblent jouer un rôle
majeur, ainsi peut-être que des facteurs hémodynamiques
directs.
La decidua est infiltrée par de nombreuses cellules.
Si les lymphocytes B et T y sont relativement rares, les
monocytes/ macrophages et les cellules natural killer (NK) y sont d'une
particulière abondance.
Le trophoblaste extravilleux (et lui seul) exprime une
combinaison particulière de molécules du human leukocyte antigen
(HLA) de classe I, HLA C, E et G (le HLA G est totalement spécifique du
trophoblaste).
Les cellules NK qui infiltrent la decidua sont en contact
étroit avec le trophoblaste invasif et contiennent des récepteurs
qui reconnaissent ces antigènes HLA I. Cette interaction pourrait
être un élément clé de la régulation de
l'invasion, par une modulation de l'effet cytolytique des cellules NK.
Le HLA G signale la présence du placenta et protège
le trophoblaste en inhibant l'effet lytique des NK.
Contrairement à l'immunité dite adaptative des
cellules T et B, qui reconnaissent le self du non-self, cette immunité
« native " reconnaît le missing self puisque les cellules NK ne sont
cytotoxiques qu'en l'absence du HLA G.
Il est aussi à remarquer que ce phénomène
doit prendre en compte des composants paternels dont l'agression doit
être évitée pour empêcher le rejet de l'allogreffe
foetale. Ce pourrait être le rôle dévolu au HLA C.
De leur côté, les monocytes favorisent une apoptose
du trophoblaste, via le tumor necrosis factor (TNF) alpha. Celle-ci est
certainement un autre élément régulateur essentiel.
Toujours est-il que les artères spiralées du
myomètre sont colonisées vers 15 semaines par du
trophoblaste qui remplace l'endothélium (acquisition des
cadhérines spécifiques) et détruit les structures
musculaires. Ces artères sont donc transformées en chenaux dont
le diamètre est multiplié par 4 à 6, et qui n'ont plus de
fonction résistive mais seulement conductrice. Cette «
transformation " des artères spiralées est manifestement une
condition indispensable à une irrigation suffisante du placenta et du
foetus.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

12 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
1.4.1.2. Anomalie de l'invasion trophoblastique
L'existence d'une anomalie de cette invasion trophoblastique a
été une étape majeure dans la compréhension
physiopathologique de la prééclampsie.
Il a été montré des les années 1970
sur des biopsies de lit placentaire que l'invasion trophoblastique est
défectueuse lorsqu'une prééclampsie doit survenir dans le
troisième trimestre, ou lors de retards de croissance foetaux
isolés. Cette anomalie consiste, soit en une absence de
transformation des artères spiralées, soit en une
transformation incomplète sur une longueur insuffisante.
Cette anomalie de placentation précède donc de
plusieurs mois les premières manifestations d'hypertension ou de
protéinurie, mais tout porte à croire que des ce moment, la
partie est jouée.
La vascularisation du placenta étant insuffisante,
l'ischémie se développe progressivement, et c'est
seulement à partir d'un seuil critique d'ischémie, atteint bien
plus tardivement, qu'apparaît l'hypertension.
1.4.1.3. Inflammation
De nombreux arguments suggèrent qu'une réaction
inflammatoire modérée, impliquant le placenta mais aussi d'autres
structures vasculaires de l'organisme maternel, serait présente dans la
grossesse normale. Cette réaction apparaît considérablement
majorée, et plus diffuse encore,
dans la prééclampsie. Cette dernière
représenterait en quelque sorte une
Ce processus inflammatoire serait étroitement lié
à l'infiltration cellulaire déjà évoquée
dans le placenta, et les anomalies qui concourent à l'insuffisance de
l'invasion trophoblastique en seraient un stimulus puissant.
On admet, sans preuve bien solide, que le facteur
déclenchant de cette réaction inflammatoire serait
immunologique.
1.4.1.4. Libération de cellules trophoblastiques
Le placenta, à la fois ischémique et inflammatoire,
libère dans la circulation maternelle une quantité très
accrue de cellules trophoblastiques nécrosées,
éventuellement dégradées et limitées à des
vésicules ; ce fait est bien acquis.
In vitro, ces vésicules sont capables d'inhiber
puissamment la prolifération de cellules endothéliales et
même de rompre la couche cellulaire de la culture.
L'hypothèse a donc été émise que ces
cellules ou vésicules libérées en large excès par
un placenta ischémique et en apoptose provoqueraient des ruptures
endothéliales, majorées encore par l'activation des monocytes (et
des polynucléaires, via le TNF a), déclenchant la cascade
classique de vasoconstriction, activation de l'hémostase, etc.
1.4.1.5. Peroxydation lipidique et radicaux libres
Dans ce phénomène de souffrance
endothéliale, un rôle important a été
attribué au stress oxydatif, dont les manifestations apparaissent aussi
bien à l'échelon placentaire que systémique. Le taux
circulant des acides gras libres est très précocement
augmenté avant une prééclampsie, et l'incorporation de ces
acides gras dans les cellules endothéliales est accrue.
Le sérum de ces patientes a une activité
lipolytique élevée. Des anomalies lipidiques maternelles
pourraient potentialiser la génération de radicaux libres.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
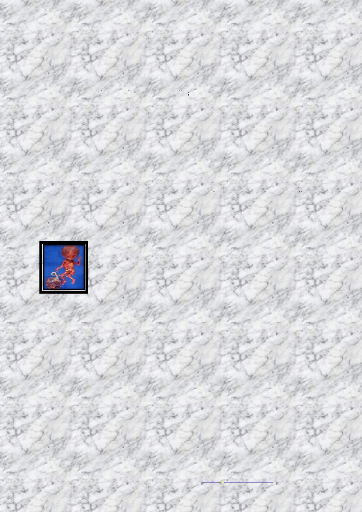
13 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
1.5. Les Conséquences
Les conséquences sont remarquées à la fois
à la femme et au foetus relativement aux causes de survenue de la
dysgravidie ; le trouble de placentation, l'hypertension,
l'ischémie...
1.5.1. Les conséquences maternelles
En réponse à cette ischémie est produit un
excès de facteurs vasoconstricteurs dont l'objectif est de diminuer le
calibre des artérioles, et donc d'augmenter la pression de perfusion.
L'effet pervers corollaire est une hypertension artérielle. A cette
hypertension s'ajoutent des anomalies liées à la
libération par le placenta ischémié de substances
toxiques, qui altèrent la paroi des vaisseaux. Ceci aboutit à des
lésions vasculaires rénales, hépatiques (microangiopathie
thrombotique), cérébrales, et des troubles hématologiques
(coagulation intravasculaire disséminée, thrombopénie) par
action toxique sur les éléments du sang.
1. 5.2. Les conséquences foetales
Le foetus ne reçoit pas assez de nutriments et
d'oxygène, ce qui provoque une souffrance foetale chronique avec retard
de croissance intra-utérin dysharmonieux (car tardif, postérieur
à la 20e semaine) : le cerveau est privilégié
par la vascularisation aux dépens des viscères et des membres :
on a un aspect échographique de « foetus araignée
» (grosse tête et membres grêles) de 1115g de poids.
L'ischémie rénale entraîne une diminution de la formation
d'urine, et donc un oligoamnios (volume insuffisant du liquide amniotique).
fig.1. foetus araignée
1.5.3. Conséquences de l'insuffisance placentaire
Laissant de côté les conséquences foetales de
l'insuffisance placentaire, nous nous limitons à l'étude des
mécanismes par lesquels l'insuffisance placentaire est responsable
d'une hypertension, d'une maladie rénale à la fois anatomique et
fonctionnelle, et d'une CIVD.
1.5.3.1. Dysfonction endothéliale
La réduction de la perfusion placentaire
consécutive à une implantation défectueuse est suivie
d'une cascade d'anomalies qui témoignent d'une altération des
fonctions endothéliales :
- une augmentation de la sensibilité aux hormones
pressives : celle-ci est connue de très longue date, manifestée
entre autres par la perte de « l'état réfractaire »
à l'angiotensine, qui caractérise la grossesse normale ;
- une activation de l'hémostase : la fréquence et
l'étendue des dépôts de fibrine dans le placenta et dans de
nombreux organes ont fait suspecter très précocement le
rôle de troubles de l'hémostase dans les manifestations de
l'hypertension gravidique. La prééclampsie a ainsi
été assimilée à un état de CIVD, et c'est
cette dernière qui expliquerait les manifestations polyviscérales
observées, en particulier au niveau du rein, du foie (syndrome HELLP),
c'est elle également qui expliquerait l'éclampsie.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

14 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
En revanche, une activation plaquettaire précoce est
certaine. Une telle stimulation est compatible avec une altération
endothéliale précoce. Elle pourrait entraîner une
activation secondaire de la coagulation et de la fibrinolyse ;
- une production de prostacycline diminuée : il existe,
très tôt également, un déséquilibre de la
production des eicosanoïdes.
Au cours d'une grossesse normale, les productions de
prostacycline et de thromboxane A2 sont toutes deux vivement stimulées,
avec cependant un rapport très en faveur de la prostacycline.
Cette stimulation est mise en évidence par une
augmentation considérable du taux de leurs métabolites, aussi
bien dans le sérum que dans l'urine.
Cela suggère que leur stimulation est un
phénomène global dans l'organisme.
De fait, la production de prostacycline est accrue dans tous
les territoires de la circulation, la production rénale est
également accrue et l'unité utéroplacentaire en
synthétise d'abondantes quantités.
Toujours est-il que la production accrue de prostacycline joue
manifestement un rôle primordial dans la vasodilatation systémique
et rénale qui caractérise l'hémodynamique de la femme
enceinte. Elle contrebalance largement l'effet vasoconstricteur et pro
coagulant qui est celui du thromboxane. Lors des grossesses avec hypertension,
la stimulation du thromboxane est sensiblement identique à celle
observée dans les grossesses normales, alors que la prostacycline est
peu ou pas stimulée.
Le rapport est donc alors en faveur du thromboxane,
c'est-à-dire de l'élément vasoconstricteur et pro
coagulant.
Cette anomalie témoigne probablement d'un trouble
fonctionnel des endothéliums, qui sont les principaux responsables de la
production de prostacycline ;
- l'apparition de marqueurs biochimiques : des arguments
supplémentaires en faveur de cette hypothèse sont apportés
par l'élévation du taux circulant de fibronectine et de facteur
VIII, marqueurs de lésion endothéliale ;
1.5.3.2. Hypertension
C'est dans ce contexte de dysfonction endothéliale qu'il
convient d'intégrer la vasoconstriction systémique et
l'hypertension qui en résulte. L'hypertension est principalement due
à la perte de la vasodilatation caractéristique de la grossesse
normale et à l'apparition, au contraire, d'une vasoconstriction.
Normalement, la grossesse est caractérisée par un état
réfractaire aux hormones pressives et singulierement l'angiotensine II ;
cette situation disparaît avant l'émergence d'une
prééclampsie. Un test à l'angiotensine a même
été utilisé en prédiction de la
prééclampsie. Le mécanisme de la vasoconstriction reste
débattu. Le déséquilibre entre prostacycline et
thromboxane y joue certainement un rôle important. Il est possible
également que le potentiel vasoconstricteur d'autres substances
(angiotensine, endothéline) soit amplifié par une baisse
d'activité de la NO synthase. Les cellules endothéliales
elles-mêmes peuvent être altérées par l'action de
cytokines pro-inflammatoires (TNF a) et par un stress oxydatif accru.
La grossesse normale est accompagnée d'une augmentation de
quelque 30 % du débit cardiaque. En dépit de celle-ci, la
vasodilatation est telle que la Pa baisse physiologiquement.
Le débit cardiaque reste généralement
élevé dans les hypertensions bénignes, mais s'abaisse dans
la prééclampsie sévère.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

15 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
Le volume plasmatique (normalement accru de près de 50 %)
est très abaissé dans les formes sévères, voire
effondré dans les formes dites « toxémie gravidique »
avec protéinurie importante et retard de croissance foetale.
Cette contraction volémique est en corrélation
directe avec le poids de naissance de l'enfant.
Elle pourrait résulter, soit de la vasoconstriction
elle-même, soit d'un trouble plus subtil de l'excrétion
sodée.
D'autres facteurs encore pourraient jouer un rôle dans la
genèse ou l'entretien de l'hypertension, le système nerveux
sympathique, le facteur atrial natriurétique, des facteurs
calciotropiques, le métabolisme du magnésium.
1.5.3.3. Néphropathie 1.5.3.3.1. Fonction rénale
L'évolution de la fonction rénale au cours de la
grossesse normale a fait l'objet de nombreuses revues dont nous retiendrons
essentiellement celles de Davison et d'Atherton.
Il existe normalement un accroissement d'environ 50 % du flux
plasmatique rénal.
La filtration glomérulaire évolue d'une
manière sensiblement parallèle, conduisant à une clairance
de la créatinine de l'ordre de 180 mL/min.
Ces deux paramètres sont généralement
diminués dans l'hypertension gravidique.
La diminution est le plus souvent de l'ordre de 25 %,
c'est-à-dire que les valeurs observées sont encore au-dessus de
celles considérées comme normales avant la grossesse.
Dans les formes les plus sévères, la filtration
glomérulaire peut cependant être beaucoup plus basse, et
l'insuffisance rénale aiguë est une complication heureusement rare,
mais habituellement d'une extrême gravité, de la
prééclampsie sévère ou du syndrome HELLP.
1.5.3.3.2. Excrétion rénale de l'acide urique
Au cours de la grossesse normale, l'uricémie s'abaisse de
30 % en moyenne, alors que s'élèvent aussi bien la clairance et
l'excrétion fractionnelle de l'acide urique. Une hyper uricémie
est associée aux formes graves de l'hypertension gravidique. Elle est
proportionnelle à la sévérité de l'atteinte
anatomique rénale et représente un index réputé du
pronostic foetal.
De fait, il existe une corrélation négative entre
les variations de l'uricémie et celles du volume plasmatique,
suggérant que la baisse de la clairance de l'acide urique reflète
la réponse physiologique du rein à l'hypovolémie.
Données anatomiques :
Les lésions constatées peuvent être
regroupées sous trois rubriques : 1.5.3.3.3. Endothéliose
glomérulaire :
C'est la lésion la plus anciennement décrite. Elle
a été considérée par la plupart des auteurs comme
spécifique de la « prééclampsie ».
Elle est composée d'un gonflement des cellules
endothéliales glomérulaires, d'un épaississement
irrégulier des membranes basales et d'une fusion des pédicelles
épithéliales.
Des dépôts sous endothéliaux de
fibrinogène peuvent être observés.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998

16 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
Quelques auteurs ont mis en évidence par
l'immunofluorescence des dépôts d'IgG ou IgM.
La caractéristique essentielle de l'endothéliose
glomérulaire est son entière réversibilité en
quelques semaines après l'accouchement. Tout au plus peut-elle laisser
quelques infimes irrégularités pariétales ou un discret
épaississement du mésangium, dont la signification pathologique
est douteuse.
1.5.3.3.4. Lésions vasculaires
Elles sont probablement moins fréquentes, mais il est
certain qu'elles ont été largement sous-estimées dans le
passé.
Il peut s'agir, soit d'une endartérite
fibroélastique, parfois sévère, touchant les
artères corticales de moyen calibre, soit de dépôts
hyalins, éventuellement occlusifs, dans la paroi des
artérioles.
Dans l'ensemble, ces lésions sont très similaires
à celles observées après plusieurs années
d'hypertension artérielle permanente.
Elles sont souvent en contraste frappant avec la normotension des
patientes, et la brève période hypertensive qui a marqué
la fin de la grossesse.
Dans notre expérience, ces lésions sont très
souvent annonciatrices d'une hypertension permanente à terme d'environ 5
ans.
1.5.3.4. Hémostase
Une thrombopénie est de loin l'anomalie
hématologique la plus fréquente dans les hypertensions de la
grossesse.
Elle est modeste dans la plupart des cas ; néanmoins, la
baisse du compte des plaquettes audessous (parfois très au-dessous) de
100 000/mm3 est la marque des formes graves, nécessitant en
général une intervention rapide.
Elle peut s'accompagner de l'apparition de produits de
dégradation de la fibrine, voire de tous les stigmates d'une CIVD. La
coexistence d'une antithrombine III diminuée et d'une fibronectine
augmentée suggère qu'une souffrance endothéliale y est
associée.
1.5.3.5. Cerveau
L'éclampsie (phase convulsive de la
prééclampsie) reste une complication majeure.
Elle est le plus souvent attribuée à une
ischémie focale par dépôts de fibrine et/ou
vasoconstriction.
Le classique oedème cérébral ou
l'encéphalopathie hypertensive sont des mécanismes bien plus
improbables, d'autant que nombre d'éclampsies apparaissent avec une
hypertension bien modeste, voire sans hypertension. Divers aspects ont
été décrits depuis l'usage du scanner ou de l'imagerie par
résonance magnétique (IRM).
La localisation souvent postérieure de ces
lésions expliquerait la fréquence des troubles visuels
précurseurs.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

17 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
1.6. La clinique
Les tableaux cliniques sont de présentation et de
gravité diverses.
Deux auteurs indiquent le risque relatif de mort foetale en
fonction du degré de l'hypertension et de la protéinurie. On voit
clairement sur ce tableau que l'hypertension, tant qu'elle est isolée,
s'accompagne d'une majoration modeste du risque foetal. Il en est de même
d'une protéinurie isolée.
Ce sont les tableaux associant les valeurs maximales de ces deux
paramètres qui comportent un risque foetal majeur. Ce risque foetal va
habituellement de pair avec le risque de complications maternelles.
1. 6.1. Hypertension simple
Une hypertension isolée au cours de la grossesse
n'obère donc que modestement le pronostic de celle-ci, avec un risque
relatif variant de 1 à 3.
Selon les classifications ci-dessus, cette hypertension peut
être « gravidique » ou « chronique »; la
différence n'est pas toujours aisée à faire sur l'instant,
même si le classique critère des 20 semaines est habituellement
utilisé comme repérage.
Quelques études assignent un pronostic un peu plus
péjoratif aux hypertensions gravidiques, d'autres aux hypertensions
chroniques. Ces hypertensions sont presque toujours asymptomatiques. Il
convient cependant de ne pas oublier que ce type de situation n'est pas
figé, et qu'à tout moment une protéinurie peut venir
compléter le tableau, majorant alors sensiblement le risque.
1.6.2. Pré éclampsie modérée
Des lors qu'une protéinurie significative est
associée à l'hypertension, le risque se situe à un niveau
nettement plus élevé.
Il demeure modeste lorsque les chiffres tensionnels sont
modérément élevés et facilement contrôlables,
coexistant habituellement avec une protéinurie de moins de 1 g/24 h.
Dans ces cas, une surveillance renforcée, tant foetale que
maternelle, est néanmoins nécessaire.
Il n'est pas exceptionnel qu'une issue
prématurée de la grossesse s'avère indiquée, soit
du fait d'un ralentissement ou d'un arrêt de la croissance foetale, soit
du fait d'une quelconque menace sur le pronostic maternel.
1.6.3. Prééclampsie grave
L'hypertension est alors majeure, menaçante, et
remarquablement insensible aux traitements antihypertenseurs. La
protéinurie est de plusieurs grammes, voire dizaines de grammes par 24
heures, avec un syndrome néphrotique.
Il existe habituellement des oedèmes diffus, infiltrant
les membres supérieurs et inférieurs, les lombes, la face. La
croissance foetale se ralentit puis s'interrompt.
Les patientes sont souvent céphalalgiques et
photophobiques. C'est dans de tels cas qu'un syndrome HELLP vient souvent
compléter le tableau, et la thrombopénie, rapidement progressive,
crée une menace majeure à court terme. Dans cette situation, la
seule issue est la terminaison de la grossesse, presque toujours par une
césarienne.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

18 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
Cette décision est relativement aisée si le terme
est suffisamment avancé pour permettre une chance raisonnable de survie
du nouveau-né dans des conditions de sécurité
acceptables.
Dans le cas contraire, on peut être tenté de
temporiser pour obtenir un peu plus de maturité foetale, mais cette
temporisation ne se fait qu'au prix d'une majoration de l'hypotrophie, et le
risque de complications maternelles est alors tres élevé.
L'extrême gravité de la situation peut parfois justifier une
césarienne dite « de sauvetage maternel » sur un enfant non
viable.
C'est bien entendu dans de tels cas que les complications
maternelles hémodynamiques (oedème pulmonaire...) ou
l'insuffisance rénale aiguë apparaissent le plus volontiers ; c'est
également dans ces cas que le pronostic vital maternel est le plus
sévèrement menacé.
Selon les statistiques, sur la totalité des femmes
enceintes, la moitié souffrirait d'une HTA essentielle parce qu'elle
existe en dehors de la grossesse. L'autre moitié développe une
HTA gravidique. Elle se manifeste généralement au cours de la
vingtième semaine d'aménorrhée alors que la femme n'avait
jamais eu de problème d'hypertension auparavant.
L'HTA gravidique correspond à une augmentation de la
tension artérielle au cours de la grossesse. La fin de la gestation est
la plus à risque. La prééclampsie apparaît
généralement chez des femmes ayant pris beaucoup de poids au
cours de leur grossesse. L'augmentation importante de la masse graisseuse,
comme chez tout individu, perturbe l'équilibre de l'organisme et
provoque de l'hypertension.
L'HTA gravidique est le plus souvent associée à une
protéinurie c'est-à-dire une présence d'albumine (une
protéine) anormale dans les urines. Le taux d'albumine dépasse
alors les 300mg/24h. Des oedèmes peuvent apparaître sur les
jambes, le visage ou les mains. Ces signes extrêmes se manifestent
lorsque la dysgravidie est soudaine et importante. Dans le cas d'une HTA
gravidique peu développée, les oedèmes sont beaucoup moins
présents.
7Maurice KLAT constate qu'en clinique, c'est d'abord
l'hypertension artérielle (systolique > 140 mmHg et/ou HTA
diastolique > 90 mmHg) qui est mise en évidence ; puis une
protéinurie (albuminurie supérieure à 300mg / 24
heures pour des raisons nycthémérales) et enfin des
oedèmes et il parle de la triade symptomatique de la
dysgravidie.
Elle doit être suspectée en cas de
céphalées, vertiges, troubles de la vues ou lorsque le foetus est
trop petit par rapport à l'âge gestationnel. En clinique, on tient
compte aussi des signes fonctionnels d'HTA : Céphalées,
Acouphènes, Phosphènes, Réflexes ostéotendineux
(ROT) vifs, barre épigastrique.
1.6.4. Signes cliniques graves
Ils doivent alerter les patientes, surtout si elles
présentent un des facteurs de risque !
PAS = 160 mm Hg ou PAD = 110 mm Hg,
Oligurie
Douleur de l'hypochondre droit
Thrombopénie et anémie
Hyperuricémie
OEdèmes des parties déclives ; OEdèmes
massifs, prenant le godet, surtout visibles au visage et aux membres
inférieurs
Réflexes ostéotendineux vifs
Vomissements
7 KLAT Maurice, Op.cit. p.257.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

19 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
Si multipare, antécédents de formes graves d'HTA en
cours de grossesse : éclampsie, HRP, mort foetale in utero...
Notion de prise de poids récente et brutale (plusieurs kg
en quelques jours) avec oligurie, Diminution des mouvements actifs foetaux.
Hauteur utérine inférieure à la normale pour
l'age gestationnel, faisant suspecter un RCIU, Protéinurie massive
à la bandelette.
Dans sa forme sévère, la patiente présente
une hypertension artérielle sévère (systolique
supérieure à 160mmHG et/ou diastolique supérieure à
110mmHg) avec des troubles neurosensoriels tels des céphalées,
des troubles visuels jusqu'à l'éclampsie et des troubles
rénaux telles l'anurie, la protéinurie sévère
(supérieure à 3gr / 24h) et l'insuffisance rénale.
1.6.5. La triade symptomatique
1.6.5.1. Hypertension :
La définition de l'hypertension au cours de la grossesse
n'est pas aussi claire qu'en d'autres circonstances, puisque la pression
artérielle (Pa) baisse physiologiquement en début de
grossesse.
Une Pa diastolique supérieure ou égale à 90
mmHg à au moins deux mesures successives séparées d'au
moins 4 heures est le critère habituellement admis.
L'ancienne définition fondée sur une augmentation
de 30 mmHg ou plus à deux examens successifs n'est plus retenue
aujourd'hui.
La Pa systolique, bien plus labile chez la femme enceinte, est un
critère fragile.
Néanmoins, la dernière recommandation du National
High Blood Pressure Education Program (NHBPEP), dont un groupe de travail sur
l'hypertension artérielle au cours de la grossesse a publié un
rapport en 2000, stipule des valeurs de 140 mmHg pour la systolique ou 90 mmHg
pour la diastolique.
Nous faisons régulièrement référence
à cette recommandation dans la mesure où elle fait
autorité. Les mesures de la Pa sont délicates chez la femme
enceinte en raison de sa labilité (rappelons que le débit
cardiaque est accru de 30 %).
Il est essentiel de pratiquer ces mesures sur un sujet aussi
détendu que possible, et à distance de l'examen
gynécologique.
La position la plus usitée est la position assise,
après quelques minutes de mise au calme et de conversation. Des
débats sans fin concernent le choix de la phase IV ou V de Korotkoff.
Cette dernière a actuellement la faveur, mais pas l'unanimité.
Les chiffres tensionnels sont très variables chez un même sujet,
pour cette raison les mesures doivent être itératives.
Dans cette variabilité intervient le facteur de stress,
dont la participation peut être grossièrement estimée en
mesurant la fréquence cardiaque. Mais un important facteur de variation
est aussi introduit par le rythme nycthéméral, très
marqué, mais aussi inversé lors des hypertensions, avec un
maximum nocturne.
La mesure ambulatoire de pression artérielle
(MAPA) n'est pas reconnue comme critère du diagnostic. Dans quelques
cas, elle peut néanmoins aider à reconnaître les
hypertensions dites « de la blouse blanche ». Les valeurs de
normalité dans la grossesse en sont à peu près
établies.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998

20 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
1.6.5.2. Protéinurie :
La protéinurie est, elle aussi, définie très
diversement.
Dans la pratique obstétricale (surtout outre-Atlantique),
sa quantification se limite souvent à un nombre de « croix »
à la bandelette, estimation entachée de nombreuses erreurs. Un
recueil des 24 heures n'est malheureusement que rarement effectué.
La protéinurie est dite « significative » si
elle excède 1 g/L sur un échantillon ou 0,3 g sur les urines de
24 heures. Une telle protéinurie vient se surajouter à
l'hypertension dans quelque 10 % des cas. Elle ne la précède pas,
mais lui succède pratiquement toujours, constituant le tableau de la
prééclampsie. Les quelques exceptions à cette règle
révèlent habituellement des néphropathies
antérieures méconnues.
Cette protéinurie est de type glomérulaire et
comporte une albuminurie prédominante.
1.6.5.3. OEdèmes :
Ce troisième élément de la triade
symptomatique caractérisant la prééclampsie n'entre plus
dans une définition pathologique aujourd'hui. De fait, des
oedèmes surviennent à un moment ou un autre dans 80 % des
grossesses normales.
Il n'en reste pas moins que des oedèmes diffus, touchant
les membres inférieurs, mais aussi les mains (signe de la bague) et la
face, peuvent représenter un signe d'alarme, surtout s'ils sont majeurs
et de constitution brutale.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207
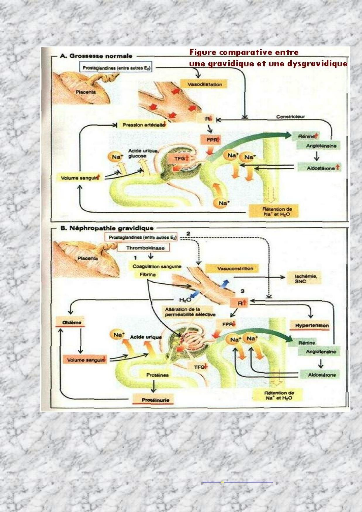
21 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
Fig.7. comparaison de triade entre grossesse normale et
toxémie gravidique
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998

22 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
1.7. Les Examens para cliniques
Ces examens sont normaux en dehors d'une complication. 1.7.1.
Explorations à réaliser
1.7.1.1. Sur le plan maternel :
Examens biologiques : bilan hépatique.
· Protéinurie (normale < 300 mg / l ou 500
mg/24h)
· Et uricémie (normale < 360 Umol / l)
Les autres examens indispensables en présence de signes
de gravité :
· NFS & plaquettes => thrombopénie ?
Anémie ? Hémoconcentration ?
· Bilan de coagulation (si Prééclampsie) :
TP, TCA, Fibrinogène, D dimères => CIVD ?
· Ionogramme sanguin (+/-) urinaire avec
créatininémie => insuffisance rénale ?
· Transaminases, LDH => cytolyse (HELLP)?
· Fond d'oeil
· Une thrombopénie, une CIVD, une cytolyse
hépatique, une insuffisance rénale franche sont toujours le
témoin d'une forme grave.
· L'association d'une anémie, d'une cytolyse
hépatique et d'une thrombopénie définit le HELLP syndrome
(Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets);
Fibronectine : elle peut être
élevée (facteur pronostic d'apparition d'une
prééclampsie).
1.7.1.2. Sur le plan foetal :
· Une Echographie obstétricale : avec
biométrie foetale, évaluation du volume du liquide amniotique,
doppler ombilical et cérébral. Normalement, les
résistances vasculaires sont faibles dans les artères ombilicales
(=> vélocité diastolique élevée) et fortes dans
les artères cérébrales (=> vélocité
diastolique faible). Dans un contexte de RCIU, une diastole ombilicale faible
ou nulle et une diastole cérébrale élevée sont des
signes de haute gravité : risque de mort foetale in utero à
brève échéance.
· Un Doppler utérin : Le Doppler utérin
normal se caractérise par une décroissance
régulière de la vélocité sanguine pendant la
diastole et le maintien d'une vélocité relativement
élevée en fin de diastole (rapport D/S > 0,40).
· Un Enregistrement cardiotocographique : A faire
après 26 SA. D'intérêt limité dans les HTA
modérées et isolées, il est indispensable dans la
surveillance des formes graves. Les altérations du rythme cardiaque
foetal, même en apparence modérées, sont le témoin
d'une souffrance foetale sévère qui précède de peu
la mort foetale in utero.
1.8. Les Diagnostiques différentiels
L'hypertension artérielle gravidique peut ressortir les
mêmes diagnostics que les pathologies suivantes : la Néphropathie,
la Glomérulonéphrite, l'Insuffisance cardiaque gauche,
l'éclampsie...
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

23 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
1.9. Les Complications
La toxémie gravidique peut générer des
crises d'épilepsie et, dans 5 à 10% des cas, une complication
cérébrale, cardiaque ou rénale. Les dangers pour la mere
et son foetus deviennent alors importants. Il faut donc surveiller strictement
la femme enceinte. En effet, les complications peuvent affecter soit la femme
enceinte soit le foetus.
1.9.1. Les complications maternelles :
1.9.1.1. Prééclampsie légère
Eelle associe à une hypertension artérielle
gravidique une protéinurie, supérieure à 300 mg/j ou
supérieure, à 2 croix à la bandelette urinaire. Dans
certains cas, la protéinurie peut manquer initialement, il est cependant
licite de suspecter une prééclampsie devant une HTA de novo
associée à l'un ou l'autre des signes suivants :
Signes de souffrance maternelle :
oedèmes d'apparition brutale ou rapidement
aggravés
uricémie supérieure à 350 umol/L
augmentation des transaminases hépatiques au-delà
des normes du laboratoire plaquettes inférieures à 150 000/mm?
Hémolyse avec élévation des LDH et
diminution de l'haptoglobine, présence de schyzocytes, de
réticulocytes,
Recherche de signes de souffrance foetale en évaluant le
bien être foetal
Diminution des mouvements actifs foetaux
retard de croissance intra-utérin (RCIU).
Oligoamnios
Anomalies du doppler ombilical
1.9.1.2. Prééclampsie sévère
Elle définit soit par une hypertension grave (pression
artérielle systolique supérieure ou égale à 160 mm
Hg et/ou pression artérielle diastolique supérieure ou
égale à 110 mm Hg), soit une hypertension artérielle
gravidique avec un ou plusieurs des signes suivants :
douleurs épigastriques, nausées, vomissements,
céphalées persistantes, hyper
réflectivité ostéo-tendineuse, troubles visuels
(phosphène, amaurose...).
protéinurie supérieure à 3,5 g/j,
créatininémie supérieure à 100 umol/L,
oligurie avec diurèse inférieure à 20
mL/H,
hémolyse,
transaminases hépatiques supérieures à trois
fois la norme du laboratoire, thrombopénie inférieure à
100 000/mm?.
Décollement rétinien exsudatif
Insuffisance rénale aiguë avec dans les cas
extrêmes une nécrose corticale
Stéatose hépatique aiguë gravidique,
hématome sous capsulaire du foie,
hémorragie cérébro-méningée
à l'occasion d'une poussée hypertensive,
rétinopathie
hypertensive. D'autres parts, on note un tableau
d'ischémie avec cécité corticale.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998

24 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
1.9.1.3. Éclampsie
Complication gravissime, elle survient dans environ 1 % des
pré-éclampsies. Elle doit être redoutée devant
certains symptômes qui doivent être particulièrement
surveillés : céphalées en casque, douleurs abdominales
intenses, nausées et vomissements, acouphènes et
phosphènes, majoration des oedèmes.
Elle se manifeste par des crises convulsives
généralisées, tonico-cloniques, suivi d'un coma
post-critique. Le risque maternel est la survenue d'un état de mal
épileptique, d'hémorragie cérébrale, d'infarctus
cérébral, d'insuffisance respiratoire. La mortalité
foetale est très élevée (50 à 80 %).
Le traitement est une urgence absolue : libération des
voies aériennes supérieures, traitement antiépileptique
(par benzodiazépines), puis extraction foetale par césarienne
dès la fin de la crise. La crise d'éclampsie peut se produire
dans les 48 heures suivant l'accouchement.
1.9.1.3. Syndrome HELLP
C'est un syndrome grave, de définition purement biologique
:
hémolyse, avec hausse des LDH, présence de
schyzocytes, baisse de l'haptoglobine, cytolyse hépatique avec hausse
des transaminases,
thrombopénie inférieure à 100 000 plaquettes
par mm3 de sang.
Ce syndrome témoigne de micro-angiopathie thrombotique et
peut se compliquer d'hématome sous-capsulaire du foie, de rupture du
foie. Le traitement est ici aussi l'extraction foetale urgente.
1.9.1.4. Autres complications maternelles : Hémorragie
cérébrale
OEdème aiguë du poumon
Insuffisance rénale aiguëRupture
hépatique
, sont responsables des décès maternels.
1.9.1.5. Les complications foetales :
Mort foetale in utero
Retard de croissance dysharmonieux
Souffrance foetale aiguë (en particulier en cas
d'hématome rétro-placentaire et d'éclampsie)
Prématurité (liée à l'obligation de
césarienne urgente provoquée par les complications. De par les
causes profondes de l'hypertension artérielle gravidique
(anomalies du placenta), le seul vrai traitement est l'accouchement).
1.10. La Prise en charge
L'hypertension gravidique se soigne très bien par
traitement médical et par beaucoup de repos. Cependant, normaliser la
tension artérielle ne diminue pas forcément le risque
d'hématome rétro placentaire, ne diminue pas les retards de
croissance intra utérine. Le traitement n'a aucune influence sur la
morbidité et la mortalité néonatale. La gravité de
certaines hypertensions artérielles gravidiques précoces oblige
parfois à proposer une interruption médicale de grossesse. Le
seul vrai traitement de l'hypertension artérielle gravidique est
l'arrêt de la grossesse mais il ne se justifie que dans les formes
graves ou proches du terme.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

25 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
La prise en charge de la pré-éclampsie se fait en
milieu hospitalier avec une surveillance maternelle et foetale
rapprochée. Seule la naissance de l'enfant permet d'arrêter la
sécrétion du placenta et l'évolution de la
pré-éclampsie vers ses complications neurologiques,
hépatiques et rénales. Les complications peuvent toutefois
survenir dans les 48 heures du post-partum, et nécessitent une
surveillance adaptée. Avant 34 semaines d'aménorrhée, il
est souhaitable de réaliser une maturation pulmonaire foetale par
corticoïdes. En cas de complications graves, une extraction foetale en
urgence peut être indiquée pour un sauvetage maternel.
En attendant un terme d'accouchement compatible entre la vie
de l'enfant et la sauvegarde de celle de la mère, celle-ci peut recevoir
des médicaments anti-hypertenseurs sous surveillance médicale en
milieu hospitalier.
Le sulfate de magnésium en intraveineux permet de
limiter l'apparition de l'éclampsie8. Chez la femme
à risque, la mise sous de petites doses d'aspirine pourrait
diminuer le risque de survenue d'une prééclampsie, nous verrons
son application dans les pages qui suivent.
Mais au mieux, nous avons disposé des traitements palliant
aux complications qui peuvent survenir, celles-ci-hautement vues.
1.10.1. En cas d'HTA légère ou
modérée :
· Surveillance en externe.
· Repos (arrêt de travail).
· Traitement médical antihypertenseur en
monothérapie, (d'indication et d'intérêt
discutés).
· Surveillance renforcée : consultation tous les 10
jours environ, bilan biologique régulier, échographie mensuelle
avec Doppler utérin (à 22 SA, à contrôler si
pathologique).
· Au 9è mois, discuter un déclenchement
artificiel du travail en fonction des conditions Obstétricales.
1.10.2. En cas d'HTA sévère ou
Prééclampsie
· Hospitalisation.
· Surveillance étroite materno-foetale.
· Prévoir la nécessité d'une
extraction foetale urgente +++ :
· Traitement médical antihypertenseur,
nécessitant souvent une association de plusieurs drogues et/ou leur
administration par voie parentérale à la seringue
électrique,
1.10.2.1. Modalités du traitement médical
antihypertenseur :
Son intérêt est limité :
- Il influence peu le pronostic car l'HTA n'est qu'un
symptôme d'une maladie
polyviscérale,
- Un traitement trop énergique peut même aggraver
une souffrance foetale en
réduisant la perfusion utéro-placentaire+++,
- Son seul objectif est d'éviter les à-coups
hypertensifs.u
8 The Magpie Trial Collaboration Group, Do women
with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? The
Magpie Trial: a randomised placebo-controlled trial [archive], Lancet,
2002;359:1877À1890.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

26 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
Sont prohibés :
- Régime sans sel et diurétiques : ils aggravent
l'hypovolémie (déjà présente chez la femme enceinte
hypertendue) et réduisent la perfusion utéro-placentaire,
- Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (foetotoxiques).
On peut utiliser :
- En première intention : antihypertenseurs centraux,
bétabloquants ou association alpha et bétabloquants.
L'alphaméthyldopa (Aldomet®) bénéficie d'une large
expérience dans ce domaine.
- En seconde intention : béta-bloquants +/- effet alpha
bloquants (Sectral®, Trandate®) inhibiteurs calciques
(Adalate®), vasodilatateurs (Népressol®).
1.10.2.1.1. Traitements préventifs :
Si le primum movens de l'hypertension gravidique est
l'ischémie placentaire, la déception apportée par le
traitement médical n'est pas surprenante conceptuellement, puisqu'il
s'agit d'un traitement symptomatique, agissant en aval du
phénomène moteur.
Agir sur ce phénomène n'est concevable qu'à
titre préventif, avant que les lésions placentaires
irréversibles soient constituées et qu'apparaissent les
symptômes qui en sont la conséquence.
· PRINCIPES : Idéalement, un traitement
préventif devrait :
À être institué très
précocement, c'est-à-dire lorsque les anomalies dues
à l'invasion trophoblastique défectueuse commencent à
apparaître ;
À avoir une action antithrombotique, voire
peut-être anti-inflammatoire ;
À rétablir la balance convenable entre
prostacycline et thromboxane, par une inhibition relativement
sélective de ce dernier.
L'aspirine à faible dose représente une solution
cohérente du problème.
Elle exerce sur les artères placentaires in vitro une
action comparable à celle montrée dans d'autres
systèmes-inhibition de la synthèse de thromboxane avec respect
relatif de celle de prostacycline.
In vivo, de faibles doses d'aspirine entraînent, chez la
femme enceinte, une réduction de l'élimination urinaire de
thromboxane B2, sans modification de l'élimination de 6-
kétoprostaglandine F1a. La production de thromboxane est
également inhibée chez le foetus.
· ASPIRINE ! MODE D'EMPLOI :
Sans entrer dans le détail de l'argumentation, il est
apparu que les récentes études négatives avaient
pâti d'une sélection très hétérogene, de
délais d'instauration du traitement allant jusqu'à 32 semaines et
de doses d'aspirine trop basses (en général 60 mg/j).
Il en ressort que globalement, en dépit des études
négatives d'effectifs considérables, le traitement demeure actif
sur la croissance foetale (une dernière méta-analyse
pratiquée après la publication demontre que cette situation est
toujours inchangée).
Si la dose d'aspirine est au moins égale à 100
mg/j, l'efficacité apparaît très supérieure, et
même un effet significatif sur la mortalité périnatale est
observé, ce qu'aucune étude individuelle
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998

27 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
n'avait montré, du fait de l'heureuse rareté de
cette complication.
L'efficacité est également très
renforcée si le traitement est commencé avant 17 semaines.
Une étude rétrospective des patientes ayant
reçu de l'aspirine dans notre département a confirmé
l'importance décisive d'un traitement précoce et montré
qu'un allongement du temps de saignement sous aspirine était
également un facteur important de succès de ce traitement.
Par analogie avec d'autres situations où l'aspirine s'est
avérée efficace, un traitement de plus en plus précoce,
voire préconceptionnel, pourrait être envisagé.
L'adjonction de faibles doses de corticoïdes est une autre
possibilité. Ces attitudes relèvent pour le moment, soit
d'observations anecdotiques, soit de courtes séries, et ne sauraient
donc être recommandées à plus large échelle avant
que des preuves plus consistantes aient été apportées.
L'association d'aspirine et d'héparine, ou la
substitution de l'aspirine par l'héparine, est également
discutée, avec un niveau de preuve qui reste encore très en
deçà du minimum souhaitable.
Néanmoins, ces différentes hypothèses en
cours de test laissent entrevoir la possibilité de sérieux
changements de stratégie dans la prochaine décennie.
· PRÉDIRE POUR POUVOIR PRÉVENIR : Le fait de
disposer d'un traitement préventif pose le problème de ses
indications.
La nécessité d'un traitement très
précoce, largement antérieur à tout symptôme
maternel, centre la question sur une prédiction précoce. Ce
problème n'est pas résolu à l'heure actuelle.
La connaissance des antécédents de la patiente a
montré une bonne efficacité, mais d'une part elle reste
relativement empirique, d'autre part elle n'est applicable qu'après que
des accidents se soient déjà produits, ce qui n'est pas
satisfaisant.
Nous ne disposons d'aucun marqueur biochimique fiable à un
stade aussi précoce. Mais certains travaux laissent espérer
qu'une étude doppler pourrait avoir une bonne valeur discriminative
entre les primipares qui auront ou non une prééclampsie.
Cette discrimination, si elle semble se confirmer, demeure
actuellement plus tardive que le terme souhaitable de début du
traitement.
Cette prédiction précoce demeure donc l'un des
principaux challenges dans les années à venir.
1.10.2.1.2. Traitements curatifs :
La thérapeutique de l'hypertension gravidique n'est pas
le point le moins débattu et c'est assurément le plus
décevant. Le problème le plus controversé est celui de
l'opportunité et des modalités d'un traitement antihypertenseur.
Il existe plusieurs types de traitement attribuable directement à la
femme enceinte et indirectement aux troubles liés aux foetus mais
rarement en remédie si ce n'est l'expulsion ou un traitement
débuté très précocement.
· MESURES GÉNÉRALES :
Le repos physique et psychique est l'une des rares mesures dont
l'utilité ne fasse aucun doute. Le repos au lit, de
préférence en décubitus latéral gauche, abaisse les
chiffres tensionnels, est souvent associé à une
décroissance de l'uricémie et semble bénéfique
à la croissance foetale.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

28 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
L'explication donnée en est le dégagement de
l'aorte et de la veine cave inférieure, qui augmenterait le débit
sanguin utérin et le débit cardiaque.Ce mode thérapeutique
est évidemment tributaire des possibilités matérielles de
la patiente (conditions de logement, présence d'autres enfants...).
· TRAITEMENT MÉDICAL DE L'HYPERTENSION
ARTÉRIELLE :
Si l'on se réf~re à ce qui a été dit
plus haut du rôle initiateur de l'ischémie placentaire, dont
l'hypertension ne serait qu'une conséquence, il n'est pas évident
que le traitement antihypertenseur soit bénéfique ni au placenta,
ni à la croissance foetale.
On peut, au contraire, soupçonner qu'un abaissement de la
pression au sein d'un circuit résistif conduise à une baisse du
débit, ce qui serait le contraire du but recherché.
Hypertension artérielle chronique ou hypertension
artérielle gravidique modérée : Il s'agit de situations
dans lesquelles le pronostic obstétrical est le plus souvent favorable.
Le traitement antihypertenseur dans ces situations n'apporte aucun
bénéfice.
Une analyse montre que dans l'ensemble, le traitement a quelques
effets positifs chez la mère : moins d'hypertensions dépassant
160/100, et moins d'hospitalisations.
En revanche, il n'a aucun effet sur le pronostic de la grossesse
et sur le pronostic foetal en particulier. Au contraire, il y a une tendance
à une plus forte incidence de l'hypotrophie foetale sous traitement. Ce
fait avait déjà été constaté dans quelques
études individuelles où le traitement en cause était un
bêtabloquant. L'effet des variations de pression sous bêtabloquant
a été occasionnellement documenté à court terme par
le doppler ombilical.
Enfin, la comparaison entre différentes classes
d'antihypertenseurs n'a montré aucun avantage décisif d'une
classe par rapport à une autre. Il est à noter une étude,
restée isolée, indiquant que l'usage d'un bêtabloquant chez
des patientes à débit cardiaque très élevé
pourrait avoir un effet bénéfique et même prévenir
la prééclampsie.
La conclusion est que le traitement antihypertenseur apporte un
très modeste bénéfice maternel dont l'intérêt
pratique n'est pas évident. Les hospitalisations en excès en
l'absence de traitement ne sont pas dues à une complication objective
mais à la seule inquiétude médicale. Le traitement
antihypertenseur n'améliore en rien le pronostic foetal, mais peut au
contraire être responsable d'hypotrophie s'il est trop intense.
Aucune étude n'a atteint un tel effectif et la
méta-analyse n'est pas forcément une méthode infaillible
pour pallier cette insuffisance. Même si l'on admet cette marge
d'incertitude, le traitement antihypertenseur dans ces indications n'est
manifestement pas un acte thérapeutique bien intéressant.
Hypertensions sévères :
Le cas est ici beaucoup moins simple dans la mesure où il
n'y a pas eu d'études contrôlées, pour des raisons
évidentes.
Le raisonnement par analogie avec d'autres hypertensions indique
que le bénéfice d'un traitement pour une hypertension de courte
durée chez une femme jeune n'est probablement pas négligeable,
même s'il n'est pas majeur. Ce traitement est susceptible d'éviter
des complications maternelles, au premier rang desquelles l'oedème
pulmonaire.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

29 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
La classique assertion du risque d'accident vasculaire
cérébral est peu crédible dans ce même raisonnement
par analogie.
En effet, les cas en sont rares et l'imputabilité des
chiffres tensionnels n'a jamais été convenablement
étayée.
Néanmoins, la pratique générale est de
traiter ces hypertensions dès lors que les chiffres dépassent
régulièrement 160 à 180 et/ou 110 mmHg. Il est
certainement aussi important que précédemment, voire plus encore,
d'agir avec doigté, et de ne pas ramener les chiffres audessous de 140
et 90 mmHg.
o Quels médicaments antihypertenseurs ?
- Les diurétiques, largement utilisés en
un temps, sont aujourd'hui complètement abandonnés.
En effet, ils diminuent le volume plasmatique, déjà
souvent déficitaire, et peuvent de ce fait aggraver la souffrance
foetale chronique.
Ils diminuent la perfusion placentaire et de nombreuses
études cliniques ont montré qu'ils étaient associés
à des poids de naissance plus bas.
- Les antihypertenseurs centraux (méthyldopa,
clonidine) ont été largement utilisés dans la
grossesse.
Ce sont certainement les produits pour lesquels
l'expérience est la plus grande et le recul le plus long. Leur
efficacité est convenable et leur innocuité semble largement
établie.
Ce sont également les seuls pour lesquels on dispose d'une
surveillance pédiatrique sur des années, démontrant
l'absence d'effets indésirables à long terme chez les enfants,
tant en ce qui concerne la croissance que la performance intellectuelle et
scolaire.
- L'hydralazine bénéficie d'un recul
comparable. Son efficacité est remarquable à doses assez
élevées et elle a de plus l'avantage théorique de ne pas
franchir, ou très peu, la barrière placentaire.
Malheureusement, la contre-partie de cette efficacité est
une tolérance clinique médiocre (palpitations,
céphalées intenses pouvant en imposer pour une menace
d'éclampsie), due à l'augmentation du débit cardiaque
déjà élevé chez ces patientes, et qui en limite
l'usage.
- La prazosine est également utilisée.
Elle jouit même d'une faveur certaine aux
États-Unis. Son efficacité antihypertensive est bonne et sa
tolérance sans problème. Comme l'hydralazine ; la prazosine a une
forte liaison protéique et son passage transplacentaire est faible.
- Les bêtabloquants sont largement utilisés
dans la grossesse.
Contrairement à ce que l'on pouvait craindre, ils
n'augmentent pas la motricité utérine.
Comme ils franchissent le placenta, ils comportent en principe un
risque d'hypoglycémie, de bronchospasme et de bradycardie
néonataux.
En fait, au fil des années, ce risque est apparu plus
théorique que réel, et les avantages du traitement
bêtabloquant semblent l'emporter sur ce risque.
Ces données rassurantes ne changent rien à ce qui a
été dit plus haut du risque d'hypotrophie si le traitement est
trop intense.
Il est par ailleurs évident qu'il convient d'assurer une
surveillance néonatale très soigneuse des enfants nés sous
bêtabloquants, surtout s'ils sont prématurés et
hypotrophes.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

30 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
- Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont
responsables chez l'animal d'une fréquence accrue de morts foetales.
Ce risque n'est pas apparu dans les observations humaines
rapportées, mais celles-ci restent anecdotiques.
En revanche, des complications néonatales ont
été rapportées, en particulier des anuries, dont plusieurs
ont été mortelles. Ces produits sont contre-indiqués dans
les deux derniers trimestres de la grossesse. A noter en revanche qu'aucune
tératogénicité n'a été observée.
Aucune inquiétude particulière n'est donc justifiée
lorsqu'une grossesse débute sous un médicament de cette
classe.
Enfin à ce jour, tout indique que les antagonistes des
récepteurs de l'angiotensine II ont les mêmes effets que les
inhibiteurs de l'enzyme de conversion et en partagent la contre-indication.
- Les bloqueurs calciques sont très
utilisés, du moins en France, chez la femme enceinte. Pourtant, leur
dossier est remarquablement pauvre.
Il y a peu de certitudes sur leur absence de
tératogénicité.
Leur action tocolytique, précieuse en cas de menace
d'accouchement prématuré, peut être source de
difficultés lors de l'accouchement, voire en post-partum.
Seules de solides études, qui manquent encore à ce
jour, pourraient leur conférer un niveau de preuve raisonnable.
o La Diététique
Le régime désodé a été
largement utilisé pendant plusieurs dizaines d'années et l'on y a
même vu en un temps une panacée.
La preuve de son inutilité et même de sa
nocivité a été apportée en 1958 par une remarquable
étude de Robinson, et après d'innombrables tergiversations, la
communauté scientifique internationale l'a banni définitivement
de la panoplie des mesures utiles chez une femme enceinte au début des
années 1970.
En effet, il limite l'expansion volémique et risque donc
de majorer la souffrance foetale ; il n'a par ailleurs aucun effet
préventif de la prééclampsie comme on l'avait
escompté en un temps. Le doute qui subsiste encore chez quelques uns
après 40 ans de preuves est donc difficilement compréhensible
!
La plupart des autres tentatives de manipulation
diététique se sont avérées infructueuses et ont
été abandonnées à leur tour. L'intérêt
d'un apport calcique accru demeure débattu, mais garde des partisans
convaincus. Il est probablement utile au moins dans les populations à
apport calcique carencé.
Suivre Le régime D.A.S.H.
Aux États-Unis, les National Institutes of Health (NIH)
préconisent le régime DASH (Dietary Approaches to Stop
Hypertension). Ce régime alimentaire est spécialement
conçu pour soigner l'hypertension. Des recherches ont
démontré son efficacité et, dans le cas d'une hypertension
légère, il peut même remplacer les médicaments
habituels. Dans ce régime, l'accent est mis sur les fruits et
légumes, les grains entiers, les noix, le poisson, la volaille et les
produits laitiers faibles en matières grasses. La consommation de
viandes rouges, de sucre, de matières grasses (et plus
particulièrement les gras saturés) et de sel y est
réduite.
Il est possible d'abaisser sa tension artérielle en
appliquant les conseils qui suivent : - Consommer beaucoup de fruits et
légumes;
- Limiter sa consommation de sel : des études indiquent
que 30 % des hypertendus (en particulier ceux qui réagissent facilement
au sodium) peuvent contrôler leur pression sanguine en
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998

31 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
réduisant leur apport en sel. Au besoin, pour cuisiner ou
assaisonner, remplacer le sel de table, le sel marin ou la fleur de sel par du
sel de potassium.
- Modérer sa consommation d'alcool et de caféine
(un maximum de quatre tasses de café par jour);
- Manger de l'ail : bien que ses vertus ne soient pas
prouvées de façon rigoureuse, plusieurs médecins
recommandent l'ail pour ses propriétés vasodilatatrices.
En cas de prééclampsie sévère, la
sévérité habituelle de l'hypertension rend son traitement
indiscutable. Celui-ci est généralement parentéral. Le
nombre de médicaments utilisables est ici plus limité.
Si aux États-Unis l'hydralazine reste le
traitement favori, d'autres produits sont plus utilisés en Europe,
même en RDC.
Une méta-analyse récente n'a montré aucune
supériorité de l'hydralazine sur les autres médicaments
d'usage parentéral. Le labétalol a été l'objet de
nombreuses études de bonne qualité, et son efficacité
aussi bien que son innocuité peuvent être tenues pour certaines.
L'urapidil a été moins étudié, mais semble se
comparer favorablement à l'hydralazine. La nicardipine, grand favori en
France, n'a donné lieu à aucune étude
contrôlée acceptable.
Enfin, les formes rapides de nifédipine, proposées
en un temps, sont actuellement contre indiquées dans tout traitement
antihypertenseur selon l'ensemble des recommandations, françaises et
internationales. Ce traitement doit être conduit avec douceur
malgré la gravité de la situation. Un palier doit être
atteint en quelques heures visant à une diastolique qui ne soit pas
inférieure à 100 mmHg. Une décroissance aux alentours de
90 mmHg ne doit être faite que secondairement et plus lentement. Un
traitement trop agressif expose aussi bien à des complications
maternelles qu'à une mort foetale rapide. Certaines mesures d'appoint
ont été proposées dans les formes très
sévères.
Leur efficacité est difficile à juger car elles
sont appliquées tardivement, dans des indications oüle
pronostic est généralement très péjoratif. Ainsi,
l'héparinothérapie et l'expansion du volume
plasmatique ont été utilisées avec
des fortunes diverses. Leurs indications doivent être mûrement
pesées en milieu spécialisé.
· TRAITEMENT OBSTÉTRICAL :
Tout ce qui vient d'être exposé indique clairement
que le traitement médical de l'hypertension gravidique est le plus
souvent décevant.
Il ne change rien aux formes dont le pronostic est
spontanément bénin, et ne permet de gagner que très peu de
terrain dans les formes sévères. Si le pronostic maternel et
foetal dans l'hypertension gravidique s'est amélioré de
manière importante depuis deux décennies, ce n'est donc pas lui
qui peut en être crédité, mais les progrès
réguliers qui ont été réalisés en
matière de surveillance et de tactique obstétricale.
L'arrêt de la grossesse est en effet la seule mesure qui
met fin aux manifestations hypertensives et protéinuriques
maternelles.
C'est donc cette décision qui doit être prise sans
hésitation dans les formes graves lorsque s'annonce une souffrance
foetale, sans placer dans le traitement médical un espoir qui a toutes
les chances d'être déçu. Agir ainsi n'est cependant
possible qu'à un terme suffisamment avancé pour que le risque
néonatal soit acceptable.
Et sur ce point, les progrès réguliers de la
néonatologie ont permis d'aborder presque sereinement des extractions
foetales à des termes inconcevables il y a encore peu.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207

32 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
C'est avant ce terme limite que toutes les ressources
médicales doivent être mises en jeu, dans le but de gagner
quelques précieuses semaines de maturité foetale.
o C.A.T. après l'accouchement
- Examen anatomopathologique du placenta. La présence
d'infarctus multiples est un signe de gravité rétrospectif.
- Suites de couches : des complications sont encore possibles
(poussée hypertensive, éclampsie, CIVD, HELLP) et l'HTA met
parfois plusieurs semaines pour disparaître. Maintenir une surveillance
étroite et n'arrêter que progressivement le traitement
antihypertenseur.
- A la sortie : la contraception doit éviter les
oestroprogestatifs, et préférer les microprogestatifs.
- Bilan vasculorénal trois mois après
l'accouchement (créatininémie, albuminurie des 24h) à la
recherche d'une pathologie sous-jacente : HTA permanente
révélée par la grossesse, néphropathie.
o Mesures préventives pour les grossesses suivantes
Un antécédent d'HTA gravidique ou de
prééclampsie peut récidiver, en général sur
un mode comparable : un antécédent sévère (HRP,
éclampsie, mort foetale in utero...) fait craindre un
événement similaire.
Il faut prévoir :
- Un arrêt d'un éventuel tabagisme et autres
toxicomanies
- Une surveillance renforcée, avec Doppler utérin
dès 5 mois : les altérations du doppler utérin peuvent
précéder de plusieurs semaines l'apparition de l'HTA et du
RCIU,
- Un traitement préventif par aspirine à faibles
doses :
Son efficacité est prouvée mais limitée.
100 mg par jour (formes pédiatriques pour nourrissons) de
la fin du premier trimestre (voire même plus tôt) jusqu'à 35
SA, (en cas de RCIU sévère ou Prééclampsie
précoces et/ou sévères).
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998

33 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
CHAP 2. PRESENTATION DU CADRE DE RECHERCHE 2.1.
Présentation de la clinique
2.1.1. Historique, objet et cadre juridique de la clinique
La clinique Bondeko est une oeuvre sociale ASBL bondeko ya sika,
une organisation non gouvernementale créée le 11. Novembre 1967,
son siege est au numéro 5219, av. de l'université dans la commune
de Limete. Pour assurer les soins de ses membres, cette ASBL a mis sur pied un
système de contribution pouvant permettre la construction dispensaire,
cela serait dans le souci de dispenser les soins de qualité à des
prix abordables dans un esprit de charité, de fraternité,
d'honnêteté et ainsi servir de modèle aux autres formations
médicales de la ville de Kinshasa. Les sommes recoltées ont
été renforcées plus tard par la contribution de certaines
personnes physiques et morales. C'est ainsi qu'est née la clinique
Bondeko qui fait l'objet de notre recherche.
Concrètement, c'est en 1982 que les membres des
communautés Bondeko avaient eüt l'idée de construire un
dispensaire aux seins du centre Bondeko en présentant le dit projet
à l'autorité de la ville, le gouverneur de la ville leur a
proposé de construire un grand hôpital au lieu d'un petit
dispensaire. Ainsi, il leur distribua le terrain `'zamba
avocat».
En 1985 a eu lieu la pose de la première pierre, mais
suite à quelques difficultés financières, les travaux ne
débutèrent qu'en 1985. En 1989, le premier bâtiment qui
abrite les services de consultation externe et spécialisés dans
la pédiatrie et la gynécologie.
En 1991 ; avec l'arrivé des spécialistes ; il y a
eu l'extension ; les médecins spécialisés. La même
année, le pavillon II abritant des services de gynécologie et la
chirurgie furent ouverts.
En 1994, les travaux de construction de la maternité et
d'incinérateur commencèrent une année avant, plus tard, la
maternité deviendra opérationnelle, il est à noter qu'en
étant oeuvre privée de l'ASBL bondeko ya sika ; la clinique
évolue au fil du temps compte tenu des moyens financiers disponibles. Le
dynamisme de dirigeants de l'un des meilleurs centres hospitaliers de la ville
de Kinshasa. La clinique Bondeko fut officiellement ouverte, aujourd'hui, cette
clinique offre des
nombreux services de qualité partant des services
médicaux (consultation, ambulatoire, hospitalisation), service
médico-technique (laboratoire, pharmacie, bloc opératoire,
radiologie) : services administratifs, services économiques et
généraux, morgue etc. Elle est jeune, certes mais son apport et
son action sur l'amélioration de la situation sanitaire à
Kinshasa sont à louer et à enhardir. La clinique Bondeko poursuit
les objectifs suivants :
> La promotion sanitaire de l'homme, > La vulgarisation de
l'évangélisation
> La restauration des esprits, de l'esprit de
fraternité et de solidarité avec le Christ > L'innovation de
la communion fraternelle
La clinique Bondeko est une institution de santé qui est
sous tutelle du Ministère de la santé Publique et de
l'Association sans but lucratif <Bondeko ya sika>.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207
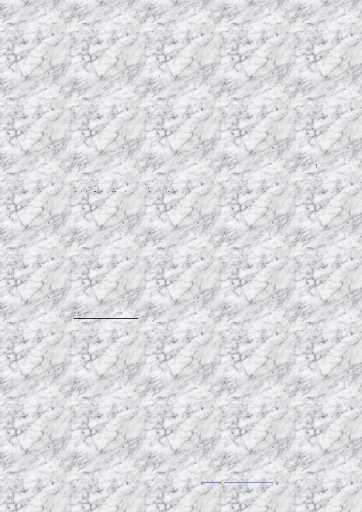
34 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
Cette association a été créée par
l'ordonnance n°178/132 du mars 1978 et à ses statuts propres
à elle. Elle est l'organe fondateur de la clinique Bondeko.
2.1.2. Situation géographique
La clinique Bondeko est située dans la zone de
santé de Funa, sur l'avenue yolo n°7252 sur la place naguère
appelée << zamba avocat>> dans la commune de
Limete. Elle est limitée :
> A l'Est à près de 200m, par la place
commerciale
> A l'Ouest par la mosquée musulmane de Limete
> Au Nord par l'entrée de l'avenue tropique de la
6ème rue Limete
> Au Sud par le quartier de la 7ème rue
Limete, on peu y accéder à partir du boulevard lumumba par
7ème rue Limete ou à partir de l'avénue de
l'université par le rond point Bongolo au yolo médical.
Situé ainsi en plein milieu de la ville de Kinshasa, la clinique est
facilement accessible à ses usagers.
2.1.3. Objectif et impact de la clinique
La clinique Bondeko poursuit les objectifs suivants :
> La promotion sanitaire de l'homme, > La vulgarisation de
l'évangélisation
> La restauration des esprits, de l'esprit de
fraternité et de solidarité avec le Christ > L'innovation de
la communion fraternelle
La clinique Bondeko est une institution de santé qui
est sous tutelle du Ministère de la santé Publique et de
l'Association sans but lucratif <Bondeko ya sika>. Cette association a
été créée par l'ordonnance n°178/132 du mars
1978 et à ses statuts propres à elle. Elle est l'organe fondateur
de la clinique BO NDEKO.
2.2. Matériels et méthodes
2.2.1. Méthodes
2.2.1.1. Nature, lieu et période d'étude
Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive,
réalisée à la clinique Bondeko. Cette étude
couronne une période de 6 mois, du 1er janvier 2009 au 30
juillet 2009.
2.2.1.2. Populations d'étude Critères d'inclusion
:
> toute accouchée qui consulte avec dysgravidie >
avoir un dossier complet
Critères d'exclusion :
> toute accouchée avec autres maladies > dossier
incomplet
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998

35 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
2.2.2. Matériels
2.2.2.1. Récolte des données
Pour la réalisation de ce travail, nous nous sommes
référés aux registres des patientes à la salle
d'accouchement de la clinique Bondeko.
2.2.2.2. Paramètres d'étude Nous avons les
paramètres suivants :
- La fréquence mensuelle
- Profils sociodémographiques : Le niveau d'étude,
L'état civil, La parité, L'age
et La résidence.
- Eléments cliniques : Le mode d'accouchement, Diagnostic
clinique,
Complications associées, Les consultations
prénatales.
- L'issue néonatale : Sexe, le score APGAR et les
Poids.
2.2.2.3. Analyse des données
Elle a été rendue possible grace à
l'utilisation des statistiques descriptives : calculs de fréquences et
de pourcentage.
2.2.2.4. Présentation des résultats
Nos résultats seront présentés sous forme de
tableau dont les fréquences et les pourcentages seront des
paramètres d'argumentation.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207
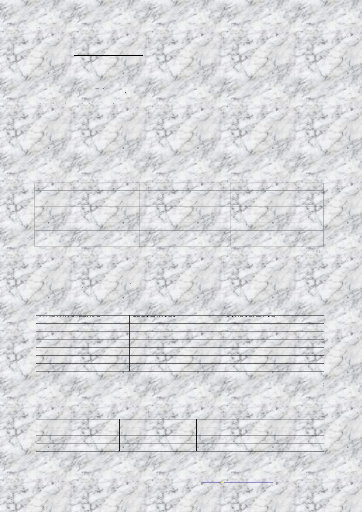
36 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
CHAP 3. LES RESULTATS
La récolte des données statistiques à
Bondeko s'est basée sur des faits suivants afin d'une
compréhension de la toxémie gravidique. Nous citons des points
ci-après :
3.1. Fréquences
Nombre des malades : 661 femmes.
3.1.1. Fréquence globale : 34 cas*100/nombre des
malades.
34*100/661=5.14%.
Sur toutes les femmes malades à Bondeko, rien
que ce pourcentage se rapporte aux femmes avec gestose
éclamptogène.
3.1.2. Répartition de la dysgravidie selon la
fréquence mensuelle
MOIS FREQEUNCES POURCENTAGE
Janvier 7 20.58
Février 6 17.11
Mars 4 11.76
Avril 9 26.46
Mai 6 17.64
Juin 2 5.88
Total 34 100%
Selon la fréquence mensuelle, nous nous rendons compte
que c'est au mois d'avril que cette dysgravidie est plus élevée
avec une fréquence de 9 soit 26,46% qu'au mois de juin, plus basse sur
l'effectif des femmes avec dysgravidie dans l'intervalle de 6 mois.
3.2. Profil sociodémographique
3.2.1. Répartition de la dysgravidie selon les niveaux
d'étude
NIVEAUX D(ETUDE FREQEUNCES POURCENTAGE
Non instruits 8 23.52
Humanité incomplète 10 29.41
Diplômée 10 29.41
Graduée 5 14.70
Licenciée 1 2.94
Total 34 100%
Ici, dans l'effectif total de 34femmes, la
fréquence est beaucoup plus élevée chez les femmes ayant
fait les humanités incomplètes et les diplômés avec
une fréquence de 20 soit 58,8% mais basse chez les licenciées
avec une fréquence d'1 soit 2,94 %.
3.2.2. Répartition de la dysgravidie selon
l'état civil
ETAT CIVIL FREQEUNCES POURCENTAGE
Mariés 32 94.11
Célibataires 2 5.88
Total 34 100%
Ici, c'est plus les mariées que les
célibataires qui contractent la toxémie gravidique avec une
fréquence de 32 soit 94.11%.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
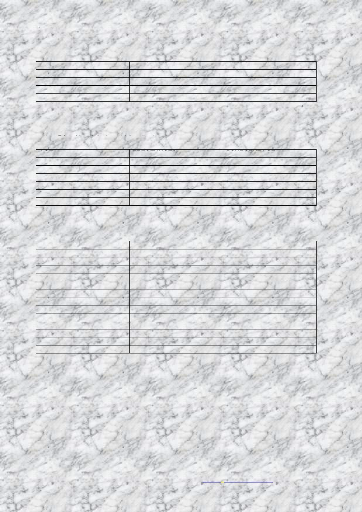
37 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
3.2.3. Répartition de la dysgravidie selon La
parité
PARITE FREQEUNCES POURCENTAGE
Primipare 8 23.52
Multipare 21 61.76
Grande multipare 5 14.7
Total 34 100%
Selon la parité, les multipares ont une
fréquence de 21 soit 61,76%, suivi des primipares avec une
fréquence de 8 soit 23,52% et en denier lieu, les grandes multipares
avec une fréquence de 5 soit 14,7%sur un total de 34 femmes
dysgravidiques.
3.2.4. Répartition de la dysgravidie selon l'age
AGE FREQEUNCES POURCENTAGE
25 2 5.88
25-30 9 26.46
30-35 4 11.76
35-40 15 44.11
40-45 4 11.76
Total 34 100%
Ici, nous comprenons que l'intervalle d'age de 35-40ans des
femmes sont atteintes avec une fréquence de 15 soit 44.11%,
contrairement à celles de moins de 25 ans avec une fréquence de 2
soit 5.88%.
3.2.5. Répartition de la dysgravidie selon La
résidence
RESIDENCES FREQEUNCES POURCENTAGE
Bandal 1 2.94%
Kalamu 4 11.76%
Kasavubu 1 2.94%
Kimbanseke 2 5.88%
Kinshasa 2 5.88%
Lemba 10 29.41%
Limete 2 5.88%
Masina 2 5.88%
Matete 6 17.64%
Makala 1 2.94%
Mont ngafula 1 2.94%
Ngaba 2 5.88%
Total 34 100%
Les femmes de Lemba consultant à Bondeko sont plus
dysgravidiques, avec une fréquence de 10 soit 29.41% par rapport aux
dysgravidiques de résidence suivantes ne possédant qu'une
fréquence de 1 soit 2.94% : Bandal, Kasavubu, Makala, Mont
ngafula.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207
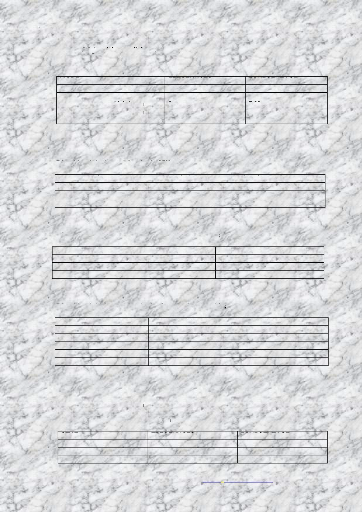
38 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
3.3. Les éléments cliniques
3.3.1. Répartition de la dysgravidie selon Les modes
d'accouchement
MODE FREQEUNCES POURCENTAGE
Eutocie 8 23.52
Dystocie
- Voie basse
- Voie haute
2 24 34
Total
5.88
70.58
100%
Contrairement à l'accouchement eutocique où on
a qu'une fréquence de 8 soit 23,52%, l'accouchement dystocique avec une
fréquence de 24 soit 76,46%.
3.3.2. Répartition de la dysgravidie selon la CPN
LIEU DE LA CPN FREQEUNCES POURCENTAGE
Bondeko 30 88.23
Ailleurs 4 11.76
Total 34 100%
Par rapport à l'effectif total des grossesses
gravidiques, les plus des cas se trouvent chez les femmes ayant fait leur CPN
à Bondeko avec une fréquence de 30 soit 88.23%
3.3.3. Répartition de la dysgravidie selon Les Diagnostics
cliniques
PREECLAMPSIE FREQEUNCES POURCENTAGE
PES 19 55.88
PEM 15 44.11
Total 34 100%
Les diagnostics cliniques de ce tableau nous montrent
parfaitement que la PES est fréquente de 19 soit 55.88% que celle
modérée avec une fréquence de 15 soit 44.11%.
3.3.4. Répartition de la dysgravidie selon les
Complications associées
COMPLICATIONS FREQEUNCES POURCENTAGE
DPPNI 1 16.66
MIU 3 50
SFA 1 16.66
SFC 1 16.66
Total 6 100%
Sur les complications associées, le MIU
prédominent avec une fréquence de 3 soit 50% sur un total de 6
contre DPPNI, SFA et SFC avec une fréquence de 1 chacune, soit
16.66%.
3.4. L'Issue néo-natale
3.4.1. Répartition de la dysgravidie selon le Sexe
SEXE FREQEUNCES POURCENTAGE
M 19 55.88
F 15 44.11
Total 34 100 %
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
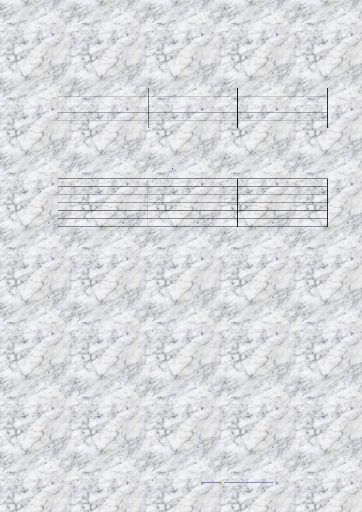
39 Travail de Fin de Cycle Prise en Charge de la
Dysgravidie à la Clinique Bondeko Janvier-Juin 2009.
Nous nous rendons compte que les enfants nés d'une
grossesse avec HTA sont beaucoup plus de sexe masculin avec une
fréquence de 19 soit 55,88 que féminin avec 15 de
fréquence soit 44.11%.
3.4.2. Répartition de la dysgravidie selon le Score
APGAR
APGAR FREQEUNCES POURCENTAGE
Bon 30 88.23
Détresse transitoire 1 2.94
Mauvais 3 8.82
Total 34 100%
Pour les enfants nés d'une femme dysgravidique, la
plupart ont un bon APGAR avec une fréquence de 30 soit 88.23%, suivie
d'un mauvais avec une fréquence de 3 soit 8.82% et vient enfin la
détresse respiratoire avec une fréquence de 1 soit 2.94%.
3.4.3. Répartition de la dysgravidie selon le Poids
POIDS FREQEUNCES POURCENTAGE
2500 10 29.41
2500-3000 7 20.58
3000-3500 11 32.35
3500-4000 6 17.64
Total 34 100%
Nous observons ici que sur 34 naissances, 10 ont un poids
inferieur à 2500g soit 29.41% et rien que 6 enfants nagent entre 3500
à 4000 g soit 17.64%, la plus basse fréquence.
Université Technologique Bel Campus.
longilachasles@yahoo.fr
+243 896139998
+243 999491500, 812484207
| 


