|

UNIVERSITE SAAD DAHLAB DE BLIDA
Faculté des lettres et sciences sociales
Département de français
MEMOIRE DE MAGISTER
Option : Didactique
EXPRESSION DE L'HYPOTHESE EN CLASSE DE FRANÇAIS,
LANGUE
ETRANGERE
Par
Laadjel KHERZAT
Devant le jury composé de :
D. MAATOUK
A. BEKKAT
S. AOUADI
EL- Hocine GRISS
Maître de conférence, U. Blida
Maître de conférence, U. Blida
Professeur, U. de Annaba
Chargé de cours
Président
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Blida, juin 05

Résumé
Le travail entrepris dans le cadre de ce mémoire
porte sur l'expression de
l'hypothèse en classe de français, langue
vivante. C'est aussi une recherche du
comment les enfants algériens l'utilisent dans
leur langue et comment, ils la
comprennent dans leur vécu de tous les jours. Une
analyse assez poussée dans
l'expression de l'hypothèse, en tant que mode
pensée, et surtout comment elle est
perçue par les jeunes algériens, en rapport
avec leur langue algérienne a été
entreprise. Des exercices puisés dans les
documents des élèves ont servi
d'exploitation à un nombre relativement important
d'élèves pour tenter de découvrir
comment, ils arrivent à utiliser l'expression de
l'hypothèse dans leur vécu de tous les
jours. Nous avons aussi tenté de comprendre le
système utilisé par les trois autres
langues : la langue nationale, l'arabe algérien et
le tamazight. Nous avons aussi
comparé les trois systèmes de l'expression de
l'hypothèse dans les langues utilisées
en Algérie, pour savoir si l'erreur découverte chez
les étudiants algériens, à savoir
l'utilisation du futur après la subjonction « si
», ne provenait pas de la contiguïté de
ces langues. Nous avons aussi pensé à
l'enseignement de l'expression de
l'hypothèse, qui, à notre sens, relève d'un
enseignement effrité, ayant besoin d'un
regroupement pour être efficace.
Nous avons cru que l'erreur provenait de l'enseignement
effrité de cette
expression de l'hypothèse et nous avons
essayé de proposer une piste de travail
pour rendre cette expression plus accessible et mieux
assurée par les étudiants
algériens qui fuient l'utilisation du conditionnel
et le futur, temps piliers de cette
forme de pensée.
Cet humble travail pourrait, peut-être, servir
de début d'analyse des
programmes de l'école algérienne, qui seront
probablement complétés par d'autres
recherches plus fines, plus élaborées, et mieux
organisées pour pouvoir rendre un
service à tous nos étudiants et les
pousser à une utilisation rationnelle de
l'expression de l'hypothèse.
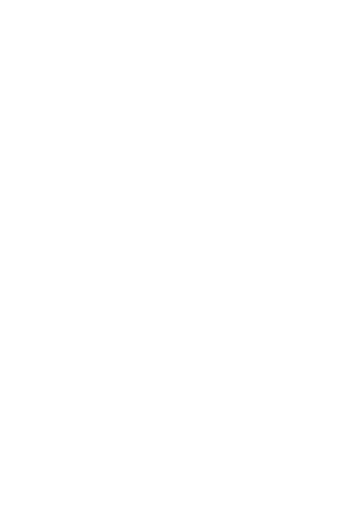
ÕÜÜÜÜÎÜÜÜÜÜÜáÜÜÜÜÜã
Çã (ÉíÍ
ÉÛá )
ÉíÓäÑáÇ
ÉÛááÇ ãÇÓÞ
í ÉíÖÑáÇ
ÈÇÑÚÅ áæÍ
ÑæÍãÊí
ÉÑÂÐãáÇ åÐå
ÑÇØÅ í åÈ
ÑÏÇÈãáÇ
áãÚáÇ äÅ
.Çíãæí
áæÇÏÊãáÇ
áÇãÚÊÓ?Ç æ
ÉíáÍãáÇ
ãåÊÛá í
äííÑÆÇÒÌáÇ
Ðíã?ÊáÇ ÑØ äã
ÇåáÇãÚÊÓÇæ
Çåãå Éíí í
ËÍÈ æå
íÑÆÇÒÌáÇ
ÈÇÈÔáÇ ÑØ äã
ÇåáÈÞÊ ÉííÂ
ÉÕÇÎæ ÑíßÊ
ÈæáÓÂ
ÉíÖÑáÇ
ÈÇÑÚÅ ÑÇØÅ
í ãÊ ÞãÚã ÏÌ
?íáÍÊ
.????? ?? ?????????
ÉíãæíáÇ
Ê?æÇÏÊáÇ í
ááÎáÇ ÇÔÊÂ?
Çäã ÇíÚÓ
ßáÐæ Ðíã?Êáá
ÉíÓÇÑÏ
ÚÌÇÑã äã
ÊÇÞÊÔã
äíÑÇãÊ
áÇãÚÊÓÇ
ÇäíÊÑÇ ÏÞáæ
Úã (
ÉíÛíÑÇã?Ç
ÉÛááÇæ
ìÍÕáÇ
ÉíÈÑÚáÇ
ÉÌÑÇÏáÇ
ÉíÈÑÚáÇ )
Ë?ËáÇ ÊÇÛááÇ
ÑÈÚ ÍÑØáÇ
ÈæáÓ ãåá ÇÖí
ÇäÞÑØÊæ
ÊÞæ
áÇãÚÊÓÇ
áËãÊãáÇæ
äííÑÆÇÒÌáÇ
ÉÈáØáÇ ÏäÚ
ÔÊßãáÇ ØÎáÇ
äÇ äÅ ÉÑÚãá
ÉáãÚÊÓãáÇ
Ë?ËáÇ ÈíáÇÓ?Ç
äíÈ
ÉäÑÇÞãáÇ
.Ë?ËáÇ
ÊÇÛááÇ
ÑæÇÌÊá ÏæÚí
"æá " ÈÕäáÇ
ÉÛíÕ ÏÚÈ
áÈÞÊÓãáÇ
ãíáÚÊáÇ í
ÚãÌáÇ äã ÏÈ?
ËíÍ ØÎáÇ ÇÐå
í ÇÈÈÓ
ÉíÖÑáá
ßßãáÇ
ãíáÚÊáÇ ä
ìáæ?Ç ÉáåæáÇ
äã Çäá ÇÏÈ
ÏÞá
ÉÈáØáÇ ÑØ
äã ÉíÖÑáÇ
áÇãÚÊÓÇ
ØíÓÈÊæ
ÈíÑÞÊá áãÚ
ÉÞíÑØ
ÍÇÑÊÞÇÈ
ÇäÑÏÇÈ
ÉÈæáØãáÇ
ÉíáÇÚáÇ
ìáÚ áæÕÍáá
.ÑíßÊáÇ äã
ÚæäáÇ ÇÐåá
ÒÆÇÂÑ
ÉÑÈÊÚãáÇ
ÊÇÞæ?Ç
áÈÞÊÓãáÇæ
ØæÑÔãáÇ
áÇãÚÊÓÇ
äíÏÇÊãáÇ
äííÑÆÇÒÌáÇ
ÉáËÇãã
ÌãÇÑÈÈ ìÑËí
ä áãä ÇãÂ
ÉíÑÆÇÒÌáÇ
ÉÓÑÏãáÇ
ÌãÇÑÈ
ÚæãÌã
ÍíÑÔÊá
ÉíÇÏÈ äæßí
ÏÞ ÚÖÇæÊãáÇ
áãÚáÇ ÇÐå
.ÉíÖÑáÇ
ÈÇÑÚ?
íä?ÞÚáÇæ ÍÕ?Ç
áÇãÚÊÓ?Ç
ìáÚ ãåÒíÍÊæ
ÇäÈ?Ø ÉãÏÎá
äíËÍÇÈáÇ ÑØ
äã ÉÞÏ ÑËÂ
ìÑÎ æ

Summary
The work undertaken within the framework of this memory concerns
the expression
of the assumption in French class, living language. It is also a
research of how the
Algerian children use it in their language and how, they
understand it in their lived of
every day.
An analysis pushed enough in the expression of the assumption, as
a thought mode,
and especially how it is perceived by young Algerian, in
connection with their Algerian
language was undertaken. Exercises drawn from the documents of
the pupils were
used as exploitation with a relatively significant number pupils
to try to discover how,
they manage to use the expression of the assumption in their
lived of everyday.
We also tried to understand the system used by the three other
languages: the
national language, Algerian Arabic and the tamazight. We also
compared the three
systems of the expression of the assumption in the languages used
in Algeria, to
know if the error discovered in the Algerian students, namely the
use of the future
after the subjonction " if ", did not come from the adjacency
of these languages. We
also thought of the teaching of the expression of the assumption,
which, in our view,
concerns an exhausted teaching, needing a regrouping to be
effective. We believed
that the error came from the exhausted teaching of this
expression of the assumption
and we tried to propose a track of work to return this expression
more accessible and
ensured better by the Algerian students who flee the
use of conditional and the future, time pillars of this form of
thought. This humble work could, perhaps, be used as beginning
of analysis of the
programs of the Algerian school, which will be probably
supplemented by other
research finer, more elaborate, and organized better to be able
to render a service all
to our students and to lead them to a rational use of the
expression of the
assumption.

Dédicace
Je dédie cet humble travail à mes parents
qui ont toujours vu dans l'école la
possibilité de l'épanouissement de tout être
et ont toujours pensé qu'ils en pouvaient
bénéficier, ne serait-ce par des compliments qui
peuvent leur être adressés par leur
entourage. Comme je le dédie aussi à mon
épouse qui, elle, a toujours cru que les
études sont faites pour les « bons à rien
» et je lui dis que j'en suis un.
Comme je tiens tout particulièrement à le
dédier à mon fils aîné ingénieur en
électro-
mécanique pour qui, il n' y a pas de salut que dans la
religion.
Enfin, je le dédie à mon autre fils,
déjà docteur en automatisme - enseignant -
chercheur dans une université Parisienne -, lequel
m'a promis une visite à son
université en cas de réussite. Comme, je tiens
à le dédier à mes professeurs qui
m'ont marqué par leur humilité et leur sagesse.

Remerciements
Mes remerciements sont adressés à tous mes
professeurs et ceux qui ont accepté
de lire de cet humble travail.
Ils vont, en particulier, à Mme Bekkat Amina, la femme
courageuse qui a su me
convaincre d'effectuer le transfert de mon dossier de
l'Université d'Alger à
l'Université de Blida, à mon ami et frère,
M. Ghreiss Hocine, chef du département du
Français, et à son adjoint et collègue, M.
Mohamed Lalleug et Surtout à notre
éminent professeur M. Saddek Aouadi qui a bien voulu me
lire et m'apporter les
différentes corrections à ce travail pour voir le
jour.
Comme, je remercie aussi Mme S. Amokrane pour ses
précieuses aides et tous ceux
qui ont pu m'encourager pour aller de l'avant.
Laadjel

SOMMAIRE
RESUME.
REMERCIMENTS.
TABLE DES MATIERES...
LISTE DES ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES
INTRODUCTION..
CH. 1. La présentation critique de
l'expression de l'hypothèse ..
1.1 Dans le bon usage de Maurice Grevisse
1.1.1 Les définitions opératoires..
1.1.2 Analyse du titre des propositions conditionnelles ou
hypothétiques.
1.1.3 Analyse de la partie renfermant les propositions
hypothétiques..
14
21
21
21
22
23
1.2
Présentation du point de vue de R.L.Wagner et J. Pinchon
1.2.1 La phrase simple..
1.2.2 Syntaxe des phrases complexes
1.2.3 Une description plus étendue..
1.2.4 Définition de la phrase complexe
1.2.5 L'éventualité pure.
1.2.6 La supposition pure.
1. 2.7 La condition..
1. 2.8 Les phrases hypothétiques normales..
1. 2.9 Les autres phrases hypothétiques
1.2.10 Systèmes hypothétiques introduit par «
si »
1.2.11 L'hypothèse précède logiquement sa
conséquence
1.2.12 Proposition du type Si + présent de l'indicatif
1.2.13 Proposition dépendante du type Si + imparfait.
1.2.14 Proposition dépendante (l'hypothèse a
toujours une valeur irréelle)..
1.2.15 Proposition dépendante du type SI + P.Q.P de
l'indicatif..
1.2.16 Système hypothétique introduit par «
quand »...
31
31
31
32
33
34
35
35
36
37
37
39
40
40
41
41
42

1.2.17 Système hypothétique introduit par «
quand »
1.2.18 Les autres hypothétiques...
1.2.19 Locutions de couleur hypothétiques formées
au moyen de « Si ».
42
43
43
1.3
Présentation du point de vue de la grammaire Larousse du
français
contemporain.
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
L'hypothèse considérée comme un
problème de subordination
Analyse du paragraphe 210..
Une phrase hypothétique..
La fréquence des structures.
Les définitions.....
1.3.3.4 Tableau de phrases types et leurs variantes..
1.3.3.5 Variantes principales de phrase type
1.3.3.6 Les variantes principales de phrases types
1.3.3.7 Systèmes introduits par « si » de
sens non hypothétique.
45
46
46
46
47
47
48
49
50
54
1. 4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
Analyse du point de vue d'O. Ducrot
La supposition..
Les emplois marginaux...
Les variantes de la structure (Si p, q)...
Les structures hypothétiques de type (Si p, q)
Les structures hypothétiques synonymes
L'indépendante à un temps autre que la forme en
(rais)
56
56
57
58
59
61
.(conditionnel)
1.4.7 Les structures homonymes des structures
hypothétiques
63
64
1.5
1.5.1
1.5.2
(Résumé des deux articles de C. Wimmer et H.
Vairel)..
Point de vue de C ; Wimmer .
Point de vue de H. vairtel ..
1.5.2.1 La valeur hypothétique de « si » dans
« si A »...
1.5.2.2 Facteurs externes
1.5.2.3
1.5.2.4
Facteurs internes
Point de vue de R. L. Wagner..
65
65
66
66
67
67
68

1. 6
(Fonctionnement de l'hypothèse en arabe, langue nationale,
en arabe
algérien et en Tamazight)
1.6.1
1.6.1.1
1. 6.1.2
1. 6.1.3
1.6.1.4
La langue nationale..
Enoncer un éventuel.
Enoncer un « hypothétique réel »..
L'adverbe « Ida »...
Idan -----(sinon, sans quoi)..
69
69
69
69
71
71
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3
Arabe algérien...
Conditionnel possible
Conditionnel impossible
Les hypothèses coordonnées..
71
72
72
72
1.6.3
Tamazight
1.6.3.1 Subjonctions utilisées en Tamazight
1.6.3.2
1.6.3.3
1.6.3.4
Le conditionnel
Les subjonctions /ma/- /m/ - /kan/ -/lokan/ - /akan/
Les subjonctions /limar/- /tili/ et /mer/..
73
73
73
74
74
1.7
Etude des circulaires et des manuels du 2
ième
palier de L'école
fondamentale.
1.7.1
1.7.2
1.7.3
La circulaire N°10/DE/20..
Analyse des documents du 2
ième
palier..
75
75
76
L'expression de l'hypothèse dans les programmes de la 4
ième
année primaire..
1.7.4
1.7.5
ième
Analyse des documents de la 6
Analyse des documents de la 5
ième
année primaire
année primaire
78
79
82
1.8
1.8.1
Les documents du troisième palier...
La circulaire du 17 octobre 1976.
86
86

1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
e
Analyse des documents de la 8 année fondamentale
e
Analyse des documents de frs. De l'élève de la 9
AF
Analyse des documents de la 7 année fondamentale
e
Analyse des documents de la 9 année fondamentale
e
87
88
92
94
CH.
2. L'ENQUETE.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Situation socio-économique..
Situation sociolinguistique.......
A propos de l'enquête
Expérimentation au niveau d'un cours
Au niveau national..
Le choix de la région.
Les exercices utilisés
97
97
97
98
98
99
99
102
2.8
2.8.1
2.8.1.1
2.8.1.2
2.8.1.3
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
2.8.2.3
L'analyse des exercices du 2
Les exercices de la 5
ième
ième
palier et de leurs résultats..
année primaire..
Exercice n°1
Exercice n°2
Exercice n°3
Analyse des résultats des exercices de 6
ième
A.E...
Exercice n°1
Exercice n°2...
Exercice n°3...
104
104
104
108
115
118
118
122
122
2.9
2.9.1
2.9.1.1
2.9.1.2
2.9.1.3
e
Exercice n°1
Exercice n°2
Exercice n°3
Analyse des exercices du troisième palier et de leurs
résultats
La 7 AF.
124
124
124
130
134
2.10
2.10. 1
Huitième année fondamentale.
Exercice n°1...
140
140

2.10.2
2.10.3
Exercice n°2.
Exercice n°3.
144
146
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
Neuvième année fondamentale
Exercice n°1.
Exercice n°2.
Exercice n°3.
149
149
154
161
2.12
2.12.1
2.12.2
2.12.3
Les propositions de solutions
Deuxième palier..
Propositions d'une progression
Le troisième palier..
2.12.3.1 Septième année fondamentale.
2.12.3.2 Huitième année fondamentale.
2.12.3.3 Neuvième année fondamentale
166
166
172
174
174
175
175
CONCLUSION..
REFERENCES...
BIBLIOGRAPHIE
177
183
186

LISTE DES ILLUSTRATIONS GRAPHIQUES
Exercices du 2
ième
palier
Figure n°1 : Exercice n°1- Item n°1.....
Figure n°2 : Exercice n°1- Item n°2 verbe
2.
Figure n°3 : Exercice n°1- Item n°3
« un seul verbe 1 membre de la phrase »
e
Figure n°5 : Exercice n°2- Item n°1..
Figure n°6 : Exercice n°2- Item n°1..
Figure n°7 : Exercice n°2 -Item n°2..
Figure n°8 : Exercice n°2- Item n°3..
Figure n°9 : Exercice n°2 -Item n°4, 1
membre
er
Figure n°4 : Exercice n°1- Item n°4,
verbe à retrouver (2 verbe).
er
ième
Figure n°10 : Exercice n°2- Item n°4,2
membre.
Figure n°11 : Exercice n°2- Item n°5,1
membre.
ième
membre.
er
Figure n°12 : Exercice n°2- Item n°5,2
105
106
107
108
109
110
111
112
113
113
114
115
Exercices du 3
ième
palier
Figure n°13 : Futur de l'indicatif...
Figure n° 14 Exercice n°1-Item n°2.
Figure n°15 : Exercice n°1-Item n°3
Figure n°16: Exercice n°1- Item n°4..
Figure n°17: Exercice n°1- Item n°5
Figure n°18: Exercice n°1-Item n°6
Figure n°19 : Exercice n°2- Item n°1..
Figure n°20 : Exercice n°2-Item n°2
Figure n°21 : Exercice n°2-Item n°3
Figure n°22 : Exercice n°2-Item n°4
125
126
126
127
128
129
130
131
132
132

Figure n°23 : Exercice n°2-item n°5
Figure n°24 : Exercice n°3-Item n°1
Figure n°25 : Exercice n°3 -Item n°1
-Premier verbe...
Figure n°26 : Exercice n°3 -Item n°1- 2
ième
Verbe
Figure n°27 : Exercice n°2 -Item n°2..
Figure n°28 : Exercice n°3 -Item n°3..
Figure n°29 : Exercice n°3 -Item 3 -2
ième
membre
133
134
135
136
136
137
138
La huitième année fondamentale
Figure n°30 : Exercice n°1-Item n°1/ 1
membre.
er
Figure n°31 : Exercice n°1-Item n°1/ 2
ième
er
ième
Figure n°33 : Exercice n°1- Item n°1/ 2
membre.
Figure n°32 : Exercice n°1- Item n°1 / 1
membre..
membre
Figure n°34 : Exercice n°2 -Item n°1..
Figure n°35 : Exercice n°2 -Item n°2..
Figure n°36 : Exercice n°3 -Item n°1..
Figure n°37: Exercice n°3 - Item n°2,1
verbe.
er
ième
Exercice de la 9
année fondamentale
141
141
143
143
145
146
147
148
Figure n°38 : Exercice n°1 - Item n°1.
Figure n°39 : Exercice n°1 - Item n°2.
Figure n°40 : Exercice n°1 - Item n°3.
Figure n°41 : Exercice n°2 - Item n°2.
Figure n°42 : Exercice n°2 - Item n°3.
Figure n°43 : Exercice n°2 - Item n°4.
Figure n°44 : Exercice n°2 - Item n°5.
150
151
152
156
157
159
160

14
INTRODUCTION
Nous avons l'intention d'aborder dans le cadre de cette
modeste recherche
la question de l'hypothèse et son expression en
classe de français, langue
étrangère. Cette dernière, avant
d'être une question de maîtrise de la langue et de
son système, est de notre point de vue liée
à l'ordre conceptuel, c'est - à - dire liée à
la logique et au raisonnement. En somme, elle fait partie de
l'articulation entre le
linguistique et le cognitif, de là, elle sera donc, la
clef de voûte de notre étude. C'est
pour quoi, il est tentant de présenter le
raisonnement comme un partenaire de la
logique. En effet, les réponses correctes dans les
tâches de raisonnement sont
fondées sur des normes logiques et les erreurs
sont des indicateurs d'un
raisonnement incohérents puisque la logique
constitue, en général, l'arrière- plan
pour l'évaluation de ses raisonnements.
Afin d'offrir un aperçu cohérent, sur le
raisonnement propositionnel, nous ferons
appel aux distinctions utilisées dans les analyses
linguistiques. La raison est que
les catégories linguistiques telles que la syntaxe, la
sémantique, la pragmatique et
les structures de surface sont très efficaces dans la
description des théories et des
phénomènes du raisonnement propositionnel.
La syntaxe, par exemple, s'occupe des règles
déterminant les combinaisons de
mots qui font qu'une phrase est grammaticale.
Dans le domaine du raisonnement, certains chercheurs mettent
l'accent sur le fait
que les inférences propositionnelles sont mieux
perçues comme un ensemble de
règles fondamentales faisant partie de notre
équipement cognitif naturel.
L'utilisation des outils linguistiques concerne aussi la
sémantique, dont le domaine
est celui de la signification des termes dans les
propositions, ainsi que la manière
dont ces données sont utilisées pour décrire
la réalité : il y a en effet une approche
spécifique dans le domaine du raisonnement, connu comme
« Modèles Mentaux »,
qui s'intéresse aux possibilités qui sont
offertes par l'affirmation du type que la
phrase « si p, alors q », confirmant ensuite que
« p » est vrai.
Ces catégories empruntées à la
linguistique peuvent être élargies aussi à
d'autres notions, telles que la pragmatique et la structure de
surface, qui jouent un
rôle très important dans le raisonnement
propositionnel. Si nous ajoutons à ces

15
notions celle du développement, un autre aspect qui
a beaucoup d'intérêt pour la
linguistique, nous aurons une approche assez complète du
raisonnement.
Cette approche utilisera quelque concept logique : le connecteur
« Si ». Il est vrai
que certains chercheurs utilisent le concept «
opérateur logique » au lieu de
connecteur. Où se situe donc la différence ? Elle
n'est pas toujours de rigueur dans
la littérature logique et pragmatique :
l'opposition se trouve définie en terme de
« portée ».
Par définition, « un opérateur est un
foncteur qui a pour argument une
proposition atomique, alors qu'un connecteur est un
foncteur qui a pour argument
une paire ordonnée de propositions ».
Il y a deux constantes fonctionnelles propres aux langages
logiques : l'opérateur
de négation d'un côté et les connecteurs de
conjonction, de disjonction, d'implication
et d'équivalence, de l'autre. La tradition logique n'a pas
utilisé cette distinction parce
que les propriétés logiques sont formulées
indépendamment du nombre d'arguments
de la fonction. La tradition anglo-saxonne, parlera de
connecteur propositionnel
tandis que la tradition continentale, d'opérateur
propositionnel, de foncteur ou de
relateur. (cf. Grize, 1972)
Toutefois, nous trouverons dans le manuel de Grize une
différence entre
opérateur ou foncteur, d'une part et relateur,
d'autre part : les foncteurs sont des
opérations sur des variables ou méta-variables
logiques : (négation, disjonction,
conjonction, conditionnelle,biconditionnelle), alors
que les relateurs
(implication, équivalence) sont définis par
des opérations booléennes (réflexivité,
symétrie, transitivité).
Certains emplois pragmatiques de « si », dits
austiniens, n'introduisent pas une
condition suffisante pour le conséquent
(définis logiquement comme condition
nécessaire pour l'antécédent)
Ex : « Si tu as soif, il y a de la limonade dans le frigo
»
Le connecteur « si », dit « d'inférence
invitée », est sur le même plan que le « si »
« austinien » et n'introduit pas une condition
suffisante pour le conséquent : par
exemple, si un père dit à son fils : « Si tu
rentres après dix heures, tu seras puni », la
lecture appropriée est celle qui interprète «
si » comme une biconditionnelle, c'est-à-
dire qui restreint la vérité de la relation
à la vérité ou à la fausseté commune de
l'antécédent.

16
Pour mieux appréhender la notion de connecteur, il serait
bon de voir la définition
d'autres auteurs.
Patrick Charaudeau, de son côté, rappelle que
ces «mots grammaticaux, encore
appelés conjonction (dans la tradition grammaticale)
ou subjonction, connecteurs,
ouvreurs, relateurs (dans la tradition linguistique), ne
sont pas monosémiques »
(Charaudeau, 1992). D'un autre côté, P. Le Goffic
écrit à propos des adverbes en
« que » et « si » que leur rôle de
connecteur (c'est-à-dire de conjonction) est clair et
reconnu par la tradition ».
Le dernier élargissement de la notion de connecteur est
celui qui la fait désigner
également les propositions, sous prétexte que
les prépositions sont comme les
conjonctions de subordination [(cf. Pottier, 1962)]. C'est
ce que Bernard Pottier
appelait des « éléments de relation
», c'est-à-dire des morphèmes qui instaurent
une relation entre deux constituants, donnant la structure :
« Syntagme A + Elément
de relation + Syntagme B ».
De son côté, Maxi Krause écrit : « le
terme de connecteur est à prendre dans un
sens très large. Les signifiants étudiés
sont des éléments de mise en relation que ce
soit de phrase à phrase ou l'intérieur d'une
même phrase. A l'intérieur de la phrase,
leur fonction syntaxique est de relier un groupe nominal
ou adverbial à un autre
groupe syntaxique, sur le plan sémantique, ils
portent (seuls ou en combinaison
avec d'autres éléments) des relations »
[(Krause 2000)]
Le terme connecteur devient alors une sorte
d'archi-lexème qui coiffe un certain
nombre de termes hyponymes comme conjonction, préposition,
adverbe, etc.
Par contre, Claude Guimier signale dans son «introduction
» du premier numéro de
Syntaxe et Sémantique : « Le terme même
de « connecteur » n'est pas reconnu par
la tradition grammaticale, qui nous a habitué au
maniement de catégories telles que
celles des prépositions, des conjonctions, des pronoms
relatifs, des adverbes, etc. »
[art. Ira Noveck, 1972]
D'une manière générale, toutes ces
idées se retrouvent résumées par Jean
Rémi Lapaire et Wilfrid Rotgé, dans
Séminaire Pratique de Linguistique anglaise où
nous lisons : «On regroupe sous le nom
très général de «connecteur» des
marqueurs appartenant à des catégories
grammaticales diverses, conjonctions de
subordination ou de coordination, des adverbes en particulier
conjonctifs ou même
dans certains cas, des prépositions (bien que cet usage
soit moins généralisé »
[ S.P.L.A -3 numéro, 1992].
e

17
Vu l'énorme association de toutes les
catégories grammaticales au concept de
« connecteur », nous avons pensé que
seule la théorie du raisonnement
propositionnel pouvait nous permettre d'obtenir des
résultats convenables.
Nous avons donc éliminé les concepts
d'opérateurs, connecteurs, connecteurs
conditionnels, ou biconditionnels, etc.
En effet, le raisonnement propositionnel nous permet
d'évoluer tout au long de
notre recherche, d'élaborer une grille englobant le
connecteur « si », appelé le plus
souvent « subjonction ».
Nous avons donc choisi d'étudier le connecteur
« si », lié à l'expression de
l'hypothèse. Cette étude s'effectuera selon
l'analyse propositionnelle ou tout
simplement selon le raisonnement propositionnel.
Pour cela, nous avons délibérément choisi
trois grammaires normatives qui font
autorité dans le milieu enseignant.
De nombreux linguistes se sont penchés sur les
problèmes que soulèvent la
notion d'hypothèse et les diverses manières
dont use le français pour l'exprimer.
Certains linguistes ont même étudié le
connecteur « si » en liaison avec les autres
connecteurs.
Pour nous, l'hypothèse ne sera perçue que
comme une proposition et « si » ne
sera vu que comme un relateur, un connecteur. On appellera la
première partie qui
suit immédiatement le « si »,
«l'antécédent» et la seconde partie qui le
suit le
«conséquent».
Il y a donc deux formes d'inférence valides liées
au conditionnel. La première est
appelée le Modus Ponens (MP) et la seconde le Modus
Tollens (MT).
Le Modus Ponens est simple. Si quelqu'un exprime la
phrase suivante : «S'il
pleut alors le trottoir est mouillé » et affirme
qu'il pleut, la conclusion que le trottoir
est mouillé est justifiée. En règle
générale, nous aurons : « Si p alors q », confirmant
ensuite que « p » est vrai ce qui justifiera la
conclusion «q ».
Cependant, le Modus Tollens demande quant à lui plus
d'effort pour être effectué.
Dans ce dernier, lorsque la prémisse majeure est « si
p alors q » et la mineure est
« non q », cela justifie la conclusion « non q
». Ainsi, lorsqu'on est informé que s'il
pleut, le trottoir est mouillé, et que le trottoir n'est
pas mouillé, on peut logiquement
conclure qu'il ne pleut pas.
Le Modus Tollens est considéré comme un
processus qui s'exécute en quatre
opérations :

18
1.- On suppose l'antécédent de la prémisse
majeure (il pleut).
2.- La supposition qui va avec le conditionnel
amène à une sorte de conclusion
provisoire «le trottoir est mouillé».
3.- La conclusion provisoire (de l'étape 2) et
l'information donnée (que le trottoir
n'est pas mouillé) amène à une
contradiction.
4.- Cette contradiction autorise l'élimination de la
supposition (ce n'est pas le cas,
donc il ne pleut pas).
Il y a aussi deux autres formes d'inférence
concernant le conditionnel qu'on
appelle «sophisme». Bien qu'ils ne soient pas valides,
ils sont assez répandus dans
le raisonnement des personnes, pour mériter d'être
cités ici. La première forme est la
négation de l'antécédent. Cette forme
d'inférence conditionnelle se base sur la
représentation du conditionnel (Si p alors q) suivie de
la négation de l'antécédent (Il
n'y a pas de p. Cela amène un très grand nombre de
personnes à conclure qu'alors
il n'y a pas alors de q.
Considérons le conditionnel présenté
ci-dessus : «s'il pleut, alors le trottoir est
mouillé», accompagné du fait qu'il ne
pleut pas : cette combinaison de prémisses
pousse beaucoup de monde à accepter la conclusion que le
trottoir n'est pas mouillé.
Or, cette conclusion n'est pas justifiée par la logique
déductive formelle. Pourquoi ?
Est-ce que cela signifie que par une journée
ensoleillée, le trottoir ne peut pas être
mouillé ? Evidemment non ? De la même
manière, il y a l'autre forme d'inférence
non valide, à savoir, l'affirmation du conséquent.
Supposons toujours la proposition 4 - «S'il pleut alors le
trottoir est mouillé », et le
fait que (le trottoir est mouillé). Ceci amène de
nombreuses personnes à accepter
« p » (il pleut).
Ici aussi, le trottoir peut être mouillé pour des
raisons qui n'ont rien à voir avec
l'antécédent. Les éléments fournis
dans les prémisses mineures dans la négation de
l'antécédent et dans l'affirmation du
conséquent, ne sont pas suffisants pour valider
les conclusions respectives. Pour notre étude, nous
prendrons le cas général du
type «Si p, q ».
Notre travail comporte deux parties :
Une première, théorique, qui compactera
(ramassera) toutes les données fournies
par les trois grammaires normatives disponibles dans
presque toutes les
bibliothèques de nos écoles, nos collèges
d'enseignement moyen et de nos lycées.
Cela ne veut pas dire que nous allons nous contenter de ces
seules grammaires.

19
Nous ajouterons à ces dernières des articles
relativement récents qui viendront
compléter nos informations grammaticales. En
général, ces articles prennent en
charge les notions anciennes sous un jour nouveau, selon une
méthode beaucoup
plus linguistique que grammaticale.
Ce type de regard neuf jeté sur les anciennes notions
grammaticales issues de
la tradition latine a permis à la linguistique d'avoir une
nouvelle perception de ces
notions. Il faudrait rappeler, ici, que la linguistique
n'est pas encore parvenue à
régler le gros problème des temps, ce qui nous
a poussé à nous intéresser à cet
aspect quelque peu traditionnel, bien que cela soit une autre
paire manches qui ne
relève directement pas de nos propos.
Cette première partie est composée de
six chapitres et comprendra la
présentation critique de l'expression de
l'hypothèse dans Le Bon usage de Maurice
Grevisse, celle du point de vue de R.L. Wagner et J.
Pinchon, celle du point de vue
de La Grammaire Larousse du français Contemporain.
Une analyse du point de vue D'O. Ducrot, à ce sujet,
viendra compléter les points
de vue énoncés ci-dessus.
Le tout sera complété par l'analyse de deux
articles de C. Wimmer et H. Vairel,
ainsi qu'une étude sur le fonctionnement de
l'hypothèse en arabe, langue nationale,
en arabe algérien et en Tamazight.
Quant à la seconde partie, elle comprendra d'abord
l'étude des circulaires et
des manuels du deuxième palier de l'école
fondamentale. Seront ensuite étudiés :
Les documents du troisième palier, à savoir la
circulaire du 17 octobre 1976, ainsi
que les autres documents de la classe qu'ils soient
utilisés par les élèves ou par les
professeurs.
Quant au chapitre IV, il s'intéressera tout d'abord
la situation socio-économique
des enquêtés et ensuite, il développera, une
enquête effectuée en 1994 avec les
élèves pour mieux appréhender ce
qu'ils ont retenu de cette activité qu'est
l'expression de l'hypothèse.
Au chapitre V, nous analyserons les réponses des
exercices donnés au second
palier de l'école fondamentale et leurs
résultats. En général, nous n'aurons à voir
que la cinquième année primaire et la
sixième année primaire. Il faut rappeler que
les premiers documents de quatrième année primaire
renfermaient l'expression de
l'hypothèse. Ils furent utilisés jusqu'en 1988,
après le premier aménagement scolaire.

e
apprécier ce qui a été retenu des
enseignements de l'hypothèse et le chapitre VII
sera consacré à faire quelques propositions de
solutions qui permettront à coup sûr
de revoir son l'enseignement de l'hypothèse. Enfin, le
travail se terminera par les
possibilités d'ouverture sur d'autres recherches sur
l'expression de l'hypothèse.
20
Au Chapitre VI, l'analyse portera sur les exercices donnés
au 3 palier pour mieux

21
Chapitre 1
La présentation critique de l'expression de
l'hypothèse
1.1 Dans le bon usage de Maurice Grevisse
L'expression de l'hypothèse apparaît dans la
quatrième partie de sa grammaire
qui traite des propositions subordonnées. Cette partie de
la grammaire comprend
trois paragraphes : Le premier traite des propositions
substantives, le second, des
propositions adjectives ou relatives et le dernier des
propositions adverbiales ou
circonstancielles.
C'est dans ce dernier chapitre que l'auteur traite
des « conditionnelles » ou
Hypothétiques.
L'auteur pense que les hypothétiques posent un
problème que l'on peut d'abord,
envisager comme un problème de subordination.
Alors que nous savons que l'expression de
l'hypothèse est d'abord un
problème de pensée que nous verrons plus
loin lorsque nous définirons les
concepts de condition et d'hypothèse
Cette subordination est commune à toutes les
propositions telles que les
comparatives, les finales, etc, elle n'est pas propre à
l'expression de l'hypothèse.
Elle mérite une description plus étendue que
les autres types de propositions.
Comprenant qu'il y a là quelque chose de différent
par rapport au reste des autres
propositions, l'auteur envisage une description plus
complète, plus étendue pour
mieux faire comprendre les hypothétiques.
1.1.1 Les définitions opératoires :
Avant de détailler le contenu des treize pages, il
serait peut-être, bon de
donner ce que veulent
proposition.
dire, pour l'auteur, les concepts de subordonnée et
de
Qu'est- ce- qu'une proposition pour l'auteur ?
Elle est : " tout mot ou tout système de mots
au moyen desquels nous
manifestons un acte de notre vie psychique ; C'est
une unité constitutive d'un

22
énoncé, composé en général
d'un groupe nominal et d'un groupe verbal et formant
une partie d'une phrase, sinon la phrase tout
entière."
1
Donc, nous pouvons comprendre que l'hypothèse, et la
condition sont un acte de la
vie psychique de l'être humain, comme «une
impression sentiment, jugement,
volonté »
Pour la subordination, l'auteur ajoute plus loin :
"La proposition subordonnée est celle qui est
dans la dépendance d'une autre
proposition qu'elle complète."
Nous devons retenir que la proposition subordonnée
conditionnelle dépendra et
complétera la proposition principale.
1.1.2 Analyse du titre de propositions conditionnelles ou
hypothétiques
Arrêtons-nous au titre du sous- chapitre qui
mérite que nous fassions des
critiques : « propositions conditionnelles ou
hypothétiques »
Le «ou » serait-il explicatif comme celui du chapitre
2 : « les propositions adjectives
ou relatives » ?
« Condition et hypothèse » seraient deux actes
de notre vie psychique, équivalents.
Le « ou » a-t-il une valeur alternative ? Ceci ne
saurait être admis et l'auteur devrait
traiter des unes et des autres.
Pour mieux saisir la nuance, nous consulterons le
dictionnaire Larousse aux
2
3
"On ne confondra pas supposition (fondement nécessaire
à l'hypothèse) qui consiste
à admettre comme réalisé quelque
chose dont on fait le point de départ d'un
raisonnement, d'où l'on tire une conséquence,
(ou une conclusion logique) avec la
articles :
« Condition » : « circonstances
extérieures dont dépendent les personnes ou les
choses ».
« Hypothèse » : « supposition que l'on
fait d'une chose possible ou non, et dont on
tire une conséquence ».
Si nous nous rangeons au point de vue notionnel de
l'auteur, nous ne saurons
comprendre qu'une catégorie grammaticale puisse
regrouper deux notions
différentes.
Cette explication est bien donnée dans la syntaxe du
français moderne :

23
condition, qui n'est qu'une circonstance sans laquelle
la conséquence ne se
produirait pas ; (ou sans qui la conclusion logique ne serait
pas valable).
A condition que, pourvu que, moyennant que, sont (.....) des
ligatures proprement
conditionnelles. Les seules conjonctions si et quand, (l'une
et l'autre sous certaines
réserves et seulement dans certains emplois) sont
vraiment suppositives, (c'est-à-
dire hypothétiques)".
1.1.3 L'analyse de la partie comprenant les propositions
hypothétiques
Cette partie comprend :
1.1.3.1 Les mots subordonnants
Tous les subordonnants ne sont traités que dans un
seul paragraphe
complété d'une page et demi de
remarques. L'auteur propose une liste de
« conjonctions ou de locutions conjonctives : 27 au
total et parmi ce nombre la
conjonction « si ».Toutefois, les remarques
qu'il donne dans ce paragraphe
admettent d'emblée une autre conjonction «
que », non citée dans la liste
précédente, dans trois cas :
- Pour éviter la répétition de la
plupart des conjonctions ou locutions
conjonctives, l'auteur donne l'exemple ci-dessous :
« A condition qu'il fera réparer et qu'il paiera.
»
- Proposition conditionnelle introduite par une proposition autre
que si : Nous
laisserons ces cas parce qu'ils n'intéressent pas notre
recherche.
- Les propositions conditionnelles marquant une
alternative, si elles ont un
même sujet, peuvent être introduites par «
que », repris ou non avec le second
verbe :
Ex : « Qu'elle le glorifie ou le salisse, les
faits qu'elle cite m'apparaissent
insignifiants ». (F. Mauriac, le noeud de vipère,
P.291).
1.1.3.2 Emploi du mode

24
- Propositions introduites par si
Trois paragraphes composent cette partie à laquelle,
il est ajouté un complément
explicatif de certaines exceptions - (le futur ou le conditionnel
après la subjonction
4
«si ») - qu'il illustre avec des exemples
empruntés à Diderot .
Il fait remarquer que ces phrases introduites par «si»
n'ont pas un sens conditionnel
bien marqué. Il rappelle que l'ensemble de ces phrases
exprime une pensée avec
«une force particulière »
Au paragraphe (2688), page n°1372, on retrouve :
d'une manière générale «si
conditionnel régit l'indicatif".
Ensuite, l'auteur précise qu'il y a lieu de tenir compte
de trois cas. Cela revient à
appliquer au français les notions calquées du latin
et qui sont :
- L'hypothèse pure et simple
Maurice Grévisse fait remarquer : "la
proposition conditionnelle exprime un
fait présent passé ou futur sur la
réalité duquel on ne se prononce pas ou indique
simplement que de la réalisation de la condition
résulte, a résulté ou résultera le fait
marqué par la principale".
Il ajoute plus loin : "Dans ce cas, la principale comme la
subordonnée ont leur verbe
à l'indicatif "
Mais ceci ne suffit pas, il est nécessaire
d'atténuer cette affirmation par une nouvelle
remarque :
« Lorsque la principale exprime un ordre, une
prière, il se met à l'impératif ou au
subjonctif"
Ex : « Si tu viens en ami, entre. Ou encore,
« s'il vient en ami, qu'il entre. »
On sait qu'il est de même pour la proposition
subordonnée quand celle-ci n'est pas
une proposition conditionnelle.
Lorsque la condition est relative à l'avenir, elle
est exprimée par le présent de
l'indicatif et parfois, on se sert de périphrase
pour indiquer explicitement que la
condition est relative à l'avenir. Ceci est un reste de
l'utilisation de la condition dans
l'ancienne langue. La condition est exprimée parfois
par une périphrase à l'aide
des verbes : (vouloir, pouvoir, devoir, aller, veniretc.). Elle
s'exprimait aussi, mais
rarement, par le futur (comme en latin). Cet usage se rencontre
encore au XVI e
siècle.

25
- Potentiel se dit d'un mode qui peut indiquer la
possibilité d'une action, une
action en puissance, virtuellement, en imaginaire.
-"La proposition conditionnelle exprime un fait futur que
l'on considère comme
éventuel ou comme imaginaire".
Nous retrouvons la règle:
"La principale se met au conditionnel présent,
la subordonnée à l'imparfait de
l'indicatif".
Ex : « Si tu faisais cela, je te haïrais » (
Brieux, la foi)
Ensuite, l'auteur rassemble de rares exceptions des
grands auteurs tels que
Racine, Gide et Valéry.
- Parfois, le fait principal est considéré comme
présent et est exprimé par le
présent de l'indicatif.
"S'il m'échappait un mot, c'est fait de votre vie"
(Racine, Bajaz, II)
- Le futur dans la principale et l'imparfait dans
la subordonnée, fait
exceptionnel :
"Si tu supprimais à présent les
prophètes, les choses mêmes prendraient une voix;
et si tu te refusais à l'entendre, toi-même
prophétiseras" (A. Gide, Saül, III).
"Ce sont eux qui seront l'avenir, si jamais la
fédération l'emportait" (FR. Mauriac,
dans le figaro littéraire du 4 mars 1968, Page
n°4).
- Dans la tournure suivante, la subordonnée a son
verbe à l'imparfait du
subjonctif. Il s'agit d'un archaïsme :
"Ne savons-nous pas qu'un homme est un homme et que si tout
fût exactement mis
à nu, personne n'oserait regarder personne?
(P. Valery, remerciements à
l'Académie Française, pléiade T1 Page
n°744)
Cet archaïsme est expliqué plus loin (n° 2697
Page n°1376 - M. Grevisse, le Bon
Usage).

26
Conclusion :
Ce sont des actions virtuelles dont la réalisation est
souvent impossible; elles
relèvent de l'imaginaire et, l'imaginaire n'est pas
totalement réalisable. Quand elles
viennent à se réaliser c'est vraiment l'exception
!
- Irréel
Définition : L'irréel est une action qui ne se
réalisera pas.
« Le conditionnel exprime donc un fait
éventuel ou irréel dont la réalisation est
regardée comme la conséquence d'un fait
supposé, d'une condition » ex : « [Ces
maisons] nous diraient des choses à
pleurer et à rire , si les pierres parlaient » A.
France , Pierre Nozière ,P.239
Nous savons qu'une pareille action ne risque pas de se
réaliser puisque les pierres
ne parlent pas.
"La proposition conditionnelle exprime un fait
présent ou passé que l'on regarde
comme contraire à la réalité"
- Quand la condition se rapporte au présent, on a la
structure suivante :
« Si + imparfait de l'indicatif.conditionnel
présent. »
- Quand la condition se rapporte au passé, on a la
structure ci-dessous :
« Si + plus - que- parfait de l'indicatif .conditionnel
passé ».
M.Grevisse fait remarquer en observations qu'après si
marquant un fait irréel dans le
passé, la langue littéraire peut mettre, dans la
subordonnée et dans la principale ou
dans l'une des propositions seulement, le plus-que-parfait du
subjonctif équivalent,
dans la subordonnée, au plus-que-parfait de
l'indicatif, et dans la principale, au
conditionnel passé.
"Si j'avais cherché, j'aurais trouvé"
"Si j'eusse cherché, j'eusse trouvé"
"Si J'avais cherché, j'eusse trouvé"
"Si j'eusse cherché, j'aurais trouvé"
"Parfois le sens de la phrase est tel que l'on a
dans l'une des deux propositions
l'irréel du présent, et dans l'autre
l'irréel du passé Avec la condition irréelle on a
parfois, dans la principale, l'imparfait de l'indicatif
se substituant au conditionnel

27
passé pour indiquer la certitude d'un fait qui
devait être la conséquence infaillible
d'un autre fait".
"Si vous n'étiez pas venu, je vous faisais
appeler" (A.France L'orme dumail,
page n°62)
Lorsque, dans une donnée d'hypothèse marquant
le potentiel ou l'irréel, un des
éléments de la proposition est mis en relief au
moyen de : "c'était......qui (ou.....que),
ç'avait été.......qui (ou.....que),
ç' eût été.....qui (ou.......que), la langue
parlée met le
verbe à l'indicatif ou au subjonctif (imparfait ou
plus que parfait selon les phrases)
Dans la langue parlée, comme dans la langue
littéraire, nous mettons le verbe au
conditionnel pour marquer l'éventualité. Par
contre,
"La langue populaire (Paris, Poitou, Anjou, Belgique, Suisse
Romande) emploie le
conditionnel après si ou si que marquent le potentiel
ou l'irréel.
Si tu pourrais m'voir à présent, tu m'donn'rais
pus d'quatre vingts ans".
(J. Rictus Cantilènes du malheur, jasante de la
vieille, cité par Renchon ).
"Si tant est que (..........) se fait suivre du subjonctif :
cette locution sert à exprimer
une supposition que l'on fait avec
l'arrière-pensée qu'elle reste douteuse ou sujette
à caution, elle se trouve aussi, et moins rarement
qu'on ne croirait, avec l'indicatif".
L'auteur a tenté de signaler dans ce paragraphe tous les
phénomènes rencontrés.
Nous ne pouvons que savoir gré à l'auteur d'avoir
tenté de tout rassembler dans ce
paragraphe. L'auteur ne pouvait qu'être contraint à
ce classement par les priori de
potentiel et d'irréel qui nous viennent directement du
latin, de l'ancien français.
Lorsque nous avons une seconde donnée
d'hypothèse coordonnée à une
première donnée ou simplement juxtaposée
commençant par si, comme si ; ces
deux structures sont fréquemment remplacées par
que, équivalent à, en supposant
que, au cas que. Ce qui explique la présence du
subjonctif.
Pour le sens, la seconde supposition est alors, comme
dépendante de la première
(tandis qu'avec si, ou si, mais si, la seconde
supposition garde une sorte
d'autonomie à l'égard de la première et ne
s'y emboîte pas convenablement.) .
En outre, deux notes signalent qu'il y a là des
constructions qui seraient l'inverse de
celles signalées précédemment. S'agirait- il
encore «de propositions introduites par
si ».
« Comme si » est une locution et le
problème posé est bien celui du mode.
Pourquoi cet amalgame ?

28
Exemple
"Si vous reculiez quatre pas et que vous creusiez, vous
trouverez un trésor"
(La fontaine, vie d'Esope).
Remarques :
- On retrouve l'indicatif, aussi ;
Exemple
"Si, demain, un pouvoir pour qui vous auriez estime et
confiance se trouvait à
votre tête et qu'il vous tendait la main"
(Charles de Gaulle, Discours et message, T.II, Page
n°387).
Fort rarement, on rencontre dans la seconde
subordonnée conditionnelle, le
subjonctif.
Exemple
"Certaines de nos craintes ne sont que l'envers(........)des
sévices et mauvais
traitements que nous ferions subir à quelqu'un si nous
étions un autre et s'il fût nous"
(P. Valéry, mélange, pléiade,T1.Page
n°324).
"La proposition introduite par si peut n'avoir aucune valeur
conditionnelle; son
verbe se met alors à l'indicatif, quand on exprime un
fait éventuel" :
· Elle peut marquer un fait dont la raison
est indiquée par la proposition qui
suit :
· Elle peut avoir la valeur causale et exprimer le
motif d'un fait indiqué avant ou
après elle"
Elle peut avoir la valeur d'une proposition substantive.
Elle est proposition - objet dans l'interrogation indirecte
Après (c'est) à peine, c'est (tout) au plus,
(c'est) tout juste, elle a la valeur d'une
indépendante.
· Elle peut avoir la valeur temporelle et marquer la
répétition
(Si =Toutes les fois que)
· Elle peut marquer l'opposition.
L'auteur mentionne en nota bene que l'on rencontre parfois,
après si, un futur ou un
conditionnel dans les cas signalés ci-dessus.
- "Ex : si cela vous fera plaisir, remettons la
paysanne en croupe derrière son
conducteur ". (Diderot, Jacques le fataliste,
édition, pléiade, P.5O8).

- Ex : «Qui
contemplations.
donc
attendons-nous,
s'ils
ne
reviendrons
pas »
29
V.Hugo,
Ici, le « si » a la valeur de la forme interrogative.
L'auteur a employé un classement très surprenant.
Car il a mêlé les propositions
conditionnelles aux propositions n'ayant « aucune valeur
conditionnelle»
N'aurait-il pas fallu qu'il choisisse de traiter les
subordonnées conditionnelles
uniquement et de laisser le reste ou bien de traiter des
propositions introduites par si
et indiquer au fur et à mesure de leur apparition les
effets de sens.
- Propositions conditionnelles introduites par une subjonction
autre que SI :
Dans les propositions conditionnelles introduites par une
conjonction autre que si, le
verbe se met :
- D'une manière générale au subjonctif.
- Il se met ordinairement au conditionnel après: au cas
où, dans les cas où,
pour le cas où, dans (ou pour) l'hypothèse
où, qui exprime assez souvent
l'éventualité.
- A l'indicatif futur (futur simple ou futur du passé )ou
au subjonctif après à (la)
condition que, sous (la ) condition que, moyennant que
(tout vieilli) l'indicatif est
présent quand la condition est tranchante, le conditionnel
si le fait est hypothétique.
- Tournures verbales de condition non introduites par une
subjonction :
Le rapport de condition peut aussi être exprimé par
:
- Un infinitif précédé de : à
ou de, - ou d'une des locutions prépositives, à
moins que, à condition de.
Ex : «A les entendre, ils ne sont pas coupables »
(Académie)
Ex : « A les détailler, les traits de
madame Gance n'avaient rien
d'extraordinaire ». (A. France, le livre de mon
ami, P.173).
- Un gérondif ayant le même sujet que le verbe
principal.
Ex : « J'attire en me vengeant sa haine et sa
colère, J'attire ses mépris
en ne me vengeant pas » (Corneille, cid,I.7).
-Un simple adjectif, un simple participe adjectif ou un simple
nom, marquant
elliptiquement la condition.
Ex : « Je t'aimais inconstant, qu'aurai-je
fait fidèle » (Racine,
Andromaque).
- Un participe présent en construction absolue ;

30
Ex «Etant admis que nous pourrons tout, qu'allons
-nous faire de
cette omnipotence » (J. Rostand, inquiétudes
d'un biologiste, P.12).
- Un participe présent ayant le même sujet que le
verbe principal.
Ex «J'observe, comme vous, cent choses tous les jours,
qui pourraient
mieux aller, prenant un autre cours »
(Molière, les Misérables).
- La locution néologique: " pour un peu".
Ex : « Pour un peu, il aurait pris rang dans la foule
des victimes » (J.
Romain, les hommes de bonne volonté, T. III, P.174)
L'auteur reste cohérent avec sa définition de la
proposition. Toutefois, il y a lieu de
se demander si " à, de, les locutions prépositives"
sont différentes des conjonctions
qui introduisent les propositions conditionnelles ? -(Si oui dans
quelle mesure ?)
1.1.3.3 - La proposition conditionnelle affecte la forme de la
proposition principale
unie à celle-ci par simple juxtaposition ou coordination.
La donnée de l'hypothèse peut s'exprimer :
- Par, n'était (ent), n'eût été,
n'eussent été, suivi d'un sujet:
Ex : « N'étaient les hirondelles qui
chantent, on entendrait rien.. » P.
Loti vers Ispahan).
- Par une "proposition interrogative "(réelle ou fictive)
:
Ex : «S'élançait- il contre la porte
tournante d'un café, il faisait le plus
souvent, avec un élan sans réserve »
(G. Duhamel, deux hommes)
- Par une proposition à l'impératif ou au
conditionnel toujours placée avant la
principale. Ex : «Fais un pas, je t'assomme »
(V. Hugo, légende)
- Par une proposition au subjonctif" (presque toujours au
présent), sans que
et surtout avec venir :
Ex : «Vienne encore un procès et je suis
achevé » (Corneille)
Conclusion :
Que veut dire "affecter la forme d'une principale "? De deux
choses l'une:
- Si l'on considère que la proposition
hypothétique est principale, où est la
subordonnée ?
- Si elle n'est pas considérée comme telle,
serait-elle la subordonnée ?
Une telle description visant à l'abondance des
termes tels que "exprimer,
"considérer," "indiquer", organise le point de vue selon
des critères sémantiques.

31
Il en résulte donc un morcellement de la description en
paragraphe tantôt régis par
le sens et tantôt régis par la forme. A quoi est
dû ceci ? Il nous semble que cette
perturbation dans l'analyse vient du fait que l'auteur
conserve les trois principaux
concepts venant du latin, à savoir : « réel,
irréel et potentiel ».
Le fait que l'auteur ne renonce pas à
l'utilisation des termes hérités du latin
(potentiel, irréel), l'amène à se
répéter dans plusieurs subdivisions souvent
différentes.
Enfin, le choix de grandes parties semble poser le
problème du rapport de la
proposition conditionnelle à la principale. On remarque
qu'il y a là une conception
grammaticale propre à l'auteur. La conditionnelle qui
est une forme de pensée a
épousé le sens de complémentarité
comme une simple proposition subordonnée
qui vient ajouter un sens complémentaire à
la principale. Or, la proposition
conditionnelle pourrait être, en soi, le principal
élément, c'est - à - dire, si nous
venions à retirer ou à enlever cette proposition,
il ne resterait pratiquement rien. Par
contre dans les infinitives ou autres propositions, la
principale garde toujours le
sens premier que la phrase tente d'engager dans le
discours. Il aurait fallu donc
rechercher d'autres outils langagiers pour traiter le
problème des hypothèses, au lieu
de leur consacrer un certain nombre de pages
supplémentaires.
1.2 Présentation du point de vue de R.L. Wagner et J.
Pinchon :
5
La question de l'hypothèse est présentée
dans la dernière partie de l'ouvrage,
sous le titre de : "La phrase "
Cette partie se subdivise en deux parties:
1. 2.1 "La phrase simple"
1.2.2 "Syntaxe des phrases complexes" :
Cette seconde partie intitulée "syntaxe des phrases
complexes" se répartit en :
1.2.2.1 Propositions conjonctives introduites par que
1.2.2.2 Propositions relatives
1.2.2.3 Propositions interrogatives indirectes
1.2.2.4 Propositions dépendantes hypothétiques

32
C'est dans la dernière partie des phrases complexes
que nous retrouvons les
hypothétiques. Leur présentation est comparable
à celle effectuée par M. Grévisse.
Le titre ne mentionne pas celui de
"conditionnelles", mais uniquement celui
d'hypothétiques". Est-ce que le concept
«conditionnel» ne figure pas dans la
grammaire de ces deux auteurs ? En effet, «ce point de
langue est l'un des plus
difficiles, en raison des profondes modifications qui
sont intervenues dans
l'expression de ce rapport et qui ont laissé des traces
jusqu'en français moderne.»
6
1.2.2.4.1 La question est abordée sous l'aspect de
la subordination au lieu de la
condition en tant que membre à part entière
ou l'hypothèse constituée de deux
membres. L'absence de l'un de ces deux membres, détruit le
système.
1.2.3 Une description plus étendue :
La description réservée à ce point de vue
peut être plus étendue que celle
prévue à d'autres catégories
propositionnelles dont les difficultés ne sont pas aussi
complexes que celles des hypothétiques.
Toutefois, le point de vue de R.L. Wagner et J. Pinchon
est différent de celui de
M.Grévisse par le fait que les propositions
hypothétiques ne sont pas comparables à
toutes les autres catégories de propositions
subordonnées. En effet, à la place de
proposition subordonnée, nous retrouvons le concept
«membre». Est-ce que ce
concept est assimilé à subordonnée ?
1.2.3.1 Pour être en conformité avec le travail
précédemment réalisé, nous verrons
les définitions de propositions, de phrases
complexes..........que donnent les auteurs
de ce point de vue.
7
les « propositions hypothétiques,
consécutives et comparatives" sont unies à la
1.2.3.2 Le paragraphe 65O, de la grammaire française
classique et moderne de R.L.
Wagner et J. Pinchon affirme à ce sujet que les
propositions hypothétiques,
consécutives et comparatives se différencient des
autres propositions dépendantes
qui se rattachent à l'ensemble de la principale.
Elles ne sont qu' " occasionnellement liées" à la
principale qui pourrait" se suffire à
elle-même ou être complétée par des
subordonnées de nature diverse" . Par contre,

33
principale de telle façon que l'une appelle
nécessairement l'autre....... «ces phrases
constituent un système".
Nous allons voir comment est défini le concept de
propositions chez nos deux
auteurs comme nous l'avons fait, auparavant chez M.Grevisse, et
ce pour mieux
mettre en évidence la différence d'analyse et
l'utilisation de cette syntaxe.
8
« Chaque division de la phrase, de la
période », les auteurs se situent dans une
zone grammaticale peu claire, puisqu'elle appartient à la
fois, à la syntaxe et à la
phonologie. En outre, le terme membre ne se définit pas
complètement d'une façon
pure, car, en mathématique, il signifie :
«expression » : «chacune des expressions
d'une égalité ou inégalité
», or expression n'a pas le sens de phrase.
Donc, les propositions de la phrase hypothétique
sont des membres d'une même
expression, la proposition subordonnée n'est pas
inféodée à la principale. les deux
propositions, sont appelées « membres ». Il y a
un véritable système qui risque de
ne plus exister, aussitôt que l'un de ses membres est
absent. Cette vision perçoit
l'hypothèse en tant que notion et non comme une
subordination.
1.2.3.3 Dans le paragraphe 588, les auteurs continuent
à utiliser le terme de
membre qui renvoie aux phrases verbales qui comportent
suivant le cas : un
membre qui a pour noyau un verbe à l'infinitif ou à
un mode personnel ; deux ou
plusieurs membres centrés autour d'un verbe à un
mode personnel.
Ceci nous pousse à poser la question : qu'est-ce qu'un
membre ?
Définition du dictionnaire Larousse :
1.2.4 Définition de la phrase complexe :
Dans le paragraphe 592 , les auteurs définissent
ce qu'ils entendent par phrase
complexe."
A partir d'une phrase comportant un sujet nominal, un
complément d'objet nominal
et un complément circonstanciel nominal, on peut
construire un autre modèle de
«phrase complexe en substituant à chacun de ces noms
un prédicat verbal. (...) la
nomenclature traditionnelle assigne le nom de proposition
subordonnée à ces
prédicats verbaux et les noms de proposition
principale, membre principal, ou
prédicat verbal, ou au terme ( ou syntagme) qui leur
servent de support."
9

34
1.2.4.1 Le sous-chapitre propre à
l'hypothèse est précédé de deux autres
paragraphes (7OO) et (701)
Le premier prend en charge les définitions et le second,
le classement.
Le paragraphe (700), en plus d'une partie historique, comprend
trois alinéas.
1.2.4.2 Le premier alinéa mentionne le
caractère commun que possèdent toutes
ces phrases :
"La réalisation du fait exprimé dans la
proposition principale y dépend d'un autre fait
conçu comme éventuel et posé comme tel,
soit comme objet d'hypothèse" Ensuite,
les auteurs utilisent le même concept que celui
utilisé par M. Grévisse: " la
proposition dépendante traduit un acte de
l'esprit par lequel ou bien on recrée le
passé, ou bien on construit l'avenir en imagination".
1.2.4.3 Le second alinéa relève : " le
fait exprimé dans la proposition principale
représente toujours une
conséquence de celui qu'exprime la proposition
dépendante: cette conséquence se tire de
l'éventualité envisagée, de l'hypothèse
formulée, ou découle d'une condition
supposée"
La formule a l'avantage d'expliquer, par une relation de
conséquence commune, le
classement d'hypothétiques, d'éventuelles et de
conditionnelles sous une même
rubrique. Elle ne lève pas la contradiction entre
la notion et son expression
syntaxique, relevée déjà chez Grevisse.
En effet, les auteurs ne distinguent pas entre la notion
«qui est une connaissance »
et l'expression syntaxique «qui traite de la fonction et
de l'ordre des mots dans la
phrase»
10
Cet aspect contradictoire a été aussi
relevé chez M. Grévisse :
1.2.4.4 Le troisième alinéa soulève le
problème du rapport existant entre les
différentes notions, conjonctions et locutions
conjonctives.
"Si" est classée à part parce que cette
conjonction "symbolise l'hypothèse d'une
11
manière indifférenciée."
Nous arrivons à un classement effectué selon les
concepts pris en charge :
1.2.5 " L'éventualité pure ": que, quand, quand-
même."

35
1.2.6 "Supposition pure" :
au cas où, pour le cas où, à supposer que,
supposé que, en admettant que"
1.2.6.1 « Supposition + restriction :" à moins que"
1.2.6.2 "Supposition +Alternative : soit que...,soit que,
que...ou que, suivant que
...ou que, selon que...que"
1.2.7 "Condition" :
1.2.7.1 "Condition pure": "à (la) condition que, sous
(la) condition que"
1.2.7.2 "Condition + souhait": "pourvu que"
1.2.7.3 "Condition + Proposition: "Pour peu que"
1.2.7.4 "Condition jugée peu recevable : si tant est que"
Ce classement définit chaque subordonnée par
la notion véhiculée et qui est
explicitée par le terme introducteur. Par contre, le
classement arrêté au paragraphe
(701), ne reprend pas le classement par notion, mais annonce une
composition en
trois parties :
D'une manière générale, l'hypothèse
est actualisée au moyen de si : le verbe de la
proposition dépendante est donc au mode indicatif.
L'emploi du subjonctif plus-que-
parfait après si dans les phrases hypothétiques
relatives au passé est un archaïsme
qui survit dans la langue écrite.
1.2.8 Phrases hypothétiques normales :
autre
«toutes celles dont la proposition dépendante
s'ouvre par une conjonction
que « si » et « quand »ou par une
locution conjonctive. Ces phrases
hypothétiques seront étudiées sous
l'angle du mode qui « est la seule question
qu 'elles posent »
1.2.8.1 "Les phrases hypothétiques introduites par
"si" et par "quand" : elles sont
étudiées à part « en raison de
leur caractère systématique et des restrictions
auxquelles y sont soumis l'emploi des modes et des temps »

36
En latin classique, il existait un rapport étroit entre le
mode de la subordonnée et
celui de la principale. On avait, soit l'indicatif dans tout le
système, soit le subjonctif.
L'indicatif énonçait l'hypothèse sans
émettre d'appréciation sur sa vraisemblance.
L'hypothèse peut porter sur un type purement logique : ex
: « si dei sunt mali, non
sunt dei » « Si les dieux sont méchants, ce
ne sont pas des Dieux », elle peut aussi
porter sur le futur, or habituellement dans ce cas, on
retrouve d'ordinaire le futur
antérieur dans la subordonnée - en
général, il y a une perte dans ce système - le
futur antérieur a été abandonné au
profit du simple futur. Nous retrouvons dès les
plus anciens textes, la forme Si + présent/futur
12
Le subjonctif imparfait présentait l'hypothèse
comme explicitement contraire à la
réalité, et le subjonctif plus-que-parfait
énonçait une hypothèse contraire à la
réalité, mais dans le passé. Il est entendu
qu'une hypothèse irréelle déroulée dans le
passé, exprimée par le plus-que-parfait,
pouvait répondre à une conséquence
irréelle présente. Ce système
précis et logique a sombré à cause des
transformations morphologiques des verbes. Les formes du
futur antérieur et de
l'imparfait du subjonctif avaient disparu pour être
remplacées par d'autres formes,
rendant ainsi le système de l'ancien français
plus largement différent de celui du
latin classique.
1.2.8.2 "Des phrases hypothétiques dont les
éléments sont liés par une
subordination implicite "
Les auteurs annoncent que "la proposition dépendante
se décèle par la mélodie et
par la place qu'elle occupe". On voit aisément
que les auteurs sont embarrassés par
le fait décelé chez M. GREVISSE. Peut-on
trouver des phrases introduites par si
et par quand pouvant être déclarées
hors norme ? Est- ce que les phrases
introduites par "si" et par "quand" constituent,
à elles seules, un caractère
systématique ? ".
" La subordination implicite ?" serait
décelable par sa place et par sa prosodie,
critère dont on connaît le peu de fiabilité
linguistique. Est-ce que la simple prosodie,
critère de linguistique, peu fiable peut nous faire
découvrir cette subordination. Est-
ce que la prosodie seule peut nous indiquer la nature
hypothétique de la phrase.
Ces domaines d'utilisation de certaines formes d'hypothèse
données par le sens et
non par une subjonction telle que stipulée par
ailleurs risquent de créer une
confusion énorme dans le classement de toutes ces
propositions. Il nous semble

37
qu'il serait très prudent de ne pas considérer,
à l'origine, que la subjonction soit un
indicateur des hypothèses. Mais, il faudrait
considérer à la place de la subjonction, le
temps comme un indicateur de l'hypothèse. Ce qui
serait plus juste. Or, le
paragraphe (592), vu plus haut, apportait la
précision que la substitution d'un
prédicat verbal à un syntagme nominal se
faisait "au moyen de morphème
complexe.....ou au moyen de morphème
simple". Ceci rend la subordination très
explicite.
1.2.9 « Les phrases hypothétiques »
:
13
Cette partie ne comprend qu'un seul paragraphe (702) qui traite
des modes
dans les propositions dépendantes.
Il est dit que "l'emploi du mode indicatif ou du
mode subjonctif dépend de la
conjonction ou de la locution conjonctive
utilisée".
Les auteurs citent que le mode subjonctif "est de
règle après, pourvu que, pour peu
que, si tant est que à supposer que, en admettant que,
à moins que, soit que .... soit
que, que ......que ». Il faut surtout
reconnaître qu'une bonne partie de ce temps a
disparu pendant l'évolution synchronique de l'expression
de l'hypothèse.
Le système de l'hypothèse «logique» ne
s'est pas modifié, mais en revanche celui
du futur a subi la perte du futur antérieur.
Il en est resté seulement celui du subjonctif imparfait
(forme issue d'un ancien plus-
que -parfait : «chantasse venant de cantavissem),
exprimant à lui seul le potentiel,
l'irréel présent ou passé.
1.2.10 "Systèmes hypothétiques introduits par si "
:
Ce paragraphe introduit trois ordres :
1.2.10.1 "L'hypothèse actualisée au moyen de
si " Cette partie comprend huit
paragraphes que nous allons étudier l'un après
l'autre :
Le paragraphe (703) : ce paragraphe introduit trois ordres :
1.2.10.2 « L'hypothèse actualisée au moyen de
« si » :

38
Le verbe de la proposition dépendante se met à
l'indicatif. Par contre, les emplois
du subjonctif plus-que-parfait sont « un
archaïsme qui survit seulement dans la
langue écrite »
1.2.10.3 "Quand l'hypothèse engage le passé, le
verbe de la proposition dépendante
est à la forme composée. Mais il est à la
forme simple lorsque l'hypothèse est au
présent, ou engage l'avenir ».
1.2.10.4 La valeur "temporelle " est donnée par le temps
du verbe de la proposition
dépendante, par un adverbe, par le temps du verbe de la
principale, mais souvent
seul le contexte suffit. Par contre, il n'y a pas de "moyen
grammatical qui permette
de distinguer .... si l'hypothèse est probable ou
improbable, si on la juge réalisable
ou si elle est irréalisable de nature ".
Les nuances devront faire appel aux critères de temps.
Mais souvent, en français, il
n'existe pas de moyen grammatical qui permette de
distinguer dans ces mêmes
systèmes si l'hypothèse est probable ou
improbable ; seuls certains moyens
lexicaux peuvent nous offrir la possibilité de
traduire ces nuances. Ex : - si vous
réussissiez, j'en serais satisfait
(hypothèse probable et réalisable)
- Si mon mulet transalpin volait, mon mulet aurait des ailes
(Rabelais) - (hypothèse
burlesque irréalisable de nature
14
1.2.11 L'hypothèse précède logiquement sa
conséquence:
Le rapport est marqué par les temps auxquels, nous mettons
les verbes de la
subordonnée et de la principale. Le fait de ne pas
observer ce rapport produit "un
déséquilibre dont on tire des effets de style "
Ex : « Si tu fais un pas de plus, tu tombes ».
« S'il était tombé, il se noyait »
« Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y
passait » (Anouilh)
L'imparfait de l'indicatif, de par sa valeur, peut prendre un
sens hypothétique, même
en proposition indépendante. On s'explique ainsi qu'il ait
pu facilement remplacer le
conditionnel. La majeure partie des auteurs se
dérobe à l'utilisation des temps
obligatoires de l'expression de l'hypothèse pour
créer un effet de style, tel que le
montrent les exemples ci-dessus.

39
Les paragraphes (704) et (705) sont tous deux des
paragraphes qui traitent des
systèmes hypothétiques relatifs au présent
et/ou à l'avenir.
Le premier est relatif au verbe de la proposition
dépendante, le second concerne le
verbe de la principale. Dans le premier alinéa du
paragraphe (704), il est question de
l'hypothèse rendant une actualité présente
(irréel du présent), le verbe doit se mettre
à l'imparfait de l'indicatif. Le présent de
l'indicatif confère à l'hypothèse le "maximum
de certitude " ou une valeur de vérité
générale. Le français distingue entre
l'hypothèse supposée pour un moment
réalisée («si tu viens ») et une hypothèse
imaginaire («si tu venais»). L'imparfait : au
contraire, il affirme que l'hypothèse ne
peut s'intégrer à l'actualité
présente du locuteur et lui confère, par rapport au
présent, une forme de neutralité.
Remarques: elles sont au nombre de trois :
1.2.11.1 Si peut-être suivi d'un futur ou d'un
conditionnel, s'il a le sens de : "S'il est
vrai que ".Ex : «s'il viendrait, je le verrais
» Corneille
1.2.11.2 Par effet de style dans les subordinations
inverses, la conséquence est
introduite par « si », « la cause étant
exprimée dans la principale introduite par c'est
que.
Ex : « Si je ne le fais pas, c'est que je n'en ai pas envie
»
1.2.11.3 Si peut avoir le sens de " toutes les fois que",
"chaque fois que".
Dans ce cas, les deux verbes des deux propositions sont à
un même temps.
« S'ils triomphaient, notre gloire n'était -elle pas
perdue ? »
Ex: « Si Napoléon l'emportait, que devenait
notre liberté ? (Chateaubriand,
mémoires O. T. III, P.20). Un autre exemple
emprunté à l'oeuvre de Monté-Cristo,
d'A. Dumas père pourrait aussi montrer ce cas :
Ex: « Si pendant le trajet les fossoyeurs reconnaissaient
qu'ils portaient un vivant au
lieu de porter un mort, Dantès ne leur donnait pas le
temps de se reconnaître : d'un
vigoureux coup de couteau il ouvrait le sac.,
profitait de leur terreur et
s'échappait ; s'ils voulaient l'arrêter, jouait du
couteau. ().
En général, l'emploi de l'imparfait dans la
conséquence se rencontre également
dans le système où la donnée est
incomplète ou irrégulière :

40
Ex « Que le gouvernement triomphât, et dans la
joie de la victoire, son étourderie
n'était qu'une peccadille. Dans la
défaite, elle devenait une trahison »Bourget
Geôle II, 33
Le futur et le conditionnel sont exclus de la proposition
dépendante. Une distinction
est à faire selon que :
1.2.12 La proposition dépendante est du type : Si +
présent de l'indicatif :
Le verbe de la principale peut être :
1.2.12.1 A l'impératif :
Ex : «Parlez aux hommes de leurs affaires, et de
l'affaire du moment et soyez
entendu de tous, si vous voulez avoir un nom »
(P.L. Courier)
1.2.12.2 A l'indicatif futur : « Qui explicite la
valeur temporelle du système : le
locuteur intègre la conséquence à son
actualité ».
Ex : «Monsieur, si je prends un arbitre de mes
procédés envers elle, ce sera
vous que tout autre» (Beaumarchais)
1.2.12.3 A l'indicatif présent : qui marque
« le caractère instantané de la
conséquence ».
Ex : « Tu bouges, tu es mort » ou indique que
la « conséquence est
logiquement impliquée par l'hypothèse ».
Ex : « Or si l'on fait attention à l'état
où était pour lors le royaume , on voit
bien qu'entreprendre de changer partout les lois et
les usages reçus, c'était une
chose qui ne pouvait retenir l'esprit de ceux qui
gouvernaient. » (Montesquieu)
1.2.12.4 Au conditionnel qui « permet au locuteur de
rejeter la conséquence hors de
son actualité présente et de situer par fiction
dans un domaine imaginaire »
Ex : « Si j'écris un autre roman, je voudrais
éclaircir cela mieux ».
-«Car enfin, si les pièces qui sont selon les
règles ne plaisent pas, et que celles qui
plaisent ne soient pas selon les règles, il
faudrait de nécessité que les règles
eussent été mal faites. »
(Molière)
1.2.13 La proposition dépendante est du type SI+ imparfait
de l'indicatif :
Le verbe de la principale peut être :

41
1.2.13.1 Au conditionnel, si l'hypothèse parle d'une
actualité présente.
Ex : «Situ m'aimais, tu m'aurais dit la
vérité.» (J. Anouilh)
1.213.2 Au présent et au futur : « si
l'hypothèse porte sur l'avenir ».
Ces deux formes qui créent une rupture dans le
système permettent au locuteur de
réintégrer dans son actualité la
conséquence de l'hypothèse »
Ex : « Si tu le voyais . Tu lui dis que. »
« Si vous deviez venir nous nous arrangerons
toujours ».
1.2.13.4 A l'impératif : ex : « Si tu le
rencontrais, dis lui que »
Le paragraphe intitulé «les systèmes
hypothétiques relatifs au passé » traite des
verbes de la proposition principale.
1.2.14 Proposition dépendante : « l'hypothèse
a toujours une valeur d'irréel »
1.2.14.1 « Dans la langue écrite courante comme dans
la langue parlée, le verbe de
la proposition dépendante est toujours au plus-que-parfait
de l'indicatif »
Ex : «S'ils [les Romains] avaient gardé les
villes à Philippe, ils auraient fait
ouvrir les yeux aux Grecs » (Montesquieu)
«Si j'avais eu, à ce moment, une femme qui
m'eût aimé, jusqu'où ne serais-je
pas monté ! »
1.2.14.2 Le plus-que-parfait du subjonctif est un «
archaïsme », dans la langue
écrite.
Une distinction est à opérer selon que :
1.2.15 La proposition dépendante est du type Si +
plus-que-parfait de l'indicatif :
Le verbe de la proposition principale peut être :
1.2.15.1 Au conditionnel passé : « Si la
conséquence est située dans le passé du
locuteur ».
Ex : «Vous auriez bien ri, si vous aviez su le
détail de cette aventure »
(Madame de Sévigné)
Le plus-que-parfait du subjonctif est considéré
comme un archaïsme.

Ex : «Si l'homme n'avait d'abord commencé
par en avoir
42
une opinion
exagérée [de sa force], elles n'eussent
jamais pu acquérir tout le développement
dont elles sont susceptibles. » (A.Comte)
1.2.15.2 Au conditionnel présent : « Si la
conséquence est contemporaine au
locuteur ».
Type : «Si je m'y étais pris autrement, je n'en
serais pas là. »
1.2.15.3 A l'imparfait de l'indicatif : pour marquer « le
caractère immédiat instantané
de la conséquence ».
Ex : «Si le bailli n'avait pas sur-le-champ averti le
commandant, si on n'avait
pas couru après la troupe joyeuse, c'en était
fait. (voltaire)
1.2.16 La proposition dépendante est du type : Si +
plus-que-parfait du subjonctif :
Le verbe peut être :
1.2.16.1 Au subjonctif plus-que-parfait
Ex : «Et une main si habile eût
sauvé l'Etat, si l'Etat eût pu être
sauvé. »
(Bossuet).
1.2.16.2 A l'indicatif forme en-rais (conditionnel)
composée ou simple. Toutes ces
constructions ne sont pas présentées comme des
archaïsmes. Les constructions ne
se répondant pas exactement d'une sphère
temporelle à l'autre font de ces
paragraphes une simple forme de présentation. De
plus, présenter d'abord les
verbes de la proposition dépendante et ensuite ceux
de la proposition principale
effacent en grande partie l'impression de système
que les auteurs s'efforcent de
présenter.
Ex : «Si l'âme de César n'eût pas
été possible, celle de Caton ne l'aurait pas
été davantage. » (Diderot)
1.2.17 Système hypothétique introduit par «
quand » :
Cette partie très courte n'est constituée que d'un
paragraphe. Le «caractère
systématique» de ces phrases est dû
à la correspondance entre les temps des
deux propositions : conditionnel présent ou passé
Ex : « Quand vous seriez reine, vous seriez sincère
» (Voltaire)

43
Mais une remarque vient aussitôt mettre en cause
cette symétrie (et donc le
caractère systématique de la phrase ?)
« Rien n'empêche toutefois d'employer le
présent ou le futur dans la proposition
principale quand le locuteur intègre le contenu de
celle-ci à son actualité présente »
Ex : Quand bien même je pourrai la réussir,
ce n'est point là ma tâche »
(Gide).
Remarque : on peut utiliser les locutions
figées : «n'était, n'était que », verbe
être ou
devoir à l'imparfait du subjonctif.
1.2.18 D'autres phrases hypothétiques :
Un seul paragraphe pour cette partie, intitulée «
subordination implicite ».
Trois cas se présentent :
1.2.18.1 Le premier type de construction conserve à
chacune des hypothèses, son
indépendance. Il y a juxtaposition des
hypothétiques.
Ex : «Les provinciales seraient sérieuses, plus
personne ne les lirait » (Gide).
1.2.18.2 « La proposition dépendante est
caractérisée par l'inversion du sujet
pronominal et une mélodie suspensive ».
Ex : « A-t-on eu du discernement dans le choix des
amis, les accidents, les
circonstances vous en séparent, on se trouve seule
dans l'univers. » (Madame du
Defrand)
Ex : «ressentais-je quelque chagrin, je
m'étudiais à prendre l'air de la
sécurité, même celui de la joie. »
(Laclos)
Remarque :
On peut employer des « locutions figées » :
n'était, n'était que, verbe être ou
devoir à l'imparfait du subjonctif
1.2.19 Locutions de couleur hypothétiques formées
au moyen de si :
« L'hypothèse peut s'allier à une comparaison
(comme si) à une opposition
(même si) à une exception (sauf si,
excepté si), à un souhait ou un regret (si
seulement). Le temps est le même qu'avec « si ».
Toutefois, « comme si est suivi le
plus souvent de l'imparfait ou le plus-que-parfait de l'indicatif
»

44
Deux paragraphes (§ 604 et §605) sont destinés
à faire entrer dans le système de
« si » des constructions assez peu
fréquentes ou dont le caractère hypothétique
n'est pas seul en cause : ils n'ont, en effet, pas de
construction fondamentalement
différentes des cas généraux vus dans les
paragraphes précédents.
Remarque : A l'époque classique, l'utilisation du
mode indicatif était autorisée dans
la seconde proposition hypothétique de reprise
introduite par "que". Nous
constatons encore de nos jours cet usage (cf. M.
Grévisse, le bon usage (§ 1038)
Seconde remarque : F. Brunot : fait remarquer que
«ce n'est pas le temps de la
principale qui amène le temps de la
subordonnée».Mais C'est le sens, donc pour
lui, le chapitre de la concordance des temps se résume en
une ligne : il n'y en pas.
L'hypothèse représente le thème et la
principale le prédicat. Thème et prédicat
peuvent être joints par le conjonctif « que »
Ex : «Vous me le diriez que je ne le croirais pas
»
Chez les auteurs, Wagner et Pinchon, la présentation de la
question de l'hypothèse
est à la fois différente et très proche de
celle de M. Grevisse : Elle est proche par
les a priori notionnels.
L'hypothèse est «acte de l'esprit
», par la présentation des mots introducteurs des
subordonnées :
Elle s'en sépare par l'abandon des notions
héritées du latin : (éventuel, potentiel),
mais irréel subsiste encore sans être opposé
aux deux autres.
Elle s'en distingue par la conscience très claire du
rapport de conséquence reliant
les deux propositions de la phrase hypothétique et surtout
par la mise en relief de la
notion de système.
Il faut reconnaître aussi que les auteurs
n'échappent pas au genre d'hypothèses
juxtaposées qu'ils dénomment
"subordonnée implicite" qui est en contradiction avec
les définitions de base qu'ils se sont données, au
début.
Les auteurs ont essayé d'imposer la notion de
système au détriment des notions
héritées du latin. Mais la réussite n'est
pas totalement apparente. D'ailleurs ce n'est
que comme cela que le système de l'expression de
l'hypothèse pourrait évoluer. En
effet, à chaque fois qu'une recherche est
entamée, elle consacre à son objet une
piste qui lui permettra une évolution sûre.
Nous allons voir un autre point de vue plus récent qui
pourrait certainement nous
permettre d'évoluer dans notre recherche :

45
1.3 Présentation du point de vue de la grammaire Larousse
du français
contemporain :
15
Les auteurs présentent la question de l'hypothèse
dans la première partie de
l'ouvrage intitulée : « Les éléments
constituants du discours ».
Le livre comprend trois parties :
A - «Les éléments constituants du
discours»
B - «Les parties du discours »
C - «La versification»
Un premier aperçu nous montre que les auteurs de
cette grammaire se sont
penchés sur le discours en premier lieu et non sur le
texte ou la phrase comme,
ont fait les auteurs des grammaires précédentes.
Car ils partent du discours comme
point de départ pour l'étude et non de la
structure. .
Nous retrouvons l'hypothèse dans la première partie
qui comprend six sous-
parties : la sous- partie qui intègre l'hypothèse
est appelée : « phrase complexe » et
s'étale sur cinquante - trois pages. L'hypothèse
est traitée en neuf pages ; soit 9/53
16
sont réservés à l'hypothèse . C'est
vraiment important Les auteurs sont conscients
de l'enjeu de l'hypothèse et lui accordent une
grande importance. Les autres
propositions, au nombre de sept (propositions
circonstancielles de temps
propositions circonstancielles d'opposition, propositions
circonstancielles de cause,
propositions circonstancielles de conséquence,
propositions circonstancielles de but,
propositions circonstancielles comparatives, et les
propositions subordonnées
relatives), sont traitées en quarante - deux pages,
soit en moyenne, six pages à
chaque catégorie. Ce qui signifie que cette
catégorie (l'hypothèse) a bénéficié
d'une grande importance
17
Il est nécessaire de faire remarquer que cet ensemble
de propositions s'oppose à trois autres genres de
propositions ; les propositions -
sujet, attribut et objet, complément de nom et d'adverbe,
et les relatives.

46
Le sous-chapitre de l'hypothèse est
présenté sensiblement à la manière de M
Grévisse, et comprend les trois points essentiels qui sont
:
1.3.1 L'hypothèse est considérée comme un
problème de subordination :
1.3.1.1 Elle mérite une description plus étendue
que les autres propositions.
1.3.1.2 Les auteurs ne semblent pas vouloir effectuer le
rapprochement entre les
hypothétiques, les comparatives et consécutives,
effectués par Wagner et Pinchon,
en vue de mettre en évidence la notion de système.
1.3.2 Analyse du paragraphe 210 :
Le paragraphe (21O) page 137 : ouvre le sous - chapitre
qui est destiné à
l'étude des propositions hypothétiques.
On remarque à sa lecture que les auteurs sont
conscients des problèmes de
« classement », et tentent d'effectuer leur
étude selon ces critères : « compte tenu
de la multiplicité de(s) forme(s) et de(s) valeur(s)
».
Par ce point, ils se distinguent des grammairiens
déjà vus.
Ce paragraphe présente le problème des
hypothétiques sous l'angle notionnel et
pose le problème du "classement " selon les
critères de "forme et de valeur "
Nous obtenons :
1.3.2.1 La phrase hypothétique :
Une phrase est dite hypothétique «lorsque l'un de
ses éléments exprime une
supposition qui est généralement aussi la condition
d'un fait qui suit cet élément ».
La donnée d'hypothèse et son corollaire
peuvent être énoncés sous diverses
formes, allant du système complexe (principale
subordonnée ou indépendante
coordonnée, au simple mot).
1.3.2.1.1 "Il peut y avoir entre les deux
éléments un rapport d'effet à cause, la
subordonnée énonçant la condition
nécessaire pour que se réalise la principale qui
exprime ainsi une sorte de conséquence ".
18

47
1.3.2.1.2 "La proposition subordonnée peut
n'exprimer qu'une éventualité offrant
plus ou moins de chance de réalisation, et la
principale, dans ce cas, exprime
simplement un fait parallèle ou opposé à
celui de la subordonnée ".
19
1.3.2.1.3 De plus, selon les modes et les temps
employés dans chaque élément,
selon le contexte aussi, le sens peut varier de
l'hypothèse réalisable à l'hypothèse
irréalisable, en passant, par tous les
degrés, du plus vraisemblable au moins
vraisemblable, et par toutes les nuances de l'expression
affective ».
20
Le classement proposé sera effectué à partir
d'une répartition de structures basées
sur un répertoire de phrases types de la langue courante
et de leurs variations.
A travers tous ces éléments, nous voyons que les
auteurs prennent en charge les
mêmes notions que celles mises en avant par les autres
auteurs.
Les auteurs introduisent dans ce même chapitre deux grandes
divisions logiques, en
distinguant «les systèmes à valeur
réellement hypothétique, des systèmes à forme
hypothétique et à valeur non
hypothétique », à côté d'un classement
basé sur la
structure.
Les auteurs réservent les deux paragraphes (216 et 217)
aux remarques portant sur
:
1.3.2.2 La fréquence des structures, leurs valeurs
communes et leurs effets de sens.
Nous remarquons qu'il est difficile d'évacuer les
valeurs notionnelles du
classement, fût-il des plus justifiés
comme celui présenté par la grammaire
Larousse.
Les auteurs reconnaissent que l'on trouve (certes)
«des emplois assez nombreux
avec le plus-que-parfait du subjonctif .(ils) font partie
d'une syntaxe soucieuse
d'élégance ».
Selon le principe étudié
précédemment avec les deux autres auteurs, nous
rappellerons les définitions qui sous-tendent les concepts
utilisés en syntaxe.
1.3.2.3 Les définitions :
1.3.2.3.1 La proposition :
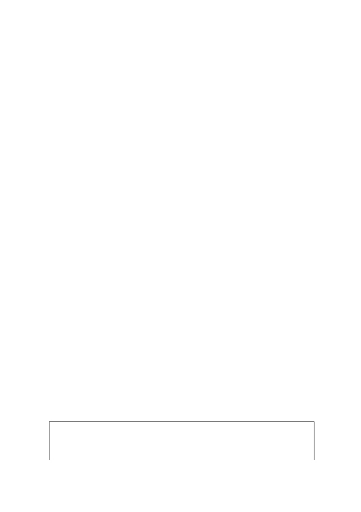
48
"Elle a, habituellement, au moins un verbe
précédé d'un sujet ......., plus rarement,
d'autres mots peuvent, à eux seuls, fixer
l'événement et devenir le centre de la
proposition."
21
1.3.2.3.2 La subordination :
"Une proposition subordonnée est placée
sous la dépendance grammaticale d'un
mot généralement un verbe ou un substantif, qui
appartient à une proposition dite
«principale » ou sous la
«dépendance de cette principale tout entière ".
22
Cependant le paragraphe 157, apporte certaines
atténuations à l'alinéa
deux :
" Certaines propositions, de forme subordonnée,
entrent cependant dans une
relation nettement coordinatrice. C'est surtout le cas
des propositions introduites par
«Si» (notion d'opposition) et «que»
(hypothétique).
Ces définitions utilisent des critères formels
et notionnels et permettent au
lecteur de classer dans le chapitre "
«subordonnée» " des phrases qui ne sont pas
des subordonnées.
Si l'on excepte le paragraphe 210, portant sur les «
problèmes de classement », le
216, renfermant les « remarques sur les
structures types et leurs variantes
principales », et le 217, comprenant les « remarques
sur les hypothétiques relatives
au présent, à l'avenir et au passé
», paragraphe évoqué plus haut, l'étude des
hypothétiques présente cinq paragraphes.
Les trois premiers étudient les types fréquents et
leurs variantes.
Les deux derniers étudient des variantes qui se
distinguent des trois premiers soit
par la forme, (pas de véritable subordination) soit par le
sens (non hypothétique).
1.3.3.4 Tableau des phrases types et de leurs
variantes. Sens hypothétique :
Les auteurs présentent dans ce paragraphe, les trois types
de « structures les
plus fréquentes ».
- Si + présent de l'indicatif futur de l'indicatif
Ex : « [] je suis affublé de cette
absurdité. Elle m'écrasera si je ne la
soutiens » ( Stendhal)
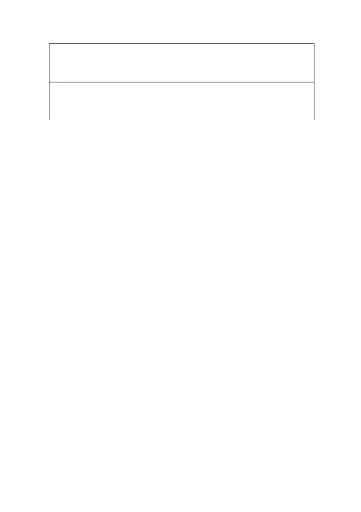
49
- Si + Imparfait de l'indicatif ..conditionnel présent
Ex : « Si le ciel tombait, il y aurait bien des
alouettes de prises » (proverbe cité
par Eluard)
- Si + Plus-que-parfait de l'indicatif.conditionnel
passé.
« Et puis, même si je te l'avais dit, tu
aurait pensé que j'étais un gosse »
Anouilh)
La première et la seconde phrase type expriment
des hypothèses relatives au
présent et au futur, la troisième indique une
hypothèse relative au passé.
Remarque :
La notion de fréquence, retenue comme critère de
classement, et celle de structure
nous paraissent distinguer très nettement cette
présentation des deux précédentes.
1.3.3.1 Elles apportent à la question une certaine
cohérence tout en n'excluant pas
les critères de sens hypothétique ou non
hypothétique.
1.3.3.2 Les auteurs font remarquer qu' : «une seconde
proposition subordonnée
hypothétique est coordonnée à la
première, elle peut être introduite par si, mais en
général, la subjonction « si » est
remplacée par la conjonction « que » et le verbe
de cette proposition se met au subjonctif », et donne
l'exemple suivant :
Ex : « J'imagine que si Benedetto Orfei était
devenu papa et que l'idée de
son hérésie ne lui eût été
inspirée qu'à ce moment, il se serait au contraire servi du
dogme » (Appolinaire).
1.3.3.5 Variantes principales des phrases types. «Les
systèmes complets introduits
par si» :
Les structures présentées sont des « variantes
» (substitutions possibles)
Les auteurs mettent en garde les utilisateurs de la « seule
règle » :
«Si n'est jamais suivie elle-même du futur de
l'indicatif ou du conditionnel »
1.3.3.5.1 Variante de " la phrase de Type N°I"
Si ..............+............Présent de l'indicatif
.................impératif :
Ex : « Faites ce que vous avez à faire.
Mais si vous êtes un être humain,
faites-le vite» (Anouilh)

50
« SI + présent de l'indicatif ..Présent de
l'indicatif :
« Si tu te tais maintenant, si tu renonces à
cette folie, j'ai une chance de te
sauver » (Anouilh)
Les auteurs font remarquer cette variante tend de plus en plus
à remplacer la phrase
type avec l'indicatif futur, dans la langue courante, c'est -
à - dire le type N° 2.
1.3.3.5.2 La variante de «la phrase de type N°3
»
Si + plus - que - parfait de l'indicatif .imparfait de
l'indicatif
« Ex : Si nous étions partis plus tard, nous le
manquions. »
SI + Imparfait de l'indicatif Imparfait de l'indicatif
« Ex : C'était évidemment, si cela
durait, la fin de votre carrière » (Giraudoux)
Si + plus- que-parfait du subjonctif .. Plus-que- parfait du
subjonctif :
« Ex : Peut-être si vous eussiez connu cette femme
plus tôt, en eussiez-vous pu
faire quelque chose » ; ( Choderlos de laclos)
1.3.3.5.3 La phrase du type mixte :
Si + plus-que- parfait du subjonctif .. Conditionnel passé
Ex : S'il eût vécu jusqu'à la
révolution et s'il eût été plus jeune, il aurait
joué
un rôle important » (Chateaubriand)
SI + Plus-que-parfait de l'indicatif . Plus-que-parfait du
subjonctif.
Ex : « Si Julien était demeuré beau,
élégant, séduisant, peut-être eût-elle
beaucoup souffert » (Maupassant).
Les auteurs font remarquer que la subjonction « si
» a été renforcée de divers
éléments qui sont : « s'il est vrai que,
si tant est que, si ce n'est que, excepté si,
sauf si :
« Je crois qu'il a fait beaucoup souffrir ma
mère, si tant est qu'il ait jamais aimé
vraiment » (Gide).
1.3.3.6 Variantes principales des phrases types :
"Systèmes complets sans si " :
Le paragraphe est partagé en deux grandes subdivisions :
A- "Avec une autre conjonction ou un conjonctif "
B - "Systèmes sans subordination formelle "
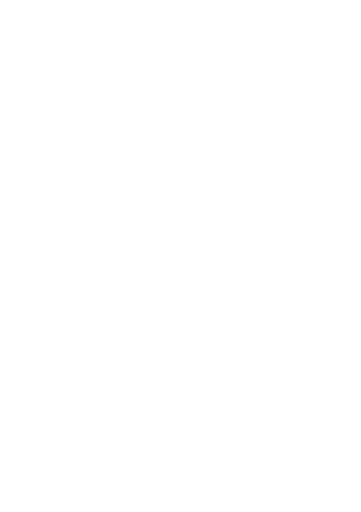
51
IL est à remarquer qu'un tel classement est permis par les
définitions molles
utilisées par les auteurs.
1.3.3.6.1 "Avec une autre conjonction ou conjonctif " :
Les auteurs rappellent que l'on peut utiliser les
conjonctifs : « quand », «quand
même», et «même quand»
Cette construction montre que le classement notionnel est
parfois difficile, du fait,
qu'il est difficile de faire la distinction entre une
proposition hypothétique et une
proposition d'opposition.
Nous obtenons la structure
1.3.3.6.1.1 « Quand +..........Conditionnel
.......Conditionnel »
Ex : « j'en aurais été touchée
quand je ne l'aurais point connue »
(Mme De La Fayette)
Les deux types de propositions sont homonymes et il
n'est pas facile de les
différencier.
On retrouve aussi la structure « même si »
avec les modes et les temps tels
qu'employés après « si »
1.3.3.6.1.2 « Qui + conditionnel
..............conditionnel »
Ex : «Seul, celui qui serait passé par ces
angoisses me comprendrait »
ou
1.3.3.6.1.3 Qui + Subjonctif ................Subjonctif
Ex : «Qui, cette nuit, eût vu s'habiller ces
barons,
Eût vu deux pages blonds, roses comme des filles
» (V.Hugo)
"Pourvu que, sauf que, à condition que, à
moins que, en supposant que, en
admettant que, pour peu que, en cas que..... ...." + SUBJONCTIF
«Pourvu que nous puissions grimper à bord
ça ira » Malraux
1.3.3.6.1.4 Selon que, suivant que.................. INDICATIF
Ex : « selon que vous serez puissant ou
misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir »
(La Fontaine)

52
Nous remarquons dans cet exemple que l'indicatif est de
rigueur (Les deux
propositions utilisent le futur de l'indicatif)
1.3.3.6.1.5 Au cas où, dans l'hypothèse
où........ CONDITIONNEL
Ex : «Au cas où il y aurait du verglas, je
retarderais mon départ en voiture».
Mais ces locutions conjonctives peuvent avoir des "valeurs
diverses et remplacer
si". Dans ce cas-là, la proposition principale peut-
être à l'indicatif, au subjonctif, au
conditionnel, à l'impératif.
La langue classique connaissait les tours :
En cas que (avec le subjonctif, que certains
puristes emploient encore
Au cas que : ex : «Prenez un parapluie,
au cas qu'il pleuve»
Le mode de la principale accompagnant toutes ces locutions
conjonctives n'est pas
contraint. En somme, nous avons une utilisation libre.
Les auteurs donnent comme remarque que les locutions
conjonctives « à moins
que » et « à condition que » sont
généralement remplacées par deux autres
locutions «à moins de » et « à
condition de », plus l'infinitif, quand le sujet est le
même dans les deux propositions. Ils rappellent
que la locution conjonctive « à
condition que » peut être suivie du futur indicatif,
avec une nuance de sens.
1.3.3.6.2 "Systèmes sans subordination formelle "
1.3.3.6.2.1 "Deux propositions indépendantes au
conditionnel.
La première peut être interrogative ".
[] Deviendrais-je fou, avait-il pensé, elle
seule [l'imagination] resterait de moi »
(Malraux).
Nous retrouvons, en général, cette tournure
très fréquente utilisant « que » devant
la seconde proposition. Il faut rappeler que ce « que
» n'est pas subordonnant, mais
il sert seulement à marquer le lien.
Ex : « le saurait-elle que ce regard ne la distrairait
pas de son écoute de la
forêt » Dumas .
Ex : «j'ai à vous dire que si vous auriez de la
répugnance à me voir votre
belle-mère, je n'en aurais pas moins, sans
doute, à vous voir mon beau-fils » (
Molière)
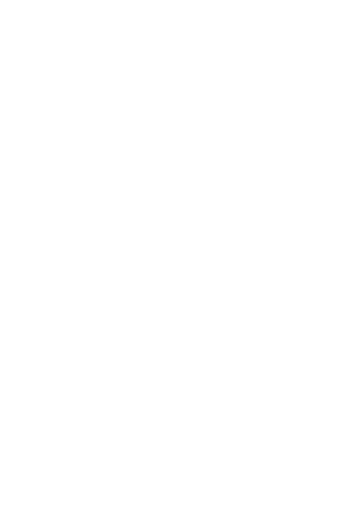
53
Les deux propositions sont souvent reliées par des
conjonctions de coordination,
mais ou et :
« Que Perken parlât de lui-même, et il
faisait surgir en Claude l'impériale blanche
du grand-père. (Malraux)
Les auteurs ont fait remarqué que « que »
est facultatif et que la construction
obtenue donne l'impression que la proposition introduite par
« que » tient sous sa
dépendance l'autre proposition. Certains Grammairiens
comme Gougenheim parlent
de « subordination inversée. Dans l'exemple
ci-dessous, les auteurs montrent bien
qu'elle est retournée.
«Il était mort qu'à peine
s'écriait-on qu'il se trouvait mal. » (Saint - Simon)
1.3.3.6.2.3 "Deux propositions indépendantes à
l'indicatif », avec inversion du sujet
dans la première, et substitution possible, dans l'une ou
l'autre, de l'impératif. »
Ex : ai-je la puissance de me venger, j'en perds l'envie
» (Chateaubriand)
1.3.3.6.2.4
"Proposition au subjonctif, introduite par "que" + la
proposition à
l'indicatif ou au conditionnel (Les deux propositions peuvent
être liées par Et)
« Quelle possédât des pistolets
à crosse, et les insurgés doublaient leurs
chances » (Malraux)
1.3.3.6.2.5 Dans un style pompeux, la conjonction « que
» peut être omise :
Ex Vienne ma doña sol []
[] et le reste est passé (V. Hugo)
Certaines constructions peuvent se rattacher à ces tours :
- "Les constructions du type : que ? ou que + Subjonctif
soit que........ soit que ...........+ Subjonctif "
« Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est mon habitude
d'aller sur les cinq heures me
promener au Palais -Royal » (Diderot)
1.3.3.6.2.6 « Les constructions figées » :
fût- il, dût- il, eût- il, ne fût- ce que.......et
n'était......." marquant l'éventualité.
« Dans les expressions figées du type : du diable
si., Dieu me punisse si ; le
sens conditionnel s'efface et l'expression fait l'effet d'une
forte négation ou d'une
forte affirmation, selon le cas »
23

54
D'autres constructions figées introduites par :
fût-il, dût-il, eût-il, ne fût-ce que,
marquant l'éventualité.
« J'en viens à souhaiter pour la France un roi,
fût-ce un despote » (Gide)
« Faire le poème de la conscience humaine, ne
fût-ce qu'à propos d'un seul homme,
ce serait fondre toute les épopées »
(Hugo)
La construction introduite par « n'était » :
« Ex : n'était le bruit, on se croirait au
paradis. »
Les auteurs font remarquer que ces constructions
étaient des constructions
subordinatives puisque dans l'ancien français,
elles comportaient la subjonction
« si ». On retrouvait « se ne fust »,
transformée en « se n'eust été », puis
remplacé
par « ce n'était », « se n'est oient
». La subjonction pouvait être omise.
« Ex : n'était un embonpoint précoce, il
ne craindrait pas à la course les plus
jeunes gens du village » ( Droz)
Faisant suite à ce paragraphe arrivent deux autres
totalement indépendants des
premiers (214-215).
1.3.3.6.2.7 (§ 214) - : "Systèmes réduits
à une seule proposition "
Une des deux propositions peut être remplacée par un
mot ou un groupe de mots ne
constituant pas nécessairement une proposition :
Ex « Heureuse, adorée, peut-être
Mathilde vivante aurait-elle eu la figure
voilà » ( Mauriac)
que
En général, ces systèmes sont des
"systèmes hypothétiques incomplets " Ils
peuvent aussi être réduits à un seul
élément.
Ex «Tu ne le croirais pas : je suis tombée dans
l'escalier ! » (Colette)
Le premier élément (de la supposition ou la
condition) est absent ; il est sous-
entendu. Nous pourrions dire ici : «si je te
disais quelque chose, tu ne le croirais
pas : je suis tombée dans l'escalier ».
L'interlocuteur le comprend sans qu'il soit
signalé par le locuteur par des expressions.
N peut aussi considérer comme système
hypothétique incomplet les tournures
isolées telles que : « Si vous voulez, si vous
saviez, s'il en fut, si ce n'est.,
si vous veniez, Si vous étiez là !...etc.
1.3.3.7 (§ 215) - "Systèmes introduits par si de sens
non hypothétique" :

55
Dans ces systèmes nous retrouvons la forme
hypothétique, mais pas la
valeur. "C'est le cas de beaucoup de tournures dont les
deux éléments sont à
l'indicatif présent ". En général, la valeur
est plutôt coordinative. Dans la plupart des
cas, la subjonction «si» introduit une proposition qui
s'oppose à la principale :
« Si l'effort est grand, au moins ne doit-il pas
être long » (Laclos)
Si la structure de cette phrase présente une forme
subordinative (présence de la
subjonction « si »), Sa valeur est plutôt
coordinative. Substituons à la subjonction
«si» la conjonction de coordination
«mais», nous obtenons la phrase coordinative
suivante :
«L'effort est grand, mais il ne doit pas être
long»
Il y a donc une opposition dans cette phrase.
Nous pouvons trouver dans chacune des propositions un temps
passé de l'indicatif :
Ex : «Si tu m'as rendu malheureux, tu ne l'as jamais
fait exprès» (Anouilh)
Nous pouvons aussi retrouver le conditionnel ou le
futur après «si», place
particulière de ces tours dans les hypothétiques :
«Mais s'il serait fâché de sa
défaite, en serait - il vraiment surpris ?» (Bossuet).
1.3.3.7.1 "Système causal "
Si introduit une proposition "exprimant " un fait
expliqué par la principale". Sa valeur
est celle d'un système causal :
Ex : «Le désert. S'il n'est d'abord que vide et
que silence, c'est qu'il n'offre
point aux amants d'un jour (Saint Exupéry)
1.3.3.7.2"Si à valeur temporelle" Cette conjonction a
pour valeur : "CHAQUE FOIS
QUE "
Ex : «Si je fais le bilan des heures qui ont
compté, à coup sûr, je retrouve
celles que nulle fortune ne m'eût procurées
(Saint Exupéry)
La présentation faite ici par les auteurs garde
toute sa cohérence grâce à des
définitions très larges.
Le sens n'est pris, ici, que comme conséquence de la
structure, chaque fois que
cela est possible. Il demeure que parfois, la structure peut
avoir plusieurs effets de
sens (cf paragraphe 215) : les auteurs ne le cachent pas (cf
paragraphe 210).Donc,
nous pouvons affirmer que la structure seule ne peut clarifier
l'hypothèse comme le
sens non plus, mais les deux à la fois peuvent
du moins donner une certaine

réponse
à notre attente. Le débat est
56
donc lancé pour une meilleure
compréhension de ce phénomène.
1.4 Analyse du point de vue d'O. Ducrot :
1.4.1 La supposition :
24
Dans le composant linguistique, les
énoncés français comprenant une
proposition conditionnelle introduite par « si » se
construisent selon la forme « Si p,
q ». La plupart des descriptions affirment l'existence d'une
certaine relation entre les
propositions « p » et « q », relation
très difficile à expliquer. Le dictionnaire Robert
suggère une autre voie qui consiste à dire que
« si » dans son usage hypothétique
« introduit une donnée d'hypothèse ».
Si doit indiquer l'acte accompli quand on
l'emploie, et non pas une représentation
intellectuelle (c'est-à-dire, une relation)
dont si serait l'expression. Cet acte est appelé
« supposition », consistant à
demander à un auditeur d'accepter pour un temps une
certaine proposition « p » qui
devient, provisoirement, le cadre du discours et surtout de la
proposition principale
« q ».
Cette contrainte est implicite, elle tient seulement au
fait qu'on ne peut, sans
admettre les contenus présupposés, poursuivre le
dialogue entamé par le locuteur.
Elle se fonde sur une convention générale du
discours qui veut que l'on réponde aux
paroles dont nous avons été le destinataire. (C'est
donc, une règle de politesse qui
veut que l'on rende les cadeaux ou les invitations).
Avec la subjonction « si », l'auditeur est clairement
sollicité de faire une hypothèse,
présentée comme hypothèse, et l'annulation
éventuelle de cet acte est envisagée au
moment même où le si est prononcé.
Le locuteur demande à l'auditeur de se
mettre dans une certaine situation
intellectuelle qui servira de toile de fond au dialogue.
Pour résumer, la thèse défendue est qu'une
proposition de type « si p, q » n'a pas
pour signification première « p est cause de q
», ni « p est condition de q ». Sa
valeur est de permettre la réalisation nécessaire
de deux actes illocutoires :
- demander à l'auditeur d'imaginer « p »,
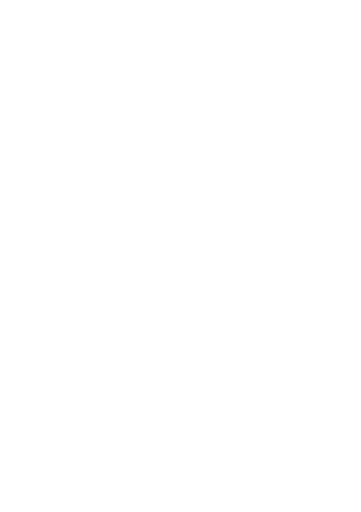
57
- une fois le dialogue introduit dans cette situation imaginaire,
y affirmer « q ».
Justifier cette description, c'est montrer les diverses
utilisations de si dans le
discours : ( si comme marque d'une relation et d'autre
part un certain nombre
d'emplois peu compatibles avec la description
classique considérée comme
prototypique, expliquant tous les emplois de si).
1.4.2 Les emplois marginaux :
Une série d'emplois sont souvent tenus pour
marginaux car ils se
comprennent mal dans le cas où si exprimerait une relation
entre propositions. Par
contre, ils se comprennent mieux si cette subjonction marque
l'accomplissement de
deux actes. IL s'agit d'abord du « si » oppositif qui
peut être paraphrasé par : « il est
vrai que ».
1.4.2.1 Si oppositif :
Ex : « s'il a de l'esprit, il n'a (en revanche) guère
de coeur » L'opposition se
situe au niveau des conséquences qu'on tire.
Ce si oppositif se distinguera du « si »
contrastif que nous allons voir dans
l'exemple ci-dessous :
Ex : « Si la cité est le coeur de Paris, le quartier
latin en est l'âme ». Dans cet
exemple, les deux propositions ne s'opposent ni par leur
contenu ni par leur
conséquence, mais elles s'opposent par leur forme.
Il s'agit là d'un « si » appelé
« présuppositionnel » (Il introduit une
proposition qui serait la présupposée de la
principale, si celle-ci était employée
isolément).
Prenons un second exemple : « Si Pierre est à
Paris, il y restera certainement ».
Ici, la subjonction « si » permet d'annuler les
présupposés de la principale en les
introduisant sous forme d'hypothèse, dans la
subordonnée.
On peut remplacer cet exemple par celui de :
« Si tu veux venir, tu as le droit ». Cet
énoncé ne peut être soumis à la loi de la
contraposition (= « p » « q » non q
non p »). Car on obtiendrait l'absurdité
suivante « Si tu n'as le droit de venir, c'est que tu ne
veux pas ».
Le « si » contrastif est destiné à
justifier la question de vérité mise à part,
l'acte
d'affirmation accompli dans la principale.
Remarque :

58
L'hypothèse « p » décrit une situation
éventuelle dans laquelle, il serait intéressant
de savoir que « q » est vrai. Nous ne voyons pas
pourquoi (« la fausseté de « q »)
entraînerait la non- réalisation de la situation.
Par contre, nous pouvons concevoir
une utilisation de la contraposition conduisant à conclure
: « S'il n'est pas intéressant
d'être au courant de « q », c'est que la
situation « p » ne se réalisera pas ».
Nous avons abordé uniquement ces deux cas pour montrer
toute la complexité de
l'utilisation de la subjonction « si », dans la langue
française.
1.4.3 Les variantes de la structure (Si p, q) :
Tous les locuteurs français savent que « si p,
q » n'est pas la seule façon
possible d'émettre l'hypothèse. Il faut
reconnaître que cette structure minimale
admet des variantes telles que :
« Si présent, présent »
« Si présent, futur »
« Si imparfait, forme en rais »
D'autres structures peuvent être privées de
l'élément « si » et peuvent se substituer
à celui-ci. Les phrases qui les utilisent (phrase à
double forme en rais, à impératif, à
interrogatifetc.), sont qualifiées de phrases
à sens hypothétiques. Le propos de
l'auteur sera de démontrer comment les phrases à
sens hypothétiques interviennent
dans les stratégies discursives et qu'elles
opèrent une pression plus ou moins
grande sur l'interlocuteur et témoignent ainsi d'un
engagement plus ou moins grand
du locuteur. Les nuances des phrases hypothétiques
résident dans les différents
dosages de ce rapport.
Selon l'enseignement de R. Jakobson, la phrase doit
être saisie comme unité
discursive à part entière. Et ceci, est
souligné par O. Ducrot : « La plupart des
phrases prononcées se donnent comme partie
intégrante d'un discours plus large,
comme continuant l'échange de parole qui les a
précédées () et d'autre part
comme appelant au débat ultérieur, comme
demandant à être complétées,
25
confirmées, compensées, à servir de base
à déductions, etc. »
Si nous prenons comme base que l'hypothèse est traduite
fondamentalement en
français moderne par la structure « si p, q »,
nous pouvons considérer que toute
phrase possédant une telle structure et qui
obéit aux mêmes contraintes sera

59
appelée synonyme, mais si une autre phrase
n'obéit pas aux mêmes contraintes,
elle est perçue comme homonyme, mais non
hypothétique.
1.4.4 Les structures hypothétiques de type (Si p, q ) :
Elles sont celles qui formulent l'hypothèse de la
façon la plus explicite. Au fil des
temps, et à tous les stades du développement
de la langue, ces structures
hypothétiques se sont équilibrées
progressivement. Le plus souvent la première
proposition débute par la subjonction « si ».
Leurs variantes sont marquées par le
e
jeu des temps. Le français de notre siècle (20
siècle) utilise les temps de l'indicatif
et n'utilise que rarement les emplois du subjonctif, car il
marque un niveau de langue
très soutenu.
La lente disparition du subjonctif est due, en partie, au fait
que « si » s'est chargé
d'une grande partie de la modalité hypothétique. En
effet, la langue arabe marque
l'hypothèse beaucoup plus par la subjonction que par
l'utilisation du temps.
Dans le système hypothétique, les temps de
l'indicatif ne jouent que très peu leur
rôle de temps, mais prennent surtout des valeurs
modales qui rendent superflu
l'emploi du subjonctif.
1.4.4.1 Si + Présent, présent :
C'est le système le plus équilibré et
il tend à s'imposer de plus en plus dans la
langue parlée.
Le présent, non marqué morphologiquement,
laisse percevoir la modalité
hypothétique introduite par « si » dans sa
nudité totale.
- Elle peut prendre la valeur générale :
(Celle des théorèmes ou des lois admises par tous)
Ex : « Si on chauffe de l'eau à 100°C, elle
bout. »
La contrainte exercée sur l'interlocuteur n'exige en
échange aucun engagement du
locuteur. Donc, présenter une telle vérité
sous forme hypothétique est le signe d'une
stratégie discursive à plus long terme.
- Elle peut aussi prendre une valeur particulière :
Ex « Si tu ne viens pas, je pars ».
On ne peut substituer que difficilement à une
telle phrase, une phrase non
hypothétique, sauf à changer le temps du verbe.

60
Ex « Je partirai à ta venue ».
Mais
« A ta venue, je pars ».
Nous ne pouvons substituer à « si », «
chaque fois que » sans changer de sens.
Pourtant, prononcer une telle phrase veut dire un engagement
total du locuteur.
« si tu viens, je pars peut-être »
« Si tu viens, je partirai peut-être »
La contrainte est totale. Toute stratégie du
locuteur consiste à présenter son
hypothèse particulière comme une hypothèse
à valeur générale.
1.4.4.2 Si + présent, Futur :
Une telle structure se distingue de la première par un
déséquilibre dans le temps. La
première proposition est analysable dans les
mêmes conditions que celles de la
première structure. Mais, l'emploi du futur dans la
seconde proposition modifie
considérablement la valeur des phrases. L'opposition
présent/futur crée l'opposition
chronologique entre la donnée hypothétique et sa
conséquence. Cette valeur ne se
fait pas dans la structure précédente.
Les deux présents matérialisent une
simultanéité dans la conséquence. Le futur
marque la possibilité d'un peut-être.
Dans la proposition « p » l'hypothèse est
présentée à l'interlocuteur de façon
contraignante, comme quelque chose d'indiscutable à
la réalisation de « q ». Le
décalage entre les deux temps (présent/futur)
permet au locuteur un engagement
de peu d'intérêt, par contre confier une
hypothèse à un futur, c'est se dégager de la
responsabilité de sa réalisation marquée
par le « peut- être ».
Ex « Si tu viens, je partirai peut-être »
Sachant depuis très longtemps que l'imparfait des
systèmes hypothétiques n'a
aucune valeur du passé mais qu'il est en mesure
de traduire un présent ou un
futur.
1.4.4.3 Le choix de « si + imparfait, forme en (rais)
» à la place de « si + présent,
futur » correspond à une stratégie de discours
plus prudente.
Ex « Si tu venais, je partirais » conserve le
même rapport chrono-consécutif
interne que « si tu viens, je partirai », mais
son actualisation est présentée en
différé et est soumise à une incertitude
plus marquée.

61
Le dit est moins ferme, le non- dit (choix laissé
à l'interlocuteur de considérer « si
p » comme cadre valable pour « q », se renforce
de plus en plus.
1.4.4.4 Si + plus- que- parfait, forme en (rais) composée
:
C'est la seule structure vivante qui situe l'hypothèse
dans le passé. Nous pouvons
formuler à son égard les remarques
précédentes pour « si + imparfait, forme en
(rais » auxquelles nous ajouterons l'aspect accompli.
Car, il est connu que les temps composés marquent l'aspect
accompli par rapport
aux temps simples qui leur correspondent.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas, face à cette
structure, une structure équivalente
du temps : « Si + présent, futur + aspect
accompli ». Elle serait du type : « *si +
passé composé, futur antérieur »
Ex « *si tu es venu, je serai parti ». Nous ne pouvons
parler de stratégie ici
puisque le coup est forcé comme dirait le joueur du
jeu d'échecs. Le locuteur est
obligé d'accepter la donnée d'hypothèse
puisque l'hypothèse est située dans le
passé. Ex : *si tu étais venu hier.
Le locuteur abandonne à l'interlocuteur l'entière
responsabilité de son actualisation
ou de sa non actualisation. D'où la valeur de reproche que
nous pouvons lui faire :
Ex « si tu venais demain, je partirais » VS
« *si tu étais venu demain, je serais
parti ». C'est le seul cas où cette structure peut
entrer dans une stratégie discursive.
1.4.5 Les structures hypothétiques synonymes :
Les phrases hypothétiques de type « si p, q »
sont celles qui produisent l'effet
de sens le plus évident parce qu'il est explicité
par la subjonction « si ». A ce titre,
elles sont tout de suite reconnues comme hypothétique.
Toutefois, elles ne sont pas
seules à présenter le sens
hypothétique, d'autres peuvent aussi le faire. Nous
pouvons leur substituer une autre possédant un sens
équivalent, mais dont la forme
est différente. Elles sont appelées «
synonymes ». Un locuteur qui marque son
discours par des phrases de ce type (hypothèse
synonyme) le fait par effet
poétique, et de style. Dans ce cas,
l'hypothèse est devinée. Plus le locuteur
s'éloigne de la forme hypothétique de type
(si p,q ) plus le sens hypothétique
s'abâtardit.

62
L'interlocuteur fera l'effort d'interpréter la chose
comme telle, moins le locuteur
donne des signes et moins il s'engage, tandis qu'il
offre à l'interlocuteur la
responsabilité du sens.
Ex « Qui te verrait, partirait »
Le parallélisme des formes en (rais) supplée
à l'absence du « si »dans la production
de l'effet hypothétique. Ainsi, la substitution de
« qui » à « si » prive la phrase
hypothétique du repère le plus évident,
atténue toutefois ce sens au profit du sujet
qui gagne en volume ce qu'il perd en précision. Une
pression sur l'interlocuteur est
exercée par la forme en (rais), mais la
responsabilité du locuteur de dire clairement
ce qu'il veut, est cachée par le recours au relatif
« qui ».
1.4.5.1 Quand + forme en (rais), forme en (rais) :
La substitution de « quand » à « si »
prive le premier d'un repère hypothétique très
important. Mais l'introduction du temps conditionnel
rééquilibre la phrase, tant du
point de vue formel que du point de vue sémantique vers la
valeur hypothétique. La
substitution à la première partie de la phrase
d'une proposition du type : « même si
+ imparfait » lui donne une valeur concessive. En plus de la
valeur stylistique d'une
telle phrase ne s'employant que dans les registres
soutenus, l'interlocuteur doit
saisir la nuance parfois ironique.
Dans l'exemple ci-dessous, le locuteur a employé deux
signes contradictoires en
apparence.
« Quand vous partiriez, vous n'iriez pas bien loin »
- quand : cette conjonction est perçue habituellement
comme conjonction de temps
qui se situe dans le registre thétique au lieu du registre
hypothétique.
- La forme en (rais) qui vient immédiatement après
pour contredire la réalisation
par sa valeur hypothétique, témoigne chez le
locuteur d'une stratégie fine. Il ne
prend pas la peine de dévoiler l'hypothèse
(absence de si), mais il offre à
l'interlocuteur un signe redoublé lui permettant ainsi de
reconnaître l'hypothèse. La
pression sur l'interlocuteur est donc égale à
celle d'une structure de type (si p, q),
mais l'engagement du locuteur est à peine indiqué
par ce dernier.
Nous quittons donc le domaine de la syntaxe pour celui
de la parataxe. Nous
abandonnons la subordination dans la stratégie du
locuteur, quand celle-ci est
encore soutenue par la double forme en (rais) que
renforce à la hausse la
conjonction « que » dans la seconde proposition.

63
Ex : « Tu voudrais, que je partirais »
Cette phrase appartient au style relâché.
L'intérêt d'une telle forme, c'est de
présenter l'hypothèse comme entièrement
indépendante de la conséquence. Le
locuteur présente deux faits sans lien explicite.
L'interlocuteur prend la peine de les
interpréter comme systémiques. L'engagement du
locuteur est limité aux différents
indices (forme en (rais), mais sa pression n'est qu'implicite.
Mais utilisant la forme interrogative, le locuteur fera preuve
d'un langage soutenu. Ex
« Viendrais- tu ? Je partirais ». L'interrogation
est le degré d'un engagement
supplémentaire du locuteur. Présenter la
conséquence de l'hypothèse comme liée à
une réponse dont on ne donne que la question,
c'est obliger l'interlocuteur à une
large responsabilité.
1.4.6 Indépendante à un temps autre que la forme
en (rais), indépendante exprimant
l'ordre :
e
comme déjà admis par l'interlocuteur. Une
fois, le cadre admis, l'interlocuteur se
trouve obligé d'accepter l'ordre. Donc, accepter
la logique du locuteur place
l'interlocuteur dans une position de faiblesse.
Nous pouvons substituer à une telle phrase une autre forme
:
« Puisque vous voulez venir, prenez le train »
L'interlocuteur est placé devant une double
interprétation possible qui dégage la
responsabilité du locuteur. Le choix de la variante
interrogative, fait que la pression
exercée sur l'interlocuteur est moins vive, mais
l'engagement du locuteur est donc
moindre.
Ex « Vous voulez venir, prenez le train »
La variante interrogative : «Vous voulez venir ? Prenez le
train »
La première de ces formes se rapproche de celle
déjà étudiée auparavant. Le
locuteur prive l'interlocuteur du repère
hypothétique « si » et se prive de la force de
la subordination. L'effet hypothétique n'est plus
suggéré ; l'effet jussif prend plus
d'importance.
La stratégie du locuteur présente le cadre
de la réalisation de la 2 proposition
1.4.6.1 Expression de l'ordre + et/ou + indicatif présent
ou futur :
Ex «pars, et je crie »

64
Ou
Ex « Pars, ou je crie »
Les deux formes correspondent, l'une à une
hypothèse positive et l'autre à une
hypothèse négative.
L'intérêt réside dans l'emploi de la
coordination puisque celle-ci place les deux
éléments sur le même plan
d'égalité.
L'emploi de la formule jussive dans le premier membre de la
phrase équivaut à une
véritable provocation. L'interlocuteur est mis en
demeure de ne pas accomplir ou
d'accomplir la réalisation. Le locuteur a choisi
une stratégie discursive très
contraignante pour l'interlocuteur. Une telle formule
engagement extrême du locuteur.
apparaît
comme un
1.4.7 Les structures homonymes des structures
hypothétiques :
Nous rencontrons des phrases homonymes à des
phrases hypothétiques. Pour
cela nous allons donner des exemples pour mieux les expliciter :
Ex « Si l'effort est grand, au moins ne doit-il pas
être long » (Laclos)
Nous pouvons lui substituer une autre phrase :
Ex «L'effort est grand mais il ne doit pas être long
»
Disparition des contraintes syntaxiques de « si » avec
possibilité d'emploi du futur
ou du conditionnel :
Ex «Si l'effort sera grand, au moins ne devra-t' il pas
être long »
Ce qui est intéressant dans ce cadre, c'est que le
locuteur utilise l'illusion d'avoir
imaginé pour « q » un cadre de
réalisation « si p ». Mais dans son esprit, la formule
utilisée ne laisse subsister aucune place à une
quelconque hypothèse. Il s'agit de la
part du locuteur d'un refus d'asserter « p » et
d'un refus d'engagement dans le
domaine thétique.
Dans les deux cas, c'est à l'interlocuteur
de prendre la responsabilité de
l'interprétation, ce qui laisse au locuteur une marge de
manoeuvre ou repli.

65
1.5
Point de vue de C. Wimmer et H. Vairel :
(Nous ne connaissons pas de grandes thèses comparables
à celle de Wagner
et ceci ne doit pas laisser croire que les linguistes se
désintéressent de la question
des hypothétiques. Un colloque sur la question s'est tenu
le 5 décembre 1981 à la
Sorbonne. Les communications présentées ont
montré qu'il reste beaucoup à dire
sur ce sujet. Pour ce qui concerne l'hypothèse, en
français, nous résumerons deux
articles dont le premier est issu d'une communication faite par
C.Wimmer et dont le
second a fait l'objet d'une publication juste après, par
H.Vairel.
1.5.1 Point de vue de C. Wimmer :
Elle tente de dégager le sens de la conjonction « SI
". Elle montre dans un
premier temps que par « si p » (= si+ prop.
Hypothétique), le locuteur construit un
imaginaire et elle distingue ensuite trois points :
1.5.1.1 « Si p » annonce une énonciation «
q » bornée dans sa portée par « p ».
L'événement « q » dépend de la
réalisation de « p » :
Ex « Nous irons dans les Vosges s'il fait beau
».(= c'est s'il fait beau que
nous irons dans les vosges)
Sans être marquée linguistiquement, une
différence sémantique peut apparaître
(Nous irons dans les Vosges pas au cinéma). Le
contenu de « q » est pris en
charge.
- L'événement peut ne pas dépendre de
la réalisation de « p », mais prendre sa
valeur informative dans le cas de cette réalisation.
Ex « Si tu as soif, il y a de la bière au
réfrigérateur ».
1.5.1.2 «Si » sélectionne une face de
l'événement :
Certaines constructions hypothétiques sans « si
» montrent un événement « q » qui
se réalisera dans tous les cas.
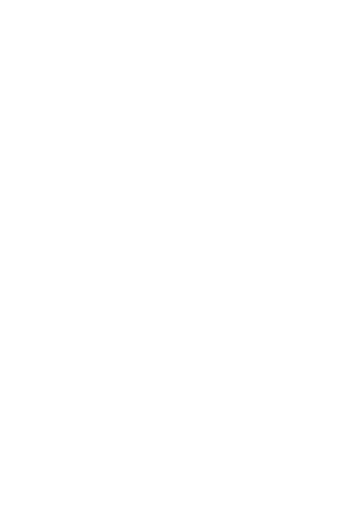
66
Ex « Qu'on l'accepte ou non, il s'imposera ».
Au contraire, « si p sélectionne une face de
l'événement et exclut la considération
de la face opposée » et « S'il vient ou s'il
téléphone, nous lui dirons que. »
1.5.1.3 La dualité du contenu « si p » :
Si p a un double contenu.
1.5.1.3.1 - la face de l'événement retenu
1.5.1.3.2 - son caractère imaginaire
Ex « Si tu viens à la réunion, dis-le moi
»
Le reste traite de problème des temps qui nous a paru
moins important que ce que
nous avons énoncé.
1.5.2 Point de vue de H.Vairel :
(Les phrases conditionnelles hypothétiques en
français : la valeur de (Si A,
B).
« Si » a deux valeurs :
- Une valeur hypothétique qui ne met en cause que la
subordonnée « Si A ».
- Une valeur conditionnelle qui met en cause la phrase « Si
A, B »
1.5.2.1
La valeur hypothétique de « si » dans « Si
A » :
« Dans un énoncé assertif, le locuteur donne
comme réelle la situation dénotée »
Ex : «Il pleut »
« Dans la conditionnelle, il suppose la
réalité de la situation A »
Dans l'exemple « Il pleut », la marque est
l'intonation. Dans l'énoncé conditionnel, la
marque est « si » « La subordonnée
conditionnelle apporte une valeur plus générale
de non position de la réalité A». (Il en va de
même pour les énoncés interrogatifs et
jussifs, ce qui explique leur substitution possible à la
subordonnée hypothétique).
L'emploi de l'indicatif (Mode de
l'énoncé) « conçu comme réel »
dans les
conditionnelles, ne pose pas de problème : La
réalité est posée dans l'assertion, et
elle est supposée dans les conditionnelles. Le
problème de si A « non
hypothétique » est donné par l'auteur
comme « un mirage ». Pour l'auteur, Si A
exprime toujours la supposition de la réalité
de la situation dénotée ». La valeur

67
particulière de telle ou telle phrase peut nous
être fournie par des «facteurs
contextuels externes ou internes à la phrase ».
1.5.2.2 Facteurs externes :
Ex : « S'il n'aime que peu la compagnie des hommes, il aura
du mal à vivre
avec cette équipe»
Si le contexte n'indique rien sur le caractère du
personnage, la phrase sera perçue
comme hypothétique. Mais, si le contexte indique
« qu'il n'aime que peu les
hommes », la phrase sera perçue comme non
hypothétique. Dans les deux cas, la
situation dénotée est problématique au plan
de l'expression.
1.5.2.3
Facteurs internes :
En général, dans ce cas, le locuteur évite
de poser une situation dénotée, soit
qu'il ne l'admet pas, soit qu'il veut mettre l'accent
sur la cause plutôt que sur la
réalité dénotée.
Ex : s'il n'aime pas la compagnie des hommes c'est qu'il a
souffert beaucoup
des siens.
1.5.2.2.1 La valeur conditionnelle de « si A, B » :
La valeur conditionnelle concerne l'ensemble « Si A, B
». Dans la plupart des cas
« la réalisation de la situation A, que l'on suppose,
est donnée comme condition de
la réalisation de la situation B », mais il est des
cas où cette définition ne convient
pas.
Ex « S'il est venu hier, je n'étais pas à la
maison ».
Avec Ducrot, l'auteur admet que la valeur fondamentale d'une
proposition de type
« Si p,q » est de permettre la réalisation
successive de deux actes illocutoires.
1.5.2.2.2 Demander à l'auditeur d'imaginer P
1.5.2.2.3 une fois le dialogue introduit dans cette
situation imaginaire, y affirmer
« q ».
1.5.2.2.4 La supposition de la réalité de la
situation A est condition de l'énonciation
de B.

68
L'étude de ces deux articles montre bien que les auteurs
n'essaient pas d'utiliser le
vieil outillage latin. Les deux auteurs tentent d'aller de la
langue vers la pensée. Ils
n'hésitent pas à explorer l'aspect
sémantique de la question que les anciens
mettaient, en général, de côté.
Ils apportent un plus à la compréhension de
l'hypothèse et peuvent certainement permettre aux
enseignants de clarifier le sens
que revêtent certaines phrases hypothétiques.
Conclusion :
Les analyses présentées précédemment
témoignent non seulement
de la difficulté de classer les phrases
hypothétiques, mais encore de les interpréter.
Les analyses traditionnelles de type sémantique
n'avaient pu dégager les
grammaires de certaines notions reprises à la grammaire
latine, notamment, celles
de « réel, irréel, éventuel, potentiel
» qui servent à compléter la situation syntactico-
sémantique qui est déjà très
enchevêtrée.
La grammaire « le bon usage » montre le
véritable fouillis grammatical auquel son
auteur, pourtant jouissant d'une forte réputation, a
abouti.
Les deux autres auteurs, avec plus ou moins de bonheur
pédagogique, donnent
d'excellentes descriptions syntaxiques des phrases
hypothétiques. Mais ils ne
répondent pas aux questions que nous nous posons, à
savoir :
- Quel sens donnent-ils «à faire une
hypothèse ? »
- Les différentes façons de construire
l'hypothèse, ont- elles la même
signification ?
La réponse à la première de ces questions
est parfois effleurée, et les auteurs s'en
tirent généralement par la mise en
évidence d'un rapport de conséquence à
l'intérieur de la phrase hypothétique.
grammaires ne la posent même pas.
Quant à la deuxième
question, les
1.5.2.4
Point de vue de R. L. Wagner :
Ce dernier
a aidé à nous faire saisir la
systématisation de plus en plus
évidente de l'expression de l'hypothèse en
français. Au cours de son évolution, la
langue s'est forgée un outil de plus en plus
équilibré pour exprimer l'hypothèse.
Nous espérons avoir montré dans nos analyses que le
choix par le locuteur d'une
structure ou d'une autre n'est jamais neutre, mais il
correspond à une stratégie
discursive.

69
Le démontage des mécanismes de l'hypothèse
n'est certainement pas une preuve
qu'elle soit totalement consciente.
L'hypothèse peut être dite entièrement
ou seulement suggérée par un faisceau
d'indices plus ou moins important, dont le principal
est « si ». Ces marques
linguistiques manifestent l'hypothèse d'une
certaine manière, sans la faire
reconnaître à coup sûr. La subordination
, la présence de « si », les formes « en
rais », ne produisent pas à elles seules le sens
hypothétique, mais tout le système à
qui nous pouvons substituer un autre système ( Si p, q)
est apte à le faire. L'effet de
sens réside dans le rapport contrainte/engagement dans la
réalisation du système
devant être décodé par l'interlocuteur
qui replacerait les nuances de pensées du
locuteur, tout en découvrant sa stratégie
discursive.
1.6 Fonctionnement de l'hypothèse en arabe, langue
nationale, en arabe algérien et
en Tamazight :
1.6.1 L'arabe, langue nationale:
L'arabe ne parvient à exprimer l'hypothèse que
par le recours à la phrase
double. Par contre, le français fait appel à
la phrase complexe, renfermant une
subordonnée et une principale.
En arabe, les deux propositions formant la phrase double
sont plutôt juxtaposées
que liées et « c'est leur rapprochement même
qui aboutit à l'expression exacte et
particulière de la pensée » [26]
1.6.1.1
énoncer un « éventuel » :
Plus ou moins accompagné de la nuance circonstancielle :
/ indama ja'ti a'lamuni /
« Dès qu'il viendra, dites- le moi »
Ou la nuance hypothétique :
[wAlAw ja'lnAhUmAlikUn lA ja'lnAhU rAsUlAn]
« et si nous en avions fait un ange, nous l'aurions
fait (en forme) d'homme»
(cor.VI.9)
1.6.1.2 Enoncer un « hypothétique
réel :

70
[lAwd°ahAbtUtAtbaU'ni]
« Si je pars, tu me suivras »
Douteux
[lAw d°AhabtU satAtbAUni]
« Si je partais, tu me suivrais »
«Irréalisé»
[lAw d°ahAbtU lA tAbi'tUni]
« Si j'étais parti, tu m'aurais suivi »
La phrase double est formée de la protase exprimant
l'éventuel ou « l'hypothétique »
et une autre appelée apodose, renfermant la réponse
à la protase.
Ex : wAkUntUid°alqaJtUAlimAnAxad°tUminhU]
« Quand je rencontrais un savant, j'apprendrais de lui
»
Nous retrouvons la particule « i'nn » « si
» (négatif/i'lla/ ( si ne pas), servent à
exprimer un hypothétique réalisable [27]
Ex : [intAma'aaléJAilmawAatbAkAUfd°ahU]
« Si tu joins contre moi la maladie au reproche,
j'en serai accablé » (exemple
emprunté à Reckendorf, synt )
Ex:
[inlAmtAslUValéJAt°iJAbèkasAlAVAtaléJAdAnAnirAkA]
« si tes vêtements ne me conviennent pas, tes dinars
me conviennent » (Ag.III,47)
Ex : [inaradtAanUHArikahUm lAm amAn d°ararahUm]
« Si je désire m'associer à eux, je ne
serai pas à l'abri de leur malfaisance. »
(Jâh.73).
Il n'est pas impossible au surplus que cette
évolution soit aussi l'indice d'une
dégradation de la notion de temps [28]. Ce qui tendrait
à le montrer c'est l'apparition
de l'exposant temporel /kana/ /jakunu/ quand on veut
marquer que l'éventuel ou
l'hypothétique se situe dans le passé :
[inkUntahAwaltahawAAnAfAmAhUntU]
« Si tu as recherché l'avanie [pour moi], je ne suis
pas humilié »

71
[inkUntajé'taHAfi'AnfAbèJtiharAmUnaléJkA]
« Si tu es venu en intercesseur, ma demeure t'est interdite
» (Zaff.219)
Dans toutes ces phrases doubles, la protase est introduite par la
particule « ida » ou
« idan » :
1.6.1.3 L'adverbe :
« ida » ou « idan » qui peut être rendu
par les expressions françaises : (alors,
donc, en conséquence) s'emploie fréquemment
dans les phrases doubles avec
« In» ou «law»
Ex : [intUsibhUm mUsibAtUnsAJatUnid°AnhUmJAqnAtUn]
« Si un malheur les frappe, alors ils se
désespèrent » Cor.XXX, 36.
Ex [lAwkAnAma'ahUAlihatUnid°AnlAabtAqUilAd°iArHi]
« si avec lui étaient [d'autres]
divinités, elles désireraient [accéder] alors
jusqu'au
maître du trône. (Co.XVII,44)
1.6.1.4 - parfois « idan » :
Qu'on pourrait rendre en français par sans quoi,
sinon, semble s'être substitué à la
protase.
Ex :
[mAtAxAd°AAlAhminwAlAdinid°AnlAd°AhAbAkUlUnilAJhi
bimAxAlAqA]
« Allah ne s'est donné aucun fils, sans quoi
(c'est-à-dire : s'il l'avait fait ), chaque
divinité eût emmené ce qu'elle avait
créé » (Cor XXIII,91)
On aurait une protase avec « law »
Ex : [lAtaq'UdUma'ahUminahUmid°anmit°lAhUm]
« Ne prenez pas place avec eux ! Sinon (c-à-d : si
vous faites) vous serez comme
eux. » (Cor.IV, 140).
Dans ce cas nous aurions une protase avec « In ».
1.6.2 Arabe algérien
(l'algérien) :
Nous distinguons deux formes de conditionnel.

72
1.6.2.1 conditionnels possible :
Nous appelons ainsi le temps du conditionnel quand l'action a la
possibilité de
se réaliser. Dans ce cas précis, L'action
n'est pas contraire à la réalité, nous
utilisons /ida/. Le temps employé est
généralement l'accompli. Il est employé dans
les deux propositions
/Iða sket kunruhtfiha/
« Si tu te taisais, tu serais condamné »
1.6.2.2 Le conditionnel impossible :
En général, l'action est contraire à la
réalité.
Les propositions hypothétiques à cette forme sont
introduites par la particule /Kun/.
Cette forme de conditionnel ne fait pas la différence
entre la forme du conditionnel
passé et la forme du conditionnel à l'irréel
du présent.
Ex/ kûn txalef smna ns ihk/
« si tu retardais d'une semaine, je te la préparerais
»
1.6.2.3 Les hypothétiques
coordonnées :
[id°AkUntxdAmtUhAtAJtra'sAklilxdmAkUnrAkt'Almat]
« Si tu avais travaillé et que tu aies
persévéré, tu aurais appris »
Dans l'exemple en arabe, nous utilisons /W/ qui est une
conjonction de coordination
et /kun/ qui est la subjonction équivalente
à « si », laquelle n'a pas été
répétée
dans la seconde proposition puisque nous avons utilisé un
auxiliaire /rak/.
Habituellement, /kun/ se répète dans la seconde
proposition [29], chose que montre
l'exemple ci-dessous :
/kunit lbarah kun lgitni lahna wa djt ma thab/
« Si tu étais venu hier, tu m'aurais trouvé et
tu aurais pris ce que tu voulais »
Les trois verbes sont à l'accompli. /kun/, dans ce cas
exprime l'irréel du passé, car
il s'agit d'une supposition qui ne s'est pas
réalisée.
Lorsque le verbe de la protase est à l'inaccompli ainsi
que celui de l'apodose, dans
ce type de construction, /kun/ sert à marquer l'expression
du potentiel.
-/lukan/
Ex : [lUkAnJAbA't°ntAAddintA'ak]

73
« S'il en envoyait, toi prends le tien»
-/lakan/
Ex : [lAkanmAjAbtHirUbètoxraJnnAxd°lviolé]
« Si elle n'apporte pas d'autres robes, je garderai la
violette»
-/kan/
Ex : [kAnhiJAarid°AbezzAfzidnAqsAlhA]
« Si elle est trop large, retaille-là »
Tous ces exemples donnés servent à exprimer
l'expression du potentiel.
1.6.3 Tamazight :
En berbère comme en arabe, la différence entre les
hypothétiques est donnée
par l'utilisation de subjonctions différentes.
1.6.3.1 Certaines subjonctions utilisées en
Tamazight :
Le dictionnaire de Tamazight, dans son article « si »
donne plusieurs formes
de particules susceptibles de traduire la subjonction « si
», nous citerons certaines
d'entre elles : (ma - im (imm))
Ex : [mAJasgAddmAJlax]
«S'il en envoyait, toi prends le tien »
1.6.3.2 Le conditionnel :
1.6.3.2.1 Le prétérit
précédé de /mer/ «si » :
IL exprime l'imparfait quand le verbe dépendant de la
proposition conditionnelle est
au futur. Il correspond alors au conditionnel présent (ou
futur) de la langue française.
Ex : lémUrUgAd°xArArabiAkéssaxnUnsAq am AkzUn]
« SI je ne craignais Dieu, je te réduirais en natte
où se vautre le chien ! »

74
Remarque : Prenons l'exemple ci-dessous où nous retrouvons
/ad/ expression qui
par tradition marque le futur dans la langue tamazight.
Mais les travaux les plus
récents hésitent encore entre l'aspect et
modalisation (Bentolila, 1981). Il est certain
que ce morphème, en fonction des contextes et des
conditions d'énonciation,
recouvre des valeurs très diverses. Pour plus
d'information, nous citerons deux
exemples dans lesquels /ad/ indique, tantôt la
valeur future, tantôt la valeur
aspectuelle.
-Valeur temporelle « futur »
[Ad°JAwAd AzkA]
« Il arrivera demain »
-Valeur aspectuelle « virtuelle » ou
générale
[éksAsanzAdAnsinakingéragwlimdizzit]
« On enlève les poils et on plonge la peau dans
l'huile »
1.6.3.3 Phrases hypothétiques
commençant par la subjonction /ma/ - /m/ - /kan/ -
/lokan/ - /nkan/ :
En général, ces trois dernières
subjonctions, ci-dessus mentionnées, sont
empruntées à l'arabe et elles sont souvent
utilisées par les Chleuhs du Maroc)
[mérat_tésHédatimGUréd°]
« Si tu manges, tu grandiras »
Ou
[lUkAnatsawdAd°rimAtébnUd°_AxxAm]
« Si tu as de l'argent, tu construiras »
1.6.3.4. Phrases hypothétiques commençant par la
subjonction /limar/ - /tili/ et /mer/:
Ex :
[lémmératsawédd°d°rim-id°rimén-JUlli
ataNédAxxAm]
« Si tu avais de l'argent, tu achèterais une belle
maison » [30]
[lémmér itébhéd°Jalli
ak-téG]

75
« Si tu étais beau, elle t'épouserait »
[lémmérttaNawsa
UrnUNd°imarAJAlliak-héssi]
«Si c'étais quelque chose d'injuste , je vous
écouterais »
On constate d'emblée que la subjonction /ma/
entraîne le présent ou futur,
l'utilisation de /limar/ -/tili/, amènerait le
conditionnel présent et l'utilisation de /mer/
appellerait le conditionnel passé.
1.7 Etude des Circulaires et des manuels du deuxième
palier de l'école
fondamentale :
1.7.1 Les circulaires :
La circulaire N°10/D.E./20/84 du 28 Février 1984, de
M. Le Ministre propose
en objectif: la mise en application de l'école
fondamentale Polytechnique pour la
rentrée scolaire 1984-1985. Il est dit : de nouvelles
dispositions visant à poursuivre
et à renforcer au cours de cette deuxième
année du cycle les objectifs relatifs à
l'exploration du milieu naturel, social et technologique sont
arrêtées.
« Il s 'agit d'entraîner progressivement
l'élève à utiliser l'écrit et ses
propriétés, à des
fins de communication. L'apprentissage du code écrit
sera, à cet effet, organisé de
manière systématique :
Transfert à l'écrit des productions orales
Utilisation de l'écrit comme mode de
communication premier, sans passer par la
médiation de l'oral »
Donc s'agit-il d'un oral écrit ou tout simplement d'un
écrit dont les difficultés sont
e
abordables. Dans le programme de conjugaison de 5 année
primaire, il est dit :
- « systématiser les temps de la conjugaison
étudiés en 4 année : Présent, futur,
passé composé (choix de l'auxiliaire de
conjugaison),
- poursuivre l'étude de l'imparfait et du subjonctif
présent,
- et introduire les formes simples du conditionnel
présent. »
e

76
L'exemple ci-dessous est donné pour la phrase
circonstancielle de condition avec
si: « Tu auras un vélo, si tu travailles
bien. »
Et pour la phrase circonstancielle de supposition avec si :
« Tu ne sortiras pas s'il pleut »
Cette circulaire de l'année 1984-1985, a été
reprise en 1994 avec une autre vision :
il s'agit de mettre en place certaines
compétences visées : en conjugaison-
grammaire, il est spécifié ceci :
Distinguer les différents types de phrases dans leur
globalité
- transformer une phrase à la forme négative
- distinguer et identifier les éléments d'une
phrase à deux ou trois constituants
- appliquer les règles d'accord dans le groupe
nominal et la relation sujet-verbe
- en conjugaison : situer les différents moments d'un
récit sur l'axe des temps ;
- manipuler les formes verbales liées au moment
où l'on parle.
Dans le programme même, il s'agit du conditionnel et non de
l'hypothèse, mais au
niveau de l'exemple donné, il y aurait l'étude de
l'hypothèse en tant que condition et
en tant que supposition. Or, l'hypothèse en tant que
telle n'est pas prise en charge
par les programmes donnés. Il y a là, donc, une
divergence difficile à expliquer.
1.7.2 Analyse des documents scolaires du 2 palier :
e
Les documents scolaires comprennent les livres des enseignants et
les livres
des élèves : Les livres des
élèves sont au nombre d'un livre par discipline et par
niveau. Les professeurs reçoivent en
général, un livre renfermant les fiches
pédagogiques préparées. En effet, ces
documents ont été inventés par l'I.P.N à un
moment où la formation des enseignants faisait cruellement
défaut. Les enseignants
étaient recrutés par les Directions
départementales de l'éducation nationale. La
formation dispensée, à l'époque, ne
concernait que quelques enseignants dont le
niveau était parfois très faible. Pour
suppléer au manque flagrant d'enseignants et
surtout, pour faire face à une population scolaire
énorme, le Ministère a décidé de
former les jeunes du niveau du baccalauréat en une
année et de les envoyer en
classe. Ce n'est que plus tard qu'il a commencé à
rallonger le temps de formation.
C'est pourquoi, actuellement, Le Ministère rejette la
faiblesse de ces élèves sur les
enseignants formés hâtivement.

77
1.7.2.1 Analyse des livres :
L'analyse des documents de la quatrième année
primaire :
Il y a deux livres, le premier est fait pour
l'élève et le second, pour l'enseignant. Tous
les deux ont été confectionnés durant
l'année 1983 - 1984, par une équipe
pédagogique constituée d'un Inspecteur
d'éducation et de formation, d'un inspecteur
de l'enseignement élémentaire, de deux
directeurs d'écoles primaires et de deux
enseignants.
Le premier livre (livre de l'élève) comprend
l'enseignement de la lecture, avec
possibilité de s'exercer à l'écriture.
Le second livre (livre du maître) comprend une série
de leçons effectuées par cette
équipe. Ce livre prend en charge toutes les leçons
de l'oral et de l'écrit. Ces livres
furent créés, au moment où la langue
française figurait au programme de la
troisième année primaire.
En quatrième année primaire,
l'élève était censé savoir lire et
écrire, ce qui a
26
poussé l'équipe pédagogique à
prévoir l'expression de l'hypothèse en fin d'année
scolaire : elle se trouve au dossier 30, c'est-à-dire le
dernier dossier de la quatrième
année primaire. D'ailleurs, ces livres sont restés,
jusqu'à l'heure actuelle en usage
dans les écoles : aucun changement n'a
été apporté à ces derniers pour montrer
l'intérêt qu'on leur porte.
Il est prévu certains exercices à faire
répéter par les élèves d'une manière quasi -
automatique :
« Si tu travailles bien, tu auras un vélo
»
Il est dit : « dire en insistant »
Ensuite, il est demandé à l'enseignant de reprendre
cette même structure à la forme
négative :
« Si tu ne travailles pas bien, tu n'auras pas de
vélo ».
Autour de ce modèle, s'organise toute la conjugaison du
futur, celle du présent de
l'indicatif, et celle du conditionnel présent.
Sur le livre du maître, une saynète met en
évidence tout le travail qu'il faudrait faire
pour parvenir à l'étude de ce futur :(Les
structures les plus courantes des temps ci-
dessus donnés sont affichées dès les
premières leçons)
Ex : Papa tu m'achèteras un vélo ?
Oui, si tu travailles bien.
La réplique :
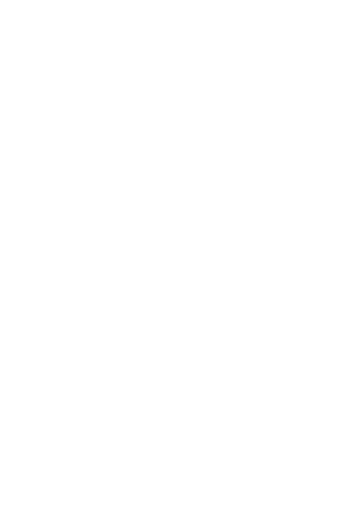
78
Et si je ne travaille pas bien.
27
Alors, tu n'auras rien
Il est demandé à l'enseignant d'entreprendre la
conjugaison du présent de l'indicatif
du verbe avoir, suivie de la conjugaison de ce
même verbe au futur simple de
l'indicatif. Ce travail est suivi d'une série
d'exercices pour renforcer cet
apprentissage de la conjugaison. Cet apprentissage dure une
vingtaine de minutes
à peu près. L'exemple ci-dessous le montre
convenablement :
Le maître donne la forme affirmative, les
élèves lui répondent par la forme négative
Consigne : J'aurai
.......................................................je n'aurai pas
28
Le travail apparaît tout à fait normal,
comme s'il s'agissait d'une langue
maternelle de l'enfant. Or, nous savons que l'expression de
l'hypothèse exige de
l'enfant la possibilité de pouvoir raisonner,
d'être capable d'analyse et d'être
e
capable d'abstraction. Pourtant, dans la classe de
4 A, l'enfant est âgé
sensiblement de 8 à 9 ans. Piaget et de Wallon
n'attribuent à l'enfant ce pouvoir
de raisonnement ou cette vertu qu'à l'âge de 11 ou
12 ans.
1.7.2.2 Les exercices proposés aux élèves
Les exercices proposés aux élèves ne sont
pas en adéquation avec la théorie
pédagogique proposée. Leur choix n'est pas
justifié et n'apporte aucune joie aux
enfants. Les difficultés qu'ils drainent sont assez
complexes pour ces jeunes élèves
et ne sont pas planifiées en fonction de leur âge
pour leur permettre de les effectuer
d'une manière graduelle en vue d'obtenir de bons
résultats.
Donc, l'apprentissage à base de
répétition a bien montré ses limites : le
renforcement par le système de répétition
permet, certes, à l'enfant d'apprendre par
coeur certaines formes verbales, mais il ne serait
point capable d'analyser, de
réfléchir et d'étendre son apprentissage
à une utilisation rationnelle lui permettant
d'entretenir un dialogue logique avec d'autres personnes.
1.7.3 L'expression de l'hypothèse dans les programmes de
quatrième année:
L'expression de l'hypothèse du type « Si +
présent ....futur de l'indicatif est
prise en charge par les apprentissages à l'oral,
d'abord et ensuite à l'écrit par le
biais d'exercices à effectuer en classe. C'est dans
la leçon de langage que les
automatismes de l'expression de l'hypothèse sont assez
bien entretenus. Nous les
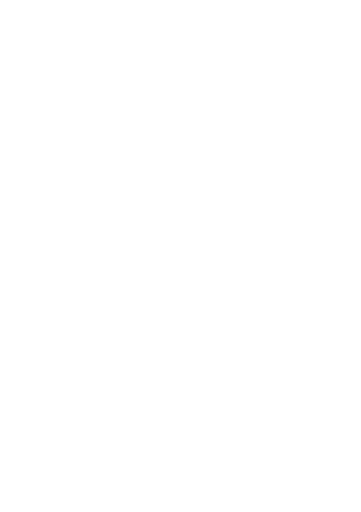
79
découvrons dans certaines lectures, mais ils ne
sont pas expliqués correctement.
L 'expression de l'hypothèse apparaît sous deux
formes : (si + présent, présent ou
encore : si + présent, futur).
29
Ex « si j'ai de l'argent, j'achète une
automobile »
L'expression de l'hypothèse est injectée
dans le langage courant du quotidien
sans éveiller la curiosité de l'apprenant sur sa
composition ou sur sa formation. Les
temps (présent, futur) sont utilisés au cours de
cette période d'apprentissage, d'une
manière automatique. Il s'agit donc d'un dressage
plutôt que d'un apprentissage.
Le conditionnel est absent durant cette phase d'apprentissage.
Parfois, il apparaît
dans certains textes donnés en fin de livre pour servir
de comptines que les élèves
doivent apprendre par coeur les temps sont extraits d'une phrase
ou d'un texte et
sont appris mécaniquement par les élèves .
Les valeurs ne font pas l'objet d'étude.
Parfois, les enseignants les voient rapidement pour
sensibiliser les élèves à leur
connaissance. On a souvent affirmé qu' « un
apprentissage systématique fondé
sur l'exploration intuitive
fonctions de la langue
des structures
de textes correspondant à diverses
écrite, peut, par une action continue ,
à long terme,
contribuer à réduire de manière
significative
devant l'écrit »
30
Conclusion :
L'apprentissage de l'expression de l'hypothèse
les inégalités d'ordre socioculturel
dans pareils cas
est
31
dont il faudrait faire l'apprentissage. En effet, la
quatrième année primaire, pour le
moment, est une classe où l'élève doit
apprendre à lire, et à écrire, avant tout.
L'apprentissage d'un point de langue tel que celui de
l'expression de l'hypothèse ne
peut être jugé important pour cette classe. Donc,
ce que nous voyons dans cette
classe ne peut provenir que de l'ancien programme où
la langue française était
enseignée à partir de la deuxième ou de la
troisième année.
inopérant. Toutefois, le programme ne
l'énonce pas comme un point de langue
1.7.4 Analyse des livres de la cinquième année
primaire :
e
durant l'année scolaire 1984-1985, par L'I.P.N.
Ils présentent l'expression de
l'hypothèse comme modèle d'expression
orale, en donnant la condition et
l'éventualité comme suit :
Les programmes de ce cours (5 année primaire)
ont été confectionnés

80
-« Tu réussiras si tu travailles bien »
«Si la pluie ne s'arrête pas, nous ne pourrons
pas sortir »
Il en résulte que les concepteurs de fiches
prévoient la structure
« Si ...+ ..... présent.....................
futur, comme seule structure d' apprentissage
pour ce niveau.
Cette structure apparaît au dossier N°24 dans
la séquence N°1. Elle figure au
niveau de la saynète ci-dessous :
Karim - Avec mes patins, je vais plus vite que toi !
Samia - je vais plus vite que toi, avec ma bicyclette
Karim et Samia - (en même temps) : faisons la course !
Karim - Tu me prêteras ta bicyclette si je gagne ?
Samia - Et toi, tu me prêteras tes patins, si je gagne
?
La reprise et la répétition de cette
saynète permettront à l'enfant d'acquérir la
structure (Si + présent, futur), d'une manière
intuitive. Le travail sur cette saynète
vise plus l'apprentissage des temps (présent, futur) que
la structure de l'expression
de l'hypothèse. A la suite de cette
séquence, d'autres viendront pour mettre en
valeur l'apprentissage du futur, en tant que temps. Cette
modalité (futur) est alors
retirée de son contexte et conjuguée d'une
manière systématique. Ce temps est
intériorisé intuitivement par les
élèves. Les exercices donnés à la suite de
cette
modalité ne portent que sur cette dernière. Elle
n'est pas perçue à l'intérieur d'un
texte ni même à l'intérieur de
l'expression de l'hypothèse, mais elle est donnée
dans de courtes phrases où les verbes sont souvent mis
à l'infinitif et l'on invite les
apprenants à les mettre au futur simple. L'expression de
l'hypothèse devient alors
un prétexte à l'étude de la modalité
du futur. Nous en concluons que l'expression de
l'hypothèse n'est pas saisie comme un
modèle d'expression orale, mais juste
comme un moyen pour faire apprendre la modalité verbale.
Nous ne retrouvons pas d'explication montrant le
fonctionnement de l'hypothèse
dans tous les manuels de cette classe, mais, nous retrouvons un
exercice qui porte
32
sur le futur .
Elle est utilisée à l'oral seulement : en
lecture , et dans certaines séances
33
d'expression orale.
L'expression de l'hypothèse est donnée à
l'oral t le travail d'assimilation s'effectue
d'une manière normale. ,Le travail est donc de type
Pavlovien.
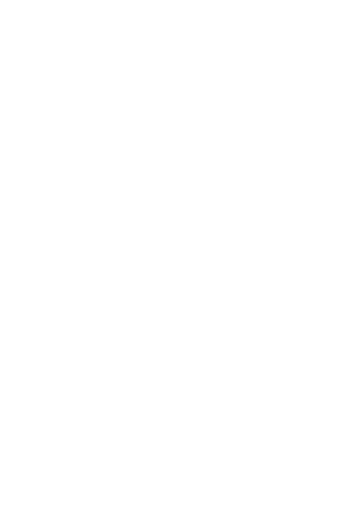
81
L'apprenant subit donc un véritable bombardement
d'expressions et de formules
creuses et on lui demande d'intérioriser l'expression de
l'hypothèse, en espérant que
plus tard, il en prendra conscience.
Actuellement, le système pavlovien
découverte du savoir par soi -même.
est partout décrié
et remplacé par la
Le livre de 5 année nous présente à
travers ces différentes lectures plusieurs
e
formes d'expression de l'hypothèse.
A la séquence N°3 du même dossier,
nous retrouvons une autre saynète qui
convoque la modalité du futur en utilisant cette
fois-ci la subjonction « quand »,
donnée avec la valeur de « si ». Donc,
il n'y a pas une suite logique dans
l'apprentissage de l'hypothèse. L'intérêt de
cette saynète, c'est de faire apprendre à
l'élève la modalité du futur.
Salim : - dit grand-père, qu'est-ce que tu cherches ?
Grand-père : - je guette la nouvelle lune.
Salim : - la nouvelle lune ?
Grand- père : - Oui ! Elle annonce le ramadan
Mansour : le croissant est tellement fin qu'il faut de bons
yeux pour le voir
Salim : - quand il fera nuit, nous la verrons mieux !
La dernière phrase de la saynète prend en charge la
modalité du futur en utilisant la
subjonction « quand ».
Si l'expression de l'hypothèse était
présente dans la première saynète, dans la
seconde, nous ne retrouvons que la modalité du
futur qu'il faudrait inculquer aux
élèves.
Nous sommes en droit d'affirmer que l'expression de
l'hypothèse ne figure pas dans
ces fiches en tant que telle, mais elle sert seulement de «
véhicule »à la modalité du
futur.
L'enseignant ne considère pas comme point de langue,
l'expression de l'hypothèse,
mais il ne la considère que comme prétexte pour
faire apprendre la modalité du
futur aux élèves. Les verbes « avoir »,
« aller », et « être » sont alors utilisés
pour
renforcer l'apprentissage de cette modalité.
L'étude de l'hypothèse prévue par les
programmes est conçue selon la
double possibilité « condition » et
« éventualité » ; au niveau de la
réalisation de ce dernier, nous ne retrouvons que
l'application de la modalité du futur. Doit - on
comprendre que les concepteurs des
fiches ont fini par réagir à la psychologie qui
fait remarquer que l'enfant dont l'âge

82
est inférieur à 12/13 ans ne peut saisir le
fonctionnement de l'hypothèse, parce qu'il
ne peut conceptualiser et ne peut faire de l'abstraction. A 10
ans, l'enfant ne peut
saisir ces mécanismes qui l'obligent à faire des
abstractions. Il est donc conseillé de
retarder cet enseignement jusqu'à ce que l'enfant
atteigne l'âge requis. L'âge
conseillé serait celui de 12/13 ans. A cet
âge, les enfants ont déjà dépassé le
concret et peuvent facilement accéder à la
conceptualisation. C'est déjà « l'âge des
opérations propositionnelles. »
34
Ils parviennent à se dégager du concret et
à
situer le réel dans un ensemble de transformations
possibles.
C'est le moment de la transformation de la pensée rendant
possibles le maniement
des hypothèses et le raisonnement sur des
propositions détachées de la
construction concrète et actuelle.
En général, le sujet est en mesure de juger des
propositions auxquelles, il ne croit
pas ou qu'il considère comme de simples hypothèses
pures. C'est la période de la
pensée formelle ou hypothético - déductive.
Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'enfant
est en mesure de comprendre
l'expression de l'hypothèse. Donc, le moment de
l'apprentissage de l'expression de
l'hypothèse est bien venu.
1.7.5 Analyse des documents de la sixième année
primaire :
1.7.5.1 Analyse du contenu du livre de l'élève :
Dans cette classe, le programme de français est
donné en 19 dossiers. Nous
remarquons que l'expression de l'hypothèse
apparaît dès la première leçon,
notamment, à l'expression écrite sous forme de
début de phrases à compléter par
l'élève :
« Si j'ai chaud, ..
Si j'ai froid,. »
A la troisième séance du premier
dossier de la 6eme année élémentaire,
l'expression de l'hypothèse apparaît sous la forme
de la structure suivante :
« Si +présent de l'indicatif présent de
l'indicatif »
Cette structure a fait son apparition à plusieurs niveaux,
et notamment au niveau de
l'exercice. Un membre de la phrase est donné et le second
est à rechercher par le
candidat pour la reconstitution des phrases du récit qu'il
vient de lire en séance de
lecture :

83
L'élève devra, en général se
remémorer le texte lu en classe. Il devra retrouver le
paragraphe ci-dessous : (S'agit-il donc d'une
mémorisation ou d'un apprentissage
conscient de l'expression de l'hypothèse ?)
« Si j'ai trop chaud, je monte ;
Si j'ai froid, je descends ;
Une montagne, je la dépasse ; ..etc. »
Cette partie du paragraphe a été tirée
du texte de lecture intitulé : « le docteur
Fergusson explique son projet ». Ce paragraphe a fait
l'objet d'une reconstitution de
texte avec les élèves. L'expression de
l'hypothèse est intériorisée implicitement.
Cette forme d'apprentissage nous montre bien que les relations
qui existent entre le
présent et le futur ou encore entre l'imparfait
et le conditionnel ne sont pas
totalement explicitées par les fiches du
maître et l'hypothèse en tant que fait de
pensée est loin de faire l'objet d'une explication
sûre et complète.
Il faut noter que les deux transformations (relation :
présent, futur ) et la relation
imparfait, conditionnel) mettent en évidence le fait que
les deux types de relations
n'évoluent point sur le même axe , mais sur deux
axes totalement différents : si la
relation (présent , futur ) évolue sur l'axe
des temps , la relation imparfait ,
conditionnel ) évoluera sur l'axe appelé
l'axe des modes
35
En effet, l'imparfait
appartenant au mode indicatif se joint au mode conditionnel pour
créer la structure
de l'expression de l'hypothèse.
1.7.5.2 Méthode de l'apprentissage de l'expression de
l'hypothèse dans cette classe :
En objectif, nous remarquons bien qu'il s'agit de l'étude
de la subjonction «si,
sinon ».
Le modèle type donné est :
« Si le vent se lève, le ballon repartira
» (hypothèse favorable)
« J'irai me promener s'il faut beau »
(déplacement de la subordonnée de
l'hypothèse)- les concepteurs de ces fiches ont bien
signalé entre parenthèses l'acte
à entreprendre.)
« S'ils ne trouvent pas d'eau, ils mourront de soif
» (hypothèse favorable)
« S'il fait beau, nous irons nous promener,
sinon, nous resterons à la
maison »
(Hypothèse défavorable exprimée par sinon)

84
C'est à partir de ces modèles que les instructions
pédagogiques recommandent à
l'enseignant d'amener l'élève à une saisie
complète de l'expression de l'hypothèse.
(Dossier 20, séance N°5)
C'est à partir de ce moment que l'apprentissage de
l'hypothèse apparaît plus clair et
mieux structuré :
Nous découvrons la structure :
« Si .+ Présent ..futur »
La seconde forme de l'expression de l'hypothèse,
c'est - à - dire, la forme en
«rais »n'apparaîtra qu'à la leçon
de conjugaison, intitulée : « le conditionnel »
La consigne donnée avance l'idée de «la
systématisation de la conjugaison des
verbes au présent du conditionnel » d'où
l'emploi du «si ».
Nous remarquons que l'intention avancée par les
concepteurs des fiches vise la
systématisation du présent du conditionnel. Ce qui
les intéresse, au premier plan,
c'est d'abord faire acquérir aux enfants le présent
du conditionnel. La vision de ces
concepteurs est portée d'abord sur le temps «le
conditionnel »avant qu'elle ne vise
l'hypothèse en tant que phénomène de
pensée.
En général, l'enseignant est presque contraint
à faire un détour par la cause
pour atteindre l'hypothèse. Nous donnons l'exemple
suivant pris dans le livre de
lecture :
« Je ne peux pas aller au stade parce que je n'ai pas
d'argent »
« J'irais au stade si j'avais de l'argent »
Désirant étudier le conditionnel, l'enseignant
fait appel à des phrases où l'on
rencontre l'hypothèse. Mais, ce n'est pas
l'hypothèse qui est au centre de cet
apprentissage, c'est plutôt le conditionnel en tant que
temps. L'hypothèse n'est là
que pour suggérer l'étude du
conditionnel. D'ailleurs, ce n'est que comme
introduction à cette étude du conditionnel qu'elle
est conviée.
Il s'agit pour chaque élève d'intérioriser
le temps qui est en relation avec l'expression
de l'hypothèse en usant de la subjonction «si
».
Nous retrouvons les deux formes de cette expression où les
temps du présent, de
l'imparfait, du futur et du conditionnel sont
étudiés.
«Si ..+ Présent de l'indicatif .futur de
l'indicatif »
« Si ..+Imparfait de l'indicatif Présent du
conditionnel »
Ces deux structures font un excellent prétexte pour
faire étudier le futur et le
conditionnel.

85
Aucun exercice conçu spécialement pour
l'acquisition de l'hypothèse n'est prévu.
Mais, nous rencontrons des exercices de conjugaison
prévoyant le futur et le
conditionnel. (Cette absence d'exercices conçus
spécialement pour ce travail montre
bien que les concepteurs n'ont pas l'intention de faire
étudier l'expression de
l'hypothèse).
Nous remarquons qu'une fois que l'étude des temps est
faite, Il est rare de voir
l'enseignant revenir sur les structures de
l'hypothèse, ce qui nous encourage à
affirmer que seule l'étude des temps intéresse les
concepteurs de ces fiches .
Nous sommes très loin du programme affiché
par les brochures- programmes.
L'expression de l'hypothèse fait partie du programme
et son étude est réalisée
uniquement parce qu'elle permet d'effectuer l'apprentissage des
temps énoncés ci-
dessus. D'ailleurs, l'hypothèse est abandonnée,
aussitôt, les temps étudiés.
L'étude des temps, à part, montre bien que
la relation qui existe entre le premier
temps (présent ou imparfait ) et le futur ou le
présent du conditionnel n'est point
exploitée .Chaque temps est étudié pour
lui-même comme s'il figurait à part et seul.
Ce qui est certain, c'est qu'au niveau de la classe de 6eme
année élémentaire, le
principe de l'étude de l'hypothèse est bien
marqué par la présence des deux formes
de structures apparaissant aussi bien à l'oral que dans
certains textes.
L'étude de ces structures est apparue une fois d'une
manière explicite et a ensuite
été évacuée, sans présentation
d'exercices appropriés à cet effet.
Nous ne retrouvons que des exercices spécifiques
aux formes temporelles déjà
vues tout au long de l'année. Il est nécessaire de
faire remarquer que le futur a été
étudié et réétudié depuis
la cinquième année élémentaire, mais le
conditionnel
n'apparaît qu'en 6eme année
élémentaire, c'est-à-dire cette année seulement.
Par contre, à l'oral, dans les saynètes,
nous retrouvons les deux formes de
structures. Nous pensons que les concepteurs ont bien
voulu faire en sorte que
l'enfant les intègre à l'oral avant de les faire
à l'écrit, en vertu, sans doute, de l'idée
qu'il est nécessaire que l'enfant apprenne d'abord
à parler pour ensuite apprendre à
écrire. Cette idée est remise en cause par les
cognitivistes qui prônent la parité de
l'oral et de l'écrit.
Ceci, nous amène à poser la question : la
préparation orale pour mieux les
approcher dans leur forme écrite est -elle
nécessaire?

86
Conclusion :
e
Dans cette classe de 6 année , l'expression de
l'hypothèse figure pourtant
dans les programmes, mais elle n'est pas étudié
d'une manière rationnelle , c'est-à -
dire , sa présence dans le manuel n'a pas
nécessité l'étude de ses mécanismes , de
sorte qu'on apprenne à l'élève à
connaître son utilisation , à travers les discours
qu'il doit réaliser quotidiennement. Elle n'a fait que
suggérer l'étude des temps qui
servent sa réalisation ou non.
L'enfant n'a pas vu le fonctionnement de l'expression de
l'hypothèse concrétisé,
mais on lui a présenté le système de
l'expression de l'hypothèse à travers certains
textes qu'il a lus.
La véritable étude de ces structures sera-t-elle
prévue au troisième palier, c'est-à-
dire, à partir de la septième année
fondamentale ?
1.8 Documents du 3 palier :
e
1.8.1 la circulaire du17 Octobre 1976 :
Elle prévoit la mise en application d'un programme
issu d'un séminaire qui
s'est déroulé du 30 juin au 2 juillet de
l'année 1976, proposant la création d'une
école fondamentale de 9ans. Il est rappelé
dans cette circulaire trois points
essentiels
1.8.1.1 « unifier les structures et les contenus de
l'enseignement moyen dispensé
dans les établissements actuellement fortement
différenciés et cloisonnés entre
eux,
1.8.1.2 Introduire chaque fois que possible tous
les aspects nouveaux de
l'enseignement qui découlent des objectifs assignés
à la nouvelle école ;
1.8.1.3 Intégrer enfin les résultats de toutes ces
actions pour réaliser complètement
l'école fondamentale polytechnique » Ces trois
axes guident l'expérience dans le
but d'unifier, d'abord l'école et ensuite les programmes.
Cette circulaire parle des langues étrangères et
leur attribue une portée universaliste
sur le point de la civilisation. La langue française
comme langue étrangère devrait
d'abord apparaître à travers « des
textes et autour de centres d'intérêt

87
principalement : scientifiques et techniques ». La
circulaire n'omet point de signaler
qu'il y a d'autres « domaines d'acquisitions »
qu'il ne faudrait pas oublier. Les
concepteurs des programmes visent d'abord une stratégie
pédagogique qui viendrait
à favoriser une certaine autonomie dans l'usage de
la langue. Nous allons donc
tenter de montrer que la méthode utilisée n'est pas
non plus un appareil solide pour
l'apprentissage des divers temps utilisés par
l'expression de l'hypothèse. L'enfant
n'a peut-être pu que survoler l'expression de
l'hypothèse sans être soumis à une
pratique.
Pour mieux mettre en évidence ces affirmations nous allons
analyser le dossier XII
de la septième année fondamentale.
1.8.2. Analyse des documents de la 7 année fondamentale :
e
1.8.2.1 Analyse du dossier XII :
36
nationale donne comme objectifs et recommandations :
« En septième année
fondamentale, l'année est consacrée
essentiellement à la pratique, la consolidation
et au perfectionnement de la langue naturelle, de la langue
de base »
Cet objectif est essentiellement linguistique, objectif qui
demeurera, pendant tout le
troisième cycle ; il s'agit d'insister sur toutes
les démarches qui conduisent à une
e
faits » Les concepteurs des fiches voudraient
qu'on étudie les temps qui se
rapportent à un fait mettant en évidence le
conditionnel. Ce temps n'est pas perçu
comme une composante de l'expression de l'hypothèse, mais
comme simple temps
qu'il faudrait faire acquérir aux apprenants de
la classe de la septième année
fondamentale.
Pour cela, nous allons parcourir certains exercices et nous
allons tenter de montrer
que ces derniers font plus à appel à
l'utilisation du conditionnel qu'à celui de
l'expression de l'hypothèse.
Les consignes de tous les exercices mettent l'accent sur
la conjugaison du
conditionnel (écris au conditionnel.... ou)
dans un autre exercice , les concepteurs
donnent la première modalité verbale (imparfait) et
demandent aux apprenants de
rechercher la seconde ...etc.)
Il faudrait de plus avancer que la brochure
éditée par le Ministère de l'éducation
Dans le livre de la classe de 7 AF, ce dossier a pour titre :
« rapporter des

88
véritable autonomie d'utilisation de la langue (langue
orale, mécanismes de lecture,
transcription graphique). Les concepteurs ne visent ici que
l'utilisation des stratégies
pédagogiques qui viendraient à favoriser une
certaine autonomie dans l'usage de la
langue.
Nous remarquons qu'il y a, là, présence d'une
hypothèse : information donnée par
les deux verbes utilisés (si + imparfait,
conditionnel), mais la conséquence à
laquelle aboutit le travail sur ces verbes ne porte
que sur la catégorisation des
temps utilisés.
Les exercices donnés en guise d'application ne font point
référence à l'hypothèse,
mais ne font qu'énoncer la catégorie temps. Nous
donnons ici certaines consignes
que nous relevons dans les exercices.
Dans le premier exercice, il s'agit pour l'apprenant de
« relever les verbes conjugués
au conditionnel » d'un petit texte
intitulé « Rêves d'enfant »
37
Dans le troisième
exercice, il est clairement signalé : «
écris au conditionnel les verbes entre
parenthèses ». (D'ailleurs les concepteurs
de ces fiches ne prennent même pas la
peine de signaler le type de conditionnel.) Ils donnent des
phrases où ils ont pris la
peine de mettre le premier membre de l'hypothèse
à l'imparfait de l'indicatif et
demandent aux apprenants de faire correspondre la
modalité du deuxième
membre, ou vice-versa. Le second exercice prend en charge
l'expression du type
« Si + présent, Futur ».
A chaque fois, ils proposent soit le premier membre
correctement écrit ou l'inverse.
Donc, l'apprentissage des temps est clairement
déterminé. Tous les exercices
donnés ne font référence qu'au conditionnel.
1.8.3 Etude des documents de la huitième année
fondamentale :
38
1.8.3.1 Analyse des documents du professeur :
C'est dans le premier dossier intitulé le conte
« tête de veau » que nous
retrouvons les expressions mentionnant l'hypothèse :
L'hypothèse apparaît sous ses deux formes les plus
utilisées :
« Si .......+......présent
........................présent »
« Si .......+.....présent
........................futur »

89
Ces deux structures se rencontrent dans le conte, les temps
accompagnant les deux
structures sont étudiés en conjugaison. L'analyse
du conte ne prend pas en charge
l'intention d'étudier l'expression de l'hypothèse
pour apporter un plus au sens que
ce conte véhicule.
Il semblerait que les concepteurs des fiches considèrent
l'expression de l'hypothèse
comme un simple point de langue qu'il faudrait utiliser à
part. Ils évitent le recours à
son explication et l'expression de l'hypothèse passe
inaperçue dans le texte. Sa
manipulation est donc faite d'une manière inconsciente par
les apprenants.
Ils l'utilisent dans des textes lus, sans chercher à
prendre conscience de sa valeur
sémantique. Nous ne rencontrons aucune
référence la signalant et pourtant elle
est bien présente dans le texte :
« Si les petites feuilles sont restées en
ordre lorsqu'on fera le lit, c'est un
homme. Si on les trouve sens dessus - dessous, c'est une
femme »
(Son étude aurait permis certainement de voir la
différence de sens que cette
dernière développe).
Essayons de vérifier le dossier N°3 qui nous
fournira, d'amples informations au sujet
de l'exploitation de l'hypothèse. Il donnera les moyens
utilisés pour la faire émerger
ou tout simplement la faire passer sous silence, parce qu'elle
n'intéresse pas les
apprenants.
1.8.3.1.1 - Le dossier N°3 :
C'est en conjugaison que nous retrouvons un titre signalant la
présence du
« mode conditionnel ». Ce mode est bien présent
dans la conjugaison. Il y a donc un
émiettement du programme pour, sans doute, faciliter
l'apprentissage des temps
utilisés par l'hypothèse.
Les buts assignés à cette leçon
apparaissent dès son commencement et sont
énumérés comme suit :
« Action soumise à condition »
(Rappels)
« Formulation d'un voeu, d'une demande polie »
(Il faudrait signaler que cette
partie de la leçon n'utilise pas l'hypothèse, mais
fait appel au conditionnel, en tant
que temps utilisé dans la demande polie ou le voeu)
«Formation du conditionnel passé »
39
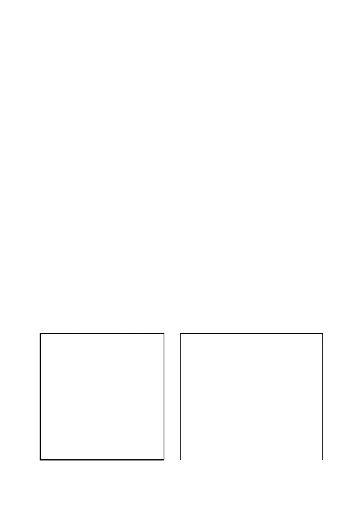
90
Sous le couvert de l'analyse du conditionnel, nous retrouvons
l'hypothèse formulée à
partir des modèles utilisant la subjonction « si
». Donc, l'hypothèse n'est présente
que comme «incitateur » à l'étude du
conditionnel. D'ailleurs, même le conditionnel
passé n'est pas amené par la phrase
hypothétique. En général, c'est souvent le
même modèle qui est repris et transformé
à ce temps, comme dans la demande
polie ou le voeu.
« J'aimerais voyager en bateau »
« J'aimerais que vous répondiez assez vite
»
Nous remarquons que c'est pour la première fois
qu'apparaît le conditionnel en tant
que mode -temps, sans passer par l'utilisation de
l'hypothèse.
1.8.3.2 Le livre de l'élève :
Dans la partie exercices, nous retrouvons une série
de sept exercices
d'application qui porte sur le conditionnel.
Le premier exercice a pour consigne le classement
des verbes employés au
conditionnel.
Le second exercice porte sur le « fléchage
» de la proposition principale à la
dépendante utilisant le conditionnel.
Deux tableaux (le premier est appelé A, et le second B)
renferment les propositions
et il est demandé à l'apprenant de tracer
une flèche reliant la principale à la
proposition dépendante dont le verbe est au
conditionnel. (Ex :
- Si tu m'avais prévenu à temps,
- Si le cycliste n'avait pas eu une
crevaison,
- Il aurait remporté la victoire.
- Je te ferais visiter de beaux sites
historiques.
- Si la sécheresse persistait
encore une semaine,
- je t'aurais accompagné volontiers
- Si tu venais chez nous,
- toutes les récoltes seraient détruites.

91
Le troisième exercice donne seulement la
dépendante et demande à l'élève de
retrouver la proposition principale : la consigne est la
suivante : « termine les
phrases suivantes : »
Ex : « Si cette équipe avait été
entraînée ........................................ ».
Le reste des exercices (4 autres) propose le remplacement du
présent de l'indicatif
par le conditionnel (exercice N°4). Dans cet exercice, il ne
s'agit pas de l'hypothèse,
mais du voeu ou du souhait entraîné par la forme
syntaxique du type :
« Je veux gagner le premier prix
.............................je voudrais gagner le
premier prix. »
Le 5 exercice porte effectivement sur la condition et
demande à l'élève de
e
parenthèses, tout en lui donnant le premier membre
ou le second. Ex : « S'il
réfléchissait un peu plus, il (voir) que ce
problème est très facile »
Cet exercice nous montre que les concepteurs de fiches ne se
soucient pas de la
valeur modale de l'hypothèse, mais ce qui les
intéresse est bien la connaissance du
conditionnel. En effet, le premier verbe est donné ici
comme «un appât », l'élève ne
réfléchit pas. Il n'a appris que des schémas
organisés par l'enseignant et doit remplir
les vides laissés par ce dernier, dans des phrases
simples. Il ne peut réellement
expliquer qu'il s'agit là d'une hypothèse.
Il lui sera certainement très difficile de
découvrir la condition de l'éventualité.
Nous remarquons que le travail sur les hypothétiques n'a
été, en fait, qu'un
travail de conjugaison des verbes aux deux temps : «
conditionnel et futur ».
L'hypothèse est utilisée comme suggestion
pour l'étude des temps énoncés ci-
dessus. Elle apparaît comme implicite ; elle n'est
là que comme accompagnatrice.
Elle ne trouve sa véritable place que dans les textes :
c'est le texte qui la véhicule
et c'est aussi, ce texte qui servira de point de départ
à l'apprentissage. Il serait donc
très difficile d'affirmer que l'hypothèse sera
assimilée par les apprenants quand on
fait un travail identique à celui-ci.
e
remplacer l'imparfait par le plus - que - parfait. Nous
donnons l'exemple qui le
montre :
« Si nous avions froid, nous allumerions le
chauffage »
La consigne donnée pour réaliser cet exercice est
la suivante : « Ecris la condition
en employant le plus - que - parfait ». Une telle consigne
suppose que l'expression
de l'hypothèse a été déjà
réalisée dans sa forme complète.
Dans le 6 exercice, il est demandé à
l'apprenant de conjuguer les verbes entre

92
Toutes ces structures ne peuvent réellement
être maîtrisées que si celles-ci font
l'objet d'une étude structurée et consciente.
Il faudrait que les enfants prennent conscience clairement du
fait hypothétique qu'ils
désarticulent en deux phrases possédant des temps
différents et le recomposent
dans son intégralité, en fournissant des exemples
de leur crû pour qu'ils le cernent
convenablement.
Il faudrait que toutes ces expressions entraînant
l'hypothèse soient vues en tant que
forme hypothétique plutôt que simple
élément générant le conditionnel.
Conclusion :
e
Dans cette classe de 8 année fondamentale,
l'expression de l'hypothèse
n'est pas traitée, dans le programme, en tant que telle,
mais elle est vue en tant que
prétexte à l'étude du conditionnel. Ce
phénomène nous pousse à dire que
l'expression de l'hypothèse n'est pas non plus
prévue dans cette classe. En effet,
les modèles hypothétiques apparaissent tout au long
de la conjugaison sans que
celle-ci fasse l'objet d'une étude complète et
consciente.
1.8.4 Analyse des documents de la neuvième année
fondamentale :
La neuvième année est la dernière
année du fondamentale ou école de base.
En somme, c'est l'année terminale des
connaissances de base. Donc, si
l'hypothèse appartient à ces connaissances,
nous pouvons dire, sans nous
tromper, que l'expression de l'hypothèse est acquise.
Un simple parcours du programme de la neuvième
année nous montre que
l'expression de l'hypothèse n'est pas prévue en
tant que point de langue à étudier,
mais les composants de cette dernière
apparaissent dans la conjugaison ,
notamment au dossier N°6, traitant du plus-que-parfait
de l'indicatif. C'est en
définissant, les valeurs modales de ce temps que
les concepteurs de fiches
abordent les problèmes d'antériorité et au
second plan, l'éventualité.
C'est dans cette partie qu'apparaissent quelques exemples du
type : « Si tu m'avais
prévenu, je t'aurais accompagné »
« Si notre équipe nationale avait battu le
Nigeria lors du match retour, elle
aurait participé aux jeux olympiques de Séoul
»

93
« Si le vent du sable avait cessé, les
touristes auraient continué leur
voyage »
40
1.8.4.1 La subordonnée circonstancielle de condition :
Elle apparaît, à son tour, au dossier IX.
Les buts assignés à cette leçon
montrent bien que les concepteurs du programme affichent la
ferme intention de
traiter de l'hypothèse. Car nous remarquons qu'il est
spécifié en tête de la leçon les
buts suivants : « Identification de la
subordonnée circonstancielle de condition »
avec les emplois de :
« Si .........+.. ....présent
.........................futur simple de l'indicatif »
« Si ...+..........imparfait de l'indicatif
............conditionnel présent »
« Si ...+.........Plus - que - parfait
...+...............conditionnel passé »
et emploi de : à condition que
.....+.........................Subjonctif.
La remarque que nous pouvons faire ici, c'est que, dans cette
classe l'expression de
l'hypothèse est presque entièrement faite.
Toutefois, l'accent demeure toujours mis
sur les temps des verbes et non sur une explication
logique de l'expression de
l'hypothèse.
Les propositions hypothétiques apparaissent
accompagnées de deux structures
de subjonction : « si » et la locution
conjonctive « à condition que » qui entraîne
l'utilisation du subjonctif.
1.8.4.2 - conjugaison :
Dans cette partie du dossier, c'est encore les valeurs modales du
conditionnel
qui retiennent l'attention des concepteurs. Les buts
assignés à cette séance
prévoient la révision de la valeur modale du
conditionnel vue en 8 année
fondamentale et plus particulièrement les
constructions utilisant la subjonction
« si ». Pourquoi donc, doit -on revoir les construction
utilisant la subjonction « si » ?
Est- ce par souci d'efficacité ou tout simplement parce
que l'on croit que le travail
accompli n'a pas été comme le voulaient les
concepteurs ?
Au dossier X, nous abordons les différentes
catégories de l'hypothèse telles que :
«Le potentiel » (l'éventualité)
«L'irréel du présent »
e

94
«L'irréel du passé »
Ce qui est certain, c'est que nous traitons de
l'hypothèse au dossier X, en
conjugaison, à côté des valeurs et
emploi du subjonctif présent développé par la
subordonnée de condition utilisant la locution conjonctive
« à condition que »
Dans ce cours, la présence de l'hypothèse est
très largement répandue, mais il faut
reconnaître que les objectifs assignés mettent en
valeur les temps plutôt que la
valeur de l'hypothèse et sa construction. Nous
pouvons toutefois, signaler que
condition et éventualité n'apparaissent pas dans le
même volet, mais voient le jour
selon un processus favorisant l'émergence du conditionnel
et du subjonctif.
Conclusion :
Il est vrai que dans cette classe , le travail est
bel et bien mis sur les
éléments composant l'hypothèse , sans
vouloir la traiter en tant que totalité où
serait perçue l'hypothèse en tant que mode de
pensée.
Même dans cette classe, l'apprentissage de
l'expression de l'hypothèse souffre
encore du manque d'une méthodologie efficace
pour permettre aux jeunes
apprenants de la comprendre et surtout d'en comprendre le
mécanisme syntaxique
qui produit à son tour une sémantique
s'intégrant dans le discours.
1.8.5 Etude des documents de français de
l'élève de neuvième année fondamentale :
Au dossier 6, apparaît un exercice traitant de
l'hypothèse sous la forme « si
...+ ...imparfait ......conditionnel », et La forme :
« Si ...+ ....plus - que - parfait
..........conditionnel passé »
L'exercice a pour consigne de faire retrouver les
propositions principales qu'il
faudrait ajouter aux dépendantes données pour
obtenir des phrases hypothétiques
complètes. Les concepteurs ont donné uniquement
les propositions subordonnées
telles que :
«Si le navire n'avait pas heurté le rocher .......
»
Ou encore
«Si le brouillard n'avait pas gêné
l'automobiliste ....... » Etc.
En général, ces phrases peuvent
facilement être découvertes puisqu'elles
proviennent du texte de lecture effectué quelques heures
auparavant. Ce sont donc

95
des phrases lues et relues, ne faudrait -il pas les faire
produire par l'élève lui-même
pour s'assurer qu'il a bien compris leur fonctionnement. Car,
c'est en démontant et
en reconstituant le système hypothétique
que l'enfant comprend le véritable
fonctionnement de l'hypothèse.
Au dossier 9, nous retrouvons d'autres exercices qui traitent du
conditionnel comme
une priorité. Ils sont au nombre de 8 qui traitent du
conditionnel : les deux premiers
exercices portent sur la conjugaison du verbe de la principale
au conditionnel. Les
deux suivants demandent à l'élève de
compléter des phrases selon un modèle
donné : « si j'avais choisi ce métier,
j'aurais gagné beaucoup d'argent »
Pour le 5 exercice, les concepteurs donnent le premier
membre de la phrase et
e
demandent à l'élève de le
compléter par le second membre. Donc, le travail
demandé est mécanique.
Le 6 invite l'élève à montrer si le
conditionnel exprime l'idée de l'éventualité, de
e
l'irréel du présent et, l'irréel du
passé. Cet exercice tente de montrer l'hypothèse en
tant que telle, or, cette dernière n'a pas
été étudiée.
Le 7 exercice revient à la conjugaison du second verbe
de la phrase hypothétique.
e
e
une interrogation et deux autres le refus poli »
Cette production montre bien que les concepteurs projettent
l'étude du conditionnel
et non l'expression de l'hypothèse. En effet, c'est
à la fin de l'étude qu'ils demandent
à l'élève de faire une production
personnelle pour s'assurer que ce dernier a
compris le temps étudié. Ils n'ont jamais
pensé exiger de l'élève une production
personnelle portant sur l'expression de l'hypothèse pour
contrôler leur apprentissage
et leur rétention.
Si une apparence d'étude de l'expression de
l'hypothèse se manifeste au niveau de
cette classe, il n'en demeure pas moins que nous
constatons que le travail est
toujours orienté vers l'étude des temps :
l'hypothèse deviendrait donc un prétexte à
l'étude des temps véhiculés par ce point de
langue.
Le 8 exercice demande à l'élève de produire
« deux phrases qui expriment poliment

96
L'hypothèse apparaît dans ces manuels comme une
simple composante de
la structure temporelle utilisant la subjonction « quand
», »si » et « que ».
A aucun moment, l'hypothèse n'apparaît sous
son vrai nom, mais nous la
retrouvons souvent sous des concepts proches ou restrictifs :
éventualité, irréel du
présent, irréel du passé, la
condition...etc.
Nous constatons que ces manuels ne renferment point
l'idée
englobante de l'expression de l'hypothèse. Mais
seule l'idée parcellaire de la
condition semble préoccuper les grammairiens de notre
école fondamentale.
Ce qui nous amène à nous poser la question :
pourquoi la grammaire scolaire ne
s'offre-t-elle pas un point de vue totalisant ?
Dans le cadre d'une grammaire de texte ne pouvons
-nous pas inclure la
conception de l'hypothèse dans sa totalité
plutôt que de la voir émiettée dans les
grammaire scolaires ?
Conclusion :
En général, l'expression de l'hypothèse
n'est pas approchée dans sa totalité
dans l'école algérienne. Elle est souvent
perçue comme morcelée à travers des
exercices que l'apprenant effectue
Conclusion générale:
L'examen des manuels a montré d'abord l'absence de
l'hypothèse en tant
que point de langue dans les manuels scolaires.
- Si le mode conditionnel et ses temps figurent dans les
programmes scolaires, ils
ne sont pas étudiés en fonction du rôle
joué dans l'expression de l'hypothèse.
- Les enfants n'ont donc pas été
placés dans la situation d'identification et
d'utilisation de l'hypothèse. Donc, ils ne peuvent
parvenir à une utilisation correcte
de ce point de langue.
- L'apprentissage du mode et des temps du conditionnel hors
situation - (si nous
considérons que l'hypothèse en est une
situation réelle)- ne favorise pas leur
utilisation dans la vie quotidienne de l'enfant.
- D'une manière générale, il y a un
manque de cohérence dans l'apprentissage de
l'expression de l'hypothèse.

97
Chapitre 2
L'enquête :
2.1 Situation socio- économique des apprenants :
Nous avons pris des élèves âgés de
9ans à 17/18ans. Ces derniers venaient
e
des deux cycles du fondamental : 4,5, et 6 année primaire
pour le premier cycle et
de 7 , 8 et 9 année du second cycle. Leurs parents
exercent diverses fonctions
e e e
dans l'agriculture : la plus grande partie est constituée
d'arboriculteurs (région de
Boufarik).
Les parents de ses élèves travaillent dans leur
majorité dans des vergers. Le
niveau culturel est bien celui d'un agriculteur algérien
analphabète qui a appris son
métier sur le tas, au contact d'autres gens sachant
convenablement leur métier
d'arboriculteur. Une infime partie est constituée de
cadres moyens : enseignants,
médecins, avocats..etc.
Ces élèves apprennent en première
année, deuxième et troisième année la langue
nationale qui est l'arabe. C'est à partir de la
quatrième année primaire qu'ils
apprennent le français comme première langue
étrangère. Leur apprentissage de
la langue étrangère se fait en classe seulement.
La seule aide qu'ils peuvent s'offrir
est bien celle de la télévision quand ils la
possèdent et la presse écrite algérienne
et étrangère qui se vend librement dans les
kiosques. Au cours de cette enquête,
leurs enseignants ont affirmé que ces élèves
ne lisent que rarement la presse
arabophone. Parfois, ils les auraient vu feuilleter la presse
francophone à la
recherche de résultats sportifs. Donc, les seules
discussions qu'ils ont en langue
française, sont bien celles organisées par leur
professeur en classe ou celles
entendues à la télévision.
2.2 Situation socio- linguistique :
En général, les élèves des cadres des
comités de gestion ou des
coopératives agricoles se classent au premier rang et
obtiennent d'excellentes
notes. Si ces élèves font l'objet d'une attention
bienveillante de la part de

98
l'enseignant, les autres sont abandonnés à leur
propre sort. Les parents comptent
beaucoup sur le travail en classe.
Ces élèves ont souvent entendu parler
français chez eux : les parents entre eux ou
la télévision. En général, les
parents sont en mesure de se payer une parabole.
Quant à la seconde catégorie dont les parents ne
sont, en réalité, que de simples
ouvriers, elle est loin de connaître la langue
française et encore moins de l'utiliser.
Ce phénomène donne à la classe un aspect
très hétérogène et ne facilite point
l'apprentissage.
L'enseignant est adulé par ces parents. Souvent, nous
avons remarqué que ces
mêmes parents amenaient leurs enfants en classe et disaient
: « Il n'est plus mon
enfant quand il est chez vous, débrouillez -vous avec
! »
Comptant énormément sur l'école, les parents
ne peuvent rien pour leurs enfants.
Donc, aucune aide n'est apportée par ces derniers à
leurs enfants.
2.3 A propos de l'enquête :
Pour essayer d'approcher convenablement le niveau de connaissance
auquel
sont parvenus les jeunes algériens, en
matière d'expression de l'hypothèse, nous
avons prévu un certain nombre d'exercices
empruntés à toutes les classes de
l'école fondamentale. En effet, vouloir rechercher
le degré d'assimilation à travers
deux cycles de l'école fondamentale, relève d'un
pari très important. Pour vérifier la
validité de la méthode utilisée, il
nous est donc paru logique de tester les deux
cycles pour plusieurs raisons :
2.4 L'expérimentation au niveau d'un cours ou d'une
classe :
Elle ne peut nous renseigner correctement sur
l'apprentissage de
l'expression de l'hypothèse. Nous avons
jugé nécessaire d'étendre cette
expérimentation à la région de Boufarik en
ne prenant que quelques classes. En
outre, l'enseignement donné par un seul enseignant
n'aurait pu suffire à nous
renseigner sur toutes les difficultés rencontrées
par les apprenants.

99
2.5 L'expérimentation au niveau national :
Pour des raisons pratiques, il était impossible
d'élargir notre terrain d'enquête
à l'ensemble du territoire algérien. En plus, nous
ne pouvons l'organiser puisqu'elle
exige de nous de grands moyens et de très grandes
dépenses.
2.6 Le choix de la région:
La région choisie est celle de Boufarik, région du
centre (Mitidja). Cette région
présente l'avantage d'être très agricole
en ayant un centre urbain et deux autres
semi urbains : (Boufarik, Birtouta , Chebli).
Boufarik avec ses 60 .000 habitants est la troisième ville
de la région après Alger et
Blida. Du point de vue linguistique, Boufarik est dans
une région arabophone. A
l'indépendance, cette ville a été
repeuplée par un exode d'ouvriers agricoles
venant des autres régions limitrophes.
Birtouta, gros village de 10243 habitants (dernier recensement),
sis à la limite de la
région d'Alger où une grande population
berbérophone réside, est linguistiquement
plus composite. Il semble toutefois que l'arabe algérien
(dialectal) s'impose de plus
en plus dans les échanges courants entre ses citoyens.
Chebli, village de 6.231 habitants, qui était un
village essentiellement agricole et
colonial est habité par des paysans. En effet, à
l'indépendance, ce petit village s'est
vidé de toute sa population : départ des colons et
même de quelques ouvriers qui y
travaillent. Les quelques boutiquiers et les quelques
fonctionnaires qui y résident
ont des origines paysannes. Au total, donc, trente
classes ont servi de terrain
d'enquête et huit cent vingt - huit élèves
ont été testés. Ils se répartissent entre le
deuxième palier de l'école fondamentale et le
troisième comme suit : 240 élèves du
primaire (deuxième palier) et 586 élèves au
troisième palier.
Au niveau du primaire, deux écoles ont bien voulu
prêter leur concours : la première
école est celle de Birtouta et la seconde est
celle de Chebli. Nous avons voulu
tester les élèves d'un milieu rural et des
élèves citadins fréquentant une école peut-
être un peu plus favorisée.
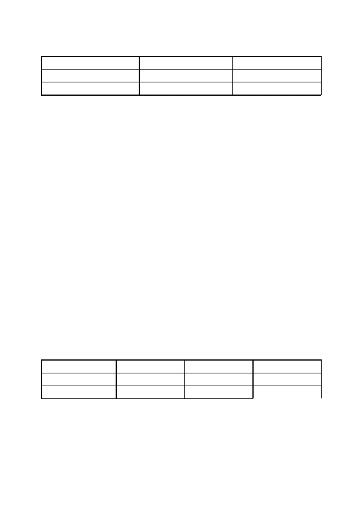
100
Tableau global des élèves du primaire ayant
subi le test :
Etablissements
Birtouta
Chebli
5 année primaire
e
4 cl. 186 élèves
6 année primaire
e
2 CL. 54 élèves
Le choix des classes dans les deux communes n'obéit
à aucun critère social,
mais nous n'avons testé que les élèves
dont les enseignants ont bien voulu
collaborer. Dans le troisième palier, nous avons pu faire
effectuer les exercices dans
six écoles fondamentales dont la situation, la
taille et la population offrent un
panorama assez complet du milieu scolaire Algérien.
La première école fondamentale (on continue
à les appeler encore de nos
jours, CEM) est celle de Boufarik (ibn Qoteiba) qui est
située dans un quartier très
populeux. C'est un gros établissement de 942
élèves, aux classes chargées. Nous
trouvons une moyenne de 40 élèves par classe, issus
tous de familles pauvres.
La seconde école fondamentale est celle de la route de
Chebli qui est aussi
une grosse école avec ses 1243 élèves qui
lui viennent de quartiers assez aisés de
Boufarik. Les classes sont chargées comme celles de
l'école Ibn qoteiba. Toutefois,
le recrutement de ses élèves est plus
intéressant sur le plan de la qualité puisque
cette école se trouve à la limite des deux
quartiers dont l'un est plus aisé que
l'autre. Des commerçants, des petits bourgeois et des
administrateurs y habitent.
Les deux écoles fondamentales décrites se trouvent
au nord de la ville de Boufarik,
quartiers récents dont les constructions datent de la
dernière décennie.
Tableau global des élèves ayant
été testés à Boufarik :
Etablissements
Ibn Qoteiba
Route de Chebli
7 année fond.
e
8 année Fond.
e
2 cl. 61 élèves
e
2 cl. 76 élèves
2cl. 76 élèves
9 année Fond.
Les deux autres écoles fondamentales de Birtouta sont
l'ancienne et la nouvelle :
l'ancienne est appelée «Lakel » et la nouvelle
« Loumi ».
La première, Ahmed Loumi est d'une grandeur moyenne
et compte 932élèves
venant, pour la plupart, des anciennes fermes
autogérées. Dans leur majorité, leurs
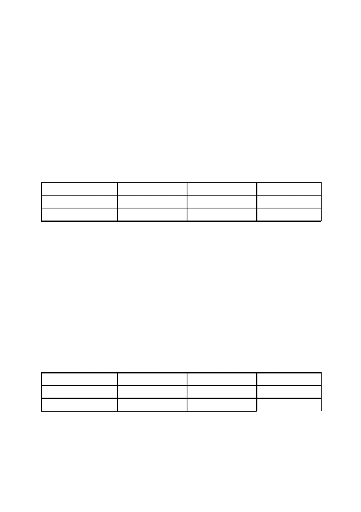
101
parents sont des paysans. Leur moyenne d'âge est
sensiblement plus élevée que
celle de l'école Lakel.
Lakel est un gros établissement qui comprend 1128
élèves venant dans leur
grande majorité du centre de Birtouta. Ce sont les
enfants de petits commerçants,
de fonctionnaires travaillant à Alger et d'artisans. Le
pourcentage d'enfants ruraux
est en général très faible. Nous
n'avons pas effectué une enquête spéciale pour
déterminer le pourcentage de toutes les catégories
; nous nous sommes contenté de
croire leurs enseignants qui ont confirmé ces
dires. Ces deux établissements
comprennent les classes de la septième à la
neuvième année fondamentale.
Tableau global des élèves ayant
été testés à Birtouta .
41
Etablissements
A.Loumi
Lakel
e
1. cl.30 élèves
1 CL.38 élèves
7 année
e
1. cl.31 élèves
1Cl.39 élèves
8 année
9 année
e
1. Cl.24 élèves
1 CL.31 élèves
Les deux autres écoles de la région du
village de Chebli sont Ibn khalef et 120
logements.
Ibn Khalef est le plus ancien établissement de
Chebli et comprend 651 élèves
répartis entre les trois niveaux (7 , 8 et 9
année fondamentale).
e e e
Cet établissement était nettement plus important
qu'aujourd'hui, car il s'est dessaisi
d'une partie de ses élèves au profit du second
établissement : les 120 logements.
Le 120 logements est assez important, 843 élèves
répartis dans les trois niveaux. Il
se trouve dans un quartier de construction récente
et populeux. Il draine la
population paysanne de la région qui a quitté les
fermes environnantes pour venir
s'y installer, fuyant le terrorisme.
Tableau Global des élèves ayant
été testés à Chebli.
Etablissements
Ibn khalef
120 logements
e
1 Cl. 37 élèves
2 cl. 69 élèves
7 année
e
1 Cl. 31 élèves
2cl.62 élèves
8 année
9e année
1Cl.28 élèves
1cl 43 élèves
Le choix de ces six écoles a été
motivé par le fait que j'exerce dans cette
région et que je peux y accéder sans aucune
contrainte. Comme je connaissais tous
les enseignants et les Chefs d'établissement,
j'avais donc la possibilité

102
d'expérimenter mes tests avec toutes les
facilités possibles. Cette logique pouvait
m'aider comme elle pouvait me causer de fâcheux
désagréments. La rigueur
risquait d'être compromise par suite de ces
connaissances ou bien elle risquait
d'être assez exagérée pour ne donner que des
résultats peu fiables. De toutes les
manières, nous avons demandé à ces
collègues d'être très rigoureux et de
n'apporter aucune aide susceptible de « fausser » les
données. En général, le travail
a été minutieusement accompli par tous. Car, nous
avons, au tout début, montré aux
collègues qu'il ne s'agissait pas d'un contrôle
effectué par le Ministère, mais d'une
activité purement scientifique devant servir à
l'élaboration d'un mémoire.
On le voit, les classes ont été choisies
dans le souci de diversifier les origines
géographiques et sociales des élèves
testés. L'échantillon ne peut prétendre à une
valeur rigoureusement mathématique, (il aurait
fallu pour cela des moyens
d'investigation qui sont actuellement hors de notre
possibilité), nous ne doutons pas
pour autant qu'il puisse avoir valeur d'exemple et
autorise des conclusions
intéressantes.
2.7 Les exercices utilisés :
Nous avons repris des exercices de classe, au lieu de leur
demander des
productions personnelles, chose qui serait certainement
plus instructive pour le
chercheur, mais nous avons préféré les
exercices pour la simple raison que ces
élèves n'ont pas été habitués
à la rédaction de productions personnelles.
Il est peut-être vrai que ces exercices ne donnent
pas réellement plus
d'informations sur l'apprentissage de l'hypothèse,
mais ils nous renseignent
certainement sur ce qui a été, au moins, fait.
Nous avons choisi donc des élèves du second et du
troisième palier ce qui
équivaut au niveau I et II d'une langue
étrangère.
En effet, les programmes en vigueur, permettent de
penser qu'avec la fin du
troisième palier, les élèves
possèdent la compétence fondamentale du niveau I
avancé ( I-II), que F. Debyser développe selon les
points suivants :
« ....vocabulaire.....de 1500 mots du français
fondamental » 1 degré, seuil à
er
ne pas dépasser.
Priorité donnée aux structures grammaticales du
français usuel, conformément aux
possibilités combinatoires....

103
Le contenu de l'enseignement est à peu près
uniquement un contenu linguistique,
les élèves ne disposant que de moyens expressifs
limités.
Il est donc exclu qu'un contenu culturel important puisse
être véhiculé. »
La neuvième année fondamentale est donc
une classe charnière quant à
l'apprentissage du F.L.E.
Le cursus scolaire suivi par ces apprenants en
français est le suivant : à l'école
primaire, leurs trois premières années étant
enseignées en arabe, ils ont commencé
e
l'apprentissage scolaire du français en 4
année primaire, puis ont suivi pendant
deux ans encore, le cycle primaire. Donc, à la fin du
second cycle, les élèves sont à
e
leur troisième année du français. Puis,
après leur passage au troisième palier (7
AF), ils ont eu une scolarité de 3ans, en français,
langue étrangère. Ces élèves ont
entre 11-12 ans en 7 AF et 13-14 en 8 AF. En
général, ils passent leur Brevet
d'Enseignement Fondamental à 16-17 ans et passent ensuite
dans le secondaire.
Ces élèves parlent l'arabe algérien qui est
la langue de communication sociale, la
plus importante pour eux (entre camarades, en famille,
dans la rue, dans les
magasins... etc.). 1/3 par estimation de ces
élèves est de langue maternelle
42
tamazight ; c'est-à-dire qu'en fait, et à des
niveaux différents, ces élèves pratiquent
trois langues, certains quatre.
Notre souci, au début, de notre enquête
était de constituer un corpus qui
puisse s'inscrire dans une moyenne de données
sociolinguistique en Algérie.
Il est illusoire de penser à aboutir à des
résultats statistiquement fiables à un niveau
national. Par contre notre attention s'est plus portée
sur la nécessité d'une analyse
valide permettant de suggérer une méthode capable
d'inculquer l'hypothèse à des
jeunes algériens, selon leurs réalités
sociales.
Nous avions eu, en effet, le choix entre une analyse de type
statistique et une
analyse plus « pragmatique » et nous avons choisi la
seconde forme parce qu'elle
e
e
préfère porter un « intérêt
» privilégié pour les groupes naturels »...
43
Le premier type d'analyse ne pouvait que relever d'un
appareillage très
important, tel que l'utilisation de machines,
d'enquêteurs...etc.
Notre ambition a été plus orientée vers une
recherche d'analyse de méthodes que
d'analyses linguistiques.
Donc, il nous fallait seulement veiller à ce que
notre groupe ne présente pas de
caractéristiques excentriques par rapport au
reste de la population scolaire
algérienne.
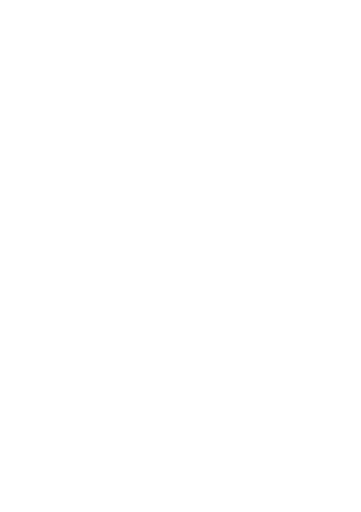
104
C'est pourquoi notre choix s'est porté sur les
apprenants scolarisés dans la
périphérie d'Alger- autrement dit, il s'agit
d'élèves scolarisés dans la banlieue
d'Alger dont le statut social des parents est dans sa
majorité celui de paysan.
Il nous fallait aussi avoir des données
précises pour cerner le rôle des
interférences linguistiques dans la
réalisation de ces exercices, savoir, en
l'occurrence quelle était la langue maternelle
de chacun d'eux. Nous avons
demandé à chaque candidat d'inscrire l'origine
de ses parents sur la feuille
d'exercices.
Sachant pertinemment que l'hypothèse dans les deux langues
(arabe et tamazight),
fonctionnent de la même manière, ce qui
occasionne le plus souvent aux
apprenants, la possibilité de transfert de langue à
langue.
2.8 Analyse des exercices du 2 palier et de leurs
résultats :
2.8.1 Les exercices de la cinquième année primaire
:
e
Les trois exercices présentés au test
d'évaluation ont été tirés du livre de
l'élève et ont été
présentés tels quels, sans commentaire.
2.8.1.1 Exercice n°1 :
Mets le temps qui convient :
É si je n'(être)..........pas là, tu ne
t'en(sortir)........pas.
É Si tu (avoir).un dictionnaire, ton travail
(être)..plus facile .
É Si tu (écrire)mieux, tu serais lisible.
É Si ta chambre était repeinte, elle
(être) ..plus agréable.
É Si vous (avoir)bien travaillé, vous
(avoir) ..plus de chance d'être
reçu.
(Il est important de souligner que vu la nature des
items nous n'étions pas en
mesure de vérifier la systématicité et faire
la distinction entre faute et erreur. Tout
écart par rapport à la « norme » de la
langue cible sera donc compté comme étant
une erreur.)
1 cas
« Si je ne suis pas là, tu ne t'en sortiras pas
» [Si + présent .. futur]
er
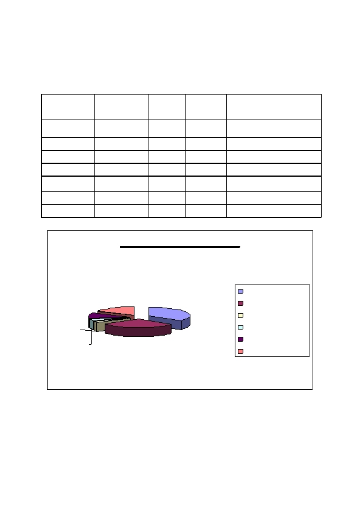
105
2 cas
« Si je n'étais pas là, tu ne t'en sortirais
pas » [si + imparfait .conditionnel]
Tableau des erreurs commises par les élèves
sur l' exercice n°1 item n°1
e
Verbe 1
était
étais
Etre
Etait
Etait
Etre
Totaux
Verbe 2
Sortirait
sortirais
Sortiras
Sortir
Sortait
Sortir
Nbre
24
21
1
3
7
12
68
%
35,29
30,88
1,47
4,41
10,29
17,66
100
Etat des verbes
Impar-condition
Rep -juste
Mauv.rep
Mauv.rep
Mauv.rep
Deux infinitifs
ITEM N°1 EXERCICE 1
18%
36%
10%
1%
4%
31%
Impar-condition
Rep -juste
Mauv.rep
Mauv.rep
Mauv.rep
Deux infinitifs
Figure n°1 : Exercice n°1- Item n°1
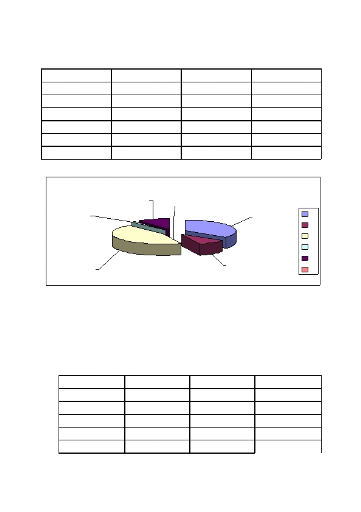
106
Exercice n°1 Item n°2(verbe 2):
Verbe n°2
Sortirait
sortirais
Sortir
sortiras
Sortait
Totaux
Nbre
24
6
30
1
7
68
%
35,29
8,82
44,11
1,47
10,29
100
État
Mauv.rep
Rep juste
Mauv.rep
Mauv.rep
Mauv.rep
10%
0%
1%
35%
45%
9%
1
2
3
4
5
6
Figure n°2 : Exercice n°1 Item n°2 verbe 2
Exercice n°1- Item n°3 un seul membre de la
phrase
Verbe
Ecrivais
Ecriva
écrirre
Ecrivai
Totaux
Nbre
16
14
4
16
68
%
23,53
20,58
5,88
23,53
100
Etat
Juste
Mauv.rep
Mauv.rep
Mauv.rep
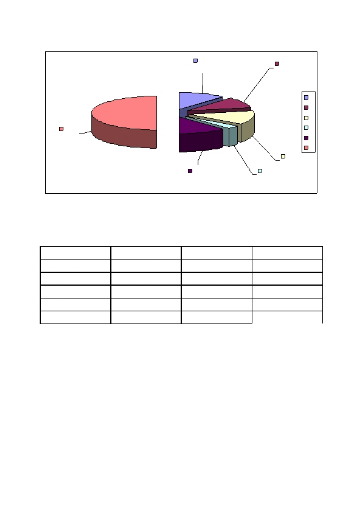
107
1
12%
2
10%
6
50%
1
2
3
4
5
6
3
13%
5
12%
4
3%
Figure n°3 : Exercice n° 1- Item
n°3 « un seul verbe 1 membre de la phrase »
er
Exercice n°1- Item n°4 (deuxième membre
de la phrase)
Verbe
Serait
Sera
seras
écrire
Totaux
Nbre
12
18
20
18
68
%
17,64
26,47
29,41
26,47
100
Etat
Juste
Faux
Faux
Faux
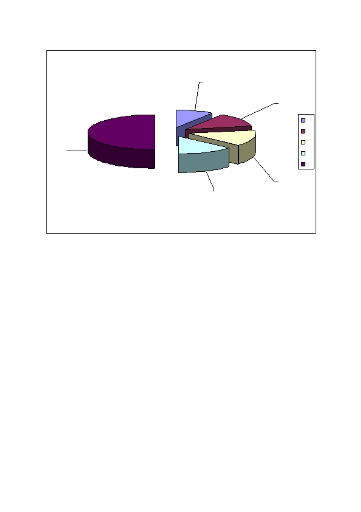
108
1
9%
2
13%
5
50%
1
2
3
4
5
3
15%
4
13%
Figure n°4 : Exercice n°1, Item
n°4, verbe à retrouver (2 verbe)
e
Le cinquième item n'a pas été traité
par l'ensemble des élèves puisqu'il s'agissait
de travailler sur les deux verbes et obtenir les trois temps
ci-dessous: « si vous avez
bien travaillé, vous avez plus de la chance d'être
reçu.
« Si vous avez bien travaillé, vous aurez plus de
chance d'être reçu »
(SI + passé composé + présent+ passé
composé +futur)
« Si vous aviez bien travaillé, vous auriez eu plus
de chance d'être reçu »
Aucune de ces réponses n'a été
donnée. Cette modalité n'a sans doute pas
été
traitée en classe ?).
2.8.1.2 l'exercice n°2
Transforme les phrases ci-dessous selon les modèles
ci-dessous :
Modèle N°1 : Les chasseurs auront du gibier à
condition de bien allumer le feu.
Modèle N°2 : Les chasseurs auront du gibier à
condition qu'ils allument le feu
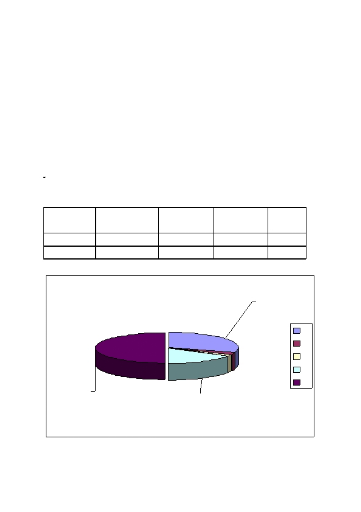
109
o Nous ferons de belles récoltes à condition de
mettre de l'engrais
o Nous ferons de belles à condition que nous ..
o Vous pourrez vivre à condition de travailler durement.
o Vous pourrez vivre à condition que vous ...
o Nous sortirons à condition que nous ayons une voiture.
o Nous sortirons à condition d'.
o On trouvera d'autres mines à condition que l'on
continue des recherches.
o Nous .à condition de
o Vous .à condition que vous .
Item n°1 de l'exercice n°2 :
Nous ferons de belles récoltes à condition que nous
mettions de l'engrais.
Item n°1
Nombre
%
Pas de
réponse
41
60,29
Res ; juste
3
4,41
Res.
Phonétiq.
2
2,94
Présent
22
32,35
1
30%
2
2%
5
51%
3
1%
1
2
3
4
5
4
16%
Figure n°5 : Exercice n°2- Item 1
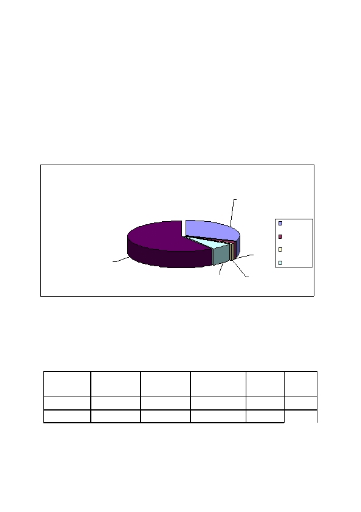
110
La connaissance de la modalité subjonctive n'est pas
maîtrisée, pourtant elle figure
au programme de cette classe. Nous avons compté
comme juste les phrases du
type :
« nous feron de belles récolte à
conditio que nous metion de l'engrais. Nous
n'avons pas tenu compte des fautes d'orthographe.
L'élève ne parvient pas à
identifier correctement l'orthographe de la conjugaison.
(conditio) est une mauvaise
prononciation héritée au contact des deux langues
«arabe-français ».
31%
59%
2%
1%
pas de
repon
res.juste
res.phonéti
infinitif
7%
Figure n°6 : Exercice n°2- Item n°1
Exercice n°2-Item n° 2:
Phrase attendue : vous pourrez vivre à condition que vous
travailliez
Item n°2
Res.juste
Res.phonéti
Infinitif
Nombre
%
Pas de
réponse
52
76,47
Totaux
3
4,41
2
2,94
11
16,17
68
100
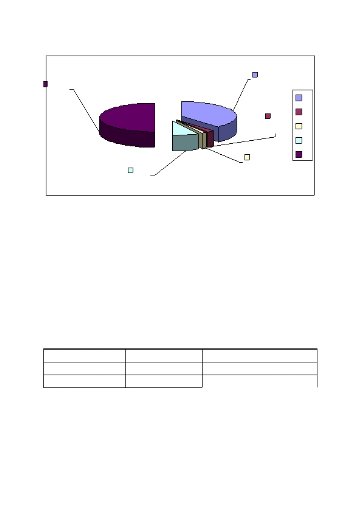
111
5
51%
1
38%
2
2%
4
8%
Figure n°7 : Exercice n°2 - Item
n°2
3
1%
1
2
3
4
5
Les phrases phonétiques sont en général, des
phrases mal orthographiées ; nous
donnons quelques unes, mais elles demeurent toujours fausses :
« vous pouré vivre à conditi que vous
travayé »
« vous pouez vivre à conditio que vous
travaillé »
L'infinitif a été placé à la place
du subjonctif - «travailler ». Les élèves ont mieux
retenu la leçon sur les infinitifs que sur le
subjonctif. En effet, l'utilisation du
subjonctif demeure très difficile pour la
majorité de nos élèves.
Item 1.2.3 ces item nécessitent pas d'infinitif.
Exercice n°2- Item n°3 :
«Nous sortirons à condition d'avoir une voiture
»
Item n°3
Nombre
%
Res. Juste
54
79,41
Pas de réponse
14
20,25
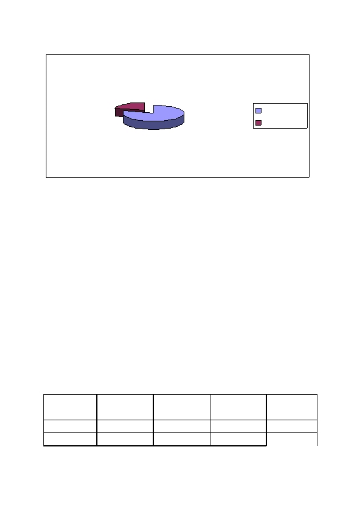
112
pas de rep
21%
Rep.juste
pas de rep
Rep.juste
79%
Figure n°8 :Exercice n°2- Item n°3
Est-ce un hasard que les élèves retrouvent
facilement l'infinitif ou la leçon sur
l'infinitif a été la mieux comprise, en classe ?
Il faut reconnaître que les résultats
sont très intéressants, ici.
La frange d'élèves qui a trouvé les
réponses justes est cette fois est très
importante (79,41 %).
Exercice n°2-Item n°4:
Dans cet item la difficulté est double : il s'agit de
mettre un futur et un infinitif.
Les résultats du premier membre de la phrase sont
nettement mieux que ceux du
deuxième membre.
-Premier membre :
(Nous trouverons à condition de continuer les recherches)
Item n°4
e
1 membre
Nombre
%
Pas de
réponse
12
17,64
Res.juste
Présent
Totaux
52
76,47
4
5,88
68
100
« Nous trouvons à condition de continuer les
recherch »
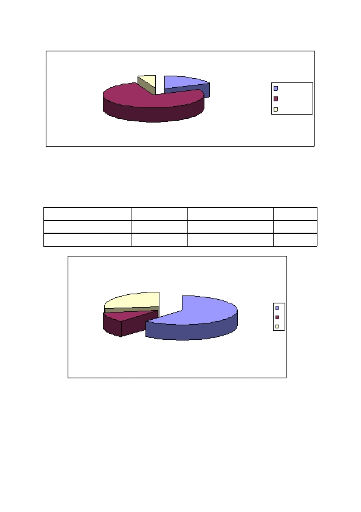
113
6%
18%
pas de rep
Rep.juste
présent
76%
Figure n°9 : Exercice n°2 - Item
n°4, 1 membre
er
2
ième
membre de l'item n°4 :
Item 4 (2
ième
membre)
Nombre
%
Pas répondu
84
61,76
Res. juste
15
11,02
Présent
37
27,20
3
27%
1
2
3
2
11%
1
62%
Figure n°10 : Exercice n°2- Item
n°4 ,2
ième
membre
Quinze élèves ont fait juste la phrase. Les
élèves qui ont cru bon de ne pas
répondre sont légèrement supérieurs
à ceux qui ont fait juste. Par contre, ceux qui
maîtrisent le présent de l'indicatif sont au nombre
de 37. Ce qui est étonnant c'est
que les élèves parviennent à trouver
l'infinitif dans l'item n°2, mais pas dans l'item
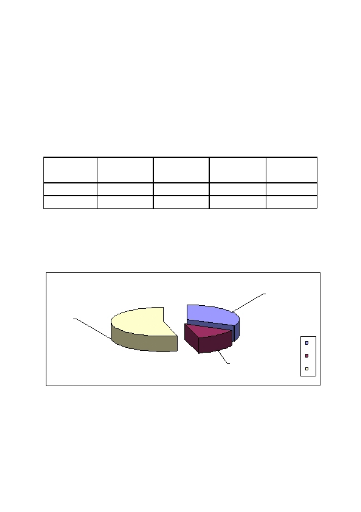
114
n°3. Ceci met en doute l'affirmation que nous avons
donnée plus haut. (la maîtrise
concernant l'infinitif).
L'item n°5 comprend aussi deux membres :
Les concepteurs des fiches n'ont donné que le
cadre de la phrase et c'est aux
élèves de fournir une phrase correcte.
Vous (futur) à condition que vous (subjonctif)
Item n° 5
e
(1 membre)
Nombre
%
Pas de répon
Res. Juste
Présent
Totaux
23
33,82
9
13,23
36
52,94
68
100
Seulement neuf connaissent le futur. Les autres, plus
nombreux semblent avoir
appris correctement la modalité du présent de
l'indicatif. Confondent-ils les deux
modalités ?
1
32%
3
55%
2
13%
1
2
3
Figure n°11 : Exercice n°2-Item n°5
,1 membre
er
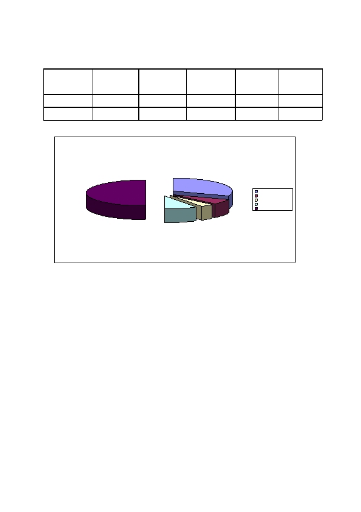
115
Deuxième membre de l'item n°5 :
Item
N°5
Pas répon
Res.juste
(2 membre)
e
Nombre
%
42
19,11
09
13,23
Res.phonét
ique
5
7,35
Présent
totaux
12
17,64
68
99,98
31%
49%
Pas répon
Res.juste
Res.phonétique
Présent
totaux
7%
4%
9%
Figure n°12 : Exercice n°2-Item5 2
2.8.1.3 Exercice n°3:
ième
membre
Sur les mêmes modèles que dessous, écris
trois phrases :
Ex : J'ai vu son adresse exacte. Je lui envoie une carte de voeux
Si j'avais son adresse exacte, je lui enverrais une carte de
voeux »
1
2
3
Cet exercice n'a été fait que par 52
élèves sur les 136 testés.
52 élèves ont donné une phrase sur les
trois, mais cette dernière est souvent mal
construite. Nous citerons quelques unes parmi-elles. Celles Qui
reviennent le plus
souvent sont celles qui acceptent la structure « à
condition de + un infinitif)
1° cas : « structure : à condition de :
« Je vai au sinima a condition demender maman »
« maman prépare le repa a condition tou les afare
»

116
« Papa condision un cade bin »
« Je sort à la r^crai ation a condition de ne pas
courire »
2 cas : avec la structure « si »( très mal
écrite)
« je sortra ce je termin men icriratur »
Les deux autres phrases attendues n'ont pas été
effectuées.
e
Nous savons qu'à une hypothèse utilisant
l'imparfait après la subjonction
« si » doit correspondre le conditionnel
présent. Donc, dans ce cas, l'élève n'a pas
encore appris correctement le fonctionnement de
l'hypothèse, mais il sait au moins
que le second membre doit avoir un temps différent de
celui du premier membre.
En général, nous avons une moyenne de 15
élèves sur l'ensemble des 68 élèves
qui a tout simplement copié les infinitifs. Ce
phénomène nous montre que ces
élèves ignorent la conjugaison des verbes
utilisés. Le pourcentage est de 17,64 %
soit sensiblement le cinquième de la classe qui
ignore la conjugaison. Nous
pouvons donc supposer :
L'enseignement de la conjugaison est mal effectué:
Les élèves n'arrivent pas à comprendre le
fonctionnement de cette conjugaison et
remettent en place les verbes à l'infinitif.
l'apprentissage est mécanique :
les enfants ne retiennent pas grand chose parce qu'ils ne sont
pas motivés.
Imparfait, conditionnel mal orthographiés :
Nous retrouvons cinq réponses soit 7,35 %
L'élève a écrit : «Si tu avé un
dictionnaire, ton travail soré plus facile » au lieu de :
«Si tu avais un dictionnaire, ton travail serait plus facile
». L'élève confond plusieurs
phonèmes à la fois. // dans « avais » et
le (u) avec le phonème //. Dans l'arabe
algérien, nous rencontrons le phonème /U/.
L'apprentissage de la conjugaison a été
effectué sans tenir compte des prononciations des
phonèmes n'existant pas dans la
langue de l'élève. Nous avons aussi
rencontré dans l'exercice un exemple très
intéressant :
« Si tu avé un dictionnaire, ton travail sura plus
facile ».
Est-ce que l'élève voudrait utiliser le
conditionnel présent ? Ce qui signifie qu'il
connaît la structure, mais ne la maîtrise pas.
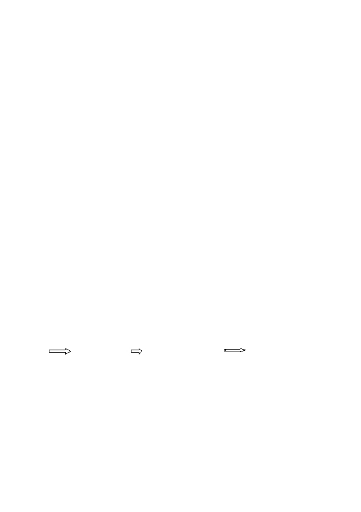
117
Nous remarquons donc ici le mélange dans la prononciation
et l'identification entre
/y / et //. En effet, dans la langue arabe, nous ne
rencontrons pas les deux
phonèmes /O/ et /_/, l'élève opère un
transfert. Pour cet élève, la règle lui semble
avoir été appliquée et nous ne pouvons
que lui faire remarquer les erreurs
d'orthographe commises. Ce qui est totalement faux.
Peut-on parler d'erreur de graphie quand nous
rencontrons une mauvaise
conjugaison. En effet, la conjugaison est mécanique et ne
doit pas donner lieu à des
erreurs. Mais il peut paraître bizarre d'en parler
ici, nous sommes convaincu que
l'appareil phonatoire de l'apprenant n'a pas été
travaillé pour qu'il puisse s'adapter
aux prononciations des voyelles de la langue française.
L'apprenant n'a donc retenu
que la prononciation arabe ou du moins les prononciations qui
s'en approchent, d'où
des erreurs.
Nous verrons certains cas de phonèmes mal
orthographiés, car nous avons senti
que les apprenants éprouvaient des difficultés de
prononciation.
Nous citerons à titre d'exemples les quelques phrases
trouvées dans les exercices :
« Si iqrivi mieux, tu soré lisible » /e/- /i/ et
// et /?/
« Si vous travairé bien, vous soré plus de
chance d'être reçu »
« Vous trevré à condition de continuer »
« Si tu avais un dictionnaire, ton travail sura plus facile
»
L'absence de certaines voyelles en arabe oblige les apprenants
à avoir une aperture
de /i/ -/u/ - Ces voyelles sont proches du point de vue
articulatoire, voici, par
exemple, les traits qui distingue les /y/ et le /_/
/y/
[ - Postérieur]
[+rond]
[+ tendu ]
[+ fermé]
/U/
[ - Postérieur ]
[+rond]
[+ tendu]
[+ fermé]
//
[ - Postérieur ]
[- rond]
[- tendu]
[-fermé]
Nous remarquons que la voyelle /y/ qui n'existe pas en
arabe est souvent
remplacée par /i/ ou par /u/. La voyelle /_/ est souvent
remplacée par /o/ ou encore
/u/. Il nous semble qu'il est nécessaire de faire
apprendre à l'élève d'abord les
prononciations des voyelles inexistantes en arabe. Le
travail sur la conjugaison
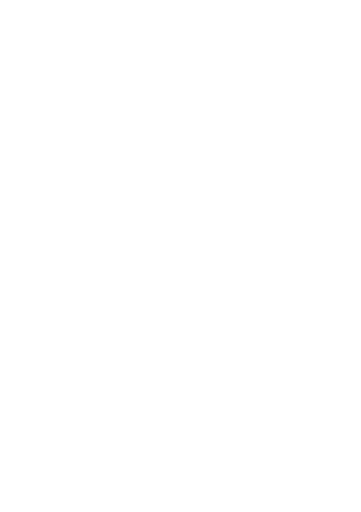
118
viendrait après. Puisque les conjugaisons sont plus
mécaniques, il nous semble
qu'un travail important sur les prononciations est plus
qu'obligatoire.
2.8.2 Analyse des résultats des exercices de la
sixième année :
Pour cette classe nous avons aussi donné trois exercices
que nous avons retirés de
leur livre de lecture. Les trois portaient sur
l'hypothèse.
2.8.2.1 Exercice n°1 :
Mets le temps qui convient :
- Si je (être) riche, je (acheter) une belle villa sur le
littoral
- Si je (sortir)..de la maison, je (prendre).froid par
ce jour
d'hiver.
- Si je ( chanter).convenablement ce morceau, je
(avoir)..une
prime .
Seuls 32 élèves ont essayé de travailler
l'item un. Pour les quatre possibilités nous
avons obtenu les résultats suivants.
Exercice n°1 - item n°1 :
Mets le temps qui convient :
(Être- acheté) - Si je
......................................riche, je ...........................une
belle villa
sur le littoral.
Pour cet item, nous avons eu quatre possibilités :
Si + présent, présent
Si + présent, futur
SI + imparfait, conditionnel
8/32 soit 25 %
3/32 soit 9,37 %
4/32 soit 12,5 %
Si + plus - que - parfait, conditionnel présent ou
passé : 0 /32 (0%)
Autres résultats faux :
SI + infinitif, infinitif 14/32 soit 43,75 %. Donc, 14
élèves ont tout simplement
recopié les infinitifs à leur place. Est-ce
que nous pouvons affirmer que ces
quatorze élèves ignorent la conjugaison ? Ou
tout simplement qu'ils ignorent

119
l'expression de l'hypothèse ? En effet, ces
élèves ne maîtrisent pas la conjugaison
des verbes, donc, nous ne pouvons dire qu'ils connaissent
l'hypothèse.
2 élèves ont mis un présent et un infinitif
2/32 soit 6,25 %
D'une manière générale et vu la marge de
liberté laissée aux élèves, le choix des
temps a été respecté, mais nous retrouvons
des cas qui posent problèmes de la
méconnaissance de la conjugaison :
(Nous n'avons pas retrouvé la forme du conditionnel
passé ou présent dans
l'expression : Si + imparfait de l'indicatif, conditionnel
présent ou passé.)
si + présent, présent.
Ex : « si je sui riche, j'achète une belle villa sur
le littoral »
« Si je suie riche, j'achetere une belle villa sur le
littoral »
L'auxiliaire être au présent n'est pas
maîtrisé : à l'oral, la prononciation de cette
conjugaison est connue, mais l'orthographe de cette forme est
évacuée.
Pour le deuxième exemple, nous appréhendons la
forme : Si + présent, futur
Là, nous rencontrons une erreur d'orthographe dans la
conjugaison du présent de
l'indicatif à la première personne (suie) au lieu
de (suis) et une erreur au futur de
l'indicatif (achetere) au lieu de (achèterai). La
conjugaison des deux verbes peut être
considérée comme saisie oralement et non
«orthographiquement».
Si + imparfait, futur.
Ex : « Si j'éter riche, j'achetera une belle ville
sur le littoral »
On retrouve aussi le présent de l'indicatif à
côté d'un imparfait mal écrit.
Si j'été riche, j'achète une belle villa sur
le littoral.
Là, encore, les deux verbes donnés à l'oral
semblent indiquer l'imparfait et le Futur.
L'erreur porte plus sur la méconnaissance de
l'expression de l'hypothèse, tout
d'abord, et sur la méconnaissance de la personne de
conjugaison. Le sujet est à la
première personne et la modalité verbale est
à la troisième personne.
Les deux verbes sont mal orthographiés (éter) au
lieu (étais) et le verbe (acheter) au
conditionnel (achèterais). Y a-t-il confusion dans les
différents sons ?
Le dernier exemple montre bien que l'enfant a inventé une
forme nouvelle de * si +
imparfait, présent de l'indicatif, forme qui n'appartient
pas à l'hypothèse.
Nous remarquons aussi la confusion de certains phonèmes
/e/ // Ceci se présente
dans la conjugaison de l'auxiliaire être - /e/ du
début de (étais et la fin de ce même
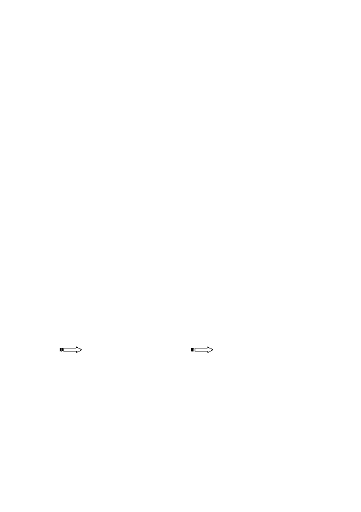
120
verbe //= (ais). Pendant l'apprentissage de la conjugaison
systématique, nous
suggérons que l'on veille à la prononciation
correcte.
Exercice n°1- item n°2:
(Sortir - prendre) si je .de la maison, je .froid par ce jour
d'hiver.
Dans cet item, nous nous attendons à quatre
réponses à structures identiques à
l'item n°1.
-
-
-
-
Si+ présent, présent,
Si + présent, futur,
Si + imparfait de l'indicatif, conditionnel présent,
Si + plus-que-parfait de l'indicatif, conditionnel présent
ou passé
Seul le cas (Si + imparfait, conditionnel) a reçu deux
réponses justes et une réponse
erronée du type :
Ex : « Si je sortirai de la maison, je prendret (prendrers)
froid par ce jour d'hiver. »
Dans ce troisième cas, nous sentons que
l'élève a quand même retenu quelque
chose de l'hypothèse, au moins dans sa forme,
mais c'est au niveau de la
conjugaison que le travail d'apprentissage a fait défaut.
Remarque : Après la subjonction « si »
l'élève a mis (sortiri) pour (sortirais) ou
encore (sortirai). Il y a donc confusion de certains
phonèmes /i/ - //, en outre, nous
retrouvons l'interférence (ou transfert de
l'arabe à la langue française).Nous
pensons aussi qu'il a mis un conditionnel ou un futur
après « si ». Pouvons -nous
affirmer que l'enfant connaît l'expression de
l'hypothèse dans ce cas précis ?
Comparons les deux phonèmes :
/i/
[ - postérieur]
[- rond]
[+tendu]
[+ fermé]
//
[ - postérieur]
[-rond]
[+ tendu]
[-fermé]
Ces deux phonèmes ne se distinguent que par le fait que
l'un est plus fermé que
l'autre, chose qui rend leur confusion plus
fréquente chez les apprenants. Il nous
semble que nous pouvons éviter ces erreurs par un
apprentissage plus soutenu de
l'expression de l'hypothèse.
« si je sortirai de la maison, je prendrais froid par ce
jour d'hiver. »

121
Dans cette réponse, nous avons un mélange de
futur et de conditionnel. Donc,
l'expression de l'hypothèse n'est pas saisie.
Cependant, il nous semble que cet
élève effectue un transfert de langue à
langue.
Nous avons aussi un autre exemple où nous retrouvons des
erreurs phonétiques qui
reposent le problème de la confusion des
phonèmes. Pouvons-nous dire que cet
élève connaît sa conjugaison ? Non. L'enfant
ignore la conjugaison des verbes et
ne maîtrise pas l'hypothèse.
« si je sortiré de la maison, je prender froid par ce
jour d'hiver. »
Exercice n°1- item n°3 :
(Chanter avoir) - Si je ..convenablement ce morceau, j'une prime.
Les réponses attendues :
-
-
-
-
-
-
Si je chante convenablement ce morceau, j'ai une prime
Si je chante convenablement ce morceau, j'aurai une prime
Si je chantais convenablement ce morceau, j'aurais une prime.
Si je chantais convenablement ce morceau, j'aurais eu une prime.
Si j'avais chanté ce morceau convenablement, j'aurais une
prime.
Si j'avais chanté ce morceau convenablement, j'aurais eu
une prime
Les résultats obtenus :
Si + présent, présent
5/32, soit 15,62 %
Le reste est totalement faux. Parmi ces nombreuses
fautes, nous retrouvons les
erreurs du type :
-Si je chanterai ce morceau convenablement, je avoir une prime
6/32 soit 18,75 %
Nous remarquons que l'élève place juste
après si le futur. Il nous semble que cet
élève a fait une interférence. En effet,
dans sa langue, il peut placer le futur juste
après la subjonction. (Le futur et le présent ne
se distinguent pas en langue arabe)
Le verbe du deuxième membre de la phrase
hypothétique n'est pas conjugué. Nous
supposons que cet élève ignore la conjugaison de
l'auxiliaire « avoir ».
Nous retrouvons aussi une erreur, mais cette fois,
l'erreur est due à la mauvaise
orthographe du temps. Nous donnons l'exemple
rencontré dans les copies des
élèves.
- Si je chante ce morceau convenablement, je orai une prime 3/32,
soit 9,37 %.

122
Le dernier exemple que nous avons retrouvé dans une copie
1/32, soit 3,12 %, est
édifiant : l'auxiliaire « avoir » se confond
avec le verbe «voir ». Nous retrouvons
aussi le conditionnel présent placé juste
après la subjonction.
- Si je chanterais ce morceau convenablement, je verai une prime
1/32. Il faut noter
que la conjugaison du verbe voir n'est pas cernée.
En conclusion à cette analyse, nous pouvons dire
qu'une bonne partie de nos
élèves ignorent l'expression de l'hypothèse,
mais ce qui plus est grave, c'est qu'ils
ignorent aussi la conjugaison de certains verbes usuels.
L'item N°4 n'a pas été donné par
l'ensemble des élèves.
2.8.2.2 Exercice n°2:
Faites huit phrases au conditionnel : (quatre avec le verbe
avoir et quatre avec le
verbe être)
1.
2.
3
4
Le travail n'a pas été fait par l'ensemble
des élèves. Les élèves sont invités
à
donner de leur cru plusieurs phrases. Ceci apparaît
comme une grande difficulté
insurmontable. Là nous sommes en droit de nous poser la
question : est-ce que ces
élèves ne sont pas habitués à
rédiger des phrases ?
2.8.2.3 Exercice n°3 :
Complète les phrases suivantes en employant
l'impératif.
1. Si tu veux être à l'heure, .
2. , si tu ne veux pas les perdre.
Complète les phrases ci-dessous en employant la
structure - Si + présent de
l'indicatif, présent.
1.., apprends tes leçons dès maintenant.

123
2. Fais vite , .
Construis une phrase selon le schéma ci-dessous
SI + présent, impératif
.
Pour le premier item nous avons obtenu les phrases suivantes :
« Si tu veux être à l'heure, presse - toi
»
« Si tu veux être à l'heure va vite »
Ces deux phrases ont été données par les
trente deux élèves
Pour l'item n°2 :
« Cours vite, si tu ne veux pas les perdre » 13/32
« vas vite , si tu ne veux pas les perdre » 16/32
« Marche, si tu ne veux pas les perdre » 3/32
Pour l'item n°3 l'ensemble des élèves a
écrit :
«Si tu veux réussir, apprends tes leçons
dès maintenant » 32/32
Les Item 4 et 5 n'ont pas été effectués par
les élèves.
A la fin du second cycle, et dans les classes
testées, nous pouvons dire que la
forme (en rais) (conditionnel) reste encore largement à
découvrir. Du point de vue
syntaxique, les apprenants éprouvent de très
grandes difficultés dans l'emploi libre
des structures hypothétiques de base. Les exercices de
conception auraient mieux
formé ces apprenants à l'utilisation de
l'expression de l'hypothèse. C'est
certainement le signe que l'expression de
l'hypothèse est loin d'être saisie et
acquise, ce qui est tout a fait normal à ce niveau
d'enseignement.
Nous pouvons aussi nous demander si les exercices structuraux
dans l'ensemble
mieux réussis, ne cachent pas une inaptitude
mentale à entrer dans le système
sémantique de l'expression de l'hypothèse. Il
nous semble qu'il aurait fallu exiger
des élèves qu'ils produisent un texte pour mieux
nous en apercevoir. Donc, n'étant
pas habitué à cette production, nous ne pouvions
que leur proposer des exercices
donnés par les manuels utilisés dans leur classe.
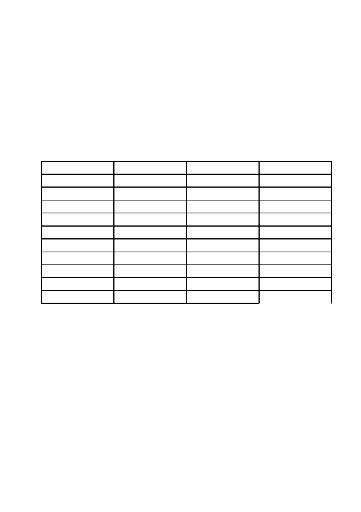
124
2.9 Analyse des résultats du 3
ième
palier :
Le test proposé a été effectué
par 743 élèves du troisième palier de
l'école
fondamentale. Le tableau ci-dessous va nous montrer la
répartition géographique de
ces élèves. Six établissements ont
participé à cette opération. Il faut, peut-
être,
rappeler que certains enseignants de certains
établissements ont cru à un contrôle
plus ou moins déguisé par l'inspecteur que je
représente en situation normale.
Le tableau ci-dessous montre le nombre
d'élèves ayant rendu le test demandé
Etablissement
Boufarik
Route de chebli
Ibn quotéiba
Birtouta
E.F.Ancienne
E .F. Lakel
Chebli
Ibn khalef
120 logements
Totaux
7 AF
e
8 AF
e
9 AF
e
-
-
20
-
76
76
40
40
15
15
24
31
36
58
174
15
15
80
28
43
278
2.9.1 Analyse des résultats de la septième
année fondamentale :
Les élèves testés dans cette classe sont au
nombre de 174 élèves.
Dans le premier exercice, nous avons essayé de demander
à l'élève de conjuguer
un seul verbe dans l'un des deux membres de la phrase. En
général, c'est le second
verbe que l'élève devrait mettre soit au
conditionnel, soit au futur, soit au présent. En
somme, il s'agit d'un contrôle de la conjugaison.
2.9.1.1 Exercice n°1:
Item n° 1:
« Si vous arrivez de bonne heure, vous pourrez visiter le
musée »
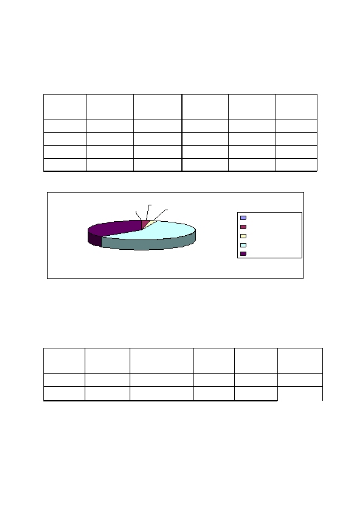
125
Si + présent, futur de l'indicatif
La seconde solution attendue est aussi : Si + présent,
présent de l'indicatif.
« Si vous arrivez de bonne heure, vous pouvez visiter le
musée»
Futur
%
Présent
%
Résultat
juste
05
2,87
52
29,88
Résultat
phonétique
03
1,72
16
9,19
infinitif
102
58,62
40
22,98
Pas de
réponse
64
36,78
60
34,48
Imparfait
-
6
3,44
Figure n°13 : Présent de l'indicatif
0%
3%
2%
37%
58%
futur
res.juste
res.phonéti
infinitif
pas de repon
Figure n° 13 : Futur de l'indicatif
Item n°2 :
«Si le vent soufflait plus fort, il déracinerait les
arbres. »
N'a pas
répondu
33
18,96 %
Résultats
justes
19
10,91 %
(mauvaise
Orthographe)
21
12,06
Présent
Futur
Imparfait
49
28,16 %
O8
4,59 %
44
25,28
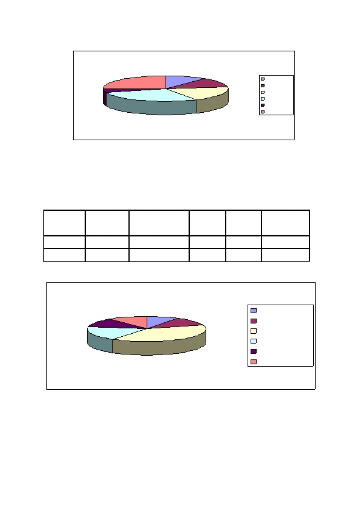
126
11%
25%
12%
5%
19%
res juste
res phonéti
pas de rep
présent
futur
imparfait
28%
Figure n°14 :Exercice n°1- Item n°2
Exercice n°1 - item n° 3:
N'a pas
répondu
69
39,65 %
Résultats
justes
15
8,62 %
(Mauv.
orthographe)
20
11,49 %
Présent
Infinitif
Imparfait
31
17,81 %
20
11,49%
19
10,91 %
11%
9%
11%
11%
18%
40%
res.justes
res.phonéti
pas de répon
présent
infinitif
imparfait
Figure n°15 : Exercice n°1 - Item
n°3
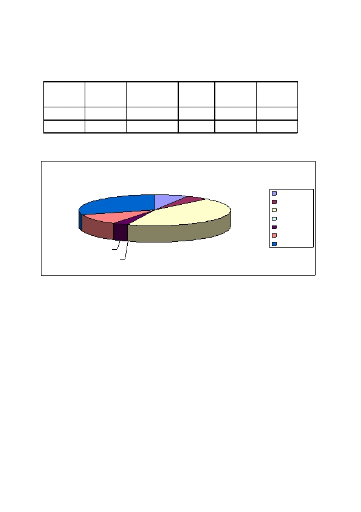
127
Exercice n°1 -Item n°4 :
«Les trapézistes tomberaient à terre, s'il n'y
avait pas de filet »
N'a pas
répondu
51
29,31 %
Résultats
justes
09
5,17 %
Justes
phonétique
12
6,89 %
Présent
Futur
Imparfait
76
43,67 %
20
11,49 %
06
3,44%
7%
5%
29%
11%
45%
res.juste
res phonéti
présent
futur
imparfait
autre
pas repon
3%
0%
Figure n°16:Exercice n°1- Item n°4
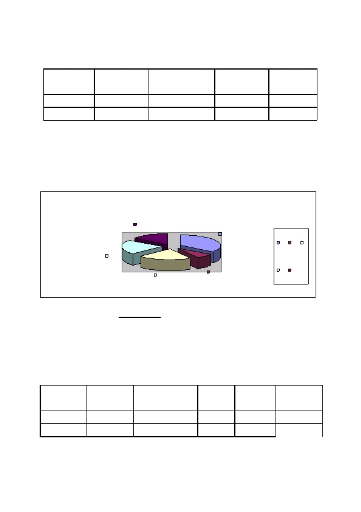
128
Item n°5 : « Si tu montais sur cette marche, tu verrais
peut-être mieux »
N'a pas
répondu
61
35,05 %
Résultats
justes
12
6,89 %
(Mauv.
Orthographe)
36
20,68 %
Présent
Infinitif
39
22,41%
26
14,94 %
5
15%
1
35%
1
2
3
4
22%
3
21%
2
7%
4
5
Figure n° 17 :Exercice n°1- Item n°5
Item n°6:
«S'il se déguisait, vous ne le reconnaîtriez
pas »
N'a
pas
répondu
43
24,71 %
Résultats
justes
15
8,62 %
Mal
orthographié
36
20,68%
Futur
Présent
Infinitif
27
15,51 %
45
25,86 %
8
4,59 %
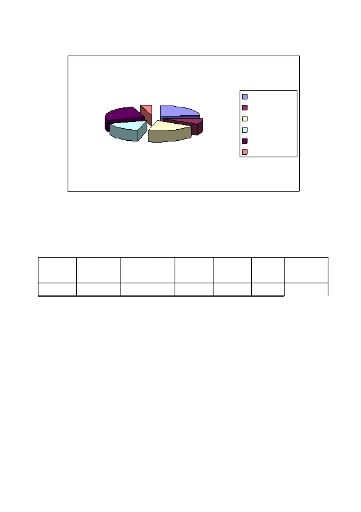
129
5%
24%
25%
9%
16%
21%
pas de repon
res.juste
mal orthog
futur
présent
infinitif
Figure n°18: Exercice n°1-Item n°6
Tableau récapitulatif :
n'a pas
répondu
14,06
Résultat
Justes
12,16
Juste(mauv
Orthograph)
14,55 %
Futur
Présent
Infinitif
Imparfait
10,05 %
26,71 %
9,91 %
12,21%
Le tableau récapitulatif montre bien que le pourcentage le
plus élevé est celui des
élèves qui ont répondu par le
présent de l'indicatif. Ceux qui ont su répondre
correctement avec une orthographe juste ne sont pas nombreux :
leur pourcentage
est de l'ordre de 12,16 %, par contre, ceux qui savent
conjuguer les verbes
phonétiquement sont légèrement plus
importants, leur pourcentage est de l'ordre
de : 14,55 %
Donc, nous constatons d'abord la méconnaissance de
l'expression de l'hypothèse,
et ensuite la mauvaise connaissance de la conjugaison des verbes
donnés au test.
Nous pouvons affirmer, sans nous tromper, que l'enseignement de
la conjugaison
est très mal assuré dans les classes. Nous
remarquons par contre que le présent de
l'indicatif est très bien su par les élèves
de ce niveau. Comme nous pouvons aussi
avancer que les temps sont appris d'une
manière orale. Ceci apparaît aux
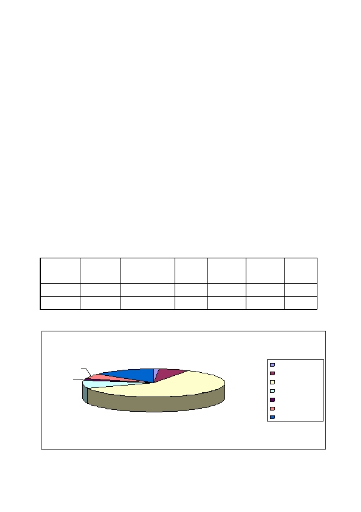
130
nombreuses erreurs que nous rencontrons dans le test. Nous avons
signalé cette
méconnaissance des temps.
A ce niveau, nous avons rencontré beaucoup de
difficultés de phonétique que nous
avons signalées plus haut.
En résumé à ce paragraphe, nous pouvons
tirer les conclusions suivantes :
-l'expression de l'hypothèse n'a pas été
assurée
- la conjugaison est très mal assise ou mal cernée,
- confusion de certains phonèmes signalés plus
haut.
2.9.1.2 Exercice n°2 :
Le second exercice comprend 5 items qui ont été
donnés comme test à 174 élèves.
La consigne est de compléter les phrases données
qui ne retiennent que le premier
membre de l'hypothèse.
1 item : « Si j'étais riche, ..
er
N'a pas
répondu
106
60,91 %
Résultat
s justes
02
1,14 %
Justes
Mauv.orthog
12
6,89 %
Présent
Infinitif
Imparfait
Futur
15
8,62 %
04
2,29 %
11
6,32 %
24
13,7%
14%
1%
7%
6%
2%
9%
61%
Res juste
res.phonéti
pas de repon
présent
infinitif
imlparfait
futur
Figure n° 19 : Exercice n°2- Item
n°1
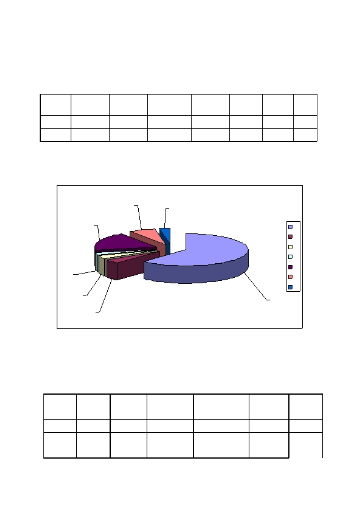
131
2
ième
item :
« Si j'avais dix huit ans,
N'a pas
répondu
108
62,0%
A répond
en arabe
07
4,02
Résultat
justes
06
3,44 %
Résultats/
Mauv.orth
04
2,29 %
A réécrit le
1 membre
e
32
18,39 %
Présent
Futur
totaux
12
6,89 %
05
2,87 %
174
100
6
7%
7
3%
5
18%
4
2%
1
2
3
4
5
6
7
3
3%
2
4%
1
63%
Figure n°20 : Exercice n°2-Item n°2
3 item :
e
« Si j'avais un électrophone,
N'a pas A écrit Résultats
répondu en arabe justes
133 08
76,43 % 4,59 %
07
4,02 %
Rep
Mauv.orthog
05
2,87 %
A réécrit le 1
membre
05
2,87 %
e
Présent
Futur
10
5,74 %
06
3,44 %
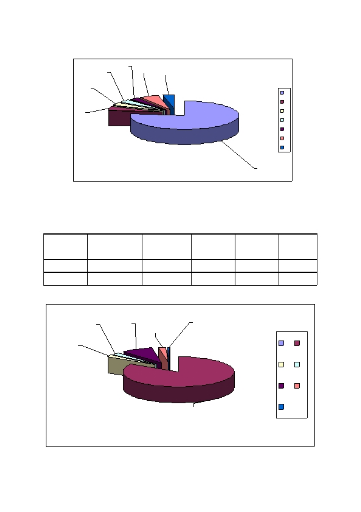
132
4
3%
5
3%
6
6%
7
3%
3
4%
2
5%
1
2
3
4
5
6
7
1
76%
Figure n°21: Exercice n°2-Item n°3
4 item : «Si les baguettes magiques existaient,
e
N'a pas
répondu
146
83,90 %
A réécrit le 1
membre
03
1,72 %
er
Résultats
justes
04
2,29 %
Résultat
Mauv ortho
16
9,19%
Présent
Futur
04
2,29 %
01
0,57 %
4
2%
5
9%
6
2%
3
2%
1
0%
7
1%
1
3
5
7
2
4
6
2
84%
Figure n°22 : Exercice n°2-Item n°4
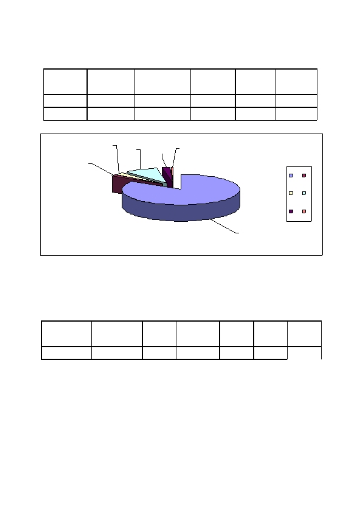
133
5 item : «S'il ne pleuvait pas,
e
N'a pas
répondu
129
74,13 %
Résultats
justes
02
1,14 %
Mauv.
Orthograph
12
6,89%
A réécrit le
1 membre
e
18
10,34 %
Présent
10
5,74 %
Futur
03
1,72 %
3
2%
4
9%
5
2%
6
1%
2
2%
1
2
3
4
5
6
1
84%
Figure n°23 : Exercice n°2-item n°5
Tableau récapitulatif
Res. justes
Res.phonétic
3,33 %
3,37%
Pas de
réponse
75,24%
Réécrit 1°
Membre
6,86%
Présent
Futur
Imparfait
5,85%
4,47·%
6,32%
Pour cet exercice, le pourcentage le plus élevé est
celui des élèves qui n'ont pas
répondu et qui est de l'ordre 71,48 %, donc, ceci montre
bien que plus de la moitié
n'ont pas compris l'expression de l'hypothèse. La
connaissance des temps (futur -
présent et imparfait) est vraiment minime. La conjugaison
n'a pas été apprise par les
élèves. Les quelques connaissances de
conjugaison que possède l'apprenant ne
sont pas maîtrisées correctement, puisque ces
élèves commettent d'énormes
erreurs en orthographe de ces verbes. Nous avons aussi
rencontré des erreurs de
phonétique que nous avons signalées plus haut et
que nous n'avons pas voulu de
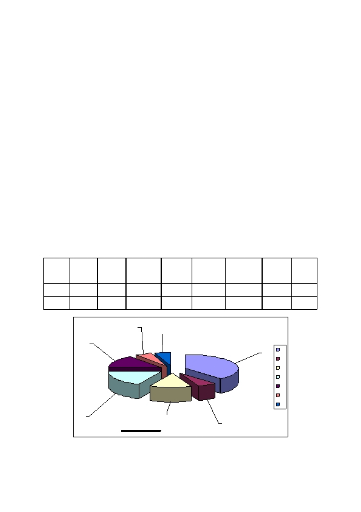
134
nouveau reprendre. Nous pouvons citer // et /e/ au futur
dans certains verbes -
(chantere) pour chanterai Est- ce que l'élève ne
connaît pas les désinences du futur,
ou tout simplement l'apprentissage a été fait
oralement ?
2.9.1.3 Exercice n°3 :
Dans cet exercice, on demande aux apprenants de conjuguer les
verbes mis entre
parenthèses.
1 item :
er
« Si je suis pauvre, tu le sais, mais si je (être),
riche que je ne te (donner) pas
les moyens de vivre sans rien faire. (A. France)
(Logiquement le premier verbe accepte l'imparfait et le
second le conditionnel
présent) - Les apprenants ont mis parfois le tout
au présent de l'indicatif et nous
l'avons accepté parce qu'il nous autorise à
identifier, au moins, l'utilisation de
l'expression de l'hypothèse. D'autres le refuseront parce
qu'il ne répond pas au sens
donné par la phrase .
pas de Rep.
rep
67
38.5
juste
10
5.74
Nbre
%
Rep.
Phoneti.
22
12.64
infinitif Présent Imparfait
Futur
Totaux
33
18.96
7
5%
25
14.36
9
5.17
8
4.59
174
100
6
5%
5
14%
1
38%
1
2
3
4
5
6
7
4
19%
3
2
Figure n°24:13%Exercice
n°3-Item 6 %n°1
Figure 24 : Exercice N°3 - Item
N°1
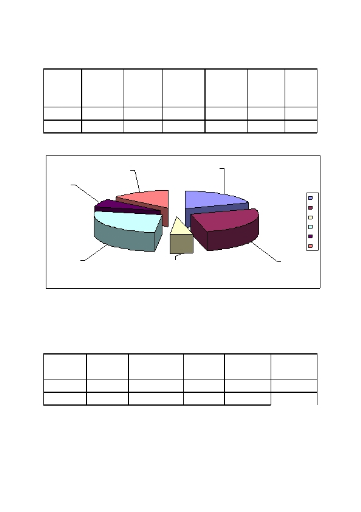
135
1 membre de l'hypothèse :
er
N'a rien
mis
34
19,54 %
Présent
46
26,43%
Résultats
justes
10
5,74 %
rep
Mauv.
Orth
47
27,01 %
Imparfait
Futur
Totaux
13
7,47%
24
13,79%
174
100
6
14%
1
20%
5
7%
1
2
3
4
5
6
4
27%
3
6%
2
26%
Figure n°25 : Exercice n°3 -Item
n°1- Premier verbe
2
ième
membre de l'hypothèse :
N'a rien
écrit
62
35,63%
Résultats
justes
10
5,74 %
Justes
Mauv Orth
27
15,51 %
Imparfait
13
7,47 %
Futur
16
9,19 %
Présent
46
26,43 %
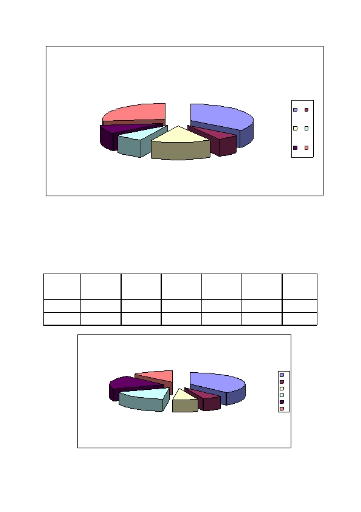
136
6
26%
1
36%
1
3
2
4
5
9%
5
6
4
7%
3
16%
2
6%
Figure n°26 : Exercice n°3 - Item
n°1- 2
ième
Verbe
2
ième
item :
« Si je ressuscite un jour, fantôme aveugle, c'est au
nez que je (reconnaître)
la partie de mon enfance. (G. Duhamel)
N'a pas
répondu
64
36,78
Résultats
juste
10
5,74 %
Mauv
Orth
12
6,89 %
Infinitif
28
16,09%
Présent
32
18,39 %
Imparfait
20
11,49%
Futur
08
4,59 %
6
12%
5
19%
1
39%
1
2
3
4
5
6
4
17%
3
7%
2
6%
Figure n°27 : Exercice n°2 -Item
n°2
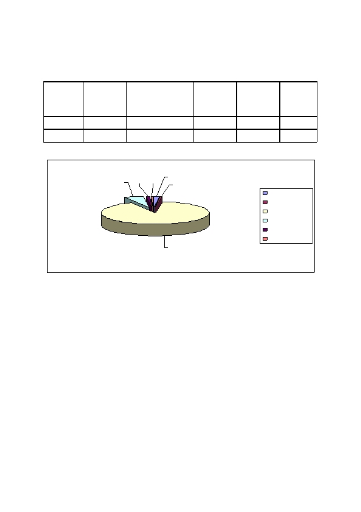
137
item :
« Ma douleur (être) médiocre si je
pouvais la dépeindre, je ne l'(entendre)
3
ième
pas. (Mme de Sévigné)
N'a pas
répondu
157
90,22 %
Résultats
Justes
3
1,72 %
Mauv.orthographe
Présent
Imparfait
Infinitif
1
0,57 %
10
5,74 %
02
1,14 %
1
0,57 %
6%
1% 1%
2%
1%
Res.justes
res.phonétic
pas de répon
présent
imparfait
infinitif
89%
Figure n°28 : Exercice n°3 -Item
n°3
N.B- le second verbe a été confondu avec entendre,
nous n'avons découvert que 6
réponses justes et le reste est mis à l'infinitif.
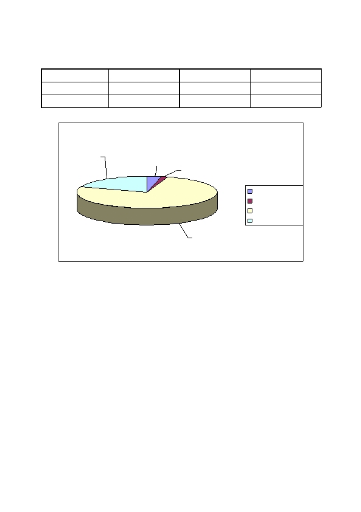
138
Deuxième membre de la phrase.
Res.justes
6
7,74
Res.phonéti
2
1,14
Pas de repon
132
75,86
infinitif
34
19,54
.
20%
3%
1%
res.juste
res.phonéti
pas de repon
infinitif
76%
Figure n°29 : Exercice n°3 -Item 3 -2
ième
membre
4
ième
item :
Je ne me ( couvrir).pas si vous vous ne vous couvrez
(Molière)
- Je ne me couvre pas si vous ne vous couvrez pas
- Je ne me couvrirai pas si vous ne vous couvrez pas
Aucune réponse n'a été fournie par les
élèves.
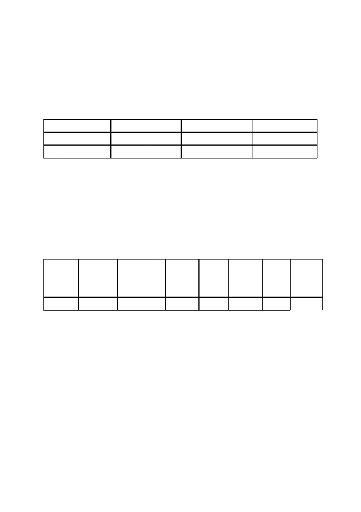
139
5
:
ième
item :
Je l'aime et le vénère, ce vieux mur. Je
ne (souffrir) pas qu'on m'y fit le
moindre changement et si on ne le démolissait, je
(sentir) comme l'effondrement
d'un point d'appui ( P.Loti)
N'a pas répondu
146
83,90 %
illisibles
27
15,51 %
Réponses justes
00
00
Présent
1
0,05 %
Cet exercice a reçu un semblant de réponse qui n'a
rien avoir avec la réponse
juste. Les 27 élèves ont écrit n'importe
quoi. Nous avons parfois retrouvé leurs noms
ou leurs prénoms, signe que ces élèves
n'avait pas saisi soit la consigne ou plus
exactement parce qu'ils n'avaient pas compris l'expression de
l'hypothèse.
Les exercices donnés ont abouti aux résultats
suivants :
N'a pas
répondu
Résultas
Justes
53,41 %
4,12 %
Résultats
phonétique
s
8,14 %
Présent Infinitif
Imparfait Futur illisible
9,54 %
6,89
5,18 %
7,46 % 16,37 %
Nous remarquons que plus de la moitié des
élèves n'ont pas réalisé les
exercices donnés. Nous pouvons donc conclure que
l'expression de l'hypothèse
n'est pas bien assise en septième année
fondamentale. La conjugaison des temps
de l'indicatif n'est pas non plus comprise et encore moins
apprise. Nous trouvons
beaucoup d'erreurs de confusion sur les pronoms personnels
et les désinences
verbales. (Les élèves confondent encore le
pronom personnel de la troisième
personne du singulier avec la troisième personne du
pluriel. (Il /ils). Parfois même, la
première personne du pluriel avec la
troisième personne du pluriel, ou encore
(Nous) avec la troisième personne du singulier
(il). Quant à la connaissance de
l'expression de l'hypothèse, nous sommes persuadé
qu'elle n'est pas comprise ou
mal effectuée.
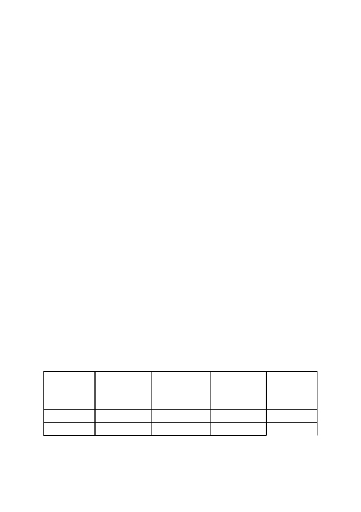
140
Les résultats obtenus sont décevants au
niveau de cette classe : nous
pensons que le travail effectué en conjugaison est
resté trop isolé sans être relié à
un point de syntaxe propre. En effet, quand la conjugaison
est rattachée à un
esprit de logique, elle demeure présente à
l'esprit de l'enfant.
2.10 La huitième année fondamentale :
2.10.1 Premier exercice :
La consigne donnée à cet exercice est la
suivante : « écris au plus-que-
parfait,les verbes mis à l'imparfait dans les phrases
suivantes.
Nous devons avoir comme résultat, l'application des deux
formules de l'expression
de l'hypothèse, à savoir :
-Si + plus- que-parfait, conditionnel présent
- Si + plus- que- parfait, conditionnel passé
Dans ces classes, les enseignants chargés de veiller sur
le test, se sont trompés et
ont donné à certains élèves les
exercices de septième année fondamentale. Pour le
dépouillement, nous n'avons tenu compte que des
élèves ayant travaillé sur les
exercices de huitième année fondamentale. Leur
nombre est de 64 élèves.
1 item :
Si nous avions froid, nous allumerions le chauffage.
Réponses :
Si nous avions eu froid, nous allumerions le chauffage
Si nous avions eu froid, nous aurions allumé le chauffage.
er
Tableau des résultats obtenus : (1 membre)
e
Ont laissé en
blanc
20
31,25%
Résultats
Justes
07
10,93%
conditionnel
Avec erreur
orth
13
20,31%
A recopié
Futur
16
25,00%
08
12,5%
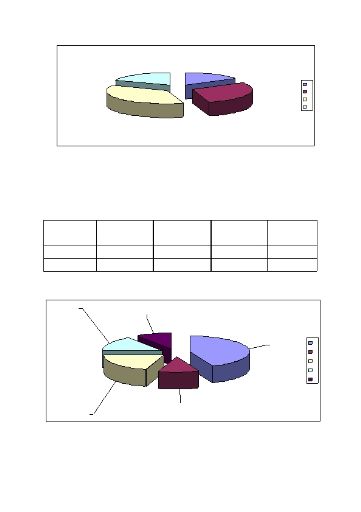
141
4
18%
1
16%
3
36%
2
30%
1
2
3
4
Figure n°30:Exercice n°1-Item n°1/
1 membre
er
2 membre :
e
Pas de
réponse
28
43,75%
Res.juste
7
10,93%
Condit.avec
erreur orthog
13
20,31%
A recopié la
phrase
10
15,62%
Futur
6
9,37%
4
16%
5
9%
1
44%
1
2
3
4
5
3
20%
2
11%
Figure n°31 : Exercice n°1-Item
n°1/ 2
ième
membre
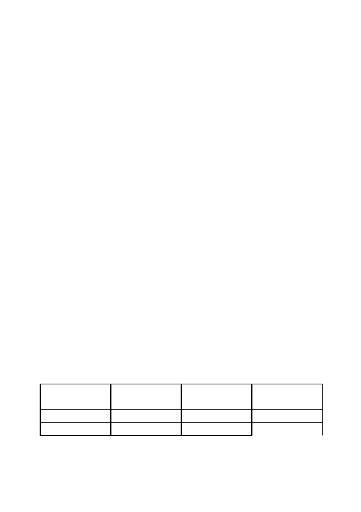
142
07 élèves ont répondu correctement, en
mettant le conditionnel présent. Il faut
signaler que nous n'avons pas rencontré la seconde forme
attendue : le conditionnel
passé.
13 élèves ont répondu au conditionnel
présent avec des erreurs en orthographe :
« Si nous avions eu froid, nous allumeriont le chauffage
» .
Nous avons aussi retrouvé le type de faute signalée
plus bas.
« nous allumeriez le chauffage ».le candidat
confond les personnes de la
conjugaison.
07 élèves se sont contentés de mettre la
forme infinitive au second membre de la
phrase hypothétique.
08 élèves ont gardé le premier membre tel
quel et ont mis au second membre le
verbe allumer à l'imparfait ce qui donne :
« Si nous avions froid, nous allumions le chauffage ».
Ceci, se comprend parfaitement puisque ces
élèves peuvent utiliser dans leur
langue le même temps dans les deux membres de la phrase
hypothétique.
06 élèves ont utilisé le futur dans le
deuxième membre en gardant dans le premier
l'imparfait, ce qui n'est pas conforme à l'expression de
l'hypothèse
« Si nous avions froid, nous allumerons le chauffage ».
20 élèves n'ont pas répondu à la
question.
Nous retrouvons aussi des fautes de conjugaison telles que :
« Si nous avions eu froid, nous allumerissons le chauffage
».
2 item :
e
Nous pouvons avoir les solutions suivantes :
-Si nous avions eu moins peur, elle nous inviterait à
manger.
-Si nous avions eu moins peur, elle nous aurait invités
à manger .
1 membre : plus-que-parfait
er
A laissé en blanc
18
28,12%
Conditionnel après
si
03
4,68%
Présent
01
1,56%
A repris les
mêmes éléments
42
65,62%
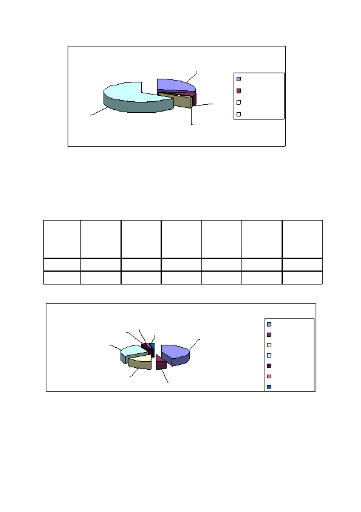
143
28%
5%
65%
pas repon
condit,apr.si
présent
a recopié
2%
Figure n°32 : Exercice n°1- Item
n°1 / 1 membre
er
2
ième
membre : conditionnel présent ou conditionnel
passé.
Nous n'avons pas trouvé de conditionnel passé.
A laissé
en blanc
28
43,75%
Imparfait
04
6,25%
Résultats
justes
10
15,62ù
mauv
orth
18
28,12%
Passé
simple
01
1,56%
P.S..avec
mauv
orth
O1
1,56%
Futur
02
3,12%
2%
2%
conditionnel (2)
3%
43%
28%
16%
6%
pas de repon
imparfait
res.juste
mauv.orthog
passé simple
ps. Mauv orth
futur
Figure n°33 : Exercice n°1- Item
n°1/ 2
ième
membre
Nous avons donc retrouvé 10 bonnes réponses. Dans
les 18 autres réponses
considérées justes, nous retrouvons beaucoup
de fautes de conjugaison. Les
désinences du conditionnel présent ne sont pas
respectées. Ce qui nous faire dire
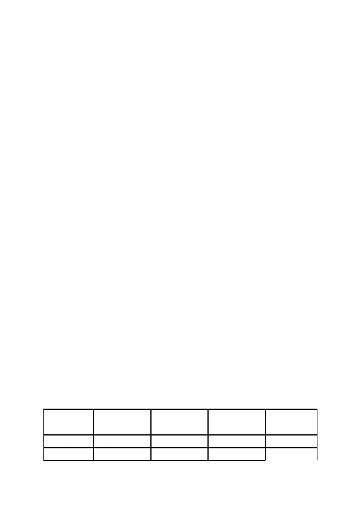
144
que l'apprentissage du conditionnel présent n'a pas
été assez bien assis chez les
apprenants.
3
ième
item et le 4
ième
item ont subi sensiblement le même traitement que ceux du 2
e
item. Il faut faire remarquer que le nombre
d'élèves n'ayant pas répondu est de (39).
Donc, les remarques faites pour l'item 2, restent les mêmes
pour ces deux items.
Nous retrouvons des erreurs dans la conjugaison du verbe inviter
:
« Si nous aurions .invitrait à manger etc.. »
« Si nous avions froid, nous allumeriont ».
Ou encore
Nous constatons ici une erreur sur la personne ; il y a confusion
entre la première
personne du pluriel et la troisième personne du pluriel.
Sur le plan des désinences,
l'élève confond la désinence de la
troisième personne du pluriel avec celle de la
première personne du pluriel. (ions) - (iont).
Nous rencontrons aussi des erreurs du type :
«Si vous agissiez autrement, on vous recompenseriez ».
L'apprenant confond la troisième personne du singulier
avec la 2
ième
personne du
pluriel (vous). Connaît-il le pronom indéfini (on) ?
Est-ce qu'il sait que ce pronom
remplace le pronom singulier de la troisième personne du
singulier ?
2.10.2 Exercice n°2:
Pour cet exercice, la consigne est :
« Ecris convenablement les verbes mis entre
parenthèses »
S'il réfléchissait un peu, il verrait que ce
problème est très facile. Cet exercice tente
de vérifier les connaissances de l'apprenant sur le
conditionnel présent.
Nous avons abouti aux résultats suivants :
Exercice N°2 -Item 1:
« s'il réfléchissait un peu , il (voir) que ce
problème est très facile ».
A laissé en
blanc
08
12,5%
Résultats
Justes
05
7,81%
mauv orth
Présent
Infinitif
06
9,37%
38
59,37%
07
10,93%
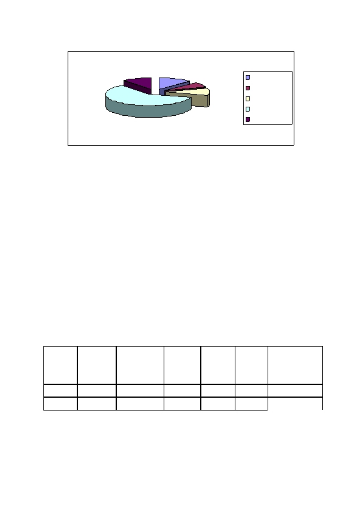
145
11%
13%
8%
9%
59%
pas de repon
res.juste
mauv.orthog
présent
infinitif
Figure n°34 : Exercice n°2 - Item
n°1
Seuls 5 élèves ont fait juste ; 6 autres ont
répondu avec une mauvaise orthographe
sur le temps. Nous pouvons citer *voirerait, *vera, *vaira etc.
Les élèves confondent les personnes et les
désinences des modalités. Savent -ils,
au moins, à quel moment, il faut utiliser tel ou tel temps
?
Le plus grand nombre d'élèves a
utilisé le présent de l'indicatif à la place du
conditionnel présent (38). (Si + imparfait, conditionnel
présent). Ne maîtrise -t-il que
le temps présent ? L'expression de l'hypothèse
n'est donc pas du tout maîtrisée.
Item 2 :
Si le poste avait fonctionné, nous pourrions
écouter la retransmission du match
Si le poste avait fonctionné nous aurions pu
écouter la retransmission du match.
Les résultats retrouvés :
A laissé
en
blanc
12
18,75%
Résultats
Justes
4
6,25%
mauv
orthographe
5
7,81%
Présent
Infinitif
Futur
29
45,31%
02
3,12%
4
6,25%
Confusion
dans la
conjugaison
08
12,5%
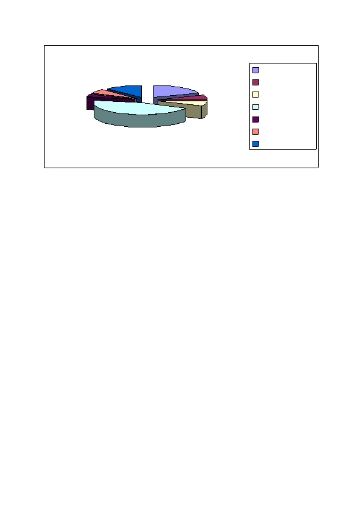
146
13%
19%
6%
3%
6%
8%
45%
pas de repon
res.juste
mauv.orthog
présent
infinitif
futur
conf, ds conj
Figure n°35 : Exercice n°2 - Item
n°2
Les résultats demeurent les mêmes : l'utilisation du
présent de l'indicatif est la plus
élevée chez ces apprenants. Ce qui est
intéressant, c'est que huit élèves ont utilisé
une forme de conjugaison assez intéressante.
« Si le poste avait fonctionné, nous pourret
écouter la retransmission ».
« Si le poste avait fonctionné, nous pourrez
écouter la retransmission ».
Il apparaît nettement que ces apprenants confondent les
personnes vous et nous.
Le 3
ième
item et le quatrième n'ont pas été
traités par les élèves testés.
Conclusion :
Dans cet exercice, nous remarquons que la connaissance de
l'hypothèse est
loin d'être assise.
D'une manière généra le, nous
rencontrons beaucoup d'erreurs de conjugaison.
2.10.3 Le troisième exercice :
Il comprend trois couples de phrases et un
modèle. L'apprenant doit
transformer ces couples de phrases indépendantes, en
phrases complexes.
- J'ai son adresse exacte. Je lui envoie une carte de voeux.
- modèle : Si j'avais son adresse exacte, je lui enverrais
une carte de voeux.
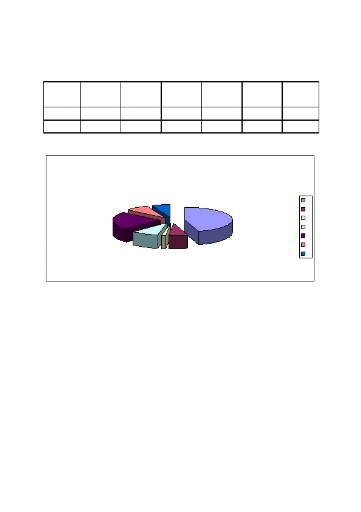
147
1 item :
Ils sortent. Nous les voyons.
S'ils sortaient, nous les verrions
A laissé
en blanc
29
45,31%
Résultats
Justes
4
6,25%
(mauv
orth
1
1,56%
A recopié
10
15,62%
e
Présent
11
17,18%
Futur
5
7,81%
Imparfait
4
6,25%
Item N°1-exercice N°3
6
8%
7
6%
1
46%
5
23%
4
9%
3
2%
2
6%
1
2
3
4
5
6
7
Figure n°36 : Exercice n°3 - Item
n°1
Le plus grand nombre d'élèves n'a pas
répondu à la question. 4 seulement
ont répondu juste et les autres ont écrit soit le
présent de l'indicatif, le futur ou même
l'imparfait.
« S'il sortais, nous le voyions »
« S'ils sortiront, (je lui) nous les voyons »
« S'il sortait, nous le voyions »
Nous retrouvons sensiblement les mêmes erreurs
découvertes plus haut dans
les autres exercices que nous re-citons pour mieux mettre
en évidence le non
apprentissage de l'expression de l'hypothèse.
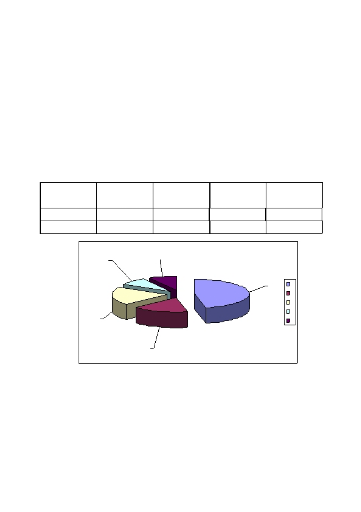
148
l'apprenant met le futur après la subjonction « si
»
Il mélange les modalités et ne respecte pas la
règle de l'utilisation des temps dans
l'hypothèse.
2
ième
Item :
Vous écrivez. J'ai de vos nouvelles
L'élève doit répondre : «si vous
écriviez, j'aurais de vos nouvelles.»
Verbe n°1
A laissé en
blanc
28
43,75%
Présent
10
15,62%
Imparfait
12
18,75%
Futur
5
7,81%
Passé
composé
5
7,81%
4
8%
5
8%
1
47%
3
20%
1
2
3
4
5
2
17%
Figure n°37: Exercice n°3 - Item
n°2/ 1 verbe
er
Nous ne trouvons aucune réponse juste. 10
élèves ont utilisé la forme si + présent,
présent.
Nous avons trouvé les réponses suivantes qui
méritent d'être étudiées :
Peut être perçu comme appartenant à la forme
: « Si + imparfait, conditionnel
« Si vous écrivai, je vorais de vous nouvelles
».

149
« Si vous avez écri, j'aurai de vos nouvelles ».
Peut être perçu comme appartenant à la forme
: »si + présent
« Si vous écrivez, j'avais de vos nouvelles ».
L'imparfait du second verbe trahit la forme.
Nous remarquons que les élèves confondent les
personnes et les désinences
de certaines modalités (cas du premier exemple).
L'expression de l'hypothèse est alors
méconnue, nous avons le deuxième cas de
l'exemple (présent, imparfait) et le troisième cas
passé composé, futur)
Le troisième item n'a pas été traité
par les élèves.
Conclusion :
L'expression de l'hypothèse n'est manifestement pas
apprise. Les élèves
rencontrent d'énormes problèmes dans la
conjugaison. Ils confondent les personnes
et mélangent les désinences des temps. Les
erreurs de phonétique sont aussi
énormes. Ils confondent le son (ai) avec (ez). Nous
pouvons citer l'erreur du premier
exemple, cité plus haut.
2.11 Analyse des items des exercices de la 9 année
fondamentale :
e
Comme pour les autres classes nous avons prévu
trois exercices pour la
neuvième année fondamentale qui totalisent 16
items.
Pour l'exercice n°1, nous donnons cinq structures et nous
demandons à l'élève de
choisir celle qui convient le mieux aux phrases
données. Notre intention est de
vérifier si l'élève sait utiliser les
structures de l'hypothèse.
2.11.1 Exercice n°1 :
Exercice n°1- item n°1:
« Tu feras des économies tu réduises tes
dépenses. »
L'élève ne peut utiliser que la structure «
à condition que » puisqu'il constate qu'il
s'agit du subjonctif dans le deuxième membre de la phrase
donnée.
Résultats obtenus :
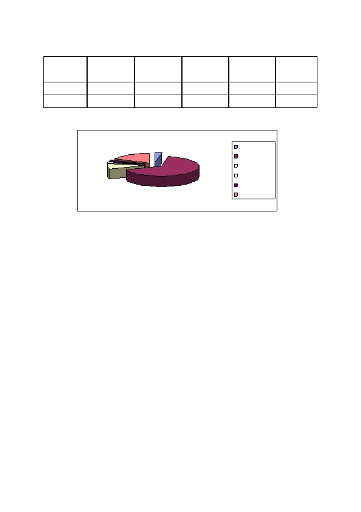
150
Si
8/278
2,87%
A condition
que
185/278
66,54%
A condition
de
22/278
7,91%
Sans
5/278
1,79%
Avec
8/278
2,87%
Pas de
repon.
50/278
17,98%
18%
3%
3%
8%
2%
66%
si
àcond que
àcond.de
sans
avec
pas de repon
Figure n°38: Exercice n°1 - Item
n°1
Nous remarquons que les résultats justes sont assez
importants.
Les résultats faux : les élèves ayant
utilisé la subjonction (Si)
Au lieu de changer la structure de la phrase, les 8
élèves ont gardé la phrase
telle quelle. Donc, ces apprenants ignorent l'utilisation de
l'hypothèse. Mêmes ceux
qui ont utilisé la structure « à
condition de », n'ont pas pensé à faire subir
à la
phrase des modifications pour répondre à
la règle qu'utilise l'expression de
l'hypothèse. Il nous semble que ces apprenants n'ont
compris qu'une chose : ils ont
des chevilles qu'il faut placer dans les vides et ils
se sont amusés à les faire de
n'importe quelle manière. Enfin ceux qui ont
utilisé les structures « sans » et
« avec » n'ont pas du tout compris le fonctionnement de
l'hypothèse.
Nous avons 185 élèves qui ont su placer la
structure adéquate, soit 66,54 % de la
classe.
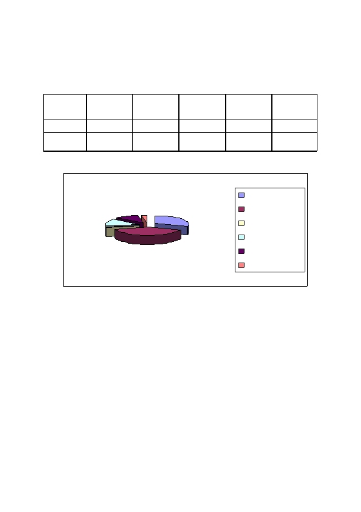
151
Item n°2 :
«S'il avait des outils, il réparerait la panne»
Tableau des résultats
A laissé
un blanc
83
29,85%
Si +(si il)
114
41%
A condition
que
06
2,15%
A condition
de
35
12,5%
Sans
32
11,5%
Avec
8
2,87%
12%
3%
30%
13%
2%
40%
pas de repon
si(si il)
à cond. Que
àcond.de
sans
avec
Figure n°39: Exercice n°1 - Item
n°2
Parmi les 114 réponses justes, nous retrouvons 52
réponses contenant (si il)
est-ce que l'apprenant ignore la règle qui dit
qu'à la rencontre de deux voyelles
identiques, on supprime la première. Les autres
structures ont été utilisées sans
qu'il y ait un changement dans la phrase. Nous pouvons
recopier l'exemple pris
dans un test :
« Il réparait la panne à condition qu'il avait
des outil »
Ceci montre bien que l'apprenant ignore le fonctionnement de
l'hypothèse ou
tout simplement, il faudrait voir ici une interférence due
à l'utilisation de sa langue
maternelle.
Nous avons aussi trouvé le « se », mis pour
« si » S'agit- il d'une simple erreur ou
s'agit-il d'une mauvaise retenue de la conjonction « si
» ?
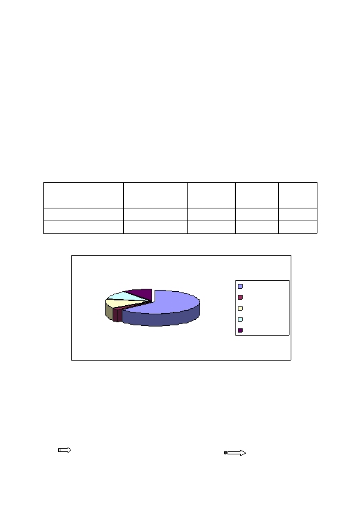
152
Les bonnes réponses sont au nombre de 62 soit 22,30 % et
nous ajoutons les 52 autres
réponses avec (si il), soit 18,70. Au total, nous
avons 41% comme réponses justes.
Nous pouvons dire dans cette classe l'expression de
l'hypothèse est Moyennement
apprise.
Item n°3 :
«Sans instruction, nous serons malheureux»
176 élèves ont retrouvé la bonne
répons, soit 63,33 %. Le reste se répartit en :
A condition de 8 élèves, soit 2,87 %
Avec .33 élèves, soit 11,87 %
Si ..32 élèves, soit 11,52 %
Rés. juste
176
63,30%
A condition de
8
2,87%
Avec
33
11,87%
Si
32
11,51%
Pas de
réponse
29
10,43%
10%
12%
12%
3%
63%
Res.juste
àcondi.de
avec
Si
pas de repon
Figure n°40: Exercice n°1 - Item
n°3
Pour les résultats justes, nous avons remarqué que
beaucoup d'élèves confondent
encore /a/ ~/Õ/. 7 élèves ont écrit
« Son » ou « sons » à la place de « sans
». Ces
élèves ne font pas la différence entre les
deux sons.
/Õ/
[+ postérieur]
/ a/
[ + postérieur]

153
[- ouvert
[+ rond
[+ nasal
]
]
]
[ + ouvert
[-rond
[+ nasal
]
]
]
Ex : « Son instruction, nous serons malheureux »
Les deux sons /Õ/ et /ã/ sont inexistants en arabe
et les apprenants les confondent
souvent.
Par contre, les apprenants ayant utilisé « avec
» et « si » ne comprennent pas le
sens de la phrase.
Item n°4 :
«Nous déménagerons à condition de
trouver un appartement plus grand »
Cette phrase ne peut admettre d'autres structures que «
à condition de », puisque
nous retrouvons un verbe à l'infinitif. Toutefois, elle
peut garder le sens hypothétique
à condition qu'elle change de forme, chose qui
n'est pas demandée dans la
consigne de l'exercice. 120 élèves ont
retrouvé la réponse juste, soit 43,16 %. Ceux
qui ont placé « sans » sont au nombre de 27 soit
9,71% .
42 élèves ont utilisé l'expression
«à condition que», sans changement de forme de
la phrase. La phrase est donc fausse. Les élèves
qui ont utilisé les deux structures
ci-dessus (sans et à condition que), ne saisissent
pas le fonctionnement de
l'hypothèse et ils constituent un fort pourcentage,
soit 24,82 %. La première
structure a été plus facile pour eux à
effectuer, par contre la seconde qui nécessite
une véritable transformation ne l'a pas été.
La transformation avec à «à condition
de » est mieux saisie que la transformation avec la
structure « à condition que »,
laquelle nécessite l'utilisation du subjonctif.
Nous pouvons affirmer que l'hypothèse n'est pas
maîtrisée dans cette classe.
5 item :
« Avec un peu d'attention, tu feras des progrès en
orthographe »
231 élèves ont effectué cet item juste, soit
83,09 %. Le reste a mis les différentes
structures en gardant la phrase telle quelle.
12 élèves ont écrit « ave » au
lieu de « avec » et 8 élèves ont mis « avic»,
au lieu de
« avec ». Donc ces élèves confondent le
deux sons :
e

154
/ß /
[- postérieur
[- rond
[- tendu
[+ fermé
/e/
[- postérieur]
[- rond
[+ tendu
[-fermé
]
]
]
]
]
]
Le /e/ est inexistant en arabe algérien, il est donc
confondu avec le /ß/
C'est probablement aussi le phénomène de
surcorrection, phénomène qui fait
reprendre l'apprenant à chaque erreur et même
quelque fois par exagération si bien
que l'on crée chez l'apprenant l'assurance
permanente. Ce dernier se fit à le
première orthographe qui se présente à son
esprit, il ne prend pas la peine de la
vérifier et utilise la première graphie qui se
présente à lui.
Item n°6:
«Rappelez-moi, si j'oublie»
A été complètement négligé par
l'ensemble des élèves testés.
Item n°7:
« Sans soleil, la vie serait impossible »
Pour cet item, il s'agit du contrôle du temps du
conditionnel présent.
Résultat : 202 élèves ont répondu
justes, soit 72,66 %
27 ont utilisé « avec » ; ils n'ont donc pas
compris l'hypothèse
4 ont confondu « sans » et « son »,
d'où confusion dans les sons /ã/ et /Õ/. Cette
erreur phonétique a déjà été
étudiée ailleurs.
En conclusion, nous pouvons dire que si l'expression de
l'hypothèse semble être
connue, il n'en demeure pas moins qu'elle reste toujours en
deçà de notre attente. .
2.11.2 Exercice n°2 :
Dans le second exercice, il y a cinq items. La consigne est
simple, il s'agit de
transformer le complément circonstanciel de
condition en une proposition
circonstancielle de condition.

155
Exercice n°2, Item n°1:
« Elle ne peut pas lire sans lunettes »
Nous pouvons obtenir les réponses suivantes :
-Elle ne peut lire qu'à condition d'avoir ses lunettes
-Elle ne peut lire qu'à condition qu'elle ait ses lunettes
-Elle ne pourrait lire que si elle avait ses lunettes.
-Si elle n'a pas de lunettes, elle ne peut lire
-si elle n'a pas de lunettes, elle ne pourra lire.
-Elle ne peut pas lire si elle n'a pas de lunettes.
78 élèves ont utilisé la forme : Si +
présent, présent,
144/278 n'ont pas répondu à cet item, soit 41 %
12 ont utilisé la forme si+présent, imparfait de
l'indicatif,
13 élèves ont utilisé une structure
inversée :
« Elle ne peut pas lire si elle n'aura pas de lunette »
18 élèves ont utilisé : si + futur, futur
« Elle ne pourra lire, si elle n'aura pas de lunettes
».
Nous remarquons que ces élèves sont sous
l'influence de l'interférence due à leur
langue maternelle.
Dans une certaine mesure, ces élèves ne
maîtrisent pas convenablement
l'hypothèse et encore moins la conjugaison du
conditionnel. Il nous semble qu'il est
nécessaire d'effectuer une séparation très
nette entre l'expression de l'hypothèse et
l'étude des temps du conditionnel. C'est à
ce prix que les enfants finiront par
comprendre le fonctionnement de l'hypothèse et
apprendront d'une manière
mécanique la conjugaison.
Item n°2 : Sur le même modèle, on
demande à l'enfant de procéder à la
transformation de la phrase ci-dessous :
« Je n'aurais pas pu résoudre le
problème sans les explications du
professeur ».
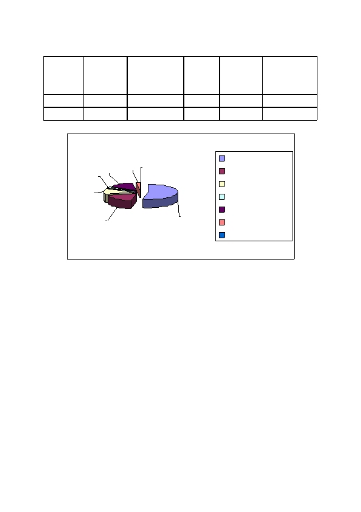
156
Tableau des résultats
A laissé
en blanc
147
52,87%
Résultats
justes
47
16,90%
(Mauv
Orthographe)
32
11,51%
Présent
7
2,51%
A recopié
seulement
38
13,66%
A écrit ne sait
pas
Lire (en arabe)
7
2,51%
14%
3%
12%
16%
3%
0%
52%
pas de repon
res.juste
mauv.orthog
présent
recopié
a écrit en arabe
Figure n°41: Exercice n°2- Item n°2
Le nombre des élèves qui n'ont pas su
répondre est très important dans cette
classe ; il dépasse largement la moitié du groupe
testé, il est de 147.
Il est aussi très important de rappeler que 07
élèves ont écrit en arabe qu'ils ne
savent pas lire. Donc, comment peut-on faire la notion de
l'hypothèse à des élèves
qui ignorent l'écriture et la lecture en langue
française ?
07 autres élèves ont utilisé le
présent de l'indicatif, tout en gardant dans le second
membre de la phrase, la modalité verbale du conditionnel :
« Si le professeur ne m'explique le problème, je
n'aurais pas pu résoudre le
problème »
Est-ce que ces élèves confondent les
deux modalités verbales (futur /
conditionnel) ?
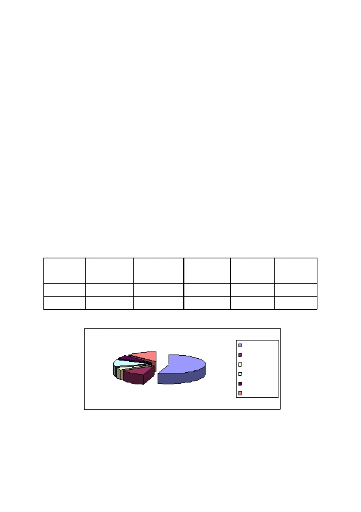
157
Où tout simplement, ils ignorent les deux modalités
? Ces enfants se sont contentés
de mettre le présent dans le premier membre et ont
laissé le second membre au
conditionnel.
32 élèves ont été plus malins, ils
ont repris la structure « sans » et ils ont inversé la
phrase :
« Sans les explications du professeur, je
n'aurais pas pu résoudre le
problème. »
Ils ont tout simplement repris la phrase de
départ en lui faisant subir des
modifications.
Comme nous avons aussi trouvé des infinitifs dans le
premier membre de la phrase :
« Le professeur, ne pas m'expliquer, je n'aurais
pas pu résoudre le
problème ».
Ne serait-elle pas copiée sur le modèle de la
langue maternelle ?
Item n°3:
«Vous irez plus vite en prenant un taxi »
Résultats :
A laissé
en blanc
172
61,87%
Résultats
justes
36
12,94%
mauv.
orthographe
12
4,31%
Présent
36
12,94%
Futur
17
6,11%
A recopié
seulement
41
14,74%
13%
5%
11%
4%
11%
56%
pas de repon
res.juste
mauv.orthog
présent
futur
à recopié
Figure n°42: Exercice n°2 - Item
n°3

158
Les 172 élèves qui n'ont pas répondu
à la consigne de l'item montre bien que
l'hypothèse n'est pas saisie par un pourcentage
très élevé = 61,87 %
36 élèves seulement ont réalisé
l'item, soit 12,94 %, les 12 autres ont réalisé
l'exercice mais avec des erreurs sur la conjugaison. Donc, ces
élèves ne maîtrisent
point le temps demandé par l'hypothèse dans cet
item.
17 ont mis la modalité future dans le membre à
transformer :
«Si vous prendrez un taxi, vous irez plus vite »
Cet exemple montre bien qu'il s'agit d'une interférence
due à la langue maternelle
de l'élève.
D'autres ont mis un imparfait et ont gardé le futur :
Conditionnel :
«Vous irez plus vite, si tu prenais un taxi »
« vous irez plus vite si vous preneriez un taxi »
futur :
« Vous irez plus vite si vous prener un taxi
Nous remarquons que ces élèves ne savent pas
conjuguer le verbe prendre. Ils
mettent n'importe quoi.
D'autres ont mis :
« Si vous aver pri le taxi, vous irez plus vite »
Ces élèves ne savent pas le passé
composé et ignorent les règles de l'hypothèse.
Pour cet item, nous rencontrons beaucoup d'erreurs dues à
la méconnaissance du
fonctionnement de l'hypothèse et surtout la
méconnaissance des mécanismes de la
conjugaison des verbes utilisés dans l'item pris pour
échantillon. Nous rencontrons
aussi la méconnaissance des pronoms personnels de
conjugaison puisque les
élèves ne parviennent pas faire suivre chaque
personne, par la désinence qui doit
l'accompagner.
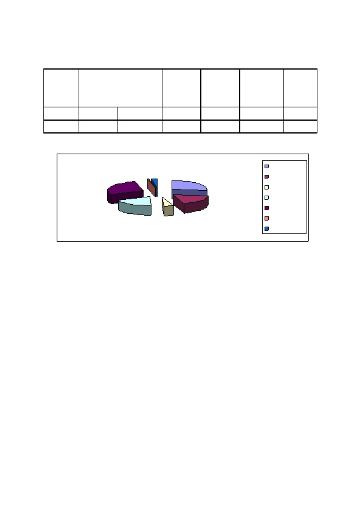
159
Item n°4:
«Avec de la patience, on arrive à tout ».
A laissé Résultats
en blanc
86
30,93%
justes
61
21,94%
mauv
orthograph
15
5,39%
Présent
61
21,94%
A
recopié
94
33,81%
Utilise 2
structures
:
3
1,07%
Imparfait
9
3,23%
1%3%
25%
28%
19%
19%
5%
pas repon
res.juste
mauv.orthog
présent
a recopié
a utilisé 2 s
imparfait
Figure n°43: Exercice n°2 - Item
n°4
61 élèves ont répondu à la consigne
de l'item en mettant correctement la phrase :
«Si on a de la patience, on arrive à tout» Ils
n'ont utilisé que la forme : si+ présent,
présent. D'ailleurs la consigne n'exige pas qu'ils mettent
telle ou telle forme.
94 ont tout simplement recopié la phrase
telle quelle. Ce nombre est
impressionnant, soit, 33,81 % des élèves
testés.
86 élèves n'ont pas répondu, soit
30,93 %. Ce pourcentage avoisine celui des
élèves qui se sont contentés de recopier.
Ces pourcentages nous obligent à dire que
l'hypothèse n'est pas maîtrisée dans cette
classe. La conjugaison des verbes utilisés
par la phrase n'est pas non plus maîtrisée.
Nous retrouvons aussi l'utilisation de
l'imparfait dans la proposition subordonnée pendant que le
verbe de la proposition
principale garde le présent de l'indicatif :
«Si j'avais de la patience, j'arrive à tout».
Ou l'utilisation de deux structures :
«Si avec de la patience, on arrive à tout »
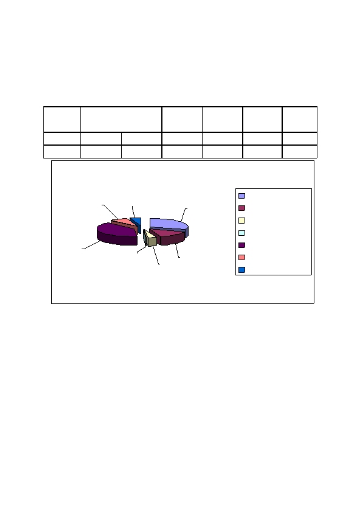
160
Item n°5 :
«En lisant, tous les jours les annonces, tu finiras
par trouver un stage
intéressant »
Ici, le verbe de la proposition subordonnée ne peut
qu'être au présent de l'indicatif
puisque le verbe de la principale est au futur.
A laissé
en blanc
86
30,93%
Résultats
Justes
39
14,02%
mauv
orth
10
3,59%
Futur
1
0,35%
A recopié
107
38,48%
Imparfait
22
7,91%
Passé
composé
13
4,66%
5%
8%
31%
38%
0%
14%
4%
pas de repon
res;juste
mauv.orthog
futur
a recopié
imparfait
P.composé
Figure n°44: Exercice n°2 - Item
n°5
Nous remarquons que nous avons 107 élèves
qui ont tout simplement recopié la
phrase et 86 ont laissé en blanc la partie
réservée à la réponse, 3 élèves ont
fait
juste et 10 autres ont écrit avec des erreurs de
conjugaison. Là, encore, nous
constatons que ces élèves ignorent les formes de
l'hypothèse et ne maîtrisent pas la
conjugaison du présent de l'indicatif. Nous donnons en
exemples quelques phrases
retrouvées dans les copies des élèves
testés.
« Si tu lisant, tu finiras par trouver un stage
intéressant »
Cette forme est à comparer à la forme utilisant le
gérondif :
« En lisant, tu finiras par trouver un stage
intéressant »

161
« Si tu li, tu finiras par trouver un stage
intéressant »
Cette deuxième forme est à considérer comme
étant l'utilisation de la structure : « Si
+ présent, futur ». Nous remarquons aussi la
présence de fautes d'orthographe,
signe d'un mauvais apprentissage de la modalité du
présent des verbes du troisième
groupe. Cette affirmation est mise en évidence dans les
phrases suivantes :
« Si nous lesons, tu finiras par trouver un stage
intéressant »
« Si tu lait, tu finiras par trouver un stage
intéressant »
Confusion dans le vocable « lait » et tu «lis
»
« Si tu lisse tous les jours les annonces, tu
finiras par trouver un stage
intéressant ». etc.
Conclusion :
Nous pouvons affirmer que ces élèves ne
maîtrisent pas l'hypothèse, ne
savent pas conjuguer les verbes qui leur sont
donnés et confondent même les
pronoms personnels (tu, nous). En un mot, ils commettent
beaucoup de fautes
d'orthographe.
2.11.3 Exercice n°3 :
Dans l'exercice N°3, il est demandé aux
élèves de construire 4 phrases
complexes en employant des subordonnées conditionnelles
introduites par « si » et
par «à condition que » :
Le travail est orienté sur l'utilisation de deux
structures bien définies. La première
peut recevoir 4 ou 5 temps si j'inclus le passé
composé. Par contre, la seconde
structure n'exige qu'une seule phrase complexe. La seule exigence
est que le temps
du verbe soit au subjonctif.
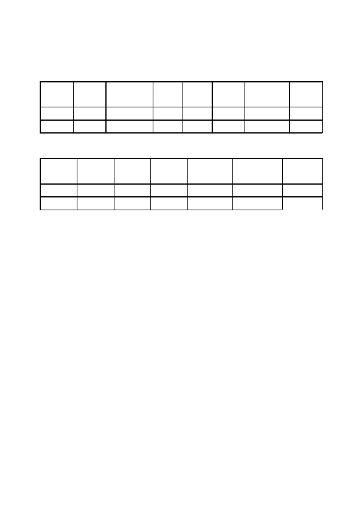
162
Résultats :
1 cas : « si »
e
Présent, Présent,
présent
48
17,26%
futur
20
7,19%
Imparfait,
conditionnel
07
2,51%
Présent Futur,
Passé
infinitif présent composé
16
5,75%
14
5,03%
15
5,39%
p- q- parfait
12
4,31%
A laissé
en blanc
146
52,51%
2 cas
e
A cond
que.just
40
14,38%
Imparfait Futur
18
6,47%
15
5,39%
Présent
25
8,99%
A cond de
20
7,19%
A laissé en
blanc
100
35,97%
A recopié
60
21,58%
Nous avons rencontré d'énormes
problèmes quant à l'analyse des erreurs
commises par les élèves, car nous n'arrivions pas
à les classer et leur donner une
interprétation logique.
Plusieurs élèves ont écrit : «
à condition que tu travail » dans la phrase : «tu
réussiras à tes examens du BEF, à condition
que tu travail » Il y a donc confusion
entre le substantif « le travail » et le présent
de l'indicatif du verbe «travailler »
D'autres ont mis juste après la structure « à
condition que » un infinitif, tel que :
«Tu apprends le français, à condition que tu
lire ».
Donc, il y a confusion entre les deux structures : «
à condition de » et « à condition
que ».
Nous avons aussi rencontré beaucoup d'erreurs sur les
temps des verbes :
« j'acheterai un vélo à condition que je
réussirai »
« je vais chez vous à condition que tu seras parmi
nous. »
« Je laisse partir à condition que tu ne dis rien
»
D'une manière générale, nous avons compris
que l'expression de l'hypothèse n'est
pas sue par les élèves. La conjugaison des verbes
pose d'énormes problèmes parce
qu'elle n'est pas maîtrisée par les apprenants.
Les pronoms personnels ne sont pas placés en
adéquation avec les désinences des
verbes dans le processus de conjugaison. Ce qui nous donne
globalement qu'à la

163
fin de la septième année fondamentale, nous avons 4
élèves sur 5 qui ne sont pas
capables de tenir en français un discours utilisant
l'hypothèse.
Or, leur âge (11-12ans) ne permet plus d'imputer cette
difficulté à une quelconque
immaturité. C'est donc que l'enseignement reçu
en ce domaine n'a pas été une
réussite, ou du moins, ils n'ont pas reçu un
enseignement de l'hypothèse.
Du point de vue morphologique, nous pouvons citer , les
résistances à
l'apprentissage, les acquisitions des élèves de la
façon suivante :
Présent :
Des auxiliaires
Des verbes en (er)
Des autres verbes.
Futur :
Des auxiliaires
Des verbes en (er)
Des verbes du 2 et 3 groupe
e e
Des verbes en (re) - résoudre
Des verbes irréguliers (mourir)
Imparfait :
Morphèmes personnels
Forme en -rais :
Morphèmes personnels
Consonnes doubles
Base de conjugaison
Temps composés :
Choix de l'auxiliaire
Accord de participes
Du point de vue syntaxique, nous pouvons classer par ordre
croissant de résistance
à l'apprentissage, les acquisitions des
élèves :
Mauvais emploi de « si »
Non - respect des contraintes syntaxiques après « si
»
Mélange des structures hypothétiques de base :
Si + présent, futur
Avec
Si + imparfait, forme en -rais.

164
Si + Plus-que-parfait, forme en (-rais) composées
Des élèves confondent « à condition que
» et « à condition de ». Ils n'arrivent pas à
distinguer que la première locution conjonctive
entraîne l'utilisation du subjonctif,
temps inscrit au programme de la septième année
fondamentale.
Il semble que le travail effectué sur le
subjonctif n'a pas été suffisamment bien
assis : nous pouvons penser que le subjonctif a
été abordé en tant que temps
seulement et non dans son environnement
hypothétique. Il aurait fallu le voir à
l'intérieur de phrases hypothétiques et
surtout, le faire fonctionner dans d'autres
situations qui amènent l'hypothèse. Comme, il
aurait pu être étudié en relation avec
la seconde locution « à condition de ». Par
comparaison, des deux structures et des
deux phrases, l'élève s'apercevra de la
différence.
D'autres élèves ne parviennent pas à
reconnaître l'emplacement de la subjonction
« si ». Il nous semble que l'activité
effectuée à son sujet n'a été que superficielle :
elle n'a pas tenu compte du rapport que cette subjonction
entretient avec les temps.
Il nous a apparu qu'ils confondent « si » avec «
sans ». Une bonne partie des élèves
ne parvient pas à établir la relation qui existe
entre la subjonction et le temps utilisé
dans la phrase hypothétique.
Seules les deux dernières phrases ont
été réalisées avec un record de 72,5%
d'élèves. Donc, les deux prépositions «
avec » et « sans » sont bien maîtrisées et
utilisées correctement par les élèves.
L'utilisation du « si » est mieux
réalisée que celle de «à condition que »
Cet enseignement apprend à l'élève
à nommer le conditionnel, le futur, ou le
présent, l'imparfait pour qu'ils s'habituent à les
isoler graphiquement de ce qui suit.
Donc le travail n'est pas effectué dans le sens de la
concordance des temps, mais à
une fin bien précise, à savoir, la maîtrise
de l'orthographe. Tout le travail est effectué
dans le but de faire la distinction morphologique du
futur / conditionnel présent,
chose qui ne peut permettre à l'apprenant d'opérer
une distinction dans les valeurs
sémantique et temporelle de ces temps. Il nous semble que
l'on ne peut dissocier
l'enseignement / apprentissage de l'orthographe de
l'explication ponctuelle de la
description grammaticale qui est à l'origine de
certaines de ses règles et qui les
explique, au moins, en partie.

165
la structure :
si + présent, futur : cette structure est sensiblement
connue par au moins la
moitié des élèves. Le reste qui la
méconnaît fait les erreurs suivantes :
- Ils utilisent après « si » le futur
- Ils confondent les morphèmes personnels :
« Si je n'ai pas nagé, je sera mort »
« Sera » qui est à la troisième
personne du singulier est accompagné par le
pronom personnel « Je ». Les apprenants ne parviennent
pas à mettre en relation
les pronoms personnels avec le signifiant de la modalité
utilisée.
La confusion de : « à condition que » et «
à condition de »
Les apprenants ne parviennent pas à comprendre
que la seconde locution
conjonctive appelle à sa suite un infinitif et l'autre
convoque le subjonctif.
« Je fera qu'est-ce que tu voudras à condition que tu
me pardonneras »
« J'ai plongé dans la mère à
condition que j'ai savé nager »
Ces élèves semblent n'avoir retenu que la
modalité future et d'une manière
approximative, puisqu'ils confondent la première
personne et la troisième du
singulier. Ils font suivre la locution conjonctive «
à condition que » de la modalité
verbale du futur. Donc, ils ignorent que la structure
« à condition que » appelle
toujours la modalité du subjonctif.
Certains élèves ne parviennent pas à
distinguer les participes passés de certains
verbes tels que « savoir, pouvoir, aller etc. Par exemple,
Ils confondent « su » avec
« savait » qu'ils écrivent comme s'il
s'agissait d'un participe passé du premier
groupe comme « lavé »/savé/.
Ils ne parviennent pas à distinguer les morphèmes
personnels « je » et « vous», « je
et il ». Et tout ceci parce qu'ils ne connaissent pas la
modalité verbale.
« je fera » pour « il fera » ou encore :
« Si je n'ai pas nagé, je sera mort ».
Donc différentes personnes devraient appeler
différentes désinences.
Sans compter tous les problèmes d'interférences
culturels qui apparaissent dans la
phrase ci-dessous :
« Si tu ne mange pas le café, manges les
gâteaux »
L'auteur de cette phrase ne voit pas le rapport qui existe entre
le sujet et le verbe :

166
il a placé « s » mange, forme impérative
et l'a retiré au présent dans « tu manges ».
Donc, ce dernier ne fait pas la différence entre
les personnes utilisées dans la
conjugaison.
.EN somme, c'est la modalité verbale qui leur fait
défaut. Ces enfants ont besoin de
plus d'apprentissage de modalités verbales. Il nous semble
qu'il faudrait mettre le
paquet sur la conjugaison afin de leur apprendre à
utiliser ces modalités verbales.
2.12 Propositions de solutions :
2.12.1 Deuxième palier :
La première partie de cette étude a montré
les limites de l'enseignement de
l'expression de l'hypothèse dans le système
éducatif algérien. Les programmes
montrent bien que l'enseignement de l'hypothèse est pris
en charge par ces derniers
assez tôt dans la scolarité de l'enfant. Il ne peut
être compris par les enfants dont
l'âge est inférieur à11-12 ans.
Les anciens programmes proposaient cet enseignement de
l'hypothèse à partir de la
quatrième année primaire. Actuellement, les
nouveaux programmes ne la prennent
en charge que dans les textes et à l'oral,
c'est-à-dire d'une manière inconsciente.
Nous la retrouvons dans la saynète proposée aux
apprenants. Elle apparaît comme
discours bien établi et que les enfants de 9-10 ans
doivent comprendre et utiliser
sans réfléchir.
Nous sentons qu'ils ne comprennent pas l'hypothèse et ne
parviennent pas à une
utilisation rationnelle. Il serait donc peu commode d'exiger
d'eux qu'ils utilisent dans
leurs discours de tous les jours, cette expression de
l'hypothèse. Pour pouvoir le
faire, il faudrait que chaque enfant ait pu assimiler la
forme et le sens de cette
expression de l'hypothèse. Dans ces programmes, c'est
à dix ans que les enfants
sont conviés à l'apprentissage de
l'hypothèse. Les psychologues estiment que l'âge
9-10 ans n'est pas l'âge idéal pour l'apprentissage
de l'hypothèse. Les psychologues
estiment que cet âge (9-10ans) ne permet pas aux enfants
d'acquérir les réflexes
nécessaires à la compréhension des
mécanismes de toute opération nécessitant
l'analyse et l'intelligibilité de l'abstrait. Cette
dernière fait appel à la période du
concret qui va de l'âge de 7-8 à 11-12 ans. J.Piaget
dit à ce sujet : « On assiste au
déroulement d'un grand processus d'ensemble que l'on
peut caractériser comme un

167
passage de la centration subjective en tous les domaines,
à une décentration à la
fois cognitive, sociale et morale....
L'intelligence représentative débute, en
effet, par une centration systématique sur
l'action propre et sur les aspects figuratifs
momentanés des secteurs du réel sur
lesquels, elle porte : puis elle aboutit à une
décentration fondée sur les coordinations
générales de l'action et permettant de
constituer les systèmes opératoires de
transformations et les invariants ou conservations
libérant la représentation du réel
44
de ses apparences figuratives trompeuses.»
Il dit encore à la page 107 de ce « Que sais je
» : « Pour ce qui (la combinaison
des facteurs) est de celle des idées ou des
propositions, il est indispensable de se
référer à la logique symbolique ou
algorithmique moderne qui est beaucoup plus
proche du travail réel de la pensée que la
syllogistique d'Aristote.
Il en va de soi que l'enfant de 12-15 ans n'en dégage
pas les lois, pas plus qu'il ne
cherche la formule des combinaisons pour combiner des
jetons. Mais ce qui est
remarquable est que, au niveau où il devient capable
de combiner des objets, par
une méthode exhaustive et symétrique, il se
révèle apte à combiner les idées, ou
hypothèses, sous la forme d'affirmation et de
négation, et d'utiliser ainsi des
opérations proportionnelles inconnues de lui
jusqu'alors : l'implication (si.. alors),
disjonction ( ou.. ou.. les deux), l'exclusion (ou ..ou) ou
l'incompatibilité (ou..ou .. ou
ni l'un ni l'autre, l'implication réciproque, etc.
»)
Ceci nous amène à conseiller l'apprentissage de
l'hypothèse à l'âge 11-12 ans, c'est
à dire quand l'enfant est capable de représentation
figurative mentale.
Il faudrait tout d'abord que ce fait grammatical n'apparaisse en
apprentissage
qu'à partir du moment où l'enfant sait lire et
écrire. Car, avant cette période, ce n'est
que peine perdue et sans résultat aucun.
Nous proposons que l'étude de
l'hypothèse soit reprise plus tard quand
l'enfant atteint l'âge fixé par les
psychologues, c'est-à-dire quand il sera en mesure de
comprendre les opérations
d'abstraction.
Nous proposons d'abord que l'expression de
l'hypothèse ne soit pas morcelée
comme il a été constaté dans les programmes
connus jusqu'à ce jour.
En effet, tous les programmes de la génération des
années 1980 - 1981 se sont
saisis de ce point de langue, très tôt ;
parfois même avant que l'enfant ne soit
parvenu à l'apprentissage de la lecture et de
l'écriture. (Voir à ce sujet le livre de 4
année primaire).
e

168
Nous ne pensons pas que les concepteurs de fiches aient
pu commettre l'erreur
suivante, à savoir, croire en la règle qui affirme
que lorsque l'enfant a compris dans
sa langue maternelle le système de fonctionnement
de l'hypothèse , ceci pourrait
facilement lui suffire à appliquer ce schéma dans
la langue étrangère . Autrement
dit, l'hypothèse ne deviendrait alors qu'un
problème lexical. C'est-à-dire, lorsque
l'enfant a appris le système de l'hypothèse dans sa
langue, il lui suffirait de connaître
un certain lexique pour pouvoir réaliser ce même
système dans la langue étrangère.
L'apprentissage de l'hypothèse a été
jusqu'à maintenant effectué dans le but
d'étudier les temps de conjugaison, c'est-à-dire,
l'hypothèse n'était là que comme un
prétexte à l'étude des temps. Nous avons
remarqué que seul l'exemple était dans
une situation hypothétique ; son analyse
dégageait le temps à étudier d'une
manière quasi systématique. Or, son
enseignement devrait se faire en tant que
pensée et non comme un point de langue qui requiert la
syntaxe et la conjugaison,
tout simplement.
Il nous paraît nécessaire que son étude se
fasse dans une certaine globalité pour
permettre la saisie de l'hypothèse dans sa
totalité en vue de la comprendre et de
pouvoir l'utiliser dans son langage de tous les jours. Cette
globalité permettra aux
apprenants d'acquérir un langage sûr leur permettant
d'utiliser consciencieusement
les opérations d'abstraction que requiert, par exemple,
l'expression de l'hypothèse.
Il nous semble que l'élément le plus
intéressant est bien l'expression de
l'hypothèse en tant que mode de pensée et
non en tant que forme suscitant
uniquement l'analyse de la syntaxe et de la conjugaison.
Aussi, nous nous
permettons d'émettre le voeu qu'elle soit, tout
d'abord, perçue comme mode de
pensée, chose qui ne peut être assimilée et
comprise par l'enfant qu'à l'âge de 11-
12 ans , c'est-à-dire , au moment où il est en
mesure de saisir les pensées les plus
compliquées.
Il est fortement conseillé que cette étude se fasse
à partir de 12 ans, mais avant cet
âge, il conviendrait de lui donner les formes
verbales des temps simples et
composés. Il les apprendra durant la scolarité qui
s'étale de 7ans à douze ans.
L'enseignement se chargera de lui apprendre les formes verbales
du futur et
du conditionnel à partir de 9 ans - 10 ans pour pouvoir le
préparer à l'utilisation de
l'expression de l'hypothèse. En effet, l'apprentissage de
l'expression de l'hypothèse
ne posera pas de problèmes et il s'attellera
seulement à l'acquisition de
l'hypothèse et à son utilisation dans le discours
du quotidien.

169
Les formes verbales doivent être sues avant
l'apprentissage de l'expression de
l'hypothèse pour éviter les difficultés
dues à la présence de l'hypothèse et des
formes verbales qui exigent de l'enfant d'énormes efforts
qu'il ne peut fournir.
Nous proposons donc une progression pouvant permettre son
enseignement :
Qu'est-ce donc que la progression ?
La progression n'est pas une idée nouvelle, mais
elle a, ces quinze dernières
années, puisé de nouveaux arguments provenant
d'hypothèse psycholinguistique
partiellement convergente, bien que leurs
présupposés et leur didactologie soient
loin de former un tout homogène.
L'hypothèse la plus connue est celle de N.
Chomsky qui a postulé de
l'existence d'un dispositif cérébral inné et
qu'il appelle « langage acquisition device »
ou L.A.D., capable de traiter selon une programmation
biogénétique universelle, les
données langagières de n'importe quelle langue.
Pour N. Chomsky, ce dispositif propre à
l'être humain est un véritable « organe
45
mental » , destiné à
«spécifier les propriétés phonétiques,
syntaxiques et
sémantiques d'une classe infinie de phrases
possibles» propriétés constitutives de
46
47
Pour R. Brown, cette progression des acquisitions est le
résultat d'une maturation
cognitive qui permet à l'enfant d'intérioriser
des structures de plus en plus
complexes sémantiquement et grammaticalement.
D'autres chercheurs se sont attelés à la
recherche de ce phénomène et sont
parvenus sensiblement aux mêmes résultats. Ce sont
H.C. Dulay et M.K. Burt.
la grammaire d'une langue donnée.
1.2.- l'intériorisation de la grammaire :
Cette conception se trouve confortée par des
travaux se plaçant dans une
perspective plus cognitiviste qu'innéiste, ayant
trait à l'acquisition de la langue
maternelle ou seconde. Ces travaux ont montré que
l'acquisition d'une grammaire
se fait toujours dans le même ordre, elle suit le
même chemin presque toujours
invariable, quels que soient l'âge, les circonstances, les
aptitudes ou le milieu dans
lequel elle s'inscrit. Il y a une «progression
naturelle » dans l'acquisition des
éléments grammaticaux d'une langue .

170
Il est certain que d'autres hypothèses linguistiques et
psychologiques consistent à
supposer que l'acquisition de la grammaire d'une langue est la
résultante de toutes
les conventions du processus de communication.
Autrement dit, elle est le résultat d'une
approche ritualisée entre les deux
partenaires socio- culturellement situés.
En réalité, la langue ne fournit que des indices ou
des balisages nécessaires
à la réussite de l'interaction. En somme,
cette nouvelle hypothèse s'inscrit à
l'opposé de la L.A.D., puisque la grammaire s'acquiert
par le jeu des interactions
sociales et non par un dispositif spécifique
comme le prévoit cette dernière
hypothèse.
Elle est très proche de celle de M. Bakhtine qui
oppose un « dialogisme
généralisé » à
« l'objectivisme abstrait » d'un F. de Saussure ou
de celle de B.
Malinowski pour qui le langage n'est qu'un
élément essentiel de toute l'activité
humaine. Pour les auteurs étudiant l'acquisition
en milieu langue maternelle, il
s'avère que l'enfant n'apprend pas la langue pour
décrire le monde ou pour jouer,
mais pour apprendre à s'insérer dans des
communications interpersonnelles avec
les membres de son entourage.
Concernant l'acquisition d'une langue étrangère
C. KRAMSCH se réfère à
plusieurs études
48
(Cf R.Scollon, 1973, E.M. Hatch, 1978, Peck, 1979,
L.W.FILLMORE,1979) qui « tentent de confronter
l'hypothèse selon laquelle, enfants
et adultes acquièrent les formes linguistiques
étrangères essentiellement par et à
travers les interactions sociales dans lesquelles ils
parviennent à s'insérer , et que
l'ordre d'acquisition de ces formes reflète
approximativement leurs progrès dans la
négociation de ces interactions »
C'est dans ces diverses idées que les didacticiens
ont pris des arguments
contestant l'utilité de toute progression.
Ainsi, G.INGRAM maintient que le
« professeur doit spéculer sur le fait que le
L.A.D. déterminera la grammaire de la
langue et qu'imposer une structure
prédéterminée n'est ni nécessaire, ni
49
souhaitable» . En effet, ce dispositif
inné assurera méthodiquement le traitement
grammatical des données langagières pourvu que
ces données soient variées et
riches. La pratique intensive permettra à l'apprenant
d'intérioriser progressivement
les régularités morpho - syntaxiques. Partant de
ceci, C.KRAMSCH considère que
le sens est plus important que la forme, que
l'expérience interactive est plus
importante que la grammaticalité de son expression.

171
Pour cette dame, seuls les exercices interactifs peuvent faire
apprendre d'une
manière progressive la grammaire des formes que l'on veut
inculquer à l'enfant.
Doit - on considérer que l'intériorisation de
la grammaire d'une langue est la
conséquence d'une maturation ontogénétique
conceptuelle (J.Piaget) ou le résultat
des interactions psychosociales (G.A. Kelly) ou bien si
elle est la conséquence
d'une programmation innée ? (N. Chomsky). Ce qui
est certain, c'est que même
dans le cas d'une immersion propre et en interactions
constantes avec les natifs,
(cas des enfants immigrés), ils n'apprennent jamais
à « parler comme on parle », en
raison qu'ils s'accrochent à une inter langue, plus ou
moins fossilisée, mais souvent
plus efficace dans leurs échanges.
Bref, il semble qu'il soit très hasardeux
d'affirmer qu'il suffit de communiquer
activement ou d'interagir intensivement dans une classe de
langue pour que la
grammaire de la langue étrangère y soit acquise.
Certains communicativistes ou interactionnistes commencent
à reconnaître les
limites à leurs hypothèses : H.H.Sterne
affirme qu'il « serait naïf d'estimer qu'un
engagement total dans la voie d'une communication vraiment
authentique apporte
une solution définitive aux problèmes de
l'apprentissage des langues » et E.
BIALYSTOK constate que « l'usage efficace de
stratégies communicatives est
indéniablement lié à la
compétence linguistique (...) et que « les
recherches
montrent que la maîtrise des formes de la langue a
une place bien définie dans
une compétence de communication ».
Après une telle démonstration, nous pensons
que la progression reste
toujours un outil pédagogique performant, ce qui ne
veut pas dire que nous
minimisons l'utilité didactique des activités
communicatives ou interactives dans la
classe de la langue.
Il s'agit pour nous d'articuler méthodiquement un
enseignement relativement formel
de la langue à un enseignement dans ses conditions
pragmatiques d'emploi.
Nos propositions s'effectueront selon une progression qui
s'étalera depuis l'école
primaire jusqu'au moyen ou (troisième palier de
l'école fondamentale).
50

172
2.12.2 Proposition de Progression
I. école primaire :
Au début de son apprentissage et une fois qu'il a
appris à lire et écrire,
l'enfant devrait apprendre les formes simples des
modalités verbales. Il doit
connaître d'une manière impeccable le
présent de l'indicatif. Pour cela, il faudrait
que les temps soient appris isolés pour permettre
à l'apprenant de connaître son
tableau de conjugaison, comme sa table de multiplication.
L'intelligibilité du système
verbale viendra après.
La première forme de l'expression de
l'hypothèse ne pourrait être accessible à
l'apprenant qu'en sixième année primaire,
c'est-à-dire, après trois années
d'apprentissage. Nous supposons qu'après trois
années d'apprentissage,
l'apprenant est en mesure de manipuler un texte et de le
comprendre.
C'est donc, à ce moment que nous pouvons lui
inculquer la première forme de
l'expression de l'hypothèse :
(Si, présent de l'indicatif ..............présent
de l'indicatif.)
Cette forme simple de l'expression de l'hypothèse met
l'enfant dans des conditions
d'apprentissage très simples qui ne lui posent aucune
difficulté.
Connaissant le temps qu'utilise l'expression de
l'hypothèse et sachant ce qu'est
l'expression de l'hypothèse dans ce cas, l'enfant se
familiarisera avec la pensée de
l'hypothèse.
Cet apprentissage renforcera chez l'enfant l'utilisation du
présent de l'indicatif et
saisira l'idée de l'expression de l'hypothèse. Cet
apprentissage doit intervenir à l'âge
de douze ans, au moins. Cette première forme doit
intervenir en classe de 6eme
année de l'école fondamentale (6eme A. Primaire),
c'est-à-dire juste à la fin de la
dernière année du second palier de l'école
fondamentale). En somme, l'hypothèse
ne peut intervenir qu'après une bonne prise de conscience
: connaissant le temps
par coeur, il ne reste plus qu'une prise de conscience, qu'il
faudra qu'il réalise.
L'enfant apprendra correctement l'utilisation de
l'hypothèse parce qu'il sait déjà les
temps qui peuvent être utilisés par ce cas
d'hypothèse .Nous n'aurons plus à nous
occuper des temps à mettre en place , mais nous
lui apprendrons au contraire à
construire des textes argumentatif utilisant l'hypothèse .
C'est d'ailleurs le moment où l'enfant se
débrouille bien en lecture et en conjugaison,
la seule difficulté qui lui reste serait celle de
l'hypothèse

173
En septième année fondamentale ou la
première année du complémentaire, l'enfant
devrait apprendre la seconde forme
«L'impératif .présent de l'indicatif
»
Il nous semble qu'il faudrait éviter de l'enseigner au
primaire puisque les trois
années utilisées ne peuvent que servir à
l'apprentissage de la lecture .Un enfant qui
ne sait pas lire correctement est un enfant
handicapé et ne pourra comprendre
l'expression de l'hypothèse quand celle-ci, dans sa
langue, ne s'exprime pas de la
même manière que celle de la langue
étrangère.
C'est pourquoi, nous préconisons qu'elle soit
enseignée à partir de la septième
année pour diverses raisons :
- L'enfant n'atteint l'âge du raisonnement que vers la
onzième ou la deuxième
année.
- L'expression de l'hypothèse ne se forme pas de la
même manière que dans
sa langue maternelle et encore moins dans la langue scolaire
acquise.
- Le système verbal des temps n'obéit pas au
même système que celui de sa
langue maternelle, ni à celui de la langue scolaire
acquise. Dans la langue de tous
les jours, l'hypothèse repose davantage sur la
subjonction. Il n'y a aucune variation
des temps, puisque le temps est soit accompli ou inaccompli.
Aussi il y a lieu de planifier un programme
d'apprentissage de l'expression de
l'hypothèse sous forme de progressions, répondant
aux aspirations des enfants et à
leur âge.
L'enseignant ne se préoccupera que de l'enseignement de
l'hypothèse et en matière
de conjugaison, il fera la correspondance des temps. Le
reste ne pourra être
programmé qu'à partir du troisième
palier, soit lors de la septième, huitième et
neuvième année du fondamental. Donc, il est
souhaitable qu'au niveau du primaire,
l'enfant sache l'utilisation des temps d'une manière
parfaite pour faciliter l'acquisition
des autres structures plus complexes de l'expression de
l'hypothèse.
| 


