Présenté par :
Jean-Marc Soulairol
POUR QUELLE(S)
HISTOIRE(S) D'ÊTRE(S) ?
Associations 1901, interrelations personnelles et
interactions sociales,
un art de faire : L'étude d'un cas sur
Valence (26), de 1997 à 2002, pour une
compréhension de l'application d'une pratique
raisonnée de l'idée de valorisation de l'individu.
Tome I
Directeur de Recherche :
Bernard LAUGIER
Université Lumière Lyon 2 Collège
Coopératif
I.S.P.E.F. Rhône - Alpes
Département des Pratiques
Educatives et Sociales
Mémoire déposé en vue de
l'obtention du
Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques
Sociales
D.H.E.P.S.
Lyon 2002
Remerciements
Depuis 1999, celui à qui je dois le plus, c'est sans
conteste, Bernard Laugier, mon Directeur de recherche. Dès le
départ, sans condition, il a su me faire bénéficier de sa
haute compétence pour réussir à me "caler" dans la posture
adéquate. Si la tâche fût compliquée, il n'a jamais
affiché une quelconque hostilité, reniement ou réfutation
de mes idées. En fait, me guidant, il a su respecter mon approche tout
en se montrant exigent. Je tiens à souligner ma dette à son
égard car nombre d'idées développées ici viennent
de nos nombreuses discussions.
De 1989 à 1996, j'ai beaucoup appris auprès de
mon ami Pierre, disparu trop vite de ma vie, véritable défi
à la logique, capable d'une objectivité hors pair par une
démonstration et celle de son contraire. En ce sens, il reste une
exception et une énigme dans mon histoire.
Mais je dois aussi beaucoup à Claire et Jean,
grands humanistes, qui m'ont donné l'envie de reprendre des
études puis transmis bénévolement, jusqu'en 1998, leurs
connaissances universitaires et leurs expériences professionnelles hors
du commun.
Je dois aussi à tous les enseignants du Dheps et
particulièrement à Isabelle Astier et Alain Kerlan qui ont su,
chacun en leur temps, me guider en tant que "sources de réflexions et
d'orientations". Mais surtout, grand merci à Joël Cadière
dont les cours m'ont permis d'aborder les thèmes de ce travail selon un
angle original.
Toutes ces personnes ont probablement exercé
une influence décisive sur ma manière d'appréhender le
monde aujourd'hui.
Bien sûr, je ne peux pas oublier la compagne de ma vie,
mon épouse Lorette, extraordinaire personnage d'abnégation
et de tendresse. Sans son soutien moral, ce travail n'aurait pas vu le
jour.
Enfin, qu'il me soit permis, ici, de remercier chaleureusement
tous mes frères et soeurs de coeur qui m'ont soutenu. Je veux parler de
mes très nombreux amis.
Avec mon plus profond respect, merci mille fois.
Sommaire
Introduction générale
6
1. L'ASSOCIATION, DE L'INDIVIDU AU
MICRO-GROUPE
19
1.1 Individu et changement : De
l'étymologie au sens
21
1.1.1 De l'individu à son identité
sociale
22
1.1.2 Vers une construction psychosociale de
l'individu : le personnage
26
1.2 Individu, configuration et
changement : une recherche identitaire
31
1.2.1 Devenir quelqu'un : angoisses et
influences, démarches identitaires.
33
1.2.2 De l'individualisme à la relation
à l'autre : la solidarité
35
1.2.3 L'identité, une série de
transactions.
41
1.3 Individu, configuration, changement et
micro-groupe : les valeurs, importance et ambivalence
44
1.3.1 Les valeurs : affaire de mots et
d'idées mais aussi production de rapports sociaux
45
1.3.2 L'individu dans son groupe, un inventeur de
manières de faire
53
1.3.3 L'hypothèse, des mots clefs pour
construire un protocole de validation
56
Conclusion : repérer l'individu
changeant à partir d'un modèle d'analyse
64
2. ENGAGEZ-VOUS, RENGAGEZ-VOUS, ILS
DISAIENT
66
2.1 Ce qui a joué :
Caractéristiques d'engagements
71
2.1.1 Du quantitatif au qualitatif : à
la découverte de l'engagement
71
2.1.2 Trois facteurs majeurs d'influence pour
justifier l'engagement
74
2.1.3 Trois catégories pour décliner
la figure de l'adhérent
80
2.2 Ce qui joue :
Caractéristiques de configuration
87
2.2.1 Perception de l'environnement associatif par
le membre
87
2.2.2 La naissance de conditions favorables à
la relation
90
2.2.3 Du rapport à la relation sociale
95
2.3 Ce qui se joue :
Caractéristiques des maturations
102
2.3.1 Grandir son engagement ou se positionner dans
le groupe
102
2.3.2 Développer sa relation sociale ou
l'élaboration du sens
108
2.3.3 Confiance en l'autre, confiance en soi ou les
processus de socialisation
111
Conclusion : Histoire(s) d'être(s)
115
3. DU BESOIN AUX ASPIRATIONS :
JEUX, TACTIQUES ET STRATÉGIES
119
3.1 Aspirations et dynamiques de
changement
123
3.1.1 Des aspirations à la satisfaction des
besoins : ce qui pousse à agir
124
3.1.2 Aspirations de l'adhérent : trois
notions successives ?
132
3.1.3 Les besoins-aspirations, une dynamique
circulaire
140
3.2 Présentation de soi : les
jeux, les enjeux
143
3.2.1 La configuration, un réseau de
relations réciproques
144
3.2.2 De la représentation sociale à
la présentation de soi
153
3.2.3 Présentations de soi : une
production de fragments identitaires
157
3.3 L'usage de manières de
faire : la quintessence du changement
163
3.3.1 "Se faire une place"
164
3.3.2 Tours et détours. Contours du
changement
169
3.3.3 La part de l'autre
170
Conclusion : L'art et la manière
174
Conclusion générale
176
Références bibliographiques
186
Bibliographie
190
Index des auteurs
192
Table des illustrations
194
Table des matières
195
« Il est bien des
merveilles dans ce monde,
il n'en est pas de plus grande que l'homme. »
(Sophocle, Vè s. av. JC)
Introduction
générale
Après avoir été bénévole,
deux ans durant, dans l'association sans but lucratif Compu's Club1(*), nous y avons été
salarié à mi-temps jusqu'en juin 2001. Nos fonctions d'assistant
de formation nous chargeaient du développement de la Section
Ifac2(*), la branche
"Formation Professionnelle et d'Éducation Populaire" de l'association.
Le Compu's Club est une association
loi 1901. Son étiquette est celle des Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication (NTIC)3(*) ; nous traduisons,
l'informatique et ses dérivés. Elle a été
fondée le 2 octobre 1997 à Valence (Drôme). Aujourd'hui
organisée en sept branches d'activités4(*). Au dernier "recensement", celui
du 30 juin 2001, elle était composée de 167
adhérents5(*)
d'origines et de profils divers âgés de 9 à 81 ans.
L'association s'est donnée, dès sa création, la mission de développer des activités
culturelles, éducatives et de loisirs afin de promouvoir l'entraide
mutuelle et le service bénévole entre ses membres. En clair, elle
utilise l'informatique « ...afin de permettre des
échanges, des manifestations et des activités artistiques,
éducatives, culturelles et de loisirs. »6(*). Pour commenter plus clairement
ce postulat : elle propose l'outil informatique afin de favoriser la
construction d'activités par les membres eux-mêmes. Ainsi,
lorsqu'une idée a suscité suffisamment d'intérêts et
généré suffisamment de mobilisations, l'association vote
la fondation d'une nouvelle branche7(*). Laquelle branche est menée par une
équipe de pilotage de un ou plusieurs membres menant à bien,
indépendamment ou en partenariat avec d'autres branches, ses projets
propres. Chaque branche est autonome dans son fonctionnement, sa gestion et sa
trésorerie. Chaque membre peut y prendre une
responsabilité8(*).
En clair, la procédure de fondation d'une branche d'activité se
déroule en trois étapes : 1) un membre exprime l'envie de lancer
une nouvelle activité, 2) après délibération, le
Conseil d'Administration "officialise" l'initiative par un document autorisant
sa fondation et son autonomie de gestion et 3) ouverture d'un compte en banque
garantissant son autonomie financière. En quelque sorte, une association
stricto sensu dans l'association Compu's Club déclarée loi
19019(*). Ce fonctionnement
et l'organisation même semblent originaux puisque nous ne connaissons pas
d'autre association loi 1901 fonctionnant sur le même
procédé. Par ailleurs, nous constatons que la participation
régulière à au moins une des activités de cette
association représentait 38% des adhérents. Par ce constat,
l'apparente défection actuelle du monde associatif ne semble pas toucher
l'association10(*). Les
autres adhérents étant des adhérents que nous appellerons
temporairement "consommateurs". Consommateurs plus ou moins assidus de
l'informatique sans participation bénévole à une
quelconque activité.
Pour présenter entièrement le Compu's Club il
convient de s'attarder sur la signification du terme même de Compu's
Club. "Compu" est le diminutif de computer (ordinateur en français). Ce
terme indique bien l'identification au monde informatique. Le "'s" est
particulièrement intéressant, il signifie l'appartenance
à. Ce qui pourrait être interprété comme
l'appartenance à une bande, une famille, une communauté voire une
élite, celle de ceux qui utilisent l'informatique. Au même titre
que ces cercles restreints ou ces confréries que peuvent sembler
être le Ladies' Cicle International, le Maxim's Business Club ou le
Lions' Club. Michel Maffesoli parle de clan, de tribu, lorsqu'il s'agit de
s'agréger, d'être un membre d'un corps collectif :
« le tribalisme rappelle empiriquement, l'importance du sentiment
d'appartenance, à un lieu, à un groupe, comme fondement essentiel
de toute vie sociale. »11(*) Pour lui, donc, le fait d'éprouver ensemble
quelque chose est facteur de socialisation. Maffesoli dit aussi qu'il est de
l'ordre de la passion partagée, de l'investissement
émotionnel : « le fondement de tout
être-ensemble [...] est "commerce des idées", "commerce
amoureux" »12(*) Mais, si avec "'s" l'accent est mis sur ce qui unit,
dans Compu's Club il y a aussi "club". Le terme de "club" correspond à
une idée d'assemblée, de cercle d'amis. Mais un club c'est aussi
ce qui sert à pousser les balles vers la cible, au golf. Alors quelles
sont les conditions d'un "bon club", d'un club où il fait bon "pousser
les balles" pour arriver à son but comme on pousse ses envies et ses
désirs à se réaliser ? D'après les
observations effectuées lors de notre pratique de
bénévole, la réponse est à la fois simple et
difficile : simple dans son expression et, il faut bien l'avouer, peu
suivie dans sa réalisation. En clair, consensuellement, on s'accorde
à dire que pour s'enrichir individuellement il faut se rencontrer,
échanger, s'entraider mais chacun, naturellement, a tendance à
proposer moins qu'il ne prend. Mais si un seul donne et les autres prennent la
mission avouée de cette association reste impossible ! Le
problème est bien, alors, de déterminer quelle est la motivation
à la fondation de nouvelles activités et l'engagement des membres
aux projets des branches de cette association.
En tant que praticien, un certain nombre d'autres "constats"
ont attiré notre curiosité et suscité notre
intérêt : qu'est-ce qui fait que cet adhérent
s'investit de plus en plus dans les activités du Club ?
Jusque-là notre pratique nous a fait simplement dire percevoir "quelque
chose qui fait la différence" en comparaison des cinq autres
associations que nous avons connu. Mais comment dépasser ces impressions
premières ? Autrement dit, comment aller au-delà de ces
observations de sens commun ? Comment expliciter sans
ambiguïté ce que nous avons été amené à
observer dans notre pratique ?
En tant qu'apprenti chercheur, notre position au
démarrage de cette recherche relevait, avant tout, de
l'observation13(*). A
partir de cette nouvelle position et parce-que notre vision des faits
évoluait, d'autres "constats" nous sont apparus plus facilement
observables. Non pas seulement dans le temps comme d'une quantification mais
plutôt dans le temps comme d'une qualification permettant de les
décrire. Ces "constats" semblaient être des "changements", des
"évolutions" des adhérents. Certains de ces "changements"
étaient exprimés spontanément par les
intéressés eux-mêmes comme un "mieux-être", un "mieux
vivre". A partir de ces expressions énoncés par
l'adhérent, nous avons pu relever que certains semblaient "aller mieux"
dès lors qu'ils se regroupaient ou participaient à un projet de
l'association. Serait-ce à dire que cette simple pratique de
"décentralisation" et d'appartenance à un groupe permettrait
d'engendrer une reconnaissance-valorisation des adhérents ?
Elle-même, générant une motivation "naturelle" et un
développement personnel indissociable de la notion de projet ? De
même, l'identification du projet, l'identification au projet,
l'identification au groupe expliquerait-elle, en partie, que 38% des
adhérents du Compu's Club soient actifs ? Pour Lévi-Strausss
« l'espace est une société de lieux-dits, comme les
personnes sont des points de repère au sein du
groupe. »14(*) voulant dire, par là, qu'il s'agit de classer
l'autre et de se classer soi-même. Si c'était le cas, en quoi et
comment cette formation de projets et cette identification
participeraient-elles à la (re)dynamisation de certains
adhérents ? Serait-ce ses aspects de responsabilisation,
d'interactions sociales, de points de repères au sein du
groupe ?
D'un exemple, voici une observation de ces faits à
propos d'une des sept branches de l'association : la section
Littérature15(*).
Cette branche a réunie, de juin 1999 à novembre 2001, huit
chômeurs d'une moyenne d'âge de 46 ans. Le pilote de la branche,
journaliste en disponibilité, a échafaudé un projet de
livre écrit à plusieurs mains. Il s'agissait de construire et
d'éditer un roman de fiction, de 1644 à nos jours, tiré de
la réalité et nourrit de faits vécus par les participants.
Ils se retrouvaient une fois par semaine environ. A notre connaissance aucun
sous-groupe ne semblait s'être constitué hormis ceux
nécessaires à l'écriture. Cette section a fait les
honneurs de la presse et de plusieurs médias, dont la
télévision, à plusieurs reprises. Leur projet était
dirigé par un écrivain professionnel. De nombreux partenaires
financiers, tant entreprises que fondations et particuliers, ont
subventionné leur "démarche d'insertion par l'écriture".
Ils ont exprimé le fait que perdre leur travail a été
synonyme d'exclusion des choses de la vie quotidienne, face à des
interlocuteurs qui demandent inlassablement les incontournables
« trois dernières feuilles de paye ». Ainsi
a émergé le projet "Échap", initié par un membre de
l'association pour construire un livre permettant de prendre la parole,
d'exprimer des idées, des constats, des désirs, à propos
de la société dans laquelle on vit. Seuls ceux qui ont
retrouvé un emploi participaient moins voire plus du tout pour se
retrouver, à la sortie du livre fin 2001 à trois auteurs. Quatre
personnes avaient retrouvé du travail et une cinquième
était sur le point de démarrer son entreprise. Nous nous
expliquons mal pourquoi, tout à coup, après deux à quatre
années de chômage, ces membres avaient subitement retrouvé
un emploi. Un seul aurait indiqué de la chance, deux du hasard, mais
quatre sur huit nous signifient qu'il se passe "autre chose" dans cette
branche.
Il serait trop fastidieux d'inventorier ici chacune des sept
branches du Compu's Club. D'autant que les mêmes "constats de
changements" peuvent être observés : engagement,
réinsertion professionnelle, ... Mais pour bien circonscrire
l'observation de ces faits, au titre d'un seul autre exemple,
considérons, en quelques mots, la branche Finance : CEB16(*). Le maître mot de cette
Section était de « se réunir entre amis pour
s'initier aux mécanismes de la finance et avoir une volonté
conviviale de compréhension du monde économique pour, à
terme, créer un club d'investissement17(*), un jeu de société, aider à
l'investissement. » Ainsi, une douzaine de membres de 27
à 74 ans se réunissaient tous les quinze jours pour
réellement jouer en Bourse l'argent qu'ils thésaurisaient chaque
mois. Ils obtenaient des résultats, ce qui semblait les stimuler !
Est-ce une des raisons qui a permis à trois d'entre eux de retrouver du
travail ? Existe-t-il un lien de causalité entre un travail
retrouvé et l'ambiance de cette branche ? Pourquoi ce membre-ci, ou
celui-là, se sentaient moins isolés et semblaient mieux supporter
la solitude de leur retraite ? Mais si d'autres personnes les ont rejoints
depuis, pourquoi certains ont abandonnés ?
Ainsi, à partir de l'ensemble des observations
énoncées précédemment, il nous est donc apparu une
vaste étendue d'interrogations. Ces interrogations constituent l'objet
même de notre recherche. Mais cela appelle à de nouveaux
questionnements. Si nous nous référons au projet majeur
avoué du Compu's Club qui est de "valoriser l'individu"18(*). Comment cette idée de
"valorisation de l'individu"19(*) peut-elle faire l'objet d'une pratique au sein d'une
association loi 1901 ? En posant cette interrogation il apparaissait que
la problématique avait un corollaire évident : pourquoi un
individu valorisé serait un indicateur de son propre changement ?
Ceci posé, nous avons relevé une piste, précisément
celle que nous annoncions plus haut : dès la fondation de
l'association en 1997, il fut choisi par le fondateur l'outil informatique
parce que, pour lui, il « semble être incontournable en ce
début de millénaire pour aider à "être dans la
société"20(*) ».
Mais, si les TIC sont imaginées comme un outil-prétexte-alibi
à la rencontre entre individus, nous pouvons légitimement
supposer qu'elles sont une première étape indispensable à
leur "mieux-être".
Muscler avec Philippe Breton (le culte de
l'Internet) ou WoltonAlors, pourquoi et dans quel contexte, quelquefois, des
instants de discussions informelles et spontanées se créent
autour d'une table alors que le matériel reste inoccupé ? De
même, si le choix de l'informatique est un outil à la fondation de
plusieurs activités informatiques, pourquoi des activités
inattendues axées, non plus uniquement sur les TIC, mais aussi (et
surtout) sur les relations humaines, la responsabilité, le
bénévolat et l'autonomie apparaissent ? Par exemple et pour
n'en citer que quelques unes : une branche Bourse, une branche
Littérature ou l'organisation de soirées thématiques
(devenues pour un temps "Les Inforums du Club", puis
abandonné), cercles de discussions autour de thèmes comme
"l'éthique informatique et l'individu" et "citoyenneté,
économie d'entreprise et informatique" entre autres. Bref, nous avons
été amené à nous demander pourquoi et de quelle
manière cette association semblait participer au "changement", à
"l'évolution" de certains de ses membres21(*) au delà de l'outil informatique.
Par ces deux côtés, l'adhérent
constaté changé et ce club informatique contexte à
valorisation de l'individu, nous voulons comprendre ce qui fait lien entre
l'association et l'individu, c'est-à-dire que nous rechercherons quelles
sont les clefs, les mécanismes qui semblent provoquer ces changements.
Mais également ce qui se passe entre les adhérents et comment ils
agissent pour "être dans l'association", "être dans le monde". En
clair :
Qu'est-ce qui fait que certains membres de ce club
informatique semblent, indépendamment de l'outil, changer ?
En conséquence, nous seront amené à
parler de deux groupes de recherches liées :
- celles qui touchent au contexte dans lequel évoluent
les membres de l'association,
- celles qui touchent aux relations interpersonnelles des
individus constitués en branches dans cette association.
Nous voulons nous intéresser à ces deux centres
de préoccupations simultanément. C'est donc vers la
psychosociologie que nous nous dirigerons. Parce-que, ce qui caractérise
la psychosociologie est « l'obligation dans laquelle [elle
se trouve] de [s']occuper, d'une façon constante,
simultanée et interdépendante, et de l'individu et de la
société [(en l'occurrence l'association)] liés en
une étroite interaction. » 22(*)
A partir de ce champ, nous approcherons, d'une part, les
processus de représentations sociales, de présentation de soi et
d'identifications. Parce-que « les représentations
sociales sont des modalités de pensée pratique, orientée
vers la communication, la compréhension et la maîtrise de
l'environnement social, matériel et
idéal. »23(*) La présentation de soi, quant à
elle, appelle aux jeux des apparences dans la relation aux autres ;
c'est-à-dire que l'individu « adopte une perspective
"théâtrale" [...] pour contrôler l'image qu'il donne de lui
même » 24(*) aux autres dans ses
activités. Enfin, l'identification signifie
« l'activité par laquelle un individu s'assimile à
un ou plusieurs autres »25(*) ; elle s'appuie donc « sur un
noyau émotionnel, sur un cadre pragmatique,
sociologique. »26(*) De plus, « l'identification est [...]
un moyen puissant de projection sur l'avenir. Elle permet la socialisation
anticipée et la définition de soi. »27(*) Ainsi, la
représentation (sociale et de soi) et l'identification sont pertinentes
pour notre recherche parce-que nous pourrons nous occuper de l'adhérent
dans son rapport avec les autres et avec le contexte environnemental Compu's
Club.
D'autre part, nous approcherons, un concept peu courant, celui
de configuration au sens où Norbert Elias l'entend :
« Ce qu'il faut entendre par configuration, c'est la figure
globale toujours changeante que forment les joueurs ; elle inclut non
seulement leur intellect, mais toute leur personne, les actions et les
relations réciproques. »28(*) Pour indiquer la pertinence de ce concept Elias
donne un exemple, une partie de cartes : « Quatre hommes
assis autour d'une table pour jouer aux cartes forment une configuration. Leurs
actes sont interdépendants. [...] Ni le "jeu" ni les "joueurs" ne sont
des abstractions. Il en va de même de la configuration que forment les
quatre joueurs autour de la table. [...]Comme on peut le voir, cette
configuration forme un ensemble de tensions. L'interdépendance des
joueurs, condition nécessaire à l'existence d'une configuration
spécifique, est une interdépendance en tant qu'alliés mais
aussi en tant qu'adversaire. »29(*). Ainsi, par ce concept de configuration, nous
pourrons nous occuper de l'adhérent dans ses relations avec les autres
au sein de l'association mais sous l'angle des interactions.
C'est-à-dire, pour suivre Elias, nous pourrons repérer
l'existence supposée d'un ensemble de dynamiques relationnelles, de
stratégies interpersonnelles et de relations variées, polyvalents
et simultanées entre l'association et l'adhérent, entre les
adhérents. Parce-que, « c'est l'équilibre de
tensions propre à chaque configuration qui permet de définir les
marges d'exercice de la "liberté" ou du
"pouvoir". »30(*)
Mais, exprimé comme nous l'avons fait jusqu'à
présent, cet ensemble ne nous paraît pas totalement satisfaisant
parce qu'il n'explique pas suffisamment. Il faut aller plus loin,
c'est-à-dire trouver un lien, quelque chose qui lie les
éléments entre eux, les fait interagir, les met en
interrelations. Le concept de configuration, cité
précédemment, porte en lui de nouvelles perspectives
théoriques. Ce qui domine c'est l'interdépendance des situations
jouant sur l'opposition entre adversaire et allié, entre distance et
rapprochement, entre échange et retrait. Ainsi, il nous semble possible
qu'il y ait, dans une configuration, l'émergence d'un nouvel
état, différent de la somme de chacune des parties qui le
compose. En d'autres termes, il nous apparaît une atmosphère
fluctuante, un "espace" commun indéfinissable, impalpable presque
irrationnel et omniprésent mais observable dans certains cas. Autrement
dit, nous imaginons un lien intime formant un ensemble indissociable,
fusionné, un égrégore31(*) qui resterait indéterminé. C'est
l'idée du modèle d'Aristote quand il dit que
« si chacun apporte son écot à un pique-nique,
il sera meilleur que celui où un seul le prépare. Ce qu'Aristote
met en scène, c'est que même ceux qui n'ont rien apportés,
apportent quelque chose d'essentiel, en particulier ils apportent ce qui permet
que le tout soit plus que la somme des parties »32(*). En fait, ce qui semblerait
unifier, faire alchimie, ce serait un certain nombre de façons
d'être et d'agir des individus qui émergeraient lors de
circonstances particulières, à des moments
adéquats et, simultanément, des "moyens d'action singuliers"
et informels seraient utilisés dans les interrelations sociales. Nous
essaierons de le découvrir à partir des valeurs et des
représentations individuelles et communes parce-que, chacun des
thèmes abordés renvoie à cet aspect reliant en tant qu'il
a affaire avec les valeurs et l'intériorisation de normes et, partant de
là, avec l'identité sociale qui se rapporte à un objet
(identité collective) et à soi (identité personnelle). Si
nous partons du fait qu'une identification n'est pas possible sans raison,
alors 1) l'identité à un objet concerne l'identification à
des projets partagés pour échapper à la dépendance
et à la fascination narcissique. Si pour Firth
« l'identité est le partage de tous les traits
particuliers. » elle peut être, aussi le partage seulement
de certains de ces traits. Ceci, reste valable même si le sens des
identifications, variables d'une culture à l'autre, est établi
par toute société entre certains êtres en excluant les
autres. A ce niveau, l'identité des individus relève d'un
schème d'appartenance plus englobant : l'identité de groupe,
de clan. 2) l'identité personnelle concerne la perception de
soi-même dans le temps et la perception de la différence par
rapport aux autres, c'est-à-dire un système de significations, de
valeurs, d'orientations, de sens par lequel le sujet se singularise et dont les
dimensions dépendent, pour une large part, des idéologies de la
personne (qui traverse une culture donnée) s'instituant comme valeur et
par des valeurs33(*). Cela
semble donc dévoiler "un lieu interactif"34(*) commun, un "moyen" informel
d'interaction, une "forme" invisible mais apparaissant quelquefois puis
disparaissant, tout en existant toujours, au gré des relations
interpersonnelles. Michel de Certeau parle d'arts de faire :
« plus qu'il n'y est représenté, l'homme ordinaire
donne en représentation le texte lui-même, dans et par le texte,
et il accrédite de surcroît le caractère universel d'un
lieu particulier où se tient le fol discours. »35(*)
Toutes ces descriptions, que nous allons développer par
la construction d'un modèle d'analyse dans la première partie de
ce document, nous amènent à avoir une vision transversale de
l'adhérent en tant qu'il est influencé par les autres
adhérents ou par l'association. Résumons-nous :
- le contexte socio-associatif du Compu's Club, la
configuration, le principe fondateur36(*),
- les relations interpersonnelles, l'identification, les
façons d'agir / d'être des adhérents,
- l'émergence d'un ciment - un "lieu" informel mais
observable, un "moyen" d'agir,
étant posés précédemment,
nous sommes en mesure, maintenant, de soumettre une hypothèse provisoire
du phénomène de changement constaté auprès de
certains adhérents :
Plus un individu utilise, dans une contingence, les moyens
de devenir "être relationnel" et en "représentation", plus cet
individu accède à un statut d'individu.
Pour simplifier sous une forme schématique,
l'hypothèse peut se présenter comme suit :
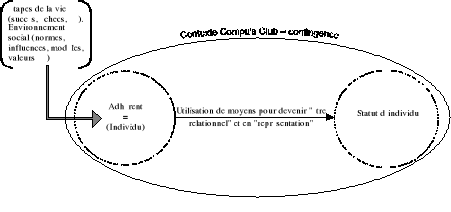
Hypothèse
Cette hypothèse prendra appuie sur les trois voies
précédentes. C'est-à-dire,
û la représentation / identification,
û la configuration et
û un "espace-moyens" fluctuant.
Ces trois voies, nous paraissent les plus fécondes
parce-qu'elles nous permettent d'approcher des éléments
d'explications possibles de notre question de départ selon deux lignes
de force : l'association vue en tant que "cadre pragmatique" mais
aussi "noyau émotionnel", et les projets des branches en tant
qu'aspects reliants sociologiquement mais aussi noyau sentimental, affectif.
Ces perspectives ont l'avantage de nous permettre de fournir un cadre
interprétatif des relations interpersonnelles et d'identité
personnelle des adhérents. De plus, cela permettra d'éclairer les
changements constatés à partir de la façon d'être de
l'adhérent dans ses relations pour s'engager et se motiver. Nous
relèverons, alors, les mécanismes qui semblent avoir permis a des
adhérents de changer et nous essaierons de comprendre, modestement, ses
articulations, ses conséquences. Pour ce faire, nous partirons 1) de
l'état de ce qui a été capitalisé dans nos lectures
sur le sujet depuis 1991, début de notre préoccupation sur les
relations interpersonnelles, et 2) de la manière dont nos interrogations
se sont révélées au Compu's Club
précisément, lors de notre pratique de bénévole
puis de salarié. Autrement dit, de ce qui nous a conduit à faire
ce choix, c'est-à-dire, vouloir comprendre les changements
constatés qui ont permis à certains adhérents de se
relancer une dynamique37(*). Ainsi, nous approcherons l'adhérent, son
identité et ses relations interpersonnelles avec les critères, la
logique, la nature et les dimensions de l'association Compu's Club. Ceci, afin
de savoir ce qui joue, se joue ou a joué dans le phénomène
de changement apparent. Donc, essayer de répondre à notre
incompréhension du phénomène de changement apparent de
l'adhérent de cette association, ce pourra être une mise à
jour des processus qui en organisent les façons différentes et
singulières d'être et d'agir en même temps que les
dynamiques relationnelles et les sentiments d'appartenances. Autrement dit, repérer les façons
d'être et d'agir dans la configuration Compu's Club afin d'essayer d'en
comprendre le sens. Nous pouvons, dès lors, faire deux
remarques. 1) "Donner du sens à une interaction sociale" devrait
passer d'abord par un cadre pratique et émotionnel ; et dans notre
cas il s'agit de l'association en tant que contingence. Cette première
piste se veut originale et spéculative. 2) "Donner du sens à une
interaction sociale" devrait passer, aussi, par la nécessité
d'échanger, de se rencontrer donc de s'identifier et d'interagir. Nous
voulons dire, à participer à des projets permettant
l'engagement et la responsabilisation en tant que principe d'auto-nomie (statut
d'individu). Ce sera notre deuxième piste qui se veut argumentée,
et aussi controversée mais semble avoir un corollaire : le
changement de certains adhérents au sein de l'association.
Dans une première partie, nous envisageons
développer les thèmes, concepts, notions et théories en
jeux. Ce qui va permettre d'éclairer les présupposés sur
l'individu38(*), son
identité, ses valeurs, mais aussi l'occasion de formuler des
repères en abordant la configuration Compu's Club, les interactions, les
relations interpersonnelles. Cette partie fortement théorique a pour but
de construire un cadre d'analyse du phénomène de changement
observé à partir des pistes qui émergeront progressivement
et de leurs articulations. Nous commencerons par l'individu parce qu'il est le
point de départ de notre interrogation et notre réflexion. Dans
le premier chapitre, nous trouverons comment il se pense aujourd'hui, ce qu'il
est, ce qu'il produit. Dans le second, nous chercherons, chez cet individu, une
de ses particularités : nous parlerons identité et
identification. Dans le troisième et dernier chapitre, nous nous
attacherons à trouver des pistes permettant une compréhension des
dynamiques relationnelles. Nous aborderons les valeurs, les interactions et les
relations interpersonnelles.
Dans la seconde partie, nous construirons le protocole de
validation et ferons part de nos méthodes d'investigations. Ainsi nous
mettrons en place des outils pouvant tester notre hypothèse à
partir du modèle d'analyse construit dans la première partie.
Même si nous avons abordé l'objet de ce travail à partir de
nos quarante mois d'observations de bénévole puis de
salarié, pour parvenir à mettre à l'épreuve des
faits l'hypothèse provisoire nous construirons un questionnaire pour
effectuer des entretiens semi-directifs. Nous retiendrons dix adhérents
ayant changé. Notre méthode de travail consistera, alors,
à rencontrer des adhérents ayant retrouvé (quelquefois
retrouvé puis perdu) une dynamique par leur implication dans
l'association. A fins d'analyses, l'enquête envisagée abordera ce
qui a amené l'adhérent à rejoindre l'association, ce qu'il
y fait et comment il le fait, enfin, ce qu'il y trouve. En clair, ce qui semble
avoir joué, semble jouer et semble se jouer dans le changement apparent
de l'adhérent. Ceci, dans le but de faire émerger les
articulations de la configuration et nous préparer à la
compréhension des mécanismes du phénomène de
changement constaté.
A partir de là, il conviendra d'expliciter, dans la
troisième partie, les conventions que l'adhérent exploite dans
ses relations avec les autres dans le contexte Compu's Club.
PREMIERE PARTIE
L'ASSOCIATION,
DE L'INDIVIDU AUX MICRO-GROUPES
1. L'association, de l'individu au
micro-groupe
Par la formulation de notre question de départ39(*), nous avons placé au
centre de notre travail l'adhérent de l'association à partir
duquel nous avons pu observer les changements que nous voulons
comprendre40(*). Ainsi,
nous posons la question des sources et des motifs de ces changements mais aussi
des processus qui les favorisent, qui les autorisent. Ceci nous conduit
d'emblée à nous interroger sur les conditions mêmes du
changement. C'est-à-dire, 1) s'il y a changement c'est qu'il y a quelque
chose d'observable ; ici, des comportements d'individus. 2) Mais ces
comportements s'exercent avant tout dans un topos, l'association. Alors que
cette association est organisée, sectorisée en
micro-groupes41(*), les
branches.
Nous nous proposons ici d'envisager les perspectives
théoriques qui nous permettraient de comprendre ce changement,
d'élucider les présupposés, les concepts fondamentaux de
ces approches ; et chemin faisant, de formuler les repères
théoriques à notre démarche de recherche. Nous pourrons
alors aboutir à un modèle d'analyse bâti sur l'articulation
de repères et de pistes qui seront retenues pour présider au
travail d'enquête et d'analyse des résultats. Dans les faits, il
va s'agir d'expliciter les changements, à la fois, par les concepts
fondamentaux autour de l'individu ; c'est-à-dire, la personne,
l'identité, les valeurs, l'engagement, les motivations, les
relations ; et ceux autour de la notion d'organisation ;
c'est-à-dire l'association, les micro-groupes, la configuration
(interrelation, interaction). Donc, il s'agira de comprendre le
phénomène par la manière dont l'individu-adhérent
se construit et par la manière dont le contexte-branche se positionne
vis-à-vis de cet individu-adhérent, l'influence. Si nous
choisissons cette approche c'est parce-qu'elle permet de situer le contexte
Compu's Club dans son ambiance, ses activités et ses fondements ;
mais également l'adhérent, ses caractéristiques et ce
qu'il produit. Pour y parvenir, nous allons donc tenter de livrer un cadre
d'analyse à partir duquel se pose notre hypothèse de
départ.
Avant même de parler du contexte, peut-être
convient-il de s'attarder sur celui sans qui les préoccupations
émises par la question de départ n'auraient pas cours. Nous
faisons bien évidemment référence ici à
l'adhérent en tant qu'individu. Ainsi, dans le premier chapitre, nous
nous efforcerons de définir ce que l'on entend par individu. Plus
précisément : comment est-il pensé ? Comment
émerge-t-il ? Que produit-il ? Mais, s'il y a changement,
c'est l'individu qui en est à la fois l'auteur et le destinataire. Donc,
simultanément, s'agissant d'appréhender, de comprendre le
changement, il conviendra de présenter ce que ce changement met en jeu.
Dans le deuxième chapitre, nous aborderons les concepts
d'identité, organisation et interrelations. Autrement dit, ce qui
caractérise l'individu par rapport à autrui. Autrui qu'il faut
entendre individuel ou collectif. Comment procède-t-il ? Quelles
influences ? Le troisième chapitre permettra de faire le lien
à la fois entre les deux précédents et la formulation
finale du modèle d'analyse. En fait, ce troisième chapitre,
reprenant ce qu'ouvrent comme perspectives les concepts
développés dans les deux premiers, nous permet de définir
la notion de valeurs. Quelle importance dans le changement ? Quelles
conséquences ? Pour terminer, nous serons amené à
poser l'hypothèse, expliciter les mots clefs qu'elle renferme et
définir le protocole de validation adopté pour le travail
d'enquête.
1.1 Individu et changement : De
l'étymologie au sens
Un individu42(*) est, étymologiquement, un
« être considéré comme distinct par rapport
à son espèce, un être humain par opposition à la
collectivité, l'élément d'une collectivité ou d'un
ensemble » En clair, l'individu serait circonscrit à sa
forme, son corps. Pour Leibniz, l'individu est unique et indivisible
« il n'y a jamais dans la nature deux êtres qui soient
parfaitement l'un comme l'autre et où il ne soit possible de trouver une
différence interne, ou fondée sur une dénomination
intrinsèque. »43(*) Ainsi, l'individu serait-il tout simplement ce
au-delà de quoi on ne peut plus diviser, au moins sans être
dénaturé ? Une monade, un atome au sens propre ?
Du côté de Gustave-Nicolas Fischer pour qui
« l'être humain est un être relationnel car les
relations définissent un aspect essentiel de son être
social »44(*) la relation humaine l'emporte
sur ce qui définit étymologiquement l'individu. Et dans ce cas,
précisément, il nous faut aller chercher en dehors du biologique
son originalité45(*). Du côté de Michel de Certeau pour qui
« l'homme ordinaire donne en
représentation »46(*) c'est la manifestation par la production (la
manière de parler, de s'habiller, d'exprimer l'art ou la culture par
exemples), les conduites qui caractérisent l'homme. Et dans ce cas,
précisément, il nous faut se demander quel personnage joue
l'individu en société ?
Nous allons aborder la notion polysémique d'individu de
manière abstraite et partielle. C'est-à-dire, d'un point de vue
psychosocial. Autrement dit, ce champ va nous permettre de comprendre
l'individu, à la fois, sous l'angle de sa représentation sociale
et de ses interrelations. En clair, ce premier chapitre va aborder l'individu
en tant qu'il est en société un être relationnel et en
même temps une personne en représentation. Ceci, afin de savoir ce
que cela apporte dans notre tentative d'explication du changement.
1.1.1 De
l'individu à son identité sociale
Nous avons relevé, dans nos lectures,
différentes façons d'énoncer, de percevoir et de penser
l'individu. Tout au début de Homo Hierarchicus47(*), Louis Dumont distingue deux
sens au mot individu : 1) l'homme particulier, empirique, non social et 2)
l'homme comme porteur de valeurs et valeur lui-même48(*). Si pour Louis Dumont
l'individu est la « valeur suprême du monde
moderne »49(*), D'autres50(*) l'affirment non seulement comme valeur mais aussi
comme principe. Ce qu'il semble falloir entendre par principe c'est la
volonté de l'homme à « fonder ses lois
lui-même à partir de sa raison. »51(*) Donc, l'individu s'affirme
à la fois comme valeur parce qu'un homme vaut un homme (égalité) et comme principe parce-que
seul l'homme peut être pour lui-même la source de ses normes et de
ses lois (liberté). L'égalité versus la hiérarchie,
la liberté versus la tradition. En son temps, le philosophe Jean-Jacques
Rousseau avait tracé la voie avec le contrat social52(*) dans lequel il distinguait la
liberté naturelle de la liberté véritable. La
première comme liberté sans règle, la deuxième
comme liberté civile où l'individu se soumettrait à des
règles librement acceptées. Le sociologue Alain Ehrenberg
actualise les propos de Rousseau en précisant que le "nouvel"
individualisme, qui se caractérise par « la montée
de la norme d'autonomie »53(*), engendre « une dépolitisation
de la société [...] puisqu'il [(l'individu)]
poursuit égoïstement son bien-être dans une ambiance
sentimentaliste faite de Restos du Coeur, de téléthons et
d'actions humanitaires diverses. »54(*). Même si, en sens
inverse, la position de Le Bon est catégorique : « la
foule [...] ravale l'individu dans sa mentalité comme dans son
comportement ; elle le dépersonnalise, l'hypnotise et
l'abrutit ; en outre, elle l'entraîne vers la
violence. »55(*) Pourtant, Elton Mayo, à la suite de sa
participation à l'expérience de Hawthorne de 1927 à
193256(*), concluait que
« l'homme ne peut être heureux qu'intégré au
sein d'un groupe »57(*), suggérant par là "qu'il se passe
quelque chose" dans ce groupe.
A la croisée de ces auteurs, s'intéresser
à l'individu pour comprendre le changement de l'adhérent au
Compu's Club pourrait être, ou bien expliquer ses comportements à
partir de sa valeur, c'est-à-dire, sa capacité à instituer
lui même ses règles et ses normes impliquant sa responsabilisation
(principe) ; ou bien s'intéresser à sa dynamique
d'émancipation, vis à vis du modèle environnant, par
exemple. Ceci, mettrait en perspective une compréhension des changements
selon la volonté qu'a l'individu à être, à la fois,
valeur et principe, libre et autonome. Cependant, mettre en exergue ces
façons de concevoir l'individu, serait au risque qu'il puisse
apparaître non social. C'est-à-dire, risquant de
générer des processus d'inhumanité voire de
"barbarie"58(*) dans son
émancipation. En fait, l'ensemble de ces auteurs nous mettraient face
à une antinomie, celle de l'individu d'un côté et de la
société de l'autre. Donc, en suivant cette voie, nous prendrions
le risque de comprendre l'adhérent seulement comme un individu
individualiste, nombriliste, narcissique, replié sur le privé et
sans règle relationnelle. Par exemple « la recherche
maximale du bonheur et minimale de la souffrance en
tant que conception utilitariste »59(*) et égocentrique. En
clair, ces façons de concevoir l'individu, bien qu'utiles à notre
recherche, n'y sont pas suffisantes. Parce-que nous perdrions la
possibilité de voir l'individu comme un être en interrelation avec
les autres.
Norbert Elias dépasse cette antinomie d'une
société indépendante des individus et d'un individu-atome,
clos et indépendant des autres individus60(*) par deux concepts fondamentaux : celui de
configuration et celui de processus. Il entend par configuration
« la figure globale toujours changeante que forment les
joueurs. » C'est-à-dire, la formation d'un ensemble
d'individus qui « inclut non seulement leur intellect, mais toute
leur personne, les actions et les relations
réciproques. »61(*). Ce qui différencie le concept de
configuration de la notion de dynamique de groupe est « la
modalité variable des chaînes d'interdépendances [...] qui
lient les individus les composant. »62(*). Autrement dit,
« les groupes se définissent par leur taille mais aussi
par des fonctions qui marquent leur degré d'évolution et de
maturité permettant à chacun d'interagir avec les
autres »63(*) alors que le concept de configuration
« récuse un mode de pensée substantialiste qui
identifie le réel aux seules réalités corporelles et
matérielles. [(Pour Elias)] les
réseaux de relations sont tout aussi "concrets" ou "réels" que
les individus qu'ils unissent. » En clair, Elias indique qu'on
ne peut analyser la configuration sans tenir compte du "sens intentionnel" des
actions menées par les individus. En ce sens, « ce sont
les dépendances réciproques qui construisent les sujets
eux-même. Ceux-ci n'existent pas avant ou en dehors des relations qui les
font être ce qu'ils sont, à chaque moment du jeu
social. »64(*)
Ici, pour rendre intelligible les notions de jeu social et de
sens intentionnel nous sommes conduit à expliciter le concept de
stratégie. Michel de Certeau nous dit que le jeu « est une
forme aristocratique d'un "art de la guerre". [...] Il donne lieu
à des espaces où des coups se proportionnent à des
situations. »65(*) Et de définir la stratégie66(*) comme « le
calcul des rapports de forces qui devient possible à partir du moment
où un sujet de vouloir et de pouvoir est isolable d'un "environnement".
Elle postule un lieu susceptible d'être circonscrit comme un propre et
donc de servir de base à une gestion de ses
relations. »67(*) Ainsi, la stratégie serait organisée
par le postulat d'une volonté et d'un pouvoir. Si nous ajoutons à
cela que la stratégie est un domaine dans lequel la pensée et
l'action sont étroitement imbriquées, expliciter le changement de
l'adhérent par la stratégie va permettre de comprendre la
manière dont l'individu joue des coups dans des espaces et selon des
situations. Goffman parle d'une « présentation de soi
stratégique. »68(*) sur la scène publique et ses manipulations
dans le rapport aux autres. Et Michel Crozier de « comportement
stratégique »69(*). Par ces deux auteurs, comprendre le
phénomène de changement nous met face à une
hypothèse : pour qu'il y ait stratégie, il faut qu'il y ait
un minimum de deux entités pensantes douées de conscience et de
volonté propre. Donc, une interrelation logique. Bref, la
stratégie semble à la fois multiple, protéiforme et
totalement inattendue ; cependant, de la stratégie, deux
idées fondamentales synthétisées émergent :
volonté et autre. Si faire de la stratégie consiste à
imposer sa volonté à l'autre, il s'agirait alors d'une logique
spécifique. Ce qui voudrait dire que cette logique est applicable aux
relations interpersonnelles. En conséquence, l'individu semble en
logique (il donne du sens) dans l'accomplissement de ses activités et de
son rôle dans la société. La stratégie devient alors
un moyen qu'il utilise pour mettre en scène sa représentation
à l'autre. Comprendre le changement de l'adhérent consistera donc
à connaître la logique qu'il emploie ; c'est-à-dire,
quels coups joués ? par rapport à quoi, à qui ?
Dans quels espaces ? A partir de quelles situations ? C'est ce que
nous chercherons à faire émerger dans le travail
d'enquête.
La stratégie, dès lors, nous permet de mieux
comprendre ce qui différencie le concept de configuration de celui de
dynamique de groupe. Pour Elias, de fait, il serait intégré dans
les configurations des équilibres fluctuants de tensions et de
forces : « C'est l'équilibre de tensions propre
à chaque configuration qui permet de définir les marges
d'exercice de la "liberté" ou du "pouvoir". »70(*) Contrairement à Kurt
Lewin, pour qui « tout groupe fonctionne selon un
équilibre quasi stationnaire et résiste à tout changement
autre que des variations autour de cet
équilibre »71(*). Ainsi, Elias distingue ces équilibres de la
notion de dynamique de groupe ; c'est-à-dire, par la transformation
de la personnalité vers son émancipation72(*). Elias renonce à
envisager la société en terme de relations de causes à
effets, mais la conçoit au travers du concept d'interdépendance
dans le cadre de ce qu'il nomme des configurations. La logique
spécifique citée précédemment, incluse dans ces
configurations, participe de ces équilibres fluctuants de tensions et de
forces (interdépendances). Il entend par processus l'évolution interdépendante
des rapports et des contraintes que les hommes exercent sur autrui et sur
eux-mêmes.
En résumé, le concept d'individu tel que nous
l'avons compris met en avant un être qui a besoin d'échanger, de
s'exprimer. Nous retiendrons ici que l'individu ne peut pas être
pensé comme quelqu'un d'isolé tel Robinson Crusoe mais
plutôt en tant qu'individu-participant chargé d'intentions. C'est
la raison pour laquelle, nous aborderons notre recherche en retenant l'individu
au sens proposé par Elias. C'est-à-dire, pour avoir quelque
chance de comprendre la contribution des actions exercées par les
adhérents dans leur changement apparent, il nous faudra connaître
la (leurs) manière(s) de construire ce sens intentionnel au sein des
activités menées au Compu's Club. Ce que nous venons de
développer sur le concept de stratégie va nous y aider. De la
même façon, il nous faudra connaître la ou les
manière(s) dont l'adhérent construit sa perception d'autrui et
des choses afin de déterminer comment il construit ce qu'il "est" dans
cette association. Nous appellerons, là, le concept de configuration
pour y répondre, parce-qu'il permettra de décrire ce qu'est un
être relationnel qui « invente le quotidien grâce aux
arts de faire, ruses subtiles, tactiques de résistance par lesquelles il
détourne les objets et les codes, se réapproprie l'espace et
l'usage à sa façon. »73(*)
1.1.2 Vers une construction psychosociale de l'individu :
le personnage
C'est en cherchant à décrire
l'individu-adhérent autour duquel s'organise l'être relationnel
que nous sommes amené à expliciter ce que nous avons
abordé en filigrane dans la section précédente.
C'est-à-dire, la personne et sa représentation. Si, par
là, nous cherchons à améliorer la connaissance du
changement observé en voulant parler de la personne, c'est parce-que
cette approche nous permet d'aborder l'individu comme corrélatif de
droits et d'obligations. Mais, la personne serait-elle tout simplement un
être humain situé à une place sociale
authentifiée ?
Selon l'étymologie traditionnelle le terme de personne
trouve sa source dans les « termes prosôpon74(*) () et persona75(*) qui désignent d'abord,
dans l'antiquité classique, le masque de
théâtre. »76(*). Mais le terme persona, en se référant
uniquement au masque, n'exerce-t-il pas seulement des fonctions
équivoques de dissimulation de l'acteur mû en personnage ?
Comme le note Jean Maisonneuve : « le sujet peut être
conduit à deux attitudes77(*) : [1)] cacher consciemment à autrui,
derrière une figure d'emprunt, ce qu'il est et fait réellement
[2)] Se cacher, surtout à soi-même, ce que l'on est ou ce que l'on
craint d'être. »78(*) En fait, c'est par le glissement du masque
gréco-romain au personnage représenté, puis du rôle
à l'acteur, qui faisait ainsi passer de la fonction sur scène au
jeu social mené par l'individu. Le masque a ainsi perdu de sa
spécificité, c'est-à-dire, il est passé de la
dissimulation directe, dans le sens se cacher physiquement, au paraître
en devenant le "personnage". Autrement dit, « devant autrui [...]
nous devons produire une image conforme à ce qu'on attend de nous ;
nous nous sentons "en représentation". Aussi, est-ce souvent par
l'adoption d'un personnage type que nous assumons notre rôle
social. »79(*) C'est la raison pour laquelle, le personnage est
distinct de l'individu puisqu'il « n'est pas exactement
l'individu que nous sommes mais celui que nous voulons persuader aux autres que
nous sommes. Ou encore, celui que les autres veulent nous persuader que nous
sommes... Ces deux définitions se confondent pour nous constituer une
façade sociale... Nous nous voyons d'abord comme autrui nous voit et
nous veut. »80(*) C'est-à-dire, « 1) l'image de
notre présentation aux autres ; 2) la conscience du jugement qu'ils
portent sur nous et 3) les sentiments positifs ou négatifs qui en
résultent. »81(*) A partir de là, il nous faut répondre
à une
question : en quoi les comportements et les attitudes de
l'adhérent expliquent-ils son évolution au Compu's Club ? En
d'autres termes, quelle signification peut avoir le personnage-adhérent
dans son changement ? Bref, au regard du concept de personne il semble
possible de se demander 1) en quoi la représentation de soi est-elle
dépendante du regard d'autrui ? 2) Dans quel(s) but(s) l'individu
veut-il persuader les autres de ce qu'il est ? Et 3) Quels sentiments,
positifs ou négatifs, en résultent-t-il ? Pour Jean
Maisonneuve, le personnage endossé : « n'est plus une
catégorie officielle mais une visée
personnelle. »82(*) Concluant que « c'est probablement ici
le cas où le personnage a le plus de chances d'exprimer assez
fidèlement la personne. »83(*) En clair, outre le personnage comme masque (le
paraître), il semble qu'il soit, à la fois, un devoir être,
c'est-à-dire : le personnage comme rôle social permettant
d'affronter la pression et la suggestion sociale ; et un veut être,
autrement dit, la vocation comme source du personnage endossé. Dans
ce cas, qu'est-ce qui fait son originalité, sa singularité,
autrement dit, sa personnalité ?
1.1.2.1 Personnalité subjective, personnalité
objective.
Le cogito cartésien, univers d'interrogations, a permis
d'inventorier les richesses de l'ordre personnel et d'en disposer. Cela veut
dire que ce qui est connu est transformé par le fait même qu'il
est connu84(*). En
d'autres termes, pour Descartes les choses ne sont qu'en tant que nous les
pensons. Ainsi, a-t-il découvert le fondement de ses travaux,
c'est-à-dire l'ego85(*). A cela, il découle que la personne devient
parfaitement un individu dans la mesure où elle prend
conscience86(*) de sa
personnalité. Ainsi, cette conscience semble d'abord distinguée
sous son aspect physique : le corps principalement, comme nous l'avons vu
en début de chapitre. Puis apparaîtrait la prise de conscience de
notre personne à tous les moments de la vie. Cette prise de conscience
semble être un aspect subjectif de la personnalité. Ce cheminement
nous conduit à rechercher un aspect objectif de la personnalité.
Avoir procéder ainsi, nous paraît nécessaire parce-qu'il
nous permet d'aborder le phénomène de changement sous l'angle des
traits moraux. Ce que nous allons développer maintenant.
La Bruyère a donné le nom de caractères à l'ensemble des traits moraux
particuliers qu'il a recueilli chez ses contemporains.87(*) Plus tard, d'autres88(*) ont essayé de
classifier les principaux types de caractères et ont
dénombré une cinquantaine de définitions du mot
"personnalité". Dans ces conditions, il nous apparaissait bien difficile
de circonscrire cet aspect objectif de la personnalité pour comprendre
le phénomène de changement. Cependant, nous dit Raymond Boudon,
« il est possible d'en préciser le sens [...] en examinant
ses caractères les plus généraux et les plus
permanents : l'individualité, l'autonomie, la stabilité ou
consistance [(le personnage)], enfin, la spécificité des
motivations. »89(*) Les béhavioristes nous fournissent une
définition des motivations : « [elles] sont des
stimuli qui poussent à l'action et dont, le plus souvent, on observe les
effets sans les saisir directement. »90(*) Cependant, « la
motivation doit être comprise en tant que mise en question permanente de
l'équilibre présent au nom d'un équilibre supérieur
futur. »91(*) Ainsi entendu, la personnalité
« n'est pas une substance (un en-soi)[...] elle est
essentiellement un système de relation. »92(*) En ce sens, « la
personnalité comme telle n'existe pas ; ce qui existe ce sont les
réseaux de relations. »93(*) Par ces deux aspects subjectifs et objectifs,
ce que nous garderons c'est que la personnalité est en
somme un ensemble des manières d'être d'un individu
distinguant dans la personnalité « le moi comme
système d'attitudes communes intériorisées, de
réponses conformes aux situations sociales et le je, principe
spontané et original. »94(*) Pour le dire autrement, il n'y aurait ni soi, ni
conscience de soi, ni communication en dehors de la société,
c'est-à-dire en dehors d'une structure qui s'établit à
travers un processus dynamique d'actes sociaux communicatifs, à travers
des échanges entre des personnes qui sont mutuellement orientées
les unes vers les autres. Par un mot : en interrelation.
Ce qu'il faut noter, en définitive, est la piste qui
s'ouvre pour comprendre comment l'adhérent en tant que personne exerce
un personnage ; comment il peut changer, évoluer pour assumer des
interactions sociales, prendre des responsabilités ou des
initiatives ; comment ses traits de caractère innés95(*)
(en construction constante) ou acquis (en développement, qui
relèverait de la réflexion, de l'effort personnel et de son
expérience) lui permettent de s'engager, de se motiver,
d'échanger, par exemples. De même, cette piste nous permettra de
rechercher au Compu's Club cette forme d'appartenance à un groupe
créant une forme d'association par des échanges où
l'identité de chaque adhérent est cachée derrière
un masque. Bref, comment la personne-adhérent est pensée en tant
que personnage-adhérent et que ce personnage-adhérent, qui est
joué, a un sens ; que ce sens prend forme dans un environnement, un
lieu. Erving Goffman nous aide dans notre résumé :
« les applications particulières de l'art de manipuler les
impressions, cet art, fondamental pour la vie sociale, grâce auquel
l'individu exerce un contrôle stratégique sur les images de
lui-même et de ses productions que les autres glanent à son
entour. »96(*) Donc, l'adhérent en tant qu'individu
peut-être compris en tant qu'être relationnel à partir de ce
qu'il veut être ; mais également, en tant qu'être en
représentation, c'est-à-dire un personnage à partir de ce
qu'il doit être.
Pour parvenir à exploiter ce que nous avons
développer dans cette section, nous retiendrons que le personnage
joué par l'individu semble être "l'instrument" de
présentation de soi aux autres. Le personnage se distingue de l'individu
en tant qu'il est construction psychosociale de la personne. Dans ce cas,
comment s'y prend-il dans sa relation à l'autre ? Ses aspirations
peuvent-elles concorder avec ce qu'il attend de la configuration ? Si nous nous
référons à ce qui précède,
c'est-à-dire que l'aspect fondamental c'est la création de canaux
de communications, de relations, alors l'extension de la participation sociale
d'un individu se caractérise par le désir de participer, les
attentes, l'intensification du sentiment d'identification et d'appartenance.
D'appartenance puisqu'on peut supposer que l'expulsion constitue l'ultime
sanction contre les réfractaires. Bref, ce qu'il faut pour l'individu,
finalement, c'est des liens à partir desquels s'exercent un
échange et une représentation. Ces liens pouvant être les
valeurs parce-que l'individu est un être de besoin qui n'existe que parce
qu'il vit en société avec d'autres individus. Inversement, nous
avons vu que la société n'existe que dans la mesure où les
individus qui la composent existent. C'est chez Elias et la notion de
configuration qu'il nous paraît résider une piste.
1.2 Individu, configuration et
changement : une recherche identitaire
Nous venons de réunir les outils pour comprendre ce qui
définit l'individu. C'est-à-dire, cet être en interaction
sociale et en représentation (personnage). Pour éclairer notre
projet de compréhension du changement observé, nous allons
chercher, si parmi les différents caractères de cet individu vus
dans le chapitre précédent, il en est qui soient des
particularités objectivables au regard de notre question de
départ.
Ainsi, parmi ces caractères, nous retenons le fait de
la sociabilité de l'individu. Il découle du concept de
sociabilité que l'individu présente un trait particulier de
relation pour se révéler à l'autre, se positionner par
rapport à l'autre ; c'est le fait de s'identifier et d'identifier.
Pour Mead, la genèse de l'identité se construit par rapport
à « l'autre
généralisé »97(*) ; c'est-à-dire
dans un rapport à autrui. Nous allons donc aborder le
phénomène de changement sous l'angle de l'identité.
Particulièrement, nous développerons un de ses mécanismes,
l'identification98(*).
Parce-que si l'identité désigne « ce qui chez
quelqu'un est conservé »99(*), l'identification renvoie davantage à des
transformations identitaires et témoigne de changements sous diverses
formes. « S'il [(l'individu)] est victime de rejet ou de
dévalorisation [...] il peut vouloir restaurer son image (restauration
identitaire). Il peut parfois rechercher une reconnaissance sociale et la
légitimation de son itinéraire (confirmation identitaire) ou se
préparer à de nouvelles opportunités (flexibilité
identitaire) »100(*) Mais ceci est possible uniquement parce-qu'il y a
"un autre". Donc, le rapport à autrui est essentiel dans la formation de
l'identité de l'individu. A partir de là, aborder
l'identité sera propre à faire apparaître un lien
spécifique entre la personne et autrui : l'identification. C'est
cette perspective de lien spécifique qui est intéressante pour la
compréhension du changement et que nous allons développer dans le
chapitre suivant.
Mais si nous relevons l'identification pour construire notre
recherche, il convient de s'intéresser à d'autres aspects du
concept. En effet, s'il y avait identité seulement là où
il y a autrui, il faudrait rejeter l'identification par rapport à un
lieu, par exemple. « Ce que je suis. A ne pas confondre avec "qui
je suis". Etant né quelque part, je m'identifie à une langue, une
nation, une confession, etc. Mais je ne suis pour rien dans ce que je
suis : on ne choisit pas son identité. »101(*) De même, il faudrait
évincer l'identification de soi pour les autres et inversement.
Autrement dit, ce qui fait « l'ensemble des
catégorisations qui permettent de reconnaître les
autres. »102(*) C'est-à-dire, les cartes
d'identité, relevés bancaires, par exemples. Autant de "papiers",
"d'écritures" à porter sur soi, qui gouvernent nos rapports
sociaux, dessinent une administration domestique et révèlent des
pratiques quotidiennes. De la même manière, il faudrait abandonner
la marque identitaire qu'est la fonction.
Cependant, ces dissemblances apparentes entre l'identification
par rapport à un autre et celle par rapport à un lieu, à
soi et à sa fonction, sont au fond identiques. L'individu qui
s'identifie à un lieu, ne le fait-il pas par rapport à ses liens
tissés avec l'autre ?103(*) De même, l'individu qui se
présente avec une pièce d'identité, ne le fait-il pas dans
un rapport à autrui ? Puisque, « ces documents
répondent à une obligation généralisée de
s'inscrire et conditionnent l'existence de l'individu dans une
société d'ordre graphique » même si à
leur manière, elles attribuent places sociales et droit d'exister ;
en clair : « secrètement, nous conditionnent et
gouvernent. »104(*) De la même manière, dirons-nous que
celui qui nomme sa fonction pour s'identifier ne se considère pas
« comme occupant une place singularisée dans le
système [...] social »105(*) et professionnel ?
Donc, il y a identification lorsqu'il y a un autre. Et c'est
le fait d'agir par rapport à cet autre que l'individu peut changer et
construire son identité. Ce qui va donc nous intéresser dans ce
chapitre c'est de chercher quels types de relations alimentent les
identifications dans cette association.
1.2.1 Devenir quelqu'un :
angoisses et influences, démarches identitaires.
Pour Patrick Boulte, dans son livre "L'Individu en
friche", « exister, c'est être nommé par
quelqu'un. »106(*) C'est-à-dire, être quelqu'un pour
quelqu'un d'autre. Gustave-Nicolas Fischer distingue l'identité
personnelle, en tant qu'elle est un « processus psychologique de
représentation de soi »107(*), de l'identité sociale, en tant qu'elle est
un « processus psychosocial de construction et de
représentation de soi »108(*). Donc, la reconnaissance des identités c'est
l'idée qu'on peut être défini, non seulement par sa
singularité, mais aussi par son appartenance. Laquelle appartenance
permettrait de révéler un forme de changement de la valorisation
ou la dévalorisation de soi. Autrement dit, la reconnaissance
individuelle passe, outre la reconnaissance de l'individu, par la
reconnaissance du groupe et la nécessité de reconnaître des
actions collectives. Et l'identification « se réalise
à travers les valeurs et les normes d'un groupe ou d'un système
culturel. » Par exemple, Serge Moscovici aborde le travail en
tant qu'il est dans l'homme : « une fois attribué
à Pierre ou Paul, Pierre ou Paul en font leur être et s'y
expriment, comme si, depuis toujours, ce travail avait été leur
travail, comme s'ils avaient commencé avec eux. [...] Le travail se
situe ainsi au centre des moyens d'action de l'homme, et la
réalité objective est potentiellement en
lui. »109(*) Pour le dire autrement, le travail est dans l'homme,
il est identification, et son ouvrage est l'expression de cette identification.
Donc, l'identification est un processus psychologique qui peut être
entendu dans deux sens distincts : « [1)]
l'ensemble des catégorisations qui permettent de reconnaître
les autres d'après des signes spécifiques et de les situer, en
conséquence, d'une façon claire ; [2)] le processus
inconscient de structuration de la personnalité par lequel autrui sert
de modèle à un individu qui incorpore ses
propriétés et s'y conforme. »110(*) Dans ce deuxième sens
il s'agirait d'une conformisation111(*) voire d'une aliénation. Mais, pour mieux
saisir les changements observés, nous préférons rapporter
à l'identification le terme d'acculturation. D'une part, parce-que
« l'acculturation comprend les phénomènes qui
résultent d'un contact direct et continu entre des groupes d'individus
de culture différentes, avec des changements conséquents dans les
types culturels originaux de l'un ou des deux
groupes »112(*). D'autre part, parce qu'il permet de dépasser
la question classique selon laquelle plus on adhère (c'est-à-dire
plus on s'identifie) à des valeurs ou à une culture, plus on
s'aliène. Le terme acculturation donne ainsi à l'individu une
dimension interactive. Mais rapporté à notre propos, pour
définir ses intérêts, donner un sens à ses actions
afin de permettre une interactivité, il faut bien que l'individu ait
quelque représentation. Ce qui nous permet d'aborder l'identification
comme une réaction qui serait pour l'individu la mobilisation d'images
lui permettant de s'engager dans un processus de changement. C'est ce que nous
allons commencer par appréhender maintenant.
1.2.1.1 L'identification, un mixte
de représentations réelles et symboliques
Cent ans après Emile Durkheim, qui opposait
déjà deux sens aux représentations (individuelles et
collectives)113(*), Allessandro Pizzorno avance la notion
d'identité, lui-aussi, au double sens individuel et collectif. Ainsi,
« pour qu'il puisse déterminer quels sont ses
intérêts, calculer coûts et bénéfices, le
sujet agent devra donc être assuré de son identité par
l'appartenance à une collectivité unifiante. Il en recevra les
critères qui lui permettront de définir ses intérêts
et de donner un sens à son action. »114(*) Donc l'individu
« sélectionne, informe, invente, et même, si besoin
est, néglige ou étouffe »115(*) ses intérêts.
Mais quels sont ces critères qui permettent à l'individu de
définir ses intérêts et donnent un sens à ses
actions ? Max Scheler affirme « l'objectivité des
valeurs, au sens où, selon lui, les valeurs existeraient
indépendamment du sujet qui les
appréhende. »116(*) Pour résumer son travail, il nous dit que 1)
les valeurs sont révélées par l'émotion, 2) les
relations entre valeurs sont, elles aussi, saisies par l'émotion et 3)
les relations entre valeurs sont aussi objectives que les valeurs
elles-mêmes.117(*)
Par cette hypothèse de Scheler, l'adhérent changeant
peut-être appréhendé comme un individu chargé
d'émotions construites sur des valeurs. Ce qui voudrait dire ici que le
changement se réfèrerait à un double niveau de
fonctionnement des valeurs : une objectivité, que nous appellerons
image réelle, concrète et une subjectivité, que nous
appellerons image symbolique liée aux représentations mentales.
Autrement dit, les valeurs se révèleraient, en même temps
qu'elles révèleraient le changement, à la fois, en
fonction du symbolique et du réel. Ce qui nous permet de voir toute
description de l'identité comme des images interactives entre les
représentations internes et externes des individus. Si plus haut, nous
avons parlé identification c'est pour dire, à partir de ces
images réelles et symboliques, qu'elle semble interpréter la
capacité à communiquer de chacun d'entre nous en même temps
que des comportements mimétiques, c'est-à-dire une forme de
changement. Autrement dit, il pourrait exister une identification, par exemple,
à un groupe, qui autoriserait le changement de certains individus, si ce
groupe est à la hauteur des attentes de ces individus. C'est pourquoi
nous prenons conscience maintenant que les interactions entre les
représentations de l'individu et les phénomènes de
changements observés au Compu's Club pourraient être intimement
liées et, finalement, n'être que le résultat de
combinatoires complexes que nous essaierons de décrire en
deuxième partie.
En résumé, l'identité est en
perpétuelle recomposition parce-qu'elle révèle et affirme
la personne et autrui, « autrui comme repère et comme
témoin »118(*) au sein même d'une configuration.
L'identification se situe, ainsi, dans l'intersubjectivité d'un groupe,
d'une part et fait appel aux valeurs en tant qu'émotion, d'autre part.
Dès lors, une question se pose : comment des individus aux
émotions différentes peuvent-ils se constituer en organisation
sociale ? Durkheim y répond par le lien social ; plus
exactement par la distinction entre deux formes de solidarité :
organique et mécanique. Mais la solidarité est elle-même
une valeur, et particulièrement ici un sentiment affectif
(émotion). Ce qui voudrait dire que si l'individu est
nécessairement social, relationnel et en représentation et qu'il
y a désir de participation et sentiment d'identification et
d'appartenance, alors, il y a relations affectives. Sans doute ce dont voulait
parler Durkheim. Ainsi, nous allons chercher au travers de cette valeur
solidarité comment lire les changements observés en terme de
sentiments. Cet effort a pour but de présenter l'adhérent
changeant en tant qu'il pourrait être vu comme un individu chargé
d'émotions.
1.2.2 De l'individualisme à la relation à
l'autre : la solidarité
Pour comprendre le changement apparent de l'adhérent
à partir de la solidarité, il nous faut rappeler ce que nous
avons développé précédemment à propos de
l'individualisme. Pour Leibniz, l'intention était claire, c'était
montrer le côté fermé de soi, isolé de
l'individualisme.119(*)
Alain Renaut cherchait dans "L'ère de l'individu" a donner
à l'individualisme une double parenté qui prendrait racine chez
Leibniz avec l'individualisme comme indépendance et Descartes avec
l'individualisme comme autonomie en tant que sujet conscient.120(*) Pour Stanislas Breton,
néo-platonicien, « il n'y a pas d'individu autonome
isolé du monde. Il n'y a pas moi face au monde mais il y a un monde
commun à chaque individu et d'une certaine façon il n'y a pas un
sujet face à un objet mais il y a tout le temps interaction
observant-observé. »121(*) Que certains soient solitaires, nous pouvons en
convenir, mais des solitaires qui entrent en contact des autres et qui
cherchent la solitude simplement comme un plaisir parmi d'autres.122(*) Bref, c'est l'inscription de
l'individu dans un réseau de relations qui confère à
l'homme sa nature spécifique, celle d'un « être
social, un être qui a besoin de la société des autres
hommes. »123(*) En gardant cette idée, nous pouvons
considérer que l'être biologique de la naissance ne devient un
être humain qu'en s'appropriant un patrimoine socioculturel
développé autour de lui. Donc, il y a nécessairement du
public dans la personne privée pour se socialiser124(*). En ce sens, il
intériorise de façon personnelle ce patrimoine de sorte qu'il lui
permette de construire son individualité. Par exemple, l'individu
à sa naissance ne serait pas grand chose s'il n'y avait pas une
mère pour lui parler, des grands frères pour lui taper dessus,
une différence sexuelle, une différence langagière, des
relations de tous ordres, un professeur, un médecin, sans cela comment
serions-nous des individus ?125(*) En effet, tout ceci c'est un peu ce que Nietzsche appelle dans "Les Trois
Métamorphoses" le "stade du lion" :
« celui qui dit non »126(*). Le premier stade est le
stade du chameau qui dit oui et accepte tout. Le deuxième, le stade du
lion qui est révolté et qui cherche à se délivrer,
à être indépendant, qui cherche à repousser tous les
"tu dois", c'est la recherche de la libération. Le but de se
délivrer c'est d'être indépendant pour se donner à
soi-même ses propres lois, ses propres valeurs. Le dernier stade, la
dernière métamorphose, c'est l'enfant. L'enfant qui dit oui, non
pas aux autres (à la loi, au "tu dois") mais à lui-même, au
devenir. C'est l'enfant créateur qui donne à lui-même sa
propre loi. Il faut toutefois émettre quelques réserves, tout
dépend d'où l'on se place ? Qui parle ? Depuis
où il parle ? Quelles sont les motivations de l'individu qui
parle ? Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il a besoin d'être
autonome en tant que phase dans la construction de son individualisme. Georges Palante a cherché à
définir l'individualisme comme sensibilité :
« ce qui porte l'individu à vouloir l'indépendant,
à céder à une certaine misanthropie et un certain
pessimisme social c'est cette sensibilité
individualiste. »127(*) Alors dans quelle mesure pouvons-nous
échapper au ressentiment de « ce goût qu'ont les
hommes de faire groupe, clan, comme les moutons de
panurge ? »128(*) comme on peut le lire dans la
"Généalogie de la morale" ? Avec
Frédéric Worms, en revanche, « l'être de
ressentiment est celui qui se défini contre ce qui le limite et par
conséquent cet individu ne s'éprouve pas comme unique. Pour
éprouver du ressentiment il faut que l'individu tienne compte finalement
des autres et de la société. »129(*) Sur ce sujet, finalement,
que peut-il bien en être de l'adhérent au Compu's Club ? Dans
la figure de l'enfant ce que semble vouloir dire Nietzsche c'est qu'il s'agit
de dépasser le ressentiment pour se situer dans le je. Ceci permet
d'éviter cette antinomie entre individu et société. Ce que
semble vouloir dire Palante c'est l'inévitable affrontement entre le
singulier et le troupeau, entre l'individu et la société,
même si l'issue doit s'avérer fatale pour l'originalité
sous quelque forme qu'elle se présente. En d'autres termes,
espérer conquérir sa liberté, la liberté de dire
oui, l'individu libre n'aurait donc d'autre choix que la révolte,
même désespérée ? Gisèle
Souchon précisant que « les pressions du politique,
du public, du religieux ne valent que si je les accepte. C'est dans la
sphère du privé que l'homme peut protéger sa
liberté individuelle. »130(*)
Pour parvenir à parler maintenant de solidarité
nous avons d'abord dû passer par un rappel de notre compréhension
de l'individualisme et de la relation à autrui. Nous en résumons,
à la fois, les deux distinctions : « l'une pour qui
l'individu a quelque chose de donné avec une référence
ultime : la conscience, la liberté ou le corps. L'autre, qui fait
de l'individu quelque chose de relatif, de construit qui doit se
déployer d'abord dans sa différence par rapport à
autrui. »131(*) ; et les trois interprétations
« selon que l'on s'attache à caractériser les
comportements (individualisme social), à légitimer les normes,
les institutions et les choix de valeurs (individualisme éthique,
contractualisme) ou à expliquer les processus sociaux (individualisme
méthodologique). »132(*)
Cependant, aujourd'hui, l'individualisme est synonyme
d'asocial, de manque de civisme et de solidarité. Il est perçu un
peu comme péjoratif, comme une étiquette. Alors qu'est-ce qui
fait que l'homme crée des formes du lien social (Durkheim) ?
Pourquoi des liens affectifs se tissent-ils ? Pour cela il nous faut
commencer par une approche psychologique
parce-qu'elle ouvre une piste de compréhension : « un
rapprochement apparaît chaque fois qu'une personne se découvre un
trait commun avec une autre. [...] C'est lui qui engendre les sentiments de
sympathie et de camaraderie. »133(*) Ainsi, la relation entre les membres dans une
configuration est une relation faite de tendances affectives, libidinale. Mais
en sociologie, Durkheim affirme que la cohésion sociale est
renforcée par les sentiments d'attraction. C'est-à-dire,
« par l'expression d'attitudes positives (la sympathie) et peut
se traduire par le désir de se rapprocher des
autres. »134(*) A ce stade, la solidarité serait faite
uniquement de relation. C'est ce qu'a bien vu André Lemos lorsqu'il
analyse les communautés virtuelles sur Internet : l'engagement dans
une relation « laisse la place à des intérêts
ponctuels et communs, ancré sur la sympathie. »135(*) Mais, « les
phénomènes sociaux étant toujours des composés
d'actions »136(*), cette relation doit s'exprimer à
l'intérieur d'un cadre et par des processus137(*), c'est-à-dire dans
des limites et par des interactions. Nous pensons encore ici, bien sûr
à ces échanges qui ne peuvent avoir lieu que dans une
configuration elle-même incluse dans un espace géographiquement
circonscrit, c'est-à-dire, une territorialité.
L'enquête d'Alain Girard, sur le choix du
conjoint138(*), visait
à déterminer le rôle de la proximité dans la
relation, elle a pu montrer, en fait, une « homogamie sociale qui
désigne le fait d'une recherche de similitude
[...] portant notamment sur leur origine sociale, culturelle et
religieuse. » Autrement dit, pour Girard, c'est la similitude
qui crée la solidarité. Exprimé par le nous elle se
traduit dans une vive sympathie et une identification mutuelle et se fonde sur
la fusion des individus dans le tout commun. Les groupes locaux
séparés sont alors capables de mener chacun une vie autonome. Les
résultats d'une expérience menée en 1979139(*), ont pu dégager la
corrélation croissante suivante : « plus la relation
est intense, plus nombreuses sont les activités conjointes et plus
importante est l'implication mutuelle. » Dans ces conditions,
comment le changement peut-il avoir cours ? Cette conformité
imposerait-elle la déviance ? C'est dans "De la division du travail
social", que Durkheim ébauche le "réel" de cette
solidarité en l'appelant "contrat". En clair, il tente d'établir
un passage de la solidarité par similitude à la solidarité
organique. C'est-à-dire, il oppose les individus "similaires"
groupés (avec une même croyance, les mêmes valeurs
partagées, les mêmes sentiments, etc.) aux individus qui sont
"différents" et se lient les uns aux autres parce qu'ils exercent des
rôles et fonctions complémentaires à l'intérieur du
système social. Autrement dit, pour Durkheim, c'est la différence
et la complémentarité qui créent la solidarité. Le
passage du "statut" (solidarité de type mécanique) au "contrat"
(solidarité de type organique) est associé à l'apparition
et au développement de la division du travail. Cette division
« supprime la rivalité entre individus en les rendant
étroitement solidaires les uns des autres et également
étroitement solidaires de la société ; l'individu est
d'autant plus moral que sa solidarité avec la société est
étroite. »140(*)
Pour récapituler, nous sommes passé de la
solidarité par similitude de Girard à la solidarité
mécanique puis organique par ce que Durkheim appelle contrat. Nous avons
repéré ce contrat comme rendant compte d'un réel où
tous les hommes sont coopérants (en interaction). Il faut ajouter que
cette solidarité est fondée sur l'association librement consentie
(liberté). Mais la solidarité basée sur les droits ne
risque-t-elle pas de glisser sur la charité141(*) ? Ainsi, pour qu'il y
ait solidarité il faut qu'il y ait un sentiment de responsabilité
mutuelle entre plusieurs personnes mais aussi une dépendance mutuelle
d'intérêts. « Les échanges
révèleraient ainsi une stratégie du coût
psychologique minimal dans la vie sociale. »142(*) Mais, toute situation
d'interaction ne manifeste-t-elle pas un conflit plus ou moins fort entre le
désir de coopérer avec autrui et le désir de
l'exploiter ? Malgré cela, une organisation sociale, qu'elle soit
groupe ou sous-groupe, peut être formée d'individus
supposés solidaires. Approcher les changements observés à
partir de la solidarité aidera à saisir l'ajustement des valeurs
organisationnelles d'un groupe avec celles des valeurs personnelles.
C'est-à-dire, elle permettra d'aborder le phénomène comme
la capacité de l'individu à maîtriser le changement dans le
but de trouver et développer une manière de s'engager. En
d'autres termes, pour analyser le Compu's Club, nous serons amené
à prendre en compte les systèmes humains en tant qu'ils
constituent une des dimensions essentielles de la configuration. La
configuration se pose donc ici au plan des relations interpersonnelles. Ainsi,
elle aura quelque chance de rendre intelligible le changement observé au
sein du Compu's Club en faisant apparaître les raisons et les motivations
des adhérents à s'engager : la solidarité en tant que
valeur produisant du lien social.
Bernard Lahire a relevé auprès d'Elias que
« pour comprendre un individu, il faut savoir quels sont les
désirs prédominants qu'il aspire à
satisfaire. »143(*) Ce qui nous a conduit à voir les valeurs
comme une représentation cognitive des besoins ; les motivations
d'une personne résultant de l'insatisfaction de certains de ses besoins.
Pour exemple, un enseignant de Paris V144(*) citait une étude menée par ses
étudiantes : « Lorsqu'on a demandé aux
syndicats quels étaient les éléments et les moyens de
motivation des salariés ? Les syndicats ont répondu la
réduction du temps de travail, l'augmentation des salaires. Les
salariés ont dit qu'au delà d'un certain niveau de salaire, ce
qui les intéressait avant tout c'était d'avoir un travail
intéressant. »145(*) Cette étude éclaire le
phénomène de changement en signifiant une hiérarchisation
des attentes de l'individu (en l'occurrence, du salarié) : à
partir d'un certain niveau de salaire... avoir un travail intéressant.
Ce que voudrait dire cette idée, est qu'on ne peut agir sur les
motivations d'une personne qu'à la condition de satisfaire ses
besoins146(*). Nous nous
intéressons à cette approche parce-qu'elle est construite sur la
notion de satisfaction de besoins hiérarchisés ; ce qui nous
permet d'aborder le phénomène de changement comme la
possibilité d'être une recherche de satisfaction des besoins par
l'adhérent.
Pour résumer ce chapitre, tantôt
l'identité apparaît comme une image symbolique, tantôt
l'image est seulement l'expression réelle de l'identité. A
l'identité réelle d'une structure sociale, par exemple, va
correspondre l'image réelle (l'accueil, les locaux, les
agréments, etc.) ; à l'identité symbolique
correspondra l'image symbolique (la crédibilité, le dynamisme, la
convivialité, etc.). L'image globale correspondra naturellement à
une combinaison complexe et fortement variable, empruntant tour à tour
aux deux composantes de l'identité : réelle et symbolique.
Donc, l'image que l'on perçoit d'une structure sociale est toujours une
combinaison complexe mêlant intimement le réel et le symbolique.
Ainsi, chacun en fonction de ses "besoins" et de ses "moyens" pourra
s'identifier aux valeurs d'un groupe ou d'un micro-groupe s'il répond
aux attentes de l'individu. Cette identification permet de passer de
l'individualisme à la solidarité à partir d'un contrat
consenti entre les individus. Contrat qu'il faut traduire par une mise en
rapport des individus entre eux sans que leur volonté préalable
ait pu discuter des conditions d'un arrangement. Autrement dit, les membres
d'un groupe, par un "va-et-vient", un "jeu" entre leur propre identité
(individuelle et sociale) et l'identité réelle et symbolique du
groupe, comme sur l'histoire plus ou moins légendaire dans laquelle ils
sont enserrés et qu'ils contribuent chaque jour à créer,
deviennent progressivement autres (changent ?), maîtrisent leurs
actions en se délivrant de la chimère "tout maîtriser", se
sentent faire partie d'un mouvement collectif (reconnaissance) où sont
en oeuvre des mécanismes d'aliénation et de
désaliénation auxquels ils participent plus ou moins innocemment.
En clair, ils s'identifient à une organisation par une série de
transactions.
1.2.3 L'identité, une
série de transactions.
Le terme de "transaction" « évoque, outre
la dimension constructiviste, le processus d'échange. Contrairement aux
notions plus consacrées de "construction" ou
"processus". »147(*) Si nous avons vu que l'identité avait des
contours flous et fuyants, elle n'en est pas moins fluide et mouvante.
Effectivement, source de continuelles renégociations et
ré-interprétations, elle se caractérise surtout par son
aspect évolutif parce-qu'elle fait l'objet d'échanges. Justement,
le concept d'identité devrait ouvrir des perspectives de
compréhension du phénomène observé dans des termes
précis de "succession d'ajustements", de "marchandage", de
"processus"148(*) donc
d'interactions. Le concept d'identité nous intéresse donc que par
les mécanismes que nous lui avons associé et que nous pensons
pouvoir utiliser pour désigner les notions d'interrelation et d'action
entrant dans le changement. C'est-à-dire, les processus d'identification
privilégiant la fonction émotionnelle et de participation qui lui
sont subséquents. En poussant ce raisonnement à ses limites, il y
aurait toujours, à la base, l'idée d'une interaction entre les
parties, des échanges qui entraîneraient des actions
réciproques, une interrelation. On peut aller jusqu'à dire que
pour qu'il y ait de "l'inter-"149(*) il faut qu'il y ait différence.
« En effet, ces différences, qui sont la source même
de la richesse interdisciplinaire, représentent, en même temps, un
problème à surmonter pour le travail
commun. »150(*) Ainsi, l'identité se construirait dans un
processus de négociations, des transactions, qui se situeraient au coeur
même des interrelations. Parce-que les acteurs doivent "inventer" de
nouvelles solutions au cours de ces interactions dynamiques. Ils sont donc
à la fois producteurs et reproducteurs de sens. Mais, ceci inclut
« l'existence d'une dimension conflictuelle qui implique une
série de compromis provisoires et de perpétuelles
renégociations, donnant le primat au changement qui résulte d'une
nécessité d'articuler des exigences
contraires. »151(*) Par ailleurs, ces transactions identitaires se
construisent dans un espace interrelationnel, contractuel (Durkheim), que nous
avons déjà nommé configuration (Elias). Donc, ce que doit
chercher et trouver l'individu, est cet "espace", c'est-à-dire ce
"lieu", cet "entre-deux", cet "inter-" autorisant son changement. Autrement
dit, les concepts d'identité et de configuration devraient pouvoir
permettre d'appréhender ce qui se joue au sein du Compu's Club.
Parce-qu'ils éclairent les changements observés sous l'angle d'un
jeu interrelationnel.
Ce que nous avons compris de l'identité nous conduit
à nous demander à partir de quoi l'adhérent s'identifie,
s'individualise, entre en relation avec autrui ? Nous avons retenu que
l'homme créait du lien social par la solidarité. Or la
solidarité est une valeur ; précisément une valeur
affective qu'il partage avec les autres, lui permet de s'identifier,
d'appartenir à un groupe. Par là, l'identification et
l'appartenance pourraient être expérimentées par
l'adhérent grâce aux valeurs. En effet, l'identification et
l'appartenance pourraient s'exercer à partir de valeurs communes
partagées imposant à l'adhérent des transactions sur ses
propres valeurs, des ajustements donc des changements. Nous allons
préciser cette notion de valeur afin de rechercher quelle part
d'influence elle prend dans une configuration et le phénomène de
changement observé.
1.3 Individu, configuration,
changement et micro-groupe : les valeurs, importance et ambivalence
Si « la valeur n'attend pas le nombre des
années »152(*) l'adhérent peut changer à n'importe
quel moment. Mais si, au regard de l'expression : « nous
n'avons pas les mêmes valeurs », comment peut-il
espérer changer ? Alors, de quoi parle-t-on quand on discute de
valeurs ? La revue Futuribles a rendu compte d'une étude
menée sur l'évolution des valeurs des Européens153(*) :
« Unité ou multiplicité, convergence ou divergence,
universalisme ou/et localisme des valeurs, sont-ils comme nous, ou sont-ils
autres ? »154(*) Les conclusions résumées des
Futuribles sont les suivantes : la société influence les
individus dans leur choix de modèles, d'idéologies. A leur tour
les individus exercent une part d'influence par exemple en rejetant ou en
reprenant ces idéologies ou ces modèles. La société est en nous qui sommes dans
la société. Elles font partie intégrante de la
personnalité des individus mais sont largement constituées en
dehors d'eux. Par exemple les grandes orientations de socialisation en
matière politique, économique ou religieuse se prennent assez
jeune et l'influence du milieu social est grande. S'il y a peu de risque de
nous tromper en postulant n'avoir pas les mêmes valeurs, pouvons-nous
avoir certaines valeurs communes ? Quelles sont les valeurs que l'on suit
quand on s'engage dans la vie publique ? Répondre à ces
questions nous intéresse tout particulièrement parce qu'elles
nous attacheront à comprendre les dynamiques relationnelles au Compu's
Club et le changement de l'adhérent. En effet, les configurations ne
sont pas simplement un élément d'identification ; elles sont
aussi la scène où se joue la vie sociale, et, souvent, le lieu
même de la socialisation. Tout comme nous avons vu (et nous allons le
préciser maintenant) qu'on devient individu en s'appropriant, en
intériorisant une logique et des valeurs qui existent dans la
société où l'on vit.
1.3.1 Les valeurs : affaire de
mots et d'idées mais aussi production de rapports sociaux
Enquêter sur les valeurs impose une distinction en deux
types : les valeurs qui sont extrinsèques, notamment socialement, qui
ont un état d'importance, de grandeur pour l'individu ou un groupe
d'individu (par exemple, être heureux et utile) et celles qui sont
intrinsèques, précieuses donc personnelles. Or, il existe
d'autres distinctions en deux types : les valeurs instrumentales
(honnêteté, politesse, se rapportant à un mode de
comportement) et les valeurs terminales, telles la liberté (qui ont
trait à des buts de l'existence)155(*). Si pour certains156(*) « les valeurs sont les ressorts
fondamentaux des désirs et des préférences, les mobiles
profonds qui nous animent » parce-que, « dans
toute société, la détermination des objectifs s'effectue
à partir d'une représentation du désirable et se manifeste
dans des idéaux collectifs » ; pour Talcott
Parsons, « les valeurs sont des repères
normatifs, des concepts abstraits qui servent à chacun de
référent pour la pensée et
l'action. »157(*) Vu sous cet angle, le terme valeurs est proche de la
notion d'éthique dans un registre philosophique. Ce qui voudrait dire
que, si le terme de valeurs a trait aux différentes vertus ou à
tous les traits de la personnalité humaine ou de la vie sociale, alors
le terme de normalisation peut comporter des termes de valeurs outre ceux
d'obligations. En l'espèce, il est intéressant de remarquer que
l'homme ne peut pas vivre sans règles qui légitiment des attentes
et justifient des sanctions. Peu importe le contenu de ces règles, elles
seraient intériorisées et correspondraient à une position
d'autonomie et d'indépendance par rapport au monde.158(*) C'est la raison pour
laquelle l'espèce humaine est une espèce normative. Bref, qu'il
s'agisse des travaux de ces auteurs, ou bien, qu'il s'agisse de Karl Marx dont
les valeurs dans sa tradition est l'idéologie (agissante,
équivalente à l'éthique et à la solidarité)
légitimant le rapport de production capitaliste dans le fonctionnement
de la société ; de Max Weber qui voit les valeurs comme
antécédentes au capitalisme et donne dans ses théories une
place prééminente à l'individu ; ou de Durkheim avec
sa conscience collective qui désigne en quelque sorte les valeurs par
lesquelles se fait le lien social, il semble que le concept de valeurs, quel
que soit le nom qui lui est donné par les auteurs que nous venons de
citer (idéologie, éthique, conscience collective), reste
très global. La première difficulté concerne donc
l'approche empirique et quantitative du concept de valeurs : en quoi
peut-on inférer la présence de telle valeur à partir de
telles batteries d'indicateurs ? Interrogation qui était
déjà apparue au début du siècle avec les premiers
tests d'intelligence. Par exemple, Jean Stoetzel différencie les valeurs
des opinions qui sont l'adhésion à un jugement qui n'existe que
lorsqu'elle est exprimée, consciente.159(*) Malgré cela, c'est à partir des
opinions que les individus expriment qu'on peut "inférer" correctement
les valeurs qui expriment, elles, les désirs et les
préférences individuelles et sociales.
En définitive, chacune des trois distinctions
proposées jusqu'ici (intrinsèque/extrinsèque,
instrumentale/terminale et repère-normatif/mobile-profond)
éclaire des aspects différents des valeurs des individus. Autant
d'indicateurs des raisons des changements observés ; ce qui devrait
témoigner de la fécondité des valeurs dans le travail
d'enquête. Mais pour aller plus loin, Max Scheler « a
reconnu la valeur non seulement des personnes singulières, mais aussi de
ces personnes communes que sont la nation, la totalité culturelle, etc.
L'homme, en la vie psychique de qui s'étagent différents niveaux
interdépendants, végétatif, instinctif, associatif,
pragmatique, est aussi esprit160(*). Ce centre d'activité libre ne subsiste que
dans l'accomplissement des actes intentionnels, c'est-à-dire se
référant aux valeurs. »161(*) Pour Raymond Boudon,
« [(Max Scheler)] affirme l'objectivité des
valeurs, au sens où les valeurs existeraient indépendamment du
sujet qui les appréhende. »162(*) C'est
précisément ce que nous allons développer dans la section
suivante, c'est-à-dire, la théorie des valeurs de Scheler. Parce-qu'elle nous amènera à
comprendre le phénomène de changement au travers de
contradictions ou de correspondances entre les valeurs personnelles et les
valeurs objectivées par l'adhérent dans ses interactions et
interrelations.
1.3.1.1 La théorie des
valeurs de Scheler, une conception des catégories morales
Pour Max Scheler, les valeurs sont
révélées par l'émotion. « Les valeurs
sont des phénomènes de base donnés à l'intuition
affective perceptive. »163(*) Mais, si des inclinations particulières
à dominante subjectives, comme le respect ou l'éthique, orientent
l'individu vers les valeurs, elles ne déterminent pas pour autant leur
contenu. Précisant que, si des mécanismes divers
(l'intérêt, le ressentiment, l'affection, par exemples)
entraînent une perception biaisée des valeurs, ils n'en affectent
pas moins les valeurs. Pour résumer la pensée de Scheler, cette
indétermination des valeurs laisse place à l'innovation, qui
réussit lorsqu'elle répond à des inclinations. Elle ouvre
à une marge d'interprétation faite de jugements de valeurs, lesquels engendrent des
conflits de valeurs. Réciproquement, ces conflits sont
incompréhensibles si l'on ne voit pas cette
indétermination.164(*) Ainsi, il traite plusieurs sources de distorsion des
valeurs. Par exemple, le pharisaïsme en tant que donnée
générale : « les individus sont normalement
mus par l'intérêt »165(*) ; le
ressentiment166(*) comme
un rapport d'impuissance à un état de chose qu'un individu
souhaiterait changer : « on peut évaluer positivement
ou négativement quelque chose qui ne le mérite pas, lorsque cette
valorisation à un effet psychologique positif sur l'évaluateur
lui-même »167(*) ; le relativisme, découlant du fait que
l'objectivité des jugements de valeur auxquels nous croyons soit le
témoin de conflits de valeurs :
« [(l'individu)] risque alors de se laisser
séduire par la thèse de la subjectivité des valeurs
morales, par la thèse de "l'arbitraire culturel" des valeurs et par les
diverses théories qui font des valeurs des
illusions »168(*) et les facteurs cognitifs qui, d'une
façon générale « font bien voir que le
contenu des valeurs est pour partie contingent et pour partie tributaire de
données propres à telle ou telle
société. »169(*)
Mais, si le contenu des valeurs est indéterminé,
Scheler note un corollaire crucial, à savoir qu'elles ne peuvent, en
elles-même, déterminer les normes170(*). Puisque, les valeurs
reçoivent un contenu particulier dans des contextes culturels
déterminés. Par suite, « les normes, qui sont
déduites de ce contenu particulier, ne sont pas des conséquences
directes des valeurs. »171(*) Cette théorie explique que les mêmes
valeurs s'expriment normalement par des symboles variables.172(*) Plus important : s'il y
a indétermination des valeurs, il y a logiquement variabilité des
normes. Comme Tocqueville ou Durkheim, Scheler suggère un passage des
valeurs aux normes par le truchement de théories : « théories
d'inspiration religieuses dans les société traditionnelles,
d'inspiration philosophique et/ou scientifique dans les sociétés
modernes. »173(*) Ainsi, les normes seraient inspirées par
les représentations et les théories en vigueur dans telle ou
telle société.174(*) Mais tout cela n'est possible, précise
Scheler, que si « la notion de personne peut se
former. »175(*) Autrement dit, si la reconnaissance des droits de
l'individu est une traduction dans le registre des normes de la valeur de
personne176(*) :
« s'il ne peut venir à aucune personne sensée
l'idée de faire deux espèces des Noirs et des
Indo-Européens, c'est en raison de l'installation définitive de
la valeur de personne humaine. »177(*) Donc, pour Scheler, la
notion de personne est une « catégorie purement
morale »178(*) distincte des notions de je179(*) (psychologie),
caractère180(*)
(sociologie) et d'âme (théologie).
Ainsi, pour Scheler, on ressent les valeurs, on ne peut les
expliquer.181(*) Ce qui
nous permet de voir une opposition entre affectif et rationnel, entre les
affects variant selon les ressources de la personne et, par exemple, des
sentiments d'attraction ou de répulsion qui eux peuvent être
aisément associés à des raisons identifiées,
articulées ou axiologiques. C'est-à-dire, des raisons pouvant
être objectivées, analysées, défendues voire
formalisées. Les raisons axiologiques devant être entendu, ici, en
tant que jugements de valeur. Par voie de conséquence, si nous nous
référons au célèbre aphorisme de Pascal,
« le coeur a ses raisons que la raison ne connaît
pas », la variabilité des valeurs ne s'explique que
« si l'on suppose que l'affectivité n'est pas vierge de
raisons métaconscientes »182(*), de raisons propres pouvant
être mises en évidence. Par exemple, un enseignant corrigeant un
examen n'a pas réellement conscience du jugement de valeur qui
détermine le "bon temps" à passer sur la copie. Cependant, il
peut "justifier" de ce "bon temps" par des raisons (entre autres) de temps
disponible, de devoir envers les candidats, de nombre de copies à
corriger, d'obligations morale diverses, tant personnelles que
professionnelles, son existence en général, le lieu de
correction.
Pour résumer : le fait que les valeurs s'expriment
de manière symbolique (tout comme nous l'écrivions pour
l'identité183(*)), le fait qu'elles donnent naissance à des
normes, que ces normes soient tirées de valeurs empruntées
à la société ambiante, constituent un système
particulier de normes et de valeurs caractéristiques d'une
société. Par extension, cela voudrait dire que la morale produit
des normes susceptibles d'orienter les agirs humains. Pour le dire autrement,
« la réflexion théorique sur les valeurs a
peut-être une influence sur la création d'un nouvel
ethos. »184(*) Ce qu'il faut entendre par ethos est
« le caractère commun à un groupe d'individus
d'une même société. »185(*) Dans notre propos, les
ethos, constituant donc des constructions tendant à l'expression de
valeurs morales.186(*)
En clair, la théorie de Scheler nous intéresse
particulièrement parce-qu'elle s'attache aux faits. Ainsi, pour
préciser ce que nous disions à la fin de la section
précédente à propos des valeurs personnelles (leur
variabilité et leur diversité) et de leur objectivation dans les
interactions et interrelations187(*), cette théorie nous permettra de
repérer 1) les sentiments de l'adhérent qui se traduisent par des
jugements de valeur188(*), 2) l'objectivation de ces jugements de valeur,
c'est-à-dire leur manifestation concrète et 3) les
développements axiologiques des valeurs communes favorisant son
changement au Compu's Club. Ceci nous amène à nous demander ce
qui peut bien conduire l'individu à la construction d'un nouvel ethos.
Ici, notre objectif est de chercher l'influence sur les changements d'une
conciliation entre les valeurs personnelles (les jugements de valeurs) qui
produisent des normes susceptibles d'orienter les agirs humains et
l'objectivité des valeurs dans les interrelations qui pourraient
engendrer la création d'un nouveau système de valeur. C'est ce
qui va être abordé maintenant dans la section suivante.
1.3.1.2
Peut-on fonder un système de valeurs ?
Nous venons de saisir que les valeurs morales dépendent
pour Scheler de nos émotions liées à des schémas
théoriques et sont le produit d'innovations. De même, nous avons
vu que la morale intervenait pour produire des normes qui sont susceptibles
d'orienter les agirs humains. Alors, si ces émotions visent et laissent
apparaître non seulement les valeurs mais aussi les agirs humains, sur
quelles bases l'individu évalue-t-il le choix de ses normes ? Par
là donc, se pose le problème d'une morale qui met en relation
l'individu avec un groupe social déterminé. Dans ce qui nous
préoccupe ici : l'adhérent changeant avec l'association. Les
analyses de Scheler affirment que « [l']indétermination
des valeurs est non seulement observable ; elle permet aussi de comprendre
qu'il existe en manière de valeurs des innovateurs, et que ceux-ci
soient tenus pour occupant une place élevée dans la
hiérarchie des valeurs. »189(*) Très proche de Weber
ou Durkheim, Scheler nous propose d'y répondre par la valeur
sentimentale de sympathie. Sympathie qu'il faut entendre non pas comme une
bonne disposition envers quelque chose, mais plutôt à la
manière de ce que nous venons de développer, comme un sentiment
éprouvé pour quelqu'un. C'est-à-dire en tant que
perception (émotion) et acte intentionnel (agirs humains). Par là
même, la sympathie permet de saisir comme telle, par exemple, une sorte
de désir d'union, de coopération positive (solidarité)
pour conduire au bonheur, au plaisir190(*) et au bien être. En début de chapitre,
nous avions relevé que pour exister et s'identifier, l'individu avait
besoin des autres, cela voudrait dire que son existence et son identification
seraient régis par le principe de sympathie régnant entre
personnes appartenant à divers groupes. En l'occurrence, entre les
adhérents de l'association répartis en branches (micro-groupes).
Ce serait, donc, la sympathie qui assurerait la cohésion de ces groupes.
Autrement dit, la sociabilité aurait trouvé ses fondements avec
la sympathie. Ce qui va nous intéresser de repérer alors, c'est
comment la sympathie va permettre une communication et signifier des conduites
interpersonnelles. Nous nous intéressons à cette approche de la
sympathie parce-qu'en tant que valeur, émotion, elle nous permet
d'aborder le phénomène de changement comme une interrelation.
Des auteurs tels Husserl ou Simmel peuvent être
évoqués à l'appui de la théorie de Scheler pour
parler d'amitié et d'éthique. L'amitié, peut être
entendue comme une lien d'affection, de tendresse, de
générosité pour une personne, une forme d'amour. Valeur
elle-même, elle est tolérance et permet une claire acceptation
entre des différences et la reconnaissance de valeurs mutuelles. En ce
sens elle marque le respect et l'égalité. Pour Aristote,
l'amitié est « un sentiment de bienveillance active et
réciproque, lien social par excellence. Nul bonheur n'est pensable si
l'on est privé d'amis. » De ce point de vue, c'est un
sentiment réciproque. Pour Kant, l'amitié « exige
que l'on se maintienne l'un à l'égard de l'autre à une
distance convenable. »191(*) Ici, l'amitié, pour être authentique,
doit se fonder sur une certaine distance. Mais ce qui définirait le
mieux l'amitié pour Scheler serait certainement une forme sublime de
sympathie à l'égard d'autrui. Autrement dit, un altruisme. En ce
sens, les changements observés pourraient être
éclairés par la question de l'amitié en tant qu'altruisme.
Parce-que la personne se manifeste à l'amitié dans la
diversité de ses actes. Cette diversité autoriserait les
interrelations permettant, à leur tour, son évolution donc son
changement. Cette amitié, en tant qu'altruisme, peut dès lors
désigner le lieu de naissance de l'éthique. C'est ce sens, qui
éclaire la question d'autrui : autrui comme autre,
altérité, non plus alter ego, différence. Cependant,
Scheler introduit une distinction essentielle entre les formes de
l'éthique et l'ethos192(*) : l'éthique apparaît
« lorsque un ethos régnant se
décompose. »193(*) Il définit l'ethos comme « le
système de normes et de valeurs caractéristique d'une
société. » Alors, si autrui est celui avec lequel
une personne peut construire véritablement une relation et une
réciprocité dans l'amitié notamment, autrui doit
être aussi celui qui impose des limites et ouvre au
désintéressement. Nous traduisons : ouvre à la
morale, à la construction d'une éthique. Pourquoi a-t-on besoin
de morale ? Parce-que, sans elle, rien de ce qui existe ne saurait
être évalué ni affronté. Pour le dire avec
André Comte-Sponville, « pour essayer de comprendre ce que
nous devrions faire, ou être, ou vivre, et mesurer par là... le
chemin qui nous en sépare. »194(*) Vu sous cet angle, la
relation à autrui dépasse le cadre strictement affectif de
Scheler. Toutefois nous lui resterons fidèle parce-que, nous le
rappelons, une perception biaisée des valeurs par les individus n'en
affectent pas moins les valeurs195(*). Or l'éthique étant une valeur, le
fait que « toute connaissance éthique s'effectue selon des
lois rigoureuses de la perception affective n'affecte en rien son
objectivité. »196(*) Ainsi, en élaborant son éthique de la
sympathie, Scheler s'attache à montrer qu'elle serait une forme
englobante. « Ce qu'il appelle "théorie de
l'identification de la sympathie" permet d'expliquer les situations de fusion.
[...] Cette théorie de l'identification est en parfaite congruence avec
le développement de l'image. »197(*) Ce qui semble faire
écho 1) à la notion de solidarité comme nous l'avons
comprise ; c'est-à-dire, ici, en tant qu'elle peut être
expliquée comme une situation de fusion et 2) au concept
d'identité en tant qu'il puisse apparaître comme une image.
Poser tout ce qui vient d'être développé
dans cette section suppose une connaissance concrète des comportements
de l'individu. Espérant découvrir, par là,
« comment la profondeur peut se cacher à la surface des
choses. »198(*) C'est-à-dire, comment le "récit" de
l'individu à la recherche de sa place, d'une relation à l'autre
et de reconnaissance identitaire permet une compréhension du
phénomène de changement. En résumé, ce que nous
apprenons, c'est que le phénomène de changement
échappe aux normes et au contenu même des valeurs.
Elles-mêmes tributaires de toutes sortes de facteurs extra-moraux. La
relation des membres d'un groupe est donc fonction des valeurs internes qu'il
produit : « l'apparition d'une valeur peut être
facilitée par le contexte ou la conjoncture ; sa persistance ne
peut s'expliquer seulement parce-qu'elle est adaptée au contexte et
à la conjoncture. »199(*) Ainsi, du changement observé qui nous a
occupé jusqu'ici, nous dirons que les valeurs permettent de comprendre
le glissement d'une logique de l'identité à une logique de
l'identification. Ce glissement pourrait être essentiellement
individualiste, pourtant, il est beaucoup plus collectif. En fait,
l'identification associe chaque personne à un groupe selon une relation.
Cette relation est la conséquence d'une attraction : on s'associe
suivant les contingences ou/et les désirs, les besoins. Ceci implique
une multiplicité de valeurs et d'intérêts opposés
les uns aux autres. L'individu n'est, ici, jamais une unité
définitive mais toujours en construction, toujours solidaire avec tous
dans l'appartenance à un même groupe ou micro-groupe. Ce qui
voudrait dire que l'intérêt qui lie l'individu à ce groupe
ou micro-groupe, ainsi que les valeurs qui sont partagées
contractuellement, deviennent progressivement ciment et vecteurs
d'éthique. Celle-ci paraissant factrice de socialisation ;
c'est-à-dire : 1) d'intégration dans un groupe et 2) de
transcendance de l'individu. Par cela, elle le transforme, le fait changer,
donne du sens à ses interrelations et interactions. Bref, cette
production individuelle permettrait de vivre, ce que nous nommerons, une
"légende collective spécifique"200(*), c'est-à-dire une reliance201(*). Désormais, il n'y
aurait plus rien de permis ou défendu mais l'individu a l'exigence de se
produire lui-même, tenu pour responsable de tout ce qu'il est, fait ou
paraît202(*). Et
cette exigence serait un défi a assumer dans la solidarité
parce-que cet effet de reliance est susceptible de donner aux individus une
place qui acquiert du sens. Ce qui nous paraît désormais
éclatant c'est que l'objectif unique de l'individu dans un groupe serait
d'être ensemble au-delà de toute autres considérations.
C'est, en tout cas, la manière de penser de Michel Maffesoli :
« [nos tribus contemporaines] n'ont que faire du but à
atteindre [...] Elles préfèrent "entrer dans" le plaisir
d'être ensemble. »203(*) Mais il est frappant de constater au Compu's Club,
que cette forme de collectivisation, cette socialisation, semble bien plus
confuse, hétérogène, mouvante, que rationnelle,
mécanique et finalisée. Par association d'idées, serait-ce
à dire que les stratégies qu'appelle l'action humaine sont des
stratégies de reliance ? Ce qui nous conduit à nous demander
si comprendre le phénomène de changement ne pourrait pas
être tenter de comprendre comment ce « entrer
dans » est "négocié" par l'adhérent ?
Parce-que cette construction individuelle de lien social, cette socialisation,
nous signifie l'influence de l'individu sur lui-même par des
manières de faire propres.
1.3.2 L'individu dans son groupe, un inventeur de
manières de faire
Certeau, dans la première partie de "L'invention du
quotidien", entame une importante recherche née,
précise-t-il, « d'une interrogation sur les
opérations des usagers, supposés voués à la
passivité et à la discipline. »204(*) Ceci suggère que ce
que nous avons vu plus haut sur la représentation d'une contingence (par
exemple, d'un groupe ou d'une situation), doit être
complétée par l'étude de ce que l'adhérent
"fabrique", "bricole", "braconne" en fabricant ces représentations. Ce
que propose Certeau, c'est « d'exhumer les formes subreptices que
prend la créativité dispersée, tactique et bricoleuse des
groupes ou des individus »205(*) qui, « par leur manière de les
utiliser à des fins et en fonction de références
étrangères au système »206(*), "subvertissent" les
productions ou les représentations imposées par une contingence.
Nous allons donc nous attacher a découvrir les types de ce que nous
avons déjà appelé des logiques spécifiques
exercées au sein d'un groupe et les ruses anonymes, les
habiletés "inventées" au coup par coup dans les
interrelations : les tactiques207(*). Ce qui nous amène à prendre appui sur
les concepts d'usages, de stratégies et de tactiques de Certeau. Nous
nous intéressons à ces concepts parce-qu'ils permettent d'aborder
le phénomène de changement rencontré dans les
différentes situations comme une inventivité incessante. Cette
inventivité, plus ou moins inconsciente, devrait nous mener au coeur
même des raisons des changements parce-qu'elle est susceptible
d'autoriser des "arts de faire" dans les relations les rendant dynamiques
relationnelles. Pour exemple, les pratiques de "bricolage" qui relèvent
des nouvelles technologies produisent une écriture particulière
favorisant une lecture rapide, signalétique et une mise en page dont la
typographie est image. Cette écriture particulière produit
à son tour une lecture particulière qui fonctionne comme un
espace ouvert à l'inventivité. Donc, un "propre" de
modèles et de relations. Cette écriture particulière
semble, par là, traiter de la dimension sociale dans lequel se trouve
inscrite une pratique symbolique (un graphisme) qui structure la fabrication
d'un sens (une intention, un imaginaire ou à une représentation
des normes) et la met en valeur. Selon Certeau, ce "propre" est le
préalable à l'élaboration d'une stratégie208(*). Il a montré comment
il y a un "geste" qui distingue un lieu autonome, un "propre", qui permet de
capitaliser les avantages acquis et de préparer des expansions
futures : « l'enfant gribouille encore et tache son livre
d'école ; même s'il est puni de ce crime, il se fait un
espace. »209(*) Il implique donc un contrôle du lieu par le
biais d'une « pratique panoptique »210(*) qui permet de le
contrôler en le transformant. Le lieu circonscrit comme un "propre" sert
alors de base pour gérer des relations, une communication et fixer des
stratégies qui les transforment en espaces lisibles. Par exemple,
« l'acte de dire est un usage de la langue et une
opération sur elle. »211(*)
La tactique s'inscrit dans le lieu de l'autre212(*). Ce qui nous permet de
regarder les actions de l'adhérent en tant qu'elles sont des tactiques,
c'est-à-dire des actions calculées que détermine l'absence
d'un "propre", mouvements dans un espace contrôlé
par autrui. C'est un art de jouer des coups, de saisir l'occasion :
« [la tactique] fait du coup par coup. Elle profite des
"occasions" et en dépend. »213(*) Autrement dit,
« un calcul qui ne peut pas compter sur un
propre. » 214(*) Il est remarquable que les termes de
"tactique" et de "stratégie", entendus dans le sens certausien, sont
antonymes, mais pas véritablement antinomiques : une manière
d'agir pour atteindre un objectif, pour l'un, une connaissance portant sur les
différentes manières d'agir, c'est-à-dire un
« art de combiner et de coordonner diverses actions
pour atteindre un but »215(*), pour l'autre. D'un point de vue individuel, l'usage
de ces pratiques serait alors un art d'être et de faire circonstanciel,
une tactique conduisant l'individu dans une autodidaxie dont on devine le
rapport au monde et à soi propice aux changements Elle serait avant tout
une construction de détours et contours, toujours substitution de
règles de contrainte. Découvrir cette réinvention du
quotidien exercée par l'adhérent doit permettre de marquer son
acculturation, ses innovations et le préparer à son changement.
Autrement dit, repérer et décomposer les stratégies ou les
tactiques adoptées par les adhérents devrait nous permettre de
comprendre le phénomène de changement aussi bien au travers de
son identité personnelle que de son identité sociale prise au jeu
des interactions avec le micro-groupe (la branche). En même temps et en
poussant ce raisonnement, cela devra nous permettre de dégager trois
points : 1) l'expression de sa personnalité, 2) son image du
micro-groupe (nous traduisons : le lieu symbolique où il veut
s'installer) et 3) son acculturation qui s'accompagne d'actions symboliques
(usages, jeux, ruses, tactiques par des potentiels d'imagination et de
créativité) destinées à consacrer son changement.
La variété des changements constatés enrichira, dès
lors, notre compréhension du phénomène. L'examen des
transformations, des changements qui affectent tour à tour les valeurs,
les conduites et les systèmes de pensée devra permettre ainsi la
description des conditions de leur apparition, leur fonctionnement et leur
éventuelle disparition.
1.3.3 L'hypothèse, des mots
clefs pour construire un protocole de validation
Maintenant que nous avons atteint l'objectif de cette
première étape, c'est-à-dire, livrer les
éléments de théories suscités par notre question de
départ216(*),
l'hypothèse subit une mutation217(*) pour devenir : « Plus un
individu use, dans une configuration, de manières de faire, plus cet
individu accède à un statut d'individu. » Cette
nouvelle hypothèse porte donc sur l'usage de manières de
faire ; c'est-à-dire, celles qui concernent l'adhérent. Pour
présider au travail d'enquête et d'analyse des résultats,
nous allons maintenant articuler les repères et les pistes qui ont
émergées afin de rendre observable l'idée
(l'hypothèse) selon laquelle le changement de l'adhérent serait
dû à la manière dont il fait usage de la configuration
Compu's Club. Par suite, nous construirons un modèle entre
l'hypothèse et les axes théoriques du changement ;
c'est-à-dire les représentations de l'individu (constructions
singulières) et ses comportements dans la configuration (actions
individuelles dans des représentations plurielles). Ceci nous
amène à synthétiser puis expliciter, pour exploitation,
les concepts clefs de notre hypothèse. C'est-à-dire, les concepts
d'individu, de configuration et de manières de faire ; mais
également, d'usage de manières de faire et de statut
d'individu.
1.3.3.1 Autour de l'individu
Même si au Compu's Club on peut supposer ne rencontrer
que des masques (des personnes en représentation, c'est-à-dire
des personnages) qui représentent les identités de manière
éthérées, une gestion des relations interpersonnelles doit
y être organisée voire formalisée par l'adhérent. Il
s'agit, par exemple, de dépendances réciproques dans la
configuration, de stratégies et de coups joués dans
l'accomplissement des activités ou d'équilibre de tensions et de
rapports de forces dans les rôles. Nous envisageons donc un réseau
de relations où les adhérents seraient liés par des agirs
singuliers interdépendants. En particulier, ceux qui permettent de
construire et de transformer son être relationnel. Lors de chaque action,
un adhérent en situation est susceptible d'exercer sur la figure globale
de l'association une influence basée sur le doit-être, le
veux-être et le pouvoir.
A partir de là, avoir réfléchi sur
l'identité nous a permis de la considérer comme un prisme autour
d'une volonté d'existence par lequel d'autres aspects, par exemples la
reconnaissance, l'appartenance ou les valeurs, sont reconnus, compris et
examinés. Ainsi, comprendre le changement des adhérents à
travers l'identité, nous a amené à nous demander
quels étaient les facteurs sociaux, psychosociaux et les circonstances
pouvant favoriser l'apparition de conduites spécifiques, motivations,
intérêts et la sélection d'idées morales nouvelles.
Nous aborderons donc la manière dont les adhérents construisent
leurs identités au sein du Compu's Club mais également les
transformations des identités. Sur ce point, l'adhérent peut
vouloir restaurer son image, rechercher une reconnaissance sociale ou se
préparer à de nouvelles opportunités s'appuyant sur les
fluctuations de la configuration. Dès lors, il est susceptible d'user
d'un lien spécifique : l'identification.
Enfin, aborder les valeurs avec Scheler dans le
phénomène de changement a révélé
l'importance décisive de la sympathie, de l'amitié et de
l'éthique en tant que sentiment émotionnel pour la
compréhension d'autrui. Nous projetons donc une éthique de base
auquel chacun participerait ; c'est-à-dire
construirait/modifierait. En particulier, celle qui dépend des
perceptions et des représentations qui, par suite, pourrait
développer des règles collectives pour devenir le "contrat
social". Ces représentations constituent les composantes du concept
"statut d'individu" car elles sont sensées définir, dans les
actions communes, l'individualisation des actes et de tous les systèmes
sociaux que l'être humain développe pour devenir une personne
sociale singulière, un individu.
1.3.3.2 Autour du concept de configuration
Le contexte environnemental dans lequel évolue un
individu nous a montré, avec Elias, l'impossibilité de dissocier
l'individu de la société. Précisément,
l'insuffisance d'analyser une configuration sans tenir compte du sens
intentionnel des actions menés par les individus. Il s'agit, par
exemple, de formes d'interrelations qui s'entrecroisent et où
l'adhérent pourrait exercer des actions synallagmatiques, des
modifications de son expérience et de ses comportements. Nous
envisageons donc un rapport qui lierait réciproquement les
adhérents les uns aux autres au sein des branches. En particulier, la
solidarité peut faire l'objet d'un apprentissage par l'adhérent
qui demande du temps empêchant l'immédiateté d'une
présentation valorisante de soi. En fait tout dépend des
intérêts et des motivations, c'est-à-dire des processus
d'évolution, qu'il suit.
A partir de là, s'intéresser à
l'identité nous a permis de saisir cette capacité à
évoluer de l'être humain à partir d'un mixe de ses
représentations réelles et symboliques distinguant le je, proche
du cogito cartésien218(*), d'autrui. La configuration sociale
particulière du Compu's Club219(*) deviendrait alors celle des adhérents dont
les interactions pourraient être présentés comme la
rencontre de la forme et du sens des représentations et des
identifications. Les identifications de l'adhérent pourraient ainsi
servir de base à la communication lors du passage à un nouveau
stade de leur engagement, participation. Cette évolution
s'exerçant à l'occasion d'échanges avec les autres, la
portée de l'identification augmente.
Enfin, aborder les valeurs sous l'angle de la configuration
nous a permis de soulever une hiérarchisation des attentes de
l'individu. Nous projetons donc l'apparition de besoins à satisfaire par
les adhérents. Autrement dit, la multiplicité des images,
laissées à la variété des expériences
vécues au sein des branches, devraient faire apparaître des
possibilités d'individualisation à partir d'une recherche de
satisfaction de besoins.
1.3.3.3 Autour des manières
de faire
C'est autour du concept de manières de faire que le
lecteur saisira mieux l'importance que nous attribuons à la
configuration. Dans la section précédente, nous avons
distribué l'espace de la configuration selon un rapport qui lierait
réciproquement les adhérents à partir de ses
représentations. Lesquelles représentations devant servir de base
à la communication. Mais avec Certeau, nous avons appris que l'individu
organisait sa communication comme un espace dans lequel, tel un joueur
d'échec qui avance alternativement ses pièces en fonction de son
adversaire, il joue des coups successifs. Ces coups, loin d'être
déstructurés, sont joués selon des tactiques et des
stratégies, c'est-à-dire de manières intentionnelles. Nous
envisageons donc les transactions, les négociations de l'adhérent
dans l'usage permanent d'un entre-deux, d'un lieu qui le noue à l'autre
dans les circonstances. En particulier, nous envisageons des ruses, des
tactiques créatives singulières de la part de l'adhérent
dans des stratégies plurielles de branches.
A partir de là, avoir réfléchi sur
l'identité nous permet de considérer cet entre-deux en tant qu'il
ne saurait posséder une propriété formelle stable. En
fait, il varierait selon des clefs propres relatives à
l'adhérent. Nous envisageons donc l'adhérent
énonçant des coups joués (usage), grâce à des
manières de faire, dans un lieu à la fois symbolique et
habitable. Parce-que, les manières de faire de l'adhérent suppose
l'habitabilité circonstancielle d'un espace symbolique par des clefs
d'accès, ses propres coups joués.
Enfin, aborder les valeurs sous l'angle des manières de
faire nous permet de considérer l'habitabilité et les coups
joués en fonction de la perception des valeurs par l'adhérent
(émotion). Nous projetons donc l'ajustement prioritaire de valeurs en
tant que coups joués dans cet entre-deux. Par exemple, pour
s'intégrer, l'adhérent pourrait être amené à
respecter et se soumettre aux systèmes de valeurs en vigueur ou en
innover de nouvelles. Il pourrait, tout aussi bien, s'en écarter ;
auquel cas il s'agirait d'un hors-lieu qui n'en demeurerait pas moins un lieu
en tant que lieu autre. Cette perception possible constitue les composantes du
concept "user de manières de faire" car elles définissent les
critères de l'habitabilité d'un entre-deux : les valeurs.
1.3.3.4 Synthèse des liens entre les mots clefs de
l'hypothèse.
La construction d'un schéma théorique explicatif
du phénomène de changement permet de synthétiser
l'explication de l'analyse des mots clefs de l'hypothèse en
désignant les variables (individu, configuration, manières de
faire) et les indicateurs220(*) à mettre en relation et en donnant du sens
à leur signification. Il devrait se présenter ainsi :
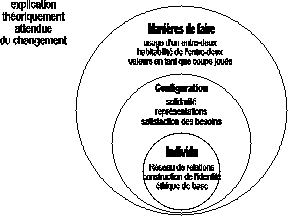
Explication
théoriquement attendue du changement
Ce schéma, envisagé fluctuant par nature (pour
reprendre l'expression d'Elias) devra donc apparaître en évolution
constante et mutation continue. Ne fût-ce qu'un instant, il faut insister
sur ce point qui, en particulier fait bien comprendre que ceci est possible
parce-que les manières de faire seront toujours débattues et le
micro-groupe évolue de façon libre et chaotique sous une
éthique de base. C'est ce que semble nous dire Lemos à propos de
l'Internet : « on est en train de voir le
développement d'un "écosystème" auto-organisant,
informationnel et communautaire dans le nerf de l'infrastructure technique de
communication. »221(*) De plus, si la morale règle les conduites
humaines, nous l'avons vu, et qu'elle concerne la raison et la perception (qui
sont elles aussi humaines), alors le témoignage des négociations
entre l'adhérent et le micro-groupe, ainsi que l'examen de ses attitudes
et comportements dans les contraintes de la configuration, c'est-à-dire
dans les limites qu'imposent les transactions avec autrui, devraient nous
donner de précieux renseignements sur ses manières de faire. Si
les discours des adhérents correspondent aux perspectives ouvertes par
le modèle d'analyse et que nous envisageons exploiter, cela devrait se
manifester d'abord par des expressions mettant l'accent sur les raisons de son
adhésion, ses engagements, ses valeurs personnelles par rapport au
fondement de l'association. Doivent apparaître ensuite, celles des
représentations et des images de l'association, de la description des
interrelations, de ses envies, de ce qu'il recherche. Enfin, l'adhérent
devrait énoncer des exemples d'interrelations, comment il y participe,
comment il les ressent, comment il s'y particularise. Bref, il s'agira de
repérer l'adhérent en tant qu'il produit des coups sans lequel il
ne peut exister comme individu. Pour nous y aider nous avons ordonné
temporairement dans le tableau suivant un certain nombre de questions.
Tableau de correspondance
mots-clefs/concepts
|
Mots clefs
Concepts
|
Individu
|
Configuration
|
Manières de faire
|
|
Personne
(adhérent)
|
û Quel sens du personnage mis en scène ?
û Quel comportement ?
û Quelle(s) motivation(s) ?
|
û Quelle place singulière ?
û Quelles actions réciproques,
interdépendantes ?
û Quelles tensions dans les situations (sens) ?
|
û Quels "coups" joués ?
û Qu'en résulte-t-il ?
û Comment participe-t-il ?
û Comment définit-il ses
intérêts ?
|
Identité
|
Présentation de soi :
û Quelle identité personnelle ?
û Quel devoir être ?
û Quelle volonté d'être (image
produite) ?
Représentation des autres :
û Quelle identité sociale ?
û Quelle perception d'autrui ?
û Quel(s) repère(s) ?
|
û Quelle reconnaissance ?
û Que se joue-t-il ?
û Quelles interrelations, interactions,
acculturation ?
|
û Quelle manière d'être ?
û Quelle(s) manières de créer,
d'inventer ?
û Quelles successions d'ajustements des coups
joués (négociation) ?
|
Valeurs
|
û Quelle(s) images(s) perçue(s) ?
û Quelle émotion révèle les
valeurs ?
û Quels besoins sont à satisfaire ?
û Quel(s) jugement(s) de valeur ?
|
û Quelle communauté de
valeurs (préférences communes) ?
û Quels ressentiments (solidarité,
sympathie) ?
û Quelle est la base d'évaluation de ses
normes ?
û Quelles valeurs sont le produit d'innovations ?
|
û Comment s'y prend-il pour ajuster les valeurs du groupe
aux siennes, détourner les normes, faire accepter ses propres
valeurs ?
û Comment s'y prend-il pour coopérer ?
|
|
De ce tableau, tiré du modèle d'analyse, nous
voulons dégager les thèmes pour le travail d'enquête.
C'est-à-dire, nous écouterons ce que les adhérents nous
diront de leur parcours personnel (identité), de leur trajectoire
(individu), de leur engagement (personnage), mais surtout de leurs
représentations (valeurs), de leurs préoccupations (besoins et
intérêts) et de leurs manières de voir, leurs
manières d'être, leurs manières de faire. Bref, ce qui fait
lien entre l'association et ses membres, ce qui donne du sens aux dynamiques
relationnelles, ce qui les fait changer. Pour nous préparer, nous avons
essayé dans ressortir quelques préoccupations :
û Eléments d'itinéraires :
Pourquoi et comment ils sont arrivés au Compu's
Club ? Remonter aux origines devra permettre de relever les
caractères des adhérents au moment de leur adhésion, les
identités déjà forgées, les valeurs originelles,
les expériences antécédentes, leur situation
professionnelle et familiale. Mais aussi les divergences, les
diversités. Autant d'éléments susceptibles de
déterminer un point de départ à leur changement :
attente, projet, besoins, par exemples. Bref, tout ce qui a pu présider
à l'adhésion.
û Nature des éléments
évoqués lorsqu'on interroge les individus :
Qu'attendent-ils des activités de l'association ?
Quelle image, quelle représentation en ont-ils ? Comment les
jugent-ils ? Pour obtenir des réponses sur la position de chacun
dans leur engagement, pointer les contradictions du statut d'individu
confronté à une pratique relationnelle en tant
qu'adhérent.
û Situations vécues comme importantes, reconnues
comme constructives, structurantes :
Quelles sont les stratégies développées
selon leur position d'ascension ou de déclin à l'égard de
leur engagement, à l'égard aussi des autres
adhérents ? Quelles sont les fortes situations ? Bref, ce qui
nous permet de déterminer une configuration, les formes de jeux.
û Construction du sens :
Quelles valeurs ? Quelle maturation de
l'expérience vécue ? Comment se caractérise le
mécanisme de dynamique ? D'engagement ? Qu'est-ce qu'il en
retiens ? Ce qui doit permettre de relever les divers processus
d'identification.
û Adaptation/accommodation :
Comment les adhérents interrogés ont-ils
répondu à l'apparition de nouveau projet ? Dans quel délai
se sont-ils engagés ? Est-ce que ça a été simple ou
compliqué ? Comment s'y sont-ils pris ? Comment
témoignent-ils de leur démarche ?
û Pratiques et discours :
En les faisant parler de leur engagement, de leurs pratiques,
on peut supposer arriver à percevoir leurs aspirations.
û Et plus tard ?
Comment l'adhérent voit son avenir au Compu's
Club ? Quel comportement, par rapport à ce qu'il a vécu,
va-t-il adopter pour l'avenir ? De même, par rapport à ses
aspirations émergentes ? Ceci afin de déterminer s'il va
continuer à s'engager dans l'association et par là se donner la
possibilité de changer encore.
Ce sont ces thèmes que nous allons chercher à
renseigner par l'enquête afin de mettre à l'épreuve des
faits notre hypothèse :
Plus un individu use, dans une configuration, de
manières de faire, plus cet individu accède à un statut
d'individu.
Conclusion : repérer
l'individu changeant à partir d'un modèle d'analyse
Dans cette première partie nous nous sommes
intéressé particulièrement au fait que le
phénomène de changement observé a
généré un réseau de questions et questionnements
à partir desquels nous avons centré l'adhérent en
interrelation avec et dans un groupe222(*). Ainsi, nous avons pointé les concepts
fondamentaux pouvant s'avérer être des pistes fécondes pour
son intelligibilité. C'est-à-dire, comme nous l'avons
montré, la question du changement pourrait être
éclairé par les concepts et notions d'individu, personnage,
identification, valeurs et configuration qui ont fait l'objet d'un
développement approfondi pour éviter leurs confusions
d'interprétations courantes. Procéder ainsi nous a appris que le
phénomène de changement n'est pas
« nécessairement provoqué par des changements de la
nature extérieure à l'homme. [...] Le seul environnement qui ait
changé est l'environnement que formaient et que forment les hommes les
uns pour les autres. »223(*) C'est pourquoi, analyser le concept d'usage de
manières de faire s'est présenté comme un cadre pertinent.
Dans un même temps, nous avons démonté les
mécanismes que ces concepts pouvaient exercer sur notre hypothèse
de départ. Pour y parvenir nous avons mobilisé les travaux
d'auteurs tels que Durkheim, Scheler, Elias, Certeau, entre autres pour
finalement proposer une nouvelle hypothèse : « Plus
un individu use, dans une configuration, de manières de faire, plus cet
individu accède à un statut d'individu.».
DEUXIEME PARTIE
ENGAGEZ-VOUS, RENGAGEZ-VOUS,
ILS DISAIENT224(*)
2.
Engagez-vous, rengagez-vous, ils disaient
Les associations loi 1901, qui veulent prendre part à
la création de liens sociaux de manière volontaire225(*), sont en permanence
confrontées à un dilemme qui les place dans un paradoxe :
comment motiver ses adhérents pour développer des
activités communes, et en même temps, comment mettre en place une
démarche de responsabilisation et donner du sens aux utopies
individuelles ? Comment construire une action se situant entre le
désir individuel de l'adhérent et l'intérêt
général de l'association ?
Le Compu's Club, association reconnue226(*) dans la région
valentinoise pour ses actions socioculturelles utilisant l'outil informatique
paraissait illustrer ce paradoxe. En effet, l'évolution de cette
association semble souligner la nécessité de développer
des activités en tenant compte de la valorisation de chaque membre
engagé.227(*)
Ceci nous a permis d'observer les phénomènes qui ont fait l'objet
de notre question de départ : qu'est-ce qui fait que certains membres de ce club
informatique semblent, indépendamment de l'outil, changer ?.
Pour comprendre ce qui se passe là, c'est-à-dire
que ces membres semblent changer et se retrouver au delà de l'outil,
nous avons eu recours à la notion de configuration dans le sens
où Norbert Elias l'entend : « figure globale toujours
changeante que forment les joueurs ; elle inclut non seulement leur
intellect, mais toute leur personne, les actions et les relations
réciproques. »228(*). C'est-à-dire
que nous allons tenter de retrouver ces "jeux d'acteurs interactifs" qui
déterminent ces transformations constantes du contexte et de l'ambiance
de cette association. Autrement dit, nous allons découvrir, là,
ce que Michel de Certeau pense des pratiques quotidiennes et des jeux
d'acteurs, c'est-à-dire « les modalités des
actions, les formalités des pratiques, les types de manières de
faire.[...][(C'est-à-dire)] spécifier des schémas
d'opération »229(*) afin de repérer soit les
représentations et les identifications soit les comportements des
membres du Compu's Club230(*). En partant de la nouvelle hypothèse,
« Plus un individu use, dans une configuration, de
manières de faire, plus cet individu accède à un statut
d'individu. » nous saurons ce que nous cherchons,
c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a figure globale toujours
changeante ? Quels éléments de notre enquête
le montrent ? En quoi on peut repérer ces figures
changeantes ? En quoi il y a représentation et
identification ? Et par là, donner du sens aux interactions
sociales des adhérents. Pour y parvenir, nous avons utilisé
progressivement trois types d'investigations :
La première s'est déroulée pendant
quarante mois231(*),
c'était notre période d'observation qui avait pour but de
découvrir l'association en fondant une taxonomie des membres et relever
une systématicité des comportements.
La deuxième, menée par l'association et avec
notre collaboration, pour mieux connaître ses adhérents,
concernait un questionnaire232(*). Il s'agissait, en avril 2000, d'identifier
statistiquement ce que les membres sont et font au sein de l'association. Cette
enquête a concerné les trente-six personnes qui ont bien voulu y
répondre (36/107). Elle nous a aidé à choisir notre
échantillon.
Enfin, la troisième, discursive, fut menée par
nous-même dans l'objectif de cette recherche et nous a permis
d'interviewer233(*) dix
membres234(*) dans
le cadre d'entretiens semi-directifs. Ceci afin de repérer
« le sens que les membres donnent à leurs pratiques et aux
événements auxquels ils sont
confrontés »235(*). C'est-à-dire que ce type d'enquête
visait à recueillir des états descriptifs de pratiques
(engagements), jeux, interactions afin d'en découvrir le sens.
Avoir choisi d'utiliser ces trois types d'investigations est
la garantie d'obtenir une réponse à notre question de
départ236(*) qui,
rappelons-le, posait notre incompréhension face au changement apparent
de certains membres indépendamment de l'outil informatique. parce-que
nos travaux d'enquêtes ont consisté, d'une part, à mesurer
et connaître pour comprendre le contexte environnemental du Compu's Club
et la manière dont le membre s'y fond. D'autre part, ils tentent
de 1) repérer les changements de conduite dans le quotidien de
l'adhérent au Compu's Club, 2) découvrir les attitudes237(*) qui favorisent la communication relationnelle et 3)
trouver le sens de l'engagement du membre. Pour ce faire, nous allons
présenter la façon dont les membres agissent ensemble, de leur
manière d'être en relation, de leur façon de mettre
l'interaction sociale238(*) au coeur des projets partagés au service de
leur propre satisfaction personnelle.
Dans notre analyse, nous avons voulu restituer les
résultats de l'enquête par entretien semi-directif en tant
qu'outil principal239(*). parce-que la nature des informations recueillies a
permis de repérer des éléments discriminants que nous ne
connaissions pas à priori. C'est-à-dire les
interprétations de situations, les systèmes de valeurs, les
ressentis, les repères normatifs, les représentations de
l'environnement contextuel, les projets personnels, etc. des membres.
Chacun de ces entretiens s'est déroulé selon un
même schéma : La durée moyenne fût d'une heure
environ. Les lieux d'interviews furent choisis selon les circonstances. Ainsi,
le premier s'est déroulé directement au domicile du membre, le
deuxième sur son lieu de travail et tous les autres à notre
domicile. La grille d'entretien comprenait trois grands thèmes avec
questions de relances240(*) :
û Comment l'adhérent est arrivé au
Compu's Club ? (ce qui a joué)
û En quoi il y a configuration ? (ce qui joue)
û Maturation de l'expérience vécue (ce
qui se joue)241(*)
Avant de présenter notre échantillon, nous avons
remarqué dans les entretiens que, d'une manière globale, les
attitudes des adhérents ne sont pas appréhendées par le
biais unique de leurs expressions superficielles. Ces expressions, bien que ne
saisissant pas les causes inconscientes, témoignent, à l'insu de
l'interviewé, d'un faisceau d'influences plus larges que nous allons
découvrir pour les utiliser, leur donner du sens. « Le
rôle de la conscience n'est il pas la production de
sens ? »242(*) Michel de Certeau nous dit que « dans
l'instant d'expression, les descriptions forment des phrases
imprévisibles, en partie illisibles. Bien qu'elles soient
composées avec un vocabulaire courant, elles tracent les ruses
d'intérêts autres et de désirs. »243(*). Ce qui est
précisément l'objet de notre recherche. Autrement dit, les mots
exprimés, livrés bruts, n'arrivent pas à rendre compte
parfaitement des faits ; ils devront être organisés pour
passer de la cohérence singulière de chaque propos à une
cohérence inter-entretiens. C'est la raison pour laquelle les propos
d'ensemble doivent se nuancer244(*). Par exemple :
1er entretien
« Çà, je pense, c'est primordial dans la vie de chaque
personne d'avoir l'amitié. Bon c'est pas l'amitié, euh, comment
dirais-je, l'amitié, euh, je ne sais pas comment t'expliquer le mot.
Mais c'est une amitié quand même... qui est très... qui est
proche du confidentiel [...] Saine, voilà. C'est le mot, une
amitié qui est, euh... qui est vraie, c'est çà. Une
amitié vraie. » (l.416)
Cette seconde partie de notre document présentera le
travail mené sur le terrain.
û Après avoir identifié les
adhérents, nous commenterons les circonstances et les divers motifs
d'adhésions. C'est-à-dire, comment et pourquoi le membre est
arrivé au Compu's Club : ce qui a joué245(*).
û Ensuite, nous décrirons ce qui le fait rester
et plus particulièrement quelle est son degré de participation
aux diverses activités proposées. C'est-à-dire que nous
analyserons en quoi il y a configuration : ce qui joue246(*).
û Enfin, nous présenterons ce qui se
joue sur le membre. C'est-à-dire, quelle maturation a-t-il de son
expérience vécue au sein du Compu's Club qui autorise son
changement ?
Introduisons, dès à
présent, la répartition des branches247(*) de l'association par
âge, sexe et situation familiale des membres pour présenter notre
échantillon248(*)
aux entretiens :
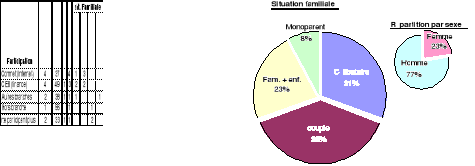
Répartition des
membres de l'association par âge, sexe et situation familiale
Ce tableau nous permet de compter treize participations
ventilées pour seulement dix personnes interviewés lors des neuf
entretiens effectués249(*). Alors, quels sont les membres qui participent
à plus d'une branche ? C'est ce que nous allons aborder dans le
premier chapitre intitulé « Ce qui a joué :
caractéristiques d'engagements ».
2.1 Ce
qui a joué : Caractéristiques d'engagements
Nous
nous intéressons, dans ce premier chapitre, au collectif, à
l'ensemble des adhérents caractérisés par leurs
différences (leur histoire, leurs origines, leurs opinions, ...) mais
aussi à leur unité sur des points précis (circonstances et
motifs d'adhésions, ...). Ce sont ces principales
caractéristiques que nous cherchons à mettre en évidence.
De plus, par cette connaissance descriptive, nous tentons d'établir un
lien (des liens) entre l'engagement et des faits. Nous l'utiliserons (les
utiliserons), ensuite dans nos interprétations, comme un facteur
d'influence dans les processus sociaux et l'établissement des
interrelations sociales. Au préalable, nous allons essayer de mesurer le
degré de "socialisation" du membre avant son adhésion.
C'est-à-dire le rapport qu'il y a entre l'engagement à un projet
et l'âge du membre ; entre l'engagement à un projet et sa
situation familiale ; etc. L'objectif est de faire émerger les
dynamiques d'engagements du groupe d'interviewés.
2.1.1 Du quantitatif au
qualitatif : à la découverte
de l'engagement
Pour introduire cette
découverte de l'engagement du membre commençons par revenir sur
la figure précédente250(*), celle qui présentait notre
échantillon. Nous avions relevé qu'il y avait plus de
participations que de membres interviewés nous faisant commenter qu'il y
en avait qui participaient à plus d'une branche. Ainsi, ceux qui
participent à plus d'une branche sont principalement :
û les célibataires, puisque nous notons quatre
participations pour trois interviews,
û les couples sans enfant (cinq participations pour
trois interviews).251(*)
Ceci constituant la première caractéristique
d'engagement relevée, c'est-à-dire que certains membres
participent à deux branches au moins.
Le graphique en secteurs de droite de cette même figure,
nous informe de l'existence de trois fois plus d'hommes que de femmes (77%
- 23%). De même, nous pouvons constater qu'il y a une nette
prédominance des situations familiales sans enfant (deux fois plus, au
moins) que nous globaliserons de la manière suivante :
Situations sans enfant (couples et célibataires)
69%
Situations avec enfant(s) (famille et monoparent) 31%
Pour conclure avec certitude que les membres sans charge
familiale participent plus que ceux avec des enfants. Nous aurions
souhaité obtenir des statistiques sur l'ensemble de l'association.
Malheureusement nous n'en disposons pas252(*).
Mais quelle influence a la situation familiale du membre sur
sa participation ? Avec le graphe en barres suivant, nous pouvons
déterminer une correspondance : plus le membre est libre de charge
familiale, plus il participe aux activités de l'association. Ce qui
correspond à ce qu'il est possible de constater à
l'échelle de l'association.
Répartition des
branches par la situation familiale des membres
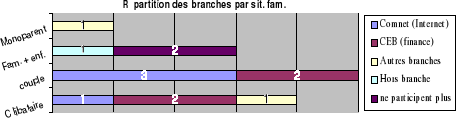 Il est, en effet, possible de remarquer que les "célibataires" et
les "couples sans enfant" participent le plus aux activités de
l'association (9/13). Alors que les membres qui ont à charge des enfants
(famille ou monoparent) participent moins (2/13) ou plus du tout (2/13
également). Ainsi, la situation familiale du membre influerait sur ses
choix d'activités au sein de l'association. En clair, sur 13
participations nous trouvons :
Il est, en effet, possible de remarquer que les "célibataires" et
les "couples sans enfant" participent le plus aux activités de
l'association (9/13). Alors que les membres qui ont à charge des enfants
(famille ou monoparent) participent moins (2/13) ou plus du tout (2/13
également). Ainsi, la situation familiale du membre influerait sur ses
choix d'activités au sein de l'association. En clair, sur 13
participations nous trouvons :
11 participations dont 9 concernent les couples sans enfant et
les célibataires
et 2 seulement, les familles avec enfant(s) et les
monoparents253(*).
Il semblerait qu'il existe un lien entre le choix de
participation du membre à une branche et le type de projet mené
par cette branche. En effet, nous pouvons constater, dans le graphe suivant,
que les activités purement informatiques, comme Internet (Comnet)
génèrent seulement un tiers des participations par rapport aux
autres projets non informatiques (4 pour 7 = 36%)254(*).
Répartition des
branches par le nombre de participants

Enfin, l'âge du membre semble, aussi, influer sur son
engagement. Si nous considérons, pour l'exemple, la branche qui dispose
du "plus jeune âge" (moyenne de 37 ans) et celle qui dispose de la "plus
élevée" (moyenne de 56 ans), l'écart est de 19 ans. Le
graphique en barre "répartition des branches par âges"
ci-après, non seulement indique cet écart, mais nous permet de
visualiser la ventilation des âges moyens par rapport aux
activités : 37 pour Comnet, 49 pour le CEB, 38 pour les autres
branches et 56 ans pour un engagement hors projet255(*).
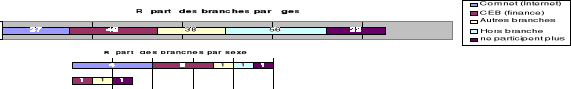
Ainsi, nous constatons que plus l'âge est avancé
plus les participations semblent s'orienter vers le fonctionnement
général de l'association et les activités non
informatiques. Il apparaît qu'en fonction de l'âge du membre, le
choix de l'activité varie.
En résumé, les caractéristiques
d'engagements jusqu'à présent relevées peuvent être
formulées ainsi :
1) Les membres sans enfant participent quantitativement plus
et plus facilement à plusieurs activités.
2) Les projets non TIC attirent trois fois plus
d'adhérents.
3) L'âge détermine
le choix de l'activité par le membre.
2.1.2 Trois facteurs majeurs
d'influence pour justifier l'engagement
A partir des informations
collectées lors des entretiens, nous tentons de livrer ici ce que sont
les motifs d'adhésions, d'une part, et les circonstances
d'adhésions, d'autre part. Notre tâche est d'essayer de comprendre
ce qui peut présider à la décision d'adhérer. Nous
nous intéresserons ainsi également au passé des
adhérents (familial, associatif et professionnel). Autrement dit, nous
livrerons les éléments, semblent-ils déterminants, sur la
décision d'adhérer et de s'engager dans un ou plusieurs projets.
En clair, il s'agit d'identifier ce qui a pu, à un moment ou un autre,
favoriser ou faciliter l'adhésion et l'engagement de nos interlocuteurs
dans cette association.
2.1.2.1 Motifs d'adhésions
Toutes les personnes interviewées, (8/10)256(*), soulignent que le motif de leur adhésion au
Compu's Club est, avant tout autre considération, un accès ou un
perfectionnement aux technologies de l'information et de la communication
(TIC). La chose ne nous paraît pas étonnante puisque
"l'étiquette" publique du Compu's Club est celle de
l'informatique !
1er entretien
« ...ce qui m'a conduit à adhérer au Club, au
départ c'est l'informatique. (l.57) ; « pour
l'amélioration de mes connaissances en informatique »
(questionnaire n°20, Q2)
3è entretien «
parce-que j'avais besoin de monter mon ordinateur
et d'abord par intérêt. » (l.10) ; [Je viens
chercher] « ...des infos, du dépannage. »
(questionnaire n°27, Q8)
9è entretien
« ...c'est l'informatique, en fait, qui m'a amenée au club.
J'avais acheté un petit ordinateur, parce-que je ne voulais pas mourir
trop bête, et savoir un peu ce que c'était »
(l.8) ; « Je désirais plus d'informations sur
l'informatique, Internet. » (questionnaire n°34, Q8)
Les réponses émises à l'occasion du
questionnaire confirment cet aspect257(*). Il nous est possible de préciser quelques
éléments recueillis lors des entretiens à partir des
réponses obtenues au questionnaire notamment chez les personnes qui ne
font plus partie de l'association258(*). Pour eux, de prime abord, l'informatique ne
semblait pas être l'unique objet d'adhésion259(*). Ils avaient répondu
à la question « Qu'êtes-vous venu chercher au
Club ? » (Q8) du questionnaire : « une
camaraderie, un échange et une ambiance »260(*). Initialement, nous avons
supputé l'idée que ces termes indiquaient l'existence d'autres
facteurs entrant en jeu dans la motivation du membre à adhérer.
C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de faire préciser
ces termes au cours des entretiens. Les réponses furent autres : en
fait, « l'ambiance, c'est se retrouver puis discuter
informatique. Entre nous. »261(*), la camaraderie c'est : « la
personne qui est en face de moi ait les mêmes sujets de
conversations. »262(*). Quant à l'échange il s'agit d'un
« échange d'idées » précisant
que cet échange d'idées est « toujours liée
à l'informatique »263(*). Il s'agit donc bien d'une adhésion pour
l'informatique.
Cependant, dans nos entretiens, nous relevons deux cas
d'adhésion qui ne sont pas directement liés aux TIC. Dans le
premier cas, s'il y a adhésion c'est parce-que cette dernière
apporte une solution, est une opportunité pour un projet.
2è entretien
« ...et ce monsieur... J'ai donc pris contact et nous avons
après peu à peu pris conscience qu'il nous fallait monter une
association pour faciliter surtout les démarches administratives et nous
sommes allés nous adresser au Compu's Club. » (l.16)
Si précédemment l'association Compu's Club
intéresse parce qu'elle donnait un cadre juridique, dans le
deuxième cas, c'est l'image de cette association qui incite à
adhérer.
8è entretien
« ...de voir qu'il y a, qu'il y a une association, des gens qui ont
pour principe d'essayer de faire bouger les choses, de venir se rencontrer, un
peu s'éclater [...] ça m'a presque... [...] ça m'a
vraiment déstabilisé dans, dans, dans l'opinion que j'avais de
dire que Valence c'était une ville morte, [...] çà c'est
vraiment intéressant. » (l.21)
L'objet d'adhésion au Compu's Club est pour les
personnes rencontrées lors des entretiens, avant tout, la participation
à l'activité informatique.
2.1.2.2 Circonstances
d'adhésion
Les circonstances par lesquelles le futur membre a pris
connaissance de l'existence du Compu's Club sont extrêmement diverses et
variées. C'est la raison pour laquelle nous les avons groupées en
trois catégories. Il y a les membres qui ont connu le Compu's Club par
l'intermédiaire d'un dépliant, d'une manifestation, d'une
affiche, etc. nous les grouperons dans la catégorie
Média. Par ailleurs, il y a ceux qui ont connu l'association
par l'intermédiaire d'une autre personne (un ami, un membre de sa
famille, un commerçant, un membre d'une autre association, etc.). Nous
les désignerons par le terme
Cooptation. Enfin, ceux que nous n'avons pas pu classer dans les deux
catégories précédentes seront positionnés dans la
catégorie Autres circonstances. En procédant ainsi, nous
avons pu construire un tableau qui nous permet de connaître l'origine de
l'information qui a suscité l'intérêt chez le sujet. nous
rendons compte, ci-dessous, de la répartition :
Entretiens
|
Média
|
Cooptation
|
Autres circonstances
|
|
1/9
|
3/9
|
1 (création)
|
|
1 (projet)
|
|
1 (connaître)
|
|
1 (attache)
|
|
1 (dynamique)
|
|
Totaux
|
5/9
|
Répartition des
circonstances d'adhésions
Si les cooptations ne semblent pas véritablement
être les moyens les plus fréquents pour connaître le Compu's
Club (3/9), les autres circonstances paraissent diffuses (1/9 média, 1/9
création, 1/9 projet, etc.).
1er entretien
« Le Compu's Club je l'ai connu dès sa naissance. Avant
même qu'il soit créé. Puisque j'en ai entendu parler dans
les locaux de XX.[(le bailleur de l'association à son
origine)]. Dès son début, quoi » (l.10)
4è entretien
« Nous avons connu le Club par
l'intermédiaire d'amis, au cours d'une soirée. »
(l.24)
7è entretien
« ...par une copine. » (l.12)
Mais nous avons relevé dans nos entretiens d'autres
circonstances dont il nous a semblé utile de nous intéresser pour
deux raisons. Premièrement, ces autres circonstances nous permettent de
repérer une démarche permettant de s'extraire ou réduire
des ruptures sociales264(*). Dans le cas ci-après il s'agit de profiter
d'une occasion offerte :
2è entretien
« J'ai connu Compu's Club par, euh, ma situation de
chômage qui m'a fait aller de portes en portes chercher du
travail. » (l. l.14) « ...et une association comme la Sdava
m'a dit « mais, il vient de sortir quelqu'un qui pourrait vous
intéresser. Ils écriv... il écrit, veut écrire un
journal, euh, un livre sur le chômage. » (l.15)
Deuxièmement, ces autres circonstances nous permettent
de repérer une démarche pour conserver ou créer un lien
social. Autrement dit, le futur membre semble adhérer pour se
socialiser. Il souhaite, ainsi, s'ouvrir un réseau de communication
grâce au groupe. Nous avons relevé trois
types d'adhésions répondant à ces
circonstances-là :
1) l'adhésion à la suite de circonstances
exceptionnelles. Dans l'exemple suivant, il s'agit d'une offre d'emploi :
un membre a adhéré après avoir postulé pour un
poste à pourvoir dans l'association et pour lequel il n'a pas
été retenu.
8è entretien
« J'ai connu le Compu's Club grâce à une
annonce de l'Anpe. Parce ce [...] qu'il y avait un poste prévu, [...] et
c'est comme çà que j'ai connu le Club. » (l.9)
2) l'adhésion dont le but semble être celui de
conserver ou de créer un lien au sein d'un couple, par exemple.
4è entretien
« Ph : C'était l'occasion aussi de faire une activité
à deux. » (l.57)
3) l'adhésion qui permet un point d'ancrage
géographique, par exemple :
6è
entretien
« L'intérêt, c'est d'avoir un circuit relationnel, un
système qui permettait d'avoir une attache sur la région.
(l.127)
Mais si l'acte d'adhésion résulte de la
découverte du Compu's Club par une tierce personne ou un média,
l'engagement peut prendre ou répondre à des motivations
personnelles : réduire des ruptures sociales, créer ou
conserver un lien social ou/et géographique.
2.1.2.3
Antécédents familiaux
Il n'est pas possible de déterminer une
éventuelle influence du passé familial dans la participation aux
activités du Compu's Club. En effet, les personnes
intéressées ont très peu abordé leur vie
personnelle antérieure à leur adhésion. En revanche, au
présent, une situation de rupture peut expliquer l'adhésion et
l'engagement. Cette rupture est abordée dans six cas sur neuf, il
s'agit de la solitude...
5è entretien
« Célibataire sans enfant. » (l.66)
« [être au Club] ça m'apporte de ne pas rester seul chez
moi, déjà. » (l.113) « Ça a changé
ma solitude. » (l.632)
Participation constatée :
« Je suis trésorier (d'une branche de l'association, ndlr)
parce qu'il faut bien prendre des responsabilités de temps en
temps. » (l.740)
...de la rupture familiale ou/et professionnelle.
6è entretien
« J'ai quitté une région, une femme, un métier,
tout un tas de choses... euh, sur un coup d'un ras-le-bol. En fait, j'avais une
petite vie, dans un petit coin et ça ne m'enthousiasmait pas du tout,
donc j'ai complètement changé... »
(l.57) « Quand je suis arrivé au Club j'étais en
instance de divorce. Un divorce qui a duré dix ans »
(l.133)
Participation constatée :
« je suis adjoint. Donc, j'ai une responsabilité en fait...
[..] Je participe à pas mal de branches... » (l.244)
8è entretien
« Je pense que ça devait faire, au moins, six mois que
j'étais au chômage. [...] Ça devait faire trois ou quatre
mois » (l.126)
Participation constatée : « [mon
dynamisme se caractérise] tout simplement...à lancer le
Marathonet (projet Juniors, ndlr), trouver des idées... »
(l.307)
Pour les trois autres, une personne aborde le thème de
la rupture à partir d'un cumul de plusieurs ruptures : longue
rupture professionnelle consécutive à une longue maladie
aggravée par une rupture familiale.
2è entretien «
Ça m'a apporté à me libérer dans un premier temps
de tout mon fiel par rapport à ma situation de chômage
mêlée à la situation de longue maladie et
mêlée à la situation de mère célibataire, ce
qu'est pas très engageant à 50 ans pour être
embauchée. » (l.506)
Ce qui semble être recherché par ce membre
relève de la valorisation, de la reconnaissance :
« que je sois lue, pas éditée mais
lue par les copains, que ce soit pris en compte. » (l.516)
une autre personne n'aborde pas le thème de la rupture
et s'engage dans l'association :
1er entretien
« Marié, une fille, profession libérale, sous-traitant
en architecture » (l.80) « je me retrouve
Trésorier. » (l.468)
un troisième membre n'aborde pas le thème de la
rupture et ne s'engage pas :
4è entretien
« Mariés, des enfants. » (l.153) « Moi,
j'ai toujours travaillé. » (l.159)
Nous avons procédé ainsi pour l'ensemble de nos
entretiens afin de pouvoir les classer dans le tableau suivant :
Répartition des
adhérents selon la thématique de la rupture
|
...avec engagement
|
...sans engagement
|
|
Thématique
de la rupture abordée...
|
Entretiens
n°3, 5, 6, 7, 8, 9
|
Entretien n°2
|
|
Thématique
de la rupture non abordée...
|
Entretien n°1
|
Entretien n°4
|
Plus après, nous mettrons au clair, à l'aide
d'indicateurs, d'autres types de ruptures. En résumé, on peut
retenir que dans six cas sur neuf, une rupture sociale paraît expliquer
l'adhésion et l'engagement.
A ce stade de notre analyse nous avons relevé trois
types de rupture de rôles sociaux : la solitude, le conflit familial
et la rupture professionnelle.
2.1.2.4 Antécédents
associatifs et professionnels
Comme précédemment, les personnes
interrogées n'ont pas expliquées leur engagement, leur
adhésion, par des antécédents associatifs et
professionnels.
Nous venons de voir comment nous avons identifié les
membres du Compu's Club par des indicateurs métriques (âge, sexe,
situation familiale, participation par branche) et des facteurs majeurs
d'influence (les ruptures sociales265(*) et le désir de création de liens et de
rôles sociaux) ce qui nous a permis de mesurer les liens qui
apparaissaient entre la situation antécédente du membre et son
adhésion, entre sa situation actuelle et son engagement.
Pour résumer :
û plus il y a rupture sociale plus il y a engagement
dans l'association.
û plus le membre est libre d'engagements familiaux,
plus il y a engagement.
Ces caractéristiques, relatives à ce que nous
avons perçu et à des comportements exprimés par
l'adhérent, vont nous aider à identifier les catégories
types des membres interviewés afin de faire émerger les
mécanismes d'identification266(*) dans notre second chapitre. C'est-à-dire les
processus inconscients, de l'ordre de l'affect, qui permettent de devenir
semblables, similaires par les rapports que les membres entretiennent avec un
projet de l'association, l'image de l'association (un idéal, une
idée) ou un pilote de branche (un leader) pour (re)constituer leur
personnalité.
Nous avons regroupé, dans le tableau ci-après,
les éléments analysés dans les sections
précédentes : âge, situation familiale, rupture de
rôle social et fonctions prises (engagements) ou participation. Ceci,
pour déterminer, par comparaisons, les comportements
dominants ou/et permanents. Nous avons ordonné ce tableau selon la
colonne "Participation ou engagement" parce-que cette
caractéristique est une expression clef de notre
hypothèse :
|
N°
|
Age
|
Situation familiale
|
Rupture
|
Participation ou engagement
|
|
Entretien 5
|
41
|
célibataire
|
oui
|
oui
|
|
Entretien 8
|
25
|
célibataire
|
oui
|
oui
|
|
Entretien 9
|
77
|
célibataire
|
oui
|
oui
|
|
Entretien 3
|
28
|
couple
|
oui
|
oui
|
|
Entretien 6
|
52
|
couple
|
oui
|
oui
|
|
Entretien 7
|
27
|
couple
|
oui
|
oui
|
|
Entretien 1
|
56
|
fam.+ enf.
|
non rupture
|
oui
|
|
Entretien 2
|
50
|
monoparent
|
oui
|
non engagement
|
|
Entretien 4 (couple)
|
32-34
|
fam. + enf.
|
non rupture
|
non engagement
|
Tableau
récapitulatif : âge, situation familiale, rupture, fonctions
prises, participation
2.1.3
Trois catégories pour décliner la
figure de l'adhérent
A partir des thèmes abordées dans le cadre des entretiens267(*), nous avons demandé
que chacun explicite ce que lui procure sa participation au Compu's Club. Ces
perceptions nous permettent d'identifier des comportements divergents. La
diversité de ces divergences nous a permis d'envisager un classement.
Nous avons considéré trois catégories d'individus qui
correspondent à trois grandes manières de décrire la
participation du membre :
- le membre actif ou membre philanthrope,
- le membre passif ou membre pharisien-prestige,
- le membre actif-passif et le membre passif-actif ou membre
synallagmatique.
2.1.3.1 Le membre
philanthrope :
Le Philanthrope est rare, (1/9). Il est celui qui vient
régulièrement aider bénévolement, fraternellement,
sans contrepartie, par foi, simplement. C'est un actif au sein du Club. Il a besoin de cette action. Mais son
attitude n'est pas toujours constante parce qu'elle constitue une contribution
ponctuelle à l'association. En fait, son comportement altruiste est
limitée dans le temps et se repère seulement par bribes, par
"coups d'éclats". Il se rapproche dans ses attitudes relationnelles
à celles du don. Le membre qui nous a permis de définir cette
catégorie est celui de l'entretien numéro un : un actif
engagé, d'une relative stabilité familiale et professionnelle.
1er entretien
« on m'a demandé, euh, et puis même sans me demander
quand j'ai vu que la personne bataillait je me suis approché d'elle, je
lui ai dit « ça va pas », euh, « oui, effectivement je
n'arrive pas à comprendre...» (l.196) « ce que je
préfère ? Moi c'est aider les gens, rendre service. »
(l.296) « je viens donner. » (l.299) « Le
salarié, il vient pour gagner sa vie.
L'autre, il le fait gratuitement, il donne son coeur » (l.524)
« [...] et puis par amour du monde associatif (l.539)
« Avoir la foi, c'est apprendre à aimer ce qu'on
fait » (l.593).
2.1.3.2 Le membre pharisien-prestige :
Celui qu'on appellera « le
Pharisien-prestige » vient à l'association pour chercher
quelque chose de précis, pas nécessairement la pratique de
l'informatique mais, plutôt, répondre à un besoin de
reconnaissance. Ce besoin s'appuie sur la nécessité de
connaître voire d'appartenir au monde de l'informatique dont la
caractéristique principale, pour "celui qui n'en fait pas partie", est
l'image du "prestige". Une première réflexion pourrait nous faire
le qualifier « sous le nom pudique de
consommateur »268(*). En fait, c'est un "passif/passif" dans sa
participation au dynamisme général de l'association même si
c'est un actif pour lui-même. Il est persuadé de faire quelque
chose pour les autres, en fait, il le fait pour lui d'abord : sa
mobilisation repose sur la reconnaissance qu'il espère en lien avec sa
motivation essentielle qui repose sur la reconnaissance qu'il obtient. Bref, un
pharisien. C'est-à-dire « celui qui présente comme
conforme à l'intérêt général ce qui est avant
tout de son intérêt. »269(*) Il sait ce qu'il veut
même s'il ne le formule pas clairement : s'aider lui-même
au succès de sa propre (ré)insertion sociale
(« pour être dans le monde », nous dirait
Louis Dumont270(*)), et
quitte l'association lorsque sa demande est satisfaite. Pour définir
cette catégorie, nous avons relevé ces caractéristiques
chez les individus deux et quatre.
2è entretien
« C'était une solution de facilité plus qu'un
service. » (l.33) « La fin du
livre me fera quitter le Compu's Club » (l.389).
4è entretien «
Na : au départ, de toute façon, Ph (le mari, ndlr)
avait envie de connaître ce monde-là » (l.52)
« ...le matériel, nous, on n'en avait point à la
maison » (l.132) « Ph : Je vois au boulot, y a un gars
qui s'y connaît bien en informatique, on en parle, on discute
beaucoup » (l.259) « Na : On préférait avoir
le matériel à la maison. » (l.482) « Na :
Maintenant l'informatique on le fait à la maison. » (l.662).
« Na : avoir du plaisir à discuter avec quelqu'un. Se
sentir sur le même piédestal, quoi. Parler de la même
chose. » (l.683) « Na : En fait on est
allé dans un club informatique pour parler informatique. [...]
Ph : On savait pas le parler au début. »
(l.883)
2.1.3.3 Le membre
synallagmatique :
Le plus fréquent (6/9) "marche au donnant-donnant".
L'entraide mutuelle271(*), lui, il connaît ! Il donne avec toujours
le secret espoir d'un retour. « Je donne si tu m'as
déjà donné ou si je suis quasiment sûr que tu me
rendras ». Il semblerait qu'il cherche à répondre
à un besoin de relations qui s'appuie sur celui d'appartenance à
un groupe qui le reconnaît. Il s'agit là d'une attitude
synallagmatique. C'est la raison pour laquelle nous lui avons attribué
ce nom.
7è entretien
« Bien on se connaît bien, donc, ça fait plusieurs
années, qu'on...On est une petite famille maintenant ! »
(l.690)
6è entretien
« ...ce qui m'a marqué dans les relations, c'est lors de mon
mariage, que certains membres du Club étaient présents au pot.
Là c'était sympa. » (l.645)
Ceci constituant un ancrage...
6è entretien
« ...je ne quitterais jamais le Club, uniquement parce qu'il y a un
lien, y'a un relationnel. » (l.66) « ...c'est un
système relationnel qui permet de... de revoir des gens
régulièrement, de, de pas les oublier, de toujours les garder en
mémoire. » (l.190)
...et la mobilisation du membre...
3è entretien
« ...je suis très content de venir au Club et s'est d'ailleurs
pour çà que je m'investis et que je fais partie des
Administrateurs. » (l.369)
...pour échanger,...
5è entretien
« C'est un moment de détente, le soir de passer une heure ou
deux heures le soir à dialoguer avec des personnes ! »
(l.110)
...communiquer, ...
5è entretien
« D'être heureux, d'être... de pouvoir échanger
des opinions. » (l.849)
...partager, ...
3è entretien
« ... d'abord, c'est le partage. » (l.255)
...développer ensemble.
6è entretien
« ...les gens ont, [...] un point commun, c'est les finances et
connaître un petit peu l'économie... [...] Et puis maintenant, on
commence à faire des formations un peu plus poussées, ça
commence à intéresser de plus en plus et je pense que ça
commence à dynamiser légèrement le groupe... »
(l.428)
On distinguera deux profils de Synallagmatique :
û le "Synallagmatique passif-actif" que nous
appellerons "Synallagmatique-copain"272(*). Il vient échanger en prenant plus. Il
exprimera ce qu'il voudrait faire pour les autres mais avancera des excuses
pour ne pas les faire. Il est, dans l'idée, relativement proche du
Pharisien-prestige. Il s'agit des individus huit et neuf.
8è entretien
Je prends plus que je ne donne « j'ai
connu le Compu's Club grâce à une annonce de l'Anpe. Parce ce
qu'il y avait un poste prévu. » (l.9) « Actuellement
aucune branche ne me plaît et puis, en plus, il y a le fait que je n'ai
pas beaucoup de temps pour m'occuper d'une branche. » (l.236)
« ...j'aimerai bien apprendre plus de choses. »
(l.458)
Je donne un peu « Si j'avais un peu plus
de temps je pense que je participerai au Club de Finances... à Comnet...
et j'essaierai d'aller voir un peu plus les jeunes chez Libertech »
(l.214) « rarement je fais de l'informatique, au Club. [...] Je viens
discuter avec les gens. J'essaie de voir s'il y a des projets à faire
avancer ou quoi que ce soit. » (l.295) « Le fait de donner
du temps, donner des idées, eh ben pour moi c'est gratifiant et
ça me suffit. A partir de là je me sens mieux. »
(l.604)
û le "Synallagmatique actif-passif" ou
"Synallagmatique-ami". Un ami n'est-il pas une personne avec qui l'on a des
affinités, proche, intime ? « Qui a de l'attachement
pour » nous dit le Quillet de 1971. C'est un sentiment
partagé, réciproque. Lacordaire (Henri-Dominique, abbé) ne
disait-il pas : « L'amitié est le plus parfait des
sentiments de l'homme parce-qu'il est le plus libre, le plus pur et le plus
profond » ? Et Montaigne à propos de la
Boétie : « Si on me presse à dire pourquoi je
l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en disant : "Parce-que
c'était lui, parce-que c'était moi" » ? Le
Synallagmatique-ami vient échanger en donnant plus. Il exprimera ce
qu'il fait réellement pour les autres mais gardera à l'esprit ce
"retour des choses" qui équilibre ses rapports. Ceci dit, les
comportements et les attitudes du Synallagmatique-ami tendent à se
rapprocher de ceux du Philanthrope. Il s'agit des individus trois, cinq, six et
sept.
3è entretien
Je prends peu « [je suis venu chercher]
de l'aide en informatique, en sachant que j'avais aussi des choses à
faire connaître... » (l.52) « je participe à
Comnet, c'est la Branche informatique liée à l'Internet. On
apprend, on fait les premiers pas sur le Web avec un pilote qui a beaucoup plus
d'expérience que nous... » (l.248)
Je donne plus que je ne prends
« ...l'association, c'est un peu basé sur "un coup j't'aide,
un coup tu m'aides". » (l.55) « Je peux apporter du
réconfort quand une personne est pas bien et qu'elle cherche un
refuge. » (l.170) « Pour moi, les valeurs
premièrement c'est l'entraide. » (l.223) « D'abord,
c'est le partage » (l.255) « Je suis très content de
venir au Club et c'est d'ailleurs pour çà que je m'investis et
que je fais partie des Administrateurs. » (l.369)
En résumé :
|
membre
|
Actif
|
Passif
|
|
Actif
|
Philanthrope
(vient aider bénévolement)
entretien n° 1
|
Synallagmatique copain
(vient échanger en prenant +)
entretiens n° 8, 9
|
|
Passif
|
Synallagmatique ami
(vient échanger en donnant +)
entretiens n° 3, 5, 6, 7
|
Pharisien-prestige
(vient consommer)
entretiens n° 2, 4
|
Tableau récapitulatif des trois figures de
l'adhérent
Ce premier chapitre voulait rechercher des
éléments de réponses à la question : comment
et pourquoi le membre est arrivé au Compu's Club ? (ce qui a
joué dans son engagement et qui pourrait jouer dans son changement).
Nous pouvons dresser un tableau récapitulatif273(*) pour nous aider dans notre
conclusion : Tableau 1
Tableau
récapitulatif (conclusion)
|
Niveau d'engagement
(à partir des entretiens)
|
Dur. d'ad°
(en mois)
|
Objet d'adhésion
|
Age
|
Sit. fam.
|
Rupture...
|
Engagement...
|
N°
|
|
Philanthrope
|
40
|
Création
|
56
|
fam.+ enf.
|
non rupture
|
oui
|
Entretien 1
|
|
Synallagmatique ami
|
40
|
Attache/Création
|
52
|
couple
|
oui
|
oui
|
Entretien 6
|
|
Synallagmatique ami
|
30
|
Cooptation
|
28
|
couple
|
oui
|
oui
|
Entretien 3
|
|
Synallagmatique ami
|
25
|
Cooptation
|
27
|
couple
|
oui
|
oui
|
Entretien 7
|
|
Synallagmatique ami
|
22
|
Média
|
41
|
célibataire
|
oui
|
oui
|
Entretien 5
|
|
Synallagmatique copain
|
34
|
Cooptation
|
77
|
célibataire
|
oui
|
oui
|
Entretien 9
|
|
Synallagmatique copain
|
16
|
Dynamique Club
|
25
|
célibataire
|
oui
|
oui
|
Entretien 8
|
|
Pharisien-prestige
|
18
|
Connaître les TIC
|
32-34
|
fam. + enf.
|
non rupture
|
non engagement
|
Entretien 4 (couple)
|
|
Pharisien-prestige
|
18
|
Projet Littérature
|
50
|
monoparent
|
oui
|
non engagement
|
Entretien 2
|
La lecture de ce tableau nous conduit à poser de
nouvelles questions dont les réponses pourraient déterminer un
nouveau paramètre : le niveau d'engagement du membre par rapport
à sa durée d'adhésion. En l'incluant dans notre analyse,
il nous permettrait de définir avec plus de précision encore
la définition des trois catégories types de membre, d'une part,
et nous indiquerait les fluctuations de l'environnement de cette association,
d'autre part. Autrement dit, y aurait-il une évolution entre les
diverses attitudes perçues : Pharisien-prestige puis
Synallagmatique (copain puis ami) puis Philanthrope ? Si
oui, quel en est le facteur ? Y aurait-il une durée au terme de
laquelle le membre prendrait la décision, consciente ou pas, de
s'engager plus ou de quitter l'association ? Pour répondre à
ces questions avec certitude il nous aurait fallu effectuer plus d'entretiens.
C'est la raison pour laquelle nous pouvons seulement indiquer, à partir
de notre échantillon, qu'il y aurait un lien entre l'ancienneté
de l'adhésion et le niveau d'engagement : plus le membre est ancien
dans l'association plus son engagement est "fort" : 18 mois pour le
Pharisien-prestige, 40 pour le Philanthrope. Mais qu'est-ce qui permet, au
cours de cette durée, l'évolution de l'engagement274(*) ? Aussi, nous ne
pouvons pas considérer la durée d'adhésion comme
facteur unique et nous le rapprocherons des autres facteurs déjà
émergés et à venir. En attendant :
Il semble que l'engagement
évolue avec la durée d'adhésion.
Conclusion :
Ce premier chapitre a
présenté en trois points nos premières analyses sur des données recueillies
auprès d'un ensemble d'individus caractérisés par leurs
différences et leur unité sur des points précis :
û Une rapide approche sociométrique a permis de
situer le membre avant son adhésion. Cette analyse nous a donné
la "carte signalétique" du membre qui semble nous indiquer trois
choses :
1. il existerait un rapport direct entre l'âge de
l'individu et son choix pour tel ou tel type d'activité : Plus
un membre est jeune plus l'activité choisie est TIC.
2. De même, il existerait un rapport direct entre la
situation familiale de l'individu et son niveau d'engagement au Compu's
Club.
Plus un membre est libre d'engagements familiaux plus il s'engage.
3. Enfin, il existerait un rapport entre la durée
d'adhésion et le niveau d'engagement : Plus l'adhésion
est ancienne, plus l'engagement est fort.
On peut en conclure que l'âge, les charges familiales et
l'ancienneté dans l'association semblent déterminer le choix de
l'activité et le niveau d'engagement du membre.
û Le deuxième point a porté sur les
circonstances et les objets d'adhésions pour relever les principales
modalités d'engagement au départ. Le fait est que le membre prend
connaissance de l'association par cooptation et qu'il la rejoint pour les
TIC.
û Le dernier volet de ce chapitre a
présenté les différentes ruptures
sociales préexistantes à l'adhésion du membre :
solitude, conflit familial et/ou rupture professionnelle. Nous avons
avancé que l'engagement serait, peut-être, le moyen de
réduire la rupture.
Ainsi, pour qu'il y ait possibilité d'engagement il
semble falloir de préférence :
- une cooptation,
- une (des) absence(s) ou une (des) perte(s) de rôle(s)
ou/et de liens sociaux,
- une (des) activité(s) en adéquation avec les
désirs (déterminés par l'âge) du membre,
De plus, pour qu'il y ait possibilité
d'évolution de cet engagement, il semble falloir :
- une longue durée d'adhésion,
En fait, nous avons relevé avec certitude deux facteurs
antérieurs à l'adhésion pouvant influencer l'engagement du
membre : la situation familiale (sans charge de famille) et la situation
personnelle (rupture sociale).275(*)
Enfin, selon ces premières analyses, ce chapitre nous a
permis de décrire trois profils types de membre. Il s'agit du
Philanthrope (il donne), du Pharisien-prestige (il prend) et du Synallagmatique
(il donne et il prend) qui se décline, lui-même, en deux
sous-profils : le Synallagmatique-ami (il donne plus qu'il ne prend) et le
Synallagmatique-copain (il prend plus qu'il ne donne).
2.2 Ce qui joue :
Caractéristiques de configuration
A présent que nous avons dégagé ce
qui a joué et les profils types des membres de cette association,
il convient de clarifier les éléments d'une configuration au sens où Norbert
Elias l'entend276(*).
C'est-à-dire, clarifier les dépendances réciproques que
les adhérents établissent entre eux et qui les lient les uns aux
autres, d'une part, et avec le contexte environnemental du Compu's Club,
d'autre part, le tout dans leurs changements permanents. Autrement dit :
voyons maintenant la conformation277(*) de ce qui joue dans les attitudes des
membres qui autorisent les interrelations. Pour cela, nous allons mettre en
évidence les principales caractéristiques de ces interrelations.
Mais, nous avons besoin de situer, au préalable, la perception que le
membre a du contexte environnemental de l'association : comment le membre
se représente-t-il l'infrastructure Compu's Club ? Ceci a pour
objectif de noter les types de relations que les membres entretiennent avec
l'association, avec l'image qu'ils s'en font et chemin faisant analyser et
commenter les mécanismes et les processus à partir desquels se
développent les relations.
2.2.1
Perception de l'environnement associatif par le membre
Les branches du Compu's Club sont peu ou pas connues
dès lors qu'elles ne touchent pas l'intérêt du membre.
Ainsi, les personnes interrogées ne peuvent donner que des informations
incomplètes à propos des diverses branches. Le fondement,
l'organisation et le fonctionnement même de l'association sont, dans tous
les cas (9/9), quasi, voire complètement inconnus.
2è entretien
« Je ne connais peut être pas assez bien le Compu's Club, mais
j'ai l'impression que c'est surtout axé sur l'informatique. »
(l.70)
4è entretien
« Y a tellement des branches diverses comme la Bourse. on peut y
aller parce qu'on aime la Bourse et pas spécialement
l'informatique. » (l.209)
9è entretien
« il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert toute
la richesse du Club. » (l.242) « Je crois que je n'ai pas
encore tout découvert. » (l.266)
Toutefois, même si ces personnes ne peuvent
définir l'association, elles n'en attribuent pas moins des aspects
positifs. Par exemple l'ouverture, les possibles,
l'échange :
1er entretien
« (un lieu) où j'ai des amis, ça m'ouvre sur des
horizons disons, pas spécialement informatique, mais sur des horizons
nouveaux que je n'avais peut-être pas pratiqué dans un autre
club. » (l.101) « Justement parce-que il y a une bonne
ambiance, une bonne entente, il s'y passe de bonne amitiés. »
(l.148)
4è entretien
« Quand il y a une Branche Échap, par exemple, c'est une
partie sociale çà. [...] c'était des chômeurs qui se
sont retrouvés pour écrire un livre. » (l.575)
6è entretien
« Le Club je le présenterai comme Club, bon, basé sur
l'informatique, au départ, je commencerai à parler des
différentes branches. et surtout ce que je ferai valoir, c'est euh...
euh... cet esprit d'échange ! L'esprit d'échange entre les
individus, qui me paraît, moi, être la source même du Club,
en fait. (l.869)
Ces aspects semblent relever principalement de jugements de
valeurs278(*)
paraissant servir de points de repère pour exprimer des attitudes.
9è entretien
« Moi, j'aimerai bien aller voir les jeunes, puisque toute ma vie,
j'ai travaillé avec des jeunes. Comment la Branche Littéraire
travaille... j'aimerai, par exemple, accompagner quelqu'un qui va apprendre
l'informatique dans la prison... [...] je crois que je comprendrai mieux le
groupe... et l'esprit du Compu's, [...] je pense que c'est un peu trop
compartimenté, et que le lien est créé par le journal...
mais peut pas rapporter toutes les valeurs qu'on peut vivre... »
(l.458) « On fait beaucoup de choses pour la relation personnelle, la
relation entre individus. [...] D'abord, si les gens apportent quelque chose,
ils se sentent partie prenante. » (l.757)
7è entretien
« ...ils sont souriants, et puis s'ils viennent, c'est qu'ils sont
bien, donc, ils se plaisent à l'association. [...]Le fait de participer
est déjà quelque chose. Si moi je suis dynamique c'est que j'ai
envie d'être dynamique. [...] Participer à la recherche d'un
local, ou participer à emménager, à
déménager, à aller donc, voir la Mairie, etc. »
(l.491) « Ben, pour moi, je sais pas, mais j'apprends en même
temps, donc moi, ce que ça m'apporte, c'est que j'apprends des trucs.
[...] Ça m'apprends toujours la vie, le milieu associatif quoi. Donc, je
croise des gens, d'autres personnes. » (l.698)
Ces aspects semblent relever, aussi, de perceptions
multiformes souvent utopiques, symboliques, d'émotions dues à
l'attirance que le membre éprouve. Le Compu's Club est perçu
comme un lieu d'expression possible, "organisé", adapté...
2è entretien
« J'ai rien attendu mais j'ai trouvé ce que j'aime y
trouver : de l'accueil... quelque chose d'agréable, quelque chose
où on peut parler... » (l.80) 279(*)
8è entretien
« un lieu de rencontre, un espace de liberté. »
(l.202)
6è entretien
« Le fait, d'avoir changé de locaux est un
élément important dans la dynamique des membres. [...] J'ai
l'impression oui, parce-que maintenant on a des locaux, qui ressemblent
à quelque chose de propre, de sérieux et çà,
ça joue énormément en faveur de cette
dynamique. » (l.573)
...où on se sent bien, favorisant les relations
(« de l'accueil »), et qui peut conférer un
sentiment d'appartenance qui semble faire naître une impression de
reconnaissance et paraît exercer une influence sur les comportements
sociaux adoptés par le membre :
« Moi, j'ai une certaine fierté
d'appartenir quand même au Club. Parce qu'il commence à avoir une
certaine notoriété dans la région et rien que
çà, déjà, ça me plaît
énormément. Quelque part, il y a une réussite.
C'est surtout çà. » (ib. l.780)
Dans huit entretiens sur neuf280(*) les membres assimilent le
Compu's Club à l'image d'un groupe particulier : un ensemble
d'habitants d'une petite agglomération rurale, un village...
6è entretien « l.219
ben moi, j'appellerai ça un petit village. [...] y'a la communication
entre les gens [...] on peut avoir de l'aide si on a un soucis, on peut poser
des questions, avoir des réponses. Et tout le coté relationnel,
[...] dans les petits villages
Quelquefois, d'un groupe intime : un groupe d'individus
se trouvant des caractères communs ressemblant à des liens de
parenté, une famille...
7è entretien « C'est
qu'on s'entend bien, on est une petite famille, quelque part, on s'entend, on
s'entend bien, quand on a des trucs qui vont pas, donc, on essais de les
résoudre. » (l.808)
...ou d'un groupe de personnes ayant un but commun, une
communauté.
3è entretien
« Le Club, pour moi, [...] ça me fait penser à un
groupe de camarades, une micro société en fait. »
(l.138)
Pour résumer, le membre ne
connaît pas avec précision l'infrastructure Compu's Club. En
revanche, il semble la percevoir symboliquement au travers de
subjectivités affectives, d'attirances basées sur la
multiplicité de ses intérêts. C'est-à-dire, à travers divers aspects
positifs :
1) l'ouverture, les possibles, l'échange,
2) un lieu d'expression, "organisé", adapté, de
bien-être,
3) l'image d'un groupe particulier (village) quelquefois
intime (famille)
Qui semblent faire naître une impression de
reconnaissance, d'appartenance servant d'espace à une gestion de ses
relations paraissant désigner un aspect du lien social.
2.2.2 La naissance de conditions favorables à la relation
En développant l'analyse de la section
précédante281(*), nous avons conclu que le membre donnait une forme
à ce qu'il ressentait pour favoriser l'échange et le partage avec
l'autre par la symbolisation du Compu's Club. Autrement dit, les membres
semblent être des sujets influencés dans leurs relations par la
représentation qu'ils ont de l'association. La section suivante veut
désigner à partir des entretiens, la relation en tant que
processus d'échanges. C'est-à-dire les membres en tant qu'acteurs
en relations de face à face282(*), de membre à membre, en interrelation dans le
cadre d'un projet, par exemple :
1er
entretien « ...tout le monde amène des
idées... » (l.354) « C'est les passions. [...] le
gars qui vient ici c'est qu'il aime ça, c'est que c'est un
passionné donc obligatoirement il va venir défendre son
idée au maximum. Il va s'emporter, le ton monte, mais le lendemain c'est
fini. » (l.344)
2è entretien
« Je peux exprimer soit mon accord, soit mon désaccord. [...]
Et ça a été entendu [...] sans se disputer, sans employer
des mots. Même si des fois on a eu des mots un peu violent, ça a
été quand même entendu et puis... Le désir de
construire ensemble a toujours été là. »
(l.96)
5è entretien
« On laisse débattre les gens qui s'expriment jusqu'à
la fin. » (l.535)
Une branche au sein du Compu's Club réunie cinq
à douze personnes. Ces personnes semblent s'être
constituées en groupes autonomes...
5è entretien
« On ne dépend plus du Club, à part qu'on est dans son
local. » (l.408)
9è entretien
« A travers la Finance, y a quand même un, un
groupe... » (l.304)
...et de manière hétérogène sur
les plans culturels et sociaux283(*) :
3è entretien
« On regroupe un petit peu des personnes, déjà de
toutes nationalités, enfin... issue, en fait... des chômeurs, des
Rmistes... On regroupe plein de personnes en fait. Il y a aussi des gens qui
sont handicapés que se soit moteur ou mental. (l.428)
Ces groupes paraissent s'organiser, soit dans le but de
satisfaire les désirs ou/et les ambitions personnelles de chacun :
le projet individuel.
7è entretien
« Bon à la CAO, c'est un truc que, moi, je veux faire, donc
y'a que moi qui veut l'faire, donc je fais des calendriers, les autres, ils
font ce qu'ils veulent. » (l.573)...
soit de poursuivre un but commun : le projet de la
branche.
...« Mais, c'est vrai, qu'au niveau de [...]
CEB, c'est des projets qu'on a tous ensemble. C'est investir, créer un
club d'Investissement, donc on a une, [...] une sorte de ligne à suivre,
et on la suit. » (ib. l.574)
Souvent les deux dans un même temps :
2è entretien
« Il a été très difficile d'arriver à
fonctionner [...] De par nos tempéraments différents, nos
objectifs et nos engagements personnels par rapport à ce livre.
Maintenant ça va, au bout de presque deux ans. » (l.261)
« Ce qui nous passionne c'est le moment où on a écrit,
où on réécrit pour affiner, pour enrichir le vocabulaire,
pour mettre la virgule là où il faut, le point là
où il faut. » (l.416)
8è entretien
« L'exemple que j'ai en tête c'est à propos de mon
projet : lorsque je suis venu en parler il y avait S (3è entretien,
ndlr), tu étais là, il y avait peut-être Ch
(l'employée du Club, ndlr). Et S... c'est pas qu'il était pas
d'accord, mais il a commencé à dire des choses auxquelles je
n'avais pas pensé. Et çà c'est super ! [...] on
espère vraiment faire le tour de la question mais [...] on espère
toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait une autre vision... de la
chose. » (l.650)
A partir de là, quels peuvent être les aspects
mobilisateurs permettant de rassembler les énergies et les
compétences individuelles pour en faire une force collective, un but
commun ? Sur l'ensemble des personnes interviewées (10/10), il est
apparu deux aspects mobilisateurs en liens l'un avec l'autre : le projet
et la relation284(*), la
relation pour le projet, le projet pour la relation. Comment la relation
peut-elle être mise au coeur des projets menés pour la
satisfaction de chacun ? Si l'on se réfère aux propos
relevés dans le sixième entretien il est probable que le projet
soit stimulateur et focalisateur d'énergie :
6è entretien
« Ce que j'y vois, en fin de compte c'est un vivier de personnes,
[...] qui discutent d'un tas de choses. Et çà, apparemment, c'est
quelque chose qui donne beaucoup de... beaucoup d'entrain, en fait. »
(l.173) « Les gens ont, [...] un point commun, c'est les finances et
connaître un petit peu l'économie... [...] Et puis maintenant, on
commence à faire des formations un peu plus poussées, ça
commence à intéresser de plus en plus et je pense que ça
commence à dynamiser légèrement le groupe... »
(l.428)
Ce champ projet-relation semble permettre la rencontre
d'intérêts ou d'attitudes définissant le ressenti de chaque
acteur : se sentir utile...
7è entretien
« On se sent utile ! » (l.907) « Je me
sens bien quoi ! » (l.97)
...se sentir gratifié...
4è entretien
« Voilà, il y avait plus tous ces gens, toute cette ambiance,
toute cette camaraderie, tout çà n'existait plus et je pense que
ça nous a pesé. (l.899). Et le fait de ne plus rencontrer
personne l'envie, elle part, la motivation, elle part... y a plus rien.
(l.930)
8è entretien
« C'est le fait de donner du temps, donner des idées. Pour
moi, c'est gratifiant et ça me suffit. Ça me suffit, à
partir de là je me sens mieux. » (l.604)
...être fier, etc.
9è entretien
« (à propos de la Finance) C'est de faire quelque chose, et de
voir un peu comment ça fonctionne ! Pour moi, c'est çà.
[...] Et puis, si on peut glaner quelque chose, euh... ben la
réussite... çà, ce serait d'abord une réussite,
ça prouverait qu'on est capable de faire quelque chose. »
(l.564)
En un mot : valorisé.
Cette recherche de valorisation par chacun se caractérise, semble-t-il,
par des conséquences que nous avons retrouvé dans les deux tiers,
au moins, des entretiens (7/9) : avoir du plaisir, se sentir bien,
être satisfait.
1er entretien
« J'y trouve un plaisir... une satisfaction. »
(l.288)
5è entretien
« D'être heureux, d'être... de pouvoir échanger
des opinions. » (l.849) « Je me sens bien... non je me sens
très bien... j'aime bien le Club. » (l.654)
7è entretien
« ...donc on s'fait plaisir. Enfin un lieu de plaisir, j'allais
dire. » (l.234)
Cette valorisation semble nous indiquer que les buts
individuels et collectifs poursuivis autorisent la création de liens. En
clair, ce sont des pratiques régulières de partage et de
solidarité qui font liens285(*). Ces pratiques nous sont fournies, entre autres, par
les propos suivants :
9è entretien
« Je crois qu'il y a une valeur de partage, qui est très
importante. Un partage sur tous les plans, sur le plan intellectuel et
connaissances, moi ce que je connais, je le partage avec d'autres. Ce que je
sais faire, je le mets au service des autres, (silence) et ça
crée une valeur morale de solidarité... (silence) Surtout
çà. » (l.476)
5è entretien
« C'est de rencontrer des personnes et d'avoir des contacts avec
d'autres personnes. Ce qui permet d'avoir des liens... »
(l.90)
Le partage indique le « fait d'avoir quelque
chose en commun avec d'autres personnes »286(*) et la solidarité nous
informe « d'une dépendance
mutuelle »287(*). Mais à eux seuls, suffisent-ils pour
établir des interrelations desquelles émergent les projets ?
La neuvième personne interviewée semble nous affirmer que la
rencontre de "l'autre" est le terreau des interrelations :
9è entretien
« Une volonté de connaître les membres du Club.
[...]C'est ce qu'il faudrait faire pour améliorer les relations entre
les membres, [...] Même pour les créer ! »
(l.710)
Sous l'angle fonctionnel de la branche, la cohésion du
groupe semble favorisée par la représentativité du
Pilote288(*). Nous avons
constaté auprès des personnes interviewées appartenant aux
branches Finance (CEB), Internet (Comnet) et Littérature
(Echap)289(*), que le
choix du Pilote a été effectué de manière
informelle, tacite...
1er entretien
« ...que certains Membres se prennent vraiment pour des chefs,
voilà. Ce qui, à mon avis fera disparaître
l'association. » (l.509)
4è entretien
« [...] Se sentir sur le même piédestal... »
(l.863)
...comme si, malgré l'égalité
revendiquée par les membres les propos étaient polarisés
par l'autorité de l'un d'entre eux. Nous pourrions presque dire :
basé sur l'inconscient parce qu'il apparaît, pour le membre, un
souci de sécurisation qui répondrait à un besoin d'accomplissement. Ce sont les exemples
suivants, par la reconnaissance (ou non) d'un responsable, qui ont permis de
mettre en évidence cet « appareil psychique
groupal »290(*)
2è entretien
« Le leader, donc, notre écrivain, était très
fouillis. On ne connaissait pas son objectif. C'était un coup oui, un
coup non. Il était impalpable. Euh... très... bon alors on va
dire artiste, il paraît que c'est une qualité. »
(l.327)
7è
entretien « On a un pilote. On appelle un
pilote une personne qui fait le boulot de leader, [...] qui répond au
coup par coup, suivant ses connaissances ou qui oriente vers la personne qui
sait [...] le travail du pilote est très important parce-que... il est
obligé d'avoir un connaissance un peu plus approfondie. »
(l.269)
Pour analyser avec précision le point qui pose la
question du Pilote, nous avons relevé que nos interlocuteurs parlaient
de son "acceptation hiérarchique" en tant que responsable comme d'une
évidence. Ainsi le Pilote semble apparaître spontanément,
simplement et reconnu de fait, à l'intérieur de la
branche :
5è entretien
« Ben y' a aussi un meneur. Y a une personne qui est un peu plus
responsable de la branche.[...] Je ne sais pas du tout, si elle s'est
désignée. » (l.691)
Pour ne présenter qu'un seul exemple, l'autorité
du Pilote de la Branche Finance291(*) est apparue sous la forme de
prééminence dont il bénéficie parce qu'il se
révèle capable d'influencer l'attitude des autres.
6è entretien
« Apparemment, moi, j'ai cette étiquette d'animateur et bon,
bé si ch'uis plus là, c'est fini. » (l.348)
Cette autorité est une qualité inhérente
à ce Pilote qui est capable d'en faire preuve,
c'est-à-dire : compétence informatique renforcé par
une certaine popularité (sympathie, simplicité,
sincérité dans ses attitudes sachant lever les "frustrations" du
groupe ; bref, sachant se faire comprendre) :
3è entretien
« On apprend avec un pilote qui a beaucoup plus d'expérience
que nous... ce qui se passe c'est... comment i faut faire, quels sont, donc,
les démarches pour pratiquer quoi. » (l.249) « Un
pilote, s'occupe un peu plus [...] de la Branche. Du bon fonctionnement et du
bon déroulement de la Branche. De canaliser les gens et de permettre a
ce que les gens aient toujours un interlocuteur [...] qui va avoir après
à communiquer l'avis de la Branche au noyau de l'association, au Compu's
Club. parce-qu'on est quand même lié à l'association, au
Compu's Club. » (l.282) « C'est pas quelqu'un qui commande,
c'est presque proscrit de commander au sein d'une association. [...] Il faut
plutôt orienter [les gens] et leur faire comprendre. » (l.292)
« Tout ce que je me souviens c'est que à l'époque,
y'avait une personne qui ne le faisait jamais (le compte-rendu de formation),
puis je lui ai simplement demandé de le faire... Elle m'a regardé
bizarrement, puis elle a accepté. Et elle a fait un travail normal.
(l.480)
Le Pilote, lui-même, a pleinement conscience
d'être un "cadre de référence"292(*), une
autorité :
6è entretien
« Je suis "Pilote", entre guillemet, de cette branche et... il est
vrai que, quand je suis plus là, apparemment , il manque un
animateur. » (l.345) « Ah ouais ouais, c'est grave,
hein, même. Elle m'a dit : « il me saoule lui »
carrément. Des fois, je crois même qu'elle était pas loin
de plus venir au Club uniquement à cause de çà. Il va
falloir modérer les choses. [...] J''ai encore du mal, parce-que j'ai...
je n'veux pas diriger, hein, à l'intérieur de cette
communauté. Je n'ai pas envie de, de... bon il va falloir que je trouve
une solution, Ms (9è entretien, ndlr), j'essaie de la calmer
gentiment... euh... et pi, va falloir que je trouve une solution quand
ça se rencontre entre PG et Ms, par exemple, c'est de freiner PG, quand
il parle trop et puis de relancer Ms pour qu'elle essaye de
s'intégrer. » (l.399)
Mais, quel est le rôle de cette autorité ?
Il semble que la réponse se trouve dans la prise en compte, non
seulement des caractéristiques et des compétences du Pilote comme
nous venons de le voir, mais aussi, dans celle d'un apprentissage à la
vie démocratique qui impose des règles de communication. Le
projet, facteur de conscientisation des règles
démocratiques :
7è entretien
« Si on veut prendre une décision, donc, chacun vote, chacun
dit ce qu'il pense, s'il n'est pas d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord,
mais c'est vrai que en général quand on a une idée, on
est, enfin... [...] S'i y'a un truc qui va pas, donc, euh... on en parle, et
bon, on essaie toujours de... » (l.389)
6è entretien
« La plupart des décisions sont, sont, sont prises
après un vote, hein, en général. Quand il s'agit de
décisions importantes, on fait voter les gens. Et puis, bon, en fonction
des arguments amenés ou des décisions que l'on doit prendre, le
vote se fait assez facilement. Et souvent, peut-être pas à
l'unanimité, mais à une large majorité. »
(l.497)
L'inverse est-il vrai ? C'est-à-dire :
lorsque l'autorité du Pilote n'est pas reconnue, il n'y aurait pas de
règle de communication et la branche ne créerait pas de
relation ? Le couple interviewé293(*), initiateurs de la Branche CAO294(*), semble nous dire que la
notion de leader est introduite par des indicateurs de
démocratie :
4è entretien
« Ph : Nous, on avait lancé l'idée. On pensait qu'en
lançant l'idée les gens allaient venir et qu'ils allaient
proposer leurs idées... Na : ...On souhaitait pas être les
moteurs. » (l.326) « Où j'ai
été déçu... ce que j'aurais aimé que
ça m'apporte plus, c'est voir plus de personnes, c'est plus discuter...
[...] Les gens sont venus chercher "quelque chose" ; il y en a aucun qui
est venu pour dire : « c'est une super idée, j'ai des
idées, je viens avec vous. » [...] Notre connaissance est
très limitée et on s'est vite rendu compte que s'il y a personne
qui arrivait avec de nouvelles connaissances on serait vite, (silence) Et les
gens qui venaient, i venaient juste pour, euh... pour faire ce qu'ils avaient
à faire et puis c'est tout, hein. ils étaient pas plus
intéressés que ça. » (l.395)
Pour résumer, le projet
permettrait les interrelations sociales. Mais si
pour caractériser cela, nous avons relevé deux aspects
reliants (le partage et la solidarité) la
représentativité du Pilote, c'est-à-dire l'acceptation
tacite de son autorité, semble autoriser l'éducation à la
démocratie.
2.2.3 Du rapport à la
relation sociale
Il nous paraît utile, ici, d'apporter quelques
précisions méthodologiques en notant que la relation de
face-à-face que nous venons d'analyser était
désignée par nos interlocuteurs avec des mots peu clairs et
précis lors des entretiens. Elle a été essentiellement
caractérisée par l'emploi d'expressions
périphériques : "tout le monde amène des
idées, défendre son idée, le ton monte, le lendemain c'est
fini, on laisse débattre"295(*), etc. Ces expressions semblent indiquer des
valeurs : le débat démocratique ("on laisse
débattre"), la liberté d'expression ("Je peux exprimer
soit mon accord, soit mon désaccord"). Dans un même temps,
elles semblent indiquer des possibles de projets296(*) ("amène des
idées") et de communications sociales
("on laisse débattre", "ça a été
entendu") ; quelquefois créatives de liens et de motivation
("le désir de construire ensemble a toujours été
là").
9è entretien
« Y'a tout un foisonnement... et une ouverture je sens qui est
prête, quelqu'un viendrait dirait, moi j'ai envie de créer un Club
comme çà, et de réunir des gens, bon, euh... ce serait
accepté. Alors, cette ouverture me plaît beaucoup... »
(l.372)
De même, le recours à certains mots communs
(l'amitié, l'ambiance, la convivialité, ...) semblent traduire la
manière d'être avec, d'agir avec, de se tenir dans, d'appartenir
au "système" en tant qu'acteur social. Par exemple :
1er entretien
« Justement parce-que il y a une bonne ambiance, une bonne
entente, il s'y passe de bonne amitiés. »
(l.148)
7è entretien
« Pour moi, convivialité, donc déjà donc,
on s'connaît, on va dire pratiquement tous, ben, ceux qui viennent
souvent, donc on se connaît tous. Euh... ben convivialité c'est
quoi ? Donc, c'est se rencontrer, discuter, ch'ais pas, donc, euh...bavarder un
p'tit peu » (l.122)
Quelquefois, un membre explique ces mots par des
faits :
9è entretien
« L'amitié, c'est au-delà... d'un service, par
exemple sur l'informatique, [...] ou d'un échange de service, c'est
arriver... à des liens beaucoup plus profonds où on se parle...
on se confie mutuellement les problèmes qu'on peut avoir et où on
essaie de mieux comprendre, de mieux, [...] se comprendre mutuellement.
s'entraider, c'est créer un lien unique ! » (l.101)
En relevant ces mots et expressions nous avons pu sonder deux
manières dont les membres semblent être en relations et
interagir :
Ø le membre en relation avec les autres, dans
l'association,
Ø le membre en relation avec les membres de sa branche
(du micro-groupe),
2.2.3.1 Je suis en relation avec
les autres hors de ma branche :
L'instant cigarette ou café semble servir de cadre
privilégié et de support à l'échange
d'informations, au partage d'expériences, à la confrontation
interpersonnelle, comme support à la détente, à la
rencontre et à l'équilibre relationnel des membres :
7è entretien
« On raconte des blagues, on boit un petit café, on fume une
cigarette, [...] ...On se chambre un p'tit peu, on... »
(l.685)
Plus que l'instant cigarette ou café, c'est l'ensemble
du temps passé au Compu's Club qui peut-être salutaire pour
certaines personnes. Par exemple répondre à une solitude...
7è entretien
« au tout début, donc quand j'étais marié,
j'étais venu [...] ma femme, elle était pas là, [...]
ça permettait, donc, en fait de, de soulager la solitude. »
(l.1045)
...voire une ré-appropriation de la capacité
à s'exprimer. Ainsi, JK (57 ans) connu pour ses problèmes de
communications (il est introverti) restait très secret sur sa vie
personnelle. Le membre interviewé au cours du neuvième entretien
nous informe avoir réussi à "enclencher" une relation :
9è entretien
« Quand j'arrive, on se fait la bise, et puis j'ai L. (7è
entretien) qui m'embarque pour me dire que lui, il a fait des
expériences, qu'il voudrait bien m'entraîner avec lui, donc, il y
a quand même quelque chose qui passe... Euh... y'a JK, qui, qui est
arrivé à me dire où il habitait, (rires) à travers
milles circonvolutions parce-que c'est son problème. »
(l.291)
Ce temps semble constituer, aussi, un "sas de
décompression"...
3è entretien
« Alors moi au Club la première chose que je fais en rentrant
c'est boire un café. Etant donné que j'ai pas eu le temps de
prendre le temps de m'asseoir et de souffler un peu, de discuter avec des gens
qui me parlent pas tout le temps boulot. Et pi, euh, et pi voir des gens,
surtout avec le sourire en rentrant ça fait tellement
plaisir. » (l.474)
8è entretien
« Aujourd'hui, le Club, pour moi, ce serait des instants [...] de
détente... [...] des récréations, en fait. (silence)
Ouais, pour moi, ce serait plutôt, voilà, des
récréations. » (l.138) « Ben, j'aime, j'aime
beaucoup le Club parce-que comme je dis c'est de la récréation et
pour, pour moi la récréation ça a toujours
été très important parce-que... enfin... je sais pas si tu
te rends compte, au, au, au bahut... mouais, c'est vrai que c'est,
peut-être, un peu trop fort. parce-que quand on est au bahut, tu vois,
les récréations c'est peut-être ce qu'on attend le plus.
Finalement. » (l.150)
...facilitant la coupure avec la vie professionnelle pour
doucement basculer dans un autre espace, d'autres relations de camaraderie,
d'amitié, ... :
9è entretien
« Comment définir l'amitié à travers ce que je
vis ? C'est toute cette chaleur, ce lien de plus en plus étroit, qui
nous unit à l'autre. » (l.111) « Je crois que c'est
à travers le déménagement. [...] j'étais absente...
mais... lorsque j'ai vu tout le travail pour aménager le nouveau local,
tout ce foisonnement de personnes que je ne connaissais pas... je vois Jc
(5è entretien, ndlr) arriver pour une réunion, et on lui a dit :
« Dis tu branches », bon, allez pof, il a quitté là le
blouson, il est monté sur la table, il a fait un branchement
électrique. Y avait A. (1er entretien), par exemple, que je ne connais
pas du tout, tout souriant, qui était là, enfin, quand j'ai vu
tout ce travail... cette ruche... ça m'a quand même beaucoup
impressionnée. J'ai vu qu'à travers les différentes
activités, il y avait un lien... » (l.247)
Quelle relation entre cohésion de l'association et
communication ? Il semble exister un minimum de règles tacites
néanmoins non transgressées comme le civisme :
1er entretien
« ...moi je pense que tant qu'il y a justement la correction et le
civisme entre les personnes y aura aucun problème... »
(l.433)
9è entretien
« ...Y'en a beaucoup d'autres qui sont véhiculés :
d'honnêteté, de justice, de sens social. »
(l.481)
Cette intégration du membre au sein de l'association
par un code d'action commun semble se faire simplement, progressivement, avec
beaucoup de patience :
1er entretien « Chacun
a son caractère. Donc déjà, euh, pour faire partie d'une
association il faut mettre un peu d'eau dans son vin. » (l.166)
« le bon point à mon avis la tolérance, y a le contact,
les discussions qui sont vraiment possibles. » (l.451)
3è entretien
« Au Club c'est justement [...] un petit nombre de personnes qui fait
preuve de la plus grande amabilité et qui essaye d'oublier... on peut
dire leur phobie ou leur répugnance à voir des gens qui sont pas
comme eux, pas normaux [...] on fait appel au coeur des gens au
Compu's. » (l.439)
La valorisation de l'individu paraissant croître avec la
centralité de sa position.
6è entretien
« Je me sens écouté. [...]Mais bon le Club en
rajoute. » (l.755)
9è entretien
« J'ai proposé d'être un lien à
l'intérieur du Club. » (l.160)
C'est dans ces situations de valorisation de l'individu qui
s'expriment par des participations et des prises de responsabilités que
semblent pouvoir émerger de nouveaux rôles sociaux.
7è entretien
« J'ai une fonction, je suis secrétaire adjoint. j'ai une
responsabilité en fait... [...] au début, j'étais
administrateur, [...] y'a deux ans. [...] c'était pas évident,
parce-que moi je pensais que, en étant administrateur, [...] y'avais des
contraintes, en fait, y'en avait pas, [...] j'avais peur que ça me
prenne, que ça me, que ça présente des contraintes.[...]
après, je me suis dit : « Bon, ben tant pis, je me lance, on va
voir ce que ça va donner ». (l.244)
3è entretien
« Ce qui m'a fait prendre des fonctions c'est de dire, euh, "y a des
choses qui méritent qu'on y fasse un peu plus attention" et euh, il faut
aussi donner un coup de main à ceux qui s'investissent beaucoup.
Ça permet, en fait, de pas se reposer mais de prendre un peu de recul et
puis de mieux comprendre. C'est vrai que quand on regarde les choses d'un point
de vue extérieur on comprend les choses de suite. On voit tout de suite
là où est problème mais quand on est dedans on a des fois
la vue obturée par des problèmes de fonctionnement et on voit pas
l'essentiel, c'est-à-dire le problème des gens, c'est pas
instantané, quoi. » (l.420)
C'est par le rôle acquis que ses relations prennent du
sens.
3è entretien
« L'association, pour moi, c'est presque un monde parfait en fait
parce-que y a pas de contrainte [..]Personne impose sa volonté. Bon, on
a quand même des dirigeants mais... c'est la
liberté ! » (l.161)
5è entretien
« Je pense, que si les gens veulent créer une branche, y a pas
de problème au niveau du Club. Puisque nous on l'a fait au niveau de la
Bourse, d'autres personnes peuvent le faire pour d'autres branches. »
(l.809)
7è entretien
« Y'a une bonne ambiance, [...] on rigole, [...] on s'fait plaisir,
[...] on fait les réunions, [...] on vient, on est cool, tranquille, et
puis voilà. » (l.232)
Sens, qui quelquefois exprime une contradiction :
l'autonomie de la branche et en même temps la dépendance à
l'association.
3è entretien « La
plupart du temps la Branche essaye de devenir autonome, étant
donné qu'elle veut pas astreindre le noyau de l'association avec des
frais inutiles. » (l.334)
7è entretien
« Oui, autonomes [...] et non, bon c'est vrai que
ça reste toujours Compu's Club. » (l.298)
9è entretien
« Elle est autonome, oui ! [...] Et ben, quand on est dans le,
d'abord on dispose d'une, d'une salle. On se réunit. Nous, nous
créons nos objectifs, euh... nous nous sommes structurés lors de
la dernière réunion... On défini un travail, on le suit
pas toujours, mais enfin, on essaie... » (l.394)
2.2.3.2 Je suis en relation avec
les autres dans ma Branche :
Nous avons pu trouver ce sens, dans les descriptions des
relations avec les autres membres dans la Branche, dans une redéfinition
de valeurs démocratiques, morales, civiques qui font repère en
s'appuyant sur un principe de liberté d'expression :
5è entretien
« le groupe laisse débattre les gens qui s'expriment
jusqu'à la fin. Çà c'est une règle. Et après
c'est vrai qu'il faut prendre une décision, mais au niveau du groupe.
S'il faut, et bien on vote ; » (l.535)
9è entretien « Je
pense qu'il y a d'abord le dialogue, et, je trouve qu'il serait difficile de ne
pas arriver à trouver un point d'entente dans le dialogue. parce-que
celui qui est contre, il expose ses raisons, on lui répond, on essaie de
bien rentré dans ses objectifs et si vraiment on y arrive pas, si on a
affaire à quelqu'un qui est complètement buté. [...] je
pense, que c'est quand même le groupe qui doit décider !
L'ensemble du groupe. [...] après la discussion, on vient aux
voix. » (l631)
...de solidarité, de partage, de respect...
9è entretien
« A travers la Finance [...] y a des liens qui se créent dans
le groupe. Ses liens n'ont pas toujours existé puisque l'année
dernière, nous avons laissé tombé PG (membre du Club,
ndlr)... Je crois que ça n'était pas notre faute, nous
n'étions pas assez... Les liens n'étaient pas assez
créés. C'est pour çà, c'était une
conséquence, ça m'a pas mal culpabilisée, mais... Il y a
eu le problème de FA (un membre du Club qui s'est suicidé), moi,
ça m'a beaucoup, beaucoup questionné. parce-que je travaillais un
peu avec lui, quand on allait... c'est lui qui m'avait initié. »
(ib.l.305)
8è entretien
« C'est la convivialité, c'est le fait de se retrouver entre
des personnes totalement différentes qui sont là simplement pour,
pour s'détendre, pour, pour communiquer ensemble, pas du tout pour se
prendre la tête. Et çà c'est, c'est vraiment quelque chose
de très important. » (l.196)
C'est aussi la confiance accordée par l'autre qui
permet d'exprimer ses inquiétudes. Le temps consacré et
l'attention particulière accordée semblent être le terreau
d'une relation (« on a pu en parler plus de dix
minutes »).
2è entretien
« Bon le jour où le père de MA. (la fille de notre
interlocutrice, ndlr) a téléphoné, il arrivaient tous les
deux (des membres de la branche, ndlr), j'étais en larmes... bon ben, on
a pu en parler plus de dix minutes mais on a quand même travaillé
un petit peu. (silence) c'est parce-que... heu... y a un milieu de
confiance. » (l.403)
Il semblerait que nous trouvions, là, un
"système interactif"297(*). C'est-à-dire une forme fluctuante incluant
toute la personne, les actions et les relations réciproques :
9è entretien
« C'était sympathique, presque trop sympathique, parce-que,
(silence) y'a un manque d'exigence, en tout cas dans notre groupe. Jo
(6è entretien), il est très, très gentil, très...
il est venu me dépanner d'ailleurs, il n'y est pas arrivé, mais
il est venu me dépanner. Jc (5è entretien) aussi. Donc les liens
se sont créer petit à petit. » (l.120)
4è entretien
« Sans citer de nom des gens qui arrivaient en nous disant (prendre
un ton ironique) « oh, y avait personne encore
aujourd'hui » ou dans ce style là. (Sur le ton de l'agacement)
C'était très désagréable... Je ne citerai pas de
nom... promis... (rires) Non, parce qu'on lui en veut pas du tout. il avait
peut-être pas tord. » (l.450)
Mais ce qui nous a paru le plus curieux ce sont les
différents niveaux de liens qu'il nous a été permis de
relever. Ceux qui glissent sur l'intimité des membres...
5è entretien
« Des fois, peut-être qu'on a pas grand chose à dire,
donc on se parle du beau temps, mais des fois, quand j'allais chez elle, on
parlait de jardinage, ou, parce-que i'avait son jardin. » (
l.309)
9è entretien
« JK, qui a d'énormes difficultés, et qui est
arrivé... c'était minable son compte-rendu... il l'a lu, mais
ça fait rien ! Il a fait un effort, moi j'ai trouvé
çà... qu'il accepte de faire une recherche et de parler... moi,
je pense que pour lui, ça a été... c'est pour
çà qu'il ne faut pas le lâcher ! »
(l.283)
L'expression de leur absence par le couple du quatrième
entretien semble le confirmer en ce sens qu'il avait adhéré pour
l'informatique298(*) et
qu'aucun autre lien ne semble s'être instauré.
4è entretien
« On a eu l'impression que les... Al et L (L. 7è entretien)
avaient tellement d'idées et étaient tellement motivés que
ça allait être génial. C'étaient les
premières impressions et elles étaient très très
bonnes. On s'est dit « chouette, on forme une super équipe ».
[...] Et puis l'équipe, elle a été vite par
terre. » (l.635)
Les positions, les comportements des individus s'en trouvent
changées, notamment pour le membre du neuvième entretien qui
souhaitait, à un certain moment, se désengager...
6è entretien
« Ms (9è entretien, ndlr) a longtemps avoué
lâcher les Finances et puis qui reste, parce-que, bon, on est un petit
groupe sympa, on discute bien et ça se passe bien. »
(l.179)
...alors, qu'il nous informe, maintenant, s'être
ravisé et convoiter de nouvelles perspectives :
9è entretien
« Garder ce contact, ses liens d'amitiés qui se créent,
parce qu'on est à l'aise maintenant, donc si on est à l'aise,
c'est qu'déjà, on, hein, on ne redoute plus celui qui est en face
de nous. » (l.331) « Il y a les copains ! (rires). J'ai pas
envie de la quitter, maintenant ! (rires) [...] C'est les liens qui sont
créés entre nous. Je vous dirai que c'est uniquement
çà. Et puis un certain engagement, j'ai l'impression que si je
quittais le groupe... » (l.441 à 450)
Comme
pour la perception du Compu's Club par le membre299(*), les valeurs, semblent
définir la relation au sein du Compu's Club tant dans les rapports avec
les autres dans la branche qu'avec les autres au sein du Compu's Club dans son
ensemble. La valorisation de l'individu paraissant croître avec la
centralité de sa position semblant autoriser les relations sociales. Le
partage et la confrontation interpersonnelle sont favorisés par des
instants privilégiés (café, cigarette, instants divers).
Ces instants pouvant constituer un "sas de décompression".
Conclusion :
Ce chapitre a
présenté ce que nous pourrions appeler, désormais, la
configuration du Compu's Club, en s'appuyant sur trois points-clefs :
û Le premier a porté sur la perception du
Compu's Club par le membre : le manque de connaissance de l'infrastructure
de cette association par le membre ne l'empêche pas d'en exprimer une
symbolisation positive pour donner une forme, une signification au contenu de
ses relations. Cette symbolisation prend en compte trois
aspects différents : les possibles (ouverture), le contexte
(lieu d'expression), l'image d'un groupe particulier (appartenance).
û Le deuxième point traitait des conditions
favorables à la relation. Deux aspects ont été
examinés : Les aspects reliants du projet : au
Compu's Club, le projet semble se caractériser d'abord par sa
capacité à permettre les interrelations. On a pu distinguer deux
aspects reliants socialement dans ces interrelations : le partage et la
solidarité.
La représentativité du Pilote : au
Compu's Club, le Pilote semble s'imposer "naturellement" par ses
compétences renforcées par la popularité. Le
caractère inconscient qui s'attache à ce phénomène
est l'autorité du Pilote que nous avons pu analyser comme une influence
sur la conduite du membre ; c'est-à-dire comme une éducation
à la démocratie.
û Le troisième point de ce chapitre a
porté sur les niveaux de la relation ; nous y avons retenu quelques
facteurs qui jouent dans l'évolution des relations, en particulier
certains instants (café, ...) semblent expliquer la fluidité des
relations interpersonnelles, la valorisation de l'individu paraît
croître avec la centralité de sa position et la
référence à un code d'action commun, les valeurs, semble
créer une relation/communication sociale créative
d'activités et de liens.
2.3 Ce qui se joue :
Caractéristiques des maturations
Après avoir décrit
en quoi il pourrait y avoir configuration au Compu's Club, ce qui
joue300(*) nous
présentons, dans ce troisième chapitre, ce qui se joue.
C'est-à-dire, quelles sont les maturations qui s'effectuent chez le
membre à l'occasion de son expérience vécue au sein du
Compu's Club ? Pour ce faire, nous avons pu mettre en exergue trois
grandes caractéristiques de ces maturations. La première,
concerne l'affirmation des rêves, des besoins, des attentes du membre dans ses
relations. Ceci, afin de relever les repères d'identité sociale
de l'adhérent et de comprendre la construction de ses identifications et
de ses représentations dans son engagement. La seconde, établit
la primauté du sens, sujet empirique par excellence parce
qu'inobservable. Il semble exact que le sens n'est pas forcément
perceptible et conscient pour le membre du Compu's Club qui l'installe dans son
comportement et son discours301(*). Mais il est seulement question de montrer que le
sens devient une "forme" justement par les comportements et les discours des
membres. La troisième, explore les processus de changement des membres
pour nous fournir les capacités d'insertions socioprofessionnelles que
le membre s'est construit, ses capacités à se "socialiser".
2.3.1 Grandir son engagement ou
se positionner dans le groupe
Sept personnes sur dix entendues sont assurément des
individus qui dépensent une énergie considérable,
sacrifiant une part de leurs loisirs et vacances pour le Compu's Club.
3è
entretien « Et donc, euh, bon ben, ma vie se
résumée à 39 heures par semaine, mon travail et puis, bon
après je partageais mes loisirs entre, entre ma vie conjugale, donc,
et... l'association. » (l.71)
7è entretien
« Pour emménager au club c'est vrai qu'il y a eu [...] pas mal
de personnes qui sont venues nous aider, [...] A (1er entretien, ndlr) qui
avait pas mal de travail... [...] est venu quand même pas mal de temps au
club pour aider. C'est vrai que bon... il aurait été au
chômage etc., ok, mais [...] donc il a passé pas mal
d'heures. » (l.938)
Tout se passe comme s'ils voulaient un changement chez eux
(sinon pourquoi ne resteraient-ils pas tranquille ?) mais sans bien savoir
lequel comme si le changement était une fin en soi, qu'il fallait
absolument "bouger", "évoluer".
1er entretien
« Le changement, oui. Le dépaysement, beinnnn, oui le
dépaysement par rapport à, au travail. »
(l.603)
2è entretien
« Je suis contre le phénomène associatif tout en y
participant. parce-que je trouve que c'est instituer. La misère entre
guillemets est bien nationalisée, bien instituée. [...] Mais je
fais partie de ces gens qui le pense et que on continu à faire du
bénévolat, on continu à avoir des gens dans les
associations sous payés. parce-que ça arrange tout le monde et si
tout le monde boycottait çà, peut-être que l'Etat se
bougerait. Mais, comme personne ne se bouge, je pense que j'ai ma place a avoir
là dedans et mon rôle à jouer comme je le fais. »
(l.137)
8è entretien
« C'est vrai, finalement, pourquoi est-ce que je viens ou pas ?
Putain, mais j'ai aucune raison ! » (l.480)
Héros des temps modernes (en fut-il) sur des
tâches incommensurables voire impossibles si nous nous
référons aux propos suivants auprès desquels nous
retrouvons l'énoncé d'une envie récurrente du Compu's
Club, celle de posséder du matériel informatique performant. Or,
ce qui gêne à la réalisation de cette envie se trouvent
être les financements.
5è entretien
« Pour moi, je pense, c'est le manque de matériel
performant. » (l. 786)
6è entretien
« Ce que j'aimerai, c'est faire évoluer le matériel de
Compu's Club, euh... vers le haut, donc, essayer de se mettre à jour
tout doucement. » (l.629)
Bref, le membre de cette association serait-il une "curieuse
figure indigène" qu'on ne pourrait évoquer qu'avec des
contradictions : "je veux changer mais je ne sais pas lequel", "je veux le
changement mais je ne sais pas combien" ? Pour faire apparaître une
cohérence nous avons pu décrire deux attitudes de base qui
déterminent ce changement et le rendent possible. Dans un premier
lieu, au niveau de l'individu, ce qui le pousse à s'engager dans la
dynamique de l'association : ses représentations de
l'atmosphère de l'association que nous allons appeler "la part
symbolique". Ensuite, au niveau de l'association, les repères
d'identité et les identifications qui permettent au membre de se
justifier mentalement son engagement et que nous appellerons "la part
réelle".
2.3.1.1 Les représentations
ou la part symbolique
Nous avons déjà relevé dans le chapitre
précédent302(*) que le membre percevait symboliquement le Compu's
Club à partir de "préjugés positifs" et de
subjectivités. Nous avons souligné qu'il ne connaissait pas
précisément l'infrastructure de l'association. Dans ce cas,
comment construit-il, pense-t-il, structure-t-il sa connaissance des autres
membres ? Les personnes interviewées nous ont fourni un certain
nombre de réponses. D'abord, il semblerait que la perception soit
simplifiée par des représentations exprimées à
partir d'un "codage" abrégé, personnel et implicite. Par exemple,
comme nous l'avons précisé plus avant303(*), l'activité
informatique de l'association ne semblait pas être la seule motivation
des adhérents. De même, pour exprimer l'activité
perçue au sein du Compu's Club les membres semblent interpréter
par des expressions périphériques et des mots communs leur propre
projection mentale. Pour arriver à cette analyse, nous avons
considéré le discours de notre premier interlocuteur à la
ligne 116 :
« Ce qui me plaît le plus, c'est
l'amitié, c'est les gens. Çà, c'est déjà la
première chose... ensuite il y a les discussions. »
Il nous renseigne par là de sa perception codée
des interrelations pour l'interpréter plus loin à la ligne
267.
« De toute façon quand on rentre dans le
Club il y a toujours quelqu'un qui bricole un ordinateur pour le
réparer. Çà c'est quand il y a quelque chose qui va pas.
Euh, y a autre chose aussi, c'est qu'on trouve souvent des gens en train de
discuter entre eux. [...]Il peuvent discuter d'informatique mais ils discutent
d'autres choses. Justement, c'est un peu l'avantage d'une association comme
çà c'est qu'on discute de tout sans parler obligatoirement
d'informatique. »
Ce qu'il est intéressant de relever chez cette personne
c'est son énoncé personnel de l'amitié qui semblent se
matérialiser par le constat positif des discussions qu'il effectue. Il
semblerait, ainsi, qu'il s'agisse là d'une articulation mentale, d'une
projection de sa perception des interrelations : l'amitié ;
bref, d'un "codage mental résumé", d'une représentation.
Nous avons, ainsi, pu relever, auprès de tous nos interlocuteurs, sans
exception, le même processus de "codage". Pour citer un seul autre
exemple : lors du quatrième entretien, le couple interviewé
se représentait mentalement le Compu's Club comme une multitude
d'associations désunies construites autour d'une personne, son
Pilote.
« Ph : ...Non mais, c'est
organisé, en fait, il y a la partie Bourse. parce-que si t'y vas en
dehors de ces... ces associations... enfin, de ces branches, tu vas pas
trouver... on va trouver qu'une personne autour... Par exemple, Lau (notre
premier salarié, ndlr) à l'époque et c'est, c'est...
ça fait isolé un peu, quoi. [...] Il y avait Échap. Il y
avait la nôtre, euh... les juniors, aussi. On n'a pas eu beaucoup de
monde donc euhhh... (l.227)
Cela pourrait expliquer la raison pour laquelle, ce couple, au
sein de sa branche, s'est senti isolé. De plus, le discours suivant,
à propos des juniors, semble faire émerger une dissonance de son
interprétation de l'association : vient-on au Club pour
l'informatique, seulement, ou pour autre chose, aussi ?304(*)
Ph : ...Ouais, la branche des
juniors, donc, les juniors quand ils venaient, bon, apparemment Lau voulait
leur faire faire quelque chose, eux ils y venaient pour le jeux. Ils
étaient content d'y venir parce qu'ils jouaient. Euh... En fait, c'est
trouver les points communs des branches et ces points communs de plusieurs
personnes qu'i viennent y rechercher. Euhmmm... Na : C'est sur
le thème de l'informatique mais c'est bien diversifié. En fait,
à la fin y a certaines branches... Ph : ...ouais mais
même les jeunes i z'y venaient pas que pour... Bon, i z'y jouaient
beaucoup sur les ordinateurs mais deux, quand j'y suis allé, i jouaient
aux cartes. Donc i z'étaient contents de se retrouver ensemble,
quoi. » (l.229)
Pour résumer, dans ses énoncés le membre
semble nous indiquer une construction de sa connaissance des autres par un
"codage mental" simplifié et intime : une représentation.
Avoir pu repérer ce "codage mental" est primordial pour
la suite de nos analyses et commentaires parce qu'il va nous permettre de
comprendre les processus d'identifications des individus. C'est ce que nous
allons aborder dans la section suivante. Mais, au préalable nous
souhaitons préciser que nous percevons les limites de cette analyse. En
effet, bien que nous soyons prudent de ne pas attribuer abusivement la cause
d'un comportement, d'une expression au membre plutôt qu'à la
situation nous avons décidé de surestimer, tout de même, le
rôle des attitudes des membres. Ceci, parce qu'elle nous paraît
être l'orientation la plus pertinente pour notre hypothèse.
2.3.1.2 Les repères
d'identité et les identifications ou la part réelle.
Nous nous sommes informé dans les chapitres
précédents305(*) que certains membres306(*) éprouvaient le
sentiment de solitude en dehors du Compu's Club. Nous allons considérer
cet exemple en tant que métaphore307(*) pour présenter les analogies que nous avons
relevées entre les repères d'identité sociale,
observables, et les identifications, inobservables. Autrement dit, nous allons
essayer de découvrir quel type de conscience de son identité et
quels symboles sociaux le membre développe dans son engagement au sein
de l'association.
2.3.1.2.1 Les repères d'identité sociale :
deux types de conscience de son identité par le membre
Nous avons pu relever, au sujet des individus qui ont
exprimé leur solitude, deux aspects des repères d'identité
sociale : les aspects psychologiques et les aspects sociologiques
1) Les aspects psychologiques, individuels semblent se
traduire par le sentiment d'exister, par exemple dans une "évasion", la
sensation d'être utile...
3è entretien
« Je me sens en week-end, déjà. Ou alors, euh, quand
c'est la semaine, bon, ben, je me sens déj... je souffle un peu, je me
sens, euh, un peu apaisé, en fait, tout bêtement et pi, et puis je
me dis « enfin un endroit où personne va
m'embêter. » (l.639)
5è entretien
« C'est un moment de détente, le soir de passer une heure ou
deux heures le soir à dialoguer avec des personnes ! » (l.110)
« Plus une joie de vivre, de dialogue et tout ça ! »
(l.637) « Je m'exprime plus facilement qu'avant. [...] Je veux dire y
a eu ce déclenchement, mais y a pas eu que le Club. »
(l.644)
7è entretien
« On se sent utile ! » (l.907) « Mais c'est vrai
qu'on se sent de mieux en mieux sans s'en apercevoir. »
(l.998)
...d'être reconnu. L'ensemble des propos suivants nous
indiquent cette reconnaissance (ou l'absence de reconnaissance) par les autres
membres et par autrui...
3è entretien
« il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué. C'est un
sentiment profond. A l'Assemblée Générale d'il y a deux
ans j'étais Membre depuis six mois et il y a eu le revote du Bureau.
[...] On a demandé "qui voulait devenir Secrétaire
Général ?" [...]J'ai vraiment été vexé
de ne pas être élu, ça m'avait vraiment
choqué. » (l.492)
5è entretien
« Maintenant, y a une personne (un professionnel de la finance, ndlr)
qui est prête à venir tous les mois, çà c'est...
pour nous ça peut devenir intéressant. [...] Du
professionnalisme, surtout, et puis surtout, peut-être, un fil conducteur
de savoir dans quelle direction il faut aller. » (l.486)
7è entretien
« J'étais le seul donc, à être contre, au
début... [...] Ils m'ont écouté, après ils ont dit,
ouais, finalement... [...] t'as raison. » (l.824)
...d'être valorisé par la liberté,
l'autonomie et la responsabilisation :
3è
entretien « Personne impose sa volonté, bon,
on a quand même des dirigeants mais c'est la liberté. »
(l.163) « il faudrait déjà faire comprendre ce que
c'est qu'une association aux jeunes, leur en parler, leur parler des statuts,
[...] Elle peut très bien faire pencher la balance dans leur vie en leur
faisant comprendre que de toute façon, s'ils font partie d'une
association ils trouveront solution à leur problème quelque soit
leur problème. » (l.693)
7è entretien
« Un lieu de rencontre, un espace de liberté »
(l.202) « C'est toujours la liberté, je vais revenir encore
à la liberté... C'est être libre... » (l.601)
« c'est qu'on était libre, donc chacun faisait comme il
voulait. [...]...là, chacun est libre de faire, donc, ce qu'il
veut. » (l.183) « J'ai pris une responsabilité donc
au niveau du Club. » (l.981)
2) Les aspects sociologiques semblent se traduire par la
notion de rôle et d'appartenance à une groupe :
3è entretien
« Moi, j'ai 27 ans. Et pourtant je suis plus bien jeune mais (rires)
je fais partie de la jeunesse. Pour moi, je suis très jeune dans ma
tête. » (l.557)
5è entretien
« Gérer les comptes, et puis surtout de... c'est surtout des
comptes de tout un groupe... qui peut être
intéressant. » (l.755)
7è entretien « C'est
qu'on s'entend bien, on est une petite famille, quelque part, on s'entend, on
s'entend bien, quand on a des trucs qui vont pas, donc, on essais de les
résoudre. » (l.808)308(*)
En clair, "j'appartiens à un groupe",
"j'appartiens à une famille", "j'appartiens à la
jeunesse" et j'ai un rôle au sein du groupe, celui de "faire
comprendre aux jeunes", de "gérer les comptes", de
participer à la "résolution des trucs qui vont pas".
2.3.1.2.2 Les identifications : symboles sociaux
En conservant toujours en filigrane dans notre analyse la
"métaphore de la solitude", nous avons relevé, dans les
entretiens, un certains nombre d'éléments,
développés ci-après, qui semblent nous indiquer des
processus d'identification, c'est-à-dire par lesquels un autre membre ou
un objet, de par ce qu'il est ou ce qu'il représente, sert de
référence à un autre. Par exemple, si nous devions retenir
seulement notre troisième interlocuteur, il identifie d'abord les
adultes qui encadrent les jeunes comme des pères de famille :
« Bon, ben y en a jamais un qui a levé la
voix, euh, parce-que avant tout c'est des pères de famille, la plupart,
bon, euh, il se trouve qu'on a un public jeune, ben on fait avec, on essaye de
comprendre. » (l.118)
Pour ensuite se substituer, "jouer" avec l'image du "bon
père de famille", celui auprès de qui on peut se confier, qui
comprend, qui élève, etc. :
« Leur enlever un petit peu la... comment dire
? ...la, la timidité peut être qu'ils peuvent avoir. Et pi
c'est pareil pour les personnes adultes qui se confient pas trop au sein de
leur famille et qui sont plutôt solitaire. » (l.125)
« Je peux apporter du réconfort quand une personne est pas
bien et qu'elle cherche un refuge pour... pour être un peu tranquille
parce qu'elle a... elle a subit une mauvaise journée. »
(l.170)
Constatons, au passage, que le public visé dans ces
"jeux" est celui d'un public que notre interlocuteur se représente comme
solitaire : « les personnes adultes qui se confient pas trop
au sein de leur famille et qui sont plutôt solitaire. ».
Ce commentaire nous permet de nous demander s'il ne s'agit pas là d'une
"réaction de compensation", d'une "substitution", qui consisterait
à déplacer sur une autre situation sa propre identité
sociale ?
Si nous devions continuer à rendre compte de cette
identification au père de famille nous pourrions faire part,
succinctement, des éléments suivants : le Pilote de branche
semble se substituer, quelquefois, à cette identification de l'image du
"bon père de famille" : toujours présent, sauveur.
« On apprend avec un pilote qui a beaucoup plus
d'expérience que nous. » (l.249) « On peut dire que
c'est, que c'est la personne qui va faire preuve de, de... qui va prendre du
recul et qui va faire preuve de discernement et de pi de perspicacité
pour essayer de comprendre les gens. » (l.274)
Ainsi, ce processus inconscient d'identification semble
être une donnée importante dès lors que l'on veut
s'interroger sur l'engagement des individus :
« Moi, je suis très content de venir au
Club et s'est d'ailleurs pour çà que je m'investis et que je fais
partie des Administrateurs. Moi, ça me plaît parce-que je me rends
compte qu'il y a des gens qui repartent après que je les ai aidé,
content. Le réconfort des autres c'est aussi très plaisant. En
plus c'est pas payant. » (l.369)
Nous avons pu relever, ainsi, cette identification à
l'image du "bon père de famille" auprès de cinq personnes
interviewées. De plus, comme pour la "métaphore de la solitude", nous avons
retrouvé ces articulations de repères d'identité sociale
et d'identifications avec la "métaphore de l'amitié", la
"métaphore de l'ambiance" et d'autres métaphores encore.
Pour synthétiser, le repère
d'identité sociale "la métaphore de la solitude" semble
être une élaboration sociale de la réalité dans
laquelle se manifeste le rapport à autrui par des énoncés
oraux en relation avec la conscience d'appartenir à un groupe.
L'identification, processus inconscient paraissant structurant
de l'engagement du membre, semble être un processus d'incorporation
à sa propre conduite des propriétés d'un modèle
valorisant son identité sociale.
2.3.2 Développer sa relation
sociale ou l'élaboration du sens
Maintenant que nous savons comment le membre semble prendre
connaissance d'autrui309(*) et comment il semble identifier, prendre conscience
de la part réelle310(*), voyons quel est le sens de son engagement qui
s'élabore. Pour se faire nous avons suivi deux axes qui nous ont
été indiqués par les entretiens et que nous allons
appeler "l'éclat de la parole" et "l'utilité sociale". Autrement
dit la communication et le bien commun.
2.3.2.1 "l'éclat de la parole" ou de la communication
à l'interrelation créative :
A maintes reprises, déjà, nous avons fait
état de règles relationnelles acceptées tacitement entre
les membres de cette association, le civisme qui se caractérisait par le
débat et l'écoute ; c'est-à-dire la communication.
Nous avons même approché une construction de sens du membre dans
ses relations. Fort de tout ce qui précède, nous pouvons aborder
une piste qui nous est apparue dans nos entretiens, sous-jacente de sens :
de la communication vers la relation sociale311(*). La personne suivante la résume en quelques
énoncés :
9è entretien
« Lorsque je suis arrivée dans cette ruche, où tout
était en l'air, y'avait des bureaux, y'avait des planches, y'avait des
fils qui pendaient de partout, et puis chacun arrivait, tombait le blouson,
prenait... bon s'occupait... qu'il y avait un branchement à
faire. » (l.488) « Fallait pas demander, fallait dire qu'il
y avait un branchement à faire » (l.494)
Ces énoncés nous indique que l'atmosphère
semble telle que la communication tacite qui s'y déroule
(« Fallait pas demander, fallait dire ») semble
permettre une relation sociale créative (« chacun
arrivait, tombait le blouson, prenait... bon s'occupait »). Mais
comment déterminer quels sont les éléments qui permettent
à des membres de s'investir avec enthousiasme et dynamisme alors que
rien n'apparaît dans l'analyse intentionnelle du sens ? Pourtant,
à travers la manière dont les adhérents expriment leur
perception de la communication dans cette association, nous avons pu
déterminer le rôle de celle-ci : un langage qui semble un
reflet de la structure des relations sociales.
2è
entretien « Les valeurs d'écoute, de
solidarité, de transmettre des connaissances, d'échanger,
d'accueil, deee... d'apport de connaissances, oui... d'aide... »
(l.163)
6è entretien L'esprit d'échange entre les individus, qui me
paraît, moi, être la source même du Club, en
fait. » (l.870)
7è entretien
« L'aide un p'tit peu, donc peut-être aider [...] Le club,
c'est un lieu de rencontres, d'échanges. » (l.78)
2.3.2.2 "L'utilité sociale" ou l'assurance de la
considération :
Dans cette association, il semble que le membre cherche son
sens dans ses actions, d'une part et en lui-même, d'autre part. En
d'autres termes il semble chercher une reconnaissance de ses actions et une
valorisation de lui-même. Pour nous clarifier, nous avons relevé
lors des entretiens que l'adhérent s'orientait vers des engagements, des
activités dont il semble penser qu'elles lui permettront de se
différencier des autres, par exemple le soutien psychologique...
2è entretien
« Mais il y a eu des moments... où...euh... deux fois j'ai...
`fin... chez G. je l'ai soutenu, une fois c'était M. Un fois ça a
été Gérard il a fallu aller le voir, on s'envoie des fax,
on se téléphone. Je crois qu'on a tous des moments. »
(l.549)
...ou bien la philanthropie...
9è entretien
« Le fait, peut-être de rendre service en hébergeant le
groupe au début de l'année... ça m'a fait
plaisir. » (l.351)
...ou encore une attitude ayant valeur d'exemple :
9è entretien
« Je suis en retard, et je ne voudrais vraiment pas arriver en
retard, parce-que je veux que le groupe ait plus d'exigences ! »
(l.691)
Ce sont ces types d'expressions, de mots utilisés et de
comportements qui semblent dire quelque chose sur le sens, qui semblent donner
du sens aux actions de l'adhérent. C'est-à-dire qui semblent
disposer les membres à la nécessité de se rencontrer...
1er entretien
« Un lieu, euh... où je me sens bien, où j'ai des amis,
ça m'ouvre sur des horizons disons, pas spécialement
informatique, mais sur des horizons nouveaux que je n'avais peut-être pas
pratiqué dans un autre club. » (l.100)
...à discuter, échanger :
1er entretien
« La relation, les échanges, les entraides, les...
Voilà, c'est ça, justement, tout. Ambiance, bon ben, quand on se
sent bien y a toujours, y a obligatoirement une bonne ambiance. Y a une bonne
ambiance. » (l.160) « Le bon point à mon avis la
tolérance, y a le contact, les discussions qui sont vraiment
possibles. » (l.451)
Ce pourrait-il que ce soit à partir de cela que la
configuration Compu's Club semble donner la possibilité de s'exprimer,
de sortir de l'implicite pour aller vers plus d'explicite et de
cohérence dans les rapports humains ? C'est-à-dire donner du
sens aux relations et aux interactions sociales ? Par exemple, nos
interlocuteurs, dans leurs discours, semblent accompagner l'autre de
l'assistanat à l'autonomie de manière plus ou moins consciente
permettant leur (re)structuration individuelle enrichie par l'identité
des autres. Autrement dit, un enseignement mutuel, valeur de l'éducation
populaire312(*) :
7è entretien
« L'esprit du club [...] l'esprit de l'association en
Général. la convivialité [...] les rencontres aussi. [...]
L'échange aussi donc, comme on fait donc au club, je connais quelque
chose, je t'apprends, tu m'apprends. » (l.43)
9è entretien
« Y'a des p'tits jeunes avec qui j'ai parlé, avec qui bon,
j'ai été invité à leur mariage, y'a une
amitié qui est née, des services rendus, en particulier, je
corrigeais les fautes d'orthographe, (rires), et de français, mais y'a
une réelle amitié, un échange qui s'est
créé. » (l.94)
Résumons-nous :
D'une part, le sens de l'engagement du membre qui
s'élabore semble partir d'une règle implicite, le civisme. Lequel
civisme semble autoriser le déroulement d'une communication implicite
générant des interrelations créatives de liens et de
sens.
D'autre part, le membre semble rechercher le sens de son
engagement dans ses actions (soutien psychologique, philanthropie, attitude
ayant valeur d'exemple) et en lui-même (nécessité de
discuter, d'échanger, etc.) par des valeurs (éducation
populaire).
En clair, le sens donné au terme de sens par les
membres interviewés semble être celui d'un ensemble
congruent de deux dimensions entre lesquelles on peut naviguer : le
civisme et l'éducation populaire, c'est-à-dire, les valeurs.
2.3.3 Confiance en l'autre, confiance en soi ou les processus de socialisation
A
partir des chapitres précédents, au cours desquels ont pu
émerger les facteurs majeurs de l'engagement313(*) des personnes
interviewées, les conditions favorables à leurs
relations314(*) et
l'élaboration du sens qu'elles semblent donner à leurs
interactions315(*), il
convient, pour circonscrire l'analyse, de rapporter ce qui paraît
être, à partir des entretiens, une base relationnelle
omniprésente et liante : la confiance. A la lecture des entretiens
effectués, nous avons pu en relever deux aspects. Le premier, serait
celui de la confiance inspirée : inspirer confiance...
2è entretien
« Je trouve comme moment fort c'est au moment où on cherchait
des sponsors. [...] j'ai trouver une photo où il y a MA (un sponsor). Il
est en photo qui donne un chèque à G. au Compu's. [...) j'ai
trouvé que c'était un moment très fort. Des gens qui nous
connaissent pas, qui nous font confiance et qui donnent du fric pour... parce
qu'on a été assez convaincant et puis il nous sentent
motivé, et puis ils y croient. » (l.492)
...le second, serait celui d'avoir confiance :
9è entretien
« L. (7è entretien, ndlr), par exemple qui a obtenu les clefs
du local, et qui était pas peu fier. » (l.389)
Mais si la confiance, d'un premier aspect, semble se donner
(avoir confiance) et se recevoir (inspirer confiance), elle paraît, par
extension, influencer les comportements des membres. C'est-à-dire
qu'elle semble engendrer une double orientation de l'adhérent. D'abord
du membre vers l'autre (les autres, l'association) que nous pourrions
caractériser par la droiture, être juste. Par exemple, la droiture
du membre envers l'association :
2è
entretien « J'ai eu l'occasion d'en avoir la
preuve. Même quand il y a des altercations [et qu']il y a un
déménagement, et bien y a pas un pelé, y en a quinze de
pelés. Et je pense que... y a des gens qui savent passer outre... leur
nombril pour... le but initial de l'association. » (l.103)
Ensuite vers le membre lui-même, c'est-à-dire une
morale comme ne pas trahir. Par exemple, l'association avait connu des moments
sans locaux, le membre suivant nous indique sa persévérance (sa
non trahison) grâce à une morale qui semblait lui indiquer ses
comportements316(*) :
1er entretien
« Les moments les plus forts [...] quand on n'avait pas de locaux.
[...] parce qu'il a fallu se battre, trouver, chercher, euh, essayer à
maintenir les gens qui avaient adhéré... euh, ce qui était
pas évident. » (l.375)
Ainsi, les adhérents du Compu's Club sembleraient
utiliser la confiance comme une relation, c'est-à-dire dans un sens
relationnel, et non pas comme un attribut. C'est-à-dire en tant que
relation qui orienterait les interrelations sociales et créerait du
lien : la confiance mutuelle : « ta confiance attire la
mienne ». Ci-après, dans ses propos, notre interlocuteur
semble indiquer qu'on peut lui faire confiance pour exécuter une
tâche ; inversement il sait, en cas d'empêchement,
« qu'on pourra s'arranger ». Il semble, par
là, indiquer sa confiance :
7è entretien
« [si]je peux pas aller à FTC, ou n'importe, je sais que
quelqu'un d'autre ira à ma place. Je sais qu'entre nous on
s'arrange. » (l.281)317(*)
Mais si le membre accorde sa confiance, c'est toujours en
croyant ou admettant que certaines conditions sont
réalisées ; celles des attentes empiriquement fondées
par lui-même. Par exemple celles qui imposent tacitement d'être
solidaire tout en restant libre...
2è entretien
« Avec, quand même en contrepartie C'est comme un engagement.
Tu viens dans l'association, mais... tu dois faire çà [...]
Même si vraiment je sais que je me sens très libre. »
(l.170)
...ou celles qui imposent tacitement un type de rapports
humains : l'union, par exemple :
6è entretien
« Le fait d'investir de son propre argent... et avec... avec les
risques que ça peut comporter. On peut avoir de la perte. Il va falloir
qu'on discute tous. Il va falloir qu'on trouve des solutions, en groupe. Y'a
encore l'esprit d'équipe qui va jouer là dedans »
(l.264)
La confiance exprimerait ainsi que, dans certaines
circonstances - celles qui pourraient fonder les relations sociales dans cette
association et permettre les interactions - le membre a de bonnes raisons de
traiter autrui comme un allié, un ami :
3è entretien
« Avant on peut dire que je faisais partie des jeunes qui
critiquaient, [...] Et moi je pense que ça m'a déjà
apporté un peu d'humilité et de confiance surtout, beaucoup de
confiance, [...] j'ai beaucoup plus d'assurance à parler avec les
gens. » (l.615)
6è entretien
« Un ami, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer
facilement, qu'on peut discuter facilement... on peut lui rentrer dedans, i dit
rien ou quand il se met en pétard, on arrête... (rires) c'est un
système relationnel qui permet de... de revoir des gens
régulièrement, de, de pas les oublier, de toujours les garder en
mémoire. » (l.190)
Cette amitié ne
semblant pas fondée sur un mouvement du coeur, mais sur une
bienveillance réfléchie, qui permettrait d'établir entre
les adhérents des liens de solidarité en tant qu'obligations
découlant de cette bienveillance :
3è entretien
« on parle de se qu'on a fait dans la semaine, déjà. On
partage un peu notre vie professionnelle. Bon, après, euh, c'est vrai
qu'on arrive à connaître un peu le cheminement de tous les gens,
euh, leur vie professionnelle, s'il y a eu un changement, s'il y a eu des
mutations, s'il y a eu un nouveau né dans la famille, si ils ont fait
une allergie ou quoi, des problèmes de santé, euh, `fin, c'est un
partage, en fait, gigantesque. »
(l.394)
Nous pourrions synthétiser ainsi :
Il est apparu lors des entretiens une base relationnelle
omniprésente et liante : la confiance en tant que relation.
Celle-ci semblant influencer les comportements de l'adhérent par la
droiture et une morale. Lequel adhérent semblerait, dès lors,
traiter autrui comme un ami bienveillant. Cette amitié semblant
créer des liens de solidarité.
Conclusion :
Ce troisième et dernier
chapitre de la deuxième partie a présenté les
caractéristiques des maturations de l'adhérent à travers
trois aspects :
û Le premier portait sur la construction des
représentations (la part symbolique) et des identifications (la part
réelle). L'engagement paraissant partir des besoins, rêves et
attentes dans les relations, le membre prenant conscience de son
identité à partir d'un "codage mental" simplifié et intime
révélant deux abords : les premiers, psychologiques,
paraissent mettre l'accent sur des énoncés
oraux d'élaboration de la réalité dans laquelle se
manifeste le rapport à autrui et la conscience d'appartenir à un
groupe. Les seconds, sociologiques, semblent se manifester par la structuration
de l'engagement qui autorise un processus d'incorporation de la conduite du
membre valorisant son identité sociale.
û Le deuxième aspect était relatif au
développement des interrelations et à l'élaboration du
sens. Les propos recueillis lors des entretiens semblent mettent l'accent,
à partir du civisme en tant que règle implicite, sur une
communication porteuse de sens entre et pour les membres dans leurs engagements
et leurs actions.
û Le troisième aspect de ce chapitre concernait
un relevé des processus de socialisation apparaissant par la confiance
en tant que relation. Cette confiance, active et passive (avoir et inspirer
confiance), semble orienter les conduites de l'adhérent vers des
comportements de droiture et de morale nous indiquant qu'il considère
l'autre comme un ami bienveillant. Ceci générant des liens de
solidarité.
Conclusion : Histoire(s)
d'être(s)
La seconde partie de ce document a
tenté de rendre compte d'une façon possible de restituer
l'enquête qui teste notre hypothèse318(*). En clair, nous avons
essayé de comprendre les causes et les raisons du changement des membres
du Compu's Club en partant des individus dans leurs dimensions collectives, de
leurs "histoires d'êtres", pour aller, tout au long de la
démarche que nous venons d'esquisser, nous situer du côté
du soi en société, de "l'histoire d'être" - par cela, notre
analyse pourrait être qualifiée de
phénoménologique319(*). Nous avons caractérisé ces histoires
dans leurs grandes variétés mais aussi dans ce qui fait leur
originalité : leur conformation.
Ce qui frappe de façon inattendue, d'un premier
côté, c'est non pas l'adhésion pour l'informatique mais la
motivation à s'engager dans des activités non TIC. D'un second
côté, c'est la similitude des mobiles à l'engagement,
à savoir la motivation personnelle du membre à réduire ses
propres ruptures sociales. Ruptures que nous avons pu noter comme
variées (solitude, conflit familial, rupture professionnelle, ...)
A partir de ce constat il a été facile de repérer une
réciprocité entre l'intensité de la (des) rupture(s)
sociale(s) et l'intensité de l'engagement. D'un troisième
côté, ce qui nous a paru intéressant de relever ce sont que
les désirs personnels du membre, ses charges familiales et sa
durée d'adhésion dans l'association influencent directement et
participent de ces engagements. S'il nous a été aisé de
classer les portraits dominants de nos interlocuteurs dans les
caractéristiques de trois profils320(*), ils n'en demeurent pas moins mouvants, fluctuants
au gré des situations et des circonstances.
Ces éléments que nous avons
récolté nous amènent à formuler une première
ébauche de configuration qui peut paraître encore, là,
primitive mais que nous préciserons dès l'introduction de la
troisième partie :
D'abord, le membre, en tant qu'individu, et le Compu's Club ne
paraissent pas en opposition. Ainsi le membre semble être une
entité intégrée dans l'association ; inversement
l'association serait intégrée aux individus321(*). Le tout présentant
"autre chose" que la somme des parties, c'est-à-dire une
interdépendance. Norbert Elias semble confirmer notre propos en nous
indiquant que « le concept d'individu se réfère
à des hommes interdépendants, mais au singulier, et le concept de
société à des hommes interdépendants, mais au
pluriel »322(*) Le tout ne semble pas être plus
valorisé que les parties même si le tout est plus important en
somme ou autre chose que les parties comme s'il s'agissait d'une
acculturation323(*)
"sauvage", "libre" mais "planifiée", d'un idéal, d'un
égrégore324(*) en somme.
Ensuite, cette interdépendance semble être une
interrelation entre des actions individuelles. C'est-à-dire que les
membres agissent les uns sur les autres et les uns par rapport aux autres en
même temps qu'ils participent à la structuration de leur propre
personnalité au Compu's Club. Ainsi, ont pu être mis en exergue
des sentiments individuels positifs de possibles, de bien-être et
d'appartenance. Ces caractéristiques attribuées permet au membre
de donner une forme à ses relations et considérer l'association
en tant qu'espace de relations formant du lien social. Dans un premier temps,
dès lors qu'un projet est en adéquation avec les désirs
personnels du membre il apparaît des interrelations basées sur le
partage et la solidarité. Participe de cette configuration,
l'autorité tacitement acceptée du Pilote du projet. La
représentation du Pilote lui confère la légitimité
nécessaire et le pouvoir utile à l'organisation autonome et
responsable du projet. Chaque individu cherchant sa valorisation par la
reconnaissance de sa position qu'il recherche de plus en plus centrale. Un code
d'action commun, c'est-à-dire les valeurs de respect, d'échange,
d'entraide mutuelle, de camaraderie, d'écoute, ..., subjectivement
attribuées définissent une éducation mutuelle, solidaire
et créatrice d'activité. Autrement dit un ethos, selon Max
Scheler.
Enfin, il semble que cette interdépendance
présente des formes spécifiques qui relient des membres entre
eux. Par exemple, toute action accomplie dans une relative indépendance
représente un "coup" dans les actions communes tels que les projets des
branches. Ce "coup" déclenchant inévitablement un "contrecoup"
d'un autre membre limitant la liberté d'action du premier membre.
Là encore, notre modèle d'analyse nous a guidé
(Elias) : « comme au jeu d'échecs, toute action
accomplie dans une relative indépendance représente un coup sur
l'échiquier social, qui déclenche infailliblement un contrecoup
d'un autre individu (sur l'échiquier social, il s'agit en
réalité de beaucoup de contrecoups exécutés par
beaucoup d'individus) limitant la liberté d'action du premier
joueur. »325(*) Le civisme et l'éducation populaire,
règles implicites, semblent porteurs de communications et
d'interrelations, donnant du sens à l'engagement par des attitudes ayant
valeur d'exemple ou de soutien moral et répondant à la
nécessité de discuter, d'échanger, d'apprendre du membre,
de traduire son ressenti intérieur par la parole. Ce qui introduit un
corollaire : le devoir d'écouter l'autre activement, surtout
lorsqu'on est positionné différemment, afin de préciser
les éléments en communs même si cela ne signifie pas
nécessairement comprendre. Pour synthétiser, le membre qualifie
le sens donné à ses actions (ses "coups") comme un ensemble
pertinent de deux dimensions liées entre elles : l'identification
et les valeurs. A cela se rajoute l'influence d'une base relationnelle
omniprésente et liante : la confiance. Les comportements du membre
tendent, par cela, à traiter l'autre comme un ami bienveillant. Cette
amitié créant des liens dynamiques de tolérance et de
solidarité.
Ainsi, bien qu'il soit difficile d'en décrire les
structures, les individus agissent et réagissent les uns par rapport aux
autres, acceptant ou s'adaptant, à partir de ses propres désirs,
pour vivre harmonieusement au Compu's Club. En d'autres termes, ces structures
semblent être un élément de la nature du membre, de sa
personnalité corrélativement développé avec les
circonstances et les situations sociales bien précises auxquelles il est
confronté. Ceci nous révèle une configuration de jeux
d'acteurs. C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir dans la
troisième partie : jeux, tactiques et stratégies.
TROISIEME PARTIE
TROISIEME PARTIE
DU BESOIN AUX ASPIRATIONS :
JEUX, TACTIQUES ET STRATEGIES
3. Du besoin aux
aspirations : jeux, tactiques et stratégies
Les résultats du
traitement du corpus montrent que la raison d'être de la participation
des adhérents dépasse le motif d'adhésion,
c'est-à-dire la pratique de l'informatique. En effet, si
l'adhérent participe, voire renforce sa participation, c'est parce-que
l'activité pratiquée va lui permettre de satisfaire des attentes
personnelles : reconnaissance de soi, appartenance à un groupe,
recherche de liens, par exemples.326(*)
Cherchant à décrire ce qui se passe entre les
individus au sein du Compu's Club, et plus particulièrement au sein des
différentes branches, nous nous sommes intéressé aux liens
entre individus, aux projets qu'ils pouvaient mener, aux valeurs qu'ils
pouvaient partager. Nous avons pu montrer que ces besoins étaient
compris dans les dynamiques relationnelles. En d'autres termes, la satisfaction
de ces besoins a pu être observée dans deux cas de figure. Dans un
premier cas de figure, l'adhérent réunit des circonstances
nécessaires à la satisfaction de ses attentes pour s'en emparer.
Il investit, ainsi, dans la dynamique relationnelle pour en jouer. Avec le
deuxième cas de figure, l'adhérent peut trouver dans les
dynamiques relationnelles les circonstances nécessaires à la
satisfaction de ses besoins. Sans s'en emparer, il profite, néanmoins,
des circonstances qui sont réunies, il les laisse jouer.
L'engagement de l'adhérent semble donc guidé par
la satisfaction de ses attentes, de ses besoins. Nous avons relevé que
les besoins à satisfaire n'ont de sens qu'en étroite liaison avec
la nature et l'importance que l'adhérent leur donne. Ce qui suppose de
tenir compte d'une certaine hiérarchie des besoins chez les divers
adhérents interviewés. Cette hiérarchie des besoins varie
suivant les satisfactions visées et se relie directement à la
hiérarchisation des valeurs auxquelles ils sont inconsciemment
attachés, qui les dirigent. En fait, cette hiérarchie des besoins
est celle dont la satisfaction permet à l'adhérent de progresser,
d'atteindre un état supérieur sans qu'il s'en rende compte. Par
exemple, l'adhésion à un projet de branche correspond à un
changement de comportement passant de l'intérêt à la
participation, entraînant une modification de l'échelle des
valeurs. Ainsi, en se référant à la théorie
d'Abraham MASLOW, l'adhérent trouve, à travers sa participation
« les racines de la satisfaction de ses besoins personnels par
les contreparties que lui apporte l'entreprise »327(*) (en l'occurrence, ici,
l'association ou la branche). Pour Maslow, la notion de besoin est proche de
celle de valeur ; les valeurs sont vues comme des représentations
cognitives des besoins. Pour simplificatrice qu'elle soit, la pyramide de
Maslow propose une hiérarchisation par émergence. A chaque fois
qu'un niveau de besoin est atteint l'homme cherchera à satisfaire le
niveau supérieur. Il pose la "réalisation de soi" comme la clef
de voûte de toute vie psychique : « un processus de développement personnel,
de réalisation de soi, se déclenche chez l'individu et l'anime
d'une manière dynamique. » Mais, pour Paul-Henry CHOMBAT
DE LAUWE il serait « vain de parler des besoins des hommes sans
tenir compte de leurs aspirations, de leurs intérêts, de leurs
systèmes de représentations et de
valeurs. »328(*) En clair, ce seraient moins les besoins que nous
devrions prendre en considération que les aspirations. Nous envisageons
donc compléter immédiatement la notion de besoin selon Maslow par
la notion d'aspiration de Chombart de Lauwe. Parce-que, s'ouvrir à la
théorie des aspirations permettra de faire ressortir les motivations les
plus profondes des adhérents, c'est-à-dire leurs désirs,
leurs espoirs et leurs espérances. Dans cette perspective, chemin
faisant, nous saisirons dans quelle mesure l'association, les micro-groupes,
les projets menés, les relations interpersonnelles, les interactions
sont capables d'y répondre.
La satisfaction des besoins-aspirations est donc un
élément constitutif de la participation de l'adhérent.
Mais, cette satisfaction des besoins-aspirations s'effectue dans les dynamiques
relationnelles et leurs articulations.329(*) Ce qui veut dire qu'elle se déroule dans les
interactions ; particulièrement sous la forme de dépendances
d'intérêts communs et de réciprocité. C'est pourquoi
la participation des adhérents, au regard des travaux de Norbert ELIAS,
peut-être posée en termes de
« dépendances réciproques qui lient les
individus les uns aux autres. »330(*) En même temps, par la
façon dont l'adhérent se donne à voir, par l'image
donnée de lui-même, par une attitude simulatrice de soi, il
obtient une sorte de maîtrise de ces dépendances. Il joue avec
l'information qu'il donne de lui-même. Ceci pose la question de la place
que l'adhérent s'accorde dans un jeu dynamique de relations,
d'adhésion à des valeurs, de participation, bref, de
dépendances réciproques. Les travaux d'Erving GOFFMAN nous
éclaireront à partir des façons d'être et de faire
de l'adhérent, de ses manipulations dans le rapport aux autres.
Goffman s'est intéressé « au maniement et
au contrôle de l'image que les individus donnent d'eux-mêmes dans
l'accomplissement de leurs activités et de leurs rôles ainsi
qu'aux moyens qu'ils utilisent pour mettre en scène ce
jeu. »331(*). Donc, nous envisageons chercher à comprendre
la participation des adhérents, non seulement, en termes de
dépendances réciproques mais aussi en termes
d'« information que l'individu transmet directement à
propos de lui-même. » ; individu capable de
« manipuler de l'information concernant une
déficience. »332(*)
Mais si l'adhérent manipule les informations qu'il
transmet sur lui-même il le fait dans des instants d'échanges. Ces
instants sont des temps, des moments mis à profit dans une visée
de représentation de soi, de présentation de soi. Ces temps
privilégiés inaugurant finalement un espace, non pas comme une
délimitation spatiale, mais comme circonstance d'un possible, d'autre
chose. Ainsi, ces instants créent du sens par un espace, une sorte de
lieu qui est distance et dans lequel l'adhérent peut "fabriquer,
braconner, élaborer, tricoter, manipuler, bricoler"333(*) (Cf. Certeau) les pratiques
nécessaires à la satisfaction de ses besoins. Bref, si
l'adhérent use d'un espace c'est pour exercer une action sur cet espace.
Nous intéresser à ces lieux d'investigations, d'aventures, de
combats où l'adhérent peut lutter, relever les défis,
oeuvrer avec les autres nous a permis de noter des manières de faire
proches de la stratégie ou de la tactique. Le changement constaté
de l'adhérent ne sera donc pleinement compréhensible que si nous
le pensons, à l'instar de Michel de CERTEAU, en termes de
« manières de faire (de marcher, de lire, de produire, de
parler, etc.). »334(*) Parce-qu'« il faut s'intéresser
non aux produits culturels offerts sur le marché des biens, mais aux
opérations qui en font usage ; il faut s'occuper des
"manières de marquer socialement l'écart opéré dans
un donné par une pratique" ». Cela va nous apporter la
possibilité d'envisager la participation de l'adhérent en termes
d'usage des circonstances335(*) créées par les dynamiques
relationnelles. Cette orientation a l'avantage de surimposer aux perspectives
élasienne et goffmanienne les usages de cet espace par
l'adhérent, c'est-à-dire « sans sortir de la place
où il lui faut bien vivre et qui lui dicte une loi, il y instaure de la
pluralité et de la créativité. Par un art de l'entre-deux,
il tire des effets imprévus. »336(*) Nous pouvons ainsi supposer
que la piste s'inscrit dans le mouvement, le changement permanent ; qu'il
se joue des opérations multiformes et fragmentaires, des manières
de faire toujours changeantes en fonction des circonstances. En fait, il s'agit
là d'une configuration (complexe) au sens où Norbert Elias
l'entend337(*). Ainsi
notre hypothèse de recherche (Plus un individu use, dans une
configuration, de manières de faire, plus cet individu accède
à un statut d'individu.) nous oriente dans une perspective
certeausienne.
Dès lors, la question de fond est : comment la
participation des membres s'inscrit-elle dans un jeu de relations qu'ils
contribuent à former et changer ? Et à partir de là,
déterminer comment cette construction, ces changements se fondent dans
une similitude de projet sur des différences de coups ? Enfin,
comment se réalise l'émergence d'un je sans cesse
renouvelé sur la base d'un ensemble multiple de coups joués, de
je ? Autrement dit, les travaux de Certeau nous indiquent qu'il doit y
avoir une logique de ces pratiques, de ces usages des circonstances. Logique
que nous allons essayer progressivement d'exhumer dans cette troisième
partie.
3.1 Aspirations et dynamiques de
changement
Jusqu'à présent nous avons rapporté les
explications données par l'adhérent quant à sa
participation aux activités du Compu's Club. Il s'avère que la
raison d'être de son engagement est commandée par la recherche de
la satisfaction de besoins personnels. Nous avons abordé, ensuite, les
dynamiques relationnelles qui reliaient ou pas les participants entre eux pour
souligner qu'elles représentaient la forme, l'espace, le lieu dans
lequel l'adhérent pouvait construire cette recherche de satisfaction.
Nous avons, alors, décrit que l'adhérent investissait ou
profitait des circonstances pour y parvenir, se trouvant ainsi dans une
relation de type socio-économique avec les autres membres, d'une part,
et avec l'association, d'autre part. Nous allons expliciter cette notion de
besoin. Pour rendre intelligible leurs processus de satisfaction au sein
même des activités des adhérents il nous semble
nécessaire de nous appuyer dans un premier temps sur les travaux du
psychologue Abraham Maslow parce-qu'il a centré ses explications de
l'activité comportementale sur le rôle fondamental de cette notion
de besoin.
Les besoins assureraient les orientations de l'individu vers
l'obtention de buts spécifiques338(*). Ainsi, Maslow a construit une
hiérarchisation des besoins sur cinq niveaux339(*). Nous laisserons de
côté le premier niveau, les besoins primaires, lié à
des déterminants physiologiques340(*) pour ne retenir que les besoins
secondaires341(*), dont
la spécification est la plus intéressante pour la suite de ce
travail parce-qu'ils résultent de l'expérience et des habitudes
acquises par l'adhérent dans l'environnement Compu's Club.
3.1.1 Des aspirations à la
satisfaction des besoins : ce qui pousse à agir
Lorsqu'un niveau de besoin est atteint l'individu cherchera
à satisfaire le niveau supérieur. Ce qui signifie qu'à
chaque fois qu'un niveau de besoin n'est pas satisfait, l'homme se raccrochera
au niveau immédiatement inférieur. Mais la validité de ce
classement hiérarchique n'a pu être vérifié en
pratique ; comme nous allons le voir, la réalité n'est pas
aussi statique. Elle présente des va-et-vient entre les
différents besoins. Cependant, ce classement constitue un instrument
méthodologique que McGrégor et Peter Drucker342(*) ont utilisé pour
élaborer la notion de direction par objectifs plutôt que par
contrôle. Ce principe inspirera, aussi, vingt ans plus tard Inglehart
dans ses travaux sur le post-matérialisme et Paul-Henri Chombart de
Lauwe343(*) qui a
cherché à établir une sociologie des aspirations. Ce sur
quoi nous reviendrons au cours des pages suivantes. Comme eux dans leurs
recherches, nous garderons la présentation habituelle sous forme de
pyramide de la hiérarchie des besoins de l'homme définis par
Maslow car elle facilite notre compréhension initiale et nos
interprétations.
Echelle de la
hiérarchie des besoins selon Maslow dite "pyramide" de
Maslow
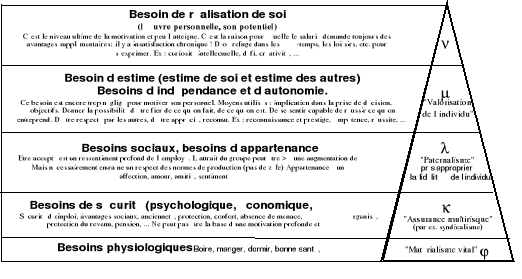
La pyramide de Maslow nous permet de situer dans sa
hiérarchisation, les besoins des adhérents interviewés.
Pour nous expliquer nous aborderons la notion de confiance ; parce-que
nous avons pu constater que la satisfaction des différents niveaux de
besoins de cette hiérarchisation se déroule chez
l'adhérent dans un climat de confiance et aboutit à un
résultat efficace en terme de quantité, qualité et
délai. De plus, la confiance semble être un supra besoin, une
condition à satisfaire réciproquement d'autres besoins. Ce qui va
nous permettre d'élargir nos interprétations sur des besoins dont
la satisfaction conditionne d'autres besoins. La confiance a été
un élément souvent énoncé par les adhérents.
Ici, dans le contexte relativement circonscrit de l'association, de la
confiance, nous pouvons donner deux interprétations des conditions de sa
réalisation. L'une à connaissance consciente, sanctionnée
par les attentes fondées de l'adhérent, par exemple, la
reconnaissance d'un projet mené. L'autre qualifiant un certain type de
rapports humains. Par exemple, une forme d'amitié bienveillante
autorisant des liens de solidarité sans obligatoirement aller
jusqu'à l'intimité. La confiance s'établissant par le
moyen d'échanges particuliers (obligations, solidarité, par
exemples) définies par des relations asymétriques que chacun
occupe dans l'association. L'une et l'autre de ces explications conduisant
l'adhérent, dans l'association, à satisfaire un besoin
relationnel. Pour résumer, si un climat de confiance est présent
(satisfait) il devient possible de s'engager dans un (des) projet(s) et/ou
rendre possible la satisfaction d'un besoin de lien social lui même
basé sur la recherche de satisfaction d'un besoin d'échanger.
C'est au fond l'argument de Maslow : satisfaire un niveau de besoin afin
de pouvoir passer à un niveau de besoin supérieur. Mais
réciproquement, cet échange est aussi attente. L'adhérent
attend de celui avec qui il est en interaction qu'il agisse dans un cadre
définit par sa position, son rôle. C'est ce qui est
désigné par les adhérents interviewés lorsqu'ils
parlent de leurs idées, présentent leurs projets.
La confiance au Compu's Club est, en résumé, une
condition à la satisfaction de relations d'échanges de
l'adhérent. Ainsi, la relation d'échange devient indispensable
pour comprendre le phénomène de changement parce-que sa
réciprocité est conditionnée par la condition de confiance
en tant qu'elle est attente, vis à vis de l'autre, du respect des
règles connues des deux. La confiance comme une assurance, en quelque
sorte ; l'assurance du respect des règles. C'est la raison pour
laquelle le rejet des règles exclut celui qui se rendrait coupable de
transgression : « ...c'est vraiment quelqu'un qui est contre
l'esprit du groupe [...] Il n'avait pas du tout envie de partager. Il n'est pas
resté. »344(*) Nous voyons là une sorte de "code interne" du
comportement.
Mais si les relations entre les adhérents peuvent
être réglées par l'échange basée sur la
confiance, peut-on les comparer aux relations entre micro-groupes (les
branches) ? Ainsi, si les besoins de sécurité psychologique
de la pyramide de Maslow (niveau )345(*) « ne peuvent pas être la base d'une
motivation profonde et prolongée. »346(*), l'originalité de
l'environnement organisé en branches du Compu's Club peut être
situé au niveau de cette hiérarchisation : "besoins
sociaux, besoins d'appartenance". Parce-que, ce que semble voir
l'adhérent de cette association est une réponse à ses
besoins d'appartenance à un groupe, ici les branches,
c'est-à-dire à des micro-groupes347(*), voire à l'association aussi ou seulement. A
plusieurs reprises, au moment des entretiens, l'adhérent a
exprimé cette appartenance348(*). Dans certains cas, c'est l'étiquette
informatique même qui autorise un sentiment d'appartenance349(*). A partir de là, nous
pouvons voir cette appartenance micro-groupale (que d'autres appelleraient
tribale350(*) ou
unité de vie sociale) comme un « idéal
communautaire »351(*), une reconnaissance à satisfaire. Cette
organisation communautaire idéale permet, dès lors, une double
communication : intra-branches (de membre à membre) et
inter-branches (de branche à branche). Ainsi, le besoin de relation ne
se limiterait pas seulement à la satisfaction d'un besoin
d'échange mais s'élargirait sur un besoin de communication en
tant qu'échange352(*). Ce qui veut dire au fond, la satisfaction des
besoins d'échanges et de communication fusionnent pour satisfaire un
besoin de relation. Sur cette idée, John Adair353(*) ne distingue plus le but
d'un projet et l'individu. Il inventorie les besoins de chaque projet selon
trois orientations intimement liées : 1) les besoins du projet,
c'est-à-dire, définir, organiser, attribuer les tâches,
contrôler la qualité et le rythme, 2) les besoins du groupe,
c'est-à-dire, être un exemple personnel, discipline, esprit
d'équipe, motivation, responsabilisation, communication, formation du
groupe et 3) les besoins individuels (valorisation, connaissance de chacun,
utilisation des capacités personnelles, formation). Une telle fusion
comprend entre autres : l'institutionnalisation du dialogue, une
définition précise des tâches, une information rigoureuse,
la fixation d'un ordre de distribution354(*) de celles-ci, le renouvellement de certaines
fonctions, comme l'élection (ou l'émergence informelle) du pilote
de la branche.
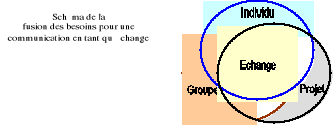
Schéma de la fusion
des besoins pour une communication en tant qu'échange
Ce schéma fait apparaître que les relations au
sein de cette association s'inscrivent dans une interaction satisfaisant leurs
besoins de communication en tant qu'échange. Cette interaction, consiste
en une multitude de situations où les adhérents sont plus ou
moins positionnés et/ou en attente/recherche de participation.
Simultanément, ces comportements prévoient évidemment
l'élaboration d'un "code externe" définissant les rapports de la
branche avec l'ensemble de l'association voire avec l'extérieur. Les
points importants sont 1) reconnaître, ici, le caractère
interactif de la branche et 2) susciter aux participants un comportement qui se
conforme à ces codes (internes et externes). Suscitation exercée
par le truchement de valeurs englobantes, celles de l'association Compu's Club,
c'est-à-dire ses valeurs fondatrices : entraide mutuelle et service
bénévole355(*). Pour exprimer différemment ce dernier point,
bien qu'il y ait une distinction de l'association en plusieurs branches qui
suivent leur propres règles et qui ont une certaine autonomie les unes
vis-à-vis des autres, l'image perçue des valeurs du Compu's Club
a la pouvoir d'intervenir et d'influencer les relations à l'intérieur de
l'association et des branches. Ceci étant possible parce-que les besoins
sont satisfaits dans le cadre d'échanges fondés sur une relation
de confiance de qualité (code interne) dans cette association qui donne
les moyens, forme une contingence, pour que cet échange existe (valeurs
englobantes).
Si nous avons mis en évidence une corrélation
entre l'organisation de cette association et un « idéal
communautaire » dans les branches, elle nous permet seulement de
la voir en tant que psychologie de métavaleurs et
métabesoins356(*)
de l'adhérent : la confiance, les échanges, la
communication. Ainsi, par là même, cet adhérent pourrait
être vu plus passif qu'actif. C'est-à-dire, qu'il pourrait
être considéré dans ses changements uniquement au travers
de choix successifs liés à des intérêts plus ou
moins grands. Or, il est constaté particulièrement actif dans ses
changements. Ceci s'est présenté dans les entretiens lors de
situations où un même besoin peut s'énoncer, s'affermir et
s'opérer graduellement.357(*) Ici, se pose, donc, le problème de la
satisfaction des besoins de l'adhérent ou plus exactement la
réalisation de ses aspirations. Nous voulons dire par là,
l'espérance de voir se réaliser ses aspirations. Chombart de
Lauwe définit l'espérance en tant qu'elle :
« correspond à une attitude globale de tout l'être
qui, au delà des désillusions et des espoirs déçus,
garde une raison de vivre malgré les échecs qu'il
rencontre. »358(*) Espérance qui est donc (en même temps
qu'elle permet) une dynamique à connotation positive (en l'occurrence
l'engagement, la motivation) et autorise l'adhérent à s'engager,
c'est-à-dire à faire évoluer ses attitudes et
comportements. En un mot, changer. Autrement dit, les aspirations peuvent jouer
un rôle dans l'évolution des relations à l'intérieur
d'une branche. L'adhérent "entre" au Compu's Club d'abord parce-qu'il
aspire à utiliser l'informatique, étiquette avant-gardiste,
à la pointe de la technologie, voire de prestige ; puis, à
la suite d'un faisceau de situations et circonstances vécu tant
personnellement que lié à l'association même, émerge
l'aspiration à des activités, des responsabilisations ;
aspire, en fait, à appartenir à un groupe intime. C'est du moins
l'image qu'il en donne : une famille, un village, une communauté.
Mais alors qu'est-ce qui motive ces aspirations ? Pour suivre Maslow,
c'est la satisfaction des besoins du niveau 359(*) qui va permettre de le motiver. Ce besoin utilise
des moyens comme l'implication dans la prise de décisions, des projets,
donner la possibilité d'être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on
est, de se sentir capable de réussir ce qu'on entreprend, d'être
respecté par les autres, d'être apprécié, reconnu,
etc. Dans cet objectif, il faut se demander comment l'adhérent
expérimente ses propres valeurs comme objectif de changement. Ici, nous
pouvons faire place à une vision globale des aspirations, qui inclut,
non seulement les aspirations matérielles, mais également les
aspirations sociales et de pouvoir. En substance,
- sur le plan matériel, l'adhérent changeant
aspire à des conditions matérielles qui développent ses
possibilités de développement personnel : le matériel
informatique, l'accès aux NTIC, ...
- sur le plan social, l'adhérent souhaite l'estime, la
reconnaissance de son engagement et de ses efforts, l'amitié, ainsi
qu'un climat humain environnemental positif, de confiance ;
- sur le plan du pouvoir, l'adhérent souhaite
comprendre ce qu'il fait, participer à l'orientation de ses
activités, à leur organisation ainsi qu'au contrôle des
résultats de son ouvrage. Maslow360(*) affirme qu'une fois ces aspirations satisfaites,
« un processus de développement personnel, de
réalisation de soi, se déclenche chez l'individu et l'anime d'une
manière dynamique. »361(*) Celui-ci entre alors dans la maturité et
adopte un comportement d'adulte. C'est ce que nous avait suggéré,
sur le plan philosophique, Nietzsche dans "les trois
métamorphoses"362(*) et que nous adaptons dans ce travail pour la
cohérence de notre interprétation. L'adhérent (l'enfant de
Nietzsche, c'est à dire l'adulte en devenir) est capable d'agir sur la
réalité extérieure et maîtriser son
environnement ; il soumet son action à l'épreuve des
faits ; il unifie sa personnalité par son oeuvre ; il n'y a
plus d'écart entre le réel et la vision qu'il en a, il n'y a plus
d'écartèlement entre ses aspirations et son ouvrage.
L'adhérent est alors capable de construire, de créer ; et
cette capacité est essentiellement dynamique. C'est ainsi que
l'adhérent, qui remplit une mission volontairement choisie (en
conséquence, dont il s'est rendu responsable), entre dans un processus
de développement continu : il fixe plus haut l'objectif suivant et
ainsi de suite jusqu'à la pleine utilisation de ses
possibilités363(*). Il change ! De la même manière,
les conditions du comportement de maturation (maturité) se
ramènent à la notion de responsabilité. Pour paraphraser
Nietzsche : l'homme qui ne peut être responsable risque de ne
jamais devenir un adulte, mûrir (évoluer donc changer). Mais,
l'exercice de la responsabilité suppose une certaine autonomie, une
liberté dans le choix des moyens, une compétence suffisante et
une possibilité de la développer, un certain contrôle sur
les résultats de son travail. Dans les entretiens, ces différents
points de liberté, autonomie et responsabilité (qu'il faut
comprendre, ici, en tant que choix), sont apparus de façon
récurrentes.364(*) Ainsi, dans leur engagement, les adhérents
constatés changeants, font ressortir l'absence de divergence entre les
aspirations personnelles et les possibilités offertes par le Compu's
Club et les projets menés par les branches. Ce qui témoigne de
l'adéquation ou de l'influence de l'organisation de
l'association365(*),
d'une part ; celle des représentations de l'adhérent et des
systèmes de valeurs366(*) du micro-groupe, d'autre part.
Il est dès lors possible de faire un premier inventaire
des besoins-aspirations de l'adhérent changeant : reconnaissance et
appartenance, autonomie et liberté, responsabilité. Ces
besoins-aspirations correspondent, dans notre enquête, soit à des
éléments extérieurs, comme l'étiquette informatique
ou la liberté de choisir sa participation à un projet ; soit
à des éléments subjectifs, tels la perception, le
raisonnement et l'action de manière à transformer une situation
existante ; soit les deux : extérieurs et subjectifs.
Paul-Henri Chombart de Lauwe suppose l'intégration sociale par une
« aspiration à la considération » et
« un besoin de ne pas être
déconsidéré. »367(*) A la reconnaissance se
superpose « une aspiration à passer à un
état jugé par lui [(l'adhérent)]
supérieur, à obtenir des objets ou un statut auquel il ne pouvait
pas jusqu'ici prétendre. »368(*) Les aspirations de
l'adhérent changeant sont orientées par des images, des symboles
liés à des représentations. En d'autres termes, les
besoins sont des pulsions et les aspirations des désirs369(*), des souhaits. Les uns,
venant de l'adhérent lui-même ou par rapport aux pressions
environnementales, les autres, sont tournés vers un but. Pour mieux
l'exprimer : un projet d'avenir qui prend forme à partir de besoins
non satisfaits d'une part, c'est-à-dire de « l'attraction
vers des objets perçus, représentés ou
imaginés »370(*), et d'autre part, qui fournit des buts à
l'adhérent en tant que sujet-agent individuel et social. Buts
formés, entretenus et réalisés en interaction avec
l'environnement Compu's Club. C'est-à-dire, le milieu associatif
particulier de cette association qui « fournit l'univers des
symboles et des valeurs par lesquels s'élaborent, s'expriment et se
diffusent les aspirations chez les personnes et dans les
collectivités »371(*) (en l'occurrence l'association). Ce milieu
étant « à la fois le milieu qui provoque
l'éclosion des aspirations, qui les entretient et les diffuse, et aussi
le lieu de leur réalisation ou de leur
frustration. »372(*) En ce qui concerne plus spécifiquement les
aspirations individuelles, nous pouvons définir celles-ci comme des
projets que forment les adhérents (quelquefois formulent) et qui les
motivent précisément à poursuivre leurs projets. En clair,
l'enquête a révélée que l'adhérent satisfait
de ses aspirations au présent pourra ne pas aspirer aller plus loin dans
ses projets373(*). Cette
traduction s'effectuant dans le but de s'assurer une socialisation374(*) ou encore de
développer des aptitudes375(*), à moins que ce besoin ne paraisse trop grand
à l'adhérent, trop difficile à réaliser376(*). Mais à l'inverse,
comme l'exprime Guy Rocher, « le milieu socioculturel
présente aussi des contraintes, des obstacles, des empêchements
aux aspirations. » Ainsi, la nécessité d'obtenir
un écho à ses désirs constitue une de ces contraintes
à l'élaboration ou au maintien de ses aspirations. C'est en
cherchant les qualités heuristiques de ce concept d'aspiration autour
duquel peut s'organiser les interrelations que nous avons tenté une
interprétation du rapport entre l'adhérent et ses
représentations. Dans notre enquête, l'aspiration est
participation. A partir de là, elle est révélatrice de
rapports entre l'individu et la société. Alors, même si
l'adhérent porte377(*) un intérêt au cadre informatique de
l'association, pris dans son sens le plus large, son intérêt
personnel peut être tourné aussi bien vers des activités,
bien sûr non TIC comme relevé dans notre enquête, mais
aussi, culturelles ou philanthropiques, c'est-à-dire,
désintéressées, comme le soulignent, sans exception, tous
les adhérents interviewés. Mais n'oublions pas qu'un
intérêt porté dépend de la valeur attribuée.
Par cela, l'adhérent devient changeant. C'est-à-dire
« à travers les choix successifs liés à des
intérêts plus ou moins grands, dans des situations
différentes, une même aspiration peut se préciser, se fixer
et se réaliser progressivement. »378(*)
Nous venons de voir que les aspirations des adhérents
se rattachent au désir et à la valeur en liaison avec la
représentation. La réalisation des aspirations doit
nécessairement s'effectuer dans une mise en projet. Cette mise en projet
lui permet de participer à la vie de l'association. Participation
caractérisée par des interactions et des interrelations sociales.
A partir du cadre d'analyse, du terrain et nous appuyant sur ce que nous avons
développé précédemment, nous pouvons supposer que
les aspirations des adhérents se modifient en fonction de trois notions
qui peuvent paraître au premier abord successives mais qui sont, en fait,
entièrement liées entre elles : « les
désirs, les espoirs et l'espérance »379(*). Plus
précisément, dans notre enquête : 1) le désir
de reconnaissance et d'appartenance à un groupe, 2) l'espoir de
développer un projet en relation avec une histoire individuelle et 3)
l'espérance d'être ou de conserver un état d'être
pour « garder une raison de vivre malgré les échecs
rencontrés. »380(*) Nous allons effectuer ici une interprétation
de ces trois notions.
3.1.2 Aspirations de
l'adhérent : trois notions successives ?
Pour décrire ces trois notions de désir, espoir
et espérance, nous allons nous appuyer sur trois situations mises en
évidence dans les entretiens. Chacune rendant compte de chacune des
notions. Sachant qu'une notion doit pouvoir s'identifier indépendamment
de l'exemple nous établirons une définition de chacune d'entre
elles à la fin de chacune des sections et un récapitulatif les
reliant à la fin du chapitre.
3.1.2.1 Les désirs : une raison du
bien-être
Pour Chombart de Lauwe, « des objets [...]
peuvent prendre une importance telle que leur absence déclenche des
gestes de désespoir ou fasse naître une attitude de
désespérance. »381(*) La branche CAO382(*) à laquelle appartient le couple
interviewé383(*)
en est un exemple significatif.
Cette branche n'existait pas ; l'idée est venue
aux Pilotes (le couple entendu en interview) de partager leur passion
personnelle : faire des cartes de visite.384(*) En réalité,
ils avaient le désir de partager une passion mais l'espoir que d'autres
la partageraient. A la création, tous les espoirs étaient
permis ; rapidement une équipe de cinq membres s'était
constituée. La création du logo de la branche devait être
« le point de départ » afin
« d'exister physiquement ». Chacun était
« motivé et plein d'idées ». Mais,
« très vite on s'est retrouvé à trois puis,
peu de temps après, à deux. »,
c'est-à-dire, le couple-Pilote. Par la suite, piloter cette branche est
devenue pour eux une obligation engendrant une
« lassitude ».385(*) L'enchaînement des faits dans le temps
ont abouti à l'expression de regrets, remords et reproches
caractérisant leur déception de n'avoir pas pu échanger,
communiquer avec les autres membres qui manifestement avaient d'autres
désirs.386(*)
En clair, pour le couple-Pilote de ce micro-groupe, le
désir de réaliser des cartes de visites était
exercé en fonction d'une représentation globale axée sur
l'utilisation du monde informatique (image avant gardiste, de prestige). Mais
à cela s'impose des motivations plus profondes ; celles
liées à un désir plus lointain de rencontrer d'autres
adhérents et d'échanger avec eux sur leur passion personnelle. Il
est aisé de constater que les propos sur leurs aspirations
révèlent des besoins de communication, de reconnaissance,
d'appartenance. Si nous prenons en considération que les faits se sont
déroulés sans qu'ils puissent satisfaire ces désirs nous
pouvons supposer que cela a engendré le délitement de la branche.
Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas eu de réponse au moins égale
au niveau d'aspiration des membres. C'est-à-dire, au niveau
d'accomplissement que l'adhérent attendait ; pour mieux l'exprimer,
espérait atteindre. Au fond, le couple-Pilote avait besoin
d'attachement, d'affection, d'amitié pour s'affirmer alors que sa
compétence et la fonction qu'il occupe, celle de pilote de branche,
auraient dû le rendre indépendant de ces besoins. En somme, le
couple part de ses manques pour exprimer une faiblesse, une dépendance
aux autres. Autrement dit, exprimer une rupture de solidarité humaine et
de besoins sociaux, ici, de reconnaissance et d'appartenance.
Dès lors, cet enchaînement de faits rend possible
l'interprétation suivante : le désir d'être reconnu et
d'appartenir à un groupe peuvent être tels que leur insuffisance,
voire leur carence, entraînent inévitablement des réactions
d'angoisses et de désespoirs conduisant à des attitudes de
lassitude, d'abandon. Le regard de l'autre et son écho
espéré positif est donc capital. Ainsi, le besoin ne crée
pas toujours le désir, le sens du rapport peut être
inversé, c'est-à-dire le désir crée le besoin
« car le désir a sa source, non seulement dans les
pulsions internes, mais dans les sollicitations des images, des
représentations. »387(*) Donc, le désir, bien que partant d'images
floues, est une mobilisation de l'individu pour obtenir quelque chose qu'il ne
possède pas. Par extension de l'idée : le conserver et le
développer s'il le possède déjà. Mais, si cette
première notion souligne, dans cette branche, des déceptions,
c'est-à-dire des besoins innassouvis, des aspirations
irréalisées engendrant un abandon, à l'inverse, la branche
CEB388(*) est un bel
exemple à la fois de réalisation des aspirations et de
cohésion.
3.1.2.2 Les espoirs : une bonne raison pour
développer un projet
Succinctement, la branche CEB s'est développée
à partir de plusieurs étapes successives.389(*) La première
étape a consisté en l'étude du langage et
l'appréhension des rouages de la Bourse. La deuxième, à
constituer la mise en place d'un portefeuille fictif d'actions pour
« se faire la main » en simulant des
investissements. La troisième, de créer un véritable club
d'investissement.390(*)
Ces étapes successives nous font penser au principe d'émergence
de Maslow : Si les besoins d'une étape sont satisfaits, il y a
développement de l'étape suivante.
Ce caractère donne une importance particulière
à l'interprétation des rapports entre les membres de cette
branche et le but à atteindre, créer un club d'investissement.
C'est l'occasion de revenir sur les représentations, les images et les
symboles relevés dans notre enquête et cadrés dans la
première partie ; mais cette fois sous l'angle des aspirations. En
clair, l'espoir serait une attente qui prendrait naissance dans un contexte
social déterminé (par exemple, il faut gagner de l'argent, le
contexte social l'oblige) par un système de valeurs propres (j'ai envie
de gagner de l'argent). Ainsi, pour chacun des quatre membres
interviewés et faisant partie de cette branche, nous retrouvons,
derrière ces images, des modèles personnels circonscrits par une
contingence et des valeurs auxquels ils attachent une grande importance. Pour
exemple, un modèle de la branche auquel se réfère un
membre dans son comportement peut l'inciter à s'investir à partir
d'intérêts différents de ceux de la réalisation du
projet commun. C'est-à-dire, l'association est vue comme un lieu
d'expérimentation pour gagner de l'argent.391(*) Mais un autre membre, se
réfère à un autre modèle et, sous son influence,
accorde plus d'importance à des valeurs d'entraide, un certain type de
relations392(*) sans
toutefois abandonner l'idée de gagner de l'argent393(*). Ici, nous supposons que les
aspirations changent de niveau et de nature. Elles passent d'une
préoccupation (la dimensions sociale) à un intérêt
libre (créer le club d'investissement). Donc, dans une certaine mesure
le système de valeurs de ce membre s'en trouve modifié bien que
le contexte social impose de gagner de l'argent dans tous les cas. Nous pouvons
citer un autre exemple se rapportant non pas à des images mais à
un modèle du rôle du pilote de la branche.394(*) Brièvement, le Pilote
veut exercer un système de type démocratique395(*) afin d'encourager les
membres dans leurs comportements de prises d'autonomie et leurs donne aussi la
possibilité de développer des sentiments de satisfaction. Cette
approche de la conscientisation semble bénéfique à
l'ensemble de la branche et encore plus pour ceux dont le niveau d'aspiration
était le plus proche de leurs capacités à les
réaliser.
En définitive, lorsque la première notion (le
désir) est réalisée, c'est-à-dire lorsque la
reconnaissance, la communication et les échanges sont présents,
les besoins-aspirations tantôt dépendent d'un système de
valeurs, tantôt tendent à le bouleverser au fur et à mesure
des situations et des circonstances. Pour le dire autrement, les espoirs sont
d'abord pris entre une perception individuelle des modèles et
l'individualité intime de chaque membre. Ainsi, le membre se
réfère plus ou moins consciemment à un processus
d'élaboration de ses représentations de la branche et des
différentes fonctions exercées, différents rôles
joués. Ensuite, les rencontres entre les différents
modèles, loin d'aboutir à des oppositions, autorisent un
développement. A moins que ce ne soit justement les discordances et les
contraintes qui rendent possibles l'assemblage de modèles nouveaux, d'un
nouveau système de valeur garantissant le succès :
« lorsque le désir, tourné vers un objet, devient
aspiration, cet objet est valorisé en fonction d'un système de
valeurs propre à une société, à un milieu, à
un groupe. »396(*) En d'autres termes, le désir devient espoir
lorsqu'un changement attendu plus important peut être
réalisé (satisfait). L'espoir est donc lié à la
préoccupation de sortir d'un état vers un nouvel état.
Nous trouvons là une boucle : au fur et à mesure que le
membre acquiert un sentiment de pouvoir dans ses échanges, la part de
l'espoir prend une place de plus en plus grande dans les communications et les
échanges ; il acquiert une certaine liberté. Mais
au-delà des désillusions (le désir) et des espoirs perdus,
l'espérance (troisième notion) correspond à une posture
globale de l'adhérent. En fait, l'espérance permet de garder une
raison de vivre dans toutes les circonstances. C'est elle qui motive, qui
engage. En ce sens, la branche Littérature (le projet Echap) est un
exemple d'espérance.
3.1.2.3 L'espérance : une raison de vivre
Tous les membres composant cette section sont en recherche
d'emploi, l'âge moyen est de 46 ans. Ce micro-groupe constitué
aspirait à s'extraire d'une première difficulté : le
piège de l'isolement, de la solitude, ennemies perfides du
chômeur. Confirmé par cette personne lasse de son engagement dans
le monde associatif : « Échap, parce-qu'on veut
s'échapper de ce carcan du chômage.»397(*) Egalement confirmé
par le Pilote, journaliste de métier: « la seule issue de
secours consiste à rester en contact, en réseau, de
manière à demeurer dans la course ». Convaincu du
bien-fondé de cette théorie du groupe et de la force
libératrice de l'écriture de leur expérience, le pilote a
échafaudé un projet de livre écrit à plusieurs
mains. Une expiation, en somme, comme les membres de cette branche se plaisent
à répéter, et le choix même du terme
"échap"398(*) exprime l'envie d'un autre état de celui de
chômeur trop âgé. Pour le Pilote, « prendre le
stylo c'est reprendre une parole arbitrairement ôtée par la perte
d'emploi. » Le symbole est très fort. Fort comme leur
cohésion et leur entraide mutuelle malgré la fraîcheur de
leurs relations au début. Ils ne se connaissaient pas. Mais fort comme
la constance et l'envie d'aller jusqu'au bout. Chose qu'ils se sont promise et
qu'ils ont finalement réalisée fin 2001. Parce-que, pour eux,
« publier un livre c'est interpeller l'Autre sur sa propre
conscience d'être, facilitant ainsi de manière indirecte, la
réinsertion sociale par l'approche de l'échange et du travail de
groupe et de recherche. Comme quelque chose de nouveau, pas vraiment encore
défini, qu'il faudrait apprendre. » En somme, des
histoires d'êtres pour une histoire d'être par l'écriture
d'une expérience. Une expérience au singulier puisque chacun a
pris un rôle dans le livre pour s'exprimer. L'intrigue faisant arbitrage
entre les accidents individuels (le chômage, les problèmes
familiaux)399(*) et leur
histoire commune prise comme un tout (la difficulté d'une
réinsertion socioprofessionnelle, d'une intégration sociale par
un emploi). A cet égard, on peut dire que cette écriture offre
une histoire chargée de sens composée d'événements
ou d'incidents. De même, elle transforme les accidents individuels
(événements ou incidents) en une histoire commune
organisée dans une totalité intelligible. Bref,
« la mise en intrigue est l'opération qui tire d'une
simple succession singulière une
configuration. »400(*) En clair, le je du texte vient en écho au je
singulier. Cette écriture de l'expérience vécue nous a
particulièrement touché parce-qu'elle implique l'adhérent
dans l'espérance. De même, elle accepte d'exposer cette commune
singularité en construisant, en leur nom propre, l'expérience de
chaque membre, une partie de leur histoire. Dès le départ il n'y
a pas eu d'écriture distancée. En fait, c'est le contraire que
nous avons perçu : une appropriation. C'est ce qui a
été relevé dans le lapsus révélateur du
second interlocuteur : « c'est un terme que j'ai
employé dans mon li... dans notre
livre. »401(*) De plus, cette pratique de l'écriture a la
particularité de rencontrer un autre dans la même
situation402(*). Par la
réalisation de cet aspiration à témoigner et à
expier403(*),
l'adhérent est devenu dynamique, a trouvé du courage,
décidé de réagir se donnant d'autant plus de chances de
réussir son insertion socioprofessionnelle404(*). Bref, cette écriture
de l'expérience vécue évolue au fil du temps et nous
informe d'une éthique en action puisqu'elle assemble les
singularités. Donc, elle est à la fois de l'agir individuel et de
l'éprouvé commun.405(*) Nous interprétons cette pratique de
l'écriture en tant qu'elle facilite le transfert et l'innovation :
elle autorise la transformation, le changement.406(*) Bref un passage qui touche
l'adhérent dans ses jugements du risque encouru. C'est-à-dire
n'être pas lu du tout, et donc avoir travaillé pour
rien.407(*) Par cela
cette pratique de l'écriture, vu comme l'espérance de sortir du
chômage, est objet d'échanges. C'est-à-dire, réduit
l'isolement. Précisément, besoin recherché par les
adhérents-auteurs de ce livre. Mieux, elle permet de consacrer des
relations interpersonnelles et des témoignages publics où l'on
parle autour et mesure l'émotion de l'adhérent-auteur408(*). Pour résumer, une
intégration du passé dans le présent qui, de ce fait,
autorise un possible futur : la réinsertion socioprofessionnelle.
Donc, à la fois, un rôle réducteur, voire la disparition
des ruptures, et un rôle constructif (la réinsertion). C'est donc
à partir de l'espérance de la réalisation d'un centre
d'intérêts (écrire un livre) que sont apparues les
aspirations de cette branche (écrire un livre pour "dire",
témoigner d'un mal-être). Mais c'est surtout en gardant en
filigrane Michel de Certeau qui dit : « Une théorie
du récit est indissociable d'une théorie des pratiques, comme sa
condition et en même temps que sa production. »409(*)
En résumé, si l'émergence de
l'espérance personnelle est mue par un manque, une rupture sociale par
exemple, elle n'en est pas moins transformée en aspirations personnelles
de réduction de ce manque, de cette rupture. Mais, l'adhérent
conscient de sa situation réelle peut transformer son aspiration
personnelle en aspiration collective de création d'un projet nouveau qui
tendra à la réduction de ses ruptures sociales. Ainsi, le membre
se porte toujours avec un autre vers un état qui lui semble meilleur que
le sien en fonction d'une vue générale qu'il peut avoir de la
société ou d'une situation.
3.1.2.4 Synthèse des trois notions : de la
succession au lien intime
D'une manière plus générale, la
réalisation des aspirations permet de satisfaire progressivement un
certain nombre de besoins. Les situations précédentes montrent
que les aspirations peuvent être observées en fonction des
comportements et des représentations. C'est la raison pour laquelle, du
simple désir (image plus ou moins fugitive)410(*) à l'espérance
(attitude globale), en passant par les espoirs (attente d'un changement), les
adhérents se situent dans « un mouvement d'ensemble qui
les prend tout entier sans qu'ils puissent toujours distinguer nettement ce qui
différencie leurs désirs, ce qui relie leurs espoirs, ce qui les
unit dans l'espérance. »411(*) Par là, les
besoins-aspirations expriment la personnalité tout entière de
l'individu dans un contexte donné. Donc, « les hommes
n'aspirent pas seulement à acquérir des biens, même
immatériels ; ils aspirent à atteindre certains états
et à réaliser les conditions dans lesquelles ces états
seront possibles, en particulier en créant des structures
nouvelles. »412(*) Néanmoins, les aspirations comportent
toujours le risque d'une grande vulnérabilité face aux tentatives
de leur satisfaction. D'où les possibles désillusions,
désespoirs et désespérances. Mais, les transformations qui
s'opèrent alors sur les représentations dans les interrelations
et les interactions amènent l'adhérent participant à jouer
un rôle de plus en plus engageant dans ses propres décisions et
orientations. Il change. Car les projets personnels se présentent petit
à petit comme des projets communs. Les valeurs personnelles sont alors
mobilisées en vue d'objectifs liés à la satisfaction des
besoins commun (par exemple, un projet) et par extension à la
satisfaction des besoins personnels. A cette fin, les notions de désir,
d'espoir et d'espérance se lient pour intervenir sur les comportements
(engagement, motivation, abandon). Ce qui fait de la réalisation des
projets menés par les branches quelque chose d'autre qu'une simple
activité.
3.1.3 Les besoins-aspirations, une
dynamique circulaire
Pour faire le point sur ce premier chapitre nous
dirons : bien que la théorie de Maslow sur les besoins humains
puisse servir de base, les notions abordées nous permettent surtout de
retenir que le comportement du membre est l'aboutissement d'un
entremêlement qui lie besoins-aspirations et représentations. Par
conséquent le fait de repérer des motifs comme : s'engager,
participer, se motiver, suivre un projet, etc. invite les adhérents
à reformuler les représentations dans une nouveau système
de valeurs pour régler les éventuelles discordances. Ce qui
permet la mise en oeuvre de projets communs. Ainsi, une vie collective
harmonieuse au sein du Compu's Club ne peut être que si les
besoins-aspirations et les objectifs individuels y trouvent un degré
suffisant de satisfaction et d'accomplissement ; et il ne peut y avoir un
degré suffisant de satisfaction des objectifs individuels que si les
micro-groupes que les membres forment, et dont ils entretiennent le
fonctionnement par leur propre action, sont constitués de telle sorte
qu'ils n'engendrent pas de tensions destructrices. Par ailleurs,
« c'est le processus psychosociologique par lequel un sujet
désirant est attiré ou poussé vers un objet proche ou
éloigné dont il prend conscience à travers des images, des
représentations, des symboles et qui contribue à définir
et à orienter ses projets. »413(*)
Au fond, il s'agit de dynamiques circulaires que nous avons eu
a interpréter dans ce chapitre. En clair, l'enquête a
révélée que les motifs d'adhésions au Compu's Club
sont les TIC ou l'image avant-gardiste de l'informatique. Au sein de
l'association naît chez l'adhérent des besoins-aspirations
liés à des désirs, espoirs et espérances
eux-mêmes dépendant des valeurs-représentations
préalablement intériorisées (histoire individuelle) ou
englobantes (à partir des valeurs de l'association). Si un
besoin-aspiration est satisfait alors il y a naissance d'un nouveau
besoin-aspiration d'ordre supérieur (Maslow) qui, à son tour, est
à satisfaire (circularité). Si le besoin-aspiration n'est pas
réalisé l'adhérent atteint un premier seuil d'aspiration.
Alors, l'adhérent pourra soit créer un nouveau besoin-aspiration
d'ordre inférieur (circularité), soit disparaître lorsque
le seuil d'aspiration est ultime. Ce qui nous amène à proposer un
schéma récapitulatif révélant cette
circularité dynamique de la théorie des besoins-aspirations des
adhérents au Compu's Club414(*) :
(voir page suivante)
Schéma de la
circularité des besoins-aspirations au Compu's Club
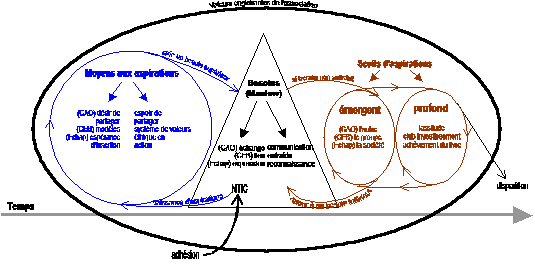
Mais, si les aspirations peuvent jouer un rôle dans
l'évolution des relations à l'intérieur d'une branche et
participe par là du changement de l'adhérent, en introduction
nous avons avancé que sa participation pouvait être posée
en termes de dépendances réciproques (Elias), de
présentation de soi (Goffman) et de manières de faire (Certeau).
Dans le deuxième chapitre nous allons aborder les deux premiers points
afin de se préparer au troisième dans le suivant.
3.2
Présentation de soi : les jeux, les enjeux
Nous venons d'interpréter le phénomène de
changement à partir des besoins-aspirations des adhérents. Nous
avons conclu que ces besoins-aspirations étaient un entremêlement
d'intérêts à satisfaire et de représentations.
Précisant que cet entremêlement peut donner naissance, à
son tour, à de nouveaux besoins-aspirations selon une circularité
de satisfaction provoquant une ré-interprétation des
systèmes de valeurs. Cette ré-interprétation permettant,
ainsi, de solutionner les éventuelles discordances dans les interactions
et interrelations.
Nous avons précisé en introduction que la
satisfaction des besoins pouvait être appréhendée dans les
dynamiques relationnelles. Autrement dit, maintenant que nous avons
interprété ce qui semble se jouer dans la participation des
adhérents, c'est-à-dire satisfaire des besoins-aspirations, il
nous faut traiter de la manière dont ils s'y prennent pour y parvenir,
leurs manières de faire. En fait, les comportements des adhérents
apparaissent proches des notions de stratégies et de tactiques. Comme
nous l'avons vu dans la première partie, les stratégies, des
manières d'agir pour atteindre un objectif et les tactiques, des
habiletés inventées au coup par coup415(*) (Certeau). Nous allons
expliciter comment les interactions et interrelations rendent visibles les
tactiques et stratégies qui les ont rendus possibles. Dès lors,
se pose la question des jeux de relations, de ce qui fait leur trame,
c'est-à-dire, quelles manières de se représenter,
communiquer, s'identifier. Pour le dire autrement, nous allons pointer dans les
deux prochains chapitres les stratégies et les tactiques exercées
par l'adhérent dans son rapport aux autres, dans sa
(re)présentation à l'autre.
Nous allons considérer au préalable la nature
des manières de faire. C'est-à-dire, « plus qu'il
n'y est représenté, l'homme ordinaire donne en
représentation »416(*). Ce qui va nous permettre de montrer en quoi il y a
logique d'action chez l'adhérent. Les travaux de Norbert Elias
faciliteront notre compréhension « de la manière
dont les individus pensent leur rapport au monde »417(*). Elias a été
conduit à considérer la société en tant qu'elle est
interdépendance des individus. Pour lui, « l'objet propre
de la sociologie [...] ce sont des individus
interdépendants. »418(*) Les formes spécifiques de ces
interdépendances formant une configuration, comme nous l'avons vu dans
la première partie. Il a été amené à partir
du concept de configuration, a étudié « comment
[...] la représentation de l'identité des personnes, dans la
relation entre la référence au nous et au je, est
variable. »419(*) Ce qui nous oblige à préciser la part
d'influence des interrelations et des interactions dans le
phénomène de changement individuel de l'adhérent. En nous
référant à Elias, cette association ne peut être
pensée qu'au travers de ses adhérents et les adhérents ne
peuvent être pensés que par leurs interactions et leurs relations
les uns avec les autres. Chemin faisant, nous traduirons ce que nous avons
relevé de la représentation de soi au Compu's Club pour rendre
intelligibles les manières de faire de l'adhérent. Pour nous y
aider nous nous réfèrerons aux travaux d'Erving Goffman
parce-qu'il assimile le monde à la scène d'un
théâtre où les relations sociales tiennent des
représentations et les individus, dans leurs interactions de
face-à-face, des rôles d'acteurs soumis à des règles
indispensables : la manière de se représenter,
l'idéalisation de sa place, l'image de soi et l'identification à
un groupe social. Nous allons donc interpréter maintenant ces deux
notions de configuration (interdépendance) selon Elias et de
présentation de soi selon Goffman à partir des dynamiques
relationnelles au Compu's Club.
3.2.1 La
configuration, un réseau de relations réciproques
Nous avons noté dans les entretiens une
détermination que l'adhérent a de se produire, de jouer un
rôle dans les relations interpersonnelles et l'impression qu'il veut
donner aux autres ou qu'il perçoit des autres. Cette
détermination prenant forme à partir de « l'attraction
vers des objets perçus, représentés ou
imaginés »420(*) pour fournir des buts à
l'adhérent : les besoins-aspirations à satisfaire. Pour
exemple, dans le domaine d'activité du Compu's Club, le monde
informatique, on peut rendre compte de déterminations semblables
observables entre les adhérents. C'est-à-dire une identification
à une organisation par un langage commun, particulier,
développé au sein d'un groupe421(*). Ce type d'identification abstraite fonctionne ainsi
à partir d'images mentales, de concepts comme le bonheur ou le fait
d'être bien dans sa peau. Tout en étant l'expression d'aptitudes
et d'intérêts personnels ou collectifs cette détermination
est également la résultante de ce qu'Elias appelle les
interdépendances entre individus. Le concept de configuration permet
d'envisager à la fois l'interdépendance croissante des relations
sociales au sein du Compu's Club et l'exigence faite à chacun de
s'affirmer singulièrement, comme un individu. En effet, cette
détermination, est entretenue et cherche à se réaliser non
pas en vase clos, mais en interaction avec et dans une configuration. Dans
cette perspective, nous considérons le Compu's Club comme
l'environnement, le lieu, l'espace où les adhérents sont
liés les uns aux autres par un ensemble de dépendances
réciproques, selon un équilibre de tensions plus ou moins
stables. Cet équilibre, à l'instar d'Elias, a la capacité
d'influer sur la figure globale Compu's Club, la rendant fluctuante, donc
changeante. Ceci nous conduit à considérer les adhérents
comme des êtres sociaux pris dans les relations d'interdépendances
c'est-à-dire, à envisager leurs comportements, leurs
participations ; par extension, essayer d'éclaircir le changement
observé, sous l'angle de configurations sociales.
3.2.1.1 De la configuration Compu's Club
Le Compu's Club est un milieu spécifique de
socialisation, une configuration au sens de Norbert Elias. Les adhérents
y sont en perpétuelle négociation dans la mesure où, par
son caractère incertain et contradictoire, la participation suppose de
la part des adhérents-acteurs un processus coordonné et
interactif de construction des actions, d'interprétation des
activités, de définition des priorités, de
compréhension des objectifs, etc. La configuration articule ainsi trois
niveaux d'interprétation, constituant une succession de niveaux
croissants : participations, régulations sociales et conventions de
fonctionnement ; et ne prend de sens que dans leurs perpétuelles
interactions. Il est en effet possible d'observer que n'importe quelle branche
de cette association développe du lien social, comme elle
développe une "présence au monde". L'un des aspects du rôle
social des branches est cette production d'identités spécifiques
au projet. Le maillage du tissu social, qui même lorsqu'il est
très vaste, n'est jamais que des "systèmes-personnes" en
relations, se déforme et se transforme nécessairement en
même temps que ceux-ci. C'est ce que nous comprenons de la notion de
configuration de Norbert Elias. Ce qui va nous permettre de l'expliquer au
travers de ses adhérents et ceux-ci par leurs interactions et
interrelations.
3.2.1.2 L'association et la branche ; trois
configurations
Nous retenons des entretiens que l'interdépendance des
adhérents n'est pas forcément connue par eux422(*) (ceux-ci peuvent même
ne jamais se rencontrer) tout en produisant des effets les uns sur les autres
par l'inscription dans une même configuration. Tel est, par exemple,
l'interdépendance entre la branche Formation (Ifac) et l'association en
tant que club informatique (LDM). Ifac utilisant le matériel
informatique pour dispenser ses formations ; lequel matériel est
paramétré et tenu en fonctionnement par une autre branche, LDM,
chargée de la maintenance. Inversement, les fonds récoltés
par les formations permettent de nouveaux achats de matériels qui seront
gérés par la branche LDM. Les membres de chacune de ces deux
branches ne se rencontrant quasiment jamais423(*). Cela signifie qu'il y a une influence
réciproque entre les logiques dominantes des branches et les actions des
membres, ces derniers sont dépendants de l'ensemble de l'association,
mais peuvent y exercer à leur tour une certaine influence. Cette
inclusion des membres dans le développement des branches se situe sur au
moins deux plans qu'il faut théoriquement distinguer bien qu'ils soient
dans les faits réunis : leur dépendance à l'égard
de l'ensemble de l'association d'une part, et à l'égard de tel
projet particulier de branche, de l'autre. La première dépendance
peut s'interpréter à un niveau macro-social. Le bon
fonctionnement du matériel pour former, dans notre exemple. Sur la
même idée, certains mécanismes tentent de réguler la
relation générale entre les différents micro-groupes et
avec l'association en général : réunions
inter-branches, bulletin d'information (appelé Bulletin Membre),
animations extérieures, par exemples.
La deuxième dépendance est micro-sociale. Elle
aborde les micro-groupes dans leur autonomie (le micro-groupe dans des
développements de projets spécifiques comme Echap, branche
Littérature, par exemples). Cela nous amène à
définir les branches comme l'une des modalités d'organisation des
adhérents du Compu's Club, et en référence aux
théories de Norbert Elias comme une configuration de relations
interpersonnelles et d'interactions qu'il faut articuler aux autres
activités de l'association. Celles-ci, étant en partie distinctes
et renvoient à différentes formes d'interdépendance entre
les adhérents, formes qui peuvent être de tailles très
variables. « Ce qui différencie les configurations, c'est
la longueur et la complexité des chaînes de relations
réciproques qui associent les individus. »424(*)
La force assimilatrice, socialisante, des
interdépendances de la configuration Compu's Club réside dans sa
capacité à inventer un espace médiatisant l'appartenance
au Compu's Club par une appartenance micro-groupale (village,
communauté, ...) qui en sort activée. L'association, le
micro-groupe, ses projets, ses relations interpersonnelles, ses interactions,
ses interdépendances placent le membre à un carrefour
d'appartenances diverses.
A partir de là, la configuration globale Compu's Club
nous est apparue comme composée, en fait, de multiples configurations
(les branches, par exemple), elles-mêmes configurations à parts
entières (une sorte d'image fractale), donc désignant des
processus d'unification qui sont instables et mouvants, mais soutenus par des
relations multiples. Dès lors, ces configurations sont apparues plus
visibles parce qu'elles imposent une coopération forte et un savoir
commun à certains moments. Par exemple, dans la branche Finance (CEB),
le membre qui a initié le projet et apporté le plus dans
l'échange pour sa fondation, s'est vu reconnaître en contrepartie
une sorte de leadership moral et d'hégémonie. Apparaît
alors la fonction de Pilote425(*). Ce sont les membres-Pilotes qui se trouvent
finalement en charge d'élaborer une partie ou la totalité des
"règles du jeu" qui constituent le fondement de la branche. Ainsi, les
moments de fondation d'une branche connaissent des processus
d'auto-organisation et d'auto-formation particulièrement forts
définissant à elle-même ses références
communes.
Il est apparu d'autres configurations d'aspect
différents et éphémères. Le "temps café" en
est un exemple. Le café est avant tout un lieu de relations sociales et
d'échanges426(*).
Ce moment crée une configuration spécifique en tant
qu'unité de temps, unité de lieu, unité d'échanges.
En effet, il est le noeud de rencontres multiples, le lieu informel où
les adhérents de l'association se retrouvent, l'endroit incomparable
où se tissent, au gré de l'instant, les discussions les plus
aberrantes, les projets les plus fous avant de disparaître et
réapparaître ensuite sous la forme d'une nouvelle configuration
identique sur le fond et différente sur la forme de la
précédente, les adhérents et les centres
d'intérêts ayant changés quelquefois. Cet exemple est
significatif de la nature des configurations et de ses fluctuations.
La configuration Compu's Club désigne donc un vaste
réseau d'interdépendances de toutes sortes (inter-branches,
intra-branches, intra-association). De cette approche, les adhérents et
les branches qui composent l'association se combinent différemment,
engendrant à chaque fois une nouvelle configuration sociale, donc de
nouvelles conditions d'échanges. L'adhérent va ainsi
s'insérer dans une multitude de configurations au sein desquelles il
agit, se différencie. Interpréter la configuration Echap (branche
Littérature) par ses moments forts et communs et en tant que
configuration à part entière, va nous permettre une
compréhension plus aisée de la part prise par une configuration
dans le changement de l'adhérent.
3.2.1.3 Inter- (-actions, -relations,
-dépendances) : le cas Echap
Le projet Echap est une métaphore de l'écriture.
Précisément, elle est une interdépendance des chemins de
vie des auteurs d'un roman à écrire entre eux avec la vie des
acteurs nés par son écriture. L'adhérent jouant le
rôle d'acteur ou d'auteur tour à tour ou simultanément pour
penser ses relations sociales, sa participation. L'écriture de ce livre
à plusieurs mains n'existe pas hors des membres de la branche et dans le
même temps cette écriture nécessite la coopération
de tous les membres-individus qui sont alors interdépendants. L'objectif
que poursuivent les membres de cette branche, en croyant donner un sens
intentionnel à leurs actions (et par là à leur vie),
correspond à ce pour quoi ils aspirent personnellement et à y
trouver la satisfaction qu'ils en espèrent ; c'est-à-dire,
au fond une reconnaissance sociale par la réinsertion professionnelle
via l'édition d'un roman. Les interactions sociales dans lesquelles les
membres-Echap partagent les attributs de chômeur portés
individuellement et les intérêts communs de réinsertion
impliquent une limitation afin de ne pas causer de rupture définitive
risquant de compromettre l'existence de la branche elle-même. Autrement
dit, l'imbrication des besoins-aspirations des membres fait constamment entrer
en jeu, des mécanismes de dépendances à l'autre engendrant
des situations de domination et des relations de pouvoir en même temps
que les dépendances créent des compromis et des
négociations sur les buts communs pour espérer atteindre les
objectifs individuels. Ce qui signifie que le moteur des interactions sociales
dans cette branche réside dans des luttes contradictoires et
conflictuelles de pouvoir. Chacun cherchant, par exemple, a prendre
intentionnellement le personnage le plus valorisant pour lui dans le roman tout
en sachant que trop d'exigences pour y parvenir prendraient le dessus au profit
de l'achèvement coûte que coûte du roman427(*). Ce pouvoir est donc
tributaire de limites qui le régule et fait du membre un individu
agissant et assujettit par auto-contrainte. Cette auto-contrainte
révélant une manière de faire prenant en compte les
émotions (valeurs) d'écoute, de démocratie, de
tolérance, par exemples. La régulation de ce pouvoir ouvre alors
à de nouveaux espaces pour offrir de nouvelles occasions centrifuges
(vers la configuration) ou centripètes (vers l'individu) à saisir
ou pas, équilibrant ainsi les tensions. En même temps, le projet
d'éditer un livre permet aux membres de la branche de maintenir (souvent
inconsciemment), par leurs interrelations et interactions, la configuration.
L'auto-contrainte ouvre des perspectives prometteuses pour les adhérents
de cette branche : une réinsertion professionnelle possible. Bref,
jeux de pouvoir, enjeux d'expériences. Il en résulte
l'idée que la configuration Echap n'est pas un collectif homogène
mais présente des rapports de forces où les comportements des uns
peuvent être contrecarrés par la résistance ou l'inertie
des autres. Par exemple, les entretiens révèlent diverses formes
de consentement moral, d'adhésion partielle voire de résignation,
ce qui ne veut jamais dire acceptation totale et feint des résistances.
Cela implique de multiples nouveaux liens parfois invisibles (la
résistance par exemple). La configuration Echap est, par là,
à la fois rigide (contraignante) et élastique,
hétérogène et contradictoire en même temps qu'elle
révèle, par son espace social relationnel, le sens intentionnel
des membres impliqués.
3.2.1.4 Dehors-dedans et vice versa
La configuration spécifique Echap à laquelle
nous nous référons est en fait celle d'une interrelation à
trois ; elle se situe entre le membre-chômeur, le roman et le
chômage. La démarche minutieuse d'interprétation que nous
voulons adopter maintenant va consister à démontrer que
l'élaboration du roman est conditionnée par une configuration
particulière et changeante qui se forme entre la nature des productions
d'écriture et le chômage, la diversité historique des
membres, l'organisation interne du travail d'écriture et
particulièrement les relations entre l'association et les membres de la
branche ainsi que le degré plus ou moins fort d'autonomie qui en
résulte pour ces derniers.
Nous partirons d'une première conséquence des
interrelations relevées : le roman est aller au-delà d'une
simple critique du chômage même si le membre a tendance à
réifier l'influence de son écriture en la mettant au centre de
son modèle d'interprétation du chômage. Cependant,
l'état de chômage vécu par le membre a constitué un
symbole et un mot de passe ; c'est ce que nous allons appeler un "passe de
complicités libres" pour l'expliquer plus loin428(*) mais que nous
définissons comme une forme de solidarité fondée sur ce
qui unit les membres d'un groupe selon une dépendance
d'intérêts réciproques. La prise en compte de la dimension
historique, en ce qui concerne les membres, a permis aux membres-romanciers (un
des rôles joués par les membres) d'échapper à des
descriptions manichéennes du genre : "le chômage, c'est la faute
aux patrons qui ne pensent qu'à l'argent" vs les causes individuelles du
vécu quotidien du chômage par les membres qui, tout en
perpétuant l'idée d'un âge d'or révolu, ne
contribuent pas à la compréhension des dynamiques des
activités de la branche Littérature. La relativisation des
commentaires qu'implique l'interprétation de cette configuration
spécifique est essentielle. L'économique, imagé par le
patron dans notre cas, il convient de le préciser, n'est qu'une partie
mineure de ce qui conditionne le chômage. A côté des
décisions patronales il y a la politique nationale et internationale, le
développement technique et le niveau d'instruction, par exemples. De
même qu'il est une partie mineure de ce qui conditionne l'accès
à un emploi ; à côté, on peut trouver une
recherche de bien-être, une reconnaissance, une appartenance, par
exemples.
La deuxième conséquence des interrelations de
cette configuration est une meilleure connaissance des liens qui unissent les
trois pôles (le membre-chômeur, le roman et le chômage). Ce
qui nous permet de comprendre le fonctionnement même des interrelations.
Par exemple, le cas de la personne interviewée dénote d'une
influence de ses ruptures sur l'écriture du livre selon des
modalités qui sont le fruit de son histoire. Les liens de
causalité sont ici repensés : le chômage n'est pas le
cheval de bataille, c'est plutôt l'expression des émotions qui ont
structuré l'identité du membre-chômeur en membre-romancier
autour de la figure du rôle joué dans le roman : le
membre-acteur.
En outre, l'arrivée des sponsors, qui fut une
satisfaction profonde et valorisante par une reconnaissance de leur projet, a
coïncidé avec une crise de remise en cause de chaque membre. Ce qui
est un élément exogène sans rapport avec le fonctionnement
normal de la branche transfigurant le rapport initial entre le rôle de
membre-chômeur et le rôle de membre-romancier reconnu par les
sponsors, basé jusqu'alors sur la dépendance totale du rôle
de membre-acteur.429(*)
Désormais, il leur faut rendre des comptes même s'ils n'y sont pas
obligés. C'est-à-dire, un engagement moral, une
éthique430(*).
Ainsi, certains phénomènes à l'intérieur de la
branche sont soumis à des logiques structurantes qui naissent hors de
celle-ci. Dès lors, l'écriture du roman a fonctionné comme
une prophétie auto-créatrice parce qu'elle a eu la
capacité de diffuser le mythe de son existence par son
élaboration, puis de le valider431(*). Il est alors facile de comprendre l'importance de
ce livre et les enjeux de sa sponsorisation parce-que le roman, les
discours sur le roman et le membre-romancier souvent ne font qu'un. Les
identités sont ici fusionnées. Ainsi, non seulement la
configuration Echap confère une nouvelle identité de fait
à ses membres, mais en plus, elle lui signifie une appartenance. La
participation reste donc un moment de grande incertitude entre les
intérêts communs et les besoins personnels à satisfaire. De
ce fait, toute la personnalité de l'adhérent va être
engagée par sa participation et déterminée par trois
dimensions : la configuration, les facteurs exogènes et les
besoins-aspirations individuels. Le changement du membre-Echap consiste alors
en des modifications identitaires provoquées par sa participation, en
tenant compte des trois dimensions précédentes.
3.2.1.5 Les causes et les raisons des
interdépendances
Dans la configuration Echap se jouent des espoirs de
réinsertion socioprofessionnelle ainsi que des ambitions intellectuelles
et de reconstruction de soi qui, d'une part, se traduisent par les
écritures et, d'autre part, prétendent à se transformer en
une place dans le monde par un positionnement statutaire432(*) en même temps qu'ils
permettent à chaque membre de concevoir l'espace des autres membres. Par
exemple, le sentiment lié d'isolement et de solitude ou d'angoisse et de
douleur en même temps que le membre se voit offert de nouvelles chances
de joie, de bien-être et de plaisir par l'écriture,
confèrent une place. Ce qui, soit dit en passant, l'expose à de
nouveaux besoins-aspirations qu'il lui faudra satisfaire (Maslow, Chombart de
Lauwe). Sous l'effet de ces tensions, l'écriture du membre prend une
valeur symbolique et pose la question de savoir ce qui a le plus de
valeur : un besoin d'emploi, un besoin d'expression par l'écriture
(d'expiation) ou un besoin de la société des autres
membres ? Que choisir ? Ainsi, l'adhérent peut être
amené à laisser de côté les chances occasionnelles
qui s'offrent à lui (un emploi immédiat, par exemple) au profit
de la poursuite de l'objectif dont il escompte une satisfaction durable (le
livre). La maîtrise de la réalité semble ainsi
échapper à la personne interviewée qui se voit proposer un
emploi, l'accepte puis démissionne433(*). Ce qui laisse la place, une nouvelle fois, à
l'intervention de variables exogènes aux décisions, à
l'évolution, aux changements. La volonté de maîtrise de ces
tensions, donc, relève de l'activité de légitimation du
membre en état de revendiquer cette maîtrise en tant qu'acteur
dans la configuration. Autrement dit, ces tensions résultent de
l'activité de l'ensemble des membres mobilisés dans le projet.
D'une certaine manière, le projet est explicité comme
règle d'interaction permettant de concevoir des dispositifs communs
échappant à chacun des membres au profit de tous. Cette position,
nous conduit à interpréter la configuration en termes de
procédures mais aussi de postures, d'attitudes, de valeurs
(éthique) nécessaires à chaque membre pour participer. Ce
qui autorise une efficience du processus de tensions au profit du projet
commun. La Branche Littérature (projet Echap) peut donc être
appréhendée comme un système d'échanges
généralisé et interactif portant sur des aspects sociaux
et, par extension, symboliques comme l'ambiance, la reconnaissance personnelle,
le prestige, etc. Ce système d'échanges étant nourri par
les apports des membres qui structurent le collectif de travail
d'écriture constitué par la branche.434(*)
Notre interprétation a tenté de montrer la
branche Littérature comme un système d'échanges qui
évolue en fonction des fluctuations de sa propre configuration. Cette
configuration s'établissant entre le membre-chômeur (son statut de
chômeur et son histoire), le roman (l'organisation interne du travail
d'écriture, les productions d'écriture et la sponsorisation du
projet) et le chômage. Certains des éléments qui
structurent cette configuration sont en partie fortuits pour le membre en ce
sens qu'il trouve parfois l'emploi qu'il recherche. Dès lors, il fait le
choix entre cet emploi et le roman. Bien évidemment, les membres
recherchent ouvertement à atteindre certains objectifs en matière
de réinsertion socioprofessionnelle, mais la configuration ouvre
à des choix qui peuvent paraître incompréhensibles, par
exemple refuser l'emploi. Par suite, le système d'échanges de la
branche continue pour s'organiser ou se réorganiser autour des
interrelations des membres dont nous comprenons maintenant la relative
détermination ; ce qui a pour conséquence de structurer leur
personnalité.
D'une manière plus générale, les
objectifs des membres constituent une part importante des
éléments constituant la représentation de la branche par
ceux-ci. Insistant sur le fait que les configurations variantes
représentent, elles-mêmes des configurations à parts
entières, cela laisse supposer que les objectifs globaux de satisfaction
des besoins-aspirations (personnels et collectifs) soient réellement
présents partout de la même façon quelles que soient les
conditions de fondation des configurations. La recherche de satisfaction des
besoins-aspirations faisant office d'invariant.
Mais, pour qu'il y ait véritablement interaction
plusieurs conditions sont à réunir. Il faut que les
adhérents acceptent un minimum de normes communes, aient un passe de
complicités libres, s'engagent dans l'échange, adaptent leur
comportement aux circonstances et situations. C'est ce que nous allons
développer maintenant à partir des représentations de soi
aux autres et de la perception de soi par les autres, formes d'interactions.
3.2.2 De
la représentation sociale à la présentation de soi
Ce que nous nous préparons à interpréter
maintenant pointe les activités de l'adhérent-personnage dans une
configuration ; c'est-à-dire les présentations de soi. Ce
qui nous amène, dans un premier temps, à rappeler ce que nous
avons trouvé de la représentation des adhérents dans la
deuxième partie.
3.2.2.1 La représentation : un imaginaire de
conformités
L'analyse des entretiens a permis de relever que pour
déterminer son comportement, l'adhérent construit (se
représente) la réalité de l'association à partir de
théories tirées de son expérience.435(*) Autrement dit, il s'agit
d'une re-construction du réel par la réalité de la
configuration Compu's Club436(*), d'une re-production mentale à partir de
perceptions préalablement intériorisées (une sorte
d'espace symbolique). De même que « nous sommes tous
enclins, semble-t-il, à identifier les gens d'après certaines
caractéristiques qui comptent pour nous, ou qui, pensons-nous, ont
certainement une importance générale. »437(*) Bref, une pensée
singulière du monde par un "imaginaire de conformités",
synthétiserons-nous. Ainsi, l'adhérent comprend et pense la
configuration au travers d'un filtre, une re-composition, une évaluation
schématique et symbolique438(*) de la réalité sociale de
l'association. Mais, cette connaissance du réel par une
réalité personnelle est aussi expérience parce-qu'elle
s'ancre de diverses manières dans la configuration. Ainsi,
l'adhérent « subit les contraintes des
représentations dominantes dans la société [(en
l'occurrence l'association)], et c'est dans leur cadre qu'il pense ou
exprime ses sentiments. »439(*) C'est donc par le contexte interactif des projets
des branches (la configuration de la branche, le cadre) que l'adhérent
est dans le monde ; c'est-à-dire, la configuration Compu's Club,
elle-même insérée dans le monde informatique.
3.2.2.2 La représentation convenue : une forme de
solidarité
Chaque adhérent a une représentation des
comportements des autres, de ce qu'il peut attendre de lui et,
réciproquement, de ce que l'autre attend qu'il fasse dans les
interactions. Ce qui veut dire, les adhérents se (re)joignent par une
représentation convenue440(*) permettant de se reconnaître, de s'identifier.
Au cours de l'enquête, cette représentation a pris l'aspect d'une
clef-passe (un passe) ; par exemple : les valeurs englobantes de
l'association, gagner de l'argent pour le CEB ou une situation de chômage
pour la branche Littérature. Ce passe permet aux membres de se
reconnaître comme des complices unis par des intérêts
communs ou des pairs unis par une identité commune tout en conservant
des différences, une singularité (leur personnalité, leur
individualité). Pour exemple, si les propos énoncés par
les adhérents de la branche Littérature441(*) méritent le nom de
représentation convenue c'est parce-que, dans ce moment, le discours
déclare leur ambition commune, leur revendication, leur
prétention, celle de représenter en vérité le
mal-être de leur passé et de leur quotidien personnel442(*). C'est ce que nous avons
déjà nommé : leur passe de complicités libres
et que nous expliquons maintenant. Ici, même si les membres sont
distincts, il existe un passe d'unification : exister par et dans la mise
en récit de leurs histoires. Donc, ce passe de complicités libres
les unit parce-qu'il définit les actions à mener ; le projet
Echap dans notre exemple. Par extension, aucune personne hors de ce passe de
complicités libres n'est censé partager cette union. C'est
pourquoi tous nos interlocuteurs mettent en exergue une définition
précise de ce qui les unit ; pour le CEB, la finance443(*) ; pour la CAO, les
cartes de visite ; pour Echap, écrire un livre ; pour les
autres, l'informatique. Ce passe a ainsi souvent été
énoncé comme une dépendance d'intérêts
communs nécessaires et réciproques. Ces dépendances
d'intérêts sont équivalentes au type de solidarité
relevé444(*).
Ici, le passe de complicités libres est une solidarité
fondée sur ce qui unit les membres. Ce qui permet d'entretenir des
relations de bases dans le micro-groupe afin de découper l'espace,
attribuer les tâches, rendre compte d'un travail, par exemples. Mais, si
les représentations se déroulent dans ces dépendances,
l'adhérent doit y choisir puis y tenir un rôle vis à vis du
groupe. Un peu sur l'idée des métaphores théâtrales
de Goffman, c'est-à-dire, choisir un rôle et un costume, une
identité d'emprunt pour entrer en scène (le personnage). Du coup,
le propos se déplace de la représentation vers la
présentation de soi.
3.2.2.3 Un cas de présentation de soi
Si les adhérents se (re)joignent par un passe de
complicités libres et restent, toutefois, distincts cela pourrait
expliquer l'imperfection des relations dans certaines situations que nous avons
pu noter dans les entretiens. Ainsi, nous avons relevé une part
d'incertitude due à ce que l'autre puisse agir différemment de ce
qui est attendu. Ce qui suggère une anticipation du comportement de
l'autre. De ce fait, cette anticipation règle la mise en oeuvre de
tactiques ou de stratégies adaptées et singulières pour
une mise en représentation de soi adéquate, appropriée.
C'est cela qui semble présider, par exemple, aux décisions
(comportement de type stratégique) de lancement ou d'arrêt d'une
branche. En effet, la CAO s'est arrêtée parce-que le couple-Pilote
anticipait le nombre de participants (zéro sur la fin) sans espoir de
retournement de la situation pour pouvoir redynamiser la branche. En la
circonstance, ce comportement (la décision) imprévisible aux yeux
des autres échappe à leur pouvoir. Ce qui nous fait dire que les
comportements sont en rapport direct non seulement avec les
représentations mais aussi avec la pratique et ses enjeux les plus
importants ; c'est-à-dire la satisfaction des besoins-aspirations
que chacun espère. Il ne faut donc pas confondre ce qui relève de
la situation et ce qui est en situation. Autrement dit, les comportements, bien
que primitivement motivés par le besoin et le désir, sont
à mettre en rapport avec la présentation de soi dans les
représentations. Les efforts des adhérents pour expliquer leurs
engagements dans l'association en sont un exemple : certains
déclaraient beaucoup participer et ne faisaient en réalité
qu'acte de présence tandis-que d'autres peu présents physiquement
par un manque de temps disaient regretter ne pas pouvoir participer plus encore
alors qu'ils étaient régulièrement force de
proposition.445(*) Le
décalage entre le comportement (forme de présentation de soi) et
la représentation a un intérêt majeur : il est
l'indicateur des motivations liées à l'histoire de
l'adhérent que nous avons relevé au cours de l'enquête. Il
permet en outre, de « distinguer la mise en scène
destinée à prouver que l'on est ce qu'on n'est pas, de celle qui
cherche à démontrer que l'on n'est pas ce qu'on
est. »446(*) C'est cet indicateur (le décalage
comportement/représentation), par suite, qui nous a permis de
dégager les aspirations dont nous avons vu que l'adhérent n'avait
pas toujours une conscience claire dans le chapitre précédent.
3.2.2.4
Représentations et présentations de soi : une
réciprocité
A partir de là, les rapports réciproques entre
comportements (présentations de soi) et représentations de la
configuration ressortent plus nettement. Par exemple, la représentation
du Compu's Club par l'adhérent donne naissance à l'expression de
métaphores qui rendent compte de la manière dont il
échafaude sa présentation de soi par des actions et une
communication. L'un parlera du bon père de famille, un autre de
l'amitié, un troisième de l'ambiance447(*) ou de la solitude448(*). Ce qui permet de
comprendre, pour le premier, l'image faite aux jeunes adhérents dans
leur participation à la branche Libertech449(*) et comment l'adhérent
envisage y répondre par un comportement adapté : l'attitude
paternaliste (image de soi). Pour le second, il s'agit d'une justification de
services rendus par amitié ; il se conduit (se présente)
alors de manière a ce que naisse chez l'autre un sentiment
d'amitié équivalent. Ainsi de suite. Chaque configuration assigne
ainsi aux adhérents qu'elle relie des figures imposées par
eux-mêmes (rôle du père, dans notre exemple) et de ce fait
est porteur de valeurs morales diversifiées qui se combinent à
celles qui prédominent dans les configurations (association et
branches). C'est ainsi que la représentation de la configuration porte
sur un jeu d'interdépendances constituant un socle sur lequel s'ancre
les présentations de soi (comportements et attitudes) de
l'adhérent-personnage au Compu's Club. Ce socle, propre à chaque
adhérent, est organisé afin de mettre en oeuvre des
stratégies autorisant une manière adaptée de se
présenter ; c'est-à-dire, d'affirmer une distinction, une
singularité, une individualité ; de produire une image de
soi et de jouer un rôle acceptable pour les autres (Goffman). Le fait de se différencier d'une manière
ou d'une autre, de se distinguer des autres, bref d'être
différent, devient dans la branche un véritable idéal
personnel par rapport à l'occupation d'une place élevée
dans l'échelle des valeurs de la branche. Qu'il en soit conscient ou
non. Nous voyons là une marge de liberté et une dynamique
d'émancipation (singularité) de l'adhérent par une mise en
adéquation, une adaptation des représentations individuelles et
collectives. Par son apprentissage social au sein de la branche
(interrelations, interactions, interdépendances) il accède
à une identité de personne individuelle, son statut
d'individu ; et l'objectif de devenir singulier a pour corollaire celui
d'être conforme aux autres puisque la singularité ne peut
s'exercer qu'à partir d'une multiplicité de
référence qui englobe toutes les singularités. Par
là, socialisation et singularisation sont inséparables parce-que
le sens de cette dernière est produit par la première. Autrement
dit, cette singularisation de l'adhérent se situe dans les relations les
uns avec les autres. A cet égard, l'adhérent n'a pas le choix de
sa présentation de soi ; il doit l'adapter (par exemple, anticiper)
à la configuration parce qu'il n'existe que parce-qu'il y est
immergé.
Passer de la représentation individuelle, imaginaire de
conformités à une représentation convenue, le passe de
complicités libres puis à la présentation de soi nous a
permis de voir 1) une réciprocité entre présentation de
soi et représentation de la configuration et 2) une
interdépendance entre les représentations, les
présentations de soi et les représentations/présentations
de soi. Au fond, la configuration est le lieu des représentations
sociales et des représentations de soi.
Nous avons repérer dans les entretiens comment les
multiples représentations de l'adhérent-personnage participent de
son changement. Nous allons affiner notre interprétation de
l'adhérent-personnage dans sa présentation aux autres par la
manière employée pour se rendre unique à leurs yeux.
C'est-à-dire se singulariser, se distinguer des autres (la distinction)
et l'impression qu'il veut produire au regard des autres. C'est ce dont il va
être question maintenant.
3.2.3
Présentations de soi : une production de fragments identitaires
3.2.3.1 Entre apparence et manière : un jeu
Nous avons relevé dans les entretiens ce que
l'adhérent jugeait important et auquel il se conformait. Notamment,
certaines valeurs (solidarité, amitié par exemples) lui ont
permis de parler de la place qu'il pouvait prendre dans les échanges
grâce à l'image qu'il pouvait véhiculer (leader, soutien
psychologique, responsabilités, etc.). En fait, les personnes
interviewées ont suggéré dans la section
précédente une impression qu'ils veulent donner aux
autres.450(*) Lorsqu'ils
sont assurés de faire bonne impression ils jugent alors des moyens
à investir dans leurs actions pour atteindre le désirable dans le
cadre du possible. Dès lors, ils attribuent un sens intentionnel
à leurs comportements. Bref, l'adhérent intègre une
manière de faire, il joue selon une stratégie. De ce jeu nous
avons identifié deux facettes : l'apparence produite qui
révèle la position que l'adhérent compte jouer et
d'où il veut jouer451(*) et la manière qui indique le rôle
visé, joué dans l'interaction (aider les jeunes, rendre des
services, par exemples452(*)). Il s'opère alors une congruence entre
l'apparence et la manière. Par exemple, les membres de la branche
Littérature révèlent leur statut social, celui de
chômeur, et la manière d'y remédier par un rôle
d'auteur qui leur permet d'exprimer un mal-être, pour eux,
inhérent à ce statut. Ils ont mis en exergue leurs
ruptures ; en revanche, ils ont peu parlé
spontanément des responsabilités qu'ils ont pris au sein de
la branche. Cet indice qui émane de l'interaction
apparence/manière est utilisé librement et inconsciemment par
l'adhérent qui lui attribue alors un sens : par le chômage
ils se donnent l'apparence d'une place centrale, important, qui interpelle
l'autre ; celle qui doit attirer sympathie, amitié et
solidarité ; une stratégie, en somme. C'est en quoi
apparence et manière dans lesquelles s'inscrit l'adhérent jouent
un rôle indéniable dans sa présentation aux autres. Mais
qu'est-ce que l'adhérent met en jeu ? Qu'est-ce qu'il donne et
qu'est-ce qu'il reçoit ?
3.2.3.2 Idéaliser sa place par la séduction et
la manipulation
Simultanément de l'apparence et de la manière,
la représentation produite par l'adhérent englobe un processus
d'idéalisation453(*). Il tente, en effet, de paraître meilleur
à ses propres yeux ainsi qu'aux yeux des autres. Il s'agit dans le
contexte d'une recherche de valorisation de soi. Ce qui participe de son
changement puisque, par là, il a intérêt à ce que
ses relations l'emportent temporairement sur ses autres considérations
dans le but d'une amélioration de soi cohérente. Il agit alors
par une stratégie de détour. N'oublions pas qu'il cherche
à satisfaire des besoins-aspirations ; il suffit de parcourir les
entretiens pour se convaincre de sa manière de séduire pour
exister, de manipuler pour arriver à ses fins. C'est pourquoi
l'adhérent-personnage entre dans un processus d'idéalisation dont
on voit pointer la (re)socialisation ; celle qui maintient le masque d'une
attitude devant être perçu positivement par les autres454(*). Pour y parvenir,
l'adhérent use de stratégies de détour (moyens à la
satisfaction). Nous en avons relevé deux : séduire et
manipuler. La séduction est avant tout une présentation de soi,
un acte d'artifices, une stratégie du charme et des promesses. Quand
l'adhérent séduit, il joue un rôle pour attirer l'autre. Ce
rôle est celui d'un hypnotiseur. Mais, cette séduction n'est pas
sans ambiguïté ni double-fond dans la mesure où elle imite
un langage par lequel l'adhérent affirme son identité. Quant
à la manipulation, elle est une technique, autre forme de
stratégie où l'autre devient une cible à malaxer en vue
d'une fin, c'est l'art du pharisaïsme. Par ces deux stratégies
l'adhérent veut convaincre de l'utilité de sa place. Comme en
témoignent les adhérents interviewés qui parlent de leurs
responsabilités ou de leur pouvoir sur les autres. C'est ce qu'illustre
la fonction de "relation publique" que la neuvième personne
interviewée nous dit s'être appropriée455(*). Cette place lui donne
le pouvoir de s'immiscer dans la vie personnelle des autres membres afin de les
aider. Par là, l'adhérent use des stratégies de
séduction et de manipulation afin d'idéaliser sa place et se
valoriser, se donne, en fait, un pouvoir ; dans cet exemple, une image de
soi sympathique en tant que pouvoir de persuasion. Il s'agit bien là
d'une stratégie de détour, d'un détournement des
sentiments. Nous y voyons au fond une sorte de tromperie456(*) parce que l'adhérent
use d'une parole secrète ou d'une attitude camouflée en
décalage avec l'argument lui-même : trouver les mots justes
pour stimuler un autre membre, faire en sorte que l'autre accepte un contenu
qu'il n'aurait pas approuvé autrement. Par exemple, la mise en oeuvre
stratégique qui a permis à un adhérent d'en convaincre un
autre pour faire un compte-rendu de réunion.457(*) En résumé,
séduire et manipuler c'est faire croire et entrer par effraction pour
convaincre, persuader dans le but d'atteindre une fin valorisante pour soi.
Mais le risque est grand, en ce sens, une représentation de soi
condamnée par le mensonge ou l'escroquerie (ou perçue comme
tels), mettrait en danger les rapports sociaux et la personnalité
même de l'adhérent. C'est ce que nous avons relevé dans les
entretiens lorsqu'un adhérent de la branche Finance (CEB) n'avait pas
envie de partager.458(*)
Ainsi, si l'expression de sa (re)présentation devient incompatible avec
l'impression donnée, alors l'interaction dans laquelle est pris
l'adhérent, se désorganise. La reconnaissance
espérée ou acquise peut disparaître constituant une source
d'insatisfaction. Dans notre exemple, l'insatisfaction a causé le
départ de l'adhérent. C'est dans cette perspective qu'il convient
de comprendre l'importance et l'enjeu de l'idéalisation de la place de
l'adhérent au Compu's Club ; la séduction et la manipulation
en sont les expressions les plus immédiates dans les interrelations,
dans les stratégies. L'interaction sociale au sein de la configuration
n'est donc pas neutre, ses enjeux, par voie de conséquence, sont
considérables : satisfaire des besoins-aspirations, gages d'une
(ré)intégration sociale.
3.2.3.3 S'adapter, une tactique pour être
Sur l'ensemble de ce chapitre459(*), il ressort une idée
importante selon laquelle les impressions données à l'autre dans
les représentations de soi des adhérents sont exposées
à des distinctions. Selon les circonstances le
personnage-adhérent peut se produire de diverses manières ;
de même qu'il peut donner une impression différente au regard des
autres. Ce qui suggère une adaptation circonstancielle des
présentations de soi. Rappelons, ici, l'omniprésence des valeurs
(englobantes, préalablement intériorisées, nouvelles ou
modifiées) qui gèrent les relations interpersonnelles à
leur base. Pour n'en rappeler que quelques-unes : échanger (la
communication), prendre des décisions démocratiquement (la
démocratie), faire confiance (la confiance). Si nous voulons retenir la
confiance pour continuer à développer notre propos c'est qu'elle
a souvent été énoncée lors des entretiens et que
nous l'avons interprété comme supposant la fidélité
en la parole donnée, élément constitutif d'une image
positive. Ceci, que ce soit avec celui qui interagit par sympathie ou avec
celui qui tient rigoureusement ses promesses par devoir. Par ailleurs, la
confiance est tenue ferme au Compu's Club comme une norme morale,
éducative et pédagogique qui favorise la démocratie, la
solidarité et la tolérance. Alors, si une rupture de confiance se
produit, l'image de soi autour de laquelle la personnalité de
l'adhérent s'était constituée peut être
détruite. L'adhérent doit donc s'efforcer de maintenir positive
l'image de sa représentation perçue par les autres.
C'est-à-dire, il doit l'adapter à la configuration ; dans
notre exemple, par la confiance. « Ainsi, une présentation
de soi réussie renforce l'image positive que les autres ont de nous et
celle que nous avons de nous-même. »460(*) Nous aurions tout aussi bien
pu retenir les échanges dont la rupture génère la
même nécessité d'adaptation. Ce qui veut dire, la
manière de se représenter de l'adhérent se situe dans sa
capacité d'adaptation aux circonstances et situations. Il s'agit
là d'une improvisation, un jeu tactique ; c'est-à-dire une
gestion au coup par coup de la présentation de soi à l'autre.
Cette interaction, image-de-soi/capacité-d'adaptation, se produit au
Compu's Club par une gestion de la présentation de soi dans la
configuration. C'est-à-dire, une évaluation permanente et
immédiate de ce qui est désirable et de ce qui est jugé
possible. La réponse circonstancielle et subite alors envisagée
par l'adhérent dans ses rapports lui permettra de saisir au vol
l'adéquation entre la présentation de soi et la
représentation de soi par autrui afin de mettre en oeuvre une tactique
(au travers d'une communication non verbale appropriée à la
situation, par exemple). L'image que l'adhérent a de soi et des autres
est en fait une condition élémentaire pour vivre parmi les autres
ou pour, du moins, arriver à s'entendre avec les autres dans les
configurations. En clair, il s'agit pour l'adhérent de faire
reconnaître, dans un système fluctuant, toujours changeant (la
configuration), son rôle et son identité par une
présentation de soi idoine en même temps qu'il accepte
l'identité des autres. Il acquiert ainsi par l'expérience de ses
interactions une aptitude à user de l'ensemble des normes et des valeurs
mises en jeu dans sa présentation pour s'adapter. Dès lors les
membres d'une même branche se trouvent placés dans une relation
étroite de dépendances mutuelles.
Nous dirons en résumé, la présentation de
soi au Compu's Club, c'est d'abord un état. C'est pour l'adhérent
une façon d'aborder la vie de cette association, de prendre contact avec
les autres, une façon de mettre en valeur sa personnalité, ses
traits distinctifs qui le caractérisent, l'individualisent, le
singularisent. Pour paraphraser la branche Littérature : c'est
l'écriture de soi et la lecture de l'autre. La présentation de
soi peut être considérée comme des actes dans le sens
où ils véhiculent une dimension en terme de mise en scène
(Goffman). La présentation de soi, c'est aussi une attitude simulatrice
dupant l'entourage. Ainsi, pour interpréter dans cette association le
poids des représentations dans le changement des adhérents, nous
n'avons pas perdu de vue que l'analyse des comportements individuels ne peut se
faire sans prendre en considération la présentation de soi dans
les interrelations. En fait, dans ces interrelations, où se construit
simultanément la représentation de soi et la
représentation sociale, l'adhérent apprend à valoriser
certains comportements et à les intégrer dans sa
représentation de soi sous forme de règles qui le concernent et
de préférences qui lui sont chères. Il y a donc une
détermination des représentations avec la configuration dans
laquelle l'adhérent se donne en représentation. La configuration
Compu's Club finit par ressembler à un théâtre dans lequel
les adhérents-personnages jouent avec les projets, trompent les autres
tout en sachant qu'ils ont besoin des deux pour satisfaire leurs
besoins-aspirations. Pour synthétiser notre interprétation nous
avons construit le schéma suivant :
Schéma
récapitulatif de la présentation de soi au Compu's
Club
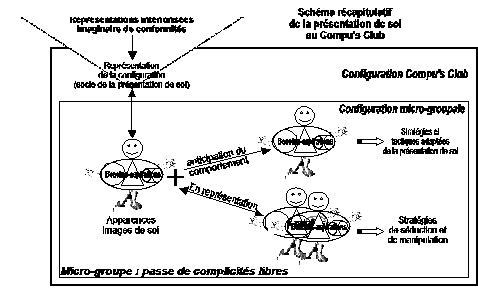
De la représentation de la configuration Compu's Club
et de la présentation de soi dans cette configuration nous dirons
finalement qu'elles participent véritablement au changement des
adhérents. Autrement dit, pour changer, l'adhérent exerce
nécessairement des présentations de soi au sein de la
configuration dont il a une représentation personnelle. En même
temps, l'image de sa présentation aux autres, la conscience du jugement
que l'autre porte sur lui et les sentiments positifs ou négatifs qui en
résultent (et par là, l'image de soi) évoluent. En clair,
les représentations de la configuration sont construites à la
fois objectivement et subjectivement. En effet, la présentation de soi
aux autres des adhérents, comme extériorisation par rapport
à soi, agit en retour de manière contraignante sur eux, la
réalité de la configuration est objectivée ; comme
produit des représentations et des participations, agit en retour
intériorisée par eux, elle est subjectivée. Cette
réciprocité, voulu ou non, de soi vers l'extérieur et
inversement, participe du changement de l'adhérent.
3.3 L'usage de manières de
faire : la quintessence du changement
Si la présentation de soi suggère des
manières de faire consistant en des manières de se
présenter alors user de présentations de soi doit pouvoir
révéler l'existence d'une logique de penser propre à
l'adhérent constitutive de ses intentions. Ainsi, l'usage renvoie
à l'utilisation des configurations (à travers diverses
manières de faire, de penser, d'être, ...) ; autrement dit,
des manières de se présenter, se représenter et autres
comportements et attitudes (afficher une apparence, investir physiquement les
lieux, mettre en scène une identité positive, constituer un
réseau de solidarité, ...) C'est à partir des
représentations de l'adhérent-usager énoncées lors
des entretiens461(*) que
nous avons pu repérer cet usage. Pour le dire autrement,
l'interprétation des représentations des configurations et les
rôles endossés pour interagir doivent être
complétés par l'interprétation de ce que l'adhérent
"fabrique", "bricole", "braconne" pendant ces interactions. En clair,
après avoir montré l'existence de présentations de soi
spécifiques aux circonstances du quotidien de l'association, il va
s'agir d'aborder dans ce chapitre en quoi l'individu-adhérent peut en
"détourner" la logique pour son propre compte. Trouver le sens
intentionnel de ces manières de faire devrait nous mettre au coeur des
mécanismes de son changement.
Certeau dans "l'invention du quotidien" pose
l'existence de deux mondes, celui de la production et celui de la consommation
ou des usages perçues comme des pratiques inventives et
créatives, qui participent de l'invention du quotidien462(*). Il conçoit la
consommation comme une "fabrication", une "poïétique" rusée,
dispersée, silencieuse, quasi invisible qui s'oppose ou négocie
avec le monde de la production dominante. Il cherche « à
se placer dans la perspective de l'énonciation [qui] met en jeu une
appropriation [,] instaure un présent relatif à un moment et
à un lieu [et] pose un contrat avec l'autre (l'interlocuteur) dans un
réseau de places et de relations. »463(*) A partir des entretiens,
nous avons découvert les modalités de ces quatre
caractéristiques de l'usage (se placer, s'approprier, s'inscrire dans
des relations et se situer dans le temps) ; ce qui va nous permettre de
comprendre le changement à partir des opérations bricoleuses
(usages) qui se construisent et se soustraient aux règles
imposées et à l'influence des configurations.
3.3.1 "Se faire une place"
3.3.1.1 L'espace : un lieu pratiqué
« L'espace est un lieu
pratiqué »464(*) souligne Michel de Certeau, en associant la
stabilité au lieu et la mobilité à l'espace. Dans la
configuration, l'adhérent peut exprimer sa personnalité, il
élabore sa vision du projet de branche, puis l'élargit au travers
de prises de responsabilités en prenant une fonction, par exemple. Son
expérience du lieu s'affine avec ses mois de participation pour finir
par coller à la réalité du projet, à l'espace. Pour
l'adhérent, cette expérience constitue des repères
indispensables à l'aménagement de ses participations et par
là de ses manières de faire (se présenter, d'être,
...), à fortiori pour celui qui est en ruptures sociales et manquait
déjà de repères par ailleurs. Ce qui suggère
l'appropriation de l'espace dans lequel il va (ré)inventer ses
participations comme un remède à ses ruptures. Le rôle de
l'imaginaire (une idéalisation, par exemple465(*)) découlant de ses
propres représentations est ici important.
3.3.1.2 S'approprier l'espace : une manière de
faire individuelle
Ces attitudes d'appropriation de l'espace sont constitutives
d'un espace personnel élargi. C'est ce qu'illustre, par exemple, le
troisième adhérent interviewé : les
représentations qu'il a de l'association466(*) et des jeunes467(*) renvoient à sa vie
personnelle468(*) et ses
propres ruptures469(*).
Au Compu's Club, il peut exprimer sa personnalité :
« je suis jeune, je veux aider, encadrer les
jeunes. »470(*) Il a pris successivement des responsabilités,
des fonctions et s'est finalement engagé471(*). Il s'est donc
approprié l'espace configurationnel de cette association en
élaborant un espace personnel élargi. Il y parvient par des
manières de se présenter, se représenter ;
c'est-à-dire, par une assiduité de la fréquentation du
lieu, ses engagements successifs, des comportements circonstanciels, etc. Son
intention étant de s'occuper des jeunes de l'association. Le sens est
fournie par ses propres représentations, celles préalablement
intériorisées (aider les autres, ...) et
construites/développées dans et par les configurations (ses
règles, ses possibles, ses valeurs, ...). Avec ce matériau, il se
donne l'image de quelqu'un de bien dans l'intention plus globale de
réaliser ses besoins-aspirations ; précisément,
être reconnu en tant qu'individu, appartenir à un
« groupe de camarades »472(*), être valorisé
par l'image valorisante inhérente aux fonctions prises. Est-il alors
possible que l'appropriation de cet espace (forme d'usage qui induit des
manières de faire diverses telle que des présentations de soi
adéquates) ouvre sur des changements de l'adhérent ?
La question de l'usage de l'espace revient à saisir ce
que celui-ci représente pour l'adhérent-usager. Notre
réflexion précédente avance l'hypothèse qu'au
départ c'est parce-qu'il existait une structure d'accueil des projets
(le Compu's Club puis, parfois, la fondation d'une branche), que les
adhérents s'engagent ; la perspective de réussir (ses
besoins-aspirations personnels mais aussi le projet commun) rendant alors
acceptables les efforts produits (l'usage de présentations de soi et
autres manières de faire) et le risque de ne pas réussir. Dans
cette perspective nous déterminons une réciprocité :
il n'y a pas de manières de faire sans l'existence de cet espace
récipiendaire qui fonctionne comme polarisation et cadre
préparateur aux changements. A partir de là, la question à
laquelle il nous est donné de répondre est : comment
l'appropriation de cet espace473(*) par un espace personnel élargi peut-il
être l'enjeu de ce qui est rendu visible (la manière de faire, de
se présenter, etc.) ainsi que le souligne Certeau dans
"L'invention du quotidien"474(*) ?
3.3.1.3 S'inscrire dans des relations : stratégies
et tactiques
En fait, l'appropriation de cet espace autorise
l'adhérent à jouer des configurations selon des possibles de
profits. Précisément, il transforme non seulement ses relations
par rapport à ce qu'il a vécu, mais également ses
présentations de soi ; il se place autrement face au projet pour
devenir auteur, inventeur, créateur. L'appropriation de l'espace se
situe donc dans une sorte de mise en usage de cet espace pour espérer
réaliser ses besoins-aspirations. Les usages constitués à
l'intérieur des interactions prennent place et produisent des
manières de faire que l'adhérent mobilise (présentation de
soi, par exemple) lorsqu'il est en contact avec une configuration.
En clair, la configuration offre un cadre
interrelationnel ; son usage permet son existence en tant que cadre
favorisant les changements ; et les manières de faire l'optimisent
par les changements mêmes. Pour ce faire, l'adhérent investit dans
la configuration selon deux types d'opérations : les
stratégies et les tactiques.
3.3.1.3.1 Les stratégies
Lorsque l'adhérent s'approprie (s'empare, use) l'espace
par une présentation de soi (par exemples : participations,
engagements, comportements, ...) il calcule les rapports de forces en jeux pour
s'en servir de base à une gestion de celle-ci dans ses relations. Il
joue, il ruse, il détourne la configuration et par là, les jeux,
les ruses, les détournements des autres selon, par exemple, un style
propre. Dans cette logique du jeu de la ruse, du détournement,
s'installe un rapport de dépendance entre ce calcul et cette gestion en
même temps qu'elle dégage une marge de liberté ; en
l'occurrence, le choix du style à employer. Il va user ainsi de
manières spécifiques de se présenter, appropriées
à la circonstance, tirées de ses intentions et qui
révèlent un lieu circonscrit comme un propre (Certeau). Ce lieu
propre est le lieu de ses intentions. Quand un adhérent
choisit une stratégie, ses jeux lui sont directement associés par
un ensemble de résultats qui restent possibles compte tenu de toutes les
stratégies dont disposent les autres adhérents. Ainsi, il
déploiera tous ses efforts pour réaliser ses motivations, ses
besoins-aspirations, lui permettant de se distancer de ses ruptures, voire les
cicatriser475(*). Son
intention (que nous traduirons, ici, comme un but à réaliser)
sera, dès lors, de veiller à réduire les
éventuelles tensions au sein du groupe. Autrement dit, aider les autres
et lui-même à regrouper l'attention, et par là à
s'engager spontanément dans le contenu officiel de la branche,
c'est-à-dire le projet, la mission ou l'objet de celle-ci. Il donne un
sens à ses intentions. Cet usage de manières de faire, ses
stratégies, autorise un degré de sécurité relatif
à chacune d'entre-elles. Il s'intéressera alors à celles
qui lui assurent le résultat le meilleur. Il s'assure ainsi et autant
qu'il le peut contre le pire ; c'est-à-dire contre une
contradiction des autres au sein du micro-groupe. Pour y parvenir, il
définit préalablement un point d'équilibre entre les
meilleures réponses à la configuration. En résumé,
l'adhérent s'approprie, se réapproprie, s'adapte, ruse, joue,
détourne constamment. Bref, il change continuellement.
3.3.1.3.2 Les tactiques
Lorsque l'adhérent exploite (s'empare, use) de la
configuration dans une situation relationnelle immédiate, ou lorsqu'il
n'a pas le choix, il va chercher soit à tirer profit des forces
existantes en leur temps opportun, soit les laisser jouer à son profit
par des manières de se présenter, immédiates et
circonstancielles. Il saisit ainsi l'occasion selon un art de faire des coups,
une tactique qui signifie l'absence de propre (Certeau). Les tactiques de
l'adhérent tentent ainsi de répondre aux besoins et aux
préoccupations personnelles de l'heure. Par exemple, la réponse
agacée des membres-Echap de la section Littérature n'a pas
évalué les conséquences de leur refus de se plier aux
exigences de l'écrivain professionnel.476(*) Ainsi, la tactique est relative aux
possibilités offertes par les circonstances mais n'obéit pas
à la loi du lieu, de la configuration, de la contingence. Elle est
manipulation (forme d'usage) de l'espace dans l'immédiateté.
Autrement dit, l'adhérent fait preuve de créativité et
d'invention en produisant des coups instantanés dans ses
présentations de soi pour déjouer le jeu des autres. Certeau
précise comment, devant les multiples détails de la vie
quotidienne, les tactiques, engendrent une activité
débordante : « il y a mille façons de jouer et de
déjouer le jeu de l'autre, c'est-à-dire l'espace constitué
par d'autres et qui caractérisent l'activité tenace, subtile,
résistante, de groupes qui, faute d'avoir un propre, doivent se
débrouiller dans un réseau de forces et de représentations
établies. »
3.3.1.3.3 Un exemple de stratégie incluant des
tactiques
Ainsi que le souligne cet exemple à propos de
l'étiquette informatique et de la mission477(*) de l'association,
l'adhérent trouve des façons de faire, des moyens de
déjouer ou de composer avec celles-ci pour arriver à ses fins. Ce
qui transparaît de l'enquête c'est la capacité de
l'adhérent à personnaliser les usages de l'informatique à
des fins qui lui semblent le plus profitable, indépendamment du dessein
initial de l'objet, c'est-à-dire indépendamment du but pour
lequel l'étiquette de l'association destinait son objet
(l'informatique). En bref, l'adhérent prétexte l'outil
informatique pour fonder quelquefois des branches sans lien direct avec l'objet
initial tout en l'utilisant véritablement comme un outil (traitement de
texte, Internet, etc.). Ainsi, ont été fondées les
branches Finance (CEB), Littérature (Echap), Jeunesse (Libertech), le
bulletin Membre, le projet R.S.I. (Réseau de Solidarité
Intergénérationnelle)478(*). En fait, il s'agit ici de choix, de
sélections (de détournement stratégique) dans la gamme des
possibilités offertes par la mission de l'association, pour tenter de
répondre aux besoins et aspirations personnelles. Ainsi,
l'adhérent s'approprie un espace qui lui permet, en tant qu'usager, de
jouer sur la mission et l'étiquette du Compu's Club, tout en se passant
des codes imposés par ce dernier (la pratique informatique), ou en
tenant compte uniquement de ceux d'entre eux qui lui sont utiles dans la
réalisation de ses propres objectifs (l'Internet, les méls ou le
traitement de texte). Ce que nous résumons par le tableau
suivante :
Tableau d'usage de
l'association par les adhérents
|
Usage de l'association
par les adhérents
|
Mission de l'association :
Proposer les TIC pour
créer des activités
|
Etiquette de l'association :
les TIC
|
|
Adhérent :
Besoins-aspirations TIC
|
Fondation d'activités TIC
par les membres
|
Utilisation des TIC par les membres en tant que fin en soi
|
|
Adhérent :
Besoins-aspirations non TIC
|
Fondation d'activités non TIC
Par les membres
|
Utilisation des TIC par les membres en tant qu'outil.
|
Ainsi, les adhérents détournent parfois les
outils, les utilisent à leur manière, avec leur logique, une
logique de la ruse. Cette logique, « qui composent, à la
limite, le réseau d'une antidiscipline », subvertie, du
dedans pour en faire autre chose, les outils informatiques ou les
représentations imposées par l'objet de l'association.
« Alors, seulement on peut apprécier l'écart ou la
similitude entre la production de l'image et la production secondaire qui se
cache dans les procès de son utilisation. »479(*) Leur mode d'emploi, se
manifestant avec suffisamment de récurrence, correspond à des
intentions, des préméditations. En somme, face aux modes
d'emplois prescrits par l'étiquette informatique, les
adhérent-usagers tendent à proposer des détournements de
l'outil, des déviances de l'objet et des variantes de la mission, pour
changer. Le sens donné à cet usage de l'association fait
référence aux représentations et aux valeurs qui
s'investissent dans l'usage de manières de faire.
3.3.1.4 Se situer dans le temps
En fait, nous venons d'interpréter les usages en
fonction des moments d'investigations qu'ils privilégient (appropriation
par des stratégies, formation des usages et inventivité par des
tactiques). Pour résumer, les stratégies des adhérents
(déterminant un propre) sont une « victoire du lieu sur le
temps »480(*). En effet, elles servent de base à une
gestion de leurs relations ; c'est-à-dire, sont un véritable
terreau de capitalisation des avantages permettant leur réutilisation.
Alors que la tactique dépend du temps parce qu'elle est
immédiateté. Ce qu'elle gagne, elle ne le garde pas.
L'adhérent use de l'occasion. La fréquence d'usage de tactiques
et stratégies dans le temps nous ont permis de circonscrire les
données sur les changements. Nous avons relevé qu'elles pouvaient
être déstabilisées puis recomposées sous d'autres
formes conduisant à une plus grande planification du temps. Ainsi, nous
avons pu rendre-compte, précédemment, de la façon dont les
adhérents-usagers usent de la configuration dans des temporalités
spécifiques aux manières de faire.
3.3.2
Tours et détours. Contours du changement
Résumons-nous. La configuration en tant qu'offreuse de
règles (c'est-à-dire une sorte de conditionnement, même si
elle est mutuellement construite entre les adhérents) conditionne
l'adhérent-usager selon une marge de liberté qui lui reste
propre : ses intentions. Les interactions entre l'offre et son utilisation
(tactiques et stratégies) renvoient aux représentations (par
exemples, sa dimension symbolique, les différentes images
développées) de l'adhérent-usager. La figure de celui-ci,
rusé, subtil, bricoleur, capable de créer ses propres usages,
apparaît comme celle d'un individu actif de son changement. Ses
manières de se présenter (comportements, attitudes, ...)
répondent aux propositions de la configuration dans l'intention de se
l'approprier et par là se donner quelques chances de réaliser ses
besoins-aspirations. Toutefois, la marge de manoeuvre de ses manières de
faire est limité à la zone définie par toutes les
manières de faire des autres adhérents-usagers, réduisant
sa marge de liberté et de pouvoir dont il est détenteur à
un moment. Autrement dit, l'appropriation de l'espace de la configuration
permet de la comprendre comme un processus de création de sens, dans et
par l'usage, dans toute sa dimension sociale. L'usage a ainsi une
épaisseur sociale. Dans cette perspective, l'usage fait partie
intégrante des manières de se présenter et autres
manières de faire, il vient s'y intégrer en même temps
qu'il les transforme et transforme, simultanément, l'état de
l'adhérent ; c'est-à-dire, caractérise son
changement. Prenons un dernier exemple. Nous avons parlé, plus haut, de
style vu en tant que manière de se présenter ;
l'interpréter, c'est interpréter un adhérent qui a
trouvé sa manière de dire481(*) par une expressivité propre (manière
de faire). C'est un art de faire, un savoir-faire pour comprendre, se
distancer, faire le point, exister, se reconnaître, acquérir une
identité, échanger, travailler sur soi, donner à
être écouté, élaborer une pensée,
évoluer, se dégager, se transformer voire se transcender, se
sublimer et par là-même changer. En effet, lorsque cette
expressivité est authentique et tombe juste, son expression par une
présentation de soi spécifique devient prégnante et
porteuse pour l'adhérent ; il change en ce sens qu'il oeuvre pour
réaliser ses besoins-aspirations. Certeau parlait
déjà d'une esthétique du savoir par un
savoir-faire482(*).
Ainsi, le style représente l'espace de ce que
l'adhérent-usager éprouve par rapport à ce qui est ou qui
doit être à un moment donné. Les bénéfices
sont donc tant au plan du savoir personnel que de la personne même. Il
n'est plus tout à fait le même qu'avant, il évolue, il
change en jouant de la configuration.
Ce qu'il est intéressant de voir finalement c'est que
l'adhérent développe une créativité
immédiate ou réfléchie (tactique ou stratégie) pour
s'adapter aux situations et arriver à ses fins, répondre à
ses attentes. Ce sont des temps d'ouverture à une socialisation (avec
l'autre), porteuse d'autodidaxie (expérience-connaissance). La
façon d'utiliser la configuration est au fond tributaire de la
façon d'user de manières de faire en tant que processus de
socialisation propre à chaque adhérent ; elles-même
tributaire des différentes histoires et des règles propres des
configurations à la fois modelées et modelantes. Si l'on
considère qu'il peut trouver là une distance avec ses ruptures
alors il change profondément, intérieurement,
intrinsèquement. Par cette autodidaxie, il acquiert de nouvelles
manières de penser et d'agir selon un espace-temps de transition plus ou
moins long : son espace personnel élargi. Elle constitue donc un
mode d'apprentissage qu'il anime comme une ressource en quelque sorte
dès qu'il est, par exemple, contraint d'inventer des solutions
inédites à un problème particulier. Son changement nous
est par là rendu intelligible.
3.3.3 La part de l'autre
Nous sommes arrivé au point de pouvoir rassembler un
certain nombre d'éléments et sceller notre propos pour souligner
avec force un autre sens : la part de l'autre dans le changement. Ce que
nous avons interprété là est de l'ordre d'une mutation de
fond individuelle, d'une singularité même si elle n'échappe
pas à une certaine régularité ou peut être comprise
par une loi. Sachant que l'expérience se soutient de
généralités, de lois, qu'elle dépasse l'un pour
toucher l'ensemble. Dans nos exemples, il peut y avoir une sorte de
ressemblance mais pas d'identité ; l'expérience (et son
énonciation, usage de l'expérience, manière de faire)
reste une singularité. C'est à partir d'elle que
l'adhérent invente. Bref, les manières de faire montrent un
rapport intersubjectif en actes mais une singularité de
l'expérience ; une similitude avec les projets mais une
multiplicité de coups joués singuliers. Une singularité
qu'il nous faut donc entendre comme une construction par la pluralité.
Ce qui témoigne de l'inscription de l'adhérent-usager dans un
contexte social configurationnel indispensable à la préparation
de son changement.
Pour l'adhérent user de manières de faire
revient donc à s'engager de manière singulière dans une
pluralité de manières de faire. En effet, dans les
énoncés, comme dans leurs énonciations, cela se marque par
un "je" qui s'assume comme auteur propre et singulier. Entre
l'énoncé et l'énonciation, un lien. Ce lien est l'usage de
manières de faire qui désigne la place que va occuper
l'adhérent-usager et où le singulier touche au
général. Cette place, outre le fait qu'elle soit au centre de sa
construction, a la particularité de rencontrer un autre (un autre je)
qui peut s'y reconnaître (un autre chômeur pour la branche
Littérature, par exemple). Dans ce cas, l'adhérent a comme but de
faire partager son expérience, c'est-à-dire de l'agir et de
l'éprouvé. Il appelle ainsi "l'autre" pour le partager,
l'évaluer (il joue un coup) et par là lui permet
d'évoluer, de changer intérieurement. L'attitude de l'autre
touche alors à des réactions d'empathie, de sympathie,
d'antipathie (le coup précédent appelle un contre-coup) qui sont
des modes de connaissances de la relation avec les autres. Dans ses
manières de se présenter, de se représenter la
configuration amène à des manières de penser, d'agir.
Ainsi, l'adhérent s'interroge, rend visible ses doutes et arrive
immanquablement aux problèmes d'éthique. Il n'y a
d'éthique que parce qu'il y a de l'autre. Chacun est à la
recherche des gestes justes, qui donnent de la dignité à ses
actions, conduit finalement à la construction d'un ethos
(Scheler483(*)).
Participer à cette construction le transforme parce-qu'elle est l'amorce
d'une responsabilité qui reconstruit, à son tour, quelque chose
de lui-même et de ses choix. L'usage de manières de faire
épouse donc les situations communes par une singularité en
même temps qu'il épouse la singularité des situations dans
le commun.
Mais pour s'autoriser à changer de la sorte, un risque
est à prendre. L'adhérent éprouve de l'angoisse,
même de la souffrance car, du fait de ses ruptures, il se sait
exposé par rapport aux autres au moment de ces usages. Il n'expose pas
seulement ses pensées mais soi-même. Il met bas le masque à
l'instant de ses manières de faire. Il n'use donc pas seul, mais avec
d'autres, pour d'autres. Ce qui surgit dans l'interaction entre soi et l'autre
est sa subjectivité qu'il ne peut exclure. En ce sens, user de
manières de faire correspond à un mode de restitution de ses
sentiments : passions, amour, haine, rejet, masochisme. L'autre n'est plus
alors seulement l'objet d'un regard extérieur, il est un confident.
Ainsi, l'usage de manières de faire prend la place des manières
de faire même et marque ce que l'adhérent cherche à
présenter. En effet, il se comporte, par exemple, de manière
à gagner la sympathie des autres. Son comportement moral tient compte du
jugement de l'autre pour obtenir une appartenance dans le regard de l'autre.
L'usage de manières de faire appelle ainsi à une éthique,
c'est une éthique en acte.
Au fond, le but de l'adhérent est de vivre
normalement484(*) pour
nier l'étiquette sociale relative a ses ruptures qui lui est
accolée par la société. L'étiquette de
chômeur en est un exemple significatif. S'ajoutent les ressources
mentales comme « le désir de faire ensemble.
»485(*) Son
identité est en train de revivre à nouveau (ou bien une nouvelle
est en train de naître) par sa volonté personnelle (il change).
Nous irons jusqu'à dire : au-delà des participations ou des
fonctions mêmes. Cette volonté est réaménagée
pour que ses situations (les étiquettes allouées par la
société) ne soient plus un handicap : il se prépare
à un changement continuellement et incessamment renouvelé dans
une configuration qui structure ses manières de faire. En effet,
celle-ci est l'organisatrice des actions produites par les manières de
faire. Elle vise à former des micro-groupes, à produire du
contact. Ainsi, les projets sont moins des idées à
développer que des idées à créer du lien social
où les manières de faire témoignent d'un désir de
réduire des ruptures, de réaliser des besoins-aspirations. Leur
usage élabore de nouvelles formes d'échanges sociales. En somme,
l'usage de manière de faire est une tension entre des aspirations et les
craintes que celles-ci suscitent en même temps que cette tension est
indispensable au changement individuel dans un cadre configurationnel.
Finalement, dans ce chapitre, nous venons de
caractériser les séquences et les procédures qui marquent
un changement d'état pour l'adhérent au travers de l'usage de
manières de faire qu'il fabrique. De la sorte, il s'approprie une place
dans les configurations (un propre dans lequel il joue en stratège et
tacticien) à partir de laquelle il va pouvoir dire les choses ;
c'est-à-dire user de manières de se présenter (de dire,
d'être, ...). Cette place a donc un sens, du sens. Un sens parce-qu'elle
constitue l'espace personnel nécessaire à sa participation ;
du sens parce-qu'elle est l'espace (au sens certausien du terme,
c'est-à-dire un lieu pratiqué) à partir duquel il va
jouer, ruser, fabriquer, détourner, bricoler, investir sa
présentation de soi, ses manières de faire, d'être, d'agir,
de penser. L'adhérent du Compu's Club est, en conclusion, la figure
exemplaire qu'impose l'invention d'équivalences de codes, la
réorganisation des systèmes. Il montre qu'il est possible de se
déplacer entre le passé et le présent pour
l'espérance d'un avenir, d'un devenir, qu'il peut inventer d'autres
images de référence, dont l'ensemble finit par donner forme
à une nouvelle représentation de soi et en jouer, en user pour
répondre à ses attentes et par là se préparer
à changer, puis changer et finalement changer continuellement. En fait,
l'adhérent est un joueur ; sa salle de jeu est un
théâtre où la dépendance des relations donne une
idée de similitude et de réciprocité mais aussi de
complémentarité entre sa singularité, son je et la
pluralité des autres je. Cela l'amène à user de tactiques
et de stratégies dans lesquelles il fait preuve de
créativité pour chercher le meilleur résultat, en
même temps qu'il définit un point d'équilibre dans ses
relations. Son acte (l'usage) est singulier, son action (la manière de
faire) est la preuve visible de ses changements en cours. Ainsi,
l'adhérent du Compu's Club est un individu pluriel qui ne peut pas
être pensé comme Robinson Crusoe mais dans une pluralité
d'individus.
C'est lorsque nous avons porté une attention
particulière aux manières de se présenter que nous avons
saisi les conditions d'émergence et l'importance du sens des usages dans
l'appropriation de l'espace. En effet, ce sont les significations
attribuées par l'adhérent-usager pour s'approprier les
configurations qui contribuent à la constitution d'une identité
nouvelle ou renforcée révélatrice de son changement.
Ainsi, les relations interpersonnelles et les interactions
révèlent la fabrication de l'espace, sorte d'entre-deux,
bâtie autour de l'usage de manières de se présenter et qui
portent les traces de la configuration dans laquelle les participations
prennent place pour répondre aux attentes et par là permettre le
changement de l'adhérent. Cet usage participe à la construction
et au renforcement d'une ambiance, qui fut si souvent énoncée par
les adhérents interviewés, et par extension, au renforcement
d'une identité groupale.
Conclusion : L'art et la
manière
Avec cette troisième et dernière partie, nous
comprenons mieux pourquoi l'enquête a identifié un certain nombre
de ruptures de l'adhérent486(*). En s'inscrivant au Compu's Club, il est fort
probable qu'il souhaite les réduire, autrement dit changer.
Nous avons voulu interpréter sa participation à
partir de ses besoins-aspirations pour rendre intelligible les changements
observés. Ce qui nous a permis de conclure que ses comportements
étaient motivés par les représentations qu'il a de
l'environnement et des autres adhérents.
Mais le caractère interdépendant des
configurations dans lesquelles il s'engage l'oblige aux relations
interpersonnelles. Ce qui nous a permis de présenter
l'interprétation du changement sous l'angle des manières de se
présenter et de leurs usages. A partir de là, l'adhérent
va provoquer ou profiter (formes d'usages) des circonstances selon des
manières de faire propres à satisfaire ses attentes. Les
manières de faire consistent en une activité de
dévoilement de son identité (présentations de soi) en
inventoriant le plus grand nombre de disponibilités existantes et vice
versa. Elles rendent comptent de la communication entre les adhérents.
En privilégiant les aspects profitables à chacun, les
adhérents font preuve d'une appropriation de l'espace, avec pour
objectif l'amélioration de leur place dans la configuration et par
là, se donnent les moyens de satisfaire leurs besoins-aspirations. Nous
sommes, avec ces usages, dans une expressivité. L'adhérent y
instaure un présent relatif à un moment et à un lieu ; il
pose un contrat avec les autres dans un réseau de places et de
relations. Les stratégies et les tactiques qu'il emploie lui permettent
d'inventer au singulier des modifications des situations interpersonnelles. De
cette créativité naissent ses engagements, il change en
même temps qu'il s'affirme comme un individu par rapport aux autres.
En résumé, comprendre les raisons du processus
de changement des adhérents de l'association Compu's Club c'est rendre
compte des dynamiques relationnelles qui caractérisent les rapports.
Ainsi, nous avons pu rendre visibles quelques matériaux participants du
phénomène observé. Grâce à la construction du
modèle d'analyse et des entretiens nous avons pu décoder les
schèmes opératoires réalisés par les
adhérents. En clair, nous avons repéré cinq
mécanismes fondamentaux des manières de faire et de leurs usages
:
û une recherche de satisfaction des besoins-aspirations
pour transformer les ruptures en mieux-être,
û une mobilisation des représentations pour les
utiliser dans les différents contextes où ils risquent d'en avoir
besoin,
û des présentations de soi adaptées pour
s'intégrer dans une configuration,
û des stratégies singulières pour
interagir,
û des tactiques individuelles pour acquérir ou
conserver leur place.
Lorsqu'une configuration favorise ces manières de
faire, les adhérents usent de tactiques et de stratégies et se
trouvent motivés par leur relations. Ils deviennent acteurs de leur
changement.
Conclusion générale
CONCLUSION GÉNÉRALE
Notre observation des adhérents-individus du Compu's
Club, association informatique, nous a fait nous interroger sur le fait que
certains parvenaient à changer. Dès lors qu'un adhérent
créait, s'engageait ou participait à un projet de branche nous
observions un mieux être, un mieux vivre que parfois il
énonçait lui-même. Nous connaissions le fonctionnement de
cette association informatique depuis sa création et ses
adhérents depuis plusieurs années. Nous savions que
l'organisation de cette association était axée sur l'autonomie de
ses branches ; et ses fondements, sur la valorisation de l'individu.
Néanmoins, pour une compréhension raisonnée du
phénomène observé, il nous fallait identifier avec
précision ces changements afin de les analyser et découvrir
quelles en étaient les clefs et les mécanismes.
Nous souhaitions donc aborder les changements de
l'individu-adhérent dans ses rapports aux autres dans une contingence.
Pour y parvenir, nous avons fait l'examen de ce qu'on entend de l'individu pour
éclairer les présupposés. Ainsi, nous avons
procédé à une recherche bibliographique sur le sens de
l'individu aujourd'hui, ce qu'il est, ce qu'il produit, ses
particularités, ses caractéristiques, ses valeurs, son (ses)
identité(s), ses représentations, ses façons de faire. Ce
fut l'occasion de formuler des repères en abordant le concept de
configuration (les interrelations, les interdépendances) et les
processus de représentations, de présentations sociales,
d'identification et de façons de faire ou d'être d'un individu au
moment du changement observé. Nous avons retenu que les
représentations sont des modalités de pensée
intériorisées, la présentation de soi appelle aux jeux des
apparences dans la relation aux autres, l'identification signifie une
socialisation et les façons de faire ou d'être supposent
l'existence d'un usage singulier du faire, être, penser.
Nous avons alors émis l'idée selon laquelle plus
un individu use de manières de faire dans une configuration plus il
change. Cette hypothèse pose l'individu dans ses relations à
l'autre, avec les autres (configuration). Mais surtout elle met en jeu des
possibles de jeux, de mise en scène de l'individu dans ces relations
(usage de manières de faire) permettant sa singularité. Ce qui a
orienté d'emblée le travail de compréhension du
phénomène dans deux directions complémentaires :
l'association vue en tant que configuration et l'adhérent vu en tant que
producteur de manières de faire, d'être, de penser
singulières. L'enjeu étant d'appréhender les
mécanismes de ce qui joue, se joue ou a joué dans le changement
apparent. Les termes clefs de cette hypothèse (individu, configuration,
manières de faire) nous a permis de construire et définir un
modèle d'analyse devant servir à notre enquête. Ainsi, le
premier objectif de la première partie a consisté à
dégager et à cerner la dynamique qui s'établissait entre
l'adhérent et son changement, ainsi que ce qui le singularisait.
Pour appréhender les raisons du changement de certains
adhérents nous avons tenté de décrire les relations
et les dépendances qui pouvaient exister entre le parcours individuel du
membre avant son adhésion et sa participation actuelle. C'est à
dire, nous avons cherché à relever si la trajectoire sociale de
l'adhérent, son histoire familiale, sa situation professionnelle
pouvaient être des raisons de son changement. Les entretiens ont
présenté le passage d'un état premier vers un autre
état sous-entendant une amélioration, c'est-à-dire un
changement mesurable dans le temps et la durée. Si nous avons pu
analyser des parcours différents, particuliers d'un membre à
l'autre, nous avons surtout pu repérer une raison commune à leur
changement : la rupture sociale. Ce qui nous a permis de connaître
ce qui les a poussé à adhérer et ce qui les fait rester ou
démissionner, avec des possibles de comparaisons entre les participants.
Deux aspects principaux se sont démarqués de l'ensemble des
interviews : une similitude des comportements à la relation
interpersonnelle et une perception individuelle de l'environnement de
l'association.
Que peut-on toutefois retenir de leur changement ? Si le
changement est le passage d'un état vers un autre, il est aussi le
passage d'une situation présente, souvent insatisfaisante vers une
situation future, désirée et espéré plus
satisfaisante. Confronté à leurs situations de ruptures, les
adhérents témoignent de plusieurs réactions possibles face
au changement. En voici trois :
û Une première réaction consiste pour
celui ayant perdu confiance en ses capacités de ne pas s'engager dans un
projet de branche, évitant ainsi une nouvelle situation qui peut
être appréhendée comme contenant un échec potentiel
et représenter une nouvelle menace pour son équilibre personnel.
û Une deuxième réaction est pour
l'adhérent de ne pas s'engager dans un projet de branche qui pourrait le
placer dans une position d'ambivalence par rapport à des habitudes
intériorisées de comportement, à des manières
d'agir et de penser.
û Une troisième réaction est pour
l'adhérent la mobilisation de ressources symboliques lui permettant de
transgresser ses déterminismes antérieurs et de s'engager dans un
projet de branche. Ces ressources symboliques se situent au niveau de
l'identité et de l'image de soi. L'identité et l'image de soi ne
sont pas figées mais évoluent au fil des interactions sociales et
des expériences qu'il vit. Ce qui lui donne une dimension d'acteur. En
usant de cette image de soi, l'adhérent peut dépasser ses
représentations et les préoccupations de cette image de soi pour
poser un acte qu'il juge important ; une manière de faire.
L'aspect dynamique du changement est donc l'idée d'un
processus, d'un devenir, d'une progression qualitative de la vie. On peut donc
voir le changement comme une amélioration continue d'un état
d'être rendue possible par ce qui a joué, joue et se joue chez
l'adhérent.
Par ailleurs, les configurations Compu's Club participent du
développement de ses adhérents. En effet, en tant
qu'équilibre de tensions, elles sont les « figures
globales toujours changeantes que forment les joueurs ; elles incluent non
seulement leur intellect, mais toute leur personne, les actions et les
relations réciproques. »487(*) Ainsi, l'enquête nous
a fourni ce que les configurations en questions avaient de particulier.
C'est-à-dire, non seulement leur composante éthique, leurs
incitations à la motivation et à l'engagement, mais aussi les
dépendances réciproques des interactions et des relations
interpersonnelles. En quelque sorte, les configurations Compu's Club sont des
incitants au changement, à la transformation de soi à soi et de
soi aux autres et visent l'obtention d'une qualité de vie meilleure. En
d'autres termes, elles sont les cadres conformés d'une
amélioration de l'état d'être de l'adhérent. Cette
vue d'ensemble permet de prendre conscience de l'importance de chaque
élément. C'est-à-dire, les adhérents se voient
progresser ; le fait de trouver une structure et d'en user, donne
l'impression que satisfaire des besoins-aspirations est réalisable. En
effet, si la configuration peut servir de cadre de base aux interrelations,
elle offre surtout la possibilité d'en user de manière
singulière pour répondre aux attentes de chacun et de tous. Une
configuration construite et modifiée par tous donne du sens aux
comportements de chacun. Construit par tous et par chacun en une incessante
interaction. Ici, chacun est quelque part obligé de fabriquer ses
présentations de soi en adéquation de la configuration de telle
sorte que l'image produite soit vue positive par le micro-groupe. Mêmes
les adhérents les plus réservés jouaient de la
configuration. La motivation se trouve chez chacun d'eux. Au début,
certains adhérents ne s'investissaient pas, et puis, ils ont pris, petit
à petit, confiance en eux et ont fini par s'impliquer et prendre des
responsabilités. Bref, cela autorise l'appropriation de la
configuration. Celle-ci a pris du sens pour eux. Ils la sentent, ils la vivent
dans une ambiance de responsabilité et de satisfaction (sinon, il ne
restent pas). Ici, la configuration donne les moyens, est le cadre pour y
parvenir. Cela leur a permis une ouverture d'esprit, le développement
d'une amitié bienveillante, une solidarité et une
tolérance vis-à-vis de la compréhension de chacun. Ce
n'était plus un adhérent qui se débat seul, mais ensemble,
ils construisaient leur satisfaction de besoins-aspirations individuels. Si le
produit est collectif, néanmoins chacun peut rester créatif et
faire ce qu'il veut. Cela laisse une place à la différence.
Chaque adhérent peut trouver cette place, sa place. Cela nous confirme
que rien n'est jamais joué d'avance dans la trajectoire d'un individu et
que l'homme n'est pas réductible à un groupe (ses appartenances),
bien que sous certains aspects, il est conforme aux caractéristiques
propres à ce groupe. Chaque individu progresse ou régresse selon
son propre contexte particulier.
Dans ces configurations, lorsqu'un adhérent prend part
aux dynamiques relationnelles, un ensemble de comportements interactifs
caractéristiques a été noté. Ces comportements sont
la conséquence de ses attentes et du sens qu'il leur donne. Il use
alors, selon les circonstances, de tactiques ou de stratégies. Le
comportement relevé en premier lieu chez les personnes
interviewées est une stratégie d'adaptation par une
présentation de soi circonstancielle afin d'attendre un but. En
deuxième lieu, ils manifestent une série d'ajustements tactiques
pour donner ou conserver une image positive de soi au regard des autres, sa
place. L'analyse du processus d'interaction dévoile que tous les
adhérents sont influencés par la présence des autres.
Chacun d'eux ajuste son comportement et utilise des stratégies et des
tactiques distinctes. En somme, lors des relations interpersonnelles, les
interactions assurent les manières de faire interprétées.
Quant à la forme de ces interactions, notre enquête établie
que les situations sont configurationnelles. C'est-à-dire que les
adhérents sont mutuellement dépendants les uns des autres pour
répondre à leurs besoins-aspirations respectifs. L'usage
singulier par un adhérent des circonstances créées par les
dynamiques relationnelles est aussi semblable que pour n'importe quel autre
adhérent. L'expression de cette singularité se développe
dans un "tiers", un entre-deux. ; l'adhérent « y est
toujours coincé dans le sort commun. appelé Chacun, cet
anti-héros est donc aussi Personne, Nemo. »488(*) La configuration est ainsi
d'un type particulier. Dans sa logique fondamentale, les adhérents en
situation de face-à-face sont les participants principaux. L'entre-deux
créé par le sens intentionnel des participations des
adhérents est un troisième partenaire indissociable pour assurer
la réussite des interactions. Il est le lieu propre et
intermédiaire de négociation de la forme et du sens. De fait, le
trialogue avec l'entre-deux est très fluctuant. Chaque adhérent
tient une place mouvant en fonction des circonstances. En somme, les dynamiques
relationnelles au sein d'une configuration possèdent une structure
interactive complexe. D'autant plus complexe que l'adhérent ne
s'engagera qu'après une analyse stratégique en termes de pouvoir
et d'alliances. Il cherchera a avoir des assurances pour savoir comment
s'engager et en évaluer les conséquences dans ses manières
de se présenter. L'adhérent voit, ainsi, une proposition pour un
accès au pouvoir. Chacun essaie d'imposer sa rationalité à
l'autre, c'est-à-dire les règles du jeu qu'il est capable de
jouer. Jeu qui se déroule à l'intérieur d'une marge de
liberté définie par son interdépendance avec les autres
même s'il « n'y a pas de formule générale
permettant précisément de calculer [...] la largeur de la marge
individuelle. »489(*)
Autrement dit, nous mesurons qu'il y a changement à
partir de trois dimensions : la dimension configurationnelle,
interpersonnelle et inter-relationnelle.
La dimension configurationnelle
Le contexte environnemental du Compu's Club intervient dans
des configurations qui impliquent une interdépendance des relations
interpersonnelles et des interactions selon des normes et des règles
sociales. Pour chacune des situations, les participants ont des rôles et
des attentes auxquels ils sont liés. Ainsi, des règles implicites
indiquent comment agir selon les circonstances. Pour y parvenir, les
adhérents créent de nouveaux systèmes de valeurs. En
interaction avec les autres, ils s'efforcent alors d'établir des
relations selon le contexte. C'est à partir des continuelles
évolutions de ces règles que nous avons pu mesurer un changement
chez l'adhérent.
La dimension interpersonnelle
Les adhérents sont membres de micro-groupes
d'appartenances qui véhiculent certaines valeurs, comportements et
façons de faire. Chacun devant comprendre la signification des
comportements de chacun pour interagir. C'est à partir des changements
de conduite lors des interactions que nous avons pu mesurer un changement de
l'adhérent.
La dimension inter-relationnelle
Dans la configuration, chacun projette une image de soi et
tente de la faire accepter par l'autre. Cette image est véhiculée
par des attitudes et des comportements. Or, ceux-ci sont le produit de
l'expressivité de chaque adhérent à partir de laquelle
l'interrelation se fonde. La présentation de soi doit alors
défendre la personnalité, la réputation, les
compétences et parfois même la place de l'adhérent. Il
s'exprime alors par un je qui le positionne par rapport aux autres. C'est
à partir des manières de faire dans la configuration que nous
avons pu mesurer un changement de l'adhérent.
Cette étude nous a permis d'atteindre notre objectif
principal. C'est-à-dire, comprendre ce qui peut expliquer le
phénomène de changement. Ainsi, nous avons maintenant une
idée très précise de comment l'adhérent du Compu's
Club participe à son évolution individuelle, son changement. A
savoir, selon le principe fondamental suivant : plus il use de
manières de faire, plus il affirme sa singularité, son
individualité donc son statut d'individu. Ce changement passe par des
représentations induisant des manières de faire
spécifiques et adéquates aux configurations. Les configurations
Compu's Club pourraient être définies de la sorte : des lieux
d'apprentissage de nouveaux modèles relationnels et de valeurs qui ne
peuvent être interactifs que selon cet apprentissage. « Ce
que nous avons en réalité sous les yeux tous les jours, qui nous
permette de comprendre comment la multitude d'individus isolés forme
quelque chose qui est quelque chose de plus et quelque chose d'autre que la
réunion d'une multitude d'individus
isolés. »490(*)
Le changement des adhérents est donc fondé sur
la conviction que l'association (ou la branche) peut être amenée
elle-même à évoluer. L'adhérent a par
conséquent une idée de ce que devront être ses nouveaux
modes de relations, qui se construisent dans l'action mais aussi dans
l'interaction et en fonction de l'imaginaire du micro-groupe. Le changement
personnel des adhérents est donc tributaire des changements globaux (une
pluralité de je) qu'il contribue à changer selon
l'espérance de réalisation de ses besoins-aspirations (la
singularité du je sans cesse renouvelé). Les deux niveaux que
touche le changement, c'est-à-dire individuel et collectif.
Individuel parce-que l'expérience vécue au sein
des situations particulières des configurations modifie l'état de
conscience de l'adhérent. Elle le met à distance de ses ruptures.
Il prend du recul. C'est une forme de restructuration individuelle. En
même temps qu'elle permet la mise en relation avec l'autre auprès
de qui il se confronte. Cette confrontation modifie ses représentations
et ses émotions et favorise la création de nouvelles valeurs par
un changement de sa conduite et de ses interrelations. Ainsi, la logique
d'usage façonne celui qui la pratique. Cette pratique devient alors
source d'apprentissage à une nouvelle forme de pensée, une
mutation individuelle. Mais prendre conscience n'est pas suffisant.
L'adhérent, coincé entre désirs individuels et normes
sociales de la configuration, doit d'abord se remettre en question pour que la
prise de conscience puisse s'accompagner d'une charge émotive afin de
passer à l'action (engagement, participation). Bref, une
intention ! Dès lors, l'adhérent perçoit
l'écart entre l'état actuel et l'état désiré
pour lui donner un sens : le sens intentionnel. A partir de là, se
mettent en place des stratégies qui seront exercées dans la
configuration selon une interdépendance avec les autres
stratégies de chaque adhérent.
Collectif parce-que c'est l'ensemble du cadre configurationnel
de la relation à l'autre et des situations favorisantes interactives qui
favorisent le changement personnel de l'adhérent. Les valeurs
démocratiques apportent une forme de soutien social. Suivre les
systèmes de règles morales que celles-ci engendrent, constituent
un ethos qui favorise l'affirmation de soi. Cette affirmation de soi
accroît l'espace de liberté et objective un prise de distance (une
distinction) par rapport aux autres en même temps qu'il permet de se
sentir reconnu et accepté par eux. Mais l'usage que l'adhérent
fait de la configuration, de son imaginaire (c'est-à-dire, par un art de
faire il invente et crée) et de ses normes, n'est pas neutre. Il influe
sur lui-même et crée une empreinte qui modifie progressivement la
configuration dans laquelle (dans lesquelles) il est immergé.
C'est-à-dire, une nouvelle identité façonnée par de
nouveaux liens et de nouveaux ancrages ainsi que de nouvelles interactions,
interrelations, interdépendances.
Si, le changement consiste en la création de nouvelles
règles et si en changeant l'adhérent modifie (change) la
manière dont il se situe par rapport aux autres en même temps que
ses propres représentations, alors, dans une configuration, lorsqu'un
individu use de manières de faire, il se singularise.
« Plus les hommes sont nombreux à devoir obéir dans
leur action aux forces naturelles indomptées de leur propre corps, moins
ils diffèrent les uns des autres dans leur comportement. Et, au
contraire, plus ces forces sont soumises à un contrôle multiple et
omniprésent dans la vie collective [...] plus elles sont contenues,
détournées et transformées, plus les différences
s'accentuent entre les individus dans leur comportement, leurs sensations,
leurs pensées, leurs objectifs, sans oublier le modelage de leurs
physionomies, plus ils "s'individualisent". Au cours de ce processus, non
seulement les individus se différencient effectivement les uns des
autres dans leur configuration, mais prend en même temps une conscience
plus aiguë de cette différence. »491(*) Si à plusieurs
reprises nous avons nommé l'adhérent de diverses façons.
Tantôt membre-auteur lorsqu'il joue le rôle d'auteur, tantôt
membre-acteur pour le rôle d'acteur, ainsi de suite
(adhérent-personnage, adhérent-individu, etc.) c'est pour
signifier la multiplicité des états et des rôles
joués par l'adhérent. L'adhérent (ou le membre)
étant la constante et les qualificatifs, les variables. Ce qui prouve la
diversité et la richesse d'un individu, autant d'éléments
signifiant sa singularité, son individualité, bref, son statut
d'individu lorsqu'il en use dans une configuration par des manières de
faire. Ainsi notre hypothèse, "plus un individu use, dans une
configuration, de manières de faire, plus cet individu accède
à un statut d'individu" s'en trouve corroborée.
![]()
Schéma
récapitulatif du changement des membres du Compu's Club
En terminant, nous voulons relever quelques pistes de
réflexions qui découlent de nos conclusions. L'analyse des
manières de faire a révélé leur caractère
interdépendant car chaque adhérent joue un rôle dans la
configuration selon des "coups" appelant un "contre coup" par "l'autre". Nous
avons vu que le désengagement d'un adhérent par rapport à
la non satisfaction de ses besoins-aspirations mène à un
comportement de lassitude puis de démission. Les manières de
faire sont alors destructrices et tendent à rejeter la faute sur autrui.
Il serait important, dans ce cas, d'approfondir l'influence de
l'éducation et de la vie personnelle sur les comportements. La
méthode du récit de vie serait ici appropriée.
Nous avons également relevé que la configuration
n'existait que si les adhérents la faisait exister par leurs
interactions et relations interpersonnelles. Nous pensons que le sens
intentionnel dans les interactions doit être précisé. Il
faut reconnaître le rôle des manières de faire et de leurs
usages dans la réalisation de la satisfaction des besoins-aspirations et
faire valoir son indispensable importance.
Références
bibliographiques
|
Alain, Eléments de philosophie, Gallimard, coll.
Folio/essais, 1990, 378p.
|
|
Bernoux Philippe, La sociologie des entreprises, Seuil, coll.
Essais, 1999, 406p.
|
|
Boudon, Raymond et Bourricaud, François, Dictionnaire
critique de la sociologie, Puf, 1994, 736p.
|
|
Boudon, Raymond, La théorie des valeurs de Scheler vue
depuis la théorie des valeurs de la sociologie classique, Travaux du
Gemas n°6, 1999, 38p.
|
|
Boulte, Patrick, L'Individu en friche, Essai sur l'exclusion,
Desclée de Brouwer, 1995, 168p.
|
|
Boutinet, Jean-Pierre, Psychologie des conduites à
projet, Puf, coll. Que sais-je, 1999, 128p.
|
|
Cazals-Ferré, Marie-Pierre et Rossi, Patricia,
Eléments de psychologie sociale, A. Colin, coll. Synthèse, 1998,
96p.
|
|
Certeau, Michel (de), L'invention du quotidien 1. arts de
faire, Gallimard, coll. Essais, 1990, 350p.
|
|
Chombart de Lauwe, Paul-Henri, La culture et le pouvoir,
L'Harmattan, Coll. Changements, 1983, 385p.
|
|
Chombart de Lauwe, Paul-Henri, Pour une sociologie des
aspirations, Denoël-Gonthier, 1971, 211p.
|
|
Corcuff, Philippe, Les nouvelles sociologies, Nathan, coll.
128, 1995, 128p.
|
|
Crozier, Michel, Friedberg, Ehrard, L'Acteur et le
Système, Seuil, coll. Essais,1977, 500p.
|
|
Descartes, René, seconde partie, Discours de la
méthode & quatrième partie, Méditations in
OEuvres et Lettres, La Pléiade, 1953, 1423 p.
|
|
Dumont Louis, Homo aequalis, Gallimard, 1976, 270p.
|
|
Dumont Louis, Homo hierarchicus, Gallimard, coll. Tel, 1979,
449p.
|
|
Dumont, Louis, Essais sur l'individualisme, Seuil, Coll.
Esprit, 1991, 310p.
|
|
Durkheim, Emile, De la division du travail social, Puf, coll.
Quadrige, 1998, 464p.
|
|
Durkheim, Emile, Le suicide, Puf, coll. Quadrige, 1999,
480p.
|
|
Ehrenberg, Alain, L'individu incertain, Calmann-Lévy,
Hachette, coll. Pluriel, 1995, 351p.
|
|
Elias, Norbert, Engagement et distanciation, Fayard, 1993,
258p.
|
|
Elias, Norbert, La société de cour, Flammarion,
coll. Champs, 1990, 330p.
|
|
Elias, Norbert, La société des Individus,
Fayard, coll. Pocket, 1991, 301p.
|
|
Epictète, Manuel, Flammarion, 1964, 48p.
|
|
Fisher, Gustave-Nicolas, Les concepts fondamentaux de la
psychologie sociale, Dunod, 1996, 226p.
|
|
Freud, Sigmund, psychologie collective et analyse du moi,
Payot, 177p.
|
|
Goffman, Erving, La mise en scène de la vie
quotidienne, la présentation de soi, Minuit, 1973, 251p.
|
|
Goffman, Erving, Stigmate, Les usages sociaux des handicaps,
Minuit, Le sens commun, 1975, 175p.
|
|
Hoffmans-Gosset, Marie-Agnès, Apprendre l'autonomie
Apprendre la socialisation, Chronique sociales, 2000, 163p.
|
|
La Bruyère, Jean (de), Les Caractères,
Gallimard, 1975, 512p.
|
|
Laville, Jean-Louis, Les services de proximité en
Europe, Syros/Alternatives, 1992, 247p.
|
|
Laville, Jean-Louis, Une troisième voie pour le
travail, Desclée de Brouwer, coll. Sociologie économique, 1999,
217p.
|
|
Maffesoli, Michel, Le temps des Tribus, La table ronde, 2000,
330p.
|
|
Maisonneuve, Jean, La psychologie sociale, Puf, coll. Que
sais-je ?, 1998, 127p.
|
|
Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même,
Flammarion, 1964, 200p.
|
|
Maslow, Abraham Harold, Vers une psychologie de l'être,
Fayard, 272p.
|
|
Moscovici, Serge, Essai sur l'histoire humaine de la nature,
Flammarion, coll. Champs, 1977, 569p.
|
|
Moscovici, Serge, Psychologie sociale des relations à
autrui, Nathan, coll. Fac, 2000, 304p.
|
|
Moscovici, Serge, Psychologie sociale, Puf, 1998, 632p.
|
|
Nietzsche, Friedrich, Ainsi parlait Zarathoustra, Gallimard,
coll. Essais, 1985, 512p.
|
|
Quivy, Raymond et Van Campenhoudt, Luc, Manuel de recherche en
sciences sociales, Dunod, Paris, 1995, 287p.
|
|
Renaut, Alain, L'individu, Hatier, coll. Optiques, 1995,
80p.
|
|
Ricoeur, Paul, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990,
421p.
|
|
Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social ou principes du
droit politique, in OEuvres complètes, T.III, Gallimard, coll.
La Pléiade, 1964, 2240p.
|
|
Scheler, Max, Nature et Formes de la sympathie. Contribution
à l'étude des lois de la vie émotionnelle, Payot, 1928,
384p.
|
Magazines et revues
|
Changement (le), revue Sciences Humaines, Hors série
n°28, mars-avril-mai 2000.
|
|
Comte-Sponville, André, Parler de morale ?,
Magazine littéraire n°361, 01-98.
|
|
Evolution des valeurs des Européens (l'), Futuribles,
revue n°200 HS, juillet-août 1995, 215p.
|
|
Magnone, Fabrice, Le Monde Libertaire n°1028, 1-7
fév. 1996.
|
Emissions radiodiffusées492(*)
|
Aristote, le maître de ceux qui savent, Fr. Cult. (Une
vie, une oeuvre), 06-08-98, 90'.
|
|
Avènement de la démocratie (l'), Fr. Cult.
(Répliques), 11-12-99, 60'. Invités : Robert Legros et
Pierre Manent.
|
|
Avons-nous besoin d'une nouvelle morale ?, Fr. Cult.
(Répliques), 16-01-98, 60'. Invités : François
Dagognet et Heinz Wismann.
|
|
Croyances collectives (les), Fr. Cult. (L'université de
tous les savoirs), 07-11-01, 20'. Conférence de Raymond Boudon.
|
|
Déclarer des valeurs communes, Fr. Cult. (Le cabinet de
curiosités), 12-12-98, 30'.
|
|
Descartes et la crise de la raison, Fr. Cult. (les vivants et
les dieux), du 19 au 23-04-98, (5x90'). Invités : Jean-Luc Marion,
Geneviève Rodis Lewis, Edgar Morin.
|
|
Descartes, Fr. Cult. (Lieux de mémoire), 30-10-98 (60')
et 06-11-98 (60').
|
|
Descartes, Fr. Cult. (Une vie, une oeuvre), 17-08-98, 90'.
|
|
Don (le), Fr. Cult. (Nuits magnétiques), du 26 au
29-03-96, (4x90').
|
|
Double (le), Fr. Cult., du 22 au 26-01-96, (5x18').
|
|
Esprit et identité, Fr. Cult. (L'université de
tous les savoirs), 15-11-01, 20'. Conférence de Joëlle Proust.
|
|
Ethique et modernité, Fr. Cult. (Philambule), 06-09-99
(60') et 24-06-99 (60').
|
|
Formes naturelles de la sympathie (les), Fr. Cult.
(L'université de tous les savoirs), 01-11-01, 20'. Conférence de
Jean Decety.
|
|
Groupes (les), Fr. Cult. (L'université de tous les
savoirs), 17-05-00. Invité : Michel Mafessoli.
|
|
Identité (l'), Fr. Cult. (L'université de tous
les savoirs), 19-05-00, 30'. Invité : Zygmunt Bauman.
|
|
Identité (l'), Fr. Cult. (Partage d'exotisme), 05-08-00
(redif. 1977), 90'. Invité : Claude Lévi-Strauss.
|
|
Individu performant (l'), Fr. Cult. (Les chemins de la
connaissance), 24-05-01, 30'. Invités : Norbert Alter et
Valérie Marange.
|
|
Individualisme (l'), Fr. Cult. (Philambule), 24-04-99, 60'.
Invité : Gisèle Souchon.
|
|
Inégalités, chômage. Les associations ont
des solutions, Fr. Cult. (L'économie en question), 15-11-99, 60'.
Invité : Jean-Louis Laville.
|
|
Jeu, opium du peuple ou lien social (le) ?, Fr. Cult.
(Staccato), 15-12-98, 90'. Invités : Christian Bucher et Marc
Valleur.
|
|
Manières de Chacal ou la ruse des dominés (les),
Fr. Cult. (Les chemins de la connaissance), 20-07-01, 35'.
Invités : Tassadit Yacine Titouth et Jean-Loup Amselle.
|
|
Mythe de l'individu (le), Fr. Cult. (Staccato), 10-12-98, 90'.
Invités : Stanislas Breton et Miguel Benasayag.
|
|
Nature humaine (la), Fr. Cult. (Divers aspects de la
pensée contemporaine), 26-09-99, 13'.
|
|
Nietzsche, Fr. Cult. (Philambule), 08-07-98, 60'.
|
|
Objets mentaux (les), 1994. Invité : Jean-Pierre
Changeux.
|
|
Part du don dans le monde moderne (la), Fr. Cult.
(Répliques), 03-01-01, 45'. Invités : Alain Caillé et
Jean-Luc Marion.
|
|
Personne (la). Universalité de la personne,
personnalité singulière, Fr. Cult. (La vie comme elle va),
01-03-01, 80'. Invité : Gérard Lurol.
|
|
Pouvoir (le), Fr. Cult. (L'université de tous les
savoirs), 30-05-01, 45'. Conférence de Claude Lefort.
|
|
Production de sens et informatique, Fr. Cult.
(L'université de tous les savoirs), 12-11-01, 20'. Conférence de
Jean-Pierre Balbe.
|
|
Réflexions sur le pouvoir, Fr. Cult. (Staccato),
16-07-99, 90'. Invité : Monique David-Ménard
|
|
Relation à l'autre (la), Fr. Cult. (Répliques),
10-10-98, 45'.
|
|
Sens (le), Fr. Cult. (L'université de tous les
savoirs), 07-01-01, 45'. Conférence d'Oswald Ducrot.
|
|
Solidarités nouvelles face au chômage, Fr. Cult.
(La vie ensemble), 10-01-99, 30'. Invité : Patrick Boulte.
|
|
Théâtre, miroir de notre société
(le) ?, Fr. Cult. (Staccato), 21-06-98, 45'. Invité : Jacques
Lassalle.
|
|
Valeurs de l'homme contemporain (les), Fr. Cult.
(Répliques), 19-08-00, 23'. Invités : Jean-Claude
Michéa et Pascal Bruckner.
|
|
Vers une vie sociale démantelée ? L'univers
précaire, Fr. Cult. (Grand angle), 06-02-99, 60'.
|
Emissions télévisuelles
|
Art comme moyen d'insertion professionnelle (l'), La
Cinquième rencontre, 06-12-99, 23'.
|
|
Autonomie et hétéronomie, La Cinquième
(Les écrans du savoir), 02-10-98, 13'.
|
|
Cerveau : modèle, morale, fraternité,
éthique, connaissances et valeurs (le), La Cinquième (Les amphis
de la cinquième), 11-11-99, 35'.
|
|
Chômage, La Cinquième (Les écrans du
savoir), 28-09-99, 13'.
|
|
Démocratie (la), La Cinquième (Utopia),
14-04-00, 10'.
|
|
Démocratie, La Cinquième, 19-11-98, 25'.
|
|
Espace et l'objet (l'), La Cinquième (Pas si vite),
12-10-98, 4'.
|
|
Ethique de la civilité, La Cinquième (Les amphis
de la cinquième), 18-11-99, 56'.
|
|
Illusions démocratiques (les), La Cinquième
(Droits d'auteurs), 28-02-99, 52'.
|
|
Images, La Cinquième (Les écrans du savoir),
18-12-98, 13'.
|
|
Individu (l'), La Cinquième (Les écrans du
savoir), 07-01-99, 13'.
|
|
Intolérance (l'), France2 (Bouillon de culture),
17-04-99, 73'.
|
|
Je est un autre, La Cinquième, 09-08-01, 40'.
|
|
Lois du bien-être (les), La Cinquième (Les
écrans du savoir), 29-05-01, 30'.
|
|
Mise en scène du travail, La Cinquième (Les
écrans du savoir), 27-01-99, 5'.
|
|
Modélisation des comportements (la), La
Cinquième, 02-11-01, 60'.
|
|
Peut-on apprendre à être autonome ?, La
Cinquième (L'éducation en question), 26-09-00, 14'.
|
|
Pouvoirs de l'imagination (les), La Cinquième
(Galilée), 03-11-98, 13'.
|
|
Valeurs (les), La Cinquième (Récits de la
jeunesse), 17-12-98, 74'.
|
Bibliographie
|
Adair John, Le leader, homme d'action, Top, 1991.
|
|
Allport, Gordon Willard, Personality, H. Holt and Co,
New-York, 1964.
|
|
Arendt, Hannah, Les mots d'Arendt, Télérama
n°2598, 27-10-99, p.22.
|
|
Argyris, Chris, Participation et organisation, Dunod, 1970.
|
|
Barbier, J.-M., Revue Sciences Humaines, Le changement, HS
n°28, mars-avril-mai 2000, p.11.
|
|
Birnbaum, Pierre et Leca, Jean, Sur l'individualisme, Presses
de la fondation nationale des sciences politiques, coll.
Références, 1991.
|
|
Boutinet, Jean-Pierre, Psychologie des conduites à
projet, Puf, coll. Que sais-je, 1999, p.3.
|
|
Carling, F., And Yet We Are Human, Chatto & Windus, 1962,
p.18-19.
|
|
Cassin, Barbara, L'équité, La Cinquième
(Les mots de la psychanalyse), 17-04-00.
|
|
Chauvel, Louis de l'Observatoire Français des
Conjonctures économiques, L'évolution des valeurs des
Européens, revue Futuribles, analyses et prospectives,
juillet-août 1995, page 176.
|
|
Combessie, Jean-Claude, la méthode en sociologie, La
découverte et Syros, Coll. Repères, 1999, p.63.
|
|
Crédoc, Les Français et la vie associative,
décembre 1998.
|
|
Dictionnaire des sciences humaines - Anthropologie/Sociologie
- Nathan, p.173.
|
|
Doise, Wilhem, L'explication de la psychologie sociale, vers
1980. (Cf. note de bas de page n°22).
|
|
Drucker, Peter, Le Management par objectifs (Management of
results), 1964.
|
|
Durkheim, Emile, Les formes élémentaires de la
vie religieuse, 1912, Puf, 2è éd., 1990.
|
|
Elias, Norbert, Qu'est-ce que la sociologie ?,
Pandora/Des Sociétés, 1981, pp.156-157.
|
|
Favier, Roland, lors de la conférence de Paul Ricoeur,
12-01-01, univ. Latourg-Maubourg, Valence.
|
|
Finkielkraut, Alain, La barbarie individualiste, Revue le
Messager Européen, In Renaut, Alain, L'individu, Hatier, coll.
Optiques, 1995, p.39.
|
|
Firth, Raymond-William, Encyclopædia Universalis 1998
à Firth.
|
|
Fischer, Gustave-Nicolas, la psychologie sociale, Seuil, Coll.
Essais, 1997.
|
|
Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique,
1962. (Cf. note de bas de page n°22).
|
|
Fridman, Viviana et Roy, Alain, cf. Rémy, Jean, La vie
quotidienne et les transactions sociales : perspectives micro ou
macro-sociologiques, Maurice Blanc, 1992.
|
|
Girard, Alain, Le Choix du conjoint, Puf, 1974.
|
|
Greimas, Aljirdas-Julien, Linguistique statistique et
linguistique structurale in Le Français moderne, 1962,
p.245.
|
|
Gusdorf, Georges, La découverte de soi, Puf in
Maisonneuve J., La psychologie sociale, Puf, 98, p.36.
|
|
Jodelet, Denise, Représentations sociales :
phénomènes, concepts et théories, in Moscovici,
Serge, Psychologie sociale, Puf, 1984, p.357.
|
|
Kant, Emmanuel, Fondements de la métaphysique des
moeurs, II, tr. V. Delbos, Delagrave.
|
|
Lahire, Bernard, Tableaux de familles. Heurs et malheurs
scolaires en milieux populaires, Seuil, Coll. Hautes études, 298p.
|
|
Laurier Turgeon, Denys DelÂge et Réal Ouellet
(dir.), Transferts culturels et métissages. Amérique/Europe, XVIe
- XXe siècle, Les Presses de l'Université Laval, 1996, p.20.
|
|
Le Bon Gustave, La psychologie des foules, 1895 in
Maisonneuve, Jean, La psychologie sociale, Puf, coll. Que sais-je ?, 1998,
p.5.
|
|
Lebreton, Nathalie, Le capital c'est l'homme, La
Cinquième (Les écrans du savoirs), 05-06-98.
|
|
Leibniz, Gottfried Wilhelm, La monadologie, Association des
Bibliophiles Universels, Version 1, août 1997, paragraphe 9, à
partir de l'édition française de 1840.
|
|
Lemos, André, Les Communautés virtuelles, Dunod,
1994, pp. 253-261.
|
|
Linton, Ralph, Le fondement culturel de la
personnalité, Dunod, 1999.
|
|
Mac Dougal, Introduction à la psychologie sociale,
1908. (Cf. note de bas de page n°22).
|
|
Maisonneuve, Jean, Introduction à la psychosociologie.
(Cf. note de bas de page n°22).
|
|
Maslow, Abraham Harold, Motivation and personality, Harper and
Row, 1954.
|
|
Mayo, Elton, Les Problèmes humains de la civilisation
industrielle (1933), Les Problèmes sociaux de la civilisation
industrielle (1947).
|
|
Mead, Georges Herbert, L'Esprit, le soi et la
société, 1934, tr. J. Cazeneuve, Puf, 1963.
|
|
Meyerson, Ignace, Problèmes de la personne, colloque du
Centre de recherches de psychologie comparative, E.P.H.E., Viè section,
Mouton, 1973.
|
|
Mole, Abraham, Théorie des objets, années 70.
(Cf. note de bas de page n°22).
|
|
Nédoncelle, Maurice, La réciprocité des
consciences, Aubier, 1942.
|
|
Palante, Georges, L'individualisme aristocratique, les Belles
Lettres, 1995.
|
|
Paulhan, F., Les Caractères, 1894, 5è
éd., 1922.
|
|
Pizzorno, Alessandro, Sur la rationalité du choix
démocratique, tr. P. Birnbaum et J. Leca dans Sur de l'individualisme,
Presses de la FNSP, 1986.
|
|
Rémy, Jean, La vie quotidienne et les transactions
sociales : perspectives micro ou macro-sociologiques, Maurice Blanc,
1992.
|
|
Ricoeur, Paul, Temps et récit. L'intrigue et le
récit historique, t.1, Point, 1991.
|
|
Rocher, Guy, Pour une théorie psychosociologique des
aspirations, dans Bélanger, P.W., Les Cahiers d'A.S.O.P.E.,
vol. VII, PUL, 1981.
|
|
Rokeach, M. (The nature of human values) New York : Free
Press, 1973 in futuribles p.15.
|
|
Scheler, Max, Le formalisme en éthique et
l'éthique matériale des valeurs, 1913-1916, tr. M. de Gandillac,
Gallimard, 1955.
|
|
Stirner, Max, L'Unique et sa propriété, 1845,
tr. E. Lasvignes, 1948.
|
|
Stoetzel, Jean, Théorie des opinions, Puf, 1943.
|
|
Tarde, Etudes de psychologie sociale, vers 1891. (Cf. note de
bas de page n°22).
|
|
Tchernia, Jean-François, Research International
in Futuribles n°200, juillet-août 1995, p.9.
|
|
Valade, Bernard, Dictionnaire de la sociologie, Larousse
Thématique, 1996.
|
Index des auteurs
Adair, John, 126, 127, 189
Alain, 2, 10, 17, 22, 23, 32, 36, 39, 40, 42, 185, 186, 187,
189
Allport, Gordon Willard, 29, 189
Alter Norbert, 187
Amselle, Jean-Loup, 187
Arendt, Hannah, 32, 189
Argyris, Chris, 129, 189
Aristote, 13, 50, 51, 116, 137, 186
Armengaud, Françoise, 32
Arvon, Henri, 36
Balbe, Jean-Pierre, 187
Barbier, J.-M., 31, 189
Bauman Zygmunt, 187
Bernoux Philippe, 153, 185
Birnbaum, Pierre, 34, 38, 189, 190
Blanc, Maurice, 42, 189, 190
Boudon, Raymond, 25, 29, 34, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 70,
81, 185, 186
Boulte, Patrick, 33, 185, 188
Bourricaud, François, 38, 185
Boutinet, Jean-Pierre, 95, 185, 189
Breton, Stanislas, 36, 187
Bruckner Pascal, 188
Bucher, Christian, 187
Caillé, Alain, 187
Carling, F., 152, 189
Cazals-Ferré, Marie-Pierre, 24, 27, 47, 68, 88, 93, 185
Certeau, Michel (de), 14, 21, 24, 26, 53, 54, 55, 58, 64, 66, 67,
69, 81, 121, 122, 138, 141, 142, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 179,
185
Changeux, Jean-Pierre, 187
Chauvel, Louis, 44, 189
Chombart de Lauwe, Paul-Henri, 19, 120, 124, 126, 128, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 143, 150, 185
Combessie, Jean-Claude, 69, 189
Comte-Sponville, André, 51, 52, 186
Corcuff, Philippe, 34, 70, 116, 142, 145, 185
Corneille, Pierre, 44
Corraze, Jacques, 28, 29
Crozier, Michel, 24, 25, 185
Dagognet, François, 186
David-Ménard, Monique, 187
Decety, Jean, 187
Denys, DelÂge, 42, 190
Descartes, René, 28, 36, 185, 187
Drucker, Peter, 124, 189
Ducrot, Oswald, 187
Dumont, Louis, 10, 17, 22, 49, 81, 185
Durkheim, Emile, 34, 35, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 50, 64, 70, 185,
189
Ehrenberg, Alain, 17, 22, 185
Eid, Georges, 11
Elias, Norbert, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 36, 38, 40,
42, 57, 58, 60, 64, 66, 87, 116, 117, 120, 122, 141, 142, 143, 144, 145, 180,
181, 183, 185, 189
Epictète, 185
Favier, Roland, 69, 189
Finkielkraut, Alain, 22, 23, 40, 189
Firth, Raymond-William, 12, 14, 189
Fisher, Gustave-Nicolas, 21, 25, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 79,
90, 91, 93, 160, 189
Freud, Sigmund, 12, 33, 38, 185
Fridman, Viviana, 42, 189
Friedberg, Ehrard, 25, 185
Girard, Alain, 39, 189
Goffman, Erving, 12, 24, 30, 121, 141, 143, 152, 154, 155, 160,
185
Greimas, Aljirdas-Julien, 168, 189
Gusdorf, Georges, 27, 189
Herskovits, Melville Jean, 34
Hoffmans-Gosset, Marie-Agnès, 185
Jerphagnon, Lucien, 46
Jodelet, Denise, 12, 21, 27, 35, 153, 189
Jouvenel, Hugues (de), 44
Kant, Emmanuel, 25, 51, 189
La Bruyère, Jean (de), 29, 185
Lagache, Daniel, 29
Lahire, Bernard, 40, 190
Lassalle, Jacques, 188
Laurier, Turgeon, 42, 190
Laville, Jean-Louis, 186, 187
Le Bon, Gustave, 22, 190
Lebreton, Nathalie, 40, 190
Leca, Jean, 34, 38, 189, 190
Lefort, Claude, 187
Legros, Robert, 186
Leibniz, Gootfried Wilhelm, 21, 36, 190
Lemos, André, 38, 60, 61, 190
Lévi-Strauss, Claude, 8, 9, 187
Levinas, Emmanuel, 22
Lewin, Kurt, 25
Linton, Ralph, 34, 190
Lipovetsky, Gilles, 22
Lurol, Gérard, 187
Maffesoli, Michel, 7, 52, 53, 126, 186
Magnone, Fabrice, 37, 186
Maisonneuve, Jean, 12, 22, 27, 28, 29, 38, 47, 68, 115, 186, 189,
190
Manent, Pierre, 186
Marange, Valérie, 187
Marc-Aurèle, 186
Marion, Jean-Luc, 187
Maslow, Abraham, 29, 41, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 128, 129,
130, 134, 139, 140, 150, 186, 190
Mayo, Elton, 22, 23, 190
Mead, Georges Herbert, 29, 31, 190
Meyerson, Ignace, 27, 190
Michéa, Jean-Claude, 188
Miguel, Benasayag, 187
Morin, Edgar, 187
Moscovici, Serge, 12, 21, 27, 33, 35, 121, 153, 186, 189
Nédoncelle, Maurice, 27, 190
Nietzsche, Friedrich, 36, 37, 47, 129, 186, 187
Palante, Georges, 37, 47, 190
Paulhan, F., 29, 190
Pizzorno, Alessandro, 34, 190
Plotin, 36
Proust, Joëlle, 187
Quivy, Raymond, 67, 186
Rayer, Yannick, 40
Réal, Ouellet, 42, 190
Redfield, Robert, 34
Rémy, Jean, 42, 189, 190
Renaut, Alain, 10, 17, 22, 23, 36, 186, 189
Ricoeur, Paul, 69, 137, 186, 189, 190
Rocher, Guy, 131, 190
Rodis Lewis, Geneviève, 187
Rokeach, M., 45, 190
Rossi, Patricia, 24, 27, 47, 68, 88, 93, 185
Rousseau, Jean-Jacques, 22, 50, 186
Roy, Alain, 42, 189
Saffange, Jean-François, 23
Scheler, Max, 25, 34, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 64, 116,
170, 185, 186, 190
Souchon, Gisèle, 37, 187
Stirner, Max, 36, 190
Stoetzel, Jean, 27, 45, 46, 190
Tchernia, Jean-François, 45, 190
Titouth, Tassadit Yacine, 187
Tocqueville, Alexis (de), 48
Valade, Bernard, 45, 190
Valleur, Marc, 187
Van Campenhoudt, Luc, 67, 186
Weber, Max, 45, 48, 50
Wismann, Heinz, 186
Worms, Frédéric, 37, 38
Table des illustrations
Hypothèse
15
Explication théoriquement attendue du
changement
60
Tableau de correspondance
mots-clefs/concepts
61
Répartition des membres de l'association
par âge, sexe et situation familiale
70
Répartition des branches par la situation
familiale des membres
72
Répartition des branches par le nombre de
participants
73
Répartition des circonstances
d'adhésions
76
Répartition des adhérents selon la
thématique de la rupture
78
Tableau récapitulatif : âge,
situation familiale, rupture, fonctions prises, participation
80
Tableau récapitulatif des trois figures
de l'adhérent
83
Tableau récapitulatif (conclusion)
84
Echelle de la hiérarchie des besoins
selon Maslow dite "pyramide" de Maslow
124
Schéma de la fusion des besoins pour une
communication en tant qu'échange
127
Schéma de la circularité des
besoins-aspirations au Compu's Club
142
Schéma récapitulatif de la
présentation de soi au Compu's Club
162
Tableau d'usage de l'association par les
adhérents
168
Schéma récapitulatif du changement
des membres du Compu's Club
184
Table des matières
Remerciements
2
Sommaire
3
Introduction générale
6
1. L'ASSOCIATION, DE L'INDIVIDU AU
MICRO-GROUPE
19
1.1 Individu et changement : De
l'étymologie au sens
21
1.1.1 De l'individu à son identité
sociale
22
1.1.2 Vers une construction psychosociale de
l'individu : le personnage
26
1.1.2.1 Personnalité subjective,
personnalité objective.
28
1.2 Individu, configuration et
changement : une recherche identitaire
31
1.2.1 Devenir quelqu'un : angoisses et
influences, démarches identitaires.
33
1.2.1.1 L'identification, un mixte de
représentations réelles et symboliques
34
1.2.2 De l'individualisme à la relation
à l'autre : la solidarité
35
1.2.3 L'identité, une série de
transactions.
41
1.3 Individu, configuration, changement et
micro-groupe : les valeurs, importance et ambivalence
44
1.3.1 Les valeurs : affaire de mots et
d'idées mais aussi production de rapports sociaux
45
1.3.1.1 La théorie des valeurs de Scheler,
une conception des catégories morales
46
1.3.1.2 Peut-on fonder un système de
valeurs ?
50
1.3.2 L'individu dans son groupe, un inventeur de
manières de faire
53
1.3.3 L'hypothèse, des mots clefs pour
construire un protocole de validation
56
1.3.3.1 Autour de l'individu
56
1.3.3.2 Autour du concept de configuration
57
1.3.3.3 Autour des manières de faire
58
1.3.3.4 Synthèse des liens entre les mots
clefs de l'hypothèse.
59
Conclusion : repérer l'individu
changeant à partir d'un modèle d'analyse
64
2. ENGAGEZ-VOUS, RENGAGEZ-VOUS, ILS
DISAIENT
66
2.1 Ce qui a joué :
Caractéristiques d'engagements
71
2.1.1 Du quantitatif au qualitatif : à
la découverte de l'engagement
71
2.1.2 Trois facteurs majeurs d'influence pour
justifier l'engagement
74
2.1.2.1 Motifs d'adhésions
74
2.1.2.2 Circonstances d'adhésion
75
2.1.2.3 Antécédents familiaux
77
2.1.2.4 Antécédents associatifs et
professionnels
78
2.1.3 Trois catégories pour décliner
la figure de l'adhérent
80
2.1.3.1 Le membre philanthrope :
80
2.1.3.2 Le membre pharisien-prestige :
81
2.1.3.3 Le membre synallagmatique :
81
2.2 Ce qui joue :
Caractéristiques de configuration
87
2.2.1 Perception de l'environnement associatif par
le membre
87
2.2.2 La naissance de conditions favorables à
la relation
90
2.2.3 Du rapport à la relation sociale
95
2.2.3.1 Je suis en relation avec les autres hors de
ma branche :
96
2.2.3.2 Je suis en relation avec les autres dans ma
Branche :
99
2.3 Ce qui se joue :
Caractéristiques des maturations
102
2.3.1 Grandir son engagement ou se positionner dans
le groupe
102
2.3.1.1 Les représentations ou la part
symbolique
103
2.3.1.2 Les repères d'identité et les
identifications ou la part réelle.
105
2.3.1.2.1 Les repères d'identité
sociale : deux types de conscience de son identité par le
membre
106
2.3.1.2.2 Les identifications : symboles
sociaux
107
2.3.2 Développer sa relation sociale ou
l'élaboration du sens
108
2.3.2.1 "l'éclat de la parole" ou de la
communication à l'interrelation créative :
109
2.3.2.2 "L'utilité sociale" ou l'assurance de
la considération :
109
2.3.3 Confiance en l'autre, confiance en soi ou les
processus de socialisation
111
Conclusion : Histoire(s) d'être(s)
115
3. DU BESOIN AUX ASPIRATIONS :
JEUX, TACTIQUES ET STRATÉGIES
119
3.1 Aspirations et dynamiques de
changement
123
3.1.1 Des aspirations à la satisfaction des
besoins : ce qui pousse à agir
124
3.1.2 Aspirations de l'adhérent : trois
notions successives ?
132
3.1.2.1 Les désirs : une raison du
bien-être
133
3.1.2.2 Les espoirs : une bonne
raison pour développer un projet
135
3.1.2.3 L'espérance : une raison de
vivre
137
3.1.2.4 Synthèse des trois notions : de
la succession au lien intime
139
3.1.3 Les besoins-aspirations, une dynamique
circulaire
140
3.2 Présentation de soi : les
jeux, les enjeux
143
3.2.1 La configuration, un réseau de
relations réciproques
144
3.2.1.1 De la configuration Compu's Club
145
3.2.1.2 L'association et la branche ; trois
configurations
145
3.2.1.3 Inter- (-actions, -relations,
-dépendances) : le cas Echap
148
3.2.1.4 Dehors-dedans et vice versa
149
3.2.1.5 Les causes et les raisons des
interdépendances
151
3.2.2 De la représentation sociale à
la présentation de soi
153
3.2.2.1 La représentation : un
imaginaire de conformités
153
3.2.2.2 La représentation convenue : une
forme de solidarité
154
3.2.2.3 Un cas de présentation de soi
155
3.2.2.4 Représentations et
présentations de soi : une réciprocité
156
3.2.3 Présentations de soi : une
production de fragments identitaires
157
3.2.3.1 Entre apparence et manière : un
jeu
157
3.2.3.2 Idéaliser sa place par la
séduction et la manipulation
158
3.2.3.3 S'adapter, une tactique pour être
160
3.3 L'usage de manières de
faire : la quintessence du changement
163
3.3.1 "Se faire une place"
164
3.3.1.1 L'espace : un lieu pratiqué
164
3.3.1.2 S'approprier l'espace : une
manière de faire individuelle
164
3.3.1.3 S'inscrire dans des relations :
stratégies et tactiques
165
3.3.1.3.1 Les stratégies
166
3.3.1.3.2 Les tactiques
167
3.3.1.3.3 Un exemple de stratégie incluant
des tactiques
167
3.3.1.4 Se situer dans le temps
168
3.3.2 Tours et détours. Contours du
changement
169
3.3.3 La part de l'autre
170
Conclusion : L'art et la manière
174
Conclusion générale
176
Références bibliographiques
186
Bibliographie
190
Index des auteurs
192
Table des illustrations
194
Table des matières
195
AUTEUR : Jean-Marc Soulairol
TITRE : Pour quelle(s) histoire(s)
d'être(s).
SOUS-TITRE : Associations 1901, interrelations
personnelles et interactions sociales, un art de faire.
DIRECTEUR DE RECHERCHE : Bernard
LAUGIER
RESUME :
Qu'est-ce qui fait que certains adhérents de
l'association informatique Compu's Club semblent, indépendamment de
l'outil, changer ?
Le changement s'est expliqué par le fait que, à
partir de ses désirs, ses espoirs et ses espérances à
satisfaire ses besoins-aspirations, l'adhérent investit dans les
dynamiques relationnelles pour en jouer ou bien profiter des circonstances pour
les laisser jouer. Pour y parvenir il joue avec l'information qu'il donne de
lui-même par la place qu'il s'accorde dans un jeu de dépendances
réciproques qu'il contribue à former et changer. Mais il le fait
lors de moments d'échanges qui rendent visibles un lieu dans lequel il
fabrique des stratégies et des tactiques propres à donner du sens
à ses jeux. Ainsi, il use de manières de faire singulières
par un je sans cesse renouvelé sur la base d'un ensemble multiple de
jeux, de je.
Le présent travail a pour but de montrer que plus un
individu use, dans une configuration, de manières de faire, plus cet
individu accède à un statut d'individu.
MOTS CLES : Individu,
besoins-aspirations,
présentation de soi,
configuration,
manières de faire.
Présenté par :
Jean-Marc Soulairol
POUR QUELLE(S)
HISTOIRE(S) D'ÊTRE(S) ?
Associations 1901, interrelations personnelles et
interactions sociales,
un art de faire : L'étude d'un cas sur
Valence (26), de 1997 à 2002, pour une
compréhension de l'application d'une pratique
raisonnée de l'idée de valorisation de l'individu.
Tome II
Directeur de Recherche :
Bernard LAUGIER
Université Lumière Lyon 2 Collège
Coopératif
I.S.P.E.F. Rhône - Alpes
Département des Pratiques
Educatives et Sociales
Mémoire déposé en vue de
l'obtention du
Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques
Sociales
D.H.E.P.S.
Lyon 2002
Annexes
Annexe 1 L'association Compu's Club
Annexe 2 L'enquête du Crédoc
Annexe 3 Le questionnaire test
Annexe 4 Entretiens, les thèmes
Annexe 5 Entretiens, les questions
Annexe 6 Premier entretien
Annexe 7 Deuxième entretien
Annexe 8 Troisième entretien
Annexe 9 Quatrième entretien
Annexe 10 Cinquième entretien
Annexe 11 Sixième entretien
Annexe 12 Septième entretien
Annexe 13 Huitième entretien
Annexe 14 Neuvième entretien
Annexe 15 Valeurs et indicateurs relevés au
cours des entretiens
Annexe 16 Valeurs retenues par Rokeach
Annexe 1 L'association Compu's
Club
Le cadre juridique :
L'association Compu's Club est une association
répondant à la loi de 1901 sur le droit d'association.
« L'association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leur
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. »493(*). Dans cette loi, Waldeck-Rousseau repense le droit
associatif sur de nouvelles bases comprenant l'abandon du droit corporatif
ancien, la primauté de l'individu et de ses droits, la liberté
d'adhésion et de sortie d'une association, la limitation de
l'association à un objet défini, l'administration par libre
délibération de ses membres égaux en droits. Le monde
post-moderne semblant se construire aujourd'hui autour de l'individu,
l'association paraît être un cadre favorable à sa
(re)valorisation. En effet, quel que soit sa typologie, l'association est
devenue un haut lieu original et singulier de socialisation, d'apprentissage,
de construction et d'exercice de la citoyenneté494(*).
L'association Compu's Club
|
Etiquette :
|
Club des Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication495(*).
Courriel : compus.club@wanadoo.fr, Internet :
www.kyxar.fr/~compus.
|
|
Objet :
|
« Provoquer des rencontres entre
passionnés des Nouvelles Technologies de l'Information et de la
Communication afin de permettre des échanges, des manifestations et des
activités artistiques, éducatives, culturelles et de
loisirs. » (art.2 des statuts)
|
|
Statut :
|
Association sans but lucratif, loi 1901.
Siren 423684331 - APE 913E - Urssaf 2603502006421130 (2
salariés)
|
|
Création :
|
Journal Officiel du 2 octobre 1997. N° 0263012169
|
|
Siège :
|
Valence (26000), 129 avenue Victor Hugo depuis le
1er novembre 2000
|
|
membres :
|
au 30 juin 2001
|
117
|
adhérents à jour de cotisation.
|
|
192
|
adhérents (9-81 ans) depuis création
(1er oct. 97.)
|
|
dont :
|
27
|
Juniors (9-17 ans)
|
(14%)
|
|
16
|
Seniors (Aînés de + 55 ans)
|
(27%)
|
|
32
|
Femmes
|
(29%)
|
|
moyenne d'âge :
|
34 ans
|
|
Reconnaissances :
|
· Agréé association d'Éducation
Populaire et association de Jeunesse n°26229.
· Centre de formation professionnelle enregistré
sous le n° 82 26 00910 26.
· Habilité par la Caisse d'Allocations Familiales
sous le numéro 7640
· La branche Libertech (adhérents de moins de 18
ans) est habilitée par le Réseau National des Juniors
Associations sous le n° 01260300.
· Habilité par le ministère de la Justice
pour dispenser des formations dans les prisons (MA26).
|
Originalités de l'organisation de l'organe
de décision et des activités :
Même si l'Association Compu's Club répond aux
critères de la loi de 1901 qui prévoit de s'associer sans aucune
formalité, elle souhaite aller au delà par une organisation
originale :
1. Le Conseil d'Administration :
Le Conseil d'Administration est composé, actuellement,
de huit Administrateurs élus496(*) pour trois ans renouvelable par tiers et
représentant l'organe de décision. Parmi ses Membres, le Conseil
élit son Bureau pour composer l'organe exécutif. A l'occasion des
réunions du Conseil, tous les premiers mardis du mois, chaque Membre du
Club, quelque soit son affiliation, peut participer aux différents
débats dans la plus parfaite démocratie. Près d'un
adhérent sur trois participe ainsi aux décisions de la vie
associative lors de ses réunions.
2. Les services et activités de l'association


Bibliothèque, logithèque, documentation
technique, manifestations diverses (forums, foires, galeries marchande,
festival de la citoyenneté, soirées des étoiles, lutte
contre le racisme, ...), participation aux assises départementales de la
vie associative, participation aux journées nationales de l'Internet,
participation au Conseil Permanent de la Jeunesse (initié par Madame
Buffet, alors ministresse de la Jeunesse et des Sports).
3. Les branches et leurs activités
Le fonctionnement de chaque branche activité est
simple : elle est composée d'une équipe de pilotage de une
ou plusieurs personnes menant à bien les projets propres à la
branche. La branche est parfaitement autonome et indépendante dans sa
gestion et sa trésorerie. Cette originalité semble
générer dynamisme et mobilisation. En effet, si nous
comptabilisons le nombre de bénévoles dans chacune des branches
et Sections, ils représentent 38% des adhérents. Lorsqu'une
idée a suscité suffisamment d'intérêts et
généré suffisamment de mobilisations497(*), le Conseil vote la
création de la nouvelle branche. La nouvelle branche peut, dès
lors, percevoir des subventions à son usage propre, émettre des
chèques à partir d'un compte bancaire dédié
à celle-ci, décider des orientations à prendre pour
réaliser ses projets. Une obligation, cependant : la tenue d'une
comptabilité. Chaque année, au moment de l'Assemblée
Générale, tous les comptes de chaque branche sont réunis
pour former la comptabilité générale de l'association. Sur
ce principe, ont été créées :
|
la branche LIBERTECH (réservé aux moins de 18
ans),
|
|
la branche Finance : le C.E.B.
Comprendre l'Économie et la Bourse et le club d'investissement Compu's
Finance.
|
|
C@O, la branche Création
@ssistée par Ordinateur
(branche dormante),
|
|
la Section Littérature et son projet Échap,
|
|
Le Club Apple, pour les fanatiques du macintosh
(branche dormante),
|
|
l'FAC, l'Institut de Formation
du Compu's Club,
|
|
le Compu's Club Aviation, apprendre à Piloter
(branche dormante),
|
|
la branche Art et Culture et son projet "Le jardin de la
création" (branche dormante),
|
|
la Section Presse et son journal multimédia,
|
|
Comnet, la branche Internet,
|
|
LDM, la branche gestion &
maintenance du parc informatique (nouvellement créée),
|
|
Le projet R.S.I. (Réseau de
Solidarité Intergénérationnelle) veut développer du
lien social entre les différentes générations grâce
à l'outil Internet (nouvellement créé).
|
Cette simple pratique de décentralisation laisse libre
la prise de responsabilités par tous ceux qui le désirent.
Dire que le Compu's Club a été fondé
grâce à la volonté d'un seul individu, son fondateur,
serait prétentieux et faux : on ne fait jamais rien tout seul !
Confirmé par Howard Becker dans un article de la revue Sciences
Humaines498(*). En
effet, il présente l'interaction qui existe entre toutes les personnes
impliquées dans une activité et il se réfère
à « l'idée chère à Everet Hughes, selon
laquelle une situation donnée est le résultat d'interactions
entre différents agents. Pour comprendre cette situation il faut donc
prendre en compte l'ensemble des parties qui y sont impliquées, de
près ou de loin. »
Ce qui est certain c'est que le Compu's Club s'est
développé, surtout, grâce à la pugnacité de
passionnés, rassemblés autour des NTIC. « ...Comme l'a
joliment résumé Norbert Elias, chacun d'entre nous porte en lui
le désir de faire telle ou telle chose qui ne peut être accomplie
sans l'aide d'autres personnes qui ont, elles aussi, des désirs à
réaliser. Les individus prennent donc part à des actions
collectives. »499(*)
Bref historique :
Le Club était, jusqu'en février 1998,
composé de 17 membres, un seul ordinateur et dans un local de 12 m²
prêté par une société valentinoise, qui voyait dans
ce geste une opportunité pour doper la vente de son matériel
informatique. Le Club végétait, en fait. Le sort a
précipité les choses début février. La
société-hôte dépose son bilan et le Club se retrouve
à la rue en quête d'un nouvel hébergement. C'est à
partir de juin 1998 que l'association a pu développer ses projets dans
une salle située 5 bis rue de Chantal à Valence (26000). Cette
salle était accessible aux personnes à mobilité
réduite. Elle a été prêtée pendant deux ans
par une entreprise d'électronique et d'informatique. Désormais
(depuis novembre 2000) c'est avenue Victor Hugo, toujours à Valence, que
l'association continue de développer ses activités dont en voici
quelques unes :
la branche LIBERTECH.
Certains mineurs de l'association se sont constitués en
Junior Association reconnu par le réseau national des Juniors
Associations. Le but est de permettre à des jeunes (moins de dix-huit
ans) de développer des projets de manière autonome selon les
normes et les contingences d'une véritable association. Le Compu's Club
a créé une branche spécifique avec élection du
Conseil d'administration Junior, du Bureau Junior, de statuts Junior, etc. Leur
âge interdisant qu'ils puissent se déclarer association 1901
à la Préfecture, un an après, l'association a
participé, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la
Ligue pour l'enseignement, à la création d'un réseau
national pouvant s'y substituer. Plusieurs projets sont en cours ou
dormants : échanges de jeux, concours de jeux en réseau,
atelier musique numérique, atelier photo numérique,
création de sites Web, etc. Mais aussi éducation à la
citoyenneté et au civisme avec diffusion de films et débats et
création d'un site axé sur l'entraide et la citoyenneté
(projet Cyber J) ; ou encore soutien scolaire par les Seniors (projet Les
deux bouts de la vie professionnelle), création d'une radio locale sur
les ondes FM et sur Internet, création d'un support multimédia
sur le patrimoine valentinois (projet Valence au fil du temps). Bref, Libertech
est un espace de débats et d'élaboration de propositions
nouvelles pour associer les jeunes aux décisions les concernant.
C'est-à-dire, imaginer et construire toutes initiatives favorisant le
dialogue entre les jeunes et la société ainsi que faciliter le
dialogue des jeunes et des institutions.
La branche finance : le C.E.B.
et le projet Club d'investissement.
Un Club d'investissement est un groupe de personnes qui
décident de mettre en commun une épargne mensuelle d'un montant
peu élevé. Mais l'objectif principal est de permettre à
ses membres d'apprendre et de comprendre les mécanismes
économiques, financiers et boursiers. Pour les membres de cette branche,
« connaître les entreprises, c'est participer à la
vie économique du pays. A l'heure de la mondialisation la
meilleure opportunité est de disposer des outils de communication et
d'information à la pointe de la technologie. » Ainsi,
c'est une véritable école de bourse qu'ils ont imaginé
afin de permettre à chacun, même les plus démunis,
d'apprendre et de comprendre les informations de la vie économique et
ses mécanismes ; de mettre en commun et échanger les
"savoirs" ; de constituer un portefeuille fictif d'actions puis investir
en réel sur les jeux boursiers ; de répartir les risques et
obtenir une fiscalité avantageuse.
La branche C@O, Création
@ssistée par Ordinateur
Initiation aux logiciels, conception de cartes de visite,
faire-part, création d'affiches, ... Le principe consiste à
mettre en oeuvre les règles de la communication par l'objet :
taille, dimensions, couleurs, dispositions, police, ...
Le projet Échap de la section Littérature.
L'idée est d'éditer un livre de fiction mettant
en parallèle la situation de chômage des membres-auteurs et des
événements historiques déroulés à Valence
depuis 1644. « Sans dévoiler la trame du livre (pour
respecter leur travail et donner l'envie de le lire), l'action démarre
de nos jours, à Valence. L'héroïne s'appelle Chantal et se
bat pour retrouver du travail. Sa lutte va faire écho avec d'autres
combats de femmes drômoises, dont le souvenir s'est parfois perdu dans
les méandres du temps... Mais pas dans les archives
départementales. Avant de se lancer dans l'écriture proprement
dite les "Échappés" se sont transformés en
détectives-historiens, remontant le temps et l'histoire de
Valence. »500(*)
l'FAC, l'Institut de
Formation du Compu's Club.
Sur le principe "Apprendre pour soi, apprendre pour les
autres, me former c'est utile pour moi, c'est utile pour les autres"
l'association Compu's Club initie et forme aux logiciels informatiques selon
une méthode propre tenant compte de la dimension affective des
apprentissages. En effet, dans cette association, pour bien apprendre, il faut
se sentir à l'aise, être "bien dans sa peau". Ainsi, l'animateur
de formation veille à placer l'apprenant en situation de
réussite, croit en ses possibilités et le lui faire savoir, part
du connu, lui donne une vision claire des objectifs, de l'itinéraire,
des résultats. Bref l'aider à construire leurs savoirs en passant
par des représentations visuelles mentales (les images décrites
avec des mots dits : comparaisons, métaphores), et des images
réelles (dessins, photos, plans, schémas). Les stratégies
mentales sont les outils utilisés pour penser, comprendre, apprendre au
Compu's Club ; pour qu'un concept soit assimilé, il faut que
l'apprenant se l'approprie par intériorisation. Il est donc prévu
régulièrement ou occasionnellement des temps d'évocation,
quelques instants au long de la séance de travail. Conscient de
possibles saturations, l'animateur de formation prévoit également
des temps de maturation, de structuration en fractionnant les apprentissages
"lourds" en plusieurs séances, séparées par des coupures
longues (quelques heures, un ou deux jours... ). A l'aide d'une grille
d'analyse des démarches, il peut faire prendre
conscience de la façon de travailler, et comparer avec les autres
stagiaires, et ainsi améliorer sa méthode. A l'aide d'une grille
d'analyse des objectifs/résultats (définition
préalable des objectifs, évaluation en fin de travail du taux de
réussite, et de la qualité des résultats), il aide
l'apprenant à se situer (sécurisant), à constater ses
progrès (valorisant). Bref, découvrir - s'entraîner -
réinvestir. L'idée du centre de formation Ifac
est donc une idée ambitieuse, englobante : l'exigence
de la formation porte sur l'être même comme une prétention
à agir sur la personne.
Le Compu's Club Aviation; la France vue d'en haut !
Découvrir le paysage drômois ou ardéchois
et bien d'autres vues du ciel. Survoler son village, sa maison ou celles de ses
amis ou parents. Comme Icare, voler, imiter l'oiseau ou admirer sur l'autoroute
A7 les voitures qui n'avancent pas à cause des embouteillages. Boire un
verre à Lyon ou à Grenoble. Ou tout simplement, voir comment
vole un avion. Telles sont les quelques possibilités qui sont offertes
par cette branche menée par un aviateur privé
expérimenté, membre de l'association. Ainsi, il organise des
baptêmes de l'air et aide à la formation théorique et
pratique du pilotage d'un avion pouvant préparer au brevet de Pilote
privé. L'acquisition d'un simulateur de vol professionnel a fait l'objet
de plusieurs réflexions pendant un temps mais abandonné lorsque
la branche s'est mise en sommeil (le moteur de l'avion est à changer).
Donner le goût et préparer aux métiers de
l'aéronautique était un projet d'insertion professionnelle.
Annexe 2 L'enquête du
Crédoc
L'enquête du Crédoc "Les Français et
la vie associative"501(*) fut réalisée en décembre 1998
auprès de 1 500 personnes représentatives de la population des
quinze ans et plus, selon la méthode des quotas : sexe, âge,
profession et catégorie sociale de l'interviewé, région,
taille de l'agglomération d'habitation. Elle nous dit : Environ 40% des
Français déclarent être membres d'au moins une association.
Seulement 21% sont adhérents à deux associations et plus.
Les "membres impliqués" (13%) sont adhérents d'au moins une
association et y consacrent plus de cinq heures par mois. Ils proviennent des
milieux aisés et diplômés.
Selon la même enquête : Les "membres ordinaires"
(26%) consacrent moins de cinq heures mensuelles à l'association. Les
"participants occasionnels" (39%) effectuent ponctuellement des dons ou des
actions. 43% d'entre eux ont moins de 40 ans, et ce sont souvent des
employés (45%) et des non-diplômés (45%). Ils sont
particulièrement sensibles aux "grandes causes" (aide aux personnes
défavorisées, solidarité internationale). Moins d'un
Français sur quatre n'est pas concerné par la vie associative.
Parmi eux, on compte 9% de "réfractaires" qui s'interdisent une
éventuelle adhésion.
Selon la même enquête : Pourquoi
n'adhère-t-on pas ? 41% des Français avancent le
problème du manque de temps. « 13% se disent
échaudés par l'existence d'associations
douteuses. »502(*) 30% des Français pensent que plus de temps
libre pourrait les pousser à accroître leur participation à
la vie associative. Mais dans les faits, mis devant la perspective maintenant
prochaine et obligatoire d'une réduction du temps de travail, seuls 7%
se sentiraient incités à devenir membre d'une association...
Annexe 3 Le questionnaire test
Enquête Test : Quel Membre êtes-vous ?
ET«N_dAdhérent»
et gagnez une souris 3 boutons "hyperclick" avec son
logiciel de paramétrage.
Objectif : mieux comprendre ses Membres pour
améliorer le Compu's Club !
Toutes les informations que vous me ferez parvenir seront
traitées de manière à respecter
votre anonymat et ne seront pas
exploitées à un niveau individuel mais collectif.
Je vous remercie de bien vouloir remplir ce questionnaire avec la plus grande
précision possible. Vos réponses demeureront
strictement confidentielles et privées, ne vous engagent
en rien et vous avez la possibilité de laisser de coté
certaines questions.
Vous vous reporterez à la fin du questionnaire pour
évaluer votre test « Quel Membre êtes-vous
? » et peut-être gagnerez-vous une souris "hyperclic"
trois boutons paramétrables !
Instructions : Plusieurs coches (X) sont
possibles pour une même question fermée sauf spécification
contraire. Pour les questions d'expression libre, si vous manquez
de place pour répondre vous pouvez utiliser une feuille de papier libre
que vous joindrez. Merci d'avance pour votre contribution.
Clubistement vôtre !
|
Le Clubiste en 3
"clics" : C3T
|
|
1er "clic" : CE
QUE JE SUIS VENU CHERCHER AU CLUB. CE QUE J'Y AI TROUVE.
C3T1
|
1. Comment avez-vous connu le Compu's Club ?
______________________________________
|
2. Qui ou/et quoi vous l'a fait rejoindre ?
______________________________________________
|
3.
|
ou
Je suis Membre depuis (environ) : 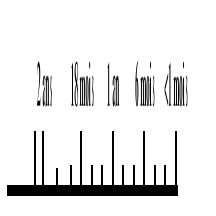
J'ai été Membre pendant : 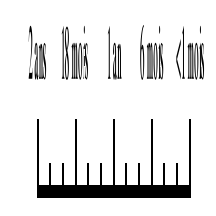
|
4. Si Vous êtes toujours Membre qu'est-ce qui vous fait
y rester ? _________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
5. Les heures d'ouverture vous conviennent-elles ? (lun
& mer 14 à 21h et sam 14 à 19h) Oui Non
Si non quels jours et heures proposez-vous ?
_______________________________________
6. Si nous vous proposions des horaires adaptés
à vos désirs :
û viendriez-vous plus souvent au Club ? Oui Non
(pourquoi ?) ___________________
û participeriez-vous à plus
d'activités ? Oui Non (pourquoi ?) ___________________
|
|
7. Vous ne renouvellerez pas ou vous n'avez pas
renouvelé votre cotisation parce-que :
vous avez un conflit avec un autre membre.
les activités ne vous intéressent... ...pas
...plus
la cotisation est trop chère, je propose le montant
suivant : _____________ F
vous habitez trop loin
___________________________________________
autre motif
____________________________________________________
|
8. Qu'êtes-vous venu chercher au Club (du
matériel, une ambiance, un échange, une camaraderie, ...) ?
_______
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L'avez-vous trouvé ? Oui Non
|
|
2ème "clic" :
CE QUE J'Y FAIS ET POURQUOI. C3T2
|
9. Avez-vous des périodes où vous venez plus
souvent au Club ? Oui Non
Si oui, est-ce dû à : des
disponibilités inattendues ? (Lesquelles) ___________________
une simple envie de vous investir plus ²?
pour répondre à la demande d'un autre
membre ?
Autre _________________________________________________
|
10.
|
Pourquoi n'envisagez-vous pas une participation à
cette activité du Club ?
...vous ne participez pas à...
...vous envisagez
participer à...
Combien de temps
par semaine ?
...Vous participez à...
Combien de temps
par semaine ?
...vous n'envisagez
pas participer à...
Au Club...
|
LIBERTECH (Ass° Juniors) ____ ____
____________________________
COMNET (Internet) ____ ____
____________________________
IFAC (Centre de format°) ____ ____
____________________________ C.A.O (Publicat° par ordi) ____ ____
____________________________ C.E.B. (Bourse & finance) ____ ____
____________________________ Section PRESSE ____ ____
____________________________ ECHAP (Littérature) ____ ____
____________________________ Autres (précisez) :
_________________________________________________________
|
11. Pouvez-vous expliquer en quelques mots la question
précédente : pourquoi vous participez ou pas ? À
cause de quoi le faites-vous ou pas, qu'est-ce que ça vous
apporte ? ...
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
12. J'ai déjà donné du matériel
au Club : Non Oui, lequel _____________________________
____________________________________________________________________________
|
13. Vous sentez-vous être plus dynamique lorsque vous
venez au Club ? Oui Non
|
14. Êtes-vous content d'y venir ? Oui Non
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
15. Appréciez-vous les responsabilités ?
Oui Non
|
16. A-t-on déjà employé le terme de
responsable à votre égard ?
Non Oui (à quel
propos) ?________________________________________________
|
|
3ème "clic" :
QUI JE SUIS : C3T3
|
17. Mme Mle M. (nom, prénom, adresse, tél.,
fax, courriel) : ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
18. Quelle est votre date de naissance ?
______________________________________________
|
19. Votre résidence principale est : un
appartement une maison autre _______________
|
20. Êtes-vous : en couple célibataire
nb d'enfants _____(âges) _________________
|
21. Si vous êtes actuellement en activité,
quelle est votre profession :
Professeur / instituteur (domaine) :
____________________________________________
Fonctionnaire ou assimilé (domaine)
___________________________________________
Artisan / commerçant / chef d'entr. (secteur
d'activité) _______________________________
Agriculteur
|
Profession libérale (secteur d'activité)
___________________________________________ Employé (secteur
d'activité) ___________________________________________________
Cadre (secteur d'activité)
_____________________________________________________
Technicien (secteur d'activité)
_________________________________________________
Ouvrier (secteur d'activité)
____________________________________________________
|
Femme / homme au foyer
Etudiant / lycéen (ce que je veux être plus
tard) ______________________________________
Autre (précisez) :
__________________________________________________________
|
22. Si vous êtes entre deux activités
professionnelles, depuis combien de temps ? _____________
|
23. Cet "accident" de carrière est-il dû
à : un licenciement économique
un accident du travail
autre ______________________________________
|
24. Le Compu's Club vous a-t-il permit d'avancer sur une piste
dans votre recherche de travail ?
vous avez retrouvé un emploi grâce au Club
Lequel ? _________________________
C'est une option que vous n'aviez pas envisagé
|
25. Êtes-vous une personne active et qui
s'implique ? Oui Non
|
26. Êtes-vous remarqué par votre
enthousiasme ? Oui Je ne sais pas
|
27. Précisons, si vous le permettez : dans la vie
vous êtes plutôt...
...passif ...actif et efficace
|
|
 Vous manquez Vous êtes habituellement
Vous manquez Vous êtes habituellement
d'énergie énergique
 Vous souhaitez qu'on Vous relevez
Vous souhaitez qu'on Vous relevez
vous laisse tranquille les défis
 Vous vous laissez Vous connaissez vos
Vous vous laissez Vous connaissez vos
influencer valeurs personnelles
|
|
 Vous fuyez devant Vous allez au bout
Vous fuyez devant Vous allez au bout
les difficultés des choses
 Vous êtes mécontent Vous vous entendez
Vous êtes mécontent Vous vous entendez
des autres bien avec les autres
 Vous ne vous préoccupez Vous vous souciez
Vous ne vous préoccupez Vous vous souciez
jamais des autres toujours des autres
 Vous êtes toujours Vous êtes toujours
Vous êtes toujours Vous êtes toujours
stressé calme et détendu
 Vous êtes insatisfait Vous êtes heureux
Vous êtes insatisfait Vous êtes heureux
de votre vie de votre vie
28. Pouvez-vous dire qu'on vous considère comme une
personne chaleureuse ?
Oui Je ne sais pas, demandez à
_______________________________________
|
|
Le Club en 3
"clics" : F3T
|
1er "clic" :
COMMENT MIEUX S'ORGANISER ET COMMUNIQUER ?
F3T1
|
29. Si vous deviez noter le Club quelle note lui
attribueriez-vous ? 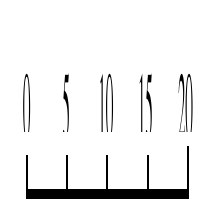
|
30. La première fois, avez-vous eu un accueil
chaleureux ? Oui Non pas assez
31. Les fois suivantes s'est-on occupé de vous ?
Oui Non pas assez
|
32. Que faire pour un meilleur accueil des nouveaux
adhérants ? ___________________________
____________________________________________________________________________
|
33. Au Club, vous y venez : en bus à
vélo en voiture à pied autre ______________
|
34. Les locaux vous paraissent-ils : assez grands Oui
Non Sans importance
assez chauffés Oui Non Pas toujours
chaleureux Oui Non Sans importance
autre information ___________________________________
|
35. Comment lisez-vous le Bulletin Membre Trimestriel :
entièrement partiellement, à ____%
la rubrique que vous avez préféré est
: _________________________________________
la rubrique que vous avez le moins aimé est :
____________________________________
Avez-vous une remarque à faire à propos du
Bulletin Trimestriel Membre ? ________________
____________________________________________________________________________
|
2ème "clic" :
LES ACTIVITES, POUR QUI ? POUR QUOI ?
F3T2
|
36. L'économie et la finance vous
intéressent-ils ? Oui Non
|
36b. L'argent est-il un sujet tabou pour vous ? Oui
Non
36t. Que pensez-vous de l'argent ?
___________________________________________________
____________________________________________________________________________
|
|
37. Connaissez-vous la section Bourse du Club ? Oui
Non
|
38. Au Club avez-vous suivi :
une initiation gratuite (laquelle) ?
____________________________________________
une formation payante en informatique (laquelle) ?
______________________________
une formation payante dans un autre domaine (lequel) ?
_________________________
Vous a-t-elle paru chère ? Oui Non
Pour quelle(s) raison(s) l'avez-vous suivi ?
_________________________________________
____________________________________________________________________________
|
39. Si la formation devait se développer voulez-vous
/ pouvez-vous participer en tant que :
formateur(trice) concepteur(trice) formations et vous
souhaitez être rémunéré : _____ l'h.
Voici mes compétences (ex. français, math,
bureautique, ...) et mon niveau : _____________________
____________________________________________________________________________
|
40. Cette éventuelle participation, vous
préférez la mettre en oeuvre ?
seul en groupe vous faire aider autre
_________________
|
41. Aimez-vous encadrer les jeunes dans leurs
activités ? Oui Non
|
Connaissez-vous la "bonne distance" pour encadrer les
jeunes ? Oui Non
|
42. Aimeriez-vous que se crée un atelier de recherche
d'emploi informatisé ? Oui Non
|
3ème "clic" :
MES IDEES POUR AMELIORER LE CLUB : P3T3
|
43. Que faudrait-il faire pour que les Membres trouvent ce
qu'ils viennent chercher au Club ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
44. Pensez-vous que le Club puisse, parfois, soulager une
certaine solitude ?
Oui Voici comment on pourrait faire pour être
plus efficace : __________________
Non
________________________________________________________________
________________________________________________________________
|
45. Le Club est-il, pour vous, un lieu de débats et
d'échanges où vous pouvez exprimer vos idées ?
Oui voici ce qu'on peut proposer pour améliorer
___________________________
Non
________________________________________________________________
|
46. Le Club est-il, pour vous, un lieu d'entraide mutuelle
où vous pouvez soutenir les autres ?
Oui voici ce qu'on peut proposer pour améliorer
___________________________
Non
________________________________________________________________
|
47. Le Club est-il, pour vous, un lieu de rencontre
favorisant l'enrichissement individuel ?
Oui voici ce qu'on peut proposer pour améliorer
___________________________
Non
________________________________________________________________
|
48. Vous prêteriez-vous à un entretien
individuel ayant pour objet de préciser ce questionnaire ? Oui
Non (pourquoi ?) ___________________________________________________
|
Si oui, Quelles sont les raisons qui vous poussent à
accepter ?
pour rendre pour détailler
autre_____________________________
service certaines réponses
_________________________________
|
49. Voulez-vous me dire quelque chose de plus ?
_______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
50. Est-ce que ce questionnaire reflète votre
pensée, votre opinion à propos du Compu's Club ?
Oui Non
|
|
|
J'ai passé environ ________ minutes pour remplir ce
questionnaire.
|
Évaluer votre test : Quel Membre
êtes-vous ?
Comptez un point par réponse "OUI" aux questions
fermées 3, 9, 12, 15, 25, 26, 37.
Comptez un point si vous avez répondu aux questions
ouvertes 8, 11, 14, 27, 32, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49.
Faites le total de vos points et reportez-vous à la
page suivante pour les résultats et savoir quel Clubiste vous
êtes !
Résultats de l'enquête test : Quel
Membre êtes-vous ?
(diffusés trois mois après dans le
Bulletin Membre)
Les trente-six membres qui ont répondu au questionnaire
sont représentatifs de l'association :
|
Compu's Club
|
Echantillon
|
Taux différentiel
|
Moyenne d'âge
|
34 ans
|
36 ans
|
2 ans
|
|
Lieu d'habitation Valence
|
56%
|
58%
|
2%
|
|
Nombre de mineurs
|
27/192 = 14%
|
6/36 = 17%
|
3%
|
|
Nombre de femmes
|
32/192 = 17%
|
7/36 = 19%
|
2%
|
Quelle "tête" a le « Clubiste
moyen » ?
C'est plutôt un homme (3 pour une femme) d'une trentaine
d'années (9-80 ans pour les extrêmes) qui vit son célibat
(1 Membre sur 2) sans enfant (seulement 19% en ont) dans un appartement (53%)
à Valence (58%). Il est employé technicien (28% des professions
exprimées) et se dit énergique (72%), actif et qui s'implique
(58%). Il ne se laisse pas influencer (41%) et va au bout des choses (75%). Il
dit être généralement calme et détendu (72%) et ne
pas avoir de problème relationnel (57%). Bref heureux dans sa vie
(81%).
Que pense-t-il du Club ?
Pour lui le Club c'est d'abord un lieu chaleureux (89%)
où l'on peut soulager sa solitude (86%), exprimer ses idées
(83%), soutenir les autres (72%). Bref un lieu de rencontres et
d'échanges favorisant l'enrichissement individuel (86%). Notre
« Membre type » est content d'y venir dans 9 cas sur 10
(11% de non-réponse). Enfin il pense que le Club mérite une note
moyenne de 16 sur 20 (12 et 20 sont les extrêmes). Enfin il lit toujours
le Bulletin Membre mais seulement à 73% de son volume total.
Que vient-il chercher au Club ?
Surtout une camaraderie et des contacts pour échanger
(69%) dans la meilleure ambiance possible (47%). Mais aussi, bien sûr,
une aide en informatique (30%).
Qu'est-ce qu'il y trouve
réellement ?
Avant toute chose une ambiance (67%), une entraide, une
convivialité (53%) puis des contacts (50%) et enfin seulement des
projets (22%) ou de l'informatique (22%). Ces quelques chiffres nous permettent
de constater que notre association propose autre chose de plus que son
étiquette informatique d'une part, et répond dans 85% des cas
à ce que le Membre vient y chercher.
Que vient-il faire au Club ?
Se détendre (39%), échanger (28%) et donner du
matériel au Club (33%). Il participe aux activités
épisodiquement (38%). La branche la plus fréquentée est
Comnet (25%) puis le C.E.B.
(20%).
Répartition des branches503(*) de l'association par
âge, sexe et situation familiale des adhérents ayant
répondu au questionnaire
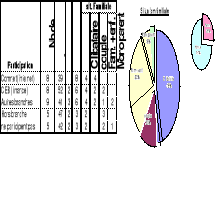
Annexe 4 Entretiens, les
thèmes
1
|
Comment le Membre est arrivé au CC (Ce qui a
joué)
|
1.1
|
Objet d'adhésion
|
1.1.1
|
Circonstances
|
1.1.2
|
Raison Informatique
|
1.1.3
|
Autres raisons
|
1.2
|
Antécédents (pouvant justifier de
l'engagement ou de la motivation)
|
1.2.1
|
Familial
|
1.2.2
|
Professionnel
|
1.2.3
|
Autres
|
1.3
|
Ce qui a convaincu au départ
|
1.3.1
|
Informatique
|
1.3.2
|
Suivre une branche, un projet
|
1.3.3
|
Autres
|
2
|
En quoi il y a configuration (Ce qui joue)
|
2.1
|
Ce qui fait rester ou pas au Compu's
Club
|
2.1.1
|
Ce qui est connu du Compu's Club
|
2.1.2
|
Description des relations entre les membres et le Compu's Club
|
2.1.3
|
Description des interactions entre membres
|
2.1.4
|
Autres
|
2.2
|
Participation aux branches
|
2.2.1
|
Description des relations entre les membres et la branche
|
2.2.2
|
Description des interactions entre membres de la branche
|
2.2.3
|
Autres descriptions
|
2.3
|
Sentiments exprimés...
|
2.3.1
|
...par le membre sur lui-même (valeurs et ressentis)
|
2.3.2
|
...par le membre sur le CC (valeurs et interactions au CC)
|
2.3.3
|
...par le membre sur les valeurs du monde associatif en
général
|
2.3.4
|
Autres
|
3
|
Maturation de l'expérience vécue (Ce qui se
joue)
|
3.1
|
Identification (Dans le sens : j'assimile le CC
à quelque chose...
|
3.1.1
|
...de familial
|
3.1.2
|
...de professionnel
|
3.1.3
|
...de camaraderie
|
3.1.4
|
Autres
|
3.2
|
Construction du sens (Dans le sens : ce qui fait
lien, ce qui rend efficient les...
|
3.2.1
|
...situations
|
3.2.2
|
...interactions
|
3.2.3
|
...actions
|
3.2.4
|
Autres
|
3.3
|
Ce qui a changé
|
3.3.1
|
comportement
|
3.3.2
|
profession
|
3.3.3
|
informatique
|
3.3.4
|
Ce qu'il faudrait faire
|
3.3.5
|
Autres
|
|
Annexe 5 Entretiens, les questions
Annonce : Dans le cadre du Dheps je
mène une enquête pour comprendre ce qui fait lien entre
l'association et la motivation (la non motivation), l'engagement (le non
engagement) de ses membres.
Notre entretien sera enregistré pour conserver le plus
fidèlement possible ta parole. Puis retranscrit, analysé et
interprété. Ceci dit, je te garantis un parfait anonymat.
A. Ce qui a joué
1. Comment as-tu connu le Club ?
(questions de relances)
- Qui t'as fait connaître le Club ?
- Qu'est-ce qu'on t'en avait dit qui t'avait
séduit ?
- Dans quelles circonstances as-tu découvert le
Club ?
- Qu'est-ce qui t'as attiré à
l'époque ? (dans le dépliant, ...)
- Qu'est-ce qui t'as fait adhérer ?
- As-tu déjà une expérience de
l'associatif ? Etais-tu satisfait ? Si non, pourquoi ?
- Fais-tu partie encore d'une autre association ?
- Participes-tu à une autre association depuis ton
adhésion au Club ?
- Qu'est-ce qui a conduit à adhérer au
Club ?
2. Avais-tu un projet en rejoignant le Club ?
- Venais-tu chercher quelque chose de précis ? De
particulier ?
- Quelque chose a-t-il déterminé ta
décision ?
- Qu'attendais-tu au moment de rejoindre le Club ?
- Quel(s) intérêt(s) trouvais-tu au
Club ?
3. Peux-tu me parler de toi à l'époque de ta
venue au Club ?
- De quel milieu viens-tu ?
- Quelle était ta situation familiale ? Ton
travail ?
- Tes parents exerçaient quel métier ?
- Etaient-ils engagés dans la vie associative, la vie
publique ?
- Qu'est-ce qui fait que tu es sensible au monde
associatif ?
B. Ce qui joue 1
1. C'est quoi, pour toi, le Club aujourd'hui ?
Quelle image en as-tu aujourd'hui ? Quelle
représentation t'en fais-tu ?
- Qu'est-ce que ça représente pour toi
aujourd'hui ?
- Qu'est-ce qui te plaît au Club ?
- Comment définis-tu le Club ?
- Peux-tu me donner deux ou trois expressions pour
décrire le Club ?
- Si tu devais présenter le Club, qu'en
dirais-tu ?
- Quelles valeurs attribues-tu au Club ?
(Pour ceux qui sont engagés)
2. Dans ta branche, ça marche comment ?
- Est-elle autonome ?
- Comment ça se passe entre les membres ?
- Qu'est-ce qui semble important dans le bon fonctionnement
de la branche ?
- Suivez-vous un projet dans la branche ? Si non,
pourquoi ?
- Si oui, comment a-t-il vu le jour ? Comment ça
c'est passé ensuite ?
- Que t'apporte-t-il personnellement ?
- Est-ce que tu as des moments de préférence
dans cette branche ?
- Peux-tu décrire un ou deux exemples de ce qui se
passe dans ta branche ?
- Qu'est-ce que ce qui se passe te paraît
déterminant dans la conduite du projet / de la branche ?
- Qu'est-ce qui te ferait quitter la branche ? Qu'est-ce
qui te fait rester ?
- Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe qui ne relève
pas du projet de la branche ?
(Pour ceux qui ne sont pas engagés)
2 bis. Connais-tu l'organisation du Club ?
- Connais-tu les branches du Club ?
- Peux-tu me donner deux ou trois expressions pour
décrire le Club ?
- Qu'est-ce que tu aimes faire au Club ?
- Qu'est-ce que tu préfère au Club ?
- Que viens-tu chercher aujourd'hui au Club ?
- Peux-tu me dire pourquoi tu ne participes pas à un
projet du Club ?
C. Ce qui joue 2
1. Tu participes depuis ... années au Club. Quels ont
été les moments forts ? Qu'est-ce que tu en retiens
aujourd'hui ?
- Que retiens-tu de ta participation ? Qu'est-ce que
ça t'as apporté ?
- Peux-tu me donner un ou deux exemples qui t'ont
particulièrement marqué dans tes relations avec les
autres dans le cadre du Club ?
- Quelque chose a-t-il changé pour toi depuis que tu
es au Club ?
- Ressens-tu (vois-tu, constates-tu) un changement dans ton
travail, ta vie personnelle, ... ?
- Si oui, comment l'expliques-tu ?
- Si non, Pourquoi ?
- Quand tu viens au Club, dans quel état d'esprit te
trouves-tu ? Comment te sens-tu ?
- Qu'est-ce qui fait que tu y restes ?
2. Quelles sont, selon toi, les obstacles à une
participation plus importante de l'ensemble des membres au Club ?
- Qu'est-ce qui pourrait susciter ton
intérêt ?
- Comment arrives-tu à dégager du
temps ?
- A quelles valeurs es-tu le plus attaché et que
tu reconnais dans le Club ?
D. Ce qui se joue
1. Que faudrait-il faire pour améliorer le
Club ?
Annexe 6 Premier entretien
A (Premier entretien) 09h20 le 1er
février 2001 Au domicile de l'interviewé.
Il s'agit du Trésorier actuel de l'association. Il a
toujours travaillé (architecte d'intérieur extérieur).
Nous l'avons toujours connu comme quelqu'un disant ne pas vouloir prendre de
responsabilité. La raison était due à une mauvaise
expérience vécue dans une autre association. Cependant il est
très actif : animations d'astronomie, participe à la branche
formation, Trésorier. 56 ans. Adhérent depuis la
création.
Après annonce.
Jm : Alors dis-moi, comment as-tu connu
le Compu's Club ?
A : Le Compu's Club je l'ai connu dès
sa... dès sa naissance. Avant même qu'il soit créé.
Puisque j'en ai entendu parler... euh... dans les locaux de M.A. (le bailleur
de l'association à son origine)... Dès son début, quoi,
dès que...
Jm : Qui te l'a fait connaître, en
fait ?
A : Ben... euh... personne... Justement c'est
les, les personnes en train de le créer qui en parlaient ouvertement
eeet c'est comme ça que j'ai su que, queeee... que ça allait se
créer, quoi, queee...
Jm : Alors, qu'est-ce qui t'as le plus
séduit ? Qu'est-ce qui t'as séduit de ce qu'il en a
été dit de cette construction de l'association ? Qu'est-ce
qui t'as séduit ?
A : Ben, ce qui m'a séduit c'est que
j'étais nul en informatique et queeee... en créant un club,
j'allai pouvoir apprendre quoi de neuf en informatique. Au départ
c'était vraiment de la consommation, justement, apprendre.
Jm : Apprendre. Les circonstances, alors
de découverte de ce club, c'était tout à fait informel,
c'était parce-que tu es arrivé, qu'on en parlait et...
A : Voilà les gens en parlaient...
euh... Bon j'ai trouvé que c'était très intéressant
puisqu'il y avait à l'époque rien à Valence. Euh... On
achetait des ordinateurs, mais bon... peuh (avec les lèvres).
Jm : Est-ce que tu te souviens de ce
qu'il en avait été dit de cette association, à
l'époque ?
A : Euh, non. Honnêtement non, non,
non. Honnêtement, heu...
Jm : A l'époque qu'est-ce qui
t'as attiré ?
A : Ben ce qui m'a attiré c'est que je
vais pouvoir enfin savoir faire marcher un ordinateur. C'est ce qui m'a
attiré sur la... cette création de, de Club.
Jm : Il n'y avait pas d'affiche ?
Il n'y avait pas de dépliant ?
A : Non, non, au départ c'était
vraiment le... vraiment y avait rien, c'était en discussion.
Jm : Alors tu as déjà une
expérience du monde associatif ?
A : Oui, j'ai été pendant...
euh... cinq ans dans un club d'astronomie, les Pléiades à
Beaumont les Valence. Euh... Justement je faisais les initiations pour les
gens.
Jm : Tu en étais
satisfait ?
A : Oui, oui, j'en étais très
satisfait. Et puis, en plus, j'aime ça hein. J'aime le monde associatif
parce-que, bon, on s'crée des amitiés et... des relations...
et... puis qu'on avance en découvertes, en idées, en tout.
Jm : Pourquoi tu n'y es pas
resté ?
A : Euh, Ben là il s'était
passé un problème qui m'a... qui a fait que jeeee.
Problème de personnalité, disons que des choses se sont faites
dans mon dos alors que j'étais associé à eux pour les
réalisations. Ça ne m'a pas plu. Justement, c'était pas...
ça ne tenait plus du monde associatif. Ça se faisait à
deux ce qui devait se faire à trois. Euh...
Jm : Et au Compu's Club tu as eu le
même sentiment à un moment de l'association ?
A : Ben non, parce-que... c'est pareil, je
serais parti. Si, si, justement si j'avais retrouvé ça... si
ça se produit un jour je partirai. Parce-que bon, je pense qu'une
association marche pas à une ou deux personnes mais à un groupe
plus important et... tout le monde doit amener, dans la mesure de ses
possibilités, euh... des idées.
Jm : Est-ce que tu fais partie d'une
autre association encore ?
A : Non.
Jm : Non ? Depuis ton
adhésion au Club tu n'as pas été tenté
d'adhérer à une autre association ?
A : Euh... honnêtement, non, hein. Je,
je, ch'suis bien dans le Club là... euh... c'est, c'est, c'est,
l'ambiance me plaît, les gens me plaisent... euh...
Jm : Alors, finalement qu'est-ce qui
t'as conduit à adhérer au Club ?
A : Ben, ce qui m'a conduit à
adhérer au Club, au départ c'est l'informatique.
Jm : C'est l'informatique, pour
résumer.
A : Voilà, au départ, c'est
l'informatique : apprendre euh... apprendre à faire marcher un
ordinateur... euh... installer les logiciels.... et puis faire fonctionner un
ordinateur.
Jm : Tu veux dire tu ne venais rien
chercher d'autre de précis ?
A : Au départ, non. Au départ,
non...
Jm : Tu n'avais pas de projet...
A : Non, et puis comme j'avais
été un petit peu... un petit peu échaudé par...
euh... par mes (silence) associations précédenteeees... j'ai, je
voulais consommer. Au départ consommer.
Jm : Qu'est-ce que tu attendais au
départ, au moment de rejoindre le Club ? Tu en attendais
quoi ? C'était qu'on t'explique l'informatique, ce genre de
chose...
A : Voilà. Qu'on m'explique
l'informatique... parce-que je ne connaissais rien.
Jm : Mais au départ une
association n'a pas vraiment de matériel. Quand elle se crée...
euh...
A : Ouais, non, mais, bon moi j'avais, moi
j'avais mon matériel déjà, hein. Chez moi, bon chez moi
j'avais, j'avais déjà acheté un ordinateur. Le tout
après c'est qu'il fallait savoir s'en servir.
Jm : Quel intérêt tu y
trouvais au Club ? Au delà de l'informatique même ?
parce-que tu as rencontré des gens, tu as entendu parler des gens, il y
a des choses qui se sont dites. On a certainement parlé d'informatique,
on a peut-être parlé d'autre chose. Est-ce que tu as trouvé
un intérêt dans les gens qui en discutaient, comment ils en
discutaient, ce qu'il en disaient, comment il voyaient la construction de cette
association ?
A : Oui, justement c'est pour ça que
je suis entré. Maintenant si ça n'avait pas été
dans mes goûts je ne serais pas rentré.
Jm : Est-ce que tu te souviens de quelle
manière on en parlait de cette association pour la construire ?
A : Au départ, non, honnêtement
non... euh... c'est trop loin. C'est...
Jm : Alors, est-ce que tu peux me parler
un petit peu de toi à l'époque de ta venue au Club ? Quelle
était ta situation familiale ?
A : Marié, euh... une fille...
voilà, profession libérale, sous-traitant en architecture.
Jm : Tes parents étaient-il
engagés dans la vie associative ?
A : Non.
Jm : Ta femme, ta fille, ...
A : Personne, personne.
Jm : Ta fille fait des études
actuellement ?
A : Elle fait des études.
Jm : Elle est ... elle fait partie d'un
club d'étudiants ?
A : Non, non, non
Jm : Alors, qu'est-ce qui fait que tu es
sensible au monde associatif ? Tu sembles dire que c'était quelque
chose que tu avais dans la peau, mais plus précisément ?
A : Ben... euh... c'est.... Moi ce que j'aime
dans la vie associative c'est que, bon, on fait connaissance de gens qui ont
d'autres idées que nous... euh... ça permet de discuter,
ça permet d'amener dans beaucoup d'idées nouvelles... euh...
beaucoup de connaissances nouvelles... euuuh... et puis de faire des relations
amicales. Ça c'est d'ailleurs, à mon avis, pour une association
le premier point c'est l'amitié, avant toute autre chose... euh...
Ça permet deeee se satisfaire soi-même. Déjà
d'amener des éléments... voilà pour moi c'est ça la
vie associative. (silence).
Jm : Alors, euh... aujourd'hui ; le
Compu's Club, aujourd'hui, c'est quoi pour toi ?
A : Euh.
Jm : Qu'est-ce que ça
représente pour toi aujourd'hui ?
A : Aujourd'hui, ben, ça, ça
représente pour moi, euh... un lieu, euh... où je me sens bien,
déjà, euh... où j'ai des amis, euh... ça
m'amèneeeee... ça m'ouvre sur des horizons disons, euh... pas
spécialement informatique, mais sur des horizons nouveaux, euh... que je
n'avais peut-être pas pratiqué dans un autre club. Donc, ça
amène quand même des...
Jm : Par exemple ?
A : Ben, c'est vrai queee, par exemple,
euh... on va parler de... Comment expliquer ? Euh... des, des, de
nouvelles connaissances, voilà, ça, ça m'amène de
nouvelles connaissances. Par exemple, par exemple, euh...
Jm : Connaissances intellectuelles, pas
de connaissances de personnes ?
A : Ah oui, oui, intellectuelles, c'est,
c'est intellectuel. Bon, de personnes, c'est... ça amène de
bonnes connaissances puisqu'il y a à chaque fois des membres qui
adhèrent. Donc c'est une nouvelle... Non moi je parle de connaissance,
euh... connaissances intellectuelles, hein. Parce-qu'on évolue, quoi, on
discute. On est déjà... Par exemple, moi j'étais sur
euh... beaucoup figé sur l'astronomie, l'archéologie. Là,
avec ces nouvelles personnes, j'ai d'autres connaissances qui viennent. Donc,
euh, ne serait-ce que sur... euh... hors mis l'informatique puisque ça
en fait partie, mais d'autres choses.
Jm : Qu'est-ce qui te plaît le
plus au Club ?
A : Ce qui me plaît le plus ?
euh... Bon, ce qui me plaît le plus, c'est le, c'est, c'est
l'amitié. C'est les gens. Ça c'est déjà la
première chose... ensuite il y a les, les, les discussions...
Jm : Discussions autour de
l'informatique ?
A : De tout, de tout puisque justement...
Jm : ... il y a des discussions autre
que l'informatique ?
A : Ben oui, je, je... ben oui, si on allait
que pour l'informatique ce serait comme retourner à sa boîte,
quoi. Eh oui. Si c'est pour parler que de l'informatique parce-qu'on est dans
un Club d'informatique, non. C'est comme si on, quand on est dans sa
boîte on parle que de son travail et puis, bon, c'est monotone, quoi.
Donc, justement c'est que, on discute d'autres, d'autres choses. Et d'ailleurs
on y fait d'autres choses. Pas que de l'informatique.
Jm : Par exemple ?
A : Par exemple, euh... on y fait de la... un
livre... un exemple qui euh... alors là ça n'a rien à voir
avec l'informatique. Il y a l'informatique, mais il y a création d'un
livre.
Jm : On se sert de l'informatique,
alors, hein ?
A : Ah oui, mais à l'heure actuelle,
on est, euh... de toute façon, actuellement on est obligé de se
servir de l'informatique pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Pour faire
un courrier, on est obligé. Ça l'informatique y a pas de
problème on y passera tous, même les vieux comme moi, on est
obligé de s'y mettre. (sourires).
Jm : Il y a autre chose qu'on y fait au
delà de l'informatique ?
A : Oui, y a la PAO-CAO., y a le... euh...
donc, ça c'est, ça ce sont des... Comment expliquer ?...
des... pour certaines gens se sont des choses très intéressantes.
Bon moi je ne me suis pas particulièrement intéressé dans
la mesure où moi j'ai un ordinateur où je suis mieux
équipé qu'au Club. Je le fais chez moi, ça, ce sont des
choses... bon il y a aussi...
Jm : ... la PAO-CAO. qu'est-ce que
c'est ?
A : Ben, c'est leeee... les logiciels qui
permettent de faire les cartes de visite, des... tout un tas d'affiches, tout
des programmes comme ça quoi, des...
Jm : Comment tu définirais le
Club ?
A : (Long silence de réflexion,
puis :) Euh, fuuu. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Jm : Est-ce que tu peux me donner deux,
trois expressions qui permettraient de décrire le Club ?
A : Euh... déjà avoir la foi...
amitié, contact... (long silence) amitié, contact (en
réfléchissant)... ambiance... l'ambiance... et y a le... oui
l'ambiance. Ça l'ambiance, c'est vraiment un point très important
aussi parce-queeee, l'ambiance, euh... l'ambiance est très bonne dans ce
Club parce-que s'il n'y avait pas eu une bonne ambiance, moi je serais parti.
Bon il y a aussi l'entente... entre les membreeeees du Club qui est très
très très bonne. Justement parce-que il y a une bonne ambiance,
une bonne entente, il s'y passe de bonne amitiés.
Jm : Euh, tu entends quoi par
ambiance ? Ça veut dire quoi ambiance ?
A : L'ambiance, eh ben c'est...
Jm : Tu me donner quelques
exemples ?
A : ... c'est le cadre, bon bé. Une
bonne ambiance c'est quand on va dans un local et qu'on se sent bien. Qu'il y a
des, des personnes intéressantes. C'est ça pour moi l'ambiance,
hein. C'est paaas...
Jm : ...Et au Club, l'ambiance du Club,
elle se caractérise, elle se définie comment ? Elle se
matérialise comment ?
A : Eh bé, par, par le... (silence) je
dirais... (silence)
Jm : ...par la relation, par
l'expression, l'échange ?
A : C'est tout, c'est tout. La relation, les
échanges, les entraides, les... Voilà, c'est ça,
justement, tout. Ambiance, bon ben, quand on se sent bien y a toujours, y a
obligatoirement une bonne ambiance. Y a une bonne ambiance, c'est normal.
Jm : Bon, tu parlais d'entente tout
à l'heure, euh, le Club comporte pas mal d'adhérents, hein, euh,
il y a cent quarante sept membres qui sont passés au Club, quatre vingt
dix sont encore à jour de leur cotisation504(*), huuuum, comment on peut
arriver à s'entendre lorsqu'il y a tant de monde ?
A : Bon, alors là, euuuh... Bon
déjà il faut mettreeee... chacun a son caractère. Donc
déjà, euh, pour faire partie d'une association il faut mettre un
peu d'eau dans son vin.
Jm : Tout le monde ne peut pas
nécessairement mettre de l'eau dans son vin. Il y a des gens qui sont
agressifs naturellement et qui...
A : Oui, mais ces personnes, obligatoirement
seront seules... elles seront, elles seront obligatoirement rejetées si
elles sont comme ça, si elles sont agressives, euh... Si elles
n'apportent rien, ben les gens, iiiirons discuter... ceux qui s'entendent, qui
apportent quelque chose ils discuterons entre eux obligatoirement, cette
personne sera obligatoirement isolée. Euh... sans même qu'on le
veuille... l'isolée. Mais obligatoirement on sera attiré vers les
personnes qui sont, qui ont leeee, une... ch'ai pas, avec qui on s'entend.
Jm : Et au Club, tu as l'impression
qu'il y a certaines personnes qui sont isolées justement ? Parce
qu'ils ont mauvais caractère ?
A : Euuuuuuh... là, actuellem... Non
parce-que justement, euh... bon il y a une chose qui est sûre c'est
que... moi je suis pas tous les jours au Club et je ne connais pas toutes les
personnes.
Jm : Oui, mais enfin tu en rencontres
quand même pas mal.
A : Oui, mais bon, euuuuh, dans
l'ensembleeee... et puis les personnes qui, qui... qui viennent pour consommer
on le voit de suite, hein. D'elles-mêmes elles se tiennent un petit peu
à l'écart. Elles, elles ne participent pas aux discussions, elle
n'est pas... elles n'sont paaas... Bon, ce sont, là obligatoirement, ce
sont des personnes qui viennent pour consommer et en principe ces personnes ne
seront jamais seules, en fait.
Jm : Tu parlais d'échanges, tout
à l'heure, d'entraide, tu peux me donner un ou deux exemples
d'entraide.
A : D'entraide. L'entraide pour moi c'est
tout. C'est pas qu'une question de... du point de vue d'une question Club.
Jm : Non, mais, justement, au Club
est-ce que tu me donner un ou deux exemple d'entraide ? Toi, tu t'es fait
aidé peut-être à un moment, tu as aidé...
A : ...Moi je, je, je m'suis fait aider,
j'ai... Ben, au début, quand les ordinateurs, quand mon ordinateur se
plantait je devais entièrement le refaire. Ben j'ai demandé, on
m'a expliqué, euh, voilà.
Jm : Tu as demandé et toi
même on t'as demandé ?
A : Oh, oui, on m'a demandé, euh, et
puis même sans me demander quand j'ai vu que la personne bataillait je me
suis approché d'elle, je lui ai dit « ça va
pas », euh, « oui, effectivement je n'arrive pas
à comprendre... ». Enfin, dans la mesure où moi je
savais le faire je lui ai expliqué et puis voilà.
Jm : Oui, pourquoi tu fais cette
démarche quand tu arrives à repérer ces gens qui sont en
difficulté et que tu vas vers elles ?
A : Ben, parce-que c'est dans mon
caractère. Mon caractère, bon, bé, euh...
Jm : Tu as toujours été
comme ça ?
A : Toujours comme ça ouais.
Jm : Si tu devais présenter le
Club à quelqu'un, à une tierce personne, un ami, pour essayer de
l'attirer au Club parce-que tu penses que ça peut être
bénéfique pour lui ? Comment tu le
présenterais ? Qu'est-ce que tu en dirais de ce Club pour qu'il
soit intéressé ?
A : Ben, je lui parlerai déjà
de l'ambiance, hein. Parce-que çaaaa...
Jm : Tu lui en parlerais comment de
cette ambiance ?
A : Ah ben, d'une bonne ambiance. C'est,
c'est...
Jm : Ça veut dire quoi une bonne
ambiance ?
A : Eh bé, justement c'est le contact
des, des gens entre eux. C'est, c'est sympa quoi. Queee, les gens, je pense
queeee... le, le collègue déjà... l'ambiance pour lui se
sera primordial. « S'il y a une mauvaise ambiance son Club il se
le garde ». Voilà, c'est ça quoi. Lui dire, lui
expliquer un peu tout ce qu'on a fait. Euh, voir si lui il retrouve
déjà ses...
Jm : Tu en parlerais comment de ce qu'on
y fait au Club ?
A : Ben, j'en parlerai... je lui dirai tout
ce qu'on y fait. C'est-à-dire, euuuuuh... le, que c'est pas
spécialement qu'informatique. Déjà lui expliquer que au
départ c'est l'informatique mais qu'il y a d'autres choses qui se font.
Le, tel queeee... la Bourseeeee... la CAO-PAO, leeee... qu'est-ce qu'il y
a ? Les autres... le reste quoi.
Jm : Alors, quelles valeurs tu
attribuerais au Club ?
A : (silence)
Jm : Quelles sont les valeurs que tu
attribuerais au Club ?
A : Qu'est-ce que tu entends par
là ?
Jm : Euh, de quelle manière tu
pourrais dire du Club : « le Club a telle chose, c'est son
fondement, c'est son pilier, s'est quelque chose qui le soutien, qui
transparaît, qui... » en quelques mots, les valeurs du
Club, qu'est-ce que c'est ?
A : Les valeurs du Club, ce serait
déjà son... son civisme. Voilà ça c'est une grosse
valeur, bon. Justement on fait un journal au Club où on parle deeee,
à chaque fois deeee (silence) civisme. Donc déjà, c'est
ça. Et puis bon, le Club, celui-là, il a, il apporte beaucoup de
choses aux gens. Au gens qui veulent, qui veulent plus, euh, (silence puis
claquement de bouche), comment dire ? les, les, il apporte aux gens donc
euuuuuh. Les gens qui recherchent justement un manque sur quelque chose,
automatiquement, euh, il sera rejoint par le Club. Il, il trouvera ce qu'il
veut parce-qu'il y aura toujours quelqu'un pour euuuh, pour lui amener ce dont
il recherche.
Jm : Tu participes à une
branche ?
A : Non.
Jm : Qu'est-ce qui fait que tu n'y
participes pas ?
A : Actuellement aucune branche ne me
plaît et puis en plus il y a le fait que je n'ai pas beaucoup de temps
pour m'occuper d'une branche. Euh, bon, j'ai d'abord, actuellement, le travail
personnel qui passe un petit peu avant, quand même, ce qui est logique.
Et puis, bon, euh, peut-être, alors, peut-être à la retraite
je m'en occuperai un peu plus (rires).
Jm : Si tu avais un peu plus de
disponibilités, euh, est-ce qu'il y a une branche que tu aimerais
créer ? Ou est-ce qu'il y a une branche à laquelle tu
aimerais participer ?
A : Ben, dans l'immédiat ce serait une
brancheeee sur la formation qui m'intéresserait. Ce serait... expliquer
un petit peu aux gens leeee, le maniement de Windows de base, montrer comment
qu'on fait un fdisk, un formatage, voilà, ce serait... donner la base
aux gens sur l'informatique.
Jm : Se serait la branche Formation,
qui...
A : ...Formation.
Jm : Est-ce qu'il y a une brancheeee,
ça ce serait si tu avais plus de disponibilités. Mais est-ce
qu'il y a une branche que tu aimerais créer ?
A : Oui, oui, j'aimerai créer une
branche mais, bon, euh, ça serait sur l'astronomie. Puisque je me suis
aperçu qu'avec un... une caméra, euh... d'un ordinateur, euh...
pour Internet, on pouvait le brancher sur le télescope et... ça
c'est une chose très intéressante. Mais, bon, le problème
qu'il y a c'est que si je crée une branche comme ça, il n'y
aurait pas beaucoup de monde qui viendrait dans la mesure où ça
se passe la nuit. il faut rester des fois jusqu'à deux heures, trois
heures du matin, euh... L'hiver, à -8, dehors à deux heures du
matin, euh, il y a pas beaucoup de volontaires. Les gens
préfèrent être sous la couette... voilà, si tu veux,
le problème qu'il y aurait à monter ceee, cetteeee... cette
branche.
Jm : Est-ce que tu pourrais me
décrire un ou deux exemples de se qui se passe dans le Club ?
A : exemple sur euh ?
Jm : Dans le Club.
A : (silence)
JM : Dans le Club, tu viens, tu es un
observateur et puis tu constates des choses qui se font. Est-ce que tu as un ou
deux exemples de choses qui se font avec d'autres membres ou d'autres membres
qui font, eux, pour faire avancer le Club ?
A : Euh...
Jm : Un ou deux exemples ?
A : Dans l'immédiat, là, des
exemples, là, euh... ne me viennent pas. Euh, ben si de toute
façon quand on rentre dans le Club il y a toujours quelqu'un qui bricole
un ordinateur pour le réparer. Ça c'est quand il y a quelque
chose qui va pas. Euh, y a autre chose aussi, c'est queeeeee on trouve souvent
des gens en train de discuter entre eux.
Jm : Ils discutent de quoi ?
d'informatique ?
A : Ben non pas spécialement
d'informatique. Il peuvent discuter d'informatique mais ils discutent d'autres
choses. Justement, c'est un peu l'avantage deee, de, d'une association comme
ça c'est que on discute de tout ... sans parler obligatoirement
d'informatique.
Jm : Euh, toi, tu viens... puisque tu es
équipé toi, tu es bien équipé. Est-ce que tu viens
au Club justement pour discuter de tout plutôt que
d'informatique ?
A : Euh, je viens au Club, euh...
plutôt pour discuter un peu de tout, bien sûr un peu d'informatique
parce-que dans ce cas là, ...
Jm : les deux ?
A : Les deux, oui, on est obligé,
hé, eeet il y a toujours des nouveautés en informatique, on en
discute. Bon moi j'ai récupéré un, un vers sur Internet
donc je l'ai mentionné aux, aux membres du Club, euh... On discute, mais
y a pas que l'informatique. On discute un peu de tout, euh. Justement,
(silence) on y retrouve un petit peu, un peu de loisirs là-dedans, ce
qui est très bon.
Jm : Qu'est-ce qui te fait rester au
Club ?
A : Justement, au Club ce qui me fait rester
c'est l'ambiance. l'ambiance qui essssst, qui est sympa. Les gens...
Jm : ...Il peut y avoir une bonne
ambiance et ne pas t'y trouver bien...
A : Ben si justement, c'est parce-que je m'y
trouve bien. Autrement, je, j'y viendrais pas. Justement, si, s'il n'y avait
pas cette ambiance bonne et sympathique, je ne viendrais pas au Club. S'il y
avait pas d'entente entre les gens, euh, c'est pareil je ne viendrais pas au
Club. Donc si j'y viens c'est que je retrouve, c'est que j'y trouve un
plaisir... une satisfaction.
Jm : Qu'est-ce que tu aimes y faire au
Club ?
A : Euh, moi j'aime surtout actuellement...
bon, pas y travailler parce-que j'ai expliqué que j'avais un ordinateur
qui est beaucoup plus puissant que ceux du Club. Mais, moi, justement pour
aider des gens, euh, pour discuter avec, avec, pour discuter avec, euh... pour
y discuter avec les gens. Pour les aider, pour, euh, pour... C'est ça la
vie.
Jm : Parmi tout ça, qu'est-ce que
tu préfères ?
A : (silence) Parmi tout ça, ce que je
préfère ? Euuuuh. Moi c'est un peu aider les gens, euh,
voilà aider les gens, rendre service, voilà. Rendre service c'est
un peu mooon... c'est ce qui me plaît.
Jm : Tu viens donner ?
A : Voilà, je viens donner, euh. Bon
quand je peux récupérer, je récupère, ça
c'est...
Jm : Alors, justement qu'est-ce que tu
viens chercher au Club ?
A : Moi, je viens surtout
récupérer des nouveautés que je ne connais pas, des mots
techniques que je ne connais pas, euh, voilà.
Jm : Sur l'informatique quoi...
A : ...Principalement sur l'informatique. Bon
bé je viens récupérer ça, bon bé je viens
récupérer aussi, euuuh... dans les discussions un nouveau savoir.
Puisqu'on ne parle pas que d'informatique. Il y a toujours des gens qui sont,
euh, qui, qui oublient, euh, qui en parlent, on en discute, justement on
apprend.
Jm : Alors, on parle de l'informatique
de quelle manière ? Uniquement sur le matériel et le
logiciel ou d'une manière plus philosophique ? Ce que ça
peut engendrer ? L'influence que ça a ? Etc.
A : Plus philosophique, voilà, plus
philosophique, oui. Oui, oui, je parle de l'informatique pure et dure, hein.
Justement, si c'n'était qu'ça, ce ne serait pas
intéressant. Ça reviendrait à ce que j'ai dit tout
à l'heure : on se retrouve dans son bureau à parler de
travail.
Jm : Alors, est-ce que tu peux me donner
un ou deux exemples qui t'ont particulièrement marqués dans tes
relations avec les autres ? Dans le cadre du Club, hein ? Des choses
qui t'auraient marqué ? L'interrogation informelle ou en venant
d'une manière informelle ou à l'occasion de réunions
puisque tu es Trésorier de l'association donc je suppose que tu dois
participer aux réunions du Conseil d'Administration et du Bureau.
A : Ce qui m'a beaucoup frappé
là-dedans c'est la liberté d'expression, voilà.
Jm : C'est une valeur de l'association,
ça, la liberté d'expression, laisser l'autre parler ?
A : Ah oui ! oui, oui.
Jm : Ou du moins
l'écouter ?
A : L'écouter, le laisser s'exprimer
et puis bon ce qui y a c'est que chaque fois quee... qu'on parle d'une chose,
tout le monde y participe, tout le monde donne son avis et... ce qui
engendreee... euh... leeee, de bon, de bonnes résolutions à la
sortie, quoi.
Jm : Comment ça se passe dans les
réunions, généralement ? Quand il y a une idée
qui est exprimée, je suppose que... d'abord qui y participe à ces
réunions ?
A : En principe tous les gens qui veulent y
venir. Justement c'est le, le...
Jm : A la réunion du Conseil
d'Administration, tout le monde peut y participer ?
A : Voilà, c'est-à-dire queee
certaine personnes veulent venir, ça ne pose aucun problème,
hein. Euh, bon...
Jm : Ça doit faire beaucoup de
monde ?
A : Oui, mais les gens se limitent d'eux
mêmes (rires).
Jm : Ah ils se limitent d'eux
mêmes. Il y a une auto limitation ?
A : Oui, c'est-à-dire, y a des gens
qui ne sont pas intéressés. A mon avis y a 20% de, de, de gens
qui viennent vraiment pour le plaisir de l'association et y a 80% de, de
consommateurs.
Jm : Donc, dans ces conversations, dans
ces discussions, puisqu'apparemment il a l'air d'y avoir du monde, il doit y
avoir des moments où le ton monte. Comment ça se passe en
général, là ? Comment ça se fait que les gens
finalement ils restent et queee... bien que le ton puisse monter ?
A : Eh ben là c'est que tout le monde
mette de l'eau dans son vin. Il faut bien qu'il y ait un peu d'ambiance !
(rires).
Jm : C'est ça qui fait
avancer ?
A : Mais oui (en riant toujours), ça,
bon, euh...
Jm : C'est les passions, quoi ?
A : C'est les passions. tout le monde est
pas... bon... le gars qui vient ici c'est qu'il aime ça, c'est que c'est
un passionné donc obligatoirement il va venir défendre son
idée au maximum. Il va s'emporter, le ton monte, mais, euh... le
lendemain c'est fini.
Jm : Toi même tu as bien dû
lancé un certain nombre d'idées ?
A : Oui, dans la mesure où... j'ai
soulevé un problème pour l'Internet, tu vois. Et bon, euh, il
s'avère que tout le monde était d'accord pour mon projet.
Effectivement, c'est intéressant pour les gens qui viennent pour
Internet.
Jm : Et si ceee... est-ce que tu as
apporté des idées, déjà, qui ont
été... euh... discutées, qui n'ont pas été
adoptées ?
A : (silence) Beuh, non, apparemment tout ce
qu'on discute, bon, euh... Y a pas que moi qui amène des idées
aussi, hein, y a... tout le monde, justement, c'est l'avantage, que tout le
monde amène des idées, tout le monde a une idée, bon
bé, il l'a soumet, on en discute et... à la sortie il arrive
toujours à en sortir quelque chose, quoi. C'est ce qu'y a de bien.
Jm : C'est ça. Je suppose qu'il y
en a qui doivent donner des idées, quand même, qui ne sont pas
acceptées ?
A : Ah ben oui, euh... Il est certain que
quand on a des... en principe les idées sont rarement pas
acceptées. Les idées sont rarement acceptées, ben, ce qui
les arrête la plupart du temps c'est l'argent. Il y a beaucoup
d'idées, bon ben il faudrait de l'argent et ça l'argent, le Club
en n'a pas. Donc on sait qu'on ne peut pas aller plus loin, quoi. Donc les
idées sont arrêtées, euh...
Jm : Pour être reprises
après, éventuellement ?
A : Effectivement. Elle peuvent être
reprises après. Pour Internet, il y a eu un problème pour mettre
Internet : c'est le coût du câble à l'année,
quoi. Au Club on n'a quand même pas un budget très important.
Jm : Est-ce que tu peux me dire pourquoi
tu ne participes pas à un projet du Club ?
A : Je ne participe pas à un projet du
Club dans la mesure où, actuellement il y en a aucun qui meee, qui me
satisfait. Puis, bon il y a aussi, leee, il faudra encore s'investir plus et
avoir plus de temps.
Jm : Alors, si tu avais ce temps
là, justement quelle est la branche à laquelle tu
participerais ?
A : Euh, moi ce serait les formations. On en
a parlé tout à l'heure, moi c'est les formations.
Jm : Tu participes depuis le
début de l'association, ça fait trois ans et quatre mois
maintenant, tu es un des pionniers de l'association. Quels ont
été pour toi les moments forts de cette association ? il y a
eu des hauts, des bas, il y a eu des moments de freins, des moments...
A : D'abord, pour moi, les moments les plus
forts ça a été justement quand le Club a été
arrêté. Quand on n'avait pas de locaux. Ça c'est, je pense
que pour moi ça a été les moments les plus, les plus forts
parce-qu'il a fallu se battre, trouver, chercher, euh, essayer à
maintenir les gens qui avaient adhéré, euh, ce qui était
pas évident.
Jm : Tu t'es senti plus, plus
dynamique ?
A : Oh oui, oui, plus dynamique, oui. Oui,
oui, je pense queee, qu'on a bien donné, tous le monde a bien
donné. C'est à dire qu'on faisait des réunions, chacun
chez soi, euh, chacun à tour de rôle on allait chez un des quatre
personnes qui s'en sont occupées la première fois, euh, qu'on n'a
pas eu de locaux, eeet.... on changeait d'appartement, on s'organisait comme
ça, c'est sympa quoi. Mais, bon, euh, c'était dur aussi
(expectoration en riant).
Jm : Qu'est-ce qui a fait que ça
a tenu, que les membres ne se sont pas essoufflés ? Parce-que la
deuxième fois que le Club a fermé, il a fermé longtemps,
il a fermé plus de cinq mois.
A : Oui, oui. Par contre la deuxième
fois où on n'avait plus de locaux le... les réunions ont
peut-être été moins fréquentes mais on était
plus nombreux. Et ça je crois que c'était, c'était pas mal
aussi. Euh, ça soulageait beaucoup de gens qui n'avaient, euh, qui la
première fois n'avaient pas participé, ont participé eeet,
je pense que ça a été un bon, euh, une bonne envie
d'arranger la sauce.
Jm : Et toi-même tu ne t'es pas
essoufflé, à un moment, lorsqu'il y a eu ces freins
là ?
A : Euh, essoufflé, non. Disons que...
non non, non non. Parce-que bon, justement, ça été le
moment, je pense, où il fallait donner le plus. C'est pas quand leeee,
quand le Club est (silence) tout prêt, dans des beaux locaux queeee,
c'est pas là qu'il faut aider le plus. C'est justement quand il est en,
un peu en... difficulté.
Jm : Alors, ça... Des moments
forts dans les freins ; est-ce qu'il y a eu des moments forts dans
l'évolution de l'association ?
A : (Silence)
Jm : Est-ce que tu as retenu des
moments, euh, des moment forts ? Où on a été
boosté, où on a été reconnu, ...
A : Ah oui, oui, oui. Oui, puisqu'on est
reconnu par la Jeunesse et Sports et beaucoup d'autres trucs administratifs.
Justement, c'est un peu le, le, le, vraiment le point fort du Club. C'est
queee, il va toujours de l'avant, toujours de l'avant, toujours de l'avant. Il
recherche à... le maximum de choses, euh, là pour ça, le
Club, là, i s'défonce. Non on peut pas dire le contraire.
Jm : Alors de ta participation,
qu'est-ce que tu en retiens ? De ta participation au Club ?
A : (Silence) Ben j'en retiens une
satisfaction, ça c'est la première chose. Autrement je ne
l'aurais pas fait, hein. La satisfaction, euh...
Jm : ... « Autrement
tu ne l'aurais pas fait » mais tu ne pouvais pas savoir, avant
de t'investir dans le Club que tu aurais satisfaction ou pas. Tu
l'espérais cette satis...
A : ...Ah oui, je l'espérais. Ah ben
bien sûr...
Jm : ...Tu ne pouvais pas
préjuger du résultat.
A : Oui, oui, non, non, mais justement, euh,
justement, c'est queee... Bé justement c'est que...
Jm : Finalement, tu n'as pas
été déçu, quoi ?
A : Ah non, non, non, non, ben non
parce-queee... et puis c'est mon caractère d'être comme
ça.
Jm : Alors, qu'est-ce que ça t'as
apporté ? Au delà de la satisfaction ?
A : Ben, des amitiés. Ça, je
pense c'est primordial dans la vie de chaque personne d'avoir l'amitié.
Bon c'est pas l'amitié, euh, comment dirais-je, l'amitié, euh, je
ne sais pas comment t'expliquer le mot. mais c'est une amitié quand
même...
Jm : ...Amitié
confidentielle ?
A : Voilà, voilà, mais c'est
une amitié, quand même, qui est très... qui est proche du
confidentiel, quand même, euh, c'est une bonne amitié, euh.
Jm : Saine ?
A : Saine, voilà. C'est le mot, une
amitié qui est, euh... qui est vraie, c'est ça. Une amitié
vraie.
Jm : Bon, tu parles beaucoup d'amis,
d'amitié, c'est une valeur importante pour toi, c'est quelque chose qui
fait partie de ton caractère, ce à quoi tu es attaché,
c'est une unité de valeur. Euh, est-ce que tu peux me donner un exemple,
un ou deux exemples qui font qu'une amitié va naître ? Ou
qu'une amitié dure ?
A : Euh, fuuuu...
Jm : Au sein du Club, j'entends bien,
avec les autres membres, hein ?
A : ...Oui, oui...
Jm : ...avec les autres membres...
A : Bien sûr, oui. Je pense, euh, tant
que les... tant que les gens, euh viennent et donnent de l'amitié
(inaudible). Pour être (inaudible) si la personne n'était pas
correcte vis-à-vis de l'autre. Ça, l'amitié, donc
tant que, moi je pense que tant qu'il y a justement la correction et le civisme
entre les personnes y aura aucun problème l'amitié sera...
durera.
Jm : Il faut quelques affinités
pour faire des amis. Il faut avoir des valeurs communes, il faut avoir...
A : Oui mais les valeurs communes on les a
puisqu'on est dans le même Club donc c'est qu'on a des valeurs communes
sinon on serait dans des clubs différents.
Jm : Ces valeurs, justement, ces valeurs
communes, quelles sont-elles ?
A : Au départ, c'est, c'est
l'informatique. Au départ, puisque c'est un Club informatique qui a
mené... Donc chacun a, a...euh...
Jm : Un Club informatique, mais il y a
d'autres clubs informatiques.
A : Oui, mais, euh. Mais bon, il y a d'autres
clubs...
Jm : Qu'est-ce qui transparaît,
quelles sont les valeurs qui suintent, qui transpirent de, de l'association et
qui permettent cette amitié, cette ambiance, cette entente ?
A : C'est son civisme ! Son
civisme !
Jm : Son civisme. Encore autre chose que
le civisme, ce serait le seul élément ? Est-ce que c'est
suffisant ?
A : (Silence) Non, c'est, c'est les, euh.
Jm : Qu'est-ce qui peut y avoir d'autre
encore ? Est-ce que l'organisation globale de l'association ? La
tolérance ?
A : C'est justement, justement, c'est tout
ça, c'est tout ça qui fait que... voilà : il y a la
tolérance, y a le, euh... le bon point à mon avis la
tolérance, y a le contact, les discussions qui sont vraiment possibles.
Justement tout ça fait un tout que justement le Club fonctionne et que
l'amitié durera. C'est justement cet ensemble total qui fait que le Club
fonctionne bien.
Jm : Alors, euh, depuis que tu es au
Club est-ce que quelque chose à changé chez toi ?
A : Euh...
Jm : Est-ce qu'il y a eu une
évolution ? Par rapport à il y a trois ans ¼ ?
Dans le Club, depuis que tu es au Club, dans le Club, éventuellement,
euh, bon l'évolution du poste je suppose qu'il a changé...
A : ...Il a changé...
Jm : ...à titre personnel, dans
le Club est-ce qu'il y a des choses que tu fais plus que tu ne faisais pas
avant, des engagements que tu as pris ? Des fonctions que tu as pris que
tu ne voulais pas prendre ? Ainsi de suite...
A : Ouui, çaaa (rires). Oui, oui,
euh...
Jm : Eventuellement, est-ce qu'il y a eu
des répercussions bénéfiques ? Euh, dans ta famille,
dans ton travail, dans tes relations.
A : Non, non, bon moi, j'étais quand
même, euh, j'avais l'esprit associatif, donc, euh, bon pour moi,
personnellement, rien n'a changé. Hors mis que, bon, je ne voulais pas
m'engager plus que ce que je m'engageais au départ et queeee... je me
retrouve Trésorier, quoi.
Jm : C'est un sacré changement
ça !
A : Oui, bon, euh...
Jm : ...Ne pas vouloir s'engager puis
finalement, petit à petit, finir Membre du Bureau, euh, Administrateur,
c'est un sacré changement ça quand même.
A : Ouui, bon jeee, c'est vrai que je ne
voulais plus, comme j'étais, j'avais eu des déboires avec mon
autre association je ne voulais plus m'engager de ce côté
là.
Jm : C'est compréhensible. Tu
l'as exprimé toi-même. Ce n'est pas tout à fait la
même association quand même, hein. Il y a autre chose qui
transparaît.
A : Ben non, l'autre par contre, non, l'autre
association était, aussi, une très bonne association, il y avait
le pareil. Mais là il s'est passé un truc que les gars ils ont
même pas voulu le faire méchamment. Bon, mais moi, ça
été question de principe. Voilà et moi je suis un gars
droit, euh, si on me fait ça, c'est fini. Il faut pas me faire ça
moi, juste ça (avec les gestes).
Jm : D'accord. (silence). Au sein de
te... à titre personnel, euh, tu, tu m'as dit il y a ce changement de
prises de fonctions, euh, est-ce qu'il y a autre chose qui aurait changé
au delà des prises de fonctions, dans ta façon de, de voir les
choses, de rencontrer d'autres personnes, de participer à cette
ambiance, à cette tolérance, à ce civisme, à cette
entente, etc. Est-ce que ça a eu des répercutions sur
toi-même et que ça se voit après dans le travail, tes
relations avec tes fournisseurs, tes clients, dans ta famille ?
A : Honnêtement, non. Non, non,
honnêtement non parce-que moi j'ai, mon caractère euh... à
mon âge je ne me referai pas. Mais bon, euh... comme je suis une personne
assez sociable, doncccc, pour moi, non il n'y a pas eu de changement. Euh, j'ai
toujours mis de l'eau dans mon vin quand il y avait du monde et qu'on
était en discussion parce-que chacun a son opinion, bon ben. Justement,
pour s'entendre il faut mettre de l'eau dans son vin et puis sorti de
là, euh...
Jm : Pourquoi tu n'as pas eu de
changement ? Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ça n'a rien
changé ?
A : Ben ça n'a pas changé dans
la mesure où j'ai toujours eu cet esprit-là. Donccc, pour moi
ça n'a pas changé, c'est toujours mon esprit, euh...
Jm : Alors, justement, dans quel
état d'esprit tu te trouves quand tu viens au Club ?
A : Ben justement, retrouver... d'être
bien. Bon, euh, moi je vais au Club comme si j'allais pratiquement aux loisirs.
C'est, euh, faire un loisir, voilà c'est ça.
Jm : C'est ça, comme tu vas
à la montagne, tu vas au Compu's Club le week-end ?
A : Voilà, exactement, hein.
Jm : Tu te sens comment quand tu y viens
au Club ?
A : Ben, euh, détendu, euh,
détendu, ça me permet, moi de me relaxer, même. J'irai
même plus loin ça me permet de me relaxer parce-que le travail
c'est pas toujours évident, il y a toujours des problèmes
(inaudible). Donc quand je vais là-bas je m'détends, je m'relaxe,
je suis cool.
Jm : Alors, qu'est-ce qui fait que tu y
restes ?
A : Ben c'est queee... j'y reste pour le
moment parce-queee y a de l'ambiance, hein. S'i y avait pas cette ambiance,
euh... Si l'ambiance se dégradait je pense que je partirai. Chez moi ce
qui fait que je reste. Il y a de l'ambiance, quoi.
Jm : Alors, ce qui ferait que tu le
quitterais c'est que justement il n'y ait plus cette ambiance.
A : Qu'il n'y ait plus cette ambiance,
voilà. et puis queee, et puis, bon, que, que, que certains Membres se
prennent vraiment pour des chefs, voilà. Ce qui, à mon avis fera
disparaître l'association.
Jm : Alors, quel sont selon toi les
obstacles à une participation plus importante au Club, au delà du
manque de disponibilités que tu as déjà
exprimé ?
A : Les obstacles (inaudible) ?
Jm : Ouais !
A : Beeeein, je pense qu'il faut, euh, bon,
les locaux sont petits donc le Club, il aura des difficultés à,
à aller plus de l'avant dans la mesure, je m'entends, euh, euh, recevoir
du monde. Déjà on est limité en surface. on a le droit de
recevoir je crois, dix-neuf personnes. Bon, donc, déjà,
déjà, euh, ça limite déjà pour faire une
extension pour faire venir du monde.
Jm : Oui, oui, euh, pour toi, pour ta
participation plus importante au Club, au delà de ton manque de
disponibilités, euh, quels sont les obstacles ? Quels seraient les
obstacles si tu avais du temps qu'est-ce qui ferait que tu participerais ou pas
à telle ou telle chose ?
A : Ah ben si j'avais plus de temps, je
participerais plus. Ça c'est sûr !
Jm : A quoi tu participerais ?
A : Hé bé, comme j'ai
expliqué tout à l'heure. J'ai, je, je pense que je m'investirai
plus dans leeee... à, à l'accueil des gens, à tout
ça quoi, à, au général du Club.
Jm : Au général du
Club ?
A : Ah oui.
Jm : tu ne participerais pas à un
projet en particulier ?
A : Euh... le seul projet où je
pourrais éventuellement... euuuh... Si, le projet comme je l'ai
expliqué tout à l'heure ça serait de me lancer un peu dans
les formations. Euh...peut-être voir, euh...
Jm : La CAO ?
A : Euh, la CAO, non, c'est paaas, c'est
paaaas...
Jm : Tu connais la CAO. Est-ce que tu en
a entendu parler avant ?
A : Ouais, pas trop.
Jm : Pour la CAO toi tu es
déjà équipé en matériel, c'est plus des gens
pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure
« c'était plus des gens qui, euh, qui viennent chercher
à apprendre... »
A : ...Qui viennent chercher à
apprendre...
Jm : ...et toi, tu, tu...
A : ...et puis bon. Et puis si moi je pense
que heu la personne qui est associative dans l'esprit, elle restera même
une fois qu'elle aura appris. Elle restera justement pour enseigner ce qu'elle
aura appris et puis, et puis par amour du monde associatif, voilà. Cette
personne restera. Bon il est certain qu'on aura toujours des gens qui viennent
que pour consommer.
Jm : S'il y en a qui viennent apprendre
à la branche CAO par exemple, euh, c'est bien qu'il y en a qui
donnent ?
A : Ben oui !
Jm : Ça c'est quelque chose... tu
ne participerais pas à donner ?
A : Euuuh, moi je pense qu'il y a
déjà des gens, euh, non plus c'est pas la peine d'être une
cinquantaine... à apprendre à d'autres parce-queeee... je pense
un peu limité... Par exemple dans la CAO ils sont un peu limités
dans le nombre de personnes. Euh, d'ailleurs dans toutes branche on devrait
limiter le nombre de personnes. Parce-que plus y en a et plus c'est le brouhaha
et moins les gens apprennent. Donc il faut quand même un petit peu
limiter les personnes dans les... (silence).
Jm : Alors, comment est-ce que tu
arrives à dégager du temps pour venir à
l'association ?
A : Bon ben là, euh, c'est en fonction
aussi de l'association. Euh, si elle a besoin de moi un après-midi, bon,
mon boulot au lieu de le faire l'après-midi je le fais le soir.
Jm : Tu est très libre dans ton
travail. C'est un peu ton travail qui guide...
A : ...qui guide...
Jm : ...tes disponibilités...
A : ...mes disponibilités,
voilà...
Jm : ...et tu peux ajuster comme
ça. Alors on va, on va, ça se termine, hein, on va aller au bout.
Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le Club ?
A : Ben, là, c'est toujours question
sous. Moi je pense ce serait deee, le matériel.
Jm : Faire évoluer le
matériel ? Les gens ne viennent pas pour ça, tu disais,
nécessairement pour ça, que pour ça.
A : Ben, euh.
Jm : Qu'ils ne venaient pas que
pour le matériel, tu disais.
A : Ah non ils ne viennent pas que pour le
matériel. Si nous, on veut faire évoluer le Club, il faut faire
évoluer le matériel. Donc, ça c'est primordial à
mon avis. Il faut avoir les logiciels, euh, euh, récents, il faut avoir
tout un tas de logistique intéressante justement pour que les gens
viennent. Bon, euh, on a l'exemple de moi qui ai un appareil plus
perfectionné que ceux du Club.
Retournement de K7 = ¾ d'h.
Jm : Alors, à cette question,
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le Club ? Faire
évoluer le matériel informatique, c'est une chose mais est-ce
qu'il y a encore autre chose dans les valeurs du Club, dans l'ambiance du Club
qu'il faudrait faire évoluer, faire avancer ? Est-ce qu'il faudrait
imaginer des permanents, des gens qui connaîtraient, euh, le relationnel,
euh.
A : Oui. Mais moi je pense que le Club, comme
il est actuellement il peut encore évoluer, euh, tel qu'il est. Je pense
qu'il y a encoreeee...
Jm : A quels points de vues ?
A : Enfin, je, il y a une bonne équipe
donc, obligatoirement, euh ça évoluera, obligatoirement. Du
moment qu'il y a une bonne équipe. Bon, embaucher des gens, c'est bien
mais le gars est là pour ça. On a un exemple malheureux... il
était bien gentil, mais bon il n'avait pas la pêche, euh. Donc
à mon avis... un bénévole il sera plus doué qu'un
salarié pour faire du travail parce-que le bénévole est
passionné, l'autre il est salarié.
Jm : Euh, le bénévole n'a
pas toujours des disponibilités...
A : ...C'est le problème, c'est, c'est
le problème. Le problème c'est que le bénévole bon
bein, il a pas toutes les disponibilités d'un salarié, donc, un
salarié on est obligé d'en avoir.
Jm : Qu'est-ce que tu entends par
bénévole ?
A : Bénévole ça
peut être. Pour moi le bénévole c'est la personne, comme
moi, qui ne reçoit pas de salaire et qui fait ça parce-que...
pour faire avancer son Club. Voilà c'est ça pour moi le
bénévole. C'est le gars qui fait ça vraiment sans but
lucratif, euh, en passionné. Et ce gars-là il amènera plus
qu'un salarié. Y a pas de problème. Le salarié, il vient
pour gagner sa vie. L'autre, il le fait gratuitement, il donne son coeur,
voilà.
Jm : Tout à l'heure tu as dit une
expression « avoir la foi ». Ça veut dire
quoi avoir la foi ?
A : Avoir la foi, c'est, c'est, apprendre
à aimer ce qu'on fait.
Jm : Aimer ce qu'on fait ?
A : Voilà !
Jm : C'est une foi dans l'amour de ce
qu'on fait ?
A : Dans l'amour de ce qu'on fait
voilà ! C'est-à-dire on retrouve une satisfaction de le
faire. C'est ça avoir la foi, la foi de ce que l'on fait.
Jm : Euh, pour reprendre le
questionnaire qui était passé il y a quelques mois. A la question
"vous sentez-vous plus dynamique quand vous venez au Club" tu avais
coché "oui" et à "êtes-vous content d'y venir" tu avais
marqué "oui". Peux-tu m'expliquer pourquoi détente et
changement ? Changement, c'est le changement de lieu, c'est le
dépaysement, ... ?
A : Euh, le changement, oui. Le
dépaysement, beinnnn, oui le dépaysement par rapport à, au
travail, ouais, c'est ça.
Jm : (Silence) Qu'est-ce qu'il faudrait
faire pour que les membres trouvent ce qu'il viennent chercher au
Club ?
A : Euh, c'est un peu ce que je t'ai
dit : c'est d'abord, c'est le matériel.
Jm : C'est le matériel. Dans un
premier temps, ils viennent pour ça. et puis après, ils...
A : Voilà, justement, justement. Par
exemple question matériel on aurait des pentium III, euh tu verrais que
les gars resteraient, viendraient plus souvent. Euh, on aurait beaucoup de
possibilités de... le gars amènerait son disque dur, deee le
formater tout ça, tu verrais que les gars ils viendraient plus souvent.
Surtout que... s'il a un 486 derrière. S'il a la même chose que
nous c'est pas la peine qu'il vienne au Club pour travailler sur les
ordinateurs, tu comprends. Si on est au dessus de lui il viendra au Club. Non
mais ça c'est... c'est une logiqueeee...
Jm : Est-ce que tu penses que le Club
peut, quelquefois, soulager une certaine solitude ?
A : Ah oui, de toute évidence, toute
évidence. toute évidence, la personne qui vit seule, elle vient
au Club, bon é ben, euh...
Jm : Qu'est-ce qu'on pourrait faire
pour, euh, pour améliorer cette solitude s'il y en a qui viennent pour
ça ?
A : Moi, là, là, là,
c'est, c'est, c'est pas nous qui allons agir, c'est la personne qui, qui, c'est
selon le comportement de la personne. Nous, nous, là on peut pas agir si
tu veux pour elle.
Après un arrêt :
A : Ce que je voulais te dire dans ton... ce
questionnaire c'est qu'il y a deux choses qui m'ont choquées :
c'est que... tu ne parles pas de la créations d'emplois que le Club
amène. Parce-que, on est arrivé à caser plusieurs
personnes et ça je pense que c'est dommage de ne pas en parler.
Parce-que des personnes ont trouvés du travail autre que... que notre
Club et ça je pense que c'est un gros point pour le Club.
Jm : Et ça c'est dû
à quoi, ça ?
A : Eh bien justement. C'est dû
à ce que tu as mal fait ton questionnaire (rires).
Jm : Non, non, mais c'est dû,
c'est dû à cette ambiance du Club ? Y a bien des gens qui
doivent changer ?
A : Non, non, c'est, c'est l'ambiance du Club
oui, c'est dû au Club, justement en étant un Club informatique de
base, ça prouve qu'il fait autre chose que de l'informatique. Et
ça je pense que, dans le questionnaire, c'est un petit dommage de pas en
parler.
Jm : Ouais, en tout cas c'est bien d'y
penser, c'est bien de me le signaler. merci. Oui y a des gens qui ont
retrouvé une place.
A : C'est de ceux-là qu'il faut
parler, c'est pas des autres. Justement là dessus tu en parles pas, ils
ne vont pas en parler et je trouve que c'est un petit peu dommage.
Annexe 7 Deuxième entretien
H (Deuxième entretien) 12h40 le
1er février 2001. Sur son lieu de travail.
Une adhérente, membre de la branche
Littérature : a retrouvé du travail après long
chômage (Formatrice en communication). 50 ans. Adhérente depuis 1
an ½. Connaît peu l'informatique.
Après annonce.
H : Il n'y a pas de questionnaire ?
Tu n'as pas fait de questionnaire à remplir ?
Jm : non, il y en avait eu un il y a
quelques mois mais tu ne l'avais pas rempli.
H : Pas vrai ? Si, je l'ai rempli
mais je ne l'ai jamais envoyé. Ça, c'est moi, tu sais. Oui,
non-non, non- non. Parce-que j'aime bien remplir tout ça, moi.
Jm : Il y a 6 ou 9 mois de ça.
H : Oh mais il y a longtemps, je
sais.
Jm : Alors, on va commencer. Comment
est-ce que tu as connu le Compu's Club ?
H : Euh... J'ai connu Compu's Club par,
euh, ma situation de chômage qui m'a fait aller de portes en portes
chercher du travail et une association comme la Sdava m'a dit «
mais, il vient de sortir quelqu'un qui pourrait vous
intéresser. Ils écriv... il écrit, veut écrire un
journal, euh, un livre sur le chômage. » Et ce monsieur...
J'ai donc pris contact et nous avons après peu à peu pris
conscience qu'il nous fallait monter une association pour faciliter surtout les
démarches administratives et nous sommes allés nous adresser au
Compu's Club. Pourquoi ? Ça, je ne peux pas dire. C'est le monsieur
en question qui devait connaître. Voilà. Donc j'ai connu cette
association comme ça.
Jm : Alors, donc tu as découvert
le Compu's Club dans ces circonstances-là. C'était une
orientation avec un monsieur qui avait en projet d'écrire un livre et
vous vous êtes rapprochés naturellement du Compu's Club. Pourquoi
particulièrement du Compu's Club, tu ne sais pas ?
H : Je n'en sais pas plus parce-que
c'était une association qui proposait des services comme l'informatique.
Ils avaient aussi... ils avaient aussi... euh... des, de, des... comment on
appelle ?... des branches... euh... pour les jeunes, des projets de
formations, il y avait aussi un journal, il y avait aussi un petit livret qui
fait qu'on s'est dit qu'on pourrait peut-être s'intégrer, faire un
section de Littérature avec un grand L.
Jm : Lorsque vous vous êtes
rapproché du Compu's Club, est-ce que la personne en question a dû
te convaincre d'adhérer au Compu's Club ? Où est-ce que
c'était une personne qui a dû te dire ce qu'était le
Compu's Club ? Pourquoi le Compu's Club ? Etc. Est-ce que tu t'en
souviens à l'époque ? Ce qui a été dit sur le
Compu's Club ?
H : Non, non. Pour nous c'était
une solution de facilité plus que... franchement hein... plus qu'un
service. C'était le service de facilité.
Jm : Tu as déjà eu une
expérience de l'associatif ?
H : Oui.
Jm : Oui... euh... beaucoup ?
H : Oui !
Jm : Dans quel domaine ?
H : Domaine d'associations familiales,
où j'étais Présidente. Domaine association des
« Chanteries de Valence » où j'étais Chef de
Coeur.
Jm : Chef de Coeur ?
H : Chorale. Domaine association d'aide
aux alcooliques à la Croix Bleue. Enfin bon, pfou. Domaine
d'alphabétisation.
Jm : Oui. Tu en avais été
satisfaite à chaque fois ?
H : Oui, oui, à chaque fois.
Jm : Qu'est-ce qui a fait que... Tu y es
encore ? Tu participes encore ?
H : Non, non.
Jm : Qu'est-ce qui fait que...
H : Bien, parce-que il y a des enfants,
le travail et puis aussi une certaine lassitude du phénomène
associatif. (silence) Et voilà...
Jm : Lassitude ?
H : Lassitude, oui. De gérer
beaucoup de choses. Un bénévolat qui petit à petit... Ben
pour moi c'était pas la solution de toujours faire du
bénévolat. Donc, ben j'me suis tournée vers autre chose de
par ma vie personnelle et professionnelle.
Jm : Là depuis que tu y es, tu y
participes, Tu participes depuis l'adhésion ?
Interrompu par une tierce personne
Jm : Depuis que tu as rejoint le Club
est-ce que tu as participé à une autre association ?
H : Oui, l'association Remaid d'aide aux
victimes. Où je suis bénévole. Et je suis administrateur
ad hoc. Je fais donc... j'ai donc fait une formation puis j'ai fait une
formation encore de bénévolat pour l'aide aux jeunes victimes qui
ont subi des violences sexuelles.
Jm : Donc tu y participes toujours.
Alors qu'est-ce qui t'as conduit au delà de la participation à ce
projet qui naturellement a amené au Compu's Club ? Est-ce qu'il y a
d'autres éléments qui auraient pu te conduire au Club ?
H : (long silence de réflexion).
En dehors du bouquin, si j'avais pu rentrer à l'association ?
Jm : Oui. Ou alors avec l'idée du
bouquin, est-ce que tu avais... heu... Bon il y avait ce projet de bouquin.
Mais est-ce que tu avais éventuellement quelque chose de
précis ?
H : Oui, moi j'ai failli plus
m'intégrer quand il y a eu des idées de projet de formations, des
projets de, très égocentriquement, d'emploi. Vu que
j'étais toujours en recherche d'emploi. Et... heu... des projets...
ouais, de structurer des choses. Mais... heu... Je dis "mais" parce-que j'ai
l'impression... je ne connais peut-être pas assez bien le Compu's Club,
mais j'ai l'impression que c'est surtout axé sur l'informatique. Tout ce
qui est informatique. Donc je me sens pas du tout apte à aider en quoi
que ce soit. Et même je n'en profite... entre guillemets... je n'en
profite pas. Je n'ai même pas... je ne sais pas bénéficier
des avantages. Voilà, hein. Il y a des formations comme des niveaux 1, 2
en informatique où j'ai jamais pu... je ne me suis pas donné les
moyens de venir. Donc je n'ai pas su bénéficier des avantages
(raclement de gorge). Voilà.
Jm : Tu, tu, tu attends quelques chose
de particulier du Club aujourd'hui ?
H : Non.
Jm : Quand tu y es entrée, tu
attendais quelque chose de particulier ?
H : Non, j'ai rien attendu mais j'ai
trouvé ce que j'aime y trouver. De l'accueil... euh... quelque chose
d'agréable, quelque chose où on peut parler... euh... les choses
sont structurées. C'est bête, hein, mais il y a des classeurs, il
y a des... On sent qu'il y a une organisation, qu'on fait pas tout et rien.
Que... ce n'est pas pour te lancer des fleurs... mais j'ai beaucoup,
beaucoup... euh... pardon, tu le gommeras (à propos de
« ce n'est pas pour te lancer des fleurs »
à ma réaction de chut !). J'ai beaucoup, beaucoup
trafiqué dans des associations. Puisque j'ai été 14 ans
à l'Adim. Enfin toutes les associations de-ci, de-là. Et je
trouve que dans cette association on sait qui fait quoi. Voilà.
Jm : Quand on parlait. Tu disais tout
à l'heure « on peut parler ». Tu peux
préciser ce que tu entends par « on peut
parler » ?
H : « On peut
parler », ben, moi j'ai toujours pu exprimer... euh... si
j'étais d'accord avec quelqu'un ou quelque chose ou avec une idée
ou si je n'étais pas d'accord.
Jm : A quelle occasion ça...
H : Ben, à l'occasion...
Jm : Tu as proposé des
services ?
H : Voilà, à l'occasion,
par exemple, d'une aide... de mettre en place éventuellement des
formations. Euh, par rapport au fonctionnement, comment ça pourrait
fonctionner, des emplois CES, mais aussi, est-ce qu'il y a un Président,
comment ça peut... enfin tout l'organigramme. Je peux exprimer soit mon
accord, soit mon désaccord. Voilà. Et ça a
été entendu et... euh... sans... euh... sans... sans, sans se
disputer, sans employer des mots. Même si des fois on a eu des mots un
peu violent, ça a été quand même entendu et puis...
Le désir de construire ensemble a toujours été là.
Voilà.
Jm : C'est ce que tu as ressenti,
donc...
H : C'est ce que j'ai senti...
Jm : ...dans tes relations avec les
autres membres au sein du Club ?
H : Oui. Et j'ai eu l'occasion de
concrétiser ça, de, de, d'en avoir la preuve. Lors... même
quand il y a des altercations, il y a un déménagement, et bien y
a pas un pelé, y en a quinze de pelés. Y a...euh... bon. Et je
pense que... on sait faire... euh... y a des gens qui savent passer outre...
leur, leur nombril pour...euh... ben, le but de... initial de l'association.
Jm : Alors, est-ce que tu peux me parler
un peu de toi à l'époque ? Tu disais que tu
étais au chômage... ça fait longtemps que tu étais
au chômage ?
H : Cinq ans.
Jm : Ca fait cinq ans que tu
étais au chômage. Et actuellement tu as retrouvé du
travail ?
H : J'ai retrouvé du travail.
Jm : Depuis combien de temps ?
H : Depuis 3 mois.
Jm : Depuis 3 mois. Euh, est-ce que tu
étais engagé dans la vie associative pendant que tu étais
au chômage déjà ? Est-ce que tes parents
étaient engagés dans la vie associative ? Ta famille
était engagée dans la vie associative ?
H : Mes parents étaient
engagés dans la vie associative, oui.
Jm : Dans des domaines proches de tes
préoccupations ?
H : Dans des domaines... de...
plutôt dans des domaines scolaires.
Jm : Scolaires ?
H : La F.O.L... voilà. Et puis
aussi dans le domaine religieux.
Jm : Dans la vie publique aussi,
peut-être ?
H : Dans la vie publique aussi. Mais,
bon... à l'époque hein... il y a quarante ans, c'était
quand même dans le domaine associatif beaucoup moins, qui avait moins
d'impact que de nos jours.
Jm : Qu'est-ce qui fait que tu es
sensible au monde associatif ?
H : (Silence de réflexion)
Jm : Qu'est-ce qui fait dans ta
personnalité que tu es attirée par le monde associatif ?
H : Ben, parce-queeee... j'ai une
certaine naïveté qui me fait croireee... à la
solidarité entre les hommes quand il y a solitarité.
Jm : Quand il y a
solidarité ?
H : Solidarité quand il y a
solitarité.
Jm : Ah, solitarité.
H : C'est un terme que j'ai
employé dans mon li... dans notre livre.
Jm : C'est ça. Donc, pour toi le
monde associatif peut répondre à une certaine solitu...
H : Bien que je sois contre (raclement
de gorge) le monde associatif.
Jm : Contre le monde
associatif ?
H : Oui, par rapport au
phénomène, à notre nation. Euh, phénomène
politique. Je suis contre le phénomène associatif tout en y
participant. Parce-que je trouve que c'est instituer la misère entre
guillemets... est bien nationalisée, bien instituée. Ça,
tu dois bien l'entendre souvent ? Mais je fais partie de ces gens qui le
pense et que on continu à faire du bénévolat, on continu
à avoir des gens dans les associations sous payés. Parce-que
ça arrange tout le monde et si tout le monde boycottait ça,
peut-être que l'Etat se bougerait. Mais, comme personne ne se bouge, je
pense que j'ai ma place a avoir là-dedans et mon rôle à
jouer comme je le fais.
Jm : b...
H : Et j'estime que je n'ai pas en
deho... à l'encontre de mes convictions. Voilà. Parce-que c'est
bien là... si tu veux... dire que je ne peux pas me dire bon,
« ben je me lave les mains, ils font rien, donc je fais
rien ». Ils se lavent les mains et ben moi j'estime que je peux
faire quelque chose.
Jm : Parce-que l'Etat pourrait faire
quelque chose ? Pourrait effectuer le même travail ? Le
même ouvrage, on va dire ?
H : Oui.
Jm : Oui. C'est ton impression ?
H : A force d'assister les gens...
(silence) parmi les gens qui vous aident et tout. Il ne devrait plus y avoir de
bénévolat. Ca devrait être... ch'ai pas... (silence)...
Jm : ...naturel...
H : fui (pour dire oui). Presque.
Jm : Alors, pooour revenir un petit peu
sur le Club, recentrer un petit peu sur le Club. Le Compu's Club, pour toi,
c'est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, hein ?
H : (silence de réflexion)
Jm : Qu'est-ce que ça
représente pour toi aujourd'hui ?
H : (silence de réflexion)
pfou...
Jm : Qu'est-ce qui te plaît ?
Euh, quelles sont ses valeurs ? Qu'est-ce que tu lui attribues ?
Qu'est-ce que ça représente pour toi ?
H : Ben, les valeurs, j'en ai un peu
parler, là. Les valeurs d'écoute, de solidarité, de
transmettre des connaissances, d'échanger, d'accueil, deee... d'apport
de connaissances, oui... d'aide... deee... Mais...je connais pas assez, je
connais moins. Je, je...
Jm : Mais justement, avec ce que tu
connais simplement, qu'est-ce que... qu'est-ce que ça
représente le Compu's Club ?
H : (court silence de réflexion)
Moi, c'est un groupe de personnes qui est prêt à accueillir
d'autres personnes, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils soient,
voilà. Avec, quand même en contrepartie un... C'est comme un
engagement. Tu, tu viens dans l'association, mais...'fin... tu dois faire
ça, quoi, `fin... euh... Même si vraiment je sais que je me sens
très libre, mais c'est... euh... enfin... euh...
Jm : il y a une certaine
mutualité...
H : Voilà, une certaine
mutualité !
Jm : ...informelle...
H : Ouais, ouais !
Jm : ... Est-ce qu'elle est
formulée cette mutualité où est-ce qu'elle vient
naturellement dans les rapports ?
H : (silence de réflexion)
Euhhhhh... Pour moi c'est naturel. Euhhhh... j'sais pas si je peux dire toi ou
le contact ?
Jm : Au sein du Club, les membres, tu,
tu vois... Tu as dû t'apercevoir de certaines choses. Est-ce que cette
mutualité t'as paru naturelle ou est-ce qu...
H : Ben moi je trouve que c'est
très naturel... Mais bon c'est... bon... tu, tu le dis toi aussi. Hein,
euh...Bon, il y a une association, mais, bon... pas en contrepartie mais
presque, bon... euh... tu demandes aussi de faire quelqu...
Jm : ...L'échange...
H : Voilà, l'échange.
Jm : Alors, si tu devais définir
le Compu's Club, tu le définirais comment ?
H : (long silence) Eh ben,
écouteeee. pfu. Ce serait difficile.
Jm : Est-ce que tu peux alors me donner
deux trois expressions qui permettraient de le décrire ?
H : (long silence puis sans
hésitation dans le ton) Groupe ouvert, (silence), ouverture,
transmission, (silence puis sur une intonation plus basse pendant la
réflexion) ouverture, transmission (nouveau silence),
mutualité.
Jm : Alors, si tu devais... euh...
convaincre quelqu'un de rejoindre le Compu's Club, de quelle manière tu
présenterais le Club ?
H : Alors, ça m'est arrivé
(sourire dans le souffle en prononçant).
Jm : Ouais, forcément, mais pas
de convaincre quelqu'un qui aurait entendu parler du Compu's Club...
H : Voilà, ça m'est
arrivé pour quelqu'un qui cherchait des formations en informatique.
Donc, moi j'ai beaucoup parlé du Compu's en disant que outre
l'informatique il y avait un accès à Internet, y avait un
accès à... faire passer... euh... des connaissances, en recevoir,
ne serait-ce que par le petit livret... euh... qu'i y avait... euh... beaucoup
de, de choses à en tirer... hummm.... Le prix de l'adhésion
rebute un peu les gens... (200F, ndlr) Euh... Il faut le dire, hein, parce-que
ça compte... eeeeet le prix des formations je suis pas très au
courant et je sais pas si les gens ont pris contact mais c'est surtout dans le
cadre de l'informatique. (silence) Maintenant, aussi, j'ai pas pu, je n'ai pas
pu assurer aux gens si vous faites une formation au Compu's Club pour
l'informatique est-ce que vous aurez une attestation de stage... voilà,
ça je n'savais pas.
Jm : hum, donc, ça, c'est ce que
tu as déjà présenté à...
H : Voilà, simplement au niveau
informatique.
Jm : ...à l'occasion de... Alors,
aujourd'hui si on devait pousser un petit peu cette présentation, au
delà du niveau informatique, une copine que tu aimerais bien, par
exemple, avoir avec toi au Club, si tu devais y venir, euh...de quelle
manière tu arriverais à la convaincre ? Au delà de
l'informatique même, parce-qu'on a l'étiquette informatique donc
bien sûr 1) on parle de l'informatique, mais qu'est-ce que tu lui dirais
pour la convaincre de venir ? De quelle manière tu
présenterais le Club à ce moment ? Dans ces
circonstances-là ?
H : Oh la la. (silence de
réflexion) Je n'aurais pas trop de critères... à part si
elle avait des enfants parce-que je sais qu'y a une... une tranche d'âge
qui est fortement représentée dans le Compu's... et... j'ai
même essayé de pousser un peu ma fille à y aller pour
créer des contacts. Surtout pour créer des contacts. Qu'elle ait
d'autre liens que le collège.
Jm : Alors : tu lui as
présenté comment...
H : A ma fille ?
Jm : Oui.
H : Voilà, en lui disant qu'il y
avait des jeunes, qu'y avait Libertech. Je lui ai fait voir le petit
livre...euh... Elle connaît J. (le Président Junior Libertech).
Mais bon...euh... bon, elle est à l'âge où c'est
l'collège, elle avait peur, tout, bon. Et aussi elle a un emploi du
temps très chargé.
Jm : Alors, dans ta branche, qui est la
branche Littérature, projet Échap, ça marche
comment ?
H : Ça marche comment ? (par
répétition puis silence de réflexion) Alors... euh...
Jm : Est-ce qu'elle est
autonome ?
H : C'est une branche qui est
complètement autonome. On se voit régulièrement donc pour
ce livre.
Jm : Vous êtes combien ?
H : Nous sommes trois. (silence)
Jm : Depuis le début ?
H : Non. (silence)
Jm : Au début vous étiez
combien ?
H : Neuf. Nous sommes trois maintenant.
(rires parce-que j'ai fais un mouvement du bras invitant à
étayer). Non, c'est dur parce-que ça c'est un sujet qui nous...
qui prend...
Jm : Qu'est-ce qui s'est
passé ?
H : Alors voilà, je veux dire que
dans les associ... quand je parlais de lassitude des associations il y a ce
désistement. Et on le voit même dans une section d'une association
il y a désistements, il y a toujours des piliers. Et moi... le fait que,
ben les associations, je m'en retire un peu, parce-que... euh... j'ai tendance
à être le pilier et puis, bon, à plus de 50 ans, y a des
jeunes qui... Y a une association, là, euh... si, si... à
l'association, à la structure à l'Echap... euh... on dit pas une
structure... on dit leeee... ?
Jm : La branche, la section.
H : La branche Échap.
Échap, parce-qu'on veut s'échapper de ce carcan du chômage,
ça fonctionne à trois. On se... on s'est organisé, on a
essayé de prendre une aide mais ça n'a pas marché par un
écrivain. Donc, on fonctionne tous les trois avec
l'éééé... l'éditrice qui nous aide
bénévolement et qui nous transmet ses connaissances... pour le
style, la syntaxe et tout. On correspond par e-mail. et on fait un rapport au
Compu's Club en passant des articles... voilà. Il faut dire que le
Compu's Club nous sollicite quand même très
régulièrement. On se sent pas complètement
abandonné. Ce serait plutôt nous qui aurions tendance à
abandonner, `fin, à abandonner... à pas trop informer
parce-que... euh... on a nos vies, parce-que ça roule, on est autonome,
et voilà.
Jm : Alors, finalement qu'est-ce qui
c'est passé de passer de neuf membres à trois ? Les six
membres qui ont disparus, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils sont
toujours membres du Club ? Il ont disparu dans la nature ?
H : Alors, je sais pas.
Jm : Est-ce qu'ils ont retrouvé
un travail ? Il se sont mariés ? ils sont partis à
l'étranger ? euh...
H : Alors, nous avons essayé
d'avoir beaucoup de contacts puis on s'est lassé, aussi. Donc... euh...
eh ben... y en a qui cherchent encore, y en a on sait pas trop... euh... y en a
qui attendent, y en aaaa qui font des stages... euh... d'écriture...
à Paris parce-que c'est quand même bien mieux qu'à Valence,
évidemment. Et euh... voilà, donccc... on ne sait pas pourquoi
c'est...
Jm : A début, (pour insister) au
début de cette branche vous étiez neuf, comment ça se
passait au début ?
H : Au début, ça se
passait assez bien. Et puis après les caractères se
dévoilent un peu. Il s'agissait d'écrire, de lire nos
écrit et de... de les adapter, de les améliorer. et le fait du
terme de corriger a été très mal pris par certains.
« Je ne veux pas que mon texte soit corrigé, il n'a pas a
être corrigé ». C'est vrai que moi au bout de deux
ans de travail, avec mes deux collègues on se rend compte que...
(prenant l'air jovial) on a toujours besoin d'être corrigé, que
c'est jamais fini (gloussements) ! Depuis notre première mouture
ça fonctionne bien. On en est à notre troisième mouture et
on espère que ce sera la bonne. Donc ça fera cinq cents pages
écrites et je crois que... (silence). C'est pas un livre de cinq cents
pages hein, au bout du compte ça fera cinq cents pages. Attend c'est un
peu un troisième (inaudible) c'est pas... Et donc, ben les autres
personnes... une, s'était pas engagée. On savait pas trop
pourquoi elle était là. Une autre, ben, pique la colère
parce-qu'il y a des tempéraments un peu épineux. Puis, y a des
faits de vie qui ont fait queee, ben ça pouvait pas coller. Et je dois
dire que pour nous trois, il a été très difficile
d'arriver à fonctionner quand même. De par nos tempéraments
différents, nos objectifs et nos engagements personnels par rapport
à ce livre. On a tous le même engagement. Mais, moi, j'ai, moi
j'ai mes soucis de mère célibataire, de chômage. Un autre
à des soucis X. Et l'autre à des soucis Y. Et donc si on veut
faire passer ça en priorité dans le livre il faut qu'y ait une
cohérence. Maintenant ça va, au bout de presque deux ans on
arrive à bien fonctionner.
Jm : Ca fait presque deux ans que le
projet est lancé ?
H : En juin, ça fera deux ans.
Jm : En juin ça fera deux ans.
H : Et c'est pour ça que je me
dis « c'est dommage qu'on ne soit plus neuf. Mais d'un autre
côté ça aurait été très dur de se lire
neuf textes, en corriger neuf, avoir neuf idées. C'est ce qu'on se
disait encore hier.
Jm : Et là, y a longtemps que
vous êtes trois ?
H : Oui, y a longtemps, plus d'un an.
Jm : Plus d'un an que vous êtes
trois. Et les autres membres sont partis tous en même temps ou ils sont
partis...
H : Y en a un qui était malade,
malheureusement.
Jm : Y en a un qui est parti pour cause
de maladie...
H : (reprenant ensemble le dernier mot)
...de maladie. Un qui est parti parce-qu'il pensait avoir trouvé du
travail, ça n'a... du moins je ne pense pas que ça ait
marché. Un autre cherche toujours. Bon, et puis il était
très coléreux. Un autre... euh... pfou... je sais plus...
Jm : Tu disais tout à l'heure
« ça n'avait pas marché avec
l'écrivain ». Qu'est-ce qui s'est passé ?
H : Alors, euh... Cet écrivain,
au niveau de la communication, ça a mal fonctionné. Nous avons eu
foi... euh... dans, dans les dires de, d'un des membres du groupe qui... euh...
nous a dit que c'était quelqu'un fabuleux parce-qu'il avait l'amour du
livre et il en a écrit quarante, donc c'est un professionnel. Et
(silence) il s'est trouvé qu'on a payé grâce à des
sponsors. Et ce monsieur au bout de cent trente pages a tout barré. Il a
réduit les pages... sur cent trente deux pages. Et faisait fi de nos
phénomènes de vie qui pourtant sont le fondement du roman. Et au
niveau des faits historiques, puisque c'est un roman historique aussi sur
Valence, bon... il le négligeait... puis, on s'est rendu compte qu'il
n'avait pas lu la moitié de not'truc. Donc, il venait, on le payait pour
ses déplacements, on l'hébergeait, on le nourrissait et il nous a
demandé quarante mille francs de plus pour poursuivre la fin du livre
alors qu'il n'avait corrigé qu'un chapitre.
Jm : Et l'argent vous l'avez
trouvé où ?
H : Par les sponsors... euh...
Jm : Vous étiez
sponsorisés.
H : Voilà.
Jm : Qu'est-ce qui semble important dans
le bon fonctionnement de la branche ? De la branche Échap, de la
branche Littérature, du projet Echap ?
H : (silence de réflexion)
Jm : Pour qu'il y ait un bon
fonctionnement, qu'est-ce qui te paraît important dans...
H : Alors, là ça
fonctionne bien.
Jm : Quels sont les
éléments qui font que ça fonctionne bien ?
H : Eh ben... euh... y a eu
pareil : l'écoute, la tolérance et le fait de pouvoir se
dire les choses sans être blessé personnellement et... euh... se
remettre en question et pi ben voilà. Et pi, on a une base de travail
à laquelle on se tient. (Silence) On sait qui fait quoi. Chaque fois on
distribue : « toi tu fais ça, toi tu fais ça,
moi je fais ça ». Et chaque semaine on se redit :
« toi tu fais ça ». Tant pis hein, c'est
bien de dire au moins on sait où on va.
Jm : Et avant, avec l'ensemble des
membres, vous étiez neuf... euh... vous êtes restés presque
un an, puisque presque un an vous êtes restés à neuf, huit
ou sept, enfin quelque chose comme ça. Euh, qu'est-ce qui faisait que
ça a fonctionné...
H : On est resté sept mois,
sept-huit mois...
Jm : ...Huit mois...
H : ...à peine, à
peine...
Jm : ...Sept mois...
H : ...oui...
Jm : Alors qu'est-ce qui fait que
pendant sept mois, justement, euh... Ce sont les mêmes
éléments ? Et se sont ces éléments là
qui ont flanchés ?
H : Non, justement, nous n'avions...pas,
on ne savait pas qui c'est... qui faisait quoi. Le Leader, donc, notre
écrivain, était très fouillis. On ne connaissait pas son
objectif. C'était un coup oui, un coup non. Il était impalpable.
Euh... très... bon alors on va dire artiste, il paraît que c'est
une qualité mais quand on est engagé à vingt-cinq mille
francs comme ça, pour moi, c'est pas... une qualité. Et euh... et
pi c'était son truc quoi. Il voulait qu'on écrive comme il
voulait. Pas comme ça, bon, et... du coup on était un peu sous
cette coupe et on a essayé, on était deux surtout, hein, à
dire « ça va pas, y a quelque chose qui va
pas » et G. toujours « mais si... Tu sais
bien comment il est, il marche à l'affectif », bon. Et
donc il fallait bien que les rôles, distribuer les rôles et les
rôles n'étaient pas bien distribuées. Et à la fin,
à force de dire à l'écrivain « ce n'est pas
ça qu'on veut, on ne s'est pas engagé à ça, au
début c'est pas comme ça comme on avait dit » il a
compris, on a dit, on te veux plus. Quarante mille francs ou rien, on a dit
« c'est rien » (fermement). Et même on aurait pu
intenter un procès pour qu'il rende les vingt cinq mille francs.
H : Qu'est-ce qui vous a
empêché de le faire ?
H : G.
Jm : G., pourquoi a-t-il essayé
de...
H : ...Parce qu'il en avait marre des
procédures. Tu sais, euh... on n'est pas procéduriers. Et c'est
vrai, ça faisait encore à ... c'est lourd. Et nous on veux finir
notre livre.
Jm : Et au sein du Club, il y a
quelqu'un qui aurait pu vous conseiller, vous donner des idées ?
H : On n'a pas voulu le mêler
à tout ça. On voulait vraiment faire notre bouquin, continuer. On
s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? « On continu tout seul. Ca
on n'en veut pas ». Et je ne sais pas si quelqu'un vous a averti
au Club et donc on a dit à l'éditrice
« voilà, où on en est ». Elle nous a
dit « je vais vous aider ». Et là, c'est
pareil comment vous faites, comment on fait, parce-qu'il sont pas ici, hein.
Ben, ils se font pas payer les déplacements, on se partage les trajets,
ça marche très bien.
Jm : En ce qui concerne le Club, pour
essayer de recentrer sur le Club...
H : ... bien sûr...
Jm :... euhmm... Lorsque vous aviez ce
souci avec l'écrivain, euh, est-ce que le Club a été au
courant ?
H : Ah, moi je pense que j'en ai
informé... Je t'en ai informé.
Jm : Oui, donc le Club était au
courant. A ce moment-là, est-ce qu'une aide a été
proposée ?
H : Oui
Jm : Est-ce que
éventuellement... est-ce qu'on a respecté ce que vous aviez
décidé ?
H : Alors voilà, je sais que je
t'en avait informé donc j'en avait informé le Président,
hein. Et une aide a été proposée mais je... ça
été, ben, par respect pour notre... Nous on a dit
« on va pas aller plus loin », le Compu's a
respecté notre décision. (silence) Personnellement je le
regrette.
Jm : Qu'il y ait eu un respect de la
décision ?
H : Non, non.
Jm : ... ou que vous n'ayez pas
été plus loin.
H : Ouais (silence) parce-que ces
vingt-cinq mille francs nous rendraient service.
Jm : Alors, euhmm... Comment ça
c'est passé ensuite lorsqueee... une fois que votre projet a
été lancé, que vous vous étiez réunis
à neuf et maintenant à trois, comment ça c'est
passé dans l'organisation, euh... l'organisation pour la suite du
projet ? Vous étiez organisés comment ? Vous utilisiez
les locaux de l'association ? Vous faisiez les réunions entre
vous ? Il y a une régularité dans ces réunions ?
Vous procédiez comment ?
H : Alors, au départ quand on
était neuf puis après sept puis après... On était
au Compu's. Et puis, peu à peu, on s'est dit qu'il nous fallait
travailler le week-end pour avoir l'écrivain... euh... deux jours et
demi à l'affilé. On pouvait pas s'installer donc au Compu's, donc
on est allé chez quelqu'un... et... ce qui fait qu'on travaillait
journée continue. On a fait ça quatre, cinq week-end et, euh...
cinq week-end, je crois. Et après, vu que le groupe s'est un petit peu
dissous, ben, on fait ça, euh... une fois chez l'un, une fois chez
l'autre, une fois chez moi. Alors quand c'est en soirée à partir
de 17 heures c'est chez moi, jusqu'à 8 heures (20 heures, ndlr) comme
hier. Et quand c'est en matinée, comme le mercredi matin, c'est ou chez
M. ou chez G. Et là on travaille de 9 heures à 1 heure (13
heures, ndlr). On travaille donc, deux fois par semaine, six heures. Ca fait
six heures par semaine, quoi... ensemble. Plus le travail à la maison,
personnel.
Jm : Qui représente combien de
temps ?
H : A peu près cinq, six heures
par semaine.
Jm : Alors, qu'est-ce qui te
paraît déterminant dans la conduite du projet ?
H : Du livre ?
Jm : Oui, du livre ?
H : (long silence de réflexion et
raclement de gorge)
Jm : Quelque chose de
déterminant. Qu'est-ce qui détermine cette conduite-là du
livre ?
H : (silence + raclement) Ben
déjà y a... Nous, ce qui détermine c'est notre envie
commune d'aboutir. On a un objectif commun. Donc on passe outre des
invitations, outre nos petits tracas. Quoiqu'il y ait des temps de partage de
plus en plus. Et on arrive à passer outre beaucoup de choses pour
arriver à écrire ce bouquin.
Jm : Qu'est-ce qui te ferais quitter la
branche Littérature, le projet Échap ?
H : La fin du livre.
Jm : La fin du livre ?
H : hum !
Jm : Uniquement ? Alors c'est ce
qui te fait rester en fait, c'est le livre ?
H : Oui, oui, oui, vraiment là,
très honnêtement.
Jm : Là, tu as abordé
quelque chose de très intéressant. Ça serait bien qu'on
puisse l'affiner. Hum... Qu'est-ce qui se passe dans le groupe, là,
à trois, qui ne relève pas de... du livre... qui ne relève
pas de la branche ? Tu disais il y a un instant : « on
commence à se dévoiler » enfin je l'ai compris
comme ça...
H : ...Eh bien, euh... On prend toujours
cinq minutes... enfin, les filles surtout, on arrive toujours un peu à
l'avance et on a toujours cinq, dix minutes pour parler. Ou quand on va chez
l'un on se prend en voiture pour parler et puis on arrive, aussi, avec un petit
gâteau, une confiture. Quand on va dans le midi, on rapporte du miel
qu'on goûte ensemble. Pour Noël M. nous a fait à chacun un
cake. Bon c'est pas... et un pot de confiture... bon... et puis je trouvais...
et puis on arrive à parler... « voilà, j'arrive de
là, je suis fatigué ». Mais, on se donne quoi, dix
minutes. Mais ces dix minutes... bon le jour où le père de MA.
(la fille de H., ndlr) a téléphoné, ils arrivaient tous
les deux, j'étais en larmes... bon ben, on a pu en parler plus de dix
minutes mais on a quand même travaillé un petit peu. (silence)
C'est parce-que... heu... y a un milieu de confiance.
Jm : Qu'est-ce que tu
préfères dans cette branche ? Est-ce que tu as des moments
de préférences dans la branche ?
H : Échap ?
Jm : Oui, oui, Echap, toujours.
H : Des moments, c'est à
dire ?
Jm : Des moments de
préférence, c'est : est-ce que c'est justement ce moment
informel qui est en dehors du projet même ? Est-ce que c'est au
moment du projet ? au moment d'écrire, au moment
d'échanger ? Est-ce que c'est au moment de la relation avec la
maison d'édition ?
H : Non, voilà, moi ce qui, moi,
c'est quand on fonctionne tous les trois. Moi, personnellement, les moments
d'échanges, on peu se téléphoner, on peut se voir
ailleurs. Mais ce qui est très... Ce qui nous passionne c'est le moment
où on a écrit, où on réécrit pour affiner,
pour enrichir le vocabulaire, pour mettre la virgule là où il
faut, le point là où il faut. Euh... Un mot qui a vraiment tout
son sens, donner le verbe à un caractère d'un personnage. Chaque
personnage a son langage. On adapte le langage au caractère, à
une situation. On a fait un calendrier. Parce-que notre roman commence en
septembre et il se fini le 25, le 23 décembre. Il faut qu'on soit...
alors on a fait un calendrier ce jour-là (inaudible) les gens diront...
donc on est obligé de suivre tout ça. On est complètement
dans l'histoire. Et ça, on a écrit pour se libérer il y a
deux ans. On a réécrit. On a réécrit et là
on en est à... à jouer avec les mots, à les mettre en
forme, à ajuster... à...
Jm : C'est ça que tu
préfères ?
H : Ah, c'est ce que nous
(insistant sur le nous) préférons, maintenant. Grâce, et
mon avis c'est ça, grâce à P. et son ami PH (les
éditeurs, ndlr) ils nous apprennent ça... euh... c'est
génial. Alors P., on s'est vu deux fois, donc euh c'est pas beaucoup,
mais ça nous suffit puisque les méls marchent très bien
tandis que avec B. (l'écrivain) on a attendu trois mois pour rien, quoi.
Et elle dit « oh là, vous voyez, si vous devriez
mettre... » et PH qui dit, « non, non, laisse-les
trouver ». Donc, c'est des gens qui ne veulent pas faire notre
travail. Qui disent « vous pouvez ». Hein, et donc
« vous savez ». Et donc on le fait. Et puis
après ils sont content. Il nous disent pas tout à la fois. Chaque
fois ils nous disent des petites choses à améliorer. Heureusement
qu'ils nous ont pas dit tout la première fois, sinon on aurait
été... Et, et, ça c'est... on voit qu'on progresse... mais
alors... M qui... je sais pas si tu te souviens, elle n'aimait pas
écrire... c'est une merveille ce qu'elle écrit. Et moi je le vois
dans mon travail. je reprends tous les textes-là, tous les documents
qu'on fait, tu sais. Et j'écris, je reprends, ...
Jm : Oui, il y a quelque chose qui
change dans ton travail...
H : Ah oui, par rapport... ah
oui !
Jm : ...y a un changement que tu
ressens, que tu vois, constates ?
H : Oui, je ne lis plus de la même
façon, je n'écris plus de la même façon.
Jm : Est-ce que tu peux me donner un ou
deux exemples qui t'ont particulièrement marqué dans tes
relations avec les autres dans le cadre de la branche ? Positif ou
négatif, un ou deux exemples qui t'ont vraiment marqué ?
Ça peut être un conflit ou, comme tu viens d'en donner un
là, ta relation avec l'éditrice, est-ce que tu as un autre
exemple ?
H : Eh bien... euh... les gens
qui...euh... moi ce qui m'a quand même touché, c'est ces gens qui
soi-disant s'engagent, qui ont beaucoup de parole, beaucoup de bagou. Et...
euh... quand ils ont peu ou pas d'intérêt s'en vont.
Jm : Ça, ça t'as
marqué ça ?
H : Ouais... euh... je pense notamment
à une personne qui a beaucoup critiqué... euh... qui disait
s'engager lui-même, qui a été la première
à...
Jm : Alors, une fois que le livre sera
terminé, tu quitteras l'association. C'est ce qu'il faut en retenir,
hein ?...
H : ...Oui...
Jm : Qu'est-ce que, au sein de
l'association, qu'est-ce que tu connais qui pourrait susciter ton
intérêt ? Ou quelles sont les valeurs que tu attribues
à l'association qui pourraient te permettre de te
réinsérer dans l'association à un autre niveau ?
Peut-être en rapprochant le livre par un atelier d'écriture, par
exemple. Ou dans un autre domaine, que tu pourrais créer,
éventuellement.
H : Moi, l'association... c'est
sûr, je pense pas y rester après le livre, j'ai... mon souhait ce
serait... se sera, c'est ce qui se fera : si je passe avenue Victor Hugo,
je sais que je peux taper, dire « bon bé ça va, je
viens boire un café, tout va bien ». Et si on m'appelle,
« tiens, on a besoin de trois interventions »
parce-que j'ai pas envie de venir et de m'y nourrir, quoi qu'on se nourrisse
toujours. Mais j'ai envie d'y apporter des choses pour transmettre. S'il y a un
atelier d'écriture dont je peux être responsable, avec des jeunes
par exemple. C'est mon grand truc. Je voudrais bien être responsable...
euh... mais aller y chercher l'enseignement d'informatique ou quoi, bon... je
sais que j'appelle un collègue du Compu's, il viendra me dépanner
mon truc, et puis... euh...
Jm : C'est pas ton dada
l'informatique...
H : C'est pas mon dada, tu as bien
dû le comprendre. Mais... euh... voilà... quoi... enfin... je
pense que je quitterai... euh... enfin quitter... non, on ne quitte pas... mais
ce sera pas... ceci dit... tchao (en tapant dans les mains), je, je... Moi, si
le Président m'appelle...euh... ben... d'ailleurs je suis pas trop
association mais si on déménage je viens, si on aménage je
viens mais si y'a dix personnes je peux rien faire. Mais, bon, je, je viens
comme je peux. Voilà. Mais je peux pas m'engager dans l'association en
tant que membre... Maintenant si je prends l'engagement de venir, là je
suis engagée. Comme à Remaid, je suis engagée. (silence)
J'ai eu des missions... voilà, après je sais pas ce que j'y
ferai, mais, voilà.
Jm : Alors aujourd'hui, tu participes
depuis deux ans à Échap, au projet Échap, hein c'est
ça à peu près ? Euh... quels ont été
les moments forts ? Et qu'est-ce que tu en retiens, aujourd'hui, de ces
moments forts ?
H : Depuis que je suis à
Échap ?
Jm : Oui, oui. Depuis deux ans ?
H : Depuis que je suis au
Compu's ?
Jm : Au Compu's, à Échap
puisque tu es peu présente au Compu's. Ou éventuellement au
Compu's aussi, tu as peut-être des moments forts au Compu's
Club ?
H : Ouais, moi ce que je trouve comme
moment fort c'est au moment où on cherchait des sponsors. J'trouvais que
il y avait des gens... euh... Moi ne n'imaginais pas tout ce
phénomène qu'il fallait de l'argent (inaudible), j'étais
loin de tout ça. Pour moi il fallait écrire et puis
c'était tout. C'était pas si compliqué que ça. Et
ces gens qui se mobilisaient pour les sponsors (bafouillage sur le mot
sponsors). Je revois encore la photo, j'ai encore rangé, j'ai trouver
une photo où il y a MA (un sponsor). Il est en photo qui donne un
chèque à G. au Compu's. Bon, et je me dis tiens c'est pas par
hasard si je trouve cette photo aujourd'hui, j'ai trouvé que
c'était un moment très fort. Des gens qui nous connaissent pas,
qui nous font confiance et qui donnent du fric pour... parce-qu'on a
été assez convaincant et puis il nous sentent motivé, et
puis ils y croient... euh... c'est pas une histoire de les décevoir ou
pas. Comme ça, on sait pas...iii... des gens qui, qui... qui oeuvrent
avec nous, quoi. Et qu'elles n'attendent pas des... parce-qu'on va pas faire
une pub du CM (sponsor) à fait ça ou MA ou ch'ai pas quoi, hein,
moi c'est. C'est... presque... c'est anonyme pratiquement les sponsors.
Jm : Alors, qu'est-ce qui a fait,
justement, que les sponsors aient perçues une motivation chez
vous ?
H : (silence de réflexion) C'est
pas moi qui ai présenté les, les projets... enfin j'étais
présente mais j'ai pas...
Jm : Il y a les projets mais il y a les
gens aussi ?
H : Ben, il y a les gens. Je pense que
la crédibilité venait beaucoup d'un personne qui connaissait bien
le CM. Et... euh... qui avait donc fait des preuves qui... pas des preuves
à faire mais qui... très crédible. Et puis... de, deee
l'engouement de G. et puis de notre présence. On a toujours
été quand même très présent. On n'a jamais
failli... euh... à une rencontre, à un coup de fil, à un
rendez-vous, pour travailler, enfin... les week-end, le soir, enfin je veux
dire on n'a jamais failli à rien. Je sais pas, on a dû être
convaincant quoi, not' projet a plu, quoi. L'histoire de Valence, le
chômage en parallèle. Bon, avec des intrigues, tout ça,
ça a plu.
Jm : Qu'est-ce que tu retiens deeee ta
participation à ce projet ? Qu'est-ce que ça t'as
apporté ?
H : Moi, ça m'a apporté...
euh... comment dire... (dit d'un seul trait) ça m'a apporté
à me libérer dans un premier temps de tout mon fiel... par
rapport à ma situation de chômage mêlée à la
situation de longue maladie et mêlée à la situation de
mère célibataire, ce qu'est pas très engagé
à 50 ans, engageant pour être embauchée. (fraction de
seconde de réflexion puis avec un débit moins rapide) Trois
surtout, difficile... Alors... j'ai écris, j'ai écris, j `ai
écris. On a toujours gardé des petites parties de ce qu'on a
écrit y a deux ans. J'ai tout gardé, même si ça ne
sert pas. Mais je me rends compte que au bout de deux ans, et c'est pas le fait
d'avoir retrouvé du travail depuis 3 mois, c'est pas ça du tout,
mais j'ai pris beaucoup de recul par rapport à mon vécu et...
j'écris mieux dans le sens plus juste parce-que je suis
dépassionné. J'ai vidé l'abcès. Y a des cicatrices,
mais le fait d'être dépassionné fait que j'emploie le mot
juste. C'est plus raisonnable. Et... euh... ça dédramatise un
peu, quand même, ma situation. Je dis pas que ça
dédramatise le chômage, mais ma situation. En fait j'ai
trouvé, aussi, quand même, pendant ces mois où j'ai
retrouvé du travail, un grand stimulant pour me préparer le
matin... euh... tout ce qu'un chômeur a du mal à faire. Avoir un
but, un projet, voir des gens, être utile, euh, qu'on nous fasse
confiance, euh... retrouver des habitudes d'écritures, que je sois
lue... pas édité mais lue par les copains, euh... Et que ce soit
pris en compte.
Jm : Bon, ben, euh, si je devais
résumer il te fallait en quelque sorte passer par là, par cette
évacuation...
H : ...Ouais...
Jm : Pour pouvoir, en fait... euh...
Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait un lien entre cette évacuation et
le fait de pouvoir retrouver un travail dans lequel on est bien ? Et on se
retrouve ?
H : Alors, je pense que le lien est
continu, hein. Le lien pour moi, il est jamais complètement
coupé. Il y a ce travail d'évacuer, donc après un travail
de deuil ettttt..., c'est à la mode mais c'est vrai, et... euh...
maintenant j'emploie le mot juste et je... en, en fait... c'est, j'ai
l'impression de, de trouver ma place mais pas que dans le travail ici, de
longtemps hein ? La place d'H. et je peux dire les choses. C'est oui,
c'est oui, c'est non, c'est non, mais je dis les choses... euh... j'arrive
à trouver ce qui ne va pas. Et je pense que le fait de trouver le mot
juste c'est aussi trouver un peu sa place. Quand on sait trouver le mot juste
et qu'on se laisse accompagner pour trouver ce mot juste, hein, bon, je n'ai
pas la science infuse. Je pense qu'après, moi, toute seule, j'arrive
à trouver ma place. Et je la cherche encore, enfin, j'essaie toujours de
l'améliorer, hein, de, de...
Jm : Si je devais reformuler, il y
aurait eu deux changements en participant à ce projet : c'est d'une
part, un changement professionnel et un changement personnel ?
H : Oui, d'abord personnel.
Jm : D'abord personnel. Comment tu
l'expliques ce changement ?
H : Eh ben je pense que le fait d'avoir
trouver des gens qui m'ont, qui ont un peu un vécu similaire ça
aide un peu. Similaire des fois plus difficile... enfin... quoique la douleur
n'est jamais à mesure égale pour chacun... et... euh... je, je
pense que... ça fait du bien de partager un peu tout ça.
Jm : Quand tu viens ?
H : Oui, je me souviens plus... euh...
je pensais à des situations qu'on vit dans l'amour.
Jm : Justement, quand tu viens... quand
tu vas... quand vous vous réunissez tous les trois, dans quel
état d'esprit tu te trouves, comment tu te sens ?
H : Alors... euh... aujourd'hui,
là, aujourd'hui ?
Jm : Aujourd'hui, oui.
H : Euphorique. On languis... euh... on
languis. Hier soir on ce serait plus quitté parce-que c'était,
woua, on était jusqu'à 8 heures mais alors. Là, MA (la
fille de H. 14 ans) a commencé à manger toute seule. Mais
c'était l'euphorie et tout de suite il faut que j'écrive. Mais il
y a eu des moments... où...euh... deux fois j'ai... `fin... chez G. Je
l'ai soutenu, une fois c'était M. Un fois ça a été
G il a fallu aller le voir, on s'envoie des fax, on se téléphone.
Je crois qu'on a tous des moments... euuuh... Voilà quoi. Mais là
en ce moment c'est l'euphorie. On pense qu'en mars ce sera fini
d'écrire. (en riant) Pour la troisième fois.
Jm : Selon toi et au delà du fait
que tu n'as pas d'affinité au niveau de l'informatique... euh... quels
seraient les autres obstacles pour une participation plus importante au
Club ?
H : Le temps.
Jm : Le temps ?
H : (silence de réflexion) Le
temps.
Jm : Principalement le temps ?
H : Oui parce-queee travailler à
35 heureeees, enfants, petits enfants et Remaid. (Silence) qui a un gros gros
travail de bénévolat.
Jm : Alors, le temps justement que tu
dégages pour toutes ces associations, tu t'y prends comment ?
Comment arrives-tu à organiser ta vie de femme, ta vie de travailleuse,
ta vie de bénévole, ta vie de mère, de
grand-mère.
H : (rires) J'y arrive (rires).
Jm : On constate que tu y arrives.
H : On constate qu'on y arrive. Euh...
c'est vrai que l'écriture m'a toujours, j'ai toujours donné du
temps pour l'écriture. J'ai toujours, toujours écrit. Même
avant le roman. Bon là ça se met en forme tant mieux. Mais, c'est
vrai que c'est de 17 heures à 18 heures, euh, à 20 heures, 19
heures 30 - 20 heures. Voilà c'est comme ça une fois par semaine.
J'ai dit aussi que le mercredi, la demi-journée que j'avais de libre, de
temps en temps je voulais pas écrire, donc ils ont accepté. Donc,
des fois j'ai mon mercredi matin. J'sais plus quoi faire (rires). Mais je vais
quand même pas donner tout ce temps. A Remaid pareil. J'essaie de me
préserver.
Jm : Tu as retrouvé du travail
depuis...
H : ...trois mois...
Jm : depuis trois mois. Comment
ça a été perçu au sein du groupe
Échap ?
H : Très bien.
Jm : Très bien ?
H : Oui.
Jm : C'était encourageant ?
Il n'y a pas eu des moments où ils ont supputé l'idée que
tu aurais pu être moins disponible ?
H : Si.
Jm : Si ? Bon, ça a
été rassurant ?
H : Oui, parce-que, c'est... (raclement
de gorge)... ah oui ("ah oui" parce-que j'ai incité au
développement avec la main)... Alors oui, oui, oui, ça a
été bien pris avec une inquiétude... euh, euh, pour ma
disponibilité en me disant « tu sais, si tu veux tu viens
plus, gnagna » pas question, pas question, donc... euuuh...
voilà, maintenant.
Retournement de K7 = ¾ d'heure.
C'est bon ? Oui, euh... (pour reprendre le fil
après le retournement de la K7) Il y a une des personnes (du groupe
Échap) qui vient de trouver un mi-temps depuis hier, il commence la
semaine prochaine. Et c'est vrai que j'ai eu quelques petites allusions :
« t'as pas beaucoup écrit... lala... ». Et
j'ai dit « ben, écoute, là tu vas voir, hein, ce
que c'est que de tout concilier », j'ai dis « t'as
pas d'enfant, t'as pas de maison à tenir... euh... »
malheureusement, bref. Mmais... euh... ça se passe très bien.
Mais il y en a une autre qui risque de trouver du travail à la fin du
mois (rire). Donc, là on a dit qu'on prendrait nos week-end. Mais bon
les week-end, ça va êtreeeee. On a déjà posé
un week-, au moins un samedi.
Jm : Elle vient d'où cette...
H : ...cette énergie...
Jm : ...cette volonté...
H : ...on a une rage...
Jm : ...d'absolument vouloir faire ce
livre ?...
H : Oui, oui, oui, vraiment. Parce-qu'on
a des choses à dire. Et pi' c'est passionnant d'apprendre à
écrire.
Jm : D'une manière... On arrive
au terme de notre interview, là. D'une manière plus globale,
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le Compu's Club ?
D'après toi ?
H : (long silence de réflexion)
Elargir les compétences. Je te l'ai dit au début, pour moi c'est
restreint à l'informatique. Compu's c'est l'informatique.
Jm : C'est l'étiquette qu'il y
a ?
H : Ah ben, pour moi.
Jm : C'est ça. Est-ce qu'il
apparaît autre chose que cette étiquette d'informatique ?
H : Les jeunes, informatique. Les
jeunes, mais c'est aussi l'informatique, les jeunes.
Jm : Très bien, est-ce que tu
connais les diverses branches de l'association ?
H : Oui, J'en connais : la
Littérature... euh... le livreee... le, le... euh... leeeee (silence) le
journal là. Vous allez pas faire un journal ?
Jm : Huuum, le Bulletin Membre.
H : Le Bulletin Meeembreee... euh...
les financeees, voilààà, et puis ben eeeeuh...
Jm : Faire des cartes de visites.
H : Oh ben, ça c'est
l'informatique.
Jm : Ça c'est informatique.
H : Ben oui !
Jm : Exact. Le Centre de formation.
H : Le Centre de formation, chee,
moaaa... je le connais pas.
Jm : Et le futur atelier Presse.
H : Oui pour faire le journal, c'est
ça. Pour faire un journal.
Jm : Euh... un journal
multimédia...
H : ...Voilà...
Jm : ...mais aussi préparer
àààà euh... préparer au métier de
journalisme.
H : Comme on fait ici ?
Jm : Comme vous faites ici.
H : Voilà. Et euh... au niveau de
la formation comment ça se passe ? Maintenant c'est à moi de
poser les questions.
Jm : Ça, c'est autre chose...
Annexe 8 Troisième
entretien
S (Troisième entretien) 19h40 le 3
février 2001
A notre domicile.
Le Vice-président au moment de l'entretien, maintenant
le nouveau Président : actuellement au travail et a toujours
été au travail (chef de chantier Travaux Publics). 28 ans. Veut
créer son entreprise. Adhérent depuis deux ans et demie. Ne
participe pas à une branche.
Après annonce.
Jm : Comment as-tu connu le Compu's
Club ?
S : J'habitais à proximité,
euh, je me suis renseigné, je cherchais un club qui soit plus sur
l'informatique, en fait, et... parce-que j'avais besoin de monter mon
ordinateur et d'abord par intérêt, je cherchais quelque chose.
Jm : Qui t'as fait connaître le
Club ?
S : Personne, par hasard.
Jm : Par hasard ? En passant dans
la rue ?
S : En passant dans la rue.
Jm : Très bien, donc personne
t'en a parlé avant, tu es entré... dans le Compu's Club... Tu te
souviens, à l'époque comment tu l'as découvert ?
Comment tu as appris ce que c'était ? Qui te l'as
présenté ? Dans quelles circonstances tu l'as
découvert ?
S : Oui, oui, très bien, en fait,
parce-que c'est pas tout à fait par hasard. Etant donné que je
cherchais des composants informatiques donc je me suis renseigné
à la boutique limitrophe, euh, sans faire de pub c'est R (notre bailleur
de l'époque) et il m'a orienté donc, euh, parce-que, eux ne
pouvaient pas monter l'ordinateur, ils avaient arrêté l'assemblage
et ils m'ont orienté vers le club informatique en disant qu'ils allaient
certainement me dépanner, ce qui a été le cas.
Jm : Donc c'est une entreprise, une
sociét...
S : ...privée, ouais...
Jm : Qui t'as dit...
S : ...qui m'a dit, oui...
Jm : ...tiens voilà une
association qui peut éventuellement te solutionner, un club informatique
qui peut éventuellement te solutionner...
S : ...exactement...
Jm : Tu n'as pas vu de dépliant,
de publicité de l'association, en fait ?
S : Jamais.
Jm : Jamais. Alors, as-tu
déjà eu une expérience de l'associatif ?
S : hummm, jamais non plus. M'enfin, à
part, euh, les associations types sportives genre UNSS et j'en passe et des
meilleures. Mais plutôt dans ma jeune époque.
Jm : Tu en avait été
satisfait ? Tu étais simple consommateur ? Tu payais une
adhésion et tu jouais... tu faisais un sport ?
S : Oui, oui, ch'uis jamais rentré
dans l'encadrement de, de, d'une association. J'ai jamais été
encadrer les jeunes plus tard. J'étais, j'étais simplement
adhérent, je bénéficiais, en fait, de, des
activités des associations.
Jm : Depuis ton adhésion au Club
tu participes à une autre association ?
S : Pas du tout.
Jm : Finalement, qu'est-ce qui t'as
conduit à adhérer au Club ? Est-ce que tu es venu le
visiter ? Hein, la société t'as indiqué
l'association, tu es venu, on a dû te présenter le Club. Qu'est-ce
qui t'as fait adhérer, finalement ?
S : Bé, y a pas cinquante solutions,
c'est... c'est surtout (silence)
Jm : ...Qu'est-ce que tu es venu y
chercher ?
S : De l'aide.
Jm : De l'aide...
S : ...De l'aide...
Jm : ...en informatique ?
S : De l'aide en informatique, oui puis bon
en sachant que c'était pas... j'avais aussi des choses à faire
connaître... euh, y avait pas mal de gens... y a, y avait des personnes
d'horizons diverses qui pouvaient dépanner le jour même mais en
sachant que, bon, j'arriverai toujours à trouver solution à mon
problème beaucoup plus tard si j'en avais eu d'autres. Donc, c'est,
c'est... l'association c'est un petit peu basé sur un coup j't'aide, un
coup je, un coup tu m'aides et puis, bon, et c'est très bien comme
ça.
Jm : Pour résumer, c'était
l'espérance d'une aide qui a déterminé ta décision
d'adhérer au Club ?
S : Oui, c'est ça. On peut parler
comme ça, ouais.
Jm : Quels intérêts, autres
que cette aide à l'informatique, tu as, à l'époque hein,
tu espérais trouver ? Au Club.
S : L'informatique, et puis bon on peut pas
parler d'aide, mais, on peut dire, peut-être une camaraderie avec des
gens qui partagent la même passion surtout. Donc, euh... ça peut
être de la camaraderie, après ça peut se transformer en
sortie autres qu'association. `Fin, au travers l'association, ça peut
faire des restaurant, ça peut faire... on peut trouver des
affinités avec les gens. C'est pas... c'est pas peine perdue de se
déplacer vers une association. On trouve toujours son compte, en
fait.
Jm : Bien, est-ce que tu peux me parler
de toi à l'époque de ta venue au Club ? Euh, quelle
était ta situation familiale, à l'époque ?
S : Alors, j'étaisssss...
Jm : Tu étais
marié ?
S : Non, j'étais pas marié, je
vivais en concubinage avec une, une demoiselle... une jeune fille. Et donc,
euh, bon ben, ma vie se résumée à 39 heures par semaine,
mon travail et puis, bon après je partageais mes loisirs entre, entre ma
vie conjugale, donc, et... l'association. En sachant que j'pouvais pas non plus
mettre l'essentiel de mon temps libre à l'association. Je l'aurais bien
fait, volontiers. Parce-que, bon, c'est une passion qui me tiens depuis bien
longtemps et... je voulais... bon enfin... il faut arriver à faire le
tri, quoi.
Jm : Tu as toujours travaillé
depuis que tu es à l'association ? Quand tu es entré, tu
avais un travail ?
S : Oui
Jm : Depuis le temps que tu y es...
Ça fait combien de temps que tu y es ?
S : Ça fait deux ans, deux ans
passés. Et tout ce temps j'ai toujours été
salarié.
Jm : Le même travail, tu n'as pas
changé ?
S : Non, non, j'ai jamais changé de
métier.
Jm : Tes parents, euh...
étaient-ils engagé dans la vie associative, la vie publique
déjà ?
S : Ouh là ! Depuis, depuis
très longtemps ils sont engagés dans la vie associative
étant donné que c'est des pétanquistes, comme on dit.
Donc, euh, eux naviguent beaucoup dans, dans les associations. Mais en plus,
euh, pas en tant qu'adhérents ou sociétaires dans un club
bouliste mais surtout en tant que dirigeant. Etant donné que mon
père est Trésorier d'une association.
Jm : De pétanque ?
S : De pétanque. Ma mère
s'occupe de la comptabilité de par le fait que mon père est
Trésorier, parce-que, donc ma mère lui donne un petit coup de
main, s'occupe d'organiser les repas, euh, les rencontres, bon ben
d'échafauder des, des, des petits challenges, des petits tournois.
Jm : Dans la vie publique, ils sont
investis ? Est-ce qu'ils font des, est-ce qu'ils sont adhérents
politiques, euh, ils participent à la Ville ? Euh...
S : Pas du tout. En tant que fonctionnaire,
bon ben, ils sont, ils sont syndiqués comme tout le monde, hein. Comme
chaque fonctionnaire qui, qui se respecte. Pour être
protégé vis-à-vis donc, euh, donc des lois, bon, euh... ce
qui se passe c'est queee, i sont pas, euh, pas politisés, euh, au point
de...
Jm : Ils sont investis dans la vie
publique ?
S : Voilà, mais, euh, sans non plu,
sans trop de virulence quoi. Ils vont pas battre le pavé tous les
jours.
Jm : Alors aujourd'hui, aujourd'hui,
euh, c'est quoi pour toi le Compu's Club, aujourd'hui ?
S : (Silence de réflexion) Pour moi le
Compu's Club, au départ le Compu's Club c'était, euh, au
départ, c'était un petit noyau de gens, euh, plu... très
intéressant on peut dire. Parce-que c'est un petit peu le noyau dur
de, du, du Club. C'est ces gens-là qui m'ont, qui m'ont
motivé, qui ont fait que je suis resté. Si j'avais pas
trouvé des gens qui, qui étaient suffisamment intéressant
et pi, bon ben, c'est toujours pareil, quand, quand on arrive pas à se
caler sur les conversations, à comprendre, euh, à comprendre les
gens... bon ben on arrête un petit peu de venir, on, on espace un peu les
visites. Mais apparemment, là j'ai trouvé mon compte et les gens,
les gens ont été super gentils avec moi. J'ai eu un accueil, on
ne peut mieux... enfin c'était plus que correct et c'est ce qui a fait
que je me sentais à l'aise pour venir et puis moi j'y venais plus
souvent.
Jm : Tu disais « des gens
très intéressants », tu entends quoi par
là ?
S : Eh bé des gens quiiii, qui ont des
connaissances, des gens qui sont agréables à vivre, des gens
qu'on voit en dehors de leur cadre professionnel, donc, euh... qui ont plus la
contrainte, euh, euh, de rentabilité ou quoi que ce soit, enfin les
contraintes qu'ils ont professionnellement parlant. Donc, euh,
forcément, on retrouve... on a une autre face des gens et, et, on a...
on a presque que le meilleur des gens. Donc, euh, euh, c'est... on n'a pas de
mal à s'entendre dans ce cadre-là.
Jm : Tu
disais « agréables à vivre » tu peux me
donner un ou deux exemples qui te font dire que ce sont des gens
agréables à vivre ? Est-ce que tu as à l'esprit un ou
deux exemples ?
S : Eh ben, déjà, le, la
tolérance dont ils font preuve avec les jeunes... pourtant ils sont, ils
sont quand même un peu exubérants les jeunes. Bon, ben y en a
jamais un qui a levé la voix, euh, parce-que avant tout c'est des
pères de famille, la plupart, bon, euh, il se trouve qu'on a un public
jeune, ben on fait avec, on essaye de comprendre. Alors que, peut-être
que chez soi ça se passe différemment parce-qu'on sait que c'est,
enfin, eux savent que c'est leurs enfants ; donc ils serrent un peu plus
la vis. Moi, au niveau de l'association, on laisse un petit peu libre court
à l'imagination et à l'exubérance parce-que on, on se dit
que ça va sortir, ça va faire que les jeunes se, se
libèrent un peu et pi, euh... et pi p'têt que... je sais pas
moi... ça les... pour ceux qui sont un peu exubérants on essaye
de, de temporiser ; pour ceux qui le sont moins, on essaye, on essaye
plutôt de les faire se trouver au niveau de l'association et de les, de
leur enlever un petit peu la... comment dire ? ...la, la timidité
peut être qu'ils peuvent avoir. Et pi c'est pareil pour les personnes
adultes qui se confient pas trop au sein de leur famille et qui sont
plutôt solitaire... et ben on arrive à...
Jm : C'est un élément
important pour toi que de, que de suivre les jeunes ? Que d'être
près d'eux ? Que de les guider ?
S : Ah oui, certainement, oui. C'est presque
même une, euh...
Jm : Est-ce que c'est le rôle de
l'association ?
S : Ah logiquement oui. Moi je pense que
l'association est un palliatif à, à... pas un palliatif,
excusez-moi, un complément à l'éducation scolaire
parce-que l'éducation scolaire est quand même limitée donc,
euh... On peut dire que, euh... quand on a fait huit heures d'école on
peut... en s'amusant on peut apprendre d'autres choses et pi apprendre des
principes de vie, euh, d'autres personnes.
Jm : Pour toi aujourd'hui le Club
ça représente quoi ?
S : Le Club, pour moi, c'est... comment
dire ? C'est, c'est pas un petit bout de ma famille, j'irai pas
jusqu'à dire ça mais, euh, je dirais plutôt que c'est...
euh... ça m'fait pas penser à mes clubs de gym de l'école
mais plutôt à un groupe de camarades, une micro
société en fait dans, dans la vie actuelle en fait. C'est en
marge.
Jm : Qu'est-ce qui te plaît dans
le Club ?
S : Ce qui me plaît dans le Club, c'est
justement, c'est ça en fait. C'est d'être en dehors des principes
de vie qu'on a d'habitude.
Jm : Alors, comment définis-tu le
Club ? Si tu devais le définir, tu le définirais
comment ?
S : Définir le club (silence)
Jm : Est-ce que tu peux me donner deux,
trois expressions pour décrire le Club ?
S : Alors, deux, trois expressions pour
décrire le Club... (silence) Je dirai déjà 1) les
Clubistes (rire) dû à notre mascotte, donc, euh, du Club.
Jm : Il y a une mascotte au Club.
S : Voilà il y a une mascotte, c'est
une petit peluche. Et donc, on l'a baptisé Cluby eeet les gens qui se
rallient au mouvement de la, donc de la société en fait, c'est
des Clubistes et, euh, chaque fois qu'on a besoin d'un Clubiste, normalement il
est là. On a qu'à sonner sur Cluby et, donc un Clubiste arrive.
Pour moi l'association, c'est ça, c'est en fait, c'est, euh, c'est le
dépannage, c'est l'entraide immédiate... il y a toujours
quelqu'un à l'écoute... euh... quand on a besoin d'un coup de
main, que se soit en dehors de l'association ou pas il y a toujours quelqu'un
à l'écoute, que se soit pour écouter ou pour faire, hein
et euh... ça peut être très divers, c'est pas... c'est...
on est tous relié autour d'une passion mais ça se limite pas
à la passion. Y a pas que l'informatique dans la vie. Donc, euh les
gens... euh.. i... y en a certain qui sont doués en informatique,
d'autres pas. Mais ils trouvent quand même leur compte ce qui fait qu'ils
reviennent. Que se soit pour autre chose ou... donc euh... moi, l'association,
pour moi je, je... je pourrais pas dire... on peut pas dire que c'est un m...
c'est presque un monde parfait en fait parce-que y a pas, y a pas de contrainte
et pi quand on n'a pas envie de faire quelque chose on le fait pas. Personne
impose sa volonté, bon, on a quand même des dirigeants mais...
euh... c'est la liberté.
...
Jm : Bon, ça c'est ce que peux
trouver un Membre Clubiste. C'est ce que peut trouver un Clubiste au Compu's
Club. Toi-même, tu peux trouver aussi ce genre de chose, euh, qu'est-ce
que tu y apportes ? Euh... au Compu's Club ?
S : Ah ben... moi, j'apporte... j'apporte...
déjà mes connaissances, bon sans être non plus
prétentieux, euh, j'apporte, bon... je peux aider les gens qui, qui sont
novices en la matière... je leur donne un coup de main. Je peux apporter
du réconfort quand une personne est pas bien et qu'elle cherche un
refuge pour... pour être un peu tranquille parce qu'elle a... elle a
subit une mauvaise journée. Donc on, on... les gens i se libèrent
un peu plus parce-qu'ils savent qu'ils sont dans une association... ça
a... ça a pas de... ça a pas de conséquence donc leur
conversation ils se livrent beaucoup plus. Donc on discute avec eux, on parle
de leurs problèmes. Bon y a ça.
Jm : Des problèmes directement
liés à l'informatique ?
S : Non, non, non. Il y a des
problèmes autres que l'informatique, bien sûr parce-que bon... on
a pas mal de gens sans emploi. Donc, on peut dire queee ces gens-là ont
encore d'autant plus besoin de réconfort parce-que c'est quand
même dur d'assumer une vie que... familiale et sociale sans travail
parce-que bon... arriver à trouver une identité dans la
société sans travail, c'est, c'est plus possible maintenant
parce-qu'on a une étiquette, euh... chômeur, on a une
étiquette Rmiste, c'est pas vrai, c'est faux ça. Les gens,
c'est... les gens... c'est peuplé d'individualités, c'est vrai
mais, euh... on n'est pas différents, c'est, c'est... je vais pas dire
non plus c'est de la chance ou de la malchance, c'est.. c'est... le coup du
sort, on peut dire...
Jm : Si tu devais présenter le
Club, qu'en dirais-tu ? Si tu devais présenter le Club à
quelqu'un dans la rue ou à un copain que tu voudrais convaincre de
rejoindre le Club ? De quelle manière tu présenterais le
Club ?
S : Ouh là, convaincre des gens j'en
ai convaincu des milliers... de faire partie de mon, de mon Club mais le
problème c'est, c'est qu'en fait i peuvent pas libérer du
temps... leur vie, donc, de tous les jours pour aller vers la
société.
Jm : Et du Club même, comment tu
le présenterais ?
S : Ah le Club je dirai... eh ben, dans la
conversation je ferai un dialogue en disant « tiens, si tu as des
problèmes en informatique, moi je fais partie d'un Club, c'est
génial, tu verras il y a plein de gens et je suis sûr que
même si c'est pas moi qui te dépanne tu trouveras toujours
chaussure à ton pied. Il y aura toujours quelqu'un qui connaîtra
plus que moi et en plus, bon, de temps en temps on discute, on boit une
boisson, et pi c'est un cadre sympa où on t'embête pas quoi ;
tu fais ce que tu veux, tu, tu apprends à connaître les gens et
puis tu bidouilles un peu l'informatique » tout bêtement.
Et puis je dirai aussi « (silence) que on peut jouer, on peut
travailler, on peut s'entraider, c'est basé sur
ça ». Dans la limite si je pouvais connaître
quelqu'un qui était très calé en informatique j'essaierai
de la faire rentrer dans le Club parce-que c'est quand même une puissance
qui est hautement qualifié dans l'informatique. Bon, quand on n'a pas
des gens comme ça il faut se dire que s'ils n'ont pas envie de venir
c'est qu'ils le font déjà à leur travail, c'est
concevable. Bon il y a des gens qui sont beaucoup moins documentés sur
les choses qui viennent quand même. Mais eux aussi apportent une richesse
parce-que la chose qu'ils savent et que nous ne savons pas, ca engrène
encore la machine et c'est ce qui fait que l'association marche bien, en
fait.
Jm : Si tu devais présenter le
fonctionnement du Club, succinctement tu en dirais quoi et quelles valeurs tu
attribuerais à ce fonctionnement ?
S : Les valeurs que j'attribuerai au
Clubbb... euh, le fonctionnement, bon, ben, euh, on est
hiérarchisé, ça c'est clair. On a des statuts, on a un
Président, on a un Vice-Président, un Trésorier, un
Secrétaire Général. Bon, on a des Administrateurs. C'est
vrai qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut, il faut que ce soit
approuvé par le Bureau. C'est les gens qui donnent encore un peu plus de
leur temps pour que l'association fonctionne. C'est ce qu'on voit pas toujours,
en fait, c'est la face cachée de l'association, c'est les gens qui
travaillent en sous-main pour que, pour le confort de tout le monde. Pour
que... il y ai jamais une baisse de régime, pour que l'association ne
prenne pas un mauvais pas, ou euh... Bon, c'est obligatoire, il faut qu'il y
ait une hiérarchie et de toute façon le fonctionnement du Club
est basé là-dessus mais les dirigeants sont suffisamment
intelligents pour pas afficher non plus leur étiquette et se
considérer avant tout comme des membres. Pour moi ça fonctionne
comme ça. Et au niveau... vous voulez parler, peut-être, de la
trésorerie, non, de l'argent ?
Jm : Non, les valeurs du Club. Quelles
valeurs tu donnerais au Club ?
S : Quelles valeurs je donnerai au
Club ?
Jm : Quelles sont ses valeurs ?
S : Ah les valeurs ?
Jm : Quelles sont ses valeurs ?
S : Ben, déjà pour moi les
valeurs c'est l'entraide. Premièrement c'est l'entraide. Avant tout,
avant toute chose. La personne qui franchie la porte c'est l'entraide. C'est
« bonjour, je peux vous renseigner ? ».
Déjà c'est la première chose qu'on dit, je pense.
Même moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de... de faire adhérer des gens
parce-que c'était mon, c'était mon... mon activité
favorite on peut dire. Parce-que je vous ai vu faire plusieurs fois et
donc...euh... ça m'a plu... j'aimais bien convaincre les gens,
devenir... parce-que déjà 1) ça me plaisait et si on
pouvait donc... faire venir des gens, les faire participer à notre
association... c'était encore mieux. Et le mieux c'est faire
adhérer un jeune. Parce-que un jeune c'est beaucoup plus
démonstratif parce-qu'on peut lui montrer ce qu'on fait, le jeu qu'on
fait... comment les autres s'amusent... C'est beaucoup plus rapide en fait et
l'adhésion est instantanée parce-que, comment... on marche,
euh... on est plein dans la mouvance des jeunes et, donc, on peut pas se
tromper, en fait, avec un Club informatique.
Jm : Tu participes à une branche
de l'association ? Tu ne m'a pas parlé des branches. Je sais qu'il
y a des branches dans l'organisation du Club. Est-ce que tu participes à
une branche ?
S : Ah oui, je participe à plusieurs
branches. C'est vrai que j'ai omis d'en parler. Bon pour moi, euh, toutes ces
branches c'est simplement des activités de l'association. c'est pas des
associations dans l'association. Ça a rien à voir. Qu'elles aient
un compte à part ou pas, pour moi c'est quand même le Compu's
Club.
Jm : Parce-que les branches ont des
comptes à part ?
S : Euh, oui, ça arrive. On a un Club
finance qui essaye de s'autofinancer en se servant du cadre de l'association.
Mais ça, nous, euh, on rentre le nez dedans quand il y a besoin d'une
logistique que eux ne peuvent pas apporter. C'est-à-dire des locaux, des
choses comme ça quoi. Bon, euh, c'est vrai que les branches... pour
moi... donc je répète que ce sont simplement des activités
de l'association et donc ça reste des... simplement des
activités. C'est, en fait des membres qui ont voulu se
spécialiser au sein de l'association. C'est pour ça que je dis
ça.
Jm : Donc à quelle branche tu
participes ?
S : Alors, je participe à Comnet,
c'est la branche informatique liée à l'Internet. On apprend
à... à... on fait les premiers pas sur le Web. On apprend, donc,
à... a... avec un Pilote qui a beaucoup plus d'expérience que
nous... ce qui se passe c'est... comment i faut faire, quels sont... donc, les
démarches pour pratiquer quoi.
Jm : Cette branche est autonome,
aussi ? Elle a un compte en banque ?
S : Pour l'instant, non, elle n'en a pas.
Pour l'instant donc on n'a pas trouvé le...
Jm : Alors, dans cette branche,
ça se passe comment entre les membres ?
S : Ben déjà, ça se
passe d'une façon très simple : d'abord, 1) c'est le partage
et donc, comme on est en création depuis... depuis qu'on démarre
juste dans nos nouveaux locaux, donc, bon ben, Comnet ça se limite
déjà à avoir... on prépare la logistique pour avoir
donc Internet beaucoup plus rapidement. Parce-que pour l'instant on a un
système qui est un petit peu vieillot, il faut le dire et pi qui peut
pas suffire à l'étendue des membres.
Jm : Entre les Membres ça se
passe comment ?
S : Ça se passe bien entre les
Membres, c'est le partage, hein, c'est « tiens, j'ai vu, euh
quelque chose à cette adresse là, tu devrais visiter, tu devrais
ton compte parce-que la semaine dernière tu m'avais dit que tu
recherchais quelque chose à se sujet. »
Jm : Qu'est-ce qui te sembles important
pour toi dans le bon fonctionnement de la branche ? Pour que ça
fonctionne bien, quelles sont les choses qui sont importantes ?
S : Déjà pour que ça
fonctionne bien... il faut pas que tout le monde parle en même temps
déjà... il faut un meneur, un Leader qui oriente un petit peu le
débat pour que, pour que, en fait la branche avance.
Jm : et c'est comme ça que
ça se passe ?
S : Oui, on a un Pilote. On appelle un Pilote
une personne donc, euh, qui, qui fait le boulot de Leader, qui, qui, en fait,
qui regroupe un petit peu les questions, qui temporise un peu pour
éviter qu'il y ait une avalanche de questions aussi, et qui
répond au coup par coup, euh, suivant ses connaissances ou qui oriente
vers la personne qui sait et qui met en relation la personne. Bon,
après, c'est vrai que le travail du Pilote est très important
parce-que... il est obligé d'avoir un connaissance un peu plus
approfondie. On peut dire que c'est, que c'est la personne qui va faire preuve
de, de... qui va prendre du recul et qui va faire preuve de discernement et
de... pi de perspicacité pour essayer de comprendre les gens parce-que
c'est pas toujours évident de, de...
Jm : Donc, pour toi, ça c'est
important qu'il y ait un Pilote qui comprenne les autres ?
S : Ah oui ! Sans ça les choses
n'avancent pas parce-que c'est le Pilote, bon (silence)...
Jm : Qu'est-ce qui te semble important
dans le bon fonctionnement de la branche ?
S : Ben, déjà d'avoir une, une
hiérarchie, quoi. Enfin, le... euh...
Jm : de la branche, hein ?
S : Voilà, euh... d'avoir un Pilote,
une personne qui s'occupe un peu plus que les autres de la branche. Du bon
fonctionnement et du bon déroulement de la branche. De canaliser les
gens et de permettre a ce que les gens aient toujours un interlocuteur... si
eux ne peuvent pas s'entendre ensemble ils auront toujours le Pilote. Donc,
euh... le Pilote, on peut appeler ça un Pilote, moi je
préfère le mot de Leader parce-que c'est quand même celui
qui va prendre les plus importantes responsabilités au sein de la
branche et qui va rendre des comptes, enfin pas rendre des comptes, mais qui va
avoir après à communiquer l'avis de la branche à... au
noyau de l'association, en fait, au Compu's Club. Parce-que on est quand
même lié à l'association, au Compu's Club, c'est elle
qu'est...
Jm : C'est donc indispensable pour le
bon fonctionnement de la branche que d'avoir quelqu'un, un Leader qui puisse,
euh, mener les autres ?
S : Pas mener... pas mener, c'est pas
quelqu'un qui commande, c'est presque proscrit de commander au sein d'une
association. Faut pas commander les gens parce-qu'ils sont commandés
à longueur de journée. Il faut plutôt les orienter et leur
faire comprendre qu'ils sont dans l'erreur quand ils se trompent ou alors de
les conforter dans leur jugement quand ils sont... quand ils ont raison. Euh...
commander, euh... c'est une grosse erreur, je pense.
Jm : Est-ce que vous suivez un projet
dans la branche ?
S : Euh... un projet... euh... On, donc, on a
projet de faire venir le Câble... le Câble donc, Internet.
Jm : C'est un projet qui a vu le jour de
quelle manière ?
S : C'est un projet qui a vu le jour à
la suite de la constatation... euh...
Jm : Oui, mais comment ça c'est
construit ? La branche comment elle s'est construite, euh, on a fait ce
constat qui manquait peut-être du Câble. Comment ça c'est
construit ?
S : Ah, ben, ça s'est construiiiit,
tout simplement en faiteee... il y avait un gros manque au sein de
l'association et il fallait qu'une branche s'occupe du phénomène
Internet. Parce-que c'était déjà un trop gros morceau pour
l'association et ça faisait trop spécialisé...
Jm : Mais au delà de
l'association même... Qui a fait ? Comment ça c'est
fait ? Qui a eu l'idée ? Comment on en a
débattu ?
S : Qui, je ne sais pas...
Jm : Pas des noms, je veux dire est-ce
que c'est deux membres qui se sont réunis et qui ont dit
« il faut faire quelque chose » ? Comment ils
ont exprimé cette idée ? Auprès de qui ? Qui a
pris la décision de créer la branche ? Etc. Est-ce que c'est
l'ensemble de l'association ? Est-ce que c'est deux, trois personnes qui
ont déposé un projet ? Comment ça c'est
passé ? De quelle manière il a vu le jour ce
projet ?
S : Ah, oui, mais attention, les branches au
sein de l'association elles se développent, en fait, elles sont
créées instantanément. C'est quelqu'un qui a un projet,
qui dit « voilà, euh, tiens, et si on faisait ça,
je vois que tout le monde a le même problème. Pourquoi on
réunirait pas les gens qui ont le même problème en disant
voilà maintenant ça va s'appeler Comnet, c'est la branche qui est
spécialisée Internet. Quand vous avez un problème
concernant Internet vous viendrez à Comnet, on vous expliquera et on
tachera de vous, de vous aider et puis vous verrez... c'est enrichissant, y a
des choses que vous n'avez certainement pas vu, y en a d'autres que vous pouvez
faire partager. » Donc, euh...
Jm : Est-ce qu'il y a une personne qui
se désigne seule Leader ?
S : Non, non, non, non, elle se
désigne tout naturellement. C'est la personne qui est, à la
limite, qui est le plus calé, qui a l'habitude de fédérer
les autres et donc le Leader est tout de suite trouvé et puis c'est la
seule personnes qui reste debout la plupart du temps, qui fait le tour de tous
les autres et qui... euh... j'estime, en fait queee... Euh... En plus il y a le
phénomène de l'âge, donc, euh, la personne qui va
être la plus, ah comment dire ?, euh... la plus posée, la
plus mesurée et puis, donc, la plus réfléchie surtout
hein, va automatiquement prendre le fauteuil de Pilote étant
donné qu'il faut quelqu'un qui soit suffisamment responsable. On peut
pas mettre n'importe qui en tant que Pilote parce-que la branche
s'arrêterait vite.
Jm : Donc le, le, le Pilote c'est la
personne qui a l'idée initiale, qui fait le tour et puis, comme
ça, voilà la branche existe ?
S : Voilà, dans son projet elle essaie
de rassembler un maximum de personnes qui...
Jm : Et cette branche devient
autonome ?
S : Ah, la plupart du temps la branche essaye
de devenir autonome, étant donné qu'elle veut pas astreindre le
noyau de l'association avec des frais inutiles en fait. Et moi je le sens comme
ça, hein.
Jm : C'est d'une autonomie
financière dont tu parles ?
S : Voilà, autonomie financière
mais qu'elle soit financière ou autre c'est pareil. Elle a une
autonomie, euh, de fonctionnement, bon, c'est vrai qu'on a des jours de
présence... des séances... on a des plannings, on ne peut pas
faire n'importe quoi, n'importe quand. Bon c'est vrai qu'on peut partager des
informations hors séance mais il faut pas exagérer il y a
d'autres branches qui, qui essayent de vivre au travers de l'association et y a
que vingt-quatre heures dans une journée !
Jm : Alors, une fois que la branche est
créée, comment ça se passe ensuite dans la branche
?
S : Eh ben, le Pilote, déjà,
inventorie, euh, en fait, euh, la vie de la branche. Qu'est-ce qu'on a
déjà et qu'est-ce qui nous faut pour fonctionner, en
fait ?
Jm : Oui, mais entre les gens, entre les
gens, comment ça se passe ensuite ?
S : Ah, entre les gens... ça se passe
comme ça, en discutant les gens communiquent entre eux, posent les
questions, euh, se répondent eux-mêmes, euh, demande, enfin, je
sais pas moi, euh...
Jm : Et généralement
quelqu'un qui demande quelque chose, s'il ne trouve pas la réponse
qu'est-ce qui se passe ?
S : Ben, c'est vexant de pas trouver la
réponse à quelque chose.
Jm : Tu as un ou deux exemples que tu
pourrais me décrire où il y a eu...
S : Ça me fait rager moi quand je
trouve pas la réponse à quelque chose.
Jm : Et dans ces cas-là,
qu'est-ce que tu fais ?
S : Ben, je fais le tour de tous les membres
et à chaque fois je trouve et pi, tout' façon, quand je trouve
pas je me... je repars tout à zéro et puis je me
démène pour trouver la solution. Et la plupart du temps, euh...
il se trouve que j'ai souvent trouvé tout seul mais la plupart du temps
je cherche la solution de facilité, c'est de demander la solution au
Club, en fait, voilà. Mais je pense que c'est pour tout le monde
pareil.
Jm : Qu'est-ce que ça t'apportes
personnellement ?
S : Ben moi, ça résout pas mal
de problèmes.
Jm : Oui, au niveau informatique, mais
personnellement, en tant qu'individu, qu'est-ce que ça
t'apportes personnellement, de participer à cette branche ?
S : (silence) Personnellement, c'est tout
simple c'est que quand je prends mon ordinateur et que je le démarre
chez moi, que je vais sur Internet, et ben, je gagne en rapidité, je
gagne en compréhension, je gagne.
Jm : Oui, mais pardon, je vais
insister : d'accord pour l'informatique, ça apporte au niveau de
l'informatique, c'est une chose, mais, personnellement qu'est-ce que ça
t'apportes ? Tu es content de venir au Club ?
Sentimentalement ?
S : Oui, oui, oui, moi je suis très
content de venir au Club et s'est d'ailleurs pour ça que je m'investis
et que je fais partie des Administrateurs. Voilà. Moi, ça me
plaît parce-que, je, euh, je me rends compte qu'il y a des gens qui
repartent, après que je les ai aidé, content. Le réconfort
des autres c'est aussi très plaisant. Bon, euh, en plus c'est pas
payant, on fait ça gratuitement donc, euh, moi ça.
Jm : Qu'est-ce qui te ferait quitter la
branche ?
S : Ce qui me ferait quitter la
branche ?
Jm : Oui.
S : Ben, c'est qu'une personne soit
désagréable avec moi.
Jm : Alors qu'est-ce qui te fait
rester ?
S : (Rire) Ben que toutes les personnes
soient toutes agréables.
Jm : Comment expliques-tu que tout le
monde soit agréable ? Parce-que vous êtes combien dans la
branche ?
S : Un petite dizaine.
Jm : Alors comment expliques-tu qu'une
dizaine de personnes, depuis pas mal de temps semblent être
agréables les unes avec les autres ?
S : Ben, de toute façon les personnes
sont toujours agréables au sein d'une association. C'est rare qu'il y
ait des frictions et de toute façon même quand il y en a, la
personne va respirer un moment dehors et ça va mieux en revenant, hein,
c'est jamais des grosses frictions.
Jm : Alors qu'est-ce qui se passe
justement dans ce groupe où il n'y a pas de grosses friction qui ne
relève pas du projet même de la branche ?
S : J'ai pas compris votre question.
Jm : Qu'est-ce qui se passe dans ta
branche, dans ta branche à toi, entre les gens, entre les membres, euh,
qui n'est pas directement lié à la branche même, le fait de
suivre le Câble et cætera, qu'est-ce qui ne relève pas du
projet directement ? Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe, autre qu'un
échange informatique du projet ? Qu'est-ce qui se passe
d'autre ?
S : Ben, y a surtout, euh, ben, on parle de
ce qu'on a fait dans la semaine, déjà. On partage un peu notre
vie professionnelle. Bon, après, euh, c'est vrai qu'on arrive à
connaître un peu le cheminement de tous les gens, euh, leur vie
professionnelle, s'il y a eu un changement, s'il y a eu des mutations, s'il y a
eu un nouveau né dans la famille, si ils ont fait une allergie ou quoi,
des problèmes de santé, euh, `fin, c'est un partage, en fait,
gigantesque mais quand on a dit tout ça et qu'on a parlé chacun
de sa petite personne il reste pas beaucoup de temps pour l'association. Alors
il faut limiter ces discussions-là, quoi.
Jm : Est-ce que tu fais partie d'une
autre branche ?
S : Euh, j'ai eu fait partie de la Bourse.
C'est donc connaître et comprendre la Bourse, il me semble, je me
rappelle jamais des abréviations mais bon euh c'est des gens... c'est
une association... au sein de l'association... c'est des gens qui se sont
regroupés autour d'un phénomène de mode en fait... c'est
plutôt des gens d'un certain âge, enfin, par rapport à la
jeunesse. C'est des gens de 30 à 70 ans, 80 ans quiiiii, qui aiment bien
parler, donc, des choses de la Bourse, quiii aiment ça parce-que, bon
c'est synonyme d'enrichissement personnel très rapide, le marché
spéculatif ça fait rêver. Donc, ces gens-là se sont
organisés pour créer un club d'investissement, euh qui a chaque
séance s'autofinance par des petites, euh, des p'tites, donc... euh...
cotisations qui, euh, qui, euh, qui agrémentent un compte qui va servir
à passer d'un compte en Bourse virtuel à un compte, euh...
réel en Bourse.
Jm : Lorsque tu faisais partie de cette
branche, euh, il y avait combien de personnes à peu
près ?
S : Eh ben quand je suis rentré, donc
à, au C.E.B., il y avait, je crois, quatre personnes quand j'ai
commencé. Quand je suis parti y en avait, euh plus du double.
Jm : Qu'est-ce qui t'en a fait partir,
en fait ?
S : Ben, mes contraintes professionnelles.
Ils avaient, en fait, organisé, en fait, la séance, donc, du
C.E.B. le mardi et le mardi j'avais pas mal de contrainte professionnelle, je
ne pouvais pas me déplacer à l'heure donnée. Et, euh, bon,
bé, surtout en étant souvent en déplacement j'avais...
j'ai, j'ai été obligé d'arrêter, quoi. Je pouvais
pas faire changer la date des séances seulement pour une personne.
Jm : Qu'est-ce qui t'as fait prendre tes
fonctions au sein de l'association puisque tu en es le
Vice-Président ?
S : Eh ben, ce qui m'a fait prendre des
fonctions c'est de dire, euh, « y a des choses qui
méritent qu'on y fasse un peu plus attention » et euh, i
faut aussi donner un coup de main à ceux qui se, qui s'investissent
beaucoup. Ça permet de, en fait de, de pas de se reposer mais de, de, de
prendre un peu de recul et puis de mieux comprendre. C'est vrai que quand on
regarde les choses d'un point de vue extérieur on comprend les choses de
suite. On voit tout de suite là où est problème mais quand
on est dedans on a des fois la vue obturée par des problèmes de
fonctionnement et on voit pas l'essentiel, c'est à dire le
problème des gens, c'est pas instantané, quoi.
Jm : Tu parles du problème des
gens, est-ce que tu peux me donner quelques exemples ?
S : Oh, ben, les problèmes des gens
c'est, c'est, en fait, euh... étant donné qu'on regroupe un petit
peu des personnes de toutes... de toutes, déjà de toutes
nationalités, de toutes, euh, enfin... issue, en fait... des
chômeurs, des Rmistes... `fin, on, on regroupe plein de personnes en
fait, hein. Donc, y a, y a aussi des, des... des gens qui sont
handicapés que se soit moteur ou mental. Bon ben, c'est, c'est à
divers degrés mais on essaie de communiquer de la meilleure façon
avec eux et je trouve que c'est ces gens-là, c'est gens qui ont des
problèmes dans la société qui, qui, qui... qui devraient
bénéficier le plus possible des associations parce-que i
reçoivent au sein de la société un regard qui n'est pas
bon, on... c'est des laissés pour compte alors que dans une association
ils peuvent, ils peuvent, euh... i peuvent, i peuvent bénéficier,
en fait, du même service qu'on propose à des gens normaux.
Jm : Tu disais « dans une
association » mais pour Compu's Club, ce qui m'intéresse
particulièrement c'est le Compu's Club, hein ?
S : Eh, ben au Club c'est justement
ça, c'est, euh, c'est, euh, en fait, c'est, c'est un petit nombre de
personnes qui fait preuve de la plus grande amabilité et qui essaye
d'oublier, euh... donc... euh... leur phobie, on peut dire leur phobie ou leur
répugnance à, à voir des, des gens qui sont pas comme eux,
pas normaux parce-que i faut pas se cacher, i faut pas se voiler la face, hein,
dans la vie de tous les jours quand on voit un handicapé moteur se
déplacer dans la rue on se dit « heéeé,
regarde-moi le lui » et on en rit. Il y a beaucoup de gens qui
en rient alors qu'i devraient pas. Alors qu'au niveau de l'association de, de
se dire « on n'a pas le droit de dire ça »
et on est, on est... je sais pas si c'est systématique, on fait appel au
coeur des gens au Compu's.
Jm : Et c'est ça qui se dit au
Compu's Club ?
S : Oui, oui, c'est ça qui se dit,
c'est ça qui se dit au Compu's Club, oui, bien sûr. Euh... je vois
pas d'ailleurs ce qui pourrait... Le message passe automatiquement au Compu's,
de toute façon, euh, i, comment dire ? On a eu un Président,
euh, qui avait cette philosophie-là, c'est à dire de, de,
considérer chaque personne comme, comme son égal et puis de toute
façon, i fallait, euh, i fallait absolument ne pas avoir de
laissé pour compte et d'ailleurs i s'arrêtait plus sur les gens
qui ont des problèmes que sur les gens qui n'en ont pas ou qui en ont
moins. Comme ça on arrivait à mettre tout le monde sur le
même pied d'égalité et, euh, on évitait de ce fait
tout, toutes leees frictions et, et en fait i iavait pu, i iavait pu de
problème.
Jm : Tu disais « il y
avait un Président qui... », il n'est plus
Président ?
S : Non, le Président, toujours pour
un problème de disponibilité à
préféré donc, un petit peu moins s'investir au sein du
Compu's pour, pour... pour certainement, je pense, il l'a fait pour prendre du
recul et mieux comprendre le Compu's et, euh, pour laisser un petit peu se
renouveler le Club, pour laisser la place à des personnes
différentes. Je pense que renouveler l'administration de, du Compu's
ça a été, c'est d'ailleurs une bonne chose parce-que
quelqu'un qui veut prendre des responsabilités au sein de l'association,
faut le pousser pour que, il fasse bénéficier de son
expérience... le Compu's.
Jm : Et là il ne participe plus
du tout, hein ?
S : Ah si, si, il participe toujours mais il
s'est, en fait plus recalé sur « je suis un membre comme
les autres plutôt que je suis un Président et j'essaye de, de
faire a ce que l'association marche. » Il investi toujours
autant de son temps mais complètement différemment. Il va, il a
plus tendance d'aller vers les branches, euh, à naviguer quoi.
D'ailleurs, bon moi je, j'ai pas franchement de, de, moi, ma branche n'existe
pas encore. Celle que je voudrai, donc, c'est une branche plutôt
spécialisée dans le matériel informatique. Donc, euh, le
jour où je lance mon projet, je vais faire, euh, je vais recenser tout
le matériel vieillot qu'on a ou le matériel qu'on veut plus et/ou
le matériel qu'on doit acheter. Et on va organiser avec les gens que
ça intéresse et je lancerai ma branche et je m'investirai
beaucoup plus dans ma branche parce-que c'est quelque chose qui me motive.
Jm : Alors, qu'est-ce que tu aimes y
faire au Club ?
S : Alors moi au Club la première
chose que je fais en rentrant c'est boire un café. Etant donné
que j'ai pas eu le temps de prendre le temps de m'asseoir et de souffler un
peu, de discuter avec des gens qui me parlent pas tout le temps boulot. Et pi,
euh, et pi voir des gens, surtout avec le sourire en rentrant ça fait
tellement plaisir que... Voilà, ça permet de se poser et puis de
faire marcher sa tête correctement pas avec, euh, pas avec le... des
contraintes et des soucis professionnels, en fait, pour moi c'est ça.
Jm : Et, et c'est, c'est ça que
tu préfères au Club ? Qu'est-ce que tu
préfères en résumé, au Club ?
S : Euh, moi, je... en
résumé ? Au Club c'est, c'est, déjà c'est des
gens (silence) qui parlent de ma passion. Voilà, ça se
résume à ça.
Jm : C'est ce que tu viens chercher
aujourd'hui ?
S : Ah, à 100%. Ça peut
dériver, en fait la conversation peut dériver sur plein de chose
bon je ne me cantonne pas à l'informatique. Mais, euh... c'est d'abord
ça et c'est ce qui fait me déplacer.
Jm : Est-ce que tu peux me donner un ou
deux exemples qui t'ont particulièrement marqué dans les
relations avec les autres dans le cadre du Compu's Club ?
S : Des exemples ?
Jm : Un ou deux exemples qui t'ont
marqué dans tes relations avec les autres ; tu as pu, euh, avoir
une relation particulière avec quelqu'un ; quelque chose a pu te
marquer positivement ou négativement, bien
entendu, ou tu as été observateur de quelque
chose, une relation entre deux Membres à un moment. Est-ce que tu as un
ou deux exemples à me donner ?
S : Non, mais me concernant il y a un exemple
qui m'a, qui m'a, en fait, qui m'a beaucoup marqué. C'est, c'est, en
fait, c'est un sentiment assez profond. Ce qui se passe c'est queeeee il y a
l'Assemblée Générale d'il y a un an... ou... non il y a
deux ans, je crois, j'étais Membre depuis six mois, je crois, et il y a
eu le revote du Bureau, bon. Et il y avait un membre qui était
rentré après moi mais qui s'était investit sur un projet,
bon, qui avait voulu lancer un projet. Et quand y a eu, donc, un renouvellement
du Bureau on a proposé un Secrétaire général. On a
demandé « qui c'était qui voulait devenir
Secrétaire Général ? » La personne
s'est présentée, je savais forcément que, bon, ben, elle
voulait l'être, moi aussi, j'ai levé la main. Cette
personne-là a été élue et j'ai vraiment
été vexé de ne pas l'être, en fait. Ça
m'avait vraiment choqué. Je m'avais dit mais « c'est
parce-qu'il faut êt'e, i faut êt'e, il faut avoir un mouvement, il
faut une branche alors on est élu dans le Bureau ? »
J'ai pas trouvé ça normal en fait parce-que j'estimais que,
même en n'ayant pas de branche et de projet à soutenir, euh, je
pouvais très bien faire un Secrétaire Général. Je
l'ai d'ailleurs été le, la, l'année d'après. Mais
je trouve que c'est... j'ai été que Secrétaire Adjoint et
j'étais déçu parce-que c'était quelqu'un qui a
lâché tout de suite l'association par la suite, en fait.
Jm : A l'époque c'est ce que,
euh, c'est ce que tu as pensé, tu as pensé que cette personne a
été élue parce-que...
S : ...be...
Jm : ...elle avait participé...
elle avait voulu lancer un projet...
S : ... hum, hum...
Jm : ...C'est ce que tu avais
pensé à l'époque, donc, c'est ça ?
S : Beiiin, non, non, non, non, c'est pas
vrai, en fait, parce-que une élection c'est à l'unanimité,
en fait, c'est, c'est le Bureau qui vote en fait, qui dit, telle personne sera
plus apte qu'une autre à assurer cette fonction-là, bon, euh...
en sachant qu'à la suite, ça a pas été le cas du
tout. Ou du moins, la personne, ses contraintes professionnelles étant
ce qu'elles étaient, c'était plutôt le Président qui
faisait son travail, euh, d'ailleurs, bon, ben, on remercie encore cette
personne-là mais au Compu's, en fait, l'essentiel du Compu's c'est notre
Président. C'est notre Président qui l'a lancé, c'est
notre Président qui l'a, qui a, à partir d'un petit noyau...
à 0 personnes est arrivé à 150 adhérents.
C'est...
Jm : Aujourd'hui, tu penses la
même chose aujourd'hui ? Avec le recul et les nouvelles fonctions
que tu as pris que, que, à l'époque, c'était un sentiment
qui, euh...
S : Non, non, non, moi, personnellement, je
suis quelqu'un très... comment dire ? C'est soit ça marche,
soit ça marche pas avec moi, hein. Les personnes sont ce qu'elles sont
mais quand ça colle pas avec quelqu'un, ça ne collera jamais.
Donc, euh, y a des gens soit je les évite comme, donc, la personne dont
on parle... j'ai plutôt préféré l'éviter
parce-que c'est une personne qui m'a semblé avoir, en fait, peu de
dynamique. C'est quelqu'un qui voulait tout tout de suite et qui avait pas
compris l'assoc... le Compu's, en fait. Le Compu's c'est quelque chose qui va,
en fait, se dérouler, avec, avec, euh, un plan très
détaillé, en fait, euh, qui va, qui va avoir un fonctionnement,
plutôt lent d'accord, mais pour bien avoi..., pour avoir des bases
solides on est obligé de parler de tout et de commencer doucement et on
peut pas créer une branche et demander vingt mille francs et pi euh, et
pi euh, lancer une branche comme ça s'en affaiblir le Compu's
lui-même. Donc, euh, il faut être un petit peu intelligent et se
dire « bon, ben si on a pas tout tout de suite on va essayer de
faire... de concrétiser la chose mais en faisant que la branche se
débrouille toute seule ».
Jm : C'était quoi ce
projet ?
S : C'était un projet sur donc, euh,
le pilotage. Euh, on proposait aux gens d'apprendre à Piloter un avion
sur informatique via un simulateur de vol et donc, euh, on devait acheter un
simulateur de vol, un ordinateur beaucoup plus puissant que le reste de notre
parc informatique. Et, euh... faire apprendre les gens à Piloter pendant
un certain nombre d'heures sur informatique pour, euh, après leur faire
bénéficier de...
Retournement de K7 = ¾ d'h.
... pour après leur faire bénéficier,
donc, d'une formation de pilotage véridique, en fait, dans un vrai
avion. Ça leur permettait d'avoir un quota d'heures qui...
Jm : Donc, il t'as fallu attendre, si je
reviens un petit peu en arrière, il t'as fallu attendre un an pour, euh,
t'intégrer dans le Bureau de l'association, c'est ça,
hein ?
S : Hum
Jm : Donc, pendant cette
année-là, quels ont été tes sentiments pendant un
an ? Est-ce que tu t'es senti moins participer à
l'association ?
S : Non, pas du tout, non.
Jm : Alors qu'est-ce qui a fait que
justement, au delà de ce qui t'as marqué, au delà de cette
fonction à laquelle tu n'as pas pu a... euh... pas pu accéder,
qu'est-ce qui fait que, finalement tu es resté dans
l'association ?
S : Eh ben, parce-que déjà
j'avais plein de copains, en dehors, en dehors de cette personne-là.
C'est ce qui fait que une personne qui plaît pas ben, ben, on l'oubli et
puis on fait qu'il y en a 149 autres, hein. De toute façon, comme je
l'ai dis, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui, qui écoute
et puis donc, euh... ch'suis tombé... d'abord je, je suis assez jeune,
donc, euh... Ch'suis tombé dans le phénomène des jeunes.
La jeunesse... elle est sans pitié la jeunesse, hein.
Jm : Quel âge tu as ?
S : Moi, j'ai 27 ans. (à ma
moût) Et pourtant je suis plus bien jeune mais (rires) je fais partie de
la jeunesse. Pour moi, je suis très jeune dans ma tête donc, euh,
je, je,je me plais aussi bien avec les gamins qui sont très jeunes,
dix-onze ans, qu'avec les personnes qui en ont trente, quarante voire cinquante
ans. Celles que j'ai le plus de mal à appréhender c'est, en fait,
c'est, c'est pas... c'est pas les jeunes, c'est surtout les, les personnes
âgées parce-qu'on sait pas, on connaît pas leur
susceptibilité et donc les personnes qui sont d'un âge
plutôt mûr se vexent beaucoup plus facilement aux paroles
données alors que les jeunes ne se marquent pas et sont pas rancuniers,
en fait.
Jm : Alors tu participes depuis un peu
plus de deux ans au Club, c'est ça deux ans, deux ans et demi...
S : ...oui, deux ans et demi...
Jm : ...deux ans et demi, au Club. Quels
ont été les moments forts pour toi ? Euh, dans ces deux
années et demi il y a dû y avoir des moments forts.
S : Ah oui, les moments forts, ils ont
été plutôt malheureux la plupart du temps. Ben, bon, le
cheminement du Club c'est déjà, d'un local assez restreint dans
une entreprise privée, il a fallu déménager alors qu'il y
a un nombre réduit de personnes. Déménager vers une autre
entreprise privée qui nous prêtait des locaux gracieusement. Donc,
déjà, c'est... euh... on se dit « qu'est-ce que va
devenir notre association ? Est-ce qu'on va trouver un local ? Est-ce
que... », bon, après il faut tout remettre en place. Il
faut faire évoluer le Club, il faut en profiter pour demander de l'aide
à droite à gauche. Il faut faire appel à toutes les bonnes
volontés, en fait. Et donc, euh, après, quand le Club, c'est vrai
que... moi j'ai constaté une chose c'est que quand il y a des
problèmes les adhérents répondent beaucoup plus souvent et
beaucoup plus rapidement et donnent beaucoup plus de leur temps que quand tout
fonctionne très bien. Quand tout fonctionne très bien il n'y a
plus personne. (Rires).
Jm : Et tu expliques ça
comment ?
S : Eh ben j'ai l'impression que les gens
sont... sont... plus versés dans l'humanitaire, le caritatif et,
eeeet... d'avoir tout le temps la main tendue au moment où c'est le plus
dur plutôt que d'être dans un petit train-train tranquille d'une
association qui roulotte et qui, qui essaye, qui vivote, en fait, il faut une
grosse grosse grosse dynamique au sein d'une association parce-que, on arrive
pas à faire déplacer les gens de chez eux si on, si on n'a pas
quelque chose qui intéresse.
Jm : Alors, qu'est-ce que tu en retiens
aujourd'hui ?
S : Ah moi j'en retiens... plein de choses.
Mais la première c'est que, en fait, on comprend mieux et on arrive
à trier le noyau dur, en fait, d'un... d'un, donc du Compu's et y a, y
a, il y a pas mal de personnes qui se détachent de ce noyau et,
euh...
Jm : C'est dû à quoi
ça ?
S : Eh ben c'est celles qui s'investissent le
plus. Donc, euh, c'est celles...
Jm : Ah qui se détachent, tu veux
dire : qui sortent du lot ?
S : Oui, la plupart du temps les personnes
qui s'investissent le plus sont Administrateurs. C'est une constatation et puis
on peut faire un phénomène statistique sur plusieurs
années : c'est la plupart du temps les personnes qui s'investissent
le plus. C'est pas les personnes ponctuelles qui aident le Compus. C'est vrai
qu'elles vont dépanner une fois, deux fois, ponctuellement mais i 'y
aura pas de suivi, y aura pas une, de, de, euh... aucun but, aucun projet
là-dedans.
Jm : Tu expliques ceux qui aident
ponctuellement l'association comment ? Ça se réduit à
quoi d'après toi ?
S : (Silence) Je sais pas trop qu'est-ce
qui...
Jm : Alors qu'est-ce que... euhmmm...
qu'est-ce que tu retiens de ta participation au Compu's Club ?
S : Moi, qu'est-ce que je retiens de ma
participation ?
Jm : Qu'est-ce que ça t'as
apporté ?
S : Ah, qu'est-ce que ça m'a
apporté ?
Jm : Oueub, ce que ça m'a
apporté, déjà... euh... ça m'a apporté un
enrichissement personnel conséquent. Moi, ce qui rentre dans ma
tête, eh ben, ça rentre et puis... euh... c'est comme si j'avais
appris, en fait, c'est comme un prolongement de l'école, ça... Et
puis j'apprends à connaître des gens d'horizons diverses. Euh... Y
a des gens quiii... qui m'ont aidés, qui, qui m'ont pris comme
j'étais alors que j'suis quand même une personne qui est quand
même assez dure au travail, étant donné que j'encadre des
gens dans ma, ma vie professionnelle donc je suis pas, pas bien souple et,
euh... comme dans mon Club j'ai été obligé de me mettre en
dessous des autres parce-que j'en savais un peu moins au départ.
Après, euh... je me suis mis au même pied d'égalité
que les autres.
Jm : Tu disais tout à l'heure
« un enrichissement personnel » est-ce que tu as
un ou deux exemples qui caractériseraient cet enrichissement
personnel ?
S : Ah, euh... oui... oui, certainement...
euh... ça m'a permis donc deee... euh... Comment je peux dire
ça ? Déjà d'apprendre à, à, à
fabriquer des ordinateurs... Ça... je fais (en pouffant) je fais
peut-être preuve d'humilité maintenant, je pense... parce-que
avant on peut dire que je faisais partie des jeunes qui critiquaient, en fait,
hein. Les personnes qui avancent pas, les personnes qui sont un peu lourdes,
qui, qui sont un petit peu, comment dire ? Qui sont beaucoup plus lentes
que soit, on a déjà du mal à se mettre à, donc,
à se mettre au même pied d'égalité avec eux. Et moi
je pense que ça m'a déjà apporté ça, un peu
d'humilité et puis, euh... un peu de confiance surtout, beaucoup de
confiance, je pense parce-que je perds, euh, j'ai beaucoup plus d'assurance
à parler avec les gens.
Jm : Est-ce que quelque chose a
changé pour toi depuis que tu es au Club ?
S : Ah oui, j'ai changé ma situation
familiale... J'étais avec une personne qui collait pas trop, en fait,
avec, euh... on avait pas trop d'atomes crochus pourtant on avait vécu
assez longtemps ensemble. Et ce, ça, ça... mes contraintes
professionnelles plus l'association, plus mes loisirs... euh... ça
faisait trop pour elle. Elle a pas supporté. Donc j'ai été
obligé, de, de fabriquer toute ma vie et de me dire, de toute
façon ça sera... ça sera avec ma vie maintenant et mes
ambitions ou, euh...ou, euh... y aura pas... `fin, ça marchera plus,
quoi. C'est comme ça.
Jm : Est-ce qu'il y a quelque chose
qui a changé chez toi depuis que tu es au Compu's Club ?
S : Chez moi, matériellement,
euh... ?
Jm : Personnellement.
S : Personnellement. Personnellement, chez
moi, non je pense pas qu'il y ait grand chose de changé. Peut-être
mon comportement... mais, euh... je sais pas, j'arrive pas, en fait on
s'analyse pas chez s... on, on,on se regarde pas vivre et on explique pas le
pourquoi on a gueulé, le pourquoi on est de bonne humeur. C'est comme
ça et c'est pas autrement. Au sein d'un, d'un... foyer on peut... on a
des jours avec, des jours sans. Alors que, euh, avec le Compu's on a toujours
des jours avec. Ça va toujours bien, je n'arrive pas à le
comprendre. Mais, bon, euh, c'est, c'est jamais, euh... enfin, c'est, c'est...
je peux pas vous dire moi, c'est...
Jm : Alors, quand tu viens au Club, dans
quel état d'esprit tu te trouves, comment tu te sens ?
S : Je me sens en week-end,
déjà (rires). Ou alors, euh, quand c'est la semaine, bon, ben, je
me sens déj... je souffle un peu, je me sens, euh, un peu apaisé,
en fait, tout bêtement et pi, et puis je me dis « enfin un
endroit où personne va m'embêter. Le téléphone va
pas sonner, j'suis pas obligé de répondre à du courrier ou
à du téléphone. » Je fais ce que j'ai envie
de faire et de toutes façons c'est comme ça quoi. J'ai...
voilà, quoi.
Jm : Alors, qu'est-ce qui fait que tu y
restes finalement au Compu's Club ?
S : Qu'est-ce qui fait que j'y reste ?
Ben, to'tes façons ch'suis pas près d'en partir... Qu'est-ce qui
fait que j'y reste ? Ce qui fait c'est queeee... je sais qu'il y a, y a...
y a des idées, là, c'est, c'est les idées qui me font dire
qu'il faut y rester parce-queee... un jour il y aura forcément une
personne qui va se lancer, qui va dire « moi, j'ai envie de faire
ça » et ça collera à ce que j'ai envie de
faire et... et je me lancerai aussi là-dedans et si faut que je me lance
dans cinquante branches je me lancerai dans cinquante branches pour peu
qu'elles m'intéressent.
Jm : Alors, quels sont les obstacles,
pour toi, pour une participation plus importante au delà des
disponibilités ?
S : Au delà des
disponibilités ?
Jm : Est-ce qu'il existe d'autre freins,
d'autres obstacles pour participer encore plus au Club ?
S : Ouh il y en a certainement. Au
delà des disponibilités il y a... déjà... on peut
dire les moyens. C'est pas les disponibilités, `fin, les moyens,
quoi.
Jm : Les moyens,
c'est-à-dire ?
S : Ben, euh... les moyens d'accéder,
en fait, euh... à l'aboutissement du projet. C'est-à-dire que,
pour l'instant, ben, concernant Comnet, il faut avoir le Câble pour
bénéficier d'Internet, euh... plus rapidement. Donc, euh... si on
n'a pas les moyens, Comnet, ca va se limiter, en fait, à la
surutilisation de, du peu de matériel qu'on a. Donc, il y a d'abord les
moyens...euh... Ce qui fait aussi, pour une association comme le Compu's, a du
mal à... en fait à... comment dire ? A..., à,
à aboutir aussi un peu ses projets c'est aussi le manque de, de
motivation de ses membres. Donc, euh... certains des membres sont très
motivés au départ et pi i se relâchent un petit peu quand
ils voyent que la dynamique est un petit peu moins importante. Ça, je
l'ai constaté, aussi. Il y a des branches qui sont tombées en
complète décrépitude à cause de ça.
Jm : Tu l'expliques comment
ça ?
S : Ben, en fait, c'est tout bête, en
fait, c'est complètement bête. Euh... on rep... en fait... on
prend le phénomène d'une branche à une autre en comparant,
en fait, la branche des jeunes, la branche des plus anciens. Les plus anciens
ont... arrivent mieux à comprendre le... en fait, le... le
phénomène de but, de projet à aboutir. Alors que les
jeunes, euh, c'est instantané, il n'y a pas de but, y a pas de... y a
pas de long terme avec les jeunes. C'est soit du moyen terme soit du court
terme. Faut que ça soit « je m'amuse tout de suite mais
jamais », euh... beaucoup plus longtemps, en fait. Donc, euh...
les jeunes, euh...Quand il y a une perte de dynamique les jeunes laissent
tomber de suite. I, i s'en vont, ils reviennent beaucoup moins souvent, ils
espacent leur visite.
Jm : Les jeunes, c'est quelle tranche
d'âge, les jeunes ?
S : Oh les jeunes ca va de huit à
dix-sept, dix-huit ans, hein. Et donc, euh... c'est des gens, enfin c'est des
personnes qui ont du mal àààà... à se
concentrer, donc, euh... sur, euh... un projet et qui acceptent pas bien,
déjà, d'être dirigés, d'être, d'être
orientés. Parce-que ils sont en dehors du cadre familial, en dehors du,
de la société, i croient, `fin, i croient pouvoir faire un peu
tout, tout et n'importe quoi et i z'aiment pas trop les barrières donc
ils font tout sauter à la volée... et... ils se rendent compte,
en fait qu'ils avancent pas s'ils ont pas un peu des barrières, des
dates et... des plannings et des projet à aboutir. Voilà, alors
que chez les personnes âgées, elles sont mûrement,
normalement, mûrement réfléchies et c'est ce qui fait que,
on trouve les personnes beaucoup plus intéressées, c'est celles
qui, qui font évoluer la branche et les personnes qui, qui... qui vont,
comme ça, en... en... étant intéressées sur le
coup, lâchent... lâchent pied tout de suite, en fait.
Jm : Alors, ben là, on arrive
à la fin de cet entretien. Une dernière question, justement pour
rebondir sur ce que tu viens de dire dernièrement. Qu'est-ce qu'il
faudrait faire pour améliorer le Club ? Tu disais que les jeunes,
par exemple, les jeunes entre autres, avaient... euh... avaient des
difficultés pour être attentifs, suivre un projet et le mener
à son terme, ils sont plus dans l'immédiateté, donc,
euh... Pour améliorer les jeunes qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Ou pour améliorer le Club dans sa globalité, qu'est-ce qu'il
faudrait faire ?
S : (silence) Pour améliorer le Club
dans son intégralité, il faudrait déjà faire...
comprendre ce que c'est qu'une association aux jeunes, leur en parler, leur
parler des statuts, leur montrer quels pouvoirs on a au sein de la
société. Parce-que le pouvoir d'une association est
énorme. Euh... Leur faire comprendre qu'une association si elle se
développeee... elle peut très bien faire pencher la balance dans
leur vie... en leur faisant comprendre que de toute façon, s'ils font
partie d'une, d'une association ils trouveront, euh... solution à leur
problème et quelque soit leur problème, pour peu que les gens qui
sont dans le Compu's prennent le temps de les écouter. Pour moi, le, en
fait, le... l'association c'est pas, euh... le Compu's c'est pas maintenant que
j'l'imagine. C'est beaucoup plus tard... avec justement ces jeunes-là et
si on... on... Le challenge, en fait, c'est faire aboutir des projets qui
canaliseront un maximum de ces gens-là. Qui auront compris, en fait, le
phénomène associatif et qui auront compris que, en fait, aider
les gens, c'est gratifiant aussi pour soi-même et, et... donc... si z'ont
pas l'occasion de le faire chez eux ou au travail, qu'ils le fassent, au moins,
au sein d'une association et qu'i donnent un peu de leur temps pour aider ceux
qui en ont besoin. Tout bêtement, pour moi, c'est ça.
Annexe 9 Quatrième
entretien
N & P (quatrième entretien) 19h40 le 6
février 2001
Au domicile des interviewés.
Un Couple marié, Pilote de la branche CAO. Elle (Na),
32 ans, ne travaillait pas au moment de son adhésion mais a
retrouvé un travail depuis, lui (Ph), 34 ans, a toujours
travaillé. (Correspond au questionnaire n°10).
A la fin, j'ai eu droit à une petite collation au
terme de l'entretien. Ce qui me fait supposer qu'il s'agissait de invitation
d'un ami ou d'une interview importante pour eux.
Après annonce.
Jm : Comment avez-vous connu le Compu's
Club ?
Na : Nous avons connu le Club... par
l'intermédiaire... d'amis, au cours d'une soirée. Nous avons
rencontré JM qui était Président d'un Club informatique,
qui en a parlé à Ph. Et Ph a été
intéressé eeeet lui a donc demandé des renseignements sur
ce Club. Et ensuite nous nous y sommes rendus.
Jm : Quels genres de renseignements tu avais
demandé à ce Club.
Ph : Bé, euh... Quel Club
c'était, euh... JM m'avait dit que c'était un Club informatique.
Donc, euhh...
Jm : On te l'avait présenté
comment ?
Ph : Au cours de la soirée
ou...
Jm : Oui au cours de la soirée.
Ph : Bé, ben, euh... on en parlait
très vaguement pour pas euh... trop je pense, euh...
Jm : Vous vous souvenez... Na,
peut-être tu te souviens comme on en avait parlé ?
Na : A moi tu n'en avais pas parlé du
tout.
Jm : Du tout ?
Na : Non. Seulement avec Ph. C'est, euh...
à la fin de la soirée que Ph m'a dit « JM est
Président d'un Club informatiqueee. »
Ph : On en avait très peu
parlé...
Na : Très peu parlé, oui.
Jm : Est-ce que tu te souviens de ce que JM
en avait dit ?
Na : (s'adressant à Ph en
difficulté pour répondre) Bon bé, t'avais dû
demander un petit peu, certainement, ce qu'il faisait...
Ph : ...En fait tu m'avais parlé qu'il
y avait un atelier de montage. Ça tu m'en avais parlé. Ça
m'avait marqué. Et que vous faisiez des formations. Tu me l'avais
présenté que sous cet angle-là, hein...
Jm : On avait parlé seulement
d'informatique ?
Ph : Seulement d'informatique, ouais...
ouais, ouais.
Jm : Alors qu'est-ce qui t'avais
séduit justement sur ce que je t'en avais dit ?
Ph : Eh ben... je connaissais rien en
informatique. Donc je me suis dis, euh... voilà...
Na : Je pense, au départ, que de
toutes façons, Ph avait envie de connaître... ce monde
là...
(s'adressant à Ph faisant une légère
moue) : C'est vrai, ça t'intéressait...
Ph : ...Oui, mais j'savais pas, euh...
Na : ...Tu ne savais pas ce que
c'était, tu ne savais pas où trouver les informations ni vers qui
se tourner pour euh...
Ph : C'était l'occasion aussi de faire
une activité à deux.
Na : Oui.
Ph : Donc, euh. C'est pour ça... c'est
ce qui a déclenché un petit peu, euh. Que Na, elle était
réticente mais sans plus. Alors que...
Na : Il sait qu'il pourra jamais me
traîner dans le sport alors qu'en informatique il s'est rendu compte
qu'il y avait une ouverture possible.
Jm : Alors, vous vous êtes rendu au
Club. Vous avez rencontré une autre personne qui vous a
présenté le Club ?
Na : Oui. Monsieur Del. ( Del=A.
1er entretien).
Ph : A., oui.
Jm : Il vous en a dit quoi, lui ?
Ph : Ben il nous l'a présenté
par rapport au prospectus que tu as fait avec euh... Alors, par rapport
à ce prospectus il nous a décrit ce qui, euh... ce que le Club
faisait.
Jm : est-ce que tu te souviens ce qu'il vous
a décrit ?
Ph : Ben, y avaiiiiiiit... l'atelier de
montage, ...
Na : ...les formations...
Ph : ...les formations... et puis le reste
ben, euh...
Na : ...Moi je me souviens, ben... il nous a
fait une démonstration, euh... qui nous a paru terriblement, euh...
`fin, on n'a rien compris...
Ph : ...Oui, parce-qu'il arrivait pas
à faire ce qu'il voulait, aussi...
Na : ...Oui, alors, il "cliquait" un peu dans
tous les sens...
Ph : ...Parce qu'il connaissait pas tout
à fait ce qu'il y avait dans les, euh... les, les menus de programmes,
démarrer.
Jm : Et ça, ça ne vous a pas
refroidit ?
Na : Non, pourtant on en a bien
rigolé.
Ph : Alors, qu'est-ce qui vous a fait
revenir ?
Ph : Après on est revenu et on t'as
vu, tu étais avec Del., je crois.
Jm : La deuxième fois, il y avait deux
personnes donc...
Ph : Le jour où on est venu
s'inscrire...
Na : ...Non, on est revenu, c'est vrai, avec
l'idée de s'inscrire mais le fait d'avoir rencontré JM qui a
été plus clair au niveau explications...
Jm : Alors, justement, ces explications,
clarifiées, c'étaient quoi ces explications ?
Ph : Eh bé, euh... tu avais
essayé de décider Na, parce-que je t'avais dit que Na
était réticente (ici, le "tu" me concernant va passer en "il" sur
ma demande. Ceci pour bien différencier mes fonctions au Compu's
Club et mon rôle d'apprenti chercheur) en lui disant que, elle pouvait
faire des fiches de cuisine, des recettes, des, euh...
Na : Il a, il a, il a, il a su me prendre par
le point où il fallait...
Ph : ...Il y a eu de la musique, aussi, je
crois... je ne sais pas...
Na : ...Oui, bon, ben...
Ph : Il nous énumérait pas mal
de choses... les comptes, il y avait les comptes, aussi.
Na : Oui, c'est surtout, c'est, c'est, c'est
sur toi que c'est resté ça.
Ph : Ouais, mais, euh...
Na : Ouais, ouais, ouais, heu... les fiches
de cuisine, c'est vrai, maintenant que tu dis, oui. Et puis qu'est-ce qu'il
nous avait parlé d'autre ? Je me souviens plus. C'est vrai, queeee,
tu avais su me, me... me toucher au point sensible où ça,
où ça m'intéresserait.
Jm : Il y avait la cuisine. Il y avait
d'autres points sensibles qui t'intéressaient ?
Na : Ben, disons, qu'il y avait Word. Comme
je suis secrétaire de formation, euh... je pensais que ça
m'intéresserait. Parce-que, moi, taper sur l'ordinateur, ça me
plaît, donc, euh...
Jm : Il y avait une idée
professionnelle derrière ? Une utilisation
professionnelle ?
Na : Disons... à cette
époque-là, je travaillais pas... et si j'avais repris mon travail
j'aurais pas eu besoin de Word. Donc, je pouvais pas me douter, à ce
moment-là, que j'en aurai besoin et que professionnellement ça
serait bien. Non, c'était plutôt parce-que j'aime taper à
la machine et tout ce qui en découle et notamment, donc,
l'ordinateur.
Jm : Alors, est-ce que vous avez
déjà eu une expérience de l'associatif ?
Ph : Moi, euh... oui, dans le sport.
Dans le sport en tant que footballeur.
Jm : En tant qu'adhérent ?
Ph : Adhérent, oui. En tant que
sportif.
Jm : Pas de fonctions prises ?
Ph : Ah, non, non, aucune.
Jm : Tu y es encore ?
Ph : Non, j'y suis plus, problèmes de
santé.
Jm : Na, et toi ?
Na : Non.
Jm : Est-ce que vous faites partie d'une
autre association ?
Na : Moi non.
Ph : Actuellement, moi le basket, on va
dire.
Jm : Est-ce que vous êtes venu chercher
quelque chose de précis, autre, que l'informatique même et les
fiches de cuisine ? Est-ce qu'il y avait autre chose de précis que
vous aviez en tête en rejoignant le Club à
l'époque ?
Na : Moi je dirais non parce qu'en fait,
euh... je n'imaginais même pas qu'il pouvait y avoir autre chose.
Ph : (signe de tête négatif)
Jm : Alors, lorsque vous avez
adhéré, quels sont les intérêts que vous avez
trouvé au Club ?
(silence) Des intérêts logistiques,
matériels, les liaisons ?
Na : Oui, oui, oui, oui (Ph faisant mine de
prendre la parole) vas-y.
Ph : Eh ben le matériel, oui. Nous on
n'en avait point à la maison. Donc, euh, au Club y en avait. Ce qui nous
a permit de tripoter un peu l'ordinateur et de nous faire envie. Parce-que par
la suite on s'est équipé parce-qu'on l'avait vu au Club et les
hommes aussi parce-qu'on a trouvé, quand même, de la
compétence malgré la première approche. Donc on a
trouvé Jm, Jc, qui nous a bien...
Na : N aussi, qui faisait l'Internet.
Ph :N, N Ay.
Na : Qui nous a beaucoup aidé dans le
choix de, du matériel.
Ph : ouais, pi, motivation aussi. Il avait su
aussi nous bien, euh...
Na : ...Ouais, il avait su nous motiver.
Jm : Qu'est-ce qu'il vous disait pour vous
motiver ?
Na : Déjà, il était
enthousiaste...
Jm : ...De par sa
personnalité ?
Na : De par sa personnalité il
était...
Ph : ...Par rapport à l'informatique,
hein...
Na : ...Oui, par rapport à
l'informatique. Déjà on sentait qu'il aimait ça, quand il
en parlait, euh... il savait en parler. Et puis, euh... quand on lui posait des
questions, il était toujours prêt à répondre, il
était... toujours près à rendre service. Et c'est vrai que
c'était bien agréable.
Jm : Et ça, ça vous a
plu ?
Na : Ouaip !
Jm : Est-ce que vous pouvez me parler un peu
de vous à l'époque de votre entrée au Club ? Vous
étiez mariés ?
Na : Oui.
Jm : Vous aviez des enfants ?
Na : Oui
Jm : Vous travailliez ? Donc tu ne
travaillais pas Na ?
Na : Moi, je travaillais pas et Ph...
Ph : ...Moi, je travaillais, j'ai toujours
travaillé.
Jm : Vos parents, est-ce qu'ils
étaient engagés dans la vie associative,
déjà ?
Ph : Ben, euh..., ben, euh... moi oui. Ils
sont toujours... bénévol.... en tant que bénévoles
pour une école, euh... à l'école que j'étais,
privée. Il était toujours besoin de bénévoles. Ils
ont toujours répondu présents. pour refaire les... les classes.
Pour les kermesses, les lotos et puis actuellement... actuellement ils sont
toujours dans ce système là, quoi.
Jm : Ils ont des fonctions, non ?
Ph : Non, euh... Si mon père a
été je crois Président, je crois, de classe. Mais je
n'étais plus chez mes parents à cette époque-là.
Jm : Pour résumer : quand tu
étais jeune tes parents étaient déjà engagés
dans la vie associative. Tu as baigné là-dedans ?
Na : Oh oui, et très dynamique...
Ph : ...Oui, mais, euh... oui, mais
c'était en fait plutôt en fait du bénévolat,
c'était pas plutôt « on a besoin de vous
venez », quoi. C'était pas tellement, euh... C'était
pour les écoles, la paroisse, euh...
Jm : C'est ce que tu en
retiens ?
Ph : C'est ce que j'en retiens.
Jm : Et toi Na. ?
Na : Mon papa était Président
d'un club de ski pendant de très nombreuses années. Bien pendant
une dizaine d'années. il a commencé par être
Trésorier. Ensuite il a été, très rapidement, au
bout d'un an ou deux, Président. Il est resté tout le temps, il
s'en est occupé, euh... vraiment à fond. On allait au ski tous
les week-end et, et puis... il avait beaucoup de réunions et j'en avais
quand même retenu que ça lui prenait beaucoup de temps...
(silence).
Jm : Tu l'as ressenti comment ?
Ça te gênait que ton père soit pris ?
Na : Non, parce-que c'était contraire
à son caractère et ça lui faisait beaucoup de bien
d'être dans la vie associative. (rires).
Jm : Bon, alors, aujourd'hui, le Club, c'est
quoi pour vous ? Qu'est-ce que ça représente pour vous
aujourd'hui ?
Na : C'est une question difficile.
Jm : euh... Comment vous le définiriez
le Club, on peut commencer comme ça ?
Na : Déjà, une rencontre... la
rencontre de, de personnes... sur un thème informatique mais...
Ph : ; ... Ce qu'on recherchait,
nous, c'est l'informatique.
Jm : Alors quelle définition vous en
donneriez ?
Na : Club informatique mais ça va plus
loin, je dirais... c'est, c'est... y a... dans ce Club informatique, il y a des
branches et à l'intérieur de ces branches je crois qu'on
s'éloigne un petit peu de l'informatique selon... par exemple
Échap (Littérature, ndlr) et des, des, des branches comme
ça où il y a un petit peu d'informatique mais quand même
des fois on s'en éloigne quand même.
Ph : En fait, oui, c'est un peu, oui...
Jm : Alors, maintenant on va
re-préciser cette question : qu'est-ce que ça
représente pour vous le Club ?
Ph : Qu'est-ce que ça
représente ?
Jm : Oui, hummm... Si vous deviez le
présenter le Club, aujourd'hui, à quelqu'un que vous aimeriez
convaincre pour rejoindre le Club, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Na : D'abord, qu'est-ce que lui il attend et
en fonction de ça qu'est-ce que le Club... est-ce que le Club... Comment
dire ?... peut lui apporter par rapport à ce qu'i souhaite. S'il
nous dit « je recherche... comme nous... pour faire de
l'informatique... j'en ai pas, je n'ai pas d'ordinateur » je lui
répondrai « là-bas tu en as à disposition,
si tu as un problème tu as quelqu'un pour t'aider ». Si
la personne recherche quelque chose, plutôt de convivial je lui dirai
« eh bien là-bas tu peux t'investir... et, euh... proposer
soit un activité, soit faire partie d'une autre
activité... » tout dépend parce-qu'il y a
tellement des branches diverses comme la Bourse. On peut y aller parce-qu'on
aime la Bourse et pas spécialement l'informatique. On peut y aller, dans
certaines branches pas spécialement pour l'informatique. Donc... euh...
pour présenter c'est pas évident parce-que c'est très
divers.
Jm : Justement, d'une manière
générale vous le présenteriez comment ? La
première fois que vous étiez venu on vous a
présenté le Club en général, vous avez retenu ce
qui vous en avait intéressé, c'est-à-dire l'informatique,
à l'époque. Aujourd'hui, après avoir fait un bout de
chemin dans le Club, de quelle manière vous présenteriez le Club
d'une manière globale ? et pour vous ? Parce-que vous allez me
donner les éléments dont vous avez été sensible.
C'est ça qui m'intéresse.
Na : Ouais. Parce-que moi je dirais
aussi : au moment où on a connu le Club et au moment où il
est maintenant, c'est pas le même.
Jm : Justement, comment le
présenteriez-vous aujourd'hui ?
Na : C'est ça le
problème ! C'est que on trouve pas tellement les mots pour arriver
à... C'est pas évident, c'est...
Jm : A ce moment-là, est-ce que vous
pouvez me donner deux, trois expressions qui décriraient le
Club ?
(silence)
Na : Déjà, c'est quelque chose
d'associatif, de, pour, euh... d... q...
Ph : ...Les gens se retrouvent pour une
même idée, en fait. la Bourse i z'y vont pour la Bourse... euh...
en fait c'est une rencontre deeee... Comment dire ça ?...
Na : ...C'est un lieu où on peut
rencontrer des gens....
Ph : ...Non mais, c'est organisé, en
fait, il y a la partie Bourse. Parce-que si t'y vas en dehors de ces... ces
associations... enfin, de ces branches tu vas pas trouver... on va trouver
qu'une personne autour... Par exemple, Lau (notre premier salarié, ndlr)
à l'époque et c'est, c'est... ça fait isolé un peu,
quoi. Comment t'expliquer ça ? C'est-à-dire si tu, euh... tu
veux aller à la Bourse tu vas à la Bourse. Si tu veux...
qu'est-ce qu'il y avait commeeee... (s'adressant à Na) ?
Na : Il y avait Échap...
Ph : Échap. Il y avait la nôtre,
euh...
Na : ...les juniors...
Ph : ...les juniors, aussi. On n'a pas eu
beaucoup de monde donc euhhh...
Na : ... La branche des juniors...
Ph : ...Ouais, la branche des juniors, donc,
les juniors quand ils venaient, bon, apparemment Lau (notre premier
salarié, ndlr) voulait leur faire faire quelque chose, eux ils y
venaient pour le jeux. Ils étaient content d'y venir parce-qu'ils
jouaient. Euh... En fait, c'est trouver les points communs des branches et ces
points communs de plusieurs personnes qu'i viennent y rechercher. Euhmmm...
Na : C'est sur le thème de
l'informatique mais c'est bien diversifié. En fait, à la fin y a
certaines branches...
Ph : ...ouais mais même les jeunes i
z'y venaient pas que pour... Bon, i z'y jouaient beaucoup sur les ordinateurs
mais deux, quand j'y suis allé, i jouaient aux cartes. Donc i
z'étaient contents de se retrouver ensemble, quoi.
Jm : Et vous, qu'est-ce qui vous plaisait au
Club ?
Ph : Ben nous c'était de, de...
connaître l'informatique, euh... approfondir...
Na : ...Voilà, en discuter avec
d'autres personnes. Le fait de parler avec d'autres personnes. De, de mettre en
commun les choses qu'on connaissait et puis surtout d'apprendre, donc, nous de
dire ce qu'on connaissait mais on avait envie de recevoir aussi.
C'est-à-dire que les gens nous parlent de ce que eux ils connaissaient.
Et je dirais même à la limite le plaisir de voir d'autres
personnes.
Ph : Ouais. je vois au boulot, y a un gars
qui s'y connaît bien en informatique, on en parle, on discute beaucoup.
Donc, euh... matériel, deee... de logiciels... dès qu'on a un
plantage, tiens, euh « il m'est arrivé ça,
qu'est-ce qui faut faire ? » C'est ça en fait
dépannage, le... C'est ce que je recherchais dans ce Club en fait.
C'était, euh... « tiens j'ai un
problème... », bon, à l'époque j'en avais
pas à la maison. Mais si, quand j'en avais un à la maison :
« j'ai eu un problème là... » Et pi,
si une personne a eu le même problème que moi j'ai eu, en
discuter. Un peu comme les forums sur Internet, quoi. Encore, les forums sur
Internet j'y vais même pas (rires). Mais c'est vrai que... moi je verrai
le Club comme ça, un forum. (silence) Plus que...
Na : Le problème, c'est que, tout le
monde, mis à part à la même heure que nous et qu'on tombe
pas obligatoirement sur la personne avec qui on aurait envie de parler. Et puis
on trouve pas le problème... on trouve pas toujours la personne
qui est capable de nous répondre... avant L. Après L, c'est vrai
que c'est différent...
Ph : Non c'est, c'est vrai, depuis qu'il y a
eu L c'est... on y allait, on posait une question et... et il arrivait à
nous dépatouiller, quoi...
Na : ...c'est mieux...
Jm : Alors quelles valeurs vous attribueriez
au Club ?
(silence)
Jm : Quelles seraient ses valeurs ?
Qu'est-ce que... j'en reviens à ma question initiale : qu'est-ce
que ça représente pour vous ? Bon, vous disiez tout à
l'heure qu'il y avait une idée de forum, y avait l'idée
« on vient chercher quelque chose, on le trouve ».
Donc y a quelqu'un qui donne, nécessairement, puisque vous venez
chercher quelque chose, quoi d'autre encore ? Quelles autres valeurs il
peut y avoir ?
Na : On était près aussi
à donner nos connaissances...
Ph : ...Ouais, par rap... par rapport...
c'est les forums...
Na : ... ouais...
Ph : ...les forums c'est un échange,
chacun donne ce qu'il sait...
Na : ...ouais...
Jm : La branche CAO (publication
assistée par ordinateur), existait lorsque vous êtes entrés
au Club ?
Na : Non, en tout les cas pas... non, non,
non, même... non... non, non.
Ph : Non.
Jm : Qui c'est qui en a eu
l'idée ?
Na : Nous deux.
Jm : Expliquez-moi ça. Comment vous
avez eu l'idée ? C'est venu comment cette idée ?
Na : Cette idée est venue parce-que
à la maison nous avions grand plaisir d'effectuer des cartes pour les
anniversaires, pour les invitations et faire des calendriers pour Noël.
Plein de petites choses comme ça. On en a fait beaucoup à la
maison. On a trouvé ça très très drôle. Et on
s'est dit que certainement beaucoup de personnes aimerait faire ça.
Qu'on pourrait en discuter ensemble. Qu'on pourrait faire des trucs très
marrants. Donc, euh... nous avons eu l'idée de... de créer cette
branche.
Jm : Bon, comment vous avez fait pour
faire connaître cette branche ? D'abord comment ça s'est
passé pour la créer ?
Na : Nous avons demandé l'autorisation
nécessaire à la Présidence (rire).
Jm : Mais encore ? C'est le
Président seul qui décidait ?
Non, le Président en a parlé lors d'une
Assemblée Générale...
Ph : ...Ouais mais elle était
déjà lancée...
Na : ... Non... non, non... Et c'est à
ce moment-là qu'il a dit...
Ph : ...Ah oui...
Na : ...voilà il y a Ph et N qui
aimeraient faire ça et à la fin de cette Assemblée
Générale, Al et L. (7è entretien, ndlr) sont venus nous
voir et ils ont dit c'est une super idée. on veut bien se mettre avec
vous et être avec vous... euh... pour faire ça.
Ph : Ouais, mais je sais pas si elle
était pas déjà lancée à cette
époque-là. Et peut-être que c'était
ààààà...
(Quelques secondes de débat pour savoir s'il s'agissait
bien de l'Assemblée Générale ou d'un Conseil
d'Administration. Propos non retranscrits. ndlr)
Jm : Vous aviez fait, peut-être,
quelques essais déjà ?
Ph : Il me semble...
Na : Non, je pense pas, non.
Ph : Peut-être pas, ouais.
Na : Non, moi je pense qu'on en avait
parlé, qu'on en avait déjà parlé...
Ph : ...effectivement c'était en
novembre. Ouais, c'était à cette période-là qu'on
en avait parlé.
Na : Non, on en avait déjà
commencé à en parler, c'est certain. On avait déjà
émis l'idée...
Ph : ...Ça avait déjà
intéressé plusieurs personnes et on avait donné aussi les
horaires. Et ces personnes là ça ne les intéressait pas au
niveau de l'horaire. C'était une maman qui...
Na : A savoir si elle serait vraiment venue
c'est une autre question.
Jm : Cette branche que vous avez
créée, elle était organisée de quelle
façon ? C'est vous qui aviez lancé l'idée ?
Ph : Nous, on avait lancé
l'idée. On pensait qu'en lançant l'idée, en fait, que les
gens allaient venir et qu'ils allaient proposer leurs idées...
Na : ...On souhaitait pas être les
moteurs...
Ph : ...On voulait pas, en fait, euhhhh... on
voulait pas guider, on voulait...
Na : ...pas diriger les autres...
Ph : ...voilà, pas diriger...
Na : ...On voulait simplement être un
groupe à décider et pas seulement nous deux.
Jm : Alors comment ça se passait
justement puisque vous souhaitiez que ce soit le groupe qui
décide ? De quelle manière ça se passait
réellement ?
Na : Ben, on était quatre. Alors au
départ on s'est demandé,
ben : « qu'est-ce qui fallait
faire ? » On s'est rendu compte qu'il fallait
peut-être se faire connaître. Ou d'abord d'avoir un, un logo... un
peu représentatif par rapport aux autres clubs.
Ph : On avait fait aussi un article...
Na : ...Un article sur le journal...
Ph : ...le journal...
Na : ...le Bulletin Membre...
Ph : ...le Bulletin Membre...
Na : Donc on s'est penché sur cette
histoire de logo. On en a parlé...
Ph : ...parce-qu'on pensait que cette
histoire de logo allait être déjà le point de
départ, euh...
Na : ...Ça nous semblait, oui. D'abord
exister, physiquement... le fait d'avoir un logo...
Ph : ...et puis chercher à... se
servir des logiciels de CAO, quoi... `fin... PAO (Publication assistée
par ordinateur, ndlr).
Na : ...Chacun choisissait celui qui lui
semblait le plus facile à utiliser.
Jm : Qu'est-ce que, justement entre les
membres, qu'est-ce qui permettait que ça fonctionne bien ?
(silence)
Ph : Ben parce-que, i z'avaient plein
d'idées, pi i z'étaient motivés. Par exemple, Al il avait
déjà fait pas mal de chose, euh, donc, il avait un press-book,
eeet... donc, on avait regardé ce qu'il avait fait. Eeeet, euh, L
(7è entretien), lui, i connaissait rien du tout mais il avait envie de
connaître. Donc, en fait, c'était déjà des gens qui
nous intéressaient. C'était vraiment leeees, ils rentraient
vraiment dans leee, dans l'objectif. Soit des gens qui avaient pleins
d'idées, soit des gens qui voulaient tout savoir.
Jm : Comment ça c'est passé
ensuite ?
Ph : Ben, ensuite, on a recherché
leee, le, l'idée...
Na : ...le logo...
Ph : ...le logo. Ce, on avait fait des
affiches et pi très vite on s'est retrouvés à trois puis
euuuuh... peu de temps après à deux. Na et moi.
Jm : Des affiches pourquoi ?
Ph : Pour se faire connaître dans
le...
Na : ...on les avait affichées dans
les locaux. Là où tout le monde venait lorsqu'on venait au Club.
C'était le meilleur endroit pour se faire connaître. Notamment une
grande banderole que Ph avait fait et L (L. 7è entretien) avait fait
uneee, une très jolie, euh... affiche... eumh, avec pleins de wordart...
en mettant des, des, tout se qu'on pouvait faire...
Ph : Et puis on avait fait aussi des choses
sur Powerpoint...
Na : ...oui...
Ph : ...qu'on avait mis que chacun pouvait y
aller mais pers... apparemment on sait pas si les gens y est allé,
quoi.
Jm : Vous parliez de motivation tout à
l'heure. Ça doit être un élément déterminant
pour que ça fonctionne, pour la conduite de la branche mais est-ce qu'il
y a d'autres éléments déterminants autres que la
motivation qui permettaient justement que la branche tourne, euh...
pendant que vous y étiez, évidemment ?
Ph : Il aurait fallu plus de monde.
Jm : Oui, mais quand vous y étiez, que
ce soit deux, trois ou quatre, pendant le fonctionnement même qu'est-ce
qui faisait que, justement, euhhh... c'était... vous y étiez,
quoi, en fait. Qu'est-ce que, que... qu'est-ce qu'ils faisaient, (en baissant
le ton et prenant un ton jovial) je n'vais pas vous tirer les mots, quand
même !
(rires)
Na : Ben, nous on y était parce-qu'il
fallait qu'il y ait tout le temps, enfin pas une personne responsable mais...
quelqu'un qui s'engage à venir, à ouvrir, à être
là pendant le temps des heures de cette branche.
Jm : Alors, qu'est-ce que ça vous a
apporté personnellement, chacun ? (en m'adressant à Ph.)
Honneur aux dames ? Allez, Na. d'abord.
(long silence)
Na : Ben (bruit buccal se rapprochant de
celui de la succion d'une dent creuse)
(silence)
Na : J'aurais aimé que ça
m'apporte beaucoup plus (rires gênés).
Jm : Alors qu'est-ce que ça t'as
apporté et qu'est-ce que tu aurais aimé que ça
t'apportes ?
Na : Moi ce qui m'a fait plaisir, c'est,
euh... Y a très peu de personnes qui sont venues mais, bon, y a eu... je
crois qu'i s'appelait Ni (un membre du Club), j'ai pu lui indiquer deux, trois
choses et ça m'a fait plaisir de voir que je le dépannais. Par
contre, où j'ai été déçu... ce que j'aurais
aimé que ça m'apporte plus, c'est voir plus de personnes, c'est
voir plus, euh... plus discuter... tout ce qu'on souhaitait, quoi,
c'est-à-dire, euh... Les gens qui sont venus, i sont venus chercher
quelque chose ; il y en a aucun qui est venu pour dire :
« c'est une super idée, j'ai des idées, je viens
avec vous » Ces gens-là, i sont partis, i sont pas
restés. Les seuls qui sont venus c'était juste pour qu'on leur
montre ce qu'on savait. Et malgré tout, nous, euh... o... notre
connaissance est très limitée et on s'est vite rendu compte que
s'il y a personne qui arrivait avec de nouvelles idées... `fin... pas
avec de nouvelles idées mais avec de nouvelles connaissances on serait
vite, euuh... (silence) Et les gens qui venaient, i venaient juste pour, euh...
pour faire ce qu'ils avaient à faire et puis c'est tout, hein. ils
étaient pas plus intéressés que ça.
Jm : Mais toi, personnellement donc ça
t'as apporté quoi ?
Na : Rien, j'ai été
déçu.
Jm : Et toi Ph ? Ça t'as
apporté quoi ? Et qu'est-ce que tu espérais que ça
t'apporterais ?
Ph : Ben, euh... pareil que Na... (à
mon expression et attitude de "c'est un peu commode et facile il reprend en
riant") Non, on en avait parlé... on en avait parlé ensemble.
Ph : Non, non, non, mais, euh... c'est ce
qu'on souhaita... Moi, ce que je souhaitais c'était, ouais... qu'il y
ait plein de gens qui viennent. Puis... soit des gens qui, euh, qui disent
« bon, j'ai une carte à faire avec quelqu'un, je sais pas
par ou, euh, prendre par ou la prendre, ch'sais pas quoi faire, euh... j'ai des
idées mais ch'ais pas les retranscrire sur
l'ordinateur ». C'est ce que, moi, je pensais qu'on allait
amener en fait. Les gens avaient leurs idées et nous on va leur dire
« peut-être en faisant comme ça, en prenant tel
logiciel, euuh... un clipart, par-ci, par-là,
euhhhh... ».
Jm : Tu aurais aimé que ça
t'apportes ça ?
Ph : Bein... c'est ce que je pensais que
ça allait faire. Que ça allait marcher comme ça, quoi.
Jm : Qu'est-ce que tu aurais aimé que
ça t'apportes et qu'est-ce que ça t'as apporté
réellement ?
Ph : Ben, ça m'apporte, euhhh...
ça m'apporte... euh... j'ai pas pensé... non. Quand on a fait ce
truc, je pensais pas...
Jm : Vous cherchiez bien quelque chose ?
Vous aviez bien envie de faire quelque chose ?
Na : Le plaisir de, de, de parler avec
d'autres personnes, de la rencontre, de... de, de pouvoir discuter de ce qu'on
avait envie et de ce qu'on aimait surtout...
Ph : ...Ouais...
Na : ...Et cette rencontre n'a pas eu lieue
telle qu'on l'a souhaité (rires gênés).
Jm : Qu'est-ce qui a fait arrêter la
branche, alors ?
Ph : Ben, le, le peu de branche qu'y avait et
puis...
Jm : Ça, vous auriez pu continuer tous
les deux...
Na : Lassitude.
Jm : Lassitude ?
Na : Ouais.
Jm : Tu entends quoi par lassitude ?
Na : Venir et qu'il y ait personne.
Ph : Si, il y avait deux personnes, enfin,
à la fin il y avait une personne : D... (membre du Club).
Na : ...Et à la fin il venait juste
pour faire ce qu'il avait à faire et il était même plus
avec nous. Et même certaines personnes en ont profité pour venir
pendant notre branche pour faire autre chose. Donc on avait vraiment
l'impression (en appuyant fortement les mots) de servir strictement à
rien.
Ph : Ouais, c'était, ouais, euh... les
heures étaient faites pour la PAO et y avait d'ot' personnes qui
venaient pour faire autre chose, quoi.
Na : Ou qui avaient l'activité
suivante et qui arrivaient une demi-heure avant pour pouvoir avancer sur leur,
euh... Je veux dire ça nous gênait pas puisqu'il y avait personne,
il faut être honnête mais c'est vrai que c'était très
frustrant pour nous.
Jm : Donc c'est ça qui a fait
que...
Ph : et pi l'ars... des fois dessss sourires
narquois, euh...
Na : Sans citer de nom des gens qui
arrivaient en nous disant (prendre un ton ironique) « oh, y avait
personne encore aujourd'hui » ou dans ce style là. (Sur
le ton de l'agacement) C'était très désagréable...
Je ne citerai pas de nom... promis... (rires) Non, parce-qu'on lui en veut pas
du tout. il avait peut-être pas tord.
Ph : Mais on pensait que ça allait
intéresser, euh... une multitude de personnes puisqu'il y a cent
membres, je crois... dans le...
Jm : ...147...
Ph : ...A l'époque il y en avait cent,
une centaine... donc on s'était dit si on touche dix, quinze
personnes...
Na : ...On aurait été
ravi...
Ph : ...c'était super quoi. Mais...
euh... ça a pas touché dix, quinze personnes. Ça en a
touché deux. Et ils sont viteeee...
Jm : Le résumé est lequel, le,
le résumé il est sur cent personnes il y a 20% de
bénévoles. Sur 20% de bénévoles si vous touchez 10%
ça fait deux...
Na : ...C'est nous... (rires)
Jm : ...Vous les avez eu...
Na : ...C'est nous, on en a eu deux...
(encore rires)...
Jm : ... Vous avez eu les 10% des 20% des
cent personnes. Les 80% restant sont des "consommateurs".
Na : Ben oui. Mais ils auraient pu consommer,
nous demander quelque chose au moins une fois pour nous faire plaisir. Ils ont
même pas consommés.
Ph : (de reprendre) Ils ont même pas
consommés.
Jm : Si vous aviez eu un créneau
horaire avec la disponibilité de locaux et du monde. Du monde je sais
pas ce que ça veut dire parce-que vous auriez très bien pu
continuer. Vous avez acheté du matériel aujourd'hui ?
Na : Oh oui !
Jm : Donc, vous auriez pu continuer, euh, si
vous n'aviez pas eu le matériel vous auriez pu continuer au Club, tous
les deux. Ne serait-ce que pour faire, euh... continuer à faire des
faire-parts, des cartes de visites, etc.
Na : Non !
Ph : Ben, on a du matériel à la
maison.
Jm : Il n'y avait pas que le monde.
Na : On préférait avoir le
matériel à la maison. Ah oui, on préfère parce-que
c'est plus facile...
Ph : On a le matériel à la
maison, donc euh, on, on le fait à la maison. L'a... l'activité
c'était, euh...
Jm : Vous préférez être
tout seul, vous. Vous ne recherchez plus cette échange avec les autres,
les autres idées et autres choses ?
Ph : Ben, y a personne...
Jm : Quand vous êtes partis il n'y
avait plus personne.
Ph : Non, il y avait plus personne quoi.
Na : Disons qu'on en discute avec les amis,
autour de nous. Tout le monde en fait un petit peu chez lui et puis, ensuite,
chacun... on le fait avec nos amis, en fait. Qui eux ce sont mis à
l'informatique...
Ph : ...Oui mais on pensait que ça
allait, euh... ça allait faire un peu pareil, quoi...
Na : ...Ouais... Mais là...
Ph : ... Vu, euh, euhmmm, autour de nous, les
gens qui z'ont un ordinateur, bon, pas tous quand même, mais, euh... la
plupart...
Na : ...Ouais, il sont motivés...
Ph : ...Ils sont motivés à
faire des trucs comme ça, comme nous, quoi.
Jm : ...Est-ce que vous pourriez me donner un
ou deux exemples de motivation ? Ça fait plusieurs fois que vous
parlez de motivation. Je sais pas bien ce que ça veut dire moi. Est-ce
qu'ils sautent au plafond quand vous vous voyez, est-ce qu...
Na : ...Non, à chaque fois qu'on se
voit « j'ai essayé de faire ça, j'y suis pas
arrivé, Ph ou Na, qu'est-ce tu en penses ? ». Par
exemple, j'avais besoin de faire un article sur Word ou une brochure parce-que,
bon, il a raison...
Jm : L'attitude des gens était
comment ? Te poser des questions c'est une chose mais l'attitude
était comment ?
Ph : Ben, par exempl...
Na : ...on se retrouve devant l'ordinateur
(rires) très rapidement.
Jm : On est enthousiaste, euh...
Na : Oui. Oui, les gens aiment bien.
Jm : Ou « j'en peux
plus...
Na : ...Non...
Jm : ...est-ce que tu peux me
dépanner ? »
Na : Non, non.
Ph : « Viens voir ce que j'ai
fais aussi, euh...
Na : ...Ouaip. « Viens voir ce
que j'ai fais, je bloque là-dessus, qu'est-ce que tu en
penses ? », euh... on s'envoie beaucoup de mail, aussi...
On...
Jm : ...Attendez, d'accord pour les
questions, d'accord pour les problèmes qu'ils pourrait y avoir. Moi, ce
qui m'intéresse c'est l'attitude des gens. C'est comment ils
réagissent ?
Na : Ils sont demandeurs...
Jm : ...Je veux dire : ils sautent
jusqu'au plafond, il font quoi quand vous vous voyez ? Vous dites
« ils sont motivés ». Motivés,
ça veut dire quoi ? Ils sautent au plafond, ils en rient, ils
frappent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à trois
heures du mat' ils sonnent « j'ai un
problème » ? Je pastiche mais c'est ça que
j'aimerais savoir. C'est comment ça se caractérise cette
manifestation au delà de la question même de l'informatique.
Comment ils réagissent, les gens ?
Na : (Bafouillant un instant des oui et des
non puis recouvrant ses esprits :) Ils ont, ils ont très envie
d'apprendre, ils ont très envie de, de savoir comment se servir du
matériel. Ils ont très envie de savoir comment se
débrouiller seul pour faire telle ou telle opération. Donc ils
nous demandent une fois, ensuite ils savent le faire. Ensuite ils recherchent
une autre opération à faire...
Ph : ...Oui, mais, bon, même, il y a
pas que nous...
Na : ...Ah non, non c'est un échange,
c'est un échange. Lorsque nous on essai par exemple de, de, je sais pas,
je vais dire n'importe quoi, de créer un fichier, de faire quelque
chose, on y arrive pas, on en discute entre nous. « Comment tu as
fait, toi, quand tu t'es trouvé devant ce
problème ? » « J'ai réagis
comme ça, ça a pas marché. »
« Et toi ? » « Moi, j'ai fais
ça et ça a marché ». Donc, on en
discute.
Jm : Alors, qu'est-ce qui se passe au sein,
quand vous étiez au Club, hein, qu'est-ce qui se passait qui ne relevait
pas de l'informatique même, entre les gens ?
(silence)
Ph : Ben, on discutait deeee... oui, de temps
en temps, on discutait de, d'autres choses que de l'informatique, euh...
Na : ...Très peu...
Ph : ...On était vraiment
là-bas pour l'informatique.
Jm : Est-ce que vous pouvez me donner deux,
trois expressions pour décrire le Club ? Le Club c'est ça,
c'est ça...
(long silence, regards croisés entre Na & Ph)
Na : Ben, euhhhhh... (nouveau long silence)
Pour moi le Club c'est, c'est... lorsqu'on est vraiment débutant c'est,
c'est un cl... comme pour nous...euh... c'est, c'est bien, c'est
l'idéal.
Ph : ...Détonateur...
Na : ...Voilà, c'est, c'est un...
voilà, ouais, le mot est...
Jm : En informatique ?
Na : ...En informatique
Jm : Donc, vous décririez le Club
que... uniquement sous l'angle informatique ?
Ph : Tu veux nous faire dire quelque chose,
c'est... Qu'est-ce que tu veux nous faire dire ? Dis-nous le.
(rires)
Na : Ben, c'est, c'est aussi une association
quelque part. Je sais pas. Y a des gens, c'est la rencontre, quoi.
Ph : Ton idée du Club s'était,
euhhh... un échange, en fait, c'était, euhhhh...
Jm : Pas mon idée, comment vous le
décririez, vous ? Est-ce que vous avez deux ou trois expressions
pour le décrire ?
(silence)
Jm : Comment l'avez-vous
perçu ?
Ph : Ben moi je l'ai perçu comme un
détonateur.
Jm : En informatique ?
Na : Toujours. Oui, mais c'est vrai que... la
partie... euh... on n'a peut-être pas assez participé à la
partie... euh... Comment dire ?... euh... sociale du Club.
C'est-à-dire organiser... Quoique si, Ph, toi tu as, tu y es allé
une fois ou deux à Valence2 ou des choses comme ça pour euh...
Mais c'était vraiment occasionnel, quoi, je veux dire, cette
partie-là on l'a pas...
Jm : Social. Il y a une partie sociale au
Club ?
(silence)
Na : Ben... euh...
Ph : ...Ben, oui, euh... quand tu veux...
quand il y a une branche Échap, par exemple, c'est une partie sociale
ça.
Jm : C'est-à-dire une partie
sociale ?
Ph : Eh ben, Échap c'était des
chômeurs qui se sont retrouvés pour écrire un livre. Donc,
on...
Jm : ...On est aussi un Club informatique,
hein ?
Ph : Oui...
Jm : ...Comment vous expliquez que des gens,
dans un Club informatique viennent pour écrire un livre ?
Na : Ils ont dû peut-être se
connaître au sein du Club informatique grâce au Club informatique
et puis quelque part de l'informatique on peut, on peut partir de ça et
faire d'autres choses.
(silence) C'est pas évident, c'est vrai qu'il y a
certaines branches qui sont pas très éloignés de
l'informatique...
Jm : ...Vous disiez qu'il y avait une partie
sociale, donc cette partie sociale si vous en parlez c'est que, euh... vous
vous êtes aperçu de quelque chose. Vous vous êtes
aperçu de quoi dans ce Club ?
Na : Ben qu'il y a des gens qui travaillent
bénévolement. (silence) Qui s'investissent, qui, qui... ben pour
moi, ça c'est du social : s'investir dans un Club comme
ça... parce-que c'est, c'est... c'est tout bénévole
quoi... On n'en retire rien de financier mais malgré tout les gens,
quand même s'investissent... (silence) On passe du temps...
Jm : Alors, qu'est-ce qui vous a
particulièrement marqué dans vos relations avec les autres, dans
le Club ? Que se soit dans la branche, dans le Club même. Ou alors,
à l'occasion d'une manifestation ? Ou à l'occasion de
réunions ?
Na : On a eu l'occasion de rencontrer des
gens sympas...
Ph : ...On était content de se
voir...
Jm : Mais qu'est-ce qui vous a
particulièrement marqué ? Je sais pas moi : quelque
chose qui vous a choqué, qui a pu, euh... vous étonner
agréablement...
Ph : Choqué, ouais, les informaticiens
sont froids d'une manière générale.
Jm : Non mais dans la relation avec les
autres ?
Ph : Oui, justement... ben...euh...
Jm : Ils sont froids...
Ph : Si on leur rentre... `fin pas entrer
d'dans, mais si on leur déclenche pas nous-mêmes, euh...
Na : ...la conversation...
Ph : ...la conversation, euh... c'est pas eux
qui viennent vers nous, quoi. `Fin ce qu'on a vu, hein, en règle
générale au Club, en fait... C'est ça...
Jm : Vous disiez tout à l'heure qu'il
y avait une partie sociale, il n'y a pas que des informaticiens alors ? En
dehors des informaticiens, dans la relation... je parle d'une relation, d'une
relation pas nécessairement informatique... une relation classique... Le
fait de dire « bonjour, ça va ? » est
déjà une relation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a
particulièrement marqué ? Est-ce que l'attitude de quelqu'un
vous a choqué ? Est-ce que une idée vous a paru
extrêmement intéressante au sein du Club, même si vous n'y
avez pas adhéré (à l'idée, ndlr) ? Je veux
dire : est-ce que vous avez été curieux de ça ?
Quelque chose qui vous a marqué ?
(silence)
Ph : Ouaf, non, j'ai pas
été...
(silence)
Na : Moi, j'ai été, enfin
ch'ais pas... j'ai vu des gens enthousiastes, ça ça m'a
marqué parce-que j'ai...
Jm : Sur quoi ?
Na : Sur ce qu'ils f'zaient.
Jm : Oui, mais quoi ?
Na : Ah, par rapport à l'informatique,
toujours, ils étaient enthousiastes deee... quand on en parlait ils
étaient.... (rires et silence) ...plein de vie. Mais bon, je crois, en
fait, qu'en dehors de l'informatique on n'a pas vraiment parlé... on n'a
jamais même parlé de notre vie privée ou quelque chose
comme ça avec d'autres membres du Club.
Jm : Bon, alors, vous, au niveau de votre
branche, au niveau de l'informatique, alors, quels ont été les
moments forts.
Na : Les deux premières séances
lorsqu'on était quatre. C'est tout.
Jm : C'était fort ? Est-ce que
vous pouvez me donner deux ou trois exemples justement... de ces, de ces moment
forts ?
Na : Euhhh... On a eu l'impression que les...
Al et L (L. 7è entretien) avaient tellement d'idées et
étaient tellement motivés que ça allait être
génial. C'étaient les premières impressions et elles
étaient très très bonnes. On s'est dit
« chouette, on forme une super équipe ».
(silence).
Jm : Et puis ?
Na : Et puis l'équipe, elle a
été vite par terre.
Jm : Non, je veux dire, et puis, est-ce qu'il
y a eu d'autres moments forts ?
Na : Non, après, je dirais ça a
été, euh... de plus en plus, euh... de moins en moins bien.
Jm : de moins en moins bien ?
Na : Ouais.
Jm : Et ça c'était dû
à quoi ? Pourquoi ils sont moins venus ?
Na : Pour les, enfin, professionnel. `Fin,
pas professionnel, familial. Il a eu une petite fille, un petit garçon
d'ailleurs, je sais plus, il pouvait plus venir Al. Et puis L est parti, euh...
au Maroc.
Ph : L est parti au Maroc.
Jm : Alors, qu'est-ce que vous retenez de
votre participation au Compu's Club ?
Na : On a essayé. Ça n'a
pas marché.
Jm : C'est ce que vous retenez ? Toi
aussi Ph ?
Ph : Ouais, ouais, ben oui.
Na : on a été... ouais... on a
été quand mêmeeee... On a essayé de tenir mais
euh... la motivation est partie et vraiment bien partie.
Jm : Hum, Est-ce qu'il y a quelque chose qui
a, qui a changé chez vous après le passage au Compu's Club ?
(j'insiste pour "meubler" le silence) Le fait d'avoir eu cette
expérience, négative apparemment, est-ce que quelque chose
à changé chez vous ? (nouveau silence, nouvelle insistance)
Est-ce que : « les associations, c'est fini, je ne
m'investis plus » ? Est-ce que vous avez dit :
« bon, il faudrait voir dans un autre domaine »,
est-ce que vous vous êtes dit : « ah bé, tiens,
j'ai voulu évoluer en informatique, je me suis acheté une
bécane » ?
Na : Oui, ben...
Jm : Qu'est-ce qui a changé ?
Na : Maintenant l'informatique on le fait
à la maison. On est aussi bien.
Jm : Oui, et puis ? Qu'est-ce qui a
changé d'autre ? Au travail maintenant tu frappes, tu travailles
maintenant ?
Na : ouais, et... je m'en sers tous les
jours.
Jm : Donc, ça t'as servi de passer au
Club, ça t'as permit de, dans ton travail, euh... de l'utiliser.
Na : Oui, j'pense pas que ce soit ce que j'ai
appris au Club.
Jm : Non. Par toi-même ?
Na : Par moi-même.
Ph : Par Ph, aussi, puisqu'il t'as
tiré.
Na : Oui. Ah oui, oui, oui, c'est ç...
en fait ce que, ce que j'apprécie de Ph c'est qu'i... en fait il m'a
tiré, il m'a donné le, le, le goût et maintenant que je
l'ai, je fais partie des accros.
Jm : Donc, ça a
changé ?
Na : Ouais !
Jm : Donc voilà quelque chose qui a
changé !
Na : (tonitruant) Voilà !
Jm : tu as été attirée
vers...
Na : ...Ouais !...
Jm : ...maintenant tu...
Na : ...j'adore ça...
Jm : ...tu adores ça ?
Na : ...Ouais !
Jm : Voilà quelque chose qui a
changé !
Na : C'est ce que je retiens le plus du Club,
c'est que ça m'a permit, ça m'a permit de taper sur les
ordinateurs. De me rendre compte que j'aimais ça... eeeeet... de laisser
Ph d'acheter l'ordinateur... Et ça vraiment c'est super !
Jm : Qu'est-ce que tu as aimé le plus
en informatique ? C'est quoi ? C'est d'appuyer sur des touches ?
C'est de voir quelque chose à l'écran ? C'est de voir qu'une
réalisation se fait ?
Na : De créer, de faire, bon, ben,
euh.... Quand je suis sous Windows, de faire mes petits fichiers. Lorsque je
suis sur Word d'arriver à faire ce que j'ai envie. Euh...
connaître les autres logiciels que je ne connais pas. Et puis... euh...
Arriver à faire ce que je souhaite. J'sais pas si je suis claire mais
lorsque j'ai envie de créer un document, lorsque j'ai envie de,
d'organiser mes fichiers d'une certaine façon, je veux pouvoir y
arriver. Et tant que j'y arrive pas il faut que... que j'trouve soit quelqu'un
qui m'explique, soit que je me débrouille.
Ph : Dans la vie, aussi, tous les jours.
Na : Ouais. Ah oui.
Ph : Pour euh...
Na : ...Je fais toutes mes lettres, perso.
Jm : Donc çaaa changé à
ce niveau là aussi. Dans la vie courante vous utilisez aussi
l'informatique ?
Na : Oui.
Jm : C'est quelque chose que vous ne faisiez
pas avant ?
Na : L'ordinateur, on peut dire qu'il est
allumé tous les jours. Il passe pas un jour sans qu'il soit
allumé.
Jm : Et pour toi, Ph, qu'est-ce qui a
changé ?
Ph : Ah, ben pour c'est pareil, aussi. Ah
oui !
Jm : Vous avez mis les enfants à
l'informatique ?
Na : Les enfants, ils font les jeux, les jeux
d'éveil et puis les jeux... moins d'éveil si je puis dire
(rires). Mais bon, euh...
Ph : Ça remplace la Playstation.
Na : Ouais.
Jm : Et donc, qu'est-ce qui a changé
pour toi ?
Ph : Ben moi pareil. Je connaissais rien en
informatique.
Jm : (Je fais une moue convenue) C'est un peu
facile.
(rires)
Ph : (en riant) on est marié pour le
meilleur et pour le pire (rires). Non, non, mais, euh... Moi je connaissais
rien en informatique maintenant je su... je navigue, quoi, je, je, euh...
j'arrive à... à...
Na : Tu as beaucoup, beaucoup
progressé.
Ph : Oui, euh... bien progressé,
oui.
Na : Il fait des choses que moi j'fais pas,
hein. Mais pas sur le même domaine.
Ph : Ouais, même maintenant j'arrive
à...
Na : ...Lui, il va plus gratouiller...
Ph : ...démonter l'ordinateur...
Na : ...Il va plus gratouiller, alors que moi
je gratouille pas du tout.
Ph : Mais par rapport, comme je te l'ai dit
tout à l'heure, au boulot, euh... l'échange entre
collègues.
Jm : Ça a permit un relationnel au
niveau professionnel que tu n'avais peut-être pas avant ?
Ph : Ben, avant je l'avais pas parce-que,
bon, je connaissais rien, donc, euh... j'en parlais pas, quoi. Je savais pas de
quoi ils parlaient, euh...
Jm : Vous aviez une conversation commune,
ça t'as permit de t'intégrer auprès de personnes que tu
n'avais pas nécessairement un contact avec eux dans un autre domaine.
Ph : Non, mais je les connaissais pas
à l'époque. j'ai tendance à souvent changer de...
boulot.
Jm : Alors, la dernière
question : Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le
Club ? (me précipitant) Ph d'abord.
(éclats de rires)
Jm : Comme ça, tu ne pourras pas dire
« moi, pareil » !
(rires)
Ph : Pour améliorer le Club ?
Ben, ch'ais pas s'il a vraiment besoin d'être amélioré
parce-que, euhhh... Il est parti en fait sur une idée que... nous...
c'est pas notre idéal.
Jm : Bon alors : quelle est
l'idée du Club et quel était votre idée ?
Ph : Ben, l'idée du Club c'est, euh...
Comme tu disais tout à l'heure, du social...
Jm : Moi, je n'ai pas dis ça. Vous,
vous avez dit ça.
Ph : Tu nous l'a fait dire.
Jm : (moue dubitative)
Ph : Siii, euh... Sois honnêteee
(rires)
Jm : Si tu veux on réécoutera
la bande ?
Ph : Ça il faudra qu'on
réécoute. Euhhh.... C'était assez malin.
Jm : Alors si vous avez dit ce que je voulais
entendre vous avez triché avec moi ?
Ph : Bon, euh de faire plusieurs branches.
Moi c'est pas ça que je recherchais au Club. C'était
plutôt, euh, donc, euhhh... un échange de... soit de montage
d'ordinateurs, soit de parler des logiciels, parler informatique, en fait.
Jm : Alors l'idée du Club. Tu
étais parti sur l'aspect social, tu peux préciser cet aspect
social ? Je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tout à
l'heure... avec la réflexion, un peu de recul, peut-être,
maintenant des idées te sont venues ? L'idée du Club n'est
pas celle de... n'était pas notre idée.
Ph : Oui, c'était regrouper, euh...
Plusieurs personnes tour... Plusieurs personnes autour d'un thème. Mais,
euh... pas l'informatique, en fait, c'est euh... plutôt... Bon, par
exemple la Bourse. Regrouper des gens qui aimaient la Bourse et se servir de
l'outil informatique. C'était ça en fait... c'est
là-dessus, l'idée du Club. Et pour, euh..., l'autre... y a, y a
quoi Comnet, aussi ?
Jm : Ouais.
Ph : ch'suis jamais allé à
Comnet mais je pense que c'est... euh, Internet. Bon, ben ça en
informatique c'est... Euh... bon... qu'est-ce qu'y a ? Bon, Échap,
c'est, euh...
Jm : Oui, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il
faudrait faire pour améliorer le Club et que ça corresponde
à vos idées ?
Ph : Eh ben, justement. Est-ce qu'il a besoin
d'être amélioré ? parce-queeee... il nous convient
pas ?
Jm : J'ai pas dit qu'on allait
l'améliorer parce-que vou...
Ph : Ouais.
Jm : Seulement, qu'est-ce qu'il faudrait
faire pour l'améliorer.
Na : C'est embêtant, en fait, parce-que
chaque personne vient au moment où ça lui semble, bien sûr,
le plus facile. Et on peut arriver, qu'on arrive et qu'il y ait plus
d'ordinateurs disponibles.
Ph : Les locaux, maintenant, sont plus
grands ?
Jm : Justement, qu'est-ce qu'il faudrait
faire pour l'améliorer ?
Ph : Faire les...
Jm : Dans les locaux ?
Ph : Non, non. Les branches et faire en
même temps les libres-services mais pas dans la même salle. `Fin,
ch'ais pas comment c'est possible...
Na : Ben, disons que ce que tu veux dire
c'est que les gens puissent prêter un oeil ou une oreille...
Ph : ...Ouais...
Na : ...à ces branches pour pouvoir
s'y intéresser. Parce-que les gens i viennent en libre-service, les
branches c'est pas à cette heure-là. Donc, ils savent même
pas, i z'ont, y z'ont même pas l'idée de dire
« tiens, je vais aller voir... dans cette branche... ce qu'on y
fait ». Alors, peut-être si c'était juste à
côté je pense que c'est l'idée que tu veux émettre
(s'adressant à Ph), ils prêteraient une petite oreille, un petit
oeil et ils se rendraient compte que finalement ça les
intéresse...
Ph : ...C'est peut-être un peu...
Na : ...puisqu'en fait les gens, i viennent
en libre-service ; c'est à ce moment-là que peut-être
il faudrait les... (court silence)
Jm : Permettre un brassage, quoi ?
Ph : V'là.
Na : (en même temps) Voilà.
Ph : C'est ce qui nous a peut-être un
peu desservi nous : c'est qu'on était à des heures à
part, donc, euh... Les gens, si ils voulaient voir la CAO c'était
à ces heures-là et... pas à une autre heure quoi.
Na : Et des fois c'est pas facile de prendre
sur soi et de dire : « je vais aller voir dans cette branche
ce qu'il se passe » Alors que si on y va naturellement, en ayant
aucune idée : « tiens, finalement, cette branche est
pas mal ! ». (silence) Voilà. Mais c'est
peut-être pas évident à gérer non plus.
Jm : Est-ce que... Qu'est-ce qu'il faudrait
encore faire pour l'améliorer ?
Na : pfouuuu (sifflement pendant la
prononciation du pfou) de toutes façons je pense que... motiver les gens
c'est pas évident. Donc, euh... pour les faire venir, euh...
Ph : De toute façon,
déjà, il était pas mal ouvert. Les horaires étaient
le plus tard possible...
Na : Les horaires était
déjà quand même assez large. Surtout le soir parce-que la
plupart des gens, quand même travaillent. Ils sont
intéressés le soir. Les horaires étaient largement
convenables. Donc, euh... au niveau des horaires je pense qu'il n'y a pas grand
chose à changer.
Jm : Vous avez reçu le dernier
Bulletin Membre ?
Na : Oui, je crois. (en regardant Ph)
Ph : Oui, oui, oui.
Jm : Vous l'avez lu ?
Na : Oui.
Jm : Entièrement ?
Na : Non, que ce qui m'intéresse.
Jm : Alors quels sont les
éléments qui vous intéressent ?
Na : Je m'en souviens plus. Il faudrait que
je l'ai sous les yeux pour, euh... pour voir ce que j'ai lu.
Ph : Il est là.
Jm : (avant qu'ils n'attrapent le Bulletin
Membre) Ça fait rien, de mémoire.
Ph : oh bé, euh... On a trop de...
Na : y a peut-être trop de choses qu'on
lit, peut-être. Beaucoup de choses. Non, généralement,
euh... je vais être un petit peu... je prends pas
généralement ce qui est trop long. Parce-que j'ai pas le courage
d'aller jusqu'au bout. Je pre... j'ai lu, bon, béh, ce qu'il y avait sur
notre branche. Sur les autres branches, généralement, je lis
assez facilement, euh... les p'tits, les p'tits résumés qu'il y a
sur les branches. Et puis, le p'tites, les p'tites astuces ou les p'tites
choses comme ça. C'est vrai, ce qui est assez vite lu, faut
reconnaître. Et pi je regarde le titre et en fonction du titre je
décide ou je ne décide pas de lire. Donc, il faut (rires) faire
très attention au titre.
Ph : Ouais. Il y a eu sur le Bulletin Membre,
les start up, là...
Jm : ...Oui ?
Ph : ...C'était intéressant,
ça.
Jm : ...Oui ?
Ph : J'ai lu ça. Euhhh...
Jm : Mais c'était un article long,
ça.
Ph : Ouais, c'était un article
long...
Na : Oui, mais la... on lit le titre et on
décide si on décide de lire ou pas.
Ph : Voilà. En fait Start up, en fait,
bon, ben, ça... on en parle beaucoup médiatique, aussi. Eeet
donc, euh... on sait pas trop ce que c'est exactement et...
Jm : Ph ?
Ph : Oui ?
Jm : A la question, euh... qu'est-ce qui vous
fait rester ?... au moment du questionnaire, là, qu'il y a eu six
ou neuf mois, tu avait marqué l'ambiance. Pourquoi tu n'en as pas
parlé ?
Ph : Si j'en ai parlé à un
moment donné.
Jm : Alors c'est quoi l'ambiance ?
Ph : L'ambiance, c'est se retrouver pi
discuter informatique. Entre nous.
Jm : D'accord. et tu avais parlé,
aussi, de ce que tu étais venu chercher. Tu étais venu chercher
l'ambiance, bon au niveau informatique, un échange, en informatique je
suppose, et une camaraderie.
Ph : Ouais. Ouais, on l'avait retrouvé
avec L (L. 7è entretien, ndlr), euh B, euh...
Jm : Est-ce que tu peux me préciser
cette camaraderie ? Quels sont les éléments qui font qu'il y
a eu camaraderie ?
Ph : (silence) Ben, euh... on parle deeee...
On échange de choses qu'on aimeee... euh... des choses en communs,
quoi.
Jm : Ouais. Vous vous tapez dans le
dos ? Euh... « Comment tu vas ? »
Ph : Euh, non, c'était pas à ce
niveau...
Jm : Alors c'est quoi camaraderie ?
Ph : (silence) Ben euh... c'était
ça, avoir un échange de... choses.
Na : Avoir du plaisir à discuter avec
quelqu'un. Se sentir sur le même piédestal, quoi. Parler de la
même chose.
Jm : Tu, tu es du même avis que
Na ?
(rires)
Na : Ben, oui c'est la même chose.
Jm : Non, j'ai besoin que... qu'il me le dise
avec ses mots. Le mariage, je crois que c'est 1+1=1, hein ?
Ph : Ouais, je crois, hein. Là,
là c'est.... C'est ce qui s'est passé.
Jm : Eh bien, euh, Na tu a marqué la
même chose : un échange, une camaraderie. Alors, pour toi, la
camaraderie, c'est quoi ?... ...Des grandes claques dans le dos ?
Na : Non, non, non. Moi, c'est que quelq...
La personne qui est en face de moi ait les mêmes sujets de conversation.
Ait envie de parler de la même chose que moi. Que je trouve cette
personne sympathique, euh... que j'éprouve du plaisir à la voir
et à discuter avec elle. Pour moi, c'est ça la camaraderie.
Jm : A la question : est-ce que tu es
contente de, de venir au Club tu avais marqué "oui" et tu l'expliquais
par les échanges d'idées et rencontrer d'autres personnes. C'est
toujours lié à l'informatique les échanges
d'idées ?
Na : Oui.
Jm : Uniquement ? Il n'y a pas d'autre
idée, euh... et rencontrer d'autres personnes c'est uniquement
informatique, aussi ?
Na : (silence) Bon. En fait on est
allé dans un club informatique pour parler informatique. Parce-qu'on n'a
pas, entre guillemets, l'occasion de le faire à un autre moment avec,
avant, avec d'autres personnes. Donc, c'était un endroit où enfin
on pouvait parler informatique avec des gens qui allaient comprendre et qui
allaient avoir envie de parler de la même chose que nous.
Ph : On savait pas le parler au
début.
Na : Non, mais on a vite appris.
Jm : Il y a quelque chose que vous aimeriez
rajouter dans votre relation avec les autres, sur l'image du Club, les valeurs
du Club, euh...
Na : Je dirai par rapport à ton, au
questionnaire dont tu parles, il a été fait à un moment
où... au niveau de notre branche de CAO on en était, euhhh...
peut-être... On n'avait peut-être pas commencé, je sais pas,
je ne me rappelle plus quelle période c'était. On dirait que au
moment où on l'a rempli on était peut-être plus positif que
ce que l'on, que ce que l'on aurait été, euh... à la fin
de notre lassitude de, de branche. je dirais qu'on n'aurait pas réagit
pareil et que, au départ, on venait en libre-service et qu'à la
fin, vu qu'on avait notre, notre branche, on venait plus au libre-service, on
pouvait pas se permettre, on n'avait pas le temps. Et ça, ça nous
a cassé quelque chose. On s'était dit...
Ph : On se retrouvait que deux et avec le
libre-service on retrouvait plus de gens. on se voyait plus après.
Na : Voilà, il y avait plus tout ces
gens, toute cette ambiance, toute cette camaraderie, tout ça n'existait
plus et je pense que ça nous a pesé.
Jm : Et pourtant il y avait bien des
informaticiens, là...
Na : Ah, non pas dans notre branche, hein. Il
y avait personne.
Ph : En CAO ? Non, mais quand on faisait
la CAO, bon on a pris du temps, bon, le mardi soir et après on pouvait
plus prendre du temps...
Jm : Aux autres heures, alors ?
Ph : Aux autres heures.
Jm : Vous n'avez jamais été
dans...
Na : On a plus pu aller...
Ph : On n'a plus pu aller...
Jm : Vous n'êtes plus allé dans
un libre-service depuis que vous étiez dans cette branche ?
Ph : J'allais en libre-service, je crois, un
quart d'heure pour voir Lau (le premier salarié du Club, ndlr), pour lui
dire, euh... faire des trucs, faire passer l'information, quoi. Lui faire
passer des informations.
Jm : Tu disais que « ça
nous a cassé quelque chose ». Quoi ?
Na : Ben, l'envie de rencontrer des gens. on
a arrêté de...
Jm : Mais qu'est-ce que ça a
cassé ? Ça, c'est la conséquence de... quand quelque
chose a cassé, la conséquence c'est que vous avez
arrêté.
Na : Ouais.
Jm : Mais, qu'est-ce qui a
cassé ?
(silence)
Na : Le fait de plus avoir de (inaudible,
voix trop basse). De se retrouver tous les deux tout seuls...
Jm : Tu disais « ça a
cassé quelque chose ». C'est ce "quelque chose" que...
Est-ce que tu peux le définir ?
Na : Eh ben, c'était leee... On aimait
rencontrer ces gens, on aimait parler avec eux...
Jm : D'informatique, hein ?
Na : D'informatique, toujours d'informatique.
Et le fait de ne plus rencontrer personne, l'envie, elle part, la motivation,
elle part... y a plus rien.
Jm : Vous êtes restés membre
pendant combien de temps ?
Na : Deux ans ou un an. On a payé deux
cotisations, donc, euh... deux ans à peu près ça.
peut-être un peu plus, non ? Parce-que regarde, un peu moins tu
penses (s'adressant à Ph) ?
Ph : Ouais
Na : On va direee...
Ph : ...Deux ans, voilà. Entre un an
et demi et deux ans.
Annexe 10 Cinquième
entretien
JC (cinquième entretien) le mercredi 7
février 2001 à 9h20
A notre domicile
41 ans, vient à l'association pour la branche Finance
et régler les problèmes informatiques (électroniques) et
de matériels de l'association (correspond au questionnaire n°8)
Après annonce
Jm : Comment as-tu connu le club ?
Jc : J'ai connu avec un dépliant dans
la boite aux lettres.
Jm : Ce dépliant, par qui il avait
été distribué ? Tu sais pas ?
Jc : Je sais pas, j'ai trouvé dans la
boite aux lettres, je sais pas qui c'est l'a distribué.
Jm : Alors, qu'est-ce qui t'as plu sur ce
dépliant ?
Jc : Euh... ben que ce soit un club
informatique, et puis... donc comme ça m'a intéressé,
j'suis allé au local pour voir un petit peu... pour avoir un peu plus
d'explications.
Jm : Et on t'as renseigné ?
Jc : Oui, oui, tout à fait, oui.
Jm : Et qu'est qu'on t'en as dit du club ?
Jc : On m'a expliqué, bon donc que les
principes d'entraide mutuelle... entre les membres, donc moi ça m'a
intéressé parce-que je connais pas mal la technique, je travaille
là-dedans, donc je pouvais aider les membres à ce
niveau-là... et j'allais surtout pour essayer d'apprendre un peu
à me servir des logiciels et... sur les PC.
Jm : On t'as parlé d'autres choses que
de l'entraide mutuelle ?
Jc : Je me rappelle pas bien là,
ça fait quand même deux ans. Ça fait loin, hein.
Jm : Euh... Est-ce que tu as
déjà eu une expérience de l'associatif ?
Jc : Oui, j'ai fait parti d'un club de photo,
quand j'étais au lycée.
Jm : Au lycée, et donc tu as
arrêté quand tu as fini d'être étudiant ?
Jc : Et c'est vrai que ça m'a bien
servi parce-que ça m'a permis d'apprendre comment marchait la photo et
tout ça, donc j'ai bien, j'ai bien apprécié.
Jm: Bon, donc tu avais bien
apprécié. Est-ce que actuellement tu fais partie d'une autre
association ?
Jc : Non, non. Autre que le Compu's Club,
non.
Jm : Finalement, qu'est-ce qui t'as conduit
à adhérer ? (silence) Dans le club, qu'est-ce qui t'as paru
intéressant, qui t'as fait dire « bon j'adhère,
quoi » ?
Jc : Ben, ce qui m'a intéressé,
c'est déjà d'avoir un local avec du matériel... donc pour
travailler déjà sur du..., sur du matériel en informatique
et puis surtout avoir d'autres personnes pour pouvoir échanger des
informations et tout ça.
Jm : Alors au-delà de l'informatique,
est-ce que tu cherchais quelque chose d'autre de précis ?
Jc : Au départ non, il n'y avait rien
de précis.
Jm : Rien de précis, au
départ.
Jc : Non, au départ, non.
Jm: Donc finalement, ce qui a
déterminé ta décision, c'est l'informatique ?
Jc : ...Tout à fait...
Jm : ...C'est la possibilité
d'apprendre des logiciels, et de pouvoir donner. Toi
éventuellement...
Jc : Et puis surtout d'échanger les
informations.
Jm : Echanger des informations. Euh... tu, tu
aimes donner ?
Jc : Ah ouais !
Jm : Qu'est-ce que ça t'apportes de
donner ?
Jc : Ben je pense que ça permet de
sortir des fois des... des personnes de leurs problèmes, et tout
ça. Si tu leurs donnes pas des fois, ils arrivent pas à s'en
sortir, et alors que c'est tellement facile, des fois, de donner juste un p'tit
truc et puis, et pi il s'en sort plus rapidement.
Jm : Et pour toi, ça t'apportes quoi
de donner ?
Jc : Une satisfaction de... de voir que...
celui qui reçoit, il est content !
Jm : Alors, est-ce que tu peux me parler un
peu de toi, à l'époque de ta venue au club ? Tu travaillais ?
Jc : Oui je travaillais, donc je travaillais
pour un gros groupe, un groupe informatique qui était Siemens... et
à l'époque ils ont externalisé la, la maintenance,
C'est-à-dire ils ont sorti la maintenance du groupe, ils ont
monté une autre société, ils nous ont mis dedans, le seul
problème, c'est qu'ils ont licencié pas mal de personnes, et moi,
moi je me suis retrouvé avec deux personnes sur Valence, et j'avais
l'habitude d'échanger pas mal d'informations, et c'est ce manque
d'information qui me manquait à priori, et c'est pour ça que j'ai
cherché...
Jm : ...Autre chose ...
Jc : ...Autre chose pour, pour palier ce
manque.
Jm : Donc c'est ça, c'était un
complément au niveau professionnel ?
Jc : Tout à fait, c'est un
complément au niveau professionnel.
Jm : D'accord. Euh... Qu'elle était ta
situation familiale ? Tu es marié ? Tu as des enfants ?
Jc : Non, célibataire.
Jm : Célibataire, sans enfant,
Jc : Sans enfant,
Jm : Tu n'es toujours pas
marié ?
Jc : Non, non toujours pas.
Jc : Euh... tes parents, ils...
étaient engagés dans la vie associative ?
Jc : Euh... non. Ils font maintenant partie
d'un club 3e âge, mais c'est tout, non avant non. Pas du tout.
Jm : Quand tu étais dans le club
photo, quand tu étais jeune, je reviens un petit peu en arrière,
tu participais à une responsabilité, tu avais pris une fonction,
quelque chose ?
Jc : J'étais vice-président,
oui.
Jm : Vice-président ?
Jc : Oui.
Jm : Et ça t'avais plu à ce
moment là, d'être vice-président ?
Jc : Oui, oui.
Jm : Oui, et ça consistait en quoi
être vice-président ?
Jc : Palier au président et puis...
Jm : Ta charge t'imposait de faire quoi ?
Jc : Mais bon, c'était un petit club
on était...
Jm : Tu as un ou deux exemples
peut-être ?
Jc : Non, non, mais c'était un petit
club, on était combien, six, sept personnes pas plus, donc je veux dire,
c'était pas un club d'une centaine de personnes, donc... au niveau
membre, on était, c'était limité
Jm : Alors, depuis que tu es rentré au
club, apparemment tu y es depuis deux ans, tu y es encore, qu'est-ce qui fait
que tu y restes ? Qu'est-ce qui fait que tu restes sensible au monde
associatif et notamment au Compu's Club ?
Jc : C'est de rencontrer des personnes et de
d'avoir des contacts avec d'autres personnes. Ce qui permet d'avoir des
liens...
Jm : Tu es sensible à ce lien.
Jc : Ah oui, tout à fait.
Jm : Alors ce lien, il réagit, il
interagit de quelle façon ce lien ? C'est-à-dire est-ce que tu
peux me donner un ou deux exemples de situations dans lesquels le lien est
apparu ?
Jc : (silence) ...pfuu, Comme ça
non.
Jm : Bon, alors après si ça te
vient,
Jc : Oui, non comme ça ça vient
pas.
Jm : Alors aujourd'hui. Aujourd'hui, pour
toi, le club c'est quoi ?
Jc : (silence) Le club...
Jm : Qu'est-ce que ça
représente pour toi le Compu's club, aujourd'hui, pour toi ?
Jc : Ben déjà d'avoir pas mal
de membres, donc d'avoir pas mal de contacts avec des personnes, avoir un local
ou y a du matériel comme je dis, et puis de la documentation, ce qui
permet de trouver des fois, des, des petites astuces, euh...
Jm : Au delà de l'informatique,
au-delà de l'aspect matériel des choses est-ce que tu as une
autre représentation du club ?
Jc : Et puis bon, y a maintenant les
branches, donc il y a...
Jm : Oui, oui comment tu définirais le
club ? Si tu devais donner une définition du club, le club c'est...
C'est quoi le club pour toi, aujourd'hui ?
Jc : C'est un moment de détente, le
soir de passer une heure ou deux heures le soir à dialoguer avec des
personnes !
Jm : Et qu'est-ce que ça t'apportes ?
Jc : De pas rester seul chez moi,
déjà !
Jm : D'accord, donc, ça te permet de
rencontrer d'autres gens.
Jc : Tout à fait ! C'est surtout
ça, c'est les rencontres.
Jm : Qu'est-ce qu'il y a d'autres qui te
plais au club ?
Jc : Le principe des branches, moi je trouve
que c'est pas mal.
Jm : Le principe des branches ?
Jc : Oui ça permet de
sélectionner des... certains membres qui sont intéressés
par certaines activités.
Jm : Tu as un ou deux exemples ?
Jc : Ben la Bourse.
Jm : La Bourse ?
Jc : Oui.
Jm : Tu participes à la Bourse ?
Jc : Oui, tout à fait, oui.
Jm : Vous y faites quoi à la Bourse ?
Jc : Ben on essaye d'apprendre un peu les
rudiments de la Bourse, à savoir un peu comment ça marche, et
puis surtout d'essayer de monter un club boursier et d'investir ...euh en
Bourse.
Jm : Alors ça, est-ce que tu peux
m'expliquer un petit peu comment ça se passe ; l'organisation de
cette branche ?
Jc : L'organisation, donc pour le moment
chacun essaye de faire... d'apporter des informations, donc au niveau
documentation on a un classeur, et chacun fait un... un résumé
d'une leçon et qui l'expose aux autres membres, pour bien comprendre un
petit peu les termes de la Bourse, le fonctionnement de la Bourse.
Jm : Ça, c'était imposée
cette organisation-là pour comprendre la Bourse sous forme de cours, ou
est-ce que c'était décidé de manière
collégiale ? Est-ce que c'est à l'initiative d'une idée
qu'il avait été lancé ?
Jc : Ça été
décidé un peu par tout le monde, c'est une décision
collégiale, parce-que sinon... c'est vrai qu'on avançait pas
trop, parce-que si on n'a pas un fil conducteur, c'est difficile de,
d'apprendre comme ça sur le tas, donc ça permet d'avoir un...
avancement sur le... et d'avoir un fil conducteur surtout.
Jm : C'est important d'avoir un fil
conducteur ?
Jc : Ah oui, tout à fait. Oui, sinon
on part dans tous les sens, on et...
Jm : Comment vous vous êtes
organisés, pour faire à chacun votre tour, une leçon ?
JC : Y a un membre qui prend le
classeur. Il fait le résumé. Quinze jours après il le
donne aux autres membres. Et quinze jours après, il expose ce qu'il a
fait, ce qui permet que pendant 15 jours les membres peuvent lire
déjà le résumé, pour... euh... si z'ont des
questions à poser, pouvoir les poser.
Jm : Qu'est-ce que, quelle autre organisation
il y a ? il n'y a que ça, vous faites uniquement des cours pour la
Bourse ?
Jc : Ben maintenant, on va commercer à
investir, aussi, donc on est en trait de chercher... De chercher des
informations sur les sociétés... pour sélectionner les
sociétés.
Jm : Alors qu'est-ce qui vous motivent
justement dans investir ?
Jc : Déjà apprendre un petit
peu comment ça marche la Bourse, et puis surtout apprendre comment
marche l'économie française et mondiale.
Jm : Oui mais ça, on peut le faire
sans investir ?
Jc : Oui, mais si on a pas de but c'est
difficile.
Jm : Donc le but, ça serait :
investir de l'argent pour voir comment cet argent-là... Quel sentiment
il y aurait de différent entre "j'apprends sans investir" et
« j'apprends en investissant" ?
Jc : Ben disons que si on investit pas, je
pense qu'on va passer à coté des problèmes. Là
ça permet de se poser des problèmes, de les résoudre et...
Jm : Vous avez de l'espoir de gagner de
l'argent ? Ou alors c'est vraiment pour vous poser uniquement des
problèmes ?
Jc : Peut-être pas au club, mais
peut-être à coté on peut investir parce-que au club je
pense que c'est plutôt pour faire des essais, des trucs comme ça
et si on veut gagner de l'argent je pense qu'il faut le faire à
coté.
Jm : Et vous êtes dans l'organisation
générale de la branche, vous êtes organisés de
quelle façon ?
Vous êtes... vous travaillez seul ? Vous utilisez le
local comment ? Qui ? Il doit bien y avoir quelqu'un qui mène le
débat ? Combien vous êtes d'abord ? Au sein de ce club ?
Jc : On est combien ? huit, neuf, non, neuf,
neuf ... neuf je crois bien, on y est neuf membres, je crois bien, c'est
ça, neuf avec R.
Jm : Neuf en permanence ou...
Jc : Non, i en a qui viennent pas,
Jm : Neuf en globalité ?
JC : Neuf en globalité.
Jm : Neuf en globalité. D'accord.
Alors, donc ma question était : dans l'organisation même de
la branche, vous êtes organisés comment ? ... Parce-que neuf
personnes, euh... tout le monde ne peut pas faire tout et n'importe quoi !
Jc : Non, alors le problème, c'est
queeee... Donc le club est pas du moins... un club d'investissement n'est pas
fait. Donc les statuts sont pas posés, rien du tout. Donc il n'y a pas
de président, ni... Pour le moment, y a que le trésorier qui est
désigné, qui s'est désigné.
Jm : Un trésorier qui s'est
désigné ?
Jc : Oui.
Jm : C'est à dire, les autres n'ont
rien eu à dire ?
Jc : Non. Si ! On était d'accord !!
Comme i'avait pas d'autres volontaires, on a été d'accord !
(rires) Donc y a tout ça à faire aussi comme travail, à
poser les statuts et à organiser le club.
Jm: Donc, y a un trésorier chez
vous.
Jc : Oui.
Jm : Donc le trésorier c'est lui qui
mène les débats.
Jc : C'est lui qui mène les
débats, oui.
Jm : Oui
Jc : Oui, tout à fait.
Jm : Oui, et puis donc quels genres de
questions sont soulevés ? Si t'as un ou deux exemples ? ... Je parle
dans la relation avec les autres ?
Jc : Ouais, ben y a beaucoup de monde qui
aimerait bien que le club démarre beaucoup plus vite, c'est vrai
que...
Jm : Oui, mais dans l'interrelation, avec les
autres ? C'est à dire, comment vous communiquez avec les autres ? Quand
vous faites la leçon, i en a un qui dit : « ouais, tu
m'emmerdes » ou alors il dit : « ouais t'as
raison », comment ça se passe ?
Jc : ...Ça se passe... (souffle)...
Ça se mène tout seul le débat.
Jm : Ça se mène tout seul ?
Jc : Oui.
Jm : Est-ce que t'as des exemples, pour dire
que ça se mène tout seul ?
Jc : (souffle) Non pas comme ça,
mais... Non quand la personne, elle se pose son résumé, en
général les gens l'écoute. Bon c'est vrai qu'y a des
questions, ça c'est sûr !
Jm : Vous ne faites que ça ? Vous ne
faites que des résumés ? Vous ne faites rien d'autres ? Vous ne
parler de rien d'autre ?
Jc : ...Ben, on parle aussi des
sociétés, des.. des...
Jm : Oui mais au-delà de la Bourse,
qu'est-ce qui se joue d'autre au delà de l'étiquette Bourse, que
vous avez dans cette branche ? Il ne se joue rien d'autre ? Vous ne discuter de
rien, vous ne plaisantez jamais ? Vous êtes des statuts de cire,
qui...
Jc : ...Non quand même pas...
Jm : ...Vous éditez un cours, et les
autres...
Jc : Ah ben non !
Jm : Les autres y
disent : « ouais j'suis d'accord » alors, comment
ça se passe ?
Jc : ...Euh, euh, y a un débat qui se
crée, euh...
Jm : Alors ce débat, est-ce que tu as
un ou deux exemples de débat qui ont été virulents par
exemples, ou un débat...
Jc : Ben sur le risque, par exemple, y a eu
un débat que... les gens étaient pas tous d'accord !..
Jm : Les gens étaient pas tous
d'accord, comment ça s'est passé ?
Jc : Ben, disons qu'y en a beaucoup qui
avaient pas compris ce que c'était le risque, que... comme on le voit en
Bourse.
Jm: D'accord, donc y en a qui ont compris,
d'autres qui ont pas compris, d'accord, pas d'accord...
Comment ça c'est passé entre eux ? Entre les
gens ? Qu'est-ce qu'il y a eu, y a eu des réactions en disant :
« tu m'emmerdes, j'suis pas d'accord, je m'en vais
! », ... ?
Jc : Ben non, personne est parti, non !
Jm : Non, mais d'accord, mais quoi d'autre,
est-ce que tu as un ou deux exemples.
Jc : (silence) Je vois pas ce que tu
veux dire.
Jm : Moi, ce qui m'intéresse de
savoir, c'est comment vous agissez les uns par rapport aux autres. C'est pas le
sujet même qui m'intéresse, c'est pas de dire : « on
fait de la Bourse, on en parle, on en débat » ça ne
m'intéresse pas vraiment. Moi ce qui m'intéresse, c'est de dire
au moment où on a débattu de ça, i en a un, il s'est
insurgé, il a jeté la chaise par la fenêtre, ou alors,
euh... euh... i en a un qui a eu une autre idée, euh... ou alors on a
parlé des petits oiseaux pendant ½ heure, on vient une heure, on se
réunit une heure, une heure ½, ben on parle des oiseaux pendant une
heure, voilà c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui se
joue.
Jc : Ben oui c'est vrai, c'est vrai, quand on
lance un débat comme ça, des fois, on déborde, on reste
pas forcément que sur la Bourse.
Jm : Alors, vous parlez de quoi à ce
moment là ?
Jc : ...Ben de tout... euh.
Jm : De tout, de rien, de la vie de famille,
la vie professionnelle, Jc pitié !!!! (rires)
Jc : (rires) Je sais pas moi ce que tu
veux...
Jm : Ah ce que je veux, non ! C'est pas
ce que je veux, c'est toi comment tu le ressens, au-delà de
l'étiquette même.
Jc : Ben en général ça
tourne toujours autour de la Bourse quand même.
Jm : Oui d'accord.
Jc : Ça, c'est sûr.
Jm : D'accord, donc ça tourne autour
de la Bourse, mais entre les gens, euh... vous réagissez comment ?
...
(silence)
Jm : Vous vous disputez ? Euh, je sais pas
moi, il doit bien y avoir...
Jc : Bien sûr, i en a qui sont pas
toujours d'accord.
Jm : Entendons-nous bien, vous êtes
neuf personnes, il y a un trésorier qui..., donc il y a de l'argent
quelque part, vous êtes des statues de cire ? Vous venez, vous partez,
vous dites au moins bonjour, vous parlez de tout, de rien. Les gens qui sont
autour comment tu les perçois ? « Tiens il y a une
personne je la vois, elle est comme ça, elle est comme
ça. »
(silence).
Jc : Ouais mais c'est difficile aussi
de juger comme ça.
Jm: C'est pas un jugement. C'est comme tu le
perçois ?
Jc : Ben, disons qui en a quand même
qui viennent, y sont un peu statiques, dans le Club, mais bon, ils attendent
peut-être de voir comment va tourner le Club, euh... et puis i en a
d'autres qui sont beaucoup plus actifs, ça c'est sûr, hein.
Jm : Bon, alors, qu'est-ce queeee...
qu'est-ce qui est important pour qu'il y est un bon fonctionnement dans cette
branche ?
Jc : Je pense qu'il faut... La solution c'est
de démarrer quand même le Club, parce-que là, il est pas
démarré.
Jm : Mais, pour qu'il y est un bon
fonctionnement dans la branche, la branche aujourd'hui, elle fonctionne,
apparemment, elle fonctionne, il y a des gens qui sont passés...
Jc : ...Oui...
Jm : ...Qui sont partis, i en a d'autres qui
arrivent ?
Jc : Oui
Jm Qu'est-ce qui les a fait venir ? C'est la
Bourse ? L'argent ? L'appât d'un gain ? Ceux qui sont partis,
pourquoi ils sont partis ? Euh.. Parce qu'ils gagnaient pas assez ou parce
qu'ils avaient des problèmes avec les autres ?
Jc : On n'a pas... On a jamais... On a jamais
investi. Donc on a jamais pu gagner d'argent déjà, donc je pense
qu'on a été un peu trop lent à démarrer, donc,
c'est pour ça que le... Dès qu'on démarrera, le plus
rapidement possible, ce sera... très bien. Ou sinon, ce qui sont venus
dernièrement je pense que c'est juste pour apprendre la Bourse, euh..
Jm : Donc, le fonctionnement aujourd'hui,
ça marche bien, aujourd'hui la Bourse, ça marche bien ou
ça marche pas bien ?
Jc : Ben disons qu'on a pas investi, donc, on
peut pas savoir si ça marche bien.
Jm : Non mais... la branche finance existe
depuis combien de temps ?
Jc : Depuis (rire), depuis un an et demi.
Jm : Depuis un an ½, donc depuis un an
½, vous vous réunissez ?
Jc : Oui, mais...
Jm : Alors qu'est-ce qui se passe dans ses
réunions ?
Jc : Y a un, un arrêt, quand
même, pendant presque six mois, là hein,
Jm : Cinq mois, oui.
Jc : Cinq mois, oui.
Jm : Donc pendant, pendant, oui un an ½
moins cinq mois...
Jc : ...Ça fait treize mois, oui.
Jm : Pendant ces treize mois, vous vous
réunissez, qu'est-ce qui se passe ? Au-delà de la Bourse, est-ce
qu'il y a autre chose ?
Jc : (silence ) Ben non, on parle plus de
Bourse qu'autre chose, hein.
Jm : Alors, pendant qu'on était
fermé, vous faisiez quoi à la Bourse, vous aviez
arrêté ?
Jc : On a arrêté pendant
combien...
Jm : ...Cinq mois...
Jc : A peine, hein, parce-que on
s'était réuni chez MS (9è entretien, ndlr).
Jm : Pourquoi chez MS ?
Jc : Parce-que c'était la plus
près du club, et pi qui avait un local à nous passer... Donc, on
se réunissait là !
Jm : Oui, MS, tu la perçois comment MS
?
Jc : ...(silence de réflexion) je la
perçois comment ? fu...
Jm : Comme une vieille sorcière (sur
le ton de la plaisanterie provocatrice, ndlr) ?
Jc : Non pas du tout, non elle est
là... (s'insurgeait-il ! Ndlr)
Jm : Tu discutes avec elle ?
Jc : Ah ouais, tout à fait.
Jm : Vous discutez de quoi, ensemble ?
Jc : ...Ben de tout et de rien ! C'est pas...
Jm : C'est quoi tout et c'est quoi rien ?
Jc : (rires) Ça dépend des
jours, des fois du beau temps, des fois de ses problèmes...
Jm : Ah oui, pourquoi vous parlez du beau
temps ?
Jc : ...Ben des fois, peut-être qu'on a
pas grand chose à dire, donc on se parle du beau temps, mais des fois,
quand j'allais chez elle, on parlait de jardinage, ou, parce-que i'avait son
jardin, ou elle parlait de ses problèmes informatiques...
Jm : Et, ça te faisait plaisir
ça ? Tu aimes bien parler du jardinage ?
Jc : Ha oui, tout à fait oui.
Jm : Pourquoi ? Tu aimes ça, ça
t'apportes quoi ?
Jc : J'aime bien jardiner puis...
Jm : Comment tu te sens, quand on parle de
jardinage, ou quand tu jardines ? Tu te sens comment ?
Jc : J'aime bien jardiner, donc, j'aime bien
savoir un p'tit peu...
Jm : Je veux dire, quand tu jardines, tu fais
la gueule ? tu ronchonnes ?
Jc : Ah ben non ! Pas du tout !
Jm : Tu te sens comment alors ? ... (rires)
« Je me sens joyeux, j'entends les oiseaux »
Jc : (rires) Je sais pas moi, je m'sens bien
! C'est tout !
Jm : Tu te sens bien,
Jc : Oui
Jm : Alors, ce bien se caractérise
comment ? (silence) Tu as de l'énergie ? tu es motivé ?
Jc : Ah, bé, Bien sûr, j'ai de
l'énergie, je suis motivé !!
Jm : Parle de toi un peu !!!
Jc : Ouaiiiiiis, mais c'est difficile !
Jm : Je sais, c'est difficile, prends ton
temps, prends ton temps.
Jc : Ouais, je sais pas moi, comme j'aime
bien la nature, c'est vrai, que jardiner, pour moi c'est, c'est une bonne
chose, ça me permet d'avoir... pour moi c'est un loisir !
Jm : Bon, on va revenir un petit peu en
arrière, est-ce que tu peux me donner deux, trois expressions pour
décrire le club ?
Jc : Pour décrire le club... euh...
Déjà, notre devise c'est l'entraide mutuelle. Donc, pour moi
c'est vrai que c'est un bon principe. Ouais, pour moi, la vie du club, c'est
surtout l'entraide mutuelle, ça évite que les gens y viennent
juste prendre sans donner... parce-que un club, si personne donne, bon, ben,
ça peut pas fonctionner... ça c'est sûr.
Jm : Alors, on va prendre la chose
différemment : si tu devais convaincre un copain, un copain de
travail, un copain, un ami quelconque, qui ne connaît pas le Club, mais
que tu aimerais attirer au club, parce-que tu penses que ça serait
bénéfique pour lui. Comment tu présenterais le Club ? Tu
lui en dirais quoi ? tu parlerais d'informatique, bien sûr, c'est
l'étiquette informatique, mais tu lui dirais quoi d'autre ?
Jc : ...je lui dirai quoi d'autre ? ben,
qu'il, qu'il peut venir déjà essayer certaines machines, certains
logiciels... qu'il a peut-être pas la possibilité de le faire chez
soi.
Jm : Ça, c'est l'informatique,
Jc : Oui, ça, c'est l'informatique.
Jm : Tu lui dirais quoi d'autre du Club
?
Jc : Et puis bon je lui expliquerais les
branches qui existent, et voir s'il y en a une qui l'intéresse.
Jm : Oui, et tu les expliquerais comment ses
branches ? Donc les branches, tu expliquerais chaque branche, fait telle et
telle chose...
Jc : ...Voilà, oui...
Jm : ...et tu lui dirais quoi des branches ?
Parce-que, si tu lui expliques que ça, il va venir en consommateur, il
va payer 200 F, et puis, il va venir utiliser le club.
Jc : Ouais, le seul problème, je sais
pas s'il peut donner quel'chose... donc c'est à lui de voir aussi, s'il
peut donner quel'chose
Jm : Mais est-ce que tu lui en parlerais ?
Jc : Et puis bon, à la rigueur, on
peut lui dire, dès qu'il a appris, il peut réapprendre à
d'autres membres, ça oui.
Jm : Alors quelles valeurs tu attribues au
Club ? On va essayer de voir différemment... Quelles valeurs tu
attribuerais au Club ?
JC : Quelles valeurs comment ?
Jm : Quelles valeurs tu attribuerais au Club
? Est-ce... qu'est-ce qui te parait important qui flotte dans le Club, mais qui
n'est pas formaliser quoi, qui est pas un ordinateur à taper sur un
piano, mais qui est autre chose qui flotte, des valeurs, on est attaché
à des valeurs au Club, on a un agrément, on a bien des valeurs
quelque part...
Jc : ...C'est surtout...
Jm : ...Ces valeurs-là quelles
sont-elles pour toi ?
Jc : Ben, pfou, moi, pour moi, c'est plus une
rencontre qu'autre chose, hein... le Club hein.
Jm : Une rencontre ?
Jm : Oui tout à fait, une rencontre
avec d'autres personnes, c'est vrai que, bon d'être affilié
à certaines... d'autres associations, c'est pas ce qui
m'intéresse le plus moi, pas ce que je cherche le plus hé.
Jm : Oui mais quel autre... Comment dire la
chose, tu sais ce que c'est qu'une valeur ? une valeur...
Jc : Oui
Jm : Ben moi je suis attaché, quand je
parle, on m'écoute, c'est le respect, la tolérance, c'est le
civisme, c'est... Au débat, ben on peut discuter, qu'est-ce qui fait
qu'on se dispute pas finalement, c'est ça les valeurs,
Jc : Oui.
Jm : Alors qu'elles sont les valeurs du Club
qui font que ça fonctionne bien à la branche finance ? Que vous
vous disputez pas quand vous débattez ? Que vous êtes
organisés ? Que...
Jc : Ben déjà, ça
permet... euh... quand les gens viennent dans une branche, je pense qu'ils
l'ont choisi parce-que ça leurs plaisaient, donc déjà...
Jm : D'accord pour les gens, mais toi, toi,
qu'elles sont pour toi les valeurs ?
JC (long silence). Euh... (re-silence long)
je sais pas moi.
Jm : Euh... Dans la branche où vous
êtes, bon, tu m'as dit que tu fonctionnais, y'avais un trésorier,
y'avais des débats, est-ce que, euh... quoi d'autres dans la branche
qui, qui te paraît intéressant que tu... Qui te parait être
quelque chose qui te... que tu ne trouverais pas ailleurs ? (silence) S'il y a
un trésorier, y a de l'argent ?
Jc : Oui
Jm : Si il y a de l'argent, l'argent il est
mis où ? C'est le trésorier du club ?
Jc : Non, non il est mis sur un compte.
Jm : Non, non je veux dire, le
trésorier de votre branche, c'est le trésorier du Club ?
Jc : Je sais même pas, non, non. Je
sais même plus qui c'est le trésorier... (rires) Non non c'est pas
le même.
Jm : Alors, c'est pas le trésorier du
Club, alors, c'est le trésorier de la branche ?
Jc : ...de la branche, hum...
Jm : Alors si vous avez un
trésorier dans la branche, c'est que vous avez des sous à la
branche, et donc par déduction, vous le mettez où cet argent ?
Jc : Ben, à la banque, pour le moment
en attendant d'aller...
Jm : A la banque, sur un compte ?
Jc : Sur un compte en attendant d'aller
sur...
Jm : Alors ça veut dire quoi ? Vous
avez un trésorier, qui est indépendant du Club, vous avez un
compte...
Jc : ...Ça veut dire...
Jm : ...qui est indépendant du Club...
ça veut dire quoi ?
Jc : Qu'on compte bien remonter un Club !
Jm : Oui, mais ça veut dire aussi que
vous êtes autonomes !
Jc : Autonomes, oui.
Jm : Voilà ! Vous travaillez tout
seul, vous vous organisez tout seul, vous avez des prises de
responsabilités au-delà de l'organisation générale
du Club. Ça c'est ce qui en découle...
Jc : Oui tout à fait. C'est vrai qu'on
ne dépend plus du Club, à part qu'on est dans son local, c'est
tout.
Jm : Voilà, vous êtes dans ses
locaux, vous êtes autonomes. Voilà, vous rendez compte de temps en
temps au club de ce que vous faites ?
Jc : ...peut-être pas assez....
Jm : Peut-être pas assez ?
Jc : Hum, parce-que, c'est vrai, je sais pas
si tout le monde est au courant de ce que l'on fait.
Jm : Alors de qu'elle manière... Vous
faites déjà des choses ?
Jc : Ça y est, on passe souvent un
article dans le... dans le... Bulletin Membre. ...Mais bon, je sais pas si tout
le monde le lit correctement.
Jm : Ça intéresse
peut-être pas tout le monde ?
Jc : Ça intéresse
peut-être pas tout le monde, tout à fait.
Jm : Bon, est-ce que vous suivez un autre
projet que celui du club d'investissement ? Parce-que y' en a qui peuvent
vouloir comprendre la Bourse sans nécessairement vouloir investir.
Jc : Tout à fait, ben y a
l'école de bourse, qu'on appelle le CEB, c'est l'école de bourse.
Qui va être à part, par rapport au club d'investissement donc les
gens peuvent faire partie du CEB sans faire partie du club d'investissement.
Jm : Est-ce que vous avez un autre projet ?
Que le Club d'investissement ?
Jc : ...Euh pour le moment non.
Jm : Non alors, comment ça a vu le
jour, le C.E.B. ? Quand tu y es rentré, il existait déjà ?
Jc : Non.
Jm : Non, comment ça a vu le jour ?
Jc : Ben parce qu'il y en a trois ou quatre
qui voulaient faire de la Bourse, et donc on s'est...
Jm : Tu faisais parti de ses trois ou quatre
?
Jc : Oui, au départ, oui.
Jm : Est-ce que tu te souviens de ce que vous
en avez dit, c'est toi qui l'as construit avec deux, trois autres personnes,
alors ?
Jc : Oui.
Jm : Est-ce que vous vous souvenez ce que
vous en avez dit pour le construire ?
Jc : Ben on a dit qu'on pouvait faire un
club, et puis voir déjà ce qu'on pouvait faire et...
Jm : Alors comment ça s'est passer
ensuite ? Comment vous avez fait pour le créer ?
Jc : ...Ben disons que pour le moment il est
pas créer, on a juste créé la branche,
Jm : La branche, comment vous avez fait pour
créer la branche ?
Jc : Je m'en rappelle plus ! (rires) Je m'en
rappelle plus... comment ça c'est passé, ça s'est
passé naturellement ! (rires)
Jm : (rires) ...Alors, naturellement,
ça veut dire quoi ?
Jc : Avoir réservé un soir pour
se réunir, et puis...
Jm : Donc, vous étiez membres du Club,
et... y a quelque chose qu'il faut préciser là, vous êtes
membres du Club, vous dites, ben, « nous on veut créer un
club d'investissement, donc on va monter une branche »...
Jc : Donc déjà on a
demandé à certains si les gens étaient
intéressés ou pas, quand même.
Jm : Donc vous avez demandé alentour
si les gens pouvaient être intéressés, euh... donc y a des
gens qui ont du répondre favorablement ?
Jc : Oui tout à fait, oui.
Jm : Et donc ça c'est passé
comment pour la construire cette branche ? Vous avez dit,
« bon ben on se réserve cette plage horaire là,
point. » Quoi ?
Jc : Au départ, c'était un peu
comme ça, oui.
Jm : Oui, ça a été
comme ça ? Et au niveau du Club, personne a réagit ? Personne a
rien fait ? ça n'a pas paru curieux en disant : « non mais
attendez là, vous êtes où là ? Vous êtes
dans un Club, vous avez une idée vous voulez monter une branche ?
Ça se fait pas comme ça » non, personne a...
Jc : Non je ne me rappelle pas.
Jm : Non tu te rappelles pas de ça ?
Tu expliques ça comment toi qu'il n'y est pas eu de réaction ?
Jc : Ben déjà que dans le
Compu's Club y a déjà pas mal de liberté à ce
niveau là. Donc, c'est vrai que on peut faire pas mal de choses... au
niveau des branches... créer des activités, donc, à ce
niveau là, donc y a pas eu de problème à ce niveau
là.
Jm : Donc, vous avez eu une large
liberté, vous avez monté votre branche. Et ensuite, alors,
ça s'est passé comment ? Vous avez fait de la pub, et puis vous
vous êtes organisés comment ? Je suppose que ça a dû
cafouiller par moment, vous avez dû réajuster des choses.
Jc : Ben, on a commencé
déjà à regarder sur Internet, et pi essayer de faire
des... portefeuilles fictifs, mais bon ça a pas été un
grand succès, ça. Parce-que le problème on y connaissait
rien du tout à la Bourse, donc, on est plus repartis maintenant sur la
formation que sur...
Jm : Qu'est-ce qui te paraît
déterminant dans la conduite du projet ? Dans la conduite de la branche,
du projet, ou du Club investissement ? Qu'est-ce qui te paraît
déterminant ?
Jc : C'est surtout la formation, je pense,
être...
Jm: la formation ?
Jc : La formation de, de la Bourse. Parce-que
pour moi on est, des, des débutants, hein.
Jm : Oui, et cette formation, elle est
prodiguée par qui ? Quand tu disais tout à l'heure, vous aviez
des cours entre vous alors...
Jc : ...Entre nous...
Jm : ...C'est une autoformation alors ?
Jc : Oui, c'est vrai, il faudrait qu'on
trouve une autre personne qui connaisse la Bourse, qui peut nous apporter
quelque chose, et surtout... surtout nous orienter un petit peu de quel
coté il faut aller.
Jm : Vous ne vous êtes jamais
approché de... d'autres personnes, de professionnels, de
spécialistes, de...
Jc : Si, si, on est allé voir des
professionnels...
Jm : Et ? ...
Jc : Donc on est allé dans un cabinet,
donc...
Jm : Oui, mais, ces professionnels, ils vous
ont aidé ?
Jc : Ah oui, tout à fait, ils nous ont
expliqué un petit peu, mais on y est pas allé très
souvent, et puis maintenant, y a une personne qui est prête à
venir tous les mois, ça c'est... pour nous ça peut devenir
intéressant.
Jm : C'est intéressant pour vous.
Jc : Tout à fait, oui.
Jm : Ça va vous apporter quoi ?
Jc : Du professionnalisme, surtout, et puis
surtout, peut-être, un fil conducteur de savoir dans quelle direction il
faut aller.
Jm : Alors, qu'est-ce qui te ferait quitter
la branche ?
Jc : (silence) Peut-être un manque de
temps.
Jm : Manque de temps ? Rien d'autre dans les
relations avec les autres ? Qu'est-ce que c'est qui te ferait quitter la
branche ?
Jc : Non, non, non, c'est plus une question
personnelle, manque de temps, un truc comme ça, mais c'est pas une...
pas une question de relation.
Jm : Si tu te disputais avec quelqu'un, tu ne
quitterais pas la branche ?
Jc : Moi ça sera difficile de
disputer, de me disputer avec quelqu'un déjà. Donc, à ce
niveau là, y a pas de problème.
Jm : Alors, qu'est-ce qui te fait rester dans
la branche ?
Jc : Apprendre la Bourse, et puis comprendre
surtout l'économie des... de la société
française.
Jm : Ok, on va poser la question
différemment, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe, dans le groupe qui
ne relève pas du projet, qui ne relève pas de l'étiquette
Bourse ? De l'étiquette de l'investissement, des finances ? Qu'est-ce
qu'il se passe d'autre dans ce groupe ?
JC : ...Qu'est-ce qu'il se passe
d'autre...
Jm : Oui, au-delà de la
Bourse ?
Jc : ...A coté de la Bourse ? Non ?
Jm : Oui à coté de la
Bourse, mais dans la branche(silence). On l'a presque abordé tout
à l'heure, tu disais qu'il y avait des débats, j'aimerais savoir
comment se passent ces débats, quoi. Est-ce que tu as un ou deux
exemples d'un sujet que vous avez débattu ? Et comment ont réagi
les uns et les autres ?
Jc : ...Ben y'avais un débat, sur la
rapidité du, de la formation du Club, donc i en a qui étaient
vraiment pressés, d'autres non, c'est vrai que... peut-être
à ce niveau là, i en a qui, ils auraient
préféré que ça démarre plus vite. Mais bon
c'était pas facile à démarrer plus vite...
Jm : Mais dans les débats, donc, les
relations que vous avez eues, qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui se dit ?
Comment ça se dit ? Et comment les gens réagissent ?
Jc : Ouaaais, en général c'est
pas violent quand même. Faut pas...
Jm : C'est pas violent, je sais pas ce que
ça veut dire, peux-tu préciser ? Est-ce que tu as un ou deux
exemples.
Jc : Ben, c'est sûr, i en a qui sont
pas toujours contents de, de comment sont menés la branche.
Jm: Oui, mais est-ce que tu as un ou deux
exemples ?
Jc : Je dis sur la rapidité de, de la
création du Club.
Jm : Non, mais un ou deux exemples dans le
sens, ben, « tel jour à telle heure on a discuté
avec telle personne de telle chose ».
Jc : Houlà, moi je... je pourrai pas
te préciser comme ça.
Jm : « Une personne a dit telle
chose, une personne était pas d'accord, elle a eu telle ou telle
réaction ». Comme je te disais tout à l'heure,
« elle a jeté sa chaise par la
fenêtre », « elle attrape au
colback », « elle s'est fait crêper le
chignon » ou alors au contraire « on les a
laissés parlé », « on s'est
entendu », « on a pris une décision, en
votant à la fin », etc. etc. Ça se passe comment
quoi ? Tu y es, tu le vis ça, ça se passe comment ?
Jc : Je veux dire, je peux pas te
préciser exactement comment ça se passe, le jour et tout
ça, je me rappelle pas moi.
Jm : D'une
manière générale...
Jc : ...Il y a eu, en
général... On laisse débattre les gens qui s'expriment
jusqu'à la fin.
Jm : Qui c'est "on" ?
Jc : Ben le groupe
Jm : Le groupe se laisse débattre,
lui-même ?
Jc : Oui tout à fait.
Jm : Alors, comment il débat ?
Jc : Il faut quand même écouter
tout le monde, hein. Faut avoir les avis de tout le monde.
Jm : Alors ça c'est une
règle ?
JC : Oui.
Jm : Alors vous attendez que tout le monde
ait exprimé son avis.
Jc : Oui tout à fait, et après
c'est vrai qu'il faut prendre une décision, mais au niveau du groupe
Jm : Alors, comment vous la prenez cette
décision ?
Jc : S'il faut, et bien on vote,
Jm : S'il faut, on vote ?
Jc : Tout à fait, oui.
Jm : Euh... Est-ce que tu connais
l'organisation générale du Club ? (silence). Donc c'est par
branche ; Qu'elles branches tu connais ?
Jc : J'en connais, ben je connais... CEB donc
le Club de Bourse. Du moins l'école de bourse, et puis Comnet et c'est
tout, les autres je les connais pas vraiment.
Jm : Non, mais tu en as entendu parler ?
Jc : Bien sûr, j'ai entendu
parlé, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, je crois qu'il y a
la littérature, mais ça, ça m'intéresse pas du
tout... y a la PAO, là. Oui, ça, à la rigueur ça,
ça pourrait m'intéresser mais j'ai pas toujours le temps non
plus... parce-que... j'ai, je travaille quand même à coté,
donc, surtout un manque de temps qui me...
Jm : Alors qu'est-ce que tu viens chercher
aujourd'hui au Club ?
Jc : ...Ben ça fait plusieurs fois que
je te le dis : c'est surtout les rencontres de gens, et puis les
recherches d'informations.
Jm : Oui, mais aujourd'hui ? Ça c'est
au départ, tu m'as dit « je venais chercher des
informations », alors aujourd'hui tu viens chercher la
même chose ?
Jc : Toujours la rencontre oui, toujours la
rencontre de personnes.
Jm : Donc apparemment tu la trouves cette
rencontre, cet échange ?
Jc : Bien sûr ! Bien sûr, sinon
je viendrai plus.
Jm : Sinon tu ne viendrais plus ?
Jc : Oui.
Jm : Ah donc, qu'est-ce qui te ferait quitter
le club ? Tu dis « ne plus retrouver l'échange, la
rencontre » Quoi d'autre encore ? Le temps, tu as parlé
du temps...
Jc : Oui ça, c'est surtout le temps,
parce-que...
Jm : Quoi d'autre encore, si ça te
plaît vraiment le club, et que tu n'as pas trop le temps, tu arriverais
à en trouver quand même, ou pas ? Ou tu arrêterais ?
Jc : Non j'essayerai d'en trouver un peu
moins qu'aujourd'hui, mais bon, je le... au moins y venir une fois par semaine
au Club
Jm : Alors, est-ce que tu peux me dire
pourquoi tu participes à ce projet Finances ? Au-delà de ton
intérêt qu'il peut y avoir pour la bourse ?
Jc : Moi, l'économie ça m'a
toujours intéressé, donc j'aimerais bien comprendre comment
ça marche.
Jm : Tu participes depuis deux ans, hein, au
Club. Quels ont été pour toi les moments forts ? De
l'association ? Qu'est-ce que tu en retiens de l'association ? Qu'elles
sont les moments forts ? Est-ce que tu as un ou deux exemples à me
donner de moments forts ?
Jc : Oui, c'est quand on a retrouvé un
local.
Jm : C'était un moment fort pour toi ?
Jc : Oui, parce-que j'avais peur quand
même qu'il s'arrête là...
Jm : Ah, oui ?
Jc : Ah oui, je me suis dit :
« si ça reste encore 6 mois sans, sans local, il va pas rester
grand monde. Pour moi, ça a été un moment fort ça,
hein... Euh...
Jm : Y a un autre moment fort ? Ce moment
fort là tu l'as ressenti comment ?
Jc : Ben, une re-vie, une...
Jm : Une re-vie oui ?
Jc : Une re-vie du Club, parce-que...
Jm : Physiquement, ça s'est ressenti
comment ?
Jc : Ben déjà, avoir... pouvoir
revenir à un local, tout ça. Avoir...
Jm : Et dans la tête, à ce
moment-là, tu l'as ressenti comment dans la tête ?
Jc : (silence ) j'ai ressenti ça
euh... (rires) c'est difficile ! J'ai du mal des fois à... à
m'exprimer... mes sentiments.
Jm : Non, non mais ça fait rien, dis
le simplement. C'est dire « quand on a rouvert, ben
j'étais super content, j'étais dynamique, j'étais...
ça s'est ressenti dans mon boulot », je sais pas moi,
c'est pas des sentiments.
Jc : Ressenti dans mon boulot, j'irai pas
jusque là.
Jm : C'est pas une psychanalyse, c'est pas
mon propos.
Jc : C'est vrai que j'étais content,
et en plus c'est vrai que...
Jm : Alors, être content, ça
s'est caractérisé comment "être content" ?
Jc : ...Euh... je, je sais pas comment je
peux... (rires)
Jm : Alors, euh... Qu'est-ce que tu retiens
de ta participation au Club ?
Jc : ...Qu'est-ce que je retiens de ma
participation au Club ? ...
Jm : Qu'est-ce que ça t'as
apporté ?
Jc : Ce que ça m'a apporté ?
Surtout au début je te dis, euh...
Jm : Non mais aujourd'hui, aujourd'hui par
rapport au début ?
Jc : Aujourd'hui, c'est vrai que je donne
souvent plus que ce que ça m'apporte.
Jm : Et ça, ça te donnes,
ça t'apportes quels sentiments, ça ?
Jc : Ça, c'est sentiment de d'essayer
de... d'apporter des... qu'est-ce que je pourrais dire ? ...
Jm : Le fait d'apporter plus que ce que
tu reçois ça te fait plaisir ? euh...
Jc : Bien sûr ça me fait
plaisir, parce-que ça me permet de mettre peut-être mes
compétences... Au service des autres membres.
Jm : Oui, mais tu aimerais quoi ? Tu aimerais
apprendre un peu plus ? Tu aimerais...
Jc : J'aimerai peut-être apprendre un
peu plus sur... surtout au niveau logiciel, mais bon là c'est pas
évident.
Jm : Et au niveau des gens, tu disais tout
à l'heure : « ça évite d'être
seul à la maison » donc ça enlève une
certaine solitude, le fait de rencontrer, bon voilà...
Jc : Tout à fait.
Jm : Au niveau de cette solitude, ça
t'a apporté une convivialité, ça t'a apporté une...
Jc : Une convivialité, oui tout
à fait.
Jm : Quoi d'autre ? (silence) Alors, est-ce
que quelque chose a changé pour toi ? A titre personnel pas au niveau de
l'informatique, ni au niveau de la Bourse, mais pour toi, personnellement
est-ce que quelque chose à changé ? ...Par exemple,
« avant j'étais renfrogné, maintenant j'ai le
sourire jusqu'aux oreilles tous les jours », quoi.
Jc : Non, je pense pas que ça m'a
changé beaucoup.
Jm : Ça n'a rien changé ?
Jc : Non.
Jm : Mais ça a changé
déjà ta solitude.
Jc : Oui, ça a changé la
solitude. Oui. Mais non au niveau caractère, je pense pas que ça
m'a changé quelque chose.
Jm : Non, pas au niveau caractère,
au...
Jc : Oui bien sûr,
Jm : Dans tes attitudes ? Dans...
Jc : Plus une joie de vivre, de dialogue et
tout ça !
Jm : Cette joie de vivre se
caractérise de quelle façon ? (silence) Si tu veux me donner un
ou deux exemples qui te font dire « ah ben ça, ça
caractérise ma joie de vivre » ?
Jc : Non, comme ça non... (rire)
Jm : La question, je vais la tourner
différemment, est-ce que cette joie de vivre se caractérise par
une participation plus fréquente au Club, par exemple ? Par la
discussion plus facile avec les autres par exemple ?
Jc : Ah oui, tout à fait, c'est vrai,
peut-être je m'exprime plus facilement... qu'avant. Bon mais je pense
qu'il n'y a pas eu que le Club, hein, y a eu... en même temps, j'ai
participé à un CE dans ma boîte, donc ça m'a permis
de m'exprimer beaucoup plus qu'avant, mais bon, c'est vrai, y a pas eu que...
je veux dire y a eu ce déclenchement, mais y a pas eu que le Club.
Jm : Y a pas eu que le Club, très
bien. Alors, y a pas eu que le Club et c'est ce que tu avais fait autour, avec
le Club, qui ont fait que tu as changé, hein ?
Jc : Tout à fait, oui.
Jm : Ça, c'est une
globalité ?
Jc : Oui, une globalité, oui.
Jm : ...Quand tu viens au club, dans quel
état d'esprit tu te trouves ? Tu te sens comment ?
Jc : Je me sens bien, je me sens... non je me
sens très bien... j'aime bien le Club.
Jm : Ok, qu'est-ce qui fait que
aujourd'hui... Alors tout à l'heure, je t'ai posé la question
à propos de la branche, qu'est-ce qui fait que tu y restes, là
c'est au niveau du Club, qu'est-ce qui fait que tu restes au Club ? Tu as pris
des fonctions dans le Club ? Des responsabilités ?
Jc : Non, non.
Jm : Pourquoi ?
Jc : Non, parce-ce que c'est un manque de
temps, et puis...
Jm : Un manque de temps ?
Jc : Ouais, tout à fait.
Jm : C'est-à-dire que tu disposes de
combien de temps ?
Jc : Ben déjà tous les week-end
je ne suis pas là.
Jm : Tous les week-end tu n'es pas
là.
Jc : Donc y a plus que la semaine, et bon le
soir, euh... tout dépend de mon travail, si je finis un peu tard, je
peux pas venir au Club, hein ! Je passe du temps...
Jm : Et les autres membres qui ont pris des
responsabilités au sein du Club, d'après toi, est-ce que c'est
parce qu'ils ont plus de temps, qu'ils ont pris des responsabilités ?
Jc : Peut-être pas forcément
peut-être pas, je sais pas, non.
Jm : D'après toi, comment ils font ?
Jc : Ben peut-être ils se
débrouillent, peut-être ils ont eu peut-être, plus envie que
moi, sûrement !
Jm : Plus envie ? Tu as moins envie en ce
moment ?
Jc : Non ! Non mais bon.
Jm : Tu peux en avoir moins envie. Ça,
ça m'intéresse par contre.
Jc : Non, non, c'est vrai, j'ai
peut-être pas trop envie de m'investir peut-être au niveau
responsabilité du Club.
Jm : Oui, et pourquoi ? A part le temps...
Jc : Je préfère, hein, et
surtout par le temps, je préfère m'investir peut-être dans
d'autres branches qui...
Jm : Tu préférerais t'investir
dans d'autres branches, laquelle par exemple ?
Jc : Comnet ou... C.E.B. Bon c'est les deux
branches où je fais partie, c'est tout.
Jm : Chez Comnet, tu peux me parler de
Comnet, de la branche Comnet ? (silence) Donc je vais reprendre un peu les
mêmes questions que j'avais prises pour le CEB, au niveau de Comnet,
euh... ça marche comment Comnet ?
Jc : Comnet, ben c'est une branche qui veut
faire de... de l'Internet. Donc on essaye déjà de gérer la
connexion Internet et pi essayer de monter un site Internet ou... extranet...
Un truc comme ça... pour, pour le Club.
Jm : Alors, comment ça se passe pour
les membres ?
Jc : ...Pareil que...
Jm : C'est-à-dire pareil ?
Jc : Ben y' a aussi un meneur.
Jm : Y a un meneur ?
Jc : Du moins un meneur, y a une personne qui
est un peu plus responsable de la branche.
Jm : Et elle s'est auto
désignée, ou elle a été élue par les autres
?
Jc : Je ne sais pas du tout, si elle s'est
désignée. Je suis arrivé un tout petit peu après,
donc je ne sais même pas comment ça c'est fait !
Jm : Ah, tu es arrivé après,
pour Comnet hein ?
Jc : Oui
Jm : C'est-à-dire tu as
participé à la création pour Comnet, non ?
Jc :, non, c'est après. Et là
aussi, y a eu pas mal de... de, de changement, de roulement, de membres, j'ai
l'impression.
Jm : Y a eu combien de membres, aujourd'hui a
peu près ? Chez Comnet ?
Jc : Je sais pas, on se retrouve six, non ?
Six, sept par là, je sais pas. Je sais même pas qui c'est qui est
membre exactement là.
Jm : Oui, mais à peu près, en
gros on peut dire, on se retrouve à deux, trois on se retrouve à
une dizaine...
Jc : Non, non, non pas une dizaine, à
cinq, six pas plus !
Jm : cinq, six ?
Jc : Pas plus non.
Jm : D'accord, euh... alors comment ça
se passe... dans la branche Comnet, entre les membres, je t'ai
déjà posé cette question, mais je vais essayer de la
préciser, euh... depuis que le Club a rouvert, puisque je te parlais
tout à l'heure que la Finance a rouvert, là, Comnet a dû
redémarrer aussi...
Jc : Oui, mais il a démarré
plus tard...
Jm : Beaucoup plus tard ?
Jc : ...parce-que nous, à la
Bourse, on se réunissait chez un particulier, que le Comnet non, donc on
a redémarré que quand y avait les locaux. On a perdu encore plus
de temps que la Bourse.
Jm : Qu'est-ce que ça t'as fait, quand
Comnet a dû arrêter ? Comnet ou le CEB ont dû arrêter ?
Le CEB, tu m'as dit que tu craignais que ça ne redémarre pas,
mais tes sentiments profonds...
Jc : ...Y a pas que le C.E.B., hein. Le Club
s'il ne redémarre pas.
Jm : Ne redémarre pas ?
Jc : Ah ben, si on retrouvait pas de local...
Jm : Ça t'aurais fait quelque chose ?
Jc : Ah oui, tout à fait, oui.
Jm : Pourquoi ?
Jc : ...Ben ça...
Jm : Vas-y, vas-y, t'es presque à
dire.
Jc : Non, ben, parce-que c'était,
j'avais pu rencontrer des personnes, pour moi, c'est un lieu de rencontres,
donc j'allais perdre ce lieu de rencontres, surtout, à ce niveau
là.
Jm : Perdre ce lieu de rencontre ?
Jc : Hum.
Jm : Donc pour en revenir à Comnet,
euh... comment ça se passe au sein de Comnet ? Euh... lorsque vous avez
des, des débats ? C'est pareil, vous êtes organisés de
la même façon ? Vous êtes autonomes ?
Jc : C'est pareil, c'est... en
général...
Jm : Vous avez un compte en
banque ?
Jc : Pas encore. ça va pas tarder !
Jm : Ça va pas tarder ? C'est
prévu ?
Jc : C'est prévu, donc... oui.
Jm : Qu'est-ce que tu y fais, toi, dans
Comnet ?
Jc : Ben, je suis Trésorier.
Jm : Trésorier ? Pourquoi tu es
Trésorier de Comnet ?
Jc : Oh, parce qu'il faut bien prendre des
responsabilités de temps en temps, quand même !
Jm : Oui, tu l'as pris un peu à contre
coeur, ou finalement...
Jc : ...Non, pas du tout...
Jm : ...c'est pas dérangeant, ou
bien... ?
Jc : Non, ça me dérange pas,
parce-que c'est pas...
Jm : C'est pour rendre service ? Ou c'est
pour... finalement tu peux dire « ça peut m'apporter
quelque chose » ?
Jc : Non, je pense que ça peut
m'apporter quelque chose.
Jm : Alors, qu'est-ce que ça peut
t'apporter ?
Jc : A gérer déjà un
compte de plusieurs personnes, et tout ça...
Retournement de K7 = ¾ h
Jm : Donc, tu disais que ça pouvais
être une bonne expérience d'être trésorier, que
ça pouvait t'apporter quelque chose pour gérer...
Jc : Gérer les comptes, et puis
surtout de... c'est surtout des comptes de tout un groupe... qui peut
être intéressant.
Jm : Alors, entre les gens, qu'est-ce que
c'est, qu'est-ce qui te paraît déterminant ? Vous avez un
projet donc, installer Internet, un Intranet...
Jc : Un Internet, oui.
Jm : Alors, qu'est-ce qui te paraît
déterminant dans la conduite de ce projet ? Ou dans la conduite de la
branche ? On va prendre plus large.
Jc : ...Ben, c'est le même
problème que la Bourse, je pense que c'est... ça risque de... un
problème de compétence. Donc il va falloir avoir la
compétence, pour créer ce site... ça, il va falloir se
l'acquérir parce-que je pense, qu'on ne l'a pas aujourd'hui.
Jm : Donc, vous avez besoin de
compétence, vous ne les avez pas ? Et comment vous faites pour les
trouver ses compétences ?
Jc : Pour le moment, y a pas grand chose de
décider.
Jm : C'est à dire, vous attendez que
le 25 décembre, que le Père Noël vous apportent les
compétences ?
(rires)
Jc : Non ! Déjà non, le
principal c'est d'essayer de se connecter déjà sur Internet...
avec une ligne grand débit. Donc, ça c'est la priorité,
dés qu'on aura ça, bé, on va se lancer après dans
le, dans la création du site. Donc il faut qu'on choisisse un logiciel
pour faire ça... et puis... ben on envisagera tous les problèmes
au fur et à mesure, je pense.
Jm : Alors, qu'est-ce que c'est qui te ferait
quitter la branche ?
Jc : ...Ben pareil, le manque de temps,
surtout, si...
Jm : Pour la Finance, tu me disais manquer de
temps, puis finalement tu t'étais investi dans Comnet en plus, t'as en
plus pris des fonctions de Trésorier.
Jc : Oui.
Jm : Donc, le temps... y a autre
chose !
Jc : Oui, parce-que ça tombe bien,
parce-que c'est toujours le lundi, donc, ça me fait juste... Je me
bloque tous les lundis, je sais, et comme ça, c'est bon. C'est vrai,
à la rigueur, s'il fallait que je me bloque d'autres soirs, je serai
pas... moins sûr, mais là, je sais, par exemple, tous les lundis
sont bloqués, donc c'est quand même plus facile pour moi.
Jm : Bon... Alors, bon on va arriver à
la fin de cet interview, de cet entretien, mon cher ministre. Alors, qu'elles
sont, selon toi, selon toi hein, les obstacles à une participation plus
importante au club ?
Jc : (réflexion) Pour moi, je pense,
c'est le manque de matériel performant.
Jm : Ah oui, au niveau de l'informatique ?
Jc : Oui,
Jm : Mais participer dans son
fonctionnement ? Participer dans son organisation ? Participer...
qu'est-ce qui ferait que des gens viendraient participer, pour toi hein ?
Jc : Qui viendraient au club ?
Jm : Oui.
Jc : Moi je pense que c'est... le manque de
matériel c'est un peu gênant, parce-que, souvent les membres, ils
ont une machine qui est plus performante que, euh... qu'au Club. Et
ça... c'est pas une bonne chose.
Jm : Au départ, i'avait les ¾
d'une machine, au départ quand le club s'est créé, et
pourtant, i'avait une trentaine de personnes, qui venaient prendre des
responsabilités, des fonctions, etc. Donc i'avait bien autre
chose ! Donc, au-delà du matériel, qu'est-ce que
d'après toi, il y aurait ?
Jc : Les fonctionnalités, ça
c'est sûr, mais c'est autre chose, les fonctionnalités, tout
ça. Mais en tant que membre, c'est sûr que je regrette un petit
peu, là, au niveau du club.
Jm : Oui, le matériel, c'est entendu,
c'est entendu.
Jc : Le matériel, oui c'est vrai que
c'est pas facile d'avoir du matériel.
Jm : Oui, ça, c'est entendu, mais...
bon le matériel est un obstacle, mais est-ce qu'il y a d'autres
obstacles pour quelqu'un qui voudrait... s'investir, euh... mettre en place
d'autres branches. Parce-que dire qu'il y a des branches, c'est bien mais...
Jc : ...Non, je pense pas...
Jm : ...il y a autre chose qui se joue,
plutôt. « Je viens pas que pour
l'informatique ». Si on veut créer une branche, c'est
qu'il y a autre chose, que l'informatique.
Jc : Non, non, je pense, que si les gens
veulent créer une branche, y a pas de problème au niveau du Club.
Puisque nous on l'a fait au niveau de la Bourse, d'autres personnes peuvent le
faire pour d'autres branches.
Jm : Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour
améliorer le club ? Au-delà du matériel informatique.
(silence) Est-ce qu'il faut peindre les murs en jaune ?...
Jc : Non, le local...
Jm : Est-ce qu'il faut mettre trois
call-girls à l'entrée.
Jc : Ça oui, ça tu peux le
faire ! Ça tu peux le faire ! Non le local, il est impeccable, c'est
vrai qu'au niveau local, là...
Jm : Avant, on avait un local qui
était pas si impeccable que ça, et pourtant i'avait quand
même une centaine de membres.
Jc : Oui, tout à fait.
Jm : Cent vingt membres, il y avait.
Jc : Mais bon, le problème, y a pas
beaucoup de monde qui vient, je trouve, hein, parce-que quand je viens le soir,
c'est vrai que c'est le lundi, euh... on se retrouve à sept ou huit. Il
pourrait y avoir plus de monde que ça. Moi, y a des personnes, des
membres que je n'ai jamais vus. Bon peut-être je ne fais pas partie de la
même branche... ou je viens pas en même temps qu'eux... mais y a
beaucoup de membres que je connais pas moi, hein, je connais très peu de
membres.
Jm : Et ça, c'est dû à
quoi ?
Jc : C'est dû à quoi ? Ben
je ne sais pas, peut-être qu'on vient pas au même moment,
peut-être qu'on a pas les mêmes intérêts... c'est
sûrement ça, hein. Peut-être que je viens pas assez souvent,
aussi.
Jm : Tu te rappelles de cette enquête
que j'avais mené en avril ?
Jc : Oui.
Jm : Donc, y a neuf mois, déjà,
oh ! Ben ça passe vite, hein. Il y avait eu les résultats sur un
des Bulletins Membres, à la question « si vous êtes
toujours membre, qu'est-ce qui vous fait y rester ? » tu
avais marqué la convivialité et l'entraide.
Jc : Hum.
Jm : C'était pas
l'informatique ?
Jc : (silence) ...Non... Mais c'est moi,
c'est plus un lieu de rencontres que... Non, c'est vrai qu'au départ, je
suis venu au club informatique, mais c'est plus avoir un lieu de rencontre et
un échange d'informations.
Jm : Qu'est-ce que tu entends par
convivialité ?
Jc : ...Convivialité, c'est,
convivialité avec les membres.
Jm : Oui, avec les membres, mais qu'est-ce
que tu entends par « convivialité avec les
membres » ?
Jc : Pouvoir discuter de... de tout et de
rien.
Jm : De tout et de rien, est-ce que tu as un
ou deux exemples quand vous discutez de tout et de rien ? Dans quel
état d'esprit tu te trouves ?
Jc : ...dans quel état d'esprit...
euh...
Jm : Comment tu te sens quand vous discutez
de tout, de rien ? Alors que tu venais pour l'informatique ?
Jc : Oui, mais c'est vrai, qu'on peut parler
de sports, on peut parler de n'importe quoi, de...
Jm : Dans quel état d'esprit, tu te
sens ? A ce moment là ?
Jc : D'être heureux, d'être... de
pouvoir échanger des opinions, des...
Jm : Heureux de pouvoir échanger des
opinions ?
Jc : hum.
Jm : Et généralement, cet
échange d'opinions, ça se passe comment ? Sans heurt, avec des
heurts, y a des conflits ?
Jc : Non, en général, ça
se passe sans heurt, quand même... Je pense que les membres, ils se
respectent entre eux, donc, ils n'ont pas...
Jm : Alors, à la
question "Qu'êtes-vous venu chercher au club ?" tu avais
marqué une ambiance et un échange, donc c'était pas de
l'informatique ?
Jc : Non !
Jm : Alors, qu'est-ce que tu entends par
ambiance ? Parce-que, quand tu as adhéré, l'ambiance tu la
connaissais pas ?
Jc : Non.
Jm : Donc, maintenant, avec deux ans de
recul, tu la connais, cette ambiance ?
Jc : Oui, tout à fait, oui.
Jm : Alors, comment tu pourrais la
définir cette ambiance ?
Jc : L'ambiance, c'est de... c'est
d'être... de... quand on rentre dans ce local, d'être bien, de...
de faire ce qu'on veut un p'tit peu... et...
(long silence)
Jm : L'ambiance se caractérise par
quoi ? Est-ce que tu as des mots pour dire, ben,
« ça, ça défini l'ambiance »
? Est-ce que quand tu arrives, y a de la musique, y a un groupe folklorique
grec qui danse sur les tables...
Jc : Non, non, pas du tout !
Jm : On boit de la bière, on mange
une choucroute, je sais pas moi ?
Jc : Non, mais je sais pas, je cherche pas
ça, c'est, pouvoir dialoguer.
Jm : Non, mais sans la chercher, tu as
marqué : qu'est-ce que tu es venu chercher : une ambiance, donc il
faut définir cette ambiance.
Jc : Pour casser ma solitude, c'est surtout
ça, l'ambiance, donc ça me permet de rencontrer des gens, des
personnes.
Jm : Oui l'ambiance, donc c'est... alors,
"êtes-vous content d'y venir ?" tu as répondu "oui", "pouvez
vous expliquer pourquoi ?" tu as marqué "parler avec des personnes
qui ont la même passion que moi", là, il s'agit bien
d'informatique.
Jc : Oui, ou pas forcément ou de
Bourse.
Jm : ...de Bourse ?
Jc : De Bourse, c'est pas forcément
d'informatique.
Jm : Donc, tu es venu dans un Club
informatique pour faire de la Bourse.
Jc : Non, au départ, non.
Jm : Non, mais finalement deux ans
après, on constate que tu es venu initialement dans un Club informatique
et que tu fais finalement de la Bourse.
Jc ... De la Bourse, oui.
Jm : Qu'est-ce qui explique ça ?
Jc : Peut-être un concourt de
circonstances, parce-que...
Jm : Un concourt de circonstances ?
Alors quel genre de concours de circonstances ?
Jc : Ben peut-être que... que j'ai
rencontré des personnes qui étaient intéressés par
la Bourse, donc, on a voulu monter une branche, à ce niveau-là.
Si j'avais rencontré personne, peut-être qu'on aurait pas
monté cette branche, ou... Et puis bon, c'est surtout le fait que le
Club accepte d'avoir des branches, et des trucs comme ça. Donc que,
c'est vrai que ça, ça facilite le travail.
Jm : "Pensez-vous que...", à la
question, "pensez-vous que le club puisse parfois soulager une certaine
solitude", tu avais répondu "oui" et tu l'as exprimé au cours de
l'entretien... Effectivement, chez toi, t'es tout seul. Cette solitude se
caractérise comment chez toi ? On est seul, mais c'est quoi, tu tournes
en rond, tu souffles, tu regardes la télé...
Jc : Non, je trouve...
Jm : Tu es pendu toute la journée au
téléphone.
Jc : Non, pas du tout.
Jm : Je sais pas, moi, c'est pour citer des
exemples.
Jc : Non, c'est bon je regarde la
télé ou je fais de l'Internet, je fais de l'informatique chez
moi. Mais bon à la rigueur, je préfère le faire au Club,
que chez moi tout seul... Ça permet deee... d'échanger des
informations.
Jm : A la question "le club est il pour vous,
un lieu de débat et d'échanges où vous pouvez exprimer des
idées" tu as répondu "oui". Est-ce que tu peux me dire, euh...
quel genre d'idées tu as déjà débattu et que tu as
pu exprimer ?
Jc : Ben par exemple... sur le système
d'exploitation Linux on a pu débattre avec certains membres et... donc
ça permet de voir un petit peu s'il y a des gens qui étaient
déjà intéressés par Linux et s'ils s'en
servaient.
Annexe 11 Sixième entretien
Jo (Sixième entretien) le mercredi 7
février 2001, 13 heures. A notre domicile.
Le Pilote de la branche Finance. Actuellement travaille
(commercial informatique) mais après plusieurs emplois
éphémères et de longues périodes de chômage
(plus de 3 ans). 52 ans. Adhérent depuis le début de
l'association (02.10.97). (Egalement Pilote de la branche Comnet). Correspond
au questionnaire n°2.
Après annonce.
Jm : Alors, comment as-tu connu le
Compu's Club ?
Jo : Et ben, moi c'est pas compliqué,
c'est toi qui avais fait la proposition quand j'étais chez MA (premier
bailleur de l'association, ndlr), puis on a démarré ensemble,
puisqu'il fallait un membre de Micro Avenir, à l'époque,
j'étais volontaire.
Jm : Pourquoi, il fallait un membre de MA
à l'époque ? Tu te rappelles ?
Jo : Ben, parce-que c'était dans les
locaux de MA et puis R. (le patron de MA, ndlr) ne voulait pas que ça se
fasse tout seul dans son coin, il voulait absolument avoir un petit
contrôle quelque part.
Jm : Et ça a posé un
problème particulier, ça, tout le monde était d'accord
?
Jo : Oh ben, y'a pas eu de problème du
tout, ça gênait pas.
Jm : Non ?
Jo : Non.
Jm : Qui t'a parlé de monter un Club
?
Jo : C'était toi.
Jm : C'était moi, j'étais venu
avec une idée, je t'en avais parlé de quelle façon ? Tu
t'en rappelles à l'époque ?
Jo : C'est loin. C'est loin, c'est loin,
c'est loin, c'était en 98, non 97, 97. On a démarré en
octobre 97. ouais donc, ça c'était fait en...
Jm : On en avait parlé un petit peu
avant quand même ?
Jo : Oui, mais septembre - octobre... mais
pas, c'était après les vacances, c'était après les
vacances, on en avait parlé, histoire de faire venir les jeunes.
Voilà, l'idée de base c'était de faire venir les jeunes
chez MA, en fait, pour faire marcher la boutique, c'était l'idée
de base, autant que je me souvienne et puis, on est parti de là,
quoi.
Jm : Et y'avait autre chose qui avait
été exprimé et qui t'avait paru intéressant
au-delà de faire venir les jeunes dans la boutique ? Tu avais
retenu autre chose, tu te rappelles d'autre chose ?
Jo : Non, à l'époque, la seule
chose que je voyais, effectivement, c'était de rester auprès de
la Micro Informatique et de continuer à bricoler là-dedans.
Jm : Parce-que c'est ton dada ?
Jo : Parce-que c'est mon dada oui.
Jm : Très bien. Alors, qu'est-ce qui
t'a séduit, en fait, de participer à ce, à cette...
à la construction de ce Club au départ ? Pourquoi tu as
été d'accord ?
Jo : Eh ben, c'est pas compliqué,
c'était tout simplement pour avoir l'impression de faire quelque chose
de nouveau, de différent du boulot habituel quoi.
Jm : Parce-que tu travaillais en
informatique ?
Jo : Je travaillais en informatique.
Jm : A ce moment là. Euh... Est-ce que
tu as déjà une expérience de l'associatif ? Est-ce que tu
en avais déjà eu une avant le Compu's Club ?
Jo : Extrêmement petite, j'étais
gamin, quand on avait monté un Club de philatélie, à
l'école, je devais être en 3e ou un truc comme
ça, j'étais Trésorier à l'époque.
Jm : Oui et ça t'avait plu ?
Jo : Oui, ça m'avait plu, mais j'ai
pas beaucoup de souvenirs de ça, parce-que c'était assez court,
c'était sur le dernier trimestre que ça c'est fait et puis
après j'ai quitté l'école.
Jm : Ah, une fois que tu as quitté
l'école, tu as quitté le Club ?
Jo : Oui oui, j'ai tout quitté en
même temps.
Jm : Très bien, tu fais partie d'une
autre association actuellement ?
Jo : Non, aucune.
Jm : Tu y as pensé peut-être
?
Jo : Non, même pas.
Jm : Non, même pas ?...Alors, qu'est-ce
qui t'a conduis à te ré-adhérer au Club tous les ans ?
Jo : En fait, c'est pas compliqué.
Euh... c'est pas compliqué... c'est très compliqué en
même temps. En fait, j'ai quitté une région, une femme, un
métier, tout un tas de choses... euh, sur un coup d'un ras-le-bol. En
fait, j'avais une petite vie, dans un petit coin et ça ne
m'enthousiasmait pas du tout, donc j'ai complètement changé, j'ai
changé de région, changé de métier... J'ai un
historique, j'ai créé une entreprise qui a coulé, donc
derrière ça, je me suis retrouvé Rmi. Donc, je me suis
senti repartir dans le mauvais sens. Et le fait de faire partie d'un Club,
ça me permettait d'avoir une accroche quelque part et de... de vivre un
peu mieux dans la région, en fait, avec... avec des relations.
Jm : Donc, c'est ce qui t'as conduit
à... Qu'est-ce qui t'as conduit à te ré-adhérer au
bout d'un an ?
Jo : Euh.... Ben en fait, la
continuité, elle est venue du fait que... bon, je voulais pas
lâcher le Club, même si des fois, moralement j'avais pas envie d'y
participer, j'avais pas mal de problèmes psychologiques qui m'ont un peu
freiné... mais ça m'a pas empêché, je ne quitterai
jamais le Club, uniquement parce qu'il y a un lien, y'a un relationnel, que
j'ai démarré ça et que je veux plus le lâcher
maintenant.
Jm : Très bien, tu disais moralement
t'avais pas envie, par moment t'avais pas envie d'y participer, à ces
moments là, comment ça c'est passé ?...Euh, tu
étais moralement fatigué et donc c'est ce qui a fait que tu t'es
éloigné du Club ?
Jo : Y'avait un peu ça et plus
d'énergie en fait. J'avais plus envie de, de, de m'embêter avec un
tas de trucs, donc, c'était plutôt un manque d'énergie
suite à ce problème psychologique, en fait.
Jm : D'accord, parce-que
généralement, quand on a une... un p'tit souci, qu'on fait partie
d'un Club, au contraire, on multiplie les rencontres, puisque tu le disais
toi-même, c'est un lieu qui permet d'avoir des liens, donc quand on est
un peu déstabilisé, à la limite... c'était pas
ça encore pour toi à l'époque ?
Jo : Ben, c'était pas un peu
déstabilisé, c'était totalement
déstabilisé.
Jm : Oui, justement, le fait d'être au
Club, comme tu le disais tout à l'heure garder ce lien...
Jo : ...Non, il fallait que, que, que je me
ressource moi-même, intérieurement déjà. Il fallait
qu'intérieurement je sois prêt à relancer la machine et
tant que ça c'était pas fait, je pouvais pas avancer.
Jm : Alors, qu'est-ce qui a fait en fait, que
tu es revenu ?
Jo : Et ben... euh... petit à petit,
j'ai retrouvé du boulot, par... de façon archaïque, mais,
bon, c'est ce qui m'a permis de raccrocher tout doucement dans le circuit, dans
le "système", entre guillemet.
Jm : La période qui était
moralement déstabilisée, c'était une période ou tu
avais perdu ton emploi ?
Jo : J'avais perdu mon entreprise.
Jm : Ton entreprise ?
Jo : Mon entreprise. Ouh alors, c'est
compliqué : mon entreprise, derrière ça le Rmi. Donc,
y'avait un aspect social négatif...
Jm : Pardon, pour préciser... au
moment ou, enfin c'est au moment du Club... hein...
Jo : Au moment du Club....
Jm : ...tu avais ton entreprise au
moment du Club ?
Jo : Non, au moment du Club, c'était
fini oui oui, j'étais chez MA (le nom du magasin de notre ancien
bailleur, ndlr)...
Jm : Voilà, donc à un moment,
tu t'es éloigné un peu du Club, c'est ça ?
...Parce-que tu étais moralement déstabilisé ?
Jo : ...Chômage et puis donc...
Jm : Donc, tu avais perdu ton emploi,
à ce moment là...
Jo : ...J'avais perdu mon emploi, à ce
moment là...
Jm : ...Et tu étais en recherche
d'emploi ?
Jo : J'étais en recherche d'emploi,
j'ai trouvé des petits boulots, ça a pas marché non plus.
Donc psychologiquement, je retombais un petit peu dans des trucs très
difficiles.
Jm : Est-ce que le Club a fait quelque chose
pour toi ? Pour t'aider à retrouver un emploi ? (silence) Là, je
précise une chose : tu peux vraiment dire les choses, ce qui
m'intéresse c'est vraiment le ressenti, quoi.
Jo : Euh...non, moi je pensais que le Club
aurait plutôt était une gêne, pour chercher du boulot.
Jm : Oui... une gêne ?
Jo : Oui plutôt une gêne,
parce-que, bon, j'ai l'impression, qu'on me tenait comme un grand technicien,
très fort, très puissant qui pouvait faire un peu n'importe quel
boulot. Quand on me parlait de travail, c'était souvent pour me
retrouver dans le même contexte que MA qui était un contexte
totalement défavorable et je voulais plus rentrer dans ce
circuit-là. Donc c'est ça aussi, qui m'a un peu freiné de
ce coté-là.
Jm : C'est la correspondance qui y avait avec
l'étiquette du Club et l'emploi que tu recherchais, qui était
trop proche à ce moment là et qui a fait que tu t'es
éloigné parce-que tu n'avais plus d'emploi ?
Jo : Oui tout à fait, voilà,
i'avait...en résumé c'est ça !
Jm : Si je devais reformuler, c'est
ça, hein ?
Jo : Oui, mais c'est ça et en
même temps, je voulais progresser dans le boulot de la Micro informatique
et j'ai suivi pas mal de stages.
Jm : Pas mal de stages ?
Jo : Oui, ça c'est une période
aussi ou le Club, je l'avais laissé totalement tombé parce-que
j'étais trop pris.
Jm : D'accord, tu avais un projet en
rejoignant le Club, à l'époque ?
Jo : Ouais, j'avais un projet d'Internet de
façon locale, en fait, C'est-à-dire : c'était un
petit truc qui marchait localement, où les gens pouvaient se connecter,
ils pouvaient créer des petites annonces, des tas de choses comme
ça. Et puis ce projet, je l'ai jamais mené à terme,
parce-que après... bé... la vie allant... j'y croyais de moins en
moins, puis j'ai laissé un peu tombé.
Jm : Alors, donc c'est...c'est... Qu'est-ce
que tu attendais du Club à l'époque, quand il a... quand il
est... quand tu l'as monté ?
Jo : Ben, au début où j'ai...
où on a monté le Club, en fin de compte, j'avais... j'attendais
rien du Club, j'avais plutôt envie de tout donné au Club.
J'attendais rien du tout en fait.
Jm : Rien du tout, au départ ? Et
quel intérêt tu en avais ?
Jo : Ben, l'intérêt, c'est ce
que je disais, c'est de... d'avoir un circuit relationnel, un système
qui permettait d'avoir une attache sur la région.
Jm : Oui, c'est vrai, c'est redondant, cette
question.
Jo : Ouais (rires)
Jm : Excuse-moi ! Est-ce que tu peux me...
Alors, tu m'as parlé déjà de toi à l'époque,
hein, au moment ou tu es venu au Club... ta situation familiale, à
l'époque, c'était quoi ? Tu étais marié ?
Jo : ...Quand je suis arrivé au
Club... j'étais en instance de divorce... un divorce qui a duré
10 ans... mais je vivais maritalement déjà...
Jm : Tu vivais maritalement... Donc tu
travaillais chez MA ?
Jo : Ouais.
Jm : Euh.... Est-ce que tes parents
étaient engagés dans la vie associative ?
Jo : Pas du tout.
Jm : Est-ce que tu as baigné là
dedans ?
Jo : Non, pas du tout, au contraire.
Jm : Dans la vie publique, peut-être
non ?
Jo : Pas du tout.
Jm : Pas du tout non plus ?
Jo : C'est le contraire.
Jm : Alors, qu'est-ce qui fait que tu as
été sensible à la vie associative ? Parce-que tu ne
connaissais pas, n'ayant pas baigné dedans, tu as une vague
expérience étant jeune...
Jo : Non, c'était un peu....
Jm : Qu'est-ce qui t'as plu dans le monde
associatif et particulièrement dans le Club ?
Jo : C'était le relationnel
uniquement... Le fait de connaître d'autres personnes... (silence) Le
fait de connaître d'autres personnes et puis de pouvoir apporter des
conseils, des choses comme ça, surtout en micro informatique, parce-que
c'était mon dada, déjà.
Jm : Très bien, alors...
Aujourd'hui... maintenant on va passer à aujourd'hui. Ça,
c'était au début quand le Club s'est monté, aujourd'hui le
Club ça représente quoi pour toi ?
Jo : Ben pour moi, aujourd'hui le Club
ça représente deux choses intéressantes : à
savoir le financement parce-que bon j'ai toujours à pouvoir gagner de
l'argent un petit peu par ce biais là, donc, c'est toujours le
coté argent qui m'intéresse et puis Comnet, ben parce-que, bon,
les réseaux Internet et tout ça, ça reste toujours un
p'tit peu mon dada...
Jm : J'ai pas compris une chose, le... tu
disais « chercher de l'argent ». Pourquoi tu
disais ça ? Tu pensais que le Club pouvait t'apporter de l'argent ?
Jo : Non, pas le Club par lui-même,
mais la section Finance du Club.
Jm : Ah, la section Finance !
Jo : La section Finance, la section Finance.
Non, non pas le Club, pas du tout, au contraire, j'en donne.
Jm : Ouais, la cotisation ?
(rires)
Jo : Ouais voilà. (rires)
Jm : Alors, aujourd'hui, au-delà de
tes participations Comnet et Finance... quelle image tu as du Club aujourd'hui
? Au-delà de l'informatique hein. Est-ce que c'est uniquement une
étiquette informatique ou est-ce que tu t'aperçois qu'il se joue
autre chose dans le Club, ça représente quoi ? Quelle image tu en
as ? Qu'est-ce qui te plait ?
Jo : En fait, le Club aujourd'hui, le Club,
le Club, le Compu's Club, en fait... qu'est-ce qu'il apporte aux gens, en fin
de compte, il apporte...
Jm : Pas nécessairement apporter...
Jo : Ce que j'y vois, en fin de compte,
c'est...euh, un vivier de personnes, en fin de compte, qui se... qui se voient
régulièrement et puis qui discutent d'un tas de choses, en plus.
Et ça, apparemment, c'est quelque chose qui donne beaucoup de...
beaucoup d'entrain, en fait.
Jm : Beaucoup d'entrain ?
Jo : Ouais,
Jm : Est-ce que tu as un ou deux exemples de,
de... qui montrent que ça donne de l'entrain ?
Jo : Ben, déjà y'a un seul
truc, c'est Ms (9è entretien) qui a longtemps avoué lâcher
les Finances et puis qui reste, parce-que, bon, on est un petit groupe sympa,
on discute bien et ça se passe bien.
Jm : D'accord.
Jo : Ça, c'est un exemple qui... qui
est vraiment flagrant !
Jm : On y reviendra tout à l'heure,
pour poursuivre le guide, hein, on y reviendra. Alors, qu'est-ce qui te plait,
toi au Club ? (silence) Au-delà de l'informatique toujours ? (silence)
On est bien d'accord, hein, c'est savoir ce qui fait lien. Maintenant si c'est
l'informatique seule qui fait lien...
Jo : ...non, moi ce qui me plait
là-dedans, c'est qu'on rencontre des amis.
Jm : Des amis ?
Jo : Moi, je vois plus comme ça,
ouais.
Jm : C'est quoi, un ami pour toi ?
Jo : Un ami, c'est quelqu'un... c'est
quelqu'un qu'on peut rencontrer facilement, qu'on peut discuter facilement...
on peut lui rentrer dedans, i dit rien ou quand il se met en pétard, on
arrête... (rires) c'est un système relationnel qui permet de... de
revoir des gens régulièrement, de, de pas les oublier, de
toujours les garder en mémoire.
Jm : Est-ce que justement en mémoire,
tu as un exemple de ce genre de relationnel... de ce genre de chose qui s'est
produite ?
Jo : Ben, y'en a un, c'est JM ! (rires)
Jm : Ou un autre peut-être !
Jo : Pan !
Jm : Ou un autre peut-être ?
Jo : Un autre ? Qui c'est que je revois
régulièrement, j'aime bien revoir ? C'est L. (7è
entretien,ndlr), par exemple, Jc (5è entretien, ndlr), c'est pareil,
c'est des gens que j'aime bien revoir, discuter avec eux, que ce soit technique
ou autre, peu importe, mais ça...ça crée un petit esprit
d'équipe quelque part.
Jm : Est-ce que tu as un exemple de quelque
chose de précis dont vous avez discuté ou il y a eu une
réaction de l'autre coté, où vous avez eu un
échange ?
Jo : ... Ben c'est des échanges
souvent anodins, donc, je les ai pas tous retenus, mais bon, il suffit des fois
que je demande un truc, bon très rapidement, je suis servi...
Inversement, ça se passe pas toujours de la même manière,
mais bon, en général, on essaye toujours de s'entraider
mutuellement. Exemple rapide : Jc (5è entretien), je demande les
statuts de la société, le lendemain matin, je les avais dans mon
E-mail.
Jm : Comment tu définirais le Club
aujourd'hui ? Si tu devais donner une définition ? Le Club c'est...
c'est ça... c'est ça... c'est ça...
Jo : (long silence) J'ai jamais
réfléchi à ça mais je dirais que... le Club
aujourd'hui c'est.....c'est.... c'est quoi, en fait ? Pour moi le Club,
c'est... c'est un ensemble de personnes qui s'y rencontrent
régulièrement et qui ont des petites activités qui les
touchent directement. Je le vois un peu comme ça, en fait, des
activités mais autres que purement informatiques.
Jm : D'accord, donc, tu dis
« autres que purement informatique », tu, tu
penses à quoi ?
Jo : Ben que ce soit le CEB, Comnet... la
Littérature, les jeunes, tout ça se sont des trucs, bon ça
tourne autour de l'informatique, ça c'est clair, mais... la base
même, c'est pas que l'informatique en fait.
Jm : Oui, tu vois, alors, cette
base-là, si tu devais la définir, tu la définirais comment
cette base ?
Jo : (long silence) ben moi, j'appellerai
ça un petit village.
Jm : Un petit village ?
Jo : Où tout le monde se
connaît.
Jm : Tout le monde se connaît ?
Jo : Ouais, je verrai ça un peu comme
ça.
Jm : Bon, parce-que dans un village,
qu'est-ce qu'il s'y passe ? Entre les gens ?
Jo : Ben, y'a la communication entre les
gens, déjà.
Jm : Oui, donc on peut communiquer.
Jo : On peut communiquer, on peut poser, on
peut avoir de l'aide éventuellement, si on a un soucis, on peut poser
des questions, avoir des réponses. Et tout le coté relationnel,
c'est, c'est.. je pense que ça rejoint un petit peu... ce qui manque
aujourd'hui dans la vie, en fait : dans le temps, dans les petits
villages, tout le monde se connaissait, bé, aujourd'hui, on est tous un
peu anonyme quelque part et ça permet de se retrouver un petit peu comme
dans un village. C'est pour ça que je vois un peu comme ça.
Jm : Alors, si on devait pousser un petit peu
plus loin et essayer de donner des noms, des termes à cette
communication, à cet aspect villageois, d'entraide et. Euh.. On
pourrait, on pourrait le décrire comment le Club ? Quel... quelles
valeurs on pourrait attribuer au Club ? Quelles seraient ses valeurs, en
quelque sorte, son fondement ?
Jo : Pour moi, le Club ce serait plutôt
une communauté.
Jm : Une communauté ?
Jo : Une communauté.
Jm : Dans le sens de... ?
Jo : Ben où on se retrouve tous, c'est
comme dans un village quoi, c'est la communauté du village.
Jm : Bon, mais dans les villages, y'a aussi
des conflits, je veux dire, y'a des heurts, y'a des débats qui sont pas
toujours...
Jo : Oui, mais bon, ça se
résout assez facilement en général, c'est pas des, des
heurts dramatiques, c'est pas catastrophique. Alors que dans l'anonymat...
Jm : ...Ça se règle
comment ?...
Jo : ...total, bon, dans l'anonymat
total...on n'oserait même pas demander quelque chose à quelqu'un
parce-qu'on le connaît pas.
Jm : ....Bon, donc tu fais partie d'une
branche, tu disais tout à l'heure, de deux branches...
Jo : ...Oui...
Jm :.Tu disais tout à l'heure :
la Finance et Comnet...
Jo : ...Et Comnet.
Jm : Comnet, qui est la branche Internet.
Jo : Comnet, qui est la branche Internet.
Jm : Bon, on va commencer par... par la
Finance, la Finance... est-ce que tu peux me parler un p'tit peu de cette
branche ? Ça marche comment ?
Jo : La Finance, en fin de compte, c'est,
c'est un ensemble de personnes, qui veulent connaître un p'tit peu mieux
tout ce qui touche l'économie. Donc, on apprend l'économie, en
même temps, bien sûr, on bascule systématiquement dans la
Bourse. Le but aujourd'hui du Club, d'une grosse partie de la majorité
des membres du Club, c'est monter un Club d'investissement, pour pouvoir jouer
en Bourse, en fait. On peut dire jouer en Bourse, puisque c'est encore comme
ça qu'on peut le percevoir et puis... voir nos performances, voir si on
est bon ou pas bon, ça doit permettre aussi d'avoir une petite
activité un peu stressante quelque part, un peu poussée.
Jm : Un peu stressante ? Le fait d'investir
son propre argent est stimulant ?
Jo : Voilà. Le fait d'investir de son
propre argent... et avec... avec les risques que ça peut comporter. On
peut avoir de la perte. Il va falloir qu'on discute tous. Il va falloir qu'on
trouve des solutions, en groupe. Y'a encore l'esprit d'équipe qui va
jouer là-dedans, il va falloir être très performant.
Jm : L'esprit d'équipe, tu entends
quoi, par esprit d'équipe ?
Jo : L'esprit d'équipe, c'est que bon,
si par exemple sur dix personnes, y'en a neuf qui disent « on
veux faire ça », il faut tenir, malgré tout,
compter un petit peu, de ce que pense la dixième personne. Et puis voir
si on peux essayer d'arranger de façon à trouver un consensus,
que tout le monde s'en sorte bien, que tout le monde y retrouve son compte.
Jm : Là, ça, ça c'est
déjà produit ça, tu as un ou deux exemples ? Où il
vous a fallu trouver un consensus ?
Jo : (silence) On est en train de
préparer justement le Club d'investissement. Le Club d'investissement
est en train de faire ça. Effectivement, tout le monde n'est pas
d'accord pour démarrer tout de suite le Club d'investissement parce-que
on a tous des opinions un peu différentes... Et petit à petit,
ben, c'est quand même en train de se créer, il suffit d'être
un peu patient et puis de faire passer les choses. Euh... ça c'est une
chose... moi, je pense que le Club d'investissement va pouvoir démarrer
très rapidement maintenant.
Jm : Combien vous êtes à la
Finance ?
Jo : Oups ! (silence) Euh... La section
CEB donc... l'ensemble qui compose la Finance doit être au alentour de
quatorze, quinze personnes, si je me trompe pas et actuellement sur neuf
personnes, peut-être dix a démarrer un Club d'investissement.
Jm : Et les autres, qu'est-ce qu'ils y font ?
qu'est-ce qu'ils viennent y chercher ?
Jo : Ben les autres en fin de compte, ils
n'osent pas rentrer dans le Club d'investissement.
Jm : On sais pourquoi ?
Jo : Moi, je pense que c'est la peur.
Jm : La peur ?
Jo : La peur et puis peut-être les
moyens d'investir, ils n'ont peut-être pas les moyens.
Jm : Oui et... euh... ils y viennent quand
même à la Finance apparemment.
Jo : Ouais mais pas
régulièrement.
Jm : Alors pas régulièrement,
mais quand ils viennent, ils viennent y faire quoi ?
Jo : Ils viennent, ils viennent participer
à la réunion.
Jm : Qu'est-ce que ça leur apporte
d'après toi ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait ?
Jo : Ben, là, je sais pas trop. Je
sais pas trop, parce-que on les voit pas trop souvent, ils viennent que
sporadiquement, donc c'est des gens qui ne restent pas vraiment au sein de
l'équipe, ils se sentent peut-être un peu exclus, je sais pas.
Jm : Tu t'es pas posé la question
à ce niveau là ?
Jo : Je me pose souvent la question, mais
j'ai jamais cherché à remédier au problème.
Jm : T'as jamais cherché à...
à savoir, hein !
Jo : Voilà.
Jm : Je suppose, que, il doit y avoir des
gens, qui sont venus, qui sont passés simplement, à la branche
Finance et qui ne viennent plus.
Jo : Oui oui.
Jm : Ces gens-là, on sait pourquoi ils
ne viennent plus ?
Jo : Non pas systématiquement, y'en a
certains que j'ai essayé de rejoindre, j'ai jamais eu de réponse,
je sais pas.
Jm : On sais pas... euh... En attendant le
Club d'investissement... vous comprenez la Bourse, hein, vous essayez de
comprendre la Bourse, l'Economie, la Finance... Et en attendant ce Club
d'investissement, euh... Qu'est-ce qui fait que les membres, d'après toi
hein, qu'est-ce qui fait que les membres, continuent à venir ? Est
ce que c'est cet optique de Club d'investissement ? Parce ça fait
combien de temps qu'elle existe, cette branche ?
Jo : Ça doit faire un peu plus d'un an
maintenant.
Jm : Un peu plus d'un an. Qu'est-ce qui les
fait tenir ?
Jo : Qu'est-ce qui les fait tenir ?
Je pense que c'est uniquement la perspective du Club d'investissement.
Jm : La perspective du Club d'investissement,
uniquement hein ?
Jo : Oui, à mon avis oui, parce-que...
Enfin la majorité des, des membres. Y'a certains membres qui viennent
parce qu'ils retrouvent un petit peu des gens sympas pour discuter. Y'a aussi
de ça. Mais une majorité des gens, quand même, veulent
arriver à créer ce Club d'investissement. Ils sont même,
quelque part pressés.
Jm : Et toi-même, tu, tu viens dans
cette perspective de Club d'investissement, mais est-ce que tu viens, est-ce
que tu y vas... est-ce que tu y participes pour quelque chose ?
Jo : Non moi, j'y viens essentiellement pour
le Club d'investissement.
Jm : Exclusivement ?
Jo : Oui.
Jm : Alors, cette branche, elle s'est
créée il y a un peu plus d'un an, hein !
Jo : Un an, un an demi, à peu
près,
Jm : Un an, un an et demi... Est-ce que t'as
participé à sa création ?
Jo : (silence) Je sais plus.
Jm : Tu sais plus si t'as participé
à sa création ?
Jo : Je sais plus si j'ai participé
à sa création ou si j'y suis rentré par la suite.
Jm : Alors, est-ce que tu te souviens comment
ça c'est passé, euh... quand tu as rejoins cette branche ?
Jo : Ben c'était... moi je crois que
j'ai rejoins cette branche, en rejoignant le Compu's Club justement,
après une période de creux et elle devait déjà
d'exister ou elle venait de démarrer, je sais plus, ça m'a
intéressé, ce qui m'avais intéressé, c'était
l'aspect Club d'investissement déjà au départ. Donc j'ai
adhéré très rapidement, maintenant, je m'souviens plus
comment j'y suis rentré, c'est une période un peu floue.
Jm : Donc vous suiviez le projet du Club
d'investissement, qu'est-ce qui te sembles important dans le fonctionnement de,
de la branche ? Euh... Qu'est-ce qui te semble important pour le bon
fonctionnement de la branche ? (silence) Ça fonctionne bien ? Y'a
des choses qui s'passent ?
Jo : Moi, ce qui me semble important oui,
c'est qu'y a un peu plus de personnes qui s'impliquent plus dans cette
branche.
Jm : Ça, c'est ce que tu as
constaté ?
Jo : Ouais, parce qu'en fin de compte, moi,
dès que je suis absent, j'ai remarqué que, que bon, cette branche
elle commençait à partir en, en ruine rapidement, parce-que j'ai
été absent pendant quelques mois et j'ai remarqué à
mon retour, que, ben, ça avait sérieusement perdu
d'adhésions.
Jm : Parce-que tu as des fonctions donc au
sein de cette branche ?
Jo : Ben, je suis Pilote, entre guillemet, de
cette branche et... il est vrai que, quand je suis plus là apparemment,
il manque un animateur.
Jm : Un animateur, donc tu as cette
étiquette d'animateur...
Jo : Ben, apparemment, moi, j'ai cette
étiquette d'animateur et bon, bé si ch'uis plus là, c'est
fini.
Jm : Si tu es plus là, c'est fini. Et
aujourd'hui, donc, tu étais en train de dire, qu'il y avait des gens qui
s'investissaient plus ? aujourd'hui ?
Jo : Non, non, non, ben pas trop encore...
Euh... Ben si, toi, tu, tu t'investis, mais à coté de ça,
y'a pas grand monde qui s'investit, ceux qui s'investissent un petit peu, c'est
surtout pour faire avancer le Club d'investissement, mais dans le sens
création uniquement. Donc y'en a deux, il me semble, c'est Jc (5è
entretien, ndlr) et L (7è entretien, ndlr)... peut-être un petit
peu B. (un membre du Club, ndlr).
Jm : Qu'est-ce qui les motive, eux ?
Jo : Raclement de gorge. Je pense que c'est
l'aspect financier, uniquement.
Jm : L'aspect financier ?
Jo : Ouais, moi je ne vois pas autre
chose.
Jm : Très bien. Hummm... Alors comment
ça se passe... ça se passe, quand vous avez une réunion,
vous vous réunissez, vous êtes organisés comment ?
Vous vous réunissez quand ? Comment ? Comment ça se passe ? Entre
les gens, hein !
Jo : Les réunions se font une fois
tous les quinze jours, tous les lundis soir à 18 h 30, la plupart des
gens viennent assez régulièrement, de tant en tant il manque
quelqu'un... Ce qui se passe en général, ben les gens sont
heureux de se retrouver, ils discutent, euh... de choses et d'autres. Certains
ont vu... ramènent des informations, d'autres... euh... d'autres dorment
même pratiquement... Donc bon, c'est... (rires)
Jm : Donc ils viennent pour dormir.
Jo : Donc ils viennent apparemment pour
dormir. Bon, ils s'investissent quand même dans le Club d'investissement
parce-qu'ils ont ramené les sommes qu'il fallait pour démarrer.
Donc, quelque part je comprends pas très bien, mais bon. Ils sont
là, ils participent... de loin, un petit peu, apparemment.
Jm : Tu parlais de somme pour
démarrer, C'est-à-dire, vous avez...
Jo : En fait pendant quelques mois, on a
commencé à mettre régulièrement de l'argent de
coté, pour pouvoir créer un premier compte... euh... une
première Bourse pour pouvoir démarrer justement ce Club
d'investissement.
Jm : Cet argent de coté, vous le
mettez où ?
Jo : Ben, actuellement, il est sur un compte
épargne à la SG (une des banques du Club).
Jm : Qui est ouvert au nom du Club ?
Jo : Qui est ouvert au nom de la section.
Jm : de la section ?
Jo : de la section.
Jm : Donc, c'est une section qui est autonome
?
Jo : Qui est autonome
financièrement.
Jm : Financièrement. Uniquement
financièrement ? Pas dans son organisation générale ?
Jo : Non, dans son organisation
générale, elle est entièrement autonome, en fait. On a
à rendre de comptes que pour la trésorerie en fin d'année
au Compu's Club Puisque c'est lui qui, qui est officiellement responsable du
Compu's Club.
Jm : Alors, est-ce que tu as un ou deux
exemples de ce qui se passe entre les membres dans cette branche ?
Jo : (silence, raclement de gorge) Y'a les
inséparables.
Jm : Les inséparables ?
Jo : L (7è entretien, ndlr) et B
(membre, ndlr), quoique B, depuis quelque temps, on le voit plus. Sinon...
y'a... y'a des gens qui ont tendance à prendre la parole et puis qui
saoulent tout le monde... là, je parle de PG (Membre, ndlr) et LP
(membre, ndlr). Ça agace certaines personnes.
Jm : Ils se sont jamais rencontrés,
eux au fait ?
Jo : Non jamais, ils se sont jamais
rencontrés.
Jm : Ça va êt' chouette quand
ils vont se rencontrés !
Jo : Là, ça va faire mal oui !
Je sais pas on verra bien, ben je sais que Ms (9è entretien, ndlr) quand
elle voit LP ou PG, elle est prête à partir.
Jm : Ah bon ?
Jo : Ah ouais ouais, c'est grave, hein,
même. Elle m'a dit : « il me saoule
lui » carrément. Des fois, je crois même qu'elle
était pas loin de plus venir au Club uniquement à cause de
ça. Il va falloir modérer les choses.
Jm : Il va falloir composer avec ouais.
Jo : Voilà, c'est ça.
Jm : Alors, comment tu fais pour composer
avec ?
Jo : Ben, moi, j'ai encore du mal, parce-que
j'ai... je n'veux pas diriger, hein, à l'intérieur de cette
communauté. Je n'ai pas envie de, de... bon il va falloir que je trouve
une solution, Ms (9è entretien, ndlr), j'essaie de la calmer
gentiment... euh... et pi, va falloir que je trouve une solution quand
ça se rencontre entre PG et Ms, par exemple, c'est de freiner PG, quand
il parle trop et puis de relancer Ms pour qu'elle essaye de
s'intégrer.
Jm : Ouais, tu n'as pas envisagé d'en
exclure l'un, l'une ou l'autre ?
Jo : Pas pour l'instant et je vois pas
pourquoi j'exclurai quelqu'un.
Jm : Oui.
Jo : Dans la mesure ou ça se passe
bien ou on arrive à démarrer le Club d'investissement y'aura
personne à exclure.
Jm : Et ses freins... C'est un frein
ça pour le développement de la branche ? qu'y ait deux personnes,
comme ça, qui ont des difficultés à, à communiquer
?
Jo : Moi, je pense que ça peut
être un frein, peut-être pas un frein pour la branche, mais
ça peut, peut-être générer des problèmes,
à la longue.
Jm : Quel genre de problème ?
Jo : Par exemple, si le Club d'investissement
se crée, il est possible qu'une personne quitte le Club d'investissement
à cause de ça.
Jm : Alors, qu'est-ce qui te parait
déterminant dans la conduite de la branche ? (silence)
C'est-à-dire, si par exemple : « s'il n'y avait pas
ça... », hein, pour te dire, pour te guider,
« s'il n'y avait pas ça, ben, la branche ne pourrait pas
exister » ? Qu'est-ce qui te paraît être le pilier
de cette branche ? « s'il n'y avait pas tel
chose » ou « tel aspect »,
ça pourrait pas exister ?
Jo : Déjà, la première
chose qui est déterminant, c'est que le Compu's Club existe, sinon, la
branche n'aurait pas pu exister, d'une part. D'autre part... euh... cette
branche elle existe aussi, parce-que les gens ont, à peu près, un
point commun, c'est donc les finances et connaître un petit peu
l'économie... euh... ça aussi, c'est déterminant pour que
ça puisse continuer. Et puis maintenant, on commence à faire des
formations... euh, un peu plus poussées, ça commence à
intéresser de plus en plus et je pense que ça commence à
dynamiser légèrement le groupe... Qu'est-ce qu'il y a d'autre de
déterminant ? non, c'est tout.
Jm : Alors, aujourd'hui, vous disiez, tu fais
des formations, vous faites des formations... euh... Comment ça se passe
pour faire ces formations ? Qui les fait ? Est-ce que vous avez un
professionnel qui vient, comment ça se passe ?
Jo : Alors, actuellement, ces formations,
c'est chaque membre, à tour de rôle, va prendre... un support de
formation qu'on a acheté... Et pi chaque membre va prendre une partie de
ce support et va en faire une synthèse. Et on en discute à la
réunion d'après. Donc, il amène la synthèse, on
prend la synthèse, on réfléchit dessus, chacun de son
coté et à la réunion d'après on en discute.
Jm : La réunion d'après,
C'est-à-dire tous les quinze jours.
Jo : Oui, tous les quinze jours,
voilà.
Jm : Vous n'avez pas de professionnels du
tout, qui vient ?
Jo : Pour l'instant, on a aucun
professionnel, ça va peut-être venir avec... avec Alt (un
organisme financier, ndlr)... On est en train de, de, d'être
séduit par ce système et je pense que ça va se faire
rapidement.
Jm: Alors, tu disais, une formation faite par
chaque membre, vous avez réussi à la mettre en place comment ?
Est-ce que tout le monde a été immédiatement d'accord,
tout le monde s'est proposé pour agir et... ou pas ?
Jo : Non, y'a quelques volontaires, qui ont
démarré, puis, faut quand même pousser un petit peu
certaines personnes, parce-que...
Jm : Comment vous avez fait pour pousser les
autres ?
Jo : Ben, on lui dit, on lui demande
gentiment de faire un résumé, puis la personne dit :
« ben je vais essayer », puis elle essaye, puis
ça se passe pas trop mal.
Jm : Elle essaye, pourquoi,
généralement quels étaient les freins ?
Jo : Oh, je pense que c'est de la
timidité ou... elle se sous-estime quelque part, je sais pas. Je sais
pas.
Jm : Oui. Et donc vous avez réussi
à les convaincre et y'en a pas qui sont partis à cause de
ça ?
Jo : Non, je pense pas qu'y en ai qui soient
partis à cause de ça, par contre, y'en a qu'on ne voit pas et qui
n'ont jamais fait cette formation...
Jm : Oui.
Jo : Donc, euh...
Jm: Alors, ceux qui ont fait cette formation
et qui avaient pas... au départ... qui avaient pas initialement
envisagés de la faire, qui ont été surpris, parce-qu'ils
sont timides ou qu'ils n'avaient pas envie de la faire, euh... vous avez
réussi en apportant quels arguments à les convaincre ?
Jo : (silence) Je pense que c'est l'esprit
d'équipe qui a fait l'argument. Chacun se sent un peu solidaire quelque
part et à un moment donné, la personne est gênée,
est gênée de ne rien faire et va s'y mettre d'elle-même.
Jm : Alors, tu penses que ça serait
une... euh... Est-ce que tu peux préciser cet esprit d'équipe ?
Jo : Ben, en fait, on a un travail. On a un
travail tous à faire. Chacun sait, que de toute façon, un Club
d'investissement ça va pas tourner tout seul, faut qu'on se
réunisse régulièrement pour prendre des décisions.
Euh... et puis... euhhh... pour la construction de ce Club d'investissement...
euh... on demande à tout le monde de participer un p'tit peu à...
à la formation, à la collecte d'informations
éventuellement... La plupart des gens ne le font pas en dehors des
heures du Club, bien sûr, mais au moment où ils se trouvent au
sein du Club, ils se sentent un peu ressoudés et de temps en temps, ils
donnent un petit peu d'eux-mêmes pour arriver à avancer.
Jm : Est-ce que tu as un ou deux exemples ou
justement, tu pourrais montrer que quelqu'un... euh, a stimulé une autre
personne, pour essayer de la convaincre. Est-ce que tu te rappelles les mots
qu'il a employé ? Ou les arguments qu'il a dû avancer ? Ou
toi-même, est-ce que tu as dû avancer des arguments pour essayer de
convaincre quelqu'un en disant : « bon c'est pas grave, on
est là, ne t'inquiètes pas, si t'y arrives pas, on va
t'aider » ou alors, « écoute, c'est
important, si on veux avancer, c'est important qu'on reste
soudé » ou... Quel argument tu as pu avancer
éventuellement pour convaincre quelqu'un ? Tu as un ou deux exemples
?
Jo : Non, j'ai pas d'exemples, parce-que,
bon, je n'y ai pas prêté attention, tout ce que je me souviens
c'est que à l'époque, y'avait une personne qui ne le faisait
jamais, puis je lui ai simplement demandé de le faire... Elle m'a
regardé bizarrement, puis elle a accepté. Et elle a fait un
travail normal.
Jm : Et ça c'est bien passé ?
Jo : Et ça c'est bien
passé.
Jm: Donc, personne n'est parti suite à
cette demande qu'il y a eu de... de...
Jo : Moi, j'ai pas souvenir de quelqu'un qui
est parti parce-qu'il n'avait pas envie de faire quelque chose.
Jm : Très bien et ça
d'après toi, ça serait dû à quoi ? Cet esprit
d'équipe, mais tu le définirais comment cet esprit
d'équipe ? En quelques mots ?
Jo : En quelques mots, c'est pas
évident. En fait, l'esprit d'équipe, déjà, y'a un
but commun, dans le sens où c'est d'la Finance, la création du
Club d'investissement donc, c'est le but commun. L'esprit d'équipe,
c'est que, bé, effectivement y'a des gens qui travaillent beaucoup, qui
amènent beaucoup de choses et, et d'autres qui n'amènent rien et
puis à un moment donné, ces personnes qui n'amènent rien,
je pense que d'elles-mêmes, elles y viennent. L'esprit d'équipe
comment il s'est créé et je sais pas. `Fin je pense que c'est le
point commun qui a fait l'équipe un petit peu.
Jm : Alors, tout à l'heure tu
disais... euh... : « on prend des décisions, tous
ensemble ». Vous vous réunissez, vous prenez des
décisions. Comment ça se passe quand vous prenez des
décisions ?
Jo : Ben, la plupart des décisions
sont, sont, sont prises après un vote, hein, en général.
Quand il s'agit de décisions importantes, on fait voter les gens. Et
puis, bon, en fonction des arguments amenés ou des décisions que
l'on doit prendre, le vote se fait assez facilement. Et souvent,
peut-être pas à l'unanimité, mais à une large
majorité.
Jm: Oui, et quand quelqu'un n'est pas
d'accord, comment ça se passe ?
Jo : Eh ben, pour l'instant... ben, il...
pfu... il adhère au Club, il reste... enfin, il reste avec le groupe
pour l'instant.
Jm: Je veux dire : il exprime son
désaccord ?
Jo : Ah ben oui, de toute façon.
Jm : Vous essayez de le convaincre ?
Vous échangez ? Vous l'attachez à une chaise ? Vous lui
mettez un bâillon ? comment vous faites ? (rires)
Jo : De toute façon, avant de prendre
la décision on en discute déjà, donc à partir de
là, on sait à peu près où on va, quoi.
Jm : Vous débattez ?
Jo : Y'a un débat qui se fait avant,
donc, bon...
Jm : Je suppose que de temps en temps le ton
doit monter ?
Jo : Ça arrive de temps en temps. Et
puis bon, c'est jamais bien méchant, en fait, on se calme très
vite et puis, euh...
Jm : Qu'est-ce qui fait que vous vous calmez
très vite ? (silence) Qu'est-ce qui fait que tout à coup ben
ça monte ? Vous débattez sur quelque chose, on a envie que
son idée passe et puis tout à coup, ben, ça reste quand
même ? Ça clenche ou pas ? Qu'est-ce qui fait ça ?
Jo : (silence) Je sais pas, je pense qu'il y
a l'abandon de la personne qui est toute seule par exemple devant un groupe...
Je l'imagine un peu comme ça.
Jm : Ça t'arrives pas d'abandonner
?
Jo : Ben pour l'instant, non, parce-que j'ai
pas eu beaucoup d'idées non plus.
(rires)
Jm : Si tu avais une idée que tu
voulais faire passer et que finalement tu devais abandonner, comment tu te
sentirais ? Frustré ? Ou tu, tu te rallierais, en te disant
« bon, bé, cette idée-là est pas passée,
une autre passera »...
Jo : Ouais, moi je suis plutôt comme
ça : lorsque je lance une idée, effectivement, si jamais
ça passe pas, c'est que, quelque part, mon idée n'était
pas bonne ou mal argumentée. Je pense que cela vient de moi, donc, je
cherche pas à aller plus loin.
Jm : Alors, qu'est-ce que... qu'est-ce qui te
ferait quitter la branche Finance ?
Jo : Eh bien, le seul truc qui me ferais
quitter la branche Finance c'est que le Club d'investissement ne se ferait
pas.
Jm : Oui, vous avez donné une
échéance pour ce Club d'investissement ?
Jo : Ben, on a commencé à en
donner une. Y'en a qui voudraient que se soit début mars, donc, ben, on
est mi-février, ça va être difficile. Je pense qu'on
repoussera un petit peu, mais, pour l'instant, y'a, y'a encore la perspective
du Club d'investissement.
Jm : Vous avez repoussé
déjà à plusieurs reprise le Club d'investissement ?
Jo : Oh oui, parce-que on avait
déjà voulu démarrer en mars, y'a un an. On a voulu
démarrer ensuite en septembre l'année dernière et pi
ça a jamais bien avancé. Donc on a repoussé,
repoussé, mais, bon, je pense que maintenant, il va falloir qu'on arrive
quand même à le créer, parce-que sinon, il va y avoir un
abandon général.
Jm : Oui et est-ce que c'est pas justement
parce-que... Ça fait trois, quatre fois que vous repoussez,
d'après ce que tu viens de me dire...
Jo : Oui oui oui.
Jm : Est-ce que justement, c'est pas le fait
de dire : « y a toujours cette perspective qui me fait
tenir, que le jour où vous allez le créer, bon y'a plus cette
perspective, c'est fini quoi » ? (silence) Non, au
contraire ?
Jo : Non, je pense que... Bon, on va vite se
former à la Bourse, on a envie d'avancer de ce coté-là et
tant que le Club d'investissement n'est pas créer je pense qu'on ne sera
pas suffisamment motivé pour continuer. Donc le Club d'investissement,
pour moi se sera un moteur pour apprendre sérieusement la Bourse.
Jm : Très bien, alors, c'est ce qui te
fait rester, quoi ?
Jo : C'est ce qui me fait rester : faut
qu'on arrive à créer ce Club d'investissement.
Jm : D'accord. Qu'est-ce qui se passe, dans
ce groupe qui ne relève pas du projet Investissement ?
Jo : (silence) Tu parles des membres qui ne
font pas partie du...
Jm : Non, non, qu'est-ce qui se passe dans le
groupe, hein ? Qu'est-ce qui flotte, qu'est-ce qu'y a ? Je reviens un
petit peu sur les sentiments que peuvent avoir, les relations sur les gens
entres eux, entre elles ? Qu'est-ce qui se passe, qui ne relève pas
du projet directement ?
Jo : Ah, d'accord. Bon déjà la
première chose qui se passe, c'est que les gens aiment bien se
réunir, au moins certains. Donc, ils viennent parce-que y'a l'esprit de
groupe quelque part, euh... Et puis on papote, on parle d'un tas de choses.
Ça c'est déjà un premier esprit qui fait que ça
tourne bien, que les gens se, se tiennent un peu entre eux, euh... Mais je
pense que c'est pratiquement le seul.
Jm : Alors, tu participes à une autre
branche, Comnet ? Tu disais ?
Jo : Voilà. Je participe à une
autre branche, qui s'appelle Comnet.
Jm : Que tu as créée, non ?
Jo : Euh... non, je crois pas, non. Ça
a dû être fait... ben, c'est peut-être même toi qui as
démarré l'idée, je sais plus.
Jm : Qu'est-ce qui t'as
intéressé à ce moment là ?
Jo : Moi, ce qui m'a intéressé,
au départ, c'était tout ce qui était réseau. Comnet
pour moi, c'est deux choses, Communication et Net, c'est réseau. Alors,
c'est pas uniquement Internet, ça peut être Intra Net, ça
peut être réseau, une machine en fait, créer un serveur
peut importe. Y'a beaucoup d'choses à faire là dedans, euh...
Pour l'instant, on redémarre parce-que y'a eu déjà un
premier échec, on a pas bien avancé. Et puis, euh ben... c'est
encore les balbutiements de ce groupe, mais apparemment, y'a une meilleure
motivation, parce-qu'on a changé de locaux. Je sens, je sens que c'est
plus solide qu'avant.
Jm : C'est ça, donc le fait, d'avoir
changé de locaux est un élément important dans la
dynamique des membres ?
Jo : J'ai l'impression oui, parce-que
maintenant on a des locaux, qui ressemblent à quelque chose de propre,
de sérieux et ça, ça joue énormément en
faveur de cette dynamique.
Jm : Y'a autre chose qui peut jouer ?
Jo : Ben pour Comnet, après ce qui
jouera certainement c'est les, les inspirations de chacun. J'ai l'impression
qu'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre Internet. C'est-à-dire,
apprendre à créer des pages personnelles ou à faire des
sites Internet, euh... Il est vrai que c'est pas très compliqué,
donc ils apprendront assez facilement. Par contre, quand on commencera à
se lancer dans l'étude des réseaux et tout ça, j'ai peur
que, ça fasse un peu frein à certaines personnes, on verra
à ce moment-là.
Jm : Et donc, tu envisages... euh...
palier... cette frayeur de certains, de quelle manière ?
Jo : Parce-que j'ai commencé par, par
faire, un petit peu... Ce que j'ai envie de faire, maintenant, c'est commencer
par faire une formation rapide et, et je dirai pas ludique mais presque.
Quelque chose de simple, de façon à ce qu'on comprenne les
réseaux. A partir du moment ou la compréhension du réseau
est faite, on avancera tout doucement et je pense que la formation se fera
malgré tout correctement.
Jm : Euh... Donc, c'est une formation qui
peut....
Jo : ...C'est une formation qui peut...
Jm : ...lever les frayeurs de certains ?
Jo : Oui, enlever les frayeurs. Comme
l'informatique a été très effrayante pour beaucoup de
personnes. A partir du moment où on les a mis tout doucement dedans,
maintenant, on les lâche plus.
Jm : Alors, qu'est-ce que tu
préfères ? Au Club ? Est-ce que tu connais les autres branches du
Club ?
Jo : Je connais par définition, mais
sans plus. Je n'ai jamais participé à aucune autre branche,
autant que je me souvienne.
Jm : quelles sont les autres branches ?
Jo : Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a PAO, PAO
donc... comme autre branche, y'a la Littérature... les jeunes... il doit
m'en manquer certainement. Je me souviens plus bien. Qu'est-ce qu'il y avait
encore ? Euh... La Formation, la branche Formation, qui est une branche motrice
du Club, maintenant, puisqu'elle apporte des fonds.
Jm : Est-ce que tu... tu sais comment est
organisé le Compu's Club ?
Jo : Ben, le Compu's Club, il est
organisé par un Conseil d'Administration, qui a un Président, une
Présidente en l'occurrence... un Trésorier et je sais pas s'il y
a de Secrétaire, j'ai pas tellement suivi l'affaire et les membres
maintenant du, du, du Conseil d'Administration sont les Pilotes des
différentes branches. Depuis peu. Et puis ben, pour l'instant, ça
se passe bien.
Jm : Donc, les Pilotes de chacune des
branches, sont d'office administrateurs ?
Jo : Sont d'office administrateurs du Compu's
Club. ils participent aux réunions, euh...Ça permet aussi de
remonter les informations de chaque branche vers le CA, de façon
à ce que... parce-que le Pilote est celui qui connaît le mieux sa
branche, qui peut en parler le mieux et les informations doivent circuler
beaucoup mieux.
Jm : Donc, ça c'est un moyen de
communication entre la branche et l'ensemble du Club ?
Jo : Voilà,
Jm : Est-ce que vous avez un autre moyen de
communiquer de ce que vous faites dans les branches, notamment de la Finance et
Comnet ? (silence) Aux autres membres du Club ?
Jo : Ben, y'a le fameux journal des membres
qui permet justement de communiquer, d'envoyer un maximum d'informations sur
toutes les branches... euh... Moi, je lis pas tout le temps à fond, mais
je sais que bon, c'est une source d'informations intéressante.
Jm : Y'a combien de membres à Comnet
?
Jo : Alors, de souvenir, de tête comme
ça, je dirais plus d'une centaine, 110, 120, je sais pas exactement.
Jm : A Comnet, Comnet.
Jo : Ah, à Comnet, on est combien
à Comnet aujourd'hui ?... Peu, on est (comptant sur ses doigts) 2, 4, 6,
8, aujourd'hui je dirais on est huit ?
Jm : huit ?
Jo : Moins d'une dizaine de personnes pour
l'instant.
Jm : Bien. Qu'est-ce que tu
préfères au Club ? (Silence) Qu'est-ce que tu viens, qu'est-ce
que tu y viens chercher au-delà des branches ? Et au-delà de cet
esprit de convivialité, est-ce que tu viens chercher autre chose ?
Jo : Je viens pas chercher autre chose, je
viens surtout essayer de conserver ce que j'ai. C'est-à-dire la partie
technique que je connais, j'aimerai bien la garder en tête... euh, Puis,
ce que j'aimerai, c'est faire évoluer le matériel de Compu's
Club, euh... vers le haut, donc, essayer de se mettre à jour tout
doucement. Mais c'est le manque de temps qui m'empêche un peu de le
faire. Mais ça, c'est une chose que je ne veux pas perdre.
Jm : Est-ce qu'il y a des exemples qui t'ont
particulièrement marqué au sein du Club, depuis trois ans et
quatre mois que tu y es ? Est-ce que, à un moment donné,
dans cette période-là, y'a quelque chose qui t'as
marqué ? Qui t'as, qui a pu te marquer agréablement ou qui a
pu te choquer ou, ou une période où... où tu as
réagi après ? Ou au contraire, une période
euphorique ?
Jo : Ben des périodes euphoriques,
j'en ai vraiment jamais eu beaucoup, parce-que, bon, j'étais pas non
plus psychologiquement toujours d'aplomb. Période douloureuse, y'en a eu
puisqu'on a perdu une personne qui était Pilote du Club d'investissement
avec, enfin du CEB, avec moi-même. Euh...Semi-tragique, c'est chaque fois
que l'on perdait des locaux, bon, qu'on était un peu, un peu à
l'abandon quelque part, le Club i tournait plus très bien... euh,
Qu'est-ce qui me faisait rager ? Ce qui me fait rager : c'est le
matériel parce qu'il est vraiment obsolète... euh... Le
réseau, qui lui est une catastrophe, quoiqu'il est en train de
s'améliorer, sinon, non d'autres exemples, euh...
Jm : Qu'est-ce qui t'as marqué ?
Qu'est-ce qui...
Jo : Si, ce qui m'a marqué dans les
relations, c'est lors de mon mariage, que certains membres du Club
étaient présents au pot. Là c'était sympa.
Jm : Hum, hum.... Donc, tu t'es marié
y'a quelque temps.
Jo : Je me suis marié, donc, y a 6, 7
mois. Sept mois maintenant.
Jm : Tu travailles actuellement ?
Jo : Oui oui oui ! J'ai un emploi depuis 3
mois, 3 mois ½...
Jm : 3 mois, 3 mois 1/2.
Jo : En tant que commercial dans une
entreprise qui vend des logiciels aux auto-écoles et j'ai en charge tout
un secteur...
Jm : Et, qu'est-ce qui a fait que tu as
retrouvé du travail il y a trois mois ?
Jo : Ben, c'est le hasard en fait, je
cherchais du travail depuis longtemps, j'ai eu pas mal d'échecs dans mes
demandes, puis soudain, j'ai vu une annonce qui m'a plût et j'ai tout de
suite opté et ça c'est passé très bien.
Jm : Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu
participes à un projet ? Qu'est-ce... Pourquoi tu participes au projet
Club d'investissement ou au projet Comnet ?
Jo : Parce-que dans la vie d'un homme je
pense qu'on a besoin tous de, de faire quelque chose dans la vie quand
même, autre bien sûr que d'oeuvrer à sa vie personnelle et
je pense que c'est une solution.
Jm : Alors, qu'est-ce que tu retiens de ta
participation au Club ? (Silence) Qu'est-ce que ça t'as apporté ?
Jo : Moi, je pense que ça m'apporte
une certaine stabilité quelque part. Un, un but aussi, quelque part, un
petit but, même s'il n'est pas énorme. Euh... Qu'est-ce que
ça m'apporte de plus ? Ben euh... Ce que ça m'apporte de plus, un
peu de chaleur humaine, dans le sens ou on se retrouve tous entre amis, euh,
entre, entre, entre, pfu, entre membres en fait.
Jm : « Un but »
tu disais. Quel but ça t'as... ?
Jo : Ben le but, en fin de compte, c'est donc
de rester toujours avec un groupe d'individus. D'avoir un endroit ou aller
régulièrement de façon à garder un système
relationnel, puis le but aussi, donc de pouvoir créer un Club
d'investissement, le but de, de réussir... de... de réussir
certaines choses, au niveau de Comnet, par exemple.
Jm : Tu disais entre amis, est-ce que tu peux
me donner un ou deux exemples de quelque chose qui peut te faire dire :
« oh ben, lui c'est un ami, lui c'est pas un ami »
?
Jo : (silence ) Ben, dans l'ensemble du Club,
je dirai que tout le monde est plus ou moins au même niveau, dans le sens
où ce sont des relations, ce sont pas vraiment des amis. Mais, ce sont
des gens qu'on apprécie bien, avec qui on discute bien, où tout
se passe bien. De temps en temps, on a des personnes, ça se passe un peu
moins bien, mais bon, je suis pas non plus, agressif systématiquement,
donc ça se passe tout seul en fait, quelque part. Et puis, j'ai quelques
personnes qui sont, qui sont vraiment des amis. Mais, là, c'est...
Euh... on va discuter de choses beaucoup plus... plus... entre guillemets,
intime peut-être, on discutera plus facilement à une personne, on
la critiquera plus facilement aussi, euh... que les autres.
Jm : Donc, tu disais quelques fois, ça
se passe moins bien ? Alors, est-ce que tu as un ou deux exemples qui montrent
que, ben « là, ça c'est mal
passé » par exemple ? Est-ce qu'à l'esprit tu as
un ou deux exemples ? Vous avez discuté des petits oiseaux, toi, tu
aimais les oiseaux verts, lui il les aimait bleus, vous n'étiez pas
d'accord, vous vous êtes foutu sur la gueule et y'en a un qui est
passé par la fenêtre...
(rires)
Jo : Non, c'est jamais arrivé !
Jm : Alors est-ce que tu as un ou deux
exemples ?
Jo : Non, c'est beaucoup plus subtil que
ça, en fait : ce qui arrive des fois, c'est que dans la discussion,
on sent qu'il n'y a pas d'accrochage, on n'arrive pas vraiment à
communiquer et c'est à partir de là ou je, je classe dans une
catégorie un peu inférieure. Uniquement par la communication.
Jm : Uniquement par la communication ?
Jo : Oui.
Jm : Mais est-ce que tu as un exemple
précisément ?
Jo : Un exemple précis je m'en
souviens pas très bien... je sais que...
Jm : Personne a dit que l'oiseau était
rouge et que...
Jo : Non, j'ai pas eu d'exemple de ce genre
là, j'ai simplement eu des ressentiments que, avec certaines personnes,
ben, je, je pouvais pas communiquer.
Jm : Alors ces ressentiments comment tu les
exprimerais ? Ça se faisait comment ? Tu avais de la
répulsion ? Quand tu le voyais, tu ne te sentais pas à l'aise ?
Tu transpirais ? Tu perdais tes cheveux ? Tu rongeais tes ongles ?
Jo : Non... Non, c'est pas, c'est pas si
dramatique que ça, c'est simplement dans la discussion, on
commençait à discuter et puis, euh... et puis on sentait que
ça s'épuisait tout seul, qu'on arrivait pas à communiquer
et puis, bon, y'a une certaine froideur qui s'est, qui s'est installée.
Donc, à partir de là, la personne, je n'allais plus au devant
d'elle quoi !
Jm : Une froideur, ça veut dire que
vous parliez plus ?
Jo : Ouais, on parlait plus. On arrivait plus
à trouver... Ben, de moins en moins, jusqu'à ce que..., bon on se
dit, bon ben, « tant pis, on arrête de
discuter ».
Jm : Ouais. Et ça va jamais
au-delà ?
Jo : Ça a jamais été
au-delà.
Jm : Et ça t'es arrivé de
renouer des liens avec quelqu'un avec qui tu avais pris de la distance ?
Jo : Ben, c'est arrivé tellement peu
de fois que, je sais même plus avec qui c'était. Je sais pas.
Jm : « Peu de
fois » de renouer, de raccourcir la distance ou que tu ais pris
de la distance ?
Jo : Non, non, d'arriver... d'avoir pris de
la distance, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux
fois, je sais pas, je sais même plus... je sais même plus si ces
personnes font encore partie du Club, je me souviens plus très bien.
Jm : Une fois ou deux fois en trois ans
¾ sur 150 membres...
Jo : Ouais, c'est pas énorme... c'est
très rare, mais bon, je sais que ça s'est produit. J'ai encore le
sentiment qui reste au fond de moi, quoi.
Jm : Alors ce sentiment-là, il
s'exprime comment aujourd'hui ? tu es... tu fais la gueule ? T'as la
rage ? euh...
Jo : Non, j'oublie c'est tout, j'oublie la
personne. Point.
Jm : Oui ?
Jo : Non, non, ça va pas plus loin.
Jm : Alors, qu'est-ce qui a changé
chez toi, depuis que tu es au Club ? Ça, ça m'intéresse.
Qu'est-ce qui a changé ? Alors, depuis que tu es au Club, chez toi
en tant que personne, peut-être physiquement y'a peut-être des
choses qui ont changé, professionnellement, euh... familialement, bon tu
t'es marié, d'accord, tu as retrouvé un travail d'accord, mais
dans tes rapports surtout, qu'est-ce qui a changé chez toi ? Est-ce que
tu te sens plus heureux ? Est-ce que tu te sens plus à l'aise dans
les conversations, est-ce que dans ton travail, tu te sens plus libre ?
Est-ce que dans les relations avec ta femme, ta nouvelle femme, tu es, euh...
tu es plus détendu ? Est-ce que vous avez l'habitude de vous
envoyer la soupe à la figure ? (rires) Ou pas, ou au contraire, vous ne
le faites plus ?
Jo : Non, dans la vie de couples, en fin de
compte, ça a pas apporté de gros changements...
Retournement de K7
Jm : Je vais reprendre : au-delà
de ta vie familiale, ça a pas changé grand-chose, tu en
étais dans ta vie professionnelle...
Jo : Dans ma vie professionnelle, ça a
pas changé grand-chose non plus. Par contre, euh... dans ma vie
personnelle en fait, j'ai l'impression de faire partie d'un groupe et donc
à partir de là, je me sens un peu plus libre, un peu plus serein,
un peu plus tranquille.
Jm : hum !
Jo : Mouais. C'est essentiellement ça.
Je ne me sens plus quelqu'un d'isolé dans un coin.
Jm : D'accord. Tu fais partie de quelque
chose, quoi ?
Jo : Je fais partie de quelque chose, d'un
groupe, de quelque chose. Même si ch'suis pas toujours là, si
ch'suis pas toujours actif, je fais malgré tout partie d'un groupe.
Jm : Très bien. Tu l'expliques comment
là, ce sentiment-là de... Est-ce que tu as des, des
éléments qui te, qui t'ont amené à ce sentiment ?
(Silence) Quand t'arrives au Club, on t'accueilles avec le sourire, on
t'accueilles avec un verre de champagne ou, euh... on t'attend avec le fusil,
on te dit pas bonjour... Au contraire, comment ça se passe ?
Jo : Non, je suis toujours accueilli avec le
sourire, ça, c'est pas un problème. Euh... on discute facilement,
c'est pas un problème non plus. Non, c'est vrai que le coté
relationnel se passe très bien, y'a rien à dire de ce
côté-là. C'est peut-être ça qui fait que, ben,
je continu où j'ai ressenti qu'y avait effectivement un groupe. C'est
vrai que c'est ce côté communication qui fait partie, on fait
partie d'un groupe.
Jm : C'est ça. Quand il y a des
décisions, tu te sens concerné, tu peux t'exprimer...
Jo : Tout à fait. Tout à fait,
ouais.
Jm : Tu te sens écouté ? tu te
sens...
Jo : Je me sens écouté.
Jm : Ouais.
Jo : Quoique maintenant, depuis que je suis
avec ma nouvelle femme, je me sens toujours écouté ! Mais bon le
Club en rajoute.
(rires)
Jm : Tout est pour le mieux, dans le meilleur
des mondes, alors !
Jo : Moi, je ne me plains pas.
(rires)
Jm : Bon, on va en rester là. Quand tu
viens au Club, dans quel état d'esprit tu te trouves ? Tu te sens
comment ?
Jo : Ben, une récréation.
Jm : Une récréation ?
Jo : Une récréation, parce-que
en général quand j'arrive au Club, j'ai même pas fini mon
boulot, encore, donc j'arrive à la dernière demi-heure de boulot
et pour moi, c'est une récréation. On va parler d'autres choses
que de boulot, quoi.
Jm : Voilà... Qu'est-ce qui te fait
rester ?
Jo : Eh ben, c'est tout l'ensemble !
Jm : C'est tout ça ?
Jo : C'est tout ça. C'est tout ce
qu'on a dit. C'est tout ce qu'on a dit qui me fait rester.
Jm : Est-ce qu'il y a d'autres choses ?
D'autres valeurs, dont on pourrait... qui pourraient transparaître au
sein du Club et qui te disent : « oh bien tiens, cette
politique là... », politique pas politicienne, hein,
« cette façon de faire, une manière publique
là, c'est quelque chose qui me sied, qui me... qui est satisfaisante
pour moi, je colle à ces valeurs là, ce sont les
miennes » ?
Jo : (silence) Je sais pas si c'est
ça, en fait. Parce-que chez moi, je définis jamais les choses
à fond. C'est, c'est, je vis toujours par sentiments, ça sent bon
ou ça sent mauvais, donc, en fonction de ça, je réagis.
Euh... le Club... moi, j'ai une certaine fierté d'appartenir quand
même au Club. Parce qu'il commence à avoir une certaine
notoriété dans la région et rien que ça,
déjà, ça me plait énormément. Quelque part,
il y a une réussite. C'est surtout ça. Et puis, bon, y rester,
j'y resterai parce-que... j'y trouve, j'y trouve un certain... un certain
état d'esprit.
Jm : Alors, quels sont... on arrive au bout
là, hein... Quels sont, selon toi, les, les obstacles à une
participation plus importante au Club ? J'entends de, de l'ensemble des membres
?
Jo : Alors là... la première
chose...
Jm : ...Qu'est-ce qui gène ?...
Jo : La première chose qui
gène, en fin de compte, c'est effectivement le temps. Parce-que tout le
monde travaille, tout le monde est pris pas mal par ses, par ses obligations.
Ce qui fait qu'on manque souvent de temps. Euh, on peut manquer de motivation
des fois aussi. On peut avoir des pertes de motivations, euh... Qu'est-ce qui
peut-être un frein aussi ? Je pense qu'il y a un coté financier un
petit peu du Club, qui commence à être gênant dans le sens
ou on peut pas avancer aussi vite que l'on voudrait. Euh... sinon, y'a pas
vraiment de frein, en fait, pour le reste.
Jm : Tu dis : « il peut y
avoir une perte de motivation » elle se caractériserait
comment cette perte de motivation ?
Jo : Oh, ben il suffit que on ait des
problèmes de travail et des problèmes de, de vie familiale pour
que le Club, on n'est pas envie d'y aller ! Quoi !
Jm : Ouais et justement, c'est pas...
puisqu'on est dans un groupe, ça peut pas être... tu disais tout
à l'heure : « une
récréation » ?
Jo : ben ça peut-être, ça
peut-être une récréation.
Jm : Pourquoi dans un cas c'est un
interlude ? Quand ça va bien c'est un interlude, quand ça va
pas bien c'est plus un interlude ?
Jo : Parce-que, quand ça va pas bien,
en fin de compte, on a tendance... Enfin, je sais que moi, je réagis
comme ça : j'ai tendance à me renfermer. A partir du moment
ou je me renferme, je veux plus être dérangé par quoi que
ce soit. Donc, le Club, j'ai même pas envie d'aller au devant des choses,
euh...
Jm : Parce qu'il y a une pression au niveau
du Club, quand même ?
Jo : Non, c'est pas qu'il y a une pression,
c'est que, y'a un état d'esprit et pi, j'ai pas le même
état d'esprit à ce moment-là.
Jm : Oui.
Jo : Alors je colle pas du tout au groupe,
donc c'est même pas la peine que j'y aille, quelque part.
Jm : Et tu l'exprimes pas ça ?
Jo : Non, je l'exprime pas.
Jm : Est-ce qu'il y a autre chose, que, le,
que cet état d'esprit là ? Il y a la communication, ... de
l'échange ? C'est ce que tu disais tout à l'heure...
Jo : ...Oui, mais cette communication et cet
échange quand on est... je pense, quand on est vraiment coincé
par le boulot... la vie familiale... enfin par les problèmes, euh...
chacun réagit peut-être différemment. Moi je sais que moi
je réagis, je me renferme, terminé, je suis un bloc et y'a rien
qui me fait agir.
Jm : Et, et donc, les amis là, les
amis au Club ?
Jo : J'ai même pas envie de discuter
avec eux.
Jm : Oui. Très bien. Tu disais :
« il pouvait y avoir des... y'a actuellement des problèmes
financiers », ça peut être un des obstacles
ça aussi. Tout à l'heure, je t'ai posé la question :
« quels pouvaient être les obstacles ? »
Jo : Oui, mais le problème financier
c'est pas le... se sera pas un obstacle majeur, c'est un petit obstacle, dans
le sens ou on pourra pas aller assez vite. Création de réseaux...
Internet.
Jm : Et qu'est-ce qui faudrait faire ? A ton
avis ?
Jo : Je sais pas ! Trouver des sous !
Jm : Oui, on peut piller une banque...
Jo : Oui trouver des sous, on peut se faire
une banque, effectivement. Disons que aujourd'hui la seule entité au
sein du Club, qui peut gagner de l'argent, c'est la formation, Ifac.
Jm : Oui.
Jo : Donc, il est vrai que... enfin y'a
ça et puis les subventions éventuellement. Donc, si vous pouvez
ramener un peu plus de sous à ce niveau-là, ça serait bien
! Si c'est possible, bien sûr et si c'est faisable.
Jm : Est-ce que tu as d'autres idées ?
(silence) Non ?
Jo : Pas vraiment.
Jm : Non. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait
faire pour améliorer le Club ? (Silence) Pour qu'il soit encore plus
convivial, comme tu le disais, que les gens puissent trouver plus d'amis, qu'il
y est un meilleur état d'esprit, qu'on s'y sente encore mieux, dans un
groupe, dans une communauté, comme tu le disais, comme dans un village
?
Jo : Je sais pas ce qu'il faut faire
parce-que en fin de compte, on est une centaine de membres. Bon, on n'est pas
tous présents en même temps, heureusement d'ailleurs, parce-que on
se connaîtrait pas bien. Euh... moi je pense que ce qui peut faire
évoluer le Club, c'est éventuellement trouver d'autres branches,
d'autres intérêts, quoi, pour faire adhérer d'autres
personnes Euh... pfuuu, bon, pousser peut-être plus la formation pour
ramener plus de sous. Mais les sous c'est surtout là, pour l'embellie du
Club en fait, pour amener tout ce qu'il faut au sein du Club... au niveau
matériel. Ce qu'on pourrait faire, si, ce qu'on pourrait faire marcher
les choses, c'est trouver des animations qui fassent venir tous les membres du
Club. Style un super match de foot à Lyon, on y va tous ou... je sais
pas, enfin des, des....
Jm : Y'a jamais eu ça au sein du Club
?
Jo : Ben, il me semble qu'on avait
lancé une fois, un truc sur, euh... sur...
Jm : Eurodisney ?
Jo : Non pas Eurodisney.
Jm : Sur la soirée des
étoiles ?
Jo : Non plus. Sur la soirée des
étoiles, ça, ça a marché, non c'était un
voyage à, au Futuroscope.
Jm : Au Futuroscope.
Jo : Au Futuroscope. Et y'a pas eu
d'adhésion, y'avais pas eu de demande. Donc je pense que au sein du
Club, il manque, il manque quelque chose qui motive les gens à venir.
Jm : Est-ce que tout le monde avait
été au courant à ce moment là ? La communication
était bien passée ? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons
que ce manque de motivation-là ?
Jo : Non, je pense que les gens avaient
peut-être pas envie simplement d'y aller. Est-ce que c'était une
mauvaise période ? Est-ce que c'était... Je sais plus.
Jm : Qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors,
justement pour que les gens soient motivés, là ?
Jo : Je sais pas.
Jm : Tu sais pas ?
Jo : Je sais pas, j'ai pas trop
d'idées.
Jm : Alors, si tu devais présenter le
Compu's Club et ce sera la dernière question. Si tu devais
présenter le Compu's Club a quelqu'un, tu es au Compu's Club, quelqu'un
vient te voir, vient au local et demande des renseignements sur le Club, tu
présenterais comment le Club ? Tu présenterais ce qu'il est, mais
aussi, euh...
Jo : Ben, C'est-à-dire, le Club je le
présenterai comme Club, bon, basé sur l'informatique, au
départ, je commencerai à parler des différentes branches.
et surtout ce que je ferai valoir, c'est euh... euh... cet esprit
d'échange ! L'esprit d'échange entre les individus, qui me
paraît, moi, être la source même du Club, en fait.
Jm : Et quelqu'un qui viendrait, en
disant : « ouais moi, j'ai juste besoin d'apprendre quelque chose
sur mon logiciel » qu'est-ce que tu ferais ? Comment tu
argumenterais ? Quels mots tu utiliserais ? Pour essayer de le convaincre,
que l'informatique, ce n'est qu'un outil ?
Jo : J'essayerai pas de le convaincre, je le
ferai inclure dans le Club et puis, c'est de lui-même qu'il se rendra
compte.
Jm : Tu penses que c'est l'atmosphère,
l'ambiance ? Tu définis comment l'ambiance ?
Jo : Bah, elle est conviviale,
sympathique.
Jm : Conviviale, est-ce que tu as un ou deux
exemples qui te font dire que c'est convivial ?
Jo : Ben, dès que quelqu'un arrive,
quelqu'un même d'étranger, dés le départ, ben, on
l'accueille à bras ouverts, on essaye d'expliquer au mieux, on le fait
participer des fois à des réunions, style C.E.B. ou Comnet. Donc
je pense que c'est comme ça que les gens se rendent compte de la
convivialité du Club.
Annexe 12 Septième
entretien
L. (septième entretien) le mercredi 14
février 2001, 19 heures 15
A notre domicile
Le Secrétaire Adjoint : depuis peu au chômage
(agent le locations immobilières). Veut créer une entreprise. 27
ans. Adh. 2 ans. (responsabilité à l'ensemble de l'association
avec participation à la branche Finance). Connaît peu
l'informatique. (n°4)
Après annonce
L. : Mais, c'est des questions ? Donc,
à choix multiple, c'est, c'est sous quelle forme ?
Jm : Ben, tu vas voir. La première
question : comment as-tu connu le Compu's Club ?
L. : Ben c'est par une copine, donc Br...
Jm : Elle t'en avait parlé comment ?
L. : Ben, en fait, euh... je la connaissais
déjà depuis pas mal de temps, je suis allé la voir une
fois, et donc elle m'a dit qu'elle s'intéressait à
l'informatique, elle voulait donc... euh... elle voulait apprendre un petit
peu, et donc, elle avait en fait un p'tit, tu sais un p'tit dépliant du
Compu's Club. Et elle m'avait proposé de, de venir avec elle. Donc moi
aussi, ça m'intéressait parce-que moi, en informatique
zéro, je n'y connaissais rien, et donc, euh... ben voilà, je suis
venu avec elle. Vous aviez une réunion ce soir là.
Jm : Qu'est-ce qu'on t'en avait dit pour te
convaincre ? Tu te rappelles à l'époque ? Ça fait combien
de temps de ça ?
L. : Houlà ! ça fait, je
me suis inscrit y'a combien de temps de ça ?... C'est la deuxième
année, même plus non ? peut-être même plus...
Jm : Plus de deux ans ?
L. : Oui je crois, oui. Euh... non. Elle me
parlait juste informatique, une association...
Jm : Donc tu l'as juste...
L. : ...donc j'ai dit, oui, oui... Oui, oui,
je l'ai vue, oui.
Jm : Tu l'as vu, tu l'as lu, tu te rappelle
dans ce dépliant, ce qui t'avait attiré ?
L. : Non, je vois pas.
Jm : Tu te rappelles pas ?
L. : Non.
Jm : C'est trop ancien.
L. : Moi, ce qui m'intéressait,
c'était apprendre l'informatique et puis voilà, quoi !
Jm : C'est ça. Est-ce que tu as
déjà eu une expérience de, de l'associatif ?
L. : Non.
Jm : Non ? Une autre association, t'as jamais
participé à une autre association ?
L. : Après, oui. Après Compu's
Club, donc, y'a eu donc la Croix Rouge...
Jm : La Croix Rouge ?
L. : Oui, mais avant non.
Jm : Alors qu'est-ce, qu'est-ce qui t'as
sensibilisé dans le monde associatif, parce-que, tu en avais jamais fait
avant, tu as connu Compu's Club, tu en as fait après, enfin pendant ?
L. : Oui, tout à fait oui,
Jm : Qu'est-ce que c'est qui t'a
motivé ?
L. : Ben un peu donc, l'esprit du club un
petit peu. Donc l'esprit de l'association en Général. Euh...
Comment dire, la convivialité un petit peu, donc, leee, les rencontres
aussi. Euh... Quoi d'autre ? Ben comme ça, ouais, donc, je pense
à (inaudible) L'échange aussi donc, comme on fait donc au club,
je connais quelque chose, je t'apprends, tu m'apprends, et puis voilà
!
Jm : Est-ce que, initialement au-delà
de l'informatique, tu avais un projet ? Au moment de venir dans l'association ?
L. : Non, non. Absolument pas non.
L'informatique c'était pas moi, donc euh... C'était pas pour
monter un projet, ni rien quoi. Comme à la Croix Rouge, aussi c'est
pareil, hein ! J'ai aucun projet, ni rien.
Jm : Très bien. Alors, est-ce que tu
peux me parler un peu de toi au moment de l'adhésion, tu étais,
tu étais marié ?
L. : Euh...
Jm : Tu avais des enfants ?
L. : J'étais marié ? Euh...
oui, j'étais marié, oui, ouais.
Jm : Ouais ? Tu avais des enfants ?
L. : Non.
Jm : Tu travaillais ?
L. : Ben, t'sais, moi mon travail, tu le
connais, donc que...
Jm : Oui, mais, tu travaillais ?
L. : Oui, oui tout à fait, oui.
Jm : Est-ce que tes parents, ou ta famille,
ou ta femme, sont déjà, ont une expérience de
l'associatif, du monde associatif ?
L. : Non.
Jm : De la vie associative ?
L. : Non.
Jm : Est-ce qu'ils étaient
engagés ? Ou, est-ce que quelqu'un de ta famille était
engagé dans la vie publique ?
L. : Non.
Jm : Non ? Personne ? Alors, je vais
reprendre un petit peu la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui fait
que tu es, que tu es sensible au monde associatif, toi-même, puisque
maintenant tu fais partie de deux associations ?
L. : Ouais... euh... pfuu... (silence)
Jm : Le monde associatif en
général ?
L. : (Silence) Ce qui m'a sensibilisé
?...
Jm : Qu'est-ce qui fait que tu es sensible,
ouais ? Qu'est-ce qui te sensibilises dans le monde associatif en
général ?
L. : L'aide un p'tit peu, donc
peut-être aider un p'tit peu donc. C'est peut-être ça
parce-que c'est comme un petit peu, ça, c'est peut-être ça,
je n'sais pas.
Jm : Alors, euh... aujourd'hui, euh... le
club, c'est quoi pour toi ?
L. : Le club, c'est un lieu de rencontres,
euh... d'échanges, Euh... Quoi d'autre ? Euh... ouais (de
réflexion).
Jm : Qu'est-ce que ça
représente ?
L. : (silence) Qu'est-ce que ça
représente ?
Jm : Ouais, qu'est-ce qui te plait au club ?
L. : (silence) (Soupir bruyant de
réflexion) (rire de contenance)...
Jm : Réfléchi lentement, y'a
pas de problème !
L. : Euh... euh... je sais pas, qu'est-ce
que... Donne-moi des exemples, plutôt.
Jm : Justement...
L. : Je n'sais pas !
Jm : Justement, y'a peut-être quelque
chose qui te plait au club ?
L. : Ben, c'est comme j't'ai dit tout
à l'heure, donc, c'est l'esprit du club, un petit peu, donc, c'est
le,le, le, le...
Jm : Oui, tout à l'heure, tu m'en
parlais, de l'esprit du club et de convivialité.
L. : Des convivialités, je n'sais pas,
je m'sens bien...
Jm : Ca veut dire quoi ?
L. : Euh... je me sens bien quoi !
Jm : Euh... l'esprit du club, ça veut
dire quoi pour toi ?
L. : Ben, l'esprit, on vient, puis
voilà quoi ! On est pas, euh... on vient...
Jm : C'est quoi cet esprit ? Tu le
définirais comment ? Quelles seraient les valeurs qui
détermineraient cet esprit du club ?
L. : Ben déjà, c'est quand tu
viens, donc, t'as pas de, comment dire ? C'est pas comme si tu vas au travail,
où t'as des contraintes, etc., donc, tu viens, tu fais c'que tu veux un
p'tit peu, donc t'es libre, t'es... Bon ! Enfin moi au sein du club, je me sens
bien, donc, je fais c'que j'veux un p'tit peu, donc...
Jm : Est-ce tu peux me donner un ou deux
exemples qui te font dire que tu te sens bien ?
L. : Euh... un ou deux exemples...
Jm : Quand tu viens au club ?
L. : Ben j'sais pas, je viens, si j'ai envie
de discuter, je discute, si j'ai envie de travailler, donc de faire quelque
chose, je le fais, si, si, si... euh...
Jm : Est-ce que tu as un exemple de ça
? (Silence) De me dire, ben, par exemple, « la semaine
dernière, je suis venu, euh... j'avais envie de faire ça, on m'a
aidé à le faire, ou j'ai aidé quelqu'un à le
faire... ou finalement... »
L. : Ben déjà...
Jm : Ou « j'avais envie de
faire mon petit train-train dans le coin, je l'ai
fait » ?
L. : Oui, ben voilà ! Ben souvent
comme tu vois, je vais souvent sur Internet, ou alors, je viens, je fais mon
CV, comme j'avais fait la dernière fois. Alors, des fois, je viens pour
en discuter, Euh... Comme je sais pas quel jour, donc queee... voilà
!
Jm : Tu parlais de convivialité,
est-ce que là aussi, tu as un ou deux exemples, qui permette de
déterminer cette... de définir cette convivialité ?
La : Ah... des exemples.
Jm : Convivialité, ça veut dire
quoi, pour toi ? Et est-ce que tu as un exemple pour agrémenter ?
L. : Pour moi, convivialité, donc
déjà donc, on s'connaît, on va dire pratiquement tous, ben,
ceux qui viennent souvent, donc on se connaît tous. Euh... ben
convivialité c'est quoi ? Donc, c'est se rencontrer, discuter, ch'ais
pas, donc, euh...bavarder un p'tit peu, fumer une clope, Euh... Je sais pas !
Discuter de, de tout et de rien, raconter des blagues, euh...n'importe !
Jm : Alors, tu disais, « on se
connaît tous », on se connaît tous, comment tu as
fait pour, pour connaître tout le monde ?
La : Ben chaque fois, qu'on vient là,
enfin... toutes façons au club, c'est toujours les mêmes qui
viennent... déjà. Bon donc, on se voit, ben c'est sûr qu'au
début, ben, y'avait que toi, donc, que je connaissais un p'tit peu et
p'tit à p'tit, bon, ben voilà. Donc à force de, de
participer à des branches etc., donc, je connais p'tit à p'tit,
donc Euh... J'ai appris à connaître tout le monde !
Jm : D'une manière concrète,
donne-moi un exemple qui t'a permis de connaître quelqu'un.
L. : Oui. Ben au début, je faisais
partie d'aucune branche, etc. Donc, euh... j'ai fais, euh... donc j'ai fait
partie de la CAO, donc j'ai connu, euh... c'était qui déjà
? Donc, euh... les deux qui y avaient là, à la C.A.O. ?
Jm : Ph. et Na. (4è entretien,
ndlr).
L. : Ph. et Na, donc par exemple. Ou alors
à la CEB, donc, Jo (6è entretien, ndlr), Jc (5è entretien,
ndlr), Euh... Qui d'autres ? Bon, B. (un membre du Club, ndlr), je le
connaissais avant, parce-que c'est moi, c'est grâce à moi qu'il a
rejoint le club.
Jm : Est-ce que tu peux me donner un exemple
de situation ? Pour connaître quelqu'un. Tu as vu quelqu'un dans le
club, qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es approché de lui, tu lui as
tapé dans le dos, c'est moi, c'est « L., qui t'es toi
? » euh...
L. : Ah oui ! D'accord.
Jm : Qu'est-ce que t'aimes faire ? Un
exemple quoi. Concret.
L. : Ben, ouais. (Silence) Ben c'est comme
dans quoi. Un exemple concret, ben c'est lundi, c'est lundi je crois ? Donc, il
y a eu Pi (un membre du Club, ndlr), je crois ? Le nouveau là. Donc je
suis arrivé, bonjour, voilà, donc, je lui dis voilà, donc
je suis, je m'appelle L., donc, bon, puis on a commencé à
discuter, il a exposé, bon donc, ce qu'il avait, ce qu'il voulait faire
etc.
Jm : Vous avez parlé de quoi ?
L. : Ben, on a parlé de, de, en fait,
c'est plutôt lui. Donc, on l'a laissé parler pour voir un petit
peu ce qu'il avait a faire, parce-que lui, il a des projets, nous on en a
pas.
Jm : Quel genre de projet, il a ?
L. : Euh... lui, donc, il fait partie d'une
association de lépreux, je crois, donc, il voulait monter un site, donc,
euh... d'Internet, il voulait euh... donc Euh... donc euh... Qu'est-ce qu'il
voulait faire ? Ben il voulait donc apprendre à faire les banderoles,
à faire, donc, des affiches, etc.... Et puis voilà quoi !
Jm : Et donc, toi tu t'es, tu lui as dit quoi
? (Silence)... Tu lui en as dit quoi du club ?
L. : Euh... qu'est-ce que j'ai dit du club ?
Je lui ai expliqué un petit peu ce qu'on faisait... J'ai expliqué
ce qu'on faisait, ce que c'était, donc, la CAO donc, ce qu'on faisait un
petit peu avant déjà, parce-que, bon, c'était un projet,
comme tu disais dormant, donc, je lui ai expliqué ce que c'était
avant.
Jm : Alors, quand t'as parlé, quand
t'as expliqué ce que c'était que le Compu's Club, qu'est-ce que
tu as mis en avant ? Du club, et de la branche ?
L. : C'est surtout la branche, que j'ai
expliqué, pas le Compu's Club.
Jm : Ok. Qu'est-ce que tu lui a dit ?
L. : De la CAO ?
Jm : Oui, quels sont les
éléments que tu as avancés, en disant la CAO, d'accord,
bon on fait de l'informatique, c'est bien, hein, c'est notre
étiquette...
L. : Oui.
Jm : Mais, est-ce que tu lui as avancé
autre chose ?
L. : Euh... ben je lui ai dit qu'on
était déjà plusieurs, donc, qu'avant on était
quatre ou cinq, à peu près, qu'on se réunissait, on
faisait, chacun faisait un petit peu, faisait comme il voulait, parce-que bon,
c'est vrai, qu'avant, ça se passait comme ça, donc, avec Ph.
& Na (4è entretien, ndlr), et donc chacun faisait... si moi je
voulais faire un calendrier, je le faisais, si, si les autres voulaient faire,
donc je sais pas moi... Une affiche, euh... ou des cartes de visites... Ils le
faisaient.
Jm : Bon d'accord, ça c'est
l'informatique. Euh... dans le... comment dire ? Quels sont les autres, il faut
pas que je te le dise...
L. : Oui, oui.
Jm : ...Mais que ça vienne tout seul,
Euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu as
avancé ? Quel argument tu as avancé ? parce-que bon, faire
un calendrier, pianoter son ordinateur, il pourrait aller dans n'importe quelle
autre association d'informatique, c'est clair...
L. : D'accord.
Jm : ...avec une étiquette
informatique. Donc, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que tu as avancé,
toi, pour nous différencier des autres clubs informatiques ?
L. : Ben, c'est qu'on était libre,
donc chacun faisait comme il voulait. Peut-être que si tu vas à
d'autres associations donc, c'est, donc c'était tout le monde faisait la
même chose alors que là, chacun est libre de faire, donc, ce qu'il
veut.
Jm : Oui, et ça se passe comment quand
on, quand chacun fait ce qu'il veut généralement ?
L. : Bien. On se donne un coup de main, donc
c'est chacun, s'il y en a un qui a un petit problème, donc, il appelle
l'autre et puis voilà ! Est-ce que j'ai répondu un p'tit peu
à ta question ?
Jm : Hum, hum. Comment tu, tu
définirais le club ? « Le club c'est », et
puis donne-moi des termes, qui pourraient définir le club.
L. : Ben, je vais reprendre mon terme de tout
à l'heure : un lieu de rencontres... Euh... qu'est-ce que c'est
d'autre ? (Silence) C'est plusieurs rencontres, j'sais pas.
Jm : C'est un lieu de liberté
puisqu'on dit qu'on peut faire ce qu'on veut, et puis quoi encore ?
L. : Et puis quoi encore ? (Silence) Je
réfléchis. (Long silence) C'est pas évident comme
ça, parce-que bon... C'est pas évident.
Jm : C'est la spontanéité qui
m'intéresse.
L. : Bon, d'accord.
Jm : C'est ce qui te viens quand...
L. : Quand y'a des questions à choix
multiples, dans quoi, ouais c'est ça, ouais, c'est vrai, tiens j'avais
oublié, c'est ça.
Jm : Réfléchi !
Réfléchi à la réponse.
L. : (rires) Alors, un lieu rencontre, un
espace de liberté, une... Je n'sais pas, moi, de...
Jm : Essaye de, de te représenter des
situations, euh... dans tes relations avec les autres, dans des
réunions, comment ça se passe, y'en a qui expriment des
idées, comment on réagit, est-ce que en un mot ou deux, tu peux
définir le club en disant, le club, « c'est, c'est
ça », « le club, quand on vient là,
on sait qu'on va trouver ça » « on sait
que, on peut avoir telle valeur » ? (Silence) Non ?
Bon on y reviendra après, ne t'inquiète pas ! Hum... on va faire
différemment. Si toi aujourd'hui, tu devais présenter le club
à quelqu'un d'autre. Supposons que tu es au club, que quelqu'un vient au
club, et, et qui te dit : « Ah j'ai entendu parler du club, et
qu'est-ce que c'est ? Explique moi ce que c'est ? ». Tu en
dirais quoi ? Tu en dirais bien sûr tout ce que fait le club au niveau
informatique...
L. : Oui.
Jm : ...à la base, mais tu dirais quoi
de plus, pour intéresser la personne, pour nous différencier des
autres clubs d'informatique ? Quelle est la différence du Compu's Club
par rapport aux autres clubs Informatiques ? Qu'est-ce que tu dirais pour
passer le, le message, et que la personne soit intéressée en
disant : « bon, ben d'accord je viens pianoter, mais je trouve
aussi autre chose » ?
L. : Alors, pour que je... comme tu dis donc,
le... Pour nous différencier déjà des autres, donc, moi je
ne connais pas d'autres clubs d'informatique, pour savoir qu'il y a des
différences...
Jm : ...Clubs informatiques proposent des
machines pour venir pianoter pareil quoi, donc...
L. : ...Oui, mais tout à fait. Je veux
dire, j'en connais pas d'autres pour, pour savoir ce qui, ce qui, ce qu'il
les... comment dire, euh... c'qui les différencie quoi !
Jm : Oui, alors, tu présenterais le
club comment ?
(rires)
Jm : Quelqu'un qui vient, qui dit :
« tiens, j'ai entendu parler du club...
L. : Ben toutes les branches
déjà, ce que tu vas lui présenter...
Jm : ...tu, tu vas lui rendre
service ?
L. : oui, oui !
Jm : Alors, une fois que tu as
présenté... Alors, tu dis quoi des branches ? Au-delà de
la CAO, on fait des cartes de visites, tu dis quoi d'autres ? Tu dis :
« c'est des copains, on se tape dans, dans le dos, c'est
convivial, c'est...
L. : Y'a une bonne ambiance,
Jm : Une bonne ambiance.
L. : Y'a ambiance, que j'ai oublié
tout à l'heure de, de le dire, qu'y a une bonne ambiance.
Jm : Ça veut dire quoi, ambiance pour
toi ?
L. : Ambiance, c'est que...ben je sais pas,
on rigole, quoi, donc, on est pas là, c'est, c'est, donc on s'fait
plaisir, que... Enfin un lieu de plaisir, j'allais dire, non. Mais on est pas,
ch'ais pas, c'est pas... ben quand on fait les réunions, ou n'importe,
on n'est pas, c'est bon, on n'est pas chacun... euh... donc chacun, chacun,
comment dire ? On voit les rides sur son front, etc.... Donc on est... ch'ais
pas, on vient, on est, on est cool, tranquille, et puis voilà.
Jm : Tu disais : « je m'y sens
bien », ça se rapproche un p'tit peu à ça.
Est-ce que tu peux préciser par : « je m'y sens bien, on
prend pas les rides », est-ce que tu as d'autres, d'autres
choses qui te font dire : « Je m'y sens
bien » ?
L. : (Silence) Moi personnellement ?
Jm : Oui, oui. Oui.
L. : Bon déjà,
déjà j'ai une fonction, enfin donc au Club, je suis donc
Secrétaire Adjoint. Donc bon, j'ai une responsabilité en fait...
donc... Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'y a d'autres ? Euh... bon, je participe
à pas mal de branches... je, enfin j'ai l'impression donc, que je, je,
je, comment dire ? Qu'au sein du club, donc je, quand même, je, je
donne un p'tit coup de main au club !
Jm : Oui.
L. : En général, à
l'association.
Jm : Oui. Pourquoi tu as pris des fonctions
de secrétaire adjoint ?
L. : On m'a forcé. Non c'est pas
vrai ! (rires)
Jm : Ça peut être ça,
hein !
L. : Non, non. Absolument pas !
Jm : C'est quoi ?
L. : Non, non, non ! Ben au
début, j'étais administrateur, donc et puis voilà, donc,
y'a, y'a, y'a deux ans. Donc, cette année Secrétaire Adjoint.
Jm : Qu'est-ce qui a fait que au
départ, tu as été administrateur, et maintenant
secrétaire adjoint ?
L. : Ben, au début, c'était pas
évident, parce-que moi je pensais que, en étant administrateur,
donc c'est vraiment, c'était, y'avait des contraintes, en fait, y'en
avait pas, donc. Donc, c'est vrai, que au début, on m'a, j'ai un p'tit
peu... J'avais, j'avais peur que ça me prenne, que ça me, que
ça présente des contraintes.
Jm : Oui.
L. : Donc après, je me suis dit :
« Bon, ben tant pis, je me lance, on va voir ce que ça va
donner ».
Jm : Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es
dit : « bon tant pis » ?
L. : Ben rien. Moi je suis quelqu'un qui a
peur de rien, donc, qui fonce, quoi, donc. Je ne sais pas, donc.
Jm : Donc aujourd'hui...
L. : Que ce soit en milieu associatif, ou en
milieu professionnel aussi, bon, je suis quelqu'un qui fonce.
Jm : Alors aujourd'hui, tu es
Secrétaire Adjoint...
L. : Oui.
Jm : Qu'est-ce qui a fait que tu as
augmenté justement ces responsabilités au sein du Club ?
C'est...
L. : Ben, j'ai vu que j'avais pas de
contraintes déjà en étant administrateur au début,
je me suis dit : « Bon, ben tant qu'à faire, on va, on va
aller au-delà, quoi ! »
Jm : Y'en a pourtant quelques-unes, des
contraintes, ne serait-ce que le relationnel, ne serait-ce que visiter
des...
L. : ...Oui, mais c'est pas...
Jm : ...des machins...
L. : Oui, mais c'est pas grave ! Pour moi,
c'est pas des contraintes, donc, alors, ben sûr, on est pas
obligé, je veux dire, si mon travail ne me le permettait pas, bon, je
peux bien dire non, donc je sais que... j'sais que c'est pas une obligation,
donc euh... au sein du club.
Jm : D'accord.
L. : Bon il faut, il faut l'faire, mais
bon... si, si, admettons que j'ai un travail et que je peux pas aller à
tel...donc, je sais pas, à France Télécom par câble,
ou n'importe, je sais que quelqu'un d'autre ira à ma place. Je sais
qu'entre nous on s'arrange, et puis voilà.
Jm : Très bien. Est-ce que tu fais
partie d'une branche du club ?
L. : Oui.
Jm : Tu peux le...
L. : ...Plusieurs.
Jm : Plusieurs branches du club ?
L. : Oui. CAO, CEB, euh... Comnet,
pratiquement toutes !
Jm : CAO, CEB, Comnet, pourquoi tu participes
à tant de branches ?
L. : Parce-que j'ai déjà pas
mal de temps libre.
Jm : Oui.
L. : Euh... parce-que je m'intéresse
à, à tout.
Jm : Tout t'intéresse ?
L. : Tout m'intéresse, donc je suis
curieux, donc, si demain y'a une autre branche etc., qui m'intéresse,
peut-être que je vais dire « oui », donc j'en suis
là.
Jm : Est-ce que ces branches-là sont,
sont autonomes ?
L. : Oui, autonomes, oui.
Jm : Oui, enfin, je veux dire...
L. : Oui et non, bon c'est vrai que ça
reste toujours Compu's Club bon.
Jm : Comment vous êtes organisés
dans cette, dans ces branches ?
L. : Euh... comment on s'organise, bon, je
sais que chaque branche a son propre compte, donc... euh... On est à...
Chaque branche a son propre compte, bon, mais c'est toujours Compu's Club,
c'est pas...
Jm : Mais au sein de la branche même ?
L. : Pour moi, c'est tu v...
Jm : ...Vous êtes organisés
comment ? Euh...
L. : Ben, y'a un Trésorier, y'a un
Pilote...
Jm : De branche ?
L. : Par exemple, oui, par exemple CEB, on a
un Trésorier, on a, on a donc un, un Président, non y'a pas de
Président. Donc un Trésorier, puis voilà.
Jm : Donc vous êtes organisés,
avec un Pilote...
L. : ...Tout à fait, tout à
fait, oui...
Jm : Des gens qui prennent des
responsabilités au sein de la branche...
La : ...Tout à fait....
Jm : Toi-même, tu en as pris des
responsabilités au sein de la branche ?
L. : Ouais.
Jm : Oui ?
L. : Ouais. Comnet, donc, coPilote.
Jm : Comnet, coPilote ?
L. : Ouais.
Jm : Très bien. Dans le sens autonome,
euh... est-ce que lorsque vous avez des décisions à prendre,
euh... ben, c'est le Compu's Club qui les prend ? Ou est-ce que c'est les
membres de la branche qui les prennent ?
L. : C'est les membres de la branche.
Jm : Et là, le Compu's Club intervient
?
L. : Euh... ben disons que, les gens... Tous
ceux qui font partie donc, de, de ces branches, font partie déjà
du Compu's Club.
Jm : Oui, donc de fait...
L. : ...Donc, voilà quoi. C'est
toujours les mêmes en fait, à peu près, qu'on voit.
Jm : Oui, donc...
L. : Donc, si on prend les décisions,
c'est, c'est ces mêmes personnes qui y seront... Par exemple que
ça soit au Conseil d'Administration, ou, euh... ou, donc, euh... Quand
tu vois par exemple CEB, bon, quand y'a un concert ou n'importe, c'est toujours
les mêmes qui se retrouvent. Si tu veux, y'a une partie qui y est, donc,
comment dire, qui est dynamique. (Silence) Et c'est à peu près
les mêmes qu'on voit, et c'est à peu près les mêmes
qu'on voit dans toutes les branches.
Jm : Les mêmes, ça
représente combien de personnes ?
L. : Je sais pas. On va dire, maximum,
ça doit tourner autour d'une dizaine. Maximum.
Jm : Donc une dizaine de personnes ?
L. : Oui. A peu près.
Jm : Et comment ça se fait que ce soit
toujours les mêmes, les autres qu'est-ce qu'ils font, parce-que y'a cent
cinquante membres au club ?
L. : Tout à fait, ouais.
Jm : Alors, les cent quarante autres,
qu'est-ce qu'ils font ?
L. : Ben, peut-être que eux, j'sais
pas. Donc, chacun vient au club avec peut-être un projet. Ou y'en a
p't-être qui viennent juste pour leur propre intérêt. Donc,
y'en a peut-être qui viennent juste pour apprendre et après se
casser. Je sais pas. C'est comme un peu de partout, donc... euh...
voilà.
Jm : Mais, tu retrouves ces, exactement les
mêmes, à peu près une dizaine de personnes, dans les trois
branches dans lesquelles tu, tu navigues ?
L. : Pas dans les trois, mais en
général, quoi. A peu près. Par exemple, tu regardes Comnet
et CEB, c'est à peu près les mêmes.
Jm : Et combien, y'en a qui sont les
mêmes ?
L. : Ben, y'a moi, y'a toi, y'a Jo (6è
entretien, ndlr), y'a Jc (5è entretien, ndlr), euuuuh... qui est-ce qui
y'a d'autre ? Euh... y'a maint'nant, et si y'a Pi (membre du Club), le nouveau.
Y'a...
Jm : Il est chez Comnet, chez la CAO et
chez... ?
L. : Non, non je parle pas de la CAO. Si, Il
fait partie de la CAO, et c'est... euh... Comnet l'intéresse.
Jm : Comnet l'intéresse.
L. : C.E.B., il a...
Jm : ...Il est pas encore venu sur Comnet ?
L. : Si Comnet, mais la dernière fois,
déjà Jo lui en a parlé, il a dit que ça
l'intéressait. D'ailleurs, il est près à prendre
l'abonnement, donc euh... etc. Y'a le nouveau aussi, là, comment il
s'appelle déjà ? Euh...je sais pas. Enfin tu vois qui c'est,
celui qui a les lunettes ? Qui vient à la Bourse donc Comnet aussi
l'intéresse, et puis donc, si tu veux, donc, on retrouve, j'ai dis une
dizaine maximum. Donc, bon on doit pas être loin, quoi !
Jm : Oui, oui. Y'a combien de personnes chez,
chez, euh chez Comnet et chez, au CEB ? Une dizaine dans les deux ?
L. : Dans les deux ? Oh un peu plus quand
même.
Jm : Un peu plus ? Y'a combien de personnes
chez... à la Finance ?
L. : Je crois, maintenant, on doit
être... neuf, à peu près. Je crois.
Jm : Neuf.
L. : Mais, y'en a toujours qui viennent tout
le temps, et y'en a qui viennent pas. Par exemple...
Jm : Dans la CEB, vous êtes combien,
même ceux qui viennent pas régulièrement ?
L. : Même ceux qui viennent pas ? Dans
les deux ?
Jm : Régulièrement. Qui
viennent pas régulièrement, qui viennent de temps en temps.
L. : On va dire une vingtaine.
Jm : Dans la Finance, y'en a une vingtaine ?
L. : Non, dans les deux : Finance et...
Jm : Dans la Finance d'abord, y'en a combien,
à peu près qui viennent ?
L. : Une dizaine.
Jm : Qui sont inscrits quoi ?
L. : Oui. Une dizaine.
Jm : Une dizaine et au CEB, et Comnet ?
L. : Comnet, euh... je sais pas, huit
à peu près.
Jm : Huit à peu près ?
D'accord. Euh... Bien, alors ça se passe comment entre les membres ?
L. : Bien.
Jm : Dans la branche ? Bien ? C'est à
dire, qu'est-ce que, quels sont les éléments qui te font dire :
« ça se passe bien » ? Tu as eu l'occasion
d'une scène, tu as participé à une scène qui te
faire dire : « ben ça se passe bien » ? Que
tu peux conclure, en disant : « ça s'passe
bien » ? Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une
scène, par exemple ?
L. : Moi je sais, que, pour n'importe quel,
enfin, j'ai pensé aux décisions, par exemple, si on veut prendre
une décision, donc, euh c'est, chacun vote, chacun dit ce qu'il pense,
hein ! Ben, s'il n'est pas d'accord, il dit qu'il n'est pas d'accord, mais
c'est vrai que en général, donc, c'est... Quand on a une
idée, on est, enfin... Comme pour Internet, par exemple, la plupart,
t'as bien vu, tout le monde était d'accord, personne n'était,
n'était contre. Euh... donc voilà donc. A ce niveau là,
ça se passe déjà bien. Euh... Qu'est-ce qu'i a d'autres ?
S'i y'a un truc qui va pas, donc, euh... on en parle, et bon, on essaie
toujours de... oui, oui. Ben, c'est comme pour les leçons, donc, qu'on
avait pris, t'avais vu la dernière fois, j'avais dis, enfin, moi
personnellement, ça me...
Jm : Les leçons ?
L. : Ouais, les leçons, là, tu
sais les leçons de la Bourse. Comment ça s'appelle ?
Jm : Ah, l'école là, le
classeur !
L. : Oui, oui voilà.
Jm : Le classeur ?
L. : Oui, oui. Moi, j'en avais
déjà parlé, y'a quelque temps, je disais que ça
m'intéressais pas trop...
Jm : Ça t'intéressais pas trop
?
L. : Bon on a, on a laissé
tombé un petit peu, et après donc, on en a reparlé, j'en
ai reparlé.
Jm : Oui.
L. : Et bon, ben c'est vrai que...
Jm : On a laissé tombé une ou
deux leçons ?
L. : Oui, Oui.
Jm : On a laissé tomber les
leçons ?
La : Oui, pour le moment, on avait dit qu'on
allait, qu'on allait les arrêter.
Jm : Ah ça, je suis pas au courant
!
L. : Si tu y étais! Tu te rappelles
pas, tu avais reçu le classeur...
Jm : Ah, la suite des leçons ?
L. : Oui, oui, voilà.
Jm : Ou de faire les leçons ?
L. : De faire, non.
Jm : Attend, attend. Tu voulais dire de faire
les leçons ? Je comprenais pas. Donc tu étais pas d'accord de
continuer à acheter...
L. : ...Voilà...
Jm : ...des leçons par correspondance,
parce-que ça pouvait faire cher pour la branche.
L. : Ça pouvait faire cher, et...
euh... c'est pas, c'est pas question de cher ou pas, mais c'est surtout que on
arrive pas à suivre. On reçoit des leçons et...
Jm : ...C'est trop rapide...
L. : C'est trop rapide, et bon, nous, on
avance à p'tit pas...
Jm : Mais pour ce qui existe là ?
Cette avancée à p'tit pas, tu étais d'accord sur les
formations, ou pas?
L. : Au début, j'étais
d'accord. Mais après, j'ai vu qu'on suivait pas.
Jm : Tu es moins d'accord maintenant ?
L. : Ouais. J'ai vu qu'on suivait pas, il
faudrait continuer...
Jm : Alors, est-ce que ça continue
quand même ?
L. : Pour le moment, ça continue.
Jm : Ça continue ? Tu participes
à faire les leçons toi-même ?
L. : Oui.
Jm : Alors là, on... Voilà une
idée qui est exprimée, je suis pas d'accord avec quelque chose,
comment ça se solutionne ?
L. : Voilà. Donc, j'ai dit que
j'étais trop d'accord, donc personne n'en a parlé, et p'tit
à p'tit, bon, ben, chacun disait ce qu'il en pensait.
Jm : Personne n'en a parlé ?
L. : Eh, non, c'est moi, en fait, qui avait
soulevé le problème. Et... donc, et puis... on a
décidé finalement de, j'ai réussi à convaincre tout
le monde. Enfin. Donc avec mes arguments,
Jm : Convaincre, on parle pas de la
même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de continuer les
formations... continue, continue pas... je veux dire, acheter des formations,
je veux dire, continuer ou pas... c'est entendu...
L. : ...C'est les leçons...
Jm : ...moi je parle : les faire, les
leçons.
L. : Ah, d'accord.
Jm : Les faire, dans l'organisation, dans la
relation, « je m'organise comme ça pour les
faire », je...
L. : D'accord. ok, ok, d'accord.
Jm : Tu étais d'accord, tu
étais pas d'accord... ?
L. : Si, si, j'étais d'accord. Ben
c'est vrai qu'il y a un roulement. Oui, oui, y'a un roulement. Bon d'accord,
ok. Moi je parlais de...
Jm : Y'a un roulement. Donc tu y participes ?
L. : Chacun son tour. Ouais.
Jm : Ça, pour faire ça, tu
étais d'accord ?
L. : Oui. Tout à fait.
Jm : Bon alors, il faut que je trouve encore
autre chose, ou tu n'étais pas d'accord.
L. : C'est vrai, oui, j'étais
d'accord...
Jm : Ce qui m'intéresse, c'est de
savoir quand tu es pas d'accord, pour savoir...
L. : Mais j'en ai jamais fait !
Jm : T'en as jamais fait ? Pourquoi, t'en as
jamais fait ?
L. : Parce-que moi, j'étais Euh...
Jm : Parce-que tu n'en avais pas envie ? Tu
ne te sens pas... Faire des résumés, ça te plait pas?
L. : Non, ça me plait pas trop, et
bon, j'avais proposé de faire, donc, plutôt d'apprendre le
vocabulaire, et donc, main'nant, de temps en temps, donc, je fais une petite
fiche, avec des, des mots de vocabulaire, donc, un petit dictionnaire en fait.
Jm : D'accord.
L. : Et puis donc, voilà. Donc je
participe quand même !
Jm : Qu'est-ce qu'ils disent les autres que
tu participes pas au résumé de formation quand même ?
L. : Rien du tout.
Jm : Rien du tout ? C'est accepté ?
L. : Ben oui, de toute façon...
Jm : Donc, c'est toléré.
L. : Bien sûr, oui.
Jm : Voilà.
L. : Ben, je suis libre un p'tit peu. Si j'ai
pas envie, je leur dis : « J'ai pas envie, ça me prend la
tête...
Jm : C'est intéressant.
L. : ...ça m'prend la
tête... Et puis voilà ! ».
Jm : Forcé, tu ne te sens pas
forcé ?
L. : Non, non. Absolument pas.
Jm : Très bien.
L. : C'est un espace de liberté.
Jm : Très bien, un espace de
liberté. Alors, tu disais tout à l'heure, dynamique, ce sont les
mêmes personnes qui sont dynamiques, qu'est-ce qui te... Quels sont
les... ce qui est visible, pour toi, qui te font dire, pour toi :
« voilà, cet élément là, me fais dire
que la personne est dynamique ».
L. : Ben, c'est le fait de participer
déjà, de venir, euh... de passer pas mal de temps au Club, donc,
voilà.
Jm : Oui donc, c'est passé pas mal de
temps ? Et physiquement les gens, tu les vois comment ? Ils sautent au plafond,
ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, ils te tapent dans le dos, Euh...
L. : Ben non, peut-être pas ! Ils ne
sautent pas au plafond, mais bon, ils sont souriants, et puis, Euh...donc,
ouais ils sont souriants, et puis donc, s'ils viennent, c'est qu'ils sont bien,
donc, ils se plaisent donc, à l'association. On ne force personne
à venir ! Celui qui a pas envie de venir, il vient pas.
Jm : Et alors, qu'est-ce qui te fait dire
qu'ils sont dynamiques ? Donc qu'ils participent à...
L. : Ben déjà le fait de
participer est déjà quelque chose. Si moi je suis dynamique et
que j'ai envie d'être dynamique. Donc, si je viens, si je viens tout le
temps, donc, c'est que je suis dynamique.
Jm : Oui, est-ce que tu as d'autres
éléments qui font dire que tu es dynamique ? parce-que tu peux
venir et puis être une statue de cire, te mettre dans le coin et rien
faire ! C'est possible.
L. : C'est participer également.
Jm : Participer à...
L. : Participer à plusieurs branches,
ou à une branche, et puis voilà. Participer, je sais pas moi,
à la recherche d'un local, ou participer, donc, à
emménager, à déménager, à aller donc, voir
telle... la Mairie, euh... bon, etc.
Jm : Alors dans les... parce-que je suppose
que vous avez des réunions, quand vous faites ces formations, etc. Quand
quelqu'un n'a pas d'idée, je reviens un petit peu là-dessus,
puisque l'histoire de la formation, n'amène pas trop
d'éléments, donc on va essayer de voir différemment,
lorsque vous avez une idée qui est émise, quelqu'un qui n'est pas
d'accord, ça doit arriver, puisque vous êtes une dizaine...
L. : ...Bien sûr, bien sûr...
Jm : ...Tu disais au CEB, huit, à peu
près Comnet, donc il arrive un moment, nécessairement, deux ou
trois ou peu importe...
L. : ...Tout à fait...
Jm : Des personnes sont pas d'accord. Comment
ça se solutionne là ? Dans ces cas-là ?
L. : Avant de voter, déjà, on
essaye d'écouter les arguments des autres, de celui, donc ceux qui sont
pas d'accord et après, en fonction de ça... parce-que c'est vrai
qu'au début on peut ne pas être d'accord, mais après avoir
entendu certains arguments, on peut, donc, changer d'avis.
Jm : Oui.
L. : On peut changer d'avis...
Jm : Oui, mais par rapport à
telle...
L. : Je peux avoir une position par rapport
à telle, à tel...
Jm : Par rapport à tel avis, ça
se solutionne ?
L. : Oui, tout à fait.
Jm : Alors, si personne ne change d'avis,
comment ça se passe ? Vous vous crêpez le chignon, vous jetez les
chaises à la figure, vous basculez ceux qui ne sont pas d'accord
à travers la fenêtre... ?
L. : Non, non, non, bien, absolument pas !
Non, non.
Jm :
L. : Ça se solutionne
tranquillement...
Jm : Comment ?
La : ...ben en discutant, c'est tout.
Jm : Ben oui, mais si on reste sur ces
positions, en disant : « Ben moi, je suis pas
d'accord », comment on fait ?
L. : Ben, si t'es pas d'accord, il faut
m'dire pourquoi tu es pas d'accord. Donc, les arguments, donnez-moi les
arguments...
Jm : Je te l'ai dit,
« même si mes arguments ne sont pas valables, je reste sur
ma position : je suis pas d'accord ». Comment ça se
solutionne dans ces cas-là ?
L. : Ben, on vote, on vote à la fin,
ça c'est à la fin. C'est ce que j'avais dit tout à
l'heure.
Jm : Oui. D'accord.
L. : On vote. Voilà.
Jm : Vous allez voter...
L. : Voilà.
Jm : Vous essayez de convaincre...
L. : Tout à fait. Pour ça, je
te dis, avant de voter, avant de voter je t'dis avant de voter on écoute
d'abord les arguments...
Jm : ...Oui, tu l'avais dit après,
excuse-moi...
L. : ...Oui, oui, avant de voter, on
écoute d'abord les arguments des autres, on peut changer d'avis. C'est
à dire, que moi, si moi que, si moi, je te dis qu'un truc, ch'suis pas
d'accord, tu vas pas me dire : « On va voter
d'abord », non, tu vas me dire : « pourquoi tu es
pas d'accord ? » Je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas
d'accord, et peut-être que ça va t'changer, donc, peut-être
que tu vas changer d'avis.
Jm : Alors, qu'est-ce qui te semble important
dans le bon fonctionnement de la branche ?
L. : (long silence) Qu'est-ce qui me
semble... ?
Jm : ...Important...
L. : ...Important... ?
Jm : Pour que la branche fonctionne bien,
qu'est-ce qui te semble, que tu vois, que tu dis : « ça
c'est important, ça permet que ça marche bien » ?
L. : Ben déjà, c'est de se
voir régulièrement.
Jm :Oui.
L. : Parce-que, je sais pas, je donne des
exemples, comme pour la CAO donc, etc. Euh... euh... donc, on se voyait au
début donc régulièrement, après, donc il y avait
Ph. (4è entretien), non c'est moi qui étais parti, plutôt.
C'est moi qui étais parti, et eux, ils en ont marre, à mon avis,
de se retrouver tous les deux...
Jm : Oui. Tu étais
parti pourquoi ?
L. : Ben, j'étais parti au Maroc. Pour
des vacances.
Jm : Pour tes vacances, au Maroc ?
L. : Voilà. Et donc, depuis que je
suis parti, donc, bon ça, donc ben....
Jm : ...Donc il faut vous voir
régulièrement pour que ça marche bien.
L. : Oui, tout à fait.
Jm : Et quoi d'autre, pour que ça
marche ?
L. : Faire, avoir des projets, faire, donc
suivre...
Jm : Suivre des projets ?
L. : Voilà. Suivre des projets, ou
ça peut être projets personnels, ça peut être, je
sais pas, n'importe.
Jm : quels genres de projets ?
L. : Ça dépend des branches. Je
sais pas. Personnel ?
Jm : Oui.
L. : Je n'sais pas. Donc au niveau de la CAO,
donc, c'est faire des cartes de visites, par exemple, un calendrier pour
l'année d'après, ou faire un album photo, ou, puis
voilà.
Jm : A la finance, là vous suivez quel
projet ?
L. : Oui, à la Finance, c'est
plutôt des projets, donc, euh... c'est pas, donc personnel ! C'est
plutôt des projets, donc euh... comment dire ? Euh... (silence)
aide-moi ! (je fais non de la tête). Donc c'est pas des projets perso...
c'est pas des projets personnels, donc, bon à la CAO, c'est un truc que,
moi, je veux faire, donc y'a que moi qui veux l'faire, donc je fais des
calendriers, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais, c'est vrai, qu'au
niveau de Comnet par exemple, au niveau de, de CEB, donc, c'est des projets
qu'on a tous ensembles donc. C'est investir, créer un club
d'Investissement, donc on a une, comment dire ? Un... Une sorte de ligne
à suivre, et on la suit.
Jm : Très bien. Est-ce que tu sais
comment a vu le jour euh... la branche Finance ? La branche Comnet ?
Est-ce que tu as participé à sa mise à jour ? A sa
création ?
L. : Euh... je crois bien oui, je crois bien.
Au début, c'était, non, c'était plutôt
l'école de Bourse, je crois...
Jm : Oui. Tu as participé à sa
création ? Qu'est-ce que vous aviez à... Donc, tu as
participé avec d'autres personnes ?
L. : Oui, tout à fait.
Jm : Ou tout seul ?
L. : Non. Non, bien sûr.
Jm : Ou avec plusieurs personnes ?
L. : Bien sûr oui.
Jm : Vous... Tu t'es senti comment là,
quand vous avez voulu créer ça ? D'abord, ça s'est
passé comment ? D'abord ?
L. : Ça c'est passé, je sais
plus qui avait lancé donc cette idée, de, on s'était dit,
donc, on s'était réunis, bon y'avait quelques personnes qui
étaient donc, intéressées, et au début, on a
créé, plutôt donc, l'Ecole de Bourse. Et c'est vrai, donc,
suite à ça, on a eu un projet, de plus tard, on avait dit de
donc, une fois qu'on, qu'on, une fois donc, qu'on a appris un petit peu donc,
les, les mécanismes de la Bourse, investir, donc, créer un club
d'Investissement.
Jm : Et alors, au moment de créer
cette branche, tu te sentais comment ?
L. : Bien ! Moi je me sens toujours
bien ! (Rires) Moi si je me sens pas bien, je me casse.
Jm : Ah !
L. : Donc voilà ! Si y'a une branche
qui, qui, qui me plais pas...
Jm : Te sentir bien, ça veut dire
quoi, physiquement te sentir bien ?
L. : Ben... Ça veut dire quoi ? Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Au fond, ouais ? (silence)
Ben, c'est toujours la liberté, je vais revenir encore à la
liberté... C'est être libre...
Jm : ...Oui, physiquement, comment c'est
toujours pareil ! Je, je te donne un autre exemple, il faut pas que je dise
trop quoi : « tu sautes au plafond, tu te roules par terre,
... » ?
L. : (Rires)
Jm : Tu fais : « Ouais
! » Tu te fous à gueuler, Euh... Moi quelqu'un qui saute
au plafond, qui a le sourire jusqu'aux oreilles, je me dis : « Il
se sent bien ». Mais c'est la conséquence de quelque
chose que je vois. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc toi, te sentir bien,
tu le définis comment "te sentir bien" ? Ça se caractérise
comment "se sentir bien" ?
L. : D'être à l'aise. Tu vas me
dire encore : « qu'est-ce que ça veut dire être
à l'aise ? ».
Jm : Oui, oui. Ça veut dire,
bé... euh... « j'ai les bras
détendus », Euh...
L. : (Silence) Je sais pas. Au fond, au fond
ouais. Je sais pas.
Jm : Je te donne un exemple. Par exemple tu
dis : « être à l'aise ». Là,
tout de suite, je sens que L. n'est pas à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il
croise les bras, parce qu'il se met la main devant la bouche, ce sont deux
éléments qui me disent L. n'est pas à l'aise. Tu comprends
?
L. : Ouais, ouais. (rires)
Jm : Voilà. Non, mais
détends-toi !
L. : Non, mais je suis détendu !
Donc... non, mais je réfléchis donc, c'est pour ça...
Jm : ...Ce sont des éléments
qui me font dire : « je le sens pas à
l'aise. »
L. : ...Non, mais, malgré ça,
je suis à l'aise quand même.
Jm : ...parce-que habituellement, je te
connais habituellement, tu croises pas les bras, Euh...
L. : Bon parce-que là, c'est un peu
sérieux, donc? bon...
Jm : Non, non t'inquiète pas !...
L. : Oui, non, mais je sais, non ben d'accord
!...
Jm : ...C'est pas sérieux ! Il y a les
trois quarts des trucs qui vont partir à la poubelle !
L. : Oui, oui, tout à fait.
Jm : Tout le monde, hein, donc
t'inquiètes pas !
L. : Ben qui c'est qui, ben je sais pas, je
sais pas si j'arriverai à teee...
Jm : ...Ben quand tu es à l'aise, tu
te croises pas les bras, euh... euh... je sais pas moi ! Il faut pas que je te
guide trop, sinon, ça va pas, quoi ! Il faut que ça vienne de
toi.
L. : Je te le dis même maintenant, je
suis quand même à l'aise, même si je croise les bras, je
fais ça, ouais tiens, je réfléchis, donc, c'est pour,
c'est pour envoyer les moteurs de recherche ! (rires)
Jm : Bon, allez, on va continuer, euh...
où j'en étais moi ? Alors, une fois que ça s'est
créer, ça s'est passé comment ensuite dans le rapport avec
les gens, entre eux ? Dans la branche ? Quoique je parle de la Finance, pour ne
prendre qu'un exemple, sinon, ce serait trop long, ça doit se passer
pareil, ou si il y a des choses qui diffèrent, tu le dis, hein ? Tu peux
passer de l'un à l'autre, hein.
L. : On se voit une fois de temps en temps,
donc au début, c'était une fois toutes les semaines, je crois,
les lundis, si mes souvenirs sont exacts, ouais, les lundis, je crois ou
mardis...
Jm : Et entre les gens, les relations entre
les gens, ça se passe comment ?
L. : Euh... ça se passe, ça se
passe comment ? Donc, on se partage déjà les tâches, donc
quand on fait des recherches etc., donc chacun...
Jm : ...Donc, ça, c'est dans la
relation, ça ?
L. : Oui, oui.
Jm : Je veux dire entre les gens, dans les
rapports entre les gens, ça se passe comment ? Vous vous disputez,
euh... vous... ?
L. : ...Ben non, non absolument pas ! Je
dirais encore bien, mais tu vas me dire toi : « ça
veux dire quoi être bien ? »
Jm : Déjà tu dis c'est bien,
donc...
L. : ...Oui, oui, tout à fait.
Jm : ...Donc, c'est déjà un
résultat, donc, j'ai déjà ça. Bien, maintenant si
après on peut affiner par un ou deux exemples qui font dire
« je suis bien », euh... donc, dans les relations,
alors, ça c'est, ça se passe bien ?
L. : Oui.
Jm : Mais, alors, donne-moi un ou deux
exemples ? (silence) Que ça se passe bien ?
L. : (Silence) Bon, bien, on vient, on passe,
on passe un petit moment, on discute, on se bat pas, on se...
Jm : Vous discuter de... d'informatique
uniquement ? Ou de Bourse uniquement ?
L. : Ben de Bourse, de tout ! de...
Jm : De quoi d'autre ?
L. : C'est vrai que pendant la
réunion, on essaye un p'tit peu de discuter que de ça. Mais c'est
vrai que des fois, ça part dans les blagues ou n'importe, donc on essaye
de...
Jm : Ça part dans les blagues.
Voilà un exemple intéressant en disant que ça se passe
bien. En racontant des blagues, on se raconte des blagues...
L. : Voilà.
Jm : Voilà, très bien, c'est
ça, tu vois ! Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui
font...
L. : Mais c'est vrai, parce-que, si t'essaies
de retrouver un p'tit peu, c'est pas évident...
Jm : ...Oui, je sais...
L. : ...Mais, donc... Alors, pourquoi
ça se passe bien ? Pourquoi ? Ça veut dire quoi "être
bien" ? Etre bien, oui... Je sais pas. Tu demandes à quelqu'un, c'est
pas évident de te le décrire...
Jm : Oui, je sais.
L. : T'es content, c'est quoi t'es content ?
Jm : Mais c'est parce-que on a pas l'habitude
de décrire, je suis content...
L. : ...Oui, oui tout à fait oui.
Jm : ...Je suis bien, une bonne
ambiance...
L. : ...Oui, tout à fait !
Jm : On a l'habitude d'un résultat,
mais ce résultat n'est qu'un résultat ! C'est bien la
conséquence d'un tas de petites choses qui font...
L. : ...Tout à fait...
Jm : ...et moi ce que je cherche, c'est
ce qui fait lien justement. Dire : « y'a une bonne
ambiance », bon, ben ça va, mais c'est bien de le dire,
ça va... mais moi, j'ai besoin de savoir quels sont les tout p'tits
éléments qui me font dire que ça va. Tu comprends, C'est
ce lien-là que je cherche. Je suis motivé, bon, ben d'accord t'es
motivé, mais pourquoi, t'es motivé, qu'est-ce qui fait ? Qui dit
que tu es motivé ? Qu'est-ce tu as fait qui te motives ? Est-ce que
c'est les autres ? Est-ce que un jour on t'a dit un mot gentil ?
Est-ce que, parce-que, quand tu parles à quelqu'un et à telle
personne, elle a toujours le sourire ? Tu vois, c'est tout ces petits
trucs qui fait dire « bé, y' a une bonne
ambiance ». C'est ça, c'est ça : je cherche,
dans... C'est ça que je cherche.
L. : Je vais essayer, donc on raconte des
blagues, on boit un petit café, on fume une cigarette, euh... puis
voilà quoi !
Jm : Bon.
L. : ...On se chambre un p'tit peu, on...
Jm : Oui, c'est bon enfant
généralement ? C'est bien perçu ?
L. : Oui, bien sûr ! Bien on se
connaît bien, donc, ça fait plusieurs années, qu'on...On
est une petite famille maintenant !
Jm : Alors qu'est-ce que ça t'as,
ça t'apportes, personnellement, personnellement hein, qu'est-ce que
ça t'apportes de participer à une branche, ou d'avoir pris euh...
euh... des responsabilités au sein du club ? parce-que t'es très
investi, tu étais administrateur, t'es Secrétaire
Général Adjoint, tu es coPilote de Comnet, tu participes à
la, à la Finance...
La : ...Toutes les branches, en fait...
Jm : ...tu es aussi à la CAO,
euh...
L. : Ben, pour moi, je sais pas, mais
j'apprends en même temps, donc moi, ce que ça m'apporte, c'est que
j'apprends des trucs.
Jm : Oui, des trucs informatiques ?
L. : Oui, tout à fait, oui.
Jm : Et autre chose que l'informatique ?
Est-ce ça t'apprends quelque chose ? Ça t'apprends la vie,
ça t'apprends...
L. : Oui, ça m'apprend toujours la
vie, le milieu...
Jm : La vie, c'est peut-être
prétentieux, mais bon...
L. : Oui, le milieu associatif quoi. Donc,
je, je...
Jm : Et pour toi, le milieu asso...
L. : ...Je croise des gens, donc euh...
d'autres personnes, donc on se, donc on voit d'autres personnes, donc on,
Euh... Comment dire ? On voit d'autres personnes.
Jm : Tu dis « ça
m'apprend le milieu associatif », donc tu as appris quoi, sur le
milieu associatif ? Ça t'apportes quoi, le milieu associatif ?
(Silence)
L. : Qu'est-ce que ça m'apporte ?
(Silence)
Jm : Euh... Est-ce que tu peux me donner un
ou deux exemples ? Que mais, tu dis : « Ben là, tiens
d'accord, j'ai appris en informatique, mais ça m'a apporté autre
chose », « tiens, je me suis fais un nouveau
copain », ou, « tiens, j'ai fait la connaissance
de quelqu'un qui était intéressant », ou au
contraire, « tiens aujourd'hui, ils m'ont tous emmerdés,
j'en ai marre, font chier »... (silence) Est-ce que tu as un ou
deux exemples, non ?
L. : Oui, ben c'est qu'on rencontre des
personnes, qui peuvent être intéressantes, donc qui vont, ben
ch'sais pas.
Jm : On reviendra sur le problème par
d'autres questions, peut-être que ça va permettre, permettre...
Quelles, je t'en... peut-être maintenant avec tout ce qu'on a dit,
ça va peut-être venir plus facilement : quelles sont les
valeurs que tu attribues au club ? (Silence) Donc, c'est un... comment tu
définirais le club ? Quelles sont ses valeurs ? C'est la question
de tout à l'heure. « Le club, c'est, c'est
ça », ben tu en as déjà dit pas mal, hein,
je vais pas les reprendre, tu as dit : « C'est un espace de
convivialité », « c'est un esprit
club », euh... « je m'y sens
bien », « c'est une bonne
ambiance », est-ce qu'il y a d'autres valeurs ? Des valeurs plus
classiques, Euh...
L. : Il y a aussi des valeurs, comment on dit
déjà ? Je sais pas, des valeurs, euh... euh...
Jm : Donne un exemple.
L. : Pour les gamins, en fait ! Pour essayer
de les motiver un p'tit peu, donc, pour...
Jm : Des valeurs d'éducation ?
L. : Voilà, ouais, ouais.
Jm : Vers les jeunes ? On est
sensibilisé aux jeunes ?
L. : Voilà oui.
Jm : Quelle autre valeur encore ? Qu'est-ce
qu'on apprend aux jeunes ?
L. : (Silence) On leur apprend à, donc
à... à suivre des projets, à être motivé,
donc à...
Jm : Comment on fait pour les motiver les
jeunes ?
L. : (Silence) Ben avec des projets.
Jm : Et eux, ils viennent. Ils sont d'accord
pour suivre des projets.
L. : Ben, c'est des projets qu'ils veulent
suivre un p'tit peu donc. On essaye de, de les aider, donc, en leur donnant
aussi des responsabilités. Justement, je sais que, je sais qu'ils ont
leur compte aussi, donc...
Jm : Et qu'est-ce qu'ils ont
comme, comme projet, comme...
L. : Ben, y'a le marathon Internet,
y'a...
Jm : Quand ils viennent au club, qu'est-ce
qu'ils font ?
L. : Ben, ils s'amusent.
Jm : Ils s'amusent.
L. : Oui. Ils s'amusent, et puis bon, puis
ils...
Jm : Ils suivent leur projet...
L. : Oui, ils suivent leur projet, des fois,
non, des fois, ils viennent pour s'amuser, pour jouer au... à leurs
trucs là, je sais pas comment ça s'appelle.
Jm : Qu'est-ce qu'on leur fait faire ?
L. : Qu'est-ce qu'on leur fait faire ?
(Silence) euh... c'est vrai que le mercredi, je viens pas souvent,
déjà, y'a beaucoup de jeunes... y'a trop de monde !
Jm : Ce que j'essaye de te faire dire, juste
une chose...
L. : Dis-le-moi, dis-le-moi !
Jm : ...Je ne veux pas te mettre sur la voie,
parce-que si je te mets sur la voie, "je pipe les dés" Et si ça
vient pas, bon, bé, ça vient pas ! C'est quelque chose qui t'as
pas... qui t'aspas touché quoi.
L. : D'accord. Je sais pas, ben je sais pas,
oui. Ch'ais pas. Peut-être... aide-moi un p'tit peu, peut-être ?
(rires)
Jm : Je te le dirais après, si tu
veux, mais pas maintenant, parce-que j'induirai vraiment, ça m'aiderai
pas dans mon enquête, d'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se
passe, au sein d'une des branches, quand tu y participes, qui est
déterminant dans la conduite du projet ? Qu'est-ce qui détermine
la conduite du projet ? Dire j'ai un projet, ça va, mais n'importe
quelle entreprise a des projets, paye des salariés et tu fais le boulot,
quoi. Qu'est-ce qui fait, que là, au sein d'une association qui est sans
but lucratif, avec des gens qui sont motivés, qu'est-ce qui te
paraît déterminant ? Dans la conduite du projet ? Qu'est-ce
qui fait que... ?
L. : Ben c'est que déjà, on a
des projets, donc, c'est des projets quand même, donc que...
Jm : Ça a émergé comment
ces projets ?
L. : Ben par les idées, tout
simplement. Ça part d'une idée, qu'un membre donc, lance dans
l'air, et puis donc, si ça nous intéresse, bon... En
général, ça nous intéresse toujours, parce qu'on
attend que des idées. Et puis, donc de ça, ça part, et
puis, donc, on essaye de suivre ça jusque, jusque, jusqu'au bout. Comme
pour le Club Investissement, c'est marrant, qu'on a... chacun investi dans le
club tous les mois, donc, voilà, on a un compte, on a... et puis
voilà !
Jm : Qu'est-ce qui te ferais quitter les
branches, la branche Finance, par exemple ?
L. : Euh... Ben si vraiment on s'entend plus
quoi ! Apparemment, bon, j'sais pas, on se réuni tous les quinze jours,
que je vois que ça se passe mal... Tu vas me
dire : « qu'est-ce que ça veut dire ça se
passe mal ? »
Jm : Très bien. Bon tu as
compris...
L. : (Rires) Je sais pas, donc. C'est, si je
vois que les, les projets, ou alors, on avance vraiment pas... euh... Si je
vois que on avance vraiment, vraiment pas, donc qu'on est toujours au
même point... peut-être, peut-être que je vais partir,
parce-que B. (membre du Club, ndlr), il a failli partir en fait du club. Parce
qu'il dit : « Oh, ben de toute façon, on fait pas grand
chose et tout ». Bon, mais c'est vrai, que moi, donc je me
console un p'tit peu, avec, en m'investissant donc à coté, donc
par Internet, donc moi j'investis, pour apprendre en dehors du Club. Donc
j'investis en Bourse, euh... puis voilà quoi. Donc si vraiment,
ça se passe mal, je vois qu'on avance pas, qu'on est toujours au
même point, ou alors s'il y a des gens inintéressants, c'est
à dire que, qui foutent la merde un petit peu, donc que... je sais
pas...
Jm : ...Tu peux me donner un ou deux exemples
?
L. : ...Comme, je sais plus comment il
s'appelle, au début qu'il venait ? A l'époque, on était
encore chez REI (le second bailleur de l'association). Y'en avait un, il
venait, il, il parlait mais pendant toute la, toute la réunion quoi,
ch'sais pas, je sais plus comment il s'appelle, mais XY...
Jm : PG (membre du Club, ndlr).
L. : ...il parlait pendant toute, toute le,
la truc, il nous laissait même pas parler, lui il disait un truc,
c'était ça...
Jm : C'était agaçant, oui.
L. : Oui, il nous écoutait même
pas, bon. Bien qu'il ait un peu d'expérience, mais bon c'est pas, on
s'en fout quoi ! Bon, il peut dire ce qu'il pense, mais, faut laisser... faut
laisser, faut laisser les autres parler aussi quoi !
Jm : Ça te ferais quitter la branche,
ça ?
L. : Peut-être, oui.
Peut-être.
Jm : Et donc, le fait de voir quelqu'un qui
laisse pas parler les autres, qu'est-ce qu'il te faudrait faire pour essayer de
changer cette situation ?
L. : Ben c'est lui dire, tout simplement !
Jm : Oui, et ça, il le comprendrait ?
L. : Ben toute façon, il peut le
comprendre. S'il le comprend, s'il est intelligent, il va le comprendre bien,
il va rester. S'il est pas intelligent, il va mal le prendre, il va partir !
Mais bon, si tout le monde est d'accord avec moi, donc, que, que c'est lui qui
fout la merde, donc, on préfère que ça soit lui qui parte.
Qu'on parte tous, il va se retrouver tout seul.
Jm : Alors, qu'est-ce qui te fait rester, en
fait ? C'est justement l'inverse ?
L. : Ben, c'est qu'on s'entend bien, on est
une petite famille, quelque part, on s'entend, on s'entend bien, quand on a des
trucs qui vont pas, donc, on essais de les résoudre.
Jm : Par exemple ? Tu as un cas, quelque
chose ?
Jm : Est-ce que, est-ce que tu as un cas
à l'esprit de quelque chose au moment où ça n'allait pas,
et comment vous avez arrangé les choses ?
L. : Euh... Voilà. Ben justement pour
les leçons, tout à l'heure, ben je vais revenir encore aux
leçons...
Jm : Oui...
L. : Bon, J'estimais que
c'était...à part...
Jm : ...Racheter encore les
leçons...
L. : Racheter, donc, racheter encore les
leçons, j'ai, j'ai trouvé que c'était, donc Euh... Que
c'était, euh... comment dire, qu'on arrivait pas à suivre, en
plus, bon c'est vrai que pour le club, donc ça coûtait cher quand
même, et donc, euh...
Jm : Si je comprends bien, vous étiez
une dizaine de personnes, à la Finance,
L. : Oui, tout à
fait.
Jm : Et tu étais le seul à
être contre....
L. : J'étais le seul donc, à
être contre, au début...
Jm : Et les autres ? Ils t'ont
écouté ?
L. : Ils m'ont écouté,
après ils ont dit, ouais, finalement...
Jm : ...Ils ont réfléchi...
L. : Finalement... t'as raison...
Jm : ...Ils se sont rallier à toi ?
L. : Voilà. Tout à fait.
Jm : D'accord.
Retournement de K 7 = ¾ d'h
L. : Après, ils m'ont dit, c'est vrai,
finalement, t'as, t'as raison, euh...Voilà.
Jm : Très bien.
L. : ...On a arrêté de...Enfin.
Voilà. On a écrit donc...
Jm : Alors, qu'est-ce qui passe dans, dans la
section, enfin dans la branche Finance, qui ne relève pas directement du
projet Club d'Investissement ? Autre chose ?
L. : J'ai pas bien compris ta question.
Jm : Est-ce que, est-ce que, il y a quelque
chose que tu vois, que tu t'aperçois, qui n'est pas directement
lié à la Finance ? Enfin, directement lié à cette
idée, à ce projet de Finance ? Autre chose, tu vois ? Est-ce que
tu vois des, des, euh... des liens qui se font entre des membres, quel type de
lien...
L. : Ah, oui, oui, bien sûr !
Jm : Oui, bien sûr, mais...
L. : Oui.
Jm : Mais quel type de lien ?
L. : Oui, ben, je ne sais pas donc, euh...
euh... ben, euh... voilà, je vais parler encore, je vais pas remonter
très longtemps, donc euh... euh... donc je parle de la semaine
dernière, donc avec Pi (membre du Club, ndlr), le nouveau donc, qui,
qui, qui a créé son, donc qui fait partie de l'association des
lépreux en France, et, euh... donc, c'est vrai que, jusqu'à,
jusqu'à lundi dernier, bon, personne ne le connaissait donc. Ca va qu'on
a discuté un p'tit, on a discuté quoi, une demi-heure ?
Jm : Oui (pour l'encourager à
poursuivre).
L. : Il nous a expliqué un p'tit peu,
et puis donc voilà quoi !
Jm : Voilà. Vous avez parlé
donc des lépreux pendant une demi-heure...
Jm : Oui, tout à fait. Peut-être
pas pendant une demi-heure, mais il nous en a parlé euh...
Jm : ...Pendant un moment...
L. : ...Pendant un petit moment, et puis,
puis, donc quoi voilà ! Bon on a vu ce qu'il voulait suivre un
p'tit peu, bon on lui a proposé qu'on pouvait l'aider un p'tit peu, mais
bon, on n'est pas professionnel, hein !
Jm : Ouais, oui.
L. : On peut lui donner un petit coup de
main, sans plus.
Jm : C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes
faire au Club, quand tu y viens ? A part le, oui, qu'est-ce que tu aimes faire
au club ?
L. : Internet.
Jm : Internet. Donc de l'informatique.
L. : Internet et voilà. Un peu
Internet, un peu discuter. Voilà.
Jm : Hum, et qu'est-ce que tu
préfères, au Club ? (silence) Au-delà de l'informatique,
tu préfères quoi ?
L. : Je préfère quoi ?
Jm : Oui. Bon, parce-que il y a
peut-être mille choses que tu aimes faire...
L. : Oui.
Jm : ...Mais parmi ces mille choses, y a
peut-être une ou deux choses que tu préfères ?
L. : ...Je peux pas dire que j'ai une chose
que je préfère, c'est plusieurs trucs, plusieurs choses.
Jm : ...Donne-moi plusieurs choses alors !
L. : Ben, je vais reprendre encore, c'est
discuter, c'est...
Jm. : Non, mais...
L. : Internet, Euh...
Jm : Donc, tu aimes discuter, c'est ça
que tu...
L. : Oui, bien sûr.
Jm : ...Que tu aimes faire ? Internet ?
L. : Internet aussi, Euh...
Jm : Discuter sur l'informatique, ou...?
L. : Non, pas forcément, non.
Jm : Pas forcément ?
L. : Non, ça peut être de
l'informatique, ça peut être de n'importe quoi, de, de...
Jm : Aujourd'hui, aujourd'hui, tu, tu viens
chercher quoi au Club ? Qu'est-ce que tu viens chercher ?
L. : Je viens chercher ma baguette de pain !
(rires)
Jm : Non mais, au-delà de l'aspect
matériel, au-delà de l'aspect informatique, puisque tu viens pour
l'informatique...
L. : Tout à fait.
Jm : ...Nécessairement, tu viens pour
l'informatique, à un moment donné ou à un autre, mais
est-ce que tu viens chercher autre chose ? Qu'est-ce que tu viens chercher
aujourd'hui ?
L. : Non, ben je, non.
Jm : Ben, ça fait plus de deux ans que
tu y es, donc, par rapport...
L. : Ben, je viens peut-être plus
apporter que chercher, je sais pas.
Jm : Ouais, tu viens apporter...
L. : ...Peut-être...
Jm : ...pourquoi tu apportes ?
L. : Ben pour les autres.
Jm : Ca t'apportes quoi, à toi
d'apporter aux autres ?
L. : Ah ! Qu'est-ce que... Je sais pas, c'est
dans la tête ça !
Jm : C'est dans la tête alors ?
L. : Je sais pas. J'aime bien aider les
autres. J'aime bien. C'est comme à la Croix Rouge, hein ! C'est pareil
!
Jm : Oui ?
L. : Qu'est-ce que je, ben le fait d'aller
passer, je sais pas moi, une journée entière dans le froid, etc.
pour aider quelqu'un, euh... ben voilà.
Jm : Tu as essayé de faire une bonne
action ?
L. : Voilà, oui !
Jm : D'accord.
L. : On se sent utile ! Je sais pas.
Jm : On se sent utile ?
L. : Oui. Comme à la Croix-Rouge, donc
c'est vrai que des fois, tu, je sais moi, donc, tu vas, donc, je sais pas moi,
tu vas, on participe à pas mal de, de, comment dire ? De, de
manifestations etc., donc euh... c'est vrai que des fois, tu, il fait froid, il
pleut, n'importe, et, et t'es là, bon c'est vrai qu'on est tous
bénévoles, on est pas payé ni rien, bon tu passes une
journée quand même entière, sous, sous le, la pluie ou le
froid ou n'importe, on n'est pas payé ni rien, et puis...
Jm : Et au club, tu te sens utile aussi ?
L. : Tout à fait ! Je pense oui !
Jm : Tu penses, ou tu en sûr ?
L. : Oui. Oui, ben j'en suis sûr, on va
dire !
Jm : Voilà. Non mais tu peux te sentir
utile...
L. : D'accord...
Jm : ...Y'a deux choses, tu peux ne pas
être utile, mais te sentir utile.
L. : Je, je suis utile. Monsieur !
Jm : Voilà. Tu te sens utile.
L. : Je suis, je suis.
Jm : Tu es utile. C'est encore mieux !
L. : Voilà.
Jm : Très bien. Euh... Alors
là, c'est une question qui est importante là. Est-ce que tu peux
me donner un ou deux exemples, qui t'ont particulièrement marqué
dans tes relations avec les autres ? Ça peut-être un exemple
positif ou négatif, qu'est-ce qui t'as particulièrement
marqué, frappé, choqué, enthousiasmé, euh... quoi ?
Est-ce que tu as un ou deux exemples ?
L. : Marqué, choqué ?
Jm : Enfin, marqué, choqué ou
enthousiasmé hein !
L. : Oui, tout à fait, oui. Euh...
Jm : Tu peux, tu peux, par exemple tu peux
dire bon : « ah ben tiens, dans telle situation, j'ai
été très agréablement étonné qu'il y
ait eu une mobilisation générale pour répondre à
ça », spontanément ou pas...Qu'est-ce, quelque
chose....
L. : Ouais, ouais...
Jm : Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a
marqué, ou...
L. : Ben pour emménager
déjà au club... C'est vrai qu'il y a eu...
Jm : Oui, qu'est-ce qu'il y a eu ?
L. : Y'a eu pas mal de personnes donc, qui
sont venues nous aider, euh...
Jm : Ça, ça t'as marqué
?
L. : Ouais. A (1er entretien,
ndlr) qui avait pas mal de travail...
Jm : Ça, tu as remarqué ?
L. : Ouais, et qui est venu quand même,
donc, qui est venu pas mal de temps au club, pour, pour aider etc. donc, c'est
vrai que bon... il aurait été au chômage etc., ok, mais
bon, c'est vrai qu'il est venu, donc il a passé pas mal d'heures, donc,
au Club, euh... c'est vrai. Voilà. Sinon, je, je réfléchis
en même temps, je sais pas.
Jm : Ce sont des moments forts pour toi ?
L. : Des moments forts, Euh...(soupirs) Fort,
est-ce que c'est le terme, je sais pas, mais bon. On va dire que c'est des
moments qui m'ont marqués. Sinon qu'est-ce qu'il y a eu d'autres ?
euh... euh... (soupirs), je sais pas, ouais comme ça, ouais...
Jm : Oui. Par rapport à ton...
L. : ...parce-que j'ai du mal à
remonter, si tu veux, beaucoup en arriver à...
Jm : Tu as le temps, hein ! Tu as le temps.
L. : Oui, oui ! (silence) Peut-être que
si tu me reposes tout à l'heure la question, je sais pas, mais bon.
Jm : Euh... alors, entre le moment ou tu es
rentré au club, et aujourd'hui, est-ce que tu t'es aperçu que
quelque chose avait changé pour toi ? Depuis que tu es au Club ?
(silence) Chez toi, pour toi ou, depuis que tu es au Club, dans, dans ta vie
courante, euh... professionnelle, familiale, au sein du club, personnellement,
euh... tu te sens mieux, tu te sens moins bien, Euh...
L. : Alors, euh... Euh... tu m'as dis
professionnellement ?
Jm : Non, non, non; c'est des exemples !
L. : Oui, oui, oui Je sais, ouais, tout
à fait.
Jm : C'est pour te donner des idées,
mais faut pas reprendre nécessairement ces thèmes-là.
Est-ce que quelque chose a changé pour toi ?
L. : Euh... offff... non, à part que
je participe de plus en plus, donc, aux activités.
Jm : Donc, ça, c'est un gros un
changement ça.
L. : Oui, tout à fait, oui.
Jm : Un changement.
L. : Oui...
Jm : Et pourquoi...
L. : ...Que des fois, je me fais engueuler
par ma femme, parce-que je...(rires)
Jm : Ça aussi, ça a
changé ?
L. : Oui ! (rires)
Jm : Tu es moins là ?
L. : Parce-que, main'nant entre la Croix
Rouge et, et, comment ça s'appelle donc ? Et donc le Club, c'est
vrai que ça fait beaucoup de choses à la fois, euh...
Jm : Oui.
L. : Et puis voilà, quoi ! Ouais !
Jm : Et euh...
L. : ...Puisque moi donc, avec les deux
associations, donc avec Compu's Club et maintenant avec la Croix Rouge, c'est
vrai que je navigue pas mal. Mais bon, et j'ai pris une responsabilité
donc au niveau du Club informatique, au niveau de la Croix Rouge aussi, et bon,
ça fait...
Jm : Comment, comment tu expliques ce
changement... que tu t'investisses de plus en plus ?
L. : Je sais pas. Donc je peux parler un peu
de la Croix Rouge ?
Jm : Euh... ce qui m'intéresse, c'est
le Club, moi. Ce qui fait lien entre le Club...
L. : C'est le Club surtout...
Jm : ...On en parlera après.
L. : Oui, oui, oui, Euh... Je sais pas, c'est
peut-être le temps d'avoir un peu de temps libre, donc on peut aider, on
peut, donc euh... être utile un p'tit peu, donc euh... donc euh...
proposer ses, ses, ses services, je sais pas, est-ce que c'est une question de
temps ? Mais je ne pense pas. Oui, parce-que bon, tous ceux qui viennent, c'est
que, ils ont un p'tit peu d'temps quand même pour venir. Ils s'y sentent
bien.
Jm : Et personnellement ? Voilà, c'est
ça. Et ça aussi, ça a changé chez toi ? Tu te sens
mieux ?
L. : Mieux qu'au début, oui, oui,
oui.
Jm : Et ça tu l'expliques comment ?
Tout ce que tu m'as dit avant, je suppose l'ambiance, que le, l'état
d'esprit...
L. : Oui.
Jm : ...le Club, l'esprit famille...
L. : Tout à fait oui. Je sais pas,
ouais. Mais c'est vrai qu'on se sent de mieux en mieux sans s'en apercevoir
quoi. Je sais pas.
Jm : Oui. Alors, pour résumer
là tout ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui fait que tu y restes ?
(silence) Pour essayer de reprendre un petit peu le plus largement possible.
L. : Qu'est-ce qui fait que j'y reste ? Ben
j'ai pas mal d'amis, donc maintenant, donc au Club, euh...Bon je participe
à plusieurs branches, donc ça, ça serait dommage de tout
laissez tomber. Parce-que bon des fois, euh... il suffit qu'il y en ait un ou
deux qui partent et... et la branche disparaît donc... comme la CAO,
Euh...euh... sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Jm : Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire
pour améliorer le club ?
L. : Pour améliorer le club ?
(silence) euh... euh... oui, oui, Qu'est-ce qu'il faudra faire ?
Jm : Qu'est-ce qui fait obstacle en fait
queee... les autres membres qui ne participent pas, puissent plus participer ?
Et que ceux qui participent, participent encore plus ?
L. : Euh... oui. Ben c'est peut-être
les prendre en mains, euh... donc Euh...
Jm : Qu'est-ce qui fait obstacle ?
L. : Faire, faire de sorte qu'ils soient,
qu'ils soient donc euh...bien à l'aise quand ils viennent, donc
dès qu'il y a quelqu'un peut-être venir lui parler, machin, bon,
essayer de, de voir un petit peu, donc, pourquoi il vient plus, bon, pour
relancer donc euh... voir donc, s'ils ont des idées, donc les suivre,
euh... euh... les écouter, quoi ! Les écouter. Oui, bon c'est
vrai, qu'il y en a, qu'il y en a beaucoup qui viennent de temps en temps. Bon
c'est vrai qu'avec le local qui avait fermé donc, on avait quand
même plus de monde à l'ancien local quand même je crois que
maintenant. J'ai l'impression, je sais pas. Non ?
Jm : Tu demandes ?
L. : Non, mais je veux dire avant, y'avait
plus de personnes. J'ai, j'ai l'impression en fait que, je voyais plus de
personnes qu'avant, à l'ancien local, que maintenant.
Jm : Y'a pas longtemps qu'il y a des nouveaux
locaux, quand même !
L. : Oui. Tout à fait, oui. C'est
sûr que ça fait pas longtemps. Donc, euh... donc qu'est-ce qu'il
faut faire ? Est-ce que ces gens, ils vont revenir, et c'est, bon, je sais pas.
Il faudrait faire quelque chose pour que... ils reviennent pour eux, ça,
je ne sais pas. (long silence) Est-ce qu'il faut pas les inviter un jour, je
sais pas... boire un verre, manger des cacahuètes, je sais pas !
Jm : Oui ?
L. : Je sais pas.
Jm : Tu penses que ça peut être
un élément important ?
L. : Je sais pas. Peut-être, je sais
pas.
Jm : On verra, un verre ?
L. : Je sais pas pourquoi ils viennent pas,
donc il faut...
Jm : Ben, bon ben c'est fini Lahcen.
L. : Oooooooh
Jm : Y'a quelque chose, peut-être, que
tu voudrais rajouter, non ?
L. : Euh... non, pour le moment non. Non, je
pense pas.
Jm : Non ?
L. : Je pense avoir tout dit, peut-être
que j'ai oublié des trucs, je sais pas, mais...
Jm : Oui. Y'avait, y'avait une question
là, qui était posée dans le questionnaire...
L. : Oui ?
Jm : ... "Pensez-vous que le club puisse
parfois soulager une certaine solitude ?"
L. : Ah, mais, c'est sûr oui.
Jm : Oui ? Toi-même un moment tu as
été solitaire ? Et ça, ça a permit de soulager
cette solitude ?
L. : Euh... euh... oui, peut-être, oui,
c'est vrai, oui. Peut-être. C'est vrai que je l'ai...
Jm : Peut-être, dans quel sens ?
L. : C'est vrai que je l'ai pas dit, ben
quand j'étais ben euh... donc, euh... au tout début, donc quand
j'étais marié, que j'étais, j'étais venu donc,
euh... euh... non ça c'est avant le, attends, non je sais plus, si, si,
j'ai adhéré au club, si j'ai adhéré au club,
après, après m'être marié en fait, oui. Ben, ma
femme, elle était pas là, donc en fait, elle était partie,
et c'est vrai que ça permettait de, oui, oui, c'est ça. Ma femme,
elle était pas là, elle était partie au Maroc, et donc, et
ben donc, euh... et c'est vrai que... Peut-être que oui, et euh...
ça permettait, donc, en fait de, de soulager la solitude.
Jm : Est-ce que le Club pour toi, c'est un
lieu qui permet de soutenir les autres ? Qui sont dans la solitude justement ?
L. : Oui, oui, bien sûr.
Jm : Euh... Est-ce que c'est aussi un lieu de
débat ?
L. : Bien sûr.
Jm : De message ?
L. : Bien sûr, oui, oui. C'est pour
celui qui est seul ou n'importe, euh... je sais pas, il vient, il passe
quelques moments au club, ça va lui faire du bien, il voit un petit peu,
donc, tous les membres, il discute, il se fait des amis, euh... il fait des
rencontres, euh... puis voilà. (silence)
Jm : Très bien.
L. : Mais c'est vrai que j'y ai pas
pensé à ce, cette solitude. Peut-être, y'en a,
peut-être qu'au sein du Club, y'en a peut-être qui viennent, qui
viennent pour certains. Mais moi au début, c'était pas pour
ça hein ! Mais peut-être qu'il y en a, y'en a plein, euh...
peut-être qu'ils vont venir pour ça, quoi. Ils sont seuls, ils
savent pas quoi faire, euh... l'informatique ils s'en foutent, mais bon, c'est
juste pour venir...
Jm : Tu penses qu'il y a des gens comme
ça ?
L. : Peut-être oui.
Jm : Tu as, tu as une ou deux personnes que
tu as en tête ?
L. : Nnnnnnnnon. Non. Non. Parce-que bon, je
connais pas la vie de chacun, donc. Je connais pas la vie de chacun, donc
peut-être, donc, peut-être que sûrement qu'il y en a, hein
!
Annexe 13 Huitième
entretien
Au (Huitième entretien) le mercredi 14
février 2001, 19 heures 15. A notre domicile.
25 ans, pas activité dans une branche. Il a
été lauréat d'un concours national de la jeunesse et
Sports avec un projet de l'association. Aujourd'hui a un travail (travail
temporaire Infographiste) après un long chômage. Adhérent
depuis 2 ans. Peu présent à l'association. Correspond au
questionnaire n°7.
Après annonce.
Jm : Comment as-tu connu le Compu's
Club ?
Au : Ben ça, tu peux y
répondre. Je suis coincé (rires) Eh ben, j'ai connu le Compu's
Club grâce à une annonce de l'Anpe. Parce-ce que j'étais,
donc, venu au Club... parce-que il y avait un poste prévu, ben le poste
de La et maintenant celui de Ch (la nouvelle employée du Club, ndlr) et
c'est comme ça que j'ai connu le Club.
Jm : Alors, quand tu es venu, quand t'es venu
au Club, y'a quelque chose qui t'as séduit ? (silence) On te l'a
présenté certainement ?
Au : Euh... C'est-à-dire ?
Jm : On a dû te présenter le
Club ?...
Au : ...Ouais, ben oui...
Jm : ...Est-ce qu'il y avait quelque chose
qui t'as séduit à ce moment-là ? A
l'époque ?
Au : C'est vrai, que... il y a une chose
qui... qui... qui m'a vraiment marqué, c'est que... jusqu'à
présent... t'sais, pour moi Valence, ça a toujours
été une ville morte. Tu vois, pour moi, c'était clair,
j'avais vraiment envie de me barrer de Valence. Et, et de voir qu'il y a, qu'il
y a une association, des gens, tu sais, qui, qui ont pour principe de, de,
d'essayer de faire bouger les choses, de, de venir se rencontrer, un peu
s'éclater et... comme je le disais se, faire bouger les choses,
ça c'est vraiment... euh... ça m'a presque... euh... Comment
dire ? Disons que ça... ça m'a vraiment
déstabilisé dans, dans, dans l'opinion que j'avais de dire que
Valence c'était une ville morte, quoi. Je m'suis, je m'suis, j'ai
compris que finalement, Valence, y'a des gens qui bougent et que, et que
ça c'est vraiment intéressant.
Jm : Et donc, quand on t'as
présenté le Club et ses différentes activités, etc.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'as particulièrement
attiré ?
Au : (silence) Dans les
activités ?
Jm : Oui, les activités, dans la
façon de fonctionner, euh... Ce genre de choses... A l'époque,
j'entends, hein ? Quand tu étais tout neuf, sans connaître le
Club.
Au : Beuh pfu... je pense pas qu'il y a ai
vraiment quelque chose qui ait, qui m'ai plus attiré que... enfin... une
activité plus qu'une autre. Non, disons que... voilà.... C'est
surtout le principe de base qui m'a intéressé. Après les
activités c'était, c'était presque secondaire, quoi.
Jm : Si je dois résumer : tu es
venu postuler à un emploi qui était vacant et... euh... tu as vu
quelque chose... un certain esprit qui flottait là, ça t'as
plu...
Au : ...Hum, hum...
Jm : ...et tu es resté.
Au : Voilà.
Jm : C'est ça. Tu disais tout à
l'heure « une association, enfin des gens, qui avaient pour
principe de faire bouger les choses ». Tu entends quoi par
là : « faire bouger les
choses » ?
Au : « Faire bouger les
choses » c'est surtout... euh... Comment... comment
expliquer ? Euh... (silence) Ben déjà, rien que... rien
que... déjà se réunir autour d'une idée tu vois
c'est vraiment un grand pas, quoi. Pour moi c'est « faire bouger
les choses ». Plutôt que chacun ayant une idée,
t'sais... Les idées, t'sais, c'est à la portée de
n'importe qui. Tout le monde peut avoir des idées sur telle chose ou
telle chose mais rien que... rien que le fait de se, de se regrouper autour
d'une idée, t'sais... essayer de faire avancer l'idée, ça,
c'est génial quoi.
Jm : Tu as à l'esprit une idée
qui t'avais, au départ, euh... surpris... eet... agréablement
surpris ?
Au : Euh... C'est-à-dire ?
Jm : Tu dis « faire bouger les
idées, on peut avoir un idée » donc, tu as bien
dû...
Au : Ah ouais, est-ce qu'il y avait un
exemple qui m'a...
Jm : ...avoir une idée...
Au : Huuum, non pas spécialement. Y
avait pas... Je sais pas s'il y avait un exemple, je n'me souviens plus
très bien... (silence) je sais plus très bien s'il y avait un cas
particulier qui, qui me poussait. Enfin, je pense pas, non.
Jm : Est-ce que tu as déjà eu
une expérience de l'associatif ?
Au : (silence) Une expérience de
l'associatif ? Euh...
Jm : Tu as déjà
participé à des associations ?
Au : Euuuh... Non. (silence) Euhhh... Non pas
en particulier. Disons queeuhhh... mon père faisait, `fin, était
président de l'association de Vietnamiens Libres de Valence. Je crois
que c'est le nom exact, je crois. Attends c'est Association des Vietnamiens
Libres de Valence, oui, il me semble que c'est ça. Et... par ce biais,
j'ai peut-être mis un doigt dans le monde associatif... Mais sans plus,
quoi. J'ai pas vraiment participé à grand chose, quoi. J'ai...
Si, j'ai participé aux différentes fêtes qu'y avait,
t'sais. J'ai, j'ai peut-être aidé à monter deux, trois
trucs mais c'est tout.
Jm : Et en fait de, de pas t'être
engagé dans une autre association sportive, culturelle ou autre... il y
a une raison à ça ?
Au : (silence) Euh... Sportive, oui,
parce-que je suis pas très sport...
Jm : ...Ou autre, une association quelconque,
hein...
Au : ...Ben...
Jm : Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas
adhéré à une autre association avant le Compu's
Club ?
Au : Certainement parce-que je n'ai pas eu
l'opportunité de, de... de connaître les associations.
Jm : Alors, depuis que tu participes au Club,
hein, depuis ton adhésion, est-ce que tu participes à une autre
association ?
Au : Depuis, euh... non.
Jm : Non, toujours pas.
Au : Je ne crois pas.
Jm : Alors est-ce que...
Au : ...A moins que ce soit à mon
insu, mais...
(rires)
Jm : Alors, est-ce que tu te souviens ce qui
t'as, qu'est-ce qui t'as conduit à adhérer au Club ?
Au : (silence) Qu'est-ce qui m'a conduit
à adhérer au Club ?
Jm : Tu étais venu pour postuler...
Au : ...Hum, hum...
Jm : ...Tu as... tu t'es rendu compte d'un
certain esprit...
Au : ...Voilà....
Jm : Qu'est-ce qui t'as fait adhérer
finalement ? Parce-queee... le, le poste a été pourvu par
une autre personne. Qu'est-ce qui t'as fait adhérer au Club.
Au : Je crois que c'est, c'est une personne
en particulier, je crois. Un, un « commercial » : Jm
(rires).
Jm : Un commercial ?
Au : Non, non, mais c'est pas
ça... c'est un monsieur qui s'appelle Jm, il a su me présenter
les choses correctement... (rires)... disons, il a su vendre son produit et
j'ai adhéré. (rires)
Jm : Non, sérieusement, est-ce que
justement dans ce qui t'as été "vendu", hein, pour reprendre ta
propre expression, dans ce qui a été présenté du
Club, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'as conduit, en particulier, qui t'as
conduit à adhérer au Club ?
Au : (Silence) hummm, pfu...
Jm : Ça fait loin, hein. Ça
fait combien de temps que tu es dans...
Au : Ch'ais pas. Je ne sais pas. Ça
doit faireeee... un peu moins de deux ans, quoi. Mais... je sais plus.
Jm : Tu sais plus. Est-ce que tu avais un
projet autre que celui de te faire embaucher en venant au Club ? En
rejoignant le Club ?
Au : (silence) Tu veux dire
« est-ce que j'avais d'autres projets » ?
Jm : Oui, est-ce que tu avais une idée
particulière ?
Au : Ahhh.
Jm : Quand tu a rejoins le Club est-ce que tu
avais un projet, une idée particulière ?
Au : Dans quel sens ?
Jm : Est-ce que tu venais chercher quelque
chose de précis ?
Au : Ah, non, pas du tout ! hummm... Ben
ma première idée c'était... je me suis dit
qu'c'était un Club informatique et donc... euh... si, si... je pouvais,
je pouvais... `Fin, comment dire ? A l'époque j'aurais pu, disons,
avoir plus de connaissances en informatique. C'est peut-être ça...
euh...
Jm : C'est ce que tu attendais quand tu
es venu rejoindre le Club ?
Au : C'est pas vraiment ce que j'attendais
mais c'est peut-être ce que j'espérais, quoi ? Je me suis dit
« ben voilà, puisque c'est un Club informatique,
peut-être que... lorsque j'en sortirai, peut-être que dans quelques
temps, je serai... beaucoup plus calé que je ne l'étais
auparavant ».
Jm : Alors, est-ce que tu peux me parler de
toi, un p'tit peu, à l'époque de ta venue au Club ? Tu
étais au chômage, donc, hein... par déduction ?
Au : Hum.
Jm : Tu étais
célibataire ?
Au : mouiii.
Jm : Euh... Y a longtemps que tu cherchais du
travail ? (silence) C'était pas récent, il y avait
quelque...
Au : Ouais, ouais, bien sûr, ouais.
mais, euh... Mais, euh... j'ai eu différentes périodes dans...
dans ma vie. `Fin, bon ça fait un peu prétentieux de dire
ça, j'trouve : « des périodes dans ma
vie ». Ça fait un peu, t'sais, euh... :
« je me souviens, y a quelques années
(rires)... ». Non, disons queee... J'ai peut-être euh...
(silence) euh... ben attend j'étais au chômage pendant un p'tit
moment, c'est vrai. Et... (silence) Tu veux pas répéter la
question là ? (rires)
Jm : Je, je te demandais : à
l'époque, donc, euh... tu, tu avais un certaine situation, tu
étais au chômage. Quand tu as rejoints le Club, est-ce que
ça faisait déjà longtemps que tu étais au
chômage ?
Au : Je pense que ça devait faire au
moins six mois... que j'étais au chômage.
Jm : Au moins six mois ?
Au : Ouais, il me semble.
Jm : Alors...
Au : ...Ah non, qu'est-ce que je dis ?
Ça devait faire trois ou quatre mois.
Jm : Trois ou quatre mois ? Tu faisais
quoi avant ?
Au : Alors, qu'est-ce que je f'sais ?
Ben, auparavant j'avais travaillé en imprimerie... en tant
qu'opérateur de P.A.O. Et juste avant encore... j'avais, j'avais
fait.... euh... le truc sur l'ambroisie, t'sais. Chargé de communication
sur l'ambroisie... euh...
Jm : Alors, on va rentrer dans le vif du
sujet, maintenant...
Au : ...Ouais, vas-y...
Jm : Aujourd'hui, euh... le Club c'est quoi
pour toi ?
Au : Aujourd'hui, le Club, pour moi, ce
serait, un... ce serait des instants de... J'irais pas jusqu'à dire des
instants de détente... parce-que ce serait, peut-être, un peu trop
fort... mais des, des récréations, en fait. (silence) Ouais, pour
moi, ce serait plutôt, voilà, des récréations.
Jm : Quelle, quelle image tu en as, en fait,
du Club ?
Au : (silence) ouh là... quelle image
j'ai...
Jm : Quelle représentation tu t'en
fais ? (silence) Qu'est-ce que ça représente pour toi, le
Club ?
Au : Hummm... Ben, comme image, à
part, euh... ben, je sais pas, euh... c'est parce-que je mets
déjà des mots sur ce que je pense. C'est-à-dire que c'est
des récréations, alors maintenant si tu veux une image, une image
en particulier...
Jm : ...Il faut préciser...
Au : ...Une image, en particulier...
Jm : Il faut préci... oui, quelles
valeurs tu peux attribuer au Club ?
Au : Ben, j'aime, j'aime beaucoup le Club
parce-que comme je dis c'est de la récréation et pour, pour moi
la récréation ça a toujours été très
important parce-que... enfin... je sais pas si tu te rends compte, au, au, au
bahut... mouais, c'est vrai que c'est, peut-être, un peu trop fort.
Parce-que quand on est au bahut, tu vois, les récréations c'est
peut-être ce qu'on attend le plus. Finalement. (rires)
Jm : Les bons élèves...
Au : Ouais, voilà, ouais. Et là
ce serait des récréations plus... euh... plus volontaires, tu
vois. C'est pas ce qu'on attend réellement mais, mais... on a envie d'y
aller, quoi.
Jm : Les, les... pour en revenir aux valeurs
du Club. Est-ce que tu as quelques expressions qui pourraient décrire le
Club. Deux, trois expressions... Quelles valeurs tu attribuerais au Club ?
(silence) « Le Club c'est... ça... »,
« Le Club, c'est ça... » (silence) L'image
que tu peux en avoir, quoi ? (silence) C'est la même question que je
pose différemment...
Au : Ben oui, je sais bien, je sais bien.
C'est bien pour ça que j'ai presque envie de te donner la même
réponse. (rires)
Jm : Réfléchis...
Au : La récréation, pour moi,
ça paraît tellement évident. Enfin, tu vois, c'est,
c'est... c'est quand même une image bien particulière quoi la
récréation. Et c'est vraiment ce que j'essaie de te dire, quoi.
C'est peut-être la meilleure illustration que je connais.
Jm : On va voir différemment : On
va dire : si tu devais présenter le Club, qu'est-ce que tu en
dirais ? (silence) Si tu devais présenter le Club à
quelqu'un, euh... Tu ne sais pas si, ce dont il peut avoir envie. Donc tu vas
présenter le Club d'une manière générale... euh...
Qu'est-ce que tu en dirais ? Bien sûr tu présenterais les
activités, hein ? Chacune des activités, donc, tu lui en
toucherais un mot. Mais surtout pour essayer de le convaincre, tu avancerais
quoi pour convaincre ?
Au : Ben je... c'est ce que j'fais avec la
plupart des gens que j'ai amené jusqu'à présent, c'est...
je leur explique tout simplement le principe de base. Le même qui m'a
motivé à entrer dans le Club. C'est-à-dire :
(silence) On peut couper ? C'est, attend, ben c'est la
convivialité, c'est, c'est le fait de se retrouver entre des personnes
totalement différentes qui sont là simplement pour, pour
s'détendre, pour, pour communiquer ensemble, pas du tout pour se prendre
la tête. Et ça c'est, c'est vraiment quelque chose de très
important, quoi, le fait de pas se prendre la tête. On est là
pour, vraiment pour... euh... je dirai pas pour s'amuser mais pour... euh...
pour voir autre chose, quoi, voilà, euh... Je sais pas vraiment comment
expliquer ça.
Jm : Puisque tu as déjà
amené des nouveaux membres au Club... euh... tu l'avais
présenté comment, le Club ? (silence) Pour les
convaincre ?
Au : bennnn... ben... (silence) ben... je....
comme je viens de dire. Bon c'est un Club, on n'est pas là pour se
prendre la tête, tu vois. On est là pour s'amuser. Les gens sont
super sympa, on peut, on rigole... voilà... je veux dire... on n'est pas
forcé de venir que pour faire de l'informatique ou autre chose, tu vois.
On peut simplement venir pour... parce-qu'on a un petit moment de libre. On
essai de voir... euh... pour rencontrer des gens, tout simplement. Ch'ai
pas.
Jm : Bon, on va essayer de préciser
deux, trois points là. Tu parlais de convivialité. Tu entends
quoi par convivialité ?
Au : Ben... Ce que j'entends par
convivialité... (silence)
Jm : Est-ce que tu peux me donner deux, trois
exemples de convivialité ? C'est peut-être plus simple.
Est-ce que tu as vu... est-ce que tu as à l'esprit...
Au : ...Par exemple, un exemple tout
bête : souvent, tu sais, ça arrive que... par exemple toi ou
n'importe qui, t'sais... on... on s'fait... on s'paye la tournée de
boisson, t'sais. Ou sa tournée de clope ou ch'ai pas, tu sais, ce genre
de chose, quoi... Je veux dire des choses qui sont relativement naturelles
et... et... enfin voilà, quoi.
Jm : Est-ce que tu as un autre exemple de
convivialité ?
Au : Un autre exemple de
convivialité.... je vais dire... (silence) pfu... déjà que
le fait de pouvoir entrer dans n'importe quelle branche, comme ça,
t'sais. Venir voir ce qui... ce qui se passe... eeet... voilà.
Même, même en venant et sans dire un mot, tu vois, simplement
écouter ce qu'ils disent, tu vois, c'est, c'est... pour moi, c'est
déjà de la convivialité, quoi.
Jm : Et là, à ce
moment-là tu arrives comme ça... euh... "inconnu", entre
guillemets, dans une branche... on te dit rien, il se passe rien... euh...
Au : Euh non, quand même j'irai pas
jusque-là mais je, je... c'est vrai que si, par exemple... `Fin, si la
semaine prochaine je devais venir, par exemple, à... à la branche
Cao... euh... j'espère, j'espère qu'ils vont venir vers moi,
qu'ils vont me dire « tiens, je vais te présenter, le, la
Cao. Alors la Cao c'est ça, ça, ça » et moi
je leur dirai « Ah ben ten, moi, justement j'ai pleins
d'idées il faudrait qu'on fasse ceci, ceci, cela », tu
vois.
Jm : Tu as eu déjà des
situations de ce genre-là ?
Au : Ben, pour te parler franchement :
jusqu'à présent j'ai pas eu l'impression de participer à
fond aux branches. Alors...
Jm : Qu'est-ce qui t'en
empêches ?
Au : C'est surtout le temps... C'est
surtout... bon... ben voilà, quoi. Seulement on a eu des
problèmes avec le Club, `fin, les locaux du Club et peut-être que
ça, ça nous a un peu plus isolés, éloignés,
quoi.
Jm : On avait fermé, oui. Hum... Si tu
avais un peu plus de temps tu aimerais participer à quoi ?
Au : Si j'avais un peu plus de temps je pense
que je participerai au Club de Finances... Euh... à Comnet... etttt...
et je pense que j'essaierai de... d'aller voir un peu plus les jeunes chez
Libertech (la branche Juniors, ndlr) parce-que j'ai vraiment envie qu'ils se
bougent le cul... j'en ai un peu marre de voir... de les voir, comme ça,
stagner... euh... Ça me prend un peu la tête, quoi. D'autant plus
que c'était parti sur, sur un bon principe. Et... et y avait quand
même du monde qui était motivé et là, tout à
coup... euh... là tu vois bien, aujourd'hui, ils sont qu'deux...
(ricanements)... T'vois... Bon, ça s'essouffle, c'est normal, bon, il
faudrait peut-être trouver quelque chose... un nouvel élan...
Quelque chose... pour ranimer la flamme, quoi.
Jm : Et ça, ça
t'intéresserais de, de...
Au : ... Oh ben oui. Moi, j'ai envie, j'ai
envie que, que ça bouge. Disons que... là j'ai... là....
l'autre jour, t'sais, lorsque j'ai amené mes amis, t'sais, pour Comnet
et qu'on a discuté, donc, du Club, y en a un qui m'a posé une
question et c'est vrai que j'ai pas su répondre. C'est, il m'a
dit : « à Comnet, mais quels sont les projets que
vous avez... en, en cours ? ». Je, j'ai pas su
répondre. Eeet, et ça, c'est, quelque part c'est... j'ai eu,
ça m'a... ça m'a... j'dirai pas que j'ai eu honte... mais je, je
leur avais présenté le, le Club... t'sais, un peu... un peu de
façon... peut-être... ch'sais pas, j'avais peut-être
utilisé des mots... un peu, un peu trop forts... je sais pas,
t'sais...
Jm : Lesquels ?
Au : Je sais plus exactement, mais disons...
la façon dont j'ai... dont j'ai parlé avec eux, peut-être
qu'ils... qu'ils semblaient extrêmement motivés et lorsqu'ils
sont... lorsqu'ils sont partis du Club j'ai eu l'impression que cette
motivation a vraiment diminuée, `fin, tu vois... j'ai, j'ai...
Jm : Après le passage au
Club ?
Au : Voilà...
Jm : Et ça c'est dû à
quoi d'après toi ?
Au : Ben... c'est dû... au fait que,
que, que la plupart des projets avancent lentement... euh... et que...
Jm : Et pour essayer de les attirer au
Club... Tu... ça serait bien si tu pouvais te souvenir de deux ou trois
mots, deux ou trois expressions que tu... que tu appréciais comme
fortes.
Au : En fait... j'ai pas eu vraiment... Ben,
en fait ce qu'y a c'est que... eux i sont partis de leur projet, t'sais... En
fait, donc, le, la personne qui travaillait avec moi... lui il m'a parlé
un peu d'Internet de ce qu'il faisait et de ce qu'il comptait faire et moi je
lui ai dit « voilà, au Club, y a des gens qui sont, qui
sont calés dans le domaine, qui vont répondre à, à
leur questions ». Parce-que c'est surtout ce qu'ils cherchent,
tu vois. Ils veulent... les questions techniques... ils veulent... des
réponses précises. Et je leur ai dit que le Club était
fait pour ça et que... et que le fait de, de, de s'engager au Club, tu
vois... c'est... je veux dire, ils sont pas obligés de faireeee...
de faire cinquante mille activités, de s'insérer dans les
branches, etc. Ils font vraiment ce qu'ils veulent, quoi. C'est vraiment
à partir de là que je suis parti.
Jm : Tout à l'heure tu m'as
parlé de Libertech (branche Juniors)... euh... Tu avais envie que
ça bouge. Pourquoi tu avais envie que ça bouge ?
Au : Ben c'est peut-être,
parce-queee... parce-que j'ai, j'ai présenté le projet "1,2,3
à vous de jouer !"...
Jm : Tu es Lauréat du concours "1,2,3
à vous de jouer !", oui.
Au : Voilà... Peut-être
parce-que je, je, j'ai eu un pied dans la branche. C'est pour ça que...
voit que ça, ça... que c'est resté au même point,
t'vois, ça m'ennuie un peu et... Comme j'aime bien aller au bout des
choses j'ai, j'ai pas envie de rest... de laisser voir les gens derrière
moi. J'ai envie de les ramener au même niveau, tu vois, ch'ais pas...
Jm : C'est quoi le principe de
Libertech ? (silence) Son fondement, c'est quoi ?
Au : Il y a un fondement ?
Jm : Ou du moins, ce que tu en as
retenu ?
Au : Ce que j'en ai retenu ?
Jm : Oui, de Libertech ? C'est construit
sur quoi Libertech ? C'est une Junior Association, Libertech. c'est
construit sur quoi les Juniors Associations ?
Au : Alors là... là franchement
tu me poses une colle parce-que je ne m'étais jamais posé la
question.
Jm : Euh... Tu disais tout à l'heure,
pour revenir un petit peu en arrière, tu disais :
« le Club c'est super sympa ».
Au : Hum, hum.
Jm : Tu entends quoi par
« super sympa » ?
Au : C'est que... jusqu'à
présent je, j'ai jamais eu à m'engueuler avec des gens. J'ai
jamais eu des mots même avec des gens... enfin... tu vois... pfu... enfin
voilà c'est sympa, quoi. Les gens, les gens viennent... tu vois... ben
voilà, quoi... c'est, c'est le principe du Club, c'est que on vient
quand on veut... et de ce fait, on n'est pas là pour se foutre sur la
gueule, quoi.
Jm : Alors, compte tenu du nombre de membres
qu'il y a, comment tu expliques, en fait, que tu ne t'es jamais engueulé
avec quelqu'un ? Est-ce que tu as déjà vu des membres
s'engueuler entre eux, d'abord ?
Au : Non.
Jm : Non. Et comment tu expliques
ça ?
Au : Ben... soit ils se cachent (rires),
soit... euh...
Jm : Toi-même, donc tu ne t'es jamais
engueulé avec quelqu'un, tu expliques ça comment ?
Au : Ben du moins, j'explique ça
parce-que je suis pas du genre à m'engueuler avec les gens,
déjà... d'une part... et en plus... euh... et en plus... euh...
je veux dire, on n'a aucune raison de s'engueuler. Déjà on se...
les gens qu'y a dans le Club... on se connaît pas vraiment
énormément, quoi. Et donc, lorsqu'on vient c'est... on parle de
choses vraiment ponctuelles, enfin, tu vois, c'est.... ça s'étend
pas non plus, t'sais, dans la vie privée, etc. Enfin... parce-que les,
la plupart des raisons d'engueulade ça touche plus la, la vie... je
dirais... presque intime... et comme c'est pas vraiment le cas... y a aucune
raison de se mettre sur la gueule.
Jm : Euh... Tu disais qu'on était pas
forcé de faire de l'informatique au Club. On y fait quoi
d'autre ?
Au : Dans le sens où, euh... En fait,
ce que je voulais dire c'est que... parce-qu'on vient on n'a pas besoin
d'être super calé en informatique pour être au Club, t'vois.
C'est ce que je dis à la plupart des amis, t'vois. Parce-que eux, i
m'd... `fin... moi, lorsque je leur dit, euh... qu'en fait le Club c'est un
échange de bons procédés. C'est-à-dire que nous, on
peut t'aider à apprendre des choses sur l'informatique et que toi, toi i
faut que tu amènes quelque chose. Et là, là, en
général ils me répondent « ouais, mais moi
je connais rien à l'informatique... » et je leur
dit « mais justement, on n'est pas obligé de faire
que de l'informatique. tu peux venir apporter ton dynamisme, ton enthousiasme,
venir encadrer les gens, même venir raconter des
blagues... », par exemple. (sourires) `Fin c'est, c'est comme
ça que... Tu vois, en général c'est ce que je dis.
Jm : Euh... Est-ce que... Bon, tu, tu es venu
cet après midi, au Club.
Au : Hum, hum.
Jm : Est-ce que tu as fait de
l'informatique ?
Au : Non... Je dirai même que
rarement... rarement je fais de l'informatique, au Club.
Jm : Tu viens y faire quoi, alors ?
Au : Je viens discuter avec les gens.
J'essaie de voir s'il y a des projets à, à faire avancer ou quoi
que ce soit, quoi.
Jm : Alors, tu parlais... euh... qu'on peut
apporter son dynamisme... tu entends quoi par dynamisme ?
Au : Ben ç't'a dire, comme je t'ai
dit : essayer de faire avancer les choses. Tout simplement, par, par ce,
par ce qu'on sait faire... euh...
Jm : Est-ce que tu as un ou deux exemples ou
trois exemples de dynamisme que toi tu pourrais produire ? (silence)
Est-ce qu'il t'arrives d'être dynamique au Club ?
Au : Euh... j'espère bien. (rires)
Jm : Bien, ça se caractérise
comment alors ?
Au : Par mon... euh... ma façon,
t'sais, d'être un peu exubérant... à raconter des choses un
peu fortes... je sais pas... (rires) Ou alors, tout simplement, euh... comme je
fais là pour, pour lancer le Marathonet (projet Juniors, ndlr), trouver
des idées. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut rencontrer les
gens, etc., quoi. Essayer de se creuser la cervelle, tout simplement.
Jm : Alors, qui, qu'est-ce qui te... tu
participes à une branche, actuellement ?
Au : Non, pas du tout.
Jm : Non. Qu'est-ce qui teeee... qu'est-ce
que tu aimes faire au Club ?
Au : (silence) Discuter avec les gens.
Jm : Uniquement ! Discuter avec les
gens ?
Au : Ouais. Sur des sujets en particulier.
Jm : D'accord. Alors, est-ce que t'as
remarqué comment ça pouvait se passer entre les membres de
l'association ? Dans leur relations, leurs façons de faire, la
façon de s'organiser, de discuter.
Au : Ben, euh... je peux... on peut imaginer
queee... qu'y a des... que dans le Club, certaines personnes se connaissent
plus que d'autres et qu'à partir de là... peut-être que les
discussions tournent... autour de ces personnes-là... enfin... plus que
d'autres. `Fin... je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire... Qu'est-ce que...
Essai de préciser ta question. Enfin, ou, ou plutôt de
répéter ta question.
Jm : Euh... Comment dire ? Bon, tu, tu
t'es positionné comme observateur de temps en temps. Tu as dû
être témoin de scènes, de façons de faire entre
membres, entre gens. Qu'est-ce que tu en as retenu ? tu en as retenu...
euh... Bon, tu parlais de dynamisme, d'enthousiasme tout à l'heure. On a
précisé dynamisme. est-ce que y a d'autres qualificatifs d'une
relation qu'il peut y avoir entre deux membres ? (silence) Dont tu aurais
été le témoin ? Est-ce que tu as un ou deux
exemples ?
Au : Maintenant que j'y ai... maintenant que
je me souviens bien, je pourrai presque revenir sur ce que je disais tout
à l'heure... et, et dire que finalement, c'est vrai j'ai peut-être
déjà vu des gens s'engueuler. Peut-être.
Jm : Et comment ça s'est
terminé ?
Au : Euh... Ça s'est terminé
par... euh... humm... je sais plus trop. Mais jusqu'à présent, je
pense que les engueulade... Enfin, les engueulades, lessss... les hausses de
température, on va dire, que j'ai remarqué jusqu'à
présent ça concernait surtout Libertech, les jeunes ettt dans ce
cas-là... je dirai pas que c'est normal, mais presque. Parce-que,
finalement, les jeunes il faut vraiment les motiver, il faut... `fin
voilà, quoi, t'sais... Euh... C'est pas évident à,
à manier les jeunes. Je le sais, j'ai, j'ai été jeune.
(rires)
Jm : Qu'est-ce qu'il faudrait leur apprendre
aux jeunes ?
Au : (silence de réflexion) Il
faudrait leur apprendre à voir les choses de plus loin. `Fin, avec plus
de recul, mais lorsque je dis ça... j'ai, j'ai presque l'impression de
prendre un coup de vieux... Ouais, parce-que...
Jm : Quel âge tu as ?
Au : J'ai 25 ans. Et, et en fait... c'est
vrai, lorsque je vois J (le Président Junior, ndlr) par exemple, la
façon dont il se comporte, etc. t'sais. Je me dis mais... merde... j'ai
trop l'impression de me voir il y a quelques années, tu vois.
C'est-à-dire, euh... un mec pratiquement j'm'enfoutiste, etc. Et je me
rends compte de ce que je suis maintenant, t'vois. Et ben, je me dis que...
(silence) Si j'avais su, à l'époque, tout ce que je sais
maintenant, certainement, que... j'aurai p't-être... ça aurait
été complètement différent, c'est vrai, mais c'est
pas possible.
Jm : Alors, qu'est-ce qu'il faudrait leur
apprendre ?
Au : Ce qu'il faudrait leur
apprendre ?
Jm : Ouais.
Au : Aàà, à
maîtriser le conflit des générations.
Jm : Oh, il faut m'expliquer.
Au : Oui, je crois bien. Eh bé c'est
simple. Moi j'ai l'impression que chaque génération refait les
mêmes erreurs que la génération précédente,
`fin, que toutes les générations. En fait, tu vois, là...
quand on est jeune on fait les cons, on fait n'importe quoi. Quand on devient
un peu plus vieux, on se rend compte de ce qu'on fait, et cætera. On
prend plus de recul et lorsqu'on est encore un peu plus vieux, eh bé, on
essai de faire en sorte que les jeunes ne fassent pas les mêmes
bêtises. Et pi, ben les jeunes qui sont là... i disent
« non, on s'en fout de ce que tu dit, t'sais, nous, on a envie de
faire ce qu'on veut ». Puis en fait c'est toujours la même
chose. C'est comme un cercle vicieux, tu vois. Et... euh... et faire en sorte
que ça s'arrange... je vois pas du tout... je vois pas trop comment
ça... à part euh... ch'ais pas.... euh... leur montrer
vraiment... Non, même, c'est pas possible, quoi... `Fin, moi je pense
que... Pfuu.
Jm : On ne sait pas comment il faudrait
faire ?
Au : Voilà, on n'a pas vraiment la
réponse. Si on avait la réponse, je pense que ça
s'saurait.... Même si je pense que chaque génération
devient plus intelligente, ça c'est vrai. Mais on fait plus ou moins les
mêmes bêtises... ben, les mêmes expériences, quoi,
finalement.
Jm : A ce moment-là, quelles valeurs
il faudrait leur proposer pour que justement ce conflit des
générations, ou conflit tout court, puisse se
réduire ? Qu'ils puissent progresser ? Quelles seraient les
valeurs qu'il faudrait leur inculquer, leur faire passer... Leur exprimer...
Au : ben... euh... Comme ça, sans
réfléchir, je dirai des valeurs qui, qui leur ressemble, des
valeurs plus proches d'eux... Eeet, mais maintenant, en y
réfléchissant, je dirai... je sais pas (rires).
Jm : Réfléchis-y mieux
alors.
Au : Voilà, oui. Parce-que c'est
facile à dire mais, euh...
Jm : Quels principes, plutôt que
valeurs, alors. Voilà, quels principes de communication il faudrait leur
inculquer...
Au : Mais, voilà. Alors,
voilà... moi, moi, moi, je, je, je pense qu'il n'y a pas vraiment de
principe, en particulier. Pas de...
Jm : ...Quelles base...
Au : ...Y a pas de base, en fait, y a pas de
base... Je, je... Ça dépend du jeune, ça dépend du
jeune. Par exemple J, t'sais, sa façon d'êtreeee, euh,
d'être vraiment j'm'enfoutiste complètement, tu vois. Ch'ai pas
ça serait... il faudrait une certaine approche... par rapport à
lui... Ben, par exemple un autre garçon, style... euh... Jon
(Trésorier Junior) ou Ale (membre Junior), tu vois, ce serait
complètement différent. Par, par exemp... A, A, A le, par contre
s'est vrai qu'Ale (silence) il est, il semble peut-êtreee... je dirai pas
plus mâture, mais, peut-être plus ouvert d'esprit. Dans le sens
où, où il écoute mieux. Mais, euh... maintenant, à
dire s'il comprend mieux... je, je sais pas.
Jm : Justement, je, je, je reformule ma
question : qu'est-ce qu'il faudrait leur apprendre ? Quels principes
il faudrait leur inculquer ? Dans la communication, est-ce qu'il faudrait
leur expliquer, non seulement leur expliquer, mais leur montrer et puis prendre
des situations pour éviter qu'il y ai un conflit ?
Au : Il, il, il faudrait, qu'il puisse
tous, qu'ils puissent tout, tout savoir. C'est-à-dire, la façon,
la façon d'écouter déjà. Ça, c'est une chose
de vraiment primordial. Et la façon de voir les choses... Eeet....
Jm : Et il faudrait qu'ils les voient comment
ces choses ?
Au : Avec beaucoup plus de recul que...
Jm : ...Mais ça veut dire quoi
« plus de recul » ?...
Au : ...Qu'est-ce qui va pas. Mais
c'est-à-dire : toi, tu leur proposes quelque chose. Eux, leur
premier avis c'est « j'aime » ou
« j'aime pas », tu vois. Mais... euh... i pensent
pas, par exemple « t'aimes pas mais peut-être que ton
voisin, il aime », tu vois ce genre de chose, par exemple.
Ça c'est le genre de chose je pense que... iiii...
Jm : Comment on pourrait appeler
ça ?
Au : Comment est-ce qu'on peut appeler
ça ? Ch'ai pas, euh...
Jm : Est-ce qu'il y a un nom pour
résumer ça ?
Au : Le recul ? La remise en
cause ? `Fin, la remise en question, ch'ai pas ? Des trucs dans ce
genre.
Jm : Est-ce que le Compu's Club fait
ça ? Il sait faire ça ? Et si non, qu'est-ce qu'il
faudrait faire pour que le Club le fasse ?
Au : Euh...
Jm : Envers Libertech, hein ?
Au : Euh... Je crois pas que le Compu's Club
le fasse... Qu'est-ce que le Compu's Club peut faire ? Alors ça si
j'avais la réponse je crois que je serai un dieu. Mais, euh... non
peut-être pas mais je veux dire : ce serait vraiment bien. Mais
euh... Pfuu... ch'sais pas... euh... moi, je dirai presque, euh... inciter les
jeunes à lire plus de livres... Mais bon, voilà, je me rend
compte que moi, à l'époque... `fin... quand j'avais plus ou moins
leur âge... on m'aurait donné un livre à lire, j'aurais
fait « ben non, pas question, hors de question ».
Alors que maintenant, tu vois je...
Jm : Alors qu'est-ce qui t'as fait
changer ?
Au : C'est, c'est, ch'sais pas... c'est
l'âge, l'expérience. Ch'sais pas, l'envie de découvrir des
choses. Ah ben voilà !
Jm : Qu'est-ce qui te donnes cette
envie ?
Au : Qu'est-ce qui m'a donné envie de
découvrir des choses ? Eh ben, hum. En fait, je crois que c'est
parti du lycée. Lorsque j'ai quitté le lycée... Parce
qu'au lycée je m'emmerdais, mais grave. je me f'sais chier. Je faisais
toutes les conneries possible. En fait en partant du lycée, et ben,
j'ai, ch'sais pas... Depuis le départ du lycée, t'vois, j'essaie
de, de découvrir de plus en plus de choses... Et, et ça
m'intéresse, quoi. Disons que depuis ça m'interpelle quelque
part. Tu vois, chaque fois que j'apprends de nouvelles choses, tu vois, je
trouve ça génial. Et tout ça, c'est parce-que, ch'sais
pas, parce-que j'ai quitté le lycée, parce-que au lycée il
y avait rien d'intéressant. `Fin pour moi, quoi.
Jm : Alors quand tu étais au
lycée, à l'extérieur tu avais le type... tu n'avais pas le
type de récréation comme le Compu's Club association ?
Au : Pas du tout.
Jm : Donc, les jeunes, là qui viennent
au Club, ont ce type de récréation. Ils sont en dehors du
lycée...
Au : ...Enfin, j'avais des
récréations, si j'av...
Jm : ...Alors quels sont les
éléments...
Au : ...ais des récréations.
Mais, ouais, d'accord... pas dans le même type Compu's Club, c'est
vrai.
Jm : Donc, ces jeunes-là, ils ont ce
type de récréation qui est le Compu's Club. Il sont en dehors du
lycée. Donc, quels sont, quels seraient les éléments
déclenchant pour que, justement, ils puissent évoluer, ils
puissent changer ? Quels principes il faudrait leurs, leurs, leurs
avancer ? Quelles valeurs il faudrait leurs inculquer pour qu'ils puissent
communiquer ? Pour qu'ils puissent avancer dans leur projets ? Qu'ils
changent leur attitude ? (silence) Est-ce que tu as vu le Compu's Club
faire des actions dans ce sens ?
Au : Euh... j'crois pas, non.
Jm : Non ? Tu viens
régulièrement au Club ?
Au : Euh... régulièrement,
euh... non, pas vraiment, non.
Jm : Alors, c'est, c'est... ta
fréquence de fréquentation ?
Au : Ben, ben, depuis qu'on a rouvert euh...
J'essaye plus ou moins, tu sais, de revenir, euh... au moins une fois par mois.
Au moins, si ce n'est deux. Mais là, non, ces derniers temps, c'est vrai
j'suis, j'suis, j'suis venu... je dirai pas toutes les semaines, mais presque
une fois par semaine... Et puis là cette semaine je suis venu deux fois,
alors bon, je vais pas revenir avant un mois, quoi. (rires)
Jm : Alors qu'est-ce que tu viens chercher
aujourd'hui au Club ?
Au : Maintenant, depuis que Ch (la nouvelle
employée du Club, ndlr) est là, j'ai l'impression que... que les
choses vont peut-être avancer un peu plus vite. Et maintenant, j'ai, j'ai
certainement plus envie qu'auparavant de venir au Club parce-que j'ai...
parce-que j'espère que ça va vraiment avancer comme, comme
j'aimerai que ça avance. C'est-à-dire que le "Journal
Multimédia" j'aimerai bien que ça se fasse. J'aimerai bien que
"les Ados sur le Rézo" ça se fasse. J'aimerai bien que tout ce
qu'on a prévu, tu vois, se fasse, quoi, tout simplement. (silence)
parce-que c'est bien, parce-que c'est.... Je veux dire : les idées
de départ étaient vraiment intéressantes. Et voilà,
quoi, on a beau... on n'a pas encore abouti, quoi.
Jm : Est-ce que tu peux me donner la raison
pour laquelle, si tu avais un peu plus de temps, tu choisirais la
Finance et Comnet ? Est-ce que ce sont les gens ?
Au : Euh... non...
Jm : Est-ce que ce sont les projets ?
Au : Non, la finance parce-que j'ai toujours
eu un, une certaine attirance pour l'économie, t'sais... j'ai... je,
je... j'étais en section économie sociale. `Fin ES. `Fin
anciennement B. ch'ai pas si tu vois ? Bac B ! Ça te dit rien
bac B ? `Fin bon, voilà. et donc, je connaissais déjà
de l'économie. `Fin surtout les théories économiques,
t'sais : sur Kentz, Smith, etc. Et je, j'avais déjà... comme
je connais déjà un petit peu l'économie je voulais essayer
d'en savoir plus sur, sur les petites ficelles de la Bourse, quoi.
Jm : hum, hum, Alors, euh...
Au : ...Et Comnet parce-que, parce-que c'est
Internet, parce-que c'est la technologie... "d'avant garde", entre guillemets,
et puis voilà. Et que j'y connais rien et donc j'aimerai bien apprendre
plus de choses.
Jm : Donc, tu viendrais pour apprendre,
là ?
Au : Voilà.
Jm : Est-ce que tu peux me donner un ou deux
exemples qui t'ont particulièrement marqué dans tes relations
avec les autres, dans le cadre du Club ? Un ou deux exemples. Ça
peut être des exemples positifs ou négatifs, hein ?
Au : (silence) hummm. Des exemples qui m'ont
marqué ? hum, hum (silence)
Jm : Est-ce que tu t'es dit :
« tiens, ça c'est super bien » ou
« ça, c'est minable, ils font n'importe
quoi ». Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'as
marqué ?
Au : (silence) Ben, à part le
comportement des jeunes... qui m'a un p'tit peu marqué, dans le sens
où ils font n'importe quoi... Et ben... à part ça. Non,
pas en particulier, non. (silence) Ben disons que, il y a peu de choses qui me
choquent en général alors je sais pas...
Jm : Alors, euh... Alors, tu participes
depuis près de deux années...
Au : ...'Fin, participer, euh... Disons que
de temps en temps je viens voir...
Jm : ...Tu es présent, tu es
adhérent...
Au : ...je jette un oeil, je viens m'informer
tout simplement.
Jm : Quels ont été... quand tu
viens t'informer, faire un petit coucou, quels ont été pour toi
les moments forts. Qu'est-ce que tu en retiens ? Quels ont
été les moments forts ? Qu'est-ce que tu retiens de, de, de
tes présences ? De tes venues au Club ?
Au : Euh... Pfuu... Qu'est-ce que j'en
retiens ? ...Ça, c'est compliqué, je, je, jusqu'à
présent je ne m'étais jamais posé ce genre de questions,
c'est vrai, euh... Mais maintenant que tu m'le dis, c'est presque une remise en
question que je dois faire et... (rires) C'est vrai : pourquoi est-ce que
je viens au Club ? C'est vrai, finalement, pourquoi est-ce que je viens ou
pas ? Putain, mais j'ai aucune raison !
Jm : Et en plus c'est ça qui
m'intéresse, au fond.
Au : Ben oui, j'ai aucune raison de venir,
finalement.
Jm : Non, je ne crois qu'on fait les choses
sans raison. Même si elles sont inconscientes. Et mon propos,
aujourd'hui, c'est essayer de mettre des mots sur cette inconscience
éventuelle, voilà. C'est ça qui m'intéresse.
Au : Ouais mais euh... pfu...
Jm : Pour trouver le lien.
Au : Moi j'aime bien, t'sais... y a une
notion que j'ai toujours adoré c'est la gratuité. La
gratuité dans tout. C'est... euh... pas accepter quoi que ce soit,
t'vois. Donner, donner, donner. Et moi, je, je, je savais pas que je suis
vraiment parti comme ça, mais... mais si je viens au Club ce serait
presque pour ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai envie de donner de mon
temps, parce-que... je sais pas si les gens en ont vraiment besoin... mais,
voilà, t'sais, parce-que j'ai envie de faire ça. Tout
simplement.
Jm : Tu es toujours
célibataire ?
Au : Hum.
Jm : Tu, tu, tu vis seul ?
Au : Non.
Jm : Tu vis chez tes parents,
encore ?
Au : Ouais.
Jm : Tu
disais : « donner du temps ». Ça
veut dire quoi « donner du temps » ? Ou plus
généralement donner, ça veut dire quoi, pour toi ?
Au : Ben donner c'est donner, reprendre c'est
voler (rires).
Jm : Quels sentiments tu peux me...
Au : Donner c'est, c'est, c'est accepter de
faire des choses sans... ouais de donner sans attendre quoi que ce soit en
retour, tout simplement. Ch'ais pas. Tu vois, depuis le temps que je suis, je
suis au Compu's Club, tu vois j'ai... au point de vue informatique, j'ai pas eu
l'impression d'avoir avancé. Mais je, je m'en contrefiche, quoi. Tu
vois, je continu à venir, tu vois, je, je, à m'éclater,
à venir m'amuser... au Club, voilà, t'sais... euh... Au
départ, peut-être resté au Club, venu au Club plutôt,
faut... parce-que j'espérais apprendre quelque chose et puis
finalement... euh... j'ai pas appris grand chose. Alors, mais, tant pis, quoi,
`fin, même pas tant pis... je m'en contrefiche, finalement. (silence)
Jm : Est-ce que... Qu'est-ce que ça
t'as apporté ? Personnellement ?
Au : De la satis... satisfaction !
Jm : De la satisfaction ?
Au : Le fait de, euh...
Jm : Tu as un ou deux exemples de
satisfaction ?
Au : Satisfaction de, de, ben, voilà,
quoi, comme je te disais, de, de, de venir, proposer des choses et ne rien
avoir en échange. Voilà, moi je trouve ça génial.
Moi, j'adore ça. C'est clair.
Jm : Et tu adores ça pourquoi, alors,
en fait ?
Au : Ben, parce-que... (nous sommes
dérangés à ce moment-là, ndlr) la satisfaction...
merde... Qu'est-ce que je voulais dire ?... (long silence)
Jm : Bon, on y reviendra. Ça te
reviendras peut-être. Est-ce que quelque chose à changé
pour toi, depuis que tu es au Club ? Est-ce que tu as eu une
évolution ? Tu as retrouvé un travail ?
Au : J'ai retrouvé plusieurs
travails.
Jm : Lesquels ?
Au : Ben, j'ai d'jà... Ben pendant que
j'étais au Club j'ai fais pas mal d'intérim, j'ai, j'ai
recommencé à travailler en imprimerie et pi là, ben, j'ai
eu un contrat de six mois pour rentrer dans un bureau d'étude eeet...
par rapport à avant j'ai peut-être... j'sais pas. Par rapport
à ce que j'étais au début dans le Club, j'ai
p't-être, j'ai certainement plus d'assurance, j'sais pas, j'ai... plus
d'argent (rires).
Jm : Tu as plus d'assurance... euh...
ça peut être dû à quoi ça ? Ce plus
d'assurance ?
Au : (silence) hummm...
Jm : Est-ce qu'il y aurait un lien au fait
que tu viennes échanger au Club, tu viennes donner au Club ? Est-ce
que ça t'apportes quelque chose personnellement ?
Au : Hummm... Ouais, je, je (silence) Ouais,
je pourrai dire que, qu'y a, peut-être, un léger... un
léger lien, tu vois, dans le sens où... euh... où donner,
t'sais, et ne rien attendre en échange... tu vois... ça,
ça... Comment dire ?... euh... (silence)... Je sais pas, euh...
pfuuuu. Un exemple tout, tout... euh... euhmmm... (long silence) pfuuuu...
Jm : On y, on y reviendra, on y reviendra.
Alors, quand tu viens au Club, dans quel état d'esprit tu te
trouves ? Comment tu te sens ?
Au : Ben, ces derniers temps lorsque je suis
venu au Club j'étais vraiment... mort, crevé, lessivé
parce-que... à cause du travail, parce-que j'ai pas mal de choses
à faire en dehors du travail. Je cours dans tous les sens. Même,
pendant un période j'avais pas une minute à moi ettt... et pi, le
simple fait de venir au Club c'était presque le... c'était une
récréation quoi, un p'tit moment, une p'tite pause... un petit
moment de "Kit & cat". Tu sais ce que c'est ? "Kit Kat" plutôt
parce-que "Kit & cat" c'est les trucs pour les chats, je crois. (rires)
Enfin, bref, quoi, ça m'a permis d'avoir... de venir et essayer de voir
autre chose, et puis voilà. Quelque chose de... pas, pas vraiment plus
sérieux mais... mais... presque.
Jm : Alors, quels sont, selon toi, les
obstacles à une... participation plus... importante des membres dans
l'association ? (silence) Qu'est-ce qui peut faire obstacle ?
Au : Euh... le temps libre.
Jm : Le temps libre. Et s'il y avait plus de
temps libre, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait faire obstacle ?
Au : A part la volonté... humm... je
vois pas. Non, je pense que si les gens avaient plus de temps libre... il...
euh... ils viendraient, certainement, plus souvent au Club.
Jm : A aucun moment tu...
Au : ...Mais, mais...
Jm : Oui ?
Au : Mais... euh... je dis ça pour
euh... je dis ça c'est surtout pour moi parce-que je ne peux pas
m'mettre à la place des gens, et pi voilà, quoi... Lorsque je
vois les jeunes, c'est les vacances, i viennent pas souvent. Bon, c'est les
jeunes !
Jm : Tu... euh... tu remets jamais en cause
le, le Club... en tant que tel... euh... en ce qui concerne l'avancée
des projets, l'avancée d'un tas de choses, les jeunes, etc. Alors,
certainement, qu'il y a des choses qui vont pas. Qu'est-ce qu'i faudrait faire,
d'après toi, pour l'améliorer le Club ?
Au : (silence) Ce serait de... Ah,
voilà ! C'est, c'est ça, ça me reviens. Euh... hum...
Une des, une des idées de départ qui m'ont, qui m'ont
incitées à venir au Club c'est que... on vient... on propose une
idée... et on fait tout pour que l'idée aille jusqu'au bout. Et,
et ça, tu vois, c'est ce que... ça c'est vraiment l'idée,
une des idées qui m'a vraiment le plus plu. (silence) Et pour, pour
qu'ça marche au Club... je pense qu'il faudrait que des gens, plus de
gens comme Ch (la dernière employée du Club, ndlr), par exemple.
Plus des gens qui ont le temps de s'occuper de ce genre de choses. Et
malheureusement... Ch, y en a qu'une !
Jm : Peut-être... i y'en aura
d'autres !
Au : Ouais, peut-être.
Jm : Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire
justement, parce-que Ch est salariée, qu'est-ce qu'il faudrait faire au
niveau du Club pour qu'on puisse... euh... embaucher d'autres
personnes ?
Au : Ben, ça, je pense que tu, tu sais
certainement mieux que moi...
Jm : Oui, mais moi j'aimerai avoir ton
avis.
Au : Oui, oui, d'accord. Ben, euh... i
faudrait, i faudrait avoir plus de subventions... humm...
Jm : Pour avoir plus de subventions,
qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Au : Il faut faire avancer les projets...
Jm : Pour faire avancer les projets,
qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Au : Il faudrait aider Ch. (rires) tu vois,
un petit cercle vicieux encore... `Fin, non, non, mais... euh... Il est, il est
évident, quoi, que, qu'il faut qu'on, qu'on puisse, qu'on essaye, qu'on
fasse presque un effort, tu vois, dans, dans... dans l'avancée, pour
faire avancer les choses, quoi, ch'ais pas, t'sais. Faut... Par exemple, hier,
tu vois, je suis venu au Club... `Fin moi, je dis ça parce-que... je...
je donne mon exemple, quoi. Hier, je suis venu au Club parce-que la semaine
dernière, tu vois, avec Ch... à propos de Marathonet (un projet
Junior, ndlr) on s'était donné rendez-vous vendredi, etc. Et que,
moi, vendredi je serai certainement pas là, je me suis
dit : « il vaut mieux que je vienne ».
Et donc je suis venu, hier, pour faire avancer leee... euh... le projet et
voilà, quoi. Et je pense que c'est... il faudrait qu'on ai plus...
euh... enfin, non, je devrais même pas dire ça parce-que ce
serait... ce serait prétentieux. Non, mais... En ce qui me concerne,
ouais, il faudrait que j'ai plus de ce genre d'idées. Que je vienne un
peu plus souvent, que j'essaie de m'y mettre un peu plus sérieusement,
etc. Rien qu'en ce qui concerne le projet que je, que j'avais en idée,
t'sais... le projet de photo
Retournement de cassette ¾ d'heure.
Le projet photo, il faudrait le mettre sur pied et, pour
l'instant, benn, il y a rien qui... `Fin j'ai même pas pris le temps
d'essayer d'y réfléchir, tu sais. J'en ai parlé autour de
moi, à des amis... je... y a certaines personnes qui sont
intéressées et... Mais il faut vraiment que je m'y mette quoi.
Moi, je... j'avance tout doucement, t'sais, j'ai déjà l'appareil
photo... Je me suis acheté un bouquin, t'sais, sur, euh... pour avoir...
pour m'y connaître un peu plus, t'sais, dans, dans le vocabulaire de, de
la photographie. C'est-à-dire, `fin, ben voilà, quoi. C'est pour
m'y mettre un peu plus quoi.
Jm : Bon, pour monter ce projet là...
il va falloir un petit peu de temps et tu en as peu actuellement. Comment tu
vas t'organiser pour dégager du temps ?
Au : Ben, ça, je... je sais pas du
tout. je pense que, un jour... il faudra que je me prenne par le col... Alors,
je ne sais pas comment je vais faire pour me prendre moi-même par le col.
`fin, je vais essayer d'le faire... et il faudra que je me coince un week-end
entier, tu vois, pour essayer de travailler ça, euh... et tout seul.
Parce-que... euh... parce-que... parce-que c'est ma façon de
travailler.
Jm : Voilà, je voulais revenir sur une
question où on avait été interrompus, euh... Qu'est-ce que
ça t'as apporté personnellement ? Qu'est-ce que tu retiens
de... de, de ton adhésion au Club, de ton passage au Club ? Euh...
Qu'est-ce qui a changé pour toi, au Club ? Comment tu l'... Comment
tu expliques ça ?
Au : Voilà : ça y est,
ça me reviens, également. C'est le fait de donner du temps,
donner des idées, eh ben pour moi c'est gratifiant et, et ça me
suffit. Ça me suffit, à partir de là ben je me sens mieux,
j'sais pas... euh... Voilà, quoi.
Jm : Oui, tu disais : « c'est
gratifiant », tu te sens mieux. Est-ce que tu as deux ou trois
exemples qui démontrent que, bé euh... que tu as cette
gratification et que tu te sens mieux ? Ça se caractérise
comment ? Que tu te sentes mieux. est-ce que tu as le sourire jusqu'au
oreilles ? Est-ce que tu sautes jusqu'au plafond ? Tu te roules par
terre ? J'exagère mais tu vois ce que je veux dire ?
Au : Je n'ai pas d'exemple précis,
mais...
Jm : ...des qualificatifs de cette... de se
sentir mieux ?
Au : (silence) Ben, euh... Lorsque j'arrive
au Club... d'habitude, tu vois, je suis un petit peu morose, tu vois. Je sors
du boulot fatigué. Et lorsque j'en repars je suis
généralement serein... je veux dire : ouais serein.
(silence).
Jm : Serein ? Tu es calme ? Tu as
des gestes lents ?
Au : Ouais, voilà. Vraiment
posé, euh... ch'ais pas, euh... C'est presque, c'est presque comme du
yoga, quoi.
Jm : Hum, Tu te souviens du questionnaire
qu'il y avait eu il y a six ou neuf mois, hein ? Qui avait
été diffusé et auquel tu avais répondu. il y avait
une question : "êtes-vous content d'y venir" tu avais coché
"oui". Et on te demandais d'expliquer pourquoi. et tu avais répondu
"parce-que c'est pour mon plaisir". Est-ce que tu peux préciser ce que
tu as voulu dire là ?
Au : Ben, je... je crois que je l'avais dit
dans le sens où... où...euh... ben je viens quand je veux, quoi.
Et donc, euh... en général, si je viens quand je veux c'est pour
mon plaisir, quoi, ch'ais, c'est, c'est... C'est presqueee... une lapalissade
pour moi. Si je viens quand j'veux c'est parce-que j'y viens pour mon
plaisir...
Jm : Alors, euh... A la question "Que
faudrait-il faire pour que les membres trouvent ce qu'ils viennent chercher au
Club ?" tu avais répondu "il faut y réfléchir
ensemble". Ensemble c'est avec qui ?
Au : (silence) J'ai répondu ça,
moi ? Ça c'est fou, ça ! (rires) Comment... (silence)
Qu'est-ce que c'est qu'ils viennent chercher au Club ? Hum, fuuu... Je
devais certainement avoir un idée en tête pour dire ça...
mais alors maintenant pour te dire laquelle idée c'tait...
Jm : Non ? Alors question
suivante : "pensez-vous que le Club puisse, parfois, soulager un certaine
solitude ?" tu avais répondu "oui". Euh... Dans quel cas ?
Toi, de temps en temps, tu te sens, euh... solitaire ?
Au : euhmmm...
Jm : Personnellement ? Est-ce que
ça meuble un moment ?
Au : Je me suis toujours sentis solitaire.
Parce-que j'ai, je pense que j'ai toujours eu une pensée... une
pensée solitaire, quoi. Je pense... j'essaie, enfin, c'est pas dans...
enfin je veux pas dire, tu vois, que je pense de façon
égoïste mais je pense, euh... tout seul. C'est-à-dire que je
n'ai, je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour avoir... pour faire avancer
mes idées. `Fin, tu vois, j'ai toujours fait en sorte de, de toujours me
débrouiller tout seul. Et c'est peut-être dans ce sens là,
quoi.
Jm : Alors, "le Club est-il pour vous un lieu
d'échanges et de débats où vous pouvez exprimer vos
idées ?" tu avais répondu "oui". Qu'est-ce que, qu'est-ce
que tu avais compris de cette question, toi ?
Au : (silence) Ben, ça veut dire
est-ce qu'on peut venir proposer une idée et en discuter.
Jm : Proposer une idée et en
discuter ? Bon, quand on discute généralement ça...
on n'est pas nécessairement d'accord ?
Au : Ben, oui, ben c'est le principe de la
discussion...
Jm : Et quand on n'est pas d'accord, est-ce
que tu as remarqué des situations particulières ?
Au : hummm...
Jm : Comment ça se passait ?
Quand tu n'étais pas d'accord, par exemple ?
Au : Là, la... l'exemple que j'ai en
tête c'est, c'est à propos de mon projet : lorsque je suis
venu en parler il y avait S (3è entretien, ndlr), y avait... tu
étais là, il y avait peut-être Ch (l'employée du
Club, ndlr) il me semble. Et S... a, c'est pas qu'il était pas d'accord,
mais il a commencé à dire des choses auxquelles je n'avais pas
pensé. Et, euh... et ça c'est, c'est super ! Je veux dire,
t'sais. Y a plein de choses auxquelles on ne pense pas... On, on, `fin, on
espère vraiment faire le tour de la question mais y a toujours
quelqu'un, `fin toujours, on espère toujours qu'il y ait quelqu'un qui,
qui ait une autre vision... de la chose. Et heureusement, d'ailleurs !
(silence)
Jm : Bien, bé on a fait le tour.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire de plus ? De
particulier ? De général ? De...
Au : Euh... mm... je sais pas... euh...
Pourquoi ne pas avoir... euh... un poste K7 ou un poste laser, au Club ?
(rires) Pour avoir un peu de musique, ch'ais pas. Ou alors essayer de voir...
quelque chose sur la musique ? T'vois, ch'ais pas... J'ai des amis qui,
qui aiment bien la musique, t'sais, ça pourrait, peut-être, les
intéresser. Bon, maintenant, je dis pas qu'i, qu'i faut faire quelque
chose sur la musique, etc. Mais je veux dire... apporter là un peu plus
de musique, ce serait, ce serait plus sympa. Comme on dit :
« la musique adoucie les moeurs ». Et donc,
peut-être que c'est la solution pour les jeunes ! Finalement :
faire tout en musique ! Mais voilà, maintenant, quel style de
musique il faut trouver ?
Jm : A la question là. Je reviens
à la question un petit peu en arrière : "connaissez-vous la
bonne distance, entre guillemets, pour encadrer les jeunes ?" tu avais
répondu "oui" Alors, quelle est-elle cette bonne distance ?
Au : C'est la distance que je, que je, que
je... C'est la distance que j'ai vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire,
euh... je viens une fois, j'essaie de discuter avec eux et pi... je reviens pas
pendant un petit moment et voilà.
Jm : Tu les laisse libre de...
Au : ...Ben, j'ai, disons que j'ai toujours
eu l'impression de bien m'entendre avec J (président Junior actuel,
ndlr), par exemple. Et, euh... je sais pas, j'ai... j'ai pas vraiment de, de
principes en particulier, tu vois. Je sui... je viens pas en
m'disant : « tiens, il faudra que je le prenne comme
ça, aujourd'hui, ou, euh... » Ch'ais pas, je, j'le prends
tout naturellement... on discute... Voilà, c'est, c'est certainement
parce-qu'on a plus de points communs, lui, il fait des jeux de rôles et
moi j'adore les jeux de rôles, etc. C'est peut-être ça
aussi.
Annexe 14 Neuvième
entretien
MS (neuvième entretien) le jeudi 15
février 2001, 9 heures. A notre domicile.
Retraitée de l'éducation, religieuse : 77
ans. Adhérente depuis 1 an et demi. Particpe à la branche Finance
uniquement. Connaît peut l'informatique. Correspond au questionnaire
n°5.
Après annonce
Jm : Comment avez-vous connu le club ?
MS : Je l'ai connu par euh... M., par Ja
(notre précédent bailleur, ndlr). Bon, c'est l'informatique, en
fait, qui m'a amenée au club. J'avais acheté un petit ordinateur,
parce-que je voulais pas mourir trop bête, et savoir un peu ce que
c'était... et puis, ben, quand on commence avec un ordinateur, il faut
continuer. Puis étant autodidacte, j'avais quelque fois des
problèmes et en fait Ja m'a mal présenté le club...
Jm : Ah !
MS :...Il m'a dit que c'était pour...
me perfectionner en informatique.
Jm : Oui.
MS : Que j'aurai des tuyaux.
Jm : Qu'est qu'il en avait dit exactement
?
MS : Ah, il m'a dit « tu
t'intéresses... ». Faut dire que à tous ses
clients, il me citait un petit peu en exemple, parce-que j'étais
âgée et que je m'intéressais à l'informatique.
Jm : Agée, âgée, quel
âge vous avez ?
MS : Ben, j'ai soixante dix sept ans, quand
même !
Jm : Ah ben, on a trois doyens qui ont quatre
vingt...
MS : Oui, mais ça fait rien, mais y'en
a qui ont quatre vingt dix ans ! (rires).
Jm : Oui, mais pas au Club !
MS : Alors, j'y suis rentrée un p'tit
peu comme ça, en me disant, ben j'pourrais, j'pourrais glaner quelques
petits tuyaux qui m'aideront. Et puis, j'avoue qu'au début, j'ai
été un p'tit peu déroutée, j'ai pas vu trop,
trop... on m'a pas présenté assez clairement le Club, et je n'ai
pas vu où on voulait en venir, et ce que j'allais faire. Euh... je crois
aussi, oui, que la présentation... On m'a dit que c'était Compu's
Club, mais je n'ai pas vu toutes les dimensions, du Compu's.
Jm : Alors, justement à
l'époque, qu'est-ce qui vous avait séduit ?
MS : Pas beaucoup. Pas beaucoup de choses.
Jm : On vous l'a présenté,
quand, quand Ja vous a approché du club...
MS : Non, Ja, lui il m'a dit
« tu t'intéresses à l'informatique, tu vois, c'est
à coté, alors, tu... »
Jm : D'accord.
MS : ... « Tu vois, tu auras
des tuyaux ».
Jm : Quelqu'un vous a reçu ?
MS : Vouis.
Jm : Qui vous a présenté le
club ?
MS : Oui, seulement... Je, euh... c'est un
peu une critique négative, c'est que je ne savais pas qui faisait
quoi.
Jm : Ah, au tout début ?
MS : Au tout début, y'avait deux ou
trois messieurs, vous deviez y être, mais j'ai pas su qui était le
responsable, qui était...C'est un petit peu flou. Et puis, du moment que
j'étais rentrée, je ne voulais pas me décourager... alors
j'ai cherché... on m'a fait trouver le Clu... le groupe qui
correspondait le mieux, j'étais tenté quand même par la
Littérature qui aurait été peut-être plus
adaptée... Puis comme je ne connaissais rien aux Finances, j'ai dit
« Oh, ben je vais rentrer là dedans ».
Jm : Ah, ben voilà. Donc à
l'époque, on vous a présenté le Club, notamment la section
Finance, vous vous êtes dit : « Bon, la section
Finance. »
MS : Voui, oui.
Jm : Donc, c'est la seule chose qui vous avez
attiré à l'époque ?
MS : Ah, mais, je n'avais pas vu du tout, du
tout, la dimension sociale du Compu's.
Jm : La dimension sociale ?
MS : Non, je ne l'ai pas senti du tout au
début.
Jm : Parce qu'il y a une dimension sociale au
Compu's ?
MS : Ah ben oui !
Jm : Ah oui ? Vous entendez quoi, par social
? Est-ce que vous avez un ou deux exemples qui vous font dire que c'est une
dimension ?
MS : Ben le travail dans les prisons, le
travail avec les jeunes...
Jm : Très bien.
MS : Et puis l'esprit du club.
Jm : L'esprit du Club ?
MS : Je l'ai senti petit à petit.
Jm : Alors euh... Est-ce que vous avez
déjà eu une expérience de l'associatif avant le Compu's
club ?
MS : Ah oui !
Jm : Oui ? Lesquels ?
MS : Oui, parce-que, j'ai travaillé
à l'Institut Frédérique Corset, qu'on a créé
d'ailleurs, avec une association. Oui, oui, oui la vie associative, oui.
Jm : Vous en étiez satisfaite ?
MS : Ah, oui. Oui, oui tout à fait.
Jm : Et vous y êtes encore non ?
MS : Non, parce-que... comme j'étais
directrice... on m'a bien offert, lorsque je suis partie, de faire partie de
l'association, mais j'ai pensé que j'arrivais avec mes idées
faites, avec mon expérience, et ce que je risquais peut-être de
gêner par ma prudence, euh... les actions futures. La nouvelle directrice
pouvait avoir des idées très différentes des miennes, et
réussir... alors, je suis allée à une ou deux
réunions, et puis, d'abord, ça faisait deux cent
kilomètres, plus deux cent au retour, quatre cent kilomètres,
ça faisait, c'était un petit peu long. J'ai
préféré leurs laisser toute liberté.
Jm : Très bien.
MS : Mais je suis en bonne relation encore
avec eux.
Jm : Euh... Vous faites partie d'une autre
association encore actuellement ?
MS : Alors, j'ai... le groupe de randonneurs,
(rires). Que j'ai un peu créé aussi, oui, que j'ai
créé, et qui est rattaché à... la maison... euh...
Louis Jourdan à Bourg les Valence. Nous dépendons d'eux, et au
début, nous étions très indépendants, et petit
à petit, peut-être aussi, c'est un certain charisme, je suis
rentrée un peu plus que par les randonnées.
Jm : Est-ce qu'il y avait quelque chose
d'autre de précis, au-delà de l'informatique, que vous
étiez venue chercher ? Tout à l'heure, vous disiez que vous
n'aviez pas senti la dimension sociale du club, mais, est-ce qu'il y avait
autre chose lorsque l'on vous l'a présenté, au-delà de la
Finance, que vous ne connaissiez pas, et que vous souhaitiez connaître,
est-ce que il y avait autre chose d'impalpable, que vous auriez perçu ?
Que vous auriez senti ? Quelque chose de précis ?
MS : Peut-être pas senti tout d'suite.
Maintenant, y'avais peut-être une recherche plus ou moins consciente,
parce-que j'aime bien... J'aime bien rentrer dans une association. Ça
me...
Jm : Vous attendiez quelque chose de
particulier en rejoignant le Club ? Au-delà de l'informatique ? C'est
uniquement l'informatique au départ ?
MS : Oui, je crois.
Jm : Oui ?
MS : ...Mais l'informatique m'a beaucoup
apporté. Parce-que ne connaissant rien, euh... y'a des p'tits jeunes
avec qui j'ai parlé, avec qui bon, j'ai été invité
à leur mariage, y'a une amitié qui est née, des services
rendus, en particulier, je corrigeais les fautes d'orthographe, (rires), et de
français, mais y'a une réelle amitié, un échange
qui s'est créé, à partir de l'informatique.
Jm : Alors, euh... vous parliez d'une
amitié, vous entendez quoi par, par amitié ? Est-ce que vous avez
un ou deux qualificatifs, à partir de, d'un ou deux exemples ? Qui
permettrait de dire : « l'amitié c'est ça pour
moi » ?
MS : L'amitié, c'est au-delà...
d'un service, par exemple sur l'informatique, au-delà d'un service ou
d'un échange de service, euh...c'est arriver... (raclement de gorge)
à des liens beaucoup plus profonds où on se parle... on se confie
mutuellement les problèmes qu'on peut avoir, euh... et où on
essaie de mieux comprendre, de mieux, pas comprendre l'autre, mais se
comprendre mutuellement.
Jm : Donc l'amitié, c'est se
comprendre mutuellement ?
MS : Se comprendre, s'entraider, c'est
créer un lien unique !
Jm : « Un lien
unique ». Ah tiens, c'est intéressant, ça. Vous
entendez quoi par ça ?
MS : Moi, mes amis... j'en ai des
quantités, j'en ai trop...(rires)
Jm : Trop, on peut dire, on a trop d'amis
?
MS : Ben oui, parce-que j'arrive pas... on
n'arrive plus à répondre après, à avoir une
présence suffisante... Comment définir l'amitié à
travers ce que je vis ? C'est toute cette chaleur, c'est toute cette... ce lien
de plus en plus étroit, qui nous unit à l'autre.
Jm : Bon, on y reviendra certainement au
cours des autres questions. Alors, juste un aparté, est-ce que vous
pouvez me parler un petit peu de vous, juste à l'époque avant
votre venue au club ? Quelle était votre situation ? Vous avez, quand
vous avez entamé une nouvelle vie, celle de la disponibilité ?
MS : Non, pas vraiment.
Jm : Non ?
MS : Non, parce-que je n'ai pas senti, au
départ... tout ce que le... toute la richesse du club, tout ce qu'il
pouvait apporter... Je ne l'ai pas senti.... J'y suis rentrée un petit
peu, lorsque j'ai vu les différents... j'ai constaté toutes les
différentes branches du Club... Et puis, c'était sympathique,
presque trop sympathique, parce-que, (silence) y'a un manque d'exigence, en
tout cas dans notre groupe. Jo (6è entretien), il est très,
très gentil, très... il est venu me dépanner d'ailleurs,
il n'y est pas arrivé, mais il est venu me dépanner. Jc
(5è entretien) aussi. Donc les liens se sont créer petit à
petit.
Jm : C'est ça la sympathie de, du Club
? C'est des liens qui se créent au-delà d'une activité en
commun ?
MS : Ah oui. A partir d'une
activité.
Jm : A partir... A partir d'une
activité. Vous disiez « presque trop »,
donc presque trop, parce-que ça avait un manque, on, on, ça
générait un manque d'exigence...
MS :...Oui...
Jm : ...Dans l'ouvrage, dans, dans...dans
l'ouvrage qui était fait en commun ?
MS : Oui, oui, en particulier dans
l'exactitude.
Jm : Dans l'exactitude, c'est à
dire... la ponctualité des heures, c'est ça ?
MS : Voui, on arrive, bon, alors y'a le
moment où on se fait la bise maintenant, ce que j'aime bien, et puis bon
comment ça va, et puis bon, alors qu'i ait cinq minutes de mise en
route, je veux bien, mais quelques fois, ça arrive à une heure,
facilement ! (rires)
Jm : Ah oui, oui. Très bien.
MS : Jo part téléphoner,
part... bon...y'a...
Jm : Oui. Un manque de rigueur....
MS : ...Pendant ce temps, ben on, on
s'occupe, on parle, on glandouille.
Jm : Et c'est dû à quoi,
ça, en fait, qu'i ait ce, comme un relâchement ?
MS : Comme un manque d'exigence, je crois.
Jm : Oui, mais ce manque d'exigence serait
dû à quoi ? D'après vous ?
MS : Bon, on se gêne pas maintenant, on
s'connaît...Hein, alors on peut quand même, et puis c'est pas
ennuyeux de se parler ! C'est bien sympathique. Seulement l'année
dernière, ça c'est terminé un peu en noeud d'boudin. Je
dis n'importe quel... parce-que, ben si on ne vient pas au club, on peut pas
venir, oh bé quand même ! on a... on n'est... on ne se sent
pas indispensable, dans le club, et, dire que si on ne vient pas, on doit
s'excuser. Et ça, moi, je le ressens très mal.
Jm : Ah oui.
MS : Parce-que, dans un groupe, un petit
groupe comme le nôtre... euh... on ne peut pas supporter que quelqu'un
s'absente trop longtemps, surtout ne donne pas les raisons de son absence.
Jm : Qu'est ce qui ferait... euh... qu'est-ce
qui ferait comprendre aux membres, qu'il est utile d'informer les autres
membres d'une absence ?
MS : Et ben, c'est...
Jm : Dans quel esprit, c'est un petit peu,
ça rejoint un petit peu la question suivante, dans quel esprit,
pensez-vous que les membres viennent au club ? Est-ce que c'est une des raisons
de cet esprit là, est-ce que c'est une des raisons qui font qu'ils ne se
sentent pas obligés de... justifier une absence ?
MS : Alors, au départ... on ne sait
pas trop quelle est la motivation des gens, on ne les connaît pas. Mais
au bout d'un certain temps, on commence à s'connaître. Alors on
sait par exemple que, B. (membre du Club, ndlr) a des occupations, qu'il lui
est quelquefois difficile de venir, mais je pense qu'il ne faut pas passer sous
silence une absence. C'est pour cela que j'ai proposé d'être un
lien à l'intérieur du club, j'ai écrit tout de suite
d'ailleurs à Je., par exemple, pour lui dire que nous étions
étonnés de son absence, que nous espérions qu'il
n'était pas souffrant, et que nous souhaitions le revoir aux prochaines
réunions.
Jm : Alors, à l'époque, pour
revenir un p'tit peu en arrière, à l'époque de, de votre
venue au club, euh... votre situation familiale, elle était laquelle
?
MS : Ben je suis... je suis
célibataire, je suis seule, mais j'ai quand même adopté,
euh... je l'ai pas adopté officiellement, mais officieusement un
garçon de l'institut, qui... qui n'avait pas accepté mon
départ, et qui a fait une grosse dépression. Alors, j'avais pris
mes précautions. Je savais qu'il y aurait un problème, j'avais
dit à tous les enfants qu'ils pouvaient venir, que ma maison...
était toujours ouverte, c'était un principe d'ailleurs, quand
j'étais à l'institut de dire que ma porte était... elle
l'était effectivement, elle était toujours ouverte... Et je leurs
ai dit qu'à Valence, ce serait pareil. Mais Aix s'était un peu
loin. Pour Ol (le fils adoptif de MS, ndlr), je lui ai pris un abonnement par
chemin de fer, mais... de venir d'Aix, par chemin de fer, il faut passer par
Marseille, c'était difficile. Je pensais le prendre pendant les
vacances, mais ça n'a pas suffit, et devant l'importance du
problème, euh...bon, ben j'ai accepté qu'il vienne.
Jm : Qu'il vienne définitivement ici
?
MS : Vouais.
Jm : Ah oui ?
MS : Oui.
Jm : Donc, il héberge chez vous ?
MS : Plus maintenant, parce qu'il est grand.
Maintenant.
Jm : Oui.
MS : Et puis à l'adolescence, et
ben... ben j'ai perdu mon Ol. Je l'avais accepté, je lui avais dit que,
il était totalement libre, et un jour au téléphone,
ça dû être à peu près quand je suis
allée au Compu's Club, j'ai eu un coup de téléphone
« Est-ce que tu reconnais ma voix ? » ... Ben non
! (rires)
Jm : Il avait grandi...
MS : Eh, il a trente ans maintenant ! Il a
trois enfants, et... tout d'suite, bon, je n'ai pas fait de reproches, je lui
avais dit qu'il était libre et qu'il n'avait aucun engagement
vis-à-vis de moi, que ce que j'avais fait, c'était totalement
gratuit... Alors tout de suite, des liens se sont créées, plus
qu'étroits, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de fils qui sont aussi
gentils à l'égard de leurs parents. Il est à Saint Maximin
et j'y vais très... enfin je n'y vais pas très souvent,
mais...
Jm : Y'a un sentiment que je souhaiterai
relever là, le fait de dire « c'était totalement
gratuit, ça avait été donné » euh...
comment on pourrait... comment on pourrait préciser ça ? Comment
on pourrait dire ? Qu'est-ce qui fait que vous avez donné ? Quels sont
les, les éléments qui ont vibré ? Qui vous ont fait donner
? Justement, envers votre fils adoptif ?
MS : C'était un enfant qui avait eu
beaucoup de problèmes... euh... sa mère avait seize ans, à
la naissance du gamin, elle avait été rejetée par sa
famille, il est né dans un foyer maternel, et un an après,
à dix sept ans, sa mère est décédée...
euh... des suites d'une overdose, d'un mélange d'overdoses, de, de
remèdes... Et ce petit a été ballotté dans...
transbahuté dans différentes familles. Quand il est arrivé
à l'institut à l'âge de dix ans, c'était en vue
d'une adoption. Je pense, ça m'entraîne un peu loin mais, c'est
pour dire l'histoire d'Ol, euh... une famille aixoise, des gens très
généreux, qui ont perdu leur fille unique morte subitement
à quatorze ans, et une psychologue... bon... imprudente... tout d'suite
a voulu qu'ils adoptent un enfant, et Ol... qui était un joli petit
garçon physiquement très, très mignon, maintenant c'est un
gros bouddha, (rires) pas très gros, mais enfin bon. Il était
très mignon, très, physiquement, très, très
gentil... avec toute une révolte intérieure qui était
cachée.
Jm : Et vous l'avez défendu.
MS : Ben, moi je l'ai accepté à
l'Institut comme tous les autres enfants, mais, j'ai fait connaissance avec ce
couple, qui venait de perdre leur fille, des gens très
généreux... (silence) mais ils avaient perdu une fille
excessivement intelligente, euh... euh... pleine de sens social, elle est
très généreuse, ils ont pensé que leur fille leurs
demandait d'accepter ce garçon. Et puis ça n'a pas marché.
Il était trop différent, il était fainéant comme
une couleuvre, très en retard pour ces études, on ne peut pas
parler d'études, il lui manquait des bases essentielles... et ça
n'a pas marché. Et on l'a ramené à l'Institut.
C'était un échec...C'est pour ça qu'il a, qu'il n'a... Il
venait avec moi pendant les vacances, mais il y en a d'autres qui sont venus et
dont je me suis occupée, ceux qui n'avaient pas de famille, bon
ça m'est arrivée...d'en ramasser pendant les vacances parce-que
c'était des cas sociaux. Des parents faisaient des démarches
auprès du juge pour prendre, pour prendre leurs enfants pendant les
vacances. Au bout de trois jours, ils en avaient marre, et hop ! On les
renvoyait à l'Institut, où il n'y avait plus personne. Alors, je
les emmenais en vacances avec moi.... Pas toujours de bon coeur, d'ailleurs !
(rires)
Jm : Pour revenir un petit peu sur le, le
club, à l'époque de votre entrée au club, votre, vous
travailliez déjà ? Vous étiez au travail ?
MS : Ah non !
Jm : Non ?
MS : Non !
Jm : Vous étiez ?
MS : J'étais retraitée.
Jm : Retraitée ! D'accord (rires)...
Donc vous avez eu, ça fait, de... pendant de très nombreuses
années, vous avez été intégrée dans diverses
associations, vous aviez déjà un terreau associatif dans votre
famille ?...Votre fratrie ? Vos parents ?
MS : Oh non, pas du tout.
Jm : Pas du tout ?
MS : Pas du tout, du tout. Non, non...
Jm : ...Alors qu'est-ce qui a fait que...
MS : ...plutôt genre droite, les
enfants bien élevés, ne reçoivent pas n'importe qui, non,
non, non, non.
Jm : Alors, qu'est-ce qui a fait que vous
soyez sensibilisée au monde associatif ?
MS : (Silence) Je ne sais pas.
Jm : « Je ne sais
pas » ?
MS : Je pense que c'est une... une, oui une
attirance, un p'tit peu... c'est comme ça !
Jm : « C'est comme
ça », quelque chose, une... C'était dans
l'air ?
MS : Voui, mais moi, j'étais un petit
peu le...un cheval boiteux ! (rires), le canard boiteux !
Jm : Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, hein,
le club c'est quoi pour vous ? Ça représente quoi ? Quelle image
vous en avez aujourd'hui ?
MS : (silence) C'est difficile...
Jm : Oui.
MS : ...de le préciser, parce-que, il
n'y a pas très longtemps que j'ai découvert toute la richesse du
Club.
Jm : Alors, on va procéder
différent. Y'a combien de temps que vous êtes au club ?
MS : Un peu plus d'un an.
Jm : Un peu plus d'un an. Et il y a combien
de temps que vous vous êtes aperçue des dimensions du Club ?
MS : Je crois que c'est à travers le
déménagement. Je n'ai pas vécu le
déménagement, j'étais absente... mais... lorsque j'ai vu
tout le travail pour aménager le nouveau local, euh... tout ce
foisonnement de personnes que je ne connaissais pas... et... je vois Jc
(5è entretien, ndlr) arriver pour une réunion, et on lui a dit :
« dis tu branches », bon, allez pof, il a
quitté là le blouson, il est monté sur la table, il a fait
un branchement électrique. Y avait Alain, par exemple, que je ne connais
pas du tout, tout souriant, qui était là, enfin, quand j'ai vu
tout ce travail... cette ruche... ça m'a quand même beaucoup
impressionnée. J'ai vu qu'à travers euh... Les différentes
activités, il y avait un lien...
Jm : Il y avait un lien.
MS : ...que je n'avais pas senti auparavant !
parce-que je n'y vais pas suffisamment. Puis j'avoue que... le permanent,
l'année dernière, m'avait pas trop...
Jm : Oui. La (l'ancien salarié du
Club) était... bon. La avait ses, ses soucis, hein, il avait ses
problèmes. On l'avait pris, il était handicapé, hein.
MS : Je ne savais pas.
Jm : Voilà, on l'avait pris, c'est
toujours cet aspect social...
MS : Oui. Oui.
Jm : ...dont on parlait tout à
l'heure.
MS : C'était à coté de
chez moi, alors je... j'y suis allée une ou deux fois comme ça,
mais j'avais pas envie d'y rester.
Jm : Alors donc, si on devait revenir sur
cette question, euh... ça représente quoi aujourd'hui ? Le Club
?
MS : Je crois que je n'ai pas encore tout
découvert.
Jm : Oui, donc, alors à cet
instant ? Maintenant...
MS : ...Mais...
Jm : ...ce qui a été
découvert, ça représente quoi ?
MS : Ah, je trouve une foule de
générosité, d'intérêt, pour (silence), je
dois ajouter à travers vous aussi, je l'ai découvert quand
même, parce-que Restaurants du Coeur, tout, bon, on sent quelqu'un qui
est porté vers les autres, et...
Jm : C'est... oui, je...
MS : Si, c'est à travers des personnes
aussi qu'on vit au club.
Jm : Voilà. A travers des personnes.
Je précise juste une chose, pour faire, ouvrir une parenthèse,
euh... bon au Club, je me positionne comme un... comme je dois être
positionner pour essayer de dynamiser, euh... là, tout de suite, je suis
étudiant.
MS : Oui, oui. Mais oui. Pour moi la
personne, y'a l'unité de la personne...
Jm : Ben moi, justement dans ma recherche,
dans mes études, il faut que je fasse cette rupture, pour justement
être le plus objectif possible dans, dans les rapports avec...
MS : Oui, ben, c'est pas de la flagornerie,
hein, si, si je vous le dis, c'est que...
Jm : ...Oui, oui. Mon ego est satisfait,
mais...
MS : C'est que je le pense. C'est quand
même à travers des personnes, qu'on découvre un groupe.
Euh... je pense par exemple, à Je (membre du Club) qui a
d'énormes difficultés, et qui est arrivé... c'était
minable son compte-rendu... il l'a lu, mais ça fait rien ! Il a
fait un effort, moi j'ai trouvé ça... qu'il accepte de faire une
recherche et de parler... moi, je pense que pour lui, ça a
été... c'est pour ça qu'il ne faut pas le lâcher
!
Jm : C'est une étape, hein.
Très très bien. Très intéressant. Alors, qu'est-ce
qui vous plaît, au Club, aujourd'hui ?
MS : (Silence) C'est la, la... pour moi c'est
que des liens se sont créés. Euh... par exemple, bon, ben quand
j'arrive, on se fait la bise, et puis j'ai L. (7è entretien) qui
m'embarque pour me dire que lui, il a fait des expériences, qu'il
voudrait bien m'entraîner avec lui, donc, il y a quand même quelque
chose qui passe... Euh... y'a Je, qui, qui est arrivé à me dire
où il habitait, (rires) à travers milles circonvolutions
parce-que c'est son problème. Y'a Jo (6è entretien) qui est, qui
est heureux de venir.
Jm : Ça se caractérise comment
"heureux" ? Jo, ça se voit comment sur lui ?
MS : Ah ben il est épanoui, il nous
parle de son travail, il... bon même à travers son petit
laisser-aller. Parce-que Jo y'a pas d'exigences, hein. Il arrive et puis...
mais, on pourrait parler de son travail pendant la réunion, ça ne
le gênerait pas ! Mais, c'est... c'est un groupe sympathique. Ro (membre
du Club, ndlr), le nouveau, s'est, s'est bien intégré. Il s'est
proposer pour être Secrétaire, ben c'était chouette quand
même ! Il nous fait part un peu de son expérience. C'est bien,
parce qu'il ne nous écrase pas.
Jm : Dans le domaine de la Finance, hein ?
MS : Voui. Oui.
Jm : Je précise. C'est ça.
MS : Donc à travers la Finance, y'a
quand même un, un groupe. Y'a des liens qui se créent dans le
groupe. Ses liens n'ont pas toujours existé puisque l'année
dernière, nous avons laissé tombé PG (membre du Club,
ndlr)...
Jm : Oui.
MS : ...Je crois que ça n'était
pas notre faute, nous n'étions pas assez... Les liens n'étaient
pas assez créés. C'est pour ça, c'était une
conséquence, ça m'a pas mal culpabilisée, mais... Il y a
eu le problème de Fa (un membre du Club qui s'est suicidé), moi,
ça m'a beaucoup, beaucoup questionné. Parce-que je, je
travaillais un peu avec lui, quand on allait, c'est lui qui m'avait
initié.
Jm : Pour préciser : Fab c'est qui ?
Un...C'est pour le mémo, hein.
MS : Fab, qui s'est suicidé, et, et
tout le monde a été surpris.
Jm : Huit jours après la, la fermeture
du, du Club là, où on avait manqué de locaux. Huit jours
avant il avait participé au déménagement, et puis il est
décédé huit jours après. Oui.
MS : Le suicide interroge beaucoup, et...
(Silence) Et là aussi, le Club avait une responsabilité, mais
était peut-être trop jeune, pas assez structuré, parce-que
Fab ne venait plus aux dernières réunions.
Jm : Sur la Finance non. Il venait, il venait
au club, hein, en libre service...
MS : Oui, mais sur la Finance, non.
Jm : ...Il faisait des passages, sur la
Finance, non, oui. Exact. Exact. Euh... c'est vrai qu'on a peut-être pas
était très réactif, euh... certainement qu'ça doit
nous, nous interroger quelque part. Euh... bon, en aucun cas, on peut
être responsable, en tant que tel, il ne faut pas culpabiliser, mais
ça peut nous, nous amener à se demander qu'est-ce qu'il faudrait
faire pour que ce genre de situation ne se reproduise pas ?
MS : Exactement. Exactement. Il a eu, il a eu
un problème...
Jm : On n'a pas su le voir...
MS : ...Il n'a pas trouvé, on n'a, il
n'a pas eu la main tendu probablement ! Probablement, parce-que ça ne
suffit pas toujours ! Mais, culpabiliser, non mais interroger, oui.
Jm : Alors, comment on pourrait
définir le club ? Aujourd'hui ? Quelques qualificatifs ?
MS : Le Compu's ? Ou ?
Jm : Oui, le Compu's Club. (Silence) A
travers la branche, aussi hein ?
MS : Oui, alors, à travers la, la
branche, moi je pense qu'il faut... garder ce contact, ses liens
d'amitiés qui se créent, parce qu'on est à l'aise
maintenant, donc si on est à l'aise, c'est qu'déjà, on,
hein, on ne redoute plus celui qui est en face de nous. On peut parler
librement, on peut dire, ce que j'ai dit la dernière réunion
« vous utilisez des sigles que je ne connais pas,
moi ». Pendant longtemps, par exemple, on me parlait de la FOL,
je ne savais pas qui était la FOL. (rires). Ca m'a fait rire, j'ai,
après j'ai compris... Mais, euh... il ne faut pas que, qu'il y ait quand
même du laisser-aller dans le travail qu'on s'est proposé.
Jm : Donc comment on pourrait qualifier le
club ? Comment on pourrait le définir ? On va prendre la question
différemment : si aujourd'hui, ça c'est peut-être
produit, vous avez, vous deviez, euh... convaincre quelqu'un de rejoindre le
club. De quelle manière le présenteriez-vous, au-delà de
la présentation des branches, de ce qu'on fait au niveau informatique
etc. ? Quels sont les éléments, quelles sont les
caractéristiques que vous emploieriez pour dire : « Bé,
le club c'est ça, tu, tu pourras, tu pourras t'y sentir comme ça,
comme ça »
MS : Je ne sais pas encore vraiment,
parce-que... je me suis interrogée, je me suis dit : « je
suis venue chercher quelque chose au Club, mais je n'ai rien
donné ». Et puis en fait, on donne par sa présence,
par, euh... par le fait de s'intégrer au Club et de participer. Mais, si
bien qu'au début de l'année, j'avais décidé de
quitter le club.
Jm : En début d'année ?
MS : Ah voui, voui, voui !
Jm : Oui, oui, je m'en souviens, oui. Et
qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, alors ?
MS : Ben le fait, peut-être de rendre
service en hébergeant... le, le groupe au début de
l'année... ça m'a fait plaisir...
Jm : Pendant, pendant notre fermeture, hein,
je précise.
MS : Oui, ça m'a, ça m'a fait,
bon j'ai eu un service à rendre... et puis, j'aurai voulu
m'intégrer davantage au moment de l'installation, faire des
étiquettes, des, ch'ais pas quoi... Je n'ai pas pu, parce-que j'ai
été appelé par Ol., qui avait des problèmes.
Jm : Alors...
MS : Je ne sais pas encore, parce-que il y a
une personne qui, qui est un peu comme moi, que j'ai rencontré en
randonnée, elle voudrait faire de l'informatique.
Jm : Donc, l'objet de l'adhésion, en
un, c'est naturellement l'informatique, c'est ce qu'on avance, mais quels
seraient les autres, comment dire... quels seraient les, comment
présenteriez vous le club ? Quels seraient les, les valeurs que vous
attribueriez au club et que vous souhaiteriez faire passer auprès d'une
personne que, que, euh... vous verriez bien... qu'elle nous rejoigne au club
?
MS : Oh, ben, voilà, je lui ai
expliqué, que à travers l'informatique, euh... y'avait... toute
une action sociale qui était entreprise, en particulier le travail dans
la prison... euh... le travail auprès des jeunes... Mais, je pense que
je n'ai pas encore tout découvert dans le Club.
Jm : Oui. Alors...
MS : C'est ce qui me gêne !
Jm : Ça viendra !, ça viendra,
c'est vrai qu'il y a autre chose.
MS : Bien sûr !
Jm : Oui. Y'a autre chose.
MS : Y'a tout un foisonnement... et une
ouverture je sens qui est prête, quelqu'un viendrait, dirait :
« moi j'ai envie de créer un Club comme ça, et de
réunir des gens » bon, euh... ce serait accepté.
Alors, cette ouverture me plaît beaucoup... mais je regrette de ne pas
assez m'y intégrer, parce-que... moi aussi je suis
débordée ! (rires)... Dans les associations, je vous ai pas dit,
tout à l'heure, que on a créé un comité de
quartier, de l'avenue d'Chabeuil. J'ai pas trop osé en parler, euh...
avec Rivasi (Député de la Drôme à l'occasion de sa
visite dans nos locaux, ndlr), l'autre jour, parce-que c'était pas le
propos, mais ce qu'elle compte faire, bon ben on le fait ! Et je dirais
même, que Patrick Labaune (le maire de Valence, ndlr) a été
très... très coopérant.
Jm : Alors, comment on pourrait qualifier, le
fait justement, j'insiste un p'tit peu, je voudrais avoir juste un mot, ou une
expression, ou quelques mots, quelques expressions, comment on pourrait
aujourd'hui définir le Club, en quelques mots, un qualificatif ? Bon le
Club, c'est du social, on l'a un p'tit peu précisé tout à
l'heure, vous aviez dit : « y'a un esprit au
club »
MS : Oui.
Jm : Euh... Est-ce que vous avez deux, trois
exemples qui peuvent... qui démontrent cet esprit, qui montrent cet
esprit, au Club ?
MS : Oh, cet esprit, moi je l'ai ressenti,
alors, vraiment, euh... (silence) au moment de l'installation.
Jm : Au moment de la dernière
installation, alors.
MS : Ah oui ! Ah oui. Euh... L. (7è
entretien), par exemple, qui, qui avait, qui a obtenu les clefs du local, et
qui était pas peu fier. Et puis chacun apportant ce qu'il était
capable de donner.
Jm : Alors, on va venir un p'tit peu, on va
re-préciser un p'tit peu le, cette branche. Cette branche Finance, c'est
une branche qui, qui fonctionne comment ? Ça marche comment cette
branche ? (rires)... Dans la technique, hein. Est-ce qu'elle est autonome ?
MS : Elle est autonome, oui !
Jm : Alors, comment c'est organisé ?
(silence) Cette autonomie s'organise de quelle façon ?
MS : Et ben, quand on est dans le, d'abord on
dispose d'une, d'une salle, on se réunit, nous, nous créons nos
objectifs, euh... euh... nous nous sommes structurés lors de la
dernière réunion... On défini un travail, on le suit pas
toujours, mais enfin, on essaie...
Jm : Vous rendez compte des fois, de ce que
vous faites ?
MS : Jusqu'à présent, au
premier trimestre, oui. Et puis, maintenant où nous nous, ça va
être difficile de suivre deux objectifs : l'école de la Bourse et
les Finances. Mais il faudra...
Jm : Oui, oui, pardon. Oui, oui je vous
laisse terminer.
MS : ...Il faudra, ça nous demandera
aussi de nous structurer, pour ne pas faire uniquement de la Finance, et...
délaisser l'école de Bourse. Alors, peut-être, qu'à
travers la Finance, concrètement, on pourra travailler l'école de
Bourse.
Jm : Oui, mais ma question, elle était
: « Est-ce que vous rendez compte au Compu's Club de ce que vous
faites ? », puisque vous disiez « on est
autonome », ma question est de dire « Est-ce
que...
MS : ...Ah oui...
Jm :...quand vous avez fait quelque chose,
l'évolution, ce que vous y faites, etc. Est-ce que vous rendez compte au
Compu's Club ? Est-ce qu'on vous demande des comptes, en fait ?
MS : Alors là, moi, je ne l'ai pas
senti. Non.
Jm : Non, vous n'avez pas senti qu'on vous
demande des comptes...
MS : Y'a Jo (6è entretien, ndlr) qui
fait un compte-rendu pour le Bulletin (le Bulletin Membre Trimestriel, ndlr),
mais ça ne reflète pas le travail de l'équipe.
Jm : Non. Alors justement, ce travail de
l'équipe... euh... ça se passe comment ? Entre les membres, ce
travail ?
MS : Ben au début de l'année,
on a essayé de se structurer à travers une étude...
Quelque chose de concret, on avait à analyser un texte, et à le
présenter aux autres. C'est très long, parce-que nous avons
abordé un chapitre dans un trimestre, (rires)... Alors, il faudra
revoir, est-ce il faut aller plus vite, faire quelque chose de plus
condensé. C'est, c'est à le, c'est à voir. On a un
instrument de travail, ce qui était déjà beaucoup.
Jm : Est-ce que, au-delà de ce
travail, sur, sur le chapitre, sur la Bourse même, sur la Finance, sur
l'Economie même, est-ce que, c'est très long, c'est un outil,
est-ce que ça apporte quelque chose dans la relation entre les membres
?
MS : Oui. Entre les membres du groupe.
Jm : Très bien.
MS : Mais pas du Compu's.
Jm : Non, non du groupe oui.
MS : Oui. Oui. Mais on est quelque fois
gêné, parce-que nous sommes des fois à des niveaux
très différents. Bon alors, je suis vraiment ! Ignare ! Et puis
ça ne m'intéresse pas.
Jm : Vous venez chercher quoi alors dans
cette branche ?
MS : Ben, on est ensemble, et puis
après tout, pourquoi ne pas savoir comment la Finance fonctionne ?
Seulement, cette différence de niveau, fait que, certains parlent de
quelque chose, ils ont... qu'il leur est tout à fait évident, et
pour moi, ça ne l'est pas.
Jm : Alors, qu'est-ce qui vous semble
important, dans le bon fonctionnement de cette branche ? (Silence)
Au-delà des outils qui peuvent être mis en place ? J'entends...
MS : Je, je crois qu'il y a trop de
disparités, et que les finances... ça m'amène à
étudier... Oh pas, pas d'une manière, mais enfin à rentrer
un petit peu dans un monde qui m'est inconnu, mais je ne pense pas que j'y
rentrerai beaucoup.
Jm : Oui. Qu'est-ce qui vous fait rester
alors ?
MS : Ah ben, parce-que, parce qu'il y a les
copains ! (rires)
Jm : Les copains. Alors, qu'est-ce qui vous
la ferait quitter ?
MS : ...Boh, j'ai pas envie de la quitter,
maintenant ! (rires)
Jm : Alors, donc, on... pour essayer de
résumer, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans ce, dans ce groupe, qui
ne relève pas du projet de la branche même ?
MS : Ben c'est les liens qui sont
créés entre nous.
Jm : Les liens. Est-ce qu'on peut avoir...
MS : Je vous dirai que c'est uniquement
ça.
Jm : C'est uniquement ça.
MS : Oui. Et puis un certain engagement, j'ai
l'impression que si je quittais le groupe... Ben, il manquerait les deux cent
francs, que je vais... hein. Il y a le... l'argent qu'on a versé, et
qu'on retire en partant, bon ben c'est un peu frustrant pour les autres, un peu
décourageant !
Jm : Qu'est-ce que vous
préférez, au-delà de la branche Finance ? Qu'est-ce que
vous préférez au Club ?
MS : ...Je ne connais pas assez les autres
branches, parce-que, euh... peut-être le fait que chaque branche soit
très autonome, on sait par des comptes-rendus ce qui se passe dans les
autres branches, mais, euh... on n'y a pas participé. On ne, on ne voit
pas comment ils travaillent, comment... Ce serait peut-être
intéressant...euh d'aller voir comment Libertech travaille, moi
j'aimerai bien aller voir les jeunes, puisque toute ma vie, j'ai, j'ai
travaillé avec des jeunes. Euh... voir comment les jeunes travaillent,
comment le, la branche littéraire travaille... Euh... j'aimerai, par
exemple, accompagner quelqu'un qui va apprendre l'informatique dans la
prison... Allez voir un petit peu comment ça se passe, je crois que je
comprendrai mieux le groupe... et l'esprit du Compu's, si je rentrais un peu
dans... je pense que c'est un peu trop compartimenté, et que le lien est
créé par le journal... mais peut pas rapporter...
Jm : ...oui...
MS : ...toutes les valeurs qu'on peut
vivre...
Jm : Quels avantages, quels avantages, il y a
à compartimenter ? Justement le club ?
MS : Si c'est, c'est bien, parce-que chaque
groupe peut approfondir son travail. Il serait impossible de travailler...
Chaque branche ne pourrait pas vivre. Mais je pense qu'on pourrait inviter...
Dire que ceux qui veulent, peuvent aller voir ce qui ce passe dans les autres
groupes. Mais, euh... en spectateurs. Si ça ne dérange pas.
Jm : Tout à l'heure vous disiez... que
euh... vous parliez de valeurs de chacune des, de chaque branche, euh...
quelles sont ces valeurs ? Que vous avez au sein de la branche Finance ? Et par
extension, quelles peuvent être les valeurs ? Ou comme, comme... quelles
peuvent être, oui, les valeurs du Compu's Club, en général
? (silence) quel serait son fondement ? Et s'appuierait sur quelle valeur au
Compu's Club ?
MS : Je crois qu'il y a une valeur de
partage, qui est très importante. Un partage sur tous les plans, sur le
plan intellectuel et connaissances, moi ce que je connais, je le partage avec
d'autres. Ce que je sais faire, je le mets au service des autres, (silence) et
ça crée une valeur morale de solidarité... (silence)
Surtout ça.
Jm : C'est surtout ça ? Des valeurs de
partage et de solidarité.
MS : Oui....Y'en a, y'en a beaucoup d'autres
qui sont véhiculés d'honnêteté de...de justice, de
sens social, euh... je crois que quand on a un doigt dans l'engrenage, la main
y passe ! (rires)
Jm : Alors, moi j'aimerai bien qu'on revienne
un petit peu sur ces valeurs, pour essayer d'y mettre des, des images, des
représentations... euh... de ce, la valeur solidarité, c'est une
valeur... est-ce qu'on peut avoir un ou deux exemples de solidarité au
sein du club ? Ou au sein de la branche, mais de la branche, on en avait
déjà parlé, au sein du club, est-ce que vous avez
été l'observateur d'un ou deux actes de solidarité ?
MS : Oh ben, lorsque je suis arrivée
dans cette ruche, où tout était en l'air, y'avait des bureaux,
y'avait des planches, y'avait de, des fils qui pendaient de partout, et puis
chacun arrivait, tombait le blouson, prenait... bon s'occupait... euh... de
l'élec, du branchement de l'électricité, un autre...
Jm : C'est quelque chose qui était
spontané ?...
MS : ...Ah oui ! Tout à
fait ! Tout à fait !...
Jm : ...Ou il fallait demander ?...
MS : Tout à fait. Fallait pas
demander, fallait dire qu'il y avait un branchement à faire. Et
puis...
Jm : La valeur d'honnêteté,
est-ce qu'il y a un ou deux exemples qui vous font dire ben là, il y a
une relation honnête ?
MS : (rires) Oui, quand je suis
arrivée, au Club, j'ai proposé... de mettre à la
disposition des autres, mon ordinateur et les programmes que j'avais, et puis
bon, ben j'ai dit que je les avais pi... que j'avais pas tout
acheté...
Jm : Ah ?
MS : Et tout de suite « Je veux
pas le savoir ! » (rires) J'ai compris qu'il ne valait mieux
pas, pas en parler ! En fait, quand on en a parlé entre nous, j'ai
compris qu'il y en avait beaucoup qui le faisait... mais je me suis sentie un
peu coupable là. (rires)
Jm : C'était le but recherché,
d'après vous ?
MS : Oh, je ne pense pas ! Mais enfin, je
pense que dans le club, on, on ne mange pas de ce pain là.
Jm : Et vous parliez de justice, enfin ?
Est-ce qu'il y a un exemple ou deux, euh...une situation qui vous fait dire
« ça, ça a été réglé
selon une valeur justice, ça été réglé
juste » ?
MS : Quelque chose me l'a vraiment fait
sentir, mais... Je ne me souviens pas à partir de quel fait. De quel
exemple... Mais je l'ai senti.
Jm : Très bien. Alors vous participez
au club depuis, un peu plus d'un an, hein, c'est ça ?...
MS : Oui.
Jm : ...Quels ont été les, les
moments forts ? On a parlé tout à l'heure de
l'aménagement, est-ce qu'il existe un autre moment fort ? Euh... et
qu'est-ce que vous avez retenu de, de cet autre moment fort ? (silence)
MS : Je ne sais pas. Bon, ça a
été surtout ce moment-là, qui a été un
moment fort. Je pense qu'il y en a eu, comme l'observation des étoiles,
entendre parler, mais je n'y étais pas... J'étais absente
à ce moment là... (silence)
Jm : Alors, qu'est-ce que
ça...Qu'est-ce que ça vous a apporté ? D'une
manière plus générale ?
MS : Ce que le Club m'a apporté ?
Jm : Oui. Qu'est-ce que ça vous a
apporté ? Qu'est ce que vous retenez de votre participation ?
MS : J'aime bien y aller maintenant ! (rires)
Une certaine... (silence) Oui, la joie de participer à quelque chose...
De participer dans mes faibles mesures, parce-que je, je n'y suis pas, pas
très, très présente, mais de participer à quelque
chose que je trouve très bien.
Jm : Alors, qu'est-ce que, entre
l'entrée au Club, et maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a
changé ?
MS : Oui, parce-que d'abord, j'y suis
à l'aise...euh... c'est, maintenant le Club n'est plus dans mon
quartier, mais je pense que... Ce serait plus proche, j'irai plus souvent, voir
un peu ce qui s'y passe. Maintenant, quand on va voir un peu ce qu'il s'y
passe, on tombe souvent sur des gens qu'on ne connaît pas. Alors
là, c'est plus difficile.
Jm : C'est plus difficile ? Il faut
relancer...les relations ?
MS :...Est-ce qu'il faudrait... Je trouve que
par exemple... une petite réunion ou chacun apporterait sa pizza, sa...
euh... toute simple, et où on apprendrait davantage à se
connaître, on resterait pas entre membres du groupe Finance, mais
où chacun se mélangerait, apporterait quelque chose, ce serait
bien. C'est pour ça, je pense que la soirée des étoiles,
ça devait être quelque chose de, de bien, qui m'a fait envie, mais
je n'ai pas pu.
Jm : Alors, cette sectorisation par branche,
c'est quelque chose qui est, qui est figée, qui est voulue, quelqu'un
qui fait partie de la Finance ne peut pas aller voir les autres ? Vous disiez
que vous aviez envie, en tant qu'invitée, est-ce que c'est quelque chose
où vous avez besoin de demander une autorisation pour faire un petit
tour dans une autre branche ? Ou...
MS : Ben, je n'oserai pas aller m'y pointer
sans...
Jm : Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui gêne
? Qu'est-ce qui freine ?
MS : Ben, je ne voudrais pas d'abord les
gêner....
Retournement K 7 = ¾ d'h
MS : Je ne voudrais pas arriver comme un
cheveu sur la soupe et risquer de gêner, parce-que quelque fois,
quelqu'un qui vient arrête un peu l'expression spontanée... Et
puis, euh... je ne sais pas si ça se fait. Et si ça peut se
faire. Moi je suis très légaliste !
Jm : Alors, si quelqu'un venait dans la
branche finance, en tant que visiteur, comment le ressentiriez vous ?
MS : Ça ne me gênerait pas dans
la mesure... où on le sent coopérant... et où on
connaît ses motivations. Pourquoi est-ce qu'il vient ? Est-ce que c'est
par curiosité ? Si quelqu'un vient dans la branche Finance en se
disant : « est-ce que là je peux retirer de l'argent,
en payant moins d'impôts ? », ça me
déplairait totalement. D'ailleurs ça me déplaît.
(rires). Mais si quelqu'un arrive pour voir comment ça s'passe... ben,
non, ça me gêne pas !
Jm : Donc, retirer de l'argent, enfin venir
pour avoir à payer moins d'impôts, ou gagner de l'argent, c'est
pas l'esprit de la branche Finance ça ? Apparemment...
MS : Non....
Jm :...Tel que vous le ressentez.
MS : Non ! On a tous envie de gagner...
Jm :...Bien sûr !
MS :...C'est humain, On sait toujours que
faire du fric, moi, je ne peux pas dire que je n'aime pas le fric, je sais
toujours qu'en faire, j'en ai jamais assez !
Jm : Alors, qu'est-ce que justement, quel est
l'esprit de la branche Finance ? Au-delà de l'objet même ? Qui est
de gagner de l'argent ?
MS : C'est de faire quelque chose, et de voir
un peu comment ça fonctionne ! Pour moi, c'est ça.
Jm : Curiosité intellectuelle ?
MS : Oui. Et puis, si on peut glaner quelque
chose, euh... ben la réussite... ça, ce serait d'abord une
réussite, ça prouverait qu'on est capable de faire quelque
chose.
Jm : Et donc, si il y avait un échec,
ça vous démontrerait que vous n'êtes pas capable de faire
quelque chose ?
MS : Non. Mais qu'on a pas...
Jm : C'est la cerise sur le gâteau quoi
!
MS : Voui, oui !
Jm : La cerise sur le gâteau, le
gain.
MS : Oui, oui, moi aussi j'aime bien, j'aime
bien réussir !
Jm : Et si vous deviez avoir un échec,
vous, vous euh... vous en retiendriez quoi ? De, de cette relation que vous
avez eue avec le Club ?
MS : Oh ben pas plus ! On partagerait la
cerise, on partagerait l'échec ! (rires)
Jm : Très bien. Alors, tout à
l'heure, vous disiez : « on peut parler
librement ». Compte tenu du nombre de personnes qu'il y a
actuellement au club, même dans la branche, puisque vous êtes
combien dans la branche ? A peu près ?
MS : ...Je ne me souviens pas. Une dizaine
?
Jm : Une dizaine ?
MS : A peine.
Jm : Oui. Une dizaine, euh... vous disiez
« on peut parler librement », dix personnes qui
parlent librement, à mon sens, nécessairement, y'en a qui sont
contre quelque part ? Alors, comment ça se résout ce genre de,
de, de pro... de situation ?
MS : Mais quelqu'un qui est, qui est
vraiment, ou c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment contre l'esprit du
groupe, on en a eu un exemple. Quelqu'un qui est venu voir et qui n'avait pas
du tout... envie de partager...bon, il n'est pas resté. Quand
même, il a refouré son nez, pour voir un peu comment on s'en
sortait, ça m'a pas bien plus d'ailleurs ! Mais enfin, on le reverra
pas, ou du moins pas souvent.... Mais autrement, euh... c'est normal dans un
groupe, heureusement que chacun a son objectif, et... c'est la richesse du
groupe que tout le monde ne soit pas d'accord.
Jm : Alors, comment ça se
résout ? Dans ces situations-là ?
MS : Ben chacun donne ses raisons, on essaie
de les étudier, et puis d'en tirer une conclusion. Ben, en fait on n'a
pas eu de gros désaccord. On en aura peut-être lorsqu'il faudra
investir. D'où l'intérêt d'avoir un conseiller.
Jm : D'avoir un conseiller, alors vous
envisagez solutionner comment ces situations ? Parce-que quelqu'un qui n'est
pas d'accord, qui reste sur sa position, il arrive bien un moment où il
faut prendre une décision ?
MS : Ah ben oui.
Jm : De quelle manière va être
prise cette décision ? (silence) Supposons qu'il y a cinq personnes qui
sont pour, cinq personnes qui sont contre, ou quatre, je ne sais pas, ou deux
personnes qui...
MS : Moi, je pense que, normalement au cours
d'une discussion, si on explique pourquoi on est pour, pourquoi on est contre,
on doit pouvoir arriver à trouver, soit une solution
intermédiaire...
Jm : Un compromis ?
MS : Un compromis. Oui.
Jm : Un compromis ?
MS : Où alors, bon ben il faut
(silence) Si c'est très grave...
Jm : Il faut trancher ?
MS : Et ben ça va claquer...
Jm : Ça va claquer ? Et pour
éviter que ça claque, alors ?
MS : Pour éviter que ça claque,
et ben... quelquefois, on peut pas toujours l'éviter. Si quelqu'un
arrive dans le groupe en pensant qu'il faut absolument travailler d'une
façon, faire, euh... parce qu'il faut gagner... Ben s'il n'est plus en
accord avec le groupe, ben il part.
Jm : Il part ? C'est à dire ? Il
part tout seul ? De fait ? Donc, il a accepté de, euh... que son message
ne passe pas, ou que son idée ne passe pas, il l'accepte tellement
que... il part de lui-même ? Sans heurt ?
MS : S'il ne veut, s'il ne veut pas, ou s'il
ne peut pas, ben il vaut mieux qu'il parte !
Jm : Oui, il vaut mieux, c'est une chose !
Mais d'abord, est-ce qu'il part ? Est-ce qu'il part, euh... de bon coeur ?
Euh... Ben comment ça se fait ? il y a deux choses euh... la
première, c'est on a un conflit, un conflit entre guillemet...
MS : ...Oui, oui, oui...
Jm : ...une situation qui oppose...
MS : ...Oui...
Jm : ...dans une discussion, euh...
« je suis d'accord, vous n'êtes pas
d'accord », ou « j'ai une idée, vous
êtes contre », ou l'inverse, peu importe, il arrive bien
un moment ou il y a une décision à prendre. Mais cette
décision, elle doit être prise, euh... par le groupe...
MS : ...Oui...
Jm : ...Par l'ensemble du groupe ? Oui, donc
comment on solutionne ça ? A un moment donné ? Même si y'en
a qui sont pas d'accord, comment on fait ? On impose, à ceux qui sont
pas d'accord, ben on leur dit : « ben c'est moi qui ai
gagné, toi tu te tais », ou comment on fait ?
MS : Je ne serai pas aussi brutale ! Mais y'a
un moment où on a un choix à faire. (silence) Je pense qu'il y a
d'abord le dialogue, et, je trouve qu'il serait difficile de ne pas arriver
à trouver un point d'entente dans le dialogue. Parce-que celui qui est
contre, il expose ses... ses raisons, on lui répond, on essaie de bien
rentré dans, dans ses objectifs, dans... et si vraiment on y arrive pas,
si on a affaire à quelqu'un qui, si on a affaire à quelqu'un qui
est complètement buté.
Jm : Oui, mais on peut se poser la question
aussi, est-ce que c'est pas soi-même qui, sont, qui, qui est
complètement buté ? Est-ce que c'est pas l'autre qui peut avoir
raison ?
MS : Ah oui, oui, mais moi je pense, que
c'est quand même le groupe qui doit décider ! L'ensemble du
groupe.
Jm : Ah, voilà ! Alors de quelle
manière l'ensemble du groupe décide ?
MS : Ben après la discussion, si, si
vraiment... on vient aux voix.
Jm : Voilà, C'est ça. Les
choses sont votées, et puis, euh... c'est le résultat du vote ?
C'est la majorité qui l'emporte ?
MS : Oui.
Jm : La majorité, donc ça se
sont des valeurs de démocratie ?
MS : Oui.
Jm : Voilà, mais avant les valeurs de
démocratie, vous avez dialogué ?
MS : Ah oui.
Jm : Ce sont des valeurs d'écoutes
?
MS : Ah, oui. Oui, oui.
Jm : De tolérance ?
MS : Oui, oui, oui.
Jm : C'est là où je voulais en
venir. Simplement.
MS : Exactement, exactement. Mais on peut
avoir affaire à des gens intolérants. Ça nous est
arrivé, par exemple au groupe de randonneurs. Un monsieur qui a beaucoup
de qualités, mais qui a un caractère... c'est un
caractériel, qui n'a jamais été corrigé, ni
redressé, et qui a été grossier, et le groupe a
décidé qu'on ne le voulait plus. Qu'on ne pouvait plus accepter
cette attitude ! Alors, on a discuté, moi j'ai dit que... Il fallait
quand même accepter les gens avec leurs qualités et leurs
défauts, puis, je me suis un peu mouillée, j'ai dit bon, qu'on,
qu'on pouvait au moins accepter qu'il fasse des excuses. C'est quelqu'un, sa
femme nous a dit qu'elle n'a jamais, dans sa vie, entendue faire des excuses.
Il ne s'abaisse pas. Et ben, il en a fait.... Il les a fait à sa
manière, il a pris la personne avec qui il avait été
grossier... Il l'a prise à part, il lui a dit on a pas trop su quoi,
elle a été très discrète, elle lui a dit
« c'est terminé, on n'en parle plus », dans
le groupe on n'en a plus parlé, c'est fini, mais il sait très
bien qu'il ne faut pas recommencer.
Jm : Très bien. Et au sein du club, ce
genre de situation ne s'est pas encore produit ?
MS : Oh, je ne pense pas, étant
donné les gens qui sont là, mais enfin, on ne sait jamais, il
peut venir quelqu'un qui soit... obstiné. Par contre, dans le groupe,
y'a eu quelqu'un qui a été pénible parce-que... il
accaparait la parole, et on était peut-être pas assez, et on
était un groupe, on était, y'avait pas assez d'unité pour
pouvoir dominer, et on en a souffert.
Jm : Hum, hum. Aujourd'hui, ce genre de
situation vous pourriez mieux la maîtriser ?
MS : Je pense.
Jm : Vous feriez quoi ? (silence)
MS : Ben, il faudrait voir comment ça
se présente.
Jm : Il accapare la parole.
MS : ...Mais peut-être euh... lui...
Donner la parole à d'autres, dire « toi qu'est-ce que tu
en penses ? », pour arrêter le flot. Sans dire à
quelqu'un, bon vous a, on peut pas être grossier, lui dire
« ça suffit, laissez parler les autres »,
mais on peut dire, par exemple : « bon ben Je (un
membre du Club, ndlr), tu n'as pas parlé, toi »,
« telle personne n'a pas parlé », en fait,
faire un petit peu une animation de groupe...
Jm : Alors, lorsque vous venez au club, dans
quel état d'esprit vous vous trouvez ? Vous vous sentez comment ?
(silence) (long silence) (très long silence)
MS : Je ne sais pas. Je suis contente d'y
aller.
Jm : Oui, euh... voilà. Contente.
Alors, comment préciser ce "content" ? Vous arrivez quand vous venez au
Club, vous venez à pieds, vous sifflotez, vous... vous courrez
après les papillons...je pastiche, hein, on est d'accord ?
MS : Mon chien m'a accompagné,
(rires)
Jm : Je pastiche, mais c'est ça,
est-ce qu'il y a des... des images qui montrent...
MS : Je me suis demandée si, si je
gardais mon chien, pour rentrer le soir ! (rires)
Jm : Oui. Est-ce que vous avez le coeur
léger ? Vous sautillez, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles,
vous sautez au plafond...
MS : Ça dépend...
Jm : ...Vous courrez, vous vous roulez par
terre ?...
MS : Ça dépend, quelquefois,
vite, vite, il faut que j'y aille, euh... j'ai eu une rencontre avant, je suis
en retard, et je ne voudrais vraiment pas arriver en retard, parce-que je veux
que le groupe ait plus d'exigences ! (rires)
Jm : Etre un exemple, c'est beaucoup plus
fort que de demander aux autres ?
MS : Ben, on peut demander que si
soi-même on respecte...
Jm : C'est ça.
MS : J'sais pas... Comme je vais à la
chorale, je suis contente d'aller chanter. Quand je vais en randonnée,
je suis contente d'aller marcher.
Jm : Alors, on arrive au bout, hein. Quels
sont, selon vous, les obstacles à une... participation plus importante
des membres du Club ? Au sein du Club ?... La vôtre, vos obstacles
à vous, c'était le manque de disponibilités, vous
êtes très prise, euh... ce... ceci dit, vous avez exprimé
l'envie, éventuellement, de vous approcher, de voir un petit peu ce qui
se passe dans les autres branches, on en a discuté tout à
l'heure, mais, en tant qu'observateur, euh... d'une manière
générale au sein du Club, quels, quels sont les obstacles qui
empêchent, pour tous les membres, d'après vous, une meilleure...
une participation plus importante ?
MS : Moi je pense que c'est un peu ce
cloisonnement, et qu'il manque une, une réunion, où on est
là simplement pour faire connaissance les uns avec les autres.
Habituellement c'est...
Jm : Ça, c'est une mesure pour
l'améliorer le Club.
MS : ...Chacun apporte quelque chose,
parce-qu'en grignotant bon ben, on va, là y a celui qui sert, qui...
« toi, je te connais, toi, je te connais pas ».
Une volonté, d'abord, peut-être, une volonté de
connaître les membres du Club.
Jm : Ça, c'est euh... c'est ce qu'il
faudrait faire pour améliorer les relations entre, entre les membres,
mais aujourd'hui...
MS : ...Même pour les créer
!...
Jm : ...Oui, oui c'est ça !
MS : Parce-que Alain, je ne le connaissais
pas du tout. Mais je ne lui ai jamais parlé !
Jm : Pourtant il y est souvent Alain, hein.
Il vient pendant les libres services.
MS : Oui...Mais je, je l'ai, je l'ai vu
à l'action... ça me l'a rendu bien sympathique, j'ai bien envie
de lui parler ! Mais, (rires) j'ai pas eu l'occasion.
Jm : Alors, aujourd'hui, là, de ce
qu'on voit, quels sont les obstacles ? Qu'est-ce qui freine aujourd'hui, pour
que les membres participent à plus de branches ? Participent encore plus
euh... à ce lien social qui peut y avoir au sein du Club, participent
encore plus à la construction, au développement de
l'association ?
MS : On est nombreux.
Jm : On est trop nombreux ? Ça
peut-être un obstacle ?
MS : C'est pas un réel... C'est une
difficulté, plus qu'un obstacle. C'est une difficulté
parce-que... quand on se rencontre, euh... par exemple pour, euh... euh...
l'accueil de Madame Rivasi... bon ben j'ai vu des gens que je ne connais pas du
tout. Et, je ne les connais pas plus, parce-que l'objectif n'est pas de se
connaître. Mais, y'aurait des, on se réunirait quelque fois, comme
ça, par petit groupe, en mêlant, faut pas qu'on soit trop
nombreux, parce-que y'a toujours des gens qu'ont... je pense qu'il faut avoir
une volonté de se réunir, de se rencontrer, et de savoir qui fait
quoi.
Jm : Alors, justement, vous vous étiez
proposée, au sein de la branche Finance, d'être la personne qui
fait le lien avec ceux qui pourraient temporairement s'éloigner, pour
essayer de, de garder un contact. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh...
qui vous plairait ? Vous verriez comment l'organisation d'une chose qui, qui
permettraient à des membres de diverses branches, ou qui participeraient
à des branches, parce-qu'on a aussi des membres qui ne participent pas
à des branches, à se réunir sous forme de, d'autres
groupes, sans que ce soit des groupes formalisés comme une branche en
suivant un projet ? Uniquement pour que l'on puisse échanger, se
rencontrer. Vous verriez comment la chose ? Quelles seraient les valeurs ou le
fondement à mettre en place ? Et quels seraient les outils qu'il
faudrait mettre en place pour y arriver ?
MS : (Silence) Alors d'abord une meilleure
connaissance du Compu's. Parce-que ceux qui arrivent prennent le train en
marche.... Donc l'accueil de ceux qui arrivent, il faudrait bien leur
présenter... toutes les branches, avant de le, de les laisser choisir.
Peut-être qu'ils aillent voir dans les branches ce qu'il se passe,
à moins qu'ils arrivent avec un but bien défini
« je veux faire partie du groupe Finance ». Ce qui
est peut-être la majorité des cas.
Jm : Dans les branches euh...
MS : Pour moi, je crois que j'aurais, il
aurait été peut-être, j'aurais, je ne regrette rien, mais
enfin au point de vue activités, peut-être que la branche
littéraire m'aurait plu davantage.
Jm : On revient au Compu's Club, à
l'objet d'adhésion, au Compu's club, c'est l'informatique, nous avons
une étiquette informatique...
MS : Oui.
Jm : ...les gens découvrent
après...
MS : Oui, oui.
Jm : Voilà. Alors quelles seraient
encore les, les façons de faire, les outils qu'il faudrait mettre en
place pour essayer de... de créer des groupes informels, qui seraient
très disparates, des gens de toutes branches...
MS : Je n'ai pas du tout
réfléchit, mais je pense que... On fait beaucoup de choses pour
la relation personnelle, la relation entre individu, euh... quand il y a le,
la, le grignotage. Un apéritif avec grignotage. D'abord, si les gens
apportent quelque chose, ils se sentent partie prenante. Il faut pas que ce
soit la même personne qui fasse les pizzas, même si elles sont
très bonnes, moi les miennes seront moins bonnes, parce-que je suis pas
cuisinière, mais je pense que c'est important que chacun apporte quelque
chose. Ne serait-ce qu'une bouteille de jus de fruits. Je pense par exemple,
aux randonnées, on mange ensemble, ben y'en a, y'en a un... euh... c'est
surtout au dessert, y'en a un qui fait passer une tablette de chocolat et puis
une boite de petits gâteaux. Y'a les messieurs qui offrent la poire,
l'apéritif, et puis après, on se taquine là-dessus, et
puis y'a l'eau chaude pour le café, tout le monde n'apporte pas de l'eau
chaude, ben c'est très... que chacun apporte quelque chose au groupe. On
apporte par sa présence, mais, même matériellement, un
petit quelque chose, je trouve que c'est très important.
Jm : C'est Aristote déjà...
MS : Oui.
Jm : ...Qui disait que justement, vous
connaissiez ?
MS : Oui, oui.
Jm : Qui disait que si chacun apportait son
écot à un pique-nique, euh... c'était beaucoup plus que la
somme de, de ce que chacun avait apporté.
MS : Bien sûr !
Jm : Ça c'est intéressant,
peut-être il faudra réfléchir à...
MS : Je ne sais pas du tout comment
l'organiser ? Comment ça peut se faire ?
Jm : Faudra réfléchir.
MS : Est-ce que ça peut être
uneee... comme vous avez fait pour les étoiles (manifestation ponctuelle
avec pique-nique et observation astrologique, ndlr), mais simplement un
pique-nique ou on fait des brochettes, par exemple, ce qui veulent viennent, et
puis... ou on partage. Euh... je, je n'ai pas réfléchi. Mais je
pense que pour s'connaître, c'est important.
Jm : Très bien, ben écoutez...
on a fait le tour, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter de
particulier ? (silence)
MS : J'allais, j'allais dire que... il serait
important... `Fin, moi je pense qu'il serait important de donner les grandes
lignes de la vie du, du Compu's Club, au début de chaque réunion.
Parce-qu'on est un groupe, mais inséré...dans une association. Et
je suis un peu restrictive pour le dire, parce-que j'ai senti, lorsque vous
l'avez fait quelques fois, y'en a un qui disait « allez vite
passons aux Finances », alors je trouve que c'est...c'est
délicat, ce, ce serait quand même bien de donner les grandes
nouvelles du club.
Jm : Bon, c'est entendu, on va y
réfléchir, je vous remercie beaucoup...
MS : Je sais pas trop comment, ça
risque aussi de dire « ça nous retarde
ça... ». Ça retarde pas, si on commence à
l'heure, je suis toujours dans mes... (rires)
Jm : Vous aviez, vous vous souvenez de ce
questionnaire qui avez été diffusé, il y a six ou neuf
mois, c'était aussi dans le cadre de, du, du même ..., hein, du
..., euh... vous aviez répondu à une question euh... "est-ce que
vous lisez le Bulletin Trimestriel ?" vous avez répondu
"entièrement", et la rubrique que vous avez
préférée ? est "Civis".
MS : Oui.
Jm : Qu'est-ce qui, pourquoi Civis en
particulier ?
MS : Parce-que je pense que ce sont les
idées qui mènent le monde.
Jm : Alors, quelles sont les idées de
Civis qui vous... qui vous semblent mener le Compu's Club ?
MS : Parce-que Civis défini un peu les
objectifs du Compu's Club.
Jm : Ah bon ?
MS : A travers le Bulletin. Euh... quand on
commence à lire "Civis", on se dit « ben c'est pas une
association qui se réunit pour faire du fric, pour, euh... pour la
gloriole, pour... » On voit qu'il y a un sens social, à
travers cette rubrique de Civis. (silence) Je sais pas si je m'explique
bien.
Jm : Si, si tout à fait.
MS : Ça défini un petit peu les
objectifs...
Jm : Alors, quels sont...
MS : Indirectement les objectifs.
Jm : Alors donc, quels sont les objectifs que
vous avez retenus ? Qui ont été défini dans Civis ? Qui
ont donnés la ligne de conduite ?
MS : Je peux pas. Je peux pas vous le dire.
ça m'a plu mais je n'peux pas...
Jm : On peut pas préciser ?
MS : Non. (rires) Je l'ai bu !
Jm : Voilà... Vous n'avez pas
répondu à la question, "le club est-il pour vous...", toujours
sur le même questionnaire, "...un lieu de rencontre favorisant
l'enrichissement individuel ?"
MS : Non, parce-que, à ce moment
là, c'était pas passé.
Jm : Aujourd'hui, vous répondriez quoi
?
MS : ...Ben j'y vois plus clair... J'allais
dire, je me suis pas assez investie dans le club, mais je sais pas si je peux
m'investir plus, parce-que j'ai trop d'activités, et que c'est venu un
peu comme ça. Mais enfin, on peut quand même, si. Je connais
davantage... je connais davantage le Club, je connais davantage les personnes
qui le composent, donc c'est un enrichissement !
Jm : Et cet enrichissement, il vient de, de
quoi ?
MS : Du contact, de ce qu'on se connaît
davantage, ça...et ça passe !
Jm : Tout ce qu'on a dit, ça passe
?
MS : Voilà.
Jm : Ça passe. Bien, ben
écoutez, merci beaucoup................
Annexe 15 Valeurs et indicateurs relevés au
cours des entretiens
Valeurs morales, psy & spirit
|
Valeurs d'être
|
Valeurs républicaines
|
Indicateurs descriptifs
|
Autres indicateurs
|
Amitié
|
Amour
|
Civisme
|
Association
|
Accueil
|
Bénévolat
|
Bien-être
|
Démocratie
|
Autonomie de la branche
|
Appropriation
|
Camaraderie
|
Bonté (valeur d'être)
|
Education
|
Autre association satisfaisante
|
Chômage
|
Conscience collective
|
Confiance
|
Education populaire
|
branches connues
|
Consommation
|
Entraide mutuelle
|
Don
|
Egalité
|
Configuration
|
Insertion professionnelle
|
Ethique
|
Ecoute
|
Justice
|
Dépliant
|
Insertion sociale
|
Famille
|
Engagement
|
Liberté
|
Embauche
|
Pédagogie
|
Partage
|
Motivation
|
Liberté d'expression
|
Emploi
|
Projet
|
Relations interpersonnelles
|
Participation
|
|
Fiches cuisines
|
Reconnaissance
|
Respect
|
Responsabilités
|
|
Hasard
|
Rencontres
|
Solidarité
|
|
|
Informatique
|
Satisfaction personnelle
|
Soutien psychologique
|
|
|
Informatique outil
|
|
Tolérance
|
|
|
Livre
|
|
|
|
|
Magasin
|
|
|
|
|
Membre ami
|
|
|
|
|
Organisation de la branche
|
|
|
|
|
Organisation du Club
|
|
|
|
|
Proximité
|
|
|
|
|
Sdava
|
|
|
|
|
Sport
|
|
|
|
|
Syndicat
|
|
|
Détail des valeurs et indicateurs par
entretien
NB Réponses A
|
|
NB Réponses H
|
|
NB Réponses S
|
|
NB Réponses N & Ph
|
|
NB Réponses JC
|
|
Indicateurs A
|
Som
|
Indicateurs H
|
Som
|
Indicateurs S
|
Som
|
Indicateurs N & Ph
|
Som
|
Indicateurs JC
|
Som
|
(vide)
|
3
|
Accueil
|
1
|
(vide)
|
4
|
(vide)
|
2
|
(vide)
|
2
|
Amitié
|
5
|
Association
|
1
|
Accueil
|
2
|
Appropriation
|
2
|
Autonomie de la branche
|
1
|
Amour
|
2
|
Autonomie de la branche
|
2
|
Appropriation
|
1
|
Bénévolat
|
4
|
Autre association satisfaisante
|
1
|
Autre association satisfaisante
|
1
|
Bien-être
|
1
|
Association
|
1
|
branches connues
|
3
|
Bénévolat
|
1
|
Bénévolat
|
3
|
branches connues
|
4
|
Autonomie de la branche
|
4
|
Camaraderie
|
1
|
branches connues
|
3
|
Bien-être
|
6
|
Camaraderie
|
1
|
branches connues
|
1
|
Consommation
|
1
|
Configuration
|
4
|
Bonté (valeur d'être)
|
1
|
Chômage
|
1
|
Camaraderie
|
2
|
Dépliant
|
1
|
Conscience collective
|
1
|
branches connues
|
2
|
Confiance
|
3
|
Civisme
|
1
|
Education
|
2
|
Démocratie
|
2
|
Civisme
|
2
|
Configuration
|
1
|
Configuration
|
5
|
Egalité
|
1
|
Dépliant
|
1
|
Configuration
|
10
|
Education
|
3
|
Consommation
|
2
|
Emploi
|
2
|
Don
|
1
|
Conscience collective
|
1
|
Embauche
|
1
|
Education
|
4
|
Engagement
|
2
|
Education
|
5
|
Démocratie
|
3
|
Emploi
|
1
|
Education populaire
|
1
|
Fiches cuisines
|
1
|
Engagement
|
2
|
Ecoute
|
1
|
Engagement
|
2
|
Engagement
|
1
|
Informatique
|
5
|
Entraide mutuelle
|
2
|
Education
|
3
|
Insertion professionnelle
|
3
|
Entraide mutuelle
|
3
|
Informatique outil
|
5
|
Informatique
|
4
|
Education populaire
|
1
|
Insertion sociale
|
3
|
Ethique
|
1
|
Insertion sociale
|
2
|
Insertion sociale
|
2
|
Engagement
|
2
|
Livre
|
2
|
Hasard
|
1
|
Liberté
|
2
|
Liberté
|
3
|
Entraide mutuelle
|
3
|
Motivation
|
1
|
Informatique
|
4
|
Membre ami
|
1
|
Liberté d'expression
|
2
|
Ethique
|
1
|
Organisation de la branche
|
1
|
Insertion sociale
|
2
|
Motivation
|
2
|
Organisation de la branche
|
1
|
Informatique
|
1
|
Organisation du Club
|
3
|
Liberté
|
2
|
Organisation de la branche
|
1
|
Organisation du Club
|
1
|
Informatique outil
|
3
|
Pédagogie
|
5
|
Magasin
|
1
|
Organisation du Club
|
2
|
Partage
|
1
|
Insertion professionnelle
|
2
|
Reconnaissance
|
1
|
Motivation
|
2
|
Partage
|
4
|
Pédagogie
|
2
|
Justice
|
1
|
Relations interpersonnelles
|
4
|
Organisation de la branche
|
2
|
Reconnaissance
|
3
|
Projet
|
2
|
Liberté
|
1
|
Respect
|
1
|
Organisation du Club
|
2
|
Relations interpersonnelles
|
2
|
Relations interpersonnelles
|
2
|
Liberté d'expression
|
1
|
Sdava
|
1
|
Partage
|
2
|
Satisfaction personnelle
|
2
|
Rencontres
|
7
|
Magasin
|
1
|
Solidarité
|
3
|
Pédagogie
|
4
|
Sport
|
1
|
Respect
|
3
|
Participation
|
2
|
Soutien psychologique
|
1
|
Proximité
|
1
|
Total
|
54
|
Responsabilités
|
1
|
Pédagogie
|
6
|
Tolérance
|
2
|
Reconnaissance
|
1
|
|
|
Satisfaction personnelle
|
3
|
Reconnaissance
|
1
|
(vide)
|
4
|
Relations interpersonnelles
|
1
|
|
|
Solidarité
|
1
|
Relations interpersonnelles
|
8
|
Total
|
57
|
Satisfaction personnelle
|
2
|
|
|
Tolérance
|
2
|
Rencontres
|
1
|
|
|
Solidarité
|
2
|
|
|
Total
|
63
|
Respect
|
1
|
|
|
Soutien psychologique
|
3
|
|
|
|
|
Responsabilités
|
1
|
|
|
Syndicat
|
1
|
|
|
|
|
Satisfaction personnelle
|
3
|
|
|
Tolérance
|
1
|
|
|
|
|
Solidarité
|
5
|
|
|
Total
|
67
|
|
|
|
|
Soutien psychologique
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tolérance
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NB Réponses Jo
|
|
NB Réponses L
|
|
NB Indicateurs Au
|
|
NB Réponses MS
|
|
Données
|
Som
|
Indicateurs Jo
|
Som
|
Indicateurs L
|
Som
|
Indicateurs Au
|
Som
|
Indicateurs MS
|
Som
|
NB Indicateurs A
|
89
|
(vide)
|
4
|
(vide)
|
1
|
(vide)
|
|
(vide)
|
2
|
NB Indicateurs H
|
53
|
Amitié
|
6
|
Accueil
|
1
|
Bénévolat
|
3
|
Accueil
|
1
|
NB Indicateurs S
|
63
|
Association
|
1
|
Amitié
|
1
|
Bien-être
|
4
|
Amitié
|
3
|
NB Indicateurs N & Ph
|
52
|
Autonomie de la branche
|
1
|
Autonomie de la branche
|
3
|
branches connues
|
1
|
Autonomie de la branche
|
2
|
NB Indicateurs JC
|
61
|
Autre association satisfaisante
|
1
|
Autre association sarisfaisante
|
1
|
Camaraderie
|
4
|
Autre association satisfaisante
|
2
|
NB Indicateurs Jo
|
78
|
Bénévolat
|
2
|
Bénévolat
|
2
|
Configuration
|
4
|
Bien-être
|
2
|
NB Indicateurs L
|
56
|
branches connues
|
3
|
Bien-être
|
6
|
Conscience collective
|
1
|
Civisme
|
1
|
NB Indicateurs Au
|
44
|
Camaraderie
|
2
|
branches connues
|
1
|
Don
|
1
|
Confiance
|
1
|
NB Indicateurs MS
|
56
|
Confiance
|
1
|
Camaraderie
|
1
|
Education
|
2
|
Configuration
|
5
|
|
|
Configuration
|
10
|
Configuration
|
2
|
Education populaire
|
1
|
Conscience collective
|
1
|
|
|
Conscience collective
|
2
|
Démocratie
|
1
|
Embauche
|
2
|
Démocratie
|
1
|
|
|
Démocratie
|
1
|
Dépliant
|
1
|
Emploi
|
1
|
Education
|
2
|
|
|
Ecoute
|
1
|
Ecoute
|
1
|
Engagement
|
2
|
Emploi
|
1
|
|
|
Education
|
1
|
Education populaire
|
1
|
Entraide mutuelle
|
3
|
Engagement
|
1
|
|
|
Engagement
|
2
|
Engagement
|
3
|
Insertion sociale
|
1
|
Ethique
|
2
|
|
|
Entraide mutuelle
|
2
|
Entraide mutuelle
|
2
|
Liberté
|
2
|
Famille
|
1
|
|
|
Informatique
|
3
|
Famille
|
2
|
Motivation
|
6
|
Informatique
|
1
|
|
|
Insertion professionnelle
|
1
|
Informatique
|
1
|
Participation
|
1
|
Informatique outil
|
1
|
|
|
Insertion sociale
|
5
|
Informatique outil
|
1
|
Pédagogie
|
2
|
Insertion sociale
|
1
|
|
|
Liberté
|
1
|
Insertion sociale
|
1
|
Relations interpersonnelles
|
1
|
Justice
|
1
|
|
|
Liberté d'expression
|
1
|
Liberté
|
6
|
Satisfaction personnelle
|
2
|
Liberté
|
1
|
|
|
Magasin
|
1
|
Membre ami
|
1
|
Total
|
44
|
Liberté d'expression
|
1
|
|
|
Organisation de la branche
|
1
|
Organisation de la branche
|
1
|
|
|
Magasin
|
1
|
|
|
Partage
|
1
|
Projet
|
3
|
|
|
Partage
|
3
|
|
|
Participation
|
1
|
Reconnaissance
|
1
|
|
|
Participation
|
2
|
|
|
Pédagogie
|
1
|
Relations interpersonnelles
|
3
|
|
|
Projet
|
2
|
|
|
Projet
|
4
|
Rencontres
|
1
|
|
|
Relations interpersonnelles
|
4
|
|
|
Reconnaissance
|
1
|
Responsabilités
|
1
|
|
|
Respect
|
1
|
|
|
Relations interpersonnelles
|
8
|
Solidarité
|
3
|
|
|
Satisfaction personnelle
|
2
|
|
|
Rencontres
|
1
|
Soutien psychologique
|
1
|
|
|
Solidarité
|
5
|
|
|
Responsabilités
|
3
|
Tolérance
|
3
|
|
|
Soutien psychologique
|
2
|
|
|
Satisfaction personnelle
|
2
|
Total
|
57
|
|
|
Tolérance
|
2
|
|
|
Solidarité
|
1
|
|
|
|
|
Total
|
58
|
|
|
Soutien psychologique
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tolérance
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annexe 16 Valeurs retenues par
Rokeach
|
Valeurs retenues par Rokeach505(*)
|
|
Valeurs terminales
|
Valeurs instrumentales
|
|
· Une vie aisée
· Une vie passionnante
· Un sentiment d'accomplissement
· Un monde en paix
· Un monde de beauté
· L'égalité
· La sécurité familiale
· La liberté
· Le bonheur
· L'harmonie
· L'harmonie intime
· La plénitude amoureuse
· La sécurité nationale
· Le plaisir
· Le salut
· Le respect de soi
· Un statut social reconnu
|
· L'amitié authentique
· La sagesse
· Ambitieux
· Large d'esprit
· Capable
· Gai
· Propre
· Courageux
· Indulgent
· Serviable
· Honnête
· Imaginatif
· Indépendant
· Intellectuel
· Logique
· Aimant
· Obéissant
· Poli
· Responsable
· Maître de soi
|
|
Cette liste est extraite de l'ouvrage de Pierre
Valette-Florence, Les styles de vie. Fondements, méthodes et
applications, Paris : Economica, 1989.
|
* 1 Voir Annexe 1.
* 2 Ifac : Institut de
formation de l'association Compu's Club.
* 3 NTIC : Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication. Appelés aussi TIC
: Technologies de l'Information et de la Communication ou NTI, Nouvelles
Technologies de l'information. qualifiées parfois de "technologies de
l'intelligence".
* 4 Depuis la mi-2001
plusieurs nouvelles branches se sont créées, voir annexe 1.
* 5 Dont 103 adhérents
à jour de leur cotisation.
* 6 Extrait des statuts de
l'association.
* 7 La branche est aussi appelée section ou
activité par certains membres.
* 8 Voir annexe 1 pour
plus de détails.
* 9 Nous trouvons là
les deux acceptions d'ampleur différente du terme association : 1)
en un sens générique, il sert à désigner tout
groupement volontaire et permanent formé entre plusieurs
personnes ; 2) en un sens spécifique, proprement juridique (loi du
1er juillet 1901), il désigne « la convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon
permanente, leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que
de partager des bénéfices. »
* 10 Ce pourcentage semble élevé en
comparaison des chiffres de l'enquête du Credoc "Les
Français et la vie associative" (13%) Voir Annexe 2.
* 11 Maffesoli, Michel, Le
temps des Tribus, La table ronde, 2000, p.XII.
* 12 Maffesoli, M., Le
temps..., ib., p.XI.
* 13 Observation avec
participation observante parce que notre position était
déjà prise au sein de l'organisation au moment de
l'observation.
* 14 Lévi-Strauss,
Claude, L'identité, émission de France Culture (Partage
d'exotisme), 05-08-00, 90'.
* 15 Voir Annexe 1.
* 16 CEB : Comprendre
l'Économie et la Bourse. Voir Annexe 1.
* 17 Ce qui fût fait
en janvier 2001.
* 18 Cf. les propos de son
fondateur.
* 19 La valorisation de
l'individu doit être interprétée comme un ensemble d'actes
et d'actions autour de valeurs partagées permettant « une
[mise en] capacité d'autonomie conduisant à l'affirmation de
l'individu comme principe, comme valeur ». Renaut, Alain,
L'individu, Hatier, coll. Optiques, 1995, p.6.
* 20 « Pour être dans le
monde », nous dirait Louis Dumont : Individu-dans-le-monde /
Individu-hors-du-monde : « L'individu, s'il est "non social"
en principe, en pensée, est social en fait : il vit en
société, "dans le monde". En contraste, le renonçant
indien (Indes) devient indépendant, autonome, un individu, en quittant
la société proprement dite, c'est un
"individu-hors-du-monde" ». Dumont Louis, Homo aequalis,
1976.
* 21 Nos observations
constatent, rappelons-le, un apparent changement. Or le changement d'un membre
peut échapper à notre observation. Pour faire court, nous dirons
que "certains membres" signifie que l'on doit réunir les
éléments suivants : 1) il faut le côtoiement entre
nous et l'observé, 2) il nous faut connaître un état
antérieur de l'observé et 3) il faut une période
d'observation suffisamment longue que nous apprécierons au cas par
cas.
* 22 Encyclopædia
Universalis, Cd-Rom, 1998. A partir des définitions de la psychologie
sociale que nous avons été amené à remarquer, lors
des cours de Dheps de deuxième année auprès de Georges
Eid, 1) la jeunesse du champ, apparue dans un livre de Tarde, "Etudes de
psychologie sociale", vers 1891, 2) la difficulté de définir le
concept : « étude de l'homme en
société » (Mac Dougal, Introduction à la
psychologie sociale, 1908) ; « étude de l'homme en
société, elle peut-être centrée sur l'homme
individuel ou sur la société comme telle »
(Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique, 1962) ;
« étude des rapports entre l'homme et la
société ou ce qui en tient lieu dans le monde
contemporain » (Abraham Mole, Théorie des objets,
années 70) ; « étude des articulations au sein
des individus, entre individus et groupe social, entre groupe social et
milieu » (Wilhem Doise, L'explication de la psychologie sociale,
vers 1980) ; « Interaction des processus sociaux et
psychologiques au niveau des conduites concrètes. Interaction des
personnes et des groupes dans le cadre de la vie quotidienne »
(Maisonneuve, Jean, Introduction à la psychosociologie).
* 23 Jodelet, Denise,
Représentations sociales : phénomènes, concepts et
théories, in Moscovici, Serge, Psychologie sociale, Puf, 1984,
p.357.
* 24 Goffman, Erving, 1959
in Moscovici, Serge, Psychologie sociale des relations à
autrui, Nathan, coll. Fac, 2000, p.48.
* 25 « On
distinguera le processus psychologique d'identification à autrui,
étape essentielle, pour Freud, de la constitution de la personne
humaine, des identifications à des groupes plus vastes, identification
à sa famille, à un groupe de pairs, à sa profession,
à sa classe, à son pays. » Dictionnaire des
sciences humaines - Anthropologie/Sociologie - Nathan, p.173.
* 26 Firth, Raymond-William,
Encyclopædia Universalis 1998 à Firth.
* 27 Dictionnaire des
sciences humaines, ib.
* 28 Elias, Norbert, La
société des Individus, Fayard, coll. Pocket, 1991, p.14.
* 29 Elias, Norbert,
Qu'est-ce que la sociologie ?, Pandora/Des Sociétés, 1981,
pp.156-157.in Elias, N., La Société..., ib.
* 30 Elias, N., La
Société..., ib., p.17.
* 31 «En réfléchissant, ce
que nous avons en réalité sous les yeux tous les jours, qui nous
permette de comprendre comment la multitude d'individus isolés forment
quelques chose qui est quelque chose de plus et quelque chose d'autre que la
réunion d'une multitude d'individus isolés» Elias, N.,
La Société..., ib., p.41.
* 32 Barbara Cassin,
Chercheuse au CNRS, in l'émission de télévision
Les mots de la psychanalyse - l'équité, La
Cinquième, 17 avril 2000. Norbert Elias prend l'image d'un
«filet qui est fait de multiples fils reliés entre eux.
Toutefois ni l'ensemble de ce réseau ni la forme qu'y prend chacun des
fils ne s'explique à partir d'un seul de ces fils, ni de tous les
différents fils en eux-mêmes ; ils s'expliquent uniquement par
leur association, leur relation entre eux. Cette relation crée un champ
de forces dont l'ordre se communique à chacun des fils, et se communique
de façon plus ou moins différente selon la position et la
fonction de chaque fil dans l'ensemble du filet. La forme du filet se modifie
lorsque se modifient la tension et la structure de l'ensemble du réseau.
Et pourtant ce filet n'est rien d'autre que la réunion de
différents fils ; et en même temps chaque fil forme à
l'intérieur de ce tout une unité en soi ; il y occupe un place
particulière et prend une forme spécifique» Elias, N.,
La société..., ib., p.15.
* 33 Pour Renaud Sainsaulieu
« l'individualité [se situe] non pas comme une
entité de départ sur laquelle se construit le monde social, mais
bien comme le résultat du jeu des relations socialement inscrites dans
l'expérience de la lutte et du conflit ».
* 34 « Nous ne
parvenons à une conception indiscutablement claire du rapport de
l'individu et de la société qu'à partir du moment
où l'on inclut dans la théorie de la société le
processus d'individualisation, le devenir permanent des individus au sein de
cette société.» Elias, N., La Société...,
p.63.
* 35 Certeau, Michel (de),
L'invention du quotidien 1. arts de faire, Gallimard, coll. folio/essais, 1990,
p.14.
* 36 Voir pages
précédentes. Le principe fondateur est basé sur
l'échange et l'entraide bénévole qui implique de ne pas
distinguer celui qui aide de celui qui est aidé. Chacun peut rejoindre
le Compu's Club pour soutenir et aider les autres au travers des
différentes activités, participant ainsi à la valorisation
des autres et à la sienne propre ce qui permet l'implication
autonome et responsabilisante du membre.
* 37 Dans le but de
faciliter notre compréhension des articulations des divers
mécanismes en jeu il est utile d'exprimer ce que nous entendons par
"redynamisation" ou "retrouver une dynamique". "Retrouver une dynamique" est le
passage d'un état vers un autre état sous-entendant une
amélioration. Cette amélioration doit pouvoir être
observable, mesurable et évaluable par des outils appropriés, ou
bien (pourquoi pas ?) exprimée par le sujet
bénéficiaire, lui-même, comme un "mieux être", un
"mieux vivre". Alors, si une "dynamique" est le passage d'un
état à un autre, il doit s'agir d'un mouvement, d'une action,
d'une énergie. Cela signifie que "retrouver une dynamique" est aussi en
relation avec le temps, la durée.
* 38 Renaut, A., L'individu,
op. cit., p.6. Dumont, Louis, Homo aequalis (1976) et Essais sur
l'individualisme, Coll. Esprit/Seuil, 1991. Ehrenberg, Alain, L'individu
incertain, Calmann-Lévy, coll. Pluriel, 1995. Elias, Norbert, La
société des individus, Fayard, coll. Pocket, 1987.
* 39 Qu'est-ce qui fait que
certains membres de ce club informatique semblent, indépendamment de
l'outil, changer ?
* 40 Cf. l'introduction
générale qui décrit ces changements.
* 41 Paul-Henri Chombart de
Lauwe parle d'unité de vie sociale : « l'unité
de vie sociale est une unité de vie quotidienne, une unité
d'usage, une unité de relation [...] Elle a une
existence. » Chombart de Lauwe, Paul-Henri, Pour une sociologie
des aspirations, Denoël-Gonthier, 1971, p.128.
* 42 Individu : du
latin individuus, qui ne peut se diviser.
* 43 Leibniz, Gottfried
Wilhelm, La monadologie, Association des Bibliophiles Universels, Version 1,
août 1997, paragraphe 9, à partir de l'édition
française de 1840.
* 44 Fisher, Gustave-Nicolas, Les concepts
fondamentaux de la psychologie sociale, Dunod, 1996, p.28.
* 45 Aborder l'individu sous
sa distinction biologique nous aurait mené à nous demander s'il
est réservé à l'homme. Ainsi, même s'il
présente dans sa structure les traces de son originalité comme
ses empreintes digitales ou son code génétique, on peut trouver
des singularités chez les végétaux, les minéraux,
les animaux. Alors, dans cette contingence, comment le corps, dans son
apparence, a-t-il une signification ? Pour Denise Jodelet, le corps
apparaît comme un médiateur du lien social :
« on s'en préoccupe : 1) soit dans une perspective
instrumentale de réussite et d'intégration sociale ; 2) soit
pour répondre à des normes sociales de présentation ;
3) soit dans l'intention des autres. » Jodelet, Denise, ss la
dir. de Serge Moscovici, Psychologie sociale des relations à autrui,
Nathan, coll. Fac, 2000, p.49.
* 46 Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit., p.14.
* 47 Dumont, Louis, Homo
hierarchicus, app.B. « Individu-dans-le-monde /
Individu-hors-du-monde. L'individu au sens 1) s'il est non social en principe,
en pensée est social en fait : il vit en société,
dans le monde. En contraste, le renonçant indien devient
indépendant, autonome, un individu, en quittant la société
proprement dite. C'est un individu-hors-du-monde. » (in
Dumont, L., Essais..., op. cit., p.304).
* 48 Dumont, L., Essais...,
ib., p.29.
* 49 Dumont, L., Essais...,
ib., p.37.
* 50 Alain Renaut, Gilles
Lipovetsky, Alain Finkielkraut, Emmanuel Levinas, par exemples.
* 51 Renaut, A., L'individu,
op. cit., p.29. Pour Alain Renaut, l'individu moderne veut
« s'approprier les normes et non plus les
recevoir » (p.21-22). Il surimpose à cela l'obligation
qu'il a d'assurer sa « responsabilité de sujet pratique
[devant] se "penser" comme l'auteur de ses actes. » (p.62).
Emmanuel Lévinas avait déjà parlé d'une
"subjectivité pratique" de responsabilité, d'éthique en
tant que « la dignité de l'homme doit être
placée dans l'ouverture à l'autre en tant
qu'autrui » (p.61). Ce qui voudrait dire que la
société est un concept théorique mental qui n'a aucune
"responsabilité" ; seul l'individu est responsable de son acte. La
responsabilité n'étant pas une notion négative ; elle
est la connaissance des conséquences de l'acte. Chacun doit donc
être conscient de ses actes, qu'il est engagé personnellement, et
disposé à en assumer, seul, les conséquences.
* 52 Rousseau, Jean-Jacques,
Du contrat social ou principes du droit politique, in OEuvres
complètes, T.III, Gallimard, coll. La Pléiade, 1964.
* 53 Ehrenberg, A.,
L'individu..., op. cit., p.19.
* 54 Ehrenberg, A., ib.
p.21.
* 55 Le Bon, Gustave, La
psychologie des foules, 1895 in Maisonneuve, Jean, La psychologie
sociale, Puf, coll. Que sais-je ?, 1998, p.5.
* 56 Mayo tire les
conclusions de son enquête dans deux petits ouvrages : Les
Problèmes humains de la civilisation industrielle (1933), et Les
Problèmes sociaux de la civilisation industrielle (1947).
* 57 Mayo, Elton in
Saffange, Jean-François, cours de Dheps 1re année le
05-11-1999.
* 58 Finkielkraut, Alain, La
barbarie individualiste, Revue le Messager Européen, In Renaut,
Alain, ib. p.39.
* 59 Finkielkraut, A.
In Renaut, A., ib. p.29. Voir aussi, Gustave-Nicolas Fisher à
la page
21et sa note de bas de page (n°44).
* 60 « Nous
ouvrons ainsi la porte à une approche et une analyse du problème
du rapport de l'individu à la société qui reste
inaccessible tant qu'on se représente l'individu, et que l'on se
définit par conséquent soi-même, comme un je sans
nous. » Elias, N., La société..., op. cit.,
p.34.
* 61 Elias, N., op. cit.,
p.14.
* 62 Elias, ib. p.15.
* 63 Cazals-Ferré,
Marie-Pierre et Rossi, Patricia, Eléments de psychologie sociale, A.
Colin, coll. Synthèse, 1998, p.80.
* 64 Elias, N., la
société..., op. cit., p.15.
* 65 Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit., p.41.
* 66 « La
stratégie est l'équivalent d'un "coup dans une partie de carte".
Elle dépend de la "qualité du jeu"c'est-à-dire à la
fois de la donne (avoir un bon jeu) et de la manière de jouer
(être un bon joueur) [...] Les stratégies, "combines subtiles",
"navigue" entre les règles, "jouent de toutes les possibilités
offertes. » Certeau, M., ib., p.87. Pour Elias, la partie de
carte est traversée par de nombreuses formes d'interrelations qui
s'entrecroisent, les actes des joueurs sont interdépendants :
« ni le "jeu, ni les "joueurs" ne sont des abstractions. [...]
L'interdépendance des joueurs [...] est une interdépendance en
tant qu'alliés mais aussi en tant qu'adversaire. » Elias,
Norbert, Qu'est-ce que la sociologie ?, Pandora, coll. Des
sociétés, 1981, pp. 156-157.
* 67 Certeau, M.,
L'invention..., op. cit., p.XLVI.
* 68 « Les
interactions sociales créent une mise en scène, à travers
laquelle les individus déploient un arsenal symbolique. »
Goffman, Erving, La mise en scène de la vie quotidienne, 1. la
présentation de soi, Minuit, 1973, cité par Fisher, G.-N., op.
cit., p.187.
* 69
« Processus par lequel la relation sociale s'exprime dans une
présentation de soi qui consiste à rendre son comportement
incertain et imprévisible aux yeux d'autrui, afin de créer une
marge de manoeuvre permettant d'exercer un pouvoir sur lui. »
Crozier, Michel, Friedberg, Ehrard, L'Acteur et le Système, Le Seuil,
1977 in Fischer, G.-N., les concepts..., ib. p.201.
* 70 Elias, N., La
société..., op. cit., p.17.
* 71 Encyclopædia
Universalis, Cd-Rom 98 à Groupe (dynamique de).
* 72
« Transformation essentielle de la structure de la
personnalité qui réside dans le déplacement du mode de
contention des affects, assigné à un dispositif
intériorisé de censure, et non plus à une autorité
située en dehors de l'individu. » Elias, op. cit. p.18.
Sur ce point, Max Scheler en critiquant Kant s'opposait déjà
à l'idée de concevoir le problème de l'ordre social
essentiellement comme un problème d'autorité. Boudon, Raymond, La
théorie des valeurs de Scheler vue depuis la théorie des valeurs
de la sociologie classique, Travaux du Gemas n°6, 1999, p.5.
* 73 Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit., quatrième de couverture.
* 74 Prosôpon :
personne, du grec Prosypon, désignant le masque.
* 75 Persona :
personne, du latin désignant le masque. Les masques étaient en
nombre limités : soixante-seize, dont vingt-huit pour la
tragédie. Ils correspondaient à des caractères fixes
à partir desquels les spectateurs pouvaient s'attendre à des
comportements ou à des attitudes déterminés.
« La création littéraire exalte en outre sinon le
"héros", du moins le "personnage". La persona de l'actant
littéraire peut aller du plus simple (le masque ou le costume
obligé de l'emploi théâtral) au plus complexe, dans le
roman psychologique ou dans l'épanchement lyrique de la poésie.
Mais chaque fois s'opère une sélection des traits de
personnalité, des situations et des actions des
personnages » (J. Campbell, The Hero with a Thousand Faces,
Panthéon Books, New York, 1949 in Encyclopædia
Universalis, Cd-Rom, 1998).
* 76 Nédoncelle,
Maurice, La réciprocité des consciences, Aubier, 1942.
« Le terme persona est lui-même
dérivé du verbe personare, qui veut dire résonner,
retentir, et désigne le masque de théâtre. [...] Cette
étymologie est généralement attribuée à
Boèce (VIe s.). En réalité, elle est déjà
attestée chez Aulu-Gelle, IIe siècle. Mais elle est fausse. Pour
des raisons d'accentuation (la deuxième syllabe de persona est longue,
la deuxième syllabe de personare est brève), il est impossible
que persona dérive de personare. Au reste, on a découvert un mot
étrusque, phersu, qui pourrait être l'amorce d'un persuna ,
changé bientôt en persona , et qui semble signifier masque. Cette
explication, même probable, reste cependant
discutée. » Meyerson, Ignace, Problèmes de la
personne, colloque du Centre de recherches de psychologie comparative,
E.P.H.E., Viè section, Mouton, 1973.
* 77 Pour Stoetzel,
l'attitude désigne « la manière dont une personne
se situe par rapport à des objets de valeur. »
Maisonneuve complète la définition :
« l'attitude consiste en une position (plus ou moins
cristallisée) d'un agent (individuel ou collectif) envers un objet
(personne, groupe, situation, valeur) ; elle s'exprime plus ou moins
ouvertement à travers divers symptômes ou indicateurs (paroles,
ton, gestes, actes, choix - ou leur absence) ; elle exerce une fonction
à la fois cognitive, énergétique et régulatrice sur
les conditions qu'elle sous-tend. » Maisonneuve, Jean,
Introduction à la psychosociologie, coll. Le psychologue, Puf, 1985
in Cazals-Ferré, M.-P. et Rossi, P., Eléments..., op.
cit., p.35.
* 78 Précisant, dans
le cas où le sujet en vient au point « d'une angoisse
intime sur sa propre valeur, que le personnage peut devenir, au sens
médical du terme, un aliéné. » Maisonneuve,
J., La psychologie..., op. cit., p.38.
* 79 Maisonneuve, J., La
psychologie..., ib., p.36.
* 80 Gusdorf, Georges, La
découverte de soi, Puf in Maisonneuve, J., La psychologie...,
ib., p.36.
* 81 Jodelet, Denise, ss. La
dir. de Moscovici, S., Psychologie..., op. cit., p.51.
* 82 « Le
personnage comme rôle social (le devoir être). »
Maisonneuve, J., op. cit., p.36. « Le personnage comme
idéal (le vouloir être). » Maisonneuve, J., ib.,
p.37.
* 83 Maisonneuve, J., ib.,
p.37.
* 84 « Le
cogito permet d'affirmer le primat de la pensée sur tout objet connu, ce
qui ouvre la voie à l'idéalisme, au kantisme, à la
phénoménologie. À la fin de la Méditation seconde,
la célèbre analyse dite du morceau de cire établit que la
perception des corps se réduit à une "inspection de l'esprit", et
que l'apparente présence des choses est, en fait, le fruit de nos
jugements. Rien n'est donc plus certain que la pensée, puisque toute
affirmation suppose celle de son existence. » Encyclopædia
Universalis, Cd-Rom, 1998.
* 85 « ...il
fallait nécessairement que moi, qui le pensais, fusse quelque
chose : et remarquant que cette vérité, "je pense, donc je
suis", était si ferme et si assurée que toutes les plus
extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de
l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le
premier principe de la philosophie que je cherchais. »
Descartes, René, Discours de la méthode, quatrième
partie, Méditations, La Pléiade, Gallimard, p.47-48.
* 86 « La
conscience est la capacité de situer l'ordre du possible par rapport au
réel. En conséquence, l'homme, lorsqu'il se trouve à un
certain niveau de vigilance, se situe par rapport à lui-même et
prend conscience de soi. » Corraze, Jacques, Encyclopædia
Universalis Cd-Rom 98 à Personnalité.
* 87 La Bruyère, Jean
(de), Les Caractères in OEuvres complètes, coll. La
Pléiade, 1951.
* 88 Paulhan, F., Les
Caractères, 1894, 5è éd., 1922. Ainsi qu'Allport, Gordon
Willard, Personality, H. Holt and Co, New-York, 1964 in
Encyclopædia Universalis, Cd-Rom, 1998 (Corraze Jacques), entre
autres.
* 89 Encyclopædia
Universalis, Cd-Rom, 1998.
* 90 In Corraze,
Jacques, Encyclopædia Universalis, Cd-Rom, 1998.
* 91 Corraze, Jacques, ib.
Ceci a fondé les conceptions d'Abraham Maslow dont les travaux attribuent à
l'homme une force de développement intrinsèque, une puissance
d'auto actualisation. Sujet que nous abordons en détail dans la
troisième partie.
* 92 Corraze, Jacques, image
spéculaire du corps, Privat, 1980 in Encyclopædia
Universalis, Cd-Rom, 98
* 93 Lagache, Daniel in
Encyclopædia Universalis, Cd-Rom, 1998 à Personnalité,
auteur, Jacques Corraze.
* 94 Mead, Gorges Herbert,
L'Esprit, le soi et la société, tr. Fr., Puf, 1963 in
Maisonneuve, J., La psychologie..., op. cit., p.35.
* 95 Partie innée qui
serait délivrée et incorporée à la naissance par un
capital culturel, social et économique. Mais, cet partie innée
serait non figée et caractériserait l'évolution de
l'individu, la partie acquise.
* 96 Goffman, Erving,
Stigmate, Les usages sociaux des handicaps, Minuit, 1975, p.152.
* 97 Mead, Georges-Herbert,
L'Esprit, le soi et la société, 1934, tr. J. Cazeneuve, Puf, 1963
in Fischer, G.-N., Les concepts..., op. cit., p.195.
* 98 Parmi les plus
importants mécanismes, Fischer a retenu successivement :
l'identification, l'influence des référents sociaux, les
processus d'évaluation personnelle et d'improvisation. Fischer, G.-N.,
Les concepts..., ib., p.196 & suiv.
* 99 Barbier, J.-M., Revue
Sciences Humaines, Le changement, Hors série n°28, mars-avril-mai
2000, p.11.
* 100 Revue Sc. Humaines
n°28, ib.
* 101 Arendt, Hannah, Les
mots d'Arendt, Télérama n°2598, 27-10-99, p.22.
* 102 Fischer, G.-N., Les
concepts..., op. cit., p.195.
* 103 « Je
n'ai jamais pu parler avec un homme sans prendre son accent ; ce n'est que
par les remarques des autres que je m'en suis aperçu. Ainsi, chacun
imite les sourires et les grimaces, les gestes et les petites actions.
Voilà comment chacun est de son village, et souvent ne retrouve une
certaine que là. Comme un lit que l'on fait à sa
forme. » Alain, Eléments de philosophie, Gallimard, coll.
Folio/essais, 1990, p.352.
* 104 Nous en voulons pour
témoignage les "sans papiers" qui vous le diront mieux que d'autres, ou
bien ceux qui "en jouent" par le faux, le "faux papier".
* 105 Armengaud,
Françoise, Encyclopædia Universalis Cd-Rom 98 à Nom.
* 106 Boulte, Patrick,
L'Individu en friche, Essai sur l'exclusion, Desclée de Bouwer, 1995,
p.40.
* 107 Identité
personnelle : « processus psychologique de
représentation de soi qui se traduit par le sentiment d'exister dans une
continuité en tant qu'être singulier et d'être reconnu comme
tel par autrui. » Fischer, G.-N., Les concepts..., op. cit.,
p.202.
* 108 Identité
sociale : « processus psychosocial de construction et de
représentation de soi résultant des interactions et des
cognitions des individus concernant leur appartenance sociale. »
Fischer, ib., p.202.
* 109 Moscovici, Serge,
Essai sur l'histoire humaine de la nature, Flammarion, coll. Champs, 1977,
p.85.
* 110 Fischer, G.-N., Les
concepts..., op. cit., p.202. D'ailleurs, Freud, au début de son ouvrage
"Psychologie collective et analyse du moi", écrit
« autrui joue dans la vie de l'individu le rôle d'un
modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un
adversaire. », Freud Sigmund, psychologie collective et analyse
du moi, 1921, tr. S. Jankelevitch in Essai de psychanalyse, Payot,
1927.
* 111 Linton, Ralph, Le
fondement culturel de la personnalité, Dunod, 1999, 138 p.
* 112 Robert Redfield,
Ralph Linton et Melville Jean Herskovits, Le Memorandum, 1936.
* 113 Durkheim, Emile, Les
formes élémentaires de la vie religieuse, 1912, Puf, 2è
éd., 1990.
* 114 Pizzorno, Alessandro,
Sur la rationalité du choix démocratique, tr. P. Birnbaum et J.
Leca dans Sur de l'individualisme, Presses de la FNSP, 1986, p.352 in
Corcuff, Philippe, Les nouvelles sociologies, Nathan, coll. 128, 1995, p.
93.
* 115 Pizzorno, ib.
p.362.
* 116 Boudon, R., La
théorie..., op. cit., p.1.
* 117 Boudon, R., La
théorie..., ib., p.16.
* 118 Jodelet, Denise, ss la dir. de Moscovici,
S., Psychologie..., op. cit., p.53.
* 119 Quant à Max
Stirner, après avoir démontré que l'homme est unique,
c'est-à-dire « rebelle à toute intégration
politique et sociale », lui reconnaît le
droit « de tout considérer comme sa
propriété. » Stirner, Max, L'Unique et sa
propriété (Der Einzige und sein Eigentum ,
1845, tr. E. Lasvignes, 1948 in Encyclopædia Universalis,
Cd-Rom, 1998 (Henri Arvon).
* 120 Alors que Nietzsche
se différencie de Descartes en valorisant un égoïsme
fondé sur le "soi organique" qui serait un ensemble de pulsions plus ou
moins conscientes.
* 121 « Un
monde ne saurait exister s'il n'est commun. Donc il y a une liaison absolue
entre monde et esprit et, relativement, esprit et monde. Donc il y a d'une part
une sorte d'autonomie, un pouvoir de distance (de mise à distance) dans
le monde lui-même (n'être pas du monde pour être dans le
monde) donc il faut définir l'individu spirituel : 2 faces, l'un
vers l'Un, l'au-delà de l'être (image : point de suite)
l'autre dans l'être lui-même (image : point d'insertion) c'est
à dire que l'être se définit par la totalité des
individus spirituels. Il n'y a donc pas possibilité à un esprit
d'exister sans la totalité des autres. Pour Plotin il n'y a donc pas de
point limite. Avant d'être un Moi l'autre est Esprit (un souffle, un
élan vital, spirituel qui fait dépasser le
monde). » Breton, Stanislas in l'émission
radiodiffusée Staccato du 10-12-1998 sur France Culture.
* 122 « Il
est bon de redire que l'homme ne se forme jamais par l'expérience
solitaire. » Alain, Eléments..., op. cit., p.218.
* 123 Elias, N., La
société..., op. cit., p.75.
* 124 Socialisation :
processus d'apprentissage par un individu des attitudes, des normes et des
valeurs propres à un groupe, à travers lequel s'opère son
intégration sociale par la diversité des relations vécues
par lui. Fischer, G.-N., Les concepts..., op. cit., p.57.
* 125 Sur ce point, Elias
développe l'idée selon laquelle l'existence humaine serait
« autant de régulations qui sous une forme ou une autre
(et trop souvent sous des formes contradictoires) sont inculquées par
l'exemple, par la parole et par l'action des adultes à l'individu qui
grandit. [...] "Tiens-toi tranquille", "ne te salis pas", "travailler,
travailler, travailler", "pense à l'Eglise", "tu n'as pas honte ?",
... » Elias, N., La société..., ib. p.163
* 126 Nietzsche, Friedrich,
Ainsi parlait Zarathoustra, tr. Bianquis, G., Aubier, 1953, p.319.
* 127 Palante, Georges,
L'individualisme aristocratique, les Belles Lettres, 1995 in Magnone,
Fabrice, Le Monde Libertaire n°1028, 1-7 fév. 1996.
* 128 Palante, G.,
L'individualisme..., ib.
* 129 Worms,
Frédéric, L'individualisme, émission radiodiffusée
Philambule sur France Culture le 24-04-99.
* 130 Souchon,
Gisèle, Les grands courants de l'individualisme, Armand Colin,
L'individualisme, émission radiodiffusée Philambule sur France
Culture le 24-04-99
* 131 Worms,
Frédéric, ib.
* 132 Birnbaum, Pierre et
Leca, Jean, Sur l'individualisme, Presses de la fondation nationale des
sciences politiques, coll. Références, 1991, 4è de
couverture.
* 133 Freud, Sigmund,
psychologie collective et analyse du moi dans Essais de psychanalyse,
Payot, 1970 in Maisonneuve, Jean, La psychologie..., op. cit.,
p.27.
* 134 Durkheim, Emile, Le
suicide, étude sociologique, Paris, Puf, 1960 in Fischer,
G.-N., Les concepts..., op. cit., p.30.
* 135 Lemos, André,
Les Communautés virtuelles in Société, Dunod,
1994, n° 45, p. 258.
* 136 Boudon, Raymond et
Bourricaud, François, Dictionnaire critique de la sociologie, Puf, 1982,
p.4.
* 137 Nous rappelons la
définition de Norbert Elias :
l'évolution interdépendante
des rapports et des contraintes que les hommes exercent sur autrui et sur
eux-mêmes. (Cf. p.
25).
* 138 Girard, Alain, Le
Choix du conjoint, Puf, 1974 in Fischer, G.-N., Les concepts..., op.
cit., p.37.
* 139 Rands et
Levinger, In Fischer, G.-N., Les concepts..., op. cit., p.45.
* 140 Encyclopædia
Universalis, Cd-Rom, 1998.
* 141 Le philosophe Alain,
philosophant sur la sociologie, nous dit à propos de la
solidarité : « Tel est finalement le monde humain,
lieu de bonheur et de gloire si l'on corrige le fanatisme par l'amour qui donne
et suppose, dont le vrai nom est charité, et dont l'application conduit
à une belle égalité, non exclusive de l'autorité,
mais tout au contraire substantielle à la vraie
autorité. » Alain, Eléments..., op. cit.,
p.350.
* 142 Gergen et Gergen
(1981), In Fischer, G.-N., Les concepts..., op. cit., p.49. Voir
aussi, dans ce même document, Alain Finkielkraut, page
23 et sa note de bas de page.
* 143 « (...)
mais ces désirs ne sont pas inscrits en lui avant toute
expérience. Ils se constituent à partir de la plus petite enfance
sous l'effet de la coexistence avec les autres et ils se fixent sous la forme
qui déterminera le cours de la vie progressivement, ou parfois aussi
très brusquement à la suite d'une expérience
particulièrement marquante. » Lahire, Bernard, Tableaux
de familles. Heurs et malheurs scolaires en milieux populaires, Seuil, Coll.
Hautes études, 298 p.
* 144 Yannick Rayer
(Conseiller d'entreprise et enseignant à Paris V).
* 145 Dans
l'émission télévisuelle de Nathalie Lebreton, journaliste,
Eco et compagnie, Les écrans du savoirs, diffusée le vendredi 5
juin 1998 : "le capital c'est l'homme". Ont participés :
Campana Eled Associés, CNDP, CCI Paris, Editions Hatier, Alternatives
économiques, la Cinquième.
* 146 Maslow a
hiérarchisé les besoins sous la forme d'une pyramide. Voir
troisième partie, p.
124.
* 147 Fridman, Viviana et
Roy, Alain, cf. Rémy, Jean, La vie quotidienne et les transactions
sociales : perspectives micro ou macro-sociologiques, Maurice Blanc,
1992.
* 148 Processus qu'il faut
entendre au sens d'Elias, cf. p.
25 : Il entend par processus
l'évolution interdépendante des rapports et des contraintes que
les hommes exercent sur autrui et sur eux-mêmes.
* 149 Inter-action,
inter-subjectivité, inter-relation, inter-dit (inter-prétation),
etc.
* 150 Laurier Turgeon,
Denys DelÂge et Réal Ouellet (dir.), Transferts culturels et
métissages. Amérique/Europe, XVIe - XXe siècle,
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1996, p. 20
in Fridman, Viviana et Roy, Alain.
* 151 Rémy, Jean, La
vie..., op. cit., p.302-305.
* 152 Corneille, Pierre, Le
Cid, Larousse, coll. Classiques, Acte II, Sc.2.
* 153 Futuribles, analyse
et prospective, directeur Hugues de Jouvenel, revue n°200 - 215 pages -
juillet-août 1995. La préparation a débutée en 1979
sous forme de séminaires par une équipe internationale
(Allemagne, Angleterre, France). En 1980, une enquête pilote fut
menée sur quatre pays européens par un questionnaire. Puis, deux
enquêtes furent effectuées dans douze pays. Au total trente-deux
mille interviews de une heure trente en moyenne ont été
réalisées. Pour cette occasion il a été
recensé et analysé toutes les données d'opinions existant
pendant les dix années précédentes. Travail que nous ne
pouvions pas faire nous-même sur le sujet.
* 154 Chauvel Louis de
l'Observatoire Français des Conjonctures économiques,
L'évolution des valeurs des Européens, revue Futuribles, analyses
et prospectives, juillet-août 1995, page 176.
* 155 Rokeach, M. (The
nature of human values) New York : Free Press, 1973 in futuribles
p.15. Voir aussi le tableau des valeurs retenues par Rokeach à l'annexe
16.
* 156 Tchernia,
Jean-François, Research International in Futuribles, analyse et
prospective juillet-août 1995, p.9. Mais aussi, Valade, Bernard,
Dictionnaire de la sociologie, Larousse Thématique, 1996, p.235.
* 157 Stoetzel, Jean,
Théorie des opinions, Puf, 1943 in Futuribles, ib. p.13.
* 158 Comme nous l'avons vu
dans le premier chapitre, la personnalité semble se constituer peu
à peu par opposition à la connaissance du monde
extérieur.
* 159 Stoetzel, Jean,
Théorie des opinions, Puf, 1943.
* 160 « [La
personne est] la substance unitaire de tous les actes qu'un être
effectue. » Scheler, Max, Le formalisme en éthique et
l'éthique matériale des valeurs, 1913-1916, tr. M. de Gandillac,
Gallimard, 1955, p.IV.
* 161 Scheler, ib. in
Encyclopædia Universalis, Cd-Rom 98 à Philosophie de la
personne (Jerphagnon, Lucien).
* 162 Boudon, R., La
théorie..., op. cit., p.1.
* 163 Scheler, M., Le
formalisme..., op. cit., p.284 in Boudon, R., La théorie...,
op. cit., p.21.
* 164 Scheler
écrit : « plus nous vivons [...] dans "notre ventre",
plus nous sommes axiologiquement pauvres. » Scheler, M., Le
formalisme..., ib. p.279 in Boudon, Gemas n°6, ib. p.23.
* 165 (Reprenant
l'expression de Tönnies) Scheler, Le formalisme..., ib. p.195 in
Boudon, Gemas n°6, ib. p.23.
* 166 Que nous avons
déjà abordé avec Georges Palante au chapitre
premier :
1.2.2 De l'individualisme à la relation
à l'autre : la solidarité, p.
37.
* 167 (S'inspirant de
Nietzsche, Die Genealogie der Moral, 1887) Scheler, Max, Ressentiment im Aufbau
der Moralen, p.3-5, in Boudon, R., La théorie..., op. cit.,
p.24.
* 168 Scheler, M., Le
formalisme..., ib. p.326 in Boudon, R., Travaux du Gemas n°6, ib.
p.25.
* 169 (faisant écho
à Durkheim) Scheler, M., Le formalisme..., ib. p.308 in Boudon,
R., Gemas n°6, ib. p.26.
* 170 « Pour
Maisonneuve (1985), les normes sont des règles et des schèmes de
conduite très largement suivis dans une société ou un
groupe donné, [...] Elles se réfèrent à ce qui
paraît socialement désirable, convenable dans tel ou tel groupe
particulier. Elles traduisent les valeurs dominantes dans ce groupe. [...]
Elles ont pour fonction la cohésion, la réduction de
l'incertitude et la socialisation. » Cazals-Ferré, M.-P.
& Rossi, P., Eléments..., op. cit., p.28.
* 171 Boudon, R., Gemas
n°6, op. cit., p.26.
* 172 Ici, Scheler
apparaît comme très proche de Weber et de Durkheim. Sur le
thème de la religion « il retrouve Benjamin
constant (De la religion considérée dans sa source, ses
formes et ses développements, 1824-1831) pour qui les religions
traduisent des idées identiques dans des symboliques variables ou
Tocqueville, qui déclare dans la "Démocratie en Amérique"
que l'immortalité de l'âme et la métempsycose sont des
traductions symboliques de la même idée. » Boudon,
R., Gemas n°6, ib. p.26
* 173 Boudon, R., Travaux
du Gemas n°6, p.28.
* 174 « De
même que les symboles sont empruntés à la
société ambiante, les normes lui sont fonctionnellement
adaptées. » Scheler, M., Le formalisme..., ib. p.232
in Boudon, R., Gemas n°6, p.27. Voir aussi note de bas de page
n°421, p.
34.
* 175 Scheler, M., Le
formalisme..., ib. p.477 in Boudon, R., Gemas n°6, ib. p.31.
* 176 Précisant, par
là, le développement de notre premier chapitre, p.
26.
* 177 Scheler cite le
paléontologue Quenstedt : « Si les Noirs et les
Indo-Européens étaient des limaces, les zoologistes en feraient
deux espèces. » Scheler, M., Le formalisme..., ib. p.299
in Boudon, R., ib. p.31.
* 178 Boudon, R., Gemas
n°6, ib. p.32.
* 179 Revoir à ce
propos le passage des "Trois métamorphoses" p.
36.
* 180 Scheler, M., le
formalisme..., ib. p.484 in Boudon, R., Gemas n°6, ib. p.31.
Revoir aussi, chapitre 1 :
caractère, p.
29.
* 181 « on ne
peut expliquer pourquoi un poème, un tableau ont de la
valeur. » Scheler, M., le formalisme..., ib. p.212 in
Boudon, R., Gemas n°6, ib. p.33.
* 182 Boudon, R., Gemas
n°6, ib. p.31.
* 183 Cf. plus haut dans ce
chapitre "
1.2.1.1 L'identification, un mixte de
représentations réelles et symboliques", p.
34.
* 184 Scheler, M., le
formalisme..., ib. p.311 in Boudon, R., Gemas n°6, ib. p.28.
* 185 Dictionnaire
Encyclopædia Universalis, Cd-Rom 98.
* 186 Louis Dumont nous dit
que « lorsqu'on compare la société indienne aux
sociétés occidentales, on est confronté à deux
systèmes de valeurs incommensurables : d'un côté, le
règne de l'égalité ; de l'autre, celui de la
hiérarchie. » Dumont, Louis, Homo hierarchicus,
Gallimard, 1966 ; Homo aequalis, Gallimard, 1977 ; Essais sur
l'individualisme, Seuil, 1983 in Boudon, R., ib.p.34.
* 187 Cf. section :
1.3.1 Les valeurs : affaire de mots et
d'idées mais aussi production de rapports sociaux, p.
46.
* 188 Cf. p.
47.
* 189 Les analyses de
Scheler sont ici très proches de celles de Weber :
« les prophètes au sens large, comme Confucius ou
Jésus, occupent une place exceptionnelle dans la hiérarchie des
grands hommes, parce qu'ils ont été des créateurs de
valeurs. En même temps, il faut comprendre que les innovateurs ne sont
reconnus que lorsqu'ils répondent aux "Neigungen" [(dispositions)] du
public. » Boudon, R. Gemas n°6, ib. p.22.
* 190 Dans Ethique à
Nicomaque (1099 a 17-21), Aristote impose le plaisir dans les actions
morales : « On n'est pas un véritable homme de bien
quand on n'éprouve aucun plaisir dans la pratique des bonnes actions,
pas plus que ne saurait être jamais appelé juste celui qui
accomplit sans plaisir des actions justes, ou libéral celui qui
n'éprouve aucun plaisir à faire des actes de
libéralité, et ainsi de suite. S'il en est ainsi, c'est en
elles-mêmes que les actions conformes à la vertu doivent
être des plaisirs. » Sur ce point, Scheler exprime un
autre argument : « l'homme peut tendre, non vers le plaisir,
mais vers le bien ; et l'on ne peut réduire l'un à l'autre
en faisant mine de croire qu'on recherche le bien en raison du plaisir qu'il y
a à faire le bien. » Scheler, M., Le formalisme..., ib.
p.257 in Boudon, R., Gemas n°6, ib. p.8. D'autres auteurs, ainsi Pascal,
Rousseau, H. Bergson, d'autres écoles telles que les Utilitaristes
anglo-saxons (Bentham, J.S.Mill) réhabilitant l'affectivité, ont
mis l'accent sur le rôle des sentiments, la valeur de l'intuition et la
fonction de l'intérêt et du désir, voire de l'amour dans le
jeu de la pensée humaine.
* 191 Kant, Emmanuel,
Fondements de la métaphysique des moeurs, II, tr. V. Delbos, Delagrave,
par.46, 148.
* 192 Scheler, M., le
formalisme..., op. cit., p.308 in Boudon, R., Gemas n°6, op.
cit., p.28.
* 193 Scheler, M., le
formalisme..., ib. p.317 in Boudon, R., Gemas n°6, ib. p.29.
* 194 Comte-Sponville,
André, Parler de morale ?, Magazine littéraire n°361,
01-98.
* 195 C'est ce que nous
avons compris avec la théorie de Scheler, p.
46.
* 196 Scheler, M., le
formalisme..., ib. p.335 in Boudon, R., Gemas n°6, ib. p.21.
* 197 Scheler, Max, Nature
et Formes de la sympathie, Payot, 1928, p.113 in Maffesoli, Michel, Le
temps des tribus, La Table Ronde, 2000, p.136.
* 198 Michel Maffesoli
montrant, à propos de la vie quotidienne, comment la profondeur pouvait
se cacher à la surface des choses. Maffesoli, M., Le temps..., op. cit.,
p.138.
* 199 Boudon, R., Gemas
n°6, ib. p.30.
* 200 Une légende
dans le sens de fabuleux, mythologique.
* 201 de re-ligare
plutôt que de recollectere, c'est-à-dire de rassembler.
* 202 On reconnaît
ici l'idée du persona, du masque qui peut être changeant et qui
surtout s'intègre dans une variété de scènes, de
situations qui ne valent que parce qu'elles sont jouées à
plusieurs. De même, la personne joue des rôles au sein d'une
configuration à laquelle elle participe, elle y prend une place.
D'où l'importance de l'apparence en tant que vecteur
d'agrégation, de sentir en commun.
* 203 Maffesoli, M., Le
temps..., op. cit., p.VII
* 204 Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit., p.XXXV.
* 205 Certeau, M.,
L'invention..., ib., p.XL.
* 206 Certeau, M.,
L'invention..., ib., p.XXXVIII.
* 207
« J'appelle tactique l'action calculée que
détermine l'absence d'un propre. [...] La tactique n'a pour lieu que
celui de l'autre. Aussi doit- elle jouer avec le terrain qui lui est
imposé tel que l'organise la loi d'une force étrangère.
Elle n'a pas le moyen de se tenir en elle même, à distance, dans
une position de retrait, de prévision et de rassemblement de soi : elle
est mouvement "à l'intérieur du champ de vision de l'ennemi",
comme le disait von Bülow, et dans l'espace contrôlé par lui.
Elle n'a donc pas la possibilité de se donner un projet global ni de
totaliser l'adversaire dans un espace distinct, visible et objectivable. Elle
fait du coup par coup. Elle profite des "occasions" et en dépend, sans
base où stocker des bénéfices, augmenter un propre et
prévoir des sorties. Ce qu'elle gagne ne se garde pas. Ce non-lieu lui
permet sans doute la mobilité, mais dans une docilité aux
aléas du temps, pour saisir au vol les possibilités qu'offre un
instant. [...] En somme, c'est un art du faible. » Certeau, M.,
L'invention..., ib., p.60,61.
* 208 Nous avons
déjà parlé de stratégie : « le
calcul des rapports de forces qui devient possible à partir du moment
où un sujet de vouloir et de pouvoir est isolable d'un "environnement".
Elle postule un lieu susceptible d'être circonscrit comme un propre et
donc de servir de base à une gestion de ses relations avec une
extériorité distincte. » Certeau, M.,
L'invention..., ib. p.XLVI.
* 209 Certeau, M.,
L'invention..., ib., p. 53.
* 210 Certeau, M.,
L'invention..., ib., p. 60.
* 211 Certeau, M.,
L'invention..., ib., p. 56.
* 212 « La
tactique n'a pour lieu que celui de l'autre. » Certeau, M.,
L'invention..., ib., p. 60.
* 213 Certeau, M.,
L'invention..., ib., p. 61.
* 214 « Le
"propre" est une victoire du lieu sur le temps. Au contraire du fait de son
non-lieu, la tactique dépend du temps, vigilante à y "saisir au
vol" des possibilités de profit. Ce qu'elle gagne, elle ne le garde
pas. » Certeau, M., L'invention..., ib., p.XLVI.
* 215 Dictionnaire Robert,
Micro Poche, tome II, 1986.
* 216 Qu'est-ce qui fait
que certains membres de ce club informatique semblent, indépendamment de
l'outil, changer ?
* 217 Hypothèse de
départ : « plus un individu utilise, dans une
contingence, les moyens de devenir "être relationnel" et en
"représentation", plus cet individu accède à un statut
d'individu ».
* 218 « La
seule idée du "je suis", et plus encore celle du "je pense", suppose
l'existence d'autres hommes et la coexistence avec d'autres. »
Elias, N., La société..., op. cit., p.105.
* 219 Cf. annexe 1 qui
détermine l'autonomisation financière et de gestion des branches
et son fondement : la valorisation de l'individu par l'entraide mutuelle
et le service bénévole.
* 220 Relations,
identité, éthique, solidarité, représentations,
besoins, entre-deux, valeurs. Ici, les indicateurs sont des
appréciations subjectives exprimant des observations. Ce qui est
observable et mesurable est le contenu ou le sens des discours.
* 221 Lemos, op. cit.,
p.257.
* 222 L'association ou la
branche (micro-groupe).
* 223 Elias, N., La
société..., op. cit., p.87.
* 224 Astérix et le
chaudron, p.14.
* 225 Nous voulons entendre
par cette expression que certaines associations effectuent des démarches
"volontairement" axées sur la construction de liens sociaux (nous
pensons aux associations d'insertions, de jeunes de banlieue, etc.) en
opposition aux associations qui produisent "involontairement" du lien social
(associations de boules, d'échecs, etc.). Ce sont bien les
premières associations qui sont visées dans notre propos.
* 226 Cf. les
différents agréments accordés à cette association.
Voir annexe 1.
* 227 Cf. la
première partie qui pose le problème.
* 228 « Le concept de configuration
permet de dépasser l'antinomie individu-société : aux
idées d'une société indépendante des individus et
d'un individu-atome, clos et indépendant des autres individus, il
substitue l'image de configurations concrètes que les individus forment
ensemble sans jamais leur préexister et qu'on ne peut analyser sans
tenir compte du "sens intentionnel" que les actions possèdent pour les
actants. Dans ces configurations toujours mouvantes s'établissent des
équilibres fluctuants de tensions et de forces. »
(Encyclopædia Universalis, 1998, à Elias).
* 229 Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit., p.XVI.
* 230 A l'instar de Michel
de Certeau : « ...quelles procédures populaires
«minuscules» et quotidiennes jouent avec les mécanismes de la
discipline et ne s'y conforment que pour les tourner ; enfin, quelles
«manières de faire» forment la contrepartie, du
côté des consommateurs (ou «dominés» ?), des
procédés muets qui organisent la mise en ordre
sociopolitique. » Certeau, M. (de), L'invention..., op. cit.,
p.XL.
* 231 En
réalité, bien que nous soyons curieux de nature, nous avons
véritablement structuré une observation, avec cahier
d'observation, depuis début 2000 seulement jusqu'au début 2001.
Cependant, nous connaissons bien cette association dans son fonctionnement et
ses fondements depuis octobre 1997 pour y avoir participé en tant que
bénévole.
* 232 Voir annexe 3.
* 233 Voir grille
d'entretien à l'annexe 5.
* 234 Neuf entretiens dont
un en couple.
* 235 Quivy Raymond et Van
Campenhoudt Luc, Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, Paris, 1995,
p.196.
* 236 Cf. p.
66.
* 237 Et plus généralement la
réaction à des stimulations dépendant de certaines
dispositions mentales pour expliquer la relation avec les réponses
fournies par le membre. Ainsi, nous pourrons repérer ses comportements
observables et inobservables grâce à nos enquêtes.
« L'attitude consiste en une position (plus ou moins
cristallisée) d'un agent (individuel ou collectif) envers un objet
(personne, groupe, situation, valeur) ; elle s'exprime plus ou moins
ouvertement à travers divers symptômes ou indicateurs (paroles,
ton, gestes, actes, choix - ou leur absence) ; elle exerce une fonction
à la fois cognitive, énergétique et régulatrice sur
les conduites qu'elle sous-tend. » (Maisonneuve, J. in
Cazals-Ferré, M.-P. et Rossi, P., Eléments... op. cit.).
* 238 Interaction
sociale : « relation interpersonnelle entre des individus
(deux au moins) qui soumet chacun d'eux à une influence
réciproque et qui est susceptible d'entraîner des modifications du
comportement. » Cazals-Ferré, M.-P. et Rossi, P.,
Eléments... op. cit., p.89.
* 239 L'observation
étant là pour "affiner" certains aspects de nos entretiens qui
pourraient paraître "artificiels" ou/et contradictoires entre la relation
d'interview et la relation que nous avons vécu au quotidien avec le
membre. C'est-à-dire que nous avons pu relever des contradictions
possibles en rapprochant nos observations (Il nous a été facile
de repérer cela parce que nous avons observé les attitudes
antérieures du membre pendant plusieurs mois voire plusieurs
années) et les réponses aux entretiens. Pour donner un seul
exemple : un membre répond sur son questionnaire ne pas être
quelqu'un qui relève les défis (Item n°27 :
« Dans la vie vous êtes plutôt... », Voir
annexe 3) alors que les faits nous indiquent sa persévérance
à mettre en oeuvre le Club d'investissement (un des projets de
l'association), malgré les difficultés rencontrées.
* 240 Voir annexe 5.
* 241 Voir grille
d'entretien à l'annexe 5.
* 242 Favier, Roland,
Philosophe, lors de la conférence de Paul Ricoeur le 12 janvier 2001
à Valence, université Latourg-Maubourg.
* 243 Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit.
* 244 « Il
s'agit de "faire parler" l'extrait au-delà de son sens manifeste, de
s'imposer une attention extrême aux mots employés (pourquoi
ceux-ci plutôt que d'autres ?) et, en quelque sorte,
d'émettre des hypothèses de sens forcées »
Combessie Jean-Claude, la méthode en sociologie, La découverte et
Syros, Coll. Repères, Paris, 1999, p.63. « L'analyse
transversale compare les mots et expressions qui
l'énoncent (ami, camarade, copain, pote...) ; un de ses objectifs
est d'en spécifier la charge sémantique », ib.
p.65.
* 245 « La
cause déterminante d'un fait social doit être recherché
parmi les faits sociaux antécédents, et non parmi les
états de conscience individuelles. » Durkheim, Emile,
PUF, Coll. quadridge, 1981, in Corcuff, P., Les nouvelles..., op.
cit., p.13
* 246 « Il
est indispensable de reconstruire les motivations des individus
concernés par le phénomène social et d'appréhender
ce phénomène comme le résultat de l'agrégation des
comportements individuels dictés par ces motivations. »
Boudon, Raymond, Individualisme et holisme dans les sciences sociales,
in Corcuff, P., Les nouvelles..., op. cit., p.15.
* 247 La ligne Autres branches du tableau
suivant concerne la branche Littérature et Junior (encadrement des
jeunes par des adultes) et la ligne Hors branche signifie que le
membre participe à la gestion globale de l'association sans suivre de
projet particulier.
* 248 Représentant
dix personnes. Soit, neuf entretiens dont un effectué en couple.
* 249 Un entretien s'est
déroulé avec le couple.
* 250 Voir tableau p.
70.
* 251 Nous avons
cherché à étayer le propos à partir des
questionnaires. Nous avons construit un tableau identique qu'il est possible de
consulter à la fin de l'annexe 3. Là aussi, les membres qui
participent à plus d'une branche sont les célibataires, puisque
nous obtenons un total de quatorze participations pour douze réponses
seulement et des couples sans enfant, puisque nous dénombrons huit
participations pour cinq réponses. Un seul adhérent "famille avec
enfant(s)" participe à plus d'une activité (huit participations
pour sept réponses).
* 252 Cependant, nous
disposons des résultats des questionnaires qui nous indiquent de la
même répartition des participations par situation familiale :
68% - 32% (voir fin de l'annexe 3).
* 253 Si nous croisons avec
notre questionnaire. Sur 28 réponses nous comptons 30
participations dont 22 concernent les couples et concubins et les
célibataires et 8 seulement les familles avec enfant(s) et les
monoparents.
* 254 Nous avons pu
constater les mêmes résultats au questionnaire (Item
n°10 : Au Club, vous participez à...:à peine un
tiers : 8 pour 22 = 27%. Voir annexe 3).
* 255 Croisons avec les
réponses du questionnaire : L'écart de la branche "plus jeune
âge" (moyenne de 39 ans) et celle de "la plus élevée"
(moyenne de 52 ans) est de 13 ans. La ventilation des âges moyens par
rapport aux activités est de : 39 ans pour Comnet (Internet), 52 ans
pour le CEB (finance), 41 ans pour les autres branches et 47 ans pour un
engagement hors projet.
* 256 En
réalité nous avons indexé neuf entretiens. Cependant, une
interview s'est déroulée en couple. C'est la raison pour laquelle
nous comptons, ici, dix personnes.
* 257 Nous restituons, ici,
des données provenant de deux sources : les entretiens et les
questionnaires. Nous nous permettons de rapprocher les données issues de
ces deux enquêtes parce que huit membres sur dix avaient répondus
au questionnaire quelques mois plus tôt ce qui nous permet de
confirmer/infirmer les réponses identifiées. Voir items à
l'annexe 3.
* 258 4è entretien,
annexe 9.
* 259 Qu'êtes-vous
venu chercher au Club ? (question n°8), annexe 3.
* 260 Qui reviennent
respectivement 8, 12 et 16 fois sur l'ensemble des questionnaires (36).
* 261 4è entretien,
l.850, annexe 9.
* 262 Ib. l.874.
* 263 Ib. l.878.
* 264 C'est-à-dire : rupture de
rôles sociaux ou/et ruptures de liens sociaux.
* 265 Voir note de bas de
page n°264 p.
76
* 266
« Processus inconscient de structuration de la
personnalité par lequel autrui sert de modèle à un
individu qui incorpore ses propriétés et s'y
conforme. » Fisher Gustave-Nicolas, Les concepts fondamentaux de
la psychologie sociale, Dunod, Paris, 1996, p.202.
« [l'identification] se réalise de façon plus large
à travers les valeurs et les normes d'un groupe ou d'un système
culturel, qui organise l'imaginaire collectif et suscite une adhésion
par la possibilité qu'elle offre aux individus de leurs
ressembler. » Fischer, G.-N., Les concepts..., op. cit.,
p.196.
* 267 Cf. annexe 5 (grille
d'entretien).
* 268 Certeau, M. (de),
l'invention..., op. cit., p.XXXVI
* 269 Boudon, R., La
théorie..., Gemas 99, op. cit., p.7. Revoir, aussi, première
partie, p.
81.
* 270 Voir note de bas de
page 20 p.
10.
* 271 Un des principes
fondateurs du Compu's Club. Annexe 1.
* 272 Forme de l'ancien
français compain, "avec qui on partage le pain". C'est un camarade que
l'on aime bien. (Dictionnaire usuel du français, Hachette, 1989).
Sachant qu'un camarade est une personne avec qui on partage certaines
occupations et qui de ce fait devient familière. Le Larousse de poche de
1978 nous dit : « Compagnon de travail, d'étude, de
chambre » et le Quillet de 1971 « Celui qui vit
familièrement avec un autre ».
* 273 Le tri est
effectué sur la colonne "Niveau d'engagement" (Philanthrope,
Pharisien-prestige, Synallagmatique). Nous avons voulu, par des couleurs,
notifier les types de profils. Par exemple : Le Synallagmatique-ami est
plutôt jeune (18-45 ans), sans enfant (célibataire ou couple), est
en rupture de rôles sociaux et s'engage depuis deux ans au moins. Nous
avons voulu croiser avec les questionnaires. Mais nous ne rendrons pas compte
du tableau ici parce que 1) l'outil d'enquête par questionnaire ne se
prête pas complètement à la démarche et 2) nous ne
disposons pas assez d'éléments pour donner le niveau d'engagement
de tous les membres qui avaient répondu. Cependant, nous y sommes
arrivé, tout de même, pour quelques-uns d'entre eux parce que nous
nous sommes aidé de notre temps d'observation qui, rappelons-le, a
duré près de quatre ans quelquefois. De plus nous avons
systématiquement classé un "membre sans engagement" dans la
catégorie Pharisien-prestige.
* 274 Nous entendons par
"évolution de l'engagement" des phases successives par laquelle passe le
membre avant d'atteindre de façon utopique "l'engagement total". Le
membre partirait d'une situation de "consommateur" (le Pharisien-prestige) pour
évoluer, dans ses attitudes d'engagements, vers les
caractéristiques du Synallagmatique (copain puis ami) puis vers celles
du Philanthrope.
* 275 Notons, cependant,
que ces deux facteurs sont fluctuants dans le temps. Parce que la situation
familiale peut changer et la situation personnelle peut évoluer. Par
cela, ces changements sont singuliers de chaque membre confronté, ne
l'oublions pas, à la pluralité de la vie de cette association,
d'une part, et de la vie sociale englobante, d'autre part.
* 276 Elias, N., La
société..., op. cit. Voir note de bas de page n°228 p.
66.
* 277 Terme emprunté
à la chimie signifiant l'arrangement d'une molécule par
différentes liaisons.
* 278 Revoir
première partie. Mais dans notre propos et par exemple :
l'éducation (valeur républicaine), la solidarité (valeur
morale), la participation (valeur d'être). « Selon
Mucchielli (1994), la valeur est un principe de référence
partagé par un ensemble d'individus. [...] elle guide le comportement
des individus qui appartiennent à un groupe. Selon Schwartz (1992), ce
seraient les besoins (primaires et
secondaires) des groupes et des institutions sociales qui
généreraient les valeurs. » Cazals-Ferré,
M.-P. et Rossi, P., Eléments..., op. cit., p.26.
* 279 Il nous a
semblé qu'il s'agissait, dans le contexte, là, d'un sentiment
d'expression possible (pour être écouté) plutôt que
de la valeur "liberté d'expression".
* 280 Seul le couple
interviewé n'a pas exprimé clairement une image de groupe du
Compu's Club. Vaguement, il a été question de forum (4è
entretien : « Ph : moi je verrai le Club comme
çà, un forum. » l.266). Nous n'avons
pas retenu cette
expression parce qu'elle nous semblait axée principalement sur
l'informatique (forum informatique). Cf. section
2.1.2.1 Motifs d'adhésion p.
74. Nous informons qu'ils ne se sont pas
ré-adhérés.
* 281 Soit, la perception
du Compu's Club par le membre.
* 282 Pour Gustave-Nicolas Fischer la nature de la
relation est expliquée par le lien établit dans un réseau
d'échanges, de communications et d'influences qui agissent sur les
comportements. Fischer N.-G., Les concepts..., op. cit., p.29.
* 283 Bien que nous ayons
déjà noté que l'âge paraissait déterminer le
choix de l'activité (voir p.
73), nous ne disposons pas
d'éléments permettant d'indiquer l'influence culturelle et
sociale. nous constatons seulement une
hétérogénéité des branches.
* 284 Nous invitons le
lecteur à se reporter aux notes de bas de page n°282 pour la définition de la relation que nous
avons retenue, celle de Gustave-Nicolas Fischer.
* 285 Dans les deux sens
suivants : 1) mettre en communication ou en rapport et 2) assembler des
feuilles de papiers pour former un livre.
* 286 Encyclopædia
Universalis 1998.
* 287 Ib. (dans son plus
large emploi : dépendance et aide mutuelle entre tous les hommes du
seul fait d'être homme)
* 288 Pilote : terme
employé pour désigner le responsable de la branche. Quelquefois
le Pilote prend l'appellation de "Président de Branche".
* 289 Représentant
les trois branches auxquelles participent les personnes interviewées.
* 290 « "Le
groupe est considéré comme un ensemble de formes, schèmes
et appareils à contenir, transposer et gérer les informations
psychiques." Le groupe est alors perçu comme une instance de nature
à créer des phénomènes psychiques qui lui sont
propres, qui ne seraient pas une simple juxtaposition des appareils psychiques
individuels. » Fischer, Gustave-Nicolas, la psychologie sociale,
du Seuil, Coll. Points d'essais, 1997 in Cazals-Ferré &
Rossi, ib, p.85.
* 291 6è entretien,
annexe 11. Il est aussi le Pilote de la branche Internet : Comnet.
* 292 Newcomb nous montre
« que les attitudes sont fonction du champ social dans lequel
sont insérés les individus : lorsque le champs social est
composé de "groupes de références" dont les attitudes sont
contradictoires, un processus se développe chez l'individu au bout
duquel il finit par choisir un ou plusieurs groupes de références
dont les "valeurs" sont compatibles. Il assure ainsi son insertion dans un
champ social en choisissant des attitudes compatibles avec les groupes de
référence dominants. » Encyclopædia
Universalis 1998.
* 293 Quatrième
entretien, annexe 9.
* 294 Voir annexe
n°1.
* 295 Voir p.
90 les propos du premier entretien.
* 296 Pour Jean-Pierre
Boutinet le projet pourrait se réduire au terme de préoccupation.
« Cette préoccupation a trait à l'effort
perpétuellement recommencé par les individus et les institutions
pour échapper à la fatalité en conférant un sens
à leurs entreprises » Boutinet, Jean-Pierre, Psychologie
des conduites à projet, Puf, coll. Que sais-je, 1999, p.3.
* 297 Sans toutefois
pouvoir encore parler de configuration (Cf. l'introduction
générale).
* 298 Rappelons que nous
avions qualifié ce couple comme des Pharisiens-prestige. Voir p.
83.
* 299 Cf. section
2.2.1 Perception de l'environnement associatif par le
membre, p.
87.
* 300 C'est-à-dire,
la perception de l'association par le membre, les conditions favorables
à sa relation et les niveaux de sa relation.
* 301 Nous avons
déjà abordé ce propos dans un autre contexte, celui des
interrelations (Cf. la section
2.2.3 Du rapport à la relation sociale).
Ici nous l'abordons dans celui du sens.
* 302 Page
87,
2.2.1 Perception de l'environnement associatif par le
membre.
* 303 Section
2.1.2.2 Circonstances d'adhésion, p.
75.
* 304 Nous rappelons que ce
couple n'est plus membre de l'association. Il y avait adhéré pour
l'informatique (cf. section 2.1.2, p.
74) et avait été identifié
comme Pharisien-prestige (cf. section 2.1.3, p.
80).
* 305 Cf. sections 2.1.2.4,
p.
78 et 2.2.2.1, p.
96.
* 306 Troisième
(« j'ai changé ma situation familiale... J'étais
avec une personne qui collait pas trop [...] j'ai été
obligé, de, de fabriquer toute ma vie et de me dire, de toute
façon ça sera... ça sera avec ma vie maintenant et mes
ambitions »), cinquième (« l.113 De pas
rester seul chez moi, déjà ! » l.876 Pour
casser ma solitude, c'est surtout ça, l'ambiance, donc ça me
permet de rencontrer des gens, des personnes. »),
septième individu (« (l.1045) ...ça
permettait, donc, en fait de, de soulager la solitude. ») et
neuvième individu (« l.165 je suis célibataire, je
suis seule. »). Confirmé par le premier
(« La personne qui vit seule, elle vient au
Club. l.616 »).
* 307 « Figure de
rhétorique qui consiste à modifier le sens à un mot en lui
attribuant une signification par comparaison sous-entendue. »
(Encyclopædia Universalis 1998)
* 308 Nous avons
déjà analysé ce passage à la page
89. Il s'agissait alors d'indiquer la
représentation de l'association par le membre. Là, il s'agit
d'avoir une lecture différente, celle des repères
d'identité sociale du membre.
* 309 C'est-à-dire
par un codage mental simplifié, ses représentations symboliques.
Cf. section p.
103,
2.3.1.1 Les représentations ou la part
symbolique.
* 310 C'est-à-dire
par des repères d'identité. Cf. p.
105,
2.3.1.2 Les repères d'identité et les
identifications ou la part réelle.
* 311 Voir aussi p.
95, section
2.2.3 Du rapport à la relation sociale.
* 312 Nous rappelons que le
Compu's Club est agréé association d'éducation
populaire.
* 313
2.1.2 Trois facteurs majeurs d'influence pour
justifier l'engagement, p.
74.
* 314
2.2.2 La naissance de conditions favorables à
la relation, p.
90.
* 315
2.3.2 Développer sa relation sociale ou
l'élaboration du sens, p.
108.
* 316 Nous
précisons, ici, en bas de page, que ce membre est très
attaché à l'amitié et la solidarité. Cf. le premier
entretien.
* 317 Nous précisons
que ce membre est celui qui « était fier d'obtenir une
clef ».
* 318 Rappelons notre
incompréhension devant le changement de certains membres du Compu's Club
indépendamment de l'outil informatique (Cf. introduction
générale, question de départ). Nous avions avancé
l'hypothèse qu'une configuration favorisant les manières de faire
des individus, leurs permettait de donner du sens à leur statut
d'individu. (Cf. hypothèse).
* 319 Nous pouvons
qualifier de phénoménologique l'analyse de la configuration de
cette association parce qu'elle a cherché à découvrir
l'essence même des personnes interviewées d'une part, et les
structurations des maturations, d'autre part. C'est-à-dire qu'elle a
tendu « à saisir les visées et les vécus des
sujets dans leur rapport à autrui et à leur propre
intimité » (Maisonneuve J., La psychologie..., op. cit.,
p.25).
* 320 Cette analyse nous a
permis d'établir trois portraits types des acteurs : le
Philanthrope, il donne ; le Synallagmatique, il échange et le
Pharisien-prestige, il prend.
* 321 De même que
nous l'avions vu dans la première partie. Voir note de bas de page
n°
44.
* 322 Elias, Norbert,
Qu'est-ce que la sociologie ? Pocket Agora, p.150 in Corcuff, P.,
Les nouvelles..., op. cit., p.24.
* 323 Dans le sens de
désignation de phénomènes de contacts et
d'interpénétration de cultures différentes.
* 324
Egrégore : groupe humain doté d'une personnalité
différente de celles des individus qui le forme. Encyclopædia
Universalis, Cd-Rom 1997. Voir aussi le rapprochement que nous avons fait de ce
terme avec Aristote et Elias à la page
13 de l'introduction générale.
* 325 Elias, Norbert, La
société de cour, Flammarion, coll. Champs, 1985, pp.152-153.
* 326 Cf. deuxième
partie, p.
74 et suiv., section
2.1.2 Trois facteurs majeurs d'influence pour
justifier l'engagement.
* 327 Maslow Abraham,
(Motivation and personality) New York : Harper and Row, 1954 in
Tissot Jacques (Marketing /vente), publication de la MIFI (Maison de
l'innovation et de la formation industrielle), 1995.
* 328 Chombart de Lauwe,
Paul-Henry, Pour une sociologie des aspirations, Denoël-Gonthier, 1971,
quatrième de couverture.
* 329 Cf. Deuxième
partie
2.2.2 La naissance de conditions favorables à la
relation, p.
90 et suivantes.
* 330 Elias, N., La
société..., op. cit., p.12. : « comme au jeu
d'échec, toute action accomplie dans une relative indépendance
représente un coup sur l'échiquier social, qui déclenche
infailliblement un contrecoup d'un autre individu limitant la liberté
d'action du premier joueur. ». Ib., p.13.
* 331 Goffman, Erving, La
mise en scène de la vie quotidienne, t1 la présentation de soi,
tr. fr., Minuit, 1961 in Moscovici, S., Psychologie..., op. cit.,
p.48.
* 332 Goffman, Erving,
Stigmate, Les éditions Minuit, coll. Le sens commun, 1996, p.57.
* 333 Sans vouloir
définir chacun des termes employés nous prenons l'exemple du
bricolage. Le mot bricole a pour origine bricola (machine de guerre ; et
bricoler (qui apparaît pour la première fois en 1867 dans le Grand
Dictionnaire Universel Larousse) a pour définition « qui
fait toutes sortes de métiers ». Dans notre propos, il
s'agira de transposer cette définition en tant que l'adhérent
"joue toutes sortes de fonctions et de rôles".
* 334 Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit., p.51.
* 335 "Usage des
circonstances", ici, doit être entendu dans un sens de "pratique des
circonstances" (d'utilisation, d'usure). C'est-à-dire, pour suivre
Certeau : « l'usage définit le
phénomène social par lequel un système de communication se
manifeste en fait ; il renvoie à une norme. »
Certeau, M. (de), ib., p.151.
* 336 Certeau, M.,
L'invention..., ib., p.52.
* 337 Configuration :
« figure globale toujours changeante que forment les
joueurs ; elle inclut non seulement leur intellect, mais toute leur
personne, les actions et les relations réciproques. »,
Elias, N., La société..., op. cit., p.14.
* 338 En
résumé, l'humain est vu comme un être se dirigeant vers son
plein épanouissement (la réalisation de soi). Cette approche
suppose l'existence du Moi et insiste sur l'importance de la conscience et de
"la conscience de soi". Le but serait donc de permettre à tout individu
de se mettre en contact avec ses émotions et ses perceptions afin de se
réaliser pleinement, c'est-à-dire, atteindre la
réalisation de soi. Pour Maslow, le comportement est aussi notre
désir conscient de croissance personnelle.
* 339 Selon Maslow, les
besoins humains sont organisés selon une hiérarchie où,
à la base, on retrouve les besoins physiologiques
élémentaires et à son sommet, les besoins psychologiques
d'épanouissement, sociaux et affectifs d'ordre supérieur. Ce
seraient ces besoins qui créeraient la motivation humaine. A la fin de
sa vie, Maslow rajoute les besoins spirituels en sixième besoin, tout en
haut de sa pyramide suggérant le dépassement de soi.
* 340 Besoins
physiologiques fondamentaux (et biologiques) sont de l'ordre de huit :
faim, soif, sommeil (repos), élimination, respiration, sexualité,
évitement de la douleur, protection de l'environnement par le logement.
En clair, ce sont les besoins dont la satisfaction est importante ou
nécessaire pour la survie.
* 341
C'est-à-dire : besoins psychologiques, sociaux et affectifs d'ordre
supérieur.
* 342 Drucker, Peter, Le
Management par objectifs (Management of results), 1964 in
Encyclopædia Universalis à Drucker P.
* 343 Chombart de Lauwe,
P.-H., op. cit.
* 344 Huitième
entretien, l.588.
* 345 Besoins
économique, physique comme la protection, le confort, l'absence de
menace, l'environnement organisé, etc.
* 346 Tissot Jacques,
Consultant, livre Marketing /vente 1995, publication de la MIFI
(Maison de l'Innovation et de la Formation industrielle)
* 347 Nous nous référons pour cette
interprétation aux propos émis par la sixième personne
interviewée, p.
89. Michel Maffesoli parle de "tribus" :
« le tribalisme rappelle, empiriquement, l'importance du
sentiment d'appartenance, à un lieu, à un groupe, comme fondement
essentiel de toute vie sociale. ». Maffesoli, M., op. cit.,
p.XII. Paul-Henri Chombart de Lauwe, quant à lui, parle d'unité
de vie sociale : « l'unité de vie sociale est une
unité de vie quotidienne, une unité d'usage, une unité de
relation [...] Elle a une existence. » Chombart de Lauwe, P.-H.,
op. cit., p.128.
* 348 Cf. enquête p.
89.
* 349 Cf. deuxième
partie, p.
81. Celui que nous avons nommé le
Pharisien-Prestige.
* 350 Michel Maffesoli a
proposé la métaphore de la "tribu" pour prendre acte de la
métamorphose du lien social (Maffesoli, M., Le temps..., op. cit.
p.III).
* 351 Maffesoli, M., Le
temps..., ib. p.XII.
* 352 Notamment à
partir de l'idée de réciprocité et de dépendance de
l'échange. Il ne s'agit donc pas, ici, de communication en tant qu'elle
puisse être émission - canal de transmission - réception -
feed back.
* 353 Adair John, Le
leader, homme d'action, Top, 1991 in Chibber, M.L., Leadership, Sai,
1998, p.40.
* 354 Par exemple,
entretien n°2 , l.313.
* 355 Deuxième
entretien : « Et j'ai eu l'occasion de concrétiser
çà, de, de, d'en avoir la preuve. [...] il y a un
déménagement, et bien y a pas un pelé, y en a 15 de
pelés. Y a...euh... bon. Et je pense que... on sait faire... euh... y a
des gens qui savent passer outre... leur, leur nombril pour...euh... ben, le
but de... initial de l'association. » (l.103).
Neuvième entretien : « [...] on
essaie de mieux comprendre, de mieux, pas comprendre l'autre, mais se
comprendre mutuellement. » (l.101) « Je crois que
c'est à travers le déménagement. [...] lorsque j'ai vu
tout le travail pour aménager le nouveau local, euh... tout ce
foisonnement de personnes que je ne connaissais pas... et... [...], enfin,
quand j'ai vu tout ce travail... cette ruche... ça m'a quand même
beaucoup impressionnée. J'ai vu qu'à travers euh... Les
différentes activités, il y avait un lien... »
(l.247).
Cinquième entretien : « les principes
d'entraide mutuelle... entre les membres, donc moi ça m'a
intéressé parce-que je connais pas mal la technique, je travaille
là-dedans, donc je pouvais aider les membres à ce niveau
là... et j'allais surtout pour essayer d'apprendre un peu à me
servir des logiciels et... sur les PC. » (l.20).
« Notre devise c'est l'entraide mutuelle. Donc, pour moi c'est
vrai que c'est un bon principe. Ouais, pour moi, la vie du club, c'est surtout
l'entraide mutuelle, ça évite que les gens y viennent juste
prendre sans donner... Parce-que un club, si personne donne, bon, ben,
ça peut pas fonctionner... ça c'est sûr. »
(l.333).
Sixième entretien : « ça se
passe pas toujours de la même manière, [...] en
général, on essaye toujours de s'entraider
mutuellement. » (l.206).
* 356 Cf. la pyramide de
Maslow. Si nous nous sommes arrêté au point 4 de la pyramide c'est
parce-ce que Maslow croyait que c'est précisément à ce
type de besoin que la majorité des gens s'arrêtent. A fortiori,
nous n'aborderons pas le point 5. D'autant que pour lui la réalisation
de soi (qu'il appelle aussi actualisation) n'est jamais complètement
atteinte et toujours à rechercher davantage.
* 357 Par exemple,
entretien n°9, l.730.
* 358 Chombart de Lauwe,
P-H., Pour une sociologie..., op. cit., p.36. De même qu'il a
défini l'espoir : « L'espoir est une attente du
maintien d'un état auquel on attache une grande valeur, de la
réalisation d'une situation nouvelle pour soi-même ou pour un
groupe plus ou moins large auquel on appartient. L'espoir est lié au
soucis, à la contrainte, à la préoccupation dont on veut
sortir, à la peur de perdre ce que l'on possède et en même
temps à l'avènement d'un ordre nouveau de conditions nouvelles
dans lesquelles une plus grande liberté sera
réalisée. » Chombart de Lauwe, P-H., Pour
une sociologie..., ib., p.35-36
* 359 Besoin
d'indépendance, d'autonomie, d'estime (de soi et des autres), par
exemple la reconnaissance et le prestige, la compétence, etc.,
c'est-à-dire la "valorisation de l'individu" en tant que tel, et non pas
dans le but de s'approprier la "fidélité" de
l'adhérent.
* 360 Maslow, A.H.,
Motivation..., op. cit. Cf. aussi notamment Argyris, Chris, Participation et
organisation, Dunod, 1970.
* 361 Pour confirmer
l'introduction de cette troisième partie en p.
120.
* 362 Voir première
partie qui pose le problème, p.
36.
* 363 Cf. la pyramide de
Maslow.
* 364 Cf. p.
106.
* 365 Cf. p.
128 qui posait cette
éventualité.
* 366 Chombart de Lauwe
précisant : « Les groupes poursuivent un but en
fonction [...] d'ensembles de représentations, de systèmes de
valeur. Pour les individus, [...leur] accomplissement n'est possible que dans
[...] des groupes auxquels [il] participe et dont il partage plus ou moins les
aspirations. » Chombart de Lauwe, P.-H., Pour une sociologie...,
op. cit., p.18.
* 367 Chombart de Lauwe,
Pour une sociologie..., op. cit., p.16.
* 368 Chombart de Lauwe,
Pour une sociologie..., ib. Nous permettant de relever, dans notre
hypothèse, « plus l'individu accède à un
statut d'individu. »
* 369 « Le
désir est un mouvement de l'être vers un objet que l'on ne
possède pas, ou de conservation et de développement d'un bien que
l'on possède. Spinoza le présentait comme "un appétit
accompagné de la conscience de lui-même". Mais cette conscience
peut être claire ou confuse. [...] La tendance qui correspond au
désir peut porter le sujet [...] vers un état vague
évoqué à travers des images parfois très flous.
Dans ce cas le désir n'a pas de limite. » Chombart de
Lauwe, P-H., Pour une sociologie..., ib., p.35.
* 370 Chombart de Lauwe,
Paul-Henri, La culture et le pouvoir, L'Harmattan, 1983, p. 272.
* 371 Rocher, Guy, Pour une
théorie psychosociologique des aspirations, dans Bélanger, P.W.
Rocher, Guy et coll.., Le projet A.S.O.P.E. : son orientation, sa
méthodologie, sa portée sociale et ses réalisations,
Les Cahiers d'A.S.O.P.E., vol. VII, PUL, 1981, p.52.
* 372 Rocher, G., Pour une
théorie..., ib. p.52.
* 373 Interview n°2,
l.389, p.
81. Interview n°4, l.259, 683, 883. Nous
précisons que cet adhérent a quitté l'association
dès lors qu'il a pu acquérir et utiliser un ordinateur de
manière autonome, c'est-à-dire chez lui.
* 374 Annexe 9,
entretien n°4 (entre autres), l.259.
* 375 Comme toutes les
personnes interviewées, par exemple : « En fait on
est allé dans un club informatique pour parler informatique. [...] On
savait pas le parler au début. » (l.883). Deuxième
partie, ib.
* 376 « Se
sentir sur le même piédestal, quoi. Parler de la même
chose. » (l.683). Deuxième partie, ib.
* 377 Plutôt moins
que plus. Cf. section
2.2.1 Perception de l'environnement associatif par le
membre, p.
87.
* 378 Chombart de Lauwe,
P-H., Pour une sociologie..., op. cit., p.19.
* 379 « Les
aspirations pourraient se situer apparemment sur trois plans successifs,
suivant la distance et la nature des objets vers lesquels elles tendent :
les désirs, les espoirs et l'espérance. » Chombart
de Lauwe, P-H., ib., p.35.
* 380 Chombart de Lauwe,
Pour une sociologie..., ib., p.36.
* 381 Chombart de Lauwe,
Pour une sociologie ..., ib., p.36.
* 382 CAO : Conception
Assistée par Ordinateur. Au moment où nous avons
interviewé le couple (entretien n°4), Pilote de la branche, la
branche était en sommeil.
* 383 Annexe 9,
entretien n°4.
* 384 Annexe 9,
entretien n°4, l.293. Nous rappelons que ces adhérents (le couple)
ont rejoint l'association pour pratiquer l'informatique qu'ils ne connaissaient
pas. Mais aussi pour élargir des liens sociaux : discuter avec un
collègue de travail, faire une activité à deux (en
couple), être reconnu (« sur le même
piédestal »), etc. (Cf. l'enquête).
* 385 Annexe 9,
entretien n°4, l.344-432.
* 386 Annexe 9,
entretien n°4, l.396-411.
* 387 Chombart de Lauwe,
Pour une sociologie..., ib., p.65.
* 388 CEB : Comprendre
l'Economie et la Bourse. Au moment de l'enquête nous avons pu interviewer
quatre membres de cette branche : entretiens n°5, 6, 7 et 9.
* 389
« Parce-qu'avant de comprendre les mécanismes de la
finance il faut du temps et acquérir une
expérience. »
* 390 Un club
d'investissement est un groupe de personnes qui décident de mettre en
commun une épargne mensuelle d'un montant peu élevé.
L'objectif principal est, à la fois, de permettre à ses membres
d'apprendre et de comprendre les mécanismes économiques,
financiers et boursiers afin de constituer un portefeuille fictif d'actions
puis investir réellement en Bourse ; répartir les risques et
obtenir une fiscalité avantageuse ; mettre en commun et
échanger des "savoirs".
* 391 Annexe 10,
entretien n°5, l.157.
* 392 Annexe 14,
entretien n°9. l.50, 284 et 291.
* 393 Annexe 14
entretien n°9, l.560.
* 394 Annexe 11,
entretien n°6, l.345, 405 et 608.
* 395
« Lorsque les aspirations des personnes et des groupes sont
prises en considération dans la décision, le pouvoir est de type
démocratique. » Chombart de Lauwe, P.-H., Pour une
sociologie..., op. cit., p.27.
* 396 Chombart de Lauwe,
P.-H., Pour une sociologie..., ib., p.28.
* 397 Annexe 7, entretien
n°2, l.50.
* 398 Le nom "Echap" est
venu à partir de la touche du clavier informatique "échap" (ou
"esc", abréviation de escape en anglais). Sur un ordinateur, cette
touche permet, en outre, de fermer des fenêtres, sortir d'une
situation.
* 399 Cf. deuxième
partie, p.
76.
* 400 Son intrigue fait
« médiation entre des événements ou des
incidents individuels, et une histoire prise comme un tout. A cet égard,
on peut dire équivalement qu'elle tire une histoire sensée de- un
divers d'événements ou d'incidents (les pragmata
d'Aristote) ; ou qu'elle transforme les événements ou
incidents en- une histoire. » Ricoeur, Paul, Temps et
récit. L'intrigue et le récit historique, t.1, Point, 1991,
p.127.
* 401 Annexe 7,
entretien n°2, l.133.
* 402 Annexe 7,
entretien n°2, l.398.
* 403 Annexe 7,
entretien n°2, l.511.
* 404 Nous rappelons au
lecteur que certains de ces membres ont retrouvé un emploi. Cf.
introduction générale.
* 405 Annexe 7,
entretien n°2, l.271.
* 406 Annexe 7,
entretien n°2, l.434 et 340.
* 407 Annexe 7,
entretien n°2, l.518 et 501.
* 408 En effet, cette
branche a fait l'objet de nombreuses publicités, radios,
télévision, journaux, signatures diverses.
* 409 Certeau, M.,
L'invention..., op. cit., p.120.
* 410 « Le
désir, lié à l'inconscient, à la partie la plus
intime de la personne, prend sa source dans des événements de la
vie du sujet et ces événements sont marqués par le cadre
social dans lequel l'individu a vécu. [...] L'histoire personnelle de
l'individu est étroitement liée à la structure et à
l'histoire de la société dont il fait partie. Il n'est pas
possible de comprendre l'une sans se référer à l'autre. La
psychologie ne peut pas ignorer la sociologie. » Chombart de
Lauwe, P-H., Pour une sociologie..., ib., p.28-29
* 411 Chombart de Lauwe,
Pour une sociologie..., ib., p.38.
* 412 Chombart de Lauwe,
Pour une sociologie..., ib., p.37. "L'état" sera
interprété, dans ce mémoire en tant que "statut
d'individu" inconsciemment visé par des actions singulières (le
désir, l'espoir et l'espérance) et l'expression "structures
nouvelles" comme une figure globale interactive, interdépendante et
réciproque, toujours changeante ; c'est-à-dire une
configuration.
* 413 Chombart de Lauwe, La
culture et le pouvoir, Stock, 1975.
* 414 Dans un soucis de
précision, nous avons placé dans ce schéma les trois
exemples de désir (CAO), espoir (CEB) et espérance (Echap).
* 415 Cf.
1.3.2 L'individu dans son groupe, un inventeur de
manières de faire, p.
53.
* 416 Certeau, M. (de),
L'invention, op. cit., p.14.
* 417 Elias, N., La
société..., op. cit., p.19.
* 418 Corcuff, P., Les
nouvelles..., op. cit., p.24.
* 419 Ib.
* 420 Chombart de Lauwe,
P.-H., La culture et le pouvoir, L'Harmattan, 1983, p. 272.
* 421 Par exemple les
smiley ( ;-) ) ou les abrégés (A+)
* 422 Cf.
l'enquête (l'adhérent. ne connaît pas
l'association).
* 423 Il est aisé
pour nous de choisir cet exemple parce-que nous avions en charge le
développement de la branche Ifac. Il y a des membres de la branche
Finance que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vu parce-que nous
ne participons pas à leurs réunions.
* 424 Elias in
Corcuff, P., Les nouvelles..., op. cit., p.26.
* 425 Dans l'enquête
nous avons relevé que le choix du Pilote se faisait de manière
informelle.
* 426 Cf. par exemple,
deuxième entretien, l.460, septième entretien, l.685,
troisième entretien, l.474. Il est intéressant, au passage, de
remarquer que cet adhérent emploi le terme "rentrer" pour dire qu'il
vient au Club. Sans y attacher trop d'importance, ce simple mot dénote,
de sa part, sa représentation de l'association, un "chez lui". Si l'on
suppose que l'image que l'on a de chez soi est un lieu de bien-être, de
refuge, de détente alors ce simple mot indique ce bien-être, ce
refuge, cette détente lorsqu'il vient à l'association.
* 427 Les trois
membres-romanciers de cette branche se sont promis de réaliser ce roman
quoi qu'il arrive. Maintenant qu'il est achevé, le projet Echap (la
configuration Echap) s'est éteinte. Cependant la branche
Littérature, actuellement en sommeil, existe toujours pour accueillir un
nouveau projet qui formera une nouvelle configuration.
* 428 Voir la section
3.2.2.2 La représentation convenue : , p.
154.
* 429 Nous faisons la
même interprétation lorsque le projet a été
médiatisé.
* 430 L.501,
« on n'a jamais failli », deuxième
entretien.
* 431 Le roman de fiction
de la Branche Littérature à été édité
puis publié fin 2001.
* 432 Par exemple,
deuxième entretien, l.528, annexe 7.
* 433 Le prétexte de
sa démission : finir le livre et écrire une pièce de
théâtre.
* 434 Deuxième
entretien, l.242 et suivantes, par exemple. Annexe 7
* 435 Cf. deuxième
partie,
2.1.2.1 Motifs d'adhésions, p.
74.
* 436 Plus
précisément, il s'agit d'une "manière" de reconstruire le
réel de l'association : « Etre réellement un
certain type de personne , ce n'est pas se borner à posséder les
attributs requis, c'est aussi adopter les normes de la conduite et de
l'apparence que le groupe social y associe. » Goffman, E., La
mise..., op. cit., p.76.
* 437 Carling, F., And Yet
We Are Human, Chatto & Windus, 1962, p.18-19 in Goffman, E.,
Stigmates, op. cit., p.34.
* 438 Cf. deuxième
partie,
2.3.1.1 Les représentations ou la part
symbolique, p.
103.
* 439 Jodelet et Moscovici
1989, p.67 in Bernoux Philippe, La sociologie des entreprises, Seuil,
coll. Essais, 1999, p.237.
* 440 Cette
représentation convenue pouvant être symbolique devenant
alors une représentation convenue symbolique. Par exemple, les membres
de la branche CEB, dans leurs aspirations à gagner de l'argent, ont une
représentation symbolique de la quantité d'argent à
gagner.
* 441 Entretien
n°2.
* 442 C'est-à-dire,
leurs diverses ruptures sociales : long chômage, famille
monoparentale, ...
* 443 Par exemple,
sixième entretien, l.489-494, annexe 11.
* 444 Cf. première
partie,
1.2.2 De l'individualisme à la relation
à l'autre : la solidarité, p.
35 : partenariat, engagement, entraide
mutuelle, bénévolat, par exemples.
* 445 Par exemple,
l'adhérent entendu au cours du septième entretien (l.245)
identifié "adhérent Synallagmatique" (c'est-à-dire, "donne
en contrepartie", tableau deuxième partie, p.
83). A l'inverse, l'adhérent
(entretien n°1) a été identifié en tant que
"adhérent Philanthrope" (ib.).
* 446 Goffman, E.,
Stigmate, op. cit., p.81.
* 447 Revenant seize fois
dans les conversations.
* 448 Cf. deuxième
partie, p.
108.
* 449 Branche
composée uniquement de mineurs. Voir annexe 1.
* 450 Section
3.2.2.4 Représentations et présentations
de soi : une réciprocité, p.
156. L'impression du père de famille aux
jeunes de la branche Libertech, par exemple.
* 451 Voici, par exemple,
ce que dit notre 7è interlocuteur : « j'ai
déjà une fonction [...] donc j'ai une
responsabilité. », l.244.
* 452 8è entretien,
l.215.et 9è entretien, l.95. Voir annexes 13 et 14.
* 453 Cf. chapitre
précédent, p.
156, "le fait de se différencier...".
* 454 Cf. deuxième
partie qui inventorie les ruptures.
* 455 En
référence des lignes 531, 709 et 757. Annexe 14.
* 456 Tromperie qui n'est
pas nécessairement vicieuse. Elle peut, en effet être altruiste en
même temps qu'elle peut servir desseins du trompeur. Après
réflexion, peut-être y a-t-il tromperie envers lui-même
d'abord. Il semble, en fait, se convaincre inconsciemment qu'une fin honorable
justifie le moyen de manipulation ?
* 457 Ici, même si
l'adhérent rend compte de son action de manière à rendre
le propos impersonnel, nous savons, par la période d'observation qu'il
en est l'acteur : « Je (membre du Club) qui a
d'énormes difficultés, et qui est arrivé... c'était
minable son compte-rendu... il l'a lu, mais ça fait rien ! Il a
fait un effort, moi j'ai trouvé çà... qu'il accepte de
faire une recherche et de parler... moi, je pense que pour lui, ça a
été... c'est pour çà qu'il ne faut pas le
lâcher ! » Neuvième entretien, l.284.
* 458 Neuvième
entretien, l.587. Annexe 14.
* 459 Section
3.2.3 Présentations de soi : une production
de fragments identitaires, p.
157.
* 460 Fischer, G.-N., Les
concepts..., op. cit., p.188.
* 461 Dont nous avons vu 1)
le rôle crucial dans la formation des participations, 2) qu'elles
étaient basées sur des valeurs historiques (préalablement
intériorisées), contextuelles ou/et (re)construites.
* 462 Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit., p.XXXVIII et suiv.
* 463 Certeau, ib.,
p.38-39.
* 464 Certeau, M. (de),
l'invention..., op. cit., p.173.
* 465 Par exemple,
troisième entretien, l.161 et 211, annexe 8.
* 466 Groupe de camarades,
micro-société (l.138), partage gigantesque (l.394-399) absence de
contrainte, monde parfait (l.161) mais suivant des règles
(hiérarchisé, l.280), sociale (aider les gens à
problèmes, l.428-436) moment de détente (l.474, 150b).
* 467 Cf. l.404, 66b,
68b-74b, 179b, 216b, 190b.
* 468 « Je
suis moi-même jeune à 27 ans », l.68-74.
* 469 Rupture familiale
(l.133b-138b) et peut-être besoin de reconnaissance professionnelle. Ce
qui nous amène à nous demander si ses responsabilités
professionnelles l'empêchent de s'extérioriser, s'exprimer et
qu'il trouverait cela au Compu's Club.
* 470 Cf. l.204b, 138, 229,
169, entre autres exemples.
* 471 Secrétaire
Adjoint, Secrétaire Général, Vice-Président et
récemment Président de l'association (01-02). De plus il a
fondé une nouvelle branche (LDM) dont il a pris le pilotage.
* 472 Troisième
entretien, l.138, annexe 8.
* 473 Plus
précisément de ce lieu en tant que non-lieu qu'est
finalement la configuration.
* 474
« L'écart entre les usages inventés et ceux
constatés en posant l'existence de deux mondes, celui de la production,
et de l'autre celui de la consommation ou des usages, perçus comme des
pratiques inventives et créatives ». Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit.
* 475 L'adhérent de
la section Littérature en a énoncé maints exemples. Annexe
7.
* 476 Deuxième
entretien, l.327, annexe 7.
* 477 Mission :
"Proposer l'outil informatique afin de favoriser la construction
d'activités par les membres eux-mêmes". Cf. introduction
générale, p.
6.
* 478 Annexe 1.
* 479 Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit., p.XXXVIII.
* 480 Certeau, M. (de),
L'invention..., ib., p.XLVII.
* 481 Ce qui nous
amène, à énoncer une définition du style, celle de
Greimas : « Le style spécifie "une structure
linguistique qui manifeste sur le plan symbolique (...) la manière
d'être au monde fondamentale d'un homme" » (Greimas,
Aljirdas-Julien, Linguistique statistique et linguistique structurale
in Le Français moderne, 1962, p.245).
* 482 « Le
"retour" de ces pratiques dans la narration [...] se rattache à un
phénomène plus large, et historiquement moins
déterminé, qu'on pourrait désigner comme une
esthétisation du savoir impliqué par le
savoir-faire », Certeau, M. (de), L'invention..., op. cit.,
p.110.
* 483 Cf. p.
50. Section
1.3.1.2 Peut-on fonder un système de
valeurs ?
* 484 Du moins à
partir de l'image qu'il a de la normalité.
* 485 Deuxième
entretien, l.98. Annexe 7.
* 486 Cf. les entretiens.
Par exemple : chômage, solitude, longue maladie, divorce.
* 487 Elias, N., La
société..., op. cit., p.14.
* 488 Certeau, M. (de),
L'invention..., op. cit. p.14.
* 489 Elias, N., La
société..., op. cit., p.93.
* 490 Elias, N., La
société..., op. cit., p.41.
* 491 Elias, N., La
société..., op. cit., p.191.
* 492
Abréviation : France Culture = Fr. Cult.
* 493 Article
1er de la loi du 1er juillet 1901.
* 494 Cf. les propos du
fondateur.
* 495 Appelé NTIC ou
TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)
* 496 Les statuts de
l'association prévoient jusqu'à douze administrateurs.
* 497
Généralement à partir d'un projet déjà
défini par le membre. Par exemple : je cherche à
écrire un livre création de la Section Littérature.
* 498 Revue Sciences
humaines n°89, décembre 1998, page 39 à 41.
* 499 Revue Sciences
humaines n°89, décembre 1998, page 40.
* 500 Magazine du Conseil
général de la Drôme, mai/juin 2000, p.24 et 25.
Dauphiné Libéré du 17 janvier 2000, « Pas
tout à fait leur vie, mais un vrai roman ». L'impartial
du 21 janvier 2000, "Chômeurs écrivains". L'Écho-le
Valentinois du 20 janvier 2000, "Comment rebondir par l'écrit avec
Échap...". Peuple Libre du 20 janvier 2000, "Des chômeurs
écrivent une fiction sur Valence". Plusieurs radios comme Radio Bleue
Drôme Ardêche, ... Et plus récemment, une double page dans
le magazine du Conseil général de la Drôme de mai/juin
2000, "Mots pour maux". La branche fut sponsarisé par la fondation
Créavenir, le Crédit Mutuel, l'entreprise Merlin, le
comité d'entreprise Imaje, la maison d'édition la Mirandole.
* 501 Enquête
Crédoc-Diise sur la Vie Associative, décembre 1998 in la
revue Crédoc n°133, Huit Français sur dix concernés
par la vie associative, 20-02-99.
* 502 Ib., p.3.
* 503 La ligne Autres
branches du tableau suivant concerne la branche Littérature et
Junior (encadrement des jeunes par des adultes) et la ligne Hors
branche signifie que le membre participe à la gestion globale de
l'association sans suivre de projet particulier.
* 504 Au moment de
l'entretien.
* 505 Revue Futuribles,
L'évolution des valeurs des Européens, n°200,
juillet-août 1995, p.16.



