|

1
Université de Lille
UFR humanités
Département Arts de la scène
Les ligues d'improvisation théâtrale dans
les Hauts-de-France :histoire, organisation et codes
Matthieu Hacot
Mémoire de Master 2
Sous la direction de Madame Ariane Martinez Soutenu à la
session de juin 2019
2
Remerciements
Je tiens à remercier Madame Ariane Martinez pour ses
précieux conseils et sa disponibilité qui ont permis
l'écriture de cet ouvrage.
J'adresse également mes remerciements à tous les
improvisateurs qui ont généreusement accepté de
répondre à mes interrogations : Monsieur Jean-Baptiste Chauvin,
membre de la Ligue Majeure d'Improvisation et co-fondateur de la compagnie
Déclic théâtre, ainsi qu'aux improvisateurs nordistes :
Monsieur Emmanuel Leroy, fondateur de la Ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul. et Monsieur
Simon Fache, membres de la Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul, Madame
Florine Sachy et Monsieur Maxime Curillon, du bureau du Groupe d'Improvisation
du Terril, Monsieur Arthur Pinta, président de la Ligue d'Improvisation
Lilloise Amateur, Monsieur Philippe Despature et Monsieur Corentin Vigou,
professeurs à l'école Impro Academy. Un grand merci
également à Thierry Bilisko pour les passionnantes discussions
à propos de l'arbitrage, ainsi qu'à Grégory Allaeys pour
son témoignage sur l'improvisation dans les Hauts-de-France .
Je souhaite également saluer et remercier tous les
improvisateurs croisés jusqu'à ce jour, avec qui les discussions
informelles entretiennent ma réflexion et mon intérêt pour
l'improvisation théâtrale.
3
Table des matières
Introduction 4
Partie 1 : Du Canada à la France :
Création et acclimatation des ligues d'improvisation 11
I.1 :Des Jeunes Comédiens au Théâtre
expérimental de Montréal :l'époque des
expérimentations.13
I.2 :La création du match d'improvisation
théâtrale .19
I.3 :L'importation du match d'improvisation
théâtrale en France :création et extensions des ligues
|
d'improvisation
|
28
|
|
I.4 :En jeux artistiques et financiers
|
..40
|
|
Partie 2 : codes et vocabulaire de l'improvisation
théâtrale
|
59
|
|
II.1 :Le règlement du match d'improvisation
théâtrale
|
59
|
|
II.2 :Lexique de l'improvisation théâtrale
|
81
|
|
Partie 3 : Paysage et évolution de
l'improvisation théâtrale dans les Hauts-de-France.
|
100
|
|
III.1 :Le paysage actuel de l'improvisation
théâtrale dans les Hauts-De-France
|
103
|
|
III,2 :Les méthodes de recrutements ; des
différences selon les origines
|
106
|
|
III.3 :Les organisations internes des compagnies
|
111
|
|
III.4 :Le staff :mettre en valeur les partenaires
|
125
|
|
Conclusion
|
..133
|
|
Bibliographie
|
..139
|
|
Annexes
|
..142
|
|
Liste des entretiens réalisés
|
.142
|
|
Les signaux d'arbitre, pour le match d'improvisation
théâtrale
|
..143
|
|
Table des illustrations
|
145
|
Introduction
« Pourquoi les salles de théâtres sont-elles
vides et les stades de football pleins à craquer ? »1 Robert
Gravel2
Dans les années 70, une crise identitaire frappe le
théâtre québécois : Durant la Révolution
Tranquille (1960-1970), des mouvements de réformes se heurtent aux
tendances traditionalistes du gouvernement en place. Une envie de changement se
manifeste dans les milieux étudiants, ainsi que dans les deux
écoles où le théâtre est enseigné : le
Conservatoire d'art Dramatique, fondé en 1958 à Québec et
L'École Nationale de Théâtre du Canada fondée en
1960 à Montréal. La rencontre entre Robert Gravel (jeune
comédien sorti du Conservatoire) et le metteur en scène
Jean-Pierre Ronfard aboutit à des créations expérimentales
et collectives qui renouvellent le paysage théâtral. Depuis son
intégration dans la troupe des Jeunes Comédiens en 1970
jusqu'à la création de la Ligue Nationale d'Improvisation en
1979, l'improvisation apparaît comme une source de créations
expérimentales.
Lorsque Robert Gravel évoque salles de
théâtre et salles de foot, il introduit une comparaison entre le
simulacre et la compétition, deux des quatre catégories que le
sociologue Roger Caillois classe dans sa typologie des formes de jeu. Celle-ci
comprend : la compétition, le hasard, le simulacre et le vertige. Dans
Les jeux et les hommes, le masque et le vertige, Caillois explique en
quoi le jeu cimente les civilisations. Il fait la remarque suivante : «[Le
jeu] repose et amuse. Il évoque une activité sans contrainte,
mais aussi sans conséquence pour la vie réelle. Il s'oppose au
sérieux de celle-ci et se voit ainsi qualifié de "frivole"
»3.
Le théâtre, qui relève du simulacre,
procure du plaisir au joueur dans la satisfaction de se faire passer pour autre
: « le masque dissimule le personnage social et libère la
personnalité véritable. »4 Les jeux de compétition
permettent aux participants de prouver leur valeur ou leur adresse dans un
domaine intellectuel ou sportif. Le cadre de la compétition dans un
temps et un espace dédiés s'impose alors comme nécessaire
pour mettre à exécution la soif de défi qui unit les
hommes sans violence. Bien que ces deux catégories (jeux de simulacre et
jeux de compétition) soient distinctes, il semble intéressant de
pointer qu'elles peuvent parfois se rejoindre sur certains points. La
présence de simulacre dans tout jeu de compétition est
difficilement contestable : tout joueur, dès lors qu'il entre dans le
cadre physique et temporel d'un jeu de compétition, s'amuse à
devenir autre.
1 Christophe Tournier, Manuel d'improvisation
théâtrale, Genève, Éditions de l'eau vive,
2006, p. 10.
2 Robert Gravel est né le 12 Septembre 1944 à
Montréal et décédé le 12 Août 1996 à
Saint-Gabriel-de Brandon.
3 Roger Caillois, Les jeux et les hommes, le masque et le
vertige, Paris, Gallimard, 1958, p. 9.
4 Ibid., p. 65.
4
5
L'expression « entrer en jeu » peut désigner
autant l'acte d'entrer dans cet espace que la préparation au jeu de
l'acteur. Le cérémonial d'une rencontre sportive englobe la
présentation des joueurs, l'ouverture de la compétition ou encore
leur entrée dans le cadre. Le terrain est une scène, et toute
scène a son public. Si celui qui s'offre à une
représentation théâtrale et celui qui concourt sont tous
deux acteurs, l'improvisation théâtrale - lorsqu'elle se pratique
sous une forme compétitive - unit ces deux niveaux de jeu.
Ce format de spectacle spécifique est aujourd'hui
pratiquée par des compagnies qui se spécialisent dans les
spectacles d'improvisation théâtrale appelées « ligues
». J'ai pu observer, dans la région des Hauts-De-France, nombreuses
compagnies qui s'essaient à cette pratique, de façon amateur ou
professionnelle. Depuis, bons nombres de formats se sont inspirés de
cette première forme et constituent aujourd'hui une base de spectacles
accessibles pour des amateurs, professionnels, ou des non praticiens du
théâtre. C'est ce qui permet aujourd'hui une grande proposition
quant à cette pratique. En effet, bons nombres de compagnies amateurs
peuplent aujourd'hui la région, évoluant conjointement avec deux
structures professionnalisantes. C'est grâce à cette grande offre
que j'ai eu l'opportunité de prolonger et multiplier les
expériences quant à une pratique artistique que j'ai
découvert en 2013 à Lyon, avec une compagnie étudiante
baptisée Collectif Lyonnais d'Artistes Polyvalents. Différentes
structures m'ont ensuite permis de consolider ma pratique. Je suis
élève, depuis septembre 2017, de l'école Impro Academy,
qui essaime ses ateliers dans toute la Région. Dirigé par le
comédien Philippe Despature, ce regroupement d'ateliers est une des
structures qui propose de découvrir et d'en apprendre davantage sur
l'improvisation théâtrale, quelque soit l'expérience de
l'élève. Cette structure enseigne les bases, mais, en dehors de
restitutions d'ateliers, ne propose que peu d'opportunités pour jouer
des spectacles. C'est l'envie de jouer davantage qui m'a fait intégrer,
en septembre 2018, le Groupe d'Improvisation du Terril, une des nombreuses
ligues d'improvisation amateurs qui existent dans la région
Hauts-de-France.
En plus des structures qui offrent une base d'enseignement
ainsi qu'une possibilité de jouer dans des spectacles, la région
est également dotée d'une des plus anciennes ligues
professionnelles d'improvisation qu'est la Ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul, fondée par le comédien Emmanuel Leroy.
Les différentes écoles et compagnies que je
côtoie, tant par mon expérience d'acteur que de spectateur, font
état d'une pratique maintenant fort répandue, sous formes de
spectacles et d'ateliers, mais également d'ateliers de formations en
milieu social et scolaire, ainsi qu'en entreprise. Ces services de formations,
dans les Hauts-De-France, sont proposés par la Ligue
6
d'improvisation de Marcq-en-Baroeul, ainsi que par
l'organisation Les pieds sur scène, gérée par Philippe
Despature, et François Samier, qui est en charge des projets de
formation. Philippe Despature propose également, en plus des ateliers de
formations et de l'école, des spectacles joués par l'organisation
professionnelle Lille Impro. Ces trois pôles d'activités sont
regroupés sous l'organisation de la Scénosphère.
La multiplicité des formes par lesquelles est
utilisée l'improvisation théâtrale dans les Hauts-De-France
fait donc état d'une pratique qui a évolué depuis le
premier spectacle d'improvisation de ce ce genre qu'est le match
d'improvisation théâtrale, inventé par le comédien
Robert Gravel en 1977 à Montréal. C'est tout l'objet de cet
ouvrage d'analyser les codes et l'histoire d'une discipline spécifique
qui est devenue aujourd'hui accessible, ce qui m'amène a étudier
les différents processus qui ont abouti à sa
démocratisation.
Cette étude étant motivée par la
curiosité et l'envie de connaître davantage les enjeux et les
codes d'une discipline que je pratique depuis maintenant 2013, il me faut en
étudier son histoire depuis la création du match d'improvisation
théâtrale. C'est ce qui m'amènera, dans un premier temps,
à étudier le contexte dans lequel Robert Gravel a
évolué pour définir les influences qui ont abouti à
la création du match d'improvisation théâtrale.
L'improvisation a joué un rôle essentiel dans de
nombreuses périodes-clés du théâtre. La commedia
dell'arte en constitue l'un des exemples les plus connus. Ses personnages-types
reflètent la société de l'époque. Les puissants
sont attaqués à travers la figure de Pantalon, marchand
Vénitien avare et libidineux ; tandis que les plus modestes auront leur
revanche grâce aux facéties du valet Arlequin : un personnage
roublard, amoureux, qui punira les figures d'autorité. Outre le
bourgeois et son valet, on y trouve également des figures qui peuplent
le quotidien des italiens de cette époque, tel le médecin,
perçu comme un charlatan qui écume les marchés pour vendre
ses élixirs douteux aux plus démunis. Ces personnages sont
typifiés par leurs masques, qui les dessine à grands traits. La
commedia dell'arte a connu au XXe siècle une reviviscence
dans la pédagogie du Vieux-Colombier, les spectacles de Giorgio Strehler
et l'école de Jacques Lecoq. Ces influences témoignent du fait
que l'improvisation, tout comme le masque, sont des sources
inépuisables, à la fois pour l'apprentissage du jeu, et pour le
renouvellement du théâtre au contact de la
société.
En créant le match d'improvisation, Robert Gravel
invente une forme de jeu où le masque et la compétition se
mêlent et ont autant de poids l'un que l'autre. Peu de traces, cependant,
évoquent avec précision la création du match
d'improvisation. Le comédien-improvisateur Jean-Baptiste
7
Chauvin la situe lors d'une soirée d'Automne 1977
rassemblant quelques personnes. Robert Gravel imagine alors un jeu
théâtral s'inspirant des règles du match de hockey. La
soirée se conclut sur la première charpente du match
d'improvisation.
Je serais ensuite amené à étudier en quoi
cette charpente a évolué, pour aboutir à la
création de la Ligue Nationale d'Improvisation en 1979.
Afin d'étudier les évènements qui ont
abouti aujourd'hui à la présence de nombreuses ligues et
organisations dans les Hauts-De-France, une partie historique sera
consacrée à l'étude de périodes-clés qui ont
façonné l'organisation des diverses structures relatives à
l'improvisation théâtrale en France. En procédant ainsi, je
relèverais les principaux évènements qui ont
sculpté la pratique. Afin d'en déceler les les grandes
évolutions, il sera nécessaire d'étudier le
règlement du match d'improvisation tel qu'il fut écrit en 1977.
L'objet de cette étude, complété par mes réflexions
relatives à mes expériences d'improvisateur et de spectateur,
sera de déterminer les transformations de ce règlement, qui
détermine encore de nos jours tout le cadre cérémonial et
rituel commun à toutes les ligues d'improvisation
théâtrale. En mêlant les jeux de simulacre et de
compétition, ce format a développé au fur et à
mesure du temps des notions spécifiques avec des termes précis.
C'est pourquoi à cet ouvrage est également joint un lexique
explicitant les termes et les notions relatives à l'improvisation
théâtrale. Je suis amené à utiliser certains de ces
termes dans le corps de cet ouvrage. Ils sont identifiés par le signe
« * » et font l'objet d'une définition et d'une
réflexion dans le lexique.
Je conclurais mon mémoire par une étude de cas
approfondie des différentes structures qui sont présentes dans la
région Hauts-de-France.
Pour développer ma réflexion, je m'appuie
à la fois sur une recherche documentaire (historique, et en ligne) et
sur des enquêtes de terrain.
Le choix de l'enquête de terrain est lié à
la fois à la nécessité de prendre du recul sur mon
expérience personnelle, et au désir de rencontrer
différents protagonistes, afin d'établir le socle commun reliant
les diverses pratiques d'improvisation sur le territoire. J'emprunte donc ici
à l'ethnologie et à la sociologie leurs pratiques de
l'observation participante, afin de trouver des réponses sur le terrain
étudié au-delà des ressources académiques. Dans le
domaine de l'improvisation, il est indispensable d'« éprouver pour
savoir »5, pour reprendre l'expression du
5 Jean Peneff, Le Goût de l'observation. Comprendre et
pratiquer l'observation participante en sciences sociales, Paris, La
Découverte, 2009, p. 10
sociologue Jean Peneff. Il commente en ces termes la pratique
de l'observation participante : 6 « La richesse de cette méthode
découle le fait que le sociologue incorpore des savoirs au moment
où il se met en porte-à-faux avec lui-même, au cours d'un
déchirement dont il doit se sortir indemne. »7
Bien que ma démarche ne soit pas sociologique
(étude exhaustive des acteurs, élaboration chiffrée des
connaissances, etc), mais bien historique et esthétique, j'ai
emprunté cette technique de l'observation participante à la
sociologie, de façon à la fois libre et rigoureuse, pour obtenir
des informations provenant d'un cercle privatif. Ma mise en «
porte-à-faux avec [moi]-même » a résidé dans ma
capacité à abandonner des convictions personnelles (sur les
définitions de tel ou tel terme, sur la nécessité de telle
ou telle règle en improvisation...) si elle se trouvent
annihilées par la réalité du terrain. Mes observations de
séances, et les entretiens que j'ai réalisés, m'ont
aidé en ce sens. Par ailleurs, le choix de l'enquête de terrain se
justifie par la nature de l'improvisation théâtrale en
elle-même : différentes expériences relatives à
cette pratique se sont exportées à grande vitesse, autant dans
l'espace que dans le temps : les ateliers de formations, les créations
de troupes et les spectacles se sont développés. Parties d'un
socle commun, ces manifestations spontanées font office de relais de ces
notions, remplaçant textes écrits et manifestes. Il y a là
une forme de transmission orale qui peut se penser selon les modalités
qu'a énoncées Paul Zumthor pour parler de la « voix
poétique » des jongleurs médiévaux, qui se
déplaçaient comme les comédiens improvisateurs
d'aujourd'hui :
La voix poétique assume la fonction cohésive et
stabilisante sans laquelle le groupe social ne pourrait survivre. Paradoxe:
grâce à l'errance de ses interprètes dans l'espace - dans
le temps, dans la conscience de soi - elle est présente en tout lieu,
connue de chacun intégrée aux discours communs, pour eux
référence permanente et sûre. Elle leur confère
justement quelque extra-temporalité; à travers elle, ils
demeurent et sont justifiés. 8
Dans son ouvrage, Jean Peneff détaille la place de
l'observateur participant dans la sociologie. C'est dans ce chapitre que seront
empruntées les techniques de cette méthode :
« L'implication est ici envisagée sous l'angle de
la maîtrise du rôle avant l'entrée. L'avantage de
connaître le milieu que l'on va étudier favorise la
rapidité : il n'y a pas une mise à distance particulière,
ni à se déprendre de son rôle naturel »9.
6 Gp.
7 Ibid.
8 Paul Zumthor, La Lettre et la voix. De la
«littérature médiévale», Paris,
Éditions du Seuil, 1987, p. 155.
9 Jean Peneff, op. cit., p. 203.
8
9
Ma position de membre des milieux étudiés
favorisera donc ma position de chercheur, étant donné que je suis
déjà sur les terrains que j'ai étudiés, que j'ai
déjà reçu des définitions dans un cadre informel ou
par l'entremise des relations que j'ai avec ses protagonistes.
». Je suis donc allé à la rencontre de
certains protagonistes qui ont oeuvré à perpétuer cette
pratique sur le territoire français ainsi que dans les Hauts-de-France..
Par la transmission orale, chacun de ces individus a reçu un
héritage d'improvisateur différent. Il est donc
intéressant de les interroger sur l'enseignement qui leur a
été transmis.
C'est dans ce but que j'ai contacté Jean-Baptiste
Chauvin et Emmanuel Leroy, qui ont été témoins de
l'importation de l'improvisation théâtrale en France, dès
le début des années 80. Ils ont également
été acteurs, par leurs différentes actions et
créations, de l'évolution de l'improvisation
théâtrale sur le territoire national. Par ailleurs, Emmanuel Leroy
étant directeur artistique de la Ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul, j'ai pu également m'interroger sur la pratique dans un
contexte plus local. L'entretien a effectivement porté sur le
positionnement d'une des plus anciennes ligues de France dans un milieu
où les initiatives par rapport à l'improvisation
théâtrale sont nombreuses. C'est également ce qui m'a
amené à m'entretenir avec des protagonistes qui sont à la
tête des différentes structures des Hauts-De-France aux
côtés desquelles j'improvise aujourd'hui.
Par les trois entités qu'elle regroupe, la
Scénosphère joue un rôle majeur dans les activités
d'improvisation théâtrale que l'on peut trouver dans les
Hauts-de-France. Je me suis entretenu avec Philippe Despature pour
découvrir les dessous et les raisons de sa naissance. Cet entretien m'a
également permis d'analyser les activités variées de cette
structure, et leur influence sur les activités de la Région.
J'ai également interrogé Simon Fache, qui est
musicien au sein de la Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul. L'entretien a
porté sur l'importance du cérémonial dans un match.
Florine Sachy et Maxime Curillon font partie du bureau du
Groupe d'Improvisation du Terril. Ces deux entretiens m'ont
éclairé sur la question des identités des ligues amateurs,
bien plus nombreuses que les ligues professionnelles. C'est pourquoi j'ai
discuté également avec Arthur Pinta, président de la Ligue
d'Improvisation Lilloise Amateur afin de comparer les mécanismes
internes de deux structures portant un héritage professionnel. Ce sont
en effet les deux plus anciennes ligues d'improvisation lilloises amateurs qui
ont étés crées avec la contribution de la Ligue
d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul.
10
J'ai abordé avec eux plusieurs questions, d'abord quant
au besoin de se créer une identité pour pouvoir offrir un aspect
différent de l'improvisation que ce que les autres ligues amateurs
proposent. J'ai donc été amené à étudier
certains formats inédits créés par ces compagnies. Ces
créations peuvent autant répondre à ce besoin de se
créer une identité que de concrétiser une vision de
l'improvisation théâtrale qui leur est propre. Je me suis
également penché sur la question de l'organisation interne de ces
compagnies, qui, en tant que ligues amateurs, ont en charge de
sélectionner les joueurs pour leurs différents spectacles.
Dès lors que l'on parle d'amateurisme, l'exigence quant à la
qualité artistique peut être difficilement acceptée comme
un critère de sélection. Ces deux entretiens ont donc eu
également pour objectif d'identifier les critères utilisés
pour sélectionner les joueurs, ainsi que les mécanismes de
formation proposés au sein de ces compagnies.
Enfin, j'ai demandé son témoignage à
Corentin Vigou, membre de la Ligue Royale de Strandovie. Nous avons
parlé ensemble du format spécifique qu'est le catch
d'improvisation, qui a la particularité d'avoir été
inventé par des improvisateurs amateurs, et est aujourd'hui
pratiqué par les professionnels.
I : Du Canada à la
France : création et acclimatation des ligues d'improvisation
« La LNI est née de deux préoccupations :
l'évolution de l'improvisation théâtrale en
général et le désir de créer un vrai jeu
théâtral. »10
Robert Gravel
La ligue Nationale d'improvisation est la première
compagnie à se consacrer à la pratique et à la diffusion
du match d'improvisation, créé par Robert Gravel en 1977. Les
ligues d'improvisation qui sont aujourd'hui implantées sur le territoire
des Hauts-de-France ont hérité de cette pratique, qui a
évolué depuis sa création.
Je me suis penché sur l'histoire du match
d'improvisation et de son créateur, afin d'établir les
paramètres qui ont favorisé son expansion et comment ce jeu
canadien a été adapté en France. J'évoquerai le
contexte social et politique dans lequel le match d'improvisation a vu le
jour,au sein d'une jeune génération de Québécois en
quête d'identité et de nouvelles formes. En parallèle, je
comparerai ce climat de renouveau avec celui de Mai 1968 en France, qui
favorise la création de troupes de théâtre
expérimentales. Bénéficiant d'une transmission orale, et
passant d'un continent à l'autre, la discipline a peu à peu
évolué.
À sa sortie du conservatoire d'art dramatique du Canada
en 1970, le jeune Gravel est influencé par les évènements
qui ont façonné la Révolution Tranquille (1960-1970) au
Québec. De ses premiers pas avec la troupe des Jeunes comédiens
(1970-1974), à la création de la Ligue Nationale d'Improvisation
en 1977, son parcours est jonché d'expériences ayant
cimenté son envie d'un théâtre nouveau. Durant sa vie
d'enseignant, il ne cesse de défendre l'improvisation comme outil de
l'acteur :
Je crois profondément que la pratique de l'impro peut
développer cette spontanéité constante. La
disponibilité que requièrent la phase de la mise en scène
et la phase des représentations relèvent de l'art de
l'improvisation. Malheur au metteur en scène qui a sa mise en
scène toute
faite à l'avance ! Malheur au comédien qui croit
que son personnage existe avant qu'il lui ait donné chair !11
L'expérience vécue avec les Jeunes
Comédiens a eu une grande influence sur Robert Gravel. Il va
développer l'improvisation comme outil de création. Sa
volonté de faire prendre des
10 Robert Gravel, Jan-Marc Lavergne, Impro :
Réflexions et analyses, Ottawa, Éditions Leméac, p.
14, 1987.
11 Ibid., p. 14
11
12
risques à l'acteur et l'échec d'une
première tentative de jeu improvisé avec les Jeunes
Comédiens en 1972 le poussent, avec quelques camarades, à fonder
un nouveau jeu où les acteurs seront soumis au regard et au jugement
d'un public venu entendre des histoires inédites. Cette nouvelle
création est signée par une structure nouvelle : Le
Théâtre Expérimental de Montréal, (fondé en
1974), la troupe des Jeunes Comédiens n'ayant pas survécu
à la Révolution Tranquille.
La création du match d'improvisation, avec son
cérémonial et ses règles, place le comédien dans un
contexte permettant chaque soir un spectacle différent par son contenu,
ce qui respecte le souhait d'expérimentation émanant de son
créateur. Le cadre strict et codifié de ce spectacle offre un
cadre solide sur lequel le comédien peut s'appuyer et effectuer ses
improvisations, avec un enjeu de victoire à la clé.
Les trois années qui séparent le premier match
d'improvisation de l'indépendance de la Ligue Nationale d'Improvisation
en 1980 ont permis de structurer une forme nouvelle, de trouver un nouveau
public, de former les acteurs à un nouvel outil, et de faire
évoluer l'improvisation théâtrale, selon la volonté
de son créateur. Cette discipline a tôt fait d'intéresser
Outre-Atlantique d'autres groupes artistiques, tels le Théâtre de
l'Unité en France, qui ne manque pas de faire appel aux québecois
pour équiper le Département des Yvelines d'une nouvelle
identité artistique et culturelle grâce à ses « ruches
» en 1981.
À la suite de ce premier contact, de multiples
antennes-relais sont créées au fur et à mesure des
expérimentations sur le territoire Français. L'improvisation
théâtrale se développe sous de multiples formes
structurantes grâce aux ligues amateurs et professionnelles, aux
différents championnats organisés et à la volonté
de jeunes improvisateurs de s'approprier cet art en créant à leur
tour des formes originales d'improvisation théâtrale.
C'est d'abord au sein de la Troupe des Jeunes Comédiens
que Robert Gravel a fait ses premières armes. Les problématiques
d'identité artistique et les conflits avec les institutions auxquels
cette troupe a été confrontée l'ont encouragé
à créer un lieu où faire ses propres
expérimentations avec le Théâtre expérimental de
Montréal.
En m'appuyant sur un dossier de Françoise Simon et
Hélène Beauchamp12, je propose ici un aperçu de
l'histoire de cette troupe, afin de montrer l'influence qu'elle a eue sur
Robert Gravel.
12 Hélène Beauchamp, Françoise Simon,
Les jeunes comédiens du Théâtre du Nouveau Monde ou
l'esprit nomade, L'annuaire théâtral, numéro
22, 1997, p. 94, disponible sur
https://www.erudit.org/fr/revues/annuaire/1997-n22-annuaire3668/041332ar.pdf
[consulté le 13/02/2019].
13
I.1 : Des Jeunes Comédiens au
Théâtre expérimental de Montréal : l'époque
des expérimentations
Robert Gravel intègre la troupe des jeunes
Comédiens à sa sortie du conservatoire en 1970, sur invitation du
metteur en scène Jean-Pierre Ronfard.
Créée en 1963 et composée de
ressortissants de l'École Nationale de Théâtre du Canada
basée à Montréal, cette compagnie a pour mission de donner
une visibilité au travail accompli entre les murs de l'école dans
le Canada anglophone, pour oeuvrer à un rapprochement culturel avec le
Canada francophone. À cette époque, Jean-Pierre Ronfard est
directeur de la section française de l'établissement. C'est avec
la pièce du Mariage forcé de Molière que cette
troupe se met en route. Pour gagner en efficacité, le groupe se
déplace pour jouer dans des universités et des lycées,
emportant avec lui tréteaux, accessoires et costumes. Il devient une
troupe itinérante, qui privilégie les bancs des
universités pour s'adresser aux étudiants du pays au lieu des
salles de spectacle traditionnelles.
Par le choix de la pièce et de la langue
française, ces jeunes comédiens exportent sur le territoire
anglophone une partie de la culture du Canada francophone.
Après le succès de la première
tournée de 1963, qui a compté 53 dates, la gestion de la troupe
est confiée à des organismes relevant à la fois des
tutelles du Canada anglophone et francophone afin de concrétiser cette
entente et d'assurer les tournées sur l'ensemble du pays. Dès la
tournée de 1964-1965, des organismes locaux - tels le conseil des
Affaires Culturels du Québec ou le Manitoba Theater Center basé
à Winnipeg (Anglophone à 95%) - et nationaux, tels le Conseil des
Arts du Canada (qui accueille en son sein des étudiants tant anglophones
que francophones) prennent en charge la tournée.
Continuant à jouer des textes essentiellement
français (L'amour médecin et L'impromptu de
Versailles de Molière en 1964-1965, une anthologie des
pièces du même auteur intitulée Leçons d'amour
de Monsieur Molière, La première famille du
poète Jules Supervielle en 1965-1966), les jeunes acteurs font preuve
d'une riche inventivité pour contourner la barrière de la langue
: ils usent du masque, de la danse et de l'acrobatie dans ses
représentations.
La troupe se constitue petit-à-petit une
identité propre, avec l'aide de Jean-Pierre Ronfard qui « met
l'accent sur la jeunesse et la spontanéité de ces tout jeunes
acteurs »13 En 1964, ils sont privés de cet
13 Ibid., p. 94.
homme sensible à leur spontanéité, qui
quitte la direction de la Section Française de L'École Nationale
de Théâtre pour parfaire ses armes de metteur en scène en
Afrique et en France. Il revient à Montréal en 1969 pour prendre
le poste de secrétaire général du Théâtre du
Nouveau Monde, compagnie fondée en 1951.
Durant cette période, les tournées
s'enchaînent, les jeunes comédiens peuvent compter sur un
partenariat conclu entre l'école et l'organisme des Canadian Players,
qui leur organise des tournées à Toronto et à Stratford.
Après une transformation interne, le Conseil National des Arts du Canada
fait appel au Centre National des arts et le Théâtre du Nouveau
monde pour subventionner la compagnie.
Le Centre National n'est, à ce stade, qu'un projet en
cours de concrétisation qui prendra ses quartiers à Ottawa en
1969.
De 1963 à 1969, de nouveaux comédiens sortis de
L'École Nationale de Théâtre viennent renforcer les rangs
de la troupe. Hélène Beauchamp et Françoise Simon
racontent que ces nouvelles recrues ont été au coeur des
mouvements étudiants qui ont secoué cette décennie :
En 1965-1966, les étudiants du Conservatoire d'Art
Dramatique participent à la grève générale des
écoles d'art et réclament un livre blanc sur l'enseignement du
théâtre au Québec (Cloutier, 1977). Les neufs
élèves admis dans la classe d'interprétation en 1966
quittent l'école nationale de théâtre après
s'être vus refuser le droit de monter un spectacle de leur
choix.14
Dans les rangs de ceux qui quittent l'école cette
année-là se trouve Raymond Cloutier, qui fonde avec certains de
ses camarades le Grand Cirque Ordinaire, l'une des troupes alternatives
émergentes de cette période :
Le Grand Cirque ordinaire a commencé par un
regroupement d'acteurs révoltés, pris dans un
théâtre québecois, en 1968-1969, qu'ils
considéraient comme aliénant [...] Aliénant pour l'artiste
en nous, le créateur, parce qu'on avait passé trois, quatre ou
cinq ans dans des écoles à se préparer pour raconter des
choses qui ne nous ressemblaient jamais.15
Cette perte de repères est aussi ressentie par les
Jeunes Comédiens. Il devient de moins en moins aisé de
véhiculer la culture d'une école à laquelle la troupe
n'est plus liée depuis son rattachement au Théâtre du
Nouveau Monde, tant sur le plan administratif que sur le plan artistique :
14 Ibid., p. 95-96.
15 Raymond Cloutier, Le Grand Cirque Ordinaire:
réflexions sur une expérience, Études
françaises, vol 15, numéro
1-2, Avril 1979, disponible sur
https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/1979-v15-n1-2-etudfr1689/036688ar.pdf
[consulté le 14/02/2019].
14
officiellement, la mission de la compagnie reste de
véhiculer les créations de l'école à travers tout
le pays, et c'est le répertoire français qui reste
privilégié. Hélène Beauchamp et Françoise
Simon qualifient cependant de « schizophrénie artistique aiguë
»16 la situation des jeunes comédiens à cette
époque. Cette schizophrénie serait causée par les
changements opérés par la Révolution Tranquille : la
troupe continue d'engager des ressortissants de l'École Nationale du
Théâtre, qui avaient eux-mêmes contesté
l'enseignement qui leur avait été dispensé.
L'arrivée de ces nouveaux comédiens encourage alors une
volonté émancipatrice. La troupe reste néanmoins
liée à des organismes anglophones et francophones qui continuent
de financer conjointement les tournées pour le rapprochement culturel,
tandis que que la Révolution Tranquille prône de plus en plus
l'indépendance du Québec.
De retour à Montréal, Jean-Pierre Ronfard tente,
conformément à ses idéaux, d'utiliser le manque de
repère de ces jeunes acteurs à des fins artistiques. La
construction progressive d'une identité propre à cette troupe
l'incite à l'envisager comme « un instrument de création.
Elle ne représentera pas d'oeuvres consacrées, mais proposera au
public l'expression artistique d'un groupe de jeunes comédiens utilisant
tous les moyens spectaculaires à sa portée
».17
L'arrivée de Robert Gravel dans la troupe en 1970
coïncide avec ce virage artistique majeur. Subventionnée par des
organismes commanditaires, elle continue à jouer des pièces
Francophones de commande. En outre, la vision de Jean-Pierre Ronfard se
concrétise avec des créations expérimentales et
collectives, à l'instar du Grand Cirque Ordinaire. La prise de risques
dont ils font preuve ne rencontre cependant pas un succès
immédiat, et les créations collectives de la troupe nomade font
l'objet de critiques défavorables durant les années qui
suivent.
Depuis 1969, les oeuvres originales divisent tantôt les
Québecois, tantôt les Canadiens anglophones. En guise de
compromis, ils laissent à leurs hôtes, pour la tournée
1970-1971, le choix d'une représentation soit « fermée
» avec un texte d'auteur, soit « ouverte » avec une
création originale. Les libertés qu'ils prennent avec les textes
d'auteurs jurent avec la mission d'exportation du travail des écoles de
théâtre québécoises, ce qui achève de les
plonger dans une crise identitaire, artistique et culturelle selon un rapport
évoqué par Hélène Beauchamp et Françoise
Simon :
En 1973, les difficultés s'accumulent. Un rapport
négatif sur la tournée de 1972 émane du Centre National
des Arts où il est fait état des insatisfactions des
commanditaires et des malentendus qui ont gangrené le partage des
tâches administratives entre le TNM et le CNA. Il
16 Hélène Beauchamp, Françoise Simon,
op. cit., p. 97 .
17 Idem.
15
16
semblerait aussi qu'il soit de plus en plus difficile de
produire des spectacles qui plaisent à tous publics : anglophones et
francophones, étudiants des écoles et des universités,
membres des différentes communautés canadiennes, grandes et
petites. Le rapport conclut à la nécessaire réorientation
des Jeunes Comédiens 18
Les tentatives de diversification de la troupe ne permettent
pas de résoudre leurs crises internes. En effet, pour instaurer une
nouvelle dynamique, la troupe décide en 1970-1971 d'engager des
comédiens venus d'autres formations. Ce qui est mal perçu par les
institutions desquelles elle dépend. À cause de la crise
identitaire et de la multiplicité des envies artistiques, il devient
difficile pour le Théâtre Du Nouveau Monde ainsi que pour les
principaux subventionneurs de continuer à soutenir la troupe. Ces
conflits rendent caducs les nouveaux projets mis en place, et provoquent le
départ de bon nombre de comédiens de la compagnie.
Fragilisée, elle éprouve des difficultés à exister
dans le paysage théâtral de l'époque : « Par ailleurs,
le mouvement du jeune théâtre voit alors naître nombre de
compagnies, qui, hors de l'institution théâtrale, prennent le
relais dans le domaine de la création et des tournées
»19.
La tournée 1970-1971, durant son passage en Ontario,
permet néanmoins la rencontre de Jean-Pierre Ronfard et Robert Gravel
avec la Comédienne Pol Pelletier20.
Tous trois contribuent, dès lors, à renforcer
l'affirmation du théâtre québecois. La disparition des
Jeunes Comédiens incite Jean-Pierre Ronfard à penser au
développement une structure autonome : « Il faut trouver un endroit
où on pourra faire ce qu'on ne peut pas faire ailleurs !!!
»21.
Ainsi témoigne Robert Gravel de la
ténacité de Jean-Pierre Ronfard. De ces cris naît un
nouveau théâtre au coeur de Montréal, en 1974 dans
l'appartement du metteur en scène.
Grâce à un arrangement avec un restaurateur pour
un loyer modeste, ils s'installent dans le dessus de l'établissement,
à la maison de Beaujeu. Les trois comédiens pourtant ne
s'intéressent pas encore à l'improvisation, n'y voyant pas un
moyen pertinent, d'après un témoignage de Robert
Gravel22. Au stade de leurs différentes carrières, les
trois têtes pensantes du Théâtre Expérimental de
Montréal ont une vision de l'improvisation basée sur la recherche
du métier d'acteur. Ils avaient
18 Ibid., p. 106.
19 Idem.
20 Pol Pelletier est née le 6 Novembre 1947 à
Ottawa (Ontario).
21 Robert Gravel, J'ai donné ma jeunesse au
T.E.M, p. 7, disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/publications/trac
[consulté le 15/02/2019].
22 Idem.
17
déjà tenté par le passé, notamment
avec les Jeunes Comédiens, d'utiliser l'Improvisation comme moteur
majeur dans une de leurs créations en 1972 : il s'agissait d'une
pièce déambulatoire à la manière d'un jeu de
monopoly grandeur nature dans laquelle les comédiens se comportaient
comme des joueurs, tirant des cartes qui avaient des conséquences pour
leurs personnages. Robert Gravel a reconnu en 1988 que l'idée manquait
de simplicité.
Il souhaite dépasser la création d'autres
troupes expérimentales émergentes, telles celles de Raymond
Cloutier avec le Grand Cirque Ordinaire :« Nos spectacles étaient
fabriqués - on ne faisait pas d'improvisation en public - mais à
partir de nos propres sauts périlleux. Dans les cirques, on n'engage pas
un acrobate pour lui dire quoi faire. »23.Le Grand Cirque
Ordinaire utilise donc l'improvisation comme technique d'écriture, alors
que le but de Robert Gravel est de la renouveler. Avec le Théâtre
Expérimental de Montréal, il met au point deux spectacles, qui,
par leur sobriété et leur durée, font de l'improvisation
le sujet central de la pièce : il joue durant tout l'été
1976 les 12 heures d'improvisation à deux comédiens aux
côtés de Gilles Renaud24. Il renouvelle
l'expérience en novembre avec les 24 heures d'improvisation à
deux comédiens, avec Lorraine Pintal25 qui remplace Gilles
Renaud.
Les titres de ces deux oeuvres interrogent, quant à
leur caractère minimaliste. Robert Gravel semble chercher
jusqu'où un acteur peut aller uniquement en improvisant : le fait que la
durée soit volontairement précisée dans le titre pousse
à croire qu'avec ce spectacle, il souhaite réellement
éprouver tant le comédien que la discipline. Il va ainsi à
l'encontre de la volonté du Grand Cirque Ordinaire, qui mettait
volontairement l'improvisation au profit de l'acteur en le magnifiant comme un
créateur.
Une captation vidéo des 24 heures d'improvisation
a été réalisée par le vidéaste Yvon
Leduc, qui devient un grand ami de Robert Gravel. Bien que ces captations ne
soient plus disponibles, des photographies et des enregistrements audios sont
disponibles sur le site du Nouveau Théâtre Expérimental de
Montréal.26
Robert Gravel et ses partenaires évoluent dans un
espace scénique chaotique : quelques canapés, tables et chaises
sont disséminés dans la pièce, les murs sont sales et
fissurés, et la majorité du public, assis à même le
sol, regarde au centre de la pièce.
23 Raymond Cloutier, op. cit., p. 189.
24 Gilles Renaud est né le 25 Septembre 1944 à
Montréal. Il est diplômé de l'École Nationale de
Théâtre en 1967.
25 Lorraine Pintal est née à Plessisville le
24Septembre 1951. Elle est depuis 1992 la directrice artistique du
Théâtre du Nouveau Monde.
26 Disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/medias/audios/improvisation
[consulté le 14/03/2019].
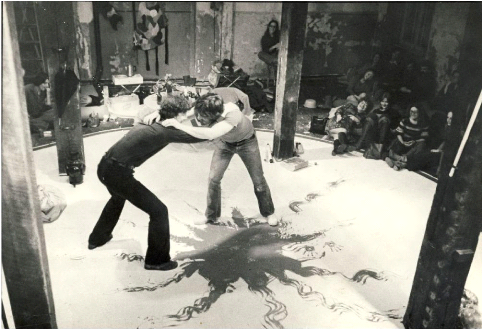
18
Robert Gravel et Gilles Renaud au centre de la maison Beaujeu
lors des 12 heures d'improvisation à 2 comédiens (1976),
photographie par Daniel Keffer,
disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/medias/galeries/12-heures-dimprovisation.
La configuration géographique attire le regard du
spectateur vers l'espace composé d'un cercle blanc au sol,
entouré de quatre poutres, faisant penser à un ring. Sur les
différentes photos, c'est en majorité dans cet espace que les
comédiens évoluent. Cette configuration a peut-être
contribué à faire germer dans l'esprit de Robert Gravel
l'idée d'une patinoire où les improvisations auraient lieu.
Le dispositif multi-frontal du public met en danger le
comédien : il est observé depuis toutes les directions, le
spectateur observent pourtant un silence presque religieux : dans les
captations audios, très peu de perturbations sonores émanent du
public. La conversation entre les deux comédiens est interrompue ou
soutenue uniquement par quelques interventions sonores du musicien et de
quelques rires.27
La gestion de l'espace et du temps s'avère difficile
tant pour les acteurs que pour les spectateurs. Il faut donc un cadre plus
solide pour que l'improvisation ait un sens et que son impact sur le public
27 Disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/medias/audios/improvisation
[consulté le 22/02/2019].
19
soit immédiat. Le rapport au temps conditionne le
comédien : sur une longue durée, il se sent encore dans une
certaine soupape de sécurité, ayant du temps pour
développer l'intrigue. Or, le souhait de Robert Gravel est d'explorer
les autres possibilités qu'offre l'improvisation théâtrale
qu'un outil d'écriture et de création de personnage. Il faut donc
un format qu l'incite à produire un résultat qui soit
immédiatement identifiable.
I.2. La création du match d'improvisation
théâtrale
Jean-Baptiste Chauvin rapporte la mise en chantier du match
d'improvisation théâtrale de la façon suivante : «
C'est au cours d'une soirée de l'automne 1977 (parait-il arrosée
!) que Robert Gravel se mit à imaginer un jeu théâtral
calqué sur les règles du hockey sur glace où
s'affronteraient deux équipes d'improvisateurs »28
Le rituel d'une rencontre sportive peut répondre
à plusieurs problèmes soulevées par les expériences
d'improvisation précédentes :
L'espace dédié au jeu est tout d'abord plus
clairement défini, ce qui aide le spectateur à se concentrer sur
l'intrigue principale. Il se constitue en juge de la représentation.
Durant les 12 heures et les 24 heures d'improvisation à
deux comédiens, il n'avait pas eu son mot à dire quant
à la qualité de ce qu'il avait vu. Robert Gravel lui donne
désormais un moyen de pouvoir exprimer son avis, grâce à un
système de vote.
Par ces formats plus courts, les improvisations laissent
également au public le loisir d'observer la qualité de
création d'un comédien lui montrant un produit qu'il aura
développé sous ses yeux. C'est tout l'intérêt de ce
format par rapport au temps, souligné par Jean-Baptiste Chauvin :
Dans le match d'improvisation, tout se conjugue au
présent. La dimension temporelle est donc fondamentale. Tout est
possible : des limites temporelles cadrent par avance ce qui se jouera dans
l'instant. L'improvisation repose sur de prises de risques. Ces risques
s'évaluent en minutes et en secondes.29
28 Jean-Baptiste Chauvin, Le match d'improvisation
théâtrale, Paris, ImproFrance, 2015, p. 37.
29 Ibid., p. 84.
20
Yvon Leduc, le lendemain de cette soirée, le convainc
de concrétiser son idée. Mais il lui reste encore à
persuader des comédiens de l'accepter, ce qu'il raconte lors d'une
entrevue avec Jean-Claude Coulbois :
« ça a été, à mon plus grand
étonnement, la plus grosse barrière à franchir
»30 . De nombreux détracteurs, dans un premier temps,
contestent en effet le cadre sportif du spectacle. L'improvisation n'est plus
un outil, mais un produit final, dont la qualité est jugée par le
public. La temporalité pousse l'improvisateur à s'impliquer
d'entrée de jeu, pour produire une improvisation dans un temps
réduit. Robert Gravel doit alors faire face au scepticisme de certains
comédiens :
Les gens disaient "tu sais très bien que dans les cours
d'improvisation, on a le temps d'improviser" . C'est vrai, c'est comme
ça que moi, quand je fais une improvisation, c'est basé aussi
là-dessus : le droit de développer l'action, le droit au rythme
personnel. C'est un cours, c'est pédagogique. T'as le droit à ton
expression, t'as le droit à l'erreur. Là je dis :"On est des bons
improvisateurs, on met tout ce qu'on a appris dans un contexte sportif.
Là t'as trente secondes, une minute pour développer - Mais moi
ça me prend une heure pour développer - Je sais, mais il faudrait
peut-être essayer, pour voir ce que ça donne" . Finalement 12
personnes ont accepté.31
Robert Gravel interroge par son nouveau procédé
le processus de création, et la qualité des spectacles
proposés à un public dans le cadre du théâtre
à textes. En posant des contraintes strictes à l'acteur, il
fournit au spectateur le loisir d'observer un comédien en plein travail.
Les comédiens, habitués à montrer le résultat d'un
long travail de répétition, sont confrontés à leur
peur d'être jugés. Le risque encouru par ce type d'exercice est
aussi de générer un certain cabotinage, à savoir le fait
de gagner la faveur d'un public, que ce soit par des effets comiques ou des
effets dramatiques. D'ailleurs, la question du comique en improvisation fait
encore débat de nos jours. Le créateur du match d'improvisation
écrit dans son livre Impro : réflexions et analyses :
« En aucun moment, le théâtre n'a le droit d'être
platte32 »33. Il reproche au théâtre
conventionnel de ne laisser à aucun moment son public s'exprimer par
rapport à la qualité de ce qu'il a pu observer.
Pour inciter l'improvisateur à se mettre au travail
face à ce public, il lui faut un enjeu. Le choix de mettre deux
équipes en compétition est aussi une façon de les inciter
à se dépasser. Tel un spectateur
30 Jean-Claude Coulbois, Entrevue avec Robert Gravel,
1996, 25 min 08 secs, disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/medias/videos/entrevue-avec-robert-gravel
[consulté le 22/02/2019].
31 Ibid., 26 min 04 secs.
32 Terme québecois pour désigner une chose
ennuyeuse.
33 Robert Gravel, Jan-Marc Lavergne, op. cit., p. 36.
21
dans une arène, le public vient voir une sorte de
combat. Il est à la fois public et juge. Le jugement étant
immédiat, le comédien sait immédiatement si ce qu'il a
produit a fonctionné ou non.
Conscient du caractère encore fragile de la forme qu'il
vient d'inventer, Robert Gravel l'essaie durant quatre soirs uniquement. Le
premier match a lieu le 1er octobre 1977, à la maison
Beaujeu. Face à Jean-Claude Coulbois, il parle d'« une relation
avec le public, fantastique, très vraie [...]c'est-à-dire que tu
le sens, si le public aime ça ou pas » à l'issue de la
représentation34. Enthousiasmée par cette
première expérience, l'équipe entière est
prête à le suivre pour trois autres spectacles, et le pousse
même à pérenniser le format. C'est le début d'une
expérience fédératrice : les communications souterraines
d'une troupe expérimentale à l'autre provoquent l'invitation de
nouvelles troupes pour grossir les effectifs de ce premier championnat, tels la
Manufacture, et même le Grand Cirque Ordinaire35. Robert
Gravel et ses camarades commencent à être dépassés,
et il faut bientôt organiser des calendriers et organiser minutieusement
les équipes pour accueillir les soixante comédiens souhaitant
participer à un deuxième tournoi. Le phénomène
s'ébruite et attire rapidement des jeunes comédiens pour grossir
le rang de spectateurs en premier lieu, curieux de découvrir cette
façon nouvelle d'improviser. La maison Beaujeu ne disposant que d'une
centaine de places, les matchs affichent « complet » en un temps
record. Par ailleurs, le spectacle se calquant sur le match de hockey attire
également un public qui ne vient pas du théâtre, mais qui
est attiré par une forme reprenant les codes d'un sport national.
Il n'est désormais plus question de
théâtre expérimental : Robert Gravel a inventé un
format original, qui demande une grande synergie. Le Théâtre
Expérimental de Montréal fonde en 1979 la Ligue Nationale
d'Improvisation, qui se consacre exclusivement au match d'improvisation
théâtrale.
Cependant, une crise éclate au sein du
Théâtre Expérimental de Montréal et provoque des
discordes entre ses différents membres : Pol Pelletier et les autres
femmes qui y officiaient sont de moins en moins satisfaites des
créations, qui laissent peu la paroles aux femmes, comme le souligne
Hélène Pedneault :
Autant l'éclatement des formes, la recherche sur le jeu
et les corps et le concept prenaient le pas sur le texte, dans les spectacles
conçus par les hommes au temps du premier Théâtre
34 Jean-Claude Coulbois, op. cit., 28 min 14 secs.
35 Joyce Cunningham, Paul Lefebvre, Dossier de presse,
p. 5,disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/medias/documents/la-ligue-nationale-dimprovisation-dossier-de-presse
[consulté le 11/03/2019].
22
Expérimental de Montréal à la Maison de
Beaujeu {Zoo, Garden Party, Orgasme I et
II), autant les mots - même peu nombreux - étaient une
matière première importante, imbriqués dans la forme, dans
les spectacles conçus par les femmes (Finalement, À
ma mère, à ma mère, à ma mère, à ma
voisine).Les femmes n'avaient pas encore beaucoup la parole dans la
société, et quand elles la prenaient, chaque mot était
vital. Les hommes jouaient et expérimentaient, les femmes
défrichaient leurs images et défendaient leur peau.Il y avait
là une différence profonde qui devait fatalement mener à
une scission 36.
Dans les archives du Nouveau Théâtre
Expérimental de Montréal se trouve une série
d'écrits baptisés Cahiers, faisant office de journal de
bord. Dans ce premier cahier rédigé par Jean-Pierre Ronfard
détaillant les activités du théâtre de Juillet 1975
à Juillet 1979, le mode de fonctionnement de la structure est ainsi
décrit :
[Le Théâtre Expérimental] fonctionnait
selon les principes de l'autogestion ; partage égal du pouvoir,
responsabilité individuelle face à l'oeuvre collective, prise de
toutes les décisions à l'unanimité. En principe, cela
signifiait " si je ne dis pas non à une action proposée (le veto
est incontournable), j'endosse personnellement cette action " . 37
Une des premières créations du
Théâtre Expérimental datant de 1975, intitulée
Une femme, un homme, est interprétée par Robert Gravel
et Pol Pelletier. Constitué de plusieurs tableaux, le spectacle
interroge et critique différentes formes de relations entre les hommes
et les femmes. C'est cette critique qui a frappe Hélène Pedneault
lorsqu'elle assiste à une des représentations : « Ils sont
deux sur scène. Ils se battent avec deux longs bâtons. Elle le
dompte comme un cheval sauvage au bout d'une longue corde »38.
Le mode de fonctionnement est satisfaisant dans un premier temps, chaque
création étant le travail conjoint d'une cellule de
création et d'une cellule d'interprètes. Pour ce spectacle, la
cellule de création est composée de Robert Claing, Robert Gravel,
Pol Pelletier, Pierre Pesant et Jean-Pierre Ronfard. De plus, l'aspect critique
des relations hommes-femmes pour ce premier spectacle permet de faire
l'unanimité au sein de la troupe du Théâtre
Expérimental de Montréal.
En 1976, le spectacle Garden Party cristallise cette
démarche collective : on compte dans la cellule de création dix
personnes appartenant à la structure, qui sont également
présentes sur scène, hommes et femmes confondus. Aucun projet par
ailleurs ne semble remis en question, ce qui permet
36 Hélène Pedneault, Robert Gravel, esquisse
d'un homme de théâtre baveux, Revue Jeu, 1997, p.
10, disponible sur
https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/1997-n82-jeu1072752/25394ac.pdf
[consulté le 11/03/2019].
37 Jean-Pierre Ronfard, Passage du Théâtre
expérimental de Montréal au Nouveau Théâtre
Expérimental, ou les avatars de l'autogestion, p. 9, disponible
sur
https://archives.nte.qc.ca/publications/cahier-i-archeologie
[consulté le 31/03/2019].
38 Hélène Pedneault, op. cit., p. 66.
23
au théâtre une grande productivité : la
même année est créé Essai en mouvement pour
trois voix de femmes, joué par Lucie Guilbert, Nicole Lecavallier
et Pol Pelletier. Dans la cellule de création se trouvent
également Alice Ronfard et Jean-Pierre-Ronfard. Ce spectacle est la
pierre angulaire d'une cellule du Théâtre Expérimental, qui
prend pour intitulé « spectacles de femmes ». Il n'est pas
mentionné par Hélène Pedneault, car Nicole Cavalier
précise dans la revue Trac Femmes qu'il « ne correspond
pas exactement à cette définition puisque l'initiateur du projet
était un homme, Jean-Pierre Ronfard, qui a aussi été
metteur en scène du spectacle »39
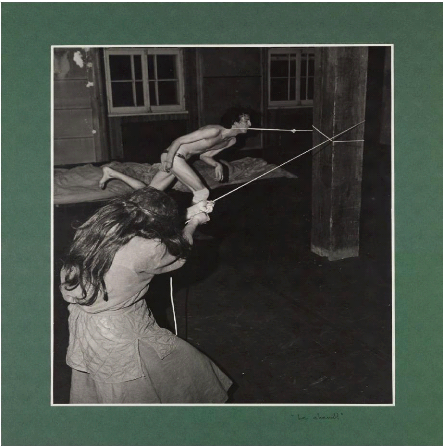
Pol Pelletier domptant Robert Gravel à la maison
Beaujeu dans Une femme un homme (1975), photographie par Robert
Duclos, disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/medias/galeries/une-femme-un-homme
39 Nicole Lecavalier, Alice Ronfard, Anne-Marie Provencher,
Dominique Gagnon, Francine Pelletier, Louise Laprade, Louise Ladouceur, Pol
Pelletier, Louise Portal, Geneviève Notebaert, Ginette Morin, Lorraine
Pintal, Trac Femmes, Introduction, 1978, p. 5, disponible
sur
https://archives.nte.qc.ca/publications/trac-femmes
[consulté le 31/03/2019].
24
Les spectacles de femmes se développent en
parallèle des autres créations du Théâtre
Expérimental. La liste établie par Hélène Pedneault
comprend Finalement en 1977 et A ma mère, à ma
mère, à ma mère, à ma voisine en 1978.
La cellule de création de Finalement se
compose de Nicole Lecavalier, Anne-Marie Provencher et
Alice Ronfard, qui sont également les trois seules
interprètes. En parallèle est joué Zoo, avec
Robert Gravel, Peter Gnass, Yvon Leduc, Pierre Pesant, Benoît Ronfard et
Denis Rousseau. Ils sont également tous interprètes dans le
spectacle. La mixité au sein des cellules de création commence
donc à diminuer : en 1978, Orgasmes est crée et
interprété par Robert Claing, Robert Gravel, Anne-Marie
Provencher et Jean-Pierre Ronfard, tandis que la pièce A ma
mère, à ma mère, à ma mère, à ma
voisine est créée et interprétée par Louise
Laprade, Pol Pelletier et Anne-Marie Provencher.
Progressivement se développent les créations
féministes au sein du Théâtre Expérimental de
Montréal. C'est un tournant dans cette troupe qui prône la
création collective. Le recul a été nécessaire pour
que les femmes prennent conscience de ce tournant : l'appellation
Spectacles de femmes n'est apparue qu'en 1978, soit trois ans
après Une femme un homme. Pol Pelletier raconte que c'est en
1976, après un évènement survenu lors de la
création de Garden Party, pendant une improvisation sur la
thématique de l'agression, que s'est opérée sa prise de
conscience :
Je regarde les comédiennes se faire tapoter, pincer,
poussailler par les comédiens. Je sens comme une colère qui
monte. A un moment donné dans l'improvisation, j'attrape la ceinture
d'un comédien comme pour le tirer vers moi. Il se retourne, furieux, et
pour me repousser me jette violemment par terre. Mes lunettes vont
s'écraser dans le coin. Je vois rouge. Je me relève. Je suis en
train de me battre [...] C'est une journée capitale dans ma vie. La
décision de ne plus travailler avec des hommes a commencé
à germer cette journée-là40.
Une scission larvée existe au sein du
Théâtre Expérimental, depuis ses premières
créations. La décision de baptiser quatre créations «
spectacles de femmes » uniquement en 1978 indique, à mon sens, que
les femmes appartenant au Théâtre Expérimental de
Montréal ont décidé cette année-là de rendre
cette démarche féministe officielle. Le match d'Improvisation,
qui existe depuis un an, parachève le litige entre les deux pôles
et provoque irrémédiablement la scission :
En ce qui concerne la L.N.I (Ligue Nationale d'Improvisation),
qui par ailleurs repose sur une très bonne idée, je suis
suprêmement énervée par l'utilisation du jeu de hockey, qui
est un jeu
exclusivement masculin et superviril. Je trouve ridicule de
voir des femmes sur la glace qui font comme si c'était
tout-à-fait normal 41
40 Pol Pelletier, Histoire d'une féministe,
extrait de Trac femmes,, 1978, p. 103-104, disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/publications/trac-femmes
[consulté le 31/03/2019].
41 Ibid., p. 109-110.
25
La Ligue Nationale d'Improvisation occupe de plus en plus de
place et de temps au sein du Théâtre Expérimental, avec un
succès inattendu. Dans ce contexte, le Théâtre
Expérimental de Montréal se scinde en deux parties : la maison
Beaujeu demeure désormais un lieu de création pour Pol Pelletier,
Louise Laprade et Nicole Lecavalier, qui fondent le Théâtre
Expérimental des Femmes. Robert Gravel cherche donc avec ses complices
un nouveau lieu pour y accueillir le Nouveau Théâtre
Expérimental, créé en 1979. Il trouve refuge à
l'Université du Québec à Montréal 42
afin d'accueillir les deux saisons suivantes de la Ligue Nationale
d'Improvisation. Le caractère institutionnel du match d'improvisation
étant incompatible avec les créations expérimentales du
Nouveau Théâtre Expérimental de Montréal, Robert
Gravel sépare les deux organismes ; la Ligue Nationale d'Improvisation
devient une structure autonome en 1980. Dès 1982, les matchs se jouent
à la salle du Spectrum de Montréal, pouvant accueillir jusque
1200 spectateurs.43.
Á travers le parcours de Robert Gravel, c'est la remise
en cause des institutions et la volonté de se forger une identité
propre pour les Québecois qui s'est affirmée par le
théâtre. Cette construction d'une identité nouvelle
s'étant traduite par la réinvention du théâtre au
moyen d'expérimentations, un phénomène similaire est
observé dans d'autres territoires faisant l'objet de contestations
sociales et culturelles. Pendant que la troupe des Jeunes Comédiens se
réappropriait l'idée d'un théâtre Québecois,
des artistes français remettaient en cause la politique culturelle
à travers plusieurs initiatives se traduisant par le renouveau de la
pratique théâtrale. Le mémoire de Jean Couturier sur le
Théâtre de l'Unité place la naissance de celui-ci dans le
cadre des « pratiques théâtrales non conventionnelles, hors
normes »44. Les problématiques similaires des compagnies
se font écho, ce qui favorisera leur rencontre en 1981, à
l'initiative de Jacques Livchine et Hervée Delafond, créateurs du
Théâtre de l'Unité.
Les deux troupes se sont, en effet, constituées en
marge des institutions :tout comme les Jeunes Comédiens au
Québec, le Théâtre de l'Unité souhaite trouver un
public nouveau, d'où son choix d'investir la rue.
42 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 38.
43 Le Spectrum a fermé ses portes en 2007. Depuis, et
selon ses manifestations, la Ligue Nationale d'Improvisation se produit
à la salle Espace Libre, dotée d'une capacité de 130
places ; ou au Club Soda, doté d'une capacité de 530 places.
44 Jean Couturier, Le théâtre de l'Unité
: un parcours singulier, sous la direction de Robert Abirached, Centre
d'études théâtrales, Université Paris X Nanterres,
1993, p. 4.
26
Tout comme le Théâtre Expérimental de
Montréal, le Théâtre de l'Unité « veut
fragiliser et métamorphoser le rituel de la représentation
théâtrale ».45 La solution pour y parvenir se
trouve hors du théâtre institutionnel, dans les créations
collectives.
En utilisant le théâtre de rue, le
Théâtre de l'Unité modifie l'espace dans lequel se trouve
le public, ce qui modifie sa fonction et sa perception du spectacle. Robert
Gravel, au temps du Théâtre Expérimental de
Montréal, avait lui aussi envisagé de modifier la place du
spectateur :il avait crée Zoo en 1977, qui offrait un parcours
déambulatoire au public, se promenant au milieu de cages qui
renfermaient tantôt des animaux, tantôt des comédiens.
Dynamiter l'espace de représentation remet en cause le confort de
l'acteur, qui peut se retrouver magnifié par un rituel auxquels se
soumettent les spectateurs lorsqu'ils vont voir une pièce de
théâtre. Le théâtre de rue propose également
de remettre en cause ce rituel :le fait d'aller chercher un public là
où il est, dans la rue, le libère du conditionnement dont il fait
l'objet dans le cadre d'une représentation institutionnelle : lorsque
nous allons au théâtre, nous nous prêtons à un rituel
précis depuis notre entrée dans le théâtre
jusqu'à notre sortie : notre entrée dans un lieu fermé,
les affiches qui nous rappellent que nous sommes dans un lieu consacré,
les ouvreurs qui nous indiquent ou nous asseoir, le noir dans la salle qui nous
prévient du début du spectacle : tout nous conditionne à
adopter une attitude respectueuse envers le lieu, le rite social et les
comédiens.
Dans le théâtre de rue, le spectateur peut
choisir de passer son chemin, ou, au contraire, avoir une part active, voir
participante à l'évènement : son regard sur les
comédiens pourra attirer l'attention d'autres passants, qui vont par
leur choix de s'arrêter et de regarder construire l'espace
théâtral. Libre également à lui de quitter la
représentation ou de la perturber à tout moment. Cette action
renforce l'interaction entre spectateur et comédien, qui peut se
retrouver quelque peu désacralisé.
Avec la création de la Ligue Nationale d'Improvisation
et du match d'improvisation théâtrale, l'équipe du
Théâtre Expérimental de Montréal a
élaboré une forme théâtrale dans laquelle le public
se trouve doté d'un certain pouvoir : il a le droit de manifester son
ressenti quant à la scène qu'il vient de voir et, si besoin est,
de faire entendre sa désapprobation grâce à des chaussons
lancés sur l'aire de jeu.
Cela fait partie du rituel du match d'improvisation : le
spectateur, à son entrée dans la salle, se voit remettre, en plus
du carton de vote pour décider quelle a été la meilleure
improvisation, une pantoufle. Il peut la jeter sur la patinoire pour manifester
son mécontentement, soit quant à la qualité de
l'improvisation qu'il vient de voir, soit quant au jugement de l'arbitre. Il
s'agit de laisser
45 Ibid., p. 11.
27
le choix au spectateur : Robert Gravel s'est un jour
exprimé, à travers une parole retranscrite dans le livre de
Jean-Baptiste Chauvin, sur la fonction du chausson : « J'ai toujours dit
en blaguant que chaque théâtre devrait offrir des caoutchoucs
à ses spectateurs pour voir si son spectacle est apprécié.
On n'a pas le droit d'être ennuyant au théâtre
»46. Un spectacle de mauvaise qualité est donc
condamné par un lancer de chausson lors d'un match d'improvisation, ou
par l'indifférence du spectateur qui passe son chemin pour le
théâtre de rue.
Ces deux formes théâtrales peuvent cependant
être en opposition du point de vue du rituel. Le théâtre de
rue invente son rituel et ses codes - qui varient d'un spectacle à
l'autre, parfois d'un lieu ou d'un public à l'autre. Le spectateur du
match d'improvisation se prête à un cérémonial
orchestré et rôdé : il est encouragé à crier,
hurler, rire, chanter, et à taper dans les mains. Dans ce rituel
interviennent entre autres le musicien qui plonge la salle dans une ambiance
sonore et conviviale, ainsi que le maître de cérémonie, qui
assume plusieurs fonctions ; hôte, présentateur, guide et
traducteur des codes du match.
Il contribue donc à insuffler entre les rangs des
spectateurs une ambiance de fête. Les expérimentations
parallèles des québecois avec le match d'improvisation et des
français du Théâtre de l'Unité avec le
théâtre de rue oeuvrent donc dans ce sens, résumé
ainsi par Jean Couturier : « Un des mythes de l'histoire du
théâtre, les Dionysies, fêtes grecques à l'origine du
théâtre, reste un élément de référence
du Théâtre de l'Unité Mais Jacques Livchine et
Hervée Delafond croient à la fonction festive de cet art contre
la notion de culture qui se reçoit dans le silence et l'ennui.
»47
À son arrivée en 1978 à
Saint-Quentin-en-Yvelines, le Théâtre de l'Unité se
retrouve dans une ville nouvelle, regroupant plusieurs communes, où tout
est à inventer en matière de culture et de programmes sociaux.
C'est donc un terrain de choix pour la compagnie qui, grâce à ses
expérimentations peut « permettre à la ville de se
découvrir, s'inventer une histoire, une mémoire, lui donner une
âme, faire du théâtre une parole supplémentaire,
créer grâce à lui des liens entre habitants de la
cité. »48
Ce lien prend forme en 1979, lorsque la troupe met en place
ses premiers stages - baptisés « Ruches » en 1981 -
mélangeant amateurs et professionnels et mêlant des arts divers,
dont l'improvisation théâtrale.
Selon les écrits de Jean-Baptiste Chauvin, 1981 marque
également la venue de la Ligue Nationale d'Improvisation pour la
première fois en France avec une tournée orchestrée par le
théâtre de la
46 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 96.
47 Jean Couturier, op. cit., p. 12.
48 Ibid., p. 49.
28
Commune d'Aubervilliers49. Les similitudes
partagées entre les deux structures, tant idéologiques
qu'artistiques et culturelles, font de la Ligue Nationale d'Improvisation un
choix pertinent pour animer les premières ruches.
I.3 L'importation du match d'improvisation
théâtrale en France : création et extensions des ligues
d'improvisation
La ville de Saint-Quentin, que Jacques Livchine avait
trouvé vide en termes d'offres culturelles et de liens sociaux à
son arrivée, ainsi que le Département des Yvelines, ont vu
naître plusieurs structures autour de l'improvisation
théâtrale qui demeurent encore aujourd'hui solides : les
premières ruches ont en effet nourris les idées
théâtrales d'Alain Degois, affectueusement surnommé «
Papy » :
Pour tout te dire, c'est le Théâtre de
l'Unité qui a fait venir le match d'impro en France, ce sont les
premiers à avoir capté le truc : ils étaient en
résidence à Saint-Quentin-En-Yvelines. Je ne sais pas comment la
connexion s'est faite, si c'est l'un qui a invité l'autre, mais le fait
est qu'en France, le Théâtre de l'Unité a été
le premier à faire de l'impro dans les années 80, avec la ligue
du Québec. Je n'ai pas connu cette période-là, mais Papy a
commencé comme ça.50
C'est en ces termes que Jean-Baptiste Chauvin me raconte les
premiers essais d'Alain Degois avec les ruches. Les années 80 voient
fleurir partout sur tout le territoire des initiatives qui
bénéficient à ceux qui sont aujourd'hui des acteurs
majeurs de l'improvisation théâtrale en France.
Alors que les ruches sont à l'origine de la
création de la Ligue d'Improvisation Française en 1981, d'autres
pédagogues du théâtre proposent des stages d'improvisation
théâtrale ouverts aux amateurs. En 1983, Emmanuel Leroy, fondateur
de la Ligue d'Improvisation de Marcq-En-Baroeul en 1992, consolide ses armes de
comédien amateur aux côtés d'Alain Knapp :
J'ai fait un stage d'improvisation théâtrale en
1983 à Alès[...].C'était un stage d'improvisation
mais
pas du tout de match d'impro. C'était Alain Knapp qui a
été un très grand pédagogue du
49 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 38.
50 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06 Mars 2019.
29
théâtre en France qui donnait ce stage
d'improvisation. Et donc j'allais suivre un stage d'improvisation pour moi.
51
Emmanuel Leroy ajoute que « [Alain Knapp] a une
réputation internationale »52,qui remonte à ses
travaux effectués avec le Théâtre-Création,
compagnie descendante de l'atelier de Recherche de Vidy ayant
éclaté en 1968. Bien que Hervé Charton, spécialiste
des travaux d'Alain Knapp, précise que « Mai 1968 et les
évènements de mai n'auront que très peu d'importance en
eux-mêmes dans l'histoire du Théâtre-Création, dont
la fondation, si elle en est concomitante et participe à la même
fête de l'esprit, n'en hérite rien de façon directe
»53, elle s'inscrit dans un mouvement contestataire similaire
à celui qui vit le Québec : que ce soit en France avec Mai 68 ou
au Québec avec la Révolution Tranquille, les révoltes
sociales favorisent l'émergence de l'improvisation dans le renouveau du
théâtre.
Le Théâtre-Création d'Alain Knapp vit mal
son rattachement à une institution : annexé au Centre Dramatique
Romand, l'atelier de recherche de Vidy, se présente comme « une
école qui cherche à désapprendre, à déformer
plutôt qu'à former »54. Il s'agit donc de
réorganiser la pédagogie du Centre Dramatique Romand dont
dépend ce même atelier, conformément à «
l'insatisfaction de Knapp et d'autres jeunes metteurs en scène face
à la formation des comédiens romands »55.
Il est intéressant de noter les similitudes, à
ce stade, entre le Théâtre-Création de Lausanne et la
troupe des Jeunes Comédiens de Montréal. Les deux structures,
toutes deux dépendantes d'institutions - Le Cendre Dramatique Romand
pour le Théatre-Création et divers organismes culturels
gouvernementaux dans un premier temps, puis le Théâtre du Nouveau
Monde pour les Jeunes Comédiens - misent sur la
spontanéité créatrice de leurs membres et favorisent un
travail de recherche au lieu d'un travail de production.
Il naît un désaccord fondamental entre ce
laboratoire et la structure institutionnelle qui emploie Alain Knapp, qui doit
fatalement aboutir à une séparation, tout comme la «
schizophrénie artistique aigue » qui a fini par empoisonner la
relation entre la troupe des Jeunes Comédiens et les différentes
structures qui l'employaient. Alain
51 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
52 Idem.
53 Hervé Charton, Alain Knapp et la liberté
dans l'improvisation théâtrale, Paris, Classique Garnier,
2017, p .85.
54 Ibid, p. 130.
55 Ibid, p .129.
30
Knapp supporte de moins en moins le Centre Dramatique Romand.
Les deux compagnies se séparent en 1968, et l'atelier de recherche prend
officiellement le nom de « Théâtre-Création ».
Knapp participe au projet de grande envergure qu'est l'Atelier international du
théâtre expérimental se déroulant du 17 Septembre au
2 Octobre 1971 à Dourdan. C'est l'occasion pour lui de rencontrer
d'autres troupes expérimentales venant de différents pays. C'est
donc, également ailleurs qu'au Québec, l'éclatement du
théâtre expérimental. C'est par ce parallèle
qu'Hervé Charton explique les raisons de l'arrivée d'Alain Knapp
au Québec :
C'est dans ce climat qu'il faut comprendre l'invitation de
Knapp au Québec, quelques temps après la publication du dossier
sur Dourdan dans la revue International Theatre Informations, qui a
fait connaître Outre-Atlantique Alain Knapp et ses idées sur
l'improvisation ; André Pagé veut former des auteurs et des
créateurs, pour raconter ce que le Québec est en train de
vivre.56
André Pagé est directeur de L'École
Nationale de Théâtre du Canada en 1974. A cette époque, la
troupe des Jeunes Comédiens, qui est issue de cette même
école, vit ses derniers instants.
Ses travaux sur l'improvisation et l'expérimentation,
ainsi que ces deux histoires parallèles, désignent Alain Knapp
pour animer, entre autres, des stages d'improvisation. Les échos
favorables qu'il obtient grâce aux méthodes
développées avec le Théâtre-Création - qui
s'est arrêté en 1975 - auprès des comédiens
québécois incitent ces derniers à perfectionner leurs
techniques en le suivant durant les stages qu'il continue à donner sur
le sol français. Robert Lepage, par exemple, « l'un de ses anciens
élèves les plus connus »57. Après avoir
assisté à un stage encadré par Alain Knapp à Paris
en 1978, il obtient le trophée Beaujeu de la Ligue Nationale
d'Improvisation en 1984 ainsi que pour la saison 1986-1987. Ce trophée
récompense, sur une année, les joueurs les plus
étoilés. Il s'agit d'une récompenses symbolique remise aux
trois joueurs ayant, aux yeux d'un invité d'honneur, effectué les
trois meilleures prestations.
C'est pourquoi Emmanuel Leroy, lorsqu'il assiste à un
stage similaire en 1983, fait connaissance avec plusieurs participantes venues
du Québec : « La, j'ai rencontré des comédiennes
québecoises qui m'ont expliqué le match d'impro, et qui m'ont
expliqué le principe. J'ai trouvé ça extraordinaire et
donc j'ai vu comment ça se passait ».58
56 Ibid., p. 192.
57 Ibid., p. 193.
58 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
31
Le fait qu'il suivre, à cette époque, un stage
d'improvisation pour perfectionner ses techniques de comédien traduit
une différence fondamentale entre la vision de l'improvisation par Alain
Knapp et celle par Robert Gravel et Yvon Leduc.
Hervé Charton rapporte qu'Alain Knapp considère
la Ligue Nationale d'Improvisation comme « un avatar du
Théâtre-Création ; le tirage au sort des thèmes
proposés par le public, les règles telles que le refus de jeu ou
autres sont pour lui directement inspirés des indications qu'il donnait
lors de ses stages à l'École Nationale de Théâtre
»59.
Il faut noter que, dans le cadre du match, les thèmes
sont donnés par l'arbitre, et non par le public. Par ailleurs, il n'est
guère surprenant qu'Alain Knapp « déteste tout ce que Gravel
et Leduc ont pu faire »60, ces deux pratiques de
l'improvisation étant difficilement comparables : Alain Knapp utilise
l'improvisation comme un des outils pour « (re)donner à l'acteur
une place de première importance dans le processus de création
»61. Dans un match d'improvisation, le joueur est amené
à assumer les fonctions de comédien, auteur et metteur en
scène, mais ce cumul résulte de l'urgence de proposer une
histoire dans un temps imparti. Il réside par conséquent cette
différence : l'improvisation, dans le match, est un produit que le
joueur doit fournir. Ce qui répond exactement à la volonté
de Robert Gravel lorsqu'il a voulu déplacer l'improvisation dans un
cadre sportif.
Le conflit qui oppose Alain Knapp aux créateurs
reconnus par l'Histoire du match d'improvisation est donc davantage
dramaturgique, voire idéologique, que résultant d'un
désaccord sur l'identité des créateurs du match
d'improvisation.
L'objet de ce litige est davantage affirmé par la
réaction d'Alain Knapp au début des années 80 : «
Aujourd'hui, la simple évocation du match d'impro, qu'il découvre
à Aubervilliers lors de la première tournée en France de
la LNI en 1981, et à laquelle ses élèves sont
invités à se confronter, le met encore en fureur »62
Cette période voit le paysage de l'improvisation
modifié en France, utilisée comme outil de création dans
les écoles de théâtre et de renforcement pédagogique
et culturel avec les ruches du Théâtre de l'Unité. Elle
adopte progressivement la forme imaginée par Robert Gravel : la
première tournée de la Ligue Nationale d'Improvisation
coïncide avec la création de la Ligue d'Improvisation
Française en 1981, première compagnie basée sur le
modèle québecois.
C'est grâce aux nombreuses dates effectuées
pendant la tournée de la Ligue Nationale d'Improvisation à
l'initiative du Théâtre de la Commune d'Aubervilliers que se
forment les
59 Hervé Charton, op. cit., p. 194.
60 Idem.
61 Ibid., p. 54.
62 Ibid., p. 194.
32
premiers improvisateurs français, dans le sens du
match. D'une rencontre à l'autre, les matchs se structurent, gagnent en
précision quant au déroulement, et différents
comédiens issus d'ateliers répartis sur tout le territoire
tentent leur chance pour la première fois face au québecois
:« Présentées d'abord en périodes
spéciales, ces courtes rencontres deviendront peu à peu des
matchs complets qui mettront en scène des joueurs européens
maîtrisant de mieux en mieux les diverses facettes du jeu
»63.
Le format, étant tout d'abord un aperçu dans le
cadre de ces différents ateliers, se présente sous une forme
allégée du match, et se consolide au fur et à mesure des
dates. La première rencontre, datant du 24 Avril 1981 à
Mérignac, présente une forme de trente minutes. Elle
évolue de façon significative à la date suivante,
où un match plus étoffé a lieu : « Cinq jours plus
tard, à Marseille, une formule spéciale est créée,
permettant à quatre équipes de participer à un
mini-tournoi en un seul match »64.
Différentes expérimentations, sous la direction
des comédiens québecois, essaiment alors sur tout le territoire,
et les jeunes comédiens issus de différents ateliers affluent de
plus en plus : « A Paris, les comédiens du Théâtre de
l'Unité, d'Alain Knapp, et de Claude Confortes l'emportent sur la troupe
Polygene, celle du Petit atelier et celle de Carlo Boso, ce qui leur donne
l'occasion de se mesurer aux étoiles de la LNI. »65
Ces éliminatoires, permettant officieusement une
sélection de joueurs prêts à affronter les
Québecois, sont les premiers signes que l'improvisation dans le sens
sportif du terme commence à se structurer en France. Il est à
noter qu'en utilisant le terme d' « étoiles », Jan-Marc
Lavergne évoque ainsi les meilleurs joueurs de la Ligue Nationale
d'Improvisation. Par ailleurs, le format dans sa dimension complète
commence à être adopté : le premier a été
disputé la même année à Poitiers.
Les éléments nécessaires étant
réunis, la Ligue d'Improvisation Française peut voir le jour
grâce aux efforts combinés des québécois et des
comédiens parisiens de la troupe Polygène et du
Théâtre de l'Unité.
Le premier match à grande échelle, opposant la
Ligue Nationale d'Improvisation à la Ligue d'Improvisation
Française, a lieu au Festival d'Avignon, le 24 Juillet 1982. Ce
spectacle peut être interprété comme une preuve que le
match d'improvisation a maintenant sa place dans le paysage
théâtral en France, étant invité par une institution
de grande envergure qu'est le festival d'Avignon.
63 Jan-Marc Lavergne, La petite histoire de la coupe du monde
d'improvisation, 1985, p.16, disponible sur
http://match.impro.free.fr/telechargements/mondial-1985.pdf
[consulté le 27/03/2019].
64 Ibid., p. 7.
65 Idem.
33
Par ailleurs, il a été vu que bon nombre de ses
premiers participants, à l'image d'Emmanuel Leroy, sont des
comédiens cherchant à se perfectionner avant d'être des
improvisateurs.
Ce jumelage établi permet d'agrandir et de varier la
proposition faite par l'improvisation théâtrale : la Ligue
Nationale d'Improvisation revient en 1983 sur le sol Européen pour de
nouveaux matchs et ateliers, mettant en place plusieurs ligues
d'Improvisation.
La médiatisation du match d'improvisation, dès
1983, lorsque Radio-Québec diffuse la première joute
théâtrale entre deux équipes Québécoises,
marque également un tournant dans l'évolution du match, et permet
d'exaucer le voeu de Robert Gravel : une pratique artistique
déplacée dans un cadre sportif, offre à des personnes
extérieures au monde du théâtre, de découvrir la
pratique.
Elle offre également à ceux qui n'ont pas
assisté aux premiers émois des ateliers en 1981 de
découvrir la discipline : Jean-Baptiste Chauvin, qui ne se destinait
guère à une pratique professionnelle dans ce milieu,
découvre le match d'improvisation théâtrale à la
télévision :
J'ai découvert la match d'improvisation à la
télé, en 1986. De mémoire, c'était une carte
blanche à un animateur qui avait fait une retranscription d'un math
d'impro de la LIF. Quand j'ai vu ça, j'ai eu très envie de le
faire. Ça n'a pas recroisé ma route, donc je ne m'en suis pas
plus préoccupé. J'ai toujours fait un peu de
théâtre, mais sans avoir plus de prétention que ça
sur un avenir professionnel ».66
Le milieu des années 80 offre à l'improvisation
théâtrale de se développer dans des domaines autres que le
domaine artistique : un premier relais étant franchi grâce
à la médiatisation du match, Jean-Baptiste Chauvin et Emmanuel
Leroy s'approprient le match d'improvisation, à l'aide de plusieurs
organismes qui voient le jour, pour en faire un instrument de pédagogie
à l'attention des plus jeunes. Deux évènements ayant lieu
à deux endroits simultanés du territoire pérenniseront
cette méthodologie.
Jean-Baptiste Chauvin bénéficie également
d'une formation de cet ordre en officiant dans les Yvelines : « J'ai
appris sur le terrain, mais avec une grande chance : comme l'impro est
arrivée sur les Yvelines, je n'avais que des gens qui connaissaient [le
match] par coeur et qui le connaissaient bien. En tout cas, dans les cadres
d'origine. »67
66 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 6 Mars 2019.
67 Ibid.
34
Dans les Yvelines, il rencontre Alain Degois, qui a suivi une
des ruches avec le théâtre de l'Unité. Alain Degois
était en discussion avec Jean Jourdan, professeur d'éducation
physique : « [Jean Jourdan] s'est toujours beaucoup
intéressé à ce qu'il appelle les « formes hybrides
», c'est-à-dire le mélange d'arts et de sports »68.
L'intérêt d'enseigner le match d'improvisation
théâtrale chez les plus jeunes - comédiens ou
écoliers - désamorce les esprits de violence et de
compétition. En cas de décrochage scolaire ou de
difficulté d'insertion, le lieu représenté par la
patinoire matérialise une structure dans laquelle une personne peut
prendre sa place et évoluer, à l'image de son évolution
dans la société : il est assimilé par le philosophe
Benoît Cambillard à « l'expression du jeu politique »,
ses paroles étant rapportées par Jean-Baptiste Chauvin :
« En occupant les différentes fonctions à
l'intérieur de la structure de jeu, les pratiquants interprètent
leur rôle en fonction de la représentation qu'ils ont des
positions qu'ils occupent et cela, dans la limite fixée par les
règlements. Ces rôles ne sont en rien des rôles fictifs
puisqu'ils relèvent de ce que Duvignaud désigne comme
étant « une élaboration, une sublimation des
éléments les plus profonds de la vie collective »69
Bien que ses propos évoquent la participation de tous
les membres du staff dans un match d'improvisation - et non uniquement des
joueurs - elles traitent de l'importance et des bénéfices de la
pratique en improvisation théâtrale : participer, dès le
plus jeune âge, à un jeu qui est une parabole de la vie politique,
favorise la prise de confiance en soi. Par ailleurs, du point de vue
individuel, la spontanéité inhérente à
l'improvisation peut être révélatrice pour tout participant
de la place qu'il pense occuper dans la société. Dans ce contexte
interviennent les valeurs véhiculées par le match d'improvisation
: construire une histoire se fait ensemble, et sur chaque improvisation, chacun
se définira implicitement ou explicitement un rôle, en termes de
propositions, de leader pour faire avancer l'intrigue, d'observation pour
évaluer la nécessité ou non d'une intervention sur
scène. Pour qu'un spectacle soit équilibré, des
circonstances optimales en termes d'écoute et de circulation de la
parole auront permis à chaque participant d'occuper tour à tour
ces différentes fonctions.
La limite fixée par les règlements dont parle
Benoît Cambillard permet la mise en place d'un filet qu'impose le vertige
de l'exercice. Le cadre solide qui instaure cette sécurité
favorise la prise de risque au sein de la patinoire. C'est là
qu'intervient l'importance d'un espace de jeu clairement défini et d'un
arbitrage juste : tout comme le comédien entrant sur scène, le
joueur, dès qu'il entre
68 Ibid.
69 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p .102-103.
35
sur la patinoire, entretien un rapport différent avec
l'espace et le temps. Il est déjà une autre personne lors de
l'entrée des équipes, car, habillé d'un maillot de joueur
de hockey, il joue déjà le rôle d'un joueur.
Le rituel du match d'improvisation invite donc tout joueur
à entrer avec un autre état : le joueur est selon Jean-Baptiste
Chauvin le héros du spectacle : « Le spectateur vient voir un
héros qui va se mettre au défi de se mettre dans pleins de
personnages différents ».70
Il abandonne progressivement son comportement quotidien, ce
qui lui permet de prendre sa place dans la patinoire avec un état plus
neutre et donc plus disponible. Le cadre de la compétition, qui impose
par définition un règlement et une attitude convenable à
respecter, pose un socle qui garantit une équité des chances et,
paradoxalement, déconstruit les tendances à jouer pour plaire
à un public. Ce qui va à l'encontre de la tendance
première que l'être humain a de vouloir séduire l'autre
à tout prix. Plusieurs fautes prévues par le règlement
luttent contre ce comportement, telles les fautes de cabotinage, de rudesse -
lorsqu'on impose de façon violente une idée ou un personnage
à son partenaire - ou encore de cliché. Je vois dans cette
configuration empêchant toute initiative individualiste un autre rapport
avec la vie politique : nous ne vivons jamais seuls, et nous composons toujours
avec les autres. Les vertus d'acceptation sociale et de prise de confiance en
soi ne peuvent donc fonctionner qu'à condition que le joueur soit au
service du collectif.
Par ailleurs, un jeu individualiste pose un autre
problème du point de vue dramaturgique. Simon Fâche, qui est
pianiste à la Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul, évoquait
ce sujet lorsque je me suis entretenu avec lui : « Et puis, si tu montes
sur scène pour plaire au public, ça veut dire que tu n'es
là que pour satisfaire ton ego. Tu n'es pas là pour faire un
spectacle »71
Malgré cette déconstruction de l'individualisme,
l'aspect compétitif du match d'improvisation théâtrale
contribue à sa mauvaise réputation en tant que pratique
artistique. Néanmoins, cela n'empêche en aucun cas d'attirer les
jeunes amateurs, tout comme l'a été Jean-Baptiste Chauvin. Il
fait un parallèle entre la pratique du match et le théâtre
à textes, ou « théâtre conventionnel » qui a
attiré mon attention : « Mais l'hypocrisie inhérente
à la « grande famille du théâtre » occulte mal
les rapports compétitifs qui font partie de la vie du comédien,
à commencer par l'audition, qui est une forme on ne peut plus claire de
compétition »72.
70 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06 Mars 2019.
71 Entretien avec Simon Fache, 27 Février 2019.
72 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 143.
36
Le milieu artistique professionnel et la vie en
société sont donc régis par des lois similaires : il faut
constamment arriver à un résultat tout en composant avec l'autre.
Par ailleurs, le grand nombre d'artistes professionnels exclue toute chance de
réussite par l'individualisme et la rudesse.
Pratiquer l'improvisation théâtrale permettrait
donc, selon moi, de préparer l'artiste aux difficultés qu'il est
amené à rencontrer tout au long de sa carrière. Il y a
donc un intérêt de découvrir cet apprentissage le plus
tôt possible.
Après son stage auprès d'Alain Knapp, Emmanuel
Leroy, qui a développé en parallèle une activité
de comédien-formateur, veut instaurer le match
d'improvisation à destination des plus jeunes comédiens :
Et du coup, j'ai ramené [le match d'improvisation] dans
le cadre du théâtre-école de la ville de Marcq-en-Baroeul
dont je suis le directeur depuis sa fondation. Et j'ai commencé à
le pratiquer avec mes élèves. Ensuite, j'ai su qu'il y avait des
comédiens à Paris qui jouaient ce jeu-là. J'ai
contacté des comédiens à paris et j'ai demandé
à un comédien de Clichy de venir dans le Nord pour
compléter notre formation.73
Avec cet enseignement, il organise dès 1984,
année de création du théâtre-école, les
premiers championnats de France de ligues juniors »74.
Influencée par son inspiration d'origine sportive, une
ligue se définit par la composition d'une équipe, par un esprit
de troupe et par conséquent d'identité. Les ateliers
donnés par les québécois ayant insufflé le
mouvement, les différentes initiatives mises en place sur le territoire
permettent de donner à l'improvisation théâtrale en France
une spécificité, que les comédiens de la Ligue
d'Improvisation Française sont chargés de défendre sur le
plan international, les ligues émergeant également à la
même époque dans d'autres pays Européens.
En 1985, la matière est suffisante pour satisfaire une
des ambitions de Robert Gravel : « "Un jour, l'improvisation couvrira la
planète et les peuples seront réunis grâce à elle !
" C'est ce que je dis souvent en blaguant, mais y a-t-il quelque chose de plus
sérieux qu'une blague ? » 75
Le 17 Avril a lieu à Montréal le premier match
de la première coupe du monde d'improvisation, opposant la Ligue
d'Improvisation Française à la Ligue Nationale d'Improvisation.
Dans cette compétition s'affrontent également la Ligue
d'Improvisation Belge et la Ligue d'improvisation Suisse.
73 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
74 Idem.
75 Robert Gravel, Introduction de la plaquette du premier
mondial d'improvisation théâtrale, op. cit, disponible sur
http://match.impro.free.fr/match-impro-index2.html
[consulté le 02/04/2019].
37
L'évènement peut être suivi par bon nombre
de personnes, grâce à sa télédiffusion en direct.
Depuis 1982, la radio et la télévision retransmettent des matchs,
grâce à la pugnacité de Robert Gravel que rapporte Jan-Marc
Lavergne : « Par exemple la télédiffusion des matchs en
direct. Au début, on en parlait en riant. Finalement, en tenant
tête aux diffuseurs qui souhaitaient une diffusion en
différé, nous avons gagné notre point »76
Le match d'improvisation a cette particularité de voir
le comédien en plein processus de création. Il perdrait donc de
son essence si les télé-diffuseurs n'avaient diffusé que
les meilleures improvisations, à la manière d'un compte-rendu
sportif montrant une compilation des meilleurs moments d'une rencontre
sportive.
C'est donc bel et bien pour conserver le match d'improvisation
en tant qu'objet théâtral que Robert Gravel a refusé de
transiger sur ce point.
La télédiffusion de ces matchs permet de toucher
une population bien plus grande et provoque l'intérêt de personnes
potentiellement étrangères au monde du théâtre.
La Ligue d'Improvisation Française étant
composée de comédiens professionnels ou en voie de
professionnalisation au moment de sa création, il faut une nouvelle
forme de structure pour accueillir ces nouvelles personnes : Jean-Baptiste
Chauvin rejoint la Ligue d'Improvisation Départementale des Yvelines,
crée en 1989 :
Puis j'ai été travailler comme animateur
à Voisins-Le-Bretonneux, à coté de Trappes. C'est
là que j'ai découvert que, dans les Yvelines, il y avait une
ligue amateure [...]Elle avait plusieurs équipes, dont une dans la ville
où je travaillais. Le lendemain-même j'étais
déjà inscrit, et mon premier cours d'impro a été
avec Papy.77
Depuis son premier stage avec les québécois au
sein du Théâtre de l'Unité, Papy effectue en effet un
travail conséquent sur l'improvisation théâtrale. Sa
profession d'éducateur lui ayant permis, avec l'appui de Jean Jourdan,
d'instaurer la pratique du match d'improvisation dans les collèges, il
continue l'opération de démocratisation de la discipline en
créant la première Ligue d'Improvisation amateure.
Le Département des Yvelines est le pionnier de
l'improvisation théâtrale en France : en tant que
département de naissance de la discipline, c'est sur ces terres que se
développent la majorité des structures offrant la pratique de
l'improvisation théâtrale, et ce grâce à une
transmission orale qui diversifie l'offre et les besoins : la Ligue
d'Improvisation Départementale des Yvelines est, à ce
76 Jan-Marc Lavergne, op. cit., p. 9.
77 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06 Mars 2019.
38
jour, une des rares ligues officiant sur l'ensemble d'un
Département. Pour répondre à la demande d'un territoire si
étendu, elle se divise en sept équipes dans plusieurs villes.
Alain Degois ayant reçu une formation orale par les Québecois, il
est le premier maillon d'une chaîne qui sera bientôt
présente sur tout le pays. Étant, par ailleurs, éducateur,
il est également, avec Jean-Baptiste Chauvin et Jean Jourdan, le
précurseur de l'improvisation théâtrale en milieu scolaire.
Il aura donc contribué à faire connaître les bienfaits de
l'improvisation théâtrale dans un contexte social, ce qui a ouvert
la voie à cette pratique dans bons nombres de collèges de France
ainsi que pour les team buildings d'entreprise.
Grâce aux ligues professionnelles qui se sont
créées durant ce temps, les amateurs ont une nouvelle
visibilité du match d'improvisation théâtrale.
En héritage des premiers ateliers de la Commune
d'Aubervilliers en 1981, la plupart des plus grandes régions du pays
s'équipent d'une ligue professionnelle. C'est ainsi que se forme,
à l'image de ce qui s'est passé dans le Département des
Yvelines, la première génération d'improvisateurs en
France : des comédiens amateurs ou professionnels ayant suivi des stages
d'improvisation grâce à la transmission des Québecois.
Le phénomène de transmission orale se poursuit,
et les troupes amateurs qui veulent se former aux matchs se tournent donc
naturellement vers les ligues professionnelles.
L'accessibilité de la discipline se heurte
bientôt à une problématique : ceux qui l'enseignent par la
parole et différents ateliers doivent faire preuve d'une grande prudence
pour respecter le matériel de base qu'est le match d'improvisation
théâtrale. Les formateurs, tels Jean-Baptiste Chauvin, ont un
devoir de transmission juste pour respecter l'héritage de ce
matériel. L'accessibilité augmentant doit alors composer avec les
nombreuses individualités qui s'intéressent à
l'improvisation :
Ce qui est difficile, c'est de transmettre l'esprit d'origine
[...] J'ai bénéficié d'une transmission orale, parce que
j'ai eu des formateurs qui étaient très bien dans l'esprit du
match d'impro, mais pleins de gens se sont formés un peu tout seuls ;
parce qu'ils étaient excentrés. Et pour certains qui pensaient
savoir. Donc transmettre l'esprit du match, c'est sûr que c'est
compliqué.78
La transmission évolue au moment-charnière qui
voit se développer les ligues amateurs : à l'initiative de Julien
Gabriel, qui était à l'époque l'arbitre en chef de la
Ligue d'Improvisation Française, les ligues professionnelles prennent en
charge de structurer le paysage de l'improvisation théâtrale
Français. L'Association Française des Ligues d'Improvisation
(AFLI) se met en place, et
78 Idem.
39
publie au milieu des années 90 un document
intitulé Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le match
d'improvisation. L'article est composé d'une quinzaine de pages ,
avec un préambule expliquant brièvement les origines du match
d'improvisation. Il décrit également la mission de cette
association : « Regroupées dans l'AFLI, les ligues ont pour mission
de développer cette forme théâtrale, en faisant respecter
les règles, les signes, la mise en scène et l»esprit du jeu
tels que définis par ses concepteurs ».79 Dans cet
article est également répertorié tout ce qui constitue un
match d'improvisation théâtrale pour que les ligues amateurs
puissent suivre le protocole.
Emmanuel Leroy a été à la tête de
cet organisme pendant un an et demi. Il définit son rôle de la
manière suivante : « L'AFLI a joué un rôle un moment
donné qui était intéressant ; discuter de ligue à
ligue en se voyant à peu près une fois par mois, et essayer
d'organiser des évènements en commun »80.
L'association opère dans un souci de cohabitation entre ligues et de
préservation de ce format d'origine. Le document publié
transmettant aux amateurs le décorum, le protocole, et le rituel
nécessaire au bon fonctionnement du match permet aux ligues de
s'entendre sur l'organisation de ces évènements communs. Il y a
un néanmoins un souci de réglementation de la pratique du match
qui est à l'origine de la création de cet organisme.
Jean-Baptiste Chauvin m'a fait part d'une certaine réticence de la part
des ligues professionnelles de transmettre une formation aux amateurs. Il
évoque l'exemple de la Ligue Ouverte et Libre d'Improvisation
Théâtrale Amateure :
Je pense que la LIF a aussi vu d'un mauvais oeil
l'arrivée des ligues amateurs, de peur que ça empiète sur
leur territoire. Typiquement, l'exemple a été la naissance de la
LOLITA : quand ils nous ont contacté, ils avaient contacté avant
la LIF, ou la LIFI - je ne sais plus laquelle des deux à l'époque
- qui leur a répondu " Vous savez, le match d'improvisation, c'est
très compliqué. Il faut s'entraîner très longtemps
avant de faire quelque chose " etc... Nous, avec Papy à Trappes, on
n'était évidemment pas dans cette logique-là
La discussion avec Jean-Baptiste Chauvin a également
révélé des difficultés financières, car
l'Association Française des Ligues d'Improvisation était aussi
chargée de collecter les droits sur le match
d'improvisation81. Les ligues amateurs se sont donc
confrontées à des difficultés économiques.
Du point de vue artistique, il est intéressant de
détailler ce qui fait l'essence d'un match d'improvisation, et
d'étudier son cadre. La dimension théâtrale étant
fortement présente, elle peut
79 Association Française des Ligues d'Improvisation,
Tout ce que vous avez vous avez toujours voulu savoir sur le match
d'improvisation, p.1 .
80 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 février 2019.
81 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06 Mars 2019.
40
rendre en effet complexe la transmission par les artistes
professionnels aux amateurs. Néanmoins, des alternatives ont
étés trouvées par certains amateurs ayant
bénéficié, entre autres, de l'appui de professionnels tel
Jean-Baptiste Chauvin. Elles permettent de contourner les difficultés
artistiques et financières. Le catch d'improvisation
théâtrale, crée par Marko Mayerl qui a été un
des principaux fondateurs de la Ligue Ouverte et Libre d'Improvisation
Théâtrale Amateure, en est un exemple.
I.4 : Enjeux artistiques et financiers.
L'analyse du match d'improvisation théâtrale
faite par Jean-Baptiste Chauvin dévoile le grand nombre de
mécanismes qui se développent pendant ce type de spectacle. C'est
là qu'intervient la problématique qu'il a évoquée
en entretien à propos de l'esprit d'origine ; et donc de faire
comprendre l'importance du fond. Il ne faut donc pas se contenter de respecter
la forme : la simplicité et la rigueur avec laquelle elle est
décrite a pour conséquence, selon moi, de montrer du match une
accessibilité relative, car elle intervient dans un cadre sportif
abritant un cadre théâtral.
Le premier niveau du match d'improvisation en terme de
dramaturgie constitue la pièce-cadre, qui abrite en son sein le cadre
des improvisations. Les comédiens qui sont chargés de poser ce
cadre composent ce que le langage commun appelle désormais le
staff*, en héritage du match de hockey. Voici ce que Jean-Baptiste
Chauvin rapporte à ce sujet :
Il est important de comprendre que le staff est au service du
spectacle, et non l'objet du spectacle. Sa sobriété ne peut que
renforcer son efficacité. Malheureusement, la tentation est souvent trop
forte, souvent chez les amateurs, d'outrepasser les limites des
différents rôles et d'en rajouter, de cabotiner, et donc de
montrer sa frustration de ne pas être à la place des
joueurs.82
La sobriété du staff doit être de rigueur
pendant que les improvisations se jouent. En-dehors des périodes de jeu,
son rôle est de garder le spectateur dans l'esprit d'un spectacle, et
doit donc s'assurer qu'aucun temps mort ne vienne interrompre le temps de la
représentation.
82 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 104.
41
La difficulté pour ces comédiens est de
respecter le fragile équilibre entre l'incarnation de leur personnage et
la fonction qu'ils ont à remplir pour consolider le cadre.
Le premier à intervenir dans ce cadre est, selon
Jean-Baptiste Chauvin, le musicien :
C'est le musicien qui ouvre les festivités et qui les
ferme, car il est le premier à entrer en scène et le dernier
à en sortir [...] L'usage du musicien vient lui aussi du hockey. Dans
les matchs de hockey, un organiste joue dès l'entrée du public et
intervient dès qu'il y a un arrêt du jeu. A la Ligue Nationale
d'improvisation, un organiste accueille également le public avec des
airs connus et des rengaines »83
Il est celui qui va donner le ton de la soirée au public,
et a un rôle similaire à celui d'un chauffeur de salle. Lorsque
j'ai disputé mon premier match contre la LICOEUR de Bordeaux, en Mars
2019, les musiciens était deux, et annonçaient l'arrivée
du maître de cérémonie. Le premier cadre est posé.
Alors que Jean-Baptiste Chauvin insiste sur l'importance que le musicien a par
rapport au rythme, certaines personnes poussent parfois la fonction a un autre
degré de dramaturgie. C'est le cas de Simon Fache : « quand je
travaille avec des comédiens que je ne connais pas, je leur laisse
croire que je les écoute. Et si eux sont à l'écoute, ils
se rendent compte que je suis un joueur de plus »84. Devenir un
joueur de plus, lorsqu'on appartient au premier cadre, demande d'être
attentif aux improvisations qui se déroulent sur la patinoire, et
d'identifier les besoins des improvisateurs, selon la situation :
Après il y a des improvisations où je ne joue
pas, et il y a aussi des improvisations où je suis vraiment
décorateur : par exemple ; si on part sur une catégorie «
heroic fantasy », je vais décorer avec de la musique de violons, et
si je vois un joueur arriver un peu en Gollum, je vais pas jouer Maya l'Abeille
!85
Simon Fache apporte ici une nuance intéressante :
lorsqu'il intervient dans une improvisation pour décorer, le musique
devient un élément dramaturgique, et non uniquement un
élément chargé de rythmer les différentes phases du
spectacle. Il peut également s'impliquer davantage : lorsqu'il
écoute l'improvisation et est capable d'identifier la situation en
cours, il devient ce joueur en plus :
Parfois, je provoque vraiment les changements de temps.
Ça m'arrive, très souvent, quand je vois les joueurs qui
installent : " tu te souviens, à l'époque, quand on avait dit
ça ..." ... vous
83 Ibid, p. 112.
84 Entretien avec Simon Fache, 27 Février 2019.
85 Idem.
42
savez quoi ? Au lieu d'en parler, on va le faire ! Je fais une
espèce de *musique de piano* , et ils se disent " Ok, on va faire un
flash-back !" [...]Quand, dans une impro, tu as des bascules de temps ou de
lieu, ça crée beaucoup de reliefs et c'est assez jouissif
à regarder.86
La musique assure autant le rythme des improvisations que le
rythme du spectacle, les deux devant être efficaces. Les joueurs et
membres du staff doivent garder à l'esprit que l'improvisation
théâtrale est avant tout une affaire d'actions, et donc de
dosages. L'intention des improvisateurs en place dans la patinoire étant
monopolisée par l'action en cours, il se peut qu'ils n'aient plus assez
de recul pour amener autre chose ou ne pas avoir conscience que l'improvisation
est en train de durer trop longtemps, au détriment d'une action
rythmée. Ce qui n`est pas le cas des improvisateurs absents de la
patinoire.
De mon expérience d'improvisateur, il est plus
aisé, lorsqu'on a une vision extérieure de l'improvisation en
cours, d'identifier quand une improvisation nécessite une intervention
supplémentaire pour la faire évoluer. Cela reste dans tous les
cas une prise de risques : un improvisateur-spectateur dans cette situation a
la responsabilité d'amener un élément nouveau pour
désamorcer le blocage de la situation, et n'a que quelques secondes pour
prendre la décision. Á ce stade, l'histoire a commencé,
des éléments sont posés dont il a eu le loisir de prendre
connaissance ; ce qui ne rend pas la tâche plus aisée : la charge
de trouver un élément nouveau, tout en étant
cohérent avec l'action qui se déroule, ferme le champ des
possibles. Ce qui n'est pas le cas au commencement d'une improvisation. Il peut
avoir tendance à prolonger sa période de réflexion pour
trouver l'élément judicieux à apporter, mais prolonge le
temps de latence ; et précipite l'agonie de l'improvisation.
Le musicien, quant à lui, observe une distance avec ce
qui a lieu dans la patinoire, tant géographique que dramaturgique.
Lorsque Simon Fache parle des improvisations donnant à
montrer des bascules de temps et de lieu, il évoque la
possibilité de donner un second souffle à l'improvisation, ou
à offrir une histoire variée. La mise en place d'un
deuxième lieu ou d'une deuxième époque fournit aux joueurs
une occasion supplémentaire de nourrir l'action. En plus d'une
improvisation plus ouverte, elle constitue un élément narratif
nouveau, dans lequel tout est à mettre en place. Cela ouvre donc un
nouveau champ des possibles, comme au commencement d'une improvisation. Il est
ensuite à la liberté des improvisateurs soit de relier les deux
actions, soit de laisser la situation secondaire évoluer sans que
86 Idem.
43
les deux improvisations n'aient de réel lien
identifiable. Dans tous les cas, l'histoire aura été davantage
nourrie, la deuxième improvisation illustrant la première, et
renforçant ainsi ses propos. La distance géographique dans
laquelle l'organisation du match place le musicien a aussi ses avantages.pour
Simon Fache : « Si tu as des comédiens qui sont en train de jouer
en avant-scène, tu vois le joueur sur le banc qui se prépare
à entrer, tu vois le coach qui vient de lui dire un truc, donc tu sais
qu'il va se passer quelque chose. Tu anticipes »87
Elle permet également au musicien d'identifier la
proposition d'un comédien, et de réagir en conséquence. Il
est encore une fois question d'écoute, car chaque individu
interprète potentiellement une proposition d'une façon
différente. La musique jouant un rôle d'illustration et
d'accompagnement, le musicien fait un choix. Il va parfois à l'encontre
de la proposition première du comédien, mais l'acceptation
étant de mise, c'est cette idée qui sera retenue : grâce
à la musique, la proposition devient concrète, et le joueur a de
la matière :
Si on est sur une écoute mutuelle, ça marche.
Par exemple, sur le match anniversaire équipe de France contre Marcq, en
comparée ; Richard88 entre sur scène avec un
personnage que moi je vois comme une espèce de Charlie Chaplin dans sa
démarche. Donc je commence à jouer une musique de cinéma
muet. Mais lui n'avait pas spécialement ça en tête, il
rentrait juste avec une démarche. Mais il entend que je joue le
cinéma muet, donc il ne parle pas. Du coup, il chope le code et installe
un personnage juste dans le visuel, avec des
onomatopées.89
Simon Fache a conçu ce rôle de musicien à
force d'expérience, et a à son tour endossé un rôle
de formation :
C'est pour ça que j'ai aussi formé un pianiste -
parce que je ne suis pas toujours là - parce que, personne ne m'a dit ce
que je devais faire. Je l'ai compris,j'en ai fait ma version avec le temps en
faisant une paire de spectacles, en étant invité ailleurs aussi
pour voir comment ça se joue. Parce que si le match est partout pareil,
le staff bouge. Donc je l'ai formé en lui disant que son boulot, c'est
que les gens tapent dans les mains. Jouer dans les impros, c'est que du bonus.
C'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais ce n'est pas ce qu'on demande
en premier.90
Si le rôle de la musique dans les improvisations
représente une véritable valeur ajoutée,
l'évolution du match d'improvisation a néanmoins donné une
fonction supplémentaire au musicien:les improvisations qui se
déroulement désormais sous une catégorie*
chantée font appel de façon
87 Idem.
88 Richard Perret, joueur de la Ligue Majeure d'improvisation,
créé en 2009. Il est régulièrement
sélectionné dans l'équipe de France.
89 Entretien avec Simon Fache, 27 Février 2019.
90 Idem.
44
directe à ce joueur. Si l'improvisation se joue de
façon comparée - quand les deux équipes improvisent l'une
après l'autre - , l'arbitre laisse le choix entre deux styles de
musique, et c'est l'équipe qui improvise en premier qui a le loisir de
choisir le style. L'équipe suivante se voit octroyer d'office le style
restant.
Une autre catégorie est dénommée la
catégorie musicale : les joueurs n'ont pas droit à la parole et
se font guider uniquement par la musique.
La nature de ces deux catégories, ainsi que le
témoignage de Simon Fache, montrent que le musicien intervient dans les
deux cadres offert par le match d'improvisation. Le choix d'intervenir dans les
improvisations doit néanmoins être judicieux afin de ne pas
détourner le propos.
Se concentrant en premier lieu sur sa mission de poser le
premier cadre, les rengaines enjouées qu'il joue au début du
spectacle mettent le public dans une condition optimale pour accueillir le
maître de cérémonie.
« Au même titre que l'arbitre, il est là au
service du match et n'a pas pour vocation de jouer un personnage. Il est le
maître d'une cérémonie, celle qui se passe devant
nous.Là encore, il ne joue pas à être M.C. »91
La cérémonie qui se passe devant nous dont parle
Jean-Baptiste Chauvin représente le premier cadre, celui de la rencontre
sportive. N'ayant pas à intervenir dans le second cadre - celui des
improvisations - il a une fonction comparable à celui d'un metteur en
scène. Bénéficiant du même point de vue
extérieur que celui du musicien, il est en charge de présenter
les joueurs au public, et il l'encourage à les applaudir.
La fonction qu'il assume a pour objectif d'établir une
passerelle entre les deux cadres pour éviter de perdre le public : il a
la charge d'expliquer au public ce que signifie telle ou telle
catégorie, et d'expliquer pourquoi l'arbitre a sifflé une faute
si besoin est.
La dimension théâtrale de ce rôle peut se
retrouver dans deux points ; tout d'abord, la fonction du metteur en
scène, car il intervient dans les deux cadres de la
représentation. Et, bien que ce ne soit pas un personnage à part
entière - par rapport aux improvisateurs - cette fonction implique
naturellement un rôle : en étant habillé de manière
élégante - ce qui va de soi pour une cérémonie - et
en s'adressant au public avec un micro, il est en représentation.
Lorsque Jean-Baptiste Chauvin, dans la dernière
citation, englobe les fonctions de maître de cérémonie et
d'arbitre dans des rôles comparables, celui de l'arbitre demande un
travail plus dosé par rapport à la notion même d'acteur.
91 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 111.
45
Il est responsable de la qualité des improvisations,
son travail est donc également analogue à celui d'un metteur en
scène. Cela implique par définition une austérité
par rapport à ce qu'il va se passer dans le premier cadre. En
préparation d'un match, il est chargé de doser avec justesse le
temps de chaque improvisation, et être judicieux dans le choix des
thèmes et des catégories. Il est de coutume que deux tiers des
improvisations soient soumis à une catégorie, le dernier tiers
étant consacré aux catégories libres. Ce dosage a pour but
de trouver un équilibre idéal entre le fait de laisser une
liberté à l'improvisateur par rapport à son imagination
grâce aux catégories libres, tout en les entrecoupant de
catégories imposées pour lui offrir une orientation.
L'évolution du match d'improvisation a , au fur et
à mesure, fait évoluer son comportement sur la patinoire, en
conséquence du service qu'il rend aux joueurs pour leur offrir un cadre
confortable :
Le fait d'improviser étant spectaculaire dans le sens
où il implique de prendre des risques sans filet, il faut un
élément pour apporter un contre-poids qui provoquera la
bienveillance chez le spectateur : c'est pourquoi la plupart des arbitres
feignent un excès d'autorité lorsqu'ils sont dans l'espace de la
représentation. Ce jeu doit cependant conserver une grande
sobriété pour garder l'intention sur les improvisations, et
l'arbitre ne doit pas se donner en spectacle. Par ailleurs, être arbitre
demande une grande connaissance du règlement et une capacité
d'analyser un jeu. J'ajouterais une autre dimension par rapport à sa
fonction de metteur en scène : avant un match, tout le staff assiste au
briefing, orchestré par l'arbitre. C'est à ce moment qu'il
informe les joueurs des catégories qui seront énoncées. Si
certains joueurs ne sont pas à l'aise avec une catégorie, il leur
est possible de demander de ne pas la jouer. Cela garantit non seulement que
les joueurs évolueront dans une atmosphère
sécurisée, mais également pour obtenir une qualité
optimale dans les improvisations. Une catégorie avec laquelle personne
n'est familier mène à une faute de non-respect de la
catégorie. Et plus un joueur connaît le cadre de l'improvisation,
plus il sera enclin à fournir des éléments pertinents.
Conforté par rapport à ses connaissances, il est bien plus
aisé d'oser prendre des risques pour mieux s'emparer du cadre et
proposer une histoire de qualité.
Les assistants-arbitres incarnent des figures conformes
à l'image d'autorité que renvoie l'arbitre. Durant les
improvisations, ils sont assis de part et d'autre du maître de
cérémonie, sur une table en face de la patinoire. A l'instar de
la situation géographique du musicien, cette position
légèrement en retrait permet d'avoir une vue extérieure -
et donc objective - non seulement sur les improvisations, mais sur le
déroulé du match dans son ensemble. Leur travail est
complémentaire de celui de l'arbitre : ce dernier est constamment sur la
patinoire, y compris pendant les
46
improvisations. Il prend soin, durant une action, de se
dissimuler aux yeux du public pour ne pas détourner leur attention.
La fonction de ces deux personnages se retrouve
également dans le travail d'incarnation d'un comédien et dans
celui d'une mise en scène par rapport au rythme du spectacle.
L'arbitre et ses deux assistants font leur entrée une
fois que les joueurs sont en place, à l'appel du maître du
cérémonie. Leurs faciès, pour des raisons
expliquées par rapport au personnage incarné par l'arbitre,
feignent à leur tour l'autorité. Une fois appelés, ils
entrent à trois sur la patinoire et feignent un conciliabule . Ils
vérifient ensuite le bon état de la patinoire, et regagnent leur
place. Pour le déroulé du spectacle, ces interventions ne sont
pas nécessaires : il va de soi que, durant la préparation du
spectacle, le bon état de la patinoire a déjà
été vérifié. Elles renforcent néanmoins le
caractère de ces personnages : le fait qu'ils entrent sur la patinoire
leur donnent l'occasion d'être présentés au public comme
des protagonistes à part entière du spectacle ; ils sont par
conséquent en état de représentation. Ce rituel renforce
également le premier cadre du spectacle : celui du terrain d'une
rencontre sportive où on vérifie le matériel pour le bon
déroulé de la rencontre.
Une fois le spectacle d'improvisation proprement
démarré, leur travail de mise en scène commence.
Analogiquement, ils peuvent même être comparés à des
assistants à la mise en scène : en soutien du maître de
cérémonie qui est en charge de gérer le temps des
improvisations et signaler à l'arbitre le délai restant, ils
peuvent observer le comportement des joueurs dans la patinoire et sur le banc
avec une plus grande distance.
Les fautes qui régissent le match d'improvisation se
divisent en trois catégories : les fautes de procédure, les
fautes de jeu, et les fautes de comportement.
Les fautes de procédures condamnent un non-respect du
rituel du match, qui déstabilise le premier cadre de
représentation. Les fautes de jeu condamnent les raccourcis que seraient
tentés de prendre les joueurs pendant les improvisations, et soulignent
de manière générale un jeu trop personnel au
détriment de la construction collective d'une improvisation. La
troisième catégorie condamne une mauvaise conduite de la part
d'un joueur, qui enfreint la première règle de bienveillance et
de bonne conduite en improvisation théâtrale.
L'arbitre ayant son attention orientée sur les
improvisations en cours, il revient donc à la charge du maître de
cérémonie et des assistants-arbitres d'exercer leur oeil
extérieur pour veiller au respect des différents cadre
s'imbriquant durant le match.
Par ailleurs, ces trois protagonistes font le relais avec le
public, notant le thème de la prochaine improvisation et sur la
catégorie sur le tableau des scores. Ils sont également
chargés de rappeler à
47
l'arbitre quelles sont les fautes qu'il a signalées, et
d'observer le comportement des joueurs qui n'interviennent pas pendant
l'improvisation.
Les assistants-arbitres sont donc, en tant que personnages,
très peu visibles aux yeux du public. Leur intervention orale servant
à désigner l'équipe qui remporte le point : soit en criant
« majorité ! » pour la couleur dominante du carton de
vote*, soit en comptant le nombre de cartons majoritaires en cas
d'incertitude.
Je soulignerai à nouveau la sobriété que
Jean-Baptiste Chauvin conseille pour incarner ces différentes fonctions
: étant responsables de la stabilité du cadre, il leur reste peu
de temps et de loisir pour pouvoir « jouer à être » :
ils sont.
La dimension théâtrale qui occupe en
majorité le match d'improvisation demande donc des connaissances
dramaturgiques, que ce soit en terme de mise en scène, d'interventions,
de placement de la voix ou de placement dans l'espace. C'est pourquoi, en terme
d'espace, la patinoire est un instrument théâtral de grande
utilité : Au début du match, le rituel exige que tous les joueurs
- y compris ceux du staff - soient présentés au public. À
l'exception du musicien de manière générale, toutes ces
présentations ont lieu à l'intérieur de la patinoire, qui
représente l'espace de jeu. Lors de leur passage dans ce lieu, tous les
comédiens sont donc dans un état d'incarnation d'un personnage.
La patinoire est également le seul endroit dans lequel les joueurs ont
le droit d'improviser. De base utilisée en référence du
match de hockey, elle sert désormais à délimiter et
définir les différents cadres de représentation du
match.
Les joueurs ont également deux niveaux d'incarnation
différents : le rôle du joueur dans le sens de la
compétition représente le premier degré, et les
personnages qu'ils vont jouer dans les improvisations le deuxième. Ils
sont donc constamment en représentation, même lorsqu'ils sont sur
le banc. Ils sont attentifs à l'improvisation en cours en tant que
comédiens, et dès que l'improvisation est terminée,
reprennent leur rôle de joueur sportif. C'est pourquoi l'usage a au fur
et à mesure instauré, par exemple, la pratique du «
tapé de patinoire » : lors des votes et de l'annonce du score, les
joueurs se font tous face et tapent en rythme sur la patinoire, pour contribuer
à l'esprit de dynamique et garder un rythme soutenu en-dehors des
improvisations. Le cadre sportif implique en effet qu'une certaine
frénésie soit toujours présente.
Le rituel du début du match présente tout
d'abord les joueurs en tant que « héros » dont parle
Jean-Baptiste Chauvin. Il s'agit de rendre le cadre clair pour le public et
d'aider les joueurs à
48
appréhender le cadre de la représentation. Ce
rituel a lieu dans un premier temps,avant que les improvisations ne commencent.
Il s'agit de l'échauffement public. C'est durant cet échauffement
que les joueurs entrent pour la première fois dans la patinoire.
Le terme d'échauffement en lui-même
sous-entendant une préparation, il pose une problématique par
rapport au rythme du spectacle. Dans sa carrière d'improvisateur,
Jean-Baptiste Chauvin a tenté d'ajuster ce rituel afin qu'il n'ai pas de
conséquence néfaste sur ce rythme :
On fait l'échauffement à l'entrée des
spectateurs. Ou à la Ligue Majeure, on fait juste un échauffement
de même pas 3 minutes, mais c'est carrément une ouverture de
scène : la scène s'allume et et on est en train de
s'échauffer. La première image c'est nous, puis on ressort. C'est
carrément une mise en scène. La Ligue Paris Impro ne fait
même plus d'échauffement : directement, on annonce les joueurs.
Après, on bénéficie ou on pâtit d'une culture du
zapping, donc il faut que ce soit rapide. J'ai déjà vu des matchs
ou c'était d'une lenteur absolue.92
La préparation et l'échauffement des
improvisateurs se font en amont, mais l'échauffement public renforce le
cadre de la rencontre sportive, et est d'une grande aide pour les joueurs :
comme le souligne Jean-Baptiste Chauvin, il est avant tout question de
présenter les joueurs aux spectateurs. Ce rituel les aide à se
faire identifier comme tels, et consolident donc le premier cadre. C'est
également un rite de passage que Robert Gravel a relevé :
Symboliquement, il est très intéressant de
devoir enjamber la bande pour arriver sur l'aire de jeu, il y a un net passage
psychologique qui s'effectue entre l'état d'être dehors (en
sécurité) et d'être dedans (en danger). Si, à mon
avis, la patinoire n'est pas vraiment une fosse aux lions, elle demeure
néanmoins une arène.93
Robert Gravel évoque ici le moment où le joueur
va se lancer dans une improvisation, et donc quitter le banc qui est sa zone de
confort. Le rituel de l'échauffement public a cette particularité
de placer le joueur dans l'espace du danger tout en le conservant dans une zone
de sécurité, puisqu'il n'est pas encore en jeu. C'est un rituel
qui leur permet d'appréhender l'aire de jeux dans laquelle ils vont
bientôt se lancer sans filet, tout en bénéficiant de
l'atmosphère sécurisante du premier cadre. Ils sont
montrés à ce moment en tant que joueurs au public, mais
Jean-Baptiste Chauvin insiste sur le fait que ce rituel n'est pas un spectacle
:
Il s'agit bien d'un moment d'échauffement, et non d'un
spectacle dans le spectacle. C'est le moment où les joueurs vont se
retrouver sur la patinoire, face au public. Ils vont pouvoir
92 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06 Mars 2019.
93 Robert Gravel, Jan-Marc Lavergne, op. cit., p. 41.
49
s'imprégner de l'ambiance de la salle et se mettre en
condition au travers d'exercices que leur propose leur coach 94.
Le fait que ce ne soit pas un spectacle signifie que les
comédiens, à ce stade, n'ont pas comme devoir d'incarner des
personnages ou de produire quelconque action, mais bel et bien de se
familiariser avec l'aire de jeu. C'est le moment qui leur permet
d'appréhender l'entièreté du spectacle, de faire
connaissance pour la première fois avec le décorum, et
également de se mettre en situation de jeu par rapport à l'autre
équipe. C'est pourquoi, en quelques minutes, les exercices
d'échauffement alternent entre les échauffements par
équipe et les échauffement de groupe : ils se préparent
à mettre en place un esprit d'équipe tout en se préparant
à construire des improvisations avec l'équipe adverse.
Le déroulement du match sépare également
ce rituel du reste du spectacle de façon nette:les équipes sont
appelées à tour de rôle par le maître de
cérémonie, et entrent directement dans la patinoire pour
s'échauffer en musique. Une fois l'échauffement terminé,
les joueurs quittent la patinoire. Lorsqu'ils sont rappelés pour
commencer le match, ils sont appelés une équipe après
l'autre, un joueur après l'autre.
Cette séparation a pou but de distinguer les deux
cadres de représentation. Comme ces deux cadres diffèrent, la
tenue diffère également : l'usage veut que, durant
l'échauffement, les joueurs soient habillés en noir, la plupart
du temps avec un t-shirt qui arbore le logo de la ligue à laquelle ils
appartiennent, leur prénom imprimé au dos. Ils existent à
ce moment en tant qu'individus, anonymes en tant que comédiens aux yeux
du public. Une fois qu'ils sont appelés à leur tour, ils ont
revêtu une tenue supplémentaire par dessus le t-shirt ; comme si
ils allaient atteindre un second degré de représentation. C'est
là que peut commencer le vertige pour l'improvisateur : son maillot lui
désigne un numéro, ainsi que son nom de famille. Le maillot
pouvant s'apparenter au costume d'un comédien, il l'aide à se
mettre « dans la situation de ». Le numéro est là pour
rappeler qu'il a une présence significative au sein de l'équipe.
Chaque improvisateur est annoncé individuellement par les soins du
maître de cérémonie, qui annonce au micro son nom et son
numéro. Il est à ce moment prêt à entrer dans le
deuxième cadre de la représentation pour improviser.
Le cadre sportif incluant donc une forte dimension
théâtrale, il est logique que les premiers français
à s'y être intéressés soient des comédiens,
soit amateurs soit professionnels. En tant que comédiens avec une
responsabilité supplémentaire, ceux qui composent le staff ont
également une responsabilité en terme de dramaturgie. Lorsque
Jean-Baptiste Chauvin évoque la tendance qu'ont
94 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit, p. 92.
50
les amateurs à cabotiner est évocatrice de leur
rôle : plusieurs fois j'ai mentionné leur responsabilité
comparable à celle d'un metteur en scène, ce qui sous-entend
qu'ils opèrent en majorité dans l'ombre du public. Ce qui peut en
effet refléter des fonctions ingrates, surtout lorsqu'ils sont sans
arrêt à vue du public. C'est pourquoi la mise en place du cadre
requiert des connaissances en terme de dramaturgie.
Bien que cette mise en place inspirée du match de
hockey permette d'établir le cadre nécessaire à la
sécurité de l'improvisateur, Robert Gravel annonce ceci, en 1988
: « D'abord, disons tout de suite que le match de hockey n'est qu'un
prétexte. Il n'est que l'emballage du spectacle ».95
Cette phrase sous-entend qu'un spectacle d'improvisation est possible en dehors
du cadre du match.
Il résulte néanmoins la mise en place d'un
rituel nécessaire au bon fonctionnement d'un spectacle d'improvisation.
Les nouveaux formats doivent donc présenter des spectacles avec un
cérémonial et un rituel semblables. Je me pencherai à
titre d'exemple sur l'invention du catch d'improvisation
théâtrale, qui a ouvert la voie à la création de
formats multiples.
Le catch fait de nos jours partie intégrante de la
pratique de l'improvisation théâtrale, répertorié
par Christophe Tournier :« Il existe naturellement beaucoup d'analogie
entre le match d'improvisation et le catch [...]deux équipes de deux
joueurs s'affrontent sur un ring en plusieurs reprises improvisées.
D'ores et déjà, le format obtient, malgré sa jeunesse, un
joli succès en France. »96
Le succès de ce format témoigne de la
montée en puissance des ligues amateurs : l'analogie dont parle
Christophe Tournier traduit chez les amateurs une volonté de ne pas
trahir le match en tant que matériel d'origine tout en concevant un
format accessible aux ligues plus modestes, tant sur le plan dramaturgique que
pratique et financier : la réglementation en catch est moins stricte
qu'en match, et la qualité des improvisations est laissée
à l'interprétation de l'arbitre. Deux joueurs suffisent pour
constituer une équipe, ce qui représente un engagement moins
conséquent pour les joueurs que pour le nombre requis pour un match : il
requiert au total la présence de deux coachs, douze joueurs - selon le
règlement - un arbitre et ses deux assistants, ainsi que d'un
maître de cérémonie.
Le succès de ce format est tel qu'il a
été depuis repris par la plupart des ligues
professionnelles. il y a une
notion de transition qui s'installe : le catch essayant d'être le plus
conforme possible au format d'origine, il a ouvert la voie à de nombreux
autres formats d'improvisation théâtrale. La plus visible est la
« performance », appelée également « cabaret
». Cette forme se rapproche de la
95 Robert Gravel, Jan-Marc Lavergne, op. cit, p.38.
96 Christophe Tournier, op. cit., p. 98.
51
définition que Christophe Tournier nomme « impro
sur le vif : « Cette formule est la plus usitée et la plus directe.
Les acteurs demandent au public un lieu, un mot ou thème d'improvisation
»97
Le point commun de tous ces formats d'improvisation est le
cadre dans lequel évoluent les improvisateurs. Et, dans chaque format,
un staff est là pour les accompagner « Le staff doit être
très solide, parce qu'on est vraiment là pour mettre un plateau
d'argent sous les improvisateurs »98. Simon fache résume
ainsi la fonction du cadre, qui doit également être parfaitement
clair pour que le public puisse identifier la nature du spectacle.
Le cadre du format cabaret diffère bien entendu du
format du match - et même du format du catch - mais se doit de garder une
forme solide pour respecter un cadre bien établi. Les
éléments indispensables de ce cadre sont le maître de
cérémonie pour faire relai entre public et improvisateur ainsi
qu'une source sonore pour garantir le rythme du spectacle. Pour des raisons
économiques, on voit la plupart du temps une chaîne
stéréo pour économiser l'intervention d'un comédien
supplémentaire, avec des musiques joyeuses et connues par le plus grand
nombre pour garantir une ambiance festive. Étant donné que c'est
un spectateur qui est à l'origine du thème, il y a
également participation du public.
La dimension de compétition étant absente, le
personnage de l'arbitre n'est plus nécessaire. Il faut néanmoins
un membre du staff pour assurer le bon rythme du spectacle et la qualité
des improvisations. Cette fonction est assumée cette fois-ci par le
maître de cérémonie : c'est lui
qui déambule dans le public pour le choix des
thèmes ou des indications qui vont donner un thème par la suite.
Il doit s'assurer de la qualité de ce thème. La forme plus libre
implique également que les improvisations n'ont aucune limite du temps.
Le maître de cérémonie est donc chargé de varier les
durées des improvisations pour garder un rythme dynamique. Il lui faut
également être capable de juger quand une improvisation doit ou
peut prendre fin.
Pour assurer un cadre minimum, la plupart des spectacles au
format cabaret ont un thème annoncé pour la soirée. Il
peut s'agir d'un genre de cinématographique, de cinéma tout
court, voire de littérature. C'est à l'ensemble de la troupe de
définir la thématique du spectacle, au regard de l'absence de
l'arbitre. Le terme « performance » se justifie dans ce format dans
le sens où les catégories propres à ce style vont apporter
par leur nature un cadre au comédien. Il y a également un aspect
de l'arène que l'on peut retrouver, ces catégories apportant la
plupart du temps une contrainte formelle dont les improvisateurs doivent tenir
compte.
Elles permettent malgré tout aux improvisateurs de
montrer leur virtuosité au public sans avoir à se soucier de
construire l'improvisation. Le maître de cérémonie est
quant à lui plus indulgent par
97 Ibid., p. 97.
98 Entretien avec Simon Fache, 27 Février 2019.
52
rapport à sa fonction d'arbitre, et laissera finir une
improvisation s'il sent que la conclusion n'est pas encore amorcée, ou
peut siffler précipitamment la fin d'une improvisation si celle-ci
n'arrive pas à se développer. Les catégories
d'échauffement que j'évoquerais dans le lexique permettent de
redynamiser l'entièreté du spectacle. Le maître de
cérémonie peut également infliger une punition à un
comédien qui aurait de façon clairement identifiable fait une
improvisation de mauvaise qualité, pour différentes raisons.
Il m'est arrivé de vivre ce genre de situations
plusieurs fois, lorsque j'ai débuté l'improvisation avec le
Collectif Lyonnais d'Artistes Polyvalents, à Lyon : la punition est
généralement une improvisation très courte, avec une
contrainte formelle simple. La punition la plus usuelle que j'ai vue consistait
à raconter la vie d'un objet en trente secondes. La nature de
l'improvisation sort suffisamment d'un cadre usuel pour provoquer
l'intérêt du public et est suffisamment courte pour permettre
à l'improvisateur de produire une histoire seul. L'effort de ce
comédien est néanmoins toujours salué, car se lancer dans
une improvisation seul est moins aisé dès lors que les camarades
n'interviennent pas pour l'aider. Le public a conscience de ça, et c'est
pourquoi cet exercice provoquera immédiatement son indulgence pour le
comédien puni. C'est aussi une bonne façon d'appréhender
la peur de l'échec, qui est une valeur fondamentale dans l'improvisation
théâtrale.
Ces nouveaux formats facilitent l'accès à
l'improvisation en contournant le format du match d'improvisation, ce qui
engendre l'apparition de nouvelles ligues sur le territoire français.
Les formats exercés n'étant plus exclusivement des matchs, les
professionnels n'ont plus à exercer un contrôle financier sur
l'utilisation de ce format. Et ces ligues se multipliant, le projet de
créer des ponts de communication entre elles devient de plus en plus
difficile. Les nouveaux formats devenant de plus en plus des spectacles
à part entière avec leurs propres codes, il y a un fossé
qui commence à se créer entre les ligues professionnelles de
match et les ligues amateurs.L'Association Française des Ligues
d'Improvisation finit par se dissoudre. Emmanuel Leroy m'en a expliqué
les raisons :
Au niveau de l'AFLI, ça s'est arrêté parce
qu'il y a eu de plus en plus de ligues amateurs, et en terme de ligues
professionnelles on était en nombre réduit[...] Et on s'est
rendus compte qu'on avait pas les mêmes préoccupations. Donc les
ligues professionnelles se sont retirées de l'AFLI et les ligues
amateurs n'ont pas réussi à se structurer99
La démocratisation de l'improvisation
théâtrale, en plus de sa réinvention par différents
formats, tient dans la nature-même du concept. Robert Gravel
déclarait, en 1988 : « En fait le spectateur se
99 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
53
dit qu'il pourrait à la limite jouer lui aussi ...
sinon avec les " pros" , du moins chez lui ou des amis. Le jeu de la LNI est
limpide, et le public comprend parfaitement quel en est l'enjeu et la
convention » .100
De simple spectateur peut alors naître rapidement
l'envie de devenir improvisateur. Et les ligues amateurs répondent
à cette envie, dans les années 90. La formation, depuis la
séparation entre les amateurs et les professionnels, a néanmoins
évolué : C'est désormais aux premières ligues
amateurs - avec l'héritage professionnel - de former les improvisateurs
en herbe. C'est ce que me confie Emmanuel Leroy : « On a aussi
laissé aux ligues amateurs le soin de donner des formations de
manière régulière aux amateurs ».101
Les professionnels se concentrant davantage sur le match
d'improvisation, ils comptent désormais avec la présence de ces
amateurs pour continuer à enrichir le paysage de l'improvisation
théâtrale et les offres qu'il propose. La problématique que
doivent maintenant respecter ces improvisateurs de la deuxième
génération est de transmettre à nouveau le cadre d'origine
dans les nouveaux formats. Il faut donc comprendre l'enjeu d'un cadre solide
posé pour un spectacle d'improvisation. Je reviens sur les paroles de
Robert Gravel : elles impliquent que les curieux qui ont eu envie de se
prêter à ce jeu après une expérience de spectateur
n'ont pas pour ambition de s'adonner à cette pratique de façon
professionnelle, mais souhaitent pratiquer un loisirs. C'est ce qui
définit également l'universalité et l'accessibilité
de l'improvisation théâtrale. Cette même
accessibilité justifie également, à mon sens, la scission
entre les amateurs et les professionnels. Les préoccupations
n'étant plus communes, il devient difficile d'évoluer ensemble
sur le terrain de la pratique artistique.
A force d'expérimentations, les amateurs
légitiment et revendiquent leur droit à la pratique
théâtrale. Certains professionnels ont bien compris le
double-terrain qu'occupe désormais la pratique, et répondent aux
demandes de formations diverses pour ensuite laisser ces jeunes ligues
évoluer : « A un moment donné, on s'est posés la
question : "Comment se situer T". On s'est dit qu'on avait formé ces
ligues. Si elles souhaitent qu'on vienne faire des formations, elles nous le
demandent, mais on va les laisser vivre »102.
Évoluant en-dehors du paysage artistique, les
spectacles que donnent ces ligues amateurs offrent en effet une vision
accessible de l'improvisation, et crée rapidement un autre engouement :
lors d'un spectacle d'improvisation - même le plus simple qui soit - les
spectateurs vont être impressionnés
100 Robert Gravel, Jan-Marc Lavergne, op. cit., p.
46.
101 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
102 Idem.
54
par la capacité de comédiens à
créer des improvisations à partir d'un matériel invisible
du point de vue des spectateurs. Le décorum est simple, les histoires
naissent à partir d'un matériel visiblement inexistant, et c'est
cette simplicité et cette accessibilité qui provoque un
deuxième engouement. Philippe Despature, directeur de la
Scénosphère dans les Hauts-de-France, m'a explique ce
phénomène :
Ce qui se passe, c'est que l'improvisation n'est finalement
pas encore très répandue, encore plein de spectateurs la
découvrent, et ils trouvent ça marrant. Donc les spectateurs ne
sont pas encore très exigeants. Très vite, tu as fait une
année d'impro, tu invites ta tante, elle vient te voir. Ce que tu fais
au niveau de la construction n'est pas terrible, mais ta tante va dire que
c'est génial, que t'as du talent... « mais non, arrêtez, vous
n'improvisez pas, c'est écrit... »... les gens ont du mal à
croire qu'il y a vraiment de l'impro. Du coup, le seuil d'exigence du public
n'est pas très élevé.103
Philippe Despature insiste sur l'aspect
récréatif des spectacles d'improvisation et de la pratique en
elle-même. C'est également en cela qu'elle séduit ; un
comédien qui se lance sans filet apparent dans une histoire où
tout reste à construire va automatiquement gagner l'admiration et la
faveur du public. Il y a cependant une contradiction entre l'engouement rapide
que la discipline a connu dans les années 90 et ce que Philippe
Despature me rapporte quant au fait qu'elle ne soit pas encore répandue.
Très peu de villes en France, de nos jours, ne possèdent pas de
ligue d'improvisation. Je suis tenté d'expliquer ces paroles par la
différence entre le nombre de ligues amateurs et le nombre de ligues
professionnelles présentes de nos jours sur le territoire : les ligues
professionnelles étant désormais minoritaires, et ne couvrant pas
tous les départements du pays, le nombre de spectateurs pouvant
accéder à des spectacles professionnels est réduit. Ils
sont, en revanche, abreuvés de spectacles d'improvisations amateurs, qui
ne bénéficient pas d'une aura similaire à celle d'une
ligue professionnelle. L'activité est donc encore sous-terraine, et les
spectacles amateurs bénéficient rarement de la promotion et de la
communication nécessaire à son véritable
éclatement.
L'aspect récréatif de l'improvisation
théâtrale ayant été approprié par la
majorité des ligues amateurs, les ligues professionnelles continuent
à officier sur un terrain similaire, et moins varié que celui du
divertissement. A la fin des années 90, et suite à la dissolution
de l'Association Française des Ligues d'Improvisation, elles se
regroupent sous le label « LIFPRO » , au nombre de huit : La Ligue du
Théâtre de l'Antre, crée en 1980, la Ligue
d'Île-de-France d'Improvisation, crée en 1987, la LISA21,
crée à Dijon en 1988, La Ligue d'Improvisation Lyonnaise
crée en 1991, la Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul, crée
en 1992, La Ligue d'Improvisation Théâtrale de l'Isère,
103 Entretien avec Philippe Despature, 25 Mars 2019.
55
crée en 1992, puis professionnalisée en 2005, la
Ligue d'Improvisation Nantes-Atlantique, crée en 1998,et la Ligue de
Niort, crée en 1998 avec la compagnie « Aline et Cie ».
Il apparaît nécessaire de fédérer
les ligues professionnelles, car leurs actions sont communes, contrairement aux
ligues amateurs. Le but de la LIFPRO, d'après Emmanuel Leroy qui en a
été le créateur, était de créer une entente
pour que ces ligues se partagent un terrain équitable sans que les
activités de l'une viennent interférer dans celle d'une autre.
Ces activités vont également au-delà du
domaine purement artistique, et la LIFPRO joue très vite un rôle
d'arbitrage pour régler les questions de territoire et de finance :
« contrairement aux ligues amateurs, il y a un enjeu financier, et il
fallait déterminer les territoires des uns et des autres
»104.
Les ligues professionnelles trouvent en effet une source de
revenus grâce aux formations, dont l'apport est souligné par
Valentine Nogalo dans son mémoire universitaire traitant de
l'enseignement de l'improvisation théâtrale en milieu scolaire
:
Depuis une quinzaine d'années, on observe le
développement de l'enseignement de l'improvisation
théâtrale et de manière particulièrement
prononcée dans le milieu de l'entreprise. Petites comme grandes
entreprises prennent conscience de l'apport de la discipline spontanée
et font appel à des comédiens improvisateurs et formateurs :
prise de parole en public, gestion des imprévus et des
conflits, teambuilding, mises en situation professionnelle... les vertus de la
pratique de l'improvisation théâtrale sont
nombreuses.105
Il est nécessaire de réglementer ces
activités afin que les lois de l'entreprise ne court-circuitent pas les
activités de ces ligues : une logique économique imposerait que
ce soit la meilleure entreprise qui emporte le contrat, la LIFPRO décide
d'associer un territoire à chaque ligue afin que celles-ci puissent
toutes faire valoir leurs contributions dans le domaine des formations :
On ne s'empiétait pas trop dessus pour l'organisation
des matchs d'improvisation, mais chacun de ces ligues avait des
opportunités de travail avec des entreprises. On s'était mis
comme code de bonne conduite que si la ligue de Paris recevait un appel d'une
entreprise de Lille par exemple, elle faisait travailler principalement des
acteurs de Lille. 106
104 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
105 Valentine Nogalo, L'improvisation théâtrale
et son enseignement dans le milieu scolaire:De la France au
Québec, les enjeux d'une pratique artistique à
part entière, sous la direction de Yves Morvan, UFR Arts et
médias, Département de médiation culturelle,
Université Paris 3 Sorbonne nouvelle, 2017, p. 93.
106 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 6 Mars 2019.
56
De nos jours, il est effectivement observable sur chacune des
plaquettes de présentations des ligues professionnelles quel que soit le
support, un service de formations aux entreprises. Emmanuel Leroy me rappelle
qu'une ligue professionnelle coûte cher : dans un cadre professionnel, le
match d'improvisation inclut en effet le transport de l'équipe
invitée - qui vient parfois vient de loin : en Janvier 2019,
l'équipe de Marcq-en-Baroeul avait invité les légendes du
Québec - et également la rémunération des
comédiens : l'ensemble des comédiens participants à un
spectacle d`improvisation, avec le staff et les joueurs confondus,
s'élève au nombre de dix-sept : douze joueurs, deux coach, un
maître de cérémonie, un arbitre, ses deux assistants et le
musicien. Il faut également rémunérer les techniciens. Il
est très difficile pour une ligue professionnelle de se rentabiliser
uniquement sur les spectacles qu'elle propose. En tant que membre d'une ligue
professionnelle, Simon Fache a pu m'expliquer ce phénomène :
C'est aussi ce qui a entretenu le problème à
l'époque : la ligue d'impro, c'est des matchs, des spectacles tout
public, mais ce n'est pas ce qui nourrit les comédiens : derrière
il y a des spectacles en entreprises, interventions, formations à la
prise de parole. Tout ce qui apporte de l'argent aux ligues professionnelles,
c'est ce que le public ne voit pas.107
La LIFPRO opère dans ce sens durant une décennie
approximative, de la fin des années 90 jusqu'à la fin des
années 2010. Durant cette période, les ligues professionnelles se
sont forgées des identités et se sont vues attribuées un
territoire à l'échelle régionale, mais l'ambition de la
LIFPRO reste, à l'image de l'AFLI, d'organiser des projets communs et de
structurer la pratique sur le plan national : depuis la première coupe
du monde 1985, ainsi que la création d'autres ligues en Europe,
l'engouement pour le match d'improvisation théâtrale devient
international. A plusieurs reprises, un championnat du monde est
réorganisé, il faut donc une équipe pour
représenter la France : « [La LIFPRO] a aussi deux grands projets :
d'abord de créer une équipe de France professionnelle, ce qui a
donné lieu après à un mondial. Et aussi de créer un
championnat de France ».108
Le point que soulève Jean-Baptiste Chauvin pose une
nouvelle problématique par rapport à la logique du partage
territorial : les ligues, avant d'être des compagnies, sont des
rassemblements d'individualités, ce qui peut par nature créer des
mésententes au sein même de ces structures. Les divergences au
sein de ces professionnels posent la question d'une légitimité
qui est plus complexe que celle des amateurs à pratiquer l'improvisation
théâtrale lorsque ce n'est pas dans un but récréatif
: au terme de certains conflits internes, des professionnels s'éloignent
de l'identité d'une troupe pour créer à leur tour d'autres
ligues, avec la même problématique de sources de
107 Entretien avec Simon Fache, 27 Février 2019.
108 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06 Mars 2019.
57
financements et de territoires : « Mais ça a
été un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a eu
des scissions dans différentes villes, et on a retrouvé deux
ligues dites professionnelles qui se sont retrouvées sur le même
territoire ; donc c'est devenu un moment donné ingérable
».109
La région parisienne est aujourd'hui jonchée de
plusieurs ligues professionnelles qui résultent de cet éclatement
: en 1996, à la suite d'un pari économique ayant
échoué, la Ligue d'Improvisation Française est dissoute,
et la Ligue d'Île-de-France d'improvisation récupère le
territoire Parisien. En 2009, une crise au sein de cette ligue provoque un
éclatement du territoire : Laurent Dubois, son ancien directeur
artistique - qui joue régulièrement avec la ligue d'Improvisation
de Marcq-en-Baroeul - est exclu de cette ligue. L'exclusion entraîne une
scission, et la Ligue d'Île-de-France d'Improvisation perd plusieurs de
ses membres, dont Jean-Baptiste Chauvin :
En 2009, la LIFI s'est scindée en deux : il y a eu pas
mal de conflits, ce qui fait qu'on est six à en être partis pour
créer la Ligue Majeure. La majorité de ceux qui sont partis - il
y avait Laurent Dubois, Richard Perret, Olivier Descargues - qui étaient
actifs sur le réseau national. Du coup, ça a créé
une espèce d'onde de choc dans les ligues professionnelles, entre ceux
qui nous ont suivis ou pas. La LIFPRO n'a plus vraiment existé
après ça. Maintenant, chaque ligue refait un peu ses trucs dans
son coin.110
La Ligue Majeure d'Improvisation rompt avec cette tradition de
partage du territoire : elle compte parmi ses rangs des improvisateurs venant
de différentes ligues. Je citerai comme exemple Emmanuel Leroy,
directeur artistique de la Ligue de Marcq-en-Baroeul, Richard Perret et
Cécile Giroud, qui viennent de la Ligue d'Improvisation Lyonnaise, ou
encore Jean-Baptiste Chauvin, qui vient des Yvelines. Il me dit, à
propos de certains de ces comédiens, qu'ils étaient «
très actifs sur le plan national »111. Il y a donc un
refus de partage des régions. Le nombre de ligues augmentant, la
solution la plus fiable pour continuer à traverser les conflits et
garder une visibilité reste la mobilité. Le projet par la LIFPRO
de créer une équipe de France reste aujourd'hui
d'actualité, mais cette équipe se forme ponctuellement en
choisissant des comédiens qui ne viennent pas de le même ligue,
mais qui officient au sein de différentes ligues du pays. Il s'agit
d'une ligue éphémère, bien que le terme en lui-même
pourrait aujourd'hui être questionné : « Le fait d'appeler
ça "match " et " ligue " donne l'impression que c'est un organigramme
national, mais ça ne reste que des compagnies de théâtre.
»112.
109 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
110 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06 Mars 2019.
111 Idem.
112 Entretien avec Simon Fache, 27 Février 2019.
58
Le terme est devenu ambigu en même temps que la pratique
de l'improvisation théâtrale s'est transformée : il
implique une structure sportive, en hommage au match de hockey, mais les
structures qui proposent aujourd'hui des matchs d'improvisation pratiquent
aujourd'hui d'autres formats, et ne se contentent désormais plus du
match d'improvisation. Le terme est utilisé aujourd'hui pour
désigner une compagnie de théâtre qui oriente ses
activités vers l'improvisation théâtrale, qu'elle soit
amateure ou professionnelle.
Il a été vu que l'improvisation
théâtrale se pratiquait au-delà du domaine artistique. Le
match d'improvisation obéissant à des règles
aisément applicables, la multiplication et la démocratisation de
la discipline a provoqué la multiplication des ligues. C'est ce qui a
rendu problématique le partage du territoire entre les ligues
professionnelles. La solution d'utiliser les outils de l'improvisation
théâtrale, grâce à la fondation du trophée
d'improvisation Culture et Diversité, a permis aux compagnies de varier
leurs activités, tout comme l'invention du catch et de nouveaux formats
qui ont suivi. Toutes ces initiatives ont transformé le paysage des
ligues d'improvisation théâtrale, et ont ouvert la pratique
à de nouveaux destinataires et pratiquants. Ces innovations ont eu pour
effet de modifier les organisations internes et générales des
compagnies et structures qui proposent l'improvisation théâtrale
comme activité principale, en ayant toute comme origine commune le match
d'improvisation crée par Robert Gravel en 1977.
La diversification des publics a eu comme effet de transformer
la pratique du match, selon qu'il est joué par des artistes
professionnels, des amateurs ou des formateurs scolaires et sociaux. Tout
l'enjeu de cette diversification est d'en adapter les formes, tout en en
conservant les règles essentielles. J'étudierai, à travers
mon expérience de spectateur et d'improvisateur, quels ont
étés les changements qui ont impacté le règlement
pour le rendre davantage accessible, tout en conservant l'esprit d'origine qui
a permis sa démocratisation. Les nouveaux formats qui se sont
développés au fur et à mesure du temps enrichissent le
vocabulaire spécifique à la pratique de l'improvisation
théâtrale. Le lexique ci-après explicite et commente les
termes relatifs aux différents spectacles ainsi qu'aux codes de
l'improvisateur.
59
II : codes et vocabulaire de l'improvisation
théâtrale
L'aspect compétitif alimente de nos jours, et depuis la
création du match d'improvisation théâtrale, les
discussions qui mettent en question le statut artistique de ce format. Parce
qu'il lie théâtre et compétition, une nouvelle forme de jeu
a été crée, avec une mécanique spécifique
qui a développé son propre vocabulaire. L'analyse du
règlement explique quels sont les codes et les pratiques mis en place
pour faire coexister théâtre et sport.
II.1 :Le règlement du match d'improvisation
théâtrale
Le règlement du match d'improvisation demeure
aujourd'hui un des codes communs à toutes les ligues et compagnies qui
se prêtent à cet exercice. Écrit en 1977 pour structurer le
premier match qui a eu lieu le 21 Octobre de la même année
à Montréal, il continue donc d'influencer le déroulement
de ces manifestations de nos jours. Les différentes versions qui en ont
étés écrites témoignent d'une volonté
d'assurer une cohérence entre la version conçue par Robert Gravel
au départ et l'actualisation nécessaire des règles
à mesure que le jeu s'est développé. Les divergences
culturelles, les moyens pratiques inégaux à la disposition des
troupes, les différentes individualités ont eu une influence sur
l'adaptation de ce règlement pour permettre à toute structure de
l'appliquer. L'engouement rapide oblige également Robert Gravel à
le compléter de trois articles pour mieux structurer les classements en
championnats. Le règlement est donc réécrit en 1987 dans
l' ouvrage co-écrit avec Jan-Marc Lavergne. Cette version peut se
retrouver aujourd'hui sur le site internet de la Ligue Nationale
d'Improvisation113.
Le document que l'Association Française des Ligues
d'Improvisation a édité dans les années 1990 englobe le
déroulé du cérémonial, les articles du
règlement, les fautes, et les différentes fonctions du staff. Il
permet ainsi de transmettre à un public européen un code venu
d'ailleurs, tout en permettant aux différentes ligues ayant
émergé dans les années 80 de pouvoir structurer de
façon cohérente leur pratique du match. Je me suis basé
sur le règlement officiel que l'on peut trouver sur le site de la Ligue
Nationale d'Improvisation, tout en reprenant des réflexions personnelles
que Jean-Baptiste Chauvin a ajouté dans Le match d'Improvisation
théâtrale, publié en 2015. Ces réflexions,
confrontées à mes observations en tant que spectateur,
témoigneront des différentes adaptations ou
113 Ligue Nationale d'improvisation, Les règlements
officiels, disponible sur
https://www.lni.ca/matchdimpro/regles-officielles
[consulté le 14/05/2019].
60
conservations des articles en fonction des situations
variées. Il faut néanmoins insister sur le but de ces
différentes adaptations : rendre le match accessible à toute
ligue tout en conservant la forme originelle telle qu'elle fût
élaborée en 1977.
[Robert Gravel] s'opposa notamment à tous ceux qui
voulaient laisser plus de place à l'expérimentation
théâtrale, au détriment de l'enjeu compétitif. Il
tenait énormément à la forme
sportive qui constituait à ses yeux la raison
d'être du match. Nous verrons qu'il avait résolument raison
114..
Article1 : Composition des équipes
« Le jeu consiste en l'affrontement de deux
équipes composées de six joueurs-improvisateurs (trois
femmes/trois hommes) et d'un entraîneur. Un arbitre et ses deux
assistants voient 115à ce que le jeu se déroule selon
les règlements »116.
Cette règle met en place deux points fondamentaux : la
parité hommes-femmes et le nombre de joueurs de chaque équipe.
Selon Jean-Baptiste Chauvin, le nombre six est significatif
quant au rythme de passage de chacun et pour économiser l'énergie
de chaque joueur : « Cette formule permet à chaque joueur de jouer
suffisamment sans que l'un de ces joueurs ne soit en mesure de lasser le public
par un trop grand nombre d'apparitions et elle propose une parité
hommes-femmes fondamentale »117.
Dans le cas des ligues amateurs, cet article pourrait poser
problème dans la mesure où la parité n'est pas toujours
assurée dans les équipes de joueurs. Cela peut expliquer pourquoi
certaines ligues, comme l'a mentionné Jean-Baptiste Chauvin, prennent
des libertés avec cette règle, comme lors du tournoi amateur de
Saint-Quentin en 1997 et à Genève en 1998.Pour ces matchs, les
équipes étaient composées de quatre joueurs et deux
joueuses.118.
En avril 2017, j'ai assisté, pour ma part, à un
match amateur entre la Ligue d'Improvisation Lilloise Amateur (LILA) et la
Balise de Limoges, où cette règle n'avait pas été
respectée par une des équipes : la Balise avait un joueur en
moins, et s'est vue recevoir, dès le début du match, une
pénalité prévue par un des points du règlement. Ce
fut également le cas lorsque j'ai disputé mon
114 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 42 .
115 Québécisme signifiant « veiller à
»
116 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
117 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 60.
118 Ibid., p. 61.
61
premier match le 09 Mars 2019 face à la Licoeur de
Bordeaux. L'arbitrage était assuré par Thierry Bilisko, qui
officie de nos jours en tant qu'improvisateur professionnel au sein de la Ligue
Paris Impro. Notre équipe était composée de quatre hommes
et de deux femmes. La faute a été sifflée après la
première improvisation.
La difficulté de respecter cette règle durant un
match s'explique également par le manque de parité au sein d'une
ligue. Jean-Baptiste Chauvin, dans Le match d'improvisation
théâtrale, a relevé des chiffres qui font état
du déséquilibre entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes
au sein d'une ligue amateur et d'une ligue professionnelle119 :
|
Ligue professionnelle
-Dans cette ligue il y a 38 % de femmes pour 62 % d'hommes
-Les femmes ont joué en moyenne 33,73 matchs, et les
hommes 36,11 matchs, (sachant que la femme qui a joué le plus de matchs
en a joué 133, et que l'homme qui en a joué le plus en a
joué 242)
-les femmes jouent en moyenne 5,27 improvisations par match,
les hommes 6,28 improvisations par match
-Durant toute leur carrière, les femmes ont eu en
moyenne 9,23 étoiles, et les hommes ont eu en moyenne 14,22
étoiles
-Dans ce classement à vie, pour les dix premiers, il y
a trois femmes pour sept hommes. Ligue amateur
-Dans cette ligue il y a 43 % de femmes pour 57
% d'hommes
-Les femmes ont joué en moyenne 18,57 matchs, et le
hommes 20,07 matchs, (sachant que la femme qui a joué le plus de matchs
en a joué 48, et que l'homme qui en a joué le plus en a
joué 67).
-Les femmes jouent en moyenne 6,6 improvisations par match,
les hommes jouent 13,5 improvisations par match.
-Durant toute leur carrière, les femmes ont eu en
moyenne 4,09 étoiles, et les hommes ont eu en moyenne 8,14
étoiles.
-Dans ce classement à vie, dans les dix premiers, il y a
trois femmes pour sept hommes.
|
Le nombre de femmes présentes dans les ligues
étant inférieur à celui de hommes, il est difficile de
faire respecter la parité de trois femmes et trois hommes.
Néanmoins, un autre problème survient dans la place à
prendre non pas uniquement sur le banc ou dans une association, mais bel et
bien au centre de la scène ou de la patinoire. Arthur Pinta,
président de la Ligue d'Improvisation Lilloise
119 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 186.
62
Amateur, me disait qu'il y avait dans l'association «
autant de joueuses que de joueurs, mais on a plus de mal à faire jouer
les filles, et en particulier en match »120 . Ce serait donc
les mécanismes spécifiques au match d'improvisation
théâtrale qui entraîneraient ce
déséquilibre.
Jean-Baptiste Chauvin a évoqué la notion de
prise de pouvoir dans le match d'improvisation, dans la répartition des
rôles. Chaque improvisation a en effet, son premier et second rôle,
(voire plusieurs), ou des personnages figurants qui agiront pour clarifier la
situation et le lieu par exemple. L'improvisateur qui fait une proposition
forte qui donnera le ton à la situation de départ prend le
lead*. Je pourrais également citer les fonctions de coach*
et de capitaine*, qui sont des figures d'autorité quant au
reste des joueurs, dans le sens où ils ont des décisions à
prendre qui impactent l'équipe entière. Les mécanismes
d'interaction entre joueurs durant le match, non seulement en ce qui concerne
les différentes fonctions prises au sein d'une équipe, mais
également dans l'incarnation des personnages, sont reliés au
problème de domination masculine soulevés par le philosophe
Pierre Bourdieu que Jean-Baptiste Chauvin assimile au match d'improvisation
théâtrale : « Par la mise en valeur de forces symboliques, la
distinction sociale des sexes se perpétue, chacun étant
cantonné dans un rôle »121. Nous aurions alors
tendance, dans un match d'improvisation, à donner aux hommes des
fonctions de responsabilité et d'autorité. Ce qui nous est
inculqué très tôt, comme le relève Jean-Baptiste
Chauvin :
Ainsi, dès notre enfance, nous sommes soumis à
ces forces qui tendent à attribuer à chacun sa place. Le petit
garçon ne joue pas à la poupée et la petite fille ne joue
pas au foot. Le petit garçon ne doit pas pleurer et la petite fille ne
doit pas salir sa robe. La jeune fille se soumet volontiers à la
séduction de con chanteur préféré quand le jeune
garçon s'identifie aux icônes violentes du cinéma ou de la
télévision. Sortir de ce carcan, c'est risquer de s'exposer aux
jugements qualificatifs péjoratifs122.
Même si la règle de la parité garantit un
équilibre dans la composition des équipes elle est insuffisante
pour garantir un équilibre dans le match :les mécanismes qui
régissent cette forme de spectacle cantonnent d'eux-mêmes les
femmes dans des positions pré-établies.
120 Entretien avec Arthur Pinta, 25 Février 2019.
121 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit, p. 183.
122 Ibid., p. 183-184.
63
Article 2 : Aire de jeu
« Pendant toute la durée de l'improvisation, le
joueur ne peut quitter l'aire de jeu (la patinoire) »123
Le joueur est seul une fois qu'il est entré dans la
patinoire, il ne peut plus communiquer avec son coach ou ses partenaires
restés en réserve. Du point de vue dramaturgique, cela oblige le
comédien à assumer son entrée quoi qu'il arrive. Cela peut
profondément modifier l'improvisation en cours si son intervention
était malvenue, contradictoire ou non nécessaire. La patinoire
peut également servir de décor ou d'élément
scénique pour matérialiser un comptoir ou un banc.
Article 3 : Durée de la partie
« Chaque partie a une durée de 90 minutes,
c'est-à-dire trois périodes de 30 minutes. Un arrêt de 10
minutes est prévu entre chaque période. »124
Jean-Baptiste Chauvin est formel :
La règle de trois fois 30 minutes est la plus
couramment respectée (...) Toutefois, il est apparu, surtout dans les
ligues amateurs, que ce découpage en trois parties était parfois
pesant pour le cérémonial. (...) Cela a amené certaines
ligues à jouer leurs matchs en deux fois 45 minutes (...) Les ligues qui
ont pris l'habitude des deux fois 45 minutes ne souhaitent pas revenir en
arrière.125
Ce point du règlement a semble-t-il
évolué avec le temps, et le match en deux fois quarante-cinq
minutes est devenu plus courant que le match en trois fois trente, car il est
plus propice à la qualité de jeu et au bien-être des
joueurs. Trois périodes de jeu avec deux interruptions engendrent le
risque de décrochage de la part du spectateur, mais également une
difficile gestion d'énergie pour le joueur. De mon expérience de
spectateur, les ligues aussi bien amateurs que professionnelles ont fait des
deux fois quarante-cinq minutes une règle implicitement officielle : Le
match de la Ligue d'Improvisation Lilloise Amateur contre La Balise de Limoges,
évoqué précédemment, suivait ce format, ainsi qu'un
match opposant la Ligue d'Improvisation Professionnelle Lyonnaise (Lily)
à la
123 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
124 Idem.
125 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit, p. 62-63.
Ligue Nationale d'Improvisation en novembre 2014 à
Lyon. Sur le règlement qui était distribué à chaque
spectateur ayant assisté au match du 24 Janvier 2019 à Comines
opposant la Ligue de Marcq-en-Baroeul aux légendes du Québec
(l'équipe était constituée de quatre des plus anciens
membres de la Ligue Nationale d'Improvisation), l'article mentionne deux
périodes de 45 minutes.
Le match contre la Licoeur s'est pourtant
déroulé selon le découpage des trois fois trente minutes.
Dans le cadre d'une ligue amateure, cela peut permettre de financer le match
grâce aux recettes de la buvette. Jean-Baptiste Chauvin explique
l'historique de cette pratique et la façon dont elle a
évolué :
C'est d'origine, mais Gravel a vraiment fait un
copié-collé du match de hockey, et les 3 périodes de 30
minutes c'était pour le hockey sur glace. Ce qui se comprend ; quand tu
as patiné 30 minutes, t'es bien fatigué. Mais faire de l'impro et
faire deux pauses, c'est trop long. Trop long pour le spectateur. Quand on
argumentait qu'il fallait faire qu'une seule pause, on nous rétorquait
que ça faisait tourner le bar. À ce moment-là, autant
faire 4 ou 5 pauses ! Mais j'en vois très rarement
maintenant.126
Quant à l'influence que deux pauses puissent avoir sur
l'énergie du comédien, j'ai pu m'apercevoir que l'improvisateur
ne se reposait jamais en match : elles étaient utilisées pour
faire le point, soit avec son équipe, soit en commun avec l'autre
équipe. Thierry Bilisko, respectant son rôle de garant de la
qualité de jeu, nous donnait des conseils et nous mettait en garde si
besoin par rapport à des maladresses de jeu. On quitte effectivement le
décorum du match, mais le joueur reste actif et retrouve très
vite son énergie une fois de retour sur la patinoire, grâce
à un échauffement rapide si besoin avant de reprendre le
match.
64
126 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06Mars 2019.
65
Article 4 : Chronométrage
« À l'intérieur de la période de 30
minutes, il n'y a aucun arrêt du temps (chrono), bien qu'il y ait
arrêt du jeu. »127
« Cela implique que tout le cérémonial (en
dehors du début et de la fin de match) fait partie intégrante du
temps de spectacle (...). Le temps qui peut être perdu pendant le
cérémonial diminue d'autant le temps de jeu »128
Ici se trouve un parfait exemple de la façon dont le
match d'improvisation conjugue jeu sportif et jeu théâtral. Non
seulement cet article garantit que la majorité du temps est
accordée au spectacle, mais il rejoint également l'idée de
ne faire décrocher ni le joueur, ni le spectateur. C'est en cela que le
match d'improvisation s'émancipe du rituel de la rencontre sportive
lorsqu'une faute est sifflée : il n'y a pas d'arrêt de jeu qui
sera ajouté au temps de la rencontre. Les fautes ne sont pas
signalées par un coup de sifflet, mais par un kazoo (ou «
gazou ») ; pour obtenir un son moins violent et éviter un
décrochage. J'ai longtemps pensé que le kazoo était
utilisé pour atténuer, voire railler la figure d'autorité
de l'arbitre, mais l'article 11 témoigne que le rôle de l'arbitre
est appréhendé avec un grand sérieux.
Le rythme du spectacle est également assuré par
une partie du staff : « Comme nous le verrons, cela nécessite
d'avoir un staff efficace dans l'énoncé et l'explication des
fautes ainsi que durant toutes les transitions... »129.
J'illustrerai ces propos avec une expérience
d'assistant-arbitre en mai 2018, lors d'un match où les deux
équipes étaient composés d'élèves de
l'école Impro Academy. Lorsque j'étais uniquement spectateur, je
pensais que le rôle de l'assistant-arbitre était uniquement de
compter les votes si l'arbitre n'était pas sûr de son compte et
d'être, en somme, un vérificateur. Or, il est aussi chargé
de noter chaque faute signalée, de taper sur ordinateur (ou de le
stipuler sur la feuille de match selon l'époque) le thème de
l'improvisation annoncée pour l'afficher aux yeux du public, et de noter
le score. Il est donc aussi un clarificateur et un garant du cadre du
spectacle, tant du point de vue cérémonial que
théâtral. Plusieurs fois, à la fin d'une improvisation,
l'arbitre est venu nous consulter - nous étions deux assistants-arbitres
- pour que nous lui rappelions les fautes qui avaient étés
signalées. Ce qui lui permet ensuite de les expliquer lors de la
confrontation des capitaines : à la fin de chaque improvisation, lorsque
celle-ci contient une ou plusieurs fautes, les deux capitaines
127 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
128 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 63.
129 Ibid. .
66
sortent sur la patinoire pour entendre les raisons qui ont
poussé l'arbitre à siffler. Il est donc primordial d'être
réactif pour assumer cette fonction.
Article 5:Sirène
« Une sirène annonce la fin de chaque période
et la fin de la partie. »130
Cette règle, me semble-t-il, a pratiquement disparu
avec le remplacement des trois périodes de trente minutes par les deux
périodes de quarante-cinq minutes. Le match d'improvisation abandonne
probablement ici une grande partie de son héritage, qui, souligne
Jean-Baptiste Chauvin, « vient directement du hockey sur glace, [la
sirène] sert dans la pratique à annoncer les début et fin
de période. Elle sert également à rappeler les spectateurs
après une pause et à signaler le retour des joueurs »131
Cette règle, de nos jours, n'a plus lieu d'être,
suite aux effets de lumière et à la musique qui se chargent
désormais de signaler aux spectateurs la reprise du spectacle. Le rappel
de ceux qui s'étaient absentés durant la pause est confié
à l'équipe d'accueil de la salle.
Article 6 : Nature des improvisations
« Les improvisations sont de deux ordres :
Comparée :
Chaque équipe, à tour de rôle, doit
improviser sur le même thème. L'équipe
désignée au hasard, par la couleur de la rondelle, a le choix de
commencer ou non. Aucune communication ne sera permise sur le banc pendant
l'improvisation de l'autre équipe. En cas d'infraction, une
pénalité sera décernée à l'équipe
fautive au moyen d'un mouchoir exhibé par les assistants de
l'arbitre.
130 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
131 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 64.
67
Mixte :
Un ou des joueurs des deux équipes doivent improviser
ensemble sur le même thème. »132
Pour préciser les propos de Jean-Baptiste Chauvin, qui
stipulent avec justesse que « la nature de l'improvisation
détermine obligatoirement toute la stratégie de l'équipe
dans la conception de l'histoire »133, il faut évoquer
le caucus* : le terme désigne le délai variant de vingt
à trente secondes dont disposent les joueurs pour préparer
l'improvisation, une fois le thème annoncé. Certains
improvisateurs critiquent son utilité, voire sa
légitimité. Ils considèrent qu'il nuit à la
spontanéité du joueur, et entre donc en contradiction avec le
concept même de l'improvisation. Il fait cependant partie du match.
J'ai néanmoins eu un jour l'occasion, lors d'un
entretien enregistré avec Corentin Vigou - un des professeurs d'Impro
Academy et membre de la ligue amateur Ligue Royale de Strandovie - de
débattre sur la différence entre un caucus pour une
improvisation mixte et une comparée : le conseil que j'ai reçu
lorsque j'étais son élève était de ne pas
définir de lieu durant un caucus pour une improvisation mixte. Le lieu
est en effet une manière de poser le cadre de sa prochaine
improvisation, et donc de donner au joueur des pistes pour développer la
situation de son personnage. Dans le cadre d'une improvisation comparée,
deux joueurs appartenant à la même équipe peuvent donc se
mettre d'accord sur le lieu durant le caucus. Mais dans le cadre d'une
improvisation mixte, l'intérêt pour le public est d'observer
comment les joueurs appartenant à une équipe adverse vont
construire ensemble une histoire. Pour que cela fonctionne et que tous les
joueurs aient le loisir de participer à la construction, il convient
donc d'entrer sur la patinoire avec un nombre minimum d'informations pour
encourager la construction commune. Cela peut également éviter
les obstructions ou les frustrations de certains joueurs : la situation se
développant au fur et à mesure, il n'est pas forcément
possible d'utiliser toutes les pistes qui auront étés
pensées pendant le caucus si elles ne conviennent pas à
l'improvisation en cours. Dans le cas inverse, si un des joueurs tient
absolument à utiliser toutes les pistes et à poser la situation
qu'il aura pensé pendant le caucus, cela pourrait mener à un
refus de jeu, ignorant les propositions de l'adversaire pour imposer ses
idées.
132 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
133 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 64.
68
Il faut également noter que les comédiens,
durant une improvisation de nature mixte, ont le droit de communiquer entre eux
- que ce soit entre membres d'une même équipe ou les deux
équipes mélangées - pour poser ensemble la suite de
l'improvisation si besoin ; à condition de ne pas enfreindre l'article
2.
L'arbitre désigne l'équipe qui aura le choix
d'improviser en premier ou non dans le cadre d'une improvisation
comparée par tirage au sort en lançant un palet de hockey. Cela
se fait la plupart du temps à vue du public, mais j'ai pu voir dans des
formats de duel (une variation du match durant 45 minutes opposant deux
comédiens) que ce tirage au sort était effectué avant le
match. Je suppose que ce tirage est effectué avant la compétition
pour éviter de nuire au rythme du spectacle, beaucoup plus court que le
match, conformément à l'article 4.
Mon expérience de spectateur m'a donné à
voir une vive réaction qui, maintenant, fait pratiquement partie du
rituel du match de la part du public : l'équipe qui choisit de laisser
la main à l'équipe adverse sera moquée, mais sera
encouragée si elle prend la main. Cette réaction peut s'expliquer
par le goût du spectateur à voir un improvisateur prendre des
risques.
Mes conversations informelles avec certains membres du Groupe
d'Improvisation du Terril concluent de façon quasiment unanime qu'il est
préférable de laisser la main. Cependant, ce n'est pas, selon
moi, gage de qualité pour l'improvisation qui va suivre : du temps aura
passé pendant que l'équipe adverse aura présenté
son improvisation, et par conséquence depuis le caucus effectué
par l'équipe dont c'est désormais le tour. Les joueurs regardent
alors leurs adversaires improviser, et prennent donc le risque d'oublier ou de
transformer ce qui aura été dit durant leur caucus. Ils risquent
également de se faire influencer par l'improvisation en cours. Or, le
plaisir de spectateur, lorsqu'il doit départager les équipes
après une improvisation comparée, réside beaucoup dans le
fait de découvrir comment chaque équipe a agi pour traiter le
thème. Il est à ce stade trop tard pour faire marche
arrière : contrairement à ce qui se fait pendant une
improvisation mixte, la concertation entre joueurs est interdite pendant que
les adversaires jouent.
Article 7 : Déroulement de chaque improvisation
« a) annonce du thème:
L'arbitre tire au hasard une carte et lit à haute voix
:
1. Nature de l'improvisation (comparée ou mixte)
2. Titre de l'improvisation
3. Nombre de joueurs
4. Catégorie de l'improvisation.
5. Durée de l'improvisation
b) concertation
Les joueurs et l'entraîneur ont vingt (20) secondes pour
se concerter et prendre place sur la patinoire. L'arbitre signale le
début de l'improvisation par un coup de sifflet.
Dans le cas d'une improvisation comparée, la rondelle est
lancée après la concertation de vingt secondes.
c) marque d'un point
L'improvisation terminée, chaque spectateur est
appelé à choisir l'équipe gagnante de l'improvisation en
montrant la couleur de son panneau de vote correspondant à
l'équipe de son choix.
Advenant un verdict nul (égalité dans le compte des
votes), aucun point n'est inscrit. »134
69
134 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
70
Article 8 : Improvisation inachevée en fin de
période
Si, à la fin de la première et de la
deuxième période, l'improvisation n'est pas terminée, elle
reprend au début de la période suivante, au point où elle
s'était arrêtée (même(s) position(s) et reprise de la
dernière réplique). En première ou deuxième
période, si la sirène se fait entendre durant le caucus,
l'improvisation sera jouée au début de période suivante.
Si la même situation se produit en fin de troisième
période, l'improvisation est annulée.
S'il reste moins de quatre (4) minutes à jouer dans une
improvisation, le maître de cérémonie signale, à
l'aide d'un carton blanc, que l'improvisation doit être terminée,
même si le temps de la période est écoulé.
En fin de troisième période, le temps minimum
accordée à la dernière improvisation, si elle ne peut
être jouée complètement à l'intérieur du
temps restant, est de 30 secondes. Le maître de cérémonie
signale, à l'aide d'un carton blanc que le temps de la période
est écoulé jusqu'à écoulement du temps de
grâce. Après les 30 secondes réglementaires, la
sirène met fin à l'improvisation et le vote est demandé
»135.
Édité en 2015, le livre de Jean-Baptiste Chauvin
présente une version raccourcie de cet article : il ne mentionne pas la
partie concernant la sirène résonnant pendant un caucus. Le
délai des quatre minutes restantes signalé par le maître de
cérémonie est quant à lui réduit à une
minute. Le commentaire qu'il en fait est très critique :
L'issue de l'improvisation reste le vote. Quelle valeur
peut-on donner à une improvisation qui a été interrompue
par une pause de 10 minutes ? Comment choisir entre les deux improvisations de
deux équipes (dans le cas d'une comparée dont une a
été jouée avant et l'autre après la pause ?
Même si les joueurs sont honnêtes et qu'ils ne se concertent pas en
coulisse, toute la
spontanéité du jeu, crée par l'urgence,
disparaît 136.
La règle stipulant qu'une improvisation interrompue par
la fin d'une période doive reprendre au début de la
période suivante est en effet néfaste pour tout le rythme du
match, et impacte autant le spectateur que le joueur. En effet, elle intervient
au moment où il est primordial de garder le public énergique et
actif. On ne peut qu'imaginer sa frustration si une improvisation était
interrompue en pleine action. Le rythme rapide du match garantit que les votes
seront faits en fonction des réactions premières des spectateurs,
et donc de leur spontanéité. Voter pour une improvisation qui
reprend après une longue pause risque donc de donner des
résultats en contradiction avec l'esprit du match. Par ailleurs, le
danger de concertation entre joueurs durant cette pause s'oppose à la
règle stipulant
135 Ibid.
136 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 73.
71
que les discussions entre joueurs sont interdites durant une
improvisation comparée, même si elle a lieu en dehors du temps de
jeu.
La partie de l'article concernant la sirène
retentissant pendant un caucus pose le même problème : les joueurs
auraient tout le loisir de préparer leur improvisation pour la
période suivante, étant déjà au courant du
thème.
Ceci dit, l'obstacle que présente cet article est
atténué par la pratique courante des deux fois quarante-cinq
minutes au lieu des trois fois trente minutes : diminuer le nombre de pauses
durant le match limite le risque que ces situations ne se produisent.
De mémoire de spectateur je n'ai pas eu l'occasion
d'assister à une improvisation se terminant par convention après
trente secondes si le temps était dépassé. Ma
réflexion me pousse à conclure que ce délai peut
être dépassé dans une limite raisonnable : il incombe
à l'arbitre, dans ces circonstances, de mettre fin à
l'improvisation le plus tôt possible. Mais il aura en charge de
l'interrompre à un moment propice ; lorsqu'il estimera qu'une fin
satisfaisante est trouvée. L'article 9 procure des outils aux joueurs et
à l'arbitre en ce qui concerne la gestion du temps.
Article 9 : Mi-temps de troisième période
« Dans les quinze dernières minutes de la
troisième période, les thèmes sont choisis dans un bocal
spécial ne contenant que des improvisations mixtes n'excédant pas
huit minutes. En troisième période, advenant la fin du temps
réglementaire de trente minutes pendant une improvisation
comparée, celle-ci se déroulera jusqu'à écoulement
de son temps »137.
L'usage veut que cette règle intervienne de nos jours
lorsque le match entre dans ses vingt dernières minutes de la
deuxième période. Elle permet à la partie de se conclure
selon plusieurs alternatives : un raisonnement élémentaire de
mathématiques permet à Jean-Baptiste Chauvin de dire que «
Lorsque que le score est équilibré de 1 ou 2 points près,
cela veut dire que tout reste possible dans
137 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
72
le dernier quart d'heure et que l'enjeu du match va se jouer
sur les dernières improvisations. Car, en 15 minutes, il y aura au moins
deux improvisations »138.
Sur une période de quinze minutes, dans le cas
supposé où deux improvisations de huit minutes chacune se
suivraient, la dernière improvisation serait donc terminée
après un délai approximatif de trente secondes après la
fin du temps réglementaire.
Comme tout dispositif spectaculaire, le match d'improvisation
doit s'achever sur une apothéose : le délai des huit minutes
à ne pas dépasser permet de garantir l'aspect vif et rapide de la
compétition, tandis que la catégorie mixte permet de finir sur
une note où les adversaires construisent ensemble une improvisation. Le
fait de terminer sur une improvisation mixte privilégie donc la
construction collective au détriment de l'enjeu du score. Selon le
rythme qui aura dominé le match dans la globalité, il peut
cependant être judicieux de terminer sur des improvisations courtes si
cela peut empêcher une baisse d'énergie pour conclure le
spectacle.
Il incombe alors à l'arbitre de maîtriser le
rythme en équilibrant le temps et le style des improvisations pour
éviter une lassitude de la part du spectateur qu'a pu relever
Jean-Baptiste Chauvin à plusieurs reprises : « Nous avons souvent
vu les spectateurs râler après une succession d'improvisations
longues ou mixtes. Certains arbitres ont tendance maintenant à moduler
leurs thèmes en limitant le choix, en alternant les mixtes et les
comparées, et en variant les durées »139.
Article 10 : Égalité
« Advenant140 une égalité
à la fin du temps réglementaire de 90 minutes, une improvisation
supplémentaire sera jouée, après une pause de soixante
secondes. Pour cette période de temps supplémentaire, la
durée des improvisations n'excédera pas cinq minutes (en mixte)
et trois minutes (en comparée). Un (1) point au classement
général sera attribué à l'équipe qui perd en
prolongation. L'équipe gagnante en obtiendra deux (2).
S'il y a égalité dans le compte des votes, une
autre improvisation suivra.
En série éliminatoire, advenant une
égalité après les trois périodes
réglementaires, le jeu se poursuivra en période(s)
supplémentaire(s) jusqu'à ce qu'un point soit marqué
»141.
138 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 74.
139 Ibid., p. 76.
140 Québécisme à valeur d'hypothèse
« S'il advient que »
141 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
73
Les notions de classement général et de
série éliminatoire sont quelque peu obscures pour les
européens, le vieux continent accueillant moins de compétitions
officielles que sur le terrain Nord-Américain.
Lors de différentes finales en mondial d'improvisation
que j'ai pu visionner, l'arbitre n'est pas épaulé par des
assistants, le cas d'une égalité peut donc se produire pour le
compte des votes. La majorité des matchs auxquels j'ai assisté
empêchait cependant ce cas de figure, les assistants-arbitres
étant sollicités pour compter le nombre de cartons en faveur de
chaque équipe, et évite donc une égalité dans le
comptage des votes.
Le cas d'un score égal à l'issue d'un match est
néanmoins une situation à laquelle j'ai assisté à
plusieurs reprises. Les notions de compétition et de dramaturgie se
mêlent alors pour prolonger le spectacle, et c'est ici que le spectateur
peut exercer un pouvoir expliqué par Jean-Baptiste Chauvin :
La situation de l'improvisation supplémentaire se
rencontre souvent, car le public a une tendance naturelle à
équilibrer le score. Si, à la fin du match et du dernier vote, il
manque un point à une équipe pour aboutir à une
égalité, le public votera pour cette équipe afin de
profiter d'une improvisation supplémentaire.142
Article 11: Pénalités
« L'arbitre est le maître absolu du jeu. En tout
temps, il peut imposer une pénalité à un joueur ou
à
une équipe pour toute infraction nuisant à la
qualité du jeu ou au déroulement de la partie. Au cours
d'une improvisation, l'arbitre signale une pénalité au moyen
d'un "gazou". La pénalité est annoncée avant le vote sur
l'improvisation »143 .
Jean-Baptiste Chauvin, dans son livre, fait de la partie
concernant l'arbitre en tant que maître absolu du jeu un article à
part entière. J'entamerai ici une réflexion sur cette fonction
:
Il me semble que le fait qu'un article entier du
règlement lui soit consacré a pour but de revaloriser la fonction
de l'arbitre. Au fur et à mesure du temps, des expérimentations
et de l'appropriation du match d'improvisation par des joueurs
extérieurs à la Ligue Nationale d'Improvisation, le rôle de
l'arbitre a eu tendance à être transformé, voire
parodié : dans bon nombre de matchs, le maître de
142 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 75.
143 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
74
cérémonie conditionne le public à le huer
en le percevant comme une figure d'autorité abusive et donc par
définition nocive pour l'improvisateur qui verra sa liberté de
création et sa spontanéité mises en danger.
La responsabilité de l'arbitre est pourtant tout autre
que celle de trouble-fête : il est garant, tant sur le point de vue
sportif que dramaturgique, du bon déroulement du match et de la
qualité des improvisations qui s'y jouent. Lui incombent la
préparation en amont des thèmes (soit par lui seul, soit avec le
concours des assistants-arbitres), la variété des
catégories et des improvisations mixtes et comparées, et le choix
du temps accordé à chaque improvisation.
Dans un match amateur, le fait que l'arbitre soit
lui-même amateur et membre d'une équipe peut influencer le contenu
du match. Par conséquent, l'usage veut qu'avant le match les joueurs
assistent à un briefing orchestré par l'arbitre dans lequel il
donne la liste des catégories. Pour que l'entente soit commune et que
les joueurs partent sur un pied d'égalité, il leur est possible
de demander de retirer la catégorie du barillet* ou de
décider si elle peut être utilisée. J'ai illustré un
exemple de ce procédé avec le match du Groupe d'Improvisation du
Terril contre la LICOEUR de Bordeaux en fin du règlement. Par ailleurs,
chaque troupe amateure ayant, au fil des ans, construit sa propre
identité et son propre style de jeu, des affinités entres ligues
peuvent se créer, et c'est l'occasion pour une ligue de découvrir
une nouvelle catégorie. Je prendrais l'exemple de Maxime Curillon, qui
arbitre la majorité des matchs organisés par le Groupe
d'Improvisation du Terril : « je ne suis pas à l'aise sur la
Shakespeare par exemple, je ne les mettrais jamais en arbitrage, c'est logique.
Les catégories que je vais faire, ce seront des catégories qu'on
aura bossé au GIT »144. L'arbitre, selon son
expérience d'improvisateur, influence donc le match. Il est en effet
logique de ne pas mettre dans le barillet une catégorie qui n'est pas
maîtrisée par l'arbitre, qui n'est alors pas en mesure de jauger
du respect de cette catégorie lors du match. Le briefing peut alors
devenir un moyen entre les improvisateurs d'échanger sur leurs
différentes façons de jouer telle ou telle catégorie ou
d'en apprendre des nouvelles : en cas de méconnaissance, l'arbitre
explique quelle est selon lui les codes et la construction qui correspondent
à cette catégorie.
144 Entretien avec Maxime Curillon et Florine Sachy, 28
Février 2019.
75
Points de pénalité
« L'équipe pénalisée se voit
accorder un ou deux points de pénalité selon la nature de
l'offense (mineure ou majeure). Une pénalité majeure est une
infraction qui détruit sciemment le jeu, tandis qu'une infraction
mineure peut être un oubli, une maladresse, un retard, etc.
L'accumulation de trois points de pénalité
(total accumulé chronologiquement par les joueurs ou leur équipe)
donne automatiquement un point à l'équipe adverse
»145.
Le match d'improvisation théâtrale de
Jean-Baptiste Chauvin explicite la nuance que cette règle implique pour
le score :« Une équipe peut donc marquer des points par le vote du
public, mais également par les fautes commises par l'autre
équipe. Cela impose donc aux joueurs de jouer dans le respect des
règles, toute faute commise permettant de gonfler le score de
l'adversaire »146.
Le match repose sur ce qu'il a défini par « une
relation tripartite »147 entre les joueurs, leurs adversaires
et le public. Le pouvoir que ce dernier détient sur l'attribution du
point peut lui permettre de contrebalancer la décision de l'arbitre.
Cela peut être une manière de défier son autorité -
surtout pour un public qui ne serait pas familiarisé avec le
règlement et ne tiendrait donc pas compte de la qualité
bafouée d'une improvisation - et de prolonger le match : en votant pour
une équipe qui a commis une faute, on peut retarder le moment
supposé d'une accumulation de trois fautes entraînant le gain du
point à l'équipe adverse et réduire le potentiel
écart des scores. Rendre ainsi la décision de l'arbitre caduque
permet donc de s'assurer que le match pourra être prolongé si les
scores amènent à une égalité, voire amener les
joueurs à se dépasser dans le futur en améliorant la
qualité de leurs improvisations pour remporter le point. Implicitement,
le vote du public se met donc également au service du match, refusant
une victoire facile.
Lorsque le public prive l'influence l'arbitre de son influence
sur le score du match, la relation tripartite se transforme alors en une
évidente complicité réunissant les joueurs et les
spectateurs contre l'arbitre.
Lors d'un match auquel j'ai assisté en novembre 2016,
et qui opposait deux équipes appartenant à la Ligue
d'Improvisation professionnelle de Marcq-en-Baroeul, un des joueurs s'est vu
siffler une faute de décrochage, dont Jean-Baptiste Chauvin donne la
définition : « Le décrochage se caractérise le plus
souvent par le fou rire. Situation bien humaine mais condamnable dans la
mesure
145 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
146 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 76.
147 Ibid., p. 72.
76
où elle casse l'imaginaire »148. Il
s'agissait d'une improvisation où les joueurs avaient la contrainte de
jouer en vers. Une catégorie aussi spécifique que celle-ci peut
permettre au spectateur de s'identifier à un joueur, qui aura tendance
à anticiper ses paroles, où à se prêter
intérieurement au même exercice. Le fou rire du joueur avait
été provoqué par un mot grivois qu'il s'apprêtait
à employer pour conclure l'improvisation, et le public l'avait bien
perçu. L'impact du décrochage sur la qualité de
l'improvisation avait été ici moindre, puisqu'il était
survenu à sa conclusion. Sans pour autant contester la faute, le public
avait été clément avec lui, parce que ce joueur
était sur le point de répondre à une attente
précise. Malgré la faute, son équipe avait remporté
ce point.
« En temps supplémentaire, l'accumulation de trois
points de pénalité par une équipe met immédiatement
(dès le signalement de l'infraction) un terme à l'improvisation
en cours et donne la victoire à l'équipe adverse.
Expulsion
Tout joueur ayant récolté deux (2)
pénalités pendant la même partie est expulsé du jeu
pour la fin de cette joute et il doit se retirer dans le vestiaire. Son
expulsion efface les points de pénalité résultant de ses
deux fautes, s'ils n'ont pas déjà été
totalisés. Les points de pénalité de toutes fautes
subséquentes, par ce joueur, sont versés au dossier de
l'équipe.
Si, à cause de l'absence d'un joueur, son équipe
ne peut remplir les exigences de la carte d'improvisation, l'autre
équipe gagne l'improvisation par défaut »149.
Cette règle a plus de conséquences si le match
est en format des « deux fois quarante-cinq minutes » que s'il est en
« trois fois trente minutes ». Elle engage la responsabilité
du joueur envers son équipe, et même envers le match : l'article 1
met l'accent sur l'équilibre mis en place par le nombre des six joueurs
avec trois hommes et trois femmes. Amputer une équipe d'un de ses
membres aura donc un impact sur cet équilibre par rapport au temps de
passage de chacun, et par conséquent sur l'énergie des joueurs et
la variété des improvisations proposées.
148 Ibid., p. 129.
149 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
77
Des alternatives ont étés posées pour
respecter cette règle de punition, et éviter de nuire à la
qualité et à l'ambiance festive du match : « Le joueur
sanctionné se voit exclu de la partie pour un nombre d'improvisations
défini par l'arbitre en fonction de de la gravité des fautes
commises »150
Jean-Baptiste Chauvin insiste sur le fait que cette pratique
est plus courante lors de rencontres amateurs ou de joueurs
inexpérimentés151, et semble s'inspirer directement du
règlement du Theatresports, inventé en 1977 par le Britannique
Keith Johnstone, dont le théoricien Christophe Tournier a
explicité le système de la punition dans le Manuel
d'improvisation théâtrale : « Suivant les pays, le
joueur puni reste plusieurs minutes sur le bord de la scène, avec sur la
tête un sac troué dissimulant son visage »152.
Lors de la finale du mondial d'improvisation en 2007,
l'arbitre Yvan Ponton avait néanmoins exclu définitivement la
joueuse québecoise Edith Cohcrane à la deuxième
période, car elle avait commise deux fautes personnelles.
Demande d'explication
« Seul le capitaine de chaque équipe a le droit de
demander des explications à l'arbitre. Toute discussion avec ce dernier
doit se dérouler dans le cercle LNI au centre de l'aire de jeu.
Advenant l'expulsion du capitaine, celui-ci sera remplacé
par l'assistant-capitaine »153.
L'article 11 conclut le règlement du match
d'improvisation tel qu'il était en vigueur jusqu'en 1987. Il se voit
complété en 1988 de deux articles supplémentaires.
150 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 77.
151 Idem.
152 Christophe Tournier, op. cit., p. 93.
153 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
78
Article 12: Classement
« Chaque victoire vaut deux (2) points au classement
général. À la fin du calendrier régulier, advenant
une égalité dans les points au classement, le gagnant des matchs
disputés en saison entre les équipes concernées
obtient la primauté. Si l'égalité ne peut être
brisée par ce principe, la différence entre les points pour et
les points contre, au total de la saison, détermine un meneur. Si
l'égalité persiste à ce stade, la différence entre
les points pour et les points contre au total des matchs mettant aux prises les
équipes en litige devient la référence. Le dossier de
l'équipe au chapitre des pénalités tranchera en dernier
recours.
Joutes éliminatoires :
À la fin du calendrier régulier, il y a une
ronde de deux demi-finales. L'équipe qui termine en tête du
classement général rencontre dans une première partie de
demi-finale l'équipe occupant la 4e et dernière place.
L'équipe terminant au 5e rang est éliminée. Les
équipes occupant la 2e et le 3e place se rencontrent dans une
deuxième joute de demi-finale. Les gagnants des deux demi-finales se
rencontrent en finale »154.
Le match d'improvisation théâtrale définit
cette pratique :« Il s'agit là de la procédure à
suivre dans un championnat ou un tournoi pour déterminer les
équipes finalistes »155
Cet article peut paraître obscur pour les
Européens, n'ayant pas une culture du match aussi poussée et
aboutie que les Québécois. Peu de championnats à grande
échelle ont eu lieu sur notre sol. La dernière coupe du monde en
date ayant été jouée en France a été
organisée en 1998 par la Ligue d'Improvisation Professionnelle de
Marcq-en-Baroeul. Ces championnats se sont, quant à eux,
multipliés sur le territoire québécois : au fur et
à mesure du temps se sont créés des tournois multiples
tels que la Coupe Charade, les grands duels de la LNI et des tournois
régionaux. Il a bien fallu, avec cette évolution, structurer
davantage le règlement pour organiser les classements. Cette
évolution n'avait pas été prévue par Robert Gravel
qui soutenait dans l'ouvrage Impro ; réflexions et analyses,
que « Le hockey n'est qu'un prétexte. Il n'est que l'emballage du
spectacle. Le jeu LNI pourrait exister sans cet environnement sportif et
coloré »156
154 Idem.
155 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 78.
156 Robert Gravel, Jan-Marc, Lavergne, op. cit., p.
38.
79
Article 13 : Protêt.
Pour qu'un protêt soit valide, il doit être
signalé aux officiels, lors du match contesté, avant la
dernière sirène annonçant la fin des
cérémonies de clôture. Un membre dûment
mandaté de la direction de la Ligue Nationale d'Improvisation jugera
alors de la recevabilité du protêt. Dans la mesure du possible, la
décision sera rendue le soir même ou dans un délai
raisonnable par le membre mandaté.Une équipe qui abusera de cette
procédure pourrait être sanctionnée. La sanction
imposée correspond au retrait de un ou deux points au classement
général 157.
Le cadre strict et clairement défini permet à
chaque joueur de se confronter à ses règles et d'enrichir son
jeu. Le caractère restrictif de cette pratique que certains opposent
à la liberté de l'artiste est donc discutable. Depuis 1977, le
règlement et la pratique du match s'étant transmis de joueur en
joueur et d'ateliers en ateliers, Jean-Baptiste Chauvin appelle à la
prudence : « Cependant, il faut se montrer prudent, car le
développement croissant des équipes et de ligues, tout
bénéfique qu'il soit, met en danger l'esprit et l'éthique
du jeu. Il convient donc de créer une base de réflexion pour que
le jeu évolue sur des fondations solides »158.
En plus de quarante ans d'existence, les modifications peu
nombreuses dont le règlement a fait l'objet ont pour but d'oeuvrer dans
ce sens. Le cas des deux fois quarante-cinq minutes qui avaient commencé
à supplanter officieusement les trois fois trente minutes en est un bon
exemple. Le match d'improvisation était soumis à l'origine au
découpage similaire aux matchs de hockey, probablement pour des raisons
culturelles. Avec son développement vers d'autres pays, le
règlement a dû s'adapter à d'autres cultures ainsi qu'aux
usages. Le découpage du temps en deux-fois quarante-cinq minutes, par
exemple, est aujourd'hui majoritaire, mais le match que j'ai joué contre
la LICOEUR de Bordeaux avec le Groupe d'Improvisation du Terril était
découpé en trois parties de trente minutes
En tant qu'institution, le match d'improvisation continue donc
de faire évoluer ses règles avec son temps. Il convient cependant
à chaque improvisateur, amateur ou professionnel, de faire preuve de
responsabilité individuelle pour conserver les fondations solides et
l'éthique du jeu chères à Jean-Baptiste Chauvin. Par
ailleurs, un règlement trop éloigné de sa forme originelle
n'aurait guère de sens et empêcherait les différentes
ligues de partager un langage commun.
Par conséquent, la fonction de l'arbitre devient
vitale, et ne se cantonne donc pas à une parodie d'autorité. Une
certaine maîtrise de ce rôle pourra néanmoins permettre
à l'arbitre-improvisateur de
157 Ligue Nationale d'Improvisation, op. cit.
158 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 80.
80
jouer de cette image tout en faisant respecter le match ; ce
qui peut divertir le public tout en garantissant le respect des règles.
Certaines initiatives individuelles qui oeuvrent à préserver
l'intégrité de la fonction, dans la plus pure tradition de la
transmission orale, sont à saluer. Je citerai en exemple un groupe
créé sur un réseau social intitulé « Arbitre,
c'est un métier ! » qui est une véritable source
d'enseignement et de partage pour appréhender et questionner le
rôle de l'arbitre. Des improvisateurs professionnels ou non rompus
à la fonction y partagent régulièrement leurs
expériences, conseils et y publient des offres de stage. C'est
également sur ce groupe que j'ai pu me procurer le document du
règlement édité par l'Association Française des
Ligues d'Improvisation.
Les initiatives individuelles, dès lors qu'elles
conservent une intégrité par rapport au support d'origine,
permettent donc au règlement du match d'improvisation de se
pérenniser grâce au bon sens et à la volonté
individuelle d'améliorer une pratique collective.
C'est pourquoi je souhaite saluer le respect du
règlement dont avaient fait preuve la Ligue d'Improvisation Lilloise
Amateur et la Balise de Limoges en Novembre 2017, en sanctionnant dès
leur entrée l'équipe limousine pour un non-respect du nombre de
joueurs, qui étaient au nombre de cinq. Le problème de trouver le
nombre de joueurs conforme à l'article 1 est souvent rencontré
chez les ligues amateurs. Celles-ci sont maintenant très nombreuses, il
est primordial qu'elles s'évertuent à respecter ce
règlement, étant maintenant les ambassadrices officieuses du
match par le nombre de rencontres proposées. Le caractère amateur
ne peut en aucun cas dispenser de l'obligation d'offrir un spectacle de
qualité.
Ce cas de figure se présentant souvent, une faute n'est
pourtant pas sifflée systématiquement à chaque match
amateur. Il incombe alors aux deux ligues en jeu de se mettre d'accord en
interne pour discuter des modalités de jeu si, par la force des choses,
il n'est pas possible de remédier à cet écart. L'entretien
a pour but de garantir un équilibre et une parité entre les
joueurs de chaque équipe, mais également entre les deux
équipes. C'est ce que j'ai pu vérifier lors de mon premier match
: l'arbitre a tout d'abord défini son style d'arbitrage, en
précisant qu'il allait être « un peu
désagréable », pour renforcer sa position d'autorité,
mais il a avant tout été pédagogue, pour éviter que
les joueurs ne soient brusqués par son attitude. Il a ensuite
énuméré les catégories qu'il avait
préparées pour le match. Nous pouvions dire si nous nous sentions
à l'aise avec ces catégories. Par exemple, une catégorie
de style en mixte avait été choisie « à la
manière de Myasaki », un réalisateur japonais, ce qui
supposait des références culturelles spécifiques. Le
danger d'une telle catégorie est de commettre une faute de non-respect
de la catégorie si les codes sont peu connus des joueurs, ou d'appuyer
sur un cliché par peur d'explorer d'autres pistes. Des douze joueurs qui
ont disputé ce match, nous étions une très forte
minorité à connaître les dessins animés Myasaki :
deux
81
joueurs au GIT, aucun à la Licoeur de Bordeaux. Nous
avons questionné l'arbitre qui nous a expliqué brièvement
ce qu'il attendait que nous produisions pour cette catégorie. Une grande
responsabilité attendait ceux qui connaissaient l'univers de Myasaki :
étaient-ils assez familiers pour respecter l'oeuvre et seraient-ils
capables de transmettre des codes clairs à leurs partenaires pendant
l'improvisation ? Avec les quelques personnes qui avaient une mince
connaissance des codes, nous avons décidé de prendre cette
responsabilité et d'accepter la catégorie. J'ai profité
d'une pause pour faire part à mes partenaires de mon appréhension
quant à cette improvisation. Mais il faut rappeler que le public est
là pour admirer la capacité de l'improvisateur à prendre
des risques. La catégorie a été tirée par l'arbitre
lors de la troisième période, et l'improvisation a
été appréciée du public.
L'expérience de ce premier match m'a fait comprendre
que le cadre doit être solide, sans pour autant être rigide. Sous
l'égide d'un arbitre professionnel, l'improvisateur a son mot à
dire s'il ressent une certaine appréhension par rapport au terrain
où l'emmènera telle ou telle catégorie. La qualité
de l'improvisation et la sécurité du joueur étant
prioritaires, c'est à l'ensemble du staff* qu'il incombe de
définir un cadre idéal pour tous. Pour que ce cadre et les
rituels relatifs aux spectacles d'improvisation soient connus de tous, il a au
fur et à mesure du temps été développé un
langage spécifique à la pratique.
II.2 :Lexique de l'improvisation
théâtrale
Il est difficile de figer dans le marbre des
définitions à des notions-clés qui sont en
perpétuelle évolution. Jean-Baptiste Chauvin a publié en
2015 un glossaire des termes relatifs au match d'improvisation dans son ouvrage
Le match d'improvisation théâtrale. Au cours de mon
parcours d'improvisateur, j'ai pu m'apercevoir que certaines notions
étaient perçues de manière différente selon les
contextes ; c'est pourquoi j'apporterai à certaines de ces
définitions ma propre réflexion due à une
expérience personnelle, afin d'être le plus exhaustif possible et
de fournir une version de ce lexique actualisée et située dans ma
pratique en France. J'y joins également la définition de termes
utilisés tout au long de ce mémoire identifiés par le
signe « * ».
82
Certains termes, parce qu'ils sont assez explicites, ou parce
que leur définition coule de source, seront absents de ce lexique. Le
but de cette liste n'étant pas d'imiter le travail que d'autres avant
moi n'ont que trop bien accompli, mais bel et bien de nourrir une
réflexion sur certains mots et définitions, dont l'explicitation
me paraît pertinente ou nécessaire.
Action (nf) :
« Centre de ce qui se passe dans l'histoire
improvisée OU cri d'alarme lancé par le coach quand ses joueurs
végètent dans un verbiage stérile »159
.
Le seul moment où le coach aurait le droit d'intervenir
ainsi serait pendant le caucus, sans quoi il se mettrait en faute
vis-à-vis du règlement qui interdit la communication entre
joueurs en action et staff sur le banc durant une improvisation en cours.
Arbitre (nm) :
« Personnage central du jeu qui donne les fautes et fait
voter le public. »160
Il faut rappeler que, selon l'article 11 du règlement :
« l'arbitre est le maître absolu du jeu ». Il doit donc se
contenter non de réprimer toute contestation à ses
décisions, mais de faire en sorte que celles-ci soient justes. Il est au
match d'improvisation ce que le dramaturge est au théâtre, et sa
charge est lourde : gérant la variation des thèmes, des
catégories, et des durées des improvisations, il est garant de
leur qualité mais également du rythme du spectacle. En accord
avec l'article 3 qui stipule qu'il n'y a aucun arrêt du temps, bien qu'il
y ait arrêt du jeu », c'est à lui de faire en sorte que le
spectacle continue et ne s'essouffle guère, gérant les
périodes de jeu et de non-jeu - où il devra alors faire valoir le
cérémonial codifié du match - c'est pourquoi la
présence d'un staff compétent pour endosser les rôles de
maître de cérémonie et d'assistants-arbitres est
primordiale. Il y a également une ambivalence entre la fonction et le
personnage, et certains arbitres expérimentés la maîtrisent
suffisamment pour offrir un divertissement supplémentaire au public.
159 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 253.
160 Idem.
83
Balance (nf)(aussi appelée " bascule " ou "trappeur
" ) :
« Détermine une double action. Dans une
improvisation, il peut y avoir deux actions en parallèle. Elles doivent
se jouer en alternance sans brouiller l'attention du public
».161
Elle peut être utilisée pour apporter une
deuxième action dans un même lieu, ou signifier une ellipse
temporelle ou un changement de lieu. Elle peut être très utile
pour faire avancer une intrigue de façon conventionnelle si l'action
n'évolue pas. Chaque compagnie, et parfois même chaque
improvisateur a ses propres codes pour amorcer une balance : il s'agit de la
signifier tant au spectateur qu'à ses camarades de jeu. J'ai appris chez
Impro Academy à amorcer une bascule en établissant un contact
visuel avec le partenaire que je sollicite. Si le partenaire évite le
contact, il jouera seul ou avec d'autres partenaires. Dans ces circonstances il
incombe aux partenaires déjà en place d'être attentifs
à ce détail, soit pour quitter l'aire de jeu et faire place
à une nouvelle intrigue parallèle, soit pour jouer avec ce
nouveau partenaire.
Dans mes débuts à Lyon, on se contentait
simplement de signaler notre présence de façon significative par
un grand saut sur le devant de la scène en jaillissant de la
réserve*.
Un code plus sommaire permet à un joueur
d'établir la bascule de façon orale en amorçant la
nouvelle action par la phrase « Pendant ce temps-là », ou
« le lendemain... » ou autre.
Balayage (nm)
«Action par laquelle les assistants-arbitres ramassent
les chaussons tombés dans la patinoire. Cette action est
commandée par ce meuglement de l'arbitre " balayage ! " ou " nettoyage
!" »162
Il est en effet très rare qu'un lancer de chaussons
soit isolé. Lors des matchs, un premier lancer de chaussons sera, dans
la majorité des cas, imité par d'autres comparses dans
l'assistance. Comme si le public, en ayant vu un premier exemple, venait de
prendre conscience du pouvoir qu'il détenait. Cela m'étonne
pourtant que l'évaluation mauvaise d'une improvisation ou d'une
décision arbitrale puisse remporter une unanimité; ce qui
m'amène à penser que le lancer de chaussons relève en
grande partie du mimétisme.
Ce code du match est aujourd'hui de moins en moins
utilisé, et sa contestation tire ses origines dans la création
même du match d'improvisation : Robert Gravel avait fait face à
plusieurs détracteurs (des joueurs en majorité) qui avaient
trouvé cette pratique trop humiliante.
161 Idem.
162 Idem.
Bande(nf) :
« Rebord de la patinoire qui délimite l'espace et
sur lequel les joueurs peuvent monter pour élever leur jeu. »163
J'en reviens à ce que j'avais évoqué dans
l'article 2 du règlement : bien utilisé, le rebord de la
patinoire peut être un très bon élément
scénographique pour délimiter un lieu ou un accessoire. Lors du
match du 20 Mai 2018 au théâtre Sébastopol à Lille
opposant l'équipe de HERO CORP contre Montréal, un des joueurs
français avait profité d'un morceau de patinoire manquant pour
matérialiser un écran de télévision en y incarnant
un présentateur.
La bande offre également aux joueurs qui ne sont pas en
action ou à l'arbitre une coulisse où se dissimuler du public
pour ne pas perturber l'action en cours. Elle devient un espace dans lequel les
improvisateurs qui sont actifs sans être en jeu peuvent continuer
à observer l'improvisation en cours, prêts à intervenir une
nouvelle fois si nécessaire. Ils peuvent notamment communiquer ensemble
pour préparer une intervention commune, sans perturber le cadre et
l'attention du public.
163 Idem.
84
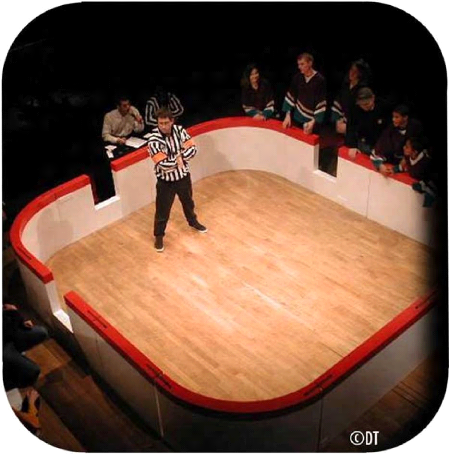
85
La Patinoire, aire de jeu du match d'improvisation. Photographie
prise en 2000 appartenant à la compagnie Déclic
Théâtre, disponible sur
http://match.impro.free.fr/images/photosXL/ensemble4XL.jpg
[consulté le 15/05/2019].
Barillet (nm) :
« Petit Cylindre monté sur un axe avec une ouverture
pour passer la main à l'intérieur. Cet objet sert à
l'arbitre pour mélanger ses thèmes. Ce dernier fait tourner le
barillet pour mélanger, puis pioche ensuite un thème à
l'intérieur »164.
164 Ibid., p. 254.
86
Le hasard, dans le match est une notion à manipuler
avec prudence. L'arbitre, préparant les thèmes, les
durées, et les catégories de chaque improvisation pour offrir un
spectacle équilibré, se doit d'avoir une certaine maîtrise,
même si « c'est aux joueurs de s'adapter au hasard et non au hasard
de s'adapter aux joueurs »165. Il est néanmoins
fréquent qu'un arbitre, durant le match, choisit
délibérément un thème sans se remettre au hasard.
Cette action est en effet nécessaire pour assurer l'équilibre du
spectacle, et varier les improvisations. Si, par exemple, deux improvisations
deux cinq minutes ont étés effectuées à la suite,
il peut choisi de sélectionner un thème avec une durée
plus courte pour la prochaine improvisation. Cette variation ne concerne pas
uniquement le temps, mais également les catégories, libres ou
imposées, ainsi que les improvisations comparées ou mixtes.
Dans une forme de cabaret*, c'est au maître de
cérémonie que revient la responsabilité de construire la
charpente du spectacle. Dans chacun des deux spectacles ; deux notions
primordiales interviendront : l'équilibre du spectacle et la
complicité avec les joueurs. Les deux personnes qui établiront
les thèmes devront tant veiller à la qualité globale du
spectacle que la complicité et la connaissance qu'ils ont des joueurs.
C'est pourquoi le choix des catégories devrait être guidé
par la volonté de faire prendre des risques aux joueurs, mais
également de leur offrir une opportunité de briller en fonction
de leurs qualités, leurs atouts, leurs préférences selon
l'enjeu du spectacle.
Cabaret (nm) :
Désigne un spectacle d'improvisation qui adopte une
forme non compétitive. Les improvisateurs effectuent des improvisations
courtes sur des thèmes que le maître de cérémonie
demande au public.
Caoutchouc (nm)
« version québecoise du chausson
»166.
« J'ai toujours dit en blaguant que chaque
théâtre devrait offrir des caoutchoucs à ses spectateurs
pour savoir si son spectacle est apprécié. On n'a pas le droit
d'être ennuyant au théâtre. Si on l'est, on reçoit
des caoutchoucs. Il ne faut pas trop s'en faire et essayer d'être
meilleur »167
165 Ibid., p. 64.
166 Ibid., p. 254.
167 Ibid., p. 96.
87
Les propos de Robert Gravel à l'assistant-arbitre de la
première heure Pierre Lavoie (en fonction de 1977 à 1984)
montrent son souhait de bousculer le joueur et de tenter de le sortir de sa
zone de confort. Cette pratique, critiquée dès sa mise en place,
reflète bien le combat qu'il livrait pour tenter de démystifier
le comédien.
De nos jours, le chausson (ou caoutchouc) a
dérivé de sa fonction première, et il n'est pas rare que
les spectateurs l'utilisent pour causer du tort à l'arbitre.
Jean-Baptiste Chauvin, en tant qu'arbitre, en a fait les frais à de
multiples reprises : « À l'expérience, [la semelle]
adhère bien aussi à la figure de l'arbitre »168
Si je remonte à mes souvenirs d'enfance et au premier
match d'improvisation auquel j'avais assisté du haut de mes 11 ans, j'y
voyais une pratique somme toute anecdotique, mais dans mon esprit il est clair
qu'elle était destinée à punir l'arbitre. Une trop longue
distance et un manque de précision de ma part en ont
décidé autrement, et c'est un obscur membre du public assis plus
bas qui a écopé de ma punition.
Il m'a été donné de voir une seule fois
un lancer de chaussons utilisé de façon conforme à la
vision de Robert Gravel : Lors du match de la LILA contre Limoges qui s'est
déroulé le 22 Avril 2017 à la salle Alain Colas à
Lille, les chaussons ont fusé sur la patinoire en pleine improvisation,
dont le manque de qualité était évident. Un chausson, puis
deux, puis une pluie. L'arbitre avait eu la sagesse, conformément au
règlement, d'interrompre l'improvisation en cours. Les compteurs avaient
étés remis à zéro, et les joueurs ont
étés invités à regagner leurs bancs pour un nouveau
caucus afin de démarrer une nouvelle improvisation de meilleure
qualité.
Je comprends que le lancer de chaussons fasse débat,
car il confère au public un terrifiant pouvoir, et, s'il est
utilisé à mauvais escient, peut devenir une distraction ou un
défouloir. Par ailleurs, le chausson est à usage unique, et, lors
du balayage, j'ai rarement vu les assistants-arbitres redistribuer les
chaussons lancés aux spectateurs. À l'image du carton de vote, le
chausson est un instrument qui permet à l'assistance de faire entendre
son opinion. Et bien que l'arbitre soit le maître incontestable du jeu,
il peut paraître légitime qu'il reçoive des chaussons
à la place des joueurs lorsque ses décisions sont remises en
cause. C'est dans ces circonstances qu'il fera également valoir ses
fonctions de pédagogue et de catalyseur : recevoir un chausson,
même si la nature du projectile est par définition anecdotique, la
signification du geste est malgré tout violente et peut atteindre la
sensibilité des joueurs ; et ce en majorité dans le cas d'un
premier match ou de joueurs officiant en amateur.
168 Ibid., p. 254.
88
Le lancer de chaussons fait débat, parce qu'il est la
seule variable sur laquelle le cérémonial du match n'a aucune
influence. Jean-Baptiste Chauvin parle « d'éducation du public
»169, afin qu'il utilise ce lancer à un moment et dans
des circonstances précises. Il faudra bien du courage pour
éduquer tout une salle. C'est, à mon sens, à la
responsabilité individuelle qu'il faut faire appel, bien que ce soit
utopique : on donne à un spectateur la possibilité de faire
entendre sa frustration et, dans une certaine mesure, exprimer sa violence.
Pour protéger le joueur de cette violence, il est donc courageux de la
part de l'arbitre de faire preuve d'une austérité volontairement
exacerbée afin qu'il soit désigné comme cible pour les
projectiles.
Cela peut également dénaturer l'objectif premier
du match, et la peur des chaussons incite certains joueurs à jouer pour
mettre ses improvisations davantage au service du public que de la
qualité globale du spectacle.
Le lancer de chaussons cultive encore cette
ambiguïté par son utilité et les débordements qu'il
peut causer. Bien que bon nombre de ligues aient abandonné cette
pratique, je crois qu'elle perdurera ; car elle fait désormais partie
intégrante du rituel du match. Aujourd'hui, lorsque je me
présente à l'entrée d'un match d'improvisation, le fait de
savoir si on va me donner un chausson reste une surprise jusqu'au bout.
Capitaine (nm) :
« C'est le référent de l'équipe
auprès de l'arbitre »170
J'ajouterai à la définition de Jean-Baptiste
Chauvin que c'est le référent de l'équipe auprès du
public, car il a un rôle d'ambassadeur de son équipe : lorsqu'une
faute est sifflée, les capitaines des deux équipes se
présentent sur la patinoire à la fin de l'improvisation pour
obtenir des explications de l'arbitre, car c'est le seul membre de
l'équipe à avoir le droit de s'adresser directement à lui.
Puisqu'il n'y a aucun arrêt de jeu durant une partie, une seule parole
doit se faire entendre pour gagner en efficacité. C'est pourquoi le
protocole au fur et à mesure a installé cette pratique : les deux
capitaines vont se saluer, puis saluer l'arbitre. Le capitaine membre de
l'équipe responsable de la faute va demander : « Monsieur
l'arbitre, pour la bonne compréhension du public et des deux
équipes, pourriez-vous nous donner une explication des fautes que vous
avez sifflées ? »171
Ce rituel du match est effectivement important pour la
compréhension du public, et ajoute un élément qui va
donner corps au match et donc au spectacle dans sa globalité :il peut
accorder un peu
169 Ibid., p. 97.
170 Ibid., p. 254.
171 Ibid., p. 54.
89
de répit aux joueurs entre chaque improvisation, et la
compréhension du public est effectivement primordiale pour un vote en
toute connaissance de cause. Cela peut aussi être un moment plaisant
où les capitaines des deux équipes peuvent faire valoir une
certaine complicité contre l'arbitre. L'issue de cette explication est
souvent suivie des protestations du public, voire d'un lancer de chaussons.
Jean-Baptiste Chauvin ajoute également qu'il est le
second du coach, et peut effectivement avoir un rôle de soutien dans la
gestion des caucus, du nombre de passages sur scène, ou va faciliter la
communication entre les joueurs et le coach.172
Lors d'un match interne (Impro Academy et la Ligue de
Marcq-en-Baroeul organisent régulièrement des matchs où
les joueurs de chaque équipe appartiennent à la même
structure), le rôle du capitaine va donc se centraliser sur une fonction
protocolaire, pour garantir un rythme respecté lors de la confrontation
des capitaines avec l'arbitre. Comme dans ces circonstances, tous les membres
du staff se connaissent, la complicité qui règne entre eux tous
fait passer l'importance du score au second plan, et cette confrontation
pourrait basculer dans un léger cabotinage. Cela peut ajouter un
élément de spectacle nouveau ,tant que ça ne nuit pas au
rythme et au respect du règlement. Bien que cette complicité
puisse se révéler également lors d'un match où les
deux équipes ne se connaissent pas, cela me semble bien plus susceptible
d'arriver lors d'une rencontre où les membres du staff ont passé
leur temps à se croiser durant les spectacles ou les entraînements
durant toute une saison.
Dans les deux cas, les équipes ont tout
intérêt à choisir un joueur expérimenté pour
endosser ce rôle, qui sera habitué à la gestion d'un rythme
particulier et qui aura appris à apprivoiser tout le décorum et
le protocole du match.
Carton de vote : (nm)
« Feuille cartonnée et carrée avec laquelle
le public vote. Cette feuille est bicolore et permet ainsi de ne pas voter
toujours pour la même équipe. »173
Comme le chausson, le carton est l'incarnation du pouvoir du
public, et sera de nature différente selon les moyens financiers de la
ligue ; mais sa qualité peut en dire beaucoup sur l'importance qu'elle
accorde au rituel du match, et donc au spectacle. Le point peut en effet
être accordé à l'applaudimètre, par un simple papier
bicolore, ou un carton. Le carton est si précieux que les
172 Ibid., p. 118.
173 Ibid., p. 254.
90
ouvreurs le reprennent à la fin du spectacle. C'est
pourquoi, à mon sens, plus le carton proposé sera de
qualité, plus le spectateur aura l'impression d'être
réellement pris en considération. Ne pas voter n'empêche
pas d'assister au spectacle ; et cela peut même être un choix. Il
m'est arrivé plusieurs fois de m'abstenir de voter tant j'étais
indécis par rapport au choix de l'improvisation que j'avais le plus
appréciée. Mais le fait de l'avoir à disposition permet de
profiter réellement du match : après un entracte, j'ai
découvert une fois que mon carton avait été
dérobé ou que je l'avais égaré. Et c'est une
sensation désagréable de ne pas pouvoir voter pour les
improvisations.
Par ailleurs, il est d'une importance capitale d'avoir des
cartons de bonne qualité afin que la voix du spectateur soit clairement
et visible, et cela facilite grandement la tâche de l'arbitre et de ses
assistants, soit pour déterminer la couleur majoritaire, soit pour
compter le nombre de cartons lorsqu'une couleur majoritaire n'apparaît
pas au premier regard.
Catch (nm)
Christophe Tournier effectue une comparaison entre la match
d'improvisation et le catch d'improvisation dans le Manuel d'improvisation
théâtrale :
Il existe naturellement beaucoup d'analogies entre le match
d'improvisation et le catch. Cette fois, elle est poussée au maximum
pour créer ce format de jeu compétitif [...], deux équipes
de deux joueurs s'affrontent sur un ring en plusieurs parties
improvisées. Le spectacle est rythmé par de courtes
improvisations 174
Cette analogie me semble à nuancer par rapport à
l'enjeu du spectacle : Corentin Vigou, lors d'un entretien
réalisé le 09 Avril 2018, me disait que « le match d'impro,
c'est très cadré et très codifié [...] tout est
fait dans le match d'impro en fait pour tirer le meilleur parti des
comédiens [...] l'exercice du catch ne tire pas les comédiens
vers la construction d'improvisation »175 car il n'y a aucun
règlement qui régit le catch. Le catch repose sur un autre
cérémonial que le match : la patinoire devient un ring, et
l'arbitre n'a pas de faute à siffler. Il est donc privé des
conventions qui lui permettent d'argumenter son évaluation des
improvisations. Ses décisions peuvent paraître plus subjectives et
sa légitimité peut être plus facilement remise en cause.
Le cadre et le rituel plus minimalistes suppriment certains
garde-fous qui facilitent le travail de l'improvisateur en match : avant un
catch, les joueurs auront préparé en amont des duos de
personnages. Bien qu'il existe également une bande symbolisée par
les cordes qui délimitent l'aire
174 Christophe Tournier, op.cit., p. 98.
175 Entretien avec Corentin Vigou, 09 Avril 2018.
de jeu, les joueurs continuent à jouer la
comédie en dehors du ring. Cela, à mon sens, incitera les joueurs
à cabotiner en dehors de l'aire de jeu, et donnera moins de valeur
à ce qu'ils pourront produire ; ils ne consacrent pas uniquement leur
énergie à l'improvisation qu'ils offriront au public. Un catch
peut donc devenir rapidement éprouvant.
Le costume et l'identité du personnage étant
soumis à la libre fantaisie des joueurs, cela brouille également
la réception du spectateur : le maillot de hockey étant
abandonné, la frontière est mince entre le personnage
incarné par l'improvisateur et le personnage en jeu. Il peut être
aisé de comprendre que ce personnage incarné soit galvanisant
pour le public au début du spectacle, mais le fait qu'il l'abandonne
pour en jouer un autre dans une improvisation me semble incohérent. Il
est également à souligner que, dans ce cadre, les joueurs ont
droit aux accessoires pour habiller leurs personnages, qu'ils peuvent utiliser
lors des improvisations.
Corentin Vigou estime que le catch est très utile pour
le joueur, dans le sens où il l'aide à développer sa
spontanéité176 ; c'est pour cela que le caucus est
absent de ce format. On parlera alors bien plus de joutes et, pour
éviter de lasser un public qui vient voir davantage des improvisations
à base de phrases-choc faites pour marquer et de répliques
courtes, le rythme est intense à gérer pour l'arbitre. Le
décorum et le cérémonial étant plus légers,
cela fait moins d'éléments qui permettent au match de
s'articuler, avec des moments définis pour une improvisation ou pour une
explication. Je comprends que le catch soit un outil pour aider l'improvisateur
à développer sa spontanéité - à condition
qu'il résiste aux tentations de cabotinage- mais j'ai toujours eu des
difficultés à y éprouver une satisfaction en tant que
spectateur.
91
176 Idem.

92
Un ring de catch d'improvisation. Photographie par le Groupe
d'Improvisation du Terril, prise lors d'un catch opposant le Groupe
d'Improvisation du Terril à la Compagnie Amandoise d'Improvisation,
disponible sur
https://www.facebook.com/improGIT/photos/a.319582521423495/1994996480548749/?type=3&theater
[consulté le 16/05/2019].
Je saluerai néanmoins l'accessibilité que ce
format offre aux ligues amateurs : il est bien plus aisé de construire
un ring que de se procurer une patinoire.
Par ailleurs, l'effectif étant réduit, la
disponibilité des joueurs et moins problématique : il suffit de
quatre joueurs, d'un arbitre et d'un maître de cérémonie.
L'absence de règlement peut également permettre à de
jeunes joueurs de faire rapidement leurs armes. Faire du catch une
première expérience d'improvisateur me semble cependant inciter
au cabotinage et à la facilité. Il sera plus difficile par la
suite de comprendre tout l'enjeu du cérémonial d'un match, et de
comprendre la légitimité d'un règlement.
93
Catégorie:(nf) :
« Contrainte imposée à une improvisation.
»177
Je nuancerai ici l'utilisation du mot « contrainte
», bien qu'une catégorie n'imposant aucune particularité soi
appelée « catégorie libre » : il s'agit, à mon
sens, davantage d'offrir un cadre à un joueur qui pourra l'aider
à structurer son improvisation et à nourrir son imaginaire durant
le caucus. Bien que plusieurs classifications de ces catégories
existent, je crois que, selon la pensée du maître de
cérémonie (dans un format cabaret) ou de l'arbitre, de nouvelles
catégories se créent chaque jour. A ma dernière
restitution d'atelier avec Impro Academy en Décembre 2018, où je
jouais un format cabaret, notre professeur nous avait prévenu qu'aucune
catégorie ne serait imposée. Cette information avait
divisé : un de mes camarades défend l'idée, et il me
semble, à juste titre, qu'une catégorie permet au public de
connaître le cadre de la prochaine improvisation et de créer une
attente. Elle peut donc être motrice de sa curiosité, et, selon sa
difficulté, pourra créer une réelle complicité avec
le joueur. Une improvisation réussie est également une
improvisation pendant laquelle les joueurs ont su prendre des risques.
Il incombe soit au maître de cérémonie
soit à l'arbitre de doser judicieusement la nature des catégories
pour qu'un spectacle soit équilibré. Un procédé a
alors été mis en place quant au dosage des différentes
catégories d'un match, que Jean-Baptiste Chauvin rapporte dans Le
match d'improvisation théâtrale : « la pratique veut
qu'il y ait une proportion de deux tiers de thèmes à
catégorie libre et un tiers de thèmes à catégorie
imposée »178.
Au regard de mes lectures, il apparaît que les
catégories puissent être classées en trois groupes :
1) Les catégories avec une contrainte formelle. Elles
imposent de façon arbitraire un élément de jeu aux
improvisateurs. Jean-Baptiste Chauvin et Christophe Tournier en
établissent six :
-sans parole
-silencieuse
-chantée
-avec accessoire
-poursuite (ou double poursuite)
-musicale
177 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 254.
178 Ibid., p. 68.
94
Certaines de ces catégories mériteraient une
définition plus approfondie, mais l'essentiel à retenir est que
ces contraintes formelles permettent au joueur de démontrer sa
virtuosité et d'offrir au public un spectacle varié. En match, le
non respect de la catégorie est une faute sanctionnée ; car elle
apparaît comme un refus de jeu de la part de l'improvisateur, ou au moins
un refus de prendre des risques. Elles facilitent également
l'écoute entre improvisateurs, leur permettant de partager des codes
formels communs.
2) Les catégories d'échauffement, qui sont
majoritairement utilisés en cabaret. Elles sont moins au service d'une
narration que de l'improvisateur lui-même, lui permettant
d'exécuter une improvisation avec une contrainte légère.
Les improvisations exécutées avec ces catégories sont
généralement assez courtes pour permettre de lancer ou de
relancer une dynamique de spectacle. Il est difficile, voire impossible de les
énumérer de façon exhaustive, car elles évoluent de
concert avec la pédagogie de l'improvisation théâtrale
enseignée. Je me permettrais donc de donner ici quelques exemples de
catégories qui me semblent être le plus illustratives. La
définition donnée sera également très personnelle
:
carré hollandais : quatre improvisateurs forment
un carré ou une autre figure géométrique selon leur
nombre. L'essentiel est que deux improvisateurs soient présents en
avant-scène en permanence. Au coup de sifflet, ils vont se mettre
à improviser ensemble sur un thème donné. Au second coup
de sifflet, les improvisateurs changent de place dans le sens horaire, ce qui
donner lieu à une nouvelle improvisation (sur le même
thème). L'improvisation continue pendant plusieurs tours, permettant aux
improvisateurs de retrouver plusieurs fois le même partenaire et de faire
évoluer une intrigue. Chaque passage est rapide pour permettre à
tous les improvisateurs d'avoir une certaine visibilité. Le maître
de cérémonie imposera un rythme de plus en plus rapide à
chaque improvisation jusqu'au coup de sifflet final.
Radio : le public va donner un nom de radio à
chaque improvisateur (avec une thématique différente). Il vaut
mieux pour les comédiens que le public invente un nom de radio pour lui
permettre d'explorer un certain imaginaire. Il n'y a pas de faute en cabaret,
mais un cliché plombe très facilement une improvisation.
95
Il est encore une fois question de rythme : c'est le
maître de cérémonie qui devra être assez habile pour
distribuer équitablement le temps de parole aux improvisateurs en
variant les sujets (débat, programme d'information, chansons...), la
catégorie « zapping » peut en être une variante.
Quatre (à ajuster selon le nombre d'improvisateurs)
manières de : le public donne une action simple à accomplir,
et chaque improvisateur l'exécutera de façon différente.
Un cérémonial tacite me semble ici être mis en place : il
est de coutume que les improvisateurs commencent tous de dos, pour ne pas voir
le passage des partenaires. Ils peuvent se mettre face public une fois leur
passage effectué. La compétition ne se fait pas sur le mode du
« renchérissement » comme dans d'autres formes (ex : danses
urbaines).
Peau de chagrin : La même improvisation sera
jouée plusieurs fois, sur un délai de plus en plus réduit.
Le rythme qui s'accélère permet de redynamiser le spectacle, mais
il arrive également qu'il soit utilisé en match ; cette
catégorie faisant appel à plusieurs des ressources du
comédien : il lui faut naturellement une bonne gestion du temps, et
devra déterminer, lors du premier passage, quels ont étés
les éléments-clés ayant permis de faire avancer l'intrigue
pour les reproduire dans la version plus courte.
Cette catégorie a l'avantage d'offrir une
première improvisation de qualité, puis de permettre à
l'improvisateur un jeu de plus en plus débridé ou singulier. Au
fur et à mesure des passages, la construction narrative ne sera plus
l'enjeu principal, mais la capacité du comédien à se
renouveler ou à varier dans un temps court ; c'est pourquoi cette
catégorie arrive souvent en fin de spectacle.
3) Les catégories de style (aussi appelées
« à la manière de »), dont Christophe Tournier
établit une liste qu'il dit « exhaustive »179, et
qui sont selon Jean-Baptiste Chauvin « déclinables à
l'infini »180, font appel aux références
culturelles communes aux acteurs et à la salle : on convoque un auteur,
une personnalité, un cinéaste ou un genre
cinématographique existant. Certains codes connus de tous permettent
d'accroître la complicité des joueurs et de la salle. Mais cette
catégorie peut permettre également à un joueur de briller
de façon individuelle, la culture générale étant
indissociable de la culture personnelle. Il montre sa capacité à
prendre le lead* s'il maîtrise la catégorie, et doit donc
soigner ses propositions si son partenaire d'en
179 Christophe Tournier, op. cit., p. 88-89.
180 Ibid., p. 69.
96
face n'a pas la même perception du « style »
convoqué, ou s'il lui est totalement inconnu. Il devra, dans ce cas,
être très habile dans son écoute.
Caucus:(nm)
« Terme venant de l'anglais et désignant le temps
de concertation donné aux équipes avant l'entrée en jeu.
»181 En anglais, « caucus » désigne à
l'origine une réunion à huis clos.
Telle est la définition donnée par Jean-Baptiste
Chauvin. Voici celle que Christophe Tournier donne dans Le Manuel
d'improvisation théâtrale :
Ce conciliabule est une séance de « brainstorming
» d'une vingtaine de secondes. Le joueur qui a la plus forte conviction
propose son idée. Les joueurs valident cette idée, sous
l'égide du coach. Les joueurs effectuent un inventaire de tout ce que
leur évoque le thème. Ils mettent en place les associations qui
pourront par la suite les aider à dynamiser ce
thème.182
J'ai rencontré et joué avec certains
improvisateurs qui boudaient la pratique du caucus. Je leur donnerai volontiers
raison s'ils se focalisaient sur cette dernière définition. Elle
donne en effet peu de place à la spontanéité et
n'encourage pas la prise de risques. Décréter une idée
meilleure qu'une autre peut frustrer un joueur si son idée est
refusée et est donc nuisible pour l'esprit d'équipe.
Cependant, le manque d'inspiration peut priver un joueur
d'avoir une idée, pertinente ou pas. La « plus forte conviction
» appartiendra donc au joueur qui lancera son idée en premier. Il
n'y a pas de temps propice à en débattre de la pertinence de
cette idée. Une fois que l'idée est sélectionnée,
tout le principe du caucus consistera à s'entendre sur la façon
de lui donner forme sur scène. Corentin Vigou parle de P.A.L (pour
(personnage, Action, Lieu) ou, de façon plus humoristique - et donc
pédagogique - le S.L.I.P (pour Situation, Lieu, Intention,
Personnage).183
S'obliger à fournir ces informations permet d'avoir un
caucus organisé, et les joueurs n'ayant pas fourni l'idée peuvent
alors y participer, ce qui garantit un équilibre quant à la prise
de parole.
La difficulté de définir
précisément cette pratique est soulignée par Jean-Baptiste
Chauvin :
« Il n'y a donc pas de recette pour que le caucus soit
profitable, il faut juste prendre conscience de l'objectif commun qui consiste
à donner au joueur qui va se lancer dans la patinoire, la confiance,
l'énergie et les quelques éléments qui lui permettront de
construire le match avec l'autre joueur »184
181 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 254.
182 Christophe Tournier, op. cit., p.56.
183 Entretien avec Corentin Vigou, 09 Avril 2018.
184 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit., p. 167-168.
97
Corentin Vigou dit souvent qu'un bon caucus commence par cette
phrase : « Ok, qui y va ? ». La première énergie est en
effet l'inspiration et l'envie. Ainsi, un joueur qui se sent inspiré par
le thème et la catégorie, et qui manifeste son envie d'entrer sur
la patinoire commencera avec une énergie positive. C'est ainsi que nos
caucus se sont déroulés le 09 Mars 2019, lors d'un match contre
la Licoeur de Bordeaux : Une fois le thème énoncé, celui
ou celle qui se sentait inspiré nous disait « J'ai envie d'y aller
». C'est ensuite à ses partenaires de lui fournir des
éléments pour constituer son SLIP. De cette façon, la
construction de l'improvisation reste équilibrée et demeure un
travail d'équipe : cela incite le joueur à prendre de la distance
grâce à une idée qui ne sera pas la sienne, sans pour
autant lui retirer son énergie.
Les joueurs se mettent également au service d'une bonne
improvisation lorsqu'ils laissent la place à ce joueur, même si
certains peuvent se sentir frustrés de ne pas jouer, soit parce que la
catégorie leur tenait à coeur, soit parce qu'ils ne sont pas
entrés depuis longtemps sur la patinoire ou autre. Mais un joueur qui
n'est pas sur la patinoire reste actif et attentif pour intervenir si besoin.
Par ailleurs, le coach notifiant les passages de chacun de ses joueurs, un
équilibre au niveau du rythme et du temps de passage de chacun peut
être trouvé. Un coach attentif dira à un joueur qui n'est
pas entré depuis plusieurs improvisations « à la prochaine,
tu y vas ».
Coach :
« Personnage censé donner des idées pendant
le caucus »185
Corentin Vigou m'a dit une fois que le coach était un
sixième joueur. Que ce soit en match ou en cabaret, il exerce son
rôle bien au-delà du temps de caucus : il a une fonction de
médiation au sein de l'équipe durant tout le spectacle. Son
équipement parfait est un chronomètre ainsi qu'un bloc-notes un
stylo pour faire sa propre feuille de match et faire un état des lieux
du match selon l'évolution de celui-ci. Bien qu'il soit possible, en
cabaret, qu'une équipe puisse s'auto-gérer et se passer du coach,
il me semble bénéfique de pouvoir s'appuyer sur un regard
extérieur et donc plus objectif. J'en appelle, pour illustrer mes
propos, à une expérience de joueur qui fut regrettable en Juin
2018 avec mes camarades de chez Impro Academy : la même équipe que
le précédent cabaret en Décembre 2018 avait
été réunis, et nous avions étés
confortés par la qualité de notre prestation
précédente. Cela nous avait mis dans un certain état de
confiance, et même procuré une envie de prendre davantage de
risques pour ce nouveau spectacle. Le résultat n'a pas été
à la hauteur de nos espérances, et la majorité de nos
improvisations étaient de piètre qualité. Ce sentiment de
déception
185 Ibid., p. 255.
98
est apparu environ après les trois premières
improvisations, et a donné le ton à la globalité du
spectacle.
Sans regard objectif, nous avons étés incapables
de nous concentrer sur l'improvisation suivante pour tenter d'en
améliorer la qualité, et nous perdions de précieuses
secondes durant le caucus à débriefer de manière
péjorative sur l'improvisation qui venait de s'achever. Comme nous
sommes encore élèves, le maître de cérémonie
tentait d'occuper le public afin de nous accorder du temps de
préparation supplémentaire ; que nous avions davantage
utilisé à débriefer sur l'improvisation
précédente qu'à en préparer une nouvelle. Le
caucus, dans ces moments-là, devient une épreuve difficile. Au
bout d'un certain temps, à court d'idées pour repousser
l'échéance, le maître de cérémonie nous avait
demandé si les comédiens étaient prêts. Parce
qu'arrive où un moment il faut véritablement se lancer, et parce
que la discussion en cours ne menait à rien de productif, j'avais fait
preuve de maladresse, voire de rudesse, en lui répondant « oui
» J'interrompais alors un de mes camarades qui était en train
d'énoncer une idée ou de débattre de la qualité de
celle qui venait d'être exposée. Ce comportement, en
débriefing d'après-match, m'avait été
reproché par mon équipe à juste titre. Je suis
persuadé qu'un oeil plus distant, et peut-être moins
impliqué affectivement, aurait pu être bénéfique
pour utiliser judicieusement le caucus et faire des improvisations davantage
étoffées.
Le fait d'être distant affectivement des joueurs ne veut
pour autant pas dire refuser tout implication dans le groupe. Être coach
demande en effet de savoir jongler entre les qualités de chaque joueur,
et de répartir équitablement leur temps de passage. Une
complicité entre joueurs et coach me semble donc primordiale.
Cette conviction m'a récemment posé un
problème de conscience ; officiant dans le cadre du trophée
inter-collèges Culture et diversité, Impro Academy organise
régulièrement entre collégiens de la métropole
Lilloise des matchs. Pour l'un d'entre eux, un coach manquait à l'appel,
et j'ai donc répondu présent.
Je ne connaissais aucun des joueurs ; mais toute la
préparation du match, depuis la mise en place des chaises et de la
patinoire jusqu'à l'échauffement, m'a permis de me faire
connaître auprès de l'équipe dont j'avais la charge et donc
d'instaurer une relation de confiance. Les intervenants étant tous
membres d'Impro Academy, il a été aisé de m'entretenir
avec eux pour discuter des modalités du spectacle. Avec cette
première expérience, je rejoins Corentin par rapport à sa
définition du coach, car je me suis senti responsable de la prestation
offerte par l'équipe à laquelle j'appartenais.
99
Lead :
Terme qui vient de l'anglais qui désigne le fait de
conduire, de guider. Dans un spectacle d'improvisation, on dit d'un joueur
qu'il prend le lead lorsqu'il prend une initiative qui va donner une piste aux
partenaires à propos du lieu de l'action, des personnages
proposés, ou qui apporte un nouvel élément permettant le
développement d'une histoire. Dans une improvisation construite avec une
grande écoute, plusieurs joueurs prennent le lead à tour de
rôle.
Réserve (nf) :
Désigne un espace de l'aire de jeu dans lequel aucune
improvisation ne se déroule. Dans un match, les joueurs ne peuvent plus
quitter la patinoire, et se mettent donc en réserve, à l'abri de
regards du public, lorsque leur personnage a fait une sortie ou qu'il y a eu
une bascule. Dans un format cabaret, la réserve est également ce
qui fait office de coulisses pour les improvisateurs. Ils se mettent sur un
côté de la scène lorsqu'ils ne sont pas en jeu, et c'est
également l'endroit dans lequel ils se concertent pour leur caucus.
Staff :
Inspiré du mot anglais qui signifie « personnel
». Dans un spectacle d'improvisation, le terme désigne l'ensemble
des joueurs faisant partie du spectacle mais qui ne jouent pas les
improvisations. Sont membres du « staff » les comédiens qui
construisent le cadre du spectacle, tels le maître de
cérémonie, le musicien, ainsi que l'arbitre et les
assistants-arbitres qui sont présents durant un match.
L'histoire de l'improvisation théâtrale en
France, ainsi que les transformations internes dans son fonctionnement,
démontrent une évolution de la discipline : au fur et à
mesure des usages et des cultures, le règlement a été
modifié, et le langage s'est enrichi avec la création de nouveaux
formats. Analyser le paysage de l'improvisation théâtrale dans les
Hauts-de-France permettra d'analyser l'influence de ces
évènements sur la pratique actuelle. Une étude de cas des
structures les plus représentatives permettra de relever et de tenir
compte des spécificités de ces compagnies, selon leurs
organisations internes et leurs origines.
100
III) Paysage et évolution de l'improvisation
théâtrale dans les Hauts-de-France
« Des ligues amateurs qui sont liées à une
ligue professionnelle, il y en a eu partout »186.
Jean-Baptiste Chauvin
Depuis que les ligues amateurs ont conquis une forme
d'autonomie dans les années 90, les relations entre ligues amateurs et
professionnelles sont faites de liens dont il est difficile de
déterminer la nature précise. J'ai pu observer, par mon
expérience et mes recherches, ce phénomène dans la
région Hauts-de-France. La concentration des structures sur un seul et
même territoire provoque, au fur et à mesure du temps, des
rapprochements - parfois ponctuels, parfois durables - davantage entre les
improvisateurs qu'entre les différentes ligues et compagnies. La
multiplication des ligues est due, depuis la disparition de l'AFLI et de la
LIFPRO, à une prise d'autonomie de certains artistes. Le même
phénomène s'est produit dans la Région-Hauts-de-France,
où l'on trouve la Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul,
dirigée par Emmanuel Leroy, et la fédération Lille Impro,
avec Philippe Despature a sa tête.
Avec l'école Impro Academy en son sein, Lille Impro a
fait un pas de plus vers la démocratisation de l'improvisation
théâtrale, en ouvrant une série d'ateliers dans les deux
départements de la Région. Je suis entré dans cette
structure en septembre 2017, en y suivant deux heure d'atelier hebdomadaires.
C'est la curiosité, et l'envie d'approfondir ma pratique, qui m'ont
amené à intégrer le Groupe d'Improvisation du Terril en
septembre 2018.
Les cours qui sont donnés à l'école Impro
Academy forment les élèves à la scène, aux
différents codes des improvisateurs, et aux différents rituels
des spectacles d'improvisation. L'école n'étant pas une ligue,
certains des élèves, au bout de quelques années, qui
souhaitent consolider leur expérience d'improvisateurs, tentent de
rejoindre une ligue déjà existante ou créent une ligue
à leur tour. En conséquence, il n'est pas rare de croiser des
improvisateurs venus de différentes ligues ou compagnies, mais ayant
reçu une formation chez Impro Academy. C'est, à mon sens, une
bonne illustration de la nature du lien qui unit et réglemente la
pratique de l'improvisation théâtrale de nos jours. C'est ce qui a
rendu complexe le travail de filiation entre les structures.Ce lien
s'étant complexifié avec le temps, il m'a fallu en étudier
l'origine. J'ai donc rencontré différents protagonistes qui ont
créé les ligues d'improvisations les plus influentes dans la
Région : Emmanuel Leroy (ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul), et
Philippe Despature (Scénosphère).
186 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06 Mars 2019.

101
Comédiens de métier, ils exercent aujourd'hui
l'improvisation théâtrale aux côté de nombreuses
ligues amateurs. J'ai pu m'entretenir avec des membres des deux plus anciennes
; Maxime Curillon et Florine Sachy, qui sont membres du bureau du Groupe
d'Improvisation du Terril, et Arthur Pinta, président de la Ligue
d'Improvisation Lilloise Amateur.
Ces ligues amateurs sont, conformément aux propos de
Jean-Baptiste Chauvin, issues des formations données par les
professionnels de la ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul.
|
La Ligue d'improvisation de Marcq-en-Baroeul- 1992
Emmanuel Leroy
|
|
La Compagnie trompe- l'oeil- 1994 Philippe
Despature
|

|
La Décade-1995
Groupe d'Improvisation du Terril depuis 2010 Maxime Curillon et
Florine Sachy
|
La Ligue d'Improvisation Lilloise Amateur - 1998
Arthur
Pinta

Les improvocateurs
Les improlocos
Les George Clownettes
|
La Scénosphère
Philippe Despature
|
|
Impro Academy Philippe Despature
|
|
La Ligue Royale de Strandovie Corentin Vigou
|
|
Les imprononçables
|
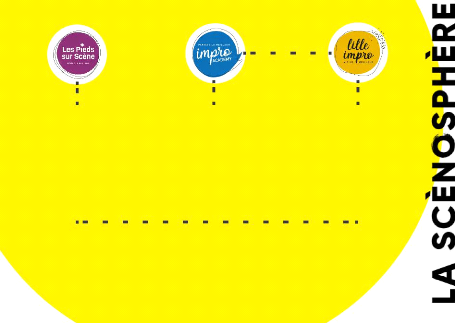
ALICIA LANDSCHOOT
Ingénieure de formations
JULES GUILLEMETTE
Ingénieur d'affaires
FRANÇOIS SAMIER
Gérant -
Commercial
PHILIPPE DESPATURE
Réf.
pédagogique &
artistique
JULIEN DESROUSSEAUX
Référent Scolaires
MAXIME GALLOT
Référent
Particuliers
L'INSTANT T
LAURA PAVARD
Chargée de communication
FLORENCE DOMEDE
Chargée de diffusion
102
Organigramme de la Scénosphère, dans les
Hauts-de-France. Image appartenant à la Scénosphère.
103
III.1 : le paysage actuel de l'improvisation
théâtrale dans les Hauts-de-France
La Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul est actuellement
composée de plusieurs comédiens qui ont étés
formés avec le théâtre-école, puis de
comédiens professionnels qui sont venus renforcer ses rangs avec le
temps.
Lorsqu'il était à la tête de l'Association
Française des Ligues d'Improvisation, Emmanuel Leroy a pu prendre
conscience des problématiques qu'impliquait la cohabitation entre
amateurs et professionnels, et des différents conflits qui opposaient
les improvisateurs. Cette expérience l'a conduit à construire sa
méthode de recrutement : plusieurs membres actuels de la ligue ont
étés membres pendant un temps du Groupe d'Improvisation du
Terril. Il arbitrait et assistait à certains de ces matchs, ce qui l'a
amené à contacter certains membres de la troupe pour
intégrer la ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul :
Et c'est comme ça qu'il a approché Greg,
Gérémy, Nicolas Tavernier, Audrey Boudon187... il a
approché beaucoup de joueurs du GIT - qui étaient
déjà des comédiens professionnels - à qui il a
proposé de rejoindre la ligue de Marcq ; ou des non professionnels
à qui il a proposé de devenir pros. Donc on s'est
retrouvés pendant plusieurs années avec des comédiens de
la Décade qui étaient dans la ligue de Marcq. Donc oui, il y
avait des liens très forts. 188
Il entretient depuis des relations sporadiques avec les
compagnies amateurs, pour des stages de formations afin de les laisser «
partir dans d'autres directions »189, et recrute
désormais uniquement des artistes professionnels. Les journées de
recrutement auxquels sont convoqués des professionnels souhaitant
intégrer la compagnie sont qualifiées de « stages-auditions
»190 . Philippe Despature, resté pendant dix ans dans la
ligue, avant de créer la Scénosphère, a été
recruté pendant qu'il était en phase de professionnalisation,
dans les années 90. Le point commun entre ces deux hommes se trouve dans
leur rencontre avec l'improvisation théâtrale : Philippe Despature
a également un parcours de comédien amateur avant de se
spécialiser dans l'improvisation. Il connaît ses premières
expériences de spectateur d'improvisation grâce aux matchs juniors
qu'Emmanuel Leroy a mis en place depuis 1984 au Théâtre-Ecole de
Marcq-en-Baroeul. C'est lors d'un stage d'improvisation en 1990 qu'il effectue
son premier match. En parallèle de ses activités amateurs, il se
professionnalise
187 Gregory Allays, Gérémy Credeville, Nicolas
Tavernier et Audrey Boudon sont des anciens membres du Groupe d'Improvisation
du Terril, qui ont étés par la suite joueurs à la Ligue
d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul.
188 Entretien avec Maxime Curillon et Florine Sachy, 28
Février 2019.
189 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
190 Idem.
104
en devenant lui-même formateur pour l'Union
Française des Cadres des Vacances, et crée en 1994 l'Association
Trompe-l'oeil pour donner ses propres ateliers d'improvisation
théâtrale. La structure existe encore de nos jours. C'est devenu
une ligue amateur. Elle était à l'époque de sa
création une des seules structures à proposer l'improvisation
théâtrale à l'extérieur de la ligue professionnelle
: « À l'époque il y avait Trompe-l'oeil en ligue amateur,
Marcq-en-Baroeul et la Décade, qui est devenue le GIT. C'était
à peu près tout, ça a bien changé ! »191
En 1998, le territoire des Hauts-de-France s'équipe
d'une nouvelle troupe avec la fondation de la Ligue d'Improvisation Lilloise
Amateur. Tout comme la Décade, crée en 1995 puis devenu le Groupe
d'Improvisation du Terril en 1998, cette association d'origine étudiante
se forme aux côtés de professionnels. A l'occasion d'une rencontre
informelle avec un de ses membres, Marc Cavignaux, j'ai appris que
c'était Laurent Dubois, un membre de la Ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul, qui a oeuvré à la construction de cette ligue.
Le Groupe d'Improvisation du Terril, parce qu'il mêle comédiens
amateurs et professionnels, a une réputation de troupe
semi-professionnelle. Pourtant, Arthur Pinta, qui a découvert
l'improvisation théâtrale dans des ateliers au collège,
désirait au départ en faire une formation qui cadre davantage
avec la pratique d'un loisir. Il s'est donc dirigé vers la Ligue
d'Improvisation Lilloise Amateur. Il en est le président depuis 2017.
Les amateurs dans les années 90 ont inventé des
formats qui les affranchissaient de la pratique originelle prônée
par les professionnels. J'ai voulu en savoir plus auprès de ces
protagonistes pour savoir quelle était leur vision de l'improvisation,
et quel était leur ambition par rapport aux spectacles qu'ils
produisaient. Mon point de départ était cette phrase d'Emmanuel
Leroy :
Je pense qu'il y a des comédiens amateurs qui ont
laissé tomber un peu la rigueur et l'esprit du match. Au niveau de la
ligue, on a contribué à la formation d'un certain nombre de
comédiens amateurs. Pendant des années - ce qui n'est plus le cas
- on a été les garants de la qualité de la mise en
scène du match. Il y a des ligues amateurs qui ont une vraie envie de
faire de la qualité, qui s'entraînent, qui se forment, qui
demandent des conseils, qui viennent voir les spectacles professionnels... donc
il n'y a pas d'opposition entre les amateurs et les professionnels, il y a
simplement des amateurs qui partent dans d'autres directions.192
191 Entretien avec Philippe Despature, 25 Mars 2019.
192 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
105
Les spectacles qui utilisent l'improvisation comme moteur ont
tous comme origine le match. C'est pourquoi Jean-Baptiste Chauvin insiste sur
la nécessité de garder l'esprit d'origine. Il a néanmoins
été démontré, notamment grâce au catch, que
le cadre qui entour le match d'improvisation théâtrale peut
être transposé à une nouvelle forme de spectacle.
Cependant, les comédiens qui composent le staff de chaque spectacle
doivent une conscience solide quant au déroulé et doivent
être capables d'assumer les fonctions de chauffeur de salle, d'arbitre,
ou de relais entre joueurs et public pour qu'un spectacle reste de
qualité.
C'est pourquoi j'ai choisi d'analyser l'organisation interne
des troupes que j'ai pu approcher, soit par une participation active pour le
Groupe d'Improvisation du Terril et la Scènosphère, soit en
m'entretenant avec certains de leurs membres pour la Ligue d'Improvisation
Lilloise Amateur.
Pendant une certaine période, les troupes
fonctionnaient de manière similaire pour sélectionner les
joueurs. En plus d'un bureau, dont la présence est obligatoire dans une
association de loi de 1901, elles avaient dans leur structure un comité
de Sélection baptisé « Comité Artistique »
chargé de sélectionner les joueurs pour leurs différents
spectacles. L'improvisation théâtrale attirant un public de plus
en plus important, il est difficile pour des amateurs de les
sélectionner uniquement sur un critère de qualité de jeu.
En revanche, l'organisation d'un match d'improvisation demande un grand staff
ainsi qu'une grande synergie. Peu d'amateurs, qui ont eu l'envie de pratiquer
l'improvisation théâtrale en assistant pour la première
fois à des spectacles, sont conscients de cette problématique et
veulent obtenir rapidement une place au centre de la scène ou de la
patinoire. Cette problématique de garantir un équilibre entre la
vie artistique et la vie associative conditionne les différentes
façons de procéder en termes de recrutement des membres.
La pratique de l'improvisation théâtrale
s'étant démocratisée, les troupes ont un fonctionnement
parfois similaire, parfois différent. J'ai choisi d'analyser cette
organisation par rapport aux différentes méthodes de recrutement,
à la sélection des joueurs et la pratique de l'improvisation au
sein de chaque troupe, puis à l'organisation des spectacles et
l'invention de nouveaux formats. Au terme de cette étude, les points
communs et les différences relevées permettront de
déterminer quels sont les aspects de l'improvisation
théâtrale qui ont évolué en quarante ans, et
pourquoi d'autres aspect ont conservé leur origine.
106
III.2 : les méthodes de recrutement des troupes :
des différences selon les origines
Chaque troupe a une méthode de recrutement
spécifique qui s'est construite par rapport à l'histoire de sa
création et de son évolution. Je me permettrai de
détailler, avec l'accord des personnes concernées, la
méthode du recrutement du Groupe d'Improvisation du Terril, à
laquelle je me suis moi-même prêté. En discutant de ce sujet
avec les protagonistes, je découvre qu'elle a évolué en
fonction des transformations internes de la troupe. Je détaillerai
ensuite la méthode de recrutement de La Ligue d'Improvisation Lilloise
Amateur, qui, en raison du nombre élevé de ses membres, doit
procéder d'une autre manière. Un troisième cas
étudié sera celui de la Scénosphère, qui offre
à ses membres l'occasion de pratiquer l'improvisation sous plusieurs
formes, y compris en-dehors du domaine artistique.
Le processus de recrutement au sein du Groupe d'Improvisation
du Terril s'est déroulé sur une journée entière, en
Septembre 2018. Chaque personne qui souhaitait y participer manifestait son
souhait par mail au bureau, qui, par retour, validait ou non cette
participation. Cette journée était consacrée à un
premier contact avec les membres du bureau et les formateurs, et
également à pratiquer un ensemble d'exercices qui permettaient de
découvrir les différents aspects de l'improvisation
théâtrale. Le point de départ a été une
série d'échauffement ludiques pour évoluer progressivement
vers des exercices de construction d'une histoire, ainsi que de construction et
d'incarnation de personnages. La troupe accueillant des personnes qui peuvent
être extérieures au domaine de l'improvisation
théâtrale, la méthode leur permet d'avoir un aperçu
de ce qu'est la discipline.
Cette méthode de recrutement a été
utilisée pour la première fois en 2013. Auparavant, la troupe
fonctionnait comme une bande d'amis - ce qu'elle est à l'origine. Les
relations que la troupe entretenait avec Emmanuel Leroy ont cependant fait
évoluer la méthode de recrutement. Cette évolution, dans
les circonstances, est directement liée à l'évolution de
l'improvisation en elle-même, et à la séparation entre
amateurs et professionnels qui a été opérée.
Florine Sachy, actuelle secrétaire, et Maxime Curillon, actuel
président, me racontent que jusqu'à cette date, le recrutement se
faisait via un système de cooptation. C'était des connaissances
des membres qui étaient acceptés au sein de la troupe. Cette
méthode a fini par se heurter à un obstacle :
107
Mais du coup, l'association ne se renouvelait pas beaucoup :
on n'était qu'entre nous, et on se sentait du coup plus ou moins
obligés de dire « oui » quand quelqu'un ramenait une personne,
parce qu'ils étaient amis. Même si on sentait que ça
n'allait pas forcément fonctionner, on ne se sentait pas de dire «
non ».193
Le fait que ce soient des connaissances des membres du
Comité Artistique, qui ont un lien fort avec la ligue professionnelle,
peut fermer ses portes à d'autres personnes souhaitant découvrir
l'improvisation théâtrale.
Le jour du recrutement, le fait de prendre la journée
entière permettait à chaque candidat d'évoluer dans une
atmosphère durable, reflétant la vie au sein de l'association. Le
groupe d'Improvisation du Terril privilégie avant tout cet état
d'esprit pour que la troupe puisse perdurer :« En-dehors du jeu, ce qu'on
va évaluer, c'est l'esprit de troupe dont la personne fait preuve.
»194 L'accent mis sur la vie associative permet à la
troupe de se construire une identité propre, ce qui ne pouvait
être possible quand ceux qui y entraient étaient uniquement des
connaissances des fondateurs ou des membres. Cela participe également
à renouveler les activités de la troupe : lorsque ceux qui y
entrent n'ont pas de parcours professionnel, ils peuvent apporter une
idée plus neuve de l'improvisation théâtrale. Cette
méthode de recrutement est également révélatrice
des valeurs de la pratique de l'improvisation théâtrale : tout
comme le match d'improvisation a démontré l'intérêt
d'être enseigné dans le domaine social, les exercices
d'improvisation auxquels nous nous sommes prêtés permettaient de
déterminer comment ils pouvaient se comporter lorsqu'ils devaient
composer une scène avec un partenaire inconnu, ou de déterminer
ce qu'ils choisissent de démontrer en construisant des personnages.
Á la différence du Groupe d'Improvisation du
Terril, La Ligue d'Improvisation Lilloise Amateur a conçu en son sein
une série d'ateliers permettant aux adhérents de
s'entraîner à l'improvisation théâtrale. Ils sont
dispensés par les adhérents les plus anciens et les plus
expérimentés, ou par des improvisateurs professionnels de
façon sporadique. Á l'issue de ces ateliers, selon les niveaux
auxquels les adhérents se sont inscrits, ils jouent un spectacle de fin
d'année en guise de restitution d'ateliers. C'est également ainsi
qu'Impro Academy fonctionne : les cours sont ouverts à tous, avec un
spectacle format cabaret en fin d'année.
La raison pour laquelle ces structures utilisent des
méthodes de recrutement peut s'expliquer selon la vision de
l'improvisation théâtrale propre à chacune d'entre elles,
et également des individus qui les ont fondées. Ainsi, Emmanuel
Leroy a fixé comme condition obligatoire que ceux qui postulent
193 Entretien avec Maxime Curillon et Florine Sachy, 28
Février 2019.
194 Idem.
108
à la Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul soient
en cours de professionnalisation ou évoluent dans un parcours
professionnel au moment où ils postulent. Par rapport à la
scission vécue entre amateurs et professionnels, c'est l'enseignement
qu'Emmanuel Leroy a reçu de l'improvisation qui peut expliquer ce choix
: au moment où il était l'un des premiers français
à s'essayer au match d'improvisation théâtrale, il
évoluait au milieu de comédiens professionnels. Il tient donc,
comme les autres ligues professionnelles, à perpétuer cette
vision de l'improvisation théâtrale qu'il a reçue. Il a
été également été rappelé que les
membres du staff et les joueurs avaient une grande responsabilité quant
à la mise en scène et à la qualité de jeu. Il
s'agit de comédiens étant habitués aux enjeux d'une
scène. Simon Fache rappelle également que « comédien,
c'est un métier, une formation. Et tout le monde ne peut pas jouer dans
un Molière195. Enfin si, tout le monde peut : il faut une
formation »196. Philippe Despature , de la
Scénosphère, défend cette approche :
J'en vois beaucoup qui disent « on va faire de l'impro
style Shakespeare, mais ce ne sera pas forcément Shakespeare », il
y en a plein qui n'ont jamais lu Shakespeare, et qui vont ensuite t'expliquer
comment faire une bonne [improvisation à la manière de]
Shakespeare. Non : ils vont t'expliquer comment faire une Shakespeare qui va
faire rigoler les gens, ça d'accord. Il y a une différence entre
faire une impro à la manière de Shakespeare et faire un
Shakespeare.197
Comédien de métier, Philippe Despature fait donc
une distinction précise entre le théâtre et l'improvisation
théâtrale. Á ses yeux, l'improvisation
théâtrale reste néanmoins accessible à tous, parce
qu'elle est avant tout récréative.198 Il a donc a
choisi de développer ses propres ateliers dans la structure Trompe
l'oeil, qui sont eux ouverts à des amateurs pour apprendre
l'improvisation.
Il a quitté la ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul en 2006. La plupart des protagonistes que j'ai pu
écouter à ce sujet font état d'un différend
personnel entre lui et Emmanuel Leroy. En recontextualisant la querelle, il me
semble que cette séparation est liée à l'histoire de
l'Improvisation théâtrale en elle-même : Emmanuel Leroy, qui
était membre de l'une des rares ligues professionnelles qui occupaient
le territoire à l'époque, a toujours inscrit le match
d'improvisation théâtrale dans un cadre professionnel. Philippe
Despature, quant à lui, a commencé à enseigner
l'improvisation en amateur, avec l'Union Française des Cadres des
Vacances.
.
195 Une catégorie « à la manière de
Molière », qui est une catégorie de style
196 Entretien avec Simon Fache, 27 Février 2019.
197 Entretien avec Philippe Despature, 25 Mars 2019.
198 Idem.
109
Alors que les premières structures qui peuplent de nos
jours la Région sont nées de la Ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul, Impro Academy, en formant des élèves à
la scène et aux codes de l'improvisation théâtrale, a
ouvert la voie à une nouvelle génération d'improvisateurs,
dont l'intérêt pour la pratique s'est consolidé. Cette
génération d'improvisateurs n'a pas connu l'improvisation
théâtrale par l'intermédiaire de professionnels, la plupart
des ateliers étant animés par les élèves les plus
anciens. Ils souhaitent jouer et goûter à la scène, en
supplément des cours qu'ils suivent. La création de ces ligues
s'ajoute à la liste, déjà conséquente, des ligues
amateurs situées dans les Hauts-de-France.
L'improvisation en amateur se pratique dans différents
objectifs ; elle peut s'inscrire dans le cadre d'un loisir - soit avec des
ateliers soit au sein d'une troupe - ou dans une volonté de
perfectionnement. Cette nuance peut être interprétée comme
significative par rapport aux relations entre les amateurs et les
professionnels de nos jours. Emmanuel Leroy résume ainsi cette relation
:
Par contre, comme on a beaucoup de demandes, on organise deux
ou trois journées de stage pour des amateurs par an. Mais on a
décidé de ne pas aller dans cette direction-là de
manière régulière. Aujourd'hui du coup, les relations avec
les amateurs sont plutôt lointaines : on en connaît certains, on
sait que des ligues amateurs viennent nous voir en fonction des spectacles,
mais on n'a pas de relation régulière. C'est à leur
demande : quand ils ont besoin de quelque chose, on
répond199.
Alors qu'Emmanuel Leroy me confiait que les ligues amateurs
formaient leur nouveaux arrivants dans leur giron, les ligues qui ont
étés formées par les professionnels prennent sur elles
d'organiser des ateliers et des formations. C'est pourquoi la Ligue
d'Improvisation Lilloise Amateur a mis en place ses ateliers internes, qui
répondent à un double objectif : ils contribuent à ouvrir
davantage la pratique de l'improvisation, mais constituent aussi un moyen de
sélectionner les improvisateurs qui veulent participer aux
spectacles.
À la différence de la Ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul, le Groupe d'Improvisation du Terril, insiste sur son souci
d'organisation et de compatibilité entre membres, et privilégie
un état d'esprit commun. C'est un des aspects auxquels Florine Sachy et
Maxime Curillon sont très attentifs pendant le processus de recrutement
:
En regardant leur jeu, on essaie de voir s'ils font beaucoup
de clichés, s'ils sont capables de sortir des personnages un peu
originaux et justes, mais on ne va pas regarder un niveau de jeu : quelqu'un
qui s'est planté, qui peut paraître nul ou faire un gros bide
devant un public, ça ne
199 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
110
nous dérange pas. On préfère ça
à quelqu'un qui improvise depuis longtemps mais qui serait bourré
de mauvais réflexes, ce qui sera beaucoup plus dur à
déconstruire.200
Ces deux troupes amateurs des Hauts-De-France se retrouvent
donc dans un processus de recrutement, où l'expérience en
improvisation théâtrale n'est pas considérée comme
une valeur. C'est grâce à des entraînements internes que les
joueurs peuvent ensuite se perfectionner.
La compagnie Trompe-l'oeil a été fondée
par Philippe Despature avant qu'il n'intègre la Ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul. Ce sont les premiers ateliers qui sont donnés au sein
de cette troupe qui favorisent la création de l'école Impro
Academy, pour répondre à une demande de plus en plus importante
:
Á un moment, on crée Impro Academy chez
Trompe-l'oeil, j'en étais encore un peu membre. C'est moi qui ai mis en
place les ateliers dans l'association : par rapport au statut, c'était
plus simple au niveau du bénévolat,
etc. et à un moment il a fallu se
séparer : les gens qui faisaient partie d'Impro Academy pensaient que,
comme ils étaient au nom de Trompe-l'oeil, ils feraient les
Improvisators un jour ; ça crée des frustrations parce que ce
n'est pas forcément le cas. On
essaie de mettre un cadre, mais ce n'est pas clair, donc on se
dit que ça ne marche pas et qu'il faut se
séparer201.
Les deux structures se séparent en 2010. Á ce
jour, les compagnies majeures de la Région ont donc une structure de
formation et une structure de création de spectacles bien distinctes,
à l'exception du Groupe d'Improvisation du Terril. Néanmoins, un
entraînement hebdomadaire est dispensé à ses membres. Cette
organisation permet d'offrir une pratique de l'improvisation
théâtrale tant pour ceux qui y voient un loisir que pour ceux qui
y cherchent un perfectionnement de leur pratique théâtrale. Elles
permettent ainsi aux débutants qui veulent jouer d'avoir une formation.
Le cas de la compagnie Trompe-l'oeil est également
révélateur de ce fonctionnement, et c'est pourquoi la
séparation entre les cours et la troupe a été
nécessaire, afin que la troupe soit composée d'improvisateurs
bénéficiant d'une certaine expérience. C'est
également ce qui encourage la multiplication des troupes sur notre
territoire : les improvisateurs ayant reçu une base par rapport aux
cours peuvent entrer dans des ligues afin de jouer des spectacles ou
créer eux-mêmes une ligue.
La façon dont l'improvisation théâtrale
est envisagée, soit en tant que loisir, soit en tant que
possibilité de perfectionnement, a une influence sur l'organisation
interne de ces ligues. Dans les Hauts-De-France, je distinguerais trois types
de ligues différents :
-une ligue professionnelle (la Ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul)
200 Entretien avec Maxime Curillon et Florine Sachy, 28
Février 2019.
201 Entretien avec Philippe Despature, 25 Mars 2019.
111
-les premières ligues amateurs : la compagnie
Trompe-l'oeil, le Groupe d'Improvisation du Terril et la Ligue d'Improvisation
Lilloise Amateur
-et les ligues qui se sont formées à
l'initiative d'amateurs expérimentés, comme les
Imprononçables - formés par des personnes issues d'Impro Academy
- ou les Improvocateurs - groupe créé par des personnes ayant
fait leur formation à la Ligue d'Improvisation Lilloise Amateur.
Je m'attacherai, pour la suite de ce mémoire, à
analyser les organisations internes de ces compagnies, afin d'étudier
les changements et nuances qui opèrent selon la vision de
l'improvisation théâtrale de chacune de ces compagnies. Je me
focaliserai ensuite sur la structure de la Scénosphère et ses
différentes antennes: l'enseignement avec Impro Academy, les formations
scolaires, sociales et en entreprise avec Les pieds sur scène, ainsi que
la fédération professionnelle Lille Impro. J'illustrerai cette
étude par des récits et analyses de mes propres
expériences au sein de cette structure, tant comme élève
qu'intervenant en atelier.
III.3) Les organisations internes des compagnies
La ligue d'improvisation de Marcq-en-Baroeul est née,
à l'image de la majorité des ligues professionnelles sur notre
territoire, du rassemblement d'un noyau d'individus qui ont
évolué chacun dans un milieu professionnel avant de se
réunir. C'est pourquoi la plupart des comédiens qui en sont
aujourd'hui membres ont d'abord rencontré Emmanuel Leroy dans un cadre
personnel. Je citerais à titre d'exemple Simon Fache, qui est
entré dans la ligue en exerçant sa profession de musicien : il
connaissait un des pianistes membre de la ligue, qui lui a demandé un
jour de venir pour effectuer un remplacement. C'est ce qui a provoqué sa
rencontre avec le directeur artistique.202 Au même titre,
Philippe Despature l'a rencontré dans le cadre professionnel :
Un jour, Emmanuel Leroy a accepté que j'entre dans la
Ligue parce que j'avais bossé avec une
troupe professionnelle
où j'étais assistant. Et eux faisaient partie de la ligue.
J'avais croisé
Emmanuel plusieurs fois, puis il m'a dit un jour que je pouvais
entrer dans la ligue. Là, ça se passe très bien. Emmanuel
avait besoin de bien connaître les gens.203
202 Entretien avec Simon Fache, 27 Février 2019
203 Entretien avec Philipppe Despature, 25 Mars 2019.
112
Au même titre, les comédiens qui ont
étés approchés venant de la compagnie La Décade
étaient déjà issus du milieu professionnel. Mon
hypothèse est que, en rapport avec la séparation entre amateurs
et professionnels - qui engendre une grande différence par rapport
à la formation et à la pratique - Emmanuel Leroy tenait à
garder l'identité des premières ligues professionnelles
françaises.
La pratique ayant évolué, les professionnels ont
comme devoir de la réinventer, de la requestionner en tant que pratique
artistique. Ils perpétuent en cela l'héritage de Robert Gravel.
Emmanuel Leroy insiste sur son exigence de travailler avec des comédiens
ayant déjà une expérience de la scène.
Il m'a détaillé les activités internes de la
compagnie de la manière suivante :
On a trois axes de travail : le premier axe, c'est d'inventer
des concepts de spectacles théâtraux improvisés[...]Le
deuxième axe de travail, c'est d'inventer des spectacles
improvisés avec des disciplines différentes du
théâtre, ou en mélangeant des disciplines. [...] Le
troisième axe de travail, c'est quand on met l'improvisation au service
d'autre chose. C'est-à-dire que ce soit au service des entreprises, des
associations, des collectivités, des mairies, des hôpitaux, des
prisons, etc.204
La recherche de « concepts » de spectacles
improvisés est confiée aux improvisateurs de la ligue qui ont une
carte blanche pour créer ces formats et montrer leurs propositions. J'ai
pu m'entretenir, pour évoquer un exemple, avec Simon Fache pour la
création d'un spectacle intitulé C'est arrivé
près de chez nous. :
La charpente de ce spectacle est née de la
volonté de trois individus : Simon Fache, Pierre Lamotte et Jacky Matte,
qui ont utilisé le cadre du spectacle d'improvisation en modifiant
l'ambiance générale. On y retrouve en effet la mécanique
de la participation du public - qui amène les thèmes grâce
à des coupures de journaux - , un accompagnement musical avec Simon
Fache pour rythmer les improvisations et leur donner une ambiance sonore, ainsi
que des comédiens jouant des clients de bistrot au premier degré
d'incarnation, puis en jouant d'autres personnages pendant leurs
improvisations. L'ambiance de ce spectacle, en raison du décors et de la
source des thèmes - qui sont des faits divers - est légère
et conviviale. Le seul en scène de l'improvisateur Jérémy
Zylberberg est un exemple où l'ambiance est différente. Ce
spectacle ayant été joué uniquement dans le cadre du
festival, il n'a pas été repris. Simon Fache l'a néanmoins
évoqué : l'improvisateur incarnait différents personnages
qui, au fur et à mesure de l'avancée de l'intrigue,
étaient liés soit par une histoire commune soit par un secret.
C'était un spectacle Long form, ce qui implique que le rythme
est plus complexe à maîtriser que dans une improvisation courte.
C'était l'histoire de quatre
204 Entretien avec Emmanuel Leroy, 22 Février 2019.
113
membres d'une même famille, dont les secrets qu'ils ne
souhaitaient pas dévoiler étaient au fur et à mesure
révélés. La long form modifie la participation du public,
qui a malgré tout eu une influence sur le déroulé du
spectacle, en proposant au comédien les caractéristiques de
chaque personnage.
Ces deux exemples illustrent le fait que le cadre et la
mécanique d'un spectacle d'improvisation peuvent être
utilisés pour monter des spectacles aux propos différents. Le
deuxième axe de recherche de la ligue nordiste consiste à tester
cette mécanique sur d'autres disciplines que le théâtre.
Il a donc été créé un spectacle
intitulé Piano Battle, à l'initiative de Simon Fache :
« C'est un spectacle qui ne peut exister que parce qu'on a un certain
nombre d'années d'histoire au sein de la ligue avec
Jacques205, l'autre pianiste ».206 Cette phase de
recherche s'inscrit également dans les phases de création qui ont
été pensées par et pour des personnes, car le format fait
appel à une discipline spécifique, et ne peut donc être
joué par des personnes étrangères à la pratique du
piano. Le spectacle était conçu à l'origine pour le Lille
Piano Festival avec l'Orchestre de Lille. Simon Fache jouait ce spectacle avec
Auxane Cartigny, un jeune pianiste. À l'origine, le cadre dans lequel
les musiciens évoluaient et les thèmes donnés
étaient inspirés d'images ou de personnages provenant du jeu
vidéo Dofus. Il s'agit d'un jeu vidéo type multi-joueurs en
ligne. Simon a l'idée de croiser le concept avec les formats de battle
d'improvisation qui sont déjà joués au sein de la ligue,
qu'il s'agisse du match ou du catch. Auxane Catigny ayant quitté la
Région, il a été est remplacé par Jacques Shab.
En discutant avec Simon Fache, j'ai avancé
l'hypothèse que, si ce spectacle ne pouvait exister que grâce
à un certain passé qu'ont vécu les deux pianistes au sein
de la ligue de Marcq-en-Baroeul, c'était parce que les deux pianistes
avaient besoin de bien connaître le partenaire et son style de jeu, afin
qu'ils puissent réussir à s'entendre pendant les improvisations.
Il m'a répondu que cette connaissance n'était pas
forcément nécessaire, pour peu que les deux pianistes aient eu
l'occasion de se mettre d'accord207. Si ce genre d'initiative
naît au sein de la ligue, c'est parce que les deux pianistes partagent
les mêmes codes d'improvisation et ont un entraînement
derrière eux à ce genre de pratiques. Simon Fache m'a
détaillé le déroulé de ce spectacle, et il contient
en effet bon nombres de similarités avec le match d'improvisation
théâtrale : les improvisations musicales sont soit de nature
comparée ou mixte, autrement dit à quatre mains. Chaque pianiste
a également le même thème en « comparée »,
ou parfois une variation. Simon Fache illustre cette idée par un exemple
: « Il y a des catégories séparées : chacun deux ou
trois minutes, soit sur le même thème,
205 Jacques Shab est pianiste à la Ligue d'Improvisation
de Marcq-en-Baroeul.
206 Entretien avec Simon Fache, 27 Février 2019.
207 Idem.
114
soit parfois sur des thèmes proches ou opposés.
Par exemple : le thème sera « La valse des vampires » pour
Jacques Shab et « Le tango des vampires » pour moi.208. Le
thème peut également être exécuté de
différentes façons, chaque pianiste se voyant imposer un style
musical à respecter. J'en ai conclu que c'était un spectacle
durant lequel il fallait suivre le partenaire et écouter la proposition
qu'il est en train de faire. Simon Fache a remarqué que ces mots
pouvaient être appliqués à la description d'un spectacle
d'improvisation théâtrale. On retrouve en effet un cadre similaire
au match : les fonctions de maître de cérémonie et
d'arbitre sont assumées par le chef d'orchestre, qui est chargé
de gérer le temps du spectacle et des improvisations, ainsi que de
donner les thèmes et les catégories. Les deux pianistes doivent
également effectuer le travail d'écoute et de création
similaire à un improvisateur lors d'un match d'improvisation : il donne
tantôt une proposition à destination de l'adversaire pour que les
deux pianistes improvisent ensemble, ou chacun improvise l'un après
l'autre sur le même thème. Les styles musicaux peuvent quant
à eux être comparés aux différentes
catégories imposées aux comédiens pendant un match
d'improvisation. Cependant, les catégories du match sont des contraintes
formelles que chacun peut suivre, ou les catégories de style vont
permettre à un improvisateur d'utiliser sa culture
générale pour improviser.
L'intérêt de croiser l'improvisation
théâtrale avec d'autres disciplines peut donc permettre à
ceux qui pratiquent la discipline en question de l'explorer davantage ou sous
des angles différents. Cependant, c'est le cadre qu'a offert le match
d'improvisation théâtrale qui permet, grâce à
l'urgence et les contraintes qui en découlent, d'effectuer une recherche
plus approfondie quant à cette discipline. Emmanuel Leroy a
essayé également de croiser l'improvisation
théâtrale avec les disciplines du cirque dans un spectacle
intitulé battle de cirque. Il m'a confié, pendant notre
entretien, une difficulté à trouver des acheteurs pour le
promouvoir. Rien de plus n'a été dit au sujet de ce spectacle, il
me paraît cependant intéressant d'émettre une
hypothèse concernant cette difficulté qui expliquerait quelle est
la limite de l'improvisation théâtrale.
Une analogie courante existe entre l'artiste de cirque et
l'improvisateur. Beaucoup d'improvisateurs utilisent le champ lexical du
cirque, ou la métaphore du cirque, pour évoquer le risque pris
par l'improvisateur. Simon Fache m'a dit, par exemple :
En ce moment, je suis musicien de cirque. Et le spectateur qui
vient voir de l'improvisation est le même qui vient voir un numéro
de cirque : tu prends un funambule : que le fil soit à 8 mètres
de haut ou à 20 cm du sol, techniquement, c'est pareil. Sauf qu'à
20 cm du sol, ce n'est pas
208 Idem.
115
impressionnant. Ou il faut que le numéro soit fou. Tu
mets le fil à 8 mètres, il ne fait que marcher, et là
ça fonctionne.209
Il me paraît également intéressant
d'évoquer à nouveau le Grand Cirque Ordinaire, qui
évoluait comme troupe de théâtre expérimental en
même temps que les Jeunes Comédiens à Montréal. Les
comédiens se présentaient comme des acrobates par rapport
à l'aspect impressionnant de ce qui était présenté
au public, mais Raymond Cloutier, un des membres de la troupe, insistait sur le
fait qu'ils n'improvisaient pas en public.
Lorsqu'il est musicien de cirque, la fonction de Simon Fache
est similaire à celle du musicien de match : il a pour tâche de
mettre le public dans une énergie positive ou conforme à la
nature du numéro, et rythme également les temps entre chaque
improvisation. À mon avis, la raison des difficultés
rencontrées à croiser l'improvisation théâtrale et
le cirque est donc due au fait que les deux cadres sont trop similaires pour
pouvoir interroger et explorer les deux disciplines, ou proposer un spectacle
d'un genre nouveau. Le cadre du cirque obéit en effet un rituel et un
cérémonial très solides, qui se suffit à
lui-même, et qui convoque la prouesse et le dépassement de soi
sans recourir au dispositif de la compétition.
Il résulte donc des différents axes de travail
de cette ligue par rapport au cadre de l'improvisation théâtrale.
Alors que j'avais évoqué précédemment les nouveaux
formats crées par les amateurs pour pratiquer l'improvisation
théâtrale en autonomie, les professionnels ont vu pendant ce temps
émerger des formes plus libres, mais dont le cadre reste comparable dans
la forme. Cependant, les cadres inventés par des amateurs se heurtent,
pour certains professionnels, à la problématique de se contenter
uniquement de la forme au détriment du fond. Dans un article,
Jean-Baptiste Chauvin a réagi face à ce phénomène
:
L'argument premier, c'est d'inviter le spectateur à
venir voir des improvisateurs se mettre au défi de créer des
histoires en direct. Mais quelles histoires vont-ils voir, à quels
personnages peuvent-ils s'accrocher pour se motiver à venir ? A de rares
exceptions près, aucune. Alors on se raccroche aux comédiens, ou
à la forme. [...] Mais le plus souvent, nous avons une promesse de
forme, mais pas de promesse de fond.210
La forme offre au comédien d'accomplir une performance,
mais c'est le manque de contenu que Jean-Baptiste Chauvin déplore lors
de certains spectacles. Ces spectacles utilisant le même matériau,
ils peuvent donner une identité tronquée de l'improvisation
théâtrale entre les
209 Idem.
210 Jean-Baptiste Chauvin, Impro:à fond la forme
!, disponible sur
https://www.improforma.fr/single-post/2019/01/21/Impro-%C3%A0-fond-la-forme
[consulté le 06/05/2019].
116
improvisateurs amateurs qui se donnent à un loisir -
qui sont actuellement en majorité - les improvisateurs perfectionnistes
et les professionnels. Un public non initié pourrait alors se retrouver
déçu. Simon Fache m'a raconté un témoignage
à ce sujet :
Une fois, quelqu'un m'a dit qu'il a été voir un
match dans un café. Ce n'était pas Marcq-en-Baroeul . Il me dit
que c'était sympa, mais sans plus. Je lui conseille alors d'aller voir
Eric Leblanc211 improviser en alexandrins sur un
match[...]Après c'est l'impro telle qu'elle est aujourd'hui, et on ne
peut absolument pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent, au
contraire c'est tant mieux. [....] il y a des gens qui font la
différence mais qui n'aiment pas les matchs professionnels parce que
c'est trop intellectuel. Mais au moins, ils ont vu les deux. 212
Il y a donc une distinction faite entre deux façons de
pratiquer l'improvisation théâtrale, ce qui m'amène
à nuancer les propos de Philippe Despature : « Il n'y a pas
beaucoup de disciplines où finalement, même si le terme n'est pas
défini, on dit juste qu'on fait de l'impro, on fait un peu comme on
veut. Eh ben ça marche. Après c'est à chacun de voir
jusqu'où il pousse son exigence ».
Cette différence quant aux exigences et motivations des
différents improvisateurs hiérarchise les différents
niveaux de formation qui sont offerts par les structures des
Hauts-De-France.
Parmi les pôles de formation à destination des
amateur dans la région Hauts-de-France se trouvent les ateliers
dispensés par la Ligue d'Improvisation Lilloise Amateur, et les ateliers
mis en place au sein d'Impro Academy. J'ai pu recueillir ces informations
grâce à des entrevues avec Arthur Pinta, président de la
Ligue d'Improvisation Lilloise Amateur, et Philippe Despature, directeur de la
Scénosphère qui s'occupe de la gestion d'Impro Academy.
Il a fallu séparer les ateliers dispensés au
sein de la compagnie Trompe-l'oeil pour distinguer les joueurs des
élèves, mais également organiser les différents
ateliers en fonction des demandes. Actuellement les ateliers d'Impro Academy
sont divisés en plusieurs niveaux : le niveau jeunes, le niveau
débutant, le niveau loisirs et le niveau compétence. Ce dernier
niveau est lui-même divisé en trois groupes. Pendant une certaine
période, ces trois groupes étaient organisés en fonction
des niveaux de jeu de chacun et étaient appelés groupes un, deux
et trois. Ils sont désormais rebaptisés groupes « auteurs
», « comédiens » et « metteurs en scène
». Philippe Despature m'a expliqué les raisons de ce remaniement.
Elles sont révélatrices de la difficulté à
évaluer le niveau d'une pratique artistique répandue :
211 Eric Leblanc est joueur à la Ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul.
212 Entretien avec Simon Fache, 25 Février 2019.
117
On s'est rendu compte que les niveaux 1,2,3, ça ne
marchait pas ; ça donne une certaine impression aux « niveau 3
», ça frustre les « niveau 1 »... du coup on s'est dit
que finalement, ce serait mieux de penser en terme de besoins. Tu as des gens
qui sont de très bons auteurs, mais
très mauvais comédiens : ils ont plein
d'idées sur le côté, mais ils ne savent pas les exprimer,
les jouer....213
Progressivement, en passant du niveau débutant au
niveau loisirs, les élèves abordent les notions de bases de
l'improvisation théâtrale, qui sont à mon sens
l'écoute et la construction du personnage. Lors des restitutions
d'atelier appelées academyades, les élèves
abordent les catégories que j'ai appelées «
catégories d'échauffement » dans le lexique. Philippe
Despature insiste cependant sur la notion de subjectivité dans
l'improvisation théâtrale. Cette subjectivité intervient
donc dans la construction des ateliers que les professeurs donnent.
Lorsque je suis entré chez Impro Academy, j'avais deux
ans d'expérience en improvisation. Je suis donc entré dans le
parcours Loisirs. Durant cette première année, la notion de
« besoins » dont parle Philippe Despature a été prise
en compte par Corentin Vigou, qui était mon professeur durant
l'année 2017-2018. Je pourrais également parler d'exigences et
d'envies.
Á mon sens, le « parcours loisirs » convient
à des gens ayant une expérience théâtrale
d'ateliers. Il les prépare cependant aux spectacles de fins
d'années, qui n'ont pas cours dans les ateliers débutants. Le
parcours compétences, avec les trois aspects qui sont travaillés
que j'ai évoqué, préparer les élèves
à des improvisations plus construites en termes de narration et de
scénario, ce qui nous pousse à travailler autant le fond des
histoires improvisées que la forme. En fonction des envies de chacun en
parcours loisirs, Corentin Vigou a néanmoins travaillé avec nous
des catégories de style*. Elles posent un cadre plus solide,
mais également des contraintes plus formelles.
C'est l'identification des capacités, des besoins et
des exigences des élèves qui ont amené Corentin Vigou
à nous faire travailler ces catégories, les ateliers étant
accessibles à tous. Selon Philippe Despature :
Ce qui est intéressant dans l'impro et notamment chez
Impro Academy, c'est que le niveau d'exigence des élèves augmente
: avant, une soirée cabaret allait à tout le monde. Mais plus il
y a du monde, plus les gens changent, ils ont envie d'avancer, d'aller plus
loin, et la recherche et l'exigence augmentent214
213 Entretien avec Philipppe Despature, 25 Mars 2019.
214 Idem.
118
C'est ce qui rend le travail pédagogique important pour
un professeur officiant chez Impro Academy : la constitution du groupe est la
première problématique à laquelle tentent de
répondre les premières séances. Lorsque j'étais en
groupe loisirs, deux critères ont été déterminants
à mon sens : le premier critère était que la plupart des
élèves se connaissaient, car ils étaient issus d'ateliers
antérieurs. Le deuxième critère, que j'ai
déjà évoqué, est que les élèves
avaient déjà une expérience d'ateliers en improvisation
théâtrale, et souhaitent donc s'aventurer dans des
catégories qui permettent la construction d'histoire. C'est ainsi
qu'avec mon groupe, j'ai été amené à suivre des
enseignements sur les catégories de style « Soap Opera » ou
« Contée ».
J'évoquerais ici une nuance qui me parait fondamentale
lorsqu'on apprend l'improvisation théâtrale, entre les «
codes » et les « clichés ». Selon la culture de chacun,
la catégorie de style n'est pas abordée de la même
manière. D'un point de vue pédagogique, les élèves
doivent s'accorder sur les codes récurrents de telle ou telle
catégorie. Il faut également qu'ils soient clairement
identifiables pour le public. Á la différence des clichés,
les codes peuvent être assimilés à des ressorts narratifs
qui permettent à l'improvisateur de construire une improvisation
grâce à des motifs récurrents, et qui lui servent d'outils
pour construire un personnage, définir un lieu et une situation. Ces
trois éléments sont également définis durant le
caucus. Le professeur d'improvisation qui fait travailler ses
élèves sur une catégorie de style a un regard similaire
à celui de l'arbitre de match lorsqu'il énonce ces
catégories : si elles sont obscures pour des improvisateurs, il a la
responsabilité de faire savoir ce qu'il entend par ces
catégories, quels enjeux doivent apparaître, quels types de
personnages sont mis en scène, ou quelle ambiance l'improvisation
instaure.
Au fur et à mesure des académyades auxquelles
j'ai participé avec le groupe loisirs, le professeur nous a
laissé davantage de libertés, et par conséquent des
responsabilités : il y a eu trois spectacles sur l'année.
Le premier spectacle était jalonné avec des
catégories d'échauffement, qui nous incitaient davantage à
la performance qu'à la construction narrative. Le deuxième
spectacle mélangeait les catégories d'échauffement et les
catégories de style. Durant le troisième spectacle, nous avions
à notre disposition une liste de toutes les catégories qui
avaient étés étudiées au long de l'année. Il
était de notre responsabilité d'improvisateurs de les utiliser
pour construire notre improvisation ou faire des improvisations en
catégorie libre.
Le dernier spectacle s'est déroulé en Juin 2018,
et n'était guère satisfaisant. Á mon sens, nous avions
trop utilisé les catégories que nous maîtrisions, et nous
en avions oublié la construction d'une histoire. Le caucus avait
été très peu utilisé, parce que nous connaissions
les codes de ces catégories, et nous nous étions moins
préoccupés de faire progresser une intrigue que de reproduire
119
des actions que nous savions déjà faire. Ces
travers interviennent lorsque l'improvisateur oublie les trois notions qui
composent les différents axes de travail du groupe Compétence.
Le travail d'improvisateur regroupe en effet les fonctions
exercées simultanément d'auteur et d'acteur. Gil Galliot, un de
fondateurs de la Ligue d'Improvisation Française, en a
témoigné dans sa préface de l'ouvrage Impro,
Improvisation et théâtre de Keith Johnstone :« Par
essence, l'improvisateur est un acteur-auteur puisqu'il produit, en même
temps que sa prestation scénique, un texte nécessaire à
l'incarnation d'un personnage ainsi qu'au développement d'une situation
pour aboutir - enfin si possible - à la construction d'une
histoire.»215 .Le groupe des élèves en
Compétence et donc divisé en trois catégories qui font
travailler aux élèves ces deux notions, puis un troisième
groupe dans lequel ils apprennent à utiliser les deux outils avec
l'enseignement de Philippe Despature: « Donc c'est pour ça qu'on a
fait compétence 1 plutôt auteurs, compétence 2 plutôt
comédiens, et compétence 3 plutôt des gens qui ont
réussi à matcher un peu tout ça et qui veulent chercher
autre chose. »216
Philippe Despature, comme Corentin Vigou et la majorité
des intervenants d'Impro Academy, ont pris le temps durant les premières
séances d'identifier les capacités et les besoins des
élèves pour construire leur programme en conséquence.
J'ai émis l'hypothèse que, jusqu'à
présent, les catégories d'échauffement et les
catégories de style avaient étés travaillées dans
les autres ateliers. Les catégories d'échauffement mettent
davantage en avant les outils d'un comédien par l'utilisation gestuelle,
et les catégories de style font travailler la dimension auteur, afin de
construire des situations plus précises et plus identifiables qui
peuvent évoluer.
Les élèves du parcours Compétence
Metteurs en Scène apprennent à utiliser les outils acquis, mais
désormais sans l'aide des catégories. Lors des académyades
de cette année, aucune catégorie ne nous était
imposée par le maître de cérémonie, et aucune liste
n'était à notre disposition. Il reste cependant à notre
liberté d'utiliser une catégorie qui nous semble adaptée
au thème donné pour nous aider à construire notre
charpente ou de donner de façon formelle une dynamique à notre
improvisation. Mais la catégorie devient à ce moment pour
l'improvisateur un outil de construction et non une contrainte. Nous sommes
donc encouragés à faire davantage de catégories libres, en
utilisant les outils de l'improvisation qui nous ont étés
enseignés.Divers codes nous permettent également d'évoluer
et de construire nos personnages. En plus de la bascule, Philippe Despature
nous a fait travailler la caricature et les changements de
status217, qui définissent l'influence ou le
215 Keith Johnstone, Impro, improvisation et
théâtre, Paris, Ipanéma, 2013, p. 9.
216 Entretien avec Philippe Despature, 25 Mars 2019
217 Terme anglais qui définit la position d'une personne
par rapport à une autre personne ou un autre groupe.
120
pouvoir qu'un personnage a sur un autre.. Ce sont
principalement deux outils qui permettent de travailler un personnage, qui est
donc davantage du ressort du travail de comédien que de celui de
l'auteur.
Le travail de caricature consiste à exagérer
volontairement le ton, l'émotion, ou la posture physique d'un personnage
afin de le rendre identifiable. C'est, à mon sens, la base du travail
d'improvisateur : si le personnage ressent une émotion facilement
identifiable, il est plus aisé de construire une situation qui aurait
provoqué cette émotion. Le travail de caricature a
consisté également à varier le niveau d'exagération
afin de pouvoir évoluer et d'être davantage disponible pour
réagir à des accidents qui surviennent durant une intrigue.
Le basculement des status a été
théorisé par le Britannique Keith Johnstone, qui a inventé
le theatersports dans les années 70. Il pourrait être
aisé de traduire cette notion par une relation de dominant à
dominé, mais Keith Johnstone étant professeur, il a
préféré utiliser ce terme, qui était moins violent
du point de vue pédagogique. Le status haut et le status bas aident les
personnages à définir leurs identités et la relation qui
les unit. Nous avons appris pendant cette année à basculer les
status de nos personnages durant une improvisation en cours. Cela a pour
conséquence de faire évoluer la relation entre ces personnages,
ce qui peut provoquer une péripétie dans la narration et donc
faire évoluer l'intrigue.
Avec ces exemples d'outils qui nous sont transmis, Philippe
Despature nous incite à travailler nos personnages et à les faire
évoluer sur scène. C'est là qu'est l'intêret des
académyades, nous permettant d'expérimenter ces outils et de
vérifier si nous sommes désormais à même de nous en
servir. Le statut d'école d'Impro Academy permet cette dimension
d'expérience dans le sens où le public sait que c'est une
restitution d'atelier. Il s'instaure donc une dimension de travail en cours qui
nous incite à tenter des expériences sans craindre un
échec.
Le travail d'école exercé par Impro Academy
diffère de celui des troupes amateurs, car il n'est pas destiné
à produire et à mettre au point des spectacles. Il existe
cependant au sein de la structure une troupe nommée Team Impro
Academy, qui accueille les élèves ayant quatre années
au moins d'expérience en improvisation théâtrale et qui
sont issus de ces ateliers. Aux dires de Philippe Despature, elle
représente une vitrine d'Impro Academy. La forme d'une troupe lui permet
d'occuper une place dans le paysage de l'improvisation théâtrale
dans les Hauts-de-France.218, en rencontrant d'autres troupes ou en
faisant d'autres spectacles sous forme de catch ou de cabarets.
218 Idem.
121
Une certaine expérience de la part des improvisateurs
qui en sont membres est exigée, et on entre donc dans cette troupe
à l'issue d'un casting. Le casting se présente sous la forme
d'une académyade sans catégorie. Cependant, les participants sont
observés par un jury composé de trois membres et ont chacun un
passage seul en scène imposé durant trois minutes. J'ai
interrogé Philippe Despature quant à la composition du jury, qui
est similaire depuis quelques années. Lorsque que j'ai passé le
casting, il était composé de Rémy Vertain, qui a
commencé en prenant des cours au sein des ateliers d'Impro Academy . Il
est depuis professeur au sein d'un de ces ateliers et intervenant pour des
prestations en milieu social, scolaire et dans les entreprises. Les deux autres
membres du jury étaient Michael Wiame et François Marzynski, tous
deux comédiens et metteurs en scène mais non improvisateurs. Ces
deux connaissances de longue date de Philippe Despature apportent une nuance
intéressante par rapport au travail d'improvisateur, en tant que
comédiens. Ainsi, Philippe me disait que François Marzynski a un
point de vue mitigé sur a pratique de l'improvisation
théâtrale, en tant que comédien professionnel : il est
davantage sensible à la position d'artiste qui monte sur scène
parce qu'il a des choses à dire219. Ce point de vue met
également en lumière la problématique de l'absence de fond
que l'on peut retrouver dans certains spectacles d'improvisation.
On peut rapprocher le système de formation des
improvisateurs chez Impro Academy à celui qui est dispensé au
sein de la Ligue d'Improvisation Lilloise Amateur . Cette dernière
dispose de trois niveaux d'ateliers : le groupe débutants s'adresse
à ceux qui font leurs premières expériences en
improvisation théâtrale, le groupe « espoirs » s'adresse
à ceux qui veulent compléter leurs expérience, et le
groupe « perf » s'attelle à des ateliers davantage
ciblés, en vue de se préparer à des rencontres de plus
grande importance, comme des matchs. Tout comme chez Impro Academy, les
improvisateurs du groupe « débutants » apprennent les
rudiments, et n'ont donc pas de restitution d'atelier. Le groupe « espoir
», à la fin de chaque année, se produit dans un concept
intitulé « La librairie de l'impro », qui se déroule au
coeur de la Librairie Les quatre chemins, à Lille. Contrairement aux
académyades, qui ont lieu dans un endroit neutre, où aucun cadre
n'est posé à part une scène, le fait de jouer dans une
librairie offre un public et un cadre. J'ai pu recueillir les propos d'Arthur
Pinta à ce sujet :
ça permet de leur faire faire un peu de scène
dans un cadre à la fois compliqué - parce qu'on est pas dans une
vraie salle de spectacle - mais par contre dans un endroit très
chaleureux. Et en essayant de créer des concepts où ils vont
pouvoir aller sur des choses nouvelles : on leur fait travailler des
catégories autour du livre en variant un peu.220
219 Idem.
220 Entretien avec Arthur Pinta, 27 Février 2019.
122
Pour un premier spectacle, ce format a donc l'avantage de
plonger le spectateur dans une ambiance particulière, ce qui constitue
une base du cadre qui vient soutenir les improvisateurs pour lesquels c'est la
première expérience de spectacle . Pour que la mécanique
du spectacle d'improvisation soit respectée, et pour compenser la
difficulté de construire le cadre en raison du lieu, Ils sont
accompagnés par le maître de cérémonie. Il a la
charge de présenter le concept du spectacle au public, de gérer
les temps de chaque improvisation et de gérer également les
catégories pour chaque improvisation. Les premières du spectacle
sont, dans la majorité des cas, exécutées en
catégorie libre.
L'avantage de la catégorie libre est de permettre
à l'improvisateur d'explorer et d'exploiter essentiellement son
imaginaire pour s'en servir comme base pour l'improvisation, mais cette absence
de repère peut aussi être un piège. Cependant, lorsqu'il
doit répondre aux exigences d'une catégorie, un improvisateur
débutant doit faire face à une situation d'urgence avec la
contrainte de fournir une improvisation répondant aux codes de cette
catégorie, ce qui peut être angoissant. Pour supprimer cette
urgence, l'improvisation tend à supprimer la peur de l'échec, et
donc la notion d'objectif. Il peut donc être intéressant
pédagogiquement d'utiliser les catégories libres lorsqu'on
débute pour apprendre à placer et construire ses idées,
sans avoir à répondre à une commande ou à
répondre à une idée que le spectateur se serait mis en
tête en anticipant ce que l'improvisateur pourrait faire.
Les improvisations de catégorie libre permettent ainsi
à ceux qui débutent d'expérimenter les codes en
improvisation appris dans les ateliers. Certains codes sont universels, telles
la bascule* permettant d'effectuer un changement de lieu ou de temps
pendant l'improvisation ou le caucus*, permettant de préparer
la situation de départ de l'improvisation. Ces codes partagés par
tous peuvent être appris dès lors que l'improvisateur en herbe
développe une certaine curiosité, ou se documente. Avec
l'évolution de l'improvisation théâtrale, de plus en plus
de bouquins ont en effet été édités à ce
sujet et permettent un accès plus libre à ces connaissances. Une
fois une base commune établie en termes d'exercices et
d'échauffement, il me semble possible pour un amateur maîtrisant
ces codes de pouvoir enseigner des catégories de style, adaptant un
genre pour lequel il éprouve de l'intérêt aux codes de
construction d'une improvisation. J'ai appris cela en m'entraînant avec
les improvisateurs du Groupe d'Improvisation du Terril. Maxime Curillon et
Florine Sachy estiment en effet que « tout le monde est capable d'animer
un training, pour peu qu'on apprenne des
123
codes sur un sujet, qu'on s'exerce »221.
Lorsque dans la troupe se trouvaient des comédiens professionnels, ils
étaient rémunérés. Depuis, c'est à chacun
qui le souhaite de proposer un entraînement sur une catégorie de
style selon ses goûts ou sa culture générale. Les
catégories de style se basant en majorité sur un genre
cinématographique, littéraire, ou même musical, il
appartient néanmoins à celui qui souhaite explorer sa
catégorie de prédilection d'en connaître les codes, ou
d'être capable de les identifier ou de les transmettre. Maxime Curillon
et Florine Sachy m'ont présenté les raisons pour lesquelles ils
avaient opté pour telle ou telle catégories de style :
Vincent222, par exemple, fera un training sur
Tolkien le jour où il se sentira de le faire, ou quand il se sentira la
légitimité de le faire. Et la légitimité il l'a.
Parce qu'il est calé sur Tolkien, et c'est super intéressant. La
Science-Fiction, avec Louis223, ça vient de deux choses :
c'est d'abord un sujet qu'on aime, qu'on connaît bien, même si on
s'est beaucoup documentés pour le préparer. Et on voulait aussi
apporter autre chose, parce qu'on voyait souvent des gens faire des robots, ou
des vaisseaux spatiaux.224
Alors que la catégorie « à la
manière de Tolkien » correspond à la volonté de
Vincent Lelong de partager un univers qu'il connaît et dont il
maîtrise les codes, la catégorie « Science-Fiction », et
la manière dont elle est travaillée par Louis Lalleau, correspond
davantage à une volonté de renouveler une catégorie de
style dont les codes sont communs et connus. Les formateurs du Groupe
d'Improvisation du Terril déplorent le nombre de clichés qui
arrivent souvent dans cette catégorie. Les soucoupes Volantes et les
vaisseaux spatiaux sont en effet des clichés dans le sens où, ils
sont utilisés pour que le public identifie la catégorie et
l'univers dans lequel l'improvisation a lieu, mais ne peuvent pas faire avancer
l'intrigue.
Louis Lalleau, pour préparer cette série
d'entraînements, a fait un travail de recherche sur le genre de la
science-fiction, qui regroupe bon nombres d'oeuvres cinématographiques
et littéraires. Peuvent être cités en exemple, le monde
post-apocalyptique, les body snatchers, ou les dystopies. Chacun de
ces genres, nous l'avons découvert, permet non seulement de varier les
jeux et les enjeux d'une improvisation à la manière d'une
science-fiction, mais a pu également être travaillé par
différents exercices d'improvisation théâtrale. Je
prendrais en exemple le sous-genre du body snatcher :
Louis Lalleau nous l'a défini comme un sous-genre de la
science-fiction dans lequel une population se fait progressivement envahir et
remplacer par des identités inconnues. Un accident vient perturber les
habitudes des protagonistes et fait comprendre que quelque chose
d'étrange est en train de passer. Les habitudes permettent aux
improvisateurs de mettre en place une situation de départ
221 Entretien avec Maxime Curillon et Florine Sachy, 28
Février 2019.
222 Vincent Lelong, membre du Groupe d'Improvisation du
Terril.
223 Louis Lalleau, membre du Groupe d'Improvisation du Terril.
224 Entretien avec Maxime Curillon et Florine Sachy, 28
Février 2019.
124
identifiable afin que chacun s'y retrouve, pendant laquelle
chaque comédien aura le loisir de construire son personnage en fonction
de son caractère et de la situation.
Travailler la première partie de ce sous-genre nous
amène à travailler une étape importante dans la
construction de l'improvisation qu'est le cadre de départ, dans lequel
nous identifions la situation, les traits de caractère des personnages
ainsi que leurs relations.
Dans une narration arrive ensuite la péripétie,
qui est l'accident qui va inciter les héros à accepter
l'aventure. Dans le sous-genre des body snatchers, nous pouvons nous amuser
à briser le cadre de départ bien construit. L'accident doit
apparaître de façon nette afin que tous les improvisateurs le
comprennent. Cet aspect nous fait travailler la proposition et l'écoute.
Il faut en effet qu'un des improvisateurs prenne la décision de briser
le cadre par un accident inhabituel : il peut s'agir d'un changement brusque de
son comportement, ou de faire remarquer qu'un élément visuel ou
de décors a été modifié. Si un changement de
décors a été opéré, il est de la
responsabilité de chacun de se souvenir que ce décor a
été installé auparavant et d'accepter la proposition.
Cela nous fait travailler les notions d'acceptation
et d'obstruction : si un improvisateur a opéré un
changement, ses partenaires doivent l'accepter et jouer en fonction de ce
changement pour la suite de l'improvisation. On qualifie d'obstruction une
attitude contraire à celle de l'acceptation : soit le joueur
empêche une idée de se développer, soit il ne prend pas en
compte la proposition du partenaire.
Lorsque l'accident est repéré, chaque
improvisateur va mettre en scène son personnage en train de subir le
changement de comportement ou de situation. Afin qu'il soit clair pour le
public, la notion d'écoute consiste à trouve le moment où
l'improvisateur pourra le faire sans le faire en même temps que ses
collègues, pour éviter une scène confuse.
La construction dramaturgique veut que le héros se
rende compte de cette situation, et qu'il soit seul contre tous pour lutter.
Afin de renforcer la menace et l'inquiétante étrangeté,
ceux qui ont subi le changement de situation deviennent un choeur et forment
une seule et même entité. Ce choeur, en improvisation, implique
d'accepter la lenteur et le silence, ce qui va à l'encontre d'une
urgence et d'un rythme rapide que l'on serait tenté d'installer pour
faire face à la peur du vide sur scène et dans l'histoire. Il
marque de façon très efficace l'inquiétante
étrangeté, car les improvisateurs qui le forment seront
forcés d'avoir un débit lent et fortement prononcé pour
que tous aient l'occasion de prononcer des paroles de façon plus ou
moins simultanée. L'effet est donc justifié.
Il a été vu, à travers cette étude
de cas, que la liste des catégories de style pouvait être sans
cesse enrichie selon la personnalité et les goûts des
improvisateurs. Alors que les improvisations et les
125
catégories peuvent évoluer selon les
connaissances de chacun, les personnes composant le staff - quel que soit le
format du spectacle - ont une formule commune à appliquer. Les
formations au staff sont moins présentes, car elles répondent
à une demande plus faible. La multiplication des concepts se focalise
sur l'improvisateur et l'ambiance générale d'un spectacle, on en
oublie par conséquent le staff dont les fonctions sont similaires dans
toute représentation. Certains professionnels, tels Thierry Bilisko ou
Jean-Baptiste Chauvin proposent néanmoins des formations ponctuelles au
staff et à l'arbitrage. C'est également par le billet de la vie
associative que l'on peut s'essayer à ces fonctions :dans la
majorité des troupes amateurs, les improvisateurs souhaitent être
au centre de la scène. Il y a donc un besoin plus conséquent pour
les fonctions de staff que de joueur. J'évoquerais les
différentes formations et expérimentations sur les rôles du
staff qui sont possibles dans le territoire des Hauts-de-France, tout en
évoquant mes expériences personnelles lorsque j'ai eu l'occasion
d'assumer certaines de ces fonctions.
III .4) Le staff : mettre en valeur les partenaires.
J'ai pu faire l'expérience d'être maître de
cérémonie sur une académyade, en Mars 2019. Étant
le relais entre le public et les improvisateurs, j'avais en charge de les
présenter et de mettre le spectateur en condition pour les accueillir.
J'avais donc à ma charge de poser le cadre qui allait orienter
l'énergie et l'ambiance du spectacle. C'est ici que se joue la
difficulté du maître de cérémonie et des membres du
staff en général, qui doivent « chauffer la salle »
pour mettre le spectateur de bonne humeur tout en étant capables de
s'effacer immédiatement lorsque les improvisations commencent.
Jusqu'ici, toutes les académyades auxquelles j'avais participé
avant d'arriver dans le parcours Compétences d'Impro Academy avaient
comme maître de cérémonie notre professeur. Puisqu'il
s'agissait de restitutions d'ateliers, il insistait pour nous faire travailler
les codes que nous avions appris ainsi que les catégories. Au parcours
compétences, nous étions encouragés à faire
davantage d'expérimentations à partir de techniques
d'improvisateurs assimilées. Je n'avais, en tant que maître de
cérémonie, pas de catégorie à imposer à mes
camarades improvisateurs. Je portais en revanche la responsabilité du
temps des improvisations et du rythme du spectacle.
126
Dans cette position, j'avais une réelle
possibilité d'observer les improvisations. Je prenais la décision
de mettre fin à l'improvisation en cours lorsque je jugeais qu'elle en
était arrivée à sa conclusion. Il faut néanmoins
avoir une capacité de gestion du temps des improvisations et du temps
global du spectacle pour que celui-ci soit équilibré ; mettre fin
à une improvisation parce qu'on l'estime terminée ne suffit pas :
à la fin du spectacle Philippe Despature est venu me voir en me disant
qu'il y avait une part d'impolitesse lorsqu'on était arbitre ou
maître de cérémonie. Il faut user de cette «
impolitesse » pour donner à des improvisations un temps
varié, et alterner les durées pour éviter de faire tomber
le rythme du spectacle dans une routine.
Le plus difficile a été pour moi de
sélectionner des thèmes parmi les propositions du public. Cela
implique d'être capable de déterminer ce qui pourrait donner un
bon thème pour une improvisation, en un temps bref pour éviter de
laisser retomber le rythme entre chaque improvisation. Le maître de
cérémonie doit être efficace lorsqu'il pose des questions
pour déterminer le thème. J'ai donc alterné les questions
ouvertes, où je demandais purement et simplement si le spectateur avait
un thème en tête. Pour varier les genres et éviter
d'inciter le spectateur à être original, j'interrogeais parfois
directement son imagination. Je demandais à la personne si elle avait en
tête un titre de film ou de livre qu'elle aurait aimé
écrire ou réaliser. Je ne saurais définir ce qui est un
bon thème en improvisation, mais il doit, à mon sens, être
assez large pour laisser l'imagination de l'improvisateur faire son chemin, et
donner des pistes identifiables pour définir un lieu ou une situation.
Parfois, lorsque des thèmes n'étaient pas satisfaisants, je
demandais leur proposition à deux personnes du public afin d'en faire un
seul thème. Je pouvais ainsi fournir aux improvisateurs un thème
qui pouvait leur donner des pistes solides, dès lors que ce thème
contenait des renseignements quant à une piste ou situation de
départ. Il est arrivé néanmoins que cela ne suffise pas.
Et, lorsque j'essaie de demander de façon habile au spectateur de
préciser et que cela prend trop de temps, cela nuit au rythme du
spectacle, ainsi qu'aux énergies des autres spectateurs et des autres
improvisateurs qui sont en attente. Il m'est arrivé une fois de
déroger à la règle que Philippe Despature avait
implicitement mis en place pour nos académyades ; faire des
improvisations sans catégorie. Je n'ai pas imposé de
catégorie à mes camarades, mais je leur ai donné une
contrainte formelle. Bien que cela ne les ait pas réellement aidé
à traiter le thème, mon but était de faire en sorte que la
contrainte provoque l'admiration du spectateur, en regardant comment l'acteur
parvenait à respecter cette contrainte. Une catégorie les aurait
aidés à construire une improvisation, mais, devant réagir
de façon vive, je n'avais pas eu le temps de penser à quelle
catégorie j'allais leur proposer. J'ai donc privilégié
l'aspect de la performance au détriment de la narration pour cette
improvisation.
127
J'ai également été maître de
cérémonie durant un spectacle intitule Impro à la
carte pour le Groupe d'Improvisation du Terril. Cette fonction, sous ce
format, est désignée par le terme de « serveur » car
les codes font référence à un menu de restaurant : les
différentes catégories sont renommées pour évoquer
des cocktails, et les spectateurs ont à leur disposition une carte de
bar qui liste toutes les catégories disponibles. Par exemple, le «
Bloody Mary » correspond à la catégorie « film
d'horreur », le « black velvet » exige que toute l'improvisation
se déroule dans l'obscurité, ou encore l'« hydromel »
correspond à la catégorie « conte ». J'ai
interrogé les membres du Groupe d'Improvisation du Terril au sujet de
cette forme, car je n'étais habitué jusqu'à présent
qu'à des formats où les thèmes choisis sur l'instant.
Cette forme modifie de façon significative tout le rythme du spectacle,
car les thèmes sont choisis avant qu'il ne commence. Deux serveurs sont
chargés d'aller à la rencontre des spectateurs une quarantaine de
minutes avant que le spectacle ne commence, pour recueillir les choix des
thèmes et des catégories. Les thèmes sont choisis par les
spectateurs, mais ils doivent choisir la catégorie qui leur correspondra
dans la carte.
Durant cette période, les serveurs sont chargés
de fournir des explications quant à la signification des
catégories, et de faire en sorte que les choix soient
équilibrés, afin d'éviter d'utiliser une catégorie
plus qu'une autre, et qu'un maximum d'entre elles soient utilisées.
Á la fin de cette sélection, les deux serveurs
bénéficient d'un temps de concertation où ils
décident qui a recueilli le meilleur thème pour telle ou telle
catégorie. C'est cette raison qui justifie, d'après les
informations qui m'ont été données, le format du
spectacle. La gestion du rythme pour le maître de cérémonie
est très différente de celle d'un cabaret dans le sens plus
classique du terme, puisque les serveurs n'ont pas à réagir sur
le vif en plein spectacle. Leur fonction reste, une fois que le spectacle a
commencé, de faire le pont entre les spectateurs et les improvisateurs.
La personne qui a la charge d'arrêter les improvisations est
appelée « patron » ou « patronne », et, lorsqu'elle
estime que l'improvisation a trouvé une conclusion satisfaisante,
actionne une clochette pour mettre fin à l'histoire. La
difficulté de ce format, lorsqu'on est maître de
cérémonie, est dans le rôle du serveur : lorsque nous
recueillons les thèmes et les catégories parmi le public, nous
jouons des personnages de serveur classiques, soit avec un comportement
particulier si la soirée un thème.
J'ai été serveur en Janvier 2018 alors que le
spectacle se jouait au Biplan, une salle de spectacle à Lille qui a
fermé ses portes en Mars 2019. Á l'occasion de cette
dernière représentation, nous avions décidé de
placer le spectacle sous le signe des années 90, qui a été
la période d'ouverture du Biplan. Ce qui nous a amené à
jouer des personnages tout en étant maîtres de
cérémonie, en adaptant notre tenue vestimentaire et notre langage
de façon conforme aux usages de cette décennie. Entre chaque
improvisation, il y avait danger de développer nos personnages de
façon excessive. Et
128
comme nous étions deux, il fallait également
équilibrer les interventions de chaque serveur. Nous avions
néanmoins le loisir de préparer un minimum ces interventions
durant les improvisations en cours, étant donné que nous n'avions
pas la charge d'imposer une catégorie ou de gérer le temps de
l'improvisation. Nous en profitions également pour nous mettre d'accord
sur le prochain thème et la prochaine catégorie qui serait
donnée.
Á travers ces deux expériences, ma conviction
est renforcée quant au travail méticuleux du maître de
cérémonie qui doit prendre des décisions et les assumer
quant au choix du thème, et être capable de s'effacer aux profits
des improvisateurs dès que l'improvisation a commencé.
Le maître de cérémonie est un des premiers
protagonistes qui apparaît aux yeux du public, et il contribue, comme les
autres membres du staff, à consolider le cadre dans lequel
évoluent les improvisateurs. Dans un match d'improvisation, la
solidité du cadre par le maître de cérémonie se
traduit par le maintien et le respect du décorum et du rituel : il
présente les joueurs un par un au public, dans le but de les valoriser,
et continue de faire le relais avec le public. Dans le match, il doit donc
noter le thème de l'improvisation pour qu'il soit visible du public, et
doit expliquer les fautes qui ont étés sifflées pendant
une improvisation. Il est donc nécessaire, pour remplir cette fonction,
d'être pédagogue dans le cadre d'un spectacle de restitution
d'atelier, ou de bénéficier d'une expérience, soit en tant
que spectateur, soit en tant qu'improvisateur, pour comprendre les tenants et
aboutissants de la fonction de maître de cérémonie. Avoir
joué plusieurs spectacles peut en effet aider, selon moi, à
cibler les obstacles auxquels les joueurs sont confrontés lorsqu'ils
jouent pour développer sa propre méthode qui permet de poser le
cadre. Une expérience de spectateur peut également donner des
pistes quant à la façon de procéder : en tant que
spectateur, je me suis fait une idée de l'effet que me provoquait le
fait d'être pris à parti par un maître de
cérémonie pendant un spectacle, ou si j'ai apprécié
ou non la façon dont il s'est adressé à moi. J'ai
été particulièrement attentif sur ce point lorsque
j'étais maître de cérémonie pour la première
fois, dans le cadre de l'académyade où, contrairement au match,
le maître de cérémonie se déplace parmi les gens du
public, et s'adresse directement à l'un d'entre eux. Cette façon
de procéder demande une certaine prudence quant au respect de la
personne : en agissant de cette façon, je déplace l'individu de
l'entité du public, et cette personne est observée pendant un
court instant par les autres spectateurs. Il y a une notion d'écoute qui
s'installe pendant ce moment, où je le mets également en
état de représentation. Il s'agit d'éviter de le mettre
mal à l'aise en le mettant en état d'observé pendant trop
longtemps.
129
Je n'ai pas eu l'occasion d'être maître de
cérémonie pendant un match d'improvisation, mais les matchs du
trophée Culture et Diversité m'ont offert d'être
assistant-arbitre et coach à deux reprises. La fonction de coach a
été détaillée davantage dans le lexique, car il est
parfois un sixième joueur pour les équipes, et n'intervient donc
pas dans le cadre. Les matchs qui se jouent dans le cadre de ce trophée
sont joués par des collégiens, le cadre et le rituel sont par
conséquent plus allégés : les improvisations sont moins
longues, et l'arbitre siffle moins de fautes.
Le trophée Culture et Diversité est né au
sein de la fondation Culture et Diversité, crée en 2006 par Marc
Andreit de La Charrière . Cette organisation travaille sur
l'accès à la Culture et aux arts pour des personnes issues de
milieux modestes. En 2009, il a reçu la visite de l'humoriste Jamel
Debouze, qui avait découvert l'improvisation dans les ateliers scolaires
de Trappes dans les années 90. Le résultat de cette rencontre est
la mise en place des ateliers d'improvisation dans bon nombre de collège
du pays, pour aboutir à la fin de l'année scolaire à un
tournoi. Dans les Hauts-de-France, les ateliers et des matchs oeuvrant dans le
cadre de ce trophée sont pris en charge par Impro Academy. Pour les
matchs, des membres de l'école sont régulièrement
appelés pour faire partie du staff, c'est ce cadre qui peut permettre
à ceux qui le souhaitent de s'exercer aux différentes fonctions
du staff, soit en coach soit en assistant-arbitre. Les fonctions d'arbitre et
de maître de cérémonie étant présentes pour
construire réellement un cadre solide, elles sont confiées
à des improvisateurs plus expérimentés.
Certaines ligues amateurs ont l'opportunité, à
leur demande, de bénéficier de formations quant au staff ou
à l'improvisation théâtrale de façon plus
générale, dispensées par des professionnels. Il arrive
également que des matchs amateurs soient arbitrés par ces
mêmes professionnels. Thierry Bilisko, qui joue avec la ligue Paris Impro
et la Ligue Majeure d'Improvisation, avait arbitré le match entre le
Groupe d'Improvisation du Terril et la Licoeur de Bordeaux, le 09 Mars 2019.
La troupe ayant bénéficié de l'appui
d'improvisateurs professionnels pour sa création, la Ligue
d'Improvisation Lilloise Amateur est en contact étroit avec certains
arbitres professionnels, qui ont au moins vingt ans de métier. J'ai pu
me rendre compte, en discutant avec Arthur Pinta, que la troupe nourrissait des
exigences plus élevées quant à ceux qui forment le staff
par rapport aux joueurs sélectionnés. Je prendrais l'exemple du
coach, qui, en tant que sixième joueur et regard extérieur durant
un match, doit avoir une solide expérience du match. Arthur Pinta m'a
détaillé le processus de sélection : la candidature de
coach est soumise au comité Artistique, qui écoute l'avis des
joueurs. Un coach qui souhaite se former aura le loisir de le faire durant un
math avec un format allégé, ou de décorum et le rituel
sont moins contraignants. Ce sont ensuite les joueurs qui font un
130
débriefing avec les membres du Comité Artistique
à propos de la prestation de celui qui veut être
coach.225
Le Comité Artistique, avant que le Groupe
d'improvisation du Terril ne modifie sa structure, était en charge de
définir les équipes et les membres du staff pour les prestations.
Lorsque j'évoquais un entraînement sur la Science-Fiction au sein
de cette troupe, le fait qu'ils aient choisi de procéder autrement est
directement lié à leur vision de l'improvisation
théâtrale, partant du postulat qu'une expérience de la
scène n'est pas forcément nécessaire pour pratiquer
l'improvisation théâtrale ou animer un entraînement. Je
reprendrais pour illustrer mes propos une phrase d'Arthur Pinta « J'ai
peut-être une vision tronquée, mais je me dis que si on est pro,
on se dit qu'on est payés pour faire une prestation, les gens on les
voit pas avant ou après, mais on fait notre prestation. Pour moi, quand
tu fais ça en amateur, c'est que tu recherches tout le côté
humain qu'il y a autour »226
Le côté humain dans une association amateur peut
poser problème pour un spectacle d'improvisation : les membres du staff
étant dans l'ombre par rapport aux joueurs, les associations amateurs
sont souvent confrontées au manque de volontaires pour remplir ces
fonctions. J'ai néanmoins souhaité terminer par une analyse des
différentes manières possibles de s'essayer à ces
fonctions dans la région Hauts-de-France pour tenter d'approfondir mon
expérience en improvisation théâtrale. Philippe Despature
soulignait que c'est en faisant qu'on apprend... c'est l'école de «
Je me casse les dents » »227. C'est, à mon sens, ce
que le Groupe d'Improvisation du Terril a mis en place par rapport à son
fonctionnement, non seulement à propos des entraînements, mais
également à propos de la constitution des équipes pour les
spectacles : la troupe ne souhaitant pas dispenser de véritables cours,
Maxime Curillon et Florine Sachy, lorsqu'ils composent ces deux équipes,
se basent sur plusieurs critères, dont la présence des
improvisateurs aux entraînements, et la place que chacun tente à
prendre au sein d'un groupe, ce qu'ils ont observé durant la
journée de recrutements. Le critère de la présence aux
entraînements est de moins en moins pris en compte, mais il avait
été mis en place pendant un certain temps pour éviter que
des improvisateurs qui avaient une faible expérience en
entraînement se retrouvent sur scène.
Au fur et à mesure que chacun évolue durant les
entraînements, ceux qui sont chargés de sélectionner les
équipes essaient de mettre en place un équilibre avec ce qu'ils
ont perçu de la prestation de chacun. Maxime Curillon et Florine Sachy
ont matérialisé les différentes prestations selon trois
catégories :
225 Entretien avec Arthur Pinta, 25 février 2019.
226 Entretien avec Maxime Curillon et Florine Sachy, 28
Février 2019.
227 Entretien avec Philippe Despature, 25 Mars 2019.
131
-Des gens qui se tiennent sur scène, dans le sens
où ils sont capables de gérer quoi qu'il se passe. Ils vont s'en
sortir. Des gens qui vont réussir à se gérer seuls, mais
qui n'arriveront pas forcément à gérer les autres. Ils
vont penser à se sauver eux, mais pas forcément les copains.
-Ceux qui sont des piliers pour eux et pour les autres.
-Ceux qu'il faut se sécuriser, qui demandent l'attention
des autres.228
Ils s'essaient, pour chaque spectacle, de former une
équipe réunissant ces trois critères. Les fonctions du
cadre sont, la plupart du temps, assurés en binôme,
particulièrement pour « Impro à la carte ». Les autres
fonctions, telles que maître de cérémonie ou coach, sont la
plupart du temps assurées par les improvisateurs les plus anciens au
sein de la troupe.
Le Groupe d'Improvisation du Terril a donc
privilégié une certaine autogestion quant à la formation
de ses improvisateurs. Ils donnent des cours qui sont des techniques
d'improvisation communes à tout improvisateur, mais c'est ensuite libre
à chacun de s'essayer et de se renseigner sur les différentes
pratiques.
Depuis la prise d'autonomie par les amateurs, le nombre de
ligues a augmenté, comme sur tout le territoire. Au-delà des
troupes professionnelles comme la Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul,
les troupes amateurs de première génération tomme le
Groupe d'Improvisation du Terril et la Ligue d'Improvisation Lilloise Amateur,
des ligues à structure plus modeste ont vu le jour. La plupart d'entre
elles sont nées à l'initiative d'improvisateurs qui ont fait
leurs armes dans les premières ligues amateurs, et qui ont
souhaité se réapproprier la discipline. C'est ainsi que des
anciens élèves d'Impro Academy ont créé la ligue
des Imprononçables à Arras, et des anciens de la Ligue
d'Improvisation Lilloise Amateur ont fondé les Impro locos ou les
Georges Clownettes. Ces initiatives indépendantes ont modifié la
façon de transmettre, d'apprendre, et de jouer. Elles ont pu contribuer
à susciter davantage de visibilité et de curiosité pour
une discipline issue du théâtre. Jean-Baptiste Chauvin, pour ces
raisons, a déclaré se sentir poche des amateurs. Il était
l'un des premiers improvisateurs formés par des professionnels, et il a
vécu la prise d'autonomie de ces mêmes amateurs, et les conflits
qui en sont découles chez les professionnels : « Oui, les amateurs
peuvent être un danger mais ce sont aussi eux qui créent
l'engouement »229. L'engouement, pour ceux qui sont curieux,
peut à mon sens offrir une riche variété de spectacles,
qui vont questionner plusieurs aspects de l'improvisation
théâtrale. Ayant en majorité pratiqué le
théâtre à textes avant de mettre essayé à
l'improvisation théâtrale, j'ai partagé un questionnement
qui existe depuis plusieurs années désormais, qui est la question
de la part artistique dans l'improvisation théâtrale. Je me
suis
228 Entretien avec Maxime Curillon et Florine Sachy, 28
Février 2019.
229 Entretien avec Jean-Baptiste Chauvin, 06 Mars 2019.
demandé si il était possible de fournir des
improvisations qui vont au-delà d'un divertissement. Jean-Baptiste
Chauvin a posé la question suivante : « Comment le joueur
pourrait-il avoir la possibilité de créer des improvisations
dramatiques dans cet univers ludique et peu enclin aux émotions tristes
? »230 . Au-delà du cadre qui peut donner une
énergie et une ambiance identifiables qui vont orienter les
émotions suscitées par les improvisations, il est
néanmoins étrange de remarquer que l'improvisation tendrait soit
à faire rire, soit à rendre triste le public. J'ai toujours
soutenu que, selon moi, la réaction du public n'appartenait pas à
l'improvisateur, dès lors qu'il est en train d'expérimenter face
au spectateur. Par ailleurs, identifier un sentiment que l'on voudrait
transmettre au public impliquerait une notion d'objectif où
l'improvisateur souhaiterait transmettre une parole précise. Vouloir
s'interroger sur ce que l'on veut dire, en tant qu'improvisateur, est pour moi
la meilleure façon d'user de clichés ou de cabotinage, voire un
de surjouer pour être certain que l'émotion du personnage soit
comprise par le public. Si l'improvisateur se met en tête de vouloir
transmettre une émotion au public, il se met dès le début
de son improvisation un objectif qui aura, à mon avis, pour
conséquence de l'aveugler par rapport aux autres possibilités et
propositions de ses partenaires. Un autre aspect qui me semble
problématique, lorsqu'on utilise le terme « d'improvisation
dramatique », est que l'on a tendance à évoquer une
émotion extrême. Cela sous-entendrait que l'improvisation
théâtrale n'aurait qu'à offrir des émotions fortes
pour être identifiables, sans réelle nuance et de variation dans
le jeu ou dans les propos. Selon Jean-Baptiste Chauvin, le travail de
l'improvisateur n'est guère de provoquer des émotions chez le
spectateur :
en tant qu'auteurs, nous parlons du monde dans lequel nous
vivons, et nous pouvons faire de grandes choses de ce pouvoir pour être
bien plus que des rigolos de service. Pas forcément en revêtant
nos impros de messages fondamentaux ou de diatribes militantes, mais juste en
cherchant à parsemer nos histoires de petits points d'interrogations qui
permettront au spectateur de prolonger son expérience
théâtrale en sortant. 231
132
230 Jean-Baptiste Chauvin, op. cit ; p.143.
231 Jean-Baptiste Chauvin, Impro : à fond la forme !,
op. cit., disponible sur
https://www.improforma.fr/single-post/2019/01/21/Impro-%C3%A0-fond-la-forme
[consulté le 14/05/2019].
133
Conclusion
Ce mémoire avait pour ambition d'observer et
d'étudier le phénomène de la démocratisation de
l'improvisation théâtrale en tant que discipline artistique, et
l'apparition de nouvelles formes ou de nouveaux formats d'improvisation, en
particulier le match. Il m'a fallu, pour respecter la longue tradition de la
transmission orale spécifique à cette discipline, partir à
la rencontre de certaines personnalités qui étaient de mes
connaissances et qui évoluaient dans un domaine similaire au mien. Comme
la documentation sur l'improvisation est assez lacunaire, les
témoignages de ces personnes et mes expériences personnelles ont
étés mes principales sources de recherche.
Le territoire des Hauts-De-France s'est imposé
naturellement comme objet d'une étude de cas, car les différentes
expériences en improvisation que j'y ai connues ainsi que les contacts
que j'y ai noués constituaient un point de départ concret et
accessible. Les difficultés que j'ai rencontrées ont
résidé dans le fait d'accepter de remettre en cause mes propres
certitudes (acquises dans la pratique), lorsque je les confrontais à des
faits historiques ou à des témoignages. Après avoir
retracé l'histoire de l'implantation du match d'improvisation
théâtrale en France, j'ai choisi d'examiner de près
différentes structures dans la Région des Hauts-De-France.
En étudiant l'origine du match d'improvisation
théâtrale, je me suis intéressé au contexte social
et politique qui englobait la période de sa création, car son
créateur, Robert Gravel, avait été au centre de ses
émeutes lorsqu'il étudiait le théâtre au
conservatoire d'art dramatique du Canada dans les années 70. La
Révolution Tranquille touchait autant les étudiants en art (qui
refusaient les méthodes d'enseignement et les oeuvres
étudiées) que les Québecois qui réclamaient leur
indépendance face au Canada.
Le renouveau du théâtre au Québec ainsi
que la recherche d'une nouvelle identité se sont traduits par
l'émergence des troupes expérimentales, qui utilisaient
l'improvisation comme outil principal de création et d'écriture.
Robert Gravel, ayant vécu l'échec de la troupe
expérimentale des Jeunes Comédiens, avait crée un
spectacle qui réinterrogeait la place de l'acteur et de l'improvisation.
Avec le match d'improvisation, l'improvisation a quitté son statut de
source de création pour devenir l'objet principal du spectacle. Le
caractère sportif, qui impliquait alors une mise en scène pour
accueillir et les joueurs et la mise en place d'un
règlement, a favorisé la mise en place d'un cadre commun pour
tous qui allait favoriser son exportation.
J'ai pu recueillir les propos de certains improvisateurs
français qui ont étés témoins de l'installation du
match d'improvisation en France. Ces recherches m'ont amené à
étudier les travaux d'Alain Knapp et de Jean-Baptiste Chauvin. Le nom
d'Alain Knapp est apparu lorsque j'ai demandé à Emmanuel Leroy,
fondateur de la Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul, de me parler de sa
rencontre avec le match d'improvisation théâtrale. Par les
différents ateliers qu'il donnait, Alain Knapp a été
amener à côtoyer les premiers improvisateurs au Québec qui
suivaient ses stages à Paris et en France. Ses expériences sur
l'improvisation, au même titre que celles de Robert Gravel, s'inscrivent
toutes deux dans des contextes de remise en cause des institutions : la
Révolution Tranquille au Québec et les évènements
de mai 1968 en France. Ces travaux de recherche sur l'improvisation
théâtrale ont nourri les différentes
expérimentations inscrites dans la remise en cause des institutions et
du paysage socio-culturel. Il n'y avait donc pas d'ambition exclusivement
artistique, ce qui a poussé certains improvisateurs à inscrire la
pratique dans d'autres domaines, tels les domaines sociaux et scolaires.
En effet, les premières expérimentations du
match d'improvisation théâtrale en France ont favorisé
l'émergence de structures culturelles à Trappes. C'est dans cette
même ville que la compagnie Déclic théâtre et les
ateliers mis en place dans les collèges ont permis une expansion de la
discipline en-dehors du domaine artistique.
Ce passé a son importance. Il explique
l'identité complexe de l'improvisation théâtrale (à
la jonction entre discipline artistique, temps récréatif et outil
d'aide à l'insertion sociale et scolaire) ainsi que le grand nombre de
structures mises en place pour la pratiquer.
La grande accessibilité et la multiplication des
ateliers d'improvisation théâtrale ont favorisé la
création de structures à vocations multiples : les
Québecois, lors d'une tournée d'ateliers en 1981, auxquels ont
assisté des jeunes comédiens qui étaient à
l'époque en cours de professionnalisation, ont accompagné
l'ascension des ligues professionnelles, dont ces mêmes comédiens
sont aujourd'hui à l'origine. Dans les années 90, l'engouement
pour la discipline a suscité le développement d'ateliers et de
ligues amateurs. La grande accessibilité et l'efficacité du cadre
sportif qui rend les enjeux d'un match d'improvisation théâtral,
grâce aux votes et du format de compétition, explique
l'intérêt qu'a cette pratique auprès de personnes qui ne
sont pas issues d'une pratique artistique. Ce développement aboutit
à la création de nouveaux formats basés sur le match
d'improvisation théâtrale, avec le catch
d'improvisation232. Marko Mayerl, son créateur, a en effet
232 p. 48.
134
135
été confronté aux refus des ligues
professionnelles de lui apprendre la pratique du match d'improvisation. Ce sont
Jean-Baptiste Chauvin et Alain Degois, qui ne faisaient pas partie d'une ligue
professionnelle, qui ont aidé Marko Mayerl et ses partenaires à
se former, et à créer Ligue Ouverte et Libre d'Improvisation
Théâtrale Amateur. L'invention du catch a répondu a permis
de dépasser deux problèmes, d'une part, celui de la
dépendance face aux professionnels, peu enclins à partager une
discipline qui leur permettait d'explorer une nouvelle facette du
théâtre et qui leur assurait un nouveau moyen de remplir les
salles ; d'autre part, celui de l'obstacle financier, au moment où
Robert Gravel et son ami Yvon Leduc ont commencé à
réclamer des droits d'auteurs.
Ce nouveau format, qui était le premier à
exister après le match d'improvisation théâtrale, a ouvert
la voie à la création de format multiples, les amateurs
s'affranchissant ainsi du modèle que les professionnels se
réservaient.
L'histoire de l'improvisation théâtrale est
marquée par plusieurs conflits. Tout d'abord, les amateurs et les
professionnels se disputent la légitimité de pratiquer cette
discipline de plus en plus distincte de la pratique artistique. De plus, un
conflit financier et territorial est aussi perceptible : les ligues
professionnelles proposent désormais des services d'aide à
l'insertion sociale, qui sont également applicables à la vie en
entreprise et aux team buildings par des ateliers de prise de parole en public,
ou encore de confiance en soi. Le Label LIFPRO a mis en place un système
de partage du territoire national pour que chaque ligue professionnelle puisse
proposer ses services aux entreprises locales. Plusieurs organismes ont
également été créés, à l'instar du
trophée d'improvisation Culture et Diversité, pour utiliser les
outils de l'improvisation théâtrale en milieu scolaire. À
ces exceptions près,
l'évolution de l'improvisation théâtrale
est marquée par des initiatives individuelles : Robert Gravel a eu
l'idée du match d'improvisation ; de la rencontre entre Papy et le
professeur d'éducation physique Jean Jourdan sont nés les
ateliers d'improvisation dans les collèges de Trappes ; Marko Mayerl est
à l'initiative du catch d'improvisation. Les initiatives individuelles
sous-entendent également que ce sont les relations humaines qui
provoquent changements et évolutions, et sont également soumises
à des conflits. Certains conflits entre professionnels ont
également donné naissance à des ligues qui sont
nées en dehors du label LIFPRO.
Apprendre l'histoire de la discipline en France m'a fait
prendre du recul sur les structures qui existent dans la région
Hauts-De-France, et qui sont soumises à des problématiques
similaires. La
136
démocratisation de cette discipline, en effet, se
traduit par son utilisation dans les structures artistiques professionnelles,
non professionnelles, sociales et scolaires.
Mes recherches, qui avaient pour ambition première
d'étudier les origines des structures dans laquelle je pratique
l'improvisation théâtrale ou proposant des spectacles dans la
région Hauts-De-France, m'ont amené à identifier ces
structures comme les héritières des questionnements et des
évolutions qui ont amené l'improvisation théâtrale
à se démocratiser et à évoluer dans
différents domaines.
Elle est aujourd'hui présente en tant
qu'activité artistique professionnelle, autrement dit avec une exigence
quant à la qualité des spectacles par la présence de la
Ligue d'Improvisation de Marcq-en-Baroeul. Certaines inimitiés et
conflits ont donné naissance à la fédération
professionnelle Lille Impro, regroupée avec L'école Impro Academy
et l'organisme de formation Les pieds sur scène sous l'égide de
La Scénosphère. J'ai privilégié l'étude de
deux ligues amateurs que sont le Groupe d'Improvisation du Terril et la Ligue
d'Improvisation Lilloise Amateur en raison de leur longévité et
de leur histoire. Elles sont représentatives de la relation qui a eu
lieu autrefois entre les amateurs et les professionnels. La
démocratisation de la discipline a ensuite creusé une distance
entre ces deux types de ligues, dont la vision de l'improvisation
théâtrale était différente. Elles continuent,
néanmoins, par leur origine professionnelle, à chercher une
exigence dans leur spectacle, tout en restant dans le format amateur. Les
membres de ces troupes amateurs cherchent à offrir des spectacles de
qualité autres que le match. C'est en effet aux amateurs que l'on doit
la majorité des nouveaux formats qui sont apparus depuis le match
d'improvisation théâtrale, et qui, grâce à un statut
d'artiste bénévole, peuvent avoir une plus grande liberté
dans la recherche et l'expérimentation. Ce phénomène
explique la multiplication des ligues d'improvisation sur le territoire.
Suite à ma formation chez Impro Academy, j'ai à
mon tour transmis les outils de l'improvisation dans le cadre d'ateliers
scolaires ou de préparation à des concours, et compris combien
elle facilitait la confiance en soi et la prise de parole en public.
Je continue aujourd'hui à multiplier mes
expériences dans les différentes domaines dans laquelle
l'improvisation théâtrale est utilisée. Mon activité
récente de formateur m'a fait comprendre certaines limites de la
démocratisation de la pratique de l'improvisation : la recherche
artistique y importe moins que les compétences acquises grâce
à l'improvisation. Elle devient un moyen et un instrument au service du
développement personnel. Un intervenant-improvisateur doit être
capable d'appréhender des problématiques qui ne sont plus
artistiques ou du domaine du loisir, mais du
137
domaine social. Par essence, un improvisateur a du courage de
se jeter sur une scène sans avoir préparée sa prestation,
c'est pourquoi la principale valeur qui est enseignée dans les ateliers
est la bienveillance. Avec l'usage, il me semble que c'est devenu moins une
valeur qu'un automatisme, et les improvisateurs s'encouragent et se
congratulent généreusement au début de chaque spectacle,
et sont félicités pour leur effort et leur audace. Ce rituel fait
désormais partie intégrante du spectacle, comme si la bonne
humeur devait être présente à tout prix.
Ce conditionnement auquel se livrent les improvisateurs et le
public à chaque spectacle d'improvisation, peut être une
explication de la mauvaise réputation dont souffre l'improvisation
théâtrale de nos jours, et qui remet en cause sa
légitimité en pratique artistique. L'indulgence dont les
improvisateurs bénéficient en effet peut les pousser au
cabotinage, aux dépens parfois de certaines choses qui pourraient
être dites sur scène et qui ne sont pas du ressort comique. Par
ailleurs, ce même conditionnement tend parfois à faire passer sous
silence des dérives, qui tiennent cependant autant de la
responsabilité du spectateur que de celle de l'improvisateur. Le
spectacle d'improvisation obéissant à une création
instantanée, il est fréquent de voir des improvisateurs
obéir à l'urgence de fournir un personnage ou une histoire en
utilisant des outils grossiers, tel des accents ou des attitudes corporelles
exagérément stéréotypées. L'improvisateur se
met alors dans une position de sécurité, où le spectateur
et ses partenaires reconnaissent de manière aisée le personnage.
L'utilisation de ces outils peut aussi mener à des propos ou des
attitudes déplacées.
Chaque spectacle d'improvisation théâtrale
étant un terrain d'expérimentation, et par conséquent de
libre expression, la bonne tenue d'un spectacle tient de la
responsabilité individuelle. En tant que juge, le spectateur a
également une responsabilité lorsqu'il est sollicité pour
donner un thème aux improvisateurs. Les deux entités sont donc
liées et participent de concert à l'élaboration et
à ce qui est dit dans un spectacle d'improvisation. Il y a donc une
responsabilité partagée pour que chacun oeuvre à la bonne
construction d'un spectacle et que les conditions soient favorables pour que la
discipline reste à la fois exigeante et accessible à tous.
Au fil de mes recherches, j'ai tenté de rencontrer des
improvisateurs aux profils variés : amateurs, professionnels,
formateurs. J'ai pris conscience, à l'issue de tous les entretiens
effectués, que tous étaient des hommes, à l'exception de
Florine Sachy. Il m'est apparu, lorsque je me suis interrogé sur la
parité dans le paysage actuel en France, que la discipline reste en
grande majorité masculine, y compris dans le domaine professionnel
où je pourrais néanmoins citer Cécile Giroud, appartenant
à la Ligue d'Improvisation Lyonnaise ainsi qu'à la Ligue Majeure
d'Improvisation. J'ai mis ce constat en relation avec les critiques de la
comédienne Pol Pelletier lorsqu'elle était au
Théâtre Expérimental de Montréal. Elle avait en
effet fortement désapprouvé le match d'improvisation,
138
transposition théâtrale des codes et des rituels
du hockey, qui excluait selon elle les femmes par rapport à la
démonstration de virilité qu'il implique. Tout au long de cet
ouvrage, il a été vu que les formats qui se jouent actuellement
dans le cadre d'un spectacle d'improvisation théâtrale sont
hérités du match d'improvisation, qui mêle
théâtre et sport. La règle de la parité dans ce
format, bien qu'elle oeuvre vers une égalité sur le plan
quantitatif, laisse place à une interrogation sur les rapports de
mixité et d'égalité dans ces deux domaines. Elle laisse en
effet en suspens la question des fonctions significatives, qui peuvent
être apparentées à celles de coach ou de capitaine pour le
match d'improvisation, qui impliquent une hiérarchisation dans une
équipe sportive, mais qui véhiculent également une figure
de virilité. Ces interrogations sur ces fonctions dirigeantes peuvent
également se retrouver dans le domaine théâtral, à
travers les professions relatives à la mise en scène,
l'enseignement ou la direction de centres dramatiques nationaux. Le sujet a
été évoqué par la maîtresse de
conférence Raphaëlle Doyon dans une étude
réalisée en Janvier 2019 intitulée Les trajectoires
professionnelles des artistes femmes en art dramatique. L'étude est
construite selon cinq domaines d'observation établis par l'actrice Reine
Prat : « -les enseignements artistiques, les formations aux métiers
de la culture, l'insertion professionnelle, / -les relations de travail au sein
des entreprises, / -l'exercice des responsabilités et la prise de
décision, / -l'accès aux moyens de production, aux réseaux
de diffusion, à la visibilité médiatique, / -les
représentations artistiques»233.
233 Raphaëlle Doyon, Les trajectoires professionnelles
des artistes femmes en art dramatique, p. 78, disponible sur
http://hf-idf.org/wp-content/uploads/2019/02/Doyon_HF_trajectoires_femmes_theatre.pdf
[consulté le 10/06/2019]
139
Bibliographie
Ouvrages
- Roger Caillois, Les jeux et les hommes, le masque et le
vertige, Paris, Gallimard, 1958
-Hervé Charton, Alain Knapp et la liberté de
création dans l'improvisation théâtrale, Paris,
Classique Garnier, 2017
-Jean-Baptiste Chauvin, Le match d'improvisation
théâtrale, Paris, Improfrance, 2015
- Robert Gravel, Jan-Marc Lavergne , Impro :réflexions
et analyses, Ottawa, Éditions Leméac, 1987
-Keith Johnstone, Impro,improvisation et
théâtre, Paris, Éditions Ipanéma, 2013
-Jean Peneff, Le Goût de l'observation. Comprendre et
pratiquer l'observation participante en sciences sociales, Paris, La
Découverte, 2009
-Christophe Tournier, Manuel d'improvisation
théâtrale, Genève, Éditions de l'Eau-vive,
2006
-Paul Zumthor, La Lettre et la voix. De la
«littérature médiévale», Paris,
Éditions du Seuil, 1987
articles en ligne
Jean-Baptiste Chauvin, Impro: à fond la forme!,
disponible sur
https://www.improforma.fr/single-post/2019/01/21/Impro-à-fond-la-forme
[consulté le 14/05/2019]
140
revues en ligne
-Hélène Beauchamp, Françoise Simon, Les
jeunes comédiens du Théâtre du Nouveau Monde ou l'esprit
nomade, L'annuaire théâtral, numéro 22, 1997,
disponible sur
https://www.erudit.org/fr/revues/annuaire/1997-n22-annuaire3668/041332ar.pdf
[consulté le 13/02/2019].
-Raymond Cloutier, Le Grand Cirque Ordinaire:
réflexions sur une expérience, Études
françaises, vol 15, numéro 1-2, Avril 1979, disponible sur
https://www.erudit.org/fr/revues/etudfr/1979-v15-n1-2-etudfr1689/036688ar.pdf
[consulté le 14/02/2019]
- Hélène Pedneault, Robert Gravel, esquisse
d'un homme de théâtre baveux, Revue Jeu, 1997,
disponible sur
https://www.erudit.org/fr/revues/jeu/1997-n82-jeu1072752/25394ac.pdf
[consulté le 11/03/2019]
mémoires et thèses
- Jean Couturier, Le théâtre de l'Unité :
un parcours singulier, sous la direction de Robert Abirached, Centre
d'études théâtrales, Université Paris X Nanterres,
1993
-Raphaëlle Doyon, Les trajectoires professionnelles des
artistes femmes en art dramatique, disponible sur
http://hf-idf.org/wp-content/uploads/2019/02/Doyon_HF_trajectoires_femmes_theatre.pdf
[consulté le 10/06/2019]
-Valentine Nogalo, L'improvisation théâtrale et
son enseignement dans le milieu scolaire:de la France au Québec, les
enjeux d'une pratique artistique à part entière, sous la
direction de Yves Morvan, UFR Arts et médias, Département de
médiation culturelle, Université Paris 3 Sorbonne nouvelle,
2017
141
dossiers de presse
-Joyce Cunningham, Paul Lefebvre, Dossier de presse de la
Ligue Nationale d'Improvisation, disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/medias/documents/la-ligue-nationale-dimprovisation-dossier-de-presse
[consulté le 11/03/2019]
- Ligue Nationale d'Improvisation, La petite histoire de la
coupe du monde d'improvisation, 1985, disponible sur
http://match.impro.free.fr/telechargements/mondial-1985.pdf
[consulté le 27/03/2019]
manifestes
-Robert Gravel, J'ai donné ma jeunesse au T.E.M,
disponible sur
http://www.nte.qc.ca/historique/
[consulté le 15/02/2019]
Nicole Lecavalier, Alice Ronfard, Anne-Marie Provencher,
Dominique Gagnon, Francine Pelletier, Louise Laprade, Louise Ladouceur, Pol
Pelletier, Louise Portal, Geneviève Notebaert, Ginette Morin, Lorraine
Pintal, Trac femmes, 1978, disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/publications/trac-femmes
consulté le 27/03/2019]
-Jean-Pierre Ronfard, Passage du Théâtre
expérimental de Montréal au Nouveau Théâtre
Expérimental, ou les avatars de l'autogestion, extrait du cahier
Archéologie, 1974, disponible sur
https://archives.nte.qc.ca/publications/cahier-i-archeologie
[consulté le 31/03/2019]
-Ligue Nationale d'improvisation, .Les règlements
officiels, 2018, disponible sur https://www.lni.ca/
matchdimpro/regles-officielles [consulté le 14/05/2019]
vidéos en ligne
Jean-Claude Coulbois, Entrevue avec Robert Gravel, 1996,
disponible sur https://archives.nte.qc.ca/
medias/videos/entrevue-avec-robert-gravel [consulté le
22/02/2019]
142
Annexes
Entretiens réalisés
-Jean-Baptiste Chauvin, co-fondateur de la compagnie
Déclic-Théâtre, membre de la Ligue Majeure d'Improvisation.
Entretien téléphonique réalisé le 06 Mars 2019.
-Maxime Curillon et Florine Sachy, président et
secrétaire du Groupe d'Improvisation du Terril. Entretien
réalisé à Lille le 28 Février 2019.
-Philippe Despature, directeur artistique de l'école Impro
Academy. Entretien réalisé à Mons-en-Baroeul le 25 Mars
2019.
-Simon Fache, pianiste à la Ligue d'Improvisation de
Marcq-en-Baroeul. Entretien réalisé à Tourcoing le 27
Février 2019.
-Emmanuel Leroy, directeur artistique de la Ligue d'Improvisation
de Marcq-en-Baroeul. Entretien téléphonique réalisé
le 22 Février 2019.
-Arthur Pinta, président de la Ligue d'Improvisation
Lilloise Amateur. Entretien réalisé à Lille le 26
Février 2019.
-Corentin Vigou, professeur chez Impro Academy. Entretien
réalisé à Lille le 09 Avril 2018.
143
Les signaux d'arbitre, pour le match d'improvisation
théâtrale
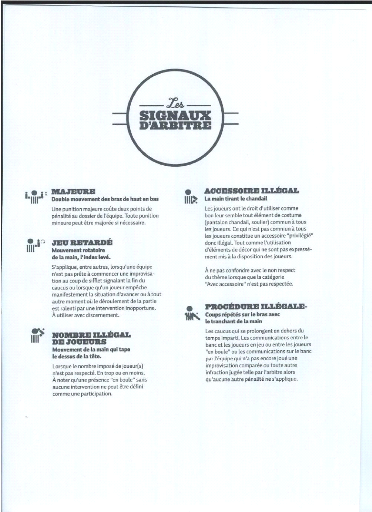
et
MANQUE D'ÉCOUTE
La main tenant le poignet
Ii y a manque d'écoute lorsque le joueur fautif, de
façon consciente ou non, ne tient pas compte de ce qui a
été dit, fait ou installé.
R.ETUS DE PERSONNAGE
La main masque la figure
RUDESSE
Coup de poing dans la main ouverte
OBSTRUCTION (Majeure)
Les bras font un X vers les épaules, poings
fermés
Lorsque l'improvisateur refuse, détruit et/ou nuit
à L'improvisation de façon intentionelLe etlau qu'il
empêche le bon déroulement de l'histoire.
n MAUVAISE
IIP CONDUITE (Majeure) Les mains sur les
hanches
Lorsque le joueur (voir même l' i nd ividu)
nuit de façon majeure au spectacle.
· s PUNITION DE MATCH
gllr Double mouvement des mains sur les hanches
Entraîne automatiquement l'expulsion et
n'ajoute pas de points de pénalité.
n .
llr
144
CABOTINAGE
Pied de nez
b utiliser avec discernement. Lorsqu'un joueur
ou une équipe tente de s'attirer la faveur du public par le biais d'une
blague bite au détriment de l'improvisation en cours_
THÈME NON RESPECTÉ
Rectangle dessiné dans le vide avec les deux
index
Lorsque des éléments du carton-thème (titre
ou catégorie) ne sont pas respectés.
Peut être annoncée comme "Non respect du
thème" ou "Non respect de La catégorie"
CLICK
Tape sur le talon
LI utiliser avec discernement. Idée
banale reproduite à plusieurs reprises lors d'un même
Match ou utilisation peu subtile d'un référant (pièce de
théâtre, film, roman, etc_).
(En Europe, ta punition appelée "dé}à vu",
signalée par La main devant L'oeitformant un zéro, apporte une
distinction supplémentaire).
· .1:
DÉCROCHAGE
Mouvement du bras de haut en bas avec le poing
ferme"
Les fous rires non contenus en sont, tes personnages ou
les accents non soutenus également. A utiliser avec
discernement.
zso
CONFUSION
Rotation complète des bras devant
le tronc
Lorsque Le jeu devient confus parce que personne ne joue la
même improvisation, lorsque des erreurs de noms, de dates, de lieux ou
autres éléments perturbent manifestement Ee déroulement
normal de L'histoire, lorsque l'histoire devient manifestement
impossible à suivre ou que ce qui est clairement
installé n'est manifestement pas respecté, il y a peut-être
confusion...
145
Table des illustrations
Photographies
-Robert Gravel et Gilles Renaud durant une
représentation des 12 heures d'improvisation à deux
comédiens (1976) 18
-Pol Pelletier et Robert Gravel durant une
représentation de Une femme, un homme (1975) 23
-La patinoire, aire de jeu du match d'improvisation
théâtrale 85
-Le ring, aire de jeu du catch d'improvisation
théâtrale 92
Schémas
-Organisation des ligues d'improvisation des Hauts-de-France
étudiées 101
-Organigramme de la Scénosphère .102
146
| 


