UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique «
ENVIDROIT »
ANALYSE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE
LUTTE
CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ESPECES MENACEES
EN AFRIQUE
CENTRALE : LE CAS DE L'ELEPHANT ET DU GORILLE
Mémoire présenté par ANGELE
SERAPHINE NANFAH DONFACK Sous la direction de Mme
Sévérine NADAUD, Maitre de conférences,
Université de Limoges
Août 2014
i
DEDICACES
Je dédie spécialement ce mémoire à
DIEU Tout Puissant et à mes parents
pour la grâce et le soutien qu'ils m'ont accordés lors de
la réalisation de ce travail.
ii
REMERCIEMENTS
Mes sincères remerciements vont à l'endroit de
ma grande soeur NGUEGUIM NANFAH Josiane, mon frère
NANFAH Rodrigue et mes petites soeurs et frère. Je
n'oublie pas mes neveux et mes nièces, Frédérique
coco, Dominique Brenda, Prince,
et Paolo Tchouchou.
Je remercie également le Ministère de
l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement
Durable (MINEPDED) et le Ministère des forêts et de la Faune
(MINFOF) du Cameroun, qui m'ont permis d'effectuer mes stages
académiques dans de très bonnes conditions. Un merci particulier
à l'endroit de ma Directrice de mon mémoire, Madame
Sévérine NADAUD pour ses conseils
méthodologiques et ses chaleureux encouragements durant la
rédaction de ce travail.
iii
LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX
I-Liste des photos et des figures
Photo 1. Eléphant de Forêt Photo 2.
Eléphant de la savane 7
Photo 3. Eléphants massacrés à Gamba au
Tchad, (au total 89) en mars 2013 11
Photo 4. Gorille de l'Ouest Photo 5. Gorille de plaine de l'Est
13
Photo 6. Des gorilles victimes du braconnage en RDC (2007)
16
Figure 1. Augmentation des aires protégées
(valeurs non cumulatives), Source UICN (1994) 20
Figure 2. Distribution des éléphants dans les
aires protégées d'Afrique Centrale 21
Figure 3. Zonage schématique d'une aire
protégée 22
II-Liste des tableaux
Tableau 1. Récapitulatif de la classification des
gorilles 14
Tableau 2. Etat de distribution des éléphants
dans sept pays d'Afrique centrale 19
Tableau 3. Les aires protégées en cours de
création au Cameroun (2012) 24
Tableau 4. Quelques aires protégées du Congo
25
Tableau 5. Quelques aires protégées du TCHAD
25
iv
ACRONYMES
AFD : Agence Française de
Développement
AGNU : Assemblée
générale des Nations Unies
ANPN : Agence Nationale des Parcs
Nationaux
APT : Aires Protégées
Transfrontalières
BAD : Banque Africaine de
Développement
BM : Banque Mondiale
CDB : Convention sur la Diversité
biologique
CDP : Conférence des Parties
CCN : Cellule de Coordination Nationale
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies
sur le Changement Climatique
CE : Commission Européenne
CEEAC : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique Centrale
CEFDHAC : Conférence sur les
Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale
CIB : Congolaise Industrielle des Bois
CITES : Convention sur le Commerce
International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages
Menacées d'Extinction
CMS : Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
COMIFAC : Commission des Forêts
d'Afrique Centrale
ECOFAC : Ecosystèmes Forestiers
d'Afrique Centrale
ETIS : Éléphant Trade
Information System
FACA : Forces Armées
Centrafricaines
FAO : Fonds des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
FCFA: Franc de la Communauté
Financière Africaine
FEM : Fonds pour l'environnement mondial
FMI : Fonds Monétaire International
FTNS : Fixed Telecommunications Network
Services
GIZ : Agence de coopération
allemande
GSEAF : Groupe de spécialistes des
éléphants d'Afrique
GTBAC : Groupe de Travail Biodiversité
d'Afrique Centrale
Ha: Hectare
v
ICCN : Institut Congolais pour la
Conservation de la Nature
IFAW: International Fund for Animal
Welfare
Kg: Kilogramme
LAGA: Last Great Ape Organization
MEFE : Ministère de l'Economie
Forestière et de l'Environnement
MIKE: Monitoring of Illegal Killing of
Elephants (Suivi de l'abattage illégale des éléphants)
MINEPDED : Ministère de
l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement
Durable
MINFOF : Ministère des Forêts et
de la Faune du Cameroun
NEPAD : Nouveau Partenariat pour le
Développement de l'Afrique
RCA : République Centrafricaine
RDC : République Démocratique
du Congo
REPAR : Réseau des Parlementaires pour
la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers
d'Afrique Centrale
RFI : Radio France internationale
OCFSA : Organisation pour la Conservation et
la Faune et de la flore sauvages en Afrique
Centrale
OFAC : Observatoire des Forêts
d'Afrique Centrale
OMD : Organisation Mondiale des Douanes
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations unies
ONUDC : Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime
PACEBCo : Programme d'Appui à la
Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo
PAPECALF: Plan d'Action Sous-Régional
des Pays de l'espace COMIFAC pour le
renforcement de l'application des législations
nationales sur la faune sauvage
PAULAB : Plan d'Action d'Urgence de Lutte
Anti braconnage
PEXULAB : Plan d'Extrême Urgence de
Lutte Anti-braconnage
PM: Premier ministre
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
POP : Polluant Organique Persistant
PROGEPP : Projet de Gestion des
Ecosystèmes Périphériques
vi
PUSAF : Plan d'Urgence pour la
Sécurisation des Aires protégées
RAPAC: Réseau des Aires
Protégées d'Afrique Centrale
RIDACC : Réseau des Institutions de
Formations Forestières et Environnementales d'Afrique
Centrale
SGTFAP : Sous Groupe de Travail Faune et
Aires Protégée
TNS : Tri National de la Sangha
TRIDOM: Trinational Dja-Odzala-Minkebe
UA : Union africaine
UE : Union européenne
UICN: Union mondiale pour la nature
UNESCO: United Nations Educational Scientific
and Cultural Organization
UNOPS: United Nations Office for Project
Services
USA: United state of America
USAID: United States Agency for International
Development
USFS: United States Forest Service
USFWS: United States Fish and Wildlife
Service
WSC: Wildlife Conservation Society
WWF: World Wide Fund for Nature
ZIC : Zone d'intérêt
cynégétique
ZICGC : Zone d'intérêt
cynégétique Gestion Communautaire
vii
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I: DIVERSITE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE
LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET GORILLES
EN
AFRIQUE CENTRALE 5
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES ELEPHANTS ET LES GORILLES
D'AFRIQUE
CENTRALE 5
Section 1 : Généralités sur les
éléphants 5
Section 2 : Généralités sur les gorilles
d'Afrique centrale 12
Section 3: Les grands complexes transfrontaliers et les aires
protégées en Afrique centrale 16
CHAPITRE II : PANOPLIE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE LUTTE
CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET GORILLES EN
AFRIQUE CENTRALE 27
Section 1 : Convention spécifique à la lutte
contre le trafic des deux espèces : La CITES 27
Section 2: Conventions internationales
généralisant la lutte contre le trafic et le braconnage des
éléphants et des gorilles 30
Section 3: Les éléphants et les gorilles :
Instruments internationaux protégeant chaque espèce
séparement 34
PARTIE II: L'IMPACT DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE
LUTTE CONTRE LE TRAFFIC ET LE BRACONNAGE DE L'ELEPHANT ET DU
GORILLE
EN AFRIQUE CENTRALE 38
CHAPITRE I. EFFECTIVITE DE LA MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX DANS LA CONSERVATION DES ELEPHANTS ET DES GORILLES
38
Section 1 : L'instauration des plans d'actions et des
stratégies de lutte contre les actes criminels
dans la faune en Afrique centrale 39
Section 2 : Mesures prises par les Etats d'Afrique centrale et
de la participation des
organisations dans la lutte contre le trafic et le braconnage
des espèces menacées 44
Section 3: Résultats de l'application des conventions
internationales de lutte contre le trafic et
le braconnage des éléphants et des gorilles
53
CHAPITRE II : LES ENTRAVES A L'APPLICATION EFFICACE DES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES
ELEPHANTS ET DES GORILLES EN AFRIQUE CENTRALE 57
viii
Section 1 : Particularités des problèmes du trafic
et du braconnage des éléphants et des gorilles
dans la sous- region 57
Section 2 : Esquisses de solution compensatoire des contraintes
existantes 61
1
INTRODUCTION GENERALE
L'Afrique centrale est située au coeur du continent
africain. Elle couvre le Cameroun, la République Centrafricaine (RCA),
le Congo, la République Démocratique du Congo (RDC), le Gabon, la
Guinée Equatoriale, Sao Tomé et Principe et le Tchad 1
. Cette sous-région subsaharienne abrite une faune variée et
diversifiée constituée entre autre de grands mammifères
dont les plus emblématiques sont les éléphants, les grands
singes, les lions, les bongo, les rhinocéros et les hippopotames.
Malheureusement, du fait de plusieurs facteurs parfois combinés
(pauvreté des populations locales, accroissement de la demande nationale
et internationale des produits fauniques, accentuation du commerce
illégal et trafic d'armes), cette richesse faunique est très
menacée avec des prélèvements anarchiques observés.
En effet, des dizaines d'espèces animales et végétales
disparaissent chaque année. Et, « Si rien n'est fait, plus de
la moitié de ces espèces risquent de disparaitre d'ici la fin de
ce siècle. Chaque espèce, même la plus insignifiante, a une
place unique au sein d'un écosystème dont l'Homme fait
également partie. La liste des espèces disparues est
déjà longue »2. A titre illustratif, on a
enregistré une perte de 11 000 éléphants en moins de 10
ans dans la zone du Parc National de Minkébé au Nord du Gabon due
essentiellement au braconnage et au commerce illicite de l'ivoire. Au Cameroun,
les actes de braconnage ont connu leurs apogées en 2012 avec une perte
énorme d'éléphants chiffrée à près de
250 dans le Parc National de Bouba N'djida. Ces deux périodes sombres de
l'histoire de l'Afrique centrale ne sont cependant pas des cas isolés.
Dans un tel contexte, Yury FEDOTOV, Directeur général de l'Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) estime que : «
le commerce illicite des espèces sauvages est une forme de
criminalité transnationale organisée, tout comme le trafic de
stupéfiants, d'armes et d'êtres humains qui apportent des
conséquences négatives sur la sécurité et le
développement »3. En d'autres termes, la
criminalité faunique est une infraction à l'échelle
planétaire au même titre que les autres formes de
criminalité et entrave la paix et la stabilité sociale. C'est
pourquoi, plusieurs acteurs de la scène internationale comme l'UNODC, la
CITES, Interpol et la Banque mondiale ont créé en 2010, le
Consortium international sur la lutte contre la criminalité faunique,
dont la finalité est de fournir des aides aux pays victimes des actes de
trafic et de braconnage.
En Afrique centrale, l'existence des instruments
internationaux sont d'une grande nécessité. L'enjeu actuel est
énorme, et ne sera profondément acquise que si ces instruments
juridiques adoptés sont respectés et pris en compte dans les
politiques sous-régionales. Car, la faune est un élément
capital et vital de notre milieu forestier. De plus, cet espace naturel
constitue la pierre angulaire de l'industrie touristique naissante du milieu.
Elle est sujette à la recherche scientifique4. Il est
essentiel de préserver la faune qui détient faut-il le
préciser une panoplie de ressources fauniques et floristiques. En
matière de protection des ressources fauniques, bon nombre d' «
instruments internationaux » seront
énumérés dans le cadre de cette étude. Selon le
dictionnaire juridique de Gérard CORNU, « un instrument
juridique est un texte (...) englobant l'ensemble des actes lato sensu
dotés d'une valeur obligatoire »5. Par ricochet, un
instrument juridique est qualifié d'international lorsqu'il s'agit d'un
texte ou un acte
1
http://lemarcheafricain.over-blog.com.
2 WILSON Edward O., Sauvons la Biodiversité !,
Dunod, avril 2007, p. 86.
3 CEEAC, Projet de Plan d'Extrême Urgence de Lutte Anti
braconnage (PEXULAB) dans la zone des savanes du Nord Cameroun, Nord-RCA et
Sud-Tchad, p.1.
4 BIGOMBE LOGO Patrice, Le retournement de l'Etat
Forestier. L'endroit et l'envers des processus de gestion forestière au
Cameroun, Préface du Professeur Maurice KAMTO, presse de l'UCAC,
2004, p.27.
5 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique,
Association Henri CAPITANT, PUF, p. 555.
2
juridique opposable à plusieurs acteurs de la
scène internationale. Dans les relations internationales, on distingue
plusieurs instruments internationaux parmi lesquels les conventions, les
protocoles, les mémorandums, les déclarations etc.
L'avènement de ces instruments en matière de lutte contre les
actes criminels dans la faune s'est fait progressivement et s'est
avéré nécessaire dans l'encadrement des modalités
d'exploitation des espèces fauniques. Ceci ayant comme ultime
finalité l'éradication en Afrique centrale du trafic et du «
braconnage ». Cette dernière notion est
définit selon Seydou OUATTARA et Mamadou MARIKO comme : «
l'exercice illégal de la chasse ». Cela revient à
dire que le braconnage est un acte commis délibérément en
violation des lois et réglementations en vigueur. Gérard CORNU
quant à lui appréhende le braconnage dans un double sens : «
au sens général, il signifie un acte de chasse ou de
pêche, interdit par les lois et règlements. Au sens technique, (le
braconnage renvoi à) tout acte de recherche et de poursuite du gibier ou
de poisson, en vue de le capturer et de le tuer, lorsque ces actes sont
effectués au moyen de procédés ou d'engins
prohibés, ou encore en des temps ou lieux interdits
»6. Au regard de cette acception, l'appréhension au
sens technique du braconnage est celle qui sera considérée dans
le cadre de cette étude. Car en Afrique centrale, les braconniers
pourchassent principalement les espèces menacées d'extinction
dans les aires protégées interdites de chasse.
Tout comme le braconnage, le trafic des
éléphants et des gorilles constitue un véritable
fléau social. Ce « trafic » peut être
apprécié de deux manières : selon qu'il est légal
ou selon qu'il est illégal. Dans le premier cas, le trafiquant agissant
légalement doit s'assurer qu'il respecte la législation en
vigueur. Le trafic illégal qui nous intéresse dans le cadre de
cette étude concerne les actes prohibés et répressifs qui
constituent une atteinte grave à l'environnement. Ainsi, cette forme de
trafic est celui qui implique le commerce, la contrebande, la capture, la
collecte interdits d'espèces menacées, d'espèces
menacées d'extinction (dont les espèces animales et
végétales soumises à des quotas de récolte ou de
capture et réglementées par des permis) et de
dérivés ou de produits de ces espèces7.
L'expression « espèce menacée
» est largement employée dans les instruments
internationaux visant la conservation de l'environnement. Il renvoie en fait,
à une division d'un genre renfermant plusieurs êtres réunis
sous un caractère commun qui les distinguent des autres êtres et
qui subissent des pressions externes comme le braconnage, le trafic et les
catastrophes naturelles entrainant ainsi leur disparition. Tel est le cas des
populations d'« éléphants » et des
gorilles. Pour ce qui est de la première espèce, l'on pourrait
l'assimiler comme des mammifères pachydermes de l'ordre des
proboscidiens. Ce sont des espèces emblématiques respectés
dans tout le continent africain, ils sont symboles de force et de croyances de
toute nature. Les «Gorilles » quant à eux
représentent les espèces et sous-espèces du genre Gorilla.
Ces deux espèces subissent depuis plusieurs décennies des actes
impitoyables qui entrainent des irréversibilités
coûteuses8, tant du point de vue environnemental
qu'économique. Les auteurs de ces actes criminels procèdent le
plus souvent par la violence et utilisent des armes redoutables et
dangereux9 pour parvenir à leurs fins.
6 Ibid., p. 136.
7 N. South et T. Wyatt. Comparing illicit trades in
wildlife and drugs: an exploratory study, Deviant Behavior, 2011,
538-61.
8 BÜRGENMEIER Beat, Hubert GREPPIN, Sylvain PERRET,
Economie aux frontières de la nature, Biologie,
économie, Agronomie, l'Harmattan, décembre 2007.
9 Plusieurs massacres des éléphants et des
autres espèces fauniques sont faits à base des armes, des bombes,
des artilleries lourdes. Face à ces moyens de chasse, les populations
vivant à proximité des airs protégées sont
également en danger.
3
Cette analyse vient à point nommé car elle a
pour soucis d'attirer l'attention des décideurs politiques, des pays
consommateurs des produits issus des pachydermes et des gorilles ainsi que le
grand public.
Dans ce travail, nous nous limiterons à analyser
uniquement les instruments internationaux tels que les conventions, les
déclarations et les accords. Pour cela, nous identifierons
spécialement ceux qui interdisent les actes criminels contre les
éléphants et les gorilles. A noter que la lutte
évoquée dans l'intitulé de cette étude consiste
à la mise en oeuvre des stratégies et plans d'actions
recommandés par ces instruments internationaux. Les pays africains
disposent en réalité des moyens nécessaires10
pour éradiquer les fléaux qui entravent leur
développement. C'est pourquoi il faut comprendre Serge BAHUCHET
lorsqu'il affirme que : « (...) L'homme, dans quelque culture que ce
soit, est capable de gérer convenablement son milieu, pourvu qu'il
dispose de bonnes conditions sociales, politiques et économiques
»11 .
Au regard de notre thème de mémoire, la question
de savoir si les instruments internationaux ont effectivement contribué
à éradiquer les actes criminels dans la sous-région
suscite notre curiosité. En d'autres termes, quel est l'apport des
instruments internationaux en ce qui concerne l'opposition faite contre le
trafic illégal et le braconnage des éléphants et des
gorilles en Afrique Centrale ? Il s'agira pour nous de vérifier si ces
instruments adoptés par les Etats de la sous-région ont
effectivement contribués à éradiquer les actes criminels
dans la faune. De jure, la lutte contre ces actes est consacrée dans une
panoplie d'instruments internationaux. Cependant, ici et là on
dénombre encore de grands massacres. Les gangsters fauniques pillent une
biosphère qui ne fait pas face et s'efface12. Dans un tel
contexte, cette étude est d'un intérêt juridique
indéniable dans la mesure où elle permet de faire le point sur
l'influence des normes internationales dans le combat mené contre les
crimes fauniques.
De plus, une portée environnementale est
appréciable parce que les éléphants et les gorilles font
partie de la biodiversité et jouent un rôle influent dans le
processus écologique. Il est donc important que ces deux espèces
soient conservées afin de garantir un environnement sain pour les
générations présentes et futures.
En outre, un intérêt économique n'est pas
en reste, car le pillage illégal des espèces fauniques ralentit
l'économie d'un Etat, voir d'une sous-région. En d'autres termes,
la gestion rationnelle des ressources fauniques contribue au
développement d'une nation et attire les touristes des quatre coins du
monde.
Par ailleurs, un intérêt politique est aussi
identifiable, ceci pour la simple raison que les activités illicites de
trafic et de braconnage menacent la sécurité intérieure
d'un Etat et de la sous région et peuvent avoir des répercutions
dans toute la communauté internationale.
Enfin, ce travail dégage une portée sanitaire,
car la viande des éléphants et des gorilles qui est vendue
à la suite des actes de trafic et de braconnage n'est pas traitée
dans les meilleures conditions. En consommant ces viandes, les populations
s'exposent aux contagions dans le cas où les animaux abattus
étaient porteurs d'un virus mortel comme le virus Ebola qui actuellement
est à l'origine des centaines de morts partout dans le monde. Les
experts déconseillent la consommation des viandes sauvages pour cette
même raison. Or, en Afrique centrale, les populations locales dans leurs
extrêmes pauvretés ne tiennent pas compte de cette exigence
lorsqu'ils consomment les viandes de brousse vendues par les trafiquants et les
braconniers.
10 Ces moyens restent enclavés par la mauvaise gestion
des dirigeants. Pourtant les états africains disposent d'assez de
ressources naturelles pour sortir de la pauvreté.
11 Serge BAHUCHET, Françoise GRENAND, Pierre GRENAND et
Pierre De Maret, Les peuples des forêts tropicales aujourd'hui,
volume I, Forêts des tropiques anthropiques. Sociodiversité,
bioversité : un guide pratique, Bruxelles, APFT, 2000, p. 9.
12 MATAGNE Patrick, Les enjeux du développement
durable, préface de MORIN Edgar, l'Harmattan, 2006, p.27.
4
Il y a donc aux vues de ce qui précède plusieurs
intérêts dégagés dans cette étude. C'est la
raison pour laquelle l'élaboration de notre mémoire s'est faite
en trois phases : la phase de collecte de données, le traitement de ces
données et la rédaction.
Dans la première phase, il a été question
pour nous de réunir tous les informations nécessaires qui
traitent du problème de braconnage et du trafic des espèces
menacées en Afrique centrale. L'occasion nous a été
donné de faire deux stages pour y parvenir. Le tout premier stage
effectué était au Ministère de l'Environnement, de la
Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) du
Cameroun et le second stage était au Ministère des forêts
et de la Faune (MINFOF) de ce pays. Lors de notre premier stage, nous avons
interrogé le Directeur des affaires juridiques sur les questions
d'impact du braconnage sur l'environnement, notamment au Cameroun. Nous avons
parcouru les ouvrages de la bibliothèque de ce ministère parmi
lesquels un bon nombre a servi dans la rédaction de ce travail. Au
MINFOF, nous sommes allés avec quelques agents de ce ministère au
parc national de Nvog Mbeti à Yaoundé, pour répertorier le
nombre d'ivoire confisqués par le ministère.
Par ailleurs, notre travail a été encadré
par un personnel chaleureux et accueillant, qui nous a apporté leur
point de vue sur le braconnage en général. Nous avons
interviewé quelques éco gardes du parc de la Mefou et Afamba
(Cameroun) qui nous a donné les détails sur la conservation des
gorilles dans cette localité du pays. Ces éco-gardes
considèrent que le braconnage continue de sévir dans le pays
à cause de l'ignorance des populations locales. Car, ces derniers
chassent illégalement dans les aires protégées à la
recherche de la nourriture. Ceci s'explique par le fait que les populations
ignorent en général les limites de la chasse traditionnelle, et
ne savent pas que les produits issus de cette chasse ne peuvent pas être
commercialisés illégalement. Le chef de brigade du parc de Waza
à l'extrême Nord du Cameroun estime que la menace qui pèse
dans la faune nationale s'explique par le manque criard des ressources
financières et matérielles pouvant décourager les
trafiquants et les braconniers.
A côté des stages effectués,
l'accès aux ressources provenant de l' internet nous a permis de mieux
développer ce travail, notamment en appréciant les
différentes actions qui ont été menées sur le
terrain. En outre, nous sommes allés au sein de certaines ONG
installés au Cameroun, qui participent à la lutte contre le
trafic et le braconnage des espèces menacées comme WWF et LAGA
qui nous a fourni des informations adéquates pour l'élaboration
de ce mémoire. Par ailleurs, une descente au siège de la COMIFAC
et au PACEBco s'est avérée necessaire. La première
organisation nous a donné un certain nombre de rapports annuels de leurs
activités. A travers les brochures qu'il offre au public, le PACEBco
nous a permis de comprendre que tous les actions sont menées pour
conserver la biodiversité en Afrique centrale.
Cette collecte de données s'est étendue sur
plusieurs semaines et a été suivie par l'analyse des informations
collectées. Ceci à travers une lecture méticuleuse et une
synthèse des données.
Pour mener à bien cette étude, l'orientation
méthodologique est structurée sur une double directive dont la
tout première consistera à présenter les instruments
internationaux qui luttent contre les actes de trafic et de braconnage des
éléphants et les gorilles (Partie I). La seconde idée se
déroulera autour de l'impact de ces instruments dans l'opposition faite
contre les actes criminels à l'égard de ces deux espèces
en Afrique centrale (Partie II).
5
PARTIE I: DIVERSITE DES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE
LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE
BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET
GORILLES EN AFRIQUE CENTRALE
Les Etats de la communauté internationale ont
envisagé plusieurs moyens de lutte contre les gangsters fauniques face
aux massacres causés dans la faune sauvage notamment en adoptant une
pluralité d'instruments internationaux (Chapitre II). Ces instruments
ont apporté une nouvelle donne, un nouveau souffle dans l'opposition
faite aux massacres des éléphants et des gorilles. Ces derniers
étant considérés en Afrique comme des
héros13, symboles de force et de puissance. Mais avant de
nous appesantir sur l'étendue de ces instruments, nous allons dans un
tout premier chapitre présenter les généralités sur
les éléphants et les gorilles en Afrique centrale (Chapitre
I).
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES
ELEPHANTS ET LES GORILLES
D'AFRIQUE CENTRALE
Compte tenu de la particularité de ces deux
espèces, nous analyserons séparement les
généralités sur les éléphants (Section I) et
les généralités sur les gorilles (Section II).
SECTION 1 : GENERALITES SUR LES ELEPHANTS
L'éléphant d'Afrique de son nom scientifique
Loxodonta africana est un mammifère énorme qui détient une
grande intelligence et s'adapte facilement au milieu dans lequel il se trouve.
La longévité des éléphants est très
remarquable et se heurte aux phénomènes tels que les changements
écologiques, la sécheresse et le braconnage. En Afrique, «
les éléphants sont bien intégrés dans les
convictions ethniques »14. Toutefois, pour des raisons
liées à son alimentation, l'éléphant ne se limite
pas, en général, à un seul type d'habitat durant le cycle
annuel.
Selon l'UICN, « En Afrique centrale, l'aire de
répartition de l'éléphant couvre les zones sèches
sub-sahariennes, les savanes herbeuses, les savanes boisées, les
forêts sèches, les forêts de montagne, les zones
marécageuses, et les forêts denses humides. Les zones
forestières couvrent presque la moitié de la superficie de la
sous-région et abritent un grand nombre
13OBAM Adolphe, Conservation et mise en valeur
des forêts au Cameroun, préface de Jean-Paul LANLY,
Yaoundé, Imprimerie Nationale, 1992, p. 83.
14 UICN, Stratégie Régionale pour la Conservation
des éléphants en Afrique Centrale, Décembre 2005, p.7.
6
d'éléphants de forêt,
considérés par certains taxonomistes comme appartenant à
une espèce à part entière (Loxodonta cyclotis)
»15. En d'autres termes, la plupart des
éléphants établissent leurs zones de confort dans les
aires parsemées de végétation qui en même temps
contribuent à leur épanouissement.
En tout état de cause, depuis plusieurs
décennies, les éléphants ont été
influencés par des actes illégaux. L'histoire de ces
espèces démontre à suffisante cette affirmation
(Paragraphe 1). De plus, les éléphants présentent des
caractéristiques bien particulières (Paragraphe 2) et un mode de
vie impressionnant (Paragraphe 3). Cependant, le trafic et le braconnage,
principales causes d'extinction des éléphants (Paragraphe 5) ont
affecté leur population (Paragraphe 4).
Paragraphe 1- Aspects historiques des
éléphants
Depuis plusieurs siècles, l'éléphant fut
l'objet de convoitises à cause de son ivoire qui représentait un
vaste commerce international. Dès le 16e siècle, les
éléphants ont disparu d'Afrique du Nord et leur présence
avait déjà diminué en Afrique
subsaharienne16.
Dans la moitié du XIXème
siècle, plusieurs arabes signalaient déjà le déclin
de l'ivoire à cause de l'intensité du braconnage de
l'éléphant. Cet état de chose ne s'améliora pas
même à la fin du XIXème siècle. En effet,
à cette période les activités des concessions
privées et de la chasse non-réglementée furent à
l'origine de l'exportation d'importantes quantités d'ivoire provenant de
l'Afrique. On estimait à un million d'individus le nombre de populations
d'éléphants en Afrique au début du 20e
siècle. Alors que l'on chassait les éléphants dans les
savanes d'Afrique orientale, occidentale et australe, les
éléphants de forêt d'Afrique de l'Ouest et Centrale ont
connu un meilleur sort puisque la pénétration des zones de
forêt était difficile et lente17. L'intensité du
braconnage des éléphants en forêt d'Afrique occidentale a
suivi et le nombre ainsi que le territoire des éléphants ont
régressé jusqu'à leur grave dépopulation à
la veille de la première guerre mondiale18.
A la fin de cette guerre, les éléphants ont
connu un moment de répit avec une légère diminution du
braconnage. Malgré le fait que la chasse commerciale pour l'ivoire fut
interdite sur la majeure partie du territoire de l'Afrique centrale dans les
années 1930, le braconnage de l'éléphant a continué
jusqu' aujourd'hui. En réalité, dans les années 1930, les
législations sur la faune n'étaient pas suffisamment
implantées en Afrique centrale. Et les autorités de
l'époque n'avaient pas conscience des effets du braconnage excessifs des
éléphants. Selon Milner-Gulland et Beddington (1993), il y avait
près de 1,4 millions d'éléphants de forêt en 1814.
Cependant à partir des années 1960, la valeur de l'ivoire a
considérablement augmenté sur les marchés. Et dix ans plus
tard, le sort des éléphants était toujours le même
et sa population a alors chuté dans la sous-région. L'ivoire
devenant rare à cause de la réduction des effectifs des
éléphants, son prix a flambé et le braconnage s'est accru
encore plus que dans les années antérieures. C'est dans ce
contexte que les Etats du monde entier réunis à Washington en
1973 ont adopté la Convention CITES qui avait pour objectif
d'éliminer le commerce des espèces menacées. L'enjeu
était capital pour la survie des espèces sauvages parce que les
législations qui préexistaient avant la Convention CITES
n'étaient pas très encadrées notamment en ce qui concerne
l'éradication du trafic des éléphants. La CITES
était donc salutaire pour les Etats africains, qui ne disposaient pas de
ressources matérielles, juridiques, financières et humaines pour
lutter farouchement contre des
15 Ibid.
16 Cumming et al. 1990.
17 Barnes 1999.
18 Roth et Douglas-Hamilton 1991, Barnes 1999.
7
actes de criminels des espèces menacées. En
dépit de cette Convention, l'effectif des éléphants a
encore chuté à presque 5% en 1980. Un pourcentage alarmant au
regard des conséquences du braconnage dans un Etat19.
De ce qui précède, les éléphants
ont été pourchassés depuis plusieurs siècles par
des trafiquants et des braconniers à la recherche de l'ivoire. L'une des
plus grandes différences entre cette époque et aujourd'hui est
sans aucun doute la présence d'une diversité d'instruments
juridique adoptés pour renforcer le combat contre les actes criminels
dans la faune sous-régionale. Ces instruments juridiques symbolisent
l'engagement des Etats en vue de conserver la biodiversité pour les
générations présentes et futures. A noter que la Liste
rouge de l'UICN de 2008 classe les éléphants d'Afrique centrale
dans la catégorie « données insuffisantes »,
avec des populations en déclin depuis les années
197020. Quid des caractéristiques des éléphants
d'Afrique centrale ?
Paragraphe 2- Caractéristiques des
éléphants d'Afrique
centrale
L'Afrique centrale regroupe deux types
d'éléphants à savoir : l'éléphant des
forêts et l'éléphant de la savane. Ces deux espèces
d'éléphants se distinguent par leur morphologie et leur
organisation sociale. En effet, les éléphants de forêt de
leur nom scientifique loxodonta africana cyclotis sont plus petits que les
éléphants de savane et ils ont de très longues et minces
défenses21 (photo 1). Leurs oreilles sont plus petites que
ceux des éléphants de savane. L'éléphant de
forêt en Afrique centrale se retrouve en grande quantité au Gabon,
au Cameroun, au Congo, et en RCA.
Les éléphants de savane (loxodonta africana
africana) quant à eux ont de grandes oreilles qui leur permettent de
réguler leur température interne. Ils ont un crâne plat et
portent des défenses. Les éléphants de la savane sont
majoritairement herbivores (herbes, feuilles, écorces) et peuvent vivre
dans un habitat où les fruits sont rares, les herbes constituant environ
60 à 95% de leur nourriture. D'un point de vue social, les
éléphants de savane (photo 2) vivent généralement
en groupe plus élargie que les éléphants de forêt.
Ils sont éparpillés dans la sous-région.
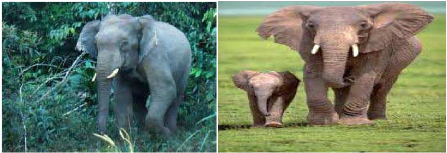
Photo 1. Eléphant de Forêt 22
Photo 2. Eléphant de la savane23
19Douglas-Hamilton 1982, Cobb 1989, Luxmoore et al.
1989, Milliken 1989, Barbier 1990, Milner-Gulland et Beddington 1993.
20 Blanc, 2008.
21 UICN, Stratégie Régionale pour la
Conservation des Eléphants en Afrique Centrale, juin 2010, p. 7.
22
www.cambodge-post.com/.
8
Actuellement leur répartition semble être
essentiellement centrée dans les aires protégées et les
environs notamment au centre et au nord Cameroun (Faro, Bénoué,
Bouba-N'djida, et Waza, Logone), au Tchad (Zakouma, Siniaka-Minia), au nord de
la RDC (Garamba) et au nord RCA (Manovou, Gounda, St Floris, et
Bamingui-Bangoran)24.
Ces deux espèces se retrouvent dans la sous
région de manière éparse. En général les
éléphants pèsent environ 120 kg à la naissance
après une gestation de 22 mois. Devenu adulte, l'éléphant
mâle pèse jusqu'à 7 tonnes et mesure 4 mètres de
haut. Ils sont classés à l'annexe II de la CMS et leur
recensement se fait de plusieurs manières, parmi lesquels le comptage
aérien, le comptage des crottes et la technique de bagage. Au regard de
ce qui précède, les éléphants présentent des
caractéristiques bien spécifiques. Qu'en est-il de leur mode de
vie ?
Paragraphe 3- Mode de vie des
éléphants
Les éléphants d'Afrique centrale se reposent
généralement à l'ombre des grands arbres et pendant la
saison sèche. Ils dorment la nuit en une ou deux périodes dans un
intervalle d'une à deux heures. Les éléphants prennent
leur bain en aspirant de l'eau des rivières ou des étangs
à partir de leur trompe et la rejette sur leur corps. Ils sont
organisés en groupe de 10 à 100 individus. Ces cellules de base
sont composées d'une femelle et de ses petits non pubères (1
à 5), et ce sont les femelles adultes qui dirigent le clan. Les
mâles adultes naviguent autour de ces groupes, à distance plus ou
moins importante. Ils sont formés soit en clans de jeunes
célibataires, soit en groupes composés de jeunes guidés
par un mâle âgé. Le plus souvent, les vieux mâles
deviennent solitaires ou se détachent de leur groupe pour rejoindre un
nouveau troupeau25.
Les éléphants à la recherche de la
nourriture peuvent parcourir de longues distances pouvant aller jusqu'à
500 km à une vitesse de 5 à 7 km/h, mais actuellement ils sont
plus ou moins sédentarisés à cause de la réduction
de leur milieu naturel et du couloir habituel de leur migration par les
activités humaines26.
En ce qui concerne leur alimentation, les
éléphants sont des Méga herbivores à régime
alimentaire mixte, ils peuvent satisfaire leurs besoins
énergétiques en ingérant des matières
végétales de faible valeur nutritionnelle27. Les
éléphants passent en général entre 70 et 90 % de
leur temps à manger28. Bien que les éléphants
de forêt consomment des herbes et des feuillages, leur régime
alimentaire comprend aussi une bonne proportion de fruits. Cette grande
consommation s'explique par le fait que les éléphants
digèrent moins de la moitié de ce qu'ils ingèrent. Il sied
d'examiner dès à présent la situation actuelle des
populations des éléphants en Afrique centrale.
23
Fr.questmachine.org/Article:Eléphant_de_savane_d'Afrique.
24 Ibid., p. 10.
25 Ministère de l'eau, de l'environnement et de la
lutte contre la désertification, Direction de la Faune, de la chasse et
des Aires Protégées, République du NIGER,
Stratégie Nationale et Plan d'Action pour la Conservation Durable
des Eléphants au Niger, p.12.
26 Namoano, 2009.
27 Du Toit & Owen Smith, 1989; Illius & Gordon, 1992.
28 Par jour, les éléphants consomment entre 100
et 300 kg d'espèces de plantes : graminées, plantes aquatiques,
feuilles d'arbres, jeunes pousses, gousses, fruits (Balanites, Borassus,
Adansonia, Tamarindus indica, Kigelia spp), racines, écorces, etc.
9
Paragraphe 4- Situation actuelle des populations
des
éléphants en Afrique centrale
Selon VADROT Claude-Marie, « Les
éléphants n'ont pas de chance : Ils vivent dans la partie de la
RDC le plus souvent parcourus par les bandes armées et marquée
par les affrontements. Des espaces immenses où, pour faire un peu
d'argent permettant de continuer à se battre et à vivre, des
rebelles, on ne sait plus trop qui ou à quoi, massacrent les
éléphants au lance-roquette »29. En effet,
dans la sous-région le braconnage s'est accru à cause de la
quête de l'ivoire30. Ce braconnage était plus intense
dans certains pays comme le Congo31 et la RCA32.
Malgré les appels à l'inventaire à la
suite du premier recensement régional33, l'état des
connaissances concernant les populations d'éléphants de
forêt et leur statut de conservation en Afrique centrale restent
médiocres, même dans les aires protégées et les
parcs nationaux clés34. Lorsqu'elles existent, les
estimations d'abondance d'éléphants se fondent en grande partie
sur des suppositions, souvent sans données corroboratives35.
Ce qui rend difficile l'appréciation des données actuelles des
éléphants en Afrique centrale.
La question de savoir comment protéger les
éléphants demeure toujours aussi difficile à
résoudre étant donné les conditions politiques,
économiques et sociales de la RCA et des pays voisins36. Il
est clair que le trafic et le braconnage des éléphants sont les
causes principales de leur disparition.
Paragraphe 5- Causes principales de la disparition
des
éléphants : L'influence du trafic et du
braconnage
Le trafic (A) et le braconnage (B) sont les principales causes
de disparition des pachydermes. D'où la raison pour laquelle ces actes
criminels dans la faune seront examinés dans la suite de cette
analyse.
A- Les actes de trafics illégaux
d'éléphants
Le commerce des animaux de la faune sauvage est aujourd'hui une
réalité qui affecte les
29 VADROT Claude-Marie, Guerres et environnement.
Panorama des paysages et des écosystèmes bouleversés,
Delachaux et niestlé, 2005, p. 22.
30 Barnes, 1992.
31 Fay et Agnagna, 1991.
32 Douglas-Hamilton et al, 1985.
33 Barnes et al. 1995.
34 Blake et Hedges 2004. Depuis 1995, la base de
données sur l'éléphant d'Afrique (AED) a relevé les
estimations d'abondance d'éléphants sur les principaux
territoires des éléphants, y compris bon nombre des sites MIKE
actuels. Depuis lors, seuls trois recensements dans l'aire de
répartition des éléphants de forêt, dont l'un s'est
déroulé sur un site MIKE actuel.
35Ibid., S'il est vrai qu'un effort
considérable a été déployé sur certains
sites pour mieux comprendre la situation de conservation des
éléphants (Fay and Agnagna 1991c, Fay 1993, Turkalo and Fay 1995,
Ekobo 1998, Van Krunkelsven et al. 2000, Blake 2002, Blom et al. 2004a), il
n'en demeure pas moins que l'inventaire MIKE actuel serait le premier
inventaire systématique, intégral/quasi intégral jamais
entrepris sur tous ces sites importants de conservation.
36 Blom et al. 2004b.
10
ressources fauniques des états de la communauté
internationale37. On recense de nombreux cas d'extinction des
espèces sauvages38 à la suite du commerce de leurs
produits. Lorsqu'il est illicite, ce commerce représente un obstacle
majeur à l'expansion d'un Etat. En effet, le trafic illicite conduit
à : « (...) nuire aux écosystèmes, affaiblit la
bonne gouvernance et la primauté du droit, menace la
sécurité et réduit les revenus découlant
d'activités économiques telles que le tourisme consacré
à la faune sauvage et du recours durable au commerce légal
d'espèces sauvages, importante source de moyens de subsistance locaux et
de développement économique national » 39 . Autrement
dit, ce trafic illicite constitue une entrave à la
sécurité et au développement économique d'un Etat.
Il a des conséquences sur la santé publique. Selon un
observateur, « Jusqu'à 75 pour cent des maladies humaines
telles que le SRAS, la grippe aviaire ou le virus Ebola peuvent être
provoquées par des agents infectieux transmissibles de l'animal à
l'homme. Le commerce illégal d'animaux ou de morceaux de leurs carcasses
contourne les contrôles de santé publique et peut mettre des
populations humaines à risque de contracter des maladies». Au
regard de ce qui précède, la perte des éléphants
n'est pas seulement préjudiciable aux éléphants, mais
aussi à la vie et à la santé de l'être humain.
Certaines autorités signalent que la forte demande en
produits issus d'animaux sauvages est un des principaux catalyseurs du trafic.
Les incitations économiques, les pratiques culturelles ou religieuses et
le simple manque de sensibilisation des consommateurs contribuent à ce
vice.
L'ivoire issu des éléphants est utilisé
pour faire les bijoux, les ornements et les sculptures
religieuses. Récemment, le transfert de l'ivoire
d'Afrique vers l'Asie orientale a été estimé à 72
tonnes par an. Et la CITES a identifié certains pays comme étant
les principaux moteurs de trafic en Afrique. Il s'agit du Kenya, de l'Ouganda,
du Vietnam et de la Chine40. Si la tendance actuelle se poursuit,
plusieurs pays de la sous-région pourraient voir disparaître leurs
populations d'éléphants d'ici dix ans.
En dehors de l'ivoire, l'éléphant est aussi
chassé pour sa viande. La viande de brousse constitue une source de
protéine essentielle pour les populations autochtones. La consommation
de cette viande est comprise entre 14,6 et 97,6 kg par personne par
an41. Les estimations concernant le prélèvement de la
viande de brousse dans l'ensemble du Bassin du Congo sont comprises entre un
million42 et cinq millions43 de tonnes par an, et le taux
de prélèvement se situe entre 23 kilogrammes par kilomètre
carré par an et 897 kilogrammes par kilomètre carré par
an44. L'intensité des prélèvements actuels
constitue une menace potentielle pour de nombreuses espèces des
écosystèmes forestiers. Quid du braconnage des
éléphants en Afrique Centrale ?
37 Wildlife Justice, Magazine sur l'application de la loi
faunique, Réplication du Model Camerounais d'Application de la Loi
Faunique, n° 007, décembre 2010, p. 2.
38 NDINGA Assiatou, Conservation Forestière en
Afrique Centrale et politique internationale. Le processus de Brazaville
en échec, l'Harmattan, octobre 2008.
39 Conférence de Londres sur le commerce illicite
d'espèces sauvages, 12-13 février 2014.
40 Laurence Caramel, Journaliste du quotidien français Le
Monde, internet.
41 Starkey, Commerce and subsistence: the hunting, sale and
consumption of bushmeat in Gabon. Fitzwilliam College. Cambridge University,
Cambridge, United Kingdom 2004.
42 Willkie et Carpenter, 1999. Wilkie, D.S, and Carpenter
J.F., 1999. Bushmeat hunting in the Congo Bassin : an assessment of impacts and
options for the mitigation. Journal Biodiversity and Conservation 8,
927-955.
43 Fa, J., D. Currie, and J. Meeuwig. 2003. Bushmeat and food
security in the Congo Basin: linkages between wildlife and people's future.
Environmental Conservation 30:71-78.
44 Nasi, R., D. Brown, D. Wilkie, E. Bennett, C. Tutin, G. van
Tol, and T. Christophersen. 2008. Conservation and use of wildlife-based
resources: the bushmeat crisis. Secretariat of the Convention on Biological
Diversity and Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor,
Indonesia and Montreal, Canada.
11
B -Le braconnage des éléphants en Afrique
centrale
Le braconnage a entrainé une perte énorme
d'éléphants. A titre d'exemple au Cameroun, plus de 128
éléphants ont été abattus en 2012 dans le parc de
Bouba Ndjida. Le Gabon a également été victime d'un
massacre sanglant à partir de 2004 dans le parc national de
Minkebé retirant à la faune de l'Afrique Centrale près de
11 000 éléphants. C'est au regard des pertes engendrées
par le braconnage que Lee White, Secrétaire Exécutif de l'Agence
nationale des parcs nationaux (ANPN) déclara : «Si nous
n'inversons pas la situation rapidement, l'avenir des éléphants
en Afrique sera compromis». Le rapport annuel de 2012 de WWF estime
que les actes de braconnage représentent le quatrième
fléau mondial après la drogue, la fabrication de la fausse
monnaie et la traite des hommes. La situation est alarmante, c'est pourquoi
tous les gouvernements de la sous-région se sont mobilisés dans
le seul but d'éradiquer le braconnage qui menace la survie des
espèces fauniques45.
Le braconnage sévit dans l'ensemble de la sous
région et menace certaines espèces fauniques46. Les
pièges en cordes ou câbles sont tendus pour les antilopes et
d'autres petits animaux. Cependant, les grands pièges ciblent les
Buffles, les Hippopotames et les Eléphants. Pour bien évaluer
l'ampleur du braconnage à base des pièges, plus de 1000
pièges ont été désamorcés en 2012 au Parc
National des Volcans au Rwanda.
Les écologistes affirment que l'influence chinoise
croissante et ses investissements en Afrique ont ouvert la porte à un
commerce illicite plus important des défenses
d'éléphants.47Etant donné les enjeux
liés à la survie des éléphants, de tels actes qui
bouleversent les effectifs des éléphants (photo 3) doivent
être sévèrement réprimandés.

Photo 3. Eléphants massacrés à
Gamba au Tchad, (au total 89) en mars 201348
45 Discours de l'ancien Président de la COMIFAC,
Monsieur Mahamat Issa Halikimi, COMIFAC NEWS n° 011 / MARS 2013.
46 MINFOF, Programme sectoriel forêts et environnement,
composante 3 « Conservation de la Biodiversité et valorisation des
produits fauniques », Mai 2003, p. 53.
47 Biggie MALOUANA, environnement, février 2013, le
braconnage d'éléphants bat son plein au Gabon , lutte contre le
braconnage.
48
www.fondationbrigittebardot.fr
12
Compte tenu de leur importance dans la biodiversité,
les éléphants doivent être protégés pour la
survie de ces espèces mais aussi pour la sécurité d'un
Etat. D'où l'intérêt de présenter dans cette
étude la nécessité de la protection des
éléphants.
C- Nécessité de la protection des
éléphants
D'un point de vue écologique, l'éléphant
joue un rôle très important dans la biodiversité. Leur
morphologie affecte profondément leur milieu, qu'ils modèlent
à leur façon. Les éléphants écartent les
sous-bois, excavent les « salines » et transportent les graines. A
titre illustratif, certains arbres importants pour l'industrie du bois ont de
grosses gratines qui sont éparpillés par les
éléphants. Si ces animaux disparaissent, la
régénération naturelle de ces espèces de plantes
serait sérieusement compromise49.
D'un point de vue économique, les
éléphants sont très importants pour le tourisme dans un
pays, ce qui contribue par ricochet au développement durable. Autrement
dit, le massacre des pachydermes constitue donc un frein économique
énorme.
De ce qui précède, les éléphants
sont confrontés au vaste fléau du trafic illégal et du
braconnage alors que leur importance dans l'environnement n'est plus à
démontrer. Il sera question dans nos prochains développements
d'énoncer les généralités sur les gorilles
d'Afrique centrale.
SECTION 2 : GENERALITES SUR LES GORILLES D'AFRIQUE
CENTRALE
Cette sous partie sera analysée en cinq points à
savoir : l'historique du trafic et du braconnage des gorilles (Paragraphe 1),
la morphologie des gorilles (Paragraphe 2), le mode de vie des gorilles
(Paragraphe 3), les particularités des gorilles (Paragraphe 4) et les
raisons d'extinction des gorilles en Afrique centrale (Paragraphe 5).
Paragraphe 1- Historique du trafic et du braconnage
des
gorilles
Dès l'antiquité, le navigateur carthaginois
Hannon avait signalé la présence des gorilles en Afrique. Et
à cette époque ces espèces n'étaient pas
très bien connues. Plusieurs noms leur étaient attribués
notamment hommes velus ou encore anthropophage. Carl Von Linné en 1758
classa l'homme dans l'ordre primate tout comme les singes. Ce qui souleva une
vive révolte au sein des congrégations ecclésiastiques.
Mais cette classification de Linné se basait sur l'apparence physique
des grands singes qui avoisinait la morphologie des êtres humains au
point où plusieurs légendes affirmaient que ces deux
espèces partageaient un ancêtre commun. On a recensé les
traces de gorilles dans les forêts de la savane où ils avaient
l'habitude de grimper dans les arbres50.
Les gorilles, comme toutes les autres espèces de
singes, sont menacés d'extinction depuis plusieurs siècles. Ils
sont présents dans dix pays de l'Ouest et du centre de l'Afrique.
L'ampleur des actes de trafic illégal et de braconnage s'est
affirmé il y a près de 100 ans. Au XXème
siècle,
49 UICN, Stratégie Régionale pour la
Conservation des Eléphants en Afrique Centrale, 2005.
50
http://www.gorilla.fr/gorilles.htm.
13
la population des gorilles a davantage redressé. On
recense près de 700 gorilles de montagne de son nom scientifique Gorilla
beringei beringei dans la région de Virunga aux frontières du
Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC. Dans les années 1990, la forêt
de Minkébé a connu un déclin catastrophique de sa
population de gorilles, sans doute en raison du virus Ebola51. Des
inventaires de grands singes comme des inventaires d'éléphants
ont été effectifs pour déterminer l'état des lieux
de ces espèces en pleine chute. Les gorilles ont une morphologie
particulière de celles des autres mammifères.
Paragraphe 2- Morphologie des gorilles
Les gorilles se déclinent en deux espèces
à savoir : les gorilles de l'est (Gorilla beringei) et les gorilles de
l'ouest (Gorilla gorilla gorilla). Ces deux espèces diffèrent par
leurs caractères morphologiques. En effet, les gorilles de l'est sont
eux-mêmes divisés en deux sous espèces notamment les
gorilles de plaine de l'est et les gorilles de montagne. Les gorilles de
plaines (Gorilla beringei graueri) sont les plus grands de toutes les
espèces de gorilles et vivent majoritairement en RDC. Ils sont moins
menacés que les gorilles de montagne, bien que soumis aux mêmes
perturbations que ceux-ci (photo 5). Les principales différences
morphologiques qui les distinguent des gorilles de montagne, sont les dents et
les poils plus courts, ainsi que des bras plus longs. Les gorilles de l'ouest
(photo 4) vivent dans les forêts tropicales de plaine du Gabon, du
Congo-Brazzaville, du Cameroun et de la République Centrafricaine avec
quelques populations recensées en Guinée
Equatoriale52.
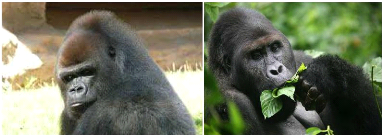
Photo 4. Gorille de l'Ouest53 Photo 5.
Gorille de plaine de l'Est54
D'une manière générale, le gorille a un
aspect impressionnant. Il a des jambes courtes et des bras longs, ainsi qu'une
grosse tête. Sa peau noire est couverte de poils noirs. Seuls sa face,
ses oreilles, ses mains et ses pieds restent imberbes. Le nez du gorille joue
un rôle d'empreinte digitale grâce aux dessins des
différents sillons.
51 HUIJBREGTS et al. 2003.
52 GB, Ingénieur écologue, Directeur de la
publication Responsable et fondateur de
Conservation-nature.fr.
53
www.linternatute.com/.
54
http://oraney.blogspot.com/2013/05/nouvel-espoir-pour-sauver-le-plus-grand.html:
Le gorille des plaines de l'Est, sa population aurait déclinée
depuis l'an 1990 (ICCN).
14
|
REGNE
|
EMBRANCHEMENT
|
CLASSE
|
ORDRE
|
FAMILLE
|
GENRE
|
|
Animal
|
Chordé vertébré
|
Mammifère placentaire
|
Primate
haplorhinien simiforme
|
Catarhinien hominoïdé gorilliné
|
Gorilla
|
Tableau 1. Récapitulatif de la
classification des gorilles
Le gorille mâle mesure entre 1,70 et 1,80 m tandis que
la femelle mesure entre 1,40 et 1,50 m. Les gorilles mâles sont
très lourds puisqu'ils font entre 135 et 275 kg dans la nature
(jusqu'à 350 kg en captivité). En moyenne, les gorilles vivent
une trentaine d'années dans la nature. Ils sont néanmoins
capables de vivre 50 ans, en captivité. Le corps est massif et
musculeux, les bras sont particulièrement puissants. Le mâle
protège toute la troupe, il possède des canines plus
développées. La face comme les oreilles sont dépourvues de
poils. L'expression est rendue plus dure par le développement des
arcades ainsi que par un prognathisme certain. La tête impressionne par
sa masse et sa hauteur. Qu'en est-il de leur mode de vie ?
Paragraphe 3- Mode de vie des gorilles
Les gorilles sont essentiellement herbivores, bien qu'une
catégorie d'insectes, comme les termites entrent aussi dans leur
régime alimentaire. Ils consomment toutes les parties
végétaux comestibles, depuis le fruit jusqu'à la racine.
Ces mammifères consacrent leur temps à la nourriture et au repos.
Les relations sociales occupent le reste de temps. C'est le mâle dominant
qui maintient son autorité sur les membres du groupe et éloigne
tout intrus. Les gorilles vivent sur terre et sont aptes à grimper sur
les arbres à la recherche de la nourriture. Quand ils sont très
âgés, les mâles deviennent lourds, c'est pourquoi ils
préfèrent rester au sol. Au regard de ce qui
précède, une question reste en suspend : quelle est la
particularité des gorilles ?
Paragraphe 4 - Particularités des gorilles
Les gorilles sont en grand danger de disparition et
particulièrement les gorilles de montagne. Ils sont inscrits à
l'Annexe I de la CMS et de la CITES55. La chasse des grands primates
protégés est encore pratiquée régulièrement
à cause de leur viande56. Les gorilles sont les plus grands
et les plus massifs des hominidés, avec un poids maximum de 230 kilos
dans le milieu naturel, et plus encore lorsqu'il est nourri par l'homme. En ce
qui concerne leur reproduction, la femelle donne naissance à un seul
petit d'environ 2 kg tous les 3 à 4 ans57. Ils sont
très convoités par les touristes fascinés par leur
morphologie qui se rapproche de notre espèce. Un pays détenant
une riche population de gorilles attire les touristes, ce qui contribue
à l'économie nationale. A la lecture des particularités
des gorilles, il sied d'examiner en quoi le trafic et le braconnage des
gorilles contribuent à leur extinction.
55 Résumé de la deuxième réunion
des parties à l'accord sur la conservation des gorilles et de leurs
habitats dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage, novembre 2011.
56 NASI Robert, EZZINE de Blas Jean Claude, Exploitation
et gestion durable des forêts en Afrique Centrale, p. 282.
57
Animaux.org, 2008, consulté le
12 juillet 2014.
15
Paragraphe 5- Les raisons d'extinction des gorilles
d'Afrique centrale : Le trafic et le braconnage
Le trafic illégal (A) et le braconnage (B) des gorilles
constituent un danger pour cette espèce mais aussi pour la
sécurité, le développement économique et durable
d'un état.
A- Le trafic illégal des gorilles
Les gorilles sont massacrés pour la consommation de
leur viande. L'Afrique centrale possède des végétaux
supérieurs, oiseaux et mammifères endémiques. Pour pallier
à la perte de leurs habitats naturels en Afrique centrale, le
réseau des zones protégées a été
étendu par la création de nouvelles aires au niveau
national58. Compte tenu de la menace que représente le trafic
des gorilles, certains experts estiment que ces espèces pourraient
s'éteindre de la nature au cours des 50 prochaines années. C'est
pourquoi Achim Steiner pense que : « C'est une tragédie pour
les grands singes mais aussi pour un nombre incalculable d'autres
espèces qui sont touchées de plein fouet par l'intensification de
ces pratiques et également bien trop souvent par le commerce
illégal. En définitive, c'est aussi une tragédie pour les
personnes qui vivent dans les communautés et les pays concernés.
Ces ressources naturelles sont leurs ressources : celles dont dépendent
la subsistance et la vie de millions de personnes ». Au regard de ce
qui précède, les actes de braconnage des gorilles n'influencent
pas seulement la biodiversité, mais aussi les conditions de vie des
communautés. Quid du braconnage des gorilles ?
B- Les actes de braconnage de gorilles
Le braconnage des espèces menacées en Afrique
centrale ne datent pas d'aujourd'hui. Les gorilles auraient perdu la
moitié de leurs effectifs entre 1996 et 1999. Ce fléau affecte
l'économie de l'Etat concerné et toute la sous-région.
David Higgins, Directeur du Programme des crimes contre l'environnement
d'INTERPOL constate avec amertume qu' : « en bref, il s'agit d'un
crime contre l'environnement. Les gorilles sont encore une autre victime du
mépris affiché par les gangs criminels organisés des lois
nationales et internationales visant à défendre la nature ».
Christian NELLEMANN, le principal auteur du rapport de 2002 sur les grands
singes a reconnu que les Etats avaient sous-estimé l'ampleur du commerce
de la viande de brousse, de l'augmentation de l'exploitation forestière
et de l'impact du virus Ebola sur les populations de grands singes.
Le braconnage des gorilles s'est accru au RDC (photo 6) et les
autorités nationales et internationales sont indignées face aux
actes qui affectent l'avenir de la biodiversité en Afrique. Un
renforcement des stratégies de lutte contre le braconnage est
nécessaire dans la sous-région. C'est la raison pour laquelle les
pays de l'espace COMIFAC ont mis en place un certain nombre de plans d'actions
afin d'éviter d'autres séquences de braconnage en Afrique
centrale.
58 PNUE, L'avenir de l'environnement en Afrique. Le
passé, le présent et les perspectives d'avenir, CMAE/PNUE,
2002, p.81.

16
Photo 6. Des gorilles victimes du braconnage en RDC
(2007) 59.
Au regard de ce qui précède, les
éléphants et les gorilles ont cruellement été
massacré par des trafiquants et les braconniers dans les grands
complexes transfrontaliers et les aires protégées qui abritent
les éléphants et les gorilles en Afrique Centrale.
SECTION 3: LES GRANDS COMPLEXES TRANSFRONTALIERS ET
LES
AIRES PROTEGEES EN AFRIQUE CENTRALE
Compte tenu de leur importance dans la conservation des
éléphants et des gorilles, nous examinerons les grands complexes
transfrontaliers en Afrique Centrale (Paragraphe 1). C'est après cela
que nous verrons la répartition de ces deux espèces dans les
aires protégées de cette sous-région (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- Les grands complexes regroupant
les
éléphants et les gorilles en Afrique centrale
Parmi ces grands complexes, nous présenterons dans
cette analyse le TNS (A), le TRIDOM (B), Le binational Mayoumba-Conkouati (C),
le binational Lac Télé-Lac Tumba (D) et le Binational Sena Oura-
Bouba N'djida (E).
A- La concentration des éléphants et des
gorilles dans le complexe
du TNS
Les aires protégées du TNS forment un ensemble
forestier qui s'étend à la limite internationale de 3 pays que
sont le Cameroun, la République Centrafricaine et la République
du Congo. Le Tri-national de la Sangha est constitué de trois parcs
nationaux et leurs zones périphériques. Au Cameroun, le parc
national désigne « un périmètre d'un seul tenant,
dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de
l'atmosphère, des eaux, et en général du milieu naturel,
présente un intérêt spécial qu'il importe de
préserver contre tout effort de
59
www.lefigaro.fr.
17
dégradation naturelle, et de soustraire à
toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et
l'évolution » et en République Centrafricaine les parcs
nationaux sont des « aires affectées à la protection des
espèces animales et végétales dans leur état
sauvage, des minéraux et formations géologiques, des biotopes et
des écosystèmes, des sites naturels et paysages présentant
une valeur scientifique ou esthétique, ainsi que la
récréation du public ». Il ressort de ces
définitions que les parcs nationaux sont des structures
théoriques aménagées par les états en vue de
garantir une meilleure protection des ressources de la biodiversité. Ces
aménagements datent de plusieurs décennies et ont
été institué dans un contexte où le pillage abusif
de la biodiversité affectait l'environnement et ses composantes.
Le TNS abrite le parc national de Lobéké
(Cameroun) qui a été crée par décret n°
2001/107/CAB/PM du 19 mars 2001. D'une superficie de 217.854 ha, sa zone tampon
englobe plusieurs ZIC auxquelles sont superposées cinq Unités
Forestières d'Aménagement. Le TNS dispose en outre des parcs
nationaux de Dzangha-Ndoki (RCA) et Nouabalé-Ndoki (République du
Congo)60. Dans le parc national de Lobéké, la
densité d'éléphants (6 individus au Km2) et de
gorilles (2,98 individus au Km2) serait la plus élevée
d'Afrique Centrale. Le parc national de Nouabalé-Ndoki quant à
lui est reparti au nord de la République du Congo, à cheval entre
les régions de la Likouala, district de Dongou, et de la Sangha,
district de Mokékou. Ce parc est limité à l'ouest par les
aires protégées centrafricaines que sont le parc national de
Dzanga-Ndoki et la réserve spéciale de forêt dense de
Dzanga-Sangha.
Le TNS recense un grand nombre d'espèces
protégées parmi lesquels les éléphants et les
gorilles. Plusieurs aménagements ont été mis en oeuvre
dans ce complexe, en vue de garantir aux espèces une meilleure
protection. Cependant, le Tri National de la Sangha souffre de l'intrusion des
braconniers attirés par la richesse et la préciosité de la
faune61. Qu'en est-il du TRIDOM ?
B- La concentration des éléphants et des
gorilles dans le complexe du
TRIDOM
Le complexe du TRIDOM a été créé
en février 2005 par le Cameroun, le Congo et le Gabon et regroupe les
parcs nationaux du Dja, Odzala, Minkebe. Sa superficie est
évaluée à 147 000 km2. Ce complexe comprend
sept aires protégées dont une variété de
mammifères y réside, notamment les éléphants de
forêt et les éléphants de savane ainsi que les gorilles de
l'est et de l'ouest. La création du TRIDOM répond aux attentes
des conventions internationales notamment la CDB et la CITES qui recommandent
aux Etats d'aménager des zones stratégiques de conservation de la
biodiversité. Lutter contre les actes criminels dans la faune sauvage
consiste à mettre en oeuvre des actions coordonnées en
étroite collaboration avec les états de la sous-région.
C'est pourquoi, un appui financier du PNUD et du FEM d'un montant de 10 117 500
dollars américains a été alloué aux gouvernements
du TRIDOM pour la mise en oeuvre effective d'un plan performent
d'aménagement dans ce complexe transfrontalier.
Les missions du TRIDOM consistent notamment à la mise
en place d'un système de contrôle efficace, à renforcer la
surveillance des tendances dans la biodiversité et
l'écosystème. Plusieurs actions ont été faites dans
le complexe TRIDOM en ce qui concerne la lutte contre le braconnage et le
développement des communautés locales. C'est ainsi qu'en
février de cette
60 Ministère des Forêts et de la Faune de la
République du Cameroun (MINFOF), Plan d'aménagement du
parc
national de Lobeké et de sa zone
périphérique, Période d'exécution : 2006 -
2010.
61 MAPEINE ONOTIANG Florantine, Mémoire sur. La
gestion transfrontalière des ressources naturelles: l'accord relatif a
la mise en place du tri-national de la Sangha (TNS) et son protocole d'accord
sur la lutte contre le braconnage, Université de Limoges (France),
Master droit international et comparé de l'environnement, 2006.
18
année, les représentants des Etats du TRIDOM et
le PNUD ont mené une réflexion qui visait à mettre
à profit les progrès de ce complexe. A côté du TNS
et du TRIDOM, l'Afrique centrale abrite d'autres complexes transfrontaliers
parmi lesquels le binational Mayoumba-Conkouati.
C-Le binational Mayoumba-Conkouati
Le Gabon et le Congo ont créé le complexe
transfrontalier Mayumba-Conkouati qui bénéficie de l'appui du
RAPAC dans la bonne marche des actions menées dans cette
localité. En novembre 2010, un accord de coopération entre les
gouvernements du Congo et du Gabon, relatif à la mise en oeuvre du parc
transfrontalier Mayumba-Conkouati, en marge du 6ème conseil
des Ministres de Kinshasa en RDC (COMIFAC, 2010) a été
signé. Le binational Mayumba-Conkouati est composé de plusieurs
aires protégées à savoir : Le parc national de Mayumba
(Gabon) qui a vu le jour en 2002, le parc national de Conkouati-Douli, (Congo)
de 505 000 ha, créé en 1980/1999 et deux parcs transfrontaliers
(Mayumba et Conkouati-Douli) qui sont proposés comme site du patrimoine
mondial inscrits sur la liste indicative de l'UNESCO62. Qu'en est-il
du binational Lac-Télé-Lac Tumba.
D-Le binational Lac Télé-Lac Tumba
Le complexe Lac Télé- Lac Tumba regroupe deux
grands pays d'Afrique centrale à
savoir : le Congo et la RDC. Ce complexe compte deux aires
protégées parmi lesquels la Réserve communautaire du lac
Télé au Congo (4 400 00 ha) et la Réserve naturelle de
Tumba Ledima en RDC s'étend sur 12 600 000 ha au Congo et en RDC (750
000 ha)63. Que penser du binational Sena Oura-Bouba N'djida ?
E-Le Binational Sena Oura- Bouba N'djida
Le 11 et 12 décembre 2007, le Cameroun a tenu une
réunion à Garoua en présence du Tchad, de la COMIFAC, du
RAPAC, et la GTZ en vue de parvenir à un accord de coopération.
Le binational Sena Oura-Bouba N'djida est situé en zone
soudano-sahélienne et comprend le parc national de Bouba N'djida
(Cameroun) et l'aire protégée de Sena Oura au Tchad. Il couvre
une superficie globale de 73 520 ha. Ces deux espaces disposent d'une large
variété d'espèces sauvages parmi lesquels les
éléphants et les gorilles. Cependant, le parc de la Bouba N'djida
a perdu un grand nombre d'éléphants à cause des
braconniers venus du soudan et des pays limitrophes. Ce nouveau complexe a pour
souci d'assurer une bonne coordination des actions de conservation
engagées de part et d'autre de leurs frontières communes; de
gérer de façon concertée les ressources forestières
et fauniques des zones transfrontalières 64 . De telles
résolutions sont appréciables étant donné que les
éléphants (tableau 2) et les gorilles sont inégalement
repartis dans la sous-région.
A côté du binational Sena Oura-Bouba N'djida, on
peut également citer le complexe transfrontalier Campo- Ma'an Rio-Campo
situé entre le Cameroun et la Guinée Equatoriale. Par ailleurs,
la Guinée Equatoriale et le Gabon ont en commun le complexe
transfrontalier Monte
62 NGOUFO Roger, Etude sur la capitalisation des
expériences d'Aires Protégées transfrontalières en
Afrique centrale, mars 2003, pp. 15-16.
63 Carlos de WASSEIGE et al, 2008.
64 Op. cit. 61, p. 19.
19
Alen Monts de Cristal qui détient dans son espace
géographique une grande quantité d'éléphants et de
gorilles.
|
PAYS
|
DEFINI
|
PROBABLE
|
POSSIBLE
|
SPECULATIVE
|
SUPERFICIE
PAR PAYS
(Km2
|
|
Cameroun
|
2.006
|
3.058
|
9.017
|
3.160
|
475.440
|
|
Congo
|
431
|
18.222
|
6.572
|
2.300
|
342.000
|
|
Gabon
|
0
|
8.132
|
14.712
|
58.309
|
267.670
|
|
Guinée Equatoriale
|
0
|
0
|
0
|
300
|
28.050
|
|
RCA
|
2.977
|
1.600
|
2.420
|
390
|
622.980
|
|
RDC
|
7.667
|
2.631
|
34.996
|
17.554
|
2.345.410
|
|
Tchad
|
1.989
|
0
|
2.000
|
550
|
1.284.000
|
|
TOTAL
|
16.450
|
32.263
|
64.477
|
82.563
|
5.365.550
|
Tableau 2. Etat de distribution des
éléphants dans sept pays d'Afrique
centrale65
Au regard de ce qui précède, plusieurs complexes
ont été créés dans la sous-région.
Quelques-uns ont été énumérés dans le cadre
de cette étude. Il ressort que les complexes transfrontaliers
constituent des zones de sécurité et de paix pour les
espèces menacés d'extinction. Il convient dès à
présent d'étudier la répartition des
éléphants et des gorilles dans les aires protégées
d'Afrique centrale.
Paragraphe 2- La répartition des
éléphants et des gorilles
dans les aires
protégées d'Afrique centrale
Une aire protégée est selon l'Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN), « un espace
géographique clairement défini, reconnu, consacré et
géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer
à long terme la conservation de la nature ainsi que les services
éco systémiques et les valeurs culturelles qui lui sont
associés ». Autrement dit, c'est une création juridique
dont le but est de gérer rationnellement les ressources naturelles d'un
espace donné. Danièle FOUTH apporte une appréciation un
peu plus générale des aires protégées en ces
termes: « Les aires protégées constituent le principal
outil de toute stratégie de conservation de la diversité
biologique d'un pays ou d'une région »66. Ibrahima
NJOYA quant à lui pense que: « (...) est une zone
géographiquement délimitée et gérée en vue
d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation et de
développement durable d'une ou de plusieurs ressources données
»67. Cette définition semble s'accorder avec le
contexte sous-régional d'Afrique centrale qui dispose de plusieurs aires
protégées. Il conviendra dans le cadre de cette étude
d'examiner
65 UICN, Stratégie Régionale pour la
Conservation des Eléphants en Afrique Centrale, décembre
2005, p. 30.
66 FOUTH Danièle, mémoire sur la Contribution
de la gestion des aires protégées du bassin du Congo au
développement durable à l'échelle locale. Cas du
Tri- national de la Sangha (TNS) », 2012.
67 NJOYA S. Ibrahim, Chasse au Cameroun, p.15.
20
principalement les parcs nationaux de cette sous
région avant d'entrevoir les autres aires
protégées. Les pays africains
conscients de la menace qui pèse sur la
biodiversité ont consacré une grande partie de leur territoire
à la conservation. L'UICN a élaboré une figure de
croissance de la superficie des aires protégées en
Afrique qui a atteint u n sommet de 250 000
Km2 en 1970, comme on peut le voir sur cette
figure.
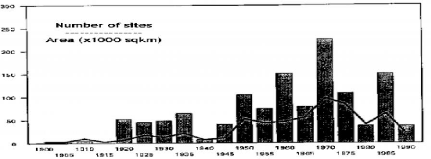
68
Figure 1 . Augmentation des aires
protégées (valeurs non cumulatives), Source UICN
(1994)
Bien que la création de ces aires ne constitue
qu'un des éléments sur lesquels doit s'appuyer tout programme
rationnel de conservation de la biodiversité , elle
représente néanmoins une des conditions nécessaires en
tant que noyau dur de toute politique nationale, régionale de
préservation des espèces vivantes
menacées69. L'UICN a défini six
catégories d'aires protégées. Les réserves
naturelles intégrales, les parcs nationaux, les monuments nationaux, et
trois autres types correspondant à ce que l'on pourrait dénommer
des réserves spécialisées : les réserves
de nature gérés, les zones de paysages
protégés, et les réserves aménagées à
utilisations multiples. A cette catégorie doivent
s'ajouter deux autres types qui ont été créées par
l'UNESCO notamment les réserves de biosphère et
les sites du patrimoine mondial70.
En Afrique centrale, une cinquantaine d'aires
protégées ont pu être recensées (voir figure
2) . La plus petite est la réserve de faune du
cratère de Mbi (Cameroun) ; la plus grande est la
réserve forestière du Minkébé (6 000 km2,
Gabon). Si l'on considère les complexes d'aires
protégées contiguës, le plus étendu est sans
conteste le complexe de Gamba (Gabon). Ce complexe abrite une grande
variété d'espèces sauvages71.
|
68 Vertigo, la revue électronique en sciences de
'l'environnement, Célestine
MENGUE-MEDOU, Dossier protégées en Afrique
: perspectives pour leur conservation».
69 RAMADE François, Le Grand
massacre. L'avenir des espèces vivantes, p.244.
70 Ibid.
71 DOUMENGE, 1990 et 1996.
|
`'Les aires
|
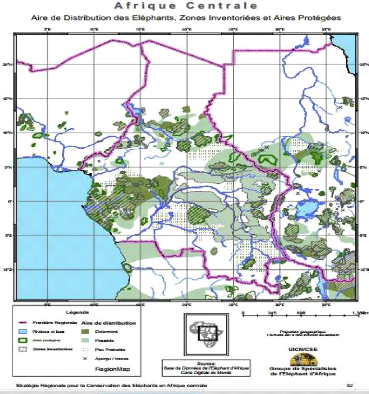
21
Figure 2. Distribution des éléphants
dans les aires protégées d'Afrique
Centrale72
Les éléphants et les gorilles sont
conservés in situ et ex situ dans la sous-région. La conservation
in situ est défini par la Convention sur la Diversité Biologique
de 1992 comme étant : « La conservation des
écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la
reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel
et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées,
dans le milieu où se sont développés leurs
caractères distinctifs ».
Par contre, la conservation ex situ représente :
« La conservation d'éléments constitutifs de la
Diversité biologique en dehors de leur milieu naturel
»73. Cette conservation est bien intégrée en
Afrique centrale à travers les parcs nationaux, les réserves et
les ZIC. Les gouvernements nationaux ont adopté des plans de gestion
d'aménagements de ces aires protégées en vue d'assurer la
protection des ressources fauniques.
72 UICN, Stratégie Régionale pour la
Conservation des Eléphants en Afrique Centrale, décembre
2005, p. 32
73 CDB.
22
Compte tenu de l'intensification des actes de braconnage, de
nouvelles aires protégées ont été mises en place
augmentant ainsi la répartition de ces zones dans tout le continent
(figure 3) depuis 1990.
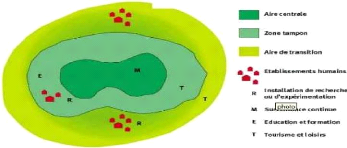
Figure 3. Zonage schématique d'une aire
protégée74
Dans le cadre de cette étude, nous examinerons les
parcs nationaux d'Afrique centrale (A) avant d'entrevoir les autres aires
protégées (B).
A- Les parcs nationaux d'Afrique centrale
Aux termes de la convention de Londres de 1933, un parc
national désigne « une aire destinée à la
récréation du public, dans laquelle la chasse, l'abattage ou la
capture de la faune, la destruction ou la collecte de la flore sont interdits,
sauf sous la direction ou le contrôle des autorités du parc
»75. Cette aire a pour but de faciliter la gestion des
ressources fauniques et floristique de l'environnement dans lequel il est
établit. A cet égard, le parc national de Monte Alen, le site
MIKE (CITES) en Guinée Équatoriale, est composé
principalement de forêts de plaine, allant jusqu'à 783 m
d'altitude. La gestion par les pouvoirs publics du parc national a
été appuyée par le programme de conservation et
d'utilisation rationnelle des écosystèmes forestiers en Afrique
centrale (ECOFAC), de l'Union Européenne (UE) et financée par la
Commission européenne (CE). Les renseignements sur les grands
mammifères de la région, en particulier les
éléphants, étaient restreints au niveau du site, bien
qu'un inventaire taxonomique intensif ait été
réalisé sous les auspices d'ECOFAC. Avant 1995, aucun recensement
des éléphants n'avait été réalisé.
C'est à cette date que l'on estima a environ 400 le nombre
d'éléphants à l'époque en Guinée
équatoriale76.
Le parc national de Nouabalé-Ndoki en République
du Congo quant à lui couvre 4 220km de forêt de plaine humide. Ce
parc contient une grande population d'éléphants. Cette
conservation d'éléphants en grande quantité s'explique par
le fait que la région n'est pas très habité par les hommes
et l'accès à ce parc est très
inaccessible77.
74 Internet.
75 Ibid.
76 Barnes et al. 1995.
77 BLAKE 2002.
23
Le parc national de Boumba Bek fait partie d'un réseau
d'aires protégées et d'unités de gestion forestière
au sud-est du Cameroun. A la fin des années 1980, cette région du
Cameroun abritait d'impressionnantes concentrations d'éléphants
de forêt et d'autres animaux sauvages78. Actuellement le
Cameroun dispose de 16 parcs nationaux79, et plus de trois en zones
de création. Le Parc de Waza à l'Extrême Nord du pays est
le plus connu et regroupe le plus grand nombre d'animaux sauvages de tout le
pays. Ce parc fait l'objet de convoitise par des touristes venus des quatre
coins du monde. On y trouve des lions, des guépards, des
éléphants, des hippopotames, des girafes, des phacochères,
des panthères etc. Cependant, force est de constater que le braconnage
sévit encore dans cette localité et ce malgré les mesures
juridiques et institutionnelles mises en oeuvre. Les éléphants et
les gorilles sont également regroupés dans d'autres aires
protégées tels que les réserves nationales et les zones
d'intérêt cynégétiques.
B- Les autres aires protégées en Afrique
Centrale
L'Afrique centrale dispose d'une très grande richesse
faunique qui a nécessité la mise en oeuvre des structures
permettant de contrôler le déplacement et les effectifs des
espèces sauvages parmi lesquels les éléphants et les
gorilles.
En dehors des parcs nationaux, on récence dans les
Etats d'Afrique centrale une panoplie de réserves comme celle de
Biosphère de Dimonika au Congo, de Luki en RDC et l'Ecosystème
Naturel du Cacongo dans la Province du Cabinda en Angola 80 . Cette
aire protégée est appréhendée différemment
dans les législations nationales des Etats d'Afrique centrale. Ainsi,
l'article 112 de la loi Tchadienne de 2008 considère que : «
Les réserves de faune sont des aires classées au nom de
l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées
pour la conservation de la biodiversité et l'aménagement de
l'habitat »81. Son homologue centrafricain estime quant
à lui que : « Les réserves de faune sont des aires
affectées à la protection de la faune et de son environnement
naturel dans lesquelles les activités agro- pastorales traditionnelles
sont réglementées, ainsi que l'accès du public
»82. Au regard de ce qui précède, ces
espaces sont interdits de chasse. Au Cameroun, on dénombre plusieurs
réserves parmi lesquels la réserve de faune du Dja, la
réserve de faune de Douala Edéa (168.116 ha), la réserve
de faune de Kimbi, le Lac Ossa wild life réserve (4.539)83
qui recensent un bon nombre de gorilles de plaines occidental. A noter que la
réserve du Dja est classée comme réserve de la
biosphère en 1981 et site du patrimoine mondial de l'UNESCO en
198784. C'est l'unique aire protégée qui ait pu au
Cameroun appartenir, aux deux catégories de réserve
instituées par l'UNESCO.
Dans cette Afrique en miniature, il y a d'autres aires
protégées comme les Sanctuaires de faune, les Jardins
zoologiques, les Zones d'intérêt cynégétique, et les
Zones d'intérêt à gestion communautaire. D'autres aires
protégées sont en cours de création au Cameroun (Tableau
3). Ces espaces nationales abritent une grande variété
d'espèces sauvages qui sont en voie d'extinction. A travers sa ferme
volonté de préserver sa biodiversité, le Cameroun s'aligne
ainsi en conformité avec la Convention de Rio de 1992 sur la
Diversité Biologique.
78 Stromayer and Ekobo 1991, Barnes et al. 1995.
79 Secrétariat Exécutif du RAPAC.
80 Idid.
81 République du Tchad, Loi N°08-014
2008-06-10 PR portant Régime des Forêts, de la Faune et des
Ressources Halieutiques.
82 Code de Protection de la Faune Sauvage de la RCA, Article 7,
1984, p. 3.
83 BENI MOUTILA Luc, Aires Protégées et
Aménagements forestiers au Cameroun: état de lieux, acteurs et
mode
de gestion.
84 AKONO J.M., Le braconnage dans la réserve du Dja :
une grave menace, in Moabi, n°2, novembre, 1995, p.6.
24
|
Nom
|
Superficie
ha
|
|
|
Parc marin de Kribi
|
126 053
|
Dossier au Premier Ministre (PM)
|
|
Parc National de Tchabal Mbabo
|
150 000
|
Avis au public signé et affiché
|
|
Parc national de Ndongore
|
230 000
|
Avis au public signé et affiché
|
|
Parc National de Kom
|
68 905
|
Dossier au Premier Ministre
|
|
Réserve écologique Intégrale de
Koupé
|
4 676
|
Dossier au Premier Ministre
|
|
Réserve de Mt Bamboutos
|
2 500
|
Avis au public signé et affiché
|
|
Réserve écologique Intégrale de
Manengoumba
|
5 252
|
Concertation bouclée
|
|
Sanctuaire à Gorilles de Bargué
|
47 686
|
Avis au public signé et affiché
|
|
Sanctuaire de Rumpi Hills
|
45 675
|
Cartographie de base
|
|
Sanctuaire de Sanaga Nyong
|
14
|
Préparation d'une visite du site
|
|
Réserve de Mont Nlonako
|
2500
|
Préparation d'une visite du site
|
|
Parc National d'Ebo
|
100 000
|
Dossier au PM
|
Tableau 3. Les aires protégées en
cours de création au Cameroun (2012)85
En RCA, il ya plusieurs types de réserves parmi
lesquels la réserve Naturelle stricte, les réserves de faune, une
réserve spéciale et une réserve privée qui sont
sous le monopole du Ministère de l'environnement, des eaux, des
forêts, de la chasse et de la pêche de la RCA, régies par
l'Ordonnance n°84.045 (1984) et la loi n°90.003 (1990). Le Gabon
quant à lui compte 13 parcs nationaux ainsi que d'autres
catégories d'aires protégées. En 2012, le Gabon a
mené un certain nombre d'activités qui contribuent à
l'évolution de la conservation de sa biodiversité notamment le
re-zonage du complexe d'aires protégées de Gamba. Selon le
Secrétariat exécutif du RAPPAC, « la superficie totale
des aires protégées du Gabon est de 3 617 038 hectares dont 2 467
131 hectares pour les parcs nationaux. La superficie des parcs marins est
estimée à 97 163 hectares. Les autres catégories d'aires
protégées représentent 1 149 907 hectares. Le pourcentage
de couverture du territoire par les aires protégées est
estimé à prêt de 14% dont environ 11% pour les parcs
nationaux »86. Au Congo, les aires protégées
sont tout aussi variée qu'au Cameroun (Tableau 4). Cette richesse
s'explique par le fait que ce pays dispose d'une importante quantité
d'espèces fauniques dont les gorilles et les éléphants qui
sont d'ailleurs reparties dans une large partie du territoire.
85 Secrétariat du RAPPAC, catégorie: Nouvelles
du Réseau. La synthèse des rapports nationaux sur la gestion des
aires protégées a contribué à ajuster le nombre
d'aires protégées en particulier avec la création de
nouvelles aires protégées en 2012. Ce tableau illustre bien les
recommandations des conventions internationales.
86 Confère site officiel du RAPPAC, catégorie
nouvelles du Réseau, publié le 21 mai 2013.
25
|
Nom
|
Nombre
|
|
Parcs nationaux
|
4
|
|
Réserves de Biosphère
|
1
|
|
Réserve communautaire
|
1
|
|
Domaines de chasse
|
2
|
|
Sanctuaires
|
3
|
Tableau 4. Quelques aires protégées
du Congo87
Le Congo tout comme le Cameroun et la RCA a inscrit le Tri
National de la Sangha (TNS) dans la liste du Patrimoine Mondial88.
D'autres aires protégées sont en cours de création au
Congo notamment la Zone d'intérêt Cynégétique (ZIC)
à Yengo au Nord du pays. Ce pays compte près de 16 aires
protégées d'une superficie totale de 4. 083. 000 ha soit 11,7% de
tout le territoire89.
En Guinée Equatoriale la loi N° 4/2 000
créant le Système National des Aires Protégées
précise que 13 aires protégées ont été mis
en place d'une superficie totale de 586.00 ha soit 18,5% de superficie totale
du pays 90 . Par ailleurs, la RCA dispose de 15 aires
protégées classiques qui sont gérées par l'Etat
assisté par les ONG locaux et internationaux. Ces espaces couvrent 11%
du territoire national91. Le Tchad malgré ses
difficultés financières recense tout de même une
variété d'aires protégées (Tableau 5). Il
bénéficie des aides des pays développés et
organisations internationales dans le but de conserver efficacement sa
biodiversité.
|
Nom
|
Nombre
|
|
Parcs nationaux
|
3
|
|
Réserves de faune
|
7
|
|
Réserve de Biosphère
|
1
|
|
Sites Ramsar
|
4
|
|
Domaine de chasse
|
4
|
|
Site du patrimoine mondial
|
1
|
Tableau 5. Quelques aires protégées du
Tchad92
87 Ibid.
88 Ibid.
89 Ibid.
90 Ibid.
91 Ibid.
92 Ibid.
Ces allocations financières sont cependant très
insuffisantes pour lutter efficacement contre le trafic et le braconnage des
espèces ciblées par les braconniers notamment les
éléphants et les gorilles. Les aires protégées de
Sao-Tomé et Principe sont divisées en deux zones. Primo,
l'Île de Sao-Tomé ayant une surface de 21.100 ha. Secundo,
l'Île de Principe avec 8.400 ha. Tercio, l'Île de Tinhosas de 23 ha
ce qui représente 30% du territoire national93.
Il s'agissait pour nous dans nos précédents
développements de présenter séparément les
généralités sur les éléphants et les
gorilles. Et cela nous a permis de comprendre que depuis plusieurs
décennies ces deux espèces pourtant emblématiques ont
été victimes des actes illégaux dans la faune. Depuis
l'intensification de ces actes criminels dans la faune, l'économie de la
sous-région n'a pas évolué et la sécurité
intérieure des Etats de cette localité est précaire. C'est
à juste titre qu'il faut comprendre Gabriel NTCHANGO lorsqu'il affirme
que : « La problématique du braconnage va désormais
au-delà du non-respect des dispositions réglementaires relatives
à la gestion durable de la faune sauvage dans les différents
Etats. En effet, elle est devenue une question de sécurité
intérieure, d'intégrité territoriale et est soumise
à la loi de l'offre et de la demande. Se concerter sur cette question
devient, plus que par le passé, une nécessité et un
exercice auquel tout Etat responsable doit se livrer mais elle ne doit pas
être traitée en vase clos ». En d'autres termes, la
lutte contre le trafic et le braconnage des espèces menacées ne
peut aboutir aux bons résultats que si les états unissent leurs
forces. En cela, les instruments internationaux sont tout à fait
indiqués car elles garantissent le développement durable des
peuples. C'est la raison pour laquelle dans la suite de cette analyse, nous
présenterons quelques instruments internationaux adoptés par les
Etats d'Afrique centrale et qui militent en faveur de la conservation des
éléphants et des gorilles.
26
93 Ibid.
27
CHAPITRE II : PANOPLIE DES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE
LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE
BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET
GORILLES EN AFRIQUE CENTRALE
L'idée d'une norme internationale de lutte contre les
actes criminels dans la faune s'est imposée dans les années 1960
comme la réaction aux dangers qui guettaient les espèces sauvages
partout dans le monde. Cependant, la prise de conscience planétaire des
conséquences désastreuses de certaines activités humaines
sur l'environnement 94 n'a pas empêché leur
continuité C'est pourquoi Raymond MBITIKON95lance cet appel
à l'attention de la communauté internationale : « Le
fléau du grand braconnage qui sévit en Afrique Centrale prend de
l'ampleur, menace dangereusement la survie des grands mammifères de nos
écosystèmes forestiers et leur sauvegarde nous interpelle tous
». Ainsi, la consécration de plusieurs textes s'est
avérée nécessaire96car ils unissent la
volonté de plusieurs états pour efficacement venir à bout
des actes criminels dans la faune.
Bien que les instruments internationaux qui seront
énumérés dans cette analyse n'aient pas comme
prétend le Professeur Stéphane DOUMBE-BILLE, « un
caractère contraignant auquel tous les états peuvent être
soumis »97, leur consécration vise néanmoins
à combler les lacunes des systèmes nationaux en matière de
protection de la biodiversité. Il sera question dans cette étude
de présenter dans une première démarche la CITES en tant
que convention spécifique de lutte contre le trafic des
éléphants et des gorilles (Section I). Dans une seconde
démarche, un accent sera mis sur les conventions internationales
généralisant cette lutte (Section 2) avant d'examiner dans un
troisième point les instruments internationaux protégeant
séparément chacun de ces espèces (Section 3).
SECTION 1 : CONVENTION SPECIFIQUE A LA LUTTE CONTRE
LE
TRAFIC DES DEUX ESPECES : LA CITES
Avant d'aborder l'étude du contenu (Paragraphe 2) et
des programmes de la convention CITES (Paragraphe 3), il convient au
préalable de présenter cette convention (Paragraphe 1).
Paragraphe 1- Présentation de la CITES
La Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) encore connu
sous l'appellation de « Convention de
94 WORSTER Donald, Les pionniers de l'écologie, Une
histoire des idées écologiques, Sang de la terre, Paris,
1992, p. 365.
95 Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, message
à l'occasion du Rapport annuel de la COMIFAC, 2012.
96 CHAMBOREDON Anthony, Du droit de l'environnement au
droit à l'environnement. A la recherche d'un juste milieu,
préface de Jean-Pierre MACHELON, l'Harmattan, janvier 2008, p. 103.
97 CORNU Marie, FROMAGEAU Jérôme, Le droit de
la forêt au XXIe siècle. Aspects internationaux, Collection
Droit du patrimoine culturel et naturel, l' Harmattan, novembre 2007, p. 24.
28
Washington » a été signée le 3 mars
1973 à Washington (USA) par 164 pays en 2004. Elle est entrée
officiellement en vigueur le 1er juillet 1975. La CITES «
règlemente l'importation, l'exportation et l'introduction en
provenance de la mer des spécimens des différentes espèces
inscrites dans ses annexes »98. Elle a été
rédigée pour donner suite à une résolution
adoptée en 1963 lors d'une session de l'Assemblée
générale de l'UICN. La nécessité de la CITES est
appréciable à plusieurs points. C'est pourquoi, William HAGUE a
déclaré à juste titre que : « (...) la CITES est
une arme fantastique dans la lutte contre le commerce illégal des
espèces sauvages. Elle est le seul organisme qui rassemble l'ensemble de
la communauté internationale sur cette question. Sa force réside
dans son caractère universel »99.
En Afrique Centrale, plusieurs pays ont adopté cette
convention à savoir : le Cameroun, le Tchad, la Guinée
équatoriale, le Gabon et Sao Tomé et Principe. Le commerce
international des espèces sauvages représente des milliards de
dollars par an et porte sur des centaines de millions de spécimens de
plantes et d'animaux. Ce commerce est varié, allant des plantes et
d'animaux vivants à une large gamme de produits dérivés et
alimentaires. Il sied d'approfondir ce travail en présentant le contenu
de la CITES.
Paragraphe 2- Contenu de la CITES
Les Etats Parties à la CITES ont élaboré
3 annexes qui regroupent les espèces menacées d'extinction.
L'expression « espèces » est défini dans l'article 1
(a) comme étant : « toute espèce, sous-espèce, ou
une de leurs populations géographiquement isolée ». La
première annexe spécifie les espèces menacées
d'extinction. La seconde annexe quant à elle classe les : «
espèces dont le commerce international doit être
contrôlée afin d'éviter qu'elles ne deviennent
menacées d'extinction»100. Enfin, la
troisième annexe : « comprend toutes les espèces qu'une
Partie déclare soumises, (...) à une réglementation ayant
pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et
nécessitant la coopération des autres Parties pour le
contrôle du commerce »101. Les
éléphants et les gorilles font partie de l'annexe 2 de la CITES.
Ils sont menacés d'extinction et c'est la raison pour laquelle leur
abattage respecte un ensemble de règles très strictes
dont la « délivrance et la présentation
préalable d'un permis d'exportation »102 .
En Afrique centrale, les peines liées aux actes
criminels à l'égard les éléphants et les gorilles
varient en fonction des législations nationales. La CITES a mis en place
deux programmes stratégiques de lutte contre le braconnage faunique. Il
sera question dans ce qui va suivre de présenter leur contenu.
Paragraphe 3- Programmes de la CITES
spécialisés dans la lutte contre le trafic et le braconnage des
espèces menacées d'extinction
Le programme MIKE (A) et ETIS (B) de la CITES sont
spécialisés dans la lutte contre le trafic et le braconnage des
espèces menacées d'extinction.
98 Liste des accords multilatéraux dans le domaine de
l'environnement, janvier 2005.
99 Hague William, Secrétaire britannique des Affaires
étrangère, à l'ouverture de la Conférence de
Londres du 12 au 13 février 2014.
100 Ibid., p. 15.
101 CITES, article 2(3).
102 Ibid., article 4(2).
29
A- Le programme MIKE en Afrique centrale
En 1997, lors de la 10e réunion de la
Conférence des Parties (CDP) de la Convention sur le Commerce
International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées
d'Extinction (CITES), les parties ont convenu d'établir un
système de surveillance sur toute l'aire de répartition des
éléphants d'Afrique et d'Asie ( Résolution 10.10). Il
s'agissait de fournir une évaluation systématique et
détaillée de l'incidence des décisions des parties visant
à autoriser, restreindre ou suspendre le commerce d'une espèce
particulière (et/ou de ses produits et dérivés). Le
système de surveillance, connu aujourd'hui sous son acronyme MIKE
(Monitoring the Illegal Killing of Elephants), a été
approuvé lors de la 41e réunion du comité
permanent de la CITES, en février 1999. Entre 1999 et 2001 un programme
pilote, financé par le United States Fish and Wildlife Service (USFWS)
et la Wildlife Conservation Society (WCS), a été mis en oeuvre en
Afrique centrale afin d'évaluer la faisabilité d'un programme
à grande échelle dans les écosystèmes forestiers
(Beyers et al. 2001).
À l'heure actuelle, le programme MIKE s'est fixé
comme finalité de : « Fournir les informations
nécessaires aux États de l'aire de répartition des
éléphants pour prendre les décisions de gestion et
d'application appropriées et pour renforcer les capacités
institutionnelles au sein des États de l'aire de répartition pour
la gestion à long terme de leurs populations d'éléphants
». Citons les objectifs plus spécifiques inclus dans ce but :
(1) « mesurer les niveaux et les tendances de la chasse illicite des
éléphants », (2) « déterminer les
changements de ces tendances, au fil du temps » et (3) «
déterminer les facteurs causaux de ces changements et évaluer
dans quelle mesure les tendances observées sont liées aux
changements émanant de la CITES en ce qui concerne les conventions
d'inscription notamment »103.
MIKE prévoit atteindre ces objectifs par le biais d'un
système de collecte des données sur site enregistrant les
tendances des populations d'éléphants, l'incidence et les
patterns de l'abattage illégal. Le programme MIKE est également
chargé de mettre au point et d'utiliser une méthodologie
standardisée pour le recueil et l'analyse des données. Quid du
programme Elephant Trade Information System (ETIS) ?
B- Programme ETIS de la CITES
Elephant Trade Information System (ETIS) est un programme
d»information qui permet d'étudier le commerce illicite de l'ivoire
et d'autres produits des éléphants. Il est géré par
l'ONG TRAFFIC104 pour le compte de la CITES. ETIS a pour objectif
d'analyser le niveau du trafic illégal et agit en
complémentarité avec le programme Mike.
Ce programme s'est fixé plusieurs objectifs parmi
lesquels : mesurer et enregistrer le niveaux et tendances actuels de la chasse
et du commerce illicite de l'ivoire dans les Etats de l'aire de
répartition et dans les entrepôts commerciaux, ainsi que les
changements dans ces niveaux et tendances; déterminer si les tendances
observées sont liées aux changements d'annexe à la CITES
de certaines populations d'éléphants et/ou à la reprise
d'un commerce licite international de l'ivoire et, dans l'affirmative ;
établir une base d'informations pour appuyer la prise de
décisions sur les besoins en matière de gestion, de protection et
de respect des dispositions en vue.
103
www.cites.org/eng/prog/MIKE.
104 Il est actuellement géré par le bureau de
TRAFFIC en Afrique orientale/australe à Harare (Zimbabwe).
30
En Août 2009, ETIS a confisqué les produits issus
d'éléphants provenant de 85 pays ou depuis 1989. Ce programme
constitue le plus grand recueil de données au monde dans la lutte contre
le commerce international illégal des ivoires
d'éléphants105.
La CITES est assistée d'autres instruments
internationaux qui généralisent la lutte contre le trafic et le
braconnage des éléphants et des gorilles.
SECTION 2 : CONVENTIONS INTERNATIONALES GENERALISANT LA
LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET DES
GORILLES
Le développement durable est à l'ordre du jour
106 dans toutes les politiques internationales. C'est pourquoi, la
Convention sur la Diversité Biologique (Paragraphe 1), la Convention
d'Alger (Paragraphe 2) et la Convention sur la Conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (Paragraphe 3) prônent
la nécessité de conserver les espèces sauvages pour
parvenir à cet idéal.
Paragraphe 1- La Convention sur la Diversité
Biologique
(CDB)
Adopté le 13 juin 1992 à Rio de Janeiro, la
Convention sur la Diversité Biologique est entrée en vigueur le
29 septembre 1994 et a été ratifié par 187 pays dont 9
états d'Afrique centrale à savoir : Le Cameroun, le Tchad, la
RDC, la République du Congo, la Guinée équatoriale, le
Gabon et Sao Tomé et Principe sont tous Parties à cette
prestigieuse convention qui a acquis au plan international une solide
réputation. En effet, la CDB est le tout premier instrument de
conservation et d'utilisation durable de la diversité
biologique107. Elle a pour objectif : « (...) la
conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses
éléments et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exploitation des ressources génétiques,
notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des
techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et
aux techniques, et grâce à un financement adéquat
»108.
La CDB dans ses dispositions préconise la conservation
in situ ou ex situ. Par ailleurs, elle recommande aux Etats d'élaborer :
« des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant
à assurer la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies,
plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures
énoncées dans la présente Convention qui la concernent
»109. Cette disposition suggère donc que les Etats
mettent en oeuvre des stratégies adéquates pour lutter
efficacement contre les actes de trafic et de braconnage des espèces
menacées. Plusieurs Etats d'Afrique centrale ont ratifiés la CDB
et pour confirmer leurs engagements, des stratégies et programmes de
lutte contre les actes criminels à l'égard des
éléphants et des gorilles ont été
élaborés et mis en oeuvre. En réalité, les
105 MANUEL ETIS de la CITES, le programme ETIS de suivi du
commerce illégal de l'ivoire et autre produit de
l'éléphant d'Afrique Loxodonta africana comme outil de protection
de l'éléphant au Cameroun.
106 ROTILLON Gilles, Faut-il croire au
développement durable ? Questions contemporaines, l'Harmattan,
2008, p. 7.
107 Liste des accords multilatéraux dans le domaine de
l'environnement, janvier 2005.
108 CDB, Article 1er.
109 Ibid., Article 6 (a).
31
Etats Parties à cette convention « s'efforcent
d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la
compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la
diversité biologique et l'utilisation durable de ses
éléments constitutifs »110. Il ressort de ce
qui précède que la CDB oriente les Etats dans
l'élaboration des mesures et programmes visant à conserver la
faune.
Au regard de ce qui précède, la CDB est, «
une réponse tangible des gouvernements et des institutions au
questionnement planétaire soulevé par la Commission Brudtland en
1987. Il s'agit là d'une priorité, à la fois globale et
vitale que se sont fixés les pays, notamment pour l'atteinte du
développement durable »111. D'où sa
pertinence reconnue en matière de relation internationale. La Convention
d'Alger de 1968 a-t-elle une influence similaire?
Paragraphe 2- La Convention d'Alger de 1968
La Convention d'Alger a été adopté
à Alger le 15 septembre 1968 dans le cadre de « la conservation
et l'utilisation des ressources en sol, en eau, en flore et en faune
»112 et est entrée en vigueur le 16 juin 1969.
Cette convention est destinée aux pays d'Afrique indépendants et
encourage les activités individuelles ou collectives113.
La Convention d'Alger a été
révisée et enregistré à Maputo (Mozambique).
Malgré le fait que cette convention a été signée
par 34 pays dont 5 ratifications en 2006, elle a eu le mérite d'avoir
instauré en Afrique un cadre juridique régional de gestion
rationnelle des ressources naturelles. Pour ce qui est de la conservation de la
faune, l'article 8 prévoit que : « les Etats contractants
reconnaissent qu'il est important et urgent d'accorder une protection
particulière aux espèces animales et végétales
menacées d'extinction ou qui serait susceptible de le devenir (...)
». Cette disposition a permis aux Etats d'Afrique centrale de
soutenir des actions, tout au moins en ce qui concerne la lutte contre le
commerce illégal et le trafic des espèces menacées. Bien
que la convention d'Alger ait été reconnue par la plupart des
Etats d'Afrique, elle est cependant restée limitée dans son
application à cause des contraintes financières qui
sévissent dans tout le continent.
Il convient dès à présent d'examiner la
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (CMS).
Paragraphe 3- La Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(CMS)
L'analyse de la CMS portera d'une part sur sa présentation
(A) et son contenu (B).
A-Présentation de la CMS
La Convention sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS) est aussi connue sous
le nom de convention de Bonn. Elle a été adoptée à
Bonn le 23 juin 1979, ratifiée par 84 pays et est entrée en
vigueur le 1er novembre 1983. En 2014, 120 états au
110 Ibid., Article 8 (i).
111 Ministère de l'Environnement et de la Faune du
Québec, Convention sur la Diversité Biologique, Stratégie
de mise en oeuvre au Québec, 1996.
112 Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et
des Ressources Naturelle encore appelée Convention d'Alger, 1988.
113 PNUE, Rapport sur l'Etat de l'environnement en Afrique de
l'ouest, 2004, p.80.
32
total ont adopté cette convention avec
l'adhésion en mai de cette année de la République de
Kirghizistan114. La Convention de Bonn vise à «
assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, marines
et aériennes sur l'ensemble de leur aire de répartition
». Il a semblé nécessaire pour les états Parties
d'adopter une convention protégeant les animaux migrateurs qui
traversent les frontières nationales pour se retrouver dans un autre
état souverain, sans qu'on ne soit en mesure de les recenser, ni de
déterminer la provenance de cet animal. Selon l'article 1 de cette
convention, une « Espèce migratrice signifie l'ensemble de la
population ou toute partie séparée géographiquement de la
population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux
sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon
prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale
». En d'autres termes, les espèces migratrices peuvent donner
lieu à une pluralité de législations et de juridictions
compétentes. Par ailleurs, la convention de Bonn dispose de 3 annexes.
Elle a été adopté par quatre pays d'Afrique Centrale parmi
lesquels : L'Angola, le Cameroun, le Gabon, Sao Tomé et Principe. Qu'en
est-il de son contenu ?
B-Contenu de la CMS
L'article 2 de la CMS précise que : « Les
Parties reconnaissent qu'il est important que les espèces migratrices
soient conservées et que les Etats de l'aire de répartition
conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l'action à
entreprendre à cette fin;
elles accordent une attention particulière aux
espèces migratrices dont l'état de conservation est
défavorable et prennent individuellement ou en coopération les
mesures appropriées et nécessaires pour conserver ces
espèces et leur habitat»115. En d'autres termes,
cette disposition recommande aux Etats Parties de mettre en place des mesures
draconiennes pour conserver les espèces migratrices. En ce qui concerne
l'Afrique centrale, plusieurs complexes transfrontaliers ont été
crées en réponse à cette convention.
Pour protéger les espèces menacées, les
Parties à la Convention de BONN s'évertuent à conserver ou
à restaurer l'habitat de l'espèce menacée ;
prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets
négatifs des activités ou des obstacles qui gênent la
migration de l'espèce; prévenir, réduire ou
contrôler, lorsque cela est possible et approprié, les facteurs
qui menacent ou risquent de menacer davantage ladite espèce ; les
États faisant partie de l'aire de répartition interdisent les
prélèvements d'animaux d'espèces, exceptions faites des
prélèvements à des fins scientifiques, des projets
d'amélioration de l'espèce. Reste que d'autres instruments
internationaux poursuivent le même but notamment la Déclaration de
Londres.
Paragraphe 4- Déclaration de Londres
Parler de la Déclaration de Londres revient à
présenter sa naissance(A) et son contenu
(B).
A-Naissance de la Déclaration de Londres
Ces dernières années, le braconnage et le trafic
des espèces menacées ont pris une ampleur énorme en
Afrique. Le massacre des éléphants dans le parc national de Bouba
N'Djida au Nord du Cameroun en 2012 illustre bien ce film d'horreur. La RCA a
également connu une
114
http://www.cms.int/fr.
115 Convention de Bonn, Principes fondamentaux, article 2.
33
perte énorme d'éléphants estimé
à 26 éléphants116 dans le site du Patrimoine
mondial de Dzanga en mai 2013. Le Tchad aussi a connu un épisode noir
marquée par l'abattage de près de 89
éléphants117 en mars 2013 à Ganda, dans le sud
du pays. C'est au vu de ces grandes catastrophes que s'inscrit la
Conférence de Londres sur le commerce illégal des espèces
sauvages tenu à Londres le 12 et 13 février 2014
réunissant ainsi 46 pays et 11 organisations internationales. Lors de
cette conférence un accord a été adopté sous
l'appellation de la « Déclaration de Londres ». Les Etats
d'Afrique centrale comme le Cameroun, le Tchad, le Gabon ayant pris part
à cette convention ont reconnu cette Déclaration comme
étant un instrument juridique international de lutte contre le trafic
des espèces sauvages. De plus, ils confirment leurs engagements à
mettre en oeuvre des stratégies pour éliminer
définitivement les actes criminels dans leurs sous-régions.
Les Etats Parties à la Déclaration de Londres se
sont fixés pour missions principales d'éradiquer les
marchés des produits illégaux issus des espèces sauvages,
de prendre des mesures juridiques dissuasives efficaces, de renforcer la lutte
contre la fraude et soutenir les moyens d'existence durables. Pour ce faire,
les pays développés parties à cette convention ont
alloué des aides financières aux pays en
développement118. Cette contribution manifeste le souci de la
communauté internationale d'accompagner les pays africains dans la
conservation de leurs ressources naturelles. Or, le commerce illégal des
espèces sauvages ne contribue pas à cet idéal. C'est
pourquoi : « Il n'est pas exagéré de dire que nous
sommes confrontés à une crise sans précédent : des
dizaines de milliers d'éléphants ont été
tués l'année dernière, plus d'un millier rhinocéros
sont morts en raison du braconnage et du trafic, et les tigres, ainsi que
beaucoup d'autres espèces, sont de plus en plus fortement
menacés. Mais ce n'est pas seulement une crise environnementale. Il
s'agit maintenant d'une industrie criminelle mondiale, au même titre que
les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains
».119 La situation des espèces sauvages est donc
précaire et la Déclaration de Londres est tout à faire
salutaire pour mener efficacement des résistances contre les trafiquants
chevronnés des grands mammifères. Cette Déclaration
s'aligne étroitement avec les résolutions de la Convention CITES.
Ce qui est la preuve manifeste de l'effectivité de la mise en oeuvre des
instruments internationaux de lutte contre les actes criminels dans la faune.
Ces instruments collaborent étroitement et garantissent la protection de
la biodiversité pour les générations présentes et
futures. Aussi, quel est le contenu de la Déclaration de Londres ?
B-Contenu de la Déclaration de Londres
Les Parties à la Déclaration de Londres
s'engagent à ne plus utiliser les produits provenant d'espèces
menacées de disparition, et à prolonger l'interdiction du
commerce d'ivoire «jusqu'à ce que la survie des
éléphants d'Afrique ne soit plus menacée par le
braconnage»120. Quand on considère le fait qu'en
Afrique centrale cinq pays ont perdu près de 65% de leurs populations
d'éléphants dans la période de 2002 et 2011, il est
aisé d'apprécier le bien-fondé de la Déclaration de
Londres qui constitue une prompte réaction de la communauté
internationale face aux crimes odieux dans la faune sauvage. Le point 2
de cette Déclaration rappelle que : « Le braconnage et les
trafics affaiblissent la primauté du droit et la bonne gouvernance et
encouragent la corruption. Ce sont des activités criminelles
organisées et très répandues qui
116 Braconnage de l'éléphant en Afrique centrale :
Le cri de coeur du Gabon, l'appel de l'ONU, internet.
117 Ibid.
118 Communiqué de presses du Secrétariat de la
CITES.
119 William Hague, Secrétaire britannique des Affaires
étrangère, à l'ouverture de la Conférence de
Londres du 12 au 13 février 2014.
120 Déclaration de Londres de 2014.
34
mettent en jeu des réseaux transnationaux. Dans
certains cas, les recettes qui en découlent servent à soutenir
d'autres activités criminelles et ont été liées
à des groupes armés impliqués dans des conflits internes
et transfrontaliers. Le nombre de forestiers et autres agents
spécialisés dans la protection des espèces sauvages
tués ou blessés est considérable ».
La convention de Londres comporte plusieurs dispositions qui
concrétisent les mesures à prendre. A titre d'exemple, le point 5
précise que: « Des mesures décisives et urgentes
s'imposent dès maintenant afin de lutter contre le commerce illicite
d'espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
Pour beaucoup d'espèces, le trafic et le braconnage est un
problème persistant et croissant. Au cours des dernières
années, certaines régions ont connu une escalade
particulièrement tragique du niveau de braconnage
d'éléphants et de rhinocéros. La grave menace qui
pèse sur ces espèces emblématiques est aussi en train de
menacer la sécurité régionale et le développement
durable. Une action visant à lutter contre le commerce illicite
d'éléphants et de rhinocéros permettra de renforcer notre
capacité à combattre le commerce illicite d'autres espèces
menacées d'extinction. Une telle action encouragera en outre
l'exploitation durable des ressources ». Il ressort de cette
disposition que les perspectives d'éradication du commerce illicite des
espèces menacées sont juridiquement prises en compte. Dans la
même logique, les Etats d'Afrique centrale ont adopté les
instruments qui protègent séparément les
éléphants et les gorilles.
SECTION 3: LES ELEPHANTS ET LES GORILLES :
INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX PROTEGEANT CHAQUE ESPECE SEPAREMENT
On peut distinguer dans une summa divisio les instruments
internationaux spécifiques de protection des éléphants
(Paragraphe 1) et ceux qui protègent spécifiquement les gorilles
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1- Conventions spécifiques de
protection des
éléphants
Parmi ceux-ci, l'on peut identifier la Déclaration de
Paris sur la lutte contre le braconnage d'éléphants et d'autres
espèces protégées (A) et la Déclaration de
Yaoundé sur la lutte anti-braconnage (B).
A-Déclaration de Paris sur la lutte contre le
braconnage d'éléphants et contre le trafic d'ivoire et d'autres
espèces protégées
Pour mieux appréhender cette Déclaration nous
présenterons son contexte (1) et son contenu (2).
1-Contexte de la Déclaration de
Paris
Au regard de l'ampleur des massacres des
éléphants et des autres espèces menacées dans toute
l'Afrique121, une table ronde a réuni à Paris
plusieurs chefs d'Etat et ministres africains le 5
121 Déclaration de Paris sur la lutte contre le
braconnage d'éléphants et contre le trafic d'ivoire et d'autres
espèces protégées, point 1.
35
décembre 2013. Le sommet de Paris a donné lieu
à une Déclaration résumée en 15 points. Cette
Déclaration a été reconnue en tant qu'instrument juridique
international de lutte contre les criminels de la faune africaine. Elle
précise en son point 3 que : « Face à des bandes
lourdement armées, qui opèrent de plus en plus de manière
transfrontalière, qui alimentent les trafics de tous genres ainsi que
l'instabilité politique, nos États sont confrontés
à un véritable défi de sécurité et de
souveraineté. Drame environnemental, avec en perspective la disparition
possible de la nature, à court terme de plusieurs grandes espèces
animales emblématiques de notre monde, le braconnage et les trafics
illicites hypothèquent les possibilités de développement
économique et social, la préservation de l'environnement de zones
toujours plus larges de nos territoires ». Il est donc constant que
le braconnage et le trafic des espèces affectent non seulement la faune
sauvage mais aussi la sécurité de l'Afrique et le
développement du continent. La France pays proche du continent africain
a initié cette table ronde en faveur des états africains parce
qu'elle entretient avec ces pays des liens très étroits depuis
plusieurs siècles. Les africains quant à eux considèrent
la France comme une nation frère qui les assiste dans tous les domaines
stratégiques des relations internationales notamment la
sécurité, la paix, la criminalité transfrontalière
et le développement durable.
La Déclaration de Paris s'aligne donc dans cette
logique et s'évertue à créer un climat de paix en Afrique.
Une attention particulière doit être faite en ce qui concerne les
moyens d'exploitation des ressources naturelles de la sous région. Car
la facilité d'action des braconniers et trafiquants provient de la
mauvaise gestion de ces ressources. De tels actes constituent des freins pour
le développement et la sécurité en Afrique. In fine, le
braconnage et les trafics illicites hypothèquent les possibilités
de développement économique et social122. Cette
affirmation est contenue dans la Déclaration de Paris.
2-Contenu de la Déclaration de Paris
Dans cette Déclaration, les chefs d'Etats s'engagent
à lutter fermement contre les actes de braconnage en Afrique. Selon les
signataires de cette Déclaration : « agir efficacement
nécessite la combinaison de moyens arsenaux répressifs
renforcés, associés à des politiques de
développement intégrées, qui prennent en compte les
dimensions humaines, environnementales, économiques et sociales de la
lutte contre le braconnage et les trafics »123. Ils sont
d'accords pour renforcer la CITES et les initiatives qu'elle a
suscitées. Une lutte efficace nécessite en effet une coordination
mondiale et des outils juridiques adaptés pour ce faire.
Les Chefs d'Etats africains attirent l'attention des pays de
destination des produits issus du braconnage d'espèces menacées,
à renforcer la recherche des importations, exportations et
réexportations effectuées en contravention des règles de
la CITES et à appliquer des sanctions sévères à
l'encontre des personnes impliquées dans ces trafics
(commerçants, intermédiaires et consommateurs124). Les
Etats africains appellent l'ensemble des grands bailleurs de fonds à
apporter leur soutien aux initiatives nationales et régionales
africaines. La lutte contre le braconnage ne peut en effet être efficace
que si elle est intégrée dans les politiques de
développement durable soutenue par les institutions internationales et
les grands bailleurs de fonds125. La Déclaration de
Yaoundé sur la lutte Anti-braconnage partage également ces
idéaux
122Ibid.
123 Ibid., point 9.
124 Ibid., point 13.
125 Ibid., point 14.
36
B- Déclaration de Yaoundé sur la lutte
Anti-Braconnage
La réunion d'urgence des Ministres de la CEEAC de
Yaoundé qui a abouti à la Déclaration sur la Lutte
Anti-Braconnage en Afrique Centrale a été
précédée du 21 au 22 mars 2013, par une réunion
préparatoire à forte mobilisation d'experts des questions de
relations extérieures, de la défense et de la
sécurité, de la faune et de l'intégration sous
régionales. Ils étaient assistés par
plusieurs représentations diplomatiques, des agences du Système
des Nations Unies (Unesco, FAO, PNUD/FME, UNOPS), des agences de
Coopération (UE, AFD, GIZ, USAID, USFS), des organisations et
institutions nationales et internationales (CEEAC, COMIFAC, RAPAC, OCFSA,
TRAFFIC, CEFDHAC, UICN, WWF, SOS Eléphants, WCS, BAD, REPAR, ECOFAC,
PACEBCO, ICCN, FTNS, NEPAD, LAGA) et des journalistes nationaux et
internationaux venant du Burundi, du Tchad, et de RFI. Cette rencontre de
Yaoundé du 23 mars 2013126 a aboutit à l'adoption d'un
Plan d'Extrême Urgence de Lutte Anti-braconnage (PEXULAB) dans la zone
septentrionale du Cameroun, du Tchad, du Nord et Nord- Ouest de la
République Centrafricaine et dans la zone forestière. Dans le
cadre de cette Déclaration, les Etats Parties : « sont vivement
préoccupés par l'abattage illégal des
éléphants en Afrique centrale pour le trafic international de
l'ivoire (...) ; ils reconnaissent que le braconnage et le commerce
international illégal de l'ivoire et de la faune sauvage portent
atteinte à l'environnement, à la paix et à la
sécurité des Etats, menacent la vie d'innocent et compromettent
la croissance économique des pays ». Cette rencontre est
intervenue après les grands massacres qui ont causé une grande
perte d'éléphants au Nord du Cameroun, au sud du Tchad et dans le
Sud- Ouest de la RCA.
Il sied dès à présent de présenter
l'Accord sur la conservation des gorilles comme principal instrument
spécifique de protection des gorilles.
Paragraphe 2- L'accord sur la conservation des
gorilles
et de leurs habitats
L'accord sur la conservation des gorilles et de leurs habitats
est un traité international qui lie plusieurs Etats dans le but de
conserver les gorilles dans leurs territoires. Il a été
négocié du 22 au 26 octobre 2007 à Paris sous les auspices
de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (CMS). L'Accord est entré en vigueur en 2008
et vise à conserver et à restaurer les populations de gorilles en
Afrique centrale et occidentale et à promouvoir la survie à long
terme de leur habitat forestier et des populations humaines qui en
dépendent, à travers le développement des plans d'actions
spécifiques aux quatre sous-espèces et couvrant
l'éducation, la recherche et la protection des
forêts127.
Le but global de l'accord est de fournir un cadre pour la
conservation des gorilles et leurs habitats par les États membres. Les
Etats parties accordent des mesures strictes de conservation dans l'aire de
répartition de l'accord ; identifient les habitats où vivent les
gorilles et assurent la protection, la gestion, la réadaptation et la
restauration de ces emplacements ; coordonnent leurs
126A la suite du massacre des éléphants dans la
zone septentrionale du Cameroun en 2012, de sources officielles, 300
dépouilles d'éléphants ont été
trouvées dépourvues de leurs défenses dans le Parc
National Camerounais de Bouba N'Djida. Ce film cauchemardesque s'est
poursuivi dans la nuit du 14 au 15 mars 2013 où environ 89
éléphants au Tchad et plus tard, environ 30
éléphants en République Centrafricaine ont
été tués. Face à ce scandale écologique, le
doigt accusateur est pointé sur les « braconniers » venant du
Soudan, lourdement armés et équipés de chameaux et de
chevaux pour leur déplacement.
127 L'Accord pour la Conservation des Gorilles et de leurs
Habitats.
37
efforts afin de supprimer des activités relatives au
braconnage. Cet accord concerne tous les espèces et sous-espèces
de gorilles reparties en Angola, au Cameroun, en RCA, en République du
Congo, en RDC, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Nigeria, au
Rwanda et en Ouganda.
Il ressort de ce qui précède que plusieurs
instruments internationaux ont été adoptés par les Etats
d'Afrique Centrale. Leur objectif essentiel est de protéger les
espèces menacées d'extinction tout en assurant une gestion
durable, c'est-à-dire une exploitation rationnelle sans
hypothéquer la satisfaction des besoins des générations
futures128. A la suite de ces instruments, les Etats d'Afrique
centrale ont établis des stratégies et des plans d'actions visant
à éradiquer les actes criminels dans la faune. Il conviendra dans
notre seconde partie de présenter l'impact des instruments
internationaux qui encadrent la lutte contre ces actes.
128 BIGOMBE LOGO Patrice, Le retournement de l'Etat
Forestier. L'endroit et l'envers des processus de gestion forestière au
Cameroun, Préface du Professeur Maurice KAMTO, presse de l'UCAC,
2004, p. 17.
38
PARTIE II: L'IMPACT DES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE
LUTTE CONTRE LE TRAFFIC ET LE
BRACONNAGE DE L'ELEPHANT ET DU
GORILLE EN AFRIQUE CENTRALE
Les instruments internationaux adoptés par les Etats
d'Afrique centrale constituent un moyen de résistance face aux massacres
des espèces menacées d'extinction. Dans cette étude, nous
avons démontré qu'il en existe plusieurs, ayant tous en commun la
conservation efficace de la biodiversité. Cela étant, ces
instruments recommandent aux Etats Parties d'instaurer au plan national et
sous-régional des stratégies de lutte contre les actes criminels
dans la faune susceptible d'affecter l'environnement, la sécurité
des peuples et le développement durable. Cela soulève la question
de l'effectivité des instruments internationaux dans la mise en oeuvre
des actions pour stopper le trafic illégal et le braconnage des
espèces menacées d'extinction (Chapitre I). En tout état
de cause, il est constant qu'en Afrique centrale, l'application des
recommandations des instruments internationaux se heurte bien souvent aux
difficultés d'ordre politique, juridique, économique et social.
Ce qui par voie de conséquence entrave l'exécution des plans
d'actions établies (Chapitre II).
CHAPITRE I. EFFECTIVITE DE LA MISE
EN OEUVRE DES INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX DANS LA
CONSERVATION DES ELEPHANTS ET
DES GORILLES
A la lecture des instruments internationaux sur la lutte
contre le trafic et le braconnage des éléphants et des gorilles,
l'on peut déceler cinq objectifs communs à savoir :
L'élaboration des stratégies et plans d'actions visant à
éradiquer les actes criminels dans la faune d'Afrique centrale, la
nécessité d'une coopération entre les Etats Parties ;
l'adoption des législations pour protéger la faune, l'aide aux
pays en développement et la réduction de la demande d'ivoire. Ces
objectifs seront pris en compte dans la suite de notre analyse qui consistera
dans une première démarche à examiner les plans d'actions
et des stratégies de lutte contre les actes criminels dans la faune
instaurés en Afrique Centrale (Section I). En seconde analyse, il sera
question de présenter les mesures prises par les Etats d'Afrique
centrale au plan national et bien évidemment la participation des
organisations transnationales dans cette lutte (Section II). C'est après
cela que nous évoquerons les résultats de l'application de ces
instruments internationaux en ce qui concerne les actes criminels dans la faune
sous-régionale.
39
SECTION 1 : L'INSTAURATION DES PLANS D'ACTIONS ET DES
STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LES ACTES CRIMINELS DANS LA FAUNE EN AFRIQUE
CENTRALE
Des méthodes diverses et des techniques de conservation
des ressources naturelles se sont accrues ces dernières années,
prenant une dimension globale et planétaire129. L'Afrique
centrale n'est pas en reste car plusieurs plans d'actions et stratégies
ont été mis en place par plusieurs acteurs de la
sous-région. Parmi ces acteurs, on peut citer la COMIFAC (paragraphe 1),
la CEEAC (Paragraphe 2), l'OCFSA (Paragraphe 3) et le RAPPAC (Paragraphe 4).
Paragraphe 1- La COMIFAC: Matérialisation de la
coopération et de la mise en oeuvre des plans d'actions de lutte contre
le trafic et le braconnage dans la sous-région
La Commission des forêts d'Afrique centrale est un
acteur influent dans la mise en oeuvre des plans d'actions et stratégies
élaborés par les Etats membres de la sous-région. C'est la
raison pour laquelle présenter (A) cette organisation semble
nécessaire pour la compréhension des plans d'actions
instaurés et appliqués par celle-ci (B).
A-Présentation de la COMIFAC : expression d'une
coopération entre les Etats d'Afrique centrale
Il conviendra de relever dans cette présentation deux
points forts à savoir : la création (1) et les objectifs (2) de
la COMIFAC.
1-Création de la COMIFAC
Créée en décembre 2000 lors de la
Conférence des Ministres en charge des Forêts d'Afrique Centrale,
la Commission des Forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) est le produit de
la Déclaration de Yaoundé du 17 mars 1999. Elle a
été officiellement opérationnelle en 2002 par la signature
de ses statuts. Le siège de la COMIFAC est à Yaoundé mais
peut être transféré dans un autre pays membre sur
décision du Sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernement130.
La première des résolutions contenues dans la Déclaration
de Yaoundé étant la création des aires
protégées transfrontalières, celle-ci fut mise en
application immédiatement après la création de la COMIFAC,
avec l'adoption le 07 décembre 2000 de l'Accord relatif à la mise
en place du TNS signé entre la République du Cameroun, la
République du Congo et la République Centrafricaine. La
durée de la COMIFAC est illimitée. Les organes de la COMIFAC sont
notamment le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement ; le Conseil des
Ministres et le Secrétariat Exécutif131. Le Burundi,
le Cameroun la RCA, le Congo, la RDC, le Gabon, la Guinée
129 Clément Jean, La forêt : un sujet
médiatisé à dimension mondiale, in Le Flamoyant,
n°32, novembre 1994, p. 4.
130Traité relatif à la conservation et
la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale,
article 6. 131 Ibid.
40
Equatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le
Tchad132 sont tous membres de cette commission.
Il ressort de ce qui précède que la COMIFAC est
un excellent instrument de coopération entre les Pays de l'Afrique
Centrale qui à cet égard, partagent des objectifs communs.
2- Objectifs de la COMIFAC
La COMIFAC est chargée de l'orientation, de
l'harmonisation, du suivi et de la mise en oeuvre des politiques
forestières et environnementales en Afrique Centrale133. Elle
assure le suivi de la Déclaration de Yaoundé de 1999. La COMIFAC
a constitué des réunions tripartites des ministres des trois pays
partenaires du TNS134. Cette organisation sous-régionale a
élaboré des plans d'actions et des stratégies en
partenariat avec les ONG locaux et internationaux pour lutter contre l'abattage
illégal des éléphants et des gorilles. C'est une
organisation de référence en ce qui concerne la mise en oeuvre
des politiques nationales et en matière de gestion des ressources
fauniques en Afrique centrale.
Différentes initiatives, et actions permettent la
construction du développement durable des peuples135. Parmi
celles-ci l'élimination des actes criminels dans la faune occupe une
place de choix. Il sied dès à présent d'examiner les plans
d'actions élaborés et mis en oeuvre par la COMIFAC.
B-Elaboration et mise en oeuvre des plans d'actions par
la COMIFAC
La COMIFAC a élaboré et mis en oeuvre plusieurs
plans d'actions parmi lesquels le PAPECALF (1) et le programme ECOFAC auquel
cette organisation a participé (2).
1-Le PAPECALF
Les Etats d'Afrique centrale ont adopté à
N'Djamena (TCHAD), le Plan d'Action Sous-Régional des Pays de l'espace
COMIFAC pour le renforcement de l'application des législations
nationales sur la faune sauvage (PAPECALF) valable pour la période
2012-2017. Ce plan d'action a pour objectif de soutenir l'application des
législations nationales et les réglementations sur la faune
sauvage dans les pays de l'espace COMIFAC. Le PAPECALF a permis de mener des
actions pour renforcer la coopération et la collaboration entre les
autorités de contrôle et les autorités judiciaires
concernées par l'application des lois sur la faune sauvage au niveau
national, ainsi qu'entre les pays de l'espace COMIFAC, ceci en mettant en place
un sous- groupe de travail sur la faune sauvage et les aires
protégées (SGTFAP). Ce SGTFAP est entré en exercice depuis
juillet 2012 et par la suite, un Groupe de Travail Biodiversité
d'Afrique Centrale (GTBAC) a été
132 COMIFAC, Rapport annuel, 2012.
133 Ibid, article 5.
134ONOTIANG MAPEINE Florantine,
mémoire sur La gestion transfrontalière des
ressources naturelles: l'accord relatif a la mise en place du tri-national de
la Sangha (TNS) et son protocole d'accord sur la lutte contre le
braconnage, 2006.
135S. BOUTILLIER, Risques écologiques.
Dommages et intérêts, Innovations Cahiers d'économie
de l'innovation N°18, l'Harmattan, 2003, p. 123.
41
créé dont l'une de ses missions consiste en la
mise en oeuvre du PAPECALF au niveau sous-régional.
Le GTBAC harmonise les procédures de contrôle au
niveau national et sous-régional, élabore des directives
sous-régionales pour l'harmonisation des stratégies nationales
ainsi que des procédures de contrôle sur le terrain, et les faire
adopter par les pays membres ; évalue les besoins en formation intensive
dans les pays membres de la COMIFAC pour tous les acteurs136 ;
adopte un plan de formation continue au niveau national et sous régional
137. Le PAPECALF consiste également à mettre en place
des moyens de dissuasion efficaces pour lutter contre le braconnage et le
commerce illégal de la faune, s'assurer que les poursuites sont
conduites de manière régulière et en respect des lois
nationales.
Par ailleurs, un plan d'action appelé
communément plan de convergence a été adopté par
les chefs d'Etats en février 2005 à Brazzaville. En outre, une
stratégie régionale pour la conservation de
l'éléphant visant à réduire l'abattage
illégal d'éléphants a été
élaboré par l'UICN et le GTBAC dont le but est d'empêcher
la fragmentation des populations d'éléphants, améliorer
les connaissances sur l'état des populations et de leurs habitats, et
changer les perceptions négatives des habitants de la région
concernant le conflit hommes/éléphants138. Aux vues de
ce qui précède, quelle a été la contribution de la
COMIFAC au programme ECOFAC ?
2- Contribution de la COMIFAC au programme
ECOFAC
Le Programme de conservation et utilisation rationnelle des
écosystèmes forestiers d'Afrique centrale (ECOFAC) a
été initié par la Commission européenne en 1992 et
financé par l'UE dans le but d'assurer la conservation des forêts
tropicales, en s'appuyant sur l'aménagement des aires
protégées. Le programme ECOFAC, a été actif en
Guinée Equatoriale depuis 1992 et est suivi par la COMIFAC. ECOFAC a
également été appliqué au Gabon depuis 1992 et a
financé en particulier la gestion et le développement du Parc
National de la Lopé139. L'Imperial Collège de Londres
a lancé en 2002 un projet sur la durabilité de la chasse de
viande de brousse au Rio Muni, en conjonction avec ECOFAC, INDEFOR, et
l'unité de recherche sur la faune sauvage de l'Université
d'Oxford. En dehors de la COMIFAC, la CEEAC est également un acteur
clé dans la lutte contre les actes criminels des espèces
menacées.
Paragraphe 2-Institution du Plan d'Action d'Urgence
de
Lutte Anti braconnage (PAULAB) : Initiative de la CEEAC
La CEEAC a une évolution historique et des missions
particulières (A) et a mené des multiples actions dans la
sous-région dont le Plan d'Action d'Urgence de Lutte Anti Braconnage
(B).
136 Les douanes, la police, les inspecteurs
vétérinaires et de quarantaine, les départements de la
faune sauvage, les agents de contrôle, les autorités portuaires et
aéroportuaires, le secteur privé, les autorités CITES, les
magistrats, les procureurs, les communautés locales, etc.
137 Par exemple sur la législation sur la faune
sauvage, l'identification des espèces, le partage et le traitement
d'informations et de renseignements, le développement et le partage des
outils d'investigations, les systèmes de marquage et
d'identification.
138 Réunion sur l'éléphant d'Afrique
Mombasa, Kenya 23-25 juin 2008, préparé par Groupe UICN/CSE de
spécialistes de l'éléphant d'Afrique à la demande
du Secrétariat de la CITES.
139 Le plan d'actions de Gorilla gorilla gorilla.
42
A-Naissance et missions de la CEEAC
La Communauté économique des états
d'Afrique Centrale a été créée en 1983 par dix pays
de la sous-région à savoir : l'Angola, le Burundi, le Cameroun,
le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la RCA, la RDC, Sao
Tomé et Principe et le Tchad. Cette communauté a pour objectif de
: « promouvoir et renforcer une coopération harmonieuse et un
développement équilibré et auto-entretenu dans tous les
domaines de l'activité économique et sociale, en particulier dans
les domaines de l'industrie, des transports et communications, de
l'énergie, de l'agriculture, des ressources naturelles, du commerce, des
douanes, etc. (...), Accroître et maintenir la stabilité
économique, renforcer les étroites relations pacifiques entre ses
membres, contribuer au progrès et au développement du
continent»140. La CEEAC a contribué aux actions
environnementales et à la gestion des ressources naturelles. Elle est un
véritable point focal institutionnel en matière de collaboration
entre les Etats d'Afrique centrale141. La CEEAC participe à
l'harmonisation des politiques et stratégies de gestion durable de
l'environnement dans la sous-région142.
En termes d'actions environnementales, la CEEAC a mis en place
un certain nombre de stratégies à savoir : la stratégie de
valorisation de la biodiversité, de l'économie forestière
et stratégie des écosystèmes marins. En outre, elle a
initié des programmes comme le PACEBCo.
Tout récemment en 2012, la CEEAC a instauré le
PAULAB au regard des massacres causés dans la faune de la
sous-région.
B-La mise en place du Plan d'Action d'Urgence de Lutte
Anti Braconnage par la CEEAC
Le Secrétariat général de la CEEAC en
accord avec le RAPAC et l'Union Européenne ont décidé
d'élaborer des plans d'actions dans la zone nord du Tchad sur la
problématique de la lutte contre le braconnage. Cette décision
était motivée par la réunion du Conseil des Ministres de
la COMIFAC tenue le 6 juin 2012 à N'djamena (Tchad) qui a mis en
évidence, la nécessité de la lutte anti-braconnage pour le
développement durable de la biodiversité dans la zone
septentrionale de la sous-région. Pour donner satisfaction aux attentes
des Etats, le Secrétariat général de la CEEAC et la
Délégation de l'Union Européenne ont proposé trois
activités suivantes : La mise en place d'un Plan d'Urgence de Lutte Anti
Braconnage dans les zones septentrionales et l'élaboration des
éléments de la stratégie de lutte anti braconnage en
Afrique centrale. Dans le cadre de ce plan d'action, une stratégie de
lutte anti braconnage a été élaboré afin de
concrétiser les objectifs fixés par les Etats d'Afrique centrale.
Tel est donc le but du PAULAB. Par ailleurs, ce plan s'assure que la
coopération entre les états de la sous- région est
effective et apporte les résultats escomptés. L'OCFSA partage
cette même ambition.
140TABUNA Honoré, la CEEAC et son
rôle dans les activités sous régionales en matière
d'environnement et de gestion des ressources naturelles, p. 5.
141 Ibid., p. 7.
142 Ibid., p. 9.
43
Paragraphe 3- L'OCFSA comme outil de coopération
et
d'unité des états d'Afrique centrale
L'Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage en
Afrique Centrale a été créé en 1983 par les chefs
d'Etats de l'Afrique centrale qui ont décidé de mettre en commun
leurs efforts pour lutter contre le braconnage au regard de la recrudescence
des populations des espèces menacées dans la sous-région.
Cette organisation est partie prenante dans l'instance suprême de
décision143 du TNS lors de la mise en oeuvre de la
12ème résolution de la Déclaration de
Yaoundé. L'OCFSA collabore étroitement avec la COMIFAC dans
l'application des législations nationales en matière de gestion
des ressources naturelles. Son champ de compétence renferme les
forêts de l'espace sous-régional.
L'OCFSA s'est donnée pour mission de s'assurer que le
patrimoine de la sous-région soit utilisé de façon
rationnelle et équitable conformément aux recommandations de la
Convention sur la Diversité biologique de 1992. Qu'en est-il du
Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale (RAPAC) ?
Paragraphe 4- Contribution du RAPAC dans la gestion
des
aires protégées d'Afrique centrale
Avant d'examiner l'apport du Réseau des Aires
Protégées d'Afrique Centrale (B) dans la lutte contre le trafic
et le braconnage des espèces menacées, il sied de
présenter en premier lieu la naissance et les finalités de cette
institution (A).
A-Naissance et finalités du RAPAC
Créé en mai 2000 à Yaoundé, le
Réseau des Aires Protégées d'Afrique Centrale est une
association sous-régionale à but non lucratif à vocation
environnementale. Ce Réseau compte dans ses rangs les gouvernements et
les ONG144.
Le RAPAC est doté d'un Secrétariat
exécutif basé à Libreville au Gabon. Il comporte par
ailleurs un Conseil scientifique composé de personnalités
scientifiques représentatives de la pluridisciplinarité de
l'aménagement des aires protégées, dont le rôle est
la validation des protocoles de recherche, l'examen des orientations et des
stratégies régionales proposées par le
Réseau145. Cette association est composée de plusieurs
pays d'Afrique centrale à savoir : le Cameroun, la République
Centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée-Equatoriale, São
Tomé et Príncipe et le Tchad.
Les missions du RAPAC consistent en l'harmonisation, la
coordination, l'échange et l'appui dans les actions menés pour
conserver la biodiversité. Il promeut les sites de conservation ex situ
en tant qu'outils de sensibilisation. Le RAPAC a également comme
finalité de promouvoir le développement et la bonne gestion des
aires protégées dans la région. Il contribue à la
mise en oeuvre du Plan de Convergence sous-régional à travers les
activités menées dans le
143 CTSA est l'instance suprême.
144
http://www.rapac.org/.
145 Ibid.
44
cadre de la Convention de partenariat signée avec la
CEEAC pour l'application du PACEBCo146 et la composante des Aires
Protées du programme ECOFAC. Il participe à la recherche et la
mise à disposition des aires protégées de ressources
techniques, matérielles et financières supplémentaires ;
au développement durable de la forêt ; à la
représentation des aires protégées auprès des
pouvoirs publics147. En Afrique centrale, le RAPAC gère
plusieurs aires protégées.
B- Gestion des aires protégées en Afrique
centrale par le RAPAC
Actuellement, le RAPAC s'occupe de la gestion de huit aires
protégées parmi lesquels : la réserve de faune du Dja
(Cameroun), le parc national d'Odzala (République du Congo), le parc
national de la Lopé (Gabon), le parc national de Monte Alén
(Guinée-Equatoriale), la forêt de Ngotto (Centrafrique), le futur
parc national de la Mbaéré-Bodingué, le site
protégé correspondant au projet de développement des zones
cynégétiques villageoises (Centrafrique), le parc naturel Obo
(São Tomé et Príncipe), le parc national de Zakouma
(Tchad). Ce Réseau publie régulièrement un bulletin
trimestriel RAPAC INFOS qui diffuse et valorise les actions
réalisées. Il bénéficie du soutien permanent de la
Commission européenne.
Au regard de ce qui précèdent, le RAPAC joue un
rôle déterminant dans la lutte contre le trafic et le braconnage
des espèces menacées en Afrique Centrale. Reste que les Etats de
la sous-région ont également intégré dans leurs
politiques nationales des actions concrètes tout en en gardant à
l'esprit la nécessité d'une coopération
sous-régionale et internationale. Dans cette logique, plusieurs
organisations internationales ont collaboré à la conservation des
espèces menacées d'extinction en Afrique centrale.
SECTION 2- MESURES PRISES PAR LES ETATS
D'AFRIQUE
CENTRALE ET DE LA PARTICIPATION DES ORGANISATIONS DANS
LA LUTTE
CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ESPECES
MENACEES
Il sera question de partir des considérations
politiques nationales mises en oeuvre (A) avant de décrypter
l'effectivité de la contribution des organisations internationales dans
la lutte contre le trafic illégal et le braconnage des
éléphants et des gorilles en Afrique Centrale.
Paragraphe 1- Mesures prises par les Etats
d'Afrique
Centrale
Pour lutter au mieux contre le trafic et le braconnage des
espèces, le Ministère de l'Environnement et des Ressources
Halieutiques du Tchad a reçu des dotations en transport routier en 2012.
Cette intervention est la continuité des actions du gouvernement
tchadien qui en 2009 avait outillé les forces armées et les
hélicoptères pour renforcer cette lutte. Ces actions ont
146 Le PACEBCo est le fruit de l'engagement pris par la BAD
d'accompagner la COMIFAC dans la mise en oeuvre du plan de convergence
adopté le 05 février 2005 lors du sommet des chefs d'Etats de la
sous-région tenu à Brazzaville, Congo. Il couvre 10 pays
d'Afrique centrale. Le programme est cofinancé par un don du FAD (Fonds
africain de développement) et les contributions de la CEEAC. Le PACEBCo
a été lancé en Septembre 2009 à Kinshasa (RDC).
147
http://www.rapac.org/Presentation.htm.
45
eu pour effet de stabiliser les populations
d'éléphants dans le Parc National de Zakouma
(Tchad)148.
Au Gabon, le gouvernement a procédé à la
destruction des stocks d'ivoire résultant des saisies
opérées par les services gouvernementaux après audit
indépendant mené en collaboration avec TRAFFIC/WWF149.
En outre, le Gabon a augmenté le budget de l'Agence Nationale des Parcs
Nationaux (ANPN) ainsi que les effectifs des éco-gardes. Le
contrôle permanent du Parc National de Minkébé (Gabon) a
été renforcé depuis 2011. Par ailleurs, une unité
de chiens de détections de produits fauniques illicites a
été instituée en 2012. Le gouvernement Gabonais a permis
que différents services en charge de l'application de la loi comme la
Justice, MINEF, ANPN, Douanes collaborent entre eux. A noter que dans la
sous-région d'Afrique Centrale, le taux d'arrestations et de poursuites
judiciaires des trafiquants d'ivoire est le plus
élevé150.
Au Cameroun, le gouvernement a pris des mesures drastiques
pour lutter efficacement contre les criminels fauniques suite au massacre de
janvier à février 2012 dans le Parc National de Bouba N'Djida
(Nord). Pendant cette brève période, près de 250
éléphants ont été tués de manière
atroce. Un Plan d'Urgence pour la Sécurisation des Aires
Protégées (PUSAP) menée sous la roulette du
Ministère des Forêts et de la Faune du Cameroun (MINFOF) a
été élaboré, d'un montant de 126.335.500.000 F.CFA.
Ce plan vise la sécurisation des aires protégées du
Cameroun. Le PUSAF prévoit entre autre le recrutement et la formation de
2.500 éco-gardes supplémentaires, soit 500 personnes par an. Il y
a également eu une mobilisation de 600 agents des troupes d'élite
du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) des forces armées
camerounaises, pour sécuriser les parcs nationaux et frontières
avec la RCA et le Tchad contre les cavaliers braconniers étrangers
pendant toute la saison sèche pour une période
indéfinie151.
Les actions du gouvernement pour combattre le trafic et le
braconnage en RCA ont été extrêmement limitées
à cause de l'instabilité sociale et politique du pays.
Néanmoins à partir de 2011, les Forces Armées
Centrafricaines (FACA) ont participé à la gestion des aires
protégées de Mbaéré Bodingue et de Dzanga-Sangha.
Cette mobilisation : « avaient pour objectif le refoulement des
braconniers soudanais à la recherche des éléphants de
forêt, menaçant ainsi le dernier bastion de protection des
éléphants du pays, le Parc National de Dzanga Ndoki, qui fait
partie du premier site tri-national du patrimoine mondiale de l'UNESCO dans le
monde, situé entre la RCA, le Congo et le Cameroun (le Tri-National de
la Sangha - TNS) »152.
En République du Congo, il y eu l'arrestation des
trafiquants asiatiques suivi d'un emprisonnement ferme de 4 ans en 2011. Ce
pays a également mis en place une Maison d'arrêt à Ouesso
(Sangha) où sévissaient un grand taux de trafic illicite et le
braconnage de la faune sauvage. En 2012, un braconnier d'ivoire a
été condamné à la peine maximale de 5 ans de prison
ferme mettant ainsi en avant la lutte contre ces actes criminels dans la faune
sauvage.
La RDC a vu sa faune sauvage être réduite de
manière intense depuis les années 80 principalement en raison du
fait que l'application de la loi faunique reste très faible. En 2011, la
Déclaration de Kinshasa a été signée pour la
sécurisation des aires protégées dans le pays, mais reste
encore à être opérationnalisée. La RDC est
aujourd'hui le seul pays à avoir encore des marchés d'ivoire
illégaux importants dans les grandes villes comme Kinshasa, Kisangani,
Goma, Bukavu et Lubumbashi. Le 21 février 2012, le WWF et TRAFFIC ont
publié un communiqué
148CEEAC (PEXULAB, SYLABAC, PAULAB et PROLABAC), La
crise du trafic d'ivoire et la gestion de la faune en Afrique Centrale,
Contribution aux réflexions initiales menées pour le
développement des Plans de Lutte Anti braconnage, 19 Mars 2013.
149 Ibid., p.4.
150 Ibid., p.5.
151 Ibid., p.6.
152 Ibid., p.7.
46
de presse exhortant les états à la
16ème Conférence des Parties de la Convention
Internationale sur le Commerce International des espèces de faune et de
flore (CITES) d'instruire un Comité Permanent.
Plusieurs organisations internationales ont collaboré
avec les états d'Afrique Centrale pour stopper définitivement le
massacre des espèces sauvages, notamment ceux qui sont menacées
d'extinction.
Paragraphe 2- Assistance des organisations
internationales
aux Etats d'Afrique centrale avec comme idéal
commun:
L'éradication des actes de trafic illégal et de
braconnage des
espèces menacées d'extinction en Afrique
centrale
Les organisations internationales ont apporté leurs
expertises aux Etats d'Afrique centrale, connaissant les contraintes que
rencontrent ces états dans la mise en oeuvre de leurs engagements
internationaux (A) 153 . De même, les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) ont favorablement contribué à
l'éradication des actes portant atteinte à la faune sauvage
(B).
A- La participation des organisations internationales
Trois organisations internationales seront mentionnées
dans le cadre de cette étude, compte tenu de leur proximité avec
les Etats de la sous-région et de la pertinence de leurs actions face
à la recrudescence des actes criminels dans la faune. Aussi, nous
mentionnerons le PNUE (1), le PNUD (2) et le FEM (3).
1-Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE) dans la
lutte contre le trafic et le braconnage des
éléphants et des gorilles
Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement est une
institution de l'ONU qui a vu le jour le 15 décembre 1972 par la
résolution 2997 lors de la XXVIIe Assemblée
générale des Nations unies. Son siège est à Gigiri
au nord de Nairobi (Kenya). Elle regroupe en son sein l'ensemble de la
communauté internationale. Elle a pour but de coordonner les
activités des Nations unies dans le domaine de l'environnement ;
assister les pays dans la mise en oeuvre de politiques
environnementales154. Cette organisation est intervenue dans la
lutte contre le trafic et le braconnage des éléphants et des
gorilles en accordant des ressources matérielles, techniques et
financières dans la sous-région.
En outre, le PNUE a amorcé des initiatives notamment la
réunion du Groupe Spécial d'Experts sur la Biodiversité
tenue en Novembre 1988 en vue d'examiner les voies et moyens de conserver les
ressources biologiques menacées. En Mai 1989, il a institué le
groupe de travail d'experts juridiques et techniques chargé
d'étudier la diversité biologique pour préparer un
cadre
153 NZEGANG M., Exploitation des forêts : une affaire
de gros moyens, de grosses têtes, de gros sous et de gros bonnets,
in La Voix du Paysan, n°33, octobre 1994, p.11.
154
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_des_Nations_unies_pour_l'environnement.
47
juridique international sur la conservation et l'utilisation
durable des ressources naturelles155. Le 6 novembre 2013, le PNUE a
organisé au Kenya la première conférence internationale
sur le respect et l'application des lois environnementales. Cette
conférence intervenait à la suite du sommet de Paris qui
s'était déroulé quelques mois au paravent. La
Conférence a réuni un ensemble d'acteurs concernés par la
protection de l'environnement parmi lesquels, les Etats, les organisations
internationales, la société civile et le secteur privé.
Les objectifs majeurs de cette conférence était de définir
des stratégies pour mieux lutter contre la criminalité de
l'environnement dans toutes ses formes, veiller à ce que les
gouvernements applique les lois et sensibiliser le public sur les dangers
posés par ce type de criminalité156. Quid de la
contribution du PNUD ?
2-La Contribution du Programme des Nations Unies pour
le Développement
(PNUD)
Le PNUD est une institution de l'Organisation des Nations
Unies créé le 1er janvier 1966. Il est présent
dans plusieurs pays et son siège est à New York (USA). Le PNUD
publie chaque année des Rapports sur le développement humain. Ce
programme assiste de nombreux autres organisations et Etats sous
développés157. Les principaux axes du PNUD consistent
en la promotion de la gouvernance démocratique, à la
réduction de la pauvreté, à la promotion du
développement humain.
Le PNUD a soutenu de nombreuses initiatives de lutte contre le
braconnage des espèces en voie d'extinction en Afrique centrale. A titre
illustratif, en février 2014 cette organisation a mené avec les
pays du complexe transfrontalier TRIDOM, une réunion de concertation
à Yaoundé (Cameroun) sur la lutte contre le braconnage et le
développement des communautés de la zone Tri-nationale
Dja-Odzale-Minkébé qui regroupe trois pays : le Cameroun, le
Congo, et le Gabon. L'objectif de la rencontre était essentiellement de
faire une analyse concrète sur l'état des lieux du projet de
conservation de la biodiversité transfrontalière et envisager la
deuxième phase du dit projet. Les résultats de ce projet ont
été appréciés lors de cette concertation notamment
en ce qui concerne la lutte contre le braconnage.
Le PNUD a également alloué une aide
financière au projet de conservation de la biodiversité
transfrontalière en collaboration avec le Fonds pour l'Environnement
Mondial (FEM) à hauteur de 10 117 500 USD 158 .
L'intervention des organisations internationales montrent bien que la
préservation de la faune est une question qui interpelle toute la
communauté internationale.
Eu égard l'apport du PNUE et du PNUD dans la lutte
contre les actes criminels dans la faune en Afrique centrale, le FEM n'est pas
en reste. En effet, cette organisation est intervenue plusieurs fois en vue de
soutenir les Etats de la sous-région dans l'application des plans et
stratégies qu'ils ont instaurés.
155 Ministère des terres, de la réinstallation et
de l'environnement, Stratégie Nationale et Plan d'action pour la
Conservation de la Biodiversité au Rwanda, Avril 2003, p. 1.
156
http://www.agora21.org/.
157 Wikipédia, l'encyclopédie libre.
158 NDAH Marie Bibiane, Responsable communication au PNUD, M.
Martin ZEH NLO, Assistant au Représentant Résident chargé
de l'unité Développement durable, Réunion des trois
bureaux pays du projet TRIDOM, Lutte contre le braconnage et
développement des communautés locales de la zone Tri-nationale
Dja-Odzale-Minkébé.
48
3-Fonds pour l'environnement mondial (FEM)
Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) est une
organisation financière indépendante qui a vu le jour en
octobre1991 et est basé à Washington (USA). En 2002, le FEM
comptait en son rang 176 pays ressortissants des quatre continents. Cette
organisation dispose d'une assemblée, d'un conseil, d'un
Secrétariat et d'un bureau d'évaluation des performances.
Le Fonds pour l'environnement mondial a financé «
les actions pour la préservation de l'environnement dans les
domaines tels que la biodiversité, la régression et
dégradation des sols, la réduction de la couche d'ozone et les
POP, la lutte contre les effets du réchauffement climatique »
159 . A ce jour, le FEM a alloué plusieurs aides financières aux
pays en développement notamment ceux d'Afrique centrale estimées
à plusieurs milliers de dollars dans la mise en oeuvre des plans
d'actions pour la protection de l'environnement. A titre illustratif, ce Fonds
a financé la COMIFAC d'un montant de 815 000 dollars américains
pour la mise en oeuvre du Projet MSP relatif au renforcement des
capacités du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC pour la
coordination régionale de la gestion durable des
forêts160 et 10 millions assisté par le PNUD pour la
mise en oeuvre du projet TRIDOM entre le Cameroun, le Congo et le
Gabon161. Le FEM a été désigné comme le
mécanisme financier pour la CDB, la CCNUCC et plus tard la Convention de
Stockholm sur les POP en 2001 et la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification en 2003162. Le FEM collabore avec
dix autres institutions mondiales qui mettent en avant la protection de
l'environnement. Il s'agit notamment du PNUD, du PNUE, de la BM, de la BAD, de
la Banque asiatique de développement, de la Banque européenne
pour la reconstruction, de la Banque interaméricaine de
développement du Fonds international de développement agricole et
du FAO. Ce dernier a particulièrement été charitable
à l'égard des pays en développement163.
De ce qui précède, les organisations
internationales ont effectivement manifesté leur soutien aux
états d'Afrique centrale comme recommandent plusieurs instruments
internationaux. Par ailleurs, les ONG ont également contribué
à l'application des programmes de cette sous-région.
B-Intervention spectaculaire des Organisations Non
Gouvernementales (ONG)
En Afrique centrale, les ONG jouent un rôle
prépondérant dans la mise en place des plans d'actions nationaux
et sous régionaux. La prépondérance de ces organisations
non gouvernementales renforce la lutte contre les actes de trafic et de
braconnage des espèces menacées en Afrique Centrale. Dans le
cadre de cette étude, nous nous limiterons à examiner
l'exécution des plans d'actions par les ONG les plus influents dans la
sous région. Parmi ceux-ci, WWF occupe une place importante.
159 Wikipédia, encyclopédie libre, FEM.
160 COMIFAC, Rapport annuel, 2012, p.18.
161 Ibid., p. 25.
162
http://www.thegef.org/gef/.
163 SOUDJAY Soulaimane, La F.A.O. Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Harmattan, coll.
Alternatives rurales, juin 1996, p. 159.
49
1-Application des plans d'actions dans la sous
région par WWF
Le WWF est une ONG internationale crée le 11 septembre
1961. Son siège est à Morges (Suisse). WWF a un large
réseau opérationnel dans 100 pays proposant 1200 programmes de
protection de la nature. Les actions menées par le World Wide Fund en
Afrique centrale sont innombrables. En effet, depuis une dizaine d'année
WWF en partenariat avec le MINFOF (Cameroun) a initié un programme au
Jardin Zoologique de Caroline du Nord qui a permis de suivre les mouvements
migratoires de quelques populations d'éléphants par la pose de
balise sur quelques matriarches. L'objectif du programme est d' «
établir les mouvements migratoires afin de planifier l'utilisation
de l'espace, prévenir les conflits homme-éléphant et
planifier la lutte anti braconnage »164. En outre, le WWF
a divisé en quatre blocs le Cameroun pour réunir les informations
sur la gestion des éléphants. A la suite de cette subdivision,
cette ONG a effectué des collectes d'informations sur l'état de
conservation des éléphants. WWF a mis en place un programme
Africain des éléphants pour créer un environnement viable
et sain en Afrique165.
L'ONG WWF a également contribué de
manière significative à l'élaboration du plan
d'aménagement du Parc National de la Bénoué en 2002. Il
s'agissait d'assurer la gestion effective du Parc National de la
Bénoué mise en oeuvre par les gardes parcs166.
Le WWF a élaboré une série de plans pour
orienter les activités liées à l'éléphant.
Le plus récent, intitulé « WWF Species Plan of Action:
2007-2011 », établit les buts et objectifs, ainsi que les
priorités des mesures du WWF dans les "paysages à
éléphants", avec un budget quinquennal prévu de 11,9
millions d'USD.167 Qu'en est-il de l'UICN ?
2-Contribution de l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature
(l'UICN)
Créée le 05 octobre 1948 à
Fontainebleau168, l'Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) occupe le premier rang mondial en matière de
préservation de l'environnement. Autrefois dénommée «
Union internationale pour la protection de la nature » l'UICN s'est
fixée pour mission notamment de promouvoir et de coordonner les actions
de protection de la nature au niveau mondial.169 Cette organisation
a en son sein tout un arsenal d'acteurs concernés par la
préservation de l'environnement à savoir : les gouvernements, les
ONG, les scientifiques, les experts indépendants, la
société civile. L'UICN est située à Gland (Suisse).
Son champ de compétence s'étend au-delà de 160 pays
repartis dans tous les quatre continents. Cette organisation intervient
profondément en Afrique centrale, avec de multiples aides et suivi
technique et scientifiques. Face au vaste fléau que représente le
braconnage, l'UICN a élaboré dans chaque sous-région de
l'Afrique des stratégies de conservation des éléphants.
164 MINFOF, Stratégie et Programme de gestion durable des
éléphants au Cameroun, 2011-2020, p.27.
165 WWF Species Action Plan 2012-2015. African Elephant.
Stratégie 2013, p. 10.
166 WWF, Africa & Madagascar Programme, Northern Sudanien
Savannah Project Cameroon.
167 CITES, L'élaboration d'un plan d'action pour
l'éléphant d'Afrique, p. 21.
168 RAFFIN Jean-Pierre, « U.I.C.N (UNION INTERNATIONALE POUR
LA CONSERVATION DE LA
NATURE) », Encyclopædia Universalis. URL:
http://www.universalis.fr/encyclopedie/u-i-c-n-union-internationale-pour-la-conservation-de-la-nature/.
169 Ibid.
50
Cet ONG avec le soutien financier du programme Carpe
(Programme régional de l'Afrique centrale pour l'environnement), a
entrepris une nouvelle gestion des forêts du Cameroun, du Gabon et de
Guinée équatoriale170. Par ailleurs, elle a mis sur
pied le Groupe des Spécialistes des Eléphants d'Afrique (GSEAF).
Ce dernier est un groupe d'experts techniques qui se consacre à la
conservation et à la gestion des éléphants d'Afrique.
Dans la sous région, l'UICN a rédigé la
« Stratégie Régionale pour la Conservation des
éléphants en Afrique Centrale ». Dans cette
stratégie, elle a pris en compte la : « nécessité
de renforcer les cadres législatifs, réglementaires et
institutionnels afin de réduire le braconnage de
l'éléphant et le commerce de ses produits ; La
nécessité d'assurer la connectivité de l'habitat entre les
populations d'éléphants afin de permettre à ces derniers
de continuer à effectuer les déplacements sur les superficies
importantes dont ils ont besoin pour survivre ; la nécessité de
changer les perceptions négatives du grand public vis-à-vis des
éléphants afin d'obtenir l'adhésion du grand public
à la conservation de l'éléphant »171.
Cette stratégie est donc un outil indispensable dans la lutte
contre les actes criminels dans la faune d'Afrique centrale.
L'UICN a également élaboré un inventaire
de l'état de conservation global des espèces
végétales et animales connu sous le nom de « liste rouge
» qui représente une référence plus fiable et plus
adapté de l'état de la diversité biologique
172. La liste rouge de l'UICN contient des annexes regroupant les
différentes catégories d'espèces.
L'ONG TRAFFIC tout comme l'UICN a apporté sa pierre
angulaire dans la lutte contre le trafic et le braconnage des
éléphants et les gorilles en Afrique centrale.
3-Appui non négligeable de l'ONG
TRAFFIC
La présentation du rôle de TRAFFIC dans la lutte
contre les actes criminels fera l'objet de nos prochaines analyses, mais avant
cela, une attention particulière doit être accordée
à l'historique de cette organisation.
a-Historique de l'ONG TRAFFIC
L'ONG TRAFFIC a été fondé en 1976 en
association avec l'UICN et WWF. Son siège social est à Cambridge,
au Royaume-Uni. Elle travaille en coopération étroite avec le
Secrétariat de la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES). TRAFFIC est représenté dans les quatre continents avec
des bases régionales. Cette ONG est leader dans le domaine de la
conservation des ressources biologiques. Elle soutient les Etats d'Afrique
Centrale. Cette organisation est sponsorisée par des fondations
caritatives telles que la Rufford Maurice Laing Foundation ainsi que des
particuliers et autres donateurs173. Au regard de ce qui
précède, il sied d'appréhender concrètement la
170 Conservation de la biodiversité forestière
en Afrique Centrale atlantique :le réseau d'aires
protégées est-il adéquat ?, Charles DOUMENGE ,
Cirad-forêt, TA 10/D, 34398 Montpellier Cedex 5, France ; Juan-Enrique
Garcia YUSTE, Agencia Española de Cooperación Internacional,
Proyecto Araucaria Amazonas Nauta ; Steve GARTLAN, WWF, Programme Cameroun,
BP6776, Yaoundé, Cameroun ; Olivier Langrand, Wwf, Programme
régional pour l'Afrique centrale, BP9144, Libreville, Gabon ; Assitou
Ndinga, UICN, Programme régional pour l'Afrique centrale, BP5506,
Yaoundé, Cameroun.
171UICN, Stratégie Régionale pour
la Conservation des éléphants en Afrique Centrale,
Décembre 2005, p.6.
172
https://www.iucn.org/fr/.
173 Wikipedia TRAFFIC.
51
contribution de l'ONG TRAFFIC dans la lutte contre les actes
criminels dans la faune en Afrique Centrale.
b- Le rôle de TRAFFIC dans la lutte contre le
trafic et le braconnage des
éléphants et des gorilles en
Afrique centrale
En 2010, TRAFFIC a soutenu trois ONG nationaux dans la mise en
oeuvre des activités alternatives au braconnage. Il s'agit de :
- MIPACAM notamment dans la mise en place de Zones
d'Intérêt Cynégétique à Gestion Communautaire
( ZICGC) ou de l'Aulacodiculture dans les alentours des zones
écologiques de grande importance telles que les Parcs nationaux et les
aires protégées en vue d'atténuer la pression humaine sur
la faune sauvage par les populations riveraines;
- APRONATURE pour le projet de renforcement et d'extension des
fermes dans le Nord, le Nord -Est et l'Est de la Reserve du Dja du Cameroun
;
- CAD dont le but est de combattre la chasse illégale
et le commerce de la viande de brousse dans le sud de la réserve
forestière de Bakundu au Cameroun.
En outre, TRAFFIC a signé conjointement avec les autres
ONG de conservation notamment le WWF et l'UICN des communiqués appelant
les chefs d'Etats et de gouvernements à protéger les
éléphants à travers la mise en oeuvre des mesures qu'il
préconise. Ceci rentre dans le cadre du plaidoyer qu'il fait.
Brièvement il était question de :
- Signaler aux braconniers et aux réseaux mafieux de
trafiquants que l'héritage naturel de la sous-région sera
défendu.
- Adopter une attitude de « zéro tolérance
» contre la corruption, le trafic d'influence, l'abus de pouvoir et
d'autres formes de corruption sont les premiers obstacles à
l'application effective des lois contre les grands trafiquants de produits
illégaux fauniques en Afrique centrale.
- Durcir les peines et renforcer l'application effective de la
Loi contre les criminels fauniques, mais aussi contre la vente d'armes et de
munitions de type grande chasse.
- Mettre l'accent sur la protection et la bonne gestion de
certaines aires protégées prioritaires - ces aires devraient
devenir des noyaux centraux pour la protection de la grande faune de la
sous-région, et être cogérées à long terme
par des agences non-gouvernementales spécialisées. - Initier un
dialogue avec les pays consommateurs : La Chine et la Thaïlande sont parmi
les plus grands consommateurs d'ivoire dans le monde entier. A long terme, la
survie des éléphants en Afrique centrale et dans le monde
dépendra du tarissement de la demande internationale d'ivoire. En 2011,
TRAFFIC a participé à l'élaboration du Plan d'action
sous-régional des pays de l'espace COMIFAC pour le renforcement de
l'application des législations nationales dans la faune sauvage
(PAPECALF). Ce plan prévoit la mise en oeuvre d'un mécanisme de
coordination régionale, mandaté à catalyser les actions
des gouvernements membres dans la lutte contre le braconnage au sein du Bassin
du Congo. Au terme d'un audit réalisé par le WWF, TRAFFIC et le
gouvernement gabonais, ce pays est devenu le premier pays de la région
à détruire son stock d'ivoire. En Octobre 2013, c'était au
tour de la RCA d'auditer ses stocks d'ivoire avec l'appui de TRAFFIC et du WWF.
En 2012, TRAFFIC et le WWF ont organisé une campagne conjointe sur le
commerce illicite de la faune sauvage intitulée ILLEGAL WILDLIFE TRADE
CAMPAIGN174. En outre, cette ONG a conclu un accord de
coopération avec la COMIFAC pour soutenir le renforcement de
l'application des législations nationales sur la faune sauvage.
Egalement, TRAFFIC a accordé son appui à la COMIFAC notamment
à l'atelier international sur
174 Dr. Dany POKEM, cadre dans l'ONG TRAFFIC.
52
la viande de brousse à Nairobi175. In fine,
TRAFFIC est un partenaire important dans la mise en oeuvre des Plans d'actions
visant à lutter contre le commerce de l'ivoire des
éléphants176. Aussi, quel est l'apport du WCS ?
4-Apports du Wildlife Conservation Society
(WCS)
La Société pour la Conservation de la Vie
sauvage de son nom anglais Wildlife Conservation Society voit le jour en 1895.
Elle est basée au Parc Zoologique du Bronx dans la ville de New York
(USA) et est présente dans près de 70 pays dans le monde. Elle
contribue à la préservation de la nature et à la
conservation des zones de la flore et de la faune dans le monde et
particulièrement en Afrique177. C'est avec les travaux de
George SCHALLERSZ sur les gorilles de montagne au Congo en 1959 que le WCS
débuta un partenariat en Afrique centrale. Ces travaux par la suite se
sont étendus dans d'autres pays de sous-région à savoir :
Le Cameroun, le Gabon, la RCA etc.
En outre, Le WCS a participé avec une compagnie
d'exploitation forestière en Afrique centrale, dans un programme dont
l'objectif est de développer des directives concernant la chasse, ce qui
inclut l'interdiction de chasser les grands singes ainsi que toutes
espèces menacées, et l'interdiction d'exporter de la viande sous
réserves des législations compétentes. En
conséquence, la chasse commerciale de viande de brousse a
été réduite. Le WCS est au Gabon depuis 1985, et
mène actuellement un programme national important qui inclut des
activités dans tous les parcs nationaux, en particulier un appui
institutionnel au CNPN. En République Centrafricaine, WCS a soutenu des
projets de conservation dans Dzanga-Ndoki et la Réserve spéciale
de Dzangha-Sangha.
Cet ONG oeuvre depuis 40 ans à la recherche et à
la conservation de l'éléphant en Afrique subsaharienne, et
utilise notamment des techniques très récentes de surveillance
continue des éléphants, des méthodes de recensement des
éléphants en forêt, la vidéographie aérienne,
la génétique, l'acoustique et la télémétrie
par satellite. En 2008, la WCS disposait de 17 millions d'USD pour des projets
en Afrique (dont 6 millions d'USAID), et prévoit de renforcer son
engagement pour la conservation de l'éléphant. La WCS
réalise actuellement plus de 150 projets en Afrique, dont bon nombre
concernent directement l'éléphant et d'autres espèces
menacées.
WCS a alloué des aides financières scientifiques
et matérielles dans les organisations sous-régionales qui
encadrent la gestion des ressources forestières dans la
sous-région. A titre d'exemple, WCS a contribué à la lutte
contre le braconnage dans le TNS à travers le Projet de Gestion des
Ecosystèmes Périphériques (PROGEPP) au Parc National
Nouabalé-Ndoki (Congo) avec comme partenaire le Ministère de
l'Economie Forestière et de l'Environnement (MEFE) du Congo. D'un point
de vue scientifique, le WCS a fourni au PROGEPP une expertise dans
l'encadrement178.
Il ressort de ce qui précède que plusieurs
initiatives ont été faites pour éliminer les actes de
trafic et de braconnage des éléphants et des gorilles en Afrique
Centrale. Ces initiatives
175 COMIFAC, Rapport annuel, 2012, p.26.
176 Convention sur le Commerce International des
Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction
(CITES), Réunion sur l'éléphant d'Afrique Mombasa, Kenya
23-25 juin 2008, Fonds pour l'éléphant d'Afrique
mécanismes de financement innovants pour le plan d'action pour
l'éléphant d'Afrique - analyse préliminaire et
recommandations pour les étapes suivantes.
177 Wikipedia, article WCS.
178 ONOTIANG Mapeine Florentine,
Mémoire sur La gestion transfrontalière des ressources
naturelles: l'accord relatif a la mise en place du tri-national de la Sangha
(TNS) et son protocole d'accord sur la lutte contre le braconnage,
2006.
53
répondent aux engagements pris par les Etats de la
sous-région. Il est donc nécessaire de marquer un point
d'arrêt sur les résultats obtenus à la suite de ces
initiatives.
SECTION 3 : RESULTATS DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS
INTERNATIONALES DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET DES
GORILLES
Les actions mis en oeuvre pour lutter efficacement contre le
trafic et le braconnage des éléphants et des gorilles ont permis
d'aboutir à une réduction relative de ces actes (Paragraphe 1),
à une amélioration des moyens stratégiques de lutte contre
les actes de trafic et le braconnage (Paragraphe 2), à une
légère répression (Paragraphe 3) et à une
brève prise de conscience des risques de la demande issus des
espèces menacées (Paragraphe 4).
Paragraphe 1- Réduction relative des actes de
trafic et
braconnage des éléphants et des gorilles dans la
sous- région
La CITES à travers ses programmes notamment MIKE, a
contribué à réduire le braconnage en Afrique centrale. En
effet, le Rapport annuel d'activité et d'analyse de MIKE indique une
diminution des abattages illégaux des éléphants par pays
(50% par rapport à 2010) sur les sites MIKE d'ici 2016179.
De même, le programme ETIS de la convention CITES a
opéré dans les Etats d'Afrique centrale des analyses annuelles
des incidents du commerce international illégal d'ivoire impliquant les
pays de l'espace COMIFAC qui a permis à titre de résultats de
réduire le commerce international illégal de l'ivoire (de 40% au
moins par rapport à 2010)180. En outre, grâce aux
analyses annuelles des incidents de commerce national illégal de la
faune sauvage, les indicateurs ont permis de faire un constat selon lequel le
commerce des produits et sous produits de la faune sauvage « serait en
diminution d'au moins 30% à partir de 2013 et connaitra davantage de
réduction d'ici 2016 »181.
La CITES a opéré des actions stratégiques
en Afrique centrale notamment en aidant les Etats de l'aire de
répartition de l'éléphant d'Afrique à
élaborer un plan d'action 182 . En République
centrafricaine, l'organe de la CITES a présenté les chiffres de
la réduction du braconnage dans ce pays. Selon ce communiqué, les
exportations d'ivoire sont quittées de 207.712 kg en 1982 à
101.410 kg en 1983 ; ce chiffre s'est détérioré en 1984
pour atteindre 42.336 kg. Un représentant de la RCA a d'ailleurs
déclaré à l'occasion d'un séminaire sur
l'application de la Convention en Afrique tenu à Bruxelles en 1984 que
des efforts ont été entrepris pour réduire le braconnage
183. En 2011, année la plus alarmante, il y a eu 25.000
éléphants braconnés sur le continent. En 2012, ce nombre a
« reculé à 22.000 et, en 2013, il était
179 MIKE/AFESG.
180 ETIS / TRAFFIC.
181 Ibid., Départements nationaux en charge de la faune
sauvage.
182 Réunion sur l'éléphant d'Afrique
Mombasa, Kenya 23-25 juin 2008, préparé par Groupe UICN/CSE de
spécialistes de l'éléphant d'Afrique à la demande
du Secrétariat de la CITES.
183
http://archive.org/.
54
supérieur à 20.000 selon la CITES
»184. Par ailleurs, Les gorilles survivent en RDC, une
région du monde secoué par des guerres185. Leur
population recommence à croître186.
L'application des instruments internationaux ont
également permis une amélioration des moyens stratégiques
de lutte contre les actes criminels dans la faune africaine.
Paragraphe 2- Amélioration des moyens
stratégiques de lutte contre le trafic et le braconnage des deux
espèces en Afrique
centrale
Cette amélioration est perceptible en ce qui concerne
les dispositions juridiques (A) et institutionnelles (B).
A- Amélioration des dispositions juridiques sous
régionaux en accord
avec les instruments internationaux visant la
conservation des
espèces fauniques
La Déclaration de Yaoundé et les accords de
Brazzaville ont suivi les résolutions de la convention de la CITES, qui
suggéraient aux Etats parties, d'instituer les reformes juridiques qui
cadrent avec ses annexes. Le Gabon s'est doté d'un Code forestier visant
à gérer de manière durable les ressources
forestières et conserver la biodiversité. En 2002, il a
créé un réseau de 13 parcs nationaux en classant 11% du
territoire national (3 millions d'hectares) en zone protégée et a
mis en place l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) qui vise à
protéger la faune et la flore gabonaise. En dehors du renforcement des
dispositions juridiques conformes aux recommandations des instruments
internationaux, un aménagement des institutions est aussi
perceptible.
B- La reforme des dispositions institutionnelles dans la
sous région
Plusieurs institutions ont été mises en place
dans la plupart des Etats de la sous-région pour lutter efficacement
contre le trafic et le braconnage des espèces menacées en Afrique
centrale. Au Cameroun, le Ministère des forêts et de la Faune
(MINFOF) est le principal acteur des actions nationales187 dans la
conservation des espèces menacées depuis l'adoption de la loi
n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la
faune et de la pêche. En 2011, le Gabon a créé la Direction
Générale de la Faune et des Aires Protégées au sein
du Ministère des Eaux et Forêts188.
184 Tony Karumba, AFP Afrique: la survie des
éléphants est toujours menacée par les braconniers,
http://www.goodplanet.info/.
185 VADROT Claude-Marie, Guerres et environnement.
Panorama des paysages et des écosystèmes bouleversés.
Delachaux et Niestlé, 2005, p. 21.
186 Les équipes de trois parcs nationaux dont le parc
des Virunga (RDC), le parc des Vocans (Rwanda) et le parc Mgahinga (Ouganda)
sont arrivées à cette conclusion à l'issu de leur
travail.
187 Stratégie et Programme de Gestion Durable des
Eléphants au Cameroun, Rapport final, 2011-2020, p. 58.
188 Article, wikipédia, le braconnage en Afrique
centrale.
55
Par ailleurs, la COMIFAC a procédé à une
refonte du cadre institutionnel sous-régional relatif aux forêts,
un Traité relatif à la conservation et la gestion durable des
écosystèmes forestiers d'Afrique centrale respectant ainsi la
nomenclature des conventions internationales.
Le Partenariat pour les forêts du bassin du Congo
(CBFP), établi en 2002 sous l'égide du Conseil des ministres en
charge des forêts de l'Afrique centrale, a reçu des fonds
substantiels des Etats-Unis d'Amérique de 2003 à 2005. Ce
financement a été largement axé sur 11 paysages
prioritaires, tous situés dans l'aire de répartition de
l'éléphant, et visait à améliorer les
capacités, la coopération régionale et la lutte contre la
fraude. S'il est vrai que des reformes juridiques et institutionnelles ont
été mis en oeuvre en Afrique centrale, qu'en est-il de la
répression des actes de trafic et de braconnage des
éléphants et des gorilles dans cette sous-région ?
Paragraphe 3- Légère répression
des actes de trafic et de
braconnage des éléphants et des
gorilles en Afrique centrale
En Afrique centrale, les Etats parties à la Convention
CITES ont adaptés leurs législations nationales en
conformité avec cette convention en ce qui concerne les annexes
classifiant chaque espèce. En outre, ces Etats ont prévu des
sanctions en cas d'atteinte à la faune conformément aux
recommandations de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). A
titre illustratif, le Cameroun a adopté la loi N°94/01 du 20
janvier 1994, portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche après son adhésion à la CDB de Rio en 1992,
l'article 158 de cette loi prévoit qu' : « Est puni d'une
amende de 3 000 000 à 10 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement d'un
(1) an à trois (3) ans ou de l'une seulement de ces peines l'auteur de
l'une des infractions suivantes : (...) l'abattage ou la capture d'animaux
protégés, soit pendant les périodes de fermeture de la
chasse, soit dans les zones interdites ou fermées à la chasse
»189. Au regard de ce qui précède, la chasse
illégale des espèces protégées dans les zones
interdites au Cameroun constitue une infraction pénale qui peut donner
lieu à une condamnation privative de liberté ou une peine
d'amende. En application à cette disposition législative, de
nombreux braconniers ont été interpellé par la brigade de
la faune, notamment dans le complexe transfrontalier du TNS. Le
législateur Tchadien a prévu dans la loi de 2008 portant
Régime des Forêts, de la Faune et des Ressources Halieutiques des
peines pénales plus répressives que son homologue camerounais en
sanctionnant les actes qui portent atteinte à la faune tchadienne commis
volontairement ou involontairement.
En ce qui concerne les actes commis volontairement, l'article
312 prévoit que : « Quiconque aura volontairement abattu,
capturé ou blessé un animal dont la chasse est interdite, en aura
ramassé ou détruit les oeufs ou en aura détruit les nids,
gîtes ou tanières, sera puni d'un emprisonnement d'un an à
trois ans et/ou d'une amende dé- 100 000 F à 500 000 FCFA sans
préjudice de leur confiscation et des dommages-intérêts
éventuels ». Par contre, l'article 313 qui
concerne les actes commis involontairement dispose que : « Quiconque
aura involontairement abattu, capturé ou blessé un animal dont la
chasse est interdite, en aura ramassé ou détruit les oeufs ou en
aura détruit les nids, gîtes ou tanières, sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à un an et/ou d'une amende de 25 000 F
à 200 000 FCFA sans préjudice de leur confiscation et des
dommage-intérêts éventuels » 190.
C'est la preuve manifeste d'une consécration effective de la
répression des actes de trafic illégal et de braconnage des
espèces menacées. Certes, beaucoup reste à faire en termes
de sanctions des délinquants
189 MINFOF CAMEROUN, Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994,
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
190 République du Tchad, Loi N°08-014 2008-06-10 PR
portant Régime des Forêts, de la Faune et des Ressources
Halieutiques
56
fauniques. C'est pourquoi WWF a publié que : «
Près de 12.000 éléphants sont tués chaque
année pour leur ivoire, la plupart en Afrique centrale, où le
nombre d'éléphants est historiqueme nt bas à la suite des
siècles de chasse, autorisée ou illégale. Un récent
regain de braconnage transfrontalier dans le Parc national de Bouba N'djida, au
Cameroun, s'est soldé par le massacre de près de la moitié
des 400 éléphants du parc. Malgré le récent appui
militaire, le braconnage continue. Mais il reste un espoir, car les braconniers
appréhendés ont été condamnés aux plus
hautes peines jamais encourues »191. Il ressort de ce qui
précède que malgré le faible taux de répression des
auteurs du trafic et du braconnage des espèces menacées
d'extinction, force est de constater que les trafiquants et les braconniers ont
souvent été interpellés et réprimandés par
la justice. En termes de résultats d'application des stratégies
et plans d'actions de lutte contre le braconnage et le trafic illégal
des espèces, l'on pourrait également mentionner une prise de
conscience embryonnaire de la demande des produits issus des espèces
menacées d'extinction.
Paragraphe 4- Prise de conscience embryonnaire des
risques de la demande des produits issus des espèces
menacées
L'Accord de Londres précise que le trafic et le
braconnage des espèces menacées ne pourraient être
combattus que « si nous éliminons à la fois la demande
et l'offre de produits illicites partout dans le monde où ce commerce a
lieu »192. Car depuis des décennies, la demande en
produits issus des éléphants et des gorilles était
très intense et provenait essentiellement des pays
développés qui en contrepartie offraient à leur
commanditaires des liquidités. Compte tenu de l'état des lieux de
l'environnement dans le monde, les Etats et les Organisations internationales
se sont mobilisés afin de barrer la route au vaste fléau qu'est
le braconnage. C'est ainsi qu'une étude menée montre la
diminution de la demande des produits issus des espèces menacées
en provenance de l'Afrique. Les pays qui exportaient illégalement les
produits issus du braconnage des espèces menacées comme la
France, l'Angleterre, la Chine, le Japon et la Thaïlande condamnent
désormais ces actes.
Il ressort de ces précédentes analyses que la
lutte contre le trafic illégal et le braconnage des espèces
menacées est effectivement engagée dans la sous-région.
Mais les résultats obtenus ne sont pas encore satisfaisants pour
prétendre à une totale réussite des projets mis en oeuvre.
En réalité, plusieurs causes spécifiques expliquent la
continuité des actes criminels dans la faune. Fort heureusement, ces
causes peuvent trouver des solutions. C'est ce que nous verrons dans notre
prochain chapitre portant sur les entraves à l'application efficace des
instruments internationaux en Afrique Centrale.
191 WWF, 2012, Les Faits marquants de la conservation, Victoires
et défis du WWF pour la protection de la biodiversité et la
réduction de l'empreinte écologique de l'humanité dans ses
zones d'action prioritaires.
192 Point 15 de l'Accord de Londres de 2014.
57
CHAPITRE II : LES ENTRAVES A
L'APPLICATION EFFICACE DES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE
LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE
BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET DES
GORILLES EN AFRIQUE CENTRALE
Depuis des décennies, plusieurs espèces
s'éteignent inexorablement au point où plus de 95% qui ont
vécu à un moment ou un autre de l'histoire de la vie n'existent
plus193. La Déclaration sur la Lutte Anti-Braconnage en
Afrique centrale reconnait que les : « initiatives nationales de lutte
contre le braconnage et le trafic illicite de la faune sauvage, en dépit
d'importants moyens déployés, n'ont pas abouti aux
résultats escomptés »194. Cette affirmation
n'est pas gratuite, car en effet plusieurs interventions juridiques,
techniques, matérielles et humaines ont été mises en
oeuvre pour bloquer la voie aux prédateurs des espèces
menacées d'extinction. Il convient de déceler les raisons de
l'échec de ces interventions dans le contexte sous-régional
(Section I) avant d'apporter quelques suggestions modestes à titre de
solutions transitoires (Section II).
SECTION 1 : PARTICULARITES DES PROBLEMES DU TRAFIC ET
DU
BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET DES GORILLES DANS LA SOUS
REGION
Aujourd'hui, toutes les initiatives pour combattre le
braconnage et le commerce illégal des espèces sont insuffisantes.
C'est sans doute la raison pour laquelle, le Professeur Alexandre KISS
considère que : « les efforts faits au niveau mondial dans la
protection des ressources forestiers n'ont abouti qu'aux résultats
modestes »195. En fait, les pays de la sous-région
se heurtent à des bandes organisées armées au-delà
des frontières des Etats, ces groupes ayant des ramifications dans
plusieurs continents livrent ainsi le commerce des produits issus du braconnage
à la loi de l'offre et de la demande196.
Beaucoup de pays souffrent du manque d'organisation et d'une
extrême lenteur dans l'application de la CDB. Les politiques nationales
de coordination n'ont pas des techniques
193 VALLAURI Daniel, Jean André, GENOT Jean-Claude, DE
PALMA Jean-Pierre, EYNARD-MACHET Richard, Biodiversité,
naturalité, humanité. Pour inspirer la gestion des
forêts, p. 22.
194 Réunion d'Urgence des Ministres de la CEEAC en
charge des Relations Extérieures, des questions de Défense et de
Sécurité, de l'Intégration Régionale et de la
Protection de la Faune sur la mise en oeuvre d'un Plan d'Extrême Urgence
sur la Lutte Anti Braconnage dans zone septentrionale de l'Afrique centrale,
Yaoundé (Cameroun), palais des congrès, 21-23 mars 2013, p. 2.
195 CORNU Marie et FROMAGEAU Jérôme, Le droit
de la forêt au XXIe siècle. Aspects internationaux, collection
Droit du patrimoine culturel et naturel, l'Harmattan, novembre 2007, p.
272.
196 Article Wikipédia, braconnage en Afrique centrale.
58
adéquates pour développer des stratégies
efficaces, sensibiliser l'opinion et faciliter le processus de
consultation197.
Au vu de ce qui précède, il convient de soulever
dans cette étude quelques raisons qui pourraient justifier la
montée grandissante du trafic et du braconnage dans la
sous-région. Pour ce faire, une première démarche
consistera à présenter l'absence lacunaire des moyens financiers
(Paragraphe 1). Par la suite, nous verrons que l'ignorance
généralisée des populations sur les effets du trafic et du
braconnage (Paragraphe 2) et la répression très réduite de
ces actes (paragraphe 3) ont limité les stratégies et plans
d'actions mis en oeuvre.
Paragraphe 1-Absence lacunaire des moyens financiers pour
lutter efficacement contre le trafic et le braconnage des espèces
sauvages
Pour lutter efficacement contre le commerce illégal et
le braconnage des espèces menacés d'extinction, le PAPECALF
prévoit que : « Les pays sont chargés de mettre en
oeuvre le (...) plan d'Action. Dans cette optique, chaque pays est tenu de
mobiliser les ressources financières et humaines adéquates.
Ainsi, chaque pays devra prévoir un budget national pour la mise en
oeuvre de ce Plan d'Action. Les Ministères en charge de la Faune sont
chargés de vulgariser le Plan d'action à travers un large
processus de concertation qui doit aboutir à la planification de la mise
en oeuvre à l'échelle nationale »198. Cette
exigence est toutefois enclavée par l'extrême pauvreté des
pays de l'Afrique subsaharienne. C'est sans aucun doute l'une des raisons de
l'intensification du braconnage des espèces menacées. Les pays de
la sous-région bien qu'ayant instaurés des plans d'actions pour
la conservation de la faune, sont pour la plupart dépourvus d'un budget
pouvant permettre de mettre en place un système de contrôle
continue des aires protégées. Sans compter le fait que ces pays
sont profondément endettés199. La création des
aires protégées transfrontaliers par les Etats n'est pas
accompagnée du même engagement au plan financier, matériel
et humain pour garantir la réalisation des objectifs. Le fonctionnement
des organes s'en trouve handicapé. D'où, « la
précaution à prendre pour ne pas multiplier inutilement les
organes et structures de gestion »200.
Les allocations provenant des Etats développés
et des organisations internationales et non gouvernementales, ne suffisent pas
à encadrer la lutte contre le braconnage. Il convient par ailleurs de
soulever l'épineux problème de l'ignorance des populations
locales face aux conséquences des actes anti fauniques.
197 WWF, Des mesures pour maitriser l'accès aux
ressources, et assurer le partage des bénéfices qui en
découlent». La situation dans dix pays, la biodiversité au
service de tous. Un document de réflexion du WWF International.
198 Secrétariat exécutif COMIFAC, Plan
d'action sous-régional des pays de l'espace COMIFAC pour le renforcement
de l'application des législations nationales sur la faune sauvage
(PAPECALF) 2012-2017.
199 CROUIGNEAU Françoise, L'endettement malsain du
tiers monde, Le Monde du 20 janvier 1988.
200 NGOUFO Roger, Etude sur la capitalisation des
expériences d'Aires Protégées transfrontalières en
Afrique centrale, mars 2003, p. 34.
59
Paragraphe 2- L'ignorance
généralisée des populations
sur les effets du trafic et
du braconnage des espèces
L'une des raisons de l'intensification du braconnage dans la
sous région est certainement liée au problème d'ignorance
des populations face aux effets parfois irréversibles de ces actes bien
que de nombreuses campagnes de sensibilisations ont été faites.
Cela expliquerait alors comme précise l'ancien Chef d'Etat ivoirien, le
peu de considération des populations pour les mesures visant à
rationaliser l'activité de la chasse. Selon lui : « l'attitude
de la grande masse de la population nationale face à la faune tient au
fait qu'elle n'a pas encore une conscience exacte de la nécessité
de conserver ce patrimoine qu'est la faune que la providence nous a offert, et
que nous devons conserver pour les générations futures
»201. Certes, en cherchant bien on peut trouver dans les
revues ou dans les publications spécialisées quelques
recommandations, au demeurant trop techniques, qui visent à informer le
public sur la nécessité d'un usage rationnel des biens et des
services environnementaux.
Néanmoins, force est de constater que si ces revues et
publications tentent de combler les lacunes des stratégies globales en
matière d'information, leur incidence reste toute minime202.
Et ceci pour plusieurs raisons : Le caractère trop technique de ces
revues et publications réduisant leur accessibilité aux seuls
professionnels ou aux spécialistes. Or, une information qui vise un
grand public doit être claire et simple. Un autre bémol à
la communication des populations est le choix de la langue de publication qui
est soit l'Anglais, le Français, ou l'espagnol, représentant les
langues étrangères héritées de la période
coloniale. Ce choix de langue restreint le nombre de citoyens alors même
que la plupart des populations riveraines des zones fauniques et
forestières ne savent ni lire, ni écrire ces langues. Ces
derniers étant des autochtones, ne parlent que les langues
vernaculaires.
Eu égard ces arguments, la communication des
populations a été mené sous la roulette de plusieurs
acteurs parmi lesquels, l'Etat à travers ses collectivités
locales, les ONG, les défenseurs de la nature, et les organisations
internationales. Cette sensibilisation est explicitement recommandée
dans la plupart des conventions internationales, notamment la Convention sur la
Diversité Biologique de Rio 1992 en son article 13 : « Les
Parties contractantes : a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de
l'importance de la conservation de la diversité biologique et des
mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par
les médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les
programmes d'enseignement; b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec
d'autres Etats et des organisations internationales, pour mettre au point des
programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
». Cependant, ces mesures entreprises n'ont pas apporté les
résultats escomptés. Tout au long de nos recherches, nous sommes
allées auprès des villageois de la tranche d'âge allant de
20 à 57 ans vivant à proximité du parc de la Mefou-Akamba
(Sud du Cameroun) pour les interroger sur le trafic et le braconnage des
espèces menacées. Sur vingt cinq personnes
interrogées203, seulement quatre d'entre elles connaissaient
que la capture illégale des espèces protégées
pouvaient donner lieu à une peine d'amende et/ou
201 KOUBO Douzo, La stratégie environnementale en
question, Côte d'ivoire, l' Harmattan, juin 2003, p. 18.
202 Ibid., pp. 19-20.
203 La collecte de données au Parc National de la
Mefou-Akamba (Cameroun), s'est faite pendant une durée de trois jours,
pendant laquelle nous avons interrogé le conservateur, le chef du
quartier où se trouve ce parc ainsi que les populations autochtones de
la localité. A ce sujet l'un des éco gardes rencontré sur
place nous informe que les principaux braconniers arrêtés dans le
Parc justifiaient leurs actes par la pauvreté dont ils sont victimes, et
qui affectent leur famille.
60
privative de liberté204. La
difficulté de la communication réside dans le fait que les
populations locales considèrent que les aires protégées
font partie de leur patrimoine personnel et comptent vivre de l'exploitation
des produits issus de ces zones forestières205.
L'échantillon des personnes interrogées
considère également que la lutte contre le braconnage est un luxe
pour les pays riches. Car en réalité, les pays en
développement des zones arides et tropicales humides sont en permanence
confrontés aux problèmes écologiques et
financiers206. De plus, les pachydermes causent de gros
dégâts sur les cultures des populations riveraines, qui par
conséquent sont plus motivées à les abattre. Cela remet
à nouveau en cause le problème du conflit
homme-éléphant dont les conséquences ont été
désastreuses depuis plusieurs décennies.
Si de manière globale on assiste à une
évolution dans le processus de partage de revenus de la rente
forestière, notamment avec le début de l'application des
dispositions législatives et règlementaires, l'impact de ces
mesures sur les conditions de vie des populations est
limité207. Tout de même, les ressources
forestières représentent un enjeu économique, à la
fois pour les populations, l'Etat et les opérateurs économiques.
Tout le monde y gagne, à des degrés divers et de diverses
manières208. Il est donc important d'informer les populations
de leurs droits sur ces ressources fauniques. Cette information selon
Greenpeace, passe par les médias si possible en direct et par les
journaux écrits ou parlés209. De sorte qu'elle sera
transmise à une grande échelle et les citoyens pourront apporter
leur soutien aux gouvernements. Quid de la répression très
réduite des actes de trafic et de braconnage ?
Paragraphe 3- Le quasi inexistence de la
répression des
trafiquants illégaux et des
braconniers
Selon Bas HUIJBREGTS au vue de l'état du trafic
illégal et du braconnage des espèces faunique : « Dans
toute l'Afrique centrale, nos efforts sont anéantis parce que la loi
n'est pas appliquée. Les braconniers ne sont jamais condamnés,
alors ils reviennent. Au Cameroun, le problème est pourtant devenu un
enjeu de sécurité nationale »210. Le
braconnage tout comme le trafic a été très encadré
d'un point de vue international et national. Au regard de la panoplie des
instruments internationaux sur la problématique de la lutte contre le
trafic et le braconnage des éléphants et des gorilles, il est
tout à fait aberrant que la répression de ces actes soit quasi
inexistantes211 en Afrique centrale. Cela alors même que le
trafic mondial et illégal de la faune sauvage est au
4ième rang mondial des trafics illicites avec une valeur
annuelle mondiale estimée entre 8 et 10 milliards de dollars
américains. Malheureusement, le trafic illégal des
espèces
204 Voir la Loi Camerounaise N°94 / 01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
205 BIGOMBE LOGO Patrice, Le retournement de l'Etat
Forestier. L'endroit et l'envers des processus de gestion
forestière au Cameroun, préface du
Professeur Maurice KAMTO, presse de l'UCAC, 2004, p. 17.
206 PRIEUR Michel, Droit de l'Environnement, Dalloz, p.
42.
207 MILOL Adonis et Pierre Jean-Michel, Impact de la
fiscalité forestière décentralisée sur le
développement local et les pratiques d'utilisation des ressources
forestières au Cameroun, Rapport de Consultation pour la Banque
Mondiale, janvier 2000, 48 p.
208 Ibid.
209 LEQUENNE Philippe, Dans les coulisses de Greenpeace,
l'Harmattan, janvier 2005, p.111.
210 Déclaration de Bas HUIJBREGTS, chargé de la
gestion des projets régionaux de conservation au WWF, interviewé
au Journal français Le monde.
211 Cela est prouvé à cause du nombre
limité de peines attribuées ou alors de la mise en condamnation
effective des trafiquants et des braconniers.
61
sauvages est encore considéré dans la plupart
des législations fauniques de la sous-région comme un
délit, au lieu d'être reconnu comme un crime, au même titre
que les trafics d'hommes, le trafic des drogues et des armes.
Le braconnage tout comme le trafic des espèces sauvages
a des effets pervers sur les revenus d'une communauté. Ces actes
fragilisent la paix et la sécurité sociale. Les braconniers sont
prêts à tout pour parvenir à leurs fins, même si pour
cela ils sont obligés de sacrifier des vies humaines qui tenteraient de
leur dissuader. Face à la gravité du problème que
soulève la répression des actes délictuels dans la faune
sauvage, on est en clin de s'interroger sur l'espérance de vie des
éléphants et des gorilles. Il se pourrait que si les trafiquants
et les braconniers continuent de perpétrer leurs actes, les
générations futures n'auront connaissance de ces espèces
emblématiques, qu'à travers les livres et musées
historiques. L'environnement doit être protégé dans toutes
ses composantes, tel est le souhait des instruments internationaux. Reste
qu'une telle ambition est enclavée par des individus inconscients de ce
que le patrimoine commun de l'humanité doit être conservé
au même titre que la dignité humaine.
Si l'on veut se prémunir contre le risque d'une
altération irréversible des effectifs des éléphants
et des gorilles dont les conséquences environnementales et
économiques pourraient être inestimables, il est nécessaire
de repenser l'ensemble des stratégies
élaborées212. Fort de ce constat, il convient de
présenter dans les développements qui vont suivre quelques
esquisses de propositions de solution.
SECTION 2 : ESQUISSES DE SOLUTIONS COMPENSATOIRES
DES
CONTRAINTES EXISTANTES
Le braconnage et le trafic des espèces prennent de plus
en plus de l'ampleur. C'est pourquoi SADIGH Elie établit que, «
les ressources naturelles doivent être préservées afin,
d'une part, de pouvoir les transmettre de la meilleure façon et dans le
meilleur état aux générations à venir, d'autre
part, de réaliser le développement durable, enfin de
préserver l'avenir du vivant. L'épuisement et la
dégradation des ressources naturelles sont essentiellement les
conséquences de l'action de l'homme, il faut donc agir sur cette action
»213. En d'autres termes, les actes criminels dans la
faune n'est pas sans conséquence sur l'économie et le
développement durable de la sous-région. L'efficacité de
l'action contre ces actes suppose « l'inscription de l'environnement
à l'agenda politique, ce qui ne passe pas uniquement par la
sensibilisation, mais une refonte des institutions économiques,
politiques, judiciaires, financières dans le sens des
intérêts protégés de l'environnement
»214. Dans le cadre de cette étude on peut tout de
même relever que l'augmentation des budgets nationaux (Paragraphe 1), la
sensibilisation du public (Paragraphe 2), la révision des
pénalités en matière d'infraction faunique (Paragraphe 3)
et un dialogue entre les états d'Afrique centrale et les pays
consommateurs (Paragraphe 4) sont des mesures compensatoires pouvant dissuader
les gangsters fauniques en Afrique centrale.
Paragraphe 1- Augmentation des budgets nationaux dans la
lutte contre les actes criminels dans la faune
Pour lutter au mieux contre le trafic et le braconnage des
espèces menacées, il faudrait
212 Douzo KOUBO, La stratégie environnementale en
question, Côte d'ivoire, l' Harmattan, juin 2003, p.13.
213 SADIGH Elie, Le Développement durable et
équitable, décembre 2008, l'Harmattan.
214 Bernard KALAORA, Au-delà de la nature
l'environnement. L'observation sociale de l'environnement, collection
« environnement », l'Harmattan, mars 1998, p. 81.
62
que le budget annuel alloué aux ministères
chargés de la faune dans la sous-région soit revue à la
hausse. L'insuffisance des ressources financières est
décriée comme une contrainte majeure de gestion des aires
protégées transfrontalières. Paradoxalement, c'est l'un
des aspects pour lesquels les acteurs et personnes ressources ont du mal
à fournir des chiffres. Ceci révèle déjà une
grande faiblesse du système de gouvernance. Un accent particulier doit
être mis au niveau des Comités de Suivi sur la compilation des
tableaux de synthèse des financements215. Les Etats de
l'Afrique centrale devraient comme recommande la Déclaration de
Yaoundé « (...) inscrire (...) le programme de lutte anti
braconnage en Afrique centrale, dans leurs budgets respectifs, et invitent leur
Ministre en charge des finances à prendre les mesures nécessaires
à cet effet »216.
Pour parvenir aux objectifs fixés, ils devraient
considérer comme priorité majeure la lutte contre le trafic et le
braconnage des espèces sauvages menacés d'extinction
conformément aux annexes de la CITES. Il s'agit ici de faire face
à trois problèmes majeurs : Décourager les braconniers et
les trafiquants illégaux, assurer la survie des mammifères en
voie d'extinction et garantir la paix et la sécurité sociale. Or,
cela nécessite une grande mobilisation financière que les Etats
de la sous-région ne disposent pas aisément.
Les politiques intérieures des Etats d'Afrique centrale
devraient être redynamisées et recentrées sur ce qui
aujourd'hui constitue incontestablement une nouvelle forme d'économie
car un pays qui dispose des espèces sauvages en abondance est largement
convoité par les touristes de tous les horizons. En
réalité, le tourisme contribue à l'économie
nationale et même sous-régionale. Il est un enjeu
considérable de développement217. A titre illustratif,
au Zimbabwe beaucoup de touristes parcourent les aires protégées
de cette nation, captivés par la variété des
espèces qui sont conservés in situ et ex situ. Le Zimbabwe
possède une des plus grandes densités d'éléphants
du continent estimés à 0,46% par Km2 derrière
le Botswana218. L'industrie de l'éléphant «
génère un revenu annuel moyen d'environ 11,75 millions de $
Z. Car au Zimbabwe, l'éléphant est un animal qui motive de
nombreux chasseurs non résidents qui sont prêts à payer
pour les 21 jours de safari réglementaire requis pour la chasse à
l'éléphant »219. Ce qui par ricochet
contribue à l'économie de cet état, dépassant ainsi
le seuil de la pauvreté ambiante de l'Afrique subsaharienne.
Il est donc constant que les stratégies et les plans
d'actions de conservation des éléphants en Afrique centrale ont
été entravés par le flou financier qui subsiste. A titre
d'exemple, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, seul le Cameroun a
cotisé pour la mobilisation des ressources financières annuelles
de la COMIFAC. Et le recouvrement des arriérés du Congo
était de100 000 000 FCFA tandis qu'au Gabon il était de 30 700
000 FCFA220, ce qui est très limité compte tenu de
dépenses annuelles de cette organisation. Au regard de ce qui
précède, conserver la faune en Afrique centrale est
bénéfique non seulement pour les populations des
éléphants et gorilles, mais aussi pour l'économie
nationale. C'est donc un investissement viable et promoteur de
développement durable des peuples. La lutte contre les actes de trafic
et de braconnage des éléphants et des gorilles nécessite
également la sensibilisation du public.
215 NGOUFO Roger, Etude sur la capitalisation des
expériences d'Aires Protégées transfrontalières en
Afrique centrale, mars 2003, p. 34.
216 Réunion d'Urgence des Ministres de la CEEAC en
charge des Relations Extérieures, des questions de Défense et de
Sécurité, de l'Intégration Régionale et de la
Protection de la Faune sur la mise en oeuvre d'un Plan d'Extrême Urgence
sur la Lutte Anti Braconnage dans zone septentrionale de l'Afrique centrale,
Yaoundé (Cameroun), Palais des congrès, 21-23 mars 2013, p.4.
217CHERUBINI Bernard, décembre 2004, Le
territoire Littoral ? Tourisme, pêche et environnement dans
l'océan Indien, l'Harmattan, p. 138.
218 COMMISSION EUROPEENNE, Faune sauvage africaine. La
ressource oubliée (Tome II), p. 251.
219 Ibid.
220 COMIFAC, Rapport annuel 2012, p. 28.
63
Paragraphe 2- La sensibilisation du public passe par
les
médias
Il est primordial de mettre en place une information
stratégique pour aviser « l'opinion publique nationale et
internationale » 221 sur les effets du braconnage à long
terme. Les populations sont « préoccupées par
l'état et le devenir des ressources forestières
»222 dans leur pays. C'est pourquoi la gestion faunique
doit être participative et fait appel à l'aide des communes et des
populations étant donné que chasser légalement profite
à tout le monde.
En effet, les chasseurs ayant les permis de chasse payent les
taxes qui sont versées en partie au ministère chargé de la
faune, une autre partie est versée aux populations du lieu de chasse.
L'année dernière la redevance faunique a apporté
près de 400 000 millions de FCFA à l'Etat du Cameroun. Les
populations doivent être informées des bénéfices des
redevances forestières car elles ont tout à gagner.
En réalité, plusieurs campagnes de
sensibilisations ont été menées dans le cadre de la lutte
contre le trafic et le braconnage des éléphants et des gorilles
en Afrique centrale. Même si ces campagnes ont permis de faire
évoluer la lutte contre ces actes criminels, il reste que nombreux sont
les citoyens de la sous-région qui n'ont pas encore eu connaissance des
effets du braconnage notamment sur la biodiversité. Il convient donc que
l'information soit faite par l'intermédiaire des médias nationaux
et internationaux notamment la télévision, l'internet, la radio,
la presse etc. Et cela avec la même intensité que sont
menées les campagnes sur les sensibilisations des maladies, des produits
technologiques ou cosmétiques. La sensibilisation du public consiste
donc à informer le grand public sur les dangers qui guettent les animaux
sauvages. Elle consiste aussi à informer le public sur les missions des
éco gardes et leur statut en Afrique Centrale. En outre elle doit
être informée des actions que mène le PAPECALF dans la
gestion de la faune sauvage. Que penser de la révision des
pénalités en matière d'infraction faunique ?
Paragraphe 3- Réviser les
pénalités en matière d'infraction
faunique
Il s'agit de mettre en oeuvre des sanctions plus
sévères en ce qui concerne les crimes ou les délits
liés aux espèces sauvages223. Les peines en
matière d'infractions fauniques dans la majorité des Etats
d'Afrique centrale sont très insuffisantes et ne sont pas en mesure de
dissuader les trafiquants et les braconniers. C'est d'ailleurs une
recommandation de la Déclaration de Yaoundé sur la Lutte Anti
Braconnage qui à ce sujet : « invitent les Parties à
mettre en oeuvre les dispositifs juridiques bilatéraux et
multilatéraux existants dans le domaine de la lutte contre le braconnage
; invitent les Etats membres à mettre en oeuvre leurs
procédures législatives internes à l'effet de criminaliser
le braconnage et le commerce illégal de l'ivoire, au même titre
que les autres infractions liées à la criminalité
transnationale organisée ». Il est donc urgent et judicieux
pour ces Etats de revoir leurs lois pénales relatives à la
qualification des infractions fauniques, en suivant l'exemple du Gabon qui est
actuellement en train de réviser son Code Pénal pour
définir le trafic de la faune sauvage comme crime, au même titre
que le trafic de la drogue. La révision
221 Brunel S, Une tragédie banalisée-la faim
dans le monde, l'Hachette, 1991, p. 27.
222 BREDIF Hervé et BOUDINOT Pierre, Quelles
forêts pour demain ? Eléments de stratégie pour une
approche rénovée du développement durable,
préface de Serge Antoine, 2001, p. 111.
223
http://iipdigital.usembassy.gov/iipdigital-fr/index.html.
64
des peines est capitale car le maximum des peines
prévues par les lois fauniques de certains pays d'Afrique centrale en
cas d'abattage d'espèces protégées est respectivement de 5
ans pour le Congo, 3 ans pour le Cameroun, 1 an pour la RCA et 6 mois pour le
Gabon224. A noter que les pays consommateurs doivent procéder
à la fermeture des marchés de la demande des produits issus des
espèces protégées.
Paragraphe 4- La fermeture des marchés de la
demande des
produits issus des espèces
protégées
Les politiques actuelles de lutte contre le trafic
illégal et le braconnage des espèces menacées lancent un
appel aux consommateurs pour qu'ils changent leurs comportements
d'achat225. Cet appel vise essentiellement les pays asiatiques comme
la Chine, la Thaïlande et le Japon qui sont les plus gros consommateurs
d'ivoire dans le monde. Selon le dernier rapport de la CITES basé sur
les données provenant du Programme de surveillance des Abattages
illicites d'éléphants (MIKE), les données de l'UICN sur
l'état des populations d'éléphants, le Système
d'information sur le commerce des éléphants (ETIS)
géré par TRAFFIC et la base de donnée de la CITES
gérée par le Centre mondial de suivi de la conservation du PNUE
(UNEP-WCMC), il existe une corrélation étroite entre
l'évolution du braconnage des éléphants et celle des
saisies massives d'ivoire. Au cours de la seule année 2011, 14 saisies
massives d'ivoire ont eu lieu depuis 23 ans. La quantité totale est
estimée à 24,3 tonnes d'ivoire de plus chaque année que
durant l'année précédente. La Chine et la Thaïlande
sont les deux premières destinations des expéditions d'ivoire
illicite d'après les informations relatives aux saisies.
Les Etats consommateurs de l'ivoire doivent adopter une
politique tolérance zéro en ce qui concerne l'exportation
frauduleuse de ce produit. De plus, le continent africain et les pays
asiatiques devraient dans leur coopération inscrire des programmes
visant la mise en oeuvre des stratégies efficaces de lutte contre le
braconnage et le trafic des espèces protégées. Il s'agit
également pour les pays consommateurs d'ivoire de mener de vastes
campagnes de sensibilisation de leurs citoyens, car beaucoup estiment que les
dents des éléphants tombent et repoussent de manière
naturelle226. Et cela est précisée dans la
Déclaration de Yaoundé sur la lutte anti braconnage de 2013, qui
« (...) exhortent les (...) pays de destination de l'ivoire issu du
braconnage à redoubler leurs efforts pour lutter contre le commerce
illicite de l'ivoire, et à sensibiliser davantage leurs concitoyens sur
les conséquences dudit commerce ». A côté de la
Chine et la Thaïlande, il est urgent que les autres pays importateurs de
l'ivoire à l'exemple de la France227 manifestent plus
sévèrement leur volonté de lutter contre le trafic
illégal des espèces menacées. A ce sujet, le PEXULAB,
« lance un appel aux pays de destination d'adopter des mesures de
réduction de la demande en ivoire ou de restriction de l'entrée
de l'ivoire dans leurs pays respectifs »228. Au demeurant,
une invitation est destinée aux Etats exportateurs de l'ivoire
224 CEEAC (PEXULAB, SYLABAC, PAULAB et PROLABAC), La crise
du trafic d'ivoire et la gestion de la faune en Afrique Centrale, Contribution
aux réflexions initiales menées pour le développement des
Plans de Lutte Anti braconnage, 19 Mars 2013, p.10.
225 DOBRE Michelle et Salvador Juan, Consommer autrement.
La réforme écologique des modes de vie, commentaire d'Edwin
ZACCAI, l'Harmattan, février 2010, p. 13.
226
http://reseaudeslournalistesrca.wordpress.com/2013/03/12/mbaiki-10-elephants-abattus-par-des-braconniers/.
227 Tout récemment, la France a manifesté ses
engagements internationaux en brulant une grande quantité d'ivoires
d'éléphants stockés illicitement dans son territoire. Dans
le même sens, la Chine a elle aussi marqué sa ferme volonté
en brulant des tonnes d'ivoire exportés illicitement en provenance du
continent africain.
228 La Déclaration sur la Lutte Anti-Braconnage en
Afrique Centrale a réuni à Yaoundé le 23 mars 2013, Les
Ministres de la CEEAC en charge des Relations Extérieures, des questions
de Défense et de Sécurité, de l'intégration
65
en provenance de l'Afrique centrale. Elle s'adresse
également à toute la communauté
internationale car la
nécessité de protéger l'environnement incombe à
toutes les couches sociales.
Régionale et de la Protection de la Faune, à
l'effet d'adopter un plan d'extrême urgence de Lutter Anti-braconnage
(PEXULAB) dans la zone septentrionale du Cameroun, du Nord et du Sud Ouest de
la RCA, du Sud du Tchad et dans la zone forestière
66
CONCLUSION GENERALE
En définitive, il était question
d'apprécier l'apport des instruments internationaux en Afrique centrale
en ce qui concerne l'opposition faite au trafic illégal et au braconnage
des éléphants et des gorilles. Pour ce faire, nous avons
présenté plusieurs normes internationales et leur portée
en Afrique centrale. Il convient de souligner que les instruments
internationaux ont largement contribué à une prise de conscience
plus ou moins mitigée des enjeux que posent le trafic et le braconnage
des éléphants et des gorilles sur l'environnement. Ces
fléaux fauniques affectent également le développement
durable, la stabilité sociale et l'économie nationale. En outre,
ils remettent en cause la souveraineté d'une nation.
Dans un tel contexte, les conventions, les déclarations
et accords internationaux signés et adoptés par les Etats ont
permis ici et là de booster le réveil de certains dirigeants qui
jadis n'avaient pas accordé une place primordiale à la protection
de la faune dans leur agenda politique. En réalité, « il
n'y a pas longtemps, certains dirigeants des pays en voie de
développement étaient méfiants à l'idée
d'ériger la protection de la qualité environnement au rang des
priorités nationales. Ils n'hésitaient pas à subordonner
cet objectif à celui de la croissance de leurs économies.
D'autres considéraient cela comme un luxe qui n'était
réservés qu'aux seuls nations riches. Il a fallu attendre la
multiplication des sommets internationaux pour qu'ils adhèrent à
cette cause »229. L'adoption des instruments
internationaux a également permis aux Etats d'Afrique Centrale
d'intégrer des mesures visant à stopper les actes criminels dans
leur faune.
Cependant, les efforts entrepris n'ont pas permis
jusqu'à ce jour de mettre un terme aux actes de trafic et de braconnage
des éléphants et des gorilles. Ceci à cause des
contraintes que connaissent les Etats de la sous- région
combinées à des politiques inertes, désorientées,
de même que dictatoriales.
Si l'on veut parvenir à de meilleurs résultats,
il faut qu'il y ait une démocratie forte et réelle en Afrique
centrale. Cela exige une alternance au pouvoir. Or dans le contexte
sous-régional, la plupart des Chefs d'Etats sont au pouvoir depuis une
vingtaine d'années, d'autres quittent le pouvoir qu'après un coup
d'état ou le cas échéant après leur mort. Partout
dans la sous- région sévissent des guerres tribales et
religieuses. Dans un tel contexte, la lutte contre les actes criminels dans la
faune, ne sera pas facilement acquise. C'est pourquoi, il serait salutaire de
redéfinir les politiques internes dans chaque Etat. Car rien ne peut se
résoudre dans le chao.
Par ailleurs, il semble nécessaire de revoir la
pertinence des instruments internationaux en ce qui concerne la sanction des
atteintes. Car, « Il est de notoriété publique qu'aucune
réglementation fut-elle stricte ne peut être efficace en terme de
résultats final si elle n'est pas suivie des sanctions. On peut penser
que l'impunité des contrevenants explique en partie le faible niveau
d'efficacité de la gestion directe en termes de résultats final
»230. En d'autres termes, il faudrait imposer des
sanctions aux Etats parties qui ne respectent pas leurs engagements,
plutôt que de multiplier des instruments internationaux platoniques,
n'ayant pour seul but que d'énoncer des lignes directrices, sans pour
autant sanctionner la violation. Tel est l'enjeu qu'impose ce thème de
travail qui est sur toutes les lèvres. Par ailleurs, il faut saluer ici
les efforts que mènent continuellement les ONG dans la lutte contre les
actes criminels dans la sous-région, quand on connait les contraintes
parfois liés à l'écologie de la sous-région. Fort
de ce qui précède, est-il
229 KOUBO Douzo, La stratégie environnementale en
question, Côte d'ivoire, l'Harmattan, juin 2003, p.116.
230Ibid., p.116.
67
exagéré de penser que le trafic et le braconnage
des éléphants et des gorilles constitueraient une sorte de bombe
à retardement en ce qui concerne la dégradation de
l'environnement à l'échelle internationale?
68
BIBLIOGRAPHIE
I- Ouvrages
AKONO, Le braconnage dans la réserve
du Dja : une grave menace, in Moabi, n°2, novembre, 1995.
BAHUCHET Serge, GRENAND Françoise, GRENAND et
Pierre De Maret Pierre, Les peuples des forêts tropicales
aujourd'hui, volume I, Forêts des tropiques anthropiques.
Sociodiversité, bioversité : un guide pratique, Bruxelles, APFT,
2000.
BENI MOUTILA Luc, Décembre 2013,
Aires Protégées et Aménagements forestiers au
Cameroun: état de lieux, acteurs et mode de gestion.
BIGOMBE LOGO Patrice, 2004, Le retournement
de l'Etat Forestier. L'endroit et l'envers des processus de gestion
forestière au Cameroun, préface du Professeur Maurice KAMTO,
presse de l'UCAC, 336 p.
BLAKE, V. 2007. Forest elephant crisis in
the Congo Bassin, Plos Biology.
BREDIF Hervé et BOUDINOT Pierre, 2001,
Quelles forêts pour demain ? Eléments de stratégie pour
une approche rénovée du développement durable,
préface de Serge Antoine, 249 p.
BOUTILLIER S., 2003, Risques
écologiques. Dommages et intérêts, Innovations Cahiers
d'économie de l'innovation N°18, édition l'Harmattan, 219
p
BÜRGENMEIER Beat, GREPPIN Hubert, PERRET
Sylvain, décembre 2007, Economie aux
frontières de la nature, Biologie, économie, Agronomie,
éd. L'Harmattan, 389 p.
CHAMBOREDON Anthony, janvier 2008, Du
droit de l'environnement au droit à l'environnement. A la recherche
d'un juste milieu, préface de Jean-Pierre MACHELON, l'Harmattan, 190
p.
CHERUBINI Bernard, décembre 2004,
Le territoire Littoral ? Tourisme, pêche et environnement dans
l'océan Indien, l'Harmattan.
COMMISSION EUROPEENNE, Faune sauvage
Africaine. La ressource oubliée (Tome II), soutenu par la Fondation
internationale pour la sauvegarde de la faune et le Département
d'élevage et de médecine vétérinaire CIRAD-EMVT.
CORNU Gérard, Vocabulaire
juridique, Association Henri CAPITANT, PUF, 1078 p.
CORNU Marie, FROMAGEAU Jérôme,
novembre 2007, Le droit de la forêt au XXIe siècle. Aspects
internationaux, collection Droit du patrimoine culturel et naturel, l'
Harmattan, 303 p.
69
CROUIGNEAU Françoise,
L'endettement malsain du tiers monde, Le Monde du 20 janvier 1988.
DOBRE Michelle, Salvador
Juan, février 2010, Consommer autrement. La réforme
écologique des modes de vie», l'Harmattan, 311 p.
JEAN Clément, novembre 1994, La
forêt : un sujet médiatisé à dimension
mondiale, in Le Flamoyant, n°32, 66 p.
KALAORA Bernard, mars 1998,
Au-delà de la nature l'environnement. L'observation sociale de
l'environnement, collection « environnement », l'Harmattan, 199 p.
KOUBO Douzo, juin 2003, La
stratégie environnementale en question, côte d'ivoire, l'
Harmattan, 189 p.
LEQUENNE Philippe, janvier 2005, Dans les
coulisses de Greenpeace, l'Harmattan, 206 p.
MATAGNE Patrick, 2006, Les enjeux du
développement durable, préface de MORIN Edgar, l'Harmattan,
217 p.
MENGUE-MEDOU Célestine, 2002, Les
aires protégées en Afrique : perspectives pour leur
conservation, Vertigo - la revue électronique en sciences de
l'environnement.
MILOL Adonis et Pierre Jean-Michel,
Impact de la fiscalité forestière décentralisée
sur le développement local et les pratiques d'utilisation des ressources
forestières au Cameroun, Rapport de Consultation pour la Banque
Mondiale, janvier 2000, 48 p.
NASI Robert, EZZINE de Blas Jean Claude,
Exploitation et gestion durable des forêts en Afrique
Centrale, éditeurs scientifiques, Harmattan.
NDINGA Assiatou, octobre 2008,
Conservation Forestière en Afrique Centrale et politique
internationale. Le processus de Brazzaville en échec, l'Harmattan,
127 p.
NJOYA S. Ibrahim, Chasse au
Cameroun, Hachette.
OBAM Adolphe, Conservation et mise en
valeur des forêts au Cameroun, préface de Jean-Paul LANLY,
Yaoundé, Imprimerie Nationale, 1992.
PNUE, 2002, L'avenir de l'environnement
en Afrique. Le passé, le présent et les perspectives d'avenir,
CMAE/PNUE, 1ère édition publié au
Royaume-Uni par Earthprint Limited.
PNUE-WCMC, 2009, Conservation et Commerce
des éléphants, 32 p.
PRIEUR Michel, Droit de
l'Environnement, Dalloz, 6è édition, novembre 2003.
RAMADE François, Le Grand
massacre. L'avenir des espèces vivantes, Hachette. SADIGH
Elie, décembre 2008, Le Développement durable et
équitable, l'Harmattan, 134 p.
70
SOUDJAY Soulaimane, juin 1996, La F.A.O.
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture,
l'Harmattan, coll. Alternatives rurales, 304 p.
STARKEY, M. 2004. Commerce and subsistence:
the hunting, sale and consumption of bushmeat in Gabon.
VADROT Claude-Marie, 2005, Guerres et
environnement. Panorama des paysages et des écosystèmes
bouleversés, Delachaux et Niestlé, 253 p.
VALLAURI Daniel, Jean André, GENOT Jean-Claude,
DE PALMA Jean-Pierre, EYNARD-MACHET Richard, Mai 2010,
Biodiversité, naturalité, humanité. Pour inspirer la
gestion des forêts, Editions TEC & Doc, Lavoisier, 466 p.
Willem WIJNSTEKERS, 2001, The Evolution of
CITES, publication funded by IFAW, 492 p. WILSON Edward O.,
Sauvons la Biodiversité !, Dunod, avril 2007, 204
p.
WORSTER Donald, 1992, Les pionniers de
l'écologie, Une histoire des idées écologiques, Sang de la
terre, Paris.
II- Mémoires, rapports
FLORANTINE MAPEINE ONOTIANG, 2006, La
gestion transfrontalière des ressources naturelles: l'accord relatif a
la mise en place du tri-national de la Sangha (TNS) et son protocole d'accord
sur la lutte contre le braconnage, Université de Limoges (France)
Master droit international et comparé de l'environnement.
KEMBO TAKAM (H.), juillet 2003, Le cadre
juridique de la gestion des aires protégées
transfrontières en Afrique centrale : Le cas du Tri-National de la
Sangha, Mémoire de troisième cycle en Droit International de
l'Environnement, Université de Limoges.
MEKEMEZA ENGO Aimée Prisca, 2007
Cohabitation population fang/CNPN, WCS dans la conservation de
l'environnement au Gabon : Analyse du cas du Parc National des Monts de
Cristal, Maîtrise, Université Omar Bongo.
RWANYIZIRI Gaspard, 2002, Populations et
aires protégées en Afrique de l'Est, Université
Michel de Montaigne-Bordeaux III - Mémoire en vue de l'obtention du DEA
en Géographie.
COMIFAC, Rapport annuel, 2012, 30 p.
PNUE, 2004, Rapport sur l'Etat de
l'environnement en Afrique de l'ouest, REDDA/NESDA, 93 p.
71
III-Articles et documents stratégiques
A- Articles
NZEGANG M., Exploitation des forêts :
une affaire de gros moyens, de grosses têtes, de gros sous et de gros
bonnêts, in La Voix du Paysan, n°33, octobre 1994, p.11.
TABUNA Honoré, la CEEAC et son
rôle dans les activités sous régionales en matière
d'environnement et de gestion des ressources naturelles, 25 p.
Wildlife Justice n° 007, décembre
2010, Magazine sur l'application de la loi faunique, Réplication du
Model Camerounais d'Application de la Loi Faunique, 12 p.
Willkie et Carpenter, 1999. Wilkie, D.S, and
Carpenter J.F., 1999. Bushmeat hunting in the Congo Bassin: an assessment
of impacts and options for the mitigation. Journal Biodiversity and
Conservation 8, 927-955.
WWF, Africa & Madagascar Programme,
Northern Sudanien Savannah Project Cameroon.
B-Documents stratégiques
CEFDHAC, Acte de la 5ème
conférence sur les Ecosystème de forêts Denses et Humides
d'Afrique Centrale, Gouvernance et partenariat multi-acteurs en vue d'une
gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique
Centrale
COMIFAC, 2013, Les Aires
Protégées Transfrontalières de l'Espace COMIFAC.
Leçons Apprises et perspectives, 25 p.
COMIFAC, Sub-Régional Guidelines for
the Participation of Local and Indegenous Communities and Ngos in Substainable
Forest Management in Central Africa, 41 p.
IUCN, Décembre 2005,
Stratégie Régionale pour la Conservation des
éléphants en Afrique Centrale, 2005, 49 p.
MINFOF, Guide pratique à l'usage
des populations rurales : Ce qu'il faut savoir sur la chasse
traditionnelle.
MINFOF, Mai 2003, Programme sectoriel
forêts et environnement,composante3 «Conservation de la
Biodiversité et valorisation des produits fauniques », 114 p.
MINISTERE DE L'EAU, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE
CONTRE LA DESERTIFICATION , Direction de la Faune, de la chasse et des
Aires Protégées, République du NIGER, Juin 2O10,
Stratégie Nationale et Plan d'Action pour la Conservation Durable
des Eléphants au Niger, 58 p.
72
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE DU
QUEBEC, 1996, Convention sur la Diversité Biologique,
Stratégie de mise en oeuvre au Québec, 122 p.
MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE DU
CAMEROUN, 2006, Plan d'aménagement du parc national de
Lobeké et de sa zone périphérique.
MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE DU
CAMEROUN, 2011, Stratégie et Programme de Gestion Durable
des Eléphants au Cameroun, Rapport final, 68 p.
MINISTERE DES TERRES, DE LA REINSTALLATION ET DE
L'ENVIRONNEMENT, Avril 2003, Stratégie Nationale et Plan
d'action pour la Conservation de la Biodiversité au Rwanda, 81
p.
TABUNA HONORE, la CEEAC et son rôle
dans les activités sous régionales en matière
d'environnement et de gestion des ressources naturelles.
WWF, Des mesures pour maitriser
l'accès aux ressources, et assurer le partage des
bénéfices qui en découlent. La situation dans dix
pays, la biodiversité au service de tous. Un document de
réflexion du WWF International.
WWF, WWF Species Action Plan 2012-2015.
African Elephant. Stratégie 2013, 83 p.
IV- Conventions, Déclarations et Accord
Convention sur le Commerce International des Espèces de
Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction (CITES), Washington,
1979.
Convention sur la Diversité Biologique (CDB), Rio,
1992.
Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des
Ressources Naturelles, Alger, 1968
Convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage, CMS, 1979.
Déclaration sur le commerce illégal des
espèces sauvages, Londres, 2013.
Accord pour la conservation des gorilles et de leurs habitats
(Accord Gorilla), Paris, 2007. Déclaration sur la Lutte Anti-Braconnage
en Afrique Centrale, Yaoundé, 2013.
Déclaration sur la lutte contre le braconnage
d'éléphants et contre le trafic d'ivoire et d'autres
espèces protégées, Paris, 2013.
V-Législations forestières nationales
Etude comparative des textes législatifs et
réglementaires relatifs a la gestion de la faune et de la chasse dans
cinq pays du bassin du Congo, Cameroun, Congo, Gabon, RCA et RDC.
73
Cameroun
Loi N° 96 /06 du 18 janvier 1996 portant Constitution de la
République du Cameroun.
Loi N°94 / 01 du 20 janvier 1994 portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche.
Décret N° 95 / 466 / PM du 20 juillet 1995 fixant les
modalités d'application du régime de la
faune.
République du Congo
L'Ordonnance n°84.045 (1984) et la loi n°90.003 (1990)
régissant le Ministère de l'environnement, des eaux, des
forêts, de la chasse et de la pêche.
Guinée Equatoriale
La loi No 4/2.000 créant le Système National des
Aires Protégées.
République Centrafricaine
Code de Protection de la Faune Sauvage, 27 Juillet 1984.
São-Tomé et Principe
Loi de protection de la faune, de la flore et des aires
protégées.
Tchad
Loi N°08-014 2008-06-10 PR portant Régime des
Forêts, de la Faune et des Ressources Halieutiques
VI -Sites internet
http://lemarcheafricain.over-blog.com
consulté le 09/01/2014.
http://
fr.questmachine.post.com consultés le 30/08/2014.
http://fr.wikipedia.org/wiki/PNUD
consulté le 22/03/2014.
http://www.agora21.org/ consulté le 12/05/2014.
http://www.cambodge.post.com/.
http://www.cites.org/eng/prog/MIKE
consulté le 17/04/2014.
http://www.focac.org/eng/
consulté le 14/06/2014.
http://www.fondationbrigittebardot.fr
consulté le 29/08/2014.
http://www.goodplanet.info/consulté
le 27/07/2014.
http://www.gorilla.fr/gorilles.htm
/consulté le 14/06/2014.
http:// www.lefigaro.fr
consulté le 27/12/2013.
http://www.linternaute.com/ consulté le 29/08/ 2014.
http://oraney.blogspot.com/2013/05/nouvel-espoir-pour-sauver-le-plus-grand.html.
http://www.rapac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=245:un-reseau--
federateur&catid=91&Itemid=100043 consulté le
27/12/2013.
http://www.rapac.org/Presentation.htm
consulté le 09/01/2014.
http://www.thegef.org/gef/
consulté le 02/08/2014.
http://www.universalis.fr/encyclopedie/u-i-c-n-union-internationale-pour-la-conservation-de-la-
nature/ consulté le 18/07/2014.
74
ANNEXES
ANNEXE I : DECLARATION DE PARIS
« LA LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE D'ELEPHANTS ET
CONTRE LE TRAFIC D'IVOIRE ET D'AUTRES ESPECES PROTEGEES ».
1. Nous, Chefs d'État et ministres, réunis
à Paris le 5 décembre 2013 à l'occasion du Sommet de
l'Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique,
exprimons notre plus profonde préoccupation sur l'ampleur et les ravages
causés par l'essor sans précédent des actes de braconnage
et de trafic qui affectent l'éléphant et les grandes
espèces menacées dans toute l'Afrique.
2. Avec ces pillages, ce sont en effet les bases du
développement et de la sécurité en Afrique qui sont
directement affaiblies par les conséquences de ces trafics criminels.
3. Face à des bandes lourdement armées, qui
opèrent de plus en plus de manière transfrontalière, qui
alimentent les trafics de tous genres ainsi que l'instabilité politique,
nos États sont confrontés à un véritable
défi de sécurité et de souveraineté. Drame
environnemental, avec en perspective la disparition possible de la nature,
à court terme de plusieurs grandes espèces animales
emblématiques de notre monde, le braconnage et les trafics illicites
hypothèquent les possibilités de développement
économique et social, la préservation de l'environnement de zones
toujours plus larges de nos territoires.
4. Nous nous engageons ainsi à agir sans délai,
de manière résolue, et appelons solennellement la
communauté internationale à rejoindre et soutenir cet effort.
5. Nous saluons à cet égard les projets
d'ampleur présentés par plusieurs pays au cours de notre
réunion, et notamment les initiatives de gestion concertée des
ressources naturelles transfrontières qui témoignent d'une forte
prise de conscience et d'une volonté d'agir sans tarder.
6. Nous saluons également et soutenons l'engagement
résolu des organismes de coopération régionale, de la
Banque Africaine de Développement, ainsi que des pays les plus souvent
ciblés par les produits illicites issus du braconnage.
7. Nous saluons enfin les annonces faites par la France, avec
celles faites par d'autres pays du Nord comme du Sud, tant pour renforcer sa
lutte contre les trafics que pour accompagner les pays africains qui se
mobilisent dans cet effort.
8. Ensemble nous appelons par ailleurs la communauté
internationale à apporter officiellement son plein soutien à la
déclaration de Marrakech (adoptée le 30 mai 2013), à la
décision 14/8 relative à la gestion de la biodiversité en
Afrique, de la conférence ministérielle africaine sur
l'Environnement, (Arusha, 12-14 septembre 2012) ainsi qu'aux conclusions
politiques et opérationnelles du Sommet international de Gaborone (3-4
décembre 2013).
9. Agir efficacement nécessite la combinaison de
moyens et arsenaux répressifs renforcés, associés à
des politiques de développement intégrées, qui prennent en
compte les dimensions humaines, environnementales, économiques et
sociales de la lutte contre le braconnage et les trafics.
10. Nous confirmons ainsi notre volonté de renforcer
la CITES et les initiatives qu'elle a suscitées, l'ONUDC et Interpol, et
d'intensifier notre coopération avec ces organisations,
11. Nous soutenons le projet d'une résolution qui
lancerait dans le cadre de l'ONUDC la création d'un mécanisme de
suivi effectifs des engagements dans le cadre de la Convention internationale
sur la lutte contre le crime organisé, dont le trafic des espèces
menacées est partie intégrante. Une lutte efficace
nécessite en effet une coordination mondiale et des outils juridiques
adaptés pour ce faire.
12.
75
Nous apportons par ailleurs notre soutien aux conclusions de
l'évènement spécial organisé à l'initiative
de l'Allemagne et du Gabon le 26 septembre dernier à New York en marge
de l'AGNU, pour renforcer l'implication des Nations-Unies, et notamment aux
quatre propositions faites à cette occasion :
- constitution d'un « groupe des amis de la lutte contre
le trafic d'espèces menacées » à New York ;
- nomination d'un représentant ou d'un envoyé
spécial du Secrétaire général des Nations Unies ; -
vote d'une résolution à l'Assemblée générale
des Nations Unies ;
- organisation d'une conférence mondiale de haut niveau
sous l'égide de l'ONU.
13. Nous appelons également les pays de destination
des produits issus du braconnage d'espèce menacées, et notamment
de l'ivoire illicite, à renforcer la recherche des importations,
exportations et réexportations effectuées en contravention des
règles de la CITES et à appliquer des sanctions
sévères à l'encontre des personnes impliquées dans
ces trafics (commerçants, intermédiaires et consommateurs).
14. Nous appelons l'ensemble des grands bailleurs de fonds
à apporter leur soutien aux initiatives nationales et régionales
africaines. La lutte contre le braconnage ne peut en effet être efficace
que si elle est intégrée dans les politiques de
développement durable appuyées par les institutions
internationales et les grands bailleurs de fonds.
15. Nous confirmons notre volonté de continuer
à nous saisir activement de ce sujet. Sur la base de cette
déclaration nos pays participeront ainsi à haut niveau à
la conférence de Londres organisée les 12 et 13 février
2014 comme à celle que le Congo propose d'organiser à Brazzaville
au printemps 2014 et oeuvreront activement pour sa réussite.
Fait à Paris, le 05 décembre 2013.
ANNEXE II : DISTRIBUTION DES ELEPHANTS ET
DES
GORILLES DANS LES ZICGC AU CAMEROUN
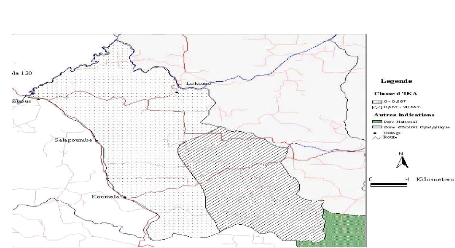
I-Distribution en classe de l'Indice Kilométrique
d'Abondance des Eléphants dans les ZICGC N° 1 au Cameroun
(WWF).
76
II- Distribution en classe de l'Indice
Kilométrique d'Abondance des
Gorilles dans les ZICGC N° 2 au
Cameroun (WWF).
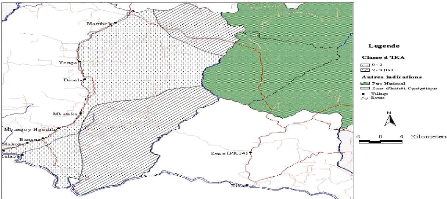
77
TABLE DES MATIERES
DEDICACES i
REMERCIEMENTS ii
LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX iii
I-Liste des photos et des figures iii
II-Liste des tableaux iii
ACRONYMES iv
SOMMAIRE vii
INTRODUCTION GENERALE 1
PARTIE I: DIVERSITE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE
LUTTE
CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET GORILLES
EN
AFRIQUE CENTRALE 5
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES ELEPHANTS ET LES
GORILLES
D'AFRIQUE CENTRALE 5
SECTION 1 : GENERALITES SUR LES ELEPHANTS 5
Paragraphe 1- Aspects historiques des éléphants
6
Paragraphe 2- Caractéristiques des éléphants
d'Afrique Centrale 7
Paragraphe 3- Mode de vie des éléphants 8
Paragraphe 4- Situation actuelle des populations des
éléphants en Afrique centrale 9
Paragraphe 5- Causes principales de la disparition des
éléphants : L'influence du trafic et
du braconnage 9
A- Les actes de trafics illégaux d'éléphants
9
B -Le braconnage des éléphants en Afrique centrale
11
C- Nécessité de la protection des
éléphants 12
SECTION 2 : GENERALITES SUR LES GORILLES D'AFRIQUE CENTRALE 12
Paragraphe 1- Historique du trafic et du braconnage des gorilles
12
Paragraphe 2- Morphologie des gorilles 13
Paragraphe 3- Mode de vie des gorilles 14
Paragraphe 4 - Particularités des gorilles 14
Paragraphe 5- Les raisons d'extinction des gorilles d'Afrique
centrale : Le trafic et le
braconnage 15
A- Le trafic illégal des gorilles 15
B- Les actes de braconnage de gorilles 15
78
SECTION 3: LES GRANDS COMPLEXES TRANSFRONTALIERS ET LES
AIRES
PROTEGEES EN AFRIQUE CENTRALE 16
Paragraphe 1- Les grands complexes regroupant les
éléphants et les gorilles en Afrique
centrale 16
A-La concentration des éléphants et des gorilles
dans le complexe du TNS 16
B- La concentration des éléphants et des gorilles
dans le complexe du TRIDOM 17
C-Le binational Mayoumba-Conkouati 18
D-Le binational Lac Télé-Lac Tumba 18
E-Le Binational Sena Oura- Bouba N'djida 18
Paragraphe 2- La répartition des éléphants
et des gorilles dans les aires protégées
d'Afrique centrale 19
A- Les parcs nationaux d'Afrique centrale 22
B- Les autres aires protégées en Afrique Centrale
23
CHAPITRE II : PANOPLIE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET GORILLES EN AFRIQUE
CENTRALE 27
SECTION 1 : CONVENTION SPECIFIQUE A LA LUTTE CONTRE LE
TRAFIC DES
DEUX ESPECES : LA CITES 27
Paragraphe 1- Présentation de la CITES 27
Paragraphe 2- Contenu de la CITES 28
Paragraphe 3- Programmes de la CITES spécialisés
dans la lutte contre le trafic et le
braconnage des espèces menacées d'extinction 28
A-Le programme MIKE en Afrique centrale 29
B- Programme ETIS de la CITES 29
SECTION 2: CONVENTIONS INTERNATIONALES GENERALISANT LA
LUTTE
CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET DES GORILLES
30
Paragraphe 1- La Convention sur la Diversité Biologique
(CDB) 30
Paragraphe 2- La Convention d'Alger de 1968 31
Paragraphe 3- La Convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage (CMS) 31
A-Présentation de la CMS 31
B-Contenu de la CMS 32
Paragraphe 4- Déclaration de Londres 32
A-Naissance de la Déclaration de Londres 32
79
B-Contenu de la Déclaration de Londres 33
SECTION 3: LES ELEPHANTS ET LES GORILLES : INSTRUMENTS
INTERNATION
AUX PROTEGEANT CHAQUE ESPECE SEPAREMENT 34
Paragraphe 1- Conventions spécifiques de protection des
éléphants 34
A-Déclaration de Paris sur la lutte contre le braconnage
d'éléphants et contre le trafic
d'ivoire et d'autres espèces protégées 34
1-Contexte de la Déclaration de Paris 34
2-Contenu de la Déclaration de Paris 35
B- Déclaration de Yaoundé sur la lutte
Anti-Braconnage 36
Paragraphe 2- L'accord sur la conservation des gorilles et de
leurs habitats 36
PARTIE II: L'IMPACT DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE
LUTTE CONTRE LE TRAFFIC ET LE BRACONNAGE DE L'ELEPHANT ET DU
GORILLE
EN AFRIQUE CENTRALE 38
CHAPITRE I. EFFECTIVITE DE LA MISE EN OEUVRE DES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DANS LA CONSERVATION DES ELEPHANTS ET
DES
GORILLES 38
SECTION 1 : L'INSTAURATION DES PLANS D'ACTIONS ET DES
STRATEGIES DE
LUTTE CONTRE LES ACTES CRIMINELS DANS LA FAUNE EN AFRIQUE
CENTRALE 39
Paragraphe 1- La COMIFAC: Matérialisation de la
coopération et de la mise en oeuvre des
plans d'actions de lutte contre le trafic et le braconnage dans
la sous-région 39
A-Présentation de la COMIFAC : expression d'une
coopération entre les Etats
d'Afrique centrale 39
1-Création de la COMIFAC 39
2- Objectifs de la COMIFAC 40
B-Elaboration et mise en oeuvre des plans d'actions par la
COMIFAC 40
1-Le PAPECALF 40
2- Contribution de la COMIFAC au programme ECOFAC 41
Paragraphe 2-Institution du Plan d'Action d'Urgence de Lutte Anti
braconnage
(PAULAB) : Initiative de la CEEAC 41
A-Naissance et missions de la CEEAC 42
B-La mise en place du Plan d'Action d'Urgence de Lutte Anti
Braconnage par la
CEEAC 42
Paragraphe 3- L'OCFSA comme outil de coopération et
d'unité des Etats d'Afrique
centrale 43
80
Paragraphe 4- Contribution du RAPAC dans la gestion des aires
protégées d'Afrique
centrale 43
A-Naissance et finalités du RAPAC 43
B- Gestion des aires protégées en Afrique centrale
par le RAPAC 44
SECTION 2: MESURES PRISES PAR LES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE ET
DE LA PARTICIPATION DES ORGANISATIONS DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET
LE BRACONNAGE DES ESPECES MENACEES 44
Paragraphe 1- Mesures prises par les Etats d'Afrique Centrale
44
Paragraphe 2- Assistance des organisations internationales aux
états d'Afrique centrale avec comme idéal commun:
L'éradication des actes de trafic illégal et de braconnage des
espèces menacées d'extinction en Afrique
centrale 46
A-La participation des organisations internationales 46
1-Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) dans
la lutte
contre le trafic et le braconnage des éléphants et
des gorilles 46
2-La Contribution du Programme des Nations Unies pour le
Développement
(PNUD) 47
3-Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 48
B-Intervention spectaculaire des Organisations Non
Gouvernementales (ONG) 48
1-Application des plans d'actions dans la sous région par
WWF 49
2-Contribution de l'Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (l'UICN)
49
3-Appui non négligeable de l'ONG TRAFFIC 50
a-Historique de l'ONG TRAFFIC 50
b-Le rôle de TRAFFIC dans la lutte contre le trafic et le
braconnage des éléphants et des
gorilles en Afrique centrale 51
4-Apports du Wildlife Conservation Society (WCS) 52
SECTION 3: RESULTATS DE L'APPLICATION DES CONVENTIONS
INTERNATION
ALES DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES ELEPHANTS
ET
DES GORILLES 53
Paragraphe 1- Réduction relative des actes de trafic et
braconnage des éléphants et des
gorilles dans la sous- région 53
Paragraphe 2- Amélioration des moyens stratégiques
de lutte contre le trafic et le
braconnage des deux espèces en Afrique centrale 54
A-Amélioration des dispositions juridiques sous
régionaux en accord avec les
instruments internationaux visant la conservation des
espèces fauniques 54
B-La reforme des dispositions institutionnelles dans la sous-
région 54
81
Paragraphe 3- Légère répression des actes de
trafic et de braconnage des éléphants et des
gorilles en Afrique centrale 55
Paragraphe 4- Prise de conscience embryonnaire des risques de la
demande des produits
issus des espèces menacées 56
CHAPITRE II : LES ENTRAVES A L'APPLICATION EFFICACE DES
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC ET LE BRACONNAGE DES
ELEPHANTS ET DES GORILLES EN AFRIQUE CENTRALE
57
SECTION 1 : PARTICULARITES DES PROBLEMES DU TRAFIC ET
DU
BRACONNAGE DES ELEPHANTS ET DES GORILLES DANS LA SOUS- REGION ... 57
Paragraphe 1-Absence lacunaire des moyens financiers pour lutter
efficacement contre le
trafic et le braconnage des espèces sauvages 58
Paragraphe 2- L'ignorance généralisée des
populations 59
sur les effets du trafic et du braconnage des espèces
59
Paragraphe 3- Le quasi inexistence de la répression des
trafiquants illégaux et des
braconniers 60
SECTION 2 : ESQUISSES DE SOLUTIONS COMPENSATOIRES DES
CONTRAINTES
EXISTANTES 61
Paragraphe 1- Augmentation des budgets nationaux dans la lutte
contre les actes criminels
dans la faune 61
Paragraphe 2- La sensibilisation du public passe par les
médias 63
Paragraphe 3- Réviser les pénalités en
matière d'infraction faunique 63
Paragraphe 4- La fermeture des marchés de la demande des
produits issus des espèces
protégées 64
CONCLUSION GENERALE 66
BIBLIOGRAPHIE 68
Ouvrages 68
II- Mémoires, rapports 70
III-Articles et documents stratégiques 71
A- Articles 71
B-Documents stratégiques 71
IV- Conventions, Déclarations et Accord 72
V-Législations forestières nationales 72
VI -Sites internet 73
ANNEXES 74
82
ANNEXE I : DECLARATION DE PARIS 74
ANNEXE II : DISTRIBUTION DES ELEPHANTS ET DES GORILLES DANS
LES ZICGC AU CAMEROUN 76
I-Distribution en classe de l'Indice Kilométrique
d'Abondance des Eléphants dans les
ZICGC N° 1 au Cameroun (WWF) 76
II- Distribution en classe de l'Indice Kilométrique
d'Abondance des Gorilles dans les
ZICGC N° 2 au Cameroun (WWF) 76



