|
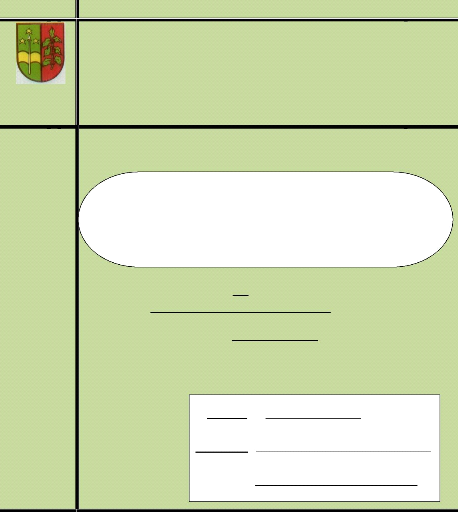
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
INSTITUT
FACULTAIRE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE
YANGAMBI
« IFA-YANGAMBI
»
B.P. 1232 KISANGANI B.P. 28 YANGAMBI
Par
ERAIFT
Contribution à la stratégie de relance de la
filière café robusta dans la Province de la Tshopo
Cas des territoires de Bafwasende et Ubundu
Albert-Jonathan BACHISEZE MAGALA
Département : Economie Agricole
Encadreurs : MSC Louis Pasteur BAMENGA BOPOKO
Directeur : Dr. Baudouin MICHEL
Professeur (Université de Liège & ERAIFT)
Présenté et défendu en vue de l'obtention du
diplôme de grade d'Ingénieur A0 en sciences Agronomiques
Département : Economie Agricole
Travail de fin d'étude
MSC Clément JASHOPOKWO UZELE
IFA-YANGAMBI
2022
|
|
ANNEE ACADEMIQUE 2021 - 2022
|
|
|
|
Première Session
|
|
|
|
|
|
ii
EPIGRAPHE
Le développement est un processus qui exige que chaque
peuple se soude les coudes et devient plus productif, plus performant, plus
compétitif, ...
Albert-Jonathan BACHISEZE MAGALA- 2022
iii
DEDICACE
A nos parents Dieudonné et Jeanne, A tous nos
frères et soeurs, les MAGALAS, A tous ceux qui militent pour un
environnement sain et durable, A tous ceux qui cultivent et diffusent les
dignes valeurs humaines, A tous ceux qui rêvent grands et croient aux
vertus de travail et d'efforts, A tous les chercheurs passionnés par les
filières et chaines de valeurs agricoles.
En signe de respect et d'encouragement
!
iv
REMERCIEMENTS
De vive voix, nous remercions le ciel pour la vie et les
capacités gracieusement accordées.
Nos remerciements les plus inaltérables s'adressent au
directeur de ce travail, le Professeur Baudoin MICHEL, de l'université
de Liège (Belgique). Nous saluons sa notoriété et sa
méticulosité dans le domaine de recherche et de
coopération internationale. En dépit de son agenda toujours
saturé : Recteur à l'IFA- Yangambi, Directeur à l'ERAIFT,
Coordonnateur à l'INERA-Yangambi, il était présent
à tout moment qu'il le fallait. Nous témoignons ensuite notre
gratitude aux Doctorants Louis Pasteur BAMENGA (ERAIFT) et Clément
JASHOPOKWO (IFA- Yangambi), lesquels j'appelais respectivement LP et Jacleus.
Ils ont bien exercé leurs rôles d'encadreurs, nous permettant
d'apprendre par nous-mêmes aux fins d'être la vraie version de
nous-mêmes.
Nous déferons sincères remerciements à
tous les membres de notre département d'économie agricole pour
leurs contributions enrichissantes lors des séminaires et entretiens
privés.
En jetant les regards plus en arrière, certains noms ne
peuvent pas être omis. Nous exprimons notre gratitude à
l'équipe des chercheurs du laboratoire ISOFYS de l'université de
Gand, en Belgique. Dirigée par le Professeur Pascal BOECKX, c'est cette
équipe qui m'a initié à la rigueur scientifique. Que le
facilitateur Héritier FUNDJI, que j'appelle Wata+, comprenne combien je
suis reconnaissant. Comment puis-je omettre le Professeur Corneille EWANGO (de
l'université de Kisangani) et le Phd Isaac MAKELELE (Université
de Bukavu) ? Ceux-là qui ont corrigé mon premier protocole de
recherche en sciences. Nous étendons toute notre gratitude à tous
les professionnels de la craie qui ont concouru à notre formation.
Nous ne saurons passer sous silence nos amis, jeunes
chercheurs avec lesquels nous sommes en train d'écrire une histoire :
Guy Robert MANDE, Merveille WOMBE, Fabrice KIMBESA, Serge ALEBADWA. Quoi
d'autre que de remercier notre équipe des jeunes entrepreneurs
YOUNECATE-Org, ...merci de nous nourrir d'optimisme et du goût
d'excellence, ...
Nous remercions nos parents, nos frères et soeurs, LES
MAGALAS pour le soutien intégral que nul mot ne saurait textuellement
exprimer. Nous n'oublierons pas nos camarades de promotion pour la
cohésion et le partage, ...
Afin de n'oublier personne, que ce document soit un motif de
satisfaction à tous ceux qui nous ont soutenus de quelconque
façon, dans notre cursus universitaire.
v
RESUME
Le café « or vert » était un poids
lourd dans l'économie congolaise et représentait entre 10
à 15 % du PIB national vers les années 1980. Des causes
intrinsèques et extrinsèques ont périclité les
productions et les exportations caféières évaluées
à moins de 1% du PIB national en 2022. A l'heure actuelle, nombreuses
causes sont déjà levées et la promotion d'un
développement axé sur la durabilité prend l'ampleur. C'est
dans ce sens que cette étude a été menée dans
l'objectif de contribuer à la stratégie de relance de la
filière café, dans la province de la Tshopo au travers les
territoires de Bafwasende et Ubundu.
A l'issu d'une approche empirique englobant des techniques
complémentaires, les analyses fonctionnelle et financière de la
filière café ont été abordées. La matrice
AFOM a été présentée et couplée pour
ressortir les options stratégiques. L'analyse fonctionnelle montre la
désorganisation de la filière à tous les niveaux causant
des très faibles productions et la compétitivité nulle des
produits. L'analyse financière montre que la filière est rentable
pour tous les acteurs avec une inégale répartition de la valeur
ajoutée. L'amélioration de rendements, de processus de
transformation et des circuits de commercialisation sont les défis
à surmonter. Un autre grand défi est d'ordre culturel dans le
sens que les populations desdits territoires ne font pas de l'agriculture leur
priorité.
La filière café affiche de bonnes perspectives
de développement dans la zone sous examen. Sa relance peut se solder par
un impact socio-économique évident et avec moins des dommages
à l'environnement. La trilogie : vulgarisation des avantages liés
au café en commençant par les leaders d'opinions, la
structuration des agriculteurs de la base au sommet, et l'investissement dans
l'homme puis dans l'équipement, est la pierre de touche de la
stratégie proposé.
Ces résultats sont une référence de poche
pour tous les entrepreneurs voulant investir dans le secteur de café
dans Tshopo et aussi pour les concepteurs, élaborateurs et bailleurs des
projets de développement.
Mots clés : Café,
Stratégie, Filière, Relance durable et Investissement dans
l'homme.
vi
ABSTRACT
Coffee « green gold » was a heavyweight in the
Congolese economy and represented between 10 to 15% of the national GDP around
the 1980s. As a result of both, intrinsic and extrinsic causes, coffee
production and exports have slipped into decline up to less than 1% of national
GDP in 2022. However, many causes have already been lifted and the promotion of
sustainable development is gaining momentum. It is within this framework that
this study was conducted with the aim of contributing to the recovery strategy
of the coffee sector, in the province of Tshopo through Bafwasende and Ubundu
territories.
At the end of an empirical approach including complementary
techniques, the functional and financial analyses of the coffee sector were
approached. The SWOT matrix was presented and exploited to bring out strategic
options. The functional analysis shows the disorganization of the sector at all
levels causing very low production and zero competitiveness of the products.
The financial analysis shows that the sector is profitable for all the actors
with an unequal distribution of the added value. Improving yields, processing
processes and marketing channels are the challenges to overcome. Another major
challenge is cultural in the way that that the populations of these territories
do not make agriculture their priority.
The coffee sector shows good development prospects in the area
under examination. Its revival can result in an obvious socio-economic impact
and with less damage to the environment. The trilogy: popularising the benefits
of coffee starting with opinion leaders, structuring farmers from the bottom
up, and human-equipment investment, is the touchstone of the proposed
strategy.
These results are a pocket reference for all entrepreneurs
wanting to invest in the coffee sector in Tshopo and also for designers,
developers and donors of development projects.
Keywords: Coffee, Strategy, Sector, Sustainable
recovery and Human investment.
vii
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE ii
DEDICACE iii
REMERCIEMENTS iv
RESUME vi
ABSTRACT vi
TABLE DES MATIERES vii
SIGLES ET ABREVIATIONS ix
LISTE DES TABLEAUX x
LISTE DES FIGURES x
0. INTRODUCTION 1
0.1. Etat de la question 2
0.2. Problématique 3
0.3. Les hypothèses 4
0.4. Les objectifs 5
0.5. Intérêt de l'étude 5
0.6. Cadre du travail 5
0.7. Subdivision du travail 5
CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL 6
1.1. COMPRENDRE LE CAFE ET LA CEFEICULTURE 6
1.2. COMMERCE DU CAFE ET SON PARADOXE 9
1.3. LES FILIERES AGRICOLES 10
CHAPITRE II. MILIEU ET METHODE 13
2.1. MILIEU D'ETUDE 13
2.2. MATERIELS 14
2.3. METHODE 15
2.3.1. Techniques de récolte de données 15
2.3.2. Méthode de récolte des données 16
CHAPITRE III. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS 23
3.1. Analyse fonctionnelle de la filière café 23
3.1.1. Description des acteurs de la filière 23
3.1.2. Délimitation des contours de la filière.
30
3.1.3. Graphe de la filière café 31
3.1.4. Formation des prix et stratégie des acteurs 32
3.1.5. Coordination des acteurs et cadre réglementaire.
34
3.2. Analyse financière de la filière 35
viii
3.2.1. Analyse de la viabilité financière de la
filière sur les acteurs 35
3.2.2. La consolidation des CPE 35
3.3. Présentation de la matrice AFOM 37
3.4. Formulation des actions stratégiques 38
3.4.1. Couplage de la matrice AFOM 38
3.4.2. Formulation des axes stratégiques 39
CHAPITRE IV. DISCUSSION DES RESULTATS 40
4.1. Analyse fonctionnelle de la filière 40
4.2. Analyse financière de la filière 42
4.3. L'analyse par matrice AFOM 44
4.4. Formulation des axes stratégiques 45
CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS 46
BIBLIOGRAPHIE 48
ANNEXE
ix
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFD AFOM ANAPI CDF CPE FAO GDP ICO INERA INS
JBM OCC ODD OIC ONAPAC PIB PNUD RBE RNE SNCC SWOT ULB VA
ERAIFT
Agence Française de Développement
Atouts Forces Opportunités Menaces
Agence National pour la Promotion des Investissements
Congolese Democratic Franc
Compte Production Exploitation
Food and Agriculture Organisation
Gross Domestic Product
International Coffee Organisation
Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques
Institut National des Statistiques
Jardin Botanique de Meise
Office Congolais de Contrôle
Objectifs de Développement Durable
Organisation Internationale du Café
Office National des Produits Agricoles du Congo
Produit Intérieur Brut
Programmes des Nations Unies pour le Développement
Résultat Brut d'Exploitation
Résultat Net d'Exploitation
Société Nationale de Chemin de fer du Congo
Strenghts Weaknesses Opportunities Threats
Université Libre de Bruxelles
Valeur Ajoutée
Ecole Régionale postuniversitaire d'Aménagement et
de Gestion
Intégrés des Forêts et territoires
x
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1. Principales différences entre les
variétés robusta et arabica 7
Tableau 2. Compte de Production 11
Tableau 3. Compte d'Exploitation 12
Tableau 4 : Prototype d'un CPE 18
Tableau 5. Profil sommaire des principaux acteurs de la
filière café 23
Tableau 6. Types de commerçants grossistes 26
Tableau 7. Types de commerçants Revendeurs 27
Tableau 8. Types de transformateurs 28
Tableau 9 : Délimitation des contours de la
filière 30
Tableau 10. Variation annuelle des prix de café 32
Tableau 11 : Compte Consolidé de la filière
café 35
Tableau 12 : Présentation de la matrice AFOM 37
Tableau 13 : Couplage de base de la matrice AFOM 38
Tableau 14 : Les axes stratégiques pour la relance de
la filière café 39
Tableau 15 : Comparaison des RNE mensuels des acteurs
filières café, Riz et Pêche 43
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Les grands producteurs du café et leurs
géo positions 8
Figure 2 : Le déséquilibre du marché
mondial du café de 1998/99 à 2002/03 9
Figure 3 : Carte de la Province de la Tshopo et ses
territoires 13
Figure 4 : Cadre méthodologique 15
Figure 5 : Analyse par matrice AFOM 19
Figure 6 : Analyse croisée de la matrice AFOM 20
Figure 7. Brainstorming pour la formulation des axes
stratégiques (UNIL, 2018) 21
Figure 8 : Eléments liés aux facteurs de
production 24
Figure 9 : Répartition des producteurs selon la
fréquence annuelle d'entretien 24
Figure 10 : Eléments liés à la Production
et Vente 25
Figure 11 : Répartition des commerçants
grossistes 26
Figure 12 : Répartition des commerçants
revendeurs 27
Figure 13 : Répartition des transformateurs 28
Figure 14 : Etapes de transformation du café :
Opération, moyens, produits et perte 29
Figure 15 : Description de la filière café en
territoires de Bafwasende et Ubundu. 31
Figure 16 : Répartition de la valeur ajoutée
entre les acteurs 36
1
0. INTRODUCTION
La République Démocratique du Congo est l'un des
rares pays africains qui ont le potentiel de devenir un véritable
grenier à grain (Lebailly et al., 2014). Ce géant au
coeur de l'Afrique centrale regorge d'importantes ressources dans tout secteur
économique (ANAPI, 2019).
Après plus de six décennies
d'indépendance, la RDC figure parmi les pays les plus pauvres du monde
et son tissu macroéconomique ne cesse de se détériorer.
L'indice de développement humain qui est l'indicateur du niveau de vie
est de 0,45 positionnant le pays à la 179e place sur 189 pays
considérés (Pourtier, 2018 ; PNUD, 2020).
Cet état résulte de nombreux facteurs parmi
lesquels nous notons le sabotage volontaire du secteur agricole par la classe
dirigeante. En effet, les représentants gouvernementaux ne sont pas
parvenus à mettre en place d'importants changements structurels qui
puissent conférer à l'agriculture son pouvoir multiplicateur et
accélérateur du processus de développement. A ce stade, la
relance du secteur agricole s'impose en leitmotiv pour tous les
acteurs qui rêvent d'un Congo fort et émergent. Un
intérêt aussi particulier est requis pour les cultures
pérennes ou industrielles qui sont des investissements durables aux
fonctions économiques, financières, écologiques et
sociales non négligeables (Ibandan, 2021).
Le café « Or vert » est la première
culture pérenne échangée dans le monde et contribue
substantiellement à booster les économies des pays (Wintgens,
2004). En RDC, après le secteur des mines, le café a
été le fer de lance de l'économie et contribuait au PIB
à hauteur de 15% (Baeumlin, 2013) dans les années 1980-1990. A
nos jours, la contribution du café au PIB national est estimée
à 1% (INS, 2021). Il est rationnel de déduire que l'effondrement
de la caféiculture a précipité nombreux congolais dans la
pauvreté. Réversiblement, la relance de la caféiculture se
solderait par un impact socio-économique évident.
A l'heure où le pays est en quête d'une bonne
stratégie de promotion et d'autonomisation des agriculteurs et de leurs
économies, il nous est question dans cette étude de faire un
état de lieux de la filière café et de formuler des
options stratégiques de sa relance dans la Province de la Tshopo,
à travers les territoires de Ubundu et de Bafwasende.
2
0.1.Etat de la question
Dans la province de la Tshopo, rare sont les études de
viabilité scientifique qui ont abordé la problématique de
la relance de la filière café.
La fondation Konrad Adenauer (2017) avait initié dans
le cadre du projet Un seul monde sans faim, des études
filières, malheureusement limitées à la pêche et au
riz dans la Tshopo. Dans notre discussion, nous avons tenté de balancer
la viabilité microéconomique de chacune de ces filières
à celle de café.
Dans le Kongo Central, Manfroy (2021) a analysé la
chaine de valeur café dans la réserve de Biosphère de Luki
par la méthode Value Chain Analysis for Development(VCA4D). A
l'issu de ses analyses, elle conclut que la filière café est
rentable pour tous les acteurs de la chaine et qu'elle peut avoir d'impacts au
niveau provincial. Aussi, elle montra que le développement de cette
chaine de valeur pourrait avoir des effets positifs sur l'environnement,
notamment sur la réduction de la déforestation.
Dans le Kwango, c'est la conclusion du chapitre 5 de Ibanda
(2021) qui nous intéresse. Il a abordé le développement
agricole et pastoral en RDC. Pour relancer les cultures pérennes, il
estime qu'il est nécessaire que les agriculteurs adoptent la
polyculture, mais également que l'Etat soutienne les exploitants
agricoles par des incitations fiscales, douanières et en investissant
dans les infrastructures routières.
A l'échelle nationale, c'est depuis 2011 que la RDC, au
travers son ministère de l'agriculture, a formulé sa
stratégie de relance de la filière café autour d'une
vision : améliorer les performances de la filière Café
sur toute la chaîne de valeur et créer des richesses en milieu
rural à travers une caféiculture professionnalisée et
compétitive. La grande province orientale était
ciblée mais non la province de la Tshopo, district de la Tshopo à
l'époque. Estimée à 100 millions de dollars et
formulée par diagnostic participatif, cette stratégie, comme
beaucoup des projets du gouvernement congolais, est restée sans
follow-up.
La présente étude, réalisée dans
le cadre du projet Coffeebridge, s'inscrit dans l'idée de
relancer la caféiculture dans la Province de la Tshopo par le secteur
privé. Une relance efficace, efficiente et durable étant
l'objectif, l'étude commence par comprendre l'état actuel de la
filière, dresse la matrice AFOM et l'analyse. Finalement, elle formule
des actions stratégiques en concert avec les Objectifs de
Développement Durable (ODD).
3
0.2.Problématique
L'agriculture est depuis les temps anciens une source de
nourriture et des revenus pour plusieurs ménages dans le monde. Elle
reste donc le facteur déterminant pour une croissance économique
inclusive des nations (ANAPI, 2019).
Dans toutes leurs diversités, les cultures
exploitées en agriculture se classent en trois grandes catégories
: les cultures vivrières, maraichères et pérennes. Ces
dernières se caractérisent par des plantations fixes et stables
qui riment avec les objectifs du développement durable (Ibandan,2021).
Par ailleurs, ces cultures sont beaucoup échangées sur le
marché international et procurent des retours financiers substantiels
aux exploitants agricoles et améliorent les réserves de changes
des pays (Wintgens, 2004). Parmi les cultures pérennes, la culture du
café démontre un potentiel économique et social
très pertinent. En effet, le café représente 4% du
commerce mondial des produits alimentaires, c'est la première
denrée agricole et la deuxième marchandise échangée
dans le monde après le pétrole et avant le blé (Chatel
et al.,2016).
Les pays africains représentaient 30% des exportations
mondiales de café vers les années 1970 et seulement 11% en 2010.
En RDC, dans les années 1980, le café était le
deuxième produit d'exportation après le cuivre et
représentait jusqu'à 15 % de la valeur des exportations totales
du pays, soit 75% des exportations du secteur agricole (Baeumlin, 2013). Les
grands bassins de productions étaient les régions de Nord et Sud
Kivu, Oriental, Equateur, Bandundu et Bas Congo (Ibandan, 2021). En 2021-2022,
la production caféière est évaluée à 250000
kg, soit une contribution de moins de 1% dans le PIB du Pays (INS, 2021).
Les causes déterminantes de cette chute «
vertigineuse » sont la tracheomychose, les conflits armés, la
défectuosité des routes agricoles et la baisse des cours
mondiaux. Les principales causes conjoncturelles y afférentes sont la
faiblesse des mécanismes de financement agricole (cas pour l'ONAPAC) et
le mauvais entretien des plantations (Rubabura et al., 2015). Cet
effondrement du secteur café a conduit à coup sûr à
la vulnérabilité des communautés locales et au
développement de la pauvreté sous ses formes (Kang et al.,
2009).
Ces dernières années sont marquées par la
mise au point des variétés résistantes à la
tracheomycose, le rétablissement du calme dans certains grands bassins
de production et la hausse continue de la consommation mondiale à
hauteur de 2,5% l'année (Tegera et al.,2014). La RDC, le
pôle de certains meilleurs cafés du monde, devrait revitaliser sa
caféiculture, un des moteurs de développement rural (Dubé,
2012).
4
Un autre élément très déterminant
est le changement climatique. Laderach et al., (2008) estiment que les
hausses généralisées des températures vont
restreindre les zones favorables à l'arabicaculture.
La Province de la Tshopo, bénie par son climat
écologique, ses vastes superficies et sa position
géostratégique, offre des conditions favorables pour la relance
effective de la filière café robusta. Le territoire de Bafwasende
est le plus vaste de la province de la Tshopo. Il fut l'un de bassin de
production de café Robusta dans la Tshopo avec une production comprise
entre 50 à 200T (Baeumlin,2013). Le territoire de Ubundu, voisin, est le
deuxième plus vaste de la province de la Tshopo (Omasombo et al.,
2017). En plus de leurs vastes étendues, les bonnes
possibilités d'exportations offrent à ces deux territoires des
avantages non négligeables. Dans cette étude, nous nous sommes
posés la question de savoir s'il y a encore des incitants
économiques ou organisationnels pour la filière café dans
les territoires de Bafwasende et Ubundu. Telle est la principale question de
cette étude.
Il en dérive 4 questions spécifiques :
1. Quel est l'état actuel de la filière
café dans les zones d'étude ?
2. Quel est l'impact financier de la filière café
sur les parties prenantes ?
3. Y-a-il des bonnes perspectives de développement de
cette filière dans ces territoires ?
4. Quelles sont les actions stratégiques pour relancer
et assurer la durabilité de la filière café dans la
province de la Tshopo
0.3.Les hypothèses
L'hypothèse centrale postule que dans les territoires
de Bafwasende et Ubundu, il ya d'incitants économiques et non
organisationnels pour la filière café.
Plus spécifiquement :
1. Dans la zone d'étude, la filière café
est dans un état d'abandon. Les productions sont faibles, les techniques
utilisées sont rudimentaires, les acteurs ne sont pas organisés
et ne bénéficient d'aucun soutien public ou privé ;
2. L'impact financier de la filière est positif sur
les parties prenantes ;
3. Il y a de bonnes perspectives de développement de
la filière café dans ces territoires. La somme atouts
-opportunités absorbe celle de faiblesses-menaces ;
4. Les actions stratégiques pour relancer et assurer
la durabilité de la filière café sont d'ordres
technico-financiers, organisationnels et institutionnels en concert avec les
Objectifs de Développement Durables (ODD).
5
0.4.Les objectifs
L'objectif principal de cette recherche est de contribuer
à la stratégie de relance de la filière café dans
la province de la Tshopo à partir des territoires de Bafwasende et de
Ubundu. Plus spécifiquement il sera question de :
1. Procéder à une analyse fonctionnelle de la
filière ;
2. Procéder à une analyse financière de la
filière ;
3. Présenter une analyse basée sur la matrice AFOM
de la filière ;
4. Formuler des actions stratégiques pour relancer et
assurer la durabilité de la filière café en concert avec
les Objectifs de Développement Durables (ODD).
0.5.Intérêt de
l'étude
Sur le plan scientifique, cette recherche est une contribution
à l'analyse des filières agricoles et des marchés en
général. En cette période où le pays est en crise
de politique agricole, les données collectées et les
résultats de cette recherche sont une littérature de plus pour
éclairer la réalité et inspirer les chercheurs
ultérieurs.
Sur le plan socio-économique, les résultats de
cette étude constituent un véritable outil de décision.
Ils ouvrent des pistes nouvelles aux développeurs et entrepreneurs pour
passer à l'action, élaborer et exécuter des projets de
revitalisation de la caféiculture.
0.6.Cadre du travail
La présente étude est réalisée
dans la Province de la Tshopo, principalement dans le territoire de Bafwasende
et Ubundu. L'étude est menée dans le cadre du projet
Coffeebridge coordonné par le JBM (Jardin Botanique de Meise)
et appuyé par nombreux partenaires : INERA (Institut National pour
l'Etude et la Recherche Agronomiques), ERAIFT (Ecole Régionale post
universitaire d'Aménagement et de gestion Intégrés des
Forêts), ULB (Université Libre de Bruxelles, ...). Le projet est
multidisciplinaire et vise à soutenir les agriculteurs du café
robusta par des études qui vont alimenter la prise de décision
à la fois au niveau des décideurs que des agriculteurs.
0.7.Subdivision du travail
De surcroit l'introduction, le travail est subdivisé en
quatre chapitres : le premier aborde le cadre conceptuel, le deuxième
décrit le matériel et méthode, le troisième
présente et interprète les résultats et le
quatrième discute les résultats. Une conclusion et plusieurs
suggestions bouclent cette recherche.
6
CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL
1.1.COMPRENDRE LE CAFE ET LA CEFEICULTURE
a. Etymologie, Historique et Expansion du
café
Le mot café vient du mot arabe « Cahouah »
ou « Qahwah » qui signifie « ravigorant » et désigne
à la fois les graines et cerises du caféier, mais aussi la
boisson obtenue à partir de ces graines et le lieu de consommation de
cette boisson (Penilleau, 1864 ; Michelle et al., 2003). Nombreux
auteurs soutiennent que le café arabica a fait son apparition dans le
Sud-Ouest de l'Ethiopie, en Afrique (Allred et al., 2009). A partir de
son berceau d'origine, le café et la caféiculture se sont
étendus dans toutes les régions du monde et aujourd'hui, il est
possible de trouver le bon café dans toutes les grandes villes du monde
(Boulo, 2013). Le café robusta est quant à lui originaire du
bassin du Congo (Fomer, 2017). Précisons que l'expansion de la
caféiculture émane des colonisateurs (Epon Eboa et al.,
2019).
b. Classification botanique et description de la
plante
Les scientifiques ont dénombré plus de 124
espèces dans le genre Coffee (Davis et al.,2019) Cependant,
Adepoju (2017) précise que seules deux espèces sont
intéressantes pour la production et commercialisation :
- Coffee arabica (Linné) qui donne le café
arabica et - Coffee canephora (Pierre) qui donne le café
robusta.
La classification botanique du café arabica est
présentée par Bouden et Kadri (2019) : Règne : Plantae,
Division : Angiosperme, Classe : Dicotyledonae, Sous classe
: Euasterids, Ordre : Gentianales, Famille : Rubiaceae,
Sous Famille : Ixoroideae, Genre : Coffee L., Espèce
: Coffee arabica.
Le caféier est un arbuste tropical pouvant atteindre 10
à 12 mètres de hauteur. Les racines sont pivotantes et selon les
espèces, le tronc est soit unicaule ou multicaule. Les branches sont
horizontalement opposées 2 à 2, aussi longues et grêles.
Les feuilles sont brillantes, verte-foncées, aux formes ovales, aux
bords ondulés, à phyllotaxie opposée, et à
pétiole très court (Champéraux, 1991). Les fleurs sont
blanches, petites, groupées en glomérules de 15 à 30.
Chaque fleur fécondée donne un fruit appelé « cerise
» et les graines qui y résultent sont les « fèves
», de couleur grise et à surface lisse (Benmedjahed, 2017)
7
c. Principales différences entre les
variétés arabica et robusta
La distinction entre ces deux variétés est
principalement génétique. C'est l'expression
génétique qui engendre les différences morphologiques et
agronomiques. Le tableau 1 ci-dessous résume les principales
différences entre ces variétés.
Tableau 1. Principales différences entre les
variétés robusta et arabica
|
N°
|
Paramètre
|
Variété Arabica
|
Variété Robusta
|
|
01
|
Origine
|
Hauts plateaux éthiopiens
|
Cote d'Ivoire, Foret congolaise, Ouganda
|
|
02
|
Date de description
|
1753
|
1895
|
|
03
|
Nombre de
chromosomes (2n)
|
44
|
22
|
|
04
|
Température moyenne
annuelle optimale
|
15-24°C
|
24-30°C
|
|
05
|
Altitudes optimales
|
500-2000m
|
2000-3000m
|
|
06
|
Précipitations optimales
|
1500-2000mm
|
2000-3000mm
|
|
07
|
Resistance
|
Fragile, frileux et délicat
|
Robuste face aux maladies,
insectes
|
|
08
|
Teneur en caféine
|
1,2- 1,5%
|
3%
|
|
09
|
Forme et couleur des
grains
|
Forme Ovale, allongée et
couleur rouge, jaune
ou
violette
|
Forme ronde, petite dimension
et de couleur jaune à
brun
|
|
10
|
Goût
|
Aromatique, plus subtil et
fruité
|
Corsé et amer
|
|
11
|
Production
|
60% de la production
mondiale
|
40% de la production mondiale
|
|
12
|
Prix
|
20-25 % plus cher que
Robusta
|
20-25 % moins cher qu'Arabica
|
Source : (Piccino, 2011)
Le tableau 1 ci-dessus montre que la caféiculture
demeure et demeurera toujours une propriété du monde tropical
humide. Un hectare de caféier Arabica ou Robusta, conduit dans de bonnes
conditions avec du matériel sélectionné, produit entre 6
et 7 tonnes de cerises, qui donneront 1,2 à 1,3 tonnes de café
marchand après transformation. Dans les périodes où les
cours du café sont très bas, les caféiculteurs
investissent peu dans leurs plantations. Ils laissent l'ombrage se
développer et se contentent de désherber. Dans ces conditions, un
hectare fournit entre 600 kg et 1 tonne de cerises, soit 100 à 200 kg de
café marchand. Dans des conditions de culture intensive au soleil, une
grande plantation peut produire correctement pendant 30 ans. Les
caféières sous ombrage, peu productives, peu entretenues, durent
souvent 50, 70, voire 100 ans (Lécolier, 2006).
8
d. Traitement post récolte de
café
Après le premier traitement post récolte (voie
sèche ou humide), s'en suivent la torréfaction
et la moulure. La torréfaction consiste à griller le café
afin de lui conférer ses qualités : forme, volume, couleur,
poids, ... (Pittia et al., 2001 ; José Alfredo, 2012). En
effet, sous l'effet de la chaleur, les sucres et l'eau donnent des caramels et
quand il n'y a plus d'eau, les sucres et les acides développent les
arômes (c'est la réaction de Maillard ou caramélisation).
En plus la réaction de Strecker intervient pour le changement de
pigmentation jusqu'au chocolat (Michelle et al., 2003). La moulure,
effectuée selon divers procédés, permet alors de
réduire le café torréfié en poudre qui est alors
vendu.
e. Producteurs et consommateurs du
café
La majorité du café consommé dans le
monde est produit dans la zone intertropicale. Depuis des années, le
Brésil est le premier producteur mondial, suivi des deux autres poids
lourds dont le Vietnam et la Colombie (Khalid, 2010).
La RDC partage le même climat que ces grands producteurs
du café, malheureusement qu'elle n'a pas encore réussi à
valoriser ce grand potentiel géostratégique.
Le café produit est consommé sous diverses
formes : en boisson, produits esthétiques, ou encore produit
diététique. Les grands producteurs sont aussi les grands
consommateurs. En Europe, la consommation est plus modeste,
modérée en Asie et très modérée en Afrique
et en Océanie (Turquie et Japon) mais très élevée
aux Etats-Unis (I.C.O, 2011). La figure 1 ci-dessous illustre les grands
producteurs du café dans le monde.
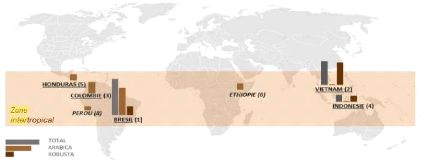
Figure 1 : Les grands producteurs du café et
leurs géo positions Source : (Khalid 2010 ; Basic,
2018)
9
1.2.COMMERCE DU CAFE ET SON PARADOXE
a. Poids du café « Or vert » et de
la caféiculture dans le monde
Le paradoxe est que le café n'est pas une
matière première vitale dans le sens où on peut vivre sans
le consommer. Il est différent du blé, du coton, du cacao ou
autres matières premières vitales pour le bien-être des
personnes. Toutefois, fort est de noter que, le café est la
matière première agricole la plus échangée au monde
après le pétrole (I.C.O, 2011).
b. Grande crise du café dans le monde
(1997-2003)
L'un des défis majeurs du commerce du café est
la volatilité des prix aux producteurs (AFD, 2008). En 1962, le premier
accord international sur le café (AIC) est conclu. Ses signataires sont
à la fois les pays producteurs en demande d'une régulation et les
pays consommateurs soucieux d'assurer un approvisionnement régulier en
qualité stable (Basic, 2018). Comme pierre de touche, l'accord a
instauré la fourchette d'évolution des prix et des quotas
à l'exportation pour chaque pays producteur. Cet accord, très
fructueux sera annulé en 1989, à la suite de nombreux
dysfonctionnements internes (Tulet, 2007). Le démantèlement de
cet accord régulateur a désorganisé l'économie
mondiale du café. A cette désorganisation s'est ajoutée la
montée en puissance de la production en Amérique Latine et en
Asie. Ces éléments ont convergé à la surabondance
de l'offre et parallèlement la baisse brutale et dramatique des cours
mondiaux aux producteurs, c'était la crise du café la plus grave
(Basic, 2018). La figure 2 ci-dessous illustre le dynamisme offre-demande du
marché pendant cette crise.
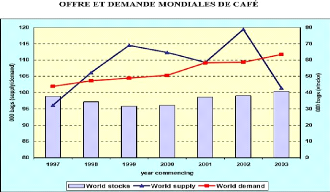
Figure 2 : Le déséquilibre du
marché mondial du café de 1998/99 à 2002/03 Source
: (O.I.C, 2004).
10
c. Période post crise de la
caféiculture
Depuis Novembre 2004, le prix mondial du café est en
pleine hausse. Les principales raisons qui justifiant des prix soutenus sont :
la demande croissante dans les pays consommateurs, des stocks faibles entre les
mains des producteurs, l'augmentation des revenus moyens de la population dans
les pays consommateurs (émergents), des coûts de production en
augmentation dans tous les pays producteurs et la nécessité du
respect à l'environnement (Tegera et al., 2014). Cependant,
Laderach et al.,(2008) prédisent que la répartition
géographique des productions du café va changer sous l'impact du
marché et du climat. Les zones favorables l'arabicaculture vont se
restreindre, occasionnant l'augmentation des prix du café de bonne
qualité. Les hausses marginales des températures seront plus
bénéfiques au Coffee robusta.
1.3.FILIERES AGRICOLES
a. Survol sur les filières et chaines de valeur
agricoles
La distinction reste peu tranchée entre ces deux
vocabulaires à tel niveau que le terme filière est traduit en
« value chain » (Chaine de valeur) en anglais.
L'approche filière est d'origine française et la
chaine de valeur est anglaise (Bockel &Tallec, 2005 ; Porter, 1986).
L'approche filière dégage les relations de cheminement et de
complémentarité le long de la chaine de production alors que la
chaine de valeur consiste à la décomposition des étapes de
production de façon à identifier les avantages compétitifs
possibles aux différents maillons du processus de production.
En d'autres mots, la chaine de valeur décrit les
nombreux niveaux depuis la conception, le bord du champ jusqu'à la tasse
du consommateur et destruction après utilisation. C'est donc une analyse
séquentielle ou éclatée des différents maillons de
la chaine de production (FAO,1997 ; Kaplinsky & Morris, 2000). En revanche,
la filière renvoie à une analyse systémique, à une
notion d'ensemble de la chaine de production.
Les principales dimensions d'une filière sont les
intrants, la production, la transformation et la commercialisation. D'un niveau
à l'autre, le degré des flux est fonction des signaux ou
incitants (le prix, crédit, ...) que reçoivent les
opérateurs économiques (CSA, 2013).
11
b. L'analyse financière d'une filière
agricole : Principes de calcul
Pour Lescuyer (2020), l'analyse financière d'une
filière permet d'estimer ses impacts sur le bien-être des parties
prenantes. Dans notre cas, il a été question de reconstituer les
comptes production-exploitation de chaque agent de la filière. Ces
comptes individuels des acteurs ont ensuite été consolidés
et interprétés.
Les recettes totales (RT) et les charges totales (CT) sont les
grandeurs fondamentales déterminées. Les charges englobent les
Consommations Intermédiaires (CI), les Autres Charges (AC) et les
Amortissements (Am). Le terme Autres charges regroupe les frais financiers
(FF), les Impôts et taxes (IT) et la rémunération du
personnel (S).
Avec les deux grandeurs fondamentales, des grandeurs
dérivées qui sont des outils standards d'analyse
financière peuvent être déterminées. Ce sont les VA,
RBE, RNE, ...
2. Détermination de la valeur ajoutée
(VA)
La valeur ajoutée représente la richesse
créée dans le processus de production-destruction. En effet, si
RT et CI sont respectivement la valeur des recettes totales et les
consommations intermédiaires. Alors la valeur ajoutée est
définie par l'équation : VA = RT-CI
Le calcul de la valeur ajoutée passe par
l'élaboration du compte de Production CP illustré par
le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2. Compte de Production
|
Désignation
|
Sigle
|
Quantité
|
Prix Unitaire (PU)
|
Annuité
d'amortissement (A.a)
|
Total
|
|
1. Les charges
|
C
|
|
|
|
CI
|
|
Les consommations intermédiaires
|
CI
|
|
|
|
?A, TFS, TG et Tr
|
a. Les achats
|
A
|
|
|
|
|
b. Travaux, fournitures et
services
|
TFS
|
|
|
|
|
c. Frais divers de gestion
|
TG
|
|
|
|
|
d. Transport
|
|
Tr
|
|
|
|
|
|
|
2. Les recettes totales
|
R
|
|
|
|
?VP, VD et SE
|
a. Vente de la Production
|
VP
|
|
|
|
|
b. Vente des déchets et sous-
produits
|
VD
|
|
|
|
|
c. Subventions d'exploitation
|
|
SE
|
|
|
|
|
|
|
Valeur Ajoutée Intérieure Brute
|
VA
|
|
|
|
RT-CI
|
Source : (Bockel & Tallec, 2005 ;
Lescuyer, 2020)
12
1. Détermination du Résultat Brut et
Net d'Exploitation (RBE et RNE)
Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) est obtenu en
déduisant des recettes totales les consommations Intermédiaires
et les autres charges. A l'opposé du RBE, le Résultat Net
d'Exploitation (RNE) exprime le gain (ou la perte) économique de l'agent
une fois acquitté de toutes les charges d'exploitation courantes. Le RNE
intègre un autre type de facteur qui a contribué à la
production : les Investissements. On considère que la production a
contribué à « l'usure » des investissements. Ainsi,
RBE = VA - AC RNE = RBE - Am
= RT - CI - AC = RT - CI - AC- Am
Source : (Bockel &Tallec, 2005 ;
Lescuyer, 2020)
Le calcul des RBE et RNE passe par l'élaboration du compte
d'Exploitation, CE illustré par tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3. Compte d'Exploitation
|
Désignation
|
Sigle
|
Quantité
|
Prix Unitaire (PU)
|
Annuité
d'amortissement (A.a)
|
Total
|
|
Autres charges et Amortissement
|
|
|
|
|
? S, FF, IT et Am
|
|
1. Autres charges
|
AC
|
|
|
|
? S, FF, IT
|
a. Rémunération du personnel
|
S
|
|
|
|
|
b. Frais Financiers
|
FF
|
|
|
|
|
c. Impôts et Taxes
|
IT
|
|
|
|
|
2.Amortissement
|
Am
|
|
|
|
|
Valeur Ajoutée Intérieure
Brute
|
VA
|
|
|
|
|
Résultat Brut d'exploitation
|
RBE
|
|
|
|
VA-AC
|
Résultat Net d'exploitation
|
RNE
|
|
|
|
RBE-Am
|
Test de Rentabilité
|
TR
|
|
|
|
(R/C) *100
|
|
Source :(Bockel&Tallec, 2005 ;
Lescuyer, 2020).
Le CP et le CE peuvent être regroupés dans un
compte unique, c'est le Compte de Production Exploitation (CPE).
d. Les Limites de l'approche filière
Il est à préciser que cette approche doit
être utilisée en complémentarité avec d'autres
outils de décisions prenant en compte les dynamiques agricoles et
territoriales. Etant bornée sur un produit spécifique, la
filière permet très difficilement d'intégrer les enjeux
transversaux indissociables aux activités agricoles et au
développement inclusif (CSA, 2013).
13
CHAPITRE II. MILIEU ET METHODE
2.1.MILIEU D'ETUDE
Notre zone d'étude a couvert les territoires de
Bafwasende et Ubundu, dans la Province de la Tshopo, la plus vaste du pays avec
199 567 km2, soit 8,5% de l'étendue nationale. Située
au Nord-est du pays, la province de la Tshopo comprend la ville de Kisangani et
sept territoires : Bafwasende, Banalia ; Ubundu,Basoko, Isangi, Opala etYahuma
(ADRASS, 2020)
La province est occupée à 87% par la forêt
dense humide. Celle-ci est favorisée par le climat correspondant au type
Af de la classification de Köppen qui y prévaut. Les sols sont dans
une large majorité ferralitique, à texture sablo argileuse.
L'hydrographie de la province s'articule autour du Fleuve Congo et la
rivière Tshopo (Bolakonga, 2013).
L'économie de la Province est centrée sur
l'agriculture et l'élevage traditionnels. Les principales cultures
exploitées sont le manioc, la banane plantain, la patate douce et le
riz. Les cultures pérennes en pleines régression concernent le
café, le cacao, l'hévéa, et le palmier à huile.
L'élevage concerne les vaches, poulets de chair et pondeuses (UNICEF,
2021).
La figure 3 présente la carte de la Province de la
Tshopo et ses territoires.
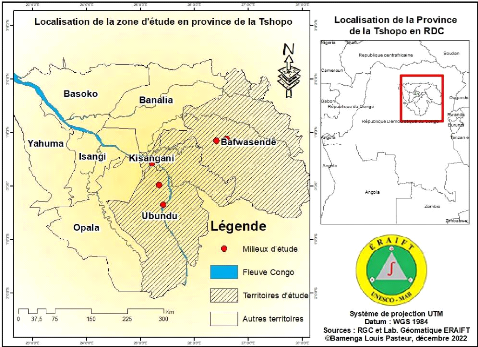
Figure 3 : Carte de la Province de la Tshopo et ses
territoires
14
Le territoire de Bafwasende (chef-lieu Bafwasende, à
262 Km de Kisangani) est le plus vaste du pays. Il s'étend sur
près du quart de la Tshopo (48 482 km2). En revanche, il est
le territoire le moins peuplé de la province (Annuaire de statistique,
2020). Ce territoire loge quatre peuples autochtones notamment : Mbuti
(Pygmées), Babali, Komo et Lombi (ADRASS, 2020). Il est limité
:
- Au Nord : Territoires de Poko (dans la
province de Bas Uele), Rungu et wamba (dans la province du Haut Uele) ;
- Au Sud : Territoires de Walikale (dans la
province du Nord-kivu) et Lubutu (dans la province du Manièma)
- A l'Est : Territoires de Mambasa (dans la
province de l'Ituri) et Lubero (dans la province du Nord-Kivu)
- A l'Ouest : Ubundu, Banalia et la ville de
Kisangani
Le territoire de Ubundu (chef-lieu la cité de Ubundu,
à 126 Km de Kisangani) est le deuxième plus grand territoire de
la province et s'étend sur 41306 km2 (Annuaire, 2020). Il
comprend neuf secteurs, une chefferie (Kirundu), des groupements et villages
(Adrass, 2020). Il partage ses limites avec les territoires de :
- Bafwasende et la ville de kisangani au Nord-ouest
;
- Kailo (Province du Manièma) au Sud ;
- Lubutu et Punia (dans la province du Manièma) à
L'Est ;
- Opalaàl'Ouest.
Source : (Omasombo et al.,
2017)
2.2.MATERIELS
Les matériels suivants ont été
utilisés :
- Un téléphone avec l'application
Kobocollect pour la collecte des données ; -
La balance et le gobelet pour la triangulation des valeurs
fournies par les acteurs ; - Un GPS 64s Garmin pour
l'enregistrement des coordonnées des acteurs ; - Un Ordinateur
portable pour l'analyse et rédaction du travail.
15
2.3.METHODE
L'objectif global de cette étude a imposé le
recours à la méthode appliquée dans le
développement stratégique. Outre l'identification des questions,
la méthode comprend la récolte et l'analyse des données,
la discussion des résultats, l'analyse AFOM et enfin
l'élaboration du plan de développement. Pour cette
dernière étape, il a été question de formuler des
actions stratégiques pour relancer la culture du café dans les
territoires sous examen et non d'un plan de développement au sens
strict. Les objectifs de Développement Durable (ODD) nous ont servi de
fil rouge dans les formulations des actions stratégiques. La figure 4
ci-dessous illustre le cadre méthodologique suivi.
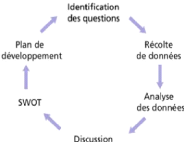
Figure 4 : Cadre méthodologique Source
: (UNIL, 2018)
La méthode probabiliste d'échantillonnage par
grappe a été appliquée dans la récolte des
données. Il était question de recenser et interroger les acteurs
par maillons et sous maillons (producteurs, transformateurs
torréfacteurs et mouleurs, commerçants grossistes et
revendeurs).
2.3.1. Techniques de récolte de
données
En plus de l'analyse documentaire qui nous a permis
d'établir le diagnostic de base et l'organisation de la recherche. C'est
la technique d'enquête à travers un questionnaire d'enquête
qui a été utilisée pour la collecte des données.
Afin de mieux aborder notre troisième et quatrième objectif, les
enquêtes ont été plus semi-indirectes, laissant les acteurs
fournir plus d'informations possibles. Pour cette même fin, nous avons
contacté des personnes ressources et initié le focus group pour
échanger sur les défis de la filière et les solutions
à envisager. Précisons qu'à chaque niveau, nous faisions
preuve d'observation et d'analyse explicative qui sont des outils
nécessaires dans la formulation des actions stratégiques.
16
2.3.2. Méthode de récolte des
données
a. Pré-enquête
Effectuée au début du mois de Juin, cette phase
nous a permis de réunir les informations nécessaires sur les
territoires sous examen et les acteurs de la filière. En plus, cette
phase nous a permis de compléter notre matériel de travail, de
tester et de nous familiariser au questionnaire d'enquêtes, de mesurer
les difficultés auxquelles nous ferons face et d'estimer le budget
nécessaire pour atteindre les objectifs assignés.
b. Enquête proprement dite
L'enquête proprement dite a débuté au mois de
Juillet pour s'achever au mois de Novembre :
b.1. A l'aide d'un questionnaire d'enquête, des
échanges ont été organisés avec les principaux
acteurs de la filière.
- Douze producteurs exploitant au moins vingt pieds de
café ont été recensés et dix ont été
interrogés ;
- Huit grossistes ont été recensés parmi
lesquels sept ont été interrogés ;
- Quarante revendeurs ont été recensés
et vingt-huit ont été interrogés aléatoirement
jusqu'au moment où il n'y avait que des redites d'informations ;
- Dix transformateurs ont été recensés
parmi lesquels sept ont été interrogés.
b.2. Le recours à l'approche participative a permis
d'organiser le focus group. Celui-ci a permis d'appréhender les
problèmes communs à la filière et de rassembler les
propositions des acteurs, les concernés directs. Les aspects
sécuritaires, d'accès au marché, d'écoulement, de
transformation, de tracasserie et de répartition de travail en fonction
du genre ont fait l'objet d'une attention particulière.
b.3. Le recours à l'approche boule de neige a permis
d'identifier des personnes ressources pour notre étude. Celles-ci sont
des banques d'informations, fruits d'une longue expérience dans les
milieux d'étude ou dans la filière café. Parmi ces
personnes ressources, y avait certains acteurs encore actifs et d'autres qui
n'exercent plus.
b.4. Des échanges très ouverts ont
été organisés avec les institutions publiques
impliquées dans la filière. Cas de l'ONAPAC et de la SNCC.
b.5. A chaque étape de la récolte des
données, l'observation et l'analyse participative avaient une place de
choix.
Comme Bolakonga, (2013), nous avons soutenu les
enquêtés dans leurs réflexions internes tout en essayant de
lever toute contrainte qui empêcherait leur libre expression. Nous avons
adopté une attitude empathique incitant les acteurs à fournir
plus d'informations utiles que possible.
17
c. La spécification des variables
Les variables qualitatives et quantitatives ont
été collectées pour atteindre les objectifs fixés.
Les principales variables quantitatives ont concerné : les
quantités produites, transformées et commercialisées ; les
charges globales de producteurs, des transformateurs et des commerçants.
Les prix aux producteurs, aux transformateurs et aux commerçants. La
taille des exploitations, le nombre des plants, l'âge et
ancienneté des acteurs, ...
Les principales variables qualitatives ont concerné :
l'état matrimonial, le niveau d'étude et la motivation des
acteurs, le mode d'accès au capital naturel, les systèmes et
stratégies de production, de transformation et de commercialisation, le
mode d'approvisionnement en intrants, les infrastructures de transport, les
contraintes à la production, les opportunités offertes.
L'ensemble de ces données a permis de saisir l'état actuel de la
filière, de juger l'impact de la filière sur les acteurs,
d'estimer les perspectives de développement de la filière et de
formuler les actions stratégiques de relance de la filière.
d. Les Méthodes d'analyse des
données
1. Analyse fonctionnelle de la
filière
Cette section a permis de saisir le fonctionnement de la
filière étudiée. Les acteurs et leurs techniques de
production ont été+ décrits, le graphe de la
filière a été présenté. La formation de
prix, la stratégie des acteurs, la coordination et le cadre
réglementaire ont également été abordés.
Plusieurs méthodes d'analyses très complémentaires ont
été utilisées. D'une part, les logiciels Excel et SPSS ont
permis de produire les tendances centrales et de positions. D'autre part,
certaines données qualitatives n'ont nécessité aucun
traitement ; elles sont reportées dans la partie des
résultats.
2. Analyse financière de la filière
Deux objectifs ont été poursuivis :
déterminer la viabilité financière de la filière
sur les acteurs et déterminer la valeur ajoutée globale de la
filière dans l'économie. Pour atteindre le premier objectif, nous
avons dressé les comptes Production Exploitation (CPE) d'un acteur type
pour chaque maillon. La viabilité financière de la filière
a été évalué grâce aux indicateurs standards
de performance financière. Ceux retenus dans cette recherche sont : la
Valeur Ajoutée, le Résultat Brut et Net d'exploitation et enfin
le rapport Recettes- Coûts ou test de rentabilité. Pour le second
objectif, nous avons agrégé tous les CPE dans un même
compte, le compte consolidé. Le tableau 4 ci-dessous est un prototype
d'un CPE.
18
Tableau 4 : Prototype d'un CPE
|
Désignation
|
Abréviation
|
Quantité
|
Prix Unitaire (PU)
|
Annuité
d'amortissement (A.a)
|
Total
|
|
1. Les charges
|
C
|
|
|
|
? CI, AC et Am
|
|
a. Les consommations intermédiaires
|
CI
|
|
|
|
?A, TFS, TG et Tr
|
|
Les Achats
|
A
|
|
|
|
|
|
Travaux, fournitures et services
|
TFS
|
|
|
|
|
|
Frais divers de gestion
|
TG
|
|
|
|
|
|
Transport
|
Tr
|
|
|
|
|
b. Autres charges
|
AC
|
|
|
|
?FF, TI et RP
|
Frais Financiers
|
FF
|
|
|
|
|
Impôts et Taxes
|
IT
|
|
|
|
|
Rémunération du personnel
|
S
|
|
|
|
|
c. Les amortissements
|
|
Am
|
|
|
|
? Aa VI
|
|
|
Les valeurs immobilisées
|
VI
|
|
|
|
|
|
2. Les recettes totales
|
RT
|
|
|
|
?VP, VD et SE
|
a. Vente de la Production
|
VP
|
|
|
|
|
b. Vente des déchets et sous-produits
|
|
VD
|
|
|
|
|
|
|
b. Subventions d'exploitation
|
SE
|
|
|
|
|
|
Valeur Ajoutée
|
VA
|
|
|
|
RT-CI
|
|
Résultat Brut d'exploitation
|
RBE
|
|
|
|
VA-AC
|
|
Résultat Net d'exploitation
|
RNE
|
|
|
|
RBE-?A.a VI
|
|
Test de Rentabilité
|
TR
|
|
|
|
(R/C) *100
|
Source : (Bockel&Tallec, 2005)
A ce niveau, il convient de préciser les bases du
processus :
1. Les calculs ont été réalisé avec
les prix du marché de Novembre 2022 ;
2. Les calculs ont considéré qu'une année a
300 jours ouvrables ;
3. L'unité monétaire utilisée est le CDF
(1$ = 2000 CDF) et les quantités sont en Kg (qui équivaut
à 2 ou 3 gobelets de café marchand ou moulu).
4. Les comptes Production-exploitation des producteurs,
transformateurs et commerçants ont été
élaborés sur base des quantités moyennes (annuelles)
produites, transformées et commercées ;
- La plupart des producteurs, transformateurs et
commerçants ont été interrogés, du moins les plus
importants en termes de quantités,
- Le CPE d'un producteur a considéré la moyenne
annuelle des producteurs de la zone d'étude : Ubundu et de Bafwasende
- Les CPE d'un transformateur et d'un commerçant ont
considéré la moyenne des transformateurs et des
commerçants exerçant dans la ville de Kisangani, au marché
central.

19
5. Pour les amortissements :
- Les producteurs utilisent leurs outils (houes, machettes,
panier de récolte et bâche) pour toutes leurs cultures et non
seulement pour le café. L'amortissement a été
appliqué après avoir divisé la valeur d'acquisition de
l'outil par 3, nombre moyen de culture d'un producteur.
- La même logique a été appliquée
pour les charges des transformateurs et des commerçants,
- Les calculs détaillés sont
présentés à l'annexe 2.
3. L'analyse AFOM
Après compréhension du stade actuel de la
filière café par analyse fonctionnelle et financière, nous
avons dressé la matrice AFOM. En effet, dresser cette dernière
après l'analyse fonctionnelle s'explique par le souci de ne pas fonder
le développement stratégique sur des impressions ou de croyances
non vérifiées (UNIL, 2018).
Cette analyse, utilisée dans nombreux contextes,
s'étend du diagnostic interne (atouts et faiblesses) au diagnostic
externe (opportunités et menaces) et pose le fondement pour
l'élaboration des axes stratégiques (Abdellaoui, 2011). La figure
5 ci-dessous illustre le prototype d'une matrice AFOM (SWOT en anglais).
|
Les quadrants seront complétés après une
analyse en trois phases :
a. Identification de tous les facteurs impactant la
filière café
b. Classement en facteurs internes et en facteurs externes
c. Sélection et priorisation de ces facteurs
d. Affectation des facteurs aux quadrants
|
Figure 5 : Analyse par matrice AFOM Source
:(Absil, 2011)
20
4. La formulation des actions stratégiques
a. Couplage de la matrice AFOM
La formulation des actions stratégiques a
consisté à l'exploitation de la matrice AFOM en mode focus group.
Fondamentalement, nous avons procédé au couplage de la matrice
qui consistait à confronter les acteurs internes et externes. La figure
6 ci-dessous illustre le couplage de base de la matrice AFOM.
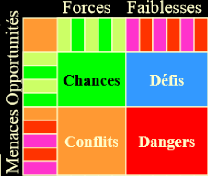
Figure 6 : Analyse croisée de la matrice
AFOM Source : (Vuillod Frederic & Vuillod Serge, 2005)
|
- Forces X Opportunités = Chances -
Faiblesses X Opportunités = défi -
Forces X Menace = Conflit
- Faiblesses X Menace = Danger
|
b. Formulation proprement-dite des options
stratégiques
Les options stratégiques ont été
formulées pour des objectifs définis et une vision
prédéfinie. Toute stratégie visant la relance de la
filière café doit corroborer avec la stratégie nationale
de relance de la caféiculture lancée en 2011.
La vision nationale dans laquelle s'inscrit celle de la
relance du café à Ubundu et à Bafwasende est :
améliorer les performances de la filière café sur
toute la chaine de valeur et créer des richesses en milieu rural
à travers une caféiculture professionnalisée et
compétitive.
Les principaux objectifs y afférents sont : (1)
Améliorer la productivité et la qualité de la
récolte, (2) Améliorer les processus de traitement, retraitement
et de torréfaction et (3) Améliorer les circuits de
commercialisation
Pour optimiser les possibilités offertes par l'analyse
AFOM, et son couplage de base, les axes stratégiques ont
été des réponses aux questions reprises dans la figure 7
ci-dessous.
21
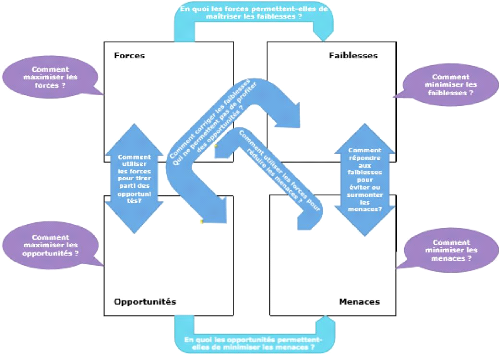
Figure 7. Brainstorming pour la formulation des axes
stratégiques (UNIL, 2018). Source : (UNIL, 2018)
e. Les obstacles à
l'étude
Outre les contraintes techniques liées aux zones
rurales, nombreux autres obstacles ont entravé la bonne
réalisation de cette étude. Il s'agit principalement de
l'accès aux informations et le biais de désirabilité
sociale.
L'accès limité aux informations s'est
observé à différents niveaux. Premièrement, le
nombre très limité des acteurs dans la filière
café. Par exemple dans la route Kisangani- Ubundu, c'est après
plus de 70 km que nous retrouvions 1 petit planteur de café.
Deuxièmement, la méfiance de certains acteurs y compris
mêmes les institutions publiques qui ne se laissaient interroger qu'en
contrepartie d'une motivation financière non prévue dans notre
budget.
Le biais de la désirabilité sociale a
été observé. Pour Crowne & Marlowe (1960) c'est
l'envie des sujets enquêtés de ne pas reporter des informations
qui le feraient mal perçus. Par certaines questions jugées «
personnelles », l'étude n'a pas certainement échappé
à ce biais.
22
Enfin, les informations fournies par les acteurs ne semblent
pas toujours fiables. Ils pouvaient donner des valeurs contradictoires au sein
d'une même interview. Cette incapacité à fournir des
chiffres précis est due au non tenu des comptes.
Face à ces défis, diverses techniques ont
été mises en place de l'amont en aval pour atteindre des
résultats plus fiables. Ces techniques consistaient à placer
l'unité déclarante dans la meilleure aisance possible,
l'agrandissement de la taille de l'échantillon et la triangulation des
données.
23
CHAPITRE III. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES
RESULTATS
3.1.Analyse fonctionnelle de la filière
café
3.1.1. Description des acteurs de la
filière
Les principaux acteurs de la filière café dans
la zone d'étude peuvent être groupés en producteurs,
commerçants et transformateurs. Le groupe de commerçants comprend
les grossistes et les revendeurs selon qu'ils s'approvisionnent auprès
des producteurs ou grossistes. Il sied de préciser que le groupe de
consommateurs n'est pas concerné par cette étude. Le tableau 5
ci-dessous donne des éléments de profil de ces acteurs.
Tableau 5. Profil sommaire des principaux acteurs
de la filière café
|
Acteurs/ Variables
|
Producteurs
|
Commerçants
|
Transformateurs
|
|
Grossistes
|
Revendeurs
|
Torréfacteur s et
Mouleurs
|
|
Age (années)
|
60,3 #177; 14,2
|
54,5 #177; 10,1
|
45,3 #177; 10,3
|
50#177;8,91
|
|
Ancienneté (années)
|
19,6 #177; 16,2
|
21,2 #177; 11,4
|
14,4 #177; 9,6
|
16,8 #177; 7,52
|
|
Niveau d'étude (%)
|
|
|
|
|
· Primaire
|
50
|
14,3
|
21,4
|
60
|
· Secondaire
|
50
|
71,4
|
67,9
|
20
|
· Universitaire
|
-
|
14,3
|
10,7
|
20
|
Etat Matrimonial (%)
|
|
|
|
|
· Veuf
|
50
|
-
|
21,4
|
-
|
· Marié
|
50
|
100
|
71,4
|
80
|
· Divorcé
|
-
|
-
|
-
|
20
|
· Célibataire
|
-
|
-
|
7,1
|
-
|
Peuples (%)
|
|
|
|
|
· Autochtone
|
75
|
71,4
|
53,6
|
60
|
· Allochtone
|
25
|
28,6
|
46,4
|
40
|
Genre (%)
|
|
|
|
|
· Féminin
|
-
|
28,6
|
60,7
|
20
|
· Masculin
|
100
|
71,4
|
39,3
|
80
|
Motivation
|
|
|
|
|
· Choix délibéré
|
87,5
|
71,4
|
78,6
|
85,71
|
· Activité héritée
|
12,5
|
28,5
|
10,7
|
-
|
· Faute de mieux
|
|
-
|
-
|
10,7
|
14,3
|
|
3.1.1.1.Producteurs
Dans la zone sous examen, la production du café est une
activité des hommes (100%) majoritairement autochtone du milieu (75%) et
d'âges variant entre 74 et 46 ans. Ils sont équitablement
répartis entre veufs et mariés, entre le niveau d'étude
primaire et secondaire. Le
24
moins expérimenté a exploité le
caféier pendant 4 ans et le plus expérimenté en a fait
pendant 36 ans. C'est par choix délibéré qu'ils exercent
la production du café, sauf 12,5% qui ont hérité
l'activité (tableau 5).
a. Facteurs de production et entretien
La figure 8 ci-dessous présente des
éléments liés aux facteurs de production
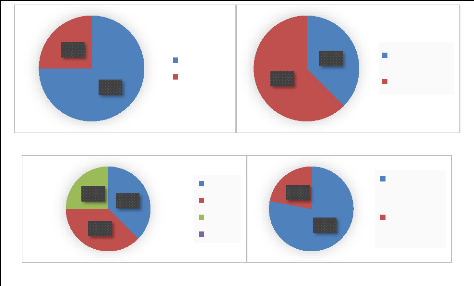
A : Mode d'acquisition foncière des producteurs B
: Taille des exploitations
C : Nombre des plants D : Utilisation de la main
d'oeuvre
25%
25%
38%
75%
37%
Ayant droit Emphytéose
35-50
450-550
980
63%
22%
78%
37%
Main
d'oeuvreFamili ale
Main d'oeuvre Exterieure
Superficie ? 0,5
Superdficie 0,5-1
Figure 8 : Eléments liés aux facteurs de
production
b. Travail d'entretien
La figure 9 ci-dessous repartit les producteurs selon le nombre
de passage d'entretien par an
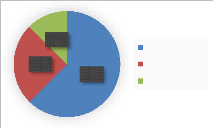
25%
13%
62%
Deux passages Un passage Aucun passaage
Figure 9 : Répartition des producteurs selon la
fréquence annuelle d'entretien
La figure 8 ci-dessus illustre le mode d'acquisition
foncière des producteurs, la taille des exploitations, le nombre des
plants et l'utilisation de la main d'oeuvre. Il en ressort que 75% des
producteurs sont des ayants-droits et 25% ont acquis la terre par
emphytéose. La taille des
25
exploitations est faible, elle est inférieure à
0,5 ha pour 37% des producteurs. Les autres producteurs emblavent une
superficie supérieure à 0,5 ha et inférieure à 1
ha. Par contre, le nombre des plants est fort diversifié, et varie entre
35 à 980. La main d'oeuvre extérieure est seulement
utilisée par 22 % de producteurs et les restes utilisent la main
d'oeuvre familiale, les femmes et les enfants, surtout en période de
récolte.
La figure 9 divise les producteurs en trois groupes. Ceux qui
entretiennent leurs exploitations deux fois l'an 62%, une fois 25% et ceux qui
n'entretiennent pas 13%.
c. Production et vente
La figure 10 ci-dessous illustre des éléments
liés à la vente des cafés par les producteurs
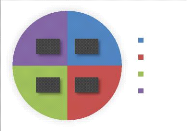
25%
25%
25%
25%
< 0,5
5,1 - 10
20,1 - 30 30
A : Répartitions des producteurs selon la
production en café rouge en Karai
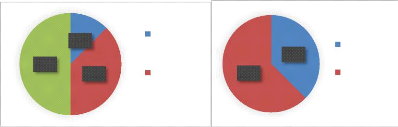
50%
12%
38%
Vente café coque
Vente café marchand
63%
37%
Vente locale
vente à Kisanganide
B : Produits livrés par les producteurs C : Lieu
de vente
Figure 10 : Eléments liés à la
Production et Vente
Cette figure 10 illustre la production en Karai (1 Karai = 17
gobelets) par saison culturale, les produits livrés et le marché
d'échange. Il en ressort que la production en café rouge varie
autour de 0,5 à 30 karai par saison culturale par producteur. Les
producteurs se répartissent en trois groupes selon les produits qu'ils
livrent au marché. La moitié livre à la fois le
café marchand et le café coque. Une autre moitié livre
soit le café marchand (38%), soit le café coque (12%). Plus de la
moitié des producteurs acheminent leurs productions au marché
urbain alors que 37,5 % des producteurs vendent localement leurs
productions.
26
3.1.1.2. Commerçants
a. Grossistes
L'activité des grossistes est partagée entre
hommes (71,4 %) et femmes (28,6 %) mariés. Les acteurs sont d'âges
variant entre 44 et 64 ans. Les trois niveaux d'étude sont
représentés : primaire (14,6 %), secondaire (71,4 %) et
universitaire (14,3 %). Ils sont majoritairement autochtones (71,4%) et d'une
grande ancienneté dans le domaine, entre 10 à 32 ans. Ils
exercent l'activité par choix délibéré (71,4%) ou
par héritage (28,4%) (tableau 5).
Les grossistes s'approvisionnent auprès des
producteurs. Les quantités sont mesurées à la balance et
aux gobelets. Il y a deux types de gobelets, l'un qui vaut 500 g et l'autre
appelé Munoko ya Tshaku vaut 750 g.
Selon leurs fonctions, les grossistes ont été
répartis en trois types : les grossistes Type 1, Type 2 et Type 3. La
figure 11 en illustre la répartition.
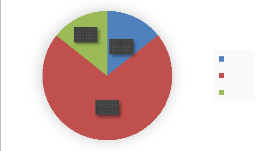
14%
72%
14%
Type 1
Type 2
Type 3
Figure 11 : Répartition des commerçants
grossistes
Le tableau 6 ci-dessous associe chaque type de grossiste à
sa principale caractéristique.
Tableau 6. Types de commerçants grossistes
|
N°
|
Typologie des grossistes
|
Abréviation
|
|
1
|
Grossistes Type 1
|
GT.1
|
|
2
|
Grossistes Type 2
|
GT.2
|
|
3
|
Grossistes Type 3
|
GT.3
|
Fonction
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
producteurs et le vendre aux revendeurs
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
producteurs et vendre le café marchand, coque ou moulu aux
consommateurs
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
producteurs et vendre le café moulu aux revendeurs
Le tableau 6 et la figure 11 ci-dessus montrent que le travail
de grossiste consiste majoritairement à acheter le café marchand
et/ou coque auprès des producteurs et vendre le café marchand
et/ou coque ou moulu aux consommateurs.
27
b. Revendeurs
Les revendeurs sont plus des femmes (60,7%) que des hommes
(39,3%) et sont d'une ancienneté entre 5 et 23 ans. Certains sont veufs
(21,4 %), mariés (71,4 %) ou célibataires (7,1 %) avec un
âge variant entre 35 à 55 ans. Ils sont majoritairement
autochtones (53,6%) et d'un niveau d'étude primaire (21,4%), secondaire
(67,9%) ou universitaire (10,7%). Ils exercent cette activité par choix
délibéré (78,6%) ou par héritage (10,7%) ou encore
par faute de mieux (10,7%) (tableau 5). Les revendeurs s'approvisionnent
majoritairement auprès des grossistes en utilisant des gobelets. Ils
sont méfiants des balances supposées être truquées.
A leur tour, ils revendent en gobelets (de volume différent que celui
des grossistes) et en boites de tomates. Comme les grossistes, les revendeurs
peuvent aussi être catégorisés selon les fonctions
accomplies. La figure 12 illustre la répartition des revendeurs : Type
1, 2, 3 et 4.
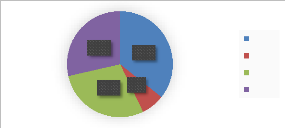
29%
28%
7%
36%
Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
Figure 12 : Répartition des commerçants
revendeurs
Le tableau 7 ci-dessous associe chaque type de revendeurs
à sa principale caractéristique.
Tableau 7. Types de commerçants Revendeurs
|
N°
|
Typologie des
revendeurs
|
Abréviation
|
|
1
|
Revendeurs Type 1
|
RT.1
|
|
2
|
Revendeurs Type 2
|
RT.2
|
|
3
|
Revendeurs Type 3
|
RT.3
|
|
4
|
Revendeurs Type 4
|
RT.4
|
Description
Acheter le café moulu auprès des grossistes et
le vendre aux consommateurs ;
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
grossistes et vendre le café moulu (après torréfaction
à la maison et mouture à l'usine torréfaction et mouture
à l'usine) ;
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
grossistes et vendre le café moulu (après torréfaction et
mouture à l'usine) ;
Acheter le café marchand et/ou coque auprès des
producteurs et vendre le café moulu aux consommateurs (après
torréfaction à l'usine ou domicile)
Le tableau 7 et la figure 12 ci-dessus montrent que les
revendeurs sont de quatre types. La majorité achète le
café moulu auprès des grossistes et le vend aux consommateurs.
28
3.1.1.3. Les transformateurs
L'activité de transformation rassemble plus d'hommes
(80%) que les femmes (20%). Les transformateurs interrogés sont
d'âges variant entre 41 et 58 ans, avec une ancienneté entre 9 et
24 ans. Ils sont mariés (80%) ou divorcés (20%) et ont à
majorité le niveau d'étude primaire (60%). Les 40% restants sont
équitablement partagés entre les niveaux secondaire et
universitaire. Ils sont majoritairement autochtones (60%) et minoritairement
(40%) allochtones. C'est par choix délibéré qu'ils
exercent la transformation du café, sauf 14,3 % qui l'exerce par faute
de mieux.
Les données recueillies nous ont permis de repartir les
transformateurs selon leurs fonctions. La figure 13 ci-dessous illustre la
répartition de transformateurs : Type 1, 2 et 3.
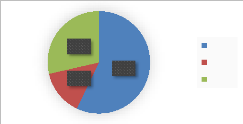
29%
14%
57%
Type 1
Type 2
Type 3
Figure 13 : Répartition des transformateurs
Le tableau 8 ci-dessous associe chaque type de transformateurs
à sa principale caractéristique.
Tableau 8. Types de transformateurs
|
N°
|
Typologie des
transformateurs
|
Abréviation
|
Description
|
|
1
|
Transformateurs Type 1
|
TT.1
|
La torréfaction : transformation du café marchand
ou coque en café torréfié
|
|
2
|
Transformateurs Type 2
|
TT.2
|
La mouture : transformation du café torréfié
en café moulu
|
|
3
|
Transformateurs Type 3
|
TT.3
|
Torréfaction et Mouture
|
La figure 13 et le tableau 8 ci-dessus illustrent que le
maillon de transformation est dominé par les torréfacteurs, TT.1.
Pour parfaire la transformation, ils sont complétés par les
mouleurs. D'autres agents assument les deux opérations.
Considérant leurs rythmes de travail, nous distinguons
les petits des grands transformateurs. Les grands transformateurs sont
installés au centre de la ville, à proximité des
dépôts des GT.1 et GT.2 où ils bénéficient
d'externalités positives. Ces transformateurs sont très peu
nombreux et ont un rythme intense de travail. A l'opposé, les petits
transformateurs sont dispersés dans tous les quartiers de la ville et
travaillent par occasion. Ce sont à majorité des revendeurs et
grossistes, possédant le matériel de torréfaction à
leurs domiciles.
Figure 14 : Etapes de transformation du café :
Opération, moyens, produits et perte
29
- Résultat sur le processus de transformation
du café dans la zone d'étude
Le système de transformation comprend le
décorticage, la torréfaction et la mouture. Il est à
préciser que juste après la récolte les baies rouges sont
séchées au soleil pendant 2 à 3 semaines et deviennent des
cafés coques ou cafés en bains prêts à être
décortiqués. Dans les zones rurales, ces cafés sont
ensuite pilés pour leur débarrasser de l'écorce externe
appelée parche ou coque. Cette opération est le
décorticage et permet d'obtenir les cafés marchands. Dans la
ville de Kisangani, le décorticage est réalisé par des
moulins mécaniques. S'ensuit alors la torréfaction,
réalisée manuellement avec le torréfacteur (vulgairement
appelé bambone). Le temps de torréfaction dépend
de la qualité recherchée. Nombreux arrêtent la
torréfaction quand le café atteint la couleur chocolat et qu'une
fumée bleue sort du torréfacteur, entre 45 à 60 minutes.
Les grains sont ensuite dégagés du torréfacteur pour le
refroidissement suivi de la mouture dans des moulins électriques. Ces
derniers sont les mêmes moulins utilisés pour la mouture de
maïs et soja, mais dont les tamis sont adaptés au diamètre
des grains de café.
D'une étape à une autre, le café perd de
poids. La figure 14 ci-dessous reprend le processus de transformation du
café et les pertes liées à chaque opération.
Café Rouge (250kg)

Séchage au soleil, perte de 55%
Café Coq ou Parche (112,5 kg)
Décorticage au mortier, pilon ou moulin
électrique, perte de 40 %
Torréfaction au torréfacteur, perte de
20,5 %
Parche, 45kg
Café Marchand (67,5kg)
Café Torréfié (53,6 kg)

Mouture au moulin électrique, perte 0%
Café Moulu, (53,6kg)
30
3.1.1.4.ONAPAC et SNCC
Anciennement appelé ONC (Office Nationale de
Café), l'ONAPAC (Office National de Produits Agricole du Congo) a pour
mission de vulgariser et d'encadrer les agriculteurs dans 21 produits
agricoles, y compris le café. De par la mission lui confiée,
l'ONAPAC serait un moteur du développent agricole dans la zone
d'étude et en RDC en général. Dans les faits, l'ONAPAC
affiche des faibles capacités à tous les niveaux. Cette structure
qui devrait accompagner les acteurs est devenue un frein majeur à cause
des taxes qu'elle prélève.
De son côté, la SNCC (Société
Nationale de Chemin de fer du Congo) est un acteur de transport. Il permet
l'évacuation de café issu de Ubundu vers la ville de Kisangani.
Les conditions de voyage sont précaires et risquées.
3.1.2. Délimitation des contours de la
filière.
Le tableau 9 ci-dessous présente les contours de la
filière café dans la zone sous examen. Tableau 9 :
Délimitation des contours de la filière
|
Activité Acteurs Fonctions Principales
Produit
Principal
|
Lieu
d'activité
|
Café marchand et coque
Café coque, marchand ou moulu
Café marchand, coque ou moulu
Bafwasende et Ubundu
Centre de Kisangani
Centre de Kisangani
Production Producteurs de
Bafwasende et Ubundu
Transformation Torréfacteurs
et mouleurs
Production
Transformation du café rouge en café moulu
Grossistes Commerce : Acheter le
café marchand et/ou coque auprès des producteurs
Commercialisation
|
Revendeurs Commerce : Acheter le
café moulu auprès des grossistes ;
|
Café moulu Centre de
Kisangani
|
Consommation Consommateurs Consommation
Café moulu La Tshopo
Le tableau 9 ci-dessus fait ressortir les différents
maillons de la filière sous examen, les acteurs, les fonctions et les
produits y afférents. Les zones des productions sont les territoires de
Bafwasende et Ubundu. La zone de transformation et de distribution est le
centre de Kisangani. La consommation est généralisée dans
toute la province de la Tshopo.
31
3.1.3. Graphe de la filière
café
La figure 15 ci-dessous illustre les flux de la filière
café depuis les lieux de production (Ubundu ou Bafwasende) jusqu'au lieu
de distribution du café moulu (Kisangani). Les lettres P, C et T sont
les différents maillons de la filière et les acteurs y
afférents. Dans les maillons C, les lettres R et G sont respectivement
les revendeurs et les grossistes. Les abrégés T.1,2, 3 et 4 sont
liés à la typologie des acteurs.

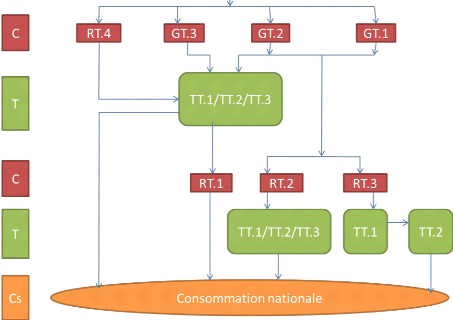
Figure 15 : Description de la filière
café en territoires de Bafwasende et Ubundu et dans la ville de
Kisangani.
32
3.1.4. Formation des prix et stratégie des
acteurs a. Formation des prix
Il est connu que dans une économie de marchés,
ce sont les dynamismes de l'offre et de la demande qui déterminent le
prix aux consommateurs. Et pour un marché approvisionné par
diverses sources, le prix est proportionnel aux variations à la hausse
ou à la baisse de l'offre du grand producteur. Les informations
récoltées auprès des acteurs et les statistiques de
l'ONAPAC et de la SNCC nous ont permis de ranger par ordre décroissant
les grands producteurs du café consommé à Kisangani. Il
s'agit de la province de l'Equateur, les territoires d'Opala, de Basoko, Kindu
et Bandundu. Dans le marché de Kisangani, les cafés des
territoires de Bafwasende et Ubundu sont très faiblement
représentés.
La faible représentation, le besoin immédiat de
liquidité et le manque d'organisation ravissent à tous les
acteurs de la filière café Bafwasende et Ubundu le pouvoir de
formation des prix. Ils sont price takers. Sur les marchés
locaux de Ubundu et de Bafwasende, le café transformé localement
est en compétition avec le café transformé à
Kisangani. Cette coexistence ne permet pas aux acteurs locaux d'être
price makers aux lieux de productions. Dans le tableau 10 ci-dessous, sont
mentionnées les variations de Prix de Vente (PV) de café en
Francs Congolais (FC) dans la Province de la Tshopo, ville de Kisangani.
Tableau 10. Variation annuelle des prix de
café
|
Période PV d'un kg du
producteur au grossiste
|
PV d'un Kg du grossiste au revendeur
|
PV d'un gobelet de café au consommateur
|
Coque Marchand Coque Marchand Moulu Moulu
Novembre-
Avril 1700 2500 2200 3000 3500 1500
|
Mai - Juillet Août-Octobre
|
2200 3000 2700 3500 4000 1800
3200 4000 3700 4500 5500 2500
|
Le tableau 10 ci-dessus montre que la crise et l'abondance de
café correspondent respectivement aux périodes
d'Août-Octobre et Novembre- Avril. La période de fortes
récoltes, appelée campagne par les acteurs, commence en Novembre
et s'étend jusqu'en Mars. La période Mai-Juillet est
alimentée par les stocks emmagasinés par les acteurs producteurs
et commerçants. La carence commence à la fin Juillet avec un pic
au mois d'Août et Septembre puis l'amélioration de la tendance
s'amorce en Octobre.
33
b. Stratégie des acteurs
Les acteurs de la filière café montent diverses
stratégies pour acquérir des meilleurs prix et/ou anticiper les
risques liés aux chutes des cours.
1. La diversification du portefeuille
Sur l'ensemble d'acteurs interrogés, 73,4% pratiquent
une autre activité régénératrice des revenus au
côté du café. Dans le maillon de la production, les acteurs
associent le café au palmier à huile. Dans le maillon de la
commercialisation, seulement 30% d'acteurs commercialisent uniquement le
café. Ce dernier est souvent accompagné du sucre, du sel, du soja
ou d'autres nombreux produits. C'est ce que les revendeurs appellent la
complémentarité des produits dans le commerce. Dans le maillon
transformation, l'équipement utilisé permet aux acteurs de se
convertir, sans efforts, en transformateurs de soja ou de maïs.
2. Le stockage de café à l'attente des
périodes de crise
La période d'offre excédentaire s'étend
de Novembre en Avril et nombreux commerçants profitent pour accumuler
des réserves à revendre dans la crise d'Août-Octobre.
Malheureusement ; la pression de la demande, le besoin immédiat de
liquidité, la défaillance des systèmes de conservation
font que rares tiennent jusqu'aux mois prévus.
3. Les achats groupés
C'est la stratégie des grossistes auprès des
producteurs obligeant ces derniers à une remise.
4. La chimie, ...très bonne mauvaise
stratégie
Les acteurs chimistes sont ceux qui trompent la vigilance des
consommateurs. En effet, c'est à l'insu des consommateurs que deux types
de cafés moulus coexistent sur le marché : le café sec et
non sec. Le café sec (le bon café) est issu du café
marchand, torréfié et moulu. Le café non sec (le mauvais
café) est issu de ce que les acteurs appellent la chimie. Plus souvent,
c'est le café coque qui est torréfié et grillé.
Pourtant 100% d'acteurs affirment être au courant des méfaits des
parches sur la santé des consommateurs et qu'il est strictement interdit
de torréfier ou moudre le café coque. Un autre cas de chimie
c'est le mélange du café coque et d'autres corps, cas du
maïs, soja et/ou noyaux de l'avocat, très bien grillés,
torréfiés et moulus.
Le service public au travers de l'ONAPAC dit être au
courant de cette mafia et ne se limite qu'à la sensibilisation des
méfaits de la parche. La répression est difficile à cause
de certains acteurs qui traitent le café à leurs domiciles. L'OCC
qui devrait mobiliser son service de police pour traquer ces cas, ne se limite
qu'à prélever les taxes.
34
3.1.5. Coordination des acteurs et cadre
réglementaire.
a. Coordination des acteurs
De façon verticale ou horizontale, il n'y a pas de
coordination proprement-dite entre les acteurs de la filière café
dans les zones sous-examen. Les données de terrain ont
révélé certains rassemblements ou mini organisations qui
ne fonctionnent que pour des besoins sociaux et non pour la structuration de la
filière. Ces regroupements sont battus sur les relations d'appartenance,
d'ancienneté et/ou de confiance. Il en résulte que chaque acteur
connait ses potentiels et réels offreurs et/ou acheteurs. Cependant,
tout acteur reste à la quête de l'offreur qui propose le plus bas
prix.
Tous les acteurs se connaissent, si pas de noms, alors de
visages. Les données récoltées ont
révélé une forme de solidarité auprès des
commerçants et transformateurs. En effet, chaque rangée de vente
ou chaque atelier de transformation a un représentant, et en cas
d'événements malheureux (deuils), la rangée ou l'atelier
se cotise pour une visite de consolation au concerné. Les
commerçants grossistes donnent des avances aux producteurs pour des
travaux pour le transport de la production et les commerçants revendeurs
achètent à crédits auprès des grossistes et
remboursent après la vente.
b. Cadre réglementaire et
politique
L'OCC, ONAPAC et DGRPT sont les organes qui font payer des
taxes, des droits et/ou des redevances.
L'ONAPAC dont les fonctions se résument en
vulgarisation de meilleures pratiques agricoles et encadrement des acteurs
(dans tous les maillons) est amorphe sur le terrain. De même pour l'OCC.
Toutes ces institutions sont rigoureuses dans le prélèvement des
taxes, que 80% de commerçants considèrent comme un frein majeur
à leur autonomisation. Par exemple, l'ONAPAC prélève par
an 65 $ par commerçant grossiste et 10$ par revendeur.
A ces institutions, ajoutons la SNCC qui est un
suppléant dans le transport. Cette institution permet aux producteurs de
dégager par voie ferrée leurs productions jusqu'en milieu urbain.
Les trains utilisés datent de l'époque coloniale et la voie
ferrée est en détérioration très avancée.
Les risques sont énormes.
35
3.2.Analyse financière de la
filière
Cette section a procédé à une analyse de
la viabilité financière des acteurs impliqués dans la
filière café robusta dans deux territoires de la Tshopo à
savoir Bafwasende et Ubundu y compris la ville de Kisangani. Les comptes
Production Exploitation (CPE) ont été présentés
puis consolidés pour dégager la valeur ajoutée
créée le long de la filière.
3.2.1. Analyse de la viabilité
financière de la filière sur les acteurs
Les outils standards d'analyse financière
dégagés par les CPE (en annexe) ont démontré que la
filière est rentable pour tous les acteurs. Le test de
rentabilité a montré que 1$ investi produit 2,5$ aux producteurs,
0,71$ aux mouleurs, 0,58 $ aux torréfacteurs et 0,2 $ aux grossistes.
3.2.2. La consolidation des CPE
L'ensemble de CPE a été agrégé
pour constituer le compte consolidé de la filière. Ce dernier a
dégagé la valeur ajoutée créée le long de la
filière. Les valeurs ajoutées moyennes et l'ensemble des acteurs
pour chaque maillon ont été considérés dans cette
consolidation. Le tableau 11 ci-dessous présente le compte
consolidé de la filière café dans la zone
d'étude
Tableau 11 : Compte Consolidé de la
filière café
|
Eléments
|
Moyenne par
acteur
|
Nombre d'acteurs
identifiés
|
Valeur Monétaire
|
|
CI Producteur
|
393000
|
10
|
3930000
|
|
CI Grossiste
|
225000000
|
8
|
1800000000
|
|
CI Revendeur
|
9728000
|
40
|
389120000
|
|
CI Torréfacteur
|
5310000
|
7
|
37170000
|
|
CI Mouleur
|
12060000
|
3
|
36180000
|
|
CI totales estimées
|
|
|
2266400000
|
|
R Producteurs
|
1400000
|
10
|
14000000
|
|
R Grossistes
|
270000000
|
8
|
2160000000
|
|
R Revendeurs
|
12600000
|
40
|
504000000
|
|
R Torréfacteurs
|
9000000
|
7
|
63000000
|
|
R Mouleurs
|
22500000
|
3
|
67500000
|
|
R totales estimées
|
315500000
|
|
2808500000
|
|
VA Producteur
|
1007000
|
10
|
10070000
|
|
VA Grossiste
|
45000000
|
8
|
360000000
|
|
VA Revendeur
|
2872000
|
40
|
114880000
|
|
VA Torréfacteur
|
3690000
|
7
|
25830000
|
|
VA Mouleur
|
10440000
|
3
|
31320000
|
|
VA Ajoutée Estimée
|
|
|
542100000
|
Le tableau 11 ci-dessus illustre les consommations
intermédiaires et les recettes pour chaque maillon de la filière.
Les différences entre ces deux grandeurs fondamentales ont permis de
36
déterminer les VA respectives. Plus de valeurs sont
créées par le maillon commercialisation, notamment les
commerçants grossistes et les revendeurs. Ensuite le maillon
transformation, respectivement les mouleurs et les torréfacteurs. Au bas
de l'échelle, les producteurs.
La figure 16 ci-dessous illustre la répartition de la VA
entre les acteurs de la filière.
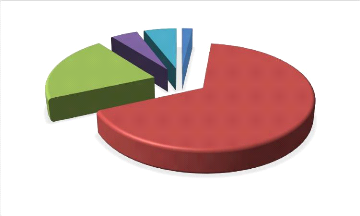
Revendeur
21%
Torréfacteur
5%
Mouleur
6%
Producteur
2%
Grossiste
66%
Figure 16 : Répartition de la valeur
ajoutée entre les acteurs
La figure 16 ci-dessus vient compléter les
résultats présentés dans le tableau 11. Il montre que 66%
de la richesse créée est l'oeuvre des commerçants
grossistes. Les autres acteurs de la filière se répartissent 34%
respectivement 21, 6, 5 et 2 % pour les revendeurs, les mouleurs, les
torréfacteurs et enfin les producteurs. Les gros investissements des
grossistes expliquent cette grande création de richesse. Le nombre
élevé des revendeurs par rapport aux autres acteurs explique la
valeur élevée de la richesse créée.
L'arriération des producteurs et de leurs techniques expliquent leur
faible contribution à la création des valeurs dans la
filière.
37
3.3.Présentation de la matrice AFOM
Le tableau 12 ci -dessous présente le diagnostic interne
et externe de la filière café dans la zone sous examen.
Tableau 12 : Présentation de la matrice
AFOM
|
|
LES POSITIFS
|
LES NEGATIFS
|
|
|
|
|
LES ATOUTS
|
LES FAIBLESSES
|
|
DIAGNOSTIC INTERNE
|
1.
|
Conditions agroécologiques favorables à la
culture de café robusta ;
|
1. Abandon des anciennes plantations, faible
production,
vieillissement des producteurs et défectuosité
des
|
2.
3.
|
Demande locale et extérieure en croissance,
disponibilité des terres et de la main d'oeuvre; Position
stratégique de Bafwasende à la
|
routes ;
2. Pénurie électrique,
tracasseries administratives,
inexistence des microcrédits,
microfinances et des
|
|
Nationale n°04, la présence de la SNCC dans
|
financements ;
|
|
Ubundu, de l'ONAPAC et des anciennes
|
3. Faible marketing pour le produit, manque
des
|
|
plantations nécessitant des faibles coûts de
|
coordinations entre les acteurs de la filière et la
vente
|
|
relance et sans déforestation ;
|
du café mélangés aux impuretés ;
|
|
4.
|
Possibilités de l'association culturale et de
l'agroforesterie ;
|
4. Existence des acteurs aux double ou triple
fonctions,
c'est le cas des grossistes - revendeurs, des
|
|
5.
|
Le caractère pérenne du café et sa
facilité de
|
revendeurs-transformateurs et des grossistes-
|
|
conservation. La pérennité est un
élément de
|
transformateurs-revendeurs ;
|
|
sédentarisation des agriculteurs et assure des
|
5. Très faible capacité technique
des producteurs, de
|
|
retours financiers réguliers. La facilité de
|
l'ONAPAC, de la SNCC et de tous les autres acteurs
|
|
stockage est un des éléments régulateurs
de
|
de la chaine. Inexistence des dépôts stabilisateurs
ou
|
|
l'offre et de la demande.
|
des usines modernes de transformation du café et de son
conditionnement.
|
|
|
LES OPPORTUNITES
|
LES MENACES
|
|
DIAGNOSTIC EXTERNE
|
1.
|
Situation sécuritaire stable et mise au point de
|
1. Fluctuations des cours internationaux,
instabilité de la
|
|
variétés résistantes à la
tracheomychose ;
|
monnaie nationale, développement des bioagresseurs
|
|
2.
|
La majoration du budget national, la bonne
|
et faible capacité de gestion des risques ;
|
|
volonté du pouvoir et des investisseurs privés
|
2. Très faible allocation du budget national au
secteur
|
|
à relancer la culture du café ;
|
agricole, faible capacité de l'INERA et ONAPAC
|
|
|
Reprise de la conscience des agriculteurs, L'ouverture au
marché extérieur où il y a une
|
dans la production des semences et dans le formation et
encadrement des paysans ;
|
|
|
grande demande croissante du café, surtout le
café Bio ;
|
3. Défectuosité de la route
Ubundu-Kisangani,
tracasseries administratives et multiplicité des taxes
|
|
4.
|
La résistance du café robusta aux effets du
|
non réglementaires ;
|
|
changement climatique et la recherche des
|
4. Guerre commerciale basée sur la
qualité des produits
|
|
puits de dioxyde de carbone ;
|
sur le marché mondial ;
|
|
5.
|
Possibilité d'accompagnement par l'INERA
|
5. Réticence de la population aux
activités caféières et
|
|
Yangambi et ONAPAC dans la ville de
|
son accoutumance au café importé.
|
|
Kisangani.
|
|
38
3.4.Formulation des actions stratégiques
3.4.1. Couplage de la matrice AFOM
Le tableau 13 ci-dessous confronte les diagnostics internes et
externe de la matrice AFOM Tableau 13 : Couplage de base de la
matrice AFOM
|
LES CHANCES
|
LES DEFITS
|
|
Comment exploiter les atouts pour saisir les
|
Comment combler les faiblesses en profitant
des
|
|
opportunités ?
|
opportunités ?
|
|
|
|
1. Structuration dans des coopératives et renforcement
des partenariats d'appui avec les
structures
compétentes (IFA et INERA Yangambi, ONAPAC, SNCC et des
partenaires de la RDC) ;
2. Intensification de l'agriculture sur l'unité de terre
;
3. Revitalisation des anciennes plantations ;
4. Mobilisation des jeunes à intégrer la
filière ;
5. Se faire de l'auto marketing pour se positionner en une
bonne affaire à la fois pour le secteur privé que le secteur
public : informer des avantages d'investir dans le café et ses effets
d'entrainements.
|
1. Investissement dans le capital humain : former
et
renforcer les compétences des producteurs et des transformateurs
sur leurs tâches respectives ;
2. Aménagement de la route Ubundu-Kisangani et
appui
technique à la SNCC, ONAPAC, IFA et INERA Yangambi ;
3. Amélioration des rendements et de la qualité de
la
récolte ;
- Installation et restauration des plantations de
café
avec des semences à hauts rendements et résistantes ;
- Adoption des innovations culturales et
d'équipements
récents ;
- Accès aux financements, aux microcrédits
ou
microfinances
4. Amélioration des processus de
traitement,
retraitement de torréfaction et de mouture ;
- Adoption des innovations et
d'équipements
récents ;
- Réduire la dépendance vis-à-vis de la
SNEL
5. Amélioration des circuits de commercialisation ;
- Inciter à la consommation locale du café
- Ouverture au marché extérieur ;
6. Attirer l'attention des investisseurs et se positionner
en
axes majeur pour le développement et réduction de la
pauvreté ;
Dans le strict respect des principes écologiques
|
|
|
LES CONFLITS
Comment utiliser les atouts pour combattre
les
menaces ?
|
LES DANGERS
Comment protéger les faiblesses des menaces
?
|
|
1. Structuration et mise en place d'un système
d'autofinancement ;
2. Mobilisation de la demande locale ;
3. Mobilisation pour la production du café bio,
très compétitif ;
4. Diffusion des effets économiques, sociaux
et
environnementaux du café et la nécessité de la
relance ;
5. Appui à la SNCC comme voie alternative aux Routes
;
|
1. Maintien de la filière à l'état non
structuré ;
2. Promotion du chacun pour soi et méfiance
vis-à-vis
des institutions publiques ;
3. Maintien des pratiques et les outils rudimentaires ;
4. Promotion de l'autarcie (limitation à
l'ouverture
extérieure et réfraction des innovations) ;
Limitation de l'auto-marketing.
|
39
3.4.2. Formulation des axes stratégiques
Les axes stratégiques pour la relance de la filière
café sont repris dans le tableau 14 ci-dessous
Tableau 14 : Axes stratégiques pour la relance
de la filière café
|
Gouvernance et Cadre
politique
|
1.
2.
3.
|
Reconnaissance du potentiel du café dans la
résolution des défis sociaux, économiques et
environnementaux ;
Appuis techniques aux institutions publiques, acteurs directs ou
indirects, de la filière café : ONAPAC, SNCC, IFA et INERA
Yangambi :
- Production et diffusion des semences améliorées,
productives et adaptées ;
- Vulgarisation des techniques efficientes ;
- Instaurer un système de control minutieux auprès
des commerçants pour limiter la
fraude (vente des cafés impurs sur le marché de
Kisangani) ; Amélioration du climat des affaires et mobilisation des
investisseurs privés :
|
|
- Résoudre les défis liés à
l'électricité et au réseau routier Kisangani-Ubundu ;
|
|
- Limiter le prélèvement fiscal à un minimum
acceptable ;
|
|
- Favoriser l'accès aux financements, microcrédits
et microfinances ;
|
|
- Faciliter l'accès au foncier
|
|
Commercialisation et Consommation
|
1.
|
Organisation des commerçants pour faire face à la
volatilité des prix ;
|
|
Promotion de la consommation du café local. Ceci se fera
par marketing, information sur le café et amélioration de la
visibilité et attractivité du produit.
|
|
Certification et labellisation du café produit localement
pour plus de crédit au niveau local et international ;
|
|
Mise en place de la technique commerciale : Pour chaque prix,
une quantité. Cette quantité doit demeurer le café pur,
non mélangé.
|
|
|
Instaurer des points de vente dans les zones reculées ;
|
|
|
Transformation
|
1.
|
Investissement dans la ressource humaine et dans
l'équipement ;
|
|
- Utilisation des équipements récents permettant
des transformations et conditionnement
conformes aux normes internationales. Ceci pourra
améliorer la qualité du café transformé et sa
compétitivité sur le marché locale et international ;
|
|
Rajeunissement des acteurs,
|
|
Création de nouveaux produits dérivés du
café ;
|
|
- Valorisation des déchets de chaque étape
|
|
- Stratification des qualités en raison de la
stratification des revenus des acheteurs,
Promouvoir une transformation bio
|
Production
|
5.
|
Investissement dans la ressource humaine et dans
l'équipement
|
|
- Formation des producteurs de café aux bonnes pratiques
agricoles (taille, sarclage,
récolte sélective, amélioration du
séchage et du stockage) ;
|
|
Structuration des producteurs par création des
associations, des coopératives.
|
|
- Renforcement de la coordination entre les producteurs ;
|
|
- Revitalisation des anciennes plantations dans un
système agroforestier ;
|
|
- Installation des champs collectifs en plus des champs
individuels ;
|
|
- Création des points de collecte, entreposage et de
vente des cafés en price makers ;
|
|
- Accompagnement par les services publics : ONAPAC, SNCC, IFA,
INERA/Ybi ;
|
|
- Mettre en place un système d'autofinancement
|
|
|
Promouvoir l'agriculture bio
|
|
40
CHAPITRE IV. DISCUSSION DES RESULTATS
4.1. Analyse fonctionnelle de la filière
a. La filière café robusta est
abandonnée
Dans la Tshopo, notamment dans les territoires de Bafwasende
et Ubundu, y compris la ville de Kisangani, nos résultats ont
révélé l'absence d'organisation de la filière
café de l'amont en aval et l'inexistence d'appui privé ou public.
Les vestiges des plantations sont encore visibles et la nature y reprend
progressivement ses droits, soit elles sont reconverties en champs des produits
vivriers. Des villages jusqu'à la grande ville de Kisangani, ce sont des
techniques rudimentaires qui sont d'application. Ces techniques
réduisent la qualité du café vendu aux et ramènent
à nulle sa compétitivité à l'échelle
nationale, régionale ou internationale.
Les tentatives d'organisation de la filière par la
création de l'Association des Vendeurs de Café de la Tshopo ont
été entreprises, malheureusement dissoutes sans atteindre le but.
Ainsi, les acteurs vivent dans de petits groupes battus sur les relations
d'appartenance, d'ancienneté et/ou de confiance. Mais dans la
globalité, tout acteur vit dans le chacun pour soi.
Ces éléments confirment notre première
hypothèse qui postulait que la filière café est dans un
état d'abandon. Les productions sont faibles, les techniques
utilisées sont rudimentaires, les acteurs ne sont pas organisés
et ne bénéficient d'aucun soutien public ou
privé.
Ces résultats corroborent avec ceux trouvés dans
la Province du Kongo Centrale (Manfroy, 2021). En effet, cette
étudiante de Gembloux avait abordé la chaine de valeur
café autour de la réserve de Biosphère de la Luki dans les
perspectives de la relance ; elle constata qu'il n'existe quasiment aucune
coordination entre les acteurs, que ce soit de façon verticale ou
horizontale, tout acteur se débrouille comme il peut.
Les résultats du Ministère de l'agriculture
(2011), élucident que la désorganisation de la
filière café est un cas généralisé sur le
territoire national. C'était à la suite des diagnostics
participatifs de la filière café dans toutes les provinces
productrices que cette triste réalité fut dégagée.
Cette désorganisation, est-elle spécifique à la
filière café ou généralisée aux cultures
pérennes ? Les résultats de De Roover (2022) et
Ibadan (2021) donnent des précisions.
De Roover (2022) avait, grâce à
la méthode Value Chain Analysis for development, abordé
la chaine de valeur hévéa, dans la Province de Sankuru, en vue de
la relance. Les conclusions sont les mêmes, la filière est
délaissée, les productions sont faibles et les acteurs vivent
l'autarcie.
41
L'étude de Ibandan (2021) conclut le
débat. Ce chercheur a analysé la place des cultures
pérennes dans l'agriculture. Cas spécifique du Kwango,
généralisé pour la RDC. Les mêmes observations
refont surface ; une désorganisation des filières des cultures
pérennes accompagnées d'une perte de bien-être : les
cultures pérennes, qui faisaient la fortune des villageois, des
enseignants et des fonctionnaires, ne représentent plus grand-chose. Les
plantations qui permettaient d'assurer une bonne éducation à la
progéniture et à la relève de l'économie sont
actuellement enherbées.
b. Les causes intrinsèques et
extrinsèques de l'arriération de la caféiculture
L'état actuel de la filière café est la
résultante de diverses causes. Certaines d'ordre interne et d'autres
d'ordre généralisé. Nombreux auteurs, cas de
Lebailly et al., (2014) corroborent que la
désorganisation du secteur agricole, et par conséquent des
filières des cultures pérennes, a commencé avec la
politique de Zaïrianisation de 1973. En effet, le départ des colons
et d'autres investisseurs poids lourds a réduit les
débouchés de ces cultures. La mise en place du Programme
d'Ajustement Structurel (PAS) vers les années 1983, l'effondrement des
cours mondiaux vers 1996, la guerre de délibération de1996-2001
ont rendu agonisantes les chaines de valeurs agricoles en RDC (O.I.C,
2004 ; Rubabura et al.,2009 ; ITC,2011)
Dans la Tshopo, ces éléments ont
précipité le départ de grandes entreprises du café
de l'époque. Les principales entreprises qui ont fermé les portes
sont : Borremans, NAHV, Doraes J. à Kisangani, Marques M. à
Ubundu, anciennement appelé Ponthierville, Smet & frères
à Bafwasende, Monteiro and Lookens à Malili, (Anon,
1943). Finalement, l'épidémie de la tracheomychose a
forcé les agriculteurs à abandonner ou à reconvertir leurs
champs de café en autres cultures (Ministère de
l'agriculture, 2011).
A Kisangani, La transformation du café est une
activité qui procure des retours financiers significatifs, mais n'attire
les jeunes à cause des conditions qu'elle exige. Passez une
journée manipulant le feu, inhalant des quantités de
fumées et déployant assez d'énergie physique, ça
semble être trop dispendieux que l'argent que procure cette
activité, disait un torréfacteur. Pour rester performant, faut
manger de la nourriture à soupe, mais tôt au tard, nous
sommes victimes des maladies de coeur, ajoutait ledit torréfacteur.
Les commerçants, sont les plus rusés de la
filière. L'application de la chimie comme technique de maximisation des
profits constitue un danger énorme qui rend hypothétique l'avenir
de cette filière. Tromper la vigilance du consommateur, en lui vendant
des impuretés sous prétexte du
42
café, c'est gagner à l'immédiat mais
perdre dans le court, moyen et long terme. Précipiter la perte de
confiance des consommateurs, c'est précipiter la chute de la
filière.
Dans les territoires de Ubundu et de Bafwasende, un autre
frein à la production de café est d'ordre anthropologique. De par
leur culture, les populations de ces deux territoires sont habituées
à l'argent facile issu de la pêche et de l'exploitation
minière. A cet aspect, s'ajoute la pro pauvreté, mentale et
matérielle, de ces populations rurales. Il en résulte que
demander à un rural de ces deux territoires d'investir aujourd'hui pour
récolter après 5 ans, c'est comme trop demander. La
préférence pour le présent a atteint son paroxysme de
sorte que l'adage « Manger, buvez car demain nous mourrons »
est devenu célèbre leitmotiv pour toutes les
tranches d'âges.
c. La filière nécessite une relance
urgente et stratégique
Au regard du potentiel agroécologique du pays, la
nécessité d'un développement vivable, viable et
équitable, plusieurs auteurs réclament avec insistance la relance
urgente de la filière café (Dubé, 2012 ; Lebailly
et al.,2014 ; Ibandan, 2021 ; Manfroy,2021). Le gouvernement
a aussi marqué son implication par l'élaboration d'un plan
stratégique de relance depuis 2011. La mise en oeuvre reste
hypothétique comme bien des projets du gouvernement congolais.
Les investisseurs privés devraient s'impliquer et les
acteurs se structurer. Dans les territoires de Bafwasende et Ubundu, des
incitants économiques sont visibles, mais les incitants organisationnels
et institutionnels sont absents. La relance doit relever ces défis sans
oublier d'intégrer les questions culturelles comme
évoquées ci-haut. Les avantages de la culture de café
devraient être clairement démontrés, tout d'abord aux
leaders d'opinion de ces zones.
4.2. Analyse financière de la filière
a. L'impact financier de la filière est positif
sur tous les agents de la filière
L'élaboration des CPE des acteurs de la filière
café a montré la viabilité financière de la
filière sur tous les acteurs. Ces retours financiers contribuent
à l'amélioration des conditions socio-économiques.
L'élaboration du compte consolidé de la filière a
dégagé une valeur ajoutée annuelle de 271 050 $,
distribuée entre producteurs, torréfacteurs, mouleurs, grossistes
et revendeurs. Les commerçants dégagent 87% (notamment 66% par
les grossistes et 21% par les revendeurs) de cette valeur ajoutée,
suivie des transformateurs, 11 % (5% pour les transformateurs et 6% pour les
mouleurs) et finalement les producteurs, 2%. Ces
éléments confirment notre deuxième hypothèse qui
postulait que l'impact financier de la filière est positif sur les
parties prenantes.
43
Manfroy (2021) est arrivé aux
résultats qu'on peut comparer aux nôtres. Elle a aussi
démontré que la filière café est rentable pour tous
les acteurs de la filière. La valeur ajoutée totale
dégagée par la filière de 156 721, 65 $. Cette valeur
ajoutée est repartie entre producteur (30%), commerçants (34%),
les transformateurs (33%) et le 3% restant est à l'Etat.
A Ubundu et Bafwasende, les faibles productivités et
faibles investissements des producteurs expliquent cette faible valeur
ajoutée. L'autre explication est la vente des produits au bord des
champs à des faibles prix. La grande valeur ajoutée des
grossistes s'explique par leurs faibles prix d'achats auprès des
producteurs et d'une marge brute de 1000 FC par Kilo à la vente.
Ensuite, les grossistes de Kisangani ont plusieurs sources d'approvisionnement
et ont monté plusieurs stratégies pour maximiser les
bénéfices (achats groupés, stockage des produits en
attente de la période de crise, la chimie, ...).
A ce niveau, la légère différence avec
les résultats de Manfroy (2021) s'explique. Dans sa
zone d'étude, le Kongo central, la production locale suffit pour
alimenter la consommation intérieure, avec un surplus exporté.
b. Et si nous comparons sa rentabilité à
celle des autres filières ?
Le tableau 15 ci-dessous confronte nos résultats de la
rentabilité financière de la filière café à
ceux de la Fondation Konrad Adenauer (2017) sur les
filières pêche et Riz dans la province de la Tshopo. Nous
présentons les valeurs du RNE suivies en parenthèses de celles
des tests de rentabilité exprimées en pourcentage. La surface
moyenne d'un exploitant de riz est de 1 ha et pour le café 0,5 ha. Le
RNE des producteurs de café ci-dessous est d'une récolte
l'année alors que celui des producteurs de riz est de deux fois. Les RNE
des pêcheurs et pour les autres acteurs de café et riz sont
mensuels. Les valeurs de transformateurs sont les moyennes de mouleurs et
torréfacteurs.
Tableau 15 : Comparaison des RNE des acteurs
filières café, Riz et Pêche
|
Acteurs
|
Résultat Net d'exploitation en FC
|
|
|
RIZ
|
CAFE
|
Pêche
|
|
Producteur
|
166 000(124)
|
1007000(354)
|
199291 (132)
|
|
Transformateur
|
858500 FC (258)
|
1077458,33(164,8)
|
-
|
|
Grossiste
|
1610000 (126)
|
3721872,67 (120)
|
682000 (174)
|
|
Détaillant dans le marché de
|
376300 (121)
|
227773,14 (128)
|
603200 (122)
|
|
Kisangani
|
|
|
|
44
Les charges requises pour chaque activité, la vitesse
d'écoulement des produits, le temps nécessaire à la
réalisation de l'activité et les possibilités de
conservation sont des éléments clés pour nuancer les
rentabilités de ces filières.
Comparant les tests de rentabilité à la hauteur
de bénéfice, nous remarquons que le commerce de café est
rentable, mais exige des grands investissements. Une grande vitesse
d'écoulement produit d'effet cumulé sur le bénéfice
mais nécessite des investissements ou réinvestissements
importants. Par contre, une faible vitesse d'écoulement, peut procurer
des retours d'investissements importants si le bénéfice unitaire
est significatif. La pêche est aussi heurtée au défi de la
conservation surtout dans un milieu comme Kisangani où
l'électricité est un réel défi. Cette incertitude
explique la réticence des grossistes de cette filière face
à des forts investissements. Pour les filières
considérées, c'est le maillon de transformation qui est
apparemment le plus rémunérateur. Pour un investissement de 1$,
un rizier gagne 1,58 et un torréfacteur 0,63. Ceci s'explique
principalement par la réduction de temps de l'activité, des
consommations intermédiaires. Et à ce niveau, il y a aussi
beaucoup d'externalités non externalisées (bruit sonore pour le
riz, pollution et bruit sonore pour le café).
4.3. L'analyse par matrice AFOM
Il y a de bonnes perspectives de développement
de la filière café robusta dans la zone
d'étude
L'environnent n'est pas un ensemble de silos fermés,
mais une toile tissée où tout est lié. L'interconnexion
des activités économiques explique la nécessité de
confronter notre matrice AFOM à celles des autres.
Dans le plan stratégique de relance de la
filière café (Ministère de l'agriculture, 2011),
une matrice AFOM y est présentée, mais celle-ci
présente un caractère national. De sa part, Manfroy
(2021) a présenté une matrice dans les conditions de la
Province de Kongo-Central, notamment dans et autour de la réserve de la
Luki.
Pour notre filière, la somme atouts-opportunités
absorbe celle de faiblesses-menaces. En effet les vastes superficies de
Bafwasente et de Ubundu, situées dans la zone intertropicale,
(Omasombo et al., 2017) confèrent à ces
deux territoires des avantages comparatifs pour accroitre la production du
café. Ce sont ces éléments qui donnent l'avantage au
Brésil, le premier producteur mondial du café (Basic,
2018). Les opportunités laissent entrevoir une lumière
au bout du tunnel, et rassurent tous les acteurs de cette filière.
L'accroissement de la demande et éventuellement des prix (Tegera
et al., 2014) l'engagement du secteur public et privé
dans la relance ne cessent de nourrir d'espoir. Les menaces et les faiblesses,
étant d'ores
45
et déjà identifiées, deviennent
surmontables si des mesures de capitalisation des atouts et opportunités
sont mises en oeuvre. Ces éléments confirment notre
troisième hypothèse qui postulait qu'il y a de bonnes
perspectives de développement de la filière café dans les
territoires sous examen.
4.4. Formulation des axes
stratégiques
Les actions qui s'exigent sont d'ordres
technico-organisationnels et institutionnels en
concert avec les ODD
Les actions stratégiques formulées à
l'issu du couplage de la matrice AFOM restent valides pour nombreuses
filières agricoles. Lebailly et al., (2014) ; Ibandan
(2021) adhèrent au couplage de notre matrice AFOM qui
définit trois principaux défis à relever pour une relance
durable). Relever ces défis c'est mener des actions sur le plan
technique par investissement dans les outils récents et dans le capital
humain, c'est structurer les acteurs de la filière et appuyer les
institutions publiques dans l'exercice de leurs fonctions. De toutes les
actions à mener, la dimension anthropologique reste un facteur
prégnant pour la réussite de la relance. Il faudrait semer et
entretenir dans l'homme de Bafwasende et Ubundu le goût de l'agriculture.
Ces éléments confirment partiellement notre
quatrième hypothèse qui postulait que les actions
stratégiques pour relancer et assurer la durabilité de la
filière café sont d'ordres technico-financiers, organisationnels
et institutionnels en concert avec les ODD. En effet, l'aspect
anthropologique n'était pas postulé.
La mise en application devrait être intelligente pour ne
pas aboutir aux résultats décevants. Les responsabilités
sont partagées entre parties prenantes
Les éléments évoqués dans ce
chapitre prouvent que dans les territoires de Bafwasende et Ubundu il y a des
incitants économiques mais non organisationnels. L'hypothèse
générale de l'étude est confirmée.
46
CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS
L'objectif assigné a été de contribuer
à la stratégie de relance de la filière café dans
la province de la Tshopo, au travers les territoires de Bafwasende et de
Ubundu. L'état actuel de la filière a été
étudié par analyses fonctionnelle et financière. La
matrice AFOM a été dressée et couplée. Finalement
des axes stratégiques ont été formulés en concert
avec les ODD.
L'analyse fonctionnelle nous a permis de dresser les contours
de cette filière. En effet, cette filière comprend trois acteurs
directs (producteurs, les commerçants et les torréfacteurs) et
deux acteurs indirects (ONAPAC et SNCC). Les consommateurs n'ont pas
été concernés par l'étude. Le diagnostic technique
a montré l'arriération de la filière café à
travers l'utilisation des équipements traditionnels à très
faible performance. Tous ces acteurs de la filière sont de price
takers et ceci s'explique par leurs faibles productivités. Entre
eux, ils développent diverses stratégies pour acquérir des
meilleurs prix et anticiper les risques liés aux variations des cours.
La diversification du portefeuille, les achats groupés, le stockage de
café à l'attente des meilleurs prix et la chimie, sont les
principales stratégies. Cette dernière, qualifiée de
chimie par les acteurs, consiste à tromper la vigilance des
consommateurs à leurs vendant des cafés mélangés
aux impuretés. C'est la mauvaise bonne stratégie.
L'analyse financière a consisté à
évaluer la viabilité financière de la filière. Les
comptes production-exploitation ont montré que la filière est
rentable pour tous les acteurs. Le compte consolidé a
évalué à 271 050$ la valeur ajoutée totale annuelle
avec une inégale répartition entre les acteurs. A lui seul, le
maillon des commerçants représente 87% de cette valeur.
Les bonnes conditions éco-climatiques et
édaphiques associées à l'amélioration du
marché du café sont les principaux atouts -opportunités.
Par contre le grand défi culturel exprimé par la réticence
de la population aux activités caféières, la grande
compétitivité sur le marché international et le mauvais
climat local des affaires sont les faiblesses-menaces. Pour la relance efficace
et efficiente de la filière, des actions stratégiques ont
été formulées pour l'ensemble des acteurs de la
filière. Celles-ci montrent que l'investissement dans les ressources
humaines et matérielles via les institutions privées ou
publiques, est la clé.
Ces résultats montrent un réel potentiel de
croissance de la filière café dans ces régions. La relance
de la filière café peut contribuer à l'amélioration
des indicateurs socio-économiques de ces zones et la
sédentarisation des communautés. Des grands efforts sont à
fournir pour maximiser les atouts et capitaliser les opportunités.
47
D'autres informations sont nécessaires pour arriver
à une relance qui atteint ses objectifs sociaux, économiques et
environnementaux. Nous suggérons donc aux futurs chercheurs d'aborder
ces quatre investigations :
1. La détermination des pôles d'approvisionnement
du café dans la ville de Kisangani ;
2. L'évaluation de la consommation du café local
dans la ville de Kisangani ;
3. L'analyse qualitative de café vendu dans la ville
de Kisangani et les conditions d'intégration du marché local aux
marchés nationaux, régionaux et Internationaux ;
4. L'analyse prédictive des effets induits de la
relance de la filière café sur l'environnement et le mode vie des
communautés locales.
48
BIBLIOGRAPHIE
Abdellaoui, O. (2011). L'analyse Stratégique SWOT et
L'entrepreneuriat : l'importance, les Impacts.
Absil, G. (2011). Analyse SWOT. Un outil d'analyse et d'aide
à la décision. APES-ULg
Adepoju,A.F .(2017). Coffee : botany, distribution, diversity,
chemical composition and its management. IOSR journal of Agriculture and
veterinary science.
ADRASS. (2020). Tableaux synoptiques. Estimation de population de
la Tshopo et de Kisangani
AFD. (2008). Café : petits producteurs, grands
marchés.
Allred, F., Yackley, K., & Vanamala, J. (2009).Trigonelline
is a novel phytoestrogen in coffee beans. J Nutr. 139 : 1833-8.
ANAPI. (2019). Investir dans le secteur agricole en RDC.
Kinshasa
Anon, J. (1943). Firm established in Belgian Congo in
Belgian Congo and United States of America Directory, 1943, pp.
81-91
Baeumlin, G. (2013). Évaluation des besoins : Groupements
de Ziralo et Buzi (Kalehe), Bulletin d'information Ziralo et Buzi-acted,
Sud-Kivu
Basic. (2018). Café : la success story qui cache la crise.
Etude sur la durabilité de la filière café. Rapport de
recherche
Benmedjahed, A.(2017). Effet de la consommation du café
sur le profile lipidique chez les hommes. Mémoire de fin d'étude
pour l'obtention du diplôme de master en Nutrition nutrition et
santé, Université de Abou Bekr Belkaïd-Tlemcen.
Bockel, L., & Tallec, F. (2005). L'approche filière :
Analyse financière.
Bolakonga, B. (2013). Influence de l'enclavement sur le
développement rural (cas du territoire d'Opala, district de la Tshopo en
RDC). Thèse de doctorat, Université de Liège, Gembloux
Agro-Bio Tech.
49
Bouden, H., & Kadri, A. (2019). Contrôle de
qualité du café et du safran. Mémoire de fin
d'étude pour l'obtention du diplôme de master en chimie des
produits naturels. Université de Blida.
Boulo, M. (2013). Comité Français du
café.
Champéraux, G. (1991). Manuel du planteur de café
Laotien, Département du Centre de Coopération Internationale de
la Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD). France
Chatel,B., & Gayi, S. (2016), Le Café,
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
CENUCED, Genève
Chetioui,F.(2020). Contribution à l'étude
qualitative des cafés de consommations commerciales dans Côte
occidentale du Lac Kivu, Est de la RD Congo, International Journal of
Innovation and Scientific
Crowne, D., & Marlowe, D. (1960). A new scale of social
desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology,
24(4), 349-354.
CSA. (2013). L'approche filière : conceptions,
avantages et risques pour l'agriculture familiale. Rapport du séminaire
international.
Davis, A.P., Chadburn,H.,
Moat,J.,O'Sullivan,R.,Hargreaves,S.,& Nic Lughadha,E. (2019). High
extinction risk for wild coffee species and implication for coffee sector
sustainability.Sci.Adv
De Roover, E. (2021). Analyse de la chaîne de valeur
hévéa selon la méthode VCA4D, dans les territoires de
Lodja et Lomela, province du Sankuru, RDC, en vue de la relance de la
filière. Mémoire de Master, Université de Liège.
Dubé, P. (2012I). Le café robusta : un potentiel
stratégique pour la RDC
Epon Eboa, C., Snoeck,D., Konaté,Z., Kassin K.,
Camara,M., Legnaté, H., Konan A., Chérif,M.,& Koné,D.
(2019), Characterization of soil fertility in Coffee (Coffea spp.) production
areas in Ivory Cost, Research Journal of Agriculture and Forestry Sciences, 7
(2) : 15-24 pp.
50
FAO. (1997). Guide pratique de l'approche filière. Le
cas de l'approvisionnement et de la distribution des produits alimentaires dans
les villes.
Folmer,B.(2017). The craft and sciences of coffee. Elsevier
l.125 London Wall, London EY 6AS, United Kingdom
Fondation Konrad Adenauer Stiftung.(2017). Les filières
agricoles en Républiques Démocratiques du Congo : Maïs, riz,
bananes plantains et pêche.
Vuillod, F., & Vuillod, S.(2005) . Livre blanc de l'analyse
stratégique SWOT.
Guyhaler,P.( 1988). Le café : les effets
bénéfiques et néfastes sur la santé. Thèse
de doctorat en pharmaceutiques, Université de Lorraine.
I.C.O. (2011). Letter from the executive director. coffee market
report
Ibandan, K.P. (2021). La place des cultures pérennes dans
l'agriculture du Kwango en RD Congo: contribution à une stratégie
de relance agricole dans Le développement agricole et pastoral au Kwango
en RD Congo, The BookEdition,
INS. (2021). Annuaire statistique de la RDC 2020.
José Alfredo, H.P. (2002). Etude de la torréfaction
: modélisation et détermination du degré de
torréfaction du café en temps réel. Thèse de
doctorat. École nationale supérieur des industries
agroalimentaires. Massy
Kang,Y.,& Khan, S. (2009), Climate change impacts on crop
yield, crop water productivity and food security, Progress in natural science,
Vol. 19: 1665-1674
Kaplinsky, R., & Morris, M. (2000). A handbook for value
chain research. Ottawa
Khalid.K. (2010). Le café : Marché et tendances.
Revue de la filière agroalimentaire. Food Magazine. Région
d'ELOUED. (Mémoire de Master). Université Echahid Hamma Lakhdar.
Eloued
Laderach P., Jarvis A., Ramírez, J., & Fisher J.
(2008). Predictions of land use changes under progressive climate change in
coffee growing regions of the AdapCCproject : Final report. Centre
International d'Agriculture Tropicale (CIAT).
51
Lebailly, P.,Michel, B.,& Ntoto, M. (2014). Quel
développement agricole pour la République Démocratique du
Congo ?
Lécolier, A. (2006). Caractérisation de certains
impacts de la mutation Laurina chez Coffea arabica L. aux niveaux
histo-morphologique et moléculaire. Thèse. Université de
la Réunion-CIRAD.
Lescuyer,G., Boutinot.L., Goglio ,P., & Bassanaga, S. (2020).
Analyse de la chaine de valeur du cacao au Cameroun.
Manfroy, S. (2021). Analyse de la chaîne de valeur
café en République démocratique du Congo selon la
méthode VCA4D : Cas de la Réserve de Biosphère de Luki.
Mémoire de Master, Université de Liège.
MAPAQ.(2018). Cerisiers Nains Rustiques : Guides des traitements
phytosanitaires. Quebec
Michelle, J.,Martine, S., & Daniel, D.(2003). Terres de
café. France : Editions Quae. Ed1, p 120.
Ministère de l'agriculture. (2010). Stratégie
sectorielle de l'agriculture et du développement rural. RDC
Ministère de l'agriculture. (2011). Stratégie de
relance de la filière café. RDC MRAC. (2020). Service de
Cartographie
O.I.C. (2004). Enseignements à tirer de la crise
mondiale du café : un problème grave pour le développement
durable. Londres
Omasombo, J.T.,Otemikongo, J.M., Stroobant,E., Obotela, N.R.,
Bolakonga,B., OlelaNonga,D.S., Krawczyk,J., Laghmouch,M. (2017). Tshopo :
Laborieuse construction politico-administrative colonuiale muée en
bastion du nationalisme congolais. Tshopo
Penilleau , A. (1864). Etude sur le café au point de
vue historique, physiologique, hygiénique & alimentaire. Ed1, 1(8),
p 90.
Piccino, S. (2011). Rôle des constituants chimiques du
café vert, du terroir et des traitements post-récolte sur la
qualité aromatique du « Bourbon Pointu ». (Thèse de
doctorat). Université de la réunion. Région de la
Réunion.
52
Pittia, P., Dalla Rosa, M., & Lerici. C.R., (2001). Textural
changes of coffee beans as affected by roasting conditions.
PNUD. (2020). The next frontier: Human Development and the
antropocene. Human Development report
Porter,M.(1986). L'avantage concurrentiel. p. 52.
Pourtier, R.(2018) « la République
Démocratique du Congo face au défi démographique »,
notes de l'IFRI. Reseach, ISSN 2351-8014 Vol 15 N°2
Rubabura,
K.,Chihire,B.,Nsambu,M.,Mugaruka,M,.&Bisimwa,M.(2015). Dégâts
actuels de caféier (Coffea Arabica) et savoir-faire paysans dans la
lutte des ravageurs insectes du caféier à Kabare Nord,
Tegera,A., Sematumba,O.,&Kabirigi, J.P. (2014). La
caféiculture et son incidence sur la transformation des conflits, cas de
localité de Ntamugenga, Kibirizi, Minova en RDC et Boneza au Rwanda.
Pole Institute, Goma. RDC
Tulet, J.C. (2007). La conquête du monde tropical par la
caféiculture
UNICEF.(2021). Pauvreté et privations de l'enfant en
République Démocratique du Congo. Province de la Tshopo
UNIL. (2018). Guide de réalisation d'un
développement stratégique... ou comment réaliser une
analyse SWOT puis passer à un plan de développement. Direction
cellule qualité Université de Liège, Gembloux Agro-Bio
Tech, Bruxelle.
Witgens, J.N. (2004). Coffee: Growing, Processing,
Substainable Production, 2ème Edition, Ed. WileyCVH, Weinheim.
Allemagne
1
ANNEXES
2
ANNEXE 01. LES CPE ANNUELS DES
ACTEURS
a. CPE d'un producteur de Café dans les
territoires de Bafwasende et Ubundu sur
un demi-hectare
|
Désignation
|
Quantité
|
PU
|
Annuité
d'amortisssemnt
|
Total
|
|
1. Les charges
|
|
|
|
395199,99
|
a. Les consommations intermédiaires
|
|
|
|
393000
|
Entretien
|
|
|
|
20000
|
Récolte
|
8,5 Sacs
|
10000
|
|
85000
|
Décorticage
|
8,5 Sacs
|
20000
|
|
170000
|
Transport
|
5 sacs
|
20000
|
|
100000
|
Emballage
|
8 sacs
|
2000
|
|
16000
|
Fil
|
|
|
|
2000
|
b. Autres Charges
|
|
|
|
0
|
Frais Financiers
|
|
|
|
0
|
Taxes et Impôts
|
|
|
|
0
|
Rémunération du personnel
|
|
|
|
0
|
c. Les amortissements
|
|
|
|
2199,99
|
|
|
Machette
|
1
|
8000
|
533,33
|
533,33
|
|
Houe
|
1
|
15000
|
1000
|
1000
|
|
Panier de récolte
|
1
|
6000
|
666,66
|
666,66
|
|
2. Les recettes
|
|
|
|
1400000
|
a. Vente de la Production
|
5sacs
|
280000
|
|
1400000
|
b. Subventions d'exploitation
|
|
|
|
0
|
|
|
Valeur Ajoutée
|
|
|
|
1007000
|
|
Résultat Brut d'exploitation
|
|
|
|
1007000
|
|
Résultat Net d'exploitation
|
|
|
|
1004800,01
|
|
Test de Rentabilité
|
|
|
|
3,542510211
|
b. CPE d'un transformateur torréfacteur au
marché central de Kisangani
|
Désignation
|
Quantité
|
PU
|
Annuité
d'amortissement
|
Total
|
|
1. Les charges
|
|
|
|
5691000
|
a. Les consommations intermédiaires
|
|
|
|
5310000
|
Le bois de chauffe
|
|
|
|
5250000
|
Prix d'achat
|
187,5 bottes
|
20000
|
|
3750000
|
Frais de chargement et transport
|
187,5 bottes
|
8000
|
|
1500000
|
Transport
|
|
|
|
60000
|
b. Autres charges
|
|
|
|
370500
|
Frais Financiers
|
|
|
|
0
|
Taxes et Impôts
|
|
|
|
60000
|
Rémunération du personnel
|
1
|
1
|
|
300000
|
c. Les amortissements
|
|
|
|
10500
|
|
|
Torréfacteur et son montage
|
1
|
120000
|
8000
|
8000
|
|
Bâche
|
1
|
15000
|
2500
|
2500
|
|
2. Les recettes
|
|
|
|
9000000
|
a. Frais de torréfaction
|
45000
|
200
|
|
9000000
|
b. Subventions d'exploitation
|
|
|
|
0
|
|
|
Valeur Ajoutée
|
|
|
|
3690000
|
|
Résultat Brut d'exploitation
|
|
|
|
3319500
|
|
Résultat Net d'exploitation
|
|
|
|
3309000
|
|
Test de Rentabilité
|
|
|
|
1,581444386
|
3
c. CPE d'un transformateur mouleur au marché
central de Kisangani
|
Désignation
|
Quantité
|
PU
|
Annuité
d'amortissement
|
Total
|
|
1. Les charges
|
|
|
|
13116666,65
|
|
a. Les consommations intermédiaires
|
|
|
|
12060000
|
|
Courant électrique/carburant
|
|
|
|
12000000
|
|
Transport
|
|
|
|
60000
|
|
b.Autres charges
|
|
|
|
830000
|
|
Frais Financiers
|
|
|
|
0
|
|
Taxes et Impôts
|
|
|
|
50000
|
|
Rémunération du personnel
|
1
|
1
|
|
720000
|
|
c. Les amortissements
|
|
|
|
226666,65
|
|
Moulin électrique
|
|
|
|
159999,99
|
|
Montage de base
|
1
|
40000
|
26666,66
|
26666,66
|
|
Dynamos
|
1
|
2000000
|
133333,33
|
133333,33
|
|
Moteur
|
1
|
1000000
|
66666,66
|
66666,66
|
|
2. Les recettes
|
|
|
|
22500000
|
|
Frais de mouture
|
90000
|
250
|
|
22500000
|
|
Subvention d'exploitation
|
|
|
|
0
|
|
Valeur Ajoutée
|
|
|
|
10440000
|
|
Résultat Brut d'exploitation
|
|
|
|
9610000
|
|
Résultat Net d'exploitation
|
|
|
|
9383333,35
|
|
Test de Rentabilité
|
|
|
|
1,715374843
|
d. CPE d'un commerçant grossiste au
marché central de Kisangani
|
Désignation
|
Quantité
|
PU
|
Annuité
d'amortissement
|
Total
|
|
1. Les charges
|
|
|
|
225337533,3
|
a. Les consommations intermédiaires
|
|
|
|
225000000
|
Achat de café
|
60000
|
3500
|
|
210000000
|
Manutention
|
|
|
|
12000000
|
Sachets/ Sacs d'emballage
|
90000
|
-
|
|
3000000
|
Transport
|
|
|
|
6000
|
b. Autres charges
|
|
|
|
304000
|
Frais Financiers
|
|
|
|
0
|
Taxes et Impôts
|
|
|
|
304000
|
Rémunération du personnel
|
|
|
|
0
|
c. Les amortissements
|
|
|
|
33533,33
|
|
|
Gobelets
|
2
|
1000
|
200
|
200
|
|
Balance électronique
|
1
|
500000
|
33333,33
|
33333,33
|
|
2. Les recettes
|
|
|
|
270000000
|
|
a. Vente
|
60000
|
4500
|
|
270000000
|
|
Valeur Ajoutée
|
|
|
|
45000000
|
|
Résultat Brut d'exploitation
|
|
|
|
44696000
|
|
Résultat Net d'exploitation
|
|
|
|
44662466,67
|
|
Test de Rentabilité
|
|
|
|
1,2%
|
4
e. CPE d'un commerçant revendeur dans le
marché central de Kisangani
|
Désignation
|
Quantité
|
PU
|
Annuité
d'amortissement
|
Total
|
|
1. Les charges
|
|
|
|
9866722,21
|
|
a. Les consommations intermédiaires
|
|
|
|
9728000
|
|
Achat de café
|
2100
|
4500
|
|
9450000
|
|
Manutention
|
|
|
|
150000
|
|
Sachets d'emballage
|
63000
|
-
|
|
63000
|
|
Transport
|
|
|
|
65000
|
|
b.Autres charges
|
|
|
|
133000
|
|
Frais Financiers
|
|
|
|
0
|
|
Taxes et Impôts
|
|
|
|
133000
|
|
Rémunération du personnel
|
|
|
|
0
|
|
c. Les amortissements
|
|
|
|
5722,21
|
|
Bassin
|
1
|
10000
|
1111,11
|
1111,11
|
|
Gobelets
|
2
|
1000
|
166,66
|
166,66
|
|
Parapluie
|
1
|
40000
|
4444,44
|
4444,44
|
|
2. Les recettes
|
|
|
|
12600000
|
|
a. Vente
|
2100
|
6000
|
|
12600000
|
|
b. Subventions d'exploitation
|
|
|
|
0
|
|
Valeur Ajoutée
|
|
|
|
2872000
|
|
Résultat Brut d'exploitation
|
|
|
|
2739000
|
|
Résultat Net d'exploitation
|
|
|
|
2733277,79
|
|
Test de Rentabilité
|
|
|
|
1,28%
|
ANNEXE 02 : LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
|
Désignation
|
Valeur
d'acquisition
|
Durée de
vie/ans
|
Réelles sources d'usure
|
Valeur
considérée/an
|
|
|
|
|
|
|
Machette
|
8000
|
3
|
5
|
533,333333
|
|
Houe
|
15000
|
3
|
5
|
1000
|
|
Panier de récolte
|
6000
|
3
|
3
|
666,666667
|
|
Balance
|
500000
|
5
|
3
|
33333,3333
|
|
Bassin
|
10000
|
3
|
3
|
1111,11111
|
|
Parapluie
|
40000
|
3
|
3
|
4444,44444
|
|
Gobelets
|
1000
|
2
|
3
|
166,666667
|
|
Torréfacteur
|
120000
|
5
|
3
|
8000
|
|
Bâche
|
15000
|
2
|
3
|
2500
|
|
Dynamos
|
2000000
|
5
|
3
|
133333,333
|
|
Montage moulin
|
400000
|
5
|
3
|
26666,6667
|
|
Groupe
|
1000000
|
5
|
3
|
66666,6667
|
5
ANNEXE 03 : LE CALCUL DE TAXES ANNUELLES LIEES A
L'ACTIVITE DE
CAFE
a. Les commerçants grossistes
|
Désignation
|
Montant (FC)
|
|
Patente commerciale
|
34000
|
|
ONAPAC
|
130000
|
|
Droits gouvernementaux
|
40000
|
|
Service d'Industrie Poids et Mesure
|
100000
|
La majorité des grossistes interrogés n'ont que
le café dans leurs dépôts. Et en résulte que c'est
l'activité de café qui supporte toutes les charges taxes (304 000
FC)
b. Les commerçants revendeurs
Taxes d'étalage
|
300000 FC
|
ONAPAC
|
20000
|
Patente commerciale
|
34000
|
Taxes parcellaire annuelle
|
5000 FC
|
|
Hormis la taxe prélevée par ONAPAC, les autres
taxes ne sont pas directement liées au café mais à
l'ensemble de produits vendus, en moyenne 3. Nous aurons (5000 +34000+300000)
/3 + 20000 FC pour déterminer la charge taxe d'un revendeur de
café.
c. Les transformateurs
|
Désignation
|
Montant (FC)
|
|
|
|
Taxe de pollution
|
180000 FC
|
L'activité du torréfacteur ne concerne pas
uniquement le café. Postulant qu'il manipule trois produits, la taxe
liée à son activité de café est de 60000 FC.
| 


