|
Université catholique du
Congo
Facultés des communications sociales
B.P :1534
Kinshasa mont-ngafula
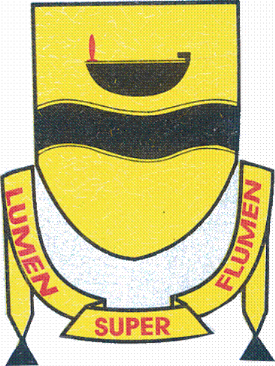

Par
Wilina
Nsimiti Gradi
Graduée en
communications sociales
Mémoire présenté et défendu
en vue de l'obtention du Grade de Licencié (Master LMD) en
Communications sociales
Option : Journalisme, Information et Communication
Directrice : Kasongo
Dioso Priscilla
Juillet
2023
Epigraphe
Dis-moi quelle langue tu
parles, je te dirai qui tu es.
Laélia Véron
« Le Français est à nous »
Dédicace
À
Nsimiti Lunam Narcisse et Mazeba Ponda Liliane. À ce
père et cette mère pour qui l'avenir de leur enfant surpasse tout
échelon de sacrifice.
À mes
frères et soeurs avec qui nous partageons non pas seulement le
même gène, mais également l'attrait vers l'excellence.
À mon
frère congolais et à ma soeur congolaise, ceux-là qui
pensent qu'il est plus que temps de révéler nos identités
culturelles et sortir de la grande nuit.
Remerciements
Observer, réfléchir, écrire et
proposer. Tous ces mots semblent si saisissables, mais au-delà de toute
réalité, l'accomplissement de ces quatre éléments
qui forment ce tout est l'oeuvre d'une force collective investie en une seule.
C'est pourquoi au terme de ce travail, nous remercions celui par qui tout a
été fait, notre unique seigneur et sauveur Jésus-Christ,
car ces derniers mots sont écrits sous l'art de sa bienfaisance signe de
son amour parfait et imparable à tout autre.
Au milieu de Signes, ces quelques phrases ne disent
que très peu la reconnaissance que nous devons à tous ceux qui
nous ont accompagné durant nos études. Il s'agit de mes parents
auxquels tout le mérite revient. À mon père,
Nsimiti Lunam Narcisse, l'homme qui a toujours su veiller sur
notre conscience et qui nous a donné l'opportunité d'être
où nous sommes. À ma mère, Mazeba Ponda
Liliane, l'héroïne dans l'ombre, la raison de ma
fermeté et l'être qui nous poussera toujours à aller de
l'avant. À ces deux êtres indispensables dans notre vie, et
à la famille qu'ils nous ont donnée, merci d'être
là.
À notre Directrice, respectivement professeure
KASONGO DIOSO Priscilla, laquelle est pour nous un
éternel maître. Plus qu'une simple désignation, nous lui
devons une fière chandelle, non seulement parce qu'elle a
été l'éclaireur de notre travail par l'écoute,
l'orientation et les échanges. Mais aussi et surtout du fait qu'elle
soit un modèle qui nous pousse vers l'excellence, une source qui
féconde ambitions et volonté de les atteindre.
Au professeur MBIYE LUMBALA Hilaire Celui par
qui nous avons connu le logos du séméon, d'ailleurs-sans jeter la
poudre sur le tapis- est le principal soubassement de notre choix. Au
Professeur EONGO Vicky, AKANDJI KOMBE, avec qui les échanges ont fait
jaillir des pistes de réflexion. À monsieur EKAMBO NOTO Ben pour
ses encouragements et son mentorat qui nous incite à ne jamais
abandonner la quête de l'excellence. À l'assistant Brunel-Acer
MUNSIKETE qui a été auprès de nous, une présence
scientifique rassurante et toujours à l'écoute.
À tous mes amis, à ceux qui nous ont
accompagnés de près et de loin, omis par volubilité de la
langue, un grand merci.
LISTE DES SIGLES
UDPS : Union pour la démocratie et le progrès
social
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
PUF : Presse universitaire de France
EPST : Enseignement primaire secondaire et technique
MD : Marqueurs discursifs
EDL : éléments de langage
LISTE DES TABLEAUX ET
DE FIGURES
? Tableaux
Tableau n°1 : Actualité.cd en
chiffres.................................................60
Tableau n°2 : politico.cd en
chiffres...................................................67
Tableau n°3 : Articles de presse
Actualité.cd.........................................72
Tableau n°4 : Article de presse
Politico.cd...........................................80
Tableau n°5 : Niveau de la culture
Actualité.cd......................................94
Tableau n°6 : Niveau de rapport de communication
Actualité.cd................100
Tableau n°7 : Niveau de la culture
Politico.cd......................................107
Tableau n°8 : Niveau de rapport de communication
Politico.cd..................111
? Figure
Figure n°1 :
l'énonciation...............................................................35
Figure n°2 : l'événement
médiatique..................................................38
INTRODUCTION
GENERALE
1. Objet d'étude
Dans ce travail nous allons étudier la
manière dont le journalisme participe à la fabrique du patrimoine
sociolinguistique. C'est-à-dire comment le discours journalistique
dynamise les innovations sociolinguistiques en langue française que le
journaliste rencontre dans la pratique de son métier et qu'il en donne
du sens.
Pour étudier ce processus qui légitime
ses innovations sociolinguistiques, nous analysons les articles de presse en
ligne de deux médias ; Actualité.cd et Politico, contenant
dix innovations produites en politique congolaise, appelées
éléments de langage (EDL).
2.
Problématique
2.1. Etat de l'art
Notre sujet fait l'objet de nombreux travaux en
sociolinguistique. Cependant ils ne l'abordent pas directement du point de
vue des médias. La problématique de l'appropriation du
français est au coeur de certains travaux en sociolinguistique
camerounais Louis-Martin Onguéné Ossono, qui s'investit à
étudier les différents usages du français dans les pays
francophones.
Orienté vers l'évolution du
français au Cameroun, le sociolinguiste a étudié les
hybridités véhiculées dans la presse. En effet, ces
études ont pour objectifs d'observer la manière dont les
journalistes camerounais dynamisent le Camfranglais et construisent de
nouvelles règles lexicales et grammaticales.
Dans son ouvrage, langues et médias en
Afrique noire francophone, il part principalement de la situation
sociolinguistique du Cameroun, en passant par la RDC, pour démontrer
comment les médias ont participé les innovations
sociolinguistiques qu'il appelle de créations littéraires.
1(*)
C'est donc sur cette même approche que nous
formulons notre problématique, qui, n'entreprend pas les médias
comme acteur dans la dynamique du français congolais, mais le
journaliste lui-même dans son travail d'énonciation.
Les lignes précédentes
n'ont eu pour but qu'une simple exploration du sujet qui féconde
l'objet d'étude. Le point présent nous permet de fixer le noeud
de la question traitée dans ce travail.
Souligner en réalité, la
question du patrimoine sociolinguistique cache un aspect important. En
République Démocratique du Congo, comme le décor
précédent l'a avancé, la langue légitime est
rattachée à une période idéalisée par les
pouvoirs coloniaux belges. Le français belge reste du moins une trace de
l'histoire congolaise sur laquelle cette nation a construit son
indépendance.
Cependant, ce caractère officiel
obscurcit une connotation de pleine existence de cette indépendance tant
que l'empreinte coloniale et une certaine symbolique occidentale demeureront.
Dans la société congolaise d'hier et d'aujourd'hui, la langue
française ; langue officielle, subit une forme de transformation
et/ou évolution dans un cadre géographique tracé qu'est le
nôtre. Les mots de cette langue gauloise ne gardent plus la même
signification et ne respectent plus une lexicologie formelle. Ceci est une
évidence, s'il faut l'expliquer scientifiquement, mais la valeur
identitaire se construit à travers elle, tenterait de s'étouffer
par cet effet de normalisation. Nous tentons de démontrer une absence
de prise en compte de cette identité linguistique produite dans les
parlures de locuteurs congolais.
Ces parlures tirent leur essence de divers
milieux, qu'ils soient musicaux, religieux, dans les périphéries
du monde de la santé, de la politique, dans lesquels la langue est un
outil de pouvoir. Dans l'histoire, l'époque zaïroise était
marquée par une particularité linguistique impressionnante du
Maréchal Mobutu. Ce, faisant, reconnaître la culture zaïroise
passait par des éléments de la langue, comme le concept Abacost,
Dinosaure ou encore Hiboux dérivé du Français, autant de
pratiques langagières propres aux zaïrois2(*), autant de lexies qui ont
caractérisées cette société.
Dans ce cadre social, de nombreuses
expressions se sont produites de manière à assouvir un besoin de
liberté, d'expression et d'affirmation auprès des autres
communautés en vendant l'idée d'adhésion à cette
idéologie. Ce qui implique une initiation. Ceci passe par un
mécanisme de véhicule naturel ; de bouche à
l'oreille, medium qui peut entraîner une altération dangereuse du
sens véhiculé et caricaturer l'image de la
société3(*).
Cependant vers les années 2012, le
médium s'adapte à une nouvelle sociologie avec la venue du web.
Nous observons la création de nouveaux médias, pure players et un
nombre important d'adhésion des journalistes à de nouvelles
plateformes, dites médias et réseaux sociaux (Facebook le plus en
vogue, suivi de twitter) et celles de blogging et de microblogging. Et une
certaine aisance apparaît dans la distribution de l'objet informationnel.
Le langage est plus libéré et les normes d'écritures se
bousculent en raison des enjeux et exigences de l'espace cybernétique.
La profession a muté.
Les journalistes sont de plus en plus
stratégiques, bavards et séducteurs. L'enjeu est de taille, car
le web est caractérisé par une immense pluralité
d'usagers.il y a ipso facto, un besoin de construire une communauté et
de préserver à l'utile agrandir son audience pour de raisons
économiques et sociopolitiques4(*). Mais cette même vient un élan
d'influence de la langue (la leur et celle des usagers). Il ne s'agit pas de
traiter du nouveau média, notre problématique articule des
évidences et tente de démontrer le fait que les journalistes
ont une grande incidence sur la langue française parlée
précisément à Kinshasa. À en voir les contenus, le
récit médiatique est chargé des effets de
réel : des commentaires, des mots polémiques, de reprises de
propos propagandistes, de qualificatifs des politiques péjoratifs et
laudatifs, des lexies qui façonnent l'imaginaire linguistique congolais
et créent l'adoption.
Les journalistes deviennent les nouveaux
médiums, des véhicules dans la société, et ceux-ci
sont incontestables en raison de leur impact sur l'opinion publique (justement
les récepteurs par un travail de ciblage du public suivant la ligne
éditoriale). Cela dit, nous constatons également que dans
certains pays francophones une appropriation et considération de la
langue, comme au Nouveau Brunswick où « le chiac est
une forme de résumé du contexte social et historique des
francophones du grand Moncton, reconstitué à l'aide de plus de
1000 textes de deux journaux, des forums de discussion, et des personnages de
dessin animé et de bande dessiné acadieman »5(*). C'est aussi le cas du
Camfranglais au Cameroun (développé par Sol), une variante du
français dont la forme la forme syntaxique suit celle du
français, mais le lexique est créatif. 6(*)
Prenons exemple du Nouchi et du Camfranglais, la
langue sert à renforcer un sentiment d'identité parmi les
locuteurs et donner une marque locale à la langue
française ; langue du colonisateur.
Cette construction de l'identité
s'opère également aujourd'hui et la politique congolaise demeure
cette mine d'or. La reconnaissance de la société est
attachée à son tour par de grandes périodes loquaces en
politique congolaise. Et les médias savent l'illustrer. En 2019, le
terme glissement a pris de l'ampleur tant en République
Démocratique du Congo par un travail de journalistes internationaux.
Les journalistes comme nouveaux véhicules de
formes lexicales influencent la langue au moyen de récits médias
internationaux, mais cette vision ne trouve pas l'affirmation de la
diversité de la variante du français au Congo. C'est pourquoi
notre recherche veut élucider ce phénomène en posant les
bases journalistiques comme preuves évidentes d'une marque culturelle
qui construit une sociolinguistique propre aux congolais. Notre travail tentera
de répondre à la question suivante : comment le
journaliste, à travers le discours journalistique, légitime les
EDLS et participe ainsi à consolider la fabrique
sociolinguistique ?
3. Hypothèse de
recherche
La question de la construction de l'identité
culturelle au biais d'un dynamisme journalistique se fonde sur une
hypothèse basée sur plusieurs réalités qui
s'inscrivent dans de domaines différents, mais dont la mise en relation
reste l'élément de la langue.
Pour ce faire, les problèmes
d'une construction du patrimoine sociolinguistique dans le milieu francophone
reposent sur de nouvelles démarches. La notion de cette construction
identitaire en République Démocratique peut s'expliquer au niveau
de la pratique du journalisme, par la récupération des EDLS et
leur construction en discours journalistique qui véhicule ces nouvelles
formes lexicales.
3.1. La construction du
discours journalistique
Les paroles ou les écrits des journalistes (qu'ils
soient des journalistiques politiques ou pas) sont donc des gages à
l'acceptation d'une idéologie qui est construite dans l'information. Le
travail de récupération des faits et mise en énonciation
permet aux journalistes de vulgariser le sens produit par les politiques
à travers le discours rapporté7(*). L'événement rapporté par les
journalistes s'inscrit alors dans une finalité générale de
raconter les faits tels quels.8(*) Ils reprennent donc des éléments
crédibles ; comme les EDLs, des déclarations, des slogans,
des expressions, pour construire un discours journalistique.
Suivant une catégorie des journalistes, les
journalistes politiques et ceux d'autres desks usent de deux langages
journalistiques pour construire l'information politique, la rhétorique
de l'expertise critique opposée à la rhétorique
journalistique préférentielle. Cette
dernière suppose que les journalistes politiques
récupèrent, traitent et publient les informations qui cadrent
avec leur propre jugement et une forme de préférence dans la
hiérarchisation de l'information.
Quant à la rhétorique de l'expertise
critique, celle-ci confère aux journalistes de tout type, un outil
didactique critique de faits rapportés, le langage journalistique n'est
pas émotionnel, plutôt critique en ce sens où la
construction du récit médiatique s'effectue dans une dimension
d'analyse critique, le langage journalistique est à cet instant un
outil didactique qui décrypte les stratégies politiques au moyen
d'un vocabulaire concret qui conserve cette doctrine d' « effet
de réels »9(*).
Ceci dit, cette manifestation de la pratique
journalistique à travers son langage, nous amène à
avancer dans un premier temps que les journalistes congolais participent
à consolider les nouveaux lexies qui à leur tour reconstruisent
la langue parlée à Kinshasa. S'il faut se référer
aux concepts clés dans les paragraphes précédents, les
journalistes récupèrent ses nouveaux sens dans les
événements qu'ils couvrent, qu'ils commentent, qu'ils analysent
et les traitent tels quels et publient ces informations tout en conservant ses
innovations en suivant une simple ligne de conduite de construction d'un
récit médiatique réaliste, basé sur des faits
réels. Dans un second temps, cette construction de récits
médiatiques réels transfère des convictions qui jouent sur
l'imaginaire linguistique du récepteur kinois. Et ce, observable
à travers le comportement linguistique du public kinois10(*).
4. Construction du cadre
théorique
Notre objet d'étude est complexe. Nous
tentons de démontrer concrètement que le journalisme
participerait à construire un patrimoine sociolinguistique et ainsi,
consolider la perspective d'une variété du français
parlée en République Démocratique, à Kinshasa. Il
implique donc de converger les approches théoriques et les disciplines,
car notre travail reconnaît la construction logique de ce patrimoine
sociolinguistique même si la communication politique est, dans notre cas,
une discipline d'occurrence.
L'interdisciplinarité s'impose. Pour
construire notre cadre théorique nous nous référons aux
travaux linguistiques et sociolinguistiques qui reprennent la philosophie de
notre étude. Notre travail se construit sur trois approches
théoriques ; la praxématique, la
sémiolinguistique du discours et les approches sur l'expression et la
communication.
Nombre de linguistiques se sont
intéressés à la sociolinguistique et sur le comment cette
science expliquer l'évolution linguistique au sein d'une
société. Une notion qui met ensemble les acteurs et les
éléments extérieurs qui influencent la langue11(*). Il est difficile de
séparer les approches sociolinguistiques et les approches linguistiques,
car les unes donnent lieu aux autres. Le premier thème de notre
recherche qu'est le langage politique s'inscrit dans une sociolinguistique
labovienne, dans le développement de la praxématique. Cette
approche prend en considération le facteur externe qui fait
évoluer la langue et l'étudie dans une perspective de nouvelles
productions de sens. La praxématique se fonde dans une vision
sémiotique s'intéresse aux signifiants du langage et atteste un
rapport entre la langue et le réel12(*). Dans notre étude, l'approche
praxématique nous aidera à comprendre la production de sens dans
le milieu politique.
Puisque la praxématique prend le mot en
contexte, nous inscrivons les vingt occurrences de notre travail dans cette
même perspective, soutenue par la sémiolinguistique de Patrick
Charaudeau.
Cependant, la construction de la
sociolinguistique congolaise s'explique à travers le journalisme, il
faudrait donc conjuguer les études médiatiques aux études
du langage. Il n'est pas question d'expliquer notre phénomène
avec les deux ancrages théoriques. Plutôt à trouver dans
les deux un élément qui ressort une perspective créative
d'où le langage journalistique qui, nous le répétons, est
la manifestation de la pratique journalistique13(*).
Le langage journalistique comme tel correspond
à toute forme de langage, mais possède une fonction sociale qui
impacte la langue. Pour l'expliquer nous puisons dans les approches
linguistiques sur l'expression et la communication développées
par l'école linguistique de Genève, principalement les travaux
d'Henri Frei et Albert Sechehaye. Ces approches permettent
d'inscrire le journaliste comme un sujet parlant dans les sciences de
l'expression et de la communication.
En tant que tel, comme l'avance Sechehaye
« le sujet parlant est un être psychologique, pourvu
d'intelligence et de volonté capable d'influencer le système
grammatical d'une langue et de la faire avancer »14(*) , plus il est devient chez
Frei « un sujet parlant conscient de la volonté de
transmettre un contenu... »15(*).
5. Construction du cadre
méthodologique
Notre
démarche méthodologique présente essentiellement une
approche qualitative. L'approche qualitative se justifie du fait que pour
étudier le phénomène de fabrique du patrimoine
sociolinguistique à Kinshasa à travers le journalisme congolais
en prenant exemple sur l'espace politique, impose une méthode
essentiellement qualitative. Il s'agira de l'analyse textuelle au premier plan.
Les occurrences (les mots porteurs
de nouveaux sens) qui font preuve d'objets empiriques matériels seront
étudiées dans une approche d'analyse qualitative de contenu. Nous
appliquerons l'analyse textuelle sur un corpus constitué d'articles de
presse de médias en ligne Actualités.cd et politic.cd.
De manière plus simpliste,
notre étude usera de la méthode qualitative avec l'entretien et
l'observation furtive pour questionner le journaliste sur le discours
qu'il produit et son implication dans la langue française. L'entretien
est donc notre technique de collecte. Les deux méthodes soutenues par
une technique documentaire pour ancrer nos travaux dans un fondement
scientifique.
6. Intérêt du
sujet
L'intérêt qui
féconde ce travail se situe à trois niveaux ; un niveau
scientifique, social et personnel.
- Niveau scientifique
Cette recherche permet
de repenser la pratique journalistique en ce qui concerne la construction des
identités à travers la langue du fait que notre recherche soit
une affirmation d'une certaine diversité de la langue française
au Congo. Ce travail entre dans l'ensemble des preuves de cette affirmation. De
nombreux travaux ont été menés en linguistique pour
étudier la situation sociolinguistique du Français en
République Démocratique.
Cependant, l'angle de la profession
journalistique que nous prenons constitue en réalité une
pertinence, dans la mesure où nous expliquons les
phénomènes de légitimation du marqueur local
à la langue française par un travail de journalistes congolais,
ce à travers les approches linguistiques. Un autre point pertinent
relève de la prise de conscience de cette compétence de sujets
journalistes dans la fabrique, la promotion et la conservation des
identités culturelles congolaises.
- Niveau social
N'étant pas
pionnier d'une certaine variété de la langue
française. Cependant, les autres variétés comme le Nouchi
en côte d'ivoire et le chiac au Canada ont rejoint la gamme de la
variété de la langue et de l'affirmation du marqueur local
de la langue française. Cette affirmation est toute une
démarche de construction de l'identité culturelle dans un grand
système qu'est la francophonie.
Ce travail tente
de démontrer l'importance d'inscrire un type spécifique
du français congolais dans la variété du
Français dans la francophonie. S'inspirant des
avancées sociolinguistiques de pays voisins (Côte
d'Ivoire et Cameroun) où la stigmatisation à une
détérioration du Français à la place à la
diversité culturelle, Nous n'avons pris que pour exemple le
milieu politique pour avancer de preuves de notre empreinte cultuel dans la
langue française, ce à travers une filière qu'est la
nôtre : le journalisme.
- Niveau personnel
Les
motivations se fixent également à long terme. Dans un
premier temps, ce travail est une forme de lutte citoyenne pour la promotion de
la culture congolaise dans la francophonie dont les lignes compositrices seront
les soubassements d'un argument pour un plaidoyer à un niveau
personnel.
Nous
espérons ensuite poursuivre des études
supérieures qui nous mèneront au doctorat. Le domaine de la
linguistique et/ou de la sociolinguistique est un choix de domaine d'expertise
en raison de la valeur qu'elle a dans la société (nous aimerions
principalement comment se fondent et comment se propagent le discours de haine
à travers le récit médiatique en République
démocratique, un pays dans une grande diversité ethnique et par
ricochet proposer dans la langue des perspectives pour éradiquer ce
fléau qui est à la base de nombreux conflits intercommunautaires,
interreligieux, etc.), et donc ce travail nous aidera à découvrir
de champs théoriques pour naître de nouvelles
perspectives.
7. Délimitation du
sujet
Les thèmes abordés dans
cette recherche sont très vastes, nous ne pouvons pas tout embrasser et
se laisser disperser. Il y a lieu de rappeler que notre travail étudie
la manière dont le journaliste participe à la fabrique du
patrimoine sociolinguistique, ce à travers une étude
interdisciplinaire du processus de légitimation des
éléments de langage en politique congolaise.
Pour fignoler la
recherche, les thèmes principaux de notre recherche se situent
premièrement au niveau de la communication politique,
précisément du discours politique. Nous ne prenons pas la
dimension large de la communication politique, plutôt une situation
discursive de la communication politique du fait que cet espace est dans notre
recherche le lieu où les EDL sont puisés.
Nous le nommons occurrences, il
s'agit de dix mots prélevés dans les discours de politiciens ou
de la politique congolaise, des mots dont le lexique créatif
représente une identité sociolinguistique kinoise. Ces
occurrences sont des objets empiriques sur lesquels observer cette fabrique
sociolinguiste. Nous étudions alors vingt à trente articles
d'Actualité.cd et Politico.cd produit entre Janvier 2021 et Janvier
2023.
En
parallèle, la pratique journalistique serait principalement
évoquée car elle fonde notre recherche. Nous évoquerons
donc les notions du langage journalistique comme manifestation d'une pratique
de construction de l'identité sociale, mais également de
l'énonciation journalistique comme lieu de représentation de la
fonction linguistique du journalistique. Pour ce faire, nous menons des
entretiens auprès de cinq journalistes.
Utilisant la
technique d'enquête. Les deux méthodes soutenues par une technique
documentaire pour ancrer nos travaux dans un fondement scientifique.
8. Division du travail
Notre travail se divise en quatre chapitres.
Ceci se fait en raison de la complexité du travail et du besoin de
construire un raisonnement logique dans la recherche.
Le premier
chapitre intitulé `Du concept aux ancrages
théoriques et méthodologiques' se consacre aux
fondements théoriques et méthodologiques. Il traite
spécifiquement des concepts clés qui constituent ce
travail, des perspectives théoriques et méthodologiques qui
expliquent notre problème de recherche.
Le deuxième chapitre intitulé
De la situation sociolinguistique au terrain de recherche
se veut être l'aperçu des parlures de la langue
français à Kinshasa. Il traitera de ce fait de dix occurrences
qui constituent notre corpus et présenter les deux médias choisis
pour parfaire ce travail.
Le
troisième chapitre portant sur l'Analyse textuelle d'articles de
presse en ligne, se consacre à l'analyse du corpus et
présentation des résultats de l'analyse textuelle. Il traite de
différentes analyses qui seront opérées à la suite
du recueil des données suivant les démarches citées
ci-haut. Ce chapitre donne lieu au quatrième chapitre.
Le quatrième s'intitule Rôle et
implication du journaliste congolais dans la fabrique
sociolinguistique, il se consacre totalement aux entretiens et
à l'analyse des résultats d'entretien. Le tout sanctionné
par des conclusions partielles et une conclusion générale.
PREMIER
CHAPITRE : DU CONCEPT AUX ANCRAGES THEORIQUES ET METHODOLOGIQUES
Ce premier chapitre pose les bases de la recherche
au travers d'une clarification des concepts clés qui construisent notre
étude..
I.1. Clarification
conceptuelle
Comme l'intitulé l'indique, les concepts
donnent lieu aux ancrages théoriques qui expliquent notre
problématique et la méthodologie qui sert à l'analyse. Il
s'agit d'explorer les différents entendements de termes suivants ;
fabrique (socio)linguistique, la sociolinguistique en elle-même et prise
dans notre champ théorique, le discours politique, le discours
journalistique, les éléments de langage, la
praxématique, et bien d'autres concepts balisés dans le
développement
I.1.1. De pratiques
langagières à la fabrique (sociolinguistique)
Il s'agit de présenter l'économie de
ce que nous entendons par fabrique sociolinguistique. Pour ce faire, nous la
mettons au sein d'une logique qui questionne son origine, pour aboutir à
cette conceptualisation. Il faut, de prime abord, rappeler le sens que ce
concept donne à notre travail. La condition se présente de
décortiquer même les mots qui la composent pour mieux
l'appréhender dans le développement.
I.1.1.1. Les
pratiques langagières
Notre étude postule un lien entre les
pratiques langagières et cette fabrique qui en serait le
résultat. Il faut donc commencer par expliciter le terme qui entre dans
celui qui sont principalement la langue, le langage et la parole. Les trois
concepts semblent introduire une confusion au niveau de leur
compréhension. Ceci remonte à la publication des travaux du
linguiste genevois Ferdinand de Saussure (1857-1913) dont le postulat
était de proposer une discipline qui étudierait la structure de
la langue : la sémiologie16(*). Dans cet élan Saussure établit la
différence entre langue, langage et parole.
Il appelle langue, un système des signes qui
entrent en relation entre eux pour constituer un tout linguistique qui
signifie quelque chose pour un groupe.
Le point de vue de la sémiologie, permet de comprendre
d'abord la langue comme un ensemble linguistique avec une visée de
signifier quelque chose. L'activité que nous pouvons attribuer à
la langue est de partager ou communiquer quelque chose.
Dans cet ordre d'idées, le langage
diffère de la langue en ce sens que c'est le langage qui sert à
communiquer cette signification. C'est donc une faculté universel qui a
une fonction sociale ; celle de renforcer le lien social au sein du
groupe humain. Et une fonction cognitive ; celle de représenter les
informations. Finalement le langage permet à l'homme de construire des
codes pour communiquer : la langue (exemple le Français).
Si ce dernier est universel, la parole est un
acte individuel ou personnel. C'est le produit de la langue, elle permet de
faire évoluer la langue grâce à cet acte personnel17(*).
Saussure ouvre les pistes vers de nouveaux angles
d'études avec cette distinction. Elle nous aide à comprendre que
les réalités sociales sont construites à l'aide de ces
trois éléments. « L'histoire de la
linguistique moderne, lors de son premier siècle, a montré la
nécessité de distinguer son objet de ses manifestations.
Ferdinand de Saussure a opposé la langue à la parole
et a préconisé une approche interne et synchronique de
l'étude de la langue. Noam Chomsky a mis au premier plan l'étude
de la faculté de langage, via la description de la compétence des
sujets parlants, la langue interne, opposée aux
performances langagières, ou langue externe18(*)e ».
Le langage est donc la fonction qui permet au
produit langue de se manifester à travers son usage, dont la parole pour
traduire enfin les réalités sociales d'un groupe. D'où la
pratique d'une langue ou la pratique langagière est la manifestation de
l'activité de la langue en interaction. Elle prend en compte les
facteurs internes à la langue et les facteurs qui l'entourent (la
culture, l'éducation, les médias, etc.).
La notion de pratiques langagières est
à assimiler au métier du journalisme pour maintenir le fil de
notre étude. Cela dit, cette notion se trouve ancrée dans les
sciences du langage, notamment en linguistique. Mais il convient de
l'étayer en la contextualisant.
Les pratiques langagières comme Bautier-Castaing les
définit sont « les manifestations résultantes dans les
activités de langage de l'interaction des différents facteurs
linguistiques, psychologiques, sociologiques, culturels, éducatifs,
affectifs...qui sont constitutifs des caractéristiques individuelles ou
d'un groupe ». 19(*) Sortant de lexique propre aux spécialistes du
langage, les pratiques langagières désignent un usage type de la
langue.
Rappelons que langage, langue sont deux mots qui
s'emploient pour désigner l'un comme l'autre dans certaines
circonstances comme la nôtre. Elles traduisent un phénomène
qui découle de l'activité discursive au sein d'une
société, qui dans une autre dimension de l'activité
interactionnelle, fait montre d'un comportement linguistique spécifique
à une communauté ou un groupe.
Dans notre travail, ces pratiques
langagières sont observables sur une structure précise (notons
qu'elles sont constatables sur toutes les structures sociétales), le
journalisme ou encore pour être large, la structure médiatique.
L'objectif est de comprendre comment cette structure fait usage de la langue en
l'occurrence la langue française pour construire la
réalité congolaise. Évidemment, faudrait se
référer à la conception de Bautier-Castaing pour
comprendre que le langage journalistique, dans toute sa visée, joue un
rôle décisif sur la construction de la chose sociale. Cette chose
est caractérisée par un code issu de lien sociopolitique
consolidé à travers les pratiques langagières
journalistiques (nous explorerons le discours journalistique dans la seconde
partie pour appuyer cette parenthèse).
Les résultats de ces pratiques se
manifestent dans l'attitude linguistique du groupe. Qui use d'une langue issue
de l'expérience de la réception du contenu qui lui est servi
à titre d'information, et dont la réception balaie le construit
dans son entièreté. Celui-ci se fonde sur la relation
transmission et appropriation entre locuteur (journaliste) et interlocuteur
pour réaliser cet acte.
I.1.1.2. La fabrique
(socio)linguistique
Les pratiques langagières nous mènent à
la considération d'une création nouvelle. C'est-à-dire que
les différents usages de la langue induisent à questionner la
portée de sa conséquence au sein du groupe. Autrement avec des
termes proches de notre filière, les pratiques langagières
journalistiques produisent quelque chose dont l'arrière-plan servirait
à mettre en commun.
Ce quelque chose est en réalité les traces
de ces pratiques, éparpillées dans toutes les formes
linguistiques, mais présentes dans l'usage commun de la langue que
partage le groupe. Avant de pouvoir présenter notre compréhension
du terme, tentons de décomposer ce concept lourd de mots à sens
différent.
- Le concept de fabrique : la fabrique
renvoie à la manière dont quelque chose est fabriquée. Les
différentes étapes qui entrent dans la construction de quelque
chose. D'où la fabrication est le concept proche de cette idée.
Une autre facette désigne une fabrique comme un dépôt, une
entreprise, une usine de fabrication de quelque chose, d'où
l'idée du lieu fait surface.
- La (socio)linguistique : le terme
indique une discipline entière. Dans la compréhension de celle-ci
, elle étudie les faits de la langue en relation avec les facteurs de la
société. La sociolinguistique voudrait mêler
l'élément sociohistorique à l'élément
linguistique pour observer les différentes transformations ou
évolutions de la langue20(*). Ces faits de la langue servent à construire
un modèle linguistique propre à une société, ou de
penser à son positionnement. Ils s'observent dans les emplois des mots
et leur signification, ce à quoi ils évoquent pour cette
société. Aux hybridations de codes, ou à leur
superposition, aux alternances codiques, etc.
À la lumière de cette parenthèse, nous
pouvons rendre en de termes clairs ce qu'est la fabrique sociolinguistique,
laquelle est pour nous : un ensemble des propriétés d'une
langue dans un contexte social donné. C'est aussi le lieu où
l'on retrouve les particularités d'une langue au regard d'autres langues
dont le code est à certain niveau identique. Enfin, c'est l'entreprise
dont la marque linguistique locale consolide l'identité culturelle de
son milieu d'évolution.
Dans ce travail, l'attention est centrée sur
les particularités de la langue française comme un code
partagé par les locuteurs francophones. Nous puisons donc dans les
structures sociales : qui sont la structure politique et la structure
médiatique, pour relever, les postulats de cette étude. Pour ce
faire, il faut explorer les arènes discursives qui s'invitent dans notre
logique de réflexion.
I.1.2. Discours
politique
I.1.2.1
Définition
Il nous est impossible de traiter du discours politique, sans
parler du discours lui-même, en ce sens qu'il soit un immense champ dans
lequel le discours politique soit l'un des genres du discours les plus
discutés.
Bien évidemment, traiter du
discours politique implique une parenthèse historique, pour comprendre
ses implications, un recul s'impose. D'abord dans ce qui se désigne
comme discours. Le dictionnaire numérique CORDIAL l'inscrit dans
plusieurs champs pour le définir :
- Dans une perspective linguistique, il est
énoncé oral ou énoncé dans son enchaînement,
expression d'une pensée.
- Dans une logique de positionnement, il est une allocution
publique, ou un développement d'une idéologie sur un sujet
donné et dans un temps donné (le discours politique, le discours
littéraire, etc.)21(*).
D'un autre côté, Le Robert le
définit comme « Énoncé supérieur à
la phrase considéré du point de vue de son
enchaînement »22(*) et c'est là même que le paragraphe prend
son sens. Suivant cette conception, le terme discours va au-delà de la
simple réalité d'un orchestre de phrases, touchant ainsi une
réalité temporellement immatérielle, en ce sens où
le discours est ce qui est dit ailleurs et bien avant.
Nous le comprenons comme une construction
énonciative complexe qui se délimite d'après un penchant
d'une recherche. Certes, le discours peut être défini selon ce que
représente le sujet qui l'énonce (une allocution publique selon
que ce soit une personnalité qui pratique une activité
langagière dans un parti politique, un espace public, ou
institutionnalisé,..) ou celui qui en assure la
responsabilité.
La complexité de ce cas est que le terme
isolé de tout champ ou positionnement est compris comme un grand
étendu de ce qui se dit. Ce « dit » se pratique dans
un lieu social et il utilise des stratégies discursives pour des fins de
persuasion, de communication et/ou de relation. Le discours politique doit
être pris dans sa dimension profonde vu par les sciences du langage,
accompagné d'un point de vue dans la communication politique.
- Le point de vue de la linguistique
Ce point de vue se fonde sur l'identification de
l'activité discursive dans la vie sociale. Pour les linguistiques,
l'explication au discours politique impose un prolongement de la
catégorisation des discours ; l'unité topique.
Celle-ci est entendue comme une institution des
paroles, parfois comme un dispositif de communication socio-historique. De
manière plus précise, l'unité topique alloue des types de
discours qui servent également à la distinction, en l'occurrence
une allocution d'un sujet dans un parti politique est un type de discours dans
une unité topique qu'est le discours politique23(*).
Il est certain que toutes les lignes
précédentes prétendent la difficulté de
définir concrètement le discours politique. L'autre bout de la
complexité se situe au niveau de différentes étapes de sa
conception. C'est-à-dire qu'il faudrait revenir à trois
dimensions du discours, pour comprendre le discours politique.
Le discours politique s'explique d'abord
d'après la sphère d'activité ; qui peut
être un domaine donné (par exemple la politique congolaise), il
suit ensuite un positionnement ; un champ qui influence en quelques sortes
le raisonnement (selon qu'il soit un discours d'opposition, de la
majorité, etc.) et cette activité discursive se produit dans un
lieu approprié (un parti politique, un meeting, un parlement,
etc.).
C'est au travers de ces trois étapes
citées dans la conception du discours de Maingueneau que nous pouvons
comprendre le discours politique dans un premier temps comme un ensemble
d'activités discursives hétérogènes dans l'espace
politique. Ceci dit, la conception de Patrick Charaudeau vient renchérir
cette dernière. En effet, dans son ouvrage Le discours politique.
Les masques du pouvoir P. Charaudeau marque la situation de politisation
du discours à la place de parler idéalement d'un discours
politique. En étudiant le discours politique dans une
interdisciplinarité, il considère que « ce n'est pas
le discours qui est politique, mais la situation qui le rend politique. Ce
n'est pas le contenu du discours qui fait qu'un discours est politique, c'est
la politique qui la politisé »24(*). L'ordre de la situation relève de
l'environnement du discours. Ceci sous-tend les éléments
constitutifs de cet environnement qui détermine le caractère
politique du discours.
Autrement, les sciences du langage statueront
sur une institutionnalisation du discours politique, vue comme un construit
légitime de pratiques discursives. Cette optique rejoint la
première défense de Maingueneau en ce sens où, elle
reconnaît les étapes de distinction du discours (infra page 2),
mais y ajoute des composantes qui n'échappent pas à la situation.
Il s'agit notamment des acteurs (développé en profondeur comme
énonciateur), de son statut dans la structure politique, etc. il sied de
noter que les courants linguistiques qui traitent du discours politique
diffèrent d'acceptations.25(*)
La disjonction a lieu spécifiquement sur les
conditions qui surdéterminent un discours politique et les divers champs
de raisonnement de celui qui se donne la quête de définir le
discours politique (énonciativiste, discursiviste, linguiste
distributionnel, etc.), car celui-ci outrepasse la simple perception de la
chose dans son habitat naturel.
- Le point de vue de la communication
politique
Pour cerner le discours politique, il nous faut, dans
une seconde perspective, avoir recours à la communication politique,
pour qui le discours politique est perçu comme un instrument. Par
opposition à la première conception qui se fonde sur une vision
du mot, la communication politique nous propose une piste matérielle en
se fondant sur l'agir ou l'action. Les auteurs qui s'y inscrivent puisent dans
la philosophie, la rhétorique et la pragmatique, les fondements du
discours politique pour l'expliquer.
Selon Maurice Charland, le discours politique
peut se définir selon qu'il soit un outil qui sert à dire la
politique. Se basant sur la pensée philosophique, le discours politique
est une manière de réfléchir sur l'organisation des
communautés, son mode de gestion, ses interactions, les lois qui
doivent les régir26(*). Pour lui, les systèmes d'organisation et les
modes de fonctionnement du politique sont essentiellement discursive. Ceux-ci
vivent dans le lieu où la question politique se mesure à partir
d'une compétence langagière, quelle que soit sa finalité
(défendre une conception du monde, un système d'idées ou
le contredire, débattre sur la réalité, ou construire de
nouvelles réalités, etc.).
En effet, Charland tente de nous mettre sur la piste
des théories du discours persuasif. Ce dernier stipule que discours
politique est fidèlement un lieu où l'on construit le consensus.
De telle manière que cette façon d'agir à travers le
langage permette les accords entre citoyens et législateurs. C'est le
moyen par excellence de confronter les idées, de mettre en relief des
débats et des délibérations autour de choix à
opérer en vue d'organiser la cité, et les orientations que
doivent prendre ces derniers27(*).
Sous d'autres conceptions d'auteurs, le discours
politique est tant un grand ensemble de discours dans une situation politique
(discours de la propagande, le discours électoral, le discours
publiciste), qu'un espace dans lequel ceux qui détiennent la
légitimité et la crédibilité de la parole,
discutent sur la chose publique et la transforme. Ces sujets légitimes
utilisent donc les techniques argumentatives pour provoquer une conduite sous
contrat d'une compétence à dire les choses, à contredire
les choses, ou encore une psycho qualité à articuler les
pensées de celui qui écoute. Dominique Wolton parle en termes de
légitimité d'expression, en comparant sa pensée, il
considère que l'on retrouve dans la communication politique, des
discours contradictoires selon ce que peut signifier la vérité
pour une position quelconque.
Ceux qui s'invitent à la logique
communicationnelle, placent le discours politique dans différentes
postures. Le lieu de convoquer Ruth Amossy et Roselyn Koren qui distendent une
approche simpliste et restreinte du discours politique se focalisant sur
la fonction de celui qui parle28(*), les deux auteures le définissent
d'après que son objet d'étude « va ainsi de la parole
professionnelle des politiciens à tous les discours qui traitent de la
chose publique dans l'espace public ».29(*)
Approche qui, sans ambigüité, rejoint
celle de Dominique Wolton. Ce dernier met en scène trois types d'acteurs
qui fabriquent et formatent le discours politique : les politiciens, les
journalistes et l'opinion publique. Instituant la communication politique
comme tout ce qui a trait à la production et à l'échange
des discours politiques tenus par les différents acteurs et
répercutés par les médias30(*).
La dernière conception nous intéresse le plus.
Elle met en relief une relation de continuité normalisée entre
deux types d'acteurs : les acteurs politiques et la presse. Occasion
faisant pour nous d'indexer le processus de légitimation du discours
politique, en ce qu'il soit un produit de co-construction. Les médias
pour s'ancrer à notre sujet les journalistes, co-construisent la
réalité investie dans un discours politique, donnant lieu une
catégorie précise du discours (le discours rapporté).
Le fait que l'auteur identifie un symétrique,
accorde une place à l'émoi qui étend cette étude.
L'idée selon laquelle, le discours politique éteint sa course
lorsque la répercussion par les journalistes ne s'effectue pas, trouve
adhésion dans nos chaînes de réflexion. Tenterons-nous de
stipuler que les pratiques discursives dans le milieu ont du sens que lorsque
le contenu du discours génère de nouvelles pratiques. Ce qui
s'explique au niveau de l'opinion publique qui devient en même temps le
lieu de réception du produit du couple énonciateur.
Dit avec ce ton la réalité semble
insalissable, or, les deux dimensions ci-hauts mettent en avant une face
commune du discours politique, allant de la simple forme syntaxique aux
objectifs escomptés par les tenants de ce discours, passent par les
médias et/ou les journalistes pour atteindre les fins recherchés.
I.1.2.2. Formes du
discours politique
Il ne s'agit pas de présenter une liste
prétendue exhaustive de celles qui peuvent être
considérées comme propres au discours politique. Si une portion
bien moins importante justifierait une caricature du discours,
l'universalité du discours lui-même apportera de la
neutralité. De manière simpliste, nous essayons de souligner le
fait que relever des éléments propres au discours politique
accentue la conception péjorative du discours en raison de la politique
elle-même qui lui donne naissance.
En effet, le terrain de la politique miné des
idéologies et de stratagèmes pour maquiller et formater les
vérités, ne permettent pas au discours politique d'avoir belle
apparence. Plus souvent associer à la manipulation et à la
séduction, le discours politique est perçu comme un discours
mensonger. Cette tendance à appréhender le discours politique
comme une pièce montée, n'exclut pas une certaine
vérité, celle qui se notifie dans les objectifs des instigateurs
de cet objet31(*). L'on
retrouve quand-même un juste milieu dans la classification de Charland,
dans le développement de la pensée de Hariman concevant le
discours politique comme un objet stylisé et scénarisé).
Celle-ci débouche d'un neutralisme entre la conception
négative et positive du discours politique. Selon que tout discours
poursuit une finalité, mais dont l'éthique seule peut
déterminer la valeur. Charland se fixe sur le contenu du discours
politique afin de relever les traits d'ordre pragmatique que l'on retrouvera
dans quatre types de discours politique. C'est-à-dire, l'action que
provoque le dit d'un discours politique correspond à une forme
précise32(*).
Selon Harriman, le discours politique est :
- Réaliste : la perception du
réel est déjantée, le discours sert aux
intérêts du monopole et la parole est instrumentalisée. Ce
qu'il faut noter dans cette première esquisse est que l'environnement
politique emporté sur le vrai. Le discours s'utilise pour manifester la
force et battre la concurrence. C'est en instant un discours qui
dédaigne les discours périphériques, (par exemple le
discours du monopartisme du président zaïrois Mobutu). Il
présente celui qui l'énonce comme un élément
irréfutable de la réalité et de la vérité.
Faisant ainsi passer les autres discours (de l'opposition) comme
déviants.
- Courtois : ici, le discours sert au
rapprochement systématique. Cela veut dire que dans une logique de
pouvoir. Ce que dit celui détient le pouvoir trouvera difficilement ou
presque jamais, une contradiction auprès de son auditoire, car avec ce
style le sujet au centre transmet ses intentions « les plus
altruistes » à son audience ou son auditoire au profit de la
reconnaissance et du respect qu'il gagne, ce qui le rend incontestable. Il
introduit visiblement le rapport entre acteurs politiques et journalistes. En
ce sens où, le journaliste jouant un rôle d'observateur et
d'analyste s'appuie sur un contenu immédiat pour retranscrire ce que lui
entend. Cependant ce que lui entend trouve dans l'opinion publique une
adhésion, et donc l'acteur politique trouve une position symbolique au
sein de la société et devient une égérie pour les
médias et les industries culturelles. D'où, les journalistes
à travers l'industrie médiatique contribuent à la
création d'un personnage symbolique et incontestable, à chaque
apparition qui mettra en lisse le théâtre du politique.
- Bureaucratique : Ici le discours est
orienté vers une logique caduque du texte. C'est-à-dire que l'on
ne tient pas compte de la dimension situationnelle pour une éventuelle
interprétation du discours investi dans le texte. Cela dit, le point de
vue est partagé s'il faut considérer ce discours d'un point de
vue positif, même s'il se réclame ainsi. L'impossibilité
à outrepasser les règles et les fondements textuels,
d'interpréter un discours politique en prenant le contexte et
l'évolution de celui-ci n'en profitent pas à la
société. Car il reste dénotatif.
- Républicain : sans doute, une
forme reconnue dans nos sociétés dites démocratiques. Ici,
on emploie les discours politiques républicains au pluriel, pour faire
montre l'absence du monopolisme. Il y a plutôt une parole
libéralisée suivant les exigences démocratiques. Dans
cette forme du discours, les acteurs qui s'y trouvent sont en synchronisation,
cela voudrait dire que le discours politique n'a de sens que dans une
chaîne mimétique
. D'où le jeu politique influe sur la manière de
dire les choses. C'est également une forme qui utilise fortement les
médias, les journalistes pour atteindre l'objectif poursuivi, la
construction de l'identité, passe indéfiniment par un couple
politique-journaliste et journaliste public33(*).
I.1.2.3.
Caractéristiques du discours politique
Nous tenons à présenter ceux qui sont
pour nous, les marques propres à l'identification d'un discours dit
politique en cinq acceptions ;
- Le discours politique est un genre discursif qui repose sur
les techniques argumentatives et rhétoriques.
- Le discours politique est prononcé par un orateur
pour un auditorat
- Le discours politique est mythique ; il propose un
contenu fabuleux, extraordinaire autour de réalités de la
société dans lequel il surgit.
- Le discours politique a une visée
psychosociale ; il vise à marquer les esprits, à
séduire et ainsi à influencer les décisions dans l'espace
public.
- Le discours politique est de type
théâtral ; il n'est pas spontané, c'est une
préfabrication de la communication avec des objectifs ciblés.
I.1.2.4. Objectifs du
discours politique
Le discours politique se dit pour poursuivre un ou
plusieurs buts. Les penseurs et chercheurs autour du discours insistent sur le
fait que le but ultime d'un discours politique est d'influencer le choix et
décision de son public pour l'amener à l'élection. Et donc
la principale finalité est électorale. Mais il n'en reste pas
moins, ces objectifs qui entrent dans cette ambition de se faire élire.
- L'ambition de se faire connaître auprès du
public, dans l'objectif lointain de trouver reconnaissance auprès de la
société.
- L'ambition de séduire, à travers une image
façonnée par le discours du protagoniste. L'objectif est plus
ancré dans le marketing politique ; où le contenu du
discours permet de mettre en avant les qualités de l'orateur.
- L'ambition de trouver adhésion pour un
système d'idées; ici l'objectif est de persuader l'autre de
l'impérialité des idées que l'on défend, de mettre
l'autre de son côté, de marquer son imaginaire à travers ce
qu'il entend de son orateur.
Il faut noter que la cible du discours est
hétérogène et donc les techniques d'approches
diffèrent selon les objectifs fixés. Les arguments
avancés par le sujet politique respectent des normes hors lesquelles
l'intention de communication n'atteint pas le succès.
I.1.2.5.
Stratégies discursives et scène argumentative du discours
politique
Patrick Charaudeau met en évidence la notion de la
scène argumentative quand il s'agit du discours politique. Pour le
saisir, la scène argumentative n'est autre que la situation
communicationnelle qui impose un enjeu social de l'acte de langage.
Ceci dit, la mise en scène de l'argumentation
dans une visée de communiquer pour persuader, séduire ou
persuader utilisent quelques stratégies, parmi lesquelles ;
certaines sont d'ordre général et d'autres particulières
selon la situation et la visée de la communication34(*). Ce qui nous intéresse
sont les stratégies d'influence discursive étant dans un cadre
qui traite du discours. Ces stratégies s'effectuent dans une triple
activité qui à son tour permet le succès de l'acte de
communication. Une qui est de problématiser, l'autre de positionner et
enfin de prouver. Dans cette triple activité les stratégies
d'influence sous-tendent que tout instigateur du discours se prépare
à mettre des dispositifs qui lui permettent d'influencer son
interlocuteur dans cette scène discursive. En outre, ces
stratégies cherchent à satisfaire trois types d'enjeux capitaux
dans notre étude.
- L'enjeu de légitimation : l'orateur
détermine son autorité par effet de reconnaissance, de telle
sorte que ce qu'il dit soit légitime grâce à son
identité sociale.
- L'enjeu de crédibilité : la
crédibilité passe par l'entretien de l'image. Et cette image
relève donc de l'éthique de l'orateur. Qui plus est, ce qu'il dit
est jugé crédible parce qu'il est non seulement légitime
de le dire, mais ce qu'il dit correspond à une certaine éthique
qui lui est propre et donne une position de vérité, sinon de
véracité et du juste.
- L'enjeu de captation : il est question
d'adhésion, c'est une stratégie pour faire adhérer l'autre
dans ses idéologies. Un enjeu très présent dans la
relation politique-presse. cet enjeu utilise comme technique la
polémique, l'interpellation, la dramaturgie, l'héroïsme, la
tragédie, etc.35(*).
La question se posera de savoir comment, même usant de
ces stratégies, le succès du discours garde cette nature de
permanence. Les réponses se situeraient au niveau des moyens
utilisés par l'acteur politique, dans sa quête de pouvoir. Surtout
de mots qu'il utilise pour fabriquer son discours. Ces mots, ces phrases
à pouvoir de marquer fortement l'imaginaire linguistique de
l'interlocuteur, servent à graver l'image et tous les
éléments que l'acteur politique aura mis en lui, et ce, parce
qu'il lui sera répétitif au biais de l'information. D'où
le travail des journalistes36(*).
Il faudrait également avancer que les
stratégies discursives ont de l'impact sur l'interlocuteur car elles
utilisent dans le discours politique, un langage avec une qualité
cognitive, capable d'être retenu par le public facilement. Ce sont donc
les éléments de langage.
I.1.3. Les
éléments de langage
I.1.3.1. Qu'est-ce un
élément de langage ?
Ce que nous désignons par éléments de
langage ne dispose pas d'une charte définitionnelle comme telle. Ce
faisant, l'emploi de ce concept, abrégé par EDL, désigne
une large gamme de pratiques langagières propres à la
communication politique et aux spécialistes du discours politique.
Tentons de définir les
éléments de langage comme un ensemble de formules
langagières employées dans le but de rendre le discours politique
attrayant et symbolique. Les éléments de langages sont en
réalité `' les résultats du maniement des signes et des
discours et de l'ingénierie symbolique''. 37(*) Ce résultat s'obtient
grâce à une chaîne d'acteurs légitimes dans la
filière politique. Qu'il s'agisse des acteurs directs de la
communication politique ; les acteurs politiques ou des acteurs indirects
qui détiennent la légitimité de communication autour de la
chose publique. Ici nous retrouvons des auxiliaires de la communication de la
communication politique ; les journalistes, les attachés de presse,
etc.
Les éléments de langage sont
utilisés pour créer du sens, sinon apporter plus de sens dans le
discours politique par effet de captation. La visée psychosociale de ces
pratiques langagières permet de conditionner la réception du
discours qui est livré. Cette façon de faire s'élabore au
niveau des écrivants dans les lieux politiques. Ils s'investissent ainsi
toute la symbolique et tout le sens dans ces formules pour recadrer et
concentrer l'attention autour de celles-ci .
Il sied de noter que l'ambition du conditionnement de
la réception d'une formule langagière n'est pas spécifique
au travail des journalistes. En effet, les écrivants qui sont les
acteurs dont le rôle est de concevoir un discours politique se fondent
sur ce stratagème dans l'objectif d'orienter les journalistes vers ce
qui doit attirer le public. Tout en pariant sur le sens maker
du journalisme38(*).
I.1.3.2.
Catégorie des EDL
Il est question d'élargir la compréhension du
terme « éléments de langage » en creusant son
contenu, c'est-à-dire ce que nous pouvons retrouver dans cet ensemble et
comment l'identifier dans un acte de communication ou encore dans un discours
politique.
Soulignons tout d'abord qu'éléments de
langages est essentiellement linguistique et langagière. En ce sens
où, la distinction a lieu au niveau de leur apparence. Ce n'est pas un
simple ensemble de signes linguistiques aussi complexes soient-ils, car on y
retrouve également la position, la posture, les gestes qui accompagnent
la construction symbolique du sens. Dans un temps de discours politique,
l'énonciateur de ce discours utilise tout un langage qui appuie le sens
de ce qu'il dit. C'est ainsi que nous aurons une catégorie
d'éléments de langage plus simple et une plus complexe.
Ces catégories sont en
réalité de types d'énoncés diversifiés
créés dans une ligne d'objectifs. Ces énoncés ont
pour mission de créer et recréer leur existence dans les
pratiques et espaces discursifs du quotidien, en outre faire partie du lexique
d'une société.
- Les éléments de langage simples
Par EDL simples nous comprenons une catégorie dont le
contenu n'est pas complexe linguistiquement parlant. Ceci concerne les petites
unités linguistiquement qui sont le paquet sémantique d'un
énoncé. Ce sont donc :
- Le mot ; choisi par
l'énonciateur pour construire son énoncé. Par exemple,
quand le bloc de position contre le pouvoir kabiliste ont utilisé le mot
« glissement » ou
« déboulonnage », dans toutes les sorties et tous
les discours pour non seulement dénoncer le système en place,
mais créer un refrain dans la société et obtenir un
comportement commun.
- Les groupes nominaux ; « l'Allemagne de
l'Afrique », « carton
jaune » c'est une formule choisie par l'énonciateur
pour d'abord évoquer l'idée centrale de l'énonciation, et
faire valoir la suite de son acte.
- Les qualificatifs ; Dans les
règles de la langue, l'emploi du qualificatif permet d'évaluer la
qualité de quelque chose ou son état. L'objectif est identique,
mais celui-ci dans une situation de discours politique ou de communication
politique, apporte une visée de dramatisation au sujet qui est
développé. Par exemple,
« Médiocre » adjectif
utilisé par le feu cardinal Laurent Monsengwo Pasinya pour
désigner un gouvernant incompétent.
Cette catégorie présente une liste de termes
dont la structure est moins complexe, mais évoque une pertinence dans le
discours de celui qui en est l'instigateur.
- Les éléments de langage complexes
Nul n'est besoin de rappeler la complexité de la
structure linguistique. Ce sont donc des formules plus investies dont la
visée suit celle de la première catégorie. Mais
diffèrent au niveau de l'apparence de ces dernières. Ils sont
caractérisés par une nature générique qui devient
de normes du discours. Certains sont de création nouvelle,
contextualisée pour appuyer une idée que l'on a ambition non
seulement de faire connaître mais de faire valoir et de la faire
accepter. Ce sont donc ;
- Les « petites phrases » :
un terme très usité chez Ollivier -Yaniv et Krieg
Planque. Le premier le désignera comme un terme qui fait sens dans un
contexte donné et pour une culture locale qui suit une situation
socio-politique ou tout simplement politique39(*). Ce terme traduit alors les pensées de
l'acteur ou les acteurs qui en sont les énonciateurs pour exprimer cette
idée et le rendre accessible aux énonciataires qui l'utiliseront
pour équivaloir à la même idée ou à une
idée proche de l'expérience. C'est ainsi que Clifford Geertz les
nomme « le concept proche de l'expérience ». c'est
par exemple : «consulter la base ».
- Les rites discursifs ou les formules rituelles
discursives : c'est du moins la formule la plus populaire du
langage politique. C'est généralement une phrase qui a pour
mission première de traduire l'intention de l'énoncé, le
ton et la mesure même de l'énoncé. On le retrouve
généralement à la fin d'une énonciation, aussi pour
rendre une image salvifique à l'énonciateur. Souvent investi dans
les voeux et l'émoi. Exemple : « que Dieu bénisse
la RDC », « Vive l'Etat droit, vive la République
Démocratique du Congo ».
Le succès d'un élément de langage
consiste à sa permanence de ce dernier dans le langage de la
société pour laquelle il est créé. Cela dit, la
réception de ces formules langagières est une étape
majeure et exigeante de la communication politique, en ce sens où elle
requiert l'intervention de plusieurs acteurs.
I.1.3.3. Conditions
de réception des EDL
Une fois que l'ingénierie met sur le marché du
langage une innovation, faudrait-il encore que celle-ci atteigne son objectif,
lequel est entre autres de marquer les esprits, de fabriquer les alliés
d'une idéologie. Ceci respecte donc quelques conditions pour que ces
fins soient effectives.
La première condition se situe au niveau des
écrivants. Le travail de l'écrivant doit relever de
compétences d'attraction. Les mots ou les unités
phraséologiques qu'il propose doivent nécessairement
posséder un dynamisme. Ce dernier se traduira par la cohérence au
contexte, au lieu, au problème ou sujet traité et au statut de
celui qui le dira en suite.
La deuxième condition est d'abord celle de
l'intermédiation entre les acteurs politiques et les journalistes qui
assurent la troisième condition. Par intermédiation, nous
comprenons le travail du juste milieu de spécialistes ou auxiliaire
légitimes de la profession dans le milieu politique qui, lorsque leur
métier est identifiable et reconnaissable, livrent un produit
méticuleux et médiatiquement remarquable.40(*)Ensuite il y a une condition
d'anticipation de la reprise médiatique que doit contenir cette formule.
A l'issue de la fabrication de ce produit, le
succès de la réception est un enjeu médiatique ou
journalistique. Parce que c'est le lieu où la condition de circulation
donne le lieu aux succès escomptés. Pour se faire, le travail du
journaliste extrait du discours de l'acteur politique celui qui paraît
pour lui symbolique et signifiant pour construire son papier de presse ou son
article. C'est est en effet le résultat de la réussite de la
seconde condition de la précédente, car le travail de
l'écrivant oriente l'angle de traitement.
Le traitement du discours par le journaliste permet
ensuite de créer un cadre légitime par une pratique de
contextualisation et d'interprétation qui s'ensuit sur base de ce que
ressort l'ouvrage de presse comme de clés d'entrées.
I.1.3.4. Construction
du sens des « éléments de langage »
La littérature précédente laisse
croire qu'il n y a pas de sens sans réussite de ces conditions
réunies ensemble. Bien évidemment ces éléments de
langage doivent introduire une nouvelle pratique dans la langue de la
localité ou de la société entière. Au niveau de
trois conditions, nous pouvons au préalable surligner quelques
éléments de construction de la signifiance pour qu'ils soient ces
mots, ces phrases acceptés et normalisés.
Le sens est donc construit dès le niveau de la
fabrication ; dans la conception du discours lui-même. Mais ceci
n'est qu'un travail de `pose pierre'. C'est réellement au niveau de la
reprise médiatique et donc le traitement de l'objet, rendu en une
information. Dans ce cas la première étape de ce travail au
niveau du discours politique qui, lors de la reprise devient un
événement médiatique en ce sens qu'il devient un fait
à rapporter ou à commenter (le point suivant nous dirons
plus) ; laisse place à un autre type de discours qui dynamise
le sens : le discours journalistique.
I.1.4. Discours
journalistique et représentation sociodiscursive
I.1.4.1. Le discours
journalistique
Le point sur le discours politique a posé un
cadre de compréhension du discours lui-même. Ce point vise
à approfondir la notion du discours journalistique, du choix de cette
terminologie et de l'importance de cet élément dans notre
travail.
Le genre dont il est question tire essence de la
profession qui permet de le classifier comme tel. Ce qui serait important est
l'appréhension du terme journalisme, le comprenant non pas comme le
conserverai le journalism studies41(*)s, comme un métier de la recherche de la
vérité au profit du public. Mais il s'agira d'appréhender
le journalisme comme pratique discursive et dans les méandres de
l'énonciation. Partant d'une définition simpliste, le journalisme
est l'exercice du métier de ceux qui informent le public à
travers les médias (les journaux, la radio, la télévision,
l'internet). Les journalistes sont donc ceux qui recueillent, traitent et
publient une information.
Vu dans un cadre énonciatif, le journalisme
consiste en un type d'énonciation au biais duquel, les
énoncés sont construits autour de faits ou
« événements » qui ont pour but de
communiquer de messages ou quelque chose selon la visée qu'elle
poursuit. C'est précisément dans le discours journalistique que
l'on retrouve la matérialité du texte qui constitue un acte
énonciatif. Pris ainsi, il respecte le schéma de
l'énonciation dont la situation de communication comporte :
- L'énonciateur : celui peut être
assimilé au destinateur ou à l'émetteur
- L'énoncé : le produit fabriqué de
l'énonciation, investi de sens et destiné à être
interprété par les énonciataires ou les destinataires
- Le lieu et le temps de l'énonciation
- L'énonciataire : ceux qui reçoivent les
énoncés (assimilés aux destinataires et aux
récepteurs, le public)
- Le référent : les objets qui l'entourent
l'énonciation42(*).
La figure ci-après
démontre ce processus.











Référent
Figure 1 : l'énonciation
I.1.4.2. Visée
du discours journalistique
S'appuyant sur les travaux du linguiste français
Charaudeau, nous comprenons que le discours journalistique comporte toujours
deux visées ; une visée d'information et visée de
captation ou de dramatisation.
- La visée d'information : ici, le discours
journalistique sert au faire-savoir. Il permet au citoyen d'être
informé suffisamment et considérablement pour participer à
la vie publique. L'enjeu est centré sur la crédibilité du
discours du journaliste. Celui-ci est donc amener vers un traitement de
l'information fidèle et exact43(*). Le journaliste s'efface pour respecter la question
d'ordre éthique, autrement l'ethos voudrait que le discours
journalistique soit au service des intérêts du public au moyen de
la transmission fidèle de l'information.
le journaliste use de pratiques discursives
conformément à la norme d'écriture. Ce, en passant par les
genres journalistiques qui le permettent. Notamment, le compte-rendu, le
reportage, etc.
- La visée de captation : le journaliste bien
qu'il soit éveillé par l'éthique, son travail ne se limite
pas qu'à une activité automate de rendre des faits. Dans sa
casquette de contre-pouvoir, la mission lui convient d'expliquer, de commenter
et de questionner. La visée de captation est centrée sur l'enjeu
de dramatisation44(*).
Celui-ci implique également le non prise de parti, même s'il
s'agit d'un genre type comme l'éditorial ou la chronique. Dans ce cas,
le journaliste se positionne comme un narrateur externe.
Pour mieux cerner la notion de discours journalistique,
Roselyne Ringoot désigne le discours journalistique comme
celui-là que l'on retrouve dans le matériel ou le support
médiatique (plus loin, elle parlera du discours des
journaux)45(*).
C'est en effet, l'énonciation du sujet journaliste autour d'un objet
qu'il traite à travers un langage propre qui respecte les normes
d'écriture de la profession46(*).
Le langage journalistique permet de prélever
les énoncés journalistiques issus dans un majeur, des
interactions discursives entre les journalistes et leurs sources. Nous
préférons parler en termes de `discours journalistique', car nous
nous attelons à ce qui est dit dans un journal (comme support, non comme
entité), ce dit, est le `dit' du journaliste sur une thématique
donnée. En abordant ainsi la question du discours journalistique, ceci
nous mènera à développer le journalisme (et ceux qui
l'exercent) dans une transportation dans le champ de l'énonciation outre
que le champ du discours.
I.1.4.3.
L'énonciation journalistique
L'objectif en clarifiant ce concept, est de
comprendre comment l'énonciation journalistique foisonne le sens, ce
à partir de production des journalistes, voir d'emblée qui parle
et comment le fait-il ? Dans sa composition, le discours journalistique
comprend donc des énoncés, des « dits », et
de faits que le sujet journaliste rapporte. D'autre part, l'énonciation
journalistique est propre au sujet lui-même (les cas de certains genres
journalistique ; les analyses, les éditoriaux, les chroniques, les
dossiers, etc.).
La construction du sens comme
préconisée dans le point précédent,
établissait une position considérable au traitement de
l'information. Ce qui doit trouver des éléments de
démonstration. En ce sens où, l'énonciation journalistique
permet d'évaluer cette thèse dans l'offre informationnelle. Cette
dernière résulte de deux types d'énonciation
indissociable.
- L'énonciation éditoriale
L'énonciation éditoriale
prépare la mise en scène de l'information. Elle est celle qui ne
relève pas de mots de la langue, mais de l'espace public de
l'information. En outre, c'est le niveau de la matérialité du
texte. C'est-à-dire son environnement tout entier.
Citant, Annelise Touboul, l'énonciation
éditoriale est « signifiant constitué par la
matérialité du support de l'écriture, l'organisation du
texte, sa mise en forme...tout ce qui en fait une existence
matérielle »47(*). Ce concept signifie une dimension médiatrice
de l'information en ce sens où elle permet la reconnaissance de l'offre
informationnelle, participant ainsi à sa légitimation ou sa
démarcation48(*).
- L'énonciation textuelle
À la fois opposée
à la première et en relation avec celle-ci, l'énonciation
textuelle concerne le contenu de l'article de presse. C'est le lieu où
le discours journalistique est palpable. C'est l'investigation des
énoncés journalistiques. La relation entre les deux types
d'énonciation journalistique se fonde sur les objectifs de pertinence de
l'offre informationnelle. Une pertinence qui n'est évaluée qu'en
termes de complémentarité entre le contenu de l'article et le
journal lui-même qui le crédibilise.
Les deux énonciations permettent
d'étudier le discours journalistique, selon l'angle du chercheur. Pour
notre cas, il est utile la répétition de la quête de la
construction et production du sens de mots qui sont utilisés dans une
localité ciblée (la capitale de la RDC) à travers le
discours journalistique. Ce discours permet donc d'appréhender les
différentes représentations sociodiscursives qui
s'opèrent à la suite du travail journalistique.
Emprunté à la conception de Ringoot,
la représentation sociodiscursive assumée par le sujet
journaliste ressort des interactions discursives du journaliste et de son
propre discours au moment du traitement et de la publication de l'information.
Autrement, c'est la résultante de la construction et du traitement de
l'événement médiatique49(*). Celui-ci est donc le mode discursif de la mise en
scène de l'information expliqué dans un tableau qui toute
l'économie du questionnement de l'architecture du discours
journalistique.
Ce tableau élaboré par Patrick
Charaudeau explique l'univers du discours journalistique. Il est important car
il donne lieu de saisir la manière dont le journaliste construit
l'information qui devient un objet à étudier.

























Faits réactions déclarations
réactions








Description explication paroles actions
Présentation explication Paroles actions






Acteurs actions contexte et témoignage rapprochement
focalisation
Figure 2 : l'événement médiatique
Les représentations sont en
réalité les effets de la pratique discursive journalistique sur
la construction et le développement de nos systèmes de
connaissances partagés dans une communauté et qui traduit une
réalité sociale. Pour le comprendre, il faut se
référer au tableau ci-haut qui démontre toute
l'activité de la pratique journalistique au biais de son mode discursif.
I.2. Ancrages
théoriques
Dans cette seconde partie de notre travail, il s'agit
de présenter les approches théoriques qui tentent d'expliquer
notre problématique en lien avec les hypothèses que nous avons
avancées dans l'introduction. S'agissant d'une construction propre
à la logique de ce travail, le champ de l'objet ; le langage, nous
oriente vers des approches développées autour du langage, mais
qui pour notre compte, se justifie, ce à travers les différentes
confrontations fréquentes dans la suite.
I.2.1. La
praxématique
I.2.1.1. Naissance
d'une linguistique de la signifiance
La première approche qui rencontre notre objet
d'étude est la praxématique. Une discipline qui dit les termes de
notre recherche à travers ses postulats fondamentaux qui permet au
chercheur d'étudier la production du sens en langage. La
praxématique est alors une sémiotique particulière en ce
sens où elle s'intéresse à la signifiance du discours ou
de ce qui le compose dans son milieu de production50(*). Une
interdisciplinarité qui converge sciences du langage et les
études autour du signe dans son milieu d'activité, mais dont les
fondements ne sont pas saisissables.
Appelée communément sémiotique
montpelliéraine, car c'est dans cette partie de la France, vers les
années 70 que naîtra cette approche nouvelle issue de la critique
sur le courant structuraliste et le développement des courants
linguistiques fidèles au postulat saussurien. Elle construit un cadre de
réflexion et d'analyse autour de la linguistique signifiante dans la
recherche de la compréhension de la production signifiante dans la
matérialité de sa réalisation51(*).
Le champ d'investigation de cette approche de la
signification se limite alors aux pratiques langagières, à partir
desquelles, elle construit une grille pour guider l'étude. Aux alentours
de sa formation, plusieurs champs théoriques l'environnent, sinon elle
emprunte aux
Théories auxquelles elle identifie les insuffisances et
pour certaines de pistes d'ouvertures pour construire sa grille. Il s'agit
notamment des théories du sens et du langage en contexte52(*).
- Praxématique et les disciplines du signe
Un lien entre la sémiologie et la
sémiotique s'installe dès le cadre de son entrée
épistémologique. En effet, la praxématique conteste
l'analyse saussurienne dont la sémiologie renferme la langue dans une
autonomisation close à la langue plutôt qu'à ses conditions
de sa production. Pour cela, il faudrait, non seulement concevoir le sens
véhiculé par la langue à travers une simple dichotomie, il
faut ajouter à cela une praxis sociale et socioculturelle53(*) pour appréhender les
phénomènes linguistiques observables dans une
société.
En outre, la praxématique s'oppose à
l'immanence du signe, elle postule que la signifiance se produit et se
réalise qu'au contact d'un référent. Le
développement de la sémiotique54(*) de Peirce soutient cette prise de position, elle
permet d'étudier les phénomènes linguistiques, la
production du sens donc, dans un système expliqué par le rapport
que le sujet parlant entretien avec la langue, ainsi son interlocuteur au
contact du même exercice pour que le résultat signifiant se
justifie par effet de reconnaissance.
Pour l'illustrer ce trop-plein théorique, le
sens du mot : orange, n'est pas immanent. Dans une perspective
où le sujet parlant de nationalité congolaise qui usera de
celui-ci aura dans un premier temps une expérience résultante du
contact de la langue qu'il manipule, le français. Le mot a donc pour
sens une couleur ou un fruit. Alors dès qu'il entre en relation avec le
milieu qui régit sa lexie, un processus référentiel se met
en marche, en identifiant dans un système (le sujet parlant congolais
vit dans un milieu, et les éléments ou facteurs sociaux
alimentent la particularité linguistique), il identifie autour de lui
les éléments socioculturels qui permettent l'actualisation de ce
qu'il sait déjà, ces facteurs se retrouvent dans une
société, eu propres à ses règles de fonctionnement,
c'est ainsi qu' Orange peut signifier une rupture.
Cet exemple soulève une autre trace
théorique en prenant en compte l'élément
société comme fondement de la signification ou du sens,
exploité notamment en sociolinguistique.
- Praxématique et sociolinguistique
Cette connivence à la sociolinguistique ne
l'intègre pas dans toute sa dimension, car en plus de tenir compte du
cadre social des productions d'activités langagières et
discursives, la sociolinguistique, car elle se limite à la simple
covariance des phénomènes sociaux et linguistique ; soit un
élément, le moins qui le réunit. Si la praxématique
se joint à la sociolinguistique, c'est évidemment parce qu'elle
suppose que la condition de production détermine favorise le sens.
I.2.1.2. Postulats de
la praxématique
Pour comprendre l'ancrage de cette première
perspective théorique implanté dans notre sujet d'étude,
il sied de présenter quatre postulats sur lesquels se fonde cette
théorie du sens.
- il n'existe pas d'immanence du
signe : la praxématique veut déconstruire le point
sur une réalité univoque de la signification. Elle pose une
perspective inverse en instituant la situation d'actualisation du sujet
parlant. « il ne peut y avoir un signifié immanent,
plutôt d'outils linguistiques dont seule l'actualisation par un sujet est
productrice de sens ».
- toute communication linguistique est une praxis
sociale : s'appuyant sur la virtualité de transformer le
milieu, le monde où les hommes sont en communication et en relation.
- le sens vient aux mots selon les conditions de sa
production et sa réalisation : celui-ci découle de
deux premiers. C'est-à-dire que la combinaison du milieu social, de sa
réalité sociopolitique et les différents types
d'interaction réalise la signifiance comme finalité qu'elle
poursuit.
- elle a pour champ d'investigation les pratiques
langagières : les pratiques langagières, comme
définies dans la première partie, sont pour la
praxématique, ce qu'est le langage pour la linguistique55(*)e.
I.2.1.3. Outils
terminologiques en praxématique
Étudier un phénomène langagier,
comme tout autre, implique des outils, ou des prédicats sur lesquels
s'appuyer pour faire convenir une pratique à un développement
théorique. C'est ainsi que chaque approche dispose d'outils
terminologiques dans lesquels sont investis la démarche pour mener
à bien une étude, sur quoi la mener et pour aboutir à quel
résultat, interprétable au moyen de quel
élément ?
- Le praxème : le praxème
est l'unité qui permet d'analyser le sens investi dans un discours. Il
est donc l'unité pratique de production de sens que la
praxématique substitue au signe. Par opposition à la dichotomie
de Saussure, elle inclut le référent comme une composante
essentiel du langage pour l'investigation du sens. Le rôle du
praxème est d'assurer le couplage entre le réal et la forme du
langage56(*).
- Couplage : le couplage est la relation
recherchée entre le langage et son ancrage dans le réel,
c'est-à-dire l'environnement qui permet de signifier quelque chose sous
contrat pour quelqu'un ou pour un groupe. Le couplage se réalise par une
catégorisation référentielle. Cette dernière
s'établit à partir d'un repérage du groupe de traits dans
le réel par sa perception et par la praxis. Ceci produit `une
véritable dialectique régit en fait la relation du réel
à sa représentation en langage ; et ce sont les
appréhensions pratiques du réel, les praxis techniques et
sociales éprouvées dans le vécu existentiel, que l'homme
versé dans le langage et qu'il y inscrit57(*)'.
- Programme d'actualisation : au niveau
du couplage on identifie les traits qui correspondent à la
réalité sociétale, ainsi pour finaliser la signification,
il faut un programme d'actualisation du discours. Le programme d'actualisation
permet de sélectionner parmi les potentialités du mot, le
signifié du praxème par un autre processus de réglage.
Les trois niveaux permettent d'obtenir les résultats
d'une investigation autour du processus de signification. Pour permettre une
compréhension approfondie de notre objet, il faut nous
référer au fondement de cette praxématique. La logique de
notre travail nous oriente vers deux autres approches pour complémenter
la première approche théorique. Il ne s'agit pas de faire un
récit autour de leur origine, plutôt de présenter les
éléments de ces approches qui cadrent avec notre étude.
I.2.2. La
sémiolinguistique du discours
I.2.2.1. Fondamentaux
de la théorie
De sémiologie et sémiotique,
respectivement science du signe dans la vie sociale pour l'une et étude
du signe, de leur système et leur signification. Et linguistique,
étude de la structure des langues et du langage. La
sémiolinguistique se veut être l'étude de la relation entre
les faits du langage et les phénomènes psycho ou sociolangagiers.
Elle a pour ambition la construction sociolangagière du sens
réalisé à travers un sujet parlant, qui est lui-même
psycho-socio-langagier.58(*) Chère à Charaudeau, la
sémiolinguistique tente de proposer une approche d'analyse du discours
en suggérant une grille pour étudier l'acte de langage dans son
intégralité. Et rechercher dans le discours, le processus de
sémiotisation, de sémiologisation, de signification59(*). Étant dans une
interdisciplinarité, la sémiolinguistique puise ses ressources
principalement dans les travaux traitant de l'analyse du discours à
partir des approches de Pécheux.
Elle part de l'hypothèse selon laquelle, le langage
comprend plusieurs dimensions ;
- Une dimension cognitive : elle permet de
connaître le rôle du langage dans le monde, selon qu'il en soit la
perception de ce dernier, ou si à travers le langage une
opération de catégorisation du monde s'effectue.
- Une dimension sociale et psychosociale : cette
dimension du langage sert à questionner les valeurs des échanges
des signes et sur la valeur de faits de langage dans la société.
- Une dimension sémiotique : la dimension
sémiotique stipule que dans la construction du sens du langage, passe
par un processus de sémiologisation et de sémiosis60(*). Mais d'étudier les
formes dans lesquelles s'investissent les significations ; les mots, les
phrases ou le texte.
Pour rendre cette grille théorique applicable, l'auteur
se fonde sur le `de quoi nous parle le langage' et sur le `comment nous parle
le langage61(*)'. La
recherche du sens et de la signification s'investissent dans une
conceptualisation et technique, lieu d'appréhension et d'organisation du
projet sémiolinguistique.
I.2.2.2. Concepts et
processus d'analyse
Les concepts et processus d'analyse sont en effet le cadre
pour mettre en pratique les postulats théoriques de sa science.
Charaudeau parle en termes d'appareil langagier (énonciatif, narratif,
et argumentatif), l'organisation formelle de mise en discours.
Repérage dans l'explicite discours, et la
compétence, reposant sur trois cadres et trois composantes62(*).
I.2.2.2.1. Le double
processus de sémiotisation
Charaudeau postule un double processus de
sémiotisation qui influe sur le monde. L'un est celui de la
transformation, qui partant d'un monde à signifier transforme celui-ci
en `monde signifié' sous l'action d'un sujet parlant. Et l'autre, celui
de la transaction qui fait de ce monde signifié un objet
d'échange avec un autre sujet parlant qui joue le rôle de
destinataire de cet objet63(*).
- Le processus de transformation
Il comprend quatre types d'opérations pour
étudier le premier niveau de sémiotisation du monde. (nous
n'allons pas nous appesantir là-dessus étant donné que
notre étude se penche sur le processus de transaction pour
compléter l'approche praxématique).
- L'identification : c'est le niveau de
l'identité des éléments matériels qui constituent
le monde. C'est-à-dire, que pour étudier un fait langagier, il
faut d'abord le désigner, c'est ainsi que les êtres du monde
deviennent des identités nominales. (un homme, une femme, un acteur, un
journaliste, ...).
- La qualification : c'est le niveau
descriptif, les êtres du monde sont reconnaissables à partir de
leurs propriétés, qui les discriminent, les différencient,
les spécifient et motivent la manière d'être. Ils
deviennent alors des identités descriptives (un homme politique, une
femme docteure, un journalistique politique...).
- L'action : c'est le niveau narratif,
ces êtres du monde agissent, et ces actions leurs donnent une raison
d'être en faisant quelque chose. Ils deviennent, sur ce point, des
identités narratives.
- La causation : il y a ici le rapport
de causalité entre le deuxième et le troisième niveau, car
la qualification de ces êtres justifie l'action. La causalité est
donc le niveau qui prend en compte le motif ou motivation de l'action. (le
président de la République s'adresse à la nation au sujet
du calendrier électoral).
Le processus de transaction alloue également quatre
principes, non entièrement différents de la transformation, car
se complétant sur certains niveaux. Certains principes se dynamisent en
relation avec un type de transformation.
- Le principe d'interaction : il stipule
que tout acte de langage est un échange entre deux partenaires qui se
reconnaissent semblables (parce que le succès de l'échange repose
sur un partage d'un savoir commun et des finalités) et
différents, car chaque partenaire joue un rôle précis,
celui d'un sujet-émettant produisant un acte de langage et un
recevant-interprétant de cet acte.
- Le principe de pertinence : il est
question de contrat socio-langagier de l'acte du langage. Une communication,
un échange n'a de pertinence que lorsque les deux partenaires partagent
le même code référent. L'acte de langage doit être
approprié à son contexte et sa finalité. 64(*)
- Le principe d'influence : il postule
que tout sujet-émettant produisant un acte de langage cherche atteint
son recevant-interprétant soit pour l'émouvoir, soit pour le
faire agir, soit pour orienter sa pensée. Dans cette même logique,
le recevant-interprétant sait qu'il est la cible.
- Le principe de régulation : ce
principe postule le fait le principe d'influence doit être
régulé entre les deux partenaires, car s'il y a influence au
niveau du sujet-émettant, il peut également y avoir une
contre-influence65(*). La
figure suivante nous démontra ce double processus.
Nous ne tenons pas à nous attarder sur les autres
outils et concepts d'analyse que nous présente Charaudeau, par besoin de
restriction, les approches théoriques sont en effet une construction
logique qui seront explicitement comprises dans le niveau d'analyse et
interprétation de résultats.
I.2.3. L'école
de Genève
Cette esquisse théorique sera
présentée de manière très brève. En
réalité, les fondements des approches que nous nous
apprêtons à présenter, ont été
soulevés dans les points précédents. S'agissant d'une
autre théorie dans le champ du langage, elle possède, cependant,
une particularité.
Lorsqu'on aborde l'école de Genève en
linguistique, cela évoque des travaux étroitement liés
à ceux de Ferdinand de Saussure. Les approches
sélectionnées dans le traité sur la langue, nous
permettent, comme l'a stipulé l'introduction, d'étudier le statut
du journaliste de là où il énonce. La notion sur
l'expressivité et la communication sont deux niveaux théoriques
sur lesquelles seront gravées nos analyses.
Débutons par Albert Sechehaye, qui propose la
stylistique pour étudier les interventions de la langue dans une
société. Son postulat tire essence de la critique sur la
théorie de Bally, considérant la théorie de l'expression
peut complète et attachée au niveau interne de la langue.
Sechehaye postulera une prise en compte générale
de la théorie de l'expression. Se fondant sur le locuteur et l'histoire
qui influence la langue. Il définit l'expression comme le but ultime du
langage, en la plaçant à l'intérieur d'un problème
grammatical66(*).
Par ailleurs, il définit le statut du locuteur,
comme sujet parlant, de nature psychologique pourvu d'intelligence et de
volonté, capable d'influencer le système grammatical et lexical
d'une langue et de la faire avancer. Cette conception attire notre attention.
Il fonde ainsi la première grille de superposition des résultats
de nos analyses. En ce sens où, la notion de légitimité de
sujet journaliste trouve un espace pour être examiner67(*).
Ce qui sera complété par Henri Frei. En
effet, s'inspirant de la linguistique fonctionnelle, Fei va lier expression et
communication en ce sens où, le sujet parlant est lié à un
besoin d'expressivité et ce besoin d'expressivité. Cette
dernière traduit une autre réalité de la conscience du
sujet parlant.
Ce que Frei tente de nous est que la langue est
résultat du niveau communicationnel du sujet parlant qui, de par son
besoin d'expressivité, a conscience du contenu qu'il transmet et la
finalité de celui-ci.
I.3. Ancrage
méthodologique
Après avoir établi le lien entre
les approches théoriques et l'objet d'étude. Le lieu
présente la manière dont nous concevons la méthode
d'analyse de l'objet traité dans ce travail. Ce travail procédera
par une méthode qualitative, car nous estimons qu'il est judicieux de
qualifier avant de quantifier. Les méthodes qualitatives sont
différentes. La première méthode est une analyse du texte
proposée par Jules Gritti. C'est une méthode d'entrée pour
solutionner notre problème à travers un corpus constitué
d'articles de presse en ligne (nous le présenterons en profondeur dans
la deuxième moitié du chapitre 2).
La deuxième méthode est
également qualitative, basée sur les entretiens
semi-structurés. Elle permet de d'ajouter à une simple analyse,
les points de vues des énonciateurs (les signataires, auteurs des
articles qui constituent notre corpus). Dans un premier temps,
définissons l'approche méthodologique.
I.3.1. La
méthodologie
Qu'est-ce que l'approche méthodologique ?
Il faudrait comprendre l'approche
méthodologique comme les moyens que nous disposons pour mener notre
étude. Il consiste exactement à présenter le modèle
sur lequel repose notre analyse.
Elle désigne une manière de
procéder dans une étude scientifique, par observation des
principes qui fondent la méthode de recherche. Elle permet de regrouper
tous les informations inhérentes à l'analyse. Pour notre compte,
nous avons jugé utile de faire usage d'un modèle bricolé
à partir des cadres outils théoriques pour l'appliquer à
l'examen d'une structure de même caractère.
Plus concrètement, la méthodologie
est l'étape de préparation de la méthode de la recherche.
Elle vise à identifier la méthode de recherche, de
spécifier les sujets à étudier, de sélectionner
adéquatement les échantillons ou les données et la
construction de méthodes qualitatives ou quantitatives
d'analyse68(*).
I.3.1.1. La
méthode
Quant à elle, La méthode scientifique est
une démarche raisonnée de l'esprit pour mener à bien un
travail scientifique. C'est le passage sine qua non pour la quête de
la vérité69(*). Pour notre compte, nous avons choisi le
bricolage d'une méthodologie qualitative. En ce sens, la démarche
de notre étude présente, à certains niveaux, une forme
quantitative.
La méthode qualitative permet de mettre
l'accent sur les effets de situation, les interactions sociales sous
contraintes, la place de l'imaginaire, le jeu des acteurs avec les normes
sociales. Disposant tout de même d'une recherche de causalité
différente de la méthode quantitative70(*).
La démarche méthodologique dans cette
étude se veut une analyse qualitative du contenu. Car nous empruntons
à l'analyse du discours et à l'analyse de contenu, de cadres
d'analyses. Dans un premier nous appliquerons l'analyse textuelle, basé
sur deux cadres d'analyses parmi tant d'autres que propose Jules Gritti.
L'analyse textuelle s'effectue (dans le troisième chapitre) sur base
d'un corpus élaboré à partir d'articles de trois
pureplayers qui constituent notre terrain d'étude. (Voir chapitre 2).
En effet, l'analyse qualitative, comme le
désigne Pierre Paillé, est une activité de l'esprit
humain tentant de faire du sens face à un monde qu'il souhaite
comprendre, interpréter ou transformer. Cette activité fait appel
à des processus qui sont ceux de la pensée qualitative de
l'être humain ordinaire pensant avec intelligence, le monde autour de
lui...71(*)
I.3.2. L'analyse
textuelle du discours
Souvent classée parmi les méthodes
d'analyse de contenu, l'analyse textuelle présente une surface qui
s'adapte aux ambitions du chercheur ou de l'analyste selon son champ. Qu'il
soit qualitativiste ou quantitativiste. L'analyse textuelle naît dans
les pas des postulats de Saussure, désignée parfois sous le terme
de linguistique textuelle72(*)Elle sera intégrée dans le vaste champ
de l'analyse de discours par Jean-Michel Adam, lequel stipule qu'il existe une
analyse textuelle du discours. La convergence s'explique du point de vue
théorique et conceptuel.
Celui considère que l'analyse du discours a besoin
d'une dimension linguistique, et de la langue en emploi ;
développement de l'idée de Saussure basée sur la langue
discursive. Jean-Michel Adam définira alors l'analyse du discours
textuelle comme une théorie de la production contextuelle du sens qu'il
est nécessaire de fonder par l'analyse de textes concrets73(*).
L'analyse textuelle du discours nous permet d'aborder
le terrain selon les approches qu'elle offre. L'une qui est lexicale ; de
quoi parle-t-on ? Les autres s'intéressent au comment
parle-t-on ? (linguistique), comment est-il
représenté ? (la cartographie cognitive), et comment
l'interpréter (analyse par thématique)74(*).
De nos jours, plusieurs modèles d'analyse
textuelle convergente, cependant contraint de chercher, mordicus, le processus
de légitimation d'un type de langage, le mode par filtrage de Jules
Gritti nous intéresse.
? Selon le modèle de Jules Gritti
Les modèles d'analyse textuelle
différentes, selon que chacune présente ses outils d'analyse.
C'est en raison de ces derniers que le modèle proposé par Jules
intéresse notre étude. C'est une grille large avec plusieurs
entrées et niveaux d'analyse par filtrage. L'analyse se déroule
en six filtrages successifs, chacun d'eux étant axé sur une
articulation différente du texte proposé à
l'observation.
Il s'agit donc d'opérationnaliser,
à l'intérieur d'un contexte théorique global,
l'étude d'une production discursive. Les six filtrages qui sont
proposés par J. Gritti s'inscrit dans une logique que l'on peut
reconstruire de la manière suivante. Les deux premiers filtres essaient
de révéler le contenu : il s'agit de retrouver les
oppositions ou les associations d'une part et d'autre part les niveaux de
culture. Ces deux filtrages ont pour objet l'analyse de la structure
fondamentale du texte en lui-même.
La deuxième perspective porte sur
l'énonciation et est destinée à étudier le profil
idéologique du locuteur. Il s'agit cette fois de trois filtres
différents. Tout d'abord, on étudie les connotations qualitatives
du texte, qui permettent de déterminer le lieu privilégié
par le locuteur, lorsqu'il désire communiquer avec un public
précis. Le deuxième filtrage étudie les lieux
idéologiques, c'est-à-dire les parties du discours où
l'idéologie du locuteur a le plus de probabilité de s'exprimer.
Un dernier filtrage de cette catégorie s'intéresse aux types de
raisonnement utilisés par locuteur. 75(*)
La dernière perspective est celle de la
relation de communication, entre le locuteur et le public, c'est-à-dire
la manière dont le locuteur parle, le type de vocabulaire utilisé
pour se qualifier lui-même et pour qualifier le destinataire.
? Les six filtrages de l'analyse textuelle
Ces filtrages sont en réalité des niveaux
d'analyse, qui peuvent être pris de façon détachée.
C'est-à-dire il est possible de procéder à une analyse
selon les ambitions du chercheur ou de faire une analyse intégrale
partant de ces 6 filtrages.
Premier filtrage
- Contenu du discours
Le travail s'accomplit sur la charpente du texte en relevant
sa structure paradigmatique. Quelles sont les associations de mots, et quels
types d'associations manifestent le sens et la vigueur d'une communication en
articulant le syntagme que constitue le discours ? Les figures
repérées dans le texte peuvent être binaires ou ternaires.
Ici, il s'agit de faire un repérage dans la structure du texte pour
relever les disjonctions et les associations opérées dans les
discours76(*).
? Le niveau de culture
Il est ici question de repérer les
différentes connotations que l'auteur institue dans son discours
- Repérer les mots
définis
Cela consiste à identifier dans le discours
les mots que l'auteur utilise, mais qui échappent à la
compréhension du reste de groupe pour deux finalités ;
? Soit pour révéler de l'idée que le
locuteur se fait de ses interlocuteurs.
? Soit pour rendre compte les champs d'intérêt du
locuteur, ceux sur lesquels il ne veut pas d'erreur de communication. Ces
définitions sont souvent idéologiques.
- Repérer les mots non définis
Ce niveaux suit l'explication du précèdent
niveaux, la différence s'établit au niveau de l'identification du
mot qui paraît inconnu au lecteur dans son intégralité (ni
le mot ni la lexie n'est connue
- Repérer les mots
traducteurs
Il s'agit des métaphores à fonction
traductrice qui visent à faire passer une communication à propos
d'un événement dans un registre de vocabulaire connu du lecteur.
(Réf) -
Repérer les termes
connotés
Ce sont les termes qui ont l'air d'appartenir à la
langue commune, mais dont le sens a été dévié par
certaines connotations qu'il faut connaître pour comprendre le terme.
- Regrouper les termes par
registres
Finalement, le regroupement des termes en
registre sportif, politique, médical, etc. permet de repérer le
niveau de culture privilégié ou imposé par
l'émetteur à son public.
- L'idéologie du locuteur
Après avoir étudié le texte
du point de vue de son contenu, J. Gritti propose deux filtrages
destinés à mettre en lumière la manière dont le
locuteur se situe vis-à-vis du contenu qu'il désire transmettre.
Cette partie permet de situer l'acteur dans l'analyse et de rendre compte du
degré d'auto-implication du locuteur. Il s'agit donc d'une analyse de
l'énonciation. On pourrait, en s'inspirant d'autres démarches,
notamment celles de M. PECHEUX (formations idéologiques), de M. FOUCAULT
(formation discursive) ou GREIMAS (schéma actantiel), proposer encore
d'autres filtrages. (Réf) discours et analyse du discours77(*).
? Les connotations qualitatives
L'analyse consiste, à l'exclusion de tout ce
qui est purement descriptif, à repérer tout ce qui sert à
apprécier ou à déprécier une réalité.
L'ensemble des connotations permettra de percevoir quel est le type
d'argumentation préféré par l'auteur. 78(*)
? L
es lieux
idéologiques
Inspiré des
topoi d'Aristote, les endroits du discours où
l'idéologie s'investit de manière implicite. C'est-à-dire
repérer dans l'énoncé les traces d'un positionnement dans
la formule phraséologique.
? Les figures de
déploiement
Ce filtrage s'occupe de la manière dont le
locuteur fait fonctionner le texte, des rapports qu'il établit à
l'intérieur de celui-ci, des « figures de style »
qui en garnissent l'argumentation. 79(*)
- Les rapports de
communication
L'acte de communication comprend trois
éléments : un locuteur, un message, un destinataire. Il
s'agit maintenant d'examiner le rapport entre le locuteur et le
destinataire.
? Le rapport entre
locuteur et destinataire
Ce filtrage veut repérer dans le discours les traces
des acteurs de la communication : Fauteur-locuteur, le(s) destinataire(s),
ainsi que les relations entre les destinateurs et destinataires. Ces relations
se manifestent pour chaque acteur dans trois lieux
privilégiés : l'usage des pronoms (une analyse lexicale),
les allusions à soi-même ou les déclarations sur soi, plus
explicites.
Pour notre analyse, nous nous limitons à
construire une grille d'analyse à partir de trois filtrages sur trois
niveaux d'analyse. Au premier niveau portant sur le contenu du discours, nous
prendrons le filtrage selon la culture. Au deuxième niveau portant sur
l'idéologie des locuteurs ; les connotations qualitatives sera le
deuxième module d'analyse et au troisième niveau, nous pour
analyser le rapport de communication, nous travaillerons sur ce rapport entre
locuteur et destinataire.
S'agissant d'une analyse croisée, la seconde
partie d'analyse est du type conversationnel.
I.3.3. L'entretien
C'est la situation au cours de laquelle un
chercheur, essaie d'obtenir d'un sujet des informations détenues par ce
dernier, que ces informations résultent d'une connaissance, d'une
expérience ou qu'elles soient la manifestation d'une opinion. C'est donc
le type de relation interpersonnelle que le chercheur organise avec les
personnes dont il attend des informations en rapport avec le
phénomène qu'il étudie80(*).
L'entretien est une démarche qui se base
sur l'acte de communication, cette démarche est préparée,
et respecte des normes préétablies. L'entretien permet au
chercheur d'entrer directement en contact avec le sujet qui se retrouve au
centre de sa recherche. Il permet à la recherche un arrière-plan
aux hypothèses relevées, mais aussi de confirmer les aspects des
résultats qu'une analyse d'autre type offre.
Pour notre compte, l'entretien nous permet de
questionner la pratique journalistique en confrontant les résultats des
analyses du corpus (les énoncés de presse dont il est
l'énonciateur. Et donc il ajouta à notre observation et à
notre analyse, un regard interne pour compléter la recherche.
L'entretien se présente sous diverses formes, il peut être
directif (structuré), semi-directif et ouvert.
I.3.3.1. L'entretien
semi-structuré
L'entretien semi-directif est l'un de
formes d'entretiens utilisé dans la démarche qualitative. Il
porte sur un certain nombre des thèmes identifiés dans un guide
d'entretien formulé au préalable par l'enquêteur.
La particularité de l'entretien semi-directif
réside dans sa mission de démystifier le protocole, et d'orienter
la recherche vers une forme conversationnelle pour éviter d'enfermer
l'interviewé dans de questions techniques.
I.3.3.1.1. Le guide
d'entretien
Le guide d'entretien est l'outil qui sert à
inscrire les grands thèmes ou les questions à aborder. Il permet
également d'inscrire les éléments de réponse tout
au long de l'entrevue.
I.3.4. Techniques
Pour mener à bien notre étude, nous usons
de l'observation participante et furtive.
I.3.4.1. L'observation
furtive
En effet, l'observation furtive permet au chercheur
d'être un examinateur extérieur du phénomène qu'il
étudie. Par contre l'observation participante, introduit le chercheur
dans l'expérience du phénomène qu'il
étudie81(*).
Conclusion
partielle
Ce premier chapitre est la partie lumineuse de ce
travail. Il a permis de poser les cadres de compréhension du sujet qui
occasionne cette étude, cadres qui ont fait objet d'une économie
dans les liminaires. Subdivisée en trois sections, chacune d'elle avait
pour ambition d'éluder la démarche de cette étude.
Dans la première section, consacrée
à la clarification conceptuelle, nous avons défini les termes qui
apparaissent dans notre sujet de manière, mais aussi indirecte. Une
étape importante, car il permet de comprendre l'intitulé du
travail et de le situer dans des champs théoriques. Cette partie a
joué un rôle crucial pour justifier les perspectives
théoriques. En traçant ainsi un chemin logique, entre le discours
politique, journalistique et les pratiques langagières qui ont soutenu
le sens donné au concept clé de cette étude ; la
fabrique sociolinguistique.
Dans la deuxième, nous avons inscrit cette
conceptuelle dans nos perspectives théoriques. En effet chaque niveau
d'appréhension conceptuelle sous-entendait une ou deux approches
théoriques. Les approches exposées convergent, et se situent dans
une interdisciplinarité interne, en ce sens où la science du
langage se décline dans plusieurs domaines à l'instar de la
sémiolinguistique qui met ensemble la science de la langue, la science
de signe et celle de l'information et de la communication.
Dans la troisième section, nous avons
exposé la méthodologie essentiellement qualitative, qui sera
mise en pratique pour étudier notre problème.
DEUXIÈME
CHAPITRE : DE LA SITUATION SOCIOLINGUISTIQUE AU TERRAIN DE RECHERCHE
Le deuxième chapitre de notre travail a deux
points. Le premier point traite de la langue française, principalement
à Kinshasa. Dans celui-ci nous faisons une brève
présentation de la situation du français à Kinshasa, car
celle-ci se retrouve au coeur de notre travail. Le deuxième point
consiste à présenter le terrain d'analyse. Nous
présenterons au premier plan les médias pure players desquels les
journalistes sont nos interviewés et dans le second plan, nous
présenterons le corpus de notre travail qui doit être soumis
à l'analyse textuelle.
II. 1. Situation
sociolinguistique à Kinshasa
Ce point est important, car il traite du
français ; le sujet qui réunit tous les domaines
cités dans ce travail. Il ne s'agit pas de centraliser l'attention
autour de celui-ci, il s'agit plutôt de présenter la situation
linguistique du français, car de lui, nous tirons les 10 mots
présents dans le corpus fini de l'analyse textuel, mais aussi parce
qu'il s'agit de la langue qui retrouvée dans le discours journalistique.
II.1.1. Aspects
sociodémographiques
La République démocratique du Congo
possède plus de 48 millions de locuteurs du français dans la
francophonie, dont plus de 10% de locuteurs en Afrique subsaharienne.82(*) La République
Démocratique du Congo possède une grande variété
linguistique. Elle possède quatre langues véhiculaires les
plus parlées dans la capitale: le lingala, le kikongo, le swahili et le
ciluba. Ainsi que les 221 vernaculaires Celles-ci se retrouvent dans les
périphéries de la capitale, sont cependant manipulées par
quelques citoyens dans la capitale à cause de l'exode rural. Le
français est donc la langue officielle (du pouvoir,
de l'administration, de l'enseignement, de la presse, etc.).
Dans la capitale, pour mesurer le succès
d'une langue et ainsi situer une certaine influence, il faut
nécessairement recourir à la catégorisation de classes
sociales imbriquées aux attitudes linguistiques83(*). Ce passage est absolu, il
aide à une formalité dans un faisceau d'arguments
légitimes d'une influence d'une langue au détriment de l'autre
à Kinshasa. Ces deux langues sont le Lingala opposé au
français, sachant que c'est la langue française qui
intéresse dans cette étude. Les attitudes linguistiques
soulignées sont en effet, une manifestation d'un
intérêt, c'est-à-dire, les motivations d'usage du
français ou du lingala en ce que chacun implique.
Vu de cet angle, nous nous amènerons à
penser que la langue de l'étranger est en conflit avec la langue
socioculturelle. Les motivations sont diverses. C'est ainsi que reprenant le
contrôle, il y a une appropriation culturelle.
II.1.2. Stratification
sociale et usage de la langue
Les lignes introductives ont
souligné la difficulté de mesurer l'influence de la langue
française. Soutenant qu'il existerait des cadres qui laissent à
une considération du plus influent. Dans ce contexte, il faut recourir
aux classes sociales et aux attitudes linguistiques. L'ambiguïté se
situe de la considération même, celle-ci serait
institutionnelle ; le cadre légal accordé au français
un caractère officiel, par ricochet, le français est la langue du
pouvoir. Cet argument annule toute confrontation, si cela doit être pris
dans toute sa légalité, mais ce besoin né dans une
perspective plus profonde : le français est historique, il raconte
une époque de domination, d'où, le rejet de sa forme culturelle,
l'adoption d'une forme locale.
Or le lingala par exemple naît dans un cadre
géographique légitime. Cependant ce qui confère au
français, une place, aux premiers abords, est d'ordre psycholinguistique
et émotionnel, en ce sens où, lorsqu'il est parlé, il
crée le souvenir, l'identité et l'appartenance. Aux seconds
abords, les locuteurs du français local bénéficie de la
reconnaissance auprès de ses pairs ; une réalité
opposée à la stigmatisation avec le lingala84(*). A partir de ces deux
facteurs, nous pouvons situer la place du français dans la capitale
congolaise à ces trois niveaux sociaux qui engendrent des attitudes
linguistiques85(*).
La classe supérieure ;
retrouvées dans la politique du pays, les instances religieuses, les
milieux éducatifs, dans la presse, etc. à côté de
celle-ci il existe, la classe moyenne qui engendre une attitude politicienne,
et la classe ouvrière qui engendre une attitude puriste
considérant le français comme une honte et une aliénation.
Ce qui nous intéresse est la première classe, car elle impacte le
reste86(*).
II.1.3. Classe
supérieure et attitudes linguistiques du Français à
Kinshasa
La classe supérieure donne lieu à trois
types d'attitude observables dans la capitale ;
- l'attitude colonialiste, elle tente de
prouver l'existence du français d'Afrique, et ce français doit se
contenter d'introduire un vocabulaire de la réalité africaine
tout en restant conforme à la norme du français standard.
87(*)
- L'attitude copropriétariste :
elle considère le français comme une
copropriété, comme « un fond commun qui constitue le
trésor collectif », qui doit partager les mêmes valeurs
et la même considération au même titre que le
français local.88(*)
- L'attitude appropriationniste : ici,
le français est considéré comme « un butin de
guerre » un trésor que l'africain, quel que soit son pays, a
arraché aux colons. Elle suppose qu'il faut rebaptiser le
français local dans son contexte national.89(*)
Dit ainsi, la pertinence de ce travail puise sa force
dans ces attitudes qui nous permettent de présenter les mots qui sont
le soubassement de notre analyse dans le troisième chapitre. Et sur base
desquels nos entretiens ont été portés.
II.1.4.
Présentation des occurrences d'analyses
Ces occurrences sont des mots que nous retrouvons dans
les articles de presse congolais. Ils sont puisés dans les
différentes communications d'acteurs politiques, produits à un
moment précis de la vie publique ; soit pendant la période
préélectorale, électorale et postélectorale, ils
sont ensuite récupérés par la presse pour en faire des
articles de presse en ligne.
Il sied de noter que nous les délimitations
entre les productions journalistiques allant de Décembre 2021 à
Décembre 2022, puisque quelques-uns ont été produits plus
tôt et dont la remontée de source étouffera
l'actualité du travail. Il s'agit de :
1. Glissement
2. Déboulonnage, (Déboulonner)
3. Taliban
4. Nouvelles unités
5. Maper, Mapé, (placer sous map)
6. Béton
7. Base, (consulter la base)
8. Guerriers
9. Kabilie
10. Coup de poing
Ces mots se retrouvent dans notre corpus que nous avons
constitué à partir de deux médias en ligne.
Actualité.cd et Politico.cd
II.2.
Présentation du terrain de recherche
Nous avons choisi de travailler avec
Actualité.cd et Politico.cd en raison de leur
référencement, et du fait qu'en tant que pure players en RDC, la
couverture de l'information est large, aussi qu'ils disposent d'une grande
audience. Cependant, la raison est également spécifique, nous
avons sélectionné un média qui pratique un journalisme
factuel et un média qui pratique un journalisme engagé.
II.2.1. Un journalisme
factuel : Actualité.cd
Le journalisme factuel est celui dont la pratique
respecte en tout temps la sacralité des faits dans le traitement de
l'information. Il se retrouve dans une pratique qui cherche l'effet de
réel. Actualité.cd se retrouve dans cette catégorie, en ce
sens où les informations qu'il offre, racontent des faits recueillis
comme ils se présentent. Cela a pour but de donner et de
préserver la crédibilité du média.90(*)
II.2.1.1.
Actualité.cd en chiffres
- Date de création : 2016
- Fondateur : LIGODI Patient
- Nature : éditeur
d'actualités et médias.
- Statistiques réseaux :
Twitter : 636 323 suiveurs/ Facebook : 200.000 abonnés/
YouTube : 7.000 abonnés/ Instagram : 92.000 followers
- Rubriques principales : Politique,
Sécurité, Sport, Economie, Société, etc.
Tableau 1 : Actaulité.cd en chiffres
|
Actualité.cd
|
|
|
Classement, catégorie média en ligne
|
1ere place
|
|
Nombre de visites
|
961.8000 en visite totale
|
|
Répartition visiteurs : Genre et tranche
d'âge
|
- 58% d'hommes contre 41% de femmes
- Age de visiteur entre 25 et 34 ans, soit 29.33%
|
|
Pays principaux
|
République Démocratique du Congo, Afrique du
Sud, Belgique, Cameroun, et autres
|
Source : Similar web
II.2.1.2.
Présentation d'Actualite.cd
Actualite.cd, est un média numérique
congolais de type commercial, basé à Kinshasa, capitale de la
République démocratique du Congo, sise avenue Rochereau Tabuley
(ex. Tombalbaye), numéro 32, dans la commune de la Gombe, qui a
été lancé le 04 août 2016 à l'Hôtel
Invest à Kinshasa, par le journaliste Patient Ligodi qui est son
fondateur et actuel Directeur général, devant Boucard Kasonga
Tshilunde (Président de l'Union nationale de la Presse congolaise de
l'époque), plusieurs professionnels de la corporation journalistique et
une quinzaine de médias91(*).
Au départ Actualite.cd n'avait que trois
rubriques, dédiées principalement aux informations liées
à la politique, l'économie et la sécurité et une
déclinaison sous forme d'humour avec la rubrique caricature,
chapotée, par le bédéiste et caricaturiste congolais
Thembo Muhindo Kash. Dans son discours lors du lancement
d'Actualité.cd, son fondateur Patient Ligodi avait affirmé
s'être servi de son expérience lors de son passage à
Politico.cd, pour bâtir un média encore plus professionnel, plus
envoûtant, plus réactif et plus complet. Actualite.cd est alors
née pour délivrer l'information en temps réel.
Son crédo demeure que l'information congolaise
doit d'abord être donnée par les médias congolais et non
par les médias étrangers. Très vite, l'expérience
d'Actualité.cd a commencé à intéresser le monde
médiatique francophone au point que le 21 octobre 2016, Patient Ligodi
le présente à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) dans
le cadre de la conférence sur le journalisme et nouvelles technologies
de l'information et de la communication en Afrique subsaharienne.
En décembre 2016, une équipe de la
radiotélévision belge de la communauté française
(RTBF) a passé plusieurs jours à la rédaction
d'Actualité.cd pour un long reportage sur la couverture de la crise
politique congolaise par la rédaction d'Actualité.cd. Ce
reportage intitulé « Au coeur de l'Info »
réalisé par Wendy Bashi et Jean-Marc Vierset a été
diffusé sur la RTBF le 6 janvier 201692(*).
Au début de l'année 2017,
Actualite.cd est devenu membre de l'Association des médias
d'informations en ligne de la RDC (MILRDC) qui a vu le jour à la suite
de la Ière Assemblée générale tenue le 12
février 2017. Patient Ligodi, à cet effet, est devenu le tout
premier président de cette plateforme qui a pour but la promotion et la
défense de la production et l'accès à l'information en
ligne pour tous dans notre pays. Le 16 février 2017, Next Corp a
lancé l'application mobile Android d'Actualité.cd en avril 2017,
une équipe de la radio onusienne Okapi a passé une journée
à la rédaction d'Actualité.cd et a produit un reportage
sur le traitement de l'information dans cette rédaction atypique.
Le 26 mai 2017, Actualite.cd a organisé la
toute première édition de son événement le News
Forum devant environ 200 personnes au Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa.
Corneille Nangaa, Président de la Commission électorale nationale
et indépendante (CENI) de l'époque était face aux
journalistes d'Actualité.cd aux internautes qui intervenaient via
Twitter, Facebook et WhatsApp, en plus de la participation d'une centaine de
personnes dans la salle. Le News Forum a été diffusé en
direct sur Twitter (Périscope) et sur Facebook Live. Le film Chroniques
congolais sur l'expérience Actualite.cd, réalisé par la
cinéaste Wendy Bashi, a été projeté en
avant-première à Bruxelles le 29 mai 2017.
Actualite.cd a remporté plusieurs
distinctions et récompenses dont les trois Prix Lucien Tshimpumpu de la
liberté de la presse décernés par l'Union nationale de la
presse du Congo (UNPC) et le Conseil supérieur de l'audiovisuel du Congo
(CSAC) lors de l'édition 2017. L'édition 2017 du Prix Lucien
Tshimpumpu restera historique car c'était pour la première fois
qu'un média en ligne puisse être primé et les trois Prix de
cette édition ont été tous décernés aux
journalistes de la rédaction d'Actualité.cd, ce qui était
également une première, de voir les journalistes d'une même
rédaction être lauréats à ces trois Prix93(*).
Depuis la succession de ces
évènements, Actualite.cd a franchi différentes
étapes qui ont fait de lui aujourd'hui l'un des géants de la
presse en ligne en RDC. En janvier 2020 les chiffres d'Actualité.cd
étaient estimés à environ 1 600 000 visiteurs uniques par
mois, environ 2.000.000 de visites par mois, plus de 250.000 followers sur
Twitter/lère audience Twitter d'un pure player d'info, près de
200.000 fans sur. Facebook, plus de 10.000 abonnés à la
Newsletter, plus de 5 000 téléchargements de l'application et
plus de 31 000 abonnés sur Instagram.
II.2.1.3. Statut
juridique et ligne éditoriale
Le média en ligne Actualite.cd appartient
à la société Next Corp, spécialisée dans la
communication digitale et dans l'édition des contenus de création
d'entreprise pour internet en République démocratique du Congo.
Next Corp est enregistré comme établissement au Guichet Unique de
Création d'Entreprise (GUCE) avec un numéro du registre de
commerce, une identification nationale et un numéro d'impôt. Pure
Player à vocation neutre, Actualite.cd n'apporte aucun jugement
personnel dans les informations qui sont livrées94(*).
II.2.1.4.
Organisation
- Structure
Le media en ligne Actualite.cd en tant qu'une
entreprise de presse est composé des organes suivants: La direction
générale, la direction de publication, la rédaction en
chef, le responsable administratif et financier, le responsable logistique, la
rédaction centrale, la production multimédia, la caricature et la
représentation en province.
- Direction Générale
La direction générale
d'Actualité.cd est sous l'autorité de Patient Ligodi (Directeur
Général). Il représente la société devant
les tiers (actionnaires, institutions politiques), engage l'entreprise
auprès des partenaires, supervise l'ensemble des activités de
l'entreprise. Il est le garant de la stratégie générale et
de la vision de la société.
- Direction de publication
Patient Ligodi est le directeur de publication
d'Actualité.cd, il est secondé par Stanys Bujakera (directeur de
publication adjoint) et de trois autres directeurs de publication adjoints, qui
ont pour charge, l'animation des desks spécialisés :
- Direction de publication Foot.cd
La direction de publication de Foot.cd est dirigée par
Monsieur Michel Tobo. Son rôle est de rendre public les informations
footballistiques afin de les communiquer au grand public.
- Direction de publication DeskEco.com
La direction de publication de DeskEco.com est
gérée par Monsieur Amédée Mwarabu. Son rôle
est de rendre publiques les informations économiques.
- Direction de publication DeskNature.com
La direction de publication de DeskNature.com est
sous la responsabilité d'Auguy Mudiayi. Son rôle est de fournir
les informations sur les enjeux du bassin du Congo, la salubrité,
l'environnement, le développement durable, la nature, le climat, l'eau,
etc.95(*)
- Rédaction en Chef
La rédaction en chef d'Actualité.cd
est composée d'un rédacteur en chef en la personne de Patrick
Maki et de deux secrétaires de rédaction, les journalistes Japhet
Toko et Michel Tobo. La rédaction centrale a pour tâche de
coordonner la rédaction centrale et veiller au respect de la ligne
éditoriale du média. Elle assure également le lien entre
la direction générale et les autres services techniques et
administratifs.
- Responsable administratif et financier
Les responsabilités administratives sont
coordonnées par Miss Bangala et Raïssa Tshikandama. Elles
gèrent les ressources financières de l'entreprise et est
chargée de dresser les prévisions budgétaires; de
normaliser les écritures de paiement des créances et de
recouvrement des recettes et mettre à jour les documents comptables.
- Responsable logistique
La logistique d'Actualité.cd est
dirigée par Lucien Ligodi qui a pour mission d'élaborer la
politique de gestion de flux et de planning production.
- Rédaction centrale
La Rédaction centrale d'Actualité.cd
basée à Kinshasa est composée de 15 journalistes
reporters, il s'agit de : Patrick Maki, Auguy Mudiayi, Prisca Lokale, Japhet
Toko, Stanys Bujakera, Michel Tobo, Grâce Muwawa, Emmanuel Kuzamba,
Fonseca Mansianga, Blaise Baise, Thérèse Ntumba, Ivan Kasongo,
Jordan Mayenikini, Clément Muamba, Berith Yakitenge.
- Production multimédia
Au sein d'Actualité.Cd la production
multimédia qui symbolise la création de l'ensemble des techniques
et des produits qui permettent l'utilisation simultanée et interactive
de plusieurs modes de représentation de l'information,
c'est-à-dire l'ensemble des techniques qui combinent plusieurs moyens de
communication de l'information est assurée par : Olivier Muamba; Lydia
Muteba; Will Cleas Nlemvo.
? Représentation en province
- Rédaction Grand Katanga
La rédaction de l'espace Grand Katanga,
couvrant les actualités des provinces qui constituaient autrefois
l'ex-Katanga la Lomami, le Tanganyika, le Haut-Lomami et le Haut-Katanga) est
dirigée par les journalistes José Mukendi et Ben Akili96(*)
- Rédaction Grand Kasaï
La rédaction de l'espace Grand Kasaï,
couvrant les actualités des provinces qui constituaient autrefois
l'ex-Kasaï Occidental et Oriental (le Kasaï, le Kasaï Central et
le Sankuru) est dirigée par le journaliste Sosthène Kambidi.
- Rédaction Région des Grands
Lacs
La rédaction de la région des Grands
Lacs composée de la République. Démocratique du Congo, le
Burundi, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie
et la Zambie, est sous la direction des journalistes Justin Mwamba, Yassin F,
Jonathan Kombi, Yvonne Kapinga, Claude Sengeya, Freddy, Lavoix Lubunga,
Chadrack Londe.
- Rédaction Kongo Central
La rédaction de la province du Kongo Central
(ex. Bas-Congo) est dirigée par le journaliste Danny Kinda Nzita.
- Rédaction Grand Bandundu
La rédaction de l'espace Grand Bandundu
couvrant les actualités des provinces qui constituaient l'ex-Bandundu
(le Kwango, le Kwilu et le Mai-Ndombe), est gérée par les
journalistes Jonathan Mesa et Gabriel Mbumba.
II.2.1.5.
Fonctionnement
Cette structure fonctionne comme une
rédaction normale avec un personnel qui travaille au quotidien depuis
Kinshasa dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. La
rédaction est composée d'une vingtaine des jeunes journalistes
habiles en nouveaux médias et spécialisés en politique,
sécurité, économie, société, santé,
justice, sports etc. Actualité.Cd propose chaque jour en moyenne 20
dépêches contenant textes, photos, vidéos, infographies,
vidéos avec pour objectif de tenir informé avec une nette
longueur d'avance. L'équipe s'appuie sur des sources directes dont les
témoignages sont toujours mis en avant.
Il dispose également des correspondants
dans les 26 provinces que compte la RDC en général et
particulièrement dans les grandes villes du pays telles que Lubumbashi
(Haut-Katanga), Goma (Nord-Kivu), Bukavu (Sud-Kivu), Kolwezi (Lualaba),
Kisangani (Tshopo), Mbandaka (Equateur), Matadi (Kongo Central). Kananga
(Kasaï-Central), Beni (Nord-Kivu), Bunia (Ituri) etc. tous travaillent
sous la coordination de la rédaction centrale basée à
Kinshasa.
Les productions d'Actualité.cd se basent
sur le travail d'une rédaction centrale basée à Kinshasa,
des bureaux régionaux à Goma, à Kananga et à
Lubumbashi en plus des correspondants à Bruxelles et à Paris.
Organigramme
d'Actualité.cd (voir page 11)






















II.2.2. Un journalisme
engagé : Politico.cd
Le journalisme engagé est plus
militantisme97(*).
L'écriture journalistique dénonce et choque. Les journalistes qui
usent de ce type, mettent en avant la fibre patriotique pour construire la
crédibilité. Le journalisme engagé est aussi une pratique
interactive, il crée un lien entre les journalistes et le public.
II.2.2.1. Politico.cd
en chiffres
- Date de création : 2016
- Fondateur : LITSANI Choukran
- Nature : éditeur
d'actualités et médias.
- Statistiques réseaux :
Twitter : 702.514/ Facebook 520.00/ YouTube :
- Rubriques principales : Politique,
Sécurité, Sport, Economie, Société, etc.98(*).
Tableau 2 : Politico.cd en chiffres
|
Politico.cd
|
|
|
Classement catégorie média en ligne
|
12e place
|
|
Nombre de visites
|
261.000 en visite totale
|
|
Répartition visiteur : genre et tranche
d'âge
|
- 57.88 % d'hommes contre 42.12%
- Dominé par les 24 à 34 ans
|
|
Pays principaux
|
République Démocratique du Congo, Cameroun,
Canada, République Tchèque, Zimbabwe
|
II.2.2.1.
Présentation de l'entreprise
POLITICO.CD appartient au holding purement congolais, LEOPARDS
MEDIAS GROUP, qui est, en terme d'audience, la première agence presse et
médias de la RDC. La totalitéì de l'équipe tant
rédactionnelle que technique est congolaise, ce qui fait de ce
média un produit local.
Le souci du détail est une
prioritéì chez POLITICO.CD qui reste
de loin le média
congolais ayant l'infrastructure technologique la plus élaborée.
Le média est également disponible en format vidéo, et en
version web, mobile et imprimée.
POLITICO.CD est le point de référence
obligeì pour tous ceux qui ne veulent pas simplement se contenter de
« consommer» l'information, mais se passionnent pour la confrontation
d'ideìes dans un pays grand et prospère. Une autre facon de
faire... Une reìdaction, composeìe de journalistes
expeìrimenteìs et de jeunes reporters : elle assure du contenu du
site et une bonne partie de sa production. Un cercle de speìcialistes,
de passionneìs et de témoins qui apportent leurs regards et leurs
lumières sur l'actualiteì.
Le siège de POLITICO.CD se trouve sur l'avenue
Kitega n°217 (croisement Mushi), commune de Lingwala, immeuble Shadary,
appartement 8, au deuxième étage.
- Historique
Crééì en février 2016
par Benjamin Litsani Choukran, POLITICO.CD est devenu en un temps record
l'acteur majeur de l'information en ligne en RDC et le seul meìdia
traitant principalement de la politique du pays, bouleversant les pratiques
habituelles tant au niveau de la rapiditéì du traitement de
l'information que dans la profondeur99(*).
Au regard des défis actuels portés par
les nouvelles technologies de l'information et de la communication,
POLITICO.CD a étéì lanceì pour répondre au
défi de l'information de qualitéì en République
Démocratique du Congo, dans le domaine politique.
Il est donc un meìdia dédiéì
aÌ la promotion d'un journalisme audacieux. Un journalisme qui apporte
la transparence dans le débat public, ainsi que dans la gestion de la
chose de l'Etat. Un contre-pouvoir qui, véritablement, se place au
milieu des acteurs politiques de tout bord et milite pour la justice.
Politico.cd est un site d'information et
d'enquête réellement premium, orienteì vers
l'intérieur que l'extérieur. Sa singularitéì, au
regard de l'offre éditoriale existante en RDC, se caractérise par
son très haut niveau d'exigence tant rédactionnelle que
ergonomique. Résolument haut de gamme, il s'adresse avant tout aÌ
un lectorat de l'élite, ce qui lui permet de se positionner comme
principale source d'information crédible sur la question politique en
RDC.
Les applications mobiles de POLITICO.CD
regroupent tant la version web que le magazine papier, tout en offrant une
expérience unique. En version Android et IOS, elles offrent un canal par
excellence de diffusion et de fidélisation du lectorat. Des outils de
notifications ainsi que l'ergonomie de standard international permettent aux
lecteurs de rester aÌ la pointe de l'information en temps réel,
tout en intervenant au débat.
POLITICO MAGAZINE est un mensuel
exclusivement consacreì aÌ l'actualiteì politique en RDC.
Acteur «du politique» et sociétal avec des valeurs
républicaines, d'ouverture, de modernitéì, d'audace et
d'innovation, il est aussi le magazine des changements aÌ l'affut des
ideìes nouvelles.
POLITICO développe l'actualiteì avec un
regard décalé et un ton qui lui est propre en laissant une large
place aÌ la photo. Sa mise en page et son style font de lui un magazine
international dédié aux décideurs. Il fait suite au site
d'actualiteì POLITICO.CD et englobe, en son sein, quatre
thématiques dont : LA POLITIQUE, L'ECONOMIE, LA PROSPECTIVE ET LE DEBAT,
permettant aux annonceurs d'associer leur image au domaine spécifique de
leur prédilection.
Tireì aÌ 25.000 exemplaires en
édition nationale, et, tous les six mois, 5000 en édition
internationale, le magazine contient 130 pages toutes en couleur,
imprimées en Afrique du Sud. Ce qui fait de lui un magazine papier
indépendant en République Démocratique du Congo. Le
magazine est directement distribueì aÌ 5000 décideurs et
hommes politiques aÌ travers le pays, en plus d'être vendu dans la
rue, faisant de lui le magazine l'un des magazines les plus lus du
pays100(*).
II.2.2.2. Cadre
juridique
POLITICO.CD et ETERNITY STUDIO appartiennent à
LEOPARDS GROUP SARL qui a comme ID. Nat : 01-93-N79269Z et RCCM :
14-A-05002.
II.2.2.3.
Fonctionnement
La rédaction de POLITICO.CD travaille tous
les jours et en continu. Les journalistes ne sont pas obligés de venir
tous les jours dans la rédaction pour travailler mais doivent produire
au moins trois articles par jour en descendant sur le terrain soit en faisant
le monitoring. POLITICO.CD met à la disposition de tous les
journalistes, une connexion internet à la rédaction et de
manière individuelle, des frais de transport chaque semaine pour toute
sorte de déplacement lié au travail, des gilets pour être
facilement identifiés lors des évènements.
Chaque journaliste est appelé à
envoyer dans le forum digital de la rédaction un sujet sur lequel il
compte travailler. Après l'appréciation ou recommandation du
rédacteur en chef ou secrétaire de rédaction, il peut
alors se lancer dans le traitement. Une fois fini, le journaliste renvoie son
article dans le même forum pour sa relecture par le rédacteur en
chef soit le secrétaire de rédaction avant sa publication. Au
cas où le journaliste ne présente aucun sujet à la
rédaction, le rédacteur en chef soit le secrétaire de
rédaction peut lui confier une tâche à remplir.
Avant que tout article soit mis en ligne, le
webmaster doit avoir l'autorisation de le faire venant du rédacteur en
chef ou du secrétaire de rédaction qui joue également le
rôle de directeur de publication et directeur de publication adjoint.
Chaque journaliste est appelé a envoyé dans le groupe WhatsApp de
la rédaction, le sujet sur lequel il travaille, de peur qu'un autre ne
tombe dessus.
En ce qui concerne la descente sur le terrain, le
journaliste signale toujours à la rédaction le sujet sur lequel
il travaille et le lieu où se déroule l'événement
à couvrir. La rédaction peut également
dépêcher un journaliste sur le terrain afin de couvrir un
événement lié à l'actualité, soit de
clients ou partenaires.
Outre le quota d'au moins trois articles par jour,
les journalistes rédigent à côté des dossiers de
presse et des enquêtes journalistiques pour alimenter le site web et
permettre ainsi aux lecteurs d'avoir des explications sur un sujet
d'actualité ou approfondir leur connaissance sur une affaire
donnée. Certains journalistes ont des accréditations dans
certains ministères et institutions publiques et couvrent
continuellement les activités de ces organisations.
POLITICO.CD a aussi des correspondants qui se
trouvent dans certaines zones de la République Démocratique du
Congo (Nord-Kivu et autres) pour couvrir tout ce qui se passe dans ces
contrées. Il contacte diverses personnes ressources pour recueillir
auprès d'elles des informations de première main et exploite de
documents officiels pour proposer au public des informations dont il a
certainement besoin
Organigramme

II.3.
Présentation d'articles de presse
Dans ce point, nous allons présenter les
articles de presse qui seront soumis à l'analyse textuelle. Nous tenons
à les présenter au second plan car ils sont tirés de deux
médias présentés dans la partie précédente.
Le corpus est composé de plus ou moins 5O articles, lesquels seront
présentés selon le modèle simpliste par Mots et
Description de l'unité (article). Soulignons que les signataires de ces
derniers ont requis l'anonymat.
Nous procédons par deux tableaux, le premier
reprend tous les articles d'Actualité.cd et le second, ceux tirés
de Politico.cd, avec comme indicateurs les dix mots cités ci-hauts, pour
chaque médias.
II.3.1. Articles
Actualité.cd
Tableau 3 : Présentation des articles
d'actualité.cd
|
MOTS
|
DESCRIPTION DE L'UNITÉ
|
|
Glissement
|
Titre
|
Date
|
Rubrique
|
|
RDC: "Il est hors de question que les acteurs politiques
marchandent la guerre à l'Est du pays pour obtenir un glissement de
mandat «-Delly Sesanga après échange avec Conseil de
Sécurité de l'ONU
|
|
Politique
|
|
RDC: catholiques et protestants plaident pour le prolongement
de la période d'enrôlement des électeurs et s'insurgent
contre tout glissement du calendrier électoral
|
|
Politique
|
|
|
Base
|
RDC : « A Genève, ce qui a faussé
tout, c'est le mode de désignation du candidat commun (Kamerhe)
|
(Mardi 13 Novembre 2018)
|
Politique
|
|
RDC : Matungulu regrette la décision de Tshisekedi et
maintient son soutien à Fayulu
|
(Lundi 12 Novembre 2018)
|
Politique
|
|
RDC : Kamerhe se retire à son tour de l'accord de
Genève
|
(Lundi 12 Novembre 2018)
|
Politique
|
|
|
Taliban
|
Dans l'Est de la RDC, l'autre guerre de la
désinformation
|
Mercredi 21 Décembre 2012
|
Sécurité
|
|
RDC : femmes des médias et
liberté de la presse sur les réseaux sociaux, quelle attitude
adopter face aux attaques ?
|
Vendredi 14 Mai 2021
|
Femme
|
|
|
Kabilie
|
Assemblée nationale : la pétition
« préfabriquée » contre Mboso vise à
mettre à mal la stabilité institutionnelle favorable à la
réussite du mandat de Félix Tshisekedi
|
Jeudi 16 Septembre 2021
|
Politique
|
|
RDC : « Nous avons été pris en
otage pour pousser la machine à la sauvegarde des intérêts
de Joseph Kabila (l'ancien député Louis Thole)
|
Samedi 30 Janvier 2021
|
Politique
|
|
RDC : Les élections et les enjeux flous et
mitigés depuis 2006, quelles leçons pour la
démocratie ?
|
Mardi 30 Mars 2021
|
Politique
|
|
|
Nouvelles unités
|
Nord-Kivu : des enseignantes nouvelles unités
n'accèdent pas à leur salaire auprès d'une banque par
manque des pièces d'identité
|
09 JUIN 20223
|
Société
|
|
EPST : le ministre des finances rassure que 70503
enseignants NU seront payés au cours de ce mois de Mai
|
Vendredi 20 Mai 2023
|
Politique
|
|
|
Maper
|
Dossier Jean-Marc Kabund : `' je crois que ça
valait la peine...'
|
Mercredi 17 Août 2022
|
Politique
|
|
RDC : Placé sous MAP, Ferdinand
Kambere transféré à Makala
|
Mardi 21 Janvier 2021
|
Politique
|
|
|
Guerrier(Warriors)
|
Etat de siège : le député Crispin
Mbindule appelle à une évaluation mais aussi des sanctions
à ceux qui ne jouent pas bien leur rôle
|
Dimanche 18 Juillet 2021
|
Sécurité
|
|
RDC : premier conseil des ministres post-remaniement
|
Vendredi 31 Mars 2023
|
Politique
|
|
RD : Gentiny Ngobila remercie Félix Tshisekedi
pour la nomination des élus de Kinshasa et du Grand Bandundu dans le
gouvernement Sama Lukonde
|
Lundi 19 Avril 2021
|
Politique
|
|
|
Déboulonner
|
RDC/ « le président Moise Katumbi n'est pas
partenaire du président Tshisekedi, C'est son plus grand
adversaire » (Steve Mbikayi)
|
Jeudi 21 Octobre 2021
|
Politique
|
|
Elections en RDC : 12 Conseils destinés aux
potentielles candidates
|
Lundi 06 Février 2023
|
Femme
|
|
Mboso sur les opérations conjointes FARDC-UPDF :
c'est la matérialisation de la nouvelle stratégie à bouter
hors d'état de nuire les groupes terroristes
|
Vendredi 24 Décembre 2021
|
Sécurité
|
|
|
Béton
|
RDC : Mboso n'a donné aucune instruction à
un membre de l'assemblée nationale concernant la réception d'un
quelconque courrier de démission de Kabund
|
Samedi 15 Janvier 2022
|
Politique
|
|
RDC : Lancement à Kenge du programme de
développement à la base de 145 territoires
|
Samedi 09 Octobre 2021
|
Politique
|
|
Kinshasa : le service national annonce pour bientôt
l'approvisionnement d'autres produits de première
nécessité
|
Mercredi 22 Mars 2022
|
Société
|
|
|
Coup de poing
|
Opération coup de poing : sur ordre du chef de
l'Etat, Gentiny Ngobila a dirigé la démolition des constructions
anarchiques sur la baie de Ngaliema
|
Jeudi 26 Janvier 2023
|
Politique
|
|
Opération Coup de poing à Kinshasa :
Après évaluation, Gentiny Ngobila satisfait de travaux
d'embellissement à Masina et Limete
|
Samedi 21 Janvier 2023
|
Politique
|
|
II.3.2. Articles
Politico.cd
Tableau 4 : Présentation des articles de
Politico.cd
|
MOTS
|
DESCRIPTION DE L'UNITE
|
|
Glissement
|
Titre
|
Date
|
Rubrique
|
|
Elections en 2023 en RDC : « Félix
Tshisekedi prépare le glissement » (JM Kabund)
|
Mardi 18 Juillet 2022
|
Politique
|
|
Les députés USN accusent le FCC de bloquer le
processus électoral et à pérenniser la culture du
glissement
|
Samedi 16 Avril 2022
|
Politique
|
|
|
Base
|
RDC : Réclamant la vérité des urnes
« la base » UDPS appelle Félix Tshisekedi à
nommer un premier ministre issu de leur parti politique
|
Samedi 16 Mars 2019
|
Politique
|
|
UDPS : Jean-Marc Kabund vomi par les secrétaires
nationaux de son parti
|
Vendredi 21 Janvier 2022
|
Politique
|
|
Jean-Marc Kabund conspué par « la
base » de l'UDPS au Palais du peuple
|
Lundi 10 Juin 2019
|
Politique
|
|
|
Taliban
|
RDC : Ci-gît l'Etat de droit de Félix
Tshisekedi
|
Mercredi 13 Avril 2022
|
Politique
|
|
RDC : Kagamé, le nouvel opposant congolais
|
Lundi 05 Décembre 2022
|
Politique
|
|
|
Kabilie
|
Décès de Kyungu Wa Kumwanza : Moise Katumbi
pleure « l'un des hommes qui ont fait tomber la
Kabilie »
|
Dimanche 22 Août 2021
|
Politique
|
|
Salomon Kalonda : « tant qu'on fera de la
Kabilie même sans joseph Kabila, rien ne changera »
|
(Lundi 10 Juin 2019)
|
Politique
|
|
RDC : Le Katanga et le monde, équation à
plusieurs inconnus (Kikaya Bin Karubi)
|
Samedi 11 Décembre 2021
|
Politique
|
|
|
Nouvelles unités
|
RDC : L'intersyndicale de l'EPST accuse Nicolas Kazadi de
bloquer la paie de nouvelles unités et menace d'aller en grève
|
Mercredi 18 Mai 2022
|
Economie
|
|
RDC : 70.053 enseignants nouvelles unités
recevront leur salaire d'avril, mai et juin dans « les prochains
jours
|
Samedi 21 Mai 2022
|
Société
|
|
|
Maper
|
Exclusion de Kabund : la force grise prend acte et
appelle à la consolidation de l'UDPS en vue des élections de 2023
|
Lundi 31 Janvier 2022
|
Politique
|
|
RDC : Vidiye Tshimanga placé sous mandat
d'arrêt provisoire
|
Mercredi 21 septembre 2022
|
Politique
|
|
|
Guerrier (Warriors)
|
« il n'y a pas de place de satisfaire aux caprices
de quelques autorités morales que ce soit » (Félix
Tshisekedi)
|
Jeudi 22 Juillet 2021
|
Politique
|
|
Gouvernement Sama : « l'heure n'est plus aux
contestations » autour de la composition de l'équipe
gouvernementale » (Willy Minga)
|
Mardi 20 Avril 2021
|
Politique
|
|
RDC : Tshisekedi Face à la menace Katumbi
|
Vendredi 07 Octobre 2022
|
Politique
|
|
|
Déboulonner
|
RDC : « La chute de Thambwe Mwamba consacre le
déboulonnage du système dictatorial..(UDPS Jean-Louis Kalamba)
|
Vendredi 05 Février 2021
|
Politique
|
|
Ituri : Félix Tshisekedi vente les
réalisations de l'IGF
|
Samedi 19 Juin 2021
|
Politique
|
|
RDC : Danny Bavuidi s'adresse à Félix
Tshisekedi sur des sujets « dérangeant les
congolais »
|
Jeudi 21 Octobre 2021
|
Société
|
|
|
Béton
|
RDC : La Résurrection
« préfabriquée » de Vital Kamerhe
|
Mercredi 29 Juin 2022
|
Politique
|
|
RDC : Arrêté pour blanchiment de capitaux
puis libéré par grâce présidentielle, Bakonga veut
un 2ème mandat pour Tshisekedi
|
Mardi 03 Janvier 2023
|
Politique
|
|
Félix Tshisekedi, la cour constitutionnelle et le
glissement : les dessous d'un coup de force
|
(Vendredi 14 Août 2020)
|
Politique
|
|
|
Coup de poing
|
Kinshasa : l'hôtel de ville lance ce lundi,
l'opération « Coup de poing » pour dégager le
tronçon de Ndjili et la 1ere Rue Limete
|
Dimanche O8 Janvier 2023
|
Société
|
|
Rencontre Tshisekedi et les bourgmestres : la
salubrité et la sécurité de la capitale au centre des
échanges
|
Vendredi 13 Janvier 2023
|
Politique
|
|
Les articles ci-dessous seront soumis
à l'analyse textuelle selon la grille d'analyse qui est
présentée dans le chapitre 3. Néanmoins, faisant cette
forme d'analyse, nous l'appliquons que sur une partie du texte.
II.4.
Difficultés du terrain
Nous avons rencontré de difficultés
d'ordre différent sur trois niveaux ;
- Au niveau du Corpus
La première difficulté est celle
liée à la récolte des mots qui sont essentiellement
produits dans le milieu politique congolais, et qui font objet de
récupération par les journalistes et mise en information. Dans
cette démarche, il a été difficile d'effectuer une
remontée des sources et de situer l'élément linguistique
dans ce cadre précis. Ce qui a donc concis notre liste.
La deuxième difficulté se situe au
niveau de la délimitation. Nous procédons par analyse du texte,
lequel est l'article qui comprend l'un des mots sélectionné,
délimité dans l'espace et dans le temps. En constituant le
corpus, nous constatons que certains articles ne se retrouvent pas dans ce
cadre spatio-temporel, et donc pour contre l'embûche, nous le mettons
entre parenthèses ( ) pour signifier la différence, mais aussi
pour enrichir l'analyse.
La troisième difficulté est liée
à l'identité de l'article, selon qu'une rubrique permet de situer
la nature de l'information. Dans notre cas, les articles qui se retrouvent dans
le corpus ne sont pas tous politiques, plutôt pris dans une
procédure de politisation comme l'a indiqué Patrick Charaudeau.
C'est-à-dire, la situation de la communication (lieu, acteur, contexte)
permet en réalité de les considérer comme des
unités politisées.
- Au niveau des entretiens
Ici, la difficulté se situe au niveau du
signataire de l'article. C'est-à-dire, nous voulons remonter à
l'énonciateur pour comprendre le dynamisme du discours journalistique.
Cependant, certains articles sont écrits par des journalistes qui
n'appartiennent plus au média choisi.
Aussi nous avons alterné l 'entretien
physique et l'entretien en ligne, car la disponibilité des
interviewés est périlleuse.
Conclusion partielle
Dans notre deuxième chapitre, plusieurs
points se sont mêlés pour le constituer. Nous avons d'abord
commencé par présenter l'objet de contextualisation de cette
étude ; le français dans une perspective de localisation.
Le premier point traitant de la situation sociolinguistique a permis de situer
le lecteur, et de le fixer à nouveau sur les objectifs de ce travail.
Dans une autre perspective, il a permis de présenter les mots qui
fondent l'analyse textuelle.
Dans le deuxième point, nous avons
présenté les médias choisis pour mener notre étude.
Leur pertinence s'est avancée au niveau de la spécificité
que chacun posséderait au regard de l'autre, selon que l'un ait une
écriture orientée vers le journalisme factuel et l'autre plus
engagé. Mais également, les présenter en chiffres pour
sous-tendre à la position de ces derniers et ce que cela implique en
tant que pure players.
Le troisième point a alloué la
présentation du corpus. Prenant en compte 25 articles de chaque
média selon les 10 mots présentés dans la première
partie afin d'identifier clairement les unités sur lesquelles l'analyse
textuelle est d'application.
Enfin, le dernier point nous a ouvert aux diverses
difficultés rencontrées dans différentes phases de notre
descente sur le terrain et de diverses stratégies pour contrer les
embuscades.
TROISIÈME
CHAPITRE : ANALYSE TEXTUELLE D'ARTICLES DE PRESSE EN LIGNE
Actualité.cd et ·Politico.cd
Comme nous l'avons stipulé, nous appliquons
deux méthodes qualitatives qui entretiennent de grilles d'analyse
différentes. Nous commencerons donc par présenter la
première grille qui touche à l'analyse textuelle du discours. Et
ensuite la mettre en application d'après la grille méthodologique
proposée par Jules Gritti.
III.1.
Présentation de la grille d'analyse
Cette grille d'analyse est construite à
partir des notions méthodologiques que l'on retrouve dans le
modèle de Jules Gritti. Cependant, notre analyse se limite à deux
filtrages. Celui de la culture et celui du rapport de communication entre
destinateur et destinataire ou encore énonciateur et énonciataire
étant dans l'univers du discours.
- Sélection et présentation des
unités textuelles élémentaires : nous
n'allons pas appliquer la méthode au niveau du texte entier. Nous
sélectionnons donc les paragraphes où l'on retrouve le mot qui
est étudié. Les paragraphes sont analysés ensemble selon
le mot qui crée le bloc d'analyse. En de termes appropriés, ces
paragraphes sont des propositions-énoncés
- Cotextualiasation : pour analyser les
paragraphes, nous prenons en compte, les textes, environnants l'unité
à étudier en soumettant les paragraphes à l'analyse. La
Cotextualiasation permet également de comptabiliser la fréquence
d'utilisation du terme.
- Application du premier filtrage (contenu
discours) : à la suite de la précédente
étape, nous soumettons les paragraphes à l'examen textuel au
niveau de la culture pour rechercher dans l'unité, la situation de
définition du mot ou la situation de non-définition du mot et
ainsi ressortir la connotation investie dans le terme.
- Application du deuxième filtrage (rapport de
communication) : nous recherchons ensuite dans le texte, le sujet
qui énonce et le rapport qu'il établit entre lui-même et
son interlocuteur.
- Conclusions du bloc d'analyse :
présentation brève de l'analyse du bloc.
- Contextualisation de l'analyse : la
contextualisation se fera en amont, au niveau de l'interprétation des
résultats.
Avant de passer à l'application de la méthode,
il sied de noter quelques consignes qui aident à suivre correctement
l'analyse. Il s'agit :
- Tout d'abord au sujet du regroupement en bloc. Le bloc est
l'espace d'analyse selon le mot, c'est-à-dire, que pour le mot Base,
nous analysons tous les articles de tel média qui traite de ce mot
directement. Et ceci se répète pour la même unité
mais avec l'autre média.
- Ensuite, il y a des unités d'enregistrement, elles
sont investies soit en un de termes tels que idem ou ibidem pour signifier
quelque chose qui a été dit. Soit en combinant Lettre chiffre,
soit X pour nombre de fois qu'un mot revient dans un article. Notons que
lorsqu'il n' y a ni lettre ni chiffre le mot est repris qu'une fois dans
l'article.
- Enfin, il convient de noter que l'interprétation
englobe les résultats de deux pure players.
III.2. Application de
la méthode
III.2.1. Les
unités textuelles élémentaires d'Actualité.cd
Article 1, Glissement
- Paragraphe « :... Il est hors de question
comme je l'entends aujourd'hui que les acteurs politiques, les décideurs
marchandent la guerre à l'Est du pays pour obtenir un glissement de
mandat parce que sans la stabilité de nos institutions nous n'aurons
jamais de paix et nous n'aurons jamais de sécurité. Donc, il nous
faut des élections qui sont tenues à date, il nous faut de bonnes
élections et pour cela je pense qu'il est encore temps de pouvoir mieux
faire... »
- ... Si ces propos ont été mal perçus
dans l'opposition, du côté du pouvoir en place, cet appel du chef
de l'Etat Félix Tshisekedi ne consacre pas le glissement mais
plutôt un moyen de pression sur la communauté internationale pour
une solution à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.
X : 2 fois
Article 2, Base
- « ...Je guide ma base quand je suis
profondément convaincu que ce que j'ai fait, réellement va amener
le peuple à la victoire ou au salut. Mais, là, je me rends compte
que c'est une voix, un vote. Mais quand le peuple qui est censé voter
vous dit, vous venez ici à Bukavu, Mbandaka, et partout, nous n'allons
pas voter pour le candidat commun choisi ... »?
Article 3, Taliban
- ...le pays d'une centaine de millions d'habitants est
coutumier du phénomène. A titre d'exemple, les élections
mobilisent régulièrement les trolls employés par les
ultras des différents partis pour décrédibiliser leurs
adversaires, entre le camp des talibans favorables au président
Félix Tshisekedi et celui des opposants surnommé Pyongyang'.
Article 4, Kabilie
- ...Pas besoin d'être crack en politologie pour
conclure que la pétition initiée contre le président de
l'assemblée nationale n'est que dilatoire. Toutes proportions
gardées, nombre d'analystes voient derrière cette pétition
l'intention délibérée de menacer la stabilité
institutionnelle actuelle obtenue au prix d'un dur combat contre la Kabilie.
- ....Halte à la désinformation et à des
accusations fallacieuses. Christophe Mboso mérite respect non seulement
pour les hautes fonctions étatiques qu'il a occupées avec
dextérité, de l'époque de feu président Mobutu
à ces jours, mais aussi au regard du rôle qu'il a joué dans
le processus de « déboulonnement de la Kabilie »
à l'assemblée nationale. Il est donc, à juste titre, l'un
des artisans du basculement de la majorité parlementaire que le pays a
récemment connu.
X : 2 fois
Article 5, Nouvelles unités
- ...Plusieurs enseignants, victimes de
l'insécurité et de la récente éruption volcanique
du Nyiragongo ont des difficultés à accéder à leur
salaire auprès de la Trust Merchant Bank (TMB) à Goma au
Nord-Kivu. Il est exigé à ces nouvelles unités, ayant
récemment intégré la paie, à brandir, soit la carte
d'électeur, soit le passeport biométrique. Alors que les uns
affirment avoir perdu leurs cartes d'électeurs lors de
l'éruption volcanique du 22 Mai 2021, d'autres témoignent que
leurs pièces d'identité ont été perdues suite
à l'insécurité...
- « ...C'est très déplorable lorsque
le gouvernement congolais exécute la paie des enseignants nouvelles
unités qui ont intégré la paie au niveau du mois d'avril
mais malheureusement, tel que vous le savez, ici chez nous, en province du
Nord-Kivu, avec les problèmes de guerre, les enseignants ont fui dans
les territoires de Nyiragongo, de Rutshuru, les maisons des uns ont
été brûlées, ils n'ont plus des cartes
d'électeurs... »
- ...ils avaient séché les cours pour exiger au
gouvernement l'amélioration de leurs conditions de travail qui passe par
la majoration de leurs salaires, le paiement de nouvelles unités et de
non payés et autres revendications conformément aux accords de
Bibwa.
X : 3 fois
Article 6, Mapé
- Ferdinand Kambere mapé, a été
transféré ce mardi matin à la prison Centrale de Makala
à Kinshasa, selon des sources judiciaires. Le secrétaire
permanent adjoint du PPRD avait passé nuit au cachot du parquet
général de Kinshasa Gombe...
Article 7, Guerrier (Warrior)
- ...si le précédent gouvernement a
été qualifié comme celui des Warriors, celui-ci est
considéré comme celui du rassemblement...
Article 8, Déboulonner
- ...Les candidats doivent être une alternative pour
déboulonner les anciens élus dans la circonscription...
Article 9, Béton
- « ... Nous sommes tous unis. Fatshi Béton.
À l'UDPS, le Béton a derrière lui qui ? Kabund ?
Mboso, le président de l'Assemblée nationale, a derrière
lui qui ... ?»
X : 2 fois
Article 10, Coup de poing
- Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila a
supervisé, mercredi 27 Janvier 2023, l'opération Coup de
poing ; la démolition de constructions anarchiques sur la baie de
Ngaliema. Il était accompagné du patron de la police ville de
Kinshasa, le général sylvano kasongo, ainsi que du commandant de
la 14ème région militaire.
Ceci étant fait, nous appliquons donc les deux
filtrages choisis pour opérer l'analyse textuelle proprement dite.
S'agissant d'appliquer pour une proposition chaque filtrage, nous
procédons par deux tableaux. Le premier concerne le filtrage
culture. Et le second, le filtrage rapport de communication. 101(*)
III.2.2. Application
du premier filtrage (Actualité.cd)
Tableau n°5 : le niveau de la culture
(Actualité.cd)
|
Niveau de la culture
|
|
Unité(s)
|
X
|
Défini
|
Non-défini
|
Sens
|
|
Glissement (A1)
|
2
|
Défini ;
Dans l'énoncé 1, nous pouvons dire qu'il existe
une définition implicite, que l'on retrouve grâce au co-texte
droit de l'unité (mandat), l'énoncé sous-tend alors le
glissement comme action liée un mandat dans le sens politique ou
électoral, si nous voyons les phrases qui suivent.
|
Non-défini
Dans l'énoncé 2, l'unité glissement n'a
aucun indice de définition. Cependant, sa compréhension est
explicite du fait que l'énoncé 1 a implanté le
décor de sa signification
|
Selon le sens 1 de l'unité glissement, ensuite à
la suite de sa conception dans l'unité textuelle, nous pouvons ainsi
dire `glissement' est le fait de trucher un second mandat.
|
|
Base (A2)
|
-
|
Pas de définition explicite
|
Non-défini,
L'unité Base n'a pas d'élément qui
explicite sa signification, il est donc non-défini. Cependant, nous
tentons de le comprendre dans la relation qu'il entretient avec d'autres
parties de l'énoncé
|
En ce sens, nous pouvons dire que l'unité Base renvoi,
en politique, un groupe de personnes partageant une même orientation
politique. Ce qui équivaut à un parti politique
|
|
Taliban (A3)
|
-
|
Défini
L'unité taliban est explicitement définie
à un niveau considérable, car les deux co-textes, celui de gaude
(le camp des) et celui de droit (favorable à Félix Tshisekedi),
construisent sa compréhension. En ce sens, l'unité renvoie
à un camp ou un groupe qui est proche ou du sujet Félix
Tshisekedi ou qui a une orientation partagée avec ce sujet.
|
|
- Le sens de cette unité est issu de sa forte relation
avec ses co-textes, signifié alors un groupe de soutien au sujet
Félix Tshisekedi, un groupe partageant la même orientation
politique que le sujet Félix Tshisekedi. Par référence
à l'unité Base, elle est également un type précis
d'un parti politique.
|
|
Kabilie (A4)
|
2
|
Pas de définition explicite dans l'énoncé
1 et 2
|
Non-défini
L'unité Kabilie n'est pas définie dans
l'énoncé 1, du fait ni le co-texte gauche n'est pas permet sa
compréhension.
Cependant dans l'énoncé 2, le co-texte de
l'unité et lui-même sont mis en exergue, cela rappelle alors une
activité de mémoire. Pour le comprendre il faut se
référer au contexte que le co-texte déboulonner introduit.
|
L'unité Kabilie n'a de sens qu' implicitement, n'ayant
il introduit de notre analyse, un mot collectif. Selon l'espace
énonciatif entier, nous comprenons qu'elle soit un camp,
évidemment qui partagent la même idéologie politique.
|
|
Nouvelles unités (A5)
|
3
|
Défini
Dans l'énoncé 1 et 2, l'unité Nouvelles
unités est définie, en ce sens où le co-texte enseignant
démontre son rapport de signifiance. C'est-à-dire, que la
compréhension du mot vient nécessairement de son co-texte, qu'il
soit présent ou absent.
L'unité nouvelles unités, signifie
désigne une catégorie ou un type de son co-texte (enseignant)
|
Non-défini,
Il est non-défini dans l'énoncé, non pas
pour absence de compréhension, plutôt, parce que les
énoncés précédents ont dynamisé sa
conception.
|
Ici, il y a également lieu de se référer
du sens premier, cependant, tenir compte de la forte relation qu'elle partage
avec son co-texte enseignant. Il désigne alors, une catégorie
d'enseignant dans un contexte politique.
|
|
Mapé (A6)
|
-
|
pas de définition explicite
|
Non-défini
l'unité mapé n'est pas clairement
définie. Mais en lien avec son co-texte, nous tentons d'établir
le rapport entre « transféré à la prison
centrale », et l'unité, ce qui peut indiquer un rapport
à la justice, à l'emprisonnement. Visionnant le texte entier, la
titraille renforce cette conception qui semble implicite.
|
Ici encore, l'espace énonciatif sauve la sens, il faut
se référer aux éléments globaux du texte pour
tenter de le comprendre. Par exemple, le titre du texte, mis ensemble avec le
co-texte gauche, fabriqué un sens qui peut être traduit par
`être saisi par la justice'. Sens introduit par mandat d'arrêt
provisoire et prison.
|
|
Guerrier(A7)
|
-
|
Pas de définition explicite
|
La spécificité de l'unité Guerrier se
trouve au niveau de son co-texte de gauche, qui introduit un acte de langage
extérieur.
« Dit de guerrier » semble signifier un
sens donné par un sujet qui n'est pas connu. Cependant, le co-texte
gouvernement établit également un rapport de signifiance. Nous
pouvons alors dire que la signifiance est implicite.
|
Ici, c'est le sens premier de l'unité `Guerrier' qui
prône sur le sens de l'unité elle-même prise dans son
contexte d'énonciation.
Même si le co-texte, n'introduit pas une signification
particulière, nous la comprenons comme un gouvernement guerrier, un
gouvernement qui lutte.
|
|
Déboulonner (A8)
|
-
|
Défini
L'unité déboulonner est plus ou moins
définie, en ce sens où ce qu'elle désigne n'est pas tout
à fait précis. En rapport avec les co-textes gauche et droit,
respectivement « alternative et « anciens
élus », l'unité traduit une action contre une
catégorie précise de personnes
|
--------
|
Les co-textes « alternative » et
« anciens élus » donnent du sens à
l'unité. Il signifiait alors une action de lutter pour remplacer, ou
`chasser' les anciens élus.
|
|
Béton (A9)
|
2
|
Défini
Dans l'énoncé, l'unité revient deux fois.
Attaché à un nom, il qualifie ce sujet. Plus loin, il se
définit comme titre de ce sujet étant soutenue par
« le »
|
--
|
L'unité Béton, a pour sens 1
« matière de résistance obtenue à partir
d'une composition chimique », devenant alors titre d'un sujet, il a
pour sens, un sujet dans l'oeuvre résiste.
|
|
Coup de poing (A10)
|
-
|
Défini
L'unité coup de poing clairement définie. Elle
désigne une opération de démolition de construction
anarchique.
|
--
|
L'unité `coup de poing' a pour sens, une
opération d'assainissement urbaine.
|
Commentaires : le niveau de la culture,
nous a permis de passer en revue la construction des énonciations
à partir des occurrences ci-hauts, ainsi nous pouvons relever les
particularités de chacune et ce qu'elle induit dans la langue
française.
À partir de nos analyses au niveau de la culture, nous
avons identifié trois faits. Il y a premièrement, une exigence
de se référer aux éléments
socio-historico-culturels pour asseoir leur sens, ce que celui qui parle ne
livre pas en premier contact. Il faut donc aller à sa rencontre.
Deuxièmement, il y a une véritable création
sociolinguistique dans l'énoncé journalistique. Le
détachement, qui exprès, au sens premier à l'emploi de
l'unité.
III.2.3. Application
du deuxième filtrage (Actualité.cd)
Tableau n°6 : le niveau de rapport de
communication (Actualité.cd)
|
Rapport de communication
|
|
Unité(s)
|
X
|
Énonciateur
|
Énonciataire-interprétant
|
|
Glissement(A1)
|
2
|
Deux types :
- Delly Sesanga (énoncé)
- Journaliste : co-énonciateur qui fait parler le
premier sujet
|
Trois cibles
- La délégation de sécurité de
Nations unies
- Le chef de l'Etat Félix Tshisekedi
- Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Base (A2)
|
-
|
Deux types :
- Vital Kamerhe ; sujet énoncé
Journaliste : co-énonciateur qui fait parler le
premier sujet
|
Deux cibles
- Actualité.cd
- Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Taliban (A3)
|
-
|
Les journalistes
- AFP
- Actualité.cd
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Kabilie (A4)
|
2
|
Le journaliste
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Nouvelles unités (A5)
|
3
|
Deux types :
- Shamavu Bahala, président de la FOSYNAT
(énoncé 1 et 2) sujet énoncé
- Un sujet anonyme
- Le journaliste ; co-énonciateur, qui fait parler
les deux sujets
|
Deux cibles :
- Le gouvernement congolais
- Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Mapé (A6)
|
-
|
Le journaliste
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Guerrier (A7)
|
-
|
Deux types :
- Tina Salama, sujet énoncé
- Le journaliste, co-énonciateur qui fait parler le
premier sujet.
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Déboulonner (A8)
|
-
|
Deux types :
- ONU Femmes, sujet énoncé
- Le journaliste, co-énonciateur, qui parlait le
premier sujet
|
Deux cibles :
- Les candidates aux élections
- Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Béton (A9)
|
-
|
Deux types :
- Christophe Mboso Nkodia, sujet énoncé
- Le journaliste, co-énonciateur qui fait parler le
premier sujet
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Coup de poing (A10)
|
-
|
Le journaliste
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
Commentaires : le rapport de
communication se lit à travers les divers jeux de rôles que l'on
peut retrouver dans ces unités textuelles élémentaires.
S'agissant d'un journalisme factuel, les formules langagières de
distance sont présentes, et façonnent la perspective
énonciative102(*). C'est-à-dire que même si dans notre
cas, nous ne prenons pas le niveau idéologique en compte, les marqueurs
discursifs103(*)
permettent d'identifier le rapport que l'énonciateur ou le
co-énonciateur entretient avec son
énonciateur-interprétant dans ce qu'il cherche à dire et
à le faire comprendre.
III.2.4. Les
unités textuelles élémentaires Politico.cd
Article 1, Glissement
- Alors que la situation socio-économique et
sécuritaire s'enlise, le président en exercice Félix
Tshisekedi préparait un glissement. Selon le député
national, Jean-Marc Kabund a Kabund.
- « ...le régime de Tshisekedi
décidé de mettre en péril la périodicité, la
sincérité et la transparence des élections en
préparant le glissement, ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux
prochaines élections... »
X : 2
Article 2, Base
- « ...nous demandons à nos
députés nationaux et provinciaux, ainsi qu'à toute la base
de L'UDPS d'en tirer toutes les conséquences de droit et
politique... »
Article 3, Taliban
- ...A son arrivée, Félix Tshisekedi a
néanmoins entrepris de décrisper l'espace politique et de
libérer la parole. Les « talibans », ses fanatiques
en quête de raison, seront bien d'accord avec cette partie...
Article 4, Kabilie
- ...les occidentaux eux-mêmes, ont un problème
de communion. Washington, Paris, Bruxelles peuvent avoir en commun cette phobie
kabilienne, mais chacun entend préserver ses intérêts...
Article 5, Nouvelles unité
- ...Dans sa déclaration, l'intersyndicale des
syndicats des enseignants de l'EPST dit avoir constaté avec
« indignation », le non-paiement, jusqu'à ce jour de
70 053 enseignants nouvelles unités...
- ...L'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire
et technique exige du premier ministre Sama Lukonde, le décaissement
immédiat et sans condition de la paie complémentaire du mois
d'avril des enseignants nouvelles unités dans un délai de 48
heures...
- ...A l'en croire, le gouvernement avait pris l'engagement de
payer toutes les nouvelles unités lors du premier trimestre de
l'année 2022.
- L'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et
technique, demande au premier ministre, d'instruire le ministre de finances
Nicolas Kazadi, de libérer sur le champ, la paie complémentaire
des enseignants nouvelles unités pour le mois d'avril...
X : 4 fois
Article 6, Mapé
- ...Vidiye Tshimanga, ancien conseiller stratégique du
chef de l'Etat Félix Tshisekedi vient d'être mapé, apprend
Politico.cd de sources judiciaires...
Article 7, Guerrier
- ...Moise Katumbi et Félix Tshisekedi vont se
retrouver nez à nez. D'abord l'ancien président qui tente alors
de s'accaparer les pleins pouvoirs pour se préparer à sa propre
succession, ensuite, Moïse Katumbi qui rechigne à prendre part au
gouvernement dit des « guerriers »...
- ...Pour se faire, la première étape consistera
à démanteler cette union de façade sur laquelle repose un
gouvernement des Warriors...
X : 2
Article 8, Déboulonner
- « ...Depuis que je suis là, je vous avais
parlé de déboulonnage, je vous avais parlé de lutter
contre la corruption et aujourd'hui on le voit, c'est vrai que ce n'est pas
encore parfait mais il y a des avancées
considérables... »
Article 9, Béton
- ...car, quelques mois avant, Félix Tshisekedi a
obligé le gouvernement congolais à revoir sa proposition
budgétaire de 7 à 10.9 milliards de dollars américains. Le
« Béton » est gonflé à bloc,
l'année qui commence serait alors celle du renouveau...
- ...les prix grimpent, les kinois suffoquent, le
« Béton » fond.il ne sait plus à querelles se
vouer...
- « ... qu'y a-t-il derrière le tour de
passe-passe constitutionnel mal ficelé que le magicien Fatshi
Béton veut nous faire gober en triturant la composition de la cour
constitutionnelle ?
X : 3 fois
Article 10, Coup de poing
...Cette rencontre entre le Président de la
République et les autorités principales intervient trois jours
après le lancement de l'opération « coup de
poing » sur le boulevard Lumumba par le gouverneur de la ville de
Kinshasa...
III.2.5. Application du
premier filtrage (Politico.cd)
Tableau n°7 : niveau de la culture
(Politico.cd)
|
Niveau de la culture
|
|
Unité(s)
|
X
|
Défini
|
Non-défini
|
Sens
|
|
Glissement (A1)
|
2
|
Défini
L'unité désigne une fraude, une ruse pour
refaire un mandat
|
--
|
Avec un langage plus libéré, nous pouvons donc
dire que l'unité glissement a pour sens, la manière frauduleuse
de gagner un second mandat.
|
|
Base (A2)
|
-
|
Défini
L'unité est ici plus précise. Elle
désigne un parti politique.
|
--
|
Dans le contexte de cette énonciation, l'unité
base a pour sens le parti politique UDPS, mais plus loin elle aura pour sens
qu'un parti politique simplement.
|
|
Taliban (A3)
|
-
|
Pas de définition explicite
|
Non-défini
L'unité taliban a pour co-texte « fanatique
de Félix Tshisekedi » ceci ne dit pas en de termes clairs, ce
que cela veut dire. Mais un groupe de personnes proches de
Félix-Tshisekedi.
|
En relation avec son co-texte, l'unité taliban a comme
sens, le militant d'un parti politique, soutenant le sujet `Félix
Tshisekedi' en l'occurrence les militants de l'UDPS
|
|
Kabilie (A4)
|
-
|
Défini
L'unité désigne un groupe de personnes proches
du sujet Kabila.
|
--
|
L'unité a pour sens, un groupe de personnes qui
partagent l'idéologie du sujet Kabila
|
|
Nouvelles unités (A5)
|
4
|
Défini
L'unité désigne une catégorie
d'enseignants.
|
--
|
L'unité a pour sens, une catégorie nouvelle
d'enseignants. Nouvelle de par le modèle économique
|
|
Mapé (A6)
|
-
|
Défini
L'unité désigne un sujet, en l'occurrence un
homme politique, qui est placé sous mandat d'arrêt provisoire.
|
--
|
Mapé a pour sens, placer un sujet sous mandat
d'arrêt provisoire
|
|
Guerrier(A7)
|
2
|
Pas de définition explicite
|
Non-défini
L'unité `guerrier', ne trouve pas en ses rapports avec
les co-textes une définition qui traduit son vouloir dire.
Néanmoins, son sens premier permet une fine acception de l'unité
comme qualificatif d'un gouvernement.
|
Le sens contextuel n'est toujours pas explicite.
Néanmoins, elle est comprise comme un gouvernement ou membre d'un
gouvernement combatif.
|
|
Déboulonner (A8)
|
-
|
Défini
L'unité est définie comme une lutte contre une
partie qui ne partage la même vision avec un autre groupe.
|
--
|
Le sens contextuel s'impose. Cela dit, l'unité a pour
sens l'action de déposséder au camp adverse. Même si le
sens existe au premier niveau, le contexte introduit de nouveaux usages.
|
|
Béton (A9)
|
3
|
Défini
L'unité désigne un titre à un sujet qui
apporte du renouveau et qui résiste.
|
--
|
L'unité Béton est le titre accordé au
président Félix Tshisekedi, pour louer ses mérites.
|
|
Coup de poing (A10)
|
-
|
Pas de définition
|
Non-défini
Il n'y a dans l'environnement du texte, un co-texte qui
introduit l'acception de l'unité. À défaut de se
référer à eux, elle désigne une initiative
lancée par le gouverneur.
|
Le sens n'étant pas explicite, nous nous en tenons au
sens construit par le co-texte. l'unité a donc pour sens, une
opération de destruction des constructions anarchique.
|
Commentaires : le choix sur Politico.cd
s'est fait en raison de son style de discours. Ceci dit, nous retrouvons les
mêmes réalités dans l'écriture journalistique
d'Actualité.cd, mais au niveau du sens, le style d'écriture de
politico.cd est plus provocant et dit clairement les termes, ce qui
renchérit la dimension sémantique de l'unité ou permet
d'identifier sa faiblesse sémantique.
III.2.6. Application
du deuxième filtrage (Politico.cd)
Tableau n°8 : niveau de rapport de
communication (politico.cd)
|
Rapport de communication
|
|
Unité(s)
|
X
|
Destinateur
|
Destinataire
|
|
Glissement(A1)
|
-
|
Deux types :
- Jean-Marc Kabund, sujet énoncé
- Le journaliste, co-énonciateur qui fait parler le
premier sujet
|
Deux cibles :
- Félix Tshisekedi
- Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Base (A2)
|
-
|
Deux types :
- Les secrétaires nationaux de l'UDPS. Sujet
énoncé
- Le journaliste, co-énonciateur, qui fait parler le
premier sujet.
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique)
|
|
Taliban (A3)
|
-
|
Le journaliste
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique
|
|
Kabilie (A4)
|
-
|
Deux types :
- Kikaya Bin Karubi, sujet énoncé
- Le journaliste, co-énonciateur qui fait parler le
premier sujet.
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique
|
|
Nouvelles unités (A5)
|
4
|
Deux types :
- L'intersyndicale de l'EPST, sujet énoncé
- Le journaliste, co-énonciateur qui fait parler le
premier sujet
|
Trois cibles
- Nicolas Kazadi, ministre de finance
- Le gouvernement congolais
- Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique
|
|
Mapé (A6)
|
-
|
Deux types :
- Vidiye Tshimanga, sujet énoncé
- Le journaliste, co-énonciateur qui fait parler le
premier sujet.
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique
|
|
Guerrier (A7)
|
2
|
Le journaliste
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique
|
|
Déboulonner (A8)
|
-
|
Le journaliste
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique
|
|
Béton (A9)
|
3
|
Le journaliste
|
Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique
|
|
Coup de poing (A10)
|
-
|
Deux types :
- Félix Tshisekedi, sujet énoncé
- Le journaliste, co-énonciateur qui fait parler le
premier sujet
|
Deux cibles :
- Les bourgmestres de la ville de Kinshasa
- Le lecteur (qui entre en contact de la production
journalistique
|
Commentaires : contrairement, à
Actualité, ces discours issus d'une pratique de journalisme plus
libéral, utilise des éléments imagés pour inciter
le lecteur lui-même à établir les différents
rapports de communication qui existent les différents protagonistes.
Nous relevons également, la présence de
l'antériorité dans cette situation d'intertextualité
apparente chez Politico.cd
III.3.
Interprétation de l'analyse textuelle
Les analyses textuelles de deux pure players ont
apporté chacune une particularité dans la perception et la
signification des occurrences précédentes. Elles ont permis de
comprendre le contexte d'utilisation dans le discours journalistique, mais
aussi qu'elles en ont les implications au niveau de la langue. Ainsi nous le
développons au niveau de la culture, ensuite au niveau du rapport de
communication.
III.3.1.
Résultats au niveau du premier filtrage : la culture
Pour faire l'économie de notre interprétation
à ce niveau, nous partons sur trois découvertes. Il s'agit
d'abord de formules énonciatives, ensuite du liage de
co-référence et enfin de l'implicite.
III.3.1.1. Les
formules énonciatives
Au cours de ces analyses, nous avons pu relever ces
particularités. Les propositions-énoncés
sélectionnés entretiennent une apparence différente. La
structure du discours diffère d'après les unités
textuelles, le média qui alloue l'énonciation et les
protagonistes de l'énonciation. Nous retrouvons donc des formules
énonciatives qui ont pour objectif de faire vivre le sujet parlant ou le
sujet énoncé. C'est ainsi que certaines propositions dont la
formule « a-t-il dit », « X s'est
exprimé » « selon les dire de X », ont
rendu aisé la connotation de quelques mots par eux, car étant en
synergie avec son sujet, celui-ci décrit son sens. Il ne s'agit pas
d'un sujet-objet (ex. le syndicat), le sujet qui véhicule le sens, le
fait par l'acte de dire.
Nous avons également rencontré l'usage
d'autres formules langagières de responsabilité
énonciative, qui ont pour mission, dans un acte d'énonciation,
de déterminer les réalités que le mot introduit. C'est, en
guise d'exemple, la formule « comme il le définit »
« selon ses propres mots ». Ces deuxièmes types de
formule aident à une remontée de source pour saisir la
connotation du mot. S'agissant de la connotation, les unités textuelles
ont été dépourvues d'une connotation directe dont les
signifiés apparaissent au moment de la lecture. Il faut donc fouiller
dans l'expérience sociale et culturelle pour rassembler les
signifiés d'un mot et saisir son sens. Nous avons eu comme premier
résultat, des mots à sens éparpillé.
Le sens éparpillé stipule que les
signifiés de ce mot sont produits chacun dans une situation et un milieu
précis. C'est donc dans cette situation que le lecteur entreprend de
rechercher le sens du mot susceptible de se l'approprier.
III.3.1.2. Le liage de
co-référence
Nous nous référons à ce que J-M Adam le
liage sémantique de co-référence qui est soit anaphorique,
soit cataphorique.
Ce liage de co-référence stipule que
l'interprétation d'un signifiant dépend d'un autre,
présent dans le co-texte104(*). Les co-textes sont présents dans notre
analyse, ils occupent une place considérable dans la connotation d'un
mot. À tel point, que l'absence ou un signifiant implicite rend la
connotation quasi impossible. De même que si le signifiant du mot est
absent, celui du co-texte prend en charge la signification. Les co-textes n'ont
pas uniquement permis de saisir les connotations ou de tenter de les saisir,
mais ils ont aussi permis de qualifier les mots. C'est-à-dire, juger de
la qualité et de la pertinence du mot au moment nous le prenons comme
élément faisant partie d'une variété de langue
française.
Nous avons donc compris qu'il existe dans notre liste
(ou dans l'ensemble de nos pratiques sociolinguistiques) de mots
sémantiquement faibles ou sémantiquement forts. Il est faible
selon que son contexte d'usage est éphémère et ceci se lit
dans le discours. Par exemple, l'unité textuelle du mot `Guerrier' son
co-texte sous-tend que son sens n'est plus d'application, selon qu'une autre
charte sémantique a pris la relève. Il n'est plus question de
gouvernement des Guerriers, mais celui du rassemblement.
Même si le mot reste gravé dans
l'imaginaire linguistique ou qu'il existerait au niveau de la
société une reconfiguration de son sens, il est une
évidence que sa portée significative tire l'essence de son
actualité dans l'habitat linguistique qu'il a fabriqué. À
de celui-ci il y a des mots sémantiquement fort qui s'invitent
spontanément dans le discours, car ils sont pourvus d'une meilleure
désignation de la réalité à laquelle le sujet
parlant ou le locuteur fait allusion. Par exemple `Glissement' ou `Kabilie' qui
s'emploient spontanément dans des situations différentes.
III.3.1.3. L'implicite
Étant issue d'un discours journalistique qui
dit et qui fait dire. Il y a des exigences qui apparaissent, notamment celle de
l'économie du langage. Le journaliste qui joue ce rôle filtre dans
son paquet d'informations, celles qui sont significatives du point de vue de
l'idéologie. Ce qui ne rend pas au premier contact de la production
journalistique le discours explicite, par ricochet le sens du mot.
Cependant n'a pas quête de cacher le sens, mais d'amener
le lecteur à l'identifier et à le comprendre. L'effort propre du
lecteur permet d'apprécier l'intrigue et les éléments.
C'est ainsi qu'on présuppose leur appropriation105(*).
Alors, l'implicite s'engage, dans notre cas, dans une
procédure des préconstruits. Toujours en relation avec les
co-textes, le texte ne dit pas directement, mais plutôt veut vouloir
dire. Cela signifie que lorsque le journaliste fait dire glissement à
Jean-Marc Kabund, le signifié posé du mot glissement n'est pas
présent. C'est en reculant vers le co-texte ou en avançant que
l'on identifie son vouloir dire, et à ce niveau, son sens contextuel.
Enfin, le point précédent a fait
état de l'absence de certains signifiés, au niveau de
l'unité elle-même et de son contexte. Ceci est justifié par
le fait que le discours journalistique présuppose le partage d'une
même expérience sociale et culturelle. Il faut donc puiser dans ce
réservoir pour connoter les unités à notre disposition.
III.3.2. Les
résultats au niveau du deuxième filtrage : le rapport de
communication
Au niveau du rapport deux faits sont à
relever. Il s'agit de la distance énonciative qui permet de comprendre
le rapport de communication qui établit les deux sujet parlants, dans la
majeure partie de nos analyses. Et cette forme d'antériorité que
façonne l'intertextualité qui justifie ce rapport de
communication.
III.3.2.1. La distance
énonciative et l'intertextualité
Le discours journalistique est en grande partie
impacté par les discours rapportés. Comme nous l'avons
démontré dans nos analyses, le journaliste raconte ce qui a
été dit par un autre sujet, mais ayant le même niveau de
connaissance de l'objet d'énonciation, Il construit son propre discours
à partir des éléments discursifs du sujet qu'il fait
parler, que lui-même le journaliste juge pertinent106(*). Il y a une fonction de
communication qu'il assume. En disant ou en écrivant, il s'adresse
directement à son lectorat et à la cible du message
supposé du sujet qu'il fait parler.
Pour ce faire, il recourt enfin à
l'antériorité du discours pour mettre les traces de cette
relation source-journaliste-public. C'est en identifiant dans le texte, un
autre texte qui le stipule clairement.
Conclusion partielle
Notre troisième chapitre a pris en charge la
première analyse qui s'agit de l'analyse textuelle selon le
modèle de Jules Gritti. Nous l'avons appliqué à la
manière d'une analyse d'ouverture qui étudie l'usage des
unités qui constituent nos occurrences. Et ainsi comprendre le mode de
fonctionnement.
Pour cela, nous avons constitué un
échantillon de cinquante articles dont la densité a imposé
de prélever dix plus pertinent dans chaque média en ligne,
respectivement dix articles d'Actualité.cd et dix autres de Politico.cd.
Nous avons donc étudié l'usage de ces unités par un
journalisme factuel qui utilise un style d'écriture neutre. Et leur
usage par un journalisme engagé ayant une écriture aiguë et
plus libérée. Chaque lot d'articles a été soumis
à deux filtrages ; celui de la culture qui prend en charge la
dimension définitive et connotative du mot et celui du rapport de
communication pour comprendre à qui s'adresse ces unités et dans
quel but.
Au niveau du premier filtrage, nous avons relevé
de formules énonciatives qui justifient cet usage, mais également
l'importance des co-textes donne la clarté du sens du mot que le sujet
emploie au niveau de la co-référence et de l'implicite.
Au niveau du deuxième filtrage, nous sommes rendus
compte que le rapport de communication s'identifie à partir du
caractère rapporté du discours et de l'intertextualité qui
démontre les traces de sujets impliqués dans cette
énonciation.
QUATRIÈME
CHAPITRE : RÔLE ET IMPLICATION DU JOURNALISTE CONGOLAIS DANS LA
FABRIQUE SOCIOLINGUISTIQUE
Analyse de données
des entretiens
Le quatrième chapitre de notre travail
consiste en la seconde partie de nos analyses. La première a
été une porte d'ouverture pour étudier les étudier
les occurrences contenues dans les articles, qui constituent un français
véhiculé dans la presse. Le quatrième chapitre permet
d'interroger directement le journaliste et son rôle dans la
création, la dynamique et la légitimation de ces
éléments de langage.
IV.1. L'entretien des
journalistes : Déroulement et grille d'évaluation
Dans ce point, nous présentons la
démarche d'analyse des données lors des entretiens avec les
journalistes. Rappelons que les entretiens sont pour notre travail, une seconde
technique dans l'approche qualitative pour examiner concrètement le
processus de légitimation à travers le point de vue interne et
externe de l'énonciateur sur son énoncé.
IV.1.1.
Déroulement des entretiens
Nous avons mené des interviews auprès
de 5 journalistes congolais qui exercent dans la presse en ligne.
Essentiellement, nous avons pris d'une manière aléatoire, les
journalistes qui traitent des sujets de politique pour nous rapprocher de l'un
des domaines dont il est question dans ce travail. Les journalistes
interrogés ne sont pas nécessairement domiciliés aux deux
pure players, en raison de la conservation de l'objectif.
Les entretiens se sont déroulés
à Kinshasa, durant la deuxième moitié du Mai. Sous une
forme d'entretien semi-directif, nous avons échangé autour de la
pratique du journalisme, martelant sur l'information de fait politique. Les
entretiens ont duré dans l'ensemble à 7 heures 48 minutes.
IV.1.2.
Présentation de la grille d'analyse
Pour analyser les données
récoltées au cours de nos entretiens, nous procédons de la
manière suivante ;
- La Retranscription de
données
La retranscription de données est
l'étape de la présentation des résultats de la recherche
sur terrain. Ces résultats peuvent être bruts ou traités.
C'est une opération qui sert transcrire la totalité de
l'enregistrement de l'entretien, ou les capsules jugées significatives
au vu des objectifs de la recherche107(*). Nous employons le terme de retranscription, car
dans notre travail nous opérons une retranscription fidèle des
données recueillies. Sous forme de tableau. Cependant, les extraits
des répondants sont traités et mis en bloc. C'est-à-dire
que nous avons rassemblé les réponses de chaque sujet
interviewé pour en faire une réponse. Ceci fait, pour
éviter l'effet du `déjà-dit'. Ces réponses
collectives sont donc le matériau sur lequel se fonde notre analyse
thématique qualitative.
- L'analyse thématique qualitative
Il s'agit d'une technique qui permet de
présenter une forme de catégorisation en thèmes en vue de
placer et confronter les éléments de réponses dans
ceux-ci.
L'analyse thématique qualitative est une
technique de l'analyse de contenu que nous utilisons dans notre grille
d'analyse. Elle s'applique à un contenu de type verbal, dans notre cas
textualisé108(*).
Les thèmes d'analyse sont construits dès le moment de
l'élaboration du guide d'entretien. Pour notre cas, nous avons choisi
une démarche itérative. Les différents sont issus de
réponses obtenues auprès des interviewés pour ainsi les
élargir.
Il s'agit de faire la synthèse, de mettre
ensemble, les éléments de réponse, et de mettre dans un
thème qui facilitera l'interprétation en mettant en
lumière les divers propos de journalistes.
- L'opération
référentielle
Il s'agit en de termes simples à
l'interprétation de résultats de l'entretien et de leur
confrontation à l'hypothèse de recherche et à l'approche
théorique auxquelles ils se rapportent. Il sied également de
noter que ce point prend en charge son interprétation de façon
isolée. Une interprétation générale et les
confronter aux hypothèses balisera les deux résultats de la
recherche.
|
Mise en discours de l'information politique

|
|
Interviewé(e)s
|
Thèmes
|
Questions
|
Variables
|
|
Tous
|
Construction de l'information politique
|
Pouvez-vous nous parler de la construction de l'information
politique?
|
La construction de l'information politique respecte la norme
de la pratique journalistique et se démarque à certains niveaux.
Car le fait politique implique une démarche différente pour
atteindre l'objectif que poursuivent les journalistes.
Les faits politiques sont diversifiés, et les
construire est également scindé selon le genre journalistique,
objet de catégorisation de la production journalistique. S'agissant de
genres journalistiques ;
- Le compte rendu ; l'information politique est
construite dans un ordre de faits pertinents. L'immédiateté et
l'amplitude du fait. Et ceci constitue l'angle d'attaque.
- Le reportage : ici la construction de l'information
politique est fidèle aux normes du reportage, c'est-à-dire
recourir aux témoignages de ceux qui s'inscrivent dans
ce fait politique. C'est ainsi qu'ici la construction de l'information
politique se réalise à travers l'assemblage et le
traitement de discours rapportés (les témoignages, les
commentaires, etc.
- Le genre d'opinion ; si le fait politique doit
être analysé, commenté et ou s'il faut discuter sur les
implications de celui-ci, l'information politique est construite par un travail
de réactualisation, contextualisation et focalisation.
C'est-à-dire que le journaliste récupère, dans la plupart
de cas, un élément qui crée le fil d'actualité, le
contextualise et le confronte dans une logique qui se veut dans cette
situation.
Cependant, de façon générale,
l'information politique se construit suivant le principe de l'écriture
de l'information fondé sur les cinq questions de
référence Qui ? Quoi ? où ? Quand ?
Pourquoi ? et le comment ? (mettant l'accent sur le qui, le quoi, le
pourquoi et le comment).
|
|
Étapes de la construction de l'information
politique
|
Quelles en sont les étapes ?
|
pour construire l'information politique, il
n'existe pas un protocole d'étapes, sinon quelques étapes
apparaissent comme un crédo, car dans le traitement d'une information
politique, le journaliste s'investigue à relever les équivoques,
à décoder une idéologie, à contredire une
fausseté, à apporter de la lumière sur la gestion de la
chose publique.
Dans cet ordre, il y a premièrement la quête de
l'information ou la collecte de l'information (soit par
descente sur le terrain, soit par un fait provoqué).
Deuxièmement, il y a la phase de traitement. Cependant,
les données traitées sont sélectionnées selon leur
pertinence. Il y a ensuite la mise en forme de l'information.
Certainement l'étape la plus minutieuse. Pour que le produit
informationnel possède la valeur recherchée, le journaliste use
de techniques d'écriture propre à la rédaction d'une
information politique, qui sont le titre interpellatif, accusatif ou
démonstratif, le corps de l'article qui explique le problème ou
l'événement, place les intrigues. Et une chute qui questionne.
Et enfin, la publication de l'article.
|
|
Critères de sélection
|
Quels en sont les critères de
sélection ?
|
La sélection des faits s'effectue sur base des attentes
du lecteur. Sachant qu'à l'ère du numérique,
l'infobésité ne facilite pas la consommation d'une information,
d'où la sélection est minutieuse. Les critères qui
apparaissent sont de diverses natures ;
- L'amplitude du fait : ici, on prélève le
fait avec le plus d'intensité, et qui reflète les
réalités de la société. Aussi faudrait qu'ils
soient circonstanciels, garder un caractère de permanence, sinon
compétent de faire durer l'actualité et engendre d'autres angles
d'écriture.
- Pertinence du fait : le choix sur ce qui est pertinent.
La pertinence ici se traduit non seulement par la virtualité du fait d'
intéresser le public, mais aussi par la sélection de mots qui
influencent la société dans un terme précis, capable de
donner force à un programme ou à une rubrique.
- L'intérêt du public : ce critère
est le plus essentiel, car le devoir du journalisme est d'être au service
du public et de servir la démocratie.
Cependant, à côté de ces trois
critères quelques éléments qui influencent la
sélection sont illustrés. Il s'agit notamment de :
- Du respect de la ligne éditoriale qui est parfois
ambiguë, car elle n'est toujours pas liée à
l'identité du média, mais à l'identité de celui qui
fait vivre l'entité médiatique. Ceci donne lieu au
deuxième élément.
- L'élément financier : le choix du fait
à mettre en information dépend également de sa
capacité à générer des revenus additionnels, non
seulement basé sur la pertinence, mais sur la cohérence aux
attentes de l'idéologie en souche.
- L'actualité qui s'applique à toute forme de
journalisme.
|
|
observation
|
Cette grille de réponse nous permet de comprendre la
fabrication d'une information politique sur un plan spécifique. Ceci
dit, une information politique entretient sa propre ligne de conduite. Il
garde tout de même de principes généraux à
l'écriture journalistique, néanmoins l'importance du domaine dans
lequel il émerge impose une autre façon de faire.
Avec une autre perception, nous comprenons que l'information
politique est à un niveau considérable, une marchandise dont sa
fabrication est purement pensée. Dans le cas du second critère de
sélection, plusieurs autres pratiques découlent de ces derniers.
Cette grille nous permet d'ouvrir les prochaines observations.
Elle était une porte d'entrée, en de termes humbles, ils
questionnent le comment avant de passer à l'implication du journaliste
lui-même.
|
Tableau 2 : au sujet de l'usage des
éléments de langage de politique et de l'implication du
journaliste
|
Usage des EDL et implication du journaliste
|
|
Interviewé(e)s
|
Thèmes
|
Questions
|
Variables
|
|
Tous
|
Réactions escomptées
|
Quelle réaction espérez-vous obtenir à la
suite de la publication d'un article qui comporte un de ces termes ?
|
La première réaction qu'espère un
journaliste à la suite de la publication de son article est la
consommation de cette information. Néanmoins, il est utile
d'ajouter que chaque journaliste entretient sa propre ambition.
L'utilisation de l'un de ces mots intervient lorsque le
journaliste veut respecter l'heure du temps et inscrire sa présence dans
l'évolution de la société. Dans ce cas, une
réaction que l'on peut espérer est le souvenir.
À côté de ceux-ci, le journaliste
espère créer le débat au sein de la
société. Le débat favorise le retour de
l'information et sa permanence e.
Il sied de noter qu'il n'existe pas une ambition mythique,
fétiche. Ceci veut dire que le journaliste n'use de ces termes pour se
créer une identité à des fins de popularités ou de
vedettisme.
|
|
Intention du journaliste
|
Avez-vous l'ambition de marquer l'esprit du lecteur ?
|
L'ambition de marquer l'esprit du lecteur est quelquefois
péjorative, car il peut se traduire par « faire la
star » que la déontologie déconseille.
D'une part, il est presque impossible de supprimer cette
ambition de marquer l'esprit parce que si l'on observe l'évolution de la
société congolaise, plusieurs faits ou réalités
marquent quotidiennement l'esprit de la population. L'impossibilité
s'installe au niveau où le journaliste exerce un métier qui exige
de faire connaître ses faits et ou de discuter autour de ceux-là.
Aussi, dans le cas de moments importants et décisifs,
un contexte historique s'installe spontanément, et influence même
l'imaginaire linguistique collective. Par exemple lors de la période
électorale, le rassemblement, les marchés, etc.
Surtout cela, l'ambition de la pratique du métier, et
dans le cadre de l'usage de ces termes est de rendre fidèlement les
faits
|
|
Mode de récupération
|
Comment effectuez-vous la récupération de ces
termes ?
|
Il est délicat de récupérer des termes
produits en politique. Le premier problème qui se pose est celui de se
retrouver collé à une idéologie politique et biaiser la
neutralité journalistique. Il faut donc de formules de distance qui sont
investies dans l'écriture journalistique. Ces formules sont
donc ;
- Le guillemet : le journaliste met entre guillemet le
mot qu'il a récupéré pour ne pas prendre position et
aussi attirer l'attention du lecteur.
- la formule de responsabilité : le journaliste
utilise une formule phraséologique pour faire montre au public qu'il
n'est pas auteur d'un terme ou d'un terme. exemple : Félix
Tshisekedi annonce le déboulonnage du système actuel, selon ses
propres mots.
- L'emploi formel : l'emploi formel intervient lorsque le
journaliste a la certitude que le mot ou terme et son contexte qu'il utilise
sont ancrés dans la mémoire du lecteur. Cela devient alors un
code formel qui cadre avec la réalité de la
société. Il utilise alors pour recourir à l'effet que ce
mot a déjà produit dans la société.
|
|
Utilisation et/ou réutilisation
|
Avez-vous connaissance de la réutilisation de ces
termes dans la société congolaise ?
|
En règle générale, lorsqu'un terme est
récupéré pour de buts soulevés ci-hauts, il est une
évidence que l'impact de celui-ci sera apparent. D'où il y a une
connaissance préalable de l'usage de ces termes au niveau de la
société, car le journaliste lui-même étant citoyen,
est en relation avec la communauté avec laquelle elle partage le
même code.
Il y a tout de même une surprise. Celle de constater la
reconfiguration du terme reçu après lecture d'un article de
presse. C'est-à-dire que l'on constate un usage qui ne cadre pas
toujours avec le contexte de création. Le sens est présent mais
le contexte change. Exemple: Glissement.
|
|
Création littéraire, signification et
contexte d'utilisation
|
Y a-t-il de termes que vous avez créés ?
Quels sont leurs significations et leur contexte
d'utilisation ?
|
Oui et non.
Il existe dans la pratique du métier de journaliste,
une compétence d'innovation en termes de mots. Cette création
traduit un manque de terme efficace pour qualifier une réalité de
la société congolaise, qui elle-même possède un
talent d'innovation observée dans la société.
Au niveau de l'exercice il y a deux situations, soit
l'innovation traite du métier lui-même (le cas de jargon
journalistique congolais). Soit l'innovation vient d'un procédé
d'adaptation dans ce même objectif de créer l'actualité.
- Oui : le cas du mot
« Coupage », qui est né d'abord
dans un contexte de conditionnement d'un traitement de l'information. Mais
dont le contexte d'usage transgresse l'éthique et s'emploie pour
désigner le dû obtenu à la suite d'un travail
journalistique (appelé populairement le transport).
- Non : certains mots ne sont pas
directement l'oeuvre du génie journalistique. Le contexte qui fait
naître de l'innovation existe déjà, mais les journalistes
trichent pour désigner un élément du monde. C'est
l'exemple type du mot « Pangistans » venu
du Kikongo Pangi signifiant frère. Le terme pangistan est
utilisé pour désigner un partisan ou un militant politique du
camp d'un candidat avec des origines kongo ou l'équivalent.
Employé fréquemment pour désigner le candidat à
la présidentielle 2018 Martin FAYULU MADIDI. Dans cet ordre, nous avons
également de termes comme, « Kamerhisme
« qui désigne toute une idéologie politique
spécifique inspirée des actions de l'acteur politique Vital
Kamerhe.
|
|
Usage et exemple d'un nouveau lexique
|
Y a-t-il des expressions ou termes politiques à la
manière de ceux-ci, que vous utilisez dans la pratique de votre
métier ? Pensez-vous que l'intervention du travail journalistique
est sine qua non pour leur dynamisme ?
|
Oui.
- Putschiste
- Penalty
- Coup sur coup
Tous ces mots sont l'oeuvre d'une partie de la
société qui à l'heure actuelle, avec les nouvelles
technologies de l'information et de la communication, peuvent directement
toucher les publics et créer le même effet. Néanmoins, en
qualité de leader d'opinion par exemple, le discours journaliste apporte
plus de crédit.
|
|
Affirmation d'une variété du
français
|
Observant la pratique de votre métier, pensez-vous
qu'il soit temps de parler d'une variété du français
congolais ?
|
Oui et non.
Les avis sont partagés. La variété du
français congolais n'apparaît pas comme une évidence. Car
notre code est tâté d'une déformation de la langue
française. Le problème se posera à la conservation de
qualité de cette langue et la perte de la valeur qu'elle a et accorde
dans certains domaines comme le domaine éducatif.
Oui parce que l'évolution de la société
congolaise fait montre de cette compétence de créativité.
Il faudrait alors exposer les avantages et désavantages pour donner le
rythme.
|
|
observation
|
Nous avons posé ces questions dans le but d'obtenir les
avis de journalistes sur leurs travaux mais aussi le rôle qu'ils jouent
dans la formation des identités culturelles en République
Démocratique du Congo, en se focalisant sur l'usage du français
dans la presse. Cela permet à notre interprétation d'être
complète et de nous faire déboucher aux diverses perspectives.
|
IV.3. Synthèse
de résultats d'entretien
Relativement aux thèmes ressortis, la
synthèse ci-après s'effectue sur deux niveaux,
conformément à la structure du guide d'entretien (voir annexe).
IV.3.1. Mise en
discours de l'information politique
? Construction de l'information politique ;
L'information politique est construite
généralement à partir de 5 questions de
référence, et particulièrement selon les genres. Pour ces
derniers, nous avons :
- Compte rendu en regards des faits pertinents
- Reportage, en recourant à l'assemblage de discours
rapportés
- Genre d'opinion, par le processus de
réactualisation, de contextualisation et de focalisation.
? Étapes de la construction de l'information
politique ;
Collecte de l'information, phase de sélection
et traitement de l'information, mise en forme de l'information (titre :
interpellatif, accusatif, persuasif/corps : mise en intrigue/chute :
étonnement), publication de l'information.
? Critères de sélection ;
L'amplitude du fait, pertinence, intérêt du
public, respect de la ligne éditoriale, finance et actualité.
IV.3.2. Usage des EDL
et implication du journaliste
? Réactions escomptées ;
Consommation de l'information, inscription au
temps, souvenir, favoriser le débat dans la société.
? Intention du journaliste ;
Rapporter les faits fidèlement, tels qu'ils se
présentent.
? Mode de récupération ;
Formules de distance dans l'écriture
journalistique ;
- Emploi du guillemet
- Emploi d'une formule langagière de distance
- Souligner la responsabilité énonciative
? Utilisation et/ou réutilisation ;
Réponse positive : usage
anticipé de ces termes, reconfiguration de ces termes par la population
? Création littéraire, signification et contexte
d'utilisation ;
Innovation au niveau interne (au niveau de la profession),
co-création de termes, co-construction du sens
? Usage d'un nouveau lexique dans la presse ;
Réponse positive : travail d'influence par
position de leader d'opinion.
? Affirmation d'une variété du français
congolais ;
Réponse positive : évidence d'un code
local, problème de conservation de valeurs linguistiques, existence
d'une compétence créative linguistique, exposé des
avantages et désavantages.
IV.4.
Interprétation des résultats d'entretien
À la suite de ces entretiens, nous sommes
amenés à comprendre trois réalités que nous
décortiquons dans notre développement.
Il s'agit d'abord de la logique du code linguistique
et sociolinguistique qui s'impose dans la pratique journalistique. Ce code
permet de normaliser les particularités du langage journalistique en ce
sens qu'il soit techniquement Universel, qu'il s'agisse de règles
d'écriture de presse, du vocabulaire recommandé. Mais aussi, de
la prise en compte de pratiques langagières sociales dans le rôle
de représentation socioculturelle du journaliste.
Ensuite de conditions de création et de la
dynamique des innovations sociolinguistiques dans la presse à travers
son discours. Et enfin du rôle du journaliste dans la
Avant d'aller plus loin, les trois
réalités ci-hauts sont à distancier d'un point de vue
strictement linguistique. Puisque l'étude fait évidemment appel
aux notions linguistiques, la terminologie employée respecte cette
logique pour de besoins de précision, non pas d'expertise en sciences du
langage.
Autrement, le vocabulaire linguistique se justifie du
fait que ce travail traite du journalisme comme une activité discursive
qui entraîne des conséquences significatives pour la
société.
IV.4.1. La logique du
code linguistique et sociolinguistique dans l'écriture de presse
Ce titre paraît polysémique et à la fois
ambigu. Il est ici question de ce que Jean De Bonville qualifie de `notion de
texte et de code journalistique'. Pour ainsi indiquer la différence de
la langue utilisée par le journaliste et par l'occasion du rôle
qu'il joue dans l'évolution du français en RDC109(*).
Comme l'ont avancé les entretiens, le
discours journalistique n'est pas fétichiste. En effet, pour en faire
cette déduction, nous nous référons aux normes et
exigences de l'écriture journalistique, qui prédisposent un
style. Ce style ne prend sens que dans une logique d'un code existant et
partagé par les membres d'une même communauté. Pour
employer les termes du métier, le journaliste use d'une langue qu'il a
déjà trouvée, connue dans sa société. Et
c'est celle-ci qui lui permet d'exercer son métier.110(*)
Le travail présent relève un rôle
qui n'a pas été subtilement souligné. Dans cet
élan, il sied de noter que l'existence de règles
d'écriture d'un papier de presse est consubstantielle aux règles
grammaticales, lexicales et syntaxiques établies par des instances
compétentes. D'où, le journaliste est amené à
raconter les faits qu'il rencontre selon l'expérience linguistique
qu'il partage avec la société et sa communauté
professionnelle.
Ancré dans la philosophie de ce travail,
nous pouvons ainsi dire à un premier niveau qu'utiliser la langue
française dans la pratique du journalisme est le résultat de la
politique des langues en République Démocratique du Congo,
instituant cette dernière comme une langue professionnelle et
administrative. Ceci constitue son premier cadre légitime. Cependant, ce
dernier ne supprime pas la spécificité du discours
journalistique, dont les énoncés laissent à pressentir les
particularités. Il est vrai `qu'il faut dire en Français pour
qu'un congolais comprenne', mais de quelle manière `le dire' ? et
comment le faire comprendre ? c'est là que naissent les
particularités.
Selon les entretiens, les journalistes congolais
écrivent l'information en respectant les 5 questions de
référence ou encore à telle forme langagière telle
norme du discours. Par exemple les genres journalistiques qui ne partagent pas
tous la même langue (ceci représente un code linguistique
déjà établi)111(*), à la suite de ces dernières, la
situation de communication réoriente l'écriture, car elle fait
converger le contexte, les objectifs et les exigences de locuteurs (relation
journaliste-lecteurs)112(*).
À partir de la situation de communication, la
logique du code linguistique donne à une autre. Celle qui prend en
compte les réalités sociales qui, investies dans le discours du
journaliste, deviennent des représentations sociales. D'où le
code sociolinguistique se pratique spontanément. Et il est diachronique.
Dans ce cas, pour rendre compte de l'évolution de la
société congolaise, le journaliste parle la langue qu'exige cet
espace.
Ce code sociolinguistique s'installe pour
répondre aux besoins du principe de l'acte de langage.
C'est-à-dire, le discours journalistique met sur scène deux types
d'actants qui s'inscrivent dans une relation légitime. Le journaliste
qui initie l'échange est en ce temps-là le sujet qui communique
quelque chose à un interprétant avec un enjeu
d'intentionnalité.113(*) Pour ce faire, le journaliste initie un
échange avec le lecteur ou le public dans une visée qui est
pragmatique. Soit une visée d'information, une visée de captation
ou une visée d'incitation. (Voir chapitre 1 : L'énonciation
journalistique).
C'est en fait au niveau de ce contrat
d'énonciation que l'on peut observer ces particularités
langagières. En outre, les modes de dire l'information se conforment
à une visée poursuivie. Dans la thématique portant sur les
critères de sélection de faits politiques, la visée de
captation met en examen un fait choisi d'après son caractère
crédible et son amplitude pour optimiser les chances d'atteindre cet
objectif.
En rapport avec notre cadre d'étude, le lieu
de confirmer les comportements discursifs du journaliste congolais issus
d'abord du code de spécialité de sa profession, ensuite des
réalités sociales qui lui impose un code spécifique
traduisant ainsi l'identité du journaliste et son appartenance sociale.
D'emblée, nous nous hasardons à
rechercher dans les variables précédentes,
l'élément qui confère le rôle décisif du
journaliste dans la dynamique de nouvelles productions linguistiques ou
sociolinguistiques. Les entretiens laissent entrevoir que ces innovations
langagières s'inscrivent dans un processus de création. Ce
dernier rallie donc des conditions de faisabilité et d'usage sans
lesquelles les dérives de l'énonciation journalistique ne
justifieraient pas la prise en considération de ces innovations.
Nous avons pu relever dans les avis des
interviewés ces conditions de faisabilité et d'usage afin
d'interpréter le niveau de l'implication du journaliste.
IV.4.2. Dynamique des
innovations sociolinguistiques dans la pratique journalistique
Les conditions qui s'affichent ici proviennent d'une
certaine liberté que possède le journaliste dans sa propre
énonciation (bien que cette liberté soit restreinte par de
facteurs d'ordre de la politique interne et externe). C'est-à-dire dans
une certaine mesure, le journaliste se voit libéraliser ses pratiques
(de terrain ou discursives) pour atteindre un objectif escompté. Plus
encore, ces conditions proviennent également de relations contractuelles
qui influencent la manière de faire et de dire du journaliste. Ces
dernières peuvent être considérées comme des
facteurs qui influencent le discours journalistique.
Nous citons entre autre ; La situation de
communication et l'expérience discursive.
La situation de communication
Comprenons en premier lieu la situation de
communication comme un ensemble de données qui régissent
l'échange. Il institue donc des attitudes selon le type de locuteurs,
leur hiérarchie, le contexte de production de cet acte de langage et le
code à utiliser114(*). La situation communicationnelle est un
élément qui surdétermine le discours du journaliste. Les
enjeux qu'ils mettent en avant sont tels que le journaliste réoriente
son travail vers les exigences de ces enjeux.
Au cours des entretiens, nous avons pu comprendre
que lorsque le journaliste se trouve confronté à une situation de
communication, autre que son propre habitat, il se comporte de manière
à rendre correct son travail. C'est le niveau de transformation. Ce
procédé s'explique de la manière suivante : en
récupérant les faits politiques la situation communicationnelle
politisée crée une scène d'énonciation. Autrement,
la source recrée le discours.
Ceci fait en sorte que le journaliste adopte une
langue appropriée selon la nature du fait. Le fait étant
politique, il faut donc dire ou parler politiquement, en reprenant les termes
techniques, parfois en les appuyant parce qu'ils sont constituées comme
des bases de l'information, même si l'on peut prêter cela à
la fainéantise de la part du journaliste. Néanmoins, quelques
exceptions démontrent une reconfiguration de ces mots
récupérés en milieu politique.
D'où lorsque le journaliste de Politico couvre
un point de presse dans lequel une personnalité politique centralise son
discours autour du mot « glissement ». Il le reprend
fidèlement pour construire le sens de son propre discours. Cet
ingrédient de sens ; sans lequel son information sera informe.
Cette conduite se nomme « effet de réel115(*)» chez Barthes. Et elle
enseigne sur cette chimie qui consiste à rentrer dans les stricts
détails d'une structure discursive et élever le coût de
l'information116(*).
Ne cherchant pas à disserter sur cette
approche de la narratologie, nous l'utilisons pour faire montre
l'effectivité de cette manière de faire en journalisme. Cet effet
de réel se réalise par exigence d'émulation. Nous sommes
donc dans un réseau discursif où le journaliste va en quête
de cet air du temps, et de la reconnaissance sociale. Il maintient alors les
rapports entre la source, lui-même et le public en utilisant le
même code. La formation de ce réseau aide le journaliste à
impacter l'imaginaire du public, qui, quand il perçoit une information
dont le contenu linguistique s'enrichit des dérives de ce réseau.
L'expérience discursive
Le maintien de cette trilogie d'acteurs crée
des habitudes dans le discours du journaliste. Le mot qu'il utilise pour rester
en proximité de réalités sociales, devient alors courant
dans sa pratique. Pour cela, le journaliste se rassure de la
pénétration de ce mot dans le code sociolinguistique. Ce qui veut
dire, accepté et utilisé couramment comme tel en
société117(*).
Dans la société congolaise, lorsque le
journaliste a repris le mot maper pour désigner les arrestations des
hommes politiques, le mot avait déjà été
utilisé sur les réseaux et médias sociaux. Cette
expérience trouve force en ce que le mot se développe dans
plusieurs discours. Et ainsi, s'utilise en connaissance de l'expansion de son
sens dans le milieu congolais. C'est en quelque sorte
l'interdiscursivité qui justifie l'usage de ces mots.
L'interdiscursivité justifie également au préalable le
caractère rapporté dans le discours du journaliste.
Un autre élément qui apparaît dans
nos entretiens, et que cette expérience discursive justifiée par
une interdiscursivité, construit une partie de la
légitimité du journaliste. Il faut alors comprendre le rôle
que joue le discours journalistique. En effet, dans le champ énonciatif,
particulièrement sur les plateformes web, l'énonciation
journalistique induit de manifestations discursives. Ces dernières que
l'on peut retrouver dans les commentaires respectent l'esprit du premier avec
lequel les lecteurs sont entrés en contact.
Dans ce cas, le journaliste devient, comme dit dans les
entretiens, un créateur du débat qui dit le terme premier. Ce
terme mène alors le fil de l'histoire et transforme le comportement
linguistique. Vitez dira dans son analyse portant sur le discours
médiatique et la norme du français parlé les productions
médiatiques permanentes sont des sources importantes du comportement
linguistique, car celui qui transmet le message en ce temps précis,
construit la situation d'énonciation118(*).
Et donc, rattachée à cette pensée,
l'énonciation du journaliste, les innovations qui paraissent constitue
un code idéalisé119(*). Non parce qu'il en soit l'auteur, mais parce qu'il
met en scène des structures discursives rapportées par un travail
artistique. C'est la manière de dire qui prime.
IV.4.3. Le rôle
du journaliste et légitimité du français congolais
Au regard de ce qui a été dit, la
question du rôle du journaliste comme énonciateur s'illustre. En
effet, nous avons relevé au cours de nos entretiens, que les occurrences
qui constituent notre corpus sont toutes de créations extérieures
au discours journalistique. Elles résultent d'un travail de
récupération. Mais la part du journaliste est conséquente.
En vérité, le journaliste lui-même
ne se positionne pas en créateur, juste en transmetteur. Cette
conception est, à notre sens, erronée si l'on regarde le contenu
de points précédents. La compétence de son
écriture, cet instrument artistique lui permet indirectement
d'être compté parmi un acteur de cette dynamique du
français dit `congolais' en ce sens où, à travers les
tournures que l'on retrouve dans son discours, il construit de la finalisation
de cette variété. Finalisation qui se traduit jusqu'au moment
où les publics usent de ces innovations comme code normal et
idéal pour l'intercompréhension.
Il sied alors de le considérer comme un
co-créateur des innovations sociolinguistiques et un acteur de
légitimité. Cette co-création vient, timidement, couvrir
une place de créateur, s'il faut nous référer aux
résultats de l'analyse textuelle, nous verrons qu'il crée
à son niveau de nouvelles règles syntagmatiques. En guise
d'exemple, le mot maper, ne correspond pas exactement aux innovations
sociolinguistiques que l'on peut identifier dans glissement ou
béton qui sont des innovations au niveau sémantique. Il
est plutôt question d'un raccourci du langage, et une innovation au
niveau de la forme pour dire Placer sous mandat d'arrêt provisoire. Ce
qui est effectivement l'oeuvre du génie journalistique pour gagner
l'espace dans l'écriture ou dans son acte de parole.
Il y a également ce supposé rôle
de créateur en puisant dans le jargon journalistique. Il est difficile
de statuer sur une création, mais il est clair que nous sommes face
à un enrichissement de la langue.
Aussi, éclairer le rôle du journaliste
nous met face à une découverte. Il est co-créateur dans sa
pratique. car la démarche de son travail consiste à raconter ce
qu'il dit. Les innovations qu'il présente donc sont puisées dans
son réservoir d'expérience socioculturelle et historique et des
interactions autour de lui qui intéressent son métier. Et donc
au niveau de la pratique journalistique, la considération d'une
légitimité du français congolais est partagée et
non pas exclusive. La variété du français qui, au niveau
de leur conception, est encore ambiguë.
Pour notre part c'est en acceptant cette conception
d'ambiguïté que nous avons fait des nouvelles découvertes.
Celles-ci sont en lien avec les résultats de la première analyse
et celles que les entretiens nous ont permis d'obtenir.
Conclusion
partielle
Ce quatrième chapitre a été une
partie spécifique dans notre travail. Il a alloué les
éléments de complémentarité pour confronter les
résultats de la recherche, à la réalité que nous
prônons. Pour ce faire, il a compris ce qui suit.
Nous avons d'abord commencé par présenter
la grille d'analyse. Ainsi, la méthode a été
appliquée. Dans cette démarche, nous avons
présenté les résultats d'entretien dans deux tableaux,
selon que nous avons pu faire l'économie de l'ensemble de
résultats. Ensuite nous avons fait une synthèse de ces
résultats par thème. Lequel est ressorti des entretiens
réalisés. Ensuite, Nous sommes passés
à une interprétation minutieuse des résultats d'entretien.
S'agissant de résultats d'entretien, nous avons
pu dégager trois éléments qui, à notre niveau,
constituent des réalités contenues dans les résultats.
Il s'agit de la logique du code linguistique et
sociolinguistique, qui justifie le fait que l'usage de termes tels que
Glissement, maper ou guerriers, parce qu'il y a exigence de parler en
français pour la compréhension du produit informationnel. Mais
aussi, puisque ces termes reprennent les réalités sociales.
Nous avons également découvert que la
dynamique des innovations sociolinguistiques dans la pratique du
journalisme, qui constitue un code à part entière du
français, est issue de plusieurs éléments en commutation.
Premièrement, la situation de communication qui recrée le
discours du journaliste d'après les exigences de l'environnement dans
lequel il construit l'information. Deuxièmement, l'expérience
discursive qui veut qu'en réponse à ce respect de la situation de
communication, les innovations s'ancrent dans l'imaginaire linguistique
collective et deviennent un code idéalisé.
Enfin, nous nous sommes posé la question de la
responsabilité du journaliste congolais dans la promotion de cette
variété du français local et sa légitimité
en tant que tel. Nous avons eu pour réponse que l'ambiguïté
apparaît lorsque nous faisons allusion à une variété
du français en République Démocratique du Congo.
Cependant, il existe dans la presse les traces de cette
variété, dont le journaliste n'est qu'un co-créateur en
raison de la dynamique de son propre discours.
BILAN DE LA
RECHERCHE
Au terme de notre étude, nous avons fait des
découvertes qui affirment ou infirment nos hypothèses. Rappelons
que l'objectif de ce travail était d'étudier comment le
journalisme comme pratique discursive, participe à la fabrique de ce que
nous appelons fabrique sociolinguistique en étudiant comment à
travers le discours journalistique les mots que l'on retrouve dans cette
fabrique sociolinguistique sont dynamisés ou construits en
unité signifiante pour la langue française.
Nous avons donc avancé qu'il existe bien une
variété du français congolais utilisée dans la
presse en ligne, dont les preuves de leur évidence doivent donner lieu
à penser ou repenser la promotion de ce patrimoine sociolinguistique. En
cours d'analyse de ces occurrences dans la presse en ligne. Nous avons
rencontré une réalité qui reconduit notre
réflexion. Il s'agit de mots qui entrent dans cette fabrique
sociolinguistique.
En réalité, il nous faut dire en de
termes humbles, que l'entrain qui nous a servi à soutenir fortement
l'existence de cette variété dans la presse, nous a fait entrer
dans une grande synergie. Les mots qui constituent nos occurrences ne sont pas
détachés de leur système. Ces systèmes sont
pluriels et c'est l'assemblage de ceux-ci qui forment cette
variété du français congolais. Et donc à
l'affirmation des hypothèses ou à leur infirmation, nous pouvons
dire ce qui suit.
Le discours journalistique se construit dans une
situation qui lui impose un code linguistique et sociolinguistique. De ce fait,
on reconnaît au journaliste ce rôle considérable de metteur
en scène des usages ou pratiques langagières de la
société dans laquelle il énonce et pour qui il travaille.
Dans son rôle, les éléments qu'il énonce sont en
partie issus de son expérience journalistique. Le travail qu'il
réalise sur le terrain, les interactions qu'il entreprend, le code qu'il
partage avec sa source exige dans la logique de les rendre comme tel. Ceci
apparaît comme un code idéalisé car la réception de
ce discours ou de ce produit journalistique est assurée par la
reconnaissance du code qui assure l'intercompréhension.
C'est donc un rapporteur de discours d'autres sujets
à qui il donne du sens à travers l'art de son énonciation.
C'est la dynamique discursive de l'énonciation journalistique qui
sublime ces occurrences et occasionne l'idéalisme de ce code. Mais
à l'ambition de fournir aux lecteurs de lignes prospectives pour la
promotion de cette partie de cette variété du français que
nous reconnaissons, se pose. Que faut-il promouvoir ?
Cette question qui débouche de la
réalité lors de l'analyse textuelle, nous a mis face à
plusieurs systèmes sociolinguistiques. Nous appelons système
sociolinguistique, les différentes catégories de
particularités d'une langue dans un milieu social bien
délimité.
Ce système est culturel, selon qu'il soit
imprégné de réalistes sociales. Et que les effets qu'il
produit en société sont en lien avec la culture (la culture
congolaise). Le mot système se justifie en ce que ces catégories
en sont en synergie et interagissent pour produire le sens que le locuteur
recherche. Et même si la catégorie est isolée dans sa
structure profonde, nous retrouvons toujours ces traces d'interactions.
Évidemment c'est par effet de culture.
Exemple: Dans une phrase tirée d'un article
sur Politico.cd, il est écrit: ... le béton Mikiliste...
Le mot Mikiliste, comme co-texte à notre
unité `béton', est tout un système sociolinguistique mais
aussi culturel. D'abord parce que Mikiliste est un mot issu d'une
déformation de la langue, Monde pour mikili faisant
référence à l'Europe. C'est une unité qui fait
partie du système appelé `langage populaire. ' Ensuite, il y a
une charte sémiotique dans ce mot «Mikiliste» construite par
la société. C'est donc un autre système. Et enfin il y a
ce mariage de code (le lingala et le français) qui donne lieu à
un autre système caractérisé par le code mixing.
Loin l'idée d'entrer en profondeur,
n'étant pas sociolinguistique. Mais puisque la presse utilise
quotidiennement ce langage. Nous trouvons judicieux, mieux, intelligible de
comprendre d'abord la composition de cette variété du
français avec le marqueur local congolais, rendre empirique ces
systèmes sociolinguistiques et culturels dans la presse, étudier
leur mode de fonctionnement, à la suite penser aux perspectives de
promotion et de valorisation. Car il s'agit là de préserver la
didactique de cette langue apportée par le facteur colonial que nous
nous approprions aujourd'hui.
CONCLUSION
GENERALE
Notre humble travail touche à sa fin, celui-ci
n'est qu'une première étape franchie sur la voie de la recherche.
Nous avons osé repenser la pratique journalistique, come pratique
discursive qui met en évidence les preuves du français congolais
et leur usage. Pour ce faire, nous avons construit ce travail sur quatre
chapitres.
Au premier qui s'est consacré aux concepts,
aux ancrages théoriques et méthodologiques, nous avons
premièrement défini les termes qui apparaissent dans notre sujet
de manière directe, mais aussi indirecte. Ensuite, nous avons inscrit
ces concepts dans nos perspectives théoriques. En effet chaque niveau
d'appréhension conceptuelle sous-entendait une ou deux approches
théoriques. Et enfin nous avons exposé la méthodologie
essentiellement qualitative, qui a été mise en pratique pour
étudier notre problème.
Au deuxième chapitre, Nous avons d'abord
commencé par présenter l'objet de contextualisation de cette
étude ; le français dans une perspective de localisation.
Le premier point traitant de la situation sociolinguistique a permis de situer
le lecteur, et de le fixer à nouveau sur les objectifs de ce travail.
Dans une autre perspective, il a permis de présenter les mots qui
fondent l'analyse textuelle. Ensuite, nous avons présenté les
médias choisis pour mener notre étude. Et enfin, nous avons
présenté les articles sur lesquels l'analyse textuelle s'est
effectuée. Suivi d'un bref exposé des difficultés
rencontrées sur le terrain.
Au troisième chapitre, Nous avons appliqué
à la manière d'une analyse d'ouverture, la méthode
d'analyse textuelle de J. Gritti
Pour cela, nous avons constitué un
échantillon de cinquante articles dont la densité a imposé
de prélever dix plus pertinent dans chaque média en ligne,
respectivement dix articles d'Actualité.cd et dix autres de Politico.cd.
Nous avons donc étudié l'usage de ces unités par un
journalisme factuel qui utilise un style d'écriture neutre. Et leur
usage par un journalisme engagé ayant une écriture aiguë et
plus libérée. Chaque lot d'articles a été soumis
à deux filtrages ; celui de la culture qui prend en charge la
dimension définitive et connotative du mot et celui du rapport de
communication pour comprendre à qui s'adresse ces unités et dans
quel but.
Au niveau du premier filtrage, nous avons relevé
de formules énonciatives qui justifient cet usage, mais également
l'importance des co-textes donne la clarté du sens du mot que le sujet
emploie au niveau de la co-référence et de l'implicite.
Au niveau du deuxième filtrage, nous sommes rendus
compte que le rapport de communication s'identifie à partir du
caractère rapporté du discours et de l'intertextualité qui
démontre les traces de sujets impliqués dans cette
énonciation.
Au quatrième chapitre enfin, nous avons d'abord
commencé par présenter la grille d'analyse. Ainsi, la
méthode a été appliquée. Dans cette
démarche, nous avons présenté les résultats
d'entretien dans deux tableaux, selon que nous avons pu faire l'économie
de l'ensemble de résultats. Ensuite nous avons fait une synthèse
de ces résultats par thème. Nous avons pu dégager trois
éléments qui, à notre niveau, constituent des
réalités contenues dans les résultats.
Il s'agit de la logique du code linguistique et
sociolinguistique, la dynamique des innovations
sociolinguistiques dans la pratique du journalisme, qui constituent un
code à part entier du français, est issu de plusieurs
éléments en commutation. Premièrement, la situation de
communication qui recrée le discours du journaliste d'après les
exigences de l'environnement dans lequel il construit l'information.
Deuxièmement, l'expérience discursive qui veut qu'en
réponse à ce respect de la situation de communication, les
innovations s'ancrent dans l'imaginaire linguistique collective et deviennent
un code idéalisé. Et nous nous sommes posé la question
de la responsabilité du journaliste congolais dans la promotion de cette
variété du français local et sa légitimité
en tant que tel. Nous avons eu pour réponse que l'ambiguïté
apparaît lorsque nous faisons allusion à une variété
du français en République Démocratique du Congo
Pour clore, en réponse à notre
hypothèse, il est évident que le choix de nos médias ont
facilité son affirmation. En effet, les deux terrains ont une
écriture qui diffère et chacun d'eux véhicule et dynamise
les innovations sociolinguistiques en langue française, selon que l'un
utilise un discours factuel crédible et distant et l'autre un discours
émotionnel et plus libéré.
En lien aux résultats des entretiens,
l'affirmation de cette hypothèse ne doit pas laisser sur la touche, les
découvertes faites au cours de nos analyses, celles de prendre en
compte la dimension intégrale de cette variété du
français congolais dans la presse et leur fonctionnement.
BIBLIOGRAPHIE
?
OUVRAGES
- ADAM, J-M., La linguistique textuelle :
introduction à l'analyse textuelle du discours, Paris, Armand
colin, 2005
- ADEISHVILI, K., L'Analyse du discours politique, Sarrebruck,
Les Editions universitaires européennes, 2016,
- Antoine, F., Analyse la radio, Méthodes et mise
en pratique, Bruxelles, Deboeck, 2016
- Berthoud, A.-C., Burger, M., Repenser le rôle
des pratiques langagières dans la constitution des espaces sociaux
contemporains, Bruxelles, Deboeck, 2014
- Bourdieu, P., Langage et pouvoir symbolique,
Paris, Points, 1991
- Boyer, H., Introduction à la
sociolinguistique, Paris, Dunod, 2019
- Calvet, J.-L., La sociolinguistique, éd. Que sais-je,
Paris, PUF, 2010
- CHARAUDEAU, P., « De l'argumentation entre
les visées d'influence de la situation de
communication », in Argumentation, Manipulation, Persuasion,
Parsi, L'Harmattan, 2003
- CHARAUDEAU, P., Le discours politique. Les masques du
pouvoir, Paris, Gallimard, 2005
- CHARAUDEAU, P., Les médias et l'information.
L'impossible transparence du discours, Bruxelles, De Boeck, 2005
- CHARLAND, M., « le langage politique »,
dans, D., WOLTON et al. La communication politique. Etats des savoirs, enjeux
et perspectives, Québec, Presses de l'Université du
Québec, 2003
- CHEVAL, J-J., « Analyser la radio.
Méthodes et mises en pratique », Frédéric
Antoine », Bruxelles, Deboeck, 2016
- D, MAINGUENEAU, D., Discours et Analyse du
discours, Paris, ARMAND COLIN, 201
- Meillet, A., « Comment les mots changent de
sens », in l'année sociologique, Paris, PUF, éd
2013, pp. 1-38
- Onguéné Ossono., Langues et Médias
en Afrique noire francophone : analyse (socio)linguistique et
didactique, Paris, éd Connaissances et Savoirs, 2017
- PAILLE, P., A., MUCCHIELLI, A., L'analyse qualitative en
Sciences humaines et sociales, Paris, Armand colin, 2016
- RINGOOT, R., Analyser le discours de presse,
Paris, Armand Colin, 2014,
- S., ALAMI, S., DESJEUX, D., GARABUAU-MOUSSAOUI, L.,
Les méthodes qualitatives, Paris, PUF, Coll. « Que
sais-je », 2009
- Saemmer, A., Tréhondart, N., Coquelin, L., Sur
quoi se fondent nos interprétations ? Introduction à la
sémiotique Sociale appliquées aux images d'actualité,
séries télé et site web de médias, Paris,
Enssib, 2022
- Schuwer, M., Parole et pouvoir. Enjeux politiques et
identitaires, Rennes, Presse Universitaire de Rennes, 200
- Shomba, Kinyamba, Comprendre Kinshasa à travers
ses locutions populaires. Sens, contexte et usages, Leuven, Acco, 2008
- Tchindjang, M., Langues et identités culturelles en
Afrique, ·Paris, éd UNESCO et Blackwell Publishing Ltd,
2008, 150 p.
- Tudesq, A.J, L'Afrique parle, L'Afrique
écoute, Paris, Karthala, 2002
? ARTICLES
- Barbéris, J., Bres, J., et Gardes-Madray, F.,
(1998), « La praxématique ». in
Etudes littéraires, n°3(21), 1989, pp 29-47
- BAUTIER-CASTAING, E., « la notion de pratiques
langagières : un outil heuristique pour une linguistique des
dialectes sociaux » in : Langage et société,
n°15, 1981
- Bourdieu, P., Ce que parler veut dire. L'économie
des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982
- C., OLLIVER-YANNIV, « Les petites
phrases » et « éléments de
langage » . Des catégories en tension ou l'impossible
contrôle de la parole par les spécialistes de la
communication, in : Communication et Langages, n°168, 2011
- Chabrol, C., Courbet, D., Fourquet-Courbet, M.-P., `'
Psychologie sociale, traitements et effets de médias'', in
Questions de communication, n°70, 1995, pp 41-78
- CHARAUDEAU, P., « une analyse
sémiolinguistique du discours », in revue langages,
n°17, Paris, 1995
- DE BONVILLE, J., « les notions de texte et
de code journalistique : définition critique ». In :
Communication, information Médias, Théories, Volume 17
n°2, Décembre 1996
- HOUTART, F., « La méthode d'analyse
textuelle de Jules Gritti », in : Méthodes d'analyse
de contenu et sociologie (en ligne). Bruxelles, Presses de
l'université de Saint-Louis, 1990
- J., BRES, « Brève introduction à la
praxématique », in L'information, n°77, 1998
- Mullan, K., « Henri Boyer (éd) Hybrides
linguistiques », in Cahiers de praxématique, n°22,
2010, p54-55V
- P., CHARAUDEAU, « une analyse
sémiolinguistique du discours », in revue langages,
n°17, Paris, Hachette, 1995
- Saemmer, A., Tréhondart, N., Coquelin, L., Sur
quoi se fondent nos interprétations ? Introduction à la
sémiotique Sociale appliquées aux images d'actualité,
séries télé et site web de médias, Paris,
Enssib, 2022
- SAITTA, E., « Les journalistes politiques et leurs
sources. D'une rhétorique de l'expertise critique à une
rhétorique du ` cynisme' », in Mots, les langages du
politique, n°87 Juillet 2008, pp 113-127
- WOLTON, D., la communication politique :
construction d'un modèle, in HERMES, LA REVUE N°4, Paris, CNRS
éditions, 1989
? NOTES DE COURS
- KAMANDA, R., Cours de linguistique générale,
Kinshasa, Faculté de communications sociales, UCC, 2020
- MBIYE, H Cours de narratologie, Notes à
l'intention des étudiants de 3ème licence
Communications sociales, UCC, Kinshasa, Année académique
2020-2021
- MUSANGANIA, J-P., Cours d'analyse du discours
médiatique, UCC, Kinshasa, 2022-2023
- TEBANGASA, D., Cours de Méthodes d'investigation en
sciences sociales. Notes de cours à l'intention des étudiants en
2e licence, en communications sociales, Kinshasa, UCC, 2019-2020
? DOCUMENTS CONNEXES
- Actualité.cd, Cahier de présentation de
l'entreprise
- Politico.cd, cahier de présentation de
l'entreprise
? THESES, MEMOIRES,
ACTE DE CONFÉRENCE
- Forsgren, M., Norén, C., Sullet-Nylander, F., le
français parlé des médias, Actes du colloque de
Stockholm 8-12 Juin 2005, Stockholm, Acta Universitatis Stockholmiensis 2007,
pp 97-111
- Mounga-Ndounkeu, B., « Anamaria curea, Entre
expression et expressivité : l'école linguistique de
Genève de 1900 à 1940. Charles Bally, Albert sechehaye,
Henri Frei », Lectures, les comptes rendus, 2015
WEBOGRAPHIE
- GRIGNON, J., Le Zaïre, Paris, INA, 1975 consulté
le 25 JANVIER 2023 à 19 :44 URL :
https://www.in.fr/ina-eclaire-actu/video/caa08014113/le-
zaire-ndeg1
- MULLAN, K., « Henri Boyer (éd), Hybrides
linguistiques. » Cahiers de praxématique en ligne, 54- 55, 2010,
document 22, mis en ligne le 01 janvier 2013, consulté le 04 Janvier
2023 à 9 :03 URL.
https://journal.openedition.org/praxemantique/1195
- MAINGUENEAU, D., « le discours politique et son «
environnement » », Mots. Les langages du politique, N°94, 2010.
Mise en ligne le 0- Novembre 2012, consulté le 02 Avril 2023 à 15
:25. URL :
http://journals.openedition.org/mots/19868
- RT, cours d'introduction à l'énonciation :
l'énonciation consulté le 09 Avril 2023 à 16h :05.
URL :
https://www.ralentirtravaux.com/lettres/cours/enonciation.php
- CHARAUDEAU,P., « Discours journalistique et
positionnements énonciatifs. Frontières et dérives »,
Semen, (en ligne), 22 /2006, mise en ligne le 01 Mai 2007, consulté le
10 Avril 2023. URL :
https://journals.openedition.org/semen/2793
- GILLET, C., « Langages et
Discours-Éléments de sémiolinguistique »,
Études de communication, (en ligne), 2, 1983, mis en ligne le 17 MAI
2012, consulté le 17 AVRIL 2023 à 10 :56. URL :
https://journals.openedition.org/edc/3319
- MOUNGA NDOUNKEU, B., « Anamaria Curea, Entre expression
et expressivité : l'école linguistique de Genève de 1900
à 1940. Charles Bally, Albert sechehaye, Henri Frei, ».in :
Lectures, (en ligne), les comptes rendus 2015 mis en ligne le 21
Décembre 2015. Consulté le 22 Avril 2023 URL:
https://lectures.revues.org/19720
- KHALID, M., La recherche et ses méthodologies
consulté le 19 avril 2023. URL :
https://www2.ift.ulaval.ca/-chaib/IFT-
6001/Slides/Rech-method.pdf
- FALLERY, B., F., RODHAIN, F., Quatre approches pour
l'analyse textuelle : lexicale, linguistique, cognitive, thématique, (en
ligne). Consulté le 20 Avril 2023. URL :
Https://hal.science/hal-00821448
- OBSERVATOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE, Qui parle
français dans le monde ? (en ligne). Consulté le 12 Mai 2023. URL
: Qui parle français dans le monde - Organisation internationale de la
Francophonie - Langue française et diversité linguistique
- TUMBWE, R., « le français dans le paysage
linguistique de la République Démocratique du Congo » in :
Environnement francophone en milieu plurilingue (en ligne). Pessac : Presses
universitaires de Bordeaux, 2012. Consulté le 12 Mai 2023. URL :
https://books.openedition.org/pub/35242
- GOTTARELLI, M., « le journalisme est un combat »
: réflexion sur un journalisme engagé, l'oeil de la maison des
journalistes. (En ligne) mis en ligne le 28 novembre 2018. Consulté le
28 Mai 2023. URL :https://www.oeil.-
maisondesjournalistes.fr/2018/11/27/journalisme-engage-politique/
- DEVILLA, L., Analyse de la linguistique textuelle -
introduction à l'analyse textuelle des discours, p. 256. Consulté
le 06 juin 2023 URL :
https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice.00120796v2
- QUINTIN, J-J., Cours d'Analyse de données
qualitatives : outils de production de données qualitatives et
méthode d'analyse, Lyon, Université Lyon 2. p44, (En ligne),
consulté le 17 juin 2023 URL :
https://www.//apprendre.auf.org./wp-content/opera/13-BF-Refrences-et-biblio-RPT-2014/
- CHARAUDEAU, P., « la situation de communication comme
lieu de conditionnement du surgissement interdiscursif », in : TRANEL,
n°44, interdiscours et intertextualité dans les médias
Neuchâtel, Institut de Linguistique de l'Université de
Neuchâtel, 2006. (en ligne),consulté le 15 Mai 2023 URL :
https://www/patrick-charaudeau.com/la-
situation-de-communication.166.hml
- VITEZ, P., le discours médiatique parlé et la
norme du français : une question d'accent. p37 consulté le 27 Mai
2023 URL :
https://journals.uni-lj.si/Vestnik/article/download/10369/9934
ANNEXES
Guide
d'entretien
Journalisme et fabrique du patrimoine
sociolinguistique: étude du processus de légitimation des
éléments de langage en politique congolais
Brève explication du titre : il est question
d'étudier la manière dont les journalistes congolais.es
véhiculent et dynamisent une variété propre du
français congolais. Ce, à partir de mots qui sont puisés
dans le milieu de la politique congolaise (ex. Glissement, La base, les
talibans, mapé, etc.) En outre, le processus de légitimation
stipule la manière dont les journalistes donnent du sens à ces
mots et qu'à travers le discours des journalistes (l'article de presse)
ces mots sont acceptés et légitimés dans la
société.
|
Présentation de l'intervieweur.
|
|
Bonjour, je m'appelle WILINA NSIMITI GRADI
J'effectue une étude autour de la manière dont le
journaliste participe à la fabrique du patrimoine sociolinguistique, ce
à travers une étude interdisciplinaire du processus de
légitimation des éléments de langage en politique
congolaise.
La durée de cet entretien ne dépassera pas 1 heure.
Au cours de l'entretien, j'aimerai que les thèmes
suivants soient au centre de notre échange: l'écriture de
l'information politique, le traitement de l'information politique, la mise en
scène de l'information et l'utilisation de mots rapportés.
|
Terrain
d'observation
`Au sujet de la mise en discours de
l'information politique'
|
Questions principales
|
Questions de clarification
|
|
? Pouvez-vous nous parler de la construction de l'information
politique?
? Quelles en sont les étapes ?
? Quels en sont les critères de sélection ?
|
Pouvez-vous m'en dire plus ?
Pouvez-vous me donner un exemple ?
Pouvez-vous approfondir ?
|
`Au sujet des mots et de
l'implication du journaliste (signataire)'
(TALIBAN, GLISSEMENT, BASE, MAPER, NOUVELLES UNITES ?
DEBOULONNAGE,
|
Questions principales
|
Questions de clarification
|
|
? Quelle réaction espérez-vous obtenir à la
suite de la publication d'un article qui comporte l'un de ces mots ?
? Avez-vous l'ambition de marquer l'esprit de vos lecteurs ?
? Comment effectuez-vous la récupération de ces
termes ?
? Avez-vous connaissance de leur utilisation ou leur
réutilisation dans la société congolaise ?
? Y'a-t-il des termes que vous avez créés ?
? Quels sont leurs significations et leurs
contextes d'utilisation ?
? Observant l'exercice de votre métier, pensez-vous qu'il
existe une langue française typique à la communauté
congolaise?
? Y'a-t-il des expressions politiques de ce genre que vous
connaissez et utiliser dans la pratique de votre métier ?
|
Pouvez-vous m'en dire plus ?
Pouvez-vous me donner un exemple ?
Pouvez-vous approfondir ?
Si oui, lesquels ?
Si oui usez-vous de cela délibérément?
|
|
|
ARTICLES DE
PRESSE
Élections 2023
en RDC : « Félix Tshisekedi prépare le glissement » (JM
Kabund)
A l'approche des élections générales
prévues au mois de septembre 2023, tel que la Constitution Rd congolaise
stipule à son article 73 : « Le scrutin pour l'élection du
président de la République est convoqué par la Commission
Électorale Nationale et Indépendante (CENI), 90 jours avant
l'expiration du mandat du président en exercice ».
Alors que la situation socio-économique et
sécuritaire s'enlise, le président en exercice, Félix
Tshisekedi préparerait un glissement, selon le député
national, Jean-Marc Kabund a Kabund.
Au cours d'un point de presse tenu ce lundi 18 juillet dans sa
résidence de Kingabwa à Kinshasa, Kabund a
révélé que : « le régime Tshisekedi a
décidé de mettre en péril la périodicité, la
sincérité et la transparence des élections en
préparant le glissement ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux
prochaines élections ».
En annonçant la création de son parti politique,
Alliance pour le Changement, ce lundi 18 juillet 2022, Jean-Marc Kabund, ex-
président ad intérim de l'UDPS a étrillé le bilan
du président Félix Tshisekedi, candidat déclaré
à sa propre succession.
Élu sur la promesse de faire de la RDC un Etat de droit
où tout sera centré sur « le peuple d'abord »,
Félix Tshisekedi a jusqu'ici un bilan de gestion mitigé,
marqué par une ribambelle de promesses non tenues.
Jean-Marc Kabund a remué le couteau dans la plaie.
Fustigeant un régime des « irresponsables jouisseurs », il se
positionne dans l'opposition contre Félix Tshisekedi, qu'il accuse
notamment d'être responsable de l'insécurité dans l'Est du
pays.
« La question de l'insécurité dans la
partie Est du pays, traduit de manière claire, l'incapacité de
Monsieur Tshisekedi à imposer la paix, la sécurité,
l'ordre et la discipline dans le pays », a-t-il indiqué.
Pour lui, en lieu et place de faire des marches de soutien aux
FARDC, il croit que le peuple congolais aurait bien décidé de
marcher contre Tshisekedi.
Tombé en disgrâce en janvier dernier à la
suite l'incident de la circulation routière ayant mis en scène
son escorte et un officier de la Garde présidentielle, incident suivi de
l'action punitive à sa résidence de Kingabwa, Jean-Marc Kabund a
tenu des propos durs à l'égard du régime de Félix
Tshisekedi dont il a été une des figures de proue durant trois
ans.
UDPS: Jean-Marc
Kabund vomi par les secrétaires nationaux de son parti
Le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc
Kabund de plus en plus isolé de son parti politique.
Les secrétaires nationaux, membres de l'exécutif
national de la présidence de l'Union pour la Démocratie et le
Progrès Social (UDPS) ont, dans une déclaration faite ce vendredi
21 décembre à Kinshasa désavoué le premier
vice-président de l'assemblée Nationale et président
intérimaire de leur parti politique, Jean-Marc Kabund.
Dans leur déclaration, les secrétaires nationaux
de l'UDPS déplorent « les actes ignobles de barbarie causés
par la garde de Kabund, en s'attaquant à la Garde Républicaine,
unité d'élite de protection du Chef de l'Etat et de son entourage
ainsi que la mise en circulation des vidéos avec intention de ternir
l'image de marque de l'Autorité suprême de la Nation ».
Aussi, ils accusent JM Kabund d'avoir incité les
combattants à lui faire allégeance pour le suivre dans sa
nouvelle vision politique en opposition au pouvoir en place et aux statuts du
Parti.
« Prenons acte de la démission unilatérale
de Monsieur Jean-Marc Kabund (sans consulter ni le chef de l'Etat ni le Parti)
à la 1ère vice-présidence de l'Assemblée Nationale,
cela constituant un manque de respect et/ou un chantage à l'endroit de
la Haute Autorité de Référence du Parti. Pour ce motif,
nous condamnons cette attitude et le désavouons. Par conséquent,
lui retirons toute confiance. Demandons à nos députés
nationaux et provinciaux ainsi qu'à toute la base de l'UDPS d'en tirer
toutes les conséquences de droit et politique », peut-on lire dans
cette déclaration.
Poussé à la porte de sortie par les
différentes structures et cadres du parti dont les députés
nationaux et provinciaux ainsi que des fédérations provinciales,
Jean-Marc Kabund a Kabund a fait marche arrière en annonçant, par
le biais de son directeur de cabinet, le retrait de sa démission au
poste qu'il occupe entant que deuxième personnalité de
l'assemblée nationale.
Selon son entourage, le président intérimaire de
l'UDPS a décidé d'écouter sa base.
« La voix du peuple triomphe toujours, la
démission n'aura plus lieu. Le président Jean-Marc Kabund a tout
compris. Une page de l'histoire est irrésistiblement tournée
», avait annoncé son directeur de cabinet à la chambre basse
du parlement congolais.
RDC: Ci-gît
l'Etat de droit de Félix Tshisekedi
C'est l'histoire d'un mythe qui s'écroule. L'histoire
d'une lutte courageuse transmise de pères en fils, mais qui sombre tel
un drame Shakespearien. Tout a commencé durant une journée qui
deviendra symbole. Le 17 janvier 1988, le jour d'anniversaire de la mort de
Lumumba, Etienne Tshisekedi n'en peut plus de chanter et danser pour le
Dictateur. Il convoque un meeting au centre de Kinshasa au pont Kasa-Vubu, lieu
des pendaisons de 1966. Il ose l'ouvrir contre le Maréchal
Président, et appelle à l'avènement de la
démocratie. Le père de Félix Tshisekedi, qui venait de
fonder l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) aux
côtés d'autres anciens cadres du parti-Etat (MPR), proclame alors
l'avènement d'un « Etat de droit ». Le mot-phrase est
lâché. Tant pis si l'armée de Mobutu intervient, faisant de
nombreux morts et blessés. Tant pis si Tshisekedi est mis aux
arrêts, alors que des psychiatres le déclarent malade mental,
frappé de paranoïa...
Aux origines d'un
mythe
Les années passeront, Mobutu et son régime
pousseront les Zaïrois à bout, mais une poignée d'hommes le
résisteront. Ils sont regroupés au sein de l'Union pour la
Nation. Lambert Mende sait de quoi je parle. Sous le manguier à Limete,
ils incarnent, aux côtés d'Etienne Tshisekedi, une alternative
viable à Mobutu. Alors que le vent de la pérestroïka souffle
sur le monde, Etienne Tshisekedi est le seul, dit-on au Zaïre,
à dompter le dollars roi, qui malmène une monnaie locale qui fait
de sa populations des millionnaires pauvres. Traquée tantôt par la
police politique de Mobutu, tantôt par la crise économique, toute
une génération de jeunes gens met cap vers l'Europe où
elle entame une véritable lutte politique, rejoignant Etienne Tshisekedi
qui croule dans des prisons de Mobutu. François Mwamba et d'autres sont
aux premières loges dans les capitales européennes et forment
l'avant-garde d'une opposition qui va incarner la future scène politique
congolaise.
Cependant, si certains gardent la tête froide en
politique, beaucoup vont s'orienter vers le « BCBG », devenant les
« mikilistes », amis de musiciens et sont chantés à
longueur de journées. Ils sont également connus comme «
Shekula ». Papa Wemba les immortalise dans le phénomène
« Chance eloko mpamba ». Dans ces mêmes années 1990, un
certain Félix Tshisekedi est filmé distribuant des coups à
l'Aéroport de Zaventem à Bruxelles, défendant son paternel
Etienne Tshisekedi d'une énième entourloupette de Mobutu, en
complicité avec les autorités belges. Son seul fait d'arme en
politique, avant de disparaitre.
Au pays, une lutte sans merci est menée entre Mobutu et
l'opposition, au prix d'énormes sacrifices. Beaucoup vont tout perdre, y
compris leurs vies. La Conférence nationale souveraine arrive. Elle
déplume et déshabille la gouvernance du Maréchal. Elle
plébiscite Etienne Tshisekedi et son programme. Son « UDPS »
crée même un gouvernement parallèle sans pouvoir. Elle
étale ses fatwa et ses promesses de mieux faire. Elle jure qu'une fois
qu'elle sera au pouvoir, les Zaïrois pourront à nouveau manger
trois fois par jour. Deux doigts en l'air, le Lider-Maximo prône
grosso-modo une politique de gauche, dans une litanie de bonnes intentions
emballées dans le sobriquet « l'Etat de droit ».
L'arrivée de Laurent - Désiré Kabila et
la chute de Mobutu ne changent rien. Le pays est ravagé par les
rebellions orchestrées par les voisins du Congo. La Guerre mondiale
africaine a lieu sur les terres congolaise. A bout de souffle et comme à
chaque fois, le peuple braque ses yeux vers Limete où un Sphinx immortel
pointe toujours ses deux doigts en l'air. Mais ce vieux loup, adulé, a
l'art de manger sa feuille de match. Ni durant Mobutu, encore moins face aux
Kabila père et fils, il ne daignera prendre les rênes du Congo.
Jusqu'à se coucher définitivement, le 1er février 2017,
non sans mener son fils aux portes d'une succession tant redoutée et
à l'aube d'une lutte politique acharnée pour l'alternance.
Etat de droit version
« mikilistes »
Félix Tshisekedi réapparait en 2006 aux
côtés de son père. Il est cependant caché
derrière les caciques de l'UDPS, les vieux de la vieille école,
qui ont fait le cent coups avec Etienne Tshisekedi. Aussi, le fils
n'était pas vraiment le choix du Père. C'est en tout cas ce
qu'affirme Albert Moleka, ancien directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi.
Ainsi, quand il est catapulté en héritier de son paternel
à la tête d'un parti mythique qui n'en était plus un en
2018, il est tout de suite contesté par Bruno Tshibala et Valentin
Mubake, les derniers compagnons de Tshisekedi qui seront rapidement
éjectés pour laisser place à la filiation naturelle.
Après trois décennies, et alors que les premières
élections pour une alternance historique arrivent, le fils tente de
rassurer, promettant de reprendre la lutte livrée jadis par son
paternel.
En août 2018, avant de réussir à
emberlificoter Vital Kamerhe dans un accord irréaliste de coalition,
Félix Tshisekedi présente alors le contenu de l'Etat de droit. Un
programme aux ambitions à la hauteur du mythe. Mobiliser 86,71 milliards
de dollars des ressources budgétaires, augmenter le revenu moyen du
congolais à 4 288 dollars américains et générer une
croissance économique forte de 25% par an en moyenne. Le fils du Sphinx
promet entre autres de « vaincre la faim ». Ce programme de
gouvernance, dont on dit inspiré du projet de société de
l'UDPS, prévoit également un paquet de réformes à
l'effet de respecter les vertus de la démocratie ; renforcer les
institutions de l'Etat et améliorer la gouvernance administrative ;
rendre le pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif et
du législatif ; extirper la corruption, la concussion, l'ethnicisme, le
tribalisme, le clientélisme ; et, toutes les dérives de
gouvernance.
« Faites attention à vos
prières, Dieu risque de vous exaucer », disait un
homme sage. Pendant qu'il s'y attendait le moins, la nuit du 09 janvier 2019,
Joseph Kabila drible Emmanuel Shadary et Martin Fayulu et laisse son fauteuil
à Félix Tshisekedi. Le peuple, partagé, exulte. Il
rêvait du changement. Peu importe lequel. Et puis, on parle là, du
Fils du sphinx tout de même. Ainsi, le 24 janvier, il envahit le Palais
de la nation pour être aux premières loges d'une prestation de
serment historique et féérique. Certes, pendant qu'il
s'étouffait dans son Gilet pare-balle, Félix Tshisekedi entend la
foule lui rappeler les promesses de son père : « le peuple d'abord
», une autre version du fameux « Etat de droit ». Dès
lors, il était clair que ce président n'avait de privilège
que de servir. Trop de promesses ont été faites. Les Congolais
avaient attendu trop longtemps.
Trois ans après, Adam Bombole lira cet édito
avec un sourire au coin des lèvres. Aux chiffres faramineux
annoncés, à des réformes prétendues, Félix
Tshisekedi est loin d'incarner ses prétentions. Au pire, c'est un
véritable naufrage au pouvoir. D'abord sur le plan humain,
le fils Tshisekedi n'hérite finalement pas de l'UDPS qu'avait son
père. Au contraire, Félix Tshisekedi s'accompagne au pouvoir
d'ancien « Mikilistes » qui l'ont fréquenté à
Bruxelles. Martin Fayulu me corrigera :« qui l'ont fréquenté
dans des bistrots de Bruxelles ». Peu importe, ces gens ne sont pas
là pour instaurer un Etat de droit. Ils connaissent l'opulence et
l'argent facile. Ils sont aux côtés de Félix Tshisekedi
parce que c'est leur tour. Ils ont du bonheur à rattraper. Une
dette de vie à payer. Accompagné de ces bras cassés,
Félix Tshisekedi se retrouve au coeur d'un capharnaüm dans son
propre palais. Dès la première année, une lutte sans merci
de pouvoir est provoquée. Vital Kamerhe y est entraîné. Le
Fondé a tort de confondre cette lutte pour un renouveau du Congo,
pour une « refondation de l'Etat », comme l'avait promis le nouveau
Président. Si 57 millions de dollars autour de l'affaire
préfabriquée ont bel et bien disparu, Thierry Taymans et la
Rawbank rembourseront 32 millions. Ne demandez pas par quel mécanisme.
Vital Kamerhe est cloué par la plume du Fondé -- qu'il me
pardonne dès lors. Enfermé à Makala. Limete exulte et se
met à rêver d'aller prendre son déjeuner au Fleuve Congo
Hotel. L'Etat de droit est là.
La longue agonie du
mythe
Tout à coup, les premiers couacs son là. Au
Palais, Félix Tshisekedi prend un fusil à pompe, le pointe sur sa
propre jambe et tire : il gracie Modeste Makabuza et autres, pourtant
condamnés pour corruption. Il jette néanmoins la faute à
Joseph Kabila et sa coalition. Nous sommes à la deuxième
année du mandat. Cette année-là est proclamée
« l'année de l'action ». Mais au final, même l'action
est étonnée. Il y a de l'action bien sûr, mais dans le sens
opposé. Les scandale s'enchainent. Bien souvent autour des grosses
sommes d'argent. Les proches du président sont pris la main dans le sac.
Mais n'iront pas en prison. Un peu comme le Chef de la nouvelle cellule
anti-corruption, vidéo à l'appui. L'Etat de droit est malade. En
phase terminale. Si certains vont être pris, à l'image d'Eteni
Longondo, leur détention est une mise en scène macabre. Jules
Alingete fait son show, mais il est à son tour déballé par
Tony Mwaba. Les Congolais contemplent impuissamment le spectacle
révoltant. La situation est tellement grave que le président
lui-même l'aggrave.
A Goma, face à la caméra de la RTNC,
Félix Tshisekedi ose prétendre que Vital Kamerhe, condamné
pour corruption, serait « un monsieur sérieux ». En
vérité, ce président n'est que trop sincère. Depuis
le début de sa lutte pour la consolidation du pouvoir, la politique
prend le dessus sur la raison. Toute une majorité achetée
à coup de billets verts, dans une opération de corruption qui
ferait passer Bernard Madoff pour un gendarme de Wall Street. Tshisekedi semble
étourdi. Il tente de faire appel à une équipe de choc,
celle des « Warriors ». Mais cette dernière a compris la
réalité. Au lieu de tenter de changer les choses, chacun joue
pour soi. Le Congo s'occupera de lui-même. Les louanges envers le
président deviennent alors le principal ouvrage de chaque ministre qui
quitte sa maison pour aller travailler. Ngobila et Mboso sont les meilleurs
dans cette catégorie. Quand ils sont pris la main dans le sac, ils
chantent. Ou encore, ils importent des « evunda » depuis la
Côte d'Ivoire. Tous les moyens sont bons.
Alors oui ! L'Etat de droit n'est pas que la lutte
anti-corruption. Il y a également les droits de l'homme. A son
arrivée, Félix Tshisekedi a néanmoins entrepris de
décrisper l'espace politique et de libérer la parole. Les «
Talibans », ses fanatiques en quête de raison, seront bien d'accord
avec cette partie. Néanmoins, Human Right Watch ne sera pas d'accord
avec moi. Dans sa livraison du mois de mars 2022, l'Organisation note que
« L'état de siège dans l'est du pays est accompagné
de répression ». L'opposante congolaise Ida Sawyer n'a que ses
tweets pour pleurer. Elle qui a participé copieusement à la lutte
anti-Kabila. Dans la capitale, on croirait que Joseph Kabila est toujours au
pouvoir. Les mêmes outrages au Chef de l'Etat conduisent à la
même prison de Makala. Des députés sont
arrêtés sans respect d'aucune procédure pour avoir
contredit le président ou sa famille politique. Je ne citerai aucun cas,
ni celui de Jean-Jacques Mamba.
Ci-gisent les rêves de Tshisekedi
Mais l'Etat de droit n'est pas éternel. Malade,
à l'agonie, elle finit par rendre l'âme. Deux faits
l'achèvent : d'abord le discours du président de la
République sur l'Etat de la nation. Face à la Nation,
Félix Tshisekedi reconnaît la réalité. Aucun
«Etat de droit » ne peut être possible sans une justice juste.
« En dépit de certains progrès que je salue, je ne saurais
rester indifférent, en ma qualité de Magistrat suprême, aux
cris de détresse et de désolation des Congolaises et Congolais
qui, chaque jour qui passe, réclament plus de garanties d'une bonne et
saine administration de la justice », a-t-il indiqué. Pour le Chef
de l'Etat, « notre justice devait pourtant rassurer tout le monde, nantis
ou non, puissant comme faible, en ayant pour égard que la protection des
droits. Bref, une justice qui, non seulement dit le droit, mais rassure que le
droit, alors le bon, a été dit ».
Cependant, comme depuis le début de son mandat, le dire
est toujours plus facile que le faire. Willy Bakonga, ancien ministre de
l'Enseignement primaire, est le deuxième cas qui achève l'Etat de
droit de Tshisekedi. L'ancien ministre a été condamné
à trois ans de servitude pénale principale le 29 avril 2021,
après avoir tenté de fuir le pays via Brazzaville. Il
était par ailleurs visé dans un autre dossier pour corruption et
détournement, pour lequel il était en fuite. Néanmoins,
à la surprise générale, en novembre 2021, il
bénéficie d'une... Grâce présidentielle ! Coup
de Théâtre, face à la pression du public, la ministre de la
Justice Rose Mutombo fait savoir que Bakonga devrait retourner en prison.
Mais voilà. Le 15 mars 2022, soit trois mois après la
sortie de Félix Tshisekedi à « mettre des hommes qu'il faut
à la place qu'il faut » au sein de l'appareil judiciaire congolais,
Willy Bakonga est au Palais du peuple, participant, comme député
national, à la rentrée parlementaire. Depuis
l'arrivée des Belges au Congo, un cas pareil n'est jamais
arrivé.
Bienvenue aux funérailles de l'Etat de droit
prôné par Félix Tshisekedi. Des funérailles qui
scellent par ailleurs la fin de l'Union pour la Démocratie et le
Progrès. Ci-gît un mythe qui n'avait que trop de
prétentions. Ci-gisent les rêvent des 13 Parlementaires. Depuis
l'au-delà, Etienne Tshisekedi et Frédéric Kibassa
voient leurs progénitures orchestrer le RAM, une taxe qui déplume
sans vergogne une population déjà à l'agonie. Quant
à Marcel Lihau, l'autre fondateur de l'UDPS, son fils a le
biftèque coincé dans la gorge. Il ne peut parler la bouche
pleine. Quand il le peut, il fait une tournée de selfies dans les
décombres de Bumba, le temps de contrer Martin Fayulu sur Twitter. La
population de la Mongala vit pourtant dans une misère indescriptible. La
priorité à Kinshasa est celle d'acheter des nouveaux 4×4 aux
Sénateurs, après ceux de députés. Mes
condoléances au Congo pour le décès inopiné du
rêve d'Etienne Tshisekedi et ses 13 fameux parlementaires, porteurs
pourtant d'un rêve qui était loin d'être impossible.
RDC : Le Katanga et
le monde, équation à plusieurs inconnus (Kikaya Bin
Karubi)
On semble l'oublier. Le monde a perdu le deuxième
Sécrétaire Général de l'ONU, le suédois Dag
Hammarskjöld, l'homme de la diplomatie preventive, en essayant de
résoudre l'équation katangaise, dans ce qui est
présenté comme un accident d'avion à Ndola en Zambie,
alors qu'il se rendait à des négociations de paix avec Moïse
Tchombe. Un petit pont lui est dédié sur la rivière
Makelele, avenue Mondjiba à Kinshasa.
Nous connaissons tous les ravages causés par la
secession katangaise, celle du Kasai et la rebellion muleliste des
années soixante avec en toile de fond, la guerre froide entre
américains et soviétiques. Le coup d'Etat de 1965 remet de
l'ordre en termes d'unification du pays mais 12 ans plus tard, soit en 1977-78,
les deux guerres du Shaba (redevenu Katanga) manquent de faire renaître
les sentiments autonomistes de cette province, prélude à une
balkanisation certaine du pays et pourquoi pas, par effet de contamination, de
l'Afrique toute entière.
J'étais alors étudiant à
l'Université de Lubumbashi où il se racontait dans les milieux
estudiantins que le Comte Alexandre de Marenches, patron des services secrets
français et architecte du «saut de la legion d'élite de
l'armée française» sur Kolwezi, aurait déclaré
que celui qui contrôlerait le Katanga, dominerait le monde. Il fallait
à tout prix barrer la route aux forces du FNLC (Front National de
Libération du Congo) de Mbumb Nathanael réputés
pro-soviétiques qui tentaient de s'accaparer des richesses du Katanga.
D'où le déploiement des forces marocaines et françaises au
secours du régime de Kinshasa. Petit episode dans la course à
l'hegémonie mondiale entre les blocs Est et Ouest.
Guerre froide nouvelle formule
Et voici que la nouvelle géopolitique remet le Katanga
au centre des convoitises des maîtres du monde. Ce que nous vivons
aujourd'hui n'est ni plus ni moins, qu'une autre guerre froide avec un nouvel
acteur: la Chine. Mais cette guerre froide n'aurait pas eu lieu si Washington
n'avait pas commis une grosse bavure pour laquelle les occidentaux veulent
trouver en Joseph Kabila Kabange, une victime expiatoire.
CAMPAGNE DE DIVERSION
Le rapport abusivement
intitulé «Congo Hold-up» n'est pas du goût de tous les
Occidentaux qui le trouvent non seulement méchant, mais aussi immoral.
Le 4 décembre 2021 était la date prévue pour le dernier
épisode de la campagne médiatique initiée par European
Investigative Collaborations (EIC) pour empêcher en réalité
Joseph Kabila et les siens de revenir sur la scène politique. Pendant
qu'une opinion friande du sensationnel se délecte des
révélations publiées par des médias
européens et américains relayés mécaniquement par
les médias africains sous la couverture des ONGs occidentales soutenues,
elles-mêmes, par des multinationales du même bord, l'opinion
avisée s'interroge, elle, sur les motivations réelles de la
campagne de diabolisation visant, curieusement, Kabila et la Chine.
Plutôt de sensibilisation, c'est une campagne de diversion...
DES FAITS DE LA VÉRITÉ
Le moment est certainement venu de rétablir les faits
de la vérité sur le contrat sino-congolais.
Premier fait : en prévision des élections de
2006 précédées du référendum de 2005 -
processus financé à 90 % par l'Union européenne - le
peuple congolais, privé de coopération structurelle depuis le
début des années 1990, reçoit des Occidentaux la promesse
ferme du retour de leurs investissements, ce en contrepartie de sa
participation massive au scrutin.
Deuxième fait : malgré justement cette
participation massive, les investissements promis tardent cependant à
venir, et l'Union européenne ne délie ni langue, ni bourse.
Troisième fait : trahi par la non-tenue de ces
promesses, Joseph Kabila Kabange adhère à la formule
«Infrastructures en échange de l'exploitation minière»
proposée par certains pays de la région.
Quatrième fait : la formule est toutefois
proposée d'abord aux Occidentaux qui, eux, la trouvent trop
risquée pour leurs intérêts. Déformation capitaliste
oblige.
Cinquième fait : la Chine accepte de prendre les
risques et se lance dans l'aventure.
Voilà l'origine du contrat sino-congolais...
Perriollo et Kapanga : cris dans le desert d'Arizona
Plus haut, allusion est faite au refus de certains Occidentaux
de voir Joseph Kabila traîné dans la boue, et les ressources
naturelles congolaises traitées comme propriété de tout le
monde, sauf des Congolais.
Dans un document intitulé «Comment les
États-Unis ont perdu du terrain au profit de la Chine dans le concours
pour l'énergie propre«, les auteurs engagent la
responsabilité directe de Washington dans l'emprise chinoise sur les
minérais stratégiques du Katanga, en citant le cas précis
de Freeport-McMoran, entreprise minière américaine connue sous la
dénomination «Tenke Fungurume Mining«, TFM.
Deux rappels sont utiles.
Premier : dans cette
joint-venture, la Gecamines avait juste 17 % des parts dans l'actionnariat
contre 32 % dans Sicomines, soit 15 % de plus. On n'a jamais entendu les
donneurs de leçons actuels dénoncer cette répartition.
Second rappel, les Américains ont vendu TFM aux
Chinois.
Rien que l'introduction édifie l'opinion
avisée.
En voici l'énoncé : «Comment les
États-Unis ont perdu du terrain au profit de la Chine dans le concours
pour l'énergie propre. Les Américains n'ont pas réussi
à sauvegarder des décennies d'investissements diplomatiques et
financiers au Congo, où la plus grande offre mondiale de cobalt est
contrôlée par des entreprises chinoises soutenues par
Pékin.
Tom Perriello l'a vu venir mais n'a rien pu faire pour
l'arrêter. André Kapanga aussi. Malgré des e-mails urgents,
des appels téléphoniques et des appels personnels, ils ont vu,
impuissants, une entreprise soutenue par le gouvernement chinois prendre
possession des Américains de l'une des plus grandes mines de cobalt au
monde.
C'était en 2016, et un accord avait été
conclu par le géant minier basé en Arizona, Freeport-McMoRan,
pour vendre le site, situé en République Démocratique du
Congo, qui figure désormais en bonne place dans l'emprise de la Chine
sur l'approvisionnement mondial en cobalt. Ce métal fait partie de
plusieurs matières premières essentielles nécessaires
à la production de batteries de voitures électriques - et est
désormais essentiel pour retirer le moteur à combustion et sevrer
le monde des combustibles fossiles qui modifient le climat.
Perriello, un diplomate américain de premier plan en
Afrique à l'époque, a tiré la sonnette d'alarme au
département d'État. M. Kapanga, alors Directeur
Général Congolais de la mine, a presque supplié
l'ambassadeur américain au Congo d'intercéder.
« C'est une erreur », se souvient M. Kapanga,
l'ayant mis en garde, suggérant que les Américains gaspillaient
des générations de relations avec le Congo, la source de plus des
deux tiers du cobalt mondial. »
Sale temps pour les occidentaux
Ce document, nous le publions en entier pour comprendre toutes
les pressions exercées sur le Président Joseph Kabila Kabange en
2016, alors année électorale. Parmi ces pressions, les sanctions
occidentales contre plusieurs personnalités congolaises proches du Chef
de l'Etat visées pour des imputations qui n'ont jamais été
matériellement ni judiciairement prouvées.
On réalise au moins que les Américains se sont
eux-mêmes mis dans de sales draps pour avoir probablement appuyé
des Européens - dont les Belges qui passent pour les meilleurs
connaisseurs du Congo - dans la phobie développée à
l'égard des Chefs d'État congolais au cours de ces 30
dernières années.
Aujourd'hui, force est de constater que les Chinois -
présents dans ce pays depuis 1973 à l'initiative du
maréchal Mobutu - ont attendu 2008 (soit 35 ans) pour
s'intéresser aux mines congolaises en 2008. Et, la première
cathode, ils ne l'ont tenue entre les mains qu'en 2015. Soit 42 ans
après.
Manono et les Kabila
Croyant détenir le monopole du bon sens,
c'est-à-dire de la rationalité, les Occidentaux viennent de se
tirer une grosse balle dans le pied avec leur fameux rapport » Congo Hold
Up«.
En effet, l'enjeu que représente le lithium dans la
fabrication des voitures électriques ramène le Katanga au-devant
de la scène.
Comme par malheur, le lithium de la RDC est certes au Katanga
(toujours le Katanga comme pour le cuivre, le cobalt et l'uranium), mais plus
précisément à Manono, dans le Tanganyika. Manono, c'est
à la fois le territoire et le village des Kabila !
Cela peut bien embarrasser plus d'un, mais le Congo - depuis
l'époque coloniale - a cette particularité d'impliquer le
leadership local dans la réalisation de tout projet intéressant
la communauté.
De ce fait, ignorer les Kabila dans la exploitation du lithium
du Tanganyika, c'est comme ignorer les Tshombe dans l'exploitation du cuivre ou
du cobalt au Lualaba ou encore les Tshisekedi dans l'exploitation du diamant au
Kasaï.
Quid du Congo courtisé ?
Dans cette guerre froide d'un genre nouveau, les Occidentaux,
eux-mêmes, ont un problème de communion. Washington, Paris et
Bruxelles peuvent avoir en commun la phobie kabilienne, mais chacun entend
préserver ses intérêts.
Washington continue de présenter la RDC comme son
intérêt stratégique en Afrique. Curieusement, c'est de
là que vient le plan de démembrement du Congo porté par un
certain Peter Pham.
Paris continue de croire dans son droit de préemption
obtenu à Berlin. Dans les médias, elle aligne ses » soldats
«. Suivez mon regard.
Bruxelles continue de rêver de sa communauté
belgo-congolaise sur le modèle de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest,
à défaut de refaire le double coup de sécession du Katanga
et du Sud-Kasaï.
Mais que fait le Congo courtisé ? Il semble avoir un
problème sérieux de choix de partenaire. Le contrat
sino-congolais en est l'exemple. Lorsqu'on voit des pays occidentaux tenter de
faire médecin après la mort pendant que des années durant
ils ont quasiment laissé la RDC crever, c'est l'indice qu'il y a du bon
dans ce contrat qui redonne vie et espoir aux Congolais. Et que quelques
ajustements dictés par l'expérience sont utiles pour redresser
effectivement le Congo.
Quand on a cette perception réaliste et pragmatique des
enjeux, on comprend la mission confiée aux barbouzes d'European
Investigative Collaborations (EIC) qui a mené « gratuitement »
ses enquêtes relayées « gratuitement » dans des
médias auxquels les journalistes d'investigation ont offert «
gratuitement » leur expertise...
RDC : L'Intersyndicale
de l'EPST accuse Nicolas Kazadi de bloquer la paie de nouvelles unités
et menace d'aller en grève
L'Intersyndicale des syndicats des enseignants de
l'Enseignement primaire, secondaire et technique exige du gouvernement Sama
Lukonde le décaissement « immédiat » et
« sans condition » de la paie complémentaire du mois
d'avril des enseignants nouvelles unités dans un délai de 48
heures faute de quoi, il menace d'aller en grève. Il a fait cette
déclaration le mardi 17 mai 2022 à Mbanza-Ngungu dans la province
du Kongo Central.
Cette structure qui milite en faveur des enseignants congolais
exige également du gouvernement de la République le
décaissement des frais de fonctionnement des établissements
scolaires dans un délai de deux jours.
Dans sa déclaration, l'intersyndicale des syndicats des
enseignants de l'EPST dit avoir constaté avec
« indignation », le non paiement jusqu'à ce jour de
70 053 enseignants nouvelles unités contrairement aux résolutions
des accords de Mbwela Lodge signés à Kisantu le 18 novembre 2021
entre le banc syndical et le gouvernement de la République.
A l'en croire, le gouvernement avait pris l'engagement de
payer toutes les nouvelles unités lors du premier trimestre de
l'année 2022. Il dit avoir constaté que ladite paie n'est pas
toujours exécutée. Il révèle en outre que le
dossier traîne au niveau du ministère des Finances.
L'Intersyndicale des syndicats des enseignants de
l'Enseignement primaire, secondaire et technique demande au premier ministre,
Jean-Michel Sama Lukonde, d'instruire le ministre des Finances, Nicolas Kazadi,
de libérer sur le champ, la paie complémentaire des enseignants
nouvelles unités pour le mois d'avril 2022.
L'intersyndicale de l'EPST rejette, par ailleurs, toute
responsabilité d'arrêt de cours qui adviendrait au gouvernement
Sama Lukonde, dépassant ce ultimatum (48h).
RDC: Vidiye Tshimanga
placé sous mandat d'arrêt provisoire
L'étau se resserre autour de Vidiye Tshimanga,
l'ex-conseiller du Chef de l'Etat.
Auditionné au parquet général près
la Cour d'Appel de Kinshasa-Gombe depuis 11 heures de ce mercredi 21 septembre
pour des faits constitutifs de prévention de corruption
présumée, Vidiye Tshimanga, ancien conseiller stratégique
du président de la République Félix Tshisekedi vient
d'être mapé, apprend POLITICO.CD de sources judiciaires.
Éclaboussé dans une affaire de corruption et
trafic d'influence dans l'acquisition des licences minières pour les
investisseurs en échange d'une participation dans une coentreprise, le
désormais ex-conseiller de Tshisekedi avait rendu rendu le tablier afin
d'avoir toute la liberté de dénoncer et lever le voile sur les
commanditaires de ce qu'il qualifie de « machination » et ainsi
démontrer, preuves à l'appui, les manipulations et
détournements de ses propos. Il avait évoqué aussi une
voie d'éthique face au scandale le concernant.
Dans l'une des vidéos publiée par Le TEMPS,
Vidiye Tshimanga propose aux investisseurs de s'associer avec sa
société congolaise, la COBAMIN.
« Avec Ivanhoe, ils ont 80%, j'en ai 20. Mes 20%
sont divisés en deux, donc vous avez 10%, c'est COBAMIN, ma
société. Les autres 10%, parce que dans la loi minière,
vous avez l'obligation d'avoir une personne congolaise dans la
société... Cette personne congolaise est quelqu'un que nous avons
choisi », a-t-il révélé.
Dans sa version, Vidiye Tshimanga a expliqué que le
contenu entier de l'enregistrement rendu public aurait été
saucissonné et sorti de son contexte.
« Ceci, aussi, afin de faire la lumière sur les
commanditaires de ce montage grossier, dont nous détenons un
enregistrement qui contredit le sens qu'ils ont voulu donner à mes
propos sortis de leurs contexte », a-t-il écrit dans sa lettre de
démission adressée au président Tshisekedi.
RDC: Tshisekedi face
à la menace Katumbi
Félix Tshisekedi fait
désormais face aux ambitions présidentielles de Moïse
Katumbi, qui veut lui prendre sa place dans des élections normalement
prévues en 2023. Comment le Chef de l'Etat congolais compte-t-il s'en
sortir ? Quelles sont ses options ?
L'histoire est un étang à
répétition. Brutus a débarqué du dos de Jules
César, Mobutu est sorti des cuisses de Lumumba. Tout comme Macky Sall,
au Sénégal, a escaladé l'arrière d'Abdoulaye Wade.
En République démocratique du Congo, cette dame indomptable a,
dans sa répétition, présenté Moïse Katumbi
dans le rôle de Judas. D'abord avec l'ancien président Joseph
Kabila, qui ira jusqu'à le qualifier ainsi. Ensuite, aujourd'hui avec
l'actuel président Félix Tshisekedi, dans une moindre mesure
certes.
En effet, alors que Joseph Kabila a longtemps paru n'avoir de
Brutus que Vital Kamerhe, ancien bras droit et ancien président de
l'Assemblée nationale, l'homme qui se targuera de l'avoir «
fabriqué » et qui a fini par rejoindre son opposition, d'un village
enfui au coeur de la région du Katanga, le Judas de Kabila a surgi. Il
s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. En 2015, cet homme d'affaires, jadis
lieutenant fidèle de l'ancien président, enfant chéri,
gouverneur de la plus riche des provinces congolaises, se décide alors
de « poignarder » Joseph Kabila dans le dos. Lui par
contre, ne se réclame que d'une ambition légitime. Une lutte
à mort va néanmoins suivre. Une boucherie. Joseph Kabila et son
ancien protégé seront animés par une rancoeur personnelle
et dans cette lutte, le Congo entier découvrira alors l'usage du
lobbying aux Etats-Unis.
Tenez : «L'argent ne fait pas de bonheur»,
disait un homme qui en manquait. Katumbi lui, veut avoir un résultat
contraire. Si le monde entier connaît Silvio Berlusconi, autrefois
surnommé «Il Cavaliere», homme politique controversé et
homme d'affaires italien sulfureux, sans avoir les deux derniers qualificatifs
péjoratifs, le richissime homme d'affaires congolais Moïse Katumbi
arpente un chemin qui coïncide étrangement à celui de
l'italien: la fin justifie les moyens. De ses origines italiennes - son
père, Nissim Soriano, un juif originaire de l'île grecque de
Rhodes, s'y est réfugié dans l'entre-deux-guerres pour fuir
l'Italie fasciste de Benito Mussolini - Katumbi tire les traits du parcours de
Berlusconi ailleurs.
D'abord une passion pour le football, où il a
bâti son «Milan AC» d'Afrique, le TP Mazembe, pour en faire
l'un des clubs phares du continent noir. Ensuite, la richesse. Oui, l'homme est
riche. Très riche même. De ses affaires prospères en Zambie
et en Afrique du Sud dans les années 1997, à son exil,
accusé par Laurent-Désiré Kabila de soutenir, avec son
frère Raphaël Katebe, les rebelles du Rassemblement congolais pour
la démocratie (RCD), Katumbi a su adroitement revenir au pays,
aidé par un certain Augustin Katumba Mwanke, pour devenir un
précieux allié du président Joseph Kabila.
Débute alors une longue amitié. Pendant plus de
dix ans, Katumbi dirige la plus riche province de la République
démocratique du Congo. Le cuivre, principale richesse du pays et du
Katanga, est au plus haut niveau de l'histoire. Notre gouverneur se construit
alors un empire. Il gère la province, tout en ayant des activités
commerciales dans les mines. Aucune loi n'interdit alors cette combinaison
dangereuse au pays. Les affaires étaient si bonnes que le Gouverneur a
vendu en 2007 Anvil Mining, de la mine de Kinsevere qui aurait appartenu
à la Gécamines, acquise pour un million de dollars, à plus
de soixante. Aucune accusation n'aboutira à quoi que ce soit.
Par ailleurs, contrairement à un pouvoir de Kabila
pingre, Moïse Katumbi se construit tout aussi une popularité. Il
redistribue «un peu» ses bénéfices. Ils aident les
riverains. Se fait accompagner par des foules. Aidé par le TP Mazembe,
il trône, si haut, sur Lubumbashi. Et puis, la province devient de plus
en plus petite. L'homme veut plus. Ça tombe bien, Kabila est à la
recherche d'un dauphin. «AKM [Augustin Katumba Mwanke] a beaucoup
pesé dans la relation entre Kabila et Moïse [Katumbi]. A sa mort,
le Président s'est rapproché de Katumbi, qui l'a beaucoup
aidé à contrôler les finances et les deals dans le
Katanga», confie un proche de Moïse Katumbi, qui a requis
l'anonymat. Nous sommes alors en 2013, raconte notre source, un proche de
l'ancien gouverneur. Le président Kabila sort des chaotiques
élections en 2011, et ne peut plus se permettre de briguer un
troisième mandat. «Je me souviens bien de la situation. A
l'époque, le Président et Moïse étaient comme des
frères. C'est de lui-même qu'est venue l'idée.
Moïse n'en voulait pas. Il ne voulait plus faire de la politique. Il
voulait se concentrer sur les affaires et mieux organiser Mazembe»,
raconte ce député congolais.
Ces détails longs et ennuyeux datent d'une
époque lointaine, au risque de vous perdre dans cette évocation
qui concerne plutôt le futur. Toujours est-il qu'à la fin, Joseph
Kabila décidera ne de pas désigner Moïse Katumbi comme
successeur. Le 23 décembre 2014, en plein Lubumbashi, devant une
marée humaine, Moïse Katumbi change de ton contre son allié
de tous les jours: Joseph Kabila. L'histoire de trois penalties passe par
là. Le monde retiendra que c'est ainsi que l'une des plus longues
complicités politiques a pris fin en République
démocratique du Congo.
Un allié
matois
Félix Tshisekedi ne pourrait pas certes
considérer Moïse Katumbi comme un « judas »,
à contrario de Joseph Kabila. Cependant, l'histoire semble se
répéter. Ecarté de la présidentielle de 2018 et
poussé en exil, l'ancien gouverneur du Katanga doit compter sur la bonne
foi de son ami de longue date, Félix Tshisekedi, pour revenir au pays,
étant même réhabilité dans ses affaires
minières. Derrière, c'est surtout l'activisme américain
qui fait croire aux deux qu'ils auraient des ambitions communes pour se
défaire de Joseph Kabila. Mike Hammer, l'ancien ambassadeur
américain en RDC et son ami l'emberlificoteur Peter Pham, sont les
deux qui monteront un tel plan saugrenu. Grosso-modo, convaincre Félix
Tshisekedi que Moïse Katumbi ne serait pas une menace pour son
pouvoir ; les pousser à s'allier.
Néanmoins, nul au Congo n'est convaincu d'une telle
union. D'autant plus qu'elle fait intervenir d'autres variables toutes autant
compliquées. D'abord l'alliance « Cap pour le
Changement », ayant amené Tshisekedi au pouvoir, grâce
au « sacrifice » d'un certain Vital Kamerhe. Puis, il faut
y ajouter d'autres, comme des anciens Kabilistes, Modeste Bahati en tête,
puis, pour finir, y dégager la matoiserie de Moïse Katumbi, qui ne
cherche alors qu'une opportunité de retrouver son passeport congolais,
comme billet d'entrée pour une élection présidentielle et
devenir ainsi Chef d'Etat en 2023, à la place d'un Félix
Tshisekedi qui rêve lui-même de demeurer président jusque
2028. Ce cocktail qui sent du souffre est nommé « Union
Sacrée pour la Nation ».
Mais rapidement, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi
vont se retrouver nez à nez. D'abord l'ancien président qui tente
alors de s'accaparer les pleins pouvoirs pour se préparer à sa
propre succession, ensuite, Moïse Katumbi qui rechine à prendre
part au gouvernement dit des « Warriors »,
préférant ainsi y surveiller Tshisekedi par l'entremise de ses
lieutenants, mais veiller surtout sur le processus électoral, notamment
la désignation des membres de la Commission électorale, tout en
tissant sa grande toile composée notamment d'un lobbying insolent
à l'international et des alliés en interne aussi étranges
que l'Eglise catholique en personne, par l'entremise de son
archevêché de Kinshasa, et la Conférence des prêtres,
connue comme la CENCO. Tous alors, forment ainsi l'arsenal fatal qui devrait
tomber sur Tshisekedi, alors que les élections s'approchent.
S'il a su deviner les intentions de son
« allié » au sein de l'Union Sacrée,
Félix Tshisekedi n'a cependant pas pu s'y préparer au même
titre que ce dernier pour y faire face. Le président,
épuisé par l'exercice du pouvoir, s'y retrouve même
piégé en perdant ses alliés, dont certains lui retourne
leurs vestes, tandis que d'autres tombent en disgrâce et se
retrouve ainsi à Makala à tomber malade et à attendre leur
probable évacuation. Parmi eux certes, il y a notamment Vital
Kamerhe, qui formait avec lui le fameux duo FATSHIVIT qui l'a amené au
pouvoir. Et le temps que Tshisekedi se rende compte de ses propres erreurs, le
voilà déjà faisant face à la menace.
Soudain, les premières proses d'une mélodie
brutale sont entonnées par nul autre que le prompteur de Kashobwe.
Olivier Kamitatu étale son verbe dans une diatribe sanglante contre
Tshisekedi. Pour autant, il est porte-parole d'un homme qui serait toujours en
alliance avec Tshisekedi. Simple partie visible de l'Iceberg. En coulisse,
l'activisme international s'y met. La machine Katumbi démarre. On voit
des hautes personnalités mondiales comme le Secrétaire
général de l'ONU, António Guterres, monter au
créneau pour exiger le calendrier des élections dont il n'est
même pas candidat. Néanmoins, une marionnette du
célèbre spectacle du « Super Trio », les
Congolais le voit ainsi gesticuler, promenant d'où venait
réellement sa motivation.
La
« FATSHIVIT » comme véritable
antidote
La panique gagne alors le camp de Tshisekedi. Patrick Muyaya,
ministre de la Communication, doit déserter son front anti-Rwandais pour
venir se frotter aux Katumbistes, sur les réseaux sociaux. Augustin
Kabuya, surnommé « Augy La Gaffe » tient sa petite
messe à Limete, mais il est autant esseulé qu'aphone. En
réalité, comme Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a
été suavement mené en bateau par son ancien allié,
qui se retrouve aujourd'hui « messie sauveur » des
Congolais, face à un régime dont il a pourtant fait partie.
Certes les comparaisons s'arrêtent. Face à Joseph
Kabila qui ne pouvait pas se présenter pour un autre mandat, Moïse
Katumbi avait le soutien d'une ribambelle d'opposants politiques. Aujourd'hui,
Félix Tshisekedi ne souffre pas du même déficit. C'est
alors qu'il peut mieux cerner cette menace et y apporter réponses. Car,
dans le fond, la vraie menace face à Tshisekedi ne saurait
être un homme seul. Au contraire. L'exercice du pouvoir est la
véritable épée de Damoclès qui pend sur la
tête du président congolais. Alors que les Congolais croulent sous
des promesses irréalisées ou peu visibles, le premier danger pour
le fils d'Etienne Tshisekedi n'est autre que le bilan du « peuple
d'abord » qui manque tant à l'appel. Ainsi, redresser la
tête, se remettre en question en mettant des vrais changements en place,
pourront alors être des vrais solutions face à la menace
Katumbi.
Pour se faire, la première étape consistera sans
doute à démanteler cette union de façade sur laquelle
repose un gouvernement des Warriors qui n'aura jamais été en
guerre que contre un deuxième mandat de Tshisekedi. Un nouveau souffle
s'imposer. Compter ses alliés, renforcer ses équipes et les
mettre réellement à l'oeuvre au service des Congolais serait
déjà un bon début.
Au Palais de la Nation, il se murmure que
« FATSHI » y a déjà pensé. D'où
l'idée d'avoir été jusqu'à la Prison centrale de
Makala pour y chercher son « Ibenge ». L'autre partie de
soi-même. Vital Kamerhe pourrait aider à la reconstitution de
FATSHIVIT, le fameux duo qui avait tant convaincu les Congolais que Joseph
Kabila, qui reste tout autant un acteur majeur du jeu politique actuel. Vital
Kamerhe devrait être l'allié idéal pour conduire un vrai
gouvernement de combat. Celui qui ira chercher le vrai bilan tant attendu. Il
devrait cependant renoncer à toute ambition qui fait tant peur à
Tshisekedi, qu'à sa famille politique. Aussi, il faudra alors s'assumer.
Puisqu'une fois que l'union serait démantelée, l'armada Katumbi
pourra alors leur tomber dessus.
Mais, rappelez-vous, un seul homme ne peut être à
lui seul un problème pour un pouvoir sortant qui peut encore faire
rêver les congolais et se maintenir. Toutefois, au risque de
paraître prétentieux, nous oublions ici, à travers ces
quelques lignes, l'idée d'une vraie de l'existence d'autres facteurs qui
pourraient tous aussi faire naître d'autres challengers incarnant la
vraie surprise de ce processus électoral désormais
redouté. Il y a également la possibilité que la tenue de
ces élections et leur transparence soient le vrai enjeu qui attend le
Congo. Il y a aussi Paul Kagame, dont les liens avec certains au pays ne sont
plus à démontrer et qui risquent de perturber amplement l'avenir
de Félix Tshisekedi. Néanmoins, le Fondé ne s'adressait
qu'au futur d'un pouvoir, et à sa capacité à se maintenir,
qui passe désormais par le courage de s'assumer et sa clairvoyance
à se réconcilier avec ses véritables dépositaires.
Sinon, Dieu seul sait que la prochaine prestation de serment se fera en italien
dans ce pays. Monoko na nga Nganga.
Ituri : Félix
Tshisekedi vente les réalisations de l'IGF
Dans le cadre sa pratique du dialogue direct avec des citoyens
représentatifs de la société, le Président de la
République a échangé ce samedi 19 juin avec les forces
vives de la province de l'Ituri sur notamment les questions liées
à l'état de siège, l'enrôlement des jeunes, la
situation économique, la pandémie de Covid19.
Parlant de la situation économique, le Président
Tshisekedi a dans son intervention, félicité l'Inspection
Générale des Finances pour ses réalisations depuis son
accession au pouvoir.
« Depuis je suis là, je vous avais parlé de
déboulonnage, je vous avais parlé de lutter contre la corruption
et aujourd'hui on le voit, c'est vrai que ce n'est pas encore parfait mais il y
a déjà des avancées considérables. Aujourd'hui de
plus en plus on sent qu'il ya la peur du gendarme donc de l'État,
aujourd'hui un responsable de l'État avant de mettre l'argent de
l'État dans sa poche, il réfléchit et dit si l'IGF passe
par ici na Bebi [Ndlr] C'est à ça que sert l'État . Nous
allons restaurer tout ça », a déclaré Félix
Tshisekedi.
Par ailleurs, le Chef de l'État a dénoncé
une sorte de mafia développée au sein de l'armée et des
institutions de la République. Insatisfait, le Chef de l'État
souligne que la justice reste un de ventre mou pour son administration.
« On a parler de justice ici, vous avez raison, c'est
l'une de mes priorités et ma raison d'être insatisfait pour le
même est que la justice est un de ventre mou pour notre administration
» a-t-il souligné déplorant une sorte magouille se traduit
notamment par le refus de levée des immunités des quelques
sénateurs visés par la justice pour détournement des
deniers publics.
Félix
Tshisekedi, la Cour constitutionnelle et le glissement : les dessous d'un coup
de force
Cravate bleu ciel, costume sombre, en bleu de nuit, c'est un
Félix Tshisekedi en « Commandant en Chef » qui débarque
au Palais du peuple ce 13 décembre 2019. Le Chef de l'État
est déterminé. Il veut impulser une nouvelle dynamique, alors que
l'euphorie de l'alternance vient de passer. Sous les acclamations d'un
public incité, le voilà annonçant la grande nouvelle :
« 2020 sera l'année de l'action
! ». La salle est étourdie. Félix Tshisekedi
veut changer le Congo, il veut créer « l'Allemagne de l'Afrique
», en partant en guerre contre la corruption, mobilisant également
les recettes. Le président est si confiant qu'il annonce, devant
une salle conquise, que le nouveau budget annuel allait connaître une
augmentation spectaculaire. Car, quelques mois avant, Félix Tshisekedi a
obligé le gouvernement congolais à revoir sa proposition
budgétaire de 7 à 10.9 milliards de dollars américains. Le
« Béton, » est gonflé à bloc,
l'année qui commence serait alors celle du renouveau.
Au pied du
mur
Mais, le Congo-Kinshasa a
connu bien de promesses. Et le début de l'année 2020 ne donne pas
raison au Chef de l'État. Tenez. Dans l'ouest de Kinshasa, le chantier
des Sauts-de-mouton, que Félix Tshisekedi attendait depuis 2019, refuse
de se terminer. Son directeur de cabinet est désavoué,
après avoir fait une grosse promesse en direct d'une radio privée
: aucun saut-de-mouton n'est inauguré au 31 janvier 2020. La suite
est un enfoncement. Son programme d'urgence de 100 jours se transforme en un
bourbier. Des détournements fusent, les procès qui s'ensuivent
resteront expéditifs et punitifs, mais sans résoudre le
problème. Le « stratège » Vital
Karmerhe tombe devant la clameur publique, alors que les fameuses actions
promises par Félix Tshisekedi ne sont toujours pas au rendez-vous.
Car, entre-temps, la Covid-19 débarque. Le budget
annuel rêvé par Tshisekedi était finalement
dénué de réalité. Il est réduit, de facto,
de moitié. José Sele Yalaghuli, ministre des Finances, est
obligé de ramener son Chef de l'État à la
réalité. Un plan de Trésorerie est publié. Il
tourne autour de 5 milliards USD. De l'autre côté, dans
l'Est de la RDC, au nord, et même au sud, au moins 6 armées
étrangères élisent domicile sur le sol congolais. Y
compris le Sud-Soudan ! La traque des ADF à Beni (Nord-Kivu)
s'essouffle, des assaillants martyrisent les populations à Lubumbashi et
à Kasumbalesa (Haut-Katanga). Même situation dans l'Ituri,
où les groupes armés rivalisent en tueries. Des centaines de
Congolais sont massacrés.
À Kinshasa, c'est le dollar américain qui
traumatise la capitale congolaise. Il fait le yo-yo avec le Franc congolais.
Les mesures de rafistolage pour contrôler l'inflation s'avèrent
insuffisantes. Les prix grimpent, les Kinois suffoquent, le
« Béton » fond. Il ne sait plus à querelles
se vouer. En juin 2020, Tshisekedi célèbre les 60 ans
d'indépendance de la RDC au pied du mur, consolé par un coup de
téléphone du Roi des Belges.
«
Démissionner » Lwamba et prendre le contrôle de la
Haute Cour
Le 04 juillet 2020, Benoit Lwamba, président de la Cour
constitutionnelle, entre au bureau de Félix Tshisekedi à la
Cité de l'Union Africaine. Le juge avait demandé à
être reçu par le Chef de l'État. Il a une requête
à lui adresser. En plein confinement, il veut se rendre à
Bruxelles, pour des soins sanitaires. Mais, la conversation, qui vient de
commencer, prend une autre tournure. Car, si Félix Tshisekedi accepte
facilement de recevoir le juge-président, il a bel et bien une
idée derrière la tête. Selon un proche de Lwamba,
c'est alors que le président va lui lancer une étrange
proposition. « Il a été clairement fait savoir au
juge-président que s'il voulait se rendre à Bruxelles, et
même recevoir ses indemnités qui ont été
bloquées, il devait d'abord démissionner »,
rapporte ce proche qui a requis l'anonymat.
D'autres expliquent qu'une lettre sera aussitôt tendue
à Benoit Lwamba, portant sa démission. «Devant des
hésitations, il a été clairement
menacé », révèle un proche du juge
congolais. Les menaces seront dissuasives, y compris la promesse de paiement
d'indemnités. Car le juge finit par se rendre à Bruxelles. Une
fuite est aussitôt organisée sur les réseaux sociaux. Une
lettre, rapidement authentifiée par des proches du président
Tshisekedi, annonce publiquement la démission du juge. Elle porte bel et
bien la signature de Benoit Lwamba.
Le vendredi 10 juillet 2020, sept juges siègent
à Cour constitutionnelle pour « constater » la
démission du président, selon un étrange
procès-verbal qui a également fuité sur les réseaux
sociaux. Cependant, le jour même, un nouveau courrier arrive,
contredisant la lettre antérieure et dont l'objet est «
démenti ». Il explique que la démission du
juge-président est fausse, la qualifiant de « rumeur ». Cette
nouvelle lettre est signée par le même Benoit Lwamba, depuis
Bruxelles.
La Présidence décide alors de contre-attaquer.
Le dimanche 12 juillet, des agents de l'Agence nationale de renseignements
(ANR) font irruption à la Cour constitutionnelle, cassant la porte
principale pour s'introduire dans les locaux de la Haute Cour. Ils auraient
spécifiquement ciblé le bureau du juge-président Benoit
Lwamba, confirme à POLITICO.CD, un proche du juge congolais. Une version
corroborée par l'avocat Théodore Ngoy, dans un communiqué
parvenu à POLITICO.CD le même jour.
« En ma qualité de Conseil habituel de
Monsieur Benoit LWAMBA BINTU, Président de la Cour Constitutionnelle et
Président du Conseil Supérieur de la Magistrature de la
République Démocratique du Congo, je me fais le devoir d'informer
l'opinion nationale et internationale que ce dimanche 12 juillet 2020, il est
fait état de la présence des agents de l'Agence Nationale de
Renseignements (ANR, en sigle), venus à bord de deux jeeps, au
siège et dans les locaux, inviolables, de la Cour constitutionnelle,
comme le sont les documents et les archives de ladite Cour »,
révèle-t-il dans ce communiqué.
« Ils ont invité le Président
intérimaire de la Cour constitutionnelle et le Directeur de Cabinet
du Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil
Supérieur de la Magistrature, Monsieur Benoit LWAMBA BINTU, à se
présenter aux bureaux de ce dernier, sans raisons claires et
valables », ajoute-t-il.
Lwamba n'était
qu'un début
L'opération est assumée dans le cercle du Chef
de l'État congolais. Selon nos informations, les services congolais
soupçonnent le Directeur du cabinet du juge Lwamba d'avoir produit un
faux document. Mais, il n'en sera pas question, d'autant plus que, depuis
Bruxelles, Benoit Lwamba assume le démenti et se considère,
à ce jour, toujours comme le juge-président de la Cour
constitutionnelle. Étrangement, à Kinshasa, le «
président de la Cour constitutionnelle ET président du Conseil
supérieur de la magistrature ad intérim », Funga
Molima Mwata Evariste Prince, annonce avoir transmis au président de la
République le procès-verbal de prise d'acte de la
démission d'un membre de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence
Benoît Lwamba Bindu, de ses fonctions de président de la Cour
constitutionnelle. Selon cette correspondance du 13 juillet 2020, le
procès-verbal a été établi à la suite de la
plénière du 10 juillet 2020 par les membres de cette Haute
Cour.
À la Présidence congolaise, on affirme alors que
la démission de Lwamba est actée. Mais, l'épisode ici est
loin d'illustrer une simple querelle entre alliés politiques, même
si, depuis plusieurs mois, le Front Commun pour le Congo (FCC) et le Chef de
l'État congolais ont du mal à accorder leurs violons. Toutefois,
d'autres révélations viennent mettre en lumière la
présence d'un agissement structuré et voulu, du moins, du
côté de Félix Tshisekedi. Car pendant que la
démission de Benoit Lwamba est contestée, le Chef de
l'État avance ses pions, en procédant rapidement à des
nominations qui vont finalement prolonger le pouvoir dans une crise.
En effet, le 17 juillet 2020, Tina Salama, porte-parole
adjointe du Chef de l'État, est envoyée à la
Télévision nationale avec tout une plie de documents. Six
heures seront nécessaires pour que l'ancienne journaliste de Radio Okapi
en vienne à bout. Il s'agit d'un lot inédit d'ordonnances
signées par le président Tshisekedi. L'armée est
principalement concernée. La grande nouvelle restera la mise sur la
touche du célèbre général John Numbi. La clameur
publique atteint les États-Unis. Des diplomates américains
n'hésitent pas à féliciter le départ de leur
bête noire par une autre, le général Gabriel
Amisi. Mais, derrière l'euphorie, c'est la gueule de bois. Car
entre les 120 ordonnances des nominations au sein de l'armée et quelques
institutions judiciaires, Félix Tshisekedi en a profité pour y
glisser une qui finira par faire sourciller le pays entier.
À la Cour constitutionnelle, en plein bras de fer
autour de la démission du juge-président Lwamba, le Chef de
l'État congolais change unilatéralement trois juges. Par
ailleurs, les faits deviennent flagrants lorsqu'il est établi que ces
ordonnances n'ont pas été contre-signées par le Premier
ministre Sylvestre Ilunkamba, comme l'exige la loi. Pendant que ce dernier
se trouvait en mission dans le Haut-Katanga, c'est étrangement le
vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, issu
du parti du président, qui s'est octroyé ce pouvoir, citant un
intérim, certes contesté.
Pièces contre
pièces judiciaires
Problème. La Constitution congolaise, dans son article
158, fixe les conditions de nomination au sein de la plus haute institution
judiciaire du pays. Et Félix Tshisekedi semble n'y avoir pas jeté
un oeil. Pour la petite histoire. Créée le 18
février 2006, la Cour constitutionnelle était une
première, issue de la Constitution et dont les compétences
étaient, entre autres, celle de juger le président de la
République et le Premier ministre. Institution de contre-pouvoir, la
Cour devait donc assurer l'État de droit, tout en permettant de
vérifier la conformité des lois par un contrôle.
Il faudra attendre juillet 2014 pour voir le président
Joseph Kabila nommer les neuf juges de cette Cour, qui prêteront serment
le 4 avril 2015 devant le président, les deux chambres du parlement
réunies en Congrès et le Conseil supérieur de la
magistrature. Les juges Vunduawe Te Pemako, Jean-Pierre Mavungu, Banyaku
Luape, Jean-Louis Esambo, Luamba Bindu, Corneille Wasenda, Funga
Molima, Kalonda Kele et Kilomba Ngozi Mala jurent et prennent ainsi
l'engagement de respecter la Constitution, d'agir avec honneur et
dignité.
Selon la Constitution congolaise promulguée en 2006, la
Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le
Président de la République, dont trois sur sa propre initiative,
trois désignés par le parlement réuni en Congrès et
trois désignés par le Conseil supérieur de la
magistrature. « Les deux tiers des membres de la Cour
constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature,
du barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour
constitutionnelle est de neuf ans non renouvelables », dit la
Loi fondamentale. Toujours selon la Constitution, la Cour
constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans.
Ainsi, trois ans après avoir mis en place la Haute
Cour, Joseph Kabila signe l'ordonnance N° 18/ 038 du 14 mai 2018, nommant
les nouveaux juges dont Norbert Nkulu, Jean Ubulu et François Bokona.
Norbert Nkulu a été désigné par la
Présidence de la République et Jean Ubulu par le Conseil
supérieur de la magistrature. François Bokona a, quant à
lui, été désigné par le parlement réuni en
Congrès.
Or, Joseph Kabila, ayant nommé trois juges le 14 mai
2018, il n'était pas possible que Félix Tshisekedi puisse en
nommer trois autres avant les trois ans requis par la loi. Le nouveau Chef de
l'État aurait dû attendre mai 2021 pour opérer des
nominations. « Ces nominations ne sont pas de nature à
apporter la paix au sein de notre coalition. Elles sont faites de
manière cavalière, en plus d'être illégales. La
constitution stipule que la Cour constitutionnelle ne peut connaître de
nomination venant du Président de la République qu'après 3
ans à l'issue d'un tirage au sort. Or, le président Joseph Kabila
Kabange avait déjà nommé 3 juges en 2018. Et donc, il n'y
avait ni opportunité, ni vacance pour nommer des nouveaux juges. De
plus, les trois juges devaient venir des trois composantes, ce qui n'a pas
été le cas. Ils sont nommés unilatéralement et sont
tous issus d'une seule composante. C'est totalement
illégal », explique Adam Chalwe Munkutu,
Secrétaire national du PPRD, parti de Joseph Kabila.
Par ailleurs, le président Félix
Tshisekedi a procédé aux trois nominations de matière
unilatérale, alors que, selon la Constitution, dans son article 158
alinéa 3, il est clairement stipulé : « La Cour
constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans.
Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au
tirage au sort d'un membre par groupe. »
Deux juges s'opposent
au forcing
Coup de tonnerre à Kinshasa. Les trois nominations, qui
devraient passer comme une lettre à la poste, coincent à la gorge
de deux juges. Le mardi 04 août 2020 jusqu'à midi, le décor
était planté à la Cour de cassation dans la capitale
congolaise, où les juges Jean Ubulu Mpungu et Noël Kilomba
Ngozimala, nommés présidents à la Cour de cassation par
une ordonnance du Chef de l'État Félix Tshisekedi le 17 juillet
2020, étaient attendus. « Les deux juges ne sont pas
joignables. On va devoir reporter l'événement »,
explique un des organisateurs à un journaliste de POLITICO.CD sur
place.Ni le Premier ministre, encore moins le président du Sénat
et la présidente de l'Assemblée nationale. Eux aussi
sèchent la cérémonie. Quelques heures après,
la copie d'une lettre écrite par les deux juges et adressée au
président Félix Tshisekedi est parvenue à
POLITICO.CD.
« Excellence Monsieur le Président
de la République, c'est par la voix des ondes et sans consultation
préalable, que nous avons appris, le 17 juillet 2020, nos nominations en
qualité de Présidents à la Cour de cassation, par
Ordonnance n°20/108 du 17 juillet 2020, lesquelles ont été
suivies de nos remplacements immédiats, alors que c'est depuis juillet
2014 pour le Juge KILOMBA, et avril 2018 pour le juge UBULU, que par nos
lettres respectives (...) nous avions levé l'option de ne plus
travailler à la Cour Suprême de Justice, jusqu'à
l'expiration de nos mandats de neuf ans à la Cour constitutionnelle, et
ce, conformément à la Constitution, en son article 158,
alinéa 3, ainsi qu'à la Loi-organique n°13/026 du 15 octobre
2013 », expliquent-ils dans cette correspondance
datée du 27 juillet 2020
En clair, les deux juges estiment que leurs mandats respectifs
à la Cour constitutionnelle sont de neuf (9) ans pour chacun, et sont
encore en cours. « En outre, l'Ordonnance n°20/108, du 17
juillet 2020 leur notifiée, ne fait pas allusion, dans ses visas,
à la Loi-organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle mais, elle s'est plutôt basée sur les articles
69, 79, 82, 152 et 153 de la Constitution, qui mettent en exergue votre pouvoir
sur les juridictions de l'Ordre judicaire et le Conseil Supérieur de la
Magistrature, alors que la Cour constitutionnelle ne fait pas partie de cet
Ordre de juridictions, dont seul son Président est en même temps
Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, et non les
membres de la Cour », font-ils remarquer au
président Félix Tshisekedi.
La polémique éclate. À la
Présidence congolaise, on répond :« Lorsque les
deux jugent affirment ne pas avoir été préalablement
consultés avant leur nomination, on peut leur rétorquer qu'ils
seront bien en peine de citer un texte légal qui prévoit une
quelconque consultation des intéressés, par le Président
de la République, avant leur nomination. Il n'y a donc pas d'obligation
de consultation envers les deux nominés », affirme un
communiqué du cabinet du président Félix Tshisekedi,
publié le 8 août 2020.
Le même communiqué répond également
au sujet des mandats des juges. « Les intéressés
évoquent leur mandat de neuf ans en cours. Or, ils n'ignorent pas les
prescrits de l'article 31 point 3 de la loi organique qui prévoient
l'incompatibilité de la fonction de membre de la Cour constitutionnelle
avec l'exercice de tout autre emploi public. Ainsi, le Juge constitutionnel ne
peut cumuler deux fonctions publiques au même moment. On peut rappeler le
cas du juge constitutionnel VUNDUAWE Te Pemako, appelé à d'autres
fonctions, alors que son mandat à la Cour constitutionnelle courrait
encore ».
Toutefois, selon les informations de POLITICO.CD, VUNDUAWE Te
Pemako, alors juge de la Cour constitutionnelle, avait sollicité
personnellement et par écrit, auprès de Joseph Kabila, pour
être nommé à la tête du Conseil d'État, qui
venait d'être créé en 2018, après éclatement
de la Cour suprême. Cette demande ayant donc entrainé une vacance
au niveau de la Cour constitutionnelle. Deux autres juges, dont Essambo et
Baniaku, avaient respectivement démissionné, créant une
vacance de 3 postes, ayant permis à Joseph Kabila de les remplacer sans
tirage au sort.
Par ailleurs, l'article 90 de la loi portant statuts des
magistrats, consulté par la rédaction de POLITICO.CD, affirme que
les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux juges de la Cour
constitutionnelle. « Les dispositions de la présente loi
ne s'appliquent pas aux membres de la Cour constitutionnelle »,
dit-elle. Ainsi, quoique magistrats de carrière, en devenant membre
de la Cour constitutionnelle, il apparaît que l'application du statut de
magistrat à l'égard de ces deux juges reste
suspendue. « Ils sont régis dès lors par
l'ordonnance portant dispositions relatives au Statut particulier des membres
de la Cour constitutionnelle », explique, notamment, l'avocat
Jean-Paul Koso Yoha, consulté par POLITICO.CD. « Par
conséquent, aussi longtemps qu'ils exécutent les fonctions de
juge à la Cour constitutionnelle, on ne peut pas prétendre leur
appliquer le statut des magistrats pour leur opposer une nomination comme
magistrat de carrière », ajoute-t-il.
Tshisekedi
prépare-t-il un glissement ?
La guerre judiciaire battra son plein au Congo-Kinshasa.
Félix Tshisekedi voit, notamment, l'opposition, et même le camp de
Joseph Kabila, contester vigoureusement ses nominations à la Cour
constitutionnelle. Néanmoins, si la polémique est vive, c'est
surtout parce que de telles nominations à la plus haute institution
judiciaire de la RDC, visent des objectifs qui font craindre une tentative de
contrôler complètement le processus électoral à
venir.
En effet, selon la Constitution de la RDC, la Cour
constitutionnelle est, notamment, arbitre des contentieux électoraux.
C'est elle qui valide tout le processus, du calendrier à la publication
des résultats définitifs, en passant par la validation des
candidatures, ainsi que leurs rejets. À Limete, la commune du centre de
Kinshasa où se situe le siège de l'Union pour la
Démocratique et le Progrès social (UDPS), des partisans du Chef
de l'État ne cachent pas leur volonté, qui guide sans doute les
manoeuvres autour de la Cour constitutionnelle. Dans une série des
vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des militants du
« Parlement débout », qui tiennent des sessions de discussions
à la gloire de Félix Tshisekedi, ont ouvertement fait savoir
qu'il n'y aura pas d'élections en 2023 comme le prévoit la loi,
même si le mandat actuel du Chef de l'État expirant à cette
échéance.
Ils prônent ouvertement un « glissement ». Un
message qui viendrait directement de l'entourage de Félix Tshisekedi.
Mais, la RDC n'est pas prête à accepter une telle idée.
« Monsieur [Félix Tshisekedi], nous vous voyons
venir. Tel Kabila, vous êtes à la manoeuvre pour inféoder
la Justice. L'État de droit commence par le respect des
textes», dénonce l'avocat Firmin Yangambi, bâtonnier de
Kisangani, via son compte Twitter. « Donc remplacer la
« Cour constitutionnelle » de Kabila par la
« Cour constitutionnelle » de Tshisekedi ? Ce n'est
pas l'État de droit ni la saine justice pour lesquels nous nous battons.
Il faut une Cour constitutionnelle indépendante de qui que ce
soit », ajoute cet avocat proche de Moïse Katumbi.
Félix Tshisekedi se prépare à un
glissement, à l'image du report des élections de 2016, qui avait
occasionné de violentes contestations dans les rues du pays. C'est
en tout cas ce que craignent beaucoup en RDC, en regardant les querelles autour
de la Cour constitutionnelle. « Qu'y a-t-il derrière le
tour de passe-passe constitutionnel mal ficelé que le magicien
#FatshiBéton veut nous faire gober en triturant la composition de la
Cour Constitutionnelle ? La deuxième année du quinquennat de tous
les changements est largement entamée, sans résultats tangibles
au compteur, avec en ligne de mire 2023. Comment faire pour durer
au-delà du terme constitutionnel, de crainte de n'être
congédié par le souverain primaire ? Glisser ! »,
s'exclame un internaute.
Autour du Chef de l'État congolais, on dément,
sans pourtant expliquer tous ces passages en force autour de la Cour
constitutionnelle. Mais, c'est l'image que prend le pouvoir de Félix
Tshisekedi. Récemment, Human Rights Watch et l'Onu ont noté une
hausse sensible des cas de violations des droits de l'homme, dont des menaces
et harcèlement envers des journalistes. Si les responsables politiques
autour du président congolais n'ont pas ouvertement évoqué
un éventuel report des élections de 2023, les actions
posées et la réalité semblent aller dans ce sens. À
moins de trois ans de l'échéance, aucune préparation n'est
visible du côté de la Commission électorale nationale
indépendante (CENI), qui doit commencer par la désignation
polémique des nouveaux acteurs, ainsi qu'un appel à des reformes
et dialogue, initié par des proches de Tshisekedi, qui risquent, en
réalité, de prendre du temps.
Est-ce une porte ouverte vers un glissement ?
Rencontre Tshisekedi
et les bourgmestres : La salubrité et la sécurité de la
capitale au centre des échanges
La salubrité et la sécurité dans la ville
de Kinshasa ont été au centre de l'audience que le
Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordée,
jeudi à la Cité de l'Union africaine, aux bourgmestres et
bourgmestres adjoints des 24 communes de la ville de Kinshasa nouvellement
nommés.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngonbila Mbaka
a déclaré à la presse au sortir de l'audience, que le Chef
de l'État a expliqué aux chefs de l'administration municipale de
la ville de Kinshasa sa vision en ce qui concerne la salubrité et la
sécurité, notamment le « phénomène
kuluna« .
Le gouverneur Ngonbila a reconnu que la ville de Kinshasa est
encore salle, bien que des efforts aient été faits pour la sortir
de la liste des 25 villes les plus sales du monde. » Il reste encore
beaucoup à faire », a-t-il souligne.
Les bourgmestres ont été conduits auprès
du Chef de l'État par le vice-premier ministre, ministre de
l'intérieur, Daniel Aselo Okito wa Nkoi.
Cette rencontre entre le Président de la
République et les autorités municipales intervient trois jours
après le lancement de l'opération «coup de poing» sur
le boulevard Lumumba par le gouverneur de la ville de Kinshasa.
Elle a consisté à l'éradication des
marchés pirates, enlèvement des épaves et véhicules
mal garés, destruction des kiosques et terrasses de fortune, garages
pirates, l'interpellation des vendeuses et vendeurs de l'eau
conditionnée dans des sachets plastiques communément
appelée «eau pure», la délocalisation des parkings des
véhicules et arrêts de bus, mais aussi de l'évacuation des
points noirs ou décharges pirates des déchets pour assurer
l'assainissement des lieux.
Pour la réussite de cette opération, les
bourgmestres des communes de Kimbanseke, Masina, N'djili, Matete et Limete ont
été instruits d'appliquer sans faille toutes ces mesures.
Cette même opération va se poursuivre vendredi
à la place Kintambo-magasin et ses environs, signale-t-on.
TABLE DES
MATIÈRES
Epigraphe 2
Dédicace 3
Remerciements 4
LISTE DES SIGLES 5
LISTE DES TABLEAUX ET DE FIGURES 6
INTRODUCTION GENERALE 7
1. Objet d'étude 7
2. Problématique 7
2.1. Etat de l'art 7
3. Hypothèse de recherche 10
3.1. La construction du discours journalistique
11
4. Construction du cadre théorique
12
5. Construction du cadre méthodologique
13
6. Intérêt du sujet 14
7. Délimitation du sujet 15
8. Division du travail 16
PREMIER CHAPITRE : DU CONCEPT AUX ANCRAGES
THEORIQUES ET METHODOLOGIQUES 17
I.1. Clarification conceptuelle 17
I.1.1. De pratiques langagières à
la fabrique (sociolinguistique) 17
I.1.1.1. Les pratiques langagières
17
I.1.1.2. La fabrique (socio)linguistique
19
I.1.2. Discours politique 21
I.1.2.1 Définition 21
I.1.2.2. Formes du discours politique 25
I.1.2.3. Caractéristiques du discours
politique 27
I.1.2.4. Objectifs du discours politique
28
I.1.2.5. Stratégies discursives et
scène argumentative du discours politique 28
I.1.3. Les éléments de langage
29
I.1.3.1. Qu'est-ce un élément de
langage ? 29
I.1.3.2. Catégorie des EDL 30
I.1.3.3. Conditions de réception des EDL
32
I.1.3.4. Construction du sens des
« éléments de langage » 33
I.1.4. Discours journalistique et
représentation
sociodiscursive
34
I.1.4.1. Le discours journalistique 34
I.1.4.2. Visée du discours journalistique
35
I.1.4.3. L'énonciation journalistique
36
I.2. Ancrages théoriques 39
I.2.1. La praxématique 39
I.2.1.1. Naissance d'une linguistique de la
signifiance 39
I.2.1.2. Postulats de la praxématique
41
I.2.1.3. Outils terminologiques en
praxématique 41
I.2.2. La sémiolinguistique du discours
43
I.2.2.1. Fondamentaux de la théorie
43
I.2.2.2. Concepts et processus d'analyse
44
I.2.2.2.1. Le double processus de
sémiotisation 44
I.2.3. L'école de Genève 46
I.3. Ancrage méthodologique 47
I.3.1. La méthodologie 47
I.3.1.1. La méthode 48
I.3.2. L'analyse textuelle du discours 48
? Le rapport entre locuteur et destinataire
52
I.3.3. L'entretien 53
I.3.3.1. L'entretien semi-structuré
53
I.3.3.1.1. Le guide d'entretien 53
I.3.4. Techniques 54
I.3.4.1. L'observation furtive 54
Conclusion partielle 55
DEUXIÈME
CHAPITRE : DE LA SITUATION SOCIOLINGUISTIQUE AU
TERRAIN DE RECHERCHE 56
II. 1. Situation sociolinguistique à
Kinshasa 56
II.1.1. Aspects sociodémographiques
56
II.1.2. Stratification sociale et usage de la
langue 57
II.1.3. Classe supérieure et attitudes
linguistiques du Français à Kinshasa 58
II.1.4. Présentation des occurrences
d'analyses 58
II.2. Présentation du terrain de recherche
59
II.2.1. Un journalisme factuel :
Actualité.cd 59
II.2.1.1. Actualité.cd en chiffres
59
II.2.1.2. Présentation d'Actualite.cd
60
II.2.1.3. Statut juridique et ligne
éditoriale 62
II.2.1.4. Organisation 62
II.2.1.5. Fonctionnement 65
Organigramme d'Actualité.cd (voir page 11)
66
II.2.2. Un journalisme engagé :
Politico.cd 66
II.2.2.1. Politico.cd en chiffres 66
II.2.2.1. Présentation de l'entreprise
67
II.2.2.2. Cadre juridique 69
II.2.2.3. Fonctionnement 69
Organigramme 70
II.3. Présentation d'articles de presse
71
II.3.1. Articles Actualité.cd 72
II.3.2. Articles Politico.cd 80
II.4. Difficultés du terrain 88
Conclusion partielle 89
TROISIÈME
CHAPITRE : ANALYSE TEXTUELLE D'ARTICLES DE
PRESSE EN LIGNE 90
III.1. Présentation de la grille d'analyse
90
III.2. Application de la méthode 91
III.2.1. Les unités textuelles
élémentaires d'Actualité.cd 91
III.2.2. Application du premier filtrage
(Actualité.cd) 94
III.2.3. Application du deuxième filtrage
(Actualité.cd) 101
III.2.4. Les unités textuelles
élémentaires Politico.cd 105
III.2.5. Application du premier filtrage
(Politico.cd) 108
III.2.6. Application du deuxième filtrage
(Politico.cd) 112
III.3. Interprétation de l'analyse
textuelle 115
III.3.1. Résultats au niveau du premier
filtrage : la culture 115
III.3.1.1. Les formules énonciatives
115
III.3.1.2. Le liage de
co-référence
116
III.3.1.3. L'implicite 116
III.3.2. Les résultats au niveau du
deuxième filtrage : le rapport de communication 117
III.3.2.1. La distance énonciative et
l'intertextualité 117
Conclusion partielle 119
QUATRIÈME
CHAPITRE :
RÔLE
ET IMPLICATION DU
JOURNALISTE
CONGOLAIS DANS LA FABRIQUE
SOCIOLINGUISTIQUE
120
IV.1. L'entretien des journalistes :
Déroulement et grille d'évaluation 120
IV.1.1. Déroulement des entretiens
120
IV.1.2. Présentation de la grille d'analyse
120
IV.2. Présentation des résultats
d'entretien
122
IV.3. Synthèse de résultats
d'entretien 133
IV.3.1. Mise en discours de l'information
politique 133
IV.3.2. Usage des EDL et implication du
journaliste 133
IV.4. Interprétation des résultats
d'entretien 134
IV.4.1. La logique du code linguistique et
sociolinguistique dans l'écriture de presse 135
IV.4.2. Dynamique des innovations
sociolinguistiques dans la pratique journalistique 137
IV.4.3. Le rôle du journaliste et
légitimité du français congolais 140
Conclusion partielle 141
BILAN DE LA RECHERCHE 142
CONCLUSION GENERALE 144
BIBLIOGRAPHIE 146
? OUVRAGES 146
? ARTICLES 147
? NOTES DE COURS 148
? DOCUMENTS CONNEXES 148
? THESES, MEMOIRES, ACTE DE CONFERENCE 148
WEBOGRAPHIE 149
ANNEXES 151
TABLE DES
MATIÈRES
179
* 1 Onguéné
Ossono., Langues et Médias en Afrique noire francophone :
analyse (socio)linguistique et didactique, Paris, éd Connaissances
et Savoirs, 2017, p27.
*
2J.,GRIGNON,LeZaïre,Paris,INA,1975
https://www.in.fr/ina-eclaire-actu/video/caa08014113/le-zaire-ndeg1
consultés le 25 JANVIER à 19 :44.
* 3 SHOMBA KINYAMBA,
Comprendre Kinshasa à travers ses locutions populaires. Sens,
contexte et usages. Leuven, Acco, 2009, p. 8.
* 4 La culture du web a
chamboulé la pratique journalistique, le modèle économique
repose sur de grandes performances qui se traduisent un nombre vertigineux
d'abonnées sur la plateforme qui alloue les médias. Les
journalistes s'adaptent alors à ce nouvel univers, soit par une rupture
innovatrice ; exploitation de formats peu exploités, soit un
rapprochement de la ligne éditoriale à une idéologie en
place, soit à travers une presse qui choque. Pour aller plus loin lire
GABSZEWICZ, J., SONNAC, N., L'industrie de médias à
l'ère numérique, Paris, La Découverte, 2010.
* 5 K., MULLAN,
« Henri Boyer (éd), Hybrides linguistiques. »
cahiers de praxématique en ligne, 54-55, 2010, document 22, mis
en ligne le 01 janvier 2013, consulté le 04 Janvier 2023 à
9 :03 URL.
https://journal.openedition.org/praxemantique/1195
* 6 MULLAN, KELLY, op.cit.
* 7 P., CHARAUDEAU., Les
médias et l'information. L'impossible transparence du discours,
Bruxelles, De Boeck, 2005, p 207.
* 8 CHARAUDEAU, P., op.cit.
* 9 Concept
développé par Roland BARTHES qui traduit une construction des
récits qui respecte le déroulement strict et formel d'un
événement raconté.
* 10 E., SAITTA,
« Les journalistes politiques et leurs sources. D'une
rhétorique de l'expertise critique à une rhétorique du
` cynisme' », in Mots, les langages du politique,
n°87 Juillet 2008, pp 113-127.
* 11 Calvet, J.-L.,
Sociolinguistique, Paris, PUF, éd. Que sais-je ?, 2010,
pp 121.
* 12J., BARBERIS, J., BRES,
et F., GARDÈS-MADRAY, (1998), « La
praxématique ». In Etudes littéraires,
n°3(21), 1989, pp 29-47.
* 13 ONGUENE, O.,
Langues et Médias en Afrique noire francophone : analyse
(socio)linguistique et didactique, Paris, éd Connaissances et
Savoirs, 2017, pp15.
* 14MOUNGA-NDOUNKEU, B.,
« Anamaria curea, Entre expression et expressivité :
l'école linguistique de Genève de 1900 à 1940. Charles
Bally, Albert sechehaye, Henri Frei », Lectures, les comptes rendus,
2015, mis en ligne le 21 Décembre 2015, consulté le 04
Février 2023 à 22 :33
* 15 MOUNGA-NDOUNKEU, B.,
op.cit.
* 16 Les travaux de Saussure
publiés en 1916 introduisent une nouvelle discipline dans les sciences
sociales et humaines. La sémiologie est la discipline qui étudie
le signe au sein de la vie sociale. Elle aura pour objet fondamental le signe
linguistique.
* 17 R., KAMANDA, Cours de
linguistique générale, Kinshasa, Faculté de communications
sociales, UCC, 2020, pp10.
* 18 R., KAMANDA,
Op.cit. p 13.
* 19 E., BAUTIER-CASTAING,
« la notion de pratiques langagières : un outil
heuristique pour une linguistique des dialectes sociaux » in :
Langage et société, n°15, 1981, pp 3.
* 20 L-J., CALVET. La
sociolinguistique, Paris, PUF. Coll. « Que
sais-je ? », P18.
* 21 Dictionnaire Cordial,
2015, Page 205.
* 22 Dictionnaire Le Robert,
Page 125.
* 23 D, MAINGUENEAU,
Discours et Analyse du discours, Paris, ARMAND COLIN, 2012, pp 12.
* 24 P., CHARAUDEAU, Le
discours politique. Les masques du pouvoir, Paris, Gallimard, 2005, pp
30.
* 25 D., MAINGUENEAU,
« le discours politique et son
« environnement » », Mots. Les langages du
politique, N°94, 2010. Mise en ligne le 0- Novembre 2012, consulté
le 02 Avril 2023 à 15 :25. URL :
http://journals.openedition.org/mots/19868
* 26 M., CHARLAND,
« le langage politique », dans, D., WOLTON et al. La
communication politique. Etats des savoirs, enjeux et perspectives,
Québec, Presses de l'Université du Québec, 2003, pp
69.
* 27 M., CHARLAND,
Op.cit. pp 71.
* 28 Reprenant la
définition de C. LE BART pour qui « le discours politique est
celui tenu par les hommes et femmes politiques dans l'exercice de leurs
fonctions ». Définition tiré dans son ouvrage
* 29 K., ADEISHVILI,
L'Analyse du discours politique, Sarrebruck, Les Editions
universitaires européennes, 2016, pp 20.
* 30 D., WOLTON, la
communication politique : construction d'un modèle, in HERMES,
LA REVUE N°4, Paris, CNRS éditions, 1989, pp 27.
* 31 D., WOLTON,
Op.cit. pp 27.
* 32 Dans le
développement de la pensée de Hariman, utilise le terme `style
'pour désigner les éléments propres à un discours
politique.
* 33 Avec l'évolution
d'internet, il n'est pas commode d'appuyer cette parenthèse.
Évidemment parce que l'instigateur du discours peut être en
relation directe avec son auditorat sans la médiation du journaliste
ou des médias. Cependant, le travail de configuration et de fabrication
de l'information pourvoit et assoit le sens
* 34 P., CHARAUDEAU,
« De l'argumentation entre les visées d'influence de la
situation de communication », in Argumentation, Manipulation,
Persuasion, Paris, L'Harmattan, 2007, pp 3.
* 35 P., CHARAUDEAU,
Op.cit. pp 4.
* 36 Dans son article,
Charaudeau présente une large liste de stratégies
utilisées en communication politique ou que l'on retrouvera dans le
discours politique, allant de la stratégie de promesse, de justification
à la stratégie de décision.
* 37 C., OLLIVER-YANNIV,
« Les petites phrases » et
« éléments de langage » . Des
catégories en tension ou l'impossible contrôle de la parole par
les spécialistes de la communication, in : Communication et
Langages, n°168, 2011, pp 57.
* 38 C, OLLIVER-YANIV,
Op.cit. p59
* 39 C. OLLIVER-YANIV,
Op.cit pp 60.
* 40 C., OLLIVER-YANIV,
Op.cit. pp 60.
* 41 Courant né
à la suite de Cultural studies en Angleterre. Elles mobilisent les
recherches autour du journalisme dans une perspective plus focalisante,
notamment dans la sociologie du journalisme. Pour aller plus loin, lire E.,
NEVEU, sociologie du journalisme, Paris, La Découverte, 2004,
123 pages.
* 42 RT, cours d'introduction
à l'énonciation : l'énonciation. URL :
https://www.ralentirtravaux.com/lettres/cours/enonciation.php
consulté le 09 avril 2023 à 16h : 54
* 43 P., CHARAUDEAU,
« Discours journalistique et positionnements énonciatifs.
Frontières et dérives », Semen, (en ligne), 22 /2006,
mise en ligne le 01 Mai 2007, consulté le 10 Avril 2023. URL :
https://journals.openedition.org/semen/2793
* 44 P., CHARAUDEAU, Op.cit
* 45 R., RINGOOT,
Analyser le discours de presse, Paris, Armand Colin, 2014, pp 17.
* 46 R., RINGOOT, Op.cit pp 21.
* 47 Pour aller plus loin,
lire le n°154 de la revue Communication et langage portant sur
« l'énonciation éditoriale en question »,
parue en Décembre 2007.
* 48 R., RINGOOT,
Op.cit. pp 45.
* 49 P., CHARAUDEAU, les
médias et l'information, l'impossible transparence du discours,
Bruxelles, De Boeck, 2011, pp 124.
* 50 J-M., BARBERIS, J.,
BRES, F., GARDES-MADRAY, « la praxématique » in
Etudes littéraires, n° (21) 3, 1989, p 29-47, pp 30.
* 51 J-M., BARBERIS, et al,
Op.cit, pp 32
* 52 J., BRES,
« Brève introduction à la
praxématique », in L'information, n°77, 1998, pp
22-23, p 22.
* 53
Développées en sociologie, la praxis sociale ou socioculturelle
désigne un système de pratiques matérielles et
intellectuelles par lesquelles les réalités sociales sont
construites et influent sur le monde.
* 54 Voir J-M., KLINKENBERG,
Précis de sémiotique, générale, Paris, Seuil, 2000,
pp 512.
* 55 J., BRES,
Op.cit. pp 2.
* 56 J-M., BARBÉRIS
et al, Op.cit pp 34.
* 57 Idem
* 58 P., CHARAUDEAU,
« une analyse sémiolinguistique du discours », in
revue langages, n°117, Paris, Hachette, 1995, pp 13.
* 59 C.,
GILLET« Langages et Discours-Éléments de
sémiolinguistique », Etudes de communication, (en
ligne), 2, 1983, mis en ligne le 17 MAI 2012, consulté le 17 AVRIL 2023
à 10 :56. URL :
https://journals.openedition.org/edc/3319
* 60 Utilisée dans le
courant peircien, pour désigner le processus selon lequel un signe
signifie quelque chose pour quelqu'un.
* 61 C., GILLET,
op.cit. pp 2.
* 62 Idem
* 63 P., CHARAUDEAU,
Op.cit, pp 2.
* 64 P., CHARAUDEAU,
Op.cit, pp 3.
* 65 P., CHARAUDEAU,
Op.cit. pp 4.
* 66 B., MOUNGA NDOUNKEU,
« Anamaria Curea, Entre expression et expressivité :
l'école linguistique de Genève de 1900 à 1940. Charles
Bally, Albert sechehaye, Henri Frei, ».in : Lectures, (en
ligne), les comptes rendus 2015 mis en ligne le 21 Décembre 2015.
URL :
https://lectures.revues.org/19720
consulté les 22 AVRIIL 2023 à 12H 03 ; pp 2.
* 67 B., MOUNGA NDOUNKEU,
Op.cit. pp 2.
* 68 M., KHALID, La
recherche et ses méthodologies. URL :
https://www2.ift.ulaval.ca/-chaib/IFT-6001/Slides/Rech-method.pdf
consulté le 19 avril 2023 à 22H36.
* 69 J.-J., CHEVAL,
« Analyser la radio. Méthodes et mises en
pratique », Frédéric Antoine »,
Bruxelles, Deboeck, 2016, pp 7.
* 70 S., ALAMI, D., DESJEUX,
I., GARABUAU-MOUSSAOUI, Les méthodes qualitatives, Paris, PUF,
Coll. « Que sais-je », 2009, pp 23.
* 71 P., PAILLE, A.,
MUCCHIELLI, L'analyse qualitative en Sciences humaines et sociales, Paris,
Armand colin, 2016, p22
* 72
Développée vers les années 60 en Amérique et en
Europe, elle naît dans le sillage de travaux autour du rapport entre le
texte et le discours. Soutenant par ailleurs que la linguistique est
transphrastique, qu'elle doit prendre le texte comme l'unité
linguistique la plus importante et la plus complexe.
* 73 J-M, ADAM, La
linguistique textuelle : introduction à l'analyse textuelle du
discours, Paris, Armand colin, 2005, pp 4.
* 74 B., FALLERY, F.,
RODHAIN, Quatre approches pour l'analyse textuelle : lexicale,
linguistique, cognitive, thématique, (en ligne). URL :
Https://hal.science/hal-00821448
consulté le 20 Avril 2023 à Minuit 57.
* 75 J-P, MUSANGANIA,
Cours d'analyse du discours médiatique, Kinshasa, Notes de
Cours à l'intention des étudiants en Journalisme, Facultés
de communications sociales, année académique 2022-2023, pp 17.
* 76 F., HOUTART,
« La méthode d'analyse textuelle de Jules Gritti »,
in : Méthodes d'analyse de contenu et sociologie (en
ligne). Bruxelles, Presses de l'université de Saint-Louis, 1990, pp 68.
* 77 F., HOUTART,
Op.cit. pp 69.
* 78 J-P., MUSANGANIA,
Idem. pp 17.
* 79 J-P., MUSANGANIA,
Op.cit. pp 18.
* 80 D., TEBANGASA,
Cours de Méthodes d'investigation en sciences sociales. Notes
de cours à l'intention des étudiants en 2e licence, en
communications sociales, Kinshasa, UCC, année académique,
2019-2020, pp 23.
* 81 D., TEBANGASA,
Op.cit. pp 8.
* 82 OBSERVATOIRE DE LA
LANGUE FRANÇAISE, Qui parle français dans le
monde ? (en ligne). URL :
Qui
parle français dans le monde - Organisation internationale de la
Francophonie - Langue française et diversité linguistique
consulté le 12 Mai 2023 à 22H37
* 83 R., TUMBWE,
« le français dans le paysage linguistique de la
République Démocratique du Congo » in :
Environnement francophone en milieu plurilingue (en ligne). Pessac :
Presses universitaires de Bordeaux, 2012. URL :
https://books.openedition.org/pub/35242
consulté le 12 Mai 2023 à 23H 17
* 84 Il en existerait une
certaine également lorsque l'on fait usage du français, mais
cette reconnaissance tourne également à la caricature au sein de
la société. Elle s'oriente vers la catégorisation d'une
classe privilégiée que d'autres, et donc dispose d'un faible
sentiment d'appartenance.
* 85 R., TUMBWE,
Op.cit. pp 4.
* 86 R., TUMBWE,
Op.cit. pp 5.
* 87 P., ZANG-ZANG,
aspects linguistiques et sociolinguistiques des français
africains, Rome, éd. Oreste Floquet, Sapienza Università,
2018, p9
* 88 P., ZNAG-ZANG,
Op.cit. pp 10.
* 89 P., ZANG-ZANG,
Op.cit. pp 11.
* 90 Simular web, URL :
https://www.similarweb.com/fr/website/actualite.cd/
consulté le 15Mai 2023 à 10 :53
* 91 Actualité.cd :
cahier de présentation, pp 1.
* 92 Actualité.cd :
op.cit., pp 2.
* 93 Actualité.cd,
Idem
* 94 Actaulité.cd,
Op.cit. pp 5.
* 95
Actualité.cd, Op.cit. p 7
* 96
Actaulité.cd, Op.cit. p8
* 97 M., GOTTARELLI,
« le journalisme est un combat » : réflexion
sur un journalisme engagé, l'oeil de la maison des journalistes. (En
ligne) mis en ligne le 28 novembre 2018. URL :
https://www.oeil.-maisondesjournalistes.fr/2018/11/27/journalisme-engage-politique/
consulté le 28 Mai 2023
* 98 Simular web. URL:
www.polito.cd
* 99 Politico.cd, cahier de
présentation, pp 2.
* 100 Politico.cd,
Op.cit. pp 3.
* 101 Notons que
l'étape de l'identification des co-textes s'est réalisée
en sélectionnant les propositions à soumettre à l'analyse
textuelle
* 102 Emprunté
à la perspective narrative de G. GENETTE, nous l'utilisons dans ce
contexte, pour expliquer le jeu de remaniement de l'énonciation qui a
pour but une mission de focalisation interne, de sélection des
informations à fournir aux lecteurs, ou encore de discours à
rapporter à la cible.
* 103 Comme défini
par D. PAILLARD, les MD sont des éléments linguistiques qui
permettent de comprendre la visée d'une énonciation en
déterminant les composants de la scène énonciative, et le
rapport qu'elles entretiennent.
* 104 L., DEVILLA, Analyse
de la linguistique textuelle - introduction à l'analyse textuelle des
discours, pp 256. URL :
https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice.00120796v2
consulté le 06 Juin 2023 à 8 :30
* 105 L., DEVILLA,
op.cit., p264
* 106 H., MBIYE, Cours
de narratologie, Notes à l'intention des étudiants de
3ème licence en Communications sociales, UCC, Kinshasa,
Année académique 2020-2021, p28
* 107 J-J., QUINTIN, Cours
d'Analyse de données qualitatives : outils de production de
données qualitatives et méthode d'analyse, Lyon,
Université Lyon 2. p44, (En ligne), URL :
https://www.//apprendre.auf.org./wp-content/opera/13-BF-Refrences-et-biblio-RPT-2014/
consulté le 17 Juin 2O23 à 18 :19
* 108 J.-J., QUINTIN,
Op.cit. pp 46.
* 109 J., DE BONVILLE,
« les notions de texte et de code journalistique :
définition critique ». In : Communication,
information Médias, Théories, Volume 17 n°2,
Décembre 1996, pp. 98-142, p 99.
* 110 Pour être
précis, le journaliste utilise des figures de discours qui sont propres
au métier de journalisme. Pour comprendre cette différence entre
cette formalité et l'usage de discours d'autres médiateurs ;
lire S.MOIRAND, les discours de la presse quotidienne, Observer, analyser,
comprendre, Paris, PUF, coll. Linguistique nouvelle, 2007, pp 179.
* 111 Le code linguistique
préétabli fait référence aux normes
d'écriture journalistique respectées dans l'exercice de la
profession. Par exemple, l'écriture d'une brève exige la
simplicité et la combinaison de mots clés pour faciliter la
compréhension aux lectures. De même qu'un éditorial est du
style libéral, où le journaliste utilise un vocabulaire poignant.
Ou encore les analyses ou chroniques qui exigent la maîtrise du code
linguistique du domaine auquel appartient le journaliste.
* 112 J., DE BONVILLE, Op.cit.
p. 102
* 113 P., CHARAUDEAU,
« Discours journalistique et positionnements énonciatifs,
Frontières et dérives », in : Enonciation et
responsabilité dans les médias, Semen, n°22, 2006,
page 2. (En ligne) URL :
https://doi.org/10.4000/semen.2793
consulté le 25 Mai 2023 à 14h 53.
* 114 P., CHARAUDEAU,
« la situation de communication comme lieu de conditionnement
du surgissement intediscursif », in : TRANEL, n°44,
interdiscours et intexteualité dans les médias
Neuchâtel, Institut de Linguistique de l4Université de
Neuchâtel, 2006. (en ligne), URL :
https://www/patrick-charaudeau.com/la-situation-de-communication.166.hml
consulté le 25 Mai 2023 à 20h 16
* 115 Théorie
développée par Barthes en 68 dans le numéro 11 de la revue
Communications : les recherches sémiologiques le vraisemblable.
L'approche est issue de la critique de la linguistique structurale. L'accusant
de ne pas prêter attention aux discours esthétiques du
récit, car pour lui les détails parfois lourds et inutiles
constituent en réalité une valeur narrative.
* 116 R., BARTHES,
« l'effet de réel », les
recherches sémiologiques le vraisemblable, in, Communications,
n°11, Paris, coll. Persée, 1968, pp 84-88, pp 84.
* 117 P., VITEZ, le
discours médiatique parlé et la norme du français :
une question d'accent. p37 URL :
https://journals.uni-lj.si/Vestnik/article/download/10369/9934
consulté le 27 Mai 2023 à 17H 21
* 118 P., VITEZ,
op.cit., pp 47.
* 119 P., VITEZ,
idem
| 


