|
CERAI
Centre
d'Études et de
Recherche Appliquée de
l'Istec
LE DEVELOPPEMENT DURABLE :
SOURCE DE PERENNITE DE
L'ENTREPRISE ?
L'enjeu de la démarche d'intégration
des principes du Développement Durable pour
les Petites et Moyennes Entreprises
en France
Maïté DRACON
Promotion 2004 ISTEC - CFA Sup
Date d'édition : 27 avril 2004

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont
soutenue et permis de mener à bien ce mémoire de fin de
cycle.
Tout d'abord, je voudrais adresser un grand merci à
messieurs Thierry Vincent, Yohan Leroy et Etienne Ruth, pour le temps qu'ils
m'ont accordé et les connaissances qu'ils m'ont transmises.
Un autre grand merci à M. Lecocq et à M. Mary
pour m'avoir ouvert les portes de leurs entreprises et m'avoir consacré
un peu de leur précieux temps.
Merci également à M. Stanislas Dupré et
à Michel Breton pour leur aimable participation et leurs conseils.
Un merci tout particulier à mon conseiller de recherche,
M. Patrick Franconie, pour son soutien et sa capacité à me
recentrer sur les points essentiels de ce vaste sujet.
Enfin, merci beaucoup à tous les intervenants de l'ISTEC
pour leur professionnalisme et la passion de l'enseignement qui les anime.
Merci aussi à Corinne Laronce et Naffissa Boutebba pour
leur implication, leur aide, et pour le courage qu'elles ont su nous insuffler
pour parvenir au terme de ce cursus.
Et je n'oublie pas, pour terminer, de remercier mes
collègues de travail qui se sont armés de patience pour lire ce
mémoire et me donner leur avis, ainsi que ma tutrice, Nathalie Sciardis,
pour m'avoir permis d'utiliser les moyens du CEA pour mener cette étude
à bien.
SOMMAIRE
Préambule 5
Introduction 7
Partie I : Le Développement
Durable : Pourquoi et Comment ? 8
1.
Le constat des échecs des sociétés occidentales 8
1.1. L'environnement
et les Hommes 8
1.2. Les Hommes et
leur qualité de vie 14
2. Le DD : une nouvelle chance pour l'avenir 21
2.1.
Définitions : développement durable et termes
associés 21
2.2. Le
Développement Durable : valeur montante de la société
23
2.3. Le
Développement durable : un gain de visibilité en
2003 et des perspectives d'avenir encourageantes 31
2.4. A qui s'adresse
le DD ? 33
Partie II : Les enjeux du DD pour les PME 35
1. Les PME en France 36
1.1. Qu'est ce qu'une
PME ? 36
1.2. Les PME face aux
trois piliers du DD 38
2. Les particularités des PME françaises face au
DD 41
2.1.
Difficultés 41
2.2. Avantages
structurels 43
3. La Responsabilité Sociale et Environnementale :
un avantage concurrentiel 44
3.1. Opinion publique,
les nouvelles tendances de fond 44
3.2. Les
marchés publiques : préférence aux entreprises
appliquant la RSE 46
3.3. Grands
Comptes : nouvelles exigences en matière de Développement
Durable 46
4. La Responsabilité Sociale et
Environnementale : un avantage financier 48
4.1. La
réduction des coûts 48
4.2. Les aides
financières 51
Partie III : La démarche d'engagement
sur la voie du DD pour une PME 53
1. Les étapes générales 53
2. Les clefs de la réussite de la démarche
57
3. Expérimentation de la faisabilité
financière de la démarche sur deux entreprises d'IDF 59
3.1. Les
entreprises sélectionnées 59
3.2. Diagnostic
développement durable 61
3.3. Application de
la démarche 68
3.4.
Résultat de l'expérimentation 82
Conclusion 84
Méthodologie 86
Bibliographie 88
Glossaire 90
Annexes 98
Annexe 1 I
Annexe 2 IV
Annexe 3 VIII
Annexe 4 IX
Annexe 5 X
Annexe 6 XI
Annexe 7 XIII
Annexe 8 XV
Annexe 9 XVI
Annexe 10 XVII
Annexe 11 XIX
Annexe 12 XXII
Annexe 13
Annexe 14 XXV
Annexe 15 XXVI
Annexe 16 XXVII
Annexe 17 XXXI
Notes 131
PREAMBULE
Lorsque l'on se penche sur ce qu'englobe le
Développement Durable, on apprend que ce n'est pas simplement une
affaire de concept. Il s'agit d'une nouvelle vision du monde. «
L'enjeu n'est pas de répondre à de nouvelles contraintes par
de nouvelles politiques ponctuelles et des actions limitées mais bien de
réinventer la société économique de demain, comme
la société de consommation a été inventée il
y a près de soixante ans »1
Le comportement majoritaire actuel dans notre
société peut être symbolisé par une image
très parlante qu'a utilisé lors d'un entretien Thierry Vincent,
chargé d'études à la CCIP : Celle d'un homme qui
marche dans le désert avec une gourde, qui est loin de toute oasis, mais
qui continue à boire comme si une source intarissable se trouvait
près de lui.
En effet, le développement du monde, tel qu'il a
été façonné par la société de
consommation, n'est pas durable.
Le DD est la réponse des sociétés
occidentales à cet état de fait pour éviter les
catastrophes annoncées sans « révolution ».
Sa diffusion implique une évolution des mentalités qui permette
de prendre un nouveau cap.
On s'aperçoit alors que lorsqu'il s'agit de passer
à l'action suite aux conclusions et préconisations des
organisations internationales, et de modifier effectivement nos habitudes, les
ONG, les gouvernements et les citoyens se tournent vers l'entreprise. Il ne
s'agit pas ici de poursuivre le débat qui consiste à
déterminer à quel maillon de l'économie il incombe de
commencer en brisant le « cercle vicieux ». L'important
est qu'il semble que les entreprises soient déclarées d'office en
première ligne et qu'elles doivent réagir par rapport à
cela.
Les grandes entreprises font déjà l'objet de
contraintes légales en France, et communiquent abondamment sur le sujet
du développement durable, qui semble plus porteur actuellement que celui
de l'innovation. Nous ne ferons pas ici le procès du « green
washing » car le fait de communiquer sur le sujet améliore la
« notoriété » du développement
durable, même si cela peut parfois nuire à son
« image ». Mais les grandes entreprises sont-elles les
mieux placées pour effectuer le changement de cap attendu ? Les
opinions divergent. La mienne est que leur « tête »
n'est pas assez proche du terrain.
1 J. BLOCH, « Développement
durable : la myopie des entreprises... », Les Echos, 30-31 août
2002, p. 43.
Les PME n'ont pas encore de contraintes légales en
matière de DD et peut-être n'en auront-elles jamais. En effet, le
débat entre la promotion de démarches volontaires et la
contrainte par la réglementation est toujours d'actualité.
Néanmoins, les PME font de plus en plus l'objet de l'attention des
pouvoirs publics, l'objectif actuel étant à la sensibilisation
des PME ainsi qu'à la compréhension de leurs
spécificités.
Alors que faire face à cela lorsque l'on est dirigeant
d'une PME ? Anticiper et intégrer le club très fermé
des pionniers de l'évolution pour un monde plus durable, ou voir
venir et espérer que la « mode » passe ?
Pour les PME qui choisissent l'anticipation se pose alors la
question du comment. Cette question n'implique pas uniquement le comment de la
démarche d'engagement sur la voie du DD, elle implique aussi de
comprendre comment une PME peut trouver un intérêt
économique à cette démarche.
L'objet de cette étude de recherche appliquée
sera donc de réaliser si la gestion des PME à travers les piliers
du DD est viable.
INTRODUCTION
Mais où va le Monde ? A cette interrogation banale
qu'on se pose devant le JT sans en attendre de réponse
particulière le monde scientifique s'accorde pour rétorquer qu'il
va vers sa fin. En tous cas, à la fin du Monde tel que nous le
connaissons.
Les raisons de cette fin anticipée ? En premier
lieu, il y a les activités humaines qui menacent les équilibres
naturels en dépit du bon sens. En second lieu, d'un point de vue social,
le mal de vivre et la pauvreté gagnent du terrain. Les situations de
rupture qui en résultent peuvent mener à des actions
destructrices au-delà de toute raison.
C'est dans ce contexte que, de la prise de conscience de
quelques Hommes, est née l'idée d'un développement plus
durable, comme une concession entre le développent
déraisonné que nous connaissons et la révolution des
écologistes.
Depuis, le développement durable est une valeur
montante de la société et devient un élément
économique incontournable pour toute entreprise ayant une vision
à long terme.
Les PME ne sont pas encore concernées de façon
réglementaire par les préceptes du développement durable.
Néanmoins, ce dernier semble être autant un moyen
d'amélioration de la société dans son ensemble que de
l'entreprise en particulier.
Mais concrètement, comment une PME peut-elle
s'approprier la démarche de DD sans grever son bilan ? Quel angle
d'approche du DD lui permettra de s'engager sur cette voie tout en
espérant un retour sur investissement à moyen
terme ? Dans les faits, une PME peut-elle améliorer sa
rentabilité grâce à une stratégie de DD ?
Pour répondre à ces questions, nous allons, dans
un premier temps, étudier le concept de DD, les phénomènes
environnementaux et sociaux qui justifient son apparition, et l'ampleur qu'il a
pris ces dernières années.
Ensuite nous ferons le bilan de l'état actuel des PME
face aux trois piliers du DD et nous nous attacherons à montrer les
bénéfices qu'elles peuvent tirer à être socialement
et environnementalement responsables.
Enfin nous proposerons une démarche
générale pour les PME et nous l'expérimenterons sur deux
TPE orientées services de la région parisienne afin
d'évaluer la faisabilité financière de cette
démarche et la réalité des bénéfices que
l'entreprise peut en tirer.
Le Développement Durable : Pourquoi et
Comment ?
1. Le constat des échecs des sociétés
occidentales
Pour bien comprendre ce qu'est le développement
durable, il est nécessaire de bien prendre en compte le contexte dans
lequel il est apparu. C'est le constat de l'échec social et
écologique de nos sociétés occidentales qui a
constitué le terreau dans lequel le caractère inévitable
d'un mode de développement durable continue de se renforcer.
1.1.
L'environnement et les Hommes
Depuis la préhistoire, l'être humain se sert de
ce qu'il trouve autour de lui pour organiser sa vie et peu à peu
améliorer son confort. Cela commença par les peaux de bêtes
qui devinrent vêtements, et les cailloux et bouts de bois qui devinrent
outils. Puis au fur et à mesure que les civilisations se
développèrent, l'Homme n'eut de cesse que de trouver une nouvelle
utilité aux produits de sa planète. Ainsi animaux,
végétaux, minéraux, gaz, lumière, eau, tout fut mis
à contribution dans la marche vers le progrès de
l'humanité.
Nous sommes ainsi arrivés, au terme actuel de cette
évolution dans les pays développés, à un mode de
vie dont le standard minimal implique la possession de quantités
d'objets ayant eux-mêmes nécessité quantités de
ressources pour leur fabrication.
Il suffit d'avoir déménagé une fois dans
sa vie pour avoir une petite idée de l'ampleur de cette accumulation
d'objets, sans compter tous ceux qui ont été jetés sans
qu'on s'y attache.
Et c'est justement ce mode de vie des pays
développés qui est aujourd'hui mis en cause dans la
surconsommation des ressources naturelles.
En effet, c'est une préoccupation qui a
émergé autour des années 70, avec les chocs
pétroliers de 73 et 79 : Les ressources naturelles de notre
planète peuvent-elles s'épuiser ? Et le verdict du monde
scientifique tombe : OUI. Et non seulement les ressources
s'épuisent plus vite qu'elles ne se renouvellent, mais il semble que
notre activité influe également sur le climat (qui se
réchauffe en risquant d'entraîner quantités de catastrophes
pour l'écosystème et pour l'humanité), et sur le monde du
vivant dans son ensemble (duquel nous dépendons également). Les
scénarios les plus catastrophiques nous prédisent des dommages
importants et irréversibles d'ici 2050 (autant dire demain).
Seulement comment revenir en arrière ?
Comment effacer les conséquences de nos erreurs sans renoncer à
l'indéniable confort que le progrès, notamment depuis les
révolutions industrielles, puis celle, plus proche, de l'information,
nous a apporté ? Il semble que cela ne soit pas
« humainement » réalisable. La seule chose que nous
puissions faire est d'essayer de rectifier le tir au plus vite, et cela est
déjà un véritable défi en soi.
1.1.1. Constats scientifiques des
impacts environnementaux de l'activité humaine
L'activité humaine génère un impact sur
l'environnement à chaque mouvement. Le seul fait de respirer nous fait
transformer l'oxygène nécessaire à notre survie en CO2
(dioxyde de carbone) qui est le principal gaz à effet de serre produit
par l'Homme. Mais cet impact là a été prévu par
l'écosystème. Nous allons nous concentrer ici sur les impacts des
activités les plus nuisibles, propres à l'Homme, et en
particulier celles des civilisations occidentales des pays
développés (ce sont en effet les pays développés
qui présentent les plus importantes émissions de CO2 dans le
monde, cf. Annexe 1) : la consommation d'énergie, la banalisation
de l'usage du papier, le recours croissant aux transports, le
développement des industries, la production de déchets
ménagers et des exemples de pollutions diverses (cf. détail de
ces constats en annexe 2)
L'homme est dépendant face à son environnement
naturel. C'est celui-ci qui lui apporte la satisfaction des besoins primaires
vitaux : l'eau, l'air, la nourriture. Même si la technologie nous
permet souvent de copier la nature, elle ne nous permettra sûrement pas
de la remplacer dans ces tâches essentielles. « La substitution
du capital reproductible au capital naturel connaît des limites. Il est
loin d'être acquis que les services écologiques actuellement
rendus par les écosystèmes puissent être
systématiquement reproduits artificiellement. On compte parmi ces
services gratuitement rendus par la nature : la purification de l'air et de
l'eau, la décomposition des déchets, la régulation du
climat, la régénération de la fertilité des sols,
la production et la préservation de la biodiversité, laquelle
procure les ressources nécessaires à l'agriculture et à
certains secteurs industriels, notamment pharmaceutique. La substitution d'un
mécanisme artificiel à ces services est dans certains cas
économiquement absurde, et dans d'autres tout simplement
impossible » 2
Sans les équilibres assurés naturellement par
l'écosystème, l'homme pourrait bien se retrouver dans un
environnement hostile.

2. Dominique Bourg, Quel avenir pour le
développement durable ? p.24 Editions Le Pommier 2002
1.1.2. Menaces à Moyen et long et
terme
ü Le
réchauffement climatique dû à l'intensification de l'effet
de serre*
Dans le cadre d'un scénario typique de
" laisser-faire ", les émissions de dioxyde de carbone
passeront de 7 milliards de tonnes par an en 1990 à 20 milliards en
2100. Ce scénario, qui tient compte des effets des autres
émissions de gaz à effet de serre, traduits en équivalent
dioxyde de carbone (en effet, la plupart des autres GES émis par
l'activité humaine ont un pouvoir absorbant plus fort que celui du CO2
et une plus longue durée de vie, même s'ils sont émis en
quantités plus petites) signifierait que les concentrations de CO2
doubleraient d'ici à 2030 et tripleraient d'ici à 2100 par
rapport à l'époque préindustrielle.
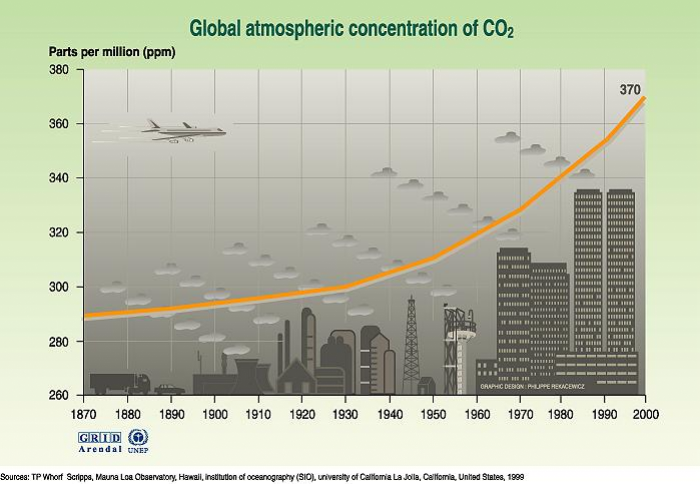
Même s'il ne faisait que doubler par rapport à
l'ère préindustrielle, un tel niveau d'émissions de
dioxyde de carbone correspondrait à des concentrations de gaz à
effet de serre à longue durée de vie plus élevées
qu'elles ne l'ont été depuis plusieurs millions
d'années.
Pour les scientifiques, le niveau de pollution lié aux
émissions de gaz à effet de serre, générés
principalement par la combustion des énergies fossiles (pétrole,
charbon, gaz), est tel que le climat de la terre se réchauffe. De
combien de degrés et à quelle échéance ? Les
prévisions divergent.
Un rapport des experts du GIEC (Groupe Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat) rendu publique le 19 février 2001 prévoit
pour le XXI° siècle une hausse de la température moyenne de
la Terre comprise entre 1,4°C et 5,8°C et une augmentation du niveau
des océans comprise entre 9 et 88 cm.
*cf. Glossaire et Annexe 3 (schéma de processus de l'effet
de serre)
Quoi qu'il en soit, les conséquences d'une augmentation
moyenne de 2° (prévision basse) à échéance de
2100, seraient considérables :
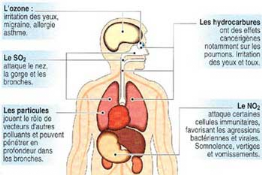 Elévation du niveau des mers
Elévation du niveau des mers
La fonte déjà amorcée d'une partie des
glaces polaires et le réchauffement des océans pourrait
entraîner une élévation du niveau des mers, menaçant
92 millions de personnes vivant dans les zones côtières. En
France, certaines régions côtières seraient
affectées, notamment les espaces deltaïques (delta du Rhône).
 Famines, santé des populations
Famines, santé des populations
Les risques de disette alimentaire et de famine peuvent
s'accroître dans certaines régions de la planète. Les
vagues de chaleur seront plus intenses et plus longues: on prévoit donc
un accroissement consécutif des maladies cardio-vasculaires;
indirectement, un certain nombre de maladies se transmettront plus facilement
(paludisme, dengue, fièvre jaune, encéphalites).
 Crues et sécheresses, précipitations
Crues et sécheresses, précipitations
Une augmentation est à prévoir de la
fréquence et de la durée des grandes crues et des grandes
sécheresses. En France, en cas d'augmentation de 2°C de la
température moyenne, les précipitations d'hiver augmenteraient de
20 %, les précipitations d'été diminueraient de 15 %.
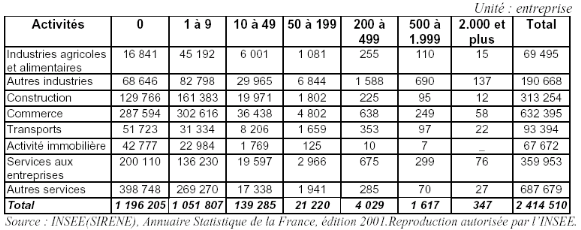 Modification des courants marins
Modification des courants marins
Certains chercheurs envisagent la possibilité d'un
ralentissement du "gulf stream " au niveau du Nord de l'océan
atlantique, ce qui aurait pour conséquence un fort refroidissement de la
température moyenne en Europe occidentale alors que le niveau de cette
température aurait tendance à s'élever sur le reste du
globe.
Cette modification rapide du climat mondial accentuerait son
instabilité et se traduirait par une augmentation de la fréquence
des catastrophes naturelles, cyclones, sécheresse, inondations, etc...
L'agriculture serait bouleversée et des déplacements massifs de
population deviendraient inévitables entre les régions
sinistrées (zones côtières inondées, accroissement
des déserts, etc...) et les zones préservées
entraînant les tensions politiques habituelles dans ce genre de
situation.
ü La
disparition définitive de certaines espèces.
L'histoire de la vie sur Terre est parsemée de
disparitions mais, en raison du déclin de la diversité biologique
dû aux activités humaines, "le taux d'extinction des
espèces est aujourd'hui 1.000 à 10.000 fois supérieur
à ce qu'il serait naturellement", avertissent les experts.
L'appauvrissement de la diversité biologique mondiale,
c'est à dire la diversité des gènes, des espèces
animales et végétales, et des milieux qui les abritent,
s'accélère au point d'être considéré
aujourd'hui comme une menace globale d'égale importance à
celle des changements climatiques. Les experts estiment que la
moitié des espèces vivantes que nous connaissons pourrait
disparaître d'ici un siècle. Et on estime qu'entre cinquante et
trois cent espèces animales et végétales
s'éteignent chaque jour (Le Monde diplomatique)
Les grandes forêts tropicales disparaissent, la
biodiversité des plantes et des micro-organismes, potentiellement riche
d'applications pour la santé humaine, diminue de façon
alarmante sous la pression d'une consommation incontrôlée des
espaces naturels et d'une exploitation forestière souvent mal
maîtrisée. Du fait de mauvaises pratiques de la sylviculture, dix
essences composent plus de 80% des forêts. Le nombre d'espèces
animales se réduit ; les grands prédateurs, indispensables
à l'équilibre des écosystèmes, se raréfient
(le Loup en Europe, le Lion en Afrique, ...).
La faune et la flore des océans est victime de la
surpèche et de la surexploitation, ainsi que de la pollution (20% des
espèces de poisson sont menacées de disparition, WWF 2002).
L'appauvrissement de la biodiversité
représente également la perte d'un potentiel économique et
médical. La pharmacopée a largement profité des
connaissances médicinales traditionnelles des différentes
ethnies. Dans le vaste ensemble des plantes non-encore inventoriées ou
mal connues il y a sans doute d'importantes moissons de nouveaux remèdes
qui ne guériront personne si on les élimine.
L'importance et l'urgence de l'enjeu ont été
universellement reconnues au Sommet de Rio de Janeiro en 1992, avec l'adoption
de la Convention sur la diversité biologique, puis confirmées par
la communauté internationale à Johannesburg en septembre 2002.
Pour sa part, l'Europe a affiché, à travers la stratégie
européenne pour la biodiversité, son ambition d'inverser la
tendance d'ici à 2010.
ü Des
risques pour la santé
Depuis le début des années 1900,
l'industrialisation a introduit dans l'environnement près de 100.000
produits chimiques. Certains ont été interdits en raison de leur
toxicité, mais seulement quelques-uns, car pour la plupart d'entre eux
leurs effets sur la santé ne sont pas étudiés. En
attendant, ils ont déjà largement pénétré
l'air, l'eau, le sol, les aliments et le corps humain.
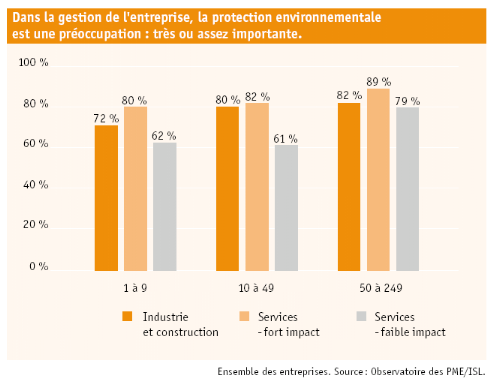
Les effets des principaux polluants sur l'organisme
humain
Ces dernières décennies, des risques nouveaux
pour la santé liés à la dégradation de
l'environnement sont apparus. Les interactions entre la santé des
français et leur environnement (impact de la pollution de l'air sur le
système respiratoire, pathologies cancéreuses liées
à l'exposition à certains produits,...) commencent à
être reconnues en matière de santé publique.
Selon le dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la
Population (FNUAP), la pollution atmosphérique fait trois millions de
victimes chaque année dans le monde. Les produits chimiques
synthétiques sont dénoncés comme notamment responsables de
troubles de la reproduction et de la fertilité.
Les hospitalisations sont plus nombreuses les jours de
pollution et selon une étude dijonnaise, le nombre d'infarctus du
myocarde s'accroît de 160% lorsque l'air est de mauvaise qualité
(travaux du Dr Yves Cottin, cardiologue au CHU de Dijon, communication de
Clotilde Royer, décembre 2003)
ü Le
manque d'eau potable
Au cours des 20 prochaines années, on s'attend
à une diminution d'un tiers, en moyenne, de l'eau disponible par
personne dans le monde (rapport mondial sur l'eau, 2003). Selon la
croissance de la population et les décisions politiques, les
pénuries d'eau concerneront, vers 2050, 7 milliards de personnes dans 60
pays (hypothèse haute) ou 2 milliards dans 48 pays (hypothèse
basse).
Alors que 40 % de la population mondiale est en pénurie
d'eau (26 pays) et 400 millions d'habitants en stress hydrique, 10 pays se
partagent 60 % des ressources mondiales.
De surcroît, plus de la moitié des cours d'eau
mondiaux sont grandement pollués.
Les villes, dont la population ne cesse de
croître, présentent une vulnérabilité face au
développement des épidémies et une sensibilité
accrue aux inondations. En 2000, 30% de la population mondiale est
urbaine et ce chiffre passera à 40% d'ici à 2010. Les villes de
plus de 10 millions d'habitants étaient 3 en 1950, 21 en 2000 (dont 17
dans des PVD) et elles seront 50 en 2025. Il y a donc urgence sanitaire :
- 1,1 milliards d'habitants n'ont pas accès à
l'eau en quantité suffisante
- 2,5 milliards d'individus vivent sans système
d'assainissement adéquat
- Plusieurs millions de personnes meurent chaque année
de maladies liées à l'eau dont la moitié sont des
enfants
En France, les eaux souterraines contribuent à
l'alimentation des sources et des cours d'eau, et leur rôle est essentiel
pendant l'été. Elles sont exploitées pour la consommation
humaine (eau potable), l'agriculture (irrigation) et l'industrie (eau
industrielle.
L'impact des activités agricoles sur la qualité
des eaux est la conséquence des pertes de fertilisants (engrais
chimiques, effluents d'élevages, aussi appelés engrais de ferme,
effluents agro-alimentaires et boues) et des produits de traitement des
cultures (produits phytosanitaires). Ces pollutions peuvent empêcher
certaines utilisations de l'eau, notamment son emploi pour l'alimentation
humaine et animale (eaux souterraines et superficielles), et entraîner
une dégradation des milieux aquatiques.
Quelle est et sera la capacité de la Terre à
supporter l'espèce humaine ?
Selon le WWF (chiffres 2002), le bilan global des
écosystèmes naturels fait état d'une diminution de 30% des
richesses naturelles de la terre, entre 1970 et 1995. Les forêts ont
perdu 12% de leur richesse biologique en trente ans... et les
écosystèmes marins, 30 %. Un milliard d'hectares de terres
autrefois cultivables ne le sont plus à cause des divers pesticides
déversés massivement... Les transports sont responsables de 70%
des émissions de gaz à effet de serre et des pics d'ozone. Or
plus de 500 millions de voitures dans le monde roulent à l'essence.
Pour rendre compte de ce constat alarmiste,
l'organisation écologiste parle d'
empreinte écologique.
C'est un mode de calcul qui permet de mesurer la part de ressources naturelles
utilisée par une population donnée. A l'échelle mondiale,
cette exploitation des ressources dépasse de 20% les capacités
biologiques de la terre.
Personne n'est capable de faire de prévision
sûre, mais le risque existe, il est élevé, et le principe
de précaution semble s'imposer.
1.2. Les Hommes et
leur qualité de vie
1.2.1. Le fossé Nord Sud
Le bilan humain et social s'est lui aussi aggravé ces
dernières années.
Sur les quarante dernières années, la fracture
entre pays riches et pays pauvres n'a cessé de s'approfondir. Les quatre
cinquièmes de la population mondiale vivent dans les pays dits " en voie
de développement ", dont un quart est acculé à une "
situation d'extrême pauvreté ", c'est-à-dire survit avec
moins de 1 dollar par jour et par personne.
La différence entre les plus pauvres et les plus riches
a ainsi doublé en 30 ans : les 20% les plus riches de la population
mondiale consomment aujourd'hui 86% des ressources tandis que les 20% les plus
pauvres n'ont à leur disposition que 1% de ces mêmes ressources.
Comme c'est le cas pour la destruction des
écosystèmes, le développement des échanges
commerciaux internationaux est montré du doigt comme en ont
témoigné les manifestations populaires à Seattle ou
ailleurs, lors des sommets de l'Organisation Mondiale du Commerce.
Le commerce est l'un des facteurs clef du
développement. Les pays sont de plus en plus dépendants du
commerce qui représente entre 1/3 et 1/4 des revenus nationaux des pays
du Sud. Si toutes les données étaient équitables, le
commerce international pourrait constituer pour les pays les plus pauvres un
moyen de créer des richesses, de générer des revenus (pour
les producteurs comme pour l'État), et de créer des emplois et
ainsi de réduire la pauvreté.
En réalité, la balance du commerce est loin de
pencher en leur faveur. Les pays les plus pauvres sont largement
marginalisés dans le commerce mondial. De 1960 à aujourd'hui, la
part des pays les moins avancés dans le commerce mondial est
passée de 2 à 0,5%. La part de l'Afrique est de 1,8% et continue
de diminuer. La mise en place des accords de l'Uruguay Round devrait rapporter
des revenus supplémentaires. Mais, d'après les estimations du
groupe des 77 pays en développement, les pays industrialisés qui
représentent 20% des membres du GATT devraient s'approprier 70% des
bénéfices générés...
Les pays les plus pauvres exportent généralement
des matières premières ou alimentaires, à faible valeur
ajoutée et au prix peu élevé et en baisse constante alors
qu'ils importent des produits transformés dont les prix sont en
augmentation régulière. Leurs balances commerciales sont donc
largement déficitaires.
De plus, la majorité des pays n'exportent qu'une ou
deux denrées (sucre, café, coton, vanille..), ce qui fragilise
leur économie et les rend totalement dépendants des fluctuations
du marché, des aléas climatiques. Plusieurs pays ont
commencé à diversifier leurs productions mais l'économie
de plus de la moitié des pays en développement dépend
encore d'une ou deux denrées principales.
Les entreprises multinationales sont présentes de
manière croissante dans les pays du Sud. On voit ainsi des marques
textiles faire les gros titres des journaux parce que leurs fournisseurs et
sous-traitants auraient eu recours, directement ou non, au travail des enfants
ou au travail forcé.
Mais ce n'est pas le seul mal qui touche les PVD et les pays
sous développés. Les principaux problèmes de ces pays
sont :
ü Le
travail des enfants
Selon le Bureau International du Travail, 1 enfant sur 8 dans
le monde, soit 179 millions, est exposé aux pires formes du travail, qui
se rapprochent de l'esclavage. De nombreuses organisations comme l'OIT et
l'Unicef, luttent pour éradiquer ce fléau. Le moyen le plus
efficace étant l'accès à l'éducation, les ONG
essaient de favoriser, pour les enfants plus âgés, une
scolarisation en alternance avec un travail dans des conditions
décentes.
ü La
sous-traitance dans les pays émergents
Dans le cas de l'industrie textile et du jouet en particulier,
les conditions de production instaurées dans des usines situées
dans des pays émergents en contrat avec des grandes marques mondiales
sont régulièrement dénoncées par les ONG. Pour
lutter contre l'existence des «sweatshops», les ONG tentent de
mobiliser les consommateurs occidentaux pour qu'ils renoncent à acheter
les produits qui y sont fabriqués. L'organisation actuelle de la
production au niveau mondial ainsi que la question de la responsabilité
du donneur d'ordre sur les conditions de travail chez ses
fournisseurs sont au coeur de la notion de responsabilité sociale
dans les secteurs concernés.
ü La
faim dans le monde
Les sommets internationaux et les appels à l'aide n'y
changent pas grand chose : 24 000 personnes meurent de faim chaque jour
et 800 millions de personnes dont 300 millions d'enfants, souffrent
toujours de la faim (chiffres ONU). L'aide au développement, sous toutes
ses formes, permet de lutter contre cet état de fait qui constitue l'un
des handicaps majeurs du développement durable dans les pays
pauvres.
ü La
santé
A peine 10% de la recherche médicale mondiale est
consacrée aux maladies qui concernent 90% de la morbidité
mondiale. Ce sont ce qu'on appelle les maladies négligées qui ne
sont pas prises en compte par l'industrie parce qu'elles affectent les
populations les plus pauvres de la planète.
Dans le cas du sida, le problème est plus celui de
l'inégalité de traitement entre les malades occidentaux et ceux
des autres continents, dont l'Afrique.
Selon l'Onusida, 42 millions de personnes vivaient avec le
virus du sida en 2002, et autant pourraient être infectées d'ici
à 2010. Partout où l'épidémie s'est propagée
sans contrôle, elle prive les pays des ressources et des capacités
dont dépendent leur sécurité et leur développement.
Dans certaines régions, le VIH/SIDA, associé à d'autres
crises, conduit des parts de plus en plus importantes de la population vers la
misère.
1.2.2. Climat social dans les pays
développés
Les problèmes en matière sociale ne concernent
pas uniquement le pays pauvres et en voie de développement.
Dans nos pays riches, dans les grandes villes, nombre
d'injustices font partie de notre quotidien et empêchent
l'épanouissement de chacun dans un contexte d'équité
sociale.
ü
Exclusion sociale
La misère existe aussi dans nos pays
développés.
« 1 million d'enfants vivent sous le seuil
de pauvreté en France » : voici l'information
principale martelée les 17 et 18 février 2004 sur toutes les
chaînes TV et radio.
Sa manifestation la plus flagrante est l'augmentation
constante du nombre de sans abris (il n'y a pas de recensement
précis, mais il suffit de prendre les transports en commun à
Paris pour s'en rendre compte). Il y a de multiples causes à ce
phénomène, mais la plus récente et la plus effrayante est
celle de la spirale qui suit la perte d'un emploi, viennent alors le
chômage de longue durée, l'impossibilité de payer ses
traites, conjugué à l'absence de famille à même de
les aider, ils sont exclus du système.
D'autres exclus du système sont les
chômeurs de longue durée qui vivent avec le
RMI.
Mais les femmes aussi rencontrent des
difficultés dans le milieu du travail:
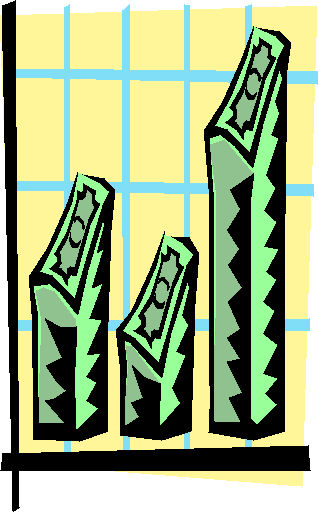 Manque
de flexibilité des entreprises en ce qui concerne l'aménagement
du temps et du lieu de travail, ce qui pénalise particulièrement
les mères de famille occupant des postes à
responsabilité Manque
de flexibilité des entreprises en ce qui concerne l'aménagement
du temps et du lieu de travail, ce qui pénalise particulièrement
les mères de famille occupant des postes à
responsabilité
 Discriminations salariales, favorisées par l'absence de grilles de
salaire ou de normes objectives permettant les comparaisons
Discriminations salariales, favorisées par l'absence de grilles de
salaire ou de normes objectives permettant les comparaisons
 Discriminations en matière de promotion ; on barre l'accès
des femmes aux échelons les plus élevés de la
hiérarchie
Discriminations en matière de promotion ; on barre l'accès
des femmes aux échelons les plus élevés de la
hiérarchie
 Préjugés négatifs, subtils mais réels, concernant
la reconnaissance des compétences ou les pressions relatives au choix de
fonder une famille.
Préjugés négatifs, subtils mais réels, concernant
la reconnaissance des compétences ou les pressions relatives au choix de
fonder une famille.
Et enfin, les personnes handicapées
sont aussi exclues de l'emploi, bien qu'elles soient souvent capables
d'effectuer certaines tâches normalement. Mais à choisir, et
malgré les subventions, les entreprises préfèrent
embaucher des personnes « valides ».
ü
Multiplication des plans sociaux
Les restructurations à grande échelle
observées en Europe suscitent des inquiétudes chez l'ensemble des
salariés et autres parties prenantes, car la fermeture d'une entreprise
ou des suppressions massives d'emplois peuvent provoquer une crise
économique, sociale ou politique grave dans une communauté. Peu
d'entreprises échappent à cette nécessité de
restructurer, qui prend souvent la forme d'une réduction des effectifs;
au cours de l'année 2000, le nombre de fusions et d'acquisitions a
atteint un niveau historique. Il apparaît que peu de restructurations
atteignent leurs objectifs et parviennent à réduire les
coûts, augmenter la productivité et améliorer la
qualité et le service à la clientèle, car elles sont
souvent préjudiciables à la motivation, à la
loyauté, à la créativité et à la
productivité du personnel (source : Livret vert de la
Commission européenne).
« Depuis quelques mois, les licenciements
économiques, les fermetures d'usine, de sites se multiplient et
n'épargnent aucune région » accusent des militants de
gauche début 2003 en France. Nombre d'exemples de suppression d'emplois
au journal de 20 h sont là pour étayer leurs accusations envers
les patrons :
- 13 000 emplois à France Télécom dont 7
500 en France
- 3 500 emplois à Air Lib sans compter les emplois dans
les entreprises sous-traitantes du bassin d'emploi d'Orly
- 830 emplois à Metaleurope
- 170 emplois à Daewoo en Lorraine
- DANONE a annoncé la fermeture anticipée des
usines LU de Ris-Orangis (416 salariés) et de Calais (247
salariés).
Ces licenciements sont très médiatisés en
raison de la forte mobilisation des salariés. Mais beaucoup
d'entreprises non médiatisées continuent à mettre la
clé sous la porte. Au 1er semestre 2002, près de 23
000 sociétés ont déposé leur bilan, soit une
augmentation de 12,7 % par rapport à la même période de
l'année précédente et tous les secteurs sont
touchés. Cela s'est traduit par une augmentation considérable du
nombre de salariés inscrits à l'ANPE après un licenciement
économique : 55 000 sur les 200 000 nouveaux inscrits.
Ces restructurations, la manière dont les dirigeants
communiquent (ou pas) sur les raisons de ces restructurations, et les
manifestations qu'il y a autour, créent un climat de conflit entre les
« travailleurs » et les entreprises et un sentiment
d'insécurité chez les salariés.
ü
Inhospitalité du lieu de travail
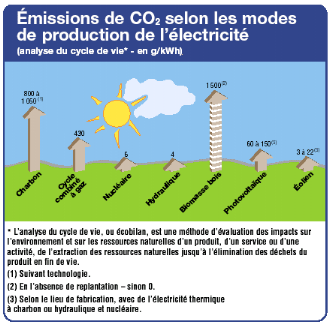
Stress des managers
Selon une enquête en ligne réalisée par Le
Journal du Management, la majorité des managers estiment supporter un
niveau de pression élevé dans le cadre de leur travail.
(novembre 2003)
Les causes de ce stress sont, aux yeux des lecteurs,
principalement de trois natures : les objectifs à respecter
(32,3 %), l'ambiance générale de l'entreprise (27,6 %)
et le rythme de vie globale (20,2 %). On notera que dans la
catégorie "autres", trois causes sont évoquées de
façon répétitive : le manque de reconnaissance, le
manque d'équité et le style de management.
Face à cette pression, la majorité des lecteurs
admettent que les conséquences sont multiples. Largement en tête,
s'installent les erreurs commises dans le travail (43,8 %). Le besoin de
récupération par des jours de repos (24,9 %) ou les
velléités de mobilité interne et externe (21,5 %)
apparaissent également comme des effets non négligeables. Enfin,
dans la catégorie "autres", de multiples conséquences sont
spontanément citées par les participants. On retiendra notamment
la baisse de productivité, la démotivation, la déprime,
l'agressivité ou encore la perte de sommeil. Autant de maux qui
confirment le poids du stress dans l'univers professionnel.
Cette enquête n'a qu'une valeur indicative, mais ce qui
est particulièrement intéressant, ce sont les réponses
faites spontanément dans la partie « autres ». Il en
ressort une mise en cause directe du management (reconnaissance,
équité, style de management). Parmi les conséquences,
l'impact sur l'entreprise est évident (la baisse de productivité,
la démotivation, la déprime ... ne sont pas des conditions
idéales pour le bon fonctionnement de l'entreprise).
Le stress n'est pas l'apanage des cadres, chaque maillon de
l'entreprise y est plus ou moins soumis, et cela constitue tant un
coût pour la collectivité (prise en charge des soins et
arrêts de travail) que pour l'entreprise (baisse de la
productivité, mauvaise qualité du service, arrêts du
travail...)
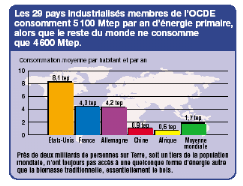 Harcèlement moral, violences...
Harcèlement moral, violences...
Selon le rapport du Bureau international du Travail (BIT), qui
représente l'étude la plus approfondie jamais
réalisée au niveau mondial sur la violence sur le lieu de
travail, celle-ci provient d'un ensemble de causes qui inclut l'individu, le
milieu et les conditions de travail, les rapports entre employés, les
rapports entre ces derniers et les clients et, enfin, les rapports entre la
direction et les employés.
Les différentes études réalisées
ces dernières années ont permis d'apporter de nouvelles preuves
de l'impact et du préjudice causés par la violence non physique,
à laquelle on se réfère souvent sous le terme de
violence psychologique et qui englobe le comportement abusif
ou tyrannique vis-à-vis d'un subalterne ou d'un pair ainsi que le
harcèlement psychologique exercé par le groupe à
l'encontre d'un individu (cf. 2 types de violences au travail en Annexe 4).
«Le concept de la violence au travail est en train d'évoluer en ce
sens que l'on accorde désormais autant d'importance aux comportements
psychologiques qu'aux comportements physiques et que l'on reconnaît
pleinement la portée des actes de violence secondaires,» explique
Vittorio Di Martino, coauteur du rapport du BIT.
La violence sur le lieu de travail a un
coût : elle provoque une rupture immédiate et
souvent durable dans les relations interpersonnelles, dans l'organisation du
travail et dans le milieu de travail pris dans son ensemble, précise le
rapport. Les employeurs assument le coût direct du travail perdu et des
améliorations sur le plan de la sécurité, mais la violence
génère aussi des coûts indirects, tels que la baisse de
l'efficacité, de la productivité et de la qualité des
produits, la détérioration de l'image de marque de l'entreprise
et la diminution de la clientèle. En Allemagne, le coût direct de
la violence psychologique dans une entreprise de 1 000 employés a
été estimé à 112.000 dollars (équivalent en
euros) par an, auxquels viennent s'ajouter 56.000 dollars en coût
indirects.
En France, un état des lieux a été
dressé par IPSOS en juin 2000. Il montre que 30% des
salariés français déclarent subir un harcèlement
moral au travail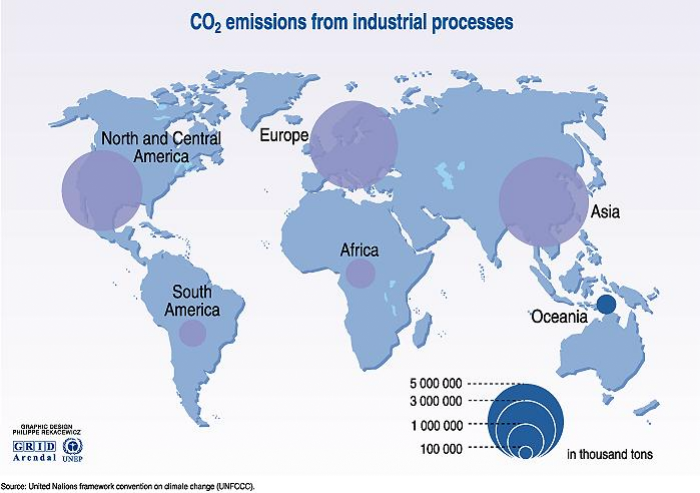 . .
Longtemps "tabou", le thème du harcèlement moral
sur le lieu de travail est aujourd'hui considéré comme un
réel problème, omniprésent au sein du monde de
l'entreprise
Selon cette enquête, trois salariés sur dix ont
le sentiment d'avoir déjà été l'objet de
harcèlement moral sur leur lieu de travail, c'est à dire d'avoir
été l'objet de conduites abusives, qui se sont manifestées
notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des
écrits répétés, pouvant porter atteinte à
leur personnalité, à leur dignité ou à leur
intégrité physique et psychologique, mettant en péril leur
emploi ou dégradant le climat social. Par ailleurs, plus du tiers des
salariés français (37%) disent avoir été
témoin du harcèlement moral d'un collègue. Pour une forte
majorité d'entre eux, les brimades sont multiples,
répétées et systématiques.
Ce phénomène est donc assez répandu et
constitue un méfait pour tous les acteurs de la société.
L'entreprise elle-même est une des plus grandes victimes à long
terme car ces violences entraînent une rupture de la nécessaire
confiance des salariés en leur entreprise.
Dans le contexte actuel de crise économique,
lié particulièrement à une crise de l'emploi, le climat
social est tendu. Traditionnellement reprochée à l'Etat, la
mauvaise conjoncture commence à être attribuée par
l'opinion publique à l'irresponsabilité des entreprises en
matière sociale.
Pour récapituler, 30% des richesses naturelles de la
planète ont disparu en 25 ans ; chaque jour, nos voitures, nos usines,
nos maisons consomment une quantité d'énergie que la
planète a mis 10 000 jours à créer ; chaque année,
une surface de forêts équivalente à la moitié de
l'Italie et une surface de terres arables égale à la
totalité des champs de blé en Australie disparaissent de la
surface du globe ; sur six milliards de personnes, un milliard est sans emploi
et un autre milliard vit dans une extrême pauvreté (sources :
rapport "Planète Vivante" du WWF et "The Ecology of Commerce" de P.
Hawken).
La grogne sociale se fait de plus en plus pressante. Beaucoup
de citoyens prennent conscience de tous les problèmes
développés plus haut, et leur « envie
d'agir » se fait de plus en plus impérieuse (cf. chanson en
Annexe 5)
Au-delà de la menace de l'espèce
humaine, le déclin des écosystèmes et les problèmes
sociaux concernent toutes les entreprises de tous les secteurs
économiques. En effet, elles fondent leur activité sur
la consommation de ressources dont elles ont souvent pris l'habitude de
considérer qu'elles étaient inépuisables alors que
certaines sont d'ores et déjà quasi épuisées. Quant
à un mauvais contexte social, en interne, il peut freiner le
développement de l'entreprise, et à l'externe, lui interdire des
débouchés.
Pour inverser cette tendance et passer à un
développement durable, l'action de tous (entreprises,
collectivités locales et citoyens) à tous les niveaux
(international, national et local) est nécessaire.
2. Le DD : une nouvelle chance pour l'avenir
2.1.
Définitions : DD et termes associés
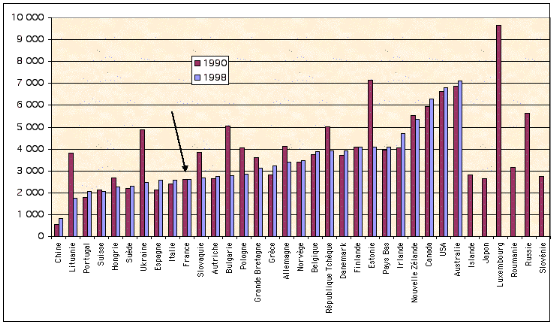
Le Développement Durable
Le développement durable (anglais : sustainable
development) est un concept relativement récent (cf. historique en
Annexe 6). Contrairement à ce que l'on croit généralement,
il ne se limite pas à une prise de conscience écologique, mais
vise à instaurer un meilleur équilibre entre les dimensions
économique, sociale et environnementale.
En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le
développement - également connue sous le nom de Commission
Brundtland - a donné du développement durable la
définition suivante:
« Un développement qui permette aux
générations présentes de satisfaire leurs besoins sans
remettre en cause la capacité des générations futures
à satisfaire les leurs »
Depuis lors, la notion de développement durable (ou de
durabilité) est devenue synonyme de recherche d'un nouvel
équilibre entre développement et rentabilité
économique, équité sociale et
respect de l'environnement, le tout dans une dynamique
de progrès.
Les Profits
Le Progrès
La Planète
Les Personnes
La double ambition du développement durable est de
faire de la rentabilité économique un moyen de
développement au service des personnes et remédier aux
déséquilibres générés par nos modes de
consommation.
Une activité est dite «durable» si elle peut
se prolonger ou se répéter sur le long terme. Ceci implique que
le capital de ressources qui l'alimente ne soit ni épuisé, ni
dégradé de manière irréversible.
Concrètement, le développement durable pose la
nécessité de maintenir ou d'améliorer la qualité de
l'environnement naturel, d'assurer la pérennité des ressources,
de réduire les différences de niveau de vie des populations dans
le monde, de favoriser l'autosuffisance des communautés, et de permettre
le transfert des connaissances ou des richesses (y compris les richesses
naturelles) d'une génération à l'autre. Le tout, en
favorisant le dialogue et la participation des populations aux décisions
qui les concernent.
Il implique aussi la participation de tous les acteurs
à la prospérité économique. Les entreprises peuvent
oeuvrer en ce sens en promouvant le rôle de la femme, en facilitant
l'accès au monde du travail pour les jeunes, en favorisant
l'intégration des personnes handicapées et en encourageant la
diversité au sein de leur personnel.
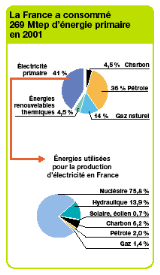 La Responsabilité Sociale et Environnementale des
entreprises
La Responsabilité Sociale et Environnementale des
entreprises
La notion de Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE) est liée à l'application aux entreprises du concept
de développement durable. La RSE (CSR, Corporate Social
Responsability , en anglais, `social' est un terme plus large que l'on traduit
souvent par « sociétal ») signifie qu'une entreprise
doit non seulement se soucier de sa rentabilité et de sa croissance,
mais aussi de ses impacts environnementaux et sociaux. Elle doit aussi
être plus attentive aux préoccupations de ses parties prenantes
("stakeholders").
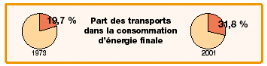 les Parties prenantes
les Parties prenantes
Une entreprise ayant une politique de RSE tient compte de
l'ensemble de ses partenaires économiques et sociaux. Les
salariés, les clients et fournisseurs, mais aussi les organisations non
gouvernementales (ONG) ou les collectivités locales et les riverains ont
un intérêt plus ou moins direct dans la vie de l'entreprise dont
ils constituent les parties prenantes ou stakeholders, en anglais (cf. Annexe
7). Les actionnaires (shareholders, en anglais) sont un type particulier de
partie prenante puisqu'ils sont directement intéressés par les
résultats économiques de l'entreprise. Quant aux
générations futures, elles trouveront leur intérêt
dans la politique à long terme de l'entreprise.
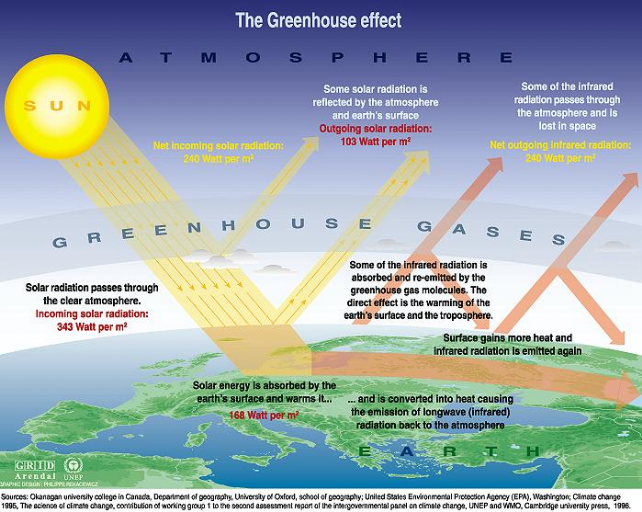 La citoyenneté d'entreprise
La citoyenneté d'entreprise
Le principe fondateur de la citoyenneté d'entreprise
est que, pour développer une activité économique
durablement prospère, l'entreprise doit placer son activité dans
une spirale vertueuse où l'entreprise se fait du bien en faisant du bien
autour d'elle, à l'ensemble de ses publics.
Cependant le terme d'entreprise "citoyenne" peut aujourd'hui
sembler un peu galvaudé car il renvoie à une
réalité large et différente selon celui qui
l'emploie : il désigne ainsi parfois des initiatives de
type fondation ou mécénat, par définition
extérieures à l'activité de l'entreprise, et
d'autres fois une manifestation de l'intégration des principes du
développement durable, car l'entreprise fonctionne et interagit
quotidiennement avec ses environnements.
 Le commerce éthique
Le commerce éthique
Il consiste à pousser les entreprises de la grande
distribution à introduire (pour un nombre croissant de produits) des
critères d'amélioration tenant compte des conditions de travail
des producteurs et à assurant une garantie d'équité
sociale aux consommateurs.
Il ne s'agit pas de modifier l'ensemble du
fonctionnement de l'entreprise mais de la pousser à modifier certaines
pratiques concernant des produits particuliers.
Cette approche est celle du collectif de l'éthique sur
l'étiquette qui travaille particulièrement sur les
vêtements, les chaussures et le matériel scolaire. Ce collectif a
élaboré un code de conduite qui fait référence aux
principales conventions élaborées par l'Organisation
Internationale du Travail (OIT).
Ces conventions définissent les normes sociales
minimales dont doivent bénéficier tous les travailleurs. Pour
cela, les acteurs du commerce éthique réfléchissent
à la mise en place d'un "label social" qui garantirait les conditions de
fabrication des produits. Le code de conduite constitue une garantie pour les
consommateurs qui cherchent de plus en plus à acheter des produits
fabriqués dans des conditions socialement convenables.
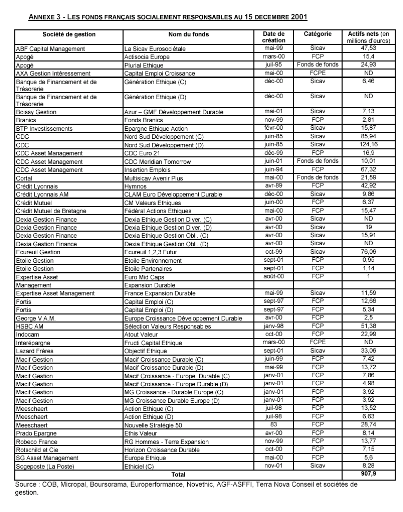 Commerce équitable
Commerce équitable
Né dans les années 60, le mouvement du commerce
équitable est le fruit d'une volonté : établir des
rapports commerciaux égaux entre les différents acteurs du
commerce mondial, en permettant aux petits producteurs de vivre dignement de
leur travail. Aujourd'hui, le commerce équitable contribue au revenu de
5 millions de personne à travers le monde*.
Les labels de commerce équitable servent à
insérer dans le système classique des produits importés
selon les critères du commerce équitable à travers des
filières particulières et labellisées.
En passant par la grande distribution l'objectif est, d'une
part, de toucher un maximum de consommateurs et par conséquent de
soutenir le développement de producteurs et d'autre part de participer
à changer le système de l'intérieur.
En France, une seule organisation est engagée dans
cette démarche. Il s'agit de l'association Max Havelaar qui promeut le
label du même nom.
2.2. Le
Développement Durable : valeur montante de la
société
2.2.1. Sur le plan politique :
ü Au
niveau international

Sommet de Rio
En 1992, la Conférence de Rio sur l'environnement et le
développement a été un progrès sans
précédent à l'échelle mondiale : à partir
des constats alarmants sur l'état de la planète et
l'évolution des conditions de vie sur Terre.
*Pour un commerce équitable, RITIMO /
SOLAGRAL, Editions Charles Léopold Mayer, Paris, 1998.
178 nations y ont élaboré un programme commun
pour le 21ème siècle, plus connu sous le nom d'Agenda 21.
Il liste une série d'actions devant être
intégrées aux législations nationales de manière
prioritaire pour progresser vers un développement durable.
L'Agenda 21 s'articule autour de 4 pôles majeurs et
interdépendants :
· L'économie
· L'environnement
· Le social
· L'éthique et le dialogue social
Malgré l'enjeu de l'Agenda 21 qui était
d'assurer la mise en application du développement durable dans des
actions concrètes et l'appropriation de ses impératifs par tous
les acteurs économiques (états, collectivités locales,
entreprises et citoyens), la conclusion 10 ans après Rio fut que les
intentions ne s'étaient pas concrétisées en actions.
 Conférence de Kyoto
Conférence de Kyoto
En 1997, la Conférence de Kyoto sur le
réchauffement de la planète a réuni 159 pays. Des accords
ont été passés pour une réduction moyenne de 5,2%
des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2010.
Les pays en voie de développement sont dispensés
de cette contrainte et la mise en place de "permis de polluer" a
été renvoyée au prochain sommet. Ce sommet a eu pour vertu
de créer un cadre institutionnel et certains résultats
méritent d'être soulignés, comme l'interdiction
quasi-générale de jeter des déchets en mer.
Mais en 1998, la conférence de Buenos Aires s'est
achevée sur un bilan globalement décevant. En définitive,
aucune décision sur la manière de mettre en pratique les accords
de Kyoto n'a été prise. Les discussions d'experts se sont
enlisées, les divergences entre pays pauvres et pays riches se sont
creusées et l'objectif de réduction des émissions globales
de gaz à effet de serre (GES) à l'horizon 2010 semble aujourd'hui
bien difficile à atteindre.
 Sommet de Johannesburg
Sommet de Johannesburg
Lors du Sommet mondial sur le développement durable
(Johannesburg, 26 août - 4 septembre 2002), une déclaration
politique et un plan de mise en oeuvre ainsi que plusieurs initiatives de
partenariat ont été adoptés. Parmi les objectifs du plan
de mise en oeuvre:
· Mettre en oeuvre, à partir de 2005, les
stratégies nationales de développement durable.
D'autres accords atteints lors du sommet
visent à:
· Accroître la part globale des énergies
renouvelables et augmenter l'accès des plus pauvres à
l'énergie ;
· Elaborer un cadre décennal de programmes d'appui
des modes de production et de consommation durables ;
· Faire en sorte que le protocole de Kyoto entre en
vigueur le plus rapidement possible ;
· Encourager une réforme des subventions ayant des
effets négatifs sur l'environnement ;
Pour mettre ces accords en oeuvre, ainsi que pour coordonner
leur suivi, des partenariats (dits de type II) entre les gouvernements, le
secteur privé et les organisations non gouvernementales ont
été annoncés.
ü Au
niveau européen

Stratégie de l'UE pour le Développement
durable
La transition vers un développement plus durable est un
des objectifs stratégiques de l'Union européenne.
En juin 2001, le Conseil européen de Göteborg a
discuté d'une stratégie proposée par la Commission
européenne en faveur du développement durable.
 Livret Vert
Livret Vert
La Commission européenne s'est mobilisée en
faveur du développement durable en lançant en juillet 2001 un
Livre Vert intitulé "Promouvoir un cadre européen pour la
responsabilité sociale des entreprises". Il préconise un
renforcement de la responsabilité sociale des entreprises en Europe, et
s'inscrit en droite ligne avec la stratégie européenne en faveur
du développement durable. Ce document pose quelques principes
généraux tels l'intégration, le reporting ou encore
l'attitude volontaire des entreprises.
 Le marché européen des droits à polluer en
2005:
Le marché européen des droits à polluer en
2005:
Le Conseil des ministres européens a adopté en
décembre 2002 une directive prévoyant le lancement d'un
marché des gaz à effet de serre en 2005 qui s'accompagnera de
quotas pour les usines polluantes.
Cette directive a été adoptée en vue de
la création d'un marché international en 2008 en vertu du
protocole de Kyoto. L'Union européenne s'est engagée à
réduire, entre 2008 et 2012, ses émissions de gaz à effet
de serre de 8% par rapport à 1990. Des objectifs ont été
assignés à chaque pays membre en fonction des différentes
situations économiques : la France est tenue de revenir au niveau
de 1990.
Dans le cadre de cet accord environ 4 000 à 5 000
établissements européens vont se voir assigner des niveaux
d'émissions à respecter. Ces quotas seront fixés par
chaque gouvernement.
Par rapport à ces quotas, trois solutions
s'offriront aux entreprises :
- Réaliser des investissements leur permettant de
produire en respectant les quotas ;
- Acheter des permis de gaz à effet de serre à
d'autres entreprises qui sont en dessous de leurs quotas ;
- Ne pas respecter les quotas et se soumettre à des
pénalités extrêmement dissuasives.
ü Au
niveau français

Ministère de l'écologie et du
Développement Durable (l'extension développement durable a
été ajoutée en 2001)
Ce ministère a mis en place deux nouveaux
organismes : le CNDD (Le Conseil National du
Développement Durable) qui se substitue au Comité français
pour le sommet mondial du développement durable, et
le CIDD (Le comité
interministériel pour le développement durable) qui se
substituera à trois instances existantes : le comité
interministériel de l'environnement (CIEN), la commission
interministérielle de lutte contre l'effet de serre (CIES) et le
comité interministériel de prévention des risques naturels
majeurs (CIPRNM).
 Stratégie nationale du DD
Stratégie nationale du DD
La Stratégie nationale de développement durable
a été adoptée lors de la première réunion du
CIDD qui s'est tenue le 3 juin 2003, pendant la semaine nationale du
développement durable. Elle s'articule avec la stratégie
européenne de développement durable adoptée en 2001, et se
veut « résolument tournée vers l'action pour les
prochaines années » (Comité Interministériel
pour le Développement Durable 3 juin 2003).
C'est un document qui mélange déclarations de
principes et objectifs précis que se fixe l'Etat, notamment en
matière de réduction de la consommation d'eau, d'émission
de GES et d'achat de voitures propres.
2.2.2. Sur le plan normatif
ü La
norme SA 8000 :
L'élaboration, en 1997, du standard Social
Accountability 8 000 (SA 8 000), par l'ONG américaine Council for
Economic Priorities (CEP), en partenariat avec des grandes entreprises, des
syndicats et des universitaires, est la principale initiative en
matière sociale.
Cette norme s'appuie sur les conventions de l'OIT, la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la Convention des
Nations Unies sur les droits des enfants, pour définir un management
socialement responsable.
Elle couvre neuf champs essentiels : le travail des enfants,
le travail forcé, l'hygiène et la sécurité, la
liberté syndicale et le droit de négociation collective, la
discrimination, les pratiques disciplinaires, le temps de travail et les
rémunérations. La norme SA 8 000 peut être
recherchée par les entreprises pour garantir le respect des droits
fondamentaux des travailleurs dans l'ensemble du monde. Le champ d'application
de la SA8000 concerne l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée
d'une entreprise, de ses fournisseurs et sous-traitants jusqu'au service
après-vente. Des entreprises, comme Reebok ou Toys'R Us,
indépendamment des pratiques sociales reconnues légalement dans
les pays en développement où elles sont installées, ont,
d'ores et déjà, adopté cette norme.
ü La
norme ISO 14001
La norme ISO 14001 spécifie les démarches que
doit entreprendre l'entreprise pour mettre en place un système de
management environnemental.
Publiées en 1996, les normes ISO 14000 tendent à
se généraliser au sein du monde de l'entreprise et des services,
de plus en plus de grandes entreprises exigeant de leurs fournisseurs
l'adoption de ce standard de qualité environnementale.
La norme ISO 14001 est une démarche volontaire de
l'entreprise, permettant la gestion des impacts de son activité sur
l'environnement, qui l'engage sur trois principaux points : la
prévention de la pollution, l'amélioration continue et la
conformité réglementaire.
Au printemps 2003, le nombre d'organisations certifiées
AFAQ ISO 14001 atteint le millier.
ü Le
règlement européen EMAS - Eco-Audit
EMAS signifie « Environmental Management and Audit Scheme
». EMAS, également appelé Eco-Audit est un règlement
européen fournissant des lignes de conduite à toute organisation
désirant gérer l'environnement sur une base volontaire. EMAS est
applicable uniquement en Europe.
L'organisme enregistré EMAS doit produire une
déclaration environnementale reprenant les résultats du
système et les objectifs futurs, chiffres à l'appui. Cette
déclaration doit être certifiée par un vérificateur
agréé, et être renouvelée tous les trois ans. Cette
déclaration est en fait un outil efficace de communication vers
l'extérieur, qui prouve la bonne foi et les efforts de l'entreprise de
manière indiscutable. La conformité légale de l'organisme
est exigée pour l'enregistrement.
Le nombre de sites enregistrés selon le
règlement EMAS en France est de quelques dizaines.
2.2.3. Sur le plan financier :
ü
Investissement Socialement Responsable (ISR)
Lancé au début du siècle par des
communautés religieuses aux Etats Unis, l'investissement
"éthique" ou responsable est sorti de l'ornière alternative avec
le lancement fin 1999, par la très classique firme Dow Jones, d'un
indice boursier spécialisé sur les entreprises leaders en
matière de développement durable.
L'ISR peut prendre 3 formes principales :
 Les fonds socialement responsables ou de développement
durable : ils intègrent des critères sociaux et
environnementaux d'évaluation d'une entreprise cotée qui sont
croisés avec des critères financiers pour sélectionner les
compagnies les plus performantes d'un point de vue développement
durable.
Les fonds socialement responsables ou de développement
durable : ils intègrent des critères sociaux et
environnementaux d'évaluation d'une entreprise cotée qui sont
croisés avec des critères financiers pour sélectionner les
compagnies les plus performantes d'un point de vue développement
durable.
 Les fonds d'exclusion : plus répandus dans les pays
anglo-saxons, ils excluent, pour des raisons morales ou religieuses, certains
secteurs comme l'armement, le jeu, le tabac...
Les fonds d'exclusion : plus répandus dans les pays
anglo-saxons, ils excluent, pour des raisons morales ou religieuses, certains
secteurs comme l'armement, le jeu, le tabac...
 L'engagement actionnarial : il consiste, pour les investisseurs,
à exiger des entreprises une politique de responsabilité sociale
plus forte par un dialogue direct, mais aussi par l'exercice des droits de vote
en assemblées générales.
L'engagement actionnarial : il consiste, pour les investisseurs,
à exiger des entreprises une politique de responsabilité sociale
plus forte par un dialogue direct, mais aussi par l'exercice des droits de vote
en assemblées générales.
En 2003, le marché de l'ISR en France
pèse près de 2 milliards d'euros
(3 milliards si on
inclut les fonds étrangers) soit un peu moins d'1% des fonds que
distribuent les banques aux investisseurs institutionnels et particuliers. Ceci
dit, il est en forte progression. Le nombre de fonds a été
multiplié par plus de deux, entre fin 2001 et septembre 2003, et les
montants investis, eux, ont été multipliés par cinq, entre
99 et 2003.
L'Investissement Socialement Responsable se développe
parce qu'un certain nombre de financiers ont acquis la conviction que
la prise en compte de critères sociaux et environnementaux permet de
mieux identifier les sociétés performantes, à moyen et
long terme.
En effet, le monde financier prend, lentement mais
sûrement, conscience des effets vertueux des stratégies de
développement durable pour anticiper les contraintes et prévenir
les risques (sociaux, écologiques, juridiques, d'image, etc.), pour
réduire les coûts liés à la consommation de
ressources ou à la production de déchets, pour innover et se
différencier sur le marché, ou encore pour attirer puis
fidéliser employés et clients, etc.
ü
Agences de notation sociale et environnementale
Créées à la fin des années 90 et
au début des années 2000, les agences de rating social et
environnemental évaluent et notent la politique de responsabilité
sociale et environnementale des entreprises. Elles travaillent pour des
investisseurs, à partir d'analyses des documents publics, de
questionnaires spécifiques, et de rencontres avec des responsables
d'entreprises. Chacune a sa propre méthodologie ce qui ne simplifie pas
le travail de réponse des entreprises et la comparaison entre leurs
différentes notes. (Cf. Agences remarquables sur le
plan international en Annexe 8)
En France, il existe une dizaine de structures proposant leurs
services d'évaluation des politiques sociale et environnementale des
entreprises soit aux investisseurs soit aux entreprises elles-mêmes dans
une démarche d'audit. Deux d'entre elles sont des agences à part
entière :
Vigeo
Dirigée par Nicole Notat, Vigeo a été
créée en juillet 2002, et a absorbé Arese, première
organisation française de ce type, créée en 97. Ses
actionnaires sont à la fois des entreprises, des syndicats et des
institutions financières parmi lesquels on compte la Caisse des
dépôts et les Caisses d'Epargne. Vigeo dispose de 15
analystes et 6 auditeurs. Cette agence propose du rating développement
durable "classique" (vendu aux investisseurs) et de la notation
sollicitée (réalisée pour les entreprises à leur
demande).
Core Ratings
Financée par Fimalac, holding propriétaire de
l'agence de notation financière Fitch, Core Ratings a été
créée en octobre 2002. L'agence franco-anglaise compte 22
analystes spécialisés. Croisant l'expertise développement
durable et la rigueur de l'analyse financière, la méthodologie de
Core Ratings repose sur une analyse des risques économiques, sociaux et
environnementaux liés au secteur d'activité des entreprises
étudiées. Le bureau français est dirigé par
Geneviève Ferone, fondatrice d'Arese.
ü Les
indices boursiers
Le premier indice composé des valeurs cotées les
mieux notées sur un plan social et environnemental, a été
lancé aux Etats-Unis, au début des années 90, par le
cabinet KLD. Depuis, les principales agences de notation ont construit le leur,
souvent en partenariat avec les indices boursiers classiques.
Aujourd'hui, on compte au moins 8 indices, dits
«éthiques» aux Etats-Unis*. Ils sont plus ou moins
utilisés et connus de la communauté financière. La
composition de chacun d'entre eux est liée à la
méthodologie de l'agence qui en est à l'origine. Ils n'appliquent
donc pas les mêmes critères de sélection d'où la
difficulté de les comparer entre eux.
En France, selon Novethic, les 60 fonds dits socialement
responsables recensés représentaient, fin octobre 2002, 1,038
milliards d'euros d'encours, soit environ 1 % des OPCVM-actions. Le total de
l'actif des investissements socialement responsables (ISR) a avoisiné,
en Europe, 34 milliards d'euros en 2000. Aux Etats-Unis, « l'activisme
actionnarial », pratique consistant à utiliser les droits de
vote liés à la détention d'actions pour proposer des
orientations aux assemblées générales, a été
la clef de voûte de l'investissement socialement responsable.
Effet induit de cet activisme, les 200 fonds éthiques
(fonds de pension, fondations, organisations religieuses et institutions
financières de développement communautaire) sont passés de
1 185 milliards de $ en 1997 à 2 160 milliards de $ aujourd'hui,
soit environ 13 % des actifs gérés professionnellement.
En France, avec plus d'une douzaine de fonds
éthiques nouveaux créés en un an, l'offre se diversifie de
plus en plus (Cf. Tableau en Annexe 9). Mais, sur les dix plus
importants fonds socialement responsables dans le monde, on ne compte,
cependant, pas d'investisseur français.
2.2.4. Sur le plan
économique : entreprises engagées
Certaines entreprises ont été fondées sur
les principes du développement durable bien avant que ce dernier ne
devienne un objectif mondial.
Elles ont été crées par des hommes et des
femmes visionnaires. Ils sont maintenant à la tête de ces
entreprises exemplaires dont les bonnes pratiques sont des modèles pour
les grandes entreprises qui ont du s'y mettre plus récemment (cf. 2
exemples de bonnes pratiques de grandes entreprises en Annexe 10)
* Aspi Eurozone, Calvert Social Index, Domini 400, Dow Jones
Sustainability Index, Ethibel Social Index, FTSE4Good, Jantzi Social Index,
MS.SRI
 Nature & Découvertes
Nature & Découvertes
Créée en 1990 par François Lemarchand,
Nature & découvertes compte aujourd'hui plus de 57 magasins,
destinés à "tous ceux qui ont le désir de comprendre le
monde naturel et d'en apprécier les bienfaits". L'enseigne propose des
produits respectueux de l'environnement, souvent réalisés par des
artisans-créateurs, ainsi que des actions pédagogiques
variées (animations, ateliers et conférences et portail Internet
naturaliste), souvent animées par ses équipes. Enfin, l'enseigne
consacre 10% de ses profits à sa Fondation, qui finance des projets de
connaissance et de protection de la nature.
 Utopies
Utopies
Reconnue comme "l'agence pionnière dans le conseil en
développement durable" (Enjeux/Les Echos, Oct. 2001), Utopies a pour
mission, depuis sa création en 1993, de promouvoir la
responsabilité sociale et environnementale auprès des
entreprises. 1ère agence de conseil en matière de
Développement Durable, le credo d'Utopies est qu'une entreprise ne vit
bien que dans un cercle vertueux où elle prospère en contribuant
à la prospérité de ses environnements. Utopies est
notamment à l'origine de nombreux rapports développement durable
de grands groupes (Lafarge (2000 et 2002), Carrefour (2001 et 2002), Michelin
(2002) et Castorama (2001), le rapport Environnement 2002 de France
Télécom...)
2.2.5. Sur le plan juridique :
 Le
Code de l'environnement : En France, depuis le 21 septembre 2000, tous
les textes de loi sont regroupés dans le Code de l'environnement. En
près de mille articles, le Code de l'environnement reprend tout ou
partie d'un ensemble de 39 lois précédemment dispersées,
sur : Le
Code de l'environnement : En France, depuis le 21 septembre 2000, tous
les textes de loi sont regroupés dans le Code de l'environnement. En
près de mille articles, le Code de l'environnement reprend tout ou
partie d'un ensemble de 39 lois précédemment dispersées,
sur :
§ la protection de la nature ;
§ la qualité de l'air et de l'eau ;
§ les industries et les activités polluantes ;
§ les déchets y compris les déchets
radioactifs ;
§ la protection du paysage, étendue à la
réglementation des enseignes publicitaires.
 Loi
NRE de 2001 : En France, Le décret d'application de l'article
116 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, votée le
15 mai 2001, est paru fin Février 2002 : il rend obligatoire, pour les
entreprises cotées, l'intégration à leur prochain rapport
annuel (à paraître début 2003) d'informations sur la
façon dont elles prennent en compte les impacts sociaux et
environnementaux de leur activité. C'est-à-dire l'obligation d'un
reporting environnemental et social pour les quelques 2000 grandes entreprises
françaises côtés en bourse. Loi
NRE de 2001 : En France, Le décret d'application de l'article
116 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques, votée le
15 mai 2001, est paru fin Février 2002 : il rend obligatoire, pour les
entreprises cotées, l'intégration à leur prochain rapport
annuel (à paraître début 2003) d'informations sur la
façon dont elles prennent en compte les impacts sociaux et
environnementaux de leur activité. C'est-à-dire l'obligation d'un
reporting environnemental et social pour les quelques 2000 grandes entreprises
françaises côtés en bourse.
Son décret d'application énumère les
critères sociaux et environnementaux, d'ordre qualitatif et quantitatif,
qui doivent être renseignés. Cela va des émissions de gaz
à effet de serre à l'égalité professionnelle entre
hommes et femmes en passant par l'insertion des personnes
handicapées.
 La
loi sur l'épargne salariale : La loi n° 2001-152 du 19
février 2001. Cette loi stipule, entre autres, que « les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières auxquelles sont
affectés les fonds recueillis par les plans d'épargne
d'entreprise (PPE), interentreprises (PPI) et les plans partenariaux
d'épargne salariale volontaire (PPESV) sont tenus de rendre compte
annuellement de la mesure dans laquelle ils prennent compte des
considérations sociales, environnementales ou éthiques, tant dans
la sélection, la conservation et la liquidation des titres
». La
loi sur l'épargne salariale : La loi n° 2001-152 du 19
février 2001. Cette loi stipule, entre autres, que « les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières auxquelles sont
affectés les fonds recueillis par les plans d'épargne
d'entreprise (PPE), interentreprises (PPI) et les plans partenariaux
d'épargne salariale volontaire (PPESV) sont tenus de rendre compte
annuellement de la mesure dans laquelle ils prennent compte des
considérations sociales, environnementales ou éthiques, tant dans
la sélection, la conservation et la liquidation des titres
».
 Le
nouveau code des marchés publics : La réforme
du Code français des marchés publics, adoptée en mars
2001, s'inspire très fortement des réflexions menées
à l'échelle européenne. En effet, en mai 2000, la
Commission a décidé de renforcer le dispositif
réglementant la passation des marchés publics par la mise
à jour de la législation européenne existante. Le
Code français des marchés publics autorise, désormais,
l'introduction des considérations sociales ou environnementales dans les
clauses d'un marché public (art. 14). Le
nouveau code des marchés publics : La réforme
du Code français des marchés publics, adoptée en mars
2001, s'inspire très fortement des réflexions menées
à l'échelle européenne. En effet, en mai 2000, la
Commission a décidé de renforcer le dispositif
réglementant la passation des marchés publics par la mise
à jour de la législation européenne existante. Le
Code français des marchés publics autorise, désormais,
l'introduction des considérations sociales ou environnementales dans les
clauses d'un marché public (art. 14).
Ainsi, les cahiers des charges du maître d'ouvrage
pourront comprendre des dispositions visant à « promouvoir
l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières
d'insertion, à lutter contre le chômage ou à
protéger l'environnement».
2.3. Le
Développement durable : un gain de visibilité en
2003 et des perspectives d'avenir encourageantes
2.3.1. Semaine du Développement
Durable
La première édition de la "Semaine du
développement durable", annoncée par le Premier ministre lors du
séminaire gouvernemental du 28 novembre dernier, s'est
déroulée du 2 au 8 juin 2003.
Cette opération, pilotée par le
secrétariat d'État au développement durable, avait pour
vocation d'expliquer le développement durable au grand public, de le
sensibiliser sur ses enjeux et de montrer concrètement les
différents niveaux de mobilisation possibles. Elle a eu cette
année pour thème : "le quotidien du citoyen durable".
Collectivités territoriales, associations, établissements
publics, entreprises et citoyens ont tous été invités
à se mobiliser pour expliquer et illustrer concrètement, au sein
de leur activité, le développement durable dans toutes ses
dimensions : économique, sociale et environnementale. Toutes les actions
menées tant au niveau national qu'au niveau local ont été
regroupées durant la même période sous le parrainage du
Secrétariat d'État au Développement Durable avec le label
"Semaine du développement durable".
2.3.2. Charte de l'environnement
Adoptée par le gouvernement le 25 juin 2003 en Conseil
des ministres, elle consacre, dans la Constitution, les principes liés
à la défense de l'environnement. Mise au même niveau que la
Déclaration des droits de l'Homme de 1789, la charte est composée
de 10 articles, dont l'article 6 qui consacre le développement
durable.
La Charte donne au législateur de nouvelles
références et notamment l'objectif de mieux concilier
développement économique, progrès social et protection de
l'environnement.
2.3.3. Forum National du
Développement Durable
Le Forum National du Développement Durable,
organisé par la revue Manager, s'est tenu à Paris en
novembre 2003 et a réuni nombre de grandes entreprises françaises
de tous secteurs.
Placé sous la présidence de Jacques Chirac, il
n'en a pas moins été boycotté par les ONG.
Mais même si, dans ces conditions, sa
légitimité reste discutable, le fait même que les grandes
entreprises y participent activement montre qu'ils sont d'avis que l'opinion
publique accorde beaucoup d'importance à leur engagement en terme de
développement durable. Leur absence à ce type de manifestation
pourrait leur porter préjudice, et cela prouve l'importance de
la réflexion de toute entreprise au sujet du développement
durable.
2.3.4. Projets en cours à la
DRIRE
Dans le cadre du plan d'action lancé par le
Ministère de l'Industrie et le Secrétariat d'Etat aux PME,
les DRIRE (Directions Régionales de l'Industrie, de la
Recherche et de l'Environnement) pourront aider financièrement
des PME à mettre en place des mesures en matière de
Développement Durable.
L'objectif d'ici l'été 2004 est d'aider au moins
un millier de PME/PMI à mettre en place des systèmes de
management environnementaux, la gestion des déchets,
l'éco-conception, l'intégration de technologies propres et
sûres, l'utilisation rationnelle de l'énergie...
De plus, la DRIRE IDF doit réaliser en 2004 un recueil
de bonnes pratiques à l'usage des PME.
Néanmoins, le pilier social du DD semble encore
être difficilement abordé par les DRIRE avec des entreprises en
majorité industrielles et plus concernées par l'environnement.
2.3.5. Un outil dédié
édité par l'AFNOR
Le guide SD 21000 - Développement Durable-
Responsabilité sociétale des entreprises - guide pour la prise en
compte des enjeux du développement durable dans la stratégie de
management de l'entreprise.
Edité en mai 2003, ce document se pose comme un guide
de bonnes pratiques et non pas comme la préparation à
l'établissement d'une nouvelle norme. En effet, normaliser la
démarche d'intégration du Développement Durable semble
à l'heure actuelle impossible.
Néanmoins, le fait que l'Afnor ait
éprouvé la nécessité d'éditer ce guide est
une preuve de plus que le Développement Durable est plus que
jamais à prendre au sérieux dans le domaine du
management.
2.3.6. Intégrer le DD aux
formations commerciales
C'est une des preuves de la validité du
Développement Durable, l'Ecole HEC a ouvert, à la rentrée
2003, un Mastère Spécialisé Management Du
Développement Durable.
Le Groupe HEC a décidé de relever ce défi
pour « accompagner les cabinets de conseil, les organisations
internationales, et les ONG dans ce changement de paradigme ». La
formation vise à former des managers capables d'appréhender le
développement durable sous ces différents aspects :
économique, social, environnemental...
D'autre part, des universités d'été et de
cycles de formation courts sont organisés à l'attention des
professionnels, comme le cycle de formation diplômant du groupe CIDEM
à Paris par exemple.
Selon un sondage publié le 24 avril 2003, 1/3 des
Français n'a jamais entendu parler du développement durable et
moins d'1/10 en donne une définition exacte. On constate bien que la
signification de la notion de DD est peu connue, et floue pour ceux qui en ont
entendu parler.
Il y a une raison à cela. C'est un thème vaste,
qui couvre énormément de domaines. De plus, il y a plusieurs
interprétations et plusieurs types d'approches qui se côtoient
dans la tentative de clarifier cette démarche.
Plusieurs questions se posent quant à
l'opportunité de mettre en oeuvre certains outils, et quant à
leur mise en place concrète (label Développement durable, normes
internationales, ...). Le fait même que ces débats existent entre
différents acteurs tend à prouver que le DD n'est pas un effet de
mode. Il tend à devenir un mode de pensée qui doit guider tous
les acteurs économiques dans leurs actes.
2003 a été une année marquante pour le
DD, surtout en terme de sensibilisation.
Il semble que l'orientation pour les années à
venir soit encore à l'heure de la sensibilisation, mais aussi à
l'appui de démarches volontaires de tous les acteurs
économiques.
2.4. A qui
s'adresse le DD ?
Comme nous l'avons vu au cours de cette première
partie, le DD est l'affaire de tous. Il semble que ce qui est encore un concept
pour beaucoup tende à réformer peu à peu l'organisation et
les valeurs du monde actuel. Réformer car le changement se fait par
l'intérieur du système. En effet, l'économie étant
l'un des piliers du DD, celui-ci ne pousse pas à une révolution.
Le fait même que le changement se fasse par une
réforme progressive du système économique place les
entreprises en première ligne.
En effet, lieu de création de richesses, d'emploi, de
réalisation sociale, et d'échanges, l'entreprise est le ciment de
nos sociétés libérales.
La société civile a déjà compris
l'intérêt que le DD aurait à ce que les entreprises
intègrent ses principes.
Mais les entreprises n'ont pas encore, pour l'immense
majorité d'entre elles, compris ce que le fait de s'intégrer dans
un Développement Durable peut leur apporter. Quant aux grandes
entreprises, elles ont du, bon gré mal gré, s'y mettre. Mais ces
entreprises cotées ne sont que 2000 environ en France, qu'en est-il des
2,5 millions de PME ?
Par les biens et services qu'il produit, par ses modes de
production, par sa politique sociale, etc., le secteur privé est en
mesure de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie
et à la préservation de l'environnement pour les
générations futures. Jusqu'ici toutefois, certains obstacles ont
freiné l'adoption de pratiques «durables» par ce secteur.
Au cours des années qui ont suivi la Conférence
de Rio, les gouvernements ont tardé à émettre des signaux
clairs vers le secteur privé ; les investissements consentis ont
été insuffisants, les consommateurs et les actionnaires - que ce
soit par manque d'intérêt ou d'information - n'ont pas
exercé une pression suffisante; à l'échelle
internationale, les marchés instables et imprévisibles ont
souvent empêché un développement industriel durable dans
des secteurs prioritaires.
Mais depuis quelques années, un changement se fait
sentir. Le public est toujours plus sensible aux questions de
«durabilité». Le milieu financier - notamment les fonds de
pension - exerce une pression croissante en faveur des investissements
socialement responsables. Face à ces mouvements d'opinion, les
entreprises européennes, puis américaines ont pris conscience de
la nécessité d'adopter un comportement éthiquement,
écologiquement et socialement responsable dans la conduite de leurs
affaires. Parallèlement, de nombreuses entreprises ont compris
l'importance d'un dialogue avec toutes leurs parties prenantes.
Ainsi, progressivement, la marge de manoeuvre des
entreprises se réduit sous l'effet conjugué de ces nouvelles
contraintes sociales, environnementales, politiques et économiques :
pour prévenir les crises potentielles, l'entreprise n'a plus le choix,
elle doit anticiper les contraintes pour ne pas les subir et les
intégrer à sa stratégie pour en faire, si possible, des
opportunités.

Les enjeux du DD pour les PME en France
Le développement durable concerne toute la
société, tous les pays, toute la planète. Les entreprises
du secteur privé, notamment les PME, ont un rôle important
à jouer en la matière, quel que soit leur domaine
d'activité - de l'industrie aux services en passant par le commerce et
l'artisanat.
Les préoccupations liées à la pollution,
à la dégradation des ressources énergétiques,
à la réduction de la biodiversité et à la
nécessité d'introduire une éthique dans l'économie
conduisent à considérer désormais la performance de
l'entreprise non plus seulement sous l'angle économique et financier,
mais également en fonction du respect des intérêts de la
communauté et de l'environnement dans lesquels elle opère. Ainsi
les entreprises qui auront intégré cette nouvelle dimension
jouiront d'une bonne image.
Cependant, le souci premier d'une PME ne semble pas être
son image, ce qui est assez logique vu son faible rayonnement en comparaison
des grandes entreprises. Son souci est d'assurer sa pérennité. Il
semble même (selon Yohan Leroy, DRIRE IDF, qui a longtemps
été sur le terrain pour les visites de la DRIRE aux entreprises)
que la préoccupation première d'un dirigeant de PME est de
« s'occuper de sa trésorerie au jour le jour » avant
même de penser au long terme. Le développement durable semble donc
éloigné de ses priorités, surtout que, contrairement aux
entreprises côtés, « il n'y a ni bâton pour l'y
pousser, ni carotte pour l'y inciter ».
Il me semble toutefois que ce n'est pas tout à fait
exact. La pression peut venir du marché des PME, que se soit des
particuliers, des grandes entreprises (dont la PME est sous-traitant ou
fournisseur), ou encore des marchés publics. Ce bâton peut aussi
se transformer en carotte si l'entreprise saisit l'opportunité que
représente la RSE pour acquérir un avantage concurrentiel sur son
marché.
De plus, les économies relatives à la
démarche de développement durable et les aides financières
qui se multiplient pour les seconder sur cette voie peuvent avoir un fort
pouvoir incitatif.
1. Les PME en France
Après avoir défini ce qu'est une PME et pourquoi
l'étude porte particulièrement sur elles, nous dresserons un
tableau de leur position actuelle face aux trois piliers du
développement durable.
1.1. Qu'est ce
qu'une PME ?
La définition des Petites et Moyennes Entreprises
retenue ici est celle, classique en France, des entreprises de moins de 500
salariés.
Néanmoins, notons que la Commission européenne a
adopté en mai 2003 une nouvelle définition des PME qui entrera
officiellement en vigueur le 1er janvier 2005.
Une entreprise moyenne est donc une entreprise de moins de
250 salariés (avec un CA de moins de 50 millions d'euros, et un total du
bilan inférieur à 43 millions d'euros) et une petite entreprise
est une entreprise de moins de 50 salariés (avec un CA et un total du
bilan de moins de 10 millions d'euros)
Cependant, pour cette étude la différence n'est
pas significative aux vues du petit nombre d'entreprises (environ 4000) qui se
trouvent entre 250 et 500 salariés, mis en regard du nombre total de
PME.
Taille et activité des entreprises de l'industrie,
du commerce et des services au 1er janvier 2000 (taille en nombre de
salariés)
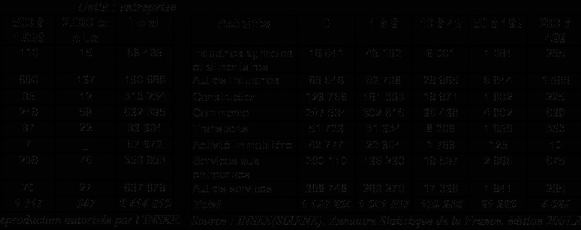
L'univers des petites et moyennes entreprises est très
hétérogène (environ 2,5 million d'entreprises de 0
à 500 salariés, dont seulement 170 000 environ emploient plus de
9 salariés).
7,6 millions de salariés sont employés par des
entreprises de moins de 200 salariés (56,6% de l'effectif moyen des
salariés) contre 5,8 millions embauchés par des entreprises de
plus de 200 salariés.
Lorsque l'on constate que seules 2000 entreprises environ ont
plus de 500 salariés et que seules 6000 ont plus de 250 salariés,
autant dire que toutes les entreprises du tissu économique
français sont des PME.
Seulement même si les grandes entreprises sont peu
nombreuses, elles concernent une partie considérable des travailleurs en
France et elles ont un pouvoir parfois comparable à celui des Etats.
Alors pourquoi ce choix des PME ?
Leur problématique en terme de Développement
Durable est différente de celle des PME, non seulement du fait de la loi
NRE, mais aussi en termes d'impacts environnementaux (« grande
entreprise, grande pollution »), d'impacts sociaux (du fait
même de leur taille), et d'enjeux économiques.
Et bien que les PME ne soient pas un groupe homogène,
on retrouvera des enjeux communs face à l'intégration d'une
démarche de Développement Durable. Même s'il est
évident qu'il y a des différences entre secteurs, entre lieux
d'implantation, entre TPE, PE et ME, il y a aussi des différences entre
deux entreprises concurrentes sur un même marché. Chaque PME est
unique mais nous nous attacherons ici à dégager des points
communs (on admettra que, lorsque l'on abordera les questions des relations
avec le personnel et des conditions de travail, seront exclues les 1,2 million
d'entreprises unipersonnelles).
Les PME dominent les secteurs secondaire et tertiaire à
quelques exceptions près (banques et assurances par exemple).
L'économie évoluant vers une économie de services,
on s'attend à ce que les PME et surtout les TPE (plus de 80 % des
entreprises françaises) gagnent encore en importance. La tendance
croissante à la création de nouvelles entreprises participe
à cette évolution.
Par ailleurs, un nombre croissant de PME développent
leurs activités au niveau international ; elles tirent profit de la
libéralisation des marchés et de l'intégration des
échanges en s'approvisionnant auprès de filiales et de
fournisseurs dans les pays en voie de développement.
Les entreprises sont au coeur du système de
production/consommation. Elles ont donc un rôle primordial à jouer
- tout comme les consommateurs - dans la mise en oeuvre du développement
durable.
1.2. Les PME face
aux trois piliers du DD
1.2.1. Conjoncture économique
globale
Selon l'enquête semestrielle de conjoncture de
décembre 2003 de la Banque de Développement des PME,
l'année 2003 a été particulièrement
décevante pour les petites et moyennes entreprises
françaises, même si elle s'est achevée un peu
mieux qu'elle n'avait débuté.
La faiblesse de la demande a plus particulièrement
affecté les entreprises exportatrices et celles de taille moyenne.
En termes sectoriels, l'activité a stagné dans
l'industrie manufacturière. Elle a reculé dans le transport et le
tourisme, tandis qu'elle a été médiocre dans le commerce
de détail. En revanche, les PME du BTP, du commerce de gros et des
services aux entreprises ont enregistré une certaine reprise des
affaires au second semestre.
En dépit de la conjoncture, les PME sont
globalement parvenues à conserver leurs effectifs
salariés, malgré des suppressions de postes dans
l'industrie et dans les entreprises exportatrices. Cependant, les
difficultés de recrutement sont toujours importantes et elles ont
augmenté au cours des six derniers mois dans les secteurs de la
construction, du commerce de détail et de
l'hôtellerie-restauration.
La situation de trésorerie est jugée un
peu plus difficile en 2003. En particulier, les tensions ont
été plus fréquentes dans le tourisme et dans le BTP.
Les chefs d'entreprise s'attendent à une
légère dégradation de leurs performances
financières en 2003, mais anticipent un redressement, notamment dans les
entreprises moyennes et dans les PME fortement exportatrices.
Les dépenses d'équipement, qui avaient
déjà été réduites en 2002, ont poursuivi
leur recul l'an dernier, tout particulièrement dans l'industrie.
Cependant, les intentions d'investissement en 2004 sont en sensible
hausse dans l'ensemble des secteurs.
Fin 2003, les carnets de commandes étaient très
peu garnis dans la plupart des secteurs d'activité. Toutefois, les
anticipations d'évolution de la demande au cours des prochains
mois sont bien meilleures, en particulier dans l'industrie, dans le commerce de
gros et les services aux entreprises. En revanche, l'optimisme est
plus mesuré dans les secteurs liés à la consommation des
ménages, peu dynamique actuellement.
Après les fortes contraintes qui ont pesé sur
l'emploi dans les PME en 2003, les embauches devraient reprendre à un
rythme modéré en 2004, les entreprises moyennes notamment
souhaitant prioritairement améliorer une
rentabilité jugée très insuffisante.
Cette enquête montre que la préoccupation
des PME est de surmonter leurs difficultés à dégager de la
trésorerie, à investir et à embaucher face à une
demande incertaine et souvent en baisse dans certains secteurs. La
priorité en matière de sensibilisation au DD sera donc de
démontrer qu'il peut être un facteur positif et non uniquement une
charge suplémentaire.
1.2.2. Questions sociales
Il n'y a pas d'études à proprement parler sur la
prise en compte de la dimension sociale du Développement Durable dans
les PME.
Ce qui ressort de mes entretiens à la DRIRE et à
la CCIP est que les PME assimilent encore majoritairement Développement
Durable à environnement.
N'oublions pas que l'immense majorité des PME sont en
fait des TPE, et que le dirigeant fait partie des citoyens français dont
deux tiers ne connaissaient pas le DD en avril 2003 (sondage IPSOS pour le
secrétariat d'Etat au développement durable). Même si la
semaine du DD a eu lieu depuis, beaucoup considèrent qu'il ne s'agit que
d'une mode ou d'un effet de manche des politiques.
De plus, l'aspect environnemental est clairement plus simple
à appréhender pour une petite structure. La plupart des PME n'ont
peut être jamais réfléchi à ce qu'est leur
« système de management » ou leur
« politique de ressources humaines ». Nous verrons aussi en
fin de partie 2 que les PME font souvent du DD au travers du pilier social sans
le savoir. Plus proches du terrain, elles sont en effet plus proches de leurs
parties prenantes.
1.2.3. Environnement
La revue " regard sur les PME " vient de publier dans le cadre
de l'observatoire des PME et pour le compte de l'agence des PME une
étude pour analyser plus en détail le couple PME /
Environnement.
« A la surprise des enquêteurs, les
réponses se regroupent autour d'un assez grande unanimité :
oui l'environnement est une notion importante, oui il faut y faire
attention, et puisque c'est difficile autant disposer d'une
réglementation claire »
L'étude confirme que les PME souffrent d'un
manque de lisibilité de la réglementation environnementale et
qu'elles sont confrontées à des difficultés d'accès
aux aides et ressentent un besoin de formation.
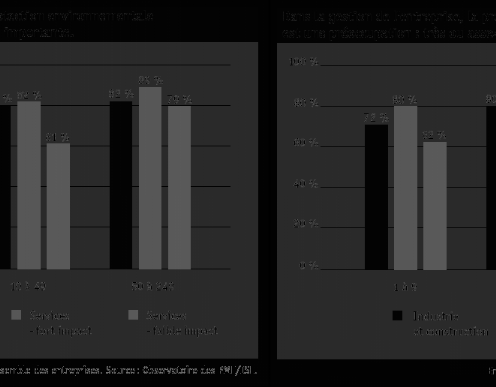
Au regard de ces résultats, on peut dire aujourd'hui
que la prise en compte de l'environnement n'est plus réservée aux
grandes entreprises. On constate que l'environnement fait partie
intégrante des préoccupations des petites et moyennes entreprises
tant de l'industrie que des services (qu'ils soient ou non à
fort impact sur l'environnement)
On trouve donc deux grandes motivations à la
prise en compte de l'environnement :
- la conviction personnelle et l'image de l'entreprise
- le caractère obligatoire de la prise en compte de
l'environnement.
Selon l'étude, les réponses montrent une
confiance limitée dans l'impact économique de la prise en compte
de l'environnement. Les PME n'ont pas encore pris en
considération le fait que des investissements dans le domaine de
l'environnement puissent avoir un effet bénéfique à long
terme sur les indicateurs de l'entreprise. Seuls 35,7% pensent
accroître la rentabilité de l'entreprise par la prise en compte de
l'environnement.
Ils sont légèrement plus confiants dans le
bénéfice concurrentiel qu'ils pourraient en tirer. Alors que les
investissements environnementaux représentent un coût à
court terme, les avantages s'intègrent dans une vision de long terme
parfois difficile à prendre en compte dans la gestion quotidienne d'une
PME.
2. Les particularités des PME françaises face
au Développement Durable
2.1.
Difficultés
2.1.1. Le manque d'informations
Les PME, du fait de leur taille, ont rarement du personnel
dédié (au moins partiellement) à la veille
réglementaire. Les dirigeants sont donc mal informés sur les
aides, quelles qu'elles soient. Les CCI et les DRIRE sont les interlocuteurs
privilégiés des PME. Quant aux aides européennes, et
celles d'organismes publics comme l'ADEME, elles sont mal connues.
A ce manque d'informations sur les aides s'ajoute un
déficit de sensibilisation spécifique aux PME en matière
de développement durable. Mais il semble que sur ce point les pouvoirs
publics (objectif des DRIRE régionales au 01/07/04 : avoir
sensibilisé 3% des PMI et PME de service aux PMI) et des organismes
privés (le MEDEF a publié en juin 2003 un cahier intitulé
Développement Durable et PME) travaillent à inverser la
tendance.
2.1.2. Le manque de ressources
financières
Comme nous l'avons vu dans la conjoncture économique
globale, les PME sont globalement dans une situation qui ne leur permet pas de
dégager des liquidités pour effectuer des investissements. Elles
doivent donc avoir recours à des emprunts bancaires pour financer leurs
investissements lourds en matière sociale ou environnementale.
Mais on comprend bien que les dirigeants soient
réticents à augmenter leur taux d'endettement pour une
démarche DD alors qu'ils comprennent encore mal les
bénéfices financiers qu'ils peuvent en tirer (cf. point
1.2.3.)
2.1.3. Les freins culturels
Certaines difficultés viennent du fait même que
les dirigeants sont influencés par la culture de la France et par la
manière française d'appréhender le monde des affaires.
Cela se manifeste notamment par :
 L'héritage de la culture catholique et le tabou de
l'argent : la religion catholique demande à celui qui veut
se consacrer au Bien (c'est-à-dire à Dieu) de faire voeu de
pauvreté. L'entreprise (riche, par définition) est donc assez
facilement soupçonnée de faire le Mal et de s'être enrichie
au détriment d'autrui. On l'accusera donc de vouloir se racheter une
conscience quand elle prétend faire du bien autour d'elle.
L'héritage de la culture catholique et le tabou de
l'argent : la religion catholique demande à celui qui veut
se consacrer au Bien (c'est-à-dire à Dieu) de faire voeu de
pauvreté. L'entreprise (riche, par définition) est donc assez
facilement soupçonnée de faire le Mal et de s'être enrichie
au détriment d'autrui. On l'accusera donc de vouloir se racheter une
conscience quand elle prétend faire du bien autour d'elle.
 Un sentiment diffus d'anti-américanisme : Il y a
encore quelques années, la responsabilité sociale et
environnementale de l'entreprise était ainsi assimilée en France
au politiquement correct à l'américaine, une sorte de
modèle bien-pensant et puritain appliqué au management. Lorsqu'on
considère qu'ils sont réputés être les plus gros
pollueurs du monde et l'un des pays les plus corrupteurs, le
développement durable y perd en crédibilité.
Un sentiment diffus d'anti-américanisme : Il y a
encore quelques années, la responsabilité sociale et
environnementale de l'entreprise était ainsi assimilée en France
au politiquement correct à l'américaine, une sorte de
modèle bien-pensant et puritain appliqué au management. Lorsqu'on
considère qu'ils sont réputés être les plus gros
pollueurs du monde et l'un des pays les plus corrupteurs, le
développement durable y perd en crédibilité.
 La peur de l'échec : si dans d'autres pays,
l'échec est considéré comme une occasion d'apprendre et de
progresser (un individu ayant créé plusieurs entreprises,
même si celles-ci ont cessé d'exister, y sera
considéré comme quelqu'un d'audacieux et de dynamique), il est vu
en France comme une faiblesse personnelle (le même individu ayant
créé plusieurs entreprises pourra être
considéré en France comme un incompétent - un
gérant de SARL ayant vécu le dépôt de bilan de son
entreprise n'est pas autorisé par la loi, à être
gérant d'une autre entreprise avant plusieurs années). Or le
développement durable consiste justement, pour l'entreprise et ses
dirigeants, à accepter de s'ouvrir à des problématiques
sociales et environnementales nouvelles, face auxquelles ils sont plutôt
démunis. Accepter de reconnaître que l'on ne maîtrise pas
tout, que l'on n'a pas toutes les réponses, et accepter l'échec
est difficile dans ce contexte.
La peur de l'échec : si dans d'autres pays,
l'échec est considéré comme une occasion d'apprendre et de
progresser (un individu ayant créé plusieurs entreprises,
même si celles-ci ont cessé d'exister, y sera
considéré comme quelqu'un d'audacieux et de dynamique), il est vu
en France comme une faiblesse personnelle (le même individu ayant
créé plusieurs entreprises pourra être
considéré en France comme un incompétent - un
gérant de SARL ayant vécu le dépôt de bilan de son
entreprise n'est pas autorisé par la loi, à être
gérant d'une autre entreprise avant plusieurs années). Or le
développement durable consiste justement, pour l'entreprise et ses
dirigeants, à accepter de s'ouvrir à des problématiques
sociales et environnementales nouvelles, face auxquelles ils sont plutôt
démunis. Accepter de reconnaître que l'on ne maîtrise pas
tout, que l'on n'a pas toutes les réponses, et accepter l'échec
est difficile dans ce contexte.
 La culture informelle du management à la
française : Cette particularité consiste en un
management reposant davantage sur une culture orale, transmise de personne
à personne, avec assez peu de formalisation et avec des objectifs moins
quantifiés et moins strictement suivis. Au contraire, le management
anglo-saxon repose sur la notion de contrat écrit. Le problème
est que les stratégies de développement durable reposent pour
partie sur le suivi de la performance sociale et environnementale, avec cette
idée qu'on ne progresse que sur ce que l'on mesure. Ainsi, tant que le
profit sera la seule chose mesurée dans l'entreprise, il demeurera le
seul objectif capable de fédérer les efforts de tous.
La culture informelle du management à la
française : Cette particularité consiste en un
management reposant davantage sur une culture orale, transmise de personne
à personne, avec assez peu de formalisation et avec des objectifs moins
quantifiés et moins strictement suivis. Au contraire, le management
anglo-saxon repose sur la notion de contrat écrit. Le problème
est que les stratégies de développement durable reposent pour
partie sur le suivi de la performance sociale et environnementale, avec cette
idée qu'on ne progresse que sur ce que l'on mesure. Ainsi, tant que le
profit sera la seule chose mesurée dans l'entreprise, il demeurera le
seul objectif capable de fédérer les efforts de tous.
 L'absence de partage des pratiques : Les entreprises
françaises vivent encore dans une culture du secret et de la
confidentialité. Elles sont donc souvent réticentes à
diffuser ou à partager entre elles les chiffres de leur performance
sociale ou environnementale, ce qui limite la diffusion des bonnes pratiques -
pourtant moyen considéré comme le plus efficace pour la
sensibilisation (à cet égard, les DRIRE comptent publier un
recueil de bonnes pratiques par secteur afin de soutenir leur action de
sensibilisation).
L'absence de partage des pratiques : Les entreprises
françaises vivent encore dans une culture du secret et de la
confidentialité. Elles sont donc souvent réticentes à
diffuser ou à partager entre elles les chiffres de leur performance
sociale ou environnementale, ce qui limite la diffusion des bonnes pratiques -
pourtant moyen considéré comme le plus efficace pour la
sensibilisation (à cet égard, les DRIRE comptent publier un
recueil de bonnes pratiques par secteur afin de soutenir leur action de
sensibilisation).
2.2. Avantages
structurels
Les PME ont de part leurs caractéristiques (taille,
nombre limité d'implantation géographiques) quelques
prédispositions à la RSE :
 Il est
plus facile pour les petites structures de mettre en oeuvre la
transversalité de la démarche de DD. En effet, le cloisonnement
des compétences y est moins marqué, les circuits d'information
sont plus courts et les réunions avec l'ensemble du personnel sont
réalisables. Il est
plus facile pour les petites structures de mettre en oeuvre la
transversalité de la démarche de DD. En effet, le cloisonnement
des compétences y est moins marqué, les circuits d'information
sont plus courts et les réunions avec l'ensemble du personnel sont
réalisables.
 Du
fait de leur taille et du rôle marqué des responsables
d'entreprise, les PME gèrent souvent leur impact sur la
société de façon plus intuitive et informelle que les
grandes entreprises. Une enquête réalisée en 2001 par le
Réseau européen de recherche sur les PME (ENSR)
révèle que de nombreuses PME ont déjà adopté
des pratiques sociales et environnementales durables, souvent définies
et comprises par les PME comme des pratiques responsables de gestion
d'entreprise. Leur engagement dans le domaine social ou au sein de leur
communauté est généralement de portée locale, de
nature occasionnelle et détaché de la stratégie
commerciale. Il semble que la principale motivation soit la conception
éthique du responsable d'entreprise Du
fait de leur taille et du rôle marqué des responsables
d'entreprise, les PME gèrent souvent leur impact sur la
société de façon plus intuitive et informelle que les
grandes entreprises. Une enquête réalisée en 2001 par le
Réseau européen de recherche sur les PME (ENSR)
révèle que de nombreuses PME ont déjà adopté
des pratiques sociales et environnementales durables, souvent définies
et comprises par les PME comme des pratiques responsables de gestion
d'entreprise. Leur engagement dans le domaine social ou au sein de leur
communauté est généralement de portée locale, de
nature occasionnelle et détaché de la stratégie
commerciale. Il semble que la principale motivation soit la conception
éthique du responsable d'entreprise
 Le PDG
d'une PME connaît ses salariés. Cette proximité rend les
licenciements plus durs pour le dirigeant, ainsi il n'en parvient à
cette extrémité que lorsqu'il est acculé. Les
licenciements apparaissent donc plus motivés aux salariés et par
conséquent ils les acceptent mieux. Le PDG
d'une PME connaît ses salariés. Cette proximité rend les
licenciements plus durs pour le dirigeant, ainsi il n'en parvient à
cette extrémité que lorsqu'il est acculé. Les
licenciements apparaissent donc plus motivés aux salariés et par
conséquent ils les acceptent mieux.
 Le
lien affectif fonctionne dans les deux sens. Ainsi, dans une PME plus que dans
une grande entreprise, l'entreprise est une deuxième famille pour le
salarié. Leur adhésion est donc plus facile à gagner. Le
lien affectif fonctionne dans les deux sens. Ainsi, dans une PME plus que dans
une grande entreprise, l'entreprise est une deuxième famille pour le
salarié. Leur adhésion est donc plus facile à gagner.
 De
nombreuses PME sont des entreprises familiales dans lesquelles l'épouse
ou la compagne joue presque toujours un rôle économique. Sans
cette aide, la majorité des PME ne pourrait tout simplement pas exister.
Cette place cruciale des femmes met les PME en excellente position pour
améliorer leur place au travail. Néanmoins, l'importance
économique des femmes dans les PME reste insuffisamment reconnue et
soutenue. De même, leurs besoins professionnels, notamment en
matière de formation, sont insuffisamment pris en compte. De
nombreuses PME sont des entreprises familiales dans lesquelles l'épouse
ou la compagne joue presque toujours un rôle économique. Sans
cette aide, la majorité des PME ne pourrait tout simplement pas exister.
Cette place cruciale des femmes met les PME en excellente position pour
améliorer leur place au travail. Néanmoins, l'importance
économique des femmes dans les PME reste insuffisamment reconnue et
soutenue. De même, leurs besoins professionnels, notamment en
matière de formation, sont insuffisamment pris en compte.
 Selon
Thierry Vincent (CCIP) le développement durable c'est « la
proximité, l'humanité et la capacité à faire
confiance à ses salariés plutôt qu'à des
conseillers ». Il me semble que ce sont des caractéristiques
que les PME ont souvent en commun avec le Développement Durable. Selon
Thierry Vincent (CCIP) le développement durable c'est « la
proximité, l'humanité et la capacité à faire
confiance à ses salariés plutôt qu'à des
conseillers ». Il me semble que ce sont des caractéristiques
que les PME ont souvent en commun avec le Développement Durable.
3. La Responsabilité Sociale et
Environnementale : un avantage concurrentiel
Dans un monde où les changements
s'accélèrent, où la pression sur les résultats et
la responsabilité éthique s'accentue, les PME sont de plus en
plus nombreuses à choisir le chemin du Développement Durable. Les
entreprises en avance dans le domaine de la protection de l'environnement et
dans le respect des normes sociales se démarquent par rapport aux autres
entreprises, ce qui devrait leur assurer un avantage concurrentiel notamment en
leur facilitant l'obtention de contrats ou en leur assurant de meilleures parts
de marché.
3.1. Opinion
publique, les nouvelles tendances de fond
L'opinion publique (avec à sa tête les
associations de citoyens telles ATAC* et des ONG) demande des comptes aux
entreprises et participe à l'élaboration des lois qui dessinent
le contexte dans lequel les entreprises évolueront demain.
61% des Français estiment que le rôle de
l'entreprise ne se limite pas à un rôle économique mais
qu'elle doit être citoyenne et intervenir dans le champ de la
solidarité (sondage SOFRES de février 2003).
Et les consommateurs suivent : pour 70 % des Européens,
la responsabilité sociale et environnementale est devenue un
"critère important ou très important" lors de l'achat d'un
produit ou service.
En, France, selon une enquête du CREDOC sur la
consommation engagée (publiée en septembre 2003), 38% des
consommateurs disent tenir compte des engagements de
« citoyenneté » des entreprises lorsqu'ils
achètent des produits industriels, de plus une personne sur deux
déclare être prête à payer un supplément de 5%
pour des produits « éthiques », une sur cinq en est
même certaine. Même s'il s'agit de déclarations d'intention,
cela montre une mobilisation certaine des consommateurs.
Pour la première fois en France, en avril 2001, un
« Guide éthique du consommateur » a été
réalisé. Il analyse 80 entreprises françaises qui
représentent 700 marques et 80 % des achats courants des ménages
français. Publié par l'Observatoire de l'Ethique, ce guide note
chaque entreprise en fonction de sept familles de critères :
stratégie, salariés, écologie, commercial, transparence,
humanitaire, citoyenneté. L'Ademe a également publié un
petit guide gratuit (Devenir un éco-consommateur, acheter et
consommer mieux, octobre 2002) pour aider le consommateur à choisir
des produits respectueux de l'environnement et l'inciter à utiliser son
pouvoir d'achat comme un moyen de pression sur les fabricants et
distributeurs : « le consommateur doit faire savoir au
détaillant qu'il veut des éco-produits et que la demande
existe ».
*ATAC : Association pour la Taxation des transactions
financières pour l'Aide aux Citoyens (association française
créée en 1998)
Ce phénomène d'éco-consommation est
encore marginal, mais il prend sa source dans une somme de tendances de
fond :
 Un retour à des devoirs citoyens : Le consommateur
est de plus en plus éduqué à la gestion des déchets
avec la mise en place progressive du tri sélectif. Les citoyens
français sont sensibilisés au problème du recyclage et de
la nécessité de réduire la quantité d'emballages
à la source. Ainsi il et clairement conseillé de
privilégier les produits au format familial plutôt que les
emballages individuels (ce qui va à l'encontre de la tendance des
fabricants à surfer sur la vague de la nomadisation des produits).
Un retour à des devoirs citoyens : Le consommateur
est de plus en plus éduqué à la gestion des déchets
avec la mise en place progressive du tri sélectif. Les citoyens
français sont sensibilisés au problème du recyclage et de
la nécessité de réduire la quantité d'emballages
à la source. Ainsi il et clairement conseillé de
privilégier les produits au format familial plutôt que les
emballages individuels (ce qui va à l'encontre de la tendance des
fabricants à surfer sur la vague de la nomadisation des produits).
 Un retour à une vie plus saine et plus proche de la
nature : on le constate surtout avec le phénomène de
rurbanisation (les citadins qui retournent vivre à la campagne), mais
aussi avec l'importance que prennent les produits « du
terroir » et la vague du « bio ».
Un retour à une vie plus saine et plus proche de la
nature : on le constate surtout avec le phénomène de
rurbanisation (les citadins qui retournent vivre à la campagne), mais
aussi avec l'importance que prennent les produits « du
terroir » et la vague du « bio ».
 Un phénomène d'empathie sociale : Lors des
manifestations diverses suite à des restructurations, on n'a jamais
entendu dans les médias de point de vue de citoyen défendant les
entreprises mises en causes. Il semble qu'il y ait eu consensus sur le
caractère révoltant de ces licenciements économiques, dans
un contexte de crise où personne, pas même les cadres et les
personnes très diplômées, n'a la sécurité de
l'emploi.
Un phénomène d'empathie sociale : Lors des
manifestations diverses suite à des restructurations, on n'a jamais
entendu dans les médias de point de vue de citoyen défendant les
entreprises mises en causes. Il semble qu'il y ait eu consensus sur le
caractère révoltant de ces licenciements économiques, dans
un contexte de crise où personne, pas même les cadres et les
personnes très diplômées, n'a la sécurité de
l'emploi.
Les consommateurs attendent donc des entreprises plus de
communication sur l'origine, les conditions de fabrication et la performance
écologique des produits qu'ils achètent. Ils sont de plus en
plus exigeants sur les critères environnementaux et sociaux et,
désormais, sur la transparence des circuits de production et de
commercialisation.
Lorsque l'on sait que les organisations de citoyens peuvent
mobiliser des millions d'individus depuis le développement d'Internet,
rien d'étonnant à ce qu'en 2000, les mouvements d'opinion
étaient la première menace perçue par les dirigeants
d'entreprises européens.
Leur liberté d'action dépend donc
désormais du niveau de confiance que leur accorde le public.
3.2. Les
marchés publics : préférence aux entreprises
appliquant la RSE
Un premier pas a été fait pour que les
marchés publics soient utilisés comme outil dans les politiques
publiques en faveur de l'environnement, en intégrant dans l'appel
d'offre des objectifs de respect de l'environnement.
Le « verdissement » des administrations publiques
consiste à sélectionner des approvisionnements aux impacts les
moindres possibles sur l'environnement.
L'article 14 du nouveau code des marchés publics
spécifie : « La définition des conditions d'exécution
d'un marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir
l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières
d'insertion, à lutter contre le chômage ou à
protéger l'environnement».
Le nouveau code, même s'il reste peu clair sur le sujet,
laisse une possibilité d'interprétation pour les acheteurs
publics. Il devrait leur permettre de sortir d'une logique de court
terme (qui consiste à favoriser le prix le plus bas)
pour adopter une vision de long terme intégrant le fait que la
qualité a un coût.
3.3. Grands
Comptes : nouvelles exigences en matière de Développement
Durable
« Ce seront probablement les grandes entreprises
clientes qui pousseront le plus les PME à adopter des pratiques
socialement responsables » (Entreprise et développement
durable, Comité 21). Les demandes particulières des clients
de l'entreprise s'imposent à elle avec la même force que la loi.
L'entreprise prendra alors en compte les risques de
déréférencement auxquels elle s'expose en ne
répondant pas aux exigences de son donneur d'ordre. En matière de
développement durable, c'est particulièrement vrai pour les
grandes entreprises qui sont maintenant les plus à même de
demander des garanties, étant elles mêmes contrôlées
sur leur performances sociales et environnementales.
Les PME - souvent fournisseurs de produits et de services pour
les grandes entreprises - sont confrontées de manière croissante
à la nécessité de répondre à certaines
questions, sinon à prouver qu'elles opèrent selon certains
critères de responsabilité. En effet, avec l'obligation de
Rédaction de rapports environnementaux et sociaux qui s'applique aux
grandes entreprises cotées, les mauvaises performances de leurs
fournisseurs et sous traitants sont inacceptables dans la mesure où
elles peuvent porter préjudice à la qualité de leurs
actions.
Les grands groupes qui ont intégré la
démarche environnementale dans leur gestion se doivent de
vérifier que toute la chaîne de production respecte les normes
qu'ils se sont fixées. Aussi font-ils pression sur leurs
sous-traitants pour obtenir des produits conformes. La sensibilisation atteint
ainsi tous les niveaux de la chaîne de production.
Dans certains grands groupes, la direction des achats
établit des listes de fournisseurs respectueux du Développement
Durable. On trouve ce type de démarches dans tous les secteurs
d'activités. Quelques exemples sont cités ci-dessous.
Dans le secteur industriel, les grandes entreprises sont de
plus en plus nombreuses à exiger de leurs fournisseurs une prise en
compte de l'environnement; ainsi le concepteur d'automobiles Renault exige de
la part de ses fournisseurs la norme ISO 14001.
Dans les services, le groupe d'assurance AGF a
expliqué comment la notion de développement durable est
répercutée sur la politique d'achat. Une clause
spécifique est insérée dans tous les contrats, et des
vérifications sont faites directement chez le fournisseur. L'assureur a
mis au point un système de notation développement durable de ses
fournisseurs par le biais d'un questionnaire qui doit être transmis avec
la réponse à l'appel d'offre. La clause spécifique se
présente ainsi : « Le fournisseur s'engage à respecter la
législation française concernant la protection de
l'environnement, tant dans le cadre de ses activités propres que de ses
prestations pour les AGF. Pour ces dernières, il s'engage
également à s'assurer que ses fournisseurs et sous-traitants
respectent les mêmes obligations. En cas de manquement à cet
engagement, les AGF se réservent le droit de résilier le contrat,
sans indemnité. »
De grandes entreprises s'inscrivent dans une
démarche plus positive qui consiste à construire des partenariats
avec leurs fournisseurs et à les accompagner dans leur démarche
environnementale. C'est le cas par exemple de l'entreprise
précurseur en matière de RSE ; Nature &
Découvertes.
Lors d'un entretien avec Etienne Ruth (responsable DD), il est
apparu que l'objectif de la Charte de Nature & Découvertes est, non
seulement de formaliser l'engagement de l'entreprise, mais aussi
d'inciter leurs fournisseurs à entamer une démarche
d'amélioration en matière de RSE. Notons que cet
objectif est formalisé dans les indicateurs de performance sociale et
environnementale de l'entreprise, ce qui l'oblige à tenir cet
engagement.
Ce type de politique créé donc un effet
d'entraînement en direction des plus petites entreprises.
Sous la pression conjuguée des investisseurs, des
consommateurs, des groupes d'opinion et parfois des gouvernements, les
entreprises doivent faire face à des exigences accrues en matière
de responsabilité et de durabilité. Ces impératifs se
fondent encore à l'heure actuelle sur des critères non
standardisés, et ils concernent surtout les multinationales et les
grandes entreprises. Il n'en demeure pas moins que cette tendance commence
à influencer le marché de manière globale. Les PME -
souvent fournisseurs de produits et de services pour les grandes entreprises -
sont confrontées de manière croissante à la
nécessité de répondre à certaines questions, sinon
à prouver qu'elles opèrent selon certains critères de
responsabilité.
4. La Responsabilité Sociale et
Environnementale : un avantage financier
4.1. La
réduction des coûts
4.1.1. Les économies en
matière d'achat et de consommation
Il s'agit d'appliquer une gestion de « bon
père de famille ». En effet, Thierry Vincent a constaté
dans les entreprises qu'il a suivies que « dès qu'une
entreprise commence à suivre sa consommation (d'eau et d'énergie
par exemple), elle baisse ».
Ceci est confirmé par Nature & Découvertes
où les compteurs d'eau sont relevés une foi par mois, surtout
dans les entrepôts (le nettoyage consomme beaucoup quand il n'est pas
surveillé).
L'eau coûte de plus en plus cher et son prix augmentera
encore à l'avenir. Le captage, le traitement et la distribution d'eau
potable ainsi que le transport et le traitement des eaux usées dans les
stations d'épuration consomment beaucoup d'énergie et
nécessitent de nombreuses infrastructures. Une gestion plus rationnelle
de l'eau permet donc à l'entreprise de réaliser des
économies intéressantes.
C'est aussi vrai pour l'énergie, les fournitures,
matières premières...
La bonne maintenance des équipements, l'analyse des
pertes éventuelles au cours du process, les économies
d'énergie, permettent une réduction des consommations.
On retiendra que tout ce qui n'est pas consommé
ne doit ni être payé, ni être traité.
En ce qui concerne les achats, outre le coût d'achat, il
faut également tenir compte de tous les coûts liés au
produit au cours de son cycle de vie:
ü Coûts directs d'exploitation (énergie,
consommation en eau et autres substances)
ü Coûts indirects (achat de matériel
supplémentaire de dépollution ou de sécurité en
fonction de nouvelles lois environnementales)
ü Coûts administratifs (achat de substances
dangereuses nécessitant des contrôles et des dispositions
spéciales (transport et stockage)
ü Coûts d'investissement supplémentaire dans
le futur pour faire des modifications nécessitant des économies
d'énergie, de consommation d'eau
ü Recyclabilité
ü Coûts d'élimination (ex.:
intégration du coût d'élimination des déchets ou
reprise des emballages par les fournisseurs dans les critères
d'achat)
ü Ecolabels.
Quand on considère le coût global, un
produit qui semble peu bon marché peut se révéler
être, au final, plus coûteux qu'un autre qui aurait
intégré en amont les contraintes écologiques et
sociales.
4.1.2. Les économies en
matière de taxes
Les taxes peuvent, dans une certaine mesure,
être considérées comme "le prix de la consommation
d'environnement". Elles s'appliquent aux rejets de polluants dans
l'air, l'eau et le sol, ainsi qu'aux émissions sonores. Pollueurs et
consommateurs sont tenus de payer à la collectivité la valeur de
la ressource qu'ils détruisent. Les redevances peuvent avoir un
aspect dissuasif en modifiant les prix relatifs des produits polluants
tels que les combustibles, les engrais, les pesticides, les batteries, etc.
Elles ont aussi un pouvoir redistributif car, la plupart du
temps, les recettes sont utilisées pour financer le traitement collectif
et la recherche sur les nouvelles techniques de dépollution.
Par exemple, en France, la loi relative à la lutte
contre le bruit institue une taxe destinée à couvrir les
dépenses d'aide aux riverains des aéroports. Elle est due par les
exploitants d'avions et dépend du nombre de décollages.
La Taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) regroupe l'ensemble des taxes visant à modifier les
comportements dans un sens plus favorable à l'environnement. Elle porte
sur un ensemble d'activités polluantes et est collectée par la
Direction générale des douanes et des droits indirects. Cette
taxe permet non seulement de dégager des ressources suffisantes pour
réparer les dommages liés aux activités polluantes des
entreprises, mais également de dissuader les pratiques polluantes.
La TGAP vise à faire apparaître le
véritable coût de la pollution. Il faut néanmoins ajouter
à cette taxe, la taxe sur l'énergie, la taxe
Éco-emballages, la taxe sur les produits pétroliers, la redevance
à l'Agence de l'eau et la TGAP pour les installations
concernées.
En outre, le CNDD va lancer un « chantier
d'une réforme fiscale » permettant d'aller vers plus
de durabilité dans l'économie française.
L'objectif est de « transférer progressivement, d'ici
2014, 10% des recettes fiscales pesant sur le travail (charges
sociales et patronales) vers l'environnement » en
étendant notamment la TGAP.
Faut-il attendre 2014 pour décider que les taxes sur
l'environnement coûtent trop cher à l'entreprise ? Plus
tôt les entreprises gèreront leur impact sur l'environnement, plus
elles feront d'économies.
4.1.3. Les économies en
matière sociale
L'application de normes sociales dépassant les
obligations juridiques fondamentales, par exemple dans le domaine de
la formation, des conditions de travail ou des relations entre la direction et
le personnel, peut également avoir des retombées directes
sur la productivité. C'est ainsi que s'ouvre une voie
permettant de concilier le développement social et une
compétitivité accrue.
Lorsqu'elles sont largement diffusées à tous les
niveaux de l'entreprise, les politiques et actions de développement
durable constituent un puissant facteur d'identification et de motivation. En
créant un climat de confiance, elles renforcent la motivation du
personnel, ce qui peut se traduire par de meilleurs résultats en
matière d'efficacité et d'innovation.
En effet, les employés sont toujours plus nombreux
à manifester des soucis éthiques et responsables quant à
la place de l'entreprise dans la société et à un renouveau
de la «citoyenneté».
Ainsi en remportant l'adhésion des salariés et
en les fédérant autour du projet d'entreprise que constitue la
démarche DD, l'entreprise minimise les risques de conflits
sociaux, diminue le taux d'absentéisme et peur espérer une
sensible amélioration de la productivité. Autant
d'éléments qui peuvent être chiffrés et qui
constituent une économie notable.
De plus, le niveau global de santé du personnel a
une influence importante sur la bonne marche de l'entreprise. Un
personnel en bonne santé, c'est:
ü Moins d'absentéisme
ü Moins de problèmes d'organisation pour remplacer
les personnes manquantes
ü Une meilleure ambiance de travail, une meilleure
motivation, d'où une meilleure productivité
ü Moins de risques d'accidents pour cause de manque de
personnel ou de stress.
Ainsi, en éliminant progressivement les causes,
l'entreprise diminue encore ses coûts sociaux tout en s'inscrivant dans
une démarche de responsabilité sociale.
Le capital social est un facteur d'intégration
et de confiance dont on commence à reconnaître les
retombées significatives sur le plan économique:
ü Il renforce la cohésion de votre entreprise et
accroît la motivation au travail
ü Il facilite les opérations commerciales et
financières et réduit leur coût (moins de frais de contrat,
moins d'intermédiaires, etc.)
ü Il favorise les collaborations entre entreprises ainsi que
le règlement collectif des problèmes
ü Il apporte des avantages commerciaux par le biais de liens
durables entre acheteurs et fournisseurs
ü Il réduit les coûts liés aux litiges
(frais d'avocats, etc.) et aux tâches de surveillance et de
contrôle
ü Il facilite la recherche et la mise en oeuvre de solutions
en matière de pollution, de bruit et d'autres problèmes
ü Il facilite la recherche de personnel pour les
employeurs
ü Il favorise l'innovation et la prise de risques.
Une entreprise possédant un riche réseau social
pourra régler de manière informelle plutôt que formelle bon
nombre d'opérations, ce qui réduira d'autant les coûts de
transaction.
Une PME peut favoriser diverses formes de capital social:
ü En promouvant de bonnes relations personnelles au sein de
l'entreprise
ü En encourageant les employés et employées
à s'engager dans la vie civile.
4.2. Les aides
financières
Elles ont pour but, soit d'inciter les pollueurs
à modifier leur comportement, soit d'aider les entreprises qui vont au
delà des normes environnementales ou sociales. Elles prennent
la forme de subventions, d'allégements fiscaux (amortissement
accéléré ou réduction des impôts et des
redevances) ou de prêts à taux réduit consentis aux
pollueurs et aux consommateurs. Elles restent toutefois d'une faible importance
(moins de 1 % du Pib).
En France, des aides financières (prêts) sont
accordées pour encourager les entreprises industrielles à
réduire la pollution des eaux, et des incitations fiscales existent pour
la promotion des énergies renouvelables : 21% de l'énergie doit
provenir d'énergies renouvelables à l'horizon 2006 selon les
engagements pris par la France au niveau européen.
La France a d'ores et déjà pris des mesures pour
parvenir à cet objectif. Les entreprises qui investissent afin
d'utiliser les énergies renouvelables bénéficient d'un
régime fiscal très particulier. Par le biais des crédits
d'impôts et de taux réduits de TVA, les coûts d'acquisition
de certains équipements mettant en oeuvre des énergies
renouvelables peuvent être réduits de 15 à 30%.
On trouve trois niveaux d'aides :
 les aides européennes : dispensées par 6
directions différentes de la Commission européenne ;
les aides européennes : dispensées par 6
directions différentes de la Commission européenne ;
 les aides au niveau national : l'ADEME, l'ANVAR, les 6 Agences
de l'eau, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la
Pêche et des Affaires rurales, le ministère de l'Écologie
et du Développement durable, le ministère de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie, le ministère de la Recherche ;
les aides au niveau national : l'ADEME, l'ANVAR, les 6 Agences
de l'eau, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la
Pêche et des Affaires rurales, le ministère de l'Écologie
et du Développement durable, le ministère de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie, le ministère de la Recherche ;
 Les aides au niveau régional : distribuées par
les conseils régionaux, qui peuvent être soumises à
approbation de la Commission européenne.
Les aides au niveau régional : distribuées par
les conseils régionaux, qui peuvent être soumises à
approbation de la Commission européenne.
Les PME et notamment les plus petites éprouvent de
nombreuses difficultés à s'y retrouver parmi tous les
dispensateurs d'aides, et, pour beaucoup, souhaiteraient l'existence d'un
interlocuteur unique.
L'ADEME, les Agences de l'eau et les DRIRE sont les principaux
dispensateurs d'aides au niveau national, pourtant on a pu constater (dans
l'étude Regards sur les PME) que l'ADEME était mal connue des
PME, surtout des plus petites.
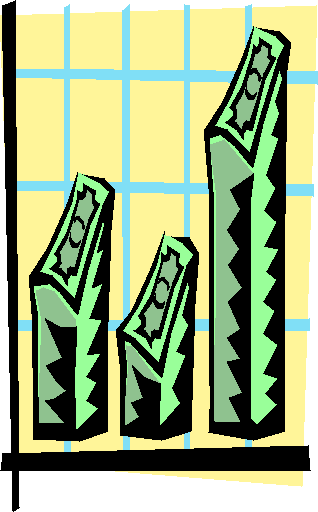
L'intérêt du Développement Durable pour
les PME semble donc bien réel. Mais les difficultés qu'elles
peuvent rencontrer à initier la démarche le sont aussi.
Les PME devront, pour s'engager sur la voie du DD, s'appuyer
sur leurs points forts et ne pas pêcher par excès en cherchant
à en faire trop tout de suite. Sans tomber toutefois dans l'autre
extrémité qui serait de collectionner quelques bonnes pratiques
et de revendiquer ensuite sa responsabilité sociale et environnementale,
elles devront trouver un juste équilibre, avec honnêteté et
dans le souci de ne pas trahir le pilier du DD que l'on occulte le plus
souvent ; la viabilité économique.
Engager une démarche de développement durable
ne veut pas dire sacrifier la rentabilité aux préoccupations
environnementales ou sociales. Il s'agit plutôt de trouver le juste
équilibre entre les dimensions économiques, écologiques et
sociales, et répondre aujourd'hui à ce que sera la PME de demain.
Dans cette optique, un programme de développement durable n'est pas un
luxe, mais un avantage concurrentiel. Pas uniquement un facteur de coût,
mais un moyen faire des économies à court terme et un
investissement à long terme.
La démarche d'engagement sur la voie du DD pour
une PME
1. Les étapes générales
Par son ampleur, l'intégration du développement
durable à l'activité quotidienne de l'entreprise ne peut
qu'être progressive. Mais alors, par où entamer cette
démarche ?
1.1. Diagnostic
social et environnemental de l'entreprise
Le diagnostic est la première étape de la
démarche. Il est essentiel pour que le projet de l'entreprise en
matière de développement durable soit cohérent avec sa
réalité quotidienne, pour qu'il soit réalisable, mais
aussi pour qu'il soit suffisamment ambitieux pour être
crédible.
Il consiste le plus souvent en l'étude de tous les
aspects de l'entreprise qui sont sensibles aux problèmes
environnementaux et sociaux.
1.2. Identification
des points prioritaires d'amélioration
L'expérience des entreprises les plus engagées
fait apparaître deux entrées possibles à la démarche
de développement durable, qui peuvent d'ailleurs être
simultanées : tout d'abord, l'entreprise doit, pour assurer la
crédibilité de son propos, s'attacher de manière
prioritaire à réduire ses impacts sociaux ou environnementaux les
plus directs et les plus importants. Souvent, l'entreprise tire de ces
priorités une série limitée d'indicateurs de performance.
Au-delà de ses impacts principaux, l'entreprise gagne aussi à
focaliser son effort sur des actions faciles à mettre en place à
court terme et dont l'effet visiblement positif (en termes d'économies,
de résultats commerciaux, de réputation, de
différenciation, etc.) aura des vertus pédagogiques et dynamiques
au sein de ces équipes.
Ces actions peu coûteuses et dynamisantes sont les
actions de réduction de la consommation des ressources et de gestion des
déchets qui font souvent partie de cette première phase.
De telles économies sont efficaces : tout d'abord,
elles permettent de motiver les équipes grâce
à des actions peu coûteuses et à effet rapidement visible,
et ensuite elles dégagent de quoi financer le passage progressif
à des projets de développement durable plus lourds. Et
souvent, ces actions permettent aussi de commencer à communiquer
la démarche auprès des clients de l'entreprise,
transformant une réduction des coûts en avantage
concurrentiel.
Il convient donc assez rapidement de piloter la
démarche de progrès et de choisir des priorités d'action
tout en s'attachant à développer la connaissance et la
compréhension de dimensions plus complexes, qui ne peuvent être
traitées au départ (les impacts indirects via les achats ou les
sous-traitants par exemple) : pour cela, beaucoup d'entreprises
prévoient l'intégration ultérieure de ces dimensions au
moyen par exemple d'une feuille de route qui définit les étapes
de progrès de l'entreprise sur cinq années au moins. Au fur et
à mesure de sa démarche, l'entreprise peut ainsi aborder les
impacts indirects de son activité.
1.3.
Définition du projet
Le projet est la résultante des points
d'amélioration recensés, de l'objet de l'entreprise (sa mission)
et du niveau d'engagement de la direction.
Il doit être clair, de façon à être
compris et intégré par les salariés, qui eux mêmes
pourront l'exposer à tous les stakeholders.
Le projet doit être diffusé. C'est pour cela
qu'il doit s'inscrire dans la durée. Il engage l'entreprise sur du long
terme.
1.4. Moyens de mise
en oeuvre du projet
Voici une grille générale des actions qui
permettront à une PME de mener son projet à bien :
ü
Donner un sens à son projet
Le projet doit être cohérent avec la mission de
l'entreprise, qu'il s'aligne sur celle-ci ou entraîne sa
redéfinition à la lumière de nouvelles perspectives. Il se
traduira par des buts et des plans d'actions spécifiques à chaque
service, mais l'essentiel est qu'il ait un sens global perceptible pour
tous.

ü
Impliquer tout le personnel
Ce projet est l'affaire de tous. Il doit créer une
dynamique participative et refléter les préoccupations de
l'ensemble des employés. C'est à cette condition qu'il mobilisera
les énergies créatrices et portera ses fruits.

ü
Mettre en place un dispositif de suivi
On ne peut gérer efficacement que ce que l'on mesure.
Les gérants le font déjà pour le suivi économique
de leur entreprise, mais ils peuvent également le faire pour les aspects
environnementaux et sociaux, en mettant en place par exemple une
comptabilité énergétique, un système de management
environnemental et/ou un bilan social.

ü
Faire preuve de souplesse
ü
Formaliser l'engagement dans l'organigramme de l'entreprise
L'organigramme de l'entreprise devrait refléter son
engagement en faveur du développement durable. C'est le meilleur moyen
d'ancrer ce programme dans la pratique quotidienne et de le lier plus
étroitement à la mission de l'entreprise.

ü
Inscrire le projet dans la durée
Pour réussir pleinement, un programme de
développement durable doit engendrer des automatismes dans les actions
au quotidien. S'il reste l'affaire d'un petit groupe qui se réunit
lorsque d'autres urgences ont été réglées, il n'a
aucune chance de donner des résultats probants.
ü
Dialoguer avec les «parties prenantes»
Qu'il s'agisse de la planification ou de la mise en oeuvre du
programme d'action, il est important d'identifier les risques et d'examiner
comment les transformer en opportunités. Les «parties
prenantes» ont un rôle important à jouer: elles sont les
interprètes les plus fiables des besoins, attentes, demandes,
priorités et préoccupations de la société.
ü
Evaluer ses résultats et les communiquer
Quoi que l'entreprise entreprenne en matière de
développement durable, il est dans l'intérêt de
l'entreprise d'évaluer ses résultats et de les communiquer. Les
systèmes de gestion et/ou la certification apportent un outil performant
en ce domaine.
ü
Faire connaître ses bonnes pratiques
Les PME devraient faire connaître leurs
expériences de «bonnes pratiques» en matière de
développement durable au sein de leur branche et auprès de leurs
fournisseurs. Les bonnes pratiques doivent être mesurables au niveau de
l'impact, innovantes (capables de produire de nouvelles solutions) et
reproductibles.
ü
Etablir des partenariats
Les PME peuvent rechercher des synergies par le biais de
partenariats avec des organisations de la société civile ou les
pouvoirs publics. Ces collaborations à long terme exigent
néanmoins beaucoup de temps et une bonne transparence. Il est
impératif en effet que l'organisation partenaire ne perde pas sa
capacité critique vis-à-vis de l'entreprise avec laquelle elle
collabore et que l'entreprise qui fait la démarche DD ne soit pas
suspectée d'essayer de les acheter.
2. Les clefs de la réussite de la démarche
2.1. Impulsion de
la direction
En amorçant une démarche de développement
durable, l'entreprise prend des engagements sociaux et environnementaux qui
dépassent largement la vision traditionnelle de sa fonction
économique. Cette réorientation représente souvent
l'amorce d'une révolution culturelle : c'est pourquoi elle n'est
possible qu'au prix d'un engagement personnel et fort des dirigeants de
l'entreprise. Il est en effet essentiel, par exemple, que les employés
comprennent qu'il s'agit, non pas d'une mode de management de plus, comme
certains tendent à le croire, mais véritablement d'un pilier
stratégique pour l'entreprise. Et ce message ne peut passer que par une
implication visible du PDG et du comité de direction sur ces questions,
qui peuvent prendre toutes sortes de formes : discours et écrits en
forme de prises de position publiques, engagement personnel dans des structures
travaillant sur ces questions, participation aux structures internes
chargées de piloter la démarche, etc.
2.2.
Intégration au système de management
Par définition, le système de management est la
courroie de transmission de l'entreprise : l'organisation, les structures, les
politiques de l'entreprise, les processus de prises de décision, les
systèmes d'évaluation ou de suivi de la performance collective et
individuelle diffusent dans l'entreprise ses valeurs et ses objectifs. Il est
donc essentiel que le développement durable soit intégré
au système de management, dès que possible, pour piloter la
démarche et assurer le respect des engagements aussi bien dans
l'entreprise que chez les sous-traitants et fournisseurs.
Cette intégration se traduit le plus souvent, dans les
entreprises, par la création d'une structure dédiée
(département ou poste spécifique, comité de
représentants des différents services) chargées de
diffuser la culture du développement durable en interne.
2.3. Formation et
mobilisation de tous les salariés
Le changement culturel important que représente le
développement durable ne peut se faire sans une formation des
équipes, pour qu'elles comprennent les enjeux de la démarche,
l'intérêt stratégique pour l'entreprise et les
conséquences sur leur travail quotidien, car la mobilisation de tous est
nécessaire pour faire progresser l'entreprise.
2.4. L'implication
des stakeholders
L'un des fondements des stratégies de
développement durable est qu'en s'ouvrant à des problèmes
sociaux ou environnementaux nouveaux, l'entreprise n'est plus experte comme
elle en a l'habitude sur son marché, mais simple débutante. Elle
est contrainte de reconnaître qu'elle n'aura pas, seule, toutes les
réponses. Les nouveaux partenariats entre entreprises et ONG se
révèlent alors précieux et constructifs.
2.5. La
transparence
Pour dialoguer et développer des partenariats, les
entreprises se doivent d'être transparentes et accepter de rendre des
comptes à leurs parties prenantes. Ces derniers attendent avant tout de
l'entreprise qu'elle fasse preuve d'honnêteté en communiquant ses
succès et ses échecs

3. Expérimentation de la faisabilité
financière de la démarche sur deux entreprises d'IDF
Nous avons vu plus haut que les TPE représentent 80%
des entreprises en France, et également le plus fort potentiel de
croissance avec l'augmentation des créations d'entreprises.
Mais nous avons vu aussi que, parmi des PME déjà
mal sensibilisées au Développement Durable, elles se sentent
encore moins concernées.
Mais cette démarche est-elle vraiment hors sujet pour
des TPE ?
Le but de cette partie est d'expérimenter, sur deux TPE
orientées service, la démarche décrite plus haut.
Notons que, de part le caractère évolutif dans
le temps de cette démarche, seul le début pourra être
étudié dans le cadre de ce mémoire.
On observera donc l'état actuel des deux entreprises
face aux aspects concrets de leur activité qui relèvent du
développement durable, pour ensuite choisir des actions pertinentes et
peu coûteuses pour entamer la démarche d'amélioration. Les
entreprises étudiées y trouveront en outre des recommandations
ainsi que des exemples d'outils qui leur permettront, le cas
échéant, de poursuivre leurs efforts sur la voie du
Développement Durable.
Il est important de préciser qu'il s'agit bien d'une
expérience.
Le résultat de cette étude, comme pour toute
expérimentation, n'aura pas valeur de loi générale.
La comparaison de ces deux cas permettra de dégager des
points communs et des différences, de lever des objections quant
à la faisabilité, dans une TPE, de certains aspects de la
démarche, et de vérifier que d'autres aspects ne posent pas de
problèmes aux dirigeants de TPE.
On pourra alors émettre des opinions plus
précises et plus argumentées quant à la viabilité
d'une démarche de Développement Durable pour une TPE.
3.1. Les
entreprises sélectionnées
Deux entreprises ont été choisies parmi cinq
contacts. Ce qui a motivé ce choix est le fait qu'elles soient toutes
les deux des TPE et que leur activité soit principalement tournée
vers les services (les autres contacts : un traiteur, une entreprise de
gestion immobilière de 120 collaborateurs, et une boutique d'impression
et de reliure de 2 personnes).
Les deux entreprises sélectionnées ne sont pas
sensées représenter un secteur ou un marché particulier.
Leur position face au développement durable est représentative
du fait même qu'elles sont des TPE, qu'elles n'appartiennent pas au
secteur industriel, et qu'elles ne sont pas sensibilisées au
développement durable.
3.1.1. IDF services
IDF services est une SARL au capital de 7 600 €
créée en 1990.
C'est une entreprise de transport qui opère
principalement en B to B sur le marché du mobilier.
Ses activités :
Ø Livraisons de meubles pour le compte de boutiques et
fabricants de meubles (mobilier traditionnel).
Ø Livraison et installation de literie chez les
particuliers
Ø Installation de meubles chez les clients finaux
Ø Dépôt
Ø Fabrication de meubles / menuiserie
Ø Les livraisons chez les particuliers constituent 95%
de leur activité.
L'entreprise est composée de 6 salariés y
compris le dirigeant (M. Lecocq) : 4 installateurs / monteurs / livreurs,
et un assistant qui seconde le dirigeant dans la gestion de la relation client
et l'organisation des tournées.
M. Lecocq a racheté l'entreprise en 2003. Son
prédécesseur lui a transmis une entreprise
bénéficiaire disposant d'un portefeuille de clients
fidèles. En 2003, la Chiffre d'affaire était de 205 000 €
pour un résultat net de 27 800 €.
En outre, étant lui-même déjà du
métier, il a amené ses propres clients, augmentant ainsi le
volume d'affaires.
Il a donc déjà dû effectuer des
investissements (dont l'achat d'un 2ème véhicule de
livraison) et envisage de continuer le développement de l'entreprise
dès que ses finances se seront rétablies (notamment des travaux
de réaménagement des locaux).
M. Lecocq est assez touché par les problèmes
sociaux et environnementaux à titre personnel. Néanmoins, il n'a
jamais envisagé d'impliquer son entreprise dans le développement
durable, pour la bonne et simple raison qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. En
effet, il n'effectuait pas, avant notre entretien, le lien entre
développement durable et respect de l'environnement et
équité sociale.
Il n'est pas réfractaire à l'idée de
mettre son entreprise à la RSE, mais exclut d'emblée tout
investissement supplémentaire.
3.1.2. Sodamin
La société Sodamin est une SARL au capital de 11
500 € créée en 1985 en tant que concessionnaire de la marque
Mobalpa (N°1 français sur le secteur de la fabrication de meubles
de cuisines, cuisines intégrées et salles de bain, la marque
fabrique également des rangements dressing et des bibliothèques).
le CA 2003 s'élevait à un peu plus d'1 millions d'euros pour un
résultat net de 15 000 €.
Sodamin dispose de 2 magasins côte à côte
à Vincennes, l'un dédié à la cuisine, l'autre
à la salle de bain.
La société est dirigée par son fondateur,
Christian Mary, et emploie 6 personnes (en dehors du dirigeant) : 2
vendeurs / concepteurs, 3 poseurs / menuisiers, et une secrétaire /
attachée commerciale. M. Mary est le conducteur des travaux ; il
supervise les dossiers de l'étude de faisabilité à la
phase finale.
En cas de pic d'activité, l'entreprise sous traite
à des poseurs externes. Néanmoins, M. Mary est très
attentif dans le choix des chantiers à sous-traiter pour ne pas entacher
l'image de qualité de l'entreprise.
Le marché est porteur tant pour l'aménagement de
neuf que pour la rénovation (en forte progression ces derniers temps
grâce à la TVA à 5,5% sur les meubles et travaux de
pose).
Compte tenu de sa localisation (grande artère
commerçante) et de son ancienneté, l'entreprise dispose d'une
solide réputation de sérieux et de savoir faire.
Leur zone de chalandise couvre principalement le Nord du
département 94 et les arrondissements de l'Est parisien.
Néanmoins, leurs magasins attirent des clients d'autres
départements, et même d'autres pays grâce au bouche à
oreille positif et à la migration d'anciens clients qui ne manquent
jamais de revenir lorsqu'ils ont une nouvelle cuisine ou salle de bain à
installer.
Le magasin dédié à la cuisine a
été entièrement refait en juin 2003, le deuxième
sera refait en juin 2004.
La philosophie de l'entreprise consiste à offrir un
niveau de qualité élevé, de privilégier une vision
globale qui intègre les rêves des clients et une adaptation
pratique à leurs modes de vie.
Les vendeurs sont d'autant plus attentifs à l'ergonomie
des cuisines qu'ils sont conscients du danger que représentent les
accidents domestiques.
Les cuisines Mobalpa sont déjà sur la
voie de l'éco-conception, même si M. Breton (responsable
développement de l'enseigne) n'a pas utilisé ce terme. En effet,
grâce aux remontées d'informations des concessionnaires, les
cuisines sont conçues par Mobalpa pour être sûres, elles
sont disposées rationnellement de manière à
économiser du temps et à éviter les mauvaises postures,
elles permettent une économie d'énergie, et facilitent le tri des
déchets en intégrant (si la surface du client le permet) des
poubelles à quatre compartiments dans un meuble dédié.
3.2. Diagnostic
Développement Durable
De manière à bien cerner la position actuelle
des entreprises étudiées face au développement durable,
j'ai réalisé plusieurs entretiens avec leurs dirigeants. Au cours
de ces entretiens, les mêmes questions ont été
posées aux deux interlocuteurs afin de pouvoir comparer les situations
de leurs entreprises respectives (Cf. trame d'entretiens en Annexe 11)
Les points importants apparaissent dans le tableau
suivant :
|
IDF service
|
|
Sodamin
|
|
Interne
|
|
Ø Très peu de consommation d'eau : uniquement
pour les sanitaires, café, et ménage.
Ø Pas de contrôle de la consommation.
Ø Pas d'usage de substances polluantes.
Ø 70 € par trimestre
|
Gestion de l'eau
|
Ø Consommation suivie régulièrement afin de
dépister d'éventuelles fuites.
Ø Personnel encouragé à économiser
l'eau (réduction de moitié entre 1999 et 2001) dans l'entreprise
comme chez les clients.
Ø Pas de rejet de substances polluantes
Ø Le ménage est fait avec de produits
biodégradables qui respectent l'environnement
Ø 115 € / trimestre
|
|
Ø Ne surveille pas encore l'évolution de la
consommation. Nous avons constaté ensemble, sur une facture, une
augmentation inhabituelle que le dirigeant était incapable
d'expliquer.
Ø Mais l'ancien patron calculait la part de consommation
en fonction des différents clients
Ø EDF = 90 € tous les deux mois environ
Ø 660 € en 2003
|
Gestion de l'énergie
|
Ø La consommation est suivie, tant pour
l'électricité que pour le carburant.
Ø Suivi plus particulier depuis l'installation de la
climatisation
Ø Contrôle particulier de la consommation de la
climatisation et du chauffe eau.
Ø Utilisation de puits de lumière et de lampes
spéciales : éclairage adapté et consommation faible.
Cet investissement a été réalisé lors des travaux
du 1er magasin (cuisines)
Ø Pas d'objectifs de réduction formalisés,
juste une volonté de réduire les factures.
Ø EDF = 720 € en moyenne tous les deux
mois
|
|
Ø Faible consommation car faible production ; les
services représentent 95% de l'activité
Ø Peu de consommation de papier (1 rame /
mois)
|
Consommation
de matières premières et fournitures de
bureau
|
Ø Pas d'activité de production
Ø Consommation de papier importante (environ 20
rames par mois)
|
|
Ø 2 camionnettes diesel
Ø Les chargements sont groupés mais les retours se
font toujours à vide.
Ø L'entretien est régulièrement
effectué au garage (pas de vidanges dans l'entreprise).
Ø L'entreprise est desservie par une ligne de bus de
banlieue et est à 10 min à pieds du métro, mais 5
salariés sur 6 viennent en voiture.
Ø Le coût d'achat prévu pour la
3ème camionnette d'occasion (achat en sept. 2004) est de 15
000 € pour une durée de vie estimée à 10 ans.
Ø 6 000 € d'entretien prévus pour 2004 soit
environ 2000 € par véhicule.
Ø 2 200 € de carburant en 2003
|
Transports
|
Ø 2 fourgonnettes diesel. L'entreprise possède
actuellement 2 anciens véhicules et est sur le point d'en prendre 2
nouveaux en leasing (280€/mois/voiture sur 5 ans).
Ø Indemnité kilométrique pour le
3ème poseur (220€/ mois). La
société envisage de prendre un 3ème
véhicule en leasing
Ø Approvisionnements par camions Mobalpa : pas de
transport combiné
Ø Les poseurs se déplacent avec les voitures de
société
Ø Les autres : voiture personnelle, et transports en
commun (la secrétaire)
Ø Pas de mesure pour favoriser l'emploi des transports en
commun
Ø Desservi par la ligne 1, le RER A et le bus 56
Ø Font appel à un transporteur pour les livraisons
chez les clients.
Ø 2 400 € de carburant en 2004 pour 4
véhicules.
Ø entretien compris dans le leasing.
|
|
Ø Uniquement des déchets courants, des emballages
et du bois.
Ø Les déchets courants ne sont pas triés.
Ø Pas de comptabilité des quantités de
déchets générés par l'entreprise.
Ø Le bois et les emballages sont menés à la
décharge
Ø 40 € par mois environ
Ø 580 € en 2003
|
Déchets
|
Ø La production de déchets n'est pas suivie, mais
leur coût d'élimination l'est.
Ø Les déchets sont composés principalement
de bois et de gravats chez les clients, et de papier et de déchets
ménager dans les boutiques.
Ø Les gravats et autres déchets sont emmenés
par les poseurs à la décharge. Un contrat a été
passé avec la voirie pour le ramassage des cartons.
Ø Pas de tri sélectif dans les bureaux
Ø Les piles, tonner, tambours... sont
réexpédiés au fabricant.
Ø Les déchets spéciaux (acide, white spirit,
décapants, colles) sont mis dans des bidons puis dans des cartons et
laissés pour le ramassage quotidien de la voirie.
Ø Décharge : 540 €/an
(dont 200 pour des cartons)
Ø Voirie : 500 € / an
|
|
Ø Pas de politique particulière.
Ø Prêt à acheter des produits
éco-conçus si le surcoût reste modeste.
Ø Pour les nouveaux équipements, il s'agit
principalement de reprises
Ø Le dirigeant ne sait pas comment choisir des produits
respectueux de l'environnement.
Ø Accepte d'acheter dès maintenant du papier
recyclé.
Ø Pas d'articles à usage unique dans le bureaux
(verres au lieu de gobelets, filtre à café permanent,...)
|
Achats
|
Ø Utilisent du papier recyclé.
Ø Pas d'articles à usage unique dans le bureaux
(verres au lieu de gobelets, filtre à café permanent,...)
Ø Ne tiennent pas compte de la consommation des produits
en ressources naturelle lors de l'achat.
Ø Prêt à acheter des produits
éco-conçus si le surcoût reste modeste.
|
|
Ø Ø le local est aux normes, les instructions sont
affichées à l'entrée sur une note de service.
Ø L'information est diffusée quant aux risque de
mauvaises postures lors du port d'objets lourds. Le personnel est formé
en interne.
|
Sécurité sur le lieu de
travail
|
Ø Pas de consigne particulière hors dispositions
légales (extincteurs, sorties de secours...)
Ø Lieux à risque identifiés mais peu
nombreux
Ø Les informations sont données de façon
informelle et sont peu respectées par les poseurs.
Ø L'ergonomie des bureaux a été
développée par les bureaux d'études de Mobalpa. Ils sont
donc assez adaptés.
|
|
Ø Pas encore de suivi des objectifs, mais c'est en
projet.
Ø Le dirigeant compte continuer les investissements pour
développer l'entreprise : 2 embauches, 1 véhicule et des
travaux d'aménagement des locaux.
|
Développement économique
|
Ø Le seul objectif est en terme de CA minimum par mois
(110 000 €)
Ø Pas d'outil de suivi des objectifs
|
|
Externe
|
|
Ø Aucune pression connue dans le sens de la RSE de la part
des donneurs d'ordre et des clients finaux.
Ø La concurrence n'utilise pas d'argumentation
« verte », et ils n'entretiennent aucun contact entre
concurrents.
|
Clients et concurrents
|
Ø Environ 15% de la clientèle est internationale,
et 10% provient de pays où les clients sont sensibilisés à
la RSE
Ø Certains clients, surtout les étrangers,
s'intéressent aux performances environnementales et sont sensibles aux
labels.
|
|
Ø Le dirigeant se fait aider dans la gestion des
tournées par son assistant. Mais celui-ci n'a aucune formation
bureautique. Il effectue tout le suivi à la main.
Ø L'unique ordinateur sert à éditer des
devis et des factures.
|
Capital social
|
Ø Peu de concertation dans la prise de décision
Ø Le dirigeant n'est pas complètement fermé
au prêt ponctuel de salariés pour une cause d'intérêt
général s'il peut en ressortir des retombées positives en
termes d'image.
|
|
Ø Aucune implication dans la vie de la collectivité
locale.
Ø Non affilié à un syndicat
Ø Pas de nuisances signalées
|
Intégration locale
|
Ø Aucune implication dans la vie de la collectivité
locale.
Ø Non affilié à un syndicat
Ø Pas de nuisances, si ce n'est un léger bruit dans
l'arrière cour de l'immeuble dû à la climatisation.
Ø Enseigne lumineuse étudiée pour ne pas
être dérangeante (bureau d'études de Mobalpa).
Ø Pas de plainte des riverains
|
Situation générale d'IDF Services
face aux exigences de la RSE
|
Atouts
|
faiblesses
|
|
Ø Entreprise en pleine réorganisation sous
l'impulsion du nouveau gérant. Les changements liés au DD seront
plus faciles à mettre en place et à accepter pour le personnel
Ø Réceptivité du dirigeant
Ø Pas de conduite irresponsable ou nuisible
détectée.
|
Ø Très peu de bases de bonnes pratiques
Ø Pas de moyens financiers à disposition pour le
DD. Les ressources prévues en cas de bonne performance en 2004 ont
déjà des emplois prévus
Ø Pas de moyens humains de qualification suffisante pour
suivre efficacement les mesures d'économies qui seraient prises.
|
En tant que dirigeant d'IDF Services, M. Lecocq est
particulièrement sensible à une argumentation
économique et civique. Dans le cadre
de l'implication dans une démarche développement durable, les
perspectives de faire des économies, d'avoir un meilleur cadre de
travail et d'être une entreprise exemplaire le séduisent.
Situation générale de Sodamin
Services face aux exigences de la RSE
|
Atouts
|
faiblesses
|
|
Ø Un bon comportement global en ce qui concerne l'aspect
environnemental
Ø Une conscience aiguë de l'importance de l'image de
l'entreprise et de la qualité perçue par le client
(enquêtes de satisfaction régulières)
Ø Prêts à intégrer une démarche
DD qui leur assure un avantage compétitif sans nécessiter
d'investissements lourds.
Ø Une franchise auprès d'une marque disposant de
bureaux d'études lui permettant d'être à la pointe de la
qualité et du respect de l'environnement (certifiée iso 9001 et
ISO 14001)
Ø Pression imminente du franchiseur qui a récemment
ajouté à son site Internet : « Mobalpa apporte
sa contribution concrète au concept de développement
durable », dans le paragraphe dédié à la
norme ISO 14001
|
Un déficit en terme de gestion du capital social et de
l'intégration à la vie locale
Mauvaise pratique dans l'élimination des déchets
spéciaux
Pas du tout de possibilité d'investissement avant 2006
(travaux des 2 magasins)
Pas de pratiques de fixation d'objectifs et de suivi. Management
informel.
|
En tant que dirigeant de Sodamin, M. Mary est
particulièrement sensible à une argumentation
image et qualité. Ce qui le
séduit avant tout dans la démarche développement durable
est d'être en mesure de communiquer sur la qualité et la
performance environnementale et sociale de ses services et sur l'engagement de
sa société.
Pour affiner ce diagnostic et obtenir des conseils de
professionnels, les entreprises pourront s'adresser à la CCIP (cf.
Annexe 12)
3.3. Application de
la démarche
3.3.1. Propositions d'actions et
coût
Sodamin
Projet d'amélioration court terme
Gestion de l'énergie / eau
|
Que peut-on changer et comment?
|
Commentaires / Responsable
|
Délais / Temps
|
Coût / Economie
|
|
- Formaliser le suivi : tenir un tableau de
bord des consommations en fonction du niveau d'activité.
- Objectif : réduction de 5 %
|
Secrétaire
|
20 min / semaine
Janvier 2005
|
_
|
|
- Réduire les émissions
polluantes : passer au GPL* (0.50€/L) pour les
véhicules des poseurs (soit 1500 € de carburant pour les 3
véhicules).
|
|
juin 2004
|
- 900 € / an / véhicule
soit 1 350€ en 2004 pour 3 véhicules
|
*cf. Annexe 13
Transports
|
Que peut-on changer et comment?
|
Commentaires / Responsable
|
Délais / Temps
|
Coût / Economie
|
|
- Réduire les émissions
polluantes : prendre le 3ème véhicule en
leasing en GPL, et remplacer le contrat des 2 premiers véhicules en
leasing par du GPL.
En changeant de prestataire ( Avis est moins cher que Renault)
|
Sujet de communication externe efficace.
|
juin. 2004
|
200€ / mois / véhicule
sur 5 ans* :
-180€/mois
pour les 3 véhicules
soit 1080 € en 2004
|
* cf. devis en Annexe 14
Déchets
|
Que peut-on changer et comment?
|
Commentaires / Responsable
|
Délais / Temps
|
Coût / Economie
|
|
- Faciliter le tri : utiliser les poubelles
compartimentées également dans les bureaux.
|
Le dirigeant effectuera un rapide contrôle des poubelles
à ordures ménagères afin de s'assurer que les consignes de
tri sont respectées.
|
Juin 2004
|
A négocier gratuite-ment auprès de Mobalpa
|
|
- Supprimer les mauvaises pratiques : payer
le traitement des déchets spéciaux
|
Poseurs
|
Juin 2004
|
60 € / an
soit 30€ en 2004
|
|
- Identifier les possibilités de réduction
des déchets : effectuer un suivi des déchets
produits par l'entreprise
|
Secrétaire
|
5 min/jours
|
_
|
Achats
Profiter également des investissements prévus dans
le développement normal de l'entreprise pour prendre en compte
des critères d'achat « responsables ».
L'entreprise ne projette aucun investissement à ce
jour.
Sécurité sur le lieu de
travail
|
Que peut-on changer et comment?
|
Commentaires / Responsable
|
Délais / Temps
|
Coût / Economie
|
|
- Rédiger une page récapitulative des consignes de
sécurité à coller aux endroits sensibles et dans les
voitures des poseurs.
- Les rappeler oralement 1 fois par mois
|
Le dirigeant
|
Juin 2004
|
_
|
Intégration locale
|
Que peut-on changer et comment?
|
Commentaires / Responsable
|
Délais / Temps
|
Coût / Economie
|
|
- Diminuer le bruit au sein de l'entreprise :
Tenir un registre des plaintes ou commentaires concernant les
nuisances que l'entreprise occasionne et des procédures mises en place
pour y remédier: (Problème/plainte,
Procédés/activités responsables, Action corrective).
|
Secrétaire
C'est une manière de soigner ses relations de
voisinage et aussi un grand avantage pour le dirigeant et pour le
personnel.
|
5 min/sem.
|
_
|
|
- Soutenir les actions de solidarité
locales : proposer à la Mairie d'effectuer la pose de
cuisines intégrées (à raison d'1 jour/mois) chez des
personnes en difficulté si la Mairie rachète à prix
coûtant les meubles invendus.
Objectif : 4 actions en 2004 (4 jours)
|
Les poseurs seraient volontaires. Et leur salaire leur serait
versé en totalité.
Ces actions éviteraient de mettre certains meubles
à la décharge.
|
Janvier 2005
|
500 €
- 40 €
|
|
Solde financier prévisionnel de la mise en
route de la démarche Développement Durable chez Sodamin à
début janvier 2005
|
Total
|
- 1 940 €
|
Non seulement cette démarche de développement
durable apportera des impacts positifs à l'entreprise, mais elle
permettra de plus de faire une légère économie. Quant au
suivi, il ne nécessitera que 37 h par an environ
à la secrétaire de M. Mary, ce qui est tout à fait
envisageable sans surcoût.
Démarche globale
Le projet de Sodamin :
Devenir le concessionnaire pionnier en termes d'implication dans
une démarche de développement durable et devenir un exemple de
bonnes pratiques tant pour les autres concessionnaires que pour les cuisinistes
d'Ile de France.
|
Donner un sens au projet
|
formaliser l'implication dans le DD. Expliquer le lien
étroit entre les impératifs de DD et les engagements de Sodamin
en son nom et en tant que concessionnaire Mobalpa.
|
|
Impliquer le personnel
|
Les impliquer dans les actions DD et écouter leur avis
afin de les valoriser. Surtout ne pas imposer les objectifs, discuter du projet
avec eux en amont.
|
|
Organiser le suivi
|
Faire de la secrétaire la responsable du suivi des actions
DD : collecte d'informations, suivi des objectifs...
|
|
Rester souple
|
Gérer les imprévus, décider dans la
concertation, adapter la démarche aux événements, mais ne
pas perdre le projet de vue.
|
|
Formaliser l'engagement
|
Rédiger la charte Sodamin annexée au contrat de
services Mobalpa (cf. Annexe 15)
|
|
Inscrire le projet dans la durée
|
Fusionner la RSE et les projets de développement normaux
de l'entreprise.
|
|
Dialoguer avec les stakeholders
|
Expliquer le nouvel engagement de Sodamin aux sous traitants, aux
fournisseurs et aux clients. Prendre contact avec les collectivités
locales, identifier avec eux les moyens de participer au dynamisme local.
|
|
Evaluer ses résultats et les communiquer
|
Faire un bilan mensuel de la position de l'entreprise par rapport
à ses objectifs DD et énumérer les bonnes pratiques du
mois. Distribuer ce document aux stakeholders (les afficher à
l'attention des clients dans le magasin)
|
|
Communiquer
|
Afficher l'engagement de l'entreprise sur ses véhicules,
sur les modèles d'exposition en magasin, et discrètement sur la
vitrine.
|
|
Etablir des partenariats
|
rechercher des association locales dynamiques et connues dans
l'optique de développer des actions conjointes à moyen terme.
|
IDF services
Projet d'amélioration court terme
Gestion de l'énergie
|
Que peut-on changer et comment?
|
Commentaires / Responsable
|
Délais / Temps
|
Coût / Economie
|
|
- Eliminer le gaspi : suivre de
manière hebdomadaire la consommation (au compteur) et annoter selon
l'activité de l'entreprise pendant la semaine
Objectif : réduction de 10 %
|
Assistant
|
10 min / semaine
Janvier 2005
|
_
- 40 €
|
|
- Réduire les émissions
polluantes : passer au GPL (0.50€/L) pour les
véhicules de livraison.
|
|
septembre 2004
|
- 420 € / an / véhicule
soit -420€ en 2004 pour 3 véhicules
|
Transports
|
Que peut-on changer et comment?
|
Commentaires / Responsable
|
Délais / Temps
|
Coût / Economie
|
|
- Réduire les émissions
polluantes : acheter en leasing des véhicules GPL neufs,
avec entretien compris.
|
Point crucial d'amélioration pour une entreprise
de transport.
|
Sept. 2004
|
280 €/mois
sur 5 ans
soit :
-720 €/an sur 10 ans pour 3
véhicules
|
Déchets
|
Que peut-on changer et comment?
|
Commentaires / Responsable
|
Délais / Temps
|
Coût / Economie
|
|
- Faciliter le tri : veiller à ce
que les sacs, poubelles et conteneurs aient une couleur spécifique pour
chaque catégorie de déchets; complétez l'information par
des pictogrammes et placer des poubelles sélectives et place de
stockage provisoire à proximité des postes de travail
|
Le dirigeant effectuera un rapide contrôle des poubelles
à ordures ménagères afin de s'assurer que les consignes de
tri sont respectées, notamment pour les déchets
spéciaux
|
Juillet 2004
|
20 €
|
|
- Identifier les possibilités de réduction
des déchets : effectuer un suivi des déchets
produits par l'entreprise
|
Assistant
|
5 min/jours
|
_
|
Il faut rappeler en permanence les consignes de tri au personnel,
expliquer à chacun comment fonctionne la collecte sélective et
où vont aller les déchets, se fixer des objectifs de
réduction et présenter les résultats au personnel.
Achats
|
Que peut-on changer et comment?
|
Commentaires / Responsable
|
Délais / Temps
|
Coût / Economie
|
|
- Profiter des investissements prévus dans le
développement normal de l'entreprise pour prendre en compte des
critères d'achat « responsables »
Ex : réfrigérateur
|
Dirigeant
Le coût est en fait le surcoût par rapport à
un achat classique.
|
Sept. 2004
|
70 € en moyenne
|
|
- Acheter du papier recyclable (on compte 1,5
rames de papier, la consommation augmentant avec la mise en place d'outils de
suivi).
|
Juin 2004
|
10 € / an
soit 4 € en 2004
|
Capital social
|
Que peut-on changer et comment?
|
Commentaires / Responsable
|
Délais / Temps
|
Coût / Economie
|
|
- Promouvoir la place des femmes au
travail : Embaucher une femme au poste de livreur/poseur
à pourvoir
(salaire : 1 350 € brut)
|
Faire appel au Fond Social Européen* et à la
CCIP : finance ment à hauteur de 40% et plus.
|
1er septembre 2004
|
-9000€/an
soit 3000 € en 2004
|
|
- Améliorer le niveau de formation du
personnel : former l'assistant et le dirigeant à la
bureautique (5 jours de formation**)
|
Aide à la formation du personnel* : environ 20 %
|
Sept. 2005
|
380 €
sans aide : 480 €
|
|
- Améliorer les conditions de
travail : nouvel agencement des locaux ( estimation initiale des
travaux à effectuer : 1 800 €, estimation des travaux
conformes pour l'obtention de l'aide : 3 500 €)
|
En termes de surcoût
Faire appel à la FACT* : 30%
|
Sept. 2005
|
650 €
|
* Annexe 16
** Annexe 17
|
Solde financier prévisionnel de la mise en
route de la démarche Développement Durable chez IDF Services
à début janvier 2005
|
|
Total si les aides ne sont pas obtenues (donc
les travaux et embauches n'entrent pas dans le calcul du coût de la
démarche DD)
|
- 86 €
|
Total avec les aides
|
- 2 536 €
|
Quel que soit le résultat des demandes de subventions,
cette démarche ne demandera aucun investissement financier de la part de
l'entreprise. Seul un investissement modeste en terme de temps sera
nécessaire. En effet, le suivi nécessitera environ 30h
par an à l'assistant de M. Lecocq.
Démarche globale
Le projet d'IDF Services :
Tenir la promesse du nom de l'entreprise en devenant une
entreprise de transport d'Ile de France « propre »,
proposant un service de qualité à ses clients et garantissant la
meilleure équité sociale possible à toutes ses parties
prenantes.
|
Donner un sens au projet
|
Structurer l'entreprise selon des principes du DD. Formaliser les
procédures au sein de l'entreprise pour un développement
solide.
|
|
Impliquer le personnel
|
Les impliquer dans les actions DD et écouter leur avis
afin de les valoriser. Surtout ne pas imposer les objectifs, discuter du projet
avec eux en amont.
Sensibiliser les chauffeurs à l'économie de
carburant.
|
|
Organiser le suivi
|
Faire de l'assistant le responsable du suivi des actions
DD. : collecte d'informations, suivi des objectifs
|
|
Rester souple
|
Gérer les imprévus, décider dans la
concertation, adapter la démarche aux événements, mais ne
pas perdre le projet de vue.
|
|
Formaliser l'engagement
|
Formuler l'engagement d'IDF Service et afficher le document sur
le panneau d'affichage à l'entrée du local.
|
|
Inscrire le projet dans la durée
|
Fusionner la RSE et les projets de développement normaux
de l'entreprise.
|
|
Dialoguer avec les stakeholders
|
Expliquer le nouvel engagement d'IDF Services aux donneurs
d'ordre et aux clients finaux. Prendre contact avec les collectivités
locales, dans un premier temps à l'occasion des demandes d'aides, puis
entretenir le dialogue.
|
|
Evaluer ses résultats et les communiquer
|
Exposer régulièrement la position de l'entreprise
par rapport à ses objectifs DD et énumérer les bonnes
pratiques du mois sur le panneau d'affichage.
|
|
Communiquer
|
Afficher l'engagement de l'entreprise sur ses
véhicules.
|
|
Etablir des partenariats
|
À envisager à plus long terme
|

3.3.2. Impacts positifs
escomptés
IDF Services :
Même si les économies s'avèrent modestes
dans le cas où les aides ne sont pas obtenues pour une meilleure gestion
du capital social, ces actions constitueront un bon début pour IDF
Services.
En effet, la formation du personnel administratif et la mise
en place des dispositifs de suivi ne manqueront pas de porter leurs fruits en
2005.
L'entreprise pourra alors espérer faire des
économies plus importantes et mieux gérer son processus
d'achats.
Car non seulement l'achat de matériel moins gourmand en
ressources et en énergie permet de réaliser des économies
significatives, mais il améliore également la qualité et
la fiabilité des achats. Ces achats verts constituent un indicateur
important de l'engagement managérial de l'entreprise en matière
de RSE.
De plus le passage au leasing soulage le dirigeant des soucis
causés par l'entretien de véhicules anciens (achetés
d'occasion) qui peuvent nécessiter des réparations
coûteuses à tout moment. En outre, le prix d'utilisation baisse,
et les économies annuelles sont significatives.
Ces avantages pour l'entreprise sont complétés
par des bénéfices certains pour la collectivité :
moins de pollution et moins de bruit.
L'implication des chauffeurs et de l'assistant dans le projet
d'intégration du développement durable aura aussi comme effet de
fédérer le personnel autour de l'objectif commun : faire
prospérer l'entreprise selon les principes (bientôt
standardisés ?) de la RSE.
Sodamin:
En mettant en oeuvre cette démarche, Sodamin
s'assurera la position de concessionnaire Mobalpa pionnier
dans l'intégration des impératifs du
développement durable à sa gestion quotidienne.
Ceci lui assurera non seulement un avantage compétitif
face à sa concurrence dans sa zone de chalandise, mais également
face aux autres concessionnaires Mobalpa d'Ile de France qui seront en retard
concernant les nouvelles exigences de Mobalpa.
De plus, Mobalpa aura probablement besoin d'une vitrine pour
montrer son engagement sur toute la chaîne de la valeur. Or la
société Fournier (marque Mobalpa) ne possède pas de point
de vente. En se positionnant comme pionnier, Sodamin bénéficiera
donc en premier de la communication effectuée par la franchise.
Quant aux actions pour favoriser l'intégration locale,
elles auront pour effet à long terme de facilité l'accès
aux aides dont l'entreprise pourrait avoir besoin pour mettre en place de
nouvelles actions. De même, elles contribueront au renforcement du
sentiment d'appartenance des salariés qui seront fiers d'oeuvrer, avec
leur entreprise, pour le bien de la communauté. L'image de l'entreprise
qu'ils diffusent à l'extérieur n'en sera que meilleure.

3.3.3. Recommandations et outils de
suivi
ü
Recommandations
Après avoir ainsi dressé le bilan de la
situation actuelle et examiné les améliorations possibles, voici
quelques recommandations pour ne pas se perdre en route et s'éloigner
des préoccupations du développement durable :
þ Veiller à l'égalité des
chances
Le développement durable implique la participation de
tous les acteurs à la prospérité économique. Les
PME peuvent oeuvrer en ce sens en promouvant le rôle de la femme, en
facilitant l'accès au monde du travail pour les jeunes, en favorisant
l'intégration des personnes handicapées et en encourageant la
diversité au sein de leur personnel.
Les PME ont aussi un rôle important à jouer dans
l'intégration ou la réintégration professionnelle des
chômeurs.
Ø Donner des emplois aux jeunes (Principe 21 de la
Déclaration de Rio) pour projeter l'image d'une entreprise
dynamique qui participe à la formation et à l'insertion
professionnelle.
Ø Lors d'un recrutement de personnel, donner leurs
chances - à compétences égales - aux personnes à la
recherche d'un emploi.
Ø Eviter de discriminer les chômeurs de longue
durée: plus le chômage dure, plus il est difficile de retrouver un
emploi.
Une entreprise responsable s'efforcera par ailleurs
d'éviter toute discrimination - sans rapport direct avec les
compétences professionnelles - basée sur des
critères tels que le sexe, la nationalité, la race, la religion
ou l'âge. Elle veillera à ne pas écarter d'office les
employés et employées ayant dépassé la
cinquantaine, voire la quarantaine, et qui risquent d'avoir beaucoup de mal
à (re)trouver du travail. Il suffit parfois d'une petite formation pour
que ces personnes soient parfaitement à niveau (notamment dans le
domaine informatique) et qu'elles puissent faire bénéficier
l'entreprise de leur précieuse expérience.
Il est de plus en plus largement reconnu que la
diversité est un aspect fondamental de la richesse et de la santé
de l'économie, et que l'intégration horizontale et verticale de
tous les groupes de population doit être activement encouragée. La
prise en compte de cette dimension dans votre entreprise vous permettra de
faire des progrès réels dans la démarche de
développement durable.
þ Informer et influencer les prestataires de
service, les sous-traitants et les fournisseurs (surtout pour
Sodamin)
Ø Informer ses fournisseurs de l'intérêt
de l'entreprise pour l'environnement et leur demander de présenter leur
gamme de produits «verts»
Ø Privilégier l'achat de produits
régionaux, qui créent des emplois au niveau local
Ø Pour la machine à café,
privilégier l'achat de cafés issus du commerce équitable,
c'est-à-dire ménageant l'environnement et assurant des conditions
de vie correctes aux petits producteurs. Penser notamment à la gamme de
produits Max Havelaar (www.maxhavelaar.fr).
þ Pour mieux gérer vos achats
Afin de mieux connaître la performance environnementale
des produits que l'entreprise utilise couramment, il faut faire une liste de
critères tels que la durabilité, le coût, la
présence de solvants, la présence d'écolabels, la
recyclabilité. Si certains de ces produits comportent trop de points
négatifs, il est judicieux de les modifier en priorité.
ü
Outils de suivi
On ne gère parfaitement que ce que l'on mesure. Pour aider
IDF Services et Sodamin dans leur démarche, voici des exemples de
«tableau de suivi» à adapter en fonction de leurs
spécificités.
BILAN ANNUEL DES CONSOMMATIONS EN EAU
|
Quantité d'eau utilisée
|
Consommation (m3/an)
|
Coûts par an
|
|
Procédés de production
|
|
|
|
Sanitaires
|
|
|
|
Lavages
|
|
|
|
Refroidissement et humidification
|
|
|
|
Arrosage
|
|
|
|
Autres
|
|
|
|
Total
|
|
|
TABLEAU ANNUEL DES CONSOMMATIONS
ENERGETIQUES
|
Mois
|
Electricité (kWh)
|
Gaz (kWh ou m3)
|
Mazout (litres)
|
Autres
|
|
Janvier
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
Décembre
|
|
|
|
|
|
Total annuel
|
|
|
|
|
BILAN ENERGETIQUE
|
Année:
|
Chiffre d'affaires:
|
|
Source énergétique
|
Consommation (c)
|
Consommation équivalente (MJ)
|
Prix unitaire (euros)
|
Coût (euros)
|
|
Electricité totale
|
|
|
|
|
|
Tarif jour
|
|
|
|
|
|
Tarif nuit
|
|
|
|
|
|
Autre tarif
|
|
|
|
|
|
Carburant des véhicules
|
|
|
|
|
|
Diesel
|
|
|
|
|
|
GPL
|
|
|
|
|
|
Autres
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
MJ
|
Total
|
|
TABLEAU DE SUIVI DES DECHETS
|
Date
|
Ordures ménagères
|
Papier et carton
|
Verre
|
Déchets organiques
|
Métaux
|
Déchets spéciaux
|
Autres (déchets de chantier, bois, etc.)
|
|
|
Q
|
C
|
Q
|
C
|
Q
|
C
|
Q
|
C
|
Q
|
C
|
Q
|
C
|
Q
|
C
|
|
../../..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
../../..
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total annuel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Q: quantité (volume ou poids) C:
coûts d'élimination (traitement et évacuation)
Sur la base des résultats ci-dessus, on pourra dresser un
bilan annuel :
BILAN ANNUEL DES DÉCHETS
|
Année
|
Chiffre d'affaires
|
|
Type de déchets
|
Quantité
(volume, poids)
|
Coûts
|
Filière d'élimination (recyclage,
incinération, compostage, etc.) et repreneur
|
|
Ordures ménagères
|
|
|
|
|
|
|
Papier et carton
|
|
|
|
|
|
|
Verre
|
|
|
|
|
|
|
Déchets organiques
|
|
|
|
|
|
|
Métaux
|
|
|
|
|
|
|
Déchets spéciaux (piles, accumulateurs, huiles,
tubes fluorescents, etc.)
|
|
|
|
|
|
|
Autres (déchets de production, déchets de chantier,
bois)
|
|
|
|
|
|
|
Total annuel
|
|
|
|
|
|
APPROVISIONNEMENT ET LIVRAISON
Analyser le système d'approvisionnement et de livraison
sous l'angle du développement durable et de l'environnement.
Pour ce faire, on peut se baser sur la distance séparant
l'entreprise de ses fournisseurs et de ses clients, en utilisant les tableaux
suivants:
|
Matière (produit) entrante
|
Origine (lieu)
|
Distance (km)
|
Moyen de transport
|
|
|
|
|
|
|
Produit sortant (nom)
|
Destination (lieu)
|
Distance (km)
|
Moyen de transport
|
|
|
|
|
|
ANALYSE DES COMPORTEMENTS D'ACHAT
Déterminer les principaux produits et matières
premières achetés par l'entreprise. Utiliser pour cela les
factures ainsi que les données de la comptabilité et reporter ces
informations dans le tableau ci-dessous. Il faut faire la distinction entre les
produits fabriqués à partir de sources non renouvelables et ceux
issus de sources renouvelables ou recyclées.
|
Matières premières/produits
|
Quantité totale par année
|
Dépense par an
|
Produit à partir de matières premières
renouvelables (oui/non)
|
Produit à partir de matières premières
recyclées (oui/non) à plus de 50%
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
Résultat de l'expérimentation
Au terme de cette expérience, on constate que les deux
entreprises étudiées ont la possibilité d'entamer une
démarche de développement durable sans investissement financier
de départ et qu'elles peuvent espérer faire des économies
substantielles dès 2005 si elles poursuivent sur cette voie.
Cependant, les deux dirigeants devront être très
vigilant et devront bien suivre les objectifs de départ tout en
préparant la suite de la démarche en concertation avec les
parties prenantes afin de fixer des objectifs plus ambitieux pour la
2ème année.
En effet, les propositions d'actions décrites ici
n'auront de véritable intérêt que si elles constituent
effectivement le premier pas d'une démarche d'amélioration
continue sur la voie de la RSE, et non pas quelques actions isolées qui
permettent aux dirigeants de se donner bonne conscience.
Pour les deux TPE, le principal frein à
l'intégration du développement durable reste le caractère
informel du management. Le principal avantage constaté est la
proximité entre le dirigeant et les salariés qui permet une bonne
circulation de l'information et des concertations plus fréquentes.
Néanmoins, on s'aperçoit que certains champs
d'amélioration sont difficiles à mettre en place vue la taille
des effectifs : le covoiturage entre salariés est par exemple
inenvisageable dans les deux cas.
De plus, la petite taille des entreprises et le fait qu'elles
soient des entreprises de service diminuent l'impact des économies qui
peuvent résulter d'une meilleure gestion des consommations (eau,
énergie, ...).
De même pour les déchets ; ils en produisent
déjà peu et font le nécessaire en les emmenant à la
décharge. Ils pourraient faire mieux, mais l'économie qu'ils
feront ne compensera pas le temps passé à la gestion des
déchets.
Une stratégie d'achats responsables est aussi assez
difficile à mettre en place dans les deux cas. Sodamin est liée
par son contrat avec Mobalpa pour la grande majorité de ses achats, ce
qui lui laisse une très faible marge de manoeuvre. Quant à IDF
Services, l'entreprise a très peu d'achats à effectuer,
l'entreprise travaille le plus souvent avec les produits de ses donneurs
d'ordre.
On constate également que cette expérience
infirme l'idée comme quoi les PME seraient plus impliquées dans
la vie locale. En effet, pour les deux exemples, tout reste à faire en
matière d'intégration locale et de dialogue avec les parties
prenantes.
Toutes ces difficultés montrent à quel point
l'étape de la réflexion personnalisée est importante pour
définir un projet adapté.
Trouver les actions pertinentes à mettre en place
à moindre coût est difficile mais pas impossible. Pour preuve, le
passage à des véhicules GPL en location qui n'est pas
évident pour une entreprise, surtout lorsqu'elle a l'habitude d'acheter
d'occasion. Cette action présente un double avantage dans l'optique du
développement durable : la réduction des émissions
polluantes, et la contribution à la dématérialisation de
l'économie en privilégiant la valeur d'usage du véhicule
par la location.
De plus, la mise en place de cette démarche aura pour
effet, dans les deux cas, de forcer l'entreprise à se mettre au suivi de
ses performances.
En effet, la démarche de développement durable
améliore les chances d'IDF Services et de Sodamin d'être
pérennes, en les structurant, et en leur donnant une mission plus
claire, d'où résulte une stratégie d'entreprise plus
efficace avec une vision à plus long terme : l'entreprise sort le
nez du guidon.
Quant à la pression du marché, elle est plus ou
moins présente selon les entreprises. Mais contrairement aux
idées préconçues, elle n'épargne pas les TPE, comme
on l'a vu avec la société Sodamin qui commence à subir la
pression de sa franchise.
Ainsi, ces deux entreprises illustrent bien les deux types
d'avantages que l'on peut tirer de la mise en place d'une démarche de
développement durable que l'on a décrit en 2ème
partie : l'avantage concurrentiel (en particulier pour Sodamin) et
l'avantage financier.
Conclusion
Il est difficile de mettre un point final à cette
étude et de conclure alors que l'on souhaiterait légitimement
connaître la suite que ces entreprises donneront aux projets
développés en 3ème partie.
Vont-ils les mettre en oeuvre ? Les modifier ? Quels
seront leurs résultats au bout d'1 an ? Quelle sera leur
contribution au développement durable au bout de quelques
années ? Autant de questions qui resteront en suspens.
Néanmoins, cette expérimentation a, de mon point
de vue, répondu aux questions essentielles.
Oui, le développement durable peut être mis en
place dans des TPE - et à fortiori dans des PME - à condition de
définir un projet cohérent avec les contraintes internes et
externes de l'entreprise.
Oui, cette démarche peut être rentable, car elle
peut ne nécessiter que peu de temps et génère des
économies.
Quant à déterminer si c'est un facteur de
pérennité, ce n'est pas cette expérience qui pourra nous
le démontrer vu le manque de recul dont nous disposons. Cependant, dans
la mesure où les actions mises en place visent à structurer ces
entreprises, réduire leurs coûts, leurs risques, améliorer
le dialogue avec leurs stakeholders, et à leur garantir un avantage
concurrentiel à moyen terme, on peut en déduire que les chances
de survie à long terme de ces entreprises seront nettement
améliorées.
Si les deux TPE étudiées se sont
prêtées à l'application de cette démarche, pourquoi
pas une autre TPE de service de l'Ile de France ?
Les économies que l'entreprise peut réaliser en
allant vers le développement durable semblent avoir un réel
pouvoir incitatif et constituent de ce fait la meilleure accroche pour
la sensibilisation des PME, avant l'avantage concurrentiel.
Contrairement à ce que redoutent les pouvoirs publics,
les TPE se sentent concernés par le développement durable une foi
qu'ils sont familiarisés avec ses implications concrètes. En
effet, ils avouent ne pas se sentir concernés par des plaquettes
informatives qu'ils voient comme des publicités pour un produit hors de
leur budget. Les dirigeant de TPE ont besoin de conseil personnalisé,
pour qu'ils initient la démarche, il faut les prendre par la main et
leur monter le chemin.
C'est un peu ce qui a été fait dans cette
étude.
Ainsi, il ne me semble plus utopique de penser que les
principes du développement durable sont applicables aux PME en adaptant
la démarche au cas par cas.
On peut s'attendre à des objections telles que :
« la démarche n'est pas assez poussée », ou
« il s'agit de développement durable à la
carte ». Mais les grandes entreprises non plus ne peuvent pas
être jusqu'au boutistes en matière de développement
durable. Car pour permettre aux entreprises de s'impliquer davantage et plus
complètement, il faudra à l'avenir que, parallèlement,
soit promue à grande échelle une consommation
durable.
Il faudra donc que le changement attendu des entreprises, et
en particulier des PME, soit accompagné par un véritable
changement en profondeur de la société. C'est le travail des
pouvoirs publics que d'assurer la synergie entre la prise de conscience des
consommateurs et les progrès des entreprises.
Mais avant que les pouvoirs publics puissent agir efficacement
en la matière, il faudra qu'une majorité d'entreprises changent
de perspective en intégrant l'idée que la mission d'une
entreprise doit être tournée vers l'extérieur et
que le profit devrait être vu comme un moyen de remplir cette
mission, et non comme une fin.
Lorsque ceci sera acquis, le monde aura, à mon sens,
fait un immense progrès.
Pour finir, collaborer avec ces deux dirigeants de TPE,
essayer de se mettre à leurs places et de voir concrètement
comment leurs entreprises peuvent, dans les contextes qui leurs sont propres,
intégrer le développement durable à leurs pratique ;
tout ceci m'a menée à acquérir la conviction que cette
démarche peut, dans leurs cas, s'avérer
bénéfique.
De plus, cette étude m'a permis de me conforter dans
mon idée de départ que la conception durable du
développement va dans le sens même de l'intérêt des
entreprises : perdurer.
Le développement durable amène donc les
entreprises à faire ce qu'elles devraient savoir le mieux faire :
maintenir un cap stratégique responsable.
Il s'agit donc bien d'assumer sa responsabilité
vis-à-vis de la communauté en faisant le choix d'un
développement qui ne compromette pas les équilibres
économiques et sociaux des régions où l'entreprise est
implantée.
Méthodologie
Réalisations au cours de ces 18 mois
d'étude :
- Choix du sujet
- Etude documentaire (ouvrages, presse, Internet)
- Choix de l'angle d'approche
- Cadrage de la problématique
- Contacts avec des professionnels du Développement
Durable
Stanislas Dupré, UTOPIES Stratégie &
Développement Durable (qui m'a conseillée sur l'angle
d'approche)
Thierry Vincent, Chargé d'études en
matière de Développement durable à la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Paris.
Yohan Leroy, Adjoint au chef de la division
développement industriel à la DRIRE Ile de France
- Entretiens avec des responsables d'entreprises.
Etienne Ruth, directeur environnement de Natures &
Découvertes
Michel Breton, responsable développement de
Mobalpa
- Entretiens avec des PME non sélectionnées
GTF (Gestion des Transactions de France), administrateurs de
biens
Synchro, atelier d'impression
Capla, traiteur
- Visites et entretiens avec les TPE
étudiées :
M. Lecocq, dirigeant d'IDF Services, entreprise de transport
à Bagnolet
M. Mary, dirigeant de Sodamin, concessionnaire Mobalpa
- Etude de faisabilité de la démarche sur les
TPE sélectionnées
Organisation de l'Etude
|
Sept-décembre 2002
|
· Pré-étude documentaire
|
Veille
Documentaire
|
|
Janvier-février 2003
|
· Choix du sujet
|
|
Mars
|
Rédaction et rendu du Projet
|
|
Avril-mai
|
· Affinement du sujet et de la problématique /
étude documentaire
|
|
Juin
|
Rédaction et rendu de la Problématique et
Méthodologie de Recherche
|
|
Juillet - octobre
|
· Suite de l'étude documentaire, réflexion sur
la valeur ajoutée de l'étude
|
|
Octobre-janvier
|
· Entretiens et étude documentaire
|
|
Janvier 2004
|
Rédaction et rendu du 1er
Jet
|
|
1ère semaine de février
|
· Entretien avec le patron d'une franchise Mobalpa
· Recherche d'une entreprise de service de région
parisienne susceptible d'accepter une proposition de démarche DD
personnalisée.
|
|
17 février
|
Soutenance 1er jet
|
|
3ème semaine de février
|
· Entretien avec un traiteur du Val de Marne
· Relance de la CGPME
|
|
Début mars
|
· Entretien avec les entreprises retenues lors de la
recherche
|
|
Mars- avril
|
· Validation de la démarche par la CCIP
· Diagnostic DD des entreprises retenues pour l'étude
à la suite des entretiens
|
|
Mi-avril
|
· Rédaction finale du mémoire
|
|
28 avril
|
Rendu du document final
|
|
Mai
|
· Réactualisation des conclusions de
l'étude
|
|
Début juin
|
· Préparation de la soutenance
|
|
14 juin 2004
|
Soutenance finale
|
Bibliographie
Principaux ouvrages :
Développement Durable ? Doctrines pratiques et
évaluations, IRD Editions, 2002.
Entreprises et Développement durable,
Comité 21, 2002.
Rapport du Sommet mondial pour le développement
durable, Nations Unies, 2002.
Pour que l'entreprise soit le moteur du développement
durable, rapport de la CCIP, mars 2003.
Le développement durable, un benchmark des meilleures
pratiques françaises et nord-américaines, par
Olivier Dubigeon, Les Echos Etudes, collection "le management
stratégique", 2002.
L'entreprise verte, le développement durable change
l'entreprise pour changer le monde, par Elisabeth Laville, Editions
Village Mondial, 2002.
Ce que le Développement Durable veut dire, par
Geneviève Férone, Dominique Debas, ..., Editions d'Organisation,
collection Regards croisés, 2003.
Le nouveau consommateur : dimensions éthiques et
enjeux planétaires, Ezzedine Mestiri, L'Hamattan, 2003.
De la parole aux actes : 67 expériences de
développement durable dans l'entreprise, Charles O.Holliday Jr.,
Victoires Editions, 2003.
Développement Durable : pour une entreprise
compétitive et responsable, Octave Gellinier, François
Xavier Simon,..., ESF Editeurs, 2002.
Développement Durable et performance de
l'entreprise, Didier Stephany, Editions liaisons, 2003.
Economie, le réveil des citoyens : les
alternatives à la mondialisation libérale, Henri
Rouillé d'Orfeuil, La Découverte, 2002.
Les entreprises face aux enjeux du Développement
Durable : élément d'un débat, Annie Najim,...,
Editions Kartala, 2003.
Développement Durable : 21 patrons
s'engagent, Pierre Delaporte, le Cherche Midi Editeurs, 2002
Johannesburg 2002 : Sommet Mondial du
Développement Durable : quels enjeux ? Quelle contribution des
scientifiques ?, Ministère des Affaires Etrangères,
Direction Générale de la coopération Internationale et du
Développement, ADFP Publications, 2002.
Guide à la mise en place du Management Environnemental
en Entreprise selon ISO 14 001, Paolo Baraochini, Presse Polytechniques et
Universitaires Romandes, 2001.
Principaux magazines :
Environnement magazine
Enjeux
Les Echos
Principaux Sites Internet :
ü
www.entreprise21.fr
ü
www.comite21.fr
ü
www.utopies.fr
ü
www.novethic.fr
ü
www.sommetjohannesburg.org
ü
www.solagral.org
ü
www.environnement.gouv.fr
ü
www.premier-ministre.gouv.fr
ü
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
ü
www.ccip.fr
ü
www.minefi.gouv.fr
ü
www.place-publique.fr
ü
www.ademe.fr
ü
www.terra-nova.fr
ü
www.netpme.fr
Glossaire
Atmosphère
Masse d'air qui entoure la terre. Elle fait, en moyenne, une
soixantaine de kilomètres d'épaisseur
Biodiversité
Diversité biologique, c'est-à-dire
variété des organismes vivants. Le développement durable
s'efforce de préserver la biodiversité au sein des
espèces, entre les espèces ainsi qu'au sein des
écosystèmes.
CIDD
Outre les missions actuelles du CIES et du CIPRNM, il est
chargé de définir, d'animer, de coordonner et de veiller à
la mise en oeuvre de la politique conduite par le Gouvernement en
matière de développement durable. A ce titre, il a adopté
la stratégie nationale de développement durable, et veillera
à sa mise en oeuvre et à son actualisation.
Il examine la cohérence de l'action de chaque
ministère avec la politique de développement durable
arrêtée par le Gouvernement, notamment dans les positions et
engagements pris par la France aux plans européen et international.
Il se réunit au moins une fois par an sous la
présidence du Premier Ministre. La première réunion du
comité interministériel pour le développement durable qui
s'est tenue au début du 2ème trimestre 2003 a permis
notamment d'adopter la stratégie nationale de développement
durable.
CNDD
Il a pour mission de réunir les représentants de
la société civile et des collectivités territoriales afin
de les associer à l'élaboration des politiques de
développement durable et à leur mise en oeuvre. A ce titre, il a
notamment une fonction de consultation et de proposition tout au long du
processus d'élaboration de la stratégie nationale de
développement durable.
Il se réunira une foi par mois, sous l'égide du
Premier ministre, et est composé d'une soixantaine de membres choisis en
fonction de leur expérience et de leur compétence dans le domaine
du développement durable et représentatifs des différents
acteurs, que sont les collectivités territoriales, les entreprises, les
associations, les syndicats...
Code de conduite
Déclaration officielle des valeurs et des pratiques
commerciales d'une entreprise, parfois élargi à ses fournisseurs.
Le code formalise un certain nombre de principes d'actions et de normes «
minimales » : en publiant son code de conduite, l'entreprise s'engage
à observer ces normes et à les faire observer par ses
sous-traitants et fournisseurs. Dans certains cas, le code est conçu
directement par une entreprise pour son activité, et dans d'autres cas,
le code est rédigé par une ONG et proposé à la
signature de nombreuses entreprises. Un code de conduite peut être global
ou porter spécifiquement sur les pratiques sociales de l'entreprise
(refus du travail des enfants, etc.), sur les pratiques éthiques (lutte
contre la corruption, etc.), ou sur les pratiques environnementales (principe
de précaution, utilisation privilégiée de ressources
renouvelables, etc.).
Commission Brundtland
Nom donné à la Commission Mondiale sur
l'Environnement et le Développement crée (en 1983) et
présidée (jusqu'en 1996) par le Dr Gro Harlem Brundtland, une
femme qui fut Premier ministre de Norvège, médecin de formation.
La commission, surtout connue pour avoir forgé le concept de DD, a
publié son rapport « Notre avenir à tous » en
avril 1987. Les recommandations de la commission ont conduit à la
convocation, en 1992 à Rio de Janeiro, de la Conférence des
Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED),
également appelé Sommet de la Terre.
Critères « éthiques »,
sociaux et environnementaux
Éléments reflétant les valeurs qui
servent de base à l'évaluation des entreprises et à la
formulation d'un choix par les consommateurs ou les investisseurs
«responsables ». Concernant spécifiquement l'investissement
responsable, on distingue les critères d'exclusion, qui visent
à d'exclure de l'univers d'investissement les entreprises qui ne
respectent pas ces critères, quelles que soient ses performances par
ailleurs (ex. : présence en Birmanie, activité liée
à l'armement... ), les critères d'inclusion, qui sont
l'exact opposé des critères d'exclusion (toute entreprise
répondant positivement à l'un de ces critères favorise son
acceptation - par exemple : utilisation d'énergies renouvelables ou
l'agriculture biologique) et les critères de notation qui sont
les sujets pour lesquels les pratiques de l'entreprise sont
étudiées et évaluées au moyen d'une lettre, d'un
chiffre, d'un classement.
Cycle de vie
Ensemble des étapes composant la «vie» d'un
produit, de l'extraction des matières premières à
l'élimination finale en passant par la fabrication et la distribution.
L'analyse du cycle de vie (ou LCA, life cycle assessment) permet
d'évaluer l'impact global d'un produit sur l'environnement
(matières, ressources, énergie, etc.).
Droits de l'homme
Les droits de l'homme reposent sur le principe selon lequel la
reconnaissance de la dignité intrinsèque et de
l'égalité et l'inaliénabilité des droits de tous
les membres de la famille humaine constitue la base de la liberté, la
justice et la paix dans le monde. Ils sont définis dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948). Au niveau
européen, l'article 6 du traité sur l'Union européenne
réaffirme que l'Union européenne "est fondée sur les
principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de
droit, principes qui sont communs aux États membres." De plus, la
Convention Européenne des Droits de l'Homme adoptée par le
Conseil de L'Europe est juridiquement contraignante dans tous les États
Membres. Enfin, la Charte européenne des droits fondamentaux
adoptée à Nice en décembre 2000 est un instrument
favorisant le respect des droits fondamentaux par les institutions
européennes et les États membres dans leur action au titre de la
législation communautaire.
Ecobilan
Bilan détaillé des impacts d'un
procédé (conception de produits ou de services) ou de prestations
(transports, etc.) sur l'environnement.
Ecosystème
Unité écologique de base formée par un
certain milieu et par les animaux, végétaux et micro-organismes
qui y vivent. Exemple: un écosystème d'eau douce se
définit par sa faune (poissons, animaux aquatiques, etc.), sa flore, la
nature du lit et des berges du lac ou des cours d'eau, le régime
hydraulique, les caractéristiques physico-chimiques de l'eau, et toutes
les interrelations qui lient ces différents éléments entre
eux.
Éco-architecture
Application des principes du développement durable
à l'architecture, afin de diminuer l'empreinte écologique de ce
secteur d'activité et des bâtiments plus
généralement, en travaillant simultanément sur trois axes
: l'économie des ressources naturelles (eau, énergie,
matières premières, etc.) et l'utilisation de matériaux
écologiques, la prise en compte de tout le cycle de vie des
bâtiments (de la construction aux déchets de démolition),
et l'intégration des considérations écologiques avec les
considérations sociales et humaines (sécurité,
santé, confort, etc.).
Éco-design (ou
écoconception)
Consiste à concevoir les produits, dès l'origine,
pour y intégrer les principes du développement durable, et
notamment l'économie des ressources naturelles à toutes les
étapes de la vie du produit (production, usage et fin de vie). Pour
certains, l'éco-design commence, en amont de la création des
objets, par une réflexion sur leur raison d'être et
l'utilité intrinsèque de leur existence.
Éco-efficacité
Ce concept vise à faire plus (de produits, de valeur...)
avec moins (d'énergie et de matières premières
consommées, de déchets produits, etc.).
L'éco-efficacité entend ainsi transformer l'industrie en y
intégrant des considérations écologiques, même si
l'accent est traditionnellement mis sur l'intérêt
économique de la démarche (économies
réalisées) plus que sur l'impact environnemental des pratiques
industrielles.
Ecolabel
Information (généralement présentée
sur une étiquette apposée sur un produit) permettant aux
consommateurs de connaître les caractéristiques environnementales
d'un article ou des méthodes de production ou de transformation
utilisées pour le produire. Les labels officiels font l'objet d'une
vérification indépendante.
Effet de serre
Phénomène naturel permettant à certains gaz
naturellement présents dans l'atmosphère (la vapeur d'eau, le
méthane, le dioxyde de carbone, l'oxyde nitreux, l'ozone) de retenir,
quelque temps, la chaleur renvoyée vers l'espace par la terre. Cet effet
de serre garanti une température moyenne globale de 15°C. Sans lui,
cette température tomberait à - 18°C. C'est l'augmentation
de la concentration de ces gaz à effet de serre qui provoque un
renforcement de l'effet de serre. Ce qui empêche la naturelle dissipation
de la chaleur terrestre dans le cosmos. Et par voie de conséquence qui
provoque un réchauffement du climat mondial
EMAS
Eco-Management and Audit Scheme. Système européen
de gestion environnementale dont les principes ont été
établis par la Commission européenne le 29 juin 1993. L'EMAS est
entré en application le 10 avril 1995. Ce système repose sur une
démarche volontaire et son objectif consiste à promouvoir une
bonne gestion environnementale des sites industriels et à établir
une communication active avec le public.
Éthique
Ensemble de valeurs issues d'une réflexion personnelle qui
guide l'action d'un individu. Dans ce sens philosophique, l'éthique
s'oppose à la morale, qui est l'ensemble des valeurs définies par
la société ou une communauté et qui s'impose à ses
membres. Le terme « éthique » est souvent utilisé, de
manière plus ou moins pertinente, pour désigner les
démarches responsables dans les entreprises : il renvoie parfois
à la « moralisation » des affaires et, en France notamment,
à la criminalité financière ou autres pratiques
illégales ; dans d'autres cas, du fait de l'histoire de l'investissement
responsable, né au début du vingtième siècle avec
les congrégations religieuses, l'approche « éthique »
de l'entreprise est souvent le reflet d'une approche « morale »,
liée à des valeurs religieuses par exemple. En matière
d'investissement, elle va de pair avec l'exclusion des entreprises ayant des
activités dans des secteurs considérés comme
condamnables.
GES : Gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre naturels sont la vapeur d'eau, le
dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, l'ozone. Ils sont
" complétés " depuis plusieurs décennies par les
chlorofluorocarbones (gaz de synthèse) et leurs substituts (HFC, PFC et
SF6). Au total, les émissions de gaz à effet de serre dues
à l'homme contribuent déjà à retenir 1 % en
plus de la chaleur terrestre qui devrait normalement être
évacuées vers l'espace. 1 %, c'est peu, mais cela
représente l'équivalent de l'énergie produite par la
combustion de un million de millions de tonnes de pétrole par an.
Global Reporting Initiative (GRI)
Initiative internationale et multi-stakeholders
visant à établir des lignes directrices pour les
rapports de développement durable. Le but est de définir les
principes généraux du reporting et d'uniformiser le contenu des
rapports de développement durable.
Gouvernance d'entreprise (Corporate governance)
Ensemble de relations entre la direction d'une entreprise, son
conseil d'administration, ses actionnaires et les autres parties prenantes. La
gouvernance d'entreprise fournit également le cadre au sein duquel sont
d'une part fixés les objectifs de l'entreprise et d'autre part
définis les moyens de les atteindre et de surveiller les
performances.
Greenwashing
Ou « verdissement d'image ». Terme utilisé par
les groupes de pression environnementaux pour désigner un certain type
de communication des entreprises sur leurs stratégies de
développement durable, dans lequel les messages sont émis avec
force sans être forcément accompagnés d'actions à la
hauteur de cette communication. Cette notion en inspire parfois d'autres :
ainsi, le terme de Bluewashing est désormais
utilisé pour désigner le rapprochement des entreprises et de
l'ONU dans le cadre du programme d'engagement volontaire des Nations-Unies, le
Global Compact.
Impact environnemental
Toute influence négative ou positive sur l'environnement
résultant d'une activité économique (ou autre).
ISO
Les normes ISO sont établies par l'Organisation
internationale de normalisation (ISO). Elles peuvent être introduites par
toute entreprise, quels que soient ses produits ou services, et
indépendamment du secteur d'activité. La série de normes
ISO 14000 se rapporte à un système de management environnemental
(SME); la série ISO 9000 traite principalement du management de la
qualité (SMQ).
Label social
Mots ou symbole censé garantir aux consommateurs que le
produit sur lequel ils sont apposés a été fabriqué
dans des conditions respectueuses des Droits de l'Homme au travail - avec
l'espoir que cette garantie soit un critère supplémentaire pour
emporter la décision d'achat.
Max Havelaar
Créée en 1988, l'association européenne
Max Havelaar agit pour un commerce équitable : un commerce juste,
efficace et bénéfique pour tous, consommateurs ou petits
producteurs des pays pauvres. Sans être elle-même impliquée
dans le commerce des produits, l'association met en contact les
coopératives de petits producteurs des pays en développement avec
les importateurs européens, en veillant au bon respect de règles
simples : contrats de partenariat durable, prix et volumes de vente garantis,
préfinancement des récoltes, chaîne d'approvisionnement la
plus courte possible. Max Havelaar porte le nom d'un héros de la
littérature hollandaise, connu pour avoir dénoncé
l'exploitation des agriculteurs dans les colonies : son sigle est une garantie
pour les consommateurs européens sur différents types de produits
garantis par l'association : café mais aussi thé, cacao, bananes,
miel et sucre.
Norme
Ensemble de procédures, pratiques ou
spécifications bénéficiant d'une large reconnaissance.
Qu'elles portent sur la qualité (par exemple ISO 9000), sur la
performance environnementale (par exemple ISO 140000) ou sur la qualité
sociale (par exemple SA 8000), les normes sont utilisées par les
entreprises pour progresser et formaliser leur démarche - en se
concentrant avant tout sur les moyens et les outils que se donne l'entreprise.
Elles permettent aussi, au fur et à mesure de leur développement,
d'étendre les bonnes pratiques des pionniers à l'ensemble des
entreprises.
OGM
Organismes Génétiquement Modifiés. Terme
apparu à la fin des années 80 dans le langage
réglementaire de la Commission européenne pour désigner
des plantes, des animaux, des bactéries dont le profil
génétique a été transformé en laboratoire
afin de leur « greffer » un ou plusieurs nouveaux caractères
génétiques pouvant provenir d'espèces très
différentes. Le génie génétique autorise en effet
ce que les lois naturelles de l'hybridation interdisent : l'échange de
gènes par-delà la barrière d'espèces, comme lorsque
des chèvres fabriquent dans leur lait une soie aussi résistante
que le fil d'araignée suite à la greffe d'un gène de cet
insecte.
ONG
Organisation Non-Gouvernementale. Selon l'Union des
associations internationales, une ONG est une association sans but lucratif et
internationale par ses membres, par ses fonctions, par la composition de sa
direction et par les sources de son financement. D'autres désignent plus
largement par le terme d'ONG toute association travaillant en faveur du
développement humain, de la lutte contre la pauvreté et les
inégalités, du développement durable et de la paix.
Malgré leurs différences, les ONG prennent de plus en plus de
poids sur la scène internationale, mobilisant l'opinion et interpellant
publiquement les entreprises sur leurs pratiques.
Ozone
L'ozone est un constituant naturel de l'atmosphère. Il se
forme par transformation photochimique, soit naturellement à haute
altitude dans la stratosphère, soit secondairement depuis d'autres gaz
polluants au niveau du sol.
Dans le premier cas, sa présence est nécessaire,
car il agit comme un voile de protection contre les rayons UV. Mais il est
dangereusement détruit par les émissions dues à l'homme -
les CFC. C'est ce qu'on appelle le «trou d'ozone».
Dans le second cas, il est en excès, car les gaz
précurseurs à son origine (NOx, COV) -
résultant de l'activité humaine - sont trop abondants. Les
concentrations trop élevées en ozone présentent des effets
néfastes pour la santé. Par ailleurs, l'ozone présent dans
les couches basses de l'atmosphère agit comme gaz à effet de
serre coresponsable du réchauffement climatique, avec le CO2,
le méthane et la vapeur d'eau.
Parties prenantes (en anglais : stakeholders)
Ensemble des personnes, communautés ou organisations qui
influent sur les activités d'une entreprise ou sont concernées
par celles-ci. Les «parties prenantes» peuvent être internes
à l'entreprise (personnel) ou externes (clientèle, fournisseurs,
actionnaires, investisseurs, communautés locales, etc.). Cf. annexe
7.
Puits de carbone
Les océans, les sols et les végétaux en
croissance absorbent naturellement le carbone présent dans
l'atmosphère. Au fond des mers, le carbone est transformé en
carbonates. Pour les mers, on ne peut pas faire grand chose (du moins à
grande échelle) pour augmenter ses capacités de stockage du
carbone. En revanche, en plantant davantage d'arbres et en révisant nos
méthodes agricoles, on peut contribuer à faire des forêts
et des champs des " puits de carbone ". Tout le problème est
de savoir quel est le carbone effectivement stocké dans ces puits. Car
plus on a de grands puits, moins on aura d'efforts à produire pour
diminuer ses émissions réelles.
Rapport de développement durable
Rapport publié régulièrement par les
entreprises sur les objectifs de leur démarche de développement
durable mais aussi sur les progrès réalisés et sur ceux
restant à accomplir. De la même manière que le rapport
annuel rend des comptes aux actionnaires (stockholders' report ou shareholders'
report) sur les aspects financiers de l'activité de l'entreprise, le
rapport de développement durable s'adresse à l'ensemble des
autres publics de l'entreprise (stakeholders' report) pour rendre des comptes
sur les aspects sociaux et environnementaux de cette activité.
Recyclage
Procédé consistant à réutiliser la
matière à l'état de déchet.
Réglementation environnementale
Obligations légales édictées par les
pouvoirs publics visant à imposer des objectifs respectant des valeurs
limites (bruit, concentration de polluants dans l'air ou dans l'eau, etc.).
Reporting
Démarche volontaire de l'entreprise, par laquelle celle-ci
assure le suivi (quantifié si possible) de ses progrès dans les
domaines environnementaux et sociaux, puis rend compte à ses
stakeholders, le plus souvent à travers un « rapport de
développement durable », sur les progrès
réalisés et sur les points restant à améliorer.
Responsabilité sociale des entreprises (en
anglais : Corporate Social Responsibility (CSR)
Terme adopté par le secteur privé à la fin
des années 90 afin de désigner ses actions en matière
sociale, environnementale et éthique en application des principes du
développement durable. En France, on parle souvent de
responsabilité sociétale.
Ressource non renouvelable
Ressource initialement présente en quantité plus ou
moins limitée, et qui est susceptible d'être épuisée
à terme. Ex.: pétrole.
Ressource renouvelable
Ressource susceptible de se reconstituer par le biais de
processus naturels (par exemple le cycle de l'eau) ou par sa propre
régénération, généralement dans un
délai qui ne dépasse pas quelques décennies.
Stakeholder
Terme anglais pour parties prenantes
Sweatshops
Que l'on peut traduire par « ateliers à sueur
», désignent les ateliers aux conditions de travail inacceptables,
en particulier les ateliers clandestins ou les ateliers qui font travailler
illégalement des enfants. Le problème des sweatshops se pose en
particulier dans les industries qui font appel à de nombreux
sous-traitants des pays en voie de développement, comme le textile, le
cuir ou les jouets.
Système de Management Environnemental (SME)
Approche structurée fixant des objectifs en matière
d'environnement ainsi que les moyens permettant de les atteindre. Le SME se
base sur les normes ISO 14000.
· Annexes
Annexe 1
Les émissions de CO2 dues à l'activité
humaine en France et dans le Monde
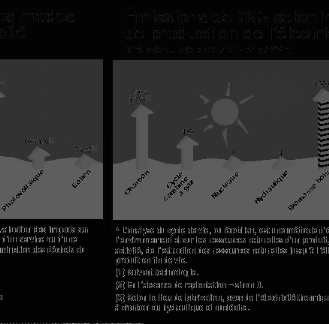
(Source : Ministère de l'économie des
finances et de l'industrie, Comprendre pour choisir)
La place des énergies renouvelables est encore
très faible dans la production et la consommation d'énergie en
France. Cependant, il est important de noter que, contrairement aux
idées reçues, énergies renouvelables ne veut pas dire non
polluantes. Bien sur les émissions de CO2 de l'énergie
hydraulique, photovoltaïque, et éolienne sont faibles, mais la
biomasse bois fait partie des énergies renouvelables (bien que pas
toujours renouvelée par la replantation des arbres) et c'est elle qui
présente le plus fort taux d'émission.
La France a fait le choix énergétique du
nucléaire, dans un souci à court terme (outre celui d'assurer
son indépendance énergétique) de ne pas aggraver nos
émissions de CO2 (cf. Annexe 2, émissions comparatives par pays)
et en postulant que le nucléaire sera l'énergie du futur et
qu'à moyen terme, une solution sera trouvée par les scientifiques
au problème des déchets radioactifs (c'est un des enjeux du
projet ITER qui fait l'actualité avec le choix du pays d'accueil). Ce
choix a fait l'objet du « débat sur les
énergies » début 2003.
Répartition mondiale des émissions de CO2
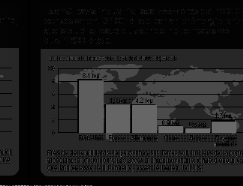
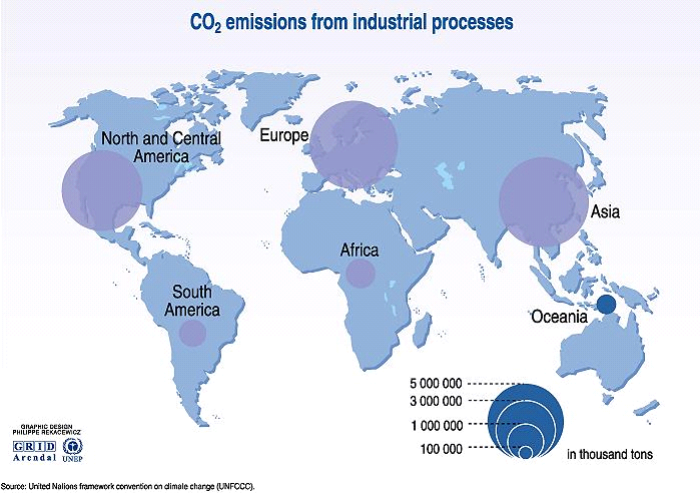
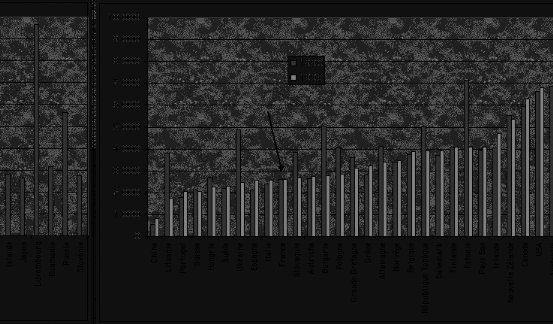
Emissions de gaz à effet de serre par habitant et par
an, selon les pays, en kg d'
équivalent
carbone (Chine : émissions de CO2 seul), pour 1990 et 1998
(classées par ordre d'importance en 1998).
On remarque que parmi les pays disposant d'un fort PNB par
habitant, les plus "vertueux", outre la France, sont la Suède et la
Suisse, qui produisent aussi - comme la France - leur électricité
avec essentiellement du nucléaire et de l'hydraulique. Dans le cas de la
Suisse se rajoute le fait que son économie est fortement
tertiarisée. On remarque aussi que les émissions par habitant en
Chine sont quasiment 10 fois plus faibles que celles des USA.
Ce graphique montre à nouveau la forte diminution
intervenue dans les anciens pays communistes.
Source : United Nations Framework Convention on Climate Change
(sauf la Chine : Ministère de l'Industrie) -
UNFCCC pour les émissions, et
Institut National d'Etudes Démographiques -
INED pour les populations ; les divisions ont
été faites par votre serviteur.
Annexe 2
Détail des constats scientifiques des impacts
environnementaux de l'activité humaine
ü La
consommation d'énergie
Nous avons besoin d'énergie tout au long de la
journée, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Inutile
d'énumérer ici la liste des appareils qu'il nous serait
impossible d'utiliser sans prise de courant ou batterie rechargeable, sans
parler de l'éclairage et du chauffage.
Notons seulement que selon l'énergie utilisée,
les impacts sur l'environnement sont différents. On distingue 4 grands
impacts :

- La déforestation (par l'usage de
l'énergie issue de la combustion du bois : la Biomasse)
- L'émission de CO2, principalement
lors de la combustion de bois, de charbon, de pétrole et de gaz
- L'épuisement des réserves de
pétrole, de gaz naturel, et de charbon
- La production de déchets radioactifs
que nous ne savons pas traiter en l'état actuel des connaissances
scientifiques, et qu'il faut donc stocker dans l'attente d'une solution.
ü
L'utilisation du papier
Le papier est devenu une composante banale de notre vie. On en
utilise tous les jours, et c'est un des rares produits pour lequel la majeure
partie de la population française se pose peu la question du gaspi. On
écrit, on rate, on jette.
De même, peu d'entreprises imposent un contrôle
sur l'utilisation du papier, sans parler des administrations. Là, on
imprime, on constate une erreur, on jette. Et malgré le
développement de la messagerie électronique et du
téléphone, on continue à se confirmer par écrit ce
qui a été dit par téléphone, et à imprimer
les emails pour les classer dans les dossiers, quand ce n'est pas uniquement
pour les lire !
Les entreprises utilisent également
énormément de cartons (emballages, transport, stockage et autres)
et émettent un grand nombre de publicités (ISR de la
grande distribution par exemple) ou supports de communication (plaquettes,
rapports annuels). Le secteur de la presse écrite est un consommateur
notable de papier.
Autant dire que dans les pays développés, on use
du papier comme s'il s'agissait d'une ressource inépuisable.
Or chacun sait que le papier se fabrique à partir de
bois, et que le bois est coupé dans des forêts.
Ce n'est pas nouveau, et c'est la raison pour laquelle le
recyclage du papier existe. Malheureusement, la production de papier ne
fonctionne pas encore en circuit fermé uniquement à base de
papiers recyclés. En effet, l'industrie papetière
française a consommé 8,1 millions de tonnes de bois et 5,7
millions de tonnes de papiers et cartons récupérés en 2002
(source Confédération française de l'industrie des
papiers, cartons & celluloses), et seuls 43% du gisement des
papiers-cartons sont valorisés (ADEME, 1999).
Le principal impact de l'usage de papier est bien sur la
déforestation, mais ce n'est pas le seul, cette industrie pollue
également les eaux et consomme beaucoup d'énergie, même si
des efforts sont faits.
ü Les
transports
Le 20ème siècle a vu
l'avènement des transports. Ainsi les distances se sont réduites,
et ont permis d'arriver au phénomène de mondialisation que nous
connaissons aujourd'hui. Mais ce progrès, s'accompagne d'impacts
environnementaux lourds :
- La voiture individuelle, les transports routiers,
l'avion : émission de gaz à effet de serre et
épuisement des réserves de pétrole (Les transports sont
à l'origine de 25% des émissions de dioxyde de carbone
générées par l'homme dans le monde).
- Le train et le métro : consommation
d'électricité (en France, environ 2/3 de l'énergie
provenant de l'énergie nucléaire, le train vient aggraver le
problème de gestion des déchets nucléaires).
Les transports de personnes et de marchandises contribuent le
plus à l'accroissement de notre consommation d'énergie en
France.

(Source : Ministère de l'économie des
finances et de l'industrie, Comprendre pour choisir)
Depuis 30 ans, malgré des progrès technologiques
(à performances égales, les moteurs consomment 50 % de moins), la
consommation d'énergie de transport par habitant a augmenté de
plus de 50 %, à cause de l'augmentation du nombre de kilomètres
parcourus avec des véhicules de plus en plus puissants, du
développement du transport de marchandises par camions et de la
démocratisation des transports aériens (le transport est de plus
en plus dépendant du seul pétrole). Au rythme actuel, cette
consommation pourrait encore croître de 10 à 20 % d'ici à
2010.
ü Le
développement de l'industrie.
Malgré toute l'attention qui peut être
portée à la sécurité dans les usines, les risques
industriels se sont développés en parallèle de
l'évolution des technologies.
De plus elle participe dans l'explosion de la consommation
d'énergie.
L'avènement des technologies du nucléaire a
apporté son lot d'accidents, dont le plus connu, car le plus
étendu et lourd de conséquences, est celui de Tchernobyl (Le 26
avril 1986, un des quatre réacteurs de la centrale de Tchernobyl, en
Ukraine, explosa et brûla). Des doses de radiation très
élevées ont atteint la population proche du réacteur et un
nuage de retombées radioactives s'est étendu vers l'Ouest).
Des accidents, comme celui, grave et spectaculaire, de l'usine
AZF à Toulouse en septembre 2001, viennent rappeler que, dans ce
domaine, le risque zéro n'est pas atteint.
Outre l'impact immédiat sur les victimes, ces accidents
causent, selon leur nature, de graves dommages à l'environnement
(pollution des eaux, des sols, de l'air) par la diffusion dans la nature de
produits chimiques dangereux.
ü Les
déchets
Le développement de la société de
consommation dans les pays industrialisés a généré
des masses de déchets dont le recyclage et/ou la destruction par
incinération posent un problème écologique crucial.
En France, chaque année, environ 580 millions de tonnes
de déchets sont produites: 400 millions de tonnes de déchets
verts, 150 millions de tonnes de déchets industriels dont 1 à 4
millions de tonnes de déchets industriels spéciaux, 1 million de
tonnes de déchets hospitaliers et 26 millions de tonnes de
déchets ménagers.
Ce dernier chiffre signifie que, en moyenne, un
Français jette 1 kg par jour d'ordures ménagères. En 1960,
ce même Français ne jetait que 600 grammes. Pour comparaison,
l'Américain jette près de 2,3 kg par jour. (Source UNESCO)
Bien que le recyclage, grâce au tri des ordures, entre
de plus en plus dans les habitudes des collectivités locales, le taux de
recyclage reste en général très faible quels que soient
les types de déchets. En effet, l'industrie du papier est celle qui a,
avec 43%, le taux de valorisation le plus élevé. Les
décharges regorgent donc d'écrans d'ordinateurs, de piles, de
vieux réfrigérateurs... Ces appareils contiennent des produits
toxiques de nature à polluer les sols et les eaux (rivières,
nappes phréatiques,...).
ü
Pollutions diverses
Ces cinq points ne sont que des exemples des impacts
d'activités faisant partie intégrante de notre mode de vie. Il y
en a bien d'autres mais ce n'est pas l'objet de ce mémoire que d'en
faire une liste exhaustive.
Il nous faut malgré tout noter les impacts d'actes de
négligence voire de malveillance qui sont monnaie courante et qui
contribuent à la dégradation de l'environnement :
- Les marées noires et dégazages en
mer qui polluent les océans et les littoraux, et menacent les
espèces marines. Tout le monde se souvient encore de la L'Amoco Cadiz en
1978 et plus récemment de l'Erika en 1999 et du Prestige fin 2002. Le
pétrole de ce dernier s'échappe encore doucement mais
régulièrement dans l'océan près des côtes
espagnoles.
- Le braconnage (chasse d'espèces
protégées). Les chimpanzés, par exemple, sont
menacés de disparition à l'état sauvage.
- Le rejet frauduleux par des industries de produits
polluants (au lieu de payer le traitement de leurs déchets) qui
entraînent une pollution des sols, des rivières et de l'air,
menaçant les écosystèmes.
- Les sacs plastiques, mégots de
cigarettes et autres déchets jetés dans la nature, qui mettent
des centaines, voire des milliers d'années à se décomposer
et qui présentent des risques pour les animaux. En Corse, les sacs
plastiques représentent non seulement une pollution visuelle, une
dégradation des sols et des fonds marins, mais ils tuent aussi des
animaux marins, comme les dauphins, qui s'étouffent en les
ingérant.
- L'accumulation de molécules pathogènes
tout au long de la chaîne alimentaire qui entraîne un
risque sanitaire (le dossier de la vache folle entraînant chez l'homme la
maladie de Creutzfeld-Jacob ou ESB -l'encéphalopathie
spongiforme bovine-, la tremblante du mouton,...).
- L'usage de pesticides et de fertilisants à
outrance dans l'agriculture, qui polluent les sols, les nappes
phréatiques (rendant ces eaux impropres à la consommation) et nos
aliments (pour manger des pommes, il est fermement recommandé de les
éplucher ou de les laver au préalable)
Annexe 3
Le processus de l'effet de Serre
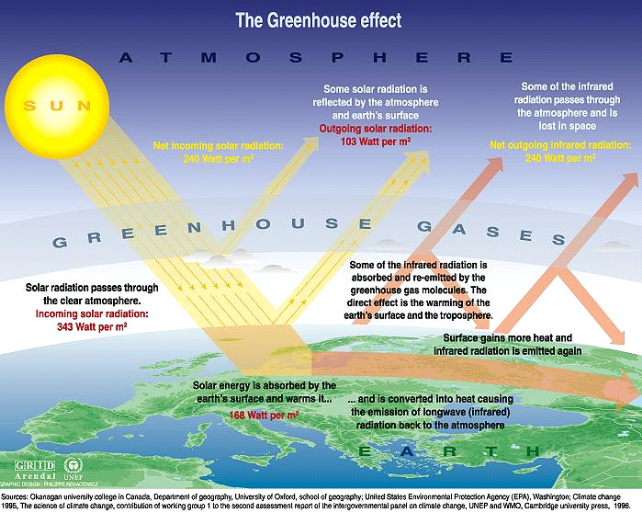
La plus grande partie du rayonnement solaire traverse
directement l'atmosphère pour réchauffer la surface du globe. La
terre, à son tour, "renvoie" cette énergie dans l'espace sous
forme de rayonnement infrarouge de grande longueur d'onde. La vapeur d'eau, le
gaz carbonique, et d'autres gaz absorbent ce rayonnement renvoyé par la
terre, empêchent l'énergie de passer directement de la surface du
globe vers l'espace, et réchauffent ainsi l'atmosphère.
L'augmentation de la teneur atmosphérique en gaz à effet de serre
(GES) peut se comparer à la pose d'un double vitrage: si les apports de
rayonnements solaires à l'intérieur de la serre restent
constants, la température s'élèvera.
Les principaux gaz à effet de serre émis par
l'activité humaine sont3 :
- le gaz carbonique (CO2) : durée de vie d'environ
100 ans dans l'atmosphère. Il provient de l'industrie, du transport, de
la production d'énergie...
- le méthane (CH4) : durée de vie de 12
ans. Les émissions de méthane proviennent des décharges,
de l'exploitation des mines de charbon et du gaz naturel, mais surtout des
activités agricoles (en France, l'agriculture contribuerait pour 57% des
émissions de CH4).
- le protoxyde d'azote (ou N20) : durée de vie
d'environ 120 ans dans l'atmosphère. Il est en partie responsable de la
destruction de l'ozone. L'agriculture contribuerait pour 75% des
émissions de N2O provenant essentiellement de la transformation des
produits azotés (engrais, fumier, lisier, résidus de
récolte) dans les sols agricoles.
3 Source Citepa (centre interprofessionnel
technique d'études de la pollution atmosphérique) 2000.
Annexe 4
2 types courants de violences aux travail
Ø Le comportement abusif ou tyrannique
vis-à-vis d'un subalterne ou d'un pair
C'est l'une des formes de violence sur le lieu de travail de
plus en plus fréquemment dénoncée. La personne qui se
comporte de cette façon blessante cherche à amoindrir un ou
plusieurs employés en utilisant des moyens vindicatifs, cruels,
malicieux ou humiliants. Par exemple:
- Elle rend la vie difficile à ceux ou celles qui ont
la capacité de réaliser son propre travail mieux
qu'elle-même;
- Elle s'adresse au personnel en criant pour lui demander
d'exécuter un travail;
- Elle insiste sur le fait que seule sa façon de faire
est la bonne;
- Elle refuse de déléguer, parce qu'elle pense
qu'on ne peut faire confiance à personne d'autre qu'à elle;
- Elle punit les autres en les critiquant constamment ou en
leur ôtant leurs responsabilités sous prétexte qu'ils ou
elles ne sont pas assez compétent(e)s.
Par exemple, une étude finlandaise visant à
évaluer les effets de ces types de comportement sur les employés
municipaux révélait les faits suivants : 40 pour cent des
travailleurs tyrannisés ressentaient un degré
«important» ou «très important» de stress ; 49 pour
cent se sentaient anormalement fatigués pendant leur travail; et 30 pour
cent étaient «souvent» ou «constamment» nerveux.
Ø Le harcèlement psychologique
exercé par le groupe à l'encontre d'un individu.
Il se produit lorsque plusieurs personnes s'allient pour
persécuter un employé ciblé en le soumettant à un
harcèlement psychologique qui peut prendre les formes suivantes: faire
constamment des remarques négatives sur cette personne ou la critiquer
sans arrêt, l'isoler en la laissant sans contact social et médire
ou diffuser de fausses informations sur elle. En Suède, on estime que le
harcèlement psychologique est à l'origine de 10 à 15 pour
cent des suicides.Annexe 5
Mickey 3D, Il faut que tu respires, 2002

Approche-toi petit, écoute-moi gamin
Je vais te
raconter l'histoire de l'être humain
Au début y'avait rien au
début c'était bien
La nature avançait y'avait pas de
chemin
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers
Des
coups de pied dans la gueule pour se faire respecter
Des routes à
sens unique il s'est mis à tracer
Des flèches dans la plaine
se sont multipliés
Et tous les événements se sont vus
maîtriser
En deux temps trois mouvements l'histoire était
pliée
C'est pas demain la veille qu'on fera marche
arrière
On a même commencé à polluer les
déserts
Il faut que tu respires
Et ça c'est rien de le
dire
Tu vas pas mourir de rire
Et c'est pas rien de le dire
D'ici
quelques années on aura bouffé la feuille
Et tes petits
enfants ils n'auront plus qu'un oeil
En plein milieu du front ils te
demanderont
Pourquoi toi t'en as deux et tu passeras pour un con
Ils te
diront comment t'as pu laisser faire ça
T'auras beau te defendre leur
expliquer tout bas
C'est pas ma faute à moi c'est la faute aux
anciens
Mais y'auraplus personne pour te laver les mains
Tu leur
raconteras l'époque où tu pouvais
Manger des fruits dans
l'herbe allongé dans les prés
Y'avait des animaux partout dans
la forêt
Au début du printemps les oiseaux
revenaient
Refrain
Le pire dans cette histoire c'est qu'on est
des esclaves
Quelque part assassin ici bien incapable
De regarder les
arbres sans se sentir coupable
A moitié défroqué cent
pour cent misérable
Alors voilà petit l'histoire de
l'être humain
C'est pas joli joli et j'connais pas la fin
T'es pas
né dans un chou mais plutôt dans un trou
Qu'on remplit tous les
jours comme une fosse à purin
Refrain
C'est demain que tout empire
refrain
Annexe 6
Origines historiques et institutionnelles du DD
Des années 60 au début des années
80 : l'émergence du concept de développement durable
Jusqu'aux années 60, les questions d'environnement sont
reléguées au «second plan ». Les politiques
environnementales sont pour l'essentiel sectorielles : elles visent à
lutter contre des pollutions localisées et dont les acteurs sont
relativement facilement identifiables (déchets, eau, etc.).
C'est au début des années 70 que des changements
vont s'opérer, tant dans la prise de conscience que dans les
débats relatifs aux questions d'environnement. Cette « prise de
conscience » par les populations des problèmes environnementaux est
liée à des inquiétudes de plus en plus prononcées
dans les sociétés du Nord vis-à-vis des impacts
négatifs de l'industrialisation. Les débats sur
l'épuisement des ressources naturelles ont commencé à
faire prendre conscience que les conditions actuelles de la croissance ne
pourront se poursuivre de façon indéfinie.
En 1971, le Club de Rome lance un vrai
pavé dans la marre en publiant Halte à la croissance.
Face à la surexploitation des ressources naturelles liée à
la croissance économique et démographique, cette association
privée internationale créée en 1968, prône la
croissance zéro. En clair, le développement économique est
alors présenté comme incompatible avec la protection de la
planète à long terme.
C'est dans ce climat de confrontation et non de conciliation
entre l'écologie et l'économie que se tient la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement humain, à
Stockholm, en 1972 (première conférence mondiale sur
l'environnement). Conférence qui sera à l'origine du premier vrai
concept de développement durable, baptisé à
l'époque éco-développement. Des
personnalités (comme Maurice Strong, organisateur de la
Conférence) insistent sur la nécessité d'intégrer
l'équité sociale et la prudence écologique dans les
modèles de développement économique du Nord et du Sud. Il
en découlera la création du Programme des Nations Unies
pour l'Environnement (PNUE) ainsi que le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD).
Cependant, l'agenda environnemental des pays
industrialisés s'est heurté aux perspectives et aux
priorités politiques des pays en développement, pour qui il
n'était pas question de réduire les taux de croissance.
Notons que les deux chocs pétroliers ainsi que la
manifestation d'une crise économique importante ont conduit pendant une
dizaine d'années à un déclin de l'attention publique et
politique vis-à-vis des questions environnementales.
A partir des années 80 : la «
montée en puissance » du développement durable
Mais plus le temps passe, plus la société civile
prend conscience de l'urgence de mettre en place une solidarité
planétaire pour faire face aux grands bouleversements des
équilibres naturels. Ainsi, au cours des années 1980, le grand
public découvre les pluies acides, le trou dans la couche d'ozone,
l'effet de serre, la déforestation et la catastrophe de
Tchernobyl !
L'ensemble de ces éléments, relayé par
les médias, a touché le grand public. Il est dorénavant
questions de problèmes « globaux » d'environnement pour
lesquels de « nouvelles formes de gouvernance » doivent être
élaborées. Ces problèmes globaux mettent en jeu l'avenir
des générations futures et peuvent avoir des effets
irréversibles qui menacent la survie de la planète et de
l'espèce humaine.
Dès 1980, l'UICN (alliance mondiale pour la nature -
c'est un organisme privé) parle pour la première fois de
Sustainable Development (traduit à l'époque par
développement soutenable). Présentée comme un « cadre
théorique et pratique » à destination des pouvoirs publics,
des praticiens du développement, etc., cette stratégie vise
à concilier les objectifs du développement des
sociétés et de conservation de la nature, lesquels ont trop
longtemps été considérés comme antinomiques. C'est
au rapport Brundtland que l'on attribue
généralement l'origine du terme de développement
durable. À l'époque Premier ministre en Norvège
et présidente de la Commission Mondiale sur l'Environnement et
le Développement, madame Gro Harlem Brundland
s'attacha à définir ce concept de développement durable
par " un développement qui répond au besoin du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ".
Depuis cette date, le concept de développement durable a
été adopté dans le monde entier.
Mais le terme n'a vraiment retenu l'attention des
médias qu'à partir de la conférence de Rio (Un
recensement de l'occurrence du terme « développement durable »
dans Le Monde et Les Échos depuis 1987 montre que l'utilisation du terme
dans ces deux quotidiens ne décolle réellement qu'à partir
de la Conférence de Rio en 1992. Le terme apparaît une fois en
1988, 9 en 1990, 19 en 1991, 46 en 1992, 137 en 1999, 119 en 2000 ;
résultats d'une recherche menée par AGGERI (2001) sur la base de
données Europresse).
Annexe 7
Parties Prenantes / Stakeholders
Salariés
Les collaborateurs de l'entreprise sont sa première source
de richesse. Ils garantissent non seulement la production d'un bien ou d'un
service, mais peuvent également, placés dans des conditions
favorables (qualité du management et de l'environnement de travail,
incitation à l'autonomie, formation et rémunération),
améliorer la qualité des produits et des services, imaginer de
nouvelles façons de travailler, etc.
Fournisseurs
Il s'agit d'établir un nouveau type de contrat avec ses
fournisseurs en établissant des relations à long terme.
L'idée n'est plus d'obtenir le meilleur prix, en écrasant les
marges de ses fournisseurs et en en changeant régulièrement, mais
de bénéficier de produits ou de services de qualité
constante, dans un bénéfice mutuel pour les deux parties.
Reste la question des responsabilités en cascade : une
entreprise engagée dans une politique socialement responsable
sélectionnera ses fournisseurs selon des critères sociaux et
environnementaux. Mais qu'en est-il des propres sous-traitants de ces
fournisseurs ? Comment aller vérifier leurs méthodes de travail
puisqu'ils restent, a priori, inconnus de l'entreprise cliente ? La
sous-traitance, et ses multiples niveaux, est au coeur de la RSE.
Clients
Prendre en compte les attentes des clients passe par un
éventail de mesures visant à améliorer le service au
consommateur via les procédures qualité, les numéros verts
et les services d'information client, les enquêtes de satisfaction, etc.
C'est aussi répondre à de nouvelles attentes sur les
qualités sociales et environnementales des produits.
Les consommateurs deviennent progressivement des
consom'acteurs qui utilisent «le pouvoir de leurs caddies» pour, par
exemple, choisir des produits labellisés commerce équitable ou se
détourner de marques stigmatisées par des ONG pour les conditions
de travail chez leurs sous-traitants.
Actionnaires
La voix des actionnaires ne cesse de s'affirmer, celle des
investisseurs institutionnels comme des petits porteurs. Détenteurs
d'une partie du capital de l'entreprise, ces actionnaires, quel que soit leur
poids, exercent de plus en plus leur droit de regard sur la politique
menée par l'entreprise y compris dans ses aspects sociaux et
environnementaux. Ils utilisent pour cela, entre autres, les assemblées
générales.
ONG (Organisations Non Gouvernementales)
Certains organismes non-gouvernementaux publient
régulièrement des informations sur les méthodes de gestion
des entreprises et en dénoncent, si nécessaire, les errements.
Leur mission consiste aussi à élaborer et publier des chartes,
voire à mener des audits sollicités par les entreprises
elles-mêmes.
Riverains
Il s'agit de tous ceux qui vivent autour des unités de
production et peuvent, directement ou indirectement, bénéficier
ou subir les impacts de cette activité économique. En anglais, on
parle de community. La vie et le développement des collectivités
locales dépendent toujours largement des retombées
économiques générées par les entreprises, en termes
d'emploi, mais aussi de taxes professionnelles, de vie des associations, de
maintien des services publics et des commerces. Dans les pays en
développement, la contribution de l'entreprise relève parfois de
notions de services publics (santé, équipement...).
Les générations futures
Le développement durable doit tenir compte des
générations à venir qui n'ont, par définition, pas
de porte-parole. De façon plus concrète, il consiste aussi
à réintroduire dans une économie et une
société occidentale vivant au rythme du court terme, les notions
de moyen et long terme.
Annexe 8
Agences de rating social et environnemental remarquables sur
le plan international
Council on Economic Priorities
C'est une association qui évalue les entreprises et
s'adresse à la communauté financière comme aux
consommateurs (par la publication du best-seller "Shopping for a better
world"). Le C.E.P. est notamment à l'origine de la norme sociale SA
8000, dont il est une agence de vérification agréée.
SAM (Sustainable Asset Managemement)
Fondée en 1995, SAM est une société
indépendante de gestion d'actifs basée en Suisse et
spécialisée dans la mise en place effective de stratégies
d'investissement durables pour des investisseurs privés et
institutionnels. En 1999, elle a lancé, en partenariat avec Dow Jones
& Company, le premier indice mondial composé selon des
critères de durabilité, le DJSI World, et a lancé en
octobre 2001, un indice européen composé selon des
critères de durabilité, le DJSI STOXX.
Calvert Group
S'adressant aux investisseurs "que le comment intéresse
autant que le combien", Calvert Group est l'un des premiers organismes
américains spécialisés dans les placements
éthiques. C'est aussi une entreprise pionnière de la
responsabilité sociale.
Annexe 9
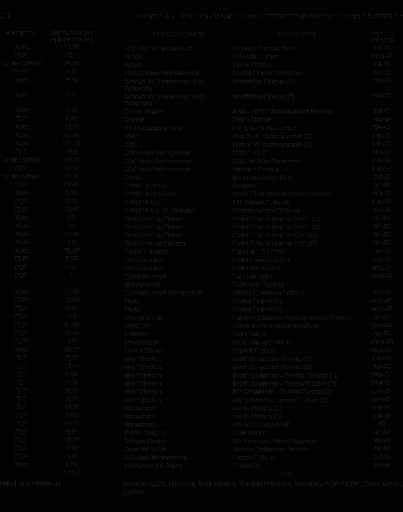
Extrait des annexes du rapport de la CCIP, Pour que
l'entreprise soit le moteur du développement durable.
Annexe 10
2 exemples de grandes entreprises qui se sont
lancées dans la démarche d'intégration du
Développement Durable
(source CCIP)
Société
Générale :
La Société générale a
commencé à mettre en place un système de management
interne avec la création d'un " comité de pilotage transversal ",
composé de toutes les directions du groupe (direction des risques et de
la gestion des immeubles, direction financière, juridique,
qualité et communication). Ce comité est chargé d'animer
la politique environnementale du groupe par des propositions, par la mise en
place d'un système de reporting interne, et par la mise en
place de mesures et de dispositifs spécifiques : le contrôle des
rejets atmosphériques, le tri sélectif des déchets, la
récupération des tubes fluorescents et des piles, le recyclage
des " déchets administratifs " (700 tonnes de papier et de carton ont
été recyclées en 2000). Des économies de papier
sont réalisées pour l'édition de documents internes et
externes.
Le groupe a même calculé l'impact de l'Intranet
sur l'édition de la documentation interne : 60 millions de pages
éditées en 1997, contre 33 millions en 1999. Direction
stratégique en matière d'environnement, la division des achats a
sélectionné un certain nombre de produits " écologiques "
(sacs poubelles, blanc liquide, colles), et incite le personnel a les utiliser.
S'agissant du siège (la tour Société
générale située à La Défense), plusieurs
dispositions ont été prises pour réduire les consommations
d'énergie. La lumière est coupée automatiquement aux
heures d'inoccupation des bureaux, et les installations de productions
frigorifiques, conçues pour améliorer la
récupération de la chaleur, permettent de couvrir 86% des besoins
de chauffage. Des installations de récupération permettent
également de récupérer de l'énergie sur les groupes
électrogènes. De même, les calories "
récupérées " au sein du centre informatique permettent de
chauffer les bureaux et une partie des locaux du centre.
En 2001, le bénéfice de cette politique a
été évalué à 7 millions de francs,
uniquement pour le siège.
Lafarge :
Signé en mars 2000, l'accord du groupe Lafarge (leader
mondial des matériaux de construction) avec le WWF (organisation
internationale de protection de l'environnement) s'inscrit dans le cadre du
programme mondial " Conservation Partner " du WWF. Membre fondateur de ce
programme, Lafarge est le premier groupe industriel à prendre un
engagement de cette importance.
Ce partenariat comporte trois volets :
· Un volet industriel, qui consiste à
améliorer les performances environnementales du groupe à travers
sept indicateurs de performance (proportion de ses carrières
réhabilitées, réduction des émissions de gaz
carbonique, pourcentage de site ayant fait l'objet d'un audit environnemental,
part d'énergies de substitution utilisées pour la production de
ciment, pourcentage de produits de substitution aux matières
premières et réduction de la consommation d'eau et du volume des
déchets des activités de production)
· Un programme de réhabilitation de ses
carrières de ciment en fin de vie. Grâce au concours de WWF, une
Charte de réhabilitation s'appliquera ainsi à l'ensemble des 800
carrières dans le monde, les meilleures pratiques de
réhabilitation étant diffusées à travers le
réseau environnement du groupe ;
· Un soutien financier du groupe pour la reforestation et
la préservation de la diversité biologique, la reforestation
dans plusieurs régions du monde (qui ne sont pas nécessairement
des régions d'implantation du groupe), pour lesquelles Lafarge versera
1,1 millions d' euros au WWF pendant cinq ans. " Forest Reborn " concernera
-entre autres- l'Inde, le Mékong, la Nouvelle-Calédonie, l'Ecosse
et l'Amérique centrale, pour parvenir à la restauration de leurs
éco-systèmes.
Ce vaste programme s'accompagne également d'actions de
sensibilisation auprès des salariés du groupe (un "guide du
partenariat" est diffusé en interne) et des entreprises du secteur,
l'objectif étant de déterminer des standards écologiques
pour l'ensemble de la profession. Premier partenariat de ce cette ampleur au
niveau mondial, les enjeux sont, de part et d'autre, fondamentaux. Car le WWF
ne s'interdira pas de critiquer les méthodes du groupe, voire de mettre
fin à cet accord si Lafarge ne respectait pas ses obligations. En
accolant leur logos, les deux partenaires ont pris un risque partagé.
Annexe 11
Trame d'entretiens
Aspects internes :
Gestion de l'eau
Votre consommation en eau peut se repartir entre
différents usages:
Procédés de production
Sanitaires (W.-C., douches, lavabos), cafétéria
et cuisine
Systèmes de refroidissement et
d'humidification
Arrosage
Autres usages (lavage des surfaces, etc.).
 Connaissez-vous votre consommation d'eau annuelle ? Mensuelle ?
Connaissez-vous votre consommation d'eau annuelle ? Mensuelle ?
 Surveillez-vous régulièrement votre consommation afin de
réagir rapidement en cas de fuite dans les canalisations ?
Surveillez-vous régulièrement votre consommation afin de
réagir rapidement en cas de fuite dans les canalisations ?
 Contrôlez-vous votre consommation pour chaque type d'activité ?
Contrôlez-vous votre consommation pour chaque type d'activité ?
 Encouragez-vous votre personnel à économiser l'eau ?
Encouragez-vous votre personnel à économiser l'eau ?
 Respectez-vous l'interdiction de rejeter à l'égout les substances
telles que: eau de Javel, peintures, solvants, acides et bases, huiles, etc.
?
Respectez-vous l'interdiction de rejeter à l'égout les substances
telles que: eau de Javel, peintures, solvants, acides et bases, huiles, etc.
?
 Votre
entreprise évite-t-elle les lavages et rinçages excessifs ? Votre
entreprise évite-t-elle les lavages et rinçages excessifs ?
 Disposez-vous de compteurs d'eau dans les secteurs qui consomment beaucoup
d'eau ?
Disposez-vous de compteurs d'eau dans les secteurs qui consomment beaucoup
d'eau ?
Gestion de l'énergie
 Connaissez-vous votre consommation annuelle d'énergie et les coûts
qu'elle engendre?
Connaissez-vous votre consommation annuelle d'énergie et les coûts
qu'elle engendre?
 Mesurez-vous votre consommation énergétique en fonction des
différentes utilisations (outils de production, chauffage, ventilation,
air conditionné, éclairage, transports, etc.)?
Mesurez-vous votre consommation énergétique en fonction des
différentes utilisations (outils de production, chauffage, ventilation,
air conditionné, éclairage, transports, etc.)?
 Vous
êtes-vous fixé des objectifs de réduction de consommation
annuelle? Vous
êtes-vous fixé des objectifs de réduction de consommation
annuelle?
 Lors
de l'achat d'un équipement, tenez-vous compte de sa consommation
d'énergie? Lors
de l'achat d'un équipement, tenez-vous compte de sa consommation
d'énergie?
 Votre
entreprise utilise-t-elle l'énergie solaire, géothermique (pompe
à chaleur) ou éolienne à la place d'une énergie non
renouvelable lorsque cela est possible? Votre
entreprise utilise-t-elle l'énergie solaire, géothermique (pompe
à chaleur) ou éolienne à la place d'une énergie non
renouvelable lorsque cela est possible?
Transports
 Privilégiez-vous le transport de marchandises par rail quand
cela est économiquement possible?
Privilégiez-vous le transport de marchandises par rail quand
cela est économiquement possible?
 Avez-vous recours au transport combiné (rail/route; transport maritime
ou fluvial/route) quand cela est économiquement possible?
Avez-vous recours au transport combiné (rail/route; transport maritime
ou fluvial/route) quand cela est économiquement possible?
 Vos
véhicules sont-ils entretenus régulièrement? Vos
véhicules sont-ils entretenus régulièrement?
 Utilisez-vous ou possédez-vous des véhicules électriques
ou fonctionnant autrement qu'à l'essence ou au diesel (biodiesel,
biogaz, GPL, etc.)?
Utilisez-vous ou possédez-vous des véhicules électriques
ou fonctionnant autrement qu'à l'essence ou au diesel (biodiesel,
biogaz, GPL, etc.)?
 Evitez-vous le retour à vide des camions de livraison? Optimisez-vous le
chargement?
Evitez-vous le retour à vide des camions de livraison? Optimisez-vous le
chargement?
 Votre
entreprise favorise-t-elle les produits fabriqués localement? Votre
entreprise favorise-t-elle les produits fabriqués localement?
 Connaissez-vous les moyens de déplacement de votre personnel?
Connaissez-vous les moyens de déplacement de votre personnel?
 Avez-vous recensé les arrêts de transports en commun à
proximité de votre entreprise?
Avez-vous recensé les arrêts de transports en commun à
proximité de votre entreprise?
 Offrez-vous à votre personnel un abonnement pour les transports en
commun?
Offrez-vous à votre personnel un abonnement pour les transports en
commun?
Déchets
 Avez-vous une idée du coût annuel d'élimination de
vos déchets (recyclage et incinération)?
Avez-vous une idée du coût annuel d'élimination de
vos déchets (recyclage et incinération)?
 Tenez-vous une comptabilité des quantités de déchets
générés par votre entreprise: par année, par
catégorie?
Tenez-vous une comptabilité des quantités de déchets
générés par votre entreprise: par année, par
catégorie?
 Connaissez-vous la composition de vos déchets?
Connaissez-vous la composition de vos déchets?
 Triez-vous les matériaux suivants: papier et carton, verre, PET,
métaux, bois, déchets organiques, piles et accumulateurs,
appareils électriques et électroniques, etc.?
Triez-vous les matériaux suivants: papier et carton, verre, PET,
métaux, bois, déchets organiques, piles et accumulateurs,
appareils électriques et électroniques, etc.?
 Avez-vous dressé une liste des déchets spéciaux
présents dans votre entreprise?
Avez-vous dressé une liste des déchets spéciaux
présents dans votre entreprise?
 Vos
déchets spéciaux sont-ils séparés du reste des
déchets? Vos
déchets spéciaux sont-ils séparés du reste des
déchets?
Achats

Sécurité sur le lieu de travail
 Connaissez-vous l'emplacement des sorties de secours, des extincteurs
?
Connaissez-vous l'emplacement des sorties de secours, des extincteurs
?
 Connaissez-vous les zones dans lesquelles la santé et la
sécurité du personnel peuvent être menacées?
Connaissez-vous les zones dans lesquelles la santé et la
sécurité du personnel peuvent être menacées?
 Le
personnel est-il parfaitement informé des consignes de
sécurité? Le
personnel est-il parfaitement informé des consignes de
sécurité?
 Existe-t-il des procédures d'urgence en cas d'accident?
Existe-t-il des procédures d'urgence en cas d'accident?
 Le
matériel et les installations nécessaires pour prévenir
les accidents sont-ils à disposition sur les lieux à risque? Le
matériel et les installations nécessaires pour prévenir
les accidents sont-ils à disposition sur les lieux à risque?
Aspects externes :
Développement économique
 Avez-vous des perspectives de croissance identifiées ?
Avez-vous des perspectives de croissance identifiées ?
 Avez-vous l'habitude de formuler des objectifs, de les suivre de façon
formalisée, et d'évaluer vos résultats ?
Avez-vous l'habitude de formuler des objectifs, de les suivre de façon
formalisée, et d'évaluer vos résultats ?
 Disposez-vous d'outils d'auto évaluation de vos performances ?
Disposez-vous d'outils d'auto évaluation de vos performances ?
Capital social :
 Avez-vous pensé à proposer aux employés de
remplacer une formation professionnelle par un engagement dans une association
ou une oeuvre d'entraide?
Avez-vous pensé à proposer aux employés de
remplacer une formation professionnelle par un engagement dans une association
ou une oeuvre d'entraide?
 Etes-vous prêt - dans un accord de réduction du temps de travail -
à consacrer quelques jours de travail rémunéré
à une cause d'intérêt général définie
par l'ensemble du personnel?
Etes-vous prêt - dans un accord de réduction du temps de travail -
à consacrer quelques jours de travail rémunéré
à une cause d'intérêt général définie
par l'ensemble du personnel?
 Encouragez-vous les plates-formes ou groupements d'entreprises ou d'employeurs
permettant de mettre en commun les ressources?
Encouragez-vous les plates-formes ou groupements d'entreprises ou d'employeurs
permettant de mettre en commun les ressources?
 Encouragez-vous la résolution de problèmes sur un mode
collectif?
Encouragez-vous la résolution de problèmes sur un mode
collectif?
 Avez-vous déjà envisagé de mettre à disposition
d'organisations non gouvernementales ou bénévoles un expert ou
une experte de l'entreprise, à titre occasionnel?
Avez-vous déjà envisagé de mettre à disposition
d'organisations non gouvernementales ou bénévoles un expert ou
une experte de l'entreprise, à titre occasionnel?
 Avez-vous pensé à soutenir des associations par la mise à
disposition de moyens logistiques ou de locaux, des dons en nature (mobilier,
nourriture, matériel) ou financiers, etc.?
Avez-vous pensé à soutenir des associations par la mise à
disposition de moyens logistiques ou de locaux, des dons en nature (mobilier,
nourriture, matériel) ou financiers, etc.?
Clients et concurrents
 Une partie de votre clientèle vient-elle de pays
sensibilisés aux questions environnementales (Allemagne, Pays-Bas, pays
scandinaves) ou à la responsabilité sociale des entreprises
(Grande-Bretagne, Europe)?
Une partie de votre clientèle vient-elle de pays
sensibilisés aux questions environnementales (Allemagne, Pays-Bas, pays
scandinaves) ou à la responsabilité sociale des entreprises
(Grande-Bretagne, Europe)?
 Votre
clientèle interroge-t-elle votre personnel sur les mesures prises en
matière de développement durable dans votre entreprise? Votre
clientèle interroge-t-elle votre personnel sur les mesures prises en
matière de développement durable dans votre entreprise?
 Avez-vous déjà demandé à vos clients s'ils se
sentent concernés par la protection de l'environnement?
l'éthique? la responsabilité sociale?
Avez-vous déjà demandé à vos clients s'ils se
sentent concernés par la protection de l'environnement?
l'éthique? la responsabilité sociale?
 Vos
concurrents utilisent-ils ou s'apprêtent-ils à utiliser
l'argumentation «verte»? Vos
concurrents utilisent-ils ou s'apprêtent-ils à utiliser
l'argumentation «verte»?
Intégration locale
 Votre entreprise génère-t-elle des odeurs
nauséabondes?
Votre entreprise génère-t-elle des odeurs
nauséabondes?
 Votre
entreprise génère-t-elle des nuisances sonores à
l'extérieur de ses installations (machines et équipements,
trafic, transports)? Si oui, ont-elles fait l'objet de plaintes ou de mesures
du niveau sonore? Votre
entreprise génère-t-elle des nuisances sonores à
l'extérieur de ses installations (machines et équipements,
trafic, transports)? Si oui, ont-elles fait l'objet de plaintes ou de mesures
du niveau sonore?
 Le
voisinage se plaint-il de vibrations provenant de votre
établissement? Le
voisinage se plaint-il de vibrations provenant de votre
établissement?
 Votre
installation de ventilation ou de climatisation génère-t-elle des
nuisances sonores ou des rejets thermiques pouvant gêner le voisinage? Votre
installation de ventilation ou de climatisation génère-t-elle des
nuisances sonores ou des rejets thermiques pouvant gêner le voisinage?
 Votre
entreprise génère-t-elle des nuisances visuelles
(dépôt de matériel usagé, bâtiments
inesthétiques, etc.)? Votre
entreprise génère-t-elle des nuisances visuelles
(dépôt de matériel usagé, bâtiments
inesthétiques, etc.)?
 Votre
entreprise produit-t-elle des lumières dérangeantes (enseignes
lumineuses clignotantes, etc.)? Votre
entreprise produit-t-elle des lumières dérangeantes (enseignes
lumineuses clignotantes, etc.)?
Annexe 12
Quelques dispositifs de conseil et de diagnostic de la
CCIP
Pré-Diagnotics Déchets et Environnement
:
PME-PMI, vous souhaitez évaluer la prise en
compte de l'environnement dans votre entreprise ?
La
CCIP-Délégation de Paris vous propose la réalisation d'un
pré-diagnostic environnement gratuit et confidentiel.
La durée
de ce pré-diagnostic est d'une demi-journée, effectué par
un conseiller environnement de la CCIP-Délégation de Paris.
Les aides au conseil ( pour IDF service
uniquement)
Vous souhaitez faire appel à un consultant
pour réaliser une mission avec la possibilité de
bénéficier d'une subvention du Conseil Régional et/ou de
l'Etat, (DRIRE) dans les domaines suivants :
- "Business Plan" et recherche de financements
extérieurs
- Etude stratégique et organisationnelle, y
compris la fonction commerciale
- Passage norme ISO 14 000 (norme
environnementale)
- Design de produits et de services
industriels
- Etude de marché pour les entreprises de moins de
trois ans d'existence
- Opérations qualité
groupées pour les TPE (Très Petites Entreprises de moins de 15
salariés)
Fonds Régional d'Aide au Conseil (FRAC)
La CCIP-Délégation de Paris se tient à votre
disposition pour instruire votre dossier.
S'informer avec CapRH :
Un nouvel outil d'information gratuit, relatif aux
techniques de gestion des ressources humaines et l'actualité en droit
social.
Capital RH est une lettre d'information
électronique, un portail de liens utiles et une véritable base
documentaire (fiches techniques par thématiques). Concis et pratique,
elle vous permettra de rester au fait de l'actualité et des tendances en
matière de gestion de ressources humaines.
Annexe 13
Le GPL
En France, le GPL Carburant est un mélange
constitué d'environ 50% de Butane et 50% de Propane. La composition de
ce mélange est régie par la norme européenne EN 589 qui
spécifie notamment un indice d'octane minimal ( MON ) de 89.
Le Butane et le Propane ont la propriété de se
maintenir sous forme liquide, à faible pression, dans des
réservoirs étanches et de se transformer en gaz lors de leur
utilisation.
Le GPL Carburant révèle des qualités souvent
méconnues :
A performances égales, le GPL Carburant
est nettement moins polluant et plus économique que
l'essence ou le Gazole. C'est aussi le carburant alternatif le plus
utilisé dans le monde !
Il est :
 respectueux de l'environnement respectueux de l'environnement
 économique économique
 performant performant
Avantage écologique :
Le GPL Carburant respecte naturellement l'environnement
:
Ne contenant ni Plomb (Pb), ni Souffre (S), ni Benzène
(C6H6), le GPL Carburant est non toxique. De plus, sa
combustion en présence d'Oxygène étant quasi totale, il ne
dégage pratiquement pas de particules d'imbrûlés.
Par rapport à l'Essence, le GPL Carburant permet une
réduction des émissions :
 d'Oxyde d'Azote (NOx) de 15 à 40 % d'Oxyde d'Azote (NOx) de 15 à 40 %
 d'Oxyde de Carbone (CO) de 20 à 60 % d'Oxyde de Carbone (CO) de 20 à 60 %
 de Gaz
Carbonique (CO2) d'environ 10 % de Gaz
Carbonique (CO2) d'environ 10 %
 d'Hydrocarbure (HC) de 30 à 60 % d'Hydrocarbure (HC) de 30 à 60 %

La Pastille Verte
Depuis février 1998, la pastille verte est accordée
aux véhicules "propres" et notamment ceux qui fonctionnent au GPL
Carburant. Cette mesure permet de circuler les jours de forts pics de pollution
même lorsque la circulation est alternée.
Avantages en termes de performances
techniques.
Les véhicules roulant au GPL Carburant
révèlent des performances confortées par les
qualités techniques qu'offre ce carburant : moteur robuste, plus
silencieux et plus souple, et une décélération en douceur
grâce à l'homogénéité de la combustion.
Le GPL Carburant est respectueux du moteur :
La combustion du GPL Carburant est propre et n'encrasse pas le
moteur.
Les huiles n'étant pas altérées, elles
conservent plus longtemps leurs qualités lubrifiantes.
Il faut savoir également que la réduction
des vibrations diminue sensiblement les nuisances sonores
améliorant ainsi le confort et la souplesse de conduite.
En résumé, on peut dire que le GPL Carburant
représente l'une des meilleures solutions alternatives
qui existe actuellement.
Avantage économique :
Les pouvoirs publics ont associé aux qualités
écologiques du GPL Carburant un intérêt
économique.
Le GPL Carburant est le moins cher de tous les
carburants à la pompe : en moyenne 0.50 € le litre
Des mesures fiscales prises dans le cadre de la loi sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 ainsi
que les différentes lois de finances soulignent la volonté des
Pouvoirs publics d'encourager sur le long terme, le développement du GPL
Carburant.
Les mesures communes aux professionnels et aux
particuliers pour l'environnement.
 Les
conseils généraux peuvent exonérer de
vignette, en totalité ou partiellement, les véhicules
les moins polluants et notamment ceux fonctionnant au GPL Carburant. Les
conseils généraux peuvent exonérer de
vignette, en totalité ou partiellement, les véhicules
les moins polluants et notamment ceux fonctionnant au GPL Carburant.

 Les conseils régionaux ont la faculté
d'exonérer partiellement ou totalement la taxe proportionnelle sur
la carte grise pour les véhicules fonctionnant au GPL
Carburant. . Les conseils régionaux ont la faculté
d'exonérer partiellement ou totalement la taxe proportionnelle sur
la carte grise pour les véhicules fonctionnant au GPL
Carburant. .
Les mesures fiscales réservées aux
professionnels
 La TVA est récupérable sur le GPL carburant, à
hauteur de 100 %, pour tous les véhicules fonctionnant au GPL
Carburant. Cette mesure concerne les véhicules particuliers, la
TVA étant déjà déductible pour les véhicules
utilitaires quel que soit le type de carburant
utilisé.
La TVA est récupérable sur le GPL carburant, à
hauteur de 100 %, pour tous les véhicules fonctionnant au GPL
Carburant. Cette mesure concerne les véhicules particuliers, la
TVA étant déjà déductible pour les véhicules
utilitaires quel que soit le type de carburant
utilisé.
 Amortissement exceptionnel sur 12 mois pour les
véhicules fonctionnant en mono-carburation (réservoir essence
d'une contenance inférieure à 15 litres), pour les
équipements spécifiques des véhicules fonctionnant au
moyen de plusieurs sources d'énergie ainsi que pour les véhicules
fonctionnant en bi-carburation (plafond fixé à 18 293, 88 euros). Amortissement exceptionnel sur 12 mois pour les
véhicules fonctionnant en mono-carburation (réservoir essence
d'une contenance inférieure à 15 litres), pour les
équipements spécifiques des véhicules fonctionnant au
moyen de plusieurs sources d'énergie ainsi que pour les véhicules
fonctionnant en bi-carburation (plafond fixé à 18 293, 88 euros).
 Exonération totale pour les véhicules
mono-carburation, de la taxe sur les véhicules de société
(T.V.S.). La T.V.S. est réduite de 50 % pour les véhicules
bi-carburation. Pour rappel, son montant est de 1 128,12 euros pour les
véhicules n'excédant pas les 7 chevaux fiscaux et de 2 439,18
euros au-delà. Cette disposition s'applique aux véhicules
particuliers (V.P.), les véhicules utilitaires (V.U.) n'étant pas
soumis à la T.V.S. Exonération totale pour les véhicules
mono-carburation, de la taxe sur les véhicules de société
(T.V.S.). La T.V.S. est réduite de 50 % pour les véhicules
bi-carburation. Pour rappel, son montant est de 1 128,12 euros pour les
véhicules n'excédant pas les 7 chevaux fiscaux et de 2 439,18
euros au-delà. Cette disposition s'applique aux véhicules
particuliers (V.P.), les véhicules utilitaires (V.U.) n'étant pas
soumis à la T.V.S.
Source : PRIMAGAZ France
Annexe 14
Devis Avis fleet service
Annexe 15
Contrat de services Mobalpa
Annexe 16
Aides accessibles aux PME étudiées
Ø Formation du personnel
OBJECTIFS
Accompagner les programmes de
formation du personnel.
ENTREPRISES BENEFICIAIRES
Seules les PME ont
accès au Fonds Social Européen au titre de l'Objectif 3 - mesure
6 " moderniser les organisations du travail et développer les
compétences " (programmation 2000 - 2006).
PROJETS SOUTENUS
Programmes de formation du
personnel, y compris cadres et dirigeants.
Tous domaines : technique,
stratégie, commercial, qualité ...
Le contenu précis
des programmes soutenus est différent selon les besoins des entreprises.
MODALITES
L'aide consiste en une subvention
dont le taux varie en fonction du programme. Elle bénéficie, le
cas échéant, d'un cofinancement du Fonds Social Européen.
Direction Régionale du travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle
DRIRE
Ø - Fonds pour l'amélioration des
conditions de travail (FACT)
OBJECTIFS
Aider les actions exemplaires
conduites par les entreprises qui modifient de façon significative les
conditions matérielles de travail et/ou d'organisation, et qui
privilégient la mise en oeuvre de solutions innovantes en matière
de conditions de travail et d'aménagement du temps de travail, dans un
contexte de dialogue social.
ENTREPRISES BENEFICIAIRES
Toutes les
entreprises.
PROJETS SOUTENUS
Acquisition
d'équipements, élaboration de procédés,
aménagement de situations de travail visant à améliorer
les conditions de travail et mettre en oeuvre des transformations de
l'organisation du travail préservant la santé physique et
psychique des salariés.
Ces projets doivent être
examinés avec les salariés ou leurs représentants.
MODALITES
L'aide consiste en une subvention
représentant au maximum :
- 50 % des études préalables (y compris le conseil
extérieur pour préparer et accompagner la mise en oeuvre du
projet) et de la réalisation de prototypes ;
- 30 % des
investissements en matériels ;
- 30 % du temps passé à
la mise en oeuvre du projet.
- Direction Régionale du travail, de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle
- Direction Départementale du
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
Ø Fonds Social Européen, demande
régionale
QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE DE SUBVENTION
?
Tout organisme intervenant dans l'un des domaines
d'activité des programmes FSE, est habilité à
présenter un projet et en particulier :
- Les associations
- Les
collectivités territoriales
- Les chambres consulaires
- Les
organismes de formation
- Les entreprises
- Les OPCA
- Les
établissements publics.
Les personnes physiques ne peuvent pas présenter de projet
sans le support d'une structure juridique.
POUR QUELS TYPES D'ACTIONS ?
Les projets
doivent répondre aux priorités fixées par le DOCUP de
l'Objectif 3, à savoir : la lutte contre le chômage, l'insertion
des personnes en difficulté, l'égalité des chances pour
tous, l'éducation et la formation tout au long de la vie, la
modernisation et l'innovation dans les organisations de travail,
l'amélioration de la participation des femmes au marché du
travail.
Le FSE finance ainsi des actions d'accompagnement, d'information,
de formation et de préformation à destination des
salariés, des demandeurs d'emploi, des chômeurs, etc.
comme:
- l'accompagnement, le tutorat et la formation des publics en
difficulté
- la formation des salariés, des demandeurs
d'emploi ou des publics en insertion
- l'information du public
éloigné de l'emploi
- les actions spécifiques en
faveur du public féminin
- les actions en faveur du public
handicapé
- la formation et l'information grâce aux TIC,
notamment en zone rurale
- l'ingénierie de projet de
développement local ayant une incidence sur la thématique de
l'emploi
Une attention particulière est réservée aux
projets qui intègrent l'égalité des chances entre les
femmes et les hommes.
OU RETIRER LE DOSSIER ?
Le dossier est
à retirer auprès du service emploi/formation de la DRTEFP de
votre région. Il comprend un formulaire type, des annexes
financières et la liste des pièces à produire.
À QUI L'ADRESSER ?
A votre DRTEFP.
Les demandes doivent obligatoirement être
déposées avant le démarrage de la formation.
Au moment du dépôt du dossier, un accusé de
réception vous sera remis par le service emploi/formation Fonds Social
Européen de la DRTEFP. Mais attention, ce justificatif ne préjuge
pas des suites qui seront données à votre dossier.
COMMENT FORMULER LA DEMANDE ?
La description
des actions pour lesquelles le porteur de projet demande un cofinancement du
Fonds Social Européen doit comporter les éléments suivants
:
- le contenu de l'action et son déroulement
- les moyens mis en
oeuvre
- les résultats attendus et les moyens d'évaluation
- le cofinancement (État, Région, OPCA, chambres consulaires)
- la prise en compte des priorités communautaires comme
l'égalité des chances femmes/hommes
LE PRINCIPE DE COMPLEMENTARITE
Le Fonds
Social Européen n'intervient jamais seul (sans le complément
d'autres ressources). En effet, un porteur de projet doit d'abord obtenir un
cofinancement public et éventuellement privé, avant de demander
le concours du FSE. Ce cofinancement peut prendre la forme d'une lettre
d'intention d'un partenaire public ou privé (qui peut être
l'apport du porteur de projet lui-même).
UNE SUBVENTION SOUS FORME DE
REMBOURSEMENT
Les actions sont financées à hauteur de
45 %. Toutefois, les projets de formation des entreprises, les actions
liées à la création d'entreprises et à la formation
des emplois jeunes sont financés à hauteur de 40 % en moyenne.
Le FSE est uniquement versé en remboursement de
dépenses réalisées, sur la base d'un bilan
d'exécution. L'organisme bénéficiaire conservera
l'ensemble des pièces des justificatives utilisées pour la
réalisation de ce bilan.
Ø Mesures en faveur des véhicules
alternatifs (ministère des finances et de l'industrie)
OBJECTIFS
Favoriser l'utilisation de
véhicules à énergie alternative.
ENTREPRISES BENEFICIAIRES
Toutes les
entreprises.
PROJETS SOUTENUS
Acquisition et utilisation
par les entreprises de véhicules fonctionnant, exclusivement ou non,
à l'énergie électrique, au GNV ou au GPLc et
d'équipements liés à ce mode de fonctionnement
(accumulateurs électriques, équipements de stockage, compression
et distribution de GNV ou GPLc ...)
MODALITES
Aides fiscales
:
Taxe sur les véhicules de sociétés
Exonération totale ou partielle.
Amortissement exceptionnel
Sur 12 mois à compter de la date de 1ère mise en
circulation des véhicules ou de la mise en service des
équipements, avant le 1er janvier 2003, applicable :
· aux véhicules automobiles
· aux accumulateurs nécessaires au fonctionnement des
véhicules
· aux équipements permettant l'utilisation de ces
énergies.
TVA concernant la consommation d'énergie :
Récupérable à 100 % sur les carburants
gazeux pour véhicules fonctionnant au GPLc ou GNV
Récupérable à 100 % sur
l'électricité consommée pour les véhicules
électriques, dans certaines conditions.
Aides à l'acquisition de véhicules
électriques :
Subventions par véhicule pour les véhicules acquis
entre le 01/01/2002 et le 31/12/2004.
Ø Développer l'usage du transport
combiné
L'aide à la décision pour les
transporteurs: études de faisabilité
Une aide financière sera accordée aux
entreprises de transport pour la réalisation d'études de
faisabilité du passage au transport combiné rail-route ou
route-fluvial, ou bien préalablement au lancement de nouvelles lignes de
transport maritime courte distance (Etude de faisabilité transport
maritime courte distance). Ces études, qui doivent éclairer la
décision des transporteurs sur l'intérêt d'utiliser le
transport combiné, portent sur les aspects commerciaux (étude du
marché), organisationnel (recherche de partenaires pour assurer une
chaîne de transport complète), financier (investissements, impacts
sur le résultat d'exploitation,...).
Elles pourront comporter une
estimation de la réduction des émissions de CO2 qui
résulteraient du passage au transport combiné. Cette aide aux
études préalables sera également ouverte à des
groupements d'entreprises de transport et/ou de chargeurs pour faciliter des
coopérations inter-entreprises en vue du développement
concerté du transport combiné, autour d'axes ou de zones
géographiques.
Cible: entreprises de transport,
groupements d'entreprises de transport et de chargeurs, éventuellement
associés à des organismes consulaires
Taux d'aide
: 50%
Assiette de l'aide : coût des
études plafonné à 75 000 euros
Ø L'aide à l'investissement en transport
combiné pour les transporteurs
Toutes les entreprises constituant la cible (transporteurs,
loueurs de matériels de transport combiné, opérateurs)
pourront bénéficier d'une subvention de 20% pour le
développement de leur activité de transport combiné (25%
pour les nouveaux accédants) subordonnée à des engagements
sur les volumes de trafic sur une période de 5 ans, pour l'acquisition
de matériels dédiés au transport combiné
rail-route.
Cette subvention sera accordée, au choix du
bénéficiaire, soit sous la forme d'une aide directement
distribuée par les délégations régionales de
l'ADEME, quel que soit le mode de financement retenu (hors location
financière), soit dans le cadre du contrat TOP 2 sous la forme d'un
crédit-bail négocié au taux du marché. Le dossier
de demande d'aide peut être téléchargé depuis le
lien ci-dessus. Le matériel concerné : caisses mobiles,
semi-remorques à prise par pince, châssis porte caisse mobile
(dans la limite d'un châssis pour deux caisses mobiles). Les entreprises
concernées : transporteurs, déménageurs, loueurs de
matériel et opérateurs de transport combiné (pour leur
flotte de démonstration)
Cible: entreprises
de transport, loueurs de matériel de transport combiné,
opérateurs de transport combiné
Taux d'aide :
25 % du montant de l'investissement si le bénéficiaire
accède à la technique, 20 % s'il en développe
l'utilisation, dans la limite de 100 euros par tonne de carbone
évitée pendant les 5 ans correspondant aux objectifs de
trafic
Assiette de l'aide : coût HT des
investissements plafonné à 1 000 000 euros
Annexe 17
Exemple de prix de stage de formation bureautique
|
Initiation à Internet
|
|
Savoir rechercher et récupérer les
différentes sortes d'information sur Internet. Utiliser la messagerie
électronique (e-mails)
|
|
Durée :
|
2 journées
|
|
Coût :
|
96 €
|
|
Date(s) :
|
Communiquée ultérieurement.
Pré-inscrivez-vous!
|
|
Word Initiation
|
|
Etre capable d'utiliser les commandes et les outils de base
d'un traitement de texte.
|
|
Durée :
|
1 journée
|
|
Coût :
|
48€
|
|
Date(s) :
|
Entre mi-avril et fin juin
|
|
Word perfectionnement
|
|
Utiliser les fonctions avancées : Tableaux,
en-têtes, publipostage....
|
|
Durée :
|
1 journée
|
|
Coût :
|
48€
|
|
Date(s) :
|
Entre début mai et fin juin
|
|
Excel Initiation
|
|
Etre capable d'utiliser les commandes et les outils de base
d'EXCEL.
|
|
Durée :
|
1 journée
|
|
Coût :
|
48€
|
|
Date(s) :
|
Communiquée ultérieurement.
Pré-inscrivez-vous!
|
Nos tarifs s'entendent TTC.
Programme détaillé de chaque formation disponible
sur demande.

Centre
d'Études et de
Recherche Appliquée de
l'Istec
174, quai de Jemmapes 75010 Paris - France
Tèl : 01 40 40 20 31 - Fax : 01 40 40 20 25 -
e-mail :
cerai@istec.fr
| 


