Introduction
La gestion durable des ressources forestières
revêt actuellement une importance cruciale, aussi bien pour les
populations rurales que pour les gouvernements et la communauté
internationale. Presque tous les Etats africains se sont dotés de
réglementations forestières qui, a priori, sont favorables
à une gestion pérenne des forêts(Le Flamboyant
n°59/60, 2005). Au cours de ces dix dernières années, le
Gabon à l'instar des autres pays du bassin du Congo a inscrit les
questions de gouvernance forestière à l'ordre du jour des
politiques et stratégies de développement économique.
Au niveau de la Direction Générale des Eaux et
Forêts, cela s'est traduit par l'élaboration d'un plan d'actions
dont les principaux objectifs visent entre autres, la mise en place des
principes de bonne gouvernance. Il s'agit en d'autres termes pour
l'administration forestière de créer des conditions pour une
meilleure contribution du secteur forestier au PIB (au moyen de la promotion,
puis l'encouragement à la certification ou l'éco-labellisation
des produits forestiers), à développer le domaine rural et la
participation des nationaux dans l'ensemble des activités
forestières1(*). En
ce qui concerne le groupe nominal mesure conservatoire qui constitue la trame
de notre étude, plusieurs définitions peuvent être
données selon les sources.
Souvent utilisée en droit de l'environnement,
l'expression « mesure conservatoire », désigne une
décision ayant pour effet de conserver provisoirement une ressource, un
droit ou un bien pour une durée indéterminée2(*). En ce qui concerne notre
travail, ces mesures sont principalement axées sur la suspension
provisoire d'attribution de nouveaux permis forestiers (décret n°
666/PR du 09/08/2004) et l'arrêt d'attribution des coupes familiales
en 2005.
La loi n° 16/01 du 31 Décembre 2001 portant code
forestier en république gabonaise dans son article 94, conditionne
l'exploitation forestière à l'attribution des permis. Or les
mesures conservatoires (décrets, arrêtés) prises
récemment dans le secteur forestier sont toujours en cours de
validité. A cet effet, l'une des problématiques sur laquelle
l'administration forestière se penche actuellement, est celle de savoir
si les initiatives émergentes de préservation des forêts
au Gabon, contribuent réellement à l'amélioration de la
légalité dans l'exploitation forestière?
Ainsi, l'objectif général de ce travail est de
ressortir les impacts liés à l'application des mesures
conservatoires prises par l'Etat sur l'exploitation des forêts. De
manière spécifique, il s'agira de faire un audit
institutionnel, et de dresser les conséquences relatives aux deux
mesures. L'intérêt d'un tel travail est qu'il permet d'avoir une
vue assez large des dispositions de la réglementation forestière
en république gabonaise et surtout de faire une analyse critique de la
nouvelle politique forestière.
Ledit travail se base sur deux principales hypothèses
qui consistent à supposer que :
(i) les mesures conservatoires prises par l'Etat contribuent
à la prolifération de l'exploitation forestière
illégale d'une part,
(ii) le cadre institutionnel actuel du secteur forestier
souffre de nombreux dysfonctionnements d'autre part.
Notre travail est constitué de quatre principaux
chapitres. Dans le premier chapitre il est question de montrer comment
l'exploitation forestière a évolué au Gabon de 1957
à 2007, de dresser un bref aperçu de la filière bois et
de présenter la méthodologie inhérente à ce
travail. Le chapitre deux est essentiellement consacré à l'audit
du cadre institutionnel, alors que le troisième chapitre se focalise
plus sur les mesures conservatoires proprement dites.
Enfin le chapitre quatre présente les tendances de
production forestière et les alternatives nécessaires à
une gestion forestière efficiente.
CHAPITRE I
GENERALITES ET METHODOLOGIE
I.1. Présentation du lieu de stage et ses
principales missions
Nous avons effectué ce stage à la Direction
Générale des Eaux et Forêts (commanditaire) au
Ministère de l'Economie Forestière, des Eaux, de la Pêche
et des Parcs Nationaux. Composé actuellement de trois directions
générales à savoir : la DGEF, la DGENEF et la DGPA,
le Ministère de l'Economie Forestière a pour principales
attributions ; la gestion du domaine forestier, de la faune sauvage, des
ressources halieutiques, le contrôle général et
l'application de la réglementation forestière dans les
forêts relevant du domaine de l'Etat3(*) .
En ce qui concerne spécifiquement la DGEF, elle est
chargée entre autres de :
þ Préparer et d'appliquer les textes
législatifs et réglementaires relatifs aux activités du
département (ministère)4(*) ;
þ D'assister le ministère des Eaux et
Forêts dans le traitement des affaires à soumettre au conseil des
ministres et à l'assemblée nationale.
Composée de six(6) directions techniques, neuf(9)
inspections provinciales, vingt six (26) cantonnements et quatorze (14)
brigades (DGEF, 2002), la Direction Générale des Eaux et
Forêts compte actuellement 671 agents (Annexe1), soit 299 agents (DPFO,
2007) de plus qu'en 2005. L'organigramme de la DGEF est établi comme
suit :
Figure 1 : Organigramme de la
DGEF
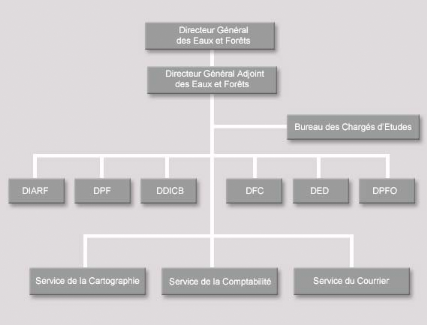
Source : DPFO(2007)
Les attributions de la Direction de la Production
Forestière au sein de laquelle nous avons été suivis,
visent principalement :
þ L'élaboration des directives
générales concernant la gestion de la forêt, la
conservation des sols, ainsi que le contrôle de leur
exécution ;
þ La proposition des conditions d'attribution des permis
forestiers ;
þ L'instruction des demandes de permis ;
þ La centralisation et la gestion des dossiers de permis
et le fichier des entreprises d'exploitation forestière ;
þ Le contrôle de la production forestière,
en liaison avec la direction compétente du ministère
chargé des domaines.5(*)
I.2. Les grands traits géographiques du Gabon
I.2.1. Situation géographique.
A cheval sur l'équateur, le Gabon (267667
km2) est bordé par l'Océan atlantique, et
possède des frontières communes avec la Guinée
équatoriale au Nord-Ouest, le Cameroun au Nord à l'Est et au Sud
par le Congo6(*) . En ce
qui concerne ses coordonnées géographiques
caractéristiques, le Gabon se trouve entre les latitudes 3°55S-
2°30N, et les longitudes 8°E -15°E7(*)(figure 2).
Figure 2 :
Situation géographique du Gabon
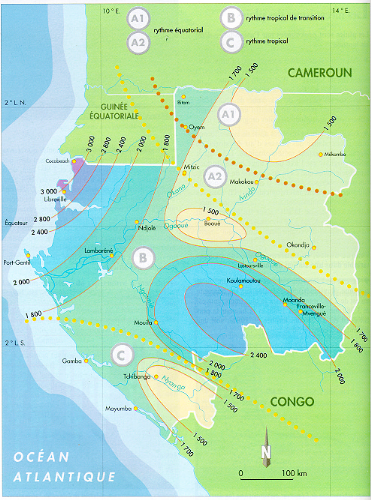
Source : Léonard et
Richard, cité par Robert NASI(1999)
I.2.2. Climatologie et Forêt
I.2.2.1 Climatologie
Le Gabon appartient à la région
climatique de « l'alizé dévié sud
atlantique » qui regroupe également le Sud du Cameroun, la
partie Nord de l'Angola et une grande partie de la cuvette congolaise. Le
climat est chaud et humide, de type équatorial8(*). La pluviométrie
annuelle varie entre 1500 et 3000 mm. Sur l'ensemble du pays, il y a opposition
entre une saison sèche très marquée
(précipitations inférieures à 100 mm/mois) de Juin
à Août et une longue saison de pluie de 9 mois. En effet, la
petite saison sèche de Décembre à Février est
souvent humide.
Mais avec les changements climatiques actuels, ces saisons
deviennent de plus en plus hétérogènes. Il existe trois
grandes régions climatiques au Gabon (figure 2) qui se
définissent comme suit :
þ La région Nord-Est où le rythme
pluviométrique est équatorial (régions A1 et A2) avec
apparition de deux véritables saisons sèches;
þ La région centrale, de Libreville à
Mbigou qui connaît un rythme pluviométrique tropical de transition
(région B), avec une saison sèche de trois mois et une saison
humide de 9 mois;
þ Tout le Sud-Ouest du pays, au Sud d'une ligne
Omboué-Ndendé est sous l'influence d'un rythme
pluviométrique tropical (région C).
I.2.2.2 Brève
présentation de la filière bois
Pour une superficie totale d'environ 26,8 millions
d'hectares, le Gabon est couvert de près de 22 millions d'hectares
9(*) de forêt (soit
85% du territoire). Il y a 20 millions d'hectares de forêt productive et
le taux de déforestation annuel est estimé à 1%.
En 2005, le potentiel total sur pied a été
estimé à environ 2.600.000.000 m3 et le potentiel
commercialisable à 1.500.000.000 m3, avec 130.000.000
m3 Okoumé (Aucoumea klaineana)10(*). Le Gabon est ainsi, un
réservoir de carbone dont l'estimation varie entre 0,90 et 5,24
gigatonnes (PSFE, 2005)
Parmi les 400 autres essences connues à part
l'Okoumé (Aucoumea klaineana) et considérées
comme exploitables, seules 65 plus connues sous le vocable « bois
divers » sont commercialisables actuellement. La filière bois
(exploitation forestière, industrie et négoce du bois) contribue
de 4% au PIB11(*) et
représente le premier employeur du secteur privé avec 12580
personnes sur un total de 55200 personnes en 2006, soit 22% de la population
active12(*) au Gabon. Ce
qui fait de la filière bois, le deuxième employeur après
la fonction publique. Le tableau 1 et la figure 3 suivants donnent
respectivement les principales activités du secteur industriel et la
répartition des différentes nationalités, dans ce
dernier.
Tableau 1 : Activités du
secteur industriel par ordre d'importance en 2006
|
Segment d'activité
|
% par segment
|
% des effectifs par origine
|
|
Gabonais
|
Européens
|
Asiatiques
|
Africains
|
|
Sciage
|
49,07
|
83,22
|
3,01
|
4,41
|
8,8
|
|
Placage
|
29,26
|
92,09
|
1,28
|
3,77
|
3,4
|
|
Contreplaqué
|
18,97
|
64,28
|
1,43
|
0
|
1,5
|
|
Tranchage
|
2,7
|
88,46
|
3,07
|
0
|
8,5
|
|
MOYENNE
|
25
|
82,01
|
2,20
|
2,05
|
5,55
|
Source : DGEF(2006)
Figure 3 : Répartition des effectifs
par nationalité dans le secteur de
L'industrie du bois en 2006
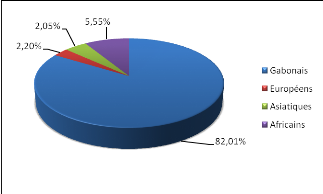
Source :
DGEF(2007)
Il ressort qu'il y a beaucoup de Gabonais qui exercent dans
les différentes branches du secteur industriel du bois. Pour un total de
65 unités de transformation locale en 2006 il y aurait environ 82,01% de
nationaux toute branche confondue. La politique du gouvernement basée
sur la création d'emplois semble donc effective au vu de ces
chiffres.
Les principales activités liées à
l'industrie du bois concernent le sciage, le déroulage et le placage tel
que le montre la figure 4 suivante.
Figure 4 : Principales
activités du secteur industriel en 2006
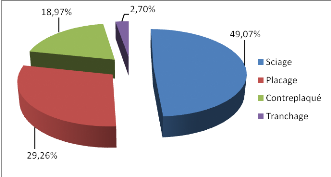
Source :
DGEF(2007
I.3. Evolution de l'exploitation forestière au
Gabon de 1957 à 2007
La surface allouée aux concessions forestières
au Gabon, a été multipliée par sept de 1957 à 1999.
La figure 5 ci-dessous présente une série chronologique de ces
concessions.
Figure 5 : Evolution
cumulée des concessions forestières
Attribuées au Gabon entre
1957 et 1997
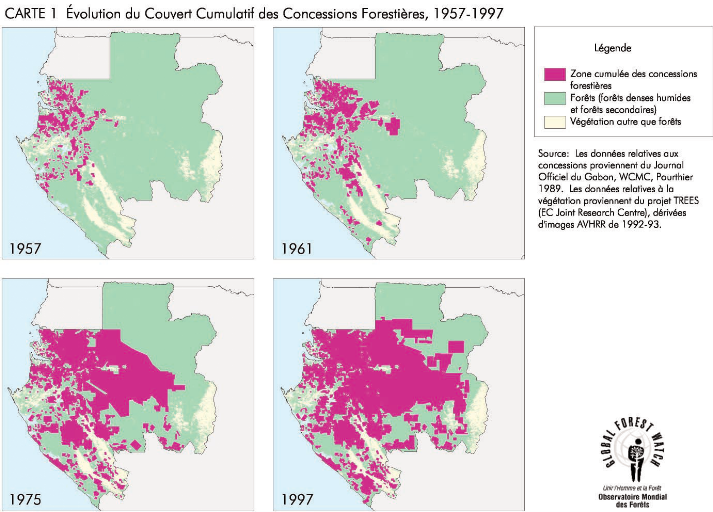
Zones cumulées des concessions
forestières.
Forêts (denses humide et secondaires).
Autre végétation
Légende
forestières
Source : GFW(2000)
En effet, la plupart des forêts où l'on peut
trouver de l'Okoumé ont été attribuées à
l'exploitation depuis 1957. Mais le début de l'exploitation
forestière au Gabon peut être situé dès le
20ème siècle, avant l'élaboration d'une
réelle législation et délimitation du domaine forestier.
La crise de 1930 a fait chuter la production de près de 50%. Ainsi
dès 1932, l'administration13(*) coloniale créa une deuxième zone.
Mais jusqu'en 1956, l'exploitation s'est poursuivie seulement
en première zone et la superficie a été à environ
trois millions d'hectares. Avec l'ouverture à l'exploitation de la
deuxième zone (Arrêté du 28 Novembre 1956, confirmé
par le décret du 13 Mars 1961),14(*) les permis accordés ont atteint deux millions
d'hectares en 1963, puis trois millions en 1968. Matériellement, la
technologie apportée par les premiers tracteurs à chenilles et le
rail de Decauville au lendemain de la deuxième guerre mondiale ont
permis cette évolution.
En outre, la construction dans les années 70 du
Transgabonais qui traverse le pays d'Est en Ouest a ouvert d'importantes
étendues de forêts et permettait ainsi l'attribution de lots
(permis) pour son financement. Ces lots constituent la troisième zone
avec une superficie de 1 520 000 hectares15(*) . En 1972, la totalité des concessions
forestières couvrait une superficie d'environ 15 millions
d'hectares16(*). En 1997,
année à laquelle le projet de la nouvelle loi forestière a
été initialement proposé ; les concessions
forestières se répartissaient entre 221 détenteurs, mais
13 compagnies seulement détenaient 50% de la superficie totale des
concessions forestières, soit environ 9 millions d'hectares.
Les trois quarts de superficie se concentraient sur quatre
provinces (Ogooué Lolo, Ogooué Ivindo, Ngounié et Moyen
Ogooué) le long du chemin de fer. Aujourd'hui, il existe toujours deux
zones (décret 1205/PR/MEFPE du 30 Aout 1993) d'exploitation
forestière (figure 6).
Figure 6 : Les différentes zones
d'exploitation forestière au Gabon
Légende :
Première zone
Deuxième zone
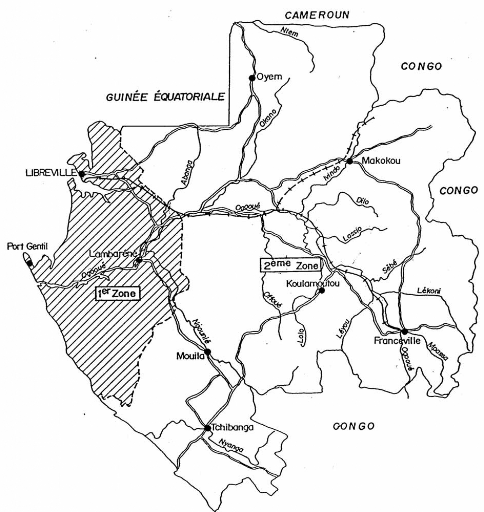
Source : Gérard BUTTOUD et
al ;(2005)
La première zone, le long de la côte et
déjà largement exploitée (100% des exploitations en 1956)
représente une superficie totale de 4.920.000 hectares (DIARF, 1998),
dont 3.335.000 hectares de forêt. Cette zone est uniquement
réservée aux exploitants forestiers nationaux, lesquels
concèdent souvent des licences en fermage à des entreprises
étrangères.
La deuxième zone avec près de 17 millions
d'hectares comprend la Nyanga, le bassin de la Ngounié, le Moyen
Ogooué et le Haut-Ogooué, l'Ogooué-Lolo et une partie de
l'Ogooué -Ivindo et du Woleu-Ntem. Cette zone regroupe actuellement,
l'essentiel des grandes exploitations forestières. Aujourd'hui, il y a
29 concessions forestières, (soit 4.19 millions d'hectares)
engagées dans le processus d'aménagement17(*). La superficie totale des
permis forestiers sur toute l'étendue du territoire national
s'élève aujourd'hui à environ 10.5 millions d'hectares
contre 11 millions en 2002. Cette variation est présentée par la
figure suivante :
Figure 7 : Evolution des superficies sous
concessions forestières en km2
Entre 1997 et
2007
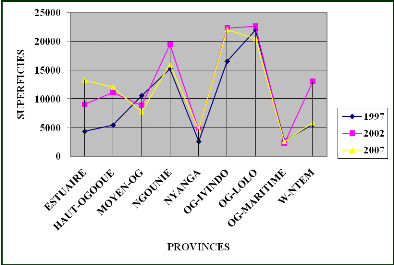
Source : MEKA(2007)
De cette synthèse, il ressort que la province de
l'Ogooué-Ivindo est celle qui a enregistrée le plus grand nombre
de permis de 2002 à 2007. Ce qui est logique compte tenu du fait que
jusqu'en 1997, une grande partie de cette province ainsi que le Woleu-Ntem,
n'étaient pas encore sous concession (figure 5).
Toutefois, la politique qui vise à transformer
à long terme, une exploitation de prélèvement
incontrôlée en une exploitation aménagée et
rationnellement gérée commence à se concrétiser.
Dans la figure 7 ci-dessus, cela se traduit par la baisse de la superficie
totale des concessions forestières, car faut-il le rappeler, la
volonté du gouvernement est de constituer un domaine à vocation
permanente de 12 millions d'hectares (soit 8 millions de forêt productive
et 4 millions pour les aires protégées)18(*). D'où la
nécessité de diminuer les concessions forestières
I.4. Méthodologie
I.4.1. Ressources
Pour l'aboutissement de ce travail, nous avons eu recours
à plusieurs de ressources (machines, hommes et documents), parmi
lesquelles :
· Les partenaires du projet (voir fiche de projet du
stagiaire) ;
· Les mémoires de DESS Ecofore/INSG ;
· Internet ;
· Code forestier gabonais (Loi 16/01 du 31
Décembre 2001)
· Un ordinateur portable, avec tous les logiciels
nécessaires au traitement de texte ;
· Des procès verbaux de 2001 à
2007 ;
· Une carte récente des concessions
forestières (Annexe 2);
· Le décret n°666/PR du 09 Août 2004
portant suspension provisoire de l'attribution de nouveaux permis forestiers en
République gabonaise (Annexe 3).
I.4.2. Méthode de travail
Nous avons commencé ce travail par une revue
bibliographique. Ce qui nous a permis non seulement d'avoir une idée
assez large de la situation de l'exploitation forestière au Gabon depuis
les années d'indépendance jusqu'aujourd'hui, mais aussi de mieux
orienter notre travail.
Ensuite, pour faire le diagnostic institutionnel, nous avons
eu recours à la règle dite des « 5M »,
d'usage courant en systèmes d'informations organisationnels (NZIENGUI,
2007)
Les « 5M » concernent : le Milieu, le
Matériel ; la Méthode ; la Main d'oeuvre et la
Matière. Mais dans le cadre de notre travail, nous avions eu recours
qu'aux quatre dernières composantes. Le Matériel concerne la
logistique et les moyens techniques utilisés. La Méthode quant
à elle, fait référence aux pratiques et démarches
adoptées dans la gestion du secteur forestier. Pour ce qui est de la
main d'oeuvre, elle a trait au diagnostic des ressources humaines. Enfin, la
matière concerne le potentiel forestier, ainsi que toutes lois
sous-jacentes.
Pour les besoins d'évaluation quantitative des impacts
liés aux mesures conservatoires, nous avons organisé les
procès verbaux (mis à notre disposition par le service
contentieux de la DED) par années afin d'avoir une base de
données complète et facilement utilisable de ces derniers.
L'évaluation qualitative s'est quant à elle
appuyée sur les trois piliers de durabilité (BRUNDTLAND, 1987)
que sont le pilier écologique, le pilier économique et le pilier
social.
CHAPITRE II
AUDIT INSTITUTIONNEL
II.1 Contexte juridique et réglementaire.
Dans le cadre de la prise en compte des recommandations, et
engagements divers contenus dans les traités, conventions et
déclarations internationales auxquels la République Gabonaise a
souscrit depuis le sommet de Rio de Janeiro en 1992, les autorités
Gabonaises ont entrepris d'importantes réformes institutionnelles et
réglementaires dans le secteur forêt et celui de la protection de
la nature (BUTTOUD, 2005).
En effet, la tradition juridique francophone exige que les
lois (ensemble de dispositions législatives) soient appliquées
par le truchement de divers autres textes juridiques en particulier des
décrets et arrêtés. Ainsi au cours de ces trois
dernières décennies, le législateur gabonais n'a
véritablement fait évoluer le système réglementaire
forestier qu'à deux reprises : d'abord par la loi 1/82 du 22
Juillet 1982 dite « loi d'orientation en matière des Eaux et
Forêts », ensuite la loi 16/01 du 31 Décembre 2001,
portant code forestier en république gabonaise.
Pour cette dernière (loi 16/01), il faut dire qu'elle
est favorable à une gestion durable des ressources naturelles
renouvelables en général et des forêts en particulier. Sur
296 articles( sur 298) techniques, seuls vingt huit (28) 19(*) projets de texte dont une (1)
loi, vingt quatre (24) décrets et trois(3) arrêtés (figure
8) ont été adoptés, ou sont en cours d'adoption. Ils
concernent notamment :
þ L'aménagement durable des forêts de
production et la gestion des forêts communautaires,
þ L'industrialisation de la filière bois,
þ La gestion de la faune et des aires
protégées,
þ Les ressources financières.
Figure 8 : Aperçu des textes
adoptés dans la loi 016/01
du
31/12/2001
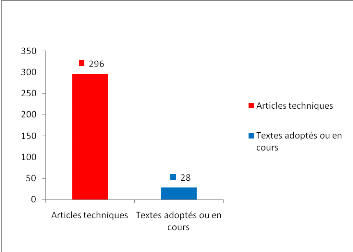
Source : MEKA(2007)
Plus des trois quarts des textes d'application prévus
n'ont pas encore été pris à ce jour. Ce qui constitue un
véritable frein à la mise en place d'une gestion
forestière efficace et opérationnelle quand bien même, il
était prévu que la loi 16/01 sorte avec tous ces textes
d'applications (GFW, 2000).
Toujours en ce qui concerne les insuffisances dans le cadre
juridique et réglementaire, l'article 96, du code forestier limite la
superficie maximale d'un PFA à 15000 ha lorsqu'il est
intégré dans une CFAD. Mais l'article 97 précise que
la superficie d'une CFAD varie entre 50000 et 200000 ha. Finalement on se
demande quel est réellement le seuil de constitution d'une
CFAD ?
En outre, plusieurs permis forestiers entourent de nombreuses
aires protégées, certains se trouvant même à
l'intérieur de ces dernières (cas du PTE n°16/84 à
Wonga-Wongué)20(*).
Ce qui constitue aussi, une forme d'exploitation forestière non
réglementaire.
Par ailleurs, plusieurs exploitants détiennent encore
des dizaines, voir des centaines de millions d'arriérés fiscaux
(MBAGOU,2007) pour des permis qui en réalité devraient faire
retour au domaine (art 275 et 281), comme ce fut le cas des cent seize (116)
permis retirés en Mai 2007.
Aussi, le code actuel dans son article 127 légalise la
pratique du fermage. Fait incohérent qui constitue un frein à ses
objectifs de développement. Considéré au départ
comme un fait illicite, (art 20 et 21 de la loi 1/82), le fermage ou
sous-traitance des concessions forestières, est aux antipodes du
processus d'aménagement durable. Sous cette pratique, le
propriétaire reçoit une rente sans qu'il ne se sente
obligé d'investir à long terme dans les concessions.
Le fermage ne rime pas également avec l'objectif global
de l'Etat qui consiste à accélérer le processus de
développement économique des régions rurales, dans la
mesure où c'est le sous-traitant qui fixe les règles de ce
« jeu » fermier-propriétaire.
Tous ces manquements corroborent ainsi le fait que le cadre
réglementaire et juridique du secteur forestier gabonais contient
encore beaucoup de points faibles tels que :
þ Le manque de mécanismes efficaces
d'application directe des textes de lois énoncés par la
législation forestière ;
þ Le manque de dispositions en faveur de la
transparence et de la responsabilité financière des processus
décisionnels forestiers ;
þ Une reglémentation forestière
contradictoire à d'autres secteurs tels que l'agriculture et
l'extraction minière.
Enfin, la filière bois au Gabon s'est dotée
récemment d'une nouvelle structure syndicale dénommée
Syndicat des Métiers du Bois du Gabon (SMBG) dont un des buts est de
proposer au gouvernement, des solutions possibles pour parvenir à une
meilleure présence des nationaux dans la filière bois21(*).
II.2. Contexte administratif et technique
Seuls 45% des agents (contre 47% aux services centraux) de la
DGEF sont affectés aux inspections provinciales et aux cantonnements
alors que c'est à eux que revient la lourde charge des opérations
de terrain. La figure suivante montre les proportions entre les agents des
services décentralisés et les agents des services centraux.
Figure 9 : Répartition
des Agents de la DGEF en 2007
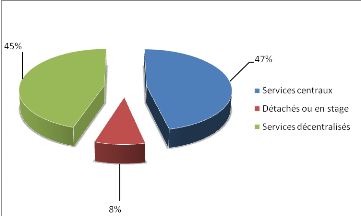
Source : MEKA
(2007)
Par ailleurs, il y a un nombre limité de moyens de
déplacements pour les agents sur le terrain. Dans certaines provinces
telles que l'Ogooué-Lolo et l'Ogooué-Ivindo, le nombre de
concessions forestières est supérieur au nombre d'agents. Ainsi
chaque agent doit surveiller près de 700 km2 de concession
(tableau 2). Ce qui n'est pas raisonnable pour un système de
contrôle qui se veut fiable, quand on sait que le ratio retenu pour
l'UICN est de un (1) agent pour 22 hectares22(*)
Tableau 2 :
Aperçu des superficies gérées par agent et par
province
|
Provinces
|
Superficies (km2)
|
Nombre d'agents
|
Superficie par agent
|
|
ESTUAIRE
|
13284
|
47
|
283
|
|
HAUT-OGOOUE
|
12029
|
31
|
388
|
|
MOYEN-OG
|
7755
|
28
|
277
|
|
NGOUNIE
|
15918
|
42
|
379
|
|
NYANGA
|
4693
|
25
|
188
|
|
OG-IVINDO
|
22055
|
36
|
613
|
|
OG-LOLO
|
20500
|
30
|
662
|
|
OG-MARITIME
|
2572
|
16
|
161
|
|
W-NTEM
|
5807
|
47
|
124
|
Source : MEKA(2007)
En ce qui concerne les ressources financières, le
budget de la DGEF (fonctionnement et investissement) s'élevait à
près de 950 millions FCFA en 2002, contre 636 millions en 2006. Ce qui
est assez paradoxal pour deux principales raisons :
En effet, la DGEF a plus besoin de moyens financiers
actuellement, parce que le renforcement des capacités de contrôle
et l'engagement vers l'application d'une foresterie moderne nécessitent
de grands investissements financiers.
Par ailleurs il est illogique que pour un secteur qui
génère plus de trois cent milliards de recettes (372 exactement
en 2006)23(*), les
retombées nécessaires à son fonctionnement soient aussi
insuffisantes.
De ce qui est de l'aspect technique, il convient de souligner
que malgré le fait que le pourcentage des gabonais exerçant dans
la filière bois soit élevé, la majorité des 65
unités24(*) de
transformations sont à capitaux étrangers, soit un pourcentage
de plus de 75%. (Annexe 4).
Les gabonais n'occupent que la seconde place avec moins de
25% et derrière les français. Le manque de moyens financiers et
surtout le manque d'incitation semblent être les raisons évidentes
pouvant expliquer ces chiffres.
II.3. Gouvernance forestière
Depuis 1990, la gouvernance est un concept qui s'impose de
plus en plus dans les secteurs ayant trait au développement tel que le
secteur forestier. Parler de gouvernance, c'est parler de pouvoir, de relations
et de reddition de comptes25(*).C'est-à-dire qu'il faut arriver à
savoir : qui dispose des informations clés ? Qui
décide ? Qui a un pouvoir d'influence ? Comment les
décisions sont-elles prises ? Qui bénéficie ?
Qui perd ? Qui rend compte ?
C'est donc à partir de ce moment qu'on arrive à
satisfaire aux cinq principales clés, caractéristiques d'une
bonne gouvernance définies par les nations unies (tableau 3).
Tableau 3 : Clés d'une bonne
gouvernance.
|
Principes
|
Principes des nations unies sur lesquels ils sont
basés
|
|
Légitimité et voix
|
Participation, recherche du consensus
|
|
Reddition de comptes
|
Obligation de rendre compte au public et aux intervenants
institutionnels, transparence.
|
|
Performance
|
Réactivité des institutions et des processus
face aux intervenants, efficacité et efficience
|
|
Impartialité
|
Equité, Primauté du droit.
|
|
Orientation
|
Vision stratégique, comprenant le développement
humain et les complexités historiques, culturelles et sociales
|
Source : DABIRE(2003)
Au niveau du Gabon, à travers la DGEF, le souci de
bonne gouvernance en matière de foresterie s'est traduit en 2006 par
plusieurs objectifs qu'on a évalués comme suit :
Tableau 4 : Situation des objectifs de la
DGEF par rapport à ses ambitions de bonne gouvernance
déclinés en 2006.
|
OBJECTIFS
|
Atteints
|
Non atteints
|
|
Finaliser le cadre réglementaire de
l'aménagement forestier
|
|
x
|
|
Mettre en application les principes de l'aménagement
durable
|
|
x
|
|
Tester le système d'adjudication à travers des
essais pilotes
|
|
x
|
|
Relancer les inventaires forestiers
|
|
x
|
|
Suivre et contrôler les activités de terrain,
notamment grâce à la télédétection par
satellite
|
|
x
|
|
Appliquer et vulgariser la loi
|
|
x
|
Source : MEKA(2007)
Il n'y a pas une réelle adéquation entre ces
objectifs de la DGEF, et les clés de bonne gouvernance, telles que
définies par le tableau 3.
Parmi les faits actuels qui cadrent aussi avec la
gouvernance, on a la certification. Au Gabon, la surface des forêts
indépendamment certifiées a quasiment doublé en mars 2003.
Plusieurs concessions ont ainsi été certifiées `Keurhout'
au Gabon : les 575.000 ha de la concession Leroy Gabon (CFAD) et une concession
de 615.000 ha gérée par le groupe Thanry-CEB puis Rougier Gabon
qui vise la double certification FSC-PAFC de l'ensemble de ses concessions.
La certification permet de s'assurer que le bois vendu
provient d'une forêt gérée durablement. Pour le producteur,
elle peut être un outil de marketing commercial26(*).
Afin qu'elle soit efficiente, la certification
nécessite :
þ Un système de traçabilité
« robuste » basé sur l'utilisation de technologies
appropriées, afin de pouvoir remonter jusqu'à une source
légale pour les produits présentés à
l'exportation ;
þ Un système de base de données unique
afin de centraliser, vérifier, croiser et synthétiser les
données27(*).
L'autre volet de la gestion forestière est la
fiscalité. En effet, l'article 244 de la loi 16/01 prévoit dix
taxes et redevances qui malheureusement ne sont pas toujours recouvertes de
manière régulière et ne cadrent pas parfois avec les
objectifs d'aménagement forestiers. Aujourd'hui il n'est
prélevé que quatre taxe (abattage, sciage, superficie et
martelage). Chaque taxe ou chaque redevance a son influence sur le
comportement des acteurs de la filière bois et de surcroît sur
les conditions d'exploitations. Le Gabon a su mettre sa politique fiscale en
oeuvre. Par exemple :
- une redevance à la superficie relativement
élevée (tel que c'est le cas actuellement, 600 FCFA /ha) incite
à faire une gestion économe de l'espace et une meilleure
valorisation des essences secondaires ;
- une redevance à la surface pondérée
selon la distance du port (annexe 2), permet d'éviter une exploitation
hyper sélective et favorise l'ouverture à l'exploitation des
massifs les plus reculés.
Néanmoins, il reste la mise en oeuvre d'une taxation
différenciée selon les essences, c'est-à-dire, une forte
taxation pour les essences telles que l'Okoumé (Aucoumea
klaineana) et l'Ozigo (Dacryodes buttnerii), puis une faible
taxation pour permettre la promotion des essences secondaires. Aussi, une forte
taxation à la sortie des grumes est censée décourager les
exportations et favoriser une transformation locale accrue.
L'unique ambigüité qu'on puisse souligner et qui
a trait à la fiscalité est la mesure selon laquelle,
l'administration forestière avait décidé d'exonérer
de 50% du montant de la redevance annuelle de superficie (soit 300 FCFA/ha),
les entreprises ayant vu leur plan d'aménagement approuvé. En
fait, une telle dérogation ne se justifie pas, sur un plan purement
institutionnel parce que l'aménagement est une contrainte légale
applicable à tous les concessionnaires forestiers.
CHAPITRE III
ETUDE DE CAS DE DEUX MESURES CONSERVATOIRES
III.1 Suspension provisoire d'attribution des permis au
Gabon
Le décret n° 666/PR du 09 Août 2004, a
fixé l'arrêt de l'attribution de nouveaux permis forestiers en
république gabonaise. Ce décret qui est intervenu moins de trois
ans après la promulgation de la loi 16/01, a fait suite aux
engagements pris par le Gabon dans la lettre de politique de
développement du secteur forestier, élaborée en 2004, en
coopération avec la Banque mondiale et les autres bailleurs de
fonds28(*).
En outre, le Gabon s'est fixé des priorités dans
le secteur forestier parmi les lesquelles, l'aménagement forestier et
l'industrialisation de la filière bois. La mise en oeuvre effective de
ces options, a nécessité alors de revoir les mécanismes
actuels de gestion en vue:
þ de faire un bilan des avancées de
l'aménagement et de l'industrialisation de la filière bois, d'en
dégager les forces et faiblesses, puis déployer de nouvelles
stratégies,
þ d'établir un bilan complet des
capacités des services centraux et de terrains de l'administration
forestière impliqués dans l'aménagement forestier.
þ de tester les adjudications (art 2 du décret
666/PR)
III.2. Arrêt d'attribution des coupes
familiales
L'arrêt d'attribution des coupes familiales en 2005
dont l'objectif s'inscrit toujours dans le droit fil de l'aménagement
durable, fait suite aux nombreux manquements liés à cette
catégorie de permis. En vigueur dans la loi 1/82 (ancienne
réglementation forestière) et destinées uniquement aux
nationaux, les coupes familiales concernaient l'attribution de cent (100)
arbres sur pieds et ont été administrées par les
inspections provinciales, sous couvert de la Direction Générale
des Eaux et Forêts.
Mais ce mode d'attribution a montré ses limites. En
effet, il s'est avéré que seuls, ceux qui ont eu les moyens
(financiers et techniques) ont pu exploiter leurs permis, car le plus souvent,
les populations locales n'en ont pas. Cela a entraîné la
prolifération du fermage avec toutes les conséquences
négatives que ce cela engendre (N'SITOU MABIALA, 2007).
Les coupes familiales n'ont pas réussi à
promouvoir une classe d'entrepreneurs nationaux.
En outre, les permis de coupes familiales ont
été attribués pour une durée d'un an. Mais dans la
pratique, les cent (100) pieds étaient abattus au terme de quelques
mois. Le reste du temps, les propriétaires de ces permis se livraient
dans leur majorité à la surexploitation avec le cautionnement de
l'administration forestière. Enfin, les coupes familiales n'avaient
aucun effet incitatif sur la valeur ajoutée de la filière
bois.
Forte de tous ces manquements, l'administration
forestière a décidé en application de l'article 95 de la
loi 16/01, de passer à l'attribution des permis de gré à
gré (PGG) en remplacement des coupes familiales. En théorie, les
PGG devraient contribuer au développement du milieu rural parce qu'ils
s'intègrent dans des forêts communautaires. Les permis de
gré à gré concernent l'attribution d'un maximum de
cinquante (50) arbres sur pieds et ne feront pas l'objet d'adjudications. La
lettre de politique de développement du secteur forestier
précise par ailleurs que « les PGG remplaceront les coupes
familiales en 2006 » Mais à jusqu'à lors, la mesure
n'est toujours pas concrète.
III.3 Evaluation des incidences liées aux deux
mesures conservatoires
Préserver les forêts par l'instauration de
mesures qui sous-tendent une foresterie moderne, est une initiative
encourageante. Mais le fait de ne pas penser aux conséquences
liées à ces mesures peut engendrer de nombreuses incidences.
C'est sans doute l'erreur qu'à commise l'administration
forestière gabonaise, car n'ayant pas prévu la mise en place
d'une stratégie d'ajustement provisoire.
De facto, la suspension provisoire d'attribution des permis et
l'arrêt d'attribution des coupes familiales affectent la
durabilité du secteur forestier par des faits tels que :
· L'exploitation forestière
illégale.
En effet, les investisseurs étrangers ayant
emprunté de l'argent auprès des banques et loué des moyens
techniques, se sont vu refuser l'attribution de permis compte tenu du
décret n°666/PR du 09/08/2004. Etant dans l'obligation de
rembourser leurs créances, ces investisseurs se lancent alors dans des
coupes illicites de bois. Aujourd'hui les usagers se contentent de couper
illégalement le bois et de venir demander l'établissement des
procès-verbaux auprès de l'administration forestière
(photo 1).
Photo 1 : Grumes portant la mention PV dans
un parc à bois d'Owendo

Source :
Steve MAGUENDJI(2007)
Ce sont donc ces procès verbaux que les usagers vont
présenter en cas de contrôle. Or le procès-verbal n'est
pas un titre d'exploitation. Ce qui est plus ou moins certain, c'est que
cette mauvaise pratique existera aussi longtemps que se prolongera l'actuelle
période transitoire.
Les mesures conservatoires ont d'autres conséquences
écologiques. En effet, elles favorisent la « contre
sélection » des essences qui elle-même est tributaire
d'une exploitation anarchique. La sélection se fait logiquement par DME,
ce qui préserve les essences avenir pour qu'ils soient exploitables
à la prochaine rotation. Or les exploitants malhonnêtes ne font
généralement pas de ces DME, leur préoccupation.
En fin, le concept d'infrastructures naturelles dont font
partie les services environnementaux (fonction récréative,
fonction hydrique, fixation du carbone, maintien de la diversité
biologique...) est tout simplement dévalorisé.
· Les incidences
économiques
Il est évident que des mesures mal conçues dans
un secteur aussi sensible que celui de la forêt, puissent avoir des
impacts sur la croissance économique. Parmi les conséquences
économiques directes, on a :
- Les pertes de recettes fiscales pour l'Etat, car ces
« pseudo- exploitants » ne payent ni taxe de superficie, ni
taxe d'abattage ;
- La non- participation des produits (bois) au calcul du
PIB29(*).
Les conséquences économiques indirectes quant
à elles, concernent les coûts du reboisement qui sont le plus
souvent onéreux. Cependant, la parafiscalité (amendes) a connu
une progression considérable ces dernières années. En
effet, les procès-verbaux établis entre 2005 et 2007 ont
largement augmentés (figure 10), par rapport à ceux
établis entre 2001 et 2004.
Figure 10 : Evolution
des PV de 2001 à 2007*
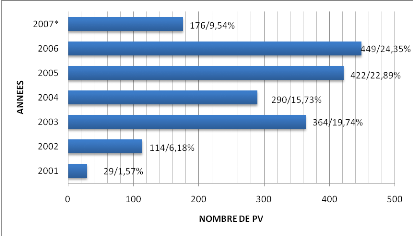
Source :
MEKA(2007)
Avant 2004, où les usagers avaient encore la
possibilité d'avoir les permis, le nombre d'infractions toutes
catégories confondues était limité. Mais avec
l'instauration de mesures conservatoires qui sont sensées
protéger les forêts, la situation devient de plus en plus
préoccupante. Les procès-verbaux relatifs à
l'exploitation sans titre étant les plus nombreux avec plus de 900
observations de 2005 à 2007 soit 86%. Les procès verbaux
établis en 2003, sont caractéristiques dans la mesure où
leur nombre élevé a servi d'appui à la décision
relative à la suspension provisoire des attributions de permis en 2004.
Toutefois il est permis d'émettre un doute sur la fiabilité des
données disponibles parce que n'étant pas récoltées
avec toute la rigueur possible (prise en compte des volumes)
· La fracture sociale
Les populations rurales qui n'ont d'ailleurs pas
été consultées, sont parmi les grandes victimes de ces
mesures conservatoires. En fait les permis de gré à gré
qui doivent remplacer les coupes familiales, vont s'attribuer dans des
forêts communautaires. Or lesdites forêts font l'objet
d'études actuellement.
En conséquence, les populations ne peuvent pas
bénéficier légalement de la manne forestière qui
leur revient de droit, ni par l'attribution de permis, encore moins par le
fermage qui constitue leur pratique préférée.
Néanmoins, l'application par l'administration forestière, des
dispositions de l'article 281 du code forestier, se fait avec rigueur.
CHAPITRE IV
TENDANCES DE PRODUCTION FORESTIERE ET ALTERNATIVES
POUR LES MESURES CONSERVATOIRES
IV. 1 La production de grumes au cours de ces
dix dernières années
La production de grumes a évolué de
manière croissante de 1998 à 2001(tableau 5), et la grande partie
était destinée à l'exportation. Par ailleurs, la
consommation locale qui était très négligeable jusqu'en
1999(environ 74000m3), connaît actuellement une progression
considérable avec plus de 2 millions de mètres cubes en 2006,
dépassant ainsi la quantité de bois exportée (1,7 millions
de mètres cubes). Ces chiffres de 2006 s'expliquent non seulement par la
prise des mesures conservatoires en 2004, mais surtout à cause de
l'instauration des barrières non tarifaires (quotas) en 2005.
Pour toute l'année 2007 les exportations de grumes ne
devraient pas atteindre 2 millions de mètres cubes, car au premier
semestre, la quantité totale exportée était de 895635
m3 (SDV, Juillet, 2007). La situation idéale (plus de
transformation locale et moins d'exportation), effective depuis 2006 devrait
donc continuer pour qu'on espère avoir les 75% de transformation locale
en 2012 tel que prévu dans l'article 227 du code forestier gabonais.
Tableau 5 : Productions de bois au Gabon de
1997 à 2006(x1000 m3)
|
ANNEES
|
TOTAL
|
MOY/AN
|
|
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
|
|
PRODUCTION DE GRUMES
|
2775
|
2164
|
2402
|
3300
|
4216
|
3615
|
3563
|
3500
|
3200
|
3100
|
31835
|
3183,5
|
|
EXPORTATION
|
2671
|
1764
|
2328
|
3173
|
2314
|
1928
|
1928
|
1928
|
1586
|
1769
|
21389
|
2138,9
|
|
CONSOMMATION LOCALE
|
105
|
400
|
74
|
127
|
1902
|
1687
|
1635
|
1572
|
1614
|
2028
|
11144
|
1114,4
|
Source : DGEF(2007)
En effet, ne peuvent exporter du bois actuellement, que des
entreprises ayant des quotas, condition qui est elle-même est assujettie
à la possession d'unités de transformations locale et d'une
concession forestière aménagée. L'Okoumé et l'Ozigo
constituent l'essentiel des volumes exploités (673069m3 en
2006). La production de bois diminue certes depuis 2001(figure 11), mais les
variations de production entre années, de 2002 à 2004 sont
inférieures à celles de 2004 à 2006. Or plus la variation
est grande, plus la production baisse. C'est dire que les mesures
conservatoires ont eu un effet sur la production de grumes.
Figure 11 : Production, Exportation et
Consommation de bois au Gabon de 1997
à 2006 (x1000 m3)
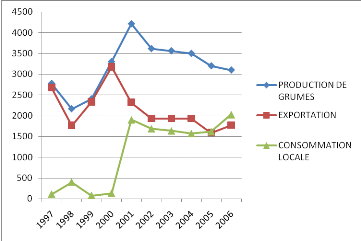
Source : MEKA(2007)
IV.2. Alternatives pour une meilleure mise en oeuvre
des mesures conservatoires
Bien que se voulant passives, les mesures conservatoires
prises par l'Etat, n'ont été accompagnées d'aucune mesure
compensatoire, pouvant permettre, non seulement la satisfaction des
usagers du secteur forestier, mais aussi la réduction des
impacts négatifs dont elles sont à l'origine aujourd'hui. Le
gouvernement aurait dû créer une commission multipartenaires,
regroupant les différentes parties prenantes du secteur forestier, pour
trouver ensemble, une solution acceptée de tous. En effet, faut-il le
rappeler, le secteur forestier est très sensible et par
conséquent les meilleures décisions ne peuvent être que
celles prises de manière consensuelle.
C'est donc après avoir fait un état des
conséquences liées aux mesures conservatoires, actuellement en
vigueur dans le secteur forestier que nous proposons ces alternatives qui
auraient dues être mises en place au moment même des
décisions.
Pour la suspension provisoire de l'attribution de permis,
l'Etat, aurait dû faire exception des coupes familiales et prendre des
mesures fortes pour proscrire le fermage. Cela aurait permis aux populations
locales de prendre conscience, non seulement de l'intérêt que le
gouvernement accorde à l'implication véritable des nationaux,
dans le développement du secteur forestier, mais également son
souci de préserver les forêts. Aussi, à partir de la date
de sortie du décret, il aurait fallu réduire de 50%, le nombre de
pieds attribués et le temps de validité des coupes familiales. De
cette manière, les habitudes (achat de 50 pieds d'arbres) se seraient
installées progressivement, jusqu'à la mise en place des permis
de gré à gré dont le début effectif aurait du
coïncidé avec l'arrêt des coupes familiales.
En ce qui concerne les grands permis à vocation
industrielle, l'Etat aurait dû prévoir beaucoup de moyens
financiers, techniques et humains pour renforcer les dispositifs de
contrôle sur le terrain.
Enfin, l'article 2 du décret 666/PR précise que
le gouvernement testera les adjudications pendant la période
transitoire. Malheureusement, au moment où le décret fut
publié, le document de mise en oeuvre de ces adjudications
n'était même pas encore ficelé. Aujourd'hui encore, il fait
l'objet d'études (MBAGOU ,2007). Or si les adjudications
commençaient aussitôt, l'exploitation illégale serait
quand même maîtrisée.
IV.3.Suggestions
Actuellement le concept de foresterie moderne requiert une
gestion forestière orthodoxe, basée sur une certaine
transparence de la part de tous les intervenants du secteur, une
réglementation cohérente et impartiale, puis des ressources
humaines disponibles et suffisantes. Malheureusement, rien de tout cela n'est
satisfaisant aujourd'hui, au vue de l'audit institutionnel que nous avons
fait.
Ce qui est encore plus surprenant, et paradoxal, c'est le fait
que le décret n°666/PR qui suspend l'attribution des permis,
prévoie en son article 2 que « pendant la période de
suspension provisoire d'attribution de permis forestiers, le gouvernement
testera le système d'adjudications ». Cela suppose alors que
les adjudications n'existeront que pendant le temps que va durer la transition.
Mais la question qu'on se pose actuellement est celle de savoir combien de
temps mettra la transition pour juger de l'efficacité du nouveau mode
d'attribution de permis ?
Du même article 2, il ressort qu'après la
période de transition on reviendra au mode classique : celui de
gré à gré. Que veut réellement l'administration
forestière ? Peut-on gérer une ressource naturelle à
long terme, avec un cadre juridique aussi flexible ? A notre avis, non,
parce que toutes les bonnes pratiques (certification, aménagement,
industrialisation, gouvernance...) qui tournent autour de la foresterie ont
d'abord pour support des lois biens pensées et ne souffrant d'aucune
ambigüité.
Pour la question des adjudications, l'idée aurait
été meilleure si elle était accompagnée de
dispositions particulières en faveur des petits exploitants. Par
exemple contingenter le nombre maximal de permis que peut acheter un
exploitant.
Mais les adjudications sont un système qui fait fi des
réalités sociales, car plus axé sur des
préoccupations d'ordre économiques. L'inquiétude qu'il
faudrait avoir proviendrait du fait que l'administration forestière
exonère d'un certain montant, les grandes sociétés sous
prétexte que leurs offres seraient meilleures.
En effet, cela a déjà été le cas
avec les plans d'aménagement, dont certaines sociétés
forestières ont bénéficié d'une réduction
de 50% de leurs charges financière vis-à-vis de l'Etat.
Pour ce qui est de l'arrêt de l'attribution des coupes
familiales, pour passer aux PGG, l'initiative est soutenable, parce que le
projet de forêts communautaires dans lequel s'intègrent ces permis
de gré à gré est une initiative de développement
rural encourageant. Mais cela n'empêche que nous puissions nous
interroger sur la longévité de ces PGG et leur efficacité
à remplacer les coupes familiales, au cas où les forêts
communautaires tarderaient à s'implanter sur toute l'étendue du
territoire.
Ainsi les principales recommandations aux problèmes que
posent l'application des mesures conservatoires aujourd'hui, sont:
þ Affecter plus de ressources (financières,
humaines et matérielles) dans les inspections provinciales et
cantonnement, afin de renforcer les dispositifs de contrôle et
maîtriser l'exploitation forestière illégale ;
þ Mettre en place, une plate-forme d'échange et
de communication pour tous les acteurs du secteur forestier ;
þ Faire des études d'impacts en prenant quelques
régions comme échantillon, afin d'estimer réellement les
pertes économiques engendrées ;
þ Accélérer la mise en place des
forêts communautaire afin de permettre l'efficacité des
PGG ;
þ Continuer l'attribution des permis, mais uniquement
par adjudications.
Conclusion
Les deux mesures conservatoires évoquées dans ce
document, n'ont pas eu les effets escomptés. Les résultats
obtenus sont plutôt accablants et contradictoires au concept de bonne
gouvernance forestière.
Les hypothèses faites en introduction ont finalement
été confirmées. C'est-à-dire qu'après
l'évaluation quantitative et qualitative des incidences liées aux
deux mesures, il s'est avéré que ces dernières sont l'un
des faits favorisant l'exploitation illégale des forêts sur toutes
ses diverses formes.
L'audit institutionnel, a permis de mettre en relief des
insuffisances notoires des cadres juridique, réglementaire,
administratif et technique du secteur forestier gabonais. Il ressort ainsi que
la réglementation est moins explicite et moins vulgarisée, il y'a
des effectifs en agents de missions réduites, puis des pratiques qui
découlent d'un manque de stratégies en matière
forestière.
C'est dire que malgré les avancées
significatives enregistrées ces dernières années dans le
secteur forestier, beaucoup reste à faire pour que la gestion durable
soit véritablement une réalité et non une expression
vaine. La gouvernance forestière à laquelle le Gabon aspire par
des moyens tels que la certification et l'aménagement des forêts
reste encore très contrastée.
Les adjudications et les permis de gré de gré
qui constituent les principaux faits des mesures étudiées, sont
des initiatives positives pour le développement d'une foresterie moderne
et communautaire, à condition qu'elles soient bien suivies et qu'elles
soient pérennes.
Aujourd'hui, Il est donc plus que nécessaire de mener
une étude de fond, afin de savoir quels sont les véritables
apports socio-économiques des systèmes d'adjudication et de
gré à gré, dans le développement du secteur
forestier au Gabon ?
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
1. F.A.O FORET (2006). Meilleurs pratiques pour l'application
des lois dans le secteur forestier, Rome Division information, 121p.
2. GFW(2000).Un premier regard sur l'exploitation
forestière au Gabon, Washington DC, Papyrus design group, 52p.
3. P.CHRISTY, J.ROLAND, O.NTOUGOU, C.WILKS ;(2003).La
forêt et la filière bois au Gabon, Libreville, Multipress-Gabon,
389 p.
PERIODIQUES
1. HEBDO INFORMATIONS, Libreville, Multipress-Gabon,
n°452,2002, 20p
2. HEBDO INFORMATIONS, Libreville, Multipress-Gabon,
n°54, 1983, 20p.
3. L'Union, Libreville, Sonapresse, n° 9536, 2007,
20p.
4. Le Flamboyant, Paris, Laballery, n° 59/60, 2005,
59p.
RAPPORTS ET MEMOIRES
1. C.MOUKEGNI SIKA(2005) La politique forestière au
Gabon de 1982 à 2005 : Reproduction de la vision occidentale ou
adaptation aux réalités locales ? 49p.
2. DGEF(2002). Rapport d'activité, 30p.
3. G.BUTTOUD et al ;(2005).Mission Technique de
diagnostic de la Gestion Durable des Forêts en vue d'atteindre l'objectif
2000 de l'OIBT en appui au Gouvernement de la République Gabonaise,
74p.
4. J.R.NZAMBA-MOMBO(2005), Etude comparée des
contraintes économiques et juridiques des systèmes d'attribution
des titres forestiers selon le mode gré à gré et par
adjudications, 26p.
5. MEF(2005). Mémorandum de politique économique
et financière pour 2004-2005, 13p.
6. MEFEPPN(2007) Note de Conjoncture Economique de la
Filière bois au 31 Décembre 2006 et perspectives 2007, 34p.
7. PSFE(2005). Document de Programme, 56p.
8. PSFE(2005).Rapport final, 248p.
9. R. NASI, S.DROUINEAU(1999).L'aménagement forestier
au Gabon : historique, bilan et perspectives, Rapport du projet FORAFRI,
64p.
10. S.IBOUANGA-MBOUMBA(2001). Etude comparative en vue d'une
récupération optimale des bois lors de la récolte au
Sud-Est du Gabon, 98p.
11. WWF(2003), l'origine du bois : un pas vars la gestion
durable des forêts, 68p.
12. Z .L.NDEMBI(2006) Problématique de la Gestion
des conflits dans le secteur d'exploitation forestière au Gabon, 53
p.
INTERNET
1. Anonyme.2007.Mesures Conservatoires, support HTML.
www.ufr.wikipedia.org/wiki/Mesure-Conservatoire.
2. A.B .DABIRE. 2003. Note analytique sur le processus
AFLEG. Support HTML.
www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/MS7-FHTM.
3. MEF(2004).Décret 666/PR du 09/08/2004, support HTML.
www.finances.gouv.ga/decret
666PR.htm.
4. MEF(2007).Carte des permis forestiers, édition 2007,
support PDF.www.finances.gouv.ga
5. MEF(2007).Echéancier des permis forestiers sur le SIG
cartographique, support PDF.
www.finances.gouv.ga.
6. O.N.U(2005). Rapport BRUNDTLAND, 1987. Support
HTML.www.un.org/french
POLYCOPIES
1. M.NZIENGUI(2007).Système d'Information
Géographique, Cap-Estérias, polycopié IC2, 84 p.
2. P.POINT(2004).Approche économique des fonctions
forestières non-marchandes, Libreville, polycopiés DESS ECOFORE,
28p.
AUTRES DOCUMENTS
1. DGEF(2007).La Forêt en Chiffres,2p.
2. DDICB(2007).Liste des opérateurs économiques de
la filière bois bénéficiaires des quotas de vente de
grumes à l'export, Juillet-Décembre. 1p.
3. DDICB(2007).Exportation de grumes par Entreprises au premier
semestre. 1p
4. MEFEPEPN(2004).Présentation des textes d'application de
la loi16/01 portant code forestier en république gabonaise. 105p

* 1 : DGEF(2006) Bilan du
plan d'action, p 4.
* 2 : Encyclopédie
numérique wikipédia
* 3 : Article 2 du
décret n° 1746 du 29/12/1983
* 4 : Article 7 du
décret n° 1746 du 29/12/1983
* 5 : Article 10 du
décret n° 1746 du 29/12/1983
* 6 : R.NASI,
S.DROUINEAU;(1999). L'aménagement forestier au Gabon : historique,
bilan et perspectives, p.1
* 7 : Atlas de l'Afrique,
cité par J .R NZAMBA MOMBO (2005).p 4
* 8 : R.NASI,
S.DROUINEAU;(1999). L'aménagement forestier au Gabon : historique,
bilan et perspectives, p.1
* 9 : PSFE, 2005, Document
de Programme, p.7
* 10 : PSFE, 2005, Rapport
final, p.64
* 11 : Ibid, p.64
* 12 : DGEF( 2007)
* 13 : NASI(R) et
al;(1999). L'aménagement forestier au Gabon : historique, bilan et
perspectives, p.9
* 14 : Ibid., p.6
* 15 : MEN(1983)
cité par S.IBOUANGA-MBOUMBA
* 16 : CHRISTY(P) et
al ;(2003). La forêt et la filière bois au Gabon.
Libreville, MULTIPRESS-GABON, p 204
* 17 :
DIARF (2007)
* 18 : GFW(2000)
* 19 :
MEFEPPN(2004).Rapport de présentation des textes d'application de la
loi16/01 portant code forestier en république gabonaise. p. 2
* 20 : Carte des permis
forestier, 2007 (Annexe 2)
* 21 : JBO « Les
PME Gabonaises à la croisée des
chemins ».in :L'Union, Libreville, Sonapresse, n° 9536,
2007, p20
* 22 : PSFE(2005) ;
Document de Programme, p.36
* 23 :
MEFEPPN(2007) ; Note de Conjoncture Economique de la Filière bois
au 31 Décembre 2006 et perspectives 2007, p.3
* 24 : DDICB(2006)
* 25 : DABIRE (2003), Note
analytique sur le processus AFLEG, UICN, pp 9-13
* 26 : CHRISTY(P) et
al ;(2003).La forêt et la filière bois au Gabon. Libreville,
MULTIPRESS-GABON, p144
* 27 : WWF (2003),
L'origine du bois : un pas vers la gestion durable des forêts,
p.34
* 28 : MEF(2005)
Mémorandum de politique économique et financière pour
2004-05, p.9
* 29 : POINT(2004),
Approche économique des fonctions forestières non-marchandes,
présentation PowerPoint, p2
*Premier trimestre 2007
| 


