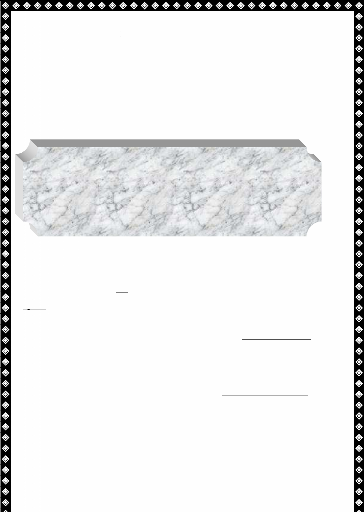
REPUBLIQUE DU BENIN
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE PARAKOU
FACULTE DES SCIENCES
ECONOMIQUES ET DE GESTION
DIFFICULTES RELATIVES A LA FAIBLE
PENETRATION DES
INVESTISSEMENTS DIRECTS
ETRANGERS AU BENIN
Mémoire présenté et soutenu en vue de
l'obtention de la Maîtrise en Sciences
Economiques
Par : GUIDIME D. Camille
0ption : Economie et Finance
Internationales
Sous la direction de :
Professeur BIAO Barthélemy
Agrégé des Sciences Economiques
Doyen de la FASEG/ UNIPAR
Directeur de recherche
Avec la collaboration de :
Parfait ON
M. AUBLON
Analyste - financier Enseignant
associer à l'UNIPAR
Année académique 2004 - 2005
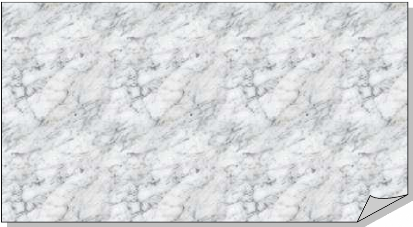
L'Université de Parakou n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises
dans les mémoires.
Ces opinions doivent être considérées
comme
propres à leurs auteurs.
DEDICACES
Ce mémoire est dédié à :
- Mes Parents AHOSSI Denanmi et GUIDIME DJAIKPON Damase.
Retrouvez en ce travail le couronnement de tant d'années de
sacrifices' de prières' de conseils et de
soutien.
- Mon oncle et sa femme Philomène et Christophe
AMOUSSOU. Retrouvez en ce travail le fruit de tant d'années de
sacrifices' de prières' de conseils et de
soutien.
- Tous mes frères et soeurs. en particulier GUIDIME
Claude et son épouse IDAKOU Béatrice Trouvez ici le fruit de vos
prières' de vos conseils' de votre soutien et de
l'espérance que vous avez mise en moi.
- Martial et Elisabeth DOSSA. Trouvez en ce travail le fruit de
quatre années de sacrifices.
- KOUASSI KOUADIO Remi. Trouves en ce travail la reconnaissance
d'un frère' et que la Paix revienne en Côte
d'Ivoire.
- TOTANGNI Adriel Armis' DOSSA Marius'
Akognon Ano. Trouvez en ce travail le produit de votre soutien
indéfectible.
- HOUNKPATIN Christian' qu'après notre dur
labeur nous vivions le bonheur et que la Vierge Marie te comble de ses
grâces !
- Révérend Père Edgard Vigan et
Révérende Soeur Denise-Sylvestre. Pour tout !
- La Communauté des Soeurs OPSCEJ du Sanctuaire de
Parakou' pour vos prières et votre soutien! A toi Maman !
- La Communauté des soeurs Dominicaines en particulier
Soeur Anne Bernard pour ton soutien indéfectible' ton
humanisme et ton Amour fraternel !
- Aux familles alliées et amies. Vous qui m'avez
aimé et soutenu' profonde reconnaissance !
- Toutes et tous mes amis (es) et camarades' pour
toutes les peines et joies vécues ensemble.
- A tous les enseignants de tous les horizons.
- Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin
à la réalisation de cette étude.
REMERCIEMENTS
Le présent document est le fruit d'une conjonction
d'exhortation' d'encouragement et d'assistance de la part de
certaines personnes à l'endroit desquelles' nous voudrions
adresser notre profonde et sincère gratitude.
Nous voudrions nommer ici :
- Notre Directeur de mémoire' le Professeur
BIAO Barthélemy pour avoir accepté de suivre ce travail
malgré ses multiples occupations.
- Notre Codirecteur de mémoire Monsieur Parfait AGBLONON
pour sa disponibilité dans le suivi de ce travail' pour ses
conseils et son soutien indéfectible.
- Mr Moustapha SANNI. Merci pour tout.
- Monsieur Yves GNANGNON pour ses conseils
- Ma marraine KPENETOUMN pour son amour maternel !
- Les familles KPENETOUMN' ANANOU'
IDAKOU' ZINSOU pour leur accueil familial et votre soutien!
- La Communauté des soeurs Dominicaines en particulier
soeur Anne Bernard pour son soutien indéfectible
- La Communauté des Petites Servantes du Coeur
Eucharistique de Jésus. Merci pour tout !
- Houankoun D.Ella pour son soutien indéfectible !
- Pères Jesus TRECONIZ et GUILLERMOT
- Isabelle DOSSOU et Wilfried DEDJI pour votre soutien et votre
souci de parfaire cette oeuvre. Merci pour tout !
- Monsieur Raoul GALNIVIER pour son soutien
indéfectible.
- Tous ceux qui de près ou de loin ont contribué
à la réussite de travail et ceux qui y trouveront un
intérêt particulier.
- Tous mes camarades et amis (es) de la première
promotion.
A tous infiniment merci !
SOMMAIRE
Dédicaces.............................................................................................
3
Remerciements..........................................................................................~
4
Sommaire................................................~~
~.............................................~ 5
Liste des tableaux et
graphiques..................................................................~~
6
Sigles et
abréviations.................................................................................~~
7
Avant-propos.............................................................................................~
9
Introduction................................................................................................
10
Première Partie : Conception des cadres
théorique, méthodologique et état
14
des lieux relatifs à l'Investissement Direct Etranger au
Bénin
Chapitre I : LE CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE L'ETUDE
............ 15
Section I: La problématique et les objectifs de la
recherche ..............................~ 15
Paragraphe 1 : La problématique et
l'intérêt de
l'étude.......................................~ 15
Paragraphe 2 : Les objectifs et les
hypothèses................................................~~ 18
Section II :La revue de littérature et méthodologie
de recherche ........................ 19
Paragraphe 1 : La revue de
littérature............................................................~~
19
Paragraphe 2 : Méthodologie de
recherche...................................................... 23
Chapitre II : LES FLUX D'IDE AU BENIN : ETAT DES LIEUX
...........................~ 25
Section I: Les secteurs de concentration d'IDE au
Bénin.................................... 25
Paragraphe 1 : Flux et stock
d'IDE.................................................................. 25
Paragraphe 2 : Types
d'IDE........................................................................~~~
29
Section II : Impacts de la pénétration d'IDE sur la
situation économique du Bénin ... 30
Paragraphe 1 : Effet sur le capital et l'investissement
national.............................. 30
Paragraphe 2 : Effet sur le transfert de technologie et
de compétence..................~~ 31
Deuxième partie : Analyse des facteurs
déterminant les Investissements
33
Directs Etrangers au Bénin
Chapitre III : CAUSES DE LA FAIBLE PENETRATION DE L'IDE AU
BENIN......~~~ 34
Section I : Facteurs de blocage des IDE au
Bénin............................................. 34
Paragraphe 1 : Facteurs
économiques............................................................
36
Paragraphe 2 : Facteurs
socioculturels............................................................
42
Section II : Analyse du cadre de
l'investissement.............................................~ 44
Paragraphe 1 : Conditions spécifiques
d'opérations des IDE..............................~~~ 44
Paragraphe2 :Conditions générales
d'opérations des IDE.................................~~~ 48
Chapitre IV : APPROCHE DE
SOLUTIONS...................................................~~ 50
Section I : Synthèse des
résultats..................................................................
50
Paragraphe 1 : Vue d'ensemble des
solutions................................................... 50
Paragraphe 2 : Les solutions
spécifiques.........................................................~
50
Section II : Mise en oeuvre des
solutions......................................................... 55
Paragraphe 1 : Elaboration d'une politique proactive pour
promouvoir les IDE......... 55
Paragraphe 2 : Faisabilité des
solutions.........................................................~~ 55
Conclusion.............................................................................................~~
56
Bibliographie.............................................................................................~
58
Annexes...................................................................................................~
60
Tabledes
matières....................................................................................~~
66
Liste des tableaux et graphiques
Tableau n.1 : Part des
investissements extérieurs par rapport aux investissements totaux sur la
période 1985-1997........................................
Tableau n.2 : Stock entrant d'IDE de 1980 à
2002........................................
Tableau n.3 : Comparaison des
performances du Bénin avec d'autres pays de la région (1988 --
2000) en dollars et pourcentages...
Tableau n.4 : Taux
d'épargne et taux d'investissement bruts au Bénin.......
Tableau n.5 : Niveau du risque
pays dans certains Etats africains...........
Tableau n.6 : Comparaison de
l'infrastructure de transport dans certains pays de
l'Afrique de l'Ouest
(2004).................................
Tableau n.7 : I ndicateurs de
productivité de la manutention au port de Cotonou
Tableau n.8 : Ressources
humaines dans certains pays d'Afrique de
l'Ouest(2002-2003)...................................................
Tableau n.9 : Fiscalité dans les pays de
l'UEMOA..........................................
Tableau n.10 : Liste des privatisations entre
1989 et 2003 ayant eu comme
repreneur des investisseurs
étrangers................................
Tableau n.11 : Flux d'IDE et Aide Internationale au
Bénin et dans les pays de la
sous-région :
1990-2000.........................................
Tableau n.12 : Taux d'Epargne et Taux
d'investissement au Bénin et en Afrique :
1990' 1995 et
2000...................................................
Tableau n.13: Matrice sur l'attrait et la
compétitivité des secteurs...................
Graphique n°1: Flux
d'IDE depuis 1970 (en million de dollars)........................
Graphique n.2 : Evolution du stock
entrant d'IDE de 1980 à 2002.......................
Graphique n.3 : Performance relative
en terme d'IDE par $1000 du PIB...............
Graphique n.4 : Facteurs de
gouvernance qui ont un effet négatif sur les affaires
(pourcentage)................................................................
Graphique n.5 : Répartition des projets
d'investissements agréés aux opérateurs
étrangers par branches d'activités entre 1992 et
2003 (pourcentage) Graphique n.6 : Les
principales filiales des sociétés transnationales (TNCs)
présentes au Bénin par pays d'origine
(pourcentage).................. Graphique n.7
: Obstacles administratifs aux investisseurs perçus au
Bénin..........
Graphique n.8 : Attrait sectoriel selon les
investisseurs présents au Bénin...........
SIGLES ET ABREVIATIONS
A
ACP Afrique' Caraïbes' Pacifique
AGOA African Growth and Opportunity Act
B
BCEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
C
CCIB Chambre de Commerce et d'industrie du Bénin
CD-ROM Compact Disk -- Read only Memory
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
CEMAC Communauté Economique Monétaire de l'Afrique
Centrale
CET/BOT Construire-Exploiter-Transferer/Buil-Operate-Transfer
CFA Communauté Financière Africaine
CFE Centre de Formalités des Entreprises
CIPB Conseil des Investisseurs Privés du Bénin
COBENAM Compagnie Béninoise de Navigation Maritime
CTD Commission Technique de Dénationalisation
CTI Commission Technique des Investissements
D
DASP Direction d'Appui au Secteur Privé
F
FBCF Formation Brute du Capital Fixe
FCFA Franc de la Communauté Financière
Africaine
FMI Fonds Monétaire International
FMN Firme Multinationale
FDI Foreign Direct Investment
IBCG Industrie Béninoise des Corps Gras
N
NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de
l'Afrique
0
OBOPAF Observatoire des Opportunités d'Affaires du
Bénin
OBRGM Office Béninois de Recherches Géologiques et
Minières
OCBN Organisation Commune Bénin - Niger des chemins de
fer et des
transports
OMC Organisation Mondiale du Commerce
P
PAC Port Autonome de Cotonou
PAS Programme d'Ajustement Structurel
PIB Produit Intérieur Brut
PMA Pays les Moins Avancés
PME Petite et Moyenne Entreprise
PMI Petite et Moyenne Industrie
s
SA Société Anonyme
SARL Société à Responsabilité
Limitée
SNC Société en Nom Collectif
SOBEMAP Société Béninoises des Manutentions
Portuaires
SONACOP Société Nationale pour la
Commercialisation des Produits Pétroliers
SONAPRA Société Nationale pour la Promotion
Agricole
STN Société Transnationale
T
TIC Technologie de l'Information et de Communication
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée
U
UE Union Européenne
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
AVANT - PROPOS
La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
demande aux étudiants en Science Economique' après
quatre années de formation de soutenir sur une question relative
à leur branche de formation.
L'objectif visé est d'affiner la capacité
d'analyse et le goût de la recherche chez les économistes et
gestionnaires formés à la faculté.
C'est pour répondre à ce principe que nous
avons décidé de réaliser l'étude dont le
thème est :
« Les difficultés relatives à la faible
pénétration des investissements étrangers directs au
Bénin ».
Les pays développés ou industrialisés
ont bénéficié d'une manière ou d'une
autre' à une époque de l'histoire d'importants
capitaux étrangers pour le décollage de leurs
économies.
C'est pourquoi la création de situations favorables
pour attirer les capitaux étrangers devient une préoccupation
pour les pays en développement afin d'amorcer un développement
durable.
La présente étude nous a permis de savoir les
déterminants liés à l'investissements étrangers
dans les pays en développement comme le Bénin. Elle nous a permis
aussi de connaître les difficultés qui empêchent le
Bénin d'attirer d'importants flux de capitaux.

NTRODUCTION
Selon la Commission des Nations Unies pour le Commerce et le
Développement CNUCED)' l'Investissement Direct Etranger (
IDE) est un « investissement impliquant une relation à long terme
et témoignant de l'intérêt durable d'une entité
résidant dans un pays (ou société mère) à
l'égard d'une entreprise résidant dans un autre pays (entreprise
bénéficiaire' entreprise affiliée ou encore
filiale étrangère)».
En clair' les IDE sont des capitaux
étrangers' soit par le biais de privatisation'
soit par le biais de délocalisation de firme' soit par la
prise de participation dans le capital d'une entreprise
étrangère.
Les IDE sont importants pour les pays en développement
car ils représentent des apports importants de capitaux. Ils traduisent
la confiance des investisseurs internationaux dans l'économie des pays
et montrent l'ouverture du pays à l'économie mondiale. Les effets
d'entraînement d'ordre technologique associés à l'IDE
comprennent un meilleur accès aux nouveaux instruments financiers et aux
transferts de nouvelles technologies.
L'histoire des faits économiques nous enseigne que les
pays du Nord ont bénéficié de flux importants d'IDE pour
amorcer leur développement économique. C'est ainsi que le plan
« Marshall » a permis la reconstruction de la plupart des pays
d'Europe.
Ensuite' dans les années 60' les
premières sociétés transnationales aux USA ont
commencé à investir à l'étranger : c'était
la première vague des IDE. Les pays d'Europe ont suivi
après' dans les années 65 : c'était la
2ème vague des IDE. La 3ème vague fut
l'investissement des nouveaux pays industrialisés en direction de tous
les pays. Ce développement montre que les pays du Nord ne
reçoivent plus de flux très importants d'IDE mais en sortent
beaucoup. Comparativement aux pays développés' les
Pays En voie de Développement (PED) reçoivent plus de flux d'IDE
que les pays
développés et en sortent peu( CNUCED'
rapport sur l'Investissement dans le monde' 2004' p 3
).
Parmi les pays en développement' ce sont
principalement les pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est qui ont réussi ces
dernières années à accroître leur part
d'IDE1. C'est au portillon de la Chine que les investisseurs de
toutes origines se bousculent actuellement.
L'Afrique' paradoxalement' ne
reçoit toujours qu'une part marginale des IDE. L'Afrique
subsaharienne' en particulier la zone UEMOA qui ne drainait que
1'2% des flux d'IDE mondiaux entre 1980 et 1990 a vu sa part
diminuer légèrement pour ne s'élever qu'à
1'1 % entre 1991 et 2002 (soit 3'7% des flux vers les
pays en développement). Le Bénin se classe en dernière
position après le Nigeria' la Côte d'Ivoire'
et le Sénégal en matière de mobilisation de flux d'IDE.
Le domaine de prédilection des projets internationaux
est celui des investissements directs étrangers. Les projets
internationaux sont des précurseurs de ces investissements directs
étrangers. Pour les investisseurs du nord' le partenariat
industriel avec les PED' conduit nécessairement à la
délocalisation industrielle2.
L'engagement des investisseurs du nord se traduit par la
création des PME -- PMI conjointes situées en Afrique. Or
l'Afrique' et particulièrement la zone UEMOA' est
devenue depuis 1999' un environnement à haut risque pour les
investisseurs compte tenu de la crise en Côte d'Ivoire qui occupe 40% du
PIB de l'union.
Toutefois' le Bénin présente un risque
pays modéré.
La Conférence des Forces Vives de la Nation
réunie à Cotonou du 19 au 28 février 1990 a amorcé
un changement d'option de la gestion de l'Economie Nationale. Le
libéralisme est désormais l'orientation nationale en
matière de l'économie' de la vie politique
recommandée à la Conférence Nationale.
1 , .
L Asie occupe 19,8 % du stock d'IDE mondial en 2001.
2 La délocalisation industrielle, c'est le
transfert à l'extérieur d'une activité productive sans que
change les marchés auxquels elle s'adresse.
Dans ce cadre de processus de libéralisation des
initiatives individuelles et collectives' un certain nombre de
textes législatifs et réglementaires ont été pris
pour encourager et protéger l'initiative privée. Il s'agit des
lois portant Code des Investissements au Bénin.
Cependant' malgré une
démocratisation fort évoluée' force est de
constater que le Bénin ne reçoit toujours qu'une petite part
d'IDE pouvant amorcer son développement économique. En
1989' le Gouvernement béninois a lancé un ambitieux
programme de réformes politique et économique. Les profondes
réformes structurelles engagées par les autorités ont
permis au Bénin d'atteindre une remarquable stabilité
macroéconomique et une bonne intégration dans l'économie
régionale et mondiale.
Ainsi' la décennie 1990 a été
marquée par la mise en place d'un programme visant la stabilisation et
la libéralisation de l'économie. La constitution du 11
décembre 1990 a consacré le droit de
propriété' le principe d'égalité de
traitement de toute personne devant la loi' le droit de libre
établissement sans distinction de nationalité et le principe du
traitement national en matière d'investissements. Un nouveau code
d'investissement a été adopté et une agence de
promotion' le Centre de Promotion des Investissements
(CPI)' a été créé. La nette
amélioration du cadre de l'investissement et le vaste programme de
privatisation et de libéralisation ont permis au Bénin
d'enregistrer une augmentation significative du flux d'IDE.
Toutefois' le Bénin a enregistré une
chute spectaculaire du flux d'IDE en 1994' malgré toutes ces
réformes ; et depuis lors' le Bénin n'a pu enregistrer
un flux important d'IDE. Certains problèmes structurels et
socio-économiques affectent le Bénin et sont plausibles en
matière d'Investissement Direct Etranger. En effet'
l'économie demeure tributaire de l'exportation du coton ; le
Bénin est ainsi vulnérable aux chocs extérieurs et sa
balance commerciale demeure structurellement déficitaire. C'est dans
l'objectif de trouver les raisons pouvant expliquer la faible
pénétration des IDE au Bénin que nous nous donnons la
tâche de réfléchir sur les caractéristiques des PED
à mobiliser d'importants capitaux pour leur développement.
C'est dans cette optique que nous avons choisi le
thème intitulé « DIFFICULTES RELATIVES A LA FAIBLE
PENETRATION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS AU BENIN ».
Ainsi' notre étude sera
présentée en quatre chapitres groupées en deux parties.
Il s'agira dans un premier temps de développer deux
chapitres dans la première partie intitulée « Conception des
cadres théorique' méthodologique et état des
lieux relatifs aux investissements directs étrangers au Bénin
». Le premier chapitre sera destiné à définir le
problème' présenter la revue de littérature et
exposer également les objectifs et hypothèses qui serviront de
base à l'étude ainsi que la méthodologie adoptée
pour l'étude .Dans le deuxième chapitre' il s'agira d'
analyser les tendances du flux d'IDE au Bénin.
Dans un second temps' il s'agira de
développer la seconde partie intitulée « Analyse des
facteurs déterminant les investissements directs étrangers au
Bénin »' à travers le chapitre trois où seront
analysées les causes de la faible pénétration des IDE au
Bénin' et le chapitre quatre où seront données
des approches de solutions.

CONCEPTION DES CADRES THEORIQUE,
METHODOLOGIQUE ET ETAT DES LIEUX RELATIFS
A L'INVESTISSEMENT ETRANGER DIRECT AU BENIN
Première partie :

CHAPITRE I : LE CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE
L'ETUDE
Dans ce chapitre' nous présenterons le
problème' la revue de littérature' les
objectifs' les hypothèses et la méthodologie.
Section 1: LA PROBLEMATIQUE ET LES OBJECTIFS DE L'ETUDE
Paragraphe 1 : La problématique et
l'intérêt de l'étude
A- La problématique
L'investissement est un axe central des politiques de
développement' et les capitaux étrangers sont
d'importants facteurs internes du développement.
Les IDE sont primordiaux pour amorcer un développement
durable dans les pays en voie de développement car ils
représentent d'importants capitaux. Ils traduisent la confiance des
investisseurs internationaux dans l'économie des pays et montrent
l'ouverture du pays à l'économie mondiale.
La forte entrée de capitaux étrangers de la
période de 1989 à 1994 a permis de financer le
développement économique du Bénin (John Igué
'1999 ; 83).
Le tableau suivant illustre la part des investissements
extérieurs par rapport aux investissements totaux sur la période
de 1985 à 1997.
Tableau 1 : Part des investissements extérieurs
par rapport aux investissements totaux sur la période 1985-1997
Années
|
1985
|
1986
|
1987
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
Investissements
totaux (en
milliards de
francs CFA)
|
18'2
|
25'3
|
23'3
|
29'9
|
24'5
|
26'0
|
26'6
|
22'6
|
25'5
|
49'9
|
65'0
|
63'1
|
71'8
|
Investissements extérieurs sur investissements totaux
(%)
|
87'5
|
79'5
|
87'2
|
89'2
|
94'6
|
96'6
|
94'3
|
93'8
|
89'5
|
92'0
|
83'1
|
89'1
|
86'3
|
|
Source : DGBM/MFE
Le taux d'épargne étant faible et le pays
dépendant des transferts de capitaux étrangers pour assurer son
niveau d'investissement actuel' l'IDE pourrait contribuer beaucoup
plus à réduire la sujétion du Bénin à l'aide
internationale.
Par ailleurs' les réformes introduites par
les nouvelles autorités démocratiques à la fin du
régime marxiste-léniniste ont permis de rétablir les
équilibres macroéconomiques' d'accélérer
l'intégration du pays dans l'économie mondiale et
d'améliorer le cadre de l'investissement avec la loi portant code des
investissements.
La décennie 1990 a été marquée
par la mise en place d'un programme visant la stabilisation et la
libéralisation de l'économie.
L'application des PAS a permis l'équilibre
macroéconomique et la libéralisation de l'économie. Ce
sont des facteurs qui ont expliqué pour la majeure partie' la
forte pénétration de l'IDE au cours de la période
1989-1994.
Les réformes introduites' ont
également été à l'origine de la privatisation de
nombreuses entreprises publiques et de l'ouverture de certains secteurs
(banque' tourisme' etc.). Le résultat de ces
réformes s'est traduit par une forte augmentation des flux entrants
d'IDE pendant la première partie des années 90. Après la
chute spectaculaire des IDE de 1994 il y a eu une reprise progressive des flux
entrants à partir de 1995 sans toutefois atteindre le niveau de 1991. Ce
qui montre qu'il y a des obstacles à une pénétration des
IDE au Bénin.
Au regard de ce qui précède' la
question est de savoir si les réformes économiques sont les seuls
facteurs de mobilisation de flux d'IDE ? Autrement dit' le
Bénin doit-il répéter les réformes chaque fois
qu'il y aurait baisse de flux d'IDE ? En effet des problèmes à la
mobilisation des capitaux étrangers au Bénin existent. Des
obstacles majeurs à une forte attraction et à une
pérennisation des IDE subsistent malgré les réformes
engagées par le gouvernement. Les principaux facteurs de blocage des
flux d'IDE sont l'accès au foncier' les problèmes de
bonne gouvernance et de transparence de l'administration publique'
le très faible niveau d'industrialisation de l'économie et les
retards dans les infrastructures.
B -- L'intérêt de l'étude
Sans constituer la solution miracle des problèmes de
développement' un fort et régulier flux des IDE permet
à un pays de parvenir à une croissance équilibrée
(cas des nouveaux pays industrialisés).
La mobilisation de capitaux étrangers dans la
formation du capital constitue un sujet de prédilection des
économistes de développement.
Au cours de ces dernières années certains pays
du tiers monde à savoir les pays d'Asie' connaissent une
importante attraction des IDE' mais' pourquoi pas le
Bénin? Il est donc question d'étudier les difficultés
relatives à la faible pénétration d'IDE dans les pays de
l'UEMOA et en particulier le Bénin.
Cette étude fera ressortir les difficultés du
Bénin à attirer les capitaux étrangers et mettra en
exergue les caractéristiques du Bénin en matière d'IDE.
Elle permettra aussi d'évaluer la politique de réforme
économique entreprise par le Bénin à partir de 1989 et de
ce fait l'évaluation du PAS.
L'intérêt de cette étude se résume
d'une part par l'importance des IDE dans le développement
économique d'un PED comme le Bénin et' d'autre part
par la démonstration que l'investissement étranger ne
dépend pas seulement des variables comme l'avantage comparatif mais
aussi des caractéristiques propres aux pays à attirer
l'investissement étranger indirect.
Conscients de l'importance de l'IDE dans la création
de la richesse' nous avons pensé qu'il est nécessaire
d'analyser les difficultés relatives à la faible
pénétration d'IDE et de dégager les politiques
économiques et sociales qui permettent de promouvoir l'IDE.
Paragraphe 2 : Les objectifs et les hypothèses
A -- Objectifs
1-objectif générai
L'objectif général de cette étude est de
faire ressortir les difficultés expliquant la faible
pénétration des IDE au Bénin. Ceci est de nature à
éclairer les responsables de la politique économique et sociale
quant aux décisions à prendre pour le développement
économique en général et pour le développement du
secteur privé en particulier. L'atteinte de cet objectif
général passe par les objectifs spécifiques.
2-Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques suivants sont visés :
- analyser les obstacles structurels et institutionnels que
rencontrent les investisseurs étrangers ;
- analyser l'évolution de l'IDE au Bénin sur la
période de 1980 en 2003 pour observer l'effet des réformes
économiques de 1990 sur l'IDE ;
- analyser les facteurs pouvant attirer plus d'IDE au
Bénin.
B- Hypothèses
Cette étude sera menée sur la base des
hypothèses ci-après :
Hypothèse 1: Les facteurs structurels comme le
coût administratif élevé' la faiblesse de
l'investissement public dans les routes' les
télécommunications' l'eau'
l'électricité et l'éducation' expliqueraient la
faible pénétration des IDE au Bénin.
Hypothèse 2 : La bonne gouvernance est un facteur
d'attrait pour les IDE.
Hypothèse 3 : L'information sur les atouts naturels
du Bénin est un facteur à l'accroissement des flux d' IDE au
Bénin.
Section II : LA REVUE DE LA LITTERATURE ET LA
METHODOLOGIE DE RECHERCHE
Paragraphe I : La revue de littérature
A- Importance des IDE dans les échanges internationaux
Les IDE sont les capitaux qui sont soit directs'
soit par le biais d'entreprises privatisées en vue d'acquérir un
intérêt durable dans une entreprise exploitée appartenant
à un pays autre que celui de l'investisseur.
Nous pouvons souligner que le concept de l'IDE ne peut se
départir de l'entreprise' plus précisément de
la firme multinationale.
C.A.MICHALET et M. DELAPIERRE in Nationalisation et
internationalisation' stratégies des multinationales
françaises dans «la crise» cité par J. BREMOND et A.
GELEDAN'(1984)' écrivait : «Le ralentissement
prononcé de l'activité économique s'est
accompagné' depuis les dix dernières
années' d'une accélération très forte de
la croissance internationale des firmes. Tout se passe comme si les
sociétés françaises avaient répondu principalement
à la crise par l'investissement à l'étranger. Celui-ci a
crû à un taux beaucoup plus élevé que celui de
l'investissement domestique».
Un intérêt particulier pour l'étude des
IDE et le déploiement des firmes multinationales pose le problème
de la dualité ou de l'unité de la théorie des relations
économiques internationales.
Au départ en effet' les économistes
classiques et néoclassiques ont sous des hypothèses
simplificatrices (notamment immobilité internationale des facteurs de
production) qui ignorent les investissements internationaux' abouti
à des conclusions partielles (l'avantage comparatif de la nation est le
déterminant de l'échange) qui n'accordent aucune place à
la firme.
Mais à partir du milieu du 20ième
siècle' deux évolutions parallèles vont voir le
jour : Certains auteurs français comme Maurice Byé et
François PERROUX'(1956)' mettent en
évidence le rôle des « Grandes Unités Internationales
» dont les stratégies apparaissent peu réductibles aux
conclusions néoclassiques.
- La théorie des avantages comparatifs a été
également critiquée dans ses
hypothèses comme dans ses conclusions : les produits ne
sont plus homogènes' la concurrence est imparfaite et les
facteurs sont internationalement mobiles.
La reconstruction de la théorie de l'échange
international sur de nouvelles bases a conduit à mettre en
évidence le rôle des firmes dans l'organisation et la structure
des échanges.
Une telle évolution permet de percevoir d'emblée
l'intérêt d'un questionnement sur les IDE et les facteurs
responsables de leur captivité.
Malgré l'importance croissante prise par les
investissements internationaux dans les économies' il
n'existe aucun cadre théorique unifié permettant de comprendre
les déterminants des IDE. La littérature existante regroupe des
aspects industriels et des caractéristiques propres aux pays. Une
première tentative a été effectuée dans les
années 70 par Dunning qui propose une approche globale des facteurs
explicatifs de l'investissement direct étranger (paradigme OLI) dans
laquelle apparaissent des éléments comme la concurrence
imparfaite' les avantages comparatifs ou l'internalisation des
coûts de transaction.
B- Les nouvelles théories du commerce international
(NTCI)
Les NTCI enrichies de l'analyse de la firme multinationale
(Brainard'1993' Markusen' 1995) sont venues
pallier les insuffisances de la théorie traditionnelle en
intégrant des éléments comme la concurrence
imparfaite' la différenciation des produits et les
économies d'échelle. Elles mettent en avant un arbitrage des FMN
entre proximité et concentration. Des firmes multinationales de type
horizontal apparaissent lorsque les avantages à s'implanter à
proximité des consommateurs sont élevés relativement aux
avantages liés à la concentration des activités. La firme
préfère donc implanter plusieurs sites de production pour servir
les marchés locaux si elle peut réaliser des économies
d'échelle entre ces différents sites du fait de la
présence d'actifs intangibles' si les coûts
d'implantation sont relativement faibles' si les coûts de
transport sont plutôt élevés et si la demande sur le
marché d'accueil est forte. Ces premiers modèles mettent l'accent
sur
les IDE de type horizontal qui correspondent à des
stratégies de conquête de marchés locaux principalement
dans les pays développés. A l'opposé' on parle
d'IDE dits de délocalisation ou verticaux lorsque les firmes
s'intègrent dans une perspective de division internationale des
processus de production. Les FMN répartissent leurs activités
entre les pays en fonction des différents avantages comparatifs. Le
modèle de Markusen & al. (1996) distingue les multinationales selon
cette typologie et complète les résultats du modèle de
Brainard sur l'arbitrage proximité-concentration qui concernent
uniquement les FMN de type horizontal. Les FMN de type vertical apparaissent
entre pays différents en taille et en dotations factorielles et
établissent les étapes de la production les plus intensives en
travail dans les pays où les coûts de la main d'oeuvre sont peu
élevés.
Toutefois' la distinction entre IDE horizontal et
vertical n'est pas aussi claire dans les faits : les FMN s'engagent souvent
dans des stratégies d'intégration complexe' qui
englobent à la fois des formes d'intégration verticale dans
certains pays et horizontale dans d'autres pays (Yeaple' 2003). Les
stratégies d'intégration complexe sont
préférées aux seules stratégies d'expansion
à l'étranger horizontale ou verticale lorsque les coûts de
transport descendent en dessous d'un certain seuil. Des coûts de
transport faibles encouragent l'IDE vertical car ils rendent accessible l'usage
d'une main d'oeuvre peu chère. Des coûts de transport
élevés favorisent au contraire l'IDE horizontal puisqu'ils
rendent les échanges commerciaux plus chers. Entre les deux
bornes' aucun motif d'expansion à l'étranger pris
isolément ne suffit à rendre attractif l'IDE. Il faut en outre
que les firmes trouvent un autre avantage qui réside dans la
complémentarité entre les deux formes d'intégration. Dans
ce cas' les coûts d'accès aux marchés mondiaux
sont doublement abaissés' par la réduction des
coûts unitaires d'une part qui engendre une augmentation des ventes.
D'autre part' par un effet d'échelle proportionnel au volume
de ventes réalisées qui permet de réduire encore plus les
coûts unitaires.
Le modèle de concurrence imparfaite a également
servi de base théorique à l'approche gravitationnelle
(Bergstrand' 1989). Elle s'applique initialement aux flux
d'échanges commerciaux entre deux pays donnés et explique
l'importance des flux par la taille du pays d'origine et d'accueil et la
distance géographique. L'équation est
également applicable aux déterminants des flux
d'investissements. Toutefois' la théorie suggère que
les échanges commerciaux et les IDE soient substituables. Du fait des
coûts de transaction' les exportations sont liées
négativement à la distance géographique et il peut
être plus efficace de produire directement dans le pays d'accueil.
Un certain nombre de variables suggérées par les
différentes approches
théoriques peuvent constituer les déterminants des
flux d'IDE dans les pays
développés ou en développement : taille des
marchés' différences de dotations
factorielles' écarts de coûts
salariaux' distance géographique...
Néanmoins' la spécificité des
économies en transition n'est jamais prise en considération dans
ces approches. Depuis 1990' les PED sont engagés dans un
vaste processus de réformes structurelles. La privatisation de secteurs
entiers de l'économie a constitué un élément majeur
de cette transformation. Différentes méthodes de privatisation
ont été suivies selon les pays en fonction des contraintes issues
de l'héritage laissé par l'ancien système et des objectifs
des gouvernements. Parmi les différentes méthodes (vente
directe' rachat par appels d'offre' privatisation par
bons...)' une méthode principale a toujours été
favorisée. Cette dernière a constitué un signal fort aux
yeux des investisseurs étrangers qui ont privilégié les
pays ayant adopté la méthode de vente directe des anciennes
entreprises d'Etat (Hunya' 1997).
Toutefois' la mobilisation des capitaux
étrangers par le biais de ces réformes économiques a connu
un ralentissement . La mobilisation des IDE dans les PED dépend
également du cadre juridique des investissements' du niveau
de corruption' du niveau du secteur industriel' de
l'administration' des infrastructures de base' du risque
pays et les atouts naturels propres à ces pays.
Paragraphe 2 : Méthodologie de la recherche
Afin de parvenir aux résultats qui permettront
d'atteindre les objectifs fixés et de vérifier les
hypothèses' il s'avère nécessaire de notre part
de suivre une méthodologie rigoureuse dans les démarches pour la
collecte des informations et des données ainsi que pour leur
traitement.
Les données utilisées dans le cadre de notre
étude sont les données secondaires. Elles ont été
collectées dans les annuaires et bulletins statistiques de la
BCEAO' la CNUCED et dans les rapports annuels disponibles au niveau
des centres de documentation de Cotonou et à la bibliothèque de
l'Université de Parakou. Il s'agit de :
A- Les outils de la recherche
1. La recherche documentaire
Dans notre étude nous avons eu recours à la
recherche documentaire. Cela nous a permis de faire le cadre théorique
et des comparaisons de résultats.
2. Les entretiens directs
Les entretiens directs avec quelques acteurs de
l'investissement et nos professeurs' nous ont permis de faire une
analyse historique et empirique de la situation.
3. La navigation sur le réseau Internet
La navigation sur le réseau Internet nous a permis
d'avoir accès à certaines données et à d'autres
études réalisées en matière d'investissements
internationaux. Cela nous a permis d'avoir les données suivantes :
- Statistiques des finances publiques publiées par le
Ministère des Finances et de l'Economie de la République du
Bénin.
- Balance des paiements publiée par la BCEAO ;
- FDI/TNC data base publié par la CNUCED ;
- Balance des paiements sur CD-ROM publiée par le Fonds
Monétaire International
- Enquête de la CNUCED auprès de 63 entreprises sur
les obstacles administratifs aux IDE.
Ces différentes sources nous ont permis de recueillir
les données suivantes sur les périodes de 1980 à 2003 :
- les flux d'IDE
- les valeurs des exportations et importations ;
- les taux de change bilatéraux réels ;
- l'effectif de la population totale ;
- les PIB ;
- la fiscalité dans les pays de l'UEMOA ;
- les ressources humaines dans certains pays de la CEDEAO ;
- la comparaison des infrastructures de transport dans certains
pays de la CEDEAO.
B- Le traitement des données
1. Les tableaux statistiques
Les tableaux nous ont permis de faire une « étude
comparative » et longitudinal' c'est à dire analyser en
amont et en aval les causes ou les conséquences d'un
phénomène.
2. Les graphiques
Des graphiques ont été obtenus à partir des
tableaux statistiques. Ils ont servi
aux comparaisons évolutives des comportements des
indicateurs.

CHAPITRE II : LES FLUX D'IDE AU BENIN : ETAT DES LIEUX
Dans ce chapitre nous ferons un état des lieux des IDE au
Bénin à travers ses tendances (section 1)' et analyser
quelques implications (section 2).
Section 1: LES SECTEURS DE CONCENTRATION D'IDE AU
BENIN
Les réformes introduites par les nouvelles
autorités démocratiques à la fin du régime
marxiste-léniniste ont permis de rétablir les équilibres
macroéconomiques' d'accélérer
l'intégration du pays dans l'économie mondiale et
d'améliorer le cadre de l'investissement. Ces reformes ont
été à l'origine de la privatisation de nombreuses
entreprises publiques et de l'ouverture de certains secteurs
(banques' tourisme' etc.). Le résultat fut une
augmentation des flux entrants d'IDE pendant la première partie des
années 90. Après la chute spectaculaire de 1994' il y
a eu une reprise progressive des flux entrants à partir de 1995 sans
toutefois atteindre le niveau de 1991.
Paragraphe 1 : Flux et stock d'IDE
A-Les flux d'IDE
En 1972' l'instauration d'un régime
marxiste-léniniste à un vaste programme de nationalisation (John
Igué' 1999) s'est traduit par la prédominance de
l'Etat dans tous les secteurs de l'économie. Ceci explique la quasi
absence des IDE au Bénin jusqu'en 1989.
Après la mise en oeuvre du PAS' les flux
d'IDE ont augmenté rapidement pour atteindre un pic en 1991 avec 120
millions de dollars (rapport de la CNUCED) ; mais ces flux ont chuté
tout aussi rapidement en 1993 et 1994. Depuis' l'évolution
des flux d'IDE a été plus lente. En 1995' ils ne
dépassaient pas 8 millions de dollars pour repartir ces dernières
années (41 millions de dollars en 2002).
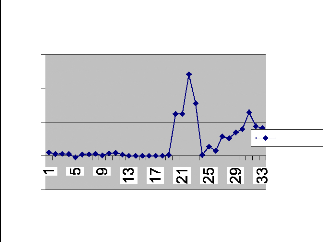
150
100
-50
Source: Réalisé par l'auteursous la base des
bases de données de la
CNUCED(2005)
50
0
Graphique 1:Flux d'IDE au Bénin(1970-2002 en million
de
dollars)
Flux d'IDE
Dans un premier temps les flux entrants d'IDE se sont
concentrés en partie sur les privatisations de nombreuses
sociétés publiques et parapubliques' dont le nombre
est passé de 130 en 1989 à 27 en 1999. Les secteurs effectivement
privatisés au Bénin pendant les années 90 sont : le
tabac' les brasseries' les huileries' les
savonneries' les cimenteries' les filatures'
la manutention des conteneurs' les sucreries et le
pétrole.
A part ces investissements de privatisation' il
convient cependant de remarquer le rôle joué par les
investissements de création (greenfields investments) ou les
investissements dans les installations existantes (brownfield). A ce
niveau' la privatisation prend en compte les considérations
d'un certain nombre d'investissements de type «greenfield» et
«brownfield»' lesquels occupent depuis 1999 une place
progressive plus importante au Bénin. Selon cette analyse' la
branche dominante est l'industrie textile (11.7646.097.000 FCFA)'
suivie respectivement de l'industrie alimentaire (46.050.538.690
FCFA)' de l'industrie de transformation de bois (19.644.431.890
FCFA) et de l'industrie chimique (7.708.209.000 FCFA)
Selon une approche «absolue»' le
Bénin a enregistré après le Nigeria le plus d'IDE
(64'6 millions de dollars) entre 1988 et 1992 que les autres pays de
la
CEDEAO. Cependant' il a occupé le
6ème rang dans la sous région avec 14'8
millions de dollars entre 1993 et 1997. On a observé une augmentation de
flux d'IDE au Bénin par la suite de 48'2 millions de dollars
entre 1998 et 2002' et le Bénin occupe toujours le
6ième rang aujourd'hui (cf tableau 2). Et selon une approche
«relative»' les flux d'IDE par habitant ont
été de 13'4 ; 2'7 et 7 '2
million de dollars' respectivement entre 1988 et 1992 ; 1993 et 1997
; 1998 et 2002. Ce qui confirme que le Bénin a enregistré ses
plus grands flux d'IDE dans la période 1988-1992.
L'approche de «La performance relative au PIB et au
pourcentage de la formation brut du capital fixe» vient également
confirmer le résultat précédent.
L'attraction des IDE a été plus forte que sur la
période 1989-1992 après les
réformes économiques entreprises par le
gouvernement de cette période.
B-Les stocks d'IDE
Notons que les stocks d'IDE sont des accumulations des flux
d'IDE. Dans l'analyse de l'évolution' ils étaient
évidemment modestes durant les années 80 (autour de 30 millions
de dollars). Depuis le début des privatisations' ils sont
passés de 34'8 millions de dollars en 1988 à
672'7 millions en 2001(voir annexe 1).
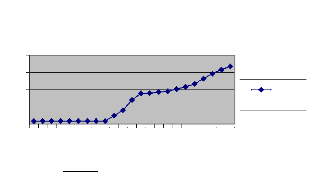
400
800
600
200
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Graphique 2 : Stock d'IDE au Bénin de
1980 à
2002(en million de dollars
Source : Réalisé par l'auteur
stock
d'IDE
Le Bénin a enregistré après le
Nigeria' la Côte d'Ivoire et le
Sénégal' le plus d'IDE (672'7 millions de
dollars) en 2002 que les autres pays de la CEDEAO.
Tableau 2 : Comparaison des performances du Bénin
avec d'autres pays de la région (1988 - 2000) en dollars et
pourcentages
|
Pays
|
PERFORMANCE ABSOLUE
|
PERFORMANCE RELATIVE
|
|
Flux d'IDE
|
Stock
d'IDE
|
Flux d'IDE par
habitant
|
Flux d'IDE
|
Stock d'IDE
|
|
Millions de dollars par an
|
Millions
de dollars
|
Millions de dollars
|
Par 1000 dollars du
PIB
|
Pourcentage
de la FBCF
|
Par
habi-
tant
|
Par 1000
dollars du
PIB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bénin
|
64,6
|
14,8
|
48,2
|
672,7
|
13,4
|
2,7
|
7,2
|
37,5
|
7,4
|
20,2
|
26,2
|
4,2
|
11,8
|
102,7
|
250
|
|
Burkina-Faso
|
2'8
|
12'2
|
12'6
|
166'0
|
0'3
|
1'2
|
1'1
|
1'1
|
5'1
|
4'6
|
0'4
|
2'6
|
1'86
|
14'0
|
51'8
|
|
Côte d'Ivoire
|
11'2
|
262'5
|
259'6
|
3673'7
|
3'5
|
18'7
|
16'7
|
3'9
|
23'5
|
21'7
|
4'8
|
20'2
|
17'4
|
222'5
|
314'2
|
|
Guinée Bissau
|
2'2
|
3'3
|
3'1
|
47'6
|
2'3
|
3'0
|
2'6
|
9'7
|
12'5
|
14'8
|
2'4
|
7'4
|
10'8
|
37'9
|
220'4
|
|
Mali
|
-0'4
|
59'4
|
78'80
|
677'8
|
0'0
|
5'4
|
7'2
|
0'4
|
21'8
|
26'2
|
0'2
|
9'2
|
13'8
|
59'6
|
192'9
|
|
Niger
|
23'2
|
10'8
|
9'8
|
456'6
|
3'0
|
1'1
|
0'9
|
9'7
|
5'6
|
4'3
|
8'6
|
5'2
|
3'6
|
40'0
|
211
|
|
Nigeria
|
92'0
|
1503'4
|
1074'4
|
22569'7
|
10'4
|
15'2
|
9'4
|
33'9
|
54'4
|
27'0
|
31'0
|
28'8
|
35'9
|
188'0
|
423'5
|
|
Sénégal
|
18'2
|
56'8
|
79'0
|
952'2
|
2'5
|
6'6
|
8'3
|
3'3
|
13'6
|
16'7
|
2'6
|
8'2
|
8'6
|
95'1
|
189
|
|
Togo
|
16'5
|
19'3
|
58'3
|
648'9
|
2'2
|
4'9
|
12'9
|
5'2
|
14'6
|
13'5
|
2'3
|
10'7
|
26'4
|
135'8
|
470'2
|
Sources : CNUCED' base de données
FDI/TNC ; Banque Mondiale' indicateurs du développement dans
le monde' 2003
Paragraphe 2 : TYPES D'IDE
Les IDE ont pris diverses formes : acquisition d'entreprises
locales' création de nouvelles unités de production et
prise de participation par les investisseurs étrangers ainsi que les
bénéfices réinvestis par ces derniers.
De 1989 à 1999' comme on l'a
déjà indiqué' la grande majorité des IDE
a été réalisée dans le cadre des privatisations.
A- Acquisition d'entreprises locales
L'acquisition est le fait de devenir propriétaire de
biens' services ou droits. A la différence de
l'achat' l'acquisition peut se faire non seulement à titre
onéreux mais aussi à titre gratuit. Le code civil
énumère les modalités d'acquisition de la
propriété (art.711 et art.712) : succession'
donation' effet des conventions' accession'
incorporation' prescription...Notons que ce type d'IDE était
le plus développé au Bénin juste après les
réformes de1990( cf annexe 1) et se traduit souvent par les
privatisations.
B- Création de nouvelles unités de production
Ces dernières années' on a
constaté un nombre croissant de nouveaux projets qui ne relèvent
pas du PAS ; il s'agit avant tout de projets d'investissement dans le secteur
des services' notamment dans les télécommunications
(Alcatel' Titan)' les banques et assurances (UBA
VIE' Société Générale des
Banques' Banque Atlantique' Banque Régionale de
Solidarité).
C- Fusion-acquisition ou prise de participation
C'est le fait de prendre part au capital' aux
bénéfices ou à la gestion d'une société ou
d'une entreprise. Il faut dire que ce type d'IDE n'a pas été
affluant jusqu'à présent : citons notamment le cas de Titan
Corporation (USA)' Afronetwork Bénin (1998)'
Profco Resources (Canada) et Tarpon-Bénin (1997).
A l'analyse' le type d'IDE dominant aujourd'hui au
Bénin est la fusionacquisition.(cf annexe 2) alors que le type d'IDE
pouvant amorcer efficacement le développement est la création
d'unités de productions.
Section II : IMPACTS DE LA PENETRATION DE L'IDE SUR LA
SITUATION
MACROECONOMIQUE DU BENIN
L'IDE est relativement important au Bénin. Il faut
mentionner qu'en 2000' le ratio des stocks d'IDE représentait
28'8% du PIB. Le poids relativement faible de l'IDE (et son
départ tardif) dans le processus de création de richesse au
Bénin est dû au fait que le seul secteur qui a
bénéficié de manière substantielle des IDE reste le
secteur secondaire' lequel représente seulement 14% du
PIB.
Toutefois cela n'empêche pas d'observer quelques effets sur
le capital et l'investissement national' sur le transfert de
technologie et de compétence.
Paragraphe 1 : Effets sur le capital et l'investissement
national
Depuis la mise en place du programme de réforme
économique et de privatisation' le taux d'investissement
national brut est passé de 13'4% à 18'8% du
PIB (voir tableau 3). Parallèlement' le taux d'épargne
a connu une légère amélioration : entre 1995 et
2000' il oscillait entre 6'7% et près de 6% du PIB
soit un taux très faible' trop faible même pour assurer
à long terme un taux d'investissement de 18'9%. Ce sont donc
les IDE' l'Aide Internationale et les transferts monétaires
qui ont financé cette différence entre l'épargne et
l'investissement au niveau national.
Tableau 3 : Taux d'épargne et taux d'investissement
bruts au Bénin
|
Taux d'épargne brut
|
Taux d'investissement brut
|
|
1985
|
1990
|
1995
|
2000
|
1985
|
1990
|
1995
|
2000
|
|
Bénin
|
-4'1
|
2'2
|
6'7
|
8'7
|
8'7
|
13'4
|
17'2
|
18'9
|
|
Moyenne
africaine
|
18'7
|
18'5
|
16'7
|
19
|
19
|
19'4
|
17'6
|
18'5
|
Source : Banque Mondiale' Indicateurs du
développement dans le monde 2003
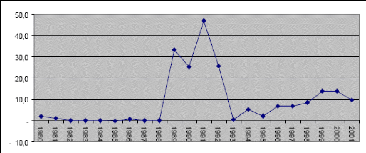
L'observation des flux d'IDE en pourcentage de la formation
brut du capital fixe nous indique qu'ils ont été très
importants dans les premières années de privatisation'
représentant jusqu'à quarante sept pour cent ( 47%) du total en
1991. Depuis' ce chiffre a nettement diminué' se
situant aux alentours de huit à neuf pour cent (8 à 9%).
Graphique 3 : Le flux d'IDE en pourcentage de la formation
brute de capital fixe
Source : Rapport, 2005, sur l'investissement
étranger direct au Bénin / CNUCED
Le taux d'épargne national étant faible et le
pays dépendant des transferts de capitaux étrangers pour assurer
son niveau d'investissement actuel' l'IDE pourrait contribuer
beaucoup plus à réduire la sujétion du Bénin
à l'aide internationale.
Paragraphe 2 : Effet sur le transfert de technologie et de
compétence
Les opportunités liées aux transferts de
technologie représentent un des effets directs associés aux
entrées des IDE. Il faut cependant considérer la capacité
d'absorption du pays d'accueil. Or dans le cas du Bénin' elle
demeure très limitée : niveau d'éducation faible et le
taux d'illettrés approche de soixante pour cent (60%) (Enquête de
la CNUCED 2003).
D'après le rapport de la CNUCED sur la politique
d'investissement au Bénin (2005)' la mise en oeuvre des
droits de propriété intellectuelle'
élément primordial
pour favoriser le transfert de technologie au secteur
privé local' demeure problématique au Bénin
malgré la ratification de l'Accord des Droits de Propriété
Intellectuelle et liée au Commerce (ADPIC) dans le cadre de l'OMC.
A la lumière de ces considérations'
les flux entrants d'IDE semblent avoir eu un impact limité pour ce qui
est du transfert de technologie et de compétence au
Bénin' à l'exception du secteur des nouvelles
technologies de l'information et de la communication (NTIC) ' et du secteur
bancaire où le phénomène a été plus
marqué.
Nous pouvons dire aussi que l'entrée d'IDE a
sûrement eu des répercutions positives sur l'économie
béninoise. Mais du fait que ce soit le secteur secondaire qui ait
enregistré la majeure partie des IDE entrants alors qu'il ne
représente que quatorze pour cent (14%) de l'économie'
l'impact des IDE est alors négligeable.

NVESTISSEMENTS ETRANGERS DIRECTS AU BENIN
ANALYSE DES FACTEURS DETERMINANT LES
Deuxième partie :

CHAPITRE III : CAUSES DE LA FAIBLE PENETRATION D'IDE AU
BENIN
La stratégie générale de toute entreprise
repose pour l'essentiel sur l'analyse de l'environnement. C'est ainsi que la
conduite d'un projet nécessite des enquêtes dans plusieurs
domaines : marché' technologie'
financement' gestion et collaboration de différentes
personnes physique et morales (promoteurs ; organisme de promotion et
d'assistance ; établissements financiers ; services administratifs).
Nous développerons dans ce chapitre les causes pouvant
expliquer la faible pénétration des IDE au Bénin. Nous
retenons les entraves structurelles et socioculturelles.
Section I : FACTEURS DE BLOCAGE DES IDE AU BENIN
Nous nous servirons de l'arbre à problèmes comme
outil d'analyse.
Ensuite il sera question dans cette section d'analyser les
facteurs économiques et les facteurs socioculturels.
Elaboration de l'arbre des problèmes

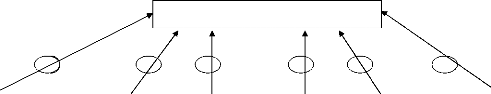
Faible pénétration des flux d'IED au
Bénin
1 2 3 4 5 6
|
Cadre
|
Inadéquation des
|
Méconnaissance
|
Coût total élevé
|
Faiblesse d
|
Environnement socio-
|
|
d'investissement
|
infrastructures de
|
des atouts
|
des facteurs de
|
tissu
|
politique de la sous région
|
|
peu favorable
|
base
|
naturels du Bénin
|
production
|
industriel
|
peu favorable
|

- Procédure d'octroi d'agrément lourde ;
- Difficultés d'accès au foncier ;
- Multiplicité des
organismes d'assistance et de promotion des IDE ;
- Système juridictionnel peu fiable ;
- Mauvaise gouvernance.
|
Non développe-
|
- Développement
|
- Peu d'unités de
|
|
- Guerre ;
|
|
ment des
centres de
|
du secteur informel ;
|
transformation ; - Dépendance de
|
|
- Crises politiques .
|
|
recherche
|
- Quasi-absence de
|
monoculture :
|
|
|
|
matières premières ;
|
le coton.
|
|
|
|
|
|
-Non développement du secteur transport
|
|




Faiblesse
d'investissements
publics

Diagramme 1 : Arbre des problèmes Source
:Réalisé par l'auteur
Paragraphe 1 : Facteurs économiques
A- Coût des facteurs de production
La création ou la délocalisation d'entreprises ou
filiales est motivée par la recherche de coûts de production
faibles.
Dans les pays de l'UEMOA en général et en
particulier le Bénin' il s'avère que les coûts
de production sont plus élevés qu'en Europe et en
Asie' Abbo K.B.(1994)' et cela est dû à
plusieurs facteurs qui lorsqu'ils sont regroupés' produisent
un coût total élevé. Ces facteurs sont très
diversifiés :
- les transports ;
- les équipements et matières premières ;
- les services d'utilité publique ;
- la faible productivité de la main d'oeuvre.
1. Les équipements et matières
premières
L'économie béninoise est tributaire d'un seul
produit d'exportation : le coton. Le coton occupe 80 % dans l'exportation
totale. Moins de 10% du coton béninois est transformé au
Bénin. A la lumière de ces considérations les
investisseurs étrangers dans le secteur de transformation sont
obligés de recourir au marché international pour acquérir
des matières premières. Ce qui induit un coût
supplémentaire dans l'acquisition des facteurs de production. Le
Bénin importe pratiquement tout l'équipement
industriel' agricole et informatique.
2. Faible productivité de la main d'oeuvre
La comparaison salariale d'un ouvrier français par
rapport à un ouvrier béninois montre que le salaire d'un ouvrier
français vaut les salaires de six ingénieurs' de dix
techniciens' de quatorze ouvriers qualifiés et trente sept
ouvriers béninois.
Si l'on considère que le salaire est fixé par la
productivité marginale du travail on est amené à dire que
la main d'oeuvre étrangère est plus qualifiée que celle
du
Bénin. L'investisseur privé importera donc la main
d'oeuvre étrangère. Ce qui augmente le coût des facteurs de
production.
B- La faiblesse du tissu industriel
Le niveau industriel est une composante dans la
captivité des IDE. Le secteur agricole est essentiellement dominé
par le coton qui est à l'origine de presque 80% de la valeur totale des
exportations. Seulement 20 % est transformé. Dans la politique de
diversification' d'autres produits ont été promus : le
riz' le manioc' le mais et la noix de cajou.
Cependant' plusieurs obstacles limitent la
production et la transformation de ces cultures. Il s'agit principalement de
difficultés liées au manque d'installation industrielle. Par
ailleurs la faiblesse du tissu industriel est liée à la
pauvreté du pays en ressources géologiques (mine'
pétrole) et à la taille réduite du marché local.
Quand à l'industrie légère de transformation'
son développement est annihilé par la taille réduite du
marché local et par la surproduction observée au Nigeria.
C- L'accès au marché
La population béninoise est d'environ 7 millions
d'habitants. La faiblesse du pouvoir d'achat rend le marché
béninois étroit. De plus' le secteur informel
dominé par le commerce de réexportation' rend peu
compétitive une entreprise installée en toute
légalité. Les acteurs du secteur informel échappent
à la fiscalité. Pour maintenir les niveaux du revenu tout en
respectant les obligations fiscales et salariales en vigueur' la
seule possibilité qui s'offre aux petites entreprises est d'augmenter
les prix du même montant que les charges fiscales (soient 30 % en
moyenne). Ces limites structurelles constituent une barrière à
l'accessibilité du marché Béninois.
Toutefois' le Bénin est signataire de
plusieurs accords régionaux et multinationaux dans le cadre commercial :
Accord de régime préférentiel des échanges au sein
de l'UEMOA' les accords de l'OMC' l'accord de partenariat
ACPUE' et l'AGOA. Le marché de l'UEMOA devrait être
stimulant à l'IDE. Or la sous-
région est caractérisée par des crises
politiques qui influencent négativement le risque pays.3 La
Côte d'Ivoire a un risque pays très élevée ; alors
qu'elle contribue pour 40 % du PIB de l'UEMOA. Par l'effet de tâche
d'huile la crise pourrait influencer négativement le climat des affaires
au Bénin.
En somme' la taille réduite du marché
Béninois' la faiblesse du pouvoir d'achat' le
secteur informel et la crise politique en Côte d'Ivoire constituent des
obstacles l'entrée massives des IDE.
Tableau 4 : Niveau du risque pays dans certains Etats
africains
|
A
Risque faible
|
B
Risque modéré
|
C
Risque important
|
D
Risque élevé
|
|
Afrique du sud
Botswana
Tunisie
|
Algérie
Bénin
Sénégal
|
Angola
Mozambique
Tanzanie
|
Nigeria
Côte d'Ivoire
Zimbabwe
|
Source : Coface 2002

D- Les infrastructures
Le niveau de développement des infrastructures de
transport et de communication influence significativement les choix des
opérateurs privés internationaux qui souhaitent mettre en place
de nouveaux projets d'investissement. Ainsi' les retards qui
caractérisent le Bénin en matière
d'infrastructures' surtout en matière de fourniture de
services d'utilité publique' pouvaient être un frein
à l'investissement privé.
1. Routes et chemins de fer
En ce qui concerne les infrastructures de
transport' le Bénin enregistre des retards
considérables par rapport aux pays de la région'
notamment le Niger' la Côte d'Ivoire et le Togo (tableau 5).
En effet' une étude réalisée par le CNUCED en
2005
3
Le risque pays est composé du risque politique et du
risque systémique lié au marché. L'appréciation est
faite par les agents de notation tels que la COFACE et EUROMONEY.
montre que les routes sont médiocres et le
réseau ferroviaire est vétuste. Le réseau routier
béninois est médiocre' 20 % des routes sont
goudronnées sur 6787 km de réseau routier. Les services de
transports sont organisés à 90 % par des sociétés
individuelles avec de petits véhicules dans des circonstances non
confortables. La durée moyenne pour relier deux grandes villes du Nord
au Sud (Cotonou- Parakou) distantes de 430 km est de cinq heures. Le faible
niveau de développement des transports augmente un coût
supplémentaire aux sociétés transnationales dans leurs
transactions à distance.
Par ailleurs ' le réseau ferroviaire ne répond
plus aux besoins actuels de
l'économie nationale' en
raison notamment de la vétusté de la voie ferrée de 438
km
qui relie les deux villes du pôle Sud et du pôle Nord que
sont Cotonou et Parakou.
Tableau 5 : Comparaison de l'infrastructure de transport
dans certains pays de l'Afrique
de l'Ouest (2004)
7
Facteurs
|
Bénin
|
Togo
|
Nigeria
|
Burkina
Faso
|
Côte
d'Ivoire
|
|
Longueur du réseau
ferroviaire en km
|
578
|
525
|
3557
|
622
|
660
|
|
Chemin de fer en km au
km2
|
0.005
|
0.009
|
0.004
|
0.002
|
0.002
|
|
Longueur du réseau
routier en km
|
6787
|
7520
|
194394
|
12506
|
50400
|
|
Routes en km au km2
|
0.006
|
0.13
|
0.21
|
0.05
|
0.16
|
|
Routes goudronnées en %
|
20
|
32
|
31
|
16
|
10
|
|
Nombre d'aéroports
goudronnés
|
1
|
2
|
36
|
2
|
|
Source : Central Investigation Agency' 2004.
2. Télécommunications
En matière d'infrastructures de
télécommunications' le Bénin se classe au
dessus de la moyenne en Afrique de l'Ouest. En effet' par rapport au
nombre de lignes téléphoniques fixes' de
téléphones portables' de fournisseurs de services
Internet et d'utilisateurs de l'Internet' seule la Côte
d'Ivoire a un taux de pénétration plus élevé.
Cependant' les opérateurs dénoncent les
difficultés et les lenteurs dans l'activation de lignes
téléphoniques fixes. Le coût de la communication reste
encore cher au Bénin comparativement aux coûts pratiqués
dans les autres pays de la sous région. Le coût
élevé de la communication augmente le coût de production
total. Ce coût élevé a ainsi un impact négatif sur
la pénétration des IDE.
3. Les services d'utilité publique
La distribution des services d'utilité publique (eau
et électricité) est médiocre dans l'ensemble du pays. Le
coût de l'électricité est élevé (95fcfa/kWh)
et les fortes variations du courant électrique entraînent des
dommages aux installations des opérateurs privés. L'addition des
coûts de ces facteurs entraîne un coût total
élevé des facteurs de productions.
4. Port et aéroport
Le port de Cotonou est l'une des principales sources de
revenus de l'économie béninoise. Cependant' le port
souffre de problèmes de corruption et d'insécurité.
En outre' en observant les indicateurs de
productivité de la manutention au port sur la période
2000-2002' on constate que le nombre de conteneurs sortis par heure
est de 19 en moyenne. La durée de stationnement est de 17 jours en
moyenne. La baisse de la productivité de la manutention au port retarde
les opérations de transactions des sociétés
transnationales. Ainsi' la mauvaise organisation de l'infrastructure
portuaire est un obstacle majeur à l'entrée des IDE.
Tableau 6 : Indicateurs de productivité de la
manutention au port de Cotonou.
|
2000
|
2001
|
2002
|
|
1. Conteneur par heure
|
|
|
|
|
SOBEMAP
|
23
|
18
|
16
|
|
Maersk (COMAN)
|
22
|
18
|
17
|
|
Bolloré (SMTC)
|
20
|
20
|
16
|
|
2. Durée moyenne de stationnement
|
|
|
|
|
SOBEMAP
|
15 jours
|
18 jours
|
18 jours
|
|
Maersk (COMAN)
|
12 jours
|
20jours
|
22 jours
|
|
Bolloré (SMTC)
|
12 jours
|
21 jours
|
18 jours
|

Source : Port autonome de Cotonou' 2002.
Notons aussi le manque de fluidité des corridors de
transit.
Par ailleurs' les formalités de passage des
marchandises sont les plus lourdes dans la Sous-région et constituent un
handicap pour la compétitivité du corridor béninois .4
Paragraphe 2 : Facteurs socioculturels
Nous analyserons le capital humain et les comportements
administratifs.
A- Capital humain
Le niveau de formation des ressources humaines et le
développement des capacités d'entreprenariat de la population
sont des composantes de tout choix de localisation des IDE. Le Bénin
semble toutefois caractérisé par des retards significatifs dans
ces domaines.
En effet' sur une population de 7'25
millions d'habitants' la main-d'oeuvre active de 2'8
millions de personnes est l'une des plus petites en Afrique de l'Ouest. Et
le
4 Rapport de la CNUCED ; examen de la politique
d'investissement au Bénin ; 2005, p.87
pays enregistre un taux de croissance démographique de
2'7 %' Rapport BCEAO'(2005).
En ce qui concerne le niveau d'éducation et de
formation des ressources humaines' le taux d'alphabétisation
de la population (40'9 %) est inférieur de 10 à 30 %
par rapport aux autres pays de la région. De plus l'accès
à l'enseignement secondaire est également très faible (18
%) et les travailleurs spécialisés demeurent rares'
tout particulièrement dans les secteurs techniques5.
Tableau 7 : Ressources humaines dans certains pays
d'Afrique de l'Ouest (2002-2003)
|
Facteurs
|
Bénin
|
Togo
|
Nigeria
|
Burkina Faso
|
Côte d'Ivoire
|
|
Population (2002 ; en millions)
|
6'5
|
4'7
|
132'8
|
11'8
|
16'5
|
|
Age 15-64 (2002) en %
|
51'8
|
53'2
|
53'7
|
51'1
|
52'6
|
|
Espérance de vie (2002) en années
|
53
|
50
|
45
|
43
|
45
|
|
Taux d'alphabétisation des
adultes (2003) en %
|
40'9
|
60'9
|
68
|
26'6
|
50'9
|
Sources : Central Investigation Agency' 2004 ;
Banque Mondiale' Indicateurs d développement dans le monde
2004
B- Gouvernance
La corruption est un facteur qui influence négativement
l'entrée des IDE. En
effet' le Bénin perd annuellement 75 millions
de dollars soit 50 milliards de FCFA.6
L'économie du pays est donc fragilisée par les
pratiques non transparentes de l'administration publique et par la
corruption' ce qui constitue un frein à la réalisation
des programmes de luttes contre la pauvreté et de sérieuses
contraintes au développement des entreprises nationales et
transnationales.
5 Selon une enquête réalisée par
la CNUCED, 2005.
6 Selon une étude réalisée par
Transparency International, juillet 2003. Le rapport fait
référence aux privatisations dans le secteur pétrolier,
précisément le cas de la SONACOP.
Graphique 4 : Facteurs de gouvernance qui ont un effet
négatif sur les affaires (pourcentage)
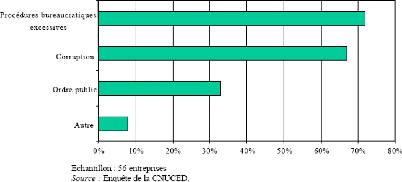
Le port de Cotonou' les douanes'
l'appareil judiciaire ainsi que les procédures d'attribution des
marchés publics sont les secteurs les plus affectés par ce
phénomène.
En effet les opérateurs privés au Bénin
identifient tous le manque de transparence' le pouvoir
discriminatoire de l'administration publique et la complexité des lois
et des règlements comme les obstacles majeurs à l'investissement
au Bénin.?
C-Meconnaissance des atouts naturels
Le Bénin possède des potentialités en
matière de ressources naturelles. Cependant ces atouts sont pendant
longtemps restés marginalisés à la différence
d'autre pays de la région. Le Bénin a un certain nombre de
ressources minières notamment l'or' le minerai de
fer' de phosphate' le marbre' le
diamant' le kaolin' le gravier et le pétrole etc.
Le secteur minier bénéficie d'un seul centre de recherche
l'Office Béninois de Recherche Géologique Minière (OBRGM)
qui du fait de ses moyens très limités ne peut publier le fruit
de ses recherches. Par ailleurs les atouts du secteur agricole sont peu
connus' du fait qu'il y ait peu de structures de recherche
outillées dans ce domaine. En outre l'industrie du
tourisme au Bénin est dans la phase initiale de son
développement. Malgré ses richesses historiques et naturelles qui
pourraient attirer un nombre considérable de touristes' il
existe un manque d'encadrement des firmes privées et un déficit
d'image du pays auprès des touristes étrangers'
surtout en ce qui concerne la sécurité.
Section II : ANALYSE DU CADRE DE L'INVESTISSEMENT
Nous allons étudier les conditions d'entrée et
d'établissement des entreprises et les conditions
générales d'opération des IDE.
Paragraphe 1 : Conditions spécifiques
d'opération des IDE A- Conditions d'entrée et
d'établissement
1. Régime de droit commun
Toute entreprise exerçant son activité au
Bénin' bénéficie des garanties ordinaires et
générales de droit commun en toute matière et plus
spécifiquement' de la liberté commerciale'
de la liberté d'entrée' de séjour et de sortie
pour le personnel expatrié' ainsi que de la liberté de
gestion et de transfert de capitaux.
L'entreprise soumise au droit béninois peut être
exploitée sous plusieurs formes : société unipersonnelle
d'une part' suivant le modèle de la société
anonyme (SA) ou de la société à responsabilité
limitée (SARL)' de la société non collectif
(SNC)' de la société de commandite simple (SCS) et du
groupement d'intérêt économique. Des capitaux minima
légaux de 1600 dollars (1 million de FCFA) et de 16000 dollars (10
million de FCFA) sont respectivement exigés pour la SARL et la SA ; la
libre fixation du capital est de règle pour toutes les autres formes de
société. L'investisseur étranger n'est soumis à
aucune restriction en ce qui concerne la constitution de société
au Bénin.
En outre toute entreprise régulièrement
constituée à l'étranger peut exercer une activité
commerciale au Bénin par l'ouverture d'une succursale dont
l'immatriculation
7 Cette analyse émane d'une enquête
réalisée par la CNUCED avec un échantillon de 56
entreprises.
est requise au Registre de Commerce et du Crédit
Mobilier (RCCM). Les filiales des sociétés transnationales
présentes au Bénin peuvent exercer leurs activités pour
une période unique de deux ans' au terme de laquelle elles
devront soit être liquidées' soit être
apportées à une société de droit béninois
existante ou à créer.
Les formalités de création et de constitution
des sociétés sont effectuées auprès du Centre de
Formalité des Entreprises (CFE)- dit « guichet unique »- qui
organise et prend en charge toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations compétentes dans un délai
maximum de 10 jours. Toutefois' dans la pratique' ce
délai est difficilement respecté' 20 jours constituant
le délai moyen pour la bonne fin des formalités de constitution
de sociétés.
2. Procédure d'octroi des régimes
privilégiés et de contrôle des investissements
Le code des investissements prévoit des régimes
privilégiés et un régime spécial. Les
régimes privilégiés' au nombre de
trois' sont le régime A ou régime de la petite et
moyenne entreprise' le régime de la grande
entreprise' et le régime C ou régime de la
stabilisation fiscale.
L'octroi du régime privilégié
(A' B ou C) résulte d'un agrément prononcé par
voie de décret du gouvernement sur proposition et avis de la Commission
Technique des Investissements (CTI)' qui précise les droits
et les obligations de l'entreprise agréée.
S'agissant du régime spécial'
l'agrément résulte d'une procédure simplifiée
prononcée par arrêté interministériel. Tout
différend entre l'administration et l'entreprise agréée
est réglée par une commission interministérielle et peut
faire l'objet d'une procédure d'arbitrage devant un collège
arbitral dont le choix des membres est libre.
En conclusion' la procédure d'octroi des
agréments des investissements est lourde car elle est soumise à
autorisation préalable de l'administration publique' qui
prend la forme de décrets pris par le gouvernement sur proposition et
avis de la CTI.
La parution des décrets d'agrément peut prendre
beaucoup de temps. Cette procédure tatillonne' peut ralentir
sensiblement les flux entrants d'IDE au Bénin. De plus étant
donné l'absence de transparence des décisions rendues par les
juridictions nationales et le manque de préparation des juges en
matière de droit des affaires' la procédure
d'arbitrage entre l'administration publique et l'investisseur privé
visant è trancher les litiges portant sur les agréments ne semble
pas un instrument permettant de sauvegarder les intérêts des
opérateurs étrangers privés.
B-Les acteurs nationaux et les privatisations
1. Les organismes de promotion, de facilitation et de soutien
des investissements
Divers organismes et institutions sont chargés de
l'incitation' de la promotion et de facilitation des
investissements. Les cinq plus importants sont le CPI' le
CFE' la DASP' l'OBOPAF et le CIPB.
L'analyse de ces institutions montre qu'il y a un manque de
coordination de leurs objectifs qui sont parfois concurrentiel. Cela fragilise
la réalisation des projets d'investissements et leur suivi. Le CPI
pourrait donc ainsi devenir le véritable interlocuteur
privilégié des investisseurs éligibles au terme du code
des investissements.
2. Privatisations
Un vaste programme de dénationalisation et de
privatisation a été entrepris dans le cadre de la loi N 92-023 du
6 août 1992 qui défini les principes de la de nationalisation et
des transferts de propriétés d'entreprises du secteur publique au
secteur privé.
Différentes procédures de privatisation ont
été utilisées' à savoir la location-
gérance' la cession d'actifs' les participations
au capital' etc.' sans que des règles techniques
précises aient été arrêtées. Les
opérateurs privés étrangers ont en principe le droit de
reprendre la totalité du capital d'une entreprise privatisée.
Dans des cas spécifiques' toutefois' par exemple
lors de la privatisation des cimenteries de
la SCB et de la SONACI et de la brasserie La Béninoise
(annexe 1)' un certain pourcentage du capital a été
réservé aux nationaux (moins de 25%) et aux salariés de
l'entreprise (moins de 5%). Le secteur privé local a participé
activement au processus de privatisation' surtout à partir de
1993: la COBENAM (navigation)' la SOTRAZ (transport)'
l'usine de noix de cajou de Parakou' la SONACOP (commercialisation
des produits pétroliers) et le centre de stockage de pétrole brut
de Sèmè-Kraké' etc.' ont
été repris par des nationaux.
Les décisions en matière de privatisation se
prennent au niveau politique (rapport de la CNUCED sur la politique
d'investissement au Bénin' 2005' P26)
Les processus des privatisations au Bénin ont
été caractérisés par les retards sur le calendrier
fixé par les autorités' les lacunes du système
juridique et fiscal et la mauvaise gouvernance.
De plus' selon un rapport publié en juillet
2003 par Transparency International' la privatisation de la SONACOP
semble avoir été effectuée dans des conditions de faible
transparence.
A la lumière de ces considérations'
nous pouvons dire que le processus de privatisation au Bénin n'est pas
du genre à faciliter l'entrée massive des IDE au Bénin.
Notons également qu'aucune privatisation d'entreprise béninoise
n'a été encore faite par le biais du marché financier
régional' la BRVM.
3. Système juridictionnel - Règlement des
différents en matière commerciale
Le fonctionnement du système juridictionnel
béninois représente un des obstacles majeurs à
l'investissement privé. Le problème principal pour les
investisseurs opérant au Bénin semble être
l'indépendance des juges et la transparence de leurs décisions.
En effet plusieurs cas de conflits se sont présentés ces
dernières années. Selon l'enquête menée par la
CNUCED auprès des investisseurs privés étrangers
présents au Bénin' ces derniers sont
préoccupés par la possibilité d'exercer leurs droits
légitimes' en particulier en ce qui concerne les
différents en matière de propriété
du foncier et de paiements des licences découlant de l'utilisation de
services (téléphonie mobile) et de certains droits de
propriété intellectuelle.
Un problème fondamental du cadre d'investissement au
Bénin est le manque de spécialisation et de formation
professionnelle des juges en matière de droit
économique' droit des affaires et des méthodes
alternatives des règlements des litiges. Celles-ci'
l'arbitrage en particulier' sont des systèmes très
adaptés à la résolution des litiges commerciaux : elles
réduisent en effet le temps de solution d'un différend et
contribuent au maintien de bonnes relations des parties.
Paragraphe 2 : Conditions générales
d'opérations des IDE
A- La fiscalité
La pression fiscale sur les entreprises béninoises se
situe dans la moyenne des impositions pratiquées dans
l'UEMOA' mais est élevé par rapport au niveau de
développement du pays. En particulier la TVA et l'impôt sur les
sociétés semblent pénaliser les opérateurs
privés. Le remboursement de l'avance sur TVA (drawbacks) est assez rare
' ce qui produit des effets négatifs sur l'activité des
sociétés transnationales au Bénin. On peut dire que les
sociétés transnationales supportent une fiscalité peu
compétitive par rapport aux autres pays de la sous
région' notamment le Sénégal et la Côte
d'Ivoire qui demeurent les principaux hôtes d'IDE de l'UEMOA.
Tableau 8 : Fiscalité dans les pays de l'UEMOA en
pourcentage.
|
Pays
|
Impôts sur le revenu
|
Impôts sur les dividendes
|
TVA
|
|
Bénin
|
38
|
18
|
18
|
|
Côte d'Ivoire
|
30
|
10
|
15
|
|
Mali
|
35
|
10
|
18
|
|
Sénégal
|
35
|
10
|
18
|
|
Burkina Faso
|
35
|
25
|
18
|
|
Guinée Bissau
|
35
|
25
|
18
|
|
Togo
|
40
|
20
|
18
|
|
Niger
|
42.5
|
18
|
19
|
Source : Rapport' 2003'sur l'investissement
étranger direct au Bénin/ CNUCED.
En matière fiscale' il convient de citer les
vastes marchés informels d'importation et de réexportations de
produits de toutes natures en direction surtout du Nigeria voisin. Ces produits
frauduleux se trouvent bien souvent sur le marché béninois et
constituent une concurrence déloyale pour tout opérateur
économique respectueux de la légalité.
B-Droit foncier
La propriété foncière au Bénin est
régie par la loi n°65-25 du 14 Août 1965. La
propriété du foncier urbain et rural est libre sans distinction
de nationalité. Toutefois il existe un droit coutumier béninois
qui autorise le permis d'habiter et le titre provisoire délivré
par l'administration dans l'attente de l'immatriculation de la parcelle mise en
valeur par le bénéficiaire du permis d'habiter. Ainsi'
l'existence de droits dits coutumiers régissant la grande partie des
terrains au Bénin représente un obstacle majeure à la
sécurité des droits de propriétés et donc à
tout investissement privé. Au contact de l'urbanisation' une
sorte de propriété coutumière moderne s'est
développée' qui ne donne pas lieu à un
véritable titre de propriété au sens juridique dans la
mesure où elle n'est pas reconnue par le droit positif8.
8 C'est l'ensemble des lois et règles
juridiques en vigueur dans un Etat donné ou dans la communauté
internationale, à un moment donné quelque soit leur source.
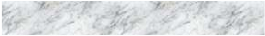
CHAPITRE IV : APPROCHES DE SOLUTIONS
Nous allons dans ce chapitre' faire ressortir les
conclusions de notre analyse ; vérifier les
hypothèses' et trouver des solutions pour une
amélioration des flux entrants d'IDE au Bénin.
Section 1: SYNTHESE DES RESULTATS
Paragraphe 1 : Vue d'ensemble des solutions
A- Résumé de l'analyse
La stabilisation du cadre macroéconomique et la mise en
oeuvre du programme de réforme et de libéralisation de
l'économie ont permis au Bénin d'enregistrer au début des
années 90 des performances remarquables de flux entrants d'IDE.
Cependant dès 1994 ; ces résultats se sont vite estompés ;
les réformes engagées par les autorités béninoises
d'alors ne semblent pas avoir été suffisantes pour
pérenniser l'IDE. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : les
lacunes du système juridictionnel' les problèmes de
transparence et de gouvernance de l'administration publique' les
retards dans le développement des infrastructures' la
faiblesse du tissu industriel' coût total élevé
des facteurs de production' la méconnaissance des atouts
naturels du Bénin' le poids du secteur informel'
et les crises politiques dans la sous région. Au regard de ce qui
précède nous observons que nos hypothèses émises se
vérifient à travers notre analyse.
C'est ainsi qu'après cette analyse nous avons
envisagé des solutions pour résoudre les problèmes
auxquels le Bénin est confronté en matière d'attraction
d'IDE.

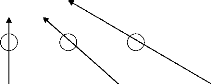
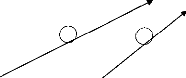
B- Elaboration de l'arbre des solutions
Forte pénétration des flux d'IDE au Bénin
6 8 9 B 5 ;

Cadre
d'investissement
favorable
Développement
des infrastructures
de base
Connaissance des
atouts naturels du
Bénin

Baisse du coût
de production
des facteurs
Développement
du tissu
industriel
Environnement
socio-politique de la
sous - région
favorable
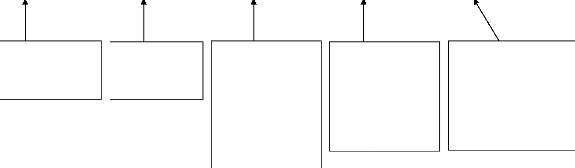
Fort taux d'investissements publics
|
Développement
|
- Développement
|
- installation
|
- Paix ;
|
|
des centres de
|
du transport ;
|
d'unité de
|
- Apaisement des
|
|
recherche
|
- Production des matières
premières ;
- Régularisation du secteur informel.
|
transformation ;
- Indépendance de monoculture : le coton.
|
crises politiques ;
|
|
|
- Procédure d'octroi d'agrément simple ;
- Facilité d'accès
au foncier ;
- Coordination des organismes d'assistance et de promotion des
IDE ;
- Système juridictionnel et judiciaire fiable ;
- Bonne et jgouvernance.
Diagramme 2 : Arbre des solutions Source :
Réalisé par l'auteur
Paragraphe 2 : Les solutions spécifiques
A- Approches de solutions liées aux problèmes du
cadre d'investissement
Moderniser le cadre d'investissement est une option essentielle
pour le rendre plus favorable aux IDE. Pour se faire' elle passe par
sept étapes :
a- Accélérer la réforme foncière
; améliorer la sécurité foncière du tenancier et
sécuriser l'acheteur en appliquant les textes légaux du droit
foncier. Cette solution consiste à mettre en oeuvre une publicité
effective des lois et règlements relative à l'accès au
foncier' à former des magistrats spécialisés en
droit des affaires et de renforcer le système judiciaire en rendant plus
indépendants les juges des tribunaux.
b- Appliquer l'arsenal des textes légaux
réglementaires existants relatifs à l'investissement.
c- Réviser le code des investissements de 1990 en ce qui
concerne l'octroi d'agrément.
d- Réformer la politique fiscale aujourd'hui
pénalisante pour les entreprises. Pour se faire il faut simplifier les
procédures et les réglementations relatives au délai de
remboursement des avances de la TVA faites par les sociétés
transnationales et réduire la pression fiscale en assainissant le
secteur informel.
e- Garantir la formation professionnelle en matière
d'investissement et la mise à niveau du personnel de
l'administration' en particulier des juges.
f- Améliorer la transparence du processus de
privatisation. Nous suggérons que les privatisations se fassent via le
marché boursier'( la Bourse Régional des Valeurs
Mobilières)' de l'UEMOA. Cela enlève toute main
politique dans le processus de privatisation.
g- Créer un organisme qui va regrouper la
CCIB' l'OBOPAF et le CPI afin qu'il y ait une coordination des
activités de ces différents organismes.
B- Approches de solutions liées au problème de
l'inadéquation des
infrastructures de base
Afin d'augmenter les flux entrants d'IDE' les
autorités béninoises doivent :
a- Rationaliser l'utilisation des fonds provenant de l'aide
publique internationale destinée aux infrastructures ;
b- Exploiter de manière plus efficace le port de
Cotonou en tant que catalyseur des IDE' au moyen de la mise à
niveau de sa gestion et de son fonctionnement. Il s'agit à ce niveau
d'accorder une plus grande autonomie fonctionnelle à ses dirigeants ;
supprimer progressivement l'inspection obligatoire des conteneurs en transit et
simplifier les procédures administratives à travers le
renforcement du guichet unique.
c- Associer des opérateurs privés étrangers
via des contrats de type CET/BOT à la réalisation des centrales
électriques.
C- Approches de solutions liées à la mauvaise
gouvernance.
Le gouvernement béninois devrait pour palier au
problème de gouvernance :
a- Intensifier son programme de lutte contre la corruption par
des actions d'envergure en direction des services administratifs sur lesquels
pèsent les soupçons.
b- Promouvoir la bonne gouvernance au niveau de
l'administration publique à travers la revalorisation des salaires du
personnel et le renforcement des contrôles et des sanctions en cas de
violation des règlements et corruption.
c- Améliorer la transparence des privatisations des
entreprises encore sous contrôle de l'Etat via le marché financier
régional ou via les appels d'offre ouverte internationale. On pourrait
aussi prendre ces mesures ci-après :
· sélectionner les agents pour leur «
honnêteté » et leur « capacité » ;
· modifier les récompenses et
pénalités qui s'offrent aux agents et usagers de l'administration
publique ;
· rassembler et analyser les informations afin d'augmenter
les chances de détection de la corruption ;
· restructurer les rapports chef-agent-usager afin
d'éliminer la conjugaison d pouvoir exclusif' du pouvoir
discrétionnaire et d'une insuffisante responsabilité ;
· changer les attitudes à l'égard de la
corruption.
D- Approches de solutions liées à la
méconnaissance des atouts naturels du Bénin

Afin d'augmenter les IDE entrant' les autorités
béninoises doivent :
a- Créer et renforcer les centres de recherche en
dotations matérielles et financières. b- Promouvoir ou «
vendre » le Bénin en faisant connaître ses divers
atouts' sur des CD-ROM par exemple et des pages publicitaires sur
les pages web.
E-Approches de solutions liées au coût
élevé des facteurs de production
Afin d'attirer plus d'IDE' les autorités
Béninoises doivent réguler le secteur informel par une campagne
de sensibilisation à la légalité. Afin d'attirer les
investissements étrangers' les autorités
béninoises devraient :
- Renforcer la formation primaire' parmi les jeunes
et les femmes.
- Favoriser la création de centres de formation et de
spécialisation afin d'améliorer les capacités techniques
du personnel des sociétés transnationales présentes au
Bénin ;
- Améliorer les services d'utilité publique tels
que le transport' l'eau'
l'électricité' le téléphone.
Section II : MISE EN OEUVRE DES SOLUTIONS
Paragraphe 1 :Elaboration d'une politique proactive pour
promouvoir les IDE
Les politiques de promotion de l'IDE devraient être
élaborées au niveau gouvernemental sur la base de
l'identification des avantages concurrentiels.
Une stratégie proactive de promotion de l'investissement
devrait faire l'objet de deux étapes lors de son élaboration :
a- L'analyse des secteurs dans lesquels le pays
bénéficie d'un avantage compétitif ; dans ce
contexte' les objectifs de chaque secteur devraient être
définis en relation avec le nombre de projets d'investissement
étrangers que le pays envisage d'attirer pendant une année
donnée ;
b- Le ciblage des investisseurs potentiels dans les secteurs
potentiels qui sont en mesure de mettre en place des projets concrets.
Paragraphe 2 : Faisabilité des solutions
La réalisation des différentes solutions
trouvées n'est possible que si certaines conditions préalables
sont remplies. En effet' la promotion des IDE doit d'abord
être une préoccupation et une priorité pour le gouvernement
à tel enseigne que le gouvernement y met les moyens humains'
matériels et financiers.
Aussi' le CPI doit jouer un rôle
prépondérant dans la promotion des IDE en travaillant en accord
avec les autres organismes chargés de promouvoir eux aussi les IDE.
En ce qui concerne l'environnement
socioéconomique' une campagne de sensibilisation doit
être faite en direction des syndicats et de l'opinion publique que la
promotion des IDE doit être collégiale.
En outre' le Bénin doit préserver
davantage sa position de pays politiquement stable. Il en est de même
pour la croissance économique actuelle.
Enfin' le Bénin ne pourrait mettre en
application ces solutions si les pays de la sous région sont dans des
crises politiques et de guerres.

CONCLUSION
Au regard de notre analyse sur les difficultés relative
à la faible pénétration des IDE au
Bénin' il ressort que même si la croissance
économique attire les capitaux privés' il est clair
que de nombreuses conditions structurelles et institutionnelles doivent
être satisfaites.
En effet' la stabilisation du cadre
macroéconomique et la mise en oeuvre du programme des réformes et
de libéralisation de l'économie ont permis au Bénin
d'enregistrer au début des années 90 des performances
remarquables de flux entrants d'IDE.
Toutefois' ces flux ont considérablement
baissé à partir de 1995. Plusieurs facteurs expliquent cette
situation : les lacunes du système juridictionnel' les
problèmes de transparence et de gouvernance de l'administration
publique' les retards dans le développement des
infrastructures' la faiblesse du tissu industriel'
coût total élevé des facteurs de production' la
méconnaissance des atouts naturels du Bénin' le poids
du secteur informel' et les crises politiques dans la sous
région.
L'IDE est la forme principale de courants de capitaux
susceptibles d'affluer vers le Bénin' eu égard aux
tendances passées. C'est pourquoi' les conditions doivent
être déployées afin d'accroître les flux entrants
d'IDE au Bénin. Les propositions suivantes portent sur certaines des
conditions qui devraient être remplies :
· La confiance publique et l'efficacité de
l'information ;
· L'efficacité de l'appareil judiciaire ;
· La protection des investisseurs ;
· Une coordination des organismes chargés de
promouvoir l'IDE ;
· La privatisation fondée sur le jeu des
marchés financiers ;
· La création et l'équipement des centres de
recherche ;
· La maîtrise des coûts des facteurs de
production ;
· La formation d'un personnel de maîtrise
qualifié ;
· La mise en place des infrastructures de base.
Enfin' la mise en place de ces conditions se
solderont par une forte pénétration des flux d'IDE. A
l'évidence' les politiques de mise en place de ces conditions
ne seront pas aisées du fait qu'elles nécessitent de grands
moyens financiers' matériels et humains.
Mais nous pensons que progressivement' les
solutions à ces politiques seront trouvées si elles peuvent
être un élément de préoccupation première
pour les décideurs politico - administratifs de notre pays.
BIBLIOGRAPHIE
1. ABBO' K.B.' (1994)'Les
difficultés inhérentes à l'investissement international
dans les PME- PMI : cas de l'Afrique Centrale (UDEAC)' tome
1' Paris : Université de Panthéon'
Sorbonne.
2. API TUNISIE/CPI' (2003)'
Elaboration d'une stratégie de promotion au Bénin'
Bénin.
3. Banque Mondiale' (1965)' Convention
pour le règlement des différends relatifs aux investissements
entre Etats et ressortissants d'autres états (CIRDI/ICSID)'
Washington.
4. BERGSTRAND'
J.H.'(1989)' The generalized gravity
equation' Monopolistic Competition and the Factor proportions
theory in International Trade' The review of Economics and
Statistics' Vol 71' n° 1' pp.143-153.
5. BERNARD Y. et COLLI J-C. (1998) Vocabulaire économique
et financier' 7ème Edition' Editions du
Seuil.
6. BRAINARD' S.L.; (1993)' A Simple
theory of multinational corporations and trade with a trade-off between
proximity and concentration' NBER Working Paper n° 4269.
7. BREMOND' J. et GELEDAN'
A.'(1976)' Dictionnaire des théories et
mécanisme
économiques' Edition Economica.
8. BYE' M. et PERROUX' F.'
(1987)' Relations économiques internationales'
Dalloz.
9. Center for International private Enterprise'
(1992)' Attirer les investissements étrangers'
Washington: USIA.
10. Centre de Promotion des Investissements'
(2000)' Guide de l'investisseur' République
du Bénin.
11. Centre de Promotion des Investissements'
(2000)' Incitations aux Investissements et procédure
d'agrément' République du Bénin.
12. CHEIK' S.D. and All'
(2005)' Rapport sur l'examen de la politique de l'investissement
Bénin' Nations Unies' New York et
Genève.
13.

CHIA' L. et GAYI' S. (1997)'
Trade diversification in Benin: Prospects and Constraints' trade
diversification in LDCs' Edward Elgar Publ. Ltd'
Cheltenham.
14. Commission technique de dénationalisation'
(2003)' Bilan des privatisations' Bénin.
15. Cours constitutionnelle' (1990)'
Loi N 90-002 du 09 mai 1990' République du
Bénin.
16. DUNNING T. H.' (1981)'
International Production and the Multinational Entreprise' Allen
and Unwin.
17. GLAIS' M.' (1975)'
Microéconomie' Edition Economica.
18. HUNYA' G.' (1997)'
Large privatisation' restructuring and foreign direct
investment' in OCDE' lessons from the economic
transition: Central and Eqstern Europe in the 1990's' Kluwer
Academic Publishers.
19. HYMER S.' (1976)' The international
operation of National Firms : A Study of Direct Foreign
Investement' Cambridge' MIT Press.
20. IGUE John O.' (1999)' Le
Bénin et la mondialisation de l'économie : les limites de
l'intégrisme du marché' Edition
Karthala' Paris (France).
21. KARL' P.S. and All'
(2004)' Rapport sur l'investissement dans le monde'
Nations Unies' New York et Genève.
22. MADELEY' J. (1992)' Trade and the
Poor : the impact of international trade on developing
countries' International technology Publications Ltd.
23. MICHALET' C.A et DELAPIERRE'
M.'(1976)' Nationalisation et
internationalisation' stratégies des multinationales
françaises dans «la crise»' Edition
Economica.
24. Ministère des Finances et de l'Economie'
(2003)' Guide d'orientation du créateur
d'entreprise' République du Bénin.
25. Ministère des Finances et de l'Economie'
(2002)' Guide fiscal de l'opérateur
économique' République du Bénin.
26. Ministère du Plan' de la Restructuration
Economique et la Promotion de l'Emploi' (1990)' Code
des investissements' République du Bénin.
ROBERT KLITGAARD' (1999)' Combattre la
Corruption' Nouveaux Horizons.
27. VERNON R. (1966)' International investment and
international trade in the trade cycle' Quaterly Journal of
Economics.
28. WOOD' A. et MAYER' J.'
(1995)' Africa's Export Structure in Comparative
Perspective' Economic Development and Regional Dynamics in
Africa: Lessons from the East Asian Experience' CNUCED'
Genève.
29. World Business group' (2002)'
Investir au Bénin' fabriqué par
CDPressDirect.com.

ANNEXES
ANNEXE 1
Tableau 10:Liste des privatisations ayant eu comme
repreneurs des investisseurs étrangers
(1989-2003)
|
Années
|
Compagnies
|
Secteurs
|
Repreneurs
|
Montant
(dollars)
|
Type de privatisation
|
|
1990
|
SOBETEX
|
Textile
|
Groupe Schaeffer
(France)
|
521949
|
Rachat de 49% des Actions détenues par l'Etat'
20% des
actions réservé aux nationaux
|
|
1990
|
MANUCIA
|
Tabac
|
Rothmans International
(Grande-Bretagne)
|
2546816
|
Privatisation à 100%
|
|
1991
|
SONACI
|
Ciment
|
SCANCEM
(Norvège)
|
7857001
|
Privatisation à 100%' 20% du capital
réservé aux nationaux
|
|
1991
|
SCB
|
Ciment
|
Groupe Amida
(France)
|
2035972
|
Rachat de 50% des actions détenues par
l'Etat' 25% du capital réservé aux nationaux
|
|
1991
|
Abattoirs de
Cotonou
|
Agro-
alimentaire
|
Agroplus
(France)
|
9717138
|
Contrat résilié
|
|
1992
|
La Béninoise
|
Boissons
|
Castel/BG I
(France)
|
14455400
|
Cession d'actif' 20% du capital réservé
aux nationaux' 5% aux salariés' 8% à
l'Etat
|
|
1994
|
SEB
|
Agro-
alimentaire
|
Hydrochem
(France)
|
666318
|
Liquidation avec cession d'actifs
|
|
1997
|
SONICOG
|
Huileries
|
SIFCA
(Côte d'Ivoire)
|
9365471
|
Cession d'actifs de 5 huilerie et une savonnerie
|
|
1997
|
SONICOG
|
Huileries
|
L'Aiglon
(Suisse)
|
1860138
|
Cession d'actifs' centre de stockage et d'embarquement
des huiles
|
|
1999
|
SCO
|
Ciment
|
Groupe SCB-Lafarge
(France)
|
3331590/
an
|
Location-gérance d'un complexe sucrier
intégré
|
|
2003
|
CSS
|
Sucrerie
|
Groupe Complant
(chine)
|
1850884/
an
|
Location-gérance
|
|
2003
|
Bénin Marina
Hôtel
|
Hôtellerie
|
Groupe BMD
(Espagne)
|
925442/
an
|
Location-gérance
|
Source : Ministère d'Etat du Bénin'
cellule des opérations de dénationalisation'2004.
Annexe 2
Graphique 5 : Répartition des projets
d'investissements agréés aux opérateurs étrangers
par branches d'activités entre 1992 et 2003 (pourcentage)
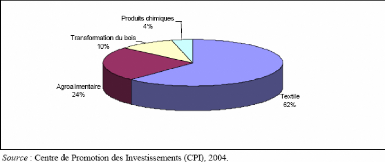
Graphique 6 : Les principales filiales des
sociétés transnationales (TNCs) présentes au Bénin
par pays d'origine (pourcentage)
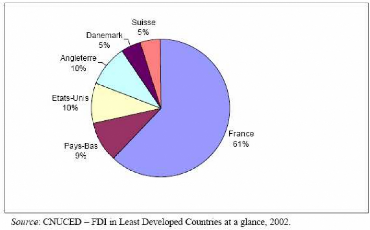
ANNEXE 3
Tableau 11 : Flux d'IED et aide internationale au
Bénin et dans les pays de la
sous-région.
|
Aide
(millions de dollars)
|
Aide par habitant
( dollars)
|
Flux d'IED par habitant
(dollars)
|
|
1990
|
1995
|
2000
|
1990
|
1995
|
2000
|
1990
|
1995
|
2000
|
|
Bénin
|
264'8
|
280'5
|
238'6
|
56'9
|
51'1
|
38'0
|
13'4
|
1'5
|
9'5
|
|
Burkina
Faso
|
335'8
|
504'9
|
343'8
|
37'3
|
49'2
|
29'8
|
0'1
|
1'0
|
2'0
|
|
Côte
d'Ivoire
|
733'2
|
1257'0
|
351'9
|
58'3
|
87'4
|
22'0
|
3'8
|
18'6
|
14'7
|
|
Mali
|
499'8
|
558'6
|
376'7
|
56'9
|
56'3
|
33'2
|
0'7
|
14'4
|
7'3
|
|
Nigeria
|
222'7
|
189'1
|
165'8
|
2'6
|
1'9
|
1'5
|
6'8
|
10'9
|
8'2
|
|
Togo
|
260'0
|
189'1
|
69'8
|
75'3
|
49'2
|
15'4
|
6'6
|
9'8
|
9'3
|
Sources : CNUCED' base de données
FDI/TNC' août 2003
Tableau12 : Taux d'épargne et taux d'investissement
au Bénin et en Afrique
|
Taux d'épargne brut
|
Taux d'investissement brut
|
|
1985
|
1990
|
1995
|
2000
|
1985
|
1990
|
1995
|
2000
|
|
Bénin
|
-4'1
|
2'2
|
6'7
|
5'9
|
8'7
|
13'4
|
17'2
|
18'9
|
|
Moyenne
africaine
|
18,7
'
|
18'5
|
16'7
|
20'9
|
19
|
19'4
|
17'6
|
18'5
|
Source : Banque mondial' Indicateurs de
développement dans le monde' 2003
Graphique 7 : Obstacles administratifs aux investisseurs
perçus au Bénin
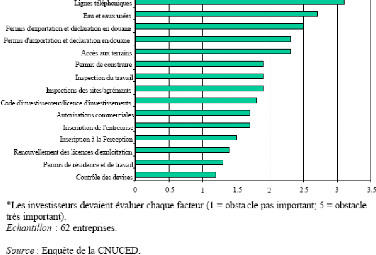
ANNEXE 5
Tableau 13 : Matrice sur l'attrait et la
compétitivité des secteurs.
|
|
|
Agriculture
|
Amélioration des flux d'IED en
Afrique
Position souhaitée
Amélioration
de la position concurrentielle
|
|
Agroalimentaire
Ecotourisme
Textile-coton
Services
portuaires et logistiques
|
|
Produits chimiques Electronique
|
Exploitation minière
Industrie
pétrolière
Services commerciaux et financiers
|
|
Modéré à faible
|
Fort
|
|
Tendances de l'IDE dans la région
|

Source : Enquête de la CNUCED d'août 2003.
Graphique 8 : Attrait sectoriel selon les investisseurs
présents au Bénin.
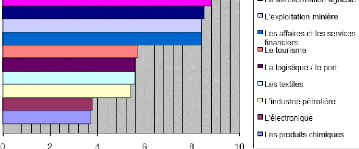
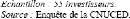
TABLE DES MATIERES
Dédicaces.................................................................................................................
3
Remerciements.........................................................................................................
4
Sommaire.................................................................................................................
5
Sigleset
abréviations................................................................................................
6
Liste des tableaux et
graphiques.................................................................................
7
Avantpropos............................................................................................................
9
Introduction..............................................................................................................
10
Première partie : Conception des cadres théorique
méthodologique et état des lieux sur les 14
investissements directs étrangers.
CHAPITRE I : LE CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE.............. 15
Section I : La problématique et les objectifs de la
recherche............................................ 15 Paragraphe 1 : Flux et
stock
d'IDE...........................................................................
15
A-La
problématique.............................................................................................
15
B-Intérêt de
l'étude.............................................................................................
17
Paragraphe 2 : Les objectifs et les
hypothèses...........................................................
18
A-Les
objectifs...................................................................................................
18
B-Les
hypothèses...............................................................................................
18
Section II :La revue de littérature et méthodologie
de recherche..................................... 19
Paragraphe 1 : La
revue de
littérature......................................................................
19
A-Importance des IDE dans les échanges
internationaux........................................... 19
B-Les nouvelles théories du commerce
international........................................... 20
Paragraphe 2 :
Méthodologie de la
recherche............................................................ 23
A- Les outils de la
recherche.................................................................................
23
1. La recherche
documentaire............................................................................
23
2. Les entretiens
directs....................................................................................
23
3. La navigation sur le réseau
Internet..................................................................
23
B- Le traitement des
données...............................................................................
24
1. Les tableaux
statistiques................................................................................
24
2. Les
graphiques............................................................................................
24
Chapitre II : LES FLUX D'IDE AU BENIN : ETAT DES
LIEUX........................................ 25
Section I: Les secteurs de concentration d'IDE au
Bénin............................................. 25
Paragraphe 1 :
Flux et stock
d'IDE..........................................................................
25
A-Les flux
d'IDE.................................................................................................
25
B-Les stocks
d'IDE................................................................................................................
27
Paragraphe 2 : Types
d'IDE...................................................................................
29
A- Acquisition d'entreprises
locales........................................................................
29
B- Création de nouvelles unités de
production.......................................................... 29
C- Fusion - acquisition ou prise de
participation.................................................... 29
Section
II : Impacts de la pénétration de l'IDE sur la situation
macroéconomique du Bénin.... 30 Paragraphe 1 : Effets sur le
capital et l'investissement national..................................... 30
Deuxième partie : Analyse des facteurs déterminants
les Investissements Directs Etrangers au Bénin 33
CHAPITRE III : CAUSES DE LA FAIBLE PENETRATION D'IDE AU
BENIN......................... 34
Section I: Facteurs de blocage des IDE au Bénin 34
Paragraphe 1 : Facteurs économiques 34
A- Coût des facteurs de production 36
1. Les équipements et matières premières
36
2. Faible productivité de la main
d'oeuvreAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 36
B- La faiblesse du tissu industriel 37
C- L'accès au marchéAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
37
D- Les infrastructures 38
1. Routes et chemins de ferAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 38
2. TélécommunicationsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
40
3. Les services d'utilité publique
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 40
4. Port et aéroportAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
40
Paragraphe 2 : Facteurs socioculturelsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 41
A- Capital humainAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 41
B- GouvernanceAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 42
C-Méconnaissance des atouts
naturelsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 43
Section II : Analyse du cadre de
l'investissementAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 44
Paragraphe 1 : Conditions spécifiques d'opérations
des IDE 44
A- Conditions d'entrée et
d'établissementAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 44
1. Régime de droit communAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..
44
2. Procédure d'octroi des régimes
privilégiés et de contrôle des investissementsAAA.. 45
B-Les acteurs nationaux et les privatisations 46
1. Les organismes de promotion' de facilitation et de
soutien des investissements 46
2. PrivatisationsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. 47
3. Système juridictionnel - Règlement des
différents en matière commerciale 47
Paragraphe 2 : Conditions générales
d'opérations des IDEAAAAAAAAAAAAAA 48
A- La fiscalitéAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 48
B- Droit foncier 49
Chapitre IV : APPROCHES DE SOLUTIONS 50
Section I: SYNTHESE DES RESULTATSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 50
Paragraphe 1 : Vue d'ensemble des solutionsAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
50
A- Résumé de l'analyse 50
B- Elaboration de l'arbre des solutionsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
51 Paragraphe 2 : Les solutions spécifiques 52
A- Approches de solutions liées aux problèmes du
cadre d'investissementAAAAAA. 52
B- Approches de solutions liées à
l'inadéquation des infrastructures de baseAAAAA 53
C- Approche de solutions liées à la mauvaise
gouvernanceAAAAAAAAAAAAA 53
D- Approche de solutions liées à la
méconnaissance des atouts naturels du BéninAAA 54 E-Approche de
solutions liées au coût élevé des facteurs de
productionAAAAAAA. 54
Section II : Mise en oeuvre des solutionsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
55
Paragraphe 1 :Elaboration d'une politique proactive pour
promouvoir les IDEAAAAAA 55
Paragraphe 2 : Faisabilité des
solutionsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 55
Conclusion 56
Bibliographie 58
Annexes 60
Table des matières 66



