|
PAUVRETE, RECHERCHE D'UN MIEUX ETRE ET
MIGRATION AU SEIN DES COMMUNAUTES DE MARINS ARTISANS PECHEURS DU SUD-OUEST
DU BENIN
Judicaël Alladatin* Roch Mongbo*, et Anne
Floquet**
*Faculté des Sciences Agronomiques de
l'Université d'Abomey-Calavi
** Centre Béninois pour l'environnement et le
Développement Economique et Social
RESUME
La présente recherche utilise une combinaison
d'approches quantitatives et qualitatives pour comprendre le
phénomène de la migration, ses déterminants
socio-économiques et ses relations avec l'accumulation ou la
pauvreté au sein des communautés de marins artisans de
Grand-Popo. Ces migrations s'inscrivent dans le cadre plus global des liens
séculaires entre les communautés du littoral d'Afrique de l'Ouest
et du Centre, fruits de nombreuses migrations dans l'histoire et toujours
rythmées par les saisons de pêche. Quatre (4) catégories de
bien-être se distinguent au sein des communautés de
pêche : « Très pauvre », « Pauvre
», « Moins pauvre », « Non pauvre ». Les facteurs tels
que les conditions physiques du village de résidence, le degré de
dépendance au sein du ménage et le taux de scolarisation sont les
plus significatifs dans la décision des pêcheurs en matière
de migration. Les pêcheurs qui migrent diminuent les actifs humains,
sociaux et naturels de leur ménage sans pour autant contribuer à
l'amélioration des revenus du ménage. En définitive, si la
migration apparait comme un moyen de diversification du risque pour les
ménages, elle constitue en réalité une stratégie
individuelle de mobilisation socio-économique.
Mots clés : migration,
« livelihood », pauvreté, stratégie de
recherche d'un mieux-être, pêche côtière.
ABSTRACT
In this study, we have used the quantitative and qualitative
methods to understand the socio-economic determining factors of the migration,
and the interrelationships between migration and poverty in Grand-Popo. The
period of migration is generally rhythm by the seasons of fishing.
Socio-economic arrangements are related to the type of decision (individual or
collective) and the financing mode of the migration. The "cluster
analysis» reveals an heterogeneity between the households with regard to
the wellbeing. Four (4) categories of wellbeing, were then identify: "Very poor
", "Poor ", "less poor ", "Non poor ". Among the factors suspected to having an
effect on the migration decision, the environment of the household or its
village, the ratio of dependence in the household and the rate of schooling in
the household, are those which have a significant effect. The fishers which
migrate decrease the human capital, the social capital and natural capital of
their household without contributing to the financial scheme. Migration remains
a strategy of diversification of risks for the households but also an
individual strategy to improve the migrant income.
Key words: migration, livelihood, poverty, coastal
fishing.
Introduction
Problématique
La FAO estime à environ 138 millions le nombre total
des personnes directement ou indirectement employées dans la pêche
artisanale en 2002 (FAO 2004). Parmi ces derniers, les pauvres se comptent par
millions, surtout en Asie et en Afrique, et vivent dans des zones rurales
reculées où il existe peu de sources alternatives de revenus et
d'emploi pour contribuer aux stratégies de subsistance (FAO op.cit). Du
fait de la dégradation continue de leur environnement, le revenu des
pêcheurs s'amenuise d'année en année, accentuant leur
état de pauvreté (Atahouet 2004). Les zones humides
béninoises sont menacées, ceci se traduit par une
dégradation d'ordre physique (érosion des berges des plans d'eau
et leurs comblements, érosion côtière), et biologique
(perte de la biodiversité, baisse de la productivité des plans
d'eau et de la fertilité des sols) (Haskoning 2000 cité par
Hodigue 2003).
La côte béninoise compte 80 campements
inégalement répartis entre trois départements du
Sud-Bénin (FIDA 2004). Les communautés de pêcheurs marins
de Grand-Popo (71% Xwla, Xwéda et Mina), sont reconnues comme
maîtresses des eaux du fait de leurs expériences historique et
culturelle de la pratique de pêche (Atti-mama 2006). A l'instar de la
plupart des milieux marginaux littoraux, Grand-Popo dispose d'importantes
ressources naturelles constituant ainsi un important pôle d'attraction
des populations qui, dès leur installation, se sont investies dans
l'exploitation des ressources (Chodaton 2003), (ABE 2001). Face à la
pauvreté, des stratégies de mobilité sont utilisées
par ces populations dans un souci d'amélioration du bien-être.
Bien qu'abondante, la littérature sur le
phénomène migratoire renseigne très peu sur ses
déterminants socio-économiques, ses réalités et ses
relations avec l'accumulation ou la pauvreté au sein des
communautés de marins artisans du Bénin. La présente
recherche traite de ces problématiques et contribue de ce fait à
la compréhension du phénomène de la pauvreté et
à sa réduction en zone de pêche au Bénin.
Trois hypothèses ont servi de fil directeur à la
recherche :
- Le milieu des pêcheurs est homogène en termes de
bien-être,
- Les caractéristiques du ménage ainsi que de
son milieu déterminent le choix de la migration comme stratégie
de recherche d'un mieux-être.
- La migration améliore le bien-être des
ménages de migrants à court et à long terme.
La zone d'étude
La Commune de Grand-Popo est située au Sud-Ouest du
département du Mono. Elle est limitée au Nord par les Communes
d'Athiémé, de Comé et de Houéyogbé, au Sud
par l'Océan Atlantique, au Sud-Ouest par les Communes de Ouidah et de
Kpomassè et à l'Ouest par la République du Togo. Cette
Commune s'étend sur une superficie de 289 km², soit 7,2% de
l'ensemble du département du Mono1(*) pour une densité moyenne de population
d'environ 140 habitants / km². Avec sept (07) arrondissements et 44
villages2(*), la population
de Grand-Popo a été estimée en 2002 à 40 335
personnes dont 19254 hommes et 21081 femmes. Selon le RGPH2, les ethnies Adja
et apparentées représentent 70% du peuplement de Grand-Popo,
suivis des Fons (21,6%), des Yoruba (1,7%), des Peuhls (0,2%), des Bariba
(0,1%), des Dendi (0,1%), des Yom Lokpa (0,1%) et d'autres ethnies
Béninoises et non Béninoises dans une proportion de 6,2%.
Le relief de la commune de Grand-Popo se compose de trois (03)
ensembles à savoir la côte à laquelle
s'intéresse notre étude, les zones marécageuses ou zones
de bas-fonds et les zones inondables puis le plateau continental terminal. Les
éléments qui composent le réseau hydrographique
sont : la lagune de Grand-Popo, une partie de l'océan Atlantique,
le fleuve Mono et une série d'affluents, La carte n° 1, montre le
réseau hydrographique de Grand-Popo.
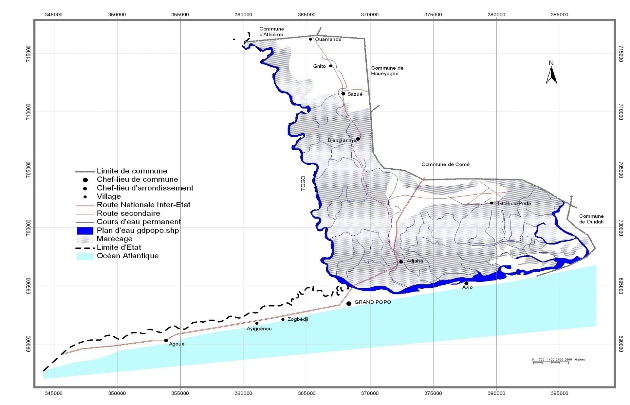
Carte n°1 : Réseau
hydrographique de Grand-Popo.
Source : Enquête,
Grand-Popo 2007
Les principales activités économiques
pratiquées sont : la production végétale (oignon,
tomate, carotte, manioc, canne à sucre), la pêche (maritime et
continentale), l'élevage, la fabrication du sel, la collecte et la
commercialisation des huîtres, la transformation et la commercialisation
du poisson et le commerce de divers ou d'aliments. La pêche est de loin
la principale activité des populations de la zone côtière
de Grand-Popo. La figure1 résume les différentes interactions
entre le système physique et le système humain dans la zone
côtière.
|
Composantes du système physique
|
Mer et lagune
|
Terres exondées
|
Berge et littoral
|
|
|
- Poissons et autres animaux aquatiques
- sable marin et lagunaire
- sel
- bois (palétuvier)
|
- Produits végétaux (produits maraîchers
surtout)
- bois
- produits animaux (élevage et faiblement chasse)
|
- Crabe
- noix de coco et rameaux de cocotier
- paille
- bois (rameaux et parties sèches des cocotiers)
- produits animaux (élevage)
|
Ressources Naturelles extraites
|
Figure n° 1 : Interactions
système physique, système humain dans la zone
côtière.
Source : Enquête Grand-Popo,
2007
Démarche méthodologique
La démarche méthodologique adoptée dans
le cadre de cette étude est une combinaison des approches qualitative et
quantitative.
A l'issue de la phase exploratoire, qui a permis entre autres,
l'établissement de la base de sondage par recensement, un
échantillon de 120 individus a été constitué pour
les entretiens standardisés à base de questionnaire. La taille de
l'échantillon par village a été déterminée
en appliquant un taux d'échantillonnage de 0,62 aux données
issues du recensement.
Pour le traitement des informations collectées, nous
nous sommes servis des logiciels Excel pour la saisie des données et
pour les graphiques. Les données saisies sont analysées avec le
logiciel SAS.
Plusieurs outils d'analyse statistique ont été
utilisés dans cette étude.
Par rapport à la première hypothèse, pour
réaliser la typologie, nous avons utilisé le « cluster
analysis ». Le modèle Logit binomiale d'analyse des choix
individuels, a été utilisé pour tester la deuxième
hypothèse de recherche. Des tests de khi-deux et de Student ont aussi
effectués pour étudier les liens entre les variables explicatives
et la variable expliquée.
Le Logit associe à l'individu i, la probabilité
Pi qui est lié à la variable expliqué.
Avec Pi = F (Ii) = 1 / 1 +
e-Ii et Ii = 0 + 1xi1
+2xi2 +3xi3 + .... +
mxim
Ii est le vecteur caractéristique des conditions du
ménage étudié ; les Xi sont les variables
explicatives et les i en sont les coefficients.
Enfin, pour la troisième hypothèse, des tests
d'indépendance de khi-deux ont été effectués.
Résultats et discussions
La pauvreté en zone de pêche maritime à
Grand-Popo
Les variables considérées dans la typologie sont
celles qui ont été indiquées par les populations comme
étant les déterminants du bien-être. Les principales
dimensions de la pauvreté selon la conception locale sont :
L'alimentation, le niveau d'éducation, la santé, le logement, la
possession de biens et équipements divers, le revenu, l`accès
à l'eau et à l'électricité, le loisir et
l'habillement.
La figure 2 montre le dendrogramme obtenu à la suite du
« cluster analysis ». L'analyse du dendrogramme nous permet
de constater que nous sommes en mesure de constituer quatre (4) classes de
ménages relativement homogènes en termes de bien-être, tout
en conservant environ 50% des informations des variables de départ. Les
variables ou déterminants de départ discriminent donc
effectivement les ménages à près de 50% : Le milieu
des pêcheurs n'est pas donc uniforme en termes de bien-être.
Le tableau 1 indique par catégorie, le profil
socio-économique de chaque classe de bien-être
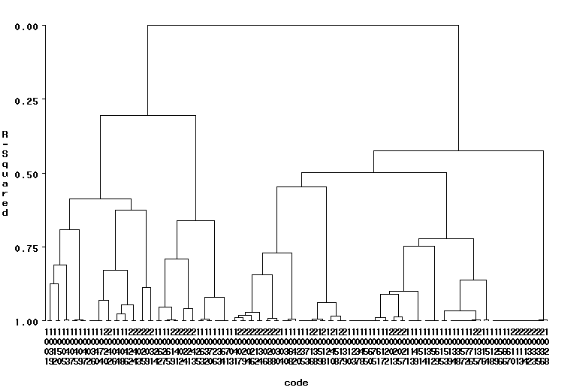
Figure n°2 : Dendrogramme des
ménages étudiés suivant leur niveau relatif de
bien-être
Source : Enquête Grand-Popo,
2007
|
Catégorie
|
Type d'habitation
|
Patrimoine
|
Ratio de dépendance (moyenne)
|
Taux de scolarisation (% moyen)
|
Sources de revenu et de financement des
activités
|
Nombre de mois de disponibilité alimentaire
(moyenne)
|
Nombre de repas fondamentaux journalier
|
Source d'eau de consommation
|
effectif
|
|
Très pauvre
|
le mur n'est pas en ciment, le toit n'est pas en tôle, il
n'y a ni fosses septiques ni électricité
|
nombre moyen de filets < 1
|
1,85
|
12,25
|
activités liées à la pêche 14% font du
manoeuvrage agricole
|
6,09
|
2,92 en période d'abondance et 2,17 en période de
soudure avec en plus une réduction des quantités servies
|
plan d'eau ou puits en saison sèche et en saison
pluvieuse
|
14
|
|
Pauvre
|
le mur n'est pas en ciment, le toit n'est pas en tôle, il
n'y a ni fosses septiques ni électricité. 1/4 vivent dans des
maisons où les murs sont en ciment et le toit en paille
|
½ ménage possède une radio. Le nombre moyen
de filets est 1,65.
|
2,27
|
51
|
activités liées à la pêche ; 23%
font du manoeuvrage agricole
|
7,18
|
3,02 en période d'abondance et de 2,25 en période
de soudure
|
plan d'eau ou d'un puits en saison pluvieuse. En saison
sèche l'eau de pompe est la plus utilisée.
|
62
|
|
Moins pauvre
|
le mur est en ciment, la toiture est en tôle, il y a
rarement une fosse septique et de l'électricité
|
50% possèdent 1 radios, 1 /10 possèdent de
barques, 1 /10 possède de terres cultivables. Le nombre moyen de
filets est d'environ 3,17. 90% ont de vélos
|
2,04.
|
62
|
activités liées à la pêche ;
maraîchage. 1 ménage sur 5 participe à un groupe de
tontine.
|
9,23
|
3,16 en période d'abondance et 3,14 en période de
soudure
|
pompe chez 90% des ménages quelle que soit la
période de l'année.
|
26
|
|
Non pauvre
|
le mur est en ciment, la toiture est en tôle, il y a
souvent de fosses septiques et d'électricité
|
90% ont de radios 10% ont 1 postes téléviseurs.
1 /5 possèdent de barques. 1/4 possède de terres
cultivables. Le nombre moyen de filets est 3,77. 1/5 possèdent de
barques et des vélos ou motos
|
1,86.
|
64
|
maraîchage location de barques et filets activités
liées à la pêche. tontine épargnes auprès des
institutions de micro finance
|
10,88
|
3,98 en période d'abondance et de 3,85 en période
de soudure
|
pompe quelle que soit la période de l'année.
|
18
|
Tableau 1 : Profil
socio-économique par catégorie de bien être.
Source : Enquête Grand-Popo,
2007.
La migration des pêcheurs marins artisans :
déterminants socio-économiques et effets sur le
bien-être
La migration des pêcheurs s'inscrit dans le cadre plus
global des liens séculaires entre les communautés du littoral
d'Afrique de l'Ouest et du Centre, fruits de nombreuses migrations dans
l'histoire et toujours rythmées par les saisons de pêche. Les
arrangements socio-économiques des migrations concernent le type de
décision (individuelle ou collective) et le mode de financement de la
migration (fonds propres ou préfinancement ou type mixte). Plusieurs
constats ont découlé de nos investigations et illustrent bien les
liens entre les relations de genre et les comportements migratoires. Par
exemple, les hommes sont beaucoup plus indépendants dans la migration,
ils migrent souvent seuls mais après quelques années, font venir
leurs femmes qui s'insèrent dans l'économie locale de la
pêche.
Les déterminants de la décision de
migration
Les résultats du modèle Logit
présentés dans le Tableau 2, permettent de connaitre les
déterminants de la migration.
Tableau n° 2 : Résultats de la
régression logistique
|
Variable
|
coefficient
|
erreur type
|
Wald
|
significativité
|
Signes attendus
|
Significativité des signes
observés
|
|
exmigrnr
|
-1,2492
|
1,1145
|
1,2563
|
0.2623
|
+
|
NS
|
|
clbe
|
0,9311
|
0.4240
|
4.8212
|
0.2460
|
-
|
NS
|
|
Village
|
0,9268
|
0.5030
|
3,3947
|
0.0654
|
+
|
*
|
|
rtmta
|
0,5045
|
0,2469
|
4,1756
|
0.0281
|
+
|
**
|
|
tsco
|
- 5,6611
|
1,2587
|
20,2271
|
0.0001
|
-
|
***
|
Percent Concordant 78.9 Somers'
D 0.596
Gamma
0.607
Tau-a 0.29
c
0.798
NB : *, ** et *** = significatif respectivement à
10%, 5% et 1% ; NS = Non Significatif
-2 Log L 163.645
Test Chi-Square Pr >
ChiSq
Likelihood Ratio 40.5824
<.0001
Score 33.6405
<.0001
Wald 24.4623
<.0001
Source: Résultats empiriques du modèle Logit
binomial avec le logiciel SAS.
· Qualité du modèle : Le ratio de
vraisemblance s'est révélé hautement significatif. Par
conséquent, le modèle est globalement significatif à 1%.
· Pouvoir de prédiction : Les prédictions
sont vérifiées dans 79.8 % des cas. Les estimations du
modèle de régression ont donné les pseudos r2
de Somer's, de Gamma, de Tau-a et de c qui sont respectivement de 0,596, 0,607,
0,29 et de 0,798. On peut donc, à partir du modèle, faire des
prévisions sur la modalité de la variable dépendante
connaissant celles des variables indépendantes avec une
probabilité allant à 79.8% d'avoir une prédiction
juste.
· Variables déterminantes : Les variables qui
déterminent le choix de la migration sont: l'environnement ou le village
de résidence (village), le taux de dépendance (rtmta) et le taux
de scolarisation (tsco). Les pêcheurs du village Avloh sont plus enclins
à migrer, de même que ceux qui sont peu scolarisés et ceux
qui ont beaucoup de personnes à charge par actif. Les autres variables
qui se sont révélées non significatives dans le
modèle ne sont pas sans effet sur la décision de migrer. Mais
leur influence aurait été cachée soit par celle des
variables révélées significatives par le modèle
(cas de la variable « catégorie de
bien-être ») soit par l'étroite corrélation
entres elles et le choix de la migration (cas de la
variable « existence de migrant non
récent »).
La migration des pêcheurs marins de Grand-Popo trouve
son explication dans deux modèles théoriques :
Ø Le modèle explicatif centré autour du
« réseau migratoire », concept
développé par Boyd, (1989); Guilmoto et Sandron, (2000) ; Kritz
et col. (1992) : les migrants non récents favorisent la
transmission des ressources informationnelles et relationnelles à
l'intérieur d'une structure à forte cohésion (le
ménage ou la famille). Les liens reliant les migrants et les
non-migrants ont alors pour fonction de minimiser les coûts et risques de
la migration. Les migrants non récents constituent des ressources pour
les candidats à l'émigration ; les réseaux qu'ils
constituent forment un « capital social » sur lequel les
candidats à l'émigration s'appuyent pour connaître
les possibilités d'hébergement, de gains et d'emploi, existant
dans la zone d'accueil.
Ø La théorie des causes cumulatives (Massey et
col.1993 ; Massey et col. 1998) : Les transferts et les
réalisations liés aux « gains de migration »,
transforment les structures sociales et économiques, augmentent les
inégalités de revenus et intensifient le sentiment de privation
chez les non-migrants. L'expérience que les migrants accumule dans les
pays d'accueil est susceptible de modifier, dans les communautés
d'origine, les perceptions et les valeurs, en créant ce que Schoorl et
Col. (2000) appelle une « véritable culture de la
migration»
Les effets de la migration sur les actifs des
ménages
Le résultat du test de khi-deux par rapport à
l'effet de l'existence des migrants de retour sur le bien-être des
ménages, montrent qu'il n'existe pas de différence significative
entre le bien-être des ménages qui ont des migrants de retour et
ceux qui n'en ont pas. Le résultat du test de khi-deux par rapport
à l'effet de l'existence des migrants non récents sur le
bien-être des ménages s'est révélée lui aussi
non significatif : nous en déduisons donc que le niveau de
bien-être d'un ménage ne dépend pas de la migration de ses
membres.
· Effets de la migration sur le capital physique du
ménage
Les migrants investissent leurs revenus primordialement dans
leur alimentation personnelle, viennent ensuite les aides à la famille
restée au village, l'acquisition des moyens de production (filets,
barques, pagaies, moteur hors bord) et l'achat de parcelles ou terre
cultivable, puis la construction de bâtiments. La plupart des migrants de
retour sont parvenus à augmenter le nombre de filets dans le
ménage. Mais seulement 5% des migrants de retour ont pu s'acheter une
barque, 20% ont pu construire des bâtiments d'habitation en
matériaux définitifs. Globalement donc, la migration
améliore mais faiblement le capital physique des ménages.
· Effets de la migration sur le capital humain et le
capital social du ménage
La migration affecte le capital humain du ménage. Le
migrant pêcheur est toujours un membre actif du ménage. La
migration de ce membre a un effet négatif sur la force productive du
ménage. Les personnes qui migrent sont souvent des personnes instruites,
capables de mener des activités permettant aux ménages de
diversifier les risques auxquels sont soumis leurs revenus. La migration
enlève aux ménages ces membres actifs et instruits qui sont les
plus susceptibles de contribuer efficacement au bien-être du
ménage.
Il est important de souligner ici que dans le cadre de la
migration internationale surtout, les cas de décès des migrants
de retour et des migrants non récent sont fréquents (environ 75%
des personnes enquêtées ont répondu avoir perdu au moins un
membre de leur famille élargie suite à une maladie
contractée lors d'une migration).
La migration, surtout internationale, rehausse le prestige
social du migrant ; mais ce prestige social ne rejaillit sur le
ménage qu'en cas de succès de la migration (à travers les
transferts d'argent et les diverses réalisations). Les ménages
ayant des membres en migration, subissent des bouleversements sociaux et
démographiques préjudiciables à leur bien-être.
· Effets de la migration sur le capital financier du
ménage
De l'avis des personnes enquêtées, les revenus en
situation de migration sont toujours plus consistants qu'en situation de non
migration. Malheureusement, l'analyse statistique montre que la contribution
des transferts d'argent aux revenus des ménages reste faible au niveau
de toutes les catégories de ménages. Les migrants participent
donc très faiblement au capital financier des ménages. De l'avis
des personnes enquêtées, la contribution des migrants nationaux
aux revenus des ménages est plus élevée que celle des
migrants internationaux. Cet état de chose pourrait s'expliquer par les
types de contrat dans lesquels s'insèrent les migrants internationaux et
où les gains ne sont rendus qu'à la fin du contrat. Aussi, le
manque de réseau de transfert fiable dans le cadre de la migration
internationale pourrait expliquer les faibles taux d'envois des migrants
internationaux.
· Effets de la migration sur le capital naturel du
ménage
La pression démographique associée au fort taux
d'immigration de pêcheurs (ghanéens) engendre une pression sur les
ressources naturelles. Cette pression sur les ressources naturelles est l'un
des principaux motifs de la migration. Ainsi, en migrant les pêcheurs
diminuent la pression sur les ressources naturelles dans les zones de
départ. La migration peut être considérée de ce fait
comme une pratique de gestion de ressources naturelles. Mais l'acquisition des
moyens de production par les migrants de retour, les transferts de technologie
et le souci de combler la part de revenus qui était assurée par
le migrant augmente encore la pression sur les ressources naturelles et conduis
à une exploitation plus intense de ces ressources.
Au total, le pêcheur qui migre diminue les actifs
humain, social et naturel de son ménage sans pour autant contribuer de
façon durable aux actifs financier et physique. La migration ne permet
pas d'améliorer le bien-être des ménages. Elle reste une
stratégie de diversification de risques (Stark et Levhari 1982, Azam et
Gubert 2002) pour les ménages avec sa contribution au capital financier
et au capital physique mais aussi une stratégie individuelle
d'amélioration du revenu pour le migrant. Pareils résultats ont
été obtenus au Chili et au Mexique en 2002 par Daniel Delaunay.
La figure 3, résume l'ensemble des interactions entre pauvreté,
migration et ressources naturelles.
Conclusion
Il ressort des résultats de la présente
recherche, que les ménages les plus aisés sont ceux qui
parviennent à faire du maraîchage en plus de la pêche. Il
est impérieux que les gouvernants, les structures d'interventions et les
pêcheurs prennent conscience de tous les désagréments
causé par la migration, afin d'amorcer les changements
nécessaires à l'amélioration du cadre législatif en
vigueur dans le domaine de la pêche et de la migration. Des
Activités Génératrices de Revenus alternatives, pourraient
être promues, qui soit existent déjà comme la fabrication
du sel, soit seront introduites comme l'élevage de crabes et
huîtres, la pisciculture etc. Les revenus de la pêche peuvent
être améliorés et régularisés dans le temps
en jouant sur la productivité des mers, sur la qualité des
équipements permettant de sortir sans danger en toute saison. Il ressort
aussi de la présente recherche, que les revenus de la migration des
pêcheurs ne sont pas rapatriés ni investis de façon
judicieuse et que la situation des pêcheurs dans les pays de migration
est volontairement maintenue précaire par divers acteurs qui en
profitent.
La mise en place de conditions optimales pour les
artisans-pêcheurs dépend de l'accès à une bonne
information sur laquelle fonder des politiques et des stratégies
appropriées. Cela requiert une collecte de données plus efficace
et un approfondissement des recherches dans le domaine de la pêche, qui
doivent être participatives et mettre à profit les connaissances
locales.
Pollutions diverses de l'environnement côtier
Surexploitation des ressources
Baisse du revenu
Accès limité aux sources alternatives de revenu et
d'emploi
M
I
G
R
A
T
I
O
N
P
A
U
V
R
E
T
E
Baisse de la diversité spécifique et intra
spécifique des ressources naturelles
Pression démographique
Conditions écologiques
Baisse des captures
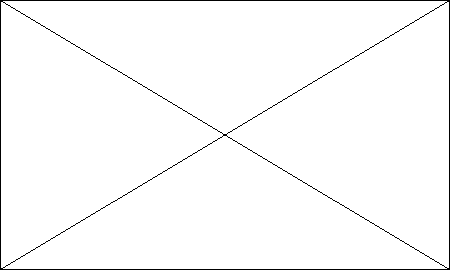
Figure 3 : Interrelations entre
pauvreté, migration et ressources naturelles.
Source : Enquête
Grand-Popo, 2007
1. Bibliographie
1. ABE (2001) ; Cadre de gestion des risques
environnementaux : Projet de gestion communautaire de la
biodiversité côtière marine du Bénin. (Version
finale avril 2001).
2. Atahouet G. N. (2004) ; les IST/VIH/SIDA dans les
communautés de pêche in bulletin PMEDP n° 17-18.
3. Atti-mama C. (2005) ; Migration de pêche au
Bénin. programme DIPA Bénin w.w.w.omd.mr.
4. Atti-mama C. (2006) ; la migration des
pécheurs au Bénin. PMEDP, projet pilote 2
«aménagement participatif des pêches en zone
côtière ».
5. Carney (1999) ; approach to sustainable livelihoods for
the poor. ODI. Poverty briefings, January 1999. w.w.w.oneworld.org/odi/
briefings/pov2.htm.
6. Chambers R., Pacey A. et Lori A. (1994) ; Les
paysans d'abord : Les innovations des agriculteurs et la recherche
agronomique. Edition KARTHALA et CTA.
7. Chodaton D. P. (2003) ; Contribution à
l'aménagement écotouristique dans les zones humides du
sud-Bénin : Secteurs Togbin - Grand-Popo . Mémoire de
DEA. FLASH, Université d'abomey-calavi.
8. Cogneau D., Tapinos G. (1997) ; Migrations
internationales, libre-échange et intégration
régionale, Document DIAL-ORSTOM.
9. Delaunay D. (2006) ; Relations entre la
pauvreté, la migration et les mobilités: dimensions territoriale
et contextuelle. Institut de Recherche pour le Développement,
Unité de Recherche « Migration, mobilités et peuplement
».
10. Diop O. 2002 ; La transformation artisanale des
produits de la pêche le long du littoral sénégalais.
Etude géographique, thèse d'état, Département de
géographie, UCAD, Dakar.
11. Diop O. (2006) ; Migration et conflit de
pêche le long du littoral sénégalo-mauritien: le cas des
pêcheurs de Guet Ndar et de Saint Louis (Sénégal).
Recherches africaines N° 03 du 19 Décembre 2006
w.w.w.recherches-africaines.net/document. php?id=259.
12. Hodigue J. (2003) ; Impact des activités de la
pêche maritime sur l'environnement côtier : cas du Littoral de
Cotonou en République du Bénin. Mémoire de DEA. FLASH,
Université d'Abomey-calavi.
13. Kébé M. (1993) ; principale
mutation de la pêche artisanale maritime sénégalaise
in : l'évaluation des ressources exploitables par la pêche
artisanale sénégalaise. T2 Paris, ORSTOM.
14. Massey D.S. Arango J., Hugo G., Kouacouci A., Pellegrino
A., Taylor J.E. (1993) ; Theories of international migrations ; a
review and appraisal, Population and development Review, 19,
n °3, Septembre 1993.
15. Mongbo R.L. et al (1992) ; cours de
méthodologie de la recherche socio-économique de la recherche en
milieu rural africain. FSA / UAC.
16. Ndione B. et R. Lalou (2001) ; tendances
récentes des migrations internationales dans le sénégal
urbain : Existe-t-il une dynamique de quartier ? Les exemples de
Dakar, Touba et kaolack. UMR-IRD Université de Provence.
17. PMEDP / DFID - FAO (2002) ; Contribution de la
recherche aux moyens d'existence durable des communautés de pêche
artisanale maritime. Etude de cas de la Guinée. Mars 2002.
18. Whitehead A. (2002); Tracking Livelihood Change:
Theoretical, Methodological and Empirical Perspectives from North-East
Ghana in Journal of Southern African Studies, Vol. 28, N°3, Special
Issue: Changing Livelihoods (Sep., 2002), pp. 575-598.
* 1 Revue permanente du secteur
urbain deuxième édition - SERHAU-SA - Juin 2000
2 Atlas monographique des communes du Bénin -
DED - Juin 2001
| 


