|
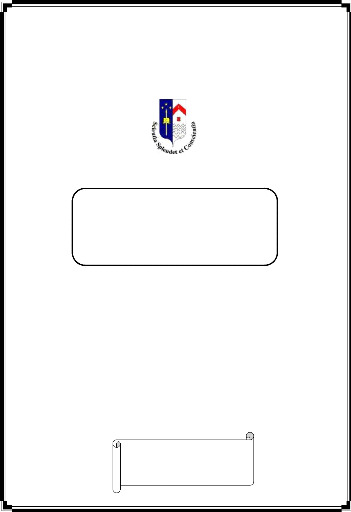
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE
L'EDUCATION
DEPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE
ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOSOCIAL D'UN GARCON
AGE DE 28
ANS VICTIME DE
CARENCE AFFECTIVE A
LUBUMBASHI
PAR
KYUNGU MUKUTA Steve
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
grade de Licencié en Psychologie
Option : Psychologie clinique
Directeur : Prof. KASONGO MALOBA TSHIKALA Philippe
Année académique 2013-2014
Première session

2
Sommaire
DEDICACE 5
REMERCIEMENTS 6
0. INTRODUCTION 8
0.1. PROBLEMATIQUE 8
0.2. HYPOTHESE DU TRAVAIL 10
0.3. OBJECTIF ET INTERET DU SUJET 11
0.4. METHODE ET TECHNIQUES 11
0.5. DELIMITATION DU SUJET 12
O.6.SUBDIVISION DU TRAVAIL 12
CHAPITRE PREMIER : CONSIDERATIONS THEORIQUES 13
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS 13
I.1.1. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, PSYCHOLOGIQUE ET PSYCHOSOCIAL
13
I.1.2. GARÇON 13
I.1.3. VICTIME 14
I.1.4.CARENCE AFFECTIVE 14
I.1.6. AFFECTION & AFFECTIVITE 15
I.2. NOTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA CARENCE AFFECTIVE 16
I.2.1. CAUSE D'UNE CARENCE AFFECTIVE 17
I.2.2. LA PERCEPTION DE LA SEPARATION PARENTALE PAR L'ENFANT
19
I.2.3. PREVENTION DES TROUBLES PSYCHIQUES CHEZ L'ENFANT 22
I.2.4. TYPES OU SORTES DE CARECE AFFECTIVE 32
I.2.5. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ET TRAITEMENT 33
1.3. LES THEORIES EXPLICATIVES RELATIVES A LA CARENCE AFFECTIVE
34
I.4. ETUDES ANTERIEURES 36
I.5. CONCLUSION PARTIELLE 40
CHAPITRE DEUXIEME: CADRE METHODOLOGIQUE 41
II.1.

3
DENOMINATION ET LOCALISATION SPATIALE 41
II.2. BREF APERCU HISTORIQUE 41
II.3. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 44
II.4. REALISATION ET PROJET D'AVENIR 46
II.5. ETUDE DES CAS 48
II.6. CARACTERISTIQUE DU CAS ETUDIE 48
II.7. METHODES ET TECHNIQUES 49
II.7.1. METHODE 49
II.7.2. TECHNIQUES 50
II.8. DIFFICULTES RENCONTREES 61
II.9. CONCLUSION PARTIELLE 61
CHAPPITRE TROISIEME : RESULTATS DE LA RECHERCHE 63
III.1. PRESENTATION ET ANALYSE DESCRIPTIVE DU CAS CLINIQUE 63
III.2. ETABLISSEMENT DE LA RELATION THERAPEUTIQUE 67
III.3. INTERVENTION THERAPEUTIQUE PAR L'ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOSOCIAL 68
III.4. DISCUSSION ET CONSTRUCTION DU SENS 72
III.5. CONCLUSION PARTIELLE 75
CONCLUSION GENERALE 75
BIBLIOGRAPHIE 79

4
EPIGRAPHE
« Les malheurs passent et le bonheur
demeure. Tout échec est promesse.
Patience obtient tout ».
Jean GUITTON

5
DEDICACE
A toi notre père céleste, qui donne la force
à ton peuple ; tu le bénis et le rend heureux. Psaumes 29 :11
A vous nos parents NGOY MUKENA LUSA DIESE Aimé et
MULONGO NGOIE Jacqueline, vous qui nous avez appris l'ordre, la discipline et
le travail, vous êtes ce qui reste de plus cher au monde,
véritables chefs d'oeuvres de notre vie. En guise de récompense
pour vos privations et peines que vous vous êtes imposé depuis
notre naissance jusqu'à ce jour. Que vos sages conseils puissent nous
aider à être utiles à tous et partout où nous nous
trouverons.
A toi notre frère Olivier KABANGE MUKUTA MUZEITUNI qui
ne cesse jamais de penser à nous. Voici à travers ces pages, les
fruits de tes sages conseils et de ton encouragement. Que les écluses du
ciel s'ouvrent afin que tu vives heureux, au jour le jour.
Feux, notre cher oncle NKULU NUMBIE Jules et notre cher
père BANZA KITUMBI Leonard, voici aux travers ces phrases les
réalisations de vos conseils. Que la terre de nos ancêtres demeure
douce et que le ciel vous soit ouvert.

6

7

8
REMERCIEMENTS
Ce travail étant réalisé grâce au
concours de multiples acteurs, nous devons présenter nos vifs sentiments
de gratitude, ainsi que nos remerciements à notre père
céleste qui connait le début et la fin de toute chose. Nous
disons merci à toutes les personnes qui de loin ou de près ont eu
à contribuer à la concrétisation de ce dernier et qui par
leurs soutien, ont fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui.
Nous remercions particulièrement notre Directeur
Philippe KASONGO MALOBA TSHIKALA, professeur associé à la
Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de
l'Université de Lubumbashi (UNILU en sigle) au département de
psychologie, option clinique, qui malgré ses multiples occupations, a
bien voulu diriger notre travail avec compétences et qualités.
Nos remerciements s'adressent également au personnel
académique, scientifique et administratif de notre Faculté en
l'occurrence : le Doyen de la Faculté le professeur Ordinaire NGOI FIAMA
BITAMBILE Balthazar, le vice doyen chargé de l'enseignement le
professeur Ordinaire ELENGESA NDUNGUNA Pascal, le vice doyen chargé de
la recherche le professeur MWENZE WA KYUNGU Erick, ainsi que le
secrétaire académique Christian MUKEMBE KISAKA SAKA, qui ont
contribué à notre formation des psychologues cliniciens, et ont
fait de nous des véritables psychologues dont la société
congolaise a besoin.
Nos sentiments de reconnaissance, à toutes les
personnes qui, malgré leurs multiples taches, leurs projets, ont
contribué sans beaucoup philosopher, ni compter leur degré de
soutien depuis premier graduat jusqu'aujourd'hui où nos rêves
deviennent une réalité palpable : FELLY KASONGO, DADDY KASONGO,
KABALA ILUNGA, BAMBINO MULONGO Asenie inoubliables.
Nous remercions nos pères, mères, oncles et
tantes pour leur soutien à travers le peu qu'ils ont : Prosper LUNDA
NGANDU, Joseph KABALA SHIMBI, Alexandre MWAMBA, Ghislain NUMBI KABANGE,
Dieudonné SIMBI NGOIE, Geneviève
NGOIE KALUME, Eugénie NGOIE, Odette MULONGO, Annie
NKULU, Nicole MPAGA, Mélanie NDAYA.
Nous sommes également reconnaissant envers nos
frères, soeurs amis et connaissance : FRANCIS, Eric NUMBI, Thierry
KYUNGU, Papy MULONGO, Bibiche LUNDA, Deca MUKALAYI, Arsène KITWA,
Trésor KYUNGU, Louise, Charlène, Ibertine, Dédier MULONGO,
Noëlla NSENGA, James TSHUNZA, Jo saint MUSENSE, Divin, Déborah
NGOIE KANKIENZA, Yolaine, Lauriane SIMBI. Jerry SONI, Etienne KANDOLA, Mathis
MUTSHAIL, Cédric TSHILEFE, Emmanuel MUTEBA MUYEMBE
Délégué de la Faculté, Nathan NGOY LUKALU,
Michée ILUNGA NGOI apôtre,
Nous remercions enfin notre pasteur Sera PANGA, nos
collègues de la promotion : KABULA BEYA François, MUMBA CHANDA
Ignace, MBAYO MPUNGU Venance, NUMBI KINGOMBA Gervais, BANZA MADI Franck, BILOLA
KAKONDE Raymond, KAHILU NAWEJI Arnold, TSHIKOMBA MWEPU Odon, KABWE MUSAMBI
Jeannot, MIANDABU MUSENGA Grace et KANKU MABIKA Gracia, qui constituent le
corps clinicien.
Notre famille, Emerence MWIKA, Patshou NGOIE SIMBI, Christian
NGOIE SIMBI, Papy KABANGE NUMBI, Eric KABALA ILUNGA, Jean-Claude MWENGE MULONGO
et Olivier MUZEITUNI KABANGE MUKUTA MUKENA.
Que la glace de DIEU vous couvre !
0. INTRODUCTION
0.1. PROBLEMATIQUE
Notre rapport des recherches est fondé sur la carence
affective qui est une situation stressante qui conduit de fois à des
maladies mentales qui perturbent la santé mentale. Ce travail est le
fruit des observations, des multiples entretiens avec la victime que nous avons
proposé d'appeler MUNONGO (pseudonyme) et les membres de sa famille.
Nous avons mené nos recherches à l'hôpital
général de référence JASON SENDWE à
Lubumbashi. Cet hôpital accueille de plus en plus des cas des maladies
comme des psychoses (puerpérale, schizophrénie), des
névroses (phobique, carcérale), des états limites
(syndrome de korsakoff, dépressions), et des troubles simples
(paludisme, crise émotionnelle).
La maladie mentale est considérée comme un
désordre dans la manière de vivre d'un individu, désordre
dont la gravité l'empêche de se comporter de façon
appropriée ou normale dans la société, la famille ou
l'environnement.
La maladie mentale est un ensemble de troubles
caractérisés par des symptômes tels que des changements
d'humeurs, des perturbations de la réflexion ou de la perception, des
observations ou des peurs insurmontables, ou encore des niveaux
élèves d'anxiétés débilitants (Kitwa,
2012).
Gelarbert (2007, p.5) déclare que les maladies mentales
produisent de la peine et de la souffrance non seulement à celui qui en
est affecté, mais aussi aux êtres chers avec lesquels il partage
sa vie. A ce niveau, nous voulons dire que : dans notre société
africaine, quand un membre est malade ou souffrant, c'est n'est pas seulement
lui qui en souffre, c'est plutôt tout le système qui en est
touché, à telle enseigne que tous les membres de sa famille
prendront chacun cette souffrance comme sienne, pour chercher comment y
remédier en vue de trouver un équilibre psychosocial.
Car certains malades mentaux sont dangereux pour
eux-mêmes et/ou pour autrui. Ainsi pour ceux-ci, l'hospitalisation en
milieu psychiatrique et leur prise en charge psychosociale est d'une
impérieuse nécessité afin de leur permettre de retrouver
leur équilibre psychique et leur réinsertion sociale.

9
*Du point de vue cognitif : la
logorrhée, les idées incohérentes, pensées
irrationnelles, délires de persécution, angoisse etc.
Nous pouvons dire qu'un sujet est malade mental à
partir du moment où il ne peut plus se comporter ou agir
conformément aux normes sociétales, tant au niveau de ses
relations familiales et amicales qu'au niveau de ses relations sociales voire
professionnelles (Kitwa, 2012).
Nous pouvons encore déclarer que tel symptôme
observé chez un tel sujet témoigne de la présence d'un
trouble du comportement ou relève d'une pathologie quelconque, si ce
symptôme devient permanant. Cela veut dire : on parle d'un trouble mental
ou d'une pathologie, lorsque les symptômes qui le témoignent
persistent ou deviennent chroniques au point de perturber le fonctionnement
mental ou physique.
« Ayant un regard sur la carence affective, un
symptôme parmi tant d'autres, nous disons qu'elle est un manque ou une
insuffisance d'une substance indispensable à la vie et normalement
apportée par le milieu » (Doron & Françoise, 2011, p.
11)
A ce niveau, Lemay (2007) « www.michel Lemay et la
notion de carence affective 24 mars 2007 ». Propose une distinction
entre carence affective et abandon : il y a risque de carence affective, quand
un enfant de moins de trois ans n'a pas noué des liens d'attachement
suffisant solide, structurant et que cette fragilité n'a pas
été réparée, soit par les parents, soit par une
famille de substitution.
A ce niveau, nous avons réfléchis en ces termes
: l'abandon n'est pas une carence affective par ce qu'il est une des causes de
carence affective chez un bon nombre d'enfants. Ne pas s'occuper d'un enfant ou
le quitter pour toujours, ceci le conduira à un manque
d'affectivité ou d'attachement.
Lors de nos observations, nous avions relevé divers
comportements qui témoignent de la carence affective dont souffre notre
patient:
*Du point de vue affectif : le refus
d'accepter sa situation, (maladie ou trouble mental), découragement
d'expliquer la raison de son hospitalisation dans le service neuropsychiatrique
refus de parler de sa famille, de raconter son histoire ou sa vie, le
mutatisme, l'attachement excessif à sa grand-mère.

10

11
*Du point de vue physique : fatigue,
agitation, manque d'appétit, le repli sur soi, la solitude, la
méfiance.
Ainsi, sur base de ce tableau clinique qui regroupe d'une
manière aléatoire des symptômes de la carence affective et
avec le souci de promouvoir le processus d'accompagnement psychosocial de ce
patient en vue d'aboutir aux remédiassions de son cas, nous avons
formulé notre préoccupation en ce termes : l'accompagnement
psychosocial pourrait-il permettre le rétablissement biopsychosocial
d'un garçon victime de carence affective
0.2. HYPOTHESE DU TRAVAIL
Pour Doront et Parot (2012, p. 354), l'hypothèse de
recherche est définie comme « la position que l'on soumet à
la vérification par l'épreuve des faits » la formulation de
l'hypothèse est la première étape de la démarche
scientifique, suivie de la mise en oeuvre des moyens appropriés,
observations ou expérimentation, pour la vérifier ou la
réfuter.
Selon Lavarde (2008, p.105), l'hypothèse
générale dite théorique est une hypothèse de
travail qui précise la problématique. Son rôle est de
guider la réflexion, d'orientation de la recherche et le travail
d'exploration préalable. Elle repose sur les connaissances
théoriques déjà existantes.
Richelle cité par Lavarde (2008, p.232), définit
l'hypothèse comme une « explication fournie à titre
provisoire dans l'attente d'une vérification ». Elle s'avoue
être une explication incertaine parce qu'elle peut être
infirmée. Elle se distingue de la théorie qui rassemble et
organise des données confirmées, ou bien articule des arguments
explicatifs
Quant à nous, nous classifions l'hypothèse
comme, moyens et techniques pratiques fournies d'une manière provisoire
qui permettraient une remédiassions aux déséquilibres
psychiques et qui pourraient répondre à la question posée
de notre rapport des recherches. Ainsi, pour répondre à notre
préoccupation, nous avons formulé notre hypothèse de
travail comme suit : les symptômes développés par notre
patient âgé de 28 ans victime de carence affective
correspondraient aux théories évoquées par
différents auteurs et les moyens thérapeutiques que nous
envisageons résoudraient ce problème.
0.3. OBJECTIF ET INTERET DU SUJET
Cette étude vise l'accompagnement psychosocial d'un
garçon âgé de 28 ans, victime de carence affective. Le but
poursuivi est non seulement l'amélioration du traitement médical
pour une meilleure prise en charge thérapeutique, mais aussi et surtout
l'établissement d'un soutien psychologique et psychosocial efficace dans
une vision holistique.
La présente étude constituera un document
scientifique qui pourra permettre aux futurs chercheurs en psychologie
clinique, en neuropsychiatrie et à tout celui qui cherchera à
embrasser le domaine de psychologie clinique, d'effectuer un soutien
psychologique, une prise en charge psychosocial ou un accompagnement
psychosocial de victimes de carence affective.
L'intérêt social de notre étude
réside dans le fait que la réinsertion sociale des victimes de
carence affective tiendra désormais compte des informations sur les
procédures et procédés d'accompagnement psychosocial.
Cette étude pourrait aussi être utile aux professionnels de la
santé mentale !
0.4. METHODE ET TECHNIQUES
Pour mener à bien leurs investigations, les chercheurs
doivent recourir à une méthode et aux techniques afin d'atteindre
les finalités qu'ils se sont assignés. Une méthode est
l'ensemble de procédures, démarches ou règles
adoptées dans la conduite d'une recherche ou dans une pratique. Les
méthodes varient quant à leur degré de
généralité, du plus vaste au plus étroit (Doront et
Parot, 2011).
Dans ce travail nous utilisons la méthode clinique qui
est une approche essentiellement qualitative. En tant qu'option
d'individualité et démarche vers le malade, elle nous a permis de
nous occuper de la situation du patient en le poussant d'exprimer librement sa
souffrance afin que nous recueillions des données. C'est-à-dire :
nous lui avons posé plusieurs questions auxquelles il répondait
librement sans lui suggérer des solutions ou soit chercher à
conclure à sa place.
Selon Kitwa (2012, p. 4) « les techniques sont
considérées comme l'ensemble des moyens et de procèdes qui
permettent à un chercheur de rassembler ou de récolter les
informations », ce qui veut dire que cet objet est le cas sur lequel le
clinicien mène ses investigations, tout en notant tout ce qu'il constate
pour mieux élaborer un rapport des

12
recherches. Dans le cadre de notre étude, cet objet est
notre patient, sur qui notre observation était fixée en vue
d'obtenir diverses informations sur sa souffrance.
La technique est un moyen ou ensemble de moyens adaptés
à une fin. Ainsi, dans cette
étude nous avons utilisé les techniques
suivantes :
l'observation clinique, l'entretien (non directif, semi
directif, directif), le counseling, la psychothérapie individuelle, le
deuil comme processus de cicatrisation des blessures de base de la psychologie
et l'accompagnement psychosocial.
0.5. DELIMITATION DU SUJET
Notre étude est limitée dans le temps et dans
l'espace. Ainsi, selon l'objet d'étude, nous nous sommes
intéressé(s) à l'accompagnement psychosocial de carence
affective, qui est un manque précoce et durable d'affection. Cette
étude porte sur le domaine de la psychologie clinique. Dans l'espace,
nous avons mené nos investigations dans la ville de Lubumbashi,
précisément à l'hôpital général
provincial de référence JASON SENDWE. C'est en ce lien et au
service de la psychiatrie (salle 10) qu'a été interné
notre patient. Dans le temps, nous avons effectué nos recherches durant
la période allant du 27 novembre 2013 au 27 novembre 2014, soit une
durée de deux mois.
O.6.SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, notre étude est
subdivisée en trois chapitres. Le premier chapitre constitue le cadre
théorique. Nous y définissons les concepts clés, parlons
des théories explicatives relatives à notre thème et
évoquons les études antérieures. Le deuxième
chapitre décrit le cadre méthodologique. Nous situons le champ
d'investigation, les méthodes et techniques utilisées pour
analyser le cas, les moyens et buts poursuivis par l'accompagnement
psychosocial, et enfin, les difficultés rencontrées.
Le troisième chapitre porte sur les résultats de
la recherche. Il présente et analyse les données recueillies
à travers les observations multiples et entretiens avec le patient
carencé affectif. Il s'agit bien de la construction du sens quant
à l'application de la psychothérapie et d'accompagnement
psychosocial.

13
CHAPITRE PREMIER
CONSIDERATIONS THEORIQUES
Dans ce chapitre, nous définissons en premier lieu les
concepts clés de notre travail, ensuite nous abordons la théorie
relative à la carence affective, enfin nous parlons des études
antérieures .
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS
La définition des concepts facilite ou permet la mise
en lumière en vue d'éviter la confusion Diverger (2008) souligne
que les questions fondamentales des définitions des concepts aux termes
des bases et des définitions des concepts aux classifications, ne
rencontre pas l'unanimité des autres. Certes, un concept peut
revêtir plusieurs significations. Ce qui importe est que la
définition des concepts éclaire le lecteur à utiliser le
terme dans le contexte du travail mené.
Nous examinons tour à tour, les concepts accompagnement
(avec ses déterminants psychologique, social et psychosocial),
garçon, victime et carence affective.
I.1.1. ACCOMPAGNEMENT SOCIAL, PSYCHOLOGIQUE ET
PSYCHOSOCIAL
L'accompagnement se dit pour une personne qui en aide une
autre dans diverses situations de la vie. L'accompagnement social concerne les
personnes malades, handicapées ou mourantes. Il vise à aider les
personnes en difficultés à résoudre les problèmes
générés par des situations d'exclusions, établir
avec elle une relation d'écoute, de soutien, de conseil et d'entraide
(Sillamy, 1972, p 15).
Selon le psychologue Guibaud (Guibaud psychologue 44,
e-monsite.com) l'accompagnement
psychologique consiste à : écouter avec bienveillance, donner la
place aux mots du sujet ainsi qu'à ce qui ne se dit pas encore, soutenir
dans les moments difficiles, aider à prendre conscience de ses
blessures, à les panser, à les nettoyer, accompagner dans sa
transformation vers un mieux-être et une voie en cohérence avec
ses aspirations profondes
L'accompagnement psychosocial est un moyen
thérapeutique ayant une action d'aide, de suivi et d'orientation vers
des solutions. Anne le Rhum 2007
I.1.2. GARÇON
Un garçon est un enfant de sexe masculin, jeune homme.

14

15
I.1.3. VICTIME
Selon Doront & Parot (2011), est victime toute «
personne» qui souffre d'un préjudice matériel, physique,
moral du fait d'agissements malveillants d'autrui ou d'événements
extérieurs préjudiciables. Par extension, est victime, tout
individu qui perd la maitrise d'un objet, d'une situation ou d'un comportement.
(victime de sa conduite), qui est le jouet des manifestations
incontrôlées.
Une victime est une personne tuée ou blessée,
c'est encore une personne ou une communauté qui souffre des agissements
de quelqu'un, des événements, soit d'une situation. Larousse
éd 20O6, p 446
Quant à nous, une victime, est tout celui qui se trouve
dans une situation inattendue ou une circonstance imprévue telle que :
l'accident, la mort des parents, la maladie, les troubles psychiques,
psychologiques ou pathologiques.
I.1.4.CARENCE AFFECTIVE
La carence est un manque d'un ou des plusieurs
éléments dans l'organisme, susceptible à la satisfaction
des besoins humains et peuvent provoquer certains troubles biologiques et
psychologiques.
Parlant de la carence affective, elle est selon Sillamy (1972,
p. 55), un manque ou une insuffisance d'affection. Les besoins affectifs de
l'homme sont aussi importants que les autres et leur insatisfaction peut
être grave de conséquences. Tous les travaux effectués
depuis une trentaine d'années sur ce sujet, aboutissent aux mêmes
conclusions : l'amour est à l'homme ce que le soleil est à la
plante, en l'absence de ces éléments, le développement se
fait mal et la mort peut même survenir.
Il s'agit d'un manque ou d'une insuffisance des liens
affectifs de l'enfant avec sa mère. Absence ou insuffisance des
ressources d'un débiteur, élément indispensable à
l'équilibre psychologique ou au développement de l'organisme.
Nous pouvons bien remarquer avec Sillamy (1973, p. 141) que la
carence affective est un manque ou insuffisance qualitative des apports
éducatifs dans les différents milieux de la vie de l'enfant
(école, famille) ne permettant pas de satisfaire les différents
besoins de l'enfant : les besoins physiques, affectifs, intellectuels,
culturels, moraux et sociaux.
Lemay (2007) souligne qu'il y a carence affective ou risque de
carence affective quand un enfant de moins de trois ans n'a pas noué des
liens d'attachement suffisamment solide, structurant et que cette
fragilité n'a pas été réparée, soit par les
parents, soit par une famille de substitution.
Quant à nous, la carence est un manque d'un être
cher, de tout organe ou pas qui procure du plaisir en donnant sens à
l'existence humaine et au bien-être, dont on ne peut jamais combler. (Un
manque ne peut être jamais comblé, car il est
irremplaçable).
I.1.6. AFFECTION & AFFECTIVITE
Bernard et Geneviève pierre (1977), définissent
l'affection comme un état qui exprime un attachement, une tendresse ou
un contact bien déterminé d'une personne pour une autre.
Pour Doront & Parot (2011) la notion d'affection est d'une
extension et d'une compréhension assez vagues, englobant des
états aussi divers que les émotions (passions, sentiments,
anxiété, angoisse, tristesse, joie, voire sensations de plaisirs
et de douleur)
L'affectivité est un ensemble des états
affectifs, des sentiments, émotions et des passions d'un individu. Si,
pour des raisons d'exposition commode, l'on distingue habituellement, dans la
vie mentale de l'homme, trois sphères différents : la
sphère intellectuelle, la vie affective, et l'activité, celles-ci
sont en réalité, intimement liées et indissociables l'une
de l'autre. Cela est particulièrement sensible pour
l'affectivité, qui constitue l'aspect le plus fondamental de la vie
psychique, la base à partir de laquelle s'édifient les relations
interhumaines et tous les liens unissant le sujet à son milieu,
lorsqu'une modification intervient dans l'organisation affective d'un
être humain, elle retentit sur l'individu tout entier, son efficience
intellectuelle, ses attitudes et son comportement.
La joie, le plaisir du succès libèrent les
énergies, stimulent l'intelligence et favorisent l'épanouissement
de la personnalité. Les préoccupations anxieuses,
l'insécurité, l'angoisse, au contraire, qui freine et inhibent le
développement de la personne, sont responsables de très
nombreuses inadaptations sociales. Elles se retrouvent dans les échecs
scolaires, la plupart des névroses, les troubles psychosomatiques et
certaines psychoses (Sillamy, 1972, p.15). Quant à nous,
l'affectivité est un ensemble des états affectifs entre-autres :
des émotions, des sentiments, et des passions, aux quels proviennent le
plaisir d'atteindre un objectif de vivre au prêt des parents, de
réussir sa vie. Et dans ce cas, le déplaisir,
révèle l'existence d'un obstacle qui empêche d'atteindre
l'objectif visé et qui conduit de fois à une carence
affective.

16
I.2. NOTIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA CARENCE AFFECTIVE
I. GENERALITES
*Origine, historique et évolution de la carence
affective
Le terme « carence » est profondément
polysémique, subjectif au sens premier, il signifie manquer, du latin
carence, mais de quel manque s'agit-il ?
Situé du côté du manque, la carence est un
constitutive de l'humain pour lequel fait toujours défaut cet obscur
objet du désir, sa de finit suppose donc un consensus théorique
sur les besoins fondamentaux de l'être, mais également sur les
seuils en de ça desquels la carence s'inscrit et pénalise de
carence n'existe pas en tant que tel, laissant chacun en repérer les
traces et en évaluant la manifestation à travers les
difficultés d'un enfant ou d'un adulte.
Le terme carence issu de la médecine, désigne le
manque ou l'insuffisance d'une substance nécessaire à la vie et
qui est apportée par l'environnement dans un cadre normal. Il est
difficile à première vue de pouvoir appliquer cette
définition au concept psychologique de carence affective ; car cz qui
manque dans ce cas est immatériel, invisible, ce qui explique sans doute
le fait que ce concept, pourtant primordial en psychologie. Ne s'est
développe que tardivement chez l'enfant est en effet relativement
récent. Car comment aurait-on pu parler d'un tel concept alors que
pendant longtemps, on considère le nourrisson comme un enfant tube
digestif ? le développement d'une psychologie plus proche de la
réalité du nourrisson, notamment grâce aux travaux de R.
Spitz concernant ce qu'il a appelé la dépression anaclitique et
hospitalisme, à permit cette simple constatation : le nourrisson a
d'autres besoins que ceux que l'on pourrait qualifier de « vitaux »,
ces travaux montrent que l'enfant a non seulement besoin de la nourriture et
des soins que peuvent lui apporter son entourage mais aussi de son
affection.
Alimenter le nourrisson, le changer ou le soigner ne sera pas
suffisant si ces actions ne sont pas accompagnées d'une certaine charge
affective. Les travaux de J. Bowlby sur le concept d'attachement l'accent sur
la primauté du « besoin d'amour » par rapport aux besoins dits
« vitaux » ou même sur la présence ou non de la
véritable mère biologique. « Mémoire de David
Fernandez les carences affectives chez l'enfant. Www. Psychologie.
Fr/CGI-bien/moteur »

17
Il a donc besoin que quelqu'un prenne soin de lui. Maman que
devez-vous à vos enfants ?
I.2.1. CAUSE D'UNE CARENCE AFFECTIVE
Comme nous l'avions souligné dans les points ci-hauts
que la carence affective est un déséquilibre ou une insuffisance
en provenance des plusieurs causent dont voici les plus marquées que
nous citerons sans pour autant entrer en détaille :
La mort d'un des parents ou de tous les deux,
Le divorce de parents, ou d'un couple parental,
L'absence des soins maternels, la naissance d'un
nouveau-né,
La polygamie des parents, l'abandon, l'antipathie entre la
mère et l'enfant, l'inoccupation de la mère vis-à-vis de
l'enfant (surtout les mères qui passent toute la journée au
service, en abandonnant leur enfant entre les mains de la bonne ou d'une autre
personne)
I.2.1.1. CONSEQUENCES DE LA CARENCE AFFECTIVE CHEZ LES
ENFANTS NEGLIGE
Ces enfants peuvent connaitre des troubles divers
appelés stigmates neuro-parthiques ou névrotiques. Ces termes
désignent une chose des troubles physiques ou psychiques ou encore
psychosomatiques que l'on rencontre chez un enfant isolé avec une
fréquence plus ou moins grande. Il s'agit en quelque sorte d'un retard,
du développement ou des certaines intégrations dont les sujets
souffriront pendant toute leur jeunesse ou même plus tard.
I.2.1.2. La naissance
Nous savons aujourd'hui que l'enfant avant sa naissance est un
être humain conscient et capable des réactions qui, dès le
sixième mois de grossesse a une vie affective active. Apres la
naissance, des bouleversements, sorti de l'utérus, le bébé
n'est plus nourri automatiquement, le pipeline qui l'approvisionnait en
oxygène et en substances nutritives, n'est plus la. Pour vivre, le
bébé doit commencer à respirer et à absorber
lui-même des nutriments. Il a besoin de quelqu'un qui le nourrit et qui
comble ses autres besoins psychologiques. Un nouveau-né doit
également se développer sur le plan mental, affectif,
moral,...

18

19

20

21
I.2.1.3. Les besoins affectifs de l'enfant
L'enfant Vient au monde en bénéficiant de
l'affection de ses parents, c'est en eux que se trouvent les
particularités physiques, intellectuelles et morales. La moindre
privation affective de sa mère provoque une frustration dont les
conséquences se répercutent sur le comportement total de la vie
de l'enfant. La psychanalyse a relevé le tort immense provoqué
par les erreurs d'éducation telles que les mots qu'il ne fallait pas
dire, un geste un peu suffit, un ton de voix qu'il ne fallait pas prendre. Tout
simplement parce que cet être humain fragile est extrêmement
sensible. Les impressions faites sur lui sont très profondément
conservées dans le subconscient. Au point de déterminer plus tard
de névroses, des psychoses et des manies, d'autres comportements tels
que l'énurésie, le vol, la coprophagie, la kleptomanie, peuvent
être les conséquences d'une carence affective intervenant dans la
relation parents enfant surtout, dans la première enfance.
Lorsque les troubles apparaissent isolés, ils ne
revêtent pas une grande signification, pourtant, l'énurésie
et l'encoprésie à elles seules peuvent se représenter
finalement pour l'adolescent une grave invalidité. En revanche, lorsque
plusieurs de ces troubles sont associés, ils sont l'indice d'état
de tension, d'angoisse, ou représentent dans le premier stade d'une
névrose infantile pour le dépistage de ces troubles psychiques de
l'enfant, d'une part, la connaissance de ces stigmates cités ci-haut est
utile :
- Le fait de sucer le pouce après l'âge de deux
à trois ans, - L'énurésie nocturne,
- L'encoprésie, l'angoisse nocturnes avec toutes les
craintes irraisonnées qui peuvent être précurseurs des
phobies ultérieures,
- Les troubles du sommeil, les cauchemars
répétés et le somnambulisme,...
C'est ainsi que l'extrême privation affective due
à l'absence d'un ou de deux parents, provoque un
déséquilibre, un retard développemental ou certains
comportements considérés comme pathologiques. Ainsi, nous pouvons
dire qu'il y a la coïncidence entre nous et Maurice Tieche lors qu'il dit
: l'amour se nourrit, que l'absence de satisfaction affective se traduisant par
un retard à la fois physique et intellectuel très marqué
(Guide pratique, 1976, p 41).
Les effets d'une séparation peuvent avoir des
répercutions plus ou moins importantes suivant le sujet, la
période de séparation, l'existence ou non d'un « substitut
maternel, infirmiers auxiliaires, autres parents ».
I.2.2. LA PERCEPTION DE LA SEPARATION PARENTALE PAR
L'ENFANT
Il nous semble important de présenter la façon
dont l'enfant perçoit la séparation parentale car elle permet de
mieux comprendre ses réactions immédiates (N. Kalter et J.
Plunkett) ont étudiés la perception qu'avaient les enfants des
causes et des conséquences de la séparation parentale, en
utilisant un test psychologique de type projectif complété par
l'interrogatoire des parents. Un enfant sur trois pensait que les enfants
étaient responsables de la séparation des parents, qu'ils soient
ou non confrontés à cette situation. Ce sentiment de
culpabilité était plus important chez les enfants de moins de
huit ans, ce qui s'explique par le mode opératoire de leur
pensée. Le divorce était le plus souvent perçu comme
source de troubles affectifs et des difficultés du comportement chez les
enfants qui vivaient dans une famille unie (37% contre 55% des enfants qui ont
des parents séparés) ces résultants confirment notre
impression clinique : L'enfant s'adapte à sa nouvelle situation
familiale et relativise à la tristesse et au chagrin. Le fait de grandir
l'aide à mieux appréhender intellectuellement cette situation.
I.2.2.1. L'adaptation de l'enfant à la
séparation parentale en fonction de son âge
Comme nous l'avons vu, les réactions de l'enfant
à la séparation parentale sont influencées par son
âge et par sa capacité(selon son stade de développement)
à intégrer à la fois intellectuellement et affectivement
la réalité de sa nouvelle situation familiale.ces données
sont confirmées par les résultats de l'étude que : J.
Wallenstein et J. Kelly ont menées depuis 1971 sur les
conséquences psychologiques de la séparation parentale chez
l'enfant(à partir de soixante familles californiennes
séparées, ayant cent trente et un enfants de deux à
dix-huit ans lors de la première consultation) ces auteurs ont
montré qu'au moment de la rupture, l'enfant a du mal à donner un
sens aux événements familiaux, sauf lorsqu'il a connu un climat
de violence familiale.
L'enfant de moins de cinq ans :
Il peut manifester un arrêt ou une régression de
ses acquisitions psychologiques ou scolaires, des troubles du sommeil ou des
manifestations d'angoisse (pleurs) lors des séparations. Il peut
présenter des troubles de comportement avec des difficultés de
contrôler
ses agressivités. Son sentiment
d'insécurité se traduit par un besoin affectif
généralisé. Parfois il se refuge dans un monde imaginaire
où il refuse la réalité et fantasme sur l'absence de
séparation ou sur la réconciliation de ses parents. Il a peur
d'être remplacé dans le coeur du parent qui ne vit pas avec lui.
Les motifs principaux de consultations spécialisées sont les
troubles du comportement, à la maison comme à l'école.
C'est devant cette tranche d'âge que les enseignants se
sentent les plus démunis face aux difficultés exprimées
par l'enfant et qu'ils ne savent pas comment intégrer dans leurs
objectifs pédagogiques cette donnée d'ordre privé.
L'enfant de six à huit ans :
Il manifeste une plus grande nostalgie du père absent.
Il peut avoir de la difficulté à quitter le giron maternel. Les
conflits de la loyauté apparaissent. Les apprentissages de la lecture et
de l'écriture sont rendus difficiles par l'absence de
disponibilités affectives. A cet âge, le repli sur un monde
imaginaire est moins souvent observé mais la peur d'être
abandonné est plus forte. L'enfant peut exprimer de la colère
contre sa mère (ce qui apparait sous forme de refus de toute
autorité) mais cache plus facilement son agressivité envers son
père ; c'est ainsi qu'un garçon de huit ans refusait de grandir ;
il était tyrannique avec sa mère, obéissant ; en fait, il
souffrait d'une relation trop exclusive avec sa mère.
L'enfant de neuf à douze ans :
Il a une capacité plus grande à comprendre la
réalité. Il investit plus facilement les activités
scolaires ou extrascolaires. Ses manifestations de rejet contre le parent qui
est parti, sont plus intenses. La colère est mieux organisée et
diriger contre un objet précis. L'alimentation sur le parent
opposé à la séparation est plus fréquente, cette
attitude pouvant entrainer un rejet complet du parent jugé fautif. Les
repères identificatoires peuvent en être perturbés, comme
les références au sens moral. En fait, l'enfant souffre parfois
de ce qu'il induit, amène en lui.
L'enfant de treize à dix-huit ans :
Il est dans une période de transition. Les conflits de
loyauté et les risques d'alignement sur un des parents sont moins
importants, car il relativise d'avantage sa place au sein des
développements familiaux. L'investissent dans son groupe de copains et
auprès d'adultes référents est plus important à cet
âge.
A ce niveau, l'étude publiée par D.M. Fergusson
est intéressante car elle est centrée sur les relations
éventuelles entre la date de survenue d'une rupture du couple parentale
et l'apparition des troubles psychiques au moment de l'adolescent. Mille deux
cents soixante-cinq enfants ont été inclus dans cette
étude prospective et comparative qui a recherché comme signes
pathologiques chez l'adolescent l'existence d'une activité sexuelle
précoce, une toxicomanie (tabac, alcool, drogue), des troubles du
comportement et des troubles de l'humeur. Des facteurs socio-économiques
concernant les parents ont été précisés, comme
l'existence des parents toxicomanes, un niveau socio-économique bas et
la persistance des conflits parentaux.
Le Giron maternel : sous la protection de la mère ou
sous la protection maternelle. Tyrannique : ne pas respecter la liberté
ou l'autorité de l'autre.
I.2.2.2. L'adaptation de l'enfant à la
séparation parentale en fonction de son sexe :
Les études ne sont pas toutes concordantes mais un
certain nombre de réactions sont plus souvent observées selon
qu'il s'agit des garçons ou des filles. C'est ainsi que J. Black et P.
Gjerde, ont réalisé en Californie une étude (prospective,
longitudinale et comparative) où cent vingt-huit enfants ont
été inclus. Les garçons âgés de trois-quatre
ans, dont les parents étaient séparés, présentaient
de façon significative une tendance à l'émotivité
et une plus grande difficulté à obéir et à
contrôler leurs impulsions.
Vers l'âge de sept ans, s'y ajoute une plus grande
agressivité, avec une recherche des limites dans leurs relations avec
les adultes. Ils présentent une hyperactivité avec un
comportement irréfléchi. Ils exprimaient de l'angoisse devant des
situations imprévues, les auteurs ont constaté que les
garçons qui présentaient des troubles du comportement
après la séparation de leurs parents, manifestaient
déjà ces troubles avant la séparation. Les conflits
parentaux, présenté avant la séparation parentale,
seraient la cause de ses troubles.
Les filles de trois ans ne semblaient pas affectées par
la séparation de leurs parents. Dès l'âge de quatre ans,
elles paraissaient plus renfermées, s'excluant plus facilement du
groupe. Cette tendance au repli semblait s'accentuer vers l'âge de sept
ans. Les filles investissaient beaucoup l'école et présentaient
de très bonnes performances intellectuelles. Il ne semblait pas y avoir
chez elles s'exprimaient globalement moins de réactions que les
garçons face aux perturbations familiales qu'elles rencontraient.

22
Les troubles présentés par l'enfant au moment de
la rupture traduisent une souffrance affective qu'il n'arrive pas à
élaborer et qui s'exprime dans des troubles du comportement est
I.2.2.3. L'évolution de l'adaptation de l'enfant
à la séparation parentale
La séparation parentale est la manifestation visible
des modifications survenues dans les relations élaborées entre un
homme et une femme devenus, parents. Il est important de dissocier
approximativement la période de la rupture, qui marque un changement
important dans la vie concrète de l'enfant (départ d'un des
parents du foyer, parfois changement de maison, d'école, de quartier,
voire de ville ou de pays), de la période où la séparation
est effective et s'accompagne d'une réorganisation de sa vie quotidienne
avec parfois, l'apparition d'un nouveau conjoint (ayant éventuellement
lui-même des enfants). Des demi-frères ou demi-soeurs peuvent
naître au sein de la nouvelle famille dite « recomposée
» ou « mosaïque » il existe une troisième
période, qui précède la rupture et qui correspond au temps
des mésententes du couple parental. L'intensité des conflits
parentaux à ce moment-là, semble jouer un rôle
prépondérant dans l'apparition des troubles psychiques chez
l'enfant, avant même que la rupture du couple ne soit annoncée.
« Gérard poussin et E. martin-Lebrun Dunod 2011 paris »
De ce fait, il est important de prévenir les troubles
psychiques chez l'enfant, dans les lignes qui suivront :
I.2.3. PREVENTION DES TROUBLES PSYCHIQUES CHEZ
L'ENFANT
La rupture du couple parental crée une souffrance
affective chez l'enfant (peut-être lorsqu'elle clôt une des
enjeux). De nombreuses études (déjà citées), ont
montré que l'adaptation dans le temps était satisfaisante pour la
plupart des enfants. Certains, pourtant, vont ressentir plus fortement l'impact
de la séparation parentale. Les troubles affectifs comme la (tristesse)
s'associent à des signes de souffrance psychique, exprimant la
difficulté qu'a l'enfant d'élaborer la rupture du lien affectif
envers ses parents. Les troubles présentés peuvent être
immédiates ou survenir à un stade tardif de son
développement. Il nous semble nécessaire de connaitre les
facteurs qui vont aider l'enfant à mieux s'adapter à sa nouvelle
situation familiale, de favoriser leur mise en place et de dépister
tôt les troubles psychiques qui nécessitent pour l'enfant, comme
pour ses parents, une prise en charge spécialisée.
I.2.3.1. les troubles psychiques présentés
par l'enfant

23
nette, qu'elle que soit l'âge. Les troubles
réactionnels sont proches de ceux que l'on peut observer au moment du
deuil : anxiété, culpabilité, dépression et
angoisse d'abandon.
*l'anxiété :
Elle traduit une inquiétude injustifiée de
l'enfant devant toute situation qu'il ne contrôle pas. Elle renvoie
à l'angoisse qu'il ressent devant toute séparation. Les liens qui
se tissent entre la mère et son bébé dans les premiers
mois sont très importants. Si les interactions sont suffisamment
adaptées entre eux, l'enfant prend confiance en lui comme il a confiance
en sa mère ; il s'adapte mieux aux situations imprévues et aux
séparations. Si les interactions sont mal adaptées, l'enfant
n'arrive pas à anticiper le comportement de l'adulte et à lui
donner un sens. Lorsqu'il est très jeune, il rejette la relation par des
pleurs ou se replie sur lu. Plus tard, devant des situations nouvelles ou peu
sécurisantes, il aura tendance à reproduire ces manifestations,
rendant la communication difficile. La situation est différente chez
l'enfant un peu plus grand, car l'utilisation du langage lui permet d'exprimer
différemment ce qu'il ressent.
*le sentiment de culpabilité :
Il est présent chez l'enfant, surtout lorsqu'il est
jeune. Sa vision egocentrique du monde (caractéristique de ses
capacités mentales à cet âge ne lui permet de comprendre
une situation qu'en fonction de lui-même. Il a l'impression que tout ce
qui arrive est de sa faute. Même s'il en est pour rien. Il se dit qu'il
n'a pas été sage, et il est puni par la séparation des ses
parents, il refuse de jouer, de manger, ce qu'il aime, soit en faisant des
bêtises qui entrainent une sanction de la part de l'adulte. D'adultes et
cela ne change pas l'amour qu'ils ont pour toi>> dans certains cas,
l'arrivée de l'enfant est effectivement la raison du départ du
père ou de la mère.
*la dépression :
Elle est fréquente lors de la séparation des
parents. Elle est en relation avec le sentiment de perte que ressente l'enfant
devant cette rupture du couple parental originel. Elle peut exprimer
également son identification à l'un de ses parents et à sa
souffrance. Elle se manifeste par une diminution du gout de vivre et par une
plus grande difficulté à investir d'autres centres
d'intérêt. Elle s'accompagne de tristesse, de mélancolie,
de perte du gout pour le jeu et d'apathie. Elle justifie un travail
spécifique pour aider l'enfant à sortir de cet

24
état pathologique, l'aider à se
différencier de ses parents et s'appuyer sur les éléments
positifs de sa vie.
*l'angoisse d'abandon :
Elle est forte au moment où l'enfant constate que l'un
de ses parents s'éloigne de l'autre. Il a peur que ses parents ne
s'intéressent plus à lui et ne le quittent. Cette angoisse est
très ancienne dans la vie psychique de l'enfant car elle apparait
lorsqu'il découvre la réalité de la séparation et
prend conscience de l'absence dès sa première année.
Très tôt, il perçoit son état de dépendance,
qui diminue au fur et à mesure qu'il acquiert une plus grande autonomie.
Mais grandir, c'est se séparer chaque jour de ses
<<tuteurs>>. Il faut beaucoup de temps (l'enfance et parfois plus)
pour atteindre cette maturité qui caractérise l'état
adulte et permet à son tour de devenir support de vie. Quelques soient
son âge et la qualité des relations qu'il a
intériorisées. L'enfant peut ressentir de l'angoisse devant le
risque d'abandon. Ce ressentiment est d'autant plus déstructurant qu'il
renvoie à une situation réelle.
*l'effet néfaste de l'abandon de l'enfant par un
de ses parents :
Il est très difficile de mettre en évidence une
relation claire entre l'irrégularité des rencontres de l'enfant
avec son père (ou leur absence, ce qui est le cas le plus
fréquent) et l'apparition de troubles psychologiques. Différents
facteurs, comme les conflits dont l'intensité peut favoriser un abandon
ultérieur, sont intriqués. Les recompositions familiales
influencent également la façon dont l'enfant réagit aux
changements survenus dans sa famille. L'observation clinique montre qu'il
souffre d'être abandonné par un de ses parents. Il est
également très perturbé par l'incohérence du
comportement de celui qui ne vit pas avec lui. On s'en soutien, une fillette de
cinq ans a dessiné une maison en ruine le jour où son père
n'est pas venu la cherché comme il avait annoncé.
Une analyse plus complète de l'étude de l'INED
réalisée en 1985 montre que l'abandon par le père
était plus fréquent lorsque la séparation du couple
parental avait lieu avant la naissance ou pendant la première
année de vie (plus d'un enfant sur deux). Le risque était moins
important lorsqu'elle survenait après l'âge d'un an (un enfant sur
quatre). Le fait qu'il y ait eu un mariage semblait également favoriser
la persistance des liens entre l'enfant et son père (un enfant sur
quatre ne le voyant plus après le divorce). Dans le cas d'union libre,
le temps de présence du père auprès de l'enfant
était déterminant : deux enfants sur trois ne voyaient plus leur
père après la rupture du couple parental lorsqu'ils avaient
vécu moins de

25

26

27
deux ans avec lui. (Contre un enfant sur quatre lorsqu'il
avait vécu plus de deux ans avec lui). Le niveau socio-économique
jouait également un rôle prépondérant dans le
maintien des liens entre l'enfant et son père : un enfant sur deux
voyait son père régulièrement lorsqu'il était
cadre, contre un enfant sur cinq quand il était ouvrier. Dans la
première étude que nous avons faite en Isère, les enfants
étaient aussi nombreux à rencontrer régulièrement
leur père, qu'elle que soit sa profession. En revanche, les abandons
étaient plus fréquents chez les ouvriers alors que les contacts
irréguliers étaient plus souvent observés lorsque le
père était cadre.
A ce niveau, Michel Lemay comme nous l'avions dit dans
l'introduction, il a opéré trois situations d'abandon non
réparées :
Intrafamiliale : un parent seul,
démuni, le plus souvent une femme avec un lourd passé
d'extrêmes limites dans ses compétences parentales, une femme qui
veut se réparer mais qui, du fait de ses compétences parentales
limitées, oscille entre des moments d'hyper protection et des moments de
rejet, qui débordée par l'enfant, le confie à une voisine,
puis culpabilisée, le reprend, puis, débordées à
nouveau, l'abandonne, c'est le départ des carences affectives.
La grande carence : Dénoncée
par Spitz, Bowlby, Myriam, David, Geneviève appel,
liées aux carences de l'institution, aux insuffisances du personnel, sa
rotation, à la fragilité des parents des milieux riches dans
lesquels les parents investissent beaucoup à l'extérieur, avec
une succession d'employés de maison, l'enfant devient difficile, la
rotation s'accélère...
Quant à Napolito, cité par Lemay, mais la
souffrance de l'enfant est toujours la même ; Michel Lemay ; pour
l'expliquer, il faut le développement de l'enfant. L'enfant pour se
construire doit effectuer deux processus simultanément d'une part et
d'autre par s'individualiser, se distinguer de l'autre ; c'est la constitution
d'une « colonne vertébrale psychique » suppose des acquis.
L'enfant prenne conscience de son corps, comme limite, comme
contenant, comme contenu, comme fierté, avec une motricité qui se
développe. Cela ne peut se faire que si l'enfant est investi, et toute
une série des stimulations. Dans la carence, du fait de la
discontinuité des soins, il y a une discordance.
S'enraciner : dans une espace, sa maison, son
quartier, des objets reconnus. Séquences temporelles
régulières. Dans ces séquences, l'enfant va
inscrire des souvenirs, donc un sentiment du présent et la
capacité de se projeter.
Conviction de pouvoir agir sur l'environnement
: afin qu'il vit des événements qu'il ne
maitrise pas, cela va attaquer sa maitrise de la
causalité.
Gère son anxiété :
découvre qu'il est limité, mortel, il va devoir accepter
d'être castré. L'anxiété est nécessaire pour
mobiliser nos compétences, à condition de ne pas être
envahi par l'anxiété. Il va introjecter des personnes
significatives. Si ces personnes se dérobent, c'est le désert,
puisque l'enfant ne peut pas tout réaliser, il va pouvoir
réaliser des désirs. Chez l'enfant carencé, ce monde
hallucinatoire est soit trop pauvre, soit il est submergeant ; il y a tel
manque qu'il lui faut créer des figures toutes puissantes. Pour
s'enraciner, il faut développer un langage, des activités
ludiques, symboliques.
Grace à cela il est possible de se construire, de
gérer son agressivité, sa sexualité. Quand « la
colonne vertébrale » est fragile, il y a une symptomatologie que
constitue le syndrome carentiel. Sur le plan symptomatique, Spitz, Bowlby,
David, appel, ont reconnu que des enfants présentant des troubles de la
relation ou les troubles relationnels, ont une absence de gestes anticipateurs,
une faute du regard, des souffrances dans leurs corps, des troubles
alimentaires, des troubles du sommeil, qui rendent ces enfants difficiles quand
on voit ces enfants évoluer, on voit apparaitre une symptomatologie
différent. Il y a beaucoup d'écrits sur les bébés
carencés, mais très peu sur ces enfants à l'âge de
latence. A 7, 10, 12 ans, ils montrent une extraordinaire avidité
affective, je les appelle les petits anthropophages de l'amour. Ils veulent
nous dévorer dans notre temps et notre espace. Le clinicien peut
d'ailleurs les reconnaitre à distance : ce sont des mots oraux qui sont
employés pour les décrire : « il me dévore »
« je ne vais pas me laisser bouffer »
Mais cette grande avidité affective s'accompagne d'une
grande difficulté à accepter les manques d'affection : les petits
anthropophages de l'amour ont du mal à digérer l'amour. Ils
présentent ce que j'ai appelé « j'ai mal à ma
mère » des mécanismes de brisure ce sont de coupure que
l'enfant déclenche que chaque fois qu'il demande de l'amour.
L'enfant va demander que l'on s'occupe de lui, mais quand on
le fait il devient agressif, injurie, est en colère. L'adulte ne
comprend pas, l'enfant veut beaucoup d'objets qui sont cassés, perdus,
très vite. A quoi sont dus ces mécanismes de brisure ?
A plusieurs causes qu'il est important de comprend : ils ont
de tels manques affectifs que ce qu'on leur apporte est toujours
dérisoires ce qu'ils reçoivent n'est jamais satisfaisant, ce qui
avive leur agressivité plus ont les aimes, plus ces enfants deviennent
agressifs et
exigeants. Une autre raison c'est que pour eux, aimer c'est
pouvoir être abandonné. Du coup ils testent : toi aussi tu vas me
rejeter, vas-tu accepter de passer le test ?
Ces enfants ont une très faible estime
d'eux-mêmes car ils n'ont pas été désirés,
ils ont des mots terribles, par exemple une petite fille convaincue
d'être mauvaise : « je suis un avortement raté »
Ces grandes blessés sont de grands
déprimés, on ne peut pas vivre avec le manque, ils vont se
construire le phantasme d'une mère mystique idéalisée qui
pourrait combler leurs manques, toutes puissance, mais avec une
agressivité à son égard car elle abandonne, il y a un
mélange détonnant de quelqu'un qui aime et de quelqu'un qui
pourrait détruire.
On comprend bien alors que quand ces enfants rencontrent un
personnage maternel (homme et femme) ca les renvoie à
l'agressivité vis-à-vis de ce personnage mythique. Cela explique
l'agressivité « qu'ils ne peuvent décharger sur ce
personnage inconnu » l'incapacité à supporter la
compétition, le manque de désir de sensorialité,
l'énurésie, l'encoprésie, le caractère
régressif de leur demande, leurs faibles capacités à se
défendre face à des pédophiles. Pour eux, une façon
que l'on s'occupe deux, est d'être malades ?
Ils ont des difficultés dans leur scolarité,
sont désorientes dans le temps, dans l'espace, dans le monde familial,
dans le monde scolaire, dans les loisirs, c'est l'échec. Mme Napolito :
quand ces enfants grandissent, c'est un drame quand ils deviennent parents.
Michel Lemay : ce sont souvent des jeunes gens qui veulent
réparer leur passé : on veut u bébé très
vite. Et dans une proportion importante, ils rejouent le drame qu'ils ont
vécu. C'est facile à comprendre si l'on fait que le désir
sexuel, le désir de couple et le désir d'enfant c'est ne pas la
même chose.
Le désir sexuel : ils ont une telle soiffe d'être
aimés, que dans le choix de l'être aimé il y a un manque
d'esprit critique. La sexualité est souvent prégénitale,
mais ils ont toujours un désir de grossesse, un désir
réparateur. Pendant la grossesse ils ont un comportement que les
maternités devraient pouvoir repérer afin de pouvoir les aider :
le bébé imaginaire est extraordinaire, il va tout réparer.
Mais, au 4eme, 5eme et 6eme mois om ne voit pas de préparatifs, pas de
layette, pas de berceau, pas de chambre, il ya un immense décalage entre
le discours et les actes concrets.

28
Accepter un partenaire, c'est accepter de partager, ne plus
fusionner avec l'enfant. Cela peut être insupportable pour ces parents
déprimés. Quand on dit cela, le risque est d'être
Souvent aussi on découvre une absence étonnante
de précaution par exemple, des prises de risque enfin de grossesse. Il y
a un mouvement d'amour et un mouvement destructeur. Le désir de
grossesse est là, mais pas le désir d'enfant. Etre parent, c'est
accompagner un être humain dans un processus de séparation et
d'individuation. C'est toujours vécu de manière ambivalente : on
voulait en petit poussin et on a un canard qui a bien raison de vouloir
s'envoler.
Ce mouvement de séparation est insupportable pour les
parents carencés. Cela a beaucoup des conséquences sur les
compétences parentales. Le bébé réel, qui dort mal,
vomi, fait caca, devient vite un bébé persécuteur, ce qui
peut aboutir à un risque de maltraitance. Pas tout de suite car c'est
d'abord un bébé qui accepte d'être un objet poupée,
mais quand l'enfant commence à expérimenter à s'opposer,
il envoie un message : tu es là pour m'accompagner, pour me
réparer, pas pour fusionner, là certains refont un enfant, ou
deviennent violents avec cet enfant persécuteur, ou partent. On ne peut
être empathique que si on ne se confond pas avec l'enfant.
Chez les parents carencés, on voit très vite des
troubles de l'empathie. Par exemple une maman dont l'enfant pleur, elle est
fatiguée, elle pense que l'enfant est fatigué. Elle va le laisser
dans le berceau et il va persécuter avec ses pleurs. Une autre fois, le
bébé est fatigué, mais elle se sent seule, il a besoin
d'être materné. Elle va le prendre, il va se raidir, refuser
d'être porté et elle va à nouveau être
persécutée.
Si le parent carencé a une mauvaise estime de
lui-même, il va craindre que ce qui vient de lui soit mauvais, nous avons
fait un travail à Montréal, à l'hôpital Saint
Justine, par apport à ces parents qui viennent consulter en urgence, il
y une anticipation du négatif, grimace qui est le signe d'une petite
douleur est interprétée comme le début d'une maladie
grave.
Même si l'on aime son enfant, il faut le
désillusionner, le limiter. Il faut pour cela couper la relation «
ca suffit, je te demande d'arrêter » si le parent a peur
d'être abandonné, il aura peur d'un acte qui coupe la relation, il
ne mettra pas de limite. L'enfant deviendra un tyran insupportable. Nous avons
parlé du fait d'accepter l'enfant comme il est, des risques de
malentendus relationnels, du désir sexuel, on a parlé du
désir de grossesse, fort du désir d'enfant-faible.

29
nous-mêmes déprimés, dans l'anticipation
négative d'une répétition anticiper négativement,
c'est stériliser toute forme d'aide. Je ne dis pas cela pour dire qu'il
n y a rien à faire mais plutôt pour dire que puis que ce syndrome
est si lourd, il faut tout faire pour l'éviter, pour la
prévention.
Selon Michel Lemay, tout homme a un désir de grossesse.
L'homme carencé va vivre fortement ce désir de grossesse par
l'intermédiaire de sa femme avec une certaine frustration. Dans la
rivalité, il va tenter d'être une mère substitut. Soit la
mère partage, soit la mère retient l'enfant et le père va
soit s'attaquer à ce petit rival, ou va boire, ou va combler dans le
travail le désir de fusion. La difficulté d'empathie se joue pour
le père comme pour la mère. Dans un premier temps, c'est «
j'ai mal à ma mère, puis ce sont des problèmes avec le
père » la prévention, ce qui est enrageant, ce que l'on
connait très bien ce syndrome. Théoriquement on pourrait
supprimer cette carence, mais elle augmente. On pourrait intervenir dès
l'adolescence dans les collèges et sensibiliser les adolescents à
la question de compétences parentales.
A la maternité on repère assez bien ces parents
qui ont une image idéalisée de l'enfant mais qui ne
préparent pas. Le travail montre que les mères sont alors
extrêmement dans leur inconscient. L'enfant dans le ventre
réactive le passé, et des réaménagements
libidinaux, psychiques, sont alors possibles avec des thérapies
brèves.
Mm Napolito : les mères seront ensuite moins
accessibles si on n'a pas travaillé à ce
moment.
Michel Lemay : et cela prendra plus de temps. Et il n y a tout
l'accueil pendant les premiers mois de la vie de l'enfant. La PMI, si elle ne
se limite pas à la taille, et au poids, peut faire beaucoup pour
accompagner les parents en difficulté. Je veux souligner un point au
tant je ne crois pas aux thérapies verbales. Les mères ont
besoins de concret, qu'on s'appuie sur les compétences de maternage,
baigner nourrit, manger en présence de quelqu'un qui va les aider
à repérer les erreurs et les ressources, les richesses
d'anticipation.
Trouver quelqu'un qui montre : je m'intéresse à
vous, à votre corps, votre espace, aux séquences temporelles. Il
ne faut pas s'embourber dans l'analyse de l'enfant imaginaire. Le grand
problème est que tant que l'enfant réparateur, on peut faire
quelque chose. Mais quand on rentre dans le cercle vicieux : enfant
persécuteur-persécuté, l'enfant devient difficile et ca
percute un couple déjà fragilisé. Tout ce qui peut
être fait avant doit l'être.

30

31

32

33

34
Mm Napolito : pour une maman qui n'a pas de mère, il
est sécurisant d'avoir une présence qui la rassure. Elle est
angoissée. Je n'ai pas eu de mère, comment vais-je faire ?
Michel Lemay : il y a un clivage en elle entre bonne et
mauvaise mère. Il faut s'appuyer sur les compétences de la bonne
mère pour modifier quelque chose. Et puis il ya les moments de repli,
des lieux de soutien (par exemple les maisons vertes créées par
Dolto)
Des structures qui font que nous sommes moins
désarmés qu'on le pense d'autant que ces parents avides
affectivement, l'aidant accompagne authentiquement sans faire penser les points
de son affectivité. Ces parents brisent peu la relation.
Quelque fois, la compétence est tellement atteindre
qu'il faut envisager un placement familial. Mais alors il ne faut pas tomber
dans le cycle placement, retour en famille puis placement à nouveau.
Puis retour qui provoque une discontinuité.
Quelque fois les parents ont toujours cassé le
placement, car il ne peut supporter qu'il y ait un parent substitut. Il faut
alors un jugement pour protéger le placement en institution quand le
placement en famille d'accueil ou le retour en famille sont trop
risqués. Une maison d'enfants avec une équipe pluridisciplinaire
dans la mesure où les personnels sont bien formés et stables,
peut être alors nécessaire.
Oui le syndrome carentiel est très grave, mais il n y a
pas lieu d'être exagérément pessimiste, il n y a pas de
répétition automatique quand les gens peuvent profiter d'une aide
adaptée. Cela suppose que tout le monde croie en l'existence de la
carence affective. Le DSM 4 « diagnostic statistique of manuel » ne
cite pas la carence affective. Si les praticiens, juges, psychiatres,
psychologues, infirmiers, puéricultrices, éducateurs, n'ont pas
conscience de l'importance de cette question dès les premières
années, l'impact incroyable des carences précoces, nous serons
d'éternels pompiers. (Qui veut dire, nous traiterons ce facteur qui est
la cause des troubles relationnels ou comportementaux, sans aboutir au
sucer).
Ne pas laisser les mères voir leurs enfants
prématurés à l'hôpital, avec les risques que les
mères fragiles fassent un deuil second aire. Croire en placement
familial que l'amour suffit, -c'est de l'escroquerie-, laisser sans aider un
parent avec un grand décalage entre enfant imaginaire et enfant
réel, voilà des risques importants. C'est la
société qui doit comprendre que ces premières
années, c'est la construction des enfants, la base qui permet de
répondre aux quatre grandes questions :
Qui suis-je ? Qu'est-ce que je fais ? Avec qui ? Au nom de quoi
?
Les médecins, les psychologues qui n'acceptent pas de
suivre ces parents et ces enfants car cela ne répond pas aux
règles de la psychothérapie, il faut dire que c'est une
population tellement fragile qu'il faut faire quelque chose.
I.2.3.2. la difficulté à reconnaître et
écouter la souffrance de l'enfant :
La rupture parentale et les conflits qui la
précédent créent une situation familiale peu propice
à l'écoute des enfants. Les parents doivent assurer la fin d'une
relation amoureuse, le départ d'une personne parfois encore
aimée, le deuil de la famille idéale qu'ils avaient
projeté pour eux et pour leurs enfants. Toutes ces blessures affectives
sont plus ou moins envahissantes selon la capacité psychique de chacun
à contenir ses émotions et à dissocier sa fonction
parentale de sa vie personnelle. En cas de dépressions, l'adulte se met
en état de dépendance psychique vis-à-vis de son
entourage, il est incapable d'avoir une relation adaptée dans les
interactions avec son enfant.
La culpabilité est très forte chez les parent,
qu'ils prennent la décision de la rupture ou qu'ils assument, leur
désire de compasser ce qu'ils pensent être un préjudice
insurmontable dans la vie de l'enfant, rend quelque fois difficile la mise en
place d'une relation sécurisante où autorité et affectio
se mêlent.
Parfois, l'enfant perçoit la fragilité de
l'adulte. Il essaie de le protéger pendant la période
édifice de la rupture du couple parental. Puis lorsqu'il le sent capable
de supporter ses sentiments, il manifeste des troubles, comme si les
barrières qu'il avait mises en place pour canaliser ses angoisses
cédaient progressivement. Les parents sont surpris de ce décalage
dans le temps.
Dans certains cas, la séparation parentale est
présentée comme idyllique. (Merveilleux). Les parents sont
très attentifs à ce que tout se passe le mieux possible pour
l'enfant. Le moindre détail est prévu. L'entente est parfois
tellement cordiale que la séparation devient difficile à
comprendre pour quelqu'un de l'extérieur (mais peut être aussi
pour l'enfant). Le discours est comme lissé : aucun reproche, aucun
grief. Il ne semble pas y avoir de situation de rupture affective ni de crise
émotionnelle. Les parents contrôlent tellement tout (leurs
sentiments, la vie matérielle) que l'enfant ne se sent plus le droit
d'exprimer sa souffrance. Condamné au silence, il doit refouler sa peine
jusqu'à ce qu'elle l'envahisse et s'exprime par des symptômes
variés (Prévention des troubles psychiques chez l'enfant).
Hormis cette prévention des troubles psychiques chez
l'enfant, nous signalons que les différentes théories qui seront
évoquées dans la partie suivante, illumineront nos zones d'ombres
que nous avons sur ces symptômes qui apparaissent dans plusieurs
troubles, maladies psychiques ou psychologiques.
I.2.4. TYPES OU SORTES DE CARECE AFFECTIVE
Lorsqu'un bébé ou un enfant reçoit des
soins maternels insuffisants de la part de sa mère sans autre
compensation de son entourage, ce dernier tombera dans une carence affective
que nous appelons : carence maternelle.
Les rapports entre l'enfant et sa maman sont discontinus,
distordus, ou insuffisants sans forcement qu'il a de séparations
physiques, c'est la carence larvée. Cette carence peut avoir des
conséquences frustrantes caractérisées.
On parle de carence sévère lorsqu'il y a un
placement prolongé et frustrant de l'enfant dans une institution, des
ruptures répétées des liens entre lui et les figures
maternelles ou extrêmement frustrantes avec les parents. La carence
maternelle sévère précoce (avant deux ans) et
prolongée est ordinairement génératrice
d'inaffectivité.
La carence nutritive liée au manque de magnésium
se traduit par des nombreux signes, entre autres : des contractions
musculaires, crampes, migraines, tremblement, engourdissement,
désorientation, perte de l'appétit, fatigue persistante, stress
ou la dépression
Le manque de soin (absence d'affection)
Le manque d'empathie (absence d'écoute et
de compréhension)
Le manque de protection (absence de guidance
et de soutien par les autres) ce qu'il faut noter est qu'un patient peut avoir
souffert d'un, de deux ou de ces trois types de carence que nous venons
d'ajouter aux sortes de carence déjà citées.
NB : on ne peut jamais revenir en
arrière et combler un manque affectif et ainsi corriger du même
coup les troubles relationnels de l'attachement et ceux associé il y a
plusieurs niveaux de gravité bien étendu.
Les réactions de l'enfant face à une
séparation se regroupent en trois phases que voici :
-protestation : l'enfant pleur, montre des
signes de détresse aigue, s'agite, cri et met en oeuvre tous les moyens
limités dont il dispose pour retrouver sa maman. Cette phase pourra
durée quelques heures à plusieurs jours.
-désespoir : l'enfant est de plus en
plus dérouté, il commence à se replier sur lui-même
en exprimant demande aucune à son entourage et relâche ses efforts
de réactions que se trouvait notre patient car il vivait dans le
désespoir de ne jamais rencontrer ses parents, ce qui le conduisait
à des réflexions de la guerre :
« En quoi serais-je utile dans la société
congolaise ? »
« Mieux vaut mourir qu'être le prototype de mes
parents » « C'est de ma faute, ils étaient unis avant ma
naissance »
« Mon entourage ne me considère pas avec raison,
fils abandonné, rejeté, qui n'a jamais vu son père...
»
-détachement : l'enfant semble
s'installer dans la séparation en acceptant les soins, il mange de
nouveau et commence à jouer. Il perd alors tout attachement à sa
mère.
I.2.5. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ET TRAITEMENT
Un diagnostic est une identification d'une maladie ou d'un
trouble à partir de ses symptômes. Quant au diagnostic
différentiel, c'est une identification d'une pathologie grâce
à la comparaison entre divers symptômes dus à plusieurs
affections.
Quant à nous, le diagnostic différentiel nous a
permit à déterminer la nature de la pathologie à partir
des symptômes ci-après :
Le refus d'accepter ou de reconnaitre son sa situation, la
solitude, méfiance,
Le refus de parler de lui ou de sa famille, voire raconter son
histoire, le repli sur soi, Attachement excessif à sa grand-mère,
les délires de persécution, agitation,
Les sujets qui ont soufferts de carence affective ou de
séparation tôt dans l'enfance, et qu'ils ont subis des
événements stressant à l'âge de l'adolescence ou
adulte, sont à une psychothérapie comportementale, ou soit
à une combinaison des deux. Les psychothérapies individuelles ou
de groupe ont une certaine efficacité chez ces patients.
La thérapie dialectique comportementale centrée
sur l'échange entre la thérapie et le patient, réduit de
manière significative le comportement autodestructeur et suicidaire chez
des individus atteint de trouble de la personnalité limite.
Des médicaments tels que les antidépresseurs et
ceux qui stabilisent l'humeur peuvent être utilisés pour traiter
des symptômes comme un trouble dépressif ou des variations
extrêmes des émotions.
Des antipsychotiques peuvent être recommandés
pour traiter la confusion mentale de la pensée et l'activation du
comportement.
Quant à nous, nous avions appliqué
l'accompagnement psychosocial pour préserver la santé mentale et
le bien-être de notre patient afin d'améliorer son
développement psychologique et son interaction sociale.
1.3. LES THEORIES EXPLICATIVES RELATIVES A LA CARENCE
AFFECTIVE
La théorie de l'attachement a été
formulée et développée par Bowlby (1958). Elle constitue
l'aboutissement de deux champs de recherches, dont Zazzo a bien retracé
l'historique (1972, 1974) ; la théorie de l'attachement marque la
convergence entre les travaux d'éthologistes et ceux de psychanalystes,
tous deux ayant montré les effets dramatiques de l'absence de relation
à un adulte privilégié, tant chez le petit de l'homme, que
chez celui du singe (macaque rhésus).
I.8.1.1. L'apport des ethnologues
Ils sont à l'origine de la théorie de
l'empreinte. Lorenz, dès 1935, synthétise les résultats de
nombreux travaux convergents décrivant l'établissement des liens
entre congénères (Lorenz étudie plus
particulièrement les oiseaux anatidés). Il définit
l'empreinte comme un mécanisme inné permettant au premier «
objet » mobile qu'il voit et qui est généralement le
congénère adulte l'ayant mis au monde. La fonction principale de
ce comportement est d'apprendre à reconnaitre les
caractéristiques des partenaires sociaux de tout animal
nouveau-né vers lesquels vont s'orienter les réactions
instinctives et les comportements sexuels.

35
I.8.1.2. L'apport des psychanalystes
Avant les éthologistes, des psychanalystes et plus
particulièrement Spitz, avaient constaté l'apparition des
troubles importants du comportement lorsqu'un enfant, élevé
jusqu'alors par le même adulte, sa mère, était soudain
séparé d'elle, pour être placé dans une
pouponnière ou un orphelinat. Ces établissements se
caractérisaient par un environnement correct pour tout ce qui concerne
les soins, la nourriture et l'hygiène, mais l'impossibilité pour
l'enfant d'y construire une relation privilégiée avec un
adulte.
A l'observation, ces enfants présentent rapidement un
tableau dépressif (trouble de l'humeur, perturbation somatique
importantes : troubles du sommeil, sensibilité accrue aux maladies,
arrêt, puis retard du développement physique et psychomoteur) qui
peut s'aggraver si la période de séparation dépasse cinq
mois. Le retard de développement s'accroit et le taux de
mortalité devient très élève étant
donné la sensibilité accrue aux maladies infectieuses. Les
carences importantes de stimulations tant physiques qu'affectives expliquent
l'évolution dramatique de ces enfants.
Au XIXème siècle, les liens qui unissent
l'enfant et ses parents ne sont pas sujets, à discussion. L'amour
maternel supposé évident. Quant à sa réciproque,
c'est en d'autres termes qu'elle se pose, le respect, l'obéissance sont
alors considérés comme devoirs filiaux, les « liens du sang
» demeurent le principal facteur explicatif des relations parents-enfants.
« p 14, 47, 48, 49, 3eme éd. A. Baudier-B. Céleste »
I.8.1.3. Deux modèles
théoriques
Ces modèles prédominent dans la première
moitie du XXème siècle : le Behaviorisme et la psychanalyste.
Tous deux mettent l'accent sur l'impotence des expériences infantiles
dans la constriction de l'individu.
Pour Watson, fondateur du behaviorisme, le conditionnement des
habitudes dans un contexte d'interaction sociale est le principal facteur de
développement. Le milieu et les stimulations qu'il offre sont
placés au premier plan. Simultanément, Freud assigne à
l'enfance une place prépondérante pour la compréhension de
l'adulte. En même temps qu'il réfute le rythme de « l'enfant
bon » perverti par la société, Freud place l'histoire
affective de l'enfant comme élément central dans la construction,
de la personnalité individuelle.

36

37

38

39

40
La diffusion de ces théories s'effectue dans une
société dont l'organisation s'est profondément
modifiée ; une forme d'organisation familiale domine : la cellule
conjugale, composée uniquement des parents et de leurs enfants.
Dans cette forme de famille dite moderne, par opposition de la
famille traditionnelle ou élargie, l'affectivité est
perçue comme l'élément essentiel du lien qui uni les
membres (parent entre eux et enfants-parents) le changement des valeurs
dû à cette « montée du sentiment » est pour
Shorter (1977) ce qui caractérise la famille moderne. Les cadres
explicatifs donnés par Watson et Freud, en accordant une place
privilégiée a la famille pour rendre compte du
développement et des caractéristiques des individus, s'appliquent
à une société toute prête à reconnaitre
l'impotence de cette composante de changement historique de ses valeurs
psychosociologiques. (Armand colin, 2010,3eme éd)
I.4. ETUDES ANTERIEURES
Comme il est de coutume que tout chercheur doit associer
à son travail, les ides d'autres chercheurs qui l'ont
précédé dans son domaine, pour la meilleure
cohésion scientifique. Ces études permettent au chercheur de
tracer une ligne de démarcation entre la littérature qu'il a
découverte et son orientation propre. Et pour ce qui concerne ces
études antérieures menées par différents chercheurs
à travers le monde au sujet de la carence affective, sont certainement
nombreuses. Cependant dans le cadre de notre rapport des recherches, nous avons
tenté de nous battre et nous avons trouvé quelques études
qui nous a apparait importantes pour nous permettre d'atteindre nos objectifs,
nous les résumons ci-dessous :
En 2000 Nsewa Kasa, a mené une étude
intitulée « la prise en charge des mineurs et son impact sur le
développement social » pour atteindre son objectif, il a
utilisé les méthodes fonctionnelles et historiques. Apres
l'enquête, il s'est posé la question de connaitre le processus
d'encadrement des enfants en situation difficile par les salésiens et de
déminer la façon dont ils interviennent pour intégrer ces
enfants dans la société en respectant toutes les conditions
possibles aux enfants.
Comme suggestions : il a parlé de la création
des maisons des passages spéciaux dans le recrutement des jeunes enfants
en situations difficiles. Il a ajoute en disant qu'il est
préférable d'organiser un enseignement professionnel dans le but
de rendre utile ces enfants dans la société. Il a par ailleurs
lancé un appel à l'Etat congolais et aux personnes de bonne
volonté de créer le centre de
rééducation et réinsertion de la jeunesse, de favoriser
ces enfants pour qu'ils soient utiles dans leur société.
En 2007, Nakijumbi Kagero, a mené ses études sur
« symptomatologie et conséquence de la carence affective » cas
du camp-vangu.
Pour son objectif, il s'est focalisé sur les
problèmes qui déséquilibrent les secteurs psychomoteur et
affectif de l'enfant, afin de donner les solutions psychologiques applicables
par la mère pour que l'enfant grandisse sans problème aucun. Il
s'est posé la question de savoir si <<la carence affective serait
due aux difficultés comportementales de la longévité que
connaitrons les enfants dans leur avenir suite à des conséquences
et symptômes, en utilisant la méthode clinique et la technique
d'entretien associée à la technique d'observation. Cette
méthode lui a permis d'observer pendant trois mois et Deacon approfondie
les symptômes et les conséquences de la carence affective qui
conduisent les enfants aux difficultés comportementales dans leur
avenir. Les deux techniques lui ont permis de recueillir les données ou
les informations, en descendant sur terrain pour s'entretenir avec les
mères et leurs enfants souffrant de la carence affective, pour connaitre
leur problème, envie de proposer une psychothérapie
adéquate.
Pour de culpabiliser l'enfant, il faut l'aider à
comprendre l'ambivalence de ses sentiments. « Tu aimes ton père et
en même temps, tu veux prendre sa place auprès de ta mère
» et lui montrer la différence qui existe entre ce qu'il ressent et
la réalité de la vie des adultes. « C'est parce-que tes
parents ne s'aiment plus qu'ils se séparent ; ce sont des histoires
».
Pour Kasongo wa Kasongo (2007), son étude se focalise
sur les conséquences qui découlent de la conduite des enfants
victimes de la carence affective paternelle dans la ville de Lubumbashi.
Apres analyse et sur base de plusieurs techniques, il est
arrivé à constater que les conditions économiques,
culturelles seraient la cause de l'abandon de ces enfants par leurs
pères, ce qui provoque une carence affective paternelle ayant comme
conséquences néfastes : un comportement déviant.
En 2011, Ilunga Kanyuki wa Kwanda Minos a mené une
étude sur : « impact de la carence affective sur le
développement psychomoteur des enfants âgés de 3 mois
à 5 mois/ cas de la maison Kilelabalanda » il a utilisé la
méthode d'enquête pour récolter des
informations sur la carence affective et son impact sur le
développement psychomoteur, en appliquant la technique documentaire qui
lui a fournie les données permettant la vérification de son
hypothèse, ainsi que l'interview qui a favorisé le contact direct
avec les enquêtés qui sont les enfants du centre kilelabalanda. Il
a fini par noter que ces enfants évoluaient normalement sur le plan du
développement moteur et accusaient un retard en ce qui concerne le
développement social. Raison pour laquelle il a proposé à
ce centre de mettre l'accent particulier sur le développement du langage
parlé chez les enfants en les stimulant à s'exercer pour parler
entre 9 et 12 mois et d'accorder des occasions des rencontres entre les enfants
du centre pour accroitre le développement social.
Dans toutes les études citées ci-dessus,
l'intensité des conflits entre les parents constitue un facteur des
risques prépondérant dans l'apparition de troubles psychiques
chez l'enfant, pendant et âpres la séparation. Pour J. Block et P.
Gjerde, les conflits, en tant que facteurs aggravants, sont les seuls
responsables des troubles observés chez les enfants, qui existaient
avant la separation. A. Cherlin, Furstenberg, P. L. Chase-Lansdale et K.
Kiernan ont mené deux études (prospectives, longitudinales,
comparatives) en Grande-Bretagne et Aux Etats-Unis, sur les enfants
âgés de onze ans, dont les parents se sont séparés,
présentaient plus de troubles du comportement et un moins bon score aux
tests de lecture et de calcul. En fait, lorsque l'on tien compte de l'existence
de conflits au sein de la famille, il n'existe pas de différence
significative entre les enfants de parents séparés et ceux de
familles unies. Cette tendance est plus nette chez les garçons. Une
grande partie de troubles présentés par les enfants âpres
la séparation de leurs parents semblerait imputable aux conflits
parentaux et ceux troubles étaient présents avant le divorce,
surtout chez les garçons.
De la même façon, Th. Chess et A. Thomas ont
montré dans une étude (longitudinale et comparative) que la
capacité d'adaptation des adolescents ne diffère pas de
façon significative entre ceux qui sont issus de famille unies et ceux
dont les parents se sont séparés sans conflit. La capacité
d'adaptation serait en revanche moins bonne lorsqu'il y a eu des conflits dans
la famille pendant leur enfance.
L'appariation des troubles du comportement est plus fortement
corrélée avec l'existence d'une mésentente parentale
qu'avec la séparation. D'âpres M. Rutter, lorsque l'enfant a une
bonne relation avec son père et/ou sa mère, il est en partie
protégé contre les effets nocifs de la discorde entre ses
parents. Les effets négatifs sont d'autant plus importants
que les conflits sont intenses avant la séparation et
que l'enfant est associé aux disputes (enjeu, témoin, confident,
porte-parole) la nature de la séparation elle-même.
Toutes ces études confirment notre expérience
clinique. L'enfant souffre de voir ses parents se déchirer. Il est
atteint au fond de lui-même dans les images qu'il a
intériorisé de chacun d'eux. Chaque agression le blesse dans la
partie de lui-même qui s'est construite au contact sans comprendre de son
père ou de sa mère. Il est d'autan plus déstabilisé
que c'est une personne aimée qui émet ces critiques la souffrance
que cela suscite chez l'enfant.
Apres avoir présenté ces études, il nous
est demandé de montrer les ressemblances et les dissemblances par apport
à notre étude couramment les ressemblances, toutes ces
études parlent sur la carence affective. Pour ce qui est des
dissemblances, la première étude porte sur : symptomatologie et
conséquence de la carence affective dans la relation mère-enfant.
« Cas du camp-vangu »
La deuxième étude porte sur la prise en charge
des mineurs et son impact sur le développement social,
La troisième est celle de J. Block et P. Gjerde, qui
ont constaté que, les conflits, en tant que facteurs aggravants, sont
les seuls responsables des troubles observés chez les enfants, qui
existent avant la séparation.
La quatrième étude parle des conséquences
qui découlent de la conduite des enfants victimes de la carence
affective paternelle dans la ville de Lubumbashi.
La cinquième est celle des A. Cherlin, R.Furstemberg,
P. L. Chasse-lansdale et K. Kiernan qui ont mené deux études
(prospectives, longitudinales, comparatives) en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis. Sur les enfants âgés de onze ans, dont les parents se
sont séparés, présentaient plus de troubles du
comportement et un moins bon score aux tests de lecture et de calcul.
La sixième est celle des Th. Chess et A. Thomas qui ont
montré dans une étude (longitudinale et comparative) que la
capacité d'adaptation des adolescents ne diffère pas de
façon significative entre ceux qui sont issus de familles unies et ceux
dont les parents se sont sépares sans conflit.
La septième est celle menée par M. Rutter, qui
démontre que lorsque l'enfant a une bonne relation avec son père
et/ou sa mère, il est en partie protégé contre les effets
de la discorde entre ses parents.
La notre parle de l'accompagnement psychosocial d'un
garçon victime de carence affective
I.5. CONCLUSION PARTIELLE
Dans ce chapitre, nous avons procédé par la
définition des concepts clés ou nous avons définis les
concepts ci-après : accompagnement, accompagnement social,
accompagnement psychologique, accompagnement psychosocial, garçon,
victime, carence, carence affective, suivi des notions spécifiques
relatives à la carence affective à ce niveau, nous avions
parlé de la généralité ou il était question
de relever des origines, de l'historique et de l'évolution de cette
carence affective , des causes et conséquences dans lesquelles nous
avions parlé de la naissance, des besoins affectifs de l'enfant, de la
perception de la séparation parentale par un enfant, de l'adaptation de
l'enfant à la séparation parentale en fonction de son âge
de son sexe, de l'évolution de l'adaptation de l'enfant à la
séparation parentale, de la prévention des troubles psychiques
chez l'enfant, des troubles psychiques présentés par l'enfant, la
difficulté à reconnaître et écouter la souffrance de
l'enfant, des théories explicatives relatives à la carence
affective aux travers lesquelles nous avions abordé les origines de
l'attachement selon les ethnologues et les psychanalystes, ainsi que des
modèles théoriques et afin des études antérieures
qui nous ont permis de faire une comparaison de ces études tout en
cherchant leurs ressemblances et leurs dissemblances question de
vérifier si nos idées convergeraient ou pas.

41
CHAPITRE DEUXIEME:
CADRE METHODOLOGIQUE
II.1. DENOMINATION ET LOCALISATION SPATIALE
Situé dans la zone de santé de la ville de
Lubumbashi, l'hôpital général provincial de
référence JASON SENDWE comprend deux grandes
parties qui sont : la partie pavillonnaire et la partie en étage dans
laquelle nous trouvons plusieurs services hospitaliers et des services de
consultations externes comprenant une série des dispensaires
spécialisés.
II.2. BREF APERCU HISTORIQUE
L'hôpital général provincial de
référence JASON SENDWE, appelé jadis
hôpital PRINCE LEOPOLD, fut construit en 1928. Les
mobiles qui avaient poussé les autorités de l'époque
à construire cet hôpital propre aux indigènes furent
à la fois d'ordre social et humanitaire, c'est-à-dire la lutte
contre les maladies endémiques dues à la poussée
démographique, afin d'éviter la contagion dans cet hôpital
dont l'édification n'a pas été une tâche facile. La
construction fut réalisée en deux phases, à savoir :
La phase de construction consacrée à la partie
pavillonnaire fut exécutée en 1928. Elle comptait à sa
construction de l'édifice à l'étage 1958. Toutefois, une
aile sera construite avant l'accession de notre pays à
l'indépendance. Les travaux seront interrompus suite aux
éléments malheureux qui avaient suivi l'indépendance du
pays.
Il faut signaler que c'est un hôpital de l'Etat qui sera
géré jusqu'en 1962 par l'Etat lui-même suite à
l'installation du camp des refugiés de triste mémoire à la
RWASHI où l'on trouvait l'hôpital universitaire
de l'université officielle du Congo et le centre ville. Les
autorités de l'université seront incapables d'accomplir la
formation des étudiants en médecine, car ils étaient
obligés de déménager pour s'installer à
l'hôpital SENDWE. Il y a, à partir de cette date,
une gestion bicéphale avec une direction de l'Etat à coté
de celle de l'université. Notons que cette même année sera
celle de l'inauguration du bâtiment en étage.
A partir de 1974, la direction de l'hôpital sera
confiée à la Gécamines pour les raisons d'ordre social,
dont la plus importante fut le souci du président de la
république de permettre à la population de la ville de
bénéficier d'une médecine et de soins de bonne
qualité à un prix moins cher.

42
Deux ans plus tard, l'université quittera pour aller
s'installer à l'ancienne clinique REINE ELISABETH,
actuellement clinique universitaire. Pendant la gestion de la Gécamines,
l'hôpital comptait : 377 agents d'exécutions, 69 agents de cadre
dont 15 médecins et 88 agents classe 4.
Compte tenu des difficultés d'ordre économique
qui ont entrainé la faillite de la Gécamines, l'autorité
politique en concertation avec le gouvernement de la province du
KATANGA, l'université de Lubumbashi, la
Gécamines, et le consulat de la Belgique, avait jugé bon de
confier la gestion de l'hôpital à l'université de
Lubumbashi qui prit la direction à partir du 30 septembre 2005. Mais
dès le 07 mai 2011, notre Etat congolais a repris la gestion
jusqu'aujourd'hui.
ENUMERATION DES SERVICES
A. PARTIE PAVILLONNAIRE
1. pavillon
Le service de médecine interne
Le pavillon clinique
Le service de pédiatrie
Les urgences
Le service neuropsychiatrie
Le service de maternité I et II
2. Services techniques
La radiologie Le laboratoire
La maternité technique
L'échographie
3. Services administratifs
La direction
La comptabilité Les statistiques

43
La gestion du personnel
L'intendance
4. Services généraux
Cuisine
Buanderie
Service d'entretien
Morgue et pompe funèbre.
B PARTIE EN ETAGE (de gauche à droite)
1. Au rez de chaussées
La pharmacie
Le dispacth
Le magasin
Le centre des brulés
2. Au premier étage
La gynécologie salle
Le bureau administratif ONG femmes SIDA
3. Au deuxième étage
La chirurgie femme
La chirurgie infantile
Le service d'ORL et ophtalmologie salle
4. Au troisième étage
La chirurgie générale et urologie salle La
traumatologie civile
La kinésithérapie
5. Au quatrième étage
La réanimation et soins intensifs
Le bloc opératoire

44
A coté de ces deux complexes, il y a la partie
pavillonnaire et le bloc en étage, il existe encore des services de
consultations externes comprenant une série des dispensaires
spécialisés suivants :
Dispensaire de pédiatrie
Dispensaire de dentisterie
Dispensaire de gynécologie
Dispensaire d'ophtalmologie
Dispensaire d'urologie et chirurgie
Dispensaire de dermatologie
Le service de protection maternelle et infantile (PMI)
Signalons en passant qu'à l'hôpital Sendwe sont
parlées deux langues ci-après : Français et Swahili. Les
langues véhiculaires diverses comme Lingala, Luba, Bemba, Tshiluba,
Tshokwe, Rund, etc.
II.3. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT
Dans cette partie, nous parlons de la structure et du
fonctionnement de l'hôpital Sendwe. Sur le plan administratif, nous
étayons la structure administrative et la structure médicale et
sur le plan du fonctionnement, nous dégageons les différentes
fonctions et leurs rôles.
a. Sur le plan administratif
L'administration de l'hôpital JASON SENDWE
est rendue complexe et délicate par le fait que son tuteur de
l'Etat congolais confie la gestion à qui il veut et cette
complexité ne facilite pas la solution des multiples problèmes
posés. Pour mieux assurer la gestion ; l'hôpital fonctionne avec
deux structures à savoir : la structure administrative et la structure
médicale.

45
1. La structure administrative
Elle est dirigée par un comité de gestion
composé d'un médecin directeur et d'un administrateur
gestionnaire. Elle donne les différents services, elle engage et affecte
le personnel soignant suivant la formation de chacun ; elle fonctionne sous la
direction du médecin directeur. Plusieurs administrateurs se sont
succédé à la tête dudit hôpital depuis sa
création dans l'ordre suivant :
MBOMBO MUJANE de 1990 à 1992 SONGA SONGA de 1992 à
1994, LUPUNGU A YAV de 1994 à 1996, KASHIKALA de 1996 à 1997,
SINGA de 1997 à 2000,
LUPUNGU A YAV de 2000 à 2003,
SHISOLA de 2003 à 2004,
KYUNGU SHIMBI de 2004 à 2006, KASEBA WILLY de 2006
à 2008,
GEORGETTE MUSONDA de 2008 à 2010,
DEOGRACIA KILONDA de 2010 à nos jours
2. La structure médicale
Elle est dirigée par un médecin directeur qui
cordonne les services médicaux, c'est un secteur très vaste qui
comprend plusieurs services spécialisés à savoir :
La chirurgie, La médecine interne
La gynécologie, La pédiatrie.
L'hôpital de jour comprend différents services
suivants dont dispensaires, l'ophtalmologie, l'ORL, les urgences et la
Protection Maternelle Infantile (P.M.I)
b. Fonctionnement et organigramme.
Fonction
Pour le bon développement de l'hôpital et sa
responsabilité en rapport avec la gestion des affaires, l'administration
et les techniques médicales sont confiées à un personnel
d'une compétence variée, lequel travaille selon les règles
établies. Il s'agit du personnel ci-après :

46
Médecin directeur ;
|
Administrateur Gestionnaire technique ;
Médecin responsable des différents services ;
Assistants médicaux ;
|
Des pharmaciens radiologues ; Des laborantins ;
Des comptables intendants et de la Trésorerie.
|
II.4. REALISATION ET PROJET D'AVENIR
a. Réalisation
L'hôpital général provincial de
référence JASON SENDWE, a pu réhabiliter
les installations sanitaires.
b. Projet d'avenir
L'hôpital général JASON SENDWE
vise à avoir une salle opératoire du type moderne
contenant tous les instruments pouvant se trouver dans une salle
opératoire digne de son nom et il compte réhabiliter toutes les
salles d'hospitalisation.
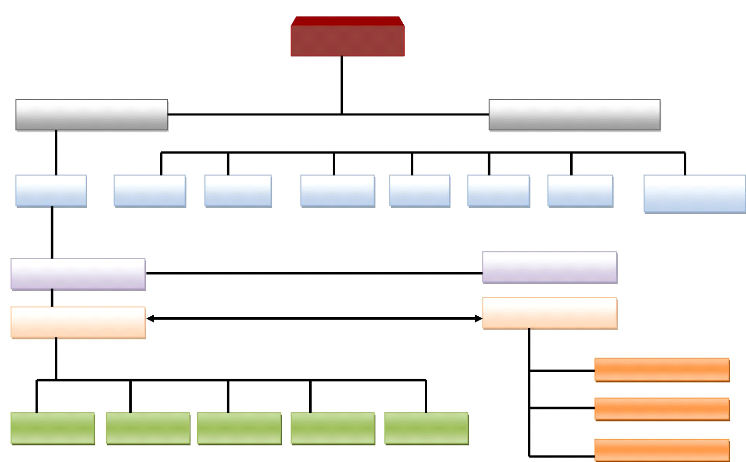
ORGANIGRAMME
DIRECTION NURSING
CHIR
GYNECOLOGIE MED INTERNE PEDIATRIE
HOPITAL DU
JOURS COURS
MEDECIN ADMINISTRATEUR
RECEP
COMP
SECRETARIAT
ADMINISTRATEUR GESTIONNAIRE
COUSSE INTENDANC
BUDGET FACT
BIUR MVT entrée /sortie
TRESOR
MEDECIN
ATTACHE JURIDIQUE
PARAMEDICAL
PHARMACIE
LABORATOIRE
RADIOLOGIE
II.5. ETUDE DES CAS
Tout travail scientifique doit être
réalisé sur base d'une population donnée, dans laquelle le
chercheur doit extraire son échantillon d'étude.
Si le terme population désigne, selon Nkongolo Mukendi
(1996, p. 152), l'ensemble de l'univers des éléments par la
recherche, elle est pour Delandsheere cité par Perrenoud (1979, p.17),
l'ensemble dans lequel on destine un message auquel l'on veut
spécialement observer ce qu'on veut étudier à travers un
échantillon.
Eu égard à ce qui précède, nous
dirons que la population est l'ensemble d'individus ou des personnes à
travers lesquelles une étude cherche à découvrir la
vérité. Pour notre travail, il est bien question d'une
étude de cas qui va nous permettre de dégager aussi permettre de
dégager les causes ainsi que les conséquences qui expliqueraient
la carence affective rencontrée chez notre patient. D'où, la
notion de la population et/ou de l'échantillon ne se pose pas avec
acuité. Nous pouvons ainsi dire que la population de notre étude
est constituée d'un seul individu qui est notre patient garçon
âgé de 28 ans, victime de carence affective rencontré
à l'hôpital général de référence JASON
SENDWE dans le service neuropsychiatrique.
II.6. CARACTERISTIQUE DU CAS ETUDIE
Il s'agit ici de définir par un caractère
distinctif en recueillant des informations concernant notre sujet, son
comportement au cours de sa vie et les principaux événements qui
ont contribué à la formation de sa personnalité.
On recherche les effets en s'intéressant à ses
relations personnelles, interpersonnelles et familiales. Les
caractéristiques ou manifestations cliniques regroupant les signes et
les symptômes qui impliquent l'existence d'un problème relevant du
domaine de l'intervention.
C'est pourquoi en clinique, nous avons une démarche
centrée sur l'individu, sa singularité, sa totalité, du
fait que le but poursuivit dans une telle recherche n'est pas la comparaison,
ni la généralisation, chaque cas est un unique. Les informations
ou résultats ne sont valables que pour ce cas d'étude.
Notre sujet d'étude a été une victime de
carence affective qui lui a couté plusieurs jours d'hospitalisation. Il
est carencé affectif présentant comme signes : attachement
excessif à sa grand-mère, le refus de parler de sa vie ainsi que
de sa famille et la solitude.

49
II.7. METHODES ET TECHNIQUES
Pour mener à bien notre étude, nous avons eu
recours à une méthode et à quelques techniques. Nous les
décrivons en vue de montrer comment nous avons procédé et
atteindre les résultats.
II.7.1. METHODE
Une méthode est l'ensemble des opérations
systématiques et rationnelles enchainées, afin de relier avec
constance, l'intention du matériel et leur validation, les techniques et
traitement transformant des données de résultats, les
procédures d'interprétation des résultats et de leur
vérification, la justification des différents choix,
répondre aux critères formés et opérations auxquels
elles doivent s'atteindre pour avoir accordé la
crédibilité recherchée. « Cijika, 2006 »
Dans cette étude, nous avons fait usage de la
méthode clinique. Le terme « clinique » vient du grec
(klinè veut dire lit) et signifie ce qui se fait au lit du malade par
opposition à ce qu'apportent d'autres sources d'informations, les
examens « paracliniques » qui se sont aujourd'hui multipliés :
dosages cliniques, examens histologiques, rayons X, scintillographies, etc.
(Kasongo Maloba, 2012-2013, p 17).
La méthode clinique, contrairement à ce que
l'étymologie laisser croire, n'est pas nécessairement celle que
la psychologie utilise auprès du lit du malade. Elle est en
général tout à fait distincte de la méthode
pathologique comparative dont il a été question. Elle est certes,
la méthode de choix (mais non la méthode exclusive)
employée, c'est-à-dire, selon P. Fraise, par les psychologues
«appelés à travailler en collaboration avec des
médecins dans les différents hôpitaux, dans les
consultations d'hygiène». Mais les psychologues cliniciens
considèrent souvent que la méthode clinique s'applique aussi bien
aux conduites adaptées qu'aux désordres de la conduite, qu'elle
est une méthode de recherche propre à accroître nos
connaissances générales en psychologie et non pas seulement la
méthode d'une certaine catégorie de praticiens.
Quant à nous, la méthode clinique est une
méthode qualitative d'étude de cas qui permet au psychologue de
récolter des données importantes sur la situation du patient,
tout en lui laissant la liberté d'expression sans aucune forme de
jugement ni de contradiction.

50
A ce niveau, nous parlerons du principe de la méthode
clinique : elle est utilisée dans le domaine pratique de psychologie,
l'expression « méthode clinique » au singulier, désigne
un ensemble de techniques qui en commun produisent des informations
concrètes sur la personne ou la situation posant un problème
et/ou révélant l'existence d'une souffrance. Le travail du
psychologue a pour objet l'individu, et non les populations L'attention est
focalisée sur la singularité de la situation. Ce sont les cas
atypiques qui intéressent le clinicien et non la caractéristique
générale rencontrée chez tous les individus.
La méthode clinique guide une activité pratique
visant à la reconnaissance et à la nomination de certains
états, aptitudes, comportements dans le but de proposer une
thérapeutique (psychothérapie par exemple). La méthode
clinique vise donc à créer une situation, avec un degré
faible de contrainte que nous nommons « consentement libre et
éclairé », en vue d'un recueil d'informations qu'elle
souhaite le plus large et le moins artificiel possible en donnant au sujet des
possibilités d'expression.
Parlons des différents aspects de la méthode
clinique pour mieux comprendre pourquoi nous l'avons choisi dans le cadre de ce
travail de fin d'étude universitaire.
Deux niveaux complémentaires sont à souligner au
sein de la psychologie clinique : le premier est celui qui a recours à
des techniques (tests, échelles, entretiens etc.). De recueil in vivo
des informations (en les isolant le moins possible de la situation «
naturelle » dans laquelle elles sont recueillies et en respectant le
contexte), alors que le second niveau ne tient pas aux outils, mais aux buts et
aux résultats. Le premier fournit des informations, le second vise
à comprendre un sujet (Kasongo Maloba, 2012-2013, p 18).
C'est ainsi que cette méthode nous est utile car elle
nous a servie de moyen ayant favorisé la tâche de récolte
des informations en posant diverses questions au patient, ces informations nous
ont permis de comprendre notre patient.
Dans le présent travail, nous n'avions pas
utilisé les échelles et les tests, mais nous avons eu recours aux
techniques développées dans la rubrique suivante.
II.7.2. TECHNIQUES
Une technique est un procédé employé pour
produire une oeuvre ou obtenir un résultat déterminé.
C'est un moyen méthodique fondé sur des connaissances
scientifiques employées à la production (Robert, 1931)

51

52

53

54

55
Quant à nous, les techniques sont les moyens ou les
voies qu'utilise une méthode scientifique pour atteindre un but bien
déterminé. Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé
les techniques suivantes :
II.7.2.1. L'OBSERVATION CLINIQUE
L'observation est à la base de la simple connaissance
du monde, des autres et sans doute de l'activité scientifique. Elle
suppose l'attention centrée sur un objet et la capacité de
discriminer les différences entre les phénomènes.
L'observation est traditionnellement définie comme l'action de
considérer avec attention suivie la nature, l'homme, la
société, afin de les mieux connaitre. Elle vise à faire
l'inventaire du réel, mais elle ne doit relever que ce qui lui parait
pertinent et significatif. A ce niveau, nous avions appliqué
l'observation directe qui impose une relation sociale au milieu
étudié ; cette relation est surtout centripète car c'est
l'observateur qui doit s'adapter au monde social qu'il veut étudier, et
s'efforcer d'y trouver une place (Kasongo Maloba, 2012-2013, p 39).
L'observation est pour nous : un moyen permettant une
attention soutenue sur un cas, un problème, un trouble ou une souffrance
en vue de l'analyser en détail.
Cette technique nous a permit d'observer la posture du
patient, ses gestes, réactions, sa tenue vestimentaire,
etc. et nous a conduit à l'entretien
clinique.
II.7.2.2. L'ENTRETIEN CLINIQUE
Il est le principal instrument dont dispose le clinicien,
qu'il s'agisse d'évaluation ou de thérapie. A l'exception de
quelques cas (enfant, sujet sans langage, etc.). La majeure partie des
informations provient du discours dont la particularité est de faire
exister les objets, les faits, les situations en dehors de leur présence
concrète. L'entretien est une partie qui se joue au moins à deux
avec une position asymétrique entre le sujet et le clinicien.
Dans l'entretien clinique il y a deux personnes qui «
échangent des paroles » l'un vient demander quelque chose à
l'autre qui ne demande rien, il vient en raison de la fonction que l'autre
occupe, fonction qui suppose une formation, laquelle permet de prendre une
certaine position dans le dialogue. Ne s'improvise pas psychologue qui veut, on
le devient à l'issue d'une formation et d'une expérience acquise
(Kasongo Maloba, 2012-2013, p 19).
L'entretien clinique est un moyen et une méthode pour
accéder à des informations sur les troubles actuels (et
éventuellement passés) d'un individu, sur sa personnalité,
sur son mode de fonctionnement psychique, mais aussi sur ses aptitudes ou ses
difficultés à appréhender le changement.
L'entretien clinique peut donc se situer dans le cadre d'une
relation de soins. On parle souvent de manière plus large d'une relation
d'aide ou de conseil (Chiland, 2010, p. 11).
L'entretien clinique permet l'accès aux
représentations les plus personnelles des sujets : histoire, conflits,
croyances, rêves, événements vécus. C'est un outil
irremplaçable dans le domaine des sciences humaines et encore davantage
dans celui de la clinique où il s'agit de comprendre l'origine de
différentes psychopathologies et d'appréhender le fonctionnement
psychologique. En effet seul le patient peut nous dire « où »
et « comment » il souffre ; il faut donc l'écouter.
Type d'entretien clinique :
I. Entretien non directif : C'est un type
d'entretien centré sur la personne au cours duquel, comme son non
l'indique, ce n'est pas le clinicien qui oriente le discours du patient, mais
le patient ou le sujet qui parle librement de lui-même en
contrôlant et en menant son discours comme il entend. Le clinicien pose
une question, donne une consigne ou bien circonscrit un thème puis
s'efface pour laisser parler le sujet. Ce dernier peut déborder
largement par apport au thème proposé, il peut évoquer ses
problèmes de santé, ses souvenirs d'enfance, sa vie familiale,
ses problèmes professionnels, et ce sont justement ces associations
libres qui intéressent le clinicien qui évite donc de
l'interrompre. Le clinicien respecte les moments de silence, les arrêts,
les discontinuités, les associations ; « ce qui est important c'est
que le sujet dise, ce qui l'a à dire, ce qu'il veut dire et ce qu'il
peut dire.
Le clinicien à ce niveau, se contente d'effectuer des
relances, de signifier des approbations dans une attitude respectueuse,
compréhensive et empathique. Les relances peuvent prendre
différentes formes : hochement de tête, acquiescement,
reformulation du dernier mot, de la dernière phrase du sujet, de la
pensée ou des idées du sujet. Même si ces relances visent
initialement un maximum de neutralité de la part du clinicien, elles ont
malgré tout une influence sur le discours produit par le sujet (Blanchet
et Coll., 199O)
A ce niveau, nous avions posé quelques questions
à notre patient juste après l'avoir reçu dans le service :
quel est ton nom? Où es-tu ? Que fais-tu ? C'est pour vérifier
s'il se localiserait facilement dans l'espace et dans le temps, s'il y aurait
cohérence ou pas dans ses propos et s'il était conscient ou pas.
Mais ses réponses témoignaient son état inconscient,
l'incohérence dans son langage et une perturbation spatiotemporelle.
II. Entretien semi-directif : Dans ce type
d'entretien, le clinicien dispose d'un guide d'entretien ; il a en tête
quelques questions qui correspondent à des thèmes sur lesquels il
se propose de mener son investigation. Ces questions ne sont pas posées
de manière hiérarchisée ni ordonnée, mais au moment
opportun de l'entretien clinique. De même dans ce type d'entretien, le
clinicien pose une question puis s'efface pour laisser parler le patient ; ce
qui est proposé est avant tout une trame à partir de laquelle le
sujet va pouvoir dérouler son discours. L'aspect spontané des
associations du sujet est moins présent dans ce type d'entretien dans la
mesure où c'est le clinicien qui cadre le discours, mais ce dernier
adopte tout de même une attitude non directive : il n'interrompt pas le
sujet, le laisse associer librement, mais seulement sur le thème
proposé. A ce niveau, nous avions donné à notre patient,
la raison de notre présence devant lui et demander s'il permettrait une
conversation, c'est avec son accord que nous lui avions posé quelques
questions en rapport avec son identité.
III. Entretien directif : L'entretien
semi-directif doit être distingué de l'entretien directif car
c'est une forme d'entretien qui peut être utilisé dans les
sciences sociales et en psychologie clinique pour compléter les
investigations. L'entretien directif correspond au questionnaire dans lequel
les questions sont ordonnée et hiérarchisées, il ne s'agit
donc pas d'un entretien clinique dans la mesure où il n'est pas
centré sur la verbalisation spontanée du sujet : celui-ci
répond seulement aux questions qui sont posées, ce qui ne permet
pas une grande implication personnelle. C'est sur base d'un questionnaire que
nous l'avions posé des questions sur sa maladie en procédant de
la manière ci après :
Nous avions commencé par l'anamnèse où
nous avions parlé de l'histoire de sa maladie ou de son trouble, pendant
son enfance, sa puberté, son adolescence et son âge adulte ; suivi
des antécédents personnels et familiaux. C'est au travers cette
forme d'entretien clinique que les séances d'entretien avec notre
patient ont débuté.
Nous avons choisi ces trois types d'entretien clinique parce
qu'il n'y a pas un type qui soit meilleur ou pire. Il est tout simplement
question de les adapter, soit à la souffrance du sujet, soit au sujet
lui-même, car, certains patients ont besoin d'être soutenus er ils
ont besoin que le clinicien intervienne d'avantage.
D'autres encore au contraire, peuvent ressentir les
interventions du psychologue comme une véritable intrusion (action de
s'introduire). Il convient alors de souligner que notre patient s'est senti
soutenu et compris, car il ne pouvait pas nous repousser lors de l'entretien ou
nous tourner le dos. Le matin pendant le tour avec les médecins, notre
présence le réconfortait et il ne voulait qu'on le quitte
après les 45 minutes d'entretien. Il préférait qu'on
continue à partager.
II.7.2.3. LE COUNSELING
Le counseling est d'abord une relation humaine qui se pratique
là où se rencontre les problèmes. Le counseling poursuit
une forme de psychologie situationnelle c'est-à-dire que c'est la
situation qui est la cause du symptôme et non l'inverse.
Le but du counseling dans ce travail, est d'amener notre
patient à prendre conscience en acceptant qu'il est carencé
affectif d'une part, et de le conduire à surmonter son état
à travers nos interventions thérapeutiques.
Le counseling poursuit un double objectif : le premier concerne
le patient : . Faire comprendre au sujet ce qui lui est arrivé et
L'aider à surmonter ce qu'il ressent, l'aider à
pouvoir s'exprimer pour se décharger des émotions ;
. Comprendre qu'il n'est pas le seul à vivre cette
situation ;
. Le patient bénéficie du soutien des autres dans
le groupe thérapeutique ou d'entre aide ; Le deuxième objectif
concerne le thérapeute :
. Apporter une aide au patient par un soutien psychologique ;
. Encourager l'affirmation positive du sujet, la prise de
décision afin de trouver la solution à ses problèmes.
A ce niveau, nous parlons des attitudes cliniques qui nous ont
permis de mieux nous entretenir avec notre patient :
1) L'ECOUTE : L'écoute en counseling
diffère de celle que nous vivons quotidiennement, il s'agit d'une forme
d'encouragement envers l'autre impliquant une sensibilité et une
attention à autrui.
Dans ce cas, l'écoute est une pratique qui permet un
certain type de relation entre le patient et le thérapeute. Cette
expérience d'écoute est souvent la première pour le sujet.
En effet, il se sent écouté sans la moindre forme de jugement.
Quant à nous, nous avions écouté notre patient avec une
attention soutenue pour le réconforter afin qu'il puisse nous parler
librement de sa situation.
2) L'ACCEPTATION : L'acceptation est une
attitude fondamentale dans le counseling, communiquer son acceptation implique
que toutes les attitudes et les comportements verbaux et non verbaux du
praticien indiquent à la personne que quelqu'un est entrain d'essayer de
la comprendre, de l'acceptation dans sa totalité.
L'acceptation est quelquefois importante que la
compréhension. La personne a avant tout besoin d'être
acceptée comme elle est, comme elle se sent, comme elle dit qu'elle se
sente avant de pouvoir explorer ses changements, en l'aidant à retrouver
son image de soi, son estime de soi. A ce niveau, nous l'avions accepté
d'abord puis accepté sa situation, pour l'encourager.
3) L'ABSENCE DE JUGEMENT : Le jugement est
un obstacle à la progression dans une relation d'aide. Il bloque les
capacités de l'autre à se responsabiliser, puisqu'il le maintient
dans la dépendance à autrui. La relation de conseil doit
s'établir sans jugement aucun. Comme le psychologue d'une manière
générale ne juge pas, nous avions constaté, aimé,
et compris sa situation question de mieux favoriser le dialogue. En tenant
compte du transfert qu'on observait chaque fois qu'on se présentait
devant lui. Notre contre transfert était de le faire voir que les
parents on ne les remplace jamais. Quand on les manque, c'est fini et personne
ne prendra plus leur place pour en fin donner toute l'affection qu'ils avaient
à leurs enfants.
Nous, notre objectif est d'aider toute personne ayant une
souffrance psychique, psychologique ou somatique à trouver une
homéostasie biopschosociale.
4) LA TOLERANCE : On fait abstraction du
jugement, cela consiste à accepter le patient tel qu'il se
présente sans parler des jugements ni des critiques. Nous avions

56
Le processus d'acceptation de la maladie ou du processus de
deuil consiste à accompagner le patient dans ses différentes
émotions, sentiments, et représentations
accepté l'état dans lequel se trouvait notre
patient quant il fut interné dans le service neuropsychiatrique de
l'hôpital de référence JASON SENDWE: sa tenue était
mal propre avant, il dégageait une mauvaise odeur car avant son
hospitalisation, il avait mis quelques jours sans se laver, ses caprices et
refus de parler de sa souffrance, sa famille, son passé, nous avons
accepté tous ces actes.
5) L'EMPATHIE : C'est se mettre à la
place du patent, mais sans éprouver les mêmes émotions
comme lui.
Elle est une forme de compréhension définie
comme la capacité à prévoir et à comprendre les
sentiments d'une autre personne. A la différence avec la sympathie ou
l'antipathie, c'est un processus dans lequel le praticien tente de faire
abstraction de son propre univers de référence, mais, sans perdre
contact avec lui pour se centrer sur la manière dont la personne
perçoit la réalité. Elle se résume par une question
à se poser régulièrement « Qu'est ce qui se passe
actuellement chez une personne qui est en face de moi ? » ici, nous nous
sommes mis à sa place pour l'écouter dans le but d'aboutir
ensemble, à une solution.
6) LA CONFIDENTIALITE : Elle exige que ce
qui se dit en en séance ne soit pas dévoilé ou
raconté sans que le concernés ne soient d'accord. Et le
psychologue a l'obligation de garantir son patient de n'est jamais
dévoiler son secret aux autres. Cela fait partie du code
déontologique du psychologue en son premier principe qui stipule que
:
Le psychologue réfère son exercice aux principes
édictés par les législateurs national, européen et
international sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur
protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et
éclairé des personnes concernées. Réciproquement,
toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un
psychologue. Le psychologue préserve (protège, ou met à
l'abri) la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret
professionnel, y compris entre collègues. Il refuse toute intervention
lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. « Code
déontologique professionnel (2013-2014, p 4).
II.4.2.4. PROCESSUS DE DEUIL

57

58

59
(sentiments d'injustice, de tristesse et de nostalgie,
angoisse, sentiment de menace de la maladie, représentation de soi,
dévalorisation, crainte du regard des autres) au sein d'une relation
humaine. Ici, accompagner le patient dans ses émotions, ne veut pas dire
: l'enfoncer davantage dans une profonde douleur ou l'encourager à se
culpabiliser, à haïr les autres, à se replier sur lui, etc.
L'accompagner dans ce cadre thérapeutique, c'est le conduire vers la
solution (sa guérison), c'est le soutenir et l'aider à
gérer son existence malgré la présence du danger ou la
permanence de l'agent causal de la souffrance.
Ce processus est une technique thérapeutique
utilisée comme le counseling qui permet au patient d'avoir conscience de
ce qui lui arrive, mais la seule différence est que ce processus ne
poursuit pas un double objectif et n'a pas des attitudes à prendre comme
dans le counseling. Cette technique permet au psychologue de dire la
vérité au patient sur sa situation pour qu'il arrive à la
comprendre et à l'accepter comme un fait normal. Ici, le psychologue a
l'obligation de dire au patient, qu'il n'est pas le premier ni le dernier
à connaitre cette souffrance, qu'il sache qu'il n'oubliera jamais sa
situation et ce problème disparaitrait lorsqu'il accepterait de le
comprendre.
Comprendre et accepter la situation, signifie :
- Accepter la souffrance, la douleur, les blessures,
- Arrêter de se condamner, se culpabiliser, se
sous-estimer, etc.
- Cesser de regretter, pleurer, se faire de souci,
- Comprendre qu'il n'y a jamais eu de problèmes eternels,
ou sans solution.
- Comprendre c'est adopter une attitude positive, une attitude
des vainqueurs,
A ce niveau, nous avons dit ce qui suit à notre patient
pour qu'il arrive à comprendre et à accepter sa situation :
« La carence affective que tu as connue, n'est pas une
situation éternelle ou incurable pour que tu y demeures sans espoir
aucun. La vie est faite des mauvais et des bonnes choses. La carence affective
est un manque d'une affection vis-à-vis de l'un des parents ou de tous
les deux à la fois. Sache qu'un manque ne peut être jamais
comblé même si on amène ses parents. Parce que, non
seulement tu as connu cette situation, mais tu l'as également
vécue. Il t'est difficile d'oublier cette souffrance, voire d'ignorer ce
problème car cela fait partie de ta
vie, tu n'es pas le seul au monde à pouvoir connaitre
un tel cas, et tu ne seras jamais le dernier, ce qui prouve qu'il y en a qui
ont connus la même situation, mais ils l'ont surmonté à
telle enseigne qu'ils sont devenus aujourd'hui encadreurs d'enfants victimes
des carences affectives et formateurs des plusieurs encadreurs des centres
d'accueil à travers le monde.
Se culpabiliser, se sous-estimer, se condamner, haïr les
parents, chercher à se venger n'est pas une solution. Le divorce ou la
rupture parentale, n'est pas l'unique cause qui expliquerait la carence
affective. D'autres sont devenus enfants carencés affectifs suite
à la mort causée par un accident, une maladie, une guerre, une
crise cardiaque, un incendie, un incident par exemple. Ces victimes vivent et
ont des grandes responsabilités dans des grandes sociétés,
entreprises, ou institutions de la place.
Tu dois savoir que tout être humain est un carencé
affectif pour quoi ?
Parce qu'il y a des gens qui manquent de magnésium dans
leur organisme (on parle de la carence nutritive), certains manquent les
aliments (carence alimentaire), d'autres manquent l'affection maternelle
(carence maternelle), il y a encore une carence d'un objet ou d'un
matériel primordial, d'un partenaire, des enfants, de l'argent, qui
prouvent suffisamment que nous manquons tous, quelque chose de valeur dans
notre vie, ce qui arrive à nous déséquilibrer. Et cela
n'est pas synonyme d'en vouloir d'autres personnes ou de haïr Dieu qui
nous a crée. On ne peut jamais rentrer dans notre passé pour
satisfaire un manque ou le combler. Le mieux à faire est de comprendre
et d'accepter la situation qui nous arrive en adoptant une attitude des
vainqueurs et non celle des perdants pour retrouver l'équilibre
biopsychosocial. C'est une nouvelle adaptation à l'adversité que
Kasongo Maloba (2011) a appelée « résilience ». Cette
force intérieure qui nous pousse à surmonter certaines
difficultés de la vie.
II.7.2.5. ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL
Faisons remarquer avec Anne le RHUM (août 2007 p.17, 18
et 19) que l'accompagnement au sens très large correspond à la
prise en compte de la singularité de la personne et de son contexte de
vie, la personne étant considérée dans sa globalité
et dans sa complexité. Toutes les dimensions du « psychosocial
» évoquées ci-dessous (santé, besoin de santé,
comportements, facteurs externes, ressources internes : compétences,
capacités, facteurs et besoins psychosociaux sont ici
intégrées. Ils s'y rajoutent tous les facteurs psychologiques,
sociaux, contextuels, pouvant se constituer des obstacles ou des ressources
à la réalisation du
projet premier du soignant. Si le projet du soignant est le
maintien ou l'amélioration de la qualité de vie du patient, il
s'agit alors d'un accompagnement global de la personne, complémentaire
à la prise en charge biomédicale. Si le projet du soignant est
l'observation du traitement par le patient, il s'agit d'un accompagnement du
soignant ciblé pour lever tous les obstacles possibles (psychologiques,
sociaux, psychosociaux...) à une prise irrégulière du
traitement.
Au sens plus restreint qui correspond à la prise en
compte d'un certains nombre des facteurs identifiés comme étant
à l'intersection des facteurs psychologiques et socioculturels, ces
facteurs psychosociaux correspondent au dernier point de toutes les dimensions
du psychosocial citées ci-dessous, c'est-à-dire à la
subjectivité du patient. C'est la manière dont une personne
ressent, se représente et juge les choses de manière consciente
(ensemble des représentations, croyances, sentiments et perception du
patient concernant sa maladie, son traitement, son contexte de vie, sur
lui-même, des capacités d'adaptation...)
Nous distinguons donc à ce niveau, les notions suivantes
:
*Santé psychosociale : elle correspond à toutes
les dimensions de la santé (mentale, sociale, et spirituelle),
exceptée la santé physique objective (déterminée
par les soignants)
*Besoins de santé psychosociale : ils correspondent
à l'ensemble de besoins de santé psychosociale de la personne qui
donne du « goût » à sa vie (besoin de plaisir, de
liberté de projets, d'appartenance.
*Comportements psychosociaux : ils correspondent aux «
performances » de la personne, c'est la manière dont une personne
entre en interaction avec son environnement. C'est l'ensemble des actions
d'adaptation, ce que la personne exprime (actions d'interaction-communication)
ou fait pour interagir avec son environnement (actions
d'interactions-créations) les comportements objectifs «
médicaux » qui visent la santé physique de l'individu avec
une très faible interaction avec l'environnement ou d'autres personnes
(par exemple, prise de médicaments chez soi, seul) ne sont pas inclus
ici.
*Facteurs externes psychosociaux : stresseurs psychosociaux
(contraintes, isolement...) et ressources psychosociales externes du milieu
(soutien, lieu et personnes ressources)
*Ressources psychosociales internes :

60
Le besoin psychosocial correspond à un besoin ressenti
par le patient ou objectivé par le soignant, important à
satisfaire, pour que le patient puisse mobilisé les comportements
Compétences psychosociales (CPS) : Habiletés
d'interactions avec son environnement ou avec d'autres personnes,
considérées complexes dans des situations problèmes de la
vie réelle. Les dix CPS définies par l'OMS (1993) peuvent
être considérées comme la base de ces CPS :
Savoir gérer son stress, ses émotions ;
Avoir conscience de soi-même et de l'empathie pour les
autres ;
Savoir donner du sens, comprendre ;
Savoir communiquer efficacement et être habile dans ses
relations interpersonnelles ;
Savoir résoudre des problèmes ;
Avoir l'esprit créatif et critique ;
Savoir prendre des décisions ;
Savoir utiliser ses ressources personnelles et ses ressources
externes, d'autres compétences, plus spécifiques, comme «
résister à la pression de peurs » ou « renforcer
l'estime de soi » peuvent se construire sur ces bases.
Capacités psychosociales : habiletés
d'interactions avec son environnement considérées moins complexes
par la personne, dans des situations simples de la vie réelle ou de la
mise en situation fictive (capacité relationnelle : savoir se faire
comprendre de son médecin sur des demandes simples...)
Facteurs et besoins psychosociaux : c'est la manière
dont une personne ressent, se représente, juge et interprète les
choses de manière consciente l'ensemble des représentations,
croyances, sentiments et perceptions du patient concernant sa maladie, son
traitement, son contexte de vie, sur lui-même, des capacités
d'adaptations...
Nous distinguons ici « facteurs » et « besoins
»psychosociaux :
Les facteurs psychosociaux correspondent au terme neutre de
l'objet psychosocial. Par exemple le sentiment d'auto-efficacité
correspond au sentiment de se sentir capable de réaliser tel
comportement de santé.

61

62
nécessaires pour réaliser un comportement de
santé, par exemple : « ce patient a besoin de renforcer son
sentiment d'auto-efficacité car il m'a dit qu'il ne se sentait pas
capable de faire ses injections tout seul alors que j'ai vérifié
qu'il maitrisait très bien la technique ».
Nous avons choisi l'accompagnement psychosocial, comme moyen
thérapeutique parce que c'est une action d'aide, de suivi et
d'orientation vers des solutions. C'est-à-dire ce moyen offre une
occasion d'échange ou de dialogue entre le thérapeute et le
patient, il permet au psychologue de conduire le patient à accepter de
guérir en le plaçant au centre de sa guérison tout en
faisant appel à sa conscience et à sa volonté car sans ces
deux facteurs, il est difficile qu'il accepte sa guérison. Il permet
encore à la société de comprendre la situation du patient,
de l'accepter, de l'accueillir à bras ouvert en le considérant
toujours comme un être utile, capable d'exercer tel ou tel métier
pour son intérêt ainsi que pour le bien-être
communautaire.
II.8. DIFFICULTES RENCONTREES
notre travail, n'a pas été facile ou simple,
nous avons connus différentes difficultés d'ordres financiers, le
caractère lui-même du travail recouvre d'énormes
difficultés car demander à une personne avec qui on n'a jamais eu
un bref moment d'échange ou de dialogue de parler de sa vie
passée, présente et de sa famille, supporter ses caprices de
répondre à l'entretien, n'est pas une chose facile. Nous n'avons
pas pu situer la carence affective car elle n'est ni un trouble, ni une des
maladies, voire le DSM IV, V, et la CIM DIX ne la classifient pas parmi divers
troubles et différentes sortes des maladies psychiques. Nous n'avons pas
trouvé facilement des livres cadrant avec notre sujet des recherches.
L'axer dans des bibliothèques n'a pas été facile.
L'élaboration de ce travail sans l'intervention du directeur,
témoigne une des difficultés rencontrées pendant la
rédaction.
II.9. CONCLUSION PARTIELLE
Dans ce deuxième chapitre consacré au cadre
méthodologique, nous avons commencé par décrire le champ
d'investigation à travers un bref aperçu historique de
l'hôpital provincial de référence JASON SENDWE
appelé jadis, hôpital Prince Léopold. Il a
été construit en 1928, pour lutter contre les maladies
endémiques dues à la poussée démographique, afin
d'éviter la contagion de la population. Après cette brève
historique, nous acheminons avec sa structure et ses fonctions, où nous
démontrons comment l'hôpital fonctionne avec la structure
administrative dirigée par un comité de gestion composé
d'un médecin directeur et d'un administrateur gestionnaire, suivi de la
structure médicale dirigée par un médecin directeur
qui coordonne les services médicaux. Après ces
structures, nous avons parlé de l `étude de cas qui est notre
patient carencé affectif, nous avons ensuite parlé des
caractéristiques du cas étudié et de la manière
dont nous avons recueilli des informations concernant notre patient : son
comportement, et les divers événements qui ont contribués
à la formation de sa personnalité. Nous avons encore parlé
des méthodes et techniques : à ce niveau, nous avons
défini la méthode clinique qui à son tour, nous a conduit
aux techniques suivantes : l'observation clinique qui nous a permis d'apporter
une attention soutenue sur la posture du patient, ses gestes, ses
réactions et sa tenue. L'entretien clinique est notre outil ou
instrument principal. Nous avons également évoqué le
counseling qui a permis au patient de prendre conscience sur la situation qui
lui est arrivée et le processus de deuil qui nous a permis d'accompagner
notre patient dans ses différentes émotions pour préserver
sa santé mentale. Nous avons épinglé l'accompagnement
psychosocial qui a favorisé son insertion dans l'environnement social.
Enfin, nous avons étayé quelques difficultés
rencontrées lors de la réalisation de ce travail.

63
CHAPPITRE TROISIEME :
RESULTATS DE LA
RECHERCHE
Dans ce chapitre, nous présentons en premier lieu notre
cas clinique, c'est-à-dire notre patient, sur qui sont fondées
nos recherches que nous avons mené lors de notre stage de
professionnalisation à l'Hôpital Général Provincial
de Référence Jason Sendwe. Ensuite nous procédons à
la description de l'accompagnement psychosocial que nous avons appliqué
comme l'un des moyens thérapeutiques pour le conduire à sa
guérison et enfin, nous terminerons par l'interprétation des
résultats.
III.1. PRESENTATION ET ANALYSE DESCRIPTIVE DU CAS CLINIQUE
a. Identité
- Nom : MUNONGO -Adresse : N° 1 Av : Araucarias Q!
-Post-Nom : BEYA Bel-air C! Kampemba
-Age : 28 Ans -Tribu : luba du Kasaï
-Sexe : M -Religion : pentecôtiste
-Profession : tous travaux -Province d'origine : Kasaï
-Lieu et date de naissance : occidental
Lubumbashi 1985
b. Plainte
Le patient a été amené par sa
grand-mère pour changement de comportement empreint
d'agressivités avec passage à l'acte, manque d'appétit,
délires de persécution, langage incohérent et
agitation.
1. ANTECEDENTS
Antécédents familiaux :
Rien à signaler, mais le patient nous a fait voir que
ses parents l'ont abandonné depuis son enfance (à l'âge de
trois ans) entre les mains de sa grand-mère. C'est elle qui l'a
élevé jusqu'aujourd'hui.
Antécédents scolaires :
Pas des particularités, car il a évolué
sans aucune difficulté depuis l'école primaire, jusqu'à ce
qu'il ait décroché son diplôme d'état en
math-physique en 2009.

64
Antécédents personnels :
Patient colérique et timide : quand il prend la
décision d'agresser quelqu'un, il le fait.
Antécédents conjugaux :
Rien à signaler. Il est marié et père d'un
enfant âgé d'une année et huit mois
2. BIOGRAPHIE
Le patient se nomme MUNONGO BEYA. Il a 28
ans, en 1992 (à l'âge de sept (7) ans, il débuta
ses études primaires à l'école primaire (E.P. en sigle)
camp Mutombo au niveau de l'arrêt dispensaire Unilu où il obtient
son certificat d'études primaires en 1999 et continue ses études
secondaires en 2000 jusqu'à décrocher son diplôme
d'état en maths physiques au lycée kiwele en 2009,
il réside au numéro 1 de l'avenue Araucarias du quartier
bel-air de la commune kampemba. Chrétienté pentecôtiste, il
est né seul chez ses parents, quand son père fut étudiant
et sa mère élève finaliste.
En 2011, il a fait le centre d'anglais et informatique pendant
quelques mois, après une année de chômage. Apres sa
formation au centre, il est entré dans la « force one Security
» du côté kilima simba, en allant vers la cité de
kipushi, où il a oeuvré pendant une année et quelques
mois.
En 2012, en il a abandonné ce travail
et s'est orienté vers la profession libérale dans des chantiers,
où il faisait tous travaux : aide maçon, charpentier, etc. Six
mois après, il a été chassé du chantier, pour son
agressivité. C'est au cours de cette année qu'il a rendu une
fille de son quartier grosse, ce qui a plus rendu son père nerveux, et
ce dernier a fini par couper contact avec son fils et a cessé de lui
envoyer de l'argent chaque fin du mois comme d'habitude.
Il a alors chômé pendant trois mois, puis il a eu
l'idée de fabriquer les pains chez lui à la maison pour subvenir
aux besoins de sa famille.
En 2013, il a perdu sa fille
aînée. Quelques mois après, il a décidé que
sa femme retourne chez ses parents pour qu'il aille habiter chez
l'aîné de la famille de son père afin renouer le contact
avec son père malgré la distance qui les sépare, ce qui
n'a pas plu sa mère biologique. C'est ici où il a
complètement changé son comportement et ce qui a fait qu'il soit
renvoyé de la maison, pour rentrer chez sa grand-mère, qui sait
gérer son agressivité. Déjà à cette
période, la relation avec sa mère n'était pas bonne,
malgré le soutien.

65
Victime de la menace de mort par son fils, et sous l'influence
de la colère, la mère décida en présence de tout le
monde de n'oser plus revoir son fils dans sa vie, car il lui a manqué
du
C'est depuis le 16 décembre 2013 qu'il
est hospitalisé à l'Hôpital Général
Provincial de Référence Jason Sendwe pour trouble comportemental
; car ce dernier, lorsque le grand frère de son père a
remarqué qu'il a changé son comportement, il l'a traité
d'un fou, d'un sorcier qui voulait détruire sa maison, parce qu'il avait
des propos suicidaires à l'égard de ses frères et soeurs,
il s'isolait et ne voulait pas parler aves ses proches, il s'énervait
à tout moment, et ce qui apparait étrange chez ses frères
et soeurs, il les insultait en les traitant des sorciers à l'absence des
parents.
3. HISTOIRE DE LA MALADIE
Tout a commencé chez son oncle paternel,
l'aîné de son père. Un jour il s'est beaucoup
demandé pourquoi il ne vit pas comme ses frères et soeurs,
pourquoi ses parents ne se sont pas épousés, pourquoi sa
présence sur terre n'est pas importante ?
Le mari de sa mère ainsi que leurs enfants ne le
considèrent pas. Dans la maison où il vit, on ne le respecte pas,
il n'a aucun rôle, aucune responsabilité, ce n'est que lui qu'on
envoie, même les petits enfants lui donnent des ordres.
C'est ainsi qu'il a jugé bon de s'enfermer dans la
chambre où il passait nuit pendant toute la journée en voulant se
suicider (se pendre) car il était assis sur un escarbot en train de
faire un noeud avec une longue corde bien attachée sur la charpente de
sa chambre. Le soir, sa petite soeur frappa à sa porte pour qu'il soit
envoyé. Il s'est jeté sur sa soeur qui le réveillait afin
de se décharger (défouler). Sa violente agression a
été mal interprétée par sa tante. Celle-ci croyait
que notre patient voulait la violer, du fait que la porte était à
moitié fermée et la fille criait au secours. En voulant se
justifier de la fausse accusation auprès de son père, ce dernier
écouta sa femme puis le chassa de sa maison en le traitant d'un violeur.
Vu que sa réputation a été foulée au pied, il s'est
décidé de causer de dégâts matériels, en
cassant les vitres de la maison, ainsi quelques chaises en plastiques, il a
détruit la porte de sa chambre, y compris la fenêtre.
Le même soir, on a fait venir sa mère. Cette
dernière, le rendra encore plus nerveux par sa présence et sa
nervosité le poussa à tenir sa mère au coup en la traitant
d'une sorcière qui est la cause de sa souffrance, il l'a promis qu'il
finira par la tuer parce qu'il a déjà une fois consulté un
marabout à la Rwashi.

66

67
respect. Il lui revient d'aller chercher une autre
mère, elle ne plus sa mère biologique, car si elle
l'était, il aurait vécu avec depuis sa naissance. . Telle est la
réaction de sa mère. Vue cette déclaration, notre patient
se tourna vers sa grand-mère pour lui demander enfin qui est sa
mère biologique et où est la vraie famille de son père?
Par ce que sa mère le refuse devant tout le monde, et son oncle paternel
le chasse de sa maison. Sa grand-mère le prit, rentra avec lui à
la maison où elle essaya de le calmer afin de mieux dialoguer.
Malgré multiples conseils prodiguée par sa grand-mère,
Munongo Beya n'a pas compris, il voulait encore rentrer menacer sa tante qui
l'a accusée injustement en le qualifiant de violeur.
Etant donné que son état nerveux allait de plus
en plus mal, et pour mettre fin à cette situation douloureuse, notre
patient voulait à tout prix se donner la mort deux jours après
les dégâts. Sa grand-mère décida de l'hospitaliser
à l'Hôpital Général Provincial de
Référence Jason Sendwe dans le service de psychiatrie homme
où le médecin psychiatre lui prescrivit des
antidépresseurs en l'occurrence de Tegretol, Aldol, Artane, Nozinan,
pour soulager sa souffrance et améliorer son état de
santé.
4. INFORMATION DE L'ENTOURAGE
Selon la grand-mère, notre patient a très bien
évolué pendant son enfance, car il ne connaissait pas qu'elle (sa
grand-mère) n'était pas sa mère biologique. Mais, quand
ses oncles ainsi que tantes maternels l'avaient informé que sa
mère est leur soeur, ils feront de leur mieux pour qu'elle prenne son
fils en charge, car leur mère (sa grand-mère), n'avait pas
suffisamment de moyens pour assurer sa scolarité, c'est ainsi qu'il a su
que celle qui l'a fait grandir, n'est jamais sa mère. Il a fini par
chercher à connaitre si cela était vrai auprès de sa
grand-mère, qui n'avait pas tardé e tardait pas de lui
témoigner la réalité.
Depuis lors, il est devenu timide, et a opté pour une
vie solitaire, manifestant une colère non exprimée que sa
grand-mère ignorait. Elle pensait que c'est passager. A cette
époque, il avait 14 ans et quelques mois.
OBSERVATION DES FAITS
Lors de nos observations, nous avons relevé les faits
ci-après : Notre patient est replié
sur lui-même ; il vit dans la solitude ;
Attachement excessif à sa grand-mère ;
Il aime rester au lit ou parfois assis pendant longtemps ;
Il se plaint de manque d'appétit ;
Le langage logorrhéique ; La méfiance ;
Le refus de parler de sa mère ou de raconter son histoire
;
Le manque d'estime de soi ; la tristesse et le
désespoir manifestés en secouant sa tête à chaque
fois etc. Cette observation nous a permis de le classer parmi les six types de
personnalité décrite par Jean-Luc Monsempeses (cité par Dr
Tumbwa, 2014, p 12).
Notre patient a un caractère sympathique
qui présente les caractéristiques suivantes :
Ses points forts : il est sensible, chaleureux et
compatissant. Il aime s'occuper des autres, être utile, donné aux
autres en s'occupant de leur confort.
Son comportement : il s'habille pour plaire aux autres. Son
visage est souvent souriant. Il aime travailler en groupe et recherche des
ambiances bienveillantes, dans un regard sympathique.
Son mode de perception et de communication : il perçoit
les gens et les situations avant tout par ses ressentiments, son langage
exprime de nombreux sentiments et d'émotions. Ses besoins psychologiques
: il souhaite être reconnu en tant que personne, se sentir aimé
pour lui-même et pas pour son travail ou ses opinions. Il recherche
également la satisfaction des besoins sensoriels (voir, entendre,
sentir, goûter).
Son choix sur une activité : il est attiré par
les métiers de relations, les métiers de service ou d'assistance
(infirmières, psychologues, assistantes sociales, hôtesses), ou
des métiers liés à l'usage des sens.
Son point négatif : il a tendance à se
sur-adapter aux besoins des autres, il a du mal à s'affirmer et peut
commettre des erreurs absurdes.
Notre patient répond à beaucoup de types des
caractères décrits par Jean-Luc Monsempes (cité par
Tumbwa, 2014, p.14) et certains autres traits de sa personnalité
apparaissent dans d'autres types de caractères de Jean-Luc.
Quelle est ta grille d'analyse qui t'a permis de relever les
faits ci-haut évoqués ?
III.2. ETABLISSEMENT DE LA RELATION
THERAPEUTIQUE
Après avoir fait cette observation sur notre patient,
nous lui avons parlé d'une possibilité de traitement par la
chimiothérapie de la part du médecin psychiatre du service
neuropsychiatrique de l'Hôpital Général Provincial de
Référence Jason Sendwe et d'un éventuel accompagnement
psychosocial de notre part, par ce que notre tâche est celle de

68

69

70

71
compléter le diagnostic médical pour un meilleur
accompagnement en tenant compte des facteurs biopsychosociaux.
Nous lui avons encore parlé de sa maladie provenant de
la carence affective, qui d'après nos observations cliniques pouvait le
conduire à des maladies névrotiques telles que : névrose
d'abandon (peur d'être abandonné ou d'abandonner quelqu'un),
délires de persécutions (le sujet pense qu'il est
pourchassé, qu'on vient le tuer ou lui faire du mal etc.)
Pour cela, nous lui avons montré la
nécessité d'entre prendre avec lui les séances
d'accompagnement psychosocial pour l'aider à comprendre toute situation
qui lui arrive, de ne plus être nerveux et ses comportements à
risque (tristesse, découragement, indifférence envers les autres,
manque d'estime de soi et aussi pour recueillir les informations pour notre
mémoire).
Avec son consentement, nous avons proposé dix
séances (10) d'accompagnement psychosocial et une séance
d'évaluation de son état physique chaque jour après
entretien clinique. (Un exercice physique) car il avait du mal à courir
par le fait qu'il passait presque toute la journée au lit. Donc deux
séances par semaine. A chaque séance, nous commençons par
annoncer la prochaine séance tout en tenant compte d'éventuels
changements du calendrier indépendamment de notre volonté.
Cela étant, nous avons l'habitude de signaler à
l'avance à notre patient et d'envisager.
Nous l'avons surtout rassuré au sujet de la
confidentialité dans la relation d'aide, tout au long du processus
d'accompagnement psychosocial. Enfin, nous lui avons demandé sa
collaboration pour faciliter cet accompagnement psychosocial proposé.
III.3. INTERVENTION THERAPEUTIQUE PAR
L'ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOSOCIAL
1ere Séance : le 19 décembre
2013 (45 minutes)
La première séance était basée sur
la prise de contact et la préparation psychologique de notre patient. Au
cours de cette séance, nous avons remarqué la méfiance
dans son regard accompagnée d'une attitude colérique, son visage
renfrogné attiré notre regard et nous pousse de nous approcher de
lui.
S'étant entretenue avec lui pendant au moins 45
minutes, il ne faisait que parler de sa grand-mère, des
difficultés qu'ils traversent, ce qui le rend plus nerveux car selon
lui, il ne souhaite jamais voir quelqu'un souffrir. Il nous avait
demandé l'importance de notre tâche au sein de ce service
neuropsychiatrique, du fait que depuis son hospitalisation, il nous voit parler
avec
les malades, sans qu'on ne leur administre les
médicaments ou leur prescrire les produits. Or, nous tous nous avons le
même blouson et on nous appelle docteur : nous lui avons dit clairement
que nous sommes psychologue(s) clinicien(s), (nous sommes ceux qui posent un
diagnostic et proposent une thérapie aux patients ayant des troubles
affectifs, comportementaux et moteurs). Ce qui veut dire : Nous traitons la
souffrance psychique ou mentale, à travers la parole. Tel que toi, (ton
agressivité, ta tristesse, ta timidité,...) ces problèmes
te viennent de la tête et te poussent d'agir tantôt d'une
manière, tantôt d'une autre, en te rendant de fois nerveux,
agressif sans que tu comprennes ou soient ils te permettent à t'isoler
des autres. Ce qui n'est pas normal. Voilà ce que Nous appelons
souffrance mentale et nous la traitons ensemble avec le malade au moyen de la
parole (entretien, dialogue, échange avec le patient) sans lui
administre ou lui prescrire aucun médicament. Ces malades sont
accueillis dans des institutions hospitalières qui sont : les centres
neuropsychiatriques, les hôpitaux et les cliniques.) Différents
des médecins, et infirmiers, notre rôle au sein de ce service est
de nous entretenir avec tous les patients ayant des problèmes
psychologiques ou somatiques pour proposer une prise en charge ou un
accompagnement psychosocial afin de les aider à comprendre toutes
situations qui se présentent devant eux, pour qu'ils acceptent de le
surmonter. A la fin de cette séance, nous avons observé son
sourire qui nous avait stimulés de lui annoncer le prochain
rendez-vous.
2eme Séance : le 23 décembre
2013 (45minutes)
Cette séance consistait d'éclairer le travail
que nous avions accompli tout au long de l'accompagnement psychosocial, faire
savoir au patient comment nous allons procéder avec l'entretien
thérapeutique chaque fois que la séance est programmée, en
échangeant avec lui sur sa maladie, sa conception par rapport à
sa maladie. Nous voulons savoir s'il est en contact avec sa mère ou si
elle est passée lui rendre visite après notre départ. Mais
nous avons compris qu'il n'y avait pas de contact par le fait qu'il
témoignait cela par son mécontentement et au travers de ses
phrases : mon père et ma mère m'ont abandonné, ils ne
veulent plus jamais me revoir ni m'aider. A la fin de cette séance,
notre présence l'avait apaisé, et nous lui avons fixé la
prochaine séance.
3eme Séance : le 26 décembre
2013 (60 minutes)
Apres l'accord du patient lors de la deuxième
séance, nous avons d'abord procédé à un entretien
directif pour relever ses identités : (Nom, Post-nom, Age, Niveau
d'étude, Sexe, Religion, Etat-civil, Profession, ambitions sociales et
professionnelles etc.). Dans cette séance, nous avons encore
procédé à la récolte des informations sur les
antécédents personnels, familiaux, organiques, scolaires,
à l'aide d'un entretien semi-directif. C'est au cours de cet entretien
qu'il nous a parlé de sa relation avec ses parents en nous montrant la
raison pour laquelle il est trop attaché à sa grand-mère.
Mais pendant le dialogue, une de ses phrases (du patient) nous a
témoigné son mécontentement d'être parent d'une
fille en nous demandant : « pourquoi mettre au monde un enfant, puis
l'abandonner ? Que Dieu m'aide de ne pas les ressembler (ressembler ses parents
qui l'ont abandonnés »
A la fin, nous lui avons annoncé l'objet de la
prochaine séance.
4eme Séance : le 02 janvier 2014 (55
minutes)
L'objet de cette quatrième séance, était
de récolter des informations sur le parcours personnel du sujet, c'est
ainsi qu'il nous a raconté son autobiographie à l'aide d'un
entretien non directif appuyé par les techniques de counseling suivantes
: la question ouverte, la clarification, la reformulation et le silence. C'est
au cours de cette séance qu'il nous a parlé du début de sa
maladie causée par la maltraitance de son oncle paternel,
l'aîné de son père, et de sa femme qui, selon lui, sont des
personnes qu'il déteste et qu'il n'aimera jamais dans sa vie. Ensuite,
il nous a témoigné sa satisfaction à travers cette phrase
: «je vous avoue tour ce que je cache ma grand-mère ». C'est
ce qui nous a poussés à annoncer le prochain rendez-vous.
5eme Séance : le 06 janvier 2014 (45
minutes)
Apres avoir obtenu les informations sur son autobiographie,
à l'aide de l'entretien appuyé sur les techniques du counseling
citées ci-haut, lors de la séance précédente ; nous
lui avons ensuite demandé de nous parler de sa maladie. En nous
racontant l'histoire de sa maladie, il nous a présenté ses
douleurs et ses angoisses de ne plus être traité d'un père
irresponsable par ses enfants ou d'un mari infidèle par sa femme.
Ensuite, il nous a demandé de le mettre en contact avec sa mère,
en nous passant le numéro téléphonique de sa mère,
chose qui n'a pas réussie. Il nous a enfin présenté ses
préférences de venir en aides les personnes les plus
démunies, le jour où il aura des moyens. Nous lui avons
fixé rendez-vous pour la prochaine la séance.
6eme Séance : le 10 janvier 2014 (30
minutes)
Dans cette séance, après avoir obtenu les
informations sur l'histoire de sa maladie, nous avons procédé
à une mise au point des faits observés chez lui depuis la
première séance de consultation psychologique et de prise de
contact jusqu'à la cinquième séance, ensuite nous avons
noté chaque fait observé.
Nous avons regroupé les traits de son caractère
lors de notre dernière séance appuyée sur l'entretien
semi-directif, et directif. Ces traits nous ont aidés à examiner
sa personnalité à partir de son attitude Empathique et
compatissante. Son visage est toujours souriant, il est un sujet émotif,
il aime assister les autres, sous stress ou devant un mal entendu et surtout
s'il est innocent. En fin, nous avons annonce l'objet de la prochaine
séance.
7eme Séance : le 13 janvier 2014 (45
minutes)
Apres avoir noté et développer les divers faits
observés ensemble avec le patient. Au cours de cette séance, nous
lui avons parlé de sa personnalité selon le type décrit
par Jean-Luc, d'une manière détaillée, afin qu'il
connaisse son caractère ainsi que sa personnalité. Ceci l'a
encouragé et l'a poussé à nous demander de multiplier ses
séances thérapeutiques.
8eme Séance : le 16 janvier 2014 (55
minutes)
Apres avoir parlé de son caractère et de sa
personnalité, il nous a témoigné sa satisfaction de
pouvoir se connaitre à travers notre accompagnement psychologique. Et
comme d'habitude, après chaque séance, nous passons à un
exercice de relaxation pendant 5 à 10 minutes pour mieux se
détendre par ce qu'il restait au lit pendant longtemps, voire toute la
journée sans prendre de l'air à l'extérieur, ni faire une
marche dans l'enceinte du service. Mais à celle-ci, nous avons
consacré 30 minutes pour divers exercices de 5 minutes chacun. A la fin,
nous lui avons annoncé qu'il nous reste deux autres séances pour
finir. C'est ainsi qu'il nous a demandé s'il pouvait faire venir sa
grand-mère..
9eme Séance : le 20 janvier 2014 (une
heure 30 minutes)
A cette séance nous avons eu à nous entretenir
avec la grand-mère du patient. A cet entretien, le patient
lui-même y était aussi convié et nous étions ravi de
voir notre patient raconter à sa grand-mère tout ce que nous
avons fait durant les précédentes séances. Le patient a
éprouvé le désir de pardonner à toutes les
personnes qu'il détestait en commençant

72

73
par sa mère biologique, de réparer avec ces
personnes. Il a accepté sa guérison ainsi que son insertion dans
la société aux travers de nos interventions. Il nous a
rassuré qu'il vivra mieux après son hospitalisation car selon
lui, la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est de partager sa
situation avec les collègues de peur qu'il ne soit plus traité de
malade mental. D'après lui, cette hospitalisation est une grande
leçon qu'il n'oubliera jamais dans sa vie parce qu'elle lui a permis de
voir, de vivre divers cas des malades mentaux qu'il entendait à travers
les garde-malades ou les membres de la famille des victimes.
10eme Séance : le 23 janvier 2014 (20
minutes)
A cette dernière séance, nous avons eu
l'occasion de remercier notre patient pour sa collaboration et son acceptation
de partager avec nous du début jusqu'à la fin de nos
séances. Nous avons été émerveillé de la
confiance qu'il nous a témoigné et du temps qu'il nous a
accordé. Nous avons constaté, qu'il y avait du nouveau à
chaque séance : des inquiétudes, des soucis, des joies. Tout cela
a contribué à l'obtention de la modification et de
l'amélioration de son état psychique voire de sa santé
mentale.
III.4. DISCUSSION ET CONSTRUCTION DU SENS
Dans cet accompagnement psychosocial pour établir
l'équilibre psychosocial, le patient concerné est un
garçon MUNONGO âgé de 28 ans, victime d'une carence
affective qui est la cause des certains événements douloureux,
rencontrés au cours de sa vie. Apres une séance de prise de
contact, de l'établissement de la relation thérapeutique, et les
informations recueillies à son entourage, son diagnostic a
révélé une carence affective existante en lui. Ainsi, un
plan expérimental basé sur l'accompagnement psychosocial a
été élaboré au moyen de ce tableau clinique :
attachement excessif à sa grand-mère, repli sur soi, manque
d'estime de soi, refus de parler de sa vie et de sa famille dépister
à partir de nos observations, et à l'aide de type de
personnalité décrite par Jean-Luc monsempes cité par Dr
Valentin Tumbwa en vue de faire disparaitre certains symptômes et
réajuster son comportement dans le but de le réintégrer
dans la société.
Au début de la prise en charge proprement-dite, notre
patient présentait un tableau clinique dont les symptômes majeurs
sont : des perturbations comportementales qui se manifestaient par un repli sur
soi, un langage logorrhéique, un refus de parler de lui et de sa
famille, l'attachement excessif à sa grand-mère, des fatigues
permanentes, la colère et une méfiance envers nous. Il
entretenait des relations harmonieuses avec sa grand-mère et se
faisait souvent des soucis suite à la séparation
avec ses parents et aux mauvaises conditions de vie.
En nous référant au guide pratique
d'éducation, les soucis manifestés par notre patient sont tout
à fait normaux à telle enseigne que la moindre privation
affective de la mère, provoque une frustration dont les
conséquences se répercutent sur le comportement total de la vie
de la victime d'un patient carencé affectif.
Quant à la psychanalyse, les défauts de
l'éducation tels que: les mauvais propos, les paroles menaçantes,
vis-à-vis de l'enfant sont à éviter parce que ce dernier
étant inconscient ces blessures influenceront son comportement. Raison
pour laquelle la maltraitance dont notre patient a été victime
chez l'aîné de la famille de son père, l'a conduit aux
troubles comportementaux.
En nous référant aux origines de la
théorie de l'attachement, il convient de souligner que les enfants qui
vivent en séparation avec leurs parents, présentent rapidement un
tableau dépressif que voici : trouble de l'humeur, perturbation
somatique importante, trouble du sommeil, sensibilité accrue aux
maladies, arrêt, puis retard du développement physique et
psychomoteur qui peut s'aggraver si la période de séparation
dépasse cinq mois (5 mois). Le retard de développement s'accroit
et le taux de mortalité devient très élevé
étant donné la sensibilité accrue aux maladies
infectieuses.
A ce niveau, nous pouvons parler du processus d'identification
qui fait que l'enfant prend souvent modèle sur l'un ou l'autre parent.
C'est le cas de le dire avec le complexe d'OEdipe qui nait essentiellement des
rapports entre enfants et parents (Pierre Daco, 1960, p. 181).
Ces processus nous renvoient aux modèles affectifs qui
déterminent des comportements à l'âge adulte. Celui qui
n'aura reçu aucune marque d'affection durant son enfance ne pourra se
référer à des modèles affectifs précis et
risquera de se comporter avec ses propres enfants comme s'était
comporté son entourage. C'est-à-dire que tout enfant qui n'a pas
vécu cette étape, aura des difficultés de se situer ou de
s'identifier pour jouer plus tard le rôle du modèle qui l'a
imité durant son enfance, car d'habitude nous reproduisons les
comportements appris chez nos parents. Mais un enfant qui a été
encadré par un bon tuteur, ou un parent modèle, il saura jouer le
rôle d'un parent responsable dans son couple. Parce

74
qu'il a été initié. La plupart de nos
comportements, reflète l'image de la vie que mènent nos parents
dans leur couple et sur tout leur réactions entre eux et
vis-à-vis d'autres personnes (membres de la famille, voisins ou
entourage) c'est ainsi qu'un garçon qui nait d'une famille
dysfonctionnelle où papa maltraitait, insultait maman et ses parents,
voire la rouer des coups jusqu'à la laisser nue en présence de
ses enfants, comme il est de coutume en Afrique surtout chez le Luba du Katanga
et du Kasaï, où la femme ne peut hausser le ton devant son mari, ni
lui résister quant il donne des ordonnances, ou soit encore, si la femme
n'est pas en bon terme avec ses beaux-frères, belles-soeurs, toutes les
fautes tomberont sur ses épaules et son mari n'aura même pas le
temps d'interroger sa famille de peur qu'il ne soit pas traiter d'un
époux dominé par sa femme. Dans ce cas, le petit garçon,
cherchera à devenir un mari dominant et dictateur dans son couple.
Même s'il étudie, il aura toujours tendance à manifester ce
genre des comportements en considérant sa femme comme un être
qu'on doit toujours instruire, éduquer, corriger, perfectionner en ayant
de tels langages : chez nous la femme n'a le droit d'ouvrir sa bouche devant
son mari, même si ce dernier l'amener un fils d'accoté, elle doit
se soumettre, d'ailleurs l'homme est autorisé d'épouser autant
des femmes qu'il veut, il peut découcher, cela ne posera pas
problème, c'est lui le chef de la maison, la femme n'est qu'une aide,
une machine à reproduction.
Dans des familles où la fille observe sa maman entrain
de désobéir son père, ou ne respecte pas sa
belle-mère, ses beaux-frères et soeurs, cette enfant agira ainsi
dans son couple car pour elle, l'attitude de sa mère à
l'égard de son père était normale. Dans beaucoup de
situations, les gens reproduisent le comportement copié des parents
pendant leur enfance, parce que pendant cette période d'enfance, la
personnalité de l'enfant est fragile, raison pour laquelle il imite
l'adulte ou le comportement de l'adulte. Ici, nous parlons de l'influence de
l'enfance sur la personnalité adulte. C'est au cours de sa croissance
que l'enfant acquiert sa vision du monde et ses habitudes de penser.
Tout au long de ce parcours se développent et se
structurent la personnalité du sujet, celle-ci sera affectée plus
ou moins gravement si des « accidents » jalonnent ce cheminement. Si
au cours de l'enfance le sujet est victime de traumatisme (carence affective,
jalousie résultant de la naissance d'un frère ou d'une soeur,
violence, etc.) la frustration de certains désirs pourra entrainer
à l'âge adulte une régression vers les stades de l'enfance,
des fixations infantiles pourront rompre ou détourner le refoulement (il
reste toujours quelque chose de la

75

76

77

78
sexualité infantile dans la sexualité adulte).
Déviance, névrose, troubles pathologiques, etc. Freud voit
d'ailleurs dans le complexe d'OEdipe, le noyau de toute névrose.
III.5. CONCLUSION PARTIELLE
Dans ce chapitre, nous avons présenté notre cas
clinique, effectué un accompagnement psychosocial pour remédier
à son problème. Il se termine par la présentation des
résultats ainsi que leurs interprétations. Notons que nous avons
appliqué la clinique non armée dans ce travail, vu que la
souffrance de notre patient ne nous a pas permis de lui administrer un test ni
le soumettre à une épreuve quelconque.
CONCLUSION GENERALE
Nous avons mené nos recherches auprès d'un
garçon de 28 ans, victime d'une carence affective causée par la
séparation d'avec ses parents. Nous l'avons rencontré à
l'Hôpital Général de Référence Jason
Sendwe.
Lors de nos observations fortuites et systématiques,
nous avons constaté que la victime de carence affective, vit non
seulement une souffrance psychique, mais aussi une souffrance sociale. C'est
donc une souffrance psychosociale qui nécessitait de l'accompagnement
psychosocial en vue de retarder uniquement la progression du trouble dans son
psychisme. Cet accompagnement reste insatisfaisant s'il ne prend pas en compte
le confort du patient et s'il ne tient pas compte de la situation affective,
relationnelle et environnementale de son état psychique.
L'intérêt social de notre étude
réside sur le fait que la réinsertion sociale d'un patient
tiendra désormais compte des informations fiables concernant la victime
de carence affective et de l'avis de l'expertise psychologique clinique, sur
les procédures et procédés d'accompagnement
psychosocial.
L'intérêt scientifique nous oriente
essentiellement sur l'apport de l'accompagnement psychosocial associé
aux méthodes cliniques, techniques d'entretien et d'observation
proprement cliniques de notre démarche méthodologique pour
faciliter les recherches de toutes les personnes qui nous liront.
Pour ce faire, nous avons formulé notre
préoccupation en ces termes : quelle peut être la stratégie
thérapeutique à utiliser pour rétablir
l'homéostasie psychosociale d'une victime de carence affective.
En guise de réponse à notre
préoccupation, nous avons formulé nos hypothèses de
recherche de la manière suivante :
- Les symptômes développés par notre
patient âgé de 28 ans, victime de carence
affective,
correspondraient aux théories évoquées par
différents auteurs et les moyens thérapeutiques que nous
envisageons résoudraient ce problème.
- La stratégie thérapeutique à utiliser
pour rétablir l'homéostasie psychosociale
de notre patient
victime de carence affective pourrait être l'accompagnement
psychosocial.
Nous nous sommes assigné comme objectif :
découvrir l'état biopsychosocial de la victime de carence
affective, lui accorder un accompagnement psychosocial nécessaire dont
elle a besoin, pour l'aider à recouvrir l'homéostasie
psychosociale de sa santé biopsychosociale.
Pour y arriver, nous avons recouru à la méthode
clinique qui consiste en une étude approfondie d'un cas. L'entretien et
l'observation clinique nous ont servi comme des techniques pour la collecte des
informations exprimées et non exprimées du patient MUNONGO. Les
techniques de counseling et les processus de deuil nous ont permis de le
conduire à accepter la situation qui lui est arrivée afin de
guérir.
Hormis l'introduction et la conclusion
générales, la travail a été structuré en
trois chapitres. Le premier chapitre a été orienté autour
des aspects théoriques ci-après : la définition des
concepts clés, les notions spécifiques inhérentes à
la carence affective et les études antérieures ; le second
chapitre a évoqué les aspects méthodologiques, le champ
d'investigation de notre recherche, les méthodes et les techniques de la
recherche, ainsi que
les difficultés rencontrées. Le troisième
chapitre enfin, a présenté les résultats, les
procédures des séances thérapeutiques suivi de la
discussion et la construction du sens.
Apres l'analyse des données, nous sommes arrivés
aux résultats suivants : notre patient est souffrant d'une carence
affective dont les symptômes majeurs étaient les suivants : le
repli sur soi, l'attachement excessif à sa mère, l'angoisse
d'abandon, la colère, la méfiance etc.
Apres dix séances thérapeutiques, nous avons
constaté les modifications favorables et l'amélioration
considérable de l'état de santé mentale de notre patient.
La joie était bien perceptible et sa collaboration a permis de soutenir
l'accompagnement que nous lui avons offert.
Ainsi, nous sommes arrivés à la conclusion selon
laquelle, l'accompagnement psychosocial s'avère indispensable aux
personnes victimes de carence affective pour les aider à surmonter leur
souffrance biopsychosociale.
Au vu des résultats obtenus dans nos investigations,
nous constatons que notre hypothèse de recherches est confirmée.
Et au regard de ce qui précède, nous demandons aux centres
d'accueil, neuropsychiatriques, hôpitaux, organismes qui s'occupent de la
prise en charge des personnes souffrant des troubles mentaux, comportementaux,
des maladies psychiques et nerveuses d'accorder une importance capitale
à l'accompagnement psychosocial pour soutenir ces personnes en
difficulté.
En définitive, notre travail n'a pas exploité ou
touché tous les aspects nécessitant l'accompagnement psychosocial
dans le cadre de la carence affective, nous suggérons à tous ceux
qui voudront aborder la question liée au manque d'affection, de recourir
à l'accompagnement psychosocial en utilisant les méthodes et
techniques cliniques.
Nous suggérons encore aux autorités
académiques d'organiser le stage dans notre domaine de psychologie
clinique en première et deuxième licence avant la rentrée
officielle académique, pour permettre aux étudiants en
psychologie clinique d'avoir une connaissance pratique permettant de venir en
aide les personnes en difficulté afin qu'ils retrouvent leur
homéostasie biopsychosociale.
Enfin, nous demandons aux enseignants (professeurs, docteurs,
chefs de travaux, assistants et assistantes), de soumettre les étudiants
en psychologie clinique à la descente sur terrain en cas des travaux
pratiques, pour leurs permettre de s'adapter aux divers cas à
traiter.

79

80
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. Anne le Rhum (2007). Accompagnement psychosocial.
Sarrebruck : Editions universitaires européennes.
2. Baudier, A & Céleste, B. (2008). Le
développement affectif et social du jeune. enfant. 3em
édition.
3. Bernard et Geneviève Pierre (1987). Bureau
d'études et de recherches pour la promotion de la santé.
Paris : La Hachette. 3em éd.
4. Blanchet, A. (1990). Guide pour la recherche en
didactique des langues et des cultures. Paris : L' Harmattan.
5. Chauchard. (1975). La sexualité de l'enfant.
Paris : PUF.
6. Chiland, C. (2010). Introduction à l'entretien
clinique. Paris : PUF. 4e tirage.
7. Daco, P. (1960). Les prodigieuses victoires de la
psychologie moderne. Paris : Editions Gérard.
8. Perrenoud, P. (2002). Les cycles d'apprentissage.
Québec : Presses de l'Université du Québec.
9. Desmeuzes-Ballant (1993). Le divorce vécu par les
enfants. Paris : Plon.
10. Diverger (2008). Prévention d'adaptation chez les
adolescents. Québec : Presses de l'Université du
Québec.
11. Frejaville, A. (2004). L'enfant au regard des
modifications familiales. Un nouveau
traité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.
Paris : PUF.
12. Gelarbert, C. (2007). Guide pratique de santé.
Dépression, traitement scientifique et naturel. Valence :
Vidasana.
13. Lavarde, A. M. (2008). Guide pratique
méthodologique des recherches en psychologie. Paris : De Boeck.
14. Montagner, H. (1989). Les Rythmes de l'enfant et de
l'adolescent. Paris : Stock.
15. Poussin, G. & Martin-le brun, E. (2011). Les enfants
du divorce, Paris, Dunod.
16. Lavarde, M. (1998). Guide pratique méthodologique
de recherche en psychologie. Paris : De Boeck. .
17. Tieche, M. (1976). Guide pratique d'éducation.
Paris : Ed. SDT
18. Roger B., (2000). Prévention des troubles
psychiques chez l'enfant. Paris : Dunod.
II. DICTIONNAIRES
1. Doront & Françoise, P. (2011). Dictionnaire
de psychologie. Paris : Dunod. 3e édition.
2. Robert, P. (1913). A commentary. Michigan
3. Sillamy, N. (1972). Dictionnaire de la
psychologie. Paris : L'homme du 20 siècle.
II. THESES
1. Kasongo Maloba Tshikala, P. (2011).
Autoreprésentations des jeunes garçons de la rue à
Lubumbashi, RD Congo. Thèse inédite. PSP-Université
catholique de Louvain. Louvain-la-Neuve.
2. Kongolo Mukendi, J.P. (1996). Evolution des effets de
la rééducation sur le développement moral des jeunes
délinquants de 12 à 18 ans. Thèse inédite
FPSE/UNILU.
III. MEMOIRES
1. Anne le Rhum (2007). L'accompagnement éducatif
psychosocial des personnes atteintes de maladies chroniques.
Méd/UCL. Mémoire inédit. Louvain-en-Woluwe.
2. Kasongo wa Kasongo (2007). Conséquences qui
découlent de la conduite des enfants victimes de la carence affective
paternelle dans la ville de Lubumbashi. Mémoire inédit.
FPSE/UNILU.
3. Nakijumbi Kagero (2007). Symptomatologie et
conséquences de la carence affective. Mémoire inédit.
FPSE/UNILU.
4. Nsewa Kasa (2000). Prise en charge des mineurs et son
impact sur le développement social. Mémoire inédit.
FPSE/UNILU.

81
IV. TFC
1. Ilunga wa Kwanda, M. (2011), Impact de la carence
affective sur le développement des enfants âgés de 3
à 5 mois, cas de la maison kilelabalanda. G3 psychologie. TFC
inédit. FPSE/UNILU.
V. COURS
1. Bilonda, G. (2014). Code déontologique
professionnel. L2 Psychologie. Cours inédit. FPSE/UNILU.
2. Cijika (2006). Méthodes des recherches
scientifiques. Promotion. Cours inédit. G2 Sciences de
l'Education.
3. Kasongo Maloba Tshikala, P. (2013). Psychologie
clinique. L1 psycho clinique. Cours inédit. FPSE/UNILU.
4. Tumbwa Mangwamba, V. (2014). Psychologie
comparée des personnalités. Aspects cliniques et transculturels.
L2 Psychologie clinique. Cours inédit. FPSE/UNILU
VI. WEBOGRAPHIES
1.
www.psychologie.com
2. www. michel lemay mars 2007
3. www. psychologie. Fr/CGI-bien/moteur
4. Guibaud psychologue 44,
e-monsite.com

82
ANNEXE
GUIDE D'ENTRETIEN SUR LA CARENCE AFFECTIVE
1. Pouvez-vous nous donner votre identité ?
· Votre nom complet
· Votre sexe
· Votre adresse, fratrie
· Tribut, religion, profession, statut, Etat-civil
2. Avez-vous faites des études
· Primaire
· Secondaire et universitaire
3. Quel est le motif de votre hospitalisation ?
4. Quelle conception avez-vous sur votre maladie
5. Quelle image avez-vous de ce service neuropsychiatrique
6. Comment avez-vous été ? une fois
hospitalisé ?
7. Comment avez-vous passé votre enfance
8. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre enfance ?
9. Comment comprenez-vous ce manque des parents ?
10. Comment est votre relation avec votre grand-mère,
mère, père, vos frères (grands et petits), votre entourage
?
11. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez un parent
accompagné de ses enfants ?
12. Pourquoi avez-vous décidé d'habiter chez votre
oncle paternel ?
13. Entretenez-vous des bonnes relations avec les enfants de
votre oncle paternel ?
14. Votre tante vous appelle-t-elle depuis que vous êtes
hospitalisé ?
15. Accepteriez-vous qu'on vous rende visite ?
16. Accepteriez-vous de partager votre situation avec des tiers
?
17. Comment avez-vous jugé votre réaction
après avoir causé des dégâts matériels chez
votre oncle paternel ?
18. Quelle sera votre réaction le jour que vous
rencontrerez votre mère ?
19. Qui considérez- vous confier vos problèmes
?
20. Quel conseil donneriez- vous à vos parents ?
21. Comment traiteriez-vous vos enfants en cas des
déviances ?
22. Comment allez-vous surmonter cette situation ?
23. Apres l'hospitalisation que diriez-vous à votre
entourage qui depuis un certain temps a remarqué votre absence dans le
quartier ?
24. Quelles sont vos expirations après l'hospitalisation
?
25. Quel est votre mot de la fin ?
| 


