|
UNIVERSITE DE GAFSA
Institut Supérieur Des Etudes
Appliquées en Humanités de Gafsa
Département de
Français

Mémoire de Master de recherche en
Linguistique
|
Sujet:
L'aspect Verbal en Français et en Arabe:
« Étude Comparative du
Fonctionnement de L'aspect dans Les deux systèmes
Verbaux:
Français et Arabe »
|
Elaboré par: Mlle. Essaidi
Feriel
Sous la direction de: Mme. Elouni
Najeh
Année Universitaire:
2021/2022
Dédicace
Je dédie Ce mémoire:
? À Mes chers Parents
? À Mes Enseignant (e) s
? À Mes Ami (e) s
Les mots ne suffisent point pour exprimer
l'affection, le respect et l'amour que je porte
pour vous.
Remerciements
Je tiens à remercier spécialement ma directrice
de recherche Madame Elouni Najeh qui m'a accompagnée au cours des
différentes étapes de ma recherche avec ses précieux
conseils et ses encouragements. Ce travail n'aurait jamais été
possible sans son soutien inconditionnel.
Mes sincères remerciements s'adressent également
à Monsieur Bouomrani Mohamed Salah, directeur de l'Institut, qui m'a
beaucoup aidée dans la rédaction de la partie qui porte sur la
langue arabe et qui a ainsi contribué à l'enrichissement de ma
documentation bibliographique.
Mes profonds respects et mes chaleureux remerciements vont
à
l'ensemble des membres du Jury d'avoir accepté
d'évaluer mon travail de recherche.
Je remercie mon cher ami Bassem Toumia de m'avoir
encouragée dans les moments difficiles.
Merci à tous ceux qui ont contribué de
prés ou de loin à la réalisation de ce modeste travail.
Table des matières
Introduction Générale 1
Chapitre I:Cadre théorique et
Méthodologique de « L'étude de l'aspect dans la
réflexion
Grammaticale » 4
1. Cadre théorique 5
2. Cadre méthodologique 14
Chapitre II:Le fonctionnement de l'aspect dans le système
verbal Français et Arabe 17
1-Le fonctionnement de l'aspect dans le système verbal
français: 18
1.1. L'étude de l'aspect en relation étroite avec
les autres catégories grammaticales: 18
1.2- L'aspect et ses manifestations dans le système verbal
Français: 19
1.3- L'étude de l'aspect comme une catégorie
grammaticale: 20
1.3.1-L'aspect accompli: 21
1.3.2-L'aspect inaccompli: 23
1.3.3- L'aspect inchoatif: 25
1.4- L'étude de l'aspect comme une catégorie
lexicale: 27
1.4.1-L'opposition itératif/ semelfactif: 27
1.4.2- L'opposition perfectif/ imperfectif: 28
1.4.3-Les valeurs aspectuelles de formes verbales: 30
1.4.4- Les périphrases verbales: 31
2-Le Fonctionnement de L'aspect dans le Système Verbal
Arabe: 34
2.1- La divergence de points de vue sur la nature du
système verbal Arabe entre
« Aspectuel/Temporel/ Aspectuo-Temporel »: 34
2.1.1- La langue Arabe comme langue aspectuelle: 34
2.1.2- La langue Arabe comme une langue temporelle : 36
2.1.3- La langue Arabe comme langue Aspectuo-Temporelle: 37
2.2- L'aspect et ses manifestations dans le système verbal
Arabe: 38
2.3- L'étude de l'aspect comme une catégorie «
Grammaticale »:
(ÉíáßÔáÇ
ÉíÍÇäáÇ äã
ÉåÌáÇ) 39
|
2.3.1 -L'aspect accompli:
(ÉãÇÊáÇ
ÉåÌáÇ)
|
|
39
|
|
2.3.3-L'aspect itératif:
(ÉÏÇÚáÇ
ÉåÌáÇ)
|
|
46
|
|
2.3.4- L'aspect inchoatif: (ÏÈáÇ
ÉåÌ)
|
|
47
|
|
2.3.5- L'aspect duratif:
(áÕÇæÊãáÇ):
|
|
47
|
|
2.3.6-L'aspect progressif:
(íÌíÑÏÊáÇ)
|
|
47
|
|
2.3.7- L'aspect non progressif:
(íÌíÑÏÊáÇ
ÑíÛáÇ):
|
|
48
|
|
2.4- L'étude de l'aspect comme une catégorie
Lexicale: (ÉíãÌÚãáÇ
|
ÉåÌáÇ)
|
48
|
|
2.4.1- Les Verbes d'Etat:
(ÉäßÇÓáÇ
áÇÚáÇ)
|
|
49
|
|
2.4.2- Les verbes d'Activité:
(ÉíßÑÍáÇ
áÇÚáÇ)
|
|
49
|
|
2.4.3- Les verbes d'Accomplissement:
(ÊÇãÇãÊáÅÇ
áÇÚ)
|
|
50
|
|
2.4.4- Les verbes d'Achèvement:
(áÇãÊßáÅÇ
áÇÚ)
|
|
50
|
|
2.4.5- Les Verbes Perfectifs:
(ÉáãÊßãáÇ
ÉÒÌäãáÇ
áÇÚáÇ)
|
|
51
|
|
2.4.6- Les verbes imperfectifs:
(ÉáãÊßã
ÑíÛáÇ æ
ÉÒÌäã ÑíÛáÇ
áÇÚáÇ)
|
|
51
|
Chapitre III: Étude comparative du fonctionnement de
l'aspect verbal dans les deux systèmes
verbaux: « Français et Arabe » 53
1-Les convergences entre les deux systèmes verbaux: 54
1.1-Les Convergences sur le plan Grammatical: 54
1.1.1 Les concepts temporels équivalents: 54
1.1.2-Les concepts aspectuels équivalents: 60
2.1-Les convergences sur le plan lexical: 66
2.1.1-Le critère de dynamicité en (FR) qui
équivaut au
ÉíßíãÇäíÏáÇ
ÑÇíÚã en (Arb): 66
2.1.2 - Les verbes perfectifs et imperfectifs: 67
2.1.3 Les interprétations contextuelles en (Fr) qui
équivalent au (
ÉíÞÇíÓáÇ
ÊÇÑíÓÊáÇ) en (Arb):
68
2-Les divergences entre les deux systèmes verbaux: 74
2.1-Les divergences sur le plan grammatical:
ÉíáßÔáÇ
ÉíÍÇäáÇ äã
ÊÇáÇÊÎáÇÇ 74
2.1.1-Les concepts Temporels divergents:
ÉáÊÎãáÇ
ÉíäãÒáÇ
ãíåÇãáÇ 74
2.1.2-Les concepts aspectuels divergents:
ÉáÊÎãáÇ
ÉíåíÌáÇ
ãíåÇãáÇ 77
|
2.2-Les divergences sur le plan Lexical:
ÉíãÌÚãáÇ
ÉíÍÇäáÇ äã
|
ÊÇáÇÊÎáÇÇ
|
81
|
|
2.2.1 -L'emploi de particules verbales
(ÉíÙááÇ
ÊÇãíÓÌáÇ):
|
81
|
|
|
2.2.2-L'emploi de la dérivation affixale:
ÞÍáÇáÇ
ÞÇÞÊÔáÇÇ
|
|
82
|
|
2.2.3-L'emploi des adverbes de temps
(ÉíäãÒáÇ
äÆÇÑÞáÇ):
|
|
83
|
|
Conclusion Générale
|
|
84
|
|
Bibliographie
|
|
87
|
|
Traduction des concepts-clés du Français vers
l'Arabe
|
|
91
|
|
1
|
« Il n'ya guère en linguistique de
question plus difficile que celle de l'aspect parce qu'il n'y en a pas de plus
controversée et sur laquelle les opinions divergent davantage (....) on
n'est d'accord ni sur la definition même de l'aspect, ni sur les rapports
de l'aspect et du temps, ni sur la façon dont l'aspect s'exprime, ni sur
la place qu'il convient de reconnaitre à l'aspect
dans le système verbal des
différentes langues2.
»
1
Bien-ecrire.com
2 J.Vendryes
(1942.85), d'autres spécialistes partagent la même impression
(CF.H.SPITZBRDT (1954.56) : «Presumably now here in modern linguistics
there is such a muddle as in the area of research on AKTIONSARTEN and aspect
» et T.F.Mitchell (1979.159) : « If there is one thing that emerges
of a large and heterogeneous literature on aspect in many languages(...) it is
that no two linguists agree on the subject(....)the whole conceptual area of
aspect is further bedevilled by the notion and term of AKTIONSART.
»).
Introduction Générale
1
L'aspect et le temps sont deux notions ambiguies qui
constituent depuis longtemps l'objet d'étude de nombreuses recherches en
linguistique générale et ce à cause de leur
complexité et leur importance dans tout système verbal. Ce sont
deux notions clés dans l'étude de toute forme verbale dans toutes
les langues. D'ailleurs de nombreuses revues, articles, séries et
même ouvrages sont régulièrement consacrés à
traiter ces deux catégories grammaticales. De plus, le temps et l'aspect
jouent les deux à la fois un rôle assez important
particulièrement au niveau de la construction d'une forme verbale. C'est
ce qui nous invite à constater qu'une forme verbale est principalement
exprimée par la combinaison de ces deux notions. En effet, le temps et
l'aspect semblent comme deux catégories fondamentales et universelles
dans les langues naturelles, c'est-à-dire la majorité des langues
établit une liaison entre le temps et l'aspect. D'ailleurs, en
dépit des différences qu'elles présentent, ces deux
notions sont intimement liées voire complémentaires et
inséparables l'une de l'autre.
Dans cette perspective, nous trouvons que le temps ou
plutôt la temporalité est définie comme étant la
localisation de la situation décrite par un énoncé sur
l'axe du temps (Dik, p237). En fait, elle peut être exprimée de
façon grammaticale, c'est-à-dire à l'aide de flexion
verbale en se focalisant principalement sur « les temps verbaux ».
Ces temps verbaux servent à indiquer une relation temporelle qui est
topiquement le moment de la parole, en la calculant à partir de ce
repère. Nous pouvons ainsi relever trois relations temporelles qui sont
le passé, le présent et le futur (Klein2009, p 43/ Saussure 1998,
p19-21). De même la temporalité peut être exprimée
aussi par des outils lexicaux, en d'autres termes par des moyens contextuels.
D'ailleurs, les langues naturelles sont des langues où la localisation
de la situation peut se faire par des morphèmes flexionnels. Par contre,
certaines autres langues ne disposent pas de catégories grammaticales
dans leur système temporel (Comrie 1985, p 50). Mais il semble que
toutes les langues naturelles sont certainement capables d'exprimer la
temporalité de l'énoncé par des contenus grammaticaux et
lexicaux à la fois. Et dans ce contexte, nous trouvons aussi que toutes
les études qui sont consacrées à traiter l'approche de la
temporalité affirment ce rapport étroit entre l'approche de la
temporalité et celle de l'aspectualité. Cette dernière
présente de sa part des valeurs temporelles de la situation
décrite. En outre, la linguistique moderne établit une
distinction entre les deux approches celle de la temporalité et celle de
l'aspectualité, de façon que la première renvoie
principalement à des informations temporelles externes de la situation.
Quant à l'aspectualité, elle transmet des valeurs temporelles
internes de la situation (Guillaume 1932/ Vetters 1996/ Klein 2009). C'est dans
ce cadre que s'inscrit notre travail qui mettra l'accent notamment sur la
question de l'aspect dans une visée
2
contrastive entre le français et l'arabe. Pour ce
faire, nous partirons d'un corpus constitué de l'oeuvre de Mohamed
Chokri « le Pain Nu » et de sa traduction en arabe «
,,iLÍJ/ jÈiJ/ ». Notre objectif à travers
cette analyse est de traiter l'aspectualité et la temporalité
dans les deux systèmes verbaux tout en focalisant l'attention
particulièrement sur les systèmes flexionnels et les particules
des langues arabe et française. Ce sont ces deux éléments
de base qui nous permetteront de construire linguistiquement les structures
temporelles des énoncés qui constitueront l'objet d'étude
du présent travail de recherche. A ceci s'ajoute que l'aspect et le
temps sont considérés comme des piliers sur lesquels la valeur
temporelle de l'énoncé se réalise. Et dans le cadre d'une
description de l'aspect et du temps, nous sommes alors contraints
d'établir une étude générale de la morphologie
verbale et des catégories grammaticales de l'arabe et du
français. Dans ce contexte, nous allons prendre en considération
les nuances structurelles et contextuelles propre à chaque langue
apprise. Autrement dit, nous allons mettre en rapport l'expression de l'aspect
et du temps dans les deux langues, vu qu'elles n'appartiennent pas à la
même famille dans la mesure où la langue française est
d'origine romane et l'arabe est d'origine sémitique. Ceci implique qu'il
existe véritablement de lourdes divergences entre elles. C'est ce que
nous essaierons dans la mesure du possible de montrer dans cette analyse.
Pour ce faire, nous allons opter pour le plan suivant. Nous
verrons dans un premier temps qu'il est nécessaire de nous attacher au
cadre théorique et méthodologique afin d'apporter un
éclairage sur notre étude multidisciplinaire. Dans un second
temps, nous nous attarderons sur le fonctionnement de l'aspect dans les deux
systèmes verbaux français et arabe. Dans ce sens, notre
intérêt sera alors fixé sur les propriétés de
chaque langue tout en mettant l'accent sur l'aspect à la fois comme
étant une catégorie grammaticalisée et comme une
catégorie lexicalisée. Dans un dernier temps et avant de
conclure, nous nous intéresserons à établir une
étude contrastive en mettant en regard les deux systèmes
linguistiques français et arabe dans le but de dégager les
convergences et les divergences aussi bien sur le plan grammatical (formel) que
sur le plan lexical (sémantique) afin de comparer les manifestations de
l'aspect dans les deux systèmes linguistiques en question.
3
Chapitre I:
Cadre théorique et Méthodologique
de
« L'étude de l'aspect dans la
réflexion
Grammaticale »
4
1. Cadre théorique
Dans cette partie, nous essayerons de présenter le
cadre théorique de notre travail qui mettra en lumière les
différentes notions clés sur lesquelles nous nous appuierons
ultérieurement. Notre attention sera principalement focalisée sur
les notions liées au verbe en général et à l'aspect
en particulier. Pour ce faire, nous allons commencer dans un premier temps par
définir le concept de l'aspect et les notions liées à
l'approche de l'Aspectualité.
En parlant de l'aspect, nous pouvons dire que cette notion a
été abordée au XIXé siècle par les
linguistes allemands pour l'étude des langues slaves. Le terme «
Aspect » a été présenté présenté
la première fois en 1829 par le linguiste allemand Carl Philippe
Reiff qui traduisait le terme « Vid », « Vue,
Espèce » qui désignait le mode de représentation
du procès. Ce terme figurait déjà dans la grammaire russe
en 1827. D'ailleurs, nous remarquons que les réflexions philosophiques
à propos de l'aspect ont augmenté les interprétations
divergentes entre les linguistes qui cherchent à développer des
considérations générales sur l'aspect. Ce dernier semble
comme un concept à discuter et à disputer à la fois. En
effet, cette notion dans le domaine de la linguistique générale
pose de redoutables problèmes méthodologiques au linguiste qui
veut l'examiner dans la mesure où ce dernier peut souvent être
confronté à divers problèmes tels que la diversité
et l'hétérogénite des formes aspectuelles selon les
langues les plus diverses. A ce propos Archaimbault a déclaré
concernant cette dualité entre les langues :
Suivant les langues considerées, l'aspect est en
effet vu soit
comme une catégorie générale,
universelle, dont les moyens convergent vers la répresentation du
procés, c'est le point de vue, soit comme une catégorie
liée à des critéres morphologiques et lexicaux
répertoriés, c'est alors l'espèce 3 .
Sans oublier dans ce contexte de tenir compte aussi de la
complexité des systèmes linguistiques en présence,
c'est-à-dire chaque langue a son propre style d'exprimer l'aspect. En
réalité, il s'agit des langues comme certaines langues romanes
qui combinent les deux notions « le temps et l'aspect »
à titre d'exemple le système verbal français. Ce dernier
fusionne les deux notions ensemble où nous trouvons des formes verbales
impliquant des valeurs temporelles qui visent à situer chronologiquement
la situation décrite et des valeurs aspectuelles qui permettent
d'envisager le déroulement de l'action. Contrairement aux langues
sémitiques comme le système verbal arabe qui est fondé sur
deux grands paradigmes qui sont de nature « aspective » l'accompli et
l'inaccompli. Ces deux paradigmes couvrent
3 Id.225
5
simultanément les trois époques
(passé/présent/futur) ce qui a déja été
mentionné par David Cohen dans son ouvrage l'Aspect Verbal en
décrivant le système verbal arabe : « De cette
pureté de l'expression de l'aspect dans son indépendance par
rapport à l'expression du temps comme aux valeurs lexicales du verbe,
certains états du sémitique peuvent fournir une claire
illustration4. », c'est-à-dire, dans le
système verbal arabe, nous trouvons que la catégorie de l'aspect
est indépendante par rapport à celle du temps. Ce qui affirme que
les deux catégories semblent comme deux catégories distinctes. En
ajoutant encore, la confusion terminologique qui règne à propos
de l'aspect. Cette notion qui est fondée sur « une
opposition des termes ». Cette variété au
niveau des termes utilisés pour décrire le procès-verbal
montre qu'il n'est jamais une expression simple, limitée à une
représentation unique. C'est totalement le contaire, il suppose souvent
l'expression d'une notion et de l'expression de la notion contraire. Dans ce
sens, nous trouvons le système verbal Français qui traite la
notion d'aspect sous l'angle de « l'opposition aspectuelle
». En effet, il suggère une longue liste
d'oppositions aspectuelles comme « accompli?inaccompli »/ «
secant?non secant » / « achevé ?inachevé ». Cette
diversité des expressions aspectuelles dans une même langue
souligne certainement le caractère de « non-limitation
» de l'aspect. Cette catégorie qui peut aller de
l'expression d'un seul type à l'expression de plusieurs types. Tous ces
problèmes méthodologiques indiquent par excellence que le
traitement de l'aspect semble un peu compliqué. D'ailleurs, les
linguistes ne sont pas d'accord même sur la définition de
l'aspect. Certains linguistes traitent l'aspect comme une catégorie de
nature grammaticale, d'autres le définissent comme une catégorie
lexicale. Ainsi que, d'autres linguistes qui proclament que l'aspect est une
catégorie grammaticale et lexicale à la fois. Dans ce contexte
J.Vendryes a déclaré en parlant de cette divergence à
propos de l'aspect :
Il n'ya guére en linguistique de question plus
difficile que
celle de l'aspect par ce qu'il n'y en a pas de plus
controversée et sur laquelle les opinions divergent davantage(...) on
n'est d'accord ni sur la défintion même de l'aspect, ni sur les
rapports de l'aspect et du temps, ni sur la façon dont l'aspect
s'exprime, ni sur la place qu'il convient de reconnaitre à l'aspect dans
le systéme verbal des différentes langues5.
C'est pour cela, la question de l'aspect en linguistique
française reste toujours une question emblématique et un sujet de
débat. D'ailleurs, les chercheurs ne cessent de chercher et de
4 David Cohen, L'Aspect Verbal, p 171.
5 J, Vendryes, 1942, 85.
6
travailler sur la variété et la divergence des
informations afin de trouver des considérations générales
appliquées à propos de l'aspect dans toutes les langues. En fait,
les questions qui se posent toujours sur l'aspect s'articulent
particulièrement autour de la nature grammaticale de cette notion,
c'est-à-dire si l'aspect relevait de la morphologie verbale, du lexique,
de la syntaxe, d'un contexte plus large, de la conjonction de tout ou partie de
ces éléments, mais également sur sa position dans
l'énoncé. Et dans la même direction, nous trouvons que les
études modernes cherchent à vérifier si l'aspect doit
obligatoirement des réponses claires et logiques pour résoudre le
problème du pluralisme, les différences et les contradictions qui
règnent par les études traditionnelles. Notre objectif premier
à travers cette étude sur l'Aspectualité est
d'éviter tout caractère dogmatique qui empêche les
apprenants à comprendre ce phénomène linguistique. C'est
pour cela, nous essaierons dans la mesure du possible d'éclaircir ce
concept et ses relations avec les autres concepts grammaticaux comme (le temps!
le mode! le verbe ! la morphologie verbale.). Et par la suite, nous aborderons
la manière dont il s'exprime dans chaque langue notamment dans les deux
systèmes linguistiques Français et Arabe, tout en mettant
l'accent à ce propos sur les points de différences et de
ressemblances entre les deux langues au niveau de son expression, en tenant
compte à la spécificité de chaque langue.
Ce travail va aussi mettre l'accent sur plusieurs
concepts-clés marquant les différentes parties de cette
étude analytique. Pour cela, nous allons essayer dans ce cadre de les
définir d'une manière générale. Parmi eux nous
citons les notions suivantes :
1-Le Verbe:
Le verbe est un constituant syntaxique et sémantique
à la fois, puisqu'il possède un lexème (radical) et un
morphème (terminaison des temps verbale). De plus, il sert à
exprimer une action, un état, un fait ou une intention,
c'est-à-dire « un procès ». Le verbe peut se
représenter sous de nombreuses formes différentes qui constituent
sa conjugaison. Dans ce contexte, nous citons ce qui a été
mentionné par Riegel en ce qui concerne la définition du verbe
:
Morphologiquement, le verbe est un mot verbale qui se
conjugue, c'est-à-dire qui est affecté par
plusieurs catégories morphologiques, il récoit les marques
spécifiques (les désinences)
7
correspond au plan de la signification au nombre comme (le
nom), à la personne, au temps et au mode6 .
En ajoutant dans ce cadre, que le verbe est le noyau de la
phrase verbale puisqu'il a comme fonction syntaxique de structurer les termes
constitutifs de l'énoncé. D'ailleurs Le linguiste Tesniére
définit le verbe comme suit : « Le noeud des noeuds ou noeud
central, il est au centre de la phrase, dont il assure l'unité
structurale en nouant les divers élements en un seul faisceau, il
s'identifie avec la phrase 7».
Bref, le présent travail est focalisé
principalement sur l'étude de l'aspect du verbe. De plus, l'aspect est
relevé du verbe qui sert à marquer « la
durée de
l'évènement8 » et
à exprimer des valeurs aspectuelles.
2-L'aspect :
L'aspect sert à donner une représentation
interne de l'idée verbale contrairement au temps qui vise à
donner une représentation externe à l'idée verbale. Dans
ce cadre, nous rappelons la définition guillaumienne en ce qui concerne
l'aspect. Ce dernier selon Gustave Guillaume est défini comme le temps
interne « impliqué » et le temps comme le temps externe «
expliqué » :
Le verbe est un sémantème
qui implique et explique le temps. Le temps impliqué est celui
que le verbe emporte avec soi, qui lui est inhérent, fait partie
intégrante de sa substance et dont la notion
est indissolublement liée à celle du verbe. Il suffit de
prononcer le nom d'un verbe comme « marcher » pour que
s'éveille dans l'esprit, avec l'idée du
procès, celle du temps destiné à en porter la
réalisation. Le temps expliqué est autre chose. Ce n'est pas le
temps que le verbe retient en soi par définition, mais le temps
divisible en moment distincts - passé, présent, futur et leurs
interprétations - que le discours lui attribue.9
Cette représentation de l'aspect sépare l'aspect
et le temps de façon que l'aspect confère une
représentation interne au verbe et propre à lui. Tandis que le
temps donne une représentation externe à l'idée verbale,
puisque cette dernière inscrite dans une chronologie, dans une
époque. De plus, nous trouvons dans la même direction une autre
définition illustrée par
6 Riegel, Pellat, Rioul 1994.
7 Tesniére, 1966.
8 J.Vendryes 1923, p117.
9 Gustave Guillaume, langage et science du langage1964: pages
47/48.
8
J.Vendryes. Ce linguiste définit la notion d'aspect
comme une catégorie qui renvoie notamment à la durée :
« On appel du nom d'aspect la catégorie de la
durée10.. ».
En ajoutant aussi que certains linguistes définissent
l'aspect comme une notion grammaticale
liée aux autres notions grammaticales comme (le temps/
le mode/ La personne...). Celles-ci fonctionnent entre eux pour décrire
l'idée verbale. Dans ce contexte nous citons une définition
de dictionnaire :
L'aspect est une catégorie grammaticale qui exprime
la répresentation que se fait le sujet-parlant du procés
exprimé par le verbe (ou par le nom d'action) c'est-à-dire, la
répresentation de sa durée, de son déroulement ou de son
achévement (aspect inchoatif, progressif, résultatif...etc...)
alors que les temps, les modaux et les auxiliaires de temps expriment les
caractéres propres du procés indiqué par le verbe
indépendamment de cette répresentation du procés par le
sujet parlant11.
Cette représentation de l'aspect implique un lien
réciproque entre le locuteur et l'Aspectualité. Le sujet parlant
peut exprimer l'idée verbale sous plusieurs manières.
Premièrement, le locuteur peut la représenter comme
(postérieure/ contemporaine/ antérieure..) par rapport au moment
de l'énonciation. Cette répresentation marque par excellence le
rapport étroit entre les deux notions grammaticales (le temps et
l'aspect). Deuxièmement, il peut exprimer son attitude vis-à-vis
du procès-verbal ce qui implique la relation entre l'aspect et la
modalité. Et dernièrement, le locuteur peut reprèsenter
l'action comme référant à lui-même ou à son
interlocuteur. Ceci affirme par excellence le rapport entre l'aspect et la
personne.
Pour résumer, les définitions de l'aspect sont
multiples et divergentes. Les linguistes se divergent encore sur la notion
d'aspect. Cette dernière pose de nombreux problèmes dans le
domaine de la linguistique générale. C'est pour cela nous avons
choisi de citer quelques définitions qui sont en rapport étroit
avec notre étude. Et de parler de l'aspect sous un angle
spécifique qui traite cette catégorie en tant qu'une
catégorie liée étroitement à la forme verbale pour
ne pas tomber dans l'ambiguïté.
3-Le Temps :
Le temps est défini dans un usage linguistique comme un
ensemble des marques morphologiques d'une conjugaison destinée à
traduire « la situation chronologique »
d'un procès. Cette définition sert à donner une conception
générale sur cette notion grammaticale.
10 J.Vendryes, 1923, p117.
11 J.Dubois et al, dictionnaire de linguistique, Paris
1973.
9
Dans notre étude, nous allons parler du temps sous un
angle spécifique, c'est-à-dire nous allons étudier le
temps en tant qu'une unité de mesure qui situe chronologiquement la
durée de l'évenement. En fait, La linguistique moderne distingue
entre deux dimensions temporelles. Dans un premier temps, nous trouvons le
temps quantitatif. Ce dernier est divisé selon certaines conventions qui
ne varient jamais, qui sont totalement dégagées de l'étre
humain. Ce dernier adopte des unités de mesure conventionnelles comme
suit (l'heure/ la seconde/ la minute et le jour). Ce type est utilisé
particuliérement avec la langue arabe qui applique parfaitement cette
dimenssion temporelle. Tandis que le temps linguistique exprime de son
coté une certaine forme de temporalité plutôt conceptuelle,
le plus souvent floue dépend la morphologie verbale et le sens de
l'énoncé. Généralement, nous trouvons que les deux
systèmes temporels fonctionnent ensemble dans la construction du
procès.
Bref, nous voulons focaliser notre attention sur cette
représentation concernant la notion du temps car dans notre travail,
nous nous intéresserons notamment sur la question de «
temporalité ». Cette dernière qui se relève de la
combinaison entre la notion d'aspect et les temps grammaticaux. De plus nous
allons focaliser particuliérement sur les formes verbales et les
particules des langues (le français et l'arabe) afin d'aborder une
étude approfondie qui s'adopte d'une description des aspects et des
temps.
4-L'aspect grammatical :
L'aspect grammatical dépend largement du temps auquel
le verbe est conjugué. Dans ce cadre, le linguiste Gosselin a
défini l'aspect grammatical comme suit : « L'aspect grammatical
définit le mode de présentation du procés tel qu'il est
indiqué essentiellement par les marques grammaticales (temps
morphologiques, semi-auxiliaires, adverbes d'aspect.12
».
De plus, nous parlons de l'aspect comme une catégorie
grammaticalisée lorsque l'information aspectuelle est encodée par
des « morphèmes grammaticaux13 ». Par
ailleurs, certains linguistes définissent cette notion comme une partie
intégrante « de la carte d'intentité des tirroirs
verbaux 14».
En un mot, nous déduisons que l'aspect grammatical
dépend les moyens grammaticaux qui sont mis en valeur dans
l'énoncé comme la morphologie verbale, les terminaisons des temps
verbaux et les semi-auxiliaires.
12 Gosselin, 1996, p10.
13 Stanojevic 2010, p108.
14 Van Raemdonck/ Meinertzhagen.
10
5-L'aspect Lexical :
L'aspect lexical correspond au sens du verbe et à
l'environnement contextuel qui peut parfois interagir. Cette notion peut
appelée aussi « Aktionsart15 » (Henrichs
1985), aspect « inhérent » (Comrie 1976) ou encore «
Télicité » (Verkuyl 1993). Dans ce contexte, nous rappelons
une définition illustrée par Stanojevic sur l'aspect lexical,
comme une catégorie qui renvoie « Au sens lexical du verbe,
ayant trait à la présence ou à l'absence des bornes
intrinséques du procés denoté par le prédicat
verbal 16».
Et par conséquent, l'aspect lexical sert à
désigner l'aspect déterminé particulièrement par
le
lexème du verbe. C'est contrairement à l'aspect
grammatical qui est déterminé par le morphème du verbe
selon des critères purement grammaticaux.
6-L'aspect accompli :
L'aspect accompli envisage le procès d'une action comme
vu au moment où son terme est avéré. L'accompli est le
plus souvent accompagné aux formes verbales composées (les formes
du passé). Celles-ci présentent l'action comme totalement
coupée du présent. Dans ce cadre, le linguiste Gosselin
définit l'aspect accompli comme suit : « Montre l'état
résultant du procés17 ».
7-L'aspect inaccompli :
L'aspect inaccompli envisage le procès comme en cours
de réalisation. L'inaccompli est le plus souvelnt accompagné aux
formes verbales simples (les formes qui renvoient au présent et futur)
qui présentent l'action comme n'est pas envisagée, en cours de
réalisation. En d'autres termes, l'aspect inaccompli correspond à
l'aspect de l'action qui est en cours de déroulement,
c'est-à-dire celui qui n'est pas parvenu à son terme. C'est
totalement le contraire de l'aspect accompli.
8- L'aspect inchoatif :
L'aspect inchoatif exprime le procès en état de
déclenchement. L'inchoatif sert à
représenter l'action comme immédiate,
instantanée. À Ce propos le linguiste Marque-Pucheu
définit l'inchoatif comme: « l'expression de commencement du
procés18 ».
9-L'aspect progressif :
L'aspect progressif sert à présenter l'action
comme en état de progression, c'est-à-dire l'action est en cours
d'accomplissement, de réalisation.
15 Aktionsart: le terme d'origine
allemande, s'applique en linguistique à la maniére dont est
conçu le déroulement du procés et à son decoupage
en phases, tells qu'exprimés, soit par le verbe lui-meme soit par sa
formed grammaticale:
fr.m.wikipédia.org
16 Stanojevic / Asio 2010, p108.
17 Gosselin 2005.
18 Marque Pucheu 1998.
11
10-L'aspect perfectif :
L'aspect perfectif ou l'aspect ponctuel. Ce dernier met
l'accent sur le résultat final du procès, c'est à dire il
exprime une action terminée. De plus le perfectif est le plus souvent
employé avec les verbes perfectifs ou les verbes
(-dynamiques19) à titre d'exemple les verbes d'État.
Dans cette perspective, nous pouvons citer ce qui a mentionné Halba en
ce qui concerne le perfectif :
Le procés verbal peut être envisagé
comme un événement ponctuel et accompli ou (perfectif), le
procés forme un tout indivisible ou (global) dont le début et la
fin sont averés, l'integralité du procés est
dominée par le locuteur qui peut l'analyser en dehors, il n'ya plus de
coincidence possible avec lui, le procés est non-sécant
20.
11-L'aspect imperfectif :
L'aspect imperfectif (linéaire) envisage l'action dans
sa durée. Il l'a présente comme un processus en cours de
déroulement. D'ailleurs l'imperfectif est le plus souvent accordé
avec les verbes imperfectifs autrement dit les verbes (+dynamique) comme par
exemple (les verbes d'activité). Dans ce contexte, nous rappelons ce qui
a déclaré Halba à propos de l'aspect imperfectif :
Le procés verbal est envisagé comme un
évenement en cours d'accomplissement ou (imperfectif), l'action est
vécue de l'intérieur sans que le locuteur ne connaisse le
début ni la fin du procés car il est en train de se
dérouler au moment ou le locuteur l'envisage, il n'ya coincidence entre
ces deux temporalités, le procés est
sécant21 .
12-L'aspect itératif :
L'aspect itératif souligne la récurence et la
répétition de l'action plus qu'une fois. L'itératif
peut être indiqué par l'emploi de l'imparfait ou
par des moyens contextuels qu'insistent sur la récurrence de
l'action.
13-L'aspect semelfactif :
L'aspect semelfactif dénote une action ponctuelle, qui
ne se produit qu'une seule fois. En
outre, le semelfactif sert à exprimer une action est
achevée dans un moment passé. Cela se fait
19 Z.Vendler, Critére de dynamicité.
20 Halba 2002, p73.
21 Halba 2002, p73.
12
par l'emploi des verbes perfectifs qui sont employés
avec le passé simple. Ce dernier implique par excellence le
caractère de « ponctualité ».
14-Les périphrases aspectuelles
:
Les périphrases aspectuelles constituent un ensemble de
périphrases verbales. Il s'agit précisémment de celles qui
marquent l'aspect du procès (état ou événement) de
façon régulière et stable. En ajoutant aussi dans le
même sens que, les périphrases aspectuelles peuvent marquer
l'état du procès (commencement/ déroulement/ progression
ou achévement).
Nous constatons que le présent travail s'appuie sur
divers concepts qui servent à
progresser et enrichir notre étude sur «
l'Aspectualité ». Cela nous fait
comprendre que cette étude scientifique est multidisciplinaire.
13
2. Cadre méthodologique
Les faits relatifs à l'aspect verbal ont
été identifiés et étudiés dans diverses
langues appartenant aux familles les plus diverses. Cette notion a
impliqué des problèmes dans le domaine de la linguistique. Ces
problèmes surgissent à cause de la divergence d'opinions entre
les linguistes. D'ailleurs cette divergence d'opinions à propos de
l'aspect provient du glissement de ce terme d'une langue à l'autre,
puisque chaque langue le traite par son propre style en s'accentuant sur des
critères spécifiques, propres à cette langue. C'est pour
cela, le linguiste éprouve une extrême difficulté au niveau
de son traitement dans une perspective unique, acceptée dans toutes les
langues. De plus, il semble difficile de l'aborder comme une catégorie
grammaticale unifiée dans son champ d'application dans toutes les
langues. Cela est dû à diverses raisons dont la plus importante
est la différence des systèmes verbaux et la particularité
de la structure interne de chaque langue. Toutes ces raisons ont formé
un véritable problème pour fournir un concept unifié dans
toutes les langues. Et malgré la diversité des études qui
se sont consacrées à l'examiner, les linguistes s'interrogent
encore concernant l'aspect. Ces interrogations s'articulent autour de sa nature
grammaticale, sa position dans l'énoncé, sa relation même
avec les autres catégories grammaticales par exemple(le temps/ le mode/
la personne/la voix). Dans ce cadre nous pouvons citer ce qui a
été mentionné par J.Vendryes, lorsqu'il parle de l'aspect
en tant qu'une catégorie qui pose de nombreux problèmes
méthodologiques : « Il n'y a guére en linguistique de
question plus difficile que celle de l'aspect par ce qu'il n'y en a pas de plus
controversée et sur laquelle les opinions divergent
davantage22... ». Pour résoudre ce problème,
la linguistique a fourni des solutions alternatives à partir des
études qui ont été menées à propos de cette
notion, dans le but de simplifier son étude dans la grammaire et de
l'analyser selon des critères qui peuvent être suivis dans toutes
les langues. C'est pour cela, nous trouvons que certains linguistes ont convenu
que l'aspect est relevé principalement du verbe et ils
répartissent l'aspect comme une catégorie grammaticale et
lexicale à la fois. Cette répartition est due à partir de
la définition du verbe. Ce dernier est défini comme un terme qui
est composé d'un côté d'un morphème,
c'est-à-dire (la terminaison des temps verbaux/ les indicateurs de
personne..). Et de l'autre côté d'un Lexéme qui
désigne le radical qui renvoie au sens du verbe. Et par
conséquent, l'aspect a été divisé alors en deux
types principaux. Premièrement, nous trouvons l'aspect comme une notion
grammaticale, c'est-à-dire une notion qui s'accorde avec les marques
22 J. Vendryes 1942, p 85.
14
grammaticales. De plus, l'aspect grammatical est défini
comme suit : « L'aspect grammatical définit le mode de
présentation du procés tel qu'il est indiqué
essentiellement par les marques grammaticales (temps morphologiques,
semi-auxiliaires, adverbes d'aspect 23 ».
Deuxièmement, nous trouvons l'aspect défini aussi comme une
catégorie lexicale, c'est-à-dire il correspond au sens du verbe.
En outre, l'aspect lexical est determiné par le lexème verbal.
C'est contrairement à l'aspect grammatical qui est
déterminé par le morphème verbal. Dans ce contexte nous
citons la définition de Confais en ce qui concerne l'aspect comme une
catégorie lexicale :
On entend par Aktionsart24, le mode d'action
impliquée dans le lexéme verbal indépendamment de ses
réalisations grammaticales (...) Cet aspect lexical constitue donc une
qualité sémantique invariante du verbe, il peut être dit
objectif au sens ou le locuteur n'a aucun moyen de la
modifier25.
A partir des ces perceptions, nous constatons que la notion
d'aspect est exclusivement liée au verbe et à tous ses
détails qu'ils soient grammaticaux ou lexicaux. Les détails
grammaticaux sont les temps verbaux/ les semi-auxiliaires qui portent des
valeurs temporelles. Et en ce qui concerne les détails lexicaux, ils
sont toujours marqués par le sens propre du verbe. En fait, l'analyse de
l'aspect est le plus souvent élaborée à partir de ses
critères sans oublier à ce propos de tenir compte à
l'environnement contextuel qui a également un rôle important dans
la détermination de l'aspect. C'est ce que nous aborderons dans ce
présent travail qui a comme objectif premier d'établir une
étude analytique, descriptive sur les systèmes temporels et
aspectuels de deux langues le Français et l'Arabe. D'ailleurs, notre
problématique s'inscrit sous l'angle des aspects et des temps verbaux de
deux systèmes linguistiques. Et nous entendons à mettre en
rapport leurs différents niveaux morphologique, grammatical,
sémantique ou contextuel, quand il sera nécessaire pour voir les
distributions différentes de chaque langue en exprimant
l'Aspectualité et la temporalité sans toucher à la
spécificité de chaque système. Et notre second objectif
à travers cette étude est d'aborder une étude comparative
entre les deux langues. Cette comparaison vise à dégager les
convergences et les divergences entre les deux systèmes linguistiques en
traitant l'Aspectualité et la temporalité. Dans ce contexte, nous
allons emprunter un chemin
23 Gosselin 1996, p 10.
24 Voir page 18 de ce document.
25 Confais 1995, p202.
15
méthodologique qui repose sur les multiples
théories qui renforcent notre recherche sur l'aspectualité et la
temporalité.
Dans le chapitre II, nous focaliserons notre attention sur le
traitement des aspects et des temps dans le système français en
suivant les théories de Comrie, Gosselin, et Vendler. Ces linguistes
traitent l'aspect comme catégorie grammaticale exprimée à
l'aide des moyens grammaticaux comme les temps verbaux/ les adverbes d'aspect/
les semi-auxiliaires. Et par la suite, ils l'examinent comme catégorie
lexicale marquée par des outils lexicaux, c'est-à-dire par le
sens propre du verbe, puisque les verbes se divisent en plusieurs types selon
le critère de dynamicité. Ce critère est bien
marqué avec la théorie de Z. Vendler. Ce dernier a établi
une distinction entre les verbes selon le critère de dynamicité.
Et puis, nous nous attarderons sur l'étude des aspects et des temps de
la langue arabe, afin de dégager les critères fondamentaux qui
décrivent comment l'aspect s'est manifesté dans le système
verbal arabe. En s'interésserant dans ce cadre à la morphologie
verbale et à l'emploi des particules préverbales qui permettent
de construire des valeurs temporelles et aspectuelles à la fois. De
plus, nous nous focaliserons en décrivant les aspects et les temps en
arabe sur des théories précises comme la théorie de Marcel
Cohen, David Cohen, Comrie. Ces théoriciens traitent les aspects et les
temps dans le système verbal arabe et ils décrivent les
propriétés du système arabe par rapport aux autres
systèmes verbaux.
Et dans le dernier chapitre, nous établirons une
étude contrastive qui vise à relever les points
d'équivalence et divergence entre le Français comme une langue
romane et l'Arabe comme une langue sémitique. Dans ce cadre, nous avons
choisi dans notre corpus l'oeuvre de Mohamed Chokri « le Pain Nu ».
Ce roman est écrit en français et traduit en arabe sous le titre
de « ,-4LÍá/ JÈiJ/ ». Notre
sélection s'est basée sur une méthodologie
spécifique, précise visant à la réussite de cette
comparaison que nous mènerons à la dernière étape
de ce travail.
Pour terminer, cette étude vise principalement à
analyser l'aspectualité d'un point de vue formel et lexical dans l'Arabe
et le Français. En plus, nous nous intéresserons à
établir une comparaison afin de mettre en regard les deux
systèmes verbaux en relevant les ressemblances et les différences
entre les deux. Cette comparaison s'est manifestée par
l'entrecroissement de plusieurs théories. Tout cela rend compte en fait
au pluralisme disciplinaire et à la complexité de notre
travail.
.
16
Chapitre II:
Le fonctionnement de l'aspect dans le
système
verbal Français et Arabe
17
1-Le fonctionnement de l'aspect dans le
système verbal français:
1.1. L'étude de l'aspect en relation
étroite avec les autres catégories grammaticales:
Dans le système verbal français, le verbe est un
élément essentiel dans la structure d'une phrase, puisqu'il
possède grammaticalement cinq catégories grammaticales qui sont
les suivantes (le temps, le mode, la voix, la personne et dernièrement
l'aspect). En fait, ces catégories grammaticales jouent un rôle
important au niveau de la construction d'une « forme verbale
». Cette dernière est exprimée par l'entrecroissement
de toutes ces catégories. D'ailleurs ces catégories semblent
fondamentales et universelles dans les langues naturelles. C'est pour cela,
nous voulons dans ce cadre prendre à l'analyse une forme verbale comme
exemple pour mieux expliquer le lien étroit entre toutes ces
catégories grammaticales. Nous prenons alors cette forme verbale
«Il a chanté ». Cette forme verbale
véhicule d'un point de vue de TAM26, les
informations suivantes. Tout d'abord, nous remarquons que cette forme verbale
d'un point de vue aspectuel indique précisément le type de la
situation décrite, car il s'agit d'une activité. Cette
dernière est exprimée par l'emploi d'un verbe (+dynamqiue),
c'est-à-dire un verbe qui comporte en lui- même « une
certaine durée ». Cette interprétation est d'un point de vue
lexical, puisque nous mettons l'accent dans ce cadre sur le sens du verbe. Par
la suite, cette forme verbale exprime aussi l'antériorité par
rapport au moment de la parole, puisque l'acte de (chanter) est
antérieure par rapport au moment ou le locuteur parle. Cette
antériorité est marquée par l'emploi d'un temps
passé (le passé composé). Ce dernier situe l'action comme
accomplie. Et par conséquent, nous déduisons que cette forme
verbale souligne d'une part une valeur temporelle (l'antériorité)
et de l'autre part une valeur aspectuelle (l'accomplissement de l'action).
Cette explication montre le rapport étroit entre les deux notions le
temps et l'aspect. Par ailleurs, cette forme verbale exprime aussi un fait
réel en s'accentuant sur l'emploi de l'indicatif comme mode personnel et
temporel.
En résumé, nous constatons à travers ce
que nous avons vu précédemment que ces trois catégories
grammaticales sont étroitement liées entre eux. En effet, ces
catégories sont plus ou moins liées à la
représentation de la temporalité. De plus, la temporalité
et l'Aspectualité désignent tous les deux des informations
temporelles. Ces informations peuvent être externes, c'est-à-dire
les relations temporelles entre le temps de la situation et le moment de
l'énonciation. Et internes à travers les propriétés
temporelles de la situation (cf.Comrie 1976). C'est pour cela, les deux
approches « la temporalité et l'Aspectualité » vont de
paire à la situation. Du fait que, la temporalité renvoie de son
côté à des données
26 TAM: abréviation de: Temporalité/
Aspectualité/ Modalité.
18
temporelles externes et l'aspectualité marquent de
l'autre coté des valeurs temporelles internes de la situation (Guillaume
1964/ Vetters 1996/ Klein 2009). Quant à la modalité, cette
dernière de sa part désigne le statut assertif de la proposition
par laquelle la situation est décrite (Nuyts 2005/Gosselin 2010). Dans
ce cadre, nous pouvons citer ce qui a mentionné Gougenheim en ce qui
concerne la notion de l'aspect : «La façon de voir l'action
exprimée par le verbe, l'attitude du sujet parlant vis-à-vis du
procés verbal, la façon dont le sujet se répresente
l'action27 ». C'est également, le sujet parlant
peut répresnter l'action de plusieurs manières. Il peut par
exemple la représenter comme passée, présente ou future,
c'est-à-dire antérieure, contemporaine ou postérieure par
rapport au moment ou il parle. Cette premiére répresentation
montre le lien étroit entre l'aspect et le temps. De même, le
locuteur peut la répresenter comme référant à
lui-même ou à son interlocuteur. Cette seconde
représentation confirme par excellence la relation entre la personne et
l'aspect. Inutile de souligner à ce propos que le mode n'est pas exclu.
Car il indique « l'attitude du sujet parlant vis-à-vis du
procès verbal 28». Ce sont aussi les mêmes
termes par lesquels Marouzeau (1951, 147) définit la modalité.
1.2- L'aspect et ses manifestations dans le
système verbal Français:
La notion d'aspect est fortement liée au verbe. Ce
dernier est défini grammaticalement comme un constituant syntaxique et
sémantique à la fois. Et cela s'explique par sa composition,
puisque le verbe est composé d'un lexème (un radical/une forme de
base)
Et d'un morphème (les terminaisons des temps verbaux).
C'est pour cela, la linguistique traite le verbe comme une catégorie
grammaticalisée et lexicalisée. En effet, Le verbe en tant qu'une
catégorie grammaticalisée basée sur des critères
grammaticaux qui lui sont attribués comme par exemple (la terminaison
des temps verbale, les semi-auxiliaires...). Et comme une catégorie
lexicalisée fondée sur un contenu sémantique. Par
ailleurs, les verbes ou (les procès29)
servent à présenter l'action en relation avec le temps.
Ce dernier est divisé en deux types selon la théorie
guillaumienne(1964). Le premier type est appelé « temps
externe », qui situe l'action selon les trois dimensions
temporelles (passé, présent, futur) à travers des
déictiques syntaxiques à titre d'exemple (les temps
morphologiques, les semi-auxiliaires...). Et le second type qui est
nommé « temps interne ». Celui-ci indique que
chaque verbe
27 Gougenheim 1938, p206.
28 Gougenheim 1938, 206.
29 « Généralement, on précis par
ailleurs que la notion de procés renvoie à des entités qui
douées d'une durée interne doivent se situer dans le temps ce qui
expliquerait aussi au moins pour les langues indo-européenes
l'association (nécessaire) du verbe avec les morphémes de temps
et d'aspects » (A.Lipsky, défintion du verbe et type de
procés).
19
comporte sa propre durée, impliquée dans son
contenu lexical. De ce point de vue, nous trouvons que les linguistes
proclament que l'aspect peut être identifié comme une
catégorie grammaticale selon des critères grammaticaux
déterminés par le temps linguistique. À ce propos nous
citons ce qui a été déclaré par Gosselin en ce qui
concerne l'aspect comme une catégorie grammaticale: « L'aspect
grammatical définit le monde de présentation du procés
(accompli, inaccompli, itératif...) tel qu'il est indiqué
essentiellement par les marques grammaticaux (temps morphologiques,
semi-auxiliaires, adverbes d'aspect30...»). Et aussi comme
une catégorie lexicale par le sens propre du verbe. D'ailleurs, l'aspect
lexical est défini aussi par le même linguiste comme suit : «
L'aspect lexical correspond au type de procés (Activité,
état, accomplissement) exprimé par le lexéme verbal et son
environnement actanciel31 ».
Donc, l'aspect est identifié dans le domaine de la
linguistique générale, d'un côté, comme une
catégorie qui s'est manifestée grammaticalement par des moyens
purement grammaticaux. Et de l'autre côté, il peut être
exprimé aussi comme une catégorie lexicale selon l'emploi des
outils lexicaux.
1.3- L'étude de l'aspect comme une
catégorie grammaticale:
Nous avons vu précédemment que les linguistes
distinguent deux types d'aspect. D'une part, l'aspect lexical qui concerne les
types de procès (les états! les activités! les
accomplissements et dernièrement les achèvements). ET de l'autre
part, l'aspect grammatical qui sert à exprimer la présentation du
procès comme par exemple (accompli! inaccompli) selon des moyens
grammaticaux. Dans ce cadre, nous allons étudier l'aspect comme une
catégorie grammaticale qui est exprimée essentiellement par le
temps grammatical. Ce dernier est défini dans la grammaire comme suit :
« le processus d'actualisation qui permet de situer le procès
par rapport au moment de l'acte d'énonciation : trois positions
Avant/Pendant/Après, sont possibles qui déterminent trois temps
Passé/Présent/Futur 32». Cette
définition nous a montré que le temps grammatical indique
principalement le positionnement du procès par rapport au locuteur qui
est à la fois (l'observateur et le raconteur). La présence du
locuteur et le moment ou ce dernier parle (Moment de la parole) sont
réservés comme des indications temporelles dans la
détermination temporelle (Passé !
30 Gosselin 1996, p10.
31 Gosselin 1996, p10.
32 S.R.Giraud « les grilles de Procuste »:
description comparé de l'infinitif en français, grec ancien,
allemand, anglais et arabe »p26.
20
Présent / Futur). Par ailleurs, dans le système
verbal français, nous remarquons le grand écart qui existe entre
les notions de temps et leurs marqueurs formels par exemple dans le
Passé, nous avons (imparfait/ passé composé/ passé
simple...). Et dans le futur aussi nous distinguons (Futur catégorique/
futur.Hypothétique). Pour mieux expliquer cette diversité des
temps verbaux. Nous allons présenter ce schéma qui sert à
nous montrer de façon plus claire cette multiplicité des temps
verbaux en Français:
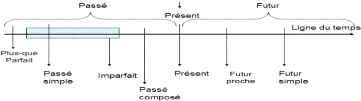
Schéma1: Répartition des Temps
Verbaux En Français33.
À travers ce schéma, nous avons constaté
que l'indicatif comme un mode personnel et
temporel à la fois, est le seul mode qui permette
grâce à ses nombreux temps de situer le procès dans l'une
des trois époques (passé/présent/futur). C'est pour cela,
nous pouvons le considérer comme le mode «
d'actualisation du procès ». En effet, il
comporte cinq formes simples auxquelles correspondent cinq formes
composées, puisque les formes simples et les formes composées
semblent symétriques de manière que les formes simples
expriment l'aspect comme inaccompli (en cours de
déroulement) et les formes composées
marquent l'aspect (accompli/achevé). C'est ce
que nous allons voir ultérieurement en établissant une
distinction entre les oppositions aspectuelles.
1.3.1-L'aspect accompli:
L'accompli sert à exprimer le procès comme
parvenu à son terme, englobe même l'état de son
accomplissement. C'est le fait de présenter la prédication
(l'idée verbale) en tant qu'un
événement advenu et non de la mise en marche d'un
processus34 . Dans ce sens, le linguiste Gosselin a
défini l'aspect accompli comme: « montre l'état
résultant du procès 35». En outre,
l'accompli est le plus souvent accompagné avec l'emploi (des formes
composées) c'est-à - dire des formes verbales qui renvoient au
temps du passé. Et pour mieux expliquer, nous
33 Le conjugueur.le Figaro.fr
34 David Cohen l'Aspect Verbal: p89.
35 Gosselin, 2005, p36.
21
allons traiter quelques exemples des « formes
verbales » qui soulignent l'accomplissement du
procès: (les exemples36 tirés de l'oeuvre « le
Pain Nu de: Mohamed Chokri):
|
Les Formes Verbales
|
Morphologie/ Syntaxe
|
Explication
|
|
1-« Nous avons pris le
chemin de l'exil ».
|
-Forme verbale composée :
cette forme verbale est
composée d'un auxiliaire
(avoir) +un participe
passé du verbe (prendre)
|
Cette forme verbale
indique que le verbe
(prendre) est conjugué au
(passé
composé).
Le passé composé situe l'action comme accomplie au
passé.
|
|
2-« Le jardin était
parfumée»
|
Forme verbale composée :
cette forme verbale est
composée d'un auxiliaire
être conjugué (à l'imparfait) +un
participe passé du verbe
(parfumer)
|
Cette forme verbale
indique que le verbe est
conjugué au plus que
parfait.
Le plus que parfait situe l'action comme accomplie au
passé (Marque l'antériorité) par rapport au présent
de l'énonciation.
|
|
3-«Je suis resté suspendu avec la
peur ».
|
- Forme verbale composée :
cette forme verbale est
composée de deux verbes
auxiliares (suis/resté) +le
verbe (suspendre).
|
- Cette forme verbale
indique que le verbe
(suspendre) est conjugué
à l'aide de deux auxiliaires ce qu'indique l'emploi de passé
surcomposé.
Le Passé surcomposé
apporte une nuance
d'accompli.
|
|
4-« Je n'aurais pas fui de
l'école ».
|
-Forme verbale composée :
cette forme verbale est
composée d'un auxiliare
avoir conjugué au
|
- Cette forme verbale
indique que le verbe (fuir) est
conjugué au conditionnel
passé.
|
36 Le Pain Nu : p5/36/30/40
22
|
|
|
(conditionnel présent) + le
participe passé de verbe
(fuir).
|
le conditionnel passé
exprime l'action comme
accomplie. (marque
l'antériorité) par rapport
au
|
|
|
|
|
(Moment de la parole).
|
|
5-« Elle
|
m'apporta
|
du
|
- Forme verbale simple :
|
Cette forme verbale
|
|
pain ».
|
|
|
cette forme verbale est
composée de verbe
(apporter) conjugué au
passé simple.
|
marque que le verbe est
conjugué au passé simple.
le Passé simple toujours
indique que l'action
accomplie.
|
Pour résumer ce que nous avons vu dans le tableau qui
précède. Nous constatons que parfois il faut prendre en
considération, que l'accompli peut être aussi indiqué par
les formes verbales simples. C'est ce que nous avons vu dans le tableau
précéde, puisque le passé simple est employé dans
l'exemple (5) par une forme verbale simple, mais il marque l'accompli.
D'ailleurs, ce temps revient toujours à présenter le
procès comme déjà accompli au passé et qui marque
l'antériorité par rapport au moment de l'énonciation(ME).
Il exprime le plus souvent l'aspect aoristique, global et accompli. Dans ce
contexte, nous allons citer la déclaration de R, Martin concernant le
passé simple : « Un noyau indivis, comme un tout fermé
sur lui même et en offre une vision globale,
indifférenciée, non sécante 37». Et
dans le même sens il a ajouté aussi: « Il parcourt
l'espace temporel du procès de sa limite initiale à sa limite
finale sans le pénétrer38 ». Et par
conséquent, nous avons constaté que toutes les formes verbales
composées appartiennent à la catégorie « des
accomplis » alors que les formes simples appartiennent soit à
« l'accompli », soit à « l'inaccompli
».
1.3.2-L'aspect inaccompli:
L'inaccompli c'est contrairement à l'aspect accompli.
Le non-accompli indique que le procès est vu en cours de
déroulement, pas encore achevé. L'inaccompli s'exprime le plus
souvent par l'emploi des formes verbales simples. Le linguiste Gosselin a
ajouté en ce qui concerne l'inaccompli: « ne présent
qu'une partie du procès (..), l'intervalle de référence
est
37 R.Martin 1971:70.
38 R.Martin 1971:95.
23
inclus dans celui du procès, les bornes initiale et
finale ne sont pas prises en compte...39» . À ce
propos, nous allons prendre à l'analyse quelques exemples à
traiter dans ce tableau: (les exemples sont tirés de même
ouvrage40):
|
Les formes verbales
|
Morphologie /syntaxe
|
Explication
|
|
1-« Je respirai
profondémment
».
|
-Forme verbale simple:
le verbe (respirer)
est
conjugué au futur simple.
|
Le futur simple indique que
l'action inaccomplie.
(marque
la postériorité par
rapport au (Moment de la
parole).
|
|
2-« Elle penchait sa tete ».
|
-Forme verbale Simple:
le verbe (pencher)
est
conjugué à l'imparfait.
|
L'imparfait indique que
l'action est en cours
de
déroulement (inaccomplie).
|
|
3-« tu remplis tes poches de
fruits
».
|
-Forme verbale Simple:
le verbe (remplir)
est
conjugué au Présent de
l'indicatif.
|
Le présent de l'indicatif ou le
présent de
l'énonciation
marque la simultanéité par
rapport au
(Moment de la
parole).
|
Conséquemment, nous avons constaté selon le
tableau qui précède. Les formes verbales simples indiquent par
excellence l'aspect « inaccompli ». C'est
également l'action s'est manifestée comme (en cours
de déroulement). Et nous avons remarqué que
l'imparfait exprime « l'aspect inaccompli », car il peut
donner une vision ralentie du procès, c'est-à-dire l'absence de
limites marquées dans le verbe.Dans ce sens, Gosselin a
déclaré en ce qui concerne la valeur temporelle de
l'imparfait:
L'imparfait renvoie donc typiquement à un moment du
passé
pendant lequel le procès se déroule, sans
préciser la situation temporelle du début et de la fin du
procès, ce temps apparait non autonome (anaphorique) et situe le
procès comme simultané par rapport à d'autres
procès du contexte et comme se déroulant en un même lieu
.... 41.
39 Gosselin, 2005, p36.
40 Le Pain Nu, p 40/32/75
41 Gosselin, 1996, p199
24
Généralement, l'aspect accompli situe le
procès dans sa globalité comme terminé, limité. En
revanche, l'aspect inaccompli exprime le procès comme en cours de
déroulement. Autrement dit duratif, inachevé. D'ailleurs,
l'aspect en français est divisé en deux sortes principales qui
surgissent pour exprimer l'idée verbale. D'une part, il l'a
exprimée comme durative (inaccomplie). Et de l'autre part comme
limitée (accomplie). Comme le montrent les deux figures suivantes :
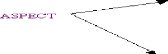
Figure242: La catégorie de
L'aspect en français.
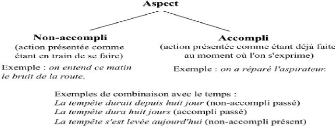
Figure343: L'opposition Aspectuelle:
Accompli/ Inaccompli.
1.3.3- L'aspect inchoatif:
L'inchoatif sert à exprimer le commencement de
l'action. Il marque la simultanéité par rapport au (Moment de
l'énonciation). De plus, l'inchoatif s'est manifesté à
l'aide des semi-auxiliaires aspectuels comme par exemple (se mettre
à/ commencer à) + verbe infinitif. Ce qui indique le
déclenchement du procès verbal. Comme dans les exemples
suivants44 :
EXP1: « Elle commençait
à m'énerver ». (Aux
(commencer à) +verbe INF).
42 Le verbe:
linguistes.com
43 Aspect :
fr.m.wikipedia.org
44 Le Pain Nu: Mohamed Chokri, p 56
25
EXP2: « Il se mit à envoyer
des signaux lumineux ». (Aux (mettre à) + vrb
INF).
1.3.4- L'aspect Progressif:
Le progressif sert à démontrer à l'aide
de la locution (être en train de) + verbe à l'infinitif,
que l'action est en cours de déroulement (la continuité) comme
dans cet exemple45 :
EXP1: Vous étes en train
d'acheter. (Être en train de+ vrb INF)
1.5.3- L'aspect Immédiat:
L'immédiat s'est manifesté à l'aide de la
locution (être sur le point de) + verbe à l'infinitif ou
par un semi-auxiliaire aspectuel de (v.aller) + verbe à
l'infinitif. Cet aspect est employé pour exprimer une action se
produira dans un futur immédiat ou futur proche. Comme dans les exemples
suivants46 :
EXP1: « Je vais chercher sa maison ».
(Aux aller+v.INF)
EXP2: « Je vais chercher un autre
bateau». (Aux aller+v.INF)
Bref, l'aspect grammatical est divisé en plusieurs
types selon l'état de l'action. En commençant par l'accompli qui
indique que l'action est terminée, totalement coupée du
présent. L'accompli est exprimé le plus souvent par les formes
verbales composés, en d'autres termes par les temps composées
(Aux (être ou avoir) + participe passé). Et l'inaccompli
qu'indique que l'action est en cours de déroulement, pas encore
achevée. Ainsi il peut être exprimé par (les formes
verbales simples) ou les temps simples ou à travers les
périphrases aspectuelles qui servent à décrire
l'état du procès entre autres, commencement (l'inchoatif)
/déroulement (duratif)...
45 Le Pain NU : Mohamed Chokri p78
46 Le Pain Nu: Mohamed Chokri. P44/83
26
1.4- L'étude de l'aspect comme une
catégorie lexicale:
L'aspect d'un verbe est dans une certaine mesure tout au moins
lié à sa valeur sémantique. En effet, l'aspect fait partie
de la définition lexicale du verbe et dans ce sens nous pouvons citer
quelques désignations illustrées par des linguistes. Nous
trouvons l'aspect lexical est appelé encore « Aktionsart
» (Hinrichs, 1985), « Aspect inhérent
» (Comrie 1976), ou encore plus «
télicité » (Verkuyl, 1993). L'aspect
lexical renvoie : « au sens lexical du verbe ayant trait à la
présence ou à l'absence des bornes intrinsèques du
procès dénoté par le prédicat verbal
47 ». Et par conséquent, nous constatons que
l'aspect lexical exclusivement lié au sens du verbe avec lequel
l'environnement contextuel peut interagir. C'est pour cela, la langue nous
confère de multiples moyens qui servent à décrire l'aspect
du verbe entre autres « le lexème verbal ». Ce
dernier peut être perfectif ou imperfectif (Halba
2002). De plus, il s'agit des adverbes ou compléments circonstanciels en
rapport avec l'expression de la durée comme les adverbes
itératifs, numéraux, des préfixes et suffixes qui portent
des valeurs aspectuelles. C'est également ce que nous allons voir en
distinguant les différents critères qui servent à exprimer
l'aspect comme partie du sens du verbe, c'est-à-dire l'aspect comme
catégorie lexicalisée.
1.4.1-L'opposition itératif/
semelfactif:
L'aspect itératif sert à décrire un
procès comme impliquant une certaine sorte de
répétition. C'est contrairement à
l'aspect semelfactif. Ce dernier envisage le procès comme n'a lieu
qu'une seule fois comme le montrent les exemples suivants48 :
Exp1: Souvent, La brosse
m'échappait des mains.
Exp2: Je revoyais de Jardin d'Ain Khabbaz.
Exp3: IL achetait un sac de pain.
Exp4: c'est lui qui l'a tué.
Donc, nous avons constaté que le bornage
et la durée du procès se
déduisent selon le sémantisme du verbe
et parfois par des indications
contextuelles. Premièrement, en parlant de l'aspect
itératif , nous avons remarqué dans l'exemple (1) que l'emploi de
l'adverbe de temps (souvent) comme un indicateur contextuel souligne par
excellence la valeur répétitive
47 Stanojevic, asic 2010, p 108.
48 Le Pain Nu: Mohamed Chokri,, p18/26/7/25.
27
du procès. De plus, l'utilisation de l'imparfait sert
à annuler le caractère ponctuel, non duratif du procès,
puisque, l'imparfait est associé dans une interprétation
itérative notamment avec l'emploi d'un verbe imperfectif pour marquer la
répétition du procès, ce que nous appelons dans la
grammaire « l'emploi de l'imparfait d'habitude
». Et dans l'exemple (2), l'aspect itératif est
exprimé par la dérivation affixale, en effet, le (R)
associé au verbe voir (revoir) indique que le procès est
répété plus qu'une fois à côté de
l'emploi de l'imparfait qui s'accorde bien avec le sémantisme des verbes
imperfectifs. Comme le verbe (voir) qui apparaît comme un verbe
(+dynamique49 ). Néanmoins, à
l'aspect semelfactif. Ce dernier est exprimé dans les deux exemples
(3+4) avec l'emploi des verbes perfectifs qui comportent en eux-mêmes
« une limitation du procès ». Cette
limitation est bien manifestée avec l'emploi des deux verbes (acheter/
tuer). Ces deux verbes sont de nature
(-dynamique50). Et dans ce contexte, nous pouvons
affimer que l'action est envisagée et sa limite finale est
fixée.
1.4.2- L'opposition perfectif/ imperfectif:
L'aspect Perfectif ou ponctuel met l'accent sur le
résultat final du procès. Il exprime une action achevée,
terminée au passé et totalement coupé de présent :
« l'aspect perfectif ou résultatif qui ajoute la notion
supplémentaire de terme au sens du verbe51 ». C'est
contrairement à l'aspect imperfectif ou linéaire, ce dernier
envisage l'action dans sa durée. Il la présente comme un
processus en cours de déroulement : « l'aspect imperfectif ou
duratif ou continu qui exprime l'action dans sa durée ininterrompue ou
sa continuité52 ».
Dans ce cadre, nous traitons les deux exemples
suivant53 pour faire la distinction entre ces deux types d'aspect
lexical:
Exp1: Nous traversâmes la
rivière .... Nous passâmes une nuit à
Oujda.
|
L'emploi de Passé Simple: Aspect
perfectif
|
Dans l'exemple précédent, l'emploi de
passé simple sert à conférer une vision synthétique
et compacte au procès, puisqu'il l'envisage comme : « un noyau
indivis comme un tout fermé sur lui-même et en offre une vision
globale indifférenciée, non sécante54
». Et dans le même sens, il a ajouté en ce qui concerne
l'emploi de passé simple : « parcourt l'espace temporel
du
49 Z, Vendler, Le critère de
dynamicité,
50 Z, Vendler, Le critère de dynamicité
51 David Cohen, l'Aspect Verbal, p 20.
52 David Cohen, L'Aspect Verbal, p20.
53 Le Pain Nu : Mohamed Chokri, p23/10
54 R.Martin 1971, p70.
28
procès de sa limite initiale à sa limite
finale sans le pénétrer55 ». En
réalité, nous trouvons le processus est perçu dans sa
globalité sans qu'une action incidente puisse en interrompre le
déroulement. Par conséquent, L'emploi de passé simple sert
à présenter le procès comme nettement
délimité dans son déroulement et orienté vers son
terme final. Dans cette perspective, nous pouvons déduire que l'emploi
de passé simple souligne l'aspect perfectif, c'est-à-dire le
procès est coupé de la situation d'énonciation et il le
rejette dans un passé révolu nettement délimité. Sa
valeur générale est limitée temporellement.
Exp2: J'observais la jeune
fille qui s'activait à laver le parterre.
|
L'emploi de L'imparfait: Aspect
Imperfectif.
|
Dans l'exemple plus haut, nous remarquons que l'emploi de
l'imparfait annule le caractère ponctuel, non sécant au
procès. Par opposition au passé simple, puisque l'imparfait
n'envisage pas les limites du procès auquel il n'assigne ni
commencement, ni fin. De plus, l'imparfait s'accorde avec l'expression de la
durée selon le sens du verbe ou le procès n'est pas
forcément long objectivement. Mais il est perçu de
l'intérieur dans son écoulement, dans la continuité de son
déroulement, sans terme final marqué. De sorte que L'imparfait
s'accorde avec les verbes imperfectifs comme dans l'exemple (2), nous
remarquons que les deux verbes (observer/activer) sont deux verbes
(+dynamiques).
En conclusion, nous déduisons que l'aspect perfectif
vise à marquer l'accomplissement du procès. Par contre l'aspect
imperfectif sert à montrer la continuité, la progression de
l'action. Dans ce contexte, nous allons proposer la figure suivante afin
d'indiquer les valeurs aspectuelles des deux aspects lexicales :
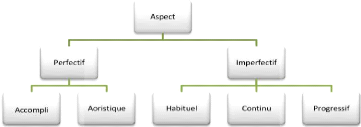
Figure456: Les valeurs aspectuelles de
L'aspect Perfectif ET Imperfectif.
55 R.Martin 1971, p 95.
56
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_aspects_(selon_Marc_Wilmet).svg
29
1.4.3-Les valeurs aspectuelles de formes
verbales:
Le système de la conjugaison des verbes français
comporte essentiellement deux formes. En effet, la distinction entre ces deux
formes est au même temps morphologique et aspectuel. En commençant
par La forme simple. Cette dernière, elle présente l'action dans
son déroulement comme inaccompli, car le verbe exprime un aspect non
ponctuel du procès. Dans cette perspective, nous rappelons la
définition Guillaumienne : « un aspect simple, tensif ou
immanent, tient la pensée en dedans du procès et éveille
dans l'esprit l'image même du verbe et dans son
déroulement57 ». Par la suite, La forme
composée. Cette dernière exprime un procès
présenté dans son achèvement. En d'autres termes, la
pensée dépasse le point de réalisation de l'acte pour
l'envisager comme une totalité : « l'aspect composé,
extensif ou transcendant, qui porte la pensée au- delà du
procès et éveille dans l'esprit non plus le déroulement
même de l'image mais le déroulement d'une séquelle de cette
image 58».
Dans ce cadre, nous proposons ce tableau pour établir
une distinction entre les valeurs aspectuelles des formes simples et
composées (les exemples59 tirés de l'oeuvre: Le Pain
Nu) :
|
Exemples
|
Forme
simple/composée
|
Temps
simple/composée
|
Valeurs aspectuelles
|
|
1-Je sortis en
courant.
|
-Forme simple
|
-Temps simple
|
-L'accomplissement
de l'action
|
|
2-Il continue de
nous suivre.
|
-Forme simple
|
-Temps simple
|
- La continuité de
l'action
|
|
3-J'ai vu ma mère
pleurer.
|
-Forme composée
|
-Temps composé
|
-L'achèvement de
l'action
|
|
4-une tombe qui sera effacée par le
temps.
|
-Forme composée
|
-Temps composé
|
-L'accomplissement
de l'action
|
|
5-Je continuai mon
chemin.
|
-Forme simple
|
-Temps simple
|
- La continuité de
l'action
|
Tableau2: Les formes verbales et leurs valeurs
aspectuelles.
Donc, nous admettons selon le tableau qui précède
que toutes les formes composées soient
achevées, accomplies. Mais, nous rejetons l'idée
que toutes les formes simples soient
57 Gustave. Guillaume (temps ET verbe),
Théories des aspects, des modes et des temps, Paris1970, p21.
58 Guillaume, (temps ET verbe), Théories des
aspects, des modes ET des temps, Paris 1970:p21.
59 Le Pain Nu, p10/11/12/43
30
obligatoirement inachevées, inaccomplies, car le
passé simple malgré sa forme verbale simple exprime le plus
souvent l'accomplissement de l'action.
1.4.4- Les périphrases verbales:
La périphrase verbale est une forme verbale complexe
constituée d'un semi-auxiliaire conjugué et d'une forme non
conjugué (à l'infinitif). En outre, les périphrases
verbales peuvent exprimer des valeurs temporelles et aspectuelles. De plus, les
périphrases aspectuelles visent par excellence à présenter
l'état de l'action à titre d'exemple (Commencement/
déroulement/achèvement). Dans ce cadre, nous
proposons le tableau suivant de Halba dans lequel il classifie les
périphrases verbales comme suit:
|
Procès
verbal
|
Antériorité
Immédiate
|
Début du
procés
|
Déroulement du procès
|
Fin du
procés
|
Postériorité
Immédiate
|
|
Aspect
verbal
|
Aspect
imminent
|
Aspect
inchoative
|
Aspect
duratif
|
Aspect
terminatif
|
Aspect
consecutive
|
|
Exemple
|
Il va+inf
|
Il
commence/il
se met à+inf
|
Il est en train
de+inf
|
Il finit/ il
cesse de+inf
|
Il vient de
+inf
|
Tableau 3: Classement de périphrases
verbales60.
Et pour expliquer davantage ce que nous avons vu dans le
tableau qui précède en ce qui concerne les différents
types de périphrases verbales. Nous prenons ces exemples pour marquer
les valeurs aspectuelles de périphrases verbales. (Les exemples sont
tirés de même ouvrage61):
Exp1: - Je vais remplir cette
bouteille.
(Aux aller+inf): L'aspect
Imminent.
Exp2: -Se mettait à pratiquer sa
folie .
(Se met à +inf):L'aspect
Inchoatif.
Exp3: -J'étais en train de me kiffer
dans un café.

(En train de +inf): L'aspect
Progressif.
60 Classement de periphrases verbales selon Halba
2002.
61 Le Pain NU: Mohamed Chokri, p45/73/22
31
Par conséquent, les périphrases verbales servent
à exprimer des valeurs aspectuelles et temporelles à travers des
formes verbales composées d'un semi-auxiliaire conjugué + un
verbe à l'infinitif. Et selon le linguiste Bruneau, les
périphrases verbales visent à conférer principalement des
valeurs aspectuelles que des valeurs temporelles notamment dans le
système verbal français : « les périphrases
verbales, c'est au fond le seul moyen que nous ayons en français
d'exprimer nettement les aspects62 ».
Grosso Modo, nous avons constaté plus vite que le
système verbal du français repose sur une véritable
inflation terminologique notamment dans la description des
phénomènes aspectuels. En fait, nous trouvons que les termes
(accompli! achevé! terminé! ponctuel! !perfectif) qui sont
utilisés comme des synonymes pour désigner que l'action est en
état d'accomplissement. Cette variété de vocables facilite
le traitement des aspects. En outre le système verbal de la langue
française met en lumière des différentes procédures
qui se manifestent comme des piliers par lesquels nous pouvons
déterminer « le positionnement du procès »,
c'est-à-dire le procès en « commencement!
achèvement! progression... ». D'ailleurs, l'Aspectualité
dans le système verbal du français est fortement liée
à la temporalité. Du fait que, les deux notions « aspect et
temps » vont de pair pour décrire l'idée verbale. De
façon que les temps composés comme par exemple (Le passé
antérieur! le plus que parfait ! le passé composé..)
désignent « L'accompli » par l'emploi des formes verbales
composées (voir chapitre II ! aspect accompli ! tableau 1). Autrement
dit les temps composés indiquent que l'action est terminée au
passé. C'est contrairement aux temps simples comme
« L'imparfait ! le présent ! le futur simple
» qui renvoient à « L'inaccompli » par des formes
verbales simples (voir chapitre II ! aspect Inaccompli !tableau 2). Sauf dans
quelques cas, comme par exemple le passé simple. Ce dernier exprime
l'aspect accompli malgré sa forme verbale simple (voir chapitre II :
partie1). Ainsi que le système verbal français est
caractérisé par le grand écart qu'il y a entre les notions
de temps et leurs marqueurs formels63 par exemple les temps du
passé ou il y a « le passé simple! le passé
antérieur! le passé composé.. ». Seulement le
présent apparaît unique. Même le futur se répartit en
futur simple et futur antérieur. Par ailleurs, l'emploi de
périphrases verbales qui fonctionnent comme des marqueurs aspectuels. En
fait, les périphrases aspectuelles servent à préciser
l'état exact du procès à travers des formes verbales
composées d'un (semi-auxiliaire conjugué+verbe à
62 Bruneau, 1931,271.
63 Voir le schéma de la répartition des
temps verbaux en français, Chapitre II, partie1.
32
l'infinitif). Ces périphrases servent à
présenter le procès comme en état de « commencement!
progression / d'accomplissement » (voir chapitre II partie1). Sans oublier
dans ce cadre de parler sur le rôle de la dérivation affixale (la
préfixation et la suffixation). Cette dernière sert à
exprimer des valeurs aspectuelles à titre d'exemple
(L'itération). De même, la notion d'aspect dans le système
verbal du français peut être exprimée comme une
catégorie « lexicalisée » (partie1! chapitre II). Et
comme une catégorie « grammaticalisée ». En effet,
l'aspect est lié au sens du verbe, c'est-à-dire au «
lexème verbal ». Ce dernier peut être perfectif
(non duratif) ou imperfectif
(duratif). Dans le même sens, nous pouvons
déduire que le contexte de son coté jouit un rôle essentiel
au niveau de la vérification de « l'aspect du verbe »
par l'emploi des adverbes temporels entre autres « souvent! brusquement!
hier! après quelques minutes.. ». De même, l'aspect dans le
système français est reconnu par la matérialisation
morphologique en d'autres termes l'aspect est manifesté comme une
catégorie grammaticale explicite, c'est-à- dire par des
critères grammaticaux observables en particulier (les formes verbales,
la derivation affixale, les locutions adverbiales...). Et pour clarifier cette
classification, nous présentons ces deux figures comme suit :
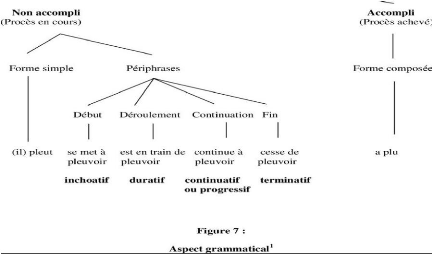
Schéma5: Aspect
Grammatical64.
64 Danielle Leeman Bouix: Grammaire du verbe
français: Des Forms au sens.
33
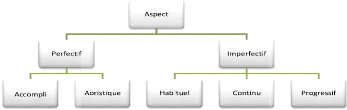
Schéma6: Aspect
Lexical65
Nous avons vu précédemment les manifestations de
l'aspect dans le système verbal français en tant qu'une
catégorie grammaticale et lexicale. Mais la question qui se pose dans
cette perspective:
Est-ce que l'aspect est-il exprimé dans toutes les
langues par les mêmes critères grammaticaux et lexicaux?
Nous essaierons dans la mesure du possible dans notre
deuxième partie de ce travail de
répondre à cette question en traitant le
fonctionnement de l'aspect dans le système de la langue arabe comme
(langue sémitique).
2-Le Fonctionnement de L'aspect dans le
Système Verbal Arabe:
2.1- La divergence de points de vue sur la nature du
système verbal Arabe entre « Aspectuel/Temporel/ Aspectuo-Temporel
»:
Les points de vue divergent autour la nature du système
verbal arabe. En effet, certains linguistes pensent que la langue arabe est
avant tout une langue principalement aspectuelle. Mais après avoir
mené plusieurs études par des grammairiens arabes sur la nature
de ce système. Il a été démontré que la
langue arabe combine entre les deux notions « le temps et
l'aspect », c'est-à-dire la langue arabe est une
langue « Aspecto-Temporelle ».
2.1.1- La langue Arabe comme langue
aspectuelle:
Selon certains linguistes, la langue arabe est une langue
sémitique apparaît comme une langue aspectuelle par excellence. En
outre, le verbe arabe peut se mettre à l'aspect accompli ou ce qu'on
appelle en arabe (El-Madhi). Et aussi à l'aspect
inaccompli (El-Moudharaa). Cela nous a montré que le
système verbal arabe repose principalement sur une opposition
65
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Les_aspects_(selon_Marc_Wilmet).svg
34
aspectuelle de l'accompli et l'inaccompli. Du fait que les
formes verbales de l'arabe ne paraissent pas déterminées par le
temps tel qu'il vient d'être défini dans le système verbal
des langues romanes comme le « Français », puisque chacune de
trois époques (passé/présent/futur) se trouve couverte
simultanément par deux formes de nature aspectuelle en arabe (l'accompli
et l'inaccompli). Premièrement et en ce qui concerne l'accompli, ce
dernier est exprimé par la forme verbale de (Faala).
Deuxièmement, l'inaccompli est exprimé par la forme verbale
(Yafaalo). Par conséquent, certains linguistes ne voient dans
l'opposition de ces deux formes verbales qu'une opposition purement
aspectuelle. Dans cette perspective, le linguiste Marcel Cohen dans
son ouvrage précisément dans(le chapitre II) a ajouté
concernant la notion d'aspect dans le système verbal arabe : «
il s'y rencontre deux formes qu'on dénomme en général
d'une manière « impropre » des temps, ces deux formes servent
à distinguer deux aspects de l'action qui sont l'accompli et
l'inaccompli66 ». Dans ce contexte, nous remarquons que le
mot « impropre » de la nomination de temps indique
sa désapprobation à une analyse purement temporelle du
système verbal arabe. De plus, David Cohen dans son ouvrage «
l'aspect verbal » a mentionné en ce qui concerne le
système arabe: « de cette « pureté » de
l'expression de l'aspect dans son indépendance par rapport à
l'expression du temps67 ». Ce qui montre que l'arabe comme
une langue dont le système verbal serait fondamentalement aspectuel et
non pas temporel. À cet égard, le linguiste David Cohen a
insisté sur cette classification qui diminue la valeur de temps dans le
système arabe: « Le système repose comme en ougaritique
essentiellement sur l'opposition aspective
inaccompli/accompli68 ». C'est pour cela, le temps dans le
système verbal arabe est manifesté comme un élément
secondaire ou le contexte qui rend compte des indicateurs temporels, et dans
cette perspective nous citons ce qui ajouté David.Cohen dans son ouvrage
concernant le positionnement de temps dans le système verbal arabe :
« de manière générale le contexte au sens le plus
général du terme peut fournir par lui même les indications
d'ordre temporel et permettre éventuellement de référer le
procès à un moment ou une situation donnés.
69». Dans le même sens, nous pouvons rappeler
Fleisch lorsqu'il a affirmé que le système verbal arabe est un
système aspectuel, puisque la forme verbale soit à l'accompli
avec la forme de (Faala) ou à l'inaccompli avec la forme
(Yafaalo), c'est-à-dire l'opposition aspectuelle semble comme
suffisante pour décrire la situation. De ce fait, nous déduisons
que les deux paradigmes de
66 Marcel Cohen, Chapitre II
67 David Cohen, L'aspect verbal, p171.
68 David Cohen, L'aspect verbal p 183.
69 David Cohen, L'aspect verbal, p183
35
l'accompli et l'inaccompli sont suffisants pour
décrire l'état de procès comme duratif ou non duratif en
rejetant toute temporalité incluse. En conséquence, la langue
arabe est une langue aspectuelle qui repose principalement sur les deux formes
verbales de L'accompli/L'inaccompli70.
En définitive, les linguistes qui rejettent la notion
de temps du système verbal arabe, ils n'excluent pas son existence d'une
manière différente. C'est juste dans une seule image celle de la
morphologie verbale, puisque la morphologie verbale en arabe n'indique pas
« explicitement » le temps du verbe. Mais la temporalité est
exprimée par l'utilisation de quelques indicateurs temporels dans
l'environnement contextuel.
2.1.2- La langue Arabe comme une langue temporelle
:
Certains grammairiens ont établi un lien étroit
entre la forme verbale et le temps. D'ailleurs, les linguistes arabes
répartissent le temps en trois époques (le présent :
ÑÖÇÍáÇ), (le passé :
íÖÇãáÇ) et (le futur :
áÈÞÊÓãáÇ). En effet,
nous pouvons déterminer le temps du verbe à partir de la
morphologie verbale, par exemple les verbes qui ont pris la forme de (Faala
: áÚ) ou (Faalto : ÊáÚ )
particuliérement avec ces verbes : « áÎÏ
/ÐÎ /ÊÏÌæ ». Ces verbes indiquent
le temps du (passé :íÖÇãáÇ
), c'est-à-dire le procès est accompli au passé de
point de vue aspectuel. En revanche les verbes qui ont pris la forme de
(Yafaalo : áÚí). Ceux-ci servent à
indiquer (Le présent / le Futur/ El-Moudharaa :
ÚÑÇÖãáÇ). Par ailleurs, le
temps de (El-Moudharaa :
ÚÑÇÖãáÇ) comme les verbes
suivants (áÚÓí /Ëåáí
/ÌÑÎí) indiquent que le procès est
inachevé (en cours de déroulement) de point de vue aspectuel. De
plus, certains linguistes affirment que le temps dans le système verbal
arabe peut être indiqué par le contexte. Autrement dit, par
l'illustration de quelques indicateurs temporels ou des particules à
titre d'exemple (Kana :äÇß / Sawfa : æÓ).
Dans cette perspective, nous pouvons citer ce qui a ajouté le
linguiste Aartun. Ce dernier a démontré que le système
verbal arabe est fondé sur le temps71 . En ajoutant dans le
même sens ce qui a dit Khrakovsky en clarifiant le point de vue
précédente de Aartun que la morphologie verbale de l'arabe
indique le temps et non pas l'aspect.
Conséquemment, les études modernes en grammaire
arabe démontrent que la langue arabe s'est manifestée comme une
langue temporelle et non pas uniquement aspectuelle. En effet, nous remarquons
l'existence de la notion de temps à travers « la forme
verbale » comme nous avons déjà
mentionné précédemment ou par « les
indicateurs temporelles » qui sont
70 H.Fleisch : l'arabe classique : Esquisse d'une
structure linguistique/Beirut Dar El Mashreq 1968, p111
71 Kjell Aartun, Zur Frage altarabischer Tempora
(Universitetsforlget, Oslo, 1963).
36
développés pour situer « le temps
de l'événement » comme (Passé/
Présent/ Futur). Comme le montre la figure suivante:


Figure7: Répartition Des Temps Verbaux En
Arabe72.
Cette répartition des temps verbaux en Arabe, nous a
montré qu'elle repose principalement sur deux temps principaux qui sont
d'origine deux formes aspectuelles et non pas temporelles. La première
est la forme de l'accompli qui sert à exprimer une action comme
terminée dans le (Passé / EL-Madhi). Et la
deuxième la forme de l'inaccompli, qui vise à
présenter l'action comme inaccomplie (en cours de déroulement)
dans un moment présent ou qui peut se réaliser au futur
(Présent-Futur : El Moudharaa).
2.1.3- La langue Arabe comme langue
Aspectuo-Temporelle:
L'Arabe est une langue qui combine entre la notion d'aspect et
celle de temps. En effet, le linguiste Comrie a affirmé que le verbe
arabe exprime le temps et l'aspect à la fois.73 Par ailleurs,
la langue arabe comporte « deux formes verbales » qui
expriment des valeurs aspectuelles et temporelles. Dans ce cadre, nous citons
ce qui a mentionné P. Larcher dans son analyse concernant l'encroisement
de (Aspect/Temps):
Pour les grammairiens arabes (Faala) s'opposait à
(Yafaalo) comme (passé à non-passé (présent/futur)
et pour les grammairiens arabisants comme (accompli/Inaccompli) autrement dit
les premiers voient dans le temps et les seconds dans l'aspect, le principe de
corrélation entre les deux formes du système verbal de
l'arabe74 .
72
Aleph-alger2.edinum.org
73 B.Comrie:op.cit.p78.
74 P. Larcher, le système verbal de l'arabe
classique, publications de l'université de provence, Aix-en provence
2003, p137.
37
Par conséquent, nous admettons que les deux concepts
(Temps/Aspect) semblent comme fusionnés. Bien qu'il y ait des
grammairiens qui aient convenu que le système arabe est fondamentalement
aspectuel, d'autres ont évoqué le temps dans la définition
même de deux termes (accompli/inaccompli). Dans ce contexte, P.
Larcher a ajouté concernant la mise en relief entre Temps/ Aspect:
le temps c'est la relation entre ce dont on parle et le
moment ou l'on
parle : un procès est présenté comme
antérieur , simultané ou postérieur au moment de
l'énonciation , l'aspect c'est la façon dont un procès se
déroule dans le temps , si le procès se déroule dans la
période de temps concernée par l'énonciation , l'aspect
est inaccompli : « inaccompli » veut donc dire « s'accomplissant
» s'il est présenté comme la trace dans cette période
d'un accomplissement ultérieur , l'aspect est
inaccompli75.
Ce point de vue admet que la langue arabe est une langue
Aspectuo-temporelle. En effet, de nombreux linguistes comme: Marcel. Cohen/
M.Gaudefroy.Demombynes / Comrie ont confirmé que le système
arabe combine entre les deux notions «le temps et l'aspect
». Les temps en arabe sont au coeur des deux formes verbales
(Faala áÚ / Yafaalo áÚí ). Du fait
que, l'appartenance de temps ne soit pas déclarée d'une
manière explicite par des marqueurs temporels, mais le temps s'est
manifesté d'une manière implicite dans les deux formes
aspectuelles l'accompli et l'inaccompli. Ces deux formes portent des valeurs
aspectuelles et temporelles. C'est pour cela, nous constatons que « la
temporalité et l'Aspectualité » coexistent dans la
langue arabe.
2.2- L'aspect et ses manifestations dans le
système verbal Arabe:
La notion d'aspect s'est manifestée dans le
système verbal arabe en deux sortes principales. Dans un premier temps,
l'aspect se manifeste comme une catégorie grammaticale
(ÉíáßÔáÇ
ÉåÌáÇ), en effet cette notion est
exprimée par des procédures grammaticales (Morphosyntaxiques) par
exemple (la forme du verbe, les faits de conjugaison, les particules verbales,
la dérivation ...). Et dans un second temps, l'aspect peut être
exprimé comme une catégorie lexicale
(ÉíãÌÚãáÇ
ÉåÌáÇ), c'est-à-dire, la notion
d'aspect est exprimée par le sens du verbe (le
critère de dynamicité76) et
aussi par l'environnement contextuel. Ce dernier emporte des moyens lexicaux
qui servent par excellence de préciser « l'Aspectualité
», en d'autres
75 Op.Cit.P.Larcher, p138.
76 Voir chapitre 1, l'aspect lexical.
38
termes (la valeur aspectuelle). D'ailleurs la langue arabe a
établi des multiples moyens qui se soient grammaticaux ou lexicaux pour
exprimer le sens de l'aspect. Dans ce contexte, nous citons ce qui a
mentionné Gosselin en parlant de l'aspect comme une catégorie
grammaticale et lexicale à la fois :
La catégorie de l'aspect se décompose en
aspect lexical correspond au
type de procès (activité, état,
accomplissement) exprimé par le lexème verbal et son
environnement actanciel (....), l'aspect grammatical définit le monde de
présentation du procès (accompli, inaccompli,
itératif.)Tel qu'il est indiqué essentiellement par les marques
grammaticales (temps morphologiques semi-auxiliaires, adverbes
d'aspect77.
Ce point de vue implique les différentes manifestations
de l'aspect dans un système verbal soit dans la langue arabe comme
étant une langue sémitique ou même dans la langue
française comme étant une langue romane. En outre, les deux
systèmes verbaux (l'Arabe et le Français) se ressemblent beaucoup
particulièrement au niveau de la manière par laquelle la
catégorie de l'aspect est exprimée. Du fait que, les deux langues
ont convenu que l'aspect peut être une catégorie à la fois
« grammaticalisée » et « lexicalisée ». La
seule différence à noter entre les deux langues s'est
manifestée précisément au niveau des procédures
soient grammaticaux ou lexicaux que chacune des deux langues utilise pour
exprimer la notion d'aspect. De plus dans le système verbal arabe la
catégorie d'aspect a eu une place importante, en effet l'arabe est
considérée comme une langue purement «
aspectuelle » (Voir chapitre II/ Partie2/Axe
1).
2.3- L'étude de l'aspect comme une
catégorie « Grammaticale »:
(ÉíáßÔáÇ
ÉíÍÇäáÇ äã
ÉåÌáÇ)
L'aspect en tant qu'une catégorie « Grammaticale
» est divisé dans le système arabe en deux types principaux,
en effet le premier type est « l'aspect Accompli
»(ãÇÊáÇ) et le second type
« l'aspect inaccompli » (ãÇÊáÇ
ÑíÛáÇ). En outre l'inaccompli en arabe
peut être divisé à d'autres aspects qui semblent comme
« Sous Aspects » et qui sont comme suit
l'aspect itératif (ÉÏÇÚáÇ),
l'aspect duratif ou le Continu
(áÕÇæÊãáÇ) et l'aspect
progressif (íÌíÑÏÊáÇ)).
C'est également ce que nous étudierons dans cette analyse.
2.3.1 -L'aspect accompli:
(ÉãÇÊáÇ
ÉåÌáÇ)
L'accompli est défini comme suit: « montre
l'état résultant du procès 78». En
effet, le
procès est vu au moment où son terme est
avéré79. Et nous avons mentionné
précédemment
77 Gosselin 1996, sémantique de la
temporalité en français « un modèle calculatoire et
cognitif du temps et de l'aspect », p10.
78 Gosselin, 2005.
39
que l'accompli (ãÇÊáÇ) dans
le système verbal arabe exprime le procès comme terminé
(íÖÞäã) au (Passé:
íÖÇãáÇ). En fait, l'accompli est
exprimé par la forme verbale (Faala: áÚ). Cette
dernière est constituée par [3 consonnes] comme le
montrent les exemples80 suivants:
Exp1... íÈÚÔ
ìåÞã í áãÚ
ìáÚ íÈ íá
JËc
[Mon père m'a trouvé un travail dans un
café populaire]
Exp2... ÉÈÇÔ
ÉÑíÛÕ
ÉíÓáÏä ÉáØ
,:Sidc
[Je suis tombé amoureux d'une fille andalouse, jeune
...]
Exp3... ÉíÑæÏ äã
CeAÎ 44 íäÖÞä
íÐáÇ ÞíÑáÇ í
ûJli [J'ai pensé au camarade qui m'a sauvé
hier soir de la patrouille...]
Exp4... ÉÙíáÛáÇ
ÁÇÈÑåßáÇ
ßáÇÓ ìáÚ
ÏÏÑÊ áÇÈ
~
·,4.;)I [Je me suis jeté sans
hésiter sur les gros fils électriques...]
Dans ce cadre, nous remarquons dans l'exemple(1) le verbe
(Trouver : ÑËÚ) indique le procès comme accompli,
achevé au passé, c'est-à-dire que le procès est
totalement coupé du présent (Moment de L'énonciation :
ãáßÊáÇ
ÉÙÍá). Cette forme verbale renvoie au
passé (l'accompli) et elle transmettre
des (valeurs aspectuelles et temporelles). Et nous comprenons
«l'accomplissement de l'action» à partir de la forme
verbale (Faala : áÚ). De plus, le locuteur n'est pas
utilisé aucune indication temporelle dans le contexte pour indiquer le
(passé). Néanmoins, dans l'exemple (3) il a utilisé un
indicateur temporel qui exprime (le passé) et qui souligne aussi
l'achèvement de l'action (ËÏÍáÇ
ÁÇåÊäÅ) (Hier Soir : Óã
Éáíá}. Mais dans les trois exemples (2/3/4),
Le locuteur a utilisé d'autres formes verbales qui sont
constituées dans les deux exemples (2/3) de [4 consonnes] et
dans l'exemple (4) de [6 consonnes] comme {Faaltu :
ÊáÚ} et {Infaala :
áÚäÅ}. Ces formes verbales renvoient le plus
souvent à la forme verbale de base (Faala : áÚ) comme une
forme verbale abstraite d'incrément, c'est-à-dire de toute
préfixation ou suffixation. Et par conséquent, le système
verbal arabe a utilisé la derivation affixale. Cette dernière
jouit un rôle essentiel pour exprimer l'accomplissement de l'action
à titre d'exemple avec les deux formes verbales (Faalto :
ÊáÚ) et (Infaala : áÚäÅ). En
effet, la première forme verbale indique l'accompli par « la
suffixation » et la deuxième par « la préfixation
».
79 Voir page 7 de ce document.
80 Le pain Nu, p29/66/101/94
40
Donc, L'accompli dans le système verbal arabe est
expliqué par les deux phénomènes grammaticaux la
préfixation et la suffixation. En fait il s'agit d'autres formes
verbales qui servent à indiquer l'accompli que les formes de (Faala:
áÚ / Faalto: ÊáÚ /Infaala:
áÚäÅ) comme dans les exemples81
suivants:
-La forme verbale (Afaala:
áÚ):
Exp1 : ÁæÏåÈ
ÁÇãáÇ ÛÑí
ÞØ æ ÉÈáÚáÇ
ßÓã
[Il a pris la canette et il commence à vider lentement
l'eau]
-La forme verbale (Istafaala:
áÚÊÓÅ):
Exp2:
äíÏÑÔÊãáÇ
ÉÈÍÕ ÈæÑÏáÇ
í ãæäáÇÈ
ÚÊãÊÓÅ
[Je me suis plu de dormir dans la rue avec les vagabonds].
Donc, Nous pouvons remarquer dans les deux exemples de formes
verbales (Afaala áÚ / Istafaala
áÚÊÓÅ) qui sont toujours fondées
sur la racine (Faala áÚ), en effet cette racine semble
comme une base commune à l'ensemble du paradigme malgré l'ajout
des divers morphèmes82et le verbe toujours garde le
même lexème83. En plus les deux formes verbales
(Afaala/ áÚ/ Istafaala áÚÊÓÅ)
visent tous les deux à exprimer « l'accompli ». Ce dernier
dans le système arabe ne se déduit pas uniquement par la forme
verbale (Faala: áÚ) mais aussi par la forme verbale
(Yafaalu: áÚí). Et nous pouvons comprendre «
L'accomplissement de l'action » à travers « le
contexte de la phrase » notamment avec les (textes narratifs:
ÉíÏÑÓáÇ
ÕæÕäáÇ) comme le montre cet exemple:
ÉÌäØ äÚ
ÏíÚÈ äÇßã
ìáÅ ÈåÐí,
ÕíÎÑáÇ
ÛÈÊáÇ æ
ÖíÈáÇ ÒÈÎáÇ
äã ÇÓíß
íÑÊÔí]
[ 84쾊퇂
ÓÈáÇã
áÇãÇÍ ÁÇÓã
ÏæÚí
[Il achète un sac de pain blanc et de tabac bon
marché et il va dans un endroit lointain de Tanger, il revient le soir
portant les vêtements des soldats....].
81 Le Pain NU.p72
82 Morphèmes : (N.M) unité minimale
de signification que l'on peut obtenir lors de la segmentation d'un
énoncé sans atteindre le niveau phonologique : synonyme : Formant
:
Larousse.fr
83 Lexème : (N.M) : de lexique
(d'après morphème) : unité minimale de signification
appartenant au lexique : synonyme : Sémantème :
Larousse.fr
84 Le Pain Nu: P14.
41
Dans ce contexte, nous déduisons que l'exemple
précédent s'inscrit dans un cadre narratif, car le locuteur est
en train de raconter « des événements
achevés » au passé. Mais il a choisi de les
raconter comme « des événements inachevés
» c'est-à-dire qui se passent au moment où il
parle (au présent) par l'emploi de la forme verbale de (Yafaalu:
áÚí) afin de revivre les moments passés et
mettre le lecteur en scène. Et dans cette perspective, nous avons
constaté que la forme verbale (Yafaalu: áÚí)
peut exprimer « l'accompli » à côté
de la forme verbale (Faala: áÚ) notamment dans un
contexte narratif. De même l'accompli dans le système arabe peut
être exprimé par « des éléments
explicites » qui peuvent intervenir comme des «
modificateurs verbaux 85 ». Ces
modificateurs sont dans la plupart de temps « des particules
verbales » qui confèrent des valeurs temporelles et
aspectuelles à la fois. En effet, l'emploi de la particule
qad+L'accompli: (ãÇÊ áÚ+ÏÞ), cette
composition toujours indique l'accomplissement de l'action dans le
(Passé) comme le montrent les exemples suivants86 :
Exp1: ÑÙÊä ä
ÉÇíÍáÇ
íäÊãáÚ
ÏÞá
[La vie m'a appris à attendre...]
Exp2: ßáãÚ äãË
ÊÖÈÞ ÏÞ
[Tu as pris le montant de votre travail...]
Nous constatons que l'emploi de particule (qad:
ÏÞ) dans les deux exemples (1+2), nous a montré que
le procès est totalement coupé du présent (Le
procès est achevé au passé). Et dans ce sens, nous citons
ce qui a mentionné David Cohen en ce qui concerne l'emploi de la
particule (qad: ÏÞ) dans le système
sémitique: « qad+accompli correspond donc à un parfait
résultatif87 ». De plus, nous remarquons que la
composition (Kana qad+accompli):
(ãÇÊáÇ + ÏÞ
äÇß) est le plus souvent marquée
l'accompli, c'est-à-dire l'action est achevée dans un
passé lointain. En plus, la particule de (kana qad+ accompli:
ãÇÊáÇ + ÏÞ
äÇß) est suffisante pour exprimer (le
passé et l'accompli) sans tenir compte à l'existence
d'un indicateur temporel dans la phrase. Comme le montrent les deux exemples
suivants88:
Exp1: ...ÉÏÆÇ
ÖÈÞ äÚ ìáÎÊ
ÏÞ äÇß
[Il avait renoncé à recevoir des
intérêts ....]
85 En linguistique, un modificateur est un
élement facultatif dans la phrase structure ou la clause la structure,
qui modifie le sens d'un autre élement dans la structure. Les
modificateurs peuvent venir soit avant soit après l'élement
modifié (la téte), selon le type de modificateur et les
régles de syntaxe du langage en question. Un modificateur placé
avant la téte est appelé un «prémodificateur»,
celui qui placé après la téte est appelé un
«postmodificateur» : modificateur grammaticale :
Stringfixer.com
86Le Pain NU p, 30/8.
87 David Cohen, L'Aspect Verbal, p185.
88 Le Pain Nu : Mohamed Chokri p, 119/131
42
Exp2: áíæØ
ÕÈ ÊãáÍ ÏÞ
Êäß
[J'avais rêvé d'une longue rangée...]
Et dans la même direction, nous trouvons une autre
particule verbale qui s'emploie avant un verbe accompli c'est le verbe
KanaDÇß (être) + Accompli. Cet emploi du
verbe Kana: DÇß + l'accompli indique l'accompli.
D'ailleurs, la position grammaticale de Kana DÇß
est le plus souvent en tête de la phrase avant le
prédicat comme dans l'exemple suivant89 :
Exp1: ÑÊÚÕáÇ
ÉÍÆÇÑ åäã
ÍæÊ ßãÓáÇ
äíÌÇØ DÇß [Le
plat de poisson sentait le thym...]
En ajoutant aussi que, parfois l'emploi du verbe (Kana:
:DÇß) uniquement dans la phrase peut indiquer
l'accompli. Comme le montrent les deux exemples suivants90:
Exp 1:
ÉÑÇÌÍáÇ äã
ÊÇãÇßÑ ßÇäå
DÇß
[Il y avait des tas de pierres]
Exp2: ÉÑíÑÍáá
áÇæÌÊã
ÇÚÆÇÈ DÇß [Il
était un colporteur de Hrirra]
C'est pour cela, nous déduisons que le verbe (Kana:
DÇß) semble comme un élément «
explicite » qui peut intervenir comme un «
modificateur verbal » qui confère une valeur
temporelle et aspectuelle (L'aspect Accompli/ Le
Passé). De plus, le verbe (Kana DÇß)
n'a pas véritablement un statut d'auxiliaire, sauf lorsqu'il
est employé avec son sens plein du verbe d'existence, c'est- à
-dire, La suppression de ce verbe dans les énoncés ou il apparait
ne poserait généralement aucun problème d'ordre
morphologique ou syntaxique91.
En résumé, le système verbal arabe n'est
pas fondé uniquement sur les temps verbaux pour exprimer l'aspect
accompli: ÉãÇÊáÇ
ÉåÌáÇ, puisque le temps semble comme un
complément secondaire en arabe. En outre, l'accompli peut être
exprimé par des procédures grammaticales en particulier par (La
morphologie verbale (la forme du verbe) / La préfixation / les
particules
89 Le Pain Nu : Mohamed Chokr, p 130
90 Le Pain Nu : Mohamed Chokri, p123/130
91 David Cohen, L'aspect Verbal, P 183.
43
préverbales). Et parfois peut être marqué
par le contexte de la phrase à partir de les marqueurs temporels comme
(Hier soir: Óã Éáíá).
2.3.2-L'aspect inaccompli:
(ãÇÊ.Ç jíi.Ç):
L'aspect inaccompli dans le système verbal arabe sert
à exprimer que l'action en cours de déroulement. De plus, son
emploi indique aussi que l'action se répète dans les trois
époques (le passé / le présent et le futur). L'inaccompli
selon Comrie92 peut être déterminé à
travers le temps interne (Temps impliqué 93 ). Et dans le
même sens, Comrie a déclaré que l'inaccompli se
répartit en deux types fondamentaux qui sont l'itératif et le
duratif. Ce dernier peut indiquer (L'aspect progressif et le non progressif)
comme le montre la figure suivante:
Aspect (ÉåÌáÇ)

Imperfectif Perfectif
(ãÇÊáÇ
ÑíÛáÇ)
(ãÇÊáÇ)

Duratif Itératif
(áÕÇæÊãáÇ)
(ÉÏÇÚáÇ)

Progressif Non-Progressif
(íÌíÑÏÊáÇ)
(íÌíÑÏÊáÇ
ÑíÛáÇ)
Figure 7:
Répartition de l'aspect entre Accompli/ Inaccompli selon
B.Comrie94.
La langue arabe a exprimé l'aspect inaccompli par la
forme verbale (Yafaalu: áÚí). Et par
l'utilisation des particules (préfixées) avant la forme verbale
de (Yafaalu:áÚí ), afin de décrire une
action qui prend « une certaine durée
» dans le temps comme dans les exemples suivants95
:
92 B.Comrie, op.cit p24.
93 Voir chapitre 2, partie 1, La Théorie
Guillaumienne: Temps expliqué / Temps impliqué.
94 5cd54955-f3f4-4d5f-85ed-ba9f0875edf1
(1).pdf
95 Le Pain Nu, p151
44
Exp1:
ÆØÇÔáÇ ìáÚ
ßÑÇãÌáÇ
áÇÌÑ
ÇäÆÌÇí ä
ËÏÍí
[Il arrive que des douaniers nous surprennent sur la plage.]
Exp 2:
ßÑÇãÌáÇ
áÇÌÑ
ÉÚáÓáÇ
ÈÍÇÕ
íÔÑí
[La propriétaire de la marchandise corrompt les
douaniers]
Exp3...
ØæÞÓáÇ äã
ÇÏíÌ ÑÐÍÊ ä
ßá íÛÈäí
[Vous devez faire attention à ne pas tomber.]
Alors, nous constatons selon les exemples
précédents, les formes verbales sont constituées à
la forme verbale de base (Yafaalu: áÚí). En
effet, cette racine semble comme une base commune à l'ensemble du
paradigme et malgré l'ajout de quelques morphèmes aux formes
verbales comme dans (Exp1 / Exp3) avec les deux verbes (Yufajiunà:
(surprendre) ÇäÆÌÇí) et
(Yànbaghi
(Falloir):íÛÈäí
). Celles-ci indiquent toujours « L'aspect Inaccompli ».
D'ailleurs, l'inaccompli dans le système verbal arabe n'est pas
exprimé uniquement par la forme verbale (Yafaalu:
áÚí) mais aussi par d'autres formes verbales comme
(Faalala: ááÚ )/ (Tafaala:
áÚÇÊ) à titre d'exemple dans les
exemples suivants96 :
Exp1: ÞØÞØÊ
íÊÈÞÑ
ãÇÙÚ
[Mes os du cou se craquent]
Exp2: ÇåÏí í
áíÇãÊ
íÑÈáÇÇ
[La cruche se balançait dans sa main.]
À ce propos, nous déduissons qu'il s'agit
d'autres formes verbales à coté de la forme verbale (Yafaalu:
áÚí) qu'indiquent l'inaccompli. D'ailleurs, nous
pouvons trouver aussi d'autres moyens syntaxiques qui peuvent exprimer l'aspect
inaccompli par exemple l'emploi « des particules préverbales
» qui sont fixées avant le verbe comme (l'association de(s)
préfixée avant le verbe qui peut marquer l'inaccompli / la
particule invariable sa (wfa) + un verbe inaccompli ....). Dans cette
direction, nous allons traiter des exemples qui peuvent spécifier le
fait à venir par rapport au présent du locuteur. En
commençant tout d'abord par l'emploi de (S:
äíÓáÇ) +un verbe inaccompli
(ãÇÊ ÑíÛ áÚ). En effet,
son emploi sert à marquer
96 Le Pain Nu : P 157/130
45
que l'action va se réaliser dans le futur
(l'action est inaccomplie), comme dans les deux
exemples suivants97 :
Exp1: äÇæØÊ
ìáÅ ÏæÚÓ
[Je retournerai à Tétouan]
Exp2: ÎæßáÇ í
ßÏÌÓ ÉÚÇÓ
ÏÚÈ
[Je te trouverai après une heure dans la hutte]
Par la suite, l'emploi de la particule sa (wfa) +inaccompli: (
ãÇÊ ÑíÛ áÚ +
æÓ). Cette particule est le plus souvent placée avant
une forme inaccomplie pour marquer la valeur de l'inaccompli et de
postériorité par rapport au moment de la parole.comme dans cet
exemple98:
Exp1: ÎæßáÇ
í ÉÚÇÓ ÏÚÈ
ßÏÌ æÓ
[Je te trouverai après une heure dans la hutte].
Dans l'exemple précédent, nous remarquons la
présence d'un indicateur temporel qui
marque la postériorité par rapport
au moment ou le locuteur parle. L'emploi de l'indicateur (Après
une Heure: ÉÚÇÓ ÏÚÈ)
marque le futur proche et l'inaccompli.
2.3.3-L'aspect itératif:
(ÉÏÇÚáÇ
ÉåÌáÇ)
L'aspect itératif peut marquer une action (en
cours de déroulement), c'est à dire une action
habituelle, itérative. Comme dans l'exemple suivant99:
Exp1 ....
ÁÇÓã áß
ÏæÚí íÈ
äÇß
[Mon père revenait chaque soir ...]
La composition de Kana äÇß
+Yafaalu áÚí +
indicateur temporel a marquée la valeur de
répétition et la continuation de l'action
à la fois. C'est-à -dire une action qui a commencé au
passé et se prolonge encore au présent, en d'autres termes
l'action n'est pas achevée.
97 Le Pain NU : Mohamed Chokri p59/155
98 Le Pain Nu, p 155
99 Le Pain NU : Mohamed Chokri p12
46
2.3.4- L'aspect inchoatif:
(ÏÈáÇ ÉåÌ )
Cet aspect est exprimé par l'emploi de (Le verbe
ÏÈ (commencer) + inaccompli).
L'inchoatif vise à exprimer le déclenchement de
l'action. En d'autres termes, Passer d'un état vers un autre comme dans
cet exemple100 :
Exp1:
ÉÑÇÒÛÈ
áØåí
ÑØãáÇ
ÏÈ
[Il a commencé à pleuvoir abondamment]
2.3.5- L'aspect duratif:
(áÕÇæÊãáÇ):
Le duratif s'est manifesté à l'aide de l'emploi
d'un verbe comme (dhala: áÙ / baka: ìÞÈ /
mazala: áÇÒÇã ) qui est
préfixé avant la forme verbale (Yafaalu:
áÚí ) pour marquer (la continuation:
ÉíÑÇÑãÊÓáÇÇ
) de l'action dans l'une des trois époques (Passé/
Présent /Futur) comme dans les deux exemples suivants101 :
Exp1: ãÇä íß
ÑÚ áÇ ÇãÇí
ÊááÙ
[Je restais des jours sans avoir connaitre comment dormir]
Exp2... åÊÞæ
ãÙÚã íÖÞí
áÇÒÇã íÈ
[Mon père passait encore la plupart de son temps au
café]
Conséquemment, Nous déduisons à travers
les deux exemples (Exp 1/2) que la valeur aspectuelle de {Duratif} est
exprimée par deux sortes. Prémierement, l'exemple (1) sert
à marquer (la Continuité dans le Passé). Et
deuxièmement, l'exemple(2) sert à indiquer que l'action est en
cours de déroulement au moment de la parole (MP).
2.3.6-L'aspect progressif:
(íÌíÑÏÊáÇ)
Le progressif est le plus souvent exprimé par cette
composition (áÚí +äÇß)
en arabe.En
effet, le progressif sert à indiquer que l'action a
pris une « certaine durée » dans le passé
comme dans l'exemple suivant102 :
Exp1: ÇÑíËß
íäÈÑÖí íÈ
äÇß
[Mon père me frappait beaucoup]
100 Le Pain Nu : Mohamed Chokri p 211
101 Le Pain Nu : Mohamed Chokri p , 36/71
102 Le Pain Nu, p 100
47
Donc, nous remarquons dans ce cadre que le verbe (frapper :
ÈÑÖí) est un verbe de« mouvement
», c'est-à-dire que l'action a pris certainement «
une certaine durée », mais elle est achevée au
passé. En outre, le verbe (frapper ÈÑÖí) est
accompagné d'un verbe préfixé qui marque (le passé
et l'antériorité).
2.3.7- L'aspect non progressif:
(íÌíÑÏÊáI
ÑíÛáI):
Le non progressif est exprimé par la même
composition du progressif (le verbe Kana äÇß + Yafaalu
áÚí), mais dans ce type d'aspect le verbe qui est
utilisé après le verbe (kana) sera un verbe (-
dynamique103) c'est-à-dire un verbe d'Etat qui marque la
valeur de stabilité comme dans l'exemple suivant104:
Exp1: ÉÑÇíÎ
äíÚ í äßÓä
Çäß
[Nous habitions à Ain Khyara].
Bref, nous avons essayé dans la mesure du possible dans
cette partie de notre analyse d'expliquer les différentes manifestations
de l'aspect sur le plan formel (Grammatical) du système verbal arabe. En
fait, la langue arabe repose essentiellement sur deux formes aspectives de base
qui servent à marquer« L'Aspectualité ». D'un
côté nous trouvons la forme
verbale (Faala : áÚ) qui marque
(l'accompli et le passé). Et de l'autre côté
l'aspect
inaccompli qui est exprimé par la forme verbale (Yafaalu
: áÚí) qui présente une action comme en
cours de déroulement (Présent / Futur : El Moudharaa).
Par ailleurs, l'inaccompli peut exprimer aussi des « sous aspects »
comme nous avons déjà vu (L'itératif ! le duratif ! le
progressif et le Non -progressif/ l'inchoatif). De plus, nous avons
également remarqué dans le même contexte que l'aspect est
exprimé par l'ajout de quelques « modificateurs
verbaux105 » qui sont préfixés avant le
verbe. Cela nous fait déduire que la langue arabe repose sur un
système complexe. Puisque l'aspect est exprimé par multiples
procédés grammaticales en particulier les
verbes-préfixés/ les particules verbales / les adverbes. .
Alors, quels sont les différents moyens lexicaux qui
sont employés pour exprimer l'aspect comme une catégorie lexicale
dans le système verbal Arabe?
2.4- L'étude de l'aspect comme une
catégorie Lexicale:
(ÉíãÌÚãáI
ÉåÌáI)
Dans cette partie de notre travail, nous focalisons
particulièrement sur la manière
par laquelle l'aspect est exprimé comme une
catégorie lexicale. Dans ce cadre, nous mettons l'accent sur les
différents outils lexicaux sur lesquels le système verbal arabe
repose pour
103 Le critère de dynamicité (voir chapitre II:
Partie 1).
104 Le Pain Nu : Mohamed Chokri p29
105 Voir page 49 de ce document.
48
décrire la « situation106
(ÚÖæáÇ) ». Cette
dernière est divisée sous plusieurs types selon
Vendler107 .Ce linguiste a établi une distinction radicale
entre les types de verbes(Les procés). En effet, nous
trouvons les verbes (d'Etat
/ÉáÇÍáÇ ) / les verbes
d'Activité
(ÉíßÑÍáÇ) / les verbes
d'Accomplissement
(ÁÇåÊäáÅÇ
ìáÚ ßæÔæáÇ)
et dernièrement les verbes d'Achèvement
(ÁÇåÊäáÅÇ).
Dans ce sens, nous pouvons dire que ces verbes sont utilisés pour
décrire la « nature de la situation :
ËÏÍáÇ ÉÚíÈØ
». Du fait que le plus souvent nous nous distinguons la nature de
la situation à partir de la signification lexicale
(íãÌÚãáÇ
ìäÚãáÇ). Cette dernière
occupe un rôle important pour montrer les différentes faces par
lesquelles l'aspect se manifeste sur le plan lexical. Et pour mieux clarifier
ce que nous avons mentionné précédemment, nous proposons
ce schéma qui classifie les différents types de la situation
comme suit :

La Situation
Etats Activités Accomplissements
Achèvements
ÉäßÇÓáÇ
ÉíßÑÍáÇ
ÊÇãÇãÊáÅÇ
áÇãÊßáÅÇ
Figure 8: La Classification de Z. Vendler:
Critère de
dynamicité108.
2.4.1- Les Verbes d'Etat: (
ÉäßÇÓáÇ
áÇÚáÇ )
Les verbes d'Etat ou (verbe
statique:äßÇÓ áÚ ) est un type
sémantique du verbe.En effet, le procès indique que son sujet
possède une certaine propriété particulière telle
que l'état, le devenir, la façon d'être. Ces verbes
n'expriment aucune action, ni progression et n'impliquent aucune durée
et ne fournissent qu'une description d'une condition. Comme le montre l'exemple
suivant109 :
Exp1: íã íá
ÇåÊÕæ íÊáÇ
áæÞÈáÇ
ÊÏÌæ
[J'ai trouvé les légumineuses que ma mère
m'a prescrites]
2.4.2- Les verbes d'Activité:
(ÉíßÑÍáÇ
áÇÚáÇ)
Les verbes d'Activité ou plutôt verbes
(dynamique). Ceux-ci sont un type sémantique de
verbes dont le procès indique un acte, une
opération, une activité typiquement effectuée par
106 Ce terme est utilisé dans l'étude de l'aspect
pour pouvoir exprimer les différents stades du procès verbal.
107 Vendler: Critère de dynamicité voir page 14 de
ce document.
108 Vendler 1967: classification des verbes selon leur mode
d'action.
109 Le Pain Nu : Mohamed Chokri p 50
49
un agent. De plus, les verbes d'Activité s'inscrivent dans
le temps et qui peuvent impliquer « une certaine durée
» comme dans les deux exemples suivants110 :
Exp1: ÓáãáÇ
ÇåÚÐÌ ÇÑÇÑã
ÊÞáÓÊ
[Je montais plusieurs fois son torse lisse]
Exp2: ÑÎáÇ
íÕÑáÇ ìáÅ
ÑÈÚ Êäß [Je traversais
vers l'autre trottoir.].
2.4.3- Les verbes d'Accomplissement:
(ÊÇãÇãÊáÅÇ
áÇÚ)
Les verbes d'accomplissement expriment un
'événement commence à se produire.111 Mais
le point de commencement et le point de l'accomplissement sont
approximativement « proches » (
äíÈÑÇÞÊã). Comme dans les
deux exemples suivants112 :
Exp1: ÏÇãÑáÇ
åÍæÑÌ í åá
ÊÚÖæ
[J'ai mis dans ses blessures, de cendres]
Exp2: íáËã
áÈÇÒãáÇ äã
ÊÇÊÞí áÇØ
ÊÏÌæ
[J'ai trouvé un enfant qui survit de dépotoirs
comme moi].
2.4.4- Les verbes d'Achèvement:
(áÇãÊßáÅÇ
áÇÚ)
Les verbes d'achèvement expriment le résultat
final de l'action. En effet, ces verbes servent
à présenter l'action comme «
terminée » et « achevée »
(ìåÊäÇ ËÏÍáÇ).
Comme dans les exemples suivants113 :
Exp1: « áÓÚãáÇ
ÒÈÎáÇ
íäÊØÚ »
[Elle m'a donné du pain au miel]
Exp2: íÇÑØ æ
íåÌæ íá
ÊáÓÛ
[Elle m'a lavé mon visage et mes
extrémités].
110 Le Pain Nu p 55/23
111 L'influence des distinctions aspectuelles sur l'acquisition
des temps en français langue étrangère :
Journals.openedition.org
112 Le Pain Nu p 63/10
113 Le Pain Nu : P 27
50
2.4.5- Les Verbes Perfectifs:
(ÉáãÊßãáÇ
ÉÒÌäãáÇ
áÇÚáÇ)
Les verbes perfectifs (Parfait/ Terminé:
ÉÒÌäãáÇ) expriment l'action
comme terminée accomplie
(ÉáãÊßã) , c'est à dire l'action
a abouti à un résultat final et le présent n'a aucun sens.
Ces verbes marquent le plus souvent la valeur d'antériorité par
rapport au moment de la parole.Comme dans les deux exemples
suivants114 :
Exp1: ÇÆÇÎ
ÉÑÈÎãáÇ äã
ÊÌÑÎ
[Je suis sorti de la boulangerie effrayé]
Exp2: äßÓã ìáÚ
ÒÇÈÎ äíÚ íÍ
í ÇÊÑËÚ
[Nous avons trouvé à cité d'Ain khabza, une
maison].
2.4.6- Les verbes imperfectifs:
(ÉáãÊßã
ÑíÛáÇ æ
ÉÒÌäã ÑíÛáÇ
áÇÚáÇ)
Les verbes imperfectifs constatent l'action en train de se
faire sans se préoccuper de son achèvement ou pas. En effet, ils
servent à décrire « le
processus115 » de l'action dans sa durée ou une
action répétitive (fréquente/ Habituelle).De plus, ces
verbes sont conjugués également au
(passé/présent/futur) comme dans les deux exemples
suivants116 :
Exp1: ÉßãÓ áËã
ÍÈÓÊ
{Elle nageait comme un poisson]
Exp2: ÉØÈ áËã
æØÊ æ
ÕæÛÊ
[Elle plongeait et flottait comme un canard].
Pour résumer, le système verbal arabe repose
essentiellement sur l'opposition aspective de «
L'accompli et l'Inaccompli ». Du fait que tout verbe
aussi ne présente à l'indicatif que deux formes verbales celle de
(l'accompli avec la forme verbale Faala : áÚ) et
celle de (l'inaccompli avec la forme verbale Yafaalu :
áÚí). C'est pour cela, plusieurs grammairiens ont
noté que la langue arabe est une langue « purement
aspective ». Par ailleurs, les formes verbales de l'arabe ne
paraissent pas déterminées par le temps tel qu'il vient
d'être défini dans d'autres langues européennes. Puisque le
système verbal de l'arabe exprime convenablement le temps et les nuances
temporelles, c'est-à-dire « la chronologie »
grâce aux particules verbales et aux particules adverbiales. En fait,
nous trouvons l'accompli porte une valeur de passé (El Madhi)
et l'inaccompli porte une valeur de présent et futur (El-
114 Le Pain Nu P 31/29
115 David Cohen, L'aspect verbal, p 55.
116 Le Pain Nu P34
51
Moudharaa). Et par conséquent, nous constatons
que dans la langue arabe, il s'agit de deux grands paradigmes qui portent des
valeurs temporelles et aspectuelles à la fois. D'ailleurs, la notion de
l'aspect est exprimée en arabe comme une catégorie grammaticale
à partir l'emploi des outils grammaticaux à titre d'exemple (les
particules verbales/ la préfixation/la suffixation...) qui servent
à exprimer des valeurs aspectuelles et temporelles. Et comme une
catégorie lexicale par l'emploi des moyens lexicaux ou contextuels comme
(Les adverbes d'aspect / les compléments circonstanciels de temps
...).
52
Chapitre III:
Étude comparative du fonctionnement
de
l'aspect verbal dans les deux systèmes
verbaux:
« Français et Arabe
»
53
Dans ce dernier chapitre, nous espérons élaborer
une étude contrastive entre les deux systèmes linguistiques le
Français et l'Arabe. En effet, cette étude vise principalement
à mettre en regard les deux systémes verbaux afin de
dégager les convergences et les divergences structurellement et
contextuellement. Autrement dit, nous sommes contraints à focaliser
essentiellement sur les variations structurelles et contextuelles propres
à chaque langue. C'est pour cela, nous aborderons une comparaison qui
porte comme objectif premier de mettre en rapport l'expression de
l'aspectualité et la temporalité dans les deux langues, bien
qu'elles n'appartiennent pas à la même famille (la langue arabe
comme une langue sémitique et la langue française comme une
langue romane) et qu'il existe aussi de lourdes différences entre
elles.
1-Les convergences entre les deux systèmes
verbaux:
1.1-Les Convergences sur le plan Grammatical:
Dans le chapitre (II), nous avons étudié «
les formes verbales » des deux systèmes
le Français et l'Arabe d'un point de vue à la fois «
Temporel et Aspectuel » dans le but de traiter
les différents modes de manifestation de l'aspect sur les deux plans, en
commençant par le plan formel et par la suite le plan lexical. En effet
nous avons constaté que chacune des deux langues à son propre
style d'exprimer l'aspect autrement dit « la catégorie
de la durée 117» d'un point de vue
structurel et contextuel. D'ailleurs les deux langues ont quasi réussi
à exprimer la notion d'aspect à l'aide de multiples outils
grammaticaux et lexicaux et dans cette partie de notre travail, nous essaierons
de dégager les convergences concernant les outils formels que les deux
langues sont convenues d'utiliser pour exprimer l'aspect comme «
une catégorie grammaticalisée
».
1.1.1 Les concepts temporels
équivalents:
Nous avons constaté que les formes verbales de temps de
la langue française et celles de l'arabe marquent de nombreux cas
d'équivalence directe comme suit:

1-La forme verbale (Yafaalu:
áÚí)
Qui équivaut au «Il fait
» (Forme du présent)
117 David Cohen, L'Aspect verbal p17.
54

2-La forme verbale (Faala:
áÚ)
Qui équivaut au « Il a fait
» (Forme du passé) 3-La
forme verbale (sa (wfa) Yafaalu: áÚí
æÓ)
Qui équivaut au « Il fera »
(Forme du futur)
Dans cette perspective, nous remarquons que les deux langues
situent d'une part, « la durée de l'événement
» selon l'une des trois époques (passé/
Présent / futur). Et de l'autre part, les deux langues sont capables de
situer « le moment de l'événement »
par rapport à son occurrence soit dans le passé ou dans le futur
comme le montrent les exemples suivants:
?Le passé proche /récent (FR) qui équivaut
au (ÈíÑÞáÇ
íÖÇãáÇ) en (Arb):
Exp1118 : «
ÈÍÊäÊ íã
ÇßÑÇÊ
Êãä»
« Je me suis endormi laissant ma
mère avec ses angoisses »
Nous remarquons que, le passé proche (récent) en
français est le plus souvent exprimé par l'utilisation du
passé composé et en arabe par l'emploi de
(ÈíÑÞáÇ
íÖÇãáÇ). De plus, son emploi dans les
deux systèmes linguistiques sert par excellence à situer le
procès dans le passé. C'est-à-dire, le repère de
l'événement est décalé avant le moment de
l'énonciation(ME). Cette « proximité »
du présent se manifeste également bien dans le système
verbal de l'arabe notamment avec la particule verbale (qad : ÏÞ)
préfixée avant le verbe de base (áÚ) comme dans
l'exemple suivant :
Exp2119: «-
ßáãÚ äãË
ÊÖÈÞ ÏÞ »
« Tu as pris le montant de votre travail
»
118 Le Pain Nu p 14
119 Le Pain Nu p30
55
Donc, L'emploi du (passé récent:
ÈíÑÞáÇ
íÖÇãáÇ) marque le prolongement d'une
action qui s'est terminée déjà au passé dans le
présent. En d'autres termes, l'action n'est pas totalement coupée
du présent, mais elle est envisagée par le locuteur à
partir du moment de l'énonciation avec « une certaine
proximité psychologique 120». De plus, le
passé récent (ÈíÑÞáÇ
íÖÇãáÇ) établit un lien vivant
entre l'action passée et le présent ou son évocation
trouve place.
?Le passé Lointain (le parfait) en (Fr) qui
équivaut au (ÏíÚÈáÇ
íÖÇãáÇ) en (Arb):
Le passé lointain ou (le parfait) est exprimé
dans la plupart des cas par l'emploi du (plus que parfait) et en arabe
par l'emploi de (ÏíÚÈáÇ
íÖÇãáÇ):
Exp3121: «
ÉÏÆÇ ÖÈÞ äÚ
ìáÎÊ ÏÞ äÇß
»
« Il avait renoncé à recevoir
d'intérêt ».
Nous déduisons que, le passé lointain ou
(ÏíÚÈáÇ
íÖÇãáÇ) vise dans les deux langues
à situer le procès par rapport un repère temporel
passé, puisqu'il exprime « l'achèvement de l'action
» au point de référence passé. Par ailleurs,
son emploi est le plus souvent indiqué par un verbe (perfectif :
ãÇÊ áÚ), c'est-à-dire l'accent
est mis sur le résultat découlant de l'achèvement du
procès. Il marque aussi « l'antériorité
» par rapport à un repère passé que se soit
explicite ou implicite. C'est pour cela, le passé lointain ou (le plus
que parfait) est indiqué dans le système verbal français
par la corrélation avec un verbe (à l'imparfait, au passé
composé ou au passé simple) comme le montre l'exemple
précédent « avait renoncé ». Et
en Arabe par l'emploi de la particule verbale (kana qad : ÏÞ
äÇß) préfixée avant le verbe de base
(Faala : áÚ) comme dans l'exemple(3): «
ìáÎÊ ÏÞ äÇß
».
?Le passé continu en (Fr) qui équivaut au
(ÑãÊÓãáÇ
íÖÇãáÇ) en (Arb):
Le passé continu est exprimé en français
le plus souvent par l'emploi de l'imparfait et en arabe par l'emploi de
(ÑãÊÓãáÇ
íÖÇãáÇ) comme dans l'exemple
suivant122 :
Exp1:ãæÄÔãáÇ
ËÏÇÍáÇ äÚ
ËÏÍÊä
ÇäááÙ
« Nous n'arrêtions de parler du
malheureux accident ».
Par conséquent, le passé continu ou
(ÑãÊÓãáÇ
íÖÇãáÇ) se manifeste dans les deux
systèmes
comme un temps analytique exprimant « l'aspect
sécant123 ». En effet, le passé continu
avec
120 Imbs 1960.
121 Le Pain Nu, p119
122 Le Pain NU, p131
123 L'aspect sécant caractérise les verbes à
l'imparfait et s'oppose à l'aspect global du passé simple (voir
site web :
maxicours.com
56
l'emploi de l'imparfait, le procès est perçu
« de l'intérieur », ce qui permet de le
séparer en deux parties et de distinguer ce qui est effectivement
réalisé et ce qui ne l'est pas encore. IL oppose «
à un certain point du temps, une partie du procès
déjà accomplie à une autre qui reste à
accomplir124 ». D'ailleurs l'emploi de l'imparfait comme
un passé continu permet de situer le procès exprimé comme
inachevé (sans limites). De plus, l'emploi de l'imparfait marque par
excellence la continuité de déroulement du procès sans
avoir terme final marqué. Et dans le système verbal du
français l'imparfait est exprimé par une forme verbale simple
(verbe+terminaisons de l'imparfait) comme dans l'exemple
précédent « arrêtions ». Et dans
le système arabe le passé continu ou
(ÑãÊÓãáÇ
íÖÇãáÇ) est indiqué par l'emploi
de la particule préverbale (dhala : J) employée
avec le verbe (Yafaalu : áÚí). Autrement dit avec un
(verbe imperfectif : ãÇÊáÇ
ÑíÛáÇ) comme le montre l'exemple
précédent : « `ia-Êä
1äááÙ ».
?Le présent en (Fr) qui
équivaut au: (ÑÖÇÍáÇ) en
(Arb)
L'emploi du présent dans les deux langues (Le
Français et L'Arabe) sert à montrer que l'événement
se déroule au moment où le locuteur parle (MP). En effet, dans le
système verbal du français la forme verbale du présent est
le plus souvent trouvée (unique /simple).
Et dans la langue arabe le présent
(ÑÖÇÍáÇ) est indiqué par la
forme verbale (Yafaalu : áÚí) et parfois par l'emploi de
la particule préverbale (Yakunu :äæßí ) avec un
verbe (imperfectif : áÚí) comme dans les deux exemples
suivants :
Exp1125 :
åÓÏÓã ÇÑåÇÔ
c,5.Ì»
« Il brandit son arme »
Exp2126 :
äÇßÏáÇ í íã
a014-4:1 Û.9s»
« Il aide ma mère dans le magasin
»
Donc, le présent
(ÑÖÇÍáÇ) est employé dans les
deux langues pour indiquer un événement
ou un état de choses contemporaines de l'acte
d'énonciation. En d'autres termes, le procès est marqué
comme vrai par le locuteur au moment de l'énonciation (ME).
124 R.Martin 1971, 70.
125 Le Pain Nu, p 124
126 Le Pain NU, p 100
57
? Le futur simple en (Fr) qui équivaut au
(áÈÞÊÓãáÇ) en (Arb):
L'emploi du futur
(áÈÞÊÓãáÇ) sert dans les
deux langues à exprimer un fait se passera dans l'avenir. D'ailleurs
dans le système verbal du français, la forme verbale du futur est
le plus souvent trouvée (simple/ unique). Et dans le système
arabe, l'emploi du futur
(áÈÞÊÓãáÇ) est
indiqué à l'aide de l'emploi de quelques particules
préverbales comme (sa (wfa) : æÓ) ou avec (le(S)
:äíÓáÇ ) et un verbe à la forme verbale
de (Yafaalu : áÚí). Et parfois, l'emploi de la forme
verbale (Yafaalu : áÚí) est suffisante pour exprimer le
futur. Comme dans les exemples suivants127 :
Exp1:íäÞáÊí
æ áÒäãáÇ äã
ÌÑÎíÓ
« IL sortira de la maison et
viendra me chercher ». Exp2:
ÎæßáÇ í
ÉÚÇÓ ÏÚÈ
ßÏÌ æÓ
« Je te trouverai après une heure
dans la hutte ».
Dans ce contexte, nous constatons que le futur
(áÈÞÊÓãáÇ) vise à
situer l'événement dans l'avenir. C'est-à-dire
après le moment de l'énonciation(ME). En plus, la projection du
procès dans l'avenir par rapport au présent de
l'énonciation peut être marquée par la seule forme verbale
au futur comme dans l'exemple (2) « trouverai » et
dans l'exemple (1) par « sortira/ viendra
». Et la valeur du futur peut être aussi confirmée
par l'emploi d'un adverbe ou un complément circonstanciel comme dans
l'exemple (2) « après une heure »
(ÉÚÇÓ ÏÚÈ).
D'ailleurs, nous avons remarqué que les deux langues peuvent employer
des adverbes de temps afin de préciser le moment de
l'événement.
?Le futur proche en (Fr) qui équivaut au
(ÈíÑÞáÇ
áÈÞÊÓãáÇ) en (Arb):
L'emploi du futur proche
(ÈíÑÞáÇ
áÈÞÊÓãáÇ) est
exprimé dans les deux systèmes par l'utilisation des indications
temporelles dans le contexte de la phrase à côté de la
forme verbale du futur. Comme le montre l'exemple suivant128 :
Exp1: ÉÌäØ
ìáÅ ÇÏÛ ÑÇÓ
æÓ
« Je voyagerai demain à Tanja
»
En conséquence, nous déduisons que l'emploi du
futur proche dans l'exemple plus haut
est indiqué pour marquer que l'action va se passer dans
un futur trés proche du présent (le présent ou le locuteur
parle).
127 Le Pain Nu, p 94
128 Le Pain Nu, p 97
58
?Le futur continu en (Fr) qui équivaut au
(ÑãÊÓãáÇ
áÈÞÊÓãáÇ) en (Arb):
Le futur continu
(ÑãÊÓãáÇ
áÈÞÊÓãáÇ) vise à
indiquer dans les deux systèmes verbaux « la
continuité de l'action » dans le futur. Comme dans cet
exemple: Exp1129 :
ìæÇåÊ ìÊÍ
íÑÌ áÙÓ
« Je continuerai à courir
jusqu'à ce que m'effondre ».
Nous remarquons que, le futur continu dans le système
verbal français est employé dans l'exemple
précédent par un verbe auxiliaire conjugué au futur
simple+verbe à l'infinitif « continuerai à courir
». Et dans le système arabe le futur continu
(ÑãÊÓãáÇ
áÈÞÊÓãáÇ) est
exprimé par la particule préverbale
áÙÓ /sa (adhalu) employée avec un
verbe à la forme verbale de (Yafaalu: áÚí)
pour exprimer « la continuité » :
« íÑÌ áÙÓ
».
Pour résumer ce que nous avons étudié
précédemment, nous constatons que les deux systèmes
verbaux (le Français et l'Arabe) disposent d'un ensemble de «
verbes auxiliaires de temps » dont nous pouvons citer les
suivants:
|
Les auxiliaires de temps
en
(Arabe)
|
Les auxiliaires de temps
en
(Français)
|
Valeurs temporelles
|
|
äÇß / áÙ
|
-Etait/Restait
|
-Le passé
íÖÇãáÇ-
|
|
áÙí/äæßí
|
-Est / Reste
|
-Le présent/ Futur
áÈÞÊÓãáÇ-
ÑÖÇÍáÇ-
|
|
áÇÒÇã
|
-Restait
|
-Le passé continu
ÑãÊÓãáÇ
íÖÇãáÇ -
|
Et dans la même direction, nous pouvons remarquer aussi
que les deux langues utilisent « des indications temporelles
» (ÉíäãÒ
äÆÇÑÞ) afin de bien situer l'action par
rapport à la situation d'énonciation don't nous mentionnons les
suivants:
|
Les indications temporelles en
(Fr)
|
Les indications temporelles en
(Arb)
ÉíäãÒ
äÆÇÑÞ
|
|
-Demain
|
ÇÏÛ-
|
|
-Hier
|
ÓãáÇÈ-
|
|
-Après une heure
|
ÉÚÇÓ ÏÚÈ-
|
129 Le Pain Nu, p 95
59
1.1.2-Les concepts aspectuels
équivalents:
Les deux langues ont réussi à exprimer l'aspect
comme une catégorie grammaticale en s'appuyant à ce propos sur de
nombreux procédés grammaticaux qui servent à exprimer
l'aspect comme la préfixation/ les semi-auxiliaires aspectuels / les
adverbes d'aspect/, les temps verbaux ...et dans ce cadre nous allons mettre en
regard les deux systèmes verbaux en essayant de dégager les cas
d'équivalences entre les deux systèmes.
?L'aspect accompli
(ÉãÇÊáÇ
ÉåÌáÇ):
En français, L'accompli est exprimé par l'emploi
des temps du passé. Quant à la langue arabe, l'accompli
(ÉãÇÊáÇ
ÉåÌáÇ) est marqué aussi par la forme
verbale (Faala: áÚ) qui indique le (passé :
íÖÇãáÇ).
?L'emploi du passé simple en (Fr) qui équivaut
au (ØíÓÈáÇ
íÖÇãáÇ) en (Arb):
Dans les deux systèmes, le passé simple
(ØíÓÈáÇ
íÖÇãáÇ) sert à exprimer «
l'aspect accompli », car ce dernier situe le procès dans le
passé. Du fait qu'il donne une vision synthétique et compacte du
procès et il l'envisage : « comme un noyau indivis, comme un
tout fermé sur lui- même et en offre une vision globale
indifférenciée, non-sécante130 »,
c'est-à-dire le processus de la conquête est perçu dans sa
globalité .L'emploi de ce temps soit dans le français ou l'arabe
indique toujours l'aspect comme « accompli » et
non-sécant131 ». Comme dans l'exemple suivant:
Exp1132 :
ìåÞãáÇ äã
áÌÑáÇ Lsà
« L'homme sortit du café ».
?L'emploi du passé lointain en (Fr) qui équivaut
au: (ÏíÚÈáÇ
íÖÇãáÇ) en (Arb):
Le passé lointain ou
(ÏíÚÈáÇ
íÖÇãáÇ) dans les deux systèmes
sert à marquer « L'aspect
Accompli », Puisqu'il situe le procès comme
totalement coupé du présent. C'est-à-dire le procès
est terminé au passé comme le montre l'exemple suivant:
Exp1133:
ÉØíÓÈ
ÉÆÇãËáÇË
e,.J A uts
« Il avait gagné trois cent simples
».
130 R.Martin 1971, 70.
131 Voir site web
maxicours.com.
132 Le Pain Nu, p 114
133 Le Pain Nu : p 118
60
Dans l'exemple qui précède, l'aspect «
accompli » est exprimé en français par l'emploi de
« plus que parfait » (avait
chuchoté). Et dans la langue arabe indiqué par la
formule suivante (Óãå ÏÞ
äÇß).
?Le passé proche en (Fr) qui équivaut au
(ÈíÑÞáÇ
íÖÇãáÇ) en (Arb):
Le passé proche ou
(ÈíÑÞáÇ
íÖÇãáÇ) dans les deux systèmes
linguistiques sert à exprimer que
le procès est accompli au passé,
c'est-à-dire marque l'aspect comme « accompli » dans un moment
passé. Comme dans l'exemple suivant:
Exp1134:
íäØÈ ÑíÇÕÚ
ÊßÓ ÏÞá
« Il a fait taire mes oiseaux d'estomac
»
Nous constatons que, le passé proche ou
(ÈíÑÞáÇ
íÖÇãáÇ) dans le système verbal
français est exprimé par l'emploi du (passé
composé) comme le montre l'exemple plus haut « a fait
». Et dans le système verbal arabe par l'emploi de la
particule préverbale (qad+ Faala:
ãÇÊáÇ + ÏÞ) «
ÏÞá ÊßÓ » pour
marquer que l'événement est décalé avant le moment
de l'énonciation.
Donc, l'aspect accompli dans la langue française et la
langue arabe est toujours exprimée à l'aide de l'emploi des temps
du passé comme (le passé simple
/ØíÓÈáÇ
íÖÇãáÇ / le passé lointain/
ÏíÚÈáÇ
íÖÇãáÇ / le passé proche
ÈíÑÞáÇ
íÖÇãáÇ) .Mais aussi, nous trouvons que
ce n'est pas suffisant d'exprimer l'accompli par les temps du passé. Par
ailleurs, nous remarquons que les deux langues utilisent d'autres moyens
grammaticaux à titre d'exemple les adverbes de temps / les particules
préverbales ....
?L'emploi des adverbes de temps
(ÉíäãÒ äÆÇÑÞ)
qui marquent « l'aspect Accompli »
(ÉãÇÊáÇ
ÉåÌáÇ) :
L'accompli peut aussi indiquer par l'emploi « des
adverbes de temps (ÉíäãÒ
äÆÇÑÞ) » dans les deux langues,
comme dans l'exemple suivant135 :
Exp1: «.
ÉíÑæÏ äã Óã
Éáíá íäÖÞä
íÐáÇ ÞíÑáÇ í
ÊÑß »
« J'ai pensé au camarade qui m'a
sauvé hier soir de la patrouille ».
Pour résumer, selon les exemples qui nous avons
étudiés, nous pouvons déduire que « l'accompli »
dans les deux langues est exprimé par de multiples
procédés grammaticaux comme (Les particules
préverbales/les temps du passé/ Les adverbes de temps....).
D'ailleurs les deux langues se ressemblent en exprimant « l'aspect
accompli » sur le plan grammatical. Et dans cette perspective,
nous allons classer les convergences au niveau des procédés
134 Le Pain Nu : p105
135 Le Pain Nu, p 101
61
grammaticaux utilisés dans les deux langues en exprimant
« l'Accompli » dans un tableau comme suit:
|
La langue arabe en exprimant l'aspect
«
Accompli »
|
La langue française en exprimant
l'aspect
« Accompli »
|
|
1-l'utilisation du passé (El-Madhi :
íÖÇãáÇ et
ses dérivations)
|
1-l'utilisation du passé (Le passé et
ses
dérivations)
|
|
2-les adverbes de temps : qui
marque
l'antériorité par rapport au moment
de
l'enonciation.
|
2-les adverbes de temps : qui
marque
l'antériorité par rapport au moment
de
l'énonciation.
|
|
3-les verbes auxiliaires(Les
particules
préverbales)
|
3-Les verbes auxiliaries
|
?L'aspect inaccompli en (Fr) qui équivaut au
(ãÇÊáÇ
ÑíÛáÇ) en
(Arb):
En français, l'inaccompli est
exprimé par l'emploi de « formes verbales simples
». Celles-ci indiquent « la
continuité de l'action ». Et en arabe, cet aspect est
marqué par « la forme verbale simple (Yafaalu:
JÚí) » qui sert à exprimer une action
est « en cours de déroulement ».
?L'emploi du passé continu en (Fr) qui équivaut
au (ÑãÊÓãáÇ
íÖÇãáÇ) en (Arb):
Le passé continu ou
(ÑãÊÓãáÇ
íÖÇãáÇ ) sert à indiquer
que l'action est en cours de déroulement. En effet, nous remarquons que
dans le système verbal français, le passé continu est
employé le plus souvent avec (l'imparfait) comme un (temps simple
employé par une forme verbale simple). D'ailleurs, l'imparfait exprime
« l'aspect sécant ». Ce dernier
n'envisage pas les limites du procès (exprime le duratif). Et
dans la langue arabe, nous trouvons le passé continu (
ÑãÊÓãáÇ
íÖÇãáÇ ) est toujours employé
avec la particule préverbale (áÙ)
préfixée avant la forme verbale de (Yafaalu
)áÚí). Comme dans cet exemple :
Exp1:
íäãáÄí
íãÓÌ JÙ
« Mon corps n'arrêtait pas de me
faire mal ».
Donc, L'emploi du passé continu sert dans les deux
systèmes à présenter une action n'est
pas achevé. Autrement dit, une action qui a
commencé au passé et elle se prolonge encore au moment de
l'énonciation (le présent de l'énonciation).
62
?L'emploi du présent en (Fr) qui équivaut au
(ÑÖÇÍáÇ) en (Arb):
Le présent vise à exprimer dans les deux langues
une action qui se déroule au moment où le locuteur parle (Moment
de la parole). De cette manière le présent marque l'aspect «
inaccompli ». En outre, dans le système verbal français, le
présent est exprimé par une forme verbale simple et en arabe dans
la plupart des cas par la forme verbe (Yafaalu: áÚí) comme
dans les deux exemples suivants136 :
Exp1: 
ÍÇÊãáÇÈ
ÞáÛí
ÈÇÈáÇ
ÚãÓ
« J'entends la porte qui se ferme
par le clé »
Exp2: ÇåÏÓÌ í
äáÂÇ ÕÞÑí
äÇØíÔáÇ
« Le diable danse maintenant dans son corps
».
Par conséquent, nous constatons que le présent
(ÑÖÇÍáÇ) sert à exprimer
l'inaccompli, et son emploi vise à expliquer que l'action est en
déroulement au moment de l'énonciation (ME).
?L'emploi du futur en (Fr) qui équivaut au
(áÈÞÊÓãáÇ) en (Arb):
Le futur simple dans les deux systèmes verbaux est
indiqué pour souligner un fait qui se passera ultérieurement et
qui peut être dans un futur proche ou futur lointain. En outre, son
emploi dans le système verbal français est toujours marqué
par « une forme verbale simple ». Et dans le
système verbal arabe est indiqué par l'utilisation «
des particules verbales » à titre
d'exemple (sa (wfa) æÓ / le
(Syn)äíÓáÇ ) préfixées
avant la forme verbale de base (Yafaalu : )áÚí)
.Comme dans les exemples suivants137:
Exp1: íáÇíÎ í
ÉäÇÈáÌáÇÈ
ÌÇÌÏáÇ
áßÓ

« Je mangerai du poulet avec le petit pois
dans mon imagination »
Exp2:

íÏíÕÑ Ðäí ä
áÈÞ áæÇÍ
æÓ
« J'essaierai avant que mon solde ne soit
épuisé »
136 Le Pain Nu, p 86/131
137 Le Pain Nu, p 89/109
63
Dans ce cadre, nous ne déduisons que l'emploi du futur
(áÈÞÊÓãáÇ) exprime dans
les deux langues l'aspect Inaccompli (ãÇÊáÇ
ÑíÛáÇ). En plus, L'aspect inaccompli peut
être exprimé dans les deux systèmes linguistiques par les
aspects suivants (l'inchoatif/ L'itératif/ le Progressif/ le
Duratif...).
?L'aspect itératif en (Fr) qui équivaut au
(ÉÏÇÚáÇ
ÉåÌáÇ) en (Arb):
L'itératif dans les deux langues exprime «
l'inaccomplissement de l'action ». En effet, cet aspect vise
à exprimer une action itérative, habituelle. Par ailleurs, dans
le système verbal du français, cette itération est
exprimée notamment par l'emploi de l'imparfait d'habitude. Cet
emploi est associé comme le présent, notamment avec
l'illustration « des adverbes de temps » qui servent
à souligner (la fréquence). Et dans la langue
arabe, l'itératif est employé par la particule préverbale
de (Kana: áÚí + äÇß) et
l'association « des indicateurs temporelles » pour renforcer
la valeur de « répétition » comme dans cet
exemple138 :

Exp1:
ÁÇÓã áß
ÏæÚí íÈ
äÇß
«Mon père revenait tous les soirs
»
Conséquemment, l'aspect itératif dans les deux
systèmes verbaux sert toujours à marquer «
l'inaccomplissement de l'action » et son
déroulement d'une « manière fréquente
».
?L'aspect inchoatif en (Fr) qui équivaut au
(ÏÈáÇ ÉåÌ) en (Arb):
L'inchoatif (ÏÈáÇ
ÉåÌ) dans les deux langues annonce le «
déclenchement de l'action ». En effet,
l'inchoatif est défini comme : « l'expression du commencement
de l'action139 », c'est-à-dire « saisit le
procès immédiatement à son début
140». À cet égard, nous trouvons l'inchoatif
dans le système verbal du français exprimé par les deux
formules suivantes (se mettre à+v.inf/ commence
à+v.inf), et dans le système de l'Arabe par un verbe
comme (ÏÈ/ ÐÎ) qui est
préfixé avant la forme verbale de base (Yafaalu
áÚí) en citant à ce propos l'exemple
suivant141 :

Exp1:
äÇßÏáÇ í íã
ÏÚÇÓ ÊÏÈ
« J'ai commencé à aider ma
mère dans le magasin »
Donc, l'inchoatif soit en français soit en arabe toujours
garde sa valeur aspectuelle comme un aspect qui mentionne « le
commencement de l'action » et l'aspect «
inaccompli ».
138 Le Pain Nu, p26
139 Marque Pucheu 1998,236.
140 Riegel et al 1994,295.
141 Le Pain NU, p 81
64
?L'aspect Progressif en (Fr) qui équivaut au
(íÌíÑÏÊáÇ) en (Arb):
Le Progressif dans les deux systèmes linguistiques sert
à montrer que l'action est « en cours de
déroulement ». Et nous trouvons le progressif se
manifeste en deux sortes dans le système verbal du français. D'un
côté, le progressif peut se manifester par cette périphrase
aspectuelle (être en train de +v.inf) .Et de
l'autre côté, le progressif ou(le durat if142 ) peut
être exprimé par l'emploi de « l'imparfait
» qui marque « la continuité de l'action
».Et en arabe, cet aspect est développé par les
deux verbes (áÙ) /
(áÇÒÇã) qui sont
préfixés avant la forme verbale de base (Yafaalu:
áÚí) comme dans les deux
exemples suivants143:

Exp1:
ãæÄÔãáÇ
ËÏÇÍáÇ äÚ
ËÏÍÊä
ÇäááÙ
« Nous n'arrêtions de parler du
malheureux accident » Exp2...
åÊÞæ ãÙÚã
íÖÞí áÇÒÇã
íÈ
« Mon père passait encore la plupart
de son temps dans le café »
Donc, l'aspect progressif de façon
générale dans les deux langues sert à exprimer la
continuité et l'inaccomplissement de
l'action.
En ajoutant aussi que, l'aspect inaccompli dans les deux
langues peut être exprimé par
l'emploi « des adverbes temporels
» qui servent à situer l'action dans un moment
précis. Et dans ce cadre nous illustrons ces exemples144
comme suit:

Exp1: ÇåÏÓÌ
í äáÂÇ
ÕÞÑí
äÇØíÔáÇ
« Le diable danse maintenant dans son corps
»
Exp2: 
ãÇí
ÉËáÇË ÏÚÈ
ßÇäå
íÞÊáäÓ
« Nous retrouverons là-bas après
trois jours »
Exp3:

ÉÌäØ ìáÅ
ÇÏÛ ÑÇÓ æÓ
« Je voyagerai demain à Tanja ».
142 L'aspect progressif est nommé par Marc Wilmet (aspect
Duratif): grammaire critique du français 2003.
143 Le Pain Nu, p 131/70
144 Le Pain Nu, p 86
65
Pour conclure, nous avons constaté qu'il s'agit de
nombreux points de convergences entre les deux langues l'Arabe et le
Français. Du fait que les deux langues ont effectivement réussi
à exprimer l'aspect du point de vue formel
en s'appuyant quasiment sur les mêmes outils formels. Et
dans cette perspective, nous voudrions aussi à mettre l'accent sur les
convergences entre les deux langues en exprimant l'aspect du point de vue
lexical.
2.1-Les convergences sur le plan lexical:
2.1.1-Le critère de dynamicité en (FR) qui
équivaut au Éíßí-41-1:1 11 J 4-4 en
(Arb):
Nous avons remarqué que les deux langues ont
adopté « le critère de
dynamicité145 » dans la classification
lexicale des verbes. En effet, la langue française a suivi cette
dynamique et elle classifie les verbes en quatre types comme suit (verbes
d'Etat/ verbes d'Activité/verbes d'Accomplissement/verbes
d'Achèvement). Par ailleurs, la langue arabe applique aussi la
même classification, parce qu'il s'agit des verbes arabes (+ dynamique)
et d'autres (dynamique) et dans ce contexte nous pouvons trouver en arabe
(ÉäßÇÓáÇ
áÇÚáÇ/ÉíßÑÍáÇ
áÇÚáÇ/
ÊÇãÇãÊáÅÇ
áÇÚ/
áÇãÊßáÅÇ
áÇÚ).
?Les verbes d'état en (Fr) qui équivaut au
ÉäßÇÓáÇ
áÇÚáÇ en (Arb):
Les verbes d'état
(ÉäßÇÓáÇ
áÇÚáÇ) sont un type sémantique du
verbe dont le procès indique que son sujet possède une «
certaine propriété particulière »
à titre d'exemple (L'état/ Le devenir/ la
façon d'être). Généralement ils n'expriment aucune
action, ni progression comme le montre l'exemple suivant146 :
Exp1: íã íá
ÇåÊÕæ íÊáÇ
áæÞÈáÇ 41i49
« J'ai trouvé les
légumineuses que ma mère m'a décrits ».
?Les verbes d'activité en (Fr) qui équivaut au
ÉíßÑÍáÇ
áÇÚáÇ en (Arb):
Les verbes d'activité
(ÉíßÑÍáÇ
áÇÚáÇ) sont un type sémantique du
verbe dont le procès
indique un acte, une
opération ou une
activité. Egalement, ce sont des verbes (-
ponctuel) comme dans cet exemple147 :
Exp1: áãÑáÇ
æ ÑÍÈáÇ
ÈáÇÍØÈ
íãÓÌ J,}ql
ÊÏÈ

« J'ai frotté mon corps avec des
algues de la mer et du sable ».
145 Voir chapitre II de ce document: Z.Vendler: critère de
dynamicité.
146 Le Pain Nu, p 17
147 Le Pain Nu, p 102
66
?Les verbes d'accomplissement en (Fr) qui équivaut au
ÊÇãÇãÊáÅÇ
áÇÚ en (Arb):
Les verbes d'accomplissement expriment que
l'événement « commence à se produire
».
Mais le point de commencement et le point de l'accomplissement
sont approximativement « proches »
(äíÈÑÇÞÊã)
comme dans cet exemple148 :
Exp1: ÑÎáÇ
íÕÑáÇ ìáÅ j..iai
Êäß
« Je traversais vers l'autre trottoir
».
?Les verbes d'achèvement en (Fr) qui équivaut au
áÇãÊßáÅÇ
áÇÚ en (Arb):
Les verbes d'achèvement présentent le
résultat final de l'action. Du fait que , le procès
est
« terminé » ou «
achevé »
(ìåÊäÇ ËÏÍáÇ).
Comme dans l'exemple suivant149 :

Exp1: «
áÓÚãáÇ
ÒÈÎáÇ
íäÊLei »
« Elle m'a donné du pain au miel
».
2.1.2 - Les verbes perfectifs et
imperfectifs:
?Les verbes perfectifs en (Fr) qui équivaut au
ÉÒÌäãáÇ
áÇÚáÇ en (Arb):
Les verbes perfectifs
(ÉÒÌäãáÇ
áÇÚáÇ) sont exprimés comme des verbes
ponctuels qui portent en eux-mêmes une limitation
temporelle. En effet, ils indiquent le résultat final du
procès et servent à présenter ce dernier comme totalement
coupé du présent énonciatif. Dans ce cadre nous citons ce
qui a mentionné David Cohen dans son ouvrage «l'aspect verbal»
concernant le perfectif : « résultatif qui ajoute la notion
supplémentaire de terme au sens du verbe150 » comme
dans montre les deux exemples suivants151 :
Exp1: 
ÉÇÊ äÐ í
ÈÇÔ Lie
« Un jeune home a chuchoté dams
l'oreille de la fille ».
Exp2:

æíÏÇÑáÇ
ÍÊ
« Il a ouvert le radio ».
148 Le Pain NU, p 23
149 Le Pain NU, p 27
150 David Cohen: L'Aspect Verbal p 185.
151 Le Pain Nu, p86/107
67
?Les verbes imperfectifs en (Fr) qui équivaut au
(ÉÒÌäã ÑíÛáÇ
áÇÚáÇ) en (Arb):
Les verbes imperfectifs envisagent l'action dans
sa durée. En outre, ils présentent l'action comme
« un processus152 »
en cours de déroulement. L'imperfectif est
définit par David Cohen comme suit: « L'aspect imperfectif ou
duratif ou continu qui exprime l'action dans sa durée ininterrompue ou
sa continuité153 ». Comme dans les exemples
suivants154:
Exp1: æØÊ
æ ÕæÛÊ
« Elle plongeait et flottait
comme un canard ».

Exp2: ÉßãÓ
áËã ÍÈÓÊ
« Elle nageait comme un poisson ».

Exp3: áÇáÇÛ
æ ÇÑÖÎ
íÑÊÔÓ
« J'achèterai des légumes et
des fruits ».
2.1.3 Les interprétations contextuelles en (Fr)
qui équivalent au (
ÉíÞÇíÓáÇ
ÊÇÑíÓÊáÇ ) en
(Arb):
Les interprétations contextuelles
(ÉíÞÇíÓáÇ
ÊÇÑíÓÊáÇ) sont des moyens
lexicaux qui sont constitués autour du contexte et qui servent à
donner des valeurs temporelles et aspectuelles à la fois. Et parmi ces
moyens nous pouvons citer comme exemples (les adverbes de temps/
les périphrases aspectuelles/ la dérivation
affixale ...).
?Les adverbes de temps en (Fr) qui équivaut au
(ÉíäãÒáÇ
áÇæÍáÇ) en (Arb):
Les adverbes de temps
(ÉíäãÒáÇ
áÇæÍáÇ) indiquent la manière
dont l'action exprimée par le verbe est envisagée dans sa
durée, son développement ou son achèvement comme le
montrent les exemples suivants155 :
Exp1: ÈÍÊäÊ
ÇåÊíÑ íÈ ÌÑÎ
äíÍ
« Quand mon père est sorti, je l'ai
vue sangloter ».
Exp2: ìÑÎ
ÊÇãáÇÚ
ÈßÑãáÇ äã
ÊáÓÑ ÊãÕáÇ
äã ÉÚÇÓ
ÚÈÑ íáÇæÌ
ÏÚÈ
152 David Cohen , L'aspect verbal p 55.
153 David Cohen, L'Aspect Verbal p185.
154 Le Pain NU, p 34/18
155 Le Pain Nu, P90
68
« Après environ un quart d'heure de
silence d'autres signes ont été envoys depuis le bateau
».
Exp3:
ÆØÇÔáÇ ÉÇÍ
ìáÅ ÞÑæÒáÇ
äæÚÏí
ÇæÐÎ
« Ils ont commencé de pousser le
bateau au bord de la mer » .
Et dans ce cadre, nous proposons le tableau suivant pour indiquer
la valeur aspecto-temporelle de chaque
adverbe de temps utilisé dans les exemples qui
précedent:
|
Les adverbes Aspecto-temporels
utilisés
|
La valeur Aspecto-temporelle des adverbes
utilisés
|
|
Quand en (Fr) Qui équivaut au äíÍ en
(Arb)-
|
L'emploi de l'adverbe (Quand : äíÍ) sert
à
marquer la valeur de « simultanéité/
la
correspondance temporelle »
|
|
Après environ un quart d'heure en (Fr) Qui-
équivaut au ÉÚÇÓ ÚÈÑ
íáÇæÌ ÏÚÈ en (Arb)
|
L'emploi de cette locution adverbiale (Après environ un
quart d'heure ÉÚÇÓ ÚÈÑ
íáÇæÌ ÏÚÈ) sert à
exprimer la valeur « de Postériorité »
|
|
Ont commencé de pousser en (Fr) Qui- équivaut au
äæÚÏí ÇæÐÎ en (Arb)
|
L'emploi de cette périphrase aspectuelle (ils
ont commencé de pousser
äæÚÏí ÇæÐÎ)
sert à
marquer « Le commencement de l'action »
|
?L'emploi de périphrases Aspectuelles en (Fr) Qui
équivaut au ÉíåíÌáÇ
ÊÇÑÇÈÚáÇ en (Arb) :
Les périphrases aspectuelles
(ÉíåíÌáÇ
ÊÇÑÇÈÚáÇ) visent
à exprimer la manière par laquelle nous voyons l'action. En
outre, les périphrases verbales (Aspectuelles) sont
exprimées par une forme verbale complexe dans les deux systémes
verbaux. De plus, cette forme complexe constituée d'un semi-auxiliaire
conjugué et d'une forme non conjugué (verbe à l'infinitif)
dans le but d'indiquer l'état de l'action (commencement
ÏÈ / déroulement äÇÑæÏ /
achèvement ÁÇåÊäÅ ).
Comme dans les exemples suivants156:
156 Le Pain Nu, p 35
69
Exp1:
ÌäÑØÔáÇÈ
ÈÚááÇ ÊÏÈ
ÇãÏäÚ
« Quand j'ai commencé de jouer par
le domino ».
Exp2: ÉÌäØ ìáÅ
íÑÓ ÈÆÇÞÍ
ÏÇÏÚÅ ÏÏÕÈ
íääÅ
« Je suis en train de préparer mes
sacs de voyage à Tanger ».
Exp3: ÑæØáÇ
áæÇäÊ äã
ÇäíåÊäÇ
ÇãÏäÚ « Quand nous avons
fini de déjeuner ».
Dans ce contexte, nous allons classifier les périphrases
aspectuelles précédentes dans le tableau suivant pour exprimer la
valeur aspectuelle de chaque périphrase verbale utilisée:
|
Les périphrases Aspectuelles utilisées
:
ÉãÏÎÊÓãáÇ
ÉíåíÌáÇ
ÊÇÑÇÈÚáÇ
|
La valeur aspectuelle de chaque périphrase
verbale utilisée : ÉíáÚ
ÉÛíÕ áßá
ÉíåíÌáÇ
ÉãíÞáÇ
ÉãÏÎÊÓã
|
|
- J'ai commencé de jouer en (Fr) Qui équivaut
au (ÈÚááÇ
ÊÏÈ) en (Arb)
|
La valeur aspectuelle de cette périphrase
est :
« Le déclenchement de l'action »
ËÏÍáÇ
ÉíÇÏÈ
|
2- Je suis en train de préparer en (Fr) Qui
équivaut en (ÏÇÏÚÅ
ÏÏÕÈ) en (Arb)
|
La valeur aspectuelle de cette périphrase est
« la progression de l'action »
ËÏÍáÇ ÌÑÏÊ
|
3- Nous avons fini de déjeuner en (Fr) Qui
équivaut au (áæÇäÊ äã
ÇäíåÊäÇ) en (Arb)
|
|
La valeur aspectuelle de cette périphrase est
« L'achèvement de l'action
ËÏÍáÇ ÉíÇåä
|
|
?La dérivation Affixale en (Fr) qui équivaut au
ÞÍáÇáÇ
ÞÇÞÊÔáÇÇ en (Arb):
La dérivation est un phénomène
grammatical qui semble comme « un processus fondamental
», qui vise à enrichir le register lexical de deux
langues .En effet, la dérivation confère naissance d'un nouveau
mot qui est déjà dérivé de la forme de base.
À cet égard, nous pouvons dire que dériver c'est de tirer
une expression nouvelle d'une autre expression par
70

suffixation ou préfixation. Ce phénomène
linguistique a joui un rôle important puisqu'il peut marquer la valeur
aspectuelle d'une forme verbale. Comme dans les exemples suivants157
: Exp1: Je revoyais le jardin d'Ain
Khabbaz.
« Dérivation par Préfixation
(Re) ».
Exp2: Je me débrouillais très
bien. « Dérivation par Préfixation
» (Dé).
Exp3:

Je retournai à Tétouan. «
Dérivation par Préfixation
»(Re).
Dans cette perspective, nous remarquons que dans les trois
exemples précédents (1/2/3),
la forme verbale de base est assujettie à
la dérivation préfixale. Mais, les
formes dérivées gardent la même valeur aspectuelle de la
forme de base.
-Voyais: l'aspect
inaccompli

« Revoyais »: L'aspect
inaccompli -Brouillais: L'aspect
inaccompli

« Débrouillais »: L'aspect
inaccompli -Tournai: L'aspect
inaccompli
« Retournai »: l'aspect
inaccompli
157 Le Pain Nu, p 100/85
71
Donc, nous constatons que dans l'exemple (1) la forme verbale
de base est exprimée à l'inaccompli, c'est à dire l'action
est durative. En d'autres termes, nous déduisons qu'avec l'addition de
(Re) préfixée juste avant
la forme de base a changé le sens du verbe
et non pas sa valeur aspectuelle. Du fait que cette
forme dérivée insiste sur l'idée de
répétition (L'itération
/ la fréquence).Et dans
l'exemple (2) l'ajout de (Dé)
préfixée avant la forme de base,
nous obtenons le contraire du mot de base sans toucher la valeur
aspectuelle de la forme principale et dans le dernier exemple, nous constatons
qu'avec la préfixation nous avons expliqué la valeur aspectuelle
(d'itération/ d'habitude) à coté de la valeur de
l'inaccomplissement. Et dans ce contexte, nous déduisons que la
préfixation dans les trois exemples ne joue aucun rôle, car les
verbes de base comme les verbes dérivés sont
généralement du même type aspectuel. D'ailleurs, dans la
langue arabe aussi, nous trouvons la forme verbale de (Faala :
áÚ) par exemple vise à exprimer toujours l'accompli.En
effet, cette forme de base peut être dérivée à
d`autres formes verbales. Malgré cette opération
dérivationnelle les formes dérivées gardent le plus
souvent la valeur aspectuelle de la forme radicale comme dans les exemples
suivants158 :
Exp1: ÁæÏåÈ
ÁÇãáÇ ÛÑí
ÞØ æ ÉÈáÚáÇ
ßÓã
(áÚ)
« Il a pris la canette et il commence à vider
lentement l'eau ».
Exp2:
äíÏÑÔÊãáÇ
ÉÈÍÕ ÈæÑÏáÇ
í ãæäáÇÈ
ÚÊãÊÓÅ
« Je me suis plu de dormir dans la rue avec les vagabonds
».
Exp3: ÑÕäÇ æ
ãÓÊÈÇ
(áÚäÇ)
« Il a souri et il est parti ».
Donc, nous constatons à travers les exemples qui
précédent, que la forme verbale de base
(Faala: áÚ) qui sert à
exprimer « L'accompli ». Cette forme est assujettie
à la dérivation
158 Le Pain Nu, p 25/36/43
72
préfixale, puisque, la forme verbale
de base (JÚi) est dérivée à
d'autres formes verbales entre autres ((JÚiÇ)
(JÚ1) (JÚÊÓi)). Et malgré cette
opération dérivationnelle, les formes dérivées
gardent la même valeur aspective de la forme radicale
(JÚi) c'est-à-dire la valeur de l'accompli
(É_4ÊIÇ Éå~IÇ).
En somme, l'aspect apparaît dans les deux langues
étroitement lié au temps, de sorte que le les deux notions jouent
un rôle essentiel dans la détermination temporelle de
l'événement. D'ailleurs, le temps et l'aspect dans les deux
systémes verbaux peuvent être expimés au niveau Formel
de différentes manières, c'est-à-dire non pas
seulement par la « forme verbale » mais aussi par d'autres
moyens grammaticaux qui accompagnent le verbe dans l'énoncé
à titre d'exemple l'emploi de particules préverbales en arabe et
les semi-auxiliaires en français. En effet, les particules
préverbales et les semi-auxiliaires peuvent donner des valeurs à
la fois temporelles et aspectuelles. De plus, l'ajout des adverbes de temps qui
servent à situer l'événement dans un moment précis.
Et au niveau lexical par le sens du verbe lui-même ou
l'environnement contextuel. Et malgré cette convergence entre les deux
systémes aux niveaux formels et lexicaux, nous remarquons qu'il existe
également des divergences ce que nous efforcerons de mettre en
évidence dans notre deuxième partie en s'accentuant à ce
propos sur les deux plans « Formel et lexical ».
73
2-Les divergences entre les deux systèmes
verbaux:
2.1-Les divergences sur le plan grammatical:
ÉíáßÔáÇ
ÉíÍÇäáÇ äã
ÊÇáÇÊÎáÇÇ
Dans la première partie de ce chapitre, nous avons
étudié les convergences entre les deux systèmes verbaux
concernant l'étude de l'aspect sur les deux plans (formel et lexical).
Mais après avoir les propriétés de chaque système
de deux, nous trouvons qu'il avait aussi de nombreuses divergences. Cela est
dû aux origines différentes de chaque langue. En effet, la langue
française est une langue d'origine romane et la langue arabe est une
langue d'origine sémitique et le fait que ces deux langues
n'appartiennent pas aux mêmes familles linguistiques nous faisons penser
aux divergences.
2.1.1-Les concepts Temporels divergents:
ÉáÊÎãáÇ
ÉíäãÒáÇ
ãíåÇãáÇ
L'expression de la « Temporalité »
diffère dans les deux systèmes linguistiques. En effet, le
système verbal du français se distingue par sa richesse
morphologique. Cette richesse morphologique est assurée par la
multiplicité des marqueurs temporels. D'ailleurs, le système
flexionnel en français comporte une forme de conjugaison pour chaque
temps, alors que le système verbal arabe dispose uniquement deux
paradigmes temporels et aspectuels à la fois, c'est-à-dire nous
conjuguons un verbe par un paradigme de deux soit l'accompli ou l'inaccompli.
C'est pour cela, nous trouvons que l'expression de la temporalité en
arabe n'existe pas comme dans le système du français. Puisque, la
notion du temps en arabe n'existe pas pour elle-même mais pour ses
proprieties. C'est pour cela nous avons constaté que la morphologie des
formes verbales en arabe est le plus souvent indiquée selon les deux
grands paradigmes qui sont « L'accompli et L'inaccompli »,
c'est-à-dire « íåÊäã
ÑíÛáÇ æ
íåÊäãáÇ » ou le premier sert
à exprimer le passé avec ses dérivés et le second
vise à indiquer simultanément le présent et le futur avec
ses dérivés. Par ailleurs nous trouvons que ces deux formes
verbales se construisent sur un même radical « lexème »
avec quelques modifications de (voyelle ou consonne / préfixe ou
suffixe) dans le but d'exprimer (le genre / la personne / le temps..). Et dans
cette perspective, nous allons proposer deux schémas pour clarifier
cette différence au niveau de l'expression de la temporalité
entre les deux systèmes verbaux.
74
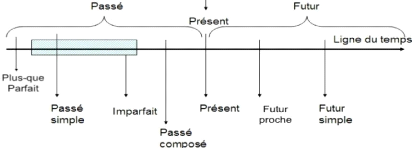
Schéma8159: «
Répartition des temps verbaux en Français »
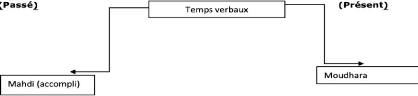
Schéma9160: «
Répartition des temps verbaux en Arabe »
Selon les deux schémas qui précédent,
nous constatons plus vite cette différence radicale entre les deux
systèmes linguistiques au niveau de l'expression de la
temporalité. En fait, le système du francais est très
riche morphologiquement grâce à la diversité des temps
verbaux. Et il est très remarquable aussi d'observer le grand
écart qui existe notamment entre les formes du temps et leurs marqueurs
morphologiques. Tandis que le système de l'Arabe ne montre que deux
marqueurs de temps à savoir les deux paradigmes. En commençant
par l'accompli qui renvoi principalement au passé : {El-Madhi} et
deuxiémement l'inaccompli qui englobe le présent et le futur :{
El-Moudharaa}. Dans ce cadre, nous allons expliquer cette différence en
ce qui concerne la structure temporelle dans les deux systèmes dans ce
tableau qui comporte des structures temporelles en arabe et français
.
·
159 Le conjugueur.le Figaro.fr
160
http://aleph.edinum.org/1417
75
|
La structure temporelle de l'arabe
|
La structure temporelle du français
|
|
-Le verbe (Faala áÚ ) v. Accompli
(ãÇÊ áÚ)
|
-Il a fait / Il fit Le passé composé
+ le passé simple.
|
|
-V. Kana+v. Inaccompli
(áÚí ãÇÊ
ÑíÛ áÚ + äÇß
áÚáÇ)
|
-Il Faisait L'imparfait
|
|
-La particule préverbale (qad) +v. accompli
(ãÇÊ áÚ +ÏÞ)
|
-Il a fait / il fit / il avait fait le plus
que parfait /le passé simple/ le
passé
composé
|
|
-V. kana +la particule (qad) +v. accompli
(áÚ ãÇÊ áÚ+
ÏÞ+ äÇß áÚáÇ)
|
-Il avait fait / Il eut fait Le plus que
parfait / le passé antérieure
|
|
-La forme verbale (Yafaalu : áÚí) v.
inaccompli
(ãÇÊ ÑíÛ
áÚ)
|
-Il fait le présent
|
|
-La particule (Syn / Sa (wfa)) +v. Inaccompli
(ãÇÊ ÑíÛ áÚ
+æÓ/ äíÓáÇ)
|
-Il fera le futur simple
|
Nous déduisons selon le tableau
précédent, que la langue arabe est fondée sur un
système un peu complexe, car le système verbal de l'Arabe exprime
les temps verbaux à l'aide des particules verbales. Ces particules sont
le plus souvent trouvées avant la forme verbale de base qui peut
être à l'accompli
(íåÊäãáÇ) ou à l'inaccompli
(íåÊäã ÑíÛáÇ).
Contrairement au système verbal du français qui est plus strict
au niveau de la détermination temporelle par rapport à l'arabe
.D'ailleurs le linguiste Marcel Cohen a ajouté en ce qui concerne la
notion du temps en arabe : « Il s'y rencontre deux formes qu'on
dénomme en général d'une manière impropre des
temps, ces deux formes servent à distinguer deux aspects de l'action
l'accompli et l'inaccompli 161» et dans le même sens
David Cohen a déclaré : «De manière
générale, le contexte au sens le plus général du
terme peut fournir par lui même les indications d'ordre temporel et
permette éventuellement de référer le procès
à un moment ou une situation données162 » .
Et par conséquent, nous constatons que le temps dans la langue arabe
n'avait pas une place importante par contre, dans la langue française le
temps se manifeste comme un pilier fondamental de son système verbal.
161 Marcel Cohen, Chapitre II,
162 David Cohen, L'Aspect Verbal, p183.
76
2.1.2-Les concepts aspectuels divergents:
ÉáÊÎãáÇ
ÉíåíÌáÇ
ãíåÇãáÇ
À la lumière de ce que nous avons vu
précèdemment, nous remarquons que les deux langues ne suivent pas
les mémes démarches sur le plan formel pour exprimer l'aspect du
verbe. En effet après avoir décrit le système verbal du
français qui se caractérise essentiellement par le grand
écart qui existe entre les notions de temps et leurs marqueurs formels
comme par exemple le passé qui englobe (Le passé simple! le
passé composé! le plus que parfait ..) quant au futur (le futur
simple ! le futur antérieur). Et seulement le présent
apparaît unique dans ce système linguistique. Cela nous fait
comprendre que le système verbal du français est
caractérisé notamment par la richesse des marqueurs du temps,
parce qu'à l'intérieur d'une même notion nous trouvons
plusieures formes différentes. De plus, la notion d'aspect en
français est liée étroitement par celle du temps. Du fait
que, l'étude de l'aspect comme une catégorie grammaticale est le
plus souvent exprimée à l'aide de la détermination
temporelle et nous trouvons également que les temps composés avec
leurs formes verbales composées marquent toujours «
l'aspect accompli » et les temps simples avec
leurs formes simples expriment « l'aspect inaccompli
». Alors que le système verbal de l'Arabe est
totalement différent du français, puisque le système
verbal de l'Arabe repose principalement sur deux grands paradigmes de nature
purement « aspective » qui sont «
L'accompli et L'inaccompli ». Et à ce
propos nous pouvons citer ce qui a déclaré David Cohen dans son
ouvrage concernant le système verbal arabe: «Ainsi dans son
fonctionnement, le système verbal de l'arabe classique se manifeste
fondamentalement dans une opposition simple, celle de l'accompli à un
inaccompli, il apparait fondé sur la pure expression de
l'aspect163.. ». Et par conséquent,le verbe arabe
ne présente à l'indicatif que deux formes verbales celle de
(Faala : JÚ ) avec l'accompli et celle de
(Yafaalu : JÚí ) avec l'inaccompli et les formes
verbales de l'arabe ne paraissent pas déterminées par le temps
comme les formes verbales du français, puisque le système verbal
de l'arabe exprime la notion de temps et le nuances temporelles grâce aux
particules préverbales et aux adverbes de temps ou l'accompli porte une
valeur (de passé : El-Madhi) et l'inaccompli a une valeur de
(présent ! futur : El-Moudharaa). Ce qui sert à marquer que
chacune de trois époques (passé ! présent!futur) se
trouver simultanément couverte par les deux seules formes verbales de
(l'accompli : JÚi) et de (l'inaccompli : JÚí) et dans ce
cadre nous citons ce qui a mentionné Fleisch concernant l'expression de
l'aspect dans le système verbal arabe:
163 David Cohen, L'Aspect Verbal p91.
77
La forme du verbe arabe est suffisant de nous montrer
c'est
l'action est achevé ou en cours de
déroulement sans tenir compte dans ce contexte à la relation qui
existe entre la temporalité du procès et le locuteur, l'arabe
pour lui est une langue aspective ou elle sert à exprimer les
différents temps à partir de les formes verbales
164 .
?L'accompli et L'inaccompli en (Fr) ?
íåÊäã ÑíÛáÇ
æ íåÊäãáÇ en (Arb):
Ces deux aspects sont exprimés différemment dans
les deux systèmes verbaux, puisque l'Arabe exprime l'accompli et
l'inaccompli par des conjugaisons distinctes du même verbe (même
lexème), c'est-à-dire par la conjugaison suffixale ou
préfixale du même verbe et à ce propos nous pouvons citer
ce qui a mentionné David Cohen dans son ouvrage l'aspect verbal:
« Le système verbal de l'arabe classique est
d'une absolue régularité à cet égard.
Structuralement dans tous les types de verbes, l'opposition inaccompli-accompli
se marque pareillement par la différence des thèmes par la place
et par la forme des autres morphèmes165 ».
Par contre le système verbal du français exprime
l'accompli et l'inaccompli notamment par les formes verbales composées
et les formes simples des temps comme dans les exemples suivants166
:
Exp1: ÉÑÇÌÊáÇ
ÞíÑØ
ÊßáÓ
[J'ai pris la route commerciale].
Exp2: ÉÐÇäáÇ äã
Ê ááØ æ
ÊÖåä
[Je me suis levé et j'ai
regardé par la fenêtre] .
Donc, selon les deux exemples qui précedent, l'accompli
(íåÊäãáÇ) est exprimé
à l'aide de « la conjugaison suffixale
» avec la forme verbale de (áÚ) qui vise
à exprimer « l'accomplissement de l'action
» (,4iiÇ
ËÏÍáÇ ). Néanmoins au
français, l'accompli est exprimé principalement par «
les formes verbales composées »
qu'indiquent « l'accomplissement de l'action
» dans le passé. Comme dans les deux exemples
suivants.
164 Fleisch, L'arabe classique: Esquisse d'une structure
linguistique /Beirut Dar El Mashreq, 1968, p111.
165 David Cohen, L'Aspect Verbal, p32.
166 Le Pain NU, p 90
78
Exp1167 : Il m'avait
parlé de cet homme. Exp2168 : Je ne
l'ai pas vu la frapper.
De même, L'accompli dans le
système verbal arabe peut être indiqué par l'utilisation
« des particules préverbales
» qui sont préfixées avant la forme verbale de
base (áÚ) comme dans les exemples
suivants169 :
Exp1: ÉÇÊáÇ äÐ
í Óãå ÏÞ
äÇß
{Il a chuchoté à l'oreille de la fille}.
Exp2: åÚã
ÊßÑÇÚÊ ÏÞ
{Je me suis battu avec lui}.
Nous remarquons selon les exemples plus haut, que l'accompli
en arabe est exprimé par l'ajout de « particules
verbales » qui sont préfixées avant la forme
de base comme le montrent les exemples précédents. En
commençant par l'exemple (1), la valeur d'accompli est indiquée
par cette composition (V. kana +la particule (qad) +v.
accompli) et dans l'exemple (2) par (La particule
préverbale (qad) +v. accompli). Et par conséquent,
nous déduisons que chaque langue a son propre style pour exprimer
l'accompli et aussi pour exprimer l'inaccompli comme le montrent les exemples
suivants170 :
Exp1: åÓÑ ÇÖÇÎ
ÊãÕ í äÎÏí
ÈÇÔáÇ
äÇß
{Le jeune homme fumait en silence, baissant la tête}.
Exp2: åÑÞí
Çã ìáÅ
ÏÇæÑáÇ áß
íÛÕí æ
æíÏÇÑáÇ
ìåÞãáÇ ÈÍÇÕ
ÊßÓí
{Le propriétaire du café coupe le radio et tous
les convives écoutent ce que lit}.
Exp3: äÌÓáÇ
ìáÅ
íääæÏíÚí
ÏÞ
{Ils pourraient me ramener en prison}.
Exp4: ãáÇÓÈ
áÕä ä
áæÇÍäÓ
{Nous essaierons d'arriver en toute sécurité}.
167 Le Pain NU, p 93
168 Le Pain NU, p 87
169 Le Pain Nu, p86
170 Le Pain Nu, P 13/25/28/80.
79
Exp5: ÉÌäØ
ìáÅ ÇÏÛ ÑÇÓ
æÓ
{Je voyagerai demain à Tanger}.
Nous remarquons à travers les exemples
précédents, que l'inaccompli en arabe est exprimé par
multiples manières. En effet, nous remarquons dans l'exemple (1)
l'inaccompli est souligné par l'emploi du verbe
(Kana:äÇß) + un verbe inaccompli (Yafaalu :
áÚí). Et dans l'exemple (2) par l'emploi de
trois verbes à la forme verbale (Yafaalu :
áÚí) qui porte la valeur de présent
(l'instantanéité). De plus, dans
l'exemple (3) la particule préverbale (qad : ÏÞ)
est employée avec un verbe inaccompli (Yafaalu
: áÚí) et dans l'exemple (4) nous insistons
particulièrement sur l'emploi de (Syn :
äíÓáÇ) préfixée
juste avant la forme verbale de base (Yafaalu :
áÚí) qui renvoie au futur et à
l'inaccomplissement de l'action (íåÊäã
ÑíÛáÇ). Et dans le dernier exemple la valeur
de l'inaccompli est exprimée par la particule verbale (sa
(wfa) : æÓ) fixée avant la forme de base
(Yafaalu : áÚí). En
conséquence, nous déduisons que la langue arabe semble capable
à exprimer l'inaccompli par de nombreux
procédés grammaticaux soient par l'emploi d'une forme verbale
simple, unique comme (Yafaalu :
áÚí) ou par l'emploi des particules verbales
qui sont trouvées employer avant le verbe (la forme de base). Ainsi que
cette forme de base (JÚí) peut
être dérivée en d'autres formes verbales à titre
d'exemple (Tafaala : áÚÇÊ / Faalala :
ááÚ) (voir chapitre II, p45). Et ces formes
verbales gardent toujours» l'aspect» de la
forme verbale de base. Dans ce cadre nous pouvons citer ce qui a affirmé
David Cohen concernant le système verbal de l'arabe :
Comme tout lexème, une forme verbale est toujours
fondée, en
arabe sur ce qu'on appelle une racine, c'est-à-dire
une base commune à l'ensemble du paradigme. Elle est constituée
dans l'immense majorité des cas par trois consonnes parfois par
quatre.la forme verbale
inclut cette racine dans une unité complexe qui comprend en outre divers
morphèmes représentent les marques propres par lesquelles elle
est identifiées171...
En comparant le système verbal de l'Arabe par le
système verbal du français, nous trouvons
que ce dernier exprime « l'inaccompli
» notamment par l'emploi « des formes
verbales simples » qui renvoient aux temps simples. Comme
dans les trois exemples suivants172:
171 David Cohen, L'Aspect Verbal p 31/32.
172 Le Pain NU, p 33/25/55
80
Exp1:
Ce travail me faisait vivre l'aventure.
{F.V.S}: « L'emploi de L'imparfait
».
Exp2: On frappa à La Porte.
{F.V.S}: « L'emploi de futur
simple ».
Exp3: Tu gardes le secret de notre affaire.
{F.V.S}: « L'emploi de présent
».
En définitive, nous constatons à partir de ce que
nous avons vu précédemment, qu'il s'agit
d'une nette divergence entre les deux systèmes
linguistiques comme le montre le tableau suivant en ce qui concerne les points
de divergences entre l'arabe et le français:
|
Le système Arabe
|
Le système Français
|
|
Les points de divergences
|
|
L'opposition aspectuelle exprimée par deux
paradigmes
purement aspective (L'accompli
et l'inaccompli)
|
L'opposition aspectuelle assurée par les
formes
verbales (simples et composées)/ (des
temps simples ou
composées)
|
|
L'utilisation des particules/copules verbales
|
L'absence des particules /copules verbal's
|
|
L'inaccompli est exprimé par diverses
structures
|
L'inaccompli est exprimé seulement par les
formes
verbales simples (temps simples)
|
2.2-Les divergences sur le plan Lexical:
ÉíãÌÚãáÇ
ÉíÍÇäáÇ äã
ÊÇáÇÊÎáÇÇ
2.2.1 -L'emploi de particules verbales (
ÉíÙááÇ
ÊÇãíÓÌáÇ ):
Le système verbal de l'arabe est bien marqué par
sa richesse lexicale. En effet, il rajoute au verbe un grand nombre de
particules, ce qui fait qu'un seul verbe peut être l'équivalent de
toute une phrase française. D'ailleurs, le système de particules
aboutit à l'apparition de valeurs aspectuo-temporelles. Ces particules
sont le plus souvent attachées aux verbes essentiels de la phrase pour
leur donner une autre signification lexicale, comme (la continuité,
81
le déclenchement, la fréquence...). Par contre,
dans le système du français, malgré l'existence des
particules. Celles-ci jouent un rôle extérieur au verbe,
c'est-à-dire le verbe français garde toujours ses valeurs
temporelles propres. Et dans ce cadre, nous remarquons que les particules
verbales dans le système de l'arabe portent des nuances temporelles et
aspectuelles, puisqu'elles servent à exprimer (le perfectif/
l'accompliíåÊäãáÇ ) ou
(l'imperfectif/ l'inaccompli íåÊäã
ÑíÛáÇ) comme le montre ce tableau.
|
Les particules préverbales qu'expriment
(le
perfectif / l'accompli)
|
Les particules préverbales
qu'indiquent
(L'imperfectif/ L'inaccompli)
|
|
la particule (qad) +v. accompli (Faala)
ãÇÊ áÚ +ÏÞ
|
Le verbe Kana +v. Inaccompli
ãÇÊ ÑíÛ
áÚ + äÇß
|
|
Le verbe Kana +la particule qad+v. accompli
(Faala)
ãÇÊ áÚ+ ÏÞ+
äÇß áÚáÇ
|
La particule préverbale (Dhala/Mazala)
+v.
inaccompli
ãÇÊ ÑíÛ
áÚ+ áÇÒÇã /áÙ
|
|
Le verbe Yakunu+la particule (qad) +v.
accompli (Faala)
ãÇÊ áÚ +ÏÞ
+äæßí
|
La particule préverbale (Syn/ sa (wfa))
+v.
inaccompli
ãÇÊ ÑíÛ
áÚ +æÓ /äíÓáÇ
|
|
Le verbe Yakunu+v .accompli
ãÇÊ áÚ
+äæßí
|
La particule (qad) +v. Inaccompli
ãÇÊ ÑíÛ
áÚ +ÏÞ
|
2.2.2-L'emploi de la dérivation affixale:
ÞÍáÇáÇ
ÞÇÞÊÔáÇÇ
Le système verbal de l'arabe est un système
« dérivationnel » par excellence. En
fait, la langue arabe est marquée notamment par la richesse de son champ
lexical grâce au phénomène de la dérivation
(ÞÇÞÊÔáÇÇ).
Ce dernier se fait par « les affixes » qui
s'ajoutent au radical (F.B). Et lorsque cet affixe est placé avant la
forme de base, il est appelé « préfixe
»
Et quand il est fixé après cette base, il est
appelé « suffixe ». Cela
résulte forcément un mot « dérivé
». D'ailleurs, « la dérivation
affixale » est marquée dans le système arabe
à partir de la forme verbale de base (Faala :
áÚ), puisque, cette forme est dérivée
sous plusieurs autres formes verbales comme par exemple (Istafaala
: áÚÊÓÅ / Infaala :
áÚäÇ / Afaala : áÚ). De
même, pour la forme verbale (Yafaalu :
áÚí) qui est dérivée aux
autres formes verbales à titre
d'exemple (Tafaala :
áÚÇÊ / Faalala : ááÚ
...). En outre, ces formes verbales
dérivées
gardent toujours la valeur aspectuelle de la forme
principale entre autres, (Faala : áÚ et ses
dérivées expriment l'accompli de la forme radicale :
íåÊäãáÇ ) et
(Yafaalu : áÚí et ses
82
dérivées marquent l'inaccompli de la
forme de base : íåÊäã
ÑíÛáÇ ). En plus, nous
remarquons que la langue arabe repose essentiellement sur la dérivation
dans son système verbal avec d'autres catégories comme (les
adjectifs, les adverbes....). Contrairement au système verbal du
français qui garde le même radical avec quelques changements au
niveau de terminaisons des conjugaisons de temps à l'autre pour marquer
la valeur de l'accompli ou l'inaccompli.
2.2.3-L'emploi des adverbes de temps
(ÉíäãÒáÇ
äÆÇÑÞáÇ):
La langue arabe s'appuie fondamentalement sur un emploi
intensif « des adverbes de temps » qui se
situent dans diverses places dans l'environnement contextuel (au début /
au milieu ou à la fin). Les adverbes et ses dérivés sont
des moyens lexicaux qui auront pour rôle de conférer un temps
précis au verbe. Ceux-ci pourront indiquer des valeurs
aspectuo-temporelles. De plus l'arabe a employé « des
semi-auxiliaires temporels » qui servent à exprimer
(La continuité
ÉíÑÇÑãÊÓáÇÇ)
comme (dhala áÙ / Baqiya íÞÈ / /
mazala áÇÒÇã ....). Et des
adverbes de temps comme par exemple (demain ÇÏÛ /
le lendemain : ÏÛ ÏÚÈ / hier Óã /
avant-hierÓã áæ / l'année
précédente íÖÇãáÇ
ãÇÚáÇ / l'année suivante
áÈÞãáÇ
ãÇÚáÇ). Ces adverbes visent
à situer l'événement par rapport aux trois dimensions
temporelles (passé/ présent, futur). Malgré le
système français repose aussi sur l'emploi des adverbes
temporels, nous trouvons la langue arabe au niveau de sa construction interne
est plus riche que le français par les indicateurs temporels.
D'ailleurs, les particules et les adverbes contribuent par excellence à
construire autour de verbes de sémantismes précis des valeurs
complexes.
Pour résumer, nous avons étudié le
français et l'arabe particulièrement sur le plan de la
morphologie verbale pour les mettre en regard au niveau de traitement des
aspects et des temps. Dans cette perspective, nous avons remarqué
l'existence d'une différence radicale entre les deux systèmes. Du
fait que, quand nous plaçons vis-à-vis de deux systémes
temporels et aspectuels comme le français et l'arabe, la première
divergence à noter c'est la différence dans les constructions
syntaxiques et l'emploi des temps et des aspects. D'un coté, le
français a un emploi stable, régulier dans une très large
mesure. De l'autre coté, l'arabe place des différences d'emplois
des temps dans ses structures de telle façon que des règles
d'utilisation semblent difficiles à dégager. Par ailleurs, le
système arabe est riche en combinaisons. Celles-ci confèrent
à la fois de multiples valeurs aspectuelles et temporelles. Et par
conséquent, nous constatons que le système verbal arabe
limité « morpho-syntaxiquement » est
fortement « sémantique ». Par contre
le systéme français s'accentue sur une morphologie très
« developpée » qui consacre
essentiellement la matiére de « Temps
».
83
Conclusion Générale
84
Dans le présent travail de recherche où l'accent
a été mis sur la comparaison de l'expression de l'aspect dans
deux systèmes temporels et aspectuels différents à savoir
le français et l'arabe, nous avons constaté que le traitement des
aspects et des temps diffère d'une langue à une autre. C'est
également ce que nous a donné l'idée de faire cette
étude comparative. Dans ce contexte, nous avons remarqué que,
malgré les convergences que nous avons dégagées notamment
sur les deux plans, c'est à dire le plan grammatical (structurel) et le
plan lexical (contextuel), les deux systèmes verbaux
étudiés présentent de nombreuses divergences.
En ce qui concerne les divergences, nous avons constaté
que le système verbal de l'arabe est très riche notamment par les
particules verbales. Celles-ci servent par excellence à transmettre des
valeurs aspectuelles et temporelles phrastiques, entre autres les verbes
déficients ajoutés aux verbes conjugués qui peuvent
exprimer des valeurs aspectuo-temporelles telles que la continuité, le
déclenchement, l'itérartion, etc. De plus, le système
arabe est riche aussi par les marqueurs temporels. Ceux-ci peuvent
confèrer des valeurs temporelles dans les trois dimensions,
l'antériorité, la simultaneité et la
postériorité. Le système arabe est également un
système dérivationnel par excellence. En effet, la langue arabe
est marquée par la richesse de son registre lexical. Cette richesse
intervienne grâce à la dérivation affixale. D'ailleurs, la
langue arabe peut exprimer l'inaccompli par de multiples compositions à
la différence de la langue française qui exprime l'inaccompli
principalement par les formes verbales simples des temps simples.
Certes le système verbal français est parfois
limité au niveau de l'expression de certains aspects, mais nous ne
pouvons pas nier sa richesse au niveau de sa morphologie verbale, puisqu'il est
caractérisé particulièrement par la diversité des
temps verbaux. D'ailleurs, la langue française semble très
stricte en matière de temps que la langue arabe. Cette dernière
n'est pas fondée sur l'expression de la temporalité, puisque le
temps semble comme un élément secondaire, marginal qui peut
être exprimé le plus souvent par l'emploi des indicateurs
temporels à titre d'exemple les adverbes de temps qui sont
employés dans l'environnement contextuel.
En guise de conclusion, nous pouvons dire que malgré
toutes ces divergences, les deux systèmes verbaux adoptent la même
méthode pour exprimer l'aspect. D'ailleurs, suite à
l'étude de notre corpus qui a prouvé d'une manière
très claire les points de convergence et de divergence entre les deux
systèmes linguistiques, nous avons déduit que les deux langues
ont réussi à expliquer et à traduire l'aspect en tant
qu'une catégorie lexicalisée et grammaticalisée à
la fois. L'objectif principal de notre travail était de mettre en regard
le fonctionnement de
85
l'aspect dans deux systèmes linguistiques
différents. Cette comparaison était menée pour faire
connaissance de la spécificité de chaque langue apprise et cette
analyse nous a montré la complexité des études
contrastives qui portent des fins didactiques en se focalisant sur les
universaux langagiers et sur les convergences entre les langues avant
même d'en explorer les divergences. Et dans cette perspective, la
question qui se pose, est-ce que les études comparatives sont-elles
encore adoptées aujourd'hui comme une méthode scientifique
efficace à suivre pour découvrir les particularités des
langues étrangères ?
86
Bibliographie
87
Les dictionnaires en ligne
utilisés:
- Dictionnaire Larousse, Version électronique,
www.larousse.fr . [Consulté
le 15/02/2022].
- Dictionnaire encyclopédique en ligne,
http//www.encyclopédie_1.com/L/li/ linguistique.HTML. [Consulté
le 15/02/2022].
Les ouvrages + les articles utilisés en
français:
- BLACHERE REGIS ET M.GAUDEFROY. DE MOMBYNES, (1942),
Grammaire de l'arabe classique, Paris, G.P.Maisonneuve.
- BLACHERE. REGIS (2007), Eléments de l'arabe
classique, Paris: Maisonneuve.
- COHEN DAVID, (1970), Etudes de linguistique
Sémitique et Arabe, Paris: Mouton.
- COHEN DAVID, (1989), L'aspect Verbal : Pages N
:
10 /17/22/26/171/180/171/165/133/157/181.
- COHEN MARCEL, (1924), Le Système Verbal
Sémitique et l'expression du temps, leroux, Paris.
- DESCLES J.P (en colloboration avec Z.GUENTCHEVA), (1980),
« Construction Formelle de la catégorie de l'aspect (Essai) »,
dans J.DAVID et R.MARTIN, éd, la notion d'aspect. METZ.FUSCHS
C, LEONARD A.M.1979, Vers une théorie des aspects, Paris.
- GOSSELIN LAURENT. (1996). Sémantique de la
Temporalité en Français, Un modèle calculatoire et
cognitif du temps et de l'aspect, Paris, éd. Duclot, champs
linguistiques.
- GREVISSE MAURICE., (1939), Précis de Grammaire
Française.
- GUILLAUME.GUSTAVE, (1929), Temps et Verbe. Théorie
des aspects, des temps et des modes-1964, in Langage et science du
langage, Paris-Québec.
- GUILLAUME. GUSTAVE, (1970), Temps et verbe, Paris:
Champion.
- HERDONC-C, (1998), Guide de la Grammaire
Française, Paris : Duculot.
- HAGEGE. CLAUDE, (1982), La structure des langues,
Paris.
- LARCHER PIERRE, (2003), Le Système Verbal de
l'arabe Classique, Aix-en-provence, Presses Universitaires de Provences,
(Coll-Manuels), 2è édition revue et augmentée.
- LEEMAN DANIELLE BOUIX, (1995), Grammaire du verbe
français : « Des Formes au Sens » : Pages N :
48/49/50/51/52/5354/55/.
88
- MOECHLER JACQUES ET GEROVEVA PUSAKAS (2007). Etudes
Sémantiques et pragmatiques sur le temps, l'aspect et la
modalité, pp. 160-162.
- RIEGEL MARTIN, JEAN-CHRISTOPHE PELLAT, RENE RIOUL, (1994),
Grammaire Méthodique du Français.
- VASSANT ANNETTE, (1980), Pour une étude de l'aspect
verbal. In. L'information grammaticale, N°4, pp.12-19.
- VETTERS, CARL, (1996), Temps, aspect et narration,
Amsterdam.
Les ouvrages en Arabe :
ÇåÇäÈãæ
ÇåÇäÚã
ÉíÈÑÚáÇ
ÉÛááÇÑãÚ
äÇÓÍ ãÇãÊ.
.íÈÑÚáÇ
æÍäáÇ í
ÊÇÓÇÑÏ
åÊÇåÌ æ
åÊÁÇÑÞ
ÉíÈÑÚáÇ
ÉÛááÇ í
áÚáÇ äãÒ
ÉãÇæÊ
ÑÇÈÌáÇ ÏÈÚ
Les références de recherche en ligne :
-
https://taoufikrahma.blogspot.com/2019/03/1.html.
-
https://www.persee.fr/doc/igram
0222-9838 1980 num 4 1 2500.
-
https://www.linguistiquefrancaise.org/articles/cmlf/pdf/2010/01/cmlf2010_000197.pdf
-
https://www.universalis.fr/encyclopedie/morphologie-linguistique/.
-
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/36801/1/12819.pdf.
- content/uploads/sites/59/2022/02/Compte rendu LG.pdf.
-
https://www.academia.edu/202363/Laspect_verbal_dans_le_Nouveau_Testament_ver
s_une_d%C3%A9finition.
-
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00437956.1964.11659808.
-
https://www.maxicours.com/se/cours/la-notion-d-aspect/.
-
https://scolagram.u-cergy.fr/index.php/numero-un/item/160-l-aspect-verbal-par-
rapport-au-temps-comparaison-entre-le-francais-et-le-croate.
-
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/226/5/1/87809.
-
https://nantilus.univ-nantes.fr/vufind/Record/PPN004014626.
-
http://search.mandumah.com/Record/145386.
-
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/2465.
-
https://m.iicss.iq/?id=98&sid=185.
-
https://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=3727.
-
https://linguistique.uqam.ca/futurs-etudiants/quest-ce-que-la-linguistique/.
- aspect.pdf (
centrederechercheberbere.fr).
- L'expression de l'aspect verbal dans le français
contemporain - Persée (
persee.fr).
89
- Aspect lexical - Lexical aspect - abcdef.wiki.
- Grammaire-fiche-14-modes-temps-et-aspects-du-verbe.pdf (
wordpress.com).
- Le verbe: valeurs temporelles, aspectuelles, modales (
ralentirtravaux.com).
- La conjugaison arabe explication simple ET rapide -
Apprendre l'arabe
(
apprendrelarabe.fr).
- Larcher Pierre, Le système verbal de l'arabe
classique, Aix-en-Provence, Presses
Universitaires de Provence (2012) (
openedition.org).
-
https://journals.openedition.org/erea/2987
.
-
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aktionsart
.
-
https://nanopdf.com/download/grammaire-du-verbe-en-franais
pdf .
-
https://journals.openedition.org/corela/5535
.
-
https://www.persee.fr/doc/slave_0080-2557_2001_num_73_1_6696
.
-
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00777641/document
.
-
https://www.persee.fr/doc/slave
0080-2557 1984 num 56 2 5408 .
- La linguistique contrastive.pdf .
- Sartori_CR1-BEO-2013.pdf .
-
http://www.linguistes.com/mots/verbe.html
.
-
https://www.universalis.fr/encyclopedie/systeme-verbal-linguistique.
Les thèses/ les mémoires
consultés:
- El-KASSAS DINA, 2005, Une étude Contrastive de
l'Arabe et du Français dans une perspective de Génération
Multilingue, 452, p. Th.Doct: Linguistique Théorique, Descriptive et
Automatique.
- GORDANA. TODOROVIC, 2014, L'aspect Verbal dans les langues
BCMS et en Français: Une étude contrastive: Mémoire de
Master.
- MOHD. NOR. AZANBIN. ABDULLAH, 2013, Etude comparative des
structures et des systèmes verbaux du Français et du Malais:
Thèse de Doctorat.
- NATALIA. YOUSSEF, 2012, Proposition pour l'enseignement du
Subjonctif aux adultes arabephones: Thèse de Doctorat.
- YORDANKA. KOZAREVA-LEVIE, 2011, L'aspect Grammatical et ses
manifestations dans les traductions En Français de Textes
Littéraires Bulgares: Thèse de Doctorat.
90
Traduction des concepts-clés
du
Français vers l'Arabe
91
· L'aspect:
ÉåÌáÇ
· L'aspect grammatical:
ÉíáßÔáÇ
ÉåÌáÇ
· L'aspect lexical:
ÉíãÌÚãáÇ
ÉåÌáÇ
· L'aspect accompli:
ÉãÇÊáÇ
ÉåÌáÇ
· L'aspect inaccompli:
ÉãÇÊ ÑíÛáÇ
ÉåÌáÇ
· L'aspect itératif:
ÉÏÇÚáÇ
ÉåÌ
· L'aspect inchoatif
:ÏÈáÇ ÉåÌ
· L'aspect duratif:
ÉáÕÇæÊãáÇ
ÉåÌáÇ
· L'aspect progressif:
ÉíÌíÑÏÊáÇ
ÉåÌáÇ
· L'aspect non progressif:
ÉíÌíÑÏÊ
ÑíÛáÇ
ÉåÌáÇ
· Les verbes d'Etat:
ÉäßÇÓáÇ
áÇÚáÇ
· Les verbes d'activité:
ÉíßÑÍáÇ
áÇÚáÇ
· Les verbes d'accomplissement :
ÊÇãÇãÊáÅÇ
áÇÚáÇ
· Les verbes d'achévement:
ÁÇåÊäáÅÇ
áÇÚ
· Les verbes perfectifs:
ÉÒÌäãáÇ
áÇÚ
· Les verbes imperfectifs :
ÉÒÌäã
ÑíÛáÇ
áÇÚáÇ
· Les indicateurs temporels
:ÉíäãÒáÇ
äÆÇÑÞáÇ
· Le critère de dynamicité
:ÉíßíãÇäíÏáÇ
ÑÇíÚã
· Les interpretations contextuelles:
ÉíÞÇíÓáÇ
ÊÇÑíÓÊáÇ
· Les adverbes de temps
:ÉíäãÒáÇ
áÇæÍáÇ
92
· Les periphrases aspectuelles
|
|
:ÉíåíÌáÇ
ÊÇÑÇÈÚáÇ
|
· Le déclenchement de
l'action
|
|
:ËÏÍáÇ
ÉíÇÏÈ
|
· La progression de l'action
|
|
: ËÏÍáÇ
ÌÑÏÊ
|
· L'achévement de
l'action
|
|
: ËÏÍáÇ
炌抁
|
· La derivation affixale
|
|
:
ÞÍáÇáÇ
ÞÇÞÊÔáÅÇ
|
· Le plan formel
|
|
:íáßÔáÇ
ìäÈãáÇ
|
· Le plan lexical
|
|
:
íãÌÚãáÇ
ìäÈãáÇ
|
· Les particules verbales
|
|
:
ÉíÙááÇ
ÊÇãíÓÌáÇ
|
· La forme verbale
|
|
:áÚáÇ
áßÔ
|
· Le système verbal
|
|
:íÙááÇ
ãÇÙäáÇ
|
· Le temps
|
|
:
äãÒáÇ
|
· La temporalité
|
|
:ÉíäãÒáÇ
|
· L'Aspectualité
|
|
:ÉíåíÌáÇ
|
· Les convergences
|
|
:ÊÇåÈÇÔÊáÇ
|
· Les divergences
|
|
:ÊÇáÇÊÎáÅÇ
|
· Comparaison:
|
|
+ M
a.; ÑÇiA
|
· Etude contrastive
|
|
:ÉäÑÇÞã
ÉÓÇÑÏ
|
|
93
| 


