|

TABLE DES MATIERES
DEDICACE V
REMERCIEMENTS VI
RESUME VIII
LISTE DES FIGURES IX
LISTE DES TABLEAUX X
LISTE DES ABREVIATIONS XI
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
1. PRÉSENTATION DU SUJET 1
2. ETAT DE LA QUESTION 1
3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET 3
3.2. INTÉRÊT DU SUJET 3
4. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHESES 4
5. MÉTHODE ET TECHNIQUES 5
6. OBJECTIF DU TRAVAIL 8
7. DÉLIMITATION DU SUJET 8
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9
PREMIERE PARTIE : APPROCHE THEORIQUE 11
CHAPITRE PREMIER : GÉNÉRALITÉS
SUR LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE 12
SECTION I : DÉFINITION DES CONCEPTS
12
1. Mise en place 12
2. Système 12
3. Messagerie électronique 13
4. Sécurisé 13
5. Postfix 13
6. Dovecot 13
7. Environnement 13
8. Cloud privé 14
SECTION II : GENERALITES SUR LA MESSAGERIE
14
1. FONCTIONNEMENT DE LA MESSAGERIE 14
1.1. Avantage de la messagerie
électronique 16
1.2. Inconvénient de la messagerie
électronique 16
1.3. Adresse de courriel 17
1.4. Protocoles de messagerie 17
Fonctionnement du protocole POP3 19
Fonctionnement du protocole IMAP 20
2. LE CLIENT DE MESSAGERIE 21
II
SECTION III : POSTFIX ET DOVECOT 22
1. POSTFIX 22
2. DOVECOT 23
CONCLUSION PARTIELLE 25
CHAPITRE DEUXIEME : PRÉSENTATION DU CADRE DE
L'ÉTUDE ET ANALYSE
DE L'EXISTANT 26
SECTION I : PRESENTATION DE LA CNSS 26
SECTION II : ANALYSE DE L'EXISTANT 35
SECTION III : CRITIQUE DE L'EXISTANT 38
1. POINTS FORTS 39
2. Points faibles 39
3. PROPOSITION DE LA SOLUTION 40
CONCLUSION PARTIELLE 40
DEUXIEME PARTIE : APPROCHE PRATIQUE 41
CHAPITRE TROISIÈME : ÉTUDE DU FUTUR
SYSTÈME 42
INTRODUCTION 42
1. BESOIN GÉNÉRAL 42
2. BESOINS TECHNIQUES 42
3. CONTRAINTES FONCTIONNELLES 43
4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 43
6. PERFORMANCE 44
v Efficacité 44
v Capacité 44
v Adaptabilité 45
v Taux d'erreur 45
v Taux d'erreur 45
7. PLANIFICATION 46
Tableau 6 : planification 46
8. CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE 46
Tableau 7 : cahier des charges technique 47
SECTION II : CONTRAINTES D'AFFAIRE ET ANALYSE DES
OBJECTIFS 49
1. CONTRAINTES D'AFFAIRE 49
1.1 Contraintes techniques 49
1.2 Problème principal 49
2. ANALYSE DES OBJECTIFS 50
2.1 Expression des besoins 50
2.2 Vision du projet 50
III
2.3 Portée du projet 51
SECTION III : CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE LOGIQUE
52
1.1. NOUVEAU PLAN D'ADRESSAGE 52
1.2 PLAN DE NOMMAGE 53
1.3 CHOIX DES PROTOCOLES 53
1.4 CHOIX DU SYSTÈME D'EXPLOITATION 54
SECTION IV : CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE PHYSIQUE
54
Avantages de la topologie en étoile : 55
1.1. ÉQUIPEMENTS D'INTERCONNEXION 55
Tableau 11 : Equipements d'interconnexion 55
1.2. ÉQUIPEMENTS TERMINAUX 56
Tableau 12 : Equipements terminaux 56
2. CHOIX DU SUPPORT DE TRANSMISSION 56
CONCLUSION PARTIELLE 57
QUATRIEME CHAPITRE : L'IMPLEMENTATION DE LA SOLUTION
58
INTRODUCTION 58
SECTION I : PRESENTATION DES SERVICES À METTRE EN
PLACE 58
1.1. STRUCTURE DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 58
SECTION II : CONFIGURATION DES SERVICES 58
2.1. PRÉPARATION DU SERVEUR 58
2.2. INSTALLATION ET CONFIGURATION DE BIND9
59
2.3. INSTALLATION ET CONFIGURATION DE POSTFIX ET DOVECOT
63
2.4. TEST DE LA SOLUTION 67
CONCLUSION PARTIELLE 69
CONCLUSION GENERALE 70
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 71
I. Ouvrages 71
II. Travaux de Fin de Cycle (TFC) et Travaux de Fin
d'Études (TFE) 71
III. Notes et Cours 71
IV. Webographie 71
V. Autres sources 72
IV
EPIGRAPHE
« L'email est devenu le système nerveux de
l'entreprise moderne ».
Bill Gates
V
DEDICACE
À toi, grand-mère Marie MUTOMBO
MUSHIYA, parmi tous mes grands-parents, tu es la seule que mes yeux
ont eu la grâce de contempler. Ton regard, ta voix, ton amour discret ont
laissé en moi une empreinte indélébile. Tu m'as
quitté trop tôt, mais ton souvenir demeure une lumière
douce qui éclaire mes pas. Ce travail est une offrande à ta
mémoire, un témoignage silencieux de ce que ton existence a
semé en moi.
À mes parents, piliers de mon
éducation et de ma persévérance, votre foi en moi a
été le socle de mes ambitions. À mes frères
et soeurs, compagnons de route et de coeur, votre présence m'a
donné la force de continuer, même dans les moments
d'incertitude.
À mes enseignants et encadreurs,
passionnés de la science, artisans de la rigueur intellectuelle, vous
avez su éveiller en moi le goût de la recherche, le respect du
savoir et l'amour de la vérité.
À mes amis sincères, qui ont
su m'écouter, me challenger, me soutenir sans jamais faillir, votre
bienveillance a été un refuge dans les tempêtes de la
rédaction.
Enfin, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à ce parcours, que cette oeuvre vous rende hommage, car
derrière chaque page se cache un fragment de votre influence.
ILUNGA MONEKA Denis
VI
REMERCIEMENTS
À l'Éternel Dieu, source de notre souffle et
auteur de toute sagesse, pour ses bontés renouvelées chaque jour
dans notre vie. Nous lui rendons grâce pour la force, la santé et
l'intelligence qu'il nous a accordées afin d'accomplir ce travail, ainsi
que pour son amour infini, manifesté tout au long de notre parcours
académique.
Nos sincères remerciements vont aux
autorités académiques ainsi qu'à l'ensemble du corps
professoral de l'Université de Kamina (UNIKAM), pour leur encadrement,
leurs conseils avisés et leur accompagnement tout au long de notre
formation.
Nous exprimons notre profonde gratitude au Professeur Daily
KALOMBO, directeur de ce travail de fin d'études, pour sa
disponibilité, son écoute attentive et son accompagnement
constant. Son inspiration, son aide précieuse et le temps qu'il nous a
consacré ont été déterminants dans la
réalisation de ce travail.
Nos remerciements particuliers vont à
l'Ingénieur Gloire KALOBA qui, malgré ses nombreuses
responsabilités, a accepté d'assurer l'encadrement de ce travail.
Nous lui adressons un grand merci pour sa générosité
et son engagement.
À nos parents, Omer MUKANA DIKULUY et Lithy UMBA
MUSHIYA, pour leur amour, leurs encouragements et leur soutien inconditionnel
tout au long de notre parcours universitaire.
Nous témoignons également notre reconnaissance
aux enseignants : Ingénieur Gabin NDAY, Ingénieur David KADIATA,
Ingénieur Gloire KALOBA et Ingénieur Cédric KALENGA, pour
la qualité de leur enseignement et leur contribution à notre
formation.
À mes frères et soeurs : Cédric
MONGA, Patient NGOY, Nadine MUTOMBO, Hortense KABANGE, Chantal KYUNGU, Falonne
MONGA, Marlice BANZA et Simon BANZA, je tiens à exprimer toute ma
reconnaissance pour leur présence constante, leur affection et leur
soutien indéfectible. Leur écoute, leurs encouragements et leurs
gestes quotidiens ont été pour moi une source de réconfort
et de motivation dans les moments de doute et de fatigue. Leur foi en mes
capacités m'a porté et m'a permis de persévérer
jusqu'à l'aboutissement de ce travail. Ce parcours académique,
bien qu'individuel, a été nourri par leur amour fraternel,
leur patience et leur générosité. À travers ce
modeste hommage, je leur rends grâce pour avoir été mes
piliers silencieux, mes confidents et mes alliés dans cette aventure
intellectuelle.
VII
À nos amis et connaissances : notamment Pascal KABEYA,
Blaise MUKAYA, Alexis KIDI, Balthazar MUYEYE, Darius MUSHIYA, EL LOMBA, Eraste
KALENGA, Aristide MONGA, Merveille KITETE, Jeannette SUMAILI, Jocelyne KASONGO
et Mical KAPINGA, ainsi qu'à tous ceux dont les noms n'ont pu
être cités ici, mais qui ont contribué de près ou de
loin à la réalisation de ce travail : cousins, cousines,
oncles, tantes, camarades de promotion, nous leur exprimons notre profonde
gratitude.
ILUNGA MONEKA Denis
VIII
RESUME
Ce travail de fin d'études s'inscrit dans une
démarche de modernisation des communications internes au sein de la
CNSS/Kamina. Face à l'usage informel et non sécurisé de
plateformes comme WhatsApp ou les clés USB pour l'échange de
documents sensibles, l'étude propose la mise en place d'un
système de messagerie électronique sécurisé, fiable
et professionnel.
La solution retenue repose sur l'intégration des
services open source Postfix (pour l'envoi des courriels via
SMTP) et Dovecot (pour la réception via IMAP/POP3),
déployés dans un environnement cloud
privé. Cette architecture garantit la confidentialité,
l'intégrité et la traçabilité des échanges,
tout en renforçant l'autonomie numérique de l'institution.
La méthodologie adoptée est celle du cycle
PPDIOO (Planifier, Préparer, Concevoir,
Implémenter, Exploiter, Optimiser), permettant une structuration
rigoureuse du projet. L'étude comprend une analyse de l'existant, la
conception logique et physique du système, l'implémentation
technique, ainsi que des tests de validation.
Les résultats démontrent que la solution
proposée répond efficacement aux besoins de la CNSS/Kamina, en
assurant une communication rapide, sécurisée et conforme aux
standards professionnels. Ce mémoire constitue ainsi une
référence pour les institutions publiques souhaitant renforcer
leur infrastructure de messagerie interne.
IX
LISTE DES FIGURES
|
N°
|
Titre de la figure
|
Page estimée
|
|
1
|
Schéma du fonctionnement de la messagerie
électronique
|
15
|
|
2
|
Protocole SMTP
|
18
|
|
3
|
Le protocole POP3
|
19
|
|
4
|
Le protocole IMAP
|
20
|
|
5
|
Architecture du serveur Postfix
|
22
|
|
6
|
Architecture du serveur Dovecot
|
23
|
|
7
|
Organigramme de la CNSS/DP Kamina
|
26
|
|
8
|
Architecture du réseau existant
|
36
|
|
9
|
Chronogramme de la mise en place (Diagramme de Gantt)
|
47
|
|
10
|
Architecture du réseau proposée
|
56
|
|
11
|
Installation de la mise à jour via la commande sudo apt
update
|
58
|
|
12
|
Installation de Bind9
|
59
|
|
13
|
Configuration du fichier named.conf.local
|
60
|
|
14
|
Configuration du fichier db.cnsskamina.cd
|
61
|
|
15
|
Configuration du fichier db.10.168.192
|
62
|
|
16
|
Configuration du fichier named.conf.options
|
62
|
|
17
|
Test du domaine avec la commande dig -x 192.168.10.1
|
63
|
|
18
|
Installation de Postfix et Dovecot
|
63
|
|
19
|
Configuration graphique de Postfix
|
64
|
|
20
|
Configuration graphique de Postfix (suite)
|
64
|
|
21
|
Fichier de configuration
main.cf de Postfix
|
65
|
|
22
|
Redémarrage de Postfix et modification du fichier
dovecot.conf
|
65
|
|
23
|
Modification du fichier 10-master.conf
|
66
|
|
24
|
Fichier édité 10-master.conf
|
66
|
|
25
|
Création des utilisateurs ilunga et gloire
|
67
|
|
26
|
Envoi du message par ilunga via Outlook
|
67
|
|
27
|
Réception du message par gloire
|
68
|
|
28
|
Réponse de gloire à ilunga
|
68
|
|
29
|
Réception du message de gloire par ilunga
|
69
|
X
LISTE DES TABLEAUX
|
N°
|
Titre du tableau
|
Page estimée
|
|
1
|
Identification des équipements matériels
|
35
|
|
2
|
Supports de transmission utilisés dans le réseau
|
36
|
|
3
|
Logiciels de base installés
|
37
|
|
4
|
Logiciels d'application utilisés
|
37
|
|
5
|
Plan d'adressage IP du réseau existant
|
38
|
|
6
|
Planification du projet (PPDIOO)
|
46
|
|
7
|
Cahier des charges technique
|
47
|
|
8
|
Portée du projet selon le modèle OSI
|
51
|
|
9
|
Nouveau plan d'adressage IP pour le système de
messagerie
|
52
|
|
10
|
Plan de nommage des équipements et services
|
53
|
|
11
|
Équipements d'interconnexion pour l'architecture
physique
|
55
|
|
12
|
Équipements terminaux pour les utilisateurs
|
56
|
|
13
|
Choix du support de transmission (câblage réseau)
|
56
|
XI
LISTE DES ABREVIATIONS
|
Sigle /
Abréviation
|
Signification complète
|
|
CNSS
|
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
|
|
RDC
|
République Démocratique du Congo
|
|
DP
|
Direction Provinciale
|
|
SMTP
|
Simple Mail Transfer Protocol
|
|
POP3
|
Post Office Protocol version 3
|
|
IMAP
|
Internet Message Access Protocol
|
|
MTA
|
Mail Transfer Agent
|
|
MDA
|
Mail Delivery Agent
|
|
DNS
|
Domain Name System
|
|
IP
|
Internet Protocol
|
|
OSI
|
Open Systems Interconnection (modèle de
référence en réseau)
|
|
TLS
|
Transport Layer Security
|
|
SSL
|
Secure Sockets Layer
|
|
VPN
|
Virtual Private Network
|
|
UI
|
Interface Utilisateur
|
|
CPU
|
Central Processing Unit
|
|
RAM
|
Random Access Memory
|
|
HDD
|
Hard Disk Drive
|
|
LTS
|
Long Term Support (version stable à support
prolongé)
|
|
GUI
|
Graphical User Interface
|
|
PPDIOO
|
Plan, Prepare, Design, Implement, Operate, Optimize (cycle de vie
de projet Cisco)
|
|
BIND9
|
Berkeley Internet Name Domain version 9 (serveur DNS)
|
|
UTP
|
Unshielded Twisted Pair (type de câble réseau)
|
|
VSAT
|
Very Small Aperture Terminal (antenne satellite)
|
|
PDF
|
Portable Document Format
|
|
http
|
HyperText Transfer Protocol
|
|
HTTPS
|
HyperText Transfer Protocol Secure
|
1
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. PRÉSENTATION DU SUJET
Depuis la création du monde, l'homme a cherché
à communiquer de près ou de loin avec ses semblables, mais plus
la distance s'accroit plus, il a difficile à résoudre ce
problème. Il lui eut fallu de développer plusieurs techniques
à ce sujet allant du tam-tam aux technologies modernes.
La messagerie électronique est un outil essentiel dans
le monde professionnel, facilitant la communication rapide et efficace entre
collaborateurs, ainsi qu'avec des partenaires externes. Cependant,
l'augmentation des cyberattaques ces dernières années impose une
vigilance accrue, notamment pour des institutions sensibles comme la
CNSS/Kamina, où des informations critiques sur les données
sociales et administratives sont échangées
régulièrement.
Lors de notre passage à la CNSS/Kamina, nous avons
constaté que les utilisateurs échangent leurs rapports et autres
documents confidentiels via WhatsApp, clé USB, une pratique qui, bien
que pratique, manque de professionnalisme et pose des risques en termes de
sécurité et de confidentialité des données.
Pour répondre à ce besoin, nous proposons la
mise en place d'un système de messagerie sécurisé et
professionnel basé sur Postfix et Dovecot, permettant aux utilisateurs
de communiquer efficacement tout en garantissant la protection des
échanges et la conformité aux bonnes pratiques en matière
de gestion des informations.
2. ETAT DE LA QUESTION
Un travail scientifique présente une norme que nous sommes
appelés à suivre.
L'état de la question se définit comme un
produit documentaire établissant le bilan critique des travaux
effectués sur un sujet donné pendant une période
déterminée et pouvant se présenter sous forme
écrite ou orale.1
'
www.dictionnaire.sensagent.leparisien.fr
consulté le 12/02/2025 à 10h55.
2
Pour cela, nous avons eu à parcourir le travail de :
ILUNGA NKONGOLO Gauthier, Étudiant à l'université de
KAMINA, G3 informatique, année académique 20192020, il a
parlé de « L'implémentation d'un serveur de messagerie
électronique » cas de la Direction de Recettes du Haut-Lomami
(DRHL).
Ici, il est question de dire clairement et distinctement sur
quoi portait son travail, en d'autres termes faire voir en quoi consiste la
problématique de son travail. Sur ce, son travail s'organise autour des
questions suivantes :
V' Que faut-il faire pour quitter un système manuel
pour un système informatisé de messagerie électronique
?
V' Pourquoi devons-nous mettre en place un serveur de
messagerie électronique ?
Pour lui, il avait proposé comme réponses
provisoires :
V' Pour quitter un système manuel vers un
système informatique de messagerie ou pour faire communiquer une
information ou un message d'un bureau à un autre qui nous demande la
présence d'un protocole du travail ou un déplacement personnel
pour faire parvenir la réponse, il serait peut-être question de
mettre en place un serveur de messagerie électronique qui nous
permettrait d'envoyer des messages électroniques d'une machine à
une autre ;
V' Nous devrions mettre en place un serveur de messagerie
électronique pour limiter le coût et avoir une rapidité
dans le partage des informations au sein de la Direction des Recettes du
Haut-Lomami.
Contrairement à notre prédécesseur, qui
s'est concentré sur l'implémentation d'un serveur de messagerie
électronique sous Windows, nous avons jugé pertinent d'adopter
une approche différente en mettant en place un système de
messagerie sécurisée basé sur Postfix et Dovecot dans un
environnement cloud privé.
3
3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET
3.1. CHOIX DU SUJET
Nous avons opté pour ce sujet parce que le monde
d'entreprise aujourd'hui a plus besoin d'un système de messagerie
sécurisée, fiable et faisant preuve d'une haute
disponibilité dans son fonctionnement.
La CNSS/Kamina étant confrontée à un
problème réel dans sa gestion, plus précisément
dans sa transmission des informations, une solution efficace et rapide doit
être au rendez-vous.
3.2. INTÉRÊT DU SUJET
L'intérêt est un sentiment de curiosité ou
de bienveillance à l'égard de quelque
chose.2
Conformément aux normes scientifiques,
l'intérêt de notre travail se justifie sur trois aspects à
savoir :
V' Du point de vue personnel
Ce sujet, nous permet de développer une certaine
connaissance acquise durant notre parcours estudiantin et en ce qui concerne la
transmission des courriers ou données électroniques sans oublier
l'obtention d'un titre de gradué en sciences informatiques ;
V' Du point de vue scientifique
Les futurs chercheurs ainsi que le monde scientifique
trouveront dans ce présent travail les avantages favorables de la
transmission des courriers électroniques. En plus, nous voudrions
apporter un soutien scientifique, voir compléter d'autres recherches qui
ont été effectuées sur ce sujet ;
V' Du point de vue social
Quant à la CNSS ce présent travail va
présenter un avantage d'une implémentation d'un serveur de
messagerie électronique pour une transmission des courriers ou
données d'une manière électronique au sein de la CNSS.
2 Prof ASIPATE SIKITIKO SIKI, Cours de MRS, G2
Info Unikam, 2016-2017, inédit.
4
4. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHESES
4.1. PROBLÉMATIQUE
La problématique est définie comme un programme
de questionnement élaboré à partir de la question
posée par le sujet3.
Elle se définie encore comme l'ensemble des questions,
des problèmes concernant un domaine de connaissances ou qui sont
posées par une situation4.
Aussi, pour nous la problématique est une question en
chaines fondamentales posée et dont les réponses données
à l'aide des procédés scientifiques feront l'objet
même de notre étude.
En regard aux difficultés que présentent la CNSS
dans l'échange des informations d'un bureau à un autre,
l'idée nous est parvenue de proposer une mise en place d'un serveur de
messagerie électronique.
Dans notre cas, nous nous poserons quelques questions
provisoires qui feront l'objet de notre étude :
ü Comment pouvons-nous arriver à mettre en place
un serveur de messagerie au sein de la CNSS ?
ü Quelle serait l'impact d'implémenter un serveur
de messagerie électronique au sein de la CNSS ?
4.2. HYPOTHÈSES
L'hypothèse est définie comme une réponse
provisoire donnée aux questions de la
problématique5.
Elle se définie encore une proposition ou un « dit
» ou une explication que l'on se contente d'énoncer sans prendre
position sur son caractère véridique, c'est-à- dire sans
l'affirmer ou la nier6.
3 ASS TRESOR, cours de méthodologie de
recherche Scientifique, G2 INFO, UNIKAM 2019-2020, inédit.
4
www.scriptor.fr,
consulté le 12/02/2025 à 10h58.
5 Ass Trésor, Cours de
méthodologie de recherche Scientifique, G2 INFO, UNIKAM 2019-2020,
inédit.
6
https://fr.m.wikipedia.org
consulté le 19/02/2025 à 14h15.
7 ASS TRESOR, cours de méthodologie de
recherche Scientifique, G2 INFO, UNIKAM 2019-2020, inédit.
5
En guise d'hypothèses à des questions nous disons
que :
y' Pour arriver à mettre en place un serveur de
messagerie opérationnelle, il nous faut configurer un serveur Postfix en
lui associant avec Dovecot pour des raisons de sécurité des
courriels enfin nous allons créer les boites aux lettres de nos
utilisateurs pour permettre à tout un chacun de recevoir et lire les
mails ;
y' Un serveur de messagerie électronique aurait comme
impact au sein de la société pour faciliter une transmission des
courriels très rapide et bien sécurisées, il
réduirait le nombre de fois de circulation ou encore résoudrait
le problème de lenteur que l'homme présente.
5. MÉTHODE ET TECHNIQUES
5.1. MÉTHODE UTILISÉE
La méthode se définie comme une voie à
suivre pour atteindre le but qu'on s'est
fixé7.
Nous avons opté pour la méthode PPDIOO, qui nous
permettra à accomplir les objectifs de la recherche sur le sujet
intitulé « Mise en place d'un système de messagerie
sécurisé avec Postfix et Dovecot dans un environnement cloud
privé ».
La méthode PPDIOO est une approche structurée
utilisée principalement dans le domaine des réseaux et des
systèmes d'information pour gérer le cycle de vie d'un projet,
notamment dans la conception, le déploiement et la gestion des
infrastructures réseau. Elle a été popularisée par
Cisco, mais reste applicable à d'autres projets informatiques.
Le sigle PPDIOO signifie : 1. Plan
(Planifier)
Cette étape consiste à analyser les besoins,
définir les objectifs, réaliser une étude de
faisabilité et préparer un plan d'action. Elle inclut la collecte
des exigences techniques, fonctionnelles et organisationnelles, ainsi que
l'évaluation des ressources nécessaires ;
6
2. Prepare (Préparer)
Cette phase vise à préparer l'environnement et les
ressources pour le déploiement. Cela comprend la formation des
équipes, la mise en place des outils, la définition des
procédures et la préparation de l'infrastructure ;
3. Design (Concevoir)
Ici, on établit la conception technique
détaillée du réseau ou du système, basée sur
les exigences recueillies. Cela inclut le design de l'architecture, le
schéma de réseau, les configurations, les choix matériels
et logiciels ;
4. Implement (Implémenter)
Cette étape correspond à la mise en oeuvre
effective du design : installation des équipements, configuration des
systèmes, déploiement des services ;
5. Operate (Faire fonctionner / Exploiter)
Après l'implémentation, cette phase concerne
l'exploitation continue, la surveillance, la gestion et la maintenance du
système ou réseau pour assurer sa performance et sa
disponibilité ;
6. Optimize (Optimiser)
La dernière phase consiste à analyser
l'implémentation en production, identifier les améliorations
possibles, ajuster ou étendre le système selon les nouveaux
besoins ou les retours d'expérience, et recommencer
éventuellement le cycle.
Dans notre mémoire, en lien avec la mise en place du
serveur de messagerie Postfix/Dovecot à la CNSS/Kamina, la
méthode PPDIOO sera utilisée pour structurer le projet afin
d'assurer :
I Une planification rigoureuse (analyse
des besoins en messagerie sécurisée) ;
I La préparation adéquate
(mise en place de matériels et formation) ;
I La conception de l'architecture du
serveur de messagerie ;
I L'implémentation technique et
la configuration des serveurs ;
I L'exploitation et la surveillance de
la performance et de la sécurité ;
7
ü Et enfin l'optimisation continue du système en
production pour répondre à de nouveaux besoins ou corriger des
failles.
Cette méthode garantit un projet bien organisé,
avec un cycle d'amélioration continue adapté à
l'évolution des exigences.
Dans le monde moderne des réseaux informatiques, de
nombreuses pièces mobiles doivent être soigneusement
contrôlées afin d'en tirer le meilleur parti. L'une des
méthodes qui peut être utilisée pour fournir cela consiste
à suivre un cycle de vie du réseau ; ces cycles de vie
définissent une approche qui peut être suivie pour chaque
étape de la vie du réseau.
5.2. TECHNIQUES UTILISÉES
La technique peut être définie comme
étant un moyen ou l'outil mis à la disposition de méthodes
pour faciliter la recherche8.
Les techniques sont des moyens utilisés pour collecter
les données; ce sont les moyens au service des méthodes qui sont
définies comme démarche intellectuelle à la
vérité9.
Pour nous, les techniques sont les démarches qui nous
permettent de récolter les données sur terrain.
Pour ce qui est de notre travail, nous avons utilisé
la technique documentaire, d'interview et d'observation.
ü La technique documentaire
Est celle qui est orienté vers une fouille
systématique de tout ce qui est en rapport avec le domaine de la
recherche c'est-à-dire tout ce qui constitue la source écrite
d'un thème de recherche. Elle consiste en l'utilisation des documents
écrits ayant une liaison avec le sujet choisi.
Elle nous a servis à la collecte des informations
nécessaires pour la lecture des ouvrages, cours, revues, en rapport avec
notre sujet.
8 Idem.
9 MULUMBATI Ngasha, A, Manuel de sociologie
générale, Ed. Africa, Lubumbashi, 1982, p.80.
8
ü La technique d'interview
Cette technique est définie comme une technique de
recherche qui consiste à faire recours à des entretiens au cours
des quels le chercheur interroge des personnes qui lui fournissent des
informations relatives au sujet de sa recherche10.
La technique d'interview nous a aidés à
recueillir des renseignements nécessités en prenant contact avec
quelques agents de la CNSS/Kamina pour la finalisation de ce travail.
ü La technique d'observation
La technique d'observation permet d'expliquer un
phénomène à travers la description de comportements, de
situations et de faits11.
Cette technique nous donne la ligne de conduite pour
concentrer notre implémentation sur les phénomènes
à implanter.
6. OBJECTIF DU TRAVAIL
L'objectif de cette recherche est de concevoir et de mettre
en oeuvre un système de messagerie sécurisé avec Postfix
et Dovecot, adapté aux besoins spécifiques de la CNSS/Kamina. Ce
travail vise à renforcer la sécurité des communications
électroniques de l'institution, à protéger les
données sensibles et à garantir leur conformité avec les
normes et réglementations en vigueur. L'objectif final est de fournir
une solution fiable et performante, tout en assurant la confidentialité,
l'intégrité et l'authenticité des échanges
électroniques.
7. DÉLIMITATION DU SUJET
Pour garantir une étude ciblée et approfondie,
la délimitation du sujet est définie comme suit :
ü Dans l'espace :
10 GRAWITZ, M., Méthodes de sciences
sociales. 11e édition, Dalloz, Paris, 2001, p. 512.
11
www.scriptor.fr,
consulté le 19/02/2025 à 17h55.
9
Ce travail se concentre exclusivement sur la CNSS au niveau de
la Direction Provinciale dans la Province du Haut-Lomami dans la ville de
Kamina en RDC ;
I Dans le temps :
Il couvre la période allant de 2025 jusqu'à la
mise en place effective et l'utilisation du système de messagerie, et
jusqu'à ce que celui-ci devienne obsolète.
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion générale,
ce mémoire est structuré en quatre chapitres,
détaillés ci-dessous :
I CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS SUR LA
MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
Ce chapitre aborde les bases théoriques de la
messagerie électronique, en expliquant les protocoles comme SMTP, IMAP
et POP3, ainsi que leurs rôles. Il traitera également des concepts
clés de sécurité, tels que le chiffrement des messages et
l'authentification, pour souligner l'importance de sécuriser les
communications électroniques
I CHAPITRE 2 : PRÉSENTATION DU CADRE DE
L'ÉTUDE ET ANALYSE DE L'EXISTANT
Ce chapitre analyse l'infrastructure actuelle de messagerie
à la CNSS/Kamina, identifiera ses lacunes et ses besoins
spécifiques. Il examinera les systèmes déjà en
place, leur performance, et les aspects nécessitant une
amélioration, tout en recueillant les exigences des utilisateurs.
I CHAPITRE 3 : ÉTUDE DU FUTUR
SYSTÈME
Ce chapitre présente la conception et l'architecture du
nouveau système de messagerie sécurisé. Il décrira
les choix technologiques, les configurations nécessaires, les pratiques
de sécurité à mettre en place, et les
bénéfices d'un environnement cloud privé pour la
CNSS/Kamina.
I CHAPITRE 4 : IMPLÉMENTATION DE LA
SOLUTION
10
Ce dernier chapitre détaille toutes les étapes
de mise en oeuvre, depuis la configuration de Postfix et Dovecot jusqu'aux
tests de performance et de sécurité. Des exemples concrets et des
captures d'écran illustreront les configurations. Une évaluation
finale permettra de mesurer les résultats obtenus et de proposer des
recommandations pour l'avenir.
11
PREMIERE PARTIE : APPROCHE THEORIQUE
12
CHAPITRE PREMIER : GÉNÉRALITÉS SUR
LA MESSAGERIE
ÉLECTRONIQUE
INTRODUCTION
Dans ce chapitre, nous allons explorer les concepts
fondamentaux liés à la mise en place d'un système de
messagerie sécurisé.
Nous examinerons les aspects techniques et organisationnels
nécessaires pour déployer une telle solution, en mettant l'accent
sur les outils spécifiques utilisés : Postfix et Dovecot dans un
environnement cloud privé.
SECTION I : DÉFINITION DES CONCEPTS
1. Mise en place
La mise en place est la réalisation,
l'exécution ou la mise en pratique d'un plan, d'une méthode ou
bien d'un concept, d'une idée, d'un modèle d'une
spécification, d'une norme ou d'une règle dans le but
précis. La mise en place est donc l'action qui doit suivre une
réflexion pour la concrétiser12.
Quant à nous La mise en place, nous la
définissons comme l'ensemble des opérations qui permettent de
définir un projet et de le réaliser, de l'analyse du besoin
à l'installation et la mise en service du système ou du
produit.
2. Système
Un système est un ensemble de composants
interconnectés qui interagissent pour réaliser un objectif
commun. Ici, nous faisons référence à un système
informatique intégrant Postfix et Dovecot, destiné à
fournir un service de messagerie fiable et sécurisé.
12
Https://watis.techtarget.com/implémentation/
consulté le 27/02/2025 à 18h30.
13
3. Messagerie électronique
Est un service géré par ordinateur, fournissant
aux utilisateurs habilités les fonctions de saisie, de distribution et
de consultation différée de messages écrits, graphiques ou
sonores qui transitent par un réseau de communication.13
Quant à nous, la messagerie électronique est un
système permettant l'envoi et la réception de messages
numériques via Internet. Elle repose sur des serveurs de messagerie qui
acheminent les courriels entre expéditeurs et destinataires, offrant une
communication rapide et efficace.
4. Sécurisé
Sécurisé signifie protéger contre les
menaces telles que les interceptions non autorisées, les accès
frauduleux ou les attaques informatiques. Dans ce travail, nous visons une
messagerie avec un haut niveau de sécurité pour garantir la
confidentialité et l'intégrité des données.
5. Postfix
Postfix est un agent de transfert de courrier (MTA) open
source. Il est utilisé pour acheminer et distribuer les courriels de
manière rapide et sécurisée, tout en intégrant des
fonctionnalités de filtrage et d'authentification avancées.
6. Dovecot
Dovecot est un serveur de messagerie open source
spécialement conçu pour la réception et le stockage
sécurisé des e-mails. Il prend en charge les protocoles IMAP et
POP3, offrant ainsi une gestion efficace des boîtes aux lettres.
7. Environnement
Un environnement informatique désigne l'ensemble des
infrastructures physiques et logicielles utilisées pour supporter une
solution. Ici, l'environnement inclut un cloud privé configuré
pour héberger le système de messagerie.
13
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/messagerie/50769,
consulté le 04/06/2025 à 11h13
14
8. Cloud privé
Est un modèle informatique qui offre un environnement
propriétaire dédié à une seule entité
commerciale. Il fournit des ressources informatiques virtualisées via
des composants physiques stockés sur place ou dans le centre de
données d'un fournisseur.14
Selon nous, Le cloud privé est une
infrastructure de cloud computing exclusivement réservée à
une organisation. Contrairement au cloud public, il garantit un contrôle
total sur les ressources, la sécurité et la gestion des
données, tout en offrant les avantages de la virtualisation et de
l'évolutivité.
SECTION II : GENERALITES SUR LA MESSAGERIE
Comme nous avons défini ci-haut la messagerie
électronique est un ensemble des dispositifs informatiques (machines et
logiciels) qui permettent la création d'un message sur un ordinateur et
son expédition, l'acheminement du message vu son ou ses destinataires,
la réception et la lecture du message.
1. FONCTIONNEMENT DE LA MESSAGERIE
La messagerie électronique est devenue un outil de
communication indispensable pour les professionnels comme pour les
particuliers, elle a un fonctionnement bien particulier15.

Figure 1 : Schéma du fonctionnement de la
messagerie
14
https://www.oracle.com/fr/cloud/definition-cloud-prive/
consulté le 04/06/2025 à 11h18
15 www.magic.fr/ comment fonctionne une messagerie
électronique/ consulté le 15/03/2025 à 13h00.
L'utilisateur B, ouvre son logiciel de messagerie
électronique (découvrir la très performante messagerie
Exchange Online). Il va envoyer une requête IMAP (Internet
15
Entre autres nous expliquerons le fonctionnement en quatre (4)
grandes parties
qui sont :
V' Envoi du mail et vérification
Un utilisateur A, rédige un email qu'il souhaite
adresser à un utilisateur B. Lorsqu'il termine la rédaction, il
clique sur le bouton d'envoi. Avec le protocole SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol), le courriel va être soumis au MSA (Mail Submission Agent) dont
la mission est de vérifier l'identité de l'émetteur du
message mais aussi de s'assurer qu'il a bien l'autorisation d'envoyer ce type
de mails.
Dès lors qu'une réponse favorable lui est
donnée (saisi exacte du couple identifiant-mot de passe par exemple), il
libère le message. Le MSA est ainsi un acteur majeur dans la lutte
contre le spam.
V' Transfert du mail
Après le MSA, c'est le MTA (Mail Transfer Agent) qui va
intervenir. Chargé de conduire le message du serveur de messagerie de
l'utilisateur A, au serveur de messagerie de l'utilisateur B, il va d'abord se
renseigner sur ce second. Pour cela, il va effectuer une requête DNS
(Domain Name System) qui doit lui permettre de connaître l'adresse IP
(Internet Protocol) du serveur destinateur. Ce dernier va, s'il est
équipé d'une solution anti-spam, chercher à s'assurer que
le serveur émetteur n'est pas déjà identifié comme
un spammeur. Si c'est le cas, il va bloquer le transfert du mail. Si, en
revanche, il est reconnu comme fiable, le transfert va s'effectuer ;
V' Réception du mail
Le serveur de messagerie de l'utilisateur B, va stocker le
message adressé par l'utilisateur A, et le MDA (Mail Delivery Agent) va
le présenter au logiciel de messagerie électronique qui, selon la
configuration retenue, pourra effectuer de nouveaux contrôles. Le mail
sera placé dans la boîte de réception ou bien dans le
dossier correspondant aux critères que vous avez définis ;
V' Lecture du mail
16 www.thpanorama.com/ blog/ tecnologia/
inconvénient de la messagerie/ consulté le 15/03/2025
à 13h08.
16
Message Accès Protocol) ou POP (Post Office Protocol)
et il sera possible de consulter le mail adressé par l'utilisateur A.
1.1. Avantage de la messagerie
électronique
La messagerie électronique à comme avantages.
Elle est plus rapide que la télécopie (fax) :
cette rapidité est dite, la télécopie était le
moyen d'envoyer des documents d'un endroit à un autre par voie
électronique en utilisant des lignes téléphoniques sa
posait une lenteur. Mais avec l'e-mail ou courrier électronique est une
méthode qui permet à l'utilisateur de saisir du texte sur son
écran et de le transmettre instantanément par réseau
(internet) à toute personne du monde entier ;
y' Le faible coût : la communication de
la messagerie électronique est moins chère ; y'
Serveurs disponibles en tout temps, indépendamment du
décalage horaire ;
y' La transmission simultanée d'un
message à plusieurs personnes : il a possible d'envoyer un message
à plusieurs personnes et tous reçoivent instantanément
;
y' A partir d'une page web (exemple :
Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.), il est possible de lire ses messages sur
n'importe quel ordinateur, n'importe où dans le monde, sans devoir
modifier la configuration du logiciel de courriel installé sur
l'ordinateur ;
y' Archivage des messages
expédiés et reçus : messages conservés dans une
boîte d'envoie ou boîte de réception ;
y' Expédition automatique d'un message
d'erreur si le courrier ne se rend pas : c'est-à-dire si un message
à envoyer est interrompu ou n'a pas pu être envoyé il y
aura un message d'erreur qui doit être envoyé à
l'utilisateur automatique.
1.2. Inconvénient de la messagerie
électronique Elle a comme
inconvénients16 :
- Son utilisation nécessite un appareil
électronique ;
- Il est possible d'envoyer du courrier en se faisant passer
pour un autre.
17
1.3. Adresse de courriel
Une adresse électronique, adresse courriel ou adresse
e-mail est une chaine de caractères permettant d'acheminer du courrier
électronique dans une boîte aux lettres17.
Les caractères autorisés pour l'écriture
des adresses se limitent aux caractères alphabétiques non
accentués, aux chiffres et à 3 autres signes : le point (.), le
signe moins (-) et le caractère souligné (_)
Une adresse de courriel se présente toujours de la
manière suivante : NomUtilisateur@NomDeDomaine
C'est subdivisé en trois parties qui sont les suivantes
:
V La première partie qui est le Nom de
l'utilisateur : Identifie l'utilisateur inscrit auprès d'un
serveur de messagerie ;
Exemple d'adresse :
denis@cnss.org
Denis = il peut s'agir d'un nom, servant les
directives données par l'administrateur.
V La deuxième partie qui est le signe @ «
arobase » ou « a commercial » qui se lit « at »
: Est un terme anglais qui signifie « chez », il sert de
séparateur entre le code d'identification de l'utilisateur et celui du
domaine ;
V Le second qui est le Nom De Domaine :
Désigne le serveur de messagerie où l'utilisateur ira
relever son courrier.
Reprenons toujours le premier exemple qui est
ilunga@cnss.org
Cnss= est le nom du domaine, qui identifie le
serveur de messagerie. Cd : identification du pays où
est implanté le domaine (exemple : RDC)
1.4. Protocoles de messagerie
Le serveur de messagerie utilise trois protocoles principaux
entre autres :
V Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ; V Protocole
POP3 (Post Office Protocol) ;
17 www.http:\\.m.wikipedia.org/wiki
consulté le 23/03/2025 à 15h38.
18
ü Protocole IMAP (Internet Message Accès
Protocol).
Il en existe encore un autre protocole qui est le MAPI
(Messaging Application Programming Interface) mais qui n'est
employé que dans le cadre de l'utilisation de Microsoft Exchange.
1.5. Protocole SMTP (simple Mail Transfer
Protocol)
Le SMTP est un protocole de la messagerie permettant
d'échanger des messages entre un expéditeur et un ou plusieurs
destinataires pourvu que leurs adresses soient connues18.
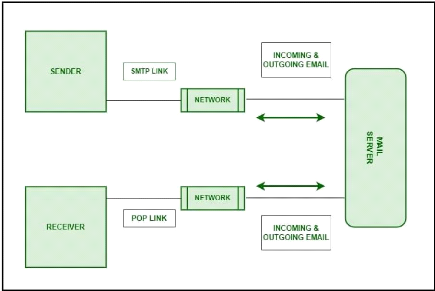
Figure 2 : Protocole SMTP
Il s'agit d'un protocole simple qui utilise le protocole de
contrôle de transmissions TCP (Transmission Control Protocol) pour le
transfert des données.
Comme fonctionnement, il s'agit d'un protocole fonctionnant en
mode connecté, encapsulé dans une trame TCP/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol). Le courrier est remis directement au
serveur de courrier du destinataire. Le protocole SMTP fonction grâce
à des commandes textuelles envoyées au serveur SMTP (par
défaut sur le port 25).
18 Ir. David KADIATA, cours de réseaux
informatique II, G3 INFO, UNIKAM, 2020-2021, inédit.
19
Comme avantage, il permet une gestion simplifiée de la
messagerie en cas de mobilité de l'utilisateur (gestion des dossiers et
messages sur le serveur). Il est plus facile de changer de client de messagerie
(aucun message à transférer etc.).
Comme inconvénient principal du protocole SMTP est
qu'il n'est pas sécurisé, il peut être facilement
piraté. Il existe ce qu'on appelle des « faux e-mail » qui
sont des messages envoyés en utilisant n'importe quelle adresse (par
exemple,
moneka@cnss.org) à
n'importe quel destinataire.
1.6. Le protocole POP3 (Post Office Protocol)
Est un protocole utilisé pour récupérer
les courriels depuis un serveur de messagerie vers un appareil local.
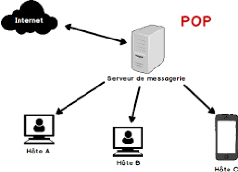
Figure 3 : Le protocole POP3
Fonctionnement du protocole POP3
1. Connexion au serveur : Le client de
messagerie se connecte au serveur POP3 et s'authentifie avec un nom
d'utilisateur et un mot de passe ;
2. Téléchargement des e-mails
: Les courriels sont transférés sur l'appareil local et,
par défaut, supprimés du serveur (sauf si configuré
autrement) ;
3. Stockage local : Une fois
téléchargés, les e-mails sont accessibles uniquement
depuis l'appareil où ils ont été reçus ;
4. Utilisation des ports : POP3 fonctionne
généralement sur le port 110 pour une connexion
standard et 995 pour une connexion sécurisée via
SSL/TLS ;
20
5. Gestion limitée : Contrairement
à IMAP, POP3 ne permet pas de gérer les e-mails directement sur
le serveur (pas de tri, de dossiers ou de synchronisation multi-appareils).
1.7. Le protocole IMAP (Internet Message Accès
Protocol).
Est un protocole qui permet d'accéder à ses
courriels directement sur un serveur de messagerie
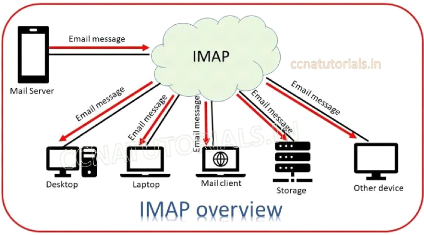
Figure 4 : Le protocole IMAP
Fonctionnement du protocole IMAP
1. Connexion au serveur : Lorsqu'un utilisateur
ouvre son client de messagerie, celui-ci se connecte au serveur IMAP et affiche
uniquement les en-têtes des courriels reçus ;
2. Consultation des messages : Lorsqu'un e-mail
est sélectionné, le client télécharge son contenu
depuis le serveur, permettant ainsi une lecture sans stocker le message
localement ;
3. Gestion des dossiers : IMAP permet de
créer, organiser et gérer des dossiers directement sur le
serveur, facilitant le tri et l'archivage des courriels ;
4. Synchronisation multi-appareils : Comme les
e-mails restent sur le serveur, toute modification (lecture, suppression,
déplacement) est immédiatement reflétée sur tous
les appareils connectés ;
21
5. Mode hors ligne : Certains clients de
messagerie offrent un mode hors ligne, permettant d'accéder
temporairement aux e-mails sans connexion internet
2. LE CLIENT DE MESSAGERIE
Un client de messagerie, logiciel de messagerie, est un
logiciel qui sert à lire et envoyer des courriers électroniques.
Ce sont en général des clients lourds mais il existe aussi des
applications web (messagerie web ou web-mail) qui offrent les mêmes
fonctionnalités.
La caractéristique essentielle de tous ces logiciels
est de permettre à un utilisateur d'accéder à sa ou ses
boîtes de courriers électroniques. Les clients de messagerie les
plus connus sont :
V' Microsoft Outlook ;
V' Mozilla ;
V' Thunderbird ; V' Evolution (GNOME) ; V' Mail (Apple) ; V'
Lotus Notes (IBM) ; V' Opéra Mail ; V' Fox-mail.
Un client de messagerie permet d'avoir accès aux
e-mails sans connexion internet. Il est plus confortable quand on doit
gérer plusieurs adresses Email avec beaucoup de dossiers et sous
dossiers (arbre IMAP) qu'on manipule régulièrement.
22
SECTION III : POSTFIX ET DOVECOT
1. POSTFIX
Est un serveur de messagerie électronique et un
logiciel libre développé par Wietse Venema et plusieurs
contributeurs. Il se charge de la livraison de courriers électroniques
(courriel) et a été conçu comme une alternative plus
rapide, plus facile à administrer et plus sécurisé que
l'historique de Sendmail19.
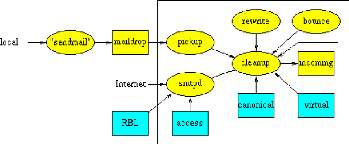
Figure 5: architecture du serveur Postfix
Il est le serveur de courriel par défaut dans plusieurs
systèmes de type Unix, comme Mac Os X, Net-BSD, diverses distributions
GNU/Linux, etc.
ü Rôle de Postfix
Le Postfix est un TMA (Transfer Mail Agent) et gère la
livraison des messages entre les serveurs localement au sein d'un
système. Il gère encore les responsabilités du MTA et de
la distribution locale.
Lorsque le Postfix est un MTA, il reçoit et distribue
des messages électroniques sur le réseau via le protocole SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol).
Pour mieux comprendre le rôle de Postfix on peut
utiliser une analogie, à savoir que Postfix agit comme un routeur.
Rappelons qu'un routeur est chargé de router (déterminer le
chemin) un paquet IP (Internet Protocol) source, l'interface sur laquelle le
19
www.wikipedia.org/wiki/qu'est-ce
qu'un service Postfix/ consulté le 23/03/2025 à 16h40.
23
paquet a été reçu et d'une table de routage
qui met en correspondance des adresses IP avec des interfaces réseaux
(de sortie) vers une destination.
2. DOVECOT
Un service Dovecot est un serveur de messagerie
électronique open source conçu principalement pour gérer
la réception, le stockage et l'accès aux courriers
électroniques. Il pe
rmet aux utilisateurs de consulter leurs messages via des
protocoles comme IMAP (Internet Message Access Protocol) et POP3 (Post Office
Protocol). Dovecot est réputé pour sa sécurité, sa
performance et sa compatibilité avec des systèmes GNU/Linux ainsi
que d'autres infrastructures de type Unix.
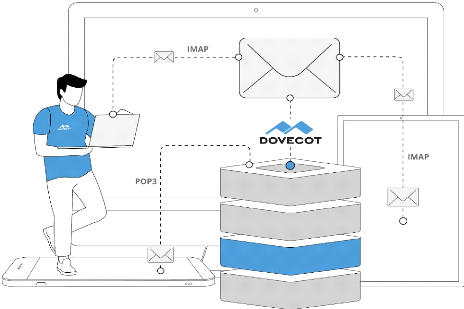
Figure 6: architecture du serveur Dovecot
2.1. Rôle de Dovecot
Dovecot est un serveur de messagerie électronique open
source conçue pour la réception, le stockage et la gestion des
courriels. Son rôle principal est :
24
I Faciliter l'accès aux
courriels pour les utilisateurs via les protocoles IMAP
(Internet Message Access Protocol) et POP3 (Post Office
Protocol) ;
I Gérer efficacement les
boîtes aux lettres des utilisateurs, en assurant leur
sécurité et leur organisation ;
I Offrir un mécanisme
d'authentification sécurisé pour contrôler l'accès
aux comptes utilisateurs ;
I Assurer une haute performance
tout en minimisant la charge sur le système grâce à une
architecture optimisée. Dovecot agit comme un gestionnaire des courriels
déjà livrés, permettant à chaque utilisateur
d'accéder à ses messages avec fluidité et
sécurité.
25
CONCLUSION PARTIELLE
En résumé, ce chapitre a permis
d'établir les bases théoriques et conceptuelles
nécessaires pour comprendre le fonctionnement, les
vulnérabilités, ainsi que les mesures de sécurité
liées à la messagerie électronique. Nous avons
défini les principaux concepts et notions connexes en lien avec la mise
en place d'un système de messagerie sécurisé.
Nous avons également examiné les
vulnérabilités courantes auxquelles ces systèmes sont
exposés et proposé des solutions adaptées pour renforcer
la sécurité, en tenant compte des spécificités d'un
environnement cloud privé. Ces connaissances fondamentales constituent
le socle sur lequel reposera la conception et l'implémentation d'un
système sécurisé utilisant Postfix et Dovecot, dans le
cadre de ce travail.
Dans le chapitre suivant, nous présenterons le cadre
d'étude, ainsi qu'une analyse de l'existant.
26
CHAPITRE DEUXIEME : PRÉSENTATION DU CADRE
DE
L'ÉTUDE ET ANALYSE DE L'EXISTANT
INTRODUCTION
Dans ce chapitre, il nous est important de préciser
les caractéristiques de concepts de base et des mots techniques
liées au domaine d'étude utilisé dans ce travail, faire
une description du réseau existant en le critiquant afin de propose une
amélioration, ainsi que faire la conception de la nouvelle
architecture.
SECTION I : PRESENTATION DE LA CNSS
1. APPERÇU HISTORIQUE
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
est l'institution publique qui prend en charge la protection sociale des
travailleurs en République Démocratique du Congo. Sa
genèse remonte à l'époque coloniale, lorsque
différentes caisses géraient séparément les
pensions, les allocations familiales et les indemnités liées aux
accidents de travail. En 1961, ces structures ont été
fusionnées pour créer l'Institut National de
Sécurité Sociale (INSS), doté d'une mission
centralisée : assurer la sécurité sociale à travers
des prestations de retraite, d'invalidité, d'allocations familiales et
de couverture des risques professionnels.
Pendant plusieurs décennies, l'INSS a
fonctionné sous cette forme, avec une organisation fortement
centralisée à Kinshasa. Ce modèle n'était plus
adapté aux besoins d'un pays aussi vaste, et avec le temps, la
nécessité de réformer le système s'est
imposée. C'est dans ce contexte que le gouvernement a adopté en
2016 une nouvelle loi sur le régime général de
sécurité sociale. Cette réforme a conduit en 2018 à
la transformation de l'INSS en CNSS. L'institution a été
dotée d'un nouveau cadre juridique, d'une autonomie de gestion plus
affirmée, et d'une organisation modernisée.
Depuis cette refonte, la CNSS a entrepris une politique de
décentralisation progressive afin de rapprocher ses services de la
population. Des antennes et directions ont été ouvertes dans
plusieurs provinces du pays. Parmi elles figure l'antenne de Kamina,
située dans la province du Haut-Lomami. Cette antenne a
été créée pour permettre aux travailleurs et
employeurs de la région d'accéder plus facilement aux services de
sécurité
L'Afrique en générale s'est dotée d'un
système de sécurité sociale plus d'un demi-siècle
après les pays industrialisés d'Europe. C'est en fait
après 1950 que les
27
sociale : immatriculation, paiements de cotisations,
traitement des dossiers de pension et de prestations familiales, etc. Elle joue
un rôle essentiel dans l'amélioration de la couverture sociale des
populations éloignées des grands centres urbains.
2. SITUATIONGEOGRAPHIQUE
La CNSS/DP Kamina est située dans la province du
Haut-Lomami, dans la ville de Kamina. Elle est située sur l'avenue
Kasa-Vubu au quartier centre urbain au numéro.
Elle est limitée :
ü Au nord par le bureau de l'ordre National des
Médecins vétérinaires ;
ü Au sud par l'avenue De la Révolution ;
ü À l'est par L'avenue Lumumba ;
ü Et à l'ouest par l'Avenue Malunga.
3. LA SECURITE SOCIALE DANS LE MONDE
C'est en 1800 que le chancelier Otton VON BISMARK convoqua les
experts de son pays qui est l'Allemagne afin de se pencher sur la question de
la sécurité sociale. Ces assises sortiront la solution selon
laquelle l'employeur et le travailleur devraient cotiser pour le compte du
travailleur.
À cet effet, nous retenons l'année 1800 comme
l'année de la création de la sécurité sociale dans
le monde entier et ayant pour père le chancelier VON BISMARK.
L'histoire continue aux États-Unis où la
sécurité sociale paraît en 1945, au lendemain de la
deuxième guerre mondiale. Elle sera ensuite utilisée dans bon
nombre de constitutions avant d'être consacrée solennellement dans
la déclaration universelle de droit de l'homme adoptée par
l'assemblée générale de l'ONU le 10 Décembre
1948.
5. LA SECURITE SOCIALE EN AFRIQUE
28
principaux régimes ont vus le jour en Afrique à
l'exception des risques professionnels pour certains pays.
Toutes les institutions de la sécurité sociales
étaient calquées sur le modèle européen, Ce n'est
qu'à quelques exceptions près que les régimes de
sécurité sociales en Afrique sont différents de ceux de
l'Europe et ne s'appliquent qu'aux salariés des secteurs
structurés qui ne couvrent qu'une très faible proportion de la
population active. Notre pays, la RDC n'a pas échappé à
cette règle.
6. LA SECURITE SOCIALE EN RDC
La sécurité sociale en RDC n'est pas le fait du
hasard, mais une conséquence de la colonisation. Celle-ci amène
avec elle un fait d'industrialisation au modèle Européen
aboutissant au monde du travail. Le monde étant déjà
là, les colonisateurs n'ont fait que transférer le système
déjà existant de l'Europe vers l'Afrique. Après
l'indépendance de notre pays, beaucoup de redressements furent
apportés par rapport au système de sécurité sociale
des colonisateurs. Comme conséquence, l'institut national de
sécurité sociale « INSS » en sigle fut
créé par le décret-loi du 29 juin 1961. Aux termes de ce
décret-loi, l'INSS était un établissement public
doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière placée sous la garantie de l'État et sa tutelle
administrative et technique était assumée par ministère du
travail et de la prévoyance sociale.
A la période coloniale, la sécurité
sociale regroupait trois caisses qui géraient différentes
branches couvertes par cette dernière à savoir :
y' La caisse de pension des travailleurs (CPT) du Congo belge et
du Rwanda qui était créée en 1956 ;
y' Les fonds coloniaux des invalides qui furent
créés en 1948 ;
y' La caisse générale pour la compensation des
allocations familiales créée en 1957.
En effet ces trois caisses travaillaient
séparément et chacune avait son système de gestion, de
finance et de l'administration. C'est en 1961 que ces trois caisses ont
été fusionnées en une seule. Cette dernière est
devenue ce que nous avions appelé Institut National de
Sécurité Sociale « INSS » en sigle, crée par
décret-loi du 29 juin 1961 et signalons avec véhémence que
cette Institution a pris le nom de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale par loi N°016/009 du 15 juillet 2016.
29
7. OBJET SOCIAL
L'objet social de la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale (CNSS) en République Démocratique
du Congo est centré sur la gestion du régime
général de sécurité sociale, tel que défini
par la loi du 15 juillet 2016. Sa vocation est d'assurer la protection sociale
des travailleurs, en couvrant les principaux risques liés à la
vie professionnelle et familiale. La CNSS intervient ainsi dans des domaines
comme les accidents de travail, les maladies professionnelles, la
maternité, la vieillesse, l'invalidité et les prestations aux
survivants.
En matière de risques professionnels, la CNSS garantit
aux assurés victimes d'un accident ou d'une maladie d'origine
professionnelle une prise en charge adaptée, sous forme
d'indemnités, de soins ou d'aides spécialisées. Ce volet
vise à sécuriser les conditions de travail et à soutenir
les travailleurs en cas d'aléas liés à leur environnement
professionnel.
La branche des prestations familiales est également
essentielle. Elle englobe les allocations prénatales, de
maternité et les allocations familiales versées aux
assurés pour alléger les charges liées à la
parentalité. Ces aides sont conçues pour soutenir
financièrement les familles durant les périodes de naissance et
d'éducation des enfants.
Quant à la pension, elle représente une
garantie de revenu pour les assurés ayant atteint l'âge
légal de départ à la retraite, ou pour ceux qui, suite
à une invalidité, ne peuvent plus exercer une activité
professionnelle. Elle s'étend aussi aux survivants en cas de
décès du travailleur affilié, leur assurant un soutien
financier partiel.
Outre ces missions principales, la CNSS a également la
responsabilité d'immatriculer les employeurs et les travailleurs, de
recouvrer les cotisations sociales, et de veiller à l'application des
textes légaux en matière de sécurité sociale. Elle
peut également promouvoir des actions sociales et sanitaires en lien
avec ses attributions.
8. MISSION DE LA CNSS/RDC
Sa mission consiste à recouvrer les cotisations
sociales en vue de payer les prestations sociales aux
bénéficiaires couverts par les trois branches ci-dessous :
ü Branches des pensions : où nous y trouvons des
prestations de veilleuse, d'invalidité et des survivants ;
30
V' Branche de risques professionnels : ici nous y
trouvons les prestations en cas d'accident travail et des maladies
professionnelles ;
V' Branche des allocations familiales : ici nous y
avons les prestations des allocations familiales.
9. GESTION ADMINISTRATIVE DE LA CNSS/RDC
L'organisation administrative de la CNSS est
structurée de la manière suivante : Conseil d'administration, la
direction générale, les directions urbaines, les directions
provinciales, les bureaux de district et les antennes.
V' Conseil d'administration
Le conseil d'administration est un l'établissement
public de la CNSS composé d'une manière tripartite et paritaire
par les partenaires sociaux. Les membres du conseil d'administration sont
nommés par l'ordonnance du Président de la République pour
un mandat de trois ans. Le Président du conseil d'administration est
élu par les membres du conseil pour une durée d'un an, la
présidence est tournante.
V' La direction
générale
La direction générale est l'organe de gestion
de la CNSS, elle est chapotée par un directeur général
(DG) et assisté par un directeur adjoint. Ces derniers sont
nommés par ordonnance du président de la République.
V' La direction provinciale
Elle est dirigée par un directeur provincial et deux
sous-directeurs dont l'un chargé de l'Administration et finances et
l'autre chargé de la technique.
V' Les Directions urbaines
Elles sont des sous-directions provinciales qui sont
situées dans des villes qui sont vastes telle la ville Province de
Kinshasa.
V' Le bureau du district
Le bureau du district est dirigé par un chef de
division appelé aussi le responsable. Ce dernier est composé de 4
services.
31
ü L'Antenne
Elle est chapotée aussi par un chef de division qui
veille scrupuleusement à son bon fonctionnement
10. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET FONCTIONNELLE DE LA
CNSS/DP-KAMINA
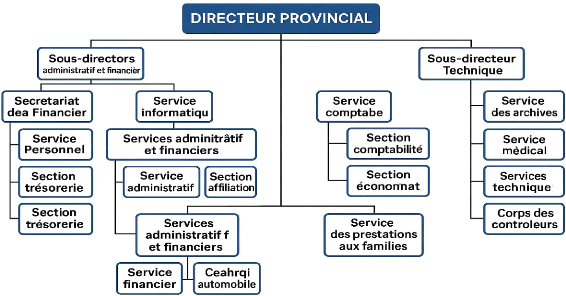
Figure 7: Organigramme
Source : Jr Elie SEKEMBE, secrétariat CNSS/Kamina, le
03/03/2025
11. STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA CNSS/DP
KAMINA
1) Le Directeur Provincial : il est le
représentant du directeur général au niveau de la
direction provinciale. Il coordonne et ordonnance toutes les activités
ainsi que toutes les opérations de cette dernière. Il est
directement géré par la direction générale.
2) Le Sous-directeur administratif et financier
: il gère tout qui est administration et finances de la
direction provinciale.
3) Le Sous-directeur Technique : il chapote
tout ce qui est technique parce que la
CNSS est une institution à caractère technique.
À l'absence du directeur c'est lui qui assume d'office
l'intérim.
4) Le Secrétariat de la direction provinciale
: d'une part, il exécute scrupuleusement les ordres du
directeur provincial et d'autre part, il accuse la réception et
l'enregistrement de tout courrier venant de l'extérieur. Il est aussi
chargé de la rédaction et l'envoi des courriers à
l'interne et de l'interne vers l'extérieur de la direction. Il comporte
quatre sections.
5) Service administratif : Il comporte en son
sein deux sections : y' La section personnelle : elle
gère tous les agents de la direction ;
y' La section paie : elle gère
l'établissement des états de paie et la suivie de paiements des
agents.
6) Service financier : il gère les
finances de cette institution, il comprend deux sections :
y' Section trésorerie : elle
s'occupe de tout ce qui est recette ou réalisation de la direction, mais
elle ne s'occupe pas de la comptabilité en profondeur
;
y' Section budget : elle se charge
de la budgétisation de toutes les activités qui requièrent
de l'argent.
7) Service comptable : il se charge de la
comptabilité. Il comporte trois sections :
y' Section comptabilité :
elle comptabilise en profondeur les dépenses et recettes
réalisées au cours d'une période donnée tout en
établissant les bilans bien détaillés pour chaque compte
;
y' Section économat : elle
gère les achats de matériels et fournitures de la direction ;
y' Section charroi automobile : elle
fait le contrôle et suivi des véhicules et motos propres à
la direction pas ceux agents.
8) Service informatique : il s'occupe de
tout ce qui est saisie, impression, scannage, envoi et réception des
courriers électroniques. Il s'occupe aussi de la gestion des
matériels, logiciels ainsi que du réseau informatique.
9) Service des archivages : il s'occupe de
la conservation des tous les dossiers physiques et électroniques de la
direction ;
10) Service médical : il
établit le bon médical, il fait le suivi et évacuation des
malades.
11) Service des employeurs et salariés
: c'est un service qui s'occupe de l'affiliation des employeurs et
immatriculation des travailleurs c'est-à-dire que ce service s'occupe de
tous les mouvements des employeurs et des travailleurs en vue d'accroitre la
production des ressources financières. Il comprend deux sections
citées dans l'organigramme.
12) Service technique : Il est dirigé
par un chef de service qui chapote toutes les sections citées dans
l'organigramme. Ce service s'occupe des retraités de la CNSS et traite
les dossiers de nouveaux demandeurs de pensions de retraite ou de pension de
veuve.
13) Service des prestations aux familles :
Il est dirigé aussi par un chef de service qui chapote toutes
les sections citées au niveau de l'organigramme. Ce service s'occupe des
payer tous les avantages sociaux dont les familles des employeurs
affiliés et des travailleurs immatriculés sont
bénéficiaires.
14) Corps des contrôleurs : Il est
dirigé par un coordonnateur qui s'occupe du contrôle et
recouvrement sur terrain des cotisations dont les employeurs doivent payer pour
leurs comptes et ceux de leurs travailleurs. Ce service est la porte
d'entrée de fond pour couvrir les différentes branches que
recouvre cette société.
SECTION II : ANALYSE DE L'EXISTANT
Dans cette section, il est nécessaire de faire
l'inventaire des équipements et des logiciels utilisés dans ce
système informatique, faire une critique sur le réseau existant
ainsi que proposé une solution pour l'amélioration du
réseau.
1. PRESENTATION DU RESEAU
Le réseau de la CNSS/Kamina est strucuré en
plusieurs segments interconnectés, chacun dédié à
un service administratif spécifique. Il repose sur une architecture
sécurisée incluant routeurs, pare-feu et liaison VSAT pour
l'accès à internet.
1.1. IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS ET LOGICIELS
1.1.1.
IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS
ü Les Ressources
Matérielles
Le service informatique de la CNSS/Kamina possède les
équipements
suivants :
N°
|
ÉQUIPEMENTS
|
NOMBRE
|
CARACTÉRISTIQUES
|
1
|
Antennes Vsat
|
1
|
Un réflecteur de 1 m de diamètre orienté
au nord-ouest à direction du satellite positionné à
180°
|
2
|
Modem
|
1
|
C'est un modem satellitaire
|
3
|
Routeur
|
3
|
2 routeurs : Marque TP-Link, Ils contiennent, 4 Ports Ethernet
(RJ45) à chaque routeur,
1 ports WAN et 1 routeur sans fil marque WAVLINK AX3000 Mesh
|
4
|
Ordinateurs laptop
|
7
|
Ordinateur portable (Laptop)
Marque : HP, HDD : 500Gb, RAM : 4Gb, CPU : 2.68GHz.
|
5
|
Ordinateurs desktop
|
5
|
5 Moniteurs dont 2 Moniteurs HP et 3 moniteurs Dell et
2 Unités centrales dont 2 (nouveau modèle) et 1
Dell HDD : 500Gb, RAM : 4Gb, CPU : 2.68GHz.
|
6
|
Imprimantes
|
3
|
1 Marque Canon série IR20163 et 2 marques HP série
2320
|
7
|
Switchs
|
4
|
Marque D-Link 24 ports
|
|
|
|
|
Marque Air-Link, Wifi 802.11, débit Radio
jusqu'à
|
8
|
Point d'accès sans fil (Air-Link)
|
1
|
300Mbps, MIMO 2T2R, PoE 802.3af, Ethernet, 2,4 et 5 GHz,
ProfNet, IP comme alimentation +9VDC à +
|
|
|
|
48VDC
|
|
Tableau 1 : identification des équipements
V' Supports de transmissions
Le support de transmission en réseau
sert à transporter les données d'un
point à un autre au sein d'un réseau
informatique. C'est un élément essentiel de
l'infrastructure réseau, car sans lui, aucune communication entre les
équipements (ordinateurs, serveurs, routeurs, etc.) ne serait
possible.
N°
|
NOM
|
TYPE
|
DESCRIPTION
|
1
|
Câble
|
COAXIAL
|
Permet de faire la transmission des données ainsi que
la transmission du signale dans le réseau.
|
2
|
Câble
|
UTP
|
Permet de faire la transmission des données dans le
réseau.
|
|
Tableau 2 : supports de transmissions
1.1.2. IDENTIFICATION DES LOGICIELS
Du point de de vue logiciels nous avons, les logiciels de base
et logiciels d'applications.
V' LOGICIELS DE BASE
N°
|
NOMS
|
FAMILLE
|
VERSION
|
OBSERVATION
|
1
|
WINDOWS 10
|
MS-windows
|
PROFETIONNEL
|
UTILISABLE
|
|
Tableau 3 : logiciels de base
ü LOGICIELS D'APPLICATIONS
|
N°
|
NOMS
|
TYPE
D'APPLICATION
|
VERSION
|
OBSERVATION
|
|
1
|
MICROSOFT OFFICE
|
Tableur, Ms Word, PowerPoint, Access
|
2013
|
UTLISABLE
|
|
2
|
Navigateur (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)
|
Navigateurs
|
|
UTLISABLE
|
|
3
|
Foxit reader
|
Est un logiciel de lecture de fichiers
PDF
|
|
UTLISABLE
|
Tableau 4 : logiciels d'applications
1.1. 3. ARCHITECTURE DU RESEAU EXISTANTE
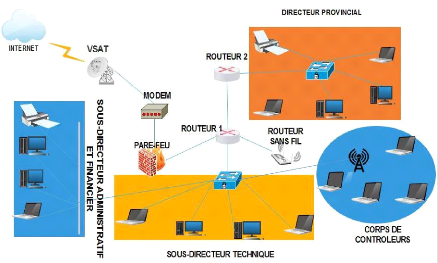
Figure 8: Architecture du réseau existante
Source : Jr Elie SEKEMBE, CNSS/Kamina, le 03/03/2025 à
11h20'
1.1.3. PLAN D'ADRESSAGE EXISTANT
Le plan d'adressage est une organisation
méthodique des adresses IP au sein d'un réseau informatique. Il
permet d'attribuer de manière structurée et cohérente les
adresses aux différents équipements (ordinateurs, serveurs,
imprimantes, routeurs, etc.) afin de faciliter leur identification, la
communication entre eux, ainsi que la gestion globale du réseau. Un bon
plan d'adressage prend en compte la taille du réseau, la segmentation en
sous-réseaux (subnetting), et les besoins spécifiques en
matière de sécurité, de routage et d'évolution.
Ne pas faire de subneting entraîne
principalement un gaspillage important d'adresses IP, surtout
en IPv4 où les adresses disponibles sont limitées. Lorsqu'on
attribue un réseau entier (par exemple une classe C avec 254 adresses
utilisables) à un groupe de seulement quelques machines, toutes les
autres adresses non utilisées sont perdues et ne
peuvent pas être attribuées ailleurs.
|
ADRESSE RESEAU
|
PREMIERE ADRESSE
|
DERNIERE ADRESSE
|
BROADCAST
|
MASQUE RESEAU
|
|
192.168.10.0/24
|
192.168.10.1
|
192.168.10.254
|
192.168.10.255
|
255.255.255.0
|
Tableau 5 : Plan d'adressage existant
SECTION III : CRITIQUE DE L'EXISTANT
L'évaluation du réseau actuel de la CNSS/Kamina
met en évidence une infrastructure informatique de base, mais
dépourvue d'un système de messagerie interne. Cette carence
freine la communication entre les agents, complique la coordination des
services et nuit à la productivité globale. La présente
section identifie les points forts pouvant faciliter l'implémentation
d'une solution, les faiblesses qui la rendent nécessaire, et propose une
réponse technique adaptée.
1. POINTS FORTS
L'environnement technique présente plusieurs atouts
pour l'intégration d'un système de messagerie :
V' Interconnexion des postes : Les machines
sont reliées en réseau local, permettant la centralisation des
services ;
V' Partage des ressources : L'infrastructure
permet la mutualisation des équipements et des services ;
V' Connexion internet haut débit :
Favorise l'échange rapide de courriels et l'accès distant aux
boîtes de réception.
Ces éléments constituent une base favorable
pour le déploiement d'un serveur de messagerie interne.
2. Points faibles
Malgré ces atouts, le réseau souffre de faiblesses
critiques en matière de communication :
V' Absence de serveur de messagerie interne :
Aucun outil officiel n'est disponible pour les échanges professionnels
;
V' Utilisation de messageries personnelles :
Les agents recourent à des services externes non maîtrisés,
compromettant la confidentialité et la traçabilité ;
V' Manque de coordination : Les
échanges sont fragmentés, non structurés, et souvent
informels ;
V' Aucune centralisation ni archivage : Les
courriels ne sont ni conservés ni organisés de manière
professionnelle ;
V' Faible autonomie numérique :
L'institution dépend de solutions tierces et ne contrôle pas ses
flux de communication.
Ces limites entravent la fluidité des échanges,
ralentissent les processus administratifs et exposent l'institution à
des risques organisationnels.
3. PROPOSITION DE LA SOLUTION
Face à l'absence d'un système de messagerie
interne structuré, il est proposé de mettre en place une solution
basée sur Postfix et Dovecot,
déployée dans un environnement cloud privé
entièrement maîtrisé par la CNSS/Kamina. Postfix
assurera la gestion des courriels en émission et en réception via
le protocole SMTP, tandis que Dovecot permettra un accès
sécurisé aux boîtes de réception à travers
les protocoles IMAP et POP. Cette architecture garantira la fiabilité,
la rapidité et la traçabilité des échanges
professionnels.
Le choix d'un cloud privé permet de conserver
l'intégralité des données au sein de l'institution,
renforçant ainsi la souveraineté numérique et la
confidentialité des communications. Chaque agent disposera d'une adresse
professionnelle, accessible depuis différents terminaux, avec des
fonctionnalités avancées telles que l'archivage automatique, la
gestion des groupes de distribution, et la protection contre les courriels
indésirables. Cette solution offrira à la CNSS/Kamina un outil
moderne, sécurisé et parfaitement adapté à ses
besoins de communication interne.
CONCLUSION PARTIELLE
L'analyse du réseau actuel de la CNSS/Kamina a mis en
évidence une absence totale de système de messagerie interne, ce
qui constitue un frein majeur à la communication entre les agents. Les
échanges informels, non structurés et non sécurisés
nuisent à la coordination et à l'efficacité des
services.
Malgré quelques atouts techniques comme
l'interconnexion des postes et une connexion internet stable, l'infrastructure
ne permet pas de répondre aux exigences d'une communication
professionnelle fiable et maîtrisée. La dépendance aux
services externes expose l'institution à des risques organisationnels et
à une perte de contrôle sur ses données.
La mise en place d'un système de messagerie
sécurisé basé sur Postfix et Dovecot,
hébergé dans un cloud privé, s'impose comme une solution
adaptée. Elle permettra d'instaurer un canal officiel, structuré
et autonome pour les échanges internes, tout en renforçant la
souveraineté numérique de la CNSS/Kamina.
DEUXIEME PARTIE : APPROCHE PRATIQUE
CHAPITRE TROISIÈME : ÉTUDE DU FUTUR
SYSTÈME
INTRODUCTION
Dans ce chapitre, il est question de concevoir un nouveau
système de messagerie interne pour la CNSS/Kamina. L'objectif est de
répondre aux besoins de communication professionnelle en mettant en
place une solution sécurisée, fiable et autonome. Pour y
parvenir, nous présenterons les besoins exprimés par
l'institution, les équipements nécessaires à la mise en
oeuvre du système, ainsi que les contraintes techniques à prendre
en compte.
SECTION I : IDENTIFICATION DES BESOINS ET OBJECTIFS DU
CLIENT
1. BESOIN GÉNÉRAL
La CNSS/Kamina souhaite moderniser son infrastructure de
communication électronique afin de faciliter les échanges
internes, améliorer la coordination entre les services, et garantir la
confidentialité des courriels professionnels. L'institution exprime le
besoin d'un système de messagerie interne maîtrisé,
indépendant des plateformes externes.
2. BESOINS TECHNIQUES
L'objectif est de mettre en place un système de
messagerie sécurisé, centralisé et accessible, basé
sur :
V' Postfix pour la gestion des courriels en
émission et en réception (SMTP) ;
V' Dovecot pour l'accès aux
boîtes de réception via les protocoles IMAP et POP ; V'
Cloud privé pour garantir la souveraineté des
données et la sécurité des échanges.
V' Le système devra permettre :
V' La création d'adresses professionnelles pour chaque
agent ou service ;
V' L'accès aux courriels depuis différents
terminaux (PC, smartphone, etc.) ;
V' L'archivage automatique des messages ;
V' La gestion des groupes de distribution et des alias ;
V' La protection contre les courriels indésirables (spam,
phishing).
3. CONTRAINTES FONCTIONNELLES
La mise en oeuvre du système devra tenir compte des
éléments suivants :
V' Coût initial lié
à l'acquisition du serveur, à la configuration du cloud
privé et aux licences éventuelles ;
V' Formation technique pour
l'administrateur chargé de la gestion du serveur Postfix/Dovecot ;
V' Disponibilité du réseau
pour assurer un accès fluide et continu aux boîtes de
réception ;
V' Sécurisation des accès
pour éviter toute intrusion ou perte de données.
4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le serveur de messagerie devra être installé sur un
matériel fiable, avec :
V' Une capacité suffisante de traitement et de
stockage pour gérer les courriels et les
archives ;
V' Une connectivité réseau stable,
intégrée au réseau local de la CNSS/Kamina ;
V' Des mécanismes de sauvegarde
régulière et de supervision en temps réel ;
V' Une interface d'administration accessible pour la
gestion des comptes et des flux.
5. EVOLUTION
L'architecture proposée est conçue pour
être hautement évolutive, ce qui signifie qu'elle pourra
facilement s'adapter aux besoins futurs de la CNSS/Kamina sans
nécessiter une refonte complète du système.
V' Sur le plan matériel, le
serveur de messagerie peut accueillir un nombre croissant de comptes
utilisateurs, et il est possible d'ajouter de nouveaux services (antispam,
archivage, supervision) sans modifier l'infrastructure de base. Le cloud
privé offre une capacité extensible en fonction des besoins ;
V' Sur le plan logiciel, Postfix et
Dovecot sont des solutions modulaires. Il est possible d'ajouter des extensions
telles que :
o La gestion des quotas de messagerie ;
o L'intégration avec des annuaires LDAP ou Active
Directory ;
o La mise en place de filtres personnalisés ;
o L'interconnexion avec d'autres sites distants via VPN ou
tunnels sécurisés.
y' Fonctionnalités futures : Le
système pourra intégrer des services avancés comme :
o La synchronisation mobile (via ActiveSync ou IMAP push) ;
o La mise en place d'un portail collaboratif (agenda, contacts
partagés) ;
o L'automatisation des réponses et la gestion des tickets
internes.
En résumé, cette architecture garantit que
l'investissement initial restera pertinent et performant, tout en offrant la
possibilité de croître en fonction des besoins futurs, tant en
termes de capacité que de services.
6. PERFORMANCE
Le système devra assurer :
y' Une faible latence dans la transmission des courriels ;
y' Une haute disponibilité du service (uptime garanti)
;
y' Une gestion efficace des connexions simultanées ;
y' Une sécurité renforcée contre les
intrusions et les pertes de données.
y' Efficacité
L'efficacité du système repose sur sa
capacité à traiter rapidement les courriels, à filtrer les
indésirables, et à garantir la livraison sans erreur. Grâce
à l'optimisation des ressources du cloud privé et à la
configuration fine de Postfix/Dovecot, la CNSS pourra offrir un service de
messagerie fiable tout en maîtrisant les coûts.
y' Capacité
La capacité du système est définie par :
y' Le nombre de comptes utilisateurs gérés ; y' Le
volume de courriels traités quotidiennement ; y' La taille des
boîtes de réception et des archives.
Le cloud privé permet d'ajuster dynamiquement ces
paramètres selon les besoins, garantissant une évolutivité
sans interruption de service.
I Adaptabilité
Le système est conçu pour s'adapter aux
évolutions technologiques et organisationnelles :
I Ajout ou suppression de comptes ;
I Modification des politiques de
sécurité ;
I Intégration avec de nouveaux
outils métiers.
Postfix et Dovecot, reposant sur des standards ouverts (SMTP,
IMAP, POP), assurent une compatibilité maximale avec les clients de
messagerie et les systèmes tiers.
I Taux d'erreur
Le taux d'erreur dans un système de messagerie se
mesure par la perte ou la corruption de messages. Grâce à la
configuration sécurisée du serveur et à l'utilisation de
protocoles chiffrés (TLS/SSL), le système minimise les risques
liés à :
I La perte de paquets ;
I Les erreurs de transmission ;
I Les attaques de type spoofing ou
man-in-the-middle.
Le taux d'erreur est surveillé en continu via des
outils de journalisation et de monitoring, permettant une intervention rapide
en cas d'anomalie.
I Taux d'erreur
Dans un système de messagerie, le taux d'erreur peut
être défini comme le pourcentage de courriels non
délivrés, corrompus ou interceptés durant leur
transmission. Il est influencé par :
I Les interruptions réseau ;
I Les erreurs de configuration
SMTP/IMAP ;
I Les attaques malveillantes (spoofing,
phishing) ;
ü Les pertes de paquets dans les transmissions TCP/IP.
Ce taux est surveillé à l'aide de journaux
d'erreurs (logs Postfix/Dovecot), d'outils de monitoring réseau, et de
tests réguliers de délivrabilité. L'objectif est de
maintenir un taux d'erreur proche de zéro, grâce à une
infrastructure sécurisée, redondante et bien
configurée.
7. PLANIFICATION
Le tableau ci-dessous présente les étapes
clés de la mise en oeuvre du système de messagerie
sécurisé :
|
N°
|
Tâche
|
Date de
début
|
Date de fin
|
Durée
|
|
01
|
Récolte des besoins et contraintes techniques
|
17/02/2025
|
03/03/2025
|
15 jours
|
|
02
|
Rédaction de l'introduction et du cadre
théorique
|
03/03/2025
|
01/04/2025
|
29 jours
|
|
03
|
Analyse de l'existant (infrastructure CNSS)
|
01/04/2025
|
16/05/2025
|
45 jours
|
|
04
|
Conception du système Postfix/Dovecot
|
16/05/2025
|
16/06/2025
|
30 jours
|
|
05
|
Acquisition des ressources matérielles et logicielles
|
16/06/2025
|
16/07/2025
|
30 jours
|
|
06
|
Installation et configuration du serveur de messagerie
|
16/07/2025
|
05/08/2025
|
20 jours
|
|
07
|
Phase de test, validation et sécurisation
|
05/08/2025
|
06/08/2025
|
2 jours
|
Tableau 6 : planification
8. CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE
Ce cahier des charges technique est formulé pour
garantir que la solution de messagerie réponde aux besoins
spécifiques de la CNSS/Kamina :
|
N°
|
Besoin formulé par le
service
informatique
|
Solution technique retenue
|
|
1
|
Centraliser la gestion des courriels
|
Déploiement d'un serveur
Postfix/Dovecot dans un cloud privé
|
|
2
|
Renforcer la sécurité des échanges
|
Chiffrement TLS/SSL + pare-feu + authentification
renforcée
|
|
3
|
Prévoir l'évolutivité du système
|
Architecture modulaire + possibilité d'ajouter des
extensions
|
|
4
|
Simplifier l'administration du système
|
Interface web d'administration (Roundcube, Webmin, etc.)
|
|
5
|
Sensibiliser les agents à l'usage de la messagerie
interne
|
Organisation d'ateliers de formation et guides d'utilisation
|
Tableau 7 : cahier des charges
technique
7. DIAGRAMME DE GANTT DU PROJET
Le diagramme de Gantt est un outil de planification visuelle
qui permet de suivre
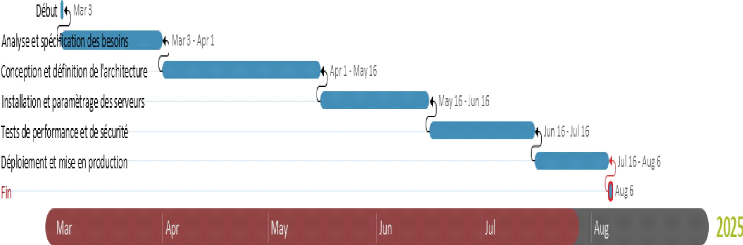
Figure 9: Chronogramme de la mise en place
L'avancement des tâches dans le temps. Il constitue un
instrument essentiel pour la gestion du projet.
SECTION II : CONTRAINTES D'AFFAIRE ET ANALYSE DES
OBJECTIFS
1. CONTRAINTES D'AFFAIRE
Dans le cadre de ce projet, nous nous concentrons sur le
service informatique de la CNSS/Kamina, dont les responsabilités
incluent la gestion des communications électroniques internes et la
sécurité des données.
1.1 Contraintes techniques
La CNSS/Kamina, en tant qu'institution publique à
vocation sociale, doit relever plusieurs défis liés à la
gestion de l'information :
I Assurer une communication fluide entre ses différents
bureaux et antennes locales ;
I Garantir la confidentialité des échanges
professionnels ;
I Réduire la dépendance aux services de
messagerie externes (Gmail, Yahoo, etc.) ; I Mettre en place une infrastructure
centralisée, sécurisée et évolutive.
L'administrateur réseau a identifié les
problèmes suivants :
I Absence d'un système de messagerie interne
maîtrisé ;
I Risques liés à la fuite d'informations sensibles
via des plateformes tierces ; I Difficulté à gérer les
comptes utilisateurs de manière centralisée ;
I Manque de traçabilité et d'archivage des
communications.
1.2 Problème principal
La CNSS/Kamina doit offrir à son personnel un moyen de
communication électronique sécurisé, rapide et autonome.
Or, l'usage actuel de services externes expose l'institution à des
risques de sécurité, de perte de données, et de
non-conformité réglementaire.
Les étapes clés incluent :
La mise en place d'un système de messagerie interne
basé sur Postfix et Dovecot, hébergé dans un cloud
privé, apparaît comme une solution optimale. Elle permettra :
y' La centralisation des communications ;
y' La réduction des risques liés à la
sécurité ;
y' L'autonomie dans la gestion des comptes et des flux ;
y' L'intégration de fonctionnalités
avancées comme l'archivage, les groupes de
distribution, et les filtres anti-spam.
2. ANALYSE DES OBJECTIFS 2.1 Expression des
besoins
Le besoin principal est de fournir à la CNSS/Kamina un
système de messagerie interne et externe :
y' Fiable et sécurisé ;
y' Facile à administrer ;
y' Compatible avec les standards ouverts (SMTP, IMAP, POP) ;
y' Accessible depuis différents terminaux.
Cela comprend :
y' La création d'adresses professionnelles pour chaque
agent ;
y' L'accès aux courriels via clients de messagerie ou
webmail ;
y' La mise en place de services additionnels : archivage,
filtrage,
authentification renforcée.
2.2 Vision du projet
Le déploiement de Postfix et Dovecot dans un cloud
privé permettra à la CNSS/Kamina de disposer d'un système
de messagerie robuste, évolutif et conforme aux exigences de
sécurité.
I Installation et configuration du
serveur de messagerie ;
I Définition des politiques de
sécurité et de gestion des comptes ;
I Intégration avec le
réseau local et les services existants ; I
Formation du personnel à l'utilisation du
système.
À long terme, le système pourra intégrer
:
I La synchronisation mobile ;
I L'interconnexion avec d'autres
institutions via VPN ; I L'intégration avec
des outils de gestion administrative.
2.3 Portée du projet
Le projet concerne principalement le département
informatique de la CNSS/Kamina, avec une portée étendue à
l'ensemble des services internes.
L'architecture du système s'appuie sur le modèle
OSI pour garantir une conception rigoureuse :
|
Couche OSI
|
Fonction dans le système de messagerie
|
|
Application
|
Gestion des courriels via Postfix/Dovecot ; interface webmail
|
|
Transport
|
Protocoles SMTP, IMAP, POP ; chiffrement TLS/SSL
|
|
Réseau
|
Routage des flux de messagerie ; adressage IP
|
|
Physique
|
Connexion au réseau local ; câblage Ethernet ;
accès cloud privé
|
Tableau 8 : portée du projet
52
SECTION III : CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE
LOGIQUE
Dans cette section, nous proposons une architecture logique
adaptée à la mise en place d'un système de messagerie
sécurisé au sein de la CNSS/Kamina. Cela inclut la
définition d'un plan d'adressage IP pour les équipements
liés au serveur de messagerie, un plan de nommage cohérent pour
les objets du réseau, ainsi que le choix des systèmes
d'exploitation nécessaires à l'implémentation de Postfix
et Dovecot dans un environnement cloud privé.
La conception logique permet de structurer les flux de
communication électronique, d'organiser les services de messagerie, et
de garantir une intégration fluide et sécurisée dans
l'infrastructure existante.
1.1. NOUVEAU PLAN D'ADRESSAGE
Le plan d'adressage IP est essentiel pour identifier chaque
équipement du réseau et organiser les flux de messagerie. Voici
le sous-réseau réservé à la messagerie interne :
|
ADRESSE
RÉSEAU
|
PREMIÈRE ADRESSE
|
DERNIÈRE
ADRESSE
|
MASQUE
|
BROADCAST
|
|
192.168.10.0/28
|
192.168.10.1
|
192.168.10.14
|
255.255.255.240
|
192.168.10.15
|
Tableau 9 : Nouveau plan d'adressage
Ce sous-réseau est dédié aux
équipements liés au système de messagerie : serveur
Postfix/Dovecot, interface webmail, outils de supervision, et postes
administratifs.
53
1.2 PLAN DE NOMMAGE
Le plan de nommage permet d'identifier clairement chaque
équipement et service dans le réseau. Voici la nomenclature
proposée pour les objets liés à la messagerie :
|
N°
|
NOM ÉQUIPEMENT
|
NOMMAGE
|
|
1
|
Serveur de messagerie
|
CNSSKmna_srv_mail
|
|
2
|
Interface Webmail
|
CNSSKmna_webmail_admin
|
|
3
|
Poste administratif
|
CNSSKmna_pc_[service]_[numéro]
|
|
4
|
Routeur principal
|
CNSSKmna_rtr_central
|
|
5
|
Switch réseau
|
CNSSKmna_swi_[localisation]
|
|
6
|
Outil de supervision
|
CNSSKmna_monitor_mail
|
|
7
|
DNS interne
|
CNSSKmna_dns_local
|
Tableau 10 : plan de nommage
Cette nomenclature facilite la gestion, la supervision et la
documentation du système, tout en assurant une cohérence dans
l'administration du réseau.
1.3 CHOIX DES PROTOCOLES
Pour assurer une communication sécurisée, fiable
et compatible avec les standards de messagerie électronique, les
protocoles suivants seront utilisés :
V' SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol) : utilisé par Postfix pour l'envoi des courriels. Il
permet de transférer les messages entre serveurs de messagerie et vers
les boîtes de réception des destinataires ;
V' IMAP (Internet Message Access
Protocol) : géré par Dovecot, il permet aux utilisateurs
de consulter leurs messages depuis plusieurs appareils tout en conservant les
courriels sur le serveur ;
V' POP3 (Post Office Protocol version 3)
: également pris en charge par Dovecot, il permet le
téléchargement des courriels sur un seul appareil, avec
suppression ou conservation sur le serveur selon la configuration ;
54
I TLS/SSL (Transport Layer Security / Secure
Sockets Layer) : ces protocoles de chiffrement assurent la
sécurité des échanges entre les clients et le serveur de
messagerie, protégeant les données contre les interceptions.
Ces protocoles garantissent une interopérabilité
avec les clients de messagerie modernes (Thunderbird, Outlook, webmail), tout
en assurant la confidentialité et l'intégrité des
communications.
1.4 CHOIX DU SYSTÈME D'EXPLOITATION
Le choix du système d'exploitation est fondamental pour
la stabilité, la sécurité et la performance du
système de messagerie. Voici les options retenues :
I Ubuntu Server 22.04 LTS : choisi
comme système d'exploitation principal pour héberger Postfix et
Dovecot. Ubuntu est réputé pour sa stabilité, sa large
communauté, sa compatibilité avec les outils open source, et sa
facilité d'administration. Il offre également un excellent
support pour les environnements cloud (OpenStack, Proxmox, etc.) ;
I Windows 10/11 : utilisé sur
les postes clients pour accéder au webmail, aux interfaces
d'administration, ou pour configurer des clients de messagerie comme Outlook ou
Thunderbird ;
I Android / iOS : pour les
utilisateurs mobiles souhaitant accéder à leurs courriels via des
applications compatibles IMAP/SMTP comme K-9 Mail, BlueMail ou Outlook
Mobile.
Ce choix assure une plateforme robuste,
sécurisée et compatible avec les besoins de la CNSS/Kamina en
matière de messagerie électronique.
SECTION IV : CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE PHYSIQUE
La conception physique du système de messagerie
sécurisé repose sur l'organisation spatiale des
équipements, leur interconnexion, et la topologie choisie pour garantir
performance, sécurité et évolutivité. Pour ce
projet, nous avons opté pour une topologie en
étoile, qui centralise les connexions autour du serveur
principal.
55
Avantages de la topologie en étoile :
I Facilité d'installation et de
maintenance ;
I Bonne évolutivité pour
ajouter de nouveaux équipements ;
I Réduction des risques en cas
de panne d'un terminal ;
I Contrôle centralisé du
trafic et de la sécurité.
1. CHOIX DES ÉQUIPEMENTS
1.1. ÉQUIPEMENTS D'INTERCONNEXION
|
N°
|
Équipement
|
Quantité
|
Caractéristiques
techniques
|
Rôle dans le
système
|
|
1
|
Serveur
Ubuntu Mail
|
1
|
Intel Xeon 3.0 GHz, RAM 16 Go, SSD 1 To, Ubuntu Server 22.04
LTS
|
Héberge Postfix, Dovecot, et les services de messagerie
|
|
2
|
Switch Gigabit
|
1 (24
ports)
|
Débit 1 Gbps par port, support VLAN, QoS, administration
web
|
Assure la connectivité entre les équipements du
réseau
|
|
3
|
Routeur sécurisé
|
1
|
WAN 1 Gbps, VPN IPsec/L2TP, pare-feu intégré,
support NAT et QoS
|
Gère l'accès Internet, la sécurité et
le routage du trafic
|
Tableau 11 : Equipements
d'interconnexion
56
1.2. ÉQUIPEMENTS TERMINAUX
|
N°
|
Équipement
|
Quantité
|
Caractéristiques
techniques
|
Rôle dans le système
|
|
1
|
Postes clients
|
15
|
Windows 10/11, Thunderbird ou Outlook, accès webmail via
navigateur
|
Consultation et envoi des courriels
|
|
2
|
Smartphones
|
Variable
|
Android/iOS, applications compatibles IMAP/SMTP (K-9 Mail,
BlueMail, Outlook Mobile)
|
Accès mobile sécurisé à la
messagerie
|
|
3
|
Casques audio
|
15
|
USB ou Jack 3.5 mm, microphone antibruit, audio
stéréo
|
Confort d'utilisation pour les appels et
visioconférences
|
Tableau 12 : Equipements terminaux
2. CHOIX DU SUPPORT DE TRANSMISSION
|
N°
|
Type de
câble
|
Catégorie
|
Longueur
|
Caractéristiques
techniques
|
Avantages
|
|
1
|
Câble Ethernet à paires torsadées
|
Cat6
|
1 Rouleau
|
4 paires torsadées, blindage U/FTP, bande passante 250
MHz, débit jusqu'à 1 Gbps
|
- Débit élevé pour les services
mail<br>-Réduction des interférences<br>-Compatible
avec les équipements réseau
|
Tableau 13 : choix du support de transmission
57
1.2. ARCHITECTURE RÉSEAU PROPOSÉE
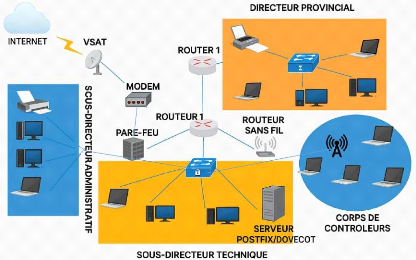
Figure 10: Architecture du réseau
proposée
CONCLUSION PARTIELLE
Dans ce chapitre, nous avons présenté les
besoins de la CNSS/Kamina pour moderniser sa communication interne à
travers un système de messagerie électronique
sécurisé, basé sur les technologies open source Postfix et
Dovecot, déployées dans un environnement cloud privé.
Nous avons décrit en détail l'architecture
logique et physique du système, le plan d'adressage IP, le choix des
protocoles de messagerie (SMTP, IMAP, POP3, TLS/SSL), ainsi que les
équipements et systèmes d'exploitation nécessaires
à l'implémentation de la solution.
58
QUATRIEME CHAPITRE : L'IMPLEMENTATION DE LA
SOLUTION
INTRODUCTION
Dans ce chapitre nous allons passer à l'étape
essentielle de notre sujet d'investigation qui est celle de faire une
démonstration de tout ce qu'on a eu à rédiger comme
théories durant le parcours de la réalisation de notre
travail.
Pour ce faire, nous allons vous présenter les outils
nécessaires, différentes parties de l'implémentation de la
solution qu'on a proposée à la CNSS/Kamina.
SECTION I : PRESENTATION DES SERVICES À METTRE
EN PLACE
1.1. STRUCTURE DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Nous avons utilisé l'adresse réseau
192.168.10.0/25. Ainsi, nous avons opté un nom de domaine
`'cnsskamina.cd.
Dans l'implémentation du projet nous avons
configuré les services
suivants :
V' Band9 ;
V' Postfix ;
V' Dovecot.
SECTION II : CONFIGURATION DES SERVICES
2.1. PRÉPARATION DU SERVEUR
Avant d'installer un nouveau logiciel, il est toujours
recommandé de mettre à jour et de mettre à niveau le
système Ubuntu 20.04. Pour commencer l'installation du Bind9, Postfix et
Dovecot en première lieu nous avons mis à jour le système
à l'aide des commandes suivantes « sudo apt update
puis sudo apt upgrade -y
».
59
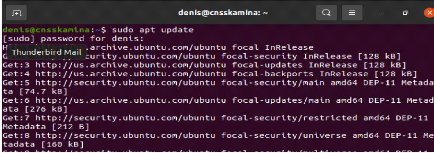
Figure 11 : Installation de la mise à jour
à l'aide de la commande "sudo apt updade "
Après la mise à jour, l'étape qui a
suivie est celle de renommer le serveur via la commande «
hostnamectl set-hostname cnsskamina.cd ».
Ensuite, nous avons modifié le nom du serveur dans le
fichier hosts situé dans le répertoire /etc/hosts
en exécutant la commande « nano /etc/hosts
». Ainsi nous avons redémarré le serveur à
l'aide de la commande « sudo reboot ». Voici le
fichier à modifier dans /etc/hosts pour changer
complètement le nom du serveur.
2.2. INSTALLATION ET CONFIGURATION DE BIND9
Nous avons installé le service de nom de domaine
(Bind9) à l'aide de la commande `' sudo apt install bind9
bind9utils bind9-doc».
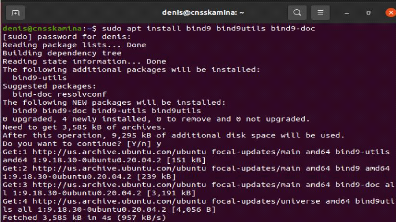
Figure 12. Installation de Bind9 à l'aide de
la commande " sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc".
60
Après avoir installer la bind9, nous avons configurer
la bind9 en éditant les fichiers `sudo nano
/etc/bind/named.conf.local»
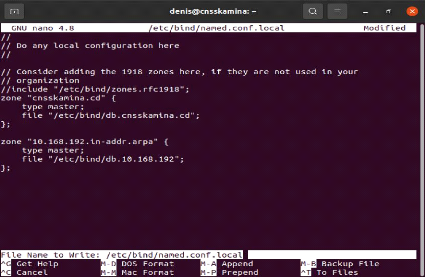
Figure 13. Configuration du fichier
named.conf.local
Nous avons configuré un fichier
`'db.cnsskamina.cd''
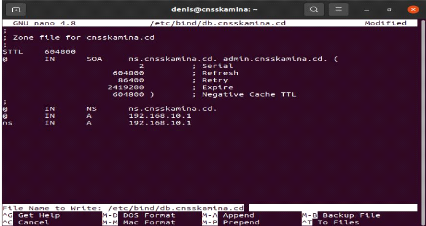
Figure 14. Configuration du fichier
db.cnsskamina.cd
61
La capture suivante montre comment nous avons copié le
fichier db.empty et coller cela dans le même
répertoire qui est bind tout a lui donnant le nom
db.10.168.192 à l'aide de la commande `'sudo cp
/etc/bind/db.empty /etc/bind/db.10.168.192» en suite
nous avons édité le fichier db.10.168.192
à l'aide de la commande `' sudo nano
/etc/bind/db.10.168.192
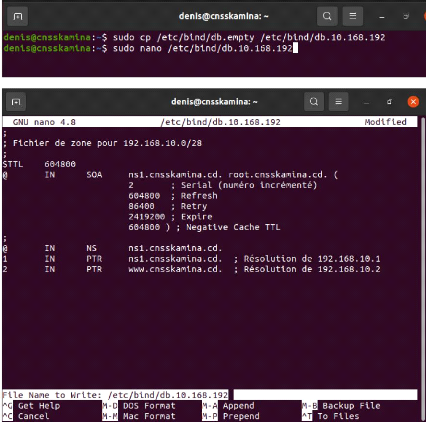
Figure 15. Configuration du fichier
db.10.168.192
Ensuite nous avons édité le fichier
named.conf.options à l'aide de la commande
`'sudo nano /etc/bind/named.conf.options»
62
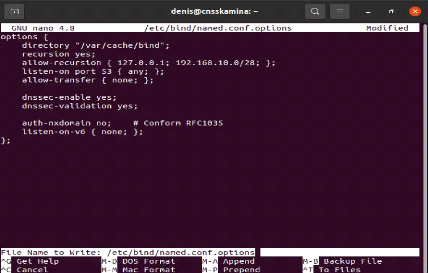
Figure 16. Configuration du fichier
namd.conf.options
En fin nous avons testé si notre domaine est bien
configurer à l'aide de la commande `'dig -x
192.168.10.1».
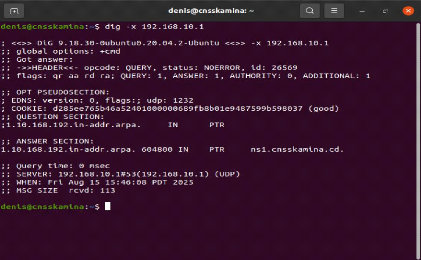
Figure 17. Test de la bind9 à l'aide de la
commande dig -x 192.168.10.1
63
2.3. INSTALLATION ET CONFIGURATION DE POSTFIX ET
DOVECOT
La capture suivante montre la manière dont nous avons
installé le Postfix et Dovecot à l'aide de la commande
`'sudo apt install postfix dovecot-imap dovecot-pop3d.
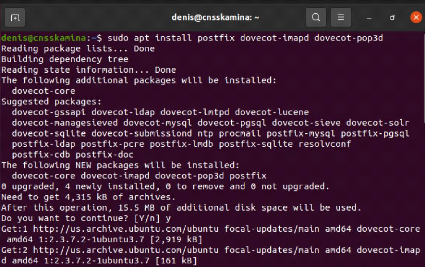
Figure 18. Installation de Postfix et
Dovecot.
La capture suivante montre la manière dont nous avons
configuré le
Postfix
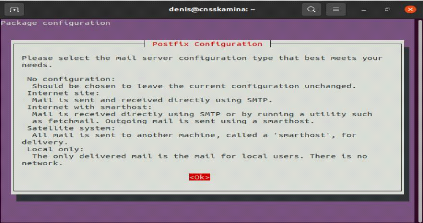
Figure 19. Configuration du Postfix
graphiquement
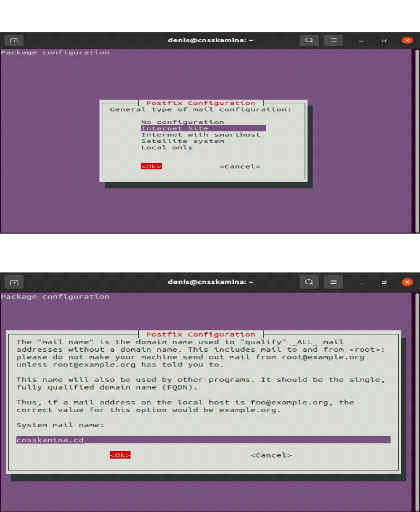
64
Figure 20. Configuration de Postfix
graphiquement
65
Voici le fichier de configuration de Postfix, nous l'avons
édité à l'aide de la commande `'sudo nano
/etc/postfix/
main.cf».
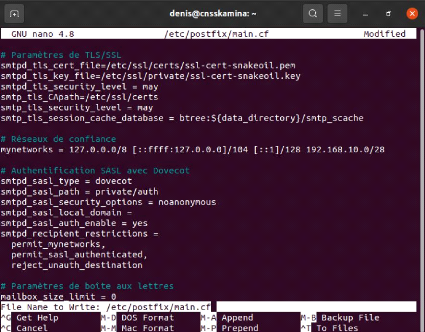
Figure 21. Fichier de configuration de
Postfix
La capture suivante montre la façon dont nous avons
redémarré le service Postfix à l'aide de la commande
`'sudo systemctl restart postfix», en suite nous
avons édité le fichier Dovecot à l'aide de la commande
`'sudo nano /etc/dovecot/dovecot.conf».
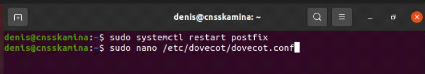
Figure 22. Redémarrage du postfix et
modification du fichier dovecot.conf
66
La capture suivante montre comment nous avons configuré
le fichier 10-master.conf à l'aide de la commande
`'sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf».
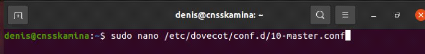
Figure 23. La commande de mondification du fichier
10.master.conf
Voici le fichier 10.master.config auquel nous
avons édité
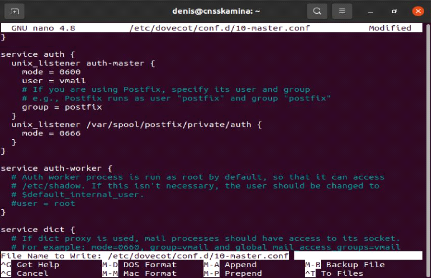
Figure 24. Modification du fichier
10.master.conf
La capture suivante montre comment nous avons créé
les utilisateurs à l'aide de la commande `'sudo useradd -m -s
/bin/false».
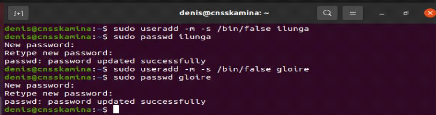
Figure 25. Création de deux utilisateurs,
ilunga et gloire à l'aide de la commande "sudo useradd -m -s
/bin/false
67
2.4. TEST DE LA SOLUTION
Voici coment l'utilisateur ilunga envoi le message à
l'aide du logiciel
outlook
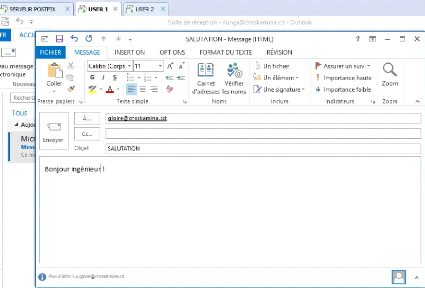
Figure 26. Envoi du message par ilunga pour
gloire
Voici la réception du message par gloire provenant de
ilunga.

Figure 27. Réception du message dans la
boîte de réception de gloire
Figure 29. La réception du message de
l'utilisateur gloire dans la boîte de réception de l'utilisateur
ilunga
68
La capturesuivante montre comment l'utilisateur gloire repond
au message de l'utilisateur ilunga.
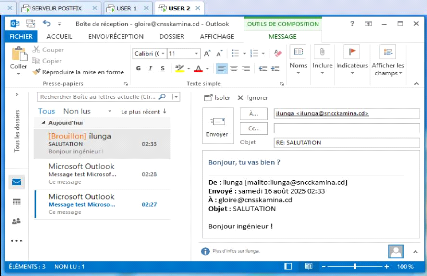
Figure 28. L'utilisateur gloire répond au
message d'utilisateur gloire
Voici l'arriver du message de l'utilisateur gloire dans la
boîte de réception de l'utilisateur ilunga
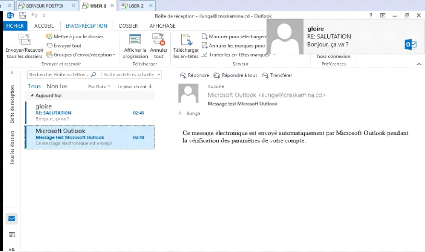
69
CONCLUSION PARTIELLE
Ce chapitre a permis de passer de la théorie à
la pratique, en démontrant de manière concrète la mise en
oeuvre d'une solution de messagerie sécurisée pour la
CNSS/Kamina. L'implémentation a commencé par la
préparation du serveur (mises à jour, configuration du nom
d'hôte), suivie de l'installation et de la configuration des services
essentiels : le service de nom de domaine Bind9, ainsi que les services de
messagerie Postfix et Dovecot.
La configuration de ces services, à travers la
modification de fichiers clés tels que named.conf.local et
main.cf, a posé les fondations d'une
communication interne sécurisée et autonome. Enfin, la
création des utilisateurs ilunga et gloire la phase de test avec le
logiciel Outlook ont permis de valider le bon fonctionnement de la solution,
prouvant ainsi sa capacité à répondre aux besoins de
l'entreprise en matière de transmission d'informations rapide et
professionnelle.
70
CONCLUSION GENERALE
La problématique initiale de ce travail a mis en
évidence le besoin de la CNSS/Kamina de se doter d'un système de
messagerie sécurisé et professionnel afin de pallier les risques
liés à l'échange d'informations confidentielles via des
méthodes non sécurisées comme WhatsApp ou les clés
USB. Pour y répondre, nous avons formulé l'hypothèse qu'il
était possible de mettre en place une solution technique efficace en
utilisant des services open source fiables tels que Postfix et Dovecot dans un
environnement cloud privé.
L'ensemble de ce mémoire a démontré la
validité de cette hypothèse. En s'appuyant sur la
méthodologie structurée PPDIOO (Planifier, Préparer,
Concevoir, Implémenter, Exploiter, Optimiser), nous avons d'abord
établi les fondements théoriques de la messagerie
électronique et de ses protocoles. Ensuite, l'analyse du système
existant a permis d'identifier ses lacunes et de concevoir une architecture sur
mesure.
La phase d'implémentation a concrétisé
cette conception. L'installation et la configuration du serveur DNS BIND9,
ainsi que des agents de transfert (Postfix) et de distribution (Dovecot) de
courriels, ont permis d'établir une infrastructure de messagerie
fonctionnelle. Les tests finaux, notamment l'envoi et la réception de
messages entre les utilisateurs, ont confirmé
l'opérationnalité et la pertinence de la solution.
En définitive, ce travail a permis d'implémenter
un système de messagerie qui non seulement résout le
problème de l'insécurité des échanges, mais apporte
également une plus-value significative à la CNSS/Kamina en termes
de professionnalisme et de rapidité de communication. Le système
mis en place garantit la confidentialité et l'intégrité
des données, répondant ainsi pleinement aux objectifs
fixés. Nous espérons que ce travail servira de
référence et que l'infrastructure proposée sera
optimisée à l'avenir pour s'adapter à l'évolution
constante des besoins de l'entreprise.
71
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
I. OUVRAGES
1. GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales,
11e édition, Dalloz, Paris, 2001.
2. MULUMBATI NGASHA, A., Manuel de sociologie
générale, Éditions Africa, Lubumbashi, 1982.
3. VITU, André, Droit pénal
général, Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, Paris.
4. BONICHOT, Jean-Claude, Droit public, Éditions
Montchrestien, Paris.
5. LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de procédure
pénale, Presses Universitaires du Congo, Kinshasa, 2011.
II. TFC et TFE
1. ILUNGA KATAMBA, P., La technologie RFID : concepts et
stratégie de mise en oeuvre, Université Laval, 2007.
2. KALALA NSAMBI, A., Problématique et perspective
des justiciables de la Cour de cassation face au principe du double
degré de juridiction, LegaNet.
3. ZUKA, Michaël, L'exception au principe du double
degré de juridiction expliquée, ACP.
III. NOTES ET COURS
1. Prof. Daily KALOMBO, Cours de méthodologie de
recherche scientifique, G2 Info, UNIKAM, 2020-2021.
2. Ir. David KADIATA, Cours de réseaux
informatiques II, G3 Info, UNIKAM, 2020-2021.
3. Ing. Gloire KALOBA, Cours de systèmes
d'exploitation, G3 Info, UNIKAM, 2021-2022.
4. Ing. Gabin NDAY, Cours de sécurité
informatique, G3 Info, UNIKAM, 2021- 2022.
IV. WEBOGRAPHIE
1.
www.wikipedia.org/wiki/qu'est-ce
qu'un service Postfix/
2. www.http:\\.m.wikipedia.org/wiki
3. www.http:\\.m.wikipedia.org/wikiguypn
4.
https://fr.m.wikipedia.org
5.
Https://watis.techtarget.com/implémentation/
72
6.
www.scriptor.fr,
7.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/messagerie/50769,
8.
www.dictionnaire.sensagent.leparisien.fr
V. AUTRES SOURCES
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo, 2006, modifiée en 2011.
2. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Statut de Rome instituant la Cour pénale
internationale, 1998.
4. Décret du 6 août 1959 portant Code de
procédure pénale.
5. Documentation technique officielle de Postfix et Dovecot
(manuels en ligne et guides de configuration).
6. Documentation Cisco sur le cycle PPDIOO (Plan, Prepare,
Design, Implement, Operate, Optimize).
| 


