|
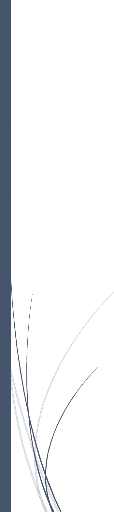
REPUBLIQUE CONGO DEMOCRATIQUE DU MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
« U.KA. »
BP 70/KANANGA

Faculté des sciences économiques et
gestion
L'incidence de l'inflation sur la consommation
des
produits agricoles dans la ville de Kananga
Par : MUSANGA KALALA Samuel
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du titre de Bachelier en sciences économiques.
Directeur : Professeur KAZADI
Kelvin
SEPTEMBRE 2025
I | Page
ÉPIGRAPHE
Il viendra un jour où ni les marchés, ni les
puissants, ni
l'égoïsme ne pourront étouffer le chant des
champs. Car la terre
n'oublie pas les coeurs justes, même quand les
sociétés
deviennent ingrates. L'économiste digne ne lit
pas seulement les
chiffres : il écoute la douleur qui se cache
derrière l'intérêt, et
la dignité qui
résiste à la haine
James Baldwin
II | P a g e
IN MEMORIAM
À la mémoire de notre regretté
père, KALALA Frederick, Père aimant et éducateur
exemplaire,
dont la bienveillance rayonnait au coeur de notre famille.
Aujourd'hui plus que jamais, nous
mesurons la profondeur de son amour, la
force de ses efforts, et la sagesse de ses conseils. Son
optimisme demeure
une lumière silencieuse, inspirant chacun de nos pas. Son souvenir
ne
s'efface pas: il s'enracine dans nos pensées, dans nos valeurs, et
dans chaque leçon de vie qu'il
nous a laissée.
III | P a g e
DEDICACE
Je dédie ce mémoire à la grande
famille KALALA, fondement de mon parcours et refuge de mon
coeur. A notre
chère mère, Angélique MBOMBO, femme de sagesse et de
courage, dont les
paroles et la force ont éveillé ma
pensée. A mon frère, Freddy KALALA dont l'amour constant,
la
tendresse et le soutient ont façonné l'homme que je suis
devenu. Ce travail est le reflet de votre
présent aimant, et c'est
à vous que je le dois.
IV | P a g e
REMERCIEMENTS
Ma gratitude la plus profonde s'élève tout
d'abord vers Dieu Tout-Puissant, Maître souverain du temps
et des
circonstances, qui m'a guidé et protégé tout au long de
ces trois années d'études. C'est par Sa grâce
que ce
parcours trouve aujourd'hui son aboutissement. Loué soit Son saint Nom,
pour les forces, la paix
et la persévérance qu'Il a
semées en moi.
Mes sincères remerciements vont à l'endroit
des autorités académiques de l'Université Notre-Dame
du
Kasaï, pour l'engagement constant dont elles font preuve dans la
formation de citoyens compétents et
dévoués à
l'avenir de notre société. Leur vision, leur rigueur et leur sens
du devoir constituent un socle
précieux pour notre croissance
intellectuelle et humaine.
Je tiens à exprimer une reconnaissance toute
particulière au Professeur Kevin KAZADI, Directeur de ce
travail,
dont la rigueur académique, la disponibilité et les conseils
avisés ont été une source inestimable
d'orientation et
de motivation.
Mes remerciements sincères vont également
à l'Assistant Justin KASHIYI et à l'Assistant Joseph
BENGUA,
encadreurs attentifs, pour leur accompagnement généreux, leur
patience et la richesse de leurs
observations, qui ont nourri chaque
étape de cette recherche.
Je remercie chaleureusement le Professeur François
TSHIONYI, Doyen de la Faculté des Sciences
Économiques et de
Gestion, pour son leadership éclairé, ainsi que l'ensemble du
bureau facultaire, pour
avoir veillé à la mise en place d'un
corps enseignant compétent et inspirant.
Du fond du coeur, je rends hommage à mes
frères et soeurs : Freddy KALALA, Bernadette KALALA,
Alphonsine
KALALA, ainsi que Célestin Tshishiku. Vos encouragements constants,
votre amour
inconditionnel et vos mots bienveillants m'ont porté,
surtout dans les moments de doute. Votre présence à
mes
côtés a été une source de courage, de joie, et de
stabilité.
Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements
à tous les amis et connaissances qui ont contribué,
de
près ou de loin, à la réussite de ce parcours. Je
pense notamment à Nelson WAY MANDELA, Narcisse
MASSAMBA et Jeannette
MPUTU, pour leurs gestes d'amitié, leur soutien fraternel et
leur
bienveillance discrète mais précieuse.
À tous les héros de l'ombre, ceux et celles
qui oeuvrent sans chercher à être nommés, que ces
lignes
traduisent la profondeur de ma reconnaissance.
Avec émotion et respect,
Samuel MUSANGA
V | P a g e
LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES 1. Tableau
1. Tableau sur la répartition des communes de Kananga :
Population, superficie, type
d'occupation 40
2.Tableau 1 : Présentation des variables
sélectionnées 41
3. Tableau 2 : Évolution trimestrielle des prix de
maïs (méga de 3kg) de 2016 à 2024 .46
4. Tableau 3 : Évolution trimestrielle du taux
d'inflation de 2016 à 2024 47
5. Tableau 4 : Statistique descriptive 49
7. Tableau 7 : Test de corrélation de Spearman entre taux
d'inflation et prix du maïs 50
9. Tableau 8 : Estimation du modèle 56
11. Tableau 9 : Test d'homoscedasticité (Breusch-Pagan)
53
12. Tableau 10 : test de normalité globale du
modèle 54
2. Graphique
1. Graphique 1 : L'inflation par la demande (courbes OG et DG)
17
2. Graphique 2 : Courbe de Phillips sur le chômage et
l'inflation 27
3. Graphique 3 : Prix et pouvoir d'achat des ménages
34
4. Graphique 4 : Signes de croissance de la ville de Kananga
40
5. Graphique 5 : Évolution combinée du taux
d'inflation et du prix du maïs à Kananga (2016-
2024) 48
6. Graphique sur la distribution des résidus
comparée à la norme 54
VI | P a g e
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYME
3. RDC : République Démocratique du Congo
4. UKA : Université Notre-Dame du Kasayi
5. BCC : Banque Centrale du Congo
6. IPC : Indice des Prix à la Consommation
7. IPP : Indice des Prix à la Production
8. PIB : Produit Intérieur Brut
9. FC / Fc : Franc Congolais
10. SS : Sum of Squares
11. df : Degrés de liberté (Degrees of
Freedom)
12. MS : Mean Square
13. F : Statistique de Fisher
14. R2 : Coefficient de détermination
15. Chi2 : Test du Chi carré
16. t : Statistique t de Student
17. L1LMD : Licence 1 dans le système
Licence-Master-Doctorat
18. DP : Dépenses Publiques
19. IPCt / IPPt : Indice des prix à la consommation /
à la production à la période t
20. M : Masse monétaire
21. V : Vitesse de circulation de la monnaie
22. P : Niveau général des prix
23. T : Volume des transactions
24. INS : Institut National de Statistique
VII | P a g e
RESUME
Mots clés : inflation, consommation,
produits agricoles, Kananga, maïs, pouvoir d'achat, économie
locale, solutions.
Ce travail cherche à comprendre comment l'inflation
influence la consommation des produits agricoles à Kananga. Il montre
comment la hausse des prix oblige les familles à changer leurs habitudes
alimentaires, surtout quand leurs revenus sont faibles.
L'inflation, c'est quand les prix augmentent partout et
pendant longtemps. Cela réduit le pouvoir d'achat : les gens peuvent
acheter moins avec le même argent. À Kananga, où les
produits agricoles comme le maïs sont essentiels pour se nourrir, cette
situation devient très difficile. Quand le prix du maïs monte, cela
montre que les familles souffrent économiquement.
Pour étudier cela, le travail utilise des
données de 2016 à 2024 et des outils statistiques sérieux
: le test de Spearman pour voir les liens entre les chiffres, une
régression linéaire pour mesurer l'effet de l'inflation, et des
tests pour vérifier si les résultats sont fiables. Les
résultats sont clairs : quand l'inflation augmente de 1 %, le prix du
maïs monte en moyenne de 0,0013 point. Le lien entre les deux est fort
(coefficient de 0,5942).
Cela a des conséquences concrètes : les familles
achètent moins, mangent moins varié, et les producteurs agricoles
ont plus de mal à vendre à bon prix. Le prix du maïs a
doublé en huit ans, ce qui montre bien la pression sur les
ménages.
Le travail propose des solutions : mieux contrôler la
monnaie, stabiliser le taux de change, soutenir les producteurs, et
protéger la sécurité alimentaire. Ces idées peuvent
aider à réduire les effets négatifs de l'inflation.
Ce mémoire ne parle pas seulement de chiffres. Il parle
aussi de la vie des gens. Derrière les statistiques, il y a des familles
qui font des choix difficiles chaque jour. Ce travail veut aider à
construire une économie plus juste, plus humaine, et plus proche des
réalités de Kananga
VIII | P a g e
ABSTRACT
Keywords: inflation, consumption,
agricultural products, Kananga, maize, purchasing power, local economy,
solutions.
This study aims to understand how inflation affects the
consumption of agricultural products in the city of Kananga. It shows how
rising prices force families to change their eating habits, especially when
their income is low.
Inflation means that prices go up everywhere and for a long
time. This reduces purchasing power, people can buy less with the same amount
of money. In Kananga, where food like maize is very important for daily meals,
inflation makes life harder. When maize prices go up, it shows that families
are struggling financially.
To study this, the research uses data from 2016 to 2024 and
reliable statistical tools: the Spearman test to check the link between
numbers, a simple linear regression to measure the effect of inflation, and
other tests to make sure the results are trustworthy. The findings are clear:
when inflation increases by 1%, the price of maize goes up by about 0.0013
point. The connection between the two is strong (correlation of 0.5942).
This has real consequences: families buy less food, eat fewer
types of food, and farmers find it harder to sell their products at good
prices. The price of maize has doubled in eight years, showing the pressure on
households.
The study suggests solutions: better control of money,
stabilizing the exchange rate, helping farmers, and protecting food security.
These ideas can help reduce the negative effects of inflation.
This research is not just about numbers. It's about people's
lives. Behind the statistics are families making hard choices every day. This
work hopes to support a fairer, more human economy that responds to the real
needs of Kananga's population.
1 | P age
INTRODUCTION GENERALE
L'inflation est sans doute l'un des concepts
économiques les plus largement reconnus. Elle a entraîné de
nombreuses nations dans des phases prolongées d'instabilité. Les
banques centrales se positionnent souvent comme des défenseurs
implacables contre l'inflation. Certains politiciens, qui avaient
été élus en promettant de maîtriser ce
phénomène, ont perdu leur siège en raison de leur
incapacité à tenir leurs promesses. En fait, le Président
Ford a même qualifié l'inflation d'ennemi public numéro un
aux États-Unis en 19741. Mais qu'est-ce que l'inflation? Et
pourquoi est-elle si importante? L'inflation est le taux d'augmentation des
prix sur une période donnée. En général, il s'agit
d'une mesure assez large, telle que la hausse globale des prix ou du coût
de la vie dans un pays. Mais elle peut aussi être calculée de
façon plus étroite, pour certains produits, les produits
agricoles, ou l'alimentation de base, par exemple. Quel que soit le contexte,
l'inflation mesure le renchérissement d'un groupe de biens ou de
services sur une période donnée, en général une
année.
Trois mots, c'est tout ce qu'il faut pour enflammer les coeurs
et éveiller des passions. « Liberté, Égalité,
Fraternité » ont guidé les esprits audacieux de la
Révolution française. « Je t'aime » est le nectar qui
nourrit les plus belles histoires d'amour. « Vie, Liberté, Bonheur
» incarnent l'essence même de la Déclaration
d'indépendance des États-Unis2. Pour de nombreux
économistes, ces mots enchanteurs se résument à «
offre, demande, prix ». Ces formules simples portent en elles le pouvoir
de transformer des sociétés et des destins. Dans toute
transaction entre un vendeur et un acheteur, le prix du bien ou du service est
déterminé par l'offre et la demande, lesquelles résultent
à leur tour de la technologie et des conditions dans lesquelles les
intéressés évoluent. À un extrême, le
marché peut être composé d'un grand nombre de vendeurs et
d'acheteurs pratiquement identiques (par exemple le marché de
maïs). À l'autre extrême, il peut n'y avoir qu'un vendeur et
qu'un acheteur (par exemple si je voulais échanger le manioc contre le
riz).
Dans la ville de Kananga, ce phénomène
économique a des répercussions significatives sur la vie
quotidienne et sur la sécurité alimentaire des habitants.
À travers cette analyse, nous proposons de vous plonger au coeur des
dynamiques économiques qui façonnent nos choix alimentaires et
notre bien-être. En unissant nos efforts pour comprendre ces enjeux, nous
pouvons bâtir des solutions collectives visant à améliorer
la qualité de vie de notre communauté. Ce travail se veut une
invitation à la réflexion et à l'engagement, car il
concerne non seulement les économistes, mais aussi chaque citoyen
soucieux de son avenir. Ensemble, explorons les mécanismes
derrière l'inflation et découvrons comment elle influe sur notre
présent et notre avenir à Kananga. Nous vous encourageons
à poursuivre cette lecture
1CEYDA O., ABC de l'économie : qu'est-ce
que l'inflation, site de FMI, finance & développement, mars
2010.
2 ASMUNDSON I., ABC de l'économie : l'offre et la
demande, site de FMI, finance & développement, juin 2010
2 | P age
enrichissante qui promet de nourrir votre curiosité et
votre compréhension des défis contemporains.
0.1. ETAT DE QUESTION
La question de « l'Analyse de l'inflation et son
incidence sur la consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga
» a été au coeur des préoccupations de certains
auteurs comme :
Marie K. TSHITENGE3, dans son
étude portant sur « Inflation et consommation des produits
agricoles dans la ville de Kananga ». L'objectif recherché
dans ce travail était d'examiner comment les variations des prix
influencent les habitudes alimentaires des ménages. Sa
problématique de ce travail était de savoir l'impact de
l'inflation sur les choix alimentaires des ménages à Kananga et
cette problématique avait comme hypothèse « L'inflation
entraîne une réduction de la diversité des produits
agricoles consommés ». L'étude conclut que l'inflation a un
impact positif direct sur la consommation des produits agricoles, provoquant
une substitution vers des aliments moins coûteux et une baisse de la
diversité alimentaire. Les résultats suggèrent qu'une
sensibilisation et des politiques de soutien aux ménages à faible
revenu sont nécessaires.
Jean-Paul L. MULUMBA4, dans sa
thématique « Les effets de l'inflation sur l'accès aux
produits alimentaires à Kananga », la préoccupation
majeure dans ce travail était celle d'analyser les conséquences
économiques de l'inflation sur l'accès alimentaire en milieu
urbain. La problématique de ce travail était de comprendre si
l'inflation impacte-elle l'accès aux produits agricoles pour les
ménages de Kananga et cette problématique avait comme
hypothèse : « L'inflation réduit l'accès aux produits
alimentaires de base pour les ménages pauvres ». Le chercheur
révèle que l'inflation aggrave l'insécurité
alimentaire, particulièrement pour les ménages à faibles
revenus, qui constatent une augmentation des dépenses alimentaires
proportionnellement à leur revenu. Les auteurs recommandent
l'implémentation de programmes alimentaires et de politiques de
régulation des prix.
3 TSHITENGE M, Inflation et consommation des produits
agricoles dans la ville de Kananga, mémoire UNIKAN, inédit
2021
4 MULUMBA J, Les effets de l'inflation sur l'accès aux
produits alimentaires à Kananga, U.KA, mémoire 2022
3 | P a g e
Sidoine M. MBALA5, dans sa
recherche ayant comme thème : « Les effets de l'inflation sur
l'accès aux produits alimentaires à Kananga », ce travail
avait comme objectif général d'étudier les adaptations
comportementales des consommateurs face à l'inflation. La
problématique de ce travail était de savoir comment les
consommateurs s'adaptent-ils à l'augmentation des prix des produits
agricoles à Kananga et l'hypothèse du départ était
« Les consommateurs modifient leurs achats en fonction des fluctuations
des prix, choisissant des alternatives moins coûteuses ».
Sidonie après ses recherches il conclut que Face aux
fluctuations des prix, les consommateurs modifient leurs habitudes d'achat,
privilégiant des alternatives moins coûteuses pour maintenir leur
accès aux produits alimentaires.
Jean-Pierre MBUYI6, dans son
article intitulé "L'impact de l'inflation sur la consommation
alimentaire en Afrique subsaharienne". La préoccupation majeure dans ce
travail était celle d'analyser comment l'inflation affecte les choix
alimentaires des ménages en Afrique subsaharienne. Cet article avait
comme problématique de savoir comment l'évolution des prix des
produits alimentaires influence la consommation des ménages en
période d'inflation. Ainsi cette problématique avait eu comme
hypothèse du départ « une augmentation des prix
entraînent une réduction de la consommation des produits de base,
modifiant ainsi le régime alimentaire des ménages ».
L'article conclut qu'une inflation élevée réduit
l'accès des ménages aux aliments essentiels, exacerbant la
malnutrition. Les politiques publiques doivent donc inclure des mesures pour
stabiliser les prix afin de garantir la sécurité alimentaire.
Marie-Claude TSHIBANDA7, dans son
article intitulé "Le rôle de l'inflation dans le changement des
comportements de consommation". L'objectif de recherche de ce travail
était d'évaluer les changements dans les comportements d'achat
des consommateurs face à l'inflation dans les zones urbaines. L'auteur
de cet article avait comme problématique de recherche qui était
de savoir quel est l'effet de l'inflation sur les décisions d'achat
des
5 MBALA S., Les effets de l'inflation sur l'accès aux
produits alimentaires à Kananga, UNIKAN, mémoire 2023
6 MBUYI J-P., L'impact de l'inflation sur la consommation
alimentaire en Afrique subsaharienne, Kinshasa RDC, Presses Universitaires
de Kinshasa 2021.
7 TSHIBANDA M-C., Le rôle de l'inflation dans le
changement des comportements de consommation, LUBUMBASHI RDC,
Éditions de l'Université de Lubumbashi, 2020.
4 | P age
consommateurs concernant les produits alimentaires. Ainsi sur
cette problématique, l'auteur avait comme hypothèse «
l'augmentation des prix entraîne un ajustement des
préférences vers des produits moins chers ou des substituts
». La recherche démontre que l'inflation modifie
considérablement les comportements d'achat, forçant les
consommateurs à faire des choix plus économiques. Cela souligne
la nécessité d'éduquer les consommateurs sur les options
abordables
Adélaïde Muna8, dans
son livre intitulé : "Consommation et inflation : enjeux pour
l'agriculture", dans ce livre, la préoccupation majeure de l'auteur
était de comprendre la relation entre inflation et consommation des
produits agricoles dans les zones urbaines d'Afrique centrale. Ainsi, pour
évoluer avec son travail Adélaïde Muna avait la
problématique majeure qui était de savoir comment la dynamique de
l'inflation influence-t-elle le marché des produits agricoles en milieu
urbain. Cette problématique avait comme hypothèse du
départ « L'inflation accroît la pression sur les producteurs
agricoles, entraînant des ajustements dans la chaîne
d'approvisionnement et la consommation ». Le livre conclut que l'inflation
a un impact direct sur la consommation des produits agricoles, avec des
répercussions à la fois sur les producteurs et les consommateurs.
Il appelle à des stratégies de soutien aux agriculteurs pour
maintenir une offre stable face à la variabilité des prix.
Pour nous démarquer aux travaux
précédents qui abordent l'inflation de manière
générale ou par des enquêtes qualitatives, notre
étude se distingue par une analyse économétrique
ciblée sur le maïs, produit de base à Kananga, avec des
données locales et des tests statistiques précis. Elle apporte
ainsi une lecture chiffrée et concrète du lien entre inflation et
consommation alimentaire.
0.2. PROBLEMATIQUE
Dans un monde de plus en plus globalisé, l'inflation
est un phénomène économique qui ne connaît pas de
frontières. Elle affecte les économies des pays, qu'ils soient
développés ou en développement, en modifiant le pouvoir
d'achat des consommateurs. Sur la scène mondiale, les fluctuations des
prix des denrées alimentaires, exacerbées par des crises
8 A MUNA, Consommation et inflation : enjeux pour
l'agriculture, Bruxelles, Éditions Agricoles de Bruxelles, 2019
Dans la ville de Kananga, l'inflation a un impact significatif
sur la consommation des produits agricoles. Dans cette ville, une hausse des
prix peut rendre les
5 | P a g e
géopolitiques, des changements climatiques et des
pandémies, ont entraîné une hausse significative du
coût de la vie. Ces fluctuations des prix des biens et services se
traduisent par des comportements d'achat variés, particulièrement
en ce qui concerne les produits agricoles essentiels à la subsistance
des populations. Ce contexte mondial d'augmentation des prix intensifie les
inégalités économiques, posant des défis pour les
ménages les plus vulnérables.
En Afrique, la situation est particulièrement
préoccupante. Le continent, riche en ressources agricoles, souffre
souvent d'une gestion inefficace de sa production et d'une dépendance
aux importations alimentaires qui les rend particulièrement sensibles
aux chocs inflationnistes, réduisant ainsi leur capacité
d'accès aux ressources alimentaires de base. Les taux d'inflation
élevés, couplés à des infrastructures
inadéquates et à des politiques économiques instables,
rendent la situation encore plus délicate. Les consommateurs africains,
en particulier ceux des zones rurales et périurbaines, ressentent
directement l'impact de l'inflation sur leur panier de la
ménagère, ce qui contribue à une pression accrue sur les
familles qui peinent à satisfaire leurs besoins devinés par la
hausse des prix alimentaires les incite à repenser leurs habitudes
d'achat.
La République Démocratique du Congo (RDC), au
coeur de l'Afrique, est un exemple frappant de cette réalité.
Avec ses vastes ressources agricoles et ses terres fertiles, le pays a le
potentiel de nourrir sa population. Cependant, l'inflation galopante,
alimentée par des conflits internes, des politiques économiques
instables et une corruption chronique, mine les capacités des Congolais
à accéder aux produits agricoles. La distorsion des prix sur le
marché local a un impact direct sur la consommation, forçant de
nombreux ménages à se tourner vers des alternatives moins
nutritives ou à réduire significativement leur consommation
alimentaire. L'inflation impacte non seulement le pouvoir d'achat des
consommateurs, mais influence également la manière dont les
producteurs agricoles ajustent leur offre face à la demande fluctuante.
Les habitants de la RDC, et particulièrement ceux de Kananga, une ville
au coeur de la province du Kasaï Central, ressentent directement les
effets de cette situation économique.
H2 : Ce taux d'inflation influencerait négativement la
consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga .
6 | P a g e
produits alimentaires moins accessibles pour les
ménages, en particulier pour les populations à faibles revenus.
Les agriculteurs, quant à eux, peuvent éprouver des
difficultés à écouler leur production à des prix
rentables. L'insécurité alimentaire est donc exacerbée,
car les consommateurs se voient forcés de réduire leurs achats ou
de se tourner vers des produits moins nutritifs.
De plus, l'inflation entraîne des coûts de
production plus élevés pour les agriculteurs, que ce soit
à cause des prix des semences, des engrais ou des équipements. En
conséquence, cela peut réduire la qualité et la
quantité des récoltes. Les variations du prix des produits
agricoles rendent également le marché instable, rendant difficile
la planification à long terme pour les agriculteurs et les
détaillants.
Cette situation crée un cercle vicieux où
l'inflation affecte la consommation, ce qui, à son tour, impacte la
production. Il est crucial d'explorer les effets de cette inflation sur la
nutrition des familles et sur l'économie locale. Comprendre ces
dynamiques peut aider les décideurs politiques à élaborer
des stratégies adaptées pour atténuer ces problèmes
et soutenir les agriculteurs comme les consommateurs. Ce sujet appelle donc
à une réflexion approfondie pour mieux saisir les enjeux
économiques et sociaux engendrés par l'inflation à
Kananga.
Ainsi, quelques questions se posent pour guider notre
réflexion dans ce
domaine:
1. Existe-t-il une corrélation entre l'inflation et la
consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga?
2. Quelle est l'incidence de taux d'inflation sur la
consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga?
0.3. HYPOTHESE
H1 : Il existerait une corrélation entre le taux
d'inflation et la consommation des produits agricoles dans la ville de
Kananga.
7 | P a g e
0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET.
Choisir de travailler sur le sujet de l'« Analyse de
l'inflation et son incidence sur la consommation des produits agricoles dans la
ville de Kananga » est pertinent pour plusieurs raisons.
0.4.1. CHOIX DU SUJET
L'inflation est un phénomène largement
étudié en économie, mais son impact spécifique sur
des villes comme Kananga, où l'agriculture joue un rôle central
dans l'économie, est moins souvent abordé. En se concentrant sur
cette ville, l'analyse permet d'explorer des réalités
économiques locales, de comprendre les défis uniques auxquels les
consommateurs et les producteurs font face et d'évaluer comment les
variations des prix affectent l'accès aux biens alimentaires
essentiels.
0.4.2. INTERET DU SUJET
a. intérêt personnel
En abordant ce sujet, nous allons approfondir nos
connaissances sur l'inflation et la consommation des produits agricoles dans la
ville de Kananga et aussi proposer des solutions pour résoudre les
problèmes d'inflation dans la ville de Kananga.
b. intérêt scientifique
Ce sujet ouvre une réflexion approfondie sur l'impact
économique de l'inflation sur un marché spécifique, celui
des produits agricoles. Il permet d'analyser la corrélation entre la
hausse des prix, la disponibilité des produits et les ajustements des
consommateurs.
De plus, une étude scientifique sur cette
problématique peut enrichir la littérature économique en
apportant des données concrètes et des analyses précises
sur la ville de Kananga, un terrain d'étude souvent peu exploré
dans les recherches économiques.
8 | P a g e
c. Intérêt social
L'inflation affecte directement le quotidien des populations
de Kananga, modifiant leur pouvoir d'achat et leurs habitudes de consommation.
Comprendre cette dynamique permet de mettre en lumière les défis
rencontrés par les ménages, les producteurs et les
commerçants, tout en apportant des pistes de solutions pour garantir
l'accès à une alimentation suffisante et
équilibrée.
Une telle étude peut également orienter les
politiques publiques vers des actions plus efficaces pour soutenir les
populations vulnérables face à la montée des prix.
1.5. OBJECTIFS DE RECHERCHE 1.5.1. Objectif
général
L'objectif général de notre recherche est
d'identifier et d'analyser l'incidence de l'inflation sur la consommation des
produits agricoles dans la ville de Kananga.
1.5.2. Objectifs spécifiques de
recherche
Et d'une manière spécifique, nous allons
chercher à déterminer l'impact de prix de produit locaux face
à la disponibilité et l'accessibilité. Donc nous allons
posséder comme suit :
1Étudier l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat
des ménages à Kananga.
2. Analyser l'effet de l'inflation sur les prix des produits
agricoles.
3.Évaluer les conséquences sur la
sécurité alimentaire des populations vulnérables.
0.6. METHODE ET TECHNIQUE UTILISEE
5.1 Méthode utilisée
En faisant ce travail, nous avons utilisé la
Méthode économétrique, cette
méthode combine des théories économiques avec des
techniques statistiques pour tester des hypothèses et modéliser
des relations économiques. Elle utilise des équations
mathématiques pour représenter des comportements observables et
permet d'estimer l'impact de différents
9 | P a g e
facteurs. Cette méthode est essentielle pour faire des
prévisions et évaluer l'efficacité des politiques
économiques.
Cette méthode consiste également à
utiliser des modèles statistiques pour examiner les relations entre
différentes variables économiques. Dans le cadre de notre
étude sur l'inflation et la consommation des produits agricoles à
Kananga, nous allons utiliser des modèles de régression.
Ça nous a permis de quantifier comment l'inflation
affecte le pouvoir d'achat des consommateurs et, par conséquent, leur
consommation de produits agricoles. Nous collecterons des données sur
les prix des produits agricoles, l'indice d'inflation et les niveaux de
consommation sur plusieurs années pour établir des relations
claires et significatives.
Nous avons également utilisé
Méthode analytique. Cette méthode se distingue
par sa capacité à décomposer un phénomène
complexe en éléments fondamentaux afin d'en examiner chaque
composante avec rigueur.
En adoptant cette approche, le chercheur dissèque
minutieusement les données de manière à clarifier la
structure sous-jacente du sujet étudié. Ce procédé
permet d'identifier des interrelations, d'extraire des tendances et de
dégager des causalités subtiles qui, autrement, resteraient
dissimulées dans l'agrégat du phénomène. En offrant
une lecture détaillée et systématique, la méthode
analytique favorise une compréhension nuancée qui concilie
précision scientifique et lucidité intellectuelle,
éclairant ainsi le chemin vers des conclusions solides et
argumentées
5.2. Technique utilisée
Nous avons utilisé la TECHNIQUE DOCUMENTAIRE
qui consiste à rassembler et à analyser des documents
existants, tels que des rapports économiques, des études
antérieures, des articles scientifiques ou des statistiques
gouvernementales pour obtenir des informations sur un sujet économique
précis. Elle permet d'accéder à des données
historiques et à des analyses antérieures, offrant des
éléments contextuels et une base de connaissances solide.
10 | P a g e
Pour ce travail, nous rassemblerons des données
à partir de ces sources afin d'avoir une base solide d'informations.
Cela permettra également de contextualiser notre étude et de
renforcer nos conclusions par des références fiables et
variées sur l'impact de l'inflation sur la consommation.
Nous avons aussi utilisé LA TECHNIQUE D'ANALYSE
DE DONNEES est une approche méthodique qui consiste à
transformer des données brutes en connaissances éclairées
et exploitables. Cette démarche se décompose en plusieurs
étapes séquentielles essentielles. Tout d'abord, il s'agit de
collecter des données provenant de sources diverses -
qu'elles soient issues d'études, de bases de données
institutionnelles ou de rapports sectoriels. La richesse et la pertinence des
informations recueillies conditionnent d'emblée la qualité de
l'analyse qui suivra.
Ensuite, le processus intègre une phase cruciale de
nettoyage et de préparation des données. Ici,
l'objectif est d'éliminer les incohérences, les doublons et les
valeurs aberrantes, tout en harmonisant les informations pour qu'elles soient
comparables entre elles. C'est un travail minutieux qui permet de garantir que
les analyses futures se basent sur des données fiables et
cohérentes. À ce stade, la transformation des données, par
le biais de techniques telles que la normalisation ou l'agrégation,
prépare le terrain pour une exploration approfondie.
La phase suivante implique l'application de techniques
statistiques et analytiques. Concrètement, cela peut inclure
l'utilisation de méthodes de régression, l'analyse en composantes
principales ou encore l'application d'algorithmes de machine learning. Ces
outils permettent de détecter des tendances, des corrélations et
des patterns qui ne sont pas immédiatement apparents à l'oeil nu.
Grâce à cette approche quantitative, chaque donnée trouve
sa place dans un modèle explicatif qui contribue à formuler des
hypothèses solides sur le phénomène
étudié.
Enfin, la connaissance extraite se matérialise par une
visualisation et une interprétation claire des résultats.
La présentation sous forme de graphiques, de tableaux et de
tableaux de bord facilite la communication des conclusions aux décideurs
ou au public ciblé.
11 | P a g e
Cette phase de vulgarisation est essentielle, car elle permet
de traduire des analyses complexes en messages accessibles et pertinents pour
une prise de décision informée.
En résumé, la technique d'analyse de
données marie rigueur scientifique et clarté pédagogique.
En orchestrant soigneusement la collecte, le nettoyage, l'analyse et la
visualisation, elle transforme un amas de chiffres en un récit
cohérent qui éclaire et inspire les décideurs, tout en
restant fidèle à une exigence de précision et de
transparence essentielle à toute recherche approfondie.
0.7. DELIMITATION DU SUJET
Pour enrichir notre recherche sur le sujet « Analyse de
l'inflation et son incidence sur la consommation des produits agricoles dans la
ville de Kananga », il est primordial de définir avec
précision les limites temporelles et spatiales de notre étude,
tout en intégrant des données primaires actuelles qui offriront
une vision réaliste et pertinente.
0.7.1. Cadre temporel :
Le cadre temporel de notre étude couvre les huit
dernières années, de 2016 à 2024. Cette période
nous permettra d'explorer les tendances récentes de l'inflation dans la
ville de Kananga et son influence sur le comportement des consommateurs.
Analyser cette phase spécifique nous aidera à comprendre comment
des événements récents ont modelé la situation
actuelle et à anticiper les développements futurs.
0.7.2. Cadre spatial :
L'étude se limiterait à la ville vibrante de
Kananga, capitale de la province du Kasaï-Central en République
Démocratique du Congo. Ce choix géographique est d'une importance
cruciale, car Kananga, avec son lien fort à l'agriculture locale,
représente un microcosme où l'influence de l'inflation se fait
ressentir au quotidien. En nous immergeant dans la réalité de
cette ville, nous pourrons recueillir des témoignages, des
données auprès des institutions comme la banque centrale et aussi
l'institut nationale de statistique de Kananga (INS) et des expériences
vécues qui enrichiront notre analyse et donneront une voix à ceux
qui sont au coeur des enjeux économiques.
12 | P a g e
En délimitant notre sujet ainsi, nous visons à
créer un récit captivant et accessible qui incitera les lecteurs
à explorer chaque page de ce mémoire. En nous appuyant sur des
données actuelles et des perspectives locales, nous espérons
offrir des éclairages précieux sur l'interaction entre inflation
et consommation agricole, contribuant ainsi à une meilleure
compréhension des défis économiques contemporains à
Kananga.
0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion
générales, notre travail sur l'analyse de l'Inflation et son
Incidence sur la Consommation de Produits Agricoles dans la Ville de Kananga
est subdivisé en trois chapitres :
Le premier chapitre porte sur le cadre théorique. Dans
ce chapitre il sera question d'offrir une exploration approfondie des
mécanismes de l'inflation, de ses causes et de ses conséquences
sur l'économie. La compréhension des principes économiques
sous-jacents nous permettra de mieux saisir les enjeux qui affectent le pouvoir
d'achat des consommateurs.
Le deuxième chapitre portera sur le cadre
d'étude et approche méthodologique. dans ce chapitre, nous
mettrons en lumière les spécificités de Kananga en tant
que centre agricole et les défis économiques auxquels ses
habitants sont confrontés. La richesse de son potentiel agricole
contraste avec les réalités économiques, soulignant la
résilience des communautés face aux difficultés.
Le troisième et dernier chapitre intitulé
présentation et interprétation des résultats analysera de
manière ciblée comment l'inflation influence la consommation de
produits agricoles à Kananga. En liant les effets de l'inflation aux
comportements d'achat des consommateurs, nous mettrons en lumière les
stratégies d'adaptation et les choix alimentaires qui émergent
dans ce contexte inflationniste.
Cette structure de recherche vise à approfondir notre
compréhension des interrelations complexes entre inflation, agriculture
et consommation à Kananga, ouvrant ainsi la voie à des solutions
éclairées.
13 | P a g e
CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE
1.1. NOTION SUR L'INFLATION
L'inflation est un phénomène économique qui
se traduit par une hausse généralisée et soutenue des prix
des biens et services. Elle diminue le pouvoir d'achat des consommateurs et
influence les décisions économiques des ménages et des
entreprises.
Suivant l'évolution du rythme de croissance des prix,
l'inflation peut donner lieu à différents
phénomènes tels que :
La désinflation9
La désinflation désigne le ralentissement du
rythme de progression des prix. Tout en restant positif, le taux peut
évoluer à la baisse et constituer un objectif de politique
économique. Certains pays peuvent également mener des politiques
de désinflation compétitive afin de relancer l'économie.
En effet, en maintenant les prix à des niveaux inférieurs par
rapport à ceux des pays compétiteurs, les autorités
favorisent la compétitivité de la production nationale, ce qui
contribue à l'augmentation des exportations et par ricochet à
l'amélioration de la balance commerciale.
La déflation10
La déflation est caractérisée par une
baisse continue du niveau général des prix, ce qui freine
l'activité économique et augmente le taux de chômage. Pour
les ménages, elle inciterait à différer leur consommation
et leur investissement dans le futur puisque la valeur de la monnaie risque de
s'apprécier. Pour ce qui est des entreprises, cette situation leur
laisse peu de possibilité pour augmenter leurs marges puisque celles-ci
ne peuvent réduire leurs coûts aussi vite que la baisse de
l'activité économique.
De ce fait, ces dernières peuvent être
portées à réduire leur niveau de production et parfois
à procéder au licenciement de leurs employés.
Conséquemment, la
9 MANDE P., Cours de macro économie L1LMD,
UKA
10 IDEM
11 IDEM
12 IDEM
14 | P a g e
déflation peut entraîner une diminution des
salaires, un accroissement du chômage et dans certains cas, une baisse de
la consommation.
L'hyperinflation11
Selon l'économiste Phillip Cagan, on parle
d'hyperinflation quand le niveau d'inflation se maintient au-dessus de 50 % par
mois. Elle peut être due à un déficit de la balance
commerciale. Avec des importations qui excèdent les exportations, la
monnaie se déprécie, ce qui, à son tour, renchérit
le prix des importations et accélère l'inflation. Elle peut aussi
être attribuée au déficit budgétaire. En effet, avec
des dépenses qui dépassent largement les recettes, l'État
se trouve dans l'obligation de se financer auprès de la Banque centrale.
Suite à cette augmentation de la masse monétaire non
concurrencée par une évolution similaire de la production de
biens et de services, le rythme d'augmentation des prix va en
s'accélérant, ce qui renvoie à la théorie
quantitative de la monnaie.
L'hyperinflation a des effets très néfastes sur
la valeur de la monnaie nationale et les pays qui ont subi une crise
hyper-inflationniste sont souvent obligés de recourir à la
dollarisation pour stabiliser le système de paiement et rétablir
la confiance du public dans la politique économique du gouvernement.
La stagflation12
La stagflation est caractérisée par une
stagnation de l'activité économique et une forte inflation. Elle
s'accompagne en général d'un taux de chômage
élevé. Deux raisons peuvent expliquer une stagflation. D'une
part, elle peut être causée par l'augmentation du prix d'un
produit stratégique importé comme le pétrole ou autres
matières premières. D'autre part, elle peut résulter d'une
offre excessive de monnaie, comme la monétisation du déficit
budgétaire. Ces phénomènes, combinés à un
ralentissement de l'activité économique, engendrent la
stagflation.
15 | P a g e
Plusieurs facteurs peuvent engendrer l'inflation : une demande
trop forte par rapport à l'offre disponible, une augmentation des
coûts de production (matières premières, salaires,
transports) ou encore une politique monétaire trop expansive qui injecte
trop de liquidités dans l'économie. On distingue l'inflation par
la demande, où l'offre ne suit pas la consommation, et l'inflation par
les coûts, qui découle de l'augmentation des prix des facteurs de
production.
Dans une ville comme Kananga, l'inflation impacte fortement la
consommation des produits agricoles : lorsque les prix des denrées
alimentaires augmentent, les ménages adaptent leur régime
alimentaire en fonction de leur budget, ce qui peut entraîner une baisse
de la diversité et de la qualité nutritionnelle. Mieux comprendre
les mécanismes de l'inflation permet d'anticiper ses effets et de
proposer des stratégies pour en limiter l'impact sur le pouvoir d'achat
et la sécurité alimentaire.
1.1.1. Définition de l'inflation
Voici trois différentes définitions d'inflation des
économistes célèbres :
Selon Milton Friedman13 dans son
ouvrage "A Monetary History of the United States" et la traduction
française de ce livre s'intitule Une histoire monétaire des
États-Unis (1963), L'inflation est toujours et partout le
résultat d'une expansion monétaire, elle est une augmentation
soutenue et généralisée des prix des biens et services.
Selon Friedman, l'inflation est
principalement causée par une augmentation de la quantité de
monnaie en circulation. Lorsque l'État imprime plus de monnaie sans
augmenter la production de biens et services, cela entraîne une hausse
des prix. Cette perspective met en avant le rôle crucial des politiques
monétaires dans la gestion de l'inflation.
Selon John Maynard Keynes14 : Dans
"The General Theory of Employment, Interest, and Money" dont la version
française s'intitule « La théorie générale de
l'emploi, de
13 FRIEDMAN M., A Monetary History of the United
States, 1867-1960", Etats-unis d'Amérique, Princeton University
Press, 1963, page 32.
14 KEYNES JM., The General Theory of Employment, Interest,
and Money", 1936, Macmillan, page 25.
16 | P a g e
l'intérêt et de la monnaie » en (1936),
Keynes définit l'inflation comme le résultat d'une demande
dépassant l'offre dans une économie ou l'augmentation des prix
qui dépasse l'augmentation des salaires.
Keynes considère que cette situation peut
découler de facteurs variés, tels que l'augmentation de la
demande agrégée pendant les périodes de
prospérité. Cela souligne le rôle des attitudes des
consommateurs et des investisseurs dans les fluctuations économiques.
Keynes souligne également l'importance de la relation entre la demande
globale et l'offre. Lorsque la demande des consommateurs pour des biens et
services augmente plus rapidement que l'offre disponible, les prix ont tendance
à monter. Ce concept met en lumière l'importance de la politique
économique pour équilibrer la demande et l'offre afin
d'éviter l'inflation.
Selon Joseph Stiglitz15: Dans
"Inflation, a growth target for monetary policy" (Objectif de croissance pour
la politique monétaire) (2000), Stiglitz définit l'inflation
comme "une augmentation durable des prix, causée par une
dévaluation de la monnaie.".
Stiglitz insiste sur l'impact psychologique et comportemental
de l'inflation sur les choix économiques des individus et des
entreprises. Cette définition met en lumière l'effet de
l'inflation sur la confiance des consommateurs et des investisseurs, reflet
d'une économie en bonne santé. Fisher fait le lien entre la
valeur de la monnaie et les prix. Lorsque la valeur de la monnaie diminue, cela
signifie qu'il faut plus de monnaie pour acheter la même quantité
de biens et services, ce qui traduit une inflation. Cette idée souligne
l'importance du maintien de la stabilité monétaire pour
prévenir l'inflation.
Nous aussi de notre part, au travers toutes ces
définitions des auteurs, nous définissons aussi l'inflation comme
une augmentation générale et soutenue des prix des biens et
services dans une économie, réduisant ainsi le pouvoir d'achat
des consommateurs. Elle reflète souvent un déséquilibre
entre l'offre et la demande de monnaie ou de produits.
15 STIEGLITZ J., The Purchasing Power of Money: Its
Determination and Relation to Credit, Interest, and Crises, 1920,
Macmillan, page 78.
17 | P a g e
Ces définitions variées illustrent la
complexité du phénomène de l'inflation et son impact sur
l'économie. Dans le cadre de la ville de Kananga, il est essentiel de
prendre en compte ces différentes perspectives pour analyser le lien
entre l'inflation et la consommation des
Produits agricoles, permettant ainsi d'orienter les politiques
publiques et les stratégies commerciales de manière efficace.
1.1.2. Les types d'inflation.
L'inflation peut être classifiée en plusieurs
types, chacun ayant des causes et des conséquences spécifiques.
Voici les principaux types :
? L'inflation monétaire
La théorie quantitative de la monnaie établit
une causalité entre les variations de la quantité de monnaie en
circulation et celles du niveau général des prix en se basant sur
l'équation de Fisher : M×V=P×T (avec M = stock de monnaie en
circulation, P = niveau général des prix, V = vitesse de
circulation de la monnaie et T = volume des transactions). Selon les
monétaristes, en considérant le plein emploi des facteurs de
production, toute variation de la quantité de monnaie implique une
variation des prix, la vitesse de circulation de la monnaie et le volume de
transaction restant constants. L'inflation dans une économie est donc le
résultat d'une émission de monnaie trop importante qui
dépasse la valeur des biens produits (volume de production) au cours
d'une période donnée. En d'autres termes, l'inflation
monétaire résulte d'une inadéquation entre la
quantité de monnaie et le volume de biens et services dans
l'économie.
? L'inflation par la demande
Dans La Théorie générale de l'emploi, de
l'intérêt et de la monnaie (1936), John Maynard Keynes affirme que
les prix, qu'ils soient globaux ou spécifiques à un bien,
obéissent à une même logique : ils sont régis par la
loi de l'offre et de la demande. Autrement dit, le niveau général
des prix dans une économie résulte, tout comme les prix
individuels, de
18 | P a g e
l'interaction entre la quantité de biens disponibles
(offre) et la quantité de biens souhaités par les consommateurs
(demande).
L'inflation dite « par la demande » se produit
lorsqu'il y a un déséquilibre : la demande globale de biens et
services dépasse les capacités de production de
l'économie, c'est-à-dire qu'il y a davantage de consommateurs
désireux d'acheter que de produits disponibles sur le marché.
Selon le fonctionnement du marché, le « prix
d'équilibre » d'un bien est atteint lorsque la quantité
offerte égale la quantité demandée. Ce raisonnement,
d'abord applicable à un marché isolé (niveau
microéconomique), peut être élargi à l'ensemble des
marchés, à l'échelle de l'économie dans son
ensemble (niveau macroéconomique). C'est ainsi que l'on peut
interpréter l'inflation par la demande comme une hausse
généralisée des prix due à une pression excessive
de la demande globale par rapport à l'offre agrégée.
Graphique N°1 : L'inflation par la
demande16.
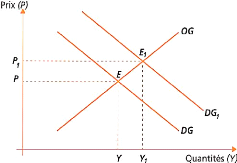
La courbe OG (Offre Globale) représente la
quantité totale de biens et services que les entreprises d'un pays sont
prêtes à produire et à proposer sur le marché. Cette
offre globale augmente avec le niveau général des prix : plus les
prix sont élevés, plus les entreprises sont encouragées
à produire, car cela rend la production plus rentable.
16 MASHALA M.,
Notes de cours de microéconomie, L1LMD, UKA,
2025.
19 | P a g e
De l'autre côté, la courbe DG (Demande Globale)
reflète la quantité totale de biens et services que les
différents agents économiques souhaitent acheter. Elle regroupe
:
? la consommation des ménages,
? les investissements des entreprises,
? les dépenses publiques (DP),
? et les exportations vers le reste du monde.
Contrairement à l'offre, la demande globale diminue
lorsque les prix augmentent. Pourquoi, Parce que des prix plus
élevés réduisent le pouvoir d'achat des consommateurs et
freinent les décisions d'investissement ou d'achat.
L'intersection entre ces deux courbes, au point E, traduit
l'équilibre global : c'est là que la quantité offerte est
exactement égale à la quantité demandée. Le prix
correspondant est appelé prix d'équilibre, noté P.
Maintenant, imaginons une situation où la demande
globale augmente. par exemple, à cause d'une hausse des dépenses
publiques ou d'une plus grande consommation. Graphiquement, cela se traduit par
un déplacement de la courbe DG vers la droite, passant de DG à
DG1.
Deux scénarios peuvent alors se produire selon la
capacité de réaction de l'offre :
1. Si l'offre est parfaitement élastique : cela
signifie que les entreprises peuvent augmenter immédiatement leur
production pour répondre à la demande croissante. Elles disposent
de ressources inutilisées, comme de la main-d'oeuvre disponible ou des
machines sous-exploitées. Dans ce cas, la quantité produite
augmente sans tension sur les prix : l'économie s'adapte sans
inflation.
2. Si l'offre est inélastique : les entreprises
atteignent leurs limites de production. Elles manquent par exemple de
main-d'oeuvre ou de capacités techniques pour produire davantage. Dans
ce contexte, l'offre ne peut pas suivre le rythme de la demande.
Résultat
20 | P a g e
? L'excès de demande provoque une hausse
généralisée des prix, autrement dit une inflation par la
demande.
? Inflation des coûts
Cette forme d'inflation est causée par une augmentation
des coûts de production, notamment les salaires, les matières
premières et l'énergie. Lorsqu'une entreprise fait face à
des coûts plus élevés, elle répercutera ces
augmentations de prix sur les consommateurs, générant ainsi une
inflation. Quand le prix des intrants agricoles (la houe, la bêche, les
semences, ou les engrais) augmente, les producteurs transmettent souvent ces
coûts aux consommateurs sous forme de prix plus élevés.
Cela peut avoir des conséquences directes sur la rentabilité des
exploitations agricoles à Kananga et sur la disponibilité des
produits à des prix accessibles17.
? Inflation importée
Elle résulte de l'augmentation des prix des biens
importés, souvent à cause de fluctuations des taux de change ou
de l'augmentation des prix sur les marchés internationaux. Cela affecte
directement le coût de la vie, surtout pour les pays dépendants
des importations c.-à-d. elle est causée par des augmentations
des prix des biens et services provenant de l'extérieur, l'inflation
importée a également un impact significatif sur les prix des
produits agricoles locaux, notamment lorsque les coûts des
matières premières internationales augmentent18.
? Inflation structurelle
Cette inflation apparaît en raison de
déséquilibres structurels dans une économie, tels que des
secteurs en difficulté ou des erreurs de politique économique.
Elle est souvent plus difficile à contrôler et nécessite
des ajustements structurels profonds. Ce type d'inflation résulte de
l'évolution des structures économiques. Par exemple, des abus
de
17 IDEM
18 MANKIW, N.G. (2021). Principles of
Economics. Cengage Learning.
21 | P a g e
monopole dans la distribution peuvent faire grimper les prix,
ou des changements dans les politiques agricoles peuvent influencer les
coûts de production19.
? L'inflation budgétaire
Désigne la hausse générale des prix qui
survient lorsqu'un État finance ses déficits par la
création excessive de monnaie (la fameuse "blanche à billet") ou
par un recours trop important à l'emprunt. En générant de
la monnaie sans augmenter la production, le pouvoir d'achat se voit
dilué, poussant les prix à la hausse.
Par ailleurs, un endettement excessif peut éroder la
confiance des investisseurs et entraîner des taux d'intérêt
en augmentation, exacerbant ainsi le déséquilibre
budgétaire. À ces mécanismes s'ajoutent d'autres facteurs,
tels qu'une politique fiscale inadéquate ou des chocs économiques
externes, qui peuvent alimenter un cercle vicieux d'instabilité
économique. Une gestion rigoureuse et équilibrée des
finances publiques est donc essentielle pour préserver la
stabilité et garantir le bien-être collectif.
Note: Les changements de comportement peuvent
créer un cercle vicieux, où la réduction de la
consommation entraîne une diminution de la demande pour les produits
agricoles, conduisant éventuellement à des pertes pour les
agriculteurs. Une compréhension approfondie de ces dynamiques est
essentielle pour élaborer des politiques qui soutiennent non seulement
les producteurs, mais également les consommateurs.
1.1.3. Mesure de l'inflation
L'inflation, définie comme la hausse
généralisée et durable des prix des biens et services, est
un indicateur clé de la santé économique d'un pays. Sa
mesure repose sur plusieurs outils et méthodes permettant de suivre son
évolution et d'en analyser les causes et effets.
1. Le déflateur du PIB : Le déflateur du PIB
est défini comme le rapport du PIB nominal au
PIB réel. Il mesure les prix de tous les biens et services
produits dans l'économie. En effet, le
19 Banque Centrale du Congo. (2023). Rapport Annuel
sur l'Inflation et la Politique Monétaire.
Le PIB nominal a donc augmenté d'une année sur
l'autre. Il a même presque doublé. Pourtant cette augmentation est
trompeuse. En effet, l'augmentation du PIB nominal est donc
22 | P a g e
déflateur du PIB ne tient compte que des prix des biens
et services produits sur le territoire national en tenant compte d'un panier de
biens et services évolutifs.
En d'autres termes, il tient compte d'un panier de biens et de
services qui évolue au gré de la composition du PIB. Cependant,
le déflateur du PIB n'est pas le meilleur instrument de mesure de
l'inflation car, en fonction du volume et de l'évolution des prix des
importations, il mésestime l'inflation.
Toutefois, il faut noter que d'après les utilisateurs,
le biais observé dans l'usage de cet instrument est habituellement
faible.
- Calcul et interprétation
Cet indicateur est trouvé par la formule ci-dessous :
|
Déflateur du PIB= PIB Nominal
PIB Réel
|
x 100
|
A titre illustratif, considérons les informations d'une
économie donnée ci-dessous :
|
Année
|
Pain
|
Sucre
|
|
Quantité
|
Prix
|
Quantité
|
Prix
|
|
2019
|
2
|
200 CDF
|
3
|
100 CDF
|
|
2020
|
1
|
300 CDF
|
4
|
250 CDF
|
- Calcul du PIB Nominal
|
2019 :
|
(2×200)
|
+ (3×100)
|
= 700 CDF
|
|
2020 :
|
(1×300)
|
+ (4×250)
|
= 1300 CDF
|
20 MANDE P., notes de cours de macro
économie, U.KA, faculté des sciences économiques et
gestion L1LMD, 20222023
23 | P a g e
largement due à l'augmentation très importante
des prix. Pour se faire une véritable idée de l'évolution
des quantités produites, on doit neutraliser l'inflation. On va pour
cela définir le PIB réel.
- Calcul du PIB Réel
|
2019:
|
(2×200)
|
+ (3×100)
|
= 700 CDF
|
|
2020:
|
(1×200)
|
+ (4×100)
|
= 600 CDF
|
On constate que le PIB réel de 2019 est égal au
PIB nominal de la même. Ce résultat est toujours
vérifié pour l'année de base puisqu'on utilise les
mêmes prix pour le PIB nominal et le PIB réel. On remarque par
ailleurs que le PIB réel de 2020 est bien inférieur au PIB
nominal de 2020. Il est même inférieur au PIB réel de 2019.
La production a donc diminué. On voit que l'évolution du PIB
nominal surestime l'évolution de la production à cause de
l'évolution des prix.
|
- Calcul du Déflateur
Déflateur du PIB 2019 :
Déflateur du PIB 2020
:
|
1300
|
du PIB
× 100 = X 100
|
100%
= 122% ou 1,22%
|
|
1300
3050
|
|
2500
|
Il est à noter que le déflateur du PIB de
l'année de base est toujours égal à 1 ou 100 et ceux des
années qui suivent mesurent le changement du PIB nominal, à
partir de l'année de base qui ne peut être attribué de
déflateur de 2019 à 2020 en moyenne, les prix ont augmenté
de 1,22 - 1 = 0,22 ou 22%. Il est donc clair que le PIB Nominal surestime la
richesse réellement disponible pendant une année.
2. l'Indice des Prix à la Consommation
(IPC)20, qui reflète les variations du prix d'un
panier de biens et services représentatif des habitudes
des ménages. Cet indice est calculé sur une période
donnée (généralement mensuelle ou annuelle) et permet
d'estimer le taux
21 IDEM
24 | P a g e
d'inflation en pourcentage. Lorsque l'IPC augmente, cela
signifie que le coût de la vie devient plus élevé,
réduisant ainsi le pouvoir d'achat des consommateurs.
L'IPC est calculé à partir de la variation des
prix d'un panier de biens et services représentatif des habitudes de
consommation des ménages. Sa formule générale est :
|
IPCt= ?(P??,*????,0
?(p??,0*????,0
|
* 100pi
|
Où :
- IPCt : indice des prix à la consommation à la
période t.
- Pt,0 : Prix du bien i à la
période t.
- Pi,0 : prix du bien i à la
période de référence 0.
- Qi,0 : quantité du bien i
consommée à la période de référence.
Cette formule compare le coût actuel du panier de
consommation par rapport à son coût lors de la période de
référence. Lorsque l'IPC augmente, cela signifie que le prix des
biens et services ont augmenté, réduisant ainsi le pouvoir
d'achat des consommateurs.
3. L'Indice des Prix à la Production
(IPP)21, qui mesure les fluctuations des prix des biens
au stade de la production. Cet indice permet d'anticiper les
variations futures des prix à la consommation, car une hausse des
coûts de production peut entraîner une augmentation des prix de
vente.
L'IPP mesure les variations des prix des biens vendus par les
producteurs avant leur commercialisation. Sa formule générale est
:
|
IPPt= ?(P??,??*????,??
?(p??,0*????,0
|
* 100pi
|
25 | P a g e
Où :
- IPPt : Indice des prix à la production à la
période t.
- Pi,t : prix du bien i vendu par le producteur à
la période t
- Pi,0 : prix du bien i vendu par le producteur à
la période de référence 0.
- Qi,t : Quantité du bien i produite à la
période t.
- Qi,t : Quantité du bien i produite à la
période de référence.
L'IPP permet d'évaluer les évolutions des prix
à la source, avant qu'ils n'impactent le marché de consommation.
Une hausse de l'IPP peut annoncer une future augmentation des prix pour les
consommateurs, notamment dans le secteur agricole.
L'inflation peut aussi être mesurée sous une
forme plus spécifique : l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix
des produits les plus volatils tels que l'énergie et les denrées
alimentaires. Cette mesure permet d'obtenir une vision plus stable et
représentative des tendances économiques à long terme.
Enfin, les banques centrales et institutions
économiques surveillent l'inflation grâce à des
modèles économiques qui prennent en compte plusieurs
paramètres, comme la masse monétaire, les coûts de
production et la demande des consommateurs. Ces analyses aident à la
prise de décisions pour ajuster les politiques monétaires et
fiscales afin de contenir l'inflation et garantir une stabilité
économique propice au développement du secteur agricole.
Ainsi, la mesure de l'inflation est une étape
fondamentale pour comprendre ses effets sur la consommation des produits
agricoles, permettant aux producteurs, consommateurs et décideurs de
mieux anticiper les fluctuations des prix et d'adapter leurs stratégies
économiques.
Lien entre IPC et IPP
L'IPP est un indicateur clé pour anticiper
l'évolution de l'IPC. En effet, une hausse des prix à la
production peut se répercuter sur les prix à la consommation.
C'est pourquoi ces indices sont suivis de près par les
économistes et les autorités monétaires afin d'ajuster les
politiques économiques et limiter l'inflation excessive.
26 | P a g e
1.1.4. Conséquences de l'inflation ? AVANTAGES
· Pour les entreprises
Les conséquences de l'inflation ne sont pas toujours
négatives. Par exemple, elle améliore la rentabilité
financière des entreprises. Ces dernières sont d'autant plus
incitées à recourir au financement externe que leurs taux de
profit internes sont supérieurs au taux d'intérêt des
capitaux empruntés. Les entreprises se trouvent stimulées par les
perspectives de gain, ce qui les incite à investir. Une telle situation
augmente la rentabilité de leurs fonds propres (effet de levier). Ceci
induit alors une croissance de la production et de l'emploi en favorisant les
investissements car elle croît la marge d'autofinancement et
allège la charge de remboursement (en cas d'emprunts à taux
fixes).
· Pour les ménages
L'inflation allège les dettes des agents
économiques en cas d'emprunts à taux fixes. En effet, elle
diminue le coût réel de l'endettement en fonction de la
différence entre le niveau des taux d'intérêt nominaux et
le niveau général des prix. De ce fait, les ménages vont
bénéficier de taux d'intérêt réels faibles et
dans certains cas, négatifs. En augmentant la valeur des biens
immobiliers, l'inflation bénéficie aux détenteurs
d'actifs. Les ménages rembourseront d'autant moins en valeur
réelle quand l'inflation est plus élevée.
? INCONVENIENT
· Pour les ménages
L'inflation entraîne une diminution du pouvoir d'achat
du revenu des ménages. Avec le renchérissement des prix des
produits, les ménages se retrouvent à utiliser une partie plus
importante de leur revenu pour consommer la même quantité de biens
et de services. En d'autres termes, quand l'inflation augmente, la valeur
réelle de la monnaie diminue. Donc, on peut acheter moins de biens avec
la même quantité de monnaie. Dans de
27 | P a g e
telles situations, les agents économiques ont alors
tendance à ne pas utiliser leurs liquidités (ils consomment
moins) au profit d'investissements dans les biens immobiliers, devises fortes,
etc.
· Pour l'activité
économique
Une inflation peut conduire, lorsqu'elle est forte, à
un ralentissement de la croissance économique et à une
détérioration de l'emploi. Aussi, une variation
accélérée et persistante des prix est-elle de nature
à avoir des impacts négatifs sur l'économie.
? Elle perturbe la répartition macroéconomique des
revenus, car la plupart des agents
économiques ne peuvent pas ajuster leurs revenus au
même rythme que l'inflation.
? Elle rend l'avenir plus incertain. En rendant incertaine
l'évolution des valeurs nominales des revenus et des prix, l'inflation
rend difficile les anticipations sur des variables macroéconomiques
telles que la consommation, l'investissement, et rend par conséquent, la
croissance économique plus hypothétique.
? Elle réduit la compétitivité-prix de
l'économie et conduit à procéder à des
réajustements monétaires. Elle minimise également la
compétitivité-produit provoquant une augmentation du taux
d'intérêt, ce qui renchérit le coût des
investissements des entreprises. Le niveau des investissements étant
inversement proportionnel au taux d'intérêt, plus le taux est
élevé, plus les investissements sont faibles, et
réciproquement. Les produits locaux exportables devenant moins
compétitifs, se vendent moins et par conséquent, les parts de
marché régressent et la croissance ralentit.
1.1.5. Impacts de certaines variables
macroéconomiques sur l'inflation22 ? Le financement monétaire du
déficit budgétaire
Lorsque les dépenses de l'État sont plus
importantes que ses recettes, il en résulte un déficit public. Ce
déficit, lorsqu'il est financé par la création
monétaire, entraine une augmentation de la quantité de monnaie en
circulation dans l'économie et alimente l'inflation.
22 Document d'information de la BANQUE DE LA
REPUBLIQUE D'HAITI, L'inflation et ses mesures, Janvier 2024
28 | P a g e
? Le taux de change
Dans un pays qui dépend fortement des importations, la
perte de valeur de la monnaie nationale a un impact significatif sur les prix.
En effet, la dépréciation de la monnaie peut entrainer une
inflation importée puisqu'il faut plus de monnaie locale pour acheter le
même bien produit à l'étranger. Les produits que le pays
importe deviennent alors plus chers, d'où une hausse
généralisée des prix sur le marché national.
? Les taux d'intérêt
Une baisse des taux d'intérêt peut induire une
accélération des prix alors que le mouvement contraire des taux
d'intérêt est un moyen pour lutter contre une inflation excessive.
Dans une période de récession, les banques centrales baissent
leurs taux directeurs afin de stimuler la demande et ainsi relancer
l'économie. Cela permet d'accroître les investissements des agents
économiques (ménages et entreprises), de dynamiser le
crédit et de relancer la consommation. En période de forte
croissance, l'inflation a tendance à augmenter et conséquemment,
on assiste plutôt à un relèvement des taux directeurs par
la Banque centrale afin d'éviter une surchauffe économique.
? Le taux de chômage
En économie, la courbe de Phillips permet de mettre en
exergue la relation négative qui existe entre le taux d'inflation et le
taux de chômage. En effet, lorsque le taux de chômage diminue, les
salaires s'accroissent et les entreprises augmentent les prix pour
rétablir leurs marges, ce qui va entrainer une hausse de l'inflation.
Inversement, l'inflation se replie lorsque le taux de chômage augmente.
En d'autres termes, une diminution prolongée de l'inflation peut
décourager les entreprises à faire de nouveaux investissements et
les conduire dans certains cas, à réduire leur effectif.
29 | P a g e
Graphique n°2 : courbe de Phillips sur le
chômage
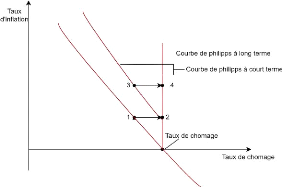
Le raisonnement est le suivant : constatant un chômage
excessif, l'Etat entreprend une politique de relance qui, moyennant une
certaine inflation, fait reculer le chômage (1) mais les salariés
constatent la baisse de leur pouvoir d'achat et exigent la compensation. Les
entreprises qui enregistrent alors la hausse du coût de la main d'oeuvre,
licencient le personnel récemment embauché. Retour au niveau de
chômage initial (2). L'Etat peut retenter l'expérience. Un recul
temporaire du taux de chômage (3) aboutira inexorablement à un
taux de chômage naturel (4). D'où l'explication proposée
par Friedman : à un court terme, il existe bien une liaison
négative entre inflation et chômage, mais à long terme il
est impossible de s'écarter durablement du taux de chômage
naturel. Les efforts interventionnistes ne font que relancer l'inflation.
1.1.6. Les moyens de lutte contre l'inflation23 ? Actions
sur la demande
Les politiques de lutte contre l'inflation visant à
réguler la demande sont caractérisées par des mesures
prises au niveau budgétaire, monétaire et des revenus.
23 Document d'information de la BANQUE DE LA
REPUBLIQUE D'HAITI, L'inflation et ses mesures, Janvier 2024
30 | P a g e
Si l'inflation est d'origine
monétaire.
La politique monétaire vise alors à restreindre
l'accroissement de la masse monétaire en circulation, en contraignant
l'accès aux crédits octroyés par les banques commerciales.
Pour ce faire, la Banque centrale a recours à une politique
monétaire restrictive à travers la hausse des taux
d'intérêt ou celle des coefficients de réserves
obligatoires. Conséquemment, elle contribue à réduire le
volume de crédit devant alimenter la demande de biens et de services
dans l'économie et par conséquent, les pressions inflationnistes
y relatives. Toutefois, la faiblesse du crédit alloué à
l'économie ne permet de stimuler ni la consommation de ménages,
ni l'investissement des entreprises. Ainsi, l'application d'une telle politique
entraîne comme effet négatif le ralentissement de
l'activité économique.
Si l'inflation est due à un excès de la
demande.
Les pouvoirs publics peuvent alors utiliser la politique
budgétaire en baissant les revenus distribués par l'État
(limitation de la progression des revenus des fonctionnaires, réduction
des programmes de travaux publics...) et en augmentant les recettes publiques
(impôts, taxes...). L'objectif est de réduire le revenu disponible
à la consommation et donc de rétablir l'équilibre entre
l'offre et la demande.
Si l'inflation est due aux coûts de
production.
Le contrôle des prix et la politique des revenus sont
dans ce cas les instruments utilisés. Le Gouvernement peut ainsi inciter
les entreprises à modérer la hausse des prix, il peut surveiller
ou même restreindre certains revenus pendant une durée
déterminée (interdiction d'indexer les salaires sur le taux
d'inflation, contrôle de la redistribution des revenus de transferts).
? Action sur l'offre
La difficulté d'obtenir des résultats
satisfaisants avec les instruments de politique visant à réguler
la demande peut amener les autorités monétaires et
budgétaires à utiliser des moyens de lutte à plus long
terme, en développant principalement la concurrence
31 | P a g e
par les prix, c'est-à-dire en incitant les entreprises
à mieux maîtriser leurs coûts de production
(amélioration de la compétitivité) et à diminuer
leurs marges bénéficiaires pour conserver leurs parts de
marché.
1.2. NOTION SUR LA CONSOMMATION
La consommation est un élément fondamental de
l'économie, représentant l'acte d'utiliser des biens et services
pour satisfaire des besoins. Elle est influencée par divers facteurs
tels que le revenu, les préférences individuelles et les
conditions économiques générales.
1.2.1. Définition de la consommation
Selon Jean Baudrillard24, il
définit la consommation comme un système de communication et de
différenciation sociale, où les objets ne sont pas seulement
utilisés pour leur fonction, mais aussi pour leur signification
culturelle et sociale
Selon Thorstein Veblen25, qui met
en avant la notion de consommation ostentatoire, où les individus
consomment des biens non pas pour leur utilité, mais pour afficher leur
statut social et leur richesse
Selon Pierre Bourdieu26 qui
explique que la consommation est un acte structuré par les habitus
sociaux, où les choix de consommation sont influencés par la
position sociale et les capitaux culturels des individus.
Nous aussi, de notre part, au travers de toutes ces
définitions des auteurs, nous définissons aussi la consommation
comme un acte social et culturel par lequel les individus acquièrent et
utilisent des biens non seulement pour satisfaire des besoins matériels,
mais aussi pour affirmer leur position sociale et exprimer des significations
symboliques. Elle devient ainsi un langage (selon Baudrillard), un marqueur de
statut (selon Veblen), et une pratique façonnée par les habitus
sociaux (selon Bourdieu).
24 BAUDRILLARD J., la société de
consommation, Gallimard, Paris, 1970.
25 VEBLEN T, La théorie de la classe de
loisir, Macmillan, New York, 1899.
26 BOURDIEU P., La distinction : critique sociale
du jugement, Les éditions de minuit, Paris, 1979.
27 SMITH A., (traduit par Germain Garnier en 1881
à partir de l'édition revue par Adolph Blanqui en 1843),
Richesse de nation, Guillaumin Libraire, Paris, 1776
32 | P a g e
Ces définitions variées illustrent la
complexité du phénomène de la consommation et sa
portée qui dépasse les simples logiques économiques. Dans
le cadre de la ville de Kananga, il est essentiel de prendre en compte ces
différentes perspectives pour analyser les comportements des
consommateurs face aux mutations sociales, économiques et culturelles.
Une telle compréhension permettrait de mieux orienter les politiques
publiques et les stratégies commerciales en fonction des
réalités sociologiques locales.
1.2.2. Types de consommation27
La consommation peut être classée en plusieurs
catégories selon son objectif et son impact économique
- Consommation finale : Utilisation des biens
et services par les ménages pour satisfaire leurs besoins personnels.
- Consommation intermédiaire :
Utilisation des biens et services par les entreprises pour produire d'autres
biens et services.
- Consommation ostentatoire : Dépenses
effectuées pour afficher un statut social élevé, comme
l'achat de produits de luxe.
- Consommation durable : Achat de biens qui
ont une longue durée de vie, comme les voitures et les appareils
électroménagers.
1.3 THEORIE SUR LA CONSOMMATION
1.3.1. Théorie de l'utilité marginale
Cette théorie de Carl Menger fondée en
1871 explique que la valeur d'un bien dépend de son
utilité marginale, c'est-à-dire l'utilité
supplémentaire qu'un individu retire de la consommation d'une
unité supplémentaire de ce bien.
Carl Menger, fondateur de l'école autrichienne
d'économie, a introduit la notion d'utilité marginale, qui
révolutionne la compréhension de la valeur des biens. Selon
cette
33 | P a g e
théorie, la valeur d'un bien dépend de
l'utilité que l'individu retire de la consommation d'une unité
supplémentaire de ce bien.
Principe central: Plus un individu consomme
un bien, plus l'utilité qu'il en retire ne tend à diminuer. Ce
concept est crucial pour expliquer la logique des prix et des choix de
consommation : un consommateur ne paiera un prix élevé que pour
les premières unités d'un bien essentiel, mais son
intérêt pour les unités supplémentaires diminuera,
réduisant la volonté de payer.
Exemple: Une personne qui achète une bouteille d'eau en
plein désert lui attribue une grande valeur (utilité marginale
élevée). Cependant, après en avoir consommé
plusieurs, son besoin diminue et elle serait prête à payer moins
pour une bouteille supplémentaire.
1.3.2. Théorie du consommateur28
Cette théorie a été fondée par
Adam Smith, elle distingue la valeur d'usage et la valeur d'échange des
biens, mettant en évidence le paradoxe de l'eau et du diamant.
Adam Smith, dans son ouvrage La Richesse des nations, fait une
distinction fondamentale entre la valeur d'usage et la valeur d'échange
d'un bien, illustrée par le paradoxe de l'eau et du diamant.
Principe central :
- La valeur d'usage représente l'utilité
réelle d'un bien (l'eau est essentielle à la survie).
- La valeur d'échange correspond au prix que les
individus sont prêts à payer pour ce bien (le diamant, bien moins
utile que l'eau, possède une valeur d'échange
élevée en raison de sa rareté).
Implication économique : Ce paradoxe
souligne que les prix des biens sur le marché ne dépendent pas
uniquement de leur utilité, mais aussi de leur rareté et de la
demande. Cette observation a contribué aux fondements de la
théorie des prix et de l'offre et la demande.
28 SMITH A., (traduit par Germain Garnier en 1881
à partir de l'édition revue par Adolph Blanqui en 1843),
Richesse de nation, Guillaumin Libraire, Paris, 1776
.
34 | P a g e
1.3.3. Théorie du comportement du consommateur
Cette théorie appartient à Jeremy
Bentham fondée en 1789, elle propose une approche utilitariste
où les individus cherchent à maximiser leur plaisir et minimiser
leur peine à travers leurs choix de consommation
Ces théories permettent de mieux comprendre les
mécanismes qui influencent les décisions des consommateurs et
leur impact sur l'économie.
Jeremy Bentham, philosophe et économiste utilitariste,
a développé une approche selon laquelle les individus cherchent
à maximiser leur plaisir et minimiser leur peine dans leurs choix de
consommation.
Principe central : Chaque individu prend ses
décisions de consommation en cherchant à obtenir le plus grand
bénéfice possible (plaisir, satisfaction), tout en
réduisant les coûts (financiers, temporels, physiques).
Exemple : Un consommateur choisira entre deux restaurants en
fonction du prix, de la qualité des plats et de l'expérience
globale pour maximiser son satisfaction.
Impact économique : Cette
théorie influence les stratégies de marketing et de fixation des
prix. Les entreprises adaptent leurs offres pour répondre aux attentes
des consommateurs, en jouant sur les perceptions de plaisir et de valeur.
RESUME
Ces trois théories ont contribué à une
meilleure compréhension des mécanismes économiques qui
influencent les décisions de consommation. Elles montrent que les choix
des individus ne sont pas aléatoires, mais reposent sur des logiques
rationnelles liées à la valeur des biens, la rareté, et la
maximisation du plaisir.
1.4. IMPACT DE L'INFLATION SUR LE POUVOIR D'ACHAT.
L'inflation a un impact disproportionné sur les prix
des biens de première nécessité. Les produits
alimentaires, le logement, les transports et les soins de santé sont
souvent les plus touchés par les hausses de prix, ce qui pèse sur
le budget des ménages. Lorsque
35 | P a g e
les coûts de ces biens essentiels augmentent, cela peut
engendrer une détérioration de la qualité de vie, en
réduisant la capacité des consommateurs à satisfaire leurs
besoins fondamentaux.
En particulier dans les périodes d'inflation
élevée, les consommateurs doivent choisir entre des options
restreintes, souvent au détriment de la qualité. Les
ménages à revenus modestes sont les plus vulnérables, car
ils consacrent une plus grande part de leurs ressources aux dépenses
courantes, rendant la situation économique encore plus
précaire.
L'inflation impacte directement le pouvoir d'achat des
consommateurs. Lorsque les prix augmentent, la capacité des
ménages à acheter des biens, y compris des produits agricoles,
diminue, surtout si les salaires stagnent. À Kananga, les ménages
qui consacrent une part importante de leur budget à l'alimentation
seront particulièrement affectés. Une inflation soutenue peut
ainsi mener à une situation où des familles doivent se contenter
de produits de moindre qualité ou réduire leur consommation, ce
qui peut engendrer des problèmes de nutrition.
1.4.1. Comment l'inflation altère les comportements
des consommateurs
L'inflation modifie les comportements des consommateurs de
diverses manières. Face à la montée des prix, ces derniers
prennent souvent des décisions plus prudentes. Cela se manifeste par un
ralentissement des achats non essentiels et un renforcement de la tendance
à rechercher des promotions ou des réductions. Les consommateurs
peuvent également chercher à faire des achats en gros ou à
stocker des biens avant une potentielle hausse des prix.
De plus, l'inflation incite les individus à oublier
l'épargne au profit des investissements tangibles, tels que l'immobilier
ou l'or, qui sont perçus comme des refuges contre la perte de valeur de
l'argent. Ce phénomène modifie ainsi la dynamique
économique globale, orientant davantage les ressources vers des actifs
physiques.
L'inflation peut aussi provoquer un sentiment d'incertitude
parmi les consommateurs, entraînant une volatilité dans les
comportements d'achat. Les ménages, craignant une aggravation de la
situation économique, sont susceptibles de changer leurs
36 | P a g e
habitudes, ce qui peut avoir des répercussions sur la
demande globale et la croissance économique.
Les changements de comportement peuvent créer un cercle
vicieux, où la réduction de la consommation entraîne une
diminution de la demande pour les produits agricoles, conduisant
éventuellement à des pertes pour les agriculteurs. Une
compréhension approfondie de ces dynamiques est essentielle pour
élaborer des politiques qui soutiennent non seulement les producteurs,
mais également les consommateurs.
1.4.2. Analyse des effets sur les prix des biens de
première nécessite
L'inflation est un phénomène économique
qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix
des biens et services. Dans le contexte spécifique de la ville de
Kananga, cette hausse des prix touche particulièrement les produits
agricoles, qui constituent une part essentielle de l'alimentation des
ménages. Les biens de première nécessité, tels que
le maïs, le manioc, le haricot et le riz, voient leurs prix fluctuer en
réponse à divers facteurs, dont l'inflation elle-même.
L'analyse des effets de l'inflation sur les prix des biens de
première nécessité révèle une dynamique
complexe. D'une part, lorsque les prix augmentent, le pouvoir d'achat des
ménages diminue, ce qui les pousse à revoir leurs choix de
consommation. Les familles, contraintes par des budgets limitées,
peuvent se tourner vers des alternatives moins coûteuses ou
réduire leur consommation. D'autre part, les producteurs agricoles,
confrontés à une hausse des coûts de production (semences,
engrais, main-d'oeuvre), peuvent être amenés à ajuster
leurs prix à la hausse pour maintenir leur rentabilité. Cela
crée un cercle vicieux où l'inflation aggrave la situation
économique des ménages et influence les décisions
stratégiques des producteurs.
Il est également pertinent de souligner que des
événements extérieurs, tels que des crises
économiques ou des fluctuations climatiques, peuvent exacerber cette
inflation. La figure ci-dessous indique comment l'augmentation de prix peut
réduire le pouvoir d'achat de ménage.
37 | P a g e
Graphique n°3 : Prix & pouvoir
d'achat29
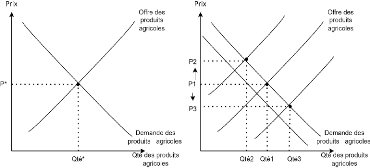
1.5. LES THEORIES ECONOMIQUES AUTOUR DE LA CONSOMMATION
1.5.1. La théorie classique de la consommation :
Idée principale: Les économistes classiques, dont
Adam Smith, considéraient que la consommation est guidée par la
rationalité des individus. Ils achètent ce dont ils ont besoin
tout en cherchant à maximiser leur satisfaction.
Lien avec l'inflation : L'inflation, en augmentant les prix,
perturbe cette rationalité. Les consommateurs doivent réajuster
leurs priorités, notamment pour les produits agricoles essentiels.
Adam Smith et la « main invisible » : Selon lui, le
marché s'autorégule en fonction des besoins et des offres.
Cependant, dans un contexte d'inflation, cette régulation devient plus
complexe30.
1.5.2. La théorie keynésienne de la
consommation :
Le rôle du revenu : Keynes affirme que les décisions
de consommation sont fortement influencées par le revenu disponible des
ménages. Avec une inflation élevée, ce revenu réel
diminue, réduisant ainsi la consommation.
29 MANDE P., Notes de cours de
macroéconomie, L2LMD, UKA, 2025.
30 SMITH A., richesse de nation (traduction de
Germain Garnier), PARIS, libraire, 1881
38 | P a g e
Effet de la propension marginale à consommer : Les
ménages à faibles revenus dépensent une plus grande part
de leur revenu sur les produits de base, comme les denrées agricoles, ce
qui rend cette théorie particulièrement pertinente pour le
contexte de Kananga.
1.5.3. La théorie comportementale :
Les choix irrationnels : Contrairement aux théories
classiques, les chercheurs comportementaux soulignent que les consommateurs ne
sont pas toujours rationnels. Sous l'effet de l'inflation, ils peuvent
céder à des comportements impulsifs ou à des biais
émotionnels (par exemple, accumuler des produits avant une hausse
prévue des prix).
Impact culturel : Les traditions et les habitudes locales
influencent aussi les décisions de consommation, notamment dans des
contextes spécifiques comme celui de Kananga.
1.5.4. Les nouvelles théories contemporaines :
La consommation collaborative : Avec l'essor des plateformes
numériques, les consommateurs partagent ou échangent des produits
pour réduire les coûts, ce qui peut inclure les produits
agricoles.
La durabilité : De plus en plus, les consommateurs
privilégient des produits durables et locaux, même en
période d'inflation.
Idées inspirées d'Adam Smith dans La
Richesse des Nations
Bien qu'Adam Smith ait écrit dans un contexte
différent, certaines de ses idées peuvent enrichir notre
analyse:
- Division du travail : L'impact de la
spécialisation sur la production et la disponibilité des produits
agricoles à Kananga.
- Prix naturel et prix de marché : La
distinction entre le coût réel de production et les variations de
prix causées par les forces du marché, particulièrement
dans un contexte inflationniste.
31 SMITH A., IDEM
39 | P a g e
1.6. LA VISION KEYNESIENNE DU COMPORTEMENT DES
CONSOMMATEURS
La théorie keynésienne, formulée par John
Maynard Keynes, affirme que la consommation des ménages est
principalement liée à leur niveau de revenu. Plus les gens
gagnent d'argent, plus ils sont susceptibles de dépenser. En
période d'inflation, lorsque les prix des services et des biens, y
compris les produits agricoles, augmentent, les consommateurs peuvent
être amenés à changer leurs habitudes d'achat. Par exemple,
ils pourraient acheter moins de produits locaux et se tourner vers des
alternatives moins chères. Ainsi, la vision keynésienne nous aide
à comprendre comment l'inflation influence non seulement les budgets des
ménages, mais aussi leurs choix alimentaires31.
Les principes fondamentaux de Keynes :
Explication des liens entre les revenus, la consommation et l'épargne,
et comment les revenus influencent directement la demande de biens, y compris
les produits agricoles.
L'effet de l'inflation : Description de la
façon dont l'inflation peut réduire le pouvoir d'achat et
provoquer un ajustement dans les habitudes de consommation (par exemple, les
ménages se tournant vers des produits agricoles moins coûteux).
La consommation comme moteur économique
: Comment, selon Keynes, la consommation est essentielle pour stimuler
la croissance économique et comment les produits agricoles jouent un
rôle central dans les économies locales comme Kananga.
Le comportement adaptatif : L'impact
psychologique de l'augmentation des prix sur les choix des consommateurs
(exemple: priorisation des besoins alimentaires de base). Pour davantage
d'exemples et d'analyses, notre mémoire apportera des éclairages
précieux sur cette dynamique à Kananga.
1.7. NOUVEAUX MODELES ET DYNAMIQUES DE CONSOMMATION
Dans le contexte actuel, de nouveaux modèles de
consommation émergent, influencés par la technologie, la
société et l'environnement. Par exemple, l'augmentation de la
vente en ligne permet aux consommateurs d'accéder à plus de
produits agricoles, même en
40 | P a g e
période de hausse des prix. De plus, une prise de
conscience croissante des questions de santé et de durabilité
pousse les consommateurs à privilégier les produits locaux et
biologiques. Ces changements dans les comportements d'achat influencent
directement la demande pour certains types de produits agricoles à
Kananga.
Transition vers un mode de consommation
durable: Les consommateurs s'orientant de plus en plus vers des choix
qui prennent en compte l'impact environnemental des produits agricoles.
Impact de la mondialisation: Analyse de la
manière dont la mondialisation a introduit de nouvelles dynamiques,
comme l'accès aux produits agricoles importés, souvent moins
chers ou compétitifs en termes de qualité.
Les innovations technologiques: Les
plateformes numériques et leur rôle dans la sensibilisation des
consommateurs aux prix des produits agricoles (par exemple : utilisation des
applications pour comparer les coûts).
Les inégalités dans les habitudes de
consommation: Exploration des différences entre les groupes
socioéconomiques, en montrant comment les populations les plus
vulnérables sont les plus touchées par l'inflation.
En explorant ces nouvelles dynamiques, notre mémoire
mettra en lumière des tendances essentielles pour comprendre la
consommation au sein de cette ville.
41 | P a g e
CONCLUSION PARTIELLE DU PREMIER CHAPITRE.
Ce premier chapitre a permis de comprendre en profondeur ce
qu'est l'inflation, ses causes, ses types, ses effets et ses liens avec la
consommation. À travers les définitions de grands
économistes comme Friedman, Keynes et Stiglitz, il a été
montré que l'inflation est une hausse générale et durable
des prix, souvent causée par une trop grande quantité de monnaie,
une forte demande ou des coûts de production élevés.
Nous avons étudié plusieurs formes d'inflation :
par la demande, par les coûts, importée, structurelle,
monétaire et budgétaire. Chacune agit différemment sur les
prix et sur le comportement des consommateurs. Les courbes économiques
comme celle de l'offre et de la demande (OG/DG) ou la courbe de Phillips ont
permis d'illustrer ces mécanismes.
L'inflation influence directement le pouvoir d'achat des
ménages. Quand les prix augmentent, les familles doivent revoir leurs
priorités, souvent en réduisant la quantité ou la
qualité des produits achetés. Les produits agricoles comme le
maïs sont les plus touchés, car ils sont essentiels à
l'alimentation.
Nous avons aussi vu que la consommation est un acte
économique, mais aussi social et culturel. Les théories de
Baudrillard, Veblen et Bourdieu montrent que les choix de consommation
dépendent du revenu, du statut social et des habitudes.
Enfin, les outils de mesure comme l'IPC, l'IPP et le
déflateur du PIB permettent de suivre l'évolution des prix. Ce
chapitre a donc posé les bases théoriques pour analyser, dans les
chapitres suivants, comment l'inflation agit concrètement sur la
consommation des produits agricoles à Kananga.
42 | P a g e
CHAPITRE 2 : KANANGA, VILLE D'AGRICULTURE ET DE DEFIS
ÉCONOMIQUES 2.1. BREF APERÇU SUR LA VILLE DE KANANGA
Kananga, fondée sous le nom de Luluabourg en 1884 par
Hermann Wibmann, a joué un rôle central dans l'histoire
économique et agricole du Kasaï-Central. Dès sa fondation,
la ville a été un point de convergence pour le commerce et
l'agriculture. Les habitants cultivaient principalement le maïs, le
manioc, les arachides, et d'autres produits vivriers essentiels à la
région.
Kananga, située en République
Démocratique du Congo, a été fondée au début
du XXe siècle, en tant que centre administratif et commercial dans la
région du Kasaï. La ville a connu une croissance rapide
après la colonisation belge, principalement grâce à
l'expansion de l'exploitation minière et agricole, notamment de la
plantation de cacao, de café et d'autres produits agricoles. Bien
qu'aucun fondateur unique ne soit spécifiquement reconnu, elle fut
initialement développée par l'administration coloniale belge en
tant que hub économique stratégique.
Au fil des décennies, Kananga a connu plusieurs phases
de développement, notamment après l'indépendance du Congo
en 1960, avec des périodes de stabilité relative et
d'instabilité politique. L'inflation, souvent liée aux
turbulences économiques et politiques, a influencé la
consommation locale, en particulier dans le secteur agricole.
L'augmentation des prix a réduit le pouvoir d'achat des
habitants, impactant la consommation de produits agricoles locaux tels que le
manioc, le maïs, et d'autres denrées essentielles. La fluctuation
de l'inflation a également provoqué des difficultés dans
la commercialisation, affectant la rentabilité des producteurs
agricoles.
Plus récemment, des efforts ont été faits
pour moderniser l'économie locale et stabiliser la monnaie, ce qui a
permis une certaine relance de la consommation agricole. La croissance
démographique et la demande accrue de produits alimentaires locaux
continuent d'influencer la dynamique économique de Kananga. La ville
reste un centre vital pour le
43 | P a g e
commerce agricole dans le Kasaï, avec une histoire riche
façonnée par l'évolution économique et politique du
Congo32.
2.2. MILIEU D'ETUDE
2.2.1. Situation administrative et géographique
Pour cette étude, nous avons choisi la ville de Kananga
comme cadre d'analyse. Située au coeur de la République
Démocratique du Congo(RDC), dans la province du Kasaï centrale,
Kananga se distingue par sa position stratégique et son rôle
majeur dans la région.
La figure ci-après offre une vue aérienne de
cette ville, permettant de mieux apprécier son cadre et sa
configuration. Cette présentation enrichit notre compréhension du
milieu et met en lumière les particularités de Kananga,
essentielles à l'approfondissement de notre recherche.
Figure n°1: représentation ultra
simplifié de la ville

Kananga se trouve à environ 900 kilomètres
à l'ouest de la capitale Kinshasa. La ville est bien bornée par
plusieurs routes principales qui relient les différentes régions
du pays. Son
32 Source :
http://geoprodig.cnrs.fr
44 | P a g e
Emplacement stratégique en fait un point de transit
important pour les échanges commerciaux.
La ville de Kananga, située au coeur de la province du
Kasaï central, s'étend sur une superficie de 743 km2 et
compte cinq communes dont Kananga (la commune principale), Ndesha, Lukonga,
Nganza, Katoka. Avec une population estimée à 1,1 million
d'habitants, Kananga joue clé dans la région. Sur le plan
administratif, cette ville possède un statut unique : elle dispose d'une
personnalité juridique propre ainsi que d'un budget indépendant.
Ce budget est alimenté par les recettes fiscales locales et par des
fonds reversés par la province et l'Etat.
Le tableau suivant présente la répartition en
détail de la superficie et la population entre les cinq
communes33. Ces données offrent un aperçu
précieux de la structure et de la dynamique de la ville, un point de
départ essentiel pour comprendre son fonctionnement.
|
Commune
|
Effectifs
|
Proportion
|
Superficie
|
Type d'occupation de l'espace
|
|
Kananga
|
300000
|
26,1
|
300km2
|
Principalement urbain
|
|
Katoka
|
225000
|
19,6
|
24km2
|
Principalement urbain et un quartier rural
|
|
Ndesha
|
173000
|
15,1
|
45km2
|
Principalement urbain
|
|
Nganza
|
254000
|
22,1
|
221km2
|
Péri urbain
|
|
Lukonga
|
196000
|
17,1
|
153km2
|
Péri urbain et rural
|
|
Total
|
1148000
|
100,00
|
753km2
|
|
Source : Mairie de la ville de Kananga, rapport annuel
2017 2.2.2. Économie et Développement
L'économie de Kananga repose principalement sur
l'agriculture, l'artisanat et le commerce. La ville est connue pour ses
marchés vibrants où l'on trouve des produits locaux, des
textiles, et des objets d'artisanat. De plus, le secteur minier, bien qu'il
soit plus développé
33 Mairie de la ville de Kananga, rapport annuel
2017
45 | P a g e
dans d'autres régions du pays, commence à montrer
des signes de croissance autour de Kananga.
Graphique n°4 : Signe de croissance ville de
Kananga
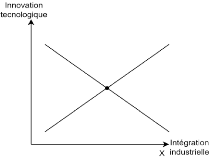
2.2.3. Aspect Culturel
La vie culturelle à Kananga est riche et
colorée. La ville est le berceau de nombreuses traditions musicales et
artistiques. Des festivals locaux, des danses traditionnelles et des
événements communautaires sont fréquents, permettant aux
habitants de célébrer leur identité et leur
héritage.
2.3. ASPECT METHODOLOGIE
Ce travail s'inscrit dans une approche quantitative visant
à analyser l'effet d'une variable macroéconomique (le taux
d'inflation) sur la consommation des produits agricoles.
En recourant exclusivement à des données
secondaires issues de sources statistiques fiables, l'étude utilise les
outils d'analyse économétrique afin d'identifier les liens
statistiques et l'influence causale entre l'inflation et les comportements de
consommation. Cette démarche permet de tester les hypothèses
empiriques et de produire des résultats rigoureux,
généralisables et appuyés par des preuves
chiffrées.
46 | P a g e
2.3.1. Variables sélectionnées du
modèle
Tableau 1 : Présentation des variables
sélectionnées
|
Code
|
Nom de la variable
|
Type de variable
|
Mesure
|
Signe attend
|
|
X
|
Prix de produits
agricoles
|
Dépendante
|
En Franc
congolais
|
-'-/-
|
|
Y
|
Le taux d'inflation
|
Indépendante
|
En pourcentage
|
-'-/-
|
2.3.2. Definition des variables
? Variable dépendante : Le prix du maïs
représente notre variable dépendante, notée Yt dans notre
modèle d'analyse. Cela signifie que cette variable évolue en
fonction d'autres facteurs économiques, notamment l'inflation, les
revenus des ménages, ou encore l'offre sur le marché local.
? Variables indépendantes : Le taux d'inflation, qui
joue ici le rôle de variable indépendante, il mesure
l'évolution générale des prix des biens et services dans
une économie, le plus souvent sur une base annuelle. Il est
calculé à partir de la variation de l'indice des prix à la
consommation (IPC) entre deux périodes. Un taux d'inflation positif
indique une hausse des prix, ce qui peut réduire le pouvoir d'achat des
consommateurs et perturber les équilibres économiques.
2.3.3. Spécification du Modèle
économétrique
Dans le cadre de notre étude sur l'impact de
l'inflation sur la consommation des produits agricoles à Kananga,
notamment le cas du maïs, nous utilisons un modèle
économétrique simple mais efficace : le modèle de
régression linéaire simple.
Ce modèle permet d'analyser la relation entre : ? une
variable dépendante : le prix du maïs (notée Yt), et
? une variable indépendante : le taux d'inflation.
47 | P a g e
L'objectif est de mesurer comment les fluctuations de l'inflation
influencent le prix du maïs, un produit de consommation courante dans les
ménages.
Le modèle est exprimé par l'équation
suivante :
Yt = fo + f1Xt + å
Où :
? â0 représente la
constante, autrement dit, le niveau estimé du prix du maïs lorsque
l'inflation est nulle.
? â1 est le coefficient de
régression, qui indique dans quelle mesure une variation de l'inflation
impacte le prix du maïs, toutes choses étant égales par
ailleurs.
? E désigne le terme d'erreur,
c'est-à-dire les influences extérieures non prises en compte dans
le modèle (autres facteurs économiques ou conjoncturels).
Grâce à des données statistiques
réelles, ce modèle nous permet d'estimer les valeurs de
â0 et â1, Ces estimations offrent une lecture
claire du poids de l'inflation dans la formation des prix agricoles, et aident
à poser un diagnostic objectif sur les contraintes que subissent les
ménages à Kananga.
2.3.4. Méthodologie d'analyse simplifiée et
accessible 1. Méthode d'analyse
Pour comprendre comment l'inflation influence la consommation
des produits agricoles, nous avons utilisé plusieurs outils statistiques
simples mais puissants :
? Test de corrélation (Pearson ou Spearman) : elle aide
à mesurer permet de voir si les deux variables (inflation et prix
agricoles) évoluent ensemble, et dans quel sens.
? Régression linéaire simple : elle aide
à mesurer combien l'inflation influence concrètement la hausse ou
la baisse des prix des produits combien l'inflation influence
concrètement la hausse ou la baisse des prix des produits agricoles.
1. Préparation et structuration : Les données
sont organisées sous forme de séries chronologiques couvrant la
période 2016-2024. Chaque année intègre une observation
du
48 | P a g e
? Interprétation du R2: Le coefficient
R2 permet d'évaluer dans quelle mesure la variation des prix
des produits agricoles est expliquée par l'inflation. Plus sa valeur est
élevée, plus l'impact de l'inflation sur les prix est
significatif.
? Tests de validité du modèle
1. Shapiro-Wilk : pour vérifier si les erreurs suivent
une distribution normale.
2. Breusch-Pagan : pour tester si la variance des erreurs reste
constante.
2.3.5. Justification du choix méthodologique
La méthodologie adoptée s'aligne parfaitement
avec notre problématique, car elle permet d'identifier la
présence d'une relation statistique entre le taux d'inflation et les
prix des produits agricoles. Elle aide également à quantifier
l'impact réel de l'inflation sur les habitudes de consommation des
ménages, notamment à travers l'évolution du pouvoir
d'achat. Ce choix méthodologique est cohérent avec les objectifs
de l'étude et s'adapte aux données disponibles sur le terrain.
2.3.6. Source des données
? Taux d'inflation : Les données ont été
extraites des rapports annuels publiés par la Banque Centrale du Congo
(BCC), qui offrent une vue claire de l'évolution du taux d'inflation en
République Démocratique du Congo au fil des années.
? Prix des produits agricoles : Les informations sur
l'évolution des prix du maïs, manioc, légumes et autres
denrées de consommation courante proviennent des publications de la
Division Provinciale de l'Économie de Kananga, basées sur les
prix moyens relevés sur les marchés locaux.
2.3.7. Traitement des données
Le traitement s'effectue en deux phases principales :
49 | P a g e
taux d'inflation et des prix moyens des produits agricoles.
Elles sont saisies dans Excel, puis importées dans STATA.
2. Analyse descriptive et économétrique : Une
fois intégrées dans STATA, les données sont
analysées à l'aide :
> D'indicateurs statistiques (moyenne, écart-type,
etc.),
> De tests de corrélation pour détecter les
relations entre inflation et prix agricoles,
> De modèles de régression linéaire
simple pour mesurer l'impact de l'inflation sur les
prix,
> De tests de validité (Shapiro-Wilk pour la
normalité, Breusch-Pagan pour l'homoscedasticité) pour assurer la
fiabilité du modèle.
2.4. ANALYSE DES DONNEES
Cette section se consacre à l'analyse et à
l'interprétation des résultats en lien avec l'effet de
l'inflation sur la consommation des produits agricoles à Kananga. Elle
comprend deux volets:
> Analyse descriptive : Présentation des tendances
des variables étudiées sur la période 2014-2024, à
l'aide de graphiques et d'indicateurs statistiques pour visualiser
l'évolution des prix face à l'inflation.
> Analyse économétrique : Application de
tests statistiques (corrélation, régression) pour mettre en
évidence le lien entre l'inflation et les prix. L'objectif est de
démontrer si et comment la hausse du niveau général des
prix influence la consommation des denrées agricoles essentielles. Les
tests de validité du modèle, tels que Breusch-Pagan et
Shapiro-Wilk, renforcent la rigueur scientifique de l'interprétation.
L'analyse de données met en lumière les
réalités locales et guide les interventions ciblées
à Kananga. Elle représente un outil précieux pour relier
les constats empiriques aux choix stratégiques en matière de
développement.
50 | P a g e
CONCLUSION PARTIELLE DU DEUXIEME CHAPITRE.
Ce deuxième chapitre a permis de présenter
à la fois le cadre géographique et économique de la ville
de Kananga, ainsi que la méthode utilisée pour analyser l'effet
de l'inflation sur la consommation des produits agricoles. Kananga, capitale du
Kasaï-Central, est une ville stratégique, composée de cinq
communes, avec une population estimée à plus d'un million
d'habitants. Elle joue un rôle central dans la production et la
consommation agricole, notamment du maïs, manioc et haricot.
Nous avons décrit les caractéristiques
administratives, démographiques et économiques de la ville, en
soulignant son lien fort avec l'agriculture locale. Les marchés de
Kananga sont dynamiques, mais les ménages y sont fortement
exposés aux hausses de prix. Cette réalité justifie le
choix de Kananga comme terrain d'étude.
Sur le plan méthodologique, nous avons adopté
une approche économétrique rigoureuse, fondée sur un
modèle de régression linéaire simple. Ce modèle
permet d'évaluer l'impact du taux d'inflation sur le prix du maïs.
Les variables ont été clairement définies : le prix du
maïs comme variable dépendante, et le taux d'inflation comme
variable explicative.
Nous avons mobilisé plusieurs outils statistiques pour
garantir la validité du modèle : le test de Spearman pour la
corrélation, le test de Shapiro-Wilk pour la normalité des
données, et le test de Breusch-Pagan pour vérifier la
stabilité des erreurs. Les données ont été
traitées avec le logiciel STATA, sur une période allant de 2016
à 2024.
Ce chapitre a donc permis de poser un cadre solide, à
la fois contextuel et méthodologique, pour analyser dans le chapitre
suivant les résultats empiriques et comprendre comment l'inflation
influence concrètement la consommation des produits agricoles à
Kananga
51 | P a g e
CHAPITRE 3. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES
RESULTATS.
Dans ce chapitre, il question de présenter les
données récoltées, les analyser et les interpréter.
Ces données seront ensuite interprétées pour mettre en
évidence l'effet réel de l'inflation sur le prix du maïs et
sur le comportement de consommation des ménages à Kananga.
L'objectif est de tirer des conclusions claires, appuyées par les
chiffres, pour éclairer les implications économiques
concrètes
3.1. PRESENTATION DES DONNEES
Tableau 2. Evolution trimestrielle des prix de maïs
(méga de 3kg) de 2016 à 2024
|
Année
|
1er trimestre (Jan - Mars)
|
2ème trimestre (Avr - Juin)
|
3ème trimestre (Juil - Sept)
|
4ème trimestre (Oct - Déc)
|
|
2016
|
2000 Fc
|
2200 Fc
|
2100 Fc
|
2300 Fc
|
|
2017
|
2300 Fc
|
2500 Fc
|
2400 Fc
|
2600 Fc
|
|
2018
|
2600 Fc
|
2800 Fc
|
2700 fc
|
2900 Fc
|
|
2019
|
3000 Fc
|
3200 Fc
|
3100 Fc
|
3300 Fc
|
|
2020
|
3500 Fc
|
3700 Fc
|
3600 Fc
|
3800 Fc
|
|
2021
|
3800 Fc
|
4000 Fc
|
4200 Fc
|
4300 Fc
|
|
2022
|
4300 Fc
|
4500 Fc
|
4600 fc
|
4800 Fc
|
|
2023
|
4800 Fc
|
5000 Fc
|
4900 Fc
|
5000 Fc
|
|
2024
|
5000 Fc
|
2500 Fc
|
2300 Fc
|
2400 Fc
|
Source : Division Provinciale de l'économie
2024
De 2400Fc en 2016 à 5000Fc en 2024 au premier trimestre,
le prix du maïs a plus que doublé, traduisant une hausse
marquée sur la période.
52 | P a g e
Tableau 3. Evolution trimestrielle du taux d'inflation
2016 à 2023.
|
Année
|
1er trimestre (Jan - Mars)
|
2ème trimestre (Avr - Juin)
|
3ème trimestre (Juil - Sept)
|
4ème trimestre (Oct - Déc)
|
|
2016
|
2,45
|
3,63
|
4,41
|
4,49
|
|
2017
|
2,21
|
3,66
|
5,01
|
5,49
|
|
2018
|
3,57
|
4,32
|
4,99
|
5,05
|
|
2019
|
3,30
|
4,53
|
5,11
|
6,02
|
|
2020
|
3,83
|
5,59
|
4,13
|
6,12
|
|
2021
|
4,75
|
5,21
|
5,44
|
5,46
|
|
2022
|
5,10
|
5,38
|
5,77
|
6,12
|
|
2023
|
8,10
|
7,45
|
10,56
|
13,30
|
|
2024
|
13,78
|
11,10
|
12,00
|
11,69
|
Source : Banque Centrale du Congo, rapport annuel
2024
Le tableau ci-haut nous constatons que le taux d'inflation au
quatrième trimestre a connu une forte augmentation de 13,30% au
quatrième trimestre en 2023.
3.2. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Ce point est consacré à l'analyse et à
l'interprétation des résultats issus de notre étude. Il
s'agit d'examiner les évolutions des taux d'inflation et des taux
d'inflation et des prix du maïs observées entre 2016 et 2024,
à travers des outils graphiques et statistiques. Cette démarche
vise à mettre en lumière les dynamiques économiques qui
ont marqué la période étudiée, tout en
vérifiant la validité des hypothèses formulées.
3.2.1. Représentation graphique de
l'évolution des différents variables combinées.
L'évolution de nos variables d'étude, à
savoir : les taux d'inflation et les prix de maïs, sera illustrée
à l'aide d'un graphique couvrant la période de 2016 à
20124, répartie en 24 trimestres.
53 | P a g e
Cette représentation graphique vise à mettre en
évidence les fluctuations et tendances observées au fil du temps,
et constitue un support visuel essentiel pour l'analyse comparative de ces
indicateurs économiques.
Graphique N°01 : Evolution des prix des maïs et le taux
d'inflation dans la ville de Kananga de
2016 à 2024
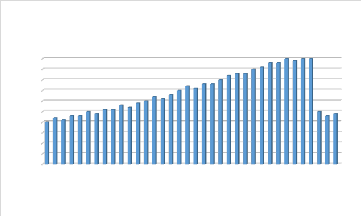
4500
4000
5000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2.45 4.41 2.21 5.01 3.57 4.99 3.30 5.11 3.83 4.13 4.73 5.44 5.10
5.77 8.10 10.56 13.78 12.00
Representation graphique de l'évolution des prix de mais
et de l'inflation
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Le graphique retrace l'évolution parallèle du
prix du maïs et du taux d'inflation trimestrielle à Kananga entre
2016 et 2024. Ces deux variables suivent globalement une tendance ascendante,
suggérant une corrélation significative entre la dynamique des
prix agricoles et le contexte inflationniste.
Entre 2016 et 2018, le taux d'inflation demeure relativement
faible, oscillant entre 2,45 % et 4,80 %. Cette période coïncide
avec des niveaux de prix du maïs encore contenus. Toutefois, à
partir de 2019, on observe une montée progressive de l'inflation, qui
atteint 9,40 % en 2021. Dans le même temps, les prix du maïs
connaissent une hausse continue, franchissant des paliers de plus en plus
élevés.
L'accélération devient plus marquée en
2022 et 2023, avec un taux d'inflation culminant à 13,78 %. Cette
séquence est également caractérisée par une
progression rapide du prix du maïs, qui dépasse nettement les
niveaux observés les années précédentes. Cette
54 | P a g e
évolution suggère une sensibilité directe
du prix agricole à la variation du niveau général des
prix.
En 2024, une légère
décélération du taux d'inflation est observée,
redescendant autour de 11 %. Cependant, le prix du maïs ne reflue pas dans
la même proportion, traduisant une certaine inertie dans le processus
d'ajustement des prix. Ce décalage est courant dans les dynamiques
inflationnistes prolongées, où les prix des biens restent rigides
à la baisse, même après une modération des pressions
inflationnistes.
Tableau 4 : Statistique
descriptive
|
variable
|
Observation
|
Moyenne
|
Ecart-types
|
Minimum
|
Maximum
|
|
Taux
d'inflation (ti)
|
24
|
6,65125
|
3,497519
|
2,21
|
13,78
|
|
Prix de maïs (pxm)
|
24
|
3312,5
|
1176,99
|
2000
|
5000
|
Source : nous même avec le logiciel
stata
Sur une période de 24 trimestres, le taux moyen
d'inflation enregistré est de 6,65125 %, avec un niveau le plus bas de
2,21 % et un sommet de 13,78 %. Cette variation reflète des mouvements
de prix plus ou moins marqués selon les périodes.
Concernant le prix du maïs, la moyenne pour une mesurette
de 3 kilos est de 3 312,5 CDF. Le prix le plus bas observé est de 2 000
CDF, tandis que le plus élevé atteint 5 000 CDF. Ces valeurs
traduisent une variation importante du prix du maïs sur l'ensemble de la
période étudiée.
55 | P a g e
3.3. ANALYSE ECONOMETRIQUE
3.3.1. Test de corrélation
Ce test permet d'analyser la relation entre deux variables,
même lorsque leurs distributions ne sont pas normales.
Nous formulons les hypothèses suivantes :
o H0 (hypothèse nulle) : il n'existe aucune
corrélation entre le taux d'inflation et le prix du maïs.
o H1 (hypothèse alternative) : il existe une
corrélation entre ces deux variables.
Le seuil de significativité choisi est de 5 % (0,05),
ce qui signifie que l'on accepte une marge d'erreur de 5 % dans notre
conclusion.
Tableau 7 : Test de corrélation entre le taux
d'inflation et le prix de maïs
|
Variables corrélées
|
Observation
|
Coef SPEAR MAN
|
prob? |t|
|
|
Taux d'inflation et
prix de maïs
|
24
|
0,5942
|
0,0022
|
Source : nous même avec l'aide du logiciel
stata
Les résultats du test de Spearman
révèlent une corrélation positive entre le taux
d'inflation et les prix du maïs, mesuré à 0,5942 ; Autrement
dit, quand le taux d'inflation augmente, les prix du maïs ont tendance
à augmenter aussi, dans une proportion relativement forte (près
de 59 % de liaison entre les deux variables).
Cela suggère qu'il existe une dynamique de co-mouvement
économique entre le niveau général des prix et ceux du
maïs, denrée stratégique dans la consommation des
ménages. La p-valeur de ce test est de 0,0022, bien en dessous du seuil
de 5 %, ce qui est statistiquement très significatif. En langage simple,
cela signifie que la probabilité que cette corrélation soit due
au hasard est très faible.
56 | P a g e
Par conséquent, on rejette l'hypothèse nulle
(qui supposait l'absence de lien) et on valide l'existence d'une relation
réelle entre les deux variables. Ce résultat a une portée
importante : il alerte sur la sensibilité du prix du maïs aux
pressions inflationnistes, et pose les bases pour une réflexion
économique plus large sur la formation des prix agricoles dans un
contexte de hausse généralisée des prix.
Il suggère aussi que des politiques de stabilisation
des prix alimentaires devraient prendre en compte l'évolution de
l'inflation globale.
Enfin, ce constat conforte le recours au test de Spearman,
bien adapté à des variables qui ne suivent pas une distribution
normale.
3.4. ESTIMATION DU MODELE
Tableau 8 : Estimation du modèle
|
Source
|
SS
|
df
|
MS
|
Number of obs.
|
24
|
|
|
F(1,22)
|
5.54
|
|
|
Model
|
56.6234468
|
1
|
56.6234468
|
|
Prob>F
|
0.0279
|
|
|
R-squared
|
0.2013
|
|
|
Residual
|
224.727217
|
22
|
10.2148735
|
|
Adj R-squared
|
0.1649
|
|
|
Total
|
281.350664
|
23
|
12.2326376
|
|
Root MSE
|
3.1961
|
|
|
|
|
Taux d'inflation
|
Coef.
|
Std. Err
|
t
|
P>|t|
|
[95% Conf. Interval]
|
|
Prix de maïs
|
0.0013334
|
2.35
|
2.35
|
0.028
|
0.000159 0.002508
|
|
_cons
|
2.234276
|
1.12
|
1.12
|
0.273
|
-1.884942 6.353493
|
Source : nous même à l'aide du logiciel
stata
La statistique Prob > F, égale à 0,0279, est
inférieure au seuil conventionnel de 5 %. Cette valeur nous conduit
à rejeter l'hypothèse nulle d'absence de lien entre les deux
variables. En d'autres termes, les variations du prix du maïs expliquent
de manière statistiquement significative les fluctuations du taux
d'inflation observées dans l'échantillon.
Le coefficient de détermination, ou R2,
s'élève à 0,1649. Cela signifie qu'environ 16,49 % des
variations du taux d'inflations sont attribuables aux changements du prix du
maïs. Ce pourcentage, bien qu'en deçà de certains seuils de
robustesse, suggère un
57 | P a g e
pouvoir explicatif partiel mais réel du modèle,
d'autant plus que l'analyse repose sur une seule variable explicative.
Sur le plan des coefficients estimés nous remarquons
que, le taux d'inflation est influencé positivement par le prix des
maïs dans la ville de Kananga, ce veut dire que toute augmentation des
taux d'inflation entraine une augmentation des prix des maïs et par
conséquent une diminution de la consommation des prix sachant que la
quantité demandées des maïs par les ménages est
fonction décroissante du prix des maïs.
En outre, cela implique que toute hausse d'une unité du
prix du maïs est associée à une augmentation moyenne de
0,0013 point du taux d'inflation, toutes choses égales par ailleurs. Ce
lien est non seulement économiquement logique, mais également
statistiquement significatif, avec une p-valeur de 0,028.
La constante du modèle, estimée à environ
2,234, représente le niveau théorique de l'inflation si le prix
du maïs était nul. Toutefois, cette valeur n'est pas significative
statistiquement (p = 0,273), et son interprétation économique
doit donc être abordée avec prudence.
En définitive, cette régression met en
évidence une corrélation positive et significative entre le prix
du maïs et le niveau d'inflation à Kananga.
3.5. TEST D'HOMOSCEDASTICITE
H0 : Variance constante des erreurs, d'où
l'homoscedasticité (hypothèse nulle).
H1 : Pas de variance constante des erreurs, présence
d'hétérosédasticité (hypothèse alternative).
Seuil de significativité : 0,05 ou 5%
58 | P a g e
Tableau 9 : Test d'HOMOSCEDASTICITE des
variables
|
Intitulés
|
Valeurs
|
|
Chi 2 (1)
|
0,06
|
|
Prob?Chi
|
0,8073
|
|
2
|
|
Source : nous même avec le logiciel
stata
Le test d'homoscedasticité de Breusch-Pagan a
donné une probabilité de 0,8073, largement supérieure au
seuil de significativité de 5 %. Ce résultat nous amène
à accepter l'hypothèse nulle, selon laquelle la variance des
erreurs est constante.
Autrement dit, les erreurs du modèle sont
homoscedastiques, ce qui signifie qu'elles sont réparties de
manière régulière. Ce constat renforce la fiabilité
statistique et la qualité économique des estimations obtenues, en
validant l'un des fondements essentiels des moindres carrés
ordinaires.
3.6. TEST DE NORMALITES GLOBALES DES RESIDUS
Graphique sur la distribution des résidus
comparée à la norme
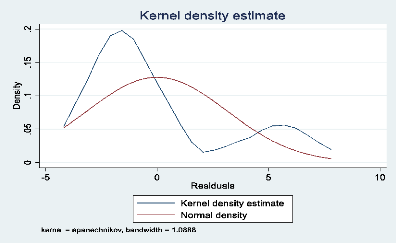
59 | P a g e
Le graphique montre que la forme réelle des erreurs du
modèle (ligne bleue) diffère de celle attendue selon une
distribution normale (ligne rouge). Cette irrégularité indique
que les résidus ne suivent pas une distribution parfaitement normale.
Cela remet en question l'usage de tests classiques et renforce l'idée
d'adopter une méthode plus robuste, comme le test de Spearman. Cette
approche est mieux adaptée pour analyser les relations entre variables
lorsque les conditions de normalité ne sont pas remplies.
Tableau 10 : test de normalité globale du
modèle
|
Variable
|
Obs
|
Pr(Skewness)
|
Pr(Kurtosis)
|
Chi 2(2)
|
Prob?Chi2
|
|
Residuals
|
24
|
0.1066
|
0.8010
|
5,53
|
0.0629
|
Source : nous même avec le logiciel
stata
Ce tableau nous montre si les erreurs (appelées
résidus) d'un modèle statistique suivent une distribution
normale, ce qui est souvent une condition importante pour valider les
résultats d'un modèle économique ou scientifique.
Le test révèle que le modèle n'est pas
distribué normalement. L'asymétrie est marquée, et le test
global dépasse le seuil critique de 0,05. Même si le kurtosis
semble conforme, cela ne suffit pas à valider la normalité
globale. En conséquence, on rejette l'hypothèse d'une
distribution gaussienne des résidus. Le modèle demeure
utilisable, mais avec prudence.
Afin d'assurer une analyse valide et rigoureuse, c'est
pourquoi nous avons opté pour une approche non paramétrique,
comme le test de Spearman. Ce test permet d'étudier les relations entre
variables même en cas de non-normalité. Nous avons retenu un seuil
de significativité de 5 % et des hypothèses claires afin de
statuer sur l'existence d'une corrélation fiable.
60 | P a g e
3.7. Interprétation des résultats
L'objectif de notre étude étais l'objectif
d'identifier et d'analyser l'incidence de l'inflation sur la consommation des
produits agricoles dans la ville de Kananga
Après analyse et traitement des données à
l'aide du logiciel Stata, nous avons abouti aux résultats selon lesquels
:
V' Le coefficient de détermination (R2),
s'élève à 0,1649 soit 16,49 % des variations du taux
d'inflations sont attribuables aux changements du prix du maïs autrement
dit les prix des maïs explique le taux d'inflation à 16,49%.
V' Sur le plan des coefficients estimés nous remarquons
que, le taux d'inflation est influencé positivement par le prix des
maïs dans la ville de Kananga, ce veut dire que toute augmentation des
taux d'inflation entraine une augmentation des prix des maïs et par
conséquent une diminution de la consommation des prix sachant que la
quantité demandées des maïs par les ménages est
fonction décroissante du prix des maïs
V' Durant la période en étude, nous avons
remarqué que le prix de mais a connue d'une manière globale une
légère augmentation allant de 2000FC au premier trimestre 2016
à 2400FC au dernier trimestre 2024.
3.8. Implications économiques des
résultats
À la lumière de ces résultats nous proposons
:
I. À l'État et à la Banque
Centrale
> De stabilisation du taux de change des Franc congolais
par rapport aux devises étrangers ;
> Investir dans les secteurs agricoles pour renforcer
l'offre locale et d'atténuer les hausses saisonnières des prix
;
> Subventionné les producteurs des bien des premiers
nécessité ;
61 | P a g e
Les Ménages quant à eux doivent
:
> Rationalisation des achats: en acheter en gros, en groupe
ou en coopérative peut réduire les coûts unitaires et
sécuriser l'approvisionnement ;
> Prioriser les produits des premiers nécessité
;
> Lutter contre le gaspillage des produits alimentaires
nécessaires à leurs survies ;
> Disposer d'une planification capable de s'adapter aux
exigences du marché (produit substituable) ;
III. Aux Entreprises Agricoles et Commerciales
> D'optimiser le coût de production,
> De fixer les prix avec transparence,
> Renforcement des circuits courts,
> D'Améliorer des méthodes de conservation.
Dans ces analyses, nous avons mis en lumière une
vérité : à Kananga, le prix du maïs est plus qu'un
chiffre, c'est un indicateur social, économique et politique, Lorsque
l'inflation dépasse les 13 %, et que les prix agricoles explosent, il
n'est plus question de subir. Les ménages doivent s'adapter, les
entreprises doivent agir, et l'État doit réguler.
En résumé, une économie qui
protège ses citoyens commence par écouter ses marchés. Les
chiffres du modèle économétrique ne sont pas un diagnostic
fermé, mais un signal d'alarme, et une invitation à la solution
collective.
62 | P a g e
CONCLUSION PARTIELLE DU TROISIEME CHAPITRE.
Ce troisième chapitre nous a permis de comprendre
concrètement comment l'inflation influence la consommation des produits
agricoles à Kananga, en particulier le maïs, qui est un aliment de
base pour la majorité des ménages. Grâce à une
analyse rigoureuse des données statistiques et à l'utilisation
d'outils économétriques, nous avons pu établir des liens
clairs entre la hausse des prix et les comportements d'achat des
consommateurs.
D'abord, l'analyse descriptive a montré que le prix du
maïs est passé de 2 000 FC en 2016 à 5 000 FC en 2024, soit
plus du double en moins de dix ans. En parallèle, le taux d'inflation a
fortement augmenté, atteignant 13,78 % en 2024. Ces chiffres traduisent
une perte de pouvoir d'achat pour les familles, surtout celles à revenus
modestes.
Ensuite, le test de corrélation de Spearman a
révélé une relation positive entre l'inflation et le prix
du maïs, avec un coefficient de 0,5942. Cela signifie que lorsque
l'inflation augmente, le prix du maïs augmente aussi, dans une proportion
significative. Ce lien est statistiquement confirmé par une p-valeur
très faible (0,0022), ce qui montre que ce résultat n'est pas
dû au hasard.
La régression linéaire simple a permis d'aller
plus loin : elle montre qu'une hausse de 1 FC du prix du maïs
entraîne une augmentation moyenne de 0,0013 point du taux d'inflation. Le
coefficient de détermination R2 est de 16,49 %, ce qui
signifie que près de 17 % des variations de l'inflation sont
expliquées par les changements du prix du maïs. Même si ce
chiffre n'est pas très élevé, il reste important dans un
contexte où une seule variable est analysée.
Le test de Breusch-Pagan a confirmé que les erreurs du
modèle sont bien réparties (homoscedasticité), ce qui
renforce la fiabilité des résultats. En revanche, le test de
normalité des résidus a montré que les erreurs ne suivent
pas une distribution parfaitement normale. C'est pourquoi nous avons
utilisé des outils adaptés, comme le test de Spearman, pour
garantir la validité de notre analyse.
63 | P a g e
Ces résultats montrent que l'inflation à Kananga
n'est pas seulement un indicateur macroéconomique : elle touche
directement les assiettes, les marchés et les choix alimentaires des
familles. Quand les prix montent, les ménages réduisent leurs
achats ou se tournent vers des produits moins nutritifs. Les producteurs, eux,
doivent faire face à des coûts plus élevés sans
être sûrs de vendre à des prix rentables.
En résumé, ce chapitre met en lumière une
réalité économique urgente : l'inflation affecte la
sécurité alimentaire, la stabilité des marchés et
le bien-être des populations. Il est donc essentiel que les
autorités économiques, les producteurs et les consommateurs
travaillent ensemble pour limiter les effets négatifs de l'inflation et
garantir un accès équitable aux produits agricoles.
64 | P a g e
CONCLUSION GENERALE
Notre étude intitulée « Analyse de
l'inflation et son incidence sur la consommation des produits agricoles dans la
ville de Kananga » s'est efforcée d'apporter un éclairage
rigoureux et structuré sur l'objectif d'identifier et d'analyser
l'incidence de l'inflation sur la consommation des produits agricoles dans la
ville de Kananga. À travers cette recherche, nous avons tenté de
répondre à deux préoccupations majeures:
? Existe-t-il une corrélation entre l'inflation et la
consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga?
? Quelle est l'incidence de taux d'inflation sur la
consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga?
À ces questions, nous avons répondu à partir
d'une hypothèse double :
? Il existerait une corrélation entre le taux
d'inflation et la consommation des produits agricoles dans la ville de
Kananga.
? Ce taux d'inflation influencerait négativement la
consommation des produits agricoles dans la ville de Kananga. Il existerait une
corrélation entre le taux d'inflation et la consommation des produits
agricoles dans la ville de Kananga.
Pour vérifier cette hypothèse, une approche
méthodologique rigoureuse a été déployée,
combinant la méthode économétrique (régression
linéaire, tests de Spearman, Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan) à la
méthode analytique, nourrie par des techniques documentaires et
statistiques, le tout appliqué à un cadre temporel allant de 2020
à 2025 et spatial limité à la ville de Kananga.
Après analyse et traitement des données à
l'aide du logiciel Stata, nous avons abouti aux résultats selon lesquels
le coefficient de détermination (R2), s'élève
à 0,1649 soit 16,49 % des variations du taux d'inflations sont
attribuables aux changements du prix du maïs autrement dit les prix des
maïs explique le taux d'inflation à 16,49%. Sur le plan des
coefficients estimés nous remarquons que, le taux d'inflation est
influencé positivement par le prix des maïs dans la ville de
Kananga, ce veut dire que toute augmentation des taux d'inflation entraine
une
65 | P a g e
augmentation des prix des maïs et par conséquent
une diminution de la consommation des prix sachant que la quantité
demandées des maïs par les ménages est fonction
décroissante du prix des maïs
Le prix du maïs, produit agricole de
référence, a doublé en l'espace de neuf ans, tandis que
l'inflation, culminant à 13,78 %, pèse lourdement sur les
habitudes de consommation des ménages. Le coefficient de liaison de
0,5942 entre l'inflation et le prix du maïs, combiné à une
influence directe de 0,0013 point par tranche de 1 % d'inflation,
démontre que ce phénomène n'est pas abstrait, il touche
les assiettes, les choix et la sécurité alimentaire au quotidien.
La régression utilisée, avec un R2 de 16,49 %, met en
lumière le rôle déterminant du prix du maïs dans la
formation inflationniste.
Mais derrière les chiffres, ce mémoire
dévoile une souffrance silencieuse : celle des ménages contraints
de réduire leur consommation, celle des producteurs exposés
à des coûts incertains, celle d'une ville agricole en quête
de régulation et de justice économique. C'est pourquoi les
suggestions formulées, stabilisation du taux de change, subvention des
biens essentiels, optimisation du coût de production, transparence dans
les prix, renforcement des circuits courts et des méthodes de
conservation, portent toutes une implication forte : si l'on veut contenir
l'inflation, il faut penser l'économie à hauteur d'homme, en
protégeant ceux qui produisent et ceux qui consomment.
En définitive, ce mémoire est plus qu'une
enquête : c'est une voix. Une voix qui refuse que les marchés
parlent plus fort que les champs, et qui rappelle que l'économiste n'est
pas un simple lecteur de courbes, mais un veilleur de conscience, capable
d'entendre la dignité là où l'intérêt veut
régner.
66 | P a g e
BIBLIOGRAPHIE
1. Ouvrages généraux
1. Friedman, M. Une histoire monétaire des
États-Unis, 1867-1960. Princeton University Press, 1963.
2. Keynes, J. M. The General Theory of Employment,
Interest, and Money. Macmillan, New-York, 1936.
3. Stiglitz, J. Inflation, a Growth Target for
Monetary Policy. Macmillan, New-York.
4. Baudrillard, J. (1970). La société de
consommation. Gallimard, Paris.
5. Veblen, T. The Theory of the Leisure Class.
Macmillan, New York, 1899.
6. Bourdieu, P. La distinction : critique sociale du
jugement. Les Éditions de Minuit, Paris, 1979.
7. Mankiw, N. G. Principles of Economics. Cengage
Learning 2021.
8. Muna, A. Consommation et inflation : enjeux pour
l'agriculture. Éditions Agricoles de Bruxelles, 2019
9. Fisher, I. The Purchasing Power of Money: Its
Determination and Relation to Credit, Interest, and Crises. Macmillan,
New-York, 1920.
10. Smith, A. Recherches sur la nature et les causes de
la richesse des nations. Guillaumin Libraire, Paris, (1776, trad.
1881).
11. Bentham, J. Introduction to the Principles of Morals
and Legislation. (Référencé indirectement via
théorie du comportement du consommateur), 1789.
2. Articles
12. Ceyda, O. ABC de l'économie : qu'est-ce que
l'inflation ? FMI, Finance & Développement, 2010.
13. A. smundson, I. ABC de l'économie : l'offre et
la demande. FMI, Finance & Développement, 2010.
14. Mbuyi, J.-P. (2021). L'impact de l'inflation sur la
consommation alimentaire en Afrique subsaharienne. Kinshasa, Presses
Universitaires de Kinshasa, 2021.
15. Tshibanda, M.-C. Le rôle de l'inflation dans le
changement des comportements de consommation. Lubumbashi, Éditions
de l'Université de Lubumbashi, 2020.
67 | P a g e
3. Cours et Mémoires universitaires
16. Mande, P. Notes de cours de macroéconomie.
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion,
Université Notre-Dame du Kasayi (UKA), (2022-2023).
17. Tshitenge, M. K. Inflation et consommation des
produits agricoles dans la ville de Kananga. Mémoire,
Université de Kananga (UNIKAN), inédit 2021.
18. Mulumba, J.-P. Les effets de l'inflation sur
l'accès aux produits alimentaires à Kananga. Mémoire,
UKA, inédit 2022.
19. G. MASHALA, Notes de cours de microéconomie,
L1LMD, UKA, 2025.
20. Mbala, S. M. Les effets de l'inflation sur
l'accès aux produits alimentaires à Kananga. Mémoire,
UNIKAN, inédit, 2023.
4. Rapports
21. Banque Centrale du Congo (BCC). Rapport annuel sur
l'inflation et la politique monétaire. Kinshasa, 2024.
22. Mairie de la ville de Kananga. (2017). Rapport annuel.
Division Provinciale de l'Économie du Kasaï-Central.
5. Webographie
23. Banque de la République d'Haïti. (2024).
L'inflation et ses mesures.
https://www.brh.ht ou
https://www.brh.ht (Consulté
pour extrait).
24. Géoprodig CNRS. Présentation de la ville de
Kananga.
http://geoprodig.cnrs.fr
http://geoprodig.cnrs.fr
68 | P a g e
Annexe
Min Max
2.21 13.78
2000 5000
Prob > chi2
|
|
|
|
|
|
=
Obs
|
Mean
|
|
|
|
24
|
6.65125
|
3.497519
|
|
|
24
|
3312.5
|
1176.699
|
. summarize ti pxm
Variable
ti
pxm
. spearman ti pxm
Number of obs = 24
0.8073
Spearman's rho = 0.5942
Test of Ho: ti and pxm are independent
Prob > |t| = 0.0022
.
reg ti pxm
Source
SS df MS Number of obs = 24
Model
Residual
Total
281.350664
56.6234468
224.727217
5.54
0.0279
0.2013
0.1649
3.1961
|
|
|
|
|
|
|
1
|
56.6234468
|
Prob > F
|
|
|
22
|
10.2148735
|
R-squared
|
|
|
|
Adj R-squared
|
|
|
|
|
23
|
12.2326376
|
F(1, 22)
Root MSE
|
|
=
=
=
=
ti
Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
pxm
_cons
.0013334 .0005664
2.234276 1.986244
|
2.35
1.12
|
0.028
0.273
|
=
.0001589
-1.884942
|
|
. estat hettest
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for
heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ti
chi2(1) = 0.06
Prob > chi2 = 0.8073
. predict residuals,res
. kdensity residuals,normal
(n() set to 24)
. predict residuals,res
variable residuals already defined
r(110);
. sktest residuals
Skewness/Kurtosis tests for Normality
joint
Variable
.002508
6.353493
Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2)
Prob>chi2
residuals
24 0.0166 0.8010 5.53 0.0629
69 | P a g e
TABLE DE MATIERE
ÉPIGRAPHE I
IN MEMORIAM II
DEDICACE III
REMERCIEMENTS IV
LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES V
LISTE DES ABREVIATIONS ET ACRONYME VI
RESUME VII
ABSTRACT VIII
INTRODUCTION GENERALE 1
0.1. ETAT DE QUESTION 2
0.2. PROBLEMATIQUE 4
0.3. HYPOTHESE 6
0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET. 7
0.4.1. CHOIX DU SUJET 7
0.4.2. INTERET DU SUJET 7
1.5. OBJECTIFS DE RECHERCHE 8
1.5.1. Objectif général 8
1.5.2. Objectifs spécifiques de recherche 8
0.6. METHODE ET TECHNIQUE UTILISEE 8
5.1 Méthode utilisée 8
5.2. Technique utilisée 9
0.7. DELIMITATION DU SUJET 11
0.7.1. Cadre temporel : 11
0.7.2. Cadre spatial : 11
0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 12
CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE 13
1.1. NOTION SUR L'INFLATION 13
1.1.1. Définition de l'inflation 15
1.1.2. Les types d'inflation. 17
1.1.3. Mesure de l'inflation 21
70 | P a g e
Lien entre IPC et IPP 25
1.1.4. Conséquences de l'inflation 26
1.1.5. Impacts de certaines variables macroéconomiques sur
l'inflation 27
1.1.6. Les moyens de lutte contre l'inflation 29
1.2. NOTION SUR LA CONSOMMATION 31
1.2.1. Définition de la consommation 31
1.2.2. Types de consommation 32
1.3 THEORIE SUR LA CONSOMMATION 32
1.3.1. Théorie de l'utilité marginale 32
1.3.2. Théorie du consommateur 33
1.3.3. Théorie du comportement du consommateur 34
1.4. IMPACT DE L'INFLATION SUR LE POUVOIR D'ACHAT. 34
1.4.1. Comment l'inflation altère les comportements des
consommateurs 35
1.4.2. Analyse des effets sur les prix des biens de
première nécessite 36
1.5. LES THEORIES ECONOMIQUES AUTOUR DE LA CONSOMMATION 37
1.5.1. La théorie classique de la consommation : 37
1.5.2. La théorie keynésienne de la consommation :
37
1.5.3. La théorie comportementale : 38
1.5.4. Les nouvelles théories contemporaines : 38
1.6. LA VISION KEYNESIENNE DU COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS
39
1.7. NOUVEAUX MODELES ET DYNAMIQUES DE CONSOMMATION 39
CONCLUSION PARTIELLE DU PREMIER CHAPITRE. 41
CHAPITRE 2 : KANANGA, VILLE D'AGRICULTURE ET DE DEFIS
ÉCONOMIQUES 42
2.1. BREF APERÇU SUR LA VILLE DE KANANGA 42
2.2. MILIEU D'ETUDE 43
2.2.1. Situation administrative et géographique
43
2.2.2. Économie et Développement 44
2.2.3. Aspect Culturel 45
2.3. ASPECT METHODOLOGIE 45
2.3.1. Variables sélectionnées du
modèle 46
2.3.2. Definition des variables 46
71 | P a g e
2.3.3. Spécification du Modèle
économétrique 46
2.3.4. Méthodologie d'analyse simplifiée et
accessible 47
2.3.5. Justification du choix méthodologique 48
2.3.6. Source des données 48
2.3.7. Traitement des données 48
2.4. ANALYSE DES DONNEES 49
CONCLUSION PARTIELLE DU DEUXIEME CHAPITRE. 50
CHAPITRE 3. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS. 51
3.1. PRESENTATION DES DONNEES 51
3.2. ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS 52
3.2.1. Représentation graphique de l'évolution des
différents variables combinées 52
Tableau 4 : Statistique descriptive 54
3.3. ANALYSE ECONOMETRIQUE 55
3.3.1. Test de corrélation 55
3.4. ESTIMATION DU MODELE 56
Tableau 8 : Estimation du modèle 56
3.5. TEST D'HOMOSCEDASTICITE 57
3.8. Implications économiques des résultats 60
CONCLUSION PARTIELLE DU TROISIEME CHAPITRE. 62
CONCLUSION GENERALE 64
BIBLIOGRAPHIE 66
Annexe 68
SEPTEMBRE 2025
REPUBLIQUE CONGO DEMOCRATIQUE DU
MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE NOTRE-DAME DU
KASAYI
« U.KA. »
BP 70/KANANGA

Faculté des sciences économiques et
gestion
L'incidence de l'inflation sur la consommation
des
produits agricoles dans la ville de Kananga
Par : MUSANGA KALALA Samuel
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du titre de Bachelier en sciences économiques.
Directeur : Professeur KAZADI Kelvin Assister par
l'assistant BENGUA Joseph
| 


