|
Katherine DANA
Mémoire de Master 1 -- Histoire moderne Sous la direction
de Pierre-Jean Souriac
Lyon et la Saône au XVIe
siècle
Je tiens en premier lieu à remercier Elisabeth pour
l'aide précieuse qu'elle m'a apportée tant en réalisant
les plans de Lyon qui figurent dans ce mémoire que pour tous ses
conseils techniques.
Je remercie particulièrement Coline et Matthieu pour
leur soutien et leurs conseils avisés ainsi que toutes les autres
personnes qui m'ont encouragée.
Enfin, dans ces quelques instants d'expression sentimentale,
je n'oublie évidemment pas Damien dont l'ingéniosité et le
talent m'accompagnent chaque jour.
Abréviations utilisées :
- AML : Archives municipales de Lyon
- ADR : Archives départementales du Rhône
INTRODUCTION
Etudier les cours d'eau dans une perspective historique semble
un projet ambitieux puisque l'éventail de thèmes qui en
découle est extrêmement vaste. Tout d'abord, les cours d'eau
peuvent être étudiés comme des axes de communication donc
de déplacement, à plus ou moins grande échelle, de
marchandises et d'individus. De ce constat s'ouvre tout le champ d'analyse des
flux commerciaux, des flux migratoires, des voies de transport et,
conséquemment, des moyens de transport. Mais les cours d'eau peuvent
également être un sujet d'étude dans un cadre
géographique précis et limité, tel qu'une ville fluviale.
Cependant, la restriction à un cadre urbain ne réduit pas de
façon substantielle les angles d'étude. En effet, une analyse
socio-économique est ici encore possible, notamment des activités
des «gens de rivière». Par ailleurs, si l'on
s'intéresse à l'eau comme élément naturel, cela
implique d'étudier la façon dont cette ressource est
employée, comme force motrice par exemple, mais aussi comment les hommes
ont tenté de la dompter. Se dévoile alors le champ des
perceptions du cours d'eau, notamment de la crainte des crues et des
remèdes appliqués pour y pallier. Dans le cadre d'une ville
installée sur les berges d'une rivière ou d'un fleuve,
l'aménagement urbain est encore un sujet d'étude possible,
particulièrement les infrastructures telles que les ponts.
Le point de départ de la présente étude
est justement le rapport entre un espace urbain, la ville de Lyon, et la
rivière qui la traverse, la Saône. Le sujet choisi à
l'origine concernait les deux cours d'eau de Lyon c'est-à-dire la
Saône et le Rhône. Le caractère atypique et vaste de ce
thème en faisait son intérêt. Dans un premier temps, le
Rhône était intégré, au moins de façon
partielle, à l'étude. En effet, sa qualité de limite
politique a rapidement exclu sa rive gauche de l'analyse. Comme la Saône
et le Rhône n'ont finalement pas les mêmes statuts, les
implications qui en découlent et le traitement qui leur est
réservé peut être très différent.
Malgré cela, le pont et la rive droite du Rhône pouvaient rester
des objets d'étude. Néanmoins, les recherches bibliographiques
ont permis de s'apercevoir que
le pont était très bien étudié.
Par ailleurs, les murailles qui longent la rive droite du fleuve rendent compte
des limites de la ville de Lyon, qui excluent donc le Rhône. Enfin, la
quantité importante de sources concernant la Saône et les
informations que celles-ci fournissent et qui n'ont pas été
exploitées ont fini de nous convaincre. Le champ d'étude se
limite donc à la seule rivière de Saône. Il convient de
préciser dès à présent les termes qui seront
employés pour qualifier la Saône. En effet, les auteurs de
l'époque moderne emploient les termes « rivière » et
« fleuve » sans faire de distinction. Cependant, on peut
considérer que ce cours d'eau est une rivière puisqu'elle se
jette dans le Rhône mais aussi un fleuve si l'on envisage que c'est le
Rhône qui la rejoint. Comme cela n'est pas toujours clairement
établi, il nous semble que ces deux termes peuvent qualifier la
Saône et l'un comme l'autre pourront être utilisés.
Cette étude de la relation entre la Saône et ses
riverains est volontairement restreinte à la ville de Lyon au sens
strict afin de correspondre à l'espace sur lequel l'administration
consulaire, c'est-à-dire le pouvoir municipal, exerce son
autorité en matière de voirie. Ainsi , il s'agit de la ville de
Lyon telle qu'elle est limitée par ses murailles et, dans ce cadre, la
Saône de la forteresse de Pierre-Scize à la confluence. Ce choix
géographique, en adéquation avec un découpage politique,
n'est pas le fruit du hasard. En effet, l'adaptation d'un espace urbain
à la présence d'une rivière est particulièrement
illustré par la prise en charge politique quotidienne et c'est le
principal angle d'étude qui a été choisi ici. Cela
implique donc que le territoire étudié ait une cohérence
spatiale et juridictionnelle. S'intéresser à la gestion d'une
rivière et à l'aménagement de ses rives revient en quelque
sorte à étudier les types de décisions prises par les
autorités à ce sujet, leur régularité et leur
évolution. Plus largement, il s'agit de déterminer les
institutions qui ont des prérogatives, dans ce domaine, dans le cadre
urbain. Il s'agit également de caractériser les
préoccupations principales qui ressortent des décisions en
matière de gestion mais aussi de s'intéresser concrètement
aux constructions et à l'entretien du pont, des ports et des berges de
la rivière. Comme les pouvoirs des différentes autorités
sur l'eau ne sont pas clairement définis, il est nécessaire de
travailler en amont sur l'aspect juridictionnel. Celui-ci est d'autant plus
intéressant qu'il concerne un élément naturel dont chacun
a l'usage et pour lequel les questions de propriété et de
prérogatives sont délicates. Les cours d'eau se
caractérisent par l'usage collectif qui en est fait, ce qui implique les
notions de bien collectif et
d'espace public et donc une redéfinition des espaces.
Ces notions sont liées à l'affirmation du pouvoir royal et
à la mainmise progressive de cette autorité sur ce qui est peu
à peu défini comme l'espace public, par opposition aux
possessions propres aux particuliers c'est-à-dire à ce qui est
privé.
C'est la raison pour laquelle notre étude commence
à la charnière entre la période médiévale et
la période moderne, qui voit l'autorité royale atteindre son
apogée. Afin de limiter le champ chronologique, car une étude sur
l'ensemble de la période moderne serait trop conséquente à
mener, le XVIe siècle a été le premier
critère temporel défini. Or, il convient de préciser les
limites que l'on applique à ce siècle même si celles-ci ont
surtout un caractère indicatif et qu'il est nécessaire, parfois,
de passer outre un tel cadre. L'année 1494 est la date qui semble la
plus appropriée pour commencer notre étude. En effet, depuis la
fin du XVe siècle et le rétablissement des foires de
Lyon par Charles VIII à cette date, la circulation dans la ville et sur
les cours d'eau est une préoccupation importante qui peut justifier de
nombreux aménagements. C'est également en 1494 que les campagnes
militaires débutent en Italie et, à partir de cette date, la cour
séjourne régulièrement à Lyon. En ce qui concerne
la fin de notre étude, plusieurs dates sont possibles. La
première est 1595 c'est-à-dire la réorganisation du
consulat et la restriction de ses prérogatives par l'Edit royal de
Chauny. D'autre part, le Traité de Lyon (1601) qui permet au royaume de
France de récupérer la Bresse et le Bugey est une borne
chronologique possible puisqu'avec ce traité, le Rhône perd son
statut de limite. Cependant, il nous a semblé plus pertinent de choisir
1595 puisque notre sujet se concentre sur l'action du consulat lyonnais. Or,
avec l'Edit de Chauny, les prérogatives consulaires sont limitées
et la tutelle royale qui s'exerce sur le pouvoir municipal s'accroît.
Il semble que l'angle d'approche adopté pour cette
étude de la Saône à Lyon au XVIe siècle
n'a pas d'antécédent suffisamment proche pour disposer de grilles
de lectures préétablies. Ainsi, ce travail a
nécessité des recherches bibliographiques variées et une
grande partie des ouvrages consultés n'apporte qu'indirectement des
informations, qu'il a été nécessaire de réunir et
de confronter. En effet, les travaux que l'on pourrait réunir sous la
dénomination « histoire de l'eau » sont assez peu nombreux.
Les cours d'eau sont généralement abordés dans des
études historiques comme des supports pour le transport commercial, donc
dans le cadre d'analyses
économiques et sociales, c'est-à-dire qu'ils ne
sont pas étudiés en soi mais indirectement. Richard Gascon, par
exemple, dans sa thèse sur les marchands lyonnais au XVIe
siècle1, évoque l'importante circulation de bateaux de
marchandises sur la rivière de Saône, ainsi que les ports de la
ville de Lyon, mais dans le cadre d'une étude à caractère
économique.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'étudier un cours d'eau, il
est utile, et même nécessaire, de se tourner vers les travaux qui
ont été menés dans des disciplines proches de l'histoire
telles que la géographie et l'archéologie. En effet, les
géographes s'intéressent souvent à l'installation des
populations à proximité des rivières et à
l'aménagement que cela nécessite. Les infrastructures et
l'aménagement sont alors les thèmes privilégiés, au
détriment des institutions qui en sont à l'origine. Cependant, de
tels renseignements, ainsi que les aspects intrinsèques au cours d'eau
tels que son débit, sont une aide précieuse à toute
étude historique d'une rivière. L'archéologie offre des
informations complémentaires, notamment sur les bateaux utilisés
à diverses époques et au sujet des infrastructures fluviales,
mais les campagnes de fouilles entreprises dans les rivières sont peu
nombreuses. De plus, la prise en charge politique des cours d'eau n'est qu'un
theme brièvement évoqué, voire marginal, dans les
recherches scientifiques. L'historien Jacques Rossiaud est l'auteur de
l'ouvrage le plus complet, parmi ceux qui ont été
consultés, en histoire de l'eau. Sa synthèse sur le Rhône
pendant la période médiévale2 traite en effet
de nombreux aspects mais ceux-ci sont surtout sociaux, économiques ou
religieux. Les questions politiques et juridictionnelles liées à
l'eau sont donc rarement abordées. Le spécialiste d'histoire
juridique Frantz Mynard peut être considéré comme l'un des
précurseurs puisqu'il étudie les pouvoirs qui disposent de
prérogatives sur les cours d'eau et particulièrement
l'affirmation progressive du pouvoir royal sur ceux-ci. L'article qu'il
consacre à ce theme offre des pistes de recherche et des approches qui
ont nourri la présente étude3.
Par ailleurs, il convient de situer notre travail dans les
études historiques de la ville de Lyon. Celles-ci sont nombreuses et
variées ; il existe plusieurs synthèses
1 GASCON, Richard, Grand commerce et vie urbaine
au XVIe siècle ; Lyon et ses marchands, tomes 1 et 2,
Paris, S.E.V.P.E.N., 1971.
2 ROSSIAUD, Jacques, Le Rhône au Moyen
Age, Paris, Flammarion, Collection Aubier, 2007, 648 pages.
3 MYNARD, Frantz, « Le fleuve et la couronne :
contribution à l'histoire du domaine fluvial (1566 - 1669) »,
in LE LOUARN, Patrick (dir.), L'eau ; sous le regard des sciences
humaines et sociales, Paris, L'Harmattan, collection Logiques sociales,
2007, 253 pages.
de l'histoire de Lyon depuis l'Antiquité mais aussi
beaucoup d'études thématiques et ponctuelles. Les
différents ouvrages généraux offrent l'avantage de
présenter le cadre général notamment les institutions
politiques lyonnaises et leur évolution. Ils constituent donc la base
nécessaire à tout étude historique de la ville. Les
travaux menés sur le XVIe siècle à Lyon
traitent d'aspects divers, notamment de la vie quotidienne des
contemporains4. La Saône est régulièrement
citée dans les études historiques de Lyon, quel que soit le
thème de ces analyses, ce qui permet de se rendre compte à quel
point la ville et sa rivière sont liées et combien cette
dernière est importante pour Lyon. Néanmoins, encore une fois, la
gestion de la rivière par les autorités n'est pas une
thématique récurrente ou elle n'est abordée
qu'indirectement et ponctuellement. Cependant le fort lien qui existe entre la
ville de Lyon et la Saône permet de trouver de nombreuses informations
dans les écrits depuis l'origine de la ville. Or ces descriptions,
historiques ou non, de la ville et de sa rivière nourrissent le
présent travail et leur apport ne saurait être minimisé.
Ainsi, il peut sembler étonnant que les travaux
traitant d'un espace urbain qui s'est peu à peu construit, depuis
l'Antiquité, sur les rives d'une rivière n'abordent que peu le
thème de la gestion politique du cours d'eau. Des réflexions ont
été menées autour de cette relation entre une ville et sa
rivière. C'est notamment le cas du colloque « La Ville et le Fleuve
», qui s'est tenu à Lyon en 1987 et dont plusieurs articles du
compte-rendu ont été utilisés5. Cependant, les
problématiques abordées sont souvent actuelles puisque l'eau en
tant que ressource, et donc la gestion de celle-ci, devient un enjeu de plus en
plus important à la période contemporaine. Les études
s'intéressant aux ports, aux quais et aux ponts représentent
également un grand intérêt. Leur principal
inconvénient est leur caractère, en général,
très factuel et technique mais ces ouvrages sur les aménagements
fluviaux offrent des éléments de comparaison et des
renseignements chronologiques intéressants.
Les recherches bibliographiques ont donc apporté de
nombreuses informations et pistes de recherche mais fortement
disséminées d'un ouvrage à l'autre. Enfin, l'apport
principal des ouvrages consultés est une base nécessaire à
la
4 BOUCHER, Jacqueline, Vivre à Lyon au
XVIe siècle, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et
d'Histoire, 2001, 159 pages.
5 L'article le plus utilisé parmi les actes
de ce colloque est le suivant : DELLUS, Jean, FREBAULT, Jean, RIVET, Martine,
«Lyon, ville fluviale», in La ville et le fleuve, actes du
colloque de Lyon (avril 1987), Paris, Editions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques, 1989, pages 37 à 48.
construction d'une réflexion et un cadre à
l'analyse des documents. En général, les autorités
politiques et leurs prérogatives sont bien décrites mais leur
action sur les cours d'eau n'est pas présentée ou, en tout cas,
pas dans le cadre d'une analyse globale. Pourtant, il est certain que les cours
d'eau représentent un enjeu politique et économique comme toutes
les voies de circulation en général, et d'autant plus lorsque la
rivière est un élément à part entière d'une
ville.
A l'instar des ouvrages de bibliographie, les sources
imprimées ont apportéde nombreuses informations mais souvent de
façon indirecte. Les descriptions de
Lyon intègrent systématiquement la
rivière de Saône et permettent de mesurer l'importance de ce cours
d'eau pour la ville. De plus, des activités liées à la
rivière sont souvent présentées et le plan
scénographique de Lyon, réalisé au milieu du
XVIe siècle, constitue lui aussi une source fondamentale. En
effet, il se caractérise principalement par le nombre de personnages
figurés dans des activités de la vie quotidienne. Beaucoup
d'entre eux sont représentés le long de la rivière, tant
sur les quais que dans des bateaux. Ce plan dispose donc de deux avantages
principaux en ce qui nous concerne ; tout d'abord, il nous informe des
activités fluviales qu'il est nécessaire de connaître pour
analyser la façon dont elles sont encadrées par les
autorités, d'autre part, ce plan constitue un bilan fiable des
infrastructures fluviales, particulièrement de la présence de
ports et de ponts. Par ailleurs, les historiens lyonnais du XVIe
siècle apportent un complément à cela par leur style
souvent très descriptif mais aussi par les évènements
qu'ils présentent. Enfin, les traités des juristes de la fin du
Moyen Age et de la période moderne sont une source inépuisable
d'informations au sujet des droits et des prérogatives dans tous les
domaines et notamment à propos des autorités qui disposent de
pouvoirs sur les rivières.
A ces sources imprimées s'ajoutent les documents
d'archives, qui constituent le vivier principal de renseignements sur le
thème qui nous intéresse. L'essentiel des sources manuscrites
consultées est réuni aux Archives municipales de Lyon. La
série DD, c'est-à-dire les archives au sujet de la voirie, a
constitué l'objet d'une grande partie des recherches. En effet, la
plupart des travaux effectués aux différentes infrastructures
fluviales sont recensés dans les différents cartons de cette
série. Afin de compléter les informations fournies par cette
recherche préalable, les documents liés à l'administration
consulaire ont fait l'objet d'une
étude particulière. Il s'agit à la fois
des recueils d'actes consulaires, c'est-à-dire des décisions
prises par les autorités municipales, et de la comptabilité de la
ville. Cette dernière n'a été utilisée que
ponctuellement alors que les actes consulaires ont été
dépouillés systématiquement tous les dix à quinze
ans en fonction des autres documents déjà transcrits. L'objectif
d'une telle méthode est de dégager les préoccupations
principales des autorités en ce qui concerne la Saône. Comme les
documents les plus importants à ce sujet sont regroupés dans la
série DD, il s'agit plutôt d'un complément mais qui est
nécessaire pour intégrer des aspects qui ne relèvent pas
des questions d'aménagement urbain. Ponctuellement, en fonction des
informations fournies par les inventaires d'archives, des cartons
classés dans d'autres séries ont été
dépouillés. Cette méthode a été
également appliquée aux Archives départementales du
Rhône, souvent de façon infructueuse. Au final, des sources
variées et parfois même très différentes ont pu
être utilisées pour la présente étude.
Les différentes recherches, particulièrement
celles qui ont été réalisées aux Archives
municipales de Lyon, ont orienté l'angle d'étude adopté.
En effet, elles ont montré qu'il existe une action des autorités
vis-à-vis des cours d'eau mais également que plusieurs pouvoirs
sont impliqués dans celle-ci. Ainsi, il convient au préalable de
déterminer les autorités qui disposent de prérogatives sur
la rivière et à quel point leurs droits sont définis mais
aussi comment ils s'appliquent. Ensuite, il semble nécessaire de
s'intéresser à la perception de la rivière, à la
gestion des risques intrinsèques à sa présence et aux
activités fluviales, puis d'analyser le type de contrôle politique
qui s'exerce sur celles-ci. Enfin, nous nous pencherons sur les infrastructures
fluviales et les aménagements réalisés au cours du
XVIe siècle puisqu'ils constituent l'illustration la plus
probante de l'action politique et de l'intérêt porté
à la rivière.
Première Partie : Prérogatives et juridictions
fluviales
de l'échelle nationale à la ville de Lyon
Il est nécessaire, avant de s'intéresser
à la prise en charge de la Saône proprement dite, dans la ville de
Lyon, de définir les différents pouvoirs qui sont
impliqués et de distinguer les prérogatives de chacun. Le
principal écueil en la matière est de distinguer les droits qui
sont définis institutionnellement de ceux qui ne sont que coutumiers,
même si l'usage, au XVIe siècle, est un critère
de légitimité important qu'il ne faut donc pas négliger.
Il est souvent, d'ailleurs, plus en accord avec la réalité que
les définitions théoriques : de ce constat, l'on comprend
aisément les conflits d'autorités qui existent entre les
différents acteurs. Ainsi, il s'agit de s'intéresser aux
définitions théoriques des pouvoirs de différents
protagonistes concernés et à leurs implications
concrètes.
A cela s'ajoute la question des droits sur une rivière,
donc sur un élément naturel qui remplit de multiples fonctions.
En effet, les cours d'eau sont à la fois des axes de communication, dont
les modalités de circulation sont déterminées, et des
réservoirs importants de ressources : d'eau, bien sûr, mais aussi
de poissons. De plus, notre sujet concerne à la fois la rivière
en elle-même mais aussi ses rivages et donc les différentes
structures construites par l'homme. Ainsi, il semble nécessaire de
définir les questions de domanialité, de juridiction et
d'administration concrète ainsi que les aspects pour lesquels ces
éléments se chevauchent. Tout d'abord, étudier le rapport
entre le pouvoir royal et les cours d'eau permettra de mettre un cadre
général à notre étude tout en présentant la
première autorité qui peut interférer dans la suite de
notre présentation. Ensuite, nous nous intéresserons aux droits
et à la définition théorique des pouvoirs qui s'exercent
sur la Saône, particulièrement dans la ville de Lyon, en
présentant les autres principaux acteurs concernés.
Chapitre I : Le pouvoir royal et les cours d'eau
Le réseau fluvial dans le royaume de France est
très dense et représente, par conséquent, un enjeu
national à la fois politique et économique. En effet, le dominer
participe de la maîtrise générale des déplacements
et des échanges, qui constitue « la source moderne du pouvoir
»1. Il s'agit ici de s'intéresser à la perception
des juristes et à la prise en charge par le pouvoir politique des cours
d'eau dans l'ensemble du royaume de France au XVIe siècle et
donc, finalement, aux prérogatives des souverains sur ceux-ci d'un point
de vue théorique comme sur le plan pratique. Pour cela, il semble utile,
tout d'abord, de définir le statut des fleuves et rivières de
France afin de déterminer ceux qui relèvent de la juridiction
royale au XVIe siècle. Ensuite, il s'agira d'analyser les
conséquences et les enjeux auxquels sont confrontés les rois de
France. Enfin, nous nous intéresserons aux moyens mis en oeuvre par le
pouvoir royal pour appliquer ses décisions en matière de cours
d'eau mais aussi aux décisions en elles-mêmes.
1 MYNARD, Frantz, « Le fleuve et la couronne :
contribution à l'histoire du domaine fluvial (1566 - 1669) »,
in LE LOUARN, Patrick (dir.), L'eau ; sous le regard des sciences
humaines et sociales, Paris, L'Harmattan, collection Logiques sociales,
2007, pages 186-187.
A. Le statut des fleuves et rivières du royaume
Le statut des cours d'eau du royaume de France constitue un
des nombreux éléments définis par les différents
juristes dès la fin du Moyen Age, mais surtout aux XVIe et
XVIIe siècles, dans le cadre du processus
général de redéfinition et d'affermissement de
l'autorité royale.
Jean Bouteiller, conseiller au Parlement de Paris à la
fin du XIVe siècle, semble être un des premiers auteurs
modernes à avoir esquissé une définition juridique et une
catégorisation des cours d'eau2. Ce travail s'inscrit dans
une démarche beaucoup plus large puisqu'il a réalisé une
présentation complete des différentes autorités, de leurs
prérogatives et des types de droits qui s'appliquent dans le royaume, du
droit naturel au droit écrit, des prérogatives seigneuriales
à celles des autorités religieuses. De plus, il
s'intéresse à des cas particuliers qui, selon lui,
nécessitent d'être éclaircis.
C'est justement en s'intéressant à la
juridiction des « rivieres courans parmy la terre d'aucun seigneur »
qu'il propose une caractérisation des cours d'eau. Jean Bouteiller
distingue, dans un premier temps, les « grosses rivieres » qui «
sont au Roy nostre Sire » ; il fournit quelques exemples pour illustrer
son propos tels que la Seine, l'Oise ou encore la Somme. Il ajoute
aussitôt qu'aux seigneurs « parmy la terre desquels les rivieres
passent, leurs terres et seigneuries vont iusques en l'eauë ».
Même si son propos reste assez vague, il semble d'emblée supposer
un chevauchement d'autorité ou, d'un autre point de vue, que l'eau
appartient au roi alors que les rives relèvent des possessions
seigneuriales. Néanmoins, le roi reste décrit comme le
propriétaire des grandes rivières et donc l'autorité
principale en la matière.
Aux « grosses rivieres », Jean Bouteiller oppose, de
façon logique, les « petites rivieres » : ces dernières
mesurant en moyenne sept pieds de large contre quatorze pieds pour les
premières selon sa propre définition. En complément de cet
ordre de grandeur, par ailleurs assez peu satisfaisant car exprimé en
moyenne et
2 BOUTEILLER, Jean, Somme rural ou le grand
coustumier général de praticque civil et canon, Paris,
Barthélémy Macé, 1603 (édition du manuscrit
annotée par Loys Charondas le Caron), Titre LXXIII, page 428.
malaisé pour distinguer des rivières dont le
cours est variable notamment en fonction des saisons, l'auteur précise
que ces cours d'eau « ne portent point de navire ». Le critère
principal de différenciation est donc la navigabilité de la
rivière. En ce qui concerne la possession des rivières non
praticables, le juriste affirme qu'elles sont « aux seigneurs parmy qui
terre et seigneurie elles passent ».
Jean Bouteiller offre donc dans sa Somme un
éclairage sur la propriété qui s'exerce sur les
rivières dans le royaume de France et donc sur les droits qui en
découlent ; les cours d'eau navigables appartiennent au roi alors que
les autres sont la propriété des seigneurs dont les possessions
terrestres sont traversées par ceux-ci.
Cet ouvrage imprimé de Jean Bouteiller possède
une caractéristique tout à fait intéressante : il s'agit
de l'édition de 1603 du manuscrit réalisé deux
siècles auparavant et celui-ci a été annoté par le
jurisconsulte Loys Charondas le Caron (1534-1613). Chaque partie, dont celle
qui concerne les rivières, est résumée et
réactualisée par ce dernier. Ainsi, il nous est possible
d'analyser, au moins partiellement, l'évolution de la perception
juridique des cours d'eau de la fin du Moyen Age au début du
XVIIe siècle et donc d'en déduire celle du
XVIe siècle.
Charondas le Caron confirme la distinction entre
rivières royales et seigneuriales mais aussi que le critère de
différenciation est la possibilité ou non de naviguer sur
celles-ci. Il ajoute néanmoins plusieurs précisions au propos de
Jean Bouteiller et particulièrement au sujet du pouvoir local sur les
rivières navigables. La première concerne la possession
seigneuriale : le juriste affirme que les rivières que les «
seigneurs prétendent à eux, à cause de leur seigneurie
» ne leur sont dues que par la « concession des Roys
»3. Il ajoute ensuite que « par le droict commun du
Royaume, tous fleuves navigables sont reputez estre du domaine du Roy, et lui
appartenir à cause de sa couronne ». La définition est,
cette fois, plus précise et tranchée : toutes les rivières
navigables appartiennent au domaine de la Couronne et les différents
seigneurs qui en possèdent sont redevables à leur souverain.
Ainsi, l'on peut supposer déceler ici les traces d'une affirmation
progressive du pouvoir royal sur les rivières ou, plus simplement, un
caractère juridictionnel indéniablement acquis.
3 Ibid., page 429.
Les autres informations apportées par Charondas le
Caron sont plus techniques et précises. Tout d'abord, il ajoute que les
« isles, iaveaux, atterrissemens et establissemens estans esdicts fleuves
et rivieres navigables et publics " appartiennent au roi. Il précise
enfin que sur les rivières royales, leurs rives et les îles
qu'elles comportent, « nul n'y doive entreprendre » puisqu'il s'agit
du domaine du roi : ce domaine, terrestre comme fluvial, dépend
directement de son autorité. L'auteur appuie son propos par une
référence à l'ordonnance royale du 7 juillet 1572. En
effet, cette décision4 de Charles IX traite de la question
des îles, îlots et « atterrissemens ". Ce dernier terme
correspond sans doute aux lieux oü l'on peut accoster voire, plus
largement, aux berges puisque lorsque Cardin le Bret évoque5,
lui aussi, l'ordonnance de juillet 1572, il écrit que cette
décision concerne « les eaux, les bords et les rivages des fleuves
".
Le texte royal a comme objectif premier d'envoyer des
représentants royaux inspecter les « entreprinses faictes sur les
îles, attérissemens et assablissemens des principales
rivières [...] qui de disposition de droit nous appartiennent et font
partie du domaine de nostre couronne ". Il est ajouté plus loin que
cette disposition comprend également les affluents et les
rivières de moindre importance ; en bref tous les îles et rivages
des cours d'eau du royaume doivent être inspectés. Toutes les
personnes qui « prétendent lesdites îles et
attérissemens leur appartenir " doivent justifier leur possession par
des titres de propriété aux commis royaux et dans le cas
contraire, il « sera procédé à la saisie
réelle et actuelle desdites îles et attérissements ". Cette
déclaration royale montre un progrès de l'autorité du roi,
une maîtrise accrue des cours d'eau mais révèle aussi un
intérêt croissant du pouvoir royal pour ceux-ci puisqu'en plus de
la juridiction des rivières, il s'attribue celle de leurs rives et des
îles qui en font partie.
René Choppin fait lui aussi
référence6 à la décision du 7 juillet
1572, prise par Charles IX, et donne son avis à ce sujet. Il
considère que ce texte ne « suit point la disposition du Droict
Romain [...] par lequel l'Isle est adiugée à celuy qui a des
4 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,
Recueil général des anciennes lois françaises depuis
l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789, Tomes IX à XV
(1438-1610), Ridgewood (New Jersey, U.S.A.), The Gregg Press Incorporated, 1964
(1e édition à Paris entre 1822 et 1833), ordonnance du
7 juillet 1572.
5 CARDIN LE BRET, De la souveraineté du
Roy, Paris, Toussaincts du Bray, 1632, pages 282-283.
6 CHOPPIN, René, Trois livres du domaine de
la couronne, Paris, Michel Sonnius, 1613, Chapitre XV, pages 168 à
177.
terres plus proches de la Riviere » et soutient son
affirmation en rappelant que c'est ce qui est décrit par Pline, au
chapitre 88 de son Histoire. Il est donc défavorable à
cette saisie sous la main du roi des îles fluviales puisqu'elle va
à l'encontre du droit romain et de l'usage. En effet, il
considère qu'il est « une chose peu rigoureuse de faire perdre la
possession de ces Isles à ceux qui en ont iouy l'espace d'un long temps
». En quelque sorte, Choppin assimile cette décision à une
appropriation royale injustifiée, une spoliation, qui s'applique au
détriment de la possession séculaire et donc de la coutume.
A l'instar de Jean Bouteiller, René Choppin distingue
deux types de rivières : « les unes sont Royales, les autres
Bannales ». Les dernières sont les rivières seigneuriales
c'est-à-dire celles qui sont sous l'autorité du seigneur (ou,
plus souvent, des seigneurs) des terres qu'elles traversent. Cette possession
seigneuriale, selon Choppin, est légitimée soit par une
permission du roi soit, encore une fois, par l'ancienneté de la
possession. Choppin semble être un des rares auteurs à nuancer
à la fois le statut royal des cours d'eau par le critère
d'ancienneté de la propriété seigneuriale et
l'intégration des îles fluviales dans le domaine de la Couronne.
En ce qui concerne le premier point, il ne peut cependant pas remettre en cause
la juridiction royale, affirmée au moins dès la fin du Moyen Age,
des rivières et fleuves navigables du royaume ; que celle-ci soit
directe ou par l'intermédiaire d'un seigneur.
Enfin, cet état de fait est totalement admis par deux
autres auteurs du début du XVIIe siècle. C'est le cas,
tout d'abord, d'Antoine Loysel, pour qui la question ne se pose pas : il
affirme7 en effet sans détour que « les grands chemins
et rivières navigables appartiennent au roi ». Il rejoint donc ici
l'ancienne analyse de Bouteiller et des autres juristes, d'autant plus que les
petites rivières (donc non navigables) relèvent, selon lui, de la
juridiction seigneuriale concernée. Néanmoins, comme René
Choppin, il perçoit les îles au même titre que les petites
rivières c'està-dire relevant d'une autorité locale. Il ne
prend donc pas en compte la décision
7 LOYSEL, Antoine, Institutes
coutumières ou Manuel de plusieurs et diverses règles, sentences
et proverbes, tant anciens que modernes du droit coutumier et plus ordinaire de
la France, Tome 1, Paris, imprimerie de Crapelet, 1846, article 232, page
245.
royale de Charles IX, précédemment
évoquée, qui concerne la propriété des îles
même si celle-ci a été entérinée par le
Parlement de Paris le 30 octobre 15728.
Cardin Le Bret, quant à lui, réalise une
synthèse9 très claire au sujet de la possession des
cours d'eau, qui confirme les éléments présentés
précédemment et qui constitue une conclusion de ceux-ci. Tout
d'abord, les cours d'eau navigables relèvent du pouvoir royal et les
autres rivières « appartiennent en propriété aux
Seigneurs des terres qu'elles arrousent ». Il précise que «
lors que les droits du Roy n'estoient pas bien cogneus, on accordoit plusieurs
droits aux Seigneurs hautsIusticiers, qui estoient voysins des grands fleuves
», notamment les droits de pêche ou l'usage des îles et des
rivages mais que ceux-ci ont été supprimés au profit du
roi. L'ordonnance du 7 juillet 1572, qu'il évoque en ce sens, constitue
donc l'appropriation par le pouvoir royal de la juridiction suprême des
cours d'eau navigables du royaume puisqu'en plus de l'eau et de ses ressources,
le roi devient le seigneur des îles et des rivages de ces mêmes
cours d'eau.
8 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,
Recueil général des anciennes lois op. cit., ordonnance
du 7 juillet 1572.
9 CARDIN LE BRET, De la souveraineté op.
cit., chapitre XII, pages 277 à 285.
B. Le roi, seigneur des rivières navigables
Comme nous l'avons présenté
précédemment, le roi de France est considéré comme
le seigneur des rivières navigables de son royaume. La
propriété effective de celle-ci n'est pas clairement
affirmée par les juristes, sauf par Loysel et Charondas le Caron (mais
ils ne développent pas leurs propos), et est absente des textes royaux
avant la seconde moitié du XVIIe siècle. Cependant, la
nuance entre la possession et les droits qui s'exercent n'est souvent pas prise
en compte. Il est certain que les cours d'eau navigables relèvent
néanmoins de l'autorité royale dans le sens où ils sont
une composante du domaine de la couronne. Ce domaine, comprend la possession
foncière attachée à la charge royale, mais aussi « un
ensemble de droits et prérogatives, qui ne sont pas des droits de
propriété mais des droits éminents, c'est-à-dire
des droits de garde et de conservation, de protection »10.
Ainsi, selon Frantz Mynard, les notions de « propriété
» et de « prérogatives » doivent être
distinguées et le « domaine fluvial » ne relève que de
la deuxième catégorie puisqu'il « est certes sous la
protection du roi mais en aucun cas sa propriété
»11, au moins en ce qui concerne le XVIe
siècle.
Frantz Mynard explique d'ailleurs que les jurisconsultes, tels
que Jean Bacquet, René Choppin et Charles Loyseau, considèrent
que les cours d'eau sont du domaine public et ne sont donc pas assimilables
à des biens privés de quelque nature qu'ils soient. En effet, les
fleuves et rivières se caractérisent par l'usage commun qui en
est fait et donc par leur statut d'éléments publics.
L'évolution du pouvoir royal vers l'absolutisme passe par la mainmise
sur ce type d'éléments et par une assimilation du public à
l'Etat et donc au roi. En ce qui concerne les cours d'eau, la transition
commence à s'effectuer au tournant du XVIe et du
XVIIe siècles, donc hors de notre champ d'étude.
Néanmoins, au XVIe siècle, même si le roi n'est
pas clairement perçu comme propriétaire du domaine fluvial, il en
reste le seigneur, c'est-à-dire le gardien et l'administrateur. Cette
position à une conséquence simple : le roi est le
détenteur d'un certain nombre de droits et de devoirs vis-à-vis
des cours d'eau navigables qu'il s'agit de déterminer.
10 MYNARD, « Le fleuve et la couronne... »,
op.cit., page 172.
11 Ibid., pages 176 et 177.
Lorsque Cardin Le Bret évoque le rôle du pouvoir
royal dans la gestion fluviale, il considère que « ce n'est pas
sans raison que les fleuves et rivieres navigables, ont merité d'estre
mises en la particuliere protection des Roys : Car c'est par leur moyen que les
Provinces se communiquent les unes aux autres les biens qu'ils recueillent
»12. Il met ici en avant le rôle fondamental de la
navigation fluviale comme moyen de communication et plus
particulièrement comme vecteur des marchandises. L'enjeu d'assurer cette
circulation au sein du royaume, donc dans un vaste espace, légitime,
d'une certaine façon, que l'autorité qui dirige tout ce
territoire en soit chargée. D'autant plus que le transport par voie
d'eau, notamment commercial, est tres développé sous l'Ancien
Régime et permet de faire transiter des quantités importantes de
marchandises ou des ressources pondéreuses comme le bois, ainsi que des
voyageurs, dans une moindre proportion.
La densité du réseau fluvial au sein du royaume
explique largement cet usage et permet de limiter le nombre de ruptures de
charge. Par exemple, il est possible de faire transiter des produits de la
façade atlantique à la Méditerranée par voie d'eau
presque sans interruption. En effet, ces biens sont transportés sur la
Loire jusqu'à la ville de Roanne oü ils sont
déchargés puis amenés par voie de terre dans les environs
de Villefranche-sur-Saône. Dans cette zone, ils sont à nouveau
placés dans des bateaux sur la Saône. Enfin, la rivière de
Saône assure le relais des marchandises jusqu'à la mer
Méditerranée par l'intermédiaire du Rhône. Un tel
trajet, d'environ un millier de kilomètres, est donc tout à fait
réalisable par voie d'eau avec seulement deux ruptures de charge et un
trajet terrestre relativement court.
Il est donc dans l'intérêt économique
comme dans l'intérêt stratégique (l'artillerie est
aisément transportable en bateau) du royaume et, par conséquent,
des souverains d'assurer et d'organiser la circulation sur le territoire par
voie de terre comme par voie d'eau. Cela entre dans le cadre de ce que Charles
Loyseau appelle la « police des grands chemins »13.
Même si Loyseau considère que ceux-ci « sont de la cathegorie
des choses, qui sont hors de commerce, dont partant la propriété
n'appartient à aucun : mais l'usage est à chacun, et qui pour
ceste cause sont appellees publiques »14, il ajoute
aussitôt que c'est justement ce caractère
12 CARDIN LE BRET, De la
souveraineté..., op. cit., chapitre XII, pages 277
à 285.
13 LOYSEAU, Charles, Traité des
seigneuries, Paris, Abel l'Angelier, 1608, page 213.
14 Ibid., page 213.
public des grands chemins qui les place sous l'autorité
directe du roi. Cette phrase de Charles Loyseau révèle, à
nouveau, toute la complexité du statut des voies de communication,
terrestres comme fluviales, mais aussi l'importance d'une prise en charge de la
circulation sur celles-ci au profit de tous.
Tout d'abord, il ne faut évidemment pas négliger
le cours des rivières en elles-mêmes, qui ne doit pas être
entravé pour plusieurs raisons. Cardin Le Bret, par exemple, rappelle
justement que ce sont elles « qui comblent de toutes sortes de richesses
les pays par où elles passent, qui animent la terre pour produire les
foins, les bleds et les fruicts »15. Deux
éléments se dégagent de cette citation : tout d'abord
l'eau des rivieres comme réservoir de ressources vivriéres
(poissons) mais aussi cette même eau comme source d'irrigation, et bien
sûr, comme force motrice. Ces usages multiples sont en partie
règlementés par la décision royale de juillet 1572. En
effet, puisque toute entreprise réalisée sur les rives d'un cours
d'eau navigable nécessite une autorisation du roi, les moulins et les
pêcheries ne peuvent pas se multiplier et ne sont ainsi pas
préjudiciables à la circulation.
D'autre part, en ce qui concerne l'irrigation, « combien
qu'il soit permis à un chacun de puiser de l'eau d'une riviere navigable
[...] toutesfois il n'est pas loisible de faire des conduits d'eaux, pour la
faire aller en un autre endroit »16, selon René Choppin.
De façon logique, un particulier ne peut donc pas dévier le cours
d'une riviere à son profit ni même en réaliser une
dérivation partielle. Ce type de travaux relévent de la
juridiction royale et, selon Choppin, cela s'explique par la « peur que
les rivieres viennent à tarir, ou bien que les eaux venant à
s'abaisser les rivieres n'en soient pas si navigables ». Ici encore, la
possibilité de naviguer est un critère fondamental : l'irrigation
des cultures, bien sûr nécessaire, ne doit pas entraver la
circulation fluviale. Ainsi, systématiquement, la finalité des
raisonnements, quel que soit l'usage des cours d'eau, revient à mettre
en avant l'importance de la possibilité de circuler sur ceux-ci.
L'un des principaux éléments permettant la
navigation sont les infrastructures telles que les ports ou, au moins, telles
que des rampes d'accés à l'eau et des structures d'arrimage des
navires. Ces éléments ponctuent le cours des
15 CARDIN LE BRET, De la
souveraineték, op. cit., chapitre XII, pages 277 à
285.
16 CHOPPIN, Trois livres du domaine*, op.
cit., chapitre XV, pages 168 à 177.
rivières de façon régulière et
sont, en général, compris dans des structures urbaines. En
théorie, ces constructions, qui sont liées à la navigation
et installées sur les rivages des cours d'eau, dépendent du
pouvoir royal, au moins depuis 1572. En fait, les lieux d'accostage sont tres
souvent aménagés par les représentants des pouvoirs
urbains ou seigneuriaux mais, sous la surveillance du Maître des ports et
de ses gardes. Le Maître des ports est un officier royal, dont la charge
apparaît à la fin du Moyen Age, qui surveille « le faict du
navigage et traffique »17. Il a également la
responsabilité de veiller « au respect de la juridiction royale
»18. Son rôle principal est donc le contrôle des
biens et produits qui circulent ainsi que la répression de tous les abus
commis, notamment aux différents péages.
Il existe un tel officier au XVIe siècle,
pour la Saône à partir du sud de Mâcon19 puis sur
le Rhône. Selon Jacques Rossiaud, le pouvoir du roi sur celui-ci est si
affirmé dès la fin du Moyen Age, que seuls ses
représentants peuvent se saisir des contrevenants qui sont dans une
barque ou sur une île rhodanienne. Il ajoute qu'en 1506 « le conseil
avignonnais va jusqu'à demander au roi de France l'autorisation de
réparer le pont et les rivages »20. Cela montre à
la fois que ce pouvoir municipal prend lui-même en charge les travaux
mais aussi qu'il attend une permission royale pour ce faire ou qu'il a besoin
d'un financement. En effet, cet exemple reste à modérer puisque
la possession royale du Rhône est, quant à elle, clairement
affirmée depuis le XIVe siècle ; donc ce cas ne
peut-être considéré comme représentatif d'une
situation globale. Il nous renseigne cependant sur plusieurs points : le roi
dispose d'officiers qui contrôlent la circulation tout en surveillant les
infrastructures fluviales. La navigation est donc facilitée et
encouragée par la volonté des rois mais aussi
contrôlée par eux.
Le principal moyen de contrôle sont donc les
péages. A ce sujet, Cardin Le Bret considère que seul le roi peut
« lever des peages sur les Fleuves : Aussi pour ce sujet il est tenu de
faire entretenir les ponts, les ports, les passages, et de rendre
17 NICOLAY, Nicolas (de), Généralle
description de l'antique et célèbre cité de Lyon, du
païs de Lyonnois et du Beaujolloys selon l'assiette, limites et confins
d'iceux païs, Lyon, Société de Topographie historique
de Lyon, 1881 (édition du manuscrit de 1573), page 36.
18 ROSSIAUD, Jacques, « Fleuve et cité,
fête et frontière : la sensa lyonnaise des années
1500 », in BRAVARD, J.-P., COMBIER, J., COMMERCON, N. (dir.),
La Saône, axe de civilisation, Actes du colloque de Mâcon
(2001), Presses universitaires de Lyon, 2002, page 401.
19 NICOLAY, Généralle
description..., op. cit., pages 201-203.
20 ROSSIAUD, Jacques, Le Rhône au Moyen
Age, Paris, Flammarion, Collection Aubier, 2007, pages 112-113.
leur canal libre »21. Il ajoute même que
« les peages n'ont esté establis que pour cette consideration
». Cardin Le Bret ne leur confère donc pas particulièrement
un rôle de contrôle mais les perçoit avant tout comme la
source de revenus nécessaire pour l'entretien des aménagements
fluviaux. Ses propos sont confirmés par un édit de septembre
153522 qui préconise que « les deniers des peages »
seront utilisés pour réparer les ponts et les grands chemins.
Cela reste théorique puisque les revenus des péages ne peuvent
suffire à entretenir tout le réseau et parce que le
bénéficiaire du péage diffère souvent du
responsable de la voirie. Cependant, que la voie soit terrestre ou fluviale, la
circulation semble toujours l'enjeu principal.
Le roi, en tant que seigneur des rivières navigables du
royaume, dispose donc d'un rôle important. En effet, il est dans
l'intérêt du royaume de faciliter la navigation fluviale,
particulièrement pour des raisons économiques. Cependant, il est
évident que la contrôler est un enjeu éminemment politique.
Le rôle principal du roi reste néanmoins de permettre la
navigation. Charondas le Caron considère d'ailleurs que afin
d'éviter les éléments « qui nuisent quelquefois
à la navigation [...] les maistres des eaües et forests doivent
pourvoir et remédier »23 à ces
empêchements. Ces officiers des Eaux et Forêts sont les agents du
roi : ils sont donc le moyen de l'application de ses décisions en la
matière.
21 CARDIN LE BRET, De la souveraineté...,
op. cit., chapitre XII, page 284.
22 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,
Recueil général des anciennes lois ..., op. cit.,
édit de septembre 1535.
23 BOUTEILLER, Somme rural..., op. cit., page
429.
C. La Maîtrise des Eaux et Forêts
Les Eaux et Forêts sont une administration
étatique, régulièrement appelée Maîtrise des
Eaux et Forêts, qui permet aux décisions du pouvoir royal
concernant les rivières, les plans d'eau et les forêts
d'être appliquées, en théorie, dans l'essentiel du royaume.
Cette institution constitue donc l'illustration concrete de la gestion des
cours d'eau et des forêts, en application des décisions royales.
Son champ d'action est relativement vaste puisqu'il s'étend peu à
peu à l'ensemble du royaume. C'est ainsi un outil au service de l'Etat,
qui comprend une organisation interne hiérarchisée et dont les
missions sont variées même si elles concernent en
général la « sauvegarde du domaine »24 de la
Couronne, selon l'expression régulièrement utilisée dans
les décisions royales à ce sujet. Les Eaux et Forêts sont
donc le moyen pour le roi d'exercer son autorité, en ce qui nous
concerne, sur les rivières et d'affirmer sa juridiction sur
celles-ci.
L'apparition de l'administration des Eaux et Forêts,
sous la dynastie des Capétiens, est concomitante de la période
d'accroissement du domaine royal, encore disséminé et
relativement restreint pendant le Moyen Age central, jusqu'à comprendre
l'essentiel du royaume durant la période moderne. La première
mention de l'expression « Eaux et Forêts » remonterait à
une ordonnance de 121925. L'administration se structure peu à
peu durant les derniers siècles du Moyen Age permettant une unité
décisionnelle dans un domaine sujet à « trop
d'autorités [...] s'ignorant entre elles »26 ainsi
qu'une uniformité de la politique de gestion, au sein du royaume. Il
s'agit ici d'étudier les moyens de cette gestion, les types de
décisions royales ainsi que l'évolution générale du
pouvoir du roi sur les cours d'eau au cours du XVIe
siècle.
Les informations à ce sujet sont assez difficiles
à trouver puisque l'essentiel des ouvrages qui se rattachent au
thème des Eaux et Forêts traitent surtout, voire uniquement, de la
gestion forestière. Un exemple de cette préférence
d'étudier les forêts au détriment des rivières nous
est fourni par la Revue des Eaux et Forêts qui,
24 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,
Recueil général des anciennes lois op. cit.,
déclaration de 1508.
25 BOURGUENOT, Louis, LEFEBVRE, Raymond etc, Les
Eaux et Forêts du XIIe au XXe siècle,
Paris, Editions du C.N.R.S, collection Histoire de l'administration
française, 1990, page 13.
26 Ibid., page 28.
en 1866, opte pour le sous-titre « Annales
forestières "27, minimisant de fait l'analyse de la gestion
fluviale. Cela se comprend assez aisément lorsque l'on étudie les
textes royaux au sujet des Eaux et Forêts : la majorité de ces
décisions concernent la conservation des forêts, les
modalités de coupe du bois et la règlementation de la
chasse28. Néanmoins, et en ce qui concerne le XVIe
siècle, des décisions royales traitent de l'organisation de
l'administration des Eaux et Forêts et d'autres légiferent sur le
fait des rivières en général c'est-à-dire au sujet
de la navigation, de la pêche, des infrastructures fluviales etc. Ce sont
ces documents qui constituent notre principale source sur le sujet.
L'administration des Eaux et Forêts est dirigée
par un officier royal dont le titre, à la fin du XVe
siècle, est « grand maistre enqueteur, et general
réformateur des eaux et forests de nostre royaume de France, et de nos
pais et duché de Bretaigne "29. La déclaration royale
de 1495 précise son rôle : c'est lui qui nomme la plupart de ses
subalternes tels que les « maistres verdiers, forestiers, procureurs,
sergens et autre offices dépandans desdites eaux et forests ". Le grand
maître, souvent nommé « souverain grand maître "
participe parfois à la rédaction des ordonnances et dispose d'un
pouvoir judiciaire à « la Table de Marbre de Paris dont il est le
Président "30 (ce nom vient d'une table de marbre « qui
occupait la largeur de la grande salle du Palais à Paris et où le
connétable, l'amiral et le grand maître des Eaux et Forêts
exerçaient leur juridiction "31). Le rôle principal du
grand maître reste la direction des différents officiers des Eaux
et Forêts que sont les maîtres particuliers, les lieutenants, les
gruyers, les procureurs et les nombreux sergents et gardes.
En 1573, l'ensemble du personnel de cette administration
représente plus de six cents officiers royaux32. Le
grand-maître en est l'unique chef jusqu'en 1575 à l'exception de
quelques territoires qui bénéficient d'un maître des Eaux
et Forêts autonome ; c'est le cas en Bretagne33 dès
1534 et dans le Dauphiné34 dès 1538. En
27 Ibid., page 722.
28 C'est le cas des édits et ordonnances de
mars 1517, de janvier 1519, de juin 1537 ou d'octobre
1561, par exemple.
29 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,
Recueil général des anciennes lois op. cit.,
déclaration royale du 20 octobre 1495.
30 BOURGUENOT, LEFEBVRE, Les Eaux , op. cit.,
page 100.
31 BELY, Lucien (dir.), Dictionnaire de l'Ancien
Régime, Paris, PUF, Quadrige, 2006, page 1198.
32 BOURGUENOT, LEFEBVRE, Les Eaux , op. cit.,
page 106.
33 Ibid., page 100.
mai 1575, l'office de grand-maître est supprimé
et remplacé par six grandsmaîtres35 ce qui permet un
meilleur quadrillage du royaume. Cela semble être le principal changement
notable dans la structure du personnel des Eaux et Forêts au cours du
XVIe siècle. Par ailleurs, les fonctions confiées aux
officiers des Eaux et Forêts sont également constantes ; elles
concernent, de façon logique, la gestion des bois et des rivières
c'est-à-dire la surveillance de l'usage qui en est fait, la
répression des délits (notamment de chasse et de pêche) et,
de façon plus générale, l'application des ordonnances
royales.
Afin que cette application soit optimale, le maillage du
territoire couvert par les officiers des Eaux et Forêts s'intensifie au
cours du XVIe siècle. Tout d'abord, il est nécessaire
de préciser que le rayon d'action de ces agents royaux croît
au-delà du cadre des rivières et des forêts royales.
Déjà, la règlementation de la pêche ne concerne pas
que les cours d'eau navigables mais, au contraire, l'ensemble du domaine
fluvial. D'autre part, c'est également le cas pour les décisions
qui concernent les forêts. Par exemple, dans l'édit du 8 octobre
1561, qui traite de la préservation de la coupe d'un tiers des taillis
du royaume, il est précisé que la décision s'applique dans
les bois « tant ceux du domaine de la couronne que ceux des
archevêques, évêques et autres gens d'église
»36 soit dans la plupart des forêts du royaume. Enfin,
l'édit de Fontainebleau de décembre 1543 rappelle que les
souverains ont « toujours eu désir de garder et faire garder et
entretenir les Eaux et Forests [...] tant celles qui nous appartiennent que
celles ausquelles avons droict »37. Ces dernières
semblent être toutes les autres rivières et forêts du
royaume, puisque l'édit concerne les « nobles, prélats et
communautés, propriétaires » de celles-ci. C'est donc
à partir de 1543 que les membres des Eaux et Forêts effectuent
leur mission dans l'intégralité du royaume.
Ce même édit, de décembre 1543, a pour
objet de permettre à tous les propriétaires dessus dits d'avoir
recours au maître des Eaux et Forêts de leur juridiction afin de
défendre leurs droits et donc de s'en remettre directement à
cette administration. Il s'agit, en quelque sorte, d'une spécialisation
judiciaire : les délits
34ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,
Recueil général des anciennes lois op. cit., édit
du 22 mai 1538.
35 BELY, Dictionnaire op. cit., page 615.
36 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,
Recueil général des anciennes lois op. cit., édit
du 8 octobre 1561.
37 Ibid., édit de décembre
1543.
qui concernent, par exemple, le braconnage ou la construction
non autorisée d'un moulin sont tranchés en première
instance au sein de chaque maîtrise des Eaux et Forêts.
L'ordonnance royale du 18 octobre 156138 rappelle à ce sujet
que la juridiction est détenue par les maîtres particuliers des
Eaux et Forêts et que les capitaines, sergents et autres gardes ne
disposent que du droit d'arrestation. Les appels, quant à eux, sont
jugés par le Grand-maître ou par un de ses lieutenants de la Table
de Marbre de Paris (il existe quelques exceptions qu'il n'est pas
nécessaire de détailler ici). D'ailleurs, des mai 1523, un
édit39 de François Ier institue un
procureur royal dans chaque siege de l'administration.
Enfin, en ce qui concerne les différentes
circonscriptions des Eaux et Forêts, il semble exister entre vingt-cinq
et trente maîtrises dans le royaume en 152540 avec une
répartition assez hétérogène des agents des Eaux et
Forêts. Henri II prend le parti d'uniformiser cela : par un édit
du mois de février 1555 « le pouvoir royal généralise
l'institution des maîtrises [des Eaux et Forêts] dans chaque
bailliage ou sénéchaussée "41. Le pouvoir royal
tente donc de rendre plus efficace l'action du personnel de l'administration
des Eaux et Forêts par une augmentation et une densification de ses
effectifs. C'est aussi le moyen d'appliquer le plus largement possible ses
décisions et que le contrôle exercé par cette
administration soit plus appuyé et plus efficace.
Les mesures royales concernant les cours d'eau durant le
XVIe siècle sont diverses mais relativement peu nombreuses.
De plus, l'ampleur de leur champ d'application est variable : certains textes
sont très précis et ne concernent qu'un territoire alors que
d'autres sont généraux, sans mention aucune de lieu. C'est
notamment le cas de l'ordonnance de mars 151642 remarquable par ses
quatre articles reglementant la pêche. L'objectif de ce texte est de
lutter contre les « pilleries, larrecins et abus qui se font aux eaues et
forests de nostre royaume, au grand dégast et destruction d'icelles ".
La première mesure est la proscription de tout un type de
matériel de pêche, présenté comme responsable du
fait que les rivières « soient aujourd'hui comme sans fruit ". Par
exemple, cette ordonnance
38 Ibid., ordonnance de St-Germain-en-Laye du
18 octobre 1561
39 Ibid., édit de mai 1523.
40 BOURGUENOT, LEFEBVRE, Les Eaux op. cit.,
page 62.
41 BELY, Dictionnaire op. cit., page 786.
42 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,
Recueil général des anciennes lois op. cit., ,
ordonnance de mars 1516 (articles 89 à 92).
règlemente la taille des mailles des filets de
pêche ; ceux-ci sont autorisés si dans chaque maille l'on peut
« boutter les doigts jusques au gras de la main ". De plus, un poids
minimum par espèce de poissons est fixé. Enfin, pour assurer le
repeuplement des rivières, il est interdit de pêcher « de
my-mars jusques à mi-may, car les poissons frayent en iceluy temps ".
Une telle précision dans les mesures prises par cette ordonnance permet
de faciliter le travail des maîtres particuliers des Eaux et Forêts
et d'éviter les litiges.
Cette ordonnance sur la pêche mise à part, les
autres décisions royales au sujet des cours d'eau sont toutes
liées, au moins indirectement, à la navigation. Tout d'abord,
l'édit de mai 152043, qui ne concerne que la Seine et ses
affluents, préconise de défricher les berges des rivières
(probablement pour éviter toute gêne aux bateaux), interdit d'y
faire des « édifices ni autres choses quelconques empeschant le
navigage » et, enfin, interdit l'imposition des bateliers et de leurs
marchandises sauf pour les droits de péage antérieurs à
1415. La plupart des autres décisions royales suivent ce modèle :
elles visent soit à limiter les structures qui peuvent gêner la
navigation44, soit à supprimer les péages ; à
la fois ceux qui n'ont pas été approuvés par le
roi45, sauf s'ils sont anciens, et ceux qui pourraient limiter le
transport commercial46.
Le roi dispose donc d'une administration qui est en charge de
l'application, dans le royaume, des décisions qu'il prend au sujet de la
gestion et de l'entretien des cours d'eau et des forêts. La
Maîtrise des Eaux et Forêts, qui existait déjà au
Moyen Age, prend de l'ampleur : ses effectifs, leur densité, et son
champ d'action croissent au XVIe siècle. Cette institution
possède une police, au sens actuel, et une justice propres, ce qui lui
confère une certaine efficacité. Son organisation, ainsi que les
mesures de surveillance et de répression qu'elle doit appliquer, sont
définies
43 Ibid., édit de mai 1520.
44 L'édit de mars 1516 précise que les
propriétaires de moulins et pêcheries installés le long de
la Loire, doivent pouvoir justifier leur possession et l'édit de juillet
1572 (présenté dans la premiere section) interdit les
constructions sur les berges de toutes les rivières sans autorisation
royale préalable.
45 François Ier, par l'édit de mars
1516, supprime les péages qui ont été établis sur
la Loire depuis un siècle sans autorisation royale suite à la
demande formulée par le procureur général des marchands de
la Loire.
46 Une décision de Louis XII, en 1501, supprime
les taxes sur les vins de Bourgogne s'ils sont vendus dans des ports
situés le long de l'Yonne et de la Seine.
par des édits et des ordonnances. Ceux-ci «
reflètent la volonté royale de construire un appareil
dépendant d'elle et d'elle seule »47 et
révèle donc l'accaparement progressif, par le pouvoir royal, des
droits et prérogatives sur les cours d'eau.
47 BELY, Dictionnaire... op. cit., page
615.
Conclusion chapitre I
Au XVIe siècle, le roi de France est
communément admis, notamment par les juristes, comme le seigneur des
fleuves et rivières navigables de son royaume. De cela, découle
un certain nombre de conséquences. En effet, le roi dispose de
différentes prérogatives sur ces rivières telles que le
droit de péage ou la règlementation de la pêche. Son
pouvoir sur les cours d'eau croît au XVIe siècle
puisqu'en plus des rivières en elles-mêmes, il s'approprie leurs
îles et leurs rivages. Cela est affirmé et effectif dès
1572 mais l'on peut penser que ce n'est que la généralisation
d'un état de fait ; comme l'affirme Frantz Mynard, les décisions
royales de la période moderne ne doivent pas être perçues
de façon tranchée comme des actes fondateurs48 mais
plutôt comme les aboutissements du processus d'affirmation et de
définition du pouvoir royal.
Les prérogatives dont le roi dispose lui permettent de
réguler, au moins de manière indirecte, les usages des cours
d'eau et particulièrement la très développée
navigation commerciale. Pour cela, il s'appuie sur une administration
hiérarchisée et autonome d'un point de vue judiciaire : les Eaux
et Forêts. Les agents royaux qui en dépendent sont donc les moyens
humains d'application d'une politique fluviale à l'échelle du
royaume. Les préoccupations de celle-ci diffèrent du « souci
romain de disposer d'une eau potable en ville » ou de
l'intérêt médiéval pour « l'accès aux
ressources protéiniques ou énergétiques fournies par les
milieux aquatiques »49 selon Patrick Le Louarn, qui voit la période
moderne comme la période du développement prononcé de la
prise en charge politique des cours d'eau. Néanmoins, nous l'avons
montré, la crainte d'une pêche excessive des poissons existe
encore, mais elle semble en effet en marge par rapport à des enjeux plus
politiques et économiques.
48 MYNARD, « Le fleuve... », op.
cit., page 179.
49 LE LOUARN, Patrick, « L'eau, bien commun
culturel ? », in LE LOUARN, Patrick (dir.), L'eau ; sous le
regard des sciences humaines et sociales, Paris, L'Harmattan, collection
Logiques sociales, 2007, page 18.
Chapitre II : Droits et autorités sur la
Saône à Lyon
En nous intéressant à l'intérêt
porté par les rois de France aux cours d'eau du royaume et donc à
la gestion fluviale au niveau national, l'importance d'une prise en charge
politique des rivières et des fleuves et les enjeux qu'elle comporte
sont clairement apparus. Nous allons réduire le cadre
géographique pour affiner notre analyse de ce thème en nous
intéressant à la rivière de Saône, et plus
précisément, à la Saône dans la ville de Lyon. Le
cadre urbain multiplie le nombre d'autorités qui, potentiellement,
prennent part à la juridiction de l'eau. En effet, il est « un lieu
de pouvoirs, de concentration des pouvoirs, de l'exercice des pouvoirs, de
conflits de pouvoir »1. Ainsi, il s'agit de définir les
différents pouvoirs qui s'exercent sur la rivière de Saône,
ses rives et les édifices fluviaux.
Pour cela, nous nous pencherons sur la juridiction de ce cours
d'eau, puis, dans un deuxième temps au droit de voirie dans la ville de
Lyon. Enfin, une étude de cas d'une affaire judiciaire au sujet du pont
de Saône illustrera les conflits d'autorité qui peuvent
apparaître lorsqu'il est question de la prise en charge politique d'une
rivière, particulièrement dans la ville de Lyon.
1 DUMONS, Bruno, ZELLER, Olivier (dir.), Gouverner
la ville en Europe, du Moyen Age au XXe siècle, Paris,
L'Harmattan, collection Villes, 2006, page 5.
A. La juridiction de la Saône
Si l'on se réfère aux éléments,
présentés dans le premier chapitre, qui permettent de
définir les droits qui s'exercent sur un cours d'eau, le premier aspect
à mettre en avant est la possibilité ou non de naviguer sur
celui-ci. En ce qui concerne la Saône, cela ne fait aucun doute, c'est
une rivière navigable et, par conséquent, elle est placée
sous la protection des rois de France. Une cérémonie affirme
d'ailleurs cela : chaque année, le jour de l'Ascension, une procession
qui remonte la Saône jusqu'à l'île Barbe (juste au nord de
Lyon) est effectuée. Cette procession est conduite par des
représentants du roi, notamment par le maître des ports. Claude de
Rubys nous explique qu'ils vont « à l'Ile Barbe par eau, armez et
embastonnez, avec l'enseigne et les tambourins, poser l'escusson et les
armoiries du Roy de France dans la riviere de Saosne, en signe qu'elle
appartenoit au Roy de bord en bord et ostoyent l'escusson du Duc de Savoye, que
les officiers de Bresse y posoient d'ordinaire la nuict precedente
»2.
Bien que la signification de cet évènement
récurrent semble clairement politique, eu égard à la
position frontalière de la ville de Lyon, Jacques Rossiaud
précise qu'il « peu être ritualisé parce qu'il n'est
plus très aigu [...] au moins depuis 1467 »3 et, de
plus, « en 1536, la Bresse [est] occupée ; mais le rituel des
panonceaux demeure pratiqué ». Cela mis à part, cette
cérémonie est donc également l'illustration du pouvoir que
détiennent les souverains sur la Saône, pouvoir que
possédaient déjà les empereurs allemands au Moyen Age
lorsque la ville de Lyon était intégrée dans le Saint
Empire romain germanique. De telles célébrations, avec de
similaires affirmations du pouvoir royal, existent dans d'autres villes
à la période moderne. C'est le cas, par exemple, dans l'estuaire
de la Loire, à Nantes, où, durant des fêtes nautiques, on
« célèbre l'emprise royale sur les cours d'eau [...] Le
souverain se présente à chaque fois en gardien des eaux, au
2 RUBYS, Claude de, Histoire véritable de
la ville de Lyon, Lyon, imprimeur Bonaventure Nugo, 1604, page 503.
3 ROSSIAUD, Jacques, « Fleuve et cité,
fête et frontière : la sensa lyonnaise des années
1500 », in BRAVARD, J.-P., COMBIER, J., COMMERCON, N. (dir.),
La Saône, axe de civilisation, Actes du colloque de Mâcon
(2001), Presses universitaires de Lyon, 2002, page 404.
nom du bien public »4. Cela confirme que les
célébrations lyonnaises que nous venons de présenter ne
sont pas un particularisme dû à la position frontalière de
la ville ; elles constituent bien sûr le rappel que Lyon est dans le
royaume de France mais elles affirment aussi les droits qu'ont les rois sur la
rivière de Saône.
Cependant, le roi de France n'est pas la seule autorité
concernée par la juridiction de la Saône, dans la ville de Lyon.
L'archevêque et le chapitre Saint-Jean sont les comtes de Lyon donc les
seigneurs temporels de la ville et peuvent ainsi avoir des prétentions
juridictionnelles sur la rivière. Même si « l'existence des
juridictions seigneuriales ne constitue en aucune façon une exception
à cette suprématie royale »5, l'on a
montré que les droits sur l'eau, même d'une rivière
navigable, peuvent appartenir à des seigneurs, soit par une concession
du roi soit par la légitimité d'une possession ancienne ; ce qui
ne remet absolument pas en cause l'autorité suprême que
possèdent les souverains. C'est d'ailleurs le cas pour les seigneurs de
Lyon et « les princes reconnaissent leurs droits et composent avec leurs
détenteurs mais affirment leur supériorité
juridictionnelle sur le grand cours de l'eau »6, par des
rituels tels que ceux précédemment présentés.
Un dossier des Archives municipales de Lyon7,
probablement constitué à la fin du XVIIe siècle
ou au début du XVIIIe siècle, regroupe un certain
nombre de documents, ou des copies de ceux-ci, qui présentent
l'évolution des différentes prérogatives de
l'archevêque et des chanoines-comtes de Lyon depuis le XIIe
siècle. Parmi ceux-ci, il est fait mention d'une bulle d'or de 1157 par
laquelle l'empereur Frédéric Ier aurait donné
de nombreux droits à l'archevêque de Lyon, notamment sur les cours
d'eau et les passages. Jacques Rossiaud complete cette information puisqu'il
écrit que « l'archevêque de Lyon en 1190 se proclame ainsi
maître de la « decize » grâce aux privilèges
obtenus de Frédéric Barberousse »8. Le terme de
« decize », au sens variable, a ici une portée juridique et
« permet de départager les droits du souverain et ceux des
seigneurs riverains »9. Ainsi, dès le XIIe
siècle,
4 MYNARD, Frantz, « Le fleuve et la couronne :
contribution à l'histoire du domaine fluvial (1566 - 1669) »,
in LE LOUARN, Patrick (dir.), L'eau ; sous le regard des sciences
humaines et sociales, Paris, L'Harmattan, collection Logiques sociales,
2007, pages 182-183.
5 BELY, Lucien (dir.), Dictionnaire de l'Ancien
Régime, Paris, PUF, Quadrige, 2006, page 709.
6 ROSSIAUD, « Fleuve et cité... »,
op.cit., page 405.
7 AML, DD 316, pièce 1.
8 ROSSIAUD, « Fleuve et cité... »,
op.cit., page 405.
9 ROSSIAUD, Jacques, Dictionnaire du Rhône
médiéval (1300-1550), Tome 2, Grenoble, Centre Alpin et
Rhodanien d'Ethnologie, 2002, page 110.
l'archevêque de Lyon dispose de la juridiction sur la
Saône. De plus, en 1307, Philippe le Bel confirme cela, et va même
plus loin, puisqu'il reconnaît à l'archevêque et aux
chanoines-comtes du chapitre Saint-Jean toute juridiction dans la ville de
Lyon, en précisant toutefois que celle-ci est « sous les garde,
ressort et superiorité du Roy »10.
Par ailleurs, les rois de France n'interfèrent pas dans
l'administration des seigneurs de Lyon, au moins pour ce qui est du
XVe siècle. Une décision royale du 14 août 1444,
par exemple, illustre cela. En effet, elle « ordonne par provision que le
maitre des eaux bois et forests n'exercera aucune juridiction sur les terres
eaux bois et forests des archeveque et chapitre de Lyon »11.
Charles VII choisit donc que les agents royaux des Eaux et Forêts
n'interviendront pas dans le comté de Lyon. Cela signifie alors que
l'archevêque et les chanoines-comtes de Lyon sont entièrement
responsables de la gestion fluviale, de l'application des décisions
royales sur le fait des Eaux et Forêts mais aussi de la répression
des délits dans le territoire qui est sous leur juridiction et notamment
de la Saône dans Lyon.
Néanmoins, cet état de fait n'est que provisoire
puisque « depuis 1543, la juridiction des Eaux et Forêts s'exerce
dans la ville mais la compétence et les droits de chacun ne sont
vraiment déterminés que depuis 1669 »12. Ainsi,
cela nous montre une évolution théorique dans la juridiction de
la Saône à Lyon, au cours du XVIe siècle.
Cependant, les sources ne semblent pas révéler de changement
notable dans la seconde moitié du siècle. De plus, la seule
sous-série13 qui concerne la Maîtrise des Eaux et
Forêts aux Archives départementales du Rhône ne contient que
des documents de la fin du XVIIe siècle ainsi que du
XVIIIe siècle. D'ailleurs, « en 1768, la maîtrise
des Eaux et Forêts réclame la police du Rhône et de la
Saône à l'intérieur de Lyon »14 ce qui
confirme que celle-ci n'avait, de toute façon, pas de
prérogatives dans la ville, ou de façon très
limitée et ponctuelle, au XVIe siècle. Cela ne remet
pas en cause la juridiction fluviale exercée par l'archevêque et
les chanoines-comtes de Lyon durant la période qui nous
intéresse.
10 AML, DD 316, pièce 1.
11 AML, DD 316, pièce 1.
12 BAYARD, Françoise, CAYEZ, Pierre,
PELLETIER, André, ROSSIAUD, Jacques, Histoire de
Lyon des
origines a nos fours, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2007,
pages 450-451.
13 ADR, sous-série 5 B : Maîtrise des
Eaux et Forêts (1673-1790).
14 BAYARD, CAYEZ, PELLETIER, ROSSIAUD, Histoire de
Lyon«~ op. cit., page 457.
Les rois de France tentent tout de même
d'interférer dans les prérogatives des seigneurs de Lyon. Il est
d'ailleurs bien connu qu'ils se saisissent des pouvoirs judiciaires de
l'archevêque de Lyon, de façon définitive en
1562-156315 (le chapitre Saint-Jean avaient perdu les siens
dès 142416). Dans ce processus d'affermissement de la tutelle
royale, « le Procureur du Roy en la Cour de Parlement de Paris, demanda
que les isles du Rhosne, et de la Saone fussent reunies au Domaine du Roy, et
tous les moulins à bled, les Pesches et autres droicts qui estoient
establis en l'une et l'autre rive de ces deux Rivières, contre
l'Archevesque et Clergé de Lyon »17. Cette demande,
évoquée par René Choppin, fait immédiatement suite,
selon lui, à un conflit opposant des représentants du roi et les
clercs d'Avignon, au sujet des îles du Rhône, en 1493. Choppin
explique plus loin que « la Cour ordonna sur une si grande affaire,
qu'elle verroit les tiltres et en delibereroit plus amplement ».
Cette affaire n'est réglée que plus de quarante
ans après. Tout d'abord, le 27 août 1534, l'archevêque et
les chanoines-comtes de Lyon comparaissent devant le sénéchal de
Lyon, « a ce deputé par la venerable court de parlement
»18 pour justifier de leurs titres de possession. Il est
précisé que les « ysles, broteaulx, peages, molins, bennes,
pescheries, barrages et autres choses estans en et sur les fleuves et rivieres
du Rosne et de la Saosne es environs de lad. ville de lyon [...] ont
esté saisies et mises soubz la main du Roy a la requeste dudit procureur
». Cela nous montre que les îles, les berges et les autres
éléments de la Saône ont été, au moins
provisoirement, remis au roi. Le principal argument des seigneurs de Lyon,
développé dans ce même document est l'ancienneté de
leurs droits « tant par terre que par eaue »19,
prérogatives qui n'ont jamais été remises en cause par les
souverains. Le 2 octobre 1536, un arrêt du Parlement de
Paris20 confirme les comtes de Lyon dans la possession de tous leurs
domaines ainsi que les droits dont ils disposent dessus. Cela rétablit
donc la situation juridictionnelle telle que était à la fin du
XVe siècle.
15 KLEINCLAUSZ, Arthur, Histoire de Lyon, des
origines à 1595, (tome 1), Genève, Laffite Reprints, 1978,
page 464.
16 MISSOL-LEGOUX, Bernard, La voirie lyonnaise du
Moyen Age à la Révolution, Lyon, Thèse de doctorat en
droit, 1966, page 78.
17 CHOPPIN, René, Trois livres du domaine
de la couronne, Paris, Michel Sonnius, 1613, page 169.
18 ADR, 10 G 1824, troisième liasse, document
du 27 août 1534.
19 ADR, 10 G 1824, troisième liasse, document
du 27 août 1534.
20 ADR, 10 G 1824, quatrième liasse,
arrêt du 2 octobre 1536.
Enfin, un procès-verbal dressé par le lieutenant
général de la sénéchaussée de Lyon le 21
janvier 1539 clôt l'affaire. En effet, il signifie la prise de possession
par le pouvoir royal des îles, rives et structures fluviales de la
Saône et du Rhône, « hors et excepté les dessus dittes
des archevêque doyen et chapitre de Lyon »21. Finalement,
le roi de France s'est donc saisi de la juridiction de la Saône et du
Rhône comme il l'escomptait mais à l'exception notoire de ces
cours d'eau dans le territoire des seigneurs-comtes de Lyon et donc à
l'exception de la Saône dans la ville de Lyon intra muros.
Néanmoins, nous l'avons montré dans le chapitre
précédent, la déclaration royale du 7 juillet 1572 semble
régler définitivement la question puisque le roi de France
s'attribue la juridiction des îles, des berges et des entreprises qui y
sont faites dans l'ensemble du royaume de France. Pourtant, les droits dont
disposent les seigneurs de Lyon semblent quant à eux se maintenir
puisque un édit d'avril 1683 leur confirme à nouveau « la
propriété, possession et jouissance des isles, islots,
atterrissements, peages, passages, bacqs, batteaux, ponts, moulins et autres
ediffices et droits sur les rivieres navigables, mesme de justice
»22 dans la limite de leur territoire.
La complexité juridictionnelle sur la Saône entre
le pouvoir royal d'une part et l'archevêque et les chanoines-comtes de
Lyon est donc importante. Bernard Missol-Legoux l'exprime clairement dans sa
thèse23 : les comtes de Lyon, par leur pouvoir seigneurial
ancien et donc légitime, disposent des prérogatives sur la
Saône mais, si l'on considère cette rivière comme un «
grand chemin », elle relève en effet de l'autorité royale.
C'est d'ailleurs par une référence au juriste Charles
Loyseau24, précédemment évoqué, que
Bernard Missol-Legoux en arrive à cette conclusion. La seule trace du
pouvoir royal dans la ville de Lyon, en lien avec la gestion fluviale, est le
maître des ports. Nicolas de Nicolay présente cela : « le roi
a estably en lad. ville de Lyon un maistre des portz, ponts et passaiges, et 17
gardes officiers qui sont tenuz demeurer par chacun jour es portes de ladite
ville »25. Le
21 ADR, 10 G 1824, huitième liasse,
procès-verbal du 21 janvier 1539, ou AML, DD 316, pièce 1 (pages
16-17).
22 AML, DD 316, pièce 1, page 17.
23 MISSOL-LEGOUX, La voirie lyonnaise~ op. cit.,
pages 116 à 118.
24 LOYSEAU, Charles, Traité des
seigneuries, Paris, Abel l'Angelier, 1608, page 213.
25 NICOLAY, Nicolas (de),
Généralle description de l'antique et célèbre
cité de Lyon, du païs de Lyonnois et du Beaujolloys selon
l'assiette, limites et confins d'iceux païs, Lyon,
Société de Topographie historique de Lyon, 1881 (édition
du manuscrit de 1573), page 131.
rôle de ces agents royaux se résume au
contrôle des marchandises qui affluent à Lyon, par voie de terre
comme par voie d'eau. Ainsi, ils ne concernent que peu le sujet de ce travail,
puisque leur rôle reste mineur en ce qui concerne les usages et la
gestion de la Saône, mais il était nécessaire de mentionner
leur présence dans la ville. Celle-ci ne modifie par pour autant les
modalités des droits sur la Saône.
En effet, les seigneurs de Lyon, c'est-à-dire
l'archevêque et les chanoinescomtes, ont la juridiction sur la
rivière de Saône dans les limites de la ville, et même
au-delà, malgré la levée provisoire d'une partie de leurs
prérogatives dans les quarante premières années du
XVIe siècle. Leur autorité est légitimée
par l'ancienneté de leurs droits même si le roi de France
possède tout de même une autorité supérieure de
fait, puisqu'il est considéré comme le seigneur des
rivières navigables. L'archevêque et les chanoines-comtes de Lyon
représentent donc, en théorie, l'autorité principale pour
tout ce qui concerne la Saône dans la ville mais, concrètement,
une partie de leur pouvoir est confiée à la municipalité
et particulièrement, ce qui relèvent des infrastructures
fluviales.
B. La voirie, une prérogative consulaire
La voirie est un des aspects de notre sujet puisque les
infrastructures urbaines telles que les ports, les ponts et
l'aménagement des berges font partie de ce domaine. Bernard
Missol-Legoux définit la notion de voirie comme l'entretien des «
voies »26 donc des espaces qui permettent de circuler ; ainsi,
cela regroupe les rues et les chemins terrestres et donc les ponts, mais aussi
les rivières et l'accès à celles-ci (embarcadères,
ports, rampes d'accès etc). Selon Charles Loyseau, le terme «
voirie » relève du droit de police qui « consiste proprement
à pouvoir faire des réglemens particuliers, pour tous les
citoyens de son distroit et territoire »27. Pour ce juriste, la
voirie dépend donc du pouvoir de police, détenu en
général, selon lui, par le roi ou par un seigneur. Cette
définition, très théorique, semble inadaptée
à notre analyse puisqu'elle ne distingue pas la juridiction de la
gestion concrete. Nous entendrons donc ici le terme de « voirie »
à la manière de Bernard Missol-Legoux ; d'autant plus qu'il ne
semble pas nécessaire de revenir sur les questions juridictionnelles
à propos de la Saône.
Cependant, comme le remarque justement Bernard Missol-Legoux,
luimême, la voirie entre dans la catégorie des
éléments fonciers et semble donc, de ce point de vue,
dépendre de la justice et des droits domaniaux28. La voirie
peut alors parfois relever de l'autorité seigneuriale, voire royale s'il
s'agit d'un cours d'eau navigable. Comme nous l'avons montré,
l'autorité seigneuriale principale qui prend part dans notre champ
d'étude est l'archevêque de Lyon ainsi que les chanoinescomtes du
chapitre Saint-Jean. S'ils disposaient d'un rôle dans la « voirie
fluviale », celui-ci serait essentiellement le financement des
infrastructures puisque les droits de péage leur reviennent du fait de
la juridiction qu'ils possèdent et parce que « toutes les coustumes
qui autorisent les peages, chargent par expres les seigneurs, qui les levent de
l'entretien des chemins, ponts... »29. Cependant, une lettre
patente de Louis XII, du 21 avril 150330, supprime tous les
impôts et taxes pour les marchands « frequentans les rivieres du
Rhone, de la Saone, et autres rivieres
26 MISSOL-LEGOUX, La voirie lyonnaise~ op.
cit., introduction.
27 LOYSEAU, Traité~ op. cit., page
213.
28 MISSOL-LEGOUX, La voirie lyonnaise~ op.
cit., introduction.
29 LOYSEAU, Traité~ op cit., page 220.
Cela est affirmé par l'édit de septembre 1535 (cf Chapitre I, A,
note de bas de page 22).
30 AML, CC 4047, pièce 4, décision
royale du 21 avril 1503.
navigables cheans en icelles »31.
L'archevêque de Lyon dispose tout de même de droits de péage
sur la Saône mais en dehors de Lyon, comme le montre la lettre qu'il
adresse à ses « peageurs, censiers et fermiers de noz peaiges par
la riviere de Saonne »32 en 1511. Ces droits ont probablement
été maintenu du fait de leur ancienneté, mais, quoi qu'il
en soit, sont extérieurs à la ville de Lyon.
De plus, il semble que dans la charte de 1320,
l'archevêque et les chanoines comtes ont reconnu que la voirie
relève de la compétence de la municipalité de
Lyon33. D'ailleurs, Eugene Courbis rappelle que « dès
les temps les plus anciens, les opérations de voirie ont
été faites par la ville. En 1309, nous voyons déjà
les syndics-procureurs donner l'autorisation de bâtir un arc sur le pont
de pierre construit sur la Saône »34. Lorsque Olivier
Zeller évoque la fonction des municipalités dans les villes
d'Europe pendant la période moderne, il confirme que « de longue
date, la voirie était une préoccupation constante » et que
celles-ci « devaient entretenir, améliorer ou édifier les
équipements urbains »35. Ainsi, il semble certain que la
voirie est un domaine qui est généralement géré par
les municipalités. C'est aussi le cas pour la ville de Lyon, que ce soit
justifié par l'usage ou effectivement par un document juridique.
Dans le cadre de la ville de Lyon, « les mesures
concernant les fortifications, le tracé des rues, la
sécurité et la salubrité des habitations, dont est
responsable le consulat, relèvent de la « voirie » et sont
confiées à un « voyer », officier municipal
»36. Le consulat est l'assemblée qui possède le
pouvoir municipal à Lyon sous l'Ancien Régime. Il est
composé de douze échevins (ou conseillers) depuis
144737, élus pour deux ans avec un renouvellement annuel par
moitié (soit six nouveaux échevins élus chaque
année). Les conseillers sont chargés de traiter
31 PARADIN DE CUYSEAULX, Guillaume,
Mémoires de l'histoire de Lyon, Roanne, Editions Horvath, 1973
(1e éd. en 1573), page 281.
32 ADR, 15 H 6, lettre du 8 janvier 1511 (date
actualisée).
33 MISSOL-LEGOUX, La voirie lyonnaise~ op. cit.,
page 78.
34 COURBIS, Eugène, La municipalité
lyonnaise sous l'Ancien Régime, Lyon, Imprimerie Mougin Rusand,
1900, pages 143-145.
35 ZELLER, Olivier, "La ville moderne", in
PINOL, Jean-Luc (dir.), Histoire de l'Europe urbaine, de
l'Antiquité au XVIIIe siècle, tome 1 (pages 595
à 857), Paris, Editions du Seuil, Collection L'Univers historique, 2003,
page 819.
36 BAYARD, CAYEZ, PELLETIER, ROSSIAUD, Histoire de
Lyon~ op. cit., page 348. 37BEGHAIN, Patrice, BENOIT, Bruno,
CORNELOUP, Gérard, THEVENON, Bruno, Dictionnaire historique de
Lyon, Lyon, Editions Stéphane Bachès, 2009, page 333.
toutes les « affaires communes »38 de la
ville ce qui leur confère un rôle politique mais aussi
économique, social ; en bref, un rôle d'administration au sens
large. Les désaccords financiers mis à part, Arthur Kleinclausz
considère qu'il n'y a que peu de conflits entre l'Eglise et le
consulat39. Il justifie cela par le fait que l'archevêque de
Lyon souhaite surtout maintenir son pouvoir judiciaire sur lequel le consulat
n'a aucune prétention. Chacun semble donc exercer son autorité de
façon distincte et la gestion de la voirie est prise en charge par la
municipalité lyonnaise.
En effet, depuis 149240, le pouvoir municipal
lyonnais nomme un préposé à la voirie, le voyer. Avant que
ce poste ne soit défini, le consulat « qui, au début du
XIVe siècle, exerçait déjà dans la ville
le « droit de voirie », chargeait à l'origine, un ou plusieurs
conseillers [...] de visiter les édifices en construction ou en
réparation, d'inspecter les ponts, portes, rues et remparts
»41. Ainsi, dès la fin du Moyen Age, même s'il
n'existait pas d'agent municipal dévoué à la voirie, des
conseillers exerçaient ponctuellement cette charge. Celle-ci est donc
constituée de deux aspects : tout d'abord de la surveillance des
édifices pour prévenir des nécessités, notamment de
réparation, mais aussi d'un rôle de maître de chantier
puisqu'il s'agit de surveiller les travaux d'édification ou de
réfection des infrastructures. Nicolas de Nicolay, contemporain,
décrit le rôle du voyer lyonnais au XVIe siècle
: celui-ci a « la sur-intendance sur la santé de ladicte ville,
pavissement et nettoyement des rues, demolition des maisons et bastiments
ruineux, reparation et entretenement des rues, portz, ponts et passages
»42. La principale précision que nous apporte cet auteur
est que le voyer est responsable de l'entretien des rues c'est-à-dire
à la fois de leur propreté mais aussi de l'entretien de leur
pavement afin qu'elles soient aisément carrossables. Enfin, ce commis
à la voirie peut décider de la destruction des édifices en
ruines ou qui représente un danger au vu de leur délabrement.
Le voyer est donc l'agent du consulat en matière de voirie
tout au long du siècle qui nous concerne. Cependant, son statut a
évolué au milieu du XVIe siècle
38 Citation des textes qui instituent les
échevins, relevée dans BAYARD, CAYEZ, PELLETIER, ROSSIAUD,
Histoire de Lyon..., op. cit., page 433.
39 KLEINCLAUSZ, Histoire de Lyon..., op. cit.,
page 481.
40 BAYARD, CAYEZ, PELLETIER, ROSSIAUD, Histoire de
Lyon..., op. cit., page 457.
41 VIAL, Eugène, "Les voyers de la ville de
Lyon", in Revue d'Histoire de Lyon, Tome 10, année 1911, Lyon,
A. Rey et Compagnie (imprimeurs-éditeurs), 1911, page 180.
42 NICOLAY, Généralle
description..., op. cit., page 142.
suite à la création, à Lyon, par un
édit de novembre 1549 d'un poste de « voyer en chef en titre
d'office »43. Eugène Vial, dans son article très
complet sur les voyers de Lyon, présente cette affaire qui ne comporte
pas de conséquences importantes, mais qu'il est utile de mentionner.
Henri II confia ce nouvel office à un marchand lyonnais, Guillaume
Chazottes, « mais le consulat fit opposition à cette nomination qui
portait atteinte à l'un de ses privileges les plus anciens, sa
juridiction de voirie, et réclama le droit de nommer son Voyer
»44. L'affaire, selon Eugene Vial, n'est réglée
qu'en 1557, après plusieurs années de procédure judiciaire
et la démission de Chazottes. Pendant ces huit années, Humbert
Gimbre, voyer de la ville nommé par le consulat, puis son fils, ont
continué d'exercer leur charge.
En 1557, le consulat est confirmé dans son pouvoir de
nomination d'un voyer pour la ville. Eugène Vial explique que, depuis
cette affaire, le voyer fait « partie du corps consulaire comme «
officier de Ville » »45. Concrètement, à
part le costume porté par ce personnage et les privilèges dont il
dispose en tant que nouveau membre du pouvoir municipal (éléments
confirmés par le consulat dans la seconde moitié du
siècle), la charge de voyer reste la même. Elle consiste donc en
l'inspection des bâtiments de la ville et en la direction des travaux qui
sont réalisés, de la volonté de la municipalité
lyonnaise. En effet, le consulat, nous l'avons montré, est le
responsable de la voirie à Lyon au XVIe siècle.
43 VIAL, « Les voyers... », op.
cit., page 182.
44 Ibid., page 182.
45 Ibid., page 183.
C. Chevauchement d'autorités ; l'affaire
Pierrevive
L'archevêque et les chanoines-comtes de Lyon
possèdent la juridiction de la Saône et des structures qui en
dépendent au XVIe siècle à Lyon. Cependant, les
questions de voirie ont été déléguées et
sont gérées par la municipalité lyonnaise. En
théorie, ces rôles semblent définis mais une affaire
judiciaire les opposant met au jour les conflits d'autorité qui
découlent d'un partage de prérogatives si peu tranché.
Le 7 février 1528, Françoise de Pierrevive, veuve
Piochet, demande à
l'archevêque l'autorisation de rebâtir sa maison,
détruite par un incendie. Sa maison
« estoit sur la pille dud. pont [de Saône] au coing
dicelluy devers leglise Saint
Jehan »46. Cette maison était donc sur le
pont de Saône ; en effet, de longue date,
des maisons y étaient installées. Léon
Boitel l'explique : « Quoique ce pont fut très
étroit, on avait toléré, sans doute en
faveur des citoyens qui y avaient des droits par
la générosité de leurs dons pour
l'achèvement de l'entreprise, la construction de
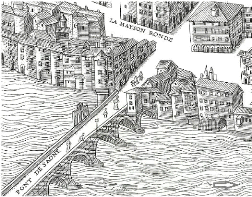
maison assises sur les piles à chaque
extrémité du pont »47. Il fait donc remonter la
présence de maisons, sur le seul pont jeté sur la Saône,
à la fin du XIe siècle ou au début du
siècle suivant. L'affaire judiciaire qui nous intéresse concerne
donc une de ces maisons, situées à l'extrémité
sud-ouest du pont de Saône et représentées sur le
plan48 ci-contre.
46 AML, DD 003, pièce 39.
47 BOITEL, Léon (dir.), Lyon ancien et
moderne, tome 2, Lyon, éditeur Léon Boitel, 1843, pages 439
à 445.
48 Extrait d'un planche du plan
scénographique de 1550, tiré de CHAMPDOR, Albert, Plan
scénographique de la ville de Lyon au XVIe
siècle, Trévoux, Editions de Trévoux, 1981, planche
XIII.
Donc, suite à l'incendie de sa maison, Françoise
de Pierrevive, le 7 février 1528, demande à l'archevêque
qu'il « lui soit loisible de reedifier et de parachever tout ainsi que a
commencé en luy donnant faculté, puissance et liberté de
ce faire »49. Sa requête est donc très claire :
les travaux ont débuté mais elle demande une autorisation
officielle de les continuer. La raison de cette demande n'est pas
identifiée ; aucun des documents consultés ne montre qu'on lui
ait suggéré de la formuler. Un acte du conseil de
l'archevêque de Lyon et du chapitre Saint-Jean, du 21 février
1528, lui fournit une réponse : sa requête est acceptée
« dung commun consentement tant quil touche mond. seigneur l'arcevesque
seigneur naturel, temporel et spirituel dud. lyon et a cause de son contat dud.
lyon ayant la directe seigneurie de la maison de lad. suppliante
»50. L'autorisation fournie est ainsi justifiée par le
pouvoir temporel de l'archevêque et du chapitre Saint-Jean ; c'est en
tant que comtes de Lyon qu'ils ont l'autorité sur cette question.
Malgré la légitimité qu'ils se donnent,
ces seigneurs nomment deux membres de leur conseil « pour empescher par
tous les moiens deuz, justes et raisonnables que lad. Dame [...] ne soit
empeschée de faict et induement au bastiment et parachevement de sad.
maison »51. Les deux commis sont Hugues du Puy, procureur
général et représentant de l'archevêque et Annemond
Chalan, « docteur es droiz, Juge de la cour des appeaulx des chasteaulx et
places »52 de l'archevêque également. Ceux-ci sont
donc chargés de s'assurer de l'application de la décision du
conseil et, par conséquent, de la reconstruction de la maison de
Françoise de Pierrevive. Leur mission est précisée plus
loin dans le même document : ils doivent aller voir « monsieur
Pomponne de Tremoille lieutenant de monSeigneur le gouverneur pour le Roy notre
souverain seigneur en la ville de lyon et pays de lyonnois pour lui supplier et
requerir que son plaisir soit ne donner ne faire empeschement à lad.
dame ». Hugues du Puy et Annemond Chalan doivent ainsi aller voir le
lieutenant du gouverneur du Lyonnais c'est-à-dire le «
représentant suprême de l'autorité royale
»53 dans la région pour confirmer la permission
accordée à Françoise de Pierrevive. Cette demande de
confirmation de leur décision est assez surprenante : il faut
peut-être la lier à la suspension
49 AML, DD 003, pièce 39.
50 AML, DD 003, pièce 40.
51 AML, DD 003, pièce 40.
52 AML, DD 003, pièce 40.
53 KLEINCLAUSZ, Histoire de Lyon..., op.
cit., page 464.
provisoire de la juridiction des seigneurs de Lyon jusqu'en
1539 au profit du roi54. Aucun document trouvé ne mentionne
cette entrevue avec le gouverneur mais comme les comtes de Lyon ne reviennent
pas sur leur décision, l'on peut penser qu'ils ont obtenu une
réponse favorable du gouverneur.
En dépit de cela, les échevins saisissent la
sénéchaussée de Lyon c'est-àdire la principale
autorité judiciaire. Les dates précises de ce recours en justice
et des démarches qui l'accompagnent ne sont pas mentionnées dans
les documents trouvés aux Archives municipales de Lyon ; cependant,
comme le désaccord semble définitivement tranché autour du
5 juillet 1528, l'on peut sans doute affirmer que l'instruction de l'affaire se
déroule entre la fin du mois de février 1528 et le mois de
juillet de la même année. Les conseillers de la ville de Lyon
réagissent donc négativement à la décision prise au
conseil de l'archevêque le 21 février 1528 mais aussi à une
« complainte » formulée par ce dernier, qui, selon eux, «
nest recevable »55. Il s'agit probablement de la demande faite
auprès du gouverneur par les représentants de l'archevêque
et du chapitre Saint-Jean de ne pas aller à l'encontre de la
décision qu'ils ont prise en faveur de Françoise de Pierrevive.
Les arguments développés par le consulat devant la
sénéchaussée contestent l'autorité des comtes de
Lyon en la matière. En effet, selon les échevins, « led.
seigneur arcevesque pretend usurper et entreprendre contre les droitz du Roy
tant par eaue que par terre »56. Ainsi, ils considèrent
que l'archevêque et son conseil ne sont pas les personnes
désignées pour prendre ce type de décisions et même
que, ce faisant, ils vont à l'encontre du pouvoir du roi.
La défense de l'archevêque (qui s'exprime aussi
au nom des chanoinescomtes de la ville) va directement à contre-courant
de ce qui lui est reproché par le consulat. En effet, il
considère « que a cause de leglise et conté de lyon Il a
plusieurs beaulx, droictz, preheminances, auctoritez et prerogatives [...] tant
par eaue que par terre en toute la ville et cyté de lyon », mais il
rappelle que c'est « soubz toutesfoys le ressort et souverainté du
Roy »57. Il est donc ici encore question du pouvoir du roi ;
adroitement, l'archevêque ne le nie pas et place même son
autorité comme légitime puisque justement conférée
par les souverains.
54 Cf Chapitre II, A.
55 AML, DD 310, pièce 24.
56 AML, DD 310, pièce 24.
57 AML, DD 310, pièce 25.
D'ailleurs, le simple recours à l'avis du gouverneur,
prévu en février 1528, montre qu'il tient compte du pouvoir
royal. L'archevêque ajoute qu'il détient la juridiction sur les
maisons de la ville et « mesmement sur les crenes, forgets, avancemens et
accroissemens des maisons estans et assises le long du rivaige de la riviere de
saosne tant sur le pont de ladite riviere que sur les pont qui ont esté
faictz et se font »58. L'archevêque considère donc
qu'il agit dans son droit puisque les maisons de la ville, le pont de
Saône et, par conséquent, les maisons qui sont sur ce pont
dépendent de son autorité. Dans le même document, il
précise que personne ne peut construire d'édifice sur la
Saône sans l'autorisation du chapitre Saint-Jean et de luimême.
Gependant, les deux parties qui s'opposent dans cette affaire,
disposent d'autres arguments en leur faveur. Tout d'abord, le consulat s'oppose
aux prérogatives revendiquées par les seigneurs de Lyon sur les
infrastructures saôniennes. Ainsi, les échevins se sentent
usurpés dans leurs droits : « nous voullons dire que le pont est de
la ville et quelle lentretient en toutes reparations et quil nest loysible a y
bastir sans la permission de la ville »59. Gette fois, sans
remettre en cause le pouvoir seigneurial, ils affirment tout de même que
l'autorisation de construire relève de leur autorité. En effet,
ils rappellent leur droit de voirie et donc qu'ils sont responsables de la
gestion concrète des édifices de la ville et, de ce fait, ce sont
eux qui détiendraient le pouvoir d'autoriser une telle reconstruction.
L'archevêque et les chanoines-comtes, quant à eux, affirment
à plusieurs reprises que la permission qu'il ont donnée à
Françoise de Pierrevive de rebâtir sa maison sur le pont de
Saône, n'a pas été décidée « contre le
droit d'autruy mêmement de la chose publique »60 mais
seulement parce que leur seigneurie leur confère le droit d'autoriser ou
non des constructions dans la ville.
Get argument touche probablement au fond du problème :
« la chose publique ». En effet, peu à peu au cours du
XVIe siècle, lorsqu'il s'agit de construction, « le
consulat oppose des arguments nouveaux fondés sur la notion d'espaces
« publics » donc inappropriables. Les rues et les places de la
cité ne sont
58 AML, DD 310, pièce 25.
59 AML, DD 310, pièce 27.
60 AML, DD 256, pièce 41, acte du conseil de
l'archevêque du 16 juin 1528.
plus, aux yeux des échevins, des territoires dont
chacun peut se rendre maître "61. Le pont de Saône
n'échappe pas à la règle : le consulat craint que les
maisons empiètent sur cet axe de circulation, déjà
étroit à l'origine. Le 9 mars 1516, lors d'une réunion du
consulat, François Deschamps rapporte « le bruist qui court que le
Roy a donné à monsieur de Maugiron permission de appensionner le
pont de saone et y faire des maisons tant dun costé que dautre
"62. Cette rumeur inquiète le consulat qui considère
que ce « seroit grant dommaige interestz a ceste ville " et qu'il faut
« y obvier par tous les moyens que pourra "63. Au moins
dès 1516, les échevins craignent donc qu'une personne puisse
construire des maisons sur le pont de Saône et l'on peut penser que c'est
une motivation importante de leur opposition aux travaux que veut effectuer
Françoise de Pierrevive. L'autre aspect intéressant de cette
rumeur, est que l'autorisation de construire aurait été
donné par le roi, ce qui n'étonne pas le consulat.
Ainsi, le roi peut intervenir ponctuellement en matière
de voirie à Lyon. C'est d'ailleurs par une intervention d'un
représentant du roi que l'affaire qui oppose l'archevêque et les
chanoines-comtes d'une part, au consulat d'autre part, est
réglée. Une délibération consulaire du 5 juillet
1528 donne les conclusions du différend. Tout d'abord, Mme de
Pierrevive n'a pu reconstruire sa maison car « elle auroit
été empêchée par auctorité de justice
"64 ce qui laisse sous-entendre que les échevins ont
été reconnus dans leurs prérogatives ; ils
réaffirment dans ce document qu'il leur « appertient led. droit de
permission et cognoissance des bastiments et édiffices et sur iceux
bailler et prendre mesures pour obvier que la rue ne soit usurpée sur la
chose publique ". Il est ensuite précisé que Françoise de
Pierrevive a renoncé à la permission obtenue du conseil de
l'archevêque et demande, cette fois, l'autorisation de
réédifier sa maison au consulat.
Celui-ci, malgré les oppositions qu'il a
formulées jusque-là, accède à sa requête, lui
permettant donc de reconstruire sa maison sur le premier arc du pont de
Saône. Néanmoins, cette volte-face surprenante n'est pas
simplement motivée par des questions de juridiction : ce n'est pas parce
que la décision lui revient que le
61 MONTENACH, Anne, Espaces et pratiques du
commerce alimentaire à Lyon au XVIIe siècle, Grenoble,
Presses universitaires de Grenoble, Collection "La Pierre et l'Ecrit", 2009,
page 144.
62 AML, BB 035, f°129 v°,
délibération du dimanche 9 mars 1516.
63 AML, BB 035, f°129 v°.
64 AML, DD 003, pièce 43.
consulat donne cette autorisation, qui va à l'encontre
de ses propos sur l'espace « public » et de sa volonté de
permettre une circulation aisée sur le pont. Il est expliqué
à ce sujet, dans la délibération consulaire, que les
échevins lui ont conféré la permission de construire
« à la demande et priere de très illustre prince Monseigneur
François Conte de Saint-Pol, lieutenant general pour le Roy nôtre
sire, conduisant presentement l'armée dud. Seigneur en Italie
»65. Cette intervention, difficile à appréhender,
peut probablement s'expliquer de diverses façons comme, par exemple, par
des liens qui pourraient exister entre les familles de Pierrevive et de
Saint-Pol ou par une requête de l'archevêque à ce
représentant du roi. Cependant, la qualité en laquelle celui-ci
peut intervenir n'est pas définie et sa demande semble impromptue.
Finalement, face à ce grand personnage, lieutenant
général du roi, le consulat a cédé et l'affaire se
conclut donc à l'avantage de Mme de Pierrevive et donc de
l'archevêque. Néanmoins, cette affaire complexe confirme chaque
autorité dans son rôle : l'archevêque et les
chanoines-comtes possèdent la juridiction de la Saône mais la
gestion concrète relève du pouvoir consulaire. Par ailleurs, le
roi reste l'autorité principale, en dernier recours, par le biais
notamment de son gouverneur ou de la sénéchaussée de Lyon.
Enfin, comme le présente Yann Ligneureux, en ce qui concerne le
XVIIe siècle, lorsqu'il évoque le pouvoir du consulat
: « le plus ancien pont de la ville, celui jeté sur la Saône,
dépendait de son autorité directe »66.
65 AML, DD 003, pièce 43.
66 LIGNEREUX, Yann, Lyon et le roi ; de la "bonne
ville" à l'absolutisme municipal (1594-1654), Seyssel (Ain),
Editions Champ Vallon, Collection Epoques, 2003, page 651.
Conclusion chapitre II
Plusieurs autorités sont concernées par la
juridiction et la prise en charge de la Saône à Lyon au
XVIe siècle. Tout d'abord, l'archevêque et les
chanoinescomtes de Lyon, seigneurs temporels de la ville, disposent de la
juridiction fluviale depuis le Moyen Age. Cependant, une suspension de ce
pouvoir pendant la première moitié du XVIe
siècle est à noter, à l'avantage des rois de France. En
effet, les souverains cherchent à affermir leur pouvoir sur la
Saône ; quoiqu'il en soit, comme c'est une rivière navigable, elle
est dans leur giron. A cela s'ajoute le consulat lyonnais, qui gère
toutes les affaires courantes et communes de la ville, et
particulièrement la voirie. Les prérogatives de ces
différents pouvoirs, pourtant identifiables, ne sont pas
cloisonnées ; l'affaire autour de la reconstruction de la maison de
Françoise de Pierrevive met au jour des conflits d'autorités
sous-jacents qui peuvent entraîner facilement des différends entre
les acteurs de la juridiction de la Saône.
Conclusion de la première partie
Les juridictions qui s'exercent sur les cours d'eau peuvent
être détenues par différentes autorités et de
manières diverses. Eric Rieth explique d'ailleurs qu'il existe, pendant
le Moyen Age et l'Ancien Régime, « un contrôle des fleuves et
des rivières de nature locale, régionale, nationale d'une part,
et d'ordre administratif, juridique, économique, politique, d'autre part
»67. Au niveau national, nous l'avons montré, le roi
détient les droits régaliens sur les cours d'eau navigables du
royaume. Il exerce son pouvoir par l'intermédiaire d'une administration,
les Eaux et Forêts, dont il tente d'améliorer l'efficacité
et le champ d'action au cours du XVIe siècle.
La maîtrise des Eaux et Forêts ne semble que peu
intervenir, voire pas du tout, dans la juridiction de la Saône à
Lyon. Celle-ci relève de l'autorité des comtes de Lyon,
c'est-à-dire de l'archevêque et du chapitre Saint-Jean, même
si les rois de France tentent de s'en saisir. Cela n'est pas aisé car
même si les seigneurs de Lyon reconnaissent le pouvoir des rois sur les
rivières navigables, ils légitiment leur juridiction par son
ancienneté et la conservent pendant l'Ancien Régime.
Les comtes de Lyon disposent, en théorie, de
l'essentiel des droits sur la Saône. Cependant, le consulat, qui
détient le pouvoir municipal, est en charge de la gestion quotidienne et
particulièrement, de la voirie. Ainsi, plusieurs autorités
interagissent dans la gestion de la Saône à Lyon, ce qui n'est pas
une particularité ni de cette ville, ni de l'administration des cours
d'eau, puisque « l'entrecroisement des institutions et des fonctions
semble avoir été un caractère ordinaire
»68 des villes sous l'Ancien Régime.
67 RIETH, Eric, Des bateaux et des fleuves,
Archéologie de la batellerie du Néolitique aux Temps modernes en
France, Paris, Editions Errance, collection des Hespérides, 1998,
page 17.
68 ZELLER, Olivier, "La ville moderne", in
PINOL, Jean-Luc (dir.), Histoire de l'Europe urbaine, de
l'Antiquité au XVIIIe siècle, tome 1, Paris,
Editions du Seuil, Collection L'Univers historique, 2003, page 856.
Deuxième partie : Représentations et usages de
la
Saône à Lyon
La rivière de Saône, plus qu'un enjeu
juridictionnel, est un espace au coeur de la ville de Lyon. C'est à la
fois un lieu d'activités mais c'est aussi un élément
naturel, avec tous les avantages et les risques impliqués par ce
qualificatif. Il s'agit d'étudier le rapport entre une communauté
urbaine et la rivière qu'elle côtoie. Cela implique de
caractériser les usages de la Saône par les Lyonnais ainsi que de
s'intéresser à l'importance de la rivière pour la ville.
De plus, il est important de déterminer les avantages et les
inconvénients de la présence d'une rivière dans un espace
urbain c'est-à-dire, la façon dont les riverains et les
autorités tirent profit des ressources et des possibilités
qu'elle offre mais aussi comment ils s'adaptent aux difficultés que la
présence d'un cours d'eau implique.
Afin d'appréhender cette relation particulière
entre une ville et ses habitants d'une part et une rivière d'autre part,
nous tenterons, dans un premier temps, d'esquisser la perception de cette
rivière en nous intéressant particulièrement à son
caractère propre, c'est-à-dire naturel, et donc à la
conscience et à la prévention des risques intrinsèques
à sa présence, dans un espace dans lequel l'homme s'est
installé. Puis nous nous intéresserons aux activités et
aux usages de la Saône à Lyon. Il s'agira donc d'analyser à
quel point la rivière est au coeur de la vie de ses riverains lyonnais
et de décrire les usages principaux qui en sont fait. Tout au long de
cette présentation, la prise en charge politique constituera l'enjeu
principal puisque après avoir défini, dans la première
partie, les autorités qui sont impliquées dans la juridiction de
la Saône, il s'agira de se pencher sur la gestion concrète et sur
ses implications.
Chapitre III : Perception et gestion des risques
L'intérêt de ce chapitre est de déterminer
la représentation de la Saône en tant que rivière
c'est-à-dire la Saône comme élément naturel,
potentiellement imprévisible, dans un cadre urbain organisé et
maîtrisé. Il s'agit donc de s'intéresser à la
perception de la rivière par les auteurs mais surtout par les individus,
particuliers comme autorités, qui la côtoient. Pour cela, nous
nous pencherons, dans un premier temps, sur les descriptions de la Saône,
puis nous présenterons les risques qui résultent de sa
présence pour la ville de Lyon et la façon dont ils sont
perçus. Enfin, nous nous pencherons sur la question de la pollution de
cette rivière, qui révèle des usages mais aussi une
certaine vision de l'eau, ainsi que sur le rôle des autorités dans
ces questions.
A. Une rivière paisible
La mention de la rivière de Saône est un
élément fondamental de toute présentation de la ville de
Lyon. En effet, la ville est systématiquement associée à
cette rivière autour de laquelle elle s'est peu à peu construite,
depuis l'Antiquité. La Saône traverse la ville de Lyon en son
milieu à la période moderne c'est-à-dire avant que le site
urbain ne s'étende également à la rive gauche du
Rhône. En effet, l'actuel quartier de la Guillotière, qui existait
déjà au XVIe siècle, n'était qu'un
faubourg de la ville, très peu peuplé, qui ne sera
intégré au royaume de France qu'après le Traité de
Lyon en 1601, et à l'espace urbain plus tardivement. La
rivière
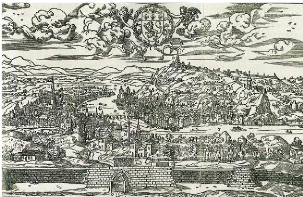
de Saône, au XVIe
siècle, est donc au
coeur de la ville de
Lyon comme cela
est figuré sur le
plan ci-contre,
réalisé vers 1564
par Antoine du
Pinet1. C'est une
rivière familière
pour ses riverains puisqu'il la côtoie quotidiennement.
L'installation progressive de la ville sur les deux berges de ce cours d'eau
révèle son caractère urbain, dans les différents
sens du terme. D'ailleurs, « il est symptomatique que tous les premiers
établissements humains se sont succédés sur ses rives
»2. Ainsi, le choix antique d'installer des habitats au bord de
la Saône, au détriment du Rhône pourtant tout proche, semble
être révélateur d'une certaine crainte de ce dernier ou,
à l'inverse mais de façon logique, la marque d'une perception
plus sereine de la Saône.
1 DU PINET, Antoine, « Plantz, pourtraictz et
descriptions de plusieurs villes et forteresses... », Lyon, Jean
d'Ogerolles, 1564, tiré de KRUMENACKER, Yves (dir.), Lyon
1562 capitale protestante, Lyon, Editions Olivétan, 2009, page
261.
2 DELLUS, Jean, FREBAULT, Jean, RIVET, Martine,
«Lyon, ville fluviale», in La ville et le fleuve, actes du
colloque de Lyon (avril 1987), Paris, Editions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques, 1989, page 38.
Ces deux cours d'eau, profondément liés à
l'histoire de Lyon, sont souvent comparés par les auteurs. En effet, la
Saône et le Rhône, généralement décrits de
paire, sont présentés comme complémentaires, justement en
raison de leurs caractères si différents. Tout d'abord, ces cours
d'eau sont souvent assimilés aux deux constituantes d'un couple
amoureux. La Saône est régulièrement
présentée allégoriquement comme une femme en raison de la
douceur de son courant et le Rhône comme son amant. En 1537,
Clément Marot les décrit ainsi : « La Saône et son
mignon / Le Rhosne qui court de vistesse »3. La confluence des
deux fleuves est alors assimilée à une union. Celle-ci est, en
général, présentée comme dominée par le
puissant fleuve du Rhône, que Charles Fontaine présente comme
« courant d'une forte alaine : /Afin que d'un brave et beau train / Saone
son amie il emmeine »4. Dans ces deux descriptions, la
puissance du Rhône est mise en exergue et implique, par
conséquent, une moindre intensité du cours de la Saône.
Des l'Antiquité, les descriptions de ces deux cours
d'eau insistent sur leurs oppositions. Par exemple, selon René Choppin,
l'auteur latin Tibulle les qualifie ainsi : « Mitis Arar5,
Rhodanusque celer »6. Il présente donc la
Saône comme une rivière « calme, tranquille
»7, à l'opposé du fleuve « rapide »
qu'est le Rhône. François de Belleforest, auteur du
XVIe siècle, confirme cette description puisque selon lui,
« la Saone coule doucement, et le Rhosne est tout ravageant, enflé
et tourbilloneux »8. Le procédé de comparaison
employé par ces auteurs peut sembler exagérer les
différences entre ces deux cours d'eau, néanmoins, il est certain
que la perception de ceux-ci est nettement définie et que la Saône
est perçue comme une rivière beaucoup moins tumultueuse que le
fleuve voisin. D'ailleurs, l'absence de moulins sur cette rivière alors
qu'ils sont nombreux sur le Rhône9 est un indice
3 Extrait d'un poème de Clément Marot,
cité dans GARDES, Gilbert, Le voyage de Lyon, Lyon,
Editions Horvath, 1993, page 90.
4 FONTAINE, Charles, Ode de l'antiquité et
excellence de la ville de Lyon, Lyon, Société des
bibliophiles lyonnais, 1890 (1e éd. en 1557), pages 12 et 13.
5 Nom de la rivière de Saône durant
l'Antiquité.
6 Citation extraite de CHOPPIN, René, Trois
livres du domaine de la couronne, Paris, Michel Sonnius, 1613, page
169.
7 GAFFIOT, Félix, Dictionnaire
Latin-Français, Paris, Editions Hachette, 2001, page 464,
définition de mitis, e.
8 BELLEFOREST, François (de), De
l'effroyable et merveilleux desbord de la rivière du Rhosne en
1570, Lyon, J. Nigon (imprimeur), 1848 (ouvrage de 1570), page 3.
9 Cela est précisé dans le chapitre IV,
B.
supplémentaire de la vision de ces cours d'eau par les
contemporains mais aussi de leur débit constaté.
Si l'on s'écarte de ces présentations
comparatives des fleuves qui passent à Lyon pour se restreindre aux
seules descriptions de la Saône, les auteurs sont également
unanimes au sujet du caractère apaisé de cette dernière.
Encore une fois, un auteur antique nous permet de commencer cette
présentation. Il s'agit de Jules César, qui a écrit
à propos de la Saône que « son cours est d'une incroyable
lenteur, au point que l'oeil ne peut juger du sens du courant
»10. Cette affirmation, quoique exagérée et
lapidaire, qualifie le cours de la Saône d'une lenteur et d'une
tranquillité indéniables. Nicolas de Nicolay, qui réalise
une description de Lyon et sa région au début des années
1570, confirme cette présentation, mais de façon plus
mesurée, puisqu'il considère que la Saône « est fleuve
tres doux et lent »11.
Une anecdote de F. Vinchant confère même à
cette rivière, sur le ton de l'humour, des qualités de
guérison du fait de sa lenteur. En effet, il raconte qu'en 1589,
Guillaume Michel, un individu souffrant de la goutte, se fait conduire à
l'Ile Barbe, au nord de Lyon, afin d'obtenir une guérison. Au retour, la
barque, menée par une batelière ivre et suite à une
collision avec le pont de Saône, se renversa. Le malade « se sentant
en l'eau, donna si bien des pieds et des mains qu'il estendit ses membres et se
délivra de l'eau et de la goutte »12. L'auteur
précise au préalable que « ce fleuve coule bien paisiblement
et si doucement qu'il peut rendre garison aux goutteux ». Quelle que soit
la valeur de ce récit et le ton sur lequel il semble être
raconté, il confirme à nouveau que la Saône est
perçue depuis l'Antiquité, et en ce qui nous concerne au
début de la période moderne, comme une rivière calme et
paisible.
Ainsi, les propos des auteurs, antiques comme modernes,
concordent et leur vision unanime de la rivière de Saône
révèlent donc une perception favorable de celle-ci. Cependant,
cette perception n'est pas forcément représentative et la vision
qu'ont les riverains de ce cours d'eau n'est pas aisée à
déterminer. Il est tout de
10 CESAR, Jules, La Guerre des Gaules, 1937,
livre premier, XII, cité dans GARDES, Gilbert, Le voyage~
op. cit., page 194.
11 NICOLAY, Nicolas (de),
Généralle description de l'antique et célèbre
cité de Lyon, du païs de Lyonnois et du Beaujolloys selon
l'assiette, limites et confins d'iceux païs, Lyon,
Société de Topographie historique de Lyon, 1881 (édition
de l'ouvrage manuscrit de 1573), page 214.
12 Citation tirée de GARDES, Le voyage~,
op. cit., page 194.
même possible de supposer que la présence de
maisons tout au long de la rive droite de la Saône, de façon
presque continue, ainsi que sur la rive gauche dans une moindre
mesure13, montre que la Saône ne représente pas une
menace importante.
Ces maisons « plantées dans l'eau
»14, dont une partie est représentée sur
l'image ci-dessous15, sont caractéristiques
des rives de la Saône dans le cadre de la
ville de Lyon. A l'inverse, les maisons au bord du Rhône
ne sont pas accolées à la
berge, ou seulement de façon sporadique, et la rive
droite du Rhône n'est bordée en
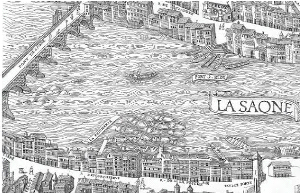
certains points que par des remparts. Ainsi, il semble
possible d'affirmer que la rivière de Saône, tant par les auteurs,
que par les riverains, est perçue comme un cours d'eau calme et
paisible. D'ailleurs, l'on sait aujourd'hui que le débit moyen de la
Saône est beaucoup
moins élevé que celui de Rhône : 250
m3 pour la rivière alors que 650 m3 pour le
fleuve16. Il semble donc logique qu'il existe une
forte différence de perception de
ces cours d'eau et que la Saône est
considérée comme une rivière au cours
favorable.
Le régime de la Saône a été
étudié par des géographes, notamment par Laurent Astrade.
Ce dernier, dans un article qu'il consacre aux débordements de cette
rivière17, explique que les crues de la Saône sont
nombreuses et très fréquentes. Cependant, la plupart de ces
débordements se concentre en amont de
13 Cependant, dans la partie nord de la ville, la rive
gauche semble comporter un chemin de halage qui empêche la
présence d'édifices au bord de l'eau.
14 LABASSE, Jean, «Réflexion d'un
géographe sur le couple ville-fleuve», in La ville et le
fleuve, actes du colloque de Lyon (avril 1987), Paris, Editions du
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1989, page 15.
15 CHAMPDOR, Albert (introduction), Plan
scénographique de la ville de Lyon au XVIe
siècle, Trévoux, Editions de Trévoux, 1981, extrait
de la planche XIII.
16 GARDES, Gilbert, Lyon, l'art et la ville,
Paris, Editions du CNRS, 1988, page 17.
17 ASTRADE, Laurent, "Les crues et les inondations de
la Saône", in La Saône, axe de civilisation, Actes du
colloque de Mâcon (2001), Presses universitaires de Lyon, 2002, pages 157
à 171.
Lyon ou, en ce qui concerne les crues dites «
méditerranéennes », elles sont en aval de cette ville.
Ainsi, la ville de Lyon semble plutôt épargnée par ces
phénomènes ; ce qui explique en partie la perception de la
Saône comme une rivière paisible. A cela s'ajoute bien sûr
la comparaison avec le Rhône, fleuve puissant, qui permet de rendre la
Saône d'autant plus familière pour les Lyonnais. Cependant, les
dangers de la présence d'une rivière, même s'ils peuvent
sembler lointains, font partie des aléas climatiques que la ville de
Lyon peut ponctuellement subir.
B. Les aléas climatiques
La Saône, bien que considérée comme un
cours d'eau familier et paisible, reste une rivière, c'est-à-dire
un élément naturel, qui connaît différents cycles de
croissance et de rétractation de son lit. De plus, une rivière
est soumise aux variations climatiques et ne peut donc être perçue
comme immuable et totalement prévisible. Ainsi, dans le cadre d'un site
urbain, un tel élément peut représenter un danger pour les
installations humaines, particulièrement les habitations, et être
à l'origine de difficultés, notamment de navigation. Les
riverains sont nécessairement, et par la force des choses, conscients
des risques qui existent. Il s'agit ici de s'intéresser à la
perception des dangers liés à la présence d'une
rivière dans la ville de Lyon, mais aussi à la prise en charge
politique voire à l'anticipation par les autorités de tels
épisodes.
Parmi les évènements climatiques qui peuvent
survenir et avoir des conséquences sur une rivière telle que la
Saône, le premier auquel nous allons nous intéresser est la forte
baisse des températures. Celle-ci peut entraîner le gel de la
rivière et donc un empêchement total de la navigation. Ce
phénomène est assez peu courant mais plusieurs occurrences sont
avérées pour la rivière de Saône. Selon Laurent
Michel, « la rudesse relative du climat et la faible pente expliquent
aussi que la Saône soit un des seuls fleuves français à
être parfois pris par les glaces, comme le Rhin »18. Il
fournit également plusieurs dates auxquelles de tels épisodes se
sont produits mais sa chronologie ne recense de tels évènements
seulement entre les années 1608 et 1956.
Cependant, des sources permettent de supposer que la
rivière de Saône a été, au moins une fois, prise par
les glaces au cours de la période que nous étudions. En effet,
Guillaume Paradin, historien lyonnais du XVIe siècle, relate
un tel évènement pour l'hiver de l'année 1500. Cet auteur
déclare que « la riviere de Saone, fut entierement gelée,
depuis Lyon, iusques à Mascon : de manière que le commerce
18 MICHEL, Laurent, La Saône,
frontière et trait d'union ; son histoire, ses riverains, son
cours, Saint-Etienne, Editions Horvath, sans date, page 64.
par eau, estoit arresté »19. Cette
information est confirmée par un acte consulaire du 7 janvier 1500. Le
consulat lyonnais accorde l'autorisation à des « poissonniers aians
bateaulx et bachoirs sur la saonne [...de] retirer leursd. bateaulx au temps du
dangier de glasses »20. Les bateliers formulent cette demande
parce qu'ils souhaitent entreposer leurs embarcations dans les fossés de
la ville ; c'est sans doute la seule raison pour laquelle ils ont besoin de
l'avis du consulat pour retirer leurs bateaux. La suite de l'acte justifie la
nécessité que les bateaux soient sortis de la rivière, car
« silz ne les retiroient serront rompuz ». En effet, la glace «
est un danger pour les bateaux, surtout en bois »21 puisque
ceux-ci pourraient se fendre sous la pression de l'eau gelée. En plus de
cela, la conséquence principale d'un tel évènement, comme
l'explique d'ailleurs Paradin, est l'arrêt provisoire de la navigation,
notamment du transport commercial, ce qui représente une perte
économique importante pour la ville de Lyon.
Outre le danger des glaces, le principal risque, beaucoup
moins anecdotique que le gel pour les personnes vivant à
proximité d'un cours d'eau, est le débordement de celui-ci. Comme
nous l'avons rapidement esquissé, le régime de la Saône
épargne la ville de Lyon de crues et d'inondations fréquentes.
Pourtant, de façon occasionnelle, de tels évènements s'y
produisent. De plus, « la Saône est restée très
dynamique au cours de la période moderne, si bien qu'il a pu lui arriver
d'envahir les habitations »22. En ce qui concerne le
XVIe siècle, aucune crue de la Saône ne semble à
noter23. Pourtant, Laurent Astrade cite l'année
157024 lorsqu'il évoque les différents
débordements connus de cette rivière au cours de l'histoire.
François de Belleforest décrit cet épisode, qu'il
présente uniquement comme une crue du Rhône, et considère
que « si la Saone eut aussi bien espandu furieusement ses ondes que son
voisin le Rhosne, c'est été fait de la plus grande partie de
ceste belle, et magnifique cité de Lyon »25.
19 PARADIN DE CUYSEAULX, Guillaume,
Mémoires de l'histoire de Lyon, Roanne, Editions Horvath, 1973
(1e éd. en 1573), pages 279 et 280.
20 AML, BB 024, f°34, v°, acte consulaire du
7 janvier 1500.
21 MICHEL, La Saône~ op. cit., page
64.
22 AYALA, Grégoire, Lyon, les bateaux de
Saint-Georges : une histoire sauvée des eaux, Lyon, Editions
lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2009, page 81.
23 Laurent Michel, dans La Saône,
fronti4rek op cit., (page 63), recense les crues connues de la Saône
et n'en relève pas entre 1408 et 1602. Par ailleurs, aucune source ne
permet de penser qu'une inondation due à la croissance de la
Saône, eut lieu au XVIe siècle.
24 ASTRADE, Les crues et les inondations de la
Saône", in La Saône, axe* op.cit., page 163.
25 BELLEFOREST, De l'effroyable et merveilleuxe
op. cit., page 4.
Cependant, au sujet de cette crue des 2 et 3 décembre
157026, Nicolas de Nicolay explique, quant à lui, que le
Rhône a tellement débordé qu'il a rejoint la
Saône27, elle-même déjà importante. Il
s'accorde donc ici avec Laurent Astrade. Au début du mois de
décembre, chaque année, la Saône est en effet dans sa phase
croissante. Son cours s'élargit, mais le maximum des hautes eaux pour
cette riviére n'est généralement atteint qu'au mois de
février28. Laurent Astrade précise d'ailleurs que
« les écrits anciens évoquent plus les catastrophes sur le
Rhône que sur la Saône, ou bien, quand celle-ci est
évoquée, il s'agit plutôt d'inondations de Lyon
engendrées par la conjugaison de la montée des deux cours d'eau
»29. L'on peut donc penser que cet épisode de
débordement des eaux de 1570 à Lyon concerne la Saône comme
le Rhône. Néanmoins, le dégât principal qui en
résulte est la destruction partielle du nouveau pont sur le Rhône
alors que celui de la Saône ne semble pas avoir subi de dommages
importants. Cet épisode est avant tout une crue du Rhône d'une
ampleur telle que la Saône s'y est joint.
La conséquence principale de ce type
d'événements est la destruction de structures telles que des
habitations ou, bien sûr, de tous les édifices à
proximité du cours d'eau, particulièrement les ponts. Cependant,
la montée des eaux comporte d'autres risques dont les autorités
au XVIe siècle sont conscientes. En effet, dans un document
produit par le consulat lyonnais au XVIe siècle30,
un article interdit de faire des latrines à proximité des puits
si ceux-ci ne sont pas protégés par un mur de béton. Ce
mur doit être suffisamment haut afin d'être « par-dessus leaux
qui pourroit estre dans led. puys, et a la mesure que leau croist alocasion du
rosne et de la saonne, de telle fasson sera faict led. beton quil puisse
rembarrer la matiere, quil ne puisse gaster le puits de son voysin
»31. Ainsi, le consulat se préoccupe des inondations
pour des raisons sanitaires, qui se justifient d'elles-mêmes. D'ailleurs,
selon Brigitte Rossignol, « dès les premiers signes d'une
épidémie, le consulat s'emploie à dresser un rempart de
protection dans la ville et [...] veille à la propreté
26 Ibid., pages 1-2.
27 NICOLAY, Généralle description~
op. cit., page 50.
28 ASTRADE, « Les crues et les inondations de la
Saône », in La Saône, axe de civilisation, op.cit.,
page 159.
29 Ibid., page 163.
30 La date de ce document n'est pas connue, mais
l'inventaire des AML le décrit comme « un code
de la construction » dans la ville et il est placé
parmi d'autres documents du XVIe siècle.
31 AML, DD 004, pièce 23, article 10.
des rivières, des puits, des fontaines
»32. Ainsi l'eau, et donc les rivières,
représente un risque de propagation des maladies et, encore une fois, un
danger d'un point de vue sanitaire. D'autre part, en 1577, le consulat
s'inquiète de la possibilité que vingt-sept
pestiférés se noient. Ceux-ci sont enfermés dans des
cabanes à Ainay, c'est-à-dire au sud de la presqu'île, afin
de limiter l'épidémie de peste. Mais, les « grandes pluyes
quy continuent journellement » laissent craindre une montée des
eaux des deux fleuves de la ville et les malades, ne pouvant sortir des
cabanes, sont en danger33. Les échevins décident donc
de faire évacuer ces personnes et demandent à Bertrand Castel, le
voyer de la ville, de s'en charger.
Le consulat lyonnais est donc préoccupé par
certains risques qui résultent de la présence d'une
rivière dans la ville. Cependant, les remèdes sont limités
et ces questions ne semblent pas primordiales pour une autorité qui est
responsable, au quotidien plus que dans l'anticipation, de l'administration de
la ville. La population, face à ces aléas climatiques, s'en remet
plutôt à la volonté de Dieu. En effet, les catastrophes
climatiques peuvent être assimilées à des punitions
divines. A ce propos, Nicolas de Nicolay considère que la grande
inondation de 1570 est la manifestation d'un rappel à l'ordre de Dieu
vis-à-vis de ses fidèles. Ainsi, cet auteur, lorsqu'il commente
la crue, trouve qu'il s'agit d'une « chose grandement emerveillable et non
moins epouvantable, que la diversité des réprimendes, qu'il
plaict à Dieu d'envoyer aux mortels, quand le trop d'aise leur faict
oblier le devoir en son endroit »34.
Les processions fluviales, dont l'objectif est l'Ile Barbe, au
nord de la ville, sont révélatrices de cette perception des
catastrophes climatiques comme manifestation divine. En effet, Jacques Rossiaud
décrit les pouvoirs attribués par les Lyonnais,
déjà au Moyen Age, à Notre-Dame de l'Ile Barbe : «
elle commande aux éléments [...] elle détourne la foudre,
obtient de Dieu la pluie, et protege des eaux »35. Elle est
donc considérée comme un recours, auquel on peut demander
protection, et comme un moyen d'intercession avec Dieu. A ce propos, Claude
de
32 ROSSIGNOL, Brigitte, Médecine et
médicaments au XVIe siècle à Lyon, Lyon,
Presses universitaires de Lyon, 1990, page 62.
33 BB 098, f°132 v° et f° 133 r°,
acte consulaire du jeudi 4 juillet 1577.
34 NICOLAY, Généralle description
op. cit., pages 48 et 49.
35 ROSSIAUD, Jacques, « Fleuve et cité,
fête et frontière : la sensa lyonnaise des années
1500 », in BRAVARD, J.-P., COMBIER, J., COMMERCON, N. (dir.),
La Saône, axe de civilisation, Actes du colloque de Mâcon
(2001), Presses universitaires de Lyon, 2002, page 399.
Rubys décrit les « Processions blanches »,
dont le nom fait référence à la couleur des habits des
processionnaires, qui se déroulent en 1504. Celles-ci vont notamment
à l'Ile Barbe, pour demander l'aide de la Vierge car « furent les
rivières, fontaines et ruisseaux, tellement tariz, que les bestes
mouroyent de soif par les champs »36. La sécheresse est
telle qu'elle entraîne une famine et les Lyonnais implorent l'aide de
Notre-Dame de l'Ile-Barbe. D'ailleurs, une sécheresse eut
également lieu durant le printemps et l'été 1556 et, comme
en 1504, « les bonnes gens faisoyent nuict et iour processions blanches
»37. D'autre part, « d'identiques mobiles fondent les
Rogations : les craintes de l'eau, du feu et de la terre »38.
En effet, la fête des Rogations, qui consiste en des «
prières faites avec processions, pendant les trois jours qui
précédent l'Ascension »39, est la demande
à Dieu d'être préservé de toutes les catastrophes,
entre autres de la sécheresse ou du débordement des eaux.
La rivière de Saône peut donc représenter
un danger pour la ville de Lyon, à la fois pour ses habitants mais aussi
pour ses constructions. Cependant, les risques, d'un point de vue climatique,
que sa présence engendre sont ponctuels et assez rares. En effet, au
cours du XVIe, deux évènements notables sont à
recenser : la Saône gelée en 1500 et la crue de 1570, conjugaison
du débordement des deux fleuves de Lyon. Les sécheresses sont
à distinguer car la Saône, dont le niveau d'eau fut probablement
trés bas en 1504 et 1556, peut alors faire office de réserve
d'eau de dernier recours. D'ailleurs, en 1556, on vient « amener le
bestail à grands troupeaux, abbrever au Rhone, et en la Saone
»40. La population lyonnaise, face à ce types
d'épisodes, semble s'en remettre à la volonté de Dieu. Le
consulat, quant à lui, n'est pas préparé à de tels
événements, ni les infrastructures qu'il a
réalisées car en 1570, le pont du Rhône, tout juste
reconstruit en pierre, est emporté par la crue. Enfin cette
autorité semble surtout préoccupée par les
conséquences sanitaires d'un débordement des rivières,
assimilant l'eau à un élément de propagation des
maladies.
36 RUBYS, Histoire véritable..., op.
cit., page 354.
37 PARADIN, Mémoires..., op. cit.,
page 357.
38 GUILLERME, André, Les temps de
l'eau ; la cité, l'eau et les techniques, Seyssel (Ain),
Champ Vallon, 1983, page 28.
39 Société de Savants et de Gens de
Lettres, La Grande Encyclopédie, inventaire raisonné
des
sciences, des lettres et des arts, Tome 28, Paris,
Société anonyme de la Grande Encyclopédie, sans date, page
812, article Rogations.
40 PARADIN, Mémoires..., op. cit.,
page 357.
C. Pollution de l'eau et risques sanitaires
Lorsque l'on évoque l'hygiène dans les villes
durant le Moyen-Age ou l'époque moderne, la saleté des rues est
une caractéristique qu'on leur appose facilement. Pourtant, « on
doit sans doute abandonner l'idée d'une cité
médiévale livrée aux puanteurs des cloaques et parcourue
de cours d'eau charriant immondices et déchets des activités
industrielles »41. En effet, selon les historiens Patrick
Boucheron, Denis Menjot et Marc Boone, dès le XIIIe
siècle, des mesures ont été prises dans les villes
d'Europe afin d'éloigner les sources de déchets, telles que les
tanneries et les boucheries, des centres urbains et de les placer en aval des
rivières. Ces auteurs admettent qu'« il est possible, toutefois,
que ces hydrosystèmes urbains se soient dégradés à
la fin du Moyen-Age, nécessitant la reprise d'une législation
répressive des villes, mais aussi la mise en oeuvre de nouveaux
chantiers de l'eau »42. Nous allons nous pencher sur ces
questions de pollution de l'eau des rivières, ici la Saône, dans
le cadre de la ville de Lyon.
Les historiens qui s'intéressent à la
région de Lyon s'accordent à décrire la Saône,
à la période moderne, comme très polluée. Par
exemple, André Latreille évoque « l'infection
»43 de la rivière qui résulte des nombreux
déchets qui y sont jetés. Ces déchets qui polluent la
Saône, sont variés : « défroques d'animaux
jetées par les bouchers, effluents de teinturerie et de tannerie, outre
forces vidanges. Dès le XVIIe siècle, les
médecins s'interrogent devant les pointes de mortalité
»44. Brigitte Rossignol, qui décrit elle aussi la
saleté de la rivière, considère que dès le
XVIe siècle, des médecins, tels qu'Ambroise
Paré, sont conscients de ces questions d'hygiène et tentent d'y
remédier45. Hormis cette question de l'intérêt
médical porté aux questions d'hygiène, les historiens sont
unanimes : la Saône sous l'Ancien Régime est une rivière
polluée par les nombreux déchets qui y sont rejetés.
41 BOUCHERON, Patrick, MENJOT, Denis, BOONE, Marc,
"La ville médiévale" in PINOL, Jean-Luc (dir.),
Histoire de l'Europe urbaine, de l'Antiquité au XVIIIe
siècle, Tome 1 (pages 287 à 582), Paris, Editions du Seuil,
Collection L'Univers historique, 2003, page 552.
42 Ibid., page 552.
43 LATREILLE, André (dir.), Portrait de la
France moderne, Histoire de Lyon et du Lyonnais, volume 1, Milan,
éditions Famot, 1976, page 180.
44 BAYARD, Françoise, CAYEZ, Pierre, PELLETIER,
André, ROSSIAUD, Jacques, Histoire de Lyon des origines à nos
fours, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2007, page 383.
45 ROSSIGNOL, Médecine et
médicaments~ op. cit., page 58.
Ce postulat est d'ailleurs confirmé par les
études archéologiques, en amont de Lyon mais aussi dans la ville
elle-même. Une campagne de fouilles dans la ville de
Chalon-sur-Saône a mis au jour ce que Louis Bonnamour nomme « un
dépotoir urbain de la fin du XVIe siècle
»46. Il s'agit d'une fosse naturelle dans la riviére oi
ont été retrouvés de nombreux objets ainsi que des
déchets végétaux ou encore de tannerie. Ainsi, la
Saône, en amont de Lyon est déjà un réservoir de
détritus quotidiens. De plus, les fouilles préventives,
réalisées au début des années 2000, dans le
quartier Saint-Georges de Lyon, ont confirmé qu'à l'époque
moderne, « la riviére semble avoir été un facteur
d'assainissement, car la berge a servi de dépotoir à des
déchets en tout genre »47.
Ainsi, la rivière de Saône était, en
quelque sorte, le déversoir des détritus pour la population
lyonnaise. Au quotidien au XVIe siècle, les déchets,
notamment ceux qui résultent du travail des artisans et des industries y
sont jetés. Les fouilles qui mettent au jour ces rejets permettent
d'ailleurs de compléter les informations fournies par les documents. Par
exemple, le quartier « Saint-Georges se concentre sur la boucherie, ce que
les trés nombreux restes d'animaux retrouvés dans le cours de la
Saône ont permis de confirmer »48. Il est
intéressant de constater que dans le cas de ces déchets de
boucherie, donc des restes d'animaux, ils se concentrent en aval de la
Saône car le quartier Saint-Georges est à
l'extrémité sud de la ville. Cependant, d'autres boucheries
existent plus au nord49 et l'on peut supposer que leurs
déchets sont également jetés dans la rivière.
D'aprés les travaux de Brigitte Rossignol, des la fin
du XVe siècle, le consulat prend des décisions au
sujet de la salubrité des rues. En effet, selon un document de 1496-1497
que cet auteur a transcrit, le consulat préconise de ne pas laisser de
fumier dans les rues mais de « porter le tout en Saône
»50. Ainsi, la conséquence directe d'une telle mesure
d'hygiéne est la pollution de la riviére. D'ailleurs le consulat
encourage les professionnels à y jeter leurs déchets afin qu'ils
ne soient pas entassés dans les rues. Par exemple, un acte consulaire de
1566,
46 BONNAMOUR, Louis, Archéologie de la
Saône, Paris, co-édition Editions Errance et ville de
Chalon-sur-Saône, 2000, page 103.
47 AYALA, Lyon, les bateaux« op cit.,
page 81
48 AYALA, Lyon, les bateaux« op cit.,
page 30
49 C'est le cas, par exemple, de la boucherie
Saint-Paul qui se trouve dans le quartier du même nom, au nord de la
ville sur la rive droite de la Saône.
50 AML, CC 531, 1496-1497, cité dans
ROSSIGNOL, Médecine et médicaments~ op. cit., page
59.
adressé « aux taneurs et aultres » leur
conseille de stocker chaque jour leurs détritus puis de les «
porter le nuict suyvant dans lad. riviere ou bien faire faire des conduictz
» c'est-à-dire, en quelque sorte, des égouts pour que «
leurs eaues et immondices » atteignent directement la
Saône51. En effet, comme les tanneries ont un usage important
d'eau, ces établissements sont à proximité des
rivières et peuvent facilement y déverser leurs déchets,
dont l'essentiel est de l'eau souillée, par le biais de simples
canalisations. Il semble d'ailleurs, qu'il est courant, et pas seulement pour
les artisans, que les Lyonnais jettent leurs déchets dans les rues ou
dans la Saône.
Plusieurs rois de France, au cours du XVIe
siècle, interviennent directement dans la question des déchets
jetés par les habitants de la ville de Lyon. En effet, de nombreuses
lettres royales, de 1509 à 1561, évoquent ce sujet et
déplorent la situation. Dans une lettre patente du 16 août 1509,
Louis XII explique que des individus possédant des maisons au bord de la
Saône ont construit des auvents ou des galeries en saillie, probablement
aux fenêtres de leurs maisons, et qu'ils « jettent immondices par
iceulx tellement que ceux qui vont et viennent par lad. ville et sur lad.
riviere [...] en ont plusieurs ennuys et puanteur »52. Plus
loin dans le document, sont précisées les conséquences de
ces gestes ; il est mentionné que cela « peult estre cause tant de
l'infection du poisson que de ceulx qui passent [...] s'en sont ensuivy
plusieurs maux et maladies ». Le principal problème
évoqué par ce document est le risque sanitaire
entraîné par ces comportements. En effet, il est
évoqué l'intoxication d'individus soit directement par un contact
avec ces déchets soit, probablement, par l'intermédiaire de
l'ingestion d'un poisson impropre à la consommation.
Afin de lutter contre ces désagréments, Louis
XII ordonne la destruction de ces saillies à Denis Richeran,
châtelain de Saint-Symphorien-le-Château qui commence les
démolitions53. L'archevêque et les chanoines-comtes de
Lyon s'y opposent car ils considèrent que c'est à eux qu' «
appartiennent touttes et chacunes les crues, fourgetz et augmentations des
maisons [...] aboutissans et confinans sus
51 AML, BB 086, f°98 v°, acte consulaire du
mardi 17 décembre 1566.
52 AML, DD 003, pièce 30.
53 VIAL, Eugène, "Les voyers de la ville de
Lyon", in Revue d'Histoire de Lyon, Tome 10, année 1911, Lyon,
A. Rey et Compagnie (imprimeurs-éditeurs), 1911, page 182, note n°
3.
et a la riviere de Saone »54. Cependant le roi
maintient sa décision en précisant qu'il n'entend «
aucunement prejudicier aux droits seigneuriaux »55. Une seconde
lettre royale du 3 septembre 151056, adressée au
sénéchal de Lyon, réitère donc l'ordre de
détruire les galeries en saillie. Il semble que cela soit inefficace
puisque Louis XII à nouveau57 , puis Henri II58 et
Charles IX59 réaffirment, à plusieurs reprises, la
nécessité de démolir les saillies des bâtiments.
Systématiquement, l'objectif principal de ces interventions est de
lutter contre cette habitude des Lyonnais de jeter les déchets «
par le haut de leurs maisons »60. L'insistance des rois de
France, surtout pendant la première moitié du XVIe
siècle, s'explique probablement par la présence
régulière de la cour à Lyon, dans le contexte des Guerres
d'Italie. En effet, ce types de préoccupations et de décisions
relèvent plutôt du pouvoir local, donc du consulat, que de
l'autorité royale. Cependant, les rois prennent des mesures similaires
pour la ville de Paris. En effet, en novembre 1539, une ordonnance royale
traite de l'entretien des rues de la capitale61. D'autre part,
Charles IX est à l'origine d'une décision similaire à
celles qui concernent le ville de Lyon puisqu'en 1564, il promulgue un
édit qui ordonne la destruction des galeries en saillie des maisons de
Paris62.
En ce qui concerne la ville de Lyon, dès Louis XII, la
responsabilité du consulat dans ces questions de voirie et
d'hygiène est évoquée. En effet, le roi considère
que « nos tres chers et bien amez les Conseillers de nostred. ville et
cité de lyon ont et doivent avoir plus que nuls autre le soing et cure
de garder les places publiques [...] aussi afin que les cours et navigage
d'icelle riviere ne soit en aucune manière empesché
»63. Plusieurs lettres royales confirment qu'il est du
rôle du consulat d'appliquer la décision de 1509 mais celles-ci
sont adressées à des
54 ADR, 10 G 860, document 15, confrontation au palais
de Roanne du 9 octobre 1509.
55 ADR, 10 G 860, document 15, 9 octobre 1509.
56 AML, DD 003, pièce 33.
57 AML, DD 003, pièce 34.
58 Par exemple, AML, DD 004, pièce 6.
59 AML, DD 004, pièce 21.
60 AML, DD 004, pièce 16. Texte royal du 25
novembre 1556 au sujet des galeries en saillie.
61 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,
Recueil général des anciennes lois françaises depuis
l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789, tomes IX à XV
(1438-1610), Ridgewood (New Jersey, U.S.A.), The Gregg Press Incorporated,
1964, ordonnance de novembre 1539.
62 Ibid., édit du 29 décembre
1564.
63 AML, DD 004, pièce 7, document 2, lettre du
1er avril 1511 au sujet des galeries en saillies à
détruire.
représentants du roi, comme le sénéchal
de Lyon64, chargés ensuite d'informer la municipalité.
Il n'y a aucune raison que les requêtes des rois n'aient pas
été relayées par ses représentants. Ainsi, il
semble surprenant que le consulat n'ait pas appliqué, ou pas avant la
fin du siècle, l'ordre de démolition des galeries en saillie.
Les sources consultées ne permettent pas de
déterminer si celui-ci a entamé la destruction des auvents
dès le début du siècle. Selon Anne Montenach, dès
1515, la municipalité avait nommé deux commis pour « veoir
et visiter les bancz et chevilles des bochiers qui sont par trop avancés
sur les rues publicques »65. Il s'agit, d'après cette
historienne, d'une tentative pour limiter les saillies, mais ce type d'essai
semble limité puisque les rois de France doivent renouveler leur
volonté au cours du siècle. Cependant, lorsqu'il s'agit des
avancées de maisons sur la rivière, le consulat semble beaucoup
moins préoccupé et réfractaire à leur
présence. En effet, en 1556, il autorise un lyonnais, Michel Cusyn,
à reconstruire une maison sur une pile au bord de la rivière
ainsi qu'à avancer celle-ci sur la Saône tant qu'elle reste dans
l'alignement des autres maisons qui ont les pieds dans l'eau66. Le
consulat ne prend donc pas en compte les risques qui découlent de la
pollution de l'eau de la rivière.
Toutes les galeries en saillies ne sont pas détruites
par le consulat lyonnais au cours du XVIe siècle puisque leur
présence constitue toujours une gêne au siècle suivant
lorsque le pouvoir municipal tente de pratiquer une politique d'alignement des
différentes habitations et édifices de la ville. Cependant, il
semble que le consulat ait tenté d'appliquer la volonté royale de
démolition de ces auvents et autres avancées par lesquels sont
jetés des déchets, probablement surtout lorsque ceux-ci
représentent une gêne pour la circulation. Il a pu rencontrer des
obstacles tels que l'opposition de propriétaires. Néanmoins, la
municipalité semble plus préoccupée par ce problème
lorsqu'il s'agit de la circulation dans les rues plutôt que sur la
Saône. En effet, le consulat incite les individus à jeter leurs
déchets dans la rivière, notamment les rejets des tanneries. La
Saône est probablement supposée emporter les déchets hors
de la ville mais la faiblesse du courant laisse sans doute
64 Par exemple, AML, DD 004, pièce 21, lettre
royale du 4 août 1561adressée au sénéchal de Lyon
mais qui autorise le consulat à démolir les saillies.
65 AML, BB 034, 8 janvier 1515, cité dans
MONTENACH, Espaces et pratiques..., op. cit., page 134.
66 AML, BB 078, f° 150 r°, jeudi 5 mars
1556.
une partie de ceux-ci stagner et tomber au fond de la
rivière. Cela expliquerait, au moins en partie, l'importante pollution
de la Saône dans la ville.
Conclusion chapitre III
La perception d'une rivière, dans son caractère
naturel, comporte plusieurs aspects. En effet, il s'agit de distinguer la
vision quotidienne du cours d'eau et les accidents climatiques. La Saône
à Lyon est perçue comme une rivière calme et paisible,
souvent présentée sous les traits d'une femme. Cependant, elle
est soumise aux fluctuations climatiques et peut changer de caractère.
Lors de ces épisodes exceptionnels, ou dans le but de les
prévenir, la population s'en remet à la volonté divine et
lui demande d'être préservée. Parmi les
évènements possibles, les inondations et les crues semblent
représenter le risque principal, à l'échelle d'une ville,
puisque elles peuvent avoir des conséquences destructrices. Le consulat
s'inquiète surtout de la montée des eaux pour des raisons
sanitaires, notamment la propagation des maladies. A l'inverse, les habitants
de la ville, d'ailleurs encouragés par le consulat, déversent de
nombreux déchets dans la rivière ; comme celle-ci se
déplace elle est peut-être assimilée à un flux
assainissant. Pourtant, les risques de pollution de l'eau semblent, au moins
partiellement, connus puisque les rois de France accusent ces déchets
d'être responsables de maladies et de l'empoisonnement des poissons de la
rivière. En cela, la pollution de la Saône pourrait
représenter une gêne dans les activités fluviales des
riverains.
Chapitre IV : Navigation et activités fluviales
Il s'agit ici de s'intéresser aux activités qui
se déroulent sur la rivière de Saône dans la ville de Lyon
au XVIe siècle c'est-à-dire aux loisirs, aux jeux,
mais également à l'un des principaux usages de cette
rivière : la navigation. Nous analyserons l'importance de celle-ci et,
plus largement, l'importance de la fréquentation de la rivière de
Saône. En plus de présenter ces activités, nous nous
pencherons sur l'administration politique de celles-ci c'est-à-dire aux
prérogatives et à l'implication des autorités dans ces
activités, lorsqu'il y en a une. Pour cela, nous nous
intéresserons d'abord aux usages de cette rivière dans le cadre
de la ville de Lyon, puis aux modalités de navigation sur la Saône
et, enfin, aux enjeux de la présence d'un axe de communication dans la
ville ainsi qu'à la prise en charge et au contrôle politique qui
en découlent.
A. « Esbat et recreation »1 sur la
Saône
Le plan scénographique de la ville de Lyon,
réalisé entre 1548 et 1553, est la principale source
iconographique dont nous disposons au sujet des activités et des loisirs
effectués par les contemporains. C'est d'ailleurs l'une des principales
caractéristiques de ce plan, d'une grande richesse par toutes les
informations qu'il fournit à propos de la vie quotidienne à Lyon
au XVIe siècle. En effet, de nombreuses scènes de vie
sont représentées à travers toute la ville et notamment
aux abords, ainsi que sur, la rivière de Saône. Ce plan nous
montre que la fréquentation de la Saône est importante puisque
beaucoup de personnes sont figurées sur les quais de cette
rivière mais aussi dans des barques ou même se baignant. De plus,
les activités qui sont décrites sont très variées
et révèlent la familiarité de la rivière pour les
Lyonnais de l'époque.
Nous adopterons ici une vision statique de la Saône
c'est-à-dire que nous percevrons cette rivière comme un espace de
la ville de Lyon dans lequel des acteurs vaquent à leurs occupations, en
laissant l'idée de navigation (donc de rivière comme axe de
communication) pour la section suivante. En effet, « il existe une
occupation humaine multi-fonctionnelle du fleuve ou de la rivière comme
il existe une occupation tout aussi diversifiée du sol
»2 ; c'est ce point de vue qui est abordé dans cette
section et qui restreint donc l'analyse à la ville de Lyon en
elle-même puisque la Saône n'est pas perçue ici comme un
vecteur mais comme un lieu à part entière. Les
représentations du plan scénographique et les descriptions
fournies par Claude de Rubys dans son Histoire de Lyon constitueront les fils
conducteurs de notre présentation.
1 Citation extraite d'une lettre patente de Louis
XII du 16 août 1509, dans laquelle sont évoqués « ceux
qui vont et viennent par lad. rivière pour prendre esbat et recreation
». AML, DD 003, pièce 3.
2 RIETH, Eric, Des bateaux et des fleuves,
Archéologie de la batellerie du Néolitique aux Temps modernes en
France, Paris, Editions Errance, collection des Hespóides, 1998,
page 16.
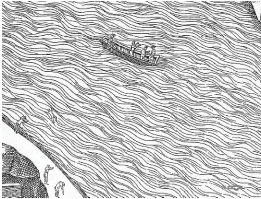
Claude de Rubys explique qu'à Lyon « l'on faict
souvent durant l'esté des esbattements sur la riviere de Saosne
»3. Le plan scénographique de Lyon nous montre justement
des activités quotidiennes plutôt estivales telles que la
baignade ou encore la promenade en bateau. L'extrait d'une
reproduction du plan
scénographique, figuré ci-dessus4,
représente ce type de loisirs nautiques. Ici, les
personnages se baignent ou naviguent sur la Saône à
proximité de Vaise c'est-à-dire
au nord de la ville de Lyon. La rivière de Saône
permet donc ce type de loisirs,
puisque le plan scénographique ne présente pas des
activités exceptionnelles mais,
au contraire, des faits quotidiens. La Saône est
également un espace dans lequel se
déroulent des jeux collectifs organisés.
Claude de Rubys présente d'ailleurs deux types de jeux
nautiques. Tout d'abord, il évoque « les joustes que font
d'ordinaire les Dimanches et jours de festes, devant le logis de Lieutenant du
Roy, les bateliers des ports de Saint-Georges et de Saint-Vincent, armez de
lances et de pavoys, allants de telle roideur et de telle vistesse sur leurs
bateaux, et s'entrerencontrants avec leurs lances tendues les ungs contre les
auttres, que le plus roide fait tresbucher le plus foible tout chaussé
et vestu dans la riviere »5. Ces joutes nautiques se
déroulent en présence d'un public puisque la chute dans l'eau
d'un jouteur est accompagnée de la « grand risée de ceux qui
les voyent »6. Claude de Rubys décrit également
un type de course sur la Saône, qui remplace certains jours les joutes.
Il explique que les concurrents « attachent une corde traversant la
riviere de bord en bord, au milieu de laquelle ils attachent une Oye suspendue
par les pieds : puis à course de bateau ils se vont attacher au col de
l'Oye : auquel ils demeurent le plus souvent pendus,
3 RUBYS, Claude de, Histoire véritable de
la ville de Lyon, Lyon, imprimeur Bonaventure Nugo, 1604, Chapitre X, page
501.
4 CHAMPDOR, Albert (introduction), Plan
scénographique de la ville de Lyon au XVIe
siècle, Trévoux, Editions de Trévoux, 1981, extrait
de la planche XXIV.
5 RUBYS, Histoire véritable«~ op.
cit., page 501.
6 Ibid., page 501.
leurs bateaux s'en allant à val l'eau
»7. Ces moments festifs sont accompagnés de musique et
l'on peut penser que les spectateurs sont nombreux sur les rives de la
rivière. La Saône est donc au centre de ces jeux qui sont porteurs
de cohésion au sein de la population lyonnaise.
D'autre part, la rivière tient une place importante
dans le déroulement de fêtes plus institutionnalisées et
régulières comme les célébrations liées
à l'Ascension, dont la procession sur la Saône a
déjà été évoquée8 pour son
caractère politique. En effet, une autre procession fluviale dans le
cadre d'une célébration à caractère religieux est
présentée par Jean-Baptiste Roch. Selon lui, « le 2 juin de
chaque année était célébrée cette fête
à la fois religieuse et profane dont l'origine remontait au martyre
chrétien de 177 »9. Il évoque ici le supplice
connu de Saint Pothin et de Sainte Blandine et de leurs compagnons à
l'époque de l'Empire romain. Ce martyre, qui s'est déroulé
à Lyon, est un épisode fondateur de la piété
populaire lyonnaise. Il explique qu'en hommage à ce martyre, chaque
année, « une procession, bannières en tête, partait,
dans des bateaux, de l'Ile Barbe, descendait jusqu'à Ainay puis se
disloquait »10. Cette procession naît donc au nord de
Lyon et traverse la ville en empruntant la Saône jusqu'à la
confluence, au sud de la ville.
De plus, le XVIe siècle est ponctué
d'entrées officielles de personnages importants qui sont l'occasion de
fêtes souvent somptueuses. D'ailleurs, leur récurrence et leur
faste sont tels que le XVIe siècle est qualifié de
« Siècle des Entrées »11 par l'historien
André Latreille. Certains rois de France, lorsqu'ils arrivent du nord,
font leur entrée solennelle par la rivière de Saône, en
bateau. L'entrée de Charles IX, au début du mois de juin 1564, se
déroule ainsi ; le roi passe la nuit à l'abbaye de l'Ile
Barbe12, au nord de Lyon, puis entre dans la ville en bateau.
Régulièrement en ces occasions, ou durant les jours qui suivent
l'entrée proprement dite, des spectacles nautiques sont
organisés. Par exemple, en 1548, en l'honneur du roi Henri II et de son
épouse est organisée une « bataille navale au
7 Ibid., page 501.
8 Cf Chapitre II, A.
9 ROCH, Jean-Baptiste, Histoire des Ponts de Lyon
de l'époque gallo-romaine à nos fours, Lyon, Editions
Horvath, 1983, page 43.
10 Ibid., page 43.
11 LATREILLE, André (dir.), Portrait de la
France moderne, Histoire de Lyon et du Lyonnais, volume 1, Milan,
éditions Famot, 1976, page 183.
12 PARADIN DE CUYSEAULX, Guillaume,
Mémoires de l'histoire de Lyon, Roanne, Editions Horvath, 1973
(1e éd. en 1573), pages 378-379.
devant du logis du Roy et deulx grandes galleres l'une aux
coulleurs du Roy l'aultre aux coulleurs de la Royne accompagnées
chacunes de trois ou quatre aultres petites [...] et en approchant commensa
l'assaut à grands coups de canons et harquebuzerye »13.
La cour assiste à ce spectacle « dedans un grand basteau faict en
maniere d'un palais [...] et apres led. passetemps qui durat jusques au soir
[...] le grand pallais
susd. et toute la grand flotte des basteaux
montèrent jusques à l'Observance oil ils soupparent et appres
s'enrevindrent par eau à torches »14. Le trajet qui suit
le spectacle part du « logis du Roy » donc sans doute du palais de
Roanne, qui est situé au bord de la Saône, en amont de la
cathédrale Saint-Jean c'est-à-dire au coeur de la ville, et
s'acheve à l'Observance donc au nord de Lyon, entre Pierre-Scize et
Vaise. Le retour est aussi effectué par bateaux, de nuit, comme
l'indique la fin de la citation. La Saône est ici le support de la
cérémonie comme c'est régulierement le cas pour d'autres
festivités qu'il n'est pas nécessaire de développer
ici.
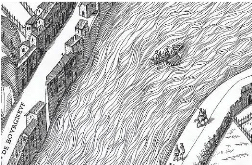
Enfin, une autre activité est représentée
sur le plan scénographique : la pêche. Sur l'extrait de ce plan
(ci-contre)15, des pêcheurs sont figurés dans une
barque sur la Saône, tenant une nasse pour attraper des poissons.
La rivière de Saône offre une
diversité d'espèces de
poissons assez importante. En effet, les pêcheurs
lyonnais pouvaient y trouver, par exemple, des brochets, des chevaines, des
sandres, des carpes, des tanches ou encore des goujons16. De plus,
elle fournit également des écrevisses. La pêche est
importante dans une société où l'on consomme
régulierement du poisson notamment en application de recommandations
religieuses. Il faut cependant préciser que, comme l'a montré
13 GUERAUD, J., Mémoires.[1536-1562],
Lyon, 1929, in GARDES, Gilbert, Le voyage de Lyon, Lyon,
Editions Horvath, 1993, page 185.
14 Ibid., page 185.
15 CHAMPDOR, Plan scénographique~ op
cit., extrait de la planche XIX.
16 MICHEL, Laurent, La Saône,
frontière et trait d'union ; son histoire, ses riverains, son
cours, Saint-Etienne, Editions Horvath, sans date, pages 65-66.
Anne Montenach, l'approvisionnement de la ville en poissons
dépasse largement le cadre de la Saône puisque le consulat, ou des
pêcheurs à leur compte, font venir ce type de denrées de la
Méditerranée ou des étangs et lacs qui s'étendent
au nord de Lyon (de la Bresse jusqu'à l'actuelle Suisse)17.
Ainsi, la pêche dépasse le cadre des loisirs et des
cérémonies présentés précédemment
puisqu'il s'agit, en général, d'une activité
commerciale.
La pêche est règlementée par les rois de
France. Le principal document à ce sujet, pour la période qui
nous concerne, est la décision royale de mars 1516, déjà
évoquée18, qui vise à limiter la pêche
dans les cours d'eau, étangs et lacs du royaume afin de lutter contre
leur dépeuplement. Malgré cela, la situation ne semble pas
particulièrement s'améliorer au cours du siècle puisque
l'ordonnance des Eaux et Forêts promulguée par Henri IV en mai
1597 explique que les pêcheurs utilisent encore du matériel trop
performant, d'ailleurs prohibé par François Ier en 1516. Selon ce
document, ils pêchent « en dépeuplant nosdites eaux, fleuves,
rivières, estangs et causent en ce faisant la cherté d'iceux
[poissons]»19. Henri IV confirme ici les mesures prises par
François Ier ; celles-ci nécessitaient donc d'être
rappelées.
Les droits de pêche à Lyon sont assez
compliqués à définir car les sources à ce propos
sont pauvres. L'archevêque et les chanoines-comtes de Lyon, en tant que
seigneurs de la Saône devraient en disposer. En 1561, le chapitre
Saint-Jean prend d'ailleurs part à un procès entre des
pêcheurs. Il est question de la pêche des aloses (poissons de mer
qui remontent les rivières durant le printemps et l'été)
« derrière les maisons de l'archeveché, de la sacristie, de
la custoderie et de maître Etienne "20. Les pêcheurs
Pierre Joly, Claude Faure « et consorts " sont opposés aux «
consorts Bidaut " et le chapitre, dans ce document, décide de soutenir
les premiers. En effet, il est expliqué que ceux-ci « ont coutume
de pescher par autorité et permission du chapitre " et donc que les
seconds ont pêché en ces lieux sans autorisation des
chanoines-comtes. La résolution de l'affaire nous est inconnue mais ce
document montre que le chapitre Saint-Jean confère des « permis
de
17 MONTENACH, Anne, Espaces et pratiques du
commerce alimentaire à Lyon au XVIIe siècle, Grenoble,
Presses universitaires de Grenoble, Collection "La Pierre et l'Ecrit", 2009,
page 165.
18 Cf Chapitre I, C.
19 ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER,
Recueil général des anciennes lois françaises depuis
l'an 420 jusqu'à la révolution de 1789, Tomes IX à XV
(1438-1610), Ridgewood (New Jersey, U.S.A.), The Gregg Press Incorporated,
1964, ordonnance de mai 1597.
20 ADR, 10 G 58, f°212.
pêche » au moins pour une partie des eaux de la
Saône. Cependant, le consulat semble lui aussi disposer de
prérogatives sur ce type de questions puisque qu'il décide, en
1555, de l'établissement d'une pêcherie d'aloses en face du
couvent de l'Observance21, en dépit de l'opposition de
l'archevêque et des chanoines-comtes de Lyon. Il semble donc qu'une
pêcherie soit installée, par le consulat, sur la rive droite de la
Saône, au nord de la ville. La pêche à Lyon ne semble par
être l'objet d'une définition juridictionnelle précise. Les
droits sur cette activité relèvent, par définition, des
seigneurs dont l'autorité s'exerce sur la Saône,
c'est-à-dire l'archevêque et le chapitre Saint-Jean. Mais le
consulat, dont le pouvoir s'affirme depuis la fin du Moyen Age, semble disposer
ou s'approprier certaines prérogatives dans ce domaine.
Les loisirs nautiques sont nombreux et variés sur la
Saône à Lyon, et même sur les berges de la rivière,
lieu de promenade, comme le montre particulièrement le plan
scénographique de la ville, qui dresse un portrait de celle-ci au milieu
du XVIe siècle. Une activité se distingue des autres
par son caractère généralement professionnel, même
si l'on peut considérer que c'est également un loisir : la
pêche. Il semble d'ailleurs qu'il s'agit du seul usage
réglementé parmi ceux qui ont été
présentés, à la fois à l'échelle du royaume
mais aussi surveillé dans le cadre de la ville de Lyon. Les
différentes activités des riverains de la Saône,
présentées d'une point de vue statique, impliquent
évidemment des déplacements sur la rivière. La navigation,
aspect essentiel dans la présentation des usages d'un cours d'eau,
constitue l'objet d'étude de la suite de notre analyse.
21 AML, BB 078, f°32 r°, acte consulaire du
mardi 17 septembre 1555.
B. La Saône, un axe de circulation
Le secrétaire de l'ambassadeur vénitien
Jérôme Lippomano, lors de son passage à Lyon en 1577,
décrit ainsi les cours d'eau de la ville : « La Saône et le
Rhône, qui la traversent et s'y joignent, lui apportent les marchandises
de l'Angleterre, de la Flandre, de l'Allemagne et de la Suisse, qui de
là sont transportées à dos de mulet en Savoie ; ou bien
par le Rhône, elles vont jusqu'à la mer »22. Cette
citation nous rappelle clairement l'importance des cours d'eau pour la ville de
Lyon dont la position géographique est en effet un atout commercial et
stratégique. La Saône fait partie de ce « milieu fluvial dont
la fonction première est celle d'axe de communication et
d'échanges»23. Nous allons nous pencher sur les
modalités de la navigation sur la Saône, notamment sur les bateaux
et les acteurs.
Il faut rappeler, au préalable, que cette
rivière navigable peut présenter des difficultés pour les
bateliers même si elle est toujours présentée comme calme.
En effet, « jusque dans la première moitié du
XIXe siècle, en l'absence de tout aménagement, la
Saône était une rivière difficile à naviguer, voire
même dangereuse »24. Les arguments d'une telle
affirmation sont surtout la présence d'obstacles dans le cours de la
rivière ainsi que le faible débit de la Saône qui limite
les périodes de navigations en amont de la ville de Verdun. Ce dernier
point ne concerne donc pas directement la ville de Lyon même si la
soumission au cours variable de la rivière rend « quelquefois les
frais d'un voyage d'un des Ports de Bourgogne à Lyon, du double ou du
triple plus cher que dans un autre temps »25.
En ce qui concerne les obstacles à la navigation
saônienne à Lyon, ils sont limités par la lettre patente du
21 avril 150326, qui est à propos de la Saône et du
Rhône. En effet, Louis XII décide qu'il faut « oster desdites
rivieres les escluses,
22 Citation de Voyage de Jérôme
Lippomano, ambassadeur de Venise en France en 1577, tirée de
GOULEMOT, Jean M., LIDSKY, Paul, MASSEAU Didier, Le voyage en France,
anthologie des voyageurs européens en France, du Moyen Age à la
fin de l'Empire, Paris, Robert Laffont, Collection Bouquins, 1995, page
124.
23 RIETH, Des bateaux et des fleuves~ op.
cit., page 8.
24Bateaux de Saône, mariniers d'hier et
d'aujourd'hui, Chalon-sur-Saône, Société d'Histoire et
d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, page 22.
25 Ibid., page 22, Citation de P.-J.
Antoine, sous-ingénieur des Etats de Bourgogne en 1774.
26 AML, CC 4047, pièce 4, (déjà
évoquée dans le chapitre II, B, au sujet de l'abolition des
péages sur la Saône).
pescheries, nassiers, molins, bennes, combres et autres choses
empeschans le cours
d'icelles rivieres, et passages de barques, ou basteaux
»27. Il existe néanmoins au
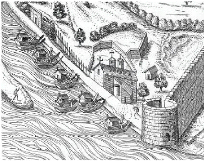
XVIe siècle des moulins à nef sur le
Rhône. Ceux-ci sont « constitués de deux
bateaux entre lesquels était installée la
roue à aubes, ils étaient amarrés aux
rives ou aux piles de ponts »28. Les
moulins à nef représentés sur le plan
scénographique sont très nombreux (une
partie est figurée ci-contre29 à
proximité
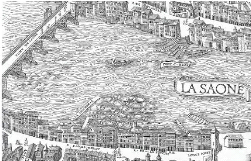
du rempart Saint-Sébastien, plus
précisément du bastion Saint-Clair) mais seulement sur le
Rhône. La Saône, quant à elle, en est dépourvue, au
moins dans le cadre de la ville de Lyon. Par contre, il existe sur la
Saône une « pescherie » qui est le principal marché aux
poissons de la ville. Celui-ci est représentée sur l'image
cicontre30. De plus, une seconde pêcherie est établie
en face du couvent de l'Observance en 155531.
Cependant, celles-ci ne semblent pas constituer la gêne
principale à la navigation sur la Saône. En effet, la principale
difficulté pour les bateliers semble être le pont de Saône
car il « formait un barrage contre lequel le courant venait se heurter
obliquement et la navigation était difficile, surtout du
côté de la rive gauche, qu'on appelait « gouffre de la mort
qui trompe », la faible largeur, 6 mètres environ, ne pouvant
suffire à la circulation très active »32. Sur
l'image de la page précédente, dans laquelle le pont est
figuré, l'on peut penser que le danger de ce passage est
27 PARADIN DE CUYSEAULX, Guillaume,
Mémoires de l'histoire de Lyon, Roanne, Editions Horvath, 1973
(1e éd. en 1573), page 281.
28 MICHEL, La Saône, fronti4re~ op. cit.,
page 57.
29 CHAMPDOR, Plan scénographique op., cit,
extrait de la planche XVI.
30 Ibid., extrait de la planche XIII.
31 Cf Chapitre III, A.
32 ROCH, Histoire des Ponts de Lyon op cit.,
page 43.
représenté par l'amplification tres nette des
vagues, justement vers la rive gauche de la rivière. Le péril
réside surtout dans l'étroitesse de passage entre « des
piles formant de larges empattements qui obstruaient la rivière
»33. Les couloirs de circulation sont si étroits que le
moindre obstacle s'y ajoutant est un réel problème. Le 3 novembre
1516, le consulat charge Edouard Grand, voyer de la ville, de retirer une
pierre qui se trouvait sous le pont de Saône parce que cette «
pierre empesche le navigage de la riviere »34. Le pont
constitue donc une réelle gêne pour la navigation et le consulat
lyonnais tente d'éviter que d'autres obstacles s'y ajoutent.
Enfin, il ne faut pas négliger le fait que la
circulation sur la Saône se fait à la descente, bien sûr,
mais que les barques remontent aussi le cours de la rivière. Encore au
XVIIIe siècle, ces trajets à contre-courant sont
pénibles car « le tirage des
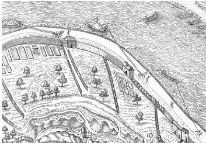
bateaux, pour remonter, est très-
difficile »35. En effet, il s'agit ici de
tirer les bateaux, à partir du rivage et
« dès le Moyen-Age [...] s'est
développé le halage par des
chevaux »36. Sur le plan
scénographique (image ci-contre)37, des
scènes de halage sont figurées et montrent qu'il
peut être effectué par des chevaux ainsi qu'à force
d'hommes mais, en l'occurrence, la barque tirée par les deux personnages
est vide et donc relativement légère ; le recours à la
force des chevaux est sans doute le plus courant, ce qui n'empêche pas
que le halage est une technique difficile. Au sujet du transport commercial sur
la Saône, Richard Gascon décrit un «
déséquilibre entre navigation descendante et navigation montante
»38, qu'il explique notamment par le poids des marchandises,
qui limite le halage. Il nuance cependant son analyse car les sources qu'il
utilise le renseignent surtout sur les exportations. Cependant, il est
33 Ibid., page 43.
34 AML, BB 036, f°15 r°.
35 Bateaux de Saône* ,op. cit., page
22, Citation de P.-J. Antoine, sous-ingénieur des Etats de Bourgogne en
1774.
36 MICHEL, La Saône, fronti4re~ op.
cit., page 53.
37 CHAMPDOR, Plan scénographique op, cit.,
extrait de la planche XXIV.
38 GASCON, Richard, Grand commerce et vie urbaine
au XVIe siècle ; Lyon et ses marchands, tome 1, Paris,
S.E.V.P.E.N., 1971, page 155.
aisément compréhensible que les matières
pondéreuses sont plus facilement
transportables par des bateaux mus par le courant que
tirés à contre-courant.
Lorsque Cardin Le Bret évoque l'importance de ne pas
déforester outre mesure, il ajoute aussitôt que le bois sert
notamment « pour faire des vaisseaux et des navires, sans quoy les mers et
les fleuves seroient du tout inutiles aux hommes »39. Il met
ici en avant le rôle fondamental de ces moyens de transport, assez peu
évoqués par les historiens. Le chercheur Eric Rieth leur consacre
d'ailleurs un livre en expliquant, des son introduction, que « les bateaux
de navigation intérieure [...] font aussi partie de ce paysage
historique et patrimonial construit autour du rapport particulier entre l'eau
et la terre »40. Il présente ici l'intérêt
historiographique de l'étude des bateaux. En ce qui concerne le
XVIe siècle, peu de sources fournissent des informations sur
ceux-ci ; la plupart sont des documents iconographiques, comme le plan
scénographique de Lyon, mais les analyser est assez malaisé sans
connaissance technique approfondie.
L'archéologie pallie en partie ces difficultés
mais les campagnes de fouilles fluviales sont assez rares et parfois peu
fructueuses, d'autant plus que les embarcations en bois se conservent mal au
fil des siècles. Louis Bonnamour est l'auteur d'un ouvrage41
qui présente les campagnes de fouilles archéologiques
réalisées dans la rivière de Saône de leur origine
à la fin des années 1990 comme le montre le sous-titre du livre :
« 150 ans de recherches ». Cet ouvrage est tout à fait
révélateur du manque d'informations sur les bateaux au
XVIe siècle puisque lorsque l'auteur évoque les
embarcations de la période moderne en général, il explique
que « une seule épave de cette époque a été
étudiée. Il s'agit d'une grande « savoyarde
»42 de la fin du XVIIe siècle
»43. Ainsi, il a fallu attendre la campagne de fouilles
d'archéologie préventive, menée à Lyon, dans la
Saône, en face du quartier Saint-Georges, entre 2002 et 2004, et dont les
conclusions ont été récemment publiées, pour
disposer de sources concrètes sur le sujet. En effet,
39 CARDIN LE BRET, De la souveraineté du
Roy, Paris, Toussaincts du Bray, 1632, Livre III, chapitre III, page
348.
40 RIETH, Des bateaux et des fleuves~ op.
cit., page 8.
41 BONNAMOUR, Louis, Archéologie de la
Saône, Paris, co-édition Editions Errance et ville de
Chalon-sur-Saône, 2000, 160 pages.
42 Type de bateau de transport.
43 BONNAMOUR, Archéologie~ op. cit.,
page 61.
« parmi les 1915 objets découverts [...] 16
embarcations, dont une barque de l'époque de Louis XV, 7 barques
à vivier du XVIe siecle... »44.
Ainsi, grâce à ces fouilles et à quelques
auteurs spécialisés, il est possible de présenter les
types de bateaux utilisés sur la Saône au XVIe
siècle. Comme l'exprime succinctement Richard Gascon, « les bateaux
sur la Saône sont des barques ou des bateaux plats et pontonnés
qu'on appelle «les « plattes » »45. Ces bateaux
à fond plat permettaient de transporter d'importantes quantités
de marchandises. Il en existe toute une variété, de la «
savoyarde » à la «bèche » en passant par la «
cadole », que nous ne détaillerons pas ici ; Laurent Michel en fait
d'ailleurs une présentation complète46. En plus de ces
bateaux de transport, un ensemble de barques communes étaient
utilisées et notamment les barques à vivier, qui sont mieux
connues depuis qu'il en a été découvert à
Saint-Georges. Comme leur nom l'indique, ce sont des embarcations qui
permettent de conserver le poisson vivant. En effet, « elles se
caractérisent pas un compartiment central perforé [entouré
de] deux compartiments étanches qui assurent la flottabilité
de

l'embarcation »47. Ces barques, aussi
appelées « bachuels »48, sont
amarrées au
port de la Pêcherie (comme on le voit sur
l'image ci-contre49), où les produits de la
pêche étaient vendus « puisque le poisson
frais doit toujours être vendu vivant
»50.
Il n'est pas étonnant que ce type de barques ait
été trouvé lors des fouilles du quartier Saint-Georges
puisque « les quartiers de Saint-Georges et de Saint-Vincent sont [...]
peuplés de pêcheurs qui officient sur la Saône
»51. Ceux-ci constituent une partie des personnes qui
travaillent sur la rivière. Au XVIe siècle, ces «
marchands fréquentant la rivière de Saône
»52 sont réunis pour défendre leurs
44 AYALA, Grégoire, Lyon, les bateaux de
Saint-Georges : une histoire sauvée des eaux, Lyon, Editions
lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2009, page 38.
45 GASCON, Grand commercek op. cit., tome 1,
page 172.
46 MICHEL, La Saône, fronti4rek op.
cit., page 54.
47 AYALA, Lyon, les bateaux op cit., page
75.
48 Ibid., page 96.
49 CHAMPDOR, Plan scénographique~ op cit.,
extrait de la planche XIII.
50 MONTENACH, Anne, Espaces et pratiques~ op.
cit, page 166.
51 Ibid., page 166.
52 Citation d'un document de 1513 in
GASCON, Grand commerce~, op.cit., tome 1, page 178.
intérêts et, dès 1504, selon Richard
Gascon, ils disposent d'une « bourse commune »53 pour
régler les péages sur la Saône, en amont de Lyon.
Une affaire judiciaire, tranchée par la
sénéchaussée en 1540, nous apprend que les acteurs de la
navigation saônienne sont regroupés dans une confrérie. En
effet, un des acteurs de l'affaire, M. Guillemin, est « recteur de la
confrerie et chappelle fondée par les marchans et pescheurs suyvant la
rivyere de Saosne »54. Un document du 17 avril
172355 présente rapidement cette association qui comprend
« despuis un temps immemorial [...] les marchands de bled, les
poissonniers, voituriers, et battelliers sur la Riviere de Saone ». Cette
confrérie dispose d'un chapelle vouée à Saint-Nicolas,
saint patron des navigateurs, dans l'église des Augustins de Lyon,
c'est-à-dire à proximité du port, et donc du quartier,
Saint-Vincent. Ainsi, la Saône est un axe de circulation emprunté
par de nombreux professionnels de la navigation, qui connaissent bien la
rivière, et qui permettent à la ville de Lyon d'être un
carrefour commercial mais qui assurent aussi son ravitaillement.
53 Ibid., page 178, et document : AML, CC
4047, pièce 8, 23 août 1508.
54 ADR, 13 H 55, acte de la
sénéchaussée du 7 octobre 1540.
55 ADR, 13 H 55, document du couvent des Augustins du
17 avril 1723.
C. Enjeux et contrôle de la navigation
saônienne
De nombreux bateaux circulent sur la Saône au
XVIe siècle, comme le montre notamment le plan
scénographique de la ville de Lyon. Selon Laurent Michel, «
jusqu'à l'apparition du chemin de fer, l'insécurité et
l'inconfort des moyens de transport terrestres ont fait préférer
la voie fluviale »56. L'archéologie confirme cette
densité de circulation puisque lors des fouilles des quais du quartier
Saint-Georges de Lyon, « les épaves de bateaux mises au jour
témoignent [...] d'une activité fluviale importante des le
début de l'époque moderne »57. Ces bateaux, qui
circulent sur la Saône, transportent des marchandises et des hommes.
Même si Laurent Michel explique que « le transport des voyageurs
n'était pas moins actif que celui des marchandises »58,
il nous semble cependant que le premier est moins régulier et à
moins grande échelle que le second. De plus, le recours à la voie
fluviale pour le transport des marchandises semble, en général,
privilégié alors que ce n'est pas systématique pour les
voyageurs. En effet, lorsque Montaigne, de retour de son voyage en Italie,
passe à Lyon au début du mois de novembre 1581, il choisit de
quitter la ville à cheval (il en achète trois à Lyon) pour
rejoindre la Loire. D'ailleurs, une fois ce fleuve franchi, il continue son
trajet à cheval59. En ce qui concerne les flux migratoires,
Olivier Zeller décrit la Saône au XVIe siècle
comme « un axe commercial majeur » mais comme « un axe
migratoire parmi d'autres »60.
Les contemporains sont conscients de l'importance de la
circulation sur la Saône et particulièrement de son enjeu
économique. D'ailleurs, l'ambassadeur vénitien Navagero rappelle
que « La Saône étant navigable est d'un grand avantage pour
la ville de Lyon. C'est par cette rivière qu'on porte à Lyon les
vins et les denrées de la Bourgogne et que Lyon expédie plus haut
ses marchandises en leur
56 MICHEL, La Saône, fronti4re op.
cit., page 53.
57 AYALA, Lyon, les bateaux«~ op cit.,
page 14.
58 MICHEL, La Saône, fronti4re«~ op.
cit., page 54.
59 MONTAIGNE, Michel (de), Journal de voyage en
Italie (1580-1581), Paris, Classiques Garnier, 1955, page 236.
60 ZELLER, Olivier, « La Saône, axe
migratoire vers Lyon au XVIe siècle ? », in
BRAVARD, J.-P., COMBIER, J., COMMERCON, N. (dir.), La Saône, axe de
civilisation, Actes du colloque de Mâcon (2001), Presses
universitaires de Lyon, 2002, page 408.
faisant remonter son cours »61. La Saône
permet donc à la ville de Lyon de diffuser des produits mais aussi d'en
recevoir. Richard Gascon précise que « Les routes de l'Italie et de
la Méditerranée mises à part, aucun ensemble de routes ne
jouait, dans l'économie de Lyon et de ses foires, un rôle
comparable à celles commandées par la Saône et ses
vallées »62. Il ne s'agit pas ici de détailler le
commerce fluvial (Richard Gascon y consacre une partie de sa thèse sur
les marchands de Lyon) mais de déterminer les enjeux principaux de la
navigation sur la Saône et de définir le contrôle politique
qui s'applique sur celle-ci.
Lorsque Richard Gascon évoque les chemins de la
vallée de la Saône, il explique que « la rivière
elle-même est le chemin le plus utilisé. Sa première
fonction est régionale ; elle unit Lyon et la Bourgogne, devenue au
cours de la première moitié du siècle sa «
mère nourrice » »63. Il présente les
produits qui empruntent cette voie fluviale : les blés, les vins, les
bois et des matériaux de construction. Cependant,
l'élément principal qui se dégage de son analyse est
l'importance de l'approvisionnement de la ville de Lyon en blé. En
effet, les campagnes environnantes ne permettent pas d'assurer le
ravitaillement de la ville mais, « même si l'agriculture de son
proche espace était pauvre, la ville pouvait s'approvisionner en
blés de Bourgogne par la Saône, en grains de Languedoc et de
Provence par le Rhône »64. Ainsi, la Saône pallie
en grande partie la faible production agricole lyonnaise et la ville de Lyon
dépend donc du blé qu'elle fait venir. Celui-ci est le plus
souvent transporté par bateaux sur la Saône, depuis la Bourgogne,
et est déchargé au port Saint-Vincent65, au nord de
Lyon.
Ce commerce prend de l'importance au cours du XVIe
siècle car « progressivement les grains ont pris la première
place et le ravitaillement de Lyon s'est trouvé sous la
dépendance des arrivages de blés de Bourgogne dès la
décennie 1531-1540 »66. Richard Gascon ajoute même
que « Les transports de grains sur la
61 ESTIENNE Charles, Guide des chemins de
France, Paris, édité par Jean Bonnerot, 1935-1936
(publication de l'édition de 1553), Tome 1, page 392, note 855 :
Citation de Navagero in « Relations des ambassadeurs
vénitiens sur les affaires de France au XVIe siècle
», documents recueillis et traduits et réunis par W. Tommasco dans
Collection des documents inédits Histoire de France, 1838, Tome
1.
62 GASCON, Grand commerce op. cit., tome 1,
page 151.
63 Ibid., page 153.
64 NEYRET, Régis (dir.), Lyon, vingt-cinq
siècles de confluences, Paris, Imprimerie nationale Editions, 2001,
page 93.
65 MONTENACH, Espaces et pratiques~ op. cit,
page 163.
66 GASCON, Grand commerce op. cit.,tome 1,
page 153.
Saône se confondent, de plus en plus, avec le
ravitaillement de Lyon »67. Ainsi, l'on comprend
aisément l'importance de ces arrivages de blé et l'importance de
leur régulation ainsi que de leur organisation. En effet,
l'approvisionnement de la ville constitue un enjeu économique et
politique au quotidien, qui relève donc du pouvoir de la
municipalité lyonnaise. Le consulat est en charge du ravitaillement en
blé de la ville et fixe le prix du pain68.
Après la crise frumentaire des années 1529 et
1530, dont la révolte populaire appelée Grande Rebeyne est une
conséquence directe, « le consulat agit, surveillant le passage de
grains par la Saône ou le Rhône, qui échappent au
ravitaillement de Lyon »69. Cette surveillance des bateaux
chargés de blé, qui passent dans Lyon, s'explique par la
volonté politique d'assurer le calme dans la ville, en permettant aux
habitants de disposer de grains et donc de pain toute l'année. Ainsi,
« au besoin, la Ville s'oppose au passage de bateaux ou de charrettes
portant des grains ailleurs que dans ses greniers »70.
Jacqueline Boucher illustre cette constatation par un acte consulaire du 13
février 1534, par lequel le consulat s'oppose au passage dans la ville
d'un bateau qui amene du froment au sud de Lyon. Il existe sans doute de tels
épisodes tout au long du XVIe siécle. C'est le cas,
par exemple, au début du mois de mars 1506, le consulat décide du
« tendaige de la cheyne »71 sur la Saône, au niveau
de Saint-Georges car il a été informé que des marchands de
blé vont vendre leurs grains au sud de Lyon alors que la ville en a
besoin. Le consulat dispose donc d'un moyen de contrôle de la navigation
dans la ville : les chaînes sur la Saône.
Au XVIe siécle, deux chaînes sont
tendues sur la Saône, d'une rive à l'autre. La premiere se trouve
à l'entrée de la ville au nord, tendue du quartier Saint-Vincent
à la forteresse de Pierre-Scize. La seconde est, quant à elle,
située à la sortie de la ville en amont de la confluence, entre
l'abbaye d'Ainay et la porte Saint-Georges72. Le consulat lyonnais
en est responsable puisque « la garde de la
67 GASCON, * LECd FRP P eLFik ERS. cit.,tome
1, page 154.
68 LIGNEREUX, Yann, Lyon et le roi : de la «
bonne ville aa j tirErRlXtisP HP XCiFiSTl (1594-1654), Seyssel, Editions
Champ Vallon, Collection Epoques, 2003, page 672.
69 BOUCHER, Jacqueline, Vivre à Lyon au
XVIe siècle, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et
d'Histoire, 2001, page 9.
70 Ibid., page 25
71 AML, BB 024, f°515 et
f°516.
72 NIEPCE, Léopold, Lyon militaire,
Lyon, Bernoux et Cumin, 1897, page 84.
ville, des clefs, portes et chaînes est un des droits
les plus anciens de la commune lyonnaise »73. L'avantage de
disposer de telles prérogatives est de pouvoir contrôler les
entrées et les sorties de la ville. Ainsi, c'est à la fois un
enjeu économique, puisque les marchandises sont surveillées et
taxées dans certains cas, et un enjeu stratégique car c'est un
moyen de défense de la ville74. La municipalité
lyonnaise nomme les commis aux chaînes et les rémunère. Il
existe des commis à « tendre et destendre lesdites chaynes » ;
en 1563, pour un mois de travail (octobre), ils reçoivent du receveur de
la ville 22 livres au total soit 15 livres pour les deux commis qui sont
à Pierre-Scize et 7 livres pour celui que s'occupe des chaînes
tendues au niveau d'Ainay75. De plus, le consulat nomme des «
commys à coucher la nuyt dans la cabanne des cheynes » afin de
surveiller que personne ne tente de les franchir. Par mandement du 2 novembre
1563, Jacques Serrier et Laurens Delacroix sont rémunérés
7 livres et 10 sous chacun, soit 15 livres au total, pour avoir tenu ce
rôle pendant tout le mois d'octobre de la même
année76. Claude de Rubys évoque ces commis qui
surveillent les individus qui entrent dans la ville ; selon lui, ils peuvent
interdire l'entrée aux « vagabonds et gens sans adveu » et
limiter l'accès à la ville en temps de guerre ou
d'épidémie77.
En effet, les chaînes, en général tendues
la nuit78, sont parfois maintenues la journée
également si le contexte rend cette mesure nécessaire. Par
exemple, en 1556, la ville de Lyon doit participer aux dépenses du roi
qui se prépare à partir en guerre. Dans ce contexte, le consulat
prélève une taxe de six deniers par livre de marchandises sur les
produits qui entrent dans la ville par la rivière,
particulièrement sur le vin79. Le contrôle des
entrées dans la ville est alors renforcé. Celui-ci est d'autant
plus important dans les périodes de troubles politiques et le consulat
n'en est pas toujours l'instigateur. En effet, Guillaume Paradin évoque
une ordonnance du gouverneur Mandelot du 16 décembre 1568, donc dans le
contexte des Guerres de Religion, qui somme aux gardes des chaînes de
« ne laisser
73 COURBIS, Eugène, La municipalité
lyonnaise sous l'Ancien Régime, Lyon, imprimerie Mougin Rusand,
1900, page 129.
74 LIGNEREUX, Lyon et le roi..., op. cit.,
page 641.
75 AML, CC 1112, f°53 v°.
76 AML, BB 083, acte consulaire du 2 novembre 1563.
77 RUBYS, Histoire véritable... op.
cit., page 477.
78 Le consulat mande des bateliers pour amener le
commis aux chaînes les fermer le soir et les ouvrir le matin (par
exemple, AML, BB 107, 1581, f° 148 r°).
79 AML, BB 078, f° 109 et 110.
descendre ny passer plus oultre, que lesdites chaisnes, de
leur garde, aucun basteau [~] sans l'avoir premierement bien visité
"80.
Ainsi, dans certaines situations d'autres autorités
prennent part dans la surveillance des entrées dans la ville ;
l'intervention du représentant militaire du roi dans le Lyonnais, dans
un contexte troublé, n'est pas surprenante. D'autre part, le roi peut
également imposer directement sa volonté au consulat. Par
exemple, en mars 1556, Henri II permet à la duchesse de Valentinois,
Diane de Poitiers, de se procurer du blé en Bourgogne et de le faire
venir par bateau ; ce blé va donc traverser la ville de Lyon, par la
Saône, sans y être vendu. Les consuls de Lyon, même s'ils
savent « la grande et urgente nécessité où sont les
habitants de cested. ville par faute de bledz », se plient à la
volonté du roi puisqu'ils ordonnent de « faire ouvrir les cheynes
pour passer ladite quantité de six à sept cens asnées
"81 de blé pour la duchesse, qui n'est autre que la favorite
du roi. Enfin, la population lyonnaise peut elle-même spontanément
tendre les chaînes lorsqu'elle le juge nécessaire. En effet,
à la fin du mois de février 1589, « le peuple et les
pennonages dressent des barricades dans les rues, tendent les chaînes de
la Saône et établissent des corps de garde aux points
stratégiques de la ville "82. Cet évènement
précède l'adhésion à la Ligue de la ville de Lyon
et montre l'importance de bloquer l'entrée dans la ville par la
Saône.
L'accès à la ville de Lyon par la rivière
de Saône constitue donc un enjeu important. Cette rivière est un
vecteur de marchandises, notamment de blé, fondamental pour
l'économie de la ville mais elle est aussi une voie d'entrée qui
doit être contrôlée pour des raisons de
sécurité. Les chaînes qui sont tendues sur la
rivière, gérées quotidiennement par le consulat,
permettent de limiter l'accès à la ville et de surveiller les
personnes, comme les marchandises, qui la traversent. Cependant, ce n'est pas
toujours un obstacle fiable. Tout d'abord, le consulat se méfie parfois
des commis aux chaînes qui « ne font leur debvoir de si prendre
garde " en certaines occasions. Ainsi, au mois de janvier 1556, il est
décidé que « pour obvier aux fraudes et abuz qui peulvent se
faire aux chaynes [...] il y aura trois clefz ausd. cheynes " qui sont
confiées trois personnes différentes : en
80 PARADIN, Mémoires de l'histoire..., op.
cit., pages 381-382.
81 AML, BB 078, f° 159 r° et v°.
82 BAYARD, Françoise, CAYEZ, Pierre, PELLETIER,
André, ROSSIAUD, Jacques, Histoire de Lyon des origines à nos
jours, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2007, page 438.
l'occurrence Jehan Tacon, Mathieu Bourgeoys et Pierre
Joly83. D'autre part, même si les commis font correctement le
travail qui leur est confié, les chaînes ne représentent
pas toujours une limite suffisante. Par exemple le 4 avril 1556, trois bateaux
chargés de blés franchissent de force, rompant la chaîne,
la sortie de la ville84. Vingt-cinq arquebusiers sont chargés
de les poursuivre en bateaux et rattrape les contrevenants à Givors. Les
bateaux, ainsi que leur cargaison de blé, sont finalement ramenés
à Lyon. Cet épisode montre donc une limite au contrôle de
la navigation par le consulat mais constitue probablement un fait
inhabituel.
83 AML, BB 078, f°110 v° et f°111
r°, acte consulaire du 16 janvier 1556.
84 AML, BB 078, f°169 v° à f°177
v°.
Conclusion chapitre IV
La Saône, dans le cadre de la ville de Lyon au
XVIe siècle, est un espace dans lequel se déroulent
des activités variées. En effet, les Lyonnais y pratiquent des
loisirs tels que la baignade et la promenade ou, dans le cadre de fêtes,
des jeux nautiques tels que les joutes. C'est aussi le lieu d'activités
professionnelles comme le transport et la vente de marchandises. La
fréquentation de ses rives et la navigation sont importantes comme le
montre le plan scénographique du milieu du XVIe
siècle, dans lequel un nombre substantiel de personnages s'affaire
autour de la Saône. D'ailleurs, la circulation sur cette rivière,
qui traverse la ville, est l'objet d'une surveillance par les autorités
municipales car les enjeux, tant économiques que stratégiques qui
la concerne, sont importants. Les usages de la Saône, divers et nombreux,
révèlent une relation forte entre les habitants de la ville de
Lyon et cette rivière. Celle-ci est un élément familier,
de leur vie quotidienne ; c'est également une source de
débouchés économiques et un moyen d'approvisionnement pour
la ville.
Conclusion de la deuxième partie
La présence d'une rivière au coeur d'un espace
urbain implique différents risques mais aussi des avantages. Tout
d'abord, le niveau d'eau d'une rivière peut varier : si l'eau est au
plus bas, la navigation est gênée voire impossible, comme lorsque
la rivière est prise par les glaces. Le principal danger reste le
débordement des eaux car il peut entraîner des destructions. Ce
risque est plutôt faible à Lyon puisque, à juste titre, la
Saône est considérée comme un cours d'eau paisible.
D'ailleurs, les activités fluviales, de loisir comme professionnelles,
qui sont variées, montrent que la Saône est une rivière
familière pour ses riverains et parfaitement intégrée
à la ville. Le trafic y est dense et la navigation plutôt
aisée, même s'il existe quelques obstacles tels que les pilles du
pont de Saône. Les riverains, comme les bateliers se soumettent à
la volonté de Dieu même s'ils tentent, par le biais de Notre-Dame
de l'Ile-Barbe ou de Saint Nicolas, patron des navigateurs, d'y
intercéder. Une fréquentation si importante de la rivière
et de ses rives, notamment l'installation d'activités de tannerie et de
boucherie, participe de la pollution de la rivière.
En effet, de nombreux déchets y sont jetés ce
qui montre une perception de la rivière comme un moyen de
débarrasser la ville de ses détritus puisqu'elle les transporte
vers le sud. Cependant, les questions d'hygiène liées à la
pollution de la
Saône préoccupent les rois de France qui
interviennent pendant la première moitiédu XVIe
siècle afin que le rejet de déchets, notamment domestiques, soit
empêchépar le pouvoir consulaire. L'application concrete de cette
volonté semble limitée.
D'autre part, il semble que le consulat, comme les riverains,
ne voit pas la rivière polluée comme un danger important en soi.
En effet, la crainte principale est, en cas de montée des eaux, la
propagation de déchets ou de maladies dans la ville. Comme ces
épisodes sont exceptionnels, le risque est faible mais c'est le
principal envisagé par le consulat. A l'inverse, les rois de France,
notamment Louis XII, perçoivent les déchets dans cette
rivière comme une gêne à la navigation et donc comme un
problème important. En effet, la navigation est fondamentale, d'un point
de vue
économique pour la ville, notamment parce qu'il s'agit
du principal moyen d'approvisionnement en blé. Le consulat se
méfie de l'accès à la ville par la rivière ; c'est
l'objet d'une surveillance, voire d'un contrôle, particulièrement
durant les épidémies et en temps de guerre. La navigation reste
cependant l'enjeu principal autour de la Saône à Lyon ce qui
explique qu'il s'agisse de la préoccupation principale du pouvoir
consulaire, dont un des rôles fondamentaux est l'entretien de la
voirie.
Troisième Partie : Les infrastructures saôniennes
Les aménagements urbains réalisés pour
s'adapter et tirer avantage de la présence de la rivière de
Saône sont la principale illustration de la prise en charge politique du
cours d'eau. En effet, la présence d'infrastructures, leur nombre, les
nouvelles réalisations ainsi que les phases de réparations, sont
un révélateur de l'intérêt porté à la
rivière. De plus, les analyser permet de comprendre les enjeux
principaux qui découlent de la présence d'une rivière dans
un site urbain et la façon dont l'homme s'y adapte ; se dégagent
alors les préoccupations principales des autorités
vis-à-vis du cours d'eau. L'entretien de la voirie et les constructions
publiques, nous l'avons vu précédemment, relèvent des
prérogatives consulaires. C'est aussi le consulat lyonnais qui prend en
charge au quotidien la principale activité fluviale c'est-à-dire
la navigation.
L'objectif de cette partie est donc de présenter les
infrastructures saôniennes et leur évolution au cours du
XVIe siècle. Ainsi, à partir de l'étude des
réalisations concrètes et des phases de réparations
décidées par la municipalité lyonnaise, il semble possible
de mesurer l'implication du pouvoir politique dans la gestion de la Saône
à Lyon. Afin de réaliser une présentation complète,
nous distinguerons les structures situées sur les rives de la
rivière de celles qui permettent de la traverser. Nous nous
intéresserons donc, dans un premier temps, à l'aménagement
des berges de la Saône puis, dans un autre chapitre, nous
présenterons les moyens qui permettent de franchir cette rivière
qui partage la ville en deux espaces, constituant ainsi un obstacle à la
circulation dans la ville.
Chapitre V : L'aménagement des berges
Les berges d'une rivière constituent l'espace
intermédiaire entre celle-ci et le sol c'est-à-dire entre la
rivière et l'espace oü les hommes sont installés. Les
usages, nombreux et variés, de la rivière de Saône à
Lyon ont été présentés. Ceux-ci nécessitent
un accès aisé, ou au moins praticable, de l'eau de la
rivière à la terre et dans l'autre sens. Le transport de
marchandises par voie d'eau et particulièrement l'approvisionnement de
la ville de Lyon en blé, par la Saône, constituent les principaux
enjeux de la circulation sur la rivière. Or, les produits qui arrivent
à Lyon par la Saône doivent être déchargés
dans la ville ce qui nécessite des structures d'accostage et d'arrimage
des bateaux et donc un aménagement des berges de la rivière.
L'entretien des rives et la fluidité de l'accès à l'eau ou
à la terre représentent donc un enjeu économique et
politique. Il s'agit ici de s'intéresser à la gestion consulaire
de ces espaces riverains et à l'évolution des structures qui les
composent, en s'attachant surtout aux travaux réalisés aux
ports.
A. Description des rives de la Saône
Avant de s'intéresser aux travaux de construction et de
réparations, effectués au cours du XVIe siècle
sur les berges de la Saône, nous allons nous pencher sur la physionomie
des structures qui bordent la rivière. Il s'agit donc de
présenter les deux rives de la Saône dans le cadre de Lyon
c'est-à-dire de Vaise, au nord de la ville, à la confluence des
deux fleuves. Pour cette description, le plan scénographique de Lyon,
réalisé vers 1550, constitue notre support principal car,
même si certaines structures ont évolué (nous le verrons
ensuite), ce plan semble suffisamment représentatif et fiable pour un
tel usage. L'image ci-dessous est une réduction de ce plan,
réalisée par Georges Braun à la fin du XVIe
siècle1. L'objet de ce développement est donc de
décrire les berges de la Saône mais aussi d'évoquer
rapidement leurs usages, les édifices qui y sont installés et
surtout les infrastructures fluviales qui les composent.

Décrire la rive droite de la Saône est assez
rapide puisqu'on constate une certaine homogénéité des
structures qui s'y trouvent. En effet, de manière
générale, des maisons sont installées tout au long de la
rivière du côté de la colline de Fourvière. Les
rares discontinuités notables sont des types d'accès à
l'eau et notamment des ports, sur lesquels nous reviendrons ensuite plus
longuement. Selon Jean Labasse, c'est une marque du
désintérêt du cours d'eau de la part de ses
1 Georges Braun, Réduction du plan
scénographique de Lyon au XVIe siècle,
in KRUMENACKER, Yves (dir.), Lyon 1562 capitale protestante,
Lyon, Editions Olivétan, 2009, page 53.
riverains. En effet, ce géographe considère
qu'il s'agit d'une illustration de la négligence des rives à la
période moderne puisque « le décor urbain leur tourne
fréquemment le dos ; les maisons plantées dans l'eau se pressent
dans un alignement compact »2. Il est aussi possible que la
présence d'édifices à la limite de l'espace constructible
soit simplement le résultat d'un rationalisation spatiale
cohérente dans cette zone urbaine dont l'expansion est
particulièrement limitée par la colline de Fourvière. De
plus, c'est également l'illustration du faible danger que semble
représenter la rivière de Saône, pour ses
riverains3, puisqu'ils ne semblent pas craindre qu'un
débordement des eaux ravage leurs habitations ou, le cas
échéant, ces dernières représentent un rempart pour
le reste de la ville du côté de Fourvière.
En ce qui concerne la rive gauche de la rivière, si
l'on met de côté les possessions propres à l'abbaye
d'Ainay, à l'extrême-sud de la presqu'île, et les abords du
pont de Saône où se trouvent des maisons, elle se
caractérise par une bande, un espace laissé vide, tout au long de
la rivière. La raison la plus logique qui explique cette situation est
probablement l'usage de cet espace pour le halage. En effet, lorsqu'il s'agit
de tirer, à l'aide de cordes, les bateaux qui remontent la Saône,
il est fondamental de disposer d'un espace suffisant sur la rive. Le halage est
nécessairement entravé par la présence du pont de
Saône, ce qui est une des explications de la présence
d'habitations de part et d'autre de ce pont. Cependant, il n'est pas certain
que cet espace reste libre pour cette raison car « la création d'un
chemin de halage en 1552-1553 entre le fossé des Terreaux, qu'on comble
le long de la rive à cette occasion, et Saint-Clair, sur la rive droite
du Rhône, fait le pendant à ce que l'on cherche à faire
depuis un certain temps le long de la Saône »4. Il est
certain que l'espace sur la rive gauche n'étant pas continu, il n'est
pas réservé au halage, cependant, on l'a
montré5, il peut servir à cet effet. De toute
manière, il est indéniable que les particuliers, comme les
marchands peuvent circuler le long de la Saône du côté de la
presqu'île.
2 LABASSE, Jean, «Réflexion d'un
géographe sur le couple ville-fleuve», in La ville et le
fleuve, actes du colloque de Lyon (avril 1987), Paris, Editions du
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1989, page 15.
3 Cet aspect est développé dans le
chapitre III, A et B.
4 Archives municipales de Lyon, Lyon, les
années Rabelais, Dossier des Archives municipales n°6,
catalogue de l'exposition de 1994, page 27.
5 Cf Chapitre IV, A.
Le plan scénographique de Lyon montre en effet que les
berges de la Saône, notamment la rive gauche, sont un lieu de passage et
de promenade comme il est
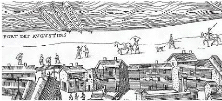
possible de le voir sur l'extrait de
ce plan, figuré ci-contre6. Cette
image représente des individus qui
se promènent, discutent ou tout
simplement circulent en empruntant l'espace libre sur la rive
gauche de la Saône (ici en amont du pont). Par ailleurs, les quais de la
rivière sont le lieu d'activités professionnelles puisque des
marchandises y sont chargées et déchargées voire vendues.
Dans son étude sur la répartition des métiers à
Lyon, Olivier Zeller a montré que les activités professionnelles
sont rarement concentrées géographiquement dans le ville. Il
distingue cependant plusieurs exceptions et notamment que « la
concentration des bateliers autour des ports est une donnée
répandue »7. De plus, « Lyon apparaissait ainsi
comme une ville entièrement centrée sur ses chapelets de ports
fluviaux »8 dont les activités économiques sont très
développées.
La fréquentation des quais et particulièrement
des espaces portuaires installés le long de la Saône est donc
importante. Un problème découle directement de cela. En effet, de
nombreux déchets résultent de ces activités, surtout
professionnelles, et infectent les quais. Yann Lignereux donne l'exemple de la
Pêcherie, en amont du pont sur la rive gauche de la Saône, qui est
un grand marché de poissons. Il cite un document du 15 mars 1618, qui
est un rapport réalisé par des commis du consulat ; dans celui-ci
est évoqué la « grande puanteur qui proceddoit des eaux,
poissons mortz et autres immondices que lesd. poissonniers gettoient dans la
place estant au bout dud. pont, lesquelles immondices servoient de spectable a
tous les passants et qui estoient pour infecter tout ce quartier la
»9. Même si ce document est quelque peu postérieur
à la période que nous étudions, c'est
6 CHAMPDOR, Albert (introduction), Plan
scénographique de la ville de Lyon au XVIe
siècle, Trévoux, Editions de Trévoux, 1981, extrait
de la planche XIII.
7 ZELLER, Olivier, Les recensements lyonnais de
1597 et 1636, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1983, page 181.
8 NEYRET, Régis (dir.), Lyon, vingt-cinq
siècles de confluences, Paris, Imprimerie nationale Editions, 2001,
page 94.
9 LIGNEREUX, Yann, Lyon et le roi ; de la "bonne
ville" à l'absolutisme municipal (1594-1654), Seyssel (Ain),
Editions Champ Vallon, Collection Epoques, 2003, page 654.
seulement à cette date que le marché aux
poissons est déplacé, ce qui implique que la situation
décrite au début de l'année 1618 s'applique pour tout le
XVIe siècle.
De plus, des particuliers déposent leurs déchets
sur les rives de la Saône ce que l'on peut sans doute expliquer par la
proximité de la rivière. En effet, en 1555, les religieux du
couvent des Augustins, situé près de la rive gauche de la
Saône, se plaignent à la sénéchaussée du fait
que des habitants de la ville déposent divers déchets à
proximité de leur monastère. Ils obtiennent d'ailleurs le soutien
du sénéchal qui interdit que soient déposés le
« fumier ny autres immondices audevant de leur esglize et couvent sous
pretexte que le port en est prochain »10. Cependant, en 1603,
le problème n'est toujours pas réglé puisque les Augustins
écrivent à nouveau au sénéchal pour se plaindre du
non-respect de l'interdiction par plusieurs personnes. Ce problème
montre que les Lyonnais déposent bien leurs déchets sur les quais
en attendant de les mettre à l'eau ou pour que la rivière les
emporte puisque, selon ce document, c'est la proximité du port et donc
de la Saône qui explique l'amoncellement de détritus.
D'ailleurs le consulat est conscient de ce problème et
tente de lutter contre cette habitude qu'ont les Lyonnais de déposer
leurs déchets sur les quais. On a montré qu'à l'inverse,
la municipalité préfère que les détritus soit
directement jetés dans la rivière11. Dans un acte
consulaire par lequel les échevins enjoignent les tanneurs de la ville
à se débarrasser de leurs déchets dans la Saône, il
est explicitement dit que cette décision va à l'encontre de ce
qui est habituellement fait. En effet, les tanneurs « gectoient
ordinairement leurs eaues et immondices par les portz et places publicques puis
au long de la riviere de saonne »12. Il est donc courant que
les déchets soient déposés sur les berges de la
Saône. Cela constitue un problème d'hygiène publique ainsi
qu'une gêne pour les habitants comme pour les personnes de passage.
Dès le XVIe siècle, le consulat s'oppose donc à
cette habitude, préférant que les déchets soient
emportés par la rivière et qu'ils ne restent pas à la vue
de tous. Les amoncellements de détritus sur les quais peuvent d'ailleurs
représenter une gêne à la circulation le long de la
rivière mais aussi aux activités commerciales qui
nécessitent le chargement et le déchargement de marchandises dans
les différents ports et accès à l'eau.
10ADR, 13 H 18, premier document, 1603, lettre des
Augustins de Lyon au sénéchal (qui évoque l'interdiction
obtenue en 1555).
11 Cf Chapitre III, C.
12 AML, BB 086, f° 98 v°, acte consulaire du
17 décembre 1566.
Les éléments les plus importants que l'on trouve
sur les berges d'une riviére

sont donc les différents accés à l'eau
qui ponctuent son cours. Ce sont en effet les structures qui illustrent le
mieux le lien entre les hommes et la riviére qu'ils côtoient ainsi
que l'importance de la navigation pour une communauté. A partir du plan
scénographique de 1550, Jacques Rossiaud a recensé les types de
ports et de débarcadères qui existent à Lyon au
XVIe siècle. Il a ainsi réalisé dix
schémas qui sont figurés cicontre13. Ces
représentations nous montrent qu'il existe à la fois des
accés à l'eau privés ou propres à un édifice
(images A, B et C) et surtout des ports. En effet, à Lyon et
particulièrement
sur les rives de la Saône, les ports sont nombreux. Ils
« s'échelonnent le long des
rives de la Saône depuis Saint-Vincent jusqu'aux
Célestins, ayant chacun sa
fonction : port aux blés, port aux vins etc.
»14. Il s'agit maintenant de présenter ces
structures qui ponctuent les rives de la Saône.
13 Ports et débarcadères urbains,
l'exemple de Lyon d'après le Plan scénographique (1550),
in ROSSIAUD, Jacques, Dictionnaire du Rhône
médiéval (1300-1550), Tome 2, Grenoble, Centre Alpin et
Rhodanien d'Ethnologie, 2002, page 276.
14 GASCON, Richard, Grand commerce et vie urbaine
au XVIe siècle ; Lyon et ses marchands, tome 1, Paris,
S.E.V.P.E.N.,1971, page 142.
B. Evolution des structures portuaires
Les ports, et les accès à l'eau en
général, sont les infrastructures principales et fondamentales
que l'on trouve sur les rives d'un cours d'eau. En effet, ils constituent le
lien privilégié entre le rivage, c'est-à-dire entre la
terre, et l'eau de la rivière puisqu'ils sont le moyen d'accès de
l'un à l'autre, et réciproquement. Le terme de « port »
renvoie à une structure d'accostage et d'amarrage des bateaux. En ce qui
concerne le XVIe siècle, il serait peut-être plus
adapté de qualifier ces lieux de « dispositifs portuaires
»15, puisqu'ils sont de nature variable et plus ou moins
sophistiqués et aboutis comme il est possible de le voir sur les
structures figurées à la page précédente.
Cependant, pour une facilité de compréhension le terme «
port », qui regroupe donc une certaine variété, sera ici
préféré.
Il ne s'agit pas ici de détailler les fonctions
précises des ports installés le long de la Saône ni leur
spécialisation marchande, d'une part parce que les documents d'archives
ne le permettent pas, d'autre part car c'est leur situation et leur
évolution structurelle qui nous intéresse
particulièrement. Les dépenses qui résultent des
différents travaux d'aménagement portuaires ne seront pas
évoquées puisqu'elles feront l'objet ultérieurement d'une
étude en soi. Il s'agit donc de présenter les ports lyonnais
installés le long de la Saône au début du siècle
ainsi que les constructions effectuées au cours du XVIe
siècle. Cependant, le contexte économique et le rôle
commercial des ports ne peut être négligé puisqu'il s'agit
de facteurs qui influent, de façon logique, sur l'importance de ces
espaces de transition entre le transport et la diffusion des produits. Ainsi,
l'évolution économique a des conséquences
indéniables sur les infrastructures portuaires.
Dès la fin du XVe siècle,
l'économie lyonnaise se développe et cette croissance,
économique comme démographique, entraîne des changements
dans les structures urbaines. D'ailleurs, « la transformation de la ville
a été telle après les années 1470, que les
données archéologiques concernant cette époque sont
15 ROSSIAUD, Jacques, Le Rhône au Moyen
Age, Paris, Flammarion, Collection Aubier, 2007, page 177.
rares »16. Selon Yann Lignereux, « Lyon
devait une partie de sa prospérité à l'important commerce
qui la traversait »17 et celui-ci se développe surtout
à partir de l'octroi des privilèges de foires par les rois de
France à la ville de Lyon, particulièrement après
l'acquisition définitive de ces privilèges en 1494. En effet,
Charles VIII rétablit cette année-là les foires de Lyon
(il y en a quatre par an) ce qui permet de faciliter les échanges
à grande échelle en réduisant les taxes
prélevées sur les marchandises. Donc, dès la fin du
XVe siècle, la ville de Lyon connaît un essor
économique important.
Ce rayonnement économique croissant entraîne une
modification des structures urbaines et notamment des ports puisqu'ils sont le
lieu de chargement et de déchargement des marchandises qui transitent
par voie d'eau. En effet, « l'ouverture de nouveaux ports sur la
Saône en 1482-1483 devant Saint-Eloi, puis en 1485-1490 derrière
le chevet de Saint-Paul montrent le développement de l'activité
portuaire, donc du trafic des marchandises. Ces nouveaux ports attestent aussi
de la paix retrouvée »18. Deux ports sont effectivement
réalisés à la fin du XVe siècle. Tout
d'abord, la construction du port Saint-Eloi, qui se trouve en amont du pont sur
la rive droite de la Saône, est prise en charge par le consulat en
148319. D'autre part, la reconstruction du port Saint-Paul
résulte, quant à elle, de la volonté des « Messieurs
de l'Eglise de Saint-Pol et leurs voisins »20 qui demandent
néanmoins l'autorisation du consulat, responsable de la voirie, pour
cela. Ce deuxième port est construit en face de l'église du
même nom c'est-à-dire sur la rive droite de la Saône,
directement en amont du nouveau port Saint-Eloi.
Ces deux nouvelles structures permettent de désenclaver
les quartiers oüelles sont construites. En effet, la rive
droite de la Saône ne comptait pas de port
entre celui des Deux-Amants (en amont de la forteresse de
Pierre-Scize donc à l'entrée nord de la ville) et le port de la
Baleine qui se situe en aval du pont de Saône.
16 NEYRET, Lyon, vingt-cinq siqcles~ op.
cit., page 86.
17 LIGNEREUX, Lyon et le roi op. cit., page
647.
18Archives municipales de Lyon, Lyon, les
années~ op. cit., page 23.
19 AML, DD 339, pièce 34, acte consulaire de
mai 1483.
20 AML, DD 339, pièce 7, premier document, acte
consulaire du 16 mars 1487.
Ces deux ports s'ajoutent aux huit qui existaient
précédemment sur les deux rives de la Saône. Ainsi, au
début du XVIe siècle, dix ports sont installés
le long de la rivière dans le cadre de la ville de Lyon, comme cela est
figuré sur le plan cidessous.
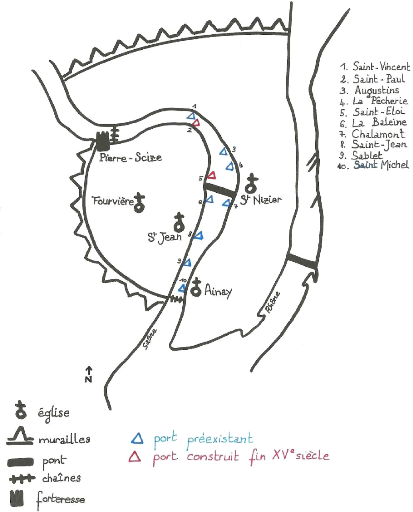
Figure 1 - Plan de Lyon et des ports sur la Saône
à la fin du XVe siècle
Trois ports sont construits à Lyon le long de la
Saône au cours du XVIe siècle ; il convient de les
présenter. Le premier port lyonnais qui est réalisé au
bord de la Saône au XVIe siècle est celui du Temple. Un
acte consulaire du 5 septembre 1508 précise le lieu où celui-ci
sera construit : « près le temple [...] entre les jardins des
frères Tourveon et le monastere Saint anthoine »21. Le
consulat décide de la réalisation de ce nouveau port parce que
« le Port de Rue chalamont de cette dite ville est mal aisé
»22. Il s'agit donc de pallier les difficultés
d'accès au port Chalamont par un second port, réalisé
à proximité. En effet, le port du Temple est construit sur la
rive gauche de la rivière, en aval du pont de Saône, entre le port
Saint-Michel (plus au sud) et le port Chalamont. Or, pour réaliser ce
nouveau lieu d'accostage, des travaux sont nécessaires. En effet, pour
faciliter la circulation aux abords de ce nouveau port, et donc l'accès
à celui-ci, le consulat décide de « faire eslargir la ruelle
qui est entre le monastere Saint anthoine d'un costé, et les maisons
appartenantes a honnorables personnes jacques et Claude Tourveon
»23. Ainsi, en 1508-1509, un nouveau port est
érigé sur la Saône et quelques aménagements sont
réalisés à proximité.
D'autre part, en 1538, François Ier offre
à la municipalité lyonnaise un jardin « questoit devant la
maison dudit seigneur appellée Roanne, pour en faire un Port sur Saonne
»24. Pour cette réalisation, le consulat demande au roi
l'autorisation de faire des travaux sur les quais, du jardin de Roanne au pont
de Saône pour « y faire rue et passaige commun »25.
François Ier, qui écrit une lettre adressée au
sénéchal de Lyon, c'est-à-dire à son
représentant, autorise la municipalité à effectuer les
travaux nécessaires à la réalisation d'un nouveau port.
L'autorisation est entérinée à la cour de la
sénéchaussée en présence du procureur de la ville
de Lyon, Jehan de la Bessée, représentant du consulat, le 12
décembre 153826. Le port de Roanne est érigé
entre 1539 et les premières années de la décennie 1540. Il
est situé sur la rive droite de la Saône, en aval du pont et
à égale distance du port de la Baleine et du port Saint-Jean et,
comme pour la réalisation du port du Temple, des travaux pour en
faciliter l'accès et permettre une fluidité du trafic sur les
quais, sont réalisés.
21 AML, DD 335, pièce 1, acte consulaire du
mardi 5 septembre 1508.
22 AML, DD 338, pièce 2, acte consulaire du 9
mars 1508.
23 AML, DD 338, pièce 2, acte consulaire du 9
mars 1508.
24 AML, DD 340, pièce 12, premier document, 30
juillet 1538.
25 AML, DD 340, pièce 12, deuxième
document, lettre royale du 25 novembre 1538.
26 AML, DD 340, pièce 12, troisième
document, acte de la sénéchaussée, 12 décembre
1538.
Enfin, un troisième port est construit sur les berges
de la rivière au XVIe siècle : il s'agit du port
Rontalon. Ce port est situé sur la rive gauche de la Saône, en
face du port Saint-Jean donc au sud de la ville. Afin de le réaliser,
Jacques Gimbre, voyer de la ville, est chargé à la fin de
l'année 1562 de détruire « la maison etant dans le tennement
de Rontalon, ensemble les murailles du côté de Bellecourt jusques
ala riviere de Saone [...afin de] faire un port et place publique pour passer
l'artillerie plus aisement [...] pour la commodité des marchands et
marchandises qui arriveront audit Port et pour l'embellissement
»27 de la ville. Ainsi, la réalisation du port Rontalon
s'accompagne de la création d'une place à proximité et
d'aménagements plus en profondeur dans la presqu'île. Ceux-ci
permettent de développer les déplacements dans le sud de la
presqu'île, au nord d'Ainay, d'autant plus que la rue de la Barre (qui
relie le pont du Rhône à la Saône) est percée par la
même occasion.
Trois ports sont donc construits le long de la Saône au
cours du XVIe siècle. Deux sont installés sur la rive
gauche dans un espace où aucune structure de ce type n'était
présente entre le port Chalamont (à proximité du pont) et
le port Saint-Michel, tout au sud de la ville. De plus, le port de Roanne,
construit sur l'autre berge, fait le pendant au port du Temple et permet lui
aussi de compléter le réseau des dispositifs portuaires. Chaque
construction de port s'accompagne d'aménagements à
proximité soit le long des rives soit plus en profondeur dans les
terres. Systématiquement, l'objectif de ces travaux est de faciliter
l'accès aux ports et donc de garantir l'utilité et
l'intérêt de ces nouvelles réalisations.
Finalement, l'important développement économique
de la ville de Lyon, quidébute à la fin du
XVe siècle et se poursuit dans les deux premiers tiers du
XVIe
siècle, correspond à la période de
construction de nouveaux ports le long des rives de la Saône. En effet,
cinq ports sont réalisés entre les années 1480 et les
années 1560. Les travaux sont donc effectués dans la
période d'essor économique puisque aucun port n'est construit
à la fin du XVIe siècle. Cependant, il convient de
préciser que la densité des ports est alors importante. Ceux-ci
sont régulièrement répartis sur les deux rives de la
Saône ; il n'est pas nécessairement utile d'en ajouter. Le plan
de
27 AML, DD 338, pièce 25, acte consulaire du 26
décembre 1562.
Lyon, figuré ci-dessous, montre que les ports
ajoutés au XVIe siècle complètent habilement le
réseau portuaire. D'autres restructurations, de moindre ampleur, sont
effectuées autour des ports de la Saône au cours du
XVIe siècle ; elles seront présentées
ultérieurement, dans le cadre de l'analyse des modalités de
financement des réparations et des constructions de ports lyonnais.
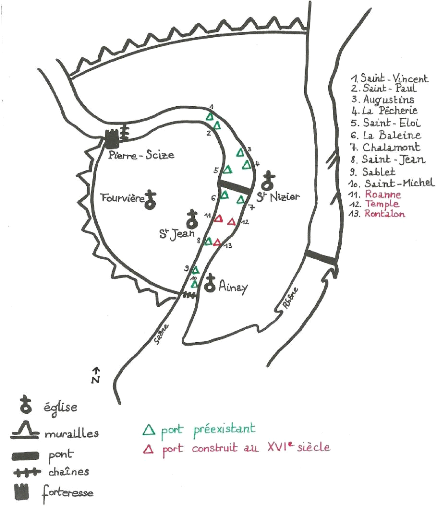
Figure 2 - Plan de Lyon et des ports construits sur la
Saône au XVIe siècle
C. Financement des travaux aux ports
Afin de déterminer l'importance de l'implication de
l'autorité municipale dans la réalisation des infrastructures
saôniennes et particulièrement dans les travaux effectués
aux différents ports, s'intéresser aux fonds qui sont
employés, ainsi qu'à leur origine, semble nécessaire. La
voirie et les dépenses qui s'y rattachent dépendent, en
théorie, du pouvoir consulaire. Cependant, ce n'est pas une règle
qui s'applique de façon systématique. Afin de présenter
les différents protagonistes qui prennent part au financement des
réparations et des constructions de ports à Lyon, nous allons
nous intéresser aux réalisations qui ont été
précédemment évoquées en y adjoignant les
entreprises de réparations. Ainsi, les structures portuaires
réalisées à la fin du XVe siècle seront
intégrées à notre analyse à titre d'exemples et
permettront une étude à plus long terme. La question du
financement de ces constructions antérieures au XVIe
siècle constitue logiquement le point de départ de notre
étude.
Il semble que pour la réalisation du port Saint-Eloi,
en 1483, le consulat prenne en charge toutes les dépenses. Dans l'acte
consulaire qui porte la décision de construction, il est indiqué
« que le devis de la paye des ouvriers et manouvriers soit faite ainsi et
par la forme et manière que l'on a accoustumé de payer pour les
autres reparations »28. En effet, le 3 août 1483, le
« recepveur [de la ville] a livré et paié de et sur les
deniers de sad. recepte »29 les artisans, notamment le
maître charpentier Estienne Chappon, qui travaillent à la
réalisation du port. En ce qui concerne le second port construit
à la fin du XVe siècle, le port Saint-Paul, le
consulat se contente de donner son accord. Comme la municipalité n'est
pas l'instigateur de cette construction, il semble logique qu'elle ne
s'acquitte pas du salaire des ouvriers et des artisans qui sont employés
à cet ouvrage. Néanmoins, les religieux de Saint-Paul et les
riverains de ce quartier, qui sont à l'origine de la construction de ce
port, demande un soutien financier du consulat à hauteur de 100 livres.
Dans un premier temps les échevins refusent car ils « n'est
à eulx possible
28 AML, DD 339, pièce 34, acte consulaire de
mai 1483.
29 AML, CC 465, f° 21 r°.
les faire bailler obstant les grandes affaires de laditte
ville »30. Ils finissent cependant par accepter de contribuer
financièrement à la réalisation du port Saint-Paul car
comme cela « touche et concerne le bien et proffit », le consulat
ordonne que « soit baillé et livré par le trésorier
et receveur general de lad. ville [...] la somme de soixante livres
»31.
Il semble donc que le consulat assume le financement des
travaux qui sont réalisés de sa volonté. De plus, son
avis, et particulièrement son accord, est requis lorsqu'il s'agit d'une
édification souhaitée par des particuliers, d'autant plus qu'elle
concerne une structure, le port Saint-Paul, dont l'utilisation ne sera pas
limitée aux personnes qui l'ont réalisée. C'est
probablement la raison pour laquelle les échevins accordent un soutien
financier à cet ouvrage dont le bénéfice sera collectif.
De plus, la réalisation de deux ports dans cette partie de la ville qui
n'en comportait pas représente un intérêt certain. Le
consulat, conscient de la nécessité que des
débarcadères soient construits en ces lieux, a, de son propre
chef, financé le port Saint-Eloi, puis, a apporté des fonds pour
la réalisation du port Saint-Paul. Il s'agit maintenant de confirmer ou
de nuancer l'implication du consulat dans la réalisation et l'entretien
des structures portuaires au cours du XVIe siècle.
Au cours du XVIe siècle, le consulat prend
parfois lui-même en charge des travaux. Il est difficile de
déterminer les raisons pour lesquelles il décide ou non de s'en
acquitter ; cela est sans doute lié à l'état des finances
de la ville et aux charges variables qui pèsent sur la
municipalité en fonction du contexte. En tout cas, la
municipalité lyonnaise finance les dépenses liées aux
démolitions nécessaires à la réalisation du port
Rontalon, puisqu'elle « enjoint a M. françois Coulaud Receveur des
deniers communs [...de] payer les journées et vacations des ouvriers qui
travailleront aux dittes démolitions »32. En ce qui
concerne la construction en ellemême du port, il semble que la ville s'en
charge également car aucun acte consulaire, ainsi qu'aucune source au
sujet de la voirie municipale, ne révèle une contribution
extérieure et les sources comptables non plus.
Il est néanmoins certain que le consulat s'acquitte
à plusieurs reprises du financement de travaux portuaires. En 1549, la
décision est prise de réparer et de
30 AML, DD 339, pièce 7, premier document, acte
consulaire du 16 mars 1488.
31 AML, DD 339, pièce 7, deuxième
document, acte consulaire du 28 septembre 1488.
32 AML, DD 338, pièce 25, acte consulaire du 26
décembre 1562.
paver deux ports sur la Saône : le port du
Temple33 et le port de la Baleine34. Pour ces deux phases
de réparations, le voyer de la ville, alors Humbert Gimbre, est en
charge de la supervision des travaux et la municipalité les finance. En
1569, le consulat décide même de vendre une boutique appartenant
à la ville car « il etoit besoin de recouvrer deniers pour la
construction et reparation d'un des ports de la Riviere de Saone [...] au bourg
Saint vincent »35. Poncet Bouvet, échevin, en est
l'acquéreur pour la somme de six cents livres. Il s'engage, avec cette
somme, à « payer et delivrer aux maçons et ouvriers qui
seront employés [...] audit Port » c'est-à-dire qu'au lieu
de donner directement l'argent au vendeur (le consulat), il est chargé
de payer lui-même les artisans qui vont réaliser les travaux. Le
consulat finance donc lui-même ces réparations mais de
façon indirecte.
La municipalité lyonnaise, c'est-à-dire
l'autorité responsable de la voirie dans la ville, n'exclue pas,
ponctuellement, de demander la participation financière de particuliers
pour les travaux qu'elle réalise. En effet, si l'on prend l'exemple du
port du Temple, réalisé en 1508-1509, dès que la
décision de construction est prise, les échevins désirent
la contribution des propriétaires des maisons situées à
proximité de celui-ci. Le consulat nomme quatre commis,
Barthélémy de Villars, Jehan de Bourges, Humbert Mathieu et Jehan
Faye, afin qu'ils déterminent « combien lesd. sieurs abbé de
St Anthoine et freres Tourveon seront intéressés à
l'affaire dud. Port en ayant regard a la commodité qu'ils et chacun
d'eux en pourront prendre, aussi les voisins qui dudit Port prendront
commodité, et de combien ils seront contribuables pour aider a survenir
ez frais »36. Les commis sont donc chargés de mesurer le
bénéfice que les différents voisins du port tireront de sa
présence, en tenant compte d'un avantage variable, probablement selon la
situation spatiale et donc la distance au port. Les religieux du couvent
Saint-Antoine et les frères Tourveon sont les seuls voisins clairement
désignés car ils doivent aménager les bâtiments
qu'ils possèdent afin de faciliter l'accès au port.
Les autres voisins du futur port du Temple comparaissent au
consulat le 5 septembre 1508, en présence de maître Denis Garbot,
procureur de la ville. Ils promettent tous de « contribuer pour faire led.
Port, chacun selon son pouvoir et
33 AML, DD 338, pièce 3, acte consulaire du 31
août 1549.
34 AML, DD 340, pièce 1, acte consulaire du 31
août 1549.
35 AML, DD 256, pièce 44, acte de vente d'une
boutique daté du 29 septembre 1569.
36 AML, DD 338, pièce 2, acte consulaire du 9
mars 1508.
faculté et ce que par lesd. commis sera ordonné
»37. Une liste des personnes qui participent au financement de
la construction de ce port figure en annexe 1. Cette procédure, le
recours à des fonds privés pour réaliser une construction
à caractère public, semble anodine. En effet, aucun des documents
consultés ne montre que cette entreprise a posé des
difficultés ou que des particuliers ont d'abord refusé de
participer pour finalement se soumettre à la volonté du consulat.
Le seul élément surprenant est que pour la construction,
précédemment évoquée, du port Saint-Eloi donc
vingt-cinq ans avant le port du Temple, la municipalité se charge de
toutes les dépenses, notamment du salaire des ouvriers comme il est
d'usage qu'elle le fasse (selon ce qui est notifié dans l'acte
consulaire à ce propos)38. Il est ainsi malaisé de
déterminer s'il est coutumier que les personnes tirant un plus grand
avantage d'une infrastructure, pourtant à usage collectif, participent
financièrement à sa réalisation. Ce qui semble cependant
certain est le fait que le critère de choix des personnes qui devront
contribuer aux travaux est fondé sur la proximité entre les
possessions de ces individus et la structure en question. Il n'est donc jamais
envisagé de demander de l'argent, par exemple, à des marchands
bateliers qui bénéficieraient pourtant de la réalisation
d'un nouveau port au moins autant que les voisins de celui-ci.
Les échevins prennent parfois leurs précautions
avant de contraindre des propriétaires à contribuer
financièrement ou à réaliser eux-mêmes des travaux.
En effet, dans le cadre de l'édification du port de Roanne en 1538-1539,
le consulat envisage de « faire rue et passaige commun »39
le long des quais, entre le pont de Saône et ce nouveau port, mais il
réclame le soutien du roi car il est nécessaire que les
propriétaires des maisons à proximité acceptent de faire
des travaux devant chez eux afin de réaliser ce chemin. Or, ces
particuliers possèdent de « belles et sumptueuses maisons » et
les échevins semblent hésiter à leur demander une
contribution, probablement car il s'agit de personnes importantes.
François Ier demande au sénéchal de Lyon de s'assurer que
les travaux soient effectués et lui indique qu'il doit, si
nécessaire, « contraindre tous ceulx [...] ayans leurd. maisons sur
lad. riviere »40 à financer la réalisation du
chemin permettant l'accès au nouveau port de Roanne.
37 AML, DD 335, pièce 1, acte consulaire du
mardi 5 septembre 1508.
38 AML, DD 339, pièce 34.
39 AML, DD 340, pièce 12, travaux
évoqués dans une lettre royale du 25 novembre 1538.
40 AML, DD 340, pièce 12, lettre royale du 25
novembre 1538.
Enfin, un dernier cas de figure est à présenter
; il s'agit du financement de travaux par des particuliers non contraints. En
effet, au début du XVIe siècle, des particuliers
souhaitant réaliser des aménagements de leurs habitations,
situées à proximité du port Chalamont, sur la rive gauche
de la Saône, obtiennent l'autorisation du consulat à condition
qu'ils réalisent quelques travaux aux abords du port. Ces
propriétaires, qui souhaitent agrandir leurs maisons, doivent ainsi
« faire une levée a niveau dudit Port de Rue Chalamont qui sera
chemin et passage Public, lesquels mur et levée seront tenus avoir fait
préalablement avant de commencer de faire leursdits Batiments
»41. Ils sont donc autorisés à faire les travaux
qu'ils souhaitent mais ils doivent d'abord aménager les accès au
port Chalamont, probablement afin de ne pas rendre celui-ci impraticable. En
1517, les mêmes voisins du port Chalamont demande au consulat « la
permission de paver ledit port, chacun devant sa maison »42 ce
qui leur est évidemment autorisé. Enfin, en 1520, Vincent
Prothonaris, habitant également à proximité de ce port,
souhaite lui aussi, comme ses voisins, agrandir sa maison. Comme pour les
autres propriétaires, le consulat lui donne l'autorisation d'effectuer
ses travaux si, en contrepartie, il aménage l'accès au port. De
plus, Vincent Prothonaris promet « donner par aulmone au Grand hospital du
Pont du Rhone la somme de vingt livres tournois »43.
Plusieurs combinaisons de financement existent donc pour les
travaux portuaires. En général, soit le consulat s'acquitte des
frais (achat des matériaux et salaire des ouvriers) soit il demande la
contribution des propriétaires des maisons qui sont à
proximité du lieu des travaux. Une seule fois au cours du siècle,
des particuliers s'opposent à ce système et refusent de
participer financièrement aux réparations d'un port, en
l'occurrence à celles du port Chalamont. Au mois d'août 1591, le
consulat fait appel au siège présidial de Lyon, expliquant que
« comme le port appellé de Rue Chalamon soit en telle ruyne que si
bien tost il n'y est pourveu il demeurera inutile non seulement pour le
publicque, Mais mesmes a ceulx qui ont maisons bouticques et magasins voysings
», il est nécessaire de procéder aux réparations. De
plus, il est précisé que ce le consulat souhaite que ces travaux
« se
41 AML, DD 335, pièce 2, actes consulaires du
17 janvier et de dernier jour de février 1510.
42 AML, DD 335, pièce 3, acte consulaire du
mardi 27 avril.
43 AML, DD 335, pièce 3, acte consulaire du
mercredi 11 janvier 1520.
facent aux despens desd. voysins et que ainsi de tous temps a
esté praticqué en ceste ville »44. Ce recours
à l'institution présidiale, dont le principal rôle est
judiciaire, implique nécessairement que la municipalité lyonnaise
est en conflit avec les propriétaires des maisons situées pres du
port. Le 27 août 1591, le différend est tranché en faveur
du consulat puisqu'il est décidé que les propriétaires de
ces maisons devront « supporter et payer les serviz des repparations quil
y conviendra faire »45.
Des le 3 septembre suivant, le consulat nomme deux commis qui
sont chargés de déterminer le prix des travaux « à
faire au port chalamont Et en apres convenir avec les proprietaires des maisons
qui sont proches »46. Il semble qu'aucun accord n'ait
été trouvé car par c'est un lieutenant du roi, le 18
septembre 1591, qui informe par lettres les vingt-huit propriétaires des
sommes qu'ils devront chacun débourser et qui en assigne vingt-cinq
à comparaître au siege présidial le lendemain47.
Les propriétaires se plaignent alors de la répartition des frais
; Jane Rochette, par exemple, est prête à contribuer « mais
Il fault que ce soit avec la raison » et elle met en avant le fait que
François Bernart, « qui tient la maison de feu daniel seguin [...]
qui en doibt plus que [...] les autres Et neanlmoings il est le moings
cottizé »48. Toute discussion est rompue le
1er octobre de la même année car les membres du siege
présidial décide que les propriétaires doivent payer ce
qui leur est demandé et un sergent royal doit, en cas de refus
d'obtempérer, les contraindre « par prinse saisye vente et
dellivrance de leurs biens »49. En 1596, les travaux semblent
avoir été effectués car les maçons et charpentiers
ont été rémunérés50 mais
l'affaire n'est toujours pas réglée car un « Estat des
restans a paier leur cottization pour la construction du port de Rue Challamon
»51 est réalisé par Dominique Dufour, receveur
des deniers de la ville ; neuf propriétaires ne se sont alors toujours
pas acquittés des sommes qui leur sont demandées depuis cinq
44 AML, DD 335, piece 8, lettre du consulat au siege
présidial daté du mois d'août 1591.
45 AML, DD 335, piece 10, acte du siege
présidial du mardi 27 août 1591.
46 AML, DD 335, piece 11, acte consulaire du mardi 3
septembre 1591.
47 AML, DD 335, piece 12, document du 18 septembre
1591.
48 AML, DD 335, piece 13, acte du siege
présidial du 19 septembre 1591, pages 6 et 7.
49 AML, DD 335, piece 17, document du siege
présidial « au premier huissier ou sergent royal requis »,
daté du 1er octobre 1591.
50 AML, DD 335, piece 40, compte de Dominique Dufour
pour les travaux du port Chalamont, pages 7 à 14.
51 AML, DD 335, piece 50.
ans. D'autres complications, qui ne concernent pas directement
notre étude, prolonge l'affaire. Celle-ci n'est résolue qu'au
début du XVIIe siècle.
Les différents travaux effectués aux ports qui
sont le long de la Saône, à Lyon au XVIe siècle
sont, en général, décidés par le consulat. Celui-ci
ne prend pas toujours en charge leur financement puisque la contribution des
Lyonnais qui résident à proximité des lieux à
aménager ou à rénover est souvent requise. A la fin du
siècle, le consulat, soutenu par les instances judiciaires, semble
appliquer systématiquement un principe que l'on peut qualifier «
d'intérêt public à tendance particulière » car,
selon lui, chacun bénéficie des nouvelles réalisations
mais surtout ceux qui vivent à proximité. Ainsi, il semble admis
par les autorités que les particuliers qui devraient tirer le plus de
profit d'une construction ou d'une rénovation de port doivent participer
aux frais qui en découlent. Le recours à un financement
privé pour des travaux dont le profit est collectif n'est pas
caractéristique des édifices fluviaux, ni du XVIe
siècle, ni de la ville de Lyon. En effet, selon Marcel Prade, le 5 avril
1399, des « lettres royales mettant à la charge des
propriétaires, même privilégiés, l'entretien du
pavé de la ville de Paris »52 sont émises. Il
semble donc s'agir d'une procédure plutôt classique.
52 PRADE, Marcel, Les ponts, monuments
historiques, Poitiers, Editions Brissaud, Collection Art et Patrimoine,
1986, page 16.
Conclusion Chapitre V
Les berges de la rivière sont un espace dans la ville
dont la caractéristique principale est d'être le lieu de
transition entre l'eau et la terre. Ainsi, les différents types
d'accès à l'eau, particulièrement les ports,
revêtent une importance particulière puisqu'ils permettent de lier
les activités fluviales et terrestres, notamment le trafic de
marchandises. Le développement économique de la ville dès
la fin du XVe siècle entraîne deux conséquences
principales en ce qui concerne les structures portuaires. La premiere, qui
accompagne l'essor des échanges commerciaux, est évidemment la
nécessité de disposer de ports praticables et suffisamment
nombreux afin de permettre une fluidité des ruptures de charge
malgré le changement de support. La deuxième conséquence
est l'augmentation supposée de la capacité de financement du
consulat. Comme celui-ci est responsable, entre autres choses, de l'entretien
de la voirie, si ses possibilités financières s'accroissent l'on
peut supposer que cela a des répercutions sur les aménagements
urbains en général.
Le nombre de ports sur la Saône croît en effet
à partir de la fin du XVe siècle et les phases de
réparations et de constructions sont régulieres jusqu'en 1569
(travaux au port Saint-Vincent) ce qui suppose une implication certaine des
autorités dans les aménagements portuaires même si la ville
a parfois recours à des financements privés. Dans le dernier
tiers du XVIe siècle, une seule phase de travaux semble
être effectuée ; il s'agit de la restauration du port Chalamont
dans les années 1590 que le consulat n'envisage pas de financer
lui-même. La fin du siècle semble donc se caractériser par
un désintérêt politique des structures portuaires. Le
contexte politique troublé et le déclin économique de Lyon
peuvent probablement expliquer cet état de fait. Il faut cependant
préciser que les ports sur la Saône sont déjà
nombreux et il ne semble pas surprenant que d'autres constructions n'aient pas
été effectuées53. De plus, les ports ne sont
pas les seuls édifices qui résultent de la présence d'une
rivière au coeur de la ville ; pour mesurer l'implication politique dans
la gestion fluviale, il convient d'étudier également les
structures qui permettent de traverser la rivière.
53 Un plan de Lyon placé en annexe 2
résume les phases de construction et de travaux portuaires au
XVIe siècle.
Chapitre VI : Franchir la Saône à Lyon
La rivière de Saône traverse la ville de Lyon et
la partage en deux centres urbains qu'il semble fondamental de relier. De ce
point de vue, la rivière constitue un obstacle aux déplacements
dans la ville puisque il faut la franchir pour passer de la presqu'île
à la partie antique de Lyon, que l'on nomme aujourd'hui « Vieux
Lyon », c'est-à-dire pour passer du côté de la colline
de Fourvière et de la primatiale Saint-Jean ou, bien sûr, pour
faire le trajet inverse. L'objet d'étude de ce chapitre est donc la
présentation des différents moyens de franchir la rivière
et particulièrement des infrastructures qui permettent la
traversée de la Saône c'est-àdire les ponts. En effet, la
principale voie de passage d'une rive à l'autre de la Saône est le
pont de pierre que nous présenterons dans un premier temps. Puis, nous
nous intéresserons à un second pont, en bois cette fois,
jeté sur la rivière au cours du XVIe siècle
ainsi qu'aux moyens secondaires qui permettent la traversée. Enfin, nous
élargirons notre analyse aux enjeux de la circulation dans la ville en
général, donc en présentant ces structures fluviales dans
une politique urbanistique plus globale.
A. Le pont de pierre
Un pont est construit à Lyon sur la Saône
dès le XIe siècle. En effet, selon Léon Boitel,
l'archevêque de Lyon Humbert Ier (vers 1048-1077) souhaitait
la réalisation d'un pont permanent sur cette rivière ; il serait
donc l'instigateur de cette construction1. L'historien lyonnais du
XVIe siècle Claude de Rubys, s'appuyant sur les propos de
Guillaume Paradin (l'un de ces auteurs a pu inspirer Léon Boitel),
explique lui aussi que l'édification de ce pont résulte de la
volonté de l'archevêque Humbert et ajoute que la construction date
de l'année 10602. Ces informations sont
complétées par Jean-Baptiste Roch, auteur d'une Histoire des
ponts de Lyon, qui considère que la pont « commencé en
1050, [...] fut inauguré en 1076 par Humbert Ier »3. Cet
auteur fournit même des détails tels que la construction a
été « réalisée avec les pierres de monuments
romains abandonnés » et ce pont comptait des « arches
irrégulières, au nombre de huit »4.
Ce pont, que l'on appelle simplement « pont de
Saône » ou « pont de pierre » au XVIe
siècle (car le pont qui est sur le fleuve n'est construit totalement en
pierre que dans la seconde moitié du siècle5) est le
principal moyen de franchir la Saône. C'est d'ailleurs pour cela que le
nom « pont de Saône » lui convient encore au XVIe
siècle puisqu'il s'agit du seul pont lyonnais jeté sur cette
rivière jusqu'au siècle suivant, ainsi, pour les contemporains,
il n'est pas nécessaire de préciser sa position spatiale dans sa
dénomination. Il semble cependant utile de rappeler que ce pont reliait
la place du Change (rive droite) et les quais qui sont à
proximité de l'église Saint-Nizier. Nous allons donc nous
intéresser à cette grande structure de pierre, à son
aspect et à ses caractéristiques mais aussi aux
réparations qu'il subit au cours du XVIe siècle. A
l'instar de l'étude des rives et particulièrement des ports, il
convient de s'intéresser à l'implication du pouvoir consulaire
dans l'entretien de cet édifice.
1 BOITEL, Léon (dir.), Lyon ancien et
moderne, tome 2, Lyon, éditeur Léon Boitel, 1843, page
440.
2 RUBYS, Claude de, Histoire véritable de
la ville de Lyon, Lyon, imprimeur Bonaventure Nugo, 1604, page 263.
3 ROCH, Jean-Baptiste, Histoire des Ponts de Lyon
de l'époque gallo-romaine à nos fours, Lyon, Editions
Horvath, 1983, page 43.
4 Ibid., page 43.
5 BURNOUF, Joëlle, GUILHOT, Jean-Olivier,
MANDY, Marie-Odile, ORCEL, Christian, Le Pont de la Guillotière ;
Franchir le Rhône à Lyon, Lyon, éditions de la
Circonscription des Antiquités historiques, collection Documents
d'archéologie en Rhône-Alpes, n°5, 1991, page 89.
Dans une lettre royale de Louis XII, donc du début du
XVIe siècle, le pont
de Saône est ainsi décrit : « Il y a ung beau
et grand pont de pierre fait et construit
sur lad. riviere de sosne, pour repasser dung lion a lautre,
lequel pont contient dix
grans arcs de pierre bien faiz »6. Cette
citation rappelle aussitôt la fonction première
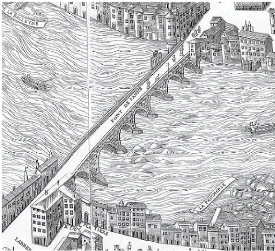
de cet édifice (franchir la rivière) et offre
également une présentation succincte de celui-ci. Il est
mentionné dans ce document que ce pont comprend dix arcs, pourtant, sur
le plan scénographique de 1550, dont un détail est figuré
ci-contre7, huit arcs sont représentés et l'on peut
penser qu'un neuvième arc n'est pas visible car il est caché par
les maisons qui le
recouvrent (au niveau de la descente Est du pont
c'est-à-dire en bas à gauche sur
l'image ci-dessus). Cela est confirmé par une description
de 1598 qui précise que le
pont de Saône « a neuf arches, et chaque arche
environ trente quatre pas de
distance »8.
La distance entre les différents arcs du pont
évoquée dans cette présentation de la fin du
XVIe siècle semble exagérée puisque les arcs
sont réputés être insuffisamment larges pour une navigation
aisée. Cependant, nous ne savons pas exactement les repères qui
ont été utilisés pour arriver à cette distance
moyenne et comme les empattements formés par les piles du pont sont
importants, il est possible qu'en divisant la longueur totale du pont par le
nombre d'arcs qu'il comprend, le résultat s'approche de l'estimation
proposée par cet auteur. Il semble
6 AML, DD 256, pièce 40.
7 CHAMPDOR, Albert, Plan scénographique de
la ville de Lyon au XVIe siècle, Trévoux,
Editions de Trévoux, 1981, montage à partir d'extraits des
planches 8 et 13.
8 Description faite par Jacques Esprinchard en 1598,
cité dans GARDES, Gilbert, Le voyage de Lyon, Lyon,
Editions Horvath, 1993, page 232.
de toute façon difficile de fournir les mesures de cet
édifice au XVIe siècle sans élément de
comparaison et sans information précise.
Une des caractéristiques de ce pont est la
présence de maisons de part et d'autre, sur la première arche,
à l'est comme à l'ouest. L'affaire judiciaire au sujet de la
reconstruction d'une de ces maisons (celle de Françoise Piochet, veuve
Pierrevive) développée précédemment9,
avait révélé l'enjeu juridictionnel
représenté par le pont et les maisons qui s'y trouvent. A
l'origine, il semble que ce pont de pierre sur la Saône dépendait
de l'autorité des seigneurs temporels et spirituels de Lyon. En effet,
Léon Boitel évoque un acte de 1167 « réglant les
droits de l'archevêque et du comte de Forez sur la ville, déclare
le pont commun aux deux seigneurs »10. Mais, on l'a vu, le
voyer de la ville de Lyon « ha la sur-intendance sur la santé de
ladicte ville, pavissement et nettoyement des rues [...] reparations et
entretenement des rues, portz, ponts et passages »11. Ainsi,
l'entretien du pont de Saône relève de la charge du voyer et donc
du consulat puisque celui-ci est un officier au service de la
municipalité lyonnaise.
Les entreprises de réparations du pont de Saône
sont peu nombreuses au XVIe siècle ou de faible importance
car très peu apparaissent dans les archives relatives à la voirie
et un sondage des actes consulaires et des comptes de la ville de Lyon n'a
fourni que peu d'exemples. Deux explications semblent possibles : tout d'abord,
cet édifice est suffisamment solide et ne nécessite que peu de
travaux au cours du XVIe siècle. D'autre part, les
dépenses engagées par le consulat pour le pont du Rhône
sont telles que les finances de la ville ne peuvent supporter des travaux aux
deux infrastructures. En effet, même s'il ne s'agit pas ici de
détailler les phases de réparation et de reconstruction du pont
du Rhône, celles-ci sont extrêmement nombreuses ; il est rare qu'un
année s'écoule sans que des maçons et autres artisans ne
soient recrutés par le consulat pour entretenir ce pont.
9 Cf Chapitre II, C.
10 BOITEL, Lyon ancien..., op. cit., page
441.
11 NICOLAY, Nicolas (de), Généralle
description de l'antique et célèbre cité de Lyon, du
païs de
Lyonnois et du Beaujolloys selon l'assiette, limites
et confins d'iceux païs, Lyon, Société de Topographie
historique de Lyon, 1881 (édition de l'ouvrage manuscrit de 1573), page
142.
De plus, le développement des échanges
commerciaux entre Lyon et la péninsule italienne ainsi que «
l'orientation italienne de la politique française »12,
ont conféré à ce pont, point névralgique de la
circulation vers l'extérieur du royaume, une importance grandissante.
Enfin, les réparations effectués au pont du Rhône sont
financées par les revenus du péage de cet édifice alors
que le pont de Saône n'apporte pas de ressources comparables puisqu'il
est dépourvu de tout bureau de douane. En 1503, par exemple, pour des
travaux au pont de Rhône, le consulat établit un « mandement
de cent livres sur les deniers du pont pour fournir aux réparations
»13. Le financement des travaux effectués au pont du
Rhône est donc garanti par les revenus propres à cet
édifice.
Quelques travaux d'entretien sont tout de même entrepris
au pont de Saône. Il s'agit en général de
réparations ponctuelles comme à la fin du mois de septembre 1501,
lorsque la premiere pile du pont, au bord de la rive gauche, fait l'objet d'un
entreprise de consolidation14. Ces travaux semblent s'assimiler
à de la prévention ; le consulat profite du début de
l'automne, lorsque « les eaues sont basses et petites »15,
pour faire réaliser quelques travaux d'entretien. Des entreprises de
réparations peuvent aussi être effectuées au niveau du
couvrement du pont. Par exemple, au début de l'année 1503, le
consulat décide qu'il est nécessaire de « baisser le
pavé et pent du pont de Saonne [...] jusques au hault dudit pont sans
que les ungs excedent les autres ains tout esgallement »16. Il
s'agit donc d'égaliser le sol et d'adoucir la pente du pont sans doute
afin de faciliter les déplacements sur celui-ci.
La principale phase de réparation du pont de
Saône entraîne un différend entre le consulat et des
particuliers, propriétaires de maisons situées sur le pont, du
côté de l'église Saint-Nizier et de part et d'autre de
celui-ci. En effet, à la fin de l'année 1546, les échevins
s'inquiètent de la fragilité du pont et envisagent d'importants
travaux qui nécessitent la destruction des maisons qui s'y trouvent. Les
propriétaires s'y opposent et l'affaire est portée par le
consulat à la cour de
12 DURAND, Georges, GUTTON, Jean-Pierre, « Les
temps modernes et la Révolution », in Le Rhône et Lyon de
la préhistoire à nos fours, (ouvrage collectif),
Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), éditions Bordessoules,
1987, page 164.
13 AML, BB 024, f° 430 v° (mardi 7 novembre
1503).
14 AML, BB 024, f°331 v° (jeudi 23 septembre
1501).
15 AML, BB 024, f°332 r° (mardi 28 septembre
1501).
16 AML, BB 024, f°394 r° et f°395
r° (mardi 14 février et mardi 21 février 1503).
justice. Le 20 décembre, le juge ordinaire de Lyon
commet des « maistres massons et charpentiers » pour visiter «
les lieux contencieulx le lendemain a deux heures » soit le 21
décembre 154617. Après une contre-visite
demandée par les propriétaires18, le juge condamne
tout de même ces derniers à « demolir et abbatre promptement
lesd. maisons et boutiques et construire des murailles joignant le grand arc
dudit pont de Saonne [...] et en ce faisant oster et arracher dicellui arc
lesd. appes, clavettes de fert et autres lyemens de bois sans faire et porter
aucun dommaige aud. pont »19. Les happes et les clavettes sont
des types d'attaches, comme des tenons, qui permettent de lier deux
éléments entre eux. Elles permettent probablement de fixer les
habitations au pont pour garantir la fiabilité de l'ensemble. Les
propriétaires, en plus de démolir leurs maisons, sont donc
chargés d'enlever toutes traces de ces édifices et de
reconsolider la structure fluviale.
En plus des visites des lieux effectuées à la
fin de l'année 1546 et au début de 1547, plusieurs rapports
d'expertise commandités par les échevins des 1541, et qu'ils ont
fourni à la cour de justice, leur ont permis d'obtenir officiellement
gain de cause. En effet, le 8 juin 1541, par exemple, plusieurs maîtres
maçons (Antoine Betenod, Claude Bousse, Pierre Vaucher et Etyenne
Rolland) sont allés « soubz les arcs et pilles du pont de saonne Et
mesmement sous les boticques de mathieu paris et ses consortz et [après]
lavoir veu et visité, disons que la pille portant lesd. boticques A
besoing destre revailler en plusieurs lieux tant dans leau que dehors pour
lassurance dud. pont »20. Il semble ainsi que la justification
principale de la sentence est la crainte exprimée par le consulat et
plusieurs artisans, maîtres maçons comme charpentiers, d'une
grande usure d'une partie du pont de Saône et donc du danger de son
effondrement partiel.
La sentence est remise en question une première fois
par une partie des propriétaires, le 11 février 1547, mais le
juge ordinaire d'entériner sa décision car il déclare que
« par eminent peril sera executee et mise a entiere execution sellon sa
forme et teneur nonobstant led. appel »21. Un des
propriétaires décide à nouveau de faire appel de la
sentence qui a été donnée. Il s'agit d'Anthoine
Guérin, qui représente ses trois enfants (Claude, Anthoinette et
Ysabeau), bénéficiaires
17 AML, DD 310, pièce 32, sentence du juge
ordinaire du 11 février 1547, qui récapitule toute l'affaire
(citation de la page 5).
18 Une liste de ceux-ci figure en annexe 3.
19 AML, DD 310, pièce 32, sentence du juge
ordinaire de Lyon du 11 février 1547, pages 15 et 16.
20 AML, DD 310, pièce 31, rapport d'une visite
au pont de Saône du 8 juin 1541.
21 AML, DD 310, pièce 32, sentence du juge
ordinaire de Lyon du 11 février 1547, pages 21 et 22.
testamentaires de la maison de Jehan Faure. Les Guérin
ne remettent pas en cause la démolition des édifices mais
considèrent qu'ils n'ont pas à effectuer les travaux
supplémentaires auxquels ils sont contraints. De plus, il n'acceptent
pas d'être « privez apperpetuyté de ny pouvoir Jamais bastir
ny ediffier ny moins appuyer et mectre clavectes et lyemens contre ledit arc
»22. Ils craignent donc simplement d'être
dépossédés de leurs biens, supposant ainsi une
appropriation de cet espace par le consulat.
Dans cette affaire, un rebondissement est fourni par
l'intervention de l'archevêque de Lyon qui s'adresse directement au
sénéchal. Il se présente comme « appelans
»23, au même titre que les propriétaires,
c'est-à-dire que ceux-ci, avec le soutien de l'archevêque, font
appel de la sentence donnée par le juge ordinaire. La défense du
primat est longuement développée. La première critique
formulée concerne le fait que le jugement a été rendu sans
l'avis des seigneurs de Lyon c'està-dire sans consultation de
l'archevêque lui-même ni des chanoines-comtes de Lyon qui se
constituent donc « appellans comme vrays seigneurs directz desd. maisons
et bouticques » et qui considèrent qu'ils « ont esté
grandement grevez et opprimez »24 dans leurs droits. La
sentence et le pouvoir du consulat sont donc directement remis en cause.
L'archevêque ajoute que, de toute façon, il « vault beaucoup
mieux garder, conserver et retenir lesd. maisons » et cela pour plusieurs
raisons. Le premier argument est évidemment la perte qu'une destruction
représenterait pour les propriétaires. Cependant, l'aspect
esthétique est également mis en avant car, selon
l'archevêque, « si elles estoient abatues y auroit grant
difformité en la rue dud. pont contre decore et ornamentum civitatis
»25. En effet, une telle destruction va à
l'encontre de l'harmonie des constructions sur le pont puisqu'une seule
extrémité de celui-ci serait pourvue d'édifices,
cependant, cet argument semble faible si le risque d'affalement du pont est
réel.
C'est justement cela qui est remis en cause par les plaignants
qui considèrent que les rapports des maîtres jurés «
sont insufisans et deffectueux car ils ont esté baillez seulement sur
led. pretendu eminent peril Mais ne furent enquis
22 AML, DD 310, pièce 32, appel en justice
d'Anthoine Guérin du 16 février 1547, pages 23 à 30.
23 AML, DD 310, pièce 35, appel formulé
par l'archevêque, non daté mais postérieur au 11
février 1547 car écrit en réaction à la sentence
définitive donnée à cette date.
24 AML, DD 310, pièce 35, page 3.
25 AML, DD 310, pièce 35, pages 4 et 5.
ne interrogez sil yavoit remede et moyen de reparer
»26. L'archevêque et les propriétaires demandent
à nouveau que des « gens notables et autres maistres massons et
charpentiers expers et non suspectz »27 soient mandés
pour visiter les lieux et trouver une solution alternative à la
démolition. Malgré l'intervention de l'archevêque et le
recours au sénéchal de Lyon, la sentence est renouvelée
par la sénéchaussée puisqu'il a « été
ordonné que lesd. proprietaires feroient entierement abbatre et demolir
leurdittes maisons et boutiques, pour descouvrir la pile dudit pont sur
laquelle elles sont scituées et assises, pour icelle pille faire reparer
»28. Ainsi, la décision de destruction de ces
bâtiments a été entérinée par la
sénéchaussée et les réparations pourront être
effectuées.
Il ne nous est pas possible d'affirmer que cette
décision judiciaire a été effectivement appliquée
mais il est probable qu'elle le fut, au moins partiellement, et que les
réparations ont été effectuées car aucun document
ne révèle d'autres difficultés à ce sujet. Cette
affaire montre que le pont de Saône représente toujours un enjeu
juridictionnel au milieu du XVIe siècle. Les
prérogatives consulaires sur celui-ci semblent tout de même
admises. Il est par ailleurs aisément compréhensible que cet
unique pont sur la Saône, voie de liaison principale entre les deux
coeurs de la ville, ait une telle importance politique. Il ne constitue
cependant pas le seul moyen de franchir la rivière.
26 AML, DD 310, pièce 35, pages 5 et 6.
27 AML, DD 310, pièce 36, défense des
propriétaires des maisons situées sur le pont de Saône, du
côté de Saint-Nizier dans le cadre de leur recours en appel.
28 AML, DD 310, pièce 39, acte consulaire du
jeudi 12 janvier 1548 qui comprend le résumé du jugement en
appel.
B. Les autres moyens de traverser la rivière
Sur l'ensemble du XVIe siècle à Lyon,
il n'existe qu'un unique pont qui permette de traverser la rivière de
Saône. Il peut sembler étonnant qu'un autre édifice de ce
type n'ait pas été réalisé mais les finances
municipales en matière de construction au cours du XVIe
siècle semblent se concentrer sur les fortifications de la ville ainsi
que sur le pont du Rhône. Cependant, ponctuellement en 1546, un
deuxième pont relie les deux parties de la ville. Ce dernier n'a qu'une
vocation provisoire et c'est peut-être pour cette raison qu'il n'est que
rarement évoqué dans les ouvrages d'histoire de Lyon. Dans le
cadre de notre analyse des moyens permettant de franchir la Saône
à Lyon, il est nécessaire de présenter ce deuxième
pont, même s'il ne fut que provisoire, et d'expliquer les raisons de sa
construction en 1546. Il convient cependant au préalable de
présenter les autres moyens habituels qui permettent de franchir la
Saône avant de nous intéresser au pont de bois.
Même si ce sont les infrastructures fluviales qui
constituent l'objet de ce chapitre, il ne faut pas négliger les autres
supports permettant de traverser la Saône qui sont utilisés par
les riverains du XVIe siècle. Il s'agit donc de
brièvement les évoquer afin d'obtenir une présentation
complète mais aussi de mesurer l'importance du pont de pierre par
rapport à celles-ci. La façon la plus évidente de franchir
une rivière, l'usage d'un pont mis à part, est l'utilisation de
bateaux. L'avantage de ces embarcations est la plus grande liberté de
destination puisque la seule contrainte est la possibilité d'accoster au
lieu d'arrivée. Les débarcadères et les ports,
précédemment présentés, sont nombreux le long des
rives de la Saône et permettent donc de franchir la rivière en de
nombreux endroits dans le cadre de la ville de Lyon.
En effet, les personnes « qui veulent passer de l'un
costé de la ville en l'autre, le font par petis basteaux qui sont en
grand nombre sur la ditte riviere, et i a grand plaisir de voir les femmes se
quereler les unes les autres, pour passer ceux qui se présentent
»29. Cette description apporte plusieurs informations. Tout
d'abord,
29 Description de Jacques Esprinchard en 1598,
cité dans GARDES, Le voyage..., op.cit., page 232.
des bateliers ont pour activité quotidienne de conduire
ceux qui le désirent d'une rive à l'autre de la Saône. Cet
état de fait révèle un usage récurrent des bateaux
de ces voituriers sinon ce métier n'existerait pas. Néanmoins, si
les bateliers se disputent les clients, l'on pourrait conclure que ces derniers
sont peu nombreux. Or, le fait que ces barques de transport d'individus soient
« en grand nombre » infirme cette supposition. Ainsi, on peut penser
que les bateliers voués à faire traverser la rivière sont
si nombreux que la concurrence est importante entre eux ce qui ne semble pas
exclure une fréquentation importante de ces embarcations et donc un
recours régulier aux voituriers pour franchir la Saône.
Ce rôle semble, en général, tenu par des
batelières. D'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste Roch décrit les
abords du pont, il évoque « rive gauche, des escaliers en bois
posés le long de la première pile donnaient accès aux
« Bêches » tenues par des marinières
»30. Le fait qu'il s'agisse d'une profession majoritairement
féminine est confirmé par de nombreux documents. Par exemple, en
1546, le chapitre Saint-Jean souhaite que deux bancs soit transporté
d'une rive à l'autre de la Saône ; les chanoines ont recours
à une « batelliere » qu'il rémunère de trois
sous31. Ce service payant n'est évidemment pas utilisé
par tous les riverains puisqu'ils leur suffit d'emprunter le pont pour
traverser la ville, voire certains possèdent sans doute leur propre
embarcation.
Le consulat a parfois recours à ce moyen de transport
pour faire passer des personnes d'une partie de la ville à l'autre.
Ainsi, au mois de mars 1525, « la ville n'ayant pas alors des bateaux lui
appartenant, et pour faciliter aux troupes le rapide passage
»32 de la Saône, les échevins choisissent
d'employer des bateliers à cet effet. Ils décident que « le
cappitaine Jehan Salla et le sieur Edouard grant ordonneront six batelliers au
port de Roanne et aultres six au port saint pol, des plus prudhommes et loyaux
quilz pourront cognoistre pour passer et repasser les gens »33
d'une berge à l'autre en aval de la forteresse de Pierre-Scize soit
plutôt au nord de la ville. Ces bateliers sont
rémunérés pour faire la traversée plusieurs fois
par jour et doivent être disponibles du matin au soir « jusques a ce
que auctrement soit ordonné »34. Un certain nombre de
personnes utilise donc des embarcations,
30 ROCH, Histoire des ponts..., op. cit.,
page 43.
31 ADR, 10 G 572, document produit par le chapitre
Saint-Jean (dépenses pour le jubilé de 1546).
32 NIEPCE, Léopold, rniiiuiilitaire,
Lyon, Bernoux et Cumin, 1897, page 93.
33 AML, BB 044, f°20 v°, acte consulaire du
jeudi 2 mars 1525.
34 AML, BB 044, f°20 v°, acte consulaire du
jeudi 2 mars 1525.
prévues à cet effet, pour traverser la Saône
et les autorités peuvent également y avoir recours.
Un autre moyen de franchir la rivière semble être
mis en place en 1562. En effet, selon Eulalie Sarles, dans le cadre des
nombreux aménagements dans la ville réalisés en 1562-1563
(notamment la construction du port Rontalon sur la rive gauche), un bac est mis
en place, en 1562, pour traverser la Saône35. Il semble qu'il
est installé plutôt au sud de la ville, en aval du pont de
Saône, et légèrement en amont de l'église Saint-Jean
(rive droite) et du nouveau port Rontalon (rive gauche). Il est
nécessaire d'apporter une précision sur la situation
géographique ; en effet, le port Rontalon, qui nous permet de situer le
bac, est en général appelé « port du Roi » par
les auteurs puisqu'il sera effectivement baptisé ainsi mais seulement
à partir de 1574 en l'honneur d'Henri III qui franchit la riviere en
direction de Saint-Jean à partir de cet
embarcadère36.
Si un bac à traille, c'est-à-dire un grand
bateau dont la trajectoire est définie par une corde qui traverse la
rivière et à laquelle il est attaché, est installé
en 1562 de la volonté de l'archevêque ; le consulat, en 1573,
revient sur l'autorisation qu'il avait formulée à ce propos. En
effet, le 7 juillet 1573, lors d'une réunion des échevins, il est
« advisé que pour l'incomodité de la ville [...] le consulat
ny doibt prester aulcun consentement »37. En effet, la mise en
place d'un bac, particulierement d'une traille, peut représenter une
gêne à la navigation, montante comme descendante, car cela permet
de systématiser la traversée de la rivière par une
embarcation lente et imposante (qui permet de « passer les charrettes,
chevaulx et mulletz qui vouldroict traverser »38). Ainsi,
même si un tel dispositif aurait l'avantage de désengorger le pont
de Saône, il représente un obstacle à la navigation et
c'est probablement la raison pour laquelle le consulat s'y oppose en 1573. Il
semble donc qu'il n'est plus question d'un bac sur la Saône des
l'été 1573. Donc, si effectivement il en fut installé un
en 1562, il est supprimé ensuite (l'acte consulaire de 1573 ne permet
pas de déterminer si le bac a été mis en place en 1562
35 KRUMENACKER, Yves (dir.), Lyon 1562 capitale
protestante, Lyon, Editions Olivétan, 2009, page 175.
36 RUBYS, +iLIRirHIériIEFIN ERS.
IEit., page 426.
37 AML, BB 091, f°104 v°, acte consulaire du
mardi 7 juillet 1573.
38 AML, BB 091, f°104 v°, acte consulaire du
mardi 7 juillet 1573.
ou non). Quoi qu'il en soit, pendant la plus grande partie du
XVIe siècle, une telle structure n'existe pas sur la
Saône.
Enfin, le dernier moyen de franchir la Saône qu'il
s'agit de présenter est le pont de bois construit pour une utilisation
ponctuelle en 1546. Il est édifié au mois de juin de cette
année car sa présence est liée à la
célébration d'un jubilé à Lyon. En effet, depuis le
XVe siècle, le pape a accordé à la ville de
Lyon un jubilé à « chaque fois que la fête du
Saint-Sacrement se rencontre avec la fête de saint Jean-Baptiste, le 24
juin »39. Ces fêtes sont plutôt rares (environ une
par siècle) et donc exceptionnelles pour la ville de Lyon. Le premier
jubilé eut lieu en 1451 et celui de 1546 est le suivant. De nombreux
pèlerins viennent à Lyon, à la cathédrale, afin
d'obtenir une indulgence plénière, c'est-à-dire une
absolution de tous leurs péchés, ce qui garantirait une
annulation de leurs peines au purgatoire. Il s'agit donc d'une
célébration importante qui attire de nombreux pèlerins
dans la ville.
En effet, Claude de Rubys explique que pour le grand Pardon et
le Jubilé de la Saint-Jean, en 1546, un nombre substantiel de
pèlerins vient à Lyon notamment de la Bresse, de la Savoie mais
aussi de tout le royaume40. Le chroniqueur Jean Guéraud
estime, quant à lui, que le jubilé de 1546 attire quatre à
cinq cent mille personnes à Lyon41. Ainsi, « pour eviter
la confusion, qu'eust esté, si ceux qui alloyent et venoyent du pardon,
se fussent rencontrés par mesme chemin, pour aller gagner le pont de
Saosne, on fit un pont de boys derrier Saint Iean, sur des batteaux, qui alloit
droict respondre aux degrez, qui sont devant l'Eglise des Celestins
»42. Ces propos sont confirmés par des actes
consulaires. En effet, le 18 juin 1546, les échevins ainsi que des
représentants de la sénéchaussée et de la
primatiale Saint-Jean se réunissent « pour conférer et
donner ordre tant du faict de la politicque que autres quil conviendra et sera
besoing faire pour cause du grand peuple quon pretend estres ict pour ceste
sainct jehan prochain »43.
Ces différentes autorités prennent donc un
certain nombre de mesures pour que le pèlerinage se déroule sans
difficulté aucune. Ils organisent par exemple les
39 BEGHAIN, Patrice, BENOIT, Bruno, CORNELOUP,
Gérard, THEVENON, Bruno, Dictionnaire
historique de Lyon, Lyon, Editions Stéphane
Bachès, 2009, article « jubilé », page 721.
40 RUBYS, Histoire véritable op. cit.,
page 373.
41 BEGHAIN, BENOIT, CORNELOUP, THEVENON,
Dictionnaire historique op. cit., article « jubilé »,
page 721.
42 RUBYS, Histoire véritable op. cit.,
page 373.
43 AML, BB 064, f°140 v°, acte consulaire du
vendredi 18 juin 1546.
conditions de logement des pèlerins, les questions de
ressources en pain ainsi que les mesures de sécurité
nécessaires44. La réalisation d'un pont sur la
Saône est une des mesures définies lors de cette entrevue du
vendredi 18 juin 1546. En effet, « lesd. seigneurs de lesglise ont
pryé et requis lesd. seigneurs conseillers de vouloir faire faire ung
pont de boys [...] pour passer et donner passaige sur saone pour obvyer quil ny
ayt confusion »45. Les échevins acceptent de prendre en
charge la construction de ce pont de bois, qui doit être
réalisé pour le jeudi suivant soit en moins d'une semaine car la
fête de la Saint-Jean est le 24 juin. Ainsi, l'archevêque et les
chanoines-comtes, qui ont plutôt tendance à affirmer leurs droits
sur la rivière et ses infrastructures au cours du XVIe
siècle, au détriment des prérogatives consulaires, donnent
néanmoins la responsabilité de l'édification du nouveau
pont au consulat.
La municipalité lyonnaise se charge effectivement de la
construction de ce pont dont la réalisation est confiée à
Jehan Bas et Loys Bolier. Ces artisans sont rémunérés par
un mandement consulaire du 8 juillet 1546, à hauteur de 60 écus
d'or, « pour avoir faict ung pont de boys de saint Jehan sur saosne tirant
droit a Rontalon »46. Il s'agit d'un pont flottant
c'est-à-dire qu'il est constitué de bateaux attachés les
uns aux autres et surmontés de planches formant une voie empruntable par
les individus. Ce pont est donc réalisé sur la Saône, en
aval du pont de pierre, et relie le quartier Saint-Jean au tènement de
Rontalon. Son utilité est à nouveau évoquée et
même précisée dans un acte consulaire ; il est construit
« parce que le pont de saone de pierre nust esté souffisant pour le
passage du peuple »47. En effet, de façon provisoire,
deux ponts permettent de traverser la rivière ce qui facilite les
déplacements d'une partie de la ville à l'autre. La durée
de la présence de ce pont de bois sur la rivière ne nous est pas
connue mais puisqu'il doit probablement constituer un empêchement
à la navigation, il fut sans doute rapidement démantelé.
De plus, il n'a été réalisé que dans le cadre du
jubilé de l'année 1546, particulièrement pour les jours
d'affluence autour du 24 juin, et perd donc rapidement son
intérêt.
44 AML, BB 064, f°141 r° et v°, acte
consulaire du vendredi 18 juin 1546.
45 AML, BB 064, f°141 v° et f°142
r°, acte consulaire du vendredi 18 juin 1546.
46 AML, BB 065, f°31 v°, acte consulaire du
jeudi 8 juillet 1546.
47 AML, BB 065, f°31 v°, acte consulaire du
jeudi 8 juillet 1546.
Finalement, hormis le pont de pierre, le principal moyen de
franchir la rivière de Saône à Lyon est l'utilisation de
barques. Celle-ci semble plutôt développée puisque
l'activité de certains bateliers est dévolue à cet usage.
Par ailleurs, il est possible qu'un bac à traille soit mis en place dans
la seconde moitié du siècle mais probablement pour une courte
durée. De même, un pont de bois est provisoirement jeté sur
la Saône en 1546 dans le cadre du jubilé de la Saint-Jean afin de
pallier aux difficultés de circulation d'un nombre important de
pèlerins venus pour l'occasion, et donc afin d'assurer une
deuxième voie de liaison dans la ville, qui s'ajoute au pont de pierre.
Ce dernier reste néanmoins le principal lien entre les deux parties de
la ville de Lyon au XVIe siècle.
C. L'enjeu de la circulation dans la ville
Il semble évident que les deux parties de la ville de
Lyon doivent pouvoir être reliées et que la présence d'un
pont est essentielle. Les moyens de franchir la rivière de Saône
sont plutôt limités et le pont de pierre est le principal axe de
communication « entre la ville des Chanoines et la ville des Bourgeois
»48. Plus que cela, le pont de Saône semble constituer un
point névralgique de passage dans la ville de Lyon et c'est ce que nous
allons démontrer. Ensuite, afin de mieux cerner l'importance de cette
voie de circulation et de ses abords, il convient de replacer les enjeux qui se
dégagent ainsi que la façon dont ils sont pris en charge par les
autorités municipales dans la politique consulaire
générale.
De nombreux indices révèlent l'importance
fondamental de circuler sur les deux ponts de la ville, et
particulièrement sur le pont de Saône. En effet, l'on peut penser
que « le regroupement des zones actives autour de l'axe de circulation que
constituent le pont de Pierre sur la Saône, achevé dès 1167
et le pont du Rhône »49 montre que ces édifices constituent
les principales voies de circulation de la ville. De plus, même s'il y a
d'autres moyens de franchir la rivière de Saône, ils sont
probablement d'un usage moins courant et moins aisé que « la rue
dudit pont »50 de pierre. L'on peut en effet assimiler le pont
de Saône à une rue de la ville mais dont l'unicité lui
confère un statut particulier qui laisse escompter une prise en charge
politique prononcée de cet axe.
Or le pont de Saône est également un lieu
stratégique de la ville ; un point névralgique qu'il s'agit, pour
les autorités, de maîtriser. L'historien lyonnais Claude de Rubys
évoque un complot protestant avorté le 4 septembre 1561. Il
explique qu'à la nuit tombée « Maligny et ses gens [...]
s'acheminarent le petit pas droict vers le Pont de Saosne, qui est au milieu de
la ville, resolus de se saisir des deux descentes de ce pont
»51. A la suite de cet épisode, le lieutenant
général de la sénéchaussée, Nery Tourveon,
aurait décidé de faire garder le pont jour et nuit mais
48 ROCH, Histoire des ponts~ op. cit., page
43.
49 BAYARD, Françoise, CAYEZ, Pierre, PELLETIER,
André, ROSSIAUD, Jacques, Histoire de Lyon des origines à nos
jours, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2007, page 351.
50 AML, DD 310, pièce 35, document produit par
l'archevêque de Lyon au sujet des maisons situées sur le pont, du
côté de Saint-Nizier, dont le consulat souhaite la
démolition en 1547.
51 RUBYS, Histoire véritable op. cit.,
page 386.
« il fut contrainct de s'en retourner en France, et
demeura le tout sans effect »52. Donc la réalisation
d'un poste de garde sur cet édifice n'a pas été
effectuée mais, selon Claude de Rubys, elle a été
envisagée. Cet épisode révèle l'importance
stratégique de contrôler le pont de Saône
c'est-à-dire l'édifice central de la ville de Lyon et le moyen
essentiel de la communication de part et d'autre de la rivière. En
effet, se saisir du pont revient à contrôler l'axe primordial de
circulation dans la ville et représente un enjeu politique mais aussi
économique et social puisque cette voie est nécessaire aux
déplacements de part et d'autre de la ville tant des individus que des
marchandises.
La circulation sur le pont de Saône est donc essentielle
et la politique consulaire à son encontre le confirme. En effet, les
affaires judiciaires, précédemment
présentées53, au sujet des maisons situées aux
deux extrémités du pont, ont montré que le consulat semble
défavorable à la présence de ces édifices. En
effet, lorsqu'il s'agit d'un demande de reconstruction d'une maison sur le pont
en 1528, la municipalité s'y oppose, obtient gain de cause d'un point de
vue juridique, et ne cede que suite à l'intervention du comte de
Saint-Pol, lieutenant du roi, donc probablement de façon contrainte. De
plus, lorsque le consulat souhaite la démolition des maisons qui sont
sur le pont, du côté de Saint-Nizier pour effectuer des travaux de
réparations, il n'évoque jamais la possibilité que
celles-ci soient ensuite reconstruites. Même si l'utilité
d'entretenir le pont ne semble pas discutable, l'on peut penser que le consulat
tente de tirer profit de la situation afin que ces maisons gênantes
disparaissent et, par conséquent, que la circulation à
l'entrée du pont soit moins entravée. En effet, ces maisons
« assises sur les piles à chaque extrémité du pont
[...] en rendait l'abord difficile et dangereux »54. Il semble
donc probable que l'enjeu de la circulation sur le pont ait encouragé le
consulat dans ses prises de positions défavorables à la
présence de maisons de part et d'autre de l'édifice.
Celles-ci ne sont pas les seuls éléments qui
empiètent sur la voie de passage que constitue le pont de Saône.
En effet, il « est équipé, dans sa partie centrale, de
52 RUBYS, Histoire véritable~ op. cit.,
page 388.
53 Deux affaires à ce sujet ont
été présentées. Tout d'abord, l'opposition du
consulat à la reconstruction de la maison de Françoise de
Pierrevive en 1528 (Chapitre 2, section 3) puis la volonté du consulat,
en 1547, qu'une partie des maisons du pont soient détruites afin de
procéder à des réparations (Chapitre 6, section 1).
54 BOITEL, Lyon ancien op. cit., page 442.
bancs de pierre disposés le long de ses parapets qui
sont, depuis le XVe siècle au moins, le lieu des changeurs
manuels et des revendeurs. Perpétuellement encombré de mercerie
[...], ils accueillent aussi des aiguiseurs de couteaux »55.
Cette description fournie par Anne Montenach révèle clairement
une occupation diversifiée mais surtout conséquente du pont par
des vendeurs. Elle explique même qu'il « est colonisé par les
colporteurs et les merciers »56. Les autorités,
conscientes de la gêne que ces marchands et leurs étals
représentent pour la circulation sur le pont, tentent de lutter contre
leur présence. Le 4 mars 1556, les représentants de la ville et
de l'archevêché se réunissent à la
sénéchaussée pour traiter ce sujet. Ils décident
à l'unanimité que « ledict pont doit demeurer vuyde et que
lon doibt chasser lesd. merciers, vendeurs, revendeurs, hors d'icelluy pour
laisser le passaige public et commun en liberté »57. Les
marchands qui officient sur le pont, informés de la décision,
viennent se plaindre au consulat le 10 mars 1556, expliquant qu'ils sont cent
vingt vendeurs en ce lieu et qu'il s'agit pour eux du « moyen de vivre et
de nourrir leursd. femmes et enfans »58. Les échevins
restent fermes mais, même s'ils ont été provisoirement
expulsés, les vendeurs reviennent peu à peu sur le pont car ils
constituent toujours une gêne à la circulation au XVIIe
siècle. Ce problème n'est pas caractéristique de la ville
de Lyon puisque selon Jean Mesqui, « en 1555, les édiles de
Grenoble adressaient supplique au roi pour obtenir la destruction des
échoppes fixes sur le pont Vieux, la circulation devenant impossible les
jours de marché »59.
Les échevins tentent donc de rendre plus aisée
la circulation sur le pont de Saône. Celui-ci permet aux individus mais
aussi à des véhicules tels que des charrettes de traverser la
rivière sans difficulté. Il s'agit d'ailleurs de la seule voie de
liaison pour les chevaux et les charrettes et ceux-ci ont besoin d'espace pour
se déplacer. Or, lorsque l'archevêque de Lyon propose la
réalisation d'un bac à traille en face de la primatiale
Saint-Jean, un des arguments qu'il avance est la possibilité de faire
traverser des animaux, des charges importantes et des carrioles grâce
à cette
55 MONTENACH, Anne, Espaces et pratiques du
commerce alimentaire à Lyon au XVIIe siècle, Grenoble,
Presses universitaires de Grenoble, Collection "La Pierre et l'Ecrit", 2009,
page 79.
56 Ibid., page 77.
57 AML, BB 078, f°149 r°, compte-rendu de la
séance à la sénéchaussée, mercredi 4 mars
1556.
58 AML, BB 078, f°153 v° et f° 154
r°, acte consulaire du mardi 10 mars 1556.
59 MESQUI, Jean, Le Pont en France avant le temps
des ingénieurs, Paris, Editions Picard, Collection Grands Manuels,
1986, page 92.
structure. Il semble donc légitime de se demander les
motivations du refus consulaire. La gêne que le bac peut
représenter pour la navigation a déjà été
évoquée, mais l'on peut penser qu'il y a également des
motivations politiques et économiques.
En effet, l'usage du bac est payant c'est-à-dire que
les personnes qui l'utilisent pourront « traverser de laultre
cousté de la Riviere de saosne a la part de fourviere En payant ce que
sera advisé et accordé pour chacunes charrette, cheval ou mulletz
»60. La mise en place du bac s'accompagnerait, en quelque
sorte, de l'établissement d'un droit de passage sur la rivière,
au moins sur les marchandises et les moyens de locomotion si ce n'est sur les
personnes. Les droits de péage sur les rivières sont au
bénéfice des seigneurs ayant la juridiction sur celles-ci. Ainsi,
les avantages de la création d'un bac à Lyon reviendraient
directement à l'archevêque et aux chanoines-comtes de la ville,
qui disposent des droits sur la rivière de Saône. L'on peut donc
supposer que cet élément financier est une des motivations du
refus formulé par le consulat au sujet de l'établissement d'un
bac à traille sur la Saône en 1573.
Enfin, développer la circulation sur la Saône,
par le biais d'un bac ou d'un pont, au niveau de la primatiale Saint-Jean,
n'est peut-être pas à l'avantage du pouvoir consulaire car les
intérêts économiques, jusqu'alors concentrés de part
et d'autre du pont de Saône pourrait partiellement se déplacer
plus au sud de la ville. En effet, une voie d'accès direct au quartier
Saint-Jean se placerait dans la continuité du pont du Rhône et de
la rue de la Barre (qui longe la place Bellecour, au sud de la
presqu'île), aménagée au début des années
1560. Ainsi, les produits qui arrivent dans la ville par le pont du Rhône
pourraient transiter directement vers la partie ouest de Lyon (donc Saint-Jean)
sans forcément passer par le coeur de la ville et le pont de pierre sur
la Saône. Le contrôle de la circulation dans la ville pourrait
être affaiblit et l'emprise du pouvoir consulaire sur la principale voie
de liaison fluviale diminuée.
Il semble que le consulat s'acquitte favorablement de la
présence d'un unique pont permanent dans la ville, qui est sous son
autorité. Il essaye d'en faciliter l'accès et de rendre les
conditions de circulation optimales sur cet axe.
60 AML, BB 091, f°104 v°, acte consulaire du
mardi 7 juillet 1573.
D'ailleurs, il semble que « le principe essentiel de la
« voirie " consiste à fluidifier le trafic tout en
sécurisant les rues [...] ce qui passe par la lutte contre tout
empiètement anarchique sur l'espace ouvert de la ville (rues, places et
ports) "61. Le consulat, responsable de la voirie, est
évidemment préoccupé, comme nous l'avons montré,
par les questions de circulation et donc par l'étroitesse des voies. De
plus, les prémices de la notion d' « espace public »
c'est-à-dire d'un espace qui est à l'usage de tous, qu'aucun
particulier ne peut s'approprier et qui est géré par les
autorités, apparaissent clairement dans les décisions
consulaires. Cette notion est un moyen pour le pouvoir municipal de mieux
maîtriser l'aménagement urbain, le tracé des rues et, par
conséquent, la bonne police dans la ville. Avec le développement
de cette césure entre ce qui est « public ", relevant alors des
autorités, et ce qui est « privé " ou « particulier ",
naissent une vigilance particulière de la part du pouvoir politique et
une lutte contre l'usurpation de l'espace collectif. Les premières
tentatives de règlementation des saillies et des avancées des
bâtiments entrent dans cette logique. Les initiatives, dans ce domaine,
sont encore limitées au XVIe siècle et la politique de
ce que l'on appelle « les alignements " prend peu à peu de
l'ampleur et est une caractéristique du siècle
suivant62.
61 MONTENACH, Espaces et pratiques..., op. cit.,
pages 132-133.
62 BAYARD, CAYEZ, PELLETIER, ROSSIAUD, Histoire
de Lyon..., op. cit., page 350.
Conclusion chapitre VI
Plusieurs façons de traverser la Saône existent
mais le pont de pierre semble en être la principale notamment parce qu'il
constitue la voie privilégiée pour le transport de marchandises
et qu'il est plus aisé de l'emprunter que de franchir la rivière
en bateau. Il s'agit de la seule structure fixe et permanente à cet
usage. De plus, il permet de relier les deux parties principales de la ville,
les deux coeurs économiques de Lyon, mais il permet aussi aux individus,
comme aux biens, de facilement circuler dans la ville. La présence d'un
unique pont sur la Saône explique la concentration des enjeux de
circulation sur lui, enjeux qui dépassent largement le cadre de la
gestion de la Saône même si le pont est un des
éléments les plus probants de l'adaptation d'une
communauté urbaine à la présence d'une rivière qui
scinde son territoire en deux.
Comme l'analyse des pouvoirs qui s'exercent sur la Saône
et les structures qui en dépendent l'avait montré, le pont est un
enjeu juridictionnel convoité par les deux principales autorités
lyonnaises, celle des seigneurs-comtes et celle des échevins. Il ne fait
aucun doute que le pouvoir du consulat s'affirme sur l'édifice puisque
les décisions de justice sont prises à son avantage
c'est-à-dire que les choix urbanistiques qu'il prend, auxquels
l'archevêque et les chanoines-comtes s'opposent, sont
entérinées par les instances judiciaires. De plus, la charge de
l'entretien du pont, comme de la voirie et des infrastructures en
général, dépend clairement du pouvoir consulaire. Les
réparations du pont de Saône semblent de faible ampleur au cours
du XVIe siècle ; il s'agit essentiellement de travaux
d'entretien. La préoccupation principale des échevins lyonnais
est d'assurer la fluidité de la circulation sur le pont. Ainsi, à
l'instar de son action dans tout le cadre urbain, le consulat lutte contre les
éléments qui peuvent constituer un obstacle au trafic et tente,
progressivement, d'affirmer la limite entre l'espace public et l'espace
privé.
Conclusion de la troisième partie
Deux catégories principales d'infrastructures fluviales
ont été présentées ; les ports, c'est-à-dire
les espaces qui font le lien entre la navigation et les activités
terrestres, et les dispositifs permettant de traverser la rivière,
particulièrement le pont de pierre. Les ports lyonnais installés
le long des rives de la Saône sont nombreux et répartis de
façon régulière. Les constructions, entre la fin du
XVe siècle et les années 1560 soit pendant la
période d'essor économique de la ville, complètent les
structures préétablies et permettent à la ville de Lyon de
disposer de nombreux lieux d'accostage et d'embarquement. Les phases de
réparations, quant à elles, ne sont pas négligeables mais
sont tout de même sporadiques au cours du XVIe siècle.
C'est également le cas des travaux d'entretien du seul pont permanent de
la Saône, peu nombreux et de faible ampleur. Olivier Zeller explique, au
sujet de la voirie dans les villes de la période moderne, que les «
modifications [...] ne s'effectuaient qu'au rythme d'actions ponctuelles, [...]
les remodelages de réseaux viaires étaient
généralement limités »63. Cette analyse
correspond effectivement à l'évolution des infrastructures
à Lyon.
Le consulat est à l'origine de l'essentiel des travaux
à usage collectif réalisés à proximité de la
rivière de Saône. Cependant, il ne s'acquitte pas
systématiquement de leur financement. En effet, les échevins
cherchent régulièrement des fonds extérieurs, et
privés, pour assumer les dépenses de construction et de
réparation, prétextant que les particuliers résidant
à proximité des lieux aménagés doivent participer,
parfois sous la contrainte, parce qu'ils tirent un plus grand
bénéfice qu'autrui des travaux effectués. A l'inverse, la
notion d'espace « public » est de plus en plus utilisée et les
échevins tentent d'en limiter l'appropriation par des particuliers, tout
en n'excluant pas que certains d'entre eux contribuent donc à son
entretien. Il semble pour autant délicat d'affirmer que le
63 ZELLER, Olivier, "La ville moderne", in
PINOL, Jean-Luc (dir.), Histoire de l'Europe urbaine, de
l'Antiquité au XVIIIe siècle, Tome 1, Paris, Editions du
Seuil, Collection L'Univers historique, 2003, page 853.
consulat se désintéresse des infrastructures
fluviales. En effet, certaines préoccupations se dégagent et sont
toutes liées, ne serait-ce qu'indirectement, à l'entretien et
à la gestion des ports et du pont. De façon logique, le consulat
est préoccupé par l'état des ports car ils sont
nécessaires aux échanges économiques et sont les liaisons
entre la voie d'eau et le réseau terrestre de transport de marchandises.
Enfin, le pont de Saône, seul accès d'une partie de la ville
à l'autre particulièrement pour les charrettes et les chevaux,
est un axe fondamental de circulation dans la ville. Les autorités
politiques locales, notamment le consulat, s'efforcent donc de faciliter le
trafic sur celui-ci. Il semble cependant que l'intérêt
porté au trafic sur la rivière de Saône et ses berges au
XVIe siècle ne constitue que les prémices d'une
préoccupation grandissante au siècle suivant64.
64 BAYARD, CAYEZ, PELLETIER, ROSSIAUD, Histoire
de Lyon..., op. cit., page 355.
CONCLUSION
Les cours d'eau et leur prise en charge, c'est-à-dire
la gestion des ressources, des risques et le contrôle de la navigation,
représentent un enjeu politique indéniable puisque les
autorités politiques ont toujours intérêt à
surveiller les voies de communication terrestres comme fluviales. La
Saône à Lyon au XVIe siècle n'échappe pas
à cette constatation et sa juridiction est convoitée par
plusieurs autorités. Depuis le Moyen-age, l'archevêque et les
chanoines-comtes de Lyon, seigneurs temporels de la ville, détiennent
les droits sur la rivière dans les limites du territoire sur lequel leur
pouvoir s'étend. Cet état de fait est remis en cause au
début du XVIe siècle car les rois de France tentent,
en vain, de se saisir de la juridiction de la Saône. En effet, dans tout
le royaume, le pouvoir royal affirme peu à peu, à partir du
XVIe siècle, ses prérogatives suprêmes sur les
cours d'eau navigables. Les seigneurs de Lyon gardent leurs droits sur la
rivière qui traverse la ville mais sous la tutelle royale. Ils disposent
ainsi des droits de pêche et des revenus des péages et, à
l'inverse, ont la charge d'entretenir les berges et les infrastructures de la
rivière.
Tous ces aspects théoriques ne s'accordent pas avec les
faits puisque la gestion des affaires courantes de la ville de Lyon, dont les
ouvrages de voirie et tout ce qui a trait à la navigation sur la
Saône, est la compétence du pouvoir municipal lyonnais, le
consulat. Plusieurs différends entre l'archevêque de Lyon et les
chanoines-comtes d'une part, et les échevins d'autre part,
révèlent un glissement des prérogatives sur la
rivière au profit de l'autorité municipale même si le
consulat ne dispose pas officiellement des droits sur la Saône. Enfin, le
roi, lointain seigneur des rivières navigables, intervient tout de
même ponctuellement dans la gestion de la rivière à Lyon,
notamment pour des questions d'hygiène. La présence
régulière de la cour à Lyon pendant une large
moitié du XVIe siècle explique probablement que le
pouvoir royal s'y intéresse particulièrement. Cependant,
l'essentiel des décisions prises par les autorités au sujet de la
Saône à Lyon est soit d'origine consulaire soit appliqué
par le consulat.
A partir de ce constat, il convient de qualifier l'action
consulaire sur la Saône au XVIe siècle. Autrement dit,
il s'agit de déterminer quelles sont les préoccupations
principales des autorités vis-à-vis d'une rivière qui
traverse l'espace urbain lyonnais et même qui le scinde en deux parties
nettement distinctes. Si l'on se penche sur le caractère même de
la Saône, une rivière, les risques liées à sa
présence et à sa situation dans la ville pourraient constituer un
des enjeux de la gestion politique. Néanmoins, la rivière
n'éveille que peu de craintes et les accidents climatiques tels que le
gel ou la crue sont rares. Les autorités ne se préparent pas
à de ces évènements difficilement prévisibles et
semblent agir en aval c'est-à-dire en réparant les
dégâts après les épisodes dévastateurs. La
Saône est plutôt perçue, par les Lyonnais comme par les
autorités locales, comme une rivière familière. Il s'agit
avant tout d'un élément à part entière de la ville
qui a plusieurs fonctions. L'un d'elle résulte d'une des
caractéristiques principales d'un cours d'eau ; sa mobilité et
donc son pouvoir de transporter des hommes et des biens hors de la ville mais
aussi des déchets. La Saône au XVIe siècle est
extrêmement polluée et les autorités encouragent les
individus à déverser leurs détritus dans la rivière
plutôt que de les laisser dans les rues. Elle est donc un remède
à la saleté dans la ville mais, à l'inverse, sa pollution
préoccupe le pouvoir royal notamment pour des raisons sanitaires. Le
consulat tente d'appliquer, en partie, les recommandations des rois mais,
à l'inverse, conseille à la population de ne pas laisser les
déchets sur les rives de la Saône mais de directement les mettre
dans la rivière. Le XVIe siècle ne porte que les
prémices de l'intérêt pour ces questions à
caractère médical et la faiblesse de cette préoccupation
n'est que peu surprenante.
Pourtant, la Saône et ses rives sont extrêmement
fréquentées, de nombreux riverains exercent la profession de
batelier et la rivière est également un lieu de loisirs. Le plan
scénographique de Lyon, réalisé au milieu du
XVIe siècle, en est la meilleure illustration car le nombre
de personnages figurés sur la rivière ou aux abords de celle-ci
est important et leurs activités sont de natures diverses. On peut
même considérer que la Saône est une vitrine de la ville
dans le sens où, lors des festivités qui ponctuent l'année
et des entrées officielles de grands personnages, de grands spectacles
et des jeux nautiques sont donnés sur la rivière. Cependant, la
principale activité qui caractérise la rivière est
évidemment la navigation et particulièrement le transport de
marchandises. La rivière est à la fois le support de
diffusion de produits mais aussi l'un des axes principaux
d'importation de la ville, notamment d'approvisionnement en blé. L'enjeu
de cet axe de circulation dans la ville est tel que le trafic fluvial est
l'objet d'une surveillance et d'un contrôle exercés par les
autorités municipales, tant pour la sécurité de la ville
que pour des préoccupations d'ordre économique. De plus, le
consulat veille à ce que la navigation ne soit pas entravée,
hormis par son contrôle lorsque cela est jugé nécessaire.
Gependant, des actions telles que le dragage du lit de la rivière, qui
permet notamment de faciliter le passage des bateaux lorsque les eaux sont
basses, ne semblent pas être effectuées au cours du
XVIe siècle. Néanmoins, l'importance de la navigation
fluviale pour la ville et les actions menées par les autorités
à son sujet sont indéniables et il semble que la circulation sur
la rivière constitue l'une des principales préoccupations du
pouvoir consulaire. L'usage important de la rivière tant pour la
navigation que pour les autres activités qui y sont pratiquées
confirme que la Saône, plus qu'une rivière dans la ville, est la
rivière de la ville c'est-à-dire un espace parfaitement
intégré au site urbain.
Gelui-ci s'est adapté à la présence de la
rivière et l'aménagement des infrastructures fluviales reste une
préoccupation au XVIe siècle. Le nombre de structures
portuaires s'accroît à cette période et les accès
à l'eau ponctuent densément et régulièrement les
rives de la Saône dès le dernier tiers du XVIe
siècle. Le consulat, responsable de la voirie, est l'instigateur de
l'essentiel des constructions et des aménagements effectués ce
qui confirme à nouveau l'importance de la navigation pour la ville. En
effet, les ports constituent le lien entre la rivière et la ville dans
son ensemble et leur présence est donc fondamentale. S'intéresser
aux modalités de financement de nouvelles structures de ce type et de
leur entretien a permis de s'apercevoir que le consulat fait très
souvent appel à des particuliers afin qu'ils contribuent à ces
dépenses. Cela pourrait constituer une marque d'une forme de
désintérêt de l'aménagement des rives de la
Saône. Gependant, le recours à des fonds privés ne semble
pas être une procédure exceptionnelle. En effet, elle est
pratiquée par les autorités municipales quelle que soit la
conjoncture économique c'est-à-dire aussi bien au début du
XVIe siècle lors de l'expansion économique de la ville
qu'à la fin de celui-ci lorsque les finances de la ville connaissent de
grandes difficultés. De plus, les simples travaux d'entretien, donc de
faible ampleur, sont en général totalement pris en charge par le
consulat.
Ainsi, la ville de Lyon au XVIe siècle est
dotée de nombreux ports répartis sur les deux rives de la
Saône.
A l'inverse, une seule infrastructure permet de traverser la
rivière et d'assurer la liaison entre les deux parties de la ville ; il
s'agit du pont de pierre, réalisé dès le XIe
siècle. Même s'il existe des alternatives au pont pour franchir la
Saône telles que l'usage de bateaux, celui-ci reste la principale voie de
communication de la presqu'île à ce que l'on nomme aujourd'hui le
« Vieux Lyon ». Cela explique qu'il focalise des enjeux politiques
à la fois d'un point de vue juridictionnel, stratégique et
économique. Il semble cependant admis que le pont jeté sur la
Saône relève de l'autorité consulaire et c'est en effet le
consulat qui l'entretient. L'unicité de cette structure permet aux
échevins de maîtriser en partie les déplacements dans la
ville mais comporte l'inconvénient de limiter la capacité de
passage. C'est pour cette raison que, lors du jubilé de la Saint-Jean en
1546, face à l'afflux de pèlerins, il est nécessaire de
réaliser pour l'occasion un pont de bois provisoire permettant de
franchir la Saône. D'autre part, le pont de pierre possède un
second inconvénient : sa situation au coeur de la ville, et le fait
qu'il soit le lieu de passage privilégié d'une partie de la ville
à l'autre, entraîne la présence de nombreux marchands et de
leurs étals qui gênent la circulation. Le consulat, avec le
soutien de l'archevêque, des chanoines comtes et des représentants
du roi à Lyon, tente à plusieurs reprises de les expulser. Les
échevins semblent également hostiles à la présence
de maisons aux deux extrémités du pont qui constituent, elles
aussi, une gêne au trafic puisqu'elles empiètent sur l'espace de
passage.
Au XVIe siècle, les préoccupations
des autorités, particulièrement du consulat lyonnais, au sujet de
la présence d'une rivière dans la ville sont assez peu nombreuses
et la prise en charge n'est que peu diversifiée. Il n'est
néanmoins pas possible de considérer que la rivière
désintéresse les autorités. Au contraire, la Saône
est un espace à part entière de la ville de Lyon mais dont
l'usage principal, la navigation, explique les mesures qui sont
appliquées à la fois pour faciliter la circulation mais
également pour la contrôler. Les chaînes qui sont tendues
sur la Saône constituent le moyen de surveiller les déplacements
sur la rivière et représentent, en quelque sorte, des remparts
fluviaux comme ceux qui entourent une grande partie de la ville de Lyon. La
rivière est prise en charge par les autorités comme une route
traversant la ville. Puisqu'elle représente tout de même un
obstacle pour la circulation, le pont de pierre est
nécessaire mais il est également un axe de communication. Les
ports sont les intermédiaires entre les déplacements terrestres
et fluviaux. La rivière, comme les infrastructures qui en
dépendent sont donc essentiellement des espaces de communication et de
déplacements. Finalement, les enjeux principaux de la gestion de la
Saône à Lyon semblent pouvoir être résumés
à la question de la circulation dans la ville. En effet, si l'on
perçoit la Saône et le pont qui la surplombe comme des voies de
communication au sein de la ville, au même titre que des avenues, on
constate qu'il est possible de lier entre elles la plupart des décisions
politiques qui entrent dans le cadre de la gestion de la Saône à
Lyon.
Annexe 1 - Liste des personnes qui contribuent au
financement de la construction du port du Temple en 1508
Source : AML, DD 335, pièce 1
- Les religieux du couvent Saint-Antoine
- Les frères Tourveon (Jacques et Claude)
- Jacques Barondeau
- Côme de la Porte
- Estienne Guenard
- Michel Fontaine
- Benoît de la Planche
- Simon Boucher (« soufletier »)
- Anthoine Combe (« bolengier »)
- Jean-Gaston Perollier
- Léonard Colomb (« teinturier »)
- M. Dechasses (représenté par M. de Balmont)
Cette liste fournit donc le nom des différents
propriétaires des maisons quisont les plus proches du port du
Temple auxquels le consulat demande une
contribution aux frais de construction de ce nouveau port
installé sur la rive gauche de la Saône en 1508. Les
métiers de trois de ces personnes sont précisés et nous ne
savons pour quelles raisons les autres propriétaires ne sont pas
présentés ainsi.
Annexe 2- Plan de Lyon : récapitulatif des
travaux et des aménagements portuaires effectués sur les rives de
la Saône au XVIe siècle
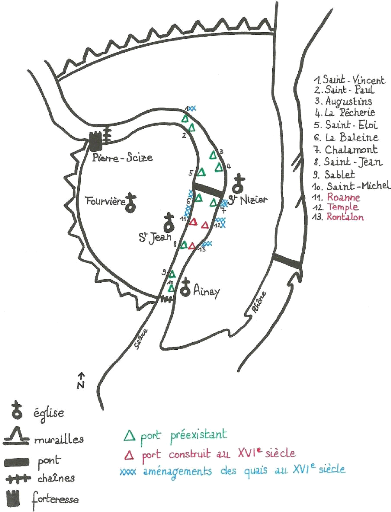
Annexe 3- Liste des propriétaires qui
s'opposent au consulat en 1547 au sujet de la destruction de leurs maisons,
situées sur le pont de Saône
Source : AML, DD 310, pièce 32, pages 1 à
19.
- Les frères Claude et Guinet Thibault
- Claude Buffereau et Barbe Paris (respectivement veuve et fille
de Mathieu Paris)
- Jherosme Guerrier - Humbert Jouvenel - Françoise
These
- Anthoine, Claude, Anthoinette et Ysabeau Guérin
(respectivement le père et ses trois enfants)
- Jehan Laurent
- Maître Barthélémy Faye et Catherine Faye
(sa soeur)
A la fin de l'année 1546, le consulat décide
d'entreprendre des réparations sur la premiere pile du pont de
Saône, du côté de l'église Saint-Nizier. Pour cela,
il décide de la démolition des maisons situées en ce lieu.
Les propriétaires, recensés ci-dessus, s'y opposent et l'affaire
est traitée en 1547 par le juge ordinaire de Lyon puis par la
sénéchaussée. Le consulat obtient gain de cause. Ce
dernier est
représenté, durant toute l'affaire par le
procureur Jehan de la Bessée. Il est
précisédans le document qu'un des
propriétaires, maître Barthélémy Faye est «
conseiller
du roi en la court de parlement à Paris ». Cela mis
à part, aucune information complémentaire n'est fournie au sujet
des différents plaignants.
Sources manuscrites
Archives municipales de Lyon
Série AA : Titres constitutifs et politiques de
la commune ; correspondance générale (1245-1790)
- AA 020 et AA 021 :
Correspondance reçue par la commune (1418 - 1788) - AA 024
à AA 028 : Correspondance reçue par la
commune (1412 - 1788) - AA 150 : Copies de messages
envoyés de la ville de Lyon (1418 - 1497)
Série BB : Administration communale
(1294-1790)
- BB 022 à BB 131 :
délibérations consulaires (1494-1594)
Série CC : Impôts, comptabilité
(1278-1792)
- CC 465 à CC 4047 : comptabilité
municipale
Série DD : Biens communaux, travaux publics,
voirie (1183-1791)
- DD 003 à DD 005 :
Suite de pièces conçues comme justificatives du droit de la ville
qui sont soit dans des cas où la ville a exercé sa
compétence de voirie, soit des actes royaux la confirmant (1475 -
1619)
- DD 256 : Dossier composite, «articles
séparés de directe» concernant les ponts et les quais
- DD 310 : Edifices et ouvrages publics -- Ponts
sur la Saône
- DD 316 : Edifices et ouvrages publics -- Ponts
sur la Saône
- DD 323 : Edifices et ouvrages publics -- Ponts
sur la Saône
- DD 333 à DD 341 :
Quais et ports sur la Saône
Archives départementales du Rhône
Série B I &RXURIT IuUCIFTIRCMSCFiIg
5pHPe
- 5 B : Maîtrise des Eaux et
Forests (1673-1790)
Série G : Clergé séculier
- 10 G : Chapitre primatial Saint-Jean
(861-1852) 10 G 58 : Eaux et forests, broteaux, pesche (1361-1778)
10 G 572 : Jubilés (1500-1666)
10 G 860 : Crues de maisons le long de la Saône
(1257-1620)
10 G 1824 : Saisie par le roi des îles et broteaux du
Rhône et de la Saône dans la juridiction de l'Eglise de Lyon
(1486-XVIIIe siècle)
Série H : Clergé régulier
- 13 H : Grands Augustins (1225-1790)
13 H 18 : Ordonnances du consulat de Lyon au sujet du droit de
port des Grands Augustins sur le quai Saint-Vincent (1603-1639)
13 H 55 : Confrérie des pescheurs et des bateliers :
fondation d'une messe en la chapelle Saint-Nicolas et don d'une vigne ;
contestations et accords (1487-1734)
Sources imprimées
Chroniques et histoires de Lyon
BELLEFOREST, François (de), De l'effroyable et
merveilleux desbord de la rivière du Rhosne en 1570, Lyon, J. Nigon
(imprimeur), 1848 (ouvrage de 1570), 6 pages.
PARADIN DE CUYSEAULX, Guillaume, Mémoires de
l'histoire de Lyon, Roanne, Editions Horvath, 1973 (1e
éd. en 1573), 444 pages.
RUBYS, Claude de, Histoire véritable de la ville de
Lyon, Lyon, imprimeur Bonaventure Nugo, 1604, 527 pages.
Ouvrages comportant des descriptions de Lyon et sa
région
CHAMPDOR, Albert (introduction), Plan scénographique
de la ville de Lyon au XVIe siècle, Trévoux, Editions de
Trévoux, 1981, album de 25 planches.
ESTIENNE, Charles, Guide des chemins de France,
Paris, édité par Jean Bonnerot, 1935-1936 (publication
commentée de la 3e édition datant de 1553), tome 1,
536 pages.
FONTAINE, Charles, Ode de l'antiquité et excellence de
la ville de Lyon, Lyon, Société des bibliophiles lyonnais,
1890 (1e éd. en 1557), 31 pages.
MONTAIGNE, Michel (de), Journal de voyage en Italie
(1580-1581), Paris, Classiques Garnier, 1955, 298 pages.
NICOLAY, Nicolas (de), Généralle description
de l'antique et célèbre cité de Lyon, du païs de
Lyonnois et du Beaujolloys selon l'assiette, limites et confins d'iceux
païs, Lyon, Société de Topographie historique de Lyon,
1881 (édition de l'ouvrage manuscrit de 1573), 283 pages.
Ouvrages juridiques et législatifs
BOUTEILLER, Jean, Somme rural ou le grand coustumier
général de praticque civil et canon, Paris,
Barthélémy Macé, 1603, 904 pages (édition du
manuscrit annotée par Loys Charondas le Caron).
CARDIN LE BRET, De la souveraineté du Roy, Paris,
Toussaincts du Bray, 1632, 709 pages.
CHOPPIN, René, Trois livres du domaine de la couronne,
Paris, Michel Sonnius, 1613, 658 pages.
ISAMBERT, JOURDAN, DECRUSY, ARMET, TAILLANDIER, Recueil
général des anciennes lois françaises depuis l'an 420
jusqu'à la révolution de 1789, Tomes IX à XV
(1438-1610), Ridgewood (New Jersey, U.S.A.), The Gregg Press Incorporated, 1964
(1e édition à Paris entre 1822 et 1833).
LOYSEAU, Charles, Traité des seigneuries, Paris,
Abel l'Angelier, 1608, 398 pages.
LOYSEL, Antoine, Institutes coutumières ou Manuel
de plusieurs et diverses règles, sentences et proverbes, tant anciens
que modernes du droit coutumier et plus ordinaire de la France, Tome 1,
Paris, imprimerie de Crapelet, 1846, 432 pages.
Bibliographie
Ouvrages généraux d'histoire de Lyon
BAYARD, Françoise, CAYEZ, Pierre, PELLETIER,
André, ROSSIAUD, Jacques, Histoire de Lyon des origines à nos
jours, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2007, 955 pages.
BENOIT, Bruno, SAUSSAC, Roland, Histoire de Lyon des origines
à 2005, Brignais, Editions des Traboules, 2005, 281 pages.
BOITEL, Léon (dir.), Lyon ancien et moderne, tome
2, Lyon, éditeur Léon Boitel, 1843, 596 pages.
DURAND, Georges, GUTTON, Jean-Pierre, « Les temps
modernes et la Révolution », in Le Rhône et Lyon de la
préhistoire à nos jours, (ouvrage collectif),
Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), éditions Bordessoules,
1987, 427 pages.
GARDES, Gilbert, Le voyage de Lyon, Lyon, Editions
Horvath, 1993, 385 pages.
GARDES, Gilbert, Lyon, l'art et la ville, Paris,
Editions du CNRS, 1988, 188 pages.
KLEINCLAUSZ, Arthur, Histoire de Lyon, des origines à
1595, (tome 1), Genève, Laffite Reprints, 1978 (1e
éd. en 1939).
NEYRET, Régis (dir.), Lyon, vingt-cinq siècles
de confluences, Paris, Imprimerie nationale Editions, 2001, 253 pages.
NIEPCE, Léopold, Lyon militaire, Lyon, Bernoux et
Cumin, 1897, 638 pages.
Ouvrages et études d'Histoire de Lyon à la
période moderne
Archives municipales de Lyon, Lyon, les années
Rabelais, Dossier des Archives municipales n°6, catalogue de
l'exposition de 1994.
BAYARD, Françoise, Vivre à Lyon sous l'Ancien
Régime, Paris, Editions Perrin, 1997, 352 pages.
BOUCHER, Jacqueline, Vivre à Lyon au XVIe
siècle, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2001, 159
pages.
GASCON, Richard, Grand commerce et vie urbaine au
XVIe siècle ; Lyon et ses marchands, tomes 1 et 2,
Paris, S.E.V.P.E.N., 1971.
KRUMENACKER, Yves (dir.), Lyon 1562 capitale
protestante, Lyon, Editions Olivétan, 2009, 335 pages.
LATREILLE, André (dir.), Portrait de la France
moderne, Histoire de Lyon et du Lyonnais, volume 1, Milan, éditions
Famot, 1976, 291 pages.
MONTENACH, Anne, Espaces et pratiques du commerce
alimentaire à Lyon au XVIIe siècle, Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble, Collection "La Pierre et l'Ecrit", 2009, 415
pages.
ROSSIGNOL, Brigitte, Médecine et médicaments au
XVIe siècle à Lyon, Lyon, Presses universitaires
de Lyon, 1990, 163 pages.
ZELLER, Olivier, Les recensements lyonnais de 1597 et
1636, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1983, 472 pages.
Outils
BEGHAIN, Patrice, BENOIT, Bruno, CORNELOUP, Gérard,
THEVENON, Bruno, Dictionnaire historique de Lyon, Lyon, Editions
Stéphane Bachès, 2009, 1504 pages.
BELY, Lucien (dir.), Dictionnaire de l'Ancien
Régime, Paris, PUF, Quadrige, 2006 (1e éd. 1996),
1408 pages.
CHARLETY, Sébastien, Bibliographie critique de
l'histoire de Lyon depuis les origines jusqu'à 1789, Lyon,
imprimeur-éditeur A. Rey, 1902, 259 pages.
DELFANTE, Charles, PELLETIER, Jean, Plans de Lyon, portraits
d'une ville (1350-2015), Lyon, éditions Stéphane
Bachès, 2006, 153 pages.
Forma Urbis ; les plans généraux de Lyon du
XVIe au XXe siècle, Lyon, Archives
municipales de Lyon, 1997.
GAFFIOT, Félix, Dictionnaire
Latin-Français, Paris, Editions Hachette, 2001, 820 pages.
GOULEMOT, Jean M., LIDSKY, Paul, MASSEAU Didier, Le voyage
en France, anthologie des voyageurs européens en France, du Moyen Age
à la fin de l'Empire, Paris, Robert Laffont, Collection Bouquins ,
1995, 1148 pages.
NICOLAS, Michel (commissaire de l'exposition), Lyon et ses
fleuves ; Les grands travaux d'autrefois, réalisme et utopie,
catalogue de l'exposition des Archives municipales de Lyon, juin-août
1982.
ROSSIAUD, Jacques, Dictionnaire du Rhône
médiéval (1300-1550), Tome 2, Grenoble, Centre Alpin et
Rhodanien d'Ethnologie, 2002, 368 pages.
Société de Savants et de Gens de Lettres, La
Grande Encyclopédie, inventaire raisonné des sciences, des
lettres et des arts, Tome 28, Paris, Société anonyme de la
Grande Encyclopédie, sans date, 1256 pages.
Ouvrages d'histoire de l'eau
ASTRADE, Laurent, "Les crues et les inondations de la
Saône", in La Saône, axe de civilisation, Actes du
colloque de Mâcon (2001), Presses universitaires de Lyon, 2002, 552
pages.
AYALA, Grégoire, Lyon, les bateaux de Saint-Georges :
une histoire sauvée des eaux, Lyon, Editions lyonnaises d'Art et
d'Histoire, 2009, 127 pages.
Bateaux de Saône, mariniers d'hier et
d'aujourd'hui, Chalon-sur-Saône, Société d'Histoire et
d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, 90 pages.
BONNAMOUR, Louis, Archéologie de la Saône,
Paris, co-édition Editions Errance et ville de Chalon-sur-Saône,
2000, 160 pages.
BOURGUENOT, Louis, LEFEBVRE, Raymond etc, Les Eaux et
Forêts du XIIe au XXe siècle, Paris, Editions du
C.N.R.S, collection Histoire de l'administration française, 1990, 767
pages.
LE LOUARN, Patrick, « L'eau, bien commun culturel ?
», in LE LOUARN, Patrick (dir.), L'eau ; sous le regard des
sciences humaines et sociales, Paris, L'Harmattan, collection Logiques
sociales, 2007, 253 pages.
MICHEL, Laurent, La Saône, frontière et trait
d'union ; son histoire, ses riverains, son cours, Saint-Etienne, Editions
Horvath, sans date, 191 pages.
MYNARD, Frantz, « Le fleuve et la couronne : contribution
à l'histoire du domaine fluvial (1566 - 1669) », in LE
LOUARN, Patrick (dir.), L'eau ; sous le regard des sciences humaines et
sociales, Paris, L'Harmattan, collection Logiques sociales, 2007, 253
pages.
RIETH, Eric, Des bateaux et des fleuves,
Archéologie de la batellerie du Néolitique aux Temps modernes en
France, Paris, Editions Errance, collection des Hespérides, 1998,
159 pages.
ROSSIAUD, Jacques, Le Rhône au Moyen Age, Paris,
Flammarion, Collection Aubier, 2007, 648 pages.
Ouvrages d'histoire des villes et de la gouvernance urbaine
BOUCHERON, Patrick, MENJOT, Denis, BOONE, Marc, "La ville
médiévale" in PINOL, Jean-Luc (dir.), Histoire de
l'Europe urbaine, de l'Antiquité au XVIIIe
siècle, Tome 1 (pages 287 à 582), Paris, Editions du Seuil,
Collection L'Univers historique, 2003, 970 pages.
COURBIS, Eugène, La municipalité lyonnaise sous
l'Ancien Régime, Lyon, Imprimerie Mougin Rusand, 1900, 181
pages.
DUMONS, Bruno, ZELLER, Olivier (dir.), Gouverner la ville en
Europe, du Moyen-Age au XXe siècle, Paris, L'Harmattan,
collection Villes, 2006, 183 pages.
LIGNEREUX, Yann, Lyon et le roi ; de la "bonne ville"
à l'absolutisme municipal (1594-1654), Seyssel (Ain), Editions
Champ Vallon, Collection Epoques, 2003, 846 pages.
ZELLER, Olivier, "La ville moderne", in PINOL,
Jean-Luc (dir.), Histoire de l'Europe urbaine, de l'Antiquité au
XVIIIe siècle, Tome 1 (pages 595 à 857), Paris, Editions du
Seuil, Collection L'Univers historique, 2003, 970 pages.
Ouvrages sur le rapport ville-cours d'eau
GUILLERME, André, Les temps de l'eau ; la cité,
l'eau et les techniques, Seyssel (Ain), Champ Vallon, 1983.
LABASSE, Jean, «Réflexion d'un géographe
sur le couple ville-fleuve», in La ville et le fleuve, actes du
colloque de Lyon (avril 1987), Paris, Editions du Comité des Travaux
Historiques et Scientifiques, 1989, 446 pages.
DELLUS, Jean, FREBAULT, Jean, RIVET, Martine, «Lyon,
ville fluviale», in La ville et le fleuve, actes du colloque de
Lyon (avril 1987), Paris, Editions du Comité des Travaux Historiques et
Scientifiques, 1989, pages 37 à 48.
MANDY, Francis, «La navigation saônienne»,
in La ville et le fleuve, actes du colloque de Lyon (avril 1987),
Paris, Editions du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques,
1989, pages 187 à 197.
NICOLAS, Michel (commissaire de l'exposition), Une femme,
deux fleuves, un lion, catalogue de l'exposition des Archives municipales
de Lyon, février-mars 1990.
ROSSIAUD, Jacques, « Fleuve et cité, fête et
frontière : la sensa lyonnaise des années 1500 »,
in BRAVARD, J.-P., COMBIER, J., COMMERCON, N. (dir.), La
Saône, axe de civilisation, Actes du colloque de Mâcon (2001),
Presses universitaires de Lyon, 2002, 552 pages.
ZELLER, Olivier, « La Saône, axe migratoire vers
Lyon au XVIe siècle ? », in BRAVARD, J.-P.,
COMBIER, J., COMMERCON, N. (dir.), La Saône, axe de
civilisation, Actes du colloque de Mâcon (2001), Presses
universitaires de Lyon, 2002, 552 pages.
Ouvrages sur l'aménagement urbain et les
infrastructures fluviales
BURNOUF, Joëlle, GUILHOT, Jean-Olivier, MANDY,
Marie-Odile, ORCEL, Christian, Le Pont de la Guillotière ; Franchir
le Rhône à Lyon, Lyon, éditions de la Circonscription
des Antiquités historiques, collection Documents d'archéologie en
Rhône-Alpes, n°5, 1991, 193 pages.
MESQUI, Jean, Le Pont en France avant le temps des
ingénieurs, Paris, Editions Picard, Collection Grands Manuels,
1986, 303 pages.
MISSOL-LEGOUX, Bernard, La voirie lyonnaise du Moyen-Age
à la Révolution, Lyon, Thèse de doctorat en droit,
1966, 240 pages.
PRADE, Marcel, Les ponts, monuments historiques,
Poitiers, Editions Brissaud, Collection Art et Patrimoine, 1986, 429 pages.
PELLETIER, Jean, Ponts et Quais de Lyon, Lyon, Editions
lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2002, 128 pages.
ROCH, Jean-Baptiste, Histoire des Ponts de Lyon de
l'époque gallo-romaine à nos fours, Lyon, Editions Horvath,
1983, 167 pages.
VIAL, Eugène, "Les voyers de la ville de Lyon", in
Revue d'Histoire de Lyon, Tome 10, année 1911, Lyon, A. Rey et
Compagnie (imprimeurs-éditeurs), 1911, pages 180 à 197.
Table des matières
INTRODUCTION 4
Première Partie : Prérogatives et
juridictions fluviales de l'échelle nationale à la
ville
de Lyon 11
Chapitre I : Le pouvoir royal et les cours d'eau 12
A. Le statut des fleuves et rivières du royaume 13
B. Le roi, seigneur des rivières navigables 18
C. La Maîtrise des Eaux et Forêts 23
Chapitre II : Droits et autorités sur la Saône
à Lyon 30
A. La juridiction de la Saône 31
B. La voirie, une prérogative consulaire 37
C. Chevauchement d'autorités ; l'affaire Pierrevive 41
Deuxième partie : Représentations et usages
de la Saône à Lyon 49
Chapitre III : Perception et gestion des risques 50
A. Une rivière paisible 51
B. Les aléas climatiques 56
C. Pollution de l'eau et risques sanitaires 61
Chapitre IV : Navigation et activités fluviales 68
A. « Esbat et recreation » sur la Saône 69
B. La Saône, un axe de circulation 75
C. Enjeux et contrôle de la navigation saônienne
81
Troisième Partie : Les infrastructures
saôniennes 90
Chapitre V : L'aménagement des berges 91
A. Description des rives de la Saône 92
B. Evolution des structures portuaires 97
C. Financement des travaux aux ports 103
Chapitre VI : Franchir la Saône à Lyon 111
A. Le pont de pierre 112
B. Les autres moyens de traverser la rivière 119
C. L'enjeu de la circulation dans la ville 125
CONCLUSION 133
Annexe 1 - Liste des personnes qui contribuent au
financement de la construction du
port du Temple en 1508 138
Annexe 2- Plan de Lyon : récapitulatif des travaux
et des aménagements portuaires effectués sur les rives de la
Saône au XVIe siècle 139
Annexe 3- Liste des propriétaires qui s'opposent
au consulat en 1547 au sujet de la destruction de leurs maisons, situées
sur le pont de Saône 140
Sources manuscrites 141
Sources imprimées 143
Bibliographie 145
|
|



