Ministère de l'Enseignement Supérieur
République du Mali
et de la Recherche Scientifique
Un Peuple-Un But- Une Foi
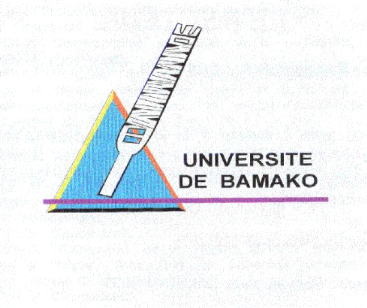
-------------

Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques
(F.S.J.P.)
Mémoire de Fin de
cycle :
La mobilisation des ressources financières dans les
collectivités territoriales du mali : cas de la commune rurale de
Sangarébougou
Thème :
BENGALY Youssouf et
CAMARA Sidy
Présenté et soutenu
par:
Pour l''obtention du diplôme de la
maîtrise
Section droit public, Option interne
M. DIARRA Daouda
Chargé de cours à la FSJP de Bamako
Dr HAÏDARA Hamzata Chargé de cours à la FSJP
de Bamako
Directeur de mémoire :
Membres du jury :
Promotion Droit Public `'Général
Kafougouna KONE'' 2004-2008 Soutenu le 19 /08 /2009 avec la mention bien.
Dédicace I
Je dédie ce présent mémoire à
mon père feu Drissa BENGALY, arraché très tôt
à notre affection. Que ce travail soit pour lui l'un des fruits de
l'arbre qu'il a planté avant de nous quitter.
Nous prions pour le repos paisible et eternel de son
âme.
Youssouf BENGALY
Dédicace II
Je dédie ce mémoire à ma mère
Diaka CAMARA qui a guidé mes premiers pas dans la vie. Maman, l'arbre
que tu as planté a maintenant produit, merci pour tout.
Sidy CAMARA
Remerciements I
Je remercie Dieu Tout Puissant de m'avoir accordé la
bonne santé pour mener à bien mes études et parvenir
à ce seuil considérable. Mes sincères
remerciements vont à l'endroit de l'ensemble des professeurs ainsi
qu'à l'administration de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques (FSJP) de Bamako pour la qualité de l'enseignement qu'ils
nous ont assuré tout au long de notre cursus universitaire.
A notre directeur de mémoire Dr HAÏDARA Hamzata
qui nous a fait un grand honneur en acceptant de diriger nos travaux. Sans
doute, c'est un honneur et aussi un privilège d'être à vos
côtés et de bénéficier de votre
expérience.
C'est aussi le lieu pour moi d'exprimer ma profonde gratitude
à l'endroit des personnes sans lesquelles ce travail serait impossible.
Il s'agit spécialement de : ma très chère
mère Abimata BENGALY qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui ;
Seydou BENGALY, chef de production eau EDM sa Bougouni ; Chata BENGALY,
secrétaire dactylo Société Nimaga Bamako ;
Sékou BENGALY, agent CMDT Dioïla ; Bakary BENGALY, ferrailleur
à Toupah (RCI) ; Maïmouna BENGALY, secrétaire
générale à la mairie de Nongon Souala (Sikasso), Boubou
DANTHIOKO, secrétaire général à la mairie de
Sangarébougou, Karamoko BENGALY, agent comptable IGM Bamako pour leurs
soutiens morals, matériels et financiers.
Mes sincères remerciements vont également
à l'endroit de Karamoko BENGALY, Kamanon BENGALY, chefs de
familles ainsi qu'à tous les membres de la famille BENGALY à
Kléla (Sikasso), Bougouni, Bamako, Toupah (RCI) et autres pour leurs
conseils et leurs appuis.
A mes amis, surtout ceux avec lesquels j'ai partagé les
chambres à l'internat de la FAST qui m'ont toujours compris,
encouragé et soutenu: ce travail est aussi le fruit d'un effort
collectif auquel vous avez directement ou indirectement contribué.
Puisse-t-il être l'expression de mon tendre attachement
amical.
Youssouf BENGALY
Remerciements II
Mes remerciements distingués s'adressent d'abord aux
professeurs de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP)
de Bamako notamment à notre directeur de mémoire Docteur
HAÏDARA Hamzata pour avoir accepté de nous encadrer.
Je remercie très particulièrement mon
père Gagny CAMARA qui a rempli d'une manière exemplaire son
devoir de famille pour que je puisse avoir une bonne instruction, N'baba grand
merci pour tout ; mon cher époux qui n'a ménagé
aucun effort pour la réussite de ce travail, mon meilleur ami Saloum
sidi SACKO qui a été tout pour moi durant ma vie scolaire
à la FSJP, mon frère Lamine CAMARA, sa femme et sa fille Mama,
grand merci pour toute l'aide que vous m'avez apporté durant ma vie
scolaire.
Mes remerciements s'adressent ensuite à toutes les
personnes qui m'ont apporté leur contribution pour ma réussite
scolaire. Il s'agit spécialement de :
- Mon oncle Boubou DATHIOKO pour qui je dis grand merci
pour son soutien morale, matériel et financier durant ma vie
scolaire,
- Ma famille : mes soeurs Iya, Paye, Nakana, Tah,
Camara ;
- Des familles DANTHIOKO à Badianbougou, TEKETE,
DOUCOURE, CAMARA à Missira, BATHILY et CISSE.
Je ne saurais me passer de dire merci à mon tonton et
petit frère Bréhima DIAWARA ainsi qu'à mon
commémorant Youssouf BENGALY
Enfin, je remercie tous les amis, camarades et toutes les
personnes de bonne volonté qui se sont toujours mises à notre
disposition chaque fois que le besoin s'est fait sentir. A toutes ces
personnes, nous leur disons grand Merci.
Sidy CAMARA
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ANICT: Agence Nationale d'Investissement des Collectivités
Territoriales
CCC: Centre de Conseil Communal
CEMAC: Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale
CIFAL : Centre International de Formation des
Autorités/Acteurs Locaux
Com. : Communautaire
CT: Collectivités Territoriales
EDM sa: Energie Du Mali s.a. (société anonyme)
FICT: Fonds d'Investissement des Collectivités
Territoriales
Fonct. : Fonctionnement
IGM: Institut Géographique du Mali
Invest. : Investissement
MEF: Ministère de l'Economie et des Finances
MRC: Mobilisation des Ressources Communales
ONG: Organisation Non Gouvernementale
PACT: Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales
PAGCR: Programme d'Appui à la Gestion des Communes
Rurales
PDESC: Programme de Développement Economique, Social et
Culturel
PDM: Programme De partenariat Municipal
Prév. : Prévisions
Réal. : Réalisations
TDRL: Taxe sur le Développement Régional et
Local
UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
Sommaire
Introduction :...............................................................................................1
Première partie : Les
généralités sur la gestion financière de la commune
rurale de Sangarébougou
Chapitre I : Les ressources
financières de la commune rurale de
Sangarébougou..............................................................................................6
Section 1 : Le cadre légal et la
base des ces ressources.............................................6
Section 2 : Le processus budgétaire
de la commune................................................11
Chapitre II : L'analyse de la
mobilisation des ressources financières dans la commune de
Sangarébougou
...........................................................................................17
Section1 : Le recouvrement des
ressources fiscales..................................................17
Section 2 : L'analyse des recettes de la
commune rurale de Sangarébougou pendant le mandat
écoulé.............................................................................................21
Deuxième partie : Les causes
difficultés de mobilisation et les stratégies de mobilisation de
ressources financières dans la commune
Chapitre I : Les causes des
difficultés de mobilisation des ressources
financières.............30
Section 1 : Les causes relevant de la
gestion de la commune au niveau local....................30
Section 2 : Les causes relevant de la
gestion communale au plan national.......................36
Chapitre II : Les stratégies de
mobilisation de ressources financières dans la
commune...................................................................................................42
Section 1 : Les solutions
préconisées au niveau
local...............................................42
Section 2 : Les solutions
préconisées au niveau
national...........................................45
Conclusion :..............................................................................51
Introduction :
Le Mali est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a entrepris la
réforme de la décentralisation par une refonte complète du
découpage territorial hérité de l'administration coloniale
française. Cette décentralisation a conduit à la
création de sept cent trois (703) communes1(*), à l'élaboration d'un code des
collectivités territoriales2(*), à la création d'une nouvelle
institution de la République (le Haut Conseil des Collectivités
Territoriales) portant ainsi le nombre des institutions à huit ainsi
qu'à l'adoption d'une politique de décentralisation sur la
période deux mille cinq-deux mille quatorze (2005-2014).
On ne saurait bien appréhender notre thème sans
savoir ce qu'est la décentralisation. La décentralisation se
traduit par le transfert d'attributions de l'Etat à des institutions
(territoriales ou non) juridiquement distinctes de lui et
bénéficiant, sous la surveillance de l'Etat, d'une certaine
autonomie de gestion3(*).
Pourtant, la constitution de la 3ème république du
Mali en date du 25 février 1992 ne semble pas donner une
définition de ces institutions appelées
« collectivités territoriales ». Elle se
limite à disposer que : « Les collectivités
territoriales sont créées et administrées dans les
conditions définies par la loi4(*) ». A s'en tenir à la
définition que nous donne le lexique des termes juridiques, les
collectivités territoriales « désignent des
entités de droit public correspondant à des groupements humains
géographiquement localisés sur une portion
déterminée du territoire nationale, auxquels l'Etat a
conféré la personnalité juridique et le pouvoir de
s'administrer par des autorités élues »5(*). Nous pouvons alors
constater que collectivités territoriales et collectivités
locales sont deux expressions qui ne désignent pas la même
réalité. On sait que la notion de collectivité
territoriale est plus extensive que celle de collectivité locale :
l'Etat, collectivité territoriale, n'est pas évidemment
qualifiable de collectivité locale.
Mais, abstraction faite de l'Etat, les collectivités
territoriales sont très exactement des collectivités locales
(qu'elles soient situées à l'intérieur ou à
l'extérieur de la métropole) et il est usuel de les
désigner par cette dernière expression6(*).
L'expression `'collectivité locale''
désigne dans le langage courant ce que la Constitution nomme
collectivité territoriale. Il faudrait seulement comprendre que
les deux expressions se situent dans le cadre de la décentralisation.
La décentralisation se donne comme but la gestion des
affaires locales au niveau local. Elle consiste en un transfert des
compétences qui doit s'accompagner du transfert des ressources
nécessaires pour gérer ces compétences, qu'elles soient
humaines, financières ou matérielles. En d'autres termes, le
transfert des compétences consiste au partage des rôles et des
responsabilités entre l'Etat et les collectivités territoriales,
afin de permettre à celles-ci d'assumer leur mission de conception, de
programmation et de mise en oeuvre des actions de développement. Ce
transfert des compétences implique la mise à la disposition des
collectivités territoriales de ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires relatives à ces
compétences transférées.
Dans ce sens, la loi n° 93-008 du 11 février 1993
modifiée, déterminant les conditions de la libre administration
des collectivités territoriales, dispose que « tout
transfert de compétences à une collectivité doit
être accompagné du transfert concomitant par l'Etat à
celle-ci des ressources et moyens nécessaires à l'exercice normal
de ces compétences7(*) ».
Les ressources financières notamment les recettes
fiscales constituent une des composantes majeures des ressources d'une commune.
Elles constituent avec les ressources humaines et les ressources techniques les
trois types pour la collectivité8(*).
Les communes du Mali, depuis l'extension de la politique de
décentralisation en 1999 semblent connaitre d'énormes
difficultés dans la mobilisation des ressources qui leur sont
attribuées par les textes de la République. Ainsi, les communes,
dans beaucoup de cas, se caractériseraient par un faible niveau de
recouvrement des impôts et taxes, le faible rendement des services
administratifs de la collectivité, la mauvaise gestion des ressources
financières.
Cet état de fait ne saurait rester ainsi. La
nécessité de faire part à l'Etat, aux partenaires
techniques et financiers de la problématique liée à la
mobilisation des ressources financières dans les collectivités
territoriales du Mali justifie notre engouement pour ce thème qui est
d'actualité.
Notre recherche s'inscrit donc dans le cadre des
stratégies efficaces pour rendre la décentralisation surtout
financière effective afin de promouvoir le développement local,
voire national9(*).
Le terme « mobilisation » n'a pas un sens
univoque. Mobiliser, c'est requérir ou faire appel à quelque
chose10(*).
Prise dans notre contexte, la mobilisation des ressources
financières dans une commune est l'action de requérir ou de faire
appel à des fonds pour le développement.
Un thème d'actualité aussi intéressant ne
saurait être mieux appréhendé qu'à travers
l'étude d'un cas spécifique : la commune rurale de
Sangarébougou.
Créée par la loi n°96-059 du 04 Novembre
1996 portant création des communes en République du Mali, la
commune rurale de Sangarébougou est issue de l'ex-arrondissement de
Kalabancoro dans le cercle de Kati (région de Koulikoro)11(*). Avec une superficie de 2 060
km2, elle est limitée au Nord-Ouest par la commune I du
District de Bamako, au Sud par la commune de Moribabougou, à l'Est par
les communes de Dialokorodji et Safo. Elle a une population estimée
à 20 184 habitants en 2001et est constituée de trois
villages peuplés comme suit : Sangarébougou 9 322
habitants, Seydoubougou 5 236 habitants et Sarambougou 5 626
habitants, qui est le chef lieu de la commune. Les femmes occupent les 52 % de
la population, les hommes 48 % et les 49,5 % de la population ont moins de 18
ans. Elle renferme la plupart des ethnies du Mali : Bambara, Peulh,
Malinké, Sénoufo, Sonrhaï, Bobo, Dogon, Maures,
Soninké etc. Les principales religions sont l'Islam (80 à 85 %),
la religion Chrétienne et enfin l'Animisme qui tend vers la
disparition.
Partenaire du programme d'Appui aux Collectivités
Territoriales (PACT/GTZ),12(*) la commune rurale de Sangarébougou ne
demeure pas en reste. Elle est aussi confrontée à des
difficultés de mobilisation qui se répercutent sur ses ressources
financières et tardent ainsi son développement.
Face à ces difficultés, les autorités
communales ont entrepris des actions qui vont des moyens non contraignants
(l'information, la sensibilisation) aux moyens contraignants (les sanctions,
les répressions et les corrections) pour y remédier.
Malgré les actions entreprises au niveau local, on ne
manque pas de constater leur insuffisance pour mobiliser des fonds
nécessaires au développement. Le problème persiste et
devient de plus en plus inquiétant. Le manque de confiance s'installe
entre les responsables de la commune et les populations qui
s'intéressent de moins en moins à la gestion de la commune, le
taux de recouvrements devenant de plus en plus faible etc. Comme
conséquence, le développement de Sangarébougou avance
à « pas de caméléon13(*) ».
Alors cette commune a-t-elle suffisamment des ressources
financières ? Ou est-elle réellement confrontée à
des difficultés de mobilisation ?
- Quel doit être l'état de sa gestion
financière?
- Quelles pourraient être les difficultés
surgissant dans ses actions de mobilisation des
ressources financières ? Ont-elles des causes?
- Quelles pourraient être les solutions pour une bonne
mobilisation des ressources financières dans cette commune ?
Toutes ces questions et bien d'autres feront l'objet de ce
travail dont l'intérêt est d'une manifeste évidence. Ainsi,
l'étude entreprise nous apportera un éclairage particulier sur ce
sujet d'actualité au coeur des débats entre les acteurs du
développement local.
Ainsi, le travail suivant sera subdivisé en deux
parties. La première partie sera consacrée aux
généralités sur la gestion financière de la commune
de Sangarébougou notamment le cadre légal déterminant ses
ressources, sa procédure budgétaire et la
deuxième partie relèvera les difficultés
de mobilisation afin d'en proposer des solutions.
Première partie :
Les généralités sur la gestion
financières de la commune rurale de Sangarébougou
La commune de Sangarébougou dispose d'un budget et des
ressources propres14(*).
Il convient alors d'étudier les ressources
financières internes de la commune (chapitre
I) après quoi nous ferrons une analyse sur la mobilisation
des ces ressources (chapitre II).
Chapitre I : Les ressources financières
internes de la commune
Les ressources financières sont des fonds ou des
sources de revenus dont dispose la commune pour pouvoir subvenir à ses
besoins.
Nous allons d'abord déterminer le cadre légal et
la base de ces ressources (section1) afin de
décrire le processus budgétaire dans la commune de
Sangarébougou (section2).
Section 1 : Le cadre légal et la base de ces
ressources
Pour l'exercice des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, la collectivité territoriale de
Sangarébougou dispose de ressources financières. Elle paye des
indemnités au maire, ses adjoints et les conseillers. Elle paye
également les salaires du personnel de la commune comme le
secrétaire, le régisseur, les autres frais de fonctionnement, de
formation et de déplacements, etc. Elle finance également les
activités telles que soutenir les services de santé et
d'éducation et la contrepartie des 20 % des investissements
accordés par l'ANICT15(*). Ces ressources financières sont le premier
instrument de la politique de développement local qui constitue la
finalité de la décentralisation.
Nous entendons par cadre légal, l'ensemble des textes
législatifs ou réglementaires déterminant les ressources
de la commune (paragraphe 1). En plus de
cela, la commune semble avoir une fiscalité basée sur les Taxes
de Développement Régional et Local (TDRL) (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Le cadre légal
déterminant les ressources de la commune de
Sangarébougou
Les ressources financières de Sangarébougou sont
fixées par :
- La loi n° 93-008 du 11/02/1993, déterminant les
conditions de la libre administration des collectivités territoriales,
modifiée par la loi n° 96-056 du
16/10/1996 ;
- La loi n° 95-034 du 12/04/1995 portant Code des
Collectivités Territoriales en
République du Mali modifiée par la loi n°
98-010 du 15/06/1998 et par la loi n° 98-066 du 30/12/1998 ;
- La loi n° 00-044 du 07 juillet 2000 déterminant
les ressources fiscales des communes, des cercles et des régions.
Cette dernière loi répartit le produit de
certains impôts d'Etat entre les communes, les cercles et les
régions. La partie qui revient à la commune est la
suivante16(*) :
- 60 % des contributions du montant des patentes et licences
;
- 80 % du montant de la taxe de développement
régional et local17(*) ;
- 80 % du montant de la taxe sur le bétail et sur les
armes à feu ;
- 100 % du montant de l'impôt sur les traitements et
salaires des personnes payées sur le budget de la commune et les
démembrements ;
- 60 % de la taxe sur les cycles à moteur :
· de cylindrée de 50 cm3 et au-dessus : 3 000
FCFA par an,
· de cylindrée de 51cm3 à 125 cm3 : 6 000
FCFA par an,
· de cylindrée au-dessus de 125 cm3 : 12 000 FCFA
par an ;
- 100 % de la taxe sur les bicyclettes : 1 000 FCFA par an
;
- 80 % des droits et taxes perçus lors de l'attribution
du titre d'autorisation d'exploitation artisanale de l'or ou d'ouverture de
carrières artisanales18(*) ;
- 50 % des taxes perçues sur le bois à
l'occasion de l'exploitation du domaine forestier de l'Etat.
Selon cette même loi, la commune peut instituer à
son profit des taxes fiscales sur les matières ci-après
citées par délibération du conseil communal faite avant le
1er octobre de l'année précédant celle
à laquelle se rapportent ces taxes19(*). Egalement, le conseil communal peut créer des
redevances en vue de couvrir les frais d'établissement et d'entretien
de ses ouvrages publics. Il s'agirait ainsi des taxes suivantes :
Taxes fiscales relevant de la décision de la
commune20(*)
1. Taxe de sortie sur les véhicules de transport public
de personnes ou de marchandises sortant du territoire de la commune lorsqu'ils
ont été chargés dans la commune : maximum de 1 000 FCFA
par sortie et par véhicule ;
2. Taxe sur les embarcations. Sans moteur : maximum de 2 000
FCFA par embarcation par an, avec moteur : 1 moteur hors-bord : maximum de 10
000 FCFA par an et par embarcation, 2 moteurs hors-bord ou plus : maximum de
20000 FCFA par embarcation par an, 1 moteur fixe ou plus : maximum de 40
000 FCFA par embarcation et par an ;
3. Taxe sur les charrettes. Les charrettes à bras :
maximum de 2 000 FCFA par an, les charrettes à traction animale :
maximum de 7 500 FCFA par an ;
4. Taxe sur les autorisations de spectacles et divertissements
occasionnels : maximum de 10 % des recettes brutes ;
5. Taxe sur les appareils de jeu installés dans les
lieux publics. Appareils automatiques : maximum de 15 000 FCFA par an et par
appareil, autres appareils : maximum de 6 000 FCFA par an et par appareil ;
6. Taxe sur les établissements de nuits, dancings,
discothèques et restaurants avec orchestre : maximum de 50 000 FCFA par
an.
Les emprunts autorisés destinés à
financer des investissements font partie des ressources des
collectivités mais, jusque là, la commune rurale de
Sangarébougou n'a été autorisée à emprunter.
Il n'y a pas encore de réglementation portant fixation des
procédures d'endettement des collectivités territoriales21(*). Les autorités
maliennes devraient y songer car cela semble aussi être capital pour le
développement des communes en général et de celle de
Sangarébougou en particulier.
Au regard de ce fondement juridique des ressources de la
commune, il ressort qu'elle a une fiscalité basée sur les Taxes
de Développement Régional et Local (TDRL).
Paragraphe 2 : Une fiscalité basée
sur les Taxes de Développement Régional et Local
(TDRL)
L'essentiel des recettes fiscales de la commune rurale de
Sangarébougou est constitué de la TDRL. Celle-ci a
été instaurée en remplacement de plusieurs autres petites
taxes. Son montant varie de 875 FCFA à 2 600 FCFA en fonction des
personnes et des années dans les communes comme dans les régions.
Elle est due pour l'année entière par toutes les personnes
âgées de plus de quatorze ans résidant au Mali au
1er janvier de l'année d'imposition ou y fixant leur
résidence dans le courant de l'année d'imposition. Plusieurs
catégories des personnes sont exemptées de la TDRL. Il s'agit
spécialement des catégories de personnes suivantes:
1. « Hommes de troupe ;
2. Indigents. Sont réputés indigents les habitants
sans ressources qui, en raison de leurs infirmités, sont dans
l'impossibilité d'assumer un travail. La situation d'indigent doit faire
l'objet d'une enquête sanctionnée par une décision du chef
d'arrondissement sur proposition du chef de village ou du chef de fraction
après avis du conseil de village ou du conseil de fraction ou par
décision du maire sur proposition du chef de quartier après avis
du conseil de quartier ;
3. Elèves des écoles et étudiants à
temps complet ;
4. Personnes âgées d'au moins soixante ans non
imposables à l'impôt général sur le revenu ;
5. Anciens militaires pensionnés de guerre et invalides du
travail dont le degré d'invalidité est égal ou
supérieur à 50 % et qui ne sont pas assujettis à
l'impôt général sur le revenu ;
6. Personnes qui étaient à la charge d'un
contribuable décédé à la suite d'un accident du
travail, qui touchent une pension à ce titre et qui ne sont pas
assujettis à l'impôt général sur le revenu ;
7. Personnes en traitement régulier pour la maladie du
sommeil, la tuberculose et la lèpre, la dracunculose et le sida ;
8. Agents diplomatiques et consulaires des nations
étrangères sous réserve que les pays qu'ils
représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques
et consulaires maliens ;
9. Mères ayant ou ayant eu quatre enfants et
plus22(*) ».
Une certaine méconnaissance semble exister à
l'égard des personnes exemptées du paiement de la TDRL. Une
idée très répandue dans la commune fait penser à
tort que les salariés fonctionnaires ou contractuels sont
exemptés de la TDRL. De ce fait, ils ne sont généralement
pas inscrits dans les rôles et c'est pourquoi il ne leur est pas
demandé de payer la TDRL. Il convient par ailleurs de rappeler que le
rôle est le document dans lequel sont inscrits la nature de
l'impôt, la matière imposable, le nom et l'adresse du redevable et
le montant dû par chaque redevable.
En revanche, la consécration juridique des ressources
financières et l'existence d'une base déterminée de
ressources fiscales impliquent leur mobilisation pour la commune afin de faire
face à ses dépenses. La commune disposant à cet effet d'un
budget doit suivre un processus dans le cadre de sa gestion financière.
Il s'agirait ainsi du processus budgétaire.
Section 2 : Le processus budgétaire de la
commune
Le processus budgétaire est la démarche suivie
dans l'élaboration et l'exécution du budget de la commune.
Il nous est alors loisible d'étudier d'abord le
processus d'élaboration du budget communal de Sangarébougou
(paragraphe 1) et ensuite son processus
d'exécution (paragraphe 2).
Paragraphe1 : Le processus d'élaboration du
budget communal
Le budget est l'acte par lequel est prévu et
autorisé l'ensemble des charges et des ressources de la commune.
L'année budgétaire commence le 1er janvier et
finit le 31décembre de la même année23(*). Le budget est établi
en équilibre réel avant le 31 octobre et est divisé en
sections, titres, sous-titres, chapitres, articles et paragraphes suivant la
nomenclature du budget de la commune fixée par décret pris en
Conseil des ministres. Il comprend deux parties tant en recettes qu'en
dépenses. La première décrit les opérations de
fonctionnement et la deuxième est relative aux opérations
d'investissements dont la tranche annuelle de réalisation du programme
pluriannuel de développement. Ces opérations d'investissement
font obligatoirement l'objet d'une ventilation sectorielle et spatiale en
fonction de leur localisation.
Le budget peut en outre comprendre des budgets annexes en cas
de besoin.
Un prélèvement obligatoire des recettes
ordinaires du budget est affecté aux dépenses d'investissement.
Mais la loi prévoit que « les taux de ces
prélèvements seront arrêtés annuellement par une
décision de l'autorité de tutelle après consultations du
président de l'exécutif de la
collectivité 24(*)». La collectivité pourrait établir
un budget additionnel en cours d'exercice lorsque les comptes de l'exercice
précédent sont connus. Ce budget est destiné à
corriger et à ajuster les prévisions du budget primitif. Il
comprend les crédits supplémentaires nécessaires en cours
d'exercice, les recettes nouvelles non prévues au budget primitif et les
opérations de recettes et dépenses portées du budget de
l'année précédente. Il doit comporter un chapitre
spécial de crédits destinés à couvrir
le montant des dégrèvements autorisés, des
admissions en non valeur et des cotes
irrécouvrables. Il est établi et voté
dans les mêmes conditions que le budget primitif et appuyé du
compte administratif de l'ordonnateur et du compte de gestion du
payeur.
Le projet de budget est préparé par le maire qui
est l'ordonnateur de la commune de Sangarébougou et soumis au vote de
son organe délibérant (le conseil municipal).
Le vote du budget est précédé d'un débat
public sur le projet de budget. Pour le budget communal, le débat public
doit être précédé d'une consultation des conseils de
villages, de fractions ou de quartiers constituant la commune25(*). Il est ensuite
approuvé par l'autorité de tutelle (le préfet).
Lorsque ce budget n'a pas été
voté en équilibre, l'autorité d'approbation le renvoie
à l'ordonnateur dans un délai de quinze jours qui suit son
dépôt.
L'ordonnateur de la commune le soumet dans les dix jours de sa
réception à une seconde lecture de l'organe
délibérant. Celui-ci doit statuer dans les huit jours, et le
budget est renvoyé immédiatement à l'autorité
d'approbation.
Après cette nouvelle délibération si le
budget n'est pas voté en équilibre ou s'il n'est pas
retourné à l'autorité d'approbation dans le délai
d'un mois à compter de son renvoi à l'ordonnateur, la
faculté de régler le budget revient à l'autorité de
tutelle. Dans chaque cercle, le représentant de l'Etat ayant la charge
des intérêts nationaux et du respect des lois assure la tutelle
des communes urbaines et rurales du cercle26(*).
Lorsque le budget n'est pas approuvé avant le
début de l'année budgétaire, les dépenses de
fonctionnement continuent d'être exécutées jusqu'à
la fin du 1er trimestre dans la limite chaque mois d'un
douzième du budget primitif de l'année précédente.
Passer ce délai l'autorité de tutelle prend les sanctions
disciplinaires.
Le budget annexe doit être soumis aux mêmes
procédures d'établissement que le budget primitif.
Après l'élaboration du budget, il s'en suit
qu'il doit être exécuté afin de le rendre
opérationnel.
Paragraphe 2 : Le processus d'exécution du
budget communal27(*)
L'exécution est l'opération par laquelle le
budget de la commune passe en phase de réalisation. « Le
budget une fois approuvé ne peut être modifié en cours
d'année. Toutefois une modification peut intervenir dans les formes
suivies pour son approbation dans les cas suivants :
· Lorsque des recettes supplémentaires sont
réalisées en cours d'année, des crédits
supplémentaires correspondants peuvent être ouverts sous
réserve des dispositions de l'article 179 du code des
collectivités et par autorisation spéciale du ministre
chargé des Collectivités territoriales.
· Pour insuffisance de crédits de fonctionnement,
des virements peuvent être opérés par l'ordonnateur :
a) d'article à article à l'intérieur du
même chapitre après délibération de l'organe
délibérant de la collectivité;
b) de chapitre à chapitre à l'intérieur
du même sous titre et sur le chapitre des dépenses
imprévues après délibération de l'organe
délibérant et approbation de l'autorité de tutelle.
· Aucun virement ne peut avoir pour objet d'augmenter de
plus de 20 % le crédit initial d'un article28(*) ».
En outre, il s'avère important de signaler que le
budget de la commune ne devient exécutoire qu'après son
approbation par le préfet. Ainsi apparaissent les acteurs du processus
budgétaire de la commune rurale de Sangarébougou :
le maire qui élabore le projet de budget, le
conseil communal qui adopte le budget, le
préfet du cercle Kati qui exerce le contrôle de
légalité sur le budget, le maire et le receveur
municipal exécutent le budget.
A ce dernier niveau peuvent éventuellement intervenir
le régisseur des recettes et le régisseur des dépenses qui
agissent pour le compte du receveur municipal.
Il faudrait par ailleurs noter que le budget
élaboré par la collectivité peut être souvent
rejeté par la tutelle et la perception.
Pour l'exécution du budget, le maire ordonne et le
receveur municipal exécute.
En fin d'année, le maire produit un compte
administratif et le receveur municipal produit un compte de gestion. Le compte
administratif doit refléter la situation réelle des finances de
la commune. Il retrace les opérations réalisées au cours
de l'exercice tant en recettes qu'en dépenses. Il fait aussi
apparaître ce qui reste à réaliser à la
clôture de l'exercice budgétaire (recettes non encore
encaissées et dépenses mandatées non payées).
Il permet ainsi de comparer rubrique par rubrique les crédits
initialement prévus et les réalisations. Il fournit les
informations nécessaires à la préparation du budget
additionnel par la reprise du résultat (excédent ou
déficit) du compte administratif. Le compte administratif est
soumis au contrôle du conseil communal de Sangarébougou. Celui-ci
consiste à vérifier la concordance entre les résultats
dégagés par le compte administratif du maire et le compte de
gestion du receveur municipal.
Ainsi, l'étude des ressources financières
internes de la commune rurale de Sangarébougou nous a permis de
comprendre le fondement juridique de ses ressources ainsi que sa base fiscale.
La connaissance de son processus budgétaire semble aussi être une
condition importante pour comprendre l'analyse que nous nous proposons de faire
sur la mobilisation de ces ressources.
Chapitre II : L'analyse de la mobilisation des
ressources financières dans la commune de
Sangarébougou
Nous entendons par « mobilisation des
ressources » l'action de requérir des fonds pour faire
face aux charges de la commune. Ainsi, pour pouvoir mobiliser des fonds, la
commune de Sangarébougou a besoin de recouvrer les taxes et les
impôts qui lui sont reconnus par la loi portant la libre
administration des collectivités29(*).
Le recouvrement des ces recettes fiscales se veut
indispensable pour la détermination de l'ampleur des recettes de la
commune.
Il nous est alors loisible d'étudier le recouvrement
ces recettes fiscales (section 1) afin d'analyser
d'une manière générale les recettes de la commune
(section 2).
Section 1: Le recouvrement des recettes fiscales de la
commune
Partant du fait que ce recouvrement obéit à un
système et à des modalités, nous examinerons le
système de recouvrement d'une part (paragraphe
1) et les modalités de recouvrement d'autre part
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le système de recouvrement
Le recouvrement des taxes et des impôts était en
vigueur bien avant l'avènement de la décentralisation. Cela
remonte à l'époque coloniale où leur collecte était
déjà une des activités centrales du colonisateur. A cette
époque, l'utilisation de la force, de la coercition et même de
l'humiliation des chefs de village faisait partie du système de
recouvrement. A l'instar des autres Etats de l'Afrique francophone, il convient
de reconnaître que le Mali a hérité, lors de son
indépendance, des règles de fonctionnement de la
comptabilité publique française30(*) : l'émission des impôts et taxes incombe
au service des impôts, leur recouvrement au service du Trésor.
Cependant, le système n'a jamais fonctionné comme prévu
compte tenu de la faible déconcentration des services des impôts
et du Trésor.
D'une manière générale, avant
l'avènement de la décentralisation c'était les chefs
d'arrondissement qui établissaient les rôles et recouvraient les
impôts pour le compte du percepteur dans le cercle de Kati. Actuellement,
la mission d'établissement des rôles revient aux agents de chaque
commune du cercle. C'est ainsi que dans la commune rurale de
Sangarébougou le secrétaire général et
régisseur de recettes assurent le recouvrement qui est fait par ce
dernier. De ce fait, le circuit du rôle des impôts et des taxes se
trouve schématisé de la manière suivante :
Schéma du circuit du rôle des impôts
et taxes31(*)
Etablissement du rôle des
Impôts et taxes par les
Agents communaux
Préfecture
Centre des impôts :
Vérification
Haut commissariat
Signature arrêté d'émission
Direction régionale des
Impôts : vérification
Ce schéma se trouve expliqué de la
manière ci-après :
Lorsque le Haut Commissariat (le gouvernorat)
reçoit le rôle, il le remet à la Direction régionale
des impôts qui, après vérification, prépare
l'arrêté d'émission pour le haut commissaire. C'est donc ce
dernier qui rend le rôle exécutoire. Le rôle rendu
exécutoire est retourné à la commune via la
préfecture, et les agents communaux le transmettent au percepteur pour
recouvrement. Parfois, le processus est lent.
En réalité, le recouvrement des impôts et
taxes semble commencer bien avant l'arrêté d'émission du
rôle.
A l'issu de cet exposé sur le système du
recouvrement, nous pouvons constater que ce n'est pas une chose aisée
compte tenu de sa complexité. Néanmoins, il nous aidera à
comprendre les modalités du recouvrement des impôts et des taxes
de la commune rurale de Sangarébougou.
Paragraphe 2 : Les modalités de
recouvrement
La patente paraît la seule recette fiscale à
être recouvrée par le percepteur, toutes les autres taxes
l'étant par les régisseurs des recettes pour le compte du
percepteur. Il faut souligner qu'un paysan qui doit, par exemple, au titre de
la
TDRL 1 000 FCFA, de la taxe sur le bétail 300 FCFA, de
la taxe sur les vélos
200 FCFA, et de la taxe sur les armes 5 000 FCFA,
considère qu'il doit payer un impôt de 6 500 FCFA. Il ne se
préoccupe pas de la nature des différents impôts que
représentent ces 6 500 FCFA. Le paiement se faisant
généralement par tranche, il peut payer une première
tranche de 4 000 FCFA par exemple, sans se soucier de la nature de la taxe
qu'il a payée. La tâche revient alors au régisseur de
répartir le montant entre la TDRL, la taxe sur le bétail,
etc.32(*)
Depuis la réforme fiscale de 1999, les petits
opérateurs économiques paient un impôt synthétique
dont la patente constitue 10,45 % et la taxe de voirie 0,55 %.
Selon la clé de répartition, 60 % de la patente
et l'intégralité de la taxe de voirie reviennent à la
commune. Ce sont les services des impôts qui recouvrent l'impôt
synthétique et le versent ensuite au Trésor. Au moment du
versement, la commune de résidence de l'opérateur
économique n'étant pas précisée, le Trésor
ne dispose pas de clé de répartition de la recette entre les
différentes collectivités. Généralement c'est
seulement la commune chef-lieu de cercle ou de région qui
bénéficie de la patente et de la taxe de voirie33(*).
Il faut noter que le chef de village est le
personnage-clé du système de recouvrement. Dans la pratique, les
populations paient les impôts au chef de
village qui en retour les reverse aux agents chargés du
recouvrement (chef d'arrondissement autrefois, régisseur des recettes
aujourd'hui). Il existe une forte corrélation entre le niveau du
recouvrement et le leadership du chef de village. Plus le chef de village est
acquis à la cause communale, plus élevé est le taux de
recouvrement34(*).
Un texte réglementaire octroyait aux chefs de village
des ristournes35(*)
calculées en fonction du montant des sommes qu'ils recouvraient. Ce
texte étant dépassé, certains chefs de village ne
perçoivent plus ces ristournes, ce qui est un facteur évident de
démotivation. L'adoption d'une réglementation sur les ristournes
aux chefs de village est nécessaire, de même que sur les
indemnités des receveurs municipaux. Ces indemnités, qui sont une
motivation pour le bénéficiaire, doivent être rapidement
réglementées pour mettre un terme à certaines pratiques
peu orthodoxes en la matière.
L'analyse du système et des modalités de
recouvrement des recettes fiscales de la commune nous a permis de comprendre
ce domaine. Elle nous conduira ainsi à analyser les recettes de la
commune en termes de ressources mobilisées.
Section 2 : L'analyse des recettes de la commune
rurale de Sangarébougou pendant le mandat
écoulé
Les recettes de la commune rurale de Sangarébougou
constituent ce qu'elle a pu mobiliser en tant que fonds. A la lumière de
notre analyse, il ressort que les recettes de la commune rurale de
Sangarébougou sont essentiellement constituées des recettes
fiscales et des recettes issues des prestations de services.
D'une manière cohérente, nous examinerons
d'abord les recettes issues du recouvrement des ressources fiscales
(paragraphe 1) et ensuite les revenus provenant des
prestations de services (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le recouvrement des ressources
fiscales
L'analyse des recettes issues du recouvrement des ressources
fiscales trouve également sa place dans notre démarche
intellectuelle. Dans la commune rurale de Sangarébougou, la situation de
recouvrement par communauté n'est pas disponible en raison du fait
qu'elle ne fait pas de recouvrement de TDRL par village. A s'en tenir à
notre source d'information36(*), les pratiques en la matière sont
fondées sur la perception des recettes au moment de la fourniture des
services comme au moment de la délivrance des actes d'état civil.
Avec ce procédé, les recettes TDRL ne sont pas
comptabilisées par la communauté.
A ce stade, les difficultés identifiées dans le
manuel de formation des élus locaux de la mission de
décentralisation sont entre autres:
- « le peu d'information entre les élus
locaux et le receveur communal sur le recouvrement des ressources ;
- l'absence totale de plan de trésorerie établi
et suivi par les élus et le receveur communal ;
- l'insuffisance des moyens matériels et humains mis
à la disposition des services de recouvrement ...
- la comptabilité budgétaire n'est pas tenue au
niveau de la commune, ce qui ne permet pas d d'avoir une situation clair chaque
mois. Le receveur doit donner la situation des recettes à l'ordonnateur
pour que celui-ci puisse enregistrer et établir à temps son
compte administratif. Il n'y aurait pas ainsi de relation de suivi entre les
services de l'assiette et du recouvrement37(*) ».
Au cours des trois dernières années du mandat
écoulé, il n'a pas eu de réalisation au titre des recettes
sur les patentes/licences dans la commune rurale de Sangarébougou
à causes de certaines de ces difficultés.
Néanmoins, il convient de signaler que les taux de
réalisation d'ensemble décroissent de plus en plus comme le
présente les tableaux ci-après. Il nous sert de soutien logique
pour notre démarche intellectuelle par le fait qu'il nous donne les
recettes de la commune rurale de Sangarébougou perçues à
la perception pendant les trois dernières années du mandat
passé.
Etat des recettes de la commune perçues à
la perception38(*)
Tableau1 :
|
Types de recettes
|
Année N-2
|
Année N-1
|
Année N
|
|
Prévisions
|
Réalisations
|
Taux
|
Prévisions
|
Réalisations
|
Taux
|
Prévisions
|
Réalisations
|
Taux
|
|
Patente/licences
Recettes forestières
Dotation de l'état
Recettes d'investissement/ANIC
|
323 723
151 661
1 267 800
8 030 514
|
0
16 200
1 315 946
11 126 121
|
0%
11%
104%
139%
|
323 723
0
1 267 800
3 171 000
|
0
0
1 355 396
1 606 103
|
0%
#VALEUR !
107%
51%
|
323 723
16 200
1 267 800
12 000 000
|
0
0
1 355 396
4 785 709
|
0%
0%
107%
40%
|
|
Total
|
9 773 698
|
12 458 267
|
127%
|
4 762 523
|
2 961 499
|
62%
|
13 607 723
|
6 141 105
|
45%
|
Entre les prévisions et les réalisations le
déficit semble se remarquer par endroit. Les recettes dépassent
souvent les prévisions contrairement aux attentes des autorités
communales. Fortes de ce constant, les autorités communales, augmentant
les prévisions suivantes, sont souvent déçues de constater
un déficit entre les prévisions et les réalisations.La
situation d'ensemble de la commune se présente comme suit dans le
tableau ci-dessus :
Tableau 2 :
|
Année 2006
Prévisions 11 915
188Réalisations 13 832 190
|
Année 2007
Prévisions25 596
416Réalisations18 987 400
|
Année 2008
Prévisions27 473
200Réalisations10 411 552
|
|
|
|
Alors, il peut être remarqué que les dotations de
l'état dépassent chaque fois les prévisions de la commune.
Le déficit entre les prévisions et les réalisations est
bien remarquable dans les deux dernières années. Ce qui explique
le faible taux de réalisation. Cela peut nous ramener à penser
que les taux de réalisation augmentent ou baissent en fonction des
années.
Le constat d'ensemble sur le recouvrement des recettes
fiscales laisse entrevoir qu'elles ne sont toujours pas à la hauteur des
attentes des autorités de la commune. Ce qui nous exhorte à
analyser les revenus des prestations de services dans la commune.
Paragraphe 2 : Les revenus financiers des
prestations de services
Nos analyses nous prouvent que les revenus des services
rendus par la commune sont issus de la prestation des services administratifs
et de la gestion des équipements marchants.
Les données recueillies auprès de la commune
rurale de Sangarébougou laissent également entrevoir des
déficits sur ces recettes financières. Pour appuyer ce propos, il
s'avère indispensable de les représenter en chiffres. D'où
les tableaux ci-après : le premier présentant les revenus
des prestations des services administratifs et le second représente les
recettes issues de la gestion des équipements marchants.
Tableau 1 : Les revenus des
prestations des services administratifs39(*)
|
Types de services
|
Année 2006
|
Année 2007
|
Année 2008
|
|
Prévisions
|
Réal.
|
Taux
|
Prévisions
|
Réalisations
|
Taux
|
Prévisions
|
Réal.
|
Taux
|
|
Livret de famille/état civil
|
50 000
|
49 000
|
98%
|
100 000
|
47 000
|
47%
|
50 000
|
54 000
|
108%
|
|
Délivrance d'actes d'état civil
|
200 000
|
312 000
|
156%
|
250 000
|
435 000
|
147%
|
500 000
|
450 900
|
90%
|
|
Acte de décès
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
|
Législation,
|
40 000
|
82 500
|
206%
|
60 000
|
381 000
|
635%
|
500 000
|
221 500
|
44%
|
|
Autres actes
|
756 000
|
188 000
|
25%
|
1 500 000
|
494 500
|
33%
|
550 000
|
1 057 000
|
192%
|
|
Total
|
1 046 000
|
631 500
|
60%
|
1 560 000
|
875 500
|
56%
|
1 050 000
|
1 278 500
|
122%
|
La prestation des services administratifs peut être,
à certains égards, génératrice de revenus
financiers pour la commune. Il s'agit entre autres des délivrances
d'actes d'état civil, de livrets ou carnets de famille, des
légalisations, etc. Ces services administratifs ne semblent pas
connaitre de difficultés majeures. La situation péri urbaine de
Sangarébougou n'est pas étrangère à cet état
de fait. Cependant, avec des taux de réalisation de plus de 150% la
question de la maîtrise de ces ressources se pose logiquement40(*).
Tableau 2 : Les revenus issus de la gestion des
équipements marchands41(*)
|
Types d'équipements marchands
|
Année 2006
|
Année 2007
|
Année 2008
|
|
Prévisions
|
Réalisations
|
Taux
|
Prévisions
|
Réalisations
|
Taux
|
Prévisions
|
Réalisations
|
Taux
|
|
Droits des places dans les marchés
|
480 000
|
9 604 150
|
2001%
|
2 500 000
|
11 587 280
|
463%
|
7 189 100
|
875 000
|
12%
|
|
Vente d'eau
|
198 000
|
182 500
|
92%
|
200 000
|
371 535
|
186%
|
942 000
|
1 115 500
|
118%
|
|
Total
|
678 000
|
9 786 650
|
1 443%
|
2 700 000
|
11 958 815
|
443%
|
8 131 100
|
1 990 500
|
24%
|
Les équipements marchands font également partie
des facteurs générateurs de revenus pour la commune de
Sangarébougou. Les revenus issus de leur gestion doit être pris en
compte dans les recettes de la commune.
Dans la gestion des équipements marchands, nous pouvons
constater que le taux de réalisation est plus ou moins croissant en
fonction des années. Cela est peut-être dû à des
facteurs d'ordre économique ou social tels que le faible revenu des
habitants et la démobilisation qui s'est installée dans les
consciences.
Les équipements collectifs marchands des
collectivités sont des infrastructures économiques qu'elles
mettent à la disposition des populations qui les utilisent contre le
paiement d'une redevance. Les principaux services marchands sont les
marchés, les boutiques, les magasins de stockage, les gares
routières, les abattoirs. Ces équipements marchands constituent
les principaux services économiques gérés par la commune
de Sangarébougou et sont des ressources importantes de
financement42(*).
Les recettes susceptibles d'être
générées par ces équipements peuvent couvrir
entièrement les besoins de fonctionnement de la commune et parfois
même de dégager un surplus pour l'investissement. Le recouvrement
de ces recettes relève entièrement de l'autorité de la
commune avec un effet du service (mise à disposition d'un espace
facilement perceptible par le contribuable).
Il semble important de souligner que les équipements
marchands de la commune de Sangarébougou constituent un lieu
privilégié de rencontre entre le secteur formel et le secteur
informel. Ce dernier largement prédominant dans l'économie
rurale, se voit participer au financement du développement de la
collectivité territoriale.
Enfin, ces équipements marchands constituent le point
de rencontre de la quasi totalité des citoyens de la commune de
Sangarébougou. De ce fait, ils susciteraient de l'intérêt
pour les operateurs économiques.
Ils constituent les éléments clés autour
desquels est structuré l'espace communal. Ainsi, leur bonne gestion
devrait être un levier d'impulsion au développement local.
Pourtant, malgré leur importance stratégique, la
gestion de ces équipements marchands ne permet pas de mobiliser les
ressources à la hauteur du potentiel existant qui semble souvent
méconnu.
Il ressort de cette première partie que pour l'exercice
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, la commune
rurale de Sangarébougou dispose de ressources financières. Elle
aurait également besoin de moyens pour financer des activités
telles que soutenir les services de santé et d'éducation et la
contrepartie des 20 % des investissements accordés par l'ANICT43(*). Ces ressources
financières constitueraient le premier instrument de la politique de
développement local.
Par le fait qu'elle n'arrive pas à mobiliser
suffisamment de ressources financières pour pouvoir fonctionner
correctement et investir à fond dans le développement, nous nous
sommes donner la mission de mettre en exergue les difficultés auxquelles
elle est confrontée afin d'en proposer des solutions.
Deuxième
partie :
Les difficultés de mobilisation et les
stratégies de mobilisation des ressources financières dans la
commune rurale de Sangarébougou
La commune rurale de Sangarébougou devrait pouvoir
mobiliser les ressources qui lui sont reconnues par la loi pour son
fonctionnement normal. Faute d'une mobilisation effective elle connaitra des
difficultés financières qui se répercuteront sur son bon
fonctionnement. Dans la visée d'une décentralisation
financière effective, il est indispensable de pallier à ces
difficultés.
D'une manière logique, il s'avère
nécessaire de mettre en exergue ces difficultés dans un
premier chapitre et les solutions préconisées
pour une bonne mobilisation des ressources dans le second
chapitre.
Chapitre I : Les causes des difficultés
de mobilisation des ressources financières
Les causes des difficultés de mobilisation
financières ne pourraient être autres que les facteurs qui ont pu
l'engendrer. Les principaux facteurs de ces difficultés de mobilisation
relèveraient en partie de la commune elle-même et de
l'administration de tutelle de la commune.
Nous examinerons ainsi les difficultés relevant de la
gestion de la commune au niveau local (section 1)
et celles qui relèvent de la gestion communale au niveau national
(l'administration de tutelle) (section
2).
Section 1 : Les causes relevant de la gestion de
la commune au niveau local
La prise en compte de la population dans la gestion des
affaires de la commune apparait comme une donne capitale. Elle peut aussi
s'annoncer comme facteur de mobilisation ou de démobilisation
financière dans la commune. En plus de cela, les autorités
communales y trouvent également leur part de responsabilité.
Nous examinerons ainsi les facteurs des difficultés de
mobilisation tenant à la population (paragraphe
1) avant d'étudier les causes relevant des
autorités communales (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les causes tenant à la
population de Sangarébougou
La population de la commune rurale de Sangarébougou
constitue la base de son développement et devrait ainsi être prise
en compte par les autorités locales et ses partenaires techniques et
financiers. Elle doit participer à la gestion des affaires communales
surtout la gestion financières de la commune. C'est dans ce sens que la
loi n°95-034 AN-RM du 12 avril 1995 portant codes des collectivités
dispose que : « Le vote du budget est
précédé d'un débat public sur le projet de budget.
Pour le budget communal, le débat public doit être
précédé d'une consultation des conseils de villages, de
fractions ou de quartiers constituant les communes44(*) ». Les textes
de lois portant organisation et fonctionnement de la commune lui reconnaissent
une multitude de droits dont elle doit jouir. Il s'agirait ainsi du droit de
participer aux débats du Centre de Conseil Communal (CCC) sur la gestion
de la commune, du droit d'accès aux comptes administratifs et aux
comptes de gestion de la commune, etc.
Cependant, d'autres réalités apparaissent dans
la pratique. La population ne s'intéressant pas à la gestion de
la commune ignore ces droits et n'en jouit pas. Elle développe
l'idée selon laquelle « la gestion des affaires communales
relève de la seule compétence des autorités localement
élues45(*) ». Or, sans son implication dans la
gestion de la commune, elle ignorerait la gestion qui est faite des
impôts et taxes perçues sur elle. Par ce fait, elle ne serait pas
encouragée à payer ses contributions fiscales. A son avis, cela
profite seulement aux responsables de la commune.
Cela peut être dû au faite que la population de la
commune rurale de Sangarébougou est en grande partie illettrée ou
parce que ceux qui sont instruits n'ont pas suffisamment le temps pour
s'intéresser à la gestion de la commune.
En outre, il convient de noter qu'avec le faible niveau de
revenus des habitants, il n'est guère facile d'exiger d'eux une
contribution fiscale.
Par ailleurs, l'engagement des populations pour payer des
impôts et taxes formalisés et budgétisés pourrait
s'accroître si, en retour, les arrondissements et villages pouvaient
bénéficier de flux financiers visibles sous forme
d'infrastructures sociales et communautaires ou sous forme de services sociaux
améliorés. Or, cela n'est possible que « si les
intérêts particuliers des villages et des arrondissements sont
respectés dans la planification du développement
communal 46(*) ».
De notre analyse, il ressort que la population de
Sangarébougou ne paraît pas être la seule responsable de ces
difficultés de mobilisation. Une part très large de
responsabilité semblerait incomber aux responsables de la commune.
Paragraphe 2 : Les causes tenant aux responsables
de la commune
Les causes de démobilisation financière tenant
aux responsables de la commune sont nombreuses. La gestion financière de
la commune laisse à désirer. En effet, le premier outil de cette
gestion à savoir la comptabilité administrative n'est pas
maîtrisée. D'une manière générale, dans le
cercle de Kati dont fait partie la commune rurale de Sangarébougou, les
fiches de comptabilité du maire n'existent que dans une seule commune
sur les onze communes. Les comptes administratifs de la commune de
Sangarébougou sont souvent produits avec un très grand retard. Le
matériel communal n'est souvent pas codifié et est soumis
à toutes les utilisations à l'image des biens de l'Etat.
Les agents communaux et principalement le receveur municipal
ne comprennent pas bien comment il convient d'utiliser les supports de
l'exécution du budget (ordres de recettes, bordereaux d'ordres de
recettes, mandats, bordereaux de mandats). La comptabilité en partie
double de la collectivité au niveau de la perception,
décidée par la Direction du Trésor depuis 1999, n'est pas
encore appliquée. Les receveurs municipaux prétextent que le
manque de personnel y serait à l'origine. Or cette comptabilité
permettrait d'avoir de façon quotidienne des informations
financières fiables sur chaque commune47(*).
La gestion du budget communal semble être une
tâche difficile à maîtriser par les nouvelles
autorités communales. L'exécution des premiers budgets a
été entachée de certaines irrégularités.
Quant à la préparation du budget, il semble aussi être un
exercice mécanique qui souffre d'un manque d'analyse et d'une
méconnaissance des plans comptables de la part de ceux qui les
établissent et de ceux qui sont chargés de les exécuter.
L'élaboration du budget se fait souvent à la hâte. Cela est
peut être dû au manque de personnel qualifié. Les
responsables communaux attendent l'arrivée des échéances
pour produire un document dont l'établissement exigerait beaucoup plus
de temps et d'efforts afin de répondre aux normes souhaitées.
Cette façon de faire rendrait les élus
vulnérables et les soumettrait ainsi à la pression de la tutelle.
L'instabilité du personnel communal due à la faiblesse de sa
rémunération et à la précarité de son statut
aggrave le manque de capacités au niveau de la commune rurale de
Sangarébougou.
S'il est vrai que le centre de conseil communal (CCC) finance
beaucoup de formations à l'adresse des élus et des agents
communaux, les agents des services déconcentrés de l'Etat et de
la préfecture n'ont pas été préparés
à assumer leur nouveau rôle d'assistance, de conseil et de
contrôle de la légalité48(*).
Le percepteur et le chef du centre des impôts qui sont
invités à toutes les formations ayant trait aux ressources
notamment fiscales (élaboration du budget et mobilisation des
ressources) y ont très peu participé. Le percepteur
justifie souvent son absence remarquée par la surcharge du travail.
Aussi, l'impact des formations demeure encore limité49(*).
La formation des fonctionnaires de la commune destinée
à les aider afin d'assumer leurs nouvelles fonctions est indispensable
pour son bon fonctionnement.
Partant du rapport sur la situation financière des
communes du cercle de Kati, il ressort que les budgets de la plupart des
communes du cercle de Kati, même lorsqu'ils sont élaborés
avec beaucoup d'incorrections, sont approuvés parce que ceux qui les
approuvent ne peuvent nullement apprécier leur qualité. La
commune rurale de Sangarébougou n'apparait pas étrangère
à cet état de fait.
C'est pourquoi la difficulté de suivi des
trésoreries de la commune due au fait que le receveur municipal (le
percepteur) soit le seul représentant du Trésor public et qu'il
ne dispose ni d'agent ni de moyen adéquat (informatique) rend plus
qu'indispensable la fourniture d'une base et des appuis à cette
structure.
La faible connaissance de la population et de la gestion des
ressources est aussi à l'affiche. En effet, la faible implication de la
population par les responsables de la commune de Sangarébougou dans
l'élaboration des plans de développement et des budgets communaux
a aussi une influence sur le taux de recouvrement. Dans le cas précis du
budget, le législateur a prévu une consultation des conseils des
communautés de villages, de quartiers, de fractions et un débat
public sur le projet de budget sans en déterminer les
modalités50(*).
Bien que les pratiques en la matière varient d'une commune à
l'autre, la population de Sangarébougou est peu informée par son
conseil communal.
Il y a aussi une absence de restitution des comptes annuels
à la population. Les comptes administratifs produits avec un
très grand retard ne font pas toujours l'objet de comptes rendus aux
conseillers communaux, à fortiori à la population.
Les citoyens, ignorant ainsi l'utilisation qui est faite de
leurs impôts ne sont pas encouragés à les payer.
Par ailleurs, le dysfonctionnement des conseils communaux et
les conflits internes sont aussi une réalité51(*). Il a aussi une influence sur
le paiement des taxes et impôts. Dans certains cas, des conseillers
communaux ayant une sensibilité politique différente de celle du
maire entravent souvent ses actions. Par ce fait, ils découragent les
habitants de la commune surtout leurs partisans dans l'acquittement de leur
contribution fiscale. La mésentente qui règne souvent entre les
villages de la commune peut être une autre raison de la difficile
mobilisation des ressources.
En certains endroits, les relations conflictuelles entre le
maire et certains chefs de village peuvent aussi jouer un rôle.
L'expérience a prouvé que les maires ayant de
l'entregent52(*) seraient
parvenus à se faire accepter par les chefs de village. Cette saine
collaboration jouerait ainsi non seulement en faveur du recouvrement mais
également en faveur de l'application de tous les actes d'administration
édictés par le maire53(*).
Il faudrait en outre noter que le manque de transparence dans
la gestion des ressources financières apparait comme un facteur de
réticence des populations dans le paiement des impôts et des
taxes. L'information sur la gestion de la commune ne semble pas circuler ni
à l'intérieur, ni à l'extérieur de la commune. Le
maire centralise souvent les informations sur la gestion communale sans les
partager avec le bureau ou le conseil communal. Il ordonne quelques fois des
dépenses sans connaître le niveau des recettes. Cela
pourrait bloquer le bon fonctionnement de la commune et frustrer les
collaborateurs.
Sans doute, force est de constater que le niveau interne de la
commune rurale de Sangarébougou regorge de nombreux facteurs pouvant
entraîner des difficultés dans la mobilisation des ressources
financières. Cependant, allusion pourrait également être
faite à d'autres facteurs de difficultés financières
indépendants de la commune.
Il s'agirait ainsi des facteurs générés
par l'administration de tutelle.
Section 2 : Les difficultés relevant de la
gestion communale au plan national
Au niveau externe de la commune, les causes de
difficultés de mobilisation des ressources financières
s'avèrent nombreuses. Nous ferrons mention des facteurs d'ordre
économique (paragraphe 1) ainsi que des
facteurs d'ordre politique de la démobilisation financière
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les facteurs d'ordre
économique relevant du niveau national
Il s'agirait ainsi de la gestion financière au niveau
national. En effet, le manque de la maîtrise de la matière
imposable s'affiche en premier lieu. Les informations sur la matière
imposable figurant dans les rôles apparaissent très en
deçà de la réalité. Le travail de mise à
jour ne semble pas toujours régulier et les communes ne semblent pas
fournir d'efforts pour l'actualisation des informations données par les
anciens administrateurs lors de la passation de pouvoir54(*). Les services techniques, tels
que ceux des impôts, ne semblent pas être associés dans les
recensements entrepris notamment dans les centres commerciaux (inventaire des
boutiques, des places sur le marché). Les contestations qui en
découlent entraîneraient ainsi des frustrations que certains
redevables expriment par le refus de s'acquitter de leur impôt. Cette
situation fait apparaître deux insuffisances majeures : une mauvaise
évaluation du potentiel fiscal et la non-concordance entre les chiffres
de la mairie et ceux du service des impôts. Dans d'autres cas, la
création de la commune rurale de Sangarébougou semble permettre
un recensement plus fiable des personnes imposables. Ce travail doit être
effectué au niveau local par les autorités communales qui
connaissent bien les populations de leur localité. Les populations
payaient des impôts pour les morts, les enfants scolarisés et les
femmes ayant plus de quatre (4) enfants55(*).
A cela vient s'ajouter le faible niveau de
déconcentration des services du trésor. Cela apparait comme une
des contraintes majeures liées au recouvrement des taxes et
impôts. Par exemple, le cercle de Kati a seulement un percepteur pour
toutes ses communes. Outre un personnel réduit, la perception serait
dépourvue de moyens de transport alors que certaines communes semblent
être éloignées de la perception. Sangarébougou est
à environ une vingtaine de kilomètres de Kati.
En général, c'est au niveau du cercle
qu'apparait la complexité du système de gestion financière
car cela semble exiger beaucoup de va-et-vient du maire ou de son personnel. Un
autre élément qui ne s'annonce pas encourageant pour la
population dans le paiement des taxes et impôts et pour le maire de la
commune dans la mise en oeuvre des actions de sensibilisation serait lié
au fait qu'il n'existe qu'une seule caisse à la perception. La commune
rurale de Sangarébougou a eu souvent de la peine à retirer des
fonds qui leur revenait parce que la caisse était vide.
A cela s'ajoute aussi le cas des ressources naturelles
sous-fiscalisées. La loi n° 00-044 du 07 juillet 2000
déterminant les ressources fiscales des communes, des cercles et des
régions mentionne les droits et taxes perçues lors de
l'attribution de titre d'autorisation d'exploitation artisanale de l'or ou
d'ouverture de carrières artisanales et les taxes perçues sur le
bois à l'occasion de l'exploitation du domaine forestier de
l'Etat56(*). Cette loi
n°00-044 du 07 juillet 2000 qui répartit la taxe entre la commune,
le cercle et la région à hauteur respectivement de 50 %pour la
commune, 25 % pour le cercle et 25 % pour la région n'est pas
appliquée. Cependant, c'est le décret n° 98-402/P-RM du 17
décembre 1998, fixant les taux, les modalités de recouvrement et
de répartition des taxes perçues à l'occasion de
l'exploitation du bois dans le domaine forestier de l'Etat qui est encore
appliqué. Ce décret est beaucoup plus avantageux pour les agents
de la conservation de la nature en charge du recouvrement : ils ont des
redevances et des recettes pour couvrir les dépenses de fonctionnement
de leur service, toutes choses dont la loi n° 44 du 2000 les prive. Cette
considération n'est sûrement pas étrangère au retard
que connaît l'application de cette loi. Dans cette loi, il n'est nulle
part fait allusion aux recettes halieutiques et fauniques57(*).
Concernant les recettes issues de la coupe du bois,
« les collectivités sont doublement lésées. Le
service de la conservation de la nature qui recouvre cette taxe ne
précise pas au Trésor au moment du versement la commune
d'origine du bois. Le Trésor ne dispose donc pas de clé de
répartition de la taxe de bois entre les différentes
collectivités. Ainsi, la taxe est généralement
attribuée à la commune dans laquelle se situe le poste de
contrôle forestier, ce qui n'encourage pas la gestion durable de la
forêt concernée. Cette situation est identique à celle de
la répartition de l'impôt synthétique58(*) ».
Il apparait ainsi à lumière de notre analyse que
la gestion financière n'est pas maîtrisée au niveau
national. La maîtrise de la matière imposable est à
discuter et malgré la détermination légale des ressources
locales, les résultats ne semblent pas refléter les attentes.
Alors, il pourrait y avoir des facteurs d'ordre politique expliquant les
difficultés de mobilisation de ressources financières dans la
commune.
Paragraphe 2 : Les facteurs d'ordre politique des
difficultés de mobilisation financière
D'autres facteurs expliquant la faiblesse du recouvrement des
taxes et impôts dans la commune rurale de Sangarébougou pourraient
porter sur les élections.
« L'électoralisme59(*) » serait devenu une entrave au
recouvrement. En effet, pour ne pas compromettre les chances du maire aux
prochaines échéances électorales, le régisseur ne
peut exercer de trop fortes pressions sur certains redevables.
Une autre raison résiderait dans la mauvaise
interprétation de la suppression de l'impôt per
capita60(*) . En
2000, le message du Premier Ministre de la 3ème
République M. Mandé SIDIBE qui déclara en son temps
à l'Assemblée Nationale la suppression de l'impôt
per capita ne semblait pas avoir été bien
compris. Nombre de populations rurales (celle de Sangarébougou
n'étant pas en marge) tendaient à croire que toutes sortes
d'impôts seraient ainsi supprimées. A l'époque, certains
chefs de villages sont même venus demander à la mairie de leur
restituer les impôts qu'ils avaient déjà payés au
titre de l'année en cours.
Il s'avère également loisible de prendre en
compte au niveau de la commune rurale de Sangarébougou l'absence de
sanctions à l'encontre des mauvais payeurs. Cela pourrait encourager le
refus de payer les impôts. Les contribuables qui s'acquittent du paiement
de leurs impôts seraient tentés de prendre l'exemple sur ceux qui
ne les paient pas.
Néanmoins, dans le cas de villages entiers où il
serait difficile de mobiliser les ressources financières la mairie a
tendance à revenir aux méthodes coercitives de l'administration
d'antan en impliquant les forces armées (gendarmes notamment) pour
récupérer les taxes et impôts dans les villages61(*).
En plus, il y a l'absence de sanctions à l'endroit de
ceux qui détourneraient des fonds à des fins autres que celles
pour lesquelles ils sont destinées. L'administration de tutelle ne
devrait pas rester passive à cela. Si la population de
Sangarébougou qui se tue à payer les impôts et les taxes ne
voit aucune réalisation faite en matière de développement,
elle sera forcement découragée à s'acquitter de sa
contribution fiscale.
L'Etat semble aussi transférer des compétences
sans le transfert concomitant des ressources financières
nécessaires comme le prévoit la loi62(*). La subvention
financière à la commune rurale de Sangarébougou et
l'accès au fonds sectoriel sont limités. Etant donné la
faiblesse des moyens personnels et matériels du service de la perception
de Kati qui a en charge le recouvrement des taxes enrôlés, c'est
donc le régisseur de la commune qui assure le recouvrement de ces taxes
au nom du receveur municipal. Le régisseur étant recruté
et employé par la commune, il agit sous la responsabilité
technique du receveur municipal. Ce qui souvent ambiguë ce poste.
La mise en exergue des difficultés de mobilisation de
ressources financières dans cette commune s'avère d'une
importance capitale. Cependant, il faudrait signaler qu'elles ne peuvent
être toutes soulignées. Seules les plus tenantes apparaissent dans
cette étude. De la connaissance de ces difficultés de
mobilisation des ressources financières dans la commune rurale de
Sangarébougou, la proposition de solutions ne semble pas être une
chose difficile. Elle ne pourrait tenir compte que des grands axes, d'où
l'élaboration de stratégies.
Chapitre II : Les stratégies
mobilisation des ressources financières dans la
commune
Pour remédier aux difficultés de mobilisation,
des solutions sont préconisées tant au niveau local
(section 1) qu'au niveau national
(section 2).
Section 1 : Les solutions
préconisées au niveau local
Il y a des démarches qui sont adoptées par le
PACT (paragraphe 1) en plus desquelles d'autres
démarches entreprises par les autres acteurs du développement
local semblent nécessaires (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les démarches
adoptées par le PACT
Au regard de ce problème majeur, le PACT a
développé une démarche de mobilisation des ressources
financières communales notamment basée sur le recouvrement de la
Taxe de Développement Régional et Local et des autres taxes
enrôlées (taxes de voirie, taxes de bétail, taxes sur les
armes). Cette démarche du PACT devrait effectivement être prise en
compte par les autorités de la commune rurale de Sangarébougou
dans le cadre d'une bonne mobilisation de ses ressources financières.
L'approche du PACT tient compte de la complexité de la
problématique de la mobilisation des ressources et s'appuie sur la
concertation entre acteurs, notamment entre les élus et la
population.
L'objectif de la démarche est d'améliorer la
mobilisation des ressources communales. Ceci nécessite de :
Ø « Analyser la situation financière
de la commune, ses faiblesses et ses potentialités ;
Ø Renforcer les compétences locales : former
les acteurs clés au cours de la démarche et sur la gestion des
fonds (élus, secrétaire général, régisseur,
comité local de mobilisation des ressources communales MRC,
etc.) ;
Ø Renforcer la communication autour de la mobilisation
des ressources. La population doit être informée et
écoutée à travers les différents canaux de
communication. La communication se fait en langue locale (atelier, radio, etc.)
et concerne le niveau interne (commune -population) et externe (commune -
partenaires) ;
Ø Susciter l'engagement des différents acteurs
locaux pour un changement de comportement et une collaboration en vue d'une
meilleure mobilisation des ressources. Il s'agit des élus, du personnel,
de la population (hommes, femmes, jeunes), des organisations de la
société civile, et des différentes corporations ;
Ø Impliquer les Services Techniques (surtout la
Perception) et la tutelle dans l'exercice afin de fournir un appui/conseil, de
former les agents communaux et de renforcer le contrôle ;
Ø Insister sur l'appropriation de la démarche
par la commune pour qu'elle continue les efforts après le départ
du facilitateur et de la structure d'appui63(*) ».
A l'instar des démarches adoptées par le PACT
dans le cadre de la mobilisation des ressources financières, les autres
acteurs du développement local ne sont pas en reste. Ils ont aussi
entrepris des démarches.
Paragraphe 2 : Les démarches des autres
acteurs du développement local64(*)
Ces démarches entreprises porteraient d'abord sur le
service des impôts. En effet, le service des impôts aurait aussi
besoin d'élaborer des outils pour l'identification des contribuables et
de la matière imposable et de procéder à un recensement
plus fiable de la matière imposable pour la constitution des
rôles. Le service du Trésor devrait recouvrer effectivement les
impôts sur rôle, produire de façon régulière
des documents plus fiables (comptabilité en partie double, situation
financière des communes, compte de gestion) et contrôler
sérieusement les procédures de passation des marchés des
communes rurales.
L'entente au sein de la commune sur le recouvrement des taxes
et impôts est également nécessaire, entre les villages,
entre les élus, et entre le conseil communal et les autorités
coutumières.
Le paiement passe par l'existence d'une certaine
« citoyenneté65(*) » communale.
L'adoption d'une stratégie de communication par chaque
maire, expliquant aux populations le sens de la décentralisation et les
informant sur toutes les activités de la mairie constitue un atout. Il
est important que les élus associent effectivement les populations
à l'élaboration des plans de développement et des budgets
communaux. Cela pourrait se faire sous forme de consultations réelles et
non fictives auprès d'un public représentatif de population de
Sangarébougou. La production régulière des comptes
administratifs par le maire, leur soumission à l'appréciation du
conseil communal élargi aux leaders de la société civile
semble nécessaire. Lors de la session du conseil communal relative au
compte administratif, le maire devrait fournir des explications sur les
recettes recouvrées, les dépenses réalisées, les
dépenses d'investissements prévues mais non
réalisées et le manque de recettes. Cet exercice devrait
permettre aux leaders de la société civile de
Sangarébougou de comprendre l'usage qui est fait des impôts et de
percevoir clairement la dépendance entre le recouvrement des
impôts et taxes et la réalisation des investissements. Ce travail
est indispensable pour asseoir la légitimité des élus
locaux de Sangarébougou, la transparence de la gestion
financière, et une certaine citoyenneté communale. Ces notions
sont les conditions sine qua non du fonctionnement normal de la
commune.
Pour une bonne mobilisation des ressources financières
au niveau de cette commune, il s'ensuit qu'il est non seulement
nécessaire d'impliquer les acteurs locaux, mais également le
gouvernement qui représente l'administration de tutelle. Ainsi des
solutions sont-elles préconisées à ce niveau.
Section 2 : Les solutions
préconisées au niveau national66(*)
Au niveau du gouvernement, des stratégies doivent
être adoptées aussi bien au niveau national
(paragraphe 1) qu'au niveau international
(paragraphe 2) afin de permettre une bonne
mobilisation des ressources financières dans les communes rurales du
Mali en général et celle de Sangarébougou en
particulier.
Paragraphe 1 : Les stratégies de
mobilisation au niveau national
A ce niveau, l'amélioration du recouvrement des taxes
et impôts semble être essentiellement un problème de
volonté politique. L'optimisation des ressources fiscales s'avère
nécessaire. Cette optimisation reposerait essentiellement sur le
renforcement de l'administration fiscale tant au niveau des services
déconcentrés de l'Etat qu'au niveau des services propres des
collectivités locales. Certaines initiatives récentes ont
montré qu'il était possible d'obtenir rapidement une
amélioration des rendements de certains impôts et taxes en jouant
simplement sur la motivation des communes à gagner leur autonomie
et en mettant en liaison les services de la commune et ceux de l'Etat.
Cette motivation pourraient être engendrée
notamment par le besoin de mettre en oeuvre des plans de développement
communaux élaborés de façon participative avec la
société civile et par des séances de formation et
sensibilisation sur la gestion communale en particulier sur la gestion des
recettes communales. Cette motivation pourrait également être
obtenue par la réalisation du recensement des activités taxables
et des contribuables ainsi que la mise en place des bases de données
informatisées.
L'implication systématique des services
déconcentrés de l'Etat dans cette animation communale
encouragerait la collaboration nécessaire entre les deux administrations
et faciliterait le transfert de compétences. Encore faudrait-il que la
déconcentration des nouvelles fonctions de l'Etat (le conseil et le
contrôle) soit également assurée à la même
vitesse67(*).
La réussite de la décentralisation passe
indubitablement par une amélioration de la marge de manoeuvre
financière des élus locaux de Sangarébougou. Si celle-ci
ne peut être progressive certains affirment qu'elle est plus liées
à la bonne gouvernance communale et à l'émergence de
« l'identité communale » dans l'esprit de la
population qu'à des mesure fiscales ou économiques. Pour cela,
les efforts peuvent se centrer sur :
- « L'identification fiscale des
contribuables ;
- Le renforcement de l'administration fiscale ;
- L'amélioration des relations entre l'administration
et les contribuables ;
- L'intégration de l'information fiscale ;
- La transparence dans la gestion des affaires des fonds de
la mairie ;
- La culture du civisme fiscal de la population ;
- Donner aux populations les motifs de payer ses
impôts ;
- Montrer à la population les réalisations de
la mairie ;
- Faire des recensements et confectionner des
rôles ;
- Lettre les agents de recouvrement dans les bonnes
conditions de travail ;
- Valoriser le métier du collecteur et des agents de
recouvrement ;
- Cultiver l'excellence des mairies ;
- Améliorer la connaissance des contribuables par la
mise en place d'une base de données géoréferencées,
la formation en gestion de bases de données informatisées et la
planification et le suivi des recettes de installations
économiques ;
- Réorganiser la collecte en réduisant le
nombre et le rôle des agents, en valorisant leur travail, en instituant
un principe de contrôle et de sanction et en augmentant le potentiel des
installations ;
- Et enfin développer un civisme fiscal dans la
commune par l'information, l'éducation et la communication sur les
droits devoirs du contribuable et par l'attribution de subventions aux
coordinations professionnelles de la commune68(*) ».
En plus de cela, il y a beaucoup à entreprendre et
à faire. Il s'agit entre autres de :
Ø Définir une stratégie qui relie
étroitement performances locales dans la mobilisation des ressources et
bénéfice des concours et subventions de l'Etat69(*)
D'une manière générale, un des objectifs
assignés à la décentralisation est de favoriser une
meilleure mobilisation de l'épargne locale. Le problème qui se
pose est celui de l'appréciation du niveau d'effort à, fournir.
Compte tenu de la faible fiscalisation nationale et locale, les
autorités doivent pouvoir viser la multiplication par deux ou trois des
prélèvements sur l'économie locale et le patrimoine de la
collectivité. Encore faut-il avoir une idée du potentiel offert
par l'une comme par l'autre. La mise en oeuvre d'une instrumentation à
la disposition de la commune rurale de Sangarébougou pour
apprécier le potentiel de la fiscalité locale et se fixer des
objectifs réalistes de mobilisation doit figurer parmi les
priorités d'action dans ce domaine. A l'étape actuelle des
politiques nationales de décentralisation, c'est moins
l'égalisation des conditions locales pour l'accès aux ressources
que l'effort pour augmenter les ressources locales qu'il faut encourager. Les
formules de partage de ressources entre l'Etat et cette collectivité
territoriale devraient donc inclure des incitations positives en matière
de mobilisation de ressources financières. Mais en même temps une
attention égale devrait être accordée à la
qualité de la dépense locale. Les formules de
décentralisation financière devraient en conséquence
intégrer des bonus en faveur de la commune rurale de
Sangarébougou au cas où elle aurait de bons ratios de gestion.
Bien que ces recommandations portent sur le niveau national,
elles ne prennent en compte que les grandes lignes de la mobilisation de
ressources financières des communes. Il serait également loisible
pour l'Etat et même pour la commune de Sangarébougou
d'entreprendre des actions au niveau international dans le cadre de la
coopération internationale pour améliorer les recettes
financières locales.
Paragraphe 2 : Les recommandations au niveau
international70(*)
Au niveau international il est effectivement souhaitable
d'échanger sur les expériences positives en matière de
décentralisation financière.
Les décentralisations africaines suivent des
trajectoires différenciées selon l'histoire, le système
politique, la culture administrative et financière, et les moyens
d'action propres à chaque pays. Il en résulte une somme
d'expériences intéressantes à partager, avec comme
principe de base la recherche de la plus grande autonomie possible des
collectivités locales.
Le recensement, la capitalisation et le partage de ces
expériences doivent permettre de créer progressivement une
intelligence partagée de la décentralisation financière en
Afrique. Le résultat attendu à l'issue de cet échange est
double : d'une part amener les Etats à admettre la
nécessité d'un ajustement institutionnel des recettes et
dépenses publiques au profit des collectivités territoriales,
pour porter la part de ces dernières à 15 % à 20 % des
dépenses et recettes publiques dans les dix années à venir
; d'autre part montrer qu'une instrumentation existe dans les différents
pays dont l'adaptation permet de concrétiser la volonté
d'accompagner la délégation de compétences avec la
délégation de moyens de les exercer aux collectivités
territoriales. L'échange devrait également concerner les
instruments de gestion des finances locales. Elle pourrait aussi viser
à terme l'harmonisation de tels instruments au niveau des
différentes zones économiques et monétaires comme cela est
actuellement envisagé dans les pays membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)71(*).
L'initiative du Centre International de Formation des
Autorités/Acteurs locaux (CIFAL) sis à Ouagadougou (Burkina Faso)
devrait être salutaire dans ce domaine. Elle permet l'échange
d'expériences en matière de mobilisation des ressources locales
afin de parvenir à l'élaboration de stratégies efficaces
pour la mobilisation des ressources financières dans les
collectivités territoriales des pays participants.
Dans l'ensemble, il s'agirait ainsi des recommandations visant
la mobilisation des ressources financières dans les collectivités
territoriales d'une manière générale. Cependant, leur
aboutissement profite à l'ensemble des collectivités
territoriales dont fait partie la commune rurale de Sangarébougou.
Conclusion :
Dès le début de la décentralisation au
Mali, la mobilisation des ressources locales a été une des
activités centrales des collectivités territoriales. Elle
apparait comme un maillon essentiel du développement de la commune en
milieu rural et de l'amélioration des conditions de vie des populations.
En réalité, la pérennité et la viabilité
économique de la commune supposeraient avant tout une
disponibilité des ressources financières. Le volume des
ressources financières à mobiliser semble être fonction
des ambitions de développement de la commune ainsi que de la
capacité et de la volonté des populations à payer les
taxes et impôts.
Malgré les ressources prévues par les textes
pour les collectivités territoriales, le financement de la
décentralisation par la commune rurale de Sangarébougou reste
problématique. Le recouvrement des recettes apparait faible et
irrégulier au point d'entraîner un retard dans le paiement des
salaires du personnel. Il semble probable qu'investir est impossible dans une
telle situation.
La Taxe de Développement Régional et Local
(TDRL) apparaît comme la taxe principale. Le conseil rural de
Sangarébougou aurait aussi tendance à analyser seulement les
revenus potentiels de la commune en ignorant les coûts de recouvrement.
Les conséquences possibles sur l'économie rurale de
Sangarébougou ou sur les ressources naturelles ne sont pas non plus
prises en compte.
Par ailleurs, le rôle des ressources naturelles dans la
mobilisation des finances pour la commune moyenne de Sangarébougou
semble être surtout indirect, vu que les moyens de vie en milieu rural et
donc la capacité de paiement seraient essentiellement basés sur
l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Dans ce cas
précis, seules les communes qui disposeraient d'un massif forestier
exploité de façon commerciale profiteront, en principe, de la
taxe forestière72(*). Tel n'est pas le cas de la commune rurale de
Sangarébougou. Dans la pratique, les bénéfices sont
limités pour ces communes qui en disposeraient. Les taxes
forestières sont collectées au niveau du cercle par le service
technique et reversées ensuite au percepteur. La part restituée
à la commune sur laquelle la forêt est située semble trop
faible car les revenus seraient repartis en parts égales entre toutes
les communes du cercle. Ce système de répartition peut
décourager une gestion durable des forêts par la commune
concernée qui en profite peu et ne reçoit pas suffisamment de
revenus pour investir dans son aménagement.
Le fait que les communes ne disposent pas encore des domaines
propres et autres patrimoines ne limite-t-il pas aussi la fiscalité
locale ?
Bien que la gestion administrative et financière ait
été un « cheval de bataille » pour les
partenaires d'appui à la décentralisation beaucoup reste encore
à faire.
L'élaboration et l'exécution de budget de la
commune posent de nombreux problèmes. L'attachement systématique
à des règles de comptabilité publique
héritées de la France ne s'avère pas compatible avec la
réalité malienne. Cela compliquerait davantage la situation.
L'amélioration du recouvrement des taxes et
impôts qui semblent être essentiellement un problème de
volonté politique nécessite la déconcentration des
services techniques de l'Etat, notamment des services des impôts et du
Trésor.
Les communes rurales du Mali en général et celle
de Sangarébougou en particulier ont réellement besoin de
mobiliser localement des ressources financières pour pouvoir fonctionner
et pour disposer de la contrepartie de l'ANICT73(*) pour les investissements et, dans l'avenir, des fonds
sectoriels pour les secteurs de la santé, de l'éducation ou de
l'hydraulique.
La mobilisation financière pourra-t-elle être
effective sans une forte implication des populations concernées, de
leurs responsables, de l'Etat et par conséquent de tous les partenaires
au développement ?
Bibliographie
Ouvrage général :
· Réné CHAPUS, droit administratif
général, tome 1,11ème édition, 1997,
Montchrestien, p.256, 360-361- ;
Ouvrage spécifique :
· « La décentralisation
financière en Afrique : succès, problèmes et
contraintes », François Paul Yatta, PDM, 2000, p.
6-7-8-9 ;
Textes législatifs et
réglementaires :
· Loi n°93-008 AN/RM du 11 février 1993
portant libre administration des collectivités territoriales
modifiée par la loi n° 96-056 du 16/10/1996 ;
· Loi n°95-034/AN-RM du 12 avril 1995 portant codes
des collectivités territoriales ;
· Loi n° 00-042 du 07 juillet 2000 portant
création de l'ANICT ;
· La loi n° 00-044 du 07 juillet 2000
déterminant les ressources fiscales des
communes, des cercles et des régions ;
Revues :
· « Etude sur la situation financière des
communes rurales du cercle de Kati », Centre de conseil communal,
Kati, Mali, rapport provisoire, novembre 2003, 2003, p. 28 ;
· « Financer la décentralisation
rurale : taxes et impôts à l'échelle local au
Bénin, Burkina Faso et Mali », Institut Royal des Tropiques,
bulletin n°357, KIT Amsterdam, 2004, p. 70-92 ;
· SNV, CEDELO, « La décentralisation au
Mali : du discours à la pratique », SNV/ KIT, Amsterdam, 2004,
p. 7.
Quelques mémoires :
· Bréhima Aguibou TRAORE et Aboubacar TRAORE :
Analyse des recettes fiscales des collectivités territoriales : cas
de la commune IV, FSJE, 2005, p. 60-66 ;
· Moussa Namory KEITA et Moussa SISSOUMA : Evaluation
de la stratégie de mobilisation des ressources locales : cas de la
mairie du district de Bamako, FSJE, 2006, p.25-32-45-64
Quelques sites internet :
www.dgi.finances. gov.ml
www.pact-mali.org
Contact :
bengyss@yahoo.fr
Cel : (+223)
66 69 59 82
(+223)74 49 80 67
Table des
matières
Introduction :...............................................................................................1
Première partie : Les
généralités sur la gestion financière de la commune
rurale de Sangarébougou
Chapitre I : Les ressources
financières de la commune rurale de
Sangarébougou..............................................................................................6
Section 1 : Le cadre légal et la
base des ces ressources............................................. 6
Paragraphe 1 : La cadre légal
déterminant les ressources de la commune........................7
Paragraphe 2 : Une fiscalité
basée sur les Taxes de Développement Régional et Local
(TDRL).....................................................................................................10
Section 2 : Le processus budgétaire
de la commune................................................11
Paragraphe 1 : Le processus d'élaboration
du budget de la commune...........................12
Paragraphe 2 : Le processus
d'exécution du budget de la commune............................14
Chapitre II : L'analyse de la
mobilisation des ressources financières dans la commune de
Sangarébougou
...........................................................................................17
Section1 : Le recouvrement des
ressources fiscales..................................................17
Paragraphe 1 : Le système de
recouvrement........................................................17
Paragraphe 2 : Les
modalités de
recouvrement.....................................................19
Section 2 : L'analyse des recettes de la
commune rurale de Sangarébougou pendant le mandat
écoulé.............................................................................................21
Paragraphe 1 : Le
recouvrement des ressources
fiscales..........................................21
Paragraphe 2 : Les revenus financiers des
prestations de services de la commune de
Sangarébougou............................................................................................24
Deuxième partie : Les causes
difficultés de mobilisation et les stratégies de mobilisation de
ressources financières dans la commune
Chapitre I : Les causes des
difficultés de mobilisation des ressources
financières.............30
Section 1 : Les causes relevant de la
gestion de la commune au niveau local....................30
Paragraphe 1 : Les causes tenant
à la population de Sangarébougou............................30
Paragraphe 2 : Les causes tenant aux
responsables de la commune sur.........................32
Section 2 : Les causes relevant de la
gestion communale au plan national.......................36
Paragraphe 1 : Les facteurs d'ordre
économique....................................................36
Paragraphe 2 : Les facteurs d'ordre
politique........................................................39
Chapitre II : Les stratégies de
mobilisation de ressources financières dans la
commune...................................................................................................42
Section 1 : Les solutions
préconisées au niveau
local...............................................42
Paragraphe 1 : Les démarches
adoptées par le PACT.............................................42
Paragraphe 2 : Les démarches des
autres acteurs du développement local.....................44
Section 2 : Les solutions
préconisées au niveau
national...........................................45
Paragraphe 1 : Les stratégies de
mobilisation au niveau national................................45
Paragraphe2 : Les recommandations au
niveau international....................................49
Conclusion :..............................................................................51
Bibliographie :...........................................................................................54

* 1 Téra
Consultants, « Plan d'action/lignes d'interventions prioritaires
de la stratégie d'accès universel », Mali,
février 2009, p.6.
* 2 Loi n°95-034 AN/RM du
12 avril 1995 portant code des collectivités au Mali.
* 3 Réné
Chapus : Droit administratif général ; Tome 1, pp.360,
361.
* 4 Constitution de la
3ème République du Mali, TITRE XI, article 97 du 25
février 1992.
* 5 « Lexique des
termes juridiques », 14ème édition, Dalloz
2003, page 114.
* 6 Réné Chapus,
« Droit administratif général », Tome 1, p.
256.
* 7 Loi n°93-008 du 11
février 1993, article 4.
* 8 Loi n°93-008 AN/RM du
11 février 1993, articles 6 et 10.
* 9 PACT/GTZ,
« mobilisation des ressources financières dans les
CT », 2008, p.2.
* 10 « Dictionnaire
de poche Larousse », 2008, p. 521.
* 11
« Présentation de la commune rurale de
Sangarébougou », Secrétariat général de
la mairie de Sangarébougou, 2009, p. 1.
* 12 Projet de la
coopération allemande au Mali.
* 13 Expression tirée
du bambara qui signifierait avancer très lentement.
* 14 Ces ressources
comprennent:
· « Les taxes et les taxes qu'elle
autorisée à percevoir ;
· Les subventions de l'Etat ;
· Les taxes rémunératoires sur les
services rendus ;
· Les revenus de son domaine ;
· Les emprunts ;
· Les dons et legs ».
* 15
« Expérience de mobilisation des ressources
financières au Mali », Allaye Biréma DICKO, Institut
Royale des Tropiques, 2004, p.72.
* 16 Loi n°00-044 du 7
juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, cercles
et régions au Mali.
* 17 Les taux de cette taxe
sont fixés aux paragraphes 1 à 7 de l'article 294 du code
général des impôts du Mali.
* 18 Prévus aux
articles 103 et 106 de l'ordonnance n° 99-32/P-RM du 19 août 1999
portant code minier au Mali.
* 19 Ces taxes se trouvent
définies dans la loi déterminant les ressources fiscales des
communes, cercles et régions.
* 20 Loi n°00-044 du 7
juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, cercles
et régions au Mali.
* 21 « Financer la
décentralisation rurale », Institut Royal des Tropics
(KIT)-Amsterdam, bulletin n°357, 2004, p.77.
* 22 Voir
www.dgi.finances.gov.ml:
« Code général des impôts » du Mali
modifié par la loi n° 05-046 AN/RM du 18 août 2005, article
152.
* 23 Loi n° 95-034 AN-RM
du 12 avril 1995 portant code des collectivités, article 170.
* 24 Article 172 de la loi
n°95-034 AN-RM du 12 avril 1995 portant code des collectivités au
Mali.
* 25 Article 174 de la loi
n°95-034 AN-RM portant code des collectivités
* 26 Article 19 de la loi
n°93-008 AN-RM portant libre administration des collectivités
* 27 Voir loi
n°95-0 34 portant code des collectivités territoriales en
République du Mali, deuxième partie, titre I, chapitre II.
* 28 Article 179 de la loi
n°95-034 AN-RM portant code des collectivités au Mali.
* 29 Loi n°93-008 AN-RM
du 11 février 1993.
* 30 « Financer la
décentralisation rurale », Institut Royal des Tropics
(KIT)-Amsterdam, bulletin n°357, 2004, p.78.
* 31 Ce schéma fut
réalisé avec le concours d'Allaye Biréma Dicko, Institut
Royal des tropiques.
* 32 Secrétariat
général de la mairie de Sangarébougou,
« enquête menée dans le cadre de la mobilisation des
ressources financières dans la commune rurale de
Sangarébougou », juillet 2009.
* 33 Informations fournies par
le secrétaire général de la commune rurale de
Sangarébougou Boubou DANTHIOKO, juillet 2009.
* 34 « Collecte de
données dans le cadre de la mobilisation des ressources
financières dans la commune rurale de Sangarébougou »,
PACT/GTZ, janvier 2006.
* 35 Ce sont des remises
faites aux chefs de villages sur les montants recouvrés.
* 36 Le secrétariat
général de la commune rurale de Sangarébougou, octobre
2008.
* 37 « Analyse des
structures des recettes fiscales des collectivités territoriales :
cas de la commune IV », Bréhima Aguibou TRAORE et Boubacar
TRAORE, mémoire de fin de cycle, FSJE, 2005, p.54.
* 38 Ces données nous
ont été fournies par le secrétariat général
de la mairie de Sangarébougou.
* 39 « Bilan de la
commune rurale de Sangarébougou », mandat 2004-2009, p. 4.
* 40 « Collecte de
données dans le cadre de la mobilisation des ressources
financières dans la commune rurale de Sangarébougou »,
PACT/GTZ, janvier 2006, p. 6.
* 41 Bilan de la commune
rurale de Sangarébougou, mandat 2004-2009, p 8.
* 42 « Analyse des
structures des recettes fiscales des collectivités territoriales :
cas de la commune IV »,Bréhima Aguibou TRAORE et Boubacar
TRAORE mémoire de fin de cycle, FSJE, 2005, p. 51.
* 43 L'ANICT est un
établissement public à caractère administratif doté
de la personnalité morale et de l'autonomie financière,
créé par la loi n° 00-042 du 07 juillet
2000. Il est chargé de :
- recevoir et allouer aux collectivités territoriales les
subventions destinées à la réalisation de leurs
investissements sous leur maîtrise d'ouvrage ;
- assurer une péréquation entre les subventions en
tenant compte du degré de développement des collectivités,
suivant des critères définis par le gouvernement ;
- aider les collectivités territoriales à
développer la mobilisation de leurs ressources financières
propres ;
- garantir les prêts contractés par les
collectivités territoriales pour le financement de leurs investissements
;
- assurer la péréquation entre les
différents budgets d'investissement des communes.
* 44 Article 174, du code des
collectivités territoriales du Mali.
* 45 Propos recueillis
auprès de certains habitants de Sangarébougou, novembre 2008.
* 46 « Financer la
décentralisation rurale », Institut Royal des Tropics
(KIT)-Amsterdam, bulletin n°357, page 89, 2004.
* 47 « Analyse des
structures des recettes des collectivités territoriales : cas de la
commune IV », Bréhima Aguibou TRAORE et Boubacar TRAORE,
mémoire de fin de cycle, FSJE, 2005, p.54.
* 48 « Financer la
décentralisation rurale au Mali », Allaye Biréma DICKO,
Institut Royal des Tropiques, 2004, p. 80.
* 49 CCC de Kati,
« Etude sur la situation financière des communes rurales du
cercle de Kati », rapport provisoire, novembre 2003, p. 28.
* 50 Article 174 du code des
collectivités du Mali (loi n°95-034 AN-RM du 12 avril 1995).
* 51 Il s'agirait d'une
situation générale dont fait état le rapport du CCC du
cercle de Kati en 2003 sur la gestion de ses communes rurales dont fait partie
celle de Sangarébougou.
* 52 L'aisance en
société, l'habileté de nouer des contacts.
* 53 « Le rendement
actuel et potentialité fiscale des communes rurales du Mali »,
CIFAL, juin 2009, p. 12.
* 54 « Financer la
décentralisation rurale », Institut Royal des Tropics
(KIT)-Amsterdam, bulletin n°357, 2004, p. 80.
* 55 Cette faute peut
être imputable au manque d'information de la population par les
autorités communales.
* 56 Loi n°00-04 du 7
juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des régions,
cercles et communes.
* 57 « Rendement et
potentialité des communes rurales du Mali », Aboubacar
SANGARE, CFAL, 2009, p.6.
* 58 « Financer la
décentralisation rurale », Institut Royal des Tropics
(KIT)-Amsterdam, bulletin n°357, p. 81.
* 59 Attitude d'un
gouvernement ou d'un parti dont la politique est guidée par des
considérations électorales.
* 60 Par tête : Ce
type d'impôt était prélevé sur chaque
contribuable.
* 61 Informations recueillies
auprès du Secrétariat général, mairie de
Sangarébougou dans le cadre de la collecte de données sur la
mobilisation des ressources financières, juin 2009.
* 62 Article 4, loi n°
93-008 AN-RM du 11 février 1993 portant libre administration des
collectivités territoriales au Mali.
* 63 « Mobilisation
des ressources financières dans les communes rurales du
Mali »,
www.pact-mali.org , 2008.
* 64 « La
décentralisation au Mali : du discours à la pratique »,
SNV/ KIT, Amsterdam, 2004. (Recommandations), p.7.
* 65 Qualité d'un
membre de la commune considéré du point de vue de ses devoirs et
ses droits politiques.
* 66 « Renforcement
des ressources des collectivités locales : exemple d'outils de
mobilisation des ressources », PDM, AIMF, CGLU, septembre 2006, p.
2.
* 67 « Analyse des
structures des recettes fiscales : cas de la commune IV »,
Bréhima Aguibou TRAORE et Boubacar TRAORE, FSJE, 2005, p. 60.
* 68 « Analyse des
structures des recettes fiscales : cas de la commune IV »,
Bréhima Aguibou TRAORE et Boubacar TRAORE, FSJE, 2005, pp. 65-66.
* 69 « La
décentralisation financière en Afrique : succès,
problèmes et contraintes », PDM, mai 2000, p. 8.
* 70 « La
décentralisation financière en Afrique : succès,
problèmes et contraintes », François Paul Yatta, PDM,
mai 2000, p.8.
* 71 Recommandations faites
par François Paul Yatta dans l'ouvrage sus cité, p. 9.
* 72 « Financer la
décentralisation rurale en Afrique », Institut Royale des
Tropiques, 2004, p. 91.
* 73 La collectivité
doit assumer 20 % du coût des investissements, l'ANICT les
finançant à hauteur de 80 %. Ces 20 % peuvent se
décomposer en apport en numéraire (10 %) et en nature (10 %), la
loi n° 00-042 du 07juillet 2000 portant sa création. (Voir
également le bulletin n° 357 de l'Institut Royale des
Tropiques, « Financer la décentralisation rurale en
Afrique », 2004, p. 72.)



