|
Le 8 février 1587, Marie Stuart est
exécutée au château de Fotheringay. Michel Duchein
écrit dans l' Histoire de l'Ecosse, qu'il est toujours
délicat de faire le récit objectif de la vie d'un roi ou d'une
reine que l'on a exécuté.1(*) Le fait même de savoir qu'une instance
juridique, un peuple révolté ou un monarque à court de
solution a choisi d'en finir avec celui ou celle qui incarnait le pouvoir peut
biaiser notre opinion. En effet, cela nous pousse à prendre parti,
à décider a posteriori de l'innocence ou de la
culpabilité de ce monarque déchu dont on a mis la tête sur
le billot. Peut-être est-ce cet acte final qui rend Marie Stuart aussi
populaire. Il suffit de consulter le catalogue des bibliothèques
nationales écossaise et britannique pour se rendre compte que le
« cas » Marie Stuart a intéressé et continue
d'intéresser de nombreux historiens, écrivains et
dramaturges.2(*) Si nous
effectuons une recherche simple grâce aux moteurs de recherche des
bibliothèques nationales en tapant « Mary, Queen of
Scots », nous obtenons un résultat comptabilisant 572
entrées dans le catalogue de la British Library et un résultat de
537 entrées pour le catalogue de la National Library of Scotland. Pour
comparaison, si l'on effectue le même type de recherche avec pour
mot-clé « Mary Tudor », nous obtenons 81
entrées dans le catalogue de la British Library et 52 dans le catalogue
de la National Library of Scotland.3(*) Pourtant si l'on s'en réfère à la
fonction principale du monarque - régner - force est de constater que le
bilan de Marie Stuart est bien pauvre : son règne n'a duré
que six ans, elle a régné sur un pays protestant alors qu'elle
était de confession catholique, mais n'a pourtant jamais
réellement montré une quelconque volonté de reconvertir
par la force son peuple insoumis et réformé.
L'intérêt que portent les historiens à la
reine d'Ecosse se situe donc ailleurs. Antoine Prost écrit dans
Douze Leçons sur l'Histoire que, bien qu'ayant pour devoir de
se montrer le plus objectif possible, l'historien est toujours plus ou moins
« ami » de son sujet d'étude.4(*) Après avoir passé
des mois voire des années à étudier, analyser et
interroger les sources qui relatent la vie d'un homme ou d'une femme,
l'historien finit par se sentir proche (ou bien complètement
différent) de ce personnage historique. Après tout il s'agit
d'une expérience humaine, c'est avant tout une rencontre, une rencontre
par sources interposées, mais une rencontre tout de même. En
lisant les diverses biographies de Marie Stuart on sent que les historiens qui
se sont lancés dans l'étude et l'analyse de ce personnage
controversé ont fini, pour la majorité d'entre eux, par se
laisser influencer par le débat qui entoure la reine d'Ecosse et qui
consiste à statuer sur la responsabilité de Marie dans le meurtre
de son second époux, Henry Darnley. Bien entendu cette controverse qui
anime la littérature du seizième siècle ne se
résume pas à ce simple incident qui ferait de Marie une
meurtrière et nous verrons par la suite qu'il est bien compliqué
d'établir la culpabilité ou l'innocence de la jeune reine dans
cette affaire ; toutefois le fait que des historiens depuis plusieurs
siècles s'évertuent à statuer sur la culpabilité ou
l'innocence de la reine montre bien que l'histoire de Marie Stuart va au
delà de l'histoire du seizième siècle. L'histoire de cette
reine, jeune, belle, romantique et condamnée avait tout d'une
tragédie, et en s'intéressant au sort de la belle Marie Stuart
plus qu'à son règne ou son peuple, certains historiens n'ont fait
que suivre un chemin qu'avaient commencer à tracer des auteurs comme
Leslie ou Buchanan en abordant le personnage de Marie Stuart sous son angle le
plus intéressant, c'est-à-dire son caractère tragique.
C'est ce caractère tragique qui assure à Marie
Stuart la postérité. Jayne Elizabeth Lewis montre que les
lectrices du XVIIIème et XIXème siècle s'identifiait
à Marie Stuart et lisaient leurs rêves mais aussi leurs propres
vies dans la sienne. 5(*)
Cela prouve que pour certains Marie Stuart n'était pas seulement un
personnage historique, elle devenait un mythe, une héroïne. Si bien
que c'est avant tout cette image de reine déchue qui passionne et non
son règne à proprement parler. Rarement la représentation
de la vie privée d'un monarque n'a tant dépassé son image
publique.6(*)
La vie de Marie a pris fin en Angleterre en février
1587. Il est peut-être étrange de commencer cette brève
biographie par la fin, mais il s'avère que cette
« fin » n'est en fait qu'un début. Parmi les devises
que Marie Stuart brodait dans sa prison de Sheffield, figurait une formule des
plus énigmatiques : « En ma fin est mon
commencement ». La reine espérait-elle que son destin
déchaîne tant de passions ? Qu'entendait-elle par
là ? Etait-ce seulement une maxime chrétienne faisant
référence à la résurrection ? Nul ne le sait
vraiment. Nombre d'historiens ce sont penchés sur la question et en
discutent encore. Mais la reine d'Ecosse ne se doutait certainement pas de
l'ampleur que prendrait cette phrase. Dans son cas précis cette phrase
est devenue littéralement prophétique tant il est vrai que son
exécution a libéré la plume des auteurs qui ont
forgé sa légende.7(*) Mais pour l'heure, il s'agit de revenir au
« vrai » commencement.
Marie Stuart est née le 7 ou le 8 décembre 1542.
Elle-même clamait qu'elle était née le 8, fête de la
Conception de la Vierge, mais John Leslie affirmait quant à lui qu'elle
était née le 7. Malheureusement aucun document n'existe qui
permette de trancher absolument le débat.8(*) Elle était la fille de Marie de Guise et de
Jacques V roi d'Ecosse, qui mourut six jours après sa naissance,
laissant sa couronne à un nourrisson. L'héritier du trône
est un enfant, ce qui en soit ne pose pas trop de problèmes car la
minorité des futurs monarques écossais était devenue, par
obligation, une tradition. Jacques IV mourut après la bataille de
Flodden en 1513, son fils, Jacques V n'avait qu'un an. C'est la réaction
de Jacques V à l'annonce de la naissance de Marie qui fut inhabituelle.
Apprenant qu'il était père d'une petite fille, le roi ce serait
exclamé : « it cam wi' a lass and it will gang wi' a
lass » (Cela a commencé par une fille, cela finira par une
fille) en référence à la manière dont la dynastie
des Stuart avait accédé au trône par le mariage de Walter
the Steward (Walter le sénéchal) avec la fille de Robert le
Bruce, Marjorie. L'histoire allait prouver qu'il avait tort, en effet la
dynastie des Stuart n'allait s'éteindre qu'en 1714 après la mort
de la reine Anne. Toutefois sa réaction (bien que qualifiée
d'apocryphe par Jenny Wormald9(*)) ajoute à la dimension tragique du personnage
Marie Stuart.
L'héritier du trône d'Ecosse était une
fille, en soit, ce n'était pas un problème majeur ; tout le
monde s'accordait à dire que ce nourrisson âgé d'une
semaine était l'héritier légitime du trône d'Ecosse.
Le contexte politique en revanche était problématique. L'Ecosse
était en guerre, et le fiasco de Solway Moss (1542) avait eu pour
conséquence de faire passer certains nobles aux mains des Anglais. La
naissance d'une future reine représentait une manne pour les monarchies
européennes : si elle vivait assez longtemps pour se marier, elle
donnerait des enfants à son mari, le roi d'Ecosse, et ces mêmes
enfants hériteraient du royaume d'Ecosse mais aussi du royaume de leur
père. Autrement dit les monarchies européennes
commençaient à comprendre l'importance stratégique du
royaume écossais. Toutes les monarchies étaient
intéressées par la possibilité d'étendre leur
domination, mais une en particulier avait un avantage. Le royaume d'Angleterre
de par sa proximité géographique, couplée à sa
supériorité militaire, et de par l'existence d'un héritier
mâle âgé de cinq ans avait incontestablement une longueur
d'avance sur les autres prétendants. Au moment où se dessine la
possibilité d'une union entre l'héritière du trône
d'Ecosse et le futur roi d'Angleterre, le jeune Edouard, l'Ecosse est
dirigée par le régent John Hamilton, comte d'Arran, qui se
montre d'abord favorable à cette union. Ce mariage pouvait ramener la
paix en Ecosse. Mais au début de l'année 1543, l'opposition de
Beaton, archevêque de Saint Andrews et du comte de Lennox (autre
prétendant au trône) pousse Arran à faire marche
arrière. Jusqu'ici il s'était montré favorable à la
diffusion de la religion réformée en Ecosse avec pour dessein de
s'affirmer comme un sympathisant anglais. Seulement dès septembre 1543,
la ferveur hérétique excède ce qu'il avait
prévu : pamphlets et littérature hérétiques
abondent. Quand Arran décide de revenir sur ses décisions prises
en faveur du protestantisme, des émeutes éclatent un peu partout.
Le pays est divisé, au parti protestant et favorable aux Anglais
s'oppose un parti pro français et catholique bien plus important.
Henri VIII se sentant dupé décide de reprendre
la guerre contre l'Ecosse. Il envoie le premier raid de l'armée anglaise
au printemps 1544 pour punir Arran de sa trahison. Seymour, qui commande
l'armée, le convainc d'épargner les lords favorables aux anglais.
Henri VIII ordonne de réduire Edimbourg à feu et à sang,
ce que s'efforce de faire Seymour. La mainmise et la violence anglaise
n'avaient jamais été aussi fortes, ce qui discrédita le
parti pro anglais. Ces évènements rallièrent la morale des
écossais. De plus, la guerre opposants les anglais aux français
prenait un autre tournant et les troupes anglaises étaient
considérablement affaiblies. Excédés par le comportement
des armées anglaises, les écossais se tournent vers leur vieil
allié français. Le nouveau roi Henri II désireux
d'investir massivement dans cette province envoie de nouvelles aides en juin
1548. Un mois plus tard, un traité est signé indiquant que la
reine d'Ecosse était promise au Dauphin français et non au futur
roi d'Angleterre. En 1550 la paix est signée entre l'Ecosse et
l'Angleterre. La défaite est humiliante pour l'Angleterre.10(*)
Après cette série de campagnes militaires
menées par l'Angleterre et plus connue sous le nom romantique de
Rough Wooing11(*), Marie de Guise fit en sorte de s'arroger le
pouvoir, prenant le contrôle comme seule et unique régente du
pays. Marie de Guise prit alors la décision d'envoyer sa fille loin des
bras armés d'Henri VIII, à la cour de France. En France, Marie
fut élevée comme la camarade des enfants d'Henri II pendant que
sa mère et ses oncles complétaient les négociations qui se
soldèrent par le mariage de la future reine d'Ecosse avec le Dauphin,
François II. Dès son arrivée en France la nouvelle
princesse est louée de toutes parts. Ce qui frappait unanimement tous
les contemporains était le charme extrême de l'enfant. Même
le roi, Henri II, semblait ébloui par cette jeune princesse. La
première fois qu'il la rencontra il se serait
écrié qu'elle était : « l'enfant
le plus accompli qu'il eût jamais vu ».12(*) Diane de Poitiers était
en charge de l'éducation des enfants du roi et de la jeune princesse
écossaise. Comme le fait remarquer John Guy, Diane de Poitiers avait un
goût particulier pour la reliure et était (après la mort de
François Ier) la plus grande collectionneuse d'oeuvres d'art
italiennes.13(*) On peut
supposer qu'elle transmit son goût pour l'art italien à Marie
Stuart qui plus tard fit venir à sa cour des artistes italiens parmi
lesquels David Rizzio, musicien italien puis conseiller personnel de la reine.
L'hospitalité dont bénéficie Marie n'est
pas seulement due à l'extrême mansuétude d'Henri II. Aux
yeux des français, Marie Stuart représentait un moyen de
s'approprier le royaume britannique, ou du moins d'exercer une pression sur les
Anglais qui, rappelons le, occupaient encore un territoire sur les côtes
françaises et persistaient dans leur prétention à la
couronne de France.14(*)
Les huguenots français s'opposèrent d'abord au mariage
considérant qu'il s'agissait d'une manoeuvre des Guise pour se
rapprocher du pouvoir. Les Guise pour contrer ces objections
commanditèrent de nombreux écrits visant à décrire
Marie comme « une bonne prise ». Ainsi, bien avant le
mariage les poètes français travaillaient sur ce thème.
Saint-Gelais écrivit un poème louant la beauté de la
reine, soulignant également les avantages politiques que l'union entre
la reine d'Ecosse et François II représentait. De même, un
sonnet écrit par Jacques Tahureau en 1554 félicitait
François II et Marie qui, en devenant reine de France acquérait
un nom qui la rendrait immortelle.15(*) Les avantages que représentait ce mariage
semblaient dissiper les hésitations. Marie, future reine d'Ecosse et
prétendante à la succession du royaume d'Angleterre était
un atout politique indéniable pour la France.
En 1558, elle épouse François II qui devient roi
un an plus tard après la mort de son père causée par un
accident. Malheureusement, François II était un jeune homme
chétif à la santé fragile. Il meurt en décembre
1560, mettant un terme à tous les rêves de grandeur qu'avaient
formulé les poètes français. Marie Stuart se retrouve
alors reine douairière, veuve, âgé de dix-huit ans et
très impopulaire auprès de sa belle-mère qui craignait
sûrement que sa bru ne cherche à se remarier avec son second fils
et nouveau roi de France Charles IX. On racontait que Marie s'était mise
sa belle mère à dos du temps où elle-même, dauphine
ou jeune reine, l'avait qualifiée avec mépris de
« fille de marchands ».16(*) Marie n'avait donc plus rien à faire en France
et prit la décision de retourner en Ecosse où son royaume
l'attendait. Elle devint reine catholique d'un royaume protestant où les
Lords de la Congrégation, tels que les avaient nommés John Knox,
avaient pris le contrôle du pays en 1559.17(*)
Au moment où Marie Stuart pose le pied sur le sol
écossais, le contexte politique européen est troublé. Les
sociétés européennes sont travaillées par
l'inquiétude religieuse. En Ecosse, les protestants dirigent le pays
emmenés par John Knox. John Knox se pose dès le début en
opposant de Marie Stuart. Alors qu'il est exilé à Genève
il écrit un pamphlet contre « les Maries »
catholiques en 1558, à savoir Marie de Guise et Marie Tudor. Dans
The First Blast of the Trumpet Against the Monstruous regiment of women,
Knox explique qu'il est légitime pour un peuple opprimé de
s'élever contre le tyran qui le gouverne qui plus est si ce tyran est
arrivé au pouvoir de manière illégitime. Cependant, le
caractère misogyne du pamphlet est ce qui ressort le plus à la
lecture du texte, ce qui vaut à John Knox de se mettre à dos les
régentes de l'époque, y compris Elizabeth18(*). Ce texte portait atteinte non
seulement au genre féminin mais aussi à la
légitimité des monarques. Dans une période de troubles
politique et religieux ce texte préconisant la révolte
représentait un danger pour la monarchie, et plus
particulièrement pour la monarchie écossaise. De ce fait on peut
dire que Knox amène dans les esprits des penseurs de son époque
l'embryon d'une pensée contestataire.
L'Ecosse n'est pas le seul pays à faire face à
des troubles religieux. Depuis la publication dans sa version définitive
de Institutio religionis chritianae (oeuvre de Calvin publiée
dans sa version définitive en 1559)19(*) les idées de Réforme se
répandent un peu partout en Europe. Le but de Calvin est clair :
« Aider ceux qui désirent d'être instruits dans la
doctrine du salut ». Il se veut l'interprète de la
volonté divine : « J'oserai hardiment protester, en
simplicité, ce que je pense de cette oeuvre la reconnaissant être
de Dieu plus que mienne » et se propose de donner « une
somme de la doctrine chrétienne ».20(*) Après la mort de la
régente Marie de Guise, le Parlement écossais, composé des
barons et des bourgeois, se réunit et adopte la Confession
écossaise et les statuts de Réforme. La Confession
écossaise, présentée par John Knox, est une profession de
foi d'inspiration calviniste qui enseigne la doctrine de la
prédestination et la justification par la foi, qui ne conserve que deux
sacrements, le baptême et la Cène, qui permet la communion sous
les deux espèces et professe la doctrine de la présence
spirituelle du Christ pendant la communion.
En France aussi la doctrine calviniste fait des émules.
Après la publication de L'institution chrétienne en
1541, traduction française du texte latin publié en 1539, les
idées de réforme se répandent en France. Calvin,
rappelé à Genève en 1541, prodigue ses conseils aux
réformés français et leur envoie des directives pour
conforter leur foi. En France les réformés s'organisent suivant
le système presbytéro-synodal que Calvin a mis au point dans les
ordonnances ecclésiastiques en 1541. Grâce à
Calvin, les français réformés reçoivent des
ministres formés. En 1560 ils auraient été près
d'une quarantaine à exercer en France.21(*) Henri II a une attitude ferme face aux protestants et
est résolu, conformément au serment du sacre des rois de France,
« d'exterminer les hérétiques ». Le 2 juin
1559, les lettres d'Ecouen donnent pour mission à de
« notables personnages » de se rendre dans les provinces
pour procéder à « l'expulsion, punition et correction
des hérétiques ». La paix du Cateau-Cambrésis (3
avril 1559) conclue entre Philippe II et Henri II est établie sur la
base de la restitution au duc de Savoie des territoires conquis en 1536 et de
l'abandon solennel par le roi de France de toutes prétentions sur Milan
et Naples. Elle est un gage de sûreté pour les deux rois :
même si cette paix est peu avantageuse pour la France, elle permet aux
Français comme aux Espagnols d'avoir les mains libres pour
résoudre les problèmes religieux. Philippe II lui aussi doit
faire face aux oppositions protestantes aux Pays-Bas. Lors de son abdication
à Bruxelles, Charles Quint dit à son fils
Philippe : « Honore la religion, consolide la foi
catholique, rétablis-la dans toute sa pureté »22(*) , l'injonction est belle
mais la promesse semble dure à tenir.
En Angleterre, la situation n'est guère plus stable. En
à peine plus de dix ans trois monarques se sont succédés
à la tête du royaume. Edouard (1547-1553) succède à
Henri VIII et tente d'orienter le pays vers le protestantisme. En 1553, c'est
Marie Tudor, fille de Catherine d'Aragon et d'Henri VIII, fervente catholique,
qui lui succède. Les anglais protestants avaient pourtant essayé
de lui substituer Jane Grey, protestante et arrière petite-fille d'Henri
VII mais les troupes des Marie Tudor vinrent à bout des opposants. Mieux
connue sous le nom de « Marie la sanglante », la reine
d'Angleterre avait pour but de restaurer la foi catholique. Epouse de Philippe
II, leur union fait craindre aux Anglais que Marie Tudor ne mettent les moyens
militaires de son mari aux service de l'Angleterre afin d'en finir avec
l'opposition protestante. La religion catholique est partout restaurée
et les hérétiques sont poursuivis, jugés et
exécutés. Le 17 novembre 1558 Marie Tudor meurt et laisse le
trône à sa demi-soeur Elizabeth. L'arrivée au pouvoir
d'Elizabeth implique des changements dans le paysage religieux européen.
Si l'on considère que la catholique Marie Tudor permettait aux
monarchies catholiques de peser plus lourd sur la scène
européenne, l'accession au pouvoir en Angleterre d'une reine protestante
remet en question cette supériorité. Il s'était
constitué une ligue de quatre pays catholiques avant novembre 1558, la
France, l'Espagne, l'Ecosse et l'Angleterre, il n'en restait maintenant plus
que trois. L'opportunité se présentait de faire avancer la cause
protestante en Ecosse grâce à l'aide de l'Angleterre et l'espoir
était grand pour les lords protestants écossais. Après que
les Ecossais voient se rapprocher le danger d'une reprise en main catholique
suite à la paix du Cateau-Cambrésis, l'espoir renaît. La
persécution organisée par Henri II contre les
hérétiques conforta les Ecossais dans leurs sentiments qu'il
fallait se débarrasser de la tutelle française. C'est dans ce but
que les protestants écossais contactèrent William Cecil
dès le mois de Juillet 1559, affirmant qu'ils voulaient répandre
le protestantisme et nouer une nouvelle amitié avec l'Angleterre. Les
Ecossais et les Anglais, après des siècles d'affrontement avaient
maintenant une religion commune et un ennemi commun, la France. Le roi de
France écrivit le 29 juin 1559 au pape Paul IV qu'un incroyable
désastre s'était abattu sur l'Ecosse et qu'il en était
navré, cependant il écrivait aussi qu'il se montrait confiant en
l'avenir et qu'il s'en remettait au jugement de Dieu qui, offensé par
cette traitrise, allait rétablir l'ordre en Ecosse. Les
évènements qui suivirent mirent à mal son optimisme.
23(*) Le jour qui suivit
la rédaction de cette lettre Henri II prit part dans un combat de joute
et fut touché par son adversaire le comte de Montgomery (son oeil et sa
gorge furent transpercés par la lance de son adversaire). Le 10 juillet
le roi meurt.
La mort d'Henri II engendre un déséquilibre en
France. La tension entre les protestants et les catholiques ne fait que
s'accroître et les deux partis sont maintenant armés.
François II, le fils d'Henri II, jeune homme malingre et souffreteux
semble peu à même d'apaiser les tensions, de plus il est largement
influencé par la famille de sa femme, les Guise. François II
doit aussi s'occuper des troubles qui sévissent en Ecosse et demande au
duc de Guise de mettre fin à la dissidence mais aucun compromis n'est
envisagé par les lords écossais. De plus, Knox met le feu aux
poudres dans un sermon à Perth qui conduit à une émeute
iconoclaste le 11 mai. Marie de Guise voyait cela comme un acte de
rébellion, d'autant plus que des tombes royales avaient
été saccagées. Une rébellion religieuse venait de
commencer. La Congrégation décide d'occuper Edimbourg, mais les
troupes françaises constituent un bouclier dans le port de Leith.
Remobilisée, la Congrégation occupe à nouveau Edimbourg en
octobre 1559 et déclare qu'elle dépose Marie de Guise. Mais
là encore l'armée française est plus forte. Des raids
punitifs sont organisés par l'armée française à
l'hiver 1559-1560. La cause rebelle semble perdue.
Des éléments extérieurs jouent alors en
sa faveur. La France ne pouvait plus continuer la guerre en Ecosse. Marie et
François étaient au pouvoir théoriquement, mais en
réalité, les Guise gouvernaient. La montée des
protestations en France inquiétait le pouvoir et après la
tentative d'enlèvement du roi déjouée à Amboise en
mars 1560, les Guise ne pouvaient pas se permettre d'envoyer des troupes en
Ecosse. En janvier 1560, l'aide anglaise arrive et le port de Leith est
bloqué. Marie de Guise, malade, meurt le 11 Juin. Les français
envoient des ambassadeurs pour négocier la paix.
Par le traité d'Edimbourg, les époux royaux
français abandonnent leur prétention au trône d'Angleterre
et reconnaissent, en des termes vagues, la légitimité de la
Kirk écossaise. La gouvernance de l'Ecosse est confiée
à trois hommes : Lord James Stewart, fils illégitime de
Jacques V, Archibald Campbell, compte d'Argyll, qui disposait de la plus grande
armée privée des îles britanniques et le compte d'Arran
fils du duc de Châtelherault, un fervent prostestant. Le premier
parlement se tient à Edimbourg en août 1560, 106 lairds
protestants étaient présents.24(*) Il s'agissait bien plus d'une assemblée
révolutionnaire déguisée que d'une assemblée
constitutionnelle. Le parlement adopte la Confession of faith
(Confession de foi) alors que le traité d'Edimbourg statuait en faveur
de la tolérance religieuse. Mais les ministres protestants pèsent
de tout leur poids sur le parlement. Parmi ces ministres se trouve John Knox.
Knox ne voulait pas que les deux religions coexistent, son modèle
était celui de l'Eglise Réformée de Genève, une
Eglise établie par la loi qui appelle à l'obéissance de
toute la population. Sur 200 lairds présents le 17 août 1560 pour
voter la Confession de foi, seulement 9 se sont abstenus. La
Congrégation sort victorieuse et l'Eglise catholique associée
à la présence française en Ecosse est
balayée.25(*)
Lorsque Marie Stuart rentre en Ecosse le 19 août 1561 le
contexte politique est rendu compliqué par le jeu des successions et les
troubles religieux. La reine apparaît dès lors comme un espoir
pour les monarchies catholiques. Pourquoi une reine si jeune et
inexpérimentée intéresse-t-elle les monarques
européens ? Tout d'abord Marie Stuart est une prétendante
sérieuse au trône d'Angleterre. En effet, Elizabeth n'est que la
fille illégitime d'Anne Boleyn et d'Henri VIII, par conséquent
l'Eglise catholique ne la reconnaît pas comme héritière
légitime du trône d'Angleterre. De ce fait, Marie Stuart qui est
la petite fille de Margueritte Tudor (épouse de James IV et soeur
d'Henri VII) est une prétendante légitime au trône anglais.
Ramener l'Ecosse dans le giron catholique devient donc un enjeu de taille si
les monarchies catholiques veulent faire pencher la balance religieuse en leur
faveur. Marie Stuart semblait dès lors promise à une grande
mission, on attendait d'elle qu'elle soit une autre Marie Tudor et qu'elle
mette fin à la rébellion protestante dans son pays.
Peut-être les monarques européens et le pape attendait-ils trop de
cette jeune reine déracinée qui voguait en 1561 vers un pays dont
elle était désormais reine mais qu'elle ne connaissait
guère.
Notre étude se concentre donc sur la période
allant de 1561, date du retour de Marie dans son pays natal, jusqu'à sa
mort en 1587. Il nous a semblé intéressant de nous attacher
à étudier les représentations de la reine d'Ecosse
à travers la littérature durant cette période car il
s'agit d'une période durant laquelle s'exprime la véritable
personnalité de Marie Stuart. En effet, la jeune princesse était
déjà la muse de nombreux poètes en France, parmi lesquels
on peut citer Ronsard, mais elle n'était le sujet de leurs écrits
que parce qu'elle représentait un enjeu pour son pays d'accueil. Elle
incarnait l'espoir qu'un jour le royaume de France s'étendrait de
l'autre côté de la Manche. On faisait l'éloge d'une jeune
fille qui n'avait rien accompli, une jeune fille que l'on admirait seulement
pour sa beauté et pour l'hypothétique richesse qu'elle offrirait
à la France. Du début de son règne jusqu'à son
exécution, Marie est jugée et décrite par les
poètes contemporains en fonction de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle
n'a pas accompli ou de ce qu'elle représente. Bien loin de la pompe de
la cour des Valois, c'est dans l'exercice du pouvoir que les poètes de
sa cour la jugent. En fonction de ses actions, de son caractère et de sa
capacité à diriger son peuple, ceux-ci l'ont louée ou
l'ont accablée.
Comme nous l'avons souligné Marie arrive dans un pays
qu'elle ne connaît guère. Envoyée en France à
l'âge de cinq ans, elle est une étrangère dans son propre
pays. De plus, elle est catholique alors que la religion réformée
est religion d'Etat. Comment va-t-elle être accueillie ? De quelle
manière est-elle décrite par les poètes de la cour ?
Pourquoi Marie a-t-elle choisi la compagnie de George Buchanan ? Quelle
influence cet humaniste aura-t-il sur Marie ? Plusieurs problèmes
peuvent être soulevés. Tout d'abord, l'on peut se demander si le
règne de Marie et l'aspect tragique de sa vie ont un rôle à
jouer dans le conflit religieux et politique qui divise l'Europe. Suite aux
accusations dont fait l'objet Marie, nous verrons que Buchanan met en avant
dans un de ses pamphlets le fait que Marie appartienne au sexe
« faible ». Quel lien peut-on faire entre les écrits
diffamatoires de Buchanan et le problème posé par le règne
d'une femme ? A l'époque moderne, nombre de théories
héritées de l'Antiquité mais aussi des penseurs
catholiques entretiennent l'idée que la femme ne peut gouverner et que
son rôle est avant tout d'enfanter, de perpétrer le lignage.
Comment ces idées se manifestent dans les écrits de
Buchanan ? Marie Stuart, bien que reine d'Ecosse, est-elle soumise aux
mêmes théories ? La propagande faite autour de Marie Stuart a
un grand retentissement à travers l'Europe, ce qui fait de la reine
d'Ecosse un personnage d'importance européenne. Ses défenseurs ou
ses détracteurs voient leurs écrits traduits du latin à
l'anglais mais aussi de l'anglais au français. Comment le
« cas » Marie Stuart est-il devenu un enjeu
européen ? Comment Marie Stuart est-elle devenue ce personnage
controversé, dont on a l'impression que la vie est construite - et
décrite - comme une tragédie ?
Les sources relatant l'histoire de Marie Stuart ne manquent
pas. Dès le 16ème siècle les historiens,
écrivains et poètes ont statué sur le cas de la reine
d'Ecosse, ce qui rend le traitement des sources d'autant plus difficile. Tant
de textes ont été écrits qu'il est difficile de savoir
auxquels nous devons nous référer. A cela s'ajoute
l'évidente difficulté que représente l'étude de
sources écrites dans une langue étrangère. Nous avons donc
étudié en priorité les textes des deux auteurs
écossais qui incarnent la défense et la mise en accusation de la
reine d'Ecosse, à savoir John Leslie et George Buchanan. Ces deux
écossais ont écrit plusieurs textes durant la période
soumise à notre étude. Tout deux ont publié une histoire
de l'Ecosse tout à fait subjective. Dans Rerum Scoticarum
historia, Buchanan glorifie les opposants à Marie Stuart et
confronte la figure de la reine à des figures nobles, vertueuses et
souvent austères comme c'est le cas de James Stewart, comte de
Moray.26(*) Leslie fait
quant à lui publier sa version de l'histoire écossaise à
Rome en 1578. Loin du récit historique fidèle, ce livre s'emploie
à célébrer la religion catholique. Les trois derniers
livres sont dédiés à Marie Stuart. En dédiant une
partie de ce récit historique à la reine catholique Leslie
embrasse la fonction de l'historien tel qu'elle était conçue
durant la Renaissance. L'histoire doit être relatée dans le but
d'inculquer des leçons politiques. Ainsi Leslie met en avant la
souffrance de rois écossais qui ont souffert et combattu pour faire
perdurer la religion catholique. Leslie inscrit Marie Stuart dans cette
lignée.27(*) Nous
avons choisi d'étudier les pamphlets se concentrant sur Marie Stuart et
non les récits historiques de ces auteurs car ces derniers, bien
qu'ayant pour but de glorifier ou d'accabler la reine, n'ont pas pour objet de
détailler le règne de Marie Stuart. Ils inscrivent seulement la
reine d'Ecosse dans une lignée afin de montrer l'héritage
catholique du royaume d'Ecosse (ce que fait Leslie) ou d'insister sur la vertu
et la droiture des prédécesseurs de la reine implicitement mises
en opposition avec les passions de Marie Stuart. Nous avons donc choisi
d'étudier plus en détails les poèmes de Buchanan
adressés à la reine d'Ecosse ainsi que les deux pamphlets Ane
Detectiovn of the duinges of Marie Quene of Scottes et De Iure regni
apud Scotos. Pour ce qui est de la défense de la reine nous nous
sommes penchés sur le texte de John Leslie A defence of the honour
of the right highe, mightye and noble Princesse Marie Quene of Scotlande and
dowager of France, with a declaration aswell of her right, title &
intereste to the succession of the crowne of Englande, as that the regimente of
women ys conformable to the lawe of God and nature. Le texte est dense et
ses multiples rééditions prouvent l'évolution du
« cas » Marie Stuart. Bien sûr l'étude de ces
textes a été couplée à la lecture des biographies
et essais qui font autorité. Nous détaillons quelques uns de ces
textes plus bas.
Pour la plupart des sources premières, comme ce fut le
cas pour Detectio, premier traité de Buchanan écrit
contre Marie Stuart, nous avons été forcés de lire des
traductions. En effet le traité a d'abord été écrit
en latin, puis traduit et publié en anglais sous le titre Ane
Detectiovn of the duinges of Marie Quene of Scottes. D'autres sources
telle que A Defence etc., ont été écrites en
écossais, qui est une forme proche de l'anglais mais qui comprend ses
propres caractères, ce qui rend la lecture et la compréhension
des textes d'autant plus difficile.
Les études récentes consacrées à
Marie Stuart sont elles aussi très nombreuses, ce qui prouve
l'intérêt toujours renouvelé des historiens pour un sujet
d'étude qui malgré les controverses continue de fasciner les
contemporains. La biographie la plus connue de Marie Stuart est sans doute la
biographie publiée en 1969 puis rééditée en 1993 et
2001 de Lady Antonia Fraser, un auteur populaire outre-Manche.28(*) En dépit du fait
qu'Antonia Fraser ait consacré plusieurs années de sa vie
à l'étude de Marie Stuart et du fait que sa biographie,
très bien documentée, fasse autorité, force est de
constater que cette oeuvre s'attache la plupart du temps à romancer les
amours de Marie Stuart, clamant que celle-ci a épousé Darnley par
amour mais fut, au contraire, contrainte d'épouser Bothwell après
qu'il l'a violée. Elle comporte nombre de passages émouvants,
notamment lorsqu'Antonia Fraser raconte au combien Marie Stuart était
proche des quatre « Maries » qui l'ont accompagné en
France et lui sont restées fidèles jusqu'à la
dernière heure. Même si selon ses propres termes, Antonia Fraser
avait pour but de « vérifier la véracité des
légendes qui entouraient Marie Stuart », elle semble suivre
ces légendes sans que leur véracité ne soit remise en
cause. Ainsi, elle consacre 75 pages au règne personnel de Marie Stuart
de 1561 à 1565 et consacre 137 pages à la période allant
de 1565 à 1568, période durant laquelle Darnley est
assassiné et Marie épouse Bothwell, son troisième mari et
prétendu meurtrier de son deuxième époux. Elle consacre
ensuite 81 pages aux années 1586 et 1587 qui précèdent
l'exécution de la reine d'Ecosse. De plus la première
édition du livre d'Antonia Fraser date de 1969 et beaucoup de travaux
ont été publiés depuis sur la Renaissance
écossaise, apportant des éléments d'analyse
supplémentaires. De même, comme l'écrivent Jenny Wormald et
John Staines,29(*) depuis
les années 1980 les Ecossais font preuve d'un regain
d'intérêt envers à leur histoire nationale. Ainsi de
nombreux ouvrages comme The Bruce de John Barbour ou The
Wallace de Blind Hary ont été republiés et traduits
(ces textes sont écrits en écossais).30(*)
Il est d'ailleurs étonnant de voir à quel point
la reine suscite chez nos contemporains des sentiments contradictoires. En
effet, une société s'est par exemple formée autour de la
passion que certaines personnes ont pour la reine d'Ecosse. Un site internet
regroupant ses poèmes, une bibliographie et une biographie lui est
d'ailleurs dédié. Cette société de
passionnés s'est formée en 1992 à l'occasion du
450ème anniversaire de la naissance de Marie Stuart. Depuis les membres
de cette société se rassemblent chaque année pour discuter
des publications récentes consacrées à Marie
Stuart.31(*) En revanche,
d'autres écossais bien moins admiratifs, restent perplexes quant
à ce personnage qui après tout n'a régné que six
ans et n'a fait que ranimer les tensions entre catholiques et protestants,
lords et monarque. Parmi ces écossais critiques se trouve Jenny Wormald,
historienne et professeur d'histoire moderne écossaise à
l'Université d'Edimbourg. Son essai publié en 1988, Mary
Queen of Scots, A Study in Failure, est une des rares biographies de la
reine d'Ecosse qui critique autant l'incapacité de cette jeune femme
à régner sur son pays.32(*) Dès la préface, Jenny Wormald annonce
qu'il ne s'agit pas d'écrire une énième biographie de la
reine destinée à analyser les passions de Marie Stuart.
L'historienne écrit cet essai-biographie (le livre est en effet assez
exhaustif pour être considéré comme une biographie) alors
que l'Ecosse s'apprête à célébrer le
400ème anniversaire de l'exécution de Marie Stuart. Le
8 février 1987, Malcolm Rifkin, secrétaire d'Etat de l'Ecosse, et
David Steele, délaissèrent pour un temps les préparatifs
de la campagne électorale à l'issue de laquelle Margaret Thatcher
allait être réélue premier ministre pour la
troisième fois, pour s'adonner à ce que Jenny Wormald
désigne comme une « Mariolatrie ».33(*) On appréciera le
néologisme. L'essai de Jenny Wormald offre une perspective
intéressante. Contrairement aux précédentes biographies
consacrées à Marie Stuart, celle-ci s'attache à
étudier la reine non pas comme une femme guidée par ses passions
et trahie par ses propres conseillers, mais comme une reine qui refusa le
pouvoir préférant se mettre en quête d'un mari pour se
faire une place sur la scène européenne. A force de rêver
au trône d'Angleterre, Marie en oubliait qu'elle avait un royaume qui
était déjà sien et qui pouvait lui apporter la gloire
qu'elle espérait, fût-elle décidée à en
prendre les commandes. L'essai comporte notamment un chapitre très
intéressant qui décrit bien les sentiments des contemporains
écossais à l'égard de leur reine. Ce peuple d'Ecosse a
attendu un an avant que Marie Stuart ne daigne se rendre dans son pays
d'origine. Certes l'Ecosse était un pays dont elle ignorait tout ou
presque, un pays dont on lui avait dit en France qu'il s'agissait d'une
contrée froide, battue par le vent et peuplée de barbares ou
d'hommes tout juste civilisés, mais il s'agissait de son
royaume.34(*) En refusant
de s'y intéresser Marie refusait le pouvoir et dénigrer par
là même son peuple qui pourtant attendait qu'un monarque prenne la
tête du pays depuis dix-neuf ans.
D'autres biographies cherchent également à
nuancer l'image de tragédienne qui semble coller au personnage de Marie
Stuart. C'est le cas de l'ouvrage édité par Michael Lynch,
Mary Stewart Queen in Three Kingdoms.35(*) Il s'agit d'une collection d'essais
publiés dans le but de prouver qu'il reste encore beaucoup
d'éléments à découvrir et à analyser
à propos de la carrière de Marie Stuart. Les essais recoupent des
thèmes divers tel que le règne de Marie en France, les relations
entre Marie et les catholiques de son royaume ou encore le goût de la
reine pour la littérature. Dès l'introduction, Michael Lynch
affirme que Marie Stuart est avant tout une légende, un mythe
façonné au fil des siècles. Il est donc d'autant plus
important aujourd'hui de se défaire de ce mythe pour étudier le
parcours de cette reine de manière historique. Souvent dans les
biographies qui lui sont consacrées, l'historien cède à la
pression exercée par cette passion fantasmagorique qui entoure le
personnage et finit par défendre Marie Stuart face à ses
agresseurs. Marie devient alors une jeune femme passionnée, fragile,
entourée d'opportunistes qui n'ont pas hésité à
fabriquer de fausses preuves pour l'incriminer. Tellement
d'interprétations ont été formulées quant à
l'origine des lettres de la Cassette qu'il devient difficile d'étudier
cette période de la vie de Marie Stuart en faisant preuve d'une
objectivité totale. Michael Lynch et les historiens qui ont
participé à l'édition de cette autre biographie de Marie
Stuart ont évité le sujet et ont choisi de se focaliser sur des
aspects de la carrière de Marie Stuart qui sont parfois occultés.
Ainsi loin de réduire Marie Stuart à un vulgaire mythe populaire
Michael Lynch affirme qu'il est important de faire la vérité sur
ce que Marie Stuart a réellement accompli. Contrairement à Jenny
Wormald, Michael Lynch affirme que Marie a apporté
énormément à la littérature écossaise et a
participé, au même titre que son père ou que son fils,
à entretenir une cour raffinée et distinguée. On apprend
aussi dans l'essai écrit par John Durkan que Marie possédait une
bibliothèque composée d'ouvrages très diversifiés.
Elle lisait Ovide mais aussi Pétrarque. Le recensement des ces ouvrages
permet d'affirmer que Marie était une reine instruite et
cultivée, ce dont elle fait la preuve à la cour d'Ecosse. En
effet, elle s'entoure de poètes et musiciens italiens, anglais et
français bien sûr mais aussi d'humanistes latinistes tel que
George Buchanan.
La biographie de John Guy est à nos yeux la plus
documentée et la plus complète.36(*) John Guy est historien et professeur à
l'université de Saint Andrews. Sa biographie de Marie Stuart
présente à la fois les qualités scientifiques d'un travail
de recherche minutieux et les qualités littéraires d'un bon
roman. On trouve dans la biographie de John Guy un luxe de détails
concernant notamment l'éducation de la jeune princesse. Aussi on apprend
que Marie décrite comme une excellente latiniste par Brantôme est
sans doute plus intéressée par ces poètes qui se piquent
de faire des vers en langue vernaculaire et mieux connu sous le nom de
Pléiade. Marie accepte d'ailleurs d'être le mécène
de Ronsard en 1556, elle n'a alors que 14 ans. John Guy affirme qu'elle aurait
préféré les sonnets français aux vers latins. Au vu
des ouvrages dont elle disposait dans sa bibliothèque, l'affirmation
semble fondée. Si John Guy ne sombre pas dans le romantisme lorsqu'il
s'agit d'évoquer les lettres de la Cassette et le meurtre de Darnley, il
avance toutefois que les lettres de la Cassette sont calomnieuses.
D'après son analyse, les lettres et les poèmes contenus dans ce
petit coffre sont le fruit d'une supercherie orchestrée par Moray, le
demi-frère de Marie, et Buchanan. Même s'il apparaît que
cette interprétation soit la plus vraisemblable, il est impossible
d'écrire qu'il s'agit là de ce qui s'est réellement
passé. En effet, nous ne disposons pas de tout le contenu de cette
cassette.
Enfin, la biographie de Michel Duchein écrite en
français offre une analyse basée à la fois sur des sources
françaises et britanniques, ce qui permet d'en apprendre plus sur le
sentiment des français à l'égard de la jeune reine
d'Ecosse.37(*) Le
désamour entre Catherine de Médicis et Marie Stuart est bien
expliqué et on comprend qu'à la mort de François II, la
vraie reine de France est bel et bien Catherine de Médicis. Le fil
conducteur que choisi Michel Duchein : « Marie Stuart, la
femme et le mythe » conduit l'auteur à discuter de
l'appropriation du personnage de Marie Stuart par les auteurs et dramaturges
des siècles suivants. C'est une ouverture très
intéressante qui permet de constater que les oeuvres écrites peu
après l'exécution ont pour point d'acmé cette fin tragique
qui consacre la reine d'Ecosse en martyre. Il est toutefois regrettable que
Michel Duchein n'ait pas insisté d'avantage sur « la
femme ». Bien sûr il relate dans le détail les passions
amoureuses de la reine mais n'inscrit pas son étude dans un champ plus
large. Il aurait été intéressant de situer le règne
et les accusations portées contre la reine dans une étude du
genre féminin et des femmes au seizième siècle.
L'étude des textes de George Buchanan, de John Leslie
(et de quelques autres poètes de la cour écossaise) et des
ouvrages cités précédemment nous amène à
nous interroger sur le rôle politique que joue le personnage de Marie
Stuart. Comment ce personnage est-il utilisé par les auteurs
contemporains et dans quel but ? De quelle manière le
caractère du personnage évolue dans la littérature du
milieu et de la fin du 16ème siècle ? Dans quelle mesure le
contexte politique, diplomatique et religieux pèse-t-il sur les
écrits de ces auteurs ?
La période étudiée peut-être
divisée en trois moments qui correspondent eux-mêmes à
trois représentations de Marie Stuart. Premièrement une
période allant de 1561 à 1565 durant laquelle Marie Stuart
endosse la fonction de reine d'Ecosse et est représentée comme
telle dans la littérature écossaise. Ensuite une deuxième
période qui s'étend de 1566 à 1572 au cours de laquelle
les pamphlets contre la reine abondent. Elle est qualifiée de
meurtrière lubrique et ses détracteurs ne manquent pas de
souligner la débilité de son sexe. Enfin un dernier moment, entre
1572 et 1587, pendant lequel la reine devient un simple personnage que l'on
utilise à dessein pour justifier ses prises de position politique. La
littérature propose alors une vision héroïque du personnage
mise en balance par une vision tyrannique.
Chapitre 1 : Marie Stuart reine : une
littérature de cour florissante, de 1561 à 1565.
Lorsqu'elle pose le pied en Ecosse le 17 août 1561,
Marie Stuart se trouve dans une position difficile. Elle retourne dans un pays
qui a infligé une défaite à son pays d'accueil, vaincu sa
mère, et qui se trouvait jusqu'à son retour dirigé par la
coalition qui s'était opposée à sa mère. Qui plus
est, elle revient pour gouverner un peuple aux yeux duquel elle est une papiste
qui exerce un culte désormais interdit.38(*) Pourtant certaines décisions de la reine
rassurent les écossais quant à ses intentions. Par exemple, Marie
choisit son demi-frère, Jacques Stewart comme conseiller principal. Il
est protestant, ce qui tend à prouver que Marie n'a pas pour objectif
d'organiser une reconquête catholique, du moins pas pour l'instant. Il
faut aussi noter que les écossais attendent un monarque depuis 19
ans ; même s'il s'agit d'une femme, catholique de surcroît, le
peuple écossais nourrit beaucoup d'espoirs quant à
l'arrivée au pouvoir de cette reine.39(*) Bien que ses connaissances en matière
politiques soient irrégulières (les futures princesses
élevées à la cour des Valois ne recevaient que des
instructions rudimentaires concernant l'art de gouverner), Marie a appris
à la cour des Valois ce que l'on pourrait appeler le
« théâtre » de la monarchie. Elle est grande,
rousse et charmeuse et on lui a appris à se mettre en scène,
à incarner le pouvoir.40(*) De plus les négociations entamées avec
son demi-frère ont abouti à la conclusion que Marie ne
modifierait pas le statu quo religieux, mais qu'elle pourrait en
contre partie assister à la messe dans sa chapelle privée. Marie
Stuart était la seule catholique à officiellement pouvoir
entendre la messe catholique. Elle est isolée mais elle reste la
souveraine incontestée. On retrouve cette dualité dans les
premiers poèmes dédiés à la reine. Les
poètes chargés de louer cette nouvelle reine font leur devoir,
ils font l'éloge de Marie Stuart, mais ces poètes sont aussi des
hommes de leur temps et ne peuvent s'empêcher de glisser dans leurs
oeuvres des conseils, afin que la jeune héritière Stuart sache
que son peuple attend d'elle qu'elle soit plus qu'une reine. Ils attendent
d'elle qu'elle soit leur sauveuse.
I. Une entrée royale mâtinée de conseils.
Les conventions fixées par la Renaissance en
matière d'entrée royale voulaient que celles-ci soient l'occasion
pour le monarque d'entrer en relation avec ses sujets. L'entrée royale
était perçue comme un épiphénomène.
L'occasion avait pour but de montrer la souveraineté du monarque et la
loyauté de ses sujets.41(*) Pour le souverain l'entrée royale était
un moment de triomphe personnel, pour les habitants de la ville l'entrée
royale représentait un devoir, celui d'accueillir au mieux le nouveau
roi ou la nouvelle reine. Il s'agissait aussi d'établir un lien entre le
dirigeant et les dirigés. L'entrée royale incarnait le moment
où le souverain faisait montre de son pouvoir politique, il se devait
d'impressionner mais aussi de rassurer. L'entrée royale
représentait un évènement d'une importance telle, qu'on
l'apparentait à un art. L'art de faire bonne impression en quelque
sorte. Cet art a sûrement atteint son apogée en France, et celle
d'Henri II le 16 juin 1549 était un parfait exemple d'entrée
royale à la française.42(*) Le continent britannique avait suivit cette
tradition. Parmi les entrées royales notables à Londres on peut
citer celles de Catherine d'Aragon en 1501 et celle d'Elizabeth en
1559.43(*) Au cours du
seizième siècle les ambassadeurs ou les intellectuels
écossais avaient été témoins de ces spectacles. Ce
fut le cas par exemple de George Buchanan qui avait lui-même
composé des vers pour accueillir Charles Quint à Bordeaux en
1540.44(*) Il eût
été étrange qu'une telle expérience acquise
à l'étranger ne puisse être mise en pratique en Ecosse.
Ainsi Marie Stuart eut droit à son entrée royale le 2 septembre
1561. L'occasion était un peu particulière. Comme nous l'avons
souligné, Marie Stuart n'arrivait pas en terrain conquis : elle
allait devoir parader devant une population majoritairement protestante alors
que le pape et les monarchies catholiques attendaient d'elle qu'elle
rétablisse la foi catholique en Ecosse. Marie Stuart avait beau avoir
assisté à de nombreux évènements à la cour
de France, celui-ci promettait d'être d'une toute autre envergure. Ses
conseillers l'avaient sûrement averti que le royaume d'Ecosse n'avait pas
les moyens du royaume de France, par conséquent la reine ne devait pas
s'attendre à être émerveillée outre mesure. La reine
et ses conseillers devaient probablement aussi penser que le faste accompagnant
l'accueil d'une reine catholique pourrait raviver les tensions religieuses que
l'on préférait pour le moment savoir enfouie. Si les dissensions
religieuses étaient étouffées, alors la reine avait une
chance d'être introduite comme il se devait dans sa propre capitale et
dans son propre royaume.
Les réactions des artisans d'Edimbourg à
l'heure où la reine était arrivée dans la capitale
laissaient présager que Marie Stuart serait accueillie par son peuple
comme un monarque dans son plein droit. En effet le 19 août 1561, alors
qu'elle se baladait entre Leith et Holyrood, Marie fut encerclée et
accueillie par toute une foule d'artisans sortis de leurs ateliers pour la
congratuler.45(*) Pourtant
deux semaines après que la reine soit revenue de France, John Knox
prononce un sermon dans la cathédrale de Saint Giles, dans lequel il
s'indigne de l'attitude de Marie qu'il qualifie
d' « idolâtre ». Cette émeute montre
aussi que les protestants avaient développés une autre
manière d'accéder au monarque, de toucher à son
intégrité, tout en guidant les nouvelles forces politiques (comme
le Town Council dirigé par un prévôt protestant)
contre les structures centralisées du pouvoir. Les
réformés ne se conforment pas aux règles de cette
cérémonie car il s'agit d'une cérémonie catholique.
En agissant de la sorte, ils touchent à l'intégrité de la
reine et mettent en doute son pouvoir effectif. Dans ce contexte,
l'entrée royale de Marie Stuart ne pouvait donner lieu qu'à une
controverse. L'entrée royale était le moment où le
monarque faisait son entrée solennelle dans la ville et prenait
officiellement possession de celle-ci. Au Moyen-âge, plus
précisément jusqu'au milieu du 14ème
siècle, étaient présents lors de cet
événement : le clergé, les officiers de la ville, la
bourgeoisie et les membres des guildes. Ce groupe accompagnait le monarque
depuis les portes de la ville jusqu'au centre-ville. Mais à partir du
15ème siècle, l'entrée royale est un
événement qui concerne toute la société et toutes
les institutions. Il faut noter qu'aux 14ème et
15ème siècles cette célébration est une
célébration catholique, durant laquelle le monarque est le
spectateur de diverses petites pièces inspirées de sujets
religieux, des scènes de la passion du Christ, des vies de la vierge
Marie ou d'autres saints. Tout au long de la procession on présentait
une série de tableaux religieux, avec pour personnages principaux les
vertus que l'on retrouvait dans le speculum principis ou
« miroir des princes ».46(*) La procession était aussi marquée par
la représentation de pièces s'inspirant de l'histoire de la
dynastie royale pour rappeler la légitimité du roi. Ainsi en 1515
lorsque François Ier fit son entrée dans la ville de Lyon, il
assista à une pièce dont le thème principal était
le baptême de Clovis, premier roi de France chrétien. La
pièce était censée rappeler le caractère
sacré de la lignée des rois de France à laquelle
appartenait François Ier.47(*) Bien que cette tradition soit catholique, les
monarques protestants étaient eux aussi mis en scène dans des
entrées royales. Ce fut le cas d'Elizabeth en 1559. Mais jamais encore
un monarque catholique n'avait fait son entrée dans une ville
dirigée par un conseil municipal protestant.
L'entrée royale eut lieu le 2 septembre :
« Upon the fecund day of September lxj, the quenes grace maid her
entres in the burgh of Edinburgh on this manner ».48(*) Un convoi devait mener Marie
Stuart du château d'Edimbourg à Holyrood. Sur le chemin Marie fut
plusieurs fois interloquée par l'offense qui lui était faite. En
effet, nombre de références furent faites à la religion
protestante. Par exemple, Thomas Randolph décrit que sur le chemin qui
conduisait Marie vers Holyrood un jeune garçon âgé de six
ans remit les clefs de la ville à la reine. Cependant, avant de lui
remettre ces clefs, le jeune homme tendit à la reine deux livres :
une Bible et un psautier. Selon Thomas Randolph, le jeune garçon
émergea d'un « globe » (on présume qu'il
s'agit d'un petit nuage) et récita ce vers à la reine tout en lui
remettant la Bible, le psautier et les clefs : « the
perfytt waye unto be heavenis hie ».49(*) John Knox rapporte que Marie fronça les
sourcils à ce moment précis. Ce qui choqua Marie, et ce que ne
rapporte pas John Knox, c'est que la Bible et le psautier étaient en
langue vernaculaire, et non en latin. Sachant que les protestants
préconisaient l'apprentissage de la foi à travers la lecture des
textes, Marie la catholique, à qui on donnait la messe en latin, dut
prendre ce cadeau comme un affront. Cependant il aurait été
impoli de le refuser. Dès le début, donc, Marie fut mise dans une
position délicate. D'autres allusions à la dure tâche qui
attendait Marie Stuart parsemaient le chemin qui devait la conduire à
Holyrood. Ainsi lorsque le cortège fit une halte au Salt Tron, des
discours étaient déclamés qui avaient pour thème le
sujet épineux de l'abolition de la messe.
L'événement censé nouer le lien entre la
reine et son peuple ne semblait pas avoir porté ses fruits. La reine
aurait dû asseoir son pouvoir à travers cet
événement mais, à l'inverse c'est le peuple et le Town
Council qui avait saisi l'occasion pour dicter à la reine ce que
devait être son rôle dans cette société protestante.
On imagine la frustration de Marie Stuart après cette procession. En
effet, le monarque censé être acclamé et loué durant
cet événement, c'était tout à coup retrouvé
dans une situation embarrassante, un piège que lui avaient tendu ses
propres sujets alors que ceux-ci ne devaient montrer qu'obéissance. En
juin 1561, Throckmorton avait dit à la reine : « Madame,
votre royaume, n'est semblable à nul autre royaume de la
Chrétienté ». Marie en faisait d'ores et
déjà l'expérience.
L'Ecosse du seizième siècle avait une tradition
selon laquelle les poètes de la cour avaient l'occasion de s'adresser
directement à leur souverain pour la nouvelle année. Il
s'agissait d'un rituel de cour durant lequel le poète montrait sa
loyauté au roi dans un exercice de flatterie royale, ce que les
britanniques appellent le « prince-pleasing ».50(*) Une sorte de
réciprocité devait découler de cette rencontre, impliquant
la reconnaissance de chacun envers le rôle de l'autre. C'était une
occasion pour le poète d'être récompensé mais aussi
une occasion pour le monarque de montrer sa magnificence et sa
générosité. La relation qui unissait le monarque à
son poète était une relation étroite qui impliquait une
confiance mutuelle. L'un utilisait l'autre à dessein. Le monarque
utilisait la réputation du poète pour affirmer la richesse
culturelle de sa cour et le poète utilisait sa relation
privilégiée pour parler au roi. Durant la période du
règne de Marie Stuart cette relation semble changer.
Le poème de bienvenue adressé à Marie
est déclamé en janvier 1562. Alexander Scott, poète de la
cour, en est l'auteur et qualifie le poème de
« bill », mot utilisé pour décrire une
correspondance entre deux amants, il signe d'ailleurs le poème comme
s'il s'agissait d'une lettre envoyée à la reine. Habituellement
le poème de bienvenue n'est qu'un véhicule servant à
étaler les sentiments du poète et de son peuple envers leur
souverain. Ce n'est rien d'autre qu'une louange. Ici Scott déroge
à la règle et glisse dans son poème une
interprétation morale et politique des maux de son temps. A New Year
Gift est un long poème (26 strophes), on peut donc s'interroger sur
le fait qu'il ait été déclamé en public comme
l'avaient été les poèmes écrits pour Jacques IV et
V. Ainsi, William Stewart poète à la cour de Jacques V avait
déclamé son poème dans la chambre du souverain.51(*) Le poète mentionne
même qu'à cette occasion Jacques V avait glissé deux
shillings dans la paume de sa main.52(*) Il semble que le poème d'Alexander Scott ait
plutôt été lu pour un cercle de lecteurs constitué
par les gens de la cour. Marie n'était à Edimbourg que depuis le
mois d'août et avait déjà reçu toutes sortes de
leçons concernant la manière de gouverner. Elle avait toutefois
réussi, peu avant la nouvelle année, à faire changer le
personnel du Conseil réformé de la ville afin que celui-ci se
montre moins hostile envers son monarque catholique. Le poème de Scott
commence ainsi :
Welcum, illustrât ladye and our quene
welcum oure lyone with the floure delyce
welcum, oure thrissill with Lorane grene
welcum, oure rubent rois upoun the ryce
welcum, oure jem and joyfull genetryce,
welcum, oure pleasand princes maist of price
God gif thee grace aganis this guid New yeir !
(1-8)53(*)
Cette strophe montre qu'il s'agit bien d'un poème de
bienvenue. Le mot « welcum » est
répété au début de chaque vers.
Le poète y fait référence au
caractère royal du monarque à travers diverses métaphores.
Marie est en effet décrite comme : « une lionne
à la fleur de lys » (v.2), référence à
l'héraldique des rois de France. A l'héraldique française
s'oppose l'héraldique anglaise lorsque le poème fait
référence à la « rubent roiss ». La
rose est une image populaire de la Vierge mais c'est aussi un symbole
associé à la dynastie des Tudor. Scott se montre donc très
prudent : il souligne le caractère sacré de la reine en
employant l'image de la rose, mais l'image est double et la rose peut
très bien être interprétée comme une simple image
utilisée dans les textes appartenant au genre littéraire de
l'amour courtois54(*). La
rose est aussi une référence au trône d'Angleterre, ce qui
permet de rappeler que Marie Stuart en est une héritière
légitime. La fleur de lys était également une fleur
utilisée dans les représentations picturales de la scène
de L'Annonciation, l'image souligne ainsi la chasteté de la reine. Au
vers 5 on trouve une autre référence à la
Vierge lorsque le poète décrit la reine comme une
« genetryce ». Les deux fleurs sont donc à la fois
des symboles qui mêlent le sacré et l'humain. Marie Stuart est
à la fois divine mais c'est aussi une femme de qui l'on attend qu'elle
donne naissance à un héritier. Dès la première
strophe Alexander Scott semble rappeler le rôle de la reine qui est de
donner un héritier au royaume d'Ecosse. Mais cela peut aussi être
interprété comme une injonction par laquelle Alexander Scott
exprime le souhait que Marie Stuart soit la
« génitrice » d'un nouveau pouvoir.
Cette lecture du vers 6 tend à rappeler les attentes
du peuple écossais. En effet après avoir traversé une
guerre opposant les Anglais aux Ecossais, après avoir accepté
l'occupation des troupes françaises et après que la religion de
leurs ancêtres fut déclarée inconstitutionnelle, nul ne
doute que les Ecossais attendaient une période d'accalmie. Marie Stuart
malgré son jeune âge incarnait aux yeux de ces personnes la
possibilité de voir naître une nouvelle politique basée sur
la concorde. La strophe d'ouverture donne d'ores et déjà des
conseils à cette reine que Scott représente comme une mère
initiatrice d'un renouveau. Les strophes ont des buts multiples et la suite du
poème s'apparente à une ligne de conduite que le poète
édicte pour la reine. Chaque strophe renferme un conseil précis.
La deuxième strophe invite la reine à faire bon usage de la
raison : « this yeir sall rycht and ressone rewle the
rod »55(*)
(v.11) ; la troisième l'invite à mettre fin au conflit
religieux et la quatrième donne pour conseil d'en référer
aux quatre principales vertus afin de rendre justice au
mieux : « Found on the first four vertews cardinal, / on
wisome, justice, force and temperans »56(*) (v.25-26). Les sept
premières strophes conseillent à la reine de bien s'entourer et
de bien choisir ses conseillers. Les cinq strophes suivantes condamnent avec
des termes forts les abus de l'Eglise avant la
Réforme : « Now to reforme thair filthy licherous
lyvis »57(*)
(v.). Les strophes 13 et 14 sont au centre du poème et forment le
« noyau » du texte. Elles expriment l'espoir que sous le
règne de Marie Stuart la raison et le droit dominent :
« rycht and reasoun...may rute » (l.111). Dans les strophes
15 à 19 le poète dénonce les opportunistes qui n'ont
embrassé le protestantisme que pour des raisons matérielles,
elles font écho aux strophes 8 à 12 dans lesquelles le
poète critique la religion de Rome et l'immoralité de ses
prêtres. Aux strophes 20 à 26 le poète fait
référence aux héritiers de la reine et donc à sa
descendance. On retrouve dans ces strophes des conseils concernant le choix du
futur mari de la reine. Comment maintenir l'ordre et entretenir une cour
splendide afin d'attirer les prétendants ? En tentant de
répondre à cette question, Scott rappelle une nouvelle fois que
Marie Stuart doit donner un hériter à son royaume. Marie Stuart
est reine mais elle est avant tout une femme, une épouse et une
mère. Le poème s'achève sur une référence
à la prophétie selon laquelle un héritier mâle
naitrait d'une reine française et qui serait le descendant au
neuvième degré de Robert le Bruce, héros et roi
écossais qui unifia le royaume.
Alexander Scott trace le chemin que Marie Stuart doit
emprunter. En la décrivant comme une génitrice il met en avant
son rôle de mère. Marie Stuart est donc mère de ses sujets
mais aussi la future mère de l'héritier qui doit assurer la
pérennité de la dynastie. Dans les conseils qu'il prodigue on
note qu'Alexander Scott souhaite que la politique de Marie s'appuie sur les
quatre principales vertus. C'est pour lui la meilleure façon de servir
le bien commun. Les concepts politiques et moraux exposés dans le
« New Year Gift » rappellent la responsabilité du
monarque et de l'Eglise devant leurs sujets. Ces deux autorités doivent
être au service du bien commun : « (...) on the commoun
weill haif ee and eir / Preiss ay to be protectrix of the pure »
(v.38-39).58(*)
Contrairement à la cérémonie de bienvenue offerte à
la reine en septembre 1561, le poème d'Alexander Scott ne se montre pas
hostile à la nouvelle reine et à sa religion. Alexander Scott
montre qu'un compromis dans l'intérêt du bien commun est possible.
Il avance cette idée avec pour objectif que la reine oriente sa
politique dans le même sens. Scott fait référence au
sophisme dans son poème: `sophistrie' (v.114). Ce mot peut-être lu
comme une attaque contre le catholicisme, toutefois il semble plus probable que
le poète se positionnant lui-même contre ce genre de
circonlocutions scolastiques n'emploie ce mot que pour critiquer
l'éloquence vaine. Scott veut atteindre la vraie éloquence, celle
que les humanistes de son temps décrivent comme le moyen
d'accéder à la vertu. Le poème donne un conseil qui doit
conduire à une action, il conduit une force qui doit guider la politique
de Marie Stuart vers le bien commun. Le poème est un exemple de
littérature humaniste car le poète utilise la littérature
comme une forme d'éloquence qui sert une fonction publique dans
l'intérêt de la communauté civile.59(*)
Comme nous l'avons précisé Scott accentue le
fait que l'un des rôles de Marie Stuart est de donner naissance à
un héritier. Certes il est important que la dynastie des Stuart ne
s'éteigne pas et surtout, il est important que la reine ait un
successeur. Le fait que le poète mentionne la succession illustre aussi
la prophétie que l'auteur rappelle dans les dernières strophes.
Ainsi l'on peut suggérer que Scott insiste sur les prétentions
écossaises à la succession du trône d'Angleterre.
Cependant, il ne le fait pas en affirmant qu'Elizabeth n'est pas une reine
légitime car bâtarde, il le fait en affirmant que Marie Stuart
doit donner naissance à un héritier qui peut devenir le futur roi
d'Angleterre et par la suite unir les deux nations. Elizabeth ne semble pas
vouloir se marier et n'a toujours pas d'enfant, si Marie Stuart donne naissance
à un fils et qu'Elizabeth meurt sans descendance alors celui-ci est
couronné roi d'Angleterre. En un sens, Alexander Scott met en avant le
futur héritier (alors que Marie n'est pas encore remariée) plus
que la reine. En procédant ainsi il évite d'attiser
l'animosité d'Elizabeth envers sa cousine. En effet, Marie Stuart et
François II avaient fait ajouter les armoiries anglaises à leurs
propres armoiries, ce qu'Elizabeth et William Cecil avaient perçu comme
un affront.
Le poète en insistant sur la naissance de
l'héritier désamorce aussi toutes les interrogations que
pouvaient soulever le règne d'une femme. John Knox clamait que le
règne d'une femme était contraire à la volonté de
Dieu, le règne de Marie Stuart entrainait donc des suspicions. Insister
sur le fait que la reine est capable d'assurer une descendance, c'est
affirmer « l'utilité » de la reine aux yeux des
plus misogynes. Le poème de bienvenue donne le ton du règne quand
il est écrit pour une entrée ou pour un événement
similaire, ici la nouvelle année. Le poème de Scott décrit
une souveraine éduquée, une cour instruite et une gardienne du
bien commun. Le poète insiste sur la concorde et donne son point de vue
sur le débat religieux. Selon lui, la radicalisation de la
Réforme n'est pas inévitable. Il décrit dans son
poème un processus mesuré et juxtapose les points de vue
protestants et catholiques plutôt que de les considérer comme
exclusivement opposés.
Le poème d'Alexander Scott n'est pas le premier
à s'inspirer du thème de la nouvelle année. Richard
Maitland de Leithington composa trois autres poèmes dans le même
style : Eternal God, tak away thy scurge écrit au moment
de la messe donnée pour la nouvelle année (1560), I can not
sing for pe vexatioun qui fait référence au conflit entre
les troupes françaises et les forces armées de la
Congrégation et qui pourrait dater du 1559 et O hie eternall God of
micht, invoquant le nom de Marie dès l'ouverture, qui exprime le
souhait que la reine-régente punisse ceux qui oppressent les innocents.
Ces trois poèmes expriment la frustration causée par l'absence de
monarque, ce qui empêche le poète de se laisser emporter par les
traditionnelles louanges.60(*) Sir Richard Maitland de Leithington était
pourtant un fervent royaliste et un francophile. En 1558, il écrivit un
poème congratulant le roi Henri II pour la prise de Calais. Il exprime
ainsi le souhait que l'exemple français ranime le désir des
Ecossais de reprendre Berwick, ville écossaise aux mains des Anglais.
L'année suivante il écrivit un poème qui louait les deux
jeunes époux et congratulait Marie de Guise pour avoir ainsi uni les
deux royaumes.
Scottis and Frenche now leif in vunitie,
As ze war brether borne in ane countrie,
Without all maner or suspitioun,
Ilk ane to other keip trew fraternitie.
Defend ane other bayth be land and sie,
And, gif onye of euill conditioun,
Scottis of Frenche, qhat man that euer he be,
With all rigour put him to punitioun. (64-72)61(*)
Un des poèmes les plus enthousiastes qu'écrit
Maitland pour Marie est Excellent princes, potent and preclair,
composé pour l'arrivée de Marie en Ecosse. On y retrouve les
thèmes suivants : le mécontentement engendré par les
troubles religieux, la ferveur royaliste et une attitude un peu naïve
consistant à croire que Marie pourrait venir à bout de tous les
conflits politiques. Pareillement à Scott, dans son poème
Maitland donne beaucoup de conseils à Marie. Maitland et Scott donnent
une indication sur l'accueil fait à la reine de France redevenue reine
d'Ecosse. L'accueil était chaleureux et le retour d'un souverain
descendant de la lignée des Stuart était porteur d'espoir.
Cependant il semble que le peuple écossais attendait beaucoup de Marie,
trop peut-être. On attendait d'elle qu'elle restaure les traditions des
good old days, qu'elle soit le symbole d'une fierté nationale
retrouvée et surtout qu'elle panse les blessures encore ouvertes de la
guerre civile. Malheureusement, Maitland (simple juge et petit
propriétaire) et Scott (musicien à la Chapelle Royale) ne
pouvaient parler pour toute une nation, laquelle était nostalgique de
l'époque où le père, et avant lui le grand-père, de
Marie régnaient en maître. Il fallait bien plus que des conseils
prodigués à travers quelques poèmes pour faire jouer
à Marie Stuart le rôle qu'ils avaient écrit pour elle.
II. Un humaniste à la
Cour : la relation entre Marie est Buchanan.
La jeune reine avait fait son entrée officielle, il
lui restait à organiser sa cour. Les diverses biographies
publiées récemment montrent que Marie Stuart n'était pas
un monarque très engagé en ce qui concernait la politique de son
royaume. Jenny Wormald a d'ailleurs choisi d'intituler le chapitre traitant du
règne effectif de la reine d'Ecosse « The reluctant ruler
1560-5 » qu'on pourrait traduire par « la reine qui ne
voulait pas gouverner ».62(*) En effet, Marie Stuart semblait bien plus
intéressée par la manoeuvre politique qui consistait à
s'assurer les faveurs de sa cousine afin que celle-ci la désigne un jour
comme son successeur légitime, plutôt que par le gouvernement de
son propre royaume. Autrement dit Marie Stuart avait les yeux rivés vers
le sud alors que ses sujets attendait qu'elle trouve des solutions aux
problèmes de leur pays. A une époque où les monarques
européens se battaient pour s'arroger un pouvoir absolu, Marie Stuart ne
semblait pas intéressée par le pouvoir. Du moins elle
n'était pas intéressée par le pouvoir que lui
conférait le trône d'Ecosse. Elle n'assistait que rarement aux
sessions parlementaires et s'y ennuyait rapidement, pis encore, il lui arrivait
de tricoter alors que le parlement tenait séance. Cependant, les
historiens qui se sont penchés sur le personnage s'accordent à
dire qu'il y a un domaine dans lequel Marie Stuart réussit. La jeune
reine écossaise bien que malhabile en politique se montra en revanche
apte à entretenir une cour resplendissante. Marie Stuart était
une jeune femme cultivée et avait appris à apprécier la
poésie et l'art italien à la cour des Valois. Avec les moyens
dont elle disposait en Ecosse elle tenta de faire venir à sa cour de
grands artistes, parmi eux George Buchanan. Pourquoi cet humaniste calviniste,
ayant voyagé et séjourné en France et en Italie
accepta-t-il de s'installer à la cour de cette jeune reine
catholique ?
Buchanan naît en 1506 dans le petit village de Killearn
près de Stirling, sa langue maternelle était sûrement le
gaëlique. Ce village de Killearn se situe en territoire Lennox,
dominé par la branche des Stuart dont Henry Darnley faisait partie. Il
vient d'une famille très modeste mais un des ses oncles maternels (James
Heriot) est riche et lui permet d'accéder à une éducation
de premier rang. Il étudie à Paris entre 1520 et 1522 et il
obtient son diplôme à Saint Andrews en 1525. Plus tard, en 1528,
il obtient un autre diplôme à Paris où il est engagé
comme membre du conseil de l'université au Collège Sainte-Barbe.
Au cours de ces études, Buchanan a pour tuteur John Mair of Haddington
qui a une grande influence sur la pensée de l'humaniste. Le
conciliarisme de Mair a sûrement pesé lourd dans le
développement de la pensée politique de Buchanan. Le
conciliarisme développait l'idée selon laquelle les Papes
devaient rendre des comptes aux conseils de l'Eglise de même que les
monarques étaient responsables devant l'assemblée de leurs
sujets. Les idées de Mair ont plus tard été
supplantées par les idées humanistes d'Erasme auxquelles Buchanan
accorde sa préférence. George Buchanan vivait de sa plume, de ses
idées et de l'argent de ses patrons. En premier lieu, il devient le
tuteur de Gilber Kennedy, comte de Kassillis (1517-58) qu'il rencontre pour la
première fois à Paris mais avec qui il retourne en Ecosse en 1534
ou 1535. Une fois en Ecosse, son contrat avec Kassillis touchant à sa
fin, il est engagé comme tuteur pour l'aîné des fils
illégitimes de Jacques V, Jacques senior, évêque commandeur
de Kelso et Melrose, né de l'union du roi avec Elizabeth Shaw of
Sauchie. Plus tard il est payé pour écrire des satires. Celles-ci
sont une telle offense pour le Cardinal David Beaton qu'en 1539 Buchanan est
forcé d'abandonner son poste et de fuir en Angleterre. Malheureusement
le climat religieux y est tout aussi dangereux qu'en Ecosse. Il repart en
France à l'automne 1539. Buchanan s'installe dans le sud-ouest à
Bordeaux, où il trouve un poste au collège de Guyenne de 1539
à 1542 et de 1545 à 1547. Parmi ses élèves se
trouve le jeune Montaigne. En 1549, il est arrêté et jugé
pour hérésie par le tribunal d'Inquisition de Lisbonne alors
qu'il accompagnait le principal André de Gouvéa, invité
par Jean III, roi du Portugal, pour présider le collège des arts
de Coimbra.
Il est finalement relâché en février 1552
et il retourne en France l'année qui suit. En 1557, Henry II le nomme
page du futur roi Charles IX. Il se serait vu offrir une charge de prêtre
en Normandie. Il aurait accepté ce poste alors qu'il était proche
de la religion protestante : avait-il accepté par convenance ou par
croyance ? Il célèbre la rétrocession de Calais dans
un poème et écrit plus tard un autre poème qui
célèbre l'union de Marie et François en avril 1558. George
Buchanan se montre favorable à l'union de l'Ecosse et de la France tout
en soulignant l'authenticité et l'intégrité du royaume
d'Ecosse. Il supporte la politique des Valois et s'oppose à celle des
Habsbourg. L'humaniste écossais est opposé à l'empire
global que menaçait de former les Habsbourg englobant le nouveau monde
et l'ancien. Buchanan était aussi très suspicieux du commerce et
de l'expansion des colonies. A la mort d'Henri II en juillet 1559, lorsque
François II succède à son père, George Buchanan
voit se dessiner la trame d'un conflit religieux. Dans son troisième
poème cérémonieux déplorant la mort de
l'éphémère François II, George Buchanan se montre
plus amer et souligne la décadence française.63(*)
Un an après la mort du Dauphin, Buchanan rentre en
Ecosse. Le fait que Buchanan ne joue un rôle au sein de la Kirk
écossaise et ne s'intéresse aux questions d'éducation qui
y sont liées (il est membre de la commission chargée de
réviser le Book of Discipline)64(*) qu'après 1563 tend à prouver que
Buchanan est retourné en Ecosse en tant que membre de l'entourage de la
reine. Il était en bons termes avec les Guise et s'était
montré très flatteur envers la reine, ce qui lui permit
peut-être de s'assurer une place à la cour. Il serait donc
arrivé le 19 août 1561 à Leith et aurait offert les
mêmes services à la reine que ceux qu'il avait offerts aux Guise
auparavant. Une autre hypothèse formulée par I.D McFarlane
affirme que le demi-frère de Marie, Jacques, aurait recommandé
l'humaniste à la reine d'Ecosse. Seulement la première preuve
d'une rencontre entre le comte de Moray et Buchanan date du 9 juin 1564, soit
trois ans après le retour de Marie.65(*) La première hypothèse est donc la plus
probable.
La situation de Buchanan est révélatrice des
obstacles que les Ecossais fidèles à leur monarque mais
protestants avaient à surmonter. En effet, George Buchanan avait
embrassé la doctrine calviniste d'une part mais avait été
au service de monarques catholiques d'autre part. De plus il était ami
des Valois. Quelle position allait-il adopter ? La dévotion dont il
avait fait preuve jusqu'ici envers les Valois laissait entendre que Buchanan
n'était pas homme à s'opposer à son souverain. En effet,
Henri II l'avait accueilli à la cour de France où il était
bien rémunéré. Certes il avait trouvé un
intérêt intellectuel dans l'austère doctrine calviniste,
mais cela faisait-il de lui un conspirateur ? Il semble que Buchanan ait
été en bons termes avec la famille de Marie Stuart, les
Guise.66(*) Deux des
poèmes écrits en France en l'honneur d'Henri II, de son fils et
de la jeune reine d'Ecosse montrent que George Buchanan était
dévoué au roi Henri II mais aussi à François de
Guise.
Dans son poème : « Ad invictissum
Franciae Regem Henricum II post victos Caletes »,67(*) Buchanan congratule Henri II
mais aussi François de Guise qui prit les commandes de
l'expédition menée contre les Anglais à Calais. Dans ce
poème, Buchanan célèbre l'alliance entre les Valois et les
Guises, décrivant ces deux familles comme gardiennes de la
liberté. Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, George Buchanan
s'opposait à l'empire des Habsbourg et craignait que leurs
velléités expansionnistes ne mettent en péril la
liberté d'autres peuples européens. Ses craintes étaient
également fondées sur le fait que Philippe II avait
épousé Marie Tudor, reine d'Angleterre et catholique. L'union de
ces deux monarques très chrétiens représentait un danger
pour les protestants. La rétrocession de Calais était une
victoire des Valois, modérés et justes, sur les Habsbourg,
ambitieux et impérialistes. Pour Buchanan les Valois présentent
un caractère modéré, ils savent conclure des alliances
quand cela est nécessaire et se sont engagés à
défendre une juste cause. A l'inverse, l'empire de Marie Tudor et
Philippe II est bien trop grand, il compte trop de satellites, ce qui pousse
les deux monarques à agir de manière autoritaire et
intolérante. Ainsi, Marie Tudor est décrite comme une
mégère assoiffée de sang :
By day the terror of war resounds in
her ears
And by night the guilty recollection of dreadful crimes.
Dark shadowes disturb her restless sleep
With terrifying dreams. 68(*)
A l'inverse François de Guise est
présenté en héros :
The courage of Francis, accustomed to find
An untraveled way through intractable difficulties,
Unvanquished and indomitable,
Surpassed his former reputation by winning new
renown.69(*)
Dans ce poème qui célèbre la victoire des
Français face aux Anglais, Buchanan formule l'espoir que l'union
Valois-Guise qui détient le pouvoir se montre plus tolérante que
les fanatiques Philippe II et Marie Tudor. Le même espoir est visible
dans le poème écrit après le mariage de François II
et de Marie Stuart. Le mariage est célébré le 24 avril
1558, à cette occasion Buchanan adresse ses sincères salutations
à François II avec l'espoir qu'il poursuive la politique
menée par son père. Il voyait dans la dynastie des Valois un
espoir de sauver le monde de l'universalisme que tentait d'imposer les
Habsbourg.
Dans le poème « Francesi Valesi et
Maria Stuarta, Regum Franciae et Scotiae, Epitalamium » l'humaniste
insiste sur la dignité et le partage équitable du pouvoir entre
les royaumes de France et d'Ecosse, ce qui prouve qu'il n'était pas au
courant de l'accord secret passé entre la reine d'Ecosse et le roi de
France visant à étendre la souveraineté française
outre-Manche. Tandis que le contrat de mariage officiel garantissait
l'indépendance de l'Ecosse durant le règne conjoint de Marie
Stuart et de son jeune époux, un accord secret avait été
passé. Les oncles Guise avaient persuadé leur jeune nièce
de signer un traité stipulant que dans le cas où Marie venait
à mourir sans descendance, son royaume et ses droits de succession
à la couronne d'Angleterre revenaient directement au royaume de
France.70(*) George
Buchanan, alors qu'il ignore probablement l'existence de cet accord secret
s'échine à décrire le peuple écossais comme
valeureux et digne. Des vers 155 à 160, il insiste sur la
longévité de la dynastie des Stuart et sur la combativité
du peuple écossais, qui a su résister aux assauts romains et
anglais : « A race so often attacked by neighbouring ennemies
(yet)/ Remaining independent of foreign dominion »71(*) (v.158-159), « Here
stood one people in possession of its ancient liberty » (v.185).
L'insistance de Buchanan sur la dignité du peuple écossais est en
partie due à la volonté du poète écossais de
contrer l'idée de la hauteur française vis à vis
d'un royaume inférieur. Michel de L'Hôpital (chancelier du royaume
à partir de 1559) par exemple insistait sur les avantages que
représentait cette union en décrivant la dot de la reine comme
une aubaine pour la France, puisque la reine d'Ecosse offrait
« une couronne royale, une terre assujettie ».72(*)
George Buchanan se présente également comme un
admirateur de la reine dans ce poème. Il félicite François
II pour son mariage avec cette reine dont la beauté rivalise avec
Hélène de Troie, cependant en bon calviniste il insiste aussi sur
le fait que ses vraies qualités sont la sagesse et la grandeur
d'âme : « You yourself discovered and approved her beauty,
/ And you were a witness of her good caracter » ;
« Virtue greater than her sex »73(*). Cependant, bien que les
qualités morales de Marie en fassent une femme plus sage que
d'ordinaire, Buchanan ne semble pas séduit par l'idée que son
pays soit gouverné par une femme. A plusieurs reprises dans le
poème, il insiste sur le fait que Marie Stuart doive obéissance
à son mari. Elle doit se soumettre à son autorité :
« Yet acknowledge your station in life as a woman, and accustom
yourself to your husband's authority ». (v.237), « Learn to
be the subject to your husband's direction ».74(*) Le fait que Marie Stuart soit
décrite comme une femme belle et sage mais qui se doit d'obéir
à son mari la discrédite d'ores et déjà dans son
rôle de reine. En effet, à aucun moment dans le poème Marie
Stuart n'est décrite comme la reine d'Ecosse. La descendance royale
écossaise est mentionnée : « Hers alone is a royal
line which includes twice centuries in its records and registers »
(v.156)75(*), mais c'est
pour mieux souligner que François II règne sur un royaume dont
l'histoire est tout aussi prestigieuse que celle du royaume de France. En
d'autres termes, Buchanan inclut dans son récit un éloge des
qualités morales de Marie Stuart mais le thème majeur du
poème est bien le prestige et la gloire du royaume d'Ecosse et non la
grandeur d'âme de la reine d'Ecosse.
Le rêve d'union entre la France et l'Ecosse fut de
courte durée. Le 5 décembre 1560, le souffreteux François
II meurt. George Buchanan ne manque pas de rédiger un poème
à cette occasion. Il n'exprime pas de regret particulier quant à
la fin du rêve dynastique formulé par les Français mais il
dresse un bilan très amer de la situation politique en France et
prédit assez justement que la France allait dès lors être
rongée par la guerre civile : « (...) France in
prosperous times has exceeded in spirit the bounds of
modération » (v.3) ; « Now new tears have
returned : one death after another is reported, one calamity after
another » (v.19).76(*)
Nous avons montré que Buchanan avait été
un poète loyal envers la dynastie des Valois et la famille Guise
auxquelles il avait dédié des poèmes élogieux. Son
poème célébrant le mariage de la reine avec le dauphin
montre qu'il était un admirateur de Marie Stuart, toutefois il ne semble
jamais avoir reconnu qu'elle était la vraie reine d'Ecosse. Il
reconnaît son charme et sa vivacité d'esprit mais pas son droit
d'exercer le pouvoir. La fonction qu'il exerce à la cour d'Ecosse prouve
toutefois qu'il reconnaît l'autorité de Marie Stuart une fois que
celle-ci accède au trône. En effet, il devient l'un des principaux
poètes de la cour et montre allégeance à la reine. Comme
il a été loyal envers Henri II et son fils, il semble que
Buchanan soit prêt à servir la reine d'Ecosse avec le plus grand
respect. Alors qu'il est incarcéré au Portugal (de 1549 à
1552), Buchanan rédige ses paraphrases des Psaumes. Il achève cet
ouvrage peu après sa sortie de prison. Devenu poète principal
à la cour d'Ecosse, il offre cet ouvrage à Marie Stuart et lui
dédie. Les premiers vers du poème ouvrant le recueil prouvent le
réel respect du poète envers la reine :
O dear lady, you now hold the sceptre of Scotland,
Bequeathed to you by innumerable royal ancestors.
You surpass your lot in life by your merits, your years by your
virtues,
Your sex by your powers of mind, and your nobility of birth
by your character.77(*)
Les derniers vers semblent préciser que la
différence confessionnelle ne représente pas un obstacle à
leur collaboration :
Lest I should seem to be displeased by what pleased you.
For what they could not hope for from the skill of their
author,
They will perchance owe to your kindly spirit. 78(*)
Le recueil de paraphrases des Psaumes que Buchanan
dédie à la reine est un recueil de textes religieux classiques
rédigés en latin. Le symbole que représente cet ouvrage
place la relation entre la reine et son poète sous les meilleurs
hospices. Buchanan, en tant que poète de la cour, était en charge
de plusieurs fonctions parmis lesquelles celle de tuteur. Le 30 janvier 1562,
Thomas Randolph, ambassadeur Anglais en Ecosse écrit à William
Cecil qu' : « Il y a à la cour de la reine un
certain M. George Buchanan, un écossais, de très bonne
éducation qui fut le percepteur du fils de Monsieur de Brissac, un homme
honnête et pieux. ».79(*) Dans la bouche de Thomas Randolph
« honnête et pieux » équivaut à dire
que Buchanan était un fidèle protestant. Thomas Randolph affirme
donc que Buchanan était le tuteur de Marie, alors âgée de
19 ans. Ce n'est pas impossible, mais il est bien plus probable qu'elle
trouvât tout simplement agréable la compagnie d'un homme si
instruit et qui avait qui plus est partagé son expérience
culturelle à la cour de France.80(*) Il lisait Tite Live avec la reine afin que celle-ci
continue son apprentissage du latin. Il était
rémunéré à hauteur de 250£ par an, ce qui pour
l'époque constitue un bon salaire.81(*) Ses revenus sont doublés en octobre 1564
lorsqu'il se voit offrir les terres de Crossraguel Abbey.
III. Marie Stuart et la
littérature de cour.
Buchanan fut au service de la reine durant les cinq
années de son règne, il eut le loisir d'écrire de nombreux
travaux pour sa muse. Comme nous l'avons précisé, le poète
avait été occupé à partir de 1552 à
compléter les paraphrases de ses Psaumes. La rédaction de ces
paraphrases s'était écoulée sur quinze ans et finalement
l'humaniste écossais décida de dédier cet ouvrage à
la reine. On sait que Buchanan avait passé trois ans de sa vie en prison
à Lisbonne après que le tribunal de l'Inquisition le condamna
pour hérésie. Quand Buchanan rentre à Paris en 1553, le
pape lui octroie son pardon et le poète désire montrer qu'il
n'est pas un opposant à l'orthodoxie. C'est dans ce contexte qu'il
entame la rédaction des paraphrases.82(*) En plus de cette entreprise, en tant que poète
latin de la cour, il est chargé d'écrire les poèmes
relatant les évènements officiels de la cour. La plupart de ses
poèmes concernaient Marie ou les cérémonies que la reine
donnait à la cour.
Deux poèmes de Buchanan furent écrits en
l'honneur de Marie. Ils forment une paire et décrivent respectivement la
reine enfant et la reine adulte. Le premier, « Maria Regina Scotiae
puella », dit combien la reine a su exercer son esprit pour devenir
érudite : « She herself surpassed both Nature and
Art by so much / That the one seemed crude and the other
unskilful »83(*). A l'inverse le second, « Eadem
adulta », est assombri par la haine que Buchanan voue au Cardinal de
Guise, ce qui laisse à penser qu'il a été écrit
après 1566, peut-être après le massacre de la
Saint-Barthélemy : « If my uncle had not been so
dangerous to me and so dishonourable, I, Mary, should have been the leading
lady of the age ».84(*) Le plus beau des poèmes que Buchanan ait
adressé à la reine est sans doute le poème dont nous avons
fait mention un peu plus haut et qui ouvre l'ouvrage de paraphrases des
Psaumes. Même si l'on constate que Buchanan a des mots durs à
l'encontre de Marie après son abdication, force est de constater que
cette dédicace semble tout à fait sincère. Le fait de
savoir que cet éloge se transforme plus tard en accusation
n'enlève rien au charme du poème.
D'autres poèmes composés en Ecosse et pour la
reine concernent des échanges d'anneaux entre Marie Stuart et la reine
Elizabeth. Au début de l'année 1562, les relations entre les deux
souveraines semblent tout à fait cordiales et l'on parle d'organiser une
rencontre entre les deux cousines l'été suivant. Sir James
Melville explique que Moray était en bons termes avec Leicester, et les
relations avec William Cecil étaient elles aussi amicales. En
février Randolph informe Cecil que : « La reine
propose de faire parvenir à sa Majesté la Reine (Elizabeth), par
son intermédiaire ou bien par celui de quelqu'un d'autre, une jolie
bague surmonté d'un diamant en forme de coeur ».85(*) Il semble que Randolph ne
reçut une réponse à cette lettre que le 17 juin. Cecil
écrivit que la reine était tout à fait enchantée
par cette idée et qu'elle appréciait la gentillesse de sa
cousine. En retour elle devait écrire quelques vers pour Marie Stuart et
envoyer à son tour une bague. Elizabeth reçut sa bague le 12
juillet, accompagnée de quelques vers écrit par Buchanan. Dans ce
cas précis, les vers de Buchanan servent la reine d'Ecosse en ce sens
qu'il ont un but politique : rassurer la reine d'Angleterre et l'informer
des bonnes grâces de sa cousine afin qu'Elizabeth accepte de la
rencontrer. On ne sait si ce sont les vers de Buchanan ou le présent qui
ont touché la reine d'Angleterre, mais Elizabeth accepta finalement de
rencontrer la reine d'Ecosse. Toutefois le 15 juillet Elizabeth reporta la
rencontre à l'année suivante, fixant la date de celle-ci aux
alentours du mois d'août 1563. Les deux reines ne se rencontrèrent
jamais.
Un deuxième groupe de poèmes écrits par
Buchanan durant le règne de la jeune reine d'Ecosse est composé
de mascarades rédigées pour divertir la cour et son monarque. La
première série de mascarades fut composée pour
l'événement du dimanche 13 janvier 1563, à l'occasion
duquel Marie Fleming fut couronnée « reine ». Ces
mascarades écrites pour amuser et divertir la cour peuvent sembler
futiles. En effet, pourquoi employer un humaniste de renom pour écrire
des pièces qui ne servent qu'à distraire la cour ? Le
rayonnement culturel d'une cour européenne avait toute son importance.
En dépit du fait que le but premier de ces mascarades ait
été de divertir, il apparaît que ces spectacles
représentaient aussi un élément de diplomatie. John Knox,
qui fulminait à l'idée que la cour écossaise ne soit que
bals et représentations, assimilait cette débauche d'amusement
à l'immoralité de la reine Marie Stuart : « Thair
began the masking, which from year to year hath continewed
since ».86(*)
Selon John Knox toutes ces festivités étaient contraires à
la volonté de dieu. Pour Knox : « banketting, immoderat
dansing » sont liés à la cupidité du monarque
qui ne se soucie pas des vrais problèmes, tel que la pauvreté par
exemple.87(*)
Le réformateur calviniste associe donc l'art de bien
gouverner à la raison et à la droiture, par opposition, tout ce
qui relève du domaine des passions, n'est qu'excès. Le monarque
ne peut gouverner selon ses passions. La raison est supérieure aux
désirs et le pouvoir ne peut être exercé de manière
juste que lorsque le monarque gouverne avec raison. On retrouve ici
l'idée de Platon selon laquelle raison et passion représentent
deux sphères opposées. Platon situait la raison et la passion
dans deux parties distinctes de l'âme. La raison, plus noble,
était placée dans la tête, tandis que la partie
désirante siégeait dans le ventre. Les passions conduisent
l'homme à négliger la raison, à ne plus vivre que selon sa
sensibilité et ses impulsions, c'est-à-dire à vivre dans
l'illusion en ignorant à la fois l'essence des choses extérieures
et la sienne. C'est ce que semble reprocher John Knox à Marie Stuart.
Cette accusation soulève deux problèmes. Tout d'abord, cela
indique que selon les réformateurs Marie Stuart n'est pas un bon
monarque parce qu'elle écoute ses désirs personnels en demandant
à sa cour de prendre part à de tels spectacles. Ceci prouve
qu'elle écoute d'avantage sa personne que ses sujets, donc c'est une
reine égoïste et immorale. Enfin, John Knox, en évoquant
l'absence de qualité morale de la reine, souligne que celle-ci est bien
trop encline à écouter ses passions et rejoint la théorie
selon laquelle les femmes, puisqu'elles sont susceptibles de céder plus
facilement à leurs passions, ne peuvent gouverner. Leur tendance
à écouter en premier lieu leur passion plutôt que leur
raison est une preuve que les femmes sont moins intelligentes que les hommes.
Autoriser une femme à gouverner une assemblée d'hommes est donc
contraire à l'ordre naturel.88(*)
Toutefois, il semble que les détracteurs de Marie
Stuart aient simplifié un phénomène beaucoup plus complexe
en jugeant les divertissements de la cour complètement inutiles. En
effet, Elizabeth et Catherine de Médicis multipliaient elles aussi les
représentations et la splendeur des fêtes qu'elles organisaient
était toujours louée.89(*) Chaque cour européenne avait sa manière
de faire valoir ses atouts culturels. Ainsi Buchanan, poète de la cour,
se devait de participer au rayonnement culturel écossais. Une
pièce ou quelques vers écrits par Buchanan à l'occasion
d'un événement célébré à la cour
assurait la renommée de la cour d'Ecosse. Ainsi l'on peut critiquer avec
John Knox la frivolité de la reine d'Ecosse habituée au faste de
la cour des Valois ou bien l'on peut se pencher sur la question suivante :
dans quel but les vers de Buchanan censés divertir la cour pouvait-il
servir l'image de la reine d'Ecosse ? Les représentations
données en Ecosse ne sont pas isolées et traduisent non seulement
les goûts personnels de la reine pour les mascarades mais sont aussi
révélatrices de l'orientation de sa politique. Lors de ses
évènements l'image publique et l'image privée du monarque
s'entremêlaient. Ainsi l'on croyait pouvoir assister publiquement
à la vie de la cour. Comment de tels évènements
pouvaient-ils façonner l'image d'un monarque ? Il n'était
pas rare que des ambassadeurs ou bien des diplomates étrangers assistent
à ce genre de représentations, si le spectacle était
réussit ils ne manquaient pas de relater la beauté de ce qu'ils
avaient vu. Ainsi, la cour écossaise se devait de rivaliser de splendeur
avec les cours de France et d'Angleterre, deux royaumes avec lesquels Marie
Stuart était intimement liée. Marie Stuart élevée
en France avait pu se familiariser avec les tours de France et autres
entrées royales organisées par les Valois.
Les cours anglaises et écossaises durant les
années 1560 affichent une certaine proximité en ce sens que les
deux jeunes reines célibataires n'hésitent pas à ce servir
des mascarades ou autres vers composés par leurs poètes de cour
pour s'adresser directement à leur « bonne soeur ».
Marie Stuart envoie une lettre accompagnée de quelques vers de Buchanan
lorsqu'il s'agit de faire montre de ses bons sentiments envers Elizabeth, la
chère soeur qu'elle aimerait enfin rencontrer. A partir de 1562, alors
que l'attention est tournée vers Marie Stuart et son futur mariage,
divers spectacles mettent en scène l'Amour Mutuel et la Chasteté.
Ainsi en 1564, Thomas Randolph (ambassadeur d'Angleterre en Ecosse) fait le
récit à Cecil d'un banquet auquel il a assisté mettant en
scène l'Amour et la Chasteté. L'ambassadeur anglais raconte que
les serveurs chantaient des vers célébrant l'amour, la
chasteté et l'amour mutuel. Pour clôturer le banquet, la chanson
finale était clairement explicite quant au sentiment de Marie Stuart
envers la reine d'Angleterre :
Rerum supremus terminus
Ut astra terres misceat,
Regina Scota diliget
Anglam, Angla Scotam diliget.90(*)
Le thème du spectacle, les personnages mis en
scène et le finale ont pleinement été choisis par Marie
Stuart pour montrer à la reine d'Angleterre aussi bien qu'au public
écossais qu'elle ne s'aviserait pas de s'engager dans une union qui
puisse briser les liens d'amitiés qui l'unissent à sa bonne
soeur.
Pour s'assurer que le message communiqué par se
spectacle soit bien compris par Elizabeth, Randolph rapporte que Marie glissa
dans sa main quelques vers qu'elle le sut gré de remettre à
Elizabeth. Ses vers étaient de Buchanan et avaient pour thème la
chasteté et l'amour mutuel. L'un des poèmes, Mutuus
Amor, concluait que l'amitié qui unissait les deux reines
était imperturbable.91(*) Le fait que Marie Stuart fasse enjoindre les vers de
Buchanan au récit de la représentation montre qu'il est
primordial pour la jeune reine écossaise que ce masque ait une double
audience : la cour écossaise présente au banquet et le
monarque anglais absent. Il s'agit d'un geste d'amitié qui tend à
montrer que même si le divertissement est donné pour la cour
écossaise, il s'adresse avant tout à Elizabeth. Ce qui souligne
le caractère politique de la pièce. Nous avons vu que Buchanan
participe à cette manoeuvre politique qui consiste à faire passer
un message diplomatique à travers le divertissement. Les vers de
Buchanan sont donc écrits afin d'asseoir la position de Marie Stuart,
comme gage de ses sentiments sincères. Un an plus, tard le
caractère dramatique que revêtait l'éventualité
d'une union n'était plus d'actualité car Marie avait choisi son
futur époux. L'union n'avait rien pour plaire à Elizabeth, Henri
Darnley était catholique et pouvait prétendre lui aussi au
trône d'Angleterre.
Avec Darnley la reine d'Ecosse espérait avoir trouver
un compagnon assez fort pour établir son propre pouvoir et
rétablir la religion catholique en Ecosse et plus tard peut-être
en Angleterre. Marie avait pour ambition de s'émanciper du
contrôle exercé par les hommes qui s'opposaient à elle sur
les questions religieuses comme politiques et l'union avec Darnley
concrétisait ce souhait. Le choix semblait rapide mais devant la
pénurie de prétendants, Marie Stuart se devait de choisir
l'option qu'elle considérait être la meilleure. Elizabeth non sans
audace avait proposé son propre favori, Robert Dudley, mais avait plus
tard fait mine de reprendre son bien. Marie Stuart envisageait même de se
marier à Don Carlos si dérangé soit-il.92(*) Le choix de Darnley
était donc perçu comme impulsif et irréfléchi,
Marie Stuart se mettait à dos Elizabeth et tous les sympathisants
anglais de son royaume. Pour affirmer son choix personnel la reine use donc de
divertissements et de performances théâtrales. En avril, alors que
Darnley est souffrant et que l'affection de la reine pour celui-ci ne fait que
s'accroître elle donne une messe pascale en grande pompe. Pour le mariage
célébré le 29 juillet 1565 peu de représentants
étrangers étaient présents, manquaient aussi la noblesse
écossaise qui désapprouvait pour la plupart cette union.
Malgré l'absence de ces personnes, John Knox insiste sur le fait que le
mariage ne fut que « bals, danses et banquets ».93(*) Buchanan encore une fois
écrivit des textes pour le mariage, abordant des thèmes bien
spécifiques afin d'affirmer une fois encore les choix de sa souveraine.
Le premier divertissement mettait en scène des dieux
et déesses qui vantaient le pouvoir du mariage et de l'amour. Il
célébrait aussi la reine comme membre de la bande des cinq
« Maries ». La deuxième pièce avait pour
personnage des visiteurs exotiques tels que des cavaliers venus d'Ethiopie, des
nymphes venues de Neptune ou encore Cupidon qui venaient présenter leurs
voeux au couple royal. Les quatre Maries se mirent en scène dans une
pièce célébrant le retour de Salus, déesse de la
vie et de la santé.94(*) Aucune de ces représentations ne semblent
aborder ouvertement un problème politique. Pourtant dans l'éloge
déclamé par les cinq Maries, Diane se lamente du fait qu'une des
cinq Maries soit arrachée à leur bande à cause de ce
mariage. A la suite de cela un débat s'engage autour des thèmes
du mariage et de la chasteté. Une bande de dieux grecs vient ensuite
vanter la supériorité d'un mariage fertile. Un mariage fertile
apporte la stabilité, tel est le message que véhicule la
pièce. Le message semble être un lieu commun mais sa
résonnance est d'autant plus grande dans le contexte politique de 1565.
Elizabeth est toujours sans enfant alors que le mariage de Marie avec Darnley
annonce la naissance d'un héritier potentiel du royaume d'Ecosse mais
aussi du royaume d'Angleterre. La structure du deuxième masque dans
lequel des visiteurs étrangers viennent rendre hommage au monarque
renvoie à la structure de nombreuses représentations
françaises au cours desquels des visiteurs étrangers viennent
congratuler le monarque. Une telle représentation assoit le pouvoir
royal, représentant le régent comme le centre autour duquel le
monde entier gravite. Cependant on note que le choix des personnages
représentés (des cavaliers éthiopiens, Cupidon, des
chevaliers de la Vertu, etc.) montrent bien que le message politique n'a pas
vocation à être retranscrit à l'étranger. Le pays
d'origine des personnages est trop exotique. Si les cavaliers avaient
été européens, le message aurait probablement eu une autre
résonnance. Ici il semble bien que Buchanan retranscrit un message avant
tout écossais : la nation attend que naisse de ce mariage un
héritier qui apporte une stabilité politique et une
pérennité dynastique.
Durant la première partie du règne de Marie
Stuart, les textes qui sont dédiés à la reine annonce la
dure tâche qui l'attend : régner sur un royaume protestant
alors qu'elle est une reine catholique. Malgré cet obstacle la
littérature de cour ne manque pas de louer cette reine dont les
poètes tels qu'Alexander Scott espèrent qu'elle apporte la
stabilité au royaume. Piètre régente mais excellent dans
l'art de la représentation, Marie Stuart a l'intelligence de faire de
l'humaniste écossais le plus renommé, George Buchanan, son tuteur
et poète attitré afin d'affirmer son image de reine
cultivée et esthète. Bien qu'il s'agisse d'une
représentation visuelle les mascarades et autres pièces
composées par Buchanan servent ses choix politiques et confirment la
volonté de la reine d'Ecosse d'entretenir l'amitié qui la lie
à sa consoeur anglaise. Toutefois le mariage qui l'unit à Darnley
semble réduire ses efforts à néant, et le contexte
politique qui s'ensuit voit croître un mécontentement
général qui s'exprime plus tard à travers les textes du
poète latiniste qui la servit autrefois si loyalement.
Chapitre 2 : Marie Stuart femme, ou la naissance
d'un personnage controversé, de 1565 à 1572.
L'exercice féminin du pouvoir était une chose
controversée à l'époque, cependant la situation
écossaise n'était pas isolée. Alors que de nombreux
penseurs s'accordaient à dire que l'accession au trône d'une reine
devait rester un événement extraordinaire au sens propre du
terme, les royaumes européens du 16ème siècle
souffrant d'une pénurie de primogéniture mâle tombaient
entre les mains de reines que certains auraient préféré
voir cantonner à leur rôle de maîtresse de maison.95(*) A la mort d'Edouard VI le 6
juillet 1553 Marie Tudor devient reine d'Angleterre, à la même
époque Marie de Guise veuve du roi Jacques V d'Ecosse est régente
du royaume écossais. Deux autres femmes héritent à leur
mort du royaume d'Angleterre et du royaume d'Ecosse. En France, depuis la mort
du souffreteux François II c'est Catherine de Médicis qui assure
la régence du pays et ce jusqu'en 1564. Les femmes au pouvoir, les
critiques pleuvent. Parmi les plus véhémentes se trouve celle de
John Knox. Bien que The First Blast of the Trumpet ?Against the Monstrous
Regimen of Women publié en 1558 soit dirigé contre Marie de
Guise et non contre sa fille, le réformateur calviniste n'a de cesse de
dire combien le règne de la jeune Marie Stuart n'est pas naturel. Pour
Knox le sexe, la religion et l'âge de Marie Stuart constituent les trois
péchés qui rendent son accession au trône contraire
à la volonté divine.96(*) Durant la première partie de son règne
seul les avertissements de John Knox sonnent l'alarme quant à
l'immoralité de cette jeune femme qui aime le théâtre,
danser et même se travestir.97(*) Un témoin rapporte que la reine aurait
même souhaité être un homme : « to know what
life it was to lie all night in the fields, or to walk upon the causeway with a
jack and knapscall »98(*). De telles affirmations quant aux déguisements
que la reine aimait à porter donnaient immédiatement à la
cour des allures scandaleuses. Usurper l'identité d'un homme est un
délit qui perturbe l'ordre établi. Ce n'est pas à cause de
ce genre de frivolités que le peuple écossais se détourne
de Marie Stuart, toutefois c'est un exemple révélateur de ce que
la littérature d'opposition considère être sa plus grande
faute. Son sexe qui ne semblait pas être un obstacle au bon
fonctionnement du royaume lorsque Marie arrive en Ecosse se trouve être
son plus grand défaut à l'aube des troubles politiques qui
s'annoncent.
Avoir une femme pour monarque implique que celle-ci choisisse
un mari et de là découlent plusieurs craintes. En effet, ce mari
s'il est étranger peut tenter d'imposer une politique favorable envers
son propre royaume (c'est une des craintes qu'avaient les Anglais envers
Philippe II époux de Marie Tudor) ou bien encore tenter d'assujettir le
royaume de sa femme à son propre royaume. Autrement dit l'on craignait
que la reine qui selon le devoir conjugal devait obéissance à son
mari ne laisse celui-ci prendre le contrôle du royaume. Le mariage
était une question épineuse, les sentiments de la reine
l'étaient plus encore. En effet, le monarque devait s'efforcer de
dissocier sa personnalité publique de sa personnalité
privée et c'est là l'un des points faibles de la reine d'Ecosse.
Ses tourments amoureux qui la font passer à la postérité
sont autant de matière à controverse dont la littérature
se saisit pour déchoir Marie et la rabaisser à sa condition de
« simple » femme.
I. Dernier éclat du règne : le
baptême de Jacques VI.
Le mariage avec Darnley fit se concentrer toutes les
attentions sur la prétention de la reine Marie Stuart à la
couronne d'Angleterre. Ce sujet fut inévitablement repris dans les
poèmes écrits pour célébrer le mariage en 1565 mais
aussi dans ceux adressés à Jacques, le fils de Marie et de
Darnley, l'année qui suivit. Sir Thomas Craig, un célèbre
avocat écossais fut l'un des premiers à avancer les arguments
selon lesquels la reine d'Ecosse était l'héritière
légitime du trône d'Angleterre. Dans Epithalamium
publié l'année du mariage Craig, malgré quelques doutes
émis quant à la loyauté de Darnley, annonce que les
royaumes d'Angleterre et d'Ecosse seront bientôt unis sous l'égide
du futur héritier qui naîtrait de ce mariage, et d'ajouter qu'il
n'y avait dès lors plus aucun doute quant à l'identité du
successeur d'Elizabeth.99(*) La naissance de Charles Jacques (futur Jacques VI)
fournit une raison supplémentaire de nourrir de tels espoirs. Les odes
écrites à l'occasion du baptême suggèrent les
attentes du peuple écossais envers ce futur roi. Jacques était le
premier héritier de sexe masculin, fils d'un monarque écossais,
à survivre depuis 1540. En soit sa naissance représentait
déjà un exploit. Le climat politique en Ecosse autour de 1565
était plus favorable à la reine et l'on note même une
certaine cordialité entre les gens de la maison royale et les grands
nobles du Privy Council.100(*) Seulement, plus tard dans l'année 1565 les
tensions à la cour d'Ecosse redeviennent palpables à cause du
regain d'intérêt accordé aux Lennox Stewart (la famille de
Darnley) et de la tentative avorté des Hamilton, du comte de Moray et du
comte d'Argyll de rétablir une majorité qui leur soit plus
favorable au sein du Privy Council.
Le comte de Moray, le demi-frère de Marie Stuart,
n'appréciait guère cette union. De nombreuses familles nobles qui
avaient reçu le soutien de Cecil lors du soulèvement contre les
Français voyaient d'un très mauvais oeil cette union catholique
qui révélait au grand jour les prétentions de la reine
écossaise à la couronne d'Angleterre. Comment donc les
festivités et la littérature qui accompagnent l'avènement
du jeune prince vont-elle combler le vide entre la famille royale et les nobles
du royaume ? Quel rôle peut avoir l'image d'une cour
revitalisée dans un royaume où les divergences d'opinion
croissent ?
Avec la naissance du dauphin, l'opportunité
était grande d'exploiter le culte de la monarchie dans le but de rallier
l'opinion publique aux choix de la maison royale. Comme nous l'avons
souligné Charles Jacques était le premier fils descendant de la
lignée des Stuart à survivre depuis 1540. Bien que son
père et sa mère aient été catholiques, il semble
que les protestants accueillaient la nouvelle avec la plus grande joie. En
effet, l'absence d'héritiers avait causé au royaume d'Ecosse bien
des tracas. En mars 1286 Alexandre III meurt accidentellement et sans
héritier ce qui vaut à l'Ecosse de s'engouffrer dans une guerre
contre le roi Edouard Ier d'Angleterre de 1296 à 1304 avant
que Robert Ier (plus connu sous le nom de Robert le Bruce)
n'accède au pouvoir.101(*) Avec Jacques VI la dynastie des Stuart perdurait.
Dès l'annonce de la naissance, la foule se précipita dans
l'église de Saint-Gilles pour remercier Dieu et des feux de joies furent
allumés un peu partout.102(*) Aucune voix ne s'éleva contre
l'allégresse générale, pas même celle de John Knox.
En prévision des dépenses que suscitait le faste d'un
baptême de cette importance une taxe nationale fut levée. Il
s'agissait du premier impôt mis en place sous le règne de Marie
Stuart. En septembre une taxe de 12 000 livres avait été
accordée par les Etats.103(*) Le baptême devait avoir lieu le 17
décembre. Malgré la décisions prise par la reine de
célébrer un baptême catholique, la Kirk ne vint
pas protester contre ce rite idolâtre.
Les célébrations s'étalèrent sur
trois jours, faisant de ce baptême un véritable festival de la
Renaissance. Michael Lynch fait référence à cet
événement comme au plus grand festival de la Renaissance que la
Grande Bretagne n'ait jamais connu. En dépit des relations houleuses qui
faisaient vaciller le couple royal, Marie réussit à faire de cet
événement un exemple de splendeur capable de rallier la
communauté entière derrière la joie que produisait la
naissance d'un héritier. Dans les préparatifs des
festivités il semble que l'expérience de Marie Stuart à la
cour des Valois ait pesée lourd. En effet, durant son enfance Marie
avait été exposé à toute une série de
magnificences françaises célébrant le triomphe d'Henri II
sur les Anglais en 1550. Toute une série de fêtes de type
Renaissance avait été donnée lors desquelles les
représentations visuelles de la monarchie avaient été
accentuées par les entrées royales et autres
références à la tradition chevaleresque. Ainsi le
rôle du monarque garant de l'ordre et de la paix était
accentué à travers moult divertissement. Sans en avoir l'air cet
art du paraître ralliait les foules et assurait au roi une certaine
côte de popularité. Le mariage de Marie Stuart avec le Dauphin fut
organisé selon le même principe. L'avantage politique que
représentait cette union était mis en avant par la
littérature de cour, les poèmes et autres somptueuses
extravagances.104(*)
Forte de cette expérience en France, depuis 1562 Marie Stuart avait
passé le plus clair de son temps à sillonner son royaume tentant,
comme l'avait fait Catherine de Médicis pour Charles IX entre 1564 et
1565, de prospecter pour la réconciliation d'un royaume divisé.
Cependant, la perspective du baptême ouvrait la
possibilité de manoeuvres diplomatiques encore plus grandes : les
ambassadeurs de pays étrangers allaient se déplacer, il
était donc primordial de faire impression afin que ceux-ci puissent
décrire de manière élogieuse les moyens mis en oeuvre par
ce pays dont on ne soulignait généralement que la pauvreté
proverbiale. Un autre enjeu politique est à souligner. La marraine de
l'enfant était Elizabeth et le comte de Bedford était
chargé de la représenter à Stirling, où se tenait
les festivités. Bien que celui-ci refusât de
pénétrer dans la chapelle pour assister à la messe qu'il
considérait comme un rite papiste, l'envoyé anglais fut satisfait
de sa mission : « les autres ambassadeurs voyaient avec une
sorte de jalousie et de dépit que les Anglais étaient
traités avec plus de distinction et étaient plus caressés
qu'eux » rapporte James Melville dans ses mémoires.105(*) La célébration
du baptême avait deux significations pour Elizabeth. Premièrement,
Marie Stuart avait réussi dans un domaine où Elizabeth avait pour
le moment échoué, elle avait assuré sa descendance.
Elizabeth n'était âgé que de 33 ans à
l'époque, la probabilité qu'elle donne naissance à un
héritier n'était pas nulle mais elle s'obstinait à vouloir
rester célibataire, ce qui amenuisait fortement les chances de voir un
jour la reine « vierge » présenter son propre enfant
à sa succession. Sans compter que depuis 1562, la question de la
succession faisait débat. En effet cette même année
beaucoup avait craint pour la santé de la reine alors atteinte de la
petite vérole. L'on craignait qu'elle ne meure sans avoir
désigné son successeur. Le jeune prince écossais
était donc un successeur tout désigné. Pourtant, le comte
de Bedford avait été envoyé à Edimbourg pour
s'assurer que la reine d'Ecosse ratifie le Traité d'Edimbourg et
garantisse de ne pas interférer dans les affaires de succession si la
reine Elizabeth venait à se trouver dans une situation délicate.
Au lieu de s'en offusquer et de congédier Bedford, la reine d'Ecosse
donna à Bedford des réponses encourageantes. Le 18
décembre, deuxième jour des festivités, Marie invite ses
convives à s'asseoir autour d'une table ronde. Ce symbole ne pouvait que
confirmer les bonnes impressions de Bedford. En effet, la table ronde rappelle
le roi Arthur, roi légendaire des britanniques. Cette image fut
liée plus tard dans le règne d'Elizabeth au retour de l'âge
d'or, elle incarnait une promesse de paix et de
prospérité.106(*) Le fait que la table ronde réapparaisse lors
du baptême de 1566 souligne la stabilité nouvelle du royaume,
stabilité qui ne pouvait admettre qu'on se querellât à
propos de droits successoraux.
Pourtant, Elizabeth a bien compris que sa « bonne
soeur » bénéficie maintenant d'un avantage. En
témoigne sa réaction à l'annonce de la naissance du
prince. Le 23 juillet 1566, quatre jours après l'accouchement, alors que
la reine donnait un bal au palais de Greenwich, un messager (Melville affirme
qu'il fut lui-même chargé de transmettre le message, certains
historiens l'ont mis en doute, cependant le luxe de détail avec lequel
il rapporte l'événement amène Michel Duchein à
considérer que le témoignage de Melville n'est pas
entièrement fictif) annonce la nouvelle à Cecil. Celui-ci s'en va
murmurer à l'oreille d'Elizabeth que la reine d'Ecosse vient de donner
naissance à un petit garçon, sur quoi la reine d'Angleterre
aurait déclaré : « La reine d'Ecosse vient de
mettre au monde un fils, pendant que je ne suis qu'une branche
stérile »107(*). Marie Stuart possède donc un avantage sur sa
cousine anglaise. Mais au lieu de raviver l'animosité de celle-ci en
abordant d'emblée le problème de la succession, elle prit le
parti d'insister sur les images de prospérité. Nonobstant les
efforts déployés pour mettre à l'aise le comte de Bedford,
la littérature de cour abordait des thèmes plus
controversés parmi lesquels l'union des deux royaumes. Un poème
écrit en latin par Patrick Adamson (un homme d'Eglise protestant) fut
déclamé qui donnait le ton des autres odes écrites
à cette occasion. Dans ce poème la Prophétie s'exprime
ainsi :
The fates will grant you to extend the territory of your
realm, until the Britons, having finished with war, will learn at last to unite
in one kingdom.108(*)
Il s'agit bien d'un tract à peine déguisé
en faveur de l'union des royaumes sous l'autorité de la dynastie Stuart.
A travers cet espoir d'union le jeune prince est promis à un bel avenir,
à tel point que le nouvel héritier éclipse les
prétentions de Marie Stuart, sa mère et l'actuelle reine
d'Ecosse. En effet, on note que les textes écrits pour le baptême
mais également ceux écrits pour le mariage se concentrent sur
l'héritier et les perspectives d'avenir qui accompagnent sa naissance.
Marie Stuart tient une place minime dans ces poèmes. Le portrait de
Marie qui découle de ces poèmes est vague car son personnage ne
se situe pas au premier plan. Qui se soucierait d'une reine régente
alors que l'Ecosse a maintenant un futur roi ?
Le portrait que les poètes de la cour dressent de la
reine d'Ecosse diffère assez peu de celui que l'on trouve dans la
littérature des années précédentes. Ainsi, le
poème que Buchanan rédige pour la naissance de Jacques VI ne
mentionne la reine qu'une seule fois, félicitant le jeune roi d'avoir
été nourri de la vertu et de l'amour pour la justice qui
caractérisent sa mère :
You also, father and mother, happy in the happiness of
parenthood,
Accustom the tender child from his young yearsTo the idea of
justice, and let him imbibe the sacred love of virtue
With his mother's milk ; let pietty be attendant on his
craddle,
And let it be the formative influence in his spirit and grow
equally with his body.109(*)
On peut rapprocher cette description de la reine avec la
manière dont Buchanan qualifie la reine d'Ecosse dans son poème
d'introduction aux Psaumes : « daughter of a hundred
Kings » ou « fille de cent rois ». On retrouve
déjà cette référence dans le poème
écrit pour le mariage de François II et de Marie Stuart :
« Hers can enumerate one hundred royal descendants from one
stock » ou « on peut citer cent descendants royaux d'une
seule branche de sa lignée». Marie Stuart bien qu'actuelle reine
d'Ecosse n'est jamais décrite comme une femme de pouvoir mais toujours
comme la fille ou la mère de rois. Dans les poèmes qui
célèbrent ses mariage ou le baptême de son fils ce sont les
fonctions que l'on attribue à la femme qui prennent le dessus. Une femme
doit obéissance à son mari et une mère se doit
d'élever son enfant. Buchanan rappelle ces devoirs à travers les
poèmes qu'il consacre à la reine d'Ecosse. Certes, il
décrit une femme dont la sagesse est supérieure à celle
des autres femmes mais jamais il ne la décrit comme une reine qui doit
gouverner. Dans le poème adressé au futur roi Buchanan va plus
loin encore en ce sens qu'il s'adresse au nouveau né comme s'il
été déjà roi et lui donne même des conseils
sur l'art de gouverner :
He will learn the true art of ruling a kingdom in peace and
war.
If he will sedulously measure all that he does by this
standard,
He will successfully undertake the rule of his
kingdom.110(*)
Bien sûr il ne semble pas inapproprié de
s'adresser à un prince comme à un roi car il est promis à
cette fonction. En revanche les thèmes abordés semblent plus
étranges. Buchanan écrit que « la gloire et le respect
sont le fruit d'une attitude irréprochable », que ses sujets
« l'aimeront parce qu'il leur donnera la preuve qu'il les aime en
retour » et critique les rois qui veulent s'arroger
l'imperium. Buchanan explicite ici le concept de royauté
légitime qu'il oppose au culte du monarque que la reine d'Ecosse tente
de mettre en place pour son fils. De même qu'il a l'impérialisme
en horreur, Buchanan récuse la vision du monarque absolu gouvernant sans
se soucier du sort de ses sujets. Il semble que la date du baptême soit
trop avancée pour que les propos de Buchanan puissent être
assimilés à une critique du gouvernement de la reine Marie
Stuart. Même si la reine se rapproche des Guises et de son ancien pays
d'accueil à cette époque, elle fait un pas vers la concorde et se
réconcilie avec Moray. Toutefois le poème dédié au
futur monarque semble clair, le modèle du monarque absolu n'a pas cours
en Ecosse et le futur roi écossais ne peut gouverner en
négligeant ses sujets. Marie Stuart quant à elle est
reléguée au second plan. Devenue mère, elle a rempli sa
principale fonction : assurer une descendance. L'ode de Buchanan
ramène donc la reine d'Ecosse à sa condition de femme
transférant d'ores et déjà le pouvoir à son fils. A
la lecture du poème il semble que Buchanan transmette l'idée
selon laquelle la norme est rétablie : la reine a enfanté,
le roi peut gouverner. Il est toutefois intéressant de noter que l'autre
roi, Darnley, est quant à lui totalement évincé du
poème, comme s'il avait été supplanté lui aussi par
son fils.
II. Marie femme adultère et meurtrière, point
d'ancrage d'une littérature calomnieuse.
En 1565, la trêve établie entre les lords
protestants et Marie Stuart semblait rompue. En choisissant d'épouser le
catholique Darnley, Marie exprimait clairement son opposition à la reine
Elizabeth, au comte de Moray et aux protestants supporters du royaume
d'Angleterre. Marie se rapprochait des nobles catholiques en Ecosse et se
tournait cette fois-ci vers ses influents oncles français, les Guise.
Une suite d'évènements complexes et controversés ajouta
à l'impopularité de Marie Stuart. Les deux partis, protestants et
catholiques, avançaient l'argument religieux afin de faire
prévaloir l'argument politique. Le récit des
évènements qui accompagne ce conflit est en général
bien connu. De ce récit découle une partie de la légende
qui entoure Marie Stuart, cette écossaise jeune, belle,
tourmentée par les passions amoureuses qui l'animent et trahie par ses
proches. Jenny Wormad nomme cette tendance à interpréter
l'histoire de manière psychologique la
psycho-history.111(*) Il est vrai que l'histoire de cette période,
qui s'étend de 1565 à 1567 (lorsque Marie est forcée
d'abdiquer) à tout d'une intrigue de tragédie. Il y avait eu des
signes avant-coureurs du scandale que la personnalité de la reine allait
engendrée peu après l'arrivée de la reine en Ecosse.
Durant l'hiver 1562-1563 un poète de la cour, Pierre
de Châtelard, un Dauphinois huguenot qui avait accompagné Marie en
Ecosse, avait été retrouvé par deux fois dans la chambre
de la reine. La première fois il fut averti par les autorités
royales. La deuxième fois, alors qu'il s'était caché sous
le lit de la reine pour attenter à sa vertu, Marie furieuse
décide que la mort immédiate doit punir ce crime. Moray eut du
mal à calmer la reine et Châtelard fut arrêté et
transféré à Saint Andrews pour y être jugé
puis exécuté. Il fut exécuté à Saint Andrews
en février 1563 et Brantôme rapporte que le jeune homme
aurait proclamé ceci avant de mourir : « Adieu, la plus
belle et la plus cruelle princesse du monde ! ».112(*) Déjà le
caractère de la reine semblait ambigu. En effet, les gens de la cour
avaient fréquemment vu la reine danser avec ce jeune homme et la reine
n'ignorait pas qu'il éprouvait des sentiments à son égard.
John Knox avec l'excessivité qu'on lui connaît affirme que ces
danses étaient : « plus propres à un bordel
qu'à un lieu honnête », ce qui finit de semer le doute
quant à la bonne morale de la reine. L'été
précédent, la reine avait déjà était
offensée par une note qu'elle avait reçu alors qu'elle
s'entretenait avec Sir Henry Sidney, un noble anglais. Le papier était
signé « Capitaine Hepburn » et contenait des propos
outranciers. C'est Randolph qui rapporte l'événement à
Cecil, mais semble si choqué qu'il se voit dans l'incapacité de
retranscrire de tels propos : « the tale is so irrverent
that I know not in what honest terms I may write it to your
honour ».113(*) Le témoignage de Randolph est le seul
à faire mention de ce billet. Nul ne sait ce que le Capitaine Hepburn y
avait écrit, on ne peut donc pas juger du caractère tout à
fait irrévérencieux de cette note. On peut aussi supposer que
Marie Stuart ait voulu cacher cet événement. Si l'on apprenait
qu'un sujet se permettait d'agir avec une telle audace, allant jusqu'à
insulter le monarque, toute la légitimité du pouvoir
exercé par la reine eût été remis en doute.
Le récit de Randolph permet de soulever un
problème : une reine doit prouver que son pouvoir est
légitime, chose qu'un roi n'a pas coutume de faire. Les femmes monarques
étaient largement victimes de telles insultes. Elizabeth et Robert
Dudley par exemple étaient considérés suspicieusement
après que la femme de Dudley, Amy Robsart, mourut dans des circonstances
mystérieuses. A l'inverse Henri VIII, pouvait mettre tous les moyens en
oeuvre pour faire assassiner ses amantes trop encombrantes.114(*) Une reine devait donc se
disculper d'être femme. Pour ce faire Elizabeth appliquait la
théorie des deux corps du monarque. Elizabeth avait un corps public,
fort et solide, qui lui permettait d'être crédible dans son
rôle de monarque intransigeant. Elle avait aussi un corps privé,
un corps de femme avec ses désirs et ses sentiments, mais celui-ci pour
ne pas nuire à la crédibilité de l'autre devait demeurer
caché. Maris Stuart semble n'avoir pas réussi à instaurer
ce diptyque si bien que les oppositions politiques la dépassent.
Déjà, en 1563, John Knox prêche avec grandiloquence contre
le supposé mariage qui se prépare avec Don Carlos. Il s'exprime
devant le parlement et devant un parterre d'aristocrates et accuse ceux qui
supportent ce mariage d'aller à l'encontre de la volonté du
Christ. Marie n'intervient pas. En octobre de la même année, Knox
s'insurge contre l'arrestation de deux protestants dont le crime était
d'avoir perturbé la messe célébrée à la
chapelle royale. Il écrit une lettre ouverte à tous les
protestants d'Ecosse les enjoignant d'apporter leur soutien à leurs
coreligionnaires. Il s'agissait d'un acte de trahison et de rébellion,
pourtant John Knox fut tout juste sermonné et acquitté en
décembre.
Ces événements sont la preuve que Marie Stuart
ne parvenait pas à affirmer son autorité de monarque. Elle
n'incarne pas le pouvoir. On a pourtant vu qu'elle savait être une
maîtresse de cérémonie, une patronne pour les poètes
de la cour mais son image publique n'était pas clairement
définie, si bien que ses détracteurs s'enquièrent
d'insister sur son point faible : son sexe. La reine aimait danser, se
déguiser et faire la fête, elle se donnait en spectacle. A
contrario elle n'avait jamais pris de décision politique notable,
tricotait lorsque le parlement tenait séance et accordait des subsides
à l'église réformée alors que les monarchies
catholiques attendaient qu'elle s'allie à la noblesse du nord afin de
rétablir la religion catholique. De plus de nombreux protestants, John
Knox en tête, lui reprochaient sa frivolité. Cette image de femme
fragile gouvernée par ses passions creuse son sillon jusqu'à
devenir l'image dominante dans la littérature de la fin des
années 1560.
Les attaques formulées par les protestants se dirigent
donc contre la faiblesse et l'immoralité inhérentes à sa
nature. L'on peut toutefois se demander pourquoi la littérature
s'attache à dépeindre Marie Stuart comme une femme lascive et
immorale alors que sa religion constitue une source de critiques toute
trouvée. Si l'on analyse les évènements d'un point de vue
purement historique, on peut supposer que les détracteurs de la reine
d'Ecosse avaient tout intérêt à justifier la
déposition de la reine en se basant sur des arguments personnels
plutôt qu'en invoquant des arguments religieux. En effet, les deux
grandes monarchies européennes qu'étaient la France de Charles IX
et l'Espagne de Philippe II auraient vite fait de répliquer si une
coalition protestante venait à détrôner une reine
catholique, intimement liée au royaume de France qui plus est. Il
fallait donc que l'attaque soit plus subtile. Les évènements qui
s'enchaînent entre 1565 et 1567 aident les détracteurs de Marie
Stuart à amorcer la chute de la reine sans que sa déposition ne
soit perçue comme une attaque directe contre la religion catholique.
Tout d'abord il y avait le mariage avec Henri Darnley. Comme
nous l'avons évoqué le mariage de la reine avec Darnley
était censé servir Marie Stuart dans son action politique.
Cependant, certains reprochaient à la reine d'avoir épousé
cet homme pour les mauvaises raisons. Un certain Thomas Jeney (poète
anglais) écrivit par exemple que Marie s'était laissée
emporter par ses passions et par ses désirs sexuels. Le poète
fait de Randolph le narrateur de son récit et insiste sur les tourments
des citoyens écossais qui contrastent avec les débordements de
Marie, laquelle dans un excès de colère avait renvoyé du
conseil ses plus proches conseillers parce qu'ils s'opposaient à son
mariage :
I saw them chased away, the Queen would not abide
Their grave advice that counselled her to watch a better tide.
Her will had wound her so to wrestle in this wrong
That no restraint might rest her rage, her extremes to
suborn.115(*)
Après ces confessions, Randolph passe en revue les
tyrans de l'histoire tout en faisant des parallèles entre leurs passions
destructrices et celles de la reine d'Ecosse. Puis l'ambassadeur s'assoupit et
la reine lui apparaît en rêve, avouant que sa beauté et sa
grâce sont la cause des ses malheurs. Son mariage n'est dû qu'au
déchainement de ses passions et son désir incontrôlable a
introduit à la cour l' « affront exubérant
d'une force efféminée ».116(*) On note que les
qualités que louaient auparavant les poètes de la cour,
c'est-à-dire la beauté et la grâce de la reine sont dans ce
poème présentées comme des caractéristiques du
péché de luxure. Les anciennes qualités sont à
présents synonymes de malheurs.
Avant que l'encre de Jeney ou d'un autre poète
protestant ne se répande, alimentant plus encore la propagande contre
Marie Stuart, un autre événement offrit aux défenseurs
catholiques de la reine écossaise l'occasion de développer une
contre-attaque. Cette occasion fut créée par le meurtre de David
Rizzio, le secrétaire italien de la reine. Assassiné dans les
appartements de la reine à Holyrood le 9 mars 1566 alors que la reine
est enceinte, l'événement est en lui-même extrêmement
dramatique. Les lords protestants emmenés par le comte de Morton et
Patrick Ruthven (le comte de Moray est exilé en Angleterre)
espéraient qu'en se débarrassant de Rizzio, symbole de
l'influence catholique en Ecosse, ils pourraient à nouveau
contrôler les décisions de Marie. En jouant sur la jalousie et la
fierté de Darnley, ils convainquirent celui-ci de faire partie du
complot et lui promirent en échange la couronne matrimoniale qu'il
espérait tant. Darnley était de moins en moins
apprécié de la reine qui le considérait comme un
personnage rustre et trivial. Leur relation se détériorait au fil
des jours et la rumeur qui courait dans Edimbourg selon laquelle l'enfant que
portait la reine était en fait le fruit d'une union entre la jeune femme
et son conseiller italien ne rendait la situation que plus compliquée.
Le plan fonctionna. Seulement Darnley, sous la pression de Marie avoua le
complot. A ce moment précis Marie entreprit une manoeuvre politique et
fit revenir son demi-frère d'exil dans le but de scinder la faction
protestante.
Les auteurs catholiques s'empressent d'exploiter cet
événement en insistant sur l'innocence de la reine. Sur le
continent, un auteur allemand fit publié en 1566 un travail
intitulé A brief and plain account of the treason not long
since perpetrated by some Scottish rebels against their most serene queen,
faithfully reported from the letters of a distinguished nobleman.117(*) Cet auteur anonyme
s'efforce dans son poème de tourner l'événement à
l'avantage de la reine et du clan catholique. Selon l'auteur le complot se
révèle être l'oeuvre de Moray qui depuis l'Angleterre et
avec l'aide de la reine Elizabeth planifiait l'assassinat non seulement de
Rizzio mais aussi celui de Marie et du bébé à
naître. Fort heureusement le plan avait échoué en partie et
Marie avait pu s'enfuir avec son mari avant de revenir pour punir les rebelles.
Pour écarter toute possibilité de liaison entre la reine et le
secrétaire italien, l'auteur n'hésite pas à falsifier les
faits en affirmant que Rizzio avait cinquante ans au moment des faits
: « a man about fifty years old ».118(*) Ainsi l'auteur rend la
liaison peu probable. En effet, Marie alors âgée de 24 ans ne
pouvait s'être amourachée d'un vieillard. En réalité
le secrétaire italien n'était âgé que d'une
trentaine d'années lorsqu'il fut assassiné. De même la
réconciliation avec Moray est passée sous silence. Moray est
décrit comme un traître et son personnage est tout simplement
l'antithèse de celui de Marie Stuart, reine innocente, endurant les
pires souffrances et revenant en héroïne pour sauver son pays de la
cruauté du clan protestant.
Les lignes directrices de cette littérature
étaient basées sur le commentaire distordu
d'événements récents. En effet on note que les textes sont
publiés la même année. La structure du débat qui
anime les auteurs écossais George Buchanan et John Leslie est
posée. Toutefois, avant d'aborder plus en détail l'accusation de
George Buchanan contre la reine d'Ecosse et la défense de John Leslie,
il nous paraît important d'évoquer l'événement qui
donne toute son impulsion à ce que l'on pourrait nommer une bataille des
livres. Dans des circonstances qui continuent de faire débat, Henri
Darnley meurt à l'aube dans une explosion qui survient à Kirk o'
Field (à quelques kilomètres d'Edimbourg) le 9 février
1567. Marie était-elle au courant du meurtre qui se tramait ?
L'a-t-elle commandité ? Notre dessein n'est pas de statuer sur la
culpabilité de la reine mais bien plutôt d'essayer de montrer
comment cet événement a définitivement scellé
l'image de la reine dans la littérature du 16ème
siècle et même des siècles suivants.
Le 15 mai 1567, Marie Stuart épouse le comte de
Bothwell. Ces noces précipitées aggravent la situation. En
août, après la défaite essuyée à Carberry
Hill, la reine d'Ecosse est emprisonnée à Lochleven après
que les lords protestants la forcent à abdiquer en faveur de son fils.
La régence est ainsi confiée à Moray. Cet
enchaînement fournit à la littérature ses principaux sujets
de débat : la reine a-t-elle tué son second mari ?
Entretenait-t-elle une liaison avec Bothwell ? Comment justifier qu'un
peuple se révolte pour déposer son monarque ? Les deux
premières questions sont examinées par un tribunal anglais ayant
pour jurés George Buchanan et le père du défunt Darnley
entre autre. La pièce maîtresse de ce procès est un petit
coffre qui contient douze poèmes et quelques lettres écrits par
Marie Stuart. Ces poèmes et ces lettres sont censés prouver sa
culpabilité. Là encore l'objet de cette étude n'est pas de
statuer sur la véracité ou non de ces lettres mais bien de
constater que l'utilisation de ces poèmes (dont on suppose que Marie
Stuart est l'auteur) par les détracteurs de la reine prouve que ceux-ci
lui reprochaient avant tout d'agir en tant que femme et non en tant que
monarque.
L'accusation liée aux lettres de la Cassette ne fait
que révéler l'antiféminisme ambiant déjà
exprimé par Knox dans The First Blast... Selon Sarah M.
Dunningan, la littérature entourant le personnage de Marie Stuart ainsi
que les propres textes de la reine contribuèrent à la
création du personnage littéraire de la souveraine.119(*) La reine aime danser et
écrire des vers, ce n'est pas ce que l'on attend d'une reine. De plus
elle écrit des vers à son amant alors que la morale
chrétienne voulait que les sentiments féminins ne s'expriment pas
publiquement. Ceci représente autant de fautes que Marie Stuart commet
sans doute malgré elle et qui poussent ses adversaires à
critiquer non pas la reine (Marie Stuart) mais la femme. En effet, leurs
pamphlets n'ont de cesse de montrer du doigt Marie Stuart la frivole et
l'adultère. Marie Stuart est décrite comme l'antithèse de
la femme chaste et discrète. Comme en témoigne ses poèmes
c'est une femme passionnée :
Pour Luy aussi ie iette mainte larme.
Premier quand il se fist de ce corps possesseur,
Duquel alors il n'auoit pas le coeur.
Puis me donna vn autre dur alarme,
Quand il versa de son sang mainte dragme,
Dont de grief il me vint lesser doleur,
Qui m'en pensa oster la vie, & frayer
De perdre las le seul rampar qui m'arme.
Pour luy depuis iay mesprisé l'honneur
Ce qui nous peut seul pouruoir de bonheur.
Pour luy i'ay hazardé grandeur & conscience.
Pour luy tous mes parentz i'ay quitté, & amis,
Et tous autres respectz sont apart mis,
Brief de vous seul ie cherche l'alliance.120(*)
Les poèmes de Marie Stuart font montre d'une
contradiction qui est pour elle destructrice. D'un côté l'envie de
dire son amour la brûle et de l'autre le fait de parler d'une telle
manière de ses passions l'expose aux diatribes du camp protestant.
Ceux-ci font d'ailleurs de cette maladresse une commodité, puisqu'ils
rendent public ces écrits passionnés dont ils donnent une
interprétation destructrice. Ce « mépris de
l'honneur » auquel le poème fait référence
constitue le leitmotiv de la littérature anti marianiste.
III. A Detection of the Doings of Mary Queen of Scots ou la
dénonciation misogyne de Buchanan.
Marie emprisonnée à Lochleven, la faction
protestante obtient ce qu'elle désirait : le pouvoir. Si les
protestants emmenés par le demi-frère de la reine
célèbrent cette victoire, les monarques européens
s'interrogent quant à la réaction que doit susciter cette
déposition. Il semblait évident que l'acte était
impardonnable. Marie Stuart bien que piètre politicienne était
une reine de droit divin et le peuple ne pouvait décider de lui
ôter ce titre. Toutefois, la succession de drames qui conduisit à
cette abdication compliquait les choses. Marie était accusée du
meurtre de son second mari, lord Darnley et avait épousé trois
mois après le crime son supposé meurtrier, qui du reste
était déjà marié. Inutile de dire que le pape ne
pouvait considérer cette union comme légitime aux yeux de
l'Eglise catholique. Pour Elizabeth, la situation était d'autant plus
compliquée. Le 16 mai 1568 Marie Stuart aborde les côtes anglaises
après s'être échappée de sa prison de Lochleven. Que
faire de cette reine fugitive ? William Cecil est d'avis qu'il faut
prendre une décision rapidement quant à l'avenir de la reine
d'Ecosse en Angleterre. En effet, la présence de la reine catholique
pouvait causer des troubles dans le royaume sachant que le nord du pays
abritait les derniers bastions catholiques. Mais Elizabeth s'obstinait à
invoquer le droit divin du monarque. Elle avait beaucoup trop d'estime pour la
fonction de Marie Stuart pour en faire d'emblée sa prisonnière.
Moray savait que sa demi-soeur ne représentait plus aucun danger
à présent car Cecil se méfiait depuis longtemps de la
reine d'Ecosse. Cependant Moray avait le juste pressentiment qu'Elizabeth
attendait des adversaires de sa « bonne soeur » qu'ils lui
apportent des preuves concrètes de son crime. Les Anglais ne prirent
donc pas immédiatement position contre la reine catholique.
Le régent Moray convint rapidement qu'il était
nécessaire d'amener une preuve de la culpabilité de sa
demi-soeur : « to fortify his cause with evidente reasons
as hir Maiestie may with conscience satifie hirself ».121(*) Le 21 mai 1568, John Wood
fut dépêché à Londres pour éclaircir la
conscience de la reine qui connaissait déjà les faits dans le
détail mais continuer à avoir des doutes sur certains points. Le
8 juin Elizabeth écrit une lettre à Moray lui demandant de
clarifier les raisons de sa démarche, il lui répond le 22 juin
stipulant que John Wood possédait une copie des lettres de la Cassette
destinées à éclairer Elizabeth quant à la
culpabilité de sa cousine écossaise. Une audience devait se tenir
à York à partir du mois d'octobre 1568, au cours de laquelle les
accusateurs de Marie Stuart devaient présenter des preuves accablantes
contre la reine d'Ecosse. Buchanan était présent à York
dans le camp des accusateurs. Deux ans plus tôt il participait aux
célébrations du baptême de Jacques VI et écrivait
pour la reine des masques censés divertir la cour et glorifier la reine
d'Ecosse. Comment ce poète latiniste, serviteur de Marie Stuart et loyal
envers le roi de France avait-il pu verser dans le camp adverse ? Pourquoi
était-il passé dans ses écrits de l'éloge à
la diffamation ?
Plusieurs hypothèses peuvent être
formulées. Les raisons religieuses d'abord. Buchanan était un
défenseur de la doctrine calviniste et trouvait dans cette doctrine
l'expression de valeurs stoïciennes qui lui étaient
chères.122(*) Il
dit d'ailleurs dans Vita, le seul document autobiographique dont nous
disposons, que son approche de la foi était plus rationnelle
qu'émotionnelle.123(*) Même si Marie le qualifie après la
lecture du pamphlet écrit à son encontre
d' « infâme athée », ses amis protestants
n'exprimèrent jamais aucun doute quant à sa
sincérité et sa dévotion envers la religion
réformée. Bien sûr John Knox lui reprochait d'entretenir le
spectacle de débauche qui se jouait à la cour, mais Buchanan
faisait bien preuve de dévotion envers la Kirk
écossaise. En 1563, il siège même à la commission
chargée de réviser The Book of Discipline en tant que
membre de l'Assemblée Générale de la Kirk.
Cependant les exemples cités précédemment prouvent que la
différence de confession n'a pas empêché Buchanan de servir
loyalement la reine. Il lui dédie même un recueil de
Psaumes. Autant de promesses qui laissent présager une relation
très cordiale. La religion n'est donc pas ce qui a causé le
changement d'opinion de Buchanan. A quel moment a-t-il décidé de
tourner le dos à Marie Stuart? Roger Mason formule
l'hypothèse selon laquelle l'humaniste aurait rencontré de
nombreux huguenots après avoir séjourné un moment en
France entre 1565 et 1566. A cette occasion il aurait pu s'apercevoir de
l'atmosphère de terreur que les Guise faisaient régner sur la
France. Déçu par l'attitude de ceux qu'il avait pourtant
loués, et par la francophilie de plus en plus affirmée de la cour
écossaise, Buchanan décida alors de se rapprocher de
Moray.124(*)
Une autre raison à sa trahison est l'assassinat de
Darnley. George Buchanan était né et avait grandi sur un
territoire gouverné par la branche des Stewart Lennox dont Henri Darnley
était un membre. Il se peut qu'il ait lui même perçu ce
meurtre comme un affront. L'Ecosse était encore au
16ème siècle gouvernée par les clans. Les
propriétaires terriens et les paysans qui travaillaient et vivaient sur
leurs terres étaient liés par des bonds. Ces bonds
assuraient loyauté et assistance entre deux familles.125(*) Ainsi les habitants devaient
le respect au seigneur tandis que celui-ci leur assurait une protection. Dans
ce contexte il est probable que George Buchanan se soit senti redevable envers
Henri Darnley et sa famille les Stewart Lennox. Enfin, le remariage hâtif
de la reine représentait un affront supplémentaire à la
morale religieuse que George Buchanan respectait. En accord avec les principes
stoïciens Buchanan pensait que l'homme devait être gouverné
par sa raison. Seule la raison pouvait conduire au bonheur et à la
sagesse. La passion était synonyme de souffrance et détournait
l'homme de ce but. En épousant le présumé assassin de son
deuxième époux, Marie Stuart cède à ses passions et
va à l'encontre de la définition du roi stoïque que
développe par la suite Buchanan dans De Iure regni apud scotos.
Pour l'heure Buchanan n'en est pas à détailler
point par point ce qui oppose le monarque au tyran. En 1567, Buchanan
rédige un pamphlet qui met en lumière les actes immoraux
perpétrés par la reine d'Ecosse. Ane Detectiovn of the
duinges of Marie Quene os Scottes est la version romancée de la
tragique épopée de Marie Stuart relatée de manière
à présenter la reine comme une meurtrière et une femme
infidèle. Ce qui frappe d'emblée à la lecture du texte est
la dureté du propos de Buchanan. George Buchanan va directement à
l'essentiel, faisant intervenir des personnages dont les témoignages
sont tout à fait grossiers, à l'image de l'histoire de Dame
Rerese qui relève plus de la farce que de la démonstration
argumentée. Dans cet épisode Buchanan avance que Marie Stuart a
confessé au régent Moray qu'elle avait logé dans un
appartement à Edimbourg où l'attendait Bothwell la nuit du
crime : « (where) dwelt harby one Dauid Chambers, Bothwels
servant, whoes backdore adioynit to the garden of the Quenis ladging. The rest,
wha gesseth nat ? »126(*) Buchanan ne fournit pas de documents qui prouvent
que la reine a bien confessé ceci à son demi-frère. Pour
finir de convaincre son lectorat de l'immoralité de la reine il poursuit
avec un récit des plus choquant selon lequel Dame Rerese conduisit
Bothwell jusqu'à la chambre de la reine où celui-ci abusa
d'elle :
My ladie Rerese a woman of maist vile vnchastitie, wha had
sometime been one of Bothwels harlots, and than was one ot the chefe of the
Quenis priuie chamber (...) where he forced hir agaynst hir will.
127(*)
Marie Stuart est le narrateur de cet évènement.
Buchanan fait mine de reprendre le récit qu'elle a fait à Moray.
Alors que le lectorat à ce moment précis peut ressentir un
certaine compassion à l'égard de Marie victime de viol, l'auteur
ajoute que Marie Stuart se rendit quelques jours plus tard dans la chambre
de son agresseur pour lui faire subir le même sort :
Buth how much agaynst hir will Dame Rerese betrayed her, tyme
the mother of truth hath disclosed. For within a few dayes efter, the Quene in
tending as I suppose to reaquite force with force and to rauish hym agayne,
sent Dame Rerese, to bryng hym captiue vnto her hyghnes.128(*)
Ce passage prouve la volonté de Buchanan de montrer
à son lectorat que la reine est animée d'un appétit sexuel
insatiable. En effet avec cette image de viol double, l'auteur exprime une
fantaisie misogyne en dépeignant le portrait d'une victime qui trahit
son désir sexuel en retournant vers son agresseur et en profitant de lui
à son tour.129(*)
George Buchanan détruit l'image de la reine gracieuse, belle et sage que
l'on trouve dans l'éloge écrit à l'occasion de son premier
mariage. Il fait de Marie une femme dévergondée, esclave de ses
passions. Ce style si peu familier à Buchanan pousse Jenny Wormald
à comparer l'humaniste à un journaliste du Times
s'abaissant à écrire dans les colonnes du Sun.
L'affirmation est d'autant plus vraie que le texte de Buchanan est
publié en anglais en 1571 avec la collaboration de William Cecil.
En effet, en 1569 alors que les comtes de Northumberland et
Westmorland incitent les Anglais du nord à se révolter (cet
épisode est plus connu sous le nom de Northern Rising), William
Cecil tente de convaincre Elizabeth que Marie Stuart met en péril la
stabilité du royaume. Les comtes du Nord avaient pour dessein de
libérer Marie Stuart afin que celle-ci épouse le Duc de Norfolk
le propriétaire terrien le plus puissant du pays. Le couple était
ensuite libre de restaurer la religion catholique dans le royaume d'Angleterre.
Le gouvernement anglais prit toutes les mesures pour écraser au plus
vite la révolte. Le pape Pie V qui n'avait visiblement pas eu vent de la
contre-offensive profita du complot pour excommunier officiellement Elizabeth.
La bulle Regnans in Excelsis débarrassait les sujets
catholiques de leur devoir d'allégeance envers la reine
hérétique et affirmait que rendre grâce à la reine
devenait par là même un péché.130(*) Elizabeth ne pouvait plus
ignorer que la présence de sa cousine écossaise sur ses terres
engendrait complots et trahisons. Cecil se chargea donc de manipuler l'opinion
publique et fit en sorte que la mainmise protestante soit renforcée.
Officiellement pourtant, un décret daté du 1er mars
1569 interdisait toute publication calomnieuse à l'encontre de la reine
Marie Stuart. Officieusement cette interdiction était contournée
pour présenter Marie en de tels termes que les Anglais la jugent
coupable de tous les maux dont ses détracteurs l'accusaient.
De ce besoin de faire renaître un sentiment
patriotique anglais naît la collaboration entre William Cecil et George
Buchanan. Dans sa défense des révolutionnaires écossais,
l'auteur avait préparé une argumentation qui se déclinait
en trois textes : Detectio, était le discours, De iure
regni apud scotos, constituait la démonstration théorique et
Rerum Scoticarum Historia contait l'histoire du peuple
écossais, tout en démontrant l'application des théories
explicitées dans De iure au fil de l'histoire
écossaise. Si De iure peut être qualifié d'ouvrage
théorique explicitant les théories politiques radicales de son
auteur, on ne peut qualifier de la sorte l'ouvrage publié en Angleterre.
Detectio (la forme latine de An Detectiovn...) a pour objet
de rendre compte du même événement pourtant son contenu ne
peut satisfaire aucun théoricien. Le pamphlet de Buchanan constitue la
partie rhétorique de sa défense de la révolte
écossaise. A la lecture du texte on sent qu'il a été
écrit pour soulever les passions. Le lecteur lorsqu'il achève de
lire ce texte se sent obligé de donner son avis. Le lecteur doit se
sentir impliqué dans le jugement. Tout est fait pour orienter son
jugement, comme le prouve la manière dont est relatée
l'épisode du viol. Le texte ne s'adresse pas aux penseurs du
siècle, il s'adresse aux peuples européens et plus
particulièrement aux citoyens anglais. Le récit des faits est
toujours vague et jamais Buchanan n'apporte de preuve à ce qu'il avance.
Il ne cite aucune autorité. De ce point de vue, le texte donne
l'impression d'avoir été écrit à la hâte dans
le seul but d'aggraver le sort de la reine d'Ecosse. Cependant le texte
présente un autre intérêt. Il semble que Buchanan
expérimente une méthode pour s'adresser au public et le toucher
directement. Le récit de Buchanan crée un personnage, il ne
s'attache pas à décrire la vérité. Parce que le
récit est orienté de manière à dévoiler les
dessous de l'affaire, le public se sent impliqué dans le débat,
comme si, à la fin du pamphlet Buchanan posait la question :
Pensez-vous que la reine mérite d'être punie ? Et tout est
orienté pour que le public réponde par l'affirmative.
La traduction du pamphlet en langue anglaise ne fait
qu'augmenter la portée de cette accusation. En 1571 le pamphlet est
imprimé en anglais et signé des initiales G.B, Thomas Wilson est
quant à lui chargé d'en faire une traduction en
« handsome Scotch ». Une traduction
française voit le jour, probablement imprimée à Londres ou
à La Rochelle. Mais en mars 1572 Catherine de Médicis en fait
interdire la diffusion, estampillant l'ouvrage comme propagande
huguenote.131(*) Ane
Detectiovn est un exercice de pure rhétorique dont les attaques
ad feminam confinent à la misogynie pure et simple. Le texte
est censé prouver que Marie Stuart est un tyran, mais ce qu'il en
ressort avant tout c'est l'image d'une mégère aux désirs
insatiables. Marie vole même le mari d'une autre pour satisfaire ses
désirs :
For Bothwell had a wife of his own, and it would take a long
time to wait for a divorce ; meanwhile the Queen could not have him
openly, or enjoy him secretly, and by no means could she do without
him.132(*)
George Buchanan affirme également que Marie Stuart n'a
pas été violée : « (...) It seemed a
marvellous fine invention that Bothwell should seize the Queen by force, and so
save her honour. »133(*) L'auteur dans sa manière de dépeindre
le personnage aide ses lecteurs à interpréter les lettres de la
Cassette, pièce maîtresse du procès contre Marie Stuart. Il
faut rappeler que les lettres de la Cassette sont adjointes à
l'édition anglaise du pamphlet.134(*) Le pamphlet donne une interprétation pour
faire la lumière sur les éventuels passages que n'auraient pas
compris les lecteurs. Même si le but premier de Buchanan est de montrer
que Marie, puisqu'elle était dépourvue de morale devait
être déposée, l'auteur insiste sur les passages scandaleux,
suggérant un portrait des plus abominables afin que son lectorat
interprète les passages ambigus des lettres de la Cassette comme
étant autant de preuve de sa culpabilité. Sa cruauté est
même clairement exprimée : « But that shows only
her contempt for him : what follows clearly proves her inhuman cruelty and
implacable hatred »135(*). L'auteur ne s'attache pas à montrer les
fautes politiques, il insiste sur les défauts inhérents au sexe
féminin dans le but de prouver que ces défauts conduisent
à l'immoralité qui elle même conduit à des actes
meurtriers. Au final, le crime majeur de la reine est d'être née
femme. Son sexe facilite l'attaque et l'accusation.
L'accusation de Buchanan tourne à la
dénonciation du genre féminin. Contrairement à John Knox
dans The First Blast..., l'humaniste ne justifie pas
l'incapacité à régner par la volonté divine mais
par la nature même du genre féminin impropre à incarner
l'autorité. A proprement dit George Buchanan n'affirme pas que les
femmes sont coupables par essence. En dévoilant l'immoralité de
la conduite de Marie Stuart George Buchanan prouve son incapacité
à régner mais ne semble pas s'opposer à la
gynécocratie en général. Cependant, sa
démonstration s'attache à critiquer toutes les faiblesses morales
qui étaient associées au genre féminin : la
concupiscence, la trahison, la faiblesse physique et morale.136(*) De ce fait, la critique de
Buchanan apparaît comme tournée d'avantage vers le genre que vers
le défaut de conscience politique. Marie Stuart n'est plus une reine,
elle redevient une simple femme que l'on accuse d'adultère.
IV. La pensée libérale de John Leslie.
Une reine incarnait une sorte de dualité. D'un
côté elle était femme, elle appartenait à la
sphère privée et la hiérarchie sociale voulait qu'elle
soit la subalterne de son époux. Les affirmations bibliques selon
lesquelles la femme avait été créée pour servir
l'homme constituaient le fondement de la hiérarchie sociale du
16ème siècle.137(*) D'un autre côté dans la Genèse
I, il est écrit que Dieu créa la femme et l'homme à son
image, ce qui suppose que la femme est l'égal de l'homme au niveau
spirituel, donc la femme peut intervenir dans la sphère publique.
Cependant d'autres images tendent à souligner
l'infériorité d'Eve par rapport à Adam. De nombreuses
représentations montrent par exemple qu'Eve est née d'une des
côtes d'Adam. Les opposants britanniques à la gynécocratie
insistaient donc sur la condition de subalterne que Dieu préconisait
pour les femmes. Pour eux, les femmes ne pouvaient diriger que leur foyer. Les
auteurs qui s'attachaient à défendre le droit des reines
britanniques à régner insistaient quant à eux sur le fait
que cette subordination n'était pas innée et qu'elle
n'était qu'une caractéristique de l'ordre politique et social
établi par des hommes. Plus précisément, pour que la
défense de ces auteurs soit efficace, ils devaient contredire l'argument
selon lequel la subordination des femmes était autorisée par
Dieu, donc naturelle. Implicitement cela remettait en cause l'ordre social
établi.
La religion est un point essentiel dans les défenses
et les accusations de Marie Stuart. Mais la religion représentait
également un point de contentieux pour sa consoeur anglaise qui, selon
la religion anglicane, devait être le chef suprême de l'Eglise.
Cette fonction posait problème car selon saint Paul une femme ne peut
présider une assemblée religieuse. Elizabeth doit donc abandonner
le titre de « chef suprême de l'Eglise anglicane »
pour celui de gouverneur suprême.138(*) La figure d'Elizabeth posait d'autres soucis
à la religion anglicane. En effet, Elizabeth avait imposé son
image de reine « vierge », ainsi son corps politique
prenait le pas sur son corps sexué. Ce titre était aussi une
manière de montrer qu'Elizabeth n'était soumise à aucune
autorité masculine puisqu'elle n'avait pas de mari. Cependant, une reine
vierge et protestante représente une anomalie. En effet, la religion
réformée considérait que le mariage était
spirituellement préférable au célibat. Luther
avançait que le désir sexuel était une composante
importante de la vie marital. Une femme devait donc procréer, ce
qu'Elizabeth ne semblait pas vouloir planifier.139(*)
La religion fournissait aussi parfois un argument
éloquent en faveur de la défense des femmes : si les femmes
étaient spirituellement égales aux hommes, il était
légitime qu'elles aient le droit d'agir consciencieusement dans le
domaine public. John Leslie, représentant de la reine d'Ecosse en
Angleterre, défend ce point de vue dans sa défense de la reine
d'Ecosse publiée en 1569. Les penseurs opposés à un
règne féminin puisaient leurs arguments principalement dans les
écritures et les textes d'Aristote. Ce sont les autorités
auxquelles se réfère John Knox. A l'inverse les auteurs tenant un
propos plus libéral (comme c'est le cas de John Leslie) se basent sur
l'expérience, c'est à dire sur des exemples historiques, afin de
prouver qu'une femme peut agir avec autant d'autorité qu'un homme et
donc qu'elle peut gouverner. En se basant sur des arguments historiques John
Leslie met en doute la loi naturelle en montrant qu'un telle loi n'existe pas.
Seules les lois promulguées par les nations ont cours. De ce fait le
règne d'une femme n'est pas contradictoire par nature. Il est
plutôt ironique que l'un des meilleurs écrits en faveur de la
gynécocratie soit rédigés pour défendre Marie
Stuart, une reine dont le pouvoir est précaire et finalement
négligeable. En effet, en 1569 Marie Stuart n'est plus reine d'Ecosse et
son frère est régent du pays.
John Leslie insiste pourtant sur le fait que les femmes sont
également des créatures sociales et qu'elles ont le droit
d'intervenir dans le domaine public :
if her reflection of the deity could be made to include all
the mental qualities attributed to man, she could not be so readily excluded
from political activity on doctrinal grounds140(*)
Le deuxième point que soulève Leslie est tout
aussi intéressant. L'auteur s'attache à une erreur linguistique
qui consiste à traduire « frères » par homme.
John Leslie rappelle que dans la Bible on ne doit pas lire
« frères » comme une référence
à la communauté masculine, mais comme une référence
à la communauté toute entière. En effet, John Leslie
rappelle que les langues classiques englobent toujours le féminin dans
le masculin. Ainsi lorsque les enfants d'Israël sont sommés de
choisir un monarque parmi « leurs frères » leur
choix n'est pas restreint à la population masculine :
Frater is the masculine gender (ye saye) and therefor women
are to be removed. Then by this rule women also muste be excluded from theire
salvation, because scriture sayeth : He that shall beleave and be baptized
shalbe saved ... And by this rule women are excluded from the eight
beatitudes... He that hatethe his brother ys in Darkenes... Shall we inferre
ther uppon that we may hate our sister ? Wherefore neither this worde
brother excludethe a sister, no this worde kinge in scripture excludethe a
Quene.141(*)
L'incapacité à régner pour une femme n'a
donc pas été instituée par les Écritures. Les
hommes ont inventé une loi naturelle au fil de l'histoire qui justifie
que les femmes doivent être leurs subordonnées. John Leslie clame
que cette interdiction n'a pas été ordonnée par le
Créateur :
I saye then that this ys a false and an unnaturall affection,
to make this surmised lawe everlatinge as nature itself is. The lawe of nature
or ius gentium ys and ever was after the time that there were any
nations or people and ever shalbe.142(*)
John Leslie conclut par la suite que les nombreuses femmes
ayant régné au cours de l'histoire sont autant d'exemples qui
peuvent contredire cette prétendue loi naturelle dont s'inspirent les
auteurs les plus conservateurs.
Face à l'affront que représentait le pamphlet
de Buchanan, les partisans marianistes doivent façonner une image en
tout point opposée qui leur permette de défendre l'honneur de la
reine d'Ecosse. Mais comment faire fi des évènements dramatiques
qui accablent la jeune Marie Stuart ? La prise de position de John Leslie
en faveur du règne féminin est un élément de
réponse. Seulement prouver qu'il est légitime pour une femme
d'accéder au pouvoir n'efface pas l'immoralité de la reine. De
même que les opposants à la reine d'Ecosse ont construit un
personnage cristallisant toutes les peurs concernant l'appétit sexuel et
le charme féminin, ses partisans construisent un modèle quasi
héroïque de reine martyrisée ayant à subir les
assauts des traîtres qui furent autrefois ses fidèles serviteurs.
Chapitre 3 : Marie Stuart, traîtresse ou
martyre ? De 1572 à 1587.
Les attaques protestantes et contre-attaques catholiques
avaient pour objet de diaboliser ou de sanctifier le caractère de la
reine. Nonobstant l'encre que la personnalité de la reine fit couler, le
sujet de dispute qui opposait partisans et opposants était tout autre.
La religion constituait le coeur du débat, mais le contexte religieux ne
permettait pas d'apposer des mots clairs sur ce conflit d'intérêt.
Il était donc plus judicieux de glorifier le caractère de Marie
Stuart pour affirmer la supériorité de la foi catholique. C'est
ce que s'attache à faire John Leslie, évêque de Ross, qui
s'était attiré les faveurs de la reine vers 1565. La
défense de la reine s'organise autour du thème du complot. Les
accusateurs présents à York n'avaient aucune preuve de la
culpabilité de la reine et n'étaient que des traîtres
cherchant par tous les moyens à accéder au pouvoir. Mais il
demeurait que l'image de la reine était ternie par les accusations
scabreuses de Buchanan qui faisaient de Marie Stuart une autre Clytemnestre.
Rappelons que le modèle féminin prôné par l'Eglise
catholique était celui de la vierge Marie. Les attaques de George
Buchanan confinaient à associer Marie Stuart à une autre figure
féminine beaucoup moins chaste.143(*) Cette appropriation du personnage par les deux
souverainetés dont la reine écossaise était la plus proche
amène à penser Marie Stuart comme un exemple (ou un
contre-exemple) utilisé à dessein pour jeter le discrédit
sur l'Eglise catholique ou bien pour incriminer les protestants
hérétiques. La littérature autour de Marie Stuart se
développe tout au long de cette période durant laquelle Marie est
une reine captive. Durant ces dix-neuf années de captivité, les
tentatives de complots que fomentait la reine d'Ecosse rythmèrent les
écrits des auteurs décrivant la reine comme une traîtresse
ou bien comme une héroïne esseulée.
I. Un « personnage » aux mains des
Anglais et des Français.
La deuxième moitié du 16ème
siècle est marquée par la diffusion de l'imprimerie et la
multiplication matérielle du livre. A partir de 1560, à
Francfort, se tient chaque année une foire du livre. En 1565, le
catalogue imprimé annonce 550 titres et de 1565 à 1600, 22 000
titres figurent au catalogue.144(*) Cette modernisation est accompagnée par la
multiplication des établissements d'enseignement permettant
l'apprentissage de la lecture. Datant de l'époque
médiévale, l'Université, établissement d'abord
voué à l'enseignement de la théologie, se répand
dans toute l'Europe au 16ème siècle. Aux 45
universités de 1400 s'ajoutent les 33 créées entre 1400 et
1500. Quinze autres universités voient le jour entre 1500 et 1550. C'est
à cette époque que naît le lecteur. On estime que le nombre
de « lecteurs-scripteurs » atteint 15% en Ecosse, 16% en
France et 25 % en Angleterre à la fin du siècle.145(*) Ces chiffres montrent qu'une
faible partie de la population représente un lectorat potentiel. Les
ruraux sont soumis au processus d'acculturation liée à la
diffusion du livre, cependant ce processus est nuancé par les relais
culturels que sont le prêtre ou le notaire. Les publications de Buchanan
et de John Leslie sont lues par les gens des villes ou des bourgs qui ont
accès à la nouvelle culture du livre. Ils sont marchands,
négociants, manufacturiers ou artisans. Ils trouvent dans ce nouvel
outil culturel un enseignement ou une distraction en langue vernaculaire.
L'autre partie du lectorat est composée de médecins, de
prêtres, de juristes qui eux communiquent et peuvent lire le latin. La
popularité des créateurs de fictions ou de textes plus
intellectuels bénéficie de l'effet amplificateur ainsi que de
l'alphabétisation de la population. Cet élargissement du lectorat
explique l'importance que la monarchie anglaise accorde à la diffusion
des textes de propagande contre Marie Stuart. L'édition en langue
vernaculaire de textes comme celui de Buchanan constitue un réel outil
de propagande pour le gouvernement anglais car il jette le discrédit sur
cette reine étrangère qui clame son droit à la succession
au trône d'Angleterre. Le nombre croissant de lecteurs a aussi pour
conséquence de diffuser l'image de Marie Stuart beaucoup plus vite.
En 1571, avec l'approbation de William Cecil, le pamphlet de
Buchanan est publié à Londres probablement par John Day, un
éditeur protestant qui avait déjà fait imprimé un
tract intitulé Salutem in Christo la même
année.146(*)
Salutem in Christo est un autre pamphlet qui justifie
l'exécution du Duc de Norfolk déjà impliqué dans la
révolte du Nord en 1569 et partie prenante dans le complot de Ridolfi
(il devait épouser la reine si le complot était mené
à bien). Dans ce pamphlet Marie Stuart est présentée comme
sa complice et l'auteur de ce tract, un certain R. G (peut-être Richard
Grafton un ardent protestant) s'attache à dévoiler le complot
politique sans trop accorder d'importance à la personnalité de la
reine, à l'inverse du récit de Buchanan. Pourquoi le gouvernement
d'Elizabeth autorise-t-il la publication de tels pamphlets alors que l'acte du
1er mars 1569 interdit la diffusion de propos diffamatoires
dirigés à l'encontre de Marie Stuart ? Comme nous l'avons
indiqué précédemment, après la révolte du
Nord Elizabeth était forcée de constater que la présence
de sa cousine mettait en péril la stabilité de son royaume. Deux
ans plus tard un autre plan était échafaudé dans le but de
libérer la reine d'Ecosse et la faire couronner reine d'Angleterre. Le
Duc de Norfolk est arrêté après que les autorités
anglaises ont déjoué le complot. An Detectioun of the duinges
of Marie Quene of Scottes, est publié peu avant le 1er
novembre de la même année. Il ne s'agit en aucun cas d'une
coïncidence. Alors que le pamphlet sort des presses anglaises, une version
est rédigé en écossais et imprimé à Saint
Andrews par Robert Lekprevik et deux éditions du récit de
Buchanan circulent déjà en Allemagne.147(*)
La décision politique prise par Cecil de rendre
publique les méfaits de Marie Stuart indique un but clair. En faisant
endosser la responsabilité de cette dénonciation calomnieuse
à l'humaniste écossais George Buchanan, le gouvernement anglais
pouvait réduire à néant la réputation de la reine
d'Ecosse sans aller à l'encontre de sa politique officielle. Aux yeux
des autres nations européennes le coupable était Buchanan. Et les
Anglais ne manquaient pas de souligner que les propres sujets de la reine
d'Ecosse lui tournaient le dos. Marie lut le papier de Buchanan avec amertume
et demanda à l'ambassadeur français à Londres, M. de
Fénelon, de faire parvenir à Elizabeth son mécontentement
quant à l'autorisation de la publication de ce pamphlet. L'ambassadeur
répondit dans une lettre à Marie qu'il n'obtint rien d'Elizabeth,
car cette dernière prétendait que le livre avait
été imprimé en Ecosse, et non en Angleterre.148(*) Charles IX protesta lui
aussi contre la publication de ces écrits diffamatoires. Mais la plainte
fut elle aussi futile car Elizabeth clamait son innocence en insistant sur le
fait que le pamphlet n'avait pas été publié en Angleterre.
Avec An Detection... le gouvernement d'Elizabeth avait obtenu ce qu'il
désirait. La réputation de Marie Stuart était au plus mal
et le besoin de contre-attaquer urgent. L'ambassadeur anglais en France demanda
à ce que le texte de Buchanan soit présenté au roi de
France : « some of Buchanan's little Latin books should be
presented to the king of France and also the noblemen of his Council, as they
will serve to good effect to disgrâce the Queen of
Scots ».149(*)
Sir Henry Killegrew, un ambassadeur itinérant, en France au moment de la
publication, distribua des copies du pamphlet à la cour de Charles IX.
Il donna un exemplaire à un ambassadeur vénitien qui se trouvait
là et à un certain « Montagne of
Montpellier » qui était alors occupé à
rédiger une histoire universelle.150(*) L'effet que produisit la lecture de ces pamphlets
fut celui que William Cecil avait espéré. La reine décrite
dans ce texte était odieuse et donc indéfendable.
La France était alors dans une position
délicate. Charles IX protesta contre la détention de la reine
d'Ecosse en Angleterre mais hésitait aussi à s'attirer les
foudres d'Elizabeth au nom de sa belle-soeur. Sir Thomas Smith rapporte
d'ailleurs que le roi de France était excédé d'entendre
que Marie Stuart persistait à comploter pour ravir le trône
d'Angleterre à Elizabeth :
Ah, the poor fool will never cease until she lose her
head ! In faith they will put her to death. I see it is her own fault and
folly. I see no remedy for it. I meant to help, but if she will not be help,
je ne puis mais. »151(*)
L'autre grande monarchie catholique n'était pas plus
encline à apporter son soutien à la reine déchue. Philippe
II dont on disait qu'il allait envoyer des troupes espagnoles en Angleterre
pour mener à bien le complot de Ridolfi n'en fit rien, se justifiant par
le fait que le Pape ne l'avait pas consulter dans l'élaboration de cette
entreprise. Le pamphlet de Buchanan édité en collaboration avec
William Cecil et Thomas Wilson avait porté ses fruits : même
la patrie d'adoption de Marie, celle qui avait tant loué sa
beauté et sa vivacité d'esprit, rechignait à lui apporter
son soutien.
La France est depuis 1560 en proie à une guerre civile
qui mène à des prises d'armes successives et cette situation ne
permet pas au roi de France de prendre fermement position contre le monarque
protestant qu'est Elizabeth. En 1571, Coligny, inspire une politique favorable
aux protestants et gagne de l'influence à la cour. En octobre 1571,
Charles IX refuse même de s'engager au côté de son homologue
espagnol dans la bataille de Lépante. En avril 1572, Catherine de
Médicis se rapproche de son homologue anglaise et met en place un
traité d'alliance. Le pacte, purement défensif, avait pour
objectif de garantir la liberté de commerce entre les deux pays.
S'étant assurée de la neutralité de la France, Elizabeth
Ière négocie aussi avec les Pays-Bas, assurant aux
rebelles un soutien de la part de leurs compatriotes anglais. Le traité
de Blois exprime la peur d'une attaque espagnole en Angleterre. Elizabeth doit
à cette époque faire face à des rébellions au sein
de son royaume (rébellions dont Marie Stuart et les catholiques anglais
sont les instigateurs) et craint une agression espagnole, d'où le besoin
de sceller une alliance avec la France.
Le pamphlet de Buchanan porte préjudice à la
réputation de Marie Stuart et par là même aux monarchies
catholiques. Toutefois, les représailles sont difficiles à mener.
En effet, le préjudice moral qui affecte Marie Stuart est grand et la
réputation créée par Buchanan est peu compatible avec
l'image pieuse d'une reine catholique. En plus de cela la traduction
française est reprise de telle manière que toute action
française à l'encontre du royaume d'Angleterre semble
préjudiciable à l'alliance franco-anglaise. La traduction de
Camuz inscrit l'histoire de Marie Stuart dans le conflit entre catholiques et
protestants et plus particulièrement dans le conflit qui oppose les
Guise, fervents catholiques, aux voix modérées du royaume.
Histoire de Marie Royne d'Escosse... histoire vrayement tragique fut
publié en 1572. L'ouvrage porte l'empreinte d'une imprimerie
écossaise mais fut semble-t-il imprimé à La Rochelle ou
à Londres. Camuz, un avocat protestant, en est le traducteur.152(*) La traduction est
publiée en mars et en avril, quelques mois avant le début des
négociations qui doivent se tenir à Blois. Le choix de Cecil de
publier ce texte à ce moment précis peut donc paraître
irréfléchi. Cependant rien ne laissait présager que la
France allait s'opposer au projet d'alliance après la lecture du
pamphlet de Buchanan. En effet, depuis 1561 les publications catholiques ne
s'étaient que très peu intéressées aux affaires de
la reine d'Ecosse. De plus Cecil avait si savamment remanié les
détails du pamphlet destiné à être traduit en
français que certains biographes eurent du mal à identifier le
texte comme la traduction du récit de Buchanan. Ceci indique qu'il
réalisait clairement le risque que cette publication pouvait
représenter pour la conclusion du Traité de Blois.
Ainsi l' « histoire vraiment
tragique » de Marie Stuart est une occasion d'évoquer le
contexte politique français plus qu'une attaque directe contre la
personnalité de la reine. La dénomination « histoire
tragique », relie l'histoire de Marie Stuart à un genre
littéraire français populaire à l'époque. La
nouvelle tragique est un petit conte qui met en oeuvre la justice universelle
et les mécanismes du destin.153(*) Faisant écho au contexte des Guerres de
Religion, ces contes transmettent l'idée de désastre, de violence
et promettent un dénouement juste. L'Histoire Tragique
décrit la chute de Marie comme une préfiguration de la chute
des Guise. Toutefois la traduction française de Buchanan ne se termine
pas sur une telle conclusion. Comme dans la version anglaise, le texte enjoint
le lecteur à faire justice lui-même en décidant si oui ou
non, la punition de Marie Stuart est juste. La priorité de
l'édition française est de montrer que Marie est une Guise et
qu'elle inspire la terreur, la cruauté et la guerre autant que ses
oncles. Marie appartient à une famille catholique meurtrière et
conspiratrice. Le pamphlet insiste ainsi sur le fait que Marie ne doit pas
être rétablie sur le trône d'Ecosse. Loin d'avoir terni les
espoirs de négociation franco-britannique, le pamphlet se
révèle être un argument de campagne diplomatique puisqu'en
avril est signé le Traité de Blois, lequel survit même au
massacre de la Saint Barthélémy. La France n'a donc aucun
intérêt à engager une bataille littéraire pour
sauver l'image de la reine d'Ecosse.
Le massacre de la Saint Barthélémy ne fait
qu'ajouter à la grogne des huguenots qui voient en Marie Stuart un moyen
d'intéresser les monarchies européennes à leur cause.
Cependant après le massacre perpétrer le 24 août 1572 la
ferveur protestante s'estompe. De nombreux protestants s'exilent pour leur
sécurité et d'autres abjurent leur foi. Le mouvement huguenot est
réduit au silence et la publication de pamphlets cesse pour un
temps.154(*) En 1573,
les auteurs protestants recouvrent de leur vigueur. Depuis les presses
genevoises la réponse au massacre s'organise. En 1574, les protestants
français influencés par la hiérarchie de Genève
tendent à étendre le conflit à l'Europe entière en
dressant le portrait d'une Europe entièrement catholique s'attaquant
à une minorité de protestants. A partir de 1574, Marie Stuart
devient un symbole important de la littérature huguenote, et ce pour
trois raisons. D'une part elle était liée à ceux que l'on
considérait comme les champions européens du catholicisme, les
Guise. D'autre part elle représentait un personnage d'importance
européenne qui incarnait l'immoralité catholique, ce qui aidait
à internationaliser la Guerre de Religion. Enfin Marie Stuart comme
Catherine de Médicis - détestée pour sa prise de position
contre les huguenots lors du massacre du 24 août 1572 - était un
exemple des dangers qu'engendrait la gynécocratie.
Le Réveille-Matin publié en 1574 ou
1575 et écrit par un réfugié du nom de Nicolas Barnaud
critique férocement Catherine de Médicis. Il la tient pour
responsable de la plupart des problèmes que subit la France. Il l'accuse
également d'avoir usurpé l'autorité de son fils et d'avoir
introduit la perversion italienne à la cour de France. Le livre est
divisé en deux parties qui sont en fait deux dialogues relatant
l'histoire de la religion en France depuis le règne de François
Ier jusqu'au massacre de la Saint Barthélémy. Le
propos est rapporté par un personnage nommé Alithie ou la
Vérité qui réside en Hongrie. Quelques amis d'Alithie
fuyant la France arrivent en Hongrie. L'un d'eux se nomme Historiographe,
l'historien, et le second Politique, le politicien. Le premier dialogue entre
Alithie et Historiographe ne mentionne que rarement le nom de Marie Stuart. Au
cours de ce dialogue, Historiographe raconte une histoire amusante pour tourner
les Guise en ridicule. Pour féliciter le Cardinal de Lorraine, en 1560
le Pape décide de lui faire cadeau d'une peinture de Michel-Ange
représentant la vierge tenant son enfant dans les bras. Le coursier
chargé d'acheminer le tableau tombe malade au cours du voyage et un
jeune catholique originaire de Lucca se propose de s'acquitter de cette
tâche. Toutefois celui-ci abhorre les Guise et décide de remplacer
le tableau par un autre dans le but d'embarrasser le cardinal de Lorraine. Le
tableau représente le Cardinal, sa nièce, Catherine de
Médicis et la duchesse de Guise complètement nus, les bras et les
jambes entrelacés.155(*) L'image renvoie aux intérêts de la
reine d'Ecosse liés à ceux de ses oncles de Lorraine.156(*)
Le second dialogue est une discussion du cas de Marie Stuart.
Cependant il attaque aussi le royaume d'Angleterre, insistant sur le manque de
puritanisme dans la religion anglicane. Barnaud critique la plus grande
puissance protestante alors que le but des huguenots est d'inciter les
puissances européennes protestantes à rejoindre leur cause. Il
souligne ensuite que le royaume court le risque de voir une catholique
accéder au pouvoir en hébergeant Marie Stuart. Les complots
perpétrés par la reine d'Ecosse prouvent qu'elle ambitionne de
débouter Elizabeth. Pour Historiographe, la possibilité que Marie
puisse un jour accéder au pouvoir en Angleterre représente le
plus grand des dangers qu'aient à craindre le peuple anglais.157(*) Il accuse ensuite Charles IX
de commanditer son évasion et affirme que la mort est une juste punition
pour celle qui n'est plus reine d'Ecosse. En effet, Historiographe
précise qu'un roi ne peut être souverain de son royaume que
lorsqu'il réside à l'intérieur de celui-ci.
A contratio, à partir de 1576, la Ligue
catholique tend à idéaliser le personnage de Marie Stuart, la
dépeignant comme une reine catholique pieuse aux mains des protestants.
Cependant il est à noter que les exemples de défense telle que
celle écrite par John Leslie ne sont en aucun point comparables aux
écrits qui sont publiés après l'exécution de Marie
Stuart et qui enjoignent les catholiques de tout pays à condamner le
royaume de Satan.158(*)
II. L'organisation de la défense de Marie Stuart par
John Leslie.
Le sort de la reine d'Ecosse pouvait provoquer une certaine
émotion chez les Français. Marie Stuart avait vécu plus de
dix ans en France et avait été reine de France, elle était
donc liée à ce royaume. L'élégie écrite par
Ronsard après le départ de la Marie Stuart tend à prouver
que les français aimaient cette jeune reine :
Bien que le trait de vostre belle face
Peinte en mon coeur le temps ne s'efface,
Et que tousjours je le porte imprimé
Comme un tableau vivement animé,
J'ay toutesfois pour la chose plus rare
(Dont mon estude & mes livres je pare)
Vostre portrait qui fait honneur au lieu,
Comme un image au temple d'un grand Dieu.159(*)
L'élégie vaut à Ronsard d'être
récompensé par la reine qui lui envoie une pension en 1566.
Toutefois le poème n'a pas le pouvoir d'émouvoir le roi de France
qui n'organise aucune propagande en faveur de l'ancienne reine de France. La
défense de Marie Stuart ne naît pas de l'indignation de son pays
d'accueil mais bien plutôt du soutien d'un seul homme. John Leslie fait
publier A Defence of the Honor of Marie, Queene of Scotland pour la
première fois en 1569. L'ouvrage est remanié et
réédité plusieurs fois jusqu'à ce que la reine soit
déclarée coupable des crimes dont on l'accuse. A l'époque
à laquelle il publie l'ouvrage en 1569, l'évêque de Ross
avait certainement pressenti le besoin d'une continuelle révision et
adaptation au contexte.
John Leslie était un homme d'Eglise et un juriste
écossais mais en aucun cas un auteur. On ne lui connaît d'ailleurs
pas d'autres écrits que ceux qui visent à organiser la
défense de la reine écossaise. Pourquoi John Leslie prend-il la
plume pour défendre la reine ? Quel intérêt avait-il
à défendre une reine que la propagande initiée par George
Buchanan avait accablée ? John Leslie avait été
envoyé à la cour des Valois avant que Marie Stuart ne quitte la
France pour conseiller à la reine de se méfier de Lord James, son
demi-frère. Il l'accusait d'être un rebelle, un homme qui voulait
détruire ce qu'il restait de la religion catholique en Ecosse afin de
prendre le pouvoir.160(*) L'avenir ne manqua pas de montrer à quel
point ce jeune avocat catholique était clairvoyant. En 1565, John Leslie
s'arroge les faveurs de la reine. Dès Juin 1566, Henry
Killigrew161(*) rapporte
que Leslie « mène toutes les affaires de
l'Etat ».162(*) John Leslie est aussi lié au complot de
Ridolfi. C'est grâce à l'intermédiaire de John Leslie qui
réside alors à Londres que Ridolfi contacte Marie
Stuart.163(*)
A l'été 1568 John Leslie est envoyé
à la conférence d' York pour intercéder en la faveur de la
reine d'Ecosse. Il désapprouve cette conférence dès
l'instant qu'il apprend sa mission car il sait que cette conférence ne
fait que conforter la colère du régent Moray contre sa
demi-soeur.164(*) Les
chances sont minces de voir Marie Stuart reprendre les commandes du pays et
d'emblée la tâche de John Leslie s'avère difficile. Il
était en Angleterre le représentant d'une souveraine qui avait
perdu presque tout pouvoir mais qui était assez puissante pour attiser
la méfiance de ses hôtes. Le double jeu du gouvernement anglais
oscillant entre sécurité de la reine d'Ecosse et
dénonciation de son immoralité rendait le travail de John Leslie
d'autant plus dur. Il ne pouvait définitivement pas compter sur l'aide
d'Elizabeth pour rétablir Marie Stuart sur le trône d'Ecosse. Le
projet de mariage avec le Duc de Norfolk promettait de faire tomber Cecil, le
plus fervent opposant à Marie et impliquait la reconnaissance de sa
légitimité dans la succession au trône d'Angleterre. Il
s'agissait aussi de la seule manière pour Marie Stuart d'exister
politiquement. Leslie se devait de tout faire pour la défendre.
Tel est le contexte de la rédaction de Defence of
the honour of... Marie Quene of Scotlande pendant l'hiver 1568-9. L'auteur
poursuivait deux buts : défendre Marie contre les charges qui
pesaient sur elle concernant le meurtre de son mari et affirmer ses droits en
tant qu'héritière présumée de la couronne
d'Angleterre. Au second dessein, Elizabeth ne pouvait apparemment rien objecter
et Leslie reçut l'aide de divers avocats apportant des arguments en
faveur de la succession écossaise.165(*) Toutefois le fait que Leslie aille jusqu'à
clamer que les commissaires anglais présents à York
étaient convaincus de l'innocence de Marie posait problème.
Leslie abusait de la gentillesse d'Elizabeth. Rappelons qu'au moment où
John Leslie rédige son texte de défense, William Cecil n'a pas
fait publier le texte de Buchanan. Elizabeth n'avait donc pas encore agi de
telle sorte à ce que les Anglais croient la reine d'Ecosse coupable du
meurtre de son deuxième mari. La défense de Leslie pouvait encore
faire tourner la situation à l'avantage de Marie Stuart. Après le
soulèvement du nord de l'Angleterre, John Leslie est emprisonné
pour quatre mois à la prison de Londres. Son assistant subit le
même sort pour avoir tenté de faire imprimer le texte de Leslie en
avril 1570.
Le texte de Leslie est divisé en trois parties et une
préface adressée au lecteur ouvre l'oeuvre, elle
s'intitule « To the gentle reader ». Cette
défense semble motivée par le devoir de loyauté et les
sentiments amicaux qu'éprouve Leslie envers la reine plus que par le
besoin de défendre la cause catholique. Les années qu'il a
passé à servir la reine en tant qu'avocat et homme d'Eglise
prouvent que l'entreprise est sincère. Le but de Leslie est de
répondre aux attaques édifiées contre Marie Stuart, contre
son caractère et sa fonction. Il a bien sûr en tête les
charges portées contre Buchanan dans Detectio mais aussi celle
de John Knox. En effet, même si le texte de Buchanan n'est pas encore
publié il est certain que John Leslie, principal représentant de
Marie Stuart à la conférence d' York, a été
confronté au texte de Buchanan. Leslie attesta plus tard après
avoir été interrogé par les agents de Lord Burghley que
d'autres supporters de Marie Stuart avaient collaboré à
l'écriture de son texte. Peut-être Marie Stuart elle-même
avait-elle lu le manuscrit et suggéré quelques
additions.166(*)
Dans la partie intitulée « To the gentle
Reader », John Leslie affirme que les lettres de la Cassette sont
calomnieuses et qu'elles n'ont pas été écrites par la
reine :
Secondelie theie pretende certaine lettres that theye furmife,
& wolde have, tho haue bene wrytté by her grace, whereby they feake
to inferre againfte her manie a prefumption, as theyre wylye braines
imagine167(*)
Et d'ajouter que les détracteurs de Marie Stuart n'ont
jamais eu entre les mains de telles preuves :
neuer have they bene able by anie directe and lawfull meanes,
to proue ani thinge at all, wherebi thei maie ftaine her grâces honour,
in anie one of the forefaide points.168(*)
John Leslie insiste sur la supercherie des lettres, car il en
existe plusieurs versions ce qui met en doute leur véracité. La
première version avait été présentée
à York en privé. A ce moment là, les lettres qui avaient
été écrites par Lennox (le père d'Henri Darnley) ne
corroboraient pas tout à fait le texte de Buchanan et elles devaient
être réécrites officiellement pour être
présentées à Westminster deux mois plus tard.
L'évêque de Ross présent à York en tant que
représentant de Marie et très informé du processus qui se
tramait a très probablement entendu ce que contenait les lettres de la
Cassette même si, selon l'historien R.H Mahon, il est peu probable qu'il
les ait eues entre les mains. Au moment du procès, un point fait
débat dans la traduction des lettres de la Cassette. La
troisième lettre s'ouvre ainsi : « Que je trouve la
plus belle commodité pour excuser vostre affaire »
(lettre conservée à Hatfield). Une copie de la lettre en latin et
envoyée à Cambridge et traduit « vostre
affaire » par « our affair ».
D'autres copies traduisent « my affair » ce qui
continue d'entretenir le doute quant au réel contenu de ces
lettres.169(*)
Après avoir mis en doute la véracité des
lettres de la Cassette, John Leslie rappelle l'entraide qui existait autrefois
entre les souverains anglais et écossais :
Some Princes of this our realme haue in theyre greate
calamitie, & amoge other, kinge Henrie the fixte fownde much comforte,
frédshippe, fuccour and relief, at the kinges handes of
Scotlande.170(*)
En 1569, John Leslie continue de croire en la bonté
d'Elizabeth. En effet, jusqu'à ce qu'éclate le complot de Ridolfi
et la révolte du Nord rien n'indique qu'Elizabeth est persuadé de
la culpabilité de sa cousine.
La première partie du livre s'attache à
contredire le récit de Buchanan pour faire passer Marie Stuart du statut
de meurtrière à celui de victime. Principalement Leslie tient
à prouver que Marie Stuart était une reine légitime. Il
passe en revue le meurtre de Darnley et le mariage avec Bothwell et tente de
jeter le discrédit sur les opposants de la reine, et plus
particulièrement sur Moray. Il écrit qu'il est inconcevable que
l'on puisse accuser Marie Stuart de tels crimes :
Thys sexe naturallye abhorrethe suche butcherlye
practizes : suerly rare yt ys to heare suche fowle practizes in
women.171(*)
L'évêque de Ross écrit ceci en faisant
mine d'oublier les exemple de Jézabel, Clytemnestre et Dalila qui
inspirent tant la littérature misogyne de l'époque. Il s'agit
ensuite de disculper Marie Stuart dans l'affaire Darnley. Marie et Darnley
s'étaient selon lui réconciliés avant la mort de celui-ci.
Ce sont les traitres, parmi eux Moray et Morton, qui ont manipulé la
reine. Ils ont convaincu la reine d'organiser le retour d'exil de Morton, en
échange de quoi ils voulaient arranger le divorce.172(*) Leslie continue en
justifiant la très courte période de deuil par le fait que la
reine avait une santé fragile. Son médecin affirmait qu'un deuil
prolongé pouvait lui être fatal.173(*)
Quant aux lettres de la Cassette elles n'ont pu être
qu'inventées par les accusateurs de la reine, car une femme si sage et
vertueuse ne pouvait s'abaisser à écrire de telles
obscénités :
Nevertheleffe, when you haue taken your befte aduantage you
can of them, fuche lettres miffive and epiftles, efpeciallie not conteininge
any expreffe commandemente of anye vnlavvfull acte or deede to be comitted and
perpetrated, not ratifienge or fpecifienge the accomplifhemete of anie fuche
acte alredye pafte, but by vnfure and vncertaine gheffes aymes, and
coniecturall fupposings, are not able in aniewife to make a lavvfull
prefumptio : much Leffe anie good & fubftanftiall prouf not onlie
agaynft your Sovereigne and Prince, but not fo muche as againft the poreft
vvoman or fymplieft vvretched creature in Scotlando.174(*)
Les preuves étaient nécessaires dans les
procès d'affaires criminelles, ainsi les adversaires de la reine
étaient contraints d'en fournir, il fallait donc qu'ils rédigent
eux-mêmes ces lettres. Les explications que fournit Leslie sont parfois
naïves mais elles ont le mérite de faire passer la reine pour une
innocente ignorante dont la grandeur d'âme l'empêche de voir les
sordides complots qui se trament. Pour clore cette première partie
Leslie tente de montrer que le peuple n'a pas le pouvoir de déposer son
souverain en invoquant l'exemple de David :
I find there that kinge David was both an adoulterer, and also
a murtherer, I finde thath God was highelie displeased with hym therefore. Yet
find I not that he was therefore by his subjects deposed.175(*)
L'exemple de David n'est pas très heureux. John Leslie
rappelle dans cet exemple que Marie est accusé des mêmes crimes
que David (le meurtre et l'adultère). Qui plus est sa conclusion tend
à penser qu'il n'infirme pas ces deux chefs d'accusation. L'exemple met
toutefois en lumière le crime commis par le peuple écossais,
lequel est contraire à la loi divine. La déposition de la
souveraine d'Ecosse est une attaque contre la royauté et doit être
punie.
Après avoir organisé une défense morale
de la reine d'Ecosse, l'avocat catholique se tourne vers une défense
plus technique et soutient le droit légitime pour la reine d'Ecosse de
succéder à Elizabeth. Cette partie constitue en fait une
réponse au traité de John Hale Allegations against the
Surmisid Title of the Quine of Scots lequel rappelle que Marie Stuart est
exclue de la succession car elle est étrangère. De plus Henri
VIII avait stipulé que si aucun descendant direct ne pouvait
succéder à la couronne d'Angleterre, il était exclu que
les descendants de sa soeur ainée Margaret, grand-mère de Marie,
accèdent au trône. En invoquant des argument historiques et
juridiques Leslie affirme que Marie Stuart n'est pas une
étrangère :
Your pretend Maxime ys, who foeuer ys borne ovvte of the
realme of Enlande, and of father àd mother not beinge vnder the
obédience of the kinge of Englande, can not be capable to inheriteany
thinge in Englàde, vvhich rule ys nothinge trevve buth altogether falfe.
For euerie ftranger and alien ys able to puchaffe the inheritance of landes
vvithin this realme, as yt maye appeare in 7 & 9 of kinge Edwarde the
fovvrthe. Yet vntill fuche time as the Kinge be intitled thervnto by
matter of recorde, the inheritance remaynethe in the alien capable of
inheritance within his realme.176(*)
Cette partie s'avère être la plus difficile
à lire pour qui est étranger au système juridique anglais
du 16ème siècle. Elle est sans doute la moins
efficace. En effet, lorsque le texte de Leslie est
réédité, en 1571 et en 1574, l'image et le statut de Marie
Stuart ne lui permettent pas de prétendre à la succession
anglaise. En effet, elle n'est théoriquement plus reine d'Ecosse et son
image de femme volage et adultère l'a même dépourvue de
toute souveraineté.
La troisième partie est selon nous la plus
intéressante. « The thyrde booke where in ys declared that the
regimente of women ys comformable to the lawe of God and nature »
indique une réelle volonté de la part de Leslie de
répondre à l'attaque de Buchanan mais plus
particulièrement au brûlot de John Knox, The First Blast.
L'audace de ce troisième livre est souvent négligée. Bien
que cette troisième partie n'apporte aucune preuve quant à
l'innocence de Maire dans l'affaire Darnley, elle représente une
démonstration théorique du caractère légitime de la
gynécocratie:
In the ftories and monumentes towchinge Aphrike, we reade of
Quene Dido of Cartharge, Cleopatra in AEgypte, & of diuers other Quenes
there.
Thus I haue, as I fuppofe, fufficientlie proued, that this
kinde of regiméte ys not againft nature, by the anciente and continuall
practife of Afis, Aphrica, & Europa, and of the whole three
partes.177(*)
Leslie donne des exemples de reines célèbres,
des exemples qu'il trouve dans l'histoire ce qui ajoute à la force de
son propos. Comme nous l'avons montré précédemment, le
règne d'une femme n'est selon lui pas contraire à la nature
puisqu'au cours de l'histoire des femmes ont régné sans que la
loi divine ne soit bafouée.
Il conclut donc à l'inverse de Knox que le pouvoir
peut être détenu par une femme sans que cela soit contre
nature :
The lawe and yfage can not be covvnted agaifte the lawe of
nature, of ius gentium, which the mofte parte of all contreies, and one greate
or notable parte of the vvhole vvorlde dothe and hathe ever vfed, But this lawe
or ufage ys fuche, Ergo yt ys not agaifte le lavve of
nature.178(*)
En un sens le débat qu'aborde John Leslie n'est pas
nouveau, il ne fait que continuer le débat polémique
initié par Christine de Pisan dans La Cité des dames.
Toutefois, comme nous l'avons fait remarquer en amont, cette prise de position
est pour l'époque assez libérale et contraste largement avec la
vision de Knox selon laquelle une femme doit obéissance à son
mari et ne peut donc pas gouverner une assemblée masculine.
Au fil des rééditions, le contenu de A
Defence évolue. A Treatise concerning the Defence of the Honor
of... Marie la version de 1571 est moins favorable à Elizabeth.
Dans cette version par exemple l'auteur fait référence à
la reine d'Angleterre en écrivant « the
Queen » ou bien « the Queen that now
is » au lieu du plus amical « my gracious
sovereign » de 1569. Il réécrit aussi la
préface de manière à ce que le lecteur comprenne que Marie
est la seule héritière légitime d'Elizabeth. Lorsqu'il est
emprisonné à la Tour de Londres Leslie révise encore sa
défense mais sa peine n'est pas récompensée. Les complots
successifs ourdis par la reine d'Ecosse et la méfiance d'Elizabeth ont
raison de ses efforts. En 1580 il réécrit en latin les deux
dernières parties pour les faire publier au Centre Catholique de Rheims.
Il tourne la défense de Marie vers la défense de la foi
catholique et la légitimité de la reine dans la succession
anglaise. Leslie nourrit également l'espoir que le fils de Marie agisse
en faveur de sa mère, allant même jusqu'à lui proposer de
régner conjointement avec une femme dont il ignore tout si ce n'est
qu'elle était incapable de régner.179(*) Les écrits de
l'évêque de Ross apparaissent bien plus comme les écrits
d'un ami loyal de la reine et ne sont pas considérés comme les
écrits d'un homme d'Eglise catholique cherchant à défendre
sa religion à tout prix. Sa dévotion pour la reine d'Ecosse est
toutefois à souligner et ses efforts en littérature ne cessent
que lorsque la cause de Marie semble perdue.
III. La fin de règne de Marie Stuart ou le
modèle tyrannique combattu par George Buchanan dans De Iure regni apud
Scotos.
En 1580, alors que le destin de la reine captive semble
scellé, les deux images proposées par Buchanan et Leslie tentent
d'influencer l'opinion publique. D'un côté Leslie et sa
défense plusieurs fois remaniée tendent à dresser le
portrait d'une reine jeune mais sage qui endure les souffrances que lui font
subir ses perfides accusateurs. De l'autre George Buchanan, ancien poète
latiniste à la cour écossaise, qui lui a préparé
une défense de ses compatriotes révolutionnaires qui montre
point par point que la reine d'Ecosse, à cause son caractère
immoral, était incapable de régner. Le personnage de Marie Stuart
qui émerge de la littérature semi autorisée en Angleterre
rend le personnage odieux. Le pamphlet de l'humaniste écossais
discrédite la reine d'Ecosse encore plus que les évidences
factuelles que ses accusateurs fournissent à York et à
Westminster. La postérité perçoit George Buchanan comme un
traître et surtout comme l'instigateur de cette image
débauchée de la reine que relaie la littérature. Pour la
défense du penseur on doit rappeler que la décision de publier le
pamphlet a été prise par William Cecil à un moment
où la politique du gouvernement anglais change d'orientation. De
même la deuxième partie du pamphlet qui est ajoutée
à l'édition anglaise et présentée comme la
continuité du texte de Buchanan est en réalité l'oeuvre de
Thomas Wilson. De plus, le récit de Buchanan est en premier lieu
écrit en latin, ce qui ne le destinait pas à être lu par la
majorité de la population. Le choix de la publication en langue
vernaculaire s'adresse à un lectorat plus populaire.180(*) L'on peut donc supputer que
George Buchanan n'avait pas écrit ce pamphlet dans le but de le faire
publier et de le diffuser si largement. Cependant il accepte la proposition de
William Cecil en ayant conscience que son texte allait être lu par un
public européen.
Mais conclure que Marie Stuart n'est en fait qu'une innocente
victime comme le laisse à penser l'ouvrage de Leslie n'est pas une
conclusion plus juste. Quelle qu'ait été le degré
d'implication de la reine dans le meurtre de Darnley, la présence de
Marie Stuart en Angleterre, ses activités et les correspondances qu'elle
entretenait avec les nobles catholiques anglais faisaient d'elle une
véritable menace pour la paix et la sécurité du royaume.
Comme le dit l'archevêque Parker, Elizabeth tenait le loup par les
oreilles. Elle avait entre ses mains une jeune femme catholique qui voulait
prendre la tête de l'Angleterre protestante, et qui en appelait à
l'Europe catholique pour supporter militairement sa cause. Elizabeth d'un point
de vue politique se devait de faire taire cet élément
perturbateur pour préserver son royaume et ses alliances à
l'étranger. La littérature diffamatoire aide Elizabeth à
discréditer Marie Stuart et sa possible succession à la couronne
d'Angleterre. Marie quant à elle ne faisait rien pour susciter la
clémence de sa « bonne soeur ». En 1583, l'oncle de
Marie, le pape et Philippe II planifièrent une invasion en Angleterre
dans le but de restaurer le catholicisme. Ce plan tourne bientôt au
complot et la faction catholique projette d'assassiner Elizabeth et de
libérer Marie Stuart.181(*) En novembre Francis Throckmorton, supposé
jouer un rôle important dans l'entreprise, est arrêté.
L'année suivante le docteur William Parry, un avocat et membre du
Parlement est jugé pour s'être associé illégalement
à la faction catholique. Il est lui aussi arrêté. En 1586,
les agents de la reine d'Angleterre déjouent un autre complot, celui de
Babington. Sans entrer dans les détails de ces complots, on peut tirer
deux conclusions quant à leurs auteurs : premièrement, les
forces catholiques du continent étaient impliquées et
prêtes à apporter leur aide pour libérer la reine d'Ecosse
et deuxièmement, Marie Stuart avait conscience de ces deux projets et
selon les propos recueillis lors des interrogatoires menés par
Walsingham, elle les approuvait.
Il n'est pas surprenant dès lors qu'Elizabeth durcisse
sa politique. Mais au lieu de faire appel à Buchanan et à sa
plume elle décide d'une action officielle. Le Bond of
Association proposé par le Conseil en octobre 1584 et adopté
sous le nom d'Acte d'Association en novembre et décrète que toute
personne qui intente à la vie de la reine ou qui clame le droit de lui
succéder, doit être jugée et condamnée à
mort. Bien que le nom de Marie Stuart ne soit pas mentionné, c'est sans
nul doute à elle que cette loi s'adresse. Pourquoi le gouvernement
n'a-t-il pas cette fois encore fait appel à George Buchanan, lequel
avait préparé une attaque en trois temps contre la reine
d'Ecosse ? Force est de constater que les complots dans lesquels
était impliquée la reine d'Ecosse obligeaient des sanctions qui
aillent au delà de la simple diatribe. Pourtant De Iure regni apud
Scotos est un texte qui justifiait de manière argumentée le
fait que la reine d'Ecosse ne pouvait régner. Le texte assimile en effet
le règne de la jeune femme à un règne tyrannique. Ecrit
entre 1567 et 1568, De Iure regni apud Scoto Dialogus est
publié en 1579. Il s'agit d'un dialogue humaniste rédigé
en latin et destiné à être lu par l'élite
européenne. Il prend la forme d'un dialogue socratique et s'apparente
aux dialogues de Platon. Les deux personnages sont George Buchanan
lui-même et Thomas Maitland of Lethington, le frère cadet de
l'ancien secrétaire de la reine William Maitland of Lethington lequel
est attaqué par Buchanan dans le texte Chamaeleon. Buchanan
considère le père de Thomas Maitland comme le Machiavel
écossais.182(*)
Le texte comporte trois parties dans lesquelles Buchanan expose deux
problèmes majeurs : pourquoi avons-nous besoin d'un roi et pourquoi
le roi doit-il être soumis à la loi ? De quelles solutions le
peuple dispose-t-il lorsque le roi refuse de se soumettre à la
loi ?
De Iure Regni Apud Scotos est dédié
à Jacques VI, fils de Marie Stuart : « GEORGIUS
BUCHANANUS IACOBO SEXTO SCOTORUM REGI S. P. D ». 183(*) Le fait que le texte soit
dédié au fils de Marie Stuart indique que l'humaniste, qui
devient plus tard le tuteur de l'enfant, désire donner un autre exemple
de gouvernement pour le futur roi, comme pour effacer le mauvais souvenir de sa
mère. Marie Stuart devient un contre-exemple. L'essai de Buchanan est
beaucoup moins diffamatoire que le pamphlet Detectio. Dans ce second
texte il s'agit d'amener des preuves qui affirment que le peuple est en droit
de se soulever contre un régime qu'il juge tyrannique. Buchanan donne
des exemples tirés de l'histoire pour illustrer son propos. Ainsi, dans
la première partie il fait remarquer à Maitland que les citoyens
les plus fidèles ne peuvent qu'accepter la punition de ceux qu'ils
croyaient être leurs souverains légitimes. Buchanan cite ensuite
l'exemple de Néron et de Caligula :
When you therefore deal with this kind of people, so clamorous
and very importunat, ask some of them what they think concerning the
punishment of Caligula, Nero or Domitian, I think there will be none of them so
addicted to the name of King that will not confess they were justly
punished.184(*)
Contrairement à John Knox qui justifie le tyrannicide
par les Saintes Ecritures, Buchanan n'ancre pas sa démonstration dans le
sacré et n'use pas d'arguments religieux. On trouve dans De Iure
des arguments fondés sur la raison et le droit naturel que l'auteur
tire de la lecture de Platon, Aristote et Cicéron.185(*) Ainsi il interpelle
Maitland :
Do you think that there was once a time when men lived in
shelters and even in caves, lacking laws and settled abodes, and strayed about
as wanderers, meeting as the mood took them, or as some {temporary} advantage
or common utility brought them together ? 186(*)
Lorsque Maitland avance que c'est pour assurer la
défense contre les ennemies que les hommes mirent fin à leur
solitude et formèrent la première société, Buchanan
le contredit en avançant que la poursuite de l'intérêt
personnel dissout plus qu'elle n'unit la société. Le moteur qui
pousse à vivre ensemble est quaedam naturae vis, une certaine
force de la nature. Cela opère comme une lumière diffusée
dans notre esprit et grâce à elle l'homme peut distinguer ce qui
est moral de ce qui ne l'est pas. Une fois qu'il démontre cela, on peut
affirmer que Buchanan est en faveur de la lex naturae, il supporte
cette opinion en s'appuyant sur deux autorités. La première est
l'évangile selon St. Luc (10, 27), dans laquelle Luc nous invite
à aimer Dieu ex animo et nos voisins comme nous-mêmes. La
deuxième est une citation présumée de Cicéron
affirmant que rien n'est plus plaisant à Dieu que « les
congrégation unies par la loi et que l'on appelle communautés
civiles ». Maitland est finalement convaincu que la première
société est le résultat d'une illumination divine. La
société ne s'est pas formée grâce à la
volonté des hommes d'agir pour le bien de tous. Selon George Buchanan,
les hommes s'unissent car la société est un état
préférable à la solitude selon Dieu. Les hommes sont donc
indéfectiblement unis, tels les membres du corps humain.187(*) Buchanan était
également très intéressé par les idées de
Cicéron. Dans De Officiis, Cicéron souligne que l'homme
est capable de raisonner et d'utiliser sa raison lorsqu'il agit dans
l'intérêt du bien commun. L'homme possède la faculté
de raisonner ce qui le pousse à reconnaître qu'il a aussi des
obligations envers autrui. Dans ce sens, on peut mesurer la vertu par le
degré d'implication dans la vie en communauté. Avec une dette
avouée aux Stoïciens, Cicéron concilie la morale et la vie
en société.188(*)
Buchanan revient ensuite avec un autre argument : la
société humaine dès son commencement est pervertie par
l'intérêt personnel et les viles passions. Il fallait un docteur
qui maintienne la société en bonne santé. Ce docteur est
le gouvernement. Lorsque les problèmes rongent la société
c'est au roi que le peuple doit faire appel. Le roi a le devoir de
« soigner » les maux de la société
Do you remember what hath been lately spoken, that an
incorporation seemeth to be very like our body, civil commotions like to
deseases, and a king to a physician ? If therefore we shall understand
what the duty of a physician is, I am of the opinion we shall not much mistake
the duty of a king. (...) there is a twofold duty incumbent on both. The one
is to preserve health, the other is to restore it, if it become weak by
sickness.189(*)
Buchanan indique que la forme de gouvernement n'a pas
d'importance du moment que l'organe qui sert à gouverner est
créé par le peuple dans le but de rendre justice. Mais le
médecin peut lui-même être infecté et faire passer
son intérêt personnel avant celui de la communauté :
« Because the authority constituted for the public utility turns to
proud domination »190(*). Les citoyens doivent trouver des lois pour
restreindre le devoir du gouverneur.191(*) Buchanan cite De Officiis, et montre que
les lois doivent être créées par le peuple pour la
même raison que le roi doit être choisi par le peuple, et la seule
loi qui vaille est une loi impartiale. Cicéron est l'autorité
principale dans ce texte de Buchanan et sa maxime utilitariste :
Populi salus suprema lex esto (Le bien du peuple est dans la loi) que
l'on retrouve à la page 18 du texte de Buchanan, guide l'humaniste.
C'est ce que Buchanan transmet aux huguenots.192(*) La masse populaire n'est pas vouée à
décider. Buchanan mentionne plutôt les magistrats et les
états. Il fait ensuite référence à la tribune
romaine et se demande pourquoi le peuple ne s'est pas élevé
contre les magistrats s'il pensait que ces derniers ne respectaient pas la loi.
Le peuple est le seul législateur. En Ecosse les lois antiques
étaient ratifiées en même temps que les rois étaient
couronnés, la cérémonie symbolisait le consentement du
peuple. Lorsque Maitland affirme qu'il est absurde d'attendre que tout le monde
soit d'accord car une telle chose est impossible, Buchanan montre
l'étendu de son populisme. Selon lui ceux qui obéissent au tyran
ne doivent pas être reconnus comme citoyens pour Buchanan ceux qui
sont citoyens sont ceux « qui obéissent aux lois, qui
s'inquiètent du bien de la société, qui
préfèrent le travail et la mise en péril de leur propre
sécurité plutôt que de vieillir dans l'immoralité et
la paresse, (ce sont) les hommes dont les efforts, bien que non reconnus dans
le présent, seront rappelés à
l'éternité »193(*)
Buchanan définit d'une manière
générale le tyran comme un gouvernement établi sans
consentement, le règne d'un maître sur des esclaves, la soumission
d'hommes libres par un autre homme libre. Il rompt le pactio mutua,
devient un ennemi public. Il est alors juste que ses sujets entrent en guerre
contre lui. De ce fait le roi ne peut agir de manière
égoïste, selon son bon plaisir. Marie Stuart en cédant
à ses désirs, en agissant selon ses envies s'est
détournée des vraies préoccupations. Les rois agissent
pour le peuple selon Buchanan. Marie Stuart n'a pas respecté ce
schéma. A juste titre elle a donc été punie. Pour Buchanan
c'est à la force civile de mettre le souverain hors de nuire et il
incombe à l'Eglise de s'assurer de la damnation de son âme. Il
cite l'épître au Corinthiens (I, 5) et semble dire que les
fidèles ne doivent rien avoir à faire avec un régent
criminel, donc l'Eglise doit les guider dans leurs prises de position contre le
roi. Toutefois, le Conseil de l'Eglise n'a pas à intervenir dans la
déposition du tyran selon Buchanan.
A l'argument qui insistait sur le fait que Marie était
une reine de droit divin et que la déposer consistait à aller
à l'encontre de la loi divine, Buchanan confronte une vision de la
souveraineté tout à fait différente. Le roi prend ses
fonctions pour servir le peuple, tout comme le peuple doit servir le roi. Les
lois sont créées par le peuple, représentées par le
Parlement et le roi est obligé de s'y soumettre. En effet, les lois
doivent contrôler le caractère dominateur du roi, afin qu'il
n'agisse pas de manière cruelle ou égoïste. Bien que
Buchanan ne site jamais le nom de Marie Stuart dans ce pamphlet, le fait qu'il
soit écrit en réaction à la déposition de la reine
prouve que Buchanan pense le règne de Marie Stuart comme un exemple de
tyrannie. La dernière image que Buchanan donne de la reine est donc
l'image d'un tyran. Cependant le texte de Buchanan n'est pas uniquement
nuisible à la réputation de la reine d'Ecosse, il
représente aussi une potentielle menace pour les monarchies absolues.
Elizabeth et ses conseillers qui trouvèrent les premiers écrits
de Buchanan si utiles n'étaient pas prêts à assumer les
implications de telles idées. Au dos d'une lettre d'Elizabeth
adressée au régent d'Ecosse, l'ambassadeur Henry Killigrew
écrit une note qui suggère l'angoisse de la reine quant à
la publication du livre de Buchanan : « bucanan to be
warned of setting forth of the booke without adduise frome hence touching
matters therin consequent touching some of our nation »194(*). Après la
publication du texte en Ecosse en 1579, la théorie politique selon
laquelle les sujets ont l'obligation de déposer les tyrans fait surface.
Elizabeth se devait de faire supprimer ce texte qui relayait les implications
radicales de la déposition de Marie Stuart. Les textes de Buchanan
furent interdits à la publication en Angleterre et une
réédition du premier pamphlet de l'humaniste ne fut
autorisée qu'en 1587, date à laquelle les Anglais avaient besoin
de textes diffamatoires pour justifier l'exécution de la reine. Jacques
VI, qui fut pourtant l'élève de Buchanan décida de
sanctionner financièrement tous les détenteurs de l'ouvrage
De Iure regni apud Scotos en 1584. Les manipulations de l'image
publique de la reine d'Ecosse n'étaient acceptables que dans une
certaine mesure. Dès lors qu'il s'agissait de soulever un
problème politique d'une plus grande envergure, l'on
préférait taire les faits. Finalement l'on retient l'image de la
reine adultère aux moeurs légères mais l'image du tyran
est à oublier, car trop polémique.
Conclusion :
Durant la période qui s'étend de 1561 à
1587 les représentations littéraires de Marie Stuart
évoluent de manière plutôt radicale. Peu après son
retour en Ecosse la reine est acclamée par une population qui voit dans
son retour une promesse de stabilité. Marie est une Stuart et le peuple
attend d'elle qu'elle honore la devise des rois de sa lignée :
Nemo me impude lacssit. Personne ne me provoque impunément.
Force est de constater que l'attitude de la reine fait mentir cette
affirmation. Tout d'abord les poètes de la cour dérogent à
la règle traditionnelle des poèmes de bienvenue pour verser dans
le genre du speculum principis. Alexander Scott parsème son
texte de conseils visant à orienter les prises de décisions
royales vers un modèle de concorde. En dépit de ces incartades
George Buchanan, promu au rang de principal poète de la cour, fait
preuve d'une loyauté sans faille envers la reine durant les six
années de son règne. On constate d'ailleurs avec une certaine
ironie que son plus fervent adversaire fut d'abord l'un de ses plus fideles
auteurs. Pendant les premières années du règne la
littérature écossaise reconnaît donc Marie Stuart comme une
souveraine légitime et reprend les thèmes abordés par les
poètes de la cour des Valois, qui sont sa beauté, sa
vivacité d'esprit et sa grande sagesse. Nul ne mentionne sa force et son
autorité, qualités que l'on associe d'ordinaire au souverain,
mais la présence de Marie Stuart en Ecosse inspire l'espoir plus que les
critiques chez les bards écossais.
Cet espoir est balayé par les évènements
de 1566 et 1567. L'orientation catholique de la politique de Marie Stuart
attise les tensions. Le 2 février 1566 Henri Darnley devenu chevalier de
l'ordre de Saint Michel pavoise sur High Street s'égosillant que
l'ancienne religion a repris le contrôle du royaume d'Ecosse.195(*) Alors que le Conseil est
constitué d'une moitié de protestants et d'une autre
moitié catholique, la tension est palpable. La naissance du futur
héritier apaise les tensions et rassemble la noblesse autour de la reine
mais les évènements futurs réduisent à néant
les efforts de réconciliation déployés par Marie Stuart.
C'est à ce moment que la littérature écossaise verse dans
la calomnie et les thèmes politiques. Si la littérature de
début de règne décrit la reine comme une jeune
beauté génitrice d'une paix nouvelle, la littérature qui
paraît après 1567 se tourne vers des thèmes comme celui de
l'Etat et de la nation. L'argumentation tripartite de Buchanan est en effet
résolument tournée vers la défense du peuple
écossais, ce qui implique de discréditer la reine. A
Detectioun of the doings of Mary Queen of Scots s'apparente toutefois plus
à une attaque ad feminam qu'à une défense des
actes révolutionnaires écossais. Ce pamphlet peut être
perçu comme l'oeuvre calomnieuse d'un opportuniste cependant il est
aussi un exemple de la manière dont Buchanan a manipulé son
lectorat grâce à la rhétorique pour faire de Marie Stuart
un personnage dénué de morale, donc coupable. Même si le
texte de l'humaniste n'est pas un exemple d'argumentation théorique il
est le premier à relater l'histoire de Marie Stuart comme une histoire
tragique. De plus, le texte joue sur tous les préjugés qui
entourent la sexualité féminine à l'époque
moderne : l'appétit sexuel démesuré, la beauté
ensorceleuse, etc. En faisant de Marie Stuart une femme adultère et
meurtrière, George Buchanan cristallise autour du personnage toutes les
pensées misogynes qui contrindiquent le règne féminin.
A partir des années 1570 la diffusion du pamphlet de
Buchanan et les complots ourdis par la reine d'Ecosse poussent le royaume
d'Angleterre et le royaume de France à prendre partie. Le royaume
d'Angleterre manipule ce perfide personnage féminin créé
par l'humaniste écossais pour discréditer les prétentions
successorales de la reine d'Ecosse mais il est plus étonnant de
constater que la patrie d'accueil de Marie Start ne s'engage pas ouvertement
contre ces écrits diffamatoires. Le jeu des alliances diplomatiques et
la volonté de tenir l'Espagne en échec ne méritaient pas
que le roi de France se mette à dos son allié d'outre-Manche. De
1567 à 1587 le sort de la reine d'Ecosse intéresse peu la cour de
France et les catholiques français. La défense de la reine
déchue est donc dans un premier temps organisée par un seul
homme, John Leslie. Toutefois les huguenots s'intéressent au personnage
de Marie Stuart après le massacre de la Saint Barthélémy
et font de la reine un personnage soumis aux champions du catholicisme que sont
les Guise. Finalement, la reine Marie Stuart intéresse d'avantage les
auteurs catholiques après que sa mort la promeut au rang de
martyr.196(*)
Nous avons tenté de montrer comment le contexte
politique et diplomatique du milieu du 16ème siècle a
influencé les représentations littéraires de la reine
Marie Stuart. George Buchanan et John Leslie ont donné naissance au
personnage Marie Stuart. Le premier pamphlet de George Buchanan utilisé
sciemment par les Anglais pour discréditer la reine d'Ecosse scelle
l'image d'une femme amoureuse, psychologiquement instable et moralement faible.
Tandis que De Iure regni apud Scoto écrit en réaction
à la déposition de la reine tend à faire de Marie Stuart
un tyran dont l'égocentrisme nuit à l'exercice du pouvoir. De ces
deux textes naît l'image d'une reine frivole et incapable d'incarner
l'autorité. Buchanan fait de Marie Stuart un contre-exemple et fait
basculer sa représentation de la reine dans un espace sexualisé
voire morbide. A l'inverse John Leslie la décrit comme innocente car
ignorante des complots qui se tramaient à Edimbourg. Leslie tente d'en
faire une reine digne mais échoue à créer une
héroïne. En effet, John Leslie ne souligne aucun faits que Marie
Stuart a accompli de son vivant qui témoigne de sa bravoure ou de sa
valeur. Il mentionne seulement qu'elle est une mère pour son peuple et
qu'elle a toujours agi dans l'intérêt de celui-ci. Si l'on s'en
réfère à la définition de l'héroïne que
donne Furetière en 1690 : « fille ou femme qui a des
vertus de héros, qui a fait quelque action
héroïque », on peut affirmer que Marie Stuart
n'était pas représentée comme une héroïne de
son vivant. Elle ne possédait pas les vertus conformes à son
sexe.197(*) La
représentation de la reine d'Ecosse forgée par Leslie a donc un
impact moindre car elle ne se base pas sur des faits concrets. A contrario
George Buchanan se base sur des faits concrets qui sont le meurtre de
Darnley et le remariage précipité avec Bothwell. L'humaniste
écossais forge quant à lui un exemple à ne pas suivre, une
héroïne que l'amour aveugle et qui laisse son pays au bord de la
guerre civile.
Nos deux auteurs écossais laissent à la
postérité une figure littéraire malléable. Les
représentations littéraires de Marie Stuart dans les
écrits de Buchanan et de John Leslie représentent
l'ébauche du mythe que forgera la postérité. D'un
côté le personnage décrit par Buchanan est un premier pas
vers la légitimation du tyrannicide, de l'autre la défense de
John Leslie offre aux catholiques une figure de martyre en devenir. Marie
Stuart, que John Leslie décrit comme une victime du protestantisme,
comme une prisonnière pieuse devient une icône que la mort
romantique consacre en martyr.
« En ma fin est mon commencement » avait
brodé Marie Stuart dans sa prison de Sheffield. Cette formule
prophétique rend compte de l'engouement des auteurs catholiques et
protestants après la mort de Marie Stuart. Si les représentations
littéraires du 16ème siècle donnent naissance
à un personnage dont la dualité suscite les passions,
l'exécution de Marie Stuart finit de hisser le personnage au rang
d'héroïne. Toutefois, puisque Marie Stuart ne semble avoir accompli
aucun acte héroïque de son vivant, c'est à la
postérité de prouver sa vertu. De là nait l'image de
prisonnière exemplaire et très catholique.198(*)
Sources et bibliographie
Sources :
Imprimés anciens :
BUCHANAN G., Ane Detectiovn of the duinges of Marie Quene
of Scottes, touchand the murder of hir husband, and hir conspiracie, adulterie,
and pretensed mariage with the Erle Bothwell. And ane defence of the trew
Lordis, mainteineris of the Kingis graces actioun and authoritie. Translatiti
out of the Latine quhilke was written by G.B, Londres, 1571.
BUCHANAN G., De Jure Regni apud Scotos, Dialogus,
imprimé par John Ross, Edimbourg, 1579.
BUCHANAN G., Georgii Buchanani Vita, Iuxta exemplar
excusum Francofordij ad Maenum anno M.D.IIC, 1608.
LESLIE J., A defence of the honour of the right highe,
mightye and noble Princesse Marie Quene of Scotlande and dowager of France,
with a declaration aswell of her right, title & intereste to the succession
of the crowne of Englande, as that the regimente of women ys conformable to the
lawe of God and nature, Londres (Rheims), imprimé par J. Foigny,
1569.
MURDIN W.B.D. (ed.), A collection of State Papers relating
to affairs in the reign of Queen Elizabeth, from the year 1571 to 1596,
Londres, imprimé par William Bowyer, 1759.
Manuscrits publiés :
BUCHANAN G., The Political Poetry,
édité par Paul J. McGinnis et Arthur H. Williamson, Edimbourg,
1995.
CRAIGIE W.A (ed.), Matiland Quarto Manuscript,
Scottish Text Society, Edimbourg, 1920.
CRANSTOUN J. (ed.), Satirical Poems of the Time of the
Reformation, I, 10, Edimbourg et Londres, Scottish Text Society,
1891-1893.
KNOX J., The First Blast of the Trumpet ?Against the
Monstrous Regimen of Women?, (1558) Edimbourg, 1995.
LESLIE J., A Defence of the honour of Marie Quene of
Scotlande, (1569), édité par ROGERS D.M., Scholar Press,
1970.
Mary Queen of Scots, Ex Libris Bibliothecae
Facultatis Juridica Edinburgi, 1812, collection de textes relatifs à la
mise en accusation de Marie Stuart.
THOMSON T., A Diurnal of Remarkable Occurents,
Bannatyne Club, 1883.
Bibliographie :
ADAMSON J., The Princely Courts of Europe 1500-1750,
Londres, 1999.
AITKEN J. M., The trial of George Buchanan Before the
Lisbon Inquisition, comprenant le texte de défense de Buchanan,
Vita de George Buchanan ainsi que la traduction des textes et des
commentaires, Londres, 1939.
BURNS J.H, The True Law of Kingship, Oxford, 1996.
CAIE G. (dir.), The European sun : proceedings of the
seventh International Conference on Medieval and Renaissance Scottish Language
and Literature, University of Strathclyde, 1993, East Linton, 2001.
CONSTANCE J., « Women's Rule in Sixteenth-Century
British Political Thought », in Renaissance Quarterly, vol.
40, numéro 3, 1987, pp. 421-451.
CADENE N., « L'histoire au féminin : la
vie de Marie Stuart par Agnès Strickland »,
Romantisme, numéro 115, 2002, p. 41-52.
DEKKER K. et MACDONALD A.A (dir.), Rhetoric, Royalty, And
Reality : Essays on The Literary Culture of Medieval and Early Modern
Scotland, Paris, Peeters, 2005.
DERMENJIAN G., GUILHAUMOU J. et LAPIED M. (dir.), Le
Panthéon des femmes, figures et représentations des
héroïnes, édition Publisud, 2004.
DONALDSON G., All the Queen's Men, Power and Politics in
Mary Stewart's Scotland, Londres, 1983.
DONALDSON G., Mary Queen of Scots, Londres, 1974.
DUCHEIN M., Histoire de l'Ecosse, Fayard, 1998, p.
230.
DUNNINGAN S.M., « The Creation and Self-Creation of
Mary Queen of Scots : Literature, Politics and Female Controversies in
Sixteenth-Century Scottish Poetry », Scotlands, 5, 1998, p.
65-88.
EDINGTON C., Court and Culture in Renaissance Scotland.
Sir David Lindsay of the Mount, University of Massachusetts Press,
1994.
FRASER A., Mary Queen of Scots, Londres, 1969.
GATHENER W.A. (édition et traduction), The
Tyrannous Reign of Mary Stewart, George Buchanan Account, Edimbourg,
1958.
GOODARE J. ET MACDONALD A.A. (dir.), Sixteenth Century
Scotland : essays in honour of Michael Lynch, Leiden, 2008.
GUY J., My Heart is my Own, The Life Of Mary Queen of
Scots, New-York, 2004.
LANGER U., « The Renaissance Novella as
Justice », Renaissance Quarterly numéro 42, 1999, pp.
311-341.
LEWIS J.E., Mary Queen of Scots : Romance and Nation,
Londres, 1998.
LOCKIE D., « The Political Career of the Bishop of
Ross, 1568-80 », in University of Birmingham Historical
Journal, vol. 4, 1953-4, pp. 98-145.
LYNCH M. (dir.), Mary Stewart Queen in Three
Kingdoms, Londres, 1988.
LYNCH M., « Queen Mary's triumph ; the
baptismal célébrations at Stirlng in December 1566 » in
Scottish Historical Review, numéro 69, 1990, pp. 1-21.
LYNCH M., Scotland : A New History, Londres,
2009, première édition en 1991.
MAHON R.H, The Indictment of Mary Queen of Scots,
Cambridge, 1923.
MASON R.A., « George Buchanan and Mary Queen of
Scots », in Scottish Church History Society, numéro
30, 2000.
MACDONALD A.A., « Mary Stewart's Entry to
Edinburgh : an Ambiguous Triumph » in The Innes Review,
volume 43, 1992, pp. 101-110.
MACDONALD A.A., LYNCH M., et COWAN I.B. (ed.), The
Renaissance in Scotland : studies in literature, religion, history, and culture
offered to John Durkan, Leiden, 1994.
MACQUEEN J. ET W., A Choice of Scottish Verses
1470-1570, Edimbourg, 1972.
MCFARLANE I.D., Buchanan, Londres, 1981.
PERRONET M. (dir.), Le XVIe siècle, 1492-1620,
Hachette Supérieur, 2005.
PHILLIPS J.E, Images of a Queen, University of
California Press, 1964.
PISCOTTIE R.L. of., The History of Scotland from 1436 to
1565, Glasgow, 1749.
RYRIE A., The Age of Reformation, The Tudor and Stewart
Realms 1485-1603, Londres, 2009.
RICHARDS J., « To Promote a Woman to Beare
Rule : Talking of Queens in Mid-Tudor England » in The
Sixteenth Century Journal, vol. 28, numéro 1, printemps 1997, pp.
101-121.
SALMON J.H.M, Renaissance and Revolt, Essays in the
intellectual and social history of early modern France, Londres, 1987.
STAINES J.D., The Tragic Histories of Mary Queen of Scots,
1560-1690, New-York, 2009.
STRONG R., Art and Power : Renaissance Festivals
1450-1650, Woodbridge, 1984.
WARNICKE R.M, Mary Queen of Scots, Londres, 2006.
WARNICKE R.M., « Sexual Heresy at the Court of Henry
VIII » in The Historical Journal, volume 30, numéro
2, 1987, p. 247-268.
WIESNER M. E., Christianity and sexuality in the early
modern world : regulating desire, reforming practice, London, 2000.
WIESNER M. E., Women and Gender in Early Modern
Europe, Cambridge University Press, 2000.
WILKINSON A.S, Mary Queen of Scots and French Public
Opinion 1542-1600, New-York, 2004.
WILLIAMS J.H. (dir.), Stewart Style 1513-1542 :
Essays on the Court of James V, East Linton, 1996.
WORMALD J., «
Bloodfeud,
Kindred and Government in Early Modern Scotland », in
Past
& Present, no. 87, mai 1980, pp. 54-97.
WORMALD J., Mary Queen of Scots, a study in failure,
Londres, 1988.
WORMALD J. (ed), Scotland : A History, Oxford,
2005.
ANNEXES :
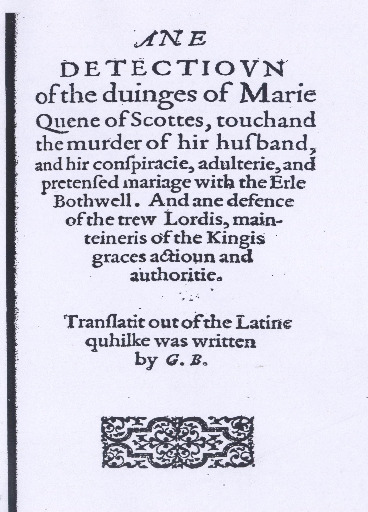
A. 1. BUCHANAN G., Ane Detectiovn of the duinges of Marie
Quene of Scottes, touchand the murder of hir husband, and hir conspiracie,
adulterie, and pretensed mariage with the Erle Bothwell. And ane defence of the
trew Lordis, mainteineris of the Kingis graces actioun and authoritie.
Translatiti out of the Latine quhilke was written by G.B, Londres, 1571,
folio 1. Bibliothèque nationale d'Edimbourg.
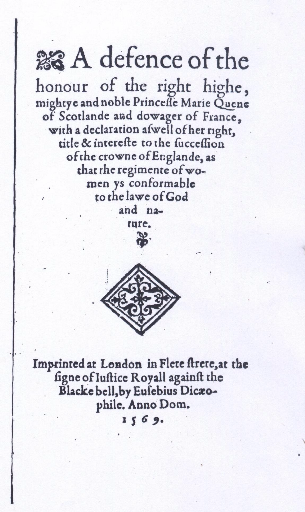
A. 2 LESLIE J., A defence of the honour of the right highe,
mightye and noble Princesse Marie Quene of Scotlande and dowager of France,
with a declaration aswell of her right, title & intereste to the succession
of the crowne of Englande, as that the regimente of women ys conformable to the
lawe of God and nature, Londres (Rheims), imprimé par J. Foigny,
1569, folio 1. Bibliothèque nationale d'Edimbourg.
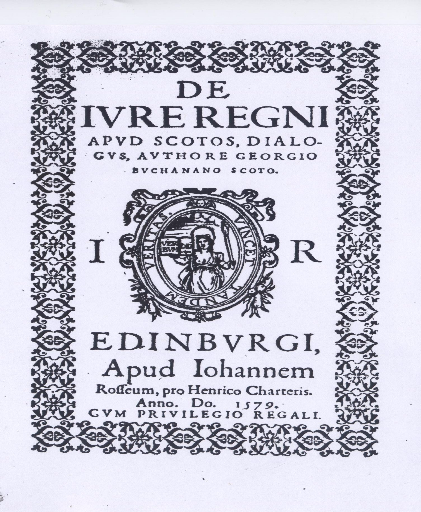 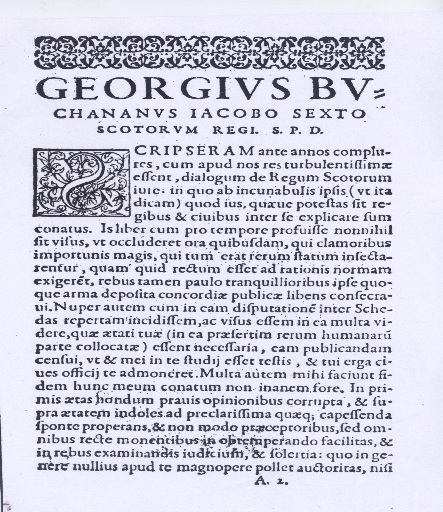
A. 3. BUCHANAN G., De Jure Regni apud Scotos, Dialogus,
imprimé par John Ross, Edimbourg, 1579, folios 1 et 2.
Bibliothèque nationale d'Edimbourg.
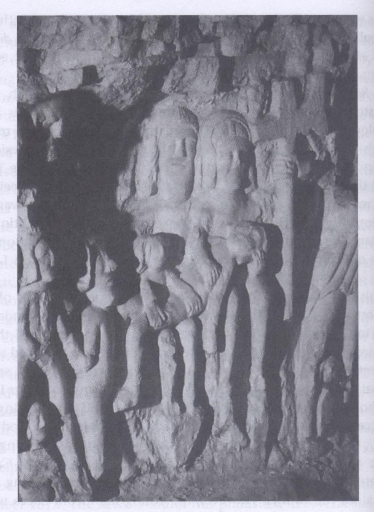
A. 4. Photographie de la Cave aux Sculptures à
Dénézé-sous-Doué dans le Maine-et-Loire. WILKINSON
A. S., Mary Queen of Scots and French Public Opinion 1542-1600,
New-York, 2004, p. 96. Photographie réalisée par René
Delon (tous droits réservés).

A. 5 Portrait de Marie Stuart en Martyr Catholique.
Frontispice de Il Compassionevole et memorabil caso, della morte della regina
di Scotia, moglie di Francesco II re di Francia, Vicenza, 1587, British Library
Board, tous droits réservés. Référence b38f9, in
STAINES J.D., The Tragic Histories of Mary Queen of Scots, 1560-1690, New-York,
2009, p. 168 (fig. 5. 2).
Tables des matières :
Introduction
..............................................................................
P. 1
Chapitre 1 : Marie Stuart reine : une
littérature de cour florissante, de 1561 à
1565........................................................................................
P. 21
I. Une entrée royale mâtinée de conseils
.................................... P. 22
II. Un humaniste à la cour : la relation entre
Marie et Buchanan ......... P. 32
III. Marie et la littérature de cour
.............................................. P. 41
Chapitre 2 : Marie Stuart femme, ou la naissance d'un
personnage controversé, de 1565 à 1572
..............................................................................
P. 50
I. Dernier éclat du règne : le
baptême de Jacques VI ...................... P. 51
II. Marie femme adultère, point d'ancrage d'une
littérature calomnieuse. P. 58 III. A Detection of the Doings of
Mary Queen of Scots ou la dénonciation misogyne de Buchanan
.................................................................. P. 66
IV. La pensée libérale de John Leslie
......................................... P. 74
Chapitre 3 : Marie Stuart, traîtresse ou
martyre ? De 1572 à 1587 ................ P. 79 I. Un
« personnage » aux mains des Anglais et des Français
............... P. 80 II. L'organisation de la défense de Marie Stuart
par John Leslie .......... P. 88 III. La fin de règne de Marie Stuart
ou le modèle tyrannique combattu par George Buchanan dans De Iure
regni apud Scotos .................................. P. 98
Conclusion
...............................................................................
P. 107
Sources et bibliographie
............................................................... P. 111
Annexes
...................................................................................
P.115
Table des matières
...................................................................... P.
119
* 1 DUCHEIN M., Histoire
de l'Ecosse, Fayard, 1998, p. 230.
* 2 Friederich von Schiller
écrit une pièce intitulée Marie Stuart en 1800
qui inspira l'opéra homonyme de Gaetano Donizetti, Stefan Zweig
écrit une biographie de la reine écossaise en 1935 et
présentée comme une tragédie. Et encore l'année
dernière, au festival d'Avignon, Fabien Chappuis mettait en scène
la pièce de Schiller.
* 3 Recherche
effectuée depuis les sites internet
www.bl.uk et
www.nls.uk.
* 4 PROST A., Douze
leçons sur l'histoire, Point Histoire, 1996.
* 5 LEWIS J.E., Mary
Queen of Scots : Romance and Nation, Londres, 1998,
p.85.
* 6 WORMALD J., Marie
Stewart, a study in failure, Londres, 1988, p.18.
* 7 DUCHEIN M., Marie
Stuart, Fayard, 1987, p. 532-556
* 8 DUCHEIN M., op.cit.
p.13.
* 9 WORMALD J., op.
cit. p.11.
* 10 RYRIE A., The Age
of Reformation, The Tudor and Stewart Realms 1485-1603, Londres, 2009,
p.207 et suivantes.
* 11 Le nom donné
à cette période fut attribué par Walter Scott.
* 12 A. de Ruble, La
première jeunesse de Marie Stuart, p. 31 (Paris, 1891) in DUCHEIN
M., op. cit., p. 36.
* 13 Sur l'éducation
que Marie Stuart reçut en France voir GUY J., My Heart is my Own,
The Life Of Mary Queen of Scots, New-York, 2004, pp. 70-84 et
plus particulièrement p. 72 sur l'influence de Diane de Poitiers en ce
qui concerne l'éducation de la jeune reine d'Ecosse.
* 14 STAINES J.D., The
Tragic Histories of Mary Queen of Scots 1560-1690, New-York, 2009, p.
21.
* 15 « Pour la
Royne Marie », OEuvres Complètes (Paris, 1873), I,
220 : « Si donc heureux un chaucun se peut rendre, / En voyant
sans faveur plus expresse, / Qui sauroit l'heur mesurer et comprendre / Du
semidieu qui l'a pour maistress ».
« Avant-Mariage de Madame Marie, Royne
d'Escosse » , Les poésies de Iacques Tahureau, Du Mans.
Mises toutes ensemble & dédiées au Reverendissime Cardinal de
Guyse. A Paris..., fol. 11. Paris, 1554. Poèmes cités
dans PHILLIPS J.E., Images of a Queen, Mary Stewart in
Sixteenth-Century Literature, Londres, 1964, p. 11.
* 16 DUCHEIN M., op.
cit., p. 89.
* 17 LYNCH M.,
Scotland : A New History, Londres, 1991, pp. 209-210.
* 18 STAINES J.D., op.
cit., p. 22.
* 19 Institutio
religionis christianae, paraît à Bâle en 1536 en latin,
composée de 6 chapitres. En 1539, à Strasbourg, une
édition latine révisée est composée de 17
chapitres. En 1541, Calvin traduit lui-même le texte en français.
Une troisième édition paraît en 1543 augmentée de 4
chapitres. Les quatrièmes et cinquièmes éditions
paraissent en 1550 et en 1554. En 1559 enfin, la dernière édition
est divisée en 4 livres et comprend 81 chapitres.
* 20 PERRONET M. (dir.),
Le XVIe siècle, 1492-1620, Hachette Supérieur, 2005, pp.
148-149.
* 21 PERRONET M., op.
cit, p. 188.
* 22 PERRONET M., op.
cit, p. 244.
* 23 WORMALD J.,op.
cit, p. 92-101. La lettre d'Henri II adressée à Paul IV est
citée page 92.
* 24 Propriétaire
terrien écossais.
* 25 Cet exposé de la
situation écossaise s'appuie sur les lectures des ouvrages d'Alec Ryrie,
de Jenny Wormald et de Michel Duchein.
* 26 BUCHANAN G., Rerum
Scoticarum historia, Edimbourg, 1582.
* 27 LESLIE J., De origine
moribus, et rebus gestis Scotorum libri decem ..., Rome, 1578. LESLIE J.,
The Historie of Scotland, edité par E.G Cody pour la Scottish
Text Society, Edimbourg, 1888.
* 28 FRASER A., Mary Queen
of Scots, Londres, 1969.
* 29 WORMALD J., Mary
Queen of Scots, A Study in Failure, Londres, 1988, pp. 11-20 et STAINES
J., The Tragic Histories of Mary Queen of Scots, 1560-1690, New-York,
2009, pp. 3-13.
* 30 BARBOUR J., The
Bruce, édité et annoté par A.A.M. Duncan, Edimbourg,
1997.
* 31
www.marie-stuart.co.uk
* 32 WORMALD J., Mary
Queen of Scots, A Study in Failure, Londres, 1988.
* 33 WORMALD J., op.
cit, p. 7.
* 34 Un mémorandum
fut publié peu avant le mariage de Marie Stuart et de François II
en novembre 1558, intitulé « L'Etat et puissance du royaume
D'Ecosse » qui décrit l'Ecosse de manière peu
flatteuse, insistant sur le fait que le climat y est misérable et les
gens fainéants et rustres.
WORMALD J., op . cit, p. 24.
* 35 LYNCH M. (dir.),
Mary Stewart Queen in Three Kingdoms, Londres, 1988.
* 36 GUY J., My Heart is My
Own, The True Life of Mary Queen of Scots, New-York, 2004.
* 37 DUCHEIN M., Marie
Stuart, Fayard, 1987.
* 38 RYRIE A., The Age
of Reformation, The Tudor and Stewart Realms 1485-1603, Londes, 2009.
* 39 MACDONALD A.A.,
« Scottish Poetry of the Reign of Mary Stewart », in CAIE
G.D. (dir.), The European Sun, Edimbourg, 2001, p.48.
* 40 LYNCH M.,
« Queen Mary's triumph ; the baptismal
célébrations at Stirlng in December 1566 » in
Scottish Historical Review, lxix, 1990, pp. 1-21.
* 41 STRONG R., Art and
Power : Renaissance Festivals 1450-1650, Woodbridge, 1984, pp. 7-10
et 98-125.
* 42 Voir MCFARLANE I.D.,
The Entry of Henri II into Paris 16 June 1549, Binghampton, 1982.
* 43 Le récit des ces
entrées royales se trouve dans le texte de Robert Lindsay of Piscottie,
The History of Scotland from 1436 to 1565, Glasgow, 1749.
* 44 MCFARLANE I.D.,
Buchanan, Londres, 1981, p. 111.
* 45 MACDONALD A.A.,
« Mary Stewart's Entry to Edinburgh : an Ambiguous
Triumph » in The Innes Review, volume 43, 1992, p. 103.
* 46 Le speculum
principis était inspiré de plus grands traités
décrivant les vertus du monarque chrétien idéal. Le
monarque devait se rapprocher de cet idéal décrit par Saint
Augustin et le De Regimine Principum. Ces traités
étaient inspirés des auteurs de l'Antiquité, d'où
l'importance particulière accordéee à cet idéal
monarchique durant la période de la Renaissance.
* 47 GUIGUE G. (ed.),
L'entrée royale de François I, roy de France en la
cité de Lyon le 12 juillet 1515, Lyon, 1889 in STRONG R., op.
cit, p. 10.
* 48 « Le
deuxième jour du mois de septembre 1561, sa majesté la reine fit
son entrée dans la ville d'Edimbourg de la manière
suivante. »
THOMSON T., A Diurnal of Remarkable Occurents,
Bannatyne Club, 1883, p. 67.
* 49 « La
meilleure manière d'être rapidement conduit au
paradis. »
* 50 MACDONALD
A.A., « Scottish Poetry of the Reign of Mary Stewart »
in CAIE G.D., The European Sun, Proceeding of the Seventh International
Conference on Medieval and Renaissance Scottish Language and Literature,
Edimbourg, 2001, p.44.
* 51 MACDONALD A.A.,
« William Stewart and the Court Poetry of the Reign of James
V » in WILLIAMS J.H. (dir.), Stewart Style 1513-1542 :
Essays on the Court of James V, East Linton, 1996, pp. 179-200.
* 52 RITCHIE W.T. (dir.),
The Bannatyne Manuscript, STS, 4 vols, Edimbourg, 1928, II, 254-255 in
MACDONALD A.A., op.cit p.44.
* 53 « Bienvenue,
glorieuse dame et notre reine / Bienvenue, notre lionne à la fleur de
lys / Bienvenue, notre chardon coloré du vert Lorrain / Bienvenue, notre
rose rouge au dessus de toutes ruses / Bienvenue, notre joyaux et joyeuse
génitrice, / Bienvenue, notre jolie princesse très
courtisée / Que Dieu vous donne la grâce de parer à cette
bonne et nouvelle année ! »
MACQUEEN J. ET W., A Choice of Scottish Verses
1470-1570, Edimbourg, 1972, pp. 179-187.
* 54 GOODARE J. (dir.),
Sixteenth-Century Scotland, essays in honour of Michael Lynch,
pp.107-109.
* 55 « Cette
année, que la loi et la raison guide votre chemin »
* 56 « Puisez dans
les quatre principales vertus, la sagesse, la justice, la force et la
tempérance »
* 57 « De
réformer maintenant leurs vies outrageusement fastueuses »
* 58 « (...) avoir
les oreilles et les yeux rivés sur le bien commun / pesez de tout
votre poids afin de devenir la protectrice des purs »
* 59 GOODARE J. (dir.),
op. cit, p. 114.
* 60 MACDONALD A.A., op.
cit, p. 47
* 61 « Les peuples
écossais et français sont maintenant unis / Comme s'ils
étaient natifs d'un seul et même pays, / Sans aucune
manière ni appréhension, / Semblables l'un l'autre, ils
conservent la vraie fraternité. / Ils se défendent mutuellement,
sur terre ou en mer, / Et, donnent à quiconque a de mauvaises
intentions, / Ecossais ou français, quelque homme qu'il soit, / Avec la
plus grande rigueur, une sévère punition. »
GRAIGIE W.A. (ed.), The Matiland Quarto Manuscript,
STS, Edinburgh, 1920, pp. 19-23.
* 62 WORMALD J., op.
cit, p. 102-128.
* 63 MASON R.A.,
« George Buchanan and Mary Queen of Scots » in
Scottish Church History Society, n° 30, 2000.
* 64 Le Book of
Discipline est basé sur le travail de John Knox et vise à
expliciter le fonctionnement de l'ordre ecclésiastique de l'Eglise
d'Ecosse. Il s'appuie sur le modèle de Genève. Cependant le
travail qui est présenté en janvier 1561 devant le parlement
n'est pas assez clair et comprend des clauses difficilement applicables. Le
travail initié par John Knox était impressionnant et très
ambitieux. Il présentait une société éduquée
grâce à une réforme des paroisses et centrée sur une
nouvelle vision de la piété. Mais la commission devant laquelle
fut présentée ce programme rejeta la proposition qui consistait
à transférer les revenus de l'ancienne religion (revenus des
terres de l'Eglise) dans les caisses des la religion Réformée.
Voir LYNCH M., Scotland, A New History, Londres, 2009, pp. 198-202. Un
deuxième livre, The Second Book of Discipline, est
présenté en 1578.
* 65 GATHENER W., The
Tyrannous reign of Reign of Mary Stewart by George Buchanan, Edimbourg,
1958, p.16. Le document en question est une lettre qui servit plus tard de
préface à l'un des textes de Buchanan, Franciscanus.
* 66 MCFARLANE I.D.,
Buchanan , Londres, 1981, p. 208.
* 67 BUCHANAN G., The
Political Poetry, édité par Paul J. McGinnis et Arthur H.
Williamson, Edimbourg, 1995, p. 76-83.
* 68 « Dans la
journée l'horreur de la guerre résonne dans ses oreilles / Et la
nuit le souvenir coupable de ses crimes dévastateurs viennent la
troubler. / Des ombres noires perturbent son sommeil mouvementé par de
terribles cauchemars. »
BUCHANAN G., « Ad invictissum Franciae Regem
Henricum II post victos Caletes », op. cit, v. 103-104, p.
82.
* 69 « Le courage
de François, habitué à trouver des chemins escarpés
au travers d'insolubles difficultés, / Invaincu et indomptable, /
Surpassa sa réputation en gagnant une renommée
nouvelle. »
BUCHANAN G., « Ad invictissum Franciae Regem
Henricum II post victos Caletes », op. cit, v. 83-85, p.
82.
* 70 PHILLIPS J.E., op.
cit, p.10
* 71 « Un peuple
si souvent attaqué par les ennemies alentours (et pourtant) /
demeuré indépendant du joug étranger » ;
« Ici se tient un peuple en pleine possession de son antique
liberté ».
* 72 PHILLIPS J.E., op.
cit, p.12
* 73
« Vous-même avez découvert et approuvé sa
beauté, / Et vous avez constaté la bonté de son
caractère. » ; « D'une vertu surpassant sa
condition »
* 74 « Toutefois
reconnaissez votre condition de femme, et habituez-vous à
l'autorité de votre mari » ; « Apprenez
à être soumise à la volonté de votre
mari ».
* 75 « Sa
lignée, celle des Stuart, est une lignée royale qui règne
depuis plus de deux siècles comme le prouvent les documents et les
registres »
* 76 « La France
des temps de paix a spirituellement outrepassé les barrières de
la modération » ; « Dès lors de
nouvelles larmes ressurgissent : on rapporte une mort après
l'autre, une succession de désastres ».
BUCHANAN G., « Deploratio status rei Gallicae, sub
mortem Francisci Secundi Regis », op. cit, pp. 144-146.
* 77 « Ô
chère dame, vous détenez maintenant le sceptre écossais, /
Qui vous a été transmis par d'innombrables ancêtres royaux.
/ Vous surpassez votre condition par vos mérites, votre âge par
vos vertus, / Votre sexe par les capacités de votre esprit, et votre
noblesse par votre caractère. »
BUCHANAN G., « Mary, the most illustrious Queen of
Scotland », op. cit, p. 274.
* 78 « De crainte
que je ne semble déplu par ce qui vous plait. / Car ce que ces vers ne
peuvent espérer de l'esprit de leur auteur, / Peut-être
l'obtiendront-ils de votre esprit bienveillant. »
* 79 BRAIN J. (ed.),
Callendar of State Papers relating to Scotland and Mary Queen of Scots
(CSP Scot), Edimbourg, 1898-1969, I, 598.
* 80 MASON R.A.,
op.cit, p. 13. Pour comparaison, William Dunbar poète à
la cour de Jacques III touche une pension de 10£ pour l'an en 1500. Voir
MACQUEEN J., « The literature of fifteenth-century
Scotland » in Jenny Wormald, Scotland : a history,
Oxford University Press. 2005.
* 81 MCFARLANE I.D.,
Buchanan, p. 213-215
* 82 MCFARLANE I.D, op.
cit, p. 249.
* 83
« Elle-même surpasse à un tel point la Nature et l'Art /
Que l'une nous semble grossière et l'autre malhabile ».
* 84 « Si mon
oncle ne m'avait pas été si nuisible, ni si déshonorant,
moi, Marie, j'aurais pu être la reine la plus importante de cette
époque »
BUCHANAN G., op. cit, p. 122.
* 85 Calendar of State
Paper Relating to Scotland I, 1547-1563, 603 : « This Queen
puposes to send the Queen's Majesty, either by him or by whomsoever bringe the
picture, a fayre ringe with a diemonde made lyke a hart ».
* 86 « Ils
introduisirent les mascarades, qui d'année en année se
perpétuèrent. »
LAING D., The Works of John Knox (Woodrow Society,
1848), ii, 314 in CARPENTER S., « Performing Diplomacies : The
1560s Court Entertainments of Mary Queen of Scots », inThe
Scottish Historical Review, volume 82, numéro 214, octobre 2003,
pp. 194-225.
* 87 KNOX J.,
Works, ii, 333, 362 in LAING D., The Works of John Knox
(Woodrow Societyn 1848).
* 88 Voir KNOX J., The
First Blast of the Trumpet ?Against the Monstrous Regimen of Women?
(1558), Edimbourg, 1995. Il est vrai que l'argument principal de ce pamphlet
repose sur le fait que le règne des femmes est contraire à
l'ordre naturel et par ordre naturel Knox entend la volonté de Dieu.
Knox fait référence aux autorités classiques dans son
texte mais il s'agit plus d'un moyen de contrer ses détracteurs en
prouvant que dès l'époque classique l'on s'opposait à la
gynécocratie. Toutefois, il apparaît évident à
l'alinéa 15 que Knox se rapproche d'Aristote et de Platon lorsqu'il
affirme que les femmes sont faibles et qu'elles manquent d'esprit. Il site par
ailleurs La Politique d'Aristote à l'alinéa 16. De plus
John Knox reprend l'argument d'Aristote selon lequel les femmes sont
inférieures aux hommes par nature, par conséquent le gouvernement
d'une femme sur une assemblée masculine est contraire à la
nature. En effet cette situation perturbe l'ordre naturel.
* 89 BROWN R. et BENTICK C.
(ed.), Calendar of State Papers : Venice, Londres, 1890, in
CARPENTER S., « Performing Diplomacies : The 1560s Court
Entertainments of Mary Queen of Scots », in The Scottish
Historical Review, volume 82, numéro 214, octobre 2003, pp.
194-225.
* 90 « Quoique la
fin de l'univers confonde le ciel et la terre, la reine d'Ecosse portera
toujours dans son coeur la reine d'Angleterre, la reine d'Angleterre portera
toujours dans son coeur la reine d'Ecosse. » KEITH, History,
ii, 220 in CARPENTER S., op. cit, p. 213.
* 91 Malheureusement il ne
nous a pas été possible de lire ce poème. Nous nous en
remettons donc au récit de Thomas Randolph répertoriés
dans le Calendar of State Papers of Scotland, ii, 637.
* 92 WORMALD J., op.
cit, p. 147.
* 93 KNOX J.,
Works, ii, 495 in CARPENTER S., op. cit, p. 215
* 94 BUCHANAN G.,
« Pompa Deorum in Nuptiis Mariae', `Pompae Equestres', in
Opera, ii, 400-403, in MCFARLANE I.D., op. cit, p. 233-4.
* 95 RICHARDS J.,
« To Promote a Woman to Beare Rule : Talking of Queens in
Mid-Tudor England » in The Sixteenth Century Journal, vol.
28, n° 1, printemps 1997, p. 121.
* 96 DUNNINGAM S.M.,
« The Creation and Self-Creation of Mary Queen of Scots :
Literature, Politics and Female Controversies in Sixteenth-Century Scottish
Poetry », Scotlands 5, 1998, p. 66
* 97 Calendar of State
Papers of Scotland, i, p. 651 in CARPENTER S., op. cit, p.
218.
* 98 « Pour savoir
ce que cela pouvait être de coucher à la belle étoile, ou
de marcher sur la chaussée vêtu d'un pourpoint en cotte de maille
et d'un casque».
* 99 CRAIG T., Henrici
Illustrissimi Ducis Albaniae, Comitis Rossiae, etc. e Marriae Serenissimae
Scotorum Reginae Epithalamium, Edinburgh, 1565, traduit dans Wrangham,
Epithalamia Tria Marianan, p. 47 in PHILLIPS J.E., op. cit, p.
29.
* 100 DONALDSON G., All
the Queen's Men : Power and Politics in Mary Stewart's Scotland,
Londres, 1983, pp.76-77.
* 101 LYNCH M., Scotland,
A New History, Londres, 1991, réédité en 2009, pp.
114-120.
* 102 DUCHEIN M., op.
cit, p. 215.
* 103 LYNCH M.,
« Queen Mary's Triumph : the Baptismal Celebrations at Stirling
in December 1566 », in The Scottish Historical Review,
volume 69, numéro 187, avril 1990, p. 2.
* 104 STRONG R.,
Splendour at Court, Londres, 1973, pp. 33-37 et 67-68.
* 105 MELVILLE J.,
Mémoires de Melville, Edimbourg, 1745, in DUCHEIN M., op.
cit. , p. 247.
* 106 IRISH C. A.,
« A Glorious Title » : Elizabeth I's manipulation
of her pubic image, 1588-1603, Université du Minnesota,
thèse, 1978, in LYNCH M., op. cit, p. 12.
* 107 MELVILLE J., op.
cit, I, p. 213.
* 108 « La
destinée garantira l'expansion des terres de votre royaume, jusqu'aux
terres des Bretons, qui lassés par la guerre, apprendront enfin à
s'unir en un seul royaume. »
ADAMSON P., Serenissimi ac Nobilissimi Scotiae Angliae
Hybernie Henrici Stuardi et Mariae Reginae, Paris, 1566, in LYNCH M.,
op. cit, p. 13. Traduction de Michael Lynch.
* 109 « Vous
aussi, père et mère, comblé de bonheur par la
paternité, / Habituez le tendre enfant dès son plus jeune
âge / A l'idée de justice, et laissez-le s'imprégner de
l'amour sacré pour la vertu / Nourrit du lait maternel ; laissez-la
piété devenir la gardienne de son berceau, / Et l'influence
formatrice de cette piété grandir dans son esprit au même
rythme que son corps. »
BUCHANAN G., « Genethliacon Jacobi Sexti Regis
Scotorum » in Political Poetry, p. 154.
* 110 « Il
apprendra l'art vrai de gouverner un royaume en paix et en guerre. / S'il
évalue consciencieusement tous ces événement selon ces
critères, / Il règnera avec succès sur son
royaume. »
BUCHANAN G., « Genethliacon Jacobi Sexti Regis
Scotorum » in Political Poetry, p. 162.
* 111 WORMALD J.,
op.cit, p.16.
* 112 BRANTÔME,
OEuvres Complètes (Paris, 1873) tome VII, p. 449-453 in DUCHEIN
M., op. cit, p. 140. Voir aussi WORMALD J., op. cit, p.
145.
* 113 « Le
récit est si irrévérencieux que je ne vois pas de quelle
manière je pourrai le retranscrire en termes appropriés à
son altesse ».
* 114 WARNICKE R.M.,
« Sexual Heresy at the Court of Henry VIII » in The
Historical Journal, volume 30, n° 2, 1987, p. 247-268. Retha M.
Warnicke détaille la manière dont le roi et Cromwell avaient
construit à Anne Boleyn une réputation de sorcière,
expliquant que la nature de son crime tenait en ce qu'elle avait un
appétit sexuel immodéré. Elle ensorcelait les hommes et
avait même eut des relations sexuelles avec son frère. Ainsi le 29
janvier 1536, lorsqu'Anne fait une fausse couche, Cromwell affirme qu'il s'agit
là d'une punition divine. Il poursuit en expliquant que l'enfant portait
les séquelles laissées par les péchés de chair
commis par sa mère.
* 115 « Je les ai
vus chassés, la reine ne suivrait pas / leur sage conseil qui
l'enjoignait d'attendre une conjoncture meilleure. / Sa volonté l'a
contrainte de pencher dans le mauvais sens / Aucun frein n'apaiserait sa
colère, ses extrêmes sont corrompus »
CRANSTOUN J. (ed.), Satirical Poems of the Time of the
Reformation, Edimbourg et Londres, Scottish Text Society,
1891-1893, I, 10 (anglais modernisé).
* 116 « wanton
slight of effeminate force », CRANSTOUN J. (ed.), op.cit.,
p. 25.
* 117 Calendar of State
Papers Foreign, 1566-1568, p. 205, no. 1091, avril, 1567, in PHILLIPS
J.E., op. cit, p. 38.
* 118 « un homme
d'une cinquantaine d'années ».
* 119 DUNNINGAM S.,
« The Creation and Self-Creation of Mary Queen of Scots :
Literature, Politics and Female Controversies in Sixteenth-Century Scottish
Poetry », Scotlands, 5, 1998, p. 68.
* 120 Mary Queen of
Scots, Ex Libris Bibliothecae Facultatis Juridica Edinburgi, 1812.
* 121 « D'armer
sa défense avec des preuves évidentes pour que sa Majesté
puisse consciemment satisfaire son besoin de justice ».
MAHON R.H., The Indictement of Mary Queen of scots,
Presse Universitaire de Cambridge, 1923, p. 8
* 122 MASON R.A.,
« George Buchanan and Mary Queen of Scots », in
Scottish Church History Society, n° 30, 2000, p. 14.
* 123Georgii Buchanani
Vita, p. xxvii, in AITKEN J.M., The trial of George Buchanan Before
the Lisbon Inquisition, including the text of Buchanan's Defences
along with a translation and commentary, Londres, 1939.
* 124 MASON R.H., op.
cit, p. 16
* 125 Ce système
conduit au développement d'une justice parallèle dans les
contrées les plus retirées du royaume d'Ecosse où
l'autorité du pouvoir centralisé est quasi nulle. Voir WORMALD
J., «
Bloodfeud,
Kindred and Government in Early Modern Scotland », in
Past
& Present, no. 87, mai 1980, pp. 54-97.
* 126
« {Où} logeait un certain David Chambers, valet de Bothwell,
dont la porte dérobée donnait sur le jardin de la reine. Le reste
qui ne saurait le deviner ? »
BUCHANAN G., Ane Detectiovn of the duinges of Marie Quene
of Scottes, touchand the murder of hir husband, and hir conspiracie, adulterie,
and pretensed mariage with the Erle Bothwell. And ane defence of the trew
Lordis, mainteineris of the Kingis graces actioun and authoritie. Translatiti
out of the Latine quhilke was written by G.B, Londres, 1571.
* 127 « ma dame
Rerese, une femme de la plus grande lascivité, qui fut autrefois l'une
des catins de Bothwell, et qui devint plus tard l'une des dames de chambre de
la reine (...) {la conduisit dans la chambre de la reine} où il la
força à se donner à lui. »
* 128 « Mais dame
Rerese avait-elle réellement agi contre la volonté de la
reine ? Il est tems de dévoiler la vérité. Car
quelques jours après, la reine, tentant comme je le suppose de combattre
le mal par le mal et de ravir à son tour son agresseur, envoya dame
Rerese chercher Bothwell pour le faire prisonnier de sa
majesté. »
* 129 STAINES J.D., The
Tragic Histories of Mary Queen of Scots, 1560-1590, New-York, 2009, p.
41.
* 130 MACCAFFEY, The
Shaping of the Elizabethan Regime, Princeton University Press, 1968, pp.
293-488.
* 131 MCFARLANE I.D.,
op. cit, p. 359-350.
* 132 « Car
Bothwell avait une femme, et il aurait fallu attendre un long moment avant que
le divorce ne soit prononcé, pendant ce temps la reine n'aurait pas pu
l'avoir pour elle toute seule, ni même profiter de lui en secret, et en
aucun cas elle n'aurait pu vivre sans lui. », BUCHANAN G.,
A Detection of Mary Queen of Scots in The Tyranous Reign of Mary
Stewart.
* 133 « Il semble
que le fait que Bothwell ait contraint la reine par la force et par là
même sauvé sa réputation soit une extraordinaire
invention. »
* 134 STAINES J.D., op.
cit, p. 38.
* 135 « Mais cela
prouve bien le mépris qu'elle éprouvait à son
égard : ce qui suit montre clairement son caractère
inhumain, cruel et sa haine implacable. »
* 136 Les sources
écrites de l'Antiquité et plus particulièrement les textes
de Platon et Aristote transmettent l'idée selon laquelle le désir
sexuel et la passion détourne l'homme de la raison et de la recherche du
savoir. C'est pourquoi ils privilégient un amour platonique.
* 137 On retrouve ces
idées dans la Genèse I et II.
* 138 JORDAN C.,
« Women's rule in sixteenth-century British political
thought » in Renaissance Quarterly, vol. 40, n° 3,
automne 1987, pp. 421-451.
* 139 WIESNER M.,
Christianity and sexuality in the early modern world : regulating desire,
reforming practice, London, 2000, pp. 78.
* 140 « si le
fait qu'elle reflète un caractère divin peut constituer la preuve
qu'elle {la femme} possède toutes les qualités spirituelles que
l'on attribue au genre masculin, on ne peut exclure la femme de la vie
politique en se basant sur la doctrine {sous prétexte qu'il est
écrit dans la Bible que la femme est la subordonnée de
l'homme} »
LESLIE J., A Defence of the honour of Marie Quene of
Scotlande, 1569, édité par D.M Rogers, Scholar Press, 1970,
folios 129 à 149.
* 141
« Frater est un nom masculin (c'est ce que vous affirmez)
donc les femmes doivent être exclues de la vie politique. Donc, si l'on
suit ce raisonnement, les femmes n'ont pas le droit au salut, car il est dit
dans les Saintes Ecritures que : Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé (...) Et selon ce raisonnement les femmes sont
exclues des huit béatitudes (...) Celui qui déteste son
frère est dans les Ténèbres (...) Devons-nous en
déduire qu'il est possible d'haïr nos soeurs ? De ce fait le
mot frère n'exclut pas les soeurs, et le mot roi dans les Ecritures
n'exclut pas le mot reine. »
* 142 « J'affirme
donc que c'est une tendance fausse et contraire à la nature que de faire
de cette supposition une loi éternelle. La loi naturelle ou ius
gentium est et a toujours été postérieure à la
création des peuples et des nations ».
* 143 On pense au
personnage de Marie Madeleine. Cette image de prostituée qui se repentit
après avoir rencontré le Christ ne pouvait être
associée à une reine. En effet, une reine catholique se devait
d'être un modèle de chasteté, en accord avec le
modèle que l'Eglise tentait d'inculquer aux femmes à
l'époque moderne. Il est intéressant de noter que le
prénom de la reine d'Ecosse renvoie directement à celui de la
vierge, mais peut-être interprété, selon les attaques
protestantes, comme une référence à Marie Madeleine. En un
sens son nom renferme aussi bien le modèle de la femme chaste que celui
de la femme passionnée. M. Wiesner offre une étude très
détaillée des conventions admises par l'Eglise au
16ème siècle en ce qui concerne le domaine de la
sexualité dans WIESNER M., Christianity and sexuality in the early
modern world : regulating desire, reforming practice, Londres, 2000, pp.
58-100.
* 144 PERRONET M., Le
XVIème siècle (1492-1620), Hachette Supérieur, Paris,
2005, p. 114.
* 145 Estimation
basée sur les recherches de Michel Perronnet.
* 146 Salutem in
Christo, Londres, 1571, in POLLARD et REDGRAVE, A Short Title
Catalogue of Books Printed in England and of English Books Printed Abroad,
1475-1640, Londres, 1926, p. 11504 in PHILLIPS J.E., op. cit, p. 61.
* 147 DE GUTTERY G.,
L'Histoire et Vie de Marie Stuart, Paris, 1589, sig avii :
« Buccanan (...) par deux fois a este Imprimé en
Allemagne ». James Emerson Phillips rapporte également
qu'à la Bibliothèque Morgan on trouve un manuscrit contemporain
de la version latine du texte de Buchanan à l'intérieur d'un
document original allemand (De Ricci, Census, II, 1504 no. MA 42) qui
date le manuscrit de 1567.
* 148 LABANOFF,
Lettres, instructions... de Marie Stuart, IV, 9, lettre du 10
décembre 1571, in PHILLIPS J.E., op. cit, p. 63.
* 149 « Quelques
exemplaires des textes latins écrits par Buchanan devraient être
présentés au roi de France ainsi qu'aux nobles de son Conseil,
car ils participeront à la disgrâce de la reine
d'Ecosse. »
Calendar of State Papers Foreign,
1569-1571, p. 570, no. 2159.
* 150 Calendar of State
Papers Foreign, 1572-1574, p. 14, no. 27
* 151 « Ah, la
pauvre idiote ne cessera donc ces activités que lorsqu'elle aura la
tête coupée ! En vrai, je vous le dis, ils la feront
exécutée. Je constate qu'elle est responsable de sa propre action
et de sa propre folie. Je n'y vois aucun remède. Je voulais aider, mais
si elle ne le désire pas, je ne puis mais. »
Sir Thomas Smith à Cecil, le 22 mars 1572 in PHILLIPS
J.E., op. cit, p. 86.
* 152 STAINES J.D., op.
cit, p. 75.
* 153 LANGER U.,
« The Renaissance Novella as Justice », Renaissance
Quarterly numéro 42, 1999, pp. 311-341.
* 154 WILKINSON A.S.,
Mary Queen of Scots and French Public Opinion, 1542-1600, Londres,
2004, p. 94.
* 155 BARNAUD, Le
Réveile-Matin, A5r-A6v, in WILKINSON A.S., op. cit, p.
95.
* 156 L'historien Andrew
Pettegree dans ses recherches suppose que l'histoire contée par Barnaud
a pu être à l'origine du thème de l'une des sculptures que
l'on retrouve à Dénézé-sous-Doué. La
sculpture représente le Cardinal de Lorraine, Catherine de
Médicis, Mary Stuart et François II. Marie est
représentée enfant, ce qui tend à accentuer la
dépendance envers ses oncles. François II semble
déjà couvert du linceul. La sculpture accentue l'influence des
Guises et de Catherine de Médicis. Leurs personnages toisent le couple
royal, alors que le pouvoir est censé être aux mais de ce jeune
couple. Voir A.4 en annexe.
* 157 BARNAUD, op. cit,
A8r, in WILKINSON A.S, op. cit, p. 97.
* 158 Certaines
publications catholiques ont presque un dessein eschatologique. Les Quinze
signes advenuz és parties d'occident, vers les royaumes d'Escosse &
d'Angleterre publié en 1587 fait références aux
quinze effusions de sang du Christ.
* 159 RONSARD,
Elégies, livre III, OEuvres Complètes, Paris, 1949, v.
152-9. L'emploi du mot « image » élève Marie
Stuart au rang d'icône. Sans la vouloir Ronsard présage du destin
tragique de la reine, qui n'est plus qu'une « image »
après 1587. En utilisant le mot « image » qui nous
renvoie au mot icône Ronsard met en relief la religion catholique et
oppose la reine aux Calvinistes iconoclastes, qui reprochent aux papistes leur
idolâtrie.
* 160 GUY J., The True
Life of Mary Queen of Scots, New-York, 2004, p. 121.
* 161 Ambassadeur anglais
envoyé auprès de la reine d'Ecosse pour régler les
problèmes divers qui représentaient une entrave à
l'amitié des deux « soeurs ».
* 162 Calendar of State
Papers, Foreign, 1566-1568, no. 508 in DUCHEIN M., op. cit, p.
217.
* 163 GUY J., op.
cit, p. 447.
* 164 LOCKIE D.,
« The Political Career of the Bishop of Ross, 1568-80 », in
University of Birmingham Historical Journal, vol. 4, 1953-4, p.102.
* 165 SOUTHERN S.C,
Elizabethan Recusant Prose 1559-82, 1950, p. 310-2 in LOCKIE D.,
op. cit, p. 104
* 166 Selon la
déclaration de Leslie : « The Book of the Defence of
the Queene's Honour, Thomas Busshop (Bishop) made, by the information of the
Lord Harris (Sir John Maxwell, Baron Herries, on of Mary's commissioners in
England), before this Examinate's comyng into England ; and that Booke was
reformid and encreased by Thomas Busshop, this Examinate, the Lord Harris, and
others at the Conference at Westmynster » in
« Interrogatories of the Bishop of Ross, October 26 nd 27,
1571 », MURDIN W., Collection of State Papers... left by William
Cecil, Londres, 1740-1759, in PHILLIPS J.E., op. cit, p. 263.
* 167
« Deuxièmement, ils prétendent avoir en leur possession
certaines lettres qui ont été écrite par sa
majesté, grâce auxquelles ils espèrent interférer
dans les présomptions d'innocence, comme se l'imaginent leurs esprits
malingres »
* 168 « Jamais ils
n'ont été capables de prouver quoi que ce soit de manière
directe et légale, ainsi ils peuvent ternir la réputation de la
reine, en insistant sur n'importe lequel des points cités
précédemment ».
ROGERS D.M. (ed.), A Defence of the honour of Marie Quene of
Scotland, 1569, Scholar Press, 1970, f.4.
* 169 MAHON R.H., The
Indictment of Mary Queen of Scots, p. 10
* 170 « Quelques
princes de notre royaume, parmi lesquels Henri VI, ont dans leurs grands
malheurs trouvé réconfort, amitié, secours et soutien
auprès des rois d'Ecosse. »
* 171 « Les gens
de ce sexe abhorre naturellement ces pratiques grossières :
assurément il est rare d'entendre que de telles pratiques sont l'apanage
des femmes. »
* 172 LESLIE J., A
Defence of the honour of Marie Quene of Scotlande, 1569, f. 7 et 8.
* 173 LESLIE J., op.
cit, f. 14.
* 174
« Néanmoins une fois que vous avez tiré le meilleur
avantage de ces lettres, de telles missives, qui ne contiennent aucune preuve
d'actes illégaux ou d'actions ayant été
perpétrées auparavant, ne faisant mention d'aucun des
évènements passé, mais que l'on présume avoir
été écrites à dessein et dans des circonstances
particulières, l'on s'aperçoit que ces lettres ne peuvent
représenter aucune preuve légale pour qui est assez sage. Elles
représentent moins des preuves substantielles contre votre Souveraine et
Prince que des preuves incriminant une pauvre femme ou simplement une pauvre
créature venue d'Ecosse. »
Leslie, op. cit, f. 11
* 175 « J'ai lu
dans les textes que le roi David était à la fois un homme
infidèle et un meurtrier. J'ai aussi constaté que Dieu avait
été contrarié par cette attitude. Mais je n'ai rien
trouvé mentionnant qu'il avait été déposé
par ses sujets. »
* 176 « Votre
prétendue maxime énonce que, quiconque est né en dehors
des frontières du royaume d'Angleterre ne peut hériter du
trône anglais, laquelle maxime n'est que mensonge. Car n'importe quel
étranger est en droit de réclamer l'héritage de terres
situées dans votre royaume, comme il est écrit dans 7 et 9 du Roi
Edouard IV. Depuis ce moment-là, comme le roi précité l'a
décidé, l'héritage reste à la portée de
l'étranger qui est capable de prouver sa légitimité dans
l'ordre de la succession anglaise. »
* 177 « Dans les
histoires et monuments africains, nous avons lu l'exemple de la reine Didon, de
Cléopâtre d'Egypte et de diverses autres reines
africaines. » ; « Donc j'ai prouvé de
manière assez persuasive, comme je le suppose, que ce type de pouvoir
n'est pas contre-nature en apportant des exemples antiques, et en montrant la
continuelle validité de ce type de pouvoir en Asie, en Afrique et en
Europe, dans ces trois continents. »
* 178 « La loi et
l'usage ne peuvent opposer à la loi naturelle, ou ius gentium,
ce que la plupart des pays, et ce que la plus grande partie du globe
considère comme légitime. Comme cette loi et cet usage ont cours,
Ergo, ils ne sont pas contraires à la loi
naturelle. »
* 179 LOCKIE D., op.
cit, p. 124.
* 180 Le texte est d'abord
présenté à la conférence de Westminster en Novembre
1568 sous le titre De Maria Scotorum Regina, totaque eius contra Regem
coniuratione, foedo cum Bothuelio adulterio, nefaria in maritum crudelitate
& rabie, horrendo insuper & deterrimo eiusdem parricidio : plena
& tragica planè Historia. On note que Buchanan est le premier
à qualifier l'histoire de la reine comme histoire tragique. Le terme
fait référence à la chute des grands personnages par
laquelle « l'attitude malveillante et scandaleuse des Princes est
réprimandée ». PUTTENHAM G., The Arte of English
Poesie, édité par Edward Arber, Londres, 1906, I.XV.48 in
STAINES J.D., op. cit, p. 36.
* 181 L'initiative est
aussi connue sous le nom de complot de Throckmorton. Dans A discouerie of
the treasons... by Francis Throckmorton (1584), auquel James Emerson
Phillips fait référence, il est fait mention des papiers que
Throckmorton avait sur lui lors de l'arrestation : « twelue
petidegrees of the discent of the Crowne of England, printed and published by
the Bishop of Rosse, in defence of the pretended title of the Scottishe Queene
his Mistresse, with certaine infamous libelles against her Maiestie printed and
published beyond the seas... ». Les travaux de John Leslie que
transportait Throckmorton étaient sûrement des copies de la
dernière édition de Defence of the honour etc.
* 182 MASON R.A,
« George Buchanan and Mary Queen of Scots », in
Scottish Church History Society, n. 30, 2000, p. 18.
* 183 « De George
Buchanan au roi d'Ecosse Jacques, sixième du nom, souhaite santé
et bonheur. »
BUCHANAN G., De Jure Regni apud Scotos, Dialogus,
(First Edition (?), 1571). Le texte est en latin, notre étude se base
donc sur une traduction en anglais du professeur Dana F. Sutton, De Iure
Regni apud Scotos, Université de Californie, 2007.
* 184 « Ainsi,
lorsque vous vous adressez à ce genre de personnes, très
tonitruantes et excessivement gênantes, demandez-leur ce qu'elles pensent
du châtiment réservé à Caligula, Néron ou
Donatien, je pense que pas une seule, si attachée soit-elle à la
fonction royale, n'osera vous dire qu'il ne s'agissait pas d'une juste
punition. »
* 185 MASON R.A., op.
cit, p. 20.
* 186
« Pensez-vous qu'il ait existé une époque durant
laquelle les hommes vivaient sous de simples abris ou même dans des
grottes, ayant élus domicile ici pour un temps et vivant sans loi,
errant en bande comme des vagabonds, se réunissant lorsqu'ils en avaient
envie ou bien pensez-vous que quelque avantage ou quelque intérêt
commun les ont poussé à se réunir ? »
* 187 BUCHANAN G., De
Iure..., pp. 6-7
* 188 SALMON J.H. M,
Renaissance and Revolt, Essays in the intellectual and social history of
early modern France, « An alternative theory of popular
resistance : Buchanan, Rosseau, and Locke. », Londres, 1987, p.
141.
* 189 « Vous
rappelez-vous de ce que nous avons dit en amont, qu'une congrégation
ressemble à un corps humain, que les troubles sociaux sont comme des
maladies et qu'un roi est semblable à un médecin ? Si nous
comprenons bien quelle est la tâche du médecin, je pense qu'il
faut être clair en ce qui concerne les devoirs du roi, (...) il incombe
aux deux une double responsabilité. La première est de maintenir
le corps en bonne santé, l'autre est de le guérir lorsqu'il est
affaibli par la maladie. »
* 190
« « Car l'autorité constituée pour assurer le
service public tourne à la domination
égoïste. »
* 191 BUCHANAN G., De
Iure, p. 10-11.
* 192 SALMON J. H M.,
op. cit, p. 142.
* 193 BUCHANAN G., De
Iure, p. 49.
* 194 « Avertir
Buchanan du danger encouru par la publication sans notre consentement de son
livre, lequel aborde des problèmes qui touchent au fonctionnement de
notre nation. »
STAINES J.D, op. cit, p. 49.
* 195 L'ordre de Saint Michel
est l'ordre le plus important dans la chevalerie française.
* 196 Après
l'exécution de Marie Stuart la représentation littéraire
peut aussi s'accompagner d'une représentation picturale de la reine en
martyre. Voir A.5 en annexe.
* 197 Voir DERMENJIAN G.,
GUILHAUMOU J. et LAPIED M. (dir.), Le Panthéon des femmes, figures
et représentations des héroïnes, édition
Publisud, 2004, pp. 29-30.
* 198 DERMENJIAN G.,
GUILHAUMOU J. et LAPIED M. (dir.), op. cit, pp. 36 et 39. Voir aussi
l'article de Nicole Cadène, « L'histoire au
féminin : la vie de Marie Stuart par Agnès
Strickland », Romantisme, n° 115, 2002, p. 41-52.
Nicole Cadène décrit comment les historiens français
pardonnaient ses fautes à Marie Stuart, comme s'ils avaient
eux-mêmes étaient charmés par ses atours. Cependant
Agnès Strickland, historienne britannique et tory offre une toute autre
vision de Marie Stuart. Son étude exhaustive des sources et sa
détermination à prouver que Marie Stuart n'était pas
qu'une femme amoureuse la conduisent à montrer que l'exercice du pouvoir
féminin est possible et que Marie Stuart était une reine qui
savait régner. En témoigne son choix de ne pas accorder la
couronne matrimoniale à Darnley pour, selon Strickland, rester
maîtresse de son royaume. Cette vision nuance l'image de femme martyre
ainsi que celle de femme immorale et adultère.
|
|



