INTRODUCTION GENERALE
La communication peut être considérée
comme la pierre angulaire du management des ressources humaines. Toutefois, le
management des hommes est un processus très délicat. Il met en
jeu non seulement la carrière des agents, mais aussi la vie de
l'entreprise. Sous nos cieux, beaucoup de travailleurs consacrent la majeure
partie de leur vie à l'organisation qui les emploie. (20 à 30 ans
de carrière).
Dans ces conditions, lorsque le management ne joue pas le
rôle qui lui est dévolu (direction, participation,
cohésion, motivation, communication...), il met en danger la vie de
l'organisation.
Par conséquent, il faut que le management soit
guidé par un souci d'objectivité, d'équité et de
transparence. C'est tout le sens de la pensée de Bruno
Henriet : « Le temps de management axé sur
la production n'est plus efficace. Les décisions issues d'un processus
de modélisation et de rationalité ne répondent pas
toujours aux exigences de l'environnement et surtout elles ne trouvent pas ce
qu'elles nécessitent d'implication de la part des exécutants. Ce
faisant dans toute approche managériale il faut intégrer une
autre dimension qui paraît d'une ultime importance, c'est la dimension
humaine »1(*).
Nonobstant ce fait, d'éminents spécialistes des
questions communicationnelles et managériales, dont le Dr Firmin
Gouba s'accordent à dire que la communication d'organisation
n'est pas encore véritablement encrée dans les moeurs de nombre
de dirigeants d'entreprises au Burkina Faso. Leurs structures rencontrent par
voix de fait de réels problèmes liés à la baisse
des rendements, au manque de prévisibilité, au gaspillage des
ressources, à l'incapacité à mobiliser les ressources
humaines... Conséquences : ces organisations sont
caractérisées par la mauvaise connaissance du rôle de
chacun, le poids de la hiérarchie, la rétention de l'information,
la centralisation excessive, l'indifférence, bref, tous ces maux qui
mettent en danger la vie de l'entreprise.
La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
ne fait pas exception à la règle. Les maux dont souffre son
système communicationnel et managérial constituent un frein
à l'atteinte de ses objectifs qui sont de fournir des prestations aux
assurés sociaux sur la base des cotisations recouvrées
auprès des employeurs.
En effet, il faut admettre avec Philippe Détrie
et Catherine Meslin-Broyez que :
« l'efficacité ne se nourrit pas exclusivement de
cohérence, mais aussi de cohésion »2(*) .
Toutefois, encore faudrait-il que cette conception soit
partagée par tous pour susciter auprès de chacun une
volonté permanente de progrès et de coopération. Ce
challenge est véritablement celui de la communication interne. Il ne
s'agit pas de prétendre réconcilier entreprise et
salariés, mais plus modestement de contribuer à ce que
l'entreprise devienne un lieu où il fait bon travailler.
C'est-à-dire une organisation à la fois efficace et
intégratrice qui développe l'appropriation des objectifs, la
cohésion et le travail en commun. Dans un tel contexte, les pratiques
managériales doivent fortement évoluer.
Le problème de la mise en cohérence de cet
ensemble va bien au-delà d'un simple changement organisationnel. Il
passe nécessairement par la définition d'un projet d'entreprise
pour le moyen terme, par l'appropriation de ce projet par l'ensemble des
acteurs autour d'enjeux préalablement discutés et enfin par la
définition pertinente du rôle de chacun dans une vision de moins
en moins hiérarchique et de plus en plus multicellulaire ou
participative. Cela induit de nouvelles relations humaines dans l'entreprise
et une nouvelle valeur dans une structure en réseau, construite non
plus sur la hiérarchisation, mais plutôt sur l'échange.
D'où toute l'importance de la communication interne et du management.
Vecteur d'explication, d'éclairage, de
visibilité des options prises par l'entreprise, la communication devient
par exemple un élément fondamental de régulation des
relations de l'organisation avec ses publics internes et externes. Une telle
spécificité fait dire à Bernard
Miège que: « La communication est devenue
en peu d'années sinon une priorité; du moins une
préoccupation première des dirigeants. Elle prend place
désormais au rang des orientations
stratégiques »3(*)
De façon plus singulière, la communication
interne a comme objectif fondamental d'améliorer la cohésion
des travailleurs et donc leur motivation. Cela grâce à un
renforcement de la culture d'entreprise et du sentiment d'appartenance,
à une amélioration de la circulation de l'information interne
afin de décloisonner les différents services, et grâce,
enfin, à l'explication d'une crise sociale ponctuelle ou d'une mutation
importante de l'entreprise. Toutes choses qui ne sont pas toujours prises en
compte à la CNSS.
Pourtant, pour Philippe Détrie et
Catherine Meslin-Broyez : « La communication
interne a pour rôle de donner du sens pour favoriser l'appropriation,
donner de l'âme pour favoriser la cohésion et inciter chacun
à mieux communiquer pour favoriser le travail en
commun ».4(*)
La communication interne efficace repose alors, plus sur des
comportements que sur des supports et donc plus sur le management que sur des
techniques. « La communication est au coeur du
management »5(*). Les organisations en quête de performance
doivent alors savoir conjuguer les dissemblances, développer
l'innovation et surtout maîtriser la complexité des relations
humaines. Faute de cela, elles s'exposent à la sclérose.
Notre sujet : « La
problématique de la communication interne
dans le management des organisations : Une analyse critique des pratiques
de la CNSS» se veut donc d'actualité. Il fait en
effet appel à la gestion des ressources humaines, à la
motivation, à la gestion et à la résolution des conflits,
à la gestion prévisionnelle, à la productivité...
Pour mieux le cerner, notre réflexion s'articulera
autour d'une problématique portant sur l'importance de la communication.
En d'autres termes, nous traiterons du rôle de la communication interne
en tant que fonction à la fois verticale et horizontale dans le
processus de management de l'entreprise.
Nous avons choisi d'analyser les pratiques
communicationnelles et managériales de la Caisse pour mettre en exergue
l'importance du rôle qu'elles doivent jouer dans l'entreprise afin
d'assurer une gestion performante et efficiente des ressources humaines.
Pour ce faire, notre mémoire comporte deux grandes
parties :
La première partie est intitulée :
« Présentation de la CNSS, organisation et
fonctionnement de la communication».Elle dresse
l'état des lieux des outils et mode de communication en vigueur à
la Caisse.
La deuxième fait le point des :
« Conséquences du mode de communication sur le
management de la CNSS».
Après une exploitation méthodique des
données récoltées, nous abordons les défis
à relever par la CNSS en vue d'un nouvel élan
communicationnel et managérial.
Le corps du travail est basé sur les résultats
d'enquête par questionnaire et d'entretiens semi-dirigés.
Après analyse et interprétation, les conclusions qui s'imposent
sont tirées.
Dans la perspective d'atteindre nos objectifs d'étude,
la problématique, le cadre théorique et conceptuel, la revue de
littérature et l'approche méthodologique sont exposés.
Ils font l'objet d'un chapitre préliminaire,
introductif à l'ensemble du mémoire.
CHAPITRE PRELIMINAIRE
APPROCHE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE
![]()
I- PROBLEMATIQUE, OBJECTIFS ET ORIGINALITE DU
THEME
« Sur le plan du
fonctionnement, les administrations africaines se ressemblent comme des soeurs
jumelles. D'un bout à l'autre du continent, le laxisme, par exemple,
règne en maître absolu. Les agents publics ne se dévouent
plus pour exécuter les tâches à eux confiées.
Conséquences : les tâches à exécuter, les
dossiers à traiter s'accumulent et un précieux temps est perdu
dans la course au développement.»6(*)
Le constat est accablant. Certes. Mais il traduit tout de
même la réalité des organisations et autres institutions en
Afrique. L'absence de mesures énergiques pour endiguer ces maux les
enracine davantage. Pire, cette situation en favorise le développement
d'autres. C'est le cas par exemple de la démotivation et de
l'absentéisme. Ces problèmes d'opacité, de perte de
responsabilité et de déontologie défaillante
rencontrés par les organisations africaines relèvent de plusieurs
explications :
-de type organisationnel classique : mauvaise
organisation et inexistence de corps de contrôle
-de type affectif: absence de valorisation de
l'employé.
-de type culturel : peut-on s'attendre à des
règles d'action uniformes de salariés qui ne développent
pas un « esprit de famille » ?
Face à de tels phénomènes, des
réformes ont été çà et là
entreprises. Mais elles n'ont pas toujours donné les résultats
escomptés. Un pays comme le Burkina Faso par exemple a voulu innover en
se dotant, malgré la contestation des syndicats, d'une Réforme
globale de l'administration publique (RGAP). En plus des problèmes
évoqués plus haut, ce document reconnaît les lourdeurs
administratives, les détournements, le pilotage à vue du
développement...et appelle à une « autre
administration ».
« Mais jusque-là, les maux n'ont pas
disparu ».7(*) Les choses se compliquent d'avantage du fait du
contexte international marqué par la mondialisation des marchés,
la complexité accrue des systèmes de décisions...Les
organisations, tout comme les administrations, sont donc à la
croisée des chemins.
La Caisse nationale de sécurité sociale
(CNSS), à des degrés divers, est concernée par certains de
ces phénomènes. On y rencontre des agents démotivés
pour fait de blocage administratif. C'est surtout le cas de ceux qui sont dans
les filières dites « traditionnelles ». Il
s'agit des secrétaires, des informaticiens, des comptables, des
contrôleurs... Recrutés pour beaucoup sur la base du
baccalauréat, certains de ces employés affirment n'avoir pas
changé d'échelle ou de catégorie depuis plus de vingt (20)
ans. Ceci, bien qu'un plan de carrière ait été
consensuellement adopté dans les années 1990.
Dans cette même logique, le statut révisé
du personnel qui est en discussion depuis 2003 aux dires des
délégués du personnel, n'est pas encore appliqué en
2006.
D'autres employés se sentent sous-estimés et
frustrés car, ne possédant pas toujours l'information. Ils
doivent surtout se contenter d'exécuter des directives. Des situations
de ce genre détériorent considérablement le cadre de
travail et le climat relationnel.
Mais s'il y a dysfonctionnement dans les relations sociales
à la CNSS, c'est qu'un cadre propice de concertation d'idées et
de convergence d'actions fait défaut. En dépit des tentatives
d'amélioration de la situation, la communication y est toujours
linéaire. Elle se résume essentiellement à la transmission
de notes ou de consignes.
Or, une communication interne bien élaborée
participe à la création d'une identité forte de
l'entreprise. Un personnel bien informé est un personnel bien
armé pour véhiculer l'image de l'entreprise tant en interne qu'en
externe. Une communication interne efficace doit alors épouser les
valeurs informatives, intégratives et participatives.
Si l'on s'accorde aujourd'hui à dire que l'information,
c'est le pouvoir, c'est parce qu'on a constaté que l'individu
informé devient apte à agir. L'information dans l'entreprise doit
alors faire l'objet d'un contrôle et d'une gestion rigoureuse. Ceci est
valable aussi bien pour l `information descendante (de la Direction vers
les employés), ascendante (des employés vers la Direction)
qu'horizontale (entre les employés). Tout ceci vise à faire du
bénéficiaire de l'information ; le salarié, un
véritable acteur dans le projet de l'entreprise.
Justement, la CNSS, dans la perspective de mettre en place un
mécanisme dont la finalité serait de favoriser la
compréhension mutuelle, l'échange et le partage d'idées
s'est engagée depuis plus d'une décennie dans la démarche
cercles de qualité. Aujourd'hui, les résultats sont plutôt
mitigés. Les cercles ne suscitent pas un grand engouement au niveau des
travailleurs. Motifs, leur inorganisation et la non perception du bien
fondé même de ces cercles.
Pour mieux informer ses agents, la caisse disposait
également d'un journal dénommé « Echos
CNSS ». Mais il ne paraît plus, officiellement pour
des raisons budgétaires.
En outre, l'existence d'un service de communication et de
relations extérieures (COMREX), témoigne a priori du souci des
dirigeants de créer des relations harmonieuses au sein de leur
administration. L'objectif poursuivi c'est de bien structurer les composantes
de cette même entité sociale et de rassembler tout le monde dans
l'oeuvre collective.
Toujours dans l'optique de la quête de
l'efficacité, les travailleurs de la caisse ont participé
à la conférence interafricaine de prévoyance sociale
(CIPRES). Organisée du 16 au 20 janvier 2006 à Ouagadougou, elle
portait sur la fonction d'administrateur et le management directorial.
Durant les cinq jours, les participants ont pu approfondir
les éléments essentiels à la fonction d'administrateur. Il
s'agissait entre autres des responsabilités et du rôle des
conseils d'administration, du diagnostic, des outils et technologies permettant
d'améliorer son fonctionnement.
En ce qui concerne le module consacré au management
directorial, les thèmes ci- après ont fait l'objet
d'échanges :l'influence de l'environnement sur l'organisation, la
planification stratégique, le pilotage de l'entreprise et le tableau de
bord, l'évaluation et le contrôle de performance, le management
opérationnel et le rôle du manager.
Les enseignements capitalisés s'inscrivent dans la
droite ligne des objectifs de la CNSS. Lors du jubilé d'or de la caisse
en 2005, l'ex Directeur Général (DG)8(*) les résumait
ainsi : « Le grand chantier de toujours c'est
l'amélioration des prestations servies et une couverture sociale encore
plus large »9(*)
Une telle volonté n'empêche cependant pas
l'existence des rumeurs à la CNSS. Celles-ci sont la conséquence
de deux principaux facteurs :
D'abord la rigidité hiérarchique. L'information
est quelquefois bloquée au niveau de la hiérarchie sans que le
personnel ne comprenne trop pourquoi. Ne disposant pas de la
« vraie information », le rendement des agents
s'en trouve affecté. D'aucuns n'hésitent donc pas à
s'occuper de leurs « propres affaires » au
détriment des « dossiers »de la CNSS.
Ensuite, il y a cette forme de lenteur. Elle est
pratiquée généralement au niveau des chefs de services et
de sections. Très souvent, beaucoup ne répercutent pas à
temps l'information à leur base. Lorsqu'ils se décident enfin
à le faire, l'information n'a plus de valeur. Si ce n'est pas le cas,
c'est l'employé qui se voit contraint de
« bâcler » le travail qu'on lui demande.
A ce propos, une anecdote. Un travailleur nous raconte qu'il
arrive par exemple que le Directeur Général soit absent. Ils
n'aperçoivent la note de service devant les informer de l'intérim
du Secrétaire Général, que longtemps après.
Parfois, pendant que le premier responsable est déjà de retour.
Pour cet employé : « en ce moment, l'information
n'a plus de sens ». Effectivement, il arrive que les notes de
service soient affichées avec un retard d'un ou de deux jours, voire
plus. Evidemment, une telle attitude joue en la défaveur de toute
l'organisation.
Au cours de l'année 2006, la preuve la plus manifeste
de rumeurs nous est donnée par les difficultés de gestion
à la CNSS. Sur ce dossier, il y a eu beaucoup de supputations
(changement au niveau directorial, licenciements...) jusqu'à ce que
l'affaire éclabousse.
En effet, quelques temps après, les journaux de la
place ont fait de « l'affaire CNSS » leurs choux
gras. Ici encore, beaucoup d'employés ont été surpris par
les informations relayées dans la presse.
A l'interne, ils étaient nombreux à n'en avoir
guère connaissance. C'est du reste pour cette raison que plusieurs
travailleurs de la caisse (du moins les nouveaux), étaient
scandalisés au fur et à mesure que la presse avançait dans
ses investigations.
A l'externe, l'image de l'organisation ne s'en porte pas
mieux. La CNSS n'a en effet, pas bonne presse ces derniers mois. En tout cas
durant l'enquête. (Voir annexes). C'est donc dire que le problème
est entier.
Même si « l'affaire » peut
avoir des dessous politiques, il n'en demeure pas moins que la communication
interne de la CNSS aurait pu permettre de donner « l'information
juste » et de rasséréner ainsi les esprits. Mais
comment cela aurait été possible quand le responsable à
la communication lui même affirme n'avoir eu connaissance du dossier
que « par la presse » ?
Quelles peuvent donc être les
répercussions du manque d'une vision globale et planifiée de la
communication interne sur le management de la CNSS ?
Cette question trouve sa pertinence à deux
niveaux :
D'abord, la communication interne de la Caisse ne
répond pas aux aspirations de bien d'employés. Il y a en effet
une divergence entre la communication techniquement conçue et
vécue quotidiennement par les salariés et celle qu'ils auraient
souhaitée. De ce fait, les travailleurs se considèrent comme des
acteurs passifs. Ils ne sont pas associés aux prises de
décisions. Jean Favatier estime cependant
que : « Le changement ne se décrète pas.
Il se communique. On sait le coût social et économique
d'une communication interne déficiente : blocages divers,
rétention d'informations, démotivation... La gestion du personnel
(ou management) et la communication interne doivent être
étroitement liées dans une perspective d'accompagnement
d'évolution et de changement »10(*).
Ensuite, et incidemment à ce qui a
été dit plus haut, les salariés ont le sentiment que leur
entreprise est renfermée sur elle-même. Il en résulte une
faiblesse au niveau de la mobilisation et de la cohésion des agents.
C'est eu égard à ces constats que nous avons
décidé de mener nos investigations et analyses suivant cette
hypothèse:
A la CNSS, les pratiques communicationnelles ne
favorisent pas la motivation et l'implication des agents.
Cette hypothèse s'explique par le fait que les
techniques d'information et de communication prédominantes à la
CNSS sont les notes de services. De ce fait, la communication est
essentiellement de type up-down (verticale). Le contact et le dialogue font
défaut.
Conséquences, tous les agents ne peuvent pas
répondre avec certitude à la triade que les tableaux du peintre
Paul Gauguin donnent à sentir : D'où
venons-nous ? Que sommes-nous ? Où
allons-nous ? Ici, il s'agit bien cependant de la
maîtrise de l'entreprise. De son histoire.De son évolution et de
ses perspectives.
Dans cette logique, nous nous sommes assigné
l'objectif suivant à travers ce mémoire :
Ø Objectif de l'étude
L'objectif de notre recherche se décline comme
suit :
Montrer quelles sont les répercussions des pratiques
communicationnelles sur le management d'une entreprise d'utilité
publique comme la CNSS.
En effet, la communication doit être au coeur de la
stratégie managériale. Ceci étant, une mauvaise
communication a forcement de graves conséquences sur le fonctionnement
général de l'entreprise. Cette situation peut notamment jouer sur
le dévouement à la tâche, la motivation, la nature
des relations interpersonnelles, la perception des employés de leur
cadre de travail...
Cet objectif d'étude est d'autant plus important que
la caisse évolue actuellement dans un contexte où les attentes de
ses différents acteurs sont nombreuses et variées.
Pour mieux cerner la situation, notre réflexion
s'articulera alors sur le déficit de communication en faisant ressortir
les grands constats, les causes, les conséquences possibles et les
solutions envisageables. Bien sûr on ne doit pas perdre de vue que
l'efficacité de cette démarche requiert d'abord un
préalable. Ce préalable est constitué par la vision que
les différents acteurs de la CNSS ont de l'importance de la
communication interne. Il s'agira de voir s'ils perçoivent en la
communication un outil efficace qui participe à la construction d'une
bonne image interne.
Au finish, tout ce cheminement nous permettra de comprendre
comment le management, en tenant compte de l'aspect psycho-sociologique de
l'organisation, peut conduire à de nouveaux comportements sociaux
à travers trois préoccupations essentielles :
-Comment faciliter la naissance d'un esprit de groupe ou
un « esprit maison » ?
-Comment promouvoir des mécanismes de communication
et d'information aux fins de management ?
-Comment gérer les conflits ?
Mais quoi qu'on dise, l'utilité d'une étude est
sans doute liée à la pertinence des résultats et des
conclusions auxquels elle abouti. Loin d'espérer que notre
réflexion sera la panacée aux grands problèmes de
communication et de management à la CNSS, nous souhaitons tout de
même contribuer à l'avancée de la recherche en ces
domaines. Ainsi, notre ambition est de faire de cette étude un cadre de
référence à d'autres éventuels chercheurs.
. Nous avons également pour souci de
satisfaire notre curiosité intellectuelle par la confrontation de nos
connaissances théoriques aux réalités de la communication
managériale dans le cas d'espèce de l'entreprise
burkinabè.
II- REVUE DE LITTÉRATURE
La communication interne et le management des organisations
constituent un continent entier du savoir et font l'objet d'un nombre
considérable de publications, dont quelques unes ont
particulièrement retenu notre attention.
Avec La communication interne au service du
Management, Phillipe Détrie et Catherine Meslin- Broyez
ont une approche originale qui place la communication interne au coeur de la
nouvelle compétitivité. Pour eux, l'absence de cohésion
interne est flagrante dans le management de nombreuses organisations. Ces
auteurs expliquent cette situation par le fait que l'entreprise n'est pas une
addition de compétences, mais une multiplication des compétences.
Une seule erreur peut donc être préjudiciable à la
performance de l'entreprise. De ces constats, ils assignent à la
communication interne les rôles suivants: «
encourager les comportements d'écoute, faire circuler l'information,
faciliter le travail en commun, promouvoir l'esprit de coopération. En
un mot, développer le sens du collectif ».11(*)
Leurs travaux nous révèlent par ailleurs que la
communication interne est capitale en matière de management. Se fondant
sur le fait qu'un de ses objectifs est l'établissement d'un climat de
confiance, Phillipe Détrie et Catherine Meslin-
Broyez soutiennent que "disposant davantage de
possibilités de dialogue et moins soumis à un système
hiérarchique dans leur recherche d'informations, les salariés
sont invités à passer d'une logique d'obéissance à
une logique de responsabilisation et d'autocontrôle"12(*) Cet état de fait
jouera fortement sur le rendement de l'organisation.
Management et organisations des
entreprises de Jean Yves Capul s'inscrit
également dans cette logique. L'ouvrage rassemble un certain nombre
d'analyses d'universitaires. Pour la majorité de ces penseurs, toutes
les organisations sont désormais soumises à de profonds
bouleversements. « Sous la pression et les contraintes de
l'environnement, les contenus du travail et les structures de l'entreprise, les
organisations sont appelées à changer »13(*).
Alex Mucchielli ne dit pas le
contraire dans La communication interne : Les clés
d'un renouvellement Il va même un peu plus loin en dressant
un amère constat des conséquences que
le dysfonctionnement de la communication interne peut engendrer. Il s'agit
entre autres des surcharges d'informations à
répercuter, de l'inattention de collaborateurs débordés,
de l'inefficacité des outils d'information interne, de la circulation
de rumeurs, de la valse des audits et des projets inutiles...
Face à de tels phénomènes, l'auteur
estime que les bonnes intentions, ne suffisent pas. Un effort inédit de
compréhension s'impose si l'on veut que la communication interne puisse
jouer le rôle grandissant que lui confèrent les attentes des
salariés et les besoins des managers dans les entreprises du XXIe
siècle.
Pour cette raison, Alex Mucchielli aborde plusieurs points
dont entre autres : l'audit de l'information et de la communication
interne. Le principe de la gestion collective des problèmes
d'information. L'implication des acteurs. La multiplicité des
dispositifs et des moyens de communication interne. L'existence d'un cadre de
référence et la cohérence du dispositif global de
communication interne. La communication interne comme outil de management. Le
principe de la communication interne comme construction collective
des situations...Alex Mucchielli en abouti à une nouvelle
façon de penser la communication interne.
Jean-Pierre le Goff, lui opte pour
les illusions du management. Il révèle
que le management qui ne prend pas en compte les différences
d'intérêts ou d'aspirations et qui par conséquent mettrait
tout le monde sur le même plan en ce qui concerne l'adhésion et
l'implication dans le travail, véhiculerait le fantasme d'une entreprise
consensuelle et homogène. Dans son ouvrage, Jean Pierre le Goff
distingue quatre dimensions dans le profil du manager: une
éthique en situation (courage de dire, respect
de l'autre, modestie), des qualités humaines
(qualité de la parole et de l'écoute), des savoir
faire (savoir concilier et négocier, humaniser les
relations au travail) et des compétences
(capacités d'analyse et de synthèse, de communication,
d'argumentation). Il s'agit en fait de développer de façon
primordiale le goût pour les relations humaines, l'ouverture d'esprit qui
permet de comprendre les réactions des uns et des autres avant de les
juger. L'écoute ici est particulièrement importante.
Une application pratique en est faite dans le
Management des organisations de Don
Hellregel, Slocum John et Richard Woodman. Cet ouvrage qui fait une
étude critique des différents styles de management, donne
à apprécier l'importance de la communication interpersonnelle
dans les organisations, fait ressortir de grandes techniques de leadership et
de résolutions des conflits...Selon les auteurs, les déplacements
qui consistent à se promener dans les locaux et à bavarder avec
les employés donnent aux dirigeants (managers) une occasion unique de
sortir de leur bureau et de s'entretenir familièrement avec le
personnel. Maints dirigeants, constatent-ils, n'utilisent guère ce mode
de communication. A leur avis, ils y trouveraient cependant une bonne occasion
de s'adresser à chacun pour lui parler de son travail et lui exprimer
personnellement les félicitations de rigueur pour un mariage
récent, une naissance, un succès scolaire ou tout autre
événement familial. « En somme, la communication,
c'est le vrai métier du manager. Le travail de celui-ci ne consiste pas
à faire de la recherche, admettre un patient dans un hôpital,
programmer des ordinateurs. Un manager fonctionne comme
l'émetteur-récepteur d'une information essentielle aux prises de
décisions »14(*)
C'est en prenant en compte ces aspects, que Marie-
Hélène Westphalen a publié
Communicator: Le guide de la communication
d'entreprise. L'auteur explique à partir de huit (08)
techniques fondamentales comment bâtir une stratégie de
communication. Le Communicator répond aux
questions de base: comment élaborer sa stratégie, quels outils
choisir...Il passe au crible les moyens dont le communicateur interne dispose
(intranet, réseaux didactiques...) « Toute politique de
communication part de l'interne pour se diriger vers l'externe. Elle doit
être à la fois homogène et
globale »15(*)
Claude Duterme, lui propose une application
des concepts de l'école de Palo Alto
au monde de l'entreprise. A travers
La communication interne en
entreprise : L'approche de Palo Alto et
l'analyse des organisations, il analyse ainsi les pratiques
actuelles de communication interne en lien avec les théories
linéaires classiques de la communication qui les fondent. Il
développe également la théorie "orchestrale" de la
communication et invite, dans la logique de l'école de Palo Alto,
à une approche de l'entreprise comme système de communication. La
conception de la communication interne en est radicalement transformée.
Cet ouvrage convie à une pratique interactionnelle et systémique
en entreprise, ainsi qu'à explorer de nouvelles pistes pour les
relations entre les acteurs organisationnels (direction, encadrement,
personnel). Et que dire des défis ?
Peter Drucker nous en donne la réponse dans
L'avenir du management. Celui qu'on appelle le
père du management moderne y développe une vision intelligente
des défis de l'époque contemporaine pour nourrir les cogitations
de tout décideur. Qu'est-ce que la performance? Comment améliorer
la productivité? Qu'utiliser pour bâtir ou mettre en oeuvre une
stratégie? Que devons-nous apporter à l'entreprise dans laquelle
nous nous trouvons?
Face aux défis considérables que l'avenir
prépare, les organisations et leurs managers, estime, Peter Drucker, ont
tendance à traîner les pas. L'avenir du
management se propose donc de leur expliquer que penser et
comment faire pour survivre et réussir demain. « Qu'est ce
que le management? Le coeur de la société moderne. Ce n'est pas
la technique, ce n'est pas l'information, ce n'est pas la productivité.
C'est l'institution en tant qu'organe social produisant des
résultats ».16(*)
Pour Peter Drucker, l'actif le plus précieux d'une
entreprise au 20è siècle était son équipement de
production. Au 21 è siècle, ce sera ses travailleurs du savoir et
leur productivité. Peter Drucker pense qu'une entreprise n'est pas
seulement une addition de produits et de services. Il s'agit selon lui, avant
tout, d'une société humaine qui génère certaines
formes culturelles. Et ceci implique le renoncement à
l'autoritarisme : « Aucun système fondé sur un
cloisonnement rigide qui confie la prise de décisions à la seule
classe de « ceux qui savent » n'est en mesure de
répondre avec rapidité et flexibilité aux exigences du
client. Cela signifie également qu'il faut rompre avec certains types de
métaphores comme les « bras » de l'entreprise. Le
service du client fait appel à toutes les capacités humaines, les
bras, la tête, le coeur ».16(*)
Dans le cas typique de la CNSS, nous avons eu recours
à plusieurs travaux, dont le mémoire de fin de cycle à
l'Ecole Nationale d' Administration et de Magistrature ENAM (2003) de
Traoré Alassane. Cette recherche portait sur :
« La communication et la problématique de la
performance des travailleurs dans les Etablissements publics : Cas de la
CNSS. » Mais à la différence de la
nôtre, cette étude s'est davantage focalisée sur les
considérations techniques de la communication sans en faire suffisamment
ressortir les aspects managériaux.
A notre niveau, nous voulons surtout démontrer que la
qualité des prestations de service d'une organisation est en partie
tributaire du degré de motivation de son personnel. Principal facteur de
production, le personnel doit donc être la première cible des
actions de communication de l'entreprise pour mieux s'approprier ses objectifs
afin de promouvoir et de défendre ses grandes causes. Faute de cette
démarche, l'entreprise court de nombreux risques de contre-
performances. Aujourd'hui en effet, l'efficacité de l'entreprise ne
dépend pas seulement de sa capacité à produire mais
également de son habilité à communiquer, à
établir des relations de confiance avec tous les acteurs dont
dépend son équilibre.
III-CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL
III-1) CADRE THEORIQUE
Dans le souci de mieux circonscrire cette étude, il est
nécessaire de la placer dans des théories qui en
définissent les grands principes. De ce fait, notre travail s'inscrit
dans la théorie des relations humaines.
III-1.1 L'Ecole des Relations Humaines
Le courant des relations humaines met
l'accent sur les facteurs physiologiques et la motivation dans
l'activité humaine. Kurt Lewin, Frederick Herzberg, Abraham Maslow et
Elton Mayo en sont les figures de proue.
Ils ont mis en évidence la dynamique de groupe, la
pyramide des besoins les effets positifs du travail en groupe. La motivation
psychologique des salariés dans l'entreprise est donc aussi importante
que la motivation matérielle. Ces travaux ont montré que
l'individu réagi aux situations surtout de façon subjective.
Selon le Dr Daouda Kouma : « Cette
perception de la situation est influencée par l'affectivité mais
aussi et surtout par les normes, les forces et le climat du groupe de
travail »17(*). L'école des relations humaines a
également permis de mieux comprendre d'autres aspects de la
réalité organisationnelle. Dans cette logique :
La quantité de travail accomplie par un ouvrier n'est
pas seulement déterminée par sa capacité physique, mais
par sa capacité sociale, c'est-à-dire son intégration au
groupe.
Les paramètres non financiers (conditions de travail,
relations sociales) jouent un rôle capital dans la motivation et la
cohésion du groupe.
La spécialisation à outrance
préconisée par l'organisation scientifique du travail de Taylor
n'est pas la forme la plus efficace de la division du travail.
Les salariés ne réagissent pas à la
direction en tant qu'individus, mais en tant que membres d'un groupe ayant sa
propre logique de fonctionnement et son propre système de valeurs. La
nécessité s'impose donc à l'entreprise de produire une
organisation du travail capable d'intégrer ces différentes
dimensions.
En quoi la théorie des relations humaines peut- elle
être utile à notre thème ? Quels rapprochements
peut-on établir entre cette théorie et le mode de communication
et de management de la CNSS ?
La théorie des relations humaines permet d'envisager
une approche de la communication dans une perspective plus large. Ainsi,
celle-ci prend en compte l'entreprise dans toutes ses dimensions et
manifestations. L'objet de cette étude étant une analyse des
pratiques communicationnelles et managériales, il nous paraît
convenable de nous intéresser aux différents actes posés
par l'entreprise, qui peuvent avoir un impact sur le public interne mais
également sur les représentations que le public externe se fait
d'elle.
Le choix des relations humaines comme cadre théorique
d'étude de la CNSS se justifie alors à plus d'un titre :
Tout d'abord, comme nous l'avons vu dans la
problématique, la CNSS est confrontée à de nombreuses
difficultés en terme de circulation de l'information. Il en
résulte des répercussions négatives sur le niveau de la
motivation et sur le rendement du personnel. Cet état de fait
entraîne surtout des coûts cachés liés aux retards et
absences des agents. Il semble donc impérieux, face à un tel
constat, de déceler les différentes causes d'insatisfaction
liées au système communicationnel et managérial actuel
afin de les prendre en compte dans le cadre des recherches de solutions.
Très souvent en effet, beaucoup de dirigeants pensent
qu'il faut « laisser du temps au temps » afin que
tout entre dans l'ordre. Ils oublient peut -être qu'un problème
qu'on garde au congélateur ne se transforme jamais en glaçons de
paix, d'amour et de détente. Il en ressort plus chaud que jamais. Opter
de laisser faire le temps, c'est donner du temps au problème de grossir
et de pourrir entraînant du coup dysfonctionnement, mécontentement
et mauvaise prise de décisions. Cette vision matérialise toute
l'importance de la théorie des relations humaines.
Ensuite, la théorie des relations humaines, par les
structures plus flexibles et plus organiques qu'elle peut engendrer,
privilégie une communication verticale bidirectionnelle. Cette
communication repose sur la qualité de la relation entre le travailleur
et son supérieur. La communication dans l'entreprise devient autant
ascendante que descendante. Sa principale fonction devient relationnelle. Il se
trouve cependant que cette dimension n'est pas suffisamment prise en compte
à la CNSS vu que la communication est essentiellement
linéaire.
Dans le domaine du management, la théorie des relations
humaines nous apprend que le comportement des agents peut être
influencé par le groupe auquel ils appartiennent. La CNSS, conçue
comme une entreprise met également en évidence ce constat. Elle
vit grâce au travail de ses employés. L'agent qui fait partie de
cette organisation est un individu qui a une vie en dehors de celle qu'il
mène dans son lieu de travail. De ce fait, son rendement peut-être
conditionné par les influences des évènements qui
surviennent dans son vécu
quotidien (naissance, mariage, décès)...
Lewin, nous l'avons vu, a axé sa réflexion sur
la dynamique des groupes. Celle-ci est la combinaison de l'ensemble des
énergies et processus conscients ou inconscients qui se déroulent
au sein d'une organisation et qui permettent de l'appréhender comme une
seule entité. Elle fait ressortir l'idée de cohésion.
La CNSS organisée en plusieurs sections semble bien
répondre à ce principe. Mais seulement, pour mener à bien
une activité dans une organisation, encore faut-il savoir à qui
et comment présenter ses idées. Pour cette raison, et au regard
de nos objectifs d'étude, nous insisterons particulièrement sur
deux composantes essentielles de la théorie des relations
humaines : la motivation et
l'implication des salariés.
Ø La motivation au
travail : Elle est liée à la satisfaction et
à la concordance entre ce que le salarié attend du travail et ce
que le travail est susceptible de lui apporter. C'est donc le goût que le
travailleur a de le faire, la mesure dans laquelle il s'y implique, la
persévérance, la continuité de l'effort qu'il consent. La
motivation résultant de la satisfaction, elle englobe les quelques
éléments suivants : le travail lui-même, le niveau
économique qu'il représente, les relations dans lequel baigne le
salarié... A la CNSS, il y a cependant des frustrations, une absence de
valorisation du travail, des conflits ce qui abouti finalement à la
démotivation des agents.
Ø L'implication : A la CNSS,
très souvent, les informations sont la chasse gardée des
directions et des groupes de certains cadres au détriment des agents. Un
peu comme si les résultats obtenus ne dépendaient que de leurs
seules compétences. Or la dynamique d'une entreprise est
couronnée par l'ensemble des énergies et la contribution de
chacun. Les entreprises qui gagnent sont celles qui cultivent l'esprit
collectif pour parfaire la réalisation d'un projet en impliquant des
hommes dans le développement des stratégies et l'ensemble des
objectifs poursuivis. La prise en compte de leurs besoins et attentes
étant un levier pour obtenir cette implication et donc gagner en
performance
Au regard de ces deux réalités, on
s'aperçoit qu'il y a deux types d'activités dans lesquelles les
agents de la CNSS interviennent :
-Le Faire : l'activité de production, de fabrication,
de transformation, d'installation, de conception...
- L'Agir : Il est relatif aux actions sur les hommes en
eux-mêmes (le management fait partie de ce domaine). Lorsqu'il y a une
divergence entre le Faire et l'Agir, cela peut aboutir à la restriction
des initiatives, la dépersonnalisation de la relation de
travail,l'anonymat, le découragement, la baisse de productivité,
l'inquiétude ... Tout ceci instaure une méfiance
générale.
Pour bien fonctionner le rouage a donc besoin d'une
information et d'une communication optimale. C'est dans cet esprit que
Wieman J. M. et Harisson R.P. (1983) déclarent
ceci: « La communication, en particulier la communication
directe inter personnelle est l'âme des organisations. Quand des
employés se trouvent engagés dans un processus de communication
inter personnelle efficace, ils augmentent leur propre sentiment de bien
-être et d'efficacité »18(*)
A partir de ce qui précède, il s'agira pour
nous, après le diagnostic du mode de communication, de faire ressortir
l'influence des pratiques communicationnelles de la CNSS sur le management de
cette organisation.
III-2) CADRE CONCEPTUEL
III-2.1 La communication
Alors qu'informer vient du latin informare, donner
forme, façonner l'esprit, communiquer, du latin communicare
signifie mettre en commun, être en contact avec. La communication
suppose alors des implications subjectives nécessitant de se
préoccuper des modes de réception, d'appropriation du message.
Pour Neveu Eric : « Informer
est surtout du ressort de la technique, communiquer est un problème de
relations humaines »19(*).
Au niveau de l'organisation stricto sensu, malgré
l'infinité des définitions, nous retiendrons celle de Bernard
MIEGE qui nous semble la plus complète au regard de nos objectifs
d'étude. On peut en effet admettre avec cet auteur que la communication
dans les entreprises poursuit trois (03) objectifs:
-Forger une identité forte et valorisée de
l'entreprise
-Aider à l'émergence d'un nouveau management du
travail
-Participer à la modernisation de la production, des
conditions et des structures de production.20(*)
III-2.2 La communication interne
Selon de nombreux auteurs, la communication interne est
l'ensemble des flux d'information à l'intérieur d'une
organisation. Mais on peut avancer avec Claude Duterme
qu"elle se réfère de plus en plus ces dernières
années à une dimension plus construite, une action volontaire au
sein de l'entreprise; la gestion de l'information et dans sa version la plus
élaborée la recherche de consensus autour de ce qu'on appelle la
culture d'entreprise »21(*)
Pour certains universitaires réputés du domaine
des théories organisationnelles, la communication et l'organisation sont
indissociables. Ainsi, selon Norbert Wienert" Tout
organisme est cohésionné dans son action grâce à la
possession des moyens qui permettent d'acquérir, d'utiliser, de retenir
et de transmettre l'information »22(*). L'organisation doit donc
accorder une place centrale à la communication parce que la structure,
l'étendue et l'ampleur des activités des organisations sont
presque entièrement déterminées par les techniques de
communication.
Dans sa composante managériale, la communication
interne a pour rôle d'encourager les compétences d'écoute,
de faire circuler l'information, de promouvoir l'esprit de coopération,
en un mot de développer le sens du collectif. Autrement, le pré
carré reprend ses droits. Sans une réelle communication interne,
l'organisation se transforme en champs libre des rumeurs, parfois
incontrôlables et nuisibles. Il y' a alors beaucoup de bruit, mais
peu de fruits.
III-2.3 Le Management
« Le management est une activité humaine
et sociale visant à stimuler les comportements, à animer des
équipes et des groupes, à développer les structures
organisationnelles et à conduire les activités d'une organisation
en vue d'atteindre un certain niveau de performance ».23(*) Définition de
Jean-Michel Plane. De ce point de vue, le management se
différencie assez nettement de la gestion qui fait plutôt
référence à la recherche de l'allocation optimale de
ressources rares.
Derrière l'appellation "management", on
retrouve donc l'idée d'organisation, de rigueur et d'efficacité,
choses dont la finalité est l'obtention de résultats meilleurs.
Le manager est un artiste, un créateur dont le principe est de savoir et
de prévoir, conquérir et fidéliser l'intérêt
d'un certain public pour un certain produit ou service. Le management de ce
fait s'oppose à l'amateurisme et à l'imitation.
Selon le père du management moderne, Peter
Drucker : « La tâche du manager (et du
management) consiste à créer un ensemble plus vaste que la somme
de toutes les parties(...)En procédant par analogie, on pourrait le
comparer au chef d'un orchestre symphonique, qui, par son effort, son
inspiration et sa direction, fait en sorte que les bruits émis
individuellement par chaque musicien se transforment en un tout musical vivant.
Mais le chef d'orchestre dispose de la partition du compositeur. Il n'en est
que l'exécutant, tandis que le manager est à la fois compositeur
et chef d'orchestre »24(*)
La communication joue un rôle irremplaçable
justement; en matière de management. Elle permet de résoudre les
problèmes fonctionnels, opérationnels et relationnels et de
satisfaire les salariés pour une plus grande motivation. Pour
Jean-Marie Peretti : « Nous
réalisons que l'entreprise de demain ne pourra remplir sa mission et
atteindre ses objectifs que si elle améliore sa faculté à
communiquer, à informer et à faire
participer »25(*)
Cette définition fait intervenir une donnée
stratégique pour l'organisation : la culture d'entreprise. Il
s'agit d'un ensemble d'idées, de croyances, de traditions, de valeurs et
de connaissances sur les quels les travailleurs se basent, fixent leurs
objectifs, consolident leur groupe, leur solidarité...
La dimension qui intéresse l'organisation, c'est celle
invisible et inconsciente. Cette dimension relève de l'ordre des
représentations, à savoir le sens que les membres des
différentes catégories socioprofessionnelles veulent donner aux
décisions qu'ils prennent, aux actes qu'ils posent, la raison de croire
en ce qu'ils font... La culture d'une organisation constitue alors un
modèle complexe de croyances et d'espérances partagées par
ses membres. La circulation de tous ces éléments se fait par le
biais de la communication.
III-2.4 L'organisation
Selon F. Gortner et
al : « La définition formelle la plus
utilisée d'une organisation est la suivante: un groupe de personnes
engagées dans des activités spécialisées et
interdépendantes en vue d'atteindre un but ou réaliser une
mission commune »26(*)
Une entreprise, une association une école, un parti
politique sont donc des organisations. Les organisations possèdent des
traits communs et se différencient d'autres regroupements sociaux comme
les foules ou la famille. Une première caractéristique des
organisations s'est d'être orientées vers un but : (produire
des biens, instruire, former...). Les organisations pour répondre
à leurs missions doivent assurer la coordination des actions
individuelles. Ainsi, Réné Lourau affirme
que : « définir rationnellement une organisation par
les services qu'elle rend ou est censée rendre n'est pas suffisant. Il
faut aussi tenir compte du fait qu'elle produit des modèles de
comportements, entretien des normes sociales, intègre ses usagers au
système social »27(*)
Cela suppose des réseaux de communication entre
les personnes et les services, des processus d'information et de prise de
décisions, des règles internes de fonctionnement
(contrôle, gestion, etc.), des principes de
réalisation du travail ( procédures, notes, méthodes
particulières) et de son contrôle...
Dès lors que leurs objectifs stratégiques se
modifient, les entreprises doivent s'interroger en permanence sur l'adaptation
de leur structure. Il y a grand intérêt à suivre les
grandes tendances d'évolution actuelle des organisations, qui
sont :
Les structures plates caractérisées par la
réduction du nombre de niveaux hiérarchiques et qui
permettent :
-d'accélérer la circulation de l'information,
notamment verticalement (puisque les lignes hiérarchiques sont
courtes)
-d'accroître la responsabilité des
collaborateurs
-de faciliter la prise de décision rapide
-de renforcer la qualité du management par la pratique
de la délégation
IV-METHODOLOGIE
Le choix de la CNSS pour la présente étude n'est
pas fortuit. Structure en charge de la gestion du régime de
sécurité sociale, elle fait l'objet d'une grande attention autant
des employeurs que des employés.
En ce qui concerne la protection sociale stricto-sensu, le
Burkina Faso connaît la présence de deux types de
structures : celles étatiques/para étatiques et celles
privées.
Les structures étatiques et para étatiques sont
constituées de la CNSS et de la Caisse Autonome de Retraite des
Fonctionnaires (CARFO). La CNSS oeuvre pour la protection sociale des
travailleurs du secteur privé tandis que la CARFO s'occupe des agents de
la fonction publique civile et militaire. Ces deux structures sont en principe
fondées sur la contribution de tous pour la protection de chacun.
Quant aux structures privées, elles regroupent les
sociétés d'assurance. Elles sont fondées sur
l'épargne d'aujourd'hui de chacun pour sa protection personnelle et
celle de sa famille nucléaire, pour demain. Ce sont des
sociétés purement commerciales.
Au regard de cette situation, il convient alors de comprendre
comment s'opère la dynamique interne d'une structure aussi importante
dans le tissu socio-économique.
Ainsi, pour ce mémoire, quatre (04) techniques de
recueil des données ont été utilisées :
-La recherche documentaire
-L'observation participante
-L'enquête par questionnaire
-L'entretien semi-dirigé
La recherche documentaire s'est attelée à faire
le point de la littérature relative à notre sujet d'étude.
L'observation participante directe a porté sur les diverses
manifestations de la communication interne et du management au sein de la CNSS.
Quant aux sondages par questionnaire et aux entretiens, ils ont servi à
recueillir les avis et les perceptions des différents acteurs de la CNSS
sur la problématique de notre thème d'étude.
IV-1 LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
A propos de recherche documentaire, plusieurs
bibliothèques nous ont fourni de précieux ouvrages. Ainsi,
avons-nous eu recours à la bibliothèque du département
Communication et Journalisme, au Centre Culturel Français, au Centre
Culturel Américain, au Centre d'Information et de Recherche sur le
développement, à la bibliothèque de la CNSS, etc.
Au sein de l'organisation, nous avons consulté des
rapports d'audit, des projets de stratégies de communication...Tous ces
documents nous ont servi de balises. En outre, des mémoires sur la
communication ou le management, des journaux, des documents de l' Association
Burkinabè pour le Management de Qualité (ABMAQ), des ouvrages
divers, nous ont aidé dans notre entreprise.
Pour tous les domaines de cette étude, Internet a
également constitué une importante source de collecte
d'informations.
IV-2 L'OBSERVATION PARTICIPANTE
Si les pratiques peuvent être
révélées par l'administration d'un questionnaire
écrit et par des entretiens, l'observation permet d'appréhender
d'autres aspects de la communication et du management. Depuis l'école de
Palo Alto, les plus grands théoriciens s'accordent à
reconnaître que « tout est communication ».
Ce n'est justement que par une observation minutieuse qu'on peut un tant soit
peu, catégoriser un style de management, déceler les failles d'un
système de communication...
Pour aborder son terrain, le chercheur a plusieurs
possibilités. La plus courante mise en oeuvre par les ethnologues
à la suite de l'anthropologue Malisnowski, consiste
à participer au plus près possible de la vie locale tout en
observant attentivement tout ce qui s y passe. C'est cette posture qui est
appelée : « observation
participante ». De l'avis du Pr Serge Théophile
Balima et de Marie-Soleil
Frère : « Le but de la démarche
est de voir, de sentir, d'éprouver soi même ce que les autres
voient, sentent, éprouvent. Il s'agit de vivre de l'intérieur la
culture, le milieu que l'on cherche à
connaître ».28(*) Notre observation est donc dite in situ. (en
situation). Cette stratégie nous a permis de décrire et de
comprendre les comportements, les attitudes, les activités et les
manières de faire de notre échantillon. Pour notre
démarche, nous avons opté pour l'approche localisée. Ce
choix se justifie par le fait que notre objet consiste en une étude
thématique précise :(l'analyse critique des pratiques
communicationnelles et managériales).
Concrètement, notre observation s'est faite tout au
long du processus de recherche et durant le stage de deux mois (25 janvier-25
mars 06) effectué au service de communication et de relations
extérieures (COMREX) de la CNSS. Au cours de ce temps, nous avons
noué des contacts, eu des entretiens informels avec des
personnes-ressources, pris connaissance de l'organisation et du fonctionnement
de la CNSS. Nous avons également observé les modes d'actions du
COMREX, jaugé de l'importance accordée à la communication
interne dans cette organisation, etc. Cette observation était de nature
psychosociologique et managériale
La dimension psychosociologique renvoyait aux individus et
groupes d'individus qui oeuvrent dans l'organisation et des relations qu'ils
entretiennent entre eux. Cet aspect est ordinairement étudié via
les thèmes de la motivation, des conflits, du style de management, de la
culture organisationnelle, ...
La dimension managériale visait à observer les
modes de définition des objectifs stratégiques et
opérationnels, les procédures de prise de décisions, la
coordination des mécanismes de contrôle... En fait, lorsqu'on
parle des organisations, l'on doit nécessairement y voir les hommes car
les structures, les équipements n'existent que par les êtres
humains.
IV-3 L'ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE
Comme l'expliquent R. Quivy et L. Van
Campenhoudt, l'enquête par questionnaire
« consiste à poser à un ensemble
de répondants, le plus souvent représentatif d'une population,
une série de questions relatives à leur situation sociale,
professionnelle ou familiale, à leurs opinions, à leur attitude
à l'égard d'opinions ou d'enjeux humains et sociaux, à
leurs attentes, à leur niveau de connaissance ou de conscience d'un
événement ou d'un problème, ou encore sur tout autre point
qui intéresse les chercheurs. L'enquête par questionnaire à
perspective sociologique se distingue du simple sondage d'opinion par le fait
qu'elle vise la vérification d'hypothèses théoriques et
l'examen de corrélations que ces hypothèses suggèrent. De
ce fait, ces enquêtes sont généralement beaucoup plus
élaborées et consistantes que ne le sont les sondages
(...) »29(*)
Sangaré/ Compaoré Nestorine
ajoute pour sa part que : «
échantillonner, c'est choisir une partie (échantillon) d'une
population pour la représenter. Quand la population choisie est
homogène, on peut extrapoler ou généraliser les
conclusions de l'enquête réalisée sur un
échantillon ».30(*) C'est à la
lumière de toutes ces définitions, que nous avons
administré le questionnaire à 103 agents de la CNSS siège(
Directeurs, Chefs de service, de section et les simples agents) sous Idrissa
Zampaligré. En son temps, nous avions entrepris de rencontrer le
Directeur Général en personne. Mais pour des raisons de
calendrier, nos tentatives sont restées vaines.
Concrètement, notre enquête a donc
concerné 07 directeurs centraux, 13 chefs de service, 30 chefs de
sections et 53 simples agents ou agents d'exécution.
En dépit du changement directorial, nous pensons que
les données recueillies sont conformes à la
réalité. En vérité, à la CNSS, comme l'ont
affirmé de nombreux responsables, les problèmes de communication
sont structurels. Le nouveau DG hérite donc de vieux problèmes
qu'il va falloir résoudre.
Voici comment se présentent les données
de notre échantillon:
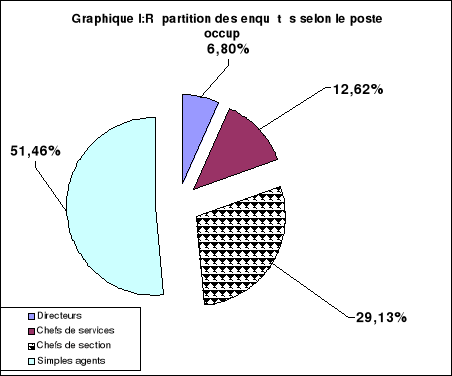 Source : Enquête de terrain
Source : Enquête de terrain
Sur un effectif total de 286 agents à la date du 31
janvier 2006, selon les statistiques de la Direction des Ressources Humaines
(DRH), 103 représente un taux de 36,01%. Ce pourcentage peut
paraître insuffisant, mais nous sommes guidés par un souci de
représentativité. Notre population-cible a été
retenue sur une base non-probabiliste. « Les échantillons
non probabilistes ne sont pas choisis au hasard mais sur la base de
critères précis. Le hasard du sens commun dont il est question
ici, diffère du hasard probabiliste ».31(*) Concrètement, il s'est
agit pour nous d'établir le parallèle entre la vision des
managers et celle des exécutants.
Notre choix de limiter le sondage aux seuls agents de la CNSS
se justifie par le caractère de notre étude qui se veut
strictement interne.
Pour le questionnaire, nous avons une alternance de questions
ouvertes et de questions fermées. L'objectif c'est de permettre aux
enquêtés d'aller au « fond » de leur
pensée. Pour cela, nous avons retenu l'administration directe
(L'enquêté rempli lui même le questionnaire). On
espère éviter ainsi toute influence. La collecte des
données s'est faite à la CNSS pendant les heures de service
Pour les besoins de notre étude, nous avons opté
spécifiquement pour l'échantillon en boule de neige. Dans cette
technique, il s'agit d'ajouter à un noyau d'individus
considérés influents (ici les managers), tous ceux qui sont en
relation de parenté, d'amitié, de travail ... avec eux (ici, le
reste du personnel). On dégage alors un système de relation
existant au sein d'une population ou d'une organisation. L'échantillon
en boule de neige permet d'analyser le comportement des individus par rapport
à la structure sociale dans la quelle ils vivent. La présence de
l'interaction permanente permet ainsi de ne pas les considérer comme
détachés de leur contexte social.
. Cette technique nous a permis d'établir des rapports
de corrélation ou d'opposition des sondés sur la
problématique de la communication interne dans le management de leur
entreprise.
Concrètement, le questionnaire est structuré en
quatre grandes parties :
La première partie consacrée à l'image
et au climat internes se veut une jauge de l'ambiance de travail à la
CNSS de façon générale.
Elle vise également à faire le point des
perceptions que les agents de la caisse ont de leur organisation. Cela nous
paraît nécessaire dans la mesure où l'on sait qu'un bon
climat de travail et une bonne image interne sont des facteurs réels de
motivation. L'image interne en particulier quand elle est jugée
« bonne », peut agir sur l'individu et faire en
sorte qu'il appréhende son cadre de travail en terme de lieu
d'épanouissement.
La deuxième partie est axée sur l'organisation,
les moyens et les orientations de la communication interne. Elle cherche
à mieux cerner tous les canaux et outils utilisés par la CNSS
dans sa communication interne.
La troisième partie se focalise sur le management et la
culture d'entreprise. Dans les grandes lignes, elle nous permet d'avoir une
idée précise de la nature des relations interpersonnelles, du
mode d'exercice de l'autorité au sein de la CNSS, du sentiment
d'appartenance ou non à la « maison »...
Enfin la dernière partie est réservée aux
propositions des agents pour de meilleures pratiques communicationnelles et
managériales à la CNSS.
PRESENTATION DES VARIABLES
D'une manière générale, est
considérée comme variable toute caractéristique de
l'environnement physique et social, tout comportement dont les manifestations
peuvent avoir un impact sur l'équilibre général.
Définie ainsi, une variable est un caractère qui peut prendre des
valeurs différentes en grandeur et en intensité, qualitativement
et quantitativement.
Pour le cas spécifique de la CNSS, nous avons retenu
trois variables : le poste occupé, l'ancienneté dans le
service et le niveau d'instruction.
-La variable « poste
occupé »
Dans une entreprise, le poste occupé joue un rôle
primordial dans le comportement et les représentations des agents. Selon
que l'on soit Directeur Général ou agent de liaison, on n'a pas
toujours la même lecture des évènements marquant la vie de
l'organisation. Dans le cas de la CNSS, cette variable nous permet justement de
comprendre la spécificité de chaque poste et d'entrevoir les
interactions possibles.
-La variable « ancienneté dans le
service »
Dans sa conception actuelle, la CNSS comprend une
variété d'individus qui n'ont pas la même
ancienneté. Il y en a qui sont à leurs débuts tout comme
ils s'en trouvent qui ont connu plusieurs phases d'évolution ou de
mutation de la structure. L'ancienneté dans le service peut être
un élément moteur d'une certaine vision des choses. La
répartition selon le nombre d'années de service est la
suivante :
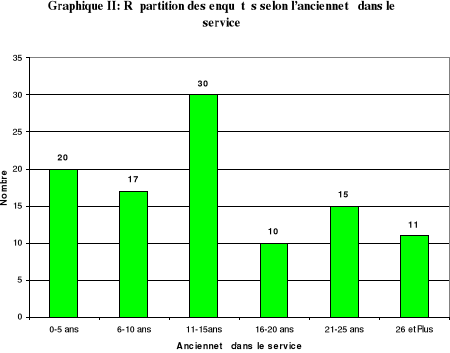
Source : Enquête de terrain
-La variable « niveau
d'études»
Ici, il s'agit de savoir qui a le niveau du primaire, du
secondaire, du supérieur ou encore aucun de ces trois niveaux.
Evidemment, lorsque nous parlons « d'aucun
niveau », nous nous fondons sur le système d'enseignement
classique. Il s'agit exactement de ceux qui ne sont pas allés à
l'école. Cela ne veut cependant pas dire qu'ils sont dépourvus
d'instruction. Notre objectif ici, c'est juste de disposer d'une variable
opératoire. A la CNSS, le niveau d'instruction permet
d'appréhender différemment les réalités. De
façon concrète, voici comment se présente le niveau
d'études de notre échantillon :
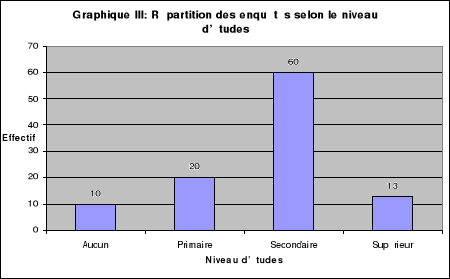
Source : Enquête de terrain
En définitive, la répartition en variables
correspond à une autre de nos préoccupations: il s'agit de voir
quel est leur impact sur les individus dans le contexte de notre cadre
d'étude. Il importe pour nous de voir si ces variables constituent des
facteurs de variation en ce qui concerne la façon dont les agents de la
CNSS appréhendent les faits et choses.
IV-4 L'ENTRETIEN
A la CNSS nous avons utilisé exclusivement l'entretien
semi-dirigé individuel auprès de 20 décideurs.(Directeurs,
Chefs de service et de section). Cet effectif s'explique : les entretiens
sont généralement indiqués pour l'étude d'une
micro-population. Nous nous sommes limités à ces derniers parce
que la communication interne est mise en oeuvre par la hiérarchie en
fonction des objectifs poursuivis. Dès lors, il s'est agit de
récolter la vision de ceux qui sont chargés de piloter la
communication interne de la CNSS.
Les entretiens se sont déroulés dans les
bureaux et ce, grâce à des rendez-vous préalables. Les
personnes ciblées à travers un certain nombre de questions
ouvertes, nous ont fourni des éléments de réponse sur ce
qu'elles pensaient de la communication interne de la CNSS, de son apport dans
le management des ressources humaines, de leur perception de l'importance du
COMREX et des interactions entre elles et cette structure... L'entretien nous a
permis d'engager un contact direct avec nos interlocuteurs. Ce climat a
favorisé des échanges plus vivants.
La possibilité de laisser parler les acteurs principaux
de notre population d'étude tout en opérant des
réaménagements et des réadaptations, a été
une des opportunités que nous a offerte la technique dans ce cas
précis. L'entretien en effet, nous a permis d'avoir une idée
assez précise des préoccupations majeures des travailleurs de
la CNSS en termes de communication interne et de management. Et que dire de la
possibilité de confronter ce que l'on a observé (les pratiques)
avec ce que les gens en disent (leurs représentations) ?
En réalité, l'entretien est plus qu'une
extraction d'information. C'est une situation sociale complexe basée sur
l'interaction entre deux personnes (l'intervieweur et l'interviewé). Le
but de l'entretien dit qualitatif est de permettre à l'interviewé
d'exprimer son point de vue, son expérience, sa propre logique... et ce
en le laissant libre de choisir le vocabulaire, le mode d'expression, l'ordre
qu'il veut...
La différence principale entre le questionnaire et
l'entretien est, comme écrit A. Blanchet, que :
« le questionnaire provoque une réponse »
alors que « l'entretien fait construire un
discours ». Par ailleurs, poursuit cet auteur,
« lorsque le sujet répond à un sondage, rien n'est
dit du contexte dans lequel les réponses sont formulées ni les
critères de jugement qui les sous-tendent »32(*)
Pour nos différents entretiens, nous avons choisi la
prise de notes. Cette technique nous a permis de mettre davantage en confiance
nos interlocuteurs, de leur donner la garantie sur le caractère
totalement anonyme de la recherche et surtout de « libérer
leur parole ». Dans notre carnet de notes, nous consignions les
choses essentielles remarquées, entendues, ressenties... Il s'agissait
non seulement d'écrire tout ce qui touche aux personnes observées
(l'accueil, les tics, les manies...) mais aussi tout ce qui
concerne le contexte et le décor dans lequel la situation se
déroule ( allure générale du bureau, relations
interpersonnelles, décoration du hall d'entrée de l'entreprise),
etc.
De plus, au moment de notre enquête, la CNSS
était accusée à tort ou à raison, de mauvaise
gestion dans les médias. Nous voulions donc observer plus de prudence en
évitant l'utilisation d `un enregistreur qui pourrait être
source de crispation et de méfiance. Nous craignions d'être
taxé d'espion roulant pour l'un au l'autre camp. Nos
préoccupations étaient et sont purement académiques.
LIMITES DE
L'ENQUETE
Les limites de l'enquête peuvent être de plusieurs
ordres :
-les réponses passionnées, agressives, ou tendant
à plaire ou à se faire remarquer
-Les limites liées à la compréhension des
items
-Les limites liées à l'auteur lui-même.
En effet, par notre simple présence, nous avons pu
provoquer des modifications dans le comportement des personnes
observées. C'est l'éternelle question de savoir si ce que nous
avons observé ou entendu ce serait déroulé de la
même manière à notre absence. Conscient donc de
l'éventualité que nous avons pu, partiellement au moins,
influencer le déroulement des évènements, nous nous sommes
attelés à recouper, vérifier et confronter nos diverses
observations. Tout ceci visait à tendre un tant soit peu vers
l'objectivité. Sans y prétendre !
Première
Partie :
LA CNSS : PRESENTATION, ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNICATION
I- PRESENTATION DE LA CNSS
C'est en 1955 que fut créée ce qui allait
devenir plus tard la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
après plusieurs transformations. En effet, suite à l'application
du Code du Travail d'Outre-mer, une petite caisse dite caisse de compensation
des prestations familiales (une seule branche de la sécurité
sociale) fut installée à Bobo-Dioulasso avec un effectif de 20
agents.
La branche des accidents du travail et maladies
professionnelles fut mise en place en 1959 et celle des pensions en 1960. La
loi n° 13-72/AN du 28 décembre 1972 créait la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale en même temps qu'elle
procédait à un réaménagement des textes. Les
nouveaux besoins d'efficacité et de rapprochement des assurés
sociaux de leur Caisse ont rendu nécessaires des réformes qui ont
été entreprises au fil du temps. La Caisse Nationale de
Sécurité Sociale est placée sous une triple tutelle.
Techniquement, elle relève du Ministère du Travail et de la
Sécurité Sociale. Financièrement, elle est sous la coupe
du Ministère des Finances et du Budget. La Gestion elle, revient
au Ministère du Commerce, de la Promotion de l'Entreprise et de
l'Artisanat.
La CNSS est régie par un Conseil d'Administration
tripartite de 12 membres comprenant :
· 4 représentants des employeurs,
· 4 représentants des travailleurs,
· 4 représentants de l'Etat.
Siègent également en qualité
d'observateurs au Conseil d'Administration deux représentants de
l'Association des Retraités Burkinabè et un représentant
du Ministère du Commerce. L'Assemblée Générale des
Sociétés d'Etat, présidée par le Président
du Faso, tient lieu d'assemblée générale des actionnaires,
approuvant la gestion du Conseil d'Administration.
Aujourd'hui, avec plus de 900 agents repartis sur l'ensemble
du territoire national, la CNSS est dotée d'une Direction
Générale, d'un Secrétariat Général, de cinq
Directions Régionales ( Bobo Dioulasso, Ouahigouya, Dédougou,
Fada N'Gourma, Ouagadougou), de neuf services provinciaux et de quatorze
guichets de paiement dans la plupart des localités.
La Direction Générale de la Caisse et son
Secrétariat Général sont assistés dans leurs
tâches par huit Directions Centrales spécialisées :
-Direction du Recouvrement et du Contentieux (DRC)
-Direction des Ressources Humaines (DRH)
-Direction Administrative, Financière et Comptable
(DAFC)
-Direction de l'Informatique et de la Statistique (DIS)
-Direction de la prévention, de l'Action Sanitaire et
Sociale (DPASS)
-Direction des investissements et de la Gestion
immobilière (DIGI)
-Direction centrale des prestations (DCP)
-Contrôle et gestion de l'Audit interne (CG-AI)
La caisse dispose également d'un
service Communication et Relations Extérieures (COMREX) rattaché
à la direction générale.
En son article 18, la constitution du
Burkina Faso stipule que : « (...) Le travail, la
sécurité sociale, la protection de la maternité et de
l'enfance... constituent des droits sociaux et culturels
(...) ». L'article 20 précise pour sa part
que : « L'Etat veille à l'amélioration
constante des conditions de travail et à la protection du
travailleur »
Au vu de ces différentes dispositions, la CNSS a pour
mission de gérer le régime de sécurité sociale
institué au Burkina Faso en faveur des travailleurs salariés. Un
régime de sécurité sociale est un système de
protection sociale obligatoire institué par l'Etat dans le but de
protéger le travailleur et sa famille contre les risques pouvant
provenir soit du travail, soit de la maladie, soit de la vieillesse ou du
décès.
Les prestations de la CNSS comprennent trois
branches :
Ø La branche des prestations familiales. Elle offre des
services de prestations familiales et de maternité.
Ø La branche des risques professionnels. Elle est
chargée des prestations en cas d'accident du travail et de maladie
professionnelle.
Ø La branche des pensions. Elle s'occupe des
prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès.
Ces branches sont complétées par une action
sanitaire et sociale.
Les ressources de la CNSS sont
constituées par :
-les
cotisations
destinées au financement des différentes branches du
régime de Sécurité Sociale
-les pénalités encourues pour cause de retard
dans le paiement des cotisations ou dans la production des
déclarations nominatives de salaire;
- le produit des placements des fonds de la CNSS;
- les dons et legs.
La structuration de la CNSS donne une idée
de la taille et de l'importance de l'organisation. Ceci suppose l'existence
d'une communauté de personnes faisant partie intégrante de son
environnement interne. La nécessité s'impose pour ce qui est de
l'utilisation de supports de communication appropriés pour faire
fonctionner tout son rouage interne.
Cette communication aide à la coordination des
activités dans le but d'atteindre les objectifs fixés par la
Direction Générale. Ce qui nous amène à dire que la
communication est à l'entreprise ce que la circulation sanguine est au
corps humain !
Dans le souci de mieux cerner tous les contours de cette
première partie, nous essayerons d'identifier les outils de
communication utilisés par la CNSS.
II- Organisation de la Communication
A la CNSS, la communication est du ressort du service
communication et relations extérieures (COMREX). Placé sous
l'autorité d'un chef, le COMREX est chargé :
-de réunir et de conserver toute documentation relative
à la sécurité sociale
-de gérer la bibliothèque de la CNSS
-d'élaborer l'organe d'information de la CNSS (qui
n'existe plus)
-d'étudier et de mettre en place des moyens
d'information autres que le journal
-d'assurer un rôle de conseil aux services de la CNSS en
matière de communication externe (présentation des
imprimés, aménagement, accueil dans les guichets)
- de diffuser auprès des partenaires sociaux notamment
des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs des
documents nécessaires à leur information
- d'assurer le suivi des relations avec les institutions
nationales, régionales et internationales spécialisées en
matière de sécurité sociale et de santé au
travail
A l'analyse, on se rend compte que le terme «
Relations Publiques » conviendrait mieux
dans la mesure où l'accent est plus mis sur la communication externe,
c'est-à-dire, faire connaître la CNSS ainsi que les prestations
diverses qu'elle peut offrir aux usagers
En principe, le COMREX s'occupe de deux volets en
matière de communication :
II-1 La communication interne
Elle est théoriquement basée sur
l'amélioration des relations interpersonnelles et interprofessionnelles
(faciliter les contacts entre les agents et leurs supérieurs
hiérarchiques et entre les supérieurs eux-mêmes). Cette
définition n'est pas assez précise. Elle peut a priori
témoigner du fait que la CNSS n'attache pas trop d'importance à
sa communication interne.
En effet, il n'est nullement fait mention de
l'élaboration d'une politique de communication interne ; du
renforcement du sentiment d'appartenance à une famille d'entreprise, de
la sensibilisation du personnel sur les enjeux du marché et les valeurs
à promouvoir, de l'enracinement d'une culture d'entreprise...L'option
est globalement à la communication technique et non relationnelle.
II-2 La communication externe
Elle est basée sur la production, la reproduction et
la publication d'un certain nombre de documents dans l'optique de mieux faire
connaître la CNSS auprès de ses usagers. Il s'agit :
-du code de sécurité sociale
-l'affiliation des employeurs
-l'immatriculation des employés
-les autres formalités à remplir pour
bénéficier des prestations offertes par la CNSS
-Le guide de l'assuré qui contient toute les
informations sur l'organisation, le fonctionnement et les diverses prestations
assurées par la CNSS
--Les dépliants qui portent d'une part sur les trois
branches techniques de la sécurité sociale, d'autre part sur le
service social de la CNSS qui intervient dans la prise en charge des cas
sociaux ; des veuves et orphelins.
En outre, le COMREX a pour mission d'organiser des
séminaires et des sessions de formations dans les provinces à
l'intention des assurés.
III- Fonctionnement de la
Communication
III-1 Types de communication et outils
utilisés
A la CNSS, la communication est principalement de nature
administrative. Les documents qui y sont utilisés se repartissent en
deux types :
-les documents de fonctionnement qui sont les actes de
gestion, d'échange d'information, de procédures de
fonctionnement.
-les documents normatifs. Il s'agit de ceux qui
réglementent, qui édictent les dispositions, qui créent le
droit. Les actes de la première catégorie sont ceux qui nous
intéressent ici. De par leur nature, ils embrassent deux aspects de la
communication :
-La communication descendante
-La communication ascendante
III-1-1 La Communication
descendante
C'est une forme de communication qui se transmet du haut vers
le bas selon la hiérarchie établie. Parmi les outils
identifiés à ce niveau, on retient les supports écrits et
les réunions avec le personnel.
III-1-1-1 Les supports écrits
Les supports écrits traitent essentiellement des
questions d'organisation et de fonctionnement des services. A la CNSS, les plus
couramment utilisés sont la note de service, la note circulaire,
la décision. Ces documents sont généralement
diffusés par affiche, à l'intention du personnel concerné.
Ils procèdent des premiers responsables. Ils ont un caractère
obligatoire parce que revêtant une valeur décisionnelle et
réglementaire. Le contenu est relatif aux missions, aux affectations du
personnel, à l'intérim, etc. Mais l'outil d'information le plus
fréquent est la note de service. Elle n'obéit pas à une
périodicité précise de parution.
III-1-1-2 Les réunions avec le
personnel
Bien planifiée, la communication interne peut
être un stimulant pour un management opérationnel des ressources
humaines. Les réunions avec le personnel sont donc importantes. En
effet, aucun agent ne peut donner le meilleur de lui même sans un
environnement propice à cet effet. Les réunions ont alors pour
objectif de permettre une personnalisation de l'information et une
ébauche de communication.
Au niveau de la CNSS, cette forme de communication existe.
Mais elle émane surtout de la Direction Générale. Celle-ci
convoque des réunions sporadiques et spontanées avec les
différents directeurs et chefs de services. Ce sont des séances
d'échanges et de réflexion sur le fonctionnement de l'entreprise.
De ces réunions procèdent les grandes décisions de
l'entreprise.
Au niveau des directions ou des services, ces cadres de
rencontres sont rares. Le manque de temps est la raison la plus avancée.
Mais lorsqu'elles ont lieu, ces réunions portent
généralement sur :
- Les problèmes ponctuels rencontrés par une
Direction ou un Service
- Les affectations et les avancements
- Le programme d'activités
- Le bilan financier
- La gestion financière de l'organisation.
Toutefois, ces réunions sont insuffisantes de
façon générale. Elles sont décidées au coup
par coup. C'est ainsi que des travailleurs avouent pouvoir passer plus de deux
mois sans pouvoir s'entretenir avec leurs supérieurs
hiérarchiques. Il s'en suit incompréhensions, rumeurs, perte de
confiance mutuelle...Un agent explique : « Nous avons
parfois envie de dire haut ce que nous pensons au plus profond de nous
mêmes ; mais le cadre adéquat n'existe pas. Cette situation
se répercute sur le déroulement normal de nos activités et
pose du même coup la problématique de l'intérêt
accordé à la communication interne à la
CNSS ».33(*) Il y a donc un frein à la diffusion de
l'information opérationnelle et motivationnelle.
III-1-2 La communication ascendante
C'est une forme de communication qui se transmet du bas vers
le haut. C'est- à- dire que ce sont les subordonnés qui
transmettent des renseignements à leurs supérieurs
hiérarchiques. A la Caisse, cette forme de communication est
pratiquée par les supports écrits, les cercles de qualité
et les activités du COMREX.
III-1-2-1 Les supports écrits
Les supports écrits de la communication ascendante
sont les notes, les rapports, les comptes-rendus. Les agents y font recours
pour fournir des informations à leurs supérieurs
hiérarchiques. Il s'agit d'attirer l'attention de ces derniers sur une
ou plusieurs questions (activités, inspection, missions...) afin de leur
permettre d'en avoir une idée précise.
III-1-2-2 Les cercles de qualité
Les cercles de qualité sont des petits groupes de 03
à 10 personnes appartenant à la même unité de
travail qui se réunissent volontairement pour identifier et
résoudre des problèmes relatifs à leurs activités.
Théoriquement, leur but est d'améliorer l'organisation et les
conditions de travail, l'information et la communication, de développer
l'adhésion du personnel et son degré d'engagement dans
l'entreprise... Le cercle de qualité se distingue donc par son approche
basée sur une culture de management participatif.
III-1-2-2-1 La genèse des cercles de
qualité à la CNSS
Au départ, ce sont la Direction Générale
des Impôts (DGI), la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires
(CARFO) et la CNSS qui avaient été identifiées par le
ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat pour
expérimenter la démarche cercles de qualité.
La CARFO et la CNSS qui sont des établissements de
prestations de services chargés à ce titre de gérer les
pensions et autres prestations sociales au profit des travailleurs
affiliés, étaient confrontées à d'énormes
difficultés d'ordre technique et organisationnel
présentées comme suit :
-Problèmes de communication des
travailleurs avec les retraités
-Problèmes de communication entre les agents en
contact direct avec les usagers et la hiérarchie
-Problème d'accueil des usagers
-Problèmes de traitement des dossiers de pensions
-Problèmes d'amélioration du climat social entre
les travailleurs
-Problèmes de création d'un cadre de travail
agréable34(*)
Pour faire face à ces difficultés, des cercles
de qualité seront crées en 1981 à la CARFO. Quant
à la CNSS, ce n'est qu'en janvier 1995 que les cercles de qualité
y ont vu le jour.
III-1-2-2-2 La politique de la qualité au sein
de la CNSS
La politique de la qualité à la CNSS est
basée sur le principe selon lequel l'ensemble du personnel doit
travailler à la pérennisation, au développement et au
rayonnement de la caisse. En contre partie, la CNSS doit veiller à ce
que son personnel soit toujours compétent et enthousiaste pour fournir
à la clientèle de meilleures prestations. Pour ce faire, la
politique de la qualité a pour but :
- d'accroître la qualité des services
- de maintenir un haut niveau de motivation, une bonne
ambiance de travail et un climat social harmonieux,
- de créer un esprit de corps, de
fidélité à l'institution, l'estime, la confiance mutuelle
entre les travailleurs d'une part, entre les travailleurs et la direction
d'autre part.
De nos jours, on compte une trentaine de cercles de
qualité à travers toutes les Directions centrales et
régionales de la CNSS.
En nous référant à
l'état général des thèmes
traités par les différentes cellules des cercles de
qualité de la CNSS35(*), le déficit d'information et le
manque de dynamisme apparaissent à première vue comme les
problèmes généraux rencontrés par les
différents services.
C'est pour cette raison que dans la plupart des solutions
préconisées, la communication est explicitement ou implicitement
notée.
Mais en réalité, il y a un
désintérêt pour ces cadres d'échanges. Les agents
ont l'impression qu'ils « perdent leur temps »
d'autant que leurs propositions ne sont généralement pas prises
en compte.
III-1-2-2-3 Interactions sociales et dynamique de
groupe
La CNSS, comme toute autre organisation est
un environnement social regroupant des personnes venant d'horizons divers. Il y
a alors émergence du désir de se faire des relations et de
partager des idées. Ces rapports jouent sur le fonctionnement de
l'organisation.
La communication liée à la
sphère interpersonnelle est influencée non seulement par la
politique de l'organisation, mais aussi par divers comportements
rattachés à chaque individu. Si chaque agent a sa façon de
communiquer au niveau informel, il devient impérieux
d'appréhender les différentes caractéristiques de ce mode
de communication et de voir leur implication dans le management de
l'entreprise. Cela est d'autant plus important que cette communication
informelle est à même de conditionner le succès de la
communication formelle.
De nos entretiens, il ressort que les agents de la CNSS n'ont
pas les mêmes centres d'intérêts lorsqu'il s'agit de
communication informelle. A titre illustratif, les cadres hautement
qualifiés tels les directeurs et chefs de service déclarent
qu'ils discutent généralement de la réputation de
l'organisation, de ses rapports avec ses usagers et son environnement... Le
souci de l'ordre et le fonctionnement des services sont évoqués
tant par les cadres supérieurs que par les cadres moyens. Dans une
dernière catégorie, on retrouve les agents d'exécution.
Leurs actions sont orientées vers le travail. Lorsqu'ils se retrouvent
de façon informelle, ils aiment échanger sur des problèmes
d'ordre général (vie quotidienne, culture, politique...)
Bien que les différentes catégories se forment
autour d'intérêts bien précis et qu'elles soient sous
tendues par des relations interpersonnelles, il n y a véritablement pas
de barrières étanches entre elles. La communication à ce
niveau peut se faire de façon spontanée. C'est pourquoi, dans
certaines directions et services, on constate des contacts informels entre le
« chef » et certains de ses subordonnés.
Mais, il y a une absence de convivialité
nécessaire aux échanges. Linéaire, la communication
interne de la Caisse n'est pas de nature à promouvoir la fluidité
de l'information, à susciter l'échange entre les
différents acteurs de l'entreprise. Il est évident, qu'au sein de
toute organisation, il y a des leaders et des subordonnés. Mais encore
faut-il que la hiérarchie soit attentive aux attentes des agents
d'exécution pour mieux ajuster ses décisions. C'est pourquoi,
même si la communication descendante est essentiellement
constituée d'ordres et de directives, elle doit être
accompagnée d'explications claires et sans équivoques pour
faciliter l'appropriation des objectifs de l'entreprise et favoriser
l'adhésion de tous. C'est dans ce sens qu'elle recouvrira un
caractère motivationnel.
III-2 Mode de Communication
Après ce bref tour d'horizon sur les
outils de communication, plusieurs constantes se dégagent :
Première observation majeure : la
communication interne de la Caisse n'a pas d'orientations stratégiques
bien définies.
Confinée dans son approche informationnelle, elle
souffre du poids de l'autorité. Le message émane essentiellement
de la direction ou de l'encadrement (chefs de sections et de services).
De ce fait, la prédominance du canal
hiérarchique compromet la valeur de la rétroaction (feed-back)
dans les relations professionnelles de l'entreprise Les cadres de concertation
faisant défaut, la possibilité pour les agents de rencontrer avec
aisance leurs supérieurs hiérarchiques s'en trouve alors, bien
réduite. Même entre eux, les conditions ne sont pas réunies
pour une bonne communication. Il est difficile dans ces situations de
connaître réellement les aspirations du personnel et de
désamorcer les éventuels conflits ou tensions. C'est du reste
pour cette raison que les agents évoquent les incompréhensions,
les frustrations,... La communication reste souvent en marge des
stratégies de la CNSS. Les premiers responsables ne lui accordent que
peu, ou pas d'importance. Elle est certes formalisée. Mais cette
communication n'a pas d'emprise réelle sur le cours de l'organisation.
Ses actions restent ponctuelles et limitées.
On note par exemple une absence de réunions
hebdomadaires de Direction. Elles sont cependant des moyens pour le personnel
de s'exprimer auprès de la Direction. Dans ce cas précis,
l'ensemble des agents ne prend pas part aux échanges. Ce sont
plutôt leurs responsables directs qui rapportent leurs attentes à
la Direction. C'est une forme de communication à deux étages qui
favorise une remontée systématique des avis et suggestions du
personnel vers la hiérarchie, par l'entremise des Chefs de Service.
Egalement absentes, les Assemblées
Générales du personnel. L'importance de ces rencontres, c'est
qu'elles permettent aux responsables et à l'ensemble du
personnel de discuter sur le fonctionnement de l'entreprise. C'est l'occasion
pour chaque acteur d'exprimer ses attentes et, éventuellement de faire
des propositions. Les assemblées générales constituent des
cadres d'expression pour le personnel et un moyen pour la Direction
d'évaluer l'état social de l'entreprise et partant un outil de
gestion participative et objective.
Mais du fait de la faiblesse d'élaboration de la
communication interne, ces différentes réalités
constituent des handicaps pour la CNSS.
Si la communication nourrit l'organisation, celle-ci va
à son tour diffuser du sens et communiquer une identité. Tout
« communique » dans l'entreprise. Tout est porteur
de sens. Mais à force de privilégier le canal
hiérarchique, l'entreprise peut subir un déficit en
matière de circulation de l'information. Normalement, ce qui est
vécu au niveau de la base devrait transiter par la voie
hiérarchique et être parfaitement connu de la direction.
En effet, l'encadrement en tant que relais dans le
réseau formel de communication est censé faire remonter les
informations qu'il reçoit. Or, bien souvent, et à en croire la
majorité des directeurs, cette répercussion n'est pas faite.
Cependant, même retransmise, il n'est pas exclu que l'information soit
victime de nombreuses déformations. Plus le circuit est long, plus la
distance hiérarchique est importante, moins les chances d'une
écoute fidèle sont réelles.
La deuxième observation majeure, c'est
la structuration hiérarchique de la caisse. A la CNSS, le COMREX est
rattaché à la Direction Générale. Cette
structuration peut faciliter la réflexion en amont du fait de la
proximité entre le communicateur et le premier responsable. Cependant,
elle peut également favoriser le cloisonnement de la communication. En
ce moment, le communicateur peu quelque peu perdre de sa
crédibilité à cause de sa trop grande dépendance.
Du reste, l'actuelle structuration ne permet pas au service de communication
d'entreprendre des initiatives ou actions conséquentes en
conformité avec les enjeux du moment.
Certaines initiatives du COMREX doivent par exemple être
soumises à l'analyse et à l'approbation de la hiérarchie.
Cela prend parfois du temps si bien que l'efficacité des actions
prévues peut en pâtir. Le service de communication étant
ainsi limité, l'entreprise est souvent confrontée au
phénomène de l'inflation ou de la pénurie des
échanges. C'est ainsi que la profusion des notes de services crée
un risque de confusion et de perte de sens. Pour ce qui est de la
pénurie, elle est le fait de la rétention d'information
provoquée par les querelles de prérogatives. L'absence de
politique et de plan de communication entraîne une juxtaposition des
actions sans coordination véritable entre elles. Les interventions du
COMREX sont donc ponctuelles et quelquefois sans objectifs précis.
Lorsqu'une action n'est cependant pas soigneusement pensée et
planifiée, elle comporte une marge d'erreurs proportionnelle à
son imprécision.
La lourdeur administrative et la lenteur des
procédures décisionnelles constituent donc des embûches au
dynamisme de la communication. C'est pour cette raison que
Marie-Hélène Westphalen enseigne que plus il y a
de niveaux hiérarchiques, moins la communication ascendante et
descendante sont favorisées.
A la CNSS, la politique globale est définie par le
sommet de la hiérarchie. C'est la même instance
décisionnelle qui définit également la structuration de
l'organisation et les champs de compétences de chaque fonction selon les
besoins. Ainsi, les choix qui sont faits et les discussions appliquées
en matière de communication relèvent à divers niveaux de
l'appréciation personnelle des premiers responsables. Le responsable du
service de communication fait part des difficultés qu'il vit au
quotidien en raison de la méconnaissance par certains de ses
responsables des enjeux de la communication. La CNSS fait ainsi appel à
l'Agence Synergie pour ses actions de communication (dépliants,
calendriers, stratégies de communication, spots publicitaires...)
parfois sans en informer le COMREX. Cet état de fait nous pousse donc
à nous interroger sur la motivation réelle de la formalisation de
la communication et sur la dimension de l'implication à la CNSS.
Les salariés sont aujourd'hui des acteurs de
l'entreprise. Il n'est plus possible de les mobiliser sans les tenir
informés des objectifs économiques, financiers, sociaux,
politiques, éthiques et culturels. Le faire, serait courir le risque de
ne communiquer que des finalités alors que la transmission du sens du
projet est primordiale. Les travailleurs ne peuvent s'approprier ce qu'ils ne
comprennent pas.
La communication interne ne se borne donc pas aux outils. Elle
suppose contenu, conception et stratégie d'entreprise. Elle se situe
dans la recherche, la remise en cause mais aussi dans la connaissance des
hommes qui composent la structure et son environnement. Ce qui n'est pas
vraiment le cas de la CNSS où on note un manque de cohérence dans
l'utilisation des outils. Il en résulte que la communication formelle
prend le pas sur les relations humaines. Les outils sans la stratégie
sont la ruine de la communication. En ce sens, la fonction communication
repose fortement sur l'identité de l'entreprise. Elle dépend de
sa taille, de son organisation, de son ancienneté, de sa culture
(rapports Direction/ Salariés plus ou moins développés).
Les travailleurs de la CNSS se forgent progressivement une
représentation de leur organisation En retour, celle-ci devrait leur
permettre de donner une signification aux événements qui
surviennent.
Au constat cependant, les conflits naissent souvent de la
méconnaissance de l'autre, en tant que personne et en tant que
représentant d'une fonction. C'est dire qu'il y a un problème
lié à la négociation de la réalité
quotidienne. L'intérêt de cette dimension est d'éclairer
sous un jour particulier la façon dont les groupes en présence
dans l'organisation en arrivent à ne plus se comprendre. La plupart des
réactions de rejet des collaborateurs proviennent donc du peu de temps
consacré par les managers de la CNSS à s'assurer que tous les
membres de l'organisation vivent sur une même planète. Cela
aboutit à un mode de communication globalement descendant et
autoritaire.
Au terme de cette première partie, nous avons
tenté d'identifier les outils de communication puis de jeter un regard
critique sur le mode de communication de la CNSS. Au bilan
général, il ressort que la communication est confrontée
à des difficultés de structuration et d'efficacité.
Quelles peuvent en être les conséquences sur le système
managérial de la Caisse?
Deuxième
Partie :
CONSEQUENCES DU MODE DE COMMUNICATION SUR LE
MANAGEMENT DE LA CNSS
Après avoir dressé l'état des lieux des
outils de communication de la CNSS, nous avons trouvé opportun d'en
faire une analyse critique dans l'optique de mettre à nue les obstacles
qui minent sa communication interne et ses répercutions sur
l'organisation.
C'est pourquoi nous nous pencherons sur trois points
essentiels dans cette partie :
-Les problèmes organisationnels
-Les problèmes sociaux
-Les problèmes psychologiques
I- Les problèmes organisationnels
Tour à tour, nous allons analyser les problèmes
organisationnels en fonction des axes suivants :
-La participation aux décisions
-Le développement des rumeurs
-La DRH et le management du personnel
I-1 La participation aux décisions
A la CNSS, même des cadres supérieurs sont
surpris de l'application d'un certain nombre de décisions. La
participation aux prises de décisions se présente donc
ainsi :
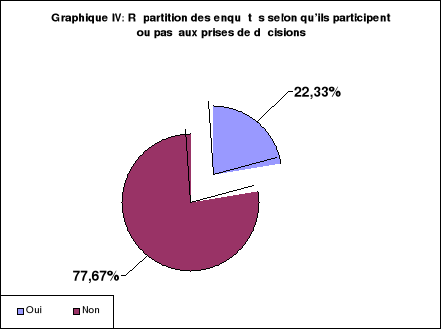 Source : Enquête de terrain
Source : Enquête de terrain
A la CNSS, 77,67 % des agents affirment ne pas participer aux
prises de décisions. Pour beaucoup : « c'est une
affaire de chefs », « ça ne nous regarde
pas », « nous n'en savons rien »...
Certes, il faut admettre qu'en général la prise
de décision allant dans le sens des orientations stratégiques
revient dans un premier temps à la Direction Générale.
Mais il n'est pas exclu que des cadres de concertation permanents et
parallèles soient mis en place pour prendre en compte les avis des
acteurs sur le terrain.
C'est fort de cela que nous soutenons que lorsque les
attitudes des travailleurs sont caractérisées par l'une des
causes précédemment citées, cela peut constituer un
obstacle majeur à la communication.
Il en est ainsi de la bureaucratisation, toujours
présente à la CNSS. Elle constitue un obstacle non
négligeable à l'exécution des tâches et à la
satisfaction rapide des besoins des usagers de la CNSS. Elle se
caractérise par le principe de la hiérarchie à savoir que
chaque palier inférieur est placé sous le contrôle et sous
la supervision d'un palier supérieur. Cette structuration rend
complexe la circulation de l'information (temps, déperdition et
distorsions).
Il se pose alors la problématique de la nature des
rapports entre les postes, des relations interprofessionnelles et de la
dynamique des groupes. Comme le martèle un chef de service :
« La communication, cette nécessité vitale est
quasiment inexistante à la caisse. Bien que nous soyons à un
niveau élevé de responsabilité, nous sommes quelquefois
sous-informés ou pas du tout informés sur de grands projets de la
maison. La structuration et le rôle du service de communication doivent
de ce fait être redéfinis. A la limite, le COMREX ne fait
qu'occuper l'espace ! »36(*)
Ces propos sont corroborés par le responsable du
COMREX lui même qui s'en défend tout de même. Pour lui,
cette situation s'explique par « le manque de
coordination » entre la Direction Générale et le
COMREX. Conséquences, il estime que « rien n'est
centralisé au niveau du COMREX ». Il va plus loin en
affirmant que certains directeurs n'ont appris les problèmes de gestion
à la CNSS « que par la presse ». L'air
abattu, il finira par lâcher : « si les autres sont
plus informés que vous, vous ne pouvez pas aller
loin »37(*). C'est dire l'état des pratiques
communicationnelles à la CNSS.
La prise de décision peut également être
révélatrice du style de management dominant. A la lumière
des éléments disponibles, le style directif l'emporte à
la CNSS. On peut le cerner à travers ce graphique :
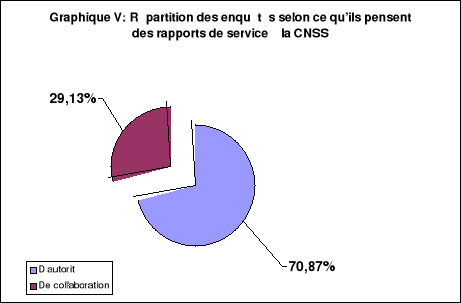 Source : Enquête de terrain
Source : Enquête de terrain
Ainsi, à la CNSS, 70, 87% des enquêtés
estiment que les rapports dominants sont ceux basés sur
l'autorité. « Ici à la CNSS, les décisions
se prennent en haut. Conséquence, il y a très
régulièrement incompréhension, démotivation,
blocage...lors de leur application. Sur le coup, c'est toute la maison qui
empathie.»38(*)
Cri de détresse d'un agent.
Les pratiques devraient plutôt favoriser un processus
dynamique d'autant plus q'aujourd'hui, « l'information (et par
là, la communication) est un pouvoir à utiliser en tant que
système aux fins d'une bonne gestion et d'un bon management. Toute prise
de décision ou toute action à entreprendre dans l'organisation
pour planifier, organiser, superviser, diriger, coordonner, contrôler,
budgétiser... gérer, en vue de répondre à la
matrice des attentes de tous les acteurs sous-tend une sélection de la
communication et l'évaluation des choix
passés »39(*).Telle est la conviction de E.R. Moss et
D.Gow
La performance de toute entreprise est donc la
résultante d'investissements conséquents à tous les
niveaux de son processus de production. Cela suppose la disponibilité de
moyens matériels et humains adaptés pour son bon fonctionnement,
mais aussi et surtout d'un mode de conduite (philosophique ou culturel),
capable de susciter l'implication et le dévouement de ses membres pour
ses différentes causes.
« En réalité, le management ne
peut s'épanouir que dans un travail d'équipe. Un cadre qui
n'écoute pas découvrira bientôt que ses collaborateurs
n'ont plus envie de lui faire par de leurs idées. Un tel système
peut fonctionner un certain temps. Mais en fin de compte, tout cadre a besoin
du feed-back actif de son entourage. Le silence obstiné du personnel est
rarement un signe d'accord avec le patron »40(*).Position de
James O. Mc Donald
I-2 Le développement des rumeurs
La communication spontanée, le désordre et la
rumeur sont à la fois des mécanismes de défense et des
révélateurs d'une mauvaise communication. Il y a au sein de la
CNSS, un besoin inhérent à chaque agent. Savoir où il est,
où il va, s'il y a des opportunités et des menaces...Selon
Philippe Béon : « Si ces attentes
sont insuffisamment insatisfaites et l'information absente, chacun pour se
défendre se précipitera sur tout ce qui peut être un
élément de réponse »41(*). C'est donc parce que chacun
prête à l'information une réalité qu'elle n'a pas et
déforme la réalité par la projection de ses
inquiétudes et de son insécurité, que naît la
rumeur.
« L'Affaire CNSS » par exemple a
été au coeur de bien de rumeurs. Pendant que certains niaient
totalement les faits, d'autres chargeaient la direction de tous les
pêchés d'Israël. Et à ce jeu, c'est celui qui
arrivait à convaincre le plus qui l'emportait. Evidemment, les
antagonismes ont fini par installer la méfiance, la suspicion... Mais
pour ce chef de service, « Même en dehors de ce cas
(l'Affaire CNSS), les bruits de couloirs sont monnaie courante ici à la
caisse. Les gens montent souvent des histoires de toutes pièces pour se
régler les comptes. Si ce n'est pas le cas, ce sont des informations
fantaisistes qui sont distillées sans qu'on ne puisse en
déterminer la source ». Justement, ce genre
d'informations faisaient cas de la décision du ministre du Travail et de
la Sécurité Sociale, de venir s'entretenir personnellement avec
tous les agents sur les problèmes de fonctionnement de la CNSS. Au
finish, il n'en sera rien.
La rumeur, « ce plus vieux média du
monde », selon l'expression de Jean Noèl
Kapferer, apparaît donc comme un palliatif face à un
manque de communication ou une communication abondante mais
déconnectée des réalités perçues par les
salariés.
Alex Mucchielli quant à
lui, voit en la rumeur un phénomène pathologique
qui reflète la dépression morale chez l'individu comme la
déficience des structures institutionnelles. Forme
d'anxiété personnelle ou collective, la rumeur reflète des
structures de carence et par là même un déséquilibre
du fonctionnement social.
La communication participe de la survie de leur organisation.
C'est en réalité à partir de la double frustration (pas le
pouvoir de savoir, pas le pouvoir de s'exprimer), que la rumeur s'amplifie.
L'information est un besoin. Le besoin de savoir qui se rattache au besoin de
sécurité. C'est le besoin de maîtriser
l'anxiété concernant l'avenir. Quand il y a absence
d'information, le personnel est désemparé. La communication doit
donc assurer un équilibre entre information descendante et ascendante.
Sinon, le besoin et la satisfaction de pouvoir s'exprimer prennent le pas sur
le souci de la vérité.
Ce déséquilibre est visible à la CNSS au
point où de nombreux travailleurs ne connaissent ni le COMREX ni les
activités qu'il mène ou est censé mener au sein de la
caisse.
Alors, à la question de savoir quelle
perception ils ont de la communication interne de la CNSS, les réponses
des enquêtés sont sans ambages :
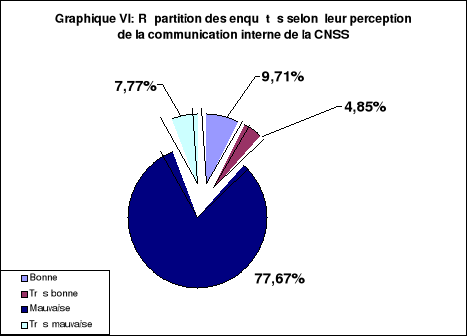 Source : Enquête de terrain
Source : Enquête de terrain
Ainsi, 77, 67% affirment que la communication interne de la
caisse est « mauvaise ». 7,77% la trouvent
même « très mauvaise » .Cela veut
donc dire qu'une politique globale et intégrée de gestion de la
communication fait défaut. D'où le fait que la rumeur
bénéficie d'un terreau particulièrement fertile. Une
communication qui ne mobilise pas et qui ne motive pas à peu de chance
d'orienter le personnel vers ses objectifs stratégiques. D'ailleurs,
pour Bernard Miège : « La
communication, en effet, n'est pas un projet qui se développerait de
façon autonome et ainsi ajouterait ses
« bénéfices » à l'entreprise de
l'extérieur. Elle s'insère dans le « système
social » existant et intervient au sein même des relations de
travail et s'intègre aux organisations telles qu'elles fonctionnent et
sont structurées »42(*). L'entreprise ne peut atteindre une telle dimension
sans se forger une identité forte et valorisée. Il importe alors
de travailler à l'émergence d'un nouveau management qui
définisse pour chaque public visé ce que l'on veut qu'il pense ou
fasse.
Mais à l'étape actuelle, la communication au
sein de la CNSS reste encore lacunaire et intermittente. Or,
« L'entreprise n'a plus le choix: elle doit s'affirmer, parler,
dialoguer. En un mot, communiquer. » 43(*)
En effet, une communication optimale au sein de l'entreprise
permet d'établir le dialogue entre ses membres, toute chose qui est
source de synergie, facteur de motivation des hommes, donc d'accroissement du
rendement. De même, elle apporte des informations indispensables dans les
domaines économique, social et politique pour entreprendre des actions
de changement dans l'organisation. L'intégration sociale, la direction
des affaires... ne sont aucunement possibles sans information. L'information
doit être considérée comme la pierre angulaire de
l'édifice communicationnel de l'entreprise. Ceci parce que son absence
ou son altération porte préjudice à toute action de
développement tant politique, social qu'économique. Comme le
souligne Tocqueville : « Sans idées
communes, il n y a pas d'actions communes, et sans actions communes, il existe
encore des hommes, mais non un corps social »44(*).
Il est vrai que tous les lieux, tous les organismes,
où s'instaurent les relations humaines seraient susceptibles de
développer des rumeurs. Des rumeurs qui peuvent être
considérées comme indices de crise, d'inconfort... Mais celles-ci
ne doivent pas devenir le vecteur principal de communication. Les organisations
traditionnelles hiérarchiques et centralisées, avec leur longue
chaîne d'autorité et leur système de communication
principalement dirigé vers le bas, ne sont pas conçues pour
s'adapter rapidement au changement.
Voyons maintenant l'action de la Direction des Ressources
Humaines (DRH) en terme de management du personnel.
I-3 La DRH face au management du personnel
Le management des ressources humaines détermine
fondamentalement l'évolution d'une entreprise. Il permet en effet
d'évaluer les besoins de la structure en ressources humaines, d'orienter
les salariés dans leur travail... C'est ainsi que la CNSS dispose d'une
Direction des Ressources Humaines (DRH).Placée sous l'autorité
d'un directeur, elle a compétence pour traiter de tous les
problèmes d'ordre administratif relatifs au management du personnel et
à sa carrière.
Dans cette optique, la DRH est spécifiquement
chargée:
- de l'organisation des procédures de
recrutement et du management du personnel
-de l'élaboration de textes relatifs au statut du
personnel et de tous les autres textes concernant les relations
professionnelles.
-du contrôle de l'application des décisions du DG
se rapportant à son domaine de compétence
-de la gestion des carrières du personnel par la
formation et le recyclage
-de le préparation de la paie du personnel
Il s'agit là de l'administration du personnel ou la
gestion quotidienne. C'est donc la dimension bureaucratique avec comme
contenu :
- l'application des textes législatifs
- le maintien de la discipline
- le recrutement du personnel
- la gestion de la formation et de la
rémunération
Mais sur le terrain, la DRH n'arrive pas véritablement
à bien jouer ce rôle. A titre illustratif, elle ne dispose pas
d'une politique formalisée de gestion des ressources humaines.
Cependant, cette politique est importante car elle permet de développer
la motivation par l'élaboration d'un projet d'entreprise ou de
différentes formes de participation des salariés Cette politique
peut également permettre d'assurer la qualité du climat social
en recherchant l'adhésion du personnel aux objectifs de l'organisation
et en diffusant les informations nécessaires.
Cela veut dire qu'au delà de la fixité de
l'organisation implantée dans l'espace, se trouve une vie sociale
effervescente où se mêlent et s'affrontent les idées, les
sentiments, les intérêts et les aspirations les plus
contradictoires. Dans la poursuite de ses objectifs, la Caisse doit donc s
`efforcer de canaliser et d'orienter cette effervescence pleine
d'imprévus.
La CNSS ne pouvant exister que par les hommes qui l'animent,
il y a en outre nécessité que ceux-ci soient
conséquemment formés. C'est du reste une des tâches de la
DRH. A cet effet, elle élabore chaque année un plan de formation.
Il s'agit de l'ensemble des actions de formation, de bilans des
compétences et de validation des acquis de l'expérience que
l'entreprise veut faire suivre à ses salariés. Il est en relation
directe avec les objectifs de développement de l'entreprise. Il comporte
généralement trois types d'actions de formation : adaptation
au poste de travail, formation liée à l'évolution des
emplois et au maintien dans l'emploi, développement des
compétences.
En 2006, le plan comportait 58 formations avec des
thèmes touchant à l'analyse financière et comptable, la
résolution des conflits par la négociation et la
médiation, le management de la formation, les outils et
procédures de Gestion des Ressources Humaines...
Mais de façon générale, les formations
sont plus axées vers les cadres qu'en direction du personnel
exécutant. Il se pose alors le problème de leur insuffisance.
Pis, les autres agents ont le sentiment d'être des
« laissés pour compte ». Il apparaît
alors que la formation ne peut jouer un rôle primordial dans
l'organisation, que si elle profite à l'ensemble de ses acteurs. Cette
stratégie peut favoriser la mise au point des acquis, le
développement des compétences et l'acquisition de nouveaux
savoirs pour les salariés et leurs dirigeants.
Pour être réellement efficace, le management des
ressources humaines doit également s'appuyer sur les outils et
techniques d'information et de communication. A la CNSS, il n'existe cependant
pas de collaboration étroite entre le COMREX et la DRH.
Or, « la communication interne n'a
d'efficacité que si elle est accompagnée par une politique de
relation humaine concordante et par un appui du management de l'entreprise. A
défaut de cette connexion, la communication interne s'apparente à
une simple politique d'information descendante dont les effets seraient
limités. »45(*)
C'est du reste pour cette raison que se pose un
problème même sur le sentiment que les employés ont sur la
CNSS. On peut le constater à travers le graphique suivant :
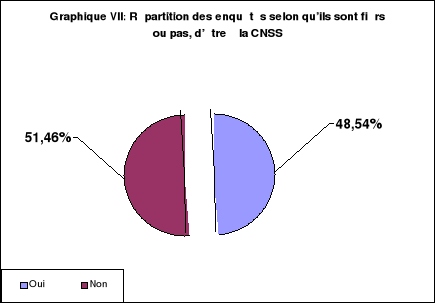 Source : Enquête de terrain
Source : Enquête de terrain
Comme on le constate, 51,46 % des enquêtés
affirment ne pas être fiers de travailler à la CNSS contre 48,54%
qui soutiennent le contraire. La majorité qui se dégage ici
évoque principalement « le manque de
motivation » et « l'absence de
considération ». Il se pose donc le problème de
l'identification à l'organisation et surtout celui de
l'indifférence qui tend à se développer au niveau des
agents de la CNSS.
En effet, beaucoup d'entre eux n'hésitent pas à
affirmer qu'ils sont davantage mus par les avantages économiques que par
une quelconque recherche de performance. D'où cette logique du
« strict minimum » : « faire
quelque chose pour justifier uniquement son salaire ». Comme
l'enseigne la théorie des relations humaines, le management comprend de
façon générale, deux principales
activités :
- Une activité d'ordre opérationnel prenant en
compte les fonctions de planification, d'organisation, d'acquisition, de
conservation. C'est ce que fait en partie la DRH.
- Et une activité énergétique qui
consiste à la création d'un climat organisationnel satisfaisant
et valorisant utilisant des ressources humaines productives, disponibles et
relativement stables. Et tout cela, à travers une politique de
communication dynamique.
Il est donc indéniable de nos jours que la fonction
communication joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la
planification, de l'organisation et du contrôle des Ressources
humaines.
C'est pourquoi l'absence d'une politique de management des
ressources humaines peut être un obstacle à la communication.
S'agissant du volet communication, une étude avait
été réalisée en 1999 par l'Agence de communication
EDIFICE dans l'optique de proposer un projet de
stratégie de communication à la CNSS. Cette étude a fait
ressortir les points suivants :
-Un manque de culture d'entreprise des agents de
première ligne. Ici, compte tenu de sa structuration et de son mode de
fonctionnement, on peut dire que la CNSS est une organisation conservatrice et
bureaucratique. Les décisions en matière de management des
ressources humaines y sont centralisées et axées sur le respect
des procédures :
-Une déperdition dans la circulation de l'information
entre les services. Cela provoque le recours à la rumeur comme canal de
communication.
-Un manque d'outils d'identification des besoins d'information
du personnel
-Une diffusion verticale de l'information.46(*)
Aujourd'hui encore, ces problèmes demeurent. En faisant
une analyse globale des points ci- dessus cités, le problème de
communication soulevé ici est lié à un déficit
d'information sous tendu par un management quelque peu inapproprié des
ressources humaines.
Jean -Pierre Beal et Pierre André Lestocartp
démontrent toutefois que : « La clef
réside aujourd'hui plus que jamais dans le management et la
communication. Aucune entreprise ne peut réussir durablement si elle ne
traite pas ses salariés, sans exception, comme ses premiers clients. Si
elle ne comprend pas que plus ses équipes apprécient leur cadre
et leur ambiance de travail plus celles-ci délivrent une bonne
qualité de service »47(*)
L'idée de base c'est que les objectifs de la Caisse ne
seront véritablement atteints que si les travailleurs se sentent
intégrés dans leur organisation de façon pratique. Le
travail n'est source d'épanouissement et de réalisation de soi
que si les besoins et les attentes des travailleurs y trouvent satisfaction.
Mais à la CNSS les problèmes organisationnels ne
sont pas les seuls obstacles liés à la communication. On a pu
également identifier des conflits sociaux.
II-Les conflits sociaux
Les conflits entre les hommes et les services sont
considérés comme des déviations du comportement normal.
La plupart du temps, ils sont dû à une absence de leadership, de
gestion participative, d'échec de planification ; etc.
Ces conflits sont généralement attribués
à des problèmes interpersonnels qui peuvent avoir un impact
négatif considérable sur le fonctionnement de l'organisation. A
la CNSS, l'existence de conflits se présente ainsi :
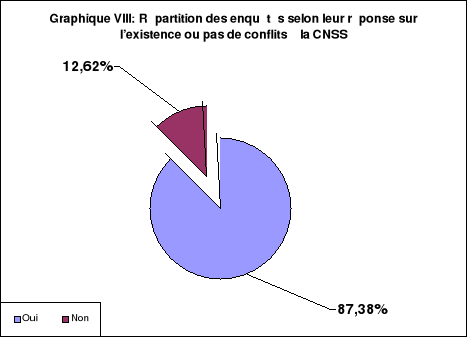
Source : Enquête de terrain
A 87,38%, les enquêtés reconnaissent
l'existence des conflits à la CNSS. Pour les sources, ils
évoquent entre autres :
-l'incompatibilité des objectifs de l'organisation avec
ceux de l'individu
-les conflits entre spécialistes et
généralistes
-les conflits de différence de niveaux
-les conflits de différence de salaire
A ces sources de conflit se rattachent des formes qui, dans
la plupart des cas, sont des disputes pour la possession d'une ressource rare,
d'un statut social, d'un prestige, ou du pouvoir. Pour ce qui est du cas
spécifique de la CNSS, les problèmes sociaux identifiés
sont de deux ordres :
II-1- Les conflits de compétences
Contrairement au malentendu qui est avant tout subjectif et
souvent unilatéral, le conflit de compétences est toujours
réciproque et comporte nécessairement une dimension objective.
Mais tant qu'il ne s'agit que d'une concurrence réelle entre deux
personnes pour l'obtention d'un bien trop rare, on ne peut pas vraiment
considérer qu'il s'agit d'un conflit de compétences.
C'est lorsque les deux personnes en rivalité commencent à
accorder plus d'attention à leur adversaire qu'à l'objet qu'elles
désirent, qu'on peut évoquer le conflit. Sans ce
détournement de l'attention, il ne s'agit que d'une compétition
réelle que la situation rend nécessaire. Dans le conflit de
compétences, l'agressivité est dirigée vers l'adversaire
lui-même, au moins en partie. Celui-ci n'est plus seulement un adversaire
ou un obstacle à l'atteinte de la satisfaction, il devient un ennemi.
Les conflits de compétence sont remarquables dans
certaines directions de la CNSS. Les deux cas que nous avons identifiés
opposaient le chef de service au chef de section. Ce dernier avançant
que c'est lui qui devrait occuper le poste de
« chef » compte tenu de son ancienneté, de
ses aptitudes et de ses compétences. Dans un tel cas de figure, chacun
estime que la seule issue intéressante à cette situation serait
une victoire. Dans leur perception, le bien désiré (le poste), ne
peut être obtenu qu'à travers la défaite de l'adversaire.
Ce que l'un obtient, l'autre le perd car il n'y a pas assez pour combler les
besoins des deux.
La concurrence est en grande partie déterminée
par la situation elle-même. Mais elle est accentuée par la
perception et le comportement des deux acteurs. C'est parce qu'ils se voient
comme des adversaires dans la poursuite du même but qu'ils
considèrent leurs actions respectives comme des débuts de
défaite et qu'ils éprouvent le besoin de réagir
immédiatement en reprenant l'avantage.
II-2 Les conflits de travail
Au cours de notre enquête, nous n'avons pas
été témoins de ce type de conflits. Mais selon les
enquêtés, à la caisse, les conflits de travail naissent
sous la forme de réclamations. Ce sont des conflits dits aussi
« conflits de droits » ou « conflits
juridiques ».
Les réclamations viennent des travailleurs
isolés ou des groupes de travailleurs se trouvant dans la même
situation. Les réclamations aboutissent en grande partie à ce
qu'on appelle les « conflits individuels ». Ces
réclamations naissent généralement des rapports quotidiens
dans l'organisation, exprimant d'habitude la protestation d'un ou de plusieurs
travailleurs contre un acte de direction( application du statut, nomination
sans réclamation, avantages sociaux...)
Ces revendications ont donné lieu à des
contentieux. C'est l'exemple de « l'affaire Tankoano S. Emile et
six autres ». Ces sept comptables ont été
licenciés par la CNSS pour une histoire de reclassement à une
catégorie supérieure induisant une reconstitution de
carrière. Titulaires du BAC G2, ils avaient été
recrutés entre 1982 et 1999 et classés en 4è
catégorie échelle B du statut du personnel de la CNSS. Au fil du
temps, ces travailleurs se plaindront du fait qu'ils exécutent les
mêmes tâches que les comptables titulaires du Diplôme
Universitaire de Technologie (DUT), pourtant classés à un niveau
supérieur (catégorie 5, échelle A). Après avoir eu
recours à la justice mais n'ayant pas trouvé un terrain d'entente
avec la direction de la CNSS, ces agents seront purement et simplement
licenciés en 2004.
Depuis lors, la Direction Générale tente de
résoudre ces types de problèmes juridiques à l'interne.
Cette mission a été assignée au
conseiller juridique de la CNSS, secondé par un inspecteur du travail.
Ils analysent les requêtes et font des propositions au DG qui
décide de la conduite finale à tenir.
Si le travailleur concerné n'est pas satisfait de cette
décision, il peut ester devant le Tribunal de Travail.
· La dimension Communication dans le
conflit
Les différents conflits ci-dessus évoqués
ont pour caractéristique fondamentale l'absence de communication. En
effet, au centre de ceux-ci, il y a un enjeu identifié et des acteurs
(les protagonistes). L'enjeu, c'est-à-dire l'objet du conflit, est
différent des intérêts poursuivis par les acteurs. Il
naît alors entre eux une rupture de relations et de communication.
L'harmonie sociale entre eux se trouve brisée. Le désaccord, le
blocage, la contradiction, le malaise prennent donc le dessus. Chaque acteur
estimant avoir raison, est convaincu que l'autre a tort.
L'approche communicationnelle qui permet de mieux
appréhender cette situation, est celle de la différence des
cadres de référence.
La communication est en effet parfaite, seulement quand le
message émis par l'un est reçu par l'autre avec la signification
exacte qu'a voulue lui donner le premier. Mais ceci est un mythe. Il existe
toujours un écart entre émission et réception dans la
mesure où celui qui parle et celui qui l'écoute a chacun son
cadre de référence. Ce cadre est constitué des
connaissances (le connu), des valeurs (le voulu et le senti) des motivations
et des opinions (le filtrage) de l'âge et de l'expérience (le
vécu), du statut et du rôle (position et fonction exercée),
des centres d'intérêts dans le travail...
Dans ce contexte, la communication peut aider à
rapprocher les cadres de référence afin de permettre à
chaque acteur de ressentir l'entreprise comme une même unité
organique dont il est membre solidaire. Mais encore faudrait-il qu'il y ait une
logique de dialogue. Ce que la structuration de la CNSS ne permet pas
réellement. Or, lorsque la communication n'appréhende pas les
préoccupations des salariés, elle ne joue pas son rôle. Les
conflits peuvent donc s'amplifier sur le lieu de travail. Le dialogue social
est ce ciment qui pacifie les relations sociales.
En plus des problèmes organisationnels et sociaux, nous
allons à présent aborder les problèmes psychologiques ou
individuels.
III-Les problèmes psychologiques
Selon les psychologues, il s'agit des problèmes issus
des valeurs sociales et des limites naturelles de l'être humain. Ils sont
souvent présents dans le milieu de travail et constituent des sources
d'insatisfaction dans les relations interpersonnelles à travers un
manque de communication.
A la CNSS, ces problèmes prennent de l'ampleur du fait
du manque d'une réelle culture d'entreprise.
III-1 La culture d'entreprise
Pour Claude Duterme48(*), parler de culture dans une organisation,
c'est faire directement allusion à la distribution des
responsabilités formelles, aux mécanismes de distribution des
rôles et aux diverses règles et normes qui orientent ou
réglementent la vie d'ensemble de l'organisation.
Les entreprises sont donc confrontées au changement
d'une manière ou d'une autre. Leur succès et le bien être
émotif, psychologique, spirituel et physique de leurs salariés
dépendent de leur capacité à s'adapter au changement.
C'est dire donc qu'au-delà de ses capacités techniques et
logistiques, l'entreprise doit se forger une personnalité de marque et
s'imposer des valeurs culturelles partagées par l'ensemble de ses
membres.
En cela, l'identité de l'entreprise est un
réfèrent de choix. Celle-ci s'appuie en effet sur une partie
formelle et une autre informelle. Les éléments formels
représentent sa stratégie, sa structure et son implantation
physique, son système d'organisation... La partie informelle recouvre sa
culture, l'expression de l'histoire de l'entreprise et des règles
internes de l'organisation. La communication peut gérer
l'identité de l'entreprise en prenant appui d'une part sur sa
réalité formelle en mutation, et en exploitant d'autre part les
leviers qu'elle peut identifier au niveau de sa réalité
informelle.
Au regard de cette situation, on peut
affirmer qu'une organisation comme la CNSS ne peut pas se passer de la culture
d'entreprise.
Ceci est d'autant plus important que selon
Helliriegert, Slocum et Woodman,
« l'efficacité et le succès d'une entreprise ne
sont pas seulement déterminés par les qualités et les
motivations des employés et des managers. Ils ne sont pas non plus
proportionnels aux aptitudes manifestées par certains groupes de
personnes à travailler convenablement ensemble bien que les
façons de faire, tant individuelles que collectives, soient essentielles
au succès de l'organisation »49(*). Il faut alors un certain
style, un caractère, une manière de faire les choses qui
transcende la volonté de telle personne ou de tel système.
Pour le cas spécifique de la CNSS, la notion
même de « culture d'entreprise » n'est pas
suffisamment comprise par la plupart des agents. Au delà de cet aspect,
c'est même le problème de la représentation et du sentiment
d'appartenance qui se trouve posé.
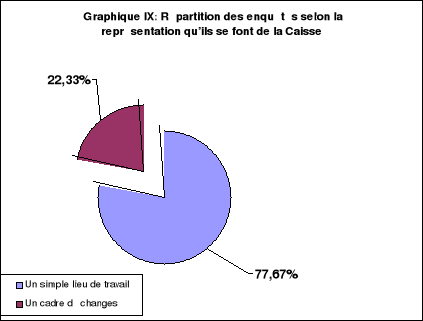
Source : Enquête de terrain
Pour 77,67% des agents de la CNSS, la caisse n'est qu'
« un simple lieu de travail ». Seuls 22,33% la
perçoivent comme « un cadre
d'échanges ».
Avant d'en tirer des conclusions, on peut noter qu'au
problème de représentation vient s'ajouter celui de
l'appartenance. Il se présente ainsi :
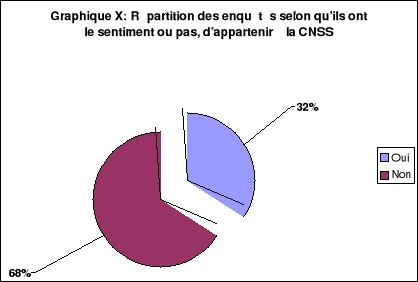
Source : Enquête de terrain
A la CNSS, 68% des enquêtés n'ont pas le
sentiment d'appartenir à la « maison ».
A l'analyse, les difficultés liées à ces
éléments peuvent constituer les obstacles pour une bonne
communication. Pour ce faire, on peut relever les problèmes
suivants :
- Une très grande centralisation dans la
réalisation des activités. 49,76% des chefs de services et de
section avouent travailler « sous
pression ».
- Ces mêmes agents notent le déficit de
communication non seulement entre les travailleurs d'un même service mais
aussi entre les différentes directions.
Tous ces problèmes façonnent la communication
interne à la CNSS et constituent du même coup, un obstacle
considérable à l'existence d'une bonne politique de
communication.
En effet, les psychosociologues Mayo (1949), Lewin
(1964) et Moreno (1965) ont montré que l'individu réagit
aux situations non pas telles qu'elles sont mais telles qu'il les
perçoit. Cette perception est influencée par son
affectivité, mais aussi et surtout par les normes, les forces et le
climat du groupe ou de l'organisation à laquelle il appartient.
Ce faisant, la CNSS ne peut se résumer en une somme
d'individus, de groupes, d'ateliers, de bureaux ou de services. Ces
éléments doivent au contraire être en état
d'interaction nécessaire, c'est-à-dire, d'interdépendance.
Cette interdépendance à l'intérieur de l'organisation est
non seulement d'ordre opératoire mais encore et surtout de nature
sociale. Elle s'inscrit dans la psychologie des individus et des groupes, comme
dans leurs relations.
Pour faire émerger « la différence
légitime de l'entreprise »50(*) , il est donc important de
donner du sens à chaque travail, de multiplier les occasions de se
rencontrer, de donner à chacun un sourire ou un compliment, confirmation
qu'il est important, etc. Ces aspects font défaut à la CNSS
parce que les responsables n'arrivent pas à nourrir l'imaginaire et
à susciter la créativité des salariés. Une grande
partie ne connaît pas les choix stratégiques de l'entreprise, ce
qu'elle veut réussir avec eux, les obstacles qu'elle risque de
rencontrer ...
Cependant, le management exige un cadre formel de mise en
oeuvre. Il est au début et à la fin de l'entreprise. Au
début, il élabore nécessairement les principes de base
permettant de situer les niveaux de responsabilité et de rechercher les
différents moyens de mise en exécution. A la fin, le management
est un outil d'évaluation de mi-parcours ou de fin d'activité
permettant ou non la reconduction de la dite activité. Il faut donc
réunir les conditions pour assurer une efficacité et une
productivité optimales. C'est cette approche systémique qui
permet de se pencher sur les rapports entre l'organisation prévue et
prescrite et l'organisation vécue et perçue et entre ce qui est
dit et ce qui reste non dit, en conservant toujours une perspective
temporelle.
Lorsqu'on parle de culture d'entreprise ou de sentiment
d'appartenance, on inclut généralement la capacité pour
les agents à intérioriser et à vivre les valeurs
véhiculées par le logotype de leur entreprise.
En effet, le logo représente l'identité visuelle
de l'organisation et s'impose comme un élément central de sa
valeur intrinsèque. Comme le dit
Westphalen : « Il fait partie d'un
ensemble d'indices qui bâtissent la personnalité d'une firme. Il
lui permet de se distinguer de ses concurrents »51(*).
Le logo est en réalité une des formes
principales d'expression de l'image voulue étant donné qu'il
traduit un certain nombre de valeurs auxquelles l'entreprise s'attache. Les
couleurs constituantes d'un logo, la forme qu'il prend, le graphisme sont des
traits significatifs du message véhiculé par le logo dans son
ensemble. La maîtrise des valeurs de l'entreprise par le personnel passe
par la capacité de celui-ci à décliner les traits
caractéristiques et les valeurs que le logo incarne, les
références auxquelles il renvoi. A la CNSS, voici comment se
présente la situation :
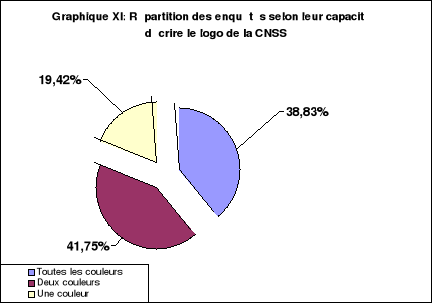 Source : Enquête de terrain
Source : Enquête de terrain
La remarque pertinente qu'on peut tirer est que 61,17%
(41,75+19,42) des enquêtés ne sont pas à mesure de donner
les trois couleurs composantes du logo de la CNSS que sont le rouge, le jaune,
le vert . Sur les 103 enquêtés, 56, soit 54, 36% ne connaissent
pas non plus la signification du logo de leur entreprise.
Avant de développer une quelconque analyse sur cet
état de fait, il convient de souligner que l'intérêt de
cette question était de mesurer le degré d'intériorisation
des valeurs imprimées de l'entreprise auprès des agents. Les
couleurs du logo d'une entreprise sont aussi significatives pour les agents de
cette entreprise, que les couleurs du drapeau national le sont pour les
citoyens de cette nation. L'incapacité d'un seul agent de l'entreprise
à savoir décrire la couleur du logo peut être encore
hautement plus significative que l'incapacité du citoyen à
décrire les couleurs du drapeau de sa nation. D'autant plus que
l'entreprise est une entité restreinte de la société et
qu'elle regroupe en son sein des personnes sensées être
convaincues des valeurs de celle-ci. On peut alors mesurer la portée
significative des réponses données par les agents.
Le problème posé ici n'est plus seulement celui
d'un manque d'information, mais surtout l'absence d'un cadre d'impression
psychologique des valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire un cadre de
culture d'une identité forte. Il est d'autant plus amplifié que
même certains responsables que nous avons rencontrés n'ont
été à mesure de nous donner la signification de ces
couleurs. Tout ce qu'ils ont pu nous dire, c'est que les dessins qui sont aux
extrémités de l'étoile jaune représentent les
différentes branches d'intervention de la CNSS : La vieillesse, les
prestations familiales, les risques professionnels et les accidents de travail.
Mais ils ne savaient pas que les couleurs (le rouge, le jaune et le vert)
renvoyaient au drapeau national et qu'elles signifiaient que la CNSS devrait
être exclusivement au service de la patrie.
Depuis longtemps, l'obsession d'identité visuelle
concentrée dans le logo exprime la recherche d'influence affective du
discours idéologique de la culture d'entreprise. Au delà de la
fonction immédiate d'identification d'une entreprise (au sens de sa
différenciation des autres), le recours au logo est le reflet de
l'influence du discours culturel de l'entreprise, et par là même,
du discours communicationnel. Le discours fait corps avec, et dans l'image
virtuelle. Cette image ne s'adresse pas seulement à la conscience
réflexive . Elle s'adresse à l'affectivité et aux
habitudes des individus c'est - à-dire à leur inconscient
personnel et social. « Le logo est à la fois le
discours de l'image et l'image du discours »52(*), affirme Bernard
Floris.
Au regard de cette situation, il faut noter que l'importance
de l'identité visuelle réside en ce qu'elle est le
véritable ciment qui unit l'ensemble des salariés et les pousse
vers un objectif commun.
Toute entreprise a en effet une image ; bonne ou
mauvaise, positive ou négative. A partir du moment où elle en
prend conscience, l'entreprise peut, soit s'en satisfaire, soit chercher
à la modifier. Il lui faut alors définir une stratégie de
communication pour gommer tel ou tel aspect négatif de cette image ou
mettre davantage en valeur tel ou tel de ses aspects positifs. Cette image est
en fait une sorte de mosaïque dont certains éléments peuvent
être rationnels (performance, méthodes de management, techniques
de productions...) D'autres revêtent un caractère plus affectif
(dynamisme, valeur des hommes, qualité des ressources humaines, etc.) Il
faut donc associer les deux, car pour Jean-Marie Floch,
« articuler le sensible et l'intelligible est essentiel au
fonctionnement de l'esprit humain »53(*).
· Les défis de la communication
Au vu de l'ensemble de ces insuffisances, il
apparaît important que la CNSS se dote d'une politique de communication.
Celle-ci doit s'articuler autour d'objectifs politiques, relationnels et
culturels clairs afin de cultiver une identité collective, d'enraciner
la culture d'entreprise et de fédérer l'ensemble du personnel.
Pour Marie Hélène Westphalen: «
La communication s'inscrit dans une perspective sociale répondant
aux attentes d'information (tout aussi irrésistibles que
légitimes) des salariés. On ne peut pas demander à des
hommes de participer à une oeuvre collective en aveugles. Ils ont besoin
de comprendre où l'entreprise va, ils ont besoin d'être reconnus
pour leurs compétences, ils ont besoin d'être
écoutés... »54(*)
En effet, que vaut une communication institutionnelle de la
CNSS visant à montrer l'image d'une entreprise consensuelle si à
contrario, les agents dans leurs actions quotidiennes butent sur la
rudesse et la dictature de la hiérarchie ?
Il sied aussi de veiller particulièrement à la
cohérence entre communication interne et communication externe. Cette
nécessité procède du fait que toutes les faces d'une
organisation s'influencent et doivent être coordonnées sous peine
de créer une dissonance. Il faut admettre avec Gilles Marion
que : « Dans la mesure où on veut
communiquer dans la durée avec un grand nombre de parties prenantes de
manière cohérente, il n y a pas d'autre solution que de
s'efforcer, en déca de toutes les expressions, de donner un contenu
cohérent à tous les discours de
l'institution »55(*). Sans cette harmonie, les agents transmettront des
messages contradictoires qui parasiteront ceux que l'institution veut diffuser
auprès de ces publics. En tout état de cause, la règle
est que la communication interne ne se décrète pas. Du reste
selon Claude Duterme : « d'une
certaine manière, on peut concrétiser la façon de
réfléchir la communication par la métamorphose du
tireur : celui-ci choisit une cible et en fonction de celle-ci (ses
déplacements, ses caractéristiques morphologiques...) va
déterminer le plus précisément possible le choix de
l'arme, des projectiles, l'emplacement, l'angle de tir, le moment, etc. Si
l'analyse a été bien conduite et les choix pertinents, un tireur
entraîné doit toucher au but avec le résultat
escompté »56(*).
En outre, il est important de relancer « Echos
CNSS » ou de créer un nouveau journal d'entreprise.
L'enquête de terrain et les entretiens ont démontré cette
« soif d'information et de communication » au
niveau des agents de la CNSS.
Enfin, les managers doivent croire aux travailleurs en faisant
appel à leur nature d'homme et savoir utiliser et respecter leurs
forces. En ce sens, la parabole du tailleur de Peter Drucker est
édifiante :
Nous sommes au Moyen-Âge. Un homme rencontre trois
tailleurs de pierre sur le chantier d'une cathédrale. Il leur demande:
« Que faites-vous? ».
Le premier répond: « Je taille
des pierres pour gagner ma vie. »
Le deuxième: « Je sculpte des
statues dans la pierre ».
Le troisième: « Je participe
à l'édification d'une
cathédrale. »...
Morale : la vision que les acteurs ont de leur travail
peut influer énormément sur leur motivation, et partant, sur la
qualité du travail effectué.
CONCLUSION GENERALE
Ce mémoire de maîtrise s'était fixé
pour objectif de montrer les influences de la communication interne de la CNSS
sur le management de l'organisation. Notre recherche devait ainsi prendre en
compte :
-Les préoccupations des cadres et des
salariés
-Les fruits des différentes réflexions
menées par les théoriciens et les praticiens de la communication
et du management.
L'enquête menée au sein de l'institution a
permis de confirmer notre hypothèse : « A la
CNSS, les pratiques communicationnelles ne favorisent pas la motivation et
l'implication des agents ». A titre illustratif, 54,46%
des enquêtés ne sont pas fiers de travailler à la CNSS.
70,88% estiment que les rapports sont de nature autoritaire. 77,67 % des agents
ne participent pas aux prises de décisions. 68% n'ont pas le sentiment
d'appartenir à la maison CNSS.
Sur la base de ces statistiques, la caisse apparaît
comme une organisation recroquevillée sur elle-même. Dans un
environnement en perpétuelle mutation, cette attitude ne favorise pas
la productivité et la performance.
En effet, ces statistiques témoignent du fait que le
fondement de ses missions, la nature de son organisation et ses principes de
fonctionnement ne sont pas suffisamment partagées par ses agents.
Par conséquent, ces derniers n'ont pas une bonne
appréciation du climat interne. Ils agissent comme si la CNSS
était un instrument de contrainte. Ce faisant, il en résulte un
faible degré d'appartenance, un manque de confiance, une absence
d'identification à des valeurs fortes.
L'absence d'une politique de communication avec des
stratégies, des objectifs et des priorités préalablement
et clairement définis, constitue l'épicentre de tous ces
phénomènes.
Or, envisager la communication comme facteur de motivation
c'est s'assurer des conditions préalables de sa manifestation
efficiente : l'écoute et le dialogue.
Cela suppose de la part des acteurs en interaction une
capacité de pondération, de partage, de tolérance et de
collaboration.
Au regard de cet état de fait, il paraît
important pour la CNSS d'oeuvrer à l'instauration d'une communication
franche, d'une écoute active et d'un dialogue dynamique avec ses
salariés.
Ce système d'information et de communication interne
doit être pertinent. Fiable. Précis. Et rapide. Si de tels
critères sont réunis, l'entreprise peut en tirer trois avantages
principaux :
- La diffusion d'une information pertinente permettant
à chacun de comprendre l'entreprise, de s'adapter en permanence aux
aléas, d'être autonome et efficace à son travail ;
- L'échange, l'enrichissement réciproque, la
coordination et l'interactivité entre personnes ou entités
- L'adhésion à une ambition, des valeurs, des
projets communs et la solidarité de tous.57(*)
Si la communication est souvent vécue
comme un mal nécessaire, c'est aussi parce que la gestion du personnel
est une difficulté majeure dans les organisations. En effet, les hommes
sont rationnels et affectifs et on ne peut prévoir lequel de ces deux
aspects sera mobilisé dans une situation. Les réactions et les
comportements ont une part d'imprévisible. Dans certains cas les
interlocuteurs mobiliseront des états du moi adulte ou parent, dans
d'autres, des états enfant.
Afficher une volonté de communication est le
point de départ d'un dispositif qui devra se structurer en tout point de
l'organisation. Les outils et techniques sont des moyens au service d'une
politique. Sans cette politique, ils risquent de se sédimenter au
gré des modes et des évolutions des supports de
communication, et de devenir rapidement aux yeux des salariés, des
symboles d'opacité plus que des éléments de transparence.
Une des tâches essentielles du management sera alors de faire en sorte
que l'approche globale des problèmes soit plus souvent présente,
le mode de relations observé de manière dominante étant
souvent réactionnel à l'environnement.
Toutes ces réactions peuvent être
efficacement contrôlées par la communication interne
E. Dupuy et I. Raynaud58(*) distinguent par exemple douze
principes de communication pouvant impulser la responsabilisation et
l'engagement du personnel :
-La lucidité :
Elle consiste à comprendre la contingence de la
communication interne,
- La volonté
réelle : Elle se traduit par la formalisation de la
fonction communication et l'attribution de budget ;
- La transparence : S'oppose
à la manie du secret
- La simplicité : Elle
garantit la compréhension du message
- La rapidité : Elle
permet de coller à l'événement
- La durée :
Elle assure que la communication est
bien un processus durable et évolutif
- La ténacité :
Elle vise à affermir la portée du message
- Le développement de la
communication : Il doit être perçu comme un
lourd investissement
- L'adaptation : Elle exprime
que la communication interne s'appuie sur une culture d'entreprise et ne
saurait se réduire à une sorte de gadgets importés
- L'engagement : Il
précise que la communication n'est pas neutre et qu'elle véhicule
des intentions
- La séduction : Elle
se traduit par un fond authentique et une forme propres à susciter
l'attention
- L'anticipation : Elle stipule
que la communication s'inscrit aussi dans un devenir qu'il faut identifier,
même s'il prend des contours incertains.
Ainsi, en élargissant son champ d'action à
l'information réciproque, aux échanges, au développement
d'une culture d'entreprise, la problématique de la communication interne
rejoint celle du management des ressources humaines. Cela se manifeste à
trois niveaux. D'abord par la participation à la définition des
objectifs, la délégation des pouvoirs et la mise en oeuvre des
décisions. Ensuite, par le développement de l'expression et de la
prise de responsabilités au niveau de chaque salarié. Enfin, par
la négociation, le partage et l'association du personnel dans les
travaux de l'organisation.
Sous cet angle, les conclusions auxquelles nous sommes
parvenus peuvent avoir quelques intérêts :
Ø Pour les principaux partenaires de la
CNSS (employeurs, employés, affiliés, travailleurs
déclarés...) : Leur intérêt résiderait
dans toute initiative tendant à améliorer la gestion de
l'entreprise, son rendement et à lui assurer sa
pérennité.
Ø Pour la CNSS :
L'étude pourrait renforcer la communication interne et le management de
l'institution.
Toutefois, s'agissant d'une étude portant sur une
seule entreprise, il y a lieu d'être prudent dans la
généralisation des résultats Par ailleurs, celle-ci ne
s'intéresse qu'aux dimensions communication interne et management de
l'entreprise. Notre mémoire n'a nullement la prétention
d'apporter un remède miracle au système communicationnel et
managérial de la CNSS. Il vise au contraire :
- A jeter les bases de réflexions futures
- A attirer l'attention des managers de l'institution sur les
inconvénients du système actuel, les écueils à
éviter pour les minimiser et surtout les possibilités
d'améliorations offertes.
Il est connu, dans toute appréciation, on note une
dose de subjectivité. L'important, c'est d'en prendre conscience, de
faire l'effort d'objectivation mais aussi de se donner les moyens d' y
parvenir.
S'il est vrai que la communication interne et le management de
la CNSS sont minés par quelques problèmes, ce serait se
méprendre que d'occulter les autres aspects du fonctionnement
général de cette administration (économiques, politiques,
psychologiques, le système d'évaluation des employés, la
communication institutionnelle...) .Ils pourront constituer des pistes de
recherche futures car nous sommes conscients de n'avoir pas
épuisé le sujet.
En définitive, le type de communication
managériale que nous préconisons ne relève pas de
positions théoriques ou doctrinaires que le dirigeant peut adapter
à la suite de ses lectures. Celui-ci doit être avant tout
persuadé que les travailleurs ont un potentiel à exploiter.
Introduire la notion de participation dans une organisation sans être
convaincu des potentiels et des dons que chacun peut apporter à
l'ensemble est une peine perdue !
La communication doit de ce fait être active et la
valorisation du capital humain, effective. A ce sujet, le Dr Firmin
Gouba déclarait fort à propos
ceci : « (...) Sans de bonnes relations, sans une
compréhension mutuelle, il n y a pas d'harmonie, fondement de la nature
humaine »59(*). C'est tout dire.
TABLES DES MATIERES
MATIERES
PAGES
Dédicace
Remerciements
Listes des abréviations
Epigraphes
Sommaire
Avant-propos
INTRODUCTION
GENERALE.............................................................1
Chapitre préliminaire : Approche
Théorique et
Méthodologique ..........................5
I- Problématique, objectifs et
originalité du
thème...................................................6
II Revue de
littérature....................................................................................13
III- Cadre théorique et
Conceptuel.....................................................................18
III-1Cadre
théorique......................................................................................18
III-1-1 L'Ecole des relations
humaines................................................................18
III-2 Cadre
conceptuel..................................................................................22
III-2-1 La
Communication.............................................................................
22
III-2-2 La Communication
Interne....................................................................22
III-2-3 Le
Management................................................................................
23
III-2-4
L'Organisation..................................................................................24
IV-
Méthodologie.......................................................................................26
IV-1 La recherche
documentaire......................................................................
27
IV-2 L'observation
participante.......................................................................27
IV-3 L'enquête par
questionnaire.....................................................................
28
IV-4
L'entretien..........................................................................................34
Première
Partie : La CNSS : Présentation,
organisation et fonctionnement de la communication
..................................................................... 37
Présentation de la
CNSS.........................................................37
II Organisation de la
communication...............................................................39
II-1 La communication
interne......................................................................40
II-2 La communication
externe......................................................................40
III- Fonctionnement de la
communication ...........................................................41
III-1 Types de communication et outils
utilisés.....................................................41
III-1-1 La Communication descendante
.............................................................. 41
III-1-1-1 Les supports
écrits.............................................................................41
III-1-1-2 Les réunions avec le personnel
.............................................................42
III-1-2 La communication ascendante
................................................................43
III-1-2-1 Les supports
écrits...........................................................................43
III-1-2-2 Les cercles de qualité
.......................................................................43
III-1-2-2-1 La genèse des cercles de qualité
à la CNSS............................................44
III-1-2-2-2 La politique de la qualité au sein de la
CNSS..........................................44
III-1-2-2-3 Interactions sociales et dynamique de
groupe..........................................45
III-2 Mode de
communication..........................................................................46
2è partie : Conséquences du mode
de communication sur le management de la CNSS. 50
I- Les problèmes organisationnels
...................................................................50
I-1 La participation aux
décisions......................................................................50
I-2 Le développement des
rumeurs...................................................................54
I-3 La DRH face au management du
personnel.....................................................57
II-Les conflits
sociaux..................................................................................61
II-1- Les conflits de
compétences.....................................................................62
II-2 Les conflits de
travail..............................................................................62
III-Les problèmes
psychologiques....................................................................
64
III-1 La culture d'entreprise
..........................................................................
64
Conclusion
Générale.................................................................................73
Table des
matières.....................................................................................77
Bibliographie ...........................................................................................79
Annexes.................................................................................................
82
B I B L I O G R A P H I E
I- OUVRAGES
I-1 COMMUNICATION
Abric J-C. (1999),
Psychologie de la communication : théories et
méthodes, Armand Colin, deuxième édition
Adès D, J-P.
Beaudoin et al (1996), Les
communications de l'entreprise: changements ou continuité?
Société Nouvelle, Fïrmin- Didot
Milon A. et M. Jouve (1996),
Communication et organisation des entreprises : approches
critiques et cas pratiques, Poitiers, Ed Bréal, Coll
Synergies
Miège B. (1996),
La société conquise par la communication, Tome 1,
logiques sociales, Presses Universitaires de Grenoble
Mucchielli A.
(1983), Rôles et Communication dans les
Organisations, Paris, éditions ESF
Westphalen M-H
(2001), Communicator, le guide de la communication
d'entreprise, Paris, Dunod, 4è éd, coll sup.
I-2 COMMUNICATION INTERNE
Auvinet J.-M., Boyer L. et
al (1997), La communication interne au coeur du
management, Paris, Editions d'Organisation
Beal J-P. & Lestocartp
A.(2003), Entre management et marketing : la communication
interne, Paris, Editions Demos
Beon Ph.(1992), Développer
sa communication interne, Paris, Nathan
Boneu F. (1990), L'entreprise
communicante : démarches et méthodes de communication
interne, Paris, Editions Liaisons
Detrie P., Meslin-Broyez
Cath. (2002), La communication interne au service du
management, Paris, Liaisons
Dupuy E., Devers T. &
Raynaud I. (1996), La communication interne : vers
une entreprise transparente, Paris, Editions d'Organisation
Duterme C. (2002), La
communication interne en entreprise - L'approche de Palo Alto et l'analyse des
organisations, Bruxelles, De Boeck Université
Libaert T. & D'Almeida N
(2002), La communication interne, Paris, Dunod, col.
Topos
Mucchielli A. (2001), La communication
interne - Les clés d'un renouvellement, Paris, Ed. Armand
Colin
I-3 COMMUNICATION INTERNE ET MANAGEMENT
Drucker P.
(1999), L'avenir du management,
Paris, Editions Village Mondial
Eldin, F.
(1998), Le management de la communication : de la
communication personnelle à la communication d'entreprise,
Paris, L'Harmattan
Floris B. (1992),
La communication managériale: La modernisation symbolique
des entreprises, Presses Universitaires de Grenoble (PUG)
Gogue J-M. (1997),
Management de la qualité, 2è
édition, Editions Economica, Paris,
Henriet B. (1993),
Leadership et management, Paris,
Liaisons
M Crener. et
Monteil B. (1979), Principes de
management, Presses Universitaires du Québec ,
Diffusion vuibert.
Plane J-M. (2003),
Management des organisations: théories, concepts,
cas, Paris, Dunod.
I-4 GENERALITES
Citeau J-P. (2002),
Gestion des Ressources Humaines : Principes
généraux et cas pratiques, 4è Ed, Armand
Colin
Crozier M. (1989), L'entreprise
à l'écoute, Paris,
Inter-Editions
Hogue J -P. (1980),
L'homme et l'organisation, Montréal :
Beauchemein Commerce,
Lussato
B.(1992), Introduction critique aux
théories d'organisation, Paris, Dunod.
Petit F., M. Dubois
(1998), Introduction à la psychologie des
organisations, Paris, Dunod.
Peretti J-M. (1994),
Ressources humaines, Paris, Editions Vuibert,
4è édition, Collection Gestion.
Sainsaulieu R.
(1989), Sociologie de l'organisation et de
l'entreprise, Presses de la Fondation Nationale de Sciences
Politiques, Paris, Dalloz.
II-MEMOIRES/ THESES
Diaouri Ismaèl(2003) ,La
communication interne de la défense : enjeux et perspective dans un
processus démocratique, Université de
Ouagadougou(UO)
Rouamba Françoise (1994), La
modernisation de l'administration au Burkina Faso : Le rôle du top
management dans l'accroissement de la productivité des agents publics de
l'Etat, ENAM
Sakandé Ibrahiman(1998)
Les déterminants de la communication dans le développement de
l'organisation : Cas des Editions Sidwaya. Université
de Ouagadougou
Traoré Alassane(2003), La
communication et la problématique de la performance des
établissements publics : Cas de la CNSS, ENAM,
Ouagadougou
Traoré/ Sédgho Scholastique
(1998), Analyse du système d'appréciation du
personnel de la CNSS du Burkina Faso, CESAG, Dakar
Ouédraogo Cyr Mathieu(1991),
La CNSS du Burkina Faso : Etude analytique des ressources, du
cadre organisationnel et du processus gestionnaire de ses services
préventifs, U.O, Ecole Supérieure des Sciences de
la Santé, thèse de doctorat de 3è cycle.
III- SITES INTERNET
www.cnss.bf
www.lemanager.com
www.afci.fr
www.webzinemaker.com
www.lentreprise.com
* 1 Bruno Henriet
(1993), Leadership et management, Editions
Liaisons, Paris, P. 125
* 2 Phillipe Détrie ,
Catherine Meslin-Broyez (1995), La communication interne au service
du Management, Editions Liaisons, Paris, P .16
* 3 Bernard MIEGE (1996),
La société conquise par la communication,
Tome 1, logiques sociales, Presses Universitaires de
Grénoble, P.43
* 4 Phillipe Détrie ,
Catherine Meslin-Broyez (1995), op.cit P .19
* 5 Phillipe Détrie ,
Catherine Meslin-Broyez (1995), op.cit. P .33
* 6 In « Le
Pays » N°3534 du 05/01/06, P.8
* 7 Opcit, P.8
* 8 Suite à une
décision du Conseil des Ministres du 24 mai 2006, Idrissa
Zampaligré a été remplacé par Innocent Coulidiaty
à la tête de la CNSS
* 9 Idrissa
Zampaligré, Echo CNSS, spécial
50è anniversaire, p.8.
* 10 Jean Favatier,
Séminaire sur la communication interne et le
management, Paris, 19 octobre 2003
* 11 Opcit, P.120
* 12 Opcit, P.75
* 13 Jean Yves Capul (Dir),
(1998), Management et organisations des entreprises,
cahiers français n° 287, Édition la Documentation
Française, P.27
* 14 Don Hellregel, Slocum John
et Richard Woodman,(1992),Management des
organisations, De Boeck Université, Bruxelles, P. 10
* 15 Marie-
Hélène Westphalen(1998) Communicator: Le guide de la
communication d'entreprise, Éditions Dunod, 3è
édition, Paris, P.59
14Peter Drucker (1999), L'avenir du
management, paris, Editions Village Mondial, p.79
* 16 Opcit, P.90
* 17 Daouda Kouma(2004-2005)
Cours de Psychosociologie des Organisations,
Communication et Journalisme, MAST I, U.O.
* 18 Wieman J. M.. et
Harisson R.P.(1983) Non verbal interaction, New Burg
Park, California, Sage, P .182
* 19 Neveu Erik (2001),
Une société de
communication ? Edition
Montchrestien, Collection clefs, 3è édition, P.76
* 20 Bernard Miege,
Opcit,P.76
* 21 Claude
Duterme(2002),La communication interne en entreprise:l'Approche de
Palo Alto et l'analyse des organisations, Editions De Boeck
Université, P.9
* 22 Norbert Wienert(1948)
Cybernetics or control and communication in animal and
machine;P .161
* 23 Jean-Michel Plane
(2003), Management des organisations: théories, concepts,
cas, Dunod, P.3
* 24 33Peter
Drucker(l973), Management: Tasks, Responsabi1ities and
Prob1ems, New York, Harper and Row, P.398
* 25 Jean-Marie Peretti
(1994), Ressources humaines, Paris, Editions Vuibert,
4è édition, Collection Gestion, P.55
* 26 F. Gortner, Julienne
Malher et Jeanne Bell Nicholson (1994) in, La gestion des
organisations publiques, Presses Universitaires du Québec,
P.44
* 27 Réné
Lourau( 2002), L'analyse institutionnelle, les
Editions de Minuit, Lonrai, P.39
* 28 Serge Théophile
Balima et Marie-soleil Frère (2003), Méthodologie
d'élaboration du mémoire de maîtrise en sciences et
techniques de l'Information et de la Communication,
Université de Ouagadougou, P.50
* 29 Quivy R. et Van
Campenhoudt L. (1988), Manuel de recherches en sciences
sociales, Bordas, Paris, P.181
* 30
Sangaré/Compaoré Nestorine(2001), Cours de
méthodologie de la recherche, U.O. , P.8
* 31 Opcit,
Sangaré/Compaoré Nestorine (2001), P.18
* 32 Blanchet A, Gotman A
(1992), L'enquête et ses méthodes :
l'entretien, Nathan, Paris, p.40
* 33 Extrait d'entretien
réalisé le 09 janvier 2006
* 34 Alain Ouattara (1986)
ENAM, Mémoire de Fin de Cycle, Les cercles de
qualité, une nouvelle approche de management P.78.
* 35 Secrétariat
Cercles de Qualité (2001), Etat général des
thèmes traités par les différentes cellules des cercles de
qualité de la CNSS, P.09
* 36 Extrait d'entretien
réalisé le 11 janvier 2006
* 37 Extraits d'entretien
réalisé le 13 mars 2006
* 38 Extrait d'entretien
réalisé le 16 janvier 2006
* 39 E.R. Moss et D.Gow (1981),
Integrated rural developpement , Washington, P.14
* 40 James O. Mc Donald (1990),
Management sans douleur, Paris, Ed.Eyrolles, P.63
* 41 Béon Philippe
(1992), Développer sa communication interne,
Paris Nathan, P.73
* 42 Bernard Miege (1989),
opcit.P ;45-46
* 43 Westphalen
Marie-Hélène (1998), Opcit p.1.
* 44 Tocqueville cité
par Roquette Michel-Louis (1998), La communication
sociale, Dunod, Paris,P.79
* 45 D'Almeida Nicole,
Libaert Thierry (2000), La communication interne de
l'entreprise, Paris, 2e édition, Dunod, p.7.
* 46 Edifice (1999-2000),
Projet de stratégie de communication pour la
CNSS, p.11
* 47 Jean -Pierre Beal et
Pierre André Lestocartp(2003), Entre management et
marketing : la communication interne, Paris, Editions Demos,
P.75
* 48 Claude Duterme, Opcit,
P.49
* 49 Helliriegert, Slocum et
Woodman, op.cit, P.59
* 50 Jean -Pierre Beal et
Pierre André Lestocartp, Opcit,P.75
* 51 Westphalen op.cit,
P.98
* 52 Bernard Floris, Opcit,
P.162
* 53 Jean-Marie Floch
(1995), Identités visuelles, Paris,
PUF,P.91
* 54 Marie Helen
Westphalen(2001), Communicator, le guide de la communication
d'entreprise, paris, Dunod, 4è éd, coll sup, p.64
* 55 Gilles Marion.
Cité par Ismaël Diaouari : in La communication
interne de la Défense : Enjeux et perspectives dans un processus
démocratique. Mémoire de Maîtrise en
Communication et Journalisme, Université de Ouagadougou, 2004-2005
* 56 Claude
Duterme ,op.cit, P.79
* 57 P. Béon(1995),
Comment développer la communication interne,
Nathan, P.9
* 58 E. Dupuy et I. Raynaud
(1988), La communication interne, vers l'entreprise
transparente, Ed d'Organisations, Paris,P.52
* 59 Dr Firmin Gouba
(2005-2006), Cours de Relations Publiques et
Marketing, MAST II, UO



