|
 Master 1 Économie Internationale et
Globalisation Master 1 Économie Internationale et
Globalisation
Séminaire Politiques Économiques et
Sociales
Elie Chosson
Directrice de Mémoire: Mme Fargeon.
LA REDISTRIBUTION DOIT-ELLE RENDRE LE TRAVAIL
PAYANT?
Étude des modalités de conciliation
entre redistribution des revenus et incitation monétaire au retour
à l'emploi.
Année Universitaire 2009/2010
L'Université n'entend donner aucune approbation ni
improbation aux opinions émises dans les travaux universitaires : ces
opinions doivent être considérées comme propres à
leurs auteurs.
Table des matièresIntroduction:
1
Chapitre I. De la distribution à la redistribution
des revenus. 4
I. Pauvreté et inégalités :
définitions et mesures. 4
A. La Pauvreté. 5
B. L'inégalité. 8
II. Pauvreté, inégalité et emploi. 12
A. L'inégale distribution des revenus primaires. 12
B. Pauvreté et emploi 15
III. La mise en oeuvre de la redistribution. 18
A. Une redistribution efficace. 18
B. L'effet désincitatif de la redistribution. 21
Chapitre II. La redistribution contre le travail. 26
I. Incidence fiscale et distorsions : comment
redistribuer ? 27
A. La courbe en « U » des TMEI: imposition
optimale des revenus. 27
B. Impôt optimal et emploi. 30
II. Les premières mesures anglo-saxonnes. 34
A. Les Etats-Unis et l'Earned Income Tax Credit. 34
B. Le Workfare anglais. 40
III. Le Revenu de Solidarité Active (RSA). 43
A. L'incitation au travail avant le RSA. 43
B. Le RSA: objectifs et mise en oeuvre. 46
C. Bilan 49
Chapitre III. Dépassements et remise en cause de
l'arbitrage monétaire entre travail et loisir. 52
I. La dynamique historique des interactions entre
redistribution et travail. 53
A. Le travail, valeur fondamentale. 54
B. Dépassements du clivage entre redistribution et
travail. 57
Les fondations de la redistribution. 58
Le compromis fordiste de l'après-guerre. 59
Retour de l'assistance, et retour du conflit entre
redistribution et travail. 61
II. Au-delà de l'arbitrage monétaire entre
travail et loisir. 64
A. La variété des incitations au travail. 64
B. L'éloignement du marché du travail. 66
III. L'allocation universelle 70
A. Fondements et modalités de mise en oeuvre. 71
Définition et justifications de l'allocation
universelle. 71
Une proposition d'allocation universelle. 74
B. Effets escomptés et limites. 77
CONCLUSION: 81
Bibliographie: 84
Annexes: 87
Je remercie Mme Fargeon pour m'avoir orienté et
cadré tout au long de mon travail.
Je tiens aussi à remercier Mme Euzéby, M.
Echinard et, de nouveau, Mme Fargeon: mon mémoire doit beaucoup à
la richesse du Séminaire Politiques Économiques et Sociales, qui
m'a permis de développer ma curiosité pour une certaine science
économique, et qui m'a obligé à rechercher sans cesse la
rigueur de l'analyse.
Enfin, je remercie vivement les soutiens apportés
pour la correction orthographique.
Ceux qui voudront y donner l'aumône n'en donnent
à nul gens sain de corps et de membres qui puisse besogne faire, dont
ils puissent gagner leur vie, mais les donnent à gens contrefaiz,
aveugles, impotents et autres misérables personnes.
Ordonnance du roi de France Jean II le Bon, 1351
Parce que je veux changer cette situation scandaleuse qui
veut que dans notre pays l'assistanat paie davantage que le travail. Je n'ai
pas été élu pour maintenir cette injustice. Je veux
libérer les gens qui sont aujourd'hui prisonniers de l'assistance.
N. Sarkozy, discours sur la Généralisation du
Revenu de Solidarité Active, 2008
Introduction:
L'INSEE publiait le 1er Avril 2010 une étude qui fit
grand bruit, et dont voici la conclusion: entre 2004 et 2007, le nombre de
personnes « riches » a explosé, tout comme le niveau
de leurs revenus1(*). Ce constat pose
deux questions, distinctes mais inter-dépendantes.
La première porte sur la pertinence d'un discours
politique dominant qui défend la protection des hauts revenus face
à l'impôt. L'évasion fiscale, la baisse de l'épargne
et des investissements, sont autant d'épouvantails qui justifient des
politiques comme le bouclier fiscal à 50% appliqué par la loi
TEPA de 2007. Au delà de cette mesure précise, c'est sur le
coût et les distorsions qu'engendre le système redistributif
français que porte la controverse. La question posée est alors:
« constitue-t-il un frein à l'activité
économique? ».
Le seconde question est celle des inégalités. En
effet, la hausse considérable du nombre des plus riches et de leurs
revenus s'accompagne d'une quasi-stagnation du nombre de personnes pauvres et
de leurs revenus. Il y a donc mécaniquement une hausse des
inégalités. Si cette hausse des inégalités ne
traduit pas nécessairement un appauvrissement des plus pauvres, cet
enrichissement des plus riches peut être condamné si l'on se
réfère à des jugements éthiques et à
certaines idées de la justice, de même si l'on songe à son
impact sur la cohésion sociale.
Nous avons donc une réflexion qui porte d'un
côté sur l'efficacité du système redistributif et de
l'autre sur la tolérance qu'il convient d'avoir à l'égard
des inégalités et de la pauvreté, et qui
déterminera les niveaux d'interventions. Ainsi, la redistribution doit
répondre au mieux à deux impératifs: justice sociale et
efficacité économique ; notre questionnement portera donc sur
leurs possibilités de conciliation.
Les inégalités et la pauvreté sont le
résultat directe du fonctionnement de l'économie. Elles
résultent des conditions d'embauches, de la dynamique économique,
du fonctionnement des différents marchés. Les salaires, les
revenus du capital, ou au contraire l'absence de ressources définissent
le niveau de vie des individus, et leurs rang dans la distribution des
richesses. Fruits du fonctionnement normal de l'économie, la
pauvreté et les inégalités ne sont pas pour autant
légitimes. Tout d'abord parce que les inégalités
empêchent de « faire mesure commune », et in
fine de faire société: lorsque elles deviennent
paroxystiques, elles scindent le collectif en sous-groupes qui fonctionnent
indépendamment, et dont les modes de vie n'ont plus rien de commun.
Ensuite, c'est la question de la juste rétribution de l'effort, du
partage de la richesse, qui est posée: les travailleurs pauvres, au bas
de l'échelle des revenus et vivant dans la pauvreté, sont-ils
inutiles? Leurs insuffisantes rétributions reflètent-elles leurs
incompétences? La redistribution est donc importante en ceci qu'elle
permet de rendre à chacun sa juste place et corrige une
répartition de la richesse qui ne reflète pas les apports de
chacun. Enfin, on peu considérer la pauvreté comme
illégitime dès lors que les moyens matériels sont
réunis pour que tous puissent accéder à un niveau de
ressource suffisant, et que par ailleurs la richesse est détenue par des
groupes qui connaissent une situation de sur-abondance.
La redistribution est un moyen de passer de ce qui
est, le fonctionnement primaire de l'économie, à ce qui
devrait être. Ce passage nécessite d'avoir une idée
précise de ce que devrait être une répartition sinon
parfaite, au moins meilleure, et qui se fonde sur un jugement des
inégalités et de la pauvreté permettant de
déterminer leur niveau désirable.
La poursuite de ce souhaitable par la redistribution des
richesses implique la mise en oeuvre de prélèvements et de
transferts. Ainsi, la redistribution, grâce à la fiscalité,
impacte de deux façons la pauvreté et les
inégalités. D'une part de façon directe, par la
levée de fonds permettant de mener des politiques et d'allouer des
richesses. D'autre part de façon indirecte, par les distorsions qui sont
générées grâce aux prélèvements: en
taxant plus telle ou telle catégorie de revenu, la forme de la
distribution des revenus est modifiée. Cependant, ces outils de la
redistribution possèdent des « effets secondaires »
et n'impactent pas que la pauvreté et les inégalités. Un
de ces effets les plus fustigé est la désincitation au travail,
conséquence à la fois de prélèvements trop
importants portant sur les revenus du travail et de transferts trop
généreux alloués aux inactifs. Il en résulte un
phénomène de trappe à inactivité, où les
individus inactifs n'ont pas d'incitation monétaire directe à
reprendre un emploi ; ceci suppose que les agents aient des comportements
calculateurs, et que le gain monétaire soit la source de toute
motivation à l'emploi.
La mise en évidence de ce conflit entre redistribution
et travail est une bonne illustration des difficultés rencontrées
dans la tentative de conciliation entre efficacité et justice sociale.
Ainsi, en écho à cette vaste question, nous nous interrogerons
sur les modalités de conciliation entre redistribution et travail : la
redistribution des revenus est-elle nécessairement source de
désincitation au travail?
Nous prendrons le parti de montrer que la redistribution n'est
pas nécessairement source de désincitation au travail, et que la
conciliation optimale entre travail et redistribution dépend pour
beaucoup des partis pris et des valeurs qui leurs sont rattachées.
Ainsi, pour répondre à cette question, nous
verrons dans une première partie que la répartition primaire des
revenus génère une forte pauvreté et de fortes
inégalités que le système redistributif permet de
corriger. Nous exposerons alors l'effet désincitatif de la
redistribution, en explicitant la notion de taux marginal effectif d'imposition
(TMEI). La forme de la courbe des TMEI rencontrée en France est en effet
à l'origine de gains très faibles au retour à l'emploi
pour les sans-emplois et les bénéficiaires de minima sociaux.
Nous présenterons dans une seconde partie un premier
type de solutions, qui, pour concilier au mieux travail et redistribution, vise
à rendre le travail payant, c'est-à-dire à redistribuer
les revenus de telle sorte que le retour à l'emploi apporte un gain
suffisant pour motiver les sans-emploi. Une ré-interprétation du
modèle standard de la redistribution optimale des revenus nous permettra
de justifier ce changement profond des objectifs de la redistribution:
l'accès à l'emploi en devient en effet un des objectifs
principal, au côté de la protection contre la pauvreté et
la lutte contre les inégalités. Des réformes ont
déjà eu lieu, mettant en oeuvre cette logique où le
travail devient une fin en soi. Nous présenterons les exemples
anglo-saxons, pour montrer les effets potentiels de telles réformes,
ainsi que les jugements qu'elles véhiculent sur le travail et
l'inactivité. La récente réforme du Revenu de
Solidarité Active (RSA) constitue une évolution dans ce sens du
système français de redistribution. Nous en présenterons
la genèse, la mise en oeuvre, ainsi que les controverses portant sur ces
effets potentiels et la logique qui la sous-tend.
Notre troisième et dernière partie sera pour
nous l'occasion de remettre en cause cette conception selon laquelle il existe
un arbitrage monétaire et rationnel qui fonde le choix de travailler ou
de rester inactif. Ainsi, nous montrerons que cette conception est
« datée », et qu'elle a accompagné
l'industrialisation de nos économies et la fondation du capitalisme. De
là date une distinction entre pauvres inaptes et pauvres aptes au
travail, distinction qui sera partiellement remise en cause par la
générosité croissante de la redistribution et par la
prééminence d'une protection sociale assurantielle. Nous verrons
ensuite que le problème de la trappe à inactivité tel
qu'il se pose aujourd'hui dans notre société post-fordiste est
loin d'être réductible au seul gain espéré au retour
à l'emploi. Le phénomène de l'exclusion sociale montre que
les sans-emploi sont exclus du marché du travail, alors que dans le
même temps l'accès à l'emploi demeure important dans la
constitution de la citoyenneté sociale, et que, plus
généralement, les motivations au travail semblent être
diverses. Ces considérations sur la place nouvelle du travail dans notre
société nous amèneront à nous demander si
l'allocation universelle peut constituer une réponse moderne au
problème de la conciliation entre travail et redistribution, en
déconnectant définitivement la motivation à l'emploi de
considérations purement monétaires.
Chapitre I. De la distribution à la
redistribution des revenus.
La redistribution des revenus se justifie par l'existence
d'inégalités importantes, et par les situations de
pauvreté pouvant être générées par le
fonctionnement de l'économie. L'objectif est donc d'apporter des
corrections, afin de produire une répartition des richesses qui permette
d'atteindre des niveaux jugés socialement satisfaisants de
pauvreté et d'inégalités. C'est pourquoi de nombreux
indicateurs ont émergés, visant à la fois à donner
une image la plus fidèle possible de la réalité des
inégalités et de la pauvreté en en comprenant les
déterminants et la complexité, mais visant aussi à
traduire le ressenti des populations vis-à-vis de ces
phénomènes et permettre aux politiques de se doter d'objectifs
simples et compréhensibles par tous. Ces indicateurs répondent
chacun à des conceptions particulières des faits qu'ils cherchent
à appréhender, et doivent donc se compléter.
Ces outils nous permettront de présenter un état
des lieux de la pauvreté et des inégalités en France. Nous
tenterons d'en comprendre les déterminants, notamment en
présentant la structure des revenus primaires, et le rôle
joué par le travail et le capital. De même, nous tenterons de
comprendre les liens entre accès à l'emploi et
pauvreté.
Grâce à cette présentation de la
distribution primaire des revenus, nous pourrons estimer l'effet de la
redistribution sur la répartition des richesses. Si nous pourrons
conclure à un effet globalement positif des impôts et transferts,
nous verrons que la redistribution est susceptible d'engendrer un effet pervers
important concernant l'incitation monétaire au retour à l'emploi,
notamment pour les bénéficiaires de minima sociaux. Nous en
présenterons les caractéristiques et quelques estimations
empiriques.
I. Pauvreté et inégalités :
définitions et mesures.
La mise en oeuvre de la redistribution tire sa
légitimité dans la correction de situations pré-existantes
jugées injustes ou inefficaces. Il est donc nécessaire de poser
un diagnostic sur l'état de la pauvreté et de
l'inégalité, en définissant ces phénomènes
au préalable et en en détaillant les modalités
d'appréciation. Nous pourrons voir ensuite quel est le degré
d'inégalité et de pauvreté dans la répartition
primaire des revenus et des revenus du travail. Nous nous intéresserons
enfin au phénomène des travailleurs pauvres en notant que,
malgré tout, les actifs restent moins pauvres que les inactifs.
A. La Pauvreté.
Avant d'observer l'état de la pauvreté en
France aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre quels sont les
moyens de l'évaluer. De nombreux modes d'évaluation de la
pauvreté ont été développés, chacun
possédant une définition de la pauvreté qui lui est
propre. Ainsi, faire un choix dans le mode d'évaluation revient à
faire un choix sur ce qu'est la pauvreté.
Principalement deux conceptions s'opposent sur la
méthode de dénombrement des individus pauvres. Pour l'une, la
pauvreté est une situation où l'accès aux biens et
services de base est inférieur à une norme jugée minimale.
Ici, c'est une vision absolue de la pauvreté qui prime,
c'est-à-dire que sa définition est invariante de l'état de
richesse de la société. C'est l'anglais Rowntree qui le premier,
dans son ouvrage de 1901, Poverty, a study of town life, cherche
à évaluer le nombre de pauvres, en mettant au point un indicateur
de pauvreté en termes absolus. Grâce aux conseils de
nutritionnistes, il quantifie les besoins nutritionnels minimaux à
satisfaire pour chaque famille, afin d'éviter les situations de maladie
et de perte de poids. De là, il compose un panier de biens satisfaisant
ces besoins en choisissant les produits les moins chers. Le seuil de
pauvreté étant alors la capacité monétaire de se
procurer ce panier-type. Plus tard, cette conception a été
développée aux États-Unis au début des
années soixante, lorsque la mise en place d'un système de
sécurité sociale complet a été
décidée : il s'agissait de financer l'assurance maladie des
plus démunis, d'où la nécessité de créer un
critère de sélection des ayant droits aux nouvelles aides ;
ce critère fut défini comme la capacité monétaire
de se procurer un panier-type.
La seconde conception du seuil de pauvreté est
exprimée en termes relatifs : le seuil de pauvreté
dépend de la répartition globale des revenus. La pauvreté
n'est donc plus l'incapacité d'accéder à un minimum, mais
l'écart existant avec le revenu considéré comme normal. On
devient pauvre lorsque notre revenu est inférieur au revenu normal,
lorsqu'on possède moins que la norme. Cette conception est
utilisée aujourd'hui par l'Union Européenne et d'autres
institutions, ainsi que par la France (à titre indicatif, sans
être utilisé comme critère dans les politiques sociales).
Le seuil est défini comme étant le revenu correspondant à
50% (ou 60%) du revenu médian (il est traditionnellement calculé
sur le revenu moyen au Royaume-Uni2(*)), c'est-à-dire le revenu dont la moitié
de la population gagne plus, et l'autre moitié a un revenu
inférieur. Ainsi, en France en 2007, le seuil de pauvreté
à 60% pour une personne seule correspondait à un revenu
disponible mensuel de 908 euros3(*).
Les deux conceptions reposent sur deux visions distinctes de
la pauvreté, et apportent des informations différentes (mais
complémentaires) sur l'état de la pauvreté.
L'intérêt de la définition en termes
absolus réside dans le fait qu'elle permet de comparer l'étendue
de la pauvreté entre plusieurs pays qui connaissent des situations fort
différentes. Par exemple, en définissant la pauvreté de
cette façon, on met en évidence que le nombre de pauvres dans un
pays « développé » est largement
inférieur à celui présent dans un pays
« pauvre », c'est-à-dire que dans ce dernier
l'accès à un minimum est moins aisé. D'ailleurs, les
organisations internationales, comme la Banque Mondiale évaluent la
pauvreté dans les pays en voie de développement en termes absolus
(personnes vivant avec moins de 1 ou 2 dollars par jour), ce qui n'est pas
réalisé pour les pays industrialisés. Pour autant, se pose
ici la question du niveau du seuil et de la composition du panier-type,
c'est-à-dire de la quantité de biens que l'on juge être
minimale. Doit-on intégrer, par exemple, l'accès à une
connexion internet dans le calcul du seuil, car elle permet de rester
intégré socialement et de chercher activement un emploi ?
La conception relative repose sur un autre parti pris. Comme
l'affirmait K.Marx en 1849, « Nos besoins et nos plaisirs ont
leur source dans la société ; nous les mesurons, par
conséquent, à la société ; nous ne les
mesurons pas aux objets de notre satisfaction. Comme ils sont de nature
sociale, ils sont de nature relative. 4(*)». De ce constat Marx tire une conclusion
fondamentale : l'accroissement des plaisirs de l'ouvrier ne s'accompagne
pas d'une plus grande satisfaction sociale, car la richesse des plus riches et
celle de la société toute entière croît au
même rythme5(*). L'insatisfaction
ne provient donc pas d'un manque vital ou de difficultés d'accès
à des services essentiels mais de la différence que l'on observe
entre soi et le niveau de vie standard. Le dénombrement des pauvres en
termes relatifs recoupe cependant largement le dénombrement en termes
absolus, puisque les individus relativement les moins bien dotés sont
aussi ceux qui auront du mal à accéder aux minimums vitaux.
La mesure relative de la pauvreté reste essentiellement
une mesure de l'inégalité de répartition des revenus. Tant
que la structure de la répartition n'est pas modifiée,
l'insatisfaction des plus pauvres est constante, et on peut même supposer
qu'elle est croissante si la richesse des plus riches croît plus
rapidement. Si l'on désire mener une action pour réduire la
pauvreté relative, il sera nécessaire de rendre la
société plus égalitaire et non pas plus riche, car il est
possible que le taux de pauvreté diminue quand la richesse globale
diminue. En effet, si les plus riches s'appauvrissent, le revenu médian
va automatiquement diminuer, diminuant du même coup le nombre de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté. En poussant la logique, il
est techniquement envisageable qu'un appauvrissement en termes absolus des plus
pauvres s'accompagne d'une diminution de la pauvreté en termes relatifs,
si la société s'appauvrit en devenant égalitaire. Cette
conception relative de la pauvreté est très bien décrite
par A.Gorz. Ainsi, pour lui, « pas plus qu'il n'y a de pauvres
quand il n'y a pas de riches, pas plus il ne peut y avoir de riches quand il
n'y a pas de pauvres : quand tout le monde est riche, personne ne
l'est ; de même quand tout le monde est pauvre.6(*)»
Cependant, les deux conceptions posent les mêmes
problèmes, propres à la fixation d'un seuil : elles
n'indiquent rien sur le positionnement des individus par rapport au seuil. En
conséquence, le revenu manquant (« income
gap ») doit être pris en compte si l'on veut se faire une
idée précise de la pauvreté : c'est le
supplément de revenu qui permettrait aux individus sous le seuil de
pauvreté d'atteindre ce seuil. L'income gap peut être
mesuré en moyenne (écart moyen au seuil, des individus les plus
pauvres), permettant ainsi d'avoir une vison globale de l'intensité de
la pauvreté. Si l'income gap s'accroît sans que le taux
de pauvreté ne bouge, cela signifie que les pauvres s'appauvrissent, ce
qui ne peut être ignoré par les politiques de lutte contre la
pauvreté. D'ailleurs comme le note A.Sen: « avec le ratio
du dénombrement comme mesure de la pauvreté, tout gouvernement
est soumis à la vive tentation de concentrer ses efforts sur les plus
riches des pauvres, puisque c'est de cette façon là que le nombre
de pauvres (...) peut être le plus aisément
réduit » 7(*). Face à cette tentation de réduire le taux de
pauvreté, c'est plutôt l'objectif de diminuer la pauvreté
des plus pauvres, c'est-à-dire la grande pauvreté qui devrait
être légitimement prioritaire8(*). Le second problème qui découle de la fixation
d'un seuil et lié au précédent : c'est la non prise
en compte de l'inégalité parmi les pauvres. Cette prise en compte
est importante puisque plus l'inégalité parmi les pauvres est
importante, plus il sera difficile de résorber le grande
pauvreté, et plus les plus pauvres seront pauvres.
Ainsi, au-delà des différentes conceptions de
la pauvreté, sa mesure doit intégrer de multiples
considérations, et seul un indicateur composite permettrait d'en donner
une image complète9(*). Il en va
de même pour l'inégalité, second phénomène
justifiant l'intervention de la redistribution des richesses, et recoupant une
réalité complexe.
B. L'inégalité.
Se poser la question « pourquoi
l'égalité? » revient selon A. Sen à se
poser une autre question: « égalité de
quoi? ». En effet, si nous parvenons à donner une
réponse à la seconde question, c'est-à-dire si nous sommes
capables de définir un champ où promouvoir
l'égalité, alors nous savons déjà pourquoi
l'égalité est importante dans cette espace. Poser la question de
la variable que nous voulons rendre égalitaire, permet de s'apercevoir
de l'universalité de cette idée, défendue aujourd'hui par
tous les courants de pensée. Même les plus libéraux,
pensant eux-mêmes se battre contre le dogme de l'égalitarisme,
défendent une certaine idée de l'égalité :
l'égalité des droits et des libertés. La défense
d'une inégalité méritocratique n'échappe pas
à la règle : à compétence égale,
traitement égal. Cependant, la notion d'égalité renvoie
bien souvent aux inégalités dans le répartition des
revenus.
Ceci se comprend fort bien si l'on accepte que le revenu est
un élément central dans la constitution d'une liberté
positive effective10(*). De plus, la
richesse, exprimée en termes monétaires, permet une comparaison
rapide entre plusieurs situations. On fait alors l'hypothèse implicite
qu'un euro procure la même utilité à tous,
indistinctement : celui qui a un revenu moindre est donc
nécessairement désavantagé. On pourrait au contraire
supposer que nous sommes tous différents, et que les besoins individuels
ne sont pas homogènes. En ce cas, réclamer
l'égalité de revenu revient à réclamer
l'inégalité des niveaux d'utilité. La facilité de
la comparaison de revenus monétaires, et l'impossibilité pour
nous de prendre en compte les préférences individuelles quant
à la détention de monnaie, font de la prise en compte des
inégalités de revenu le meilleur objectif pour le système
redistributif11(*).
Prendre en compte le degré d'inégalité
existant dans une société semble justifié au moins pour
deux raisons. Tout d'abord parce que les inégalités, si elles
sont trop fortes et trop ressenties peuvent fortement nuire à la
cohésion sociale, et ceci d'autant plus que les plus pauvres sont
démunis. Ainsi, calculer le niveau d'inégalité
après redistribution revient à appréhender quel est le
degré d'acceptation des inégalités : plus le
système redistributif égalise les revenus, plus l'aversion pour
l'inégalité est importante, et inversement. Ensuite, parce que le
niveau d'inégalités reflète le fonctionnement du
système économique, que l'on peut juger à l'aune du
degré d'inégalités qu'il génère. Calculer le
niveau d'inégalités sur les revenus primaires permet de
comprendre comment sont répartis les fruits de l'activité
économique.
S'il est pertinent d'appréhender le niveau
d'inégalité, quelle méthode employer ? De nombreux
indicateurs sont à notre disposition, mais nous en retiendrons ici
principalement trois : le rapport inter-quantiles, l'indice de Gini et
l'indice d'Atkinson.
Le rapport inter-quantiles est le plus simple et le plus
intuitif des indicateurs. C'est le rapport entre, par exemple, le
neuvième décile et le premier décile, c'est-à-dire
entre le revenu dont 90% de la population gagne moins et le revenu dont 10% de
la population gagne moins. Si le rapport est de 3, alors on peut dire que les
10% les plus riches gagnent, au moins, trois fois plus que les 10% les plus
pauvres. Il est aussi possible, par exemple, de calculer le rapport entre la
médiane (cinquième décile) et le premier décile,
afin de voir la dispersion des revenus en bas de l'échelle. La prise en
compte des déciles peut aussi donner lieu au calcul du revenu moyen par
décile (par exemple le revenu moyen des 10% les plus riches). Il
s'ensuit que le rapport entre les revenus moyens du dernier et du premier
décile sera fortement majoré par rapport au rapport
interdécile, et ceci d'autant plus que les plus riches sont très
riches et les plus pauvres très pauvres. Comparer le revenu moyen des
10% les plus riches et le neuvième décile permet
d'appréhender la dispersion en haut de l'échelle : plus le
revenu moyen est supérieur au décile, plus
l'extrémité des hauts revenus est élevée. Des
rapports peuvent être calculés avec tous les quantiles possibles,
par exemple entre des centiles (les 1% les plus riches gagnent au moins x
fois le revenu des 1% les plus pauvres), ou des quintiles (les 20% les
plus riches gagnent au moins x fois le revenu des 20% les plus
pauvres).
Après le rapport inter-quantiles, l'indice de Gini est
l'un des indicateurs les plus usités, parce qu'il reste intuitif, et
parce qu'il permet de mesurer l'écart existant entre
l'égalité parfaite et la distribution effective des revenus. Il
est compris entre 0 et 1, avec 1, l'inégalité absolue (un
individu possède tous les revenus), et 0 l'égalité
parfaite. On peut représenter grâce à la courbe de Lorenz
différents types de distribution des revenus (cf. Graphique 1).
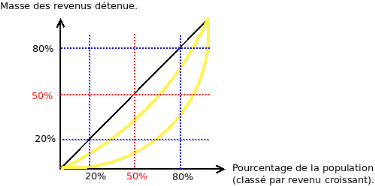 Graphique 1: Courbe de Lorenz Graphique 1: Courbe de Lorenz
On a en abscisse la population classée par ordre
croissant de revenus, et en ordonnée la masse des revenus. Dans le cas
d'une répartition parfaitement égalitaire (droite), 50% de la
population détient 50% de la masse des revenus, 20% de la population
détient 20% des revenus, 80% détient 80% des revenus. Par contre,
dans le cas de répartitions plus inégalitaires, les courbes
s'éloignent de la bissectrice : dans le cas de la
répartition A, les 20% les plus pauvres ne détiennent que moins
de 10% des revenus, et les 20% les plus riches détiennent plus de 30%
des revenus. Pour la répartition B, les 20% les plus riches
détiennent environ 60% des revenus tandis que les 20% les plus pauvres
détiennent moins de 20% des revenus. Ainsi, étant donné
que plus l'écart entre la bissectrice et la répartition effective
est important plus les inégalités sont fortes, on peut mesurer
l'espace séparant la représentation de le répartition
effective de la répartition égalitaire pour juger de l'ampleur
des inégalités. L'indice de Gini mesure cet espace (grâce
à une formule de type intégrale) et l'exprime par rapport au cas
parfaitement inégalitaire (où l'indice est donc égal
à 1). C'est donc le rapport entre, d'une part, la surface comprise entre
la courbe de Lorenz effective et la courbe de Lorenz parfaitement
égalitaire, et d'autre part, la surface définie par [EFG].
On peut trouver comme critique à l'indice de Gini qu'il
ne permet pas de différencier deux distributions ayant le même
écart global avec la distribution égalitaire mais n'ayant pas la
même forme, l'une pouvant être plus inégalitaire au bas de
la distribution (aplatissement plus marqué au début de la courbe
de Lorenz), l'autre plus inégalitaire en haut de la distribution
(verticalité plus marquée en haut de la courbe de Lorenz)12(*) (pour le détail, cf.Annexe
3)
Enfin, on peut présenter l'indice de Atkinson qui
possède la particularité d'introduire une vision normative de
l'inégalité. Tous les indicateurs que nous avons
présentés précédemment permettent d'exprimer un
niveau d'inégalité mais permettent difficilement de juger de ce
niveau. Bien qu'ils permettent des comparaisons (inter-temporelles et
spatiales), ils ne permettent pas de dire, pour un niveau donné
d'inégalités, s'il est acceptable ou souhaitable. T.Atkinson
affirme ainsi: « for the economist (...) it is more natural to
begin by considering the ordinal problem of obtaining a ranking of
distributions, since this may require less agreement about the form of the
social welfare function 13(*)». C'est donc par facilité que la plupart
des indicateurs développés permettent de comparer les
degrés d'inégalité de deux distributions (classement
ordinal des distributions), sans chercher à juger du degré
d'inégalité d'une redistribution, en se référant
à une fonction de bien-être social
prédéterminée. En conséquence l'indice
développé par Atkinson vise à comparer plusieurs
distributions d'inégalité pour un niveau d'aversion sociale
à l'inégalité déterminée, et à faire
évoluer l'indice en fonction de l'aversion à
l'inégalité (pour une explication en détail du calcul et
des implications de l'indice de Atkinson, cf.Annexe 3).
En nous empêchant de faire mesure commune, et en
signifiant un dysfonctionnement de la répartition opérée
par les marchés, de trop fortes inégalités justifient
l'intervention correctrice de la redistribution. Cette correction doit reposer
sur des indicateurs, dont la diversité nous permet de prendre en compte
les différents aspects de l'inégalité de revenus. Ces
indicateurs nous permettent en outre d'intégrer à la fois une
dimension positive et une dimension normative, les deux étant
nécessaires pour appréhender au mieux les
inégalités.
Nous venons de définir précisément les
notions de pauvreté et d'inégalité. Il en ressort qu'il
n'existe pas de façon juste et universelle de les appréhender, et
que choisir l'une ou l'autre des conceptions n'est pas sans incidence. Il
convient désormais d'observer, grâce à ces
définitions et à ces indicateurs, l'état des
inégalités et de la pauvreté en France.
II. Pauvreté, inégalité et
emploi.
Après avoir défini la pauvreté et les
inégalités, et après avoir présenté les
moyens de mesures qui nous sont offerts, il convient d'appréhender leurs
importances et leurs caractéristiques en France. Ainsi, nous
présenterons les grandes tendances relatives à la pauvreté
et les inégalités, en s'attachant surtout à comprendre
quels en sont leurs déterminants. Nous verrons tout d'abord que les
inégalités de revenus primaires sont importantes, en raison des
fortes inégalités de salaires et des inégales dotations en
patrimoine. Nous verrons ensuite que la pauvreté est aussi la
conséquence des inégalités face à l'emploi :
l'inactivité et la précarité du salariat en sont les
principaux déterminants. La dégradation des conditions d'emplois
impacte ainsi défavorablement les travailleurs, qui sont, par
conséquent, de plus en plus vulnérables face à la
pauvreté.
A. L'inégale distribution des revenus primaires.
La structure des revenus primaires évolue avec la
structure productive, et l'avènement de la
« société salariale » s'accompagne
logiquement d'une prééminence des inégalités de
salaire dans la structure des inégalités. En effet, le fait que
tout le monde devienne salarié n'implique pas de resserrement des
inégalités, car comme l'indique R.Castel, on a vu
apparaître un « salariat bourgeois 14(*)», constitué
de cadres, de professions intellectuelles, favorisés par la
tertiarisation de l'économie. Cette bourgeoisie salariée ne se
substitue pas aux emplois peu payés et peu qualifiés, encore
nombreux.
Ainsi, c'est dans la structure des revenus salariaux qu'il
faut chercher l'origine d'une part importante des inégalités de
revenus (revenus primaires autant que disponibles). En 2006, la distribution
des salaires nets annuels est caractérisée par un écart
interdécile (D9/D1) de 2,97, signifiant ainsi que les 10% des
salariés les mieux payés gagnent au moins trois fois le salaire
des 10% les moins bien payés. Bien que ce chiffre soit
conséquent, il faut noter que les inégalités de salaire
ont eu fortement tendance à diminuer depuis l'après-guerre :
le rapport interdécile était ainsi de 4,12 en 1965. Les
inégalités entament alors une nette diminution jusqu'au
début des années quatre-vingt, après quoi elles se
stabilisent jusqu'à nos jours15(*). Il faut noter que cette baisse du rapport D9/D1
s'explique avant tout par une diminution des inégalités dans le
bas de la distribution des salaires : le rapport D9/D5 reste parfaitement
stable, tandis que le rapport D5/D1 diminue très
régulièrement (cf. Graphique 1).
Graphique 1: Evolution des rapports
interdéciles de la distribution des salaires nets annuels. Source:
INSEE, 2010. ![]()
Ainsi, c'est principalement la revalorisation des bas salaires
qui a permis cette baisse tendancielle des inégalités. Le Salaire
Minimum Inter-professionnel de Croissance (SMIC) remplace le SMIG (Salaire
Minimum Inter-professionnel Garanti) en 1970, avec, lors de cette transition
une réévaluation importante de son niveau, mais surtout une
modification du mode de calcul du salaire minimum, qui n'est plus indexé
seulement sur l'inflation mais aussi sur le taux de salaire horaire ouvrier. De
même, les revendications salariales issues des contestations de Mai 1968
vont se répercuter en hausses des bas salaires qui seront nombreuses
durant les années soixante-dix. Le premier décile de la
distribution des salaires croit ainsi de 15% entre 1967 et 1968, de 20%
l'année suivante, ou encore de 21% entre 1973 et 1974. Les mêmes
années, le taux de croissance du neuvième décile n'est que
de 8%, 12% et 17%. Le rôle du salaire minimum apparaît ici comme
prépondérant dans le compression de l'éventail des
salaires au bas de la distribution16(*) : l'augmentation du SMIC a un fort impact
négatif sur l'évolution du rapport D5/D1.
La diminution des inégalités de salaires a
été cependant de plus en plus faible depuis les années
quatre-vingt, et l'on observe même une hausse du rapport D9/D1 ente 1984
et 1994 (de 3,09 à 3,23). Le rapport stagne ensuite jusqu'en 2006, alors
qu'entre 1966 et 1984 le rapport passe de 4,18 à 3,09. Outre la
croissance qui est plus faible aujourd'hui que lors de la période
d'accumulation fordiste des « trente glorieuses »,
il faut noter que les hauts salaires ont aujourd'hui tendance à
croître beaucoup plus rapidement que le reste des salaires : entre 1984
et 2006, l'écart entre le salaire moyen et le salaire médian a
été multiplié par deux17(*) (l'élévation plus rapide du salaire
moyen dénote la hausse des valeurs extrêmes dans la partie
supérieure de la distribution des salaires).
Outre les salaires, le capital joue un rôle
déterminant dans la constitution des inégalités de
revenus : les inégalités entre revenus d'activités
sont faibles comparées aux inégalités de
répartition du patrimoine. Ainsi, les 50% des ménages les moins
bien dotés en patrimoine ne possèdent que 10% du patrimoine
total. A l'inverse, les 10% les mieux dotés possèdent 40% du
patrimoine total. L'indice de Gini calculé sur la répartition du
patrimoine atteint ainsi presque 0,7. En comparaison, l'indice de Gini
calculé sur les revenus primaires, c'est-à-dire y compris les
revenus du capital et les revenus du travail, atteint 0,48.
Les inégalités de dotations en patrimoine sont
liées aux classes d'âges (le patrimoine croît fortement avec
l'âge des détenteurs), mais aussi au niveau de revenu. Ainsi, les
hauts revenus sont ceux qui détiennent le plus de patrimoine, et sont
ceux dont la part du revenu issue du patrimoine de rapport est la plus
importante. Selon T.Piketty, la hausse de la proportion des revenus du capital
avec la hausse du revenu primaire a toujours été un trait du
capitalisme18(*).
Cependant, cette relation s'est fortement atténuée au fil du
XXème siècle, et la part des revenus du capital chez les hauts
revenus a fortement décrue. Désormais, seulement pour les
fractiles extrêmement supérieurs, les revenus du capital sont
majoritaires et supplantent les revenus d'activité. Ainsi, les revenus
du travail salarié restent majoritaires jusque pour ce que Piketty
appelle les « classes moyennes19(*) », c'est-à-dire les plus
pauvres des plus riches (fractile P90-9920(*)). Ensuite, les revenus d'activité des
indépendants prennent le dessus (fractile P99-99,9) pour enfin
céder la place, à la marge, aux revenus du capital mobilier (pour
les « 200 familles » les plus riches, les revenus
du capital représentent 60% du total des revenus). La part des revenus
du capital est donc croissante avec le revenu surtout pour les hauts
revenus ; de même, la part des revenus issue du capital mobilier
croît avec le revenu mais de façon significative que pour les
très hauts revenus (90% des revenus du capital sont issus du capital
mobilier pour les « 200 familles »). La véritable
richesse résidant, dans la société capitaliste, dans la
détention du capital des entreprises, alors qu'elle résidait,
sous l'ancien régime, dans la propriété
foncière21(*).
B. Pauvreté et emploi
La répartition des revenus primaires est loin
d'être égalitaire, autant en raison d'une inégale
répartition du capital que de fortes inégalités au sein du
salariat. Ces inégalités salariales sont importantes et
révèlent que l'emploi n'est pas un statut offrant des avantages
et une sécurité uniformes. La situation d'emploi des individus
conditionne pour une large part leur positionnement vis-à-vis du seuil
de pauvreté ; cette importance de l'emploi se traduit de deux
façons : d'une part par l'accès -ou non- à l'emploi,
et d'autre part par la qualité de l'emploi obtenu.
Graphique 2: Évolution du nombre de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté à 60%. Source: INSEE,
2010![]()
Entre 1996 et 2006, le taux de pauvreté (seuil de 60%)
en France a diminué, quoique très légèrement :
il est passé de 13,5% à 13,2%. Cependant, dans le même
temps, le nombre de pauvres a augmenté de 300 000 personnes, au
point qu'en 2007, le nombre de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté est à peu de choses près celui de 1990
(cf.Graphique 2).
Malgré tout, la France se positionne plutôt bien
par rapport aux autres pays de l'OCDE. Neuf pays ont un taux de pauvreté
plus faible, dont la Suède (11,4%) ou la République
Tchèque (11,5%), tandis que vingt-et-un pays affichent des taux de
pauvreté supérieurs, pouvant aller jusqu'à 23,9% pour les
États-Unis ou 21% pour l'Espagne. Ces bonnes performances de la France
peuvent s'expliquer pour D. Clerc par l'importance de notre système
redistributif, qui permet de lutter efficacement contre la pauvreté. Par
conséquent, compte tenu de cette « protection »
pouvant être jugée plutôt efficace, il faut trouver une
explication à la légère hausse du nombre de personnes
pauvres que nous avons observée entre 1996 et 2006. Pour D. Clerc, c'est
la dégradation des conditions d'emplois qui en est le facteur
explicatif22(*).
L'accès à l'emploi reste un des principaux
moyens de se protéger de la pauvreté. Les inactifs (hors
retraités) connaissent un taux de pauvreté de plus de 48%, ce qui
est deux fois plus important que le taux de pauvreté maximum des actifs.
Au sein des actifs, la situation n'est pas homogène, puisque on peut
estimer23(*) que le tiers
des chômeurs (c'est-à-dire en recherche active d'emploi) vivent
dans un ménage pauvre, ce qui est conséquent.
Mais, si l'emploi reste protecteur, tous les emplois ne
permettent pas une protection homogène. On voit grâce à
l'Illustration 2 que le niveau de pauvreté est fortement
influencé par la Profession et Catégorie Socioprofessionnelle
(PCS) de la personne de référence du ménage.
Illustration 2: Taux de pauvreté (seuil
à 60%), selon la PCS de la personne de référence du
ménage. Source: INSEE, Enquête Revenus Fiscaux 2007![]()
On observe un lien direct entre emploi et pauvreté: si
le taux de pauvreté pour les agriculteurs exploitants atteint 24,63% en
2007, il n'est que de 2,67% pour les cadres supérieurs. On remarque
qu'après les agriculteurs, ce sont les employés, ouvriers, et
travailleurs indépendants qui ont les taux de pauvreté les plus
élevés, légèrement au dessus du taux de
pauvreté globale. Le travail n'est donc pas toujours protecteur, puisque
le quart d'une profession vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté.
Au delà de la PCS, la qualité de l'emploi
s'apprécie par le type de contrats. Ainsi, les temps partiels sont bien
plus exposés au risque de pauvreté que les travailleurs à
temps plein. Pour dépasser le seuil de pauvreté en travaillant
(sans prendre en compte les transferts sociaux), il faut travailler au moins
137 heures par mois au salaire horaire net de 6,62€. Une personne
travaillant à mi-temps, soit soixante-dix heures par mois, payée
au SMIC, ne touche que 463,4€ mensuels, ce qui est loin du seuil de
pauvreté. Pour le tiers des personnes en temps partiel, cette situation
est subie, c'est-à-dire que les revenus du foyer où les
compléments de revenus ne permettent pas d'atteindre un niveau de vie
jugé satisfaisant. De même, la forte croissance des flux
d'embauches en CDD (70% des embauches se font aujourd'hui en CDD24(*)) ou en intérim
contribue à fragiliser l'emploi. Le taux de pauvreté (seuil
à 60%) des personnes ayant cumulé emploi et chômage sur une
année est de 29% lorsque le chômage est dominant, et de 20%
lorsque l'emploi est dominant, alors que lors de la même étude, le
taux de pauvreté des personnes en CDI à temps complet
était de 4%25(*).
La statut du travailleur détermine donc son positionnement
vis-à-vis de la pauvreté.
Globalement, le nombre de travailleurs26(*) vivant dans un ménage
pauvre est 1,74 millions en 2005. La même année, 3,745 millions de
travailleurs avaient un revenu d'activité qui n'atteignait pas le seuil
de pauvreté à 60%27(*). En parallèle, l'intensité de la
pauvreté avant impôts et transferts, c'est-à-dire sur les
revenus primaires (donc issus du travail pour une large part), pour
un seuil de pauvreté à 60% du revenu médian, est ainsi de
72,6% en France en 2005. L'écart moyen entre le revenu primaire des
individus pauvres et le seuil de pauvreté représente donc 72,6%
de ce seuil. Cet écart s'est accru depuis 1985, où il
était de 67% du seuil de pauvreté. Les personnes vivant sous le
seuil de pauvreté du fait d'emplois peu rémunérateurs ou
d'absence d'emploi ont ainsi vu leur situation se dégrader en moyenne
entre 1985 et 2005.
Il demeure sans doute préférable aujourd'hui
d'être en emploi que d'être inactif si l'on cherche à se
prémunir contre la pauvreté. Néanmoins, certains emplois
offrent une protection relativement faible, et globalement la situation des
travailleurs semble se dégrader.
La distribution primaire des revenus est donc
caractérisée par des inégalités et une
pauvreté importante. Le travail est un facteur déterminant dans
la constitution de ces inégalités ; de même, le
travail semble être de moins en moins protecteur à l'égard
de la pauvreté. Si l'objectif de la redistribution est de lutter contre
les inégalités et la pauvreté, son intervention se trouve
ainsi tout à fait justifiée.
III. La mise en oeuvre de la redistribution.
Nous devons juger de la capacité du système
redistributif à modifier la répartition des richesses. Il s'agit
de voir s'il permet d'atténuer les disparités de richesses et les
situations de pauvreté, et, à ce titre, nous tenterons de voir
quels en sont les instruments les plus efficaces. Mais, si la redistribution
atteint son objectif en termes de justice sociale, il convient de
vérifier que cette action ne soit pas faite au détriment de
l'efficacité économique. C'est pourquoi nous présenterons
le potentiel effet de désincitation au travail, souvent associé
à une redistribution trop généreuse, ainsi que son
effectivité dans le cas de la France.
A. Une redistribution efficace.
L'état de la pauvreté et des
inégalités en France est fortement impacté par la
redistribution des revenus. Ainsi, la redistributivité issue de la
conjugaison des principaux transferts et prélèvements semble
importante, c'est-à-dire que les transferts bénéficient
plus aux ménages les plus pauvres, et que les prélèvements
impactent plus les revenus les plus élevés (cf. Graphique 3).
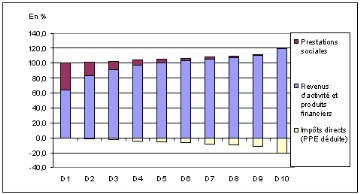 Graphique 3: Composition du revenu disponible, selon le niveau de
revenu. Source: La Documentation Française. Graphique 3: Composition du revenu disponible, selon le niveau de
revenu. Source: La Documentation Française.
![]()
Ainsi, on observe qu'en France les revenus primaires (c'est-à-dire les
« revenus d'activité et produits financiers » sur le
graphique) ne sont pas équivalents aux revenus disponibles. Pour le
premier décile de revenus, le revenu primaire représente un peu
plus de 60% du revenu disponible : le système socio-fiscal
permet donc de fournir 40% de leur revenu disponible. Les transferts
alloués semblent donc protéger efficacement les individus les
plus pauvres du risque de pauvreté. Pour les personnes ayant un revenu
disponible compris entre le quatrième et le cinquième
décile, les revenus primaires représentent 100% du revenu
disponible : les effets des prestations sociales perçues et des
impôts directs payés se compensent à peu près. Pour
les personnes du dernier décile, les revenus primaires
représentent 120% de leur revenu disponible, les impôts directs
payés en représentant 20%. On observe donc que la part du revenu
primaire dans le revenu disponible est fortement croissante avec le revenu, de
même que la part des prestations sociales dans le revenu disponible est
fortement décroissante avec le revenu. On peut donc conclure à
une forte redistributivité du système socio-fiscal
français puisqu'il permet, grâce aux impôts et transferts de
lisser les inégalités de revenus primaires.
La redistribution a aussi un impact important sur la
pauvreté. Elle permet de réduire de 20 points de pourcentage le
taux de pauvreté avec un seuil à 60% du revenu médian , et
de 23,6 points si l'on prend en compte un seuil à 50% (cf. Tableau
1).
Le tableau nous indique aussi que la redistribution a un effet
positif sur l'income gap. L'intensité de la pauvreté est
fortement réduite grâce au système redistributif :
l'écart entre le revenu moyen des personnes pauvres et le seuil de
pauvreté (fixé à 60% du revenu médian) passe ainsi
de 72,6% de ce seuil à 22,4% grâce à la redistribution. Les
individus qui demeurent pauvres malgré l'intervention du système
socio-fiscal, sont en moyenne moins pauvres que si la redistribution
était inexistante. Ce sont les transferts qui, en toute logique,
impactent les taux de pauvreté
Tableau 1: Effet de la redistribution sur
différentes mesures de la pauvreté. Source: OCDE, 2008![]()
Si la redistribution semble jouer globalement un rôle
important, il faut tenter maintenant de comprendre quels en sont les
instruments les plus efficaces28(*)(pour un détail de ces instruments, cf.Annexe 9).
L'impôt sur le revenu (IR) semble être un
instrument particulièrement redistributif, ceci d'autant plus que seuls
les 50% les plus riches des ménages payent effectivement cet
impôt29(*). Son
prélèvement génère une amputation globale du revenu
net
30(*)
importante, d'un peu plus de 5%. Le prélèvement
opéré par l'IR est cependant beaucoup plus important pour les
hauts revenus puisque, pour les revenus du quintile supérieur, il
représente une perte de 10,5% du revenu net, contre 1,8% pour le
troisième quintile et une majoration de 0,3% pour le premier quintile.
Ceci est consécutif à la structure progressive de cet
impôt : le taux d'imposition augmente avec le revenu imposable.
Ainsi, le barème actuellement en vigueur de l'IR réalise une
division du quotient familial en cinq tranches : pour les revenus
inférieurs à 5875 €, le taux d'imposition est nul, puis il
est de 5,5% pour les tranches de revenus comprises entre 5875 et 11720€,
de 14% pour les tranches comprises entre 11720 et 26030€, de 30% pour les
tranches allant de 26030 à 69783€. Pour toutes les tranches de
revenus supérieures à 69783€, le taux d'imposition est de
40%, ce qui représente le taux marginal supérieur de
l'impôt sur le revenu. Au final, le rapport inter-quintiles est de 7,24
pour le revenu net, et est réduit à 6,45 une fois déduit
l'IR (sans la Prime Pour l'Emploi).
Les transferts monétaires sont ceux qui
égalisent le plus la répartition des revenus et, ce, que ce
soient des transferts sous condition de ressources ou des transferts sans
condition de ressources. On remarque ainsi que les « prestations
familiales sans condition de ressources » génèrent une
augmentation du revenu net du premier quintile de 14,7%, contre seulement 1%
pour le dernier quintile. Les prestations ne varient pas en fonction du revenu
mais en fonction de la composition du foyer, mais les sommes versées
représentent une part plus importante des bas revenus que des hauts
revenus. Le rapport inter-quintile passe ainsi de 7,24 à 6,37 : la
réduction des inégalités est plus forte qu'avec l'IR.
Paradoxalement, les prestations familiales mises sous condition de ressources
sont moins redistributives, en raison de leur plus faible ampleur. Elles
représentent 9,1% du revenu net du premier quintile, et 0% du revenu net
du dernier quintile, mais ne ramènent la ratio inter-quintile qu'a 6,64,
ce qui est moins efficace que l'IR et que les prestations sans condition de
ressources. Les aides au logement, elles aussi sous conditions de ressources
sont extrêmement efficaces, grâce à leur ampleur : les
individus du premier quintile ont reçu en moyenne 1190€ par
équivalent adulte à ce titre en 2008. Les aides au logement
cumulées au revenu net permettent d'atteindre un rapport inter-quintile
de 6,14 : elles sont l'outil de redistribution correcteur des
inégalités le plus efficace. Les minima sociaux quant à
eux, représentent en moyenne 920€ annuels pour le premier quintile
en équivalent adulte, et permettent d'atteindre un ratio de 6,36: ils
sont donc moins redistributifs que les aides au logement. Il permettent
toutefois de réduire le taux de pauvreté et l'intensité de
pauvreté des ménages modestes.
Au final, le système socio-fiscal permet de faire
passer le rapport inter-quintiles de 7,23 pour le revenu net à 4,1 pour
le revenu disponible (après transferts). Le coefficient de Gini passe
de 0,48 à 0,28 en France en 2005 grâce à la redistribution,
ce qui en constitue une baisse, conséquente, de 41%31(*).
Si la redistribution des revenus en France remplit donc
plutôt bien ses objectifs en terme de réduction des
inégalités et de la pauvreté, il reste à voir si
elle n'entrave pas la fonctionnement de l'économie, en dévaluant
le travail, pour ses allocataires.
B. L'effet désincitatif de la redistribution.
Nous l'avons vu, redistribuer semble nécessaire compte
tenu des inégalités et de la pauvreté qui
caractérisent la distribution des revenus primaires. Cette position est
d'autant plus évidente que nous avons montré que le
système socio-fiscal français permet une forte réduction
des inégalités et de la pauvreté. Cependant, la
redistribution impacte la distribution des revenus et instaure des distorsions
dans le jeu « normal » de l'économie. Afin de juger
de l'efficacité de la redistribution il est nécessaire d'observer
ces distorsions, leur importance et leurs conséquences.
Le régime fiscal français, et la redistribution
qui lui est associée sont caractérisés par la
convexité de la courbe du taux marginal effectif d'imposition (TMEI)
à l'instar de la quasi-totalité des pays de l'OCDE. Le taux
marginal d'imposition représente le taux auquel est imposé chaque
euro supplémentaire gagné, c'est-à-dire la part de chaque
euro gagné qui est confisquée par l'impôt. Par exemple,
appliqué à l'impôt sur le revenu français, le taux
marginal d'imposition est croissant par palier, compte tenu du barème en
tranches : le taux marginal d'imposition sur le revenu est constant jusqu'au
passage à la tranche supérieure où il connaît un
« bond ». Cependant, se focaliser sur le taux marginal
d'imposition sur le revenu reste limité : cet indicateur ne prend pas en
compte l'ensemble des impôts et taxes pesant sur l'euro
supplémentaire gagné, ni ne prend en compte les gains ou pertes
de transferts liés à la progression du revenu primaire. C'est
pourquoi il convient de prendre en considération le TMEI qui
révèle le résultat d'une compensation entre transferts et
impôts, c'est-à-dire qui indique l'imposition nette pour chaque
euro supplémentaire gagné.
Ainsi, lorsqu'un agent voit son revenu augmenter, il peut
être soumis à un nouvel impôt ou voir son taux d'imposition
augmenter, mais aussi perdre des transferts qui lui étaient jusqu'alors
accordés et qui sont supprimés en raison d'une mise sous
condition de ressources. Par exemple le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) est un
transfert différentiel, c'est-à-dire que chaque euro
supplémentaire gagné au travail est déduit du montant de
l'allocation : la hausse du revenu primaire entraîne une baisse du
transfert perçu. Mais cette perte de transferts n'est pas
forcément aussi évidente, et ne concerne pas que les transferts
financiers : la perte de l'éligibilité à la Couverture
Maladie Universelle (CMU), ou la perte de la gratuité dans les
transports en commun constituent un coût, au même titre que
l'ensemble des avantages accordés sous conditions de ressources ou au
titre des minima sociaux. Ce n'est donc pas seulement le niveau de revenu qui
conditionne l'octroi d'aides mais aussi le statut de l'individu : passer
du RMI à un emploi à mi-temps n'entraîne pas une hausse de
revenu significative, mais un changement de statut qui peut être
coûteux en raison de la perte des droits connexes ouverts aux
allocataires de minima (pour le détail des droits connexes, cf.Annexe
5).
Cette perte de transferts sera plus importante pour les bas
revenus que pour les hauts revenus, ce qui constitue donc une augmentation
d'autant du TMEI pour cette première catégorie de revenus. A
l'inverse, plus les revenus sont élevés, plus cette perte de
transferts est faible, donc moins le TMEI en est impacté. Cependant,
compte tenu de la progressivité de l'impôt sur le revenu, la
hausse du revenu entraîne une hausse plus importante du taux
d'imposition, ce qui effectue une pression à la hausse sur le TMEI pour
les hauts revenus.
Pour comprendre ce que recoupe la notion de TMEI, on peut
recourir à une formalisation élémentaire (pour le
détail de cette formalisation, voire Annexe 4). On obtient :
Le TMEI est égal à 1 moins le rapport entre la
variation du revenu disponible (äYD) et la variation du revenu primaire
(äYP). On peut illustrer cette expression du TMEI par des exemples
numériques. Ainsi, si le TMEI vaut 0,6, cela signifie que
(äYD/äYP) vaut 0,4, c'est-à-dire que la hausse de revenu
disponible ne représente que 40% de la hausse du revenu primaire : 60%
de chaque euro supplémentaire gagné sont alors confisqués
par le système redistributif. Si le TMEI vaut 0,8, (äYD/äYP)
vaut 0,2 : lorsque les revenus primaires d'un agent augmentent de 5 euros, son
revenu disponible n'augmente que de 1 euro. Dernier exemple : si le TMEI
vaut 0,2, (äYD/äYP) vaut 0,8, cela signifie que lorsque les revenus
primaires d'un agent augmentent de 1,25 euros, son revenu disponible n'augmente
que de 1 euros. c'est-à-dire que l'agent perd 20% de chaque euro
supplémentaire gagné.
Le TMEI représente donc l'évolution du revenu
disponible en fonction du revenu primaire. Plus le TMEI est
élevé, plus l'écart entre revenu disponible
supplémentaire et revenu primaire supplémentaire sera important.
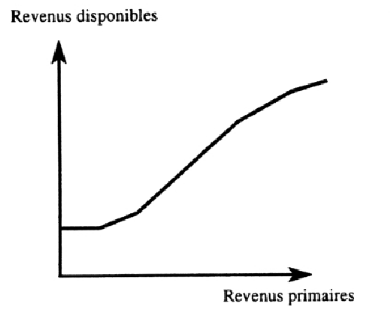 Graphique 4: Évolution du revenu disponible en fonction du revenu
primaire. (Bourguignon F., Chiapori P.-A., 1998) Graphique 4: Évolution du revenu disponible en fonction du revenu
primaire. (Bourguignon F., Chiapori P.-A., 1998)
Ainsi, lorsque le TMEI est proche de 100%, toute augmentation
de revenu primaire se traduit par une augmentation nulle ou quasi-nulle du
revenu disponible. Lorsque le niveau du TMEI diminue, la hausse de revenu
disponible consécutive à une hausse de revenu primaire est
croissante. Le Graphique 4 traduit ainsi la courbe convexe du TMEI en
représentant le revenu disponible en fonction du revenu primaire. Ce
graphique illustre le fonctionnement de la redistribution en France à
une époque où le RMI existait encore sans mécanismes
significatifs d'incitations financières au travail, et où
l'absence de bouclier fiscal pour les hauts revenus ne tempérait pas le
rôle redistributif de l'impôt sur le revenu. On voit nettement que,
au début de la courbe, la hausse des revenus primaires (des revenus du
travail pour cette catégorie de population) n'entraîne aucune
hausse de revenu disponible tant que les revenus du travail ne dépassent
pas le seuil du RMI. Ensuite la courbe commence à croître, mais
très faiblement en raison principalement de la perte d'allocations. Les
revenus moyens sont ceux pour lesquels le TMEI est le plus faible (le revenu
disponible augmente alors dans les mêmes proportions quasiment que les
revenus primaires), car à ce niveau les hausses de revenu
n'entraînent plus de pertes d'allocations, et parce que la
progressivité de l'impôt sur le revenu ne joue pas encore un
rôle significatif. Le TMEI croît pour les hauts revenus, mais
très légèrement : on voit la fonction de revenu
disponible s'aplanir faiblement. C'est alors la progressivité de
l'impôt sur le revenu qui en est à l'origine.
Piketty a réalisé une estimation précise
du TMEI français32(*) sur des données de 1996. Il conclut à
une forme en « U » fortement aplati en haut de la
distribution des salaires (cf.Graphique 5). Le TMEI le plus important
s'applique pour le premier décile de salaires, c'est-à-dire
incluant une forte proportion d'individus travaillant à temps partiel et
gagnant peu, et atteint 80% (TMEI moyen appliqué au premier
décile de salaires). Piketty réalise une estimation pour les
personnes sans revenus d'activités : le TMEI atteint alors
facilement 100%33(*).
Graphique 5: Taux marginaux effectifs d'imposition
moyens par déciles de salaires net. Source: Piketty, 1997. ![]()
Ce qui est surprenant à la vue de cette estimation,
c'est la faiblesse du TMEI moyen pour les derniers déciles (63,1% pour
le dernier décile). On pourrait l'imputer pour une part au fait que
c'est la calcul d'une moyenne, donc qui rend peu compte des revenus
extrêmement élevés et des forts TMEI qui pourraient leur
être appliqués. Or, si l'on suppose un revenu infini, le TMEI
estimé par Piketty n'atteint que 70% pour une personne seule, ceci
étant une estimation haute puisqu'elle ne prend pas en compte les
éventuelles exonérations d'impôts. La question de la
désincitation au travail se pose donc d'une façon plus intense
pour les sans-emplois et les bas salaires : du premier au quatrième
décile de salaire, le TMEI moyen est supérieur à celui que
connaît le dernier décile de salaires.
Les estimations de Piketty et de Bourguignon et Chiaporri
semblent donc converger. Cependant, les modes de calculs envisageables sont
nombreux et peuvent diverger, principalement en raison des difficultés
liées à la délimitation du champ d'analyse. Ainsi, les
services publics et l'accès gratuit ou à faible coût
à certains services sont extrêmement délicats à
prendre en compte, car difficilement évaluables, et nous les ignorerons
de fait. Une seconde question se pose concernant la prise en compte -ou non- de
la protection sociale. A ce sujet, il n'y a pas de réponses
tranchées. Si l'on décide de prendre en compte la protection
sociale dans le calcul du TMEI, il faut assimiler le revenu primaire au salaire
brut ou super-brut. En effet, les cotisations sociales sont
considérées comme des prélèvements et doivent donc
être intégrées au calcul du TMEI. Les cotisations
patronales peuvent être incluses si l'on considère que ce sont les
salariés qui les payent in fine. Par exemple, dans l'estimation
de Piketty que nous avons présentée, les salaires super-bruts
(c'est-à-dire y compris les cotisations patronales et salariales) sont
pris en compte.
Pour F. Bourguignon, au contraire, la protection sociale ne
doit pas être prise en compte. Tout d'abord en raison de son
caractère contributif, qui fait que le montant des cotisations sociales
versées détermine pour une bonne part le montant des prestations
reçues. C'est la cas de l'assurance chômage, par exemple, ou du
système de retraites. Ce dernier donne lieu à une redistribution
longitudinale, c'est-à-dire qui opère dans le temps et non pas
entre agents : si l'on suppose une neutralité actuarielle34(*) du système,
l'intégralité des sommes versées sera
récupérée dans le futur. Pour Bourguignon les retraites ne
sont donc que des « salaires différés ».
Outre la contributivité, c'est la relation entre revenu et consentement
à payer qui neutralise l'impact de la protection sociale sur les TMEI.
Compte tenu de la proportionnalité des cotisations sociales, si l'on
suppose un besoin de soins plus important pour les bas revenus, ou si l'on
suppose un consentement à payer constant avec le revenu, alors on peut
considérer que les cotisations sociales opèrent une
redistribution transversale et impactent les TMEI (les TMEI seraient plus
faibles en bas de la courbe et plus élevés dans sa partie
supérieure). Bourguignon préfère supposer a
contrario35(*) que le
consentement à payer croît avec le revenu, et que les besoins de
soins sont constants pour tous niveaux de revenus, ce qui supprime l'effet
redistributif des cotisations sociales, qui n'impactent donc pas le niveau des
TMEI (hormis peut être pour les hauts revenus où les cotisations
finissent par dépasser le consentement à payer, ce qui pourrait
entraîner un relèvement du TMEI pour les très hauts
revenus).
On peut considérer que les hypothèses
formulées par Bourguignon sont discutables, et que la
contributivité de la protection sociale n'est que partielle, validant
ainsi la prise en compte de la protection sociale. D'autant plus si on cherche
à évaluer le TMEI afin d'évaluer les désincitations
au travail pesant sur les agents à un moment donné. Piketty en
donne une illustration monétaire : un RMIste ayant un revenu de 530
euros mensuels (RMI et allocations logements cumulés) trouve un emploi
pour lequel l'employeur déboursera 1370 euros mensuels
(c'est-à-dire cotisations sociales y compris), ce qui représente
ce qu'il est prêt à payer pour ce travailleur, son consentement
à payer. Au final, l'individu ne touchera effectivement que
760 €par mois : le revenu super-brut croît de 158% tandis que
le revenu disponible ne croît que de 43%.
La redistribution des revenus en France a donc des effets
paradoxaux. D'un côté elle est efficace et parvient plutôt
bien à atténuer la pauvreté et les
inégalités générées par le distribution
primaire des revenus. De l'autre côté, elle peut s'avérer
fortement désincitative au travail, en raison principalement des
transferts monétaires et des aides publiques, décroissants avec
le revenu et dépendants du statut des individus ; la redistribution vise
pourtant à pallier à des situations difficiles qui trouvent leur
origine dans des défaillances de l'emploi (précarité, bas
salaire, chômage).
Ainsi, la pauvreté et les inégalités
avant redistribution sont importantes, et trouvent leur source dans les
inégales répartition du travail et du capital ainsi que dans les
inégalités salariales. L'accès à l'emploi, bien
qu'encore protecteur, ne suffit pas à se prémunir contre la
pauvreté. Ceci légitime l'intervention de la redistribution, qui
s'avère être plutôt efficace mais possède un effet
pervers notable qui est la désincitation au travail. Ceci pose
problème si l'on fait l'hypothèse que les agents, calculateurs,
comparent rationnellement les gains attendus de l'emploi et de
l'inactivité subventionnée. De même, cette
désincitation est gênante si l'on attache au travail une valeur
morale et qu'on le considère comme une fin en soi.
Selon le parti pris, cet effet désincitatif de la
redistribution pourra susciter différents types de réponses et
appeler des réformes diverses. Nous verrons ainsi dans une seconde
partie la stratégie qui vise à donner un nouvel objectif à
la redistribution : rendre le travail payant.
Chapitre II. La redistribution contre le travail.
On peut en effet choisir de penser que des transferts trop
généreux ou que des prélèvements trop lourds
démotivent l'activité économique. On considère
alors que la redistribution est coûteuse et réduit l'offre de
travail des inactifs. Cette conception d'une redistribution source de
désincitation au travail s'accompagne souvent d'un discours plus
général visant à promouvoir les contreparties en travail
et en efforts des allocataires de transferts sociaux, et visant à
délégitimer les inactifs subventionnés. Dès lors,
l'objectif est d'accroître les gains au retour à l'emploi, et
supprimer la trappe à inactivité.
Nous verrons en premier lieu que si la théorie de
l'impôt optimal préconisait au départ la convexité
de la courbe des TMEI, une de ses ré-interprétations
récentes permet de démontrer l'optimalité de
réduire les TMEI pesant sur les inactifs bénéficiaires de
transferts sociaux. Nous verrons en deuxième et troisième parties
les réformes mises an place dans cette optique, dans les pays
anglo-saxons tout d'abord, et en France ensuite.
I. Incidence fiscale et distorsions : comment
redistribuer ?
La théorie économique a produit des
modèles qui décrivent ce que devrait être une
redistribution optimale. Le modèle canonique est ici celui
proposé par Mirrlees en 1971 et repris ensuite par Diammond. La
principale conclusion que l'on en retiendra ici est que, nonobstant les effets
désincitatifs pouvant être générés par des
taux marginaux importants imposés aux bas revenus, une courbe en
« U » des TMEI est optimale. En effet, il convient de faire
peser sur les personnes les moins productives et les moins nombreuses les taux
d'impositions les plus élevés, si l'on se fixe comme objectif de
maximiser les recettes fiscales. Nous montrerons ensuite que les prolongements
de ce modèle permettent de mettre en évidence l'importance du
choix qui est réalisé : si, au lieu de maximiser les
recettes c'est l'emploi qui est au centre des préoccupations, lisser la
courbe des TMEI notamment en bas de la distribution peut s'avérer
efficace.
A. La courbe en « U » des TMEI:
imposition optimale des revenus.
Mirrlees fût le premier a proposer un modèle de
taxation optimale qui prenne en compte la possible désincitation au
travail pouvant être générée. Il pose un certain
nombre d'hypothèses pour construire son modèle. Tout d'abord il
considère des agents rationnels calculateurs qui réalisent donc
un arbitrage entre travail et loisir en fonction du coût et des avantages
de chacune de ces options : le loisir devient de plus en plus
coûteux au fur et à mesure que la salaire augmente36(*). L'offre individuelle de
travail comme l'offre de marché sont donc croissantes avec le salaire.
De plus Mirrlees suppose l'existence d'un marché du travail parfaitement
concurrentiel, où le salaire est exogène et les salariés
sont price-taker : il n'y a pas de fixation de salaire
résultant de rapports de force ou de négociations collectives.
Comme dans le modèle classique du marché du travail c'est la
productivité marginale du travail qui détermine le salaire,
à ceci près que pour Mirrlees c'est la productivité de
chaque salarié qui détermine son niveau de salaire
individuel : des bas salaires sont versés aux travailleurs peu
efficaces, et des hauts salaires aux travailleurs très productifs.
Mirrlees intègre dans le modèle un impôt sur le revenu au
taux uniforme pour tous les agents, et qui répond au programme de la
puissance publique qui est de maximiser le rendement de l'impôt pour
maximiser le transfert versé aux individus ayant une productivité
nulle, donc un salaire nul. On ne prend en compte que l'impôt sur le
revenu puisqu'un impôt sur le revenu déterminé de
façon optimal est suffisant et doit constituer
l'intégralité des prélèvements
Le modèle vise à fixer la valeur du taux
d'imposition qui soit optimale. Pour chaque augmentation du taux, la
désincitiation au travail est plus forte, ce qui implique que certains
travailleurs renoncent au travail et au salaire et ne payent donc plus
l'impôt : le rendement de l'impôt diminue. D'un autre
côté, les préférences individuelles en terme de
travail et de loisir ne sont pas homogènes : d'autres individus ne
changerons pas leur offre de travail suite à la hausse d'impôt
afin de ne pas perdre trop de revenu, et certains iront même
jusqu'à faire croître leur offre de travail afin de compenser la
diminution du taux de salaire net. En conséquence de ce second effet, le
rendement de l'impôt augmente avec l'augmentation du taux d'imposition.
On suppose que l'effet revenu domine au départ : des
taux d'imposition encore faibles nécessitent des efforts de faible
importance pour être compensés ; mais au bout d'un certain moment,
l'effet substitution domine : la diminution de salaire net devient trop
importante pour être compensée, et le coût
d'opportunité du loisir devient extrêmement faible. L'offre de
travail diminue donc à partir d'un certain niveau du taux d'imposition.
L'État a donc intérêt à augmenter l'impôt
jusqu'au moment où le gain supplémentaire de recette fiscale est
exactement compensé par la parte de recettes induite par la
désincitation au travail ainsi engendré. En égalisant ces
deux effets, on obtient (pour un détail de la formalisation, cf.Annexe
7):
![]()
Le taux optimal (t*) est donc décroissant de
l'élasticité de l'offre de travail (e). Plus
l'élasticité est importante, plus l'effet substitution dominera
l'effet revenu pour des niveaux faibles d'imposition, donc moins la hausse du
taux sera efficace. Si l'élasticité de l'offre de travail est de
0,5, c'est-à-dire si pour une baisse de 20% du salaire net, l'offre de
travail diminue de 10%, le taux d'impôt optimal est donc égal
à 66%. Si l'élasticité est égale à 1 le taux
d'imposition sera de 50%. Si l'élasticité est égale
à 0, c'est-à-dire si l'offre de travail ne dépend pas de
la contrepartie en salaire, alors le taux d'imposition sera de 100%,
c'est-à-dire confisquant l'intégralité des revenus. On
note que le taux optimal correspond au sommet de la « Courbe de
Laffer 37(*)»: c'est
le taux maximal à partir duquel le rendement de l'impôt diminue.
En effet, l'économiste A. Laffer imaginait en 1974 que les
États-Unis avaient dépassé ce taux optimal: il
préconisait donc de diminuer le taux d'imposition pour augmenter le
rendement de l'impôt.
En reprenant ce modèle élaboré par
Mirrlees, Diamond a démontré l'optimalité d'une courbe en
« U » des taux marginaux effectifs d'imposition. Il faut
introduire ici l'existence d'une pluralité de taux d'imposition :
on note t(y) le taux d'imposition pour chaque niveau (y) de revenu avant
redistribution.
Le taux marginal d'imposition optimal t'*(y) pour chaque
niveau de revenu brut correspond au même programme de maximisation de la
part de la puissance publique que précédemment. Lorsque le taux
marginal d'imposition augmente, et passe de t'(y) à [t'(y) + dt'] pour
les revenus compris entre (y) et [y + dy], l'effet est double, comme dans le
modèle de Mirrlees. Cette augmentation du taux marginal correspond
nécessairement à une augmentation des taux d'imposition sur tous
les revenus supérieurs à (y), et à une augmentation du
différentiel de taux d'imposition entre tous les niveaux de revenus
compris sur l'espace [y + dy]. Dès lors, le produit de l'impôt va
croître, puisque le taux d'imposition va croître lui aussi pour les
revenus supérieurs à (y). Mais, un second effet intervient :
pour les individus ayant un revenu compris entre (y) et (y + dy), l'incitation
à travailler plus est réduite en raison de la hausse du taux
marginal, de même que pour tous les revenus supérieurs à
(y) le salaire net diminue suite à la hausse de t', pouvant ainsi
générer une désincitation au travail. On a donc un effet
ambiguë sur l'évolution des recettes de l'impôt compte tenu
de ces deux effets contradictoires. Comme précédemment,
l'État doit augmenter t' jusqu'au moment où l'effet positif sera
intégralement compensé par l'effet négatif : le taux
marginal optimal t'* égalise donc ces deux effets. Pour tous niveaux de
revenu (y) on a , après égalisation (cf.Annexe 7):
Le rapport ![]() compare le poids des agents dont
le revenu est égal à y*38(*) au poids des agents dont le revenu est
supérieur à y*39(*). Ce qui signifie que lorsque le rapport est faible,
le poids des agents dont le revenu est supérieur à y* est
très important par rapport au poids des agents ayant un revenu de y*.
Plus le rapport diminue, plus le poids relatif des agents plus aisés est
important. Du point de vue des finances publiques, il est donc souhaitable
d'imposer un taux marginal important lorsque le rapport est faible : les
agents pour lesquels le taux marginal va augmenter, qui vont donc
connaître une forte désincitation au travail, sont relativement
peu nombreux comparativement au nombre de gens qui vont voir leur niveau
d'imposition augmenter (sans que les incitations soient changées). De
plus, on observe que le taux marginal prend en compte
l'élasticité de l'offre de travail de l'ensemble des
travailleurs, comme précédemment. Le taux marginal d'imposition
optimal évolue aussi en fonction du niveau de salaire w,
c'est-à-dire en fonction du niveau de productivité des individus
: plus w est élevé, donc plus les individus sont supposés
être productifs, plus le taux marginal doit être bas, car plus la
désincitation au travail est coûteuse. compare le poids des agents dont
le revenu est égal à y*38(*) au poids des agents dont le revenu est
supérieur à y*39(*). Ce qui signifie que lorsque le rapport est faible,
le poids des agents dont le revenu est supérieur à y* est
très important par rapport au poids des agents ayant un revenu de y*.
Plus le rapport diminue, plus le poids relatif des agents plus aisés est
important. Du point de vue des finances publiques, il est donc souhaitable
d'imposer un taux marginal important lorsque le rapport est faible : les
agents pour lesquels le taux marginal va augmenter, qui vont donc
connaître une forte désincitation au travail, sont relativement
peu nombreux comparativement au nombre de gens qui vont voir leur niveau
d'imposition augmenter (sans que les incitations soient changées). De
plus, on observe que le taux marginal prend en compte
l'élasticité de l'offre de travail de l'ensemble des
travailleurs, comme précédemment. Le taux marginal d'imposition
optimal évolue aussi en fonction du niveau de salaire w,
c'est-à-dire en fonction du niveau de productivité des individus
: plus w est élevé, donc plus les individus sont supposés
être productifs, plus le taux marginal doit être bas, car plus la
désincitation au travail est coûteuse.
Au final, le taux marginal d'imposition optimal pour tout
niveau de revenu (y) décroît avec la hausse du nombre d'agents
auxquels il est imposé ainsi qu'avec la hausse de la productivité
des agents auxquels il est imposé et décroît avec
l'élasticité de l'offre de travail pour ce groupe de revenus,
mais croît avec le nombre d'agents ayant un revenu supérieur
à (y).
Ainsi, la courbe des taux marginaux effectifs d'imposition
doit avoir une forme convexe, avec des taux élevés aux deux
extrémités de la distribution des revenus (hauts et bas revenus)
en raison du faible nombre d'agents présents à ces
extrémités. Mais le taux marginal doit être plus
élevé pour les bas revenus que pour les hauts revenus car plus le
revenu est bas, plus le nombre d'individus plus riches est
élevé40(*)(cf.Annexe 6). Cette différence entre hauts et
bas revenus est accentuée si on suppose que les bas revenus ont une
élasticité de l'offre de travail plus faible que les hauts
revenus41(*). Enfin, les
bas revenus sont les moins productifs par hypothèse donc sont ceux qu'il
est le moins gênant de désinciter au travail. On justifie donc la
forme en « U » des taux marginaux mais aussi le fait que
les taux marginaux soient plus faibles en haut de la distribution qu'en bas.
La redistribution telle qu'elle est mise en place aujourd'hui
en France semble donc correspondre aux canons de l'optimalité
déterminés par le modèle standard de la redistribution, la
désincitation au travail pesant sur certains individus étant
compensée par la hausse des recettes sur d'autres catégories
d'agents. On peut en conclure ceci : si l'objectif est de maximiser le
niveau du transfert versé, alors il faut accroître le taux
marginal d'imposition pour les bas revenus c'est-à-dire ne pas les
inciter à travailler plus, donc favoriser leur dépendance aux
transferts sociaux.
B. Impôt optimal et emploi.
Cependant, les hypothèses du modèle que nous
venons de présenter sont irréalistes à bien des
égards, notamment concernant les comportements des offreurs de travail
et l'objectif maximisateur de la puissance publique.
Ainsi Piketty modifie le modèle Mirrlees-Diamond en
postulant un comportement des agents différent : plutôt que de
savoir si les agents modifient le nombre d'heures de travail offertes, il
suppose que c'est l'incitation à chercher du travail, et l'incitation
à changer d'emploi pour atteindre une meilleure situation ou obtenir un
avancement qui sont impactés par le taux marginal d'imposition. Il
s'intéresse donc à la marge intensive de l'offre de
travail42(*). C'est
l'effort et la motivation des agents qui sont évalués. Il
distingue trois catégories de population: les sans-emplois, les bas
salaires, et les hauts salaires. Chacune dispose d'un niveau de salaire (nul
pour les sans-emplois, w1 pour les bas salaires, w2 pour
les hauts salaires), d'un revenu disponible (respectivement y0,
y1 et y2) et rassemble un nombre d'agents (m0,
m1 et m2). y0 représente un transfert
monétaire alloué à tous les individus, et qui constitue
l'unique revenu des sans-emploi. Le taux marginal effectif d'imposition lors du
passage du non-emploi vers l'emploi, (T0), est
représenté par : (cf.Annexe 7) 43(*)
Si l'État décide de faire croître T0
en le faisant passer à (T0+ dT0), deux
effets se feront jour. D'un côté une hausse des recettes
consécutive à la hausse d'impôts payés par tous les
salariés sur leur fraction de salaire inférieure à
w1 (pour faire croître To, il faut que
y1 diminue, donc que le taux d'impôt sur les bas salaires soit
plus important). De l'autre côté la baisse de l'écart
(y1 - y0) entraîne une désincitation
à trouver un emploi, donc une augmentation du nombre de personnes
restant au chômage et une baisse des travailleurs à bas salaires.
Ainsi, si (y1 - y0) augmente de 1% alors une proportion
supplémentaire de chômeurs égale à e0 %
trouve un emploi à bas salaires, et inversement dans le cas d'une baisse
de l'écart. Il y a donc une baisse des recettes, en raison de cette
désincitation au travail de même qu'en raison d'une hausse des
taux d'imposition s'appliquant à toutes les catégories de
salaires supérieurs (ceci est nécessaire si l'on suppose que les
taux marginaux ne sont pas modifiés pour les autres catégories
d'individus). Le taux marginal optimal To* qui
égalise les deux effets est :
![]()
Pour la transition des bas salaires vers les hauts salaires,
l'expression du taux marginal optimal est proche, avec e1
l'élasticité de probabilité de transition associée
à une variation de (y2 -y1). On a :
Dans son article, Piketty reconnaît que la conclusion
est proche de celle du modèle Mirrlees-Diamond, et exprime
« la même logique » : si le taux marginal
effectif décroît avec l'élasticité-revenu de l'offre
de travail dans le premier cas, Piketty fait décroitre le taux marginal
avec l'élasticité de probabilité de transition, pointant
l'importance du gain de revenu espéré dans le choix de chercher
-ou pas- un emploi.
L'intérêt de la formulation proposée par
Piketty est de distinguer les sans-emploi des personnes en emploi, et donc de
permettre une comparaison aisée entre T0 et T1.
Par exemple, si les sans-emploi et les bas-revenu ont la même
élasticité de transition, T0* sera supérieur
à T1*, ceci s'expliquant comme avec Mirrlees-Diamond par le
nombre de personnes ayant un revenu plus élevé44(*). Pour maximiser les recettes
publiques, et donc le niveau de transferts sociaux Y0, il semble
donc préférable de désinciter à l'emploi et de
taxer de façon importante les bas revenus, plutôt que de
pénaliser les hauts revenus. Ce constat est extrêmement
paradoxal : pour venir en aide aux plus démunis, il faut
privilégier la dépendance à l'aide publique plutôt
que la sortie autonome de la pauvreté par l'emploi.
L'intérêt du modèle présenté est justement de
pouvoir dépasser ce paradoxe. En identifiant clairement deux taux
optimaux pour deux catégories distinctes de populations, Piketty permet
de faire apparaître la possibilité d'un arbitrage entre eux, afin
de savoir lequel augmenter et lequel réduire. Si l'objectif social est
la maximisation des recettes, alors l'arbitrage en faveur d'un taux marginal
pesant sur l'accès à l'emploi plus élevé que le
taux pesant sur la transition entre bas et hauts salaire a déjà
été démontré. Cependant, on peut suivre Piketty et
adjoindre à ce premier objectif celui de faire croître l'emploi.
Il note en effet: « la redistribution fiscale socialement
optimale dépend donc du poids relatif que l'objectif social accorde
à la réduction du chômage d'une part, et au niveau de
transfert (Y0) dont bénéficient ceux qui n'ont pas pu
trouver d'emploi d'autre part »45(*). L'État peut ainsi chercher à
diminuer T0 en dessous de son niveau optimal pour les recettes
publiques T0*, afin de susciter une hausse de l'offre de
travail à bas salaires. Pour que l'effet sur le budget soit
atténué ou nul, il convient de faire croître T1
dans des proportions suffisantes. On finance donc des créations
d'emplois en reportant leur coût sur des hausses d'impôts portant
sur les hauts revenus. Ceci peut fonctionner dès lors que
l'élasticité de transition du chômage vers l'emploi est
suffisante. Les études sur l'élasticité de l'offre de
travail semblent montrer des élasticités de l'offre de travail
pour la transition du non-emploi vers l'emploi comprises entre 1 et 1,5. Ces
estimations sont notamment basées sur une étude de N. Eissa et
J.B. Liebman qui évalue l'effet de la réforme de l'EITC en 1986
sur l'offre de travail des mères célibataires : la hausse
des montants distribués a entraîné une hausse de 2,8 points
de pourcentage du taux d'emploi des mères célibataires. De
même, Card et Robbins se sont servi de l'expérience
contrôlée menée au Canada entre 1992 et 1998 et visant la
mise en place d'une incitation au travail pour les chefs de familles
monoparentales. L'effet de ce programme, intitulé Self Sufficenciy
Project a pu être évalué précisément
grâce à la présence d'un groupe contrôle et d'un
groupe de traitement percevant un supplément de revenu consécutif
au retour à l'emploi permettant de doubler les revenus du travail. Lors
de la première année de l'expérience, le taux d'emploi du
groupe traitement croît de 21 points de pourcentages, contre une hausse
de seulement 6 points de pourcentages pour le groupe contrôle.
L'étude canadienne aboutit à des élasticités de
transition entre non-emploi et emploi oscillant entre 1 et 1,5, l'étude
de Eissa et Liebman aboutissant à des élasticités proches
de 1. Si ces estimations de l'élasticité de l'offre de travail
sont correctes46(*), alors
il sera peu coûteux et très efficace de lisser le bas de la courbe
des TMEI : en diminuant les TMEI appliqués à la transition
vers l'emploi, on accroit (y1-y0) ce qui fera
croître dans une proportion importante l'offre de travail à bas
salaires des sans-emplois. Dans le même temps, plus les
élasticités de transition vers l'emploi (e0) sont
élevées, et plus e0 est supérieur à
e1, plus il sera intéressant de financer cette hausse de
l'offre d'emploi des inactifs par une hausse des TMEI appliqués au
passage d'emplois peu payés (w1) à des emplois mieux
payés (w2), c'est-à-dire une hausse de
T1.
En changeant de focale, c'est-à-dire en se fixant
comme objectif l'emploi et non pas la maximisation des recettes fiscales,
Piketty démontre que la redistribution peut, en se réformant,
c'est-à-dire en diminuant les TMEI appliqués aux inactifs et en
augmentant les TMEI appliqués aux hauts revenus, devenir l'alliée
de l'emploi et non plus son ennemi. Cependant, il faut rappeler que l'action
sur l'incitation de l'offre de travail ne sera pas suffisante : il faut
que la demande de travail soit à même d'absorber ce surplus
d'offre. On peut mettre en avant le fait qu'en subventionnant l'emploi, ce type
de mesures pourra permettre d'accroître l'acceptabilité des bas
salaires pour les travailleurs, ce qui peut être un stimulant pour la
demande de travail. On pourrait toutefois imaginer, dans une optique
kaleckienne, qu'une simple hausse des salaires permettrait du même coup
d'accroître l'incitation au travail et la demande effective, donc in
fine la demande de travail.
II. Les premières mesures anglo-saxonnes.
Les pays anglo-saxons, principalement les États-Unis
et le Royaume-Uni, on entamé depuis les années quatre-vingt un
virage dans la mise en oeuvre de leurs politiques sociales. Le nouveau
paradigme reprend l'idée d'une réduction des
désincitations pesant sur l'offre de travail à bas salaires pour
résoudre le problème de la trappe à inactivité.
Plus globalement, ces réformes se sont attachées à
renforcer la séparation entre bénéficiaires de l'aide
sociale bien-portants et bénéficiaires inaptes au travail, dans
le but de réduire la désincitation au travail. L'idée
principale étant que l'aide sociale accordée sans contrepartie en
travail induit de l'oisiveté. On fait alors l'hypotyhèse que les
individus sont calculateurs et réalisent un arbitrage monétaire
entre travail et loisir subventionné : il faut donc renforcer les
incitations monétaires au travail, et parallèlement,
réduire les incitations à l'inactivité. Plus
indirectement, ces réformes correspondaient à une modification
profonde des modalités du contrat social, ainsi qu'une modification de
l'acceptabilité de chacun à participer à un système
redistributif en direction des plus démunis. Ces réformes se sont
inscrites dans un mouvement plus vaste vers le workfare, signifiant
littéralement work for welfare, et affirmant que le
bénéfice de l'aide sociale devrait fait l'objet d'une
contrepartie en travail, au nom d'un certain jugement moral du travail et de
l'oisiveté.
A. Les Etats-Unis et l'Earned Income Tax Credit.
Aux E.-U., le système de valeurs dominant
intègre l'idée que le travail est la clé de la sortie de
la pauvreté. En citant les résultats du sondage World Values
Survey, Alesina A. et Glaeser E. notent ainsi que 60% des
américains sondés pensent que les pauvres sont paresseux47(*).
La loi fédérale de 1996 portant sur l'octroi
des principales aides sociales est imprégnée de cette conception,
et fait suite à une longue période de maturation et
d'évolution lente dans les mentalités. Le champ de la
réforme est limité puisque elle concerne principalement les
conditions d'octroi des aides sociales aux familles monoparentales
(c'est-à-dire principalement les mères célibataires).
Comme le note G. Burtless, cette réforme répond à un
ensemble de modifications profondes dans la société
américaine, dont notamment un large accès des femmes au
marché du travail qui coïncidait avec un faible niveau
d'activité pour les mères au foyer recevant des aides sociales ;
cette coïncidence rendait « l'oisiveté » des
mères au foyer moins légitime. L'autre facteur explicatif pouvant
être le développement massif de la pauvreté parmi les
salariés les moins qualifiés. Par exemple, le salaire réel
des hommes ayant un niveau scolaire inférieur à la moyenne a
diminué entre 1975 et 1995. Plus globalement, on observe que, si le
montant du neuvième décile de salaire horaire réel
croît de 10% entre 1972 et 1996, le niveau de la médiane des
salaires chute de 10% sur la même période. Les mères
célibataires faisant généralement partie de la partie
inférieure de l'échelle des salaires, leur situation s'est
dégradée parallèlement. Si l'on souhaite mettre en oeuvre
une politique sociale fidèle au jugement moral négatif sur
l'oisiveté dans un contexte d'appauvrissement des travailleurs, l'aide
sociale doit se substituer au travail comme moyen de s'extraire de la
pauvreté, tout en rendant le travail attractif. Ainsi, les deux
objectifs de la réforme de 1996 furent d'accroître la part des
mères célibataires en emploi et d'accroître les revenus
nets des parents à bas revenus ayant un emploi (ne sont donc pas
concernés, sur ce second volet, que les parents célibataires).
La loi de 1996, intitulée PRWORA (Personal
Responsability and Work Opportunity Reconciliation Act) permet ainsi le
passage du programme Aid to Families with Dependent Children (AFDC) au
programme au Temporary Assistance to Needy Families (TANF). Ceci
entraîne notamment un durcissement des conditions de versement des aides,
puisque les prestations sociales financées par le gouvernement
fédéral ne peuvent, dès lors, plus être
versées que pour une durée maximum de cinq années
consécutives. De nombreux États (les deux tiers d'entre eux) sont
allés encore plus loin, certains interdisant le versement des aides plus
de deux années consécutives. Du coup, le montant global des aides
accordées a fortement diminué. En parallèle, la loi oblige
les parents bénéficiaires à s'inscrire dans des programmes
de recherche d'emploi et d'insertion (formation, par exemple), sans quoi les
aides sont supprimées. Pour Burtless, une des principales
conséquences de cette réforme a été de marginaliser
une part importante d'anciens bénéficiaires et de
bénéficiaires potentiels des aides sociales. Il note ainsi que
les mères célibataires quittant le programme d'aides en sortent
beaucoup plus tôt qu'auparavant. Il estime en outre que de nombreuses
bénéficiaires potentielles ont été
dissuadées de demander l'ouverture de leurs droits. Ceci étant
confirmé par les travaux de Grogger J., Karoly L. et Kerman J. en
200248(*) qui montrent
qu'un des effets principaux de ce mouvement de réforme est la diminution
du recours aux aides sociales49(*).
 Graphique 6: Barème de l'EITC en 2007. Source: Burtless G.,
2008 Graphique 6: Barème de l'EITC en 2007. Source: Burtless G.,
2008
Si la loi PRWORA marque une étape importante dans la
marche vers le workfare aux USA, ce mouvement de revalorisation du travail a
démarré bien plus tôt avec l'Earned Income Tax
Credit (EITC), mis en place en 1975. L'EITC consiste en un crédit
d'impôt pouvant donner lieu à un versement (dans le cas où
le crédit d'impôt accordé supplante les impôts
payés), qui s'applique aux ménages à bas revenus dont au
moins un membre travail (excluant donc de fait les ménages sans actifs,
qui doivent faire appel aux allocations chômage, très
restrictives). L'EITC s'applique en trois étapes (cf. Graphique 6). Dans
une première phase, c'est-à-dire pour des revenus
d'activité inférieurs à 11 700 dollars pour un
ménage avec au moins deux enfants, le crédit d'impôt
augmente avec le revenu. Dans une seconde phase, le crédit d'impôt
reste stable et ne varie plus avec le revenu. Enfin, dans une dernière
phase le montant du crédit d'impôt décroît avec le
revenu : pour le même ménage, la dernière phase
débute dès lors que les revenus salariaux du ménage
atteignent 15000 dollars, et prend fin pour des revenus salariaux de plus de
37 000 dollars. Ainsi, on peut lire sur le graphique qu'un ménage
bi-actif avec un enfant à charge et 20 000 dollars de salaire
annuel touchera un peu plus de 2000 dollars d'EITC à l'année.
Le mécanisme, au départ réservé
aux travailleurs ayant des personnes à leur charge, s'est ouvert aux
personnes sans enfants, mais reste largement favorable aux familles avec
enfants50(*). Burtless
note ainsi qu'un couple sans enfants dont les deux membres travaillent à
temps plein payés au salaire minimum n'est pas éligible à
l'EITC ; le même couple, avec deux enfants touchera 2000 dollars
(annuels). L'EITC a pour but de rendre le travail payant, c'est-à-dire
de réduire les effets désincitatifs liés à la
reprise d'un emploi, donc de lisser la courbe des TMEI: un ménage
inactif n'aura pas droit à l'aide, et sera donc incité
financièrement à sortir du chômage. L'objectif étant
de réduire la pauvreté en réaffirmant le travail comme
valeur fondamentale et en en faisant une condition stricte à l'octroi de
l'aide.
L'EITC n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis sa
création, en partie en raison de réformes ayant assoupli les
conditions d'accès, en 1986 (indexation des montants de l'EITC sur
l'inflation et augmentation des barèmes) et 1993 (extension du
dispositif aux ménages sans enfant). On observe ainsi que d'un montant
de 3 milliards de dollars en 1975 et 1985 (stagnation sur la période),
le budget fédéral consacré à l'EITC a fortement
crû ensuite, atteignant 35 milliards en 1999 et 39 milliards en 2005
(l'EITC représentait 1,8% du budget fédéral en 1998). En
1998, il concernait 19,5 millions de foyers américains (soit un
ménage sur cinq). Au delà de l'ampleur de ce dispositif, c'est sa
capacité à réduire la pauvreté des travailleurs
à bas salaires, ainsi qu'à lisser la courbe des TMEI, notamment
lors du passage du chômage à l'emploi, qu'il faut évaluer.
Concernant l'impact sur la pauvreté, on peut chercher
à évaluer la diminution du taux de pauvreté51(*) induite par l'EITC. En
d'autres termes, il convient de dénombrer le nombre de personnes pauvres
sans l'EITC et de réaliser le même calcul une fois l'aide
versée. Le revenu de référence52(*) n'intègre pas les
impôts versés, les prestations sociales non-monétaires
(principalement des bons d'alimentation) et les gains en capital, mais
intègre les prestations sociales monétaires (retraites, TANF,
chômage...) hormis l'EITC. Ainsi, en prenant en compte ce revenu de
référence, 34,5 millions de personnes vivaient sous le seuil de
pauvreté aux USA en 1998. Si l'on retranche les impôts
versés et les gains en capital, le nombre de personnes pauvres ne varie
quasiment pas (+100 000 personnes pauvres). En revanche, si l'on retranche les
impôts versés, c'est-à-dire en intégrant l'EITC et
que l'on ajoute les gains en capital et l'EITC, le nombre de pauvres passe
à 30,2 millions. L'EITC permet donc de passer d'un taux de
pauvreté de 12,7% (au revenu de référence) à un
taux de 11,1% (EITC y compris). Ce mécanisme semble donc efficace
globalement dans la lutte contre la pauvreté, bien que d'autres
programmes semblent réduire la pauvreté de façon beaucoup
plus conséquente, à l'instar des prestations de
sécurité sociale sans condition de ressource, dont principalement
les retraites et assurances chômages, qui génèrent une
baisse du taux de pauvreté de 6,3 points.
Concernant l'impact de l'EITC sur l'incitation au travail et
le TMEI, on peut noter une pluralité d'effets contradictoires, selon O.
Bontout. La principale contradiction résidant dans l'existence d'un
effet revenu et d'un effet substitution, contradiction qui s'avère donc
être vérifiée empiriquement à défaut
d'être comprise par la théorie économique
néo-classique53(*).
Lors de la phase ascendante du mécanisme, l'EITC permet d'instaurer un
Taux Marginal d'Imposition (TMI) négatif, c'est-à-dire que pour
chaque euro supplémentaire gagné au travail, le revenu disponible
obtenu est croissant (le gain au travail est croissant avec le
salaire)54(*). Si l'on
intègre dans le raisonnement l'impôt sur le revenu (IR), on
conserve ce TMI négatif mais de façon moins marquée. Par
exemple, dans le cas d'une famille monoparentale avec deux enfants, le TMI pour
l'EITC et l'IR cumulés est négatif jusqu'à 10000 dollars
de revenus nets annuels. Le TMI augmente brusquement lors de l'entrée
dans l'IR (hausse de 15 points de TMI), et lors de l'entrée dans la
phase plateau de l'EITC (hausse de 25 points du TMI) où il devient
positif. Cette hausse par palier du TMI n'aboutit à un taux
d'imposition moyen positif qu'à partir de 20 000 dollars de revenu net
pour ce type de ménage. Ainsi, en ne prenant en compte que l'IR et
l'EITC, on observe que pour tous revenus salariaux inférieurs à
20 000 dollars, le revenu disponible est supérieur ou égal au
revenu salarial. En intégrant les prestations sociales, on observe que
pour le même ménage gagnant 5000 dollars de revenus salariaux, le
TMI des prestations sociales prises isolément (ici le TANF et les bons
alimentaires octroyés sous condition de ressource), c'est-à-dire
si l'on ne prend en compte que la perte de transfert liée à la
hausse de revenu du travail, serait de plus de 70% (une hausse du revenu
primaire de 1 dollar n'entrainant une hausse du revenu disponible de seulement
0,3 dollar, compte tenu de la perte de transferts). L'intervention du
système fiscal (IR et EITC) ajoutée aux transferts sociaux donne
un TMI de 30% pour les mêmes revenus salariaux, ce qui constitue une
forte baisse par rapport au TMI ne prenant en compte que le transfert.
Le taux marginal d'imposition « global »,
donc le Taux Marginal Effectif d'Imposition, est négatif seulement pour
des revenus salariaux inférieurs à 1500 dollars annuels, et
atteint 50% juste avant la sortie du TANF, pour des revenus salariaux de
près de 10 000 dollars. L'EITC joue donc parfaitement son rôle en
rendant le travail incitatif, bien plus qu'il ne le serait sans ce dispositif.
Certes, en prenant en compte l'ensemble du système socio-fiscal, l'effet
de l'EITC est plus une forte baisse du TMEI que l'instauration d'un TMEI
négatif pour les bas revenus (hormis pour les très bas revenus),
mais on peut dire que l'EITC parvient, au moins pour les bas revenus, à
contrecarrer les désincitations au travail inhérentes au
système redistributif.
Cependant, au-delà de cet effet substitution (le gain
au travail croît dans la phase ascendante de l'EITC, ce qui est
susceptible d'entrainer une hausse de l'offre de travail), il existe,
dès lors que le bénéficiaire atteint le
« plateau » et ce jusqu'à la fin de la phase
descendante de l'EITC, un effet-revenu qui génère une nouvelle
désincitation au travail. Ceci s'explique par le fait qu'à partir
de ce stade, la hausse du revenu disponible avec le salaire va stagner puis
ralentir, entraînant donc une hausse du TMEI. Ainsi, dans le cas d'un
chef de famille ne travaillant pas à temps plein mais ayant atteint la
phase descendante de l'EITC, chaque heure travaillée
supplémentaire générera de moins en moins de revenus.
Selon O. Bontout, l'effet revenu domine d'autant plus dans le cas d'un
ménage bi-actif : si l'entrée sur le marché du travail est
séquentielle, lorsque le premier membre du couple entre sur le
marché du travail, le revenu du ménage peut augmenter de telle
façon qu'il atteigne la phase descendante de l'EITC, auquel cas la
désincitation au travail du second travailleur est forte (plus il
travaillera, plus le montant reçu au titre de l'EITC sera faible). Pour
les personnes déjà en emploi, sur les phases plateau et surtout
descendante, l'effet revenu risque de générer une baisse du
nombre d'heures travaillées. Plus généralement, l'effet
revenu semble dominer pour les travailleurs atteignant la phase plateau,
générant une incitation à diminuer le nombre d'heures
travaillées, de même que lors de la phase descendante, la perte de
l'EITC semble amener des « effets revenus et substitutions
négatifs 55(*)», donc une incitation à diminuer le temps
de travail. Cependant, Eissa et Liebman ne parviennent pas à observer
cet effet dans leur étude sur l'extension de l'EITC de 1986, bien qu'ils
admettent que cet effet aurait dû être constaté selon toute
vraisemblance théorique. Ils expliquent cela par le fait que beaucoup de
bénéficiaires de l'EITC n'en n'ont pas conscience (ceci
s'expliquant -pour eux- par la forme de cette redistribution qui prend la forme
d'un crédit d'impôt, et non pas d'un véritable transfert
perçu régulièrement). Pour les auteurs, même les
individus conscients de recevoir l'EITC ne le perçoivent probablement
que comme un transfert forfaitaire, donc invariant du nombre d'heures de
travail56(*).
Globalement, l'effet de l'EITC sur l'emploi est
indéniablement positif, de même que son effet sur la
pauvreté, quoique d'une moindre ampleur. Cependant, les mesures
précises de cet impact ne font pas consensus. S'il y a bien une forte
incitation à passer du non-emploi vers l'emploi, tout au moins pour les
personnes seules, on peut observer une désincitation à l'emploi
pour les seconds salaires des couples bi-actifs et une incitation -au moins
théorique- à réduire le temps de travail dans les phases
plateau et descendante.
B. Le Workfare anglais.
Tout comme aux États-Unis, c'est à partir des
années quatre-vingt que la protection sociale change de logique au
R.-U., en évoluant vers une logique de workfare. D'un même
mouvement est instauré une contrepartie en travail qui conditionne
l'octroi des principales aides ainsi que des aménagements fiscaux visant
à atténuer les TMEI pour la transition du non-emploi vers
l'emploi, donc de rendre le travail payant. Traditionnellement, le
système social anglais met l'accent de façon majoritaire sur les
prestations à vocation universelle sous conditions de ressources et non
contributives, financées par le système fiscal. A partir des
années quatre-vingt, le ciblage des politiques sociales va aller
croissant, entraînant, outre la restriction des conditions d'octroi des
aides, une massification des contrôles des bénéficiaires et
une hausse de la contrepartie en travail exigée. Les premières
réformes allant dans ce sens furent celles de 1988 et 1998.
Ainsi, dès 1988 est mis en place le Family Credit
dont l'objectif explicite est de renforcer les incitations
monétaires au retour à l'emploi. Ce crédit d'impôt
remboursable reste cependant de faible ampleur, puisqu'il est
réservé aux familles avec enfants dont au moins un des membres
travaille. De plus, au moins un des actifs du ménage doit travailler
plus de 24 heures hebdomadaires pour que le ménage puisse recevoir
l'aide. Les conditions d'octroi seront assouplies (notamment par la
réduction du nombre d'heures de travail minimales à 16 heures
hebdomadaires), jusqu'en 1998, où le dispositif sera
réformé. A cette date, le Working Family Tax Credit
(WFTC) succède au Family credit. Le WFTC s'inscrit dans le
cadre du New Deal du gouvernement de T. Blair, qui vise plus
globalement à modifier les relations existantes entre travail et
redistribution, en introduisant la sanction et la menace sur les sans-emplois,
et en introduisant l'idée d'une contrepartie nécessaire à
tous octrois d'aides sociales. C'est pourquoi P. Le Galès, insistant
sur l'héritage libéral du New Labour des années
quatre-vingt-dix, affirme : « toute la tradition
social-démocrate de l'accès universel à certains droits et
allocations a été remplacée par une rhétorique des
droits et responsabilités des individus57(*)». On parle alors de « workfare
symbolique 58(*)», qui fait reposer le système de
sanctions sur un discours politique visant à rendre l'individu redevable
de l'effort fourni par la collectivité. L'allocataire est alors un
« profiteur » potentiel qu'il faut contrôler pour
éviter tout abus.
Le New Deal consistait en un ciblage plus important
des aides sur les publics connaissant les plus grandes difficultés, et,
en parallèle, de réintégrer les allocataires de minima au
marché du travail, et notamment les mères célibataires,
les seniors et les moins de 25 ans. Une offre importante de formation a ainsi
été menée en direction de ces publics, mais dans une
logique de devoir, c'est-à-dire assortie de sanctions en cas de non
participation à ces programmes. La logique du workfare est introduite
dans le versement des minima : les montants ont été
réduits (ce qui réduit le TMEI et la désincitation au
travail), des emprunts bonifiés remplacent parfois les
subventions59(*), et le
montant de l'allocation peut être affecté par le refus d'un
emploi. Ainsi, les allocations chômage ont été
remplacées par la Job Seeker Allowance (JSA), qui durcit les
conditions d'octroi de l'aide : il faut prouver une recherche active
d'emploi, et l'allocation chômage n'est versée plus que durant 6
mois maximum (contre 12 mois auparavant). De même, les minima sociaux
sont soumis à cette logique de la contrepartie en travail : le
montant de l'Income Support peut être réduit en cas de
refus d'un emploi ou de non présentation à un entretien
d'embauche. D'un autre côté, des mesures incitatives accompagnent
le WFTC pour faciliter le retour à l'emploi : pour les familles
monoparentales, l'Income Support est versé durant les deux
premières semaines de la reprise d'activité, et d'autres
allocations peuvent se cumuler temporairement avec le salaire60(*).
Le WFTC se veut être une solution à la fois au
problème de la pauvreté des enfants en opérant une
redistribution en faveur des familles, et au problème de la
« trappe à inactivité » en redistribuant vers
les travailleurs pauvres. Contrairement au dispositif étasunien,
l'octroi de ce crédit d'impôt n'a pas été
étendu aux célibataires sans-enfants, conservant ainsi son
objectif familialiste et de protection de l'enfance. Pour
bénéficier du WFTC, il faut qu'au moins un actif du couple
travaille plus de 26 heures hebdomadaires, qu'au moins un enfant de moins de 16
ans soit présent dans le ménage, et que le patrimoine du
ménage soit suffisamment faible (inférieur à 8000£ en
2000). Il en résulte que la reprise d'emplois à temps très
partiel n'est pas du tout incitée, au contraire de l'EITC qui
s'enclenche dès la première heure travaillée. Le WFTC est
calculé sur les revenus nets du foyer (c'est-à-dire y compris les
revenus du travail, les pensions de retraite, et les revenus d'épargne,
tous nets d'impôts): pour tous ménages satisfaisant les conditions
d'octroi (c'est-à-dire travaillant suffisamment) et ayant un revenu net
hebdomadaire inférieur ou égal à 90£, le montant du
crédit d'impôt est maximal, soit 52,3£ hebdomadaires
(c'est-à-dire environ 210£ par mois). Ensuite, pour la part du
revenu qui excède les 90£ hebdomadaires, le WFTC est
dégressif à un taux de 55% (pour chaque euro
supplémentaire de revenu net, le montant supplémentaire de
crédit d'impôt est diminué de 55%). Outre ce versement de
base, le WFTC comprend aussi des majorations, en fonction du nombre d'enfants
à charge, mais aussi une majoration pour garde d'enfants (elle couvre
70% du cout de la garde, avec un plafond maximal évoluant en fonction du
nombre d'enfants à faire garder). Outre l'incitation financière,
on voit donc que les difficultés matérielles entravant le retour
à l'emploi sont aussi prises en compte.
Les évaluations du WFTC laissent pourtant entrevoir une
efficacité plutôt faible, à la fois en termes
redistributifs qu'en termes de retour à l'emploi. D'un point de vue
redistributif, l'effet du WFTC est modeste. En effet, ce ne sont pas les
individus les plus pauvres qui vont en bénéficier, puisqu'ils ne
travaillent pas ou pas assez. Ce sont donc les individus situés dans les
deuxième et troisième déciles qui vont en
bénéficier le plus : le WFTC représente ainsi plus de
10% du revenu disponible dans le premier cas, et près de 7% dans le
second cas61(*).
Dès le cinquième décile de revenu disponible, la part du
WFTC dans le revenu disponible est proche de 0. L'effet estimé sur la
pauvreté est lui aussi faible, car les plus nécessiteux ne sont
pas concernés. Le WFTC joue un rôle faible dans la lutte contre la
pauvreté.
D'un point de vue de l'incitation au travail, le WFTC impacte
de façon importante les TMEI. Le nombre de personnes ayant un TMEI
compris entre 90% et 100% passe ainsi de 222 000 à 115 000
grâce au dispositif. De même, la réduction du nombre
d'individus ayant un TMEI compris entre 70% et 80% est de 249 000. Mais,
comme dans le cas de l'EITC, le dispositif est susceptible d'accroître le
TMEI pour les personnes déjà en emploi et qui atteignent la phase
dégressive : il y a donc un risque de baisse du nombre d'heures
travaillées, ou en tout cas de désincitation à travailler
plus. Ainsi, 711 000 personnes supplémentaires vont avoir un TMEI
compris entre 60% et 70%, et 207 000 personnes supplémentaires un
TMEI compris entre 50% et 60%. Au final, le nombre de personnes ayant un TMEI
supérieur à 50% augmente de 57,28% avec le WFTC, ce qui est un
résultat plutôt négatif. On voit donc une baisse du nombre
de personnes concernées par de très hauts TMEI, mais globalement
une hausse du nombre de personnes concernées par des hauts TMEI
(supérieurs à 50%). Au final, la hausse du taux d'activité
induite par le WFTC était estimée en 2 000 à 0,15%,
ce qui signifie que chaque nouvel entrant sur le marché du travail
coûterait environ 60 000£62(*).
III. Le Revenu de Solidarité Active (RSA).
La France a elle aussi cherché à rendre le
travail payant, en fustigeant l'assistanat et l'oisiveté que
subventionnerait une redistribution trop généreuse. La citation
de N.Sarkozy mise en exergue au début du mémoire illustre bien la
conception de la redistribution qui a pris le dessus et qui est devenue
aujourd'hui « incontestable » et consensuelle. La mise en
place du RSA est symptomatique de cette évolution des mentalités.
Nous verrons que des réformes visant à rendre le travail payant
en articulant mieux travail et redistribution ont émergé bien
avant le RSA, mais jamais dans une même ampleur, et toujours sans
remettre en cause la structure des transferts existants. Le RSA constitue donc
une rupture importante dans le paysage socio-fiscal français. Nous en
présenterons les caractéristiques, et, ensuite, nous en
réaliserons un bilan en évaluant son impact sur la
pauvreté, sur l'incitation à l'emploi, et, plus globalement sur
le marché du travail.
A. L'incitation au travail avant le RSA.
La volonté de rendre le travail payant ne date pas, en
France de l'instauration du RSA. L'intéressement proposé aux
RMIstes, puis la Prime Pour l'Emploi (PPE) visaient déjà à
accroître l'incitation à la reprise d'emploi.
L'intéressement est une procédure qui a
accompagné certains minima sociaux (le RMI et l'Allocation
Spécifique de Solidarité (ASS) notamment). Elle vise à
permettre un cumul entre revenu d'activité et minimum social
temporairement, pour atténuer l'effet du TMEI important appliqué
à la transition du non-emploi vers l'emploi. Appliqué au RMI,
l'intéressement permettait de cumuler intégralement le revenu
d'activité et l'allocation durant trois à six mois après
la reprise d'activité63(*). Ensuite, le cumul n'est plus que de 50% (seul 50% du
revenu d'activité est déduit du RMI), et ce jusqu'à 12
à 15 mois après la reprise d'activités
(c'est-à-dire jusqu'à la quatrième DTR suivant la reprise
d'activité). Plusieurs arguments peuvent justifier que, contrairement
aux dispositifs de l'EITC ou du WFTC, et comme nous le verrons du RSA,
l'intéressement ne proposait qu'un cumul temporaire entre allocation et
salaire. Ainsi, on peut considérer tout d'abord que la phase de reprise
d'activité sera suivie par une hausse de la qualification et de
l'expérience, donc une hausse de la probabilité de trouver par la
suite un emploi mieux payé, ce qui justifie que le soutien financier ne
soit que temporaire. Mais surtout, le cumul temporaire se justifie par le fait
que les coûts liés à la reprise d'un emploi ne sont pas
permanents et interviennent à un moment donné. Ainsi, le gain au
retour à l'emploi, déjà faible en raison du haut TMEI, est
encore affaibli par ces dépenses nécessaires à l'obtention
d'un emploi (61,4% des anciens allocataires déclarent avoir fait face
à des frais dans leur recherche d'emploi). Ces dépenses sont
temporaires (par exemple équipement en moyens de communications, achat
d'une voiture, achat de vêtements), et se résorbent peu
après l'entrée en activité. Il n'est donc pas
légitime de verser de façon indéfinie une aide à la
reprise de l'emploi.
Outre l'intéressement, la Prime Pour l'Emploi (PPE)
constitue aussi un moyen qui a été mis en oeuvre dans le but
d'inciter financièrement au retour à l'emploi. Et c'est avec
cette exclamation que T.Piketty saluait, en janvier 2001 sa mise en
place64(*):
« L'impôt négatif est né! ».
La logique est en effet toute différente de l'intéressement,
puisque la PPE est un crédit remboursable calculé sur l'IRPP,
à l'image des mesures anglo-saxonnes, qui s'appliquent pour tous les
travailleurs payés aux alentours du SMIC. La prime est calculée
en appliquant au revenu fiscal de référence un taux de prime. Le
calcul est d'abord réalisé en équivalent temps-plein, puis
le montant de la prime est rapporté au temps de travail effectif en
prenant en compte une majoration octroyée pour « temps
incomplet »65(*). Des majorations sont aussi octroyées pour les
ménages mono-actifs et pour les enfants à charge. Le taux de
prime est fixe pour tous les revenus compris entre 0,3 et 1 SMIC, puis
décroît ensuite avec la hausse du revenu, pour atteindre 0%
lorsque le revenu est de 1,4 SMIC. Le taux de prime maximal (i.e. le niveau
fixe du taux appliqué jusqu'à 1 SMIC) a fortement
crû : il est passé de 4,4% en 2002 à 7,7% en 2008.
Ainsi, ce dispositif n'a cessé de s'amplifier depuis sa
création : le montant total de la PPE a doublé entre 2002 et
200866(*), à la
fois sous l'effet d'un assouplissement des conditions d'octroi, et d'une plus
grande générosité dans le calcul du montant de la prime.
Outre l'évolution du taux, des facilités ont été
introduites, notamment des versements anticipés versés dès
la reprise d'emploi et avant le versement de la PPE afin de faciliter la
passage du non-emploi vers l'emploi, ou encore une hausse de la majoration pour
« temps incomplet ».
L'effet de la PPE sur le gain à la reprise
d'activité est réel, mais faible. Ainsi, la PPE permet de
réduire de 6,6 points le TMEI67(*) pour les personnes gagnant entre 0,3 et 1 SMIC
(c'est-à-dire y compris des bénéficiaires de minima
sociaux qui ne travaillent pas suffisamment pour sortir définitivement
de l'assistance). Les gains au passage du RMI au SMIC à mi-temps et
à plein-temps sont augmentés grâce à la PPE :
pour l'entrée dans l'emploi à mi-temps, la PPE permet d'augmenter
en moyenne le gain mensuel à la reprise d'activité de 29,45
euros, en comparaison du gain sans PPE ni intéressement68(*). A titre de comparaison,
l'augmentation du gain mensuel généré par
l'intéressement pour la transition vers un emploi à mi-temps est,
elle, de 71 euros. Pour le passage du RMI au SMIC à plein temps, la
hausse du gain mensuel à la reprise d'activité est de 40 euros
grâce à la PPE et est presque nulle pour l'intéressement.
Au-delà de l'ampleur limitée de l'incitation
générée par le PPE, il faut noter qu'elle est
potentiellement génératrice de désincitations
au-delà de 1 SMIC (c'est le même type d'effet que celui qui
intervient à partir du plateau de l'EITC), en raison de la baisse
continue du taux de prime qui intervient à ce moment-là.
La PPE permet aussi de réduire la pauvreté et de
jouer un rôle redistributif, mais ceci dans une ampleur très
faible. En 2008, la PPE a permis de faire sortir 370 000 personnes de la
pauvreté, dont 110 000 travailleurs69(*). Les ménages qui voient leurs revenus
augmenter le plus grâce à la PPE sont les couples bi-actifs
où les deux actifs sont à mi-temps (la PPE entraîne une
hausse de 4,5% du revenu mensuel du ménage), ceux où un individu
est à mi-temps et l'autre à plein-temps (hausse de 4,3%), et les
couples où les deux sont à plein-temps (4,1%). A l'inverse, la
PPE ne bénéficie ni aux ménages ayant des revenus trop
importants, ni aux ménages totalement inactifs ou ne travaillant pas
assez pour travailler un tiers-temps au SMIC (0,3 SMIC). Les inactifs et les
très faibles temps partiels ne voient donc pas leurs revenus
croître, alors que ce sont ceux qui sont les plus pauvres, et qui
composent la majorité des individus vivant sous le seuil de
pauvreté.
B. Le RSA: objectifs et mise en oeuvre.
La mise en oeuvre du RSA le 1er juin 200970(*) est la suite logique des
mesures que nous venons de présenter : son objectif prioritaire est
en effet d'accroitre le gain au retour à l'emploi et donc de remettre en
cause l'effet désincitatif des hauts TMEI appliqués sur la
transition du non-emploi vers l'emploi. Nous présenterons tout d'abord
les objectifs du RSA, et, ensuite, ses modalités de mises en oeuvre.
La réforme du RSA se veut être plus qu'une
mesure additionnelle, et cherche plutôt à refondre les transferts
sociaux. Ainsi, «l'ambition du revenu de solidarité active est
de modifier en profondeur l'exercice de la solidarité 71(*)», selon M.Hirsh, son
principal instigateur. Et, de fait, le RSA propose un certain nombre
d'innovations, a priori positives, qui changent radicalement la nature de la
solidarité. On peut noter principalement quatre objectifs poursuivis par
le RSA : une nouvelle approche de l'évaluation des politiques
publiques et des réformes sociales en particulier, une simplification et
une rationalisation du système des minima sociaux, la suppression de la
trappe à inactivité, et, enfin, une réduction absolue de
la pauvreté en France.
L'expérimentation qui a été
réalisée constitue une première en France, car,
jusqu'alors, un principe d'égalité de traitement entre tous les
citoyens interdisait de ne pas offrir à tous le même traitement.
Ce procédé d'expérimentation est censé apporter une
information détaillée sur les effets que l'on peut attendre de la
mise en place généralisée du RSA, ainsi que sur la
meilleure façon de procéder à sa mise en oeuvre, en
comparant les résultats obtenus dans les zones tests avec les zones
témoins qui ne voient pas de changement durant la durée de
l'expérience. Au total 34 départements ont participé
à l'expérience.
Ensuite, le RSA vise à rationaliser les dépenses
publiques et à simplifier le système des minima sociaux, qui
étaient au nombre de neuf avant son instauration (cf. Annexe 9). Le RSA
fusionne ainsi le RMI et l'Allocation Parents Isolés (API)72(*), deux minima sociaux, avec la
Prime Pour l'Emploi (PPE). L'objectif initial était d'inclure un nombre
plus important de minima, mais les problèmes liés notamment aux
différences d'organismes financeurs ont contraint le RSA à
n'inclure que deux minima sociaux.
Enfin, et surtout, le RSA se fixe comme objectif de
résoudre en même temps le problème de la trappe à
inactivité en rendant le travail payant, et le problème de la
trappe à pauvreté, en s'attaquant à la fois à la
pauvreté conséquence de l'exclusion du travail ainsi qu'au
phénomène des travailleurs pauvres dont le nombre a cru de 21%
entre 2003 et 2005 selon M.Hirsh.
Pour répondre à ces objectifs, le RSA vise
à revaloriser le travail en instaurant un cumul entre minima et salaires
à hauteur de 62% du revenu d'activité.
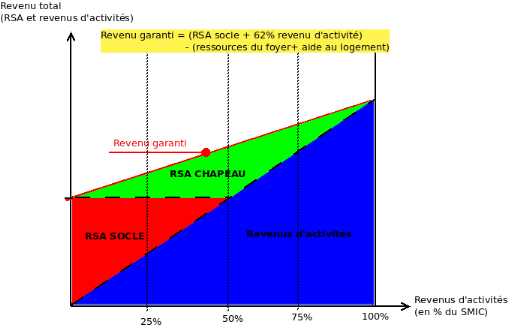 Graphique 7: Méthode de calcul du RSA et de cumul revenu
d'activité/RSA. Source: Inspiré par le Conseil
Général de l'Isère, présentation du RSA,
2010 Graphique 7: Méthode de calcul du RSA et de cumul revenu
d'activité/RSA. Source: Inspiré par le Conseil
Général de l'Isère, présentation du RSA,
2010
Le RSA se divise en deux composantes. Tout d'abord le
« RSA socle », qui correspond à l'ancien RMI :
c'est une allocation différentielle, dont le montant diminue avec la
hausse des revenus primaires. Elle permet de garantir à tous un revenu
de 460 euros, qui est versé aux personnes sans travail ou ne parvenant
pas à gagner ce montant en travaillant. Le RSA socle, appelé
montant forfaitaire, peut être majoré, dans le cas d'une personne
seule ayant au moins un enfant à charge, ou dans le cas d'une femme
isolée en situation de grossesse. C'est cette majoration qui fait office
de substitution à l'ancienne API (les montants de l'API étaient
en effet sensiblement supérieurs aux montants du RSA, pour une structure
équivalente du ménage). Les individus qui travaillent voient,
certes, le montant de leur allocation se réduire ; cependant, la baisse
de l'allocation est moins rapide que la hausse du revenu du travail. Ainsi, le
« RSA chapeau » est une allocation versée aux
travailleurs, qu'ils soient bénéficiaires ou non du RSA socle.
Le montant de l'allocation versée est égal à la somme du
RSA socle et de 62% des revenus d'activités (on prend en compte le
salaire net), à laquelle on retranche les revenus du foyer et les aides
au logement. Ainsi, dans le cas d'une personne seule travaillant à
mi-temps avec un salaire net de 500, on somme les 460 euros du RSA socle et les
62% des 500 euros, puis on déduit le salaire perçu (500
euros)73(*), et on obtient
une allocation d'un montant de 270 euros. Ajoutée aux 500 euros de
salaires, elle permet de faire en sorte que le revenu mensuel de la personne
atteint 770 euros. Ainsi, à la différence du RMI, seuls 62% des
revenus d'activités sont pris en compte dans la réduction de
l'allocation. Ceci correspond à un taux marginal d'imposition de 38%,
c'est-à-dire que chaque euro supplémentaire gagné se
traduit par une réduction de l'allocation de 38 centimes. A raison de
cette dégressivité de l'allocation, son montant est nul aux
alentours de 1,04 SMIC74(*).
Le RSA chapeau, qui vise à inciter au retour à
l'emploi, se distingue fortement de la PPE, mécanisme
pré-existant ayant une vocation similaire. On peut distinguer quatre
divergences entre l'ancien et le nouveau dispositif. Tout d'abord, le calcul de
l'allocation ne se fait pas sur les mêmes bases : le foyer fiscal,
sur lequel était calculé la PPE, est remplacé par un foyer
spécifique au RSA qui a la particularité de prendre en compte le
concubinage, alors que de simples conjoints ne forment pas traditionnellement
un foyer fiscal. Cette évolution peut sembler de bon sens, car elle
permet de coller au plus près des réelles ressources du
ménage : le montant de l'allocation pourra être fortement
réduit, voire être supprimé en raison des revenus du
concubin. Ensuite le RSA entre en jeu dès la première heure
travaillée, à l'image de l'EITC, alors qu'il existait un seuil
minimal pour la PPE (0,3 SMIC), comme pour le WFTC. Ceci est positif dans le
sens où le retour au travail est subventionné même si
l'individu ne parvient pas à trouver un emploi à temps plein.
D'un autre côté, cela revient à subventionner des emplois
de mauvaise qualité, payant peu ou à temps très partiel.
De plus, le RSA chapeau est plus stricte que la PPE, car un complément
de revenu n'est versé que jusqu'à 1,04 SMIC environ pour une
personne seule, comme on l'a vu, contre 1,4 SMIC avec la PPE. Enfin, il faut
noter que la PPE était versée ou déduite des impôts
automatiquement ; désormais, les bénéficiaires potentiels
doivent faire la demande et apporter les preuves de leur
éligibilité au dispositif, ce qui peut s'avérer
décourageant, surtout dans le cas de montants alloués de faible
ampleur. Pour l'instant, le RSA est une avance du montant de PPE devant
être versé l'année suivante : si la PPE alors
calculée est supérieure au montant effectivement reçu de
RSA l'année précédente, alors un différentiel est
versé, de telle sorte que l'individu bénéficie du
dispositif le plus avantageux. Mais cette situation n'a pas vocation à
durer dans le temps, et cet accès au dispositif le plus avantageux est
remis en cause par le gel intervenu des barèmes de la PPE.
Outre l'incitation financière, le Projet du RSA
prévoit l'instauration d'une aide personnalisée de retour
à l'emploi, qui s'inscrit dans le renforcement de la notion
d'échange, droits contre devoirs. L'allocataire est obligé de
rechercher activement un emploi, et, dans le cas où pôle emploi
lui enlève le statut de demandeur d'emploi, c'est-à-dire si l'on
considère qu'il y a manquement aux devoirs de l'allocataire75(*), ce dernier peut voir l'aide
mise en suspens76(*). En
échange de ce durcissement, la loi instaure le principe d'un
interlocuteur par allocataire dans l'accompagnement à l'emploi, au sein
de Pôle Emploi ou d'autres prestataires, rétablissant ainsi la
« vocation universelle du service public de l'emploi77(*) ». Le RSA
affiche ici son originalité : pour favoriser le retour à
l'emploi, les dimensions pécuniaires et incitatives, tout comme les
besoins d'accompagnements semblent être pris en compte.
C. Bilan
Un certain nombre de critiques ont émergées,
anticipant un certain nombre d'effets pervers potentiels, et pointant du doigt
les fondements même de cette politique. Nous observerons, à la
lumière des premières observations empiriques
réalisées, si le RSA a tenu ses promesses, ou si les
inquiétudes de certains se sont avérées fondées.
Tout d'abord, le RSA envoie un signal clair aux
employeurs : la collectivité se charge du financement du
différentiel existant entre le « salaire de
réserve » des inactifs et le salaire proposé par les
entreprises (bien souvent le SMIC pour les RMIstes). Dès lors, rien
n'empêche les employeurs de faire pression à la baisse sur les
rémunérations : la prime versée par la
collectivité modifie l'arbitrage des demandeurs d'emplois en rendant des
salaires plus faibles plus attractifs. Dans la mesure où un arbitrage
entre loisir et travail existe, et dans le cas où il repose sur des
considérations de niveaux de salaires, alors on peut affirmer que le RSA
va accroître l'acceptabilité des bas salaires par les
allocataires. De même, il devient plus avantageux d'accepter un
« petit boulot », à temps partiel. Pour J.Gadrey, le
RSA constitue donc « un encouragement pour les employeurs
à abuser du travail précaire78(*) ». Ce risque de « trappe
à précarité » met donc fortement en doute
l'efficacité du RSA à juguler le phénomène des
travailleurs pauvres.
Ensuite, le RSA repose sur une conception spécifique
de la relation entre travail et assistance, proche de celle prévalant
largement dans ce que Robert Castel appelait la
« modernité libérale ». Le travail
de l'individu, l'effort qu'il fournit, devient la justification de l'aide qu'on
lui octroie, et l'oisif, l'inactif « volontaire » ne peut
faire valoir son droit à l'aide. Il y a séparation entre le
« bon » pauvre et le « mauvais »
pauvre. D'où le système de contrôle de la recherche de
travail dans le cadre du RSA, identique à celui des chômeurs et
beaucoup plus strict que celui prévalant lors du RMI. Au-delà des
problèmes moraux posés par cette conception de l'assistance, le
poids donné au travail s'avère être fortement
pénalisant pour les allocataires se trouvant dans l'incapacité de
travailler (personnes en situation de handicap par exemple), qui ne pourront
pas bénéficier de l'ensemble du dispositif. Une dualisation des
allocataires est créée.
Enfin, un troisième type de critique porte plus sur
les limites du RSA, ses contours trop restreints. D'un point de vue
quantitatif, beaucoup d'auteurs fustigent la faible ambition du dispositif,
à l'image de D. Clerc qui note que s'« il y aurait
mauvaise foi à contester que les travailleurs pauvres vont voir leur
situation financière s'améliorer », à la
question de savoir si cet effort est suffisant il répond:
« A l'évidence, non 79(*)». De fait, il rappelle que l'instauration
du RSA s'accompagne de la suppression d'un ensemble d'avantages et d'aides qui
étaient accordés précédemment aux RMIstes. Par
exemple, la mise sous condition de ressources des « aides
connexes », garanties auparavant par le statut même de
l'allocataire. Au final, les montants mis en oeuvre ne permettront pas
d'atteindre le seuil de pauvreté de 60% du revenu médian, de 908
euros de revenu disponible en 2007, alors que le RSA
« socle » pour une personne seule atteint en 2010 un peu
plus de 460 euros. Pour les travailleurs pauvres, l'effort
réalisé ne semble pas être non plus satisfaisant puisque,
selon D.Clerc, un programme permettant à tous les travailleurs pauvres
de passer le seuil de pauvreté coûterait environ 10 milliards
d'euros80(*), contre un
dispositif effectif d'environ 2 milliards aujourd'hui. De plus, selon lui, le
RSA actuel ne va générer, en moyenne, que 50 euros
supplémentaires pour chaque allocataire en emploi, ce qui semble
insuffisant au regard des objectifs affichés. En outre, les contours du
programme sont eux aussi critiqués. En effet, les conditions
d'éligibilité au RSA sont strictes, avec notamment le fait
d'avoir au moins 25 ans hormis pour des cas spécifiques
c'est-à-dire s'il y a des enfants à charge dans le foyer, ou si
la personne a travaillé déjà au moins une année les
deux dernières années.
Les premières évaluations
réalisées, à la fois sur les expérimentations et
sur la généralisation montrent des résultats
contradictoires selon les études.
Le bilan de l'expérimentation laissait envisager un
programme performant avec des résultats significatifs. Selon la
Direction Générale du Trésor et de la Politique
Économique (DGTPE)81(*), l'expérimentation est en effet
concluante : l'effet global du RSA est une diminution du taux de
pauvreté pour chaque type de ménage en moyenne, avec un taux
moyen diminuant de 0,8 point de pourcentages grâce au programme. Cet
effet est le plus important pour les familles monoparentales en emploi,
où le taux de pauvreté est inférieur de 3 points dans les
zones tests par rapport aux zones témoins. L'effet sur le revenu est
positif pour tous types de ménages, à la différence du
RMI, notamment pour les personnes seules ou les familles monoparentales passant
en emploi à quart-temps, où il y a un gain de revenu là ou
il n'y en avait pas auparavant (sans prendre en compte les mesures
d'intéressement et les aides connexes). Les premières estimations
des effets du RSA sur le TMEI des bénéficiaires semblent aussi
positives. D. Anne et Y. L'horty82(*) ont ainsi simulé quel pourrait être
l'effet du RSA sur la « durée de
réservation 83(*)»; le résultat est que pour toutes
les catégories de ménages et pour toutes situations
d'allocataires, c'est-à-dire en intégrant les droits connexes
locaux et nationaux, le RSA permet que dès la première heure
travaillée, le revenu du ménage supplante le revenu obtenu en
restant dans l'oisiveté. La durée de réservation est donc
ramenée à 0.
A contrario, on peut se baser sur d'autres
études qui tempèrent fortement l'efficacité du RSA. Tout
en reconnaissant un impact sur la reprise d'activité du RSA, quoique
très peu significatif (si 19,1% des allocataires ont repris un emploi
durant l'expérimentation dans les zones tests, ils sont 17,6% dans les
zones témoins), une étude de la DREES84(*), réalisée sur
l'expérimentation montre que le dispositif a un réel impact sur
la nature des emplois exercés par les allocataires. Ainsi, le nombre
d'heures travaillées par les personnes passant à l'emploi dans
les zones tests semble être généralement plus faible :
la part des allocataires passant à l'activité et travaillant au
moins 28 heures hebdomadaires diminue de presque 5 points dans les zones tests.
Le nombre d'allocataires devenant actifs avec un travail de moins de neuf
heures passe de 5,2% en zones témoins à 8,6% en zones tests.
Ceci peut s'expliquer entre autres, par des préférences
différentes des allocataires en termes d'emplois entre zones tests et
zones témoins : on voit après enquête que 17% des
allocataires cherchant un emploi recherchent un emploi à temps partiel
en zone test, contre 14% en zone témoin. Il est probable que ceci
résulte d'un « effet revenu » induit par
l'augmentation du gain à l'emploi. D'un côté, le RSA semble
modifier la nature des emplois vers plus de précarité et des
emplois moins rémunérateurs (temps partiel), mais ceci peut
résulter des préférences des allocataires pour ce type de
contrat, qui seraient ainsi révélées par le RSA (il offre
un protection et permet donc de révéler ses véritables
préférences). Enfin, l'étude analyse l'impact des mesures
d'accompagnement, et sur ce point, il n'y a pas de différences entre
zones tests et témoins pour les personnes accédant à
l'emploi durant l'expérimentation : dans chaque zone, 43% des
personnes déclarent avoir été en contact avec un
interlocuteur d'accompagnement.
Au final, les premières expérimentations
laissent entrevoir un impact très flou et peu significatif sur la
pauvreté et l'activité des allocataires.
Pour conclure, il est clair que les attentes suscitées
par le RSA sont fortement tempérées, sur le principe même
du dispositif autant que par les évaluations déjà
réalisées. Si théoriquement l'effet en terme de
réduction des désincitations au travail paraît clair, les
premières estimations empiriques ne montrent pas de réussite
significative sur les retours effectifs à l'emploi. De plus, le RSA
semble porteur d'effets pervers, qu'il conviendra d'estimer par une analyse
précise et dans la durée du dispositif.
Chapitre III. Dépassements et remise en cause
de l'arbitrage monétaire entre travail et loisir.
La théorie économique se satisfait donc de
l'hypothèse d'agents calculateurs, qui réalisent un choix
rationnel entre le travail et l'inactivité en comparant les
contreparties monétaires de chacune des situations. Dans ce cadre, la
redistribution s'oppose effectivement au travail puisqu'elle offre des revenus
aux inactifs, et dévalue donc le travail. Les réformes
anglo-saxonnes et françaises, que nous avons présentées,
entérinent cette vision négative de la redistribution.
Cependant, cette conclusion n'est pas pleinement
satisfaisante, et peut être remise en cause. Tout d'abord parce que la
redistribution des richesses est issue d'une construction historique,
parallèle au salariat. Ainsi, l'aide sociale, restrictive au
départ, et fondée sur la distinction entre aptes et inaptes au
travail, s'est progressivement élargie, incluant de façon
croissante les personnes aptes au travail dans le versement d'aides,
abandonnant donc l'idée d'un véritable arbitrage entre travail et
loisir. De même, grâce à la conjonction d'une
prééminence des assurances sociales et d'une
société de plein-emploi, le conflit entre travail et
redistribution a ainsi pu être sinon résolu, du moins mis de
coté.
Ensuite, l'idée de l'arbitrage peut être
réfutée en montrant que ce qui pousse les individus à
travailler est autrement plus complexe que le simple calcul du gain
espéré, ce qui limite l'impact potentiellement négatif
d'une redistribution trop généreuse. Nous verrons alors que le
travail constitue un moyen de réalisation de soi, et qu'il permet de
faire société « entre égaux », selon
l'expression de R. Castel. De là, on déduit que l'explication la
plus probable à la prise de distance avec le monde du travail
réside dans une incapacité à chercher et/ou trouver du
travail, et dont les déterminants sont largement sociologiques. Nous
substituerons donc à un arbitrage travail/loisir un
phénomène d'exclusion sociale.
Nous présenterons en dernier lieu la proposition
d'allocation universelle, comme un moyen de dépasser le conflit existant
entre redistribution et incitation au travail. Si l'arbitrage monétaire
est bien réel, alors l'allocation se propose d'en changer les
paramètres en dévaluant le travail et en réévaluant
l'inactivité. Si les incitations au travail dépassent le cadre
monétaire, alors l'allocation universelle permettra de garantir pour
chacun un libre choix, sans désinciter au retour à l'emploi.
I. La dynamique historique des interactions entre
redistribution et travail.
La protection sociale s'est construite parallèlement
à l'industrialisation. Nous sommes passés, petit à petit,
d'une société où la communauté assurait la
protection face aux aléas de la vie à une société
de droits et de devoirs, où la solidarité s'exprime dans un lien
entre chacun et la collectivité, par le biais du statut notamment. Mais
la redistribution s'est aussi construite parallèlement au salariat et
plus largement aux bouleversements de la place du travail dans la
société et dans les valeurs morales.
Ainsi, nous sommes passés d'une redistribution de
faible ampleur réservée aux individus inaptes au travail,
à une redistribution plus massive, allant jusqu'à subventionner
des individus inactifs et aptes au travail. Arrivée à ce point
là de son développement, il semblerait que la redistribution ait
à évoluer de nouveau, mais, cette fois-ci, en opérant un
retour aux valeurs fondant l'idée d'une redistribution
désincitative et illégitime pour les inactifs.
A. Le travail, valeur fondamentale.
Le XVIIIème siècle entame une
rupture dans les conceptions du travail et de l'assistance. Tout d'abord parce
que le travail n'est plus dégradant, mais au contraire est
considéré comme source de toute richesse, et comme facteur de
progrès. Ensuite parce que l'assistance publique se renforce et trouve
sa légitimité dans la remise en cause des protections
rapprochées mises à mal par l'urbanisation et
l'industrialisation. Le rôle potentiellement désincitatif de
l'assistance est mis en avant, et la construction des prémisses de
l'État providence se fera sur cette distinction entre pauvres aptes et
pauvres inaptes au travail.
La conception du travail change profondément, et ce
pour plusieurs raisons. Tout d'abord en réponse aux bouleversements
« infrastructurels85(*) »: les rapports de production
évoluent en effet, sous le coup de l'industrialisation. L'industrie,
cette nouvelle forme de production, laisse entrevoir aux hommes des
perspectives illimitées de gains de productivité, dont le travail
est le fondement. A.Smith met ainsi en avant la richesse qui peut être
générée par une rationalisation des formes d'organisation
du travail. Le travail répond au besoin, nouveau, d'accroître la
richesse. Mais le travail n'a de valeur que parce qu'il est le fruit de la
liberté individuelle. C'est le désir de chacun de s'enrichir,
d'améliorer sa situation qui pousse au travail et permet la
création de richesses. Ainsi, les anciens modes de gestion des
désaffiliés sont remis en cause. Les lieux de travaux
forcés, fondations et hôpitaux ne sont plus justifiés : ces
institutions « stérilisent » la force de travail et
la création de richesse. L'idée qui s'impose alors est que
« toute fabrique nouvelle qui n'est pas le fruit de l'industrie
et qui n'a pas pour guide l'intérêt personnel ne peut
réussir 86(*)». Ainsi, le désir d'améliorer
sa situation devient le moteur de l'industrie, du capitalisme dans son
ensemble. L'octroi de subventions aux pauvres capables ne pourra alors
être qu'inefficace, puisque le travail ne sera plus la seule
réponse à la recherche d'enrichissement.
De plus, l'industrie nécessite pour se
développer l'avènement d'un véritable marché du
travail. On entend par là la mise en place de rapports d'échanges
entre travailleurs et industriels, les travailleurs se proposant de vendre leur
force de travail. L'idée qui apparaît pour justifier le traitement
de la force de travail comme une marchandise est celle de l'homme libre, du
citoyen, qui dispose de sa force de travail. Le travailleur ne se vend pas, il
vend sa force de travail. On peut donc faire le négoce de sa force de
travail, selon son bon vouloir. Dès lors que la force de travail
s'échange, elle fait l'objet des mêmes règles que pour tout
autres types d'échanges sur tous les marchés : il n'y a
d'échanges qu'avantageux pour les deux parties prenantes. Le contrat est
l'expression de cet échange mutuellement avantageux. Si l'échange
n'a pas lieu, c'est parce que ses modalités ne conviennent pas à
au moins une des parties : l'individu qui ne vend pas sa force de travail le
fait parce qu'il n'y trouve pas son compte. Ainsi, l'idée du
marché du travail soutient l'idée du travail comme un choix
libre, ce qui délégitimise l'aide aux sans-emplois; de plus,
cette idée permet de déplacer la responsabilité de la
lutte contre la pauvreté, de la puissance publique vers le jeu naturel
des forces économiques : le marché du travail sera
créateur de richesse et permettra à chacun d'en retirer sa juste
part87(*). Le
marché du travail est alors la réponse à l'indigence et
à la question sociale.
Les changements sociologiques et dans les mentalités
qui ont lieu à l'époque accompagnent ce bouleversement des
rapports de production. Weber en appelle ainsi à l'ethos de la
nouvelle bourgeoisie et à l'esprit protestant, qui se traduit
grossièrement par la « valorisation des activités
terrestres », qui étaient jusqu'alors
méprisées. A.Hirschman évoque lui le recours à la
notion d'intérêt économique pour pallier la violence des
rapports humains et pour rationaliser la vie en société. On
retrouve l'idée du « doux commerce » de Montesquieu,
ou de la main invisible qui sera reprise par A. Smith. Il en résulte
« une large approbation de la volonté d'enrichissement
ainsi que des activités qui en témoignent 88(*)» ,
c'est-à-dire entre autres, le travail.
Dès lors qu'est attachée au travail une valeur
morale, que celui-ci devient le faiseur de progrès, et qu'il structure
les rapports sociaux, la mise en place de la redistribution ne pourra se faire
qu'en évitant d'entrer en conflit avec le travail. La peur de l'effet
désincitatif d'une redistribution trop généreuse
s'illustre bien avec la remise en cause du système de Speenhamland,
ayant cours en Angleterre entre 1795 et 1834. C'est l'instauration d'un
« droit de vivre 89(*)», sous la forme d'une allocation
différentielle : un niveau de revenu est garanti à tous,
travailleurs ou inactifs, et les gains réalisés au travail sont
déduits du montant du transfert (à l'image du RMI ou du RSA
socle). Le transfert est indexé sur les prix des produits de base, et
vise donc à permettre à tous d'accéder à un certain
niveau de vie, jugé comme minimum90(*). Ce système redistributif provoqua les
critiques de plus en plus vives de la part d'un certain nombre de penseurs
libéraux. Ainsi, les effets désincitatifs de cette allocation
sont vivement critiqués. Dès 1797, un observateur affirmait
qu'« on trouve des gens qui préfèrent une pension
de la paroisse et une vie paresseuse à des salaires élevés
en contrepartie d'un dur labeur 91(*)». De plus l'assiduité au travail et
la productivité des travailleurs se dégradèrent : la
garantie d'un droit de vivre dispensait les individus de tout effort pour
conserver leurs emplois. Le travail devenait une sinécure, faite
uniquement pour sauvegarder les apparences92(*). Plus grave encore : sous couvert d'aides aux
pauvres, le système de Speenhamland engendra un appauvrissement. La
baisse des salaires qui s'en suivit, permise par la subvention des actifs
pauvres, entraîna une diminution des revenus (ceci d'autant plus que
selon Polanyi les barèmes des aides de Speenhamlmand ne furent pas
toujours respectés). L'abolition de ce système en 1934
répondra ainsi à la volonté « que la
population dépendante soit graduellement mais fermement arrachée
à son mode de vie actuel, et exposée à l'influence
vivifiante et émancipatrice de la liberté économique
93(*)».
L'idée que la redistribution entre en conflit avec le travail sera
dès lors ancrée dans les esprits.
La révolution française est aussi
imprégnée de cette nouvelle conception du travail et de la
redistribution. La loi du 17 mars 1791 affirme la liberté du travail,
considérant la vente de la force de travail comme un négoce
semblable aux autres: « il sera libre à toute personne de
faire tel négoce, d'exercer telle profession, art ou métier que
bon lui semble 94(*)». La contrepartie à cette
liberté du travail est le maintien ferme du tri des nécessiteux,
mais tout en conservant une certaine ambiguïté quant au niveau
d'universalité à adopter. Les recommandations du Comité
pour l'extinction de la mendicité de l'assemblée constituante
font appel à un principe fort : « tout homme a droit
à sa subsistance », d'où l'obligation pour la
puissance publique de « pourvoir à la subsistance de tous
ceux de ses membres qui pourront en manquer 95(*)»; il n'y a pas ici,
en apparence, d'opposition entre travail et assistance, puisque on ne
s'intéresse pas aux raisons qui poussent l'individu à manquer de
richesse : quand bien même il pourrait travailler, il doit être
secouru. Cependant, ces recommandations, si elles marquent une évolution
nette vers une plus grande générosité et une plus grande
universalité de l'assistance sociale, ne seront pas suivies de faits. La
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793 proclame ainsi
que « la société doit la subsistance aux citoyens
malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens
d'exister à ceux qui sont hors d'état de
travailler 96(*)». Aucun transfert monétaire ne sera
versé aux individus aptes au travail. L'assistance peut donc entrer en
conflit avec l'activité, et, si elle apparaît comme un devoir
moral, il est subordonné au travail présenté comme valeur
fondamentale : « le pauvre ne doit pas, par les secours qu'il
reçoit du gouvernement, être tout à fait aussi bien que
s'il n'avait pas besoin de ces secours », c'est-à-dire
s'il était un travailleur méritant.
C'est sur ces bases que les fondements de l'État social
sont posés, en ce sens qu'une forme de redistribution est
instaurée. La nation se substitue à la
« communauté rapprochée » pour secourir les
indigents, dans les bornes que nous avons présentées. De
même, la République cherche à se substituer à la
charité privée, en prenant en charge la gestion des
hôpitaux et asiles. L'impôt est prélevé, et
pèse sur tous les citoyens « en raison de leurs
facultés97(*) », et non plus selon leurs
privilèges ou leurs pouvoirs. Un nouveau système fiscal est
institué, réunissant quatre prélèvements,
baptisés plus tard les « quatre vieilles », qui
perdureront jusqu'à la fin du XIXème siècle.
B. Dépassements du clivage entre redistribution et
travail.
A partir de la fin du XIXème siècle, la
conception de la redistribution va être modifiée, permettant un
dépassement du conflit entre redistribution et travail. La chronologie
de ce dépassement débute avec la victoire de l'assurance contre
l'assistance à partir de la fin du XIXème siècle pour
prendre en charge les pauvres valides. Ensuite, les « trente
glorieuses » permettront de renforcer ce rôle
prépondérant de l'assurance, tout en instaurant une
« société salariale », qui, sans
résoudre à proprement parler le conflit entre travail et
redistribution, rendra cette question désuète. Enfin,
« l'effritement de la société
salariale », lors de la dégradation des conditions
d'emplois à partir des années quatre-vingt, favorisera un retour
de l'assistance pour prendre en charge les pauvres valides, si d'un
côté on peut voir dans cette subvention de l'oisiveté un
choix audacieux de traitement du conflit entre travail et redistribution, ce
renouveau de l'assistance relancera les critiques portées contre la
redistribution et favorisera un retour des idées mettant en avant la
nécessité d'une contrepartie en travail à tous
bénéfices d'aides sociales.
Les fondations de la redistribution.
Le choix qui a été fait en France de
privilégier l'assurance dans le traitement de la pauvreté valide
est le résultat d'une confrontation avec les tenants de transferts
monétaires non contributifs, c'est-à-dire l'assistance.
L'assurance se propose de prendre en charge le risque chômage, les
cotisations permettant d'acquérir un droit à une allocation
chômage. La redistribution ainsi opérée n'agit qu'entre
travailleurs et sans-emplois : la lutte contre la pauvreté et les
inégalités passe donc par la protection face au chômage,
que l'on peut considérer comme le principal facteur de
déchéance des pauvres valides. Les transferts monétaires
non-contributifs seront réservés aux pauvres non-valides.
Finalement, le choix de l'assurance permet de mettre de côté le
conflit entre redistribution et emploi puisque ce n'est plus la redistribution
à proprement parler qui protège les pauvres valides de la
pauvreté. Il n'y a plus subvention de l'oisiveté puisque le
travailleur a acquis par son travail et ses cotisations un droit à
être protégé de la pauvreté.
Le débat qui oppose assistance et assurance peut
être illustré par le débat opposant J. Jaurès a A.
Mirman à la chambre des députés lors du vote de la loi sur
les retraites en 1905. J. Jaurès s'oppose au traitement de la
pauvreté par l'assistance, qui est alors défendue par un autre
socialiste, A. Mirman, et met en avant l'assurance qui offre un droit
véritable, et qui confère à l'ayant droit une
propriété sociale. Pour Jaurès, s'il y a entre assistance
et assurance « une différence réelle,
substantielle, une différence de droit, une différence sociale,
c'est parce que [...] dans l'assurance, l'ayant droit [...] à l'heure
où la loi marque l'échéance de sa retraite, il l'aura
[...] avec une certitude absolue. Vous ne pouvez empêcher qu'une loi
d'assistance, même si elle est dominée par le principe nouveau du
droit à la vie, n'ait pas la même rigueur, la même
certitude. Du moment que vous êtes obligés de dire «
privé de ressources », vous introduisez par là même un
élément d'appréciation, de discussion »98(*) . Ainsi, dans
l'assurance, « l'État s'oblige en s'obligeant »,
alors que dans l'assistance l'État ne doit rien au
bénéficiaire, et lui accorde un transfert qui prend la forme
d'une aumône. Comme le rappel J. Jaurès, l'assistance
nécessite d'apprécier la situation du bénéficiaire,
donc de contrôler, de vérifier le respect des conditions d'octroi.
Si on voit à cette époque le
développement des assurances sociales obligatoires, apparaissent aussi
de nombreux transferts assitanciels, réservés à certaines
catégories de population, mais d'une générosité
croissante. Leur financement par l'impôt va lui aussi contribuer à
résoudre le conflit entre travail et redistribution : on voit
apparaître une conception fortement redistributive de l'impôt, qui
fait fi de son potentiel effet désincitatif. Deux réformes
majeures témoignent de cette évolution vers notre système
moderne de prélèvements : la mise en place du premier
impôt progressif en 1901, et la création de l'impôt sur le
revenu en 1914. En 1901, après de longs débats parlementaires, la
progressivité est introduite dans l'impôt sur les successions.
Jusqu'alors, les prélèvements portant sur les successions
étaient justifiés comme étant la contrepartie normale des
services rendus par l'Etat aux détenteurs de patrimoine,
c'est-à-dire surtout la sécurité des titres et et des
biens qui permettait leur conservation, et donc leur passage de
génération en génération. Mais lorsque est
introduit la progressivité, la justification de l'impôt devient
explicitement la redistribution des richesses et la lutte contre les
inégalités : l'impôt tire sa légitimité
de son atténuation des inégalités, et de son rôle en
terme de justice sociale. A partir de 1914, l'impôt sur le revenu va
prolonger cette logique redistributive à tous les revenus. Globalement,
la progressivité de cet impôt et son ampleur vont aller croissants
jusque dans les années quatre-vingt-dix, notamment sous le coup des
réformes intervenues en 1936, 1945 et des majorations exceptionnelles de
1968 et 1981.
Le compromis fordiste de l'après-guerre.
Le débat de 1905 sur les retraites s'inscrivait dans
une mouvement large de développement des assurances sociales jusqu'aux
« trente glorieuses », qui vont marquer la victoire de
l'assurance sur l'assistance, et vont ainsi permettre la résolution du
conflit entre travail et redistribution.
Premièrement cette résolution se fera d'une
façon détournée. Ainsi, pour R. Castel, c'est
l'avènement de la société salariale qui permet cette
résolution. Elle se caractérise par deux traits majeurs ;
tout d'abord l'instauration de droits liés aux statuts des
travailleurs, et qui permettent de se prémunir contre la survenue de
risques sociaux ; ensuite, par la quasi absence de chômage qui
caractérise cette époque, avec un maintien d'une stabilité
des emplois et de bonnes conditions d'embauches, c'est-à-dire la mise de
côté de la question de la pauvreté valide99(*). Les droits liés aux
statuts des travailleurs et les conditions d'emplois ne permettraient pas,
seuls, de résoudre le problème de la prise en charge des pauvres
valides, puisqu'en sont exclus les inactifs. Dès que les inactifs sont
supprimés, ou du moins se raréfient, la pauvreté valide ne
pose plus question, et les assurances sociales des travailleurs suffisent
à protéger contre l'indigence et la pauvreté.
Deuxièmement, outre la
« société salariale », on peut
mettre en avant la « socialisation du salaire »
comme facteur de résolution du conflit entre redistribution et emploi.
L'idée de salaire socialisé renvoi à la fixation du niveau
des salaires par une négociation collective : le marché
n'est pas seul à déterminer la rémunération du
travail, et la négociation qui s'y substitue permet de rendre la
distribution des revenus primaires plus proches des contributions effectives et
des volontés de chacune des parties. Mais, surtout, l'idée de
salaire socialisé renvoi aux cotisations sociales, obligatoires et
versées au système public d'assurance sociale, qui permettent la
détention d'une propriété sociale. Ce salaire
socialisé constitue pour B. Friot « la forme
révolutionnaire de ressource des valides exonérés de
l'obligation de travailler 100(*)». Et, en effet, avec les assurances
sociales, et surtout depuis la mise en place d'une assurance sociale contre le
risque chômage en 1959, le salaire socialisé permet de subvenir
aux besoins de certains inactifs, et donc de les dispenser d'emploi au moins
temporairement grâce au versement d'une allocation. Il ne viendrait
à personne d'adosser à cette allocation une obligation de
travailler, ou encore d'affirmer qu'elle désincite au travail, puisque
c'est par le travail qu'elle a été acquise.
C'est donc le « compromis fordiste »,
dominant en France durant les trente glorieuses qui a permis cette
résolution du conflit. On entend par compromis fordiste un état
où existe la « garantie d'un partage des gains de
productivité 101(*)», c'est-à-dire où les
rapports de forces entre travailleurs et capitalistes sont
régulés et équilibrés. Les droits des
salariés, les bonnes conditions d'embauches et le développement
du salaire socialisé en sont des expressions.
La fondation des grands systèmes d'assurances sociales
s'accompagnent de la même vision du travail comme valeur fondamentale et
qui ne doit pas être découragé. Cependant, les
mentalités évoluent et des brèches sont ouvertes dans
cette conception qui oppose travail et redistribution.
Si, d'un côté en 1946 « la nation
garantit à tous (...) la protection de la santé, la
sécurité matérielle, la sécurité et les
loisirs 102(*)», l'aptitude au travail demeure un
critère strict d'éligibilité aux transferts sociaux.
Ainsi, « tout être qui, en raison de son âge, de son
état physique ou mental, de la situation économique, se trouve
dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la
collectivité des moyens convenables d'existence 103(*)». En parallèle,
le droit au travail continue d'être la solution au problème de la
pauvreté104(*).
Le rapport Beveridge cultive lui aussi cette ambiguïté. Beveridge
se propose de lutter contre le « scandale de la
misère » grâce à la
« libération du besoin 105(*)», mais il condamne
fermement l'oisiveté et réserve la protection sociale et la
redistribution aux personnes ne pouvant pas travailler. Pourtant, dans son
ouvrage, Du travail pour tous dans une société
libre106(*), il
aborde sous un angle nouveau la question de l'arbitrage entre travail et
loisir, toutefois sans abandonner la condamnation morale de l'oisiveté.
En réponse aux réactions107(*) à sa proposition de système
d'assurances sociales, il affirmera que pour lui, « dans une
société libre [...] il ne faut pas que les hommes encourent des
pénalités, des amendes parce qu'ils refusent de travailler ou
parce qu'ils ne travaillent pas. Il est essentiel pour la liberté [...]
que chaque individu soit capable de choisir entre le loisir et un salaire plus
élevé 108(*)». On observe donc dans
l'après-guerre un maintien de l'idée selon laquelle une
redistribution trop généreuse peut décourager le retour
à l'emploi, avec l'idée que le travail est un devoir moral ;
cependant, la pensée commence à évoluer vers une
compréhension plus grande des individus sans-emplois, et les
éventuels effets pervers de la redistribution sont de plus en plus
contrebalancés par les besoins de la lutte contre la pauvreté et
les inégalités, qui se font pressantes.
Retour de l'assistance, et retour du conflit entre
redistribution et travail.
La montée du chômage, et la mauvaise
qualité des emplois, c'est-à-dire « l'effritement
de la société salariale 109(*)» vont constituer un terreau favorable
à l'évolution vers une conception assistancielle du traitement de
la pauvreté valide. On peut considérer que cette évolution
va légitimer les remises en causes modernes de la redistribution qui
fustigent son effet désincitatif.
Entre 1975 et 1985, le taux de chômage est
multiplié par deux (il passe de 3,5% à 9%). En 1984, l'Allocation
Spécifique de Solidarité (ASS) constituait une première
réponse à cette dégradation de l'emploi, en visant
à faire face à l'arrivée en fin de droits d'un nombre
croissant de chômeurs. Ce phénomène, alors nouveau, marque
une limite profonde du système assurentiel et contributif, car
semble-t-il, une bonne conjoncture en est une condition de son bon
fonctionnement. Mais c'est la mise en place du RMI en 1988, alors solution
transitoire pour faire face à la montée du chômage, qui
marquera une véritable rupture, en redéfinissant les rapports
qu'entretiennent emploi et redistribution, et en remettant véritablement
en cause la prééminence de l'assurance.
Pour R.Castel, le RMI est ainsi innovant à deux
égards. Premièrement il met un terme à la distinction
entre aptes et inaptes au travail, en allouant un transfert monétaire
à des individus valides. C'est pourquoi le RMI sera jugé
désincitatif, car il sera la source des forts TMEI rencontrés
dans la transition du non-emploi vers l'emploi. Le taux de chômage est
alors très élevé : le RMI permet d'empêcher de
tomber dans le dénuement le plus total de ceux qui, bien que voulant
travailler, sont dans l'incapacité de le faire. C'est donc la mise en
application du préambule de la constitution de 1946, qui affirmait que
la situation économique pouvait expliquer l'incapacité de
travailler. La nation ne peut plus garantir le droit au travail qui
légitimait pourtant la dichotomie aptes/inaptes dans l'octroi des
transferts monétaires. En effet, les individus pouvant travailler ne
reçoivent pas d'aide que parce qu'ils peuvent travailler pour subvenir
à leurs besoins. C'est donc la conjoncture qui légitimise ce
transfert déconnecté de quelconque contrepartie en travail.
Ensuite, le RMI marque une rupture car il met l'accent sur le devoir
d'insertion de la puissance publique à l'égard des
sans-emplois110(*). En
effet, la peur de subventionner l'oisiveté est forte, et les conditions
d'octroi du RMI sont strictes, en tous cas dans les intentions ; la loi indique
ainsi que, outre la condition d''âge du bénéficiaire, ce
dernier devra s'engager « à participer aux actions ou
activités définies avec [lui], nécessaires à son
insertion sociale ou professionnelle 111(*)». De même, l'allocataire doit,
régulièrement, prouver son indigence en déclarant ses
revenus à l'administration.
Mais, l'instauration du RMI c'est aussi, comme le note
A.Purière, la victoire de Mirman sur Jaurès, c'est-à-dire
le retour de l'assistance au détriment de l'assurance. Le RMI n'est pas
contributif, ce n'est pas un droit acquis par le travail. Ainsi, il sera facile
de montrer du doigt les bénéficiaires, pouvant alors être
perçus comme des profiteurs d'une richesse qu'ils ne contribuent pas
à créer. De plus, on peut facilement faire croire que le RMI est
une aumône, concédée gracieusement par l'État, et
par lui seul : les RMIstes sont donc placés dans un rapport de
sujétion vis-à-vis de la puissance publique, qui se substitue
à l'autonomie conférée par les assurances. Car outre la
délégitimisation des bénéficiaires et leur
sujétion, le RMI justifie, selon B. Friot et A. Purière le
démantèlement des assurances sociales, et plus
particulièrement de l'assurance chômage : alors que le RMI
est institué pour faire face à l'exclusion du marché du
travail, les conditions de l'assurance chômage se durcissent
(durée de versement évoluant en fonction de la durée de
cotisation préalable en 1982, ou encore institution de la
dégressivité de l'allocation chômage avec le temps en
1992).
C'est donc par ce retour à l'assistance que le conflit
entre redistribution et travail est ravivé. En effet, soit on
adhère à l'idée d'un arbitrage entre travail et
redistribution, et alors le RMI est fortement désincitatif de par les
forts TMEI qu'il engendre. Soit on refuse d'accepter cette hypothèse, et
le RMI ravive le conflit puisqu'il permet à un discours condamnant
l'assistanat de refaire surface. D'ailleurs ce renouveau du conflit s'illustre
bien avec les choix fiscaux qui ont été réalisés
depuis cette période. La progressivité de l'IRPP a
été fortement réduite, en raison de la diminution du
nombre de tranches et des taux d'imposition. En 1990, le barème
comprenait 13 tranches, et le taux d'imposition applicable à la
dernière tranche était de 56,8%. En 2010, le barème est
réduit à cinq tranches, avec un taux applicable à la
dernière tranche de seulement 40%. Si en 1990, un taux nul s'appliquait
aux revenus inférieurs à l'équivalent de 3 821,74
euros, aujourd'hui tous les revenus inférieurs à 5 875
€ ne sont pas imposés. En 1990, un taux de 14% était
appliqué dès 4 733,98 euros de revenus ; aujourd'hui c'est
seulement à partir de 11 720€ que s'applique un tel taux. Les
impôts sur les bas revenus et les revenus moyens ont donc
été fortement réduits. Certains proposent même
aujourd'hui de supprimer la première tranche de l'impôt sur le
revenu112(*), arguant
des effets pervers d'une taxation trop importante des bas revenus.
Le rôle économique et social joué par le
travail a fortement déterminé le type de redistribution mise en
oeuvre, tout au long de l'histoire du capitalisme. Ainsi, la peur de
décourager au travail est apparue avec son institution en tant que
moteur du progrès et de créateur de richesse. C'est seulement
lorsque le travail est venu à manquer et que la redistribution s'est
affranchie de cette peur de la désincitation, afin d'éviter le
développement d'une grande pauvreté parmi des inactifs de plus en
plus nombreux, que le système redistributif a rompu la distinction
traditionnelle entre pauvres aptes et inaptes au travail. Cet accroissement de
la redistribution s'est fait au détriment de l'assurance sociale
obligatoire, qui constituait pourtant un mode de conciliation entre travail et
redistribution permettant d'éviter les effets désincitatifs.
II. Au-delà de l'arbitrage monétaire
entre travail et loisir.
On peut tenter de répondre à notre
problématique de départ en montrant que l'inactivité ne
résulte pas nécessairement d'un arbitrage monétaire entre
travail et redistribution, et que d'autres facteurs doivent être pris en
compte si l'on cherche à comprendre les incitations à la reprise
d'activité et les déterminants du maintien hors de l'emploi.
A. La variété des incitations au
travail.
La logique qui vise à rendre le travail payant pour
solutionner le problème de la « trappe à
inactivité » repose sur l'idée que seul un gain
financier est susceptible de motiver le retour à l'emploi. Or, les faits
contredisent cette hypothèse : un tiers des allocataires du RMI qui
sortent du dispositif grâce à l'emploi n'y trouve pas de gain
financier significatif113(*). Donc, des individus, sans-emplois, retournent vers
l'emploi pour d'autres motifs que le gain direct et monétaire attendu.
Nous présenterons quatre arguments qui confèrent au travail et
à l'emploi des avantages
« extra-monétaires » : le travail comme
réalisation de soi et comme activité créatrice, le travail
comme facteur de sociabilisation, le travail comme condition nécessaire
au profit du loisir, et, enfin, le travail comme voie d'accès à
la citoyenneté sociale.
Tout d'abord, Marx affirmait que «considérer
le travail simplement comme un sacrifice, donc comme source de valeur, comme
prix payé par les choses et donnant du prix aux choses suivant qu'elles
coûtent plus ou moins de travail, c'est s'en tenir à une
définition purement négative (...) Le travail est une
activité positive, créatrice114(*) ». La motivation au travail n'est donc
pas que pécuniaire, car le travail peut être enrichissant. Marx va
même jusqu'à identifier humanité et travail, puisqu'il
considère le travail comme l'essence de l'homme. Ainsi, le travail
permet l'expression de l'individualité de chacun, car l'objet qui est
façonné est à l'image de celui qui l'a
façonné. L'homme prend donc conscience de lui-même
grâce au travail, et, en même temps se démarque. Le travail
est donc un fondement de l'estime de soi. La vision que Marx a du travail n'est
pas la vision qu'il a du salariat, car, en effet, le travail comme essence de
l'homme, c'est-à-dire vivre pour travailler, n'est pas le travail
aliéné par l'exploitation capitaliste : travailler pour
vivre.
De plus, le travail permet la socialisation des individus,
puisque par l'objet qui est produit chacun devient utile aux autres. Marx voit
ainsi la socialisation comme le travail qui est réalisé pour les
autres : l'échange des fruits du travail permet de
reconnaître le travailleur, donc de l'intégrer, et permet de
satisfaire un besoin par l'utilisation de l'objet façonné.
L'idée d'une socialisation par le travail sera étoffée par
d'autres auteurs et d'autres courants de pensée. Il en ressort que la
socialisation par le travail passe aussi par l'apprentissage des codes qu'il
nécessite, car le travail instaure des coopérations, des
relations inter-personnelles qui sont normées, et par les relations
extra-familiales qu'il permet. Sans réduire le lien social à la
relation de travail115(*), il est
clair que ce dernier en est une composante importante.
Ensuite, le travail permet de structurer le temps. Si on
pousse la logique néo-classique de l'arbitrage entre travail et loisir
jusqu'au bout, dès lors que le coût d'opportunité du loisir
est nul, l'individu ne travaille plus du tout et ne se consacre qu'au loisir.
Mais que fait-il de tout ce temps ? Nous pouvons parier qu'il travaille,
au sens où il entreprend une activité créatrice
nécessitant un effort. Le travail peut ainsi être
considéré comme un « condiment de plaisir de la
paresse 116(*)» : en
l'absence totale de travail, au sens d'activité créatrice, mais
aussi au sens de temps contraint, le loisir perd toute saveur et tout
intérêt. Ainsi, une étude sociologique montre très
bien cette importance du travail dans la vie et dans l'identité des
individus, en montrant que la perte de travail est fréquemment
accompagnée d'une raréfaction des contacts sociaux et des
difficultés à se projeter dans l'avenir. Le loisir total
entraîne une forme de délaissement : « sans
contacts avec le monde extérieur, les travailleurs ont perdu toute
possibilité matérielle et psychologique d'utiliser ce temps (...)
La forme la plus fréquente d'utilisation du temps chez les hommes est ne
rien faire 117(*)».
Enfin, le travail salarié permet aujourd'hui
d'accéder à un statut, à une reconnaissance sociale, et
constitue un élément important de la citoyenneté sociale.
La citoyenneté sociale, telle que R.Castel l'entend, est une composante
de la citoyenneté démocratique dans son ensemble118(*), c'est-à-dire que la pleine
citoyenneté démocratique nécessite pour être
réelle un accès à la citoyenneté sociale. Il la
définit comme « le fait de pouvoir disposer d'un minimum
de ressources et de droits indispensables pour s'assurer une certaine
indépendance sociale 119(*)». Comment accéder à cette
citoyenneté sociale ? Du point de vue des ressources, le travail et
la redistribution sont tous deux à même d'en garantir un certain
niveau. Mais concernant l'accès aux droits indispensables, la question
est plus complexe. Le travail salarié permet encore, quoique de moins en
moins, d'accéder à un certain nombre de droits, notamment
grâce à la protection sociale, mais aussi grâce au droit du
travail qui règle les conditions d'embauche et de licenciement et
égalise les rapports de force entre employeurs et salariés. La
redistribution a un effet plus ambigu : elle permet à la fois
d'éviter les situations de pauvreté qui remettent en cause la
citoyenneté sociale, mais génère aussi des rapports de
sujétions entre institutions et assistés qui remettent en cause
l'indépendance sociale. La redistribution des revenus ne peut donc pas
pallier complètement au travail, car celui-ci permet l'autonomie
économique. La cohabitation de travailleurs et d'assistés rend
plus difficile la constitution d'une « société de
semblables 120(*)»,
caractérisée par des « systèmes
d'échanges réciproques » ou chacun peut être
« traité à parité 121(*)». La
réciprocité est fondamentale, et c'est ce à quoi le
travail permet d'accéder : contribuer, avec tous, à l'effort
collectif, se légitimer, et, in fine accéder à la
pleine citoyenneté. Les individus vont donc chercher à travailler
non pas seulement pour un salaire, mais aussi pour devenir un membre à
part entière de la société. De plus, la protection qui est
offerte aux travailleurs du fait de leur statut, renforce cet attachement
extra-salarial au travail.
Dès lors que la motivation au travail ne repose plus
exclusivement sur le gain monétaire espéré, on peut penser
que la redistribution des revenus, et les aides accordées aux inactifs
ne sont pas nécessairement la source de la « trappe à
inactivité ».
B. L'éloignement du marché du travail.
On peut montrer que la redistribution des revenus n'est pas
la source de la désincitation au travail des inactifs
bénéficiaires des minima sociaux en rappelant qu'ils sont une
majorité à s'inscrire dans une démarche de recherche
d'emploi (les trois quarts), ceci avec la même intensité que les
chômeurs122(*). De
même, il serait absurde de croire que le maintien dans
l'inactivité résulterait d'un calcul, puisque « 40%
des RMIstes jugent dévalorisante la perception de cette
allocation » : l'enjeu du retour à l'emploi
dépasse largement le cadre du gain espéré123(*). Pour expliquer cette
contradiction entre une recherche active d'emploi et un maintien durable dans
l'inactivité, nous nous intéresserons à l'idée
d'exclusion sociale. Nous montrerons ensuite précisément quels
sont les principales barrières à la sortie de l'assistance.
B.Gazier identifie124(*) deux façons qu'ont les économistes
pour concevoir l'exclusion sociale. Tout d'abord l'exclusion comme un
« processus interactif », résultat des
comportements des agents issus de calculs économiques rationnels et de
choix volontaires. C'est cette conception qui sous-tend les réformes
visant à accroître les gains monétaires au retour à
l'emploi. Ensuite, l'exclusion sociale peut être conçue comme un
« processus anonyme », conséquence de
mécanismes institutionnels et de grandes tendances sociétales,
soit en raison du fonctionnement même du capitalisme et du marché
du travail, qui nécessite pour son bon fonctionnement la présence
d'une « classe de sur-numéraires », soit
par l'émergence d'une classe d'individus
« non-compétitifs », mis hors-jeux par
leurs caractéristiques individuelles, et insérés dans un
cercle vicieux où une difficulté individuelle
génère de nouvelles difficultés. L'exclusion sociale comme
« processus anonyme » est soutenue par les
nombreux arguments permettant de penser que le travail possède
intrinsèquement des avantages et peut être désiré
pour lui-même : le non-retour à l'emploi peut alors
être considéré comme subi, puisque l'emploi apparaît
comme intrinsèquement désirable.
Le véritable problème de la trappe à
inactivité réside donc bien dans l'éloignement des
bénéficiaires du marché du travail. Cet éloignement
peut posséder des sources diverses dont principalement une carence de
formation, l'isolement et la pauvreté.
Ainsi, si la capacité à mobiliser des relations
sociales est déterminante dans l'accès à des emplois de
qualité et durables, donc dans la sortie de la dépendance, les
allocataires du RMI mobilisent moins le réseau relationnel que les
personnes sans-emplois et touchant les allocations chômage. Ceci
provenant en partie du fait que les allocataires du RMI sont jeunes (21% des
allocataires ont moins de 29 ans125(*)), donc ayant un carnet d'adresses professionnelles
plus léger. De plus, de nombreux allocataires du RMI le deviennent
après avoir épuisés leurs droits aux allocations
chômages, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas exercé
d'activité professionnelle depuis plus longtemps en moyenne que les
chômeurs, ce qui entraîne une perte de contact avec
d'éventuels employeurs. Il en résulte que les RMIstes font en
moyenne plus appel au service public de l'emploi (77,5%126(*)) qu'aux relations
personnelles (65%). Ceci est aggravé par le niveau de formation des
individus : si 76% des RMIstes ayant un diplôme supérieur au
baccalauréat font appel au réseau personnel dans leur recherche
d'emploi, ce n'est le cas que pour 61% des RMIstes sans aucun
diplôme127(*). De
plus, les plus diplômés sont aussi ceux qui diversifient le plus
les modalités de recherche d'emploi (plus de quatre modes de recherches
en moyenne pour les personnes ayant un diplôme supérieur au
baccalauréat, seulement trois pour les sans diplômes). Or,
près de 79% des RMIstes, 80% des bénéficiaires de l'ASS,
et 81% des bénéficiaires de l'API n'ont pas atteint le
baccalauréat, et respectivement 42,2%, 40,9% et 37,7% d'entre eux
déclarent n'avoir aucun diplôme128(*).
On entrevoit ici une difficulté qui s'impose aux
allocataires de transferts désireux de travailler qui est la limitation
subie du champ de recherche. Ceci est d'autant plus préoccupant que le
repli sur les services publics de l'emploi suite à une carence du
réseau relationnel a pour conséquence une diminution de la
qualité des emplois. Ainsi, plus de 70% des emplois trouvés
grâce au service public de l'emploi sont des contrats aidés ou des
stages rémunérés, contre à peu près 25% pour
les emplois trouvés de façon autonome. De même, seulement
5% des emplois trouvés par le service public sont des CDI contre 22%
pour la recherche indépendante. Cette difficulté à faire
jouer les réseaux de relations se trouve confirmée par le
ressenti des allocataires : 25% des RMIstes et 16% des allocataires de l'AAH et
de l'API disent ressentir un isolement129(*). Cette souffrance déclarée recoupe la
situation familiale effective des allocataires : 59% des allocataires du
RMI sont des hommes ou des femmes sans enfant, et 23% des femmes seules avec
enfants130(*).
Ensuite, outre son impact sur la capacité à
mobiliser une diversité de modes de recherches d'emplois, le niveau de
formation conditionne largement l'employabilité des allocataires et leur
chance de sortie de l'inactivité. Les allocataires jeunes sont
faiblement expérimentés, donc peu attractifs pour les employeurs.
Les allocataires âgés sont en décalage par rapport aux
compétence requises. Ceci est accru par l'apparition depuis les
années quatre-vingt-dix de « nouvelles normes
d'emplois 131(*)», où la sélectivité
est accrue et porte de plus en plus sur de nouveaux critères, comme par
exemple la responsabilité, le capacité d'initiative et
d'autonomie. Ce faisceau de compétences est directement issu du capital
social, du capital culturel, du niveau de formation, c'est-à-dire
d'autant de paramètres qui sont indépendant de la seule
volonté de l'individu. Et, si le besoin de formation est
avéré, y accéder est souvent difficile pour les
allocataires. Outre la démotivation, des contraintes matérielles
peuvent en effet intervenir, comme le financement de la formation, par exemple,
qui n'est pas toujours pris en charge, ou le temps long de la formation. Les
allocataires justifient leur entrée dans une assistance durable par la
difficulté d'accéder à une formation en raison d'un
découragement, d'une trop grande complexité, ou de trop faibles
rémunérations liées aux stages132(*).
La situation financière peut aussi favoriser le
maintien dans l'assistance. La recherche d'emploi repose sur la motivation mais
aussi sur les moyens disponibles pour réaliser les projets. Ainsi, de
nombreux allocataires disent nécessiter un moyen de transport133(*), ou la mise à
disposition de moyens pour la garde d'enfants134(*) (aides financières, conseils) avant de
débuter une recherche active d'emploi. On peut noter en dernier lieu que
8% des RMIstes déclarent que leurs problèmes de santé sont
à l'origine de leur maintien hors de l'emploi.
Chaque difficulté que nous venons de présenter
renforce d'autres difficultés, et éloigne un peu plus
l'allocataire de l'emploi : on a donc un processus cumulatif. Ce
processus a été mis en évidence par G.Myrdal, pour qui
« un processus social tend à prendre un caractère
cumulatif et à gagner de la vitesse à un rythme
accéléré 135(*)». La dynamique des
inégalités est alors la conséquence des interactions entre
plusieurs facteurs qui se renforcent mutuellement. La pauvreté, le
déficit de formation, la dégradation des conditions de
santé, la criminalité sont quelques-uns de ces facteurs
identifiés par Myrdal dans son étude de la situation des
afro-américains. Dans le cas des allocataires de minima sociaux, on
retrouve ce cumul : mauvaise formation, faible accès à
l'enseignement public, mauvaises conditions de santé, pauvreté,
démotivation, cassure des liens sociaux. Certes, tous les allocataires
ne relèvent pas de cette mécanique : par exemple de nombreux
jeunes sont allocataires pour un temps court, comme une transition entre deux
situations d'emplois, une « assistance
différée ». Mais, il existe d'autres postures
d'allocataires, caractérisées par S. Paugam comme une
« assistance installée » ou
« revendiquée », où la motivation au
travail est faible ou nulle, en raison des facteurs que nous avons
mentionnés plus haut, et après un temps long de maintien dans
l'assistance.
Les déterminants du retour à l'emploi pour les
allocataires de minima sociaux sont donc autrement plus complexes que
l'idée du calcul monétaire rationnel, et la redistribution n'est
donc pas la principale source de la « trappe à
inactivité ». Les allocataires du RMI s'inscrivent
majoritairement dans des démarches de recherches d'emplois, mais se
heurtent à des difficultés importantes, et font souvent l'objet
d'un cumul de problèmes qui interagissent sous la forme d'un
auto-renforcement. L'incitation monétaire au retour à l'emploi
n'impactera pas toutes ces situations où l'inactivité ne
résulte pas d'un choix rationnel et calculateur, et s'avérera
donc peu efficace.
En mettant en évidence la diversité des
incitations au travail ainsi que l'existence du phénomène
d'exclusion sociale des allocataires de minima, nous avons pu montrer que la
redistribution des revenus n'est pas nécessairement la source de la
trappe à inactivité.
III. L'allocation universelle
La proposition d'allocation universelle tranche de
façon radicale le conflit que nous avons mis en évidence entre
travail et redistribution, car elle déconnecte le travail du revenu. Ce
dernier n'est plus la récompense de l'effort fourni, mais est
versé à chacun, oisifs ou travailleurs. Les justifications de
cette mesure reposent à la fois sur des considérations
éthiques et de justice sociale qui valent pour toute
société et pour tout temps, mais aussi sur la prise en compte des
évolutions récentes de nos sociétés,
c'est-à-dire principalement la diminution du travail nécessaire,
et la prise en compte de l'activité en lieu et place du travail. Des
modèles ont émergé pour proposer des formes d'organisation
de la redistribution qui permettent de mettre en place cette allocation, et
montrent qu'une telle mesure n'est pas hors de portée.
Cependant, les effets réels de sa mise en place font
débats et ne peuvent être parfaitement anticipés. Il existe
en effet des possibilités d'effets pervers, par exemple sur les salaires
ou sur l'accès à la citoyenneté sociale. Ainsi, nous
conclurons que si l'allocation universelle peut constituer, sous certaines
formes, une avancée importante vers une résolution du conflit
entre travail et redistribution, elle reste limitée, car elle n'impacte
que les paramètres sur lesquels reposent l'hypothétique arbitrage
monétaire entre travail et loisir, et ignore les autres
déterminants de la « trappe à
inactivité » que nous avons présentés plus
haut.
A. Fondements et modalités de mise en oeuvre.
Sans omettre de présenter la diversité des
justifications possibles à l'idée d'une allocation universelle,
nous tenterons d'en donner une définition simple. Sur cette base, nous
présenterons une proposition de réforme mettant en application
cette idée, afin de montrer qu'elle n'a rien d'irréaliste.
Définition et justifications de l'allocation
universelle.
Van Parijs donne une définition claire de ce qu'est
une allocation universelle. Pour lui, c'est un transfert monétaire
versé à tous les membres d'une communauté, sans
contrepartie en travail et sans condition de ressources. Mais, il
reconnaît dans le même temps que les possibilités sont
diverses, et que le terme même d'allocation universelle peut renvoyer
à des conceptions très diverses. L'universalité ne permet
pas de caractériser suffisamment ce type d'allocation : si ce qui
est universel ne souffre aucune exception136(*), on parle souvent de suffrage universel pour
désigner un vote qui exclut un certain nombre de personnes (mineurs,
citoyens sous le coup d'une sanction ou jugés irresponsables).
Plutôt que d'universalité, il convient donc de parler
d'inconditionnalité : l'allocation universelle est en fait une
allocation versée sans condition, donc à tous. Par
conséquent, elle permet de modifier les paramètres à
partir desquels les agents maximisateurs résolvent leur programme :
le coût d'opportunité lié au loisir est fortement
réduit, au point de devenir nul dès lors que l'allocation est
d'un montant équivalent au salaire pouvant être atteint sur le
marché du travail. En d'autres termes, l'allocation dévalue le
travail. En reprenant les paramètres du modèle de T.Piketty, on
montre aisément que l'allocation universelle permet de diminuer le TMEI
qui s'applique lors du passage du non-emploi vers l'emploi. Dans le cas d'une
allocation conditionnée par l'inactivité, y1 est
égal à (w1-tw1), alors que dans le cas
d'une allocation universelle, y1 est égal à (w1
- tw1+y0). L'allocation universelle permet donc
d'accroître l'écart entre y0 et y1,
c'est-à -dire d'accroître les gains au retour à l'emploi ;
or, le TMEI est une fonction décroissante de cet écart137(*).
La légitimité d'une allocation universelle
n'est pas évidente : pourquoi, en effet, du plus riche au plus
démuni, chacun percevrait de la collectivité un même
montant ? Pourtant, de nombreux auteurs et penseurs ont pensé
trouver dans une allocation universelle une solution aux problèmes
posés par l'assistance ainsi qu'une bonne façon de mettre en
oeuvre une politique qui soit à la fois la plus juste possible et la
plus efficace. Les justifications théoriques de l'allocation universelle
sont nombreuses et trouvent leur source à la fois parmi de fervents
libéraux que parmi des penseurs d'obédience socialiste. On peut
ainsi réunir les arguments qui défendent une allocation
universelle en quatre groupes.
Premièrement, on trouve un recours à
l'environnement pour justifier l'allocation universelle. Si l'on
considère en effet l'environnement comme un propriété
collective, c'est-à-dire si chacun en est propriétaire, alors son
utilisation, les richesses qu'il recèle, doivent donner lieu à
une rétribution de tous. T. Paine émet une proposition de ce type
à la fin du XVIIIème siècle, en l'appelant
« indemnité de droit naturel », devant
être versée à tous, riches ou pauvres. Le
« socialiste utopique 138(*)» C. Fourrier reprendra cette idée,
en mettant en avant la privatisation des terres qui soustrait les richesses
naturelles aux individus. En suivant cette logique, les propriétaires
n'ont pas à recevoir l'allocation, puisqu'ils bénéficient
déjà des richesses naturelles ; la proposition de Fourrier
n'est donc qu'une forme partielle d'allocation universelle. L'État de
l'Alaska, seule communauté politique à avoir mis en oeuvre une
allocation universelle inconditionnelle, la finance grâce aux revenus
tirés de l'exploitation du pétrole, et la justifie par le partage
des richesses du sol.
Ensuite, l'allocation universelle a été
justifiée par la hausse de la productivité du travail139(*). « La fin du
travail 140(*)» annoncée, entendu comme la fin du
travail nécessaire, doit être accompagnée du versement
d'une allocation pour éviter que les chômeurs, qui se trouveront
en nombre croissant, se retrouvent exclus et mis à l'écart, dans
le dénuement. C'est donc admettre que pour satisfaire nos besoins, le
temps de travail nécessaire diminue. De là, l'allocation permet
un passage du travail jugé nécessaire, c'est-à-dire
à la fois nécessaire pour la subsistance de chacun, mais aussi
nécessaire pour la création des richesses
« suffisantes », au travail utile, c'est-à-dire un
travail non-contraint, satisfaisant à la fois pour le travailleur et
pour les bénéficiaires du fruit de ce travail141(*). L'allocation permet donc
d'accompagner le passage d'une société de plein-emploi à
une société de pleine activité.
Troisièmement vient la conception
« libérale » de l'allocation universelle. Elle se
défend alors au nom de la liberté individuelle et se substitue
à toutes autres allocations. La proposition d'impôt négatif
de M. Friedman relève de cette justification. Pour lui, il faut
substituer à l'état social une seule prestation, simple et
individuelle, afin d'en rationaliser le fonctionnement et de s'extraire des
logiques collectives. De plus, cette prestation, pour être efficace, ne
doit pas entraver le fonctionnement du marché : elle doit donc
être forfaitaire, c'est-à-dire versée à tous pour un
même montant, et le prélèvement fiscal qui la supporte doit
être proportionnel, ou linéaire, pour ne pas entraîner de
distorsions. Bien que l'allocation soit versée à tous, la
proportionnalité de l'impôt permet d'obtenir une redistribution
des richesses des plus aisés vers les plus pauvres (cf.Annexe 8).
L'allocation universelle est considérée dans ce cadre comme
l'instrument permettant de dégager la puissance publique de toutes
responsabilités à l'égard de la pauvreté et des
inégalités pouvant être générées par
le marché. En effet, dès lors que l'allocation est
instituée, il n'est plus légitime d'imposer un salaire minimum,
puisque les individus ont désormais la capacité matérielle
de refuser un contrat jugé désavantageux. L'allocation est alors
perçue comme un moyen de permettre la réalisation
d'échanges mutuellement avantageux par le contrat, dont les parties
prenantes sont réellement libres.
Pour finir, l'allocation universelle peut être
défendue par des considérations de justice sociale. Ainsi, Van
Parijs et Van der Veen vont faire appel à Marx pour justifier
l'idée d'allocation universelle. Le communisme est défini par
Marx lui-même comme l'état où chacun possède la
richesse matérielle qui correspond à son besoin : van Parij
et van der Veen identifient alors un « critère
marxien 142(*)» permettant de juger de
l'optimalité d'une redistribution des revenus. Pour eux, le
critère marxien permet de définir comme optimale une
redistribution des revenus qui maximise la part de la richesse nationale
allouée aux individus selon leurs besoins. L'allocation universelle, qui
pourrait être modulée selon une estimation faite des besoins
spécifiques de certaines catégories de population143(*) (personnes
âgées ou en situation de handicap, par exemple), est fixée
à un niveau qui permette de satisfaire, au départ, les besoins
les plus élémentaires, puis voit son niveau s'accroître
à mesure que la richesse produite s'accroît.
Outre la référence à Marx, Van Parijs
essaye de justifier l'idée d'une allocation universelle grâce
à la conception rawlsienne de l'équité et de la justice
sociale. En particulier, il se demande si une telle allocation permettrait de
satisfaire le critère du maximin élaboré par
Rawls, c'est-à-dire s'il permet de maximiser le bien-être des
individus les moins bien lotis (cf.Annexe 1). Van Parijs note, à juste
titre, que le bien-être est, chez Rawls, dépendant de la dotation
de chacun en « biens premiers », dont : le revenu et
la richesse ; les prérogatives et responsabilités des
différentes fonctions sociales ; et les bases sociales du respect
de soi-même. Si la mise en place d'une allocation universelle permet
certes d'allouer à tous un revenu, de garantir un niveau de richesse, la
situation sociale de dépendance qui en résulte interdit
l'accès à un minimum de responsabilités et de pouvoir, et
n'offre aucune prérogative au bénéficiaire. De même,
si Van Parijs note que l'inconditionnalité permet d'éviter une
sélection des allocataires et l'obligation de prouver son
dénuement, et permet donc de réunir les conditions sociales du
respect de soi-même, la dépendance et la situation
d'infériorité qui résultent de cette situation,
l'incapacité de subvenir par ses propres moyens à ses besoins,
remettent en cause l'accès au respect de soi-même. Rechercher les
fondements éthiques d'une allocation parfaitement inconditionnelle dans
le philosophie rawlsienne semble donc sujet à débat.
Une proposition d'allocation universelle.
Les cas de mise en oeuvre d'une réelle allocation
universelle sont rares. De fait, c'est la caractère universel de ce type
de subsides qui semble être le plus complexe à appliquer. Ainsi,
si l'existence de minima de subsistance est généralisée,
et en tout cas effective en France depuis 1988, ils ne s'appliquent jamais
à tous c'est-à-dire y compris aux travailleurs et sont en
général fonction du revenu du foyer. De même, des personnes
correspondant aux critères de richesses requis pour être
éligibles peuvent se voir refuser l'aide, car d'autres critères
existent, tels que l'assiduité à la recherche d'emploi et les
démonstrations de bonne volonté. Pourtant, Van Parijs et B.
Gilain ont imaginé quelles pourraient être les modalités de
mise en place d'une allocation universelle en Belgique, et on peut retirer de
cette simulation de nombreux enseignements généraux quant aux
modalités d'applications de ce type d'allocation.
Les auteurs identifient trois modes envisageables de mise en
oeuvre : la stratégie substitutive, la stratégie de Atkinson
et la stratégie additive. La stratégie substitutive consiste en
un remplacement de tous les transferts pré-existants dont le montant est
inférieur à celui de l'allocation universelle, qui sera
financée alors par un impôt sur le revenu qui exclu l'allocation.
On peut choisir, à l'inverse, d'instaurer une allocation universelle qui
s'ajoute aux transferts pré-existants, mais dont le financement devra
inclure une taxation de ces revenus de transferts. Une dernière
stratégie, présentée par A. Atkinson, se veut
intermédiaire, et propose de déduire des transferts perçus
seulement la moitié du montant de l'allocation.
Dans tous les scénarios, une allocation de 8 000
francs belges de 1992, soit l'équivalent d'un peu moins de 300 euros de
2009, est versée « de façon inconditionnelle
à tout résident permanent âgé de 18 ans au
moins. 144(*)» (on a donc une allocation qui n'est pas
universelle puisque excluant les mineurs). De même, les avantages fiscaux
et transferts (allocations familiales) reçus en raison de la
présence d'un enfant à charge de plus de 18 ans sont
supprimés, ces derniers étant bénéficiaires de
l'allocation universelle. Les avantages fiscaux liés à la famille
(quotient familial) et à la situation maritale (réduction
d'impôts pour les couples mariés ) sont supprimés :
l'allocation est versée individuellement à chaque individu, et
sans considérations du foyer. Dans le scénario substitutif, tous
les transferts inférieurs à 300 euros mensuels sont
supprimés, et les transferts restants (marge supérieure des
transferts monétaires) demeurent exonérés d'impôts.
Le financement de l'allocation peut donc être réalisé par
les économies réalisées sur les transferts (entre 20% et
36% du coût total de l'allocation universelle), les économies
réalisées sur les prestations familiales (qui représentent
4% du coût total de l'allocation) et un réajustement du
barème de l'impôt sur le revenu, tel que présenté
dans le Tableau 2.
Tableau 2: Modification du barème de
l'impôt sur le revenu proposée par Gillain et Van Parijs. Source:
Un scénario de court-terme...![]()
Le rendement de l'impôt va donc croître de
façon importante, puisque les taux d'imposition augmentent pour presque
toutes les tranches de revenu imposable (hormis pour la première
tranche, entre autres). Ce barème est calculé de telle sorte que,
compte tenu des économies réalisées sur les transferts et
prestations familiales (pris en compte ici de l'estimation haute des
économies réalisées sur les transferts monétaires),
la mise en oeuvre de l'allocation soit neutre budgétairement. Ceci se
motive pour les auteurs par le fait que la mesure ne doit pas être
financée par la dynamique économique qu'elle est susceptible
d'enclencher, donc elle ne doit pas faire l'objet d'un pari ou d'une
anticipation qui justifierait le recours à l'endettement. En terme de
prélèvements, la proposition Gillain-Van Parijs
génère une diminution de la progressivité de l'impôt
sur le revenu puisque les hausses d'impôts impactent plus fortement les
tranches basses. Par exemple, on peut comparer l'effet de la réforme sur
le montant d'impôt sur le revenu payé par une personne ayant un
revenu imposable de 300 000 francs belges et une autre personne un revenu
de 2 500 000 francs belges : le montant d'impôt
payé par la première personne est multiplié par 1,6,
contre 1,09 pour la seconde personne. Cependant, le transfert forfaitaire
représentera une part plus importante des revenus disponibles les plus
bas, et les montants d'impôts prélevés sur les hauts
revenus demeureront supérieurs au montant de l'allocation, ce qui permet
de maintenir une redistribution des plus pauvres vers les plus riches.
Comme le notent les auteurs, cette proposition d'allocation
universelle est insuffisante (son montant demeure inférieur au niveau
des minima sociaux), et ne constitue pas une proposition d'allocation
universelle optimale. Cependant, cette simulation a le mérite de montrer
qu'enclencher une réforme qui aille dans le sens de l'allocation
universelle est réaliste, et non pas hors de portée. En effet, la
stratégie à adopter consiste à « placer
délicatement, à la base du système de
sécurité sociale, un socle modeste qui permette d'amorcer une
dynamique nouvelle 145(*)», pour se substituer, à terme, aux
minima existants.
B. Effets escomptés et limites.
L'instauration d'une allocation universelle est susceptible
d'engendrer de nombreux effets et de modifier les conditions de fonctionnement
du marché du travail. L'offre et la demande de travail seront
impactées, et des effets pourront se faire sentir sur le chômage,
les salaires, et les conditions d'emplois.
L'effet de l'allocation sur les salaires est ambigu. En
effet, deux effets peuvent se contredire : d'un côté les
offreurs de travail pourront refuser des emplois peu payés, qu'ils
acceptaient auparavant, car l'allocation leur donne les moyens de subsistance
permettant de vivre sans emploi. De l'autre côté, les emplois peu
payés seront plus supportables car accompagnés du versement de
l'allocation : les individus pourront vivre convenablement en
exerçant des métiers qui ne le permettaient pas auparavant,
grâce à l'allocation, et accepteront donc plus facilement
d'exercer ce type de métier, ce qui incitera les employeurs à
baisser les salaires. Nous l'avons vu précédemment, un des effets
pervers potentiel du RSA pourrait être cette dévalorisation des
salaires et des conditions d'emplois induites par le versement d'une subvention
aux individus en emploi.
Lorsque Polanyi décrit l'expérience de
Speenhamland, il constate bien une baisse des salaires et des conditions
d'emplois. Pour lui, cette baisse du salaire n'est pas un effet
mécanique induit par l'instauration du « droit de
vivre », mais plutôt la conséquence de l'absence
d'organisation des travailleurs. En étant organisés et en
refusant les bas salaires et les mauvaises conditions d'emplois, les
travailleurs auraient pu permettre par leur action d'entraîner une hausse
des salaires et une amélioration des conditions de travail.
Curieusement, les lois interdisant l'organisation des travailleurs ont
été votées peu après l'instauration du
« droit de vivre » (en 1799, soit quatre ans plus
tard), comme le note Polanyi : si les travailleurs auraient pu
s'organiser, et exercer un droit de grève, les employeurs n'auraient pas
résisté longtemps sans pouvoir trouver de main d'oeuvre face aux
grévistes prenant le temps, n'étant pas poussé par la faim
parce que subventionnés par la paroisse. L'effet sur les salaires
dépend donc des rapports de force entre les acteurs du marché du
travail.
D'autres paramètres doivent être pris en compte
pour évaluer l'évolution des salaires conséquente à
l'instauration d'une allocation. Van Parijs affirme que le versement de cette
subvention aux travailleurs aura deux effets simultanés:
« push up the rate wage for unattractive, unrewarding work (...)
and bring down the average wage rate for attractive, intrinsically rewarding
work ». En effet, l'octroi de l'allocation modifie les
arbitrages, comme nous l'avons rappelé précédemment. Cette
phrase de Van Parijs exprime à la fois le changement dans les calculs
monétaires des agents, c'est-à-dire la baisse du coût
d'opportunité du loisir, mais aussi la modification de paramètres
plus complexes qui rentrent en compte dans les arbitrages individuels et qui
dépassent largement le cadre monétaire. La
pénibilité du travail, la satisfaction que l'on en retire sont
des éléments pris en compte dans les préférences
individuelles. Le versement de l'allocation permet de révéler ces
préférences, qui ne pouvaient pas s'exprimer auparavant, en
raison de la double liberté des travailleurs. De là, les
métiers enrichissant verront leur rétribution baisser puisque ce
n'est plus seulement le salaire mais aussi l'activité en elle-même
qui rend le travail attractif. A l'inverse, les métiers ennuyeux ou
pénibles verront leurs salaires considérablement augmenter afin
d'attirer les travailleurs. A. Smith affirmait dès 1776 que
« les salaires du travail varient suivant que l'emploi est
aisé ou pénible, propre ou malpropre, honorable ou
méprisé 146(*)», et la théorie des
différences compensatrices a repris cet argument. La cadre de
réflexion permettant d'arriver à ces conclusions est celui de la
concurrence parfaite, où les offreurs de travail sont libres d'accepter
ou de refuser un emploi selon la pénibilité qui lui est
rattachée. Or, le fonctionnement réel du capitalisme ne permet
pas de réunir ces conditions, et l'offre de travail est contrainte par
les impératifs de la vie à accepter de mauvais emplois147(*). L'allocation universelle
permet donc de réunir les conditions permettant l'émergence d'une
inégalité de salaire corrélée avec la
pénibilité du travail, et permet de rompre avec des rapports de
force déséquilibrés entre employeurs et
employés.
Outre le niveau des salaires, l'allocation universelle
modifie aussi le niveau de chômage d'une économie, et ce de
plusieurs façons. Tout d'abord par la réduction de la trappe
à inactivité, si on admet l'hypothèse d'un arbitrage entre
travail et loisir. En effet, les estimations réalisées par Van
Parijs et Gillain montrent que, dans les trois scénarios
explorés, la réduction du TMEI pour les bas revenus est
importante. Ainsi, dans le cas du scénario substitutif, la
présence du TMEI proche de 100% ne peut être
évitée : les marges de transferts conditionnels
supérieures au montant de l'allocation demeurent. Pour autant, l'ampleur
de la trappe à inactivité est fortement diminuée : le
niveau de revenu primaire à partir duquel le cumul de la perte de
transferts et des prélèvements supplémentaires permet de
voir le revenu disponible s'accroître, passe de 18 729 francs belges
à 13 194 francs pour un bénéficiaire de
l'équivalent belge du R.M.I. On sort donc plus tôt de la trappe
à inactivité. L'allocation n'étant pas imposable, le taux
d'imposition de la première tranche n'évoluant pas, de même
que les effets de seuil des minima n'étant pas supprimés, le TMEI
n'est modifié que par le montant de l'allocation, qui compense donc
partiellement les pertes de transferts induites par le changement de statut ou
la hausse du revenu d'activité. Un second effet sur le chômage
pourra passer par la hausse de la demande effective, donc de l'emploi,
générée par une redistribution en faveur des plus bas
revenus, dont la propension à consommer est la plus haute. En effet, si
l'on considère que le montant de l'allocation a vocation à
croître, selon le critère marxien, la conséquence en est
une hausse des bas revenus (l'effet est identique si une allocation d'un
montant important, supérieur aux minima pré-existants est
instituée dès le départ). L'effet sur l'emploi semble donc
être globalement favorable.
L'allocation universelle n'est pourtant pas exempte de
critiques. La principale étant qu'elle risque d'entériner des
situations d'exclusions sociales préoccupantes. En effet, soit
l'allocation universelle peut-être défendue en arguant de
l'ineffectivité de l'arbitrage monétaire entre travail et loisir
et elle permet alors d'atténuer le coût du non-emploi ; soit elle
est justifiée au nom de cet arbitrage monétaire et c'est
justement pour que cet arbitrage soit fait dans de bonnes conditions que
l'allocation est instaurée. Or, nous avons pu voir
précédemment combien les individus hors de l'emploi sont exclus
de la dynamique économique, et que le non-emploi ne relève que
rarement d'un choix. Dès lors, l'idée d'allocation universelle,
qu'elle adhère ou non à l'idée de l'arbitrage n'est
acceptable que dans la mesure où elle est liée à la mise
en place d'un accompagnement performant des sans-emplois, passant -entre
autres- par la formation et l'aide à la recherche d'emploi.
De plus, la hausse éternelle de la productivité
et l'arrivée de la fin du travail peuvent être
considérés comme utopiques. Les progrès technologiques
réalisés font miroiter en trompe-l'oeil une hausse de la
productivité, puisqu'effectivement l'utilisation de telle ou telle
machine permet de produire plus vite. Cependant, on peut penser que le travail
des hommes a toujours constitué la source de toutes richesses, et ce
aujourd'hui encore. Les gains de productivité, les progrès
technologiques, la substitution du capital au travail n'ont pas effacés
cette réalité. La tertiarisation incontestable de nos
économies ne repose que sur l'industrialisation des économies
émergentes. Chaque machine que nous produisons, censée remplir
des tâches plus efficacement que le travailleur repose sur une
quantité croissante de « travail incorporé ».
A bien des égards, la fin du travail ne semble donc pas être une
hypothèse valable, à court-terme et à mode de production
inchangé.
Pour résumer le dilemme qui est posé par
l'allocation universelle, on peut citer A.Caillé:
« effectué[e] sur un mode libéral pour signifier
aux exclus que l'on est quitte avec eux, ou fait dans la logique caritative qui
développe la passivité des bénéficiaires, [elle]
risque d'être la pire des choses. Mais [elle] peut aussi signifier un
pari de confiance de l'État et de la société
vis-à-vis des exclus, pari sur leur liberté et sur leur libre
investissement dans des activités d'intérêt
collectif ».
Le conflit entre travail et redistribution est donc
traité de deux façons par l'allocation universelle : en
modifiant les paramètres du choix entre travail et redistribution et en
se proposant de mettre en oeuvre une redistribution qui intègre
l'idée de motivations non-monétaires à l'emploi. Dans
cette seconde optique, défendre l'idée d'une allocation
universelle permet du même coup de défendre l'idée que la
redistribution n'est pas nécessairement source de désincitation
au travail. De ce fait, l'allocation universelle prend l'exact contre-pied des
dernières réformes de la fiscalité et des minima sociaux
en faisant le pari d'une conception du travail plus positive, et
libératrice.
De nombreux arguments nous montrent que la redistribution des
revenus ne doit pas être considérée automatiquement comme
la source de la « trappe à inactivité ».
Ainsi, l'histoire du travail et de la redistribution a mis en
évidence comment le conflit qui les oppose a émergé, et
comment ensuite il avait été résolu par le choix d'une
protection sociale assurantielle peu redistributive, au détriment de
l'assistance. La résolution du conflit n'est pas réelle puisque
elle passe par le refus d'une véritable redistribution verticale
forte : plutôt que de reposer sur l'idée que la
redistribution ne s'oppose pas au travail, la prééminence de
l'assurance a écarté les situations où ce conflit pouvait
potentiellement voir le jour.
Ensuite, la remise en cause de l'assurance, en raison
notamment d'une dégradation de l'emploi, marque le retour
nécessaire de l'assistance, et ouvre la voie à un renouveau de la
critique de la redistribution, trop généreuse et
désincitant au travail ses bénéficiaires, devenus
illégitimes. Mais, il faut noter que ce renouveau de l'assistance
coïncide avec le développement de l'exclusion sociale, qui concerne
de nombreux bénéficiaires de minima, et qui oblige à
repenser le conflit entre redistribution et travail : plutôt que
désincitative, la redistribution permet de protéger des individus
qui, bien que cherchant à retourner vers l'emploi, n'y parviennent pas,
et s'installent dans l'inactivité, contraints plutôt que par
choix. De même, les avantages procurés par l'emploi et le travail
permettent de penser que les inactifs ne le sont que rarement en raison d'un
calcul monétaire et rationnel.
L'allocation universelle permet de prendre acte de cette
exclusion en garantissant un niveau de revenu à tous, donc en
re-légitimant les exclus du marché du travail, principaux
bénéficiaires de la redistribution. Cette forme de redistribution
permet aussi d'intégrer l'idée d'un arbitrage monétaire
entre travail et redistribution si tant est qu'il existe ; mais plutôt
que de la concevoir comme un conflit, l'allocation y voit une
opportunité pour revaloriser le loisir, loin des réformes visant
à rendre le travail payant, et dont le fondement semble n'être que
la valeur morale attachée par certains au travail.
CONCLUSION:
Nous ne pouvons trancher de façon radicale la question
que nous nous posions concernant la conciliation entre travail et
redistribution des revenus.
D'un côté, il est indéniable que les
prélèvements portant sur les bas revenus, et que les transferts
en direction d'individus inactifs, réduisent le gain au retour à
l'emploi et donc l'incitation à travailler. On l'a vu dans le cas de la
France, les gains monétaires sont très faibles, voir nuls dans le
cas de bénéficiaires de minima sociaux reprenant un emploi. D'un
autre côté, nous avons montré que le maintien hors de
l'emploi n'est que rarement la conséquence de cet effet
désincitatif, et que d'autres paramètres jouent un rôle
important, tels que le manque de qualification, le manque de moyens, une
carence de relations sociales, et plus globalement une perte d'estime de soi et
de motivation. Ces facteurs d'inactivité sont plus complexes à
appréhender qu'un simple calcul de taux marginal ; pour les comprendre,
il est nécessaire de se pencher sur la situation réellement
vécue des allocataires, ainsi que sur leur perception de l'assistance et
de l'emploi.
Néanmoins, si les forts TMEI observés ne sont
pas la source du maintien dans l'inactivité, faire croître de
façon significative les gains au retour à l'emploi peut permettre
d'accroître la motivation à l'emploi des inactifs, et in
fine d'accroître l'emploi. Les gains à l'emploi vont donc
plutôt impacter la sortie de l'inactivité, tandis que le
« processus anonyme » de l'exclusion sociale va
jouer un rôle prépondérant dans l'ampleur de
l'inactivité subventionnée.
Cette pluralité de paramètres nous permet
d'affirmer que la redistribution n'est pas nécessairement source de
désincitation au travail, puisqu'au moins dans certains cas ce sont
d'autres paramètres qui freinent le retour à l'emploi, et puisque
nous avons montré qu'il existait des situations de retour vers l'emploi
non accompagnées de gains monétaires significatifs.
Cette conclusion, pourtant peu en phase avec les
recommandations traditionnelles de la théorie standard, repose sur des
faits empiriques et sur une tentative de compréhension des allocataires
de minima. Elle demeure malgré tout emprunte de certains partis pris,
concernant notamment la valeur attachée au travail. A l'inverse de ceux
qui s'en tiennent à la désincitation monétaire pour
expliquer le maintien dans l'inactivité, et qui doivent donc supposer
que le seul avantage offert par le travail est la rétribution
monétaire obtenue en retour, nous pensons que le travail apporte bien
plus qu'un salaire : le sentiment d'appartenance au collectif,
l'accès à des protections, la mise en oeuvre et l'acquisition
d'un savoir-faire, la reconnaissance sociale.
Cependant, dans une société où tous ces
avantages sont remis en cause, c'est-à-dire où le travail n'est
plus protecteur, où il n'est plus intéressant, où il est
rabaissant et abrutissant, alors, oui, seul le salaire est à même
d'attirer les individus au travail. Défendre la hausse des gains
monétaires au retour à l'emploi comme seul moyen
d'accroître l'offre de travail revient ainsi à entériner
cette dégradation des conditions d'emploi.
De plus, si l'on accepte l'idée que la
désincitation au travail provient de trop faibles gains au retour
à l'emploi, ce n'est pas nécessairement la redistribution qui en
est la cause. En effet, le gain au retour à l'emploi est certes
déterminé par le TMEI, mais aussi - et peut-être surtout-
par le niveau des salaires. Les réformes visant à réduire
les TMEI appliqués au retour à l'emploi (EITC, WFTC, RSA)
ignorent l'éventualité où de trop bas salaires sont
à l'origine de la faible incitation au travail. Ceci est d'autant plus
dommageable que cette stratégie risque d'inciter à la
modération salariale en subventionnant les bas salaires. A l'inverse de
ces réformes, on pourrait, en vue accroître l'incitation
monétaire au travail, contraindre les salaires à la hausse. Dans
cette optique, ce n'est plus la redistribution qui est source de
désincitation, mais bien le fonctionnement du marché du travail,
qui génère des salaires trop faibles, offre des emplois
précaires, et finit par décourager les individus au retour
à l'emploi.
Pour apporter une réponse au conflit pouvant exister
entre travail et redistribution, il faut garder à l'esprit qu'elle
semble aujourd'hui nécessaire, en raison de l'état de la
pauvreté et des inégalités, dégradé par les
évolutions récentes sur le marché du travail. Le risque
est de la délégitimer, étant considérée
comme trop généreuse et désincitative, donc inefficace,
alors qu'elle apporte des revenus, souvent vitaux, et qu'elle permet de
maintenir la cohésion sociale en atténuant, tant bien que mal,
les disparités de revenus. Les réformes visant à rendre le
travail payant s'inscrivent ainsi dans un mouvement plus vaste de mesures
visant à mettre en place des contreparties en travail aux transferts, et
à durcir les conditions d'octroi des aides. Les objectifs de la
redistribution, en termes de justice sociale et de protection contre certains
risques, sont ainsi contrebalancés par des considérations
d'efficacité économique et par des jugements moraux portant sur
le travail et l'oisiveté.
C'est d'ailleurs de cette importance des valeurs, et des
hypothèses qui en découlent, que provient la difficulté de
trancher la question de la conciliation entre travail et redistribution. Par
exemple, la théorie standard de l'impôt optimal peut servir
à la fois à justifier des hauts TMEI et des bas TMEI pour les
inactifs et les bas revenus, selon les objectifs que l'on donne à la
puissance publique, respectivement la maximisation du niveau des transferts ou
la maximisation de l'emploi. Autre illustration de l'importance des
valeurs : l'acceptation de l'idée d'arbitrage monétaire peut
mener à des stratégies visant à rendre le travail payant
si le travail est une fin en soi, ou au contraire à revaloriser le
loisir si l'on attache de l'importance à la production non-marchande et
au temps libre.
L'allocation universelle peut être
présentée comme une solution au problème de la
conciliation entre travail et redistribution qui met explicitement en avant
certaines valeurs et certains partis pris : remise en cause du travail
à tout prix, importance d'un rapport de force équilibré
entre employeurs et travailleurs, importance du loisir. L'objectif de
l'allocation universelle est ainsi de faire en sorte que le travail
salarié et le travail au sens noble du terme se confondent, en rendant
à tous la liberté de travailler à loisir, et permettre de
« faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser
le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le
soir, de faire de la critique après le repas, selon mon bon plaisir,
sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique ».
Certes, cette vision idyllique du travail
présentée par Marx ne fait pas référence
explicitement à l'allocation universelle. Cependant, elle repose elle
aussi sur une volonté de placer le travail contraint et
l'efficacité économique au service de la justice sociale et d'une
certaine vision du vivre ensemble. Sans évincer le problème de
l'efficacité économique, il faut arbitrer le conflit entre
travail et redistribution en mettant en avant des exigences éthiques et
en se posant la question de la fin que l'on poursuit : le travail doit-il
servir à produire des richesses dont nous aurions la jouissance, ou se
suffit-il à lui-même ?
A ce sujet J.M. Keynes affirmait :
« Nous avons perdu nos illusions, non pas
que nous soyons plus pauvres qu'avant [...] mais parce que les valeurs autres
qu'économiques semblent avoir été sacrifiées. En
pure perte, dans la mesure où notre système économique ne
nous permet pas de tirer le meilleur parti de la richesse autorisée par
le progrès technique, qu'il en est même loin, ce qui nous
amène à penser que nous aurions pu faire une bien meilleure
utilisation de ces possibilités inexploitées. 148(*)»
Voilà quel devrait être l'objectif de la
redistribution : profiter au mieux, et de façon partagée,
des fruits du travail.
Bibliographie:
Articles:
· Anne D., L'Horty Y., « Les
effets du Revenu de Solidarité Active sur les gains du retour à
l'emploi », Revue économique, vol. 60, 2009/3,
pp.767-776.
· Atkinson T., « On the
Mesurement of Inequality », Journal of Economic Theory,
Cambridge, 1969.
· Bonnefoy V., Buffeteau S., Cazenave M-C.
« De la prime pour l'emploi au revenu de solidarité
active : un déplacement de la cible au profit des travailleurs
pauvres », INSEE, France, portait social 2009, pp.87-106.
· Bontout O., « L'Earned
Income Tax Credit , un crédit d'impôt ciblé sur les foyers
de salariés modestes aux États-Unis »,
Économie et Statistique, n°335, 2005.
· Bourguignon F., Chiappori P.-A.,
« Fiscalité et redistribution », Revue
française d'économie, vol.13 n°1, 1998, pp.3-64.
· Burtless G., « Evaluation de
la réforme du Welfare aux Etats-Unis », Revue
française des affaires sociales, n°4, 2008., pp.193-215.
· Castel R., « La
citoyenneté sociale menacée », Cités,
n°35, 2008/3.
· Clerc D., « RSA: le diable
ou le bon dieu? Un état des lieux », L'Economie
Politique,n°43, 2009/3
· Cochard M. et al. « Les
effets incitatifs de la PPE: une évaluation difficile »,
Économie et Statistique, n° 412, 2008.
· Delarue V., « Le WFTC, un
nouveau crédit d'impôt pour les familles de travailleurs à
bas revenus au Royaume-Uni », Economie et Statistique,
n°335, 2000
· Duclos J.-Y. et al., « Une
analyse des taux marginaux effectifs d'imposition au
Québec », Revue d'analyse économique, vol.84
n°1, 2008.
· Eissa N., Liebman J.B.,
« Labor suppply response to the earned income tax
credit », The Quarterly Journal of Economics, mai 1996,
pp.605-637
· Fabre V. et Sautory O.,
« Enquête sur les expérimentations du
RSA: Premiers résultats », 2009 DREES, Document de
Travail n°87
· Fougère D., Kramarz F.
« La Mobilité Salariale en France de 1967 à
1999 ». In Rapport du CAE (Ed.), Inégalités
Économiques. 2001, pp.333-353, La Documentation
Française.
· Frobert L., Ferraton C.,
« Gunnar Myrdal, l'économie comme science morale »,
L'Économie Politique, n°20, 2003.
· Garner H., Méda D., Senik C.,
« La place du travail dans les identités »,
Économie et Statistique, n°393-394, 2006.
· Gilain B., Van Parijs P.
« Un Scénario de Court-terme et son Impact
Redistributif ». La revue du MAUSS, n°7, 1996
pp.151-157.
· Grogger J., Lynn A.K., Klerman J.A.,
« A decade of welfare reform », RAND research
brief, 2002
· Guillemot D. et al. « Trappe
à chômage ou trappe à pauvreté. Quel est le sort des
allocataires du RMI? » Revue économique , vol.55
n°6, 2002
· Hirsh M., « Une nouvelle
étape de notre histoire sociale », Partage n°203,
2008.
· Keynes, J.M., « De
l'autosuffisance nationale », L'Economie Politique
, n°31, 2006.
· Lagarenne C, Legendre N.,
« Les travailleurs pauvres en France: facteurs individuels et
familiaux », Économie et Statistique n° 335,
2000.
· Le Galès P.,
« Succès économique et limites sociales du New
Labour », Etudes n°4082, 2008.
· Lollivier S. , « La
pauvreté: définitions et mesures », Regards
croisés sur l'économie, 2008/2, n°4, pp.21-29
· Marical F., « Les
mécanismes de réduction des inégalités de revenus
en 2008 », France, portrait Social, INSEE, 2009
· Piketty T., « La
redistribution fiscale face au chômage », Revue
française d'économie, Volume 12 n°1, 1997,
pp.157-201.
· Pla A., « Conditions de vie
et accès à l'emploi des bénéficiaires de minima
sociaux »., Données Sociales: La société
française, 2006
· Pla A. « Sortie des minima
sociaux et accès à l'emploi », Études et
Résultats, n°567, 2007
· Rioux L., « Les allocataires
du RMI: une recherche d'emploi active mais qui débouche souvent sur un
emploi aidé », INSEE Première, n°720,
2000.
· Rioux L., « Recherche
d'emploi et insertion professionnelle des allocataires du RMI »,
Économie et Statistique, n°346-347, 2001.
· Rodriguez J. , « De la
charité publique à la mise au travail »,
www.laviedesidees.fr,
septembre 2008.
· Sterdyniak H., Stancanelli E.,
« Un bilan des études sur la prime pour l'emploi »,
Revue de l'OFCE, janvier 2004
· Van der Veen R., Van Parijs P.,
« A capitalist road to communism », Basic Income
Studies, vol.1 n°1, 2006. pp.1-23
· Van Parijs P.,
« Payés pour ne rien faire: simple justice ou ignominie? Les
fondements éthiques de l'allocation universelle »,
Futuribles, n°144, 1990, pp.29-42
Ouvrages:
· Alesina A., Glaeser E.L.,
Combattre les inégalités et la pauvreté: les
Etats-Unis face à l'Europe, Flammarion, 2006.
· Beveridge W., Du travail pour tous
dans une société libre, 1945, Éditions
Domat-Monchrestien.
· Bihr A., Pfefferkorn R.,
Déchiffrer les inégalités, 1999, La Découverte
· Guerrien B., Dictionnaire
d'analyse économique, 2002, La Découverte.
· Castel R., Les
métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat,
1995, Gallimard, coll. « Folio ».
· Cattacin S. et all., Retour au
travail! Le workfare comme instrument de réforme, 2002.
Éditions Universitaires de Fribourh, coll. Res Socialis,
· Gorz A., Écologie et
Politique, 1978, Éditions du Seuil.
· Hirsh M., Livre Vert. Vers un
revenu de solidarité active., La Documentation Française,
2008
· Lafargue P., La droit à la
paresse, 1996, Le Temps des Cerises.
· Marx K., Travail salarié et
capital, traduction de 1891, Université du Québéc
à Chicoutimi (UQAC), Les classiques des sciences sociales,
http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
· Méda D., Le travail, une
valeur en voie de disparition, 1995, Éditions Aubier.
· Milhaud E., Le Plan
Beveridge, 1943, Les Annales de l'Économie Collective.
· Paugam S., La disqualification
sociale: essai sur la nouvelle pauvreté, 2000, PUF, coll.
« Quadriges ».
· Paugam S. (sous la dir.),
L'exclusion, l'état des savoirs, 1996, La Découverte.
· Piketty T., L'économie des
inégalités, 2008, La Découverte, coll.
« Repères ».
· Piketty T. Les Hauts Revenus en
France au XXème siècle. Inégalités et
redistributions 1901-1998, 2001, Grasset
· Polanyi K., La grande
transformation, 2009, Gallimard.
· Purière A., Assistance
sociale et contrepartie. Actualité d'un débat ancien, 2008,
L'Harmattan
· Sen A., L'économie est une
science morale, 2003, La Découverte
· Sen A., Repenser
l'inégalité, 2000, Éditions du Seuil, coll.
« L'Histoire Immédiate ».
· Smith A., Recherches sur la nature
et les causes de la richesse des nations I, 1991, GF Flammarion,
· Van Parijs, Vanderborght Y.,
L'allocation Universelle, 2005 La Découverte, coll. Repères,
Rapports:
· Bourguignon F., Fiscalité
et redistribution, Rapport du Conseil d'Analyse Économique, 1998.
· Létard V., Rapport
d'Information, Commission des affaires sociales sur les minima sociaux,
Sénat, 2005
Annexes:
Annexe 1: Théorie de la justice et
distribution optimale des revenus.
En 1971, John Rawls, philosophe américain,
publie Théorie de la Justice, un ouvrage majeur dans la
pensée économique de l'équité et de la justice
sociale, dans lequel il va élaborer une théorie tout à
fait originale de la justice. Rawls va parvenir à conjuguer l'existence
de libertés fondamentales et de principes très forts de justice
sociale dans un état de l'économie particulier, qui
possède les caractéristiques d'un optimum de Pareto. Rawls va
imaginer une procédure d'élaboration des règles
fondamentales permettant d'atteindre un état optimal de justice sociale.
L'ensemble des agents sont placés sous un «voile d'ignorance»,
c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils seront hommes ou femmes, riches
ou pauvres, salariés ou patrons, handicapés ou bien portant,
c'est-à-dire qu'elles seront leurs fonctions et leurs statuts sociaux
dans le réel. A partir de là, l'ensemble des agents ignorants
vont chercher à établir un certain nombre de règles ou
principes qui feront l'unanimité et qui régiront le
fonctionnement de l'économie réelle, chacun sachant qu'il peut
potentiellement se trouver dans des positions sociales défavorables.
Selon Rawls ces grands principes sont au nombre de deux:
· Le principe d'égales libertés:
chaque agent a droit à un système de libertés aussi
nombreuses que la compatibilité avec le même système de
libertés pour chaque autre agent est garantie. Le nombre de
libertés garanties est donc maximum, tant qu'elles ne nuisent pas aux
libertés d'autrui.
· Le principe de différence: ce principe,
définition parfaite de l'équité, justifie l'existence
d'inégalités entre les agents, sous deux conditions:
? a: dans le respect de
l'égalité des chances, c'est-à-dire la même
possibilité pour
chaque agent d'accéder a des fonctions
et situations sociales,...
? b: ...et en faveur des individus les plus
défavorisés.
Chacune de ces règles étant
hiérarchisées dans cet ordre. Les libertés individuelles
ne peuvent être remises en cause par la nécessité de
rétablir l'égalité des chances ou de mettre en place une
redistribution des plus riches vers les plus pauvres. L'élaboration de
ces principes par les individus est guidée par leur volonté de
garantir l'accès aux «biens premiers», qui selon
Rawls regroupent l'ensemble des valeurs sociales de base. Les biens premiers,
qui dépendent de l'organisation sociale et institutionnelle de la
société, sont désirés par chaque individus sous le
voile d'ignorance et influencent leurs facultés de réalisation
des objectifs qu'ils se sont fixé: les libertés de base, de
circulation, le revenu et la richesse, les prérogatives et
responsabilités des différentes fonctions sociales et les bases
sociales du respect de soi-même.
Grâce à ces deux critères, on peut
observer quelles sont les principales critiques que Rawls adresse a la
conception utilitariste et parétienne de la distribution optimale des
revenus: critique de l'absence de prise en compte de la liberté dans
l'atteinte d'un état social optimal, et de la non-prise en compte des
particularités individuelles et des différences de dotations dans
le critère de maximisation de la somme des utilités
individuelles. L'état social qui respecte ces principes est donc
profondément équitable dans le respect le plus stricte des
libertés individuelles. De plus, Rawls va chercher a montrer en quoi cet
état social peut aussi être parfaitement efficace grâce aux
critères du maximin et du leximin.
Pour Rawls, l'état social juste sera efficace s'il est
un optimum de Pareto: il s'agit donc de trouver l'optimum qui minimise les
inégalités « subies ». Le critère du maximin
revient a maximiser l'avantage des individus se trouvant dans la position
sociale la plus favorable, et donc à opérer un choix parmi les
optimaux selon ce critère. L'état social juste est donc un
optimum de Pareto qui maximise les utilités des agents les plus mal
lotis. Ce critère comporte cependant une limite: si deux états, X
et Y, génèrent des avantages équivalents pour les
individus les plus défavorisés, et que dans le même temps
le passage de X a Y permet de faire croître l'avantage des individus les
mieux lotis, le seul critère du maximin ne permet pas d'opérer un
chois entre ces deux critères. Pourtant, Y est plus efficace au sens de
Pareto, et donc préférable. Il convient dès lors
d'employer le critère du leximin, selon lequel il faut choisir
l'état social qui donne le plus grand avantage aux individus
placés juste au dessus des plus défavorisés, et remonter
ainsi l'échelle sociale jusqu'au moment où l'état social
désigné sera celui qui donne le plus grand avantage aux
sociétaires les plus favorisés, compte tenu du fait qu'aucun
autre état ne maximise les dotations d'individus moins favorisés.
Rawls parvient grâce au voile d'ignorance,
procédure fondamentalement hypothétique, a concilier dans un
même état social équité et efficacité. Il
nous indique que la redistribution des revenus devra toujours s'attacher
à améliorer la situation des plus pauvres en priorité.
Annexe 3: Du revenu primaire brut total au revenu
disponible brut total. Source: INSEE, 2010
On voit ainsi que la part des salaires dans le
revenu disponible a crû de 10 points de pourcentages entre 1960 et 2008,
la part des revenus du capital a crû de près de 4 points, tandis
que la part des revenus des indépendants a baissée de 13 points.
Les prestations sociales représentent aujourd'hui 26,2% du revenu
primaire brut contre seulement 15,5% en 1960. De même, les cotisations
sociales et l'impôt sur le revenu ont représenté une
proportion croissante du revenu primaire sur la période. Cependant,
l'impôt sur le revenu ne représente toujours que 11,6% du revenu
primaire, contre un peu plus de 27% pour les cotisations sociales.![]()
Au final, la revenu disponible brut global représentait
95% du revenu primaire brut global en 1960, et il en représente
aujourd'hui 89%, ce qui dénote la croissance du système
redistributif.
Annexe 4: Calculs de quelques indicateurs
d'inégalités de revenus.
L'indice de Gini:
![]()
Avec X la fréquence cumulée de la population
classée par ordre de revenu croissant, pour tout individus ou groupes
d'individus (i), et Y la fréquence cumulée du revenu.
Une des limites de cet indice de concentration est de ne pas
savoir différencier deux distributions de revenus ayant le même
espacement avec la courbe de Lorenz parfaitement égalitaire, mais
n'ayant pas la même forme.
Ainsi, les deux distribution A et B pourront
générer le même indice de Gini, alors que dans la
distribution B les individus les plus pauvres sont plus riches que dans la
distribution A, et que dans la distribution B les individus les plus riches
sont plus riches que dans le distribution A. Par exemple, si on décide
de fixer un objectif « rawlsien » à la
redistribution, l'indice de Gini ne permettra pas de déterminer le
niveau d'inégalité satisfaisant qui bénéficie le
plus aux plus pauvres.
L'indice de Atkinson:
![]()
On a, pour tout agent (i), un revenu
(yi). Y désigne le revenu moyen
et N le nombre d'individus. Avec ? un paramètre positif qui
caractérise le degré d'aversion pour l'inégalité de
la population. Plus le paramètre est proche de 0, plus l'aversion pour
les inégalités est forte: on corrige artificiellement la
distribution des revenus en la rendant plus ou moins égalitaire,
grâce à ce paramètre. Ainsi, lorsque il est bas, les
inégalités de la distribution des revenus sont exacerbées:
les revenus bas par rapport au revenu moyen sont réduits, et les revenus
hauts par rapport au revenu moyen sont augmentés.
Ainsi, on voit que le distribution corrigée
(yi /Y)^(1-0,25) est plus inégalitaire que
la distribution corrigée (yi/Y)^(1-0,75).
Ceci permet de prendre en compte l'aversion pour les inégalités
qui est plus forte pour ?=0,25 que pour ?=0,75. Il faut ajouter que
l'expression ![]() croît de façon exponentielle avec
yi/Y, ce qui implique que pour un niveau
donné de ?, la correction à la baisse des bas revenus est plus
faible que la correction à la hausse des hauts revenus. Il y a donc une
sensibilité plus importante aux inégalités de revenu
générées par de très hauts revenus. croît de façon exponentielle avec
yi/Y, ce qui implique que pour un niveau
donné de ?, la correction à la baisse des bas revenus est plus
faible que la correction à la hausse des hauts revenus. Il y a donc une
sensibilité plus importante aux inégalités de revenu
générées par de très hauts revenus.![]()
Dès lors, lorsque on calcule la moyenne de ces deux
distributions, c'est-à-dire:
![]()
, on obtient une moyenne beaucoup plus élevée
pour des valeurs faibles de ? (la moyenne de la distribution (yi
/Y)^(1-0,25) sera plus élevée que la moyenne pour
la distribution (yi/Y)^(1-0,75)).
On a en outre, pour une même valeur de ?, une moyenne
plus élevée lorsque la distribution initiale y(i) est
inégalitaire par le haut (c'est-à-dire lorsque les
inégalités proviennent de hauts revenus très hauts), et on
a une moyenne plus faible lorsque la distribution initiale est
inégalitaire par le bas (bas revenus très bas). Ce calcul de
moyenne permet de prendre en compte les valeurs extrêmes de la
distribution.
Le terme ![]() est nécessairement positif
tant que ? est différent de 1, et est croissant avec la baisse de ?. est nécessairement positif
tant que ? est différent de 1, et est croissant avec la baisse de ?.
On déduit donc de l'ensemble de ces
propriété que l'indicateur d'inégalité est
croissant avec la baisse de ?. Plus l'aversion pour l'inégalité
est forte, c'est-à-dire plus ? est proche de 0, plus l'indice de
Atkinson sera proche de 1 pour une même distribution des revenus y(i).
Donc, plus la société marque une aversion forte pour
l'inégalité, plus l'indice de Atkinson sera élevé.
De plus, l'indice croît avec la hausse des inégalités pour
une même valeur de ?.
Une dernière propriété de cet indice
concerne sa réaction face à la redistribution: plus ? est bas,
plus les ponctions réalisées par le redistribution sur les hauts
revenus permettent de réduire l'indicateur d'inégalités,
alors qu'a l'inverse, plus ? est élevé (i.e. plus la
tolérance à l'égard des inégalités est
forte), moins les ponctions sur les hauts revenus réduisent l'indicateur
d'inégalités. De même, plus ? est bas, plus les transferts
octroyés aux plus pauvres (valeurs extrêmes basses de la
distribution) font baisser l'indicateur d'inégalités, et
inversement lorsque ? est élevé, où ces transferts
génèrent une diminution plus faible de l'indicateur
d'inégalités.
Annexe 7: Formalisation du TMEI, inspirée par
Duclos J-Y. et al.
On peut comprendre le Taux Marginal Effectif d'Imposition
(TMEI) grâce à une formalisation très simple. On a, avec YD
le revenu disponible, YL les revenus d'activité, YK les revenus du
capital, Ysub les revenus issus des transferts et T les impôts
payés:
![]()
On fait l'hypothèse que le montant d'impôts
payés (T) augmente avec les revenus primaires (YK + YL), et que les
montants des transferts (Ysub) diminuent avec les revenus primaires:
![]()
![]()
donc:
![]()
Le revenu primaire (YP) est composé des revenus du
capital (YK) et des revenus du travail (YL). Donc:
![]()
On obtient une fonction exprimant le revenu disponible en
fonction du revenu primaire. Ainsi, en dérivant, on exprime la variation
du revenu disponible en fonction des variations de revenus primaires:
![]()
d'où:
![]()
En sachant que le TMEI est égal à ![]() , c'est-à-dire la différence entre la hausse d'impôt
consécutive à la hausse du revenu primaire et la baisse des
transferts consécutive à cette même hausse de revenu
primaire. , c'est-à-dire la différence entre la hausse d'impôt
consécutive à la hausse du revenu primaire et la baisse des
transferts consécutive à cette même hausse de revenu
primaire.
On a: ![]()
Le TMEI est donc fonction de la relation qu'entretiennent les
revenus primaires et les revenus disponibles. Plus le rapport ![]() sera important, c'est-à-dire plus la hausse du revenu primaire
entraîne une hausse importante du revenu disponible, plus le TMEI sera
faible. A l'inverse plus la rapport sera faible, c'est-à-dire plus les
hausses de revenu primaire sont confisquées par le système fiscal
ou se traduisent par des pertes de transferts, plus le TMEI sera
élevé. La rapport sera supérieur à 1 dès
lors que la hausse de revenu primaire entraîne une hausse plus importante
du revenu disponible. Un dispositif tel que le RSA chapeau vise ainsi à
faire passer ce rapport au dessus de 1. sera important, c'est-à-dire plus la hausse du revenu primaire
entraîne une hausse importante du revenu disponible, plus le TMEI sera
faible. A l'inverse plus la rapport sera faible, c'est-à-dire plus les
hausses de revenu primaire sont confisquées par le système fiscal
ou se traduisent par des pertes de transferts, plus le TMEI sera
élevé. La rapport sera supérieur à 1 dès
lors que la hausse de revenu primaire entraîne une hausse plus importante
du revenu disponible. Un dispositif tel que le RSA chapeau vise ainsi à
faire passer ce rapport au dessus de 1.
Annexe 8: Détail des droits connexes
attribués selon le statut, avant la réforme du RSA. Source:
Rapport d'informations du Sénat, Commission des affaires sociales, Mai
2005
On peut classer en trois grands
groupes les droits connexes: les « droits connexes
légaux », les « mesures
spécifiques » et les « transferts et
avantages locaux ».
· Les droits connexes légaux:
? Les allocataires du RMI et de l'API ont droit aux aides au
logement à taux plein. De plus, pour les bénéficiaires de
l'AAH qui touchent les aides au logement, une « majoration pour
vie autonome » est automatiquement versée, d'un montant
de 95,92 euros mensuels.
? Les allocataires bénéficient de nombreux
avantages fiscaux: pour tous, exonération de CRDS ; exonération
de CSG pour tous hormis -entre autres- les bénéficiaires de l'ASS
; l'AAH et le RMI ne sont pas pris en compte dans le calcul des revenus fiscaux
pour l'IRPP et les bénéficiaires de l'API et du RMI voient leur
dette fiscale « suspendue ».
? Exonération de taxe d'habitation pour les RMIstes.
? Les bénéficiaires de l'AAH, du minimum
vieillesse et du RMI notamment, sont exonérés de redevance
audiovisuelle.
? Accès pour tous les allocataires à la
Couverture Maladie Universelle (CMU), hormis dans le cas où ils sont
déjà affiliés à un régime de
sécurité sociale par ailleurs. Accès à la CMU
complémentaire pour les RMIstes.
? Les bénéficiaires de l'ASS et de l'AER
valident des trimestres pour l'assurance vieillesse.
· Les mesures spécifiques:
? La prime de Noël, versée habituellement tous les
ans aux bénéficiaires du RMI, de l'ASS, de l'AER. Son montant
était en 2005 de 152,45 euros.
? Tarification sociale du téléphone: le RMI,
l'AAH et et l'ASS ouvrent droit à une réduction forfaitaire de
six euros sur les factures de téléphone (des réductions
sont aussi accordées pour l'électricité, mais en raison du
revenu et non pas du statut).
· Les transferts et avantages locaux:
? Ces aides et avantages sont versés par les conseils
généraux et les municipalités, et sont donc très
divers et répondent à des logiques différentes selon les
territoires. De plus, certains de ces avantages sont fonction du revenu,
d'autres du statut.
? Les aides en fonction du statut sont le plus souvent des
tarifs réduits pour l'accès à des services publics
(services municipaux...)
? On peut noter à titre d'exemple l'accès
gratuit pour tous les RMIstes aux transports en commun dans la région
Ile-de-France.
Ainsi, tous ces avantages contribuent à
accroître le coût du retour à l'emploi s'il se traduit par
un changement de statut. Le TMEI réel est donc bien plus
élevé que les estimations qui en sont traditionnellement faites
et ne prenant en compte que les transferts monétaires directes.
Annexe 9: Estimations du TMI optimal dans le cas
français par Salanié (in Salanié B. (1998).
Un Exemple de Taxation Optimale. In Rapport du CAE Fiscalité et
Redistribution ).
Salanié a estimé le terme ![]() pour la distribution des salaires bruts en France en 1998: pour la distribution des salaires bruts en France en 1998:
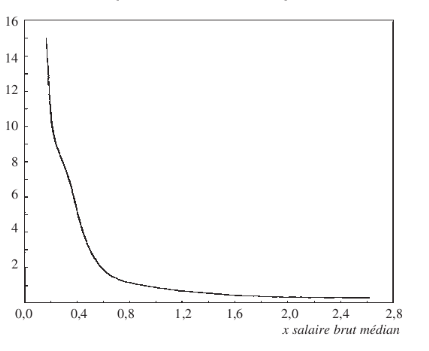 On trouve en toute logique que pour les revenus faibles, le nombre
d'individus gagnant plus est beaucoup plus élevé que la
densité d'agents concernés par ces faibles revenus, ce qui
explique que l'on ait un rapport supérieur à 14 pour les
très bas revenus. Cependant, le rapport diminue très fortement
est s'approche de 1 pour des salaires équivalents au salaire brut
médian, et de 0 pour des salaires proches de 2 fois le salaire brut
médian et supérieurs. On trouve en toute logique que pour les revenus faibles, le nombre
d'individus gagnant plus est beaucoup plus élevé que la
densité d'agents concernés par ces faibles revenus, ce qui
explique que l'on ait un rapport supérieur à 14 pour les
très bas revenus. Cependant, le rapport diminue très fortement
est s'approche de 1 pour des salaires équivalents au salaire brut
médian, et de 0 pour des salaires proches de 2 fois le salaire brut
médian et supérieurs.
En conséquence, si l'on suppose une
élasticité de l'offre de travail de 0,3 et que le gouvernement
adopte comme objectif de maximiser le transfert alloué aux
ménages les plus pauvres (objectif rawlsien), Salanié trouve une
courbe des TMI optimaux qui n'est pas convexe, et qui décroit
linéairement avec le salaire brut:
Ainsi, compte tenu de l'optimalité d'imposer les
individus de faible productivité, compte tenu de la répartition
des individus selon le salaire, et compte tenu de la présence
d'objectifs rawlsiens, le taux marginal d'imposition optimal est fortement
décroissant avec le salaire brut médian: proche de 100% pour les
revenus les plus faibles, et de 50% pour les plus élevés.
Selon Salanié, les TMI que l'on trouve effectivement en
France ne sont donc pas optimaux au moins pour les salaires les pus
élevés, qui devraient subir des TMI extrêmement faibles au
vue de son application du modèle Mirrlees-Diamond. Pour lui, seuls les
TMI proches de 1 pour les bas revenus sont donc justifiables au regard du
modèle Mirrlees-Diamond. Il conclu donc de l'absence de problèmes
liés aux hauts taux marginaux d'imposition appliqués aux bas
revenus: la faible productivité de ces individus et leur faible nombre
justifient donc que 100% de leurs revenus supplémentaires soient
taxés.
Annexe 11: L'impôt optimal sur les revenus: de
la maximisation des recettes fiscales à la maximisation de
l'emploi.
Nous reprenons ici l'analyse de la théorie de
l'impôt optimale formulée par Piketty dans son article, La
Redistribution Fiscale face au Chômage.
Les fondements de la taxation optimale: Mirrlees,
1971.
Chaque agent (i) reçoit un salaire horaire
(wi) dont le montant correspond exactement à sa
productivité. L'agent choisit son niveau d'offre de travail
(li) en vue de maximiser son utilité (U), qui
décroît avec la quantité de travail offerte et croît
avec le revenu disponible après impôts (yi). On a:
U(yi ; li)
Un taux d'imposition uniforme (t) est appliqué, et dont
le niveau est déterminé par l'Etat. L'objectif de la puissance
publique est de maximiser le niveau des recettes publiques (R), dont le montant
est égale au taux d'imposition multiplié par le revenu moyen
(ymo):
R=tymo
Les recettes fiscales servent à financer un transfert
alloué aux individus ayant une productivité nulle, donc un
salaire nul.
Le taux de salaire net est égal à:
(1-t)wi . C'est le salaire horaire, duquel est déduit
l'impôt.
Le modèle permet de voir quel est le niveau optimal de
(t). Pour cela, il convient de voir quels sont les effets d'une hausse de (t)
de d%. Tout d'abord, le taux d'imposition devient (t+dt).
En conséquence, le taux de salaire net devient
(1-t-dt)wi
On a une baisse du taux de salaire net de ![]() % %
En effet:![]()
Avec (e) l'élasticité de l'offre de travail, on
a, par définition:![]()
Donc: ![]() . Comme . Comme ![]() , la
baisse de salaire net conduit à une baisse de l'offre de travail , la
baisse de salaire net conduit à une baisse de l'offre de travail ![]() égale à égale à ![]() %. %.
La variation des recettes fiscales (äR) combine l'effet
positif dû à la hausse du taux ![]()
et l'effet négatif dû à la baisse de
l'offre d'emploi: ![]()
On a: ![]()
Le taux d'imposition optimal est celui à partir duquel
les deux effets s'égalisent: on augmente le taux tant que l'effet
positif sur les recettes est supérieur à l'effet négatif
de la désincitation à l'emploi. Au delà de t*, l'effet
négatif supplanterait l'effet positif, et les recettes fiscales
diminueraient.
Donc: ![]() lorsque lorsque ![]() ,
c'est-à-dire : ,
c'est-à-dire : ![]() . .
On obtient ![]() , avec t* le sommet de la courbe
de Laffer. , avec t* le sommet de la courbe
de Laffer.
Réinterprétation du modèle
avec une imposition non-linéaire: Diamond (1996).
Mirrlees avait déjà intégré en
1971 une pluralité de taux pour différentes catégories de
revenus; cependant, en suivant Piketty, nous en présenterons ici la
ré-interprétation faite par Diamond.
Aucun paramètre n'est modifié hormis le taux
d'imposition. On a désormais t(y) la fonction résumant tous les
prélèvements et transferts attribués aux agents en
fonction de leur revenu primaire (y).On a t(0)<0 : un impôt
négatif est versé aux agents dont les revenus d'activités
sont nuls (y=0).
On a t'(y) le taux marginal appliqué au revenu (y),
c'est-à-dire le taux prélevé sur une unité de
revenu primaire supplémentaire.
La même méthode que précédemment
est appliquée : on observe quel est l'effet d'une hausse du taux
marginal sur les recettes fiscales afin de déterminer le niveau du taux
marginal optimal. Ainsi, on suppose une hausse des taux marginaux
appliqués aux revenus compris entre y et dy :le taux marginal passe de
t'(y) à t'(y)+dt'.
Comme précédemment, l'effet est ambigüe. On
a, d'un côté, une hausse des recettes: le taux d'imposition
augmente pour tous les agents ayant un revenu supérieur à (y). En
effet, pour que le taux marginal s'accroisse pour tous les revenus compris
entre y et y+dy sans que les taux marginaux soient modifiés pour les
revenus supérieurs à y+dy, il faut accroître les taux
d'imposition appliqués à chaque niveau de revenu compris entre y
et y+dy en faisant en sorte que le hausse du taux augmente avec le revenu. Pour
que les taux marginaux appliqués aux revenus supérieurs à
y+dy n'évoluent pas, les taux d'imposition qui leurs sont
appliqués doivent tous croître dans une même proportion. On
ne prend pas ici en compte les éventuels effets revenus
générés par cette hausse des taux d'imposition sur tous
les agents ayant un revenu supérieur à y+dy.
Cette hausse des recettes est de![]() sur chaque
niveau de revenu supérieur à (y). sur chaque
niveau de revenu supérieur à (y).
La part de la population dont le revenu est supérieur
à (y) s'exprime ainsi: ![]()
Avec F(w) la fonction de répartition des taux de
salaires et wy le taux de salaire correspondant à un revenu
disponible égal à (y), la hausse globale des recettes est donc:
![]()
De l'autre côté, tous les agents situés
entre y et y+dy voient leur taux marginal augmenter, ce qui induit, pour
Piketty, que « leur taux de salaire net est passé de
(1-t')w à (1-t'-dt')w ». Cette baisse du salaire net
réduit l'incitation au travail: on a donc une baisse de l'offre de
travail qui peut impacter négativement les recettes, égale
à :![]() %, avec e l'élasticité de l'offre de
travail des individus ayant un revenu compris entre y et y+dy. %, avec e l'élasticité de l'offre de
travail des individus ayant un revenu compris entre y et y+dy.
Il en résulte une baisse des recettes fiscales
dégagées sur ce groupe de:![]() %. %.
Le nombre d'agents ayant un revenu disponible compris entre y
et y+dy s'exprime par la fonction de densité de la distribution des
salaires (la fonction de densité exprime l'intégrale de la
fonction de répartition sur un intervalle donné), soit : ![]() la densité (i.e. le nombre d'agents) pour des taux de
salaires compris entre wy et wy+dw, correspondants
à l'intervalle de revenu disponible (y ; y +dy). la densité (i.e. le nombre d'agents) pour des taux de
salaires compris entre wy et wy+dw, correspondants
à l'intervalle de revenu disponible (y ; y +dy).
On a une baisse globale des recettes de : ![]()
L'évolution globale des recettes fiscales est ainsi:
![]()
On maximise les recettes fiscales lorsque on atteint le taux
marginal d'imposition qui ne génère plus de hausse de recettes
(c'est-à-dire avant qu'il génère une baisse de recettes),
c'est-à-dire pour dR=0
On obtient alors:
![]()
De la maximisation des recettes fiscales à
la maximisation de l'emploi: Piketty (1997).
Piketty fait l'hypothèse que les agents ne font pas
faire varier leur quantité de travail offerte (les heures de travail
offertes par un individu n'évoluent pas en fonction de l'imposition),
mais plutôt « la quantité d'effort et
d'investissement personnel pour trouver un emploi ou pour être promu
à un taux de salaire plus élevé ». Par
souci de simplicité, on distingue trois groupes de revenus, dont les
caractéristiques peuvent être résumées dans le
tableau suivant:
|
Sans-emplois
|
Bas-salaires
|
Haut-salaires
|
|
Niveaux de salaires
|
|
W1
|
W2
|
|
Revenus disponibles
(y compris prélèvements et
transferts).
|
y0
|
y1
|
y2
|
|
Nombre d'agents
|
m0
|
m1
|
m2
|
|
Taux moyen de prélèvement.
|
|
|
|
|
TMEI appliqués:
(la formule est celle présentée Chap.I
Part.III)
|
Pour le passage du non-emploi vers
l'emploi:
![]()
|
Pour le passage des bas salaires aux hauts
salaires:
![]()
|
|
On peut dès lors exprimer le revenu disponible des bas
salaires (y1), qui est égal au revenu disponible des
sans-emplois (le transfert y0) auquel on ajoute le salaire
w1 diminué du TMEI:
![]()
De même pour le revenu disponible des hauts salaires:
![]()
Les recettes fiscales (R ) sont définies par ![]()
On défini e0 l'élasticité de
la probabilité de transition entre le non-emploi et l'emploi à
bas salaires par rapport à l'écart y1-y0 :
lorsque y1-y0 augmente de 1% « alors une
proportion e0% supplémentaire de chômeurs trouvent un
emploi à bas salaires ».
Comme précédemment on cherche à
déterminer les taux marginaux effectifs d'imposition optimaux, ici
T0* et T1*.
Une hausse de T0 jusqu'à
T0+dT0 entraine une hausse des recettes fiscales de:
![]()
Avec ![]() les recettes nouvelles correspondant
aux impôts payés par tous les salariés sur leur fraction de
salaire brut inférieure à w1, et les recettes nouvelles correspondant
aux impôts payés par tous les salariés sur leur fraction de
salaire brut inférieure à w1, et ![]() la
perte de recettes dû à la baisse de l'emploi à bas salaire
(dm1) consécutive à la désincitation au
travail, accrût par la hausse de T0. la
perte de recettes dû à la baisse de l'emploi à bas salaire
(dm1) consécutive à la désincitation au
travail, accrût par la hausse de T0.
En effet, le hausse de T0 entraîne une baisse
de y1-y0 de ![]() %. Le nombre de personnes
demeurant inactives va augmenter de %. Le nombre de personnes
demeurant inactives va augmenter de ![]() personnes. Au final, la
baisse du nombre d'employés à bas salaires est égale
à: personnes. Au final, la
baisse du nombre d'employés à bas salaires est égale
à:
![]()
On remplace dm1 par son expression, et on obtient:
![]()
Et, pour dR=0, c'est-à-dire si l'on vise à
maximiser les recettes fiscales:
![]()
En suivant la même logique, on obtient pour la
transition des emplois à bas salaires vers les emplois à hauts
salaires un taux marginal effectif d'imposition optimal de:
![]()
Annexe 15: Représentation graphique de
l'impôt négatif
Un impôt négatif peut s'avérer identique,
d'un point de vue redistributif, au versement d'une allocation universelle
financée par un impôt proportionnel.
Voici l'effet redistributif d'une telle allocation:
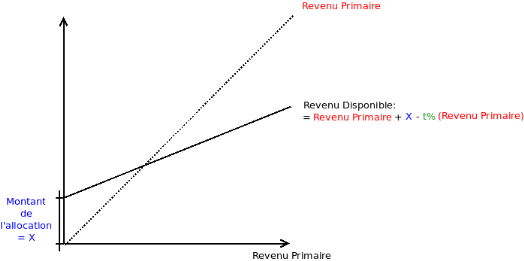
Et voici l'effet redistributif d'un impôt
négatif::
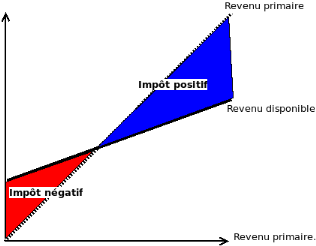
Annexe 16: principaux éléments du système
redistributif français:
Les prélèvements:
· Principaux impôts directs:
· Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques (IRPP): ![]()
Voici le barème de l'IRPP pour l'imposition 2010 des
revenus de 2009. Le calcul du revenu imposable est obtenu en déduisant
du Revenu Brut Global (grosso modo les revenus primaires) les charges
déductibles et les abattements, et après mise en rapport avec la
quotient familial (revenu imposable du foyer fiscal divisé par le nombre
de parts du foyer).
En 2008, l'IRPP a permis de dégager 51740 millions
d'euros de recette nette. 44,6% des foyers fiscaux sont non-imposables.
· Contribution Social
Généralisée: impôt sur les revenus
prélevé à la source. Le taux de prélèvement
oscille entre 7,5% pour les revenus d'activités et 8,2% pour les revenus
du patrimoine et de placements. Elle a permi de dégager 76,3 milliards
d'euros de recette, ce qui est largement supérieur à l'IRPP.
· Contribution pour le Remboursent de la Dette Sociale
(CRDS): impôt prélevé à la source sur les
revenus d'activités, du patrimoine et de remplacements. Taux de 0,5%
appliqué aux revenus brutes.
· Taxe d'habitation: payée par toutes
personnes physiques ayant la jouissance privative d'un logement. Les RMIstes en
sont exonérés.
· Cotisations sociales :
· Fonctions des salaires, elles sont imputées aux
employeurs, aux salariés et aux indépendants; Elles sont
déduites du salaire versé par l'employeur qui a à sa
charge leur versement aux différentes caisses de sécurité
sociale (URSSAF, UNEDIC...). Le taux effectif de cotisations sociales
employeurs était de 26,5% en 2007, et de 14,71% pour les salariés
(y compris la CSG et la CRDS).
Les transferts monétaires:
· Transferts sans condition de ressource:
· Allocations familiales: versées à
tous les foyers à partir du deuxième enfant à charge. On
dénombrait en 2002 près de 4 millions d'allocataires.
· Les prestations d'assurances sociales:
protection contre le risque maladie, assurance retraite, assurance
chômage.
· Transferts sous condition de ressource:
· Allocation de rentrée scolaire.
· Aides au logement: Allocations de Logements
à caractère familial (environ un million d'allocataires),
Allocation Personnalisé au logement (APL) (2,6 millions d'allocataires),
Allocation de logement à caractère social, 2 millions
d'allocataires).
· Les neufs minima sociaux pré-existants au
RSA:
· L'Allocation aux Adultes Handicapés
(AAH), versée aux adultes handicapés ne bénéficiant
pas d'une rente consécutive à un accident du travail. Allocation
différentielle, dont le montant maximum atteint 696,63 euros pour une
personne seule.
· L'Allocation de Parent isolé (API),
versée aux adultes seuls ayant au moins un enfant à charge et aux
femmes enceintes isolées. Allocation différentielle, dont le
montant maximal était en 2005 de 778 euros pour un ménage avec
un enfant à charge.
· L'Allocation Temporaire d'Attente (ATA),
allocation forfaitaire versée à certaines catégories
de population en attente d'insertion (notamment les demandeurs d'asile et les
anciens prisonniers), et pouvant justifier d'un revenu inférieur au RMI.
Montant: 10,67 euros par jour.
· L'Allocation Equivalent Retraite,(AER)
versée aux personnes ayant cotisés au moins 161 trimestres mais
n'ayant pas atteint 60 ans (n'ayant donc pas droit à la retraite). Les
allocataires doivent prouver un revenu inférieur à 1570€
pour une personne seule. Montant forfaitaire de 32€ par jour pour une
personne seule.
· L'Allocation de Solidarité
Spécifique (ASS), versée aux personnes en recherche d'emploi
pouvant justifier de revenus inférieurs à 605,6 euros par mois
pour une personne seule pour une allocation à taux plein. Montant
forfaitaire: 15,14€/ jour (le montant décroit par pallier en
fonction des ressources).
· Le Revenu Minimum d'Insertion, (RMI), allocation
différentielle versée à tous les résidents en
France de plus de 25 ans, et dont le montant maximal était en 2009 de
454,63€.
· L'Allocation supplémentaire
d'Invalidité (ASI), pour les moins de soixante ans percevant une
trop faible pension d'invalidité.
· L'Allocation Supplémentaire Vieillesse
(ASV) pour les plus de soixante-cinq ans ne disposant pas de droits suffisants
à l'assurance vieillesse.
· L'Allocation veuvage, pour « les
conjoints d'assurés sociaux
décédés ».
Les minima ne sont plus que huit aujourd'hui, le RSA (cf.
Chap.II Part.III) s'étant substitué au RMI et à l'API. On
voit que la plupart de ces transferts non-contributifs sont institués
pour pallier une insuffisance du système d'assurances sociales
(allocations chômage insuffisantes ou épuisées pour l'ASS
et le RMI dans une moindre mesure, protection contre le risque maladie
insuffisante pour l'ASI ou pour l'AAH, assurances retraite défaillantes
dans le cas de l'ASV ou de l'AER ...)
Résumé:
Nous nous sommes attachés tout au long de notre
mémoire à comprendre quels étaient les modalités de
conciliation entre travail et redistribution, compte tenu tout d'abord de
l'effet désincitatif de la redistribution, mais prenant aussi en compte
les impératifs éthiques qui justifient que les revenus soient
taxés et que des transferts soient octroyés. En effet, nous avons
pu voir que les inégalités et la pauvreté seraient
extrêmement importants sans l'intervention redistributive de
l'État.
Plus précisément, nous avons cherché
à savoir si, nécessairement, la redistribution désincite
les agents inactifs à retourner vers l'emploi. Or, il apparaît que
si cet effet existe et ne peut être ignoré, nous devons prendre en
compte d'autres déterminants du maintien hors de l'emploi.
Les récentes réformes visant à rendre le
travail payant adhèrent à cette vision d'une redistribution
nécessairement désincitative, que nous remettons en cause. Nous
nous sommes donc attachés à montrer que d'autres pistes
étaient envisageables pour concilier au mieux travail et redistribution,
mais que des choix devaient alors être faits, en terme de valeur
attribué au travail et à la redistribution, et en termes
d'hypothèses concernant les comportements des agents.
Notre travail repose essentiellement sur une recherche
d'informations, de données chiffrées, d'idées et
d'analyses, provenant à la fois d'articles et d'ouvrages de recherche,
mais aussi d'essais ou de textes mettant en avant des partis pris.
Mots clé:
Pauvreté et Inégalités ; Redistribution ;
Offre de travail ; Incitation monétaire ; Exclusion sociale.
* 1 Godefroy P., et al.,
Inégalités de niveaux de vie et pauvreté, INSEE, Avril
2010.
* 2 La différence entre revenu
moyen et revenu médian est importante. En effet, évaluer le taux
de pauvreté par rapport au revenu moyen revient à intégrer
dans l'appréciation de la norme des valeurs extrêmes. Si une
poignée d'individus touche des revenus extrêmement
élevés, sans commune mesure avec le reste de la distribution des
revenus, la moyenne va s''élever fortement, et si tant est que le seuil
de pauvreté prenne appui sur elle, un nombre fortement croissant
d'individus seront considérés comme pauvres. Ceci pose la
question de la fixation d'une norme sociale.
* 3 Le revenu disponible comprenant les
revenus primaires et les prestations sociales, dont on déduit les quatre
impôts directs (impôt sur le revenu, CSG, CRDS, taxe d'habitation).
cf.Annexe 9
* 4 Marx K.,
Travail salarié et capital, traduction de 1891, UQAC,
Les classiques des sciences sociales,
http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm, p.31
* 5 Ainsi, Marx, pour parler de la
tendance du capitalisme à la paupérisation, utilisera le terme
allemand « verelendung », signifiant en
français « paupérisation absolue »,
ou « immisération », c'est-à-dire la
croissance de la misère. Marx fustige donc une augmentation de
l'indigence, de la pauvreté en termes réels. In Gorz A.,
Écologie et Politique, 1978, Éditions du Seuil..
* 6 Gorz A. Écologie et
Politique , op.cit.
* 7 Sen A.,
Repenser l'inégalité, 2000, Éditions du Seuil,
coll. « L'Histoire Immédiate ». p.154
* 8 Ceci d'autant plus si l'on se fixe
des objectifs rawlsiens, c'est-à-dire lorsque les
inégalités entre les agents face à la redistribution
bénéficient aux individus les plus pauvres (Cf. Annexe 1).
* 9 Sen aboutit à une estimation
de la pauvreté monétaire prenant en compte à la fois le
dénombrement, l'income gap et l'inégalité parmi
les pauvres. Selon lui, un bon indicateur de pauvreté pourrait
résulter de cette formule:
![]()
On estime la pauvreté (P) avec le taux de
pauvreté (H), l'input gap (I), et l'indice de Gini (G) des personnes
vivant sous le seuil de pauvreté.
* 10 Au sens que lui donne A.Sen. La
liberté positive représente alors « ce qu'une
personne, toutes choses prises en compte est capable, ou incapable
d'accomplir » In Sen A., L'économie
est une science morale, 2003, La Découverte p.48. Un individu sans
ressources, en raison par exemple d'une grave famine, ne pourra pas nourrir sa
famille. Il a le droit de travailler, de gagner de l'argent mais ne le peut
pas. Son incapacité effective à nourrir sa famille constitue une
privation de liberté positive. Marx avait déjà
pointé cette distinction pouvant exister entre liberté juridique
et effective. Le salarié est doublement libre, disait-il, non sans
être dupe de l'effectivité de cette liberté.
* 11 Pour autant, les débats
à ce sujet sont complexes, et ne peuvent être tranchés de
façon aussi arbitraire, hormis par commodité.
* 12 Atkinson T., On the Mesurement
of Inequality, Journal of Economic Theory, Cambridge, 1969. cf. p.255
* 13 Ibid. p.245
* 14 In Castel R., Les
métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat,
1995, Gallimard, coll. « Folio ».
* 15 In Bihr A.,Pfefferkorn R.,
Déchiffrer les inégalités, 1999, La
Découverte
* 16 Fougère D., Kramarz F. La
Mobilité Salariale en France de 1967 à 1999. In Rapport du CAE
(Ed.), Inégalités Économiques. 2001, pp.333-353,
La Documentation Française.
* 17 En 1984, le revenu moyen est
supérieur de 2100 euros au revenu médian (euros courants). En
2006, cet écart atteint 4300 euros. Source: INSEE, 2010.
* 18 Piketty T. Les Hauts Revenus
en France au XXème siècle. Inégalités et
redistributions 1901-1998, 2001, Grasset. p.94
* 19 Ibid.
* 20 On désigne par fractile
P90-99, les foyers fiscaux faisant partie des 10% les plus riches, mais ne
faisant pas partie des 1% les plus riches. Le fractile P99-99,9 désigne
les 1% des revenus les plus riches à l'exclusion des 0,1%
supérieurs.
* 21 Piketty T. Les Hauts Revenus
en France au XXème siècle, op.cit. p.100
* 22 Clerc D., La France des
travailleurs pauvres, 2008, Grasset.
* 23 Clerc D. La
Paupérisation des Français, 2010, Armand Colin.
* 24 Clerc D., La France des
travailleurs pauvres, op.cit.
* 25 In Lagarenne C, Legendre N.,
« Les travailleurs pauvres en France: facteurs individuels et
familiaux », Économie et Statistique n° 335,
2000.
* 26 Au sens de l'INSEE,
c'est-à-dire ayant travaillé au moins six mois au cours des douze
derniers mois.
* 27 Chiffres issus de l'Observatoire
des Inégalités, à la page:
http://www.inegalites.fr/spip.php?article905&var_recherche=travailleurs%20pauvres&id_mot=76
* 28 Marical F., « Les
mécanismes de réduction des inégalités de revenus
en 2008 », France, portrait Social, INSEE, 2009
* 29 Bourguignon F.,
Fiscalité et redistribution, Rapport du Conseil d'Analyse
Économique, 1998. p.38
* 30 Le revenu net est, pour l'INSEE,
le revenu « effectivement perçu »,
c'est-à-dire le revenu « super-brut » diminué
des cotisations sociales et des contributions sociales (CSG et CRDS)
* 31 Seuls cinq pays de l'OCDE
réalisent une baisse de l'indice de Gini plus importante grâce
à la redistribution : la Suède ( baisse de 46% de l'indice
de Gini), le Danemark (-45%), la Belgique (-44%), la République
Tchèque et le Luxembourg (-42%).
* 32 Piketty T., « La
redistribution fiscale face au chômage », Revue
française d'économie, Volume 12 n°1, 1997
* 33 Piketty T., L'économie
des inégalités, Repères, La Découverte, 2008,
p.99
* 34 c'est-à-dire si la valeur
actualisée des pensions de retraites perçues est égale aux
cotisations versées.
* 35 Bourguignon F., Fiscalité
et redistribution , op.cit. p.40
* 36 Dans ce modèle les agents
prennent en compte le salaire net, c'est-à-dire le taux de salaire net
d'impôt.
* 37 Piketty T., « La
redistribution fiscale face au chômage », op.cit.
* 38 f(y) désignant la
densité des individus ayant un revenu de y (cf.Annexe 7)
* 39 1-F(y) désignant le nombre
d'agent ayant un revenu supérieur à y (cf.Annexe 7)
* 40 En se rappelant l'hypothèse
faite par Mirrlees d'une équivalence entre niveau de salaire et
productivité du travailleur, imposer un taux marginal important aux bas
revenus permet de faire peser le financement du budget de l'État sur les
individus les moins productifs. Il est moins coûteux de décourager
le travail faiblement productif que le travail très productif.
* 41 Piketty T., « La
redistribution fiscale face au chômage », op.cit.
* 42 On entend par « marge
intensive » le nombre d'heures de travail offertes et la motivation
à l'emploi. La « marge extensive » de l'offre de
travail désigne quant à elle le choix binaire de travailler ou de
ne pas travailler.
* 43 Ceci correspond à la
formule du TMEI présentée Chapitre I partie III.
* 44 Avec e0 =
e1,, et si l'on suppose une fonction de répartition des
salaires suivant une loi normale, on a :
[m0e0 /
(m1+m2)] < [m1e1 /
m2]
Donc, T0* est bien supérieur à
T1*.
* 45 Piketty T., « La
redistribution fiscale face au chômage », op.cit. p.181
* 46 On peut cependant en douter :
ces études reposent principalement sur l'analyse de l'offre de travail
des femmes, qui est généralement plus forte que
l'élasticité des hommes. Il faudrait donc envisager des
élasticités plus faibles.
* 47 Alesina A., Glaeser E.L.,
Combattre les inégalités et la pauvreté: les
Etats-Unis face à l'Europe, Flammarion, 2006.
* 48 Grogger J., Lynn A.K., Klerman
J.A., « A decade of welfare reform », RAND research
brief, 2002
* 49 Pour eux, l'effet sur la
diminution du recours à l'aide sociale est très fort dans le cas
où le travail est obligatoire pour toucher l'aide, et l'effet est
important dans le cas de sanctions lors du non-respect des contraintes de
recherches d'emploi et d'insertion, la fixation d'une limite maximum de temps
durant lequel l'aide sera versée, et la combinaison d'incitations
financières au travail faibles et d'une obligation de travailler.
* 50 Burtless G.,
« Evaluation de la réforme du Welfare aux
Etats-Unis », Revue française des affaires sociales,
n°4, 2008., pp.193-215.
* 51 Mesuré aux USA en termes
absolus [cf. Partie I Chapitre I]
* 52 Bontout O.,
« L'Earned Income Tax Credit , un crédit
d'impôt ciblé sur les foyers de salariés modestes aux
États-Unis », Économie et Statistique,
n°335, 2005.
* 53 La théorie du marché
du travail néo-classique formule l'hypothèse de
substituabilité brute de l'offre de travail,
c'est-à-dire une prééminence permanente de l'effet
substitution sur l'effet revenu. En prenant en compte l'effet substitution et
l'effet revenu, la courbe d'offre de travail ne serait pas toujours croissante
avec le salaire, et il y aurait donc la possibilité d'équilibres
multiples. Le théorème de Sonnenschein permet de montrer que les
fonctions d'offre et de demande dans un contexte de concurrence pure et
parfaite ont une forme quelconque, obligeant la théorie standard a
formuler une hypothèse hasardeuse pour sauvegarder les conclusions du
modèles.
* 54 Nous résonnons à ce
stade sur l'EITC pris isolément, c'est pourquoi nous parlons du TMI et
non pas du TMEI.
* 55 Bontout O.,
« L'Earned Income Tax Credit , un crédit
d'impôt ciblé sur les foyers de salariés modestes aux
États-Unis », op.cit.
* 56 Eissa N., Liebman J.B.,
« Labor suppply response to the earned income tax credit »,
The Quarterly Journal of Economics, mai 1996, pp.605-637
* 57 Le Galès P.,
« Succès économique et limites sociales du New
Labour », Etudes n°4082, 2008.
* 58 Cattacin S. et all.,
Retour au travail! Le workfare comme instrument de
réforme, 2002.Editions Universitaires de Fribourh, coll. Res
Socialis,
* 59 Ibid.
* 60 Notamment l'allocation logement et
l'allocation pour les taxes locales, qui peuvent être cumulées
durant quatre semaines avec le salaire. Source: Missoc
* 61 Delarue V., « Le WFTC,
un nouveau crédit d'impôt pour les familles de travailleurs
à bas revenus au Royaume-Uni », Economie et
Statistique, n°335, 2000
* 62 Étude de Blundell et al.,
Cité par Cochard M. et al. « Les effets incitatifs de la PPE:
une évaluation difficile », Economie et Statistique,
n° 412, 2008.
* 63 Le cumul intégral
intervient durant les deux premières Déclarations Trimestrielles
de Ressources (DTR) après la reprise d'activités. Les DTR devant
s'effectuer tous les trois mois, le cumul intégral est compris entre
trois mois et six mois.
* 64 Piketty T.,
« L'impôt négatif est né »,
Libération, Janvier 2001.
* 65 L'objectif est d'inciter à
reprendre un emploi. Les temps partiels n'apportant un gain à la reprise
d'activité que très faible, voir nul compte tenu du TMEI, le PPE
vise à les favoriser.
* 66 Tandis que 2,1 milliards d'euros
étaient versés en 2002, le montant atteint 4,5 milliards d'euros
en 2008
* 67 Étude de Bargain et Terraz
de 2002 basée sur un modèle de micro-simulation; citée in
Sterdyniak H., Stancanelli E., « Un bilan des études sur la
prime pour l'emploi », Revue de l'OFCE, janvier 2004
* 68 Ibid.
* 69 Seules 220 000 personnes sont
sorties de la pauvreté grâce à la PPE en 2002.
* 70 Suite à l'adoption de la
loi le 1er décembre 2008.
* 71 Hirsh
M., Livre Vert. Vers un revenu de solidarité
active., La Documentation Française, 2008
* 72 Loi n° 2008-1249 du 1er
décembre 2008, Article 1
* 73 Dans le cas d'un ménage
comportant un ou plusieurs enfants à charge, il aurait fallu
déduire aussi les allocations familiales.
* 74 Le RSA s'annule à partir
d'un salaire net de 1210,5 euros, pour une personne seule.
* 75 En particulier si
l'allocataire-demandeur d'emploi refuse deux offres d'emplois jugées
« raisonnables ».
* 76 Certes, comme le note D.Clerc
l'allocataire peut « faire connaître ses
observations » en cas de suspension. Mais quelles observations seront
jugées valables en cas de refus consécutifs d'offres d'emplois
jugées personnellement insatisfaisante ? In Clerc D.,
« RSA: le diable ou le bon dieu ? Un état des
lieux », L'Economie Politique,n°43, 2009/3
* 77 Martin Hirsh, « Une
nouvelle étape de notre histoire sociale », Partage
n°203
* 78 J.Gadrey, Partage n°203
* 79 In Clerc D.,
« RSA : le diable ou le bon dieu ? Un état
des lieux », op.cit.
* 80 Cité par J.Gadrey,
op.cit.
* 81 Reproduit in Partage n°205
* 82 Anne D., L'Horty Y.,
« Les effets du Revenu de Solidarité Active sur les gains du
retour à l'emploi », Revue économique, vol.
60, 2009/3, pp.767-776.
* 83 La durée de
réservation se définissant comme le temps de travail hebdomadaire
payé au SMIC qui permet d'obtenir un revenu supérieur au revenu
qui serait obtenu en restant inactif.
* 84 DREES, Document de Travail,
n°87, Avril 2009.
* 85 Infrastructure au sens marxiste du
terme, c'est-à-dire désignant l'état des forces
productives et des rapports de production.
* 86 Citation de Leclerc de Montlinot,
cité in Castel R., Les métamorphose de la question
sociale, op.cit. p.284
* 87 A propos de la liberté du
travail, la quatrième rapport du Comité pour l'extinction de la
mendicité de l'assemblée constituante s'exprime ainsi :
« c'est par elle seule que le travail se distribue naturellement
dans les lieux où les besoins l'appellent, que l'industrie reçoit
son plus grand encouragement, que toutes les entreprises deviennent faciles, et
qu'enfin le niveau de la main d'oeuvre, condition si désirable pour la
prospérité de l'État, s'établit dans toutes les
patries de l'empire ». In Castel R., Les
métamorphoses de la question sociale, op.cit. p.300
* 88 A. Hirshman, cité in
Méda D., Le travail, une valeur en voie de disparition, 1995,
Éditions Aubier. p.75
* 89 Polanyi K., La grande
transformation, 2009, Gallimard.
* 90 Le système de Speenhamland
était caractérisé par un barème indexé sur
le prix du pain. Lorsque le prix d'une miche de pain
« coûtera un shilling, alors chaque pauvre et industrieuse
personne aura pour son soutien trois shillings par semaine [...] et pour le
soutien de son épouse et de chaque membre de sa famille un shilling et
six pence ». Recommandation des juges réunis à
Speenhamland en 1795 et instituant le « droit à la
vie ». Cité in Polanyi K., La grande transformation,
op.cit., p.129
* 91 In Rodriguez J. , « De
la charité publique à la mise au travail »,
www.laviedesidees.fr,
septembre 2008.
* 92 Polanyi K., La grande
transformation, 2009, Gallimard. p.131
* 93 Citation de Mackay T., marchand et
penseur libéral anglais à propos de la fin de Speenhamland. In
Rodriguez J. , « De la charité publique à la mise au
travail », op.cit.
* 94 Cité in Méda D.,
Le travail, une valeur en voie de disparition, op.cit. p.73
* 95 Cité in Castel R., Les
métamorphoses de la question sociale, op.cit p.296
* 96 DDHC de 1793, article 21
* 97 DDHC 1791, article 13.
* 98 Cité in Purière
A., Assistance sociale et contrepartie. Actualité
d'un débat ancien, 2008, L'Harmattan
* 99 Le taux de chômage en 1975,
au début de la « crise » (chocs pétroliers,
stagflation...) était de 3,5%.
* 100 Cité in Purière
A., Assistance sociale et contrepartie. Actualité
d'un débat ancien, op.cit.
* 101 Ceci est un des
éléments caractérisant le fordisme selon R. Boyer.
Cité in Guerrien B., Dictionnaire d'analyse économique, La
Découverte, 2002.
* 102 Préambule de la
constitution de 1946
* 103 Préambule de la
constitution de 1946
* 104 « Chacun a le
droit de travailler et d'obtenir un emploi », Préambule
de la constitution de 1946.
* 105 Milhaud E., Le Plan
Beveridge, 1943, Les Annales de l'Économie Collective.
* 106 Beveridge W.,
Du travail pour tous dans une société libre,
1945, Éditions Domat-Monchrestien.
* 107 Il cite notamment un article
paru dans la presse anglaise en 1943: « beaucoup de plans
modernes -y compris le plan Beveridge- n'ont-ils pas tendance à
négliger le fait [...] que les travailleurs de l'avenir [...] auront
besoin du vieil aiguillon de la récompense et de la punition [...] pour
soutenir la course qu'il faut effectuer dans ce monde de
concurrence ». Beveridge W., Du travail
pour tous dans une société libre, op.cit. p.210
* 108 ibid
* 109 Castel R., Les
métamorphoses de la question sociale, op.cit.
* 110 La loi du 1er décembre
1988 relative au Revenu Minimum d'Insertion affirme ainsi:
« L'insertion sociale et professionnelle des personnes en
difficulté constitue un impératif national. »
* 111 Ibid.
* 112 Proposition formulée par
le Président N. Sarkozy en 2009
* 113 Guillemot D., et al.
« Trappe à chômage ou trappe à pauvreté.
Quel est le sort des allocataires du RMI ? » Revue
économique , vol.55 n°6, 2002
* 114 In Garner H., Méda D.,
Senik C., « La place du travail dans les
identités », op.cit.
* 115 Bien entendu, l'apprentissage
des codes qui permettent de faire société peut se faire ailleurs
que dans le travail, tout comme l'élargissement du champ relationnel.
Mais dans notre société salariale, le travail reste crucial.
* 116 Lafargue P., La droit
à la paresse, 1996, Le Temps des Cerises. p.40
* 117 Étude de Jahosa,
Lazarfeld et Zeisel, citée in Garner H., Méda D., Senik C.,
« La place du travail dans les identités »,
op.cit.
* 118 L'autre composante étant
la citoyenneté politique, c'est-à-dire la citoyenneté
telle qu'on l'entend habituellement, et qui est représentée par
le droit de vote.
* 119 Castel R., « La
citoyenneté sociale menacée », Cités,
n°35, 2008/3.
* 120 Castel R., « La
citoyenneté sociale menacée », op.cit.
* 121 Ibid.
* 122 Rioux L., « Les
allocataires du RMI: une recherche d'emploi active mais qui débouche
souvent sur un emploi aidé », INSEE Première,
n°720, 2000.
* 123 Pla A., « Conditions
de vie et accès à l'emploi des bénéficiaires de
minima sociaux »., Données Sociales : La
société française, 2006. A noter que ce chiffre est
beaucoup plus faible pour les allocataires de l'AAH et de l'API.
* 124 In Paugam S. (sous la dir.),
L'exclusion, l'état des savoirs, édition la
découverte.
* 125 Calcul sur la bas des
données de la CAF.
* 126 77,5% des RMIstes en recherche
d'emploi se sont adressés au service public de l'emploi.
* 127 Rioux L., « Les
allocataires du RMI : une recherche d'emploi active mais qui débouche
souvent sur un emploi », op.cit.
* 128 Pla A. « Sortie des
minima sociaux et accès à l'emploi », Études
et Résultats, n°567, 2007
* 129 Pla A., « Conditions
de vie et accès à l'emploi des bénéficiaires de
minima sociaux », op.cit.
* 130 Calcul sur la bas des
données de la CAF.
* 131 Dubar C., in Paugam S.(dir.),
L'exclusion, l'état des savoirs, op.cit.
* 132 In Paugam S.,
La disqualification sociale: essai sur la nouvelle
pauvreté, 2000, PUF, coll. « Quadriges ».
* 133 20% des RMIstes sans emploi
déclarent avoir besoin, pour rechercher un emploi, d'un moyen de
transport. Sondage TNS-Soffres
* 134 10% des RMIstes sans emploi
disent avoir besoin, pour rechercher un emploi, d'une aide à la garde
d'enfants. Ibid
* 135 Citation de Myrdal in Frobert
L.,Ferraton C., « Gunnar Myrdal, l'économie comme science
morale », L'Économie Politique, n°20 2003
* 136 Dérivé du mot
latin universus signifiant « tout entier », le
dictionnaire Larousse définit le mot universel comme
caractérisant ce qui « embrasse la totalité des
êtres et des choses », qui « s'applique à tous
les cas ».
* 137 On rappel que le TMEI du passage
du non-emploi vers l'emploi a été défini comme suit par
Piketty:![]()
* 138 Dénomination
donnée par K.Marx, in Le Manifeste du Parti Communiste.
* 139 Voir à ce sujet la
proposition de Y. Bresson
* 140 Titre de l'ouvrage de J.Rifkin.
L'auteur pointe du doigt la persistance de taux de chômage
élevé et l'apparition d'une « croissance sans
emplois ». Ces phénomène s'expliquant, pour lui, par la
hausse de la productivité, et la nullité des mécanismes de
destruction créatrice et de déversement des emplois entre
secteurs.
* 141 On retrouve la distinction que
Marx opère entre salariat et travail (au sens noble du terme, donc).
* 142 « Consequently,
the Marxian criterion should be constructed as implicitly imposing a constraint
on the maximisation of the relative share of society's total product
distributed according to needs: this share should be and remain large enough,
in absolute terms, to secure the satisfaction of each individual's fundamental
needs ». Cité in Van der Veen R., Van Parijs
P., « A capitalist road to communism »,
Basic Income Studies, vol.1 n°1, 2006. pp.1-23
* 143 Ibid.
* 144 Gilain B., Van Parijs P.
« Un Scénario de Court-terme et son Impact
Redistributif ». La revue du MAUSS, n°7, 1996
pp.151-157.
* 145 In Gilain B., Van Parijs P.
« Un Scénario de Court-terme et son Impact
Redistributif », op.cit.
* 146 Smith A., Recherches sur
la nature et les causes de la richesse des nations I, 1991, GF Flammarion,
p.174
* 147 A propos des luttes touchant
à la fixation des salaires entre employeurs et employés, Smith
affirme que « les maîtres sont en état de tenir
ferme plus longtemps », et que « beaucoup
d'ouvriers ne pourraient pas subsister sans travail une semaine ».
In Smith A., Recherches sur la nature et les causes de la richesse des
nations I, op.cit., p.137
* 148 Keynes, J.M., De
l'autosuffisance nationale, L'Economie Politique , n°31, 2006.
|
|



