|

ANNEE ACADEMIQUE 2019 - 2020
[1]
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE DE KANANGA
« UNIKAN »

FACULTE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE
GESTION
Apport des crédits bancaires dans
l'expansion
des Petites et Moyennes Entreprises.
Cas de la BCDC/Kananga de 2017 à
2019
Travail de Fin de Cycle présenté en vue de
l'obtention du grade de gradué en Sciences Economiques et de
Gestion.
Par WAKUTEKA BALUNTU Arthur
[2]
EPIGRAPHE
« De toutes les possessions, la sagesse seule
est
immortelle ».
« On ne peut pas labourer, semer,
récolter et
manger le même jour ».
Proverbes et dictions Africaines.
[3]
DEDICACE
A toi l'Eternel Dieu tout puissant, créateur du
ciel et de la terre ; nous avons évoqué ton nom le jour de
détresse, tu nous as exaucé. Nous te louerons à
jamais.
A vous mes très chers parents : Jean-Jadot BALUNTU
BUAKALE et Henriette TSHITUAKANUENZA KABASELE, pour les sacrifices
énormes que vous avez consenti. Vous vous êtes donnés dans
la logique d'accepter toutes les peines et souffrances tout au long de ce
parcours ; vous vous êtes démenés jour et nuit pour mon
bonheur. Vous avez travaillé dur pour rendre ma réussite
complète. Je vous dédie ce travail, fruit de votre grand
amour.
Arthur WAKUTEKA BALUNTU
[4]
AVANT- PROPOS
Nous remercions l'Eternel Dieu pour la grâce qu'il
nous a accordé depuis notre enfance jusqu'à ce jour. Que son nom
soit loué à jamais. Car dit-on, Ceux qui viennent à lui ne
rentrent jamais déçus.
Nos remerciements s'adressent en général
à tous les enseignants de l'Université de Kananga et en
particulier à ceux de la faculté des sciences Economiques et de
Gestion pour leur engagement tant louable dans notre formation pour nous rendre
ainsi utile à la société.
Nous remercions également l'assistant MBAMBI
MUTAMBA Jean-Paul qui, malgré ses multiples occupations, a
consacré son temps et son intelligence à diriger le
présent travail. Qu'il trouve à travers ces lignes, notre grande
reconnaissance.
Nous serons ingrats si nous ne saluons pas les bienfaits
de certains membres de la famille qui, de loin ou de près, ont
pensé à nos études. Nous avons cité : Chef Henri
KAPENGA WA KAPENGA ; Berthe MADIMBU TSHIBOLA ; Olivier ELAMENJI TSHIBANGU ;
Donatien KATSHIENKE KAMBA ; Valentin TSHIBANGU BANZEBA ; Marceline MUSHIYA
KANKU ; Roger MPONGO KABASELE et tant d'autres. Trouvez aussi nos
sincères remerciements.
A vous aussi, compagnons de lutte, amis et connaissances :
François BULOBA MUYAYA ; Victoire LUKUSA LUMBALA ; Norbert NYIME KAZADI
; Frederick NGELEKA NKONGOLO ; Jean KADIOBO MUAMBA ; Emmanuel MULEBA
TSHIBALABALA ; Joëlle KANKU BINYANGA ; José NTUMBA MUPOYI ; Etienne
MUYAYA et tant d'autres. Pour tous ce que vous avez faits dans ma vie, trouvez
à travers ce présent travail, notre profonde
considération.
A vous, frères et soeurs, neveux et nièces,
que ce travail vous serve de modèle pour aussi faire plus que nous dans
les jours avenirs.
Que tous ceux qui nous sont chers et dont les noms ne
figurent pas dans ce présent travail, trouvent ici, l'expression de
notre reconnaissance.
Arthur WAKUTEKA BALUNTU
[5]
SIGLES ET ABREVIATIONS
|
·
|
BCC
|
: Banque Centrale du Congo
|
|
·
|
BCDC
|
: Banque Commerciale du Congo
|
|
·
|
BCZ
|
: Banque Nationale du Zaïre
|
|
·
|
BNB
|
: Banque Nationale de Belgique
|
|
·
|
ISP
|
: Institut Supérieur Pédagogique
|
|
·
|
KGA
|
: Kananga
|
|
·
|
Kin
|
: Kinshasa
|
|
·
|
PME
|
: Petite et Moyennes Entreprises
|
|
·
|
RDC
|
: République Démocratique du Congo
|
|
·
|
SEG
|
: Sciences Economiques et de gestion
|
|
·
|
TFC
|
: Travail de Fin de Cycle
|
|
·
|
ULK
|
: Université Libre de Kinshasa
|
|
·
|
UNIKAN
|
: Université de Kananga
|
|
·
|
UNIKIN
|
: Université de Kinshasa
|
|
·
|
UNILU
|
: Université de LUBUMBASHI
|
|
·
|
USD
|
: Dollars Américain
|
Ayant constaté que certaines PME sont entrain de
disparaitre sur le marché par manque de financement et pourtant, elles
sont considérées comme le moteur de la
[6]
INTRODUCTION GENERALE
En République Démocratique du Congo, selon les
normes académiques, pour marquer la fin d'un cycle d'études
universitaires, l'étudiant doit rédiger un travail scientifique
sur un thème choisi, qu'il doit développer en fonction des
réalités du vécu quotidien.
Pour la fin de notre cycle de graduat en Sciences Economiques
et de Gestion à l'Université de Kananga, notre étude porte
sur « l'Apport des crédits bancaires dans l'expansion des petites
et moyennes entreprises. Cas de la BCDC/Kananga ».
De nos jours, le problème des entreprises et des
institutions bancaires préoccupe beaucoup des gens. Mener une
étude sur des faits qui préoccupent beaucoup des gens
ramène un éclaircissement et un savoir supplémentaire sur
certains faits que nous envisageons, mais qui sans se faire une idée
globale de ce qu'est le fondement même de ce qu'on fait.
Notons cependant que les Petites et Moyennes Entreprises
constituent de nos jours un grand moteur de la croissance économique et
une absorption du chômage, puis sont également les facteurs du
développement dans le sens qu'elles favorisent le niveau
d'activités dans son ensemble, c'est pourquoi un accent particulier doit
être accordé pour leur expansion et pour cela il faut un
financement adéquat lequel proviendrait des institutions
financières bancaires qui, à travers certains critères
accordent le crédit pour pallier aux insuffisances de ces dites PME.
Les banques de dépôts dans leur rôle
d'intermédiaire financier, reçoivent d'épargnes des
ménages et deviennent les agents à capacité de financement
et les transforment en crédit pour les octroyer aux agents à
besoin de financement où figurent les PME qui en
bénéficieront pour accroitre leur production afin de maintenir
l'équilibre des activités.
Tout au long de ce travail, nous donnons la lumière sur
les aspects qui font l'essentiel même de notre étude. Nous
démontrerons l'interdépendance entre les PME et les institutions
bancaires ; l'apport que ces dernières accordent aux PME ; les avantages
que tirent les parties concernées et la redevabilité des PME aux
institutions bancaires qui leur octroient des crédits pour assurer le
bon fonctionnement.
1. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le premier acte que l'on pose dans toute recherche
scientifique est le choix du sujet. Le choix de ce sujet est motivé
d'une part, par l'aspect du développement qu'il incarne et qui cadre
avec notre formation ; et d'autre part, par les constats et observations faits
durant notre parcours dans ce premier cycle universitaire.
[7]
croissance économique permettant le
développement des activités et luttant contre le chômage
à travers le nombre du personnel qu'elles engagent, vu les multiples
difficultés qu'elles sont entrain de rencontrer dans
l'accessibilité du crédit pour maintenir leur niveau
d'activités et surtout en voyant certaines conditions d'octroi de
crédit, nous nous penchons au travers ce sujet pour voir si les
institutions financières bancaires en général et la
BCDC/Kananga en particulier accordent-elles facilement le crédit aux PME
en vue de booster le développement à travers leurs
activités. C'est-à-dire voir l'apport des institutions
financières bancaires dans l'expansion des PME.
Raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet pour apporter
plus de lumière sur la bipartite Banques - PME, qui, de nos jours, pose
des sérieux problèmes à ceux qui souhaitent en être
acteurs afin de donner notre part d'idées pour leur permettre
d'être bien informé avant de s'y donner.
Faisant recours à toutes les préoccupations
évoquées, notre sujet porte un intérêt à
trois dimensions :
- Sur la dimension scientifique :
Ce travail servira de guide aux futurs chercheurs qui
envisageront l'exploité. Il nous laisse un souvenir inoubliable
enregistré sur la liste des chercheurs ayant traité ce sujet.
Grâce à ce thème même, nous avons eu connaissance en
ce qui concerne les institutions bancaires, les entreprises et d'autres aspects
qui, à notre niveau demeuraient inanimés.
- Sur la dimension pratique et sociale
Le présent sujet est d'intérêt capital du
fait que l'économie Congolaise dépend aujourd'hui en grande
partie tant à l'informel qu'au formel, des petites et moyennes
entreprises. Si ces PME sont financées par les banques, elles vont
participer à son développement par la création de
l'emploi, des richesses, à la stabilité et au bien-être
social. Ce qui entrainerait une augmentation de la production et de la
croissance économique. Ce travail sera pour beaucoup, une voie ouverte
à la connaissance sur des notions qui demeuraient inconnues.
- Sur le plan personnel
Ce sujet a apporté un savoir supplémentaire
à notre bagage intellectuel ; une connaissance nouvelle et nous a permis
d'être à la hauteur des certaines réalités inconnues
mais qui nécessitaient être connues. Mettre en pratique certaines
théories apprises, et approfondir également nos connaissances
dans le domaine d'économie financière.
[8]
2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 2.1. Problématique
Toute recherche scientifique doit nécessairement
poursuivre un but et jouer un rôle. Il est donc important pour se faire,
de ressortir la question majeure de notre étude. C'est-à-dire la
problématique qui doit être posée sous forme des questions
car elle est la phase essentielle de toute recherche scientifique.
Une problématique de recherche est l'écart qui
existe entre ce qui est connu et ce que nous voudrons savoir à propos
d'un phénomène donné. La recherche nait toujours de
l'existence d'un problème à résoudre ou à
clarifier. Il y a problème lorsqu'on ressent la nécessité
de combler un écart conscient entre ce qu'on sait et ce qu'on devrait
savoir. (1)
Grawitz et Pinto la définissent comme l'ensemble des
questions que l'on se pose devant un constat qui soutient une étude ou
une recherche pour arriver à la vérité scientifique.
(2)
Disons ici que l'apport des crédits bancaires dans
l'expansion des PME est l'un des piliers du développement et de la
consolidation d'une économie dans un pays. Il peut s'agir des
entreprises qui sont butées à certaines difficultés
financières et qui recourent aux institutions bancaires pour y
remédier, ou dans le cas échéant, les banques peuvent
aussi être en difficultés et recourir aux autres banques pour le
réconfort.
Eu égard à ce qui précède, nous
nous penchons sur notre question principale de recherche à savoir :
? Quel est l'apport des crédits bancaires dans
l'expansion des petites et moyennes entreprises ? En d'autres termes, est-ce
que le crédit bancaire octroyé par la BCDC permet-il l'expansion
des PME du Kasaï Central ? Telle est la question pour laquelle nous
tenterons de trouver les réponses dans la suite de notre travail.
2.2. Hypothèses
A chaque question posée correspond une réponse
au minimum. Selon Nsabua Tshiabukole Joseph, l'hypothèse est
définie comme une réponse provisoire ou l'ensemble des
réponses que le chercheur attribue aux questions qu'il s'est posé
dans la problématique et qui doivent être affirmées,
infirmées ou nuancées selon les résultats de la recherche.
(3)
1 MUAYILA KABIBU H., Méthodologie de
recherche en sciences économiques et de gestion, Maison Beni
Collection ; Kinshasa - RDC, 2015, P.7.
2 GRAWTIZ et PINTO, Méthode de recherche en
Sciences Sociale, 7ème édition, Ed. DALLOZ,
Paris, 1999, P.18
3 NSABUA TSHIABUKOLE J., Notes du Cours des
Méthodes de recherche en Sciences Sociales ; G2 SEG ; UNIKAN, 2018 -
2019, Inédit.
[9]
Dans cet ordre d'idées, nous tentons de répondre
à priori à notre question du
départ :
Les crédits bancaires auraient un apport significatif
au cas où ils favorisent l'expansion des petites et moyennes entreprises
(PME) dans leur accroissement des activités et si ceux-ci (les
crédits) sont accordés par la BCDC/Kananga poussant ainsi aux PME
de maintenir un équilibre dans leur production, car le crédit en
économie est comparable à l'huile au moteur où trop
d'huile fait griffer le mécanisme et peu d'huile entrave ce dernier,
c'est pourquoi le crédit doit être équilibré. Donc
l'octroi des crédits par la BCDC aurait un apport significatif au cas
où ils favoriseraient l'expansion des petites et moyennes entreprises du
Kasaï Central.
Telles sont les hypothèses que nous allons affirmer,
infirmer ou nuancer au cours de notre recherche.
3. ETAT DE LA QUESTION
Avant de développer une hypothèse de recherche,
le chercheur doit faire l'état de la question. Le terme état de
la question renvoi donc à se faire une idée sur les travaux
antérieurs qui ont été publiés en rapport avec
notre sujet et en quoi notre réflexion va-t-elle s'en débarquer.
(4)
L'état de la question c'est un tour d'horizon des
connaissances acquises et des recherches au moment de la rédaction du
travail. Il apparait comme inventaire de ce qui est déjà
écrit dans le domaine de la recherche que l'on entreprend. Il
précise les différentes orientations abordées en relevant
les mérites et les faiblesses des auteurs lus. En réalité,
l'Etat de la question met en lumière les aspects du problème qui
n'ont pas encore été étudiés et qui méritent
de l'être. (5)
Certes, la question des banques et des PME a
déjà été au coeur des plusieurs
préoccupations par certains auteurs. Nous n'avons pas la
prétention d'apporter ici, ce qui n'a jamais été dit ni
jamais attendu, mais sinon nous contribuons avec une pierre à la
construction de cet édifice qu'est la science.
Etant sur la voie de la complémentarité
scientifique, nous voulons ici reconnaitre que certaines personnes qui ont fini
avant nous, ont abordé d'une façon ou d'une autre, la question
des banques et des PME.
Yumba Wakungelani Patient dans son travail intitulé :
« Gestion des risques des crédits dans les banques commerciales ;
cas de la RAWBANK » a donné les notions sur la gestion des risques
des crédits et avait soulevé comme problématique : quelles
sont les méthodes d'analyse du risque des crédits ? Il est
arrivé à la conclusion selon laquelle, les banquiers disposent
d'une variété des méthodes permettant de se
prémunir
4 ANNETTE BUISSON, Littérature
étrangères et francophones, Ed. DALLOZ, Paris, France, 2006,
P.9
5 NTUMBA NGANDU, Guide de rédaction d'un
travail scientifique, ISP/KANANGA, CREDOP, KANANGA, 2008, P.41
[10]
contre les risques des crédits en passant par les
garanties pour prévenir des risques d'insolvabilité du
préteur. (6)
Yeta Balutidi Princesse dans son travail de fin de cycle
intitulé : « Apport des Petites et moyennes entreprises au
développement socio - économique de la RDC » a
évoqué la notion d'encadrement des PME en RDC et est
arrivé à la conclusion selon laquelle, l'évaluation des
apports et contraintes des PME en RDC font un défis qu'il faudrait
relevé pour donner du bon sens à l'économie
Congolaise.(7)
MAYAVANGUA DIKONDO Eric dans son travail de fin cycle
intitulé : « Contribution d'une banque commerciale au
développement socio - économique de la RDC ; cas de la BCDC
» a, en ce qui lui concerne, démontré d'une manière
générale l'importance et la contribution d'une banque commerciale
au développement d'un pays. Il a conclu en disant que les banques
commerciales font aujourd'hui face à certaines difficultés aux
prêts et doivent songer à développer des stratégies
appropriées pour fidéliser leur clientèle.
(8)
Après lecture de tous ces travaux
précédents, le grand point de ressemblance est que nous nous
sommes tous retrouvés dans le même secteur parlant des banques,
des institutions bancaires et des entreprises. La seule différence avec
notre présent travail est que, nous allons, en l'occurrence des
idées que nos prédécesseurs ont soulevées,
démontré l'apport des banques face aux PME et leur
interdépendance les unes aux autres.
4. METHODES ET TECHNIQUES 4.1. Méthodes
Madeleine Grawitz dit qu'au sens le plus élevé
et le plus général du terme, la méthode est l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, le
démontre et les vérifie.(9)
Il existe plusieurs méthodes de collecte des
données dans une recherche scientifique. Il est parfois difficile pour
nous de déclarer certaines méthodes moins bonnes pour
répondre à la question de notre recherche.
Ainsi, pour atteindre les objectifs de notre recherche, nous
avons recouru aux méthodes analytiques et statistiques.
? La méthode analytique
6 YUMBA WAKUNGELANI P., Gestion des risques des
crédits dans les banques commerciales ; cas de la RAWBANK, UNILU, SEG,
2016, Inédit.
7 YETA BALUTIDI P., Apport des Petites et moyennes
entreprises au développement socio - économique de la RDC,
UNIKIN, SEG, 2008, Inédit.
8 MAYAVANGUA DIKONDO E., Contribution d'une banque
commerciale au développement socio - économique de la RDC ; cas
de la BCDC, ULK, SEG, 2007, Inédit.
9 GRAWITZ, M. Méthode de recherches en
Sciences Sociales, 11ème Ed. Ed. DALLOZ, Paris, 2000,
P.398
[11]
Selon Henry Muayila Kabibu, cette méthode est
définit comme une analyse systématique de toutes les informations
ainsi que toutes les données récoltées. (10)
Cette méthode nous a aidé à analyser des nombreuses
données qui ont été recueillies grâce à nos
recherches sur terrain.
? La méthode statistique
Cette méthode nous a permis de faire la collecte, la
présentation, l'analyse ainsi que l'interprétation des toutes les
données au cours de notre présent travail.
4.2. Techniques
P. Roger définit les techniques comme étant des
outils qui permettent aux chercheur de récolter et, dans une certaine
mesure, de traiter les informations nécessaires à
l'élaboration d'un travail scientifique ce ne sont donc que des outils
mis à la disposition de la recherche et organisés par la
méthode dans ce but.(11)
En ce qui concerne les techniques, nous avons tout au court de
ce travail, recouru à deux techniques :
- La technique documentaire et - La technique d'interview
a. La technique documentaire
Ici, la collecte des données passe par la lecture des
documents écrits. Celle-ci nous a aidé à accéder
aux documents ayant servi à notre cause pour la réussite du
présent travail.
b. La technique d'interview
Cette méthode inspire un tête-à-tête
entre les deux parties. C'est-à-dire le chercheur et toute personne qui
dans le cadre de cette recherche, a contribué à l'avancement du
travail.
5. DELIMITATION DU SUJET
Pour bien mener cette étude, nous l'avons situé
dans le temps et dans l'espace pour ainsi faire la part des choses.
a. Délimitation spatiale
10 MUAYILA KABIBU H., Op.cit., P.33
11 Roger P. Cité par BAKENGA R. Op.cit
[12]
Dans l'espace, nous avons choisi la Banque Commerciale du
Congo (BCDC/Kananga) comme cadre de notre étude.
b. Délimitation temporaire
Par rapport au temps, nous situons notre étude sur une
période de 3 ans, soit de 2017 à 2019. Période pendant
laquelle nous avons remarqué plusieurs opérations au sein de la
BCDC/Kananga et aussi grâce à la disponibilité des
données.
6. PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL
Hormis l'introduction générale et la conclusion
générale, notre travail comprend trois chapitres répartis
comme suit :
Le premier chapitre basé sur l'approche conceptuelle.
Il comprend deux grands points : Le premier consacré aux notions sur les
entreprises et le deuxième aux notions sur les banques et les
institutions bancaires. Nous donnerons ainsi l'essentiel sur chacun de ces
points qui feront le contenu même de notre premier chapitre.
Le deuxième chapitre concerne la présentation du
cadre de notre étude. Il comprend un point et des sous-points. Dans ce
chapitre, nous présentons la BCDC/Kananga, son repère historique,
sa situation géographique, son statut juridique, sa structure
fonctionnelle ainsi que son organigramme.
Quant au dernier chapitre (troisième), il est
basé sur l'apport des crédits bancaires dans l'expansion des
petites et moyennes entreprises. C'est le fondement même de notre
étude. Il comprend deux sous-points : la présentation des
données et L'analyse des données.
Enfin, suivront nos critiques et suggestions avant d'atterrir
par la conclusion générale précitée. La
bibliographie et la Table des matières feront nos pages ultimes.
[13]
CHAPITRE PREMIER
APPROCHE CONCEPTUELLE
Ce chapitre basé sur l'approche conceptuelle, mettra en
clair certains concepts relatifs à notre sujet, concepts sur lesquels
sera focalisée notre réflexion et qui font l'essentiel même
de notre présent chapitre. Il est subdivisé en deux points : le
premier consacré aux notions sur les entreprises et le deuxième
aux notions sur les banques et institutions bancaires. Une conclusion partielle
bouclera ce chapitre.
I.1. NOTIONS SUR LES ENTREPRISES
Au cours de ce point, nous nous baserons sur quatre
sous-points essentiels pour présenter et comprendre ce que c'est une
entreprise. Le premier sous-point vise à proposer des définitions
possibles de l'entreprise ; le deuxième s'intéressera aux
produits que peut produire une entreprise ; le troisième traitera sur
les sortes et la classification des entreprises et le dernier sous-point sera
réservé au rôle économique et social ainsi que les
objectifs de l'entreprise.
I.1.1. DEFINITION DE L'ENTREPRISE
Dans l'histoire économique, on trouve nombreuses
définitions de l'entreprise. Il est important de signaler que plusieurs
auteurs l'on définit de l'une ou de l'autre manière selon les
circonstances dans lesquelles ils s'y trouvaient.
Selon F. Perroux, l'entreprise est une organisation de la
production dans laquelle on combine les prix des divers facteurs de production
apportés des agents distincts en vue de vendre un bien ou des services
sur le marché pour obtenir par la différence entre deux prix
(prix de revient et prix de vente) le plus grand gain monétaire
possible. (12)
Selon Colin Clark, une entreprise est « toute
organisation dont l'objet est de pouvoir à la production, à
l'échange ou à la circulation des biens ou des services ».
C'est l'unité économique dans laquelle sont groupés et
coordonnés les facteurs humains et matériels de l'activité
économique. (13)
Karim Messeghen et Olivier Torres définissent aussi
l'entreprise comme tout organisme autonome disposant des moyens humains et
matériels qu'elle combine en vue de produire les biens et services
destinés à la vente. (14)
Partant des définitions ci-haut évoquées,
nous pouvons encore dire qu'une Entreprise est une organisation
économique qui réunit les moyens humains, matériels et
financiers pour produire des biens ou des services destinés à
être vendus dans un but lucratif.
12 PERROUX, F., L'Economie du XXè
Siècle, 2 Edition, PUF, Paris, 1965, P.37.
13 COLIN CLARK., Théorie du
développement économique, 2ème Ed. Paris,
1976, P.50
14 MESSEGHEN K., et TORRES O., Entrepreneuriat et
PME, Paris, France, 2015, P.16
[14]
I.1.2. LES PRODUITS DE L'ENTREPRISE
Avant d'entrer en profondeur de ce sous-point, disons d'abord
un mot sur le terme « produit » qui est la base même de notre
réflexion dans les lignes qui suivent.
Un produit est le fruit d'une production agricole ou
industrielle. C'est une richesse ou encore une marchandise. Un produit est
également le résultat de l'activité humaine.
(15)
Les produits de l'entreprise sont tous les revenus que
l'Entreprise va générer dans toutes ses activités. Ils
sont de trois natures :
· Les produits d'exploitation ;
· Les produits financiers et
· Les produits exceptionnels.
a. Les produits d'exploitation
Il s'agit des produits que l'on trouve le plus souvent quand
on analyse le rendement d'une Entreprise. Les produits d'exploitation
comprennent :
· Les prestations de services ;
· Les ventes des produits finis ou des marchandises et
· Les subventions d'exploitation.
b. Les produits financiers
Ils sont en général peu élevés
dans des entreprises. En effet, très peu d'entreprises ont une
trésorerie suffisante pour en tirer des revenus. Les produits financiers
comprennent :
· Les revenus de participation, revenus des titres
immobilisés, des prêts ou des créances ;
· Les escomptes obtenus et
· Les gains de change.
c. Les produits exceptionnels
Les produits exceptionnels comprennent :
· Les quotes-parts de subvention d'investissement ;
· Et tous les autres éléments accessoires de
l'entreprise.
15 KHODJA M., Gestion des Entreprises,
2ème année LMD, Paris, 2017, P.6
[15]
I.1.3. SORTES ET CLASSIFICATION DES ENTREPRISES(16) Les
entreprises peuvent-être classées suivant plusieurs
critères :
a. EN FONCTION DE LEUR ACTIVITE, nous avons :
· Les entreprises artisanales : celles
qui vendent les activités manuelles ;
· Les entreprises Commerciales : Celles
qui achètent les biens pour la vente sans transformation ;
· Les entreprises industrielles : Elles
transforment les matières premières et vendent les produits finis
ou semi-finis ;
· Les entreprises de service : Sont
celles qui rendent un service sans fabrication d'objets physiques.
b. EN FONCTION DE LEUR SECTEUR ECONOMIQUE, nous avons
:
· Les entreprises du secteur primaire :
Il s'agit des entreprises qui exercent les activités liées
à l'extraction des ressources naturelles (l'agriculture, la pêche,
l'exploitation forestière ou minière, etc.) ;
· Les entreprises du secteur secondaire
: Il s'agit des entreprises dont leurs activités sont
liées à la transformation des ressources naturelles issues du
secteur primaire (Industrie, bâtiment et travaux publics, etc.
· Les entreprises du secteur tertiaire
: Il s'agit des entreprises qui regroupent toutes les activités
économiques qui ne font pas partie du secteur primaire et secondaire. Il
s'agit des entreprises marchandes.
c. EN FONCTION DE LEUR TAILLE ET DE LEUR IMPACT
ECONOMIQUE, nous avons :
· Les Très Petites Entreprises (TPE)
: Ce sont des entreprises dont le nombre des travailleurs est
très limité, soit d'une personne à dix.
· Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) :
Il s'agit des Entreprises comprenant de 2 à 500 personnes ;
· Les Grandes Entreprises : Celles qui
comptent plus de 500 personnes ;
· Le Groupe d'Entreprises : Sont celles
comportant une société mère et des filiales, etc.
16 BULAMBA NYAMI D., Notes du Cours des
Théories générales de Management, G2 SEG, UNIKAN,
2018-2019, Inédit.
[16]
d. EN FONCTION DE LA BRANCHE ET DU SECTEUR
D'ACTIVITES, nous avons :
· Le secteur : c'est l'ensemble des
Entreprises ayant la même activité principale ;
· La Branche : C'est l'ensemble
d'unités de production fournissant un même produit ou service.
e. EN FONCTION DE LEUR STATUT JURIDIQUE, Nous avons
:
· Les Entreprises individuelles ;
· Les Sociétés Civiles ;
· Les Sociétés Commerciales ;
· Les Sociétés Coopératives et
· Les associations.
I.1.4. OBJECIFS, ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE
L'ENTREPRISE
L'Entreprise est aussi une réalité
sociétale qui influence la société. Sa contribution
économique se manifeste sous forme de création d'emplois, des
produits, des valeurs, des revenus et des ressources pour des
collectivités publiques, d'innovation et de la diffusion du
progrès technique. L'entreprise joue deux rôles principaux ; un
rôle économique et un rôle social.
a. Objectifs de l'entreprise
L'objectif de l'Entreprise est la finalité que
l'Entreprise cherche. Ces objectifs varient selon les types d'Entreprises et le
système social dans lequel elle se trouve.(17)
Voici les objectifs poursuivis par les entreprises en
fonction de leur classification et sortes :
· Réaliser des profits ;
· Maximiser ces profits là ;
· Satisfaire les clients ;
· Exercer un rôle humanitaire (ONG, Associations)
;
· Promouvoir le maintien de l'Entreprise dans toute
circonstance pour ne pas favoriser sa faillite, etc.
b. Rôle économique et social de
l'entreprise Toute Entreprise peut jouer plusieurs rôles, entre autre
:
17 KHODJA, M. Op.cit., P.8
[17]
? Le rôle de production des biens et services :
l'Entreprise doit contribuer à mieux les différents facteurs de
production par rapport à un niveau de production donné et pour un
moindre coût.
? Le rôle d'innovation : Pour lutter contre la
concurrence. L'Entreprise doit constamment améliorer ses méthodes
de production et chercher à découvrir des nouveaux biens et
services ;
? Le rôle de répartition : Elle met en
évidence les biens de l'Entreprise avec les autres agents
économiques ;
? L'Entreprise peut jouer encore le rôle de
créateur des richesses.
[18]
I.2. NOTIONS SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS
BANCAIRES
Avant d'aller plus loin dans ce point, définissons
d'abord la Banque et les institutions bancaires.
Une Banque est une société financière
qui gère les dépôts et collecte l'épargne des
clients, accorde des prêts et offre des services
financiers.(18)
Une institution bancaire (autrement appelée Banque
universelle ou commerciale) peut être aussi bien un grand
établissement financier jouissant d'une présence et d'une
notoriété internationale qu'un petit établissement
local.
I.2.1. CREATION ET FONCTIONNEMENT DES BANQUES ET
INSTITUTIONS FINANCIERES
A l'exception des Banques Centrales qui ont un statut
juridique différent, les conditions qui réglementent la
création des Banques Commerciales et des Institutions financières
sont les mêmes que celles auxquelles sont soumises toutes les entreprises
commerciales.
Etant elles-mêmes des « commerçants »
d'argent, les banques et les institutions financières doivent :
- Respecter à leur création, les conditions
édictées par le code de commerce en vigueur du pays ou elles
étalent leurs activités. C'est-à-dire que les
associés fondateurs des banques commerciales et des institutions
financières doivent avoir qualité de commerçant ;
- Etre enregistrée au registre de commerce et du
crédit mobilier (RCCM).
En République Démocratique du Congo, en dehors
de deux premières conditions, les commerçants, qu'ils s'agissent
des personnes physiques ou morales, doivent avoir le numéro de
l'identification nationale.
En plus des formalités énumérées
ci-dessus, les banques commerciales et les institutions bancaires doivent
observer avec attention la réglementation en matière du droit
financier du pays où elles évoluent. Il s'agit ici des conditions
d'ordre juridiques.
Au-delà des conditions juridiques, les banques et les
institutions financières doivent remplir certaines exigences qui sont
d'ordre financier. En dehors du rôle économico-financier, les
banques jouent également un triple rôle pour les entreprises lors
de l'augmentation de capital, essentiellement pour toutes les
opérations.
En effet, les banques et les institutions financières
doivent avoir un capital propre dont le seuil est déterminé par
le code du commerce.
18 PETIT DU TALLIS, G., Les crédits et les
Banques, Sirey, Paris, 1964, P.56
19 MBAMBI MUTAMBA, J.P., Notes du Cours d'Economie
monétaire générale, G3 SEG, UNIKAN, 2019-2020,
Inédit.
[19]
Pour être plus ouvert dans ce point, nous voulons ici,
donner des notions supplémentaires sur les institutions
financières parce que nous en avons évoquées au cours de
cette présente partie.
I.2.2. LES INSTITUTIONS FINANCIERES
Les institutions financières sont par
définition les intermédiaires financiers qui récoltent le
fonds auprès des agents à capacité de financement pour les
distribuer aux autres agents en besoin de financement.(19)
Ainsi, ces institutions financières peuvent être
classées en deux catégories :
· Les institutions financières bancaires et
· Les institutions financières non bancaires.
Parlant des institutions financières bancaires, elles
ont pour rôle la création et la gestion de la monnaie quelle que
soit sa forme. Elles sont des passifs constituées par la monnaie liquide
et sont aussi appelées « intermédiaires bancaires ou
institutions financières monétaires ».
Il s'agit donc de :
· Banque centrale ou banque d'émission ;
· Banques commerciales ou Banques de dépôt
;
· Banques d'affaires et
· Les offices des chèques postaux.
a. LA BANQUE CENTRALE OU BANQUE D'EMISSION
La Banque Centrale est une institution placée à
la tête et au-dessus d'un système bancaire composé d'une
multitude des banques ordinaires (qui servent d'intermédiaire financier
entre les agents économiques et qui émettent de la monnaie de
type scripturale).
Elle est indispensable au système bancaire dès
l'instant où il y a multiplicité des banques ordinaires. Elle
assure la compassassion entre elle et contrôle le flux d'émission
des monnaies des banques ordinaires. Elle joue un rôle crucial dans les
relations extérieures monétaires et financières avec
d'autres systèmes monétaires et financiers nationaux ou
internationaux.
On l'appelle souvent « le préteur en dernier
essor » car elle apporte des liquidités aux banques ordinaires en
difficulté pour éviter un risque systémique.
C'est-à-dire la propagation d'une crise à tout le système
bancaire et financier.
[20]
Elle est une autorité monétaire ayant seule le
privilège de mettre en pratique la politique monétaire. Elle est
aussi appelée « Banque des banques » « Banque de l'Etat
ou encore banque nationale ».
En République Démocratique du Congo notre cher
et beau pays, elle est baptisée BANQUE CENTRALE DU CONGO, BCC en sigle
et a été créée par le décret-loi du 23
Février 1961. Avant le 22 Juin 1964, date de son entrée en
activités, le conseil monétaire créé par le
décret-loi du 03 Octobre 1960 après la liquidation de la Banque
Centrale du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi, a exercé en fait tous les
pouvoirs d'une banque centrale en matière d'émission de
crédit et de change.
En plus de son rôle d'institut d'émission, c'est
à la Banque Centrale du Congo que revient le contrôle des
institutions bancaires et financières ainsi que la conception et la mise
en pratique de la politique monétaire.
Son capital est entièrement souscrit par l'Etat alors
que le capital de la Banque Centrale du Congo et du Ruanda-Urundi se
répartissait 60% pour les pouvoirs publics, 20% pour la Banque Nationale
de la Belgique et 20% restant pour le public.
Missions de la Banque Centrale du Congo
Aux termes de la loi N°005/2002 du 07 Mars 2002 portant
constitution, organisation et fonctionnement de la BCC, il est dévolu
à cette dernière les missions suivantes :
· Elle est la seule institution habileté à
émettre les billets et les pièces ayant cours légal sur le
territoire national et assurer la stabilité tant interne qu'externe de
la monnaie nationale ;
· Mettre en oeuvre la politique monétaire du pays
dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau
général des prix, donc assurer la stabilité interne et
externe de la monnaie nationale ;
· Définir et gérer les réserves
officielles de la République ;
· Edicter les normes et règlements concernant les
opérations sur les devises étrangères ;
· Participer à la négociation de tout
accord international comportant les modalités de paiement et en assurer
l'exécution ;
· Elaborer la règlementation et contrôler
les établissements des crédits, les institutions de
micro-finances et les autres intermédiaires financiers ;
· Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes
de compassassions et de paiement ;
[21]
· Promouvoir le développement des marchés
monétaires et des capitaux ;
· Agréer le paiement pour le compte de l'Etat.
Elle administre tout compte spécial de l'Etat. Elle achète, vend,
perçoit et décaisse pour le compte de l'Etat tout chèque,
valeur mobilière et autre ;
· Emettre d'office ou à la demande du
gouvernement des avis ou des conseils sur toute politique que celui-ci envisage
de prendre.
Objet social de la Banque Centrale du Congo
L'article 3 de la présente loi n°005/2002 du 07
Mai 2002 confère à cette dernière la charge de
définir et de mettre en oeuvre la politique monétaire du pays
dont l'objectif fondamental est d'assurer la stabilité du niveau
général des prix ;
· D'émettre la monnaie fiduciaire ;
· De contrôler et de veiller à la masse
monétaire en circulation ;
· De jouer le rôle de caisse de l'Etat en
liégeant en son sein tout le fonds récolté pour le compte
du trésor public ;
· D'être conseillère principale du
Gouvernement en matière économico-financière et surtout
monétaire ;
· De contrôler et d'encadrer les crédits
octroyés par les banques de dépôts aux opérateurs
économiques ;
· De règlementer le taux de parité avec
différentes monnaies ;
· D'aider les banques commerciales privées en
réescomptant leur portefeuille et effet.
b. LES BANQUES COMMERCIALES OU BANQUES DE DEPOT
Les Banques commerciales ou banque de dépôt sont
celles dont l'activité principale consiste à effectuer des
opérations des crédits et à recevoir du public des
dépôts des fonds à vie et à terme. Elles peuvent
être encore considérées comme des entreprises
privées faisant le commerce d'argent.
Leur activité essentielle consiste en effet à
recevoir des dépôts et à faire des prêts, le plus
souvent à court terme ; leurs profits sont obtenus sur la
différence entre le taux d'intérêt qu'elles
perçoivent auprès de leurs emprunteurs et celui qu'elles paient
à leurs déposants.
Il s'agit des banques qui font le commerce d'argent. Ce sont
les entreprises qui font la profession habituelle de recevoir les
dépôts à vue et à court terme et d'octroyer le
crédit à court terme.
[22]
Ces banques sont en général des
Sociétés Anonymes. Elles reçoivent les capitaux des
épargnants et le fonds des Entreprises et le placent au mieux.
Les Banques Commerciales, en République
Démocratique du Congo sont trop liquides, l'implantation
géographique de ces banques ne couvre qu'une partie infinie du pays.
A l'heure actuelle, les plus connues sont :
7. ACCESS BANK RDC ;
8. ADVANS BANQUE CONGO
9. AFRILAND FIRST BANK CD ;
10. BANK OF AFRICA ;
11. BANQUE COMMERCIALE DU CONGO ;
12. BANQUE GABONAISE FRANCAISE INTERNANTIONALE
(BGFIBANK) ;
13. BANQUE INTERNATIONALE DE CREDIT ;
14. BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AU CONGO (BIAC) ;
15. BYBLOS BANK CONGO
16. CITI GROUP
17. ECOBANK RDC ;
18. FIRST INTERNATIONAL BANK ;
19. LA CRUCHE BANQUE ;
20. PROCREDIT BANQUE ;
21. RAWBANK ;
22. SOFIBANQUE ;
23. STANDARD BANK CONGO ;
24. TRUST MERCHANT BANK (TMB) ;
25. UNITED BANK FOR AFRICA ;
26. FIRST BANK OF NIGERIA (FBN Bank).
[23]
Rôles des Banques Commerciales
Les banques commerciales jouent des différents
rôles dans la vie économique et financière du pays.
Notamment :
? Elles récoltent l'épargne des ménages
et la distribue aux Entreprises ; ? Elles jouent le rôle monétaire
en engendrant de la monnaie scripturale ;
? Elles orientent les opérateurs économiques
avec les conseils dans la conduite de leurs affaires ;
? Elles centralisent dans le domaine de change d'offre et de
demande des devises ;
? Elles jouent dans les pays en développement un autre
rôle démonétisé de l'économie nationale en
faisant utiliser la monnaie dans les échanges commerciaux dans les coins
les plus reculés de leurs villages.
c. LES BANQUES D'AFFAIRES
Leur principale activité consiste essentiellement
à assurer le service de conseil et d'assistance en matière de
patrimoine et d'ingénierie financière et d'une manière
générale tous les services destinés à faciliter la
création de développement et la structuration d'Entreprises.
Ce sont des banques industrielles qui travaillent avec leurs
ressources propres ou celles des syndicats des gros capitalistes.
Notons cependant que, le système bancaire congolais n'a
jamais connu des banques d'affaires, sauf la « COFIKI » compagnie
financière de Kinshasa qui a fait une tentative, mais elle a
échoué.
Quant aux institutions financières non-bancaires, ce
sont des institutions qui n'ont pas le statut des banques et qui ne disposent
pas de capacité de création de monnaie dont leur passif est
composé non de la monnaie liquide, mais des créances à
terme.
26.1. ROLE DES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES
Le rôle joué par les banques et les institutions
financières est essentiellement un rôle
économico-financier.
Dans son aspect économique, les banques et institutions
financières jouent le rôle d'agents de développement dans
la mesure où elles collectent des fonds et les distribuent soit pour
financer la consommation (crédits à la consommation) soit pour
financer la production (produit à la production) en tenant compte de la
politique
[24]
économique du pays. Elles ont un grand rôle dans
la sélection des projets en fonction de leurs perspectives
économiques.(20)
L'octroi des crédits à l'exportation ou à
l'importation par les banques aux entreprises présente les effets un peu
plus décisifs non seulement sur la balance commerciale, mais aussi sur
le PIB et la balance de paiement des nations.
L'aspect financier du rôle des banques et institutions
financières réside en ce qu'elles sont une source de secours
financier pour les Entreprises et pour l'Etat. Lorsque les Entreprises
éprouvent le besoin en fonds de roulement et que l'Etat est en situation
d'impasse budgétaire, les banques et institutions financières
leur fournissent les fonds dont elles ont besoin pour leur fonctionnement.
Le rôle de conseil joué par les banques
intervient lorsqu'elles font bénéficier aux entreprises de leur
expérience dans les opérations d'augmentation du capital qui sont
très complexe pour ces dernières.
Lorsque les Entreprises lancent les actions sur le
marché financier, ces dernières sont offertes aux investisseurs
par l'intermédiaire des guichets bancaires. Dans ce cas précis,
les banques jouent le rôle d'agent de placement.
Dans le cas d'un crédit documentaire ouvert par une
banque pour son client, elles jouent le rôle d'intermédiaire entre
le client et son fournisseur. Elles jouent en même temps le rôle de
garantie lorsque la banque du client et celle du fournisseur contractent un
crédit documentaire irrévocable.
Tels sont les points sur lesquels nous avons tournés
notre réflexion au cours de la présente partie afin de mener
à bon port ceux qui nous lirons à comprendre notre enchainement
d'idées pour la réalisation du présent travail.
Tout au long de ce chapitre basé sur l'approche
conceptuelle, nous avons essayé de démontrer les concepts qui
fesaient l'essentiel de notre réflexion. Notre lumière a
consisté aux concepts des notions sur les Entreprises et sur les banques
et les institutions bancaires. Nous avons dans notre premier point,
essayé de proposer les définitions de l'Entreprise, les produits
d'une entreprise, nous avons aussi parlé des sortes d'entreprises et de
leur rôle sur différents plans. Nous avons ensuite apporté
un éclairage sur les notions des banques et institutions bancaires tout
en démontrant le rôle combien important joué par les
institutions précitées dans le développement du pays et de
son économie.
20 PETIT DU TALLIS, G. Op.cit. P.70.
[25]
CHAPITRE DEUXIEME
RESENTATION DU CADRE D'ETUDE
Le cadre de notre étude n'est rien d'autre que la
BANQUE COMMERCIALE DU CONGO, Agence de Kananga. Ce chapitre est composé
de cinq points : le premier présente le repère historique; le
deuxième pressente la situation géographique de la BCDC/Kananga ;
le troisième quant à lui parle du statut juridique ; le
quatrième présente les objectifs et la structure fonctionnelle de
la BCDC et le cinquième enfin présentera son organigramme.
II.1. REPERE HISTORIQUE DE LA BCDC
Plus qu'un simple opérateur économique et
financier du Congo, la BCDC tire ses origines depuis 1909 lorsqu'au sein de la
Banque d'Outre -Mer qui groupait les plus importants établissements
financiers du pays, naît l'idée de créer une banque au
Congo Belge.
Il fallait créer pour les besoins de la jeune colonie,
un organisme bancaire belge en son essence. Cela obligea la Belgique d'agir
rapidement pour éviter l'infiltration et la prépondérante
influence des groupes étrangers si l'on parvenait à mettre sur
pied cet organisme belge. Cette banque rendra encore un précieux service
à la colonie belge et contribuera au progrès économique du
pays en assurant la diffusion de la monnaie sur toute l'étendue du
territoire national.
Il fut décidé de créer le 11 janvier 1909
la Banque du Congo Belge (BCB), et l'assemblée constituante se tint
à cette date. L'objet de la Banque, aux termes même des statuts en
vue du développement économique du Congo, était
d'effectuer toutes les opérations de banque, de change, de finance, de
trésorerie, de commissions et de ducroire , d'acheter et de vendre les
matières précieuses, les métaux et les lingots de toute
nature; et de représenter à titre de commissionnaire, de
mandataire ou d'agent, tout particulier, société, administrations
et établissements du secteur privé ou public en effectuant les
opérations pour compte de tiers.
Monsieur OMER LEPREUX, Directeur de la Banque Nationale de la
Belgique (BNB) fut désigné par le Conseil d'Administration pour
l'exercice de la nouvelle banque. Les dirigeants de la BCB,
décidèrent d'établir la première agence à
Matadi, Non seulement parce que c'était déjà un centre
commercial relativement actif et constituait le port le plus important, mais
surtout parce que la banque pouvait y compter en recourant à la
clientèle et à l'aide de la compagnie du chemin de fer du
Congo.
Ce n'est que petit à petit que les relations bancaires
normales s'établirent, car il existait à l'époque peu de
"clients indépendants" pour une banque. Le jour même où la
Banque du Congo Belge a donné des nouveaux statuts restreignant
considérablement ses responsabilités d'actions, une autre banque
fut constituée à son initiative. C'était la Banque
Commerciale du Congo (BCDC) dont l'objet était de reprendre les
opérations auxquelles la Banque du Congo Belge devrait renoncer.
[26]
L'histoire de la Banque Commerciale du Congo, BCDC en sigle,
remonte aux premières années de la création de la
République Démocratique du Congo et est directement liée
à la création du système bancaire congolais.
En 1960, le Congo devient un Etat souverain, la banque du
Congo belge fait apport de ses activités européennes à la
banque belgo-congolaise constituée le 14 avril à Bruxelles. Cette
dernière est connue depuis 1965 sous la dénomination de Banque
belgo-congolaise actionnaire, aux côtés de l'Etat congolais et de
partenaire privés, de la Banque congolaise qui portera le nom de la
Banque commerciale Zaïroise (BCZ) et qui reprendra ensuite la
dénomination de la BANQUE COMMERCIALE DU CONGO, BCDC en sigle.
De 1997 à 2003 ; l'effondrement de l'économie du
pays et la longue guerre civile ont imposé à la Banque de
réduire sa taille à un nouveau comptable à ses clients.
En 2004, profitant de l'amélioration du climat
sociopolitique et de la relance économique consécutive. La BCDC
ré déplace son réseau sur l'ensemble du territoire et
adapte son organisation commerciale aux niveaux de besoins de sa
clientèle : de particuliers, de MPE, des grandes entreprises et des
institutions financières.
La BCDC est aujourd'hui l'une des premières banques
congolaises actives sur l'ensemble du territoire de la République
Démocratique du Congo.
II.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA BCDC/KANANGA
La Banque Commerciale du Congo BCDC en sigle, Agence de
Kananga se trouve au centre-ville de Kananga sur le boulevard Lumumba au
quartier Malandji, commune de Kananga. Elle est bornée :
? au nord par le bureau de la Police Nationale congolaise ;
? au sud par la CADECO et la maison communale de Kananga ; ?
à l'Est par l'entrepôt de la compagnie Service Air et
? A l'ouest par l'hôtel MED.
La Banque Commerciale du Congo a son siège Social sur
le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, ville Province de
Kinshasa. Elle possède en outre 19 agences à travers le pays dont
6 à Kinshasa et 13 à l'intérieur du pays. Ces Agences sont
reparties comme suit :
Ville province de Kinshasa :
1. Siège social : sis, boulevard du 30juin ;
2. Agence de LIMETE : 7ème rue côté
résidentiel ;
[27]
3. Agence de MATONGE : rond-point victoire ;
4. Agence ROYAL/GOMBE : sis, boulevard du 30juin ;
5. Agence de PLAZA village LHF : 16ème rue industriel
;
6. Agence de l'UNIKIN : université de Kinshasa
Réseau intérieur
7. Agence de MATADI ;
8. Agence de GOMA ;
9. Agence de BENI ;
10. Agence de BUTEMBO ;
11. Agence de BUNIA ;
12. Agence de KINSANGANI ;
13. Agence de BUKAVU ;
14. Agence de KANANGA ;
15. Agence de MBUJI MAYI ;
16. Succursale de LUBUMBASHI ;
17. Agences de KOLWEZI ;
18. Agence de LIKASI et
19. Agence de FUNGURUME
II.3. STATUT JURIDIQUE
La Banque Commerciale du Congo. Est une société
à responsabilité limitées exerçant des
activités des établissements de crédit telles que
définies par l'instruction de la BCDC. Son capital social au 31
décembre est de 635.818.000 CDF.
II.4. OBJECTIFS ET STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA
BCDC
II.4.1. OBJECTIFS DE LA BCDC
La banque commerciale du Congo reste le leader incontesté
oeuvrant dans le secteur bancaire depuis bientôt un siècle. Ses
objectifs poursuivis sont les suivants :
[28]
V' Forte d'une expérience remontant à
1909, la Banque Commerciale du Congo se concentre sur les métiers
spécialisés qui s'adressent à une clientèle
sélectionnée : l'entreprise, des banques et les particuliers ;
V' La banque vise à répondre aux
besoins du conseil et de produit financiers à haute valeur
ajoutée à partir de son siège de Kinshasa, de sa
succursale de Lubumbashi, de son réseau d'agences actives dans
l'ensemble du pays et de ses relations internationales
privilégiées ;
V' La Banque Commerciale du Congo s'emploie à
mettre en oeuvre les principes de bonne gouvernance qui visent à
garantir la réputation de la Banque comme partenaire commercial et
opérateur financier fiable et fidèle à ses valeurs
essentielles ;
V' La banque commerciale du Congo veut être une
banque dynamique, créative, tournée vers l'avenir, capable de
jouer son rôle d'opérateur économique et financier de
premier plan, de satisfaire ses actionnaires et de permettre à son
personnel de s'épanouir avec fierté au sein de son entreprise
.
II.4.2. STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA BCDC
L'organisation de la banque commerciale du Congo se
présente de la manière
suivante :
a. Le conseil d'administration
Le conseil d'administration de la banque commerciale du Congo
est un organe de décision ultime, sauf dans les matières que le
droit des sociétés ou les statuts réservent aux
actionnaires dans son processus décisionnel. Le conseil d'administration
de la banque commerciale du Congo vise à la présenté et
succès de ses activités de services financiers. Il estime donc
indispensable de privilégier les rendements financiers à long
terme. Tout en restant attentif aux intérêts des clients de la
banque de ses actionnaires, de son personnel et des communautés au sein
desquelles elle opère.
b. Le comité d'audit et complaisance
Le comité d'audit et complaisance exercent les
contrôles suivants :
? L'intégrité des états financiers et de
communiqués de presse relatifs à la performance financière
de la BCDC ;
? De la qualité du processus d'audit externe ;
? La finalité du processus d'audit interne (tous les
cinq ans ou moins. le comité d'audit et complaisance organise une
évaluation externe de finalité et participe à la
nomination ou la révocation de l'auditeur général ;
[29]
· La finalité du système de contrôle
interne en générale , et en particulier du système de
gestion des risques de procédures de contrôle de conformité
aux lois aux règlements et aux principes de bonne conduite des affaires
à la BCDC chaque année, le comité d'audit et complaisance
passe en revue les évaluations de la finalité du contrôle
interne réalisées par le management , le « rapport
complaisance » soumis par le complaisance office . Ainsi que les rapports
sur les pratiques potentiellement douteuses signalés au système
d'alerte interne de la BCDC. Le comité d'audit complainte offices.
En outre, le comité d'audit et complaisance :
· Vérifie les informations publiées dans
l'annuel sur le contrôle interne et sur les activités du
comité d'audit et complaisance ;
· Accomplit toute mission liée au contrôle
interne à l'audit interne ou externe que le conseil d'administration ou
le président peut lui assigner.
Le comité d'audit et complaisance se composent
actuellement de cinq administrateurs non exécutifs. Son président
et les membres désignés par le conseil d'administration.
c. Le comité de direction
Le rôle du comité de direction consiste à
gérer la BCDC dans le respect des valeurs des stratégies, des
politiques, des plans et de budgets arrêtés par le conseil
d'administration.
Dans l'exercice de ce rôle, le comité de
direction est responsable du respect du cadre juridique et réglementaire
qui s'applique à la BCDC.
Dans la composition actuelle du comité de direction,
seul l'administrateur délégué est membre du conseil
d'administration. Il préside, organise commande contrôle et dirige
; Il assume vis-à-vis du conseil d'administration, la
responsabilité de l'exercice par le comité de direction de ces
pouvoirs.
Le conseil d'administration nome les membres du comité
de direction sur base d'une proposition formulée par l'administrateur
délégué en concertation avec le président.
La BCDC/Kananga comprend cinq directions, à savoir :
· La direction des risques ;
· La direction commerciale ;
· La direction retail et personnal banking ;
· La direction de l'exploitation ;
· La direction finances et comptabilité.
[30]
1) LA DIRECTION DES RISQUES
La gestion risque constitue un des aspects essentiels des
activités de la BCDC et exerce un impact sur tous les domaines
stratégiques pour garantir les risques auxquels ces activités
sont exposées, le suivi et la maîtrise. La BCDC s'est dotée
d'une structure organisationnelle de gestion et de contrôle des
risques
? Département Risk Management and
Compliance
Il vérifie la mise en place des systèmes et
procédures permettant d'identifier, de contrôler et de signaler
les principaux risques notamment :
· Les risques opérationnels ;
· Les risques d'intégrité ;
· Les risques de liquidité ;
· Les risques du marché.
? Département Contrôle Interne
Processus mis en place par le conseil d'administration, la
direction et autres membres du personnel en vue de fournir des assurances
raisonnables en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la
banque dans les domaines de :
· L'efficacité et la sécurité des
opérations ;
· Protection du patrimoine et des personnes ;
· Fiabilité, exhaustivité et
disponibilité des informations ;
· Conformité aux normes et usages professionnels
et déontologiques, aux plans, procédures et politiques
générales de la banque.
? Département Crédits
Il a pour mission d'assurer la maîtrise de tous les
risques de crédit inhérent aux activités de la banque et
ce dans un cadre d'éthique professionnelle.
2) LA DIRECTION COMMERCIALE
Avec la mise en place de la direction Retail and Personal
Banking, la direction commerciale peut efficacement concentrer ses efforts sur
ses clients de base à savoir :
· Les grandes entreprises ;
· Les institutions ;
· Les banques commerciales ;
· Les entreprises publiques ;
· La gestion des fonds internationaux.
[31]
3) LA DIRECTION RETAIL ET PERSONNAL BANKING
L'activité Retail and Personal Banking répond
à une logique de segmentation bien ciblée en faveur d'une
clientèle des particuliers, des salariés et également des
PME dont la taille ne justifie pas le recours au service de Corporate
Banking.
4) LA DIRECTION DE L'EXPLOITATION
Les chantiers prioritaires du développement portent sur
:
· Le service clientèle et opérations locales
(SCOL) ;
· Le service opérations internationales (OPI) ;
· Service sur mesure aux grandes entreprises (à
Kinshasa).
5) LA DIRECTION FINANCES ET COMPTABILITÉ
Elle a pour mission :
· La surveillance des comptes internes et l'analyse des
relevés périodiques ;
· L'assainissement de la situation comptable de la
banque ;
· La réduction de la durée et du volume
des suspens dans des comptes internes ;
· La maîtrise des imputations comptables des
opérations par les gestionnaires ;
· La réalisation d'autres travaux spéciaux
et ponctuels.
II.4.3. LES VALEURS DE LA BCDC
Les valeurs de la banque commerciale du Congo sont les
suivantes :
· La banque commerciale du Congo occupe une place
prépondérante sur son marché et offre un éventail
complet de services financiers pour les particuliers, les entreprises, les
investisseurs institutionnels et le secteur public ;
· La banque commerciale du Congo veut ETRE
incontestée dans le secteur bancaire ;
· La banque commerciale du Congo est une entreprise qui
vise à offrir à la fois la stabilité et
flexibilité, solidarité et novateur
· Elle est solide : fiable et durable ;
· Elle est novateur : s'améliore et se
différencie sans cesse ;
[32]
? Elle est directe : tenir un discours limpide
et mener une action nette ;
La démarche éthique de La banque commerciale du
Congo recouvre un ensemble de valeurs essentielles intégrité,
loyauté, objectivité, confidentialité, franchise et
honnêteté.
CAISSIER MIXTE
CDF, M.E
BUREAU D'ECHANGE
CAISSIER MIXTE
COMPTEUR DE
CAISSE
PREPOSE
SOURCE : SECRETARIAT DE LA BCDC/AGENCE DE
KANANGA
[33]
II.5. ORGANIGRAMME DE LA BCDC/KANANGA
1 CHEF D'AGENCE
CHEF D'AGENCE
ADJOINT
COMPTABILITE
CELLULE
INFOR.
ET
TELECOM
CAISSIER PRINCIPAL
CDF et M.E
OPERATEUR W.U.
SCOL. OPI.
CORRESPONDANCE
ECI
LEGENDE
CDF : Francs Congolais M.E. :
Monnaie étrangère
OPI : Opérations
Internationales
SCOL : Service clientèle et
opérations locales
W.U. : Western Union
ECI : Entité contrôle interne
|
|
[34]
CHAPITRE TROISIEME
APPORT DES CREDITS BANCAIRES DANS L'EXPANSION
DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Le présent chapitre qui est même le dernier de
notre travail, traduit les résultats de notre recherche surtout dans son
volet des données chiffrées. Nous présentons dans ce
chapitre l'intégralité de toutes les données
récoltées sur terrain. C'est-à-dire le volume des
crédits accordés par la BCDC/Agence de Kananga aux Petites et
Moyennes Entreprises de la place en vue de booster leur expansion.
Ce chapitre est subdivisé en deux grands points : la
présentation des données et l'analyse des données.
Après suivront nos critiques et suggestions avant d'atterrir par la
conclusion générale de notre travail.
III.1. PRESENTATION DES DONNEES
Les données dont nous présentons sur ce premier
point sont telles que reçues à la Banque Commerciale du Congo
(BCDC/Agence de Kananga) et elles n'ont subi aucune modification de notre
part.
Nous présentons ici, l'intégralité des
crédits octroyés par la Banque Commerciale du Congo/Agence de
Kananga aux petites et moyennes entreprises sans aucune modification
supplémentaire.
La BCDC/Kananga a, au cours de nos trois années
sous-étude (2017, 2018 et 2019) octroyé un crédit de
l'ordre de 7.106.010$ USD (Sept millions cent et six milles dix dollars
Américains) aux petites et moyennes entreprises du Kasaï
Central.
Ce montant (7.106.010$ USD) octroyé par la
BCDC/Kananga est la somme totale de toutes les trois années de notre
étude. Vous trouverez ci-dessous (dans les tableaux), la
répartition annuelle et mensuelle de ce crédit octroyé par
la BCDC/Kananga aux PME de la place.
[35]
Tableau N°1 : Présentation des
crédits octroyés par la BCDC/Agence de Kananga aux PME du
Kasaï Central en 2017. (Montants exprimés en Dollars
Américains)
Crédits
Périodes
|
Crédits en USD
|
Janvier
|
177.430
|
Février
|
200.000
|
Mars
|
100.000
|
Avril
|
250.000
|
Mai
|
123.570
|
Juin
|
50.000
|
Juillet
|
200.000
|
Aout
|
300.000
|
Septembre
|
150.000
|
Octobre
|
150.000
|
Novembre
|
200.000
|
Décembre
|
228.170
|
TOTAL
|
2.129.170
|
|
Source : BCDC/Agence de Kananga, Service caisse principale.
[36]
Tableau N°2 : Présentation des
crédits octroyés par la BCDC/Agence de Kananga aux PME du
Kasaï Central en 2018. (Montants exprimés en Dollars
Américains)
Crédits
Périodes
|
Crédits en USD
|
Janvier
|
300.000
|
Février
|
400.000
|
Mars
|
105.710
|
Avril
|
100.000
|
Mai
|
150.000
|
Juin
|
150.000
|
Juillet
|
205.250
|
Aout
|
100.000
|
Septembre
|
295.750
|
Octobre
|
150.000
|
Novembre
|
194.290
|
Décembre
|
180.495
|
TOTAL
|
2.331.495
|
|
Source : BCDC/Agence de Kananga, Service caisse principale.
[37]
Tableau N°3 : Présentation des
crédits octroyés par la BCDC/Agence de Kananga aux PME du
Kasaï Central en 2019. (Montants exprimés en Dollars
Américains)
Crédits
Périodes
|
Crédits en USD
|
Janvier
|
280.000
|
Février
|
100.000
|
Mars
|
150.000
|
Avril
|
279.560
|
Mai
|
50.000
|
Juin
|
120.000
|
Juillet
|
220.440
|
Aout
|
180.000
|
Septembre
|
725.345
|
Octobre
|
100.000
|
Novembre
|
320.000
|
Décembre
|
120.000
|
TOTAL
|
2.645.345
|
|
Source : BCDC/Agence de Kananga, Service caisse principale.
[38]
Tableau N°4 : Synthèse des
crédits octroyés par la BCDC/Agence de Kananga aux PME du
Kasaï Central de 2017 à 2019
Crédits
Périodes
|
Crédits en USD
|
2017
|
|
2.129.170
|
2018
|
|
2.331.495
|
2019
|
|
2.645.345
|
|
TOTAL
|
7.106.010
|
|
Source : BCDC/Agence de Kananga, Service caisse principale.
[39]
III.2. ANALYSE DES DONNEES
Sur ce point, nous avons traité les données
récoltées au cours de notre étude à la Banque
Commerciale du Congo avec une seule différence par rapport aux
données présentées dans le point précédent.
Ci-dessous, nous allons démontré en fonction de pourcentage, le
volume des crédits accordés par la BCDC aux PME du Kasaï
Central et certaines variations par rapport au volume octroyé
mensuellement. Cette même analyse est représentée sous
forme graphique (année par année et mois par mois) pour faire
voir de façon claire, la répartition annuelle des crédits
octroyés année/année.
Tableau N°5 : Analyse des
crédits octroyés par la BCDC/Agence de Kananga aux PME du
Kasaï Central en 2017
Crédits
Périodes
|
Crédits en USD
|
%
|
Janvier
|
177.430
|
8,33
|
Février
|
200.000
|
9,39
|
Mars
|
100.000
|
4,69
|
Avril
|
250.000
|
11,74
|
Mai
|
123.570
|
5,80
|
Juin
|
50.000
|
2,34
|
Juillet
|
200.000
|
9,39
|
Aout
|
300.000
|
14
|
Septembre
|
150.000
|
7
|
Octobre
|
150.000
|
7
|
Novembre
|
200.000
|
9,39
|
Décembre
|
228.170
|
10,71
|
TOTAL
|
2.129.170
|
100
|
|
Source : Nous-même à partir des
données du tableau N°1.
[40]
Graphique N°1 : Présentation des
crédits octroyés par la BCDC/Kananga en 2017 en Pourcentage.
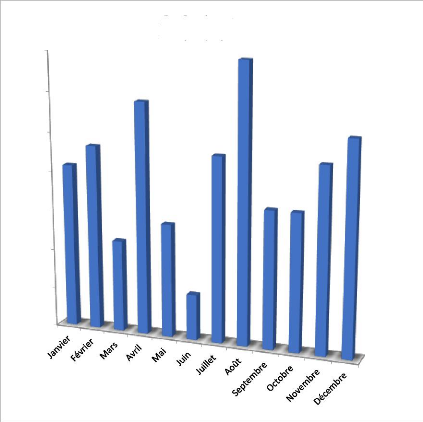
14
12
10
8
6
4
2
0
2017
Source : Nous-même à partir des
données du tableau N°5.
COMMENTAIRE : Les données de ce
tableau montrent qu'au cours de l'année 2017, la BCDC/Kananga a
octroyé les crédits de l'ordre de 2.129.170 USD repartis en 12
mois. Et c'est au mois d'aout qu'il y a eu l'octroi des crédits
supérieurs par rapport à d'autres mois en fonctions des
activités y relatives. Le mois de Septembre et celui d'Octobre ont quant
à eux le nombre égal des crédits octroyés et le
mois de Juin a un montant inférieur par rapport aux autres mois, ces
dents de scie sont dues aux besoins des différentes entreprises, car on
n'accorde pas le crédit hasardement, mais plutôt lorsque la
demande se fait sentir pas les entreprises qui sont en besoin de
financement.
[41]
Tableau N°6 : Analyse des crédits
octroyés par la BCDC/Agence de Kananga aux PME du Kasaï Central en
2018
Crédits
Périodes
|
Crédits en USD
|
%
|
Janvier
|
300.000
|
12,9
|
Février
|
400.000
|
17,1
|
Mars
|
105.710
|
4,53
|
Avril
|
100.000
|
4,28
|
Mai
|
150.000
|
6,44
|
Juin
|
150.000
|
6,44
|
Juillet
|
205.250
|
8,8
|
Aout
|
100.000
|
4,28
|
Septembre
|
295.750
|
12,6
|
Octobre
|
150.000
|
6,44
|
Novembre
|
194.290
|
8,33
|
Décembre
|
180.495
|
7,74
|
TOTAL
|
2.331.4 95
|
100
|
|
Source : Nous-même à partir des
données du tableau N°2.
[42]
Graphique N°2 : Présentation des
crédits octroyés par la BCDC/Kananga en 2018 en Pourcentage.
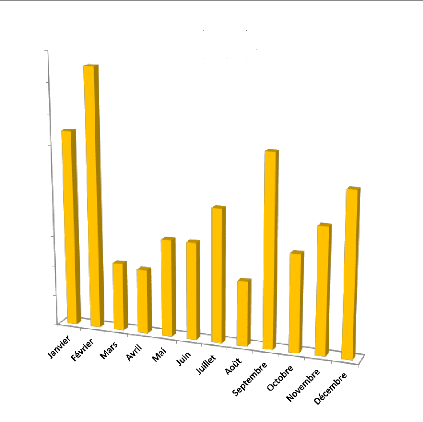
18 2018
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Source : Nous même en fonction des
données du tableau N°2.
COMMENTAIRE : Ces données prouvent
que les crédits octroyés par la BCDC/Kga au cours de
l'année 2018 sont supérieurs à ceux de 2017 par
l'écart de 202.325USD soit 2,37% et le crédit élevé
a été octroyé au mois de Février alors que celui
très faible a été octroyé au mois d'avril.
[43]
Tableau N°7 : Analyse des crédits
octroyés par la BCDC/Agence de Kananga aux PME du Kasaï Central en
2019
Crédits
Périodes
|
Crédits en USD
|
%
|
Janvier
|
280.000
|
10,5
8
|
Février
|
100.000
|
3,78
|
Mars
|
150.000
|
5,67
|
Avril
|
279.560
|
10,5
6
|
Mai
|
50.000
|
1,89
|
Juin
|
120.000
|
4,53
|
Juillet
|
220.440
|
8,33
|
Aout
|
180.000
|
6,80
|
Septembre
|
725.345
|
27,4
1
|
Octobre
|
100.000
|
3,78
|
Novembre
|
320.000
|
12
|
Décembre
|
120.000
|
4,53
|
TOTAL
|
2.645.3 45
|
100
|
|
Source : Nous-mêmes à partir des
données du tableau N°3.
[44]
Graphique N°3 : Présentation des
crédits octroyés par la BCDC/Kananga en 2019 en Pourcentage.
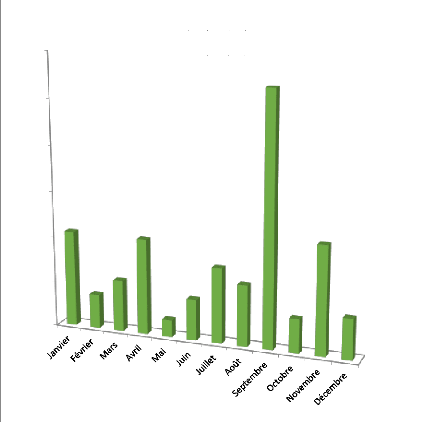
30 2019
25
20
15
10
5
0
Source : Nous-mêmes à partir des
données du tableau N°3.
COMMENTAIRE : Au cours de l'année
2019, la BCDC/Kananga a octroyé un crédit élevé au
mois de Septembre revenant à l'ordre de 725.345USD, soit 27,41% montant
qui s'avère supérieur par rapport à d'autres mois et le
crédit faible a été octroyé au mois de mai par
manque de beaucoup d'activités commerciales.
[45]
Tableau N°8 : Analyse des crédits
octroyés par la BCDC/Agence de Kananga aux PME du Kasaï Central de
2017 à 2019
Crédits
Périodes
|
Crédits en USD
|
%
|
2017
|
2.129.170
|
29,96
|
2018
|
2.331.495
|
32,8
|
2019
|
2.645.345
|
37,22
|
TOTAL
|
7.106.010
|
100
|
|
Source : Nous-mêmes à partir des
données du tableau N°4.
Graphique N°4 : Présentation de
tous les crédits octroyés par la BCDC/Kananga de 2017 à
2019 en pourcentage.
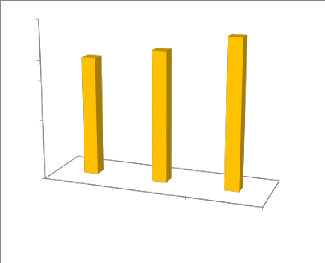
2017, 2018 et 2019
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2017
2018
2019
Source : Nous-mêmes à partir des
données du tableau N°4.
[46]
A la lumière de ce qui précède, nous
l'avons dit ci-haut et redisons encore que la Banque Commerciale du Congo
(BCDC/Kga) a, au cours de ces trois années sous-études (2017,
2018 et 2019) octroyé aux PME du Kasaï Central un crédit de
l'ordre de 7.106.010 $ USD (Sept millions cent et six milles dix dollars
américains).
En rapport avec les données du tableau N°8, il
nous revient à éclairer que durant toutes les années
sous-étude, le crédit octroyé par la BCDC/Kga aux PME du
Kasaï Central en 2019 est supérieur aux autres années soit
un montant de l'ordre de 2.645.345$ avec un écart de 313.850$ par
rapport à l'année 2018 soit 4,41% de supériorité et
516.175$ par rapport à l'année 2017 soit 7,26% de
supériorité entre 2017 et 2019. Cela est dû au manque
d'activités commerciales régulières dans la province en
2017 et 2018 suite aux évènements malheureux de triste
mémoire causés par le mouvement insurrectionnel KAMUINA NSAPU
dans la province du Kasaï central pendant ces deux années de la
présente étude. C'est ce qui a favorisé cet écart
entre nos trois années sous-étude et marqué ainsi la
différence entre 2019 et les deux précédentes
années.
[47]
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
L'oeuvre humaine n'a jamais été parfaite.
Certaines erreurs, omissions et imperfections nécessitent des mesures
appropriées afin qu'elles n'entravent pas la bonne marche de
l'organisation mise en place ; la Banque Commerciale du Congo (BCDC/Kananga)
n'en fait pas exception.
1. CRITIQUES
Nous n'avons pas beaucoup des remarques à formuler
vis-à-vis de la Banque Commerciale du Congo (BCDC/Kananga).
Néanmoins, notre profond regret en premier lieu porte sur la non
considération des chercheurs dans cet établissement. A en croire,
ce grand établissement qu'est la BCDC/Kananga n'est pas organisé
en matière de réception et d'encadrement des chercheurs ; encore
moins à la livraison des données recherchées par ces
derniers. Nos données à la BCDC/Kananga ont été
recueillies avec beaucoup des souffrances.
Dans cette perspective, nos appréciations
négatives à l'égard de la BCDC/KGA se formulent en ces
termes :
· La BCDC/KGA ne considère pas tellement les
chercheurs ;
· Elle n'a pas une bonne politique d'octroi des
crédits ;
· Elle ne mobilise pas les PME du Kasaï Central
à l'épargne pour que ces dernières soient redevables ;
· Plus surtout, la BCDC/KGA ne sensibilise pas les
opérateurs économiques et sociaux sur l'importance de la
sollicitation des crédits et ne donne pas aux PME membres les
connaissances techniques nécessaires.
2. SUGGESTIONS
Pour toutes les faiblesses qui rongent cet
établissement des crédits, nous suggérons ce qui suit :
· Considérer valablement les chercheurs :
étudiants, stagiaires et tant d'autres, car ce sont eux qui, à
travers leur recherche, feront beaucoup connaitre votre établissement
à la face du monde ;
· La Banque Commerciale du Congo (BCDC/Kananga) doit
revoir sa politique d'octroi des crédits car l'impact d'une banque
commerciale dépende de la gestion des crédits tels que les
capital emprunté, le taux d'intérêt et le mode de
remboursement ;
· Elle doit mobiliser les Petites et Moyennes
Entreprises (PME) membres à épargner plus pour permettre à
la Banque Commerciale
[48]
du Congo (BCDC/Kananga) d'octroyer les crédits ; ceci
conduira les PME à booster l'économie du Kasaï Central ;
? Elle doit sensibiliser les opérateurs économiques
et sociaux sur l'importance de la sollicitation du crédit ;
? Elle doit enfin donner aux membres les connaissances techniques
nécessaires.
[49]
CONCLUSION GENERALE
Nous voici arrivé à la fin de notre travail de
fin de cycle qui porte sur : « l'Apport des crédits
bancaires dans l'expansion des Petites et moyennes Entreprises. Cas de la
Banque Commerciale du Congo (BCDC/Agence de Kananga) de 2017 à 2019.
Tout au long de ce travail, notre souci était de savoir les
crédits que la BCDC/Kananga a octroyé aux Petites et Moyennes
Entreprises de la place pour booster rationnellement l'économie du
Kasaï Central.
Pour y parvenir, nous avons subdivisé ce travail en
trois chapitres comprenant chacun des points et des sous-points avant
d'atterrir par nos critiques et suggestions ainsi que la conclusion
générale.
Le premier chapitre est basé sur l'approche
conceptuelle. Il comprend deux grands points : le premier est consacré
aux notions sur les entreprises et le deuxième point consacré aux
notions sur les banques et les institutions bancaires.
Le deuxième chapitre concerne la présentation du
cadre de notre étude qui est la Banque Commerciale du Congo
(BCDC/Kananga). Dans ce chapitre, nous avons présenté cet
établissement, son repère historique, sa situation
géographique, son statut juridique, sa structure fonctionnelle ainsi que
son organigramme.
Et notre troisième chapitre est basé sur
l'apport des crédits bancaires dans l'expansion des petites et moyennes
entreprises. C'est le fondement même de notre étude. Il comprend
deux points : la présentation des données et l'analyse des
données.
La problématique de notre étude était de
savoir quel est l'apport des crédits bancaires dans l'expansion des PME
du Kasaï central ? En d'autres termes, est-ce que les crédits
bancaires octroyés par la Banque Commerciale du Congo (BCDC/Kananga)
permettent-ils l'expansion des PME du Kasaï Central ?
Nos hypothèses du départ étaient
formulées en ces termes : Les crédits bancaires auraient un
apport significatif au cas où ils favorisent l'expansion des petites et
moyennes entreprises dans leur accroissement des activités et si ceux-ci
(les crédits) sont accordés par la BCDC/Kananga poussant ainsi
aux PME de maintenir en équilibre dans leur production, car le
crédit en économie est comparable à l'huile au moteur
où trop d'huile fait griffer le mécanisme et peu d'huile entrave
ce dernier, c'est pourquoi le crédit doit être
équilibré. Donc l'octroi des crédits par la BCDC aurait un
apport significatif au cas où ils favoriseraient l'expansion des petites
et moyennes entreprises du Kasaï Central.
Tout au long de ce travail, les méthodes analytique et
statistique ainsi que les techniques documentaires et d'interview ont
été utilisées afin de récolter les données
et vérifier nos hypothèses du départ.
Après analyse et traitement des données, nos
hypothèses ont été confirmées , car les
crédits bancaires octroyés par la Banque Commerciale du Congo
(BCDC/Kananga) ont un apport significatif parce qu'ils permettent l'expansion
des
[50]
PME et les permettent également de maintenir leurs
activités en équilibre. C'est pourquoi, nous sommes arrivé
aux s résultats suivants : le crédit octroyé par la
BCDC/KGA aux PME du Kasaï Central en 2019 est supérieur aux autres
années de notre étude soit un montant de l'ordre de 2.645.345$
avec un écart de 313.850$ par rapport à l'année 2018 soit
4,41% de supériorité et 516.175$ par rapport à
l'année 2017 soit 7,26% de supériorité entre 2017 et 2019.
Cela est dû au manque d'activités commerciales
régulières dans la province en 2017 et 2018 suite aux
évènements malheureux de triste mémoire causés par
le mouvement insurrectionnel KAMUINA NSAPU dans la province du Kasaï
central pendant ces deux années de la présente étude.
C'est ce qui a favorisé cet écart entre nos trois années
sous-étude et marqué ainsi la différence entre 2019 et les
deux précédentes années (2018 et 2017).
Tout au long de ce travail, nous avons
révélé certaines difficultés auxquelles la BCDC/KGA
fait face dans l'octroi des crédits ; entre autre : le manque d'une
bonne politique d'octroi des crédits ; elle ne mobilise pas les PME du
Kasaï Central à l'épargne pour que ces dernières
soient redevables ; plus surtout, la BCDC/KGA ne sensibilise pas les
opérateurs économiques et sociaux sur l'importance de la
sollicitation des crédits et ne donne pas aux PME membres les
connaissances techniques nécessaires. Pour pallier à ces
difficultés, nous avons suggéré ce qui suit : la Banque
Commerciale du Congo (BCDC/Kananga) doit revoir sa politique d'octroi des
crédits car l'impact d'une banque commerciale dépende de la
gestion des crédits tels que les capital emprunté, le taux
d'intérêt et le mode de remboursement ; elle doit mobiliser les
Petites et Moyennes Entreprises (PME) membres à épargner plus
pour permettre à cette dernière d'octroyer les crédits ;
ceci conduira les PME à booster l'économie du Kasaï Central
; elle doit sensibiliser les opérateurs économiques et sociaux
sur l'importance de la sollicitation du crédit ; elle doit enfin donner
aux membres les connaissances techniques nécessaires.
Somme toute, la question des banques et des PME a
déjà été au coeur des plusieurs
préoccupations par certains auteurs avant nous, nous n'avons pas la
prétention d'avoir apporté ici, ce qui n'a jamais
été dit ou jamais entendu ; Néanmoins, nous contribuons
avec une pierre à cet édifice en construction qu'est la
science.
[51]
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. MUAYILA KABIBU Henri ; Méthodologie de recherche
en Sciences
Economiques et de Gestion, Maison Beni Collection,
Kinshasa, RDC, 2015 ;
2. Annette BUISSON, Littératures
étrangères et francophones, Edition DALLOZ, Paris, France,
2006 ;
3. PERROUX, F., L'Economie du XXème siècle,
2ème édition, PUF, Paris, France, 1965 ;
4. Colin CLARK ; Théorie du développement
économique, 2ème édition, Paris, France, 1976 ;
5. MESSEGHEN K. et TORRES O., Entrepreneuriat et PME,
Paris, France, 2015 ;
6. KHODJA M., Gestion des Entreprises, 2ème
année LMD, Paris, France, 2017 ;
7. PETIT DU TALLIS G., Les crédits et les
Banques, Sirey, Paris, France, 1964.
8. NTUMBA NGANDU ; Guide de rédaction d'un travail
scientifique, ISP/KGA, CREDOP, KANANGA, 2008.
II. NOTES DES COURS
1. BULAMBA NYAMI Damien ; Notes du Cours de Théories
générales de Management ; G2 SEG, UNIKAN, 2018-2019,
Inédit.
2. MBAMBI MUTAMBA Jean-Paul ; Notes du Cours d'Economie
monétaire générale, G3 SEG, UNIKAN, 2019 - 2020,
Inédit.
3. NSABUA TSHIABUKOLE Joseph ; Notes du Cours de Méthodes
de recherche en Sciences sociales, G2 SEG, UNIKAN, 2018 - 2019,
Inédit.
III. TFC ET MEMOIRES
1. YUMBA WAKUNGELANI Patient ; Gestion des risques des
crédits dans les banques commerciales ; Mémoire de fin
d'études, UNILU, SEG, 2016, Inédit.
2. YETA BALUTUDI Princesse ; Apport des PME au
développement socio-économique de la RDC ; Travail de fin de
cycle, UNIKIN, SEG, 2018, Inédit.
3. MAYAVANGUA DIKONDO Eric ; contribution d'une banque
commerciale au développement socio-économique de la RDC ; Travail
de fin de cycle, Université Libre de Kinshasa, SEG, 2007,
Inédit.
[52]
TABLE DES MATIERES
0. INTRODUCTION GENERALE 1
0.1. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6
0.2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 8
0.3. ETAT DE LA QUESTION 9
0.4. METHODES ET TECHNIQUES 10
0.5. DELIMITATION DU SUJET 11
0.6. PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL 12
CHAPITRE I : APPROCHE CONCEPTUELLE 13
I.1. NOTIONS SUR LES ENTREPRISES 13
I.1.1. DEFINITION DE L'ENTREPRISE 13
I.1.2. LES PRODUITS DE L'ENTREPRISE 14
I.1.3. SORTES ET CLASSIFICATION DES ENTREPRISES() 15
I.1.4. OBJECIFS, ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L'ENTREPRISE
16
I.2. NOTIONS SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS BANCAIRES
18
I.2.1. CREATION ET FONCTIONNEMENT DES BANQUES ET INSTITUTIONS
FINANCIERES 18
I.2.2. LES INSTITUTIONS FINANCIERES 19
2.3. ROLE DES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES 23
CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE D'ETUDE
25
II.1. SITUATION HISTORIQUE DE LA BCDC 25
II.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA BCDC/KANANGA 26
II.3. STATUT JURIDIQUE 27
II.4. OBJECTIFS ET STRUCTURE FONCTIONNELLE DE LA BCDC 27
II.5. ORGANIGRAMME DE LA BCDC/KANANGA 33
CHAP. III :
PPORT DES CREDITS BANCAIRES DANS L'EXPANSION DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 34
III.1. PRESENTATION DES DONNEES 34
III.2. ANALYSE DES DONNEES 39
CRITIQUES ET SUGGESTIONS 46
CONCLUSION GENERALE 49
BIBLOIGRAPHIE 51
TABLE DES MATIERES 52
| 


