|
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
INSTITUT SUPEURIEUR PEDAGOGIQUE DE BUKAVU

ISP/BUKAVU
B.P. 854/BUKAVU
SECTION DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
HISTOIRE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA DANS LA CHEFFERIE
DE LUINDI EN TERRITOIRE DE MWENGA (1930-2019)
DEPARTEMENT D'HISTOIRE-SCIENCES SOCIALES, GESTION DU
PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT
Par MUKAMBA MULUNGULA Alexandre
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du diplôme de Graduat en Pédagogie Appliquée.
Option :Histoire-Sciences Sociales, Gestion du
Patrimoine et
Développement.
Directeur :ASSUMANI KILEMBWE
Théodore
Chef de Travaux
Année Académique 2021-2022
IN
MEMORIAM
Nous gardons une pensée pieuse de nos regrettés
parents, père Mulungula Mwagalwa et mère Mazambi Namukondo
Suzanne, qui nous ont quitté très tôt, alors que nous
comptions encore beaucoup sur leur affection et leur soutien.
EPIGRAPHE
« Le propre de l'homme est de combattre par la loi,
régulièrement, avec la loyauté et la
fidélité. Le propre de la bête est de combattre par la
force et la ruse. »
Nicolas Machiavel, Le Prince, Puf, 1532, Paris,
année ?, P132
Nous dédions ce travail à tous les membres de
notre famille.
REMERCIEMENTS
Ce présent travail, est l'outil des plusieurs apports.
Ainsi, nos remerciements les plus sincères s'adressent-ils :
A l'éternel notre Dieu pour l'amour, sa bonté,
sa miséricorde, sa grâce et ses multiples
bénédictions en notre faveur. « Deus caritas est, Dieu
est amour ».
Nous rendons un hommage particulier au chef des travaux
ASSUMANI Kilembwe Théodore qui a accepté de diriger ce travail
malgré ses multiples charges et fonctions, son dévouement, son
consentement, ses conseils et observation bien constrictifs et avisés
ont été d'une valeur indéniable dans la réalisation
de ce travail. Nous lui resterons à jamais reconnaissants.
Aux autorités académiques de l'ISP/BUKAVU, nous
voyons directement respectivement la section de lettres et sciences humaineset
le département d'histoire qui ont donnés de la saveur à
notre être, nous en restons reconnaissant.
A vous mes frères, soeurs, Mutimanwa Mwagalwa Gentil
Homme, Bulambo Mulungula Christophe, Kika Ishukwe, Milenge Zamukulu
Héritier, Mbilizi Itongwa Réné, Benjamin Mulonda,Balolwa
Mutekulwa Consolatrice, ...
Pour clore ce propos, nous saisissons de cette occasion pour
remercier de tout coeur nos camarades et ami(e)s de lutte : Bahati Nakwana
sylvain, Elias Mutimanwa, Samitamba Mutalwa Jacques, Ngama Faustin, Kasindi
Byabele Pacifique, Bashibalera Dominique, Anita Mulonda, Tumusifu Lucienne,
Ponga Shukrani Lucienne, Nathalie, Kito Milemba, Vérité Watuta,
Bubala Héritier, Justin Kyanza, Milemba Matata, Pasteur Kulimushi
Cihonde Laurent, Wilondja Zihalirhwa, Bahezile Mateso Eliote, Atuliya
Dodo...pour leur esprit de collaboration ;
Que ceux qui ne sont pas cités ici nommément
trouvent l'expression de notre sincère gratitude.
.
MUKAMBA MULUNGULA Alexandre
SIGLES ET ABREVIATIONS
AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la
libération (du Congo/Zaïre)
AG : Administrateur Gestionnaire
APIDE : Appui aux Initiatives de Développement
Intégré
AVSI : Associations des Volontaires de Service
International
BP : Boite Postale
CAMPS/HIA : Centre d'Assistance
Médico-psychologique Hope in Action
CECA : Communauté des églises
Chrétiennes en Afrique
CELPA : Communauté des Églises Libres de
Pentecôte en Afrique
CEPAC : Communauté des Églises de
Pentecôte en Afrique Centrale
CICR : Comité International de la Croix-Rouge
CT : Chef de Travaux
CUB : Centre Universitaire de Bukavu
Ed. : Edition
EP : École Primaire
IRC : International Rescue Committee
ISDR : Institut Supérieur de Développement
Rural
ISP : Institut Supérieur Pédagogique
Km : Kilomètre
ZS : Zone de Santé
PUF : presse universitaire française
USK : Université Simon Kimbangu
CADHOM : Collection d'Action pour la défense de
droit de l'homme
CAPAC : Cellule d'appuis politologique en Afrique
centrale
DES : Diplôme d'étude supérieur
C.IJ : Cours international de justice
CTB : Coopération technique Belge
ONGD : Organisation non gouvernementale de
développement
ONG : organisation non gouvernementale
P : Page
OPCIT : Opera citato
RCD : Rassemblement congolaise pour la
démocratie
SPA : Sciences politiques et Administrative
PAM : Programme Alimentaire Mondial
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
NRC : Norvegian Refugians Concil
RN2 : Route Nationale Numéro Deux
INTRODUCTION GENERALE
Cette introduction générale présente le
choix et l'intérêt du sujet, l'état de la question, la
problématique et les hypothèses, la délimitation du sujet,
la méthodologie utilisée et les sources, les difficultés
rencontrées et la subdivision du travail.
CHOIX ET INTERET DU SUJET
Notre travail s'intitule « Histoire du
groupement de Mukangala dans la chefferie de Luindi en territoire de
Mwenga (1930-2019) ». Le choix d'un sujet n'est pas un fait de
hasard, il dépend de certains paramètres dont
l'intérêt du sujet pour le chercheur, la disponibilité des
sources et l'intérêt scientifique du chercheur. Les facteurs qui
nous ont poussé à porter notre choix sur ce sujet sont surtout
d'ordre scientifique et personnel. En effet, sur le plan scientifique, nous
voulons apporter notre contribution à l'élaboration de l'histoire
des entités politico-administratives de la République
Démocratique du Congo, en général, et celle des Banyindu,
en particulier.
En outre, sur le plan personnel, en notre qualité de
natif du groupement de Mukangala, nous voulons apporter une lumière
nécessaire à la connaissance de cette entité
politico-administrative, car aucun travail scientifique à
caractère historique n'y a jamais été consacré.
ETAT
DE LA QUESTION
L'état de la question est définie comme une
théorie de progrès scientifique qui n'est pas l'oeuvre d'un homme
mais d'une quantité des gens qui réussissent, qui critiquent, qui
ajoutent et élaguent1(*). Pour bien préciser notre sujet d'étude,
nous avons d'abord exploité la littérature existante sur la
chefferie de Lwindi, en général, et sur le groupement de
Mukangala, en particulier. Ainsi, avons-nous exploité les travaux des
auteurs suivants.
Ahadi Lukogo a étudié l'évolution sociale
et économique de la chefferie de Luindi (1996-2015). Il a analysé
comment la population ne cesse de se disperser vers d'autres régions
à cause de divers facteurs dont les conflits de succession au pouvoir
à la tête de la chefferie2(*).
Ambroise Bulambo Katambu a publié un ouvrage
intitulé « Mourir au Kivu : du génocide tutsi aux
massacres dans l'Est du Congo ». Il a étudié les
massacres perpétrés par les forces armées zaïroises
(FAZ) pendant les conflits interétatiques enclenchés en 1993, les
massacres des réfugiées hutu rwandais par l'AFDL et les troupes
du Rwanda, les massacres perpétrés par les miliciens Interahamwe
depuis 1996, les crimes contre l'humanité imputables à l'AFDL et
à ses alliés Rwandais depuis 1998 jusqu'en 2000. Il a
souligné aussi que, depuis le déclanchement des hostilités
en RD Congo en 1996, on a enregistré des violations massives des droits
de l'homme que l'on peut qualifier, selon le cas, des crimes des guerres, des
crimes contre l'humanité, voire des génocides. Toutes ces
violations des droits de l'homme, bien qu'elles constituent une menace
à la paix et à la sécurité internationales,
n'ont jamais été prises au sérieux par la
communauté internationale. Elles sont restées anonymes ;
sans nom malgré le fait que tous ces éléments constitutifs
des crimes des guerres, des crimes contre l'humanité, des
génocides soient réunis. Ainsi, vingt-deux mois après le
déclanchement de la « deuxième
libération », le 02 août 1998, l'on a
dénombré plus d'un million de personnes massacrées, sans
compter le massacre des réfugiés pendant la campagne de l'AFDL et
de l'APR (1996-1997). Il dit enfin que, plus de cent massacres ont
été systématiquement commis au Congo/Zaïre depuis
1996 jusqu'en 2001. Les plus connus sont : le massacre des
réfugiés Hutu rwandais en 1996, de Bukavu et Goma en 1996-1997,
de Kasika le 24 août 1998 et de Makobola en 19993(*).
Bob Kabamba et A. Muholongo Malumalu ont
présenté un ouvrage intitulé « cadastre des
infrastructures : problèmes et recommandations »
où ils ont étudié cette chefferie dans plusieurs aspects
pour essayer d'amener une solution à la crise conflictuelle de
« bwami » et d'autres problèmes de cette chefferie.
Ils ont aussi démontré les problèmes qui se posent dans
cette entité suite au massacre d'août 1998 et aux guerres à
répétition. Et ils ont proposé des recommandations aux
autorités politico-administratives de la RDC dans le but
d'améliorer la situation sociopolitique des habitants de cette
entité4(*).
Chishugi Mastaki Trish, dans son mémoire de licence
à l'ISDR/Bukavu intitulé «Application des
mécanismes de la justice traditionnelle, une alternative pour la
stabilité locale dans la chefferie de Luindi dans le territoire de
Mwenga de 1998-2010 », explique la manière dont la
justice traditionnelle maintenait la stabilité sociale où les
différentes guerres ont eu des effets néfastes sur la vie sociale
et le développement intégral de cette entité
politico-administrative du territoire de Mwenga5(*). Pas clair, à compléter.
Miyali Mubeza Stanislas, dont le travail
s'intitule «Histoire socio-politique de la chefferie de Luindi
(1923-2007) », a exploré les origines des nyindu. Il s'est
appesanti sur l'organisation sociale et politique de ceux-ci pendant les
périodes coloniale et postcoloniale6(*).
Mubuto Kuzindamolo Wasolela a présenté, en 2003,
un mémoire de licence intitulé « dynamique
sociopolitique dans les collectivités-chefferies de Basile, Luindi et
Wamuzimu de 1998 à 2003 ». Le contexte dans lequel il avait
étudié la chefferie de Luindi a beaucoup changé. Son
étude met plus l'accent sur l'aspect purement socio-politique. Les
résultats de son travail ont montré que l'évolution de
cette chefferie jalonnée de conflits, crises et résistances a eu
des conséquences incalculables sur la population et sur l'entité
elle-même. Le chef de la chefferie de Luindi fut assassiné dans
un massacre indescriptible opéré par les forces de l'APR au
compte du RCD/Goma dans sa juridiction7(*).
Mutiki Lutala Jonas a, dans son « Essai sur
l'exercice du pouvoir politique chez les Banyindu dans la
collectivité chefferie de Luindi en territoire de
Mwenga (1976-1977), fait l'analyse de la succession au pouvoir dans la
chefferie de Luindi8(*).
Mwavita Kishago montre, dans son mémoire de
licence en Développement rural qui porte sur les effets des guerres
sur l'environnement naturel de la chefferie de Luindi en territoire de
Mwenga, comment les guerres qu'a connues la chefferie de Luindi ont
détruit le tissu économique de cette entité. Et pour
survivre, la population s'est livrée aux activités de fabrication
de la braise et de la scierie jugées plus bénéfiques que
celles de champs qualifiées de moins rentables par cette population
meurtrie par les guerres9(*).
Wilondja Mwati a travaillé
sur « les incidences socio-culturelles de la
déscolarisation des jeunes filles âgées de 6 à 17
ans dans le groupement d'Ihanga en chefferie de Luindi (2006-2007) ».
L'auteur analyse la problématique de la déscolarisation des
filles, la dégradation des conditions de vie ayant entrainé la
pauvreté qui a rongé toutes les bases sur lesquelles reposait
l'éducation des enfants, en général, et celle des filles
en, particulier10(*).
Zamukulu Milenge Héritier, dans son travail sur
l'impact des massacres de Kasika sur le développement socio-politique
dans la chefferie de Luindi (1998-2013), a démontré qu'avant
ces massacres, le développement socio-politique de cette entité
se manifestait par un pouvoir coutumier fort et stable, une production agricole
forte accompagnée d'une main-d'oeuvre qualifiée, un
système éducatif et sanitaire efficace et adapté et une
politique gouvernementale stable et forte. Les conséquences
socio-politiques des massacres sont l'affaiblissement du pouvoir coutumier, le
dépeuplement de la chefferie, des pertes en vies humaines, la baisse de
la production essentiellement agricole et commerciale, la dégradation du
système éducatif et sanitaire, l'incendie des maisons, les
pillages, l'abandon des activités champêtres, la
désorganisation du tissu social, l'arrêt du fonctionnement du
poste de santé de Kashindaba, le manque d'enseignants qualifiés
dans les écoles secondaires, l'exode rural, la famine, la malnutrition,
la sous-alimentation, la dégradation de coût de vie,
l'insécurité alimentaire, la rareté des produits, les
arrestations arbitraires et les accusations mutuelles, la fracture sociale et
l'absence de la décentralisation du pouvoir. Bref, le
sous-développement serait le principal effet de ces massacres11(*).
Par rapport aux travaux ci-haut présentés, le
nôtre se distingue par le fait qu'il met l'accent sur l'histoire du
groupement de Mukangala, l'une des entités politico-administratives qui
composent la chefferie de Luindi en territoire de Mwenga
(1930-2019) ».
L'approche diachronique nous permettra de voir les permanences
etles changements intervenus dans l'évolution de ce groupement au cours
de cette longue période d'environ quatre-vingt-neuf ans. Notre objectif
est d'apporter la lumière sur l'histoire de cette entité
politico-administrative à travers les réponses données aux
questions de notre problématique. Cela nous permet de jeter un pont
entre le passé et l'avenir en transmettant aux générations
futures les connaissances sur la manière dont a fonctionné ce
groupement pendant la période sous étude.
PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE
Larousse
définit la problématique comme étant un problème ou
un ensemble des problèmes un peu bien posés par une situation
quelconque et auxquels il faut trouver une solution par la recherche12(*).
La problématique est encore définie comme
l'ensemble des questions que se pose le chercheur avant d'entamer la
recherche13(*).
La population de la chefferie de Luindi est globalement
constituée des Nyindu et des Lega qui sont des peuples Bantu14(*). Les habitants ont
traversé une longue période de paix et de concorde, de
répugnance de la violence en s'attachant à leur culture pacifique
et leurs valeurs culturelles éducationnelles. Malgré les
difficultés que peut soulever l'étude de l'histoire du groupement
de Mukangala dans la chefferie de Luindi en territoire de Mwenga (1930-2019),
il est possible de clarifier les origines, l'évolution et les
difficultés qu'a connues ce groupement en tenant à
répondre aux questions suivantes :
0. Quelles sont les origines du groupement de
Mukangala ?
1. Quelle a été l'évolution de ce
groupement, de 1930 à 2019 ?
2. Quelles sont les difficultés que ce groupement a
connues et ses perceptives
HYPOTHESES
P. Rongere dit que l'hypothèse est comprise comme une
proposition de réponse aux questions que l'on pose à propos de
l'objet de la recherche formulée telle que l'observation et l'analyse
puissent fournir une réponse15(*).
Loka-Ne-Kongo définit l'hypothèse de travail
comme une proposition qui tente d'expliquer les problèmes posés
à partir de l'observation : c'est une idée directe, une
tentative d'explication des faits au début de la recherche
destinée à orienter l'investigation et être maintenue
d'après les résultats de l'analyse16(*). Elle est d'un rôle
important comme guide dans le travail de recherche. Ainsi, avons-nous
formulé les hypothèses ci-après au vu de la
problématique posée ci-dessus.
1. Les origines du groupement de Mukangala sont à
situer au cours de l'année 1912.
2. Ce groupement a connu, au cours de son histoire, une
organisation administrative bien structurée et
hiérarchisée de la base au sommet, du niveau des villages
à celui du groupement. Son évolution a été
marquée par des hauts et des bas, des défis liés à
des conflits du pouvoir coutumier et fonciers.
3. Les difficultés que rencontre le groupement de
Mukangala sont d'ordre économique, social, politique et culturel
s'inscrivant dans les grandes lignes de celles de la chefferie de Luindi, mais
avec quelques spécificités locales. Dans ses perspectives figure
la gestion de conflits par les autorités compétentes en ramenant
ensemble les deux parties protagonistes.
0.5.
DELIMITATION DU SUJET
Tout travail d'Histoire doit être délimité
au moins sur le plan temporel et spatial pour sa clarté et sa
faisabilité.
0.5.1. DELIMITATION CHRONOLOGIQUE
Notre étude s'étend sur
la période allant de 1930 à 2019.
L'année 1930, que nous avons considérée comme terminus
a quo a été marquée par la création du
groupement sous étude pendant la période coloniale et par sa
reconnaissance officielle par le colonisateur. L'année 2019, prise pour
terminus ad quem, est inscrite dans les annales politiques du
groupement de Mukangala en ce sens qu'il a connu pour la première fois
la visite d'un gouverneur de province du Sud-Kivu, en la personne de monsieur
Théo Ngwabidje Kasi, pour la confirmation du premier cas en province de
la maladie à virus d'Ebola détecté à Kasika.
0.5.2. DELIMITATION SPATIALE
Le groupement de Mukangala est situé dans la chefferie
de Luindi, en territoire de Mwenga, à cent kilomètres du
chef-lieu de la province du Sud-Kivu, sur la route nationale n° 2,
Bukavu-Kamituga-Kindu, en République Démocratique du Congo.
0.6. METHODES, TECHNIQUES ET SOURCES
La valeur d'un travail scientifique tient à la
qualité de la méthodologie et de sources utilisées.
0.5.1. METHODES
Nos seules connaissances, quelles qu'elles soient ne
suffiraient pas pour produire un travail qui se veut scientifique. Nous avons
dû, pour mener cette recherche à bon port, recourir à une
méthodologie fondée sur les méthodes historique et
comparative, les techniques et les sources.
La
méthode historique
Elle est fondée sur l'évolution des faits et des
phénomènes, des situations et des évènements avec
ses deux approches : approche génétique et approche
diachronique.
L'approche génétique explique les faits par
leurs antécédents, leurs causes. Elle nous a permis de remonter
aux mythes et légendes des origines de la population de Mukangala, aux
causes de différentes guerres et rébellions vécues dans ce
milieu. Cela nous a amené à établir la relation de causes
à effets des réalités qui ont marqué l'histoire du
groupement de Mukangala pendant la période sous étude17(*).
L'approche diachronique consiste à situer les faits et
les évènements dans leur évolution dans le temps en tenant
compte de l'environnement et de la conjoncture dans lesquels ces faits se sont
passés. Elle dégage les changements et les permanences dans le
cheminement des faits étudiés. Elle nous a aidé à
appréhender l'évolution de l'organisation et du fonctionnement du
groupement de Mukangala sur tous les plans, politique, économique,
social et culturel.
A. La méthode comparative
Pendant la description et l'analyse des faits, la
méthode comparative nous a aidé à les confronter pour
dégager les ressemblances et les différences. Nous avons
comparé l'histoire des habitants de Mukangala sous la colonisation
à celle de la période postcoloniale.
0.5.2. TECHNIQUES
La technique de recherche constitue l'ensemble d'instruments
(moyens matériels) que le chercheur utilise pour conduire ses
investigations. Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé deux
types des techniques : techniques documentaires et techniques vivantes.
Les techniques documentaires nous ont aidé dans
l'exploitation des documents écrits dont les ouvrages, les documents
d'archives, les mémoires et TFC, les articles et même les notes de
cours.
Les techniques vivantes ont consisté en des interviews
avec nos informateurs. Elles nous ont permis de recueillir les données
orales pour compléter et nuancer les renseignements tirés des
documents écrits.
0.5.3. SOURCES UTILISEES
Nous avons utilisé trois types des sources : les
sources orales, les sources écrites et les sources numériques ou
en soft.
S'agissant des sources orales, nous avons interrogé
plusieurs informateurs censés connaître l'histoire du groupement
de Mukangala. Il s'agit du chef de groupement, du chef intérimaire, des
notables et autres sages de Mukangala, des intellectuels ainsi que des paysans.
Pour ce faire, nous avons dû sillonner le groupement de Mukangala et la
chefferie de Luindi.
Quant aux sources écrites, nous avons parcouru des
ouvrages, des documents d'archives, des travaux scientifiques, des revues et
des notes de cours en rapport avec notre sujet de recherche18(*).
0.7. DIFFICULTES RENCONTREES
Toute recherche scientifique rencontre nécessairement
certains obstacles qui, dans certains cas, peuvent handicaper sa
réalisation. En ce qui nous concerne, nous avons connu quelques
difficultés dont les plus importantes sont :
- La résistance de certaines personnes à
répondre à nos questions ;
- L'insuffisance de documents ayant trait à l'objet de
notre recherche dans les bibliothèques de la place ainsi qu'au
Ministère provincial de l'Intérieur.
Pour contourner ces difficultés et dans le souci
d'obtenir les renseignements suffisants, nous avons usé de la patience,
de la persévérance, de la négociation avec nos
enquêtés et de la complémentarité des sources
utilisées.
0.8.
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Ce travail comporte quatre chapitres avec une introduction et
une conclusion générales. Le premier chapitre porte sur les
origines du groupement de Mukangala. Le second chapitre est consacré
à l'organisation du groupement de Mukangala. Le troisième
chapitre examine le
CHAPITRE PREMIER. ORIGINES DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
Dans ce chapitre, nous allons présenter le milieu
physique, car il a fort influencé la mentalité des Nyindu.
Ensuite, nous allons essayer d'émettre quelques hypothèses sur
l'origine politique traditionnelle de Nyindu, Bahofa et la définition
des concepts.
I.1.
PRESENTATION PHYSIQUE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
La présentation du groupement de Mukangala porte
sur sa situation géographique, son relief, son climat, la nature de
son sol, son hydrographie et sa végétation.
I.1.1. Situation géographique
Le groupement de Mukangala est l'un de huit groupements ruraux
qui forment la chefferie de Luindi et dont le chef-lieu porte le nom de
Muhimbili. Sur la carte géographique de la République
Démocratique du Congo, il est situé à l'Est dans la
province du Sud-Kivu, territoire de Mwenga, chefferie de Luindi. Il occupe une
superficie de 109 km² sur l'étendue de la chefferie de Luindi. Il
renferme une population de 12652 habitants, soit une densité de
116habitants/km².
Il est limité :
- Au Nord, par la rivière Zokwe qui le sépare
avec le groupement d'Ihanga ;
- Au Sud, par la rivière Nakachocho qui le
sépare avec le groupement de Kiomvu ;
- A l'Est, par la rivière Nalumbalanga qui forme une
limite naturelle avec le groupement de Kigogo ;
- A l'Ouest, par l'affluent du fleuve Congo, la rivière
Ulindi qui le sépare avec la chefferie de Basile par le groupement de
Balobola19(*).
- *
CARTE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
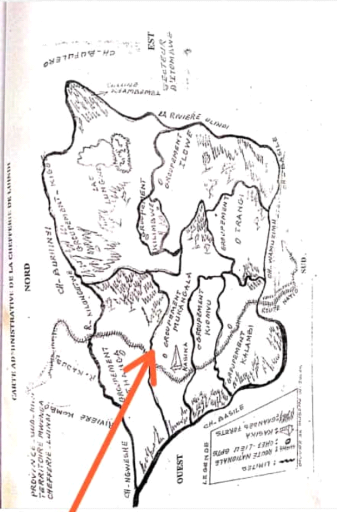
I.1.2. Relief
Le groupement de Mukangala est une région
particulièrement montagneuse. Son relief très accidenté
présente des altitudes fortes élevées dépassant
1000 m. Les points culminants sont : Mukangala, Nakitundu et Karangiro.
Nakitundu est la plus élevée montagne du territoire de Mwenga
avec une altitude de 1500m.
I.1.3. Climat
Le groupement de Mukangala jouit d'un climat de montagne
caractérisé par deux saisons : l'une pluvieuse et longue
variant entre 8 et 10mois dans les régions forestières (Kashaka,
Kwapinga, Mulamba, Kalengesha, Ndola et Mushinga). Et l'autre sèche est
très courte de 4 à 2 mois dans les régions savanes
(Muhimbili, Kidasa, Mukasa, Kahulile et Kikombe).
I.1.4. Végétation
La végétation du groupement de Mukangala est
essentiellement des deux types : la forêt et la savane. A par la
forêt et la savane, il est aussi couvert d'une végétation
des bambous qui poussent dans la localité Kasika /village de de
Matambilunga.
I.1.5. Sol et sous-sol
Le sol du groupement de Mukangala est volcanique, un sol
dérivé des roches granitiques et le sol des plaines alluviales
enrichis par les alluvions dans les vallées de cours d'eau. Pour les
peuples riverains, ces sols leur offrent des avantages pour l'agriculture,
surtout pour les cultures maraîchères et vivrières. Dans
cette entité, on trouve certains minerais comme la cassitérite et
l'or.
I.1.6.Hydrographie
L'hydrographie du groupement de Mukangala est dominée
par des rivières dont les plus importantes en débit sont Ulindi,
Zokwe, Lumetekelo, Nalumbalanga. La rivière Ulindi possède deux
chutes exploitables pour l'installation des centrales hydro-électriques.
Ce groupement possède également des étangs piscicoles.
I.2.
SITUATION DEMOGRAPHIQUE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
Ce point aborde la composition de la population, l'habitat,
les origines et la mise en place de la population du groupement sous
étude.
I.2.1. Population
La façon dont le groupement de Mukangala est
peuplé n'est pas différente de celle d'autres groupements tels
Kalambi, Kilimbwe, Kigogo, Ihanga, Ilowe, Irangi et Kiomvu dans la chefferie de
Luindi en territoire de Mwenga. Ainsi, ce groupement est essentiellement
habité par les ethnies Nyindu (majoritaire) et Lega.
Tableau n°1. Evolution de la population de Mukangala
(1930- 2019)
|
N°
|
Année
|
Habitants
|
|
01
|
1930
|
5235
|
|
02
|
1940
|
6653
|
|
03
|
1950
|
8675
|
|
04
|
1960
|
9782
|
|
05
|
1970
|
10103
|
|
06
|
1980
|
11301
|
|
07
|
1990
|
11953
|
|
08
|
2000
|
853
|
|
09
|
2010
|
7672
|
|
10
|
2019
|
12652
|
Source :rapport annuel de la population de groupement de
mukangala
Commentaire :cette population a connue des
différentes variations face aux circonstances qui a eu la chefferie de
Lwindi en générale et le groupement de Mukangala en particulier
notamment la guerre de la RCD qui a favorisé le massacre de kasika du
24 Août 1998.
Partant de ce tableau, nous constatons que la population du
groupement de Mukangala n'a été multipliée que par 2,4 en
89 ans, en passant de 5 235 habitants en 1930 à 12 652
âmes en 2019. Cette croissance démographique lente s'explique
surtout par le dépeuplement que ce groupement a connu au cours des
années 1998 à 2005, à cause des guerres à
répétition, des massacres du 23 au 24 Août 1998, des
déplacements de la population vers les entités voisines plus ou
moins sécurisées et l'exode rural.
I.2.2. Habitat
Pour Sauvet T., dans le dictionnaire économique et
social, « le logement est en fait le phénomène social
numéro un selon lequel on détermine le niveau de vie des
individus. Un mauvais logement est la source de beaucoup de maux, sa
réalisation est liée à de nombreux facteurs
économiques et sociaux »20(*).
Ainsi donc, ce groupement connait plusieurs types de maisons
à savoir : maisons en planches, en briques cuites dont la plupart
ont été construites par les colons belges et les missionnaires
des églises chrétiennes, et les huttes qui tendent à
disparaitre.
I.2.3. Origines et mise en place des habitants de
Mukangala
Dans ce point, nous expliquons les origines des Nyindu, leurs
migrations et leur installation dans la chefferie de Luindi, en
général, et dans le groupement de Mukangala, en particulier.
Luindi est une chefferie habitée par l'ethnie nyindu semi-bantu
originaire de la cuvette centrale depuis le 14e siècle, selon
les sources orales. Les Nyindu ont d'abord résidé à Mukuju
Naho qui est leur premier site entre Kamituga et Mwenga. Ensuite, ils se
dirigèrent à Kangele (une roche de Rubumba ou Lubumba) au bord de
la rivière Lushiingi (Ulindi) où vivait un certain Muga, un homme
très fort et d'origine bantu. Les Nyindu comptent cinq clans anciens
descendants de Muga Mabondo Muhona Kalungu. Il s'agit de clans : Batumba,
Babulizi, Bashimbi, Banyamuganga et Balambo, Les autres clans sont venus les
rejoindre plus tard, comme celui des Mbula.
La chefferie de Luindi est localisée dans le Territoire
de Mwenga au Sud-Kivu en République démocratique du Congo. Elle
est composée de 8 Groupements: Kilimbwe, Kigogo, Ilowe, Mukangala,
Kihomvu, Kalambi, Ihanga et Irangi. Cette Chefferie était dirigée
par un monarque qui porte le titre de « Mwami Naluindi
Kinyabami », de la dynastie dont découleraient celles d'autres
royaumes du Kivu. Cette appellation vient du nom d'un
« muntu » nommé Kanyindu qui aurait anciennement
vécu dans la cuvette centrale, selon les écrits de Mumbe
Kapingi21(*). Kanyindu
serait le père de Muga Mabondo Muhona Kalungu qui aurait
émigré en suivant le cours du fleuve Congo. Avant
l'arrivée des Blancs, Naluindi dirigeait tout le royaume de Banyindu
dans l'actuelle province du Sud-Kivu. Son royaume s'étendait à
partir de Kilungudwe en chefferie de Burhinyi jusqu'à Mukuju chez le
chef Lubemba-wamuzimu de Kitutu dans l'actuelle chefferie des Wamuzimu,
toujours en territoire de Mwenga22(*).
I.2.4. ORGANISATION DES NYINDU
Dans ce point, nous analysons brièvement l'organisation
politique, économique et socio-culturelle des Nyindu de la chefferie de
Luindi.
ORGANISATION POLITIQUE DES NYINDU
Le pouvoir royal de Luindi est à la fois monarchique et
initiatique. Il remonte aux temps très anciens dans des mythes et
légendes qui tissent ses origines.
A.1.
Origines de la royauté de Luindi
A la tête du royaume de Lwindi, la succession se fait du
père au fils. Le royaume aurait été fondé, selon la
tradition orale, par « Data wa Nyabatwa » venu de Mukuju en
allant à Kalungu pour rendre visite à un certain Nakabumbano. Ce
dernier lui céda, sous la pluie, son trône royal. En ce
moment-là, Data wa Nyabatwa se proclama roi en disant :
« Nyi'tolera bwani bwami », ce qui veut dire
littéralement : « J'ai ramassé mon
royaume ». Ce fut l'origine du royaume des Batumba de Luindi, aux
environs de l'an 1620 ap.J.C. Ceux qui nomment les rois de Luindi sont les
Benenamishungwe kalazambango, une petite lignée des Bashimbi de Luindi.
Ils peuvent être aidés par les Banyamuganga, gardiens des insignes
du pouvoir. Ceux-ci portent le titre de « Bagingi » en
kinyindu, qui veut dire sages en français.
A.2.
Les insignes du pouvoir monarchique de Luindi
L'un des insignes du pouvoir royal à Luindi est
« l'Ishungwe » : la calotte ou chapeau fabriqué
à partir de la peau de léopard ou de lion dans lequel on incruste
un os de chaque ancien roi décédé, des os des animaux
très dangereux comme le lion, le gorille et le léopard. Ce
chapeau n'est pas porté au hasard, car il représente les anciens
chefs morts comme chefs du gouvernement de Luindi, leurs couronnes du royaume.
Ce chapeau était seulement porté par les Batambu ou
chefs de groupements et le mwami ou roi. Chez les Nyindu, si le roi
meurt, la famille régnante des Batumba choisit celui qui mérite
de remplacer le roi défunt, en fait rapport à Nabulizi
qui est l'ainé de la tribu et à Nashimbi pour solliciter
leur accord quant à ce.
A.3.
Les dignitaires du royaume de Luindi
Les dignitaires et détenteurs du pouvoir politique dans
la chefferie de Luindi sont :
1° « Mutambo » : chef coutumier, chef
de groupement ;
2° « Mugula » : chef de
localité, notable ;
3° « Changalume » : militaire ou
policier ;
4° « Mwambali Wa Mwami » : garde
du corps du roi ou valet du mwami ;
Tableau n°2. Entités administratives de la
chefferie de Luindi
|
N°
|
Groupements
|
Habitants
|
Nom du Chef
|
Clan régnant
|
Autres clans du groupement
|
Localités
|
|
1
|
Kalambi
|
7.645
|
Itongwa Kasuli Nakalambi
|
Batumba
|
Bagezi, Balambo, Bashitabyale, Basele et Bashimwenda
|
Kakangala, Itumba, Kalimoto et kalambi
|
|
02
|
Kigogo
|
6.645
|
Baguma Mwati Kigogo
|
Benemutalwa
|
Bashinda, Balambo, Balande, Balizi, Basimbi et Batwa.
|
Muhuzi, Kashindaba, Kadete, Ishungwe, Kadita et Muhembeje
|
|
M
|
Kilimbwe
|
3.561
|
Kabumbanyungu Lusenda
|
Balande
|
Babulinzi, Balambo, Balimbizi, Bamulinda et Batwa
|
Kilimbwe, Matembu, Ishongo, Katembu et Kisogo
|
|
04
|
Kiomvu
|
3.090
|
Kisongo Gaston
|
Bakyoka
|
Balobola, Batumba, Bakyoka, Bagezi et Balimbizi
|
Kiomvu, Ngenga, Lutambi etKalimoto
|
|
05
|
Ihanga
|
2.922
|
Pierre MULINDWA
|
Bahofa
|
Batumba, Bashi, Babulinzi, Bahofa et Bawanda
|
Lukunga, Butongo, Nyakalenge, Kangola, Chowe, Misela,
Kibuti et Malangi
|
|
06
|
Irangi
|
5.868
|
Nyirangi Bulambo Palambibo
|
Banyamuganga
|
Bagezi, Bakyoka, Batumba, Banamuganga et Bashimwenda
|
Kataraka, Ilolo, Ngole, Kabukimba, Kitale, Ilibo et Mulole
|
|
07
|
Ilowe
|
1.183
|
Mulamba Mulate Kilande
|
Balande
|
Balambo, Balande, Bashinda, Banamuganga et Bamulinda
|
Ilowe I , Ilowe II, Nyabaleke et Kishele
|
|
08
|
Mukangala
|
12.652
|
Mwenebatende Nabuhombya Joseph
|
Bahofa
|
Batumba, Balande, Basimbi, Banamuganga, Babulinji, Basele,
Bamulinda et Bahofa
|
Kasika, Pinga, Mulamba (Kalizi), Kipinda, Muhimbili, Pinga,
Mushinga, Kalemba, Kuhulile, Ngendje et Ilemba.
|
|
TOTAL
|
43.566
|
|
|
|
|
Source : Archives administratives de la chefferie de
Luindi,rapport annuel de la chefferie de lwindi , 2019, pp.7-12.
Commentaire : ce tableau établi les
différentes entités administratives de la chefferie de Luindi,
ainsi que ses responsables.
A.4.
Les maisons royales de Luindi
Les maisons importantes dans l'enclos du roi de Luindi sont :
« Ngombe, Isengero; Luhero, Kajumiro ».
a. « Ngombe » : une case où tout le
monde arrive, même les enfants et les femmes.
b. « Isengero »: la maison des
délégués du roi et les chefs de groupements pour donner
leurs rapports relatifs à leur mission.
c. « Luhero » : le logement de visiteurs
amis du roi et des batambo ou chefs de groupements.
d. « Kajumiro » : la maison dans laquelle
on vêtit le roi (Mwami) et dans laquelle sont entreposés tous les
matériels du mwami. Personne n'entrait dans cette maison au hasard, sauf
le roi et les Bagingi, les sages, qui l'ont habillé. Aussi, les
Banyamuganga et les Bashimbi étaient admis d'y entrer.
Le royaume ne donne pas l'héritage à la femme.
La succession est donc du Père au fils. D'où, si le roi meurt
sans laisser l'enfant, on recourtdans une autre famille de la même
lignée royale pour nommer l'autre Roi.
e. « Namushembe, Lushembe » :
- « Namushembe » : c'est un collier
portant la coquille d'un grand escargot.
- « Lushembe » : ce sont des boules
tissées et sur lesquelles sont dessinées plusieurs images du
roi.
Les entités administratives ont des noms
spécifiques dans le parler et la culture des Nyindu. Il s'agit
principalement de :
- « Kaya » : village local ;
- « Twaya » : groupement ;
- « Kihugo » : chefferie, territoire,
province ou pays ;
- « Kibhaja » : continent ou monde.
ORGANISATION SOCIALE
Sur le plan social, les Nyindu sont organisés en
familles et en clans qui constituent leur ethnie. Ils ont une culture composite
compte tenu de la position de leur chefferie au carrefour de différentes
cultures auxquelles ils ont fait d'importants emprunts : les Lega, les
Shi, les Fuliru et les Bembe.
B.1. Généalogie des clans nyindu
Les clans nyindu trouvent leur origine dans l'ancêtre
commun Muga Mabondo Muhona Kalungu qui aurait mis au monde cinq enfants:
- Ndanga Shenondo, ancêtre du clan de Balizi ;
- Kalungu, ascendant du clan de Bashimbi ;
- Nabatwa, qui est à la base du clan de
Batumba ;
- Ngondwe, qui a formé le clan de
Banyamuganga ;
- Bulambo, ancêtre du clan de Balambo23(*).
B.2.
Toponymie et anthroponymie chez les Nyindu
La toponymie est aussi bien fournie chez les Nyindu. Ainsi,
par exemple, nomme-t-on les quatre points cardinaux en Kinyindu :
« Ishere » : Est, « Indija » : Ouest,
« Ikagere »: Nord et « Imashaje » :
Sud.
Quant à l'anthroponymie, les jumeaux chez les Nyindu
sont désignés par les mots suivants :
- Ceux du sexe masculin : « Shonga »
pour le premier-né et « Mughaja », pour le
puis-né.
- Les jumelles sont appelées
« Ngungwa », pour l'aînée et
« Nakito », la puis-née.
Celui qui précède les jumeaux est appelé
« Kabika ». Les enfants suivent les jumeaux sont
nommés : « Mbirize », homme ou femme né
directement après les jumeaux ou les jumelles. Et
« Mulonda » est celui ou celle qui vient après
Mbirize. Les enfants qui précèdent les jumeaux sont
appelés : « Katambu », pour le premier-né et
« Kabika » pour le second.
Le père des jumeaux est appelé
« Muhasha ». Celui qui met au monde les jumeaux deux fois
est nommé « Kishali », et la femme
« Nyihasha ».
La naissance des jumeaux était entourée d'un
mythe et de rites. Quand une femme mettait au monde des jumeaux, elle devrait
passer une semaine sans se faire voir à l'extérieur. Les membres
de deux familles exécutaient des danses traditionnelles et la
ravitaillaient en nourriture. On en informait aussi les autorités
administratives comme le mwami, le chef de groupement et le chef de
localité. Après trois mois, la sortie des jumeaux se faisait par
la célébration d'une grande fête accompagnée
d'offrandes. La mère des jumeaux se couvrait de la peau du chacal
(musimba) et se coiffait d'un chapeau fait de plumes de l'aigle (nyuunda). Le
jour de cette célébration, on offrait également des
cadeaux aux jumeaux, après les avoir bien vêtus.
Celui qui désobéit aux normes et coutumes
légués par les anciens était sévèrement
puni. On mettait sur lui un signe dit `'Shuluuliro`'. Si quelqu'un commettait
une faute grave, il devrait être pris et emballé dans les feuilles
sèches de bananier pour qu'il soit brûlé vif. Pour
s'encourager au travail, les Nyindu utilisaient le terme
« Mwakolesa » qui veut dire : courage. La
réponse est : « Bâ-ho » qui signifie
`'vive''.
B.3.
Mariage coutumier chez les Nyindu
Pour contracter le mariage, la coutume des Nyindu exigeait au
jeune époux de verser comme dot trois catégories de
chèvres réparties comme suit :
- « Mbene y' u muhoho », la chèvre
consacrée pour supplier la belle famille ;
- « Mbene y'u musiingiro », plusieurs
chèvres consacrées à la dot ;
- « Mbene y'u mokyo », la chèvre
que les parents vont manger.
« Mbene » en kinyindu signifie une
chèvre. En outre, les Nyindu donnaient une autre valeur dotale en
métal appelé `'Izingi'', un rouleau de métal qui
coûtait très cher.
Les Nyindu utilisaient plusieurs biens de valeur comme dot. Il
s'agit notamment de:
- « Iziingi » : Ce que portaient les
femmes comme anneaux sur leurs jambes ;
- « Kihiga » : du sel emballé dans
des feuilles sèches de bananier (bibamba) ;
- « Tulanga » (perles) :
utilisé par le roi et les femmes honorées comme chainette et par
les « Nyihasha » (mamans qui ont mis au monde les
jumeaux) ;
- «Kikonda » : vin d'honneur que les Nyindu
apportaient pour accompagner la dot ;
- « Kugokera » : la réalisation du
mariage et que personne ne pouvait plus venir causer la rupture de ce que vous
avez fixés comme alliance ;
- « Iziingi » (rouleau de métal
doré), Kihiga (sel), mbene (chèvre) et Kalanga (perle)
constituent l'essentiel de la valeur dotale (kikonda) chez les Nyindu. Tandis
que « Kugokera » consiste à finaliser ou
clôturer le mariage en versants les biens supplémentaires.
Pour un handicapé physique, la coutume nyindu
prévoit qu'Il puisse obtenir gratuitement une femme chez son oncle
maternel.
Avec l'avènement du christianisme, avant que le mariage
ne soit consommé, il doit d'abord être béni à
l'église. Mais, avant tout, il faut doter et conclure l'alliance
entre les deux familles. Celles-ci conviennent de la date de noces. Ce jour-
là, on emmène la fille en présence de deux familles. La
famille du jeune époux reçoit la jeune épouse de mains de
sa mère pendant que l'assistance exécute des danses, mange et
prend de la bière. Le soir, les vieilles femmes vérifient si la
fille est encore vierge. Si elle ne l'est plus, les convives ne peuvent pas
manger là-bas. Même les parents du jeune époux ne doivent
pas manger la nourriture qu'apportera la famille de leur belle-fille.
Le `'Kihaango `' est le pacte de sang utilisé pour lier
les gens de jadis dans la culture Nyindu, car les conflits et la haine
étaient récurrents. Le pacte de sang entraînait la mort du
traître, car celui-ci était considéré comme ayant
péché contre la personne avec qui ils ont fait le pacte mais
aussi contre la famille toute entière. Même si les membres de sa
famille n'étaient pas présents au moment du pacte de sang, ils
étaient toujours victimes de conséquences de cet abus.
ORGANISATION CULTURELLE DES NYINDU
Les Nyindu ne connaissaient pas l'initiation des jeunes
garçons par « Kimbilikiti ». Ce sont les Lega qui
leur ont appris ce type d'initiation et ce pouvoir coutumier utilisé
pour diriger et éduquer les jeunes garçons dans le but de marquer
le passage à l'âge adulte. Selon la coutume lega, ce rite
initiatique est organisé par les gardiens coutumiers appellés
Bami, porteurs d'une calotte appelée «Kikumbu ». On les
appelle « bami ba kikumbu », c'est-à-dire des
autorités morales et coutumières coiffés des calottes
faites des peaux d'animaux, gardiens de la coutume et protecteurs de l'ordre
public. Si quelqu'un se bat avec sa femme, par exemple, ce sont eux qui le
jugent. Mais ce que les Nyindu connaissaient depuis lors c'était le
« bwami bwa Mukwendekwende ». Pour les Nyindu, leur
héros initiatique « Mukwendekwende » de Luindi est
plus grand que Kimbilikiti de Lega. Seul le mwami porte le
« Lushembe » qui le différentie des chefs de
groupements qui portent « l'Ishungwe ». Le
« Lushembe » n'appartient qu'au mwami chez les Batumba. Le
chapeau royal des Nyindu est fabriqué à base de la peau de
l'animal appelé « Kidasi ». Sur cette couronne, on
fixe «l'Ishungwe », symbole du pouvoir royal. L'animal
précité vit dans les cavernes que les Nyindu appellent
«Lwaala». Après, on tisse sur la couronne royale un bourrelet
de chainette appelé « Lushembe », symbole du pouvoir
de gouverner. Selon la coutume nyindu, si le père meurt, c'est son fils
ainé qui est son héritier. Si l'aîné était
décédé avant son père ou s'il présente
certaines incapacités, c'est le fils cadet qui hérite et donc
sera le répondant numéro 1 de la famille. Toutefois, même
si l'aîné est l'héritier de la famille, il est
appelé à gérer en connivence avec le cadet.
Lors des cérémonies d'héritage,
l'aîné reçoit la lance et la machette, le bracelet ou
« Lugolo » et le sac traditionnel (musange). On doit
l'habiller avec respect devant toute la famille. Le cadet étant
vêtu, on le montre à toute la famille et on lui donne la
responsabilité sur tous les biens et la richesse que son père a
laissée. S'il y a d'autres biens comme des chèvres ou des vaches,
la famille les partage à tous les enfants24(*).
CONSIDERATIONS SOCIOLINGUISTIQUES
Le kinyindu est un parler bantu. Selon Musombwa Ivuzi Michel,
il s'agit d'une langue en tons, et il n'y est pas facile de prononcer un mot
correctement sans recourir à un ton approprié. C'est ce ton qui
confère le sens au mot. La montée ou la chute de la voix dans la
parole affecte le sens de ce qui est dit25(*). La disparition progressive du Kinyindu est due au
fait que la plupart des Nyindu se camouflent et ne veulent pas parler leur
langue devant les membres d'autres ethnies. Par ailleurs une certaine
confusion plane sur la véritable identité nyindu, dans leurs
esprits, et même dans ceux de certains chercheurs. A titre
d'illustration, les Nyindu ont été omis sur bien des sites qui,
pourtant, se veulent mentionner toutes les ethnies africaines ou congolaises.
C'est le cas du site ezakwantu.com qui mentionne à la date d'aujourd'hui
plus de 7400 tribus parmi lesquelles les Nyindu ne figurent pas. En outre, il
en est de même du site Wikipédia qui contient une liste de
groupes ethniques d'Afrique26(*).
Cependant, le parler kinyindu véhicule une importante
sagesse et une culture très riche. A titre illustratif, nous reprenons
ci-dessous quelques proverbes en kinyindu et leurs explications.
0. « Ake'ba muguma ili anyali
mugumaana.»
Littéralement, cela veut dire : « Il peut
être seul, mais en bonne santé ». Ce qui signifie que la
force d'un groupe ne tient pas au nombrede ses membres, mais plutôt
à sa viabilité.
1. « Bugale ho bwaanga kuziindana
butakutaangé.»
Littéralement, ce proverbe se traduit par : «
La richesse, il est bon qu'elle vous arrive à la fin, au lieu qu'elle
vous arrive au début ». La signification en est qu'il est
préférable de finir dans l'abondance que de commencer avec elle
et finir dans la misère.
2. «Utali'ho atakeshuuli'ngungujiba.»
Littéralement, cet adage s'explique
par :«Celui qui n'est pas présent, son piège n'attrape
pas la géante colombe». Le sens profond de ce proverbe est :
Si vous travaillez avec un homme malhonnête, à votre absence, il
privilégiera ses intérêts au détriment des
vôtres. On l'illustre, par exemple, par l'achat de deux vaches ;
l'ami malhonnête s'appropriera la plus grasse vache et vous laissera la
chétive.
3. « Ugaheera luungu, ataheera
luguma »
Littéralement, cela signifie : « Quand on
fait du bien, il ne faut pas choisir à qui le faire, car on ne connait
pas toujours celui qui pourra être utile dans l'avenir». En effet,
celui qui fait du bien ne doit pas discriminer les gens. On peut, par exemple,
favoriser ses enfants et ne rien obtenir d'eux en retour. Jean de la Fontaine
n'a-t-il pas dit dans son texte intitulé « le cerf à la
fontaine » : « Ce qu'on méprise se montre
souvent plus utile que ce qu'on vante »
I.3.
CREATION DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
Parler de la création du groupement de Mukangala nous
amène à examiner les origines du clan régnant, celui des
Bahofa, et la création proprement dite du groupement pendant la
période coloniale.
I.3.1. Origines des Bahofa
Selon la tradition orale, qui n'en donne qu'une seule version,
les Bahofa seraient venus de Kitutu, chez les Bakute de la famille de Lubemba.
Ils auraient suivi le chemin menant vers Luhwinja à la recherche de la
sécurité, car les Bahofa s'étaient disputés
à Kitutu avec les Bakute. Ceux-ci formaient des groupes composés
des véritables guerriers qui étaient de plus en plus
sollicités pour des renforts. Après un temps passé
à Luhwinja, ils jugèrent bon de rentrer chez eux à Kitutu.
En cours de route, les Bahofa firent une esclave à Lwindi où ils
avaient été attirés par le milieu et avaient
décidé de s'installer à trois endroits différents,
à savoir : Ngendje, Kanenge et Ilemba. Pendant ce temps, le chef du
groupe Bahofa soutenait fort le mwami de Luindi. Il lui soigna sa plaie dite
incurable et guérit son fils qui souffrait de l'épilepsie pendant
plusieurs années. Il a aussi combattu énergiquement du
côté du mwami et arracha beaucoup de victoires en sa faveur.
Devant cette campagne victorieuse remportée grâce à son ami
guerrier, le mwami sollicita encore Bahofa de combattre Muhindo qui occupait
illégalement Ihanga et Mukangala. A l'issue de la bataille, cette
entité revint à Lisasu Lubula grand frère de Bahofa, et
Ihanga échut à Bahofa en guise de récompense pour la
victoire gagnée27(*).
I.4.
Origines des Lega : Bunyoro28(*)
Les historiens affirment que les Bantu avaient fui la
désertification du Sahara vers le deuxième millénaire
avant notre ère. Dans cette fuite, ils ont pris deux
directions :
Une tranche s'est dirigée vers le Sud-ouest du Sahara
et a atteint la région de Bénoué (NOK). C'est elle qui
forma le noyau bantu occidental. Une autre tranche s'est orientée vers
Sud-est du Sahara et a abouti au Nil moyen (Kouch). Elle aurait formé
dans le Bunyoro le noyau bantu oriental. Les Lega auraient appartenu à
ce groupe.
Nous considérons donc Bunyoro comme le milieu originel
des Lega pour deux raisons. D'une part, parce que c'est à partir de ce
site que le non Lega serait attribué à un petit groupe qui, plus
tard, désignera toute une tribu. D'autre part, parce que c'est le
premier noyau des Lega. Le Bunyoro s'étendait entre le lac Albert
à l'Ouest et l'Ouganda à l'Est, le fleuve Nil et le lac victoria
au Nord, et le royaume de Toro au Sud.
C'est une région très favorable, par la nature,
à cause de son sol volcanique assez bien arrosé permettant une
bonne culture des bananes. Cette fertilité de sol peut justifier
l'installation des Bantu dans cette région. L'installation des Bantu
dans le Bunyoro n'est pas définitive suite aux attaques
extérieures des Selluk et Dinka ; une grande partie de la population
bantu parmi laquelle les Lega, quitte la région et se lance à la
quête de nouveaux territoires. Ceci est affirmé par Lybeth en ces
termes : « Au XVe siècle sous la poussée des
Silluk et Dinka, les bantu de l'entre Albert-Victoria se mettent en route par
la tracée de Ruwenzori. Ils forment les groupes Bakumu et Warega
»29(*).
Causes des migrations des Lega
Sans entrer en détail, nous citons à titre
d'exemple, les causes principales de migrations lega.
a) Opposition entre membres de la famille ou
opposition ainé-cadet.
Elle met aux prises les enfants d'une même famille,
c'est-à-dire l'ainé et cadet. Elle résulte surtout du
conflit de pouvoir. Des fois, il arrive qu'après la mort du père,
le cadet ne veut pas accepter l'autorité de l'ainé. Il s'oppose
à lui et veut même le dominer. Devant cette situation, l'opinion
publique peut être partagée. Les uns soutiennent l'ainé,
les autres le cadet. A cause de son pouvoir légitime, si le père
ne l'avait pas déshérité, l'ainé peut avoir
beaucoup de partisans. Le contraire peut être aussi et cela compte tenu
des qualités du cadet : sagesse et justice. Dans tous les cas, l'un
parvient après tout à s'imposer sur l'autre. Le vaincu est
souvent obligé de quitter le pays, il va fonder avec son groupe un
nouveau village. Toutefois, ils se reconnaissent comme des frères et
entretiennent parfois de bonnes relations. Le cas des Bashikumbilwa et des
Bashimwenda en territoire de Mwenga. Comme nous venons de le voir, l'opposition
ainé-cadet peut provoquer la scission d'un groupe.
b) Opposition intra-groupe30(*)
Elle n'est autre chose que le conflit qui éclate
à la l'intérieur d'un même groupe opposant les jeunes et
les vieux. Parlant de ce genre d'opposition, Darcet écrit :
« Les générations actuelles ne veulent pas
obéir aux lois mises en place par les hommes de vieilles
générations dans une société qui n'évolue
pas beaucoup pendant toute la vie »31(*).
Dans les sociétés dites traditionnelles, l'homme
n'est jamais isolé ; il passe sa vie dans une unité sociale
ayant ses us et coutumes. Ceux-ci constituent le fil conducteur de
l'unité sociale ; tout membre est obligé de les observer
pour la bonne marche du groupe. Leur violation doit être
sévèrement punie par la société. Parfois,
l'individu quittait avant que des mesures du groupe ne soient prises. Roger
Sendegeye aborde dans le même sens en affirmant : « la non
obéissance aux lois étai sévèrement
sanctionnée des menaces de calamités sur le milieu social.
Certains gens ou des familles entières partent avant que le poids des
sanctions ne pèse sur elles. »
Et Mulungbati d'ajouter : « un exemple si
intéressant peut illustrer nos propos sur la scène qui s'est
passé à Mawe. Il s'agit d'un homme répondant au nom de
Kitunde Mukambilwa qui était tombé amoureux de sa
belle-soeur », l'épouse de son petit frère. Etant
donné qu'il ne pouvait pas le lui dire, il garda ce sentiment à
coeur tout en préparant son coup. Un jour aux environs de dix heures,
Kitunde s'était rendu au champ où sa
« belle-soeur » était seule. Là, il fit appel
à l'épouse de son petit frère qui vint, car elle ne
n'attendait pas à l'événement qui devait arriver.
Lorsqu'elle se trouvait déjà à quelques mètres de
son beau-père, ce dernier sauta sur elle et commença à la
déshabiller. C'est lorsque la femme se rendit compte du but poursuivi
par son « beau-père », elle poussa des cris.
Aussitôt, les hommes accoururent et trouvèrent la femme entrain de
pleurer alors que l'homme s'était déjà sauvé. La
femme expliqua la scène. Arrivée au village, ces gens
trouvèrent Kitunde Mukambilwa déjà parti pour Kamituga.
L'acte posé par Kitunde Mukambilwa est
énergiquement condamnable par la société lega, qu'on
appelle « Muzombo », c'est-à-dire un acte
délicieux même s'il n'avait pas atteint son but, celui d'avoir une
relation sexuelle avec sa « belle-soeur ». Il l'avait
après tout violé, car il avait osé le faire. Cette
tentative suffisait. Ayant avalé les conséquences de sa
faute : sanction et humiliation ; il avait jugé bon de se
réfugier à Kamituga où il se trouve actuellement depuis ce
jour-là. Semble-t-il qu'il n'est plus jamais retourné à
Mawe. Comme on peut le remarquer, la contradiction entre les
intérêts personnels et les lois des groupes était un motif
pour qu'un individu soit écarté ou s'écarte du groupe.
c) Opposition intergroupe31(*)
Nous venons de voir que l'opposition ainé-cadet et
l'opposition intra-groupe peuvent occasionner le départ d'une fraction
du groupe. Cependant, l'installation des migrateurs dans la
« région d'exil » n'est pas toujours pacifique, car
celle-ci est déjà une cause d'opposition aux premiers occupants
de la région. A ces propos Amselle note : « La
prise en considération des problèmes migratoires conduit
naturellement à opposer les migrants à la société
d'accueil »32(*). Après un affrontement, les vaincus sont
obligés, soit de se soumettre, soit d'abandonner le lieu. Pour la plus
part des cas, la seconde solution est adoptée. C'est le cas des
Bashikumbilwa.
Après cette analyse de différentes causes,
présentons succinctement les itinéraires des migrations lega, car
elles ont déjà fait de plusieurs études
antérieures.
1. Itinéraires des migrations des Lega32(*)
Vers le XVIème siècle, écrit Tshimanga wa
Tshimanga, les populations lega venues du Nord-est du Zaïre se sont
avancés jusqu'au Mniéma. Mais, avant d'atteindre le Maniema, ils
se seraient heurtés aux hostilités de Wakasamale, une population
à peau claire dans la région du Haut-Zaïre
(Uélé) et se sont scindés en deux tranches qui se seraient
encore retrouvés à Kakolo au confluent de la Lugulu et de
l'Ulindi, parmi les ouvrages et les travaux qui parlent des migrations lega,
citons : Tshimanga wa Tshimanga et Banamwezi L.
Le premier groupe lega est passé par la voie orientale
à l'Ouesr des grands lacs pour déboucher à Kakolo, lieu de
leur dernière dispersion. L'autre groupe avait gagné de
l'Uélé et remonta le fleuve Zaïre par se rive droite
jusqu'à l'embouchure de l'Ulindi pour s'installer enfin à Kakolo.
C'est la voie occidentale. Ceci a amené Polepole Iginzi à dire
que les Lega ont une certaine fraternité avec plusieurs tribus de
la région du Haut-Zaire telles que les Bakumu, les Mituku, les Baleka et
les Balokele.33(*)
La tradition orale recueillie chez les Lega raconte que le
lega, ancêtre éponyme des Lega, avait eu deux fils :
Kendakenda (ainé) et Lulimba. Le premier avait pour fils Mwema
père de Sungu grand-père de Bulambo. Lega et la famille de son
fils Lulimba auraient suivi la voie orientale et les membres de la famille de
Kendakenda auraient emprunté la voie occidentale. L'arbre
généalogique ci-dessous décrit la descendance de lega.
Arbre généalogique des Lega
KENDAKENDA
LULIMBA
MWEMA
SUNGU
BULAMBO
MWEND KUMBILWA KASUNJU
MUBIGALO MWANGO KIKUNGU MBOBOSHI
I.3.2. De la création du groupement de
Mukangala
Le groupement de Mukangala est situé dans la chefferie
de Luindi en territoire de Mwenga, province du Sud-Kivu. Sa création a
eu lieu en 1912 par le Décret-loi du 02 Mai 1912. Il est devenu
opérationnel en 1929. Les premiers animateurs de cette entité
furent :
- Lisasu Lubula comme premier chef du groupement ;
- Kikojoka Kangere : conseiller ;
- Kimwanga Bashimbirwe : conseiller ;
- Lungwahi Baguma : conseiller ;
- Namujumbi Buhashe : conseiller ;
- Nabuvuma Ndeka : secrétaire.
C'était sous la supervision du Mwami Kabuka
Lukandamira34(*).
CHAPITRE DEUXIEME. ORGANISATION DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
Ce deuxième chapitre analyse l'organisation et le
fonctionnement du groupement de Mukangala dans les domaines politique,
économique, social et culturel.
II.1.
ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
L'étude de l'organisation politico-administrative de la
RD Congo, en général, exige qu'on se familiarise avec certaines
appellations telles : groupement, chefferie, territoire. Pour être
bref, nous allons définir sommairement ces trois concepts
utilisés dans ce travail.
II.1.1. DEFINITION DES CONCEPTS
De façon simple un Groupement, selon le Groupe
Jérémie, est une communauté traditionnelle reconnue par
l'administration. Il est dirigé par un chef coutumier reconnu et investi
par les pouvoirs publics. Au terme de cette Ordonnance-loi n°82/006 du 25
février 1982 portant l'organisation territoriale, politique et
administrative de la République du Zaïre, est groupement toute
communauté traditionnelle organisée sur base de la coutume et
érigé en circonscription administrative sous l'autorité
d'un chef coutumier reconnu et investi par le pouvoir public. Il comporte soit
une grande localité, soit un et un semble de petites localités
numériquement faibles. Il est subdivisé en localités
dépourvues de la personnalité juridique. 34(*).35(*) Une chefferie est un ensemble
généralement homogène de communautés
traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa
tête un chef désigné par la coutume, reconnu et investi par
les pouvoirs publics36(*).
Alors qu'un territoire est l'une des composantes de la réalité
matérielle de l'Etat-nation et de sa souveraineté,
délimitée par des frontières37(*).C'est l'étendue de la
surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain, une collectivité
politique nationale. C'est aussi une étendue du pays sur laquelle
s'exerce une autorité, une juridiction (surface d'une subdivision
administrative)38(*).
II.1.2. ANIMATEURS DE LA VIE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE
Ce point traite de l'organisation politique et administrative
en examinant les différents chefs qui ont dirigé le groupement
de Mukangala, son organigramme, et les chefs de différentes
localités39(*).
Tableau n°3. Chefs de groupement de Mukangala
(1930-nos jours)
|
N°
|
Chefs de groupement
|
Périodes
|
|
01.
|
Lisasu Lubula Joseph
|
De 1930 à 1940
|
|
02.
|
Nabuhombya Kamende
|
De 1940 à 1956
|
|
03.
|
Songa Lisasu Modeste
|
De 1956 à 1996
|
|
04.
|
Mwenebatende Nabuhombya
|
De 1996 à nos jours
|
Source : Mwenebatende Nabuhombya chef de groupement
interviewé à Kasika, le 15 Juillet 2022.
Commentaire : Il ressort de ce tableau que groupement n'a
connu que quatre chefs de groupement depuis sa création et tous sont de
la même famille de Bahofa ; le pouvoir est
héréditaire.
Le chef de groupement a sous sa gouverne les chefs de
localités ou « Kapita ». Le tableau ci-dessous
présente les chefs de localités (Kapita) actuels dans le
groupement de Mukangala.
Tableau n°4 : Les chefs de localité
dans le groupement de Mukangala
|
N°
|
Les chefs des localités
|
Localités
|
|
01.
|
Bulaya Wilondja
|
Kasika
|
|
02.
|
Nabayayu Lembelembe
|
Kalemba
|
|
03.
|
Kipinda Mukobelwa
|
Kipinda
|
|
04.
|
Mwenilemba Nijembwe
|
Ilemba
|
|
05
|
Manueli Bunyenyeli
|
Muhimbili
|
|
07
|
Makongola Kamenja
|
Ngendje
|
|
08
|
Muluta Igunzi
|
Kahulile
|
|
09
|
Pinga Kitoga
|
Pinga
|
|
10
|
Nandola Kasololo
|
Mushinga
|
|
11
|
Kalizi Mwenebatu
|
Kalizi
|
Source : Mwenebatende Nabuhombya chef de groupement
interviwé à Kasika le 15 Juillet 2022.
Commentaire : Les « Kapita » qui
avaient bien travaillé avec le chef de groupement sont devenus des chefs
de localité et ont donné leurs noms aux entités sous leur
gestion. Ce fut le cas de Kalizi, Pinga et Kipinda.
ORGANIGRAMME DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
Chef de groupement
Secrétaire Administratif
Etat-civil
Chefs de localité
Tribunal secondaire
Conseillers
Chefs de sous localité
Chef de quartier
Chefs de 10 maisons
Source : les archives du groupement de Mukamgala,
inédit, Mwimbili, 2021.
Commentaire :Cet organigramme présente les
différents animateurs de la vie politique et administrative du
groupement de Mukongola et les postes qu'ils occupent. Il s'agit, du sommet
à la base, des autorités ci-après.
II.1.3. ORGANISATION SUR LE PLAN ADMINISTRATIF
Dans les années 1930, le groupement de Mukangala
n'avait pas encore de bureau du groupement. Le chef de groupement installait
son administration sous un arbre de ficus
ou « Mulumba ». Les habitants fixaient des pierres
à l'ombre de cet arbre et les utilisaient comme des chaises pour
s'assoir lors des meetings ou des palabres dues à la mésentente
entre eux. Le chef de groupement travaille en collaboration avec les chefs de
localité ou « kapita». Ces derniers font office des juges
au niveau du groupement et supervisent les travaux communautaires
appelés « Salongo » aux quartiers.
C'est-à-dire qu'ils contrôlent le jeton attribué aux
participants au travail organisé par le chef de groupement afin de
dénicher ceux qui ont désobéi à ses ordres afin
qu'ils payent des amandes.
II.2.
ATTRIBUTIONS DES ANIMATEURS DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
II.2.1. Le chef de groupement
Il est le personnel administratif du groupement.Il veille au
respect de la constitution et des lois du pays. Il est le représentant
du chef de l'Etat dans son entité. Il reste le responsable de la
politique de son groupement. Il transmet ses rapports tant mensuels qu'annuels
à son chef direct qui est le mwami ou le chef de la chefferie de Luindi.
Le chef de groupement n'est pas élu, son pouvoir se transmet du
père au fils. Il est toujours choisi dans la famille régnante
conformément à la coutume. Il préside la réunion de
sécurité de son entité. Il veille également au
développement de son entité et au bien-être de sa
population.
II.2.2. Le Secrétaire administratif
Il est le personnel administratif etattaché de bureau.
Il est le plus proche du chef de groupement. Il rapporte les réunions
tenues au groupement. En cas d'un problème, il note les
déclarations de plaignants, des accusés et des témoins. Il
joue le même rôle que le chef de groupement. Il assume
l'intérim du chef de groupement à son absence.
Les secrétaires administratifs depuis 1912 jusqu'en
2022 sont :
- Nabuvuma Ndeka : De 1930 à 1940
- Mbilize Kika : De 1940 à 1956
- Emil Lisasu : De 1956 à 1996
- Kasindi Lubunga : De 1996 à nos jours
II.2.3. Les chefs de localités
Ils représentent le chef de groupement dans leurs
localités respectives et transmettent les rapports mensuels et annuels
au groupement.
II.2.4. Le tribunal secondaire du groupement
Il a la compétence judiciaire, notamment le pouvoir
d'installer un tribunal. La chefferie de Luindi a un tribunal divisé en
deux chambres, celle siégeant auprès du mwami et le tribunal
secondaire basé dans le groupement de Mukangala. Ce tribunal secondaire
statue sur les infractions ayant trait à la coutume et d'autres
punissables. Il rend des jugements en premier ressort. Cette juridiction
coutumière simplifie la distance pour ceux qui ne veulent pas
déposer leurs plaintes au niveau de la chefferie. Ceux-ci le font au
niveau du tribunal secondaire avant de s'adresser au tribunal principal. Les
noms des juges du tribunal secondaire depuis 1912 jusqu'en
2022 sont :Mufwabule Mulumba, Daniel Shonga, Rwanyonga
Timothée et Katubaka Papy.
II.2.5. Le bureau d'état civil
C'est un service qui a son siège principal au
chef-lieu de la chefferie à Kasika. Mais, vu que la chefferie est vaste
et les fonctionnaires engagés dans ce service sont peu nombreux, on a
créé des sous-branches de l'état civil dans les
groupements. Il a comme rôle de veiller sur la croissance de la
population. Cela veut dire, connaître les statistiques de la population,
enregistrer les nouveau-nés, les décès et les mariages.
Les animateurs de ce service depuis 1912 jusqu'en 2022 dans le groupement de
Mukangala sont :Mirimba Nakwana Laurent de 1930 à 1960,
Kitoga Binga de 1960 à 1998 et Museme Kabasele de 2002 à nos
jours.
II.2.6. Les conseillers :
Ils ont pour rôle de prodiguer des conseils au chef de
groupement et à la population dans la gestion du pouvoir
coutumier40(*). Les noms
des différents conseillers et leurs périodes, de 1912 à
2022 :
1° De 1930 à 1940 :
Ø Lubunga Mutumoyi,
Ø Kalizi Kalala,
Ø Lujuire Nakuzimu,
Ø Kalinde Basheka.
2° De 1940 à 1956 :
Ø Bisimwa Shonga,
Ø Fumba Kisenya,
Ø Bahezire Mujandwa.
3° De 1956 à 1996 :
Ø Muganguzi Kapenge,
Ø Mbilizi Mujengwa,
Ø Déogratias Musombwa.
4° De 1996 à nos jours :
Ø Mazambi Ikando Michel,
Ø Maroyi Banamwezi,
Ø Lwesso Kaseke.
Ici, il faut parler des activités et plan ou horaire de
travail hebdomadaire, mensuel et annuel au niveau du groupement, du financement
des activités et des agents, des salaires des agents, leur recrutement
et leurs mouvements. Le chef du groupement est à la tête de son
entité. Il a comme rôle de faire respecter les programmes
provenant de la haute hiérarchie. Les chefs de village sont des agents
administratifs chargés d'exécution des programmes. Les
« Nyumba kumi » sont des agents chargés
d'information du groupement et de la sécurité. Les vieux sages
sont chargés des conseils pour le développement de la
chefferie41(*). Pour
fonctionner, le groupement reçoit une rétrocession ; et
surtout la perception des certaines taxes sur le marché de Kidasa de
chaque Mercredi. Voilà là où les travailleurs du
groupement tirent leur motivation ainsi le nécessaire pour le
fonctionnement du bureau.
II.3.
ORGANISATION SUR LE PLAN ECONOMIQUE
Pour Raymond Boudon et ses collaborateurs, le
développement économique se traduit, sur le plan de la
qualité, par l'essor d'une économie de marché, par le
passage d'une agriculture de subsistance à une économie de
marché et par le programme de l'industrialisation sur le plan
quantitatif ; il se mesure par le recours aux différents indices,
notamment l'évolution du produit national brut(PNB)42(*).
Ce développement revêt aussi des
conséquences sociales : dépérissement
d'allégeance traditionnelle, individualisation des rapports sociaux,
essor de la division du travail social et donc la spécialisation des
tâches, urbanisation, apparition d'un certain niveau de mobilité
sociale43(*).
Alain Birou montre, pour sa part, que le concept
développement économique est utilisé de façon
très générale et parfois assez précise pour
signifier la croissance organique, harmoniser donc un progrès de
l'économie s'inscrivant dans un progrès général de
la société44(*).
Ces deux définitions sont complémentaires et
mettent l'accent sur les conditions pour qu'on parle d'un développement
économique. En effet, un développement économique requiert
le progrès économique ou mieux, la croissance, le progrès
social et humain. Ceci est d'autant vrai qu'à chaque mode de production
correspond un type de société bien
déterminé45(*).
De ce qui précède, nous comprenons par le
concept développement économique du groupement sous étude,
les efforts (stratégies) fournis par les autorités
coutumières de Mukangala et la population en collaboration avec certains
ONGD en vue de produire et de faire participer la population à
l'augmentation du produit national ou international brut. Il sera question de
répertorier les activités d'investissements et de production
initiée par le groupement, le gouvernement central et la population dans
le processus global de production des biens et services dans le groupement de
Mukangala tout en mesurant la qualité de vie menée par cette
population autochtone46(*).
II.3.1. AGRICULTURE ET PECHE
A. L'agriculture
Les Nyindu sont des paysans cultivateurs. Ils cultivent
surtout pour la satisfaction de leurs besoins alimentaires. Ainsi,
cultivent-ils le manioc (aliment de base), le maïs, la banane, l'arachide,
le palmier à huile et le haricot. Actuellement, l'agriculture a un
caractère extensif pour des raisons économiques, ainsi elle
devient une source des revenus et des richesses pour la population locale. Les
activités agricoles sont considérées comme une des
composantes majeures du paysage, finalités premières de la
géographie économique. Même si leur poids en matière
d'emploi s'est fortement restreint dans les économies
développées et s'est réduit depuis quelques années
dans les pays à transition (anciens pays socialistes européens,
nouveaux pays industriels), les secteurs agricoles restent importants en raison
de la surface qu'ils occupent et surtout les enjeux dont ils sont
l'objet46(*).
Le groupement de Mukangala est une entité à
vocation agricole jouissant d'un climat favorable à la
déstructure. Il est habité par une population dont la
majorité s'occupe de l'agriculture, de l'élevage et de la
pêche. En effet, plus de 90% de la population vivent des activités
agricoles. Malgré les conditions éco-climatiques variées
qui permettent la production de diverses denrées agricoles
nécessaires pour l'alimentation et comme matières
premières pour l'industrie, cette entité accuse encore une
production fort instable, insuffisante. A Mukangala, le secteur de cultures est
caractérisé par un niveau faible de technicité, de
productivité et de l'utilisation d'intrants agricoles, une main d'oeuvre
qui est essentiellement féminine et une taille réduite des
exploitations. Alors que la population de cette entité continue de
s'accroître à un rythme accéléré, la
production vivrière ne connaît qu'une croissance très
modeste et irrégulière accusant même une tendance à
la stagnation. Conscientes que l'autosuffisance alimentaire est une des
conditions préalables au développement autonome de cette
entité, ses autorités, en collaboration avec la population locale
et des ONGD ; dans leurs discours, projets et programmes ont toujours
placé l'agriculture parmi les premières priorités.
Et pour atteindre leur objectif, certaines stratégies
sont mises en oeuvre, à savoir :
1° Intensification de
l'agriculture
La population de Mukangala utilise cette technique pour
augmenter et améliorer la production agricole par unité de
surface en fonction des besoins alimentaires de tout habitant du milieu dans le
souci non seulement d'améliorer des conditions de vie, mais aussi de
lutter contre les importations de certains produits agricoles.
2° La pratique de l'assolement
Elle consiste en une succession de cultures sur un même
sol. Elle facilite à la population de Mukangala de diversifier la
production agricole dans un même champ, c'est-à-dire entretenir
une succession de cultures sur le même sol.
3° La pratique de politique d'aménagement
du sol
Elle est utilisée par population de de Luindi, en
général, et Mukangala, en particulier, dans le but d'irriguer des
champs ou d'utiliser les engrais en vue d'assurer une meilleure production
agricole.
4°L'accroissement de l'échange entre les
zones de production et les marchés
d'écoulement aussi bien à l'échelon national,
provincial, territorial, de chefferie et que du groupement en
réhabilitant la route nationale numéro 2 et celles de desserte
agricole (Kasika-Kigogo, Kalambi-Irangi, 10 km, et Kigogo-Ngingu, 4 km) par la
chefferie en collaboration avec la population locale et le financement de
l'IRC/Tuungane.
5° La réduction de perte
alimentaire après la récolte grâce aux techniques
de conservation et de stockage.
6° L'amélioration de
l'élevage en utilisant le vaccin pour protéger les
bétails et volailles contre les maladies (grippe aviaire, fièvre
aphteuse).
7° L'exploitation nationale des rivières
et étangs afin de lutter contre la famine et la destruction des
alevins.
8° La relance de l'élevage
familiale à travers les formations sur les petits
élevages familiaux par des ONGD et l'éducation sur
l'hygiène et la prophylaxie de l'éleveur selon les
filières.
9°La pratique du système des
tontines-services dans le défrichage de champs de paysans,
« Kisali » en kinyindu.
10° La promotion de la pisciculture en
termes d'encouragement du secteur en octroyant des subventions aux
pisciculteurs par les ONGD (APIDE, NRC et FHI) et la mise en place par l'Etat
de tarifs de faveur au profit des populations.
11° La vulgarisation des connaissances
culturales à faibles intrants agricoles47(*).
Nous pouvons conclure ce point en disant que l'économie
du groupement de Mukangala repose sur :
a. Les minerais (cassitérites) :
dans les carrés miniers de Mininga, Misela, Kalesha, Zokwe et Mulenga.
b. L'agriculture des différentes
plantes : manioc comme aliment de base pour la population,
bananes, palmier à huile, maïs, haricots, colocases et ignames.
c. L'élevage des petits
bétails : chèvre, mouton, cochon, lapin et
cobaye.
B. La pêche
La pêche est faite artisanalement par un petit nombre de
pêcheurs dans les rivières comme Ulindi, Zokwe et Lumetekelo, pour
la survie de la population de Mukangala, par la famille Balambo et les
autres.
Le groupement de Mukangala dispose des étangs
piscicoles estimés à 220 (service de son
développement)48(*).
II.3.2. ELEVAGE
Cette activité était considérée
comme marginale réservée aux Tutsi dits Banyamulenge qui
élèvent les bovins, les ovins et les caprins, leur principale
richesse. Depuis 1990, tout le monde a compris qu'avec l'élevage, soit
des volailles ou des porcins, on peut parvenir à résoudre
facilement certains problèmes de la vie comme la dot,
l'anniversaire, le deuil, la maladie et la naissance. On pratique davantage
l'élevage en divagation alors qu'il comporte plus d'inconvénients
que d'avantages.
II.3.3. CHASSE
Pour attraper les gibiers, les peuples nyindu habitué
à la chasse utilise la lance, le chien, les pièges dont les
fosses ou « bwena », une fosse de deux mètres de
profondeur et long de quatre mètres couvert légèrement des
tiges d'arbres en mettant à l'intérieur les tiges pointues.
Certains pièges sont placés au sol sur la piste des animaux
«mchika» et des oiseaux, ou une ficelle en forme circulaire
placée à une hauteur de 30 à 50cm pour attraper les
gibiers par le cou, piège dit « Ilamba », et bien
d'autres formes de pièges49(*).
II.3.4. COMMERCE
Le groupement de Mukangala est suffisamment fertile, ce qui
explique la commercialisation des produits agricoles par les agriculteurs
eux-mêmes. En dehors de cela, il existe un grand centre commercial de
Kidasa qui permet aux agriculteurs de vendre leurs produits à un prix
plus élevé. A part la commercialisation des produits agricoles et
manufacturées, une partie de la population s'adonne à la
commercialisation des produits miniers tels l'or et la cassitérite. Les
grands commerçants de cette entité qui ont fait la
renommée depuis l'époque coloniale sont : 1° Bulambo
Kakobanya Moise : Congolais, originaire de la chefferie de Luindi, de la
famille Balande ;
2° Kafatuka Shabani : Congolais, originaire de
Maniema ;
3° Monsieur Shuni : Blanc d'origine belge.
4° Mulimandja Jean : Congolais, originaire de
Shabunda ;
5° Kilengelela Roger: Congolais, originaire de la
chefferie de Lwindi, de la famille de Babulindji ;
6° Mupali : de nationalité grecque.
Le tableau ci-dessous reprend les noms des grands
commerçants du milieu et leurs activités avant les massacres de
Kasika du 24 août 1998.
Tableau n°5 : Les commerçants de
Mukangala et leurs activités
|
1.
|
Kakobanya Bulambo Moise
|
Manioc, riz, savon, sucre, piles,
mais,haricot,habit, ...
|
|
2.
|
Fungandjira Paul
|
Manioc, riz, savon, sucre, piles,
mais,haricot,habit, ...
|
|
3.
|
Zakayo Ngonyosi
|
Manioc, riz, savon, sucre, piles,
mais,haricot,habit, ...
|
|
4.
|
Elvis Kasegere
|
Manioc, riz, savon, sucre, piles,
mais,haricot,habit, ...
|
|
05
|
Bulambo Ngomu Petros
|
Manioc, riz, savon, sucre, piles,
mais,haricot,habit, ...
|
Tableau n°6 : Les commerçants de
Mukangala après les massacres de Kasika
|
1.
|
Aluma Kabeza
|
Loueur de véhicule Bukavu/ Kasika
|
|
2.
|
Bahati Kalegeza Tiba
|
Loueur de véhicule Bukavu/ Kasika
|
|
3.
|
Matata Milemba
|
Loueur de véhicule Bukavu/ Kasika
|
|
4.
|
Mugambwa Rwanyonga Kabila
|
Loueur de véhicule Bukavu/ Kasika
|
|
5.
|
Wilondja Kapita
|
Loueur de véhicule Bukavu/ Kasika
|
|
6.
|
Toto Kilombwe
|
Loueur de véhicule Bukavu/ Kasika
|
|
7.
|
Mutimanwa Mwagalwa Gentil Homme
|
Vendeur de cassitérites et autres minerais
|
|
8.
|
Mazambi Winene Kahugusi
|
Vendeur de cassitérites et autres minerais
|
|
9.
|
Mukamba Lwesso
|
Vendeur de cassitérites et autres minerais
|
|
10.
|
Yaya Rwanyonga
|
Vendeur de cassitérites et autres minerais
|
|
11.
|
Mwilo Mwenemunga
|
Vendeur de cassitérites et autres minerais
|
|
12.
|
Riziki Bulambo
|
Vendeur de cassitérites et autres minerais
|
|
13.
|
Kwabene Wakusolela
|
Vendeur de cassitérites et autres minerais
|
|
14.
|
Bashilwango Wilondja Demu
|
Vendeur d'unités et de téléphone
portable
|
|
15.
|
Fadhili Kitoga
|
Vendeur d'unités et de téléphone
portable
|
|
16.
|
Watuta Ndabiruba
|
Vendeur des planches et sticks d'arbres
|
|
17.
|
Bahezile Mateso Eliote
|
Vendeur des planches et sticks d'arbres
|
|
18.
|
Lubunga Kigombe Ernest
|
Vendeur des planches et sticks d'arbres
|
|
19.
|
Wakulungwa Wilondja Mamy
|
Vendeuse des poissons salés
|
|
20.
|
Dorcas Nsimire
|
Vendeuse des poissons salés
|
Tableau n°7 Les marchés du groupement de
Mukangala
|
N°
|
Nom du marché
|
Localisation
|
Jour de fonctionnement
|
|
1.
|
Kidasa
|
Kidasa
|
Chaque mercredi
|
|
2.
|
Mulamba
|
Mulamba
|
Chaque dimanche
|
|
3.
|
Mukasa
|
Mukasa
|
Chaque dimanche
|
Source : François Mburugunyu Nganangana,
Président du marché de Kidasa, interviewé le 29 Août
2022 à Kasika.
Commentaire :
Avant les guerres de rébellions de l'AFDL et du
RCD/Goma, les deux petits marchés et le centre commercial du groupement
sous étude fonctionnaient normalement. Mais avec les destructions dues
aux guerres à répétition, ces petits marchés et
centre commercial demandent d'être reconstruits en y restaurant les
hangars et les étalages et d'être sécurisés par la
police du marché et les comités de gestion pour permettre aux
vendeurs et acheteurs de bien mener leurs activités.
II.3.5. VOIES DE COMMUNICATION
Le groupement de Mukangala est traversé par la route
nationale n° 2 sur une longueur de 12 km du Nord au Sud
(Zokwe à Nakachocho) avec beaucoup de ponts dont plusieurs viennent
d'être réhabilités en 2008 par une société
chinoise. C'est le cas de ponts Zokwe, Lumetekelo et Nakachocho. La route de
desserte agricole : Kasika-Kigogo 12 Km est totalement impraticable. Des
efforts sont, cependant, fournis par les ONG internationales et locales pour sa
réhabilitation. Toutefois, la route de desserte agricole Kasika-Kilimbwe
longue de 12km n'est plus opérationnelle, car non entretenue depuis une
longue période. Pour écouler les produits agricoles de cette
entité, on utilise des camions de marque Fuso, Toyota, Benz,... sur la
route nationale n°2, elle aussi peu praticable en saison
des pluies. Le groupement de Mukangala n'a pas de chemin de fer, ni
d'aérodrome et ses rivières ne sont pas navigables. Cela explique
pourquoi le coût de transport des produits vivriers et des personnes est
élevé dans le milieu50(*).
II.3.6. RESEAUX DE COMMUNICATION CELLULAIRE
Le groupement de Mukangala est arrosé par les
réseaux de télécommunication Vodacom et Airtel.
II.3.7. ARTISANAT
Les Nyindu sont considérés comme les plus
anciens habitants de Mukangala. Ils ont connu l'artisanat depuis la
période des migrations bantoues avec la lance et la serpe. Actuellement,
la menuiserie, la coupe et couture et la forge se développent au jour le
jour. Les grands forgerons du groupement de Mukangala sont :
1° Sila Kashande,
2° Gaye Musombwa,
3° Wakilongo Masekwa,
4° Mungongo Mutalwa,
5° Munyololo Bulambo Donat51(*).
II.4.
SITUATION SOCIO-CULTURELLE
Dans la situation socio-culturelle, nous analysons les
secteurs de l'éducation, de la santé, des sports et loisirs.
II.4.1. ENSEIGNEMENT OU EDUCATION SCOLAIRE
Le niveau de vie de la population commence par
l'éducation. Cependant, la formation scolaire demeure l'apanage des
enfants des personnes plus ou moins nanties dans ce groupement. Toutefois, les
habitants s'efforcent d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais
ceux-ci étudient avec beaucoup de difficultés suite au payement
des frais d'études par les parents d'élèves au niveau
secondaire. Aujourd'hui il y a un allégement au niveau primaire
grâce à la gratuité instaurée par le
président de la république.
La première école fut construite dans les
années 1923-1924 par les missionnaires catholiques dans la
localité de Kahulile. C'est l'EP Kahulile du réseau
Catholique. Actuellement, ce groupement compte 6 écoles primaires et 5
écoles secondaires qui fonctionnent normalement.
Tableau n°8. Ecoles primaires du groupement de
Mukangala
|
N°
|
Dénomination
|
Réseau
|
Localité
|
Nombre de Classes
|
Observation
|
|
1.
|
Nakitundu
|
Protestant (CELPA)
|
Mulamba
|
6
|
Construit en briques et tôles
|
|
2.
|
Kasika
|
Protestant (CELPA)
|
Muhimblili
|
6
|
Construit en briques et tôles
|
|
3.
|
Ashia
|
Catholique
|
Mukasa
|
6
|
Construit en briques et tôles
|
|
4.
|
Kigalama
|
CECA 40
|
Kahulile
|
12
|
Construit en briques et tôles
|
|
5.
|
Mubeza
|
Officielle
|
Collectivité
|
6
|
Construit en briques et tôles
|
|
6.
|
Itombwe
|
Kimbanguiste
|
Ngendje
|
6
|
Construit en briques et tôles
|
Source : CTB/PAIDECO-WAGA (Avec la
participation de l'Université Officielle de Bukavu pour la
rédaction), Plan de développement local, 2010-2012 de la
collectivité-chefferie de Luindi en territoire de Mwenga, Bukavu,
2010, pp.55-59.
Tableau n°9. Ecoles secondaires du
groupement de Mukangala
|
N°
|
Dénomination
|
Réseau
|
Localité
|
Nombre de Classes
|
Observation
|
|
1.
|
Kasika
|
Protestant(CELPA)
|
Muhimblili
|
6
|
Construit en planches et tôles
|
|
2.
|
Miki
|
Catholique
|
Mukasa
|
6
|
Construit en briques et tôles
|
|
3.
|
Lunungu
|
CECA 40
|
Kahulile
|
12
|
Construit en briques et tôles
|
|
4.
|
Mula Mba
|
CELPA
|
Mulamba
|
6
|
Construit en planches et tôles
|
|
5.
|
Buhamba
|
Anglican
|
Ngendje
|
6
|
Construit en planches et tôles
|
Source : C.T.B/PAIDECO-WAGA, 2010, op.cit.,
pp.51-52.
Commentaire :
Le groupement de Mukangala n'a aucun établissement
d'Enseignement Supérieur ou Universitaire et il n'a aucune école
professionnelle. L'enseignement dans ce groupement connait un sérieux
problème de gestion et d'administration. C'est par exemple le cas dans
les villages de Kashaka, Ndola, Mushinga et Karangiro. Bien que situées
dans le groupement de Mukangala en chefferie de Lwindi, les écoles
conventionnées catholiques et protestantes sont gérées par
leurs congrégations respectives. Cela cause beaucoup de problèmes
lors du paiement des salaires de l'Etat et même en cas d'assistance aux
écoles par les organisations non gouvernementales internationales, car
les écoles de localités de Mulamba et Kahulile se trouvent
souvent oubliées. Ainsi, contrairement à d'autres groupements,
Mukagala n'a pas eu d'opportunités d'hériter des infrastructures
scolaires coloniales. Seulement, les écoles primaires Kasika et Ashia
ainsi que l'école secondaire Miki ont été construites,
soit par les prêtres, les missionnaires protestants.
En définitive, le groupement de Mukangala compte 6
écoles primaires et 5 écoles secondaires dont certains d'entre
elles sont construites en planches et tôles et d'autres en briques et
tôles. Ces écoles éprouvent également le manque de
matériels didactiques, de bancs et de fournitures scolaires52(*).
II.4.2. FORMATIONS SANITAIRES
Le groupement de Mukangala se trouve dans la zone de
santé de Mwenga. Il compte un centre de santé, celui de
Mukasa/Kasika, qui fonctionne sous la supervision de la zone de santé de
Mwenga. Mais, ce groupement abrite quelques postes de santé et
maternités tels que présentés dans le tableau
ci-dessous.
Tableau n°10. Centre de santé et postes de
santé du groupement de Mukangala
|
N°
|
Dénomination
|
Réseau
|
Localité
|
Observation
|
|
01
|
P.S. Mulamba
|
Protestant (CELPA)
|
Mulamba
|
Construit en briques et tôles
|
|
02
|
P.S. Kidasa
|
Privé
|
Kidasa
|
Construit en briques et tôles
|
|
03
|
S.C. Mukasa
|
Catholique
|
Mukasa
|
Construit en briques et tôles
|
|
04
|
P.S. Kidasa
|
Privé
|
Kanenge
|
Construit en planches et tôles
|
|
05
|
P.S. Kasika/Collectivité
|
Officielle
|
Collectivité
|
Construit en briques et tôles
|
Source: CTB/PAIDECO-WAGA, 2010,
op.cit., pp.65-69.
Commentaire :
Il convient de signaler que malgré la supervision du
centre de santé de Mukasa, la carence en produits pharmaceutiques dans
les postes de santé et maternités reste un problème
sérieux à résoudre. Il faut aussi penser aux moyens de
transport pouvant permettre aux patients d'atteindre, soit le centre de
santé de Mukasa, soit les postes de santé de la place. A cela
s'ajoute le manque de courant électrique pour les interventions
chirurgicales au centre de santé de Mukasa et le manque des salles pour
les malades, de salles d'opérations et de maternité à
Mulamba et au poste de santé de Kasika/collectivité.
Par rapport au nombre d'habitants du groupement de
Mukangala qui est sans hôpital de référence, il est
à signaler que la couverture médicale reste faible. Pour un total
de 2 448 âmes, un centre de santé, quatre postes de
santé qui sont moins équipés en mobiliers, sont largement
insuffisants. Quant aux prestataires de services, il sied de signaler que le
nombre des médecins et d'infirmiers est très réduit.
Concernant la répartition des structures médicales, il y a
inégalité par rapport aux différentes
localités. Un centre de santé qui n'est même pas
situé au centre du groupement, exige que les gens qui viennent de
Mulamba, Ndola, Mushinga et Kashaka parcourent un long trajet pour
l'atteindre53(*).
II.4.3. HABITAT
Le concept de l'habitat a une signification très large
qui dépasse celle de logement au sens strict du mot. En ville comme
à la campagne, aménager l'habitat ne signifie pas exclusivement
construire un logement. Il s'agit bien sûr de cela, mais aussi de
l'aménagement de tout l'environnement immédiat de l'espace vital
qui entoure le logement, la ville ou le village. Aussi en milieu rural, le
problème de l'habitat couvre à la fois l'ensemble des
activités qui visent la construction des bâtiments
d'élevages et les hangars de stockages de produits. Il concerne
également l'aménagement des latrines, des sources d'eau potable,
de tout le site dans lequel est construit le village. En milieu urbain, la
question de l'habitat concerne notamment la construction des immeubles
résidentiels, des conduites ou des adductions d'eau potable,
l'éclairage public, les surfaces de loisirs collectifs ainsi que des
bâtiments d'utilité publique. De tous les temps et dans toutes les
civilisations qui ont jalonné l'histoire de l'humanité, le
problème de l'habitat a toujours été l'une des
préoccupations essentielles de l'homme soucieux d'aménager le
mieux possible son espace vital. De l'abri rudimentaire au building gratte-ciel
des villes modernes en passant par la case de la hutte de nos campagnes,
l'homme a toujours cherché dans l'abri les meilleurs moyens de se
protéger contre les multiples pièges que lui tend la nature, et
qui rendent son existence terrestre très vulnérable. La
construction ou l'aménagement de l'habitat vise, en effet, à
protéger l'homme contre les intempéries
atmosphériques telles la chaleur, le froid, la neige et la pluie ainsi
que les attaques d'autres bestioles et des bêtes féroces qui
peuvent menacer son existence et son intégrité physique. En RDC,
le problème de l'amélioration de l'habitat demeure aujourd'hui
l'une de grandes questions auxquelles des solutions urgentes doivent être
trouvées.
En ville comme à la campagne, on est confronté
à d'énormes problèmes d'insalubrité du territoire
et du développement, sans oublier ce problème capital de la
santé mentale et physique de la population54(*). Face à cette
situation, la population du groupement de Mukangala utilise des
stratégies suivantes pour résoudre ces problèmes :
1° La réhabilitation des maisons (toitures des
chaumes, en tôles, pavement, fenêtres, et portes) pour lutter
contre les intempéries atmosphériques ;
2° La construction des maisons en planches ou en
briques ;
3° L'assainissement de l'environnement : la
canalisation des eaux des pluies, débouchage des déchets pour la
lutte contre les insectes nuisibles, les maladies et les
érosions ;
4° L'aménagement et la protection des sources
d'eau potable : les puits et fontaines publics ont été
aménagés dans la chefferie de Lwindi grâce à
l'initiative de l'église et des autorités de la chefferie de
Luindi en collaboration avec la population et certaines ONGD.
L'amélioration de l'habitat et de l'habillement a pris
des allures rapides aux années 2000. En effet, avant le massacre de
Kasika en 1998, les autochtones de Mukangala vivaient en majorité dans
les huttes, des cases et des maisons en terre battue, en planches ou en
briques. Avant cet évènement, le groupement de Mukangala comptait
seulement 92 maisons en briques y compris les centres de santé, les
postes de santé, les écoles, les églises et les bureaux
administratifs. A nos jours, grâce à l'influence sociale des
milieux voisins, de l'église et des ONGD, la population de Mukangala a
commencé et continue de construire des maisons en matériaux
durables, dont leur dénombrement peut envoisiner 500 maisons.
Quant au mode d'habillement, chez les filles et les femmes,
les pagnes battent le record sur les autres habits. Les jupes sont les plus
souvent portées par les filles qui vont à l'école, pas
d'habits collants ni de munies jupes parce qu'ils sont interdits par
l'église et par la coutume.
Pour ce qui concerne la construction des églises,
certaines communautés protestantes ont érigé des temples
en matériaux durables dans le groupement de Mukangala avec la
participation active de leurs fidèles. Il s'agit de la 5ème
CELPA Ngenjde, Kashaka, Kasika et Mulamba( 2010-2012) ; de la
21e CNCA Ilemba et de l'Eglise Méthodiste de Muhimbili.
Dans le cadre de l'éducation chrétienne, les
églises ont organisé plusieurs séminaires dans des
départements des oeuvres sociales à l'intention des veuves,
orphelins, femmes violées et d'autres catégories des personnes
vulnérables. Elles ont également apporté une assistance
humanitaire aux victimes des guerres. La 5ème CELPA a, pour
cet effet, ouvert les bureaux de l'organisation CAMPS/HIA à Kasika dans
le but d'aider les femmes violées sur le plan psycho-social55(*) de 2007 à 2011. De
même, des projets d'adduction d'eau potable ont été
exécutés ou réhabilités dans le groupement de
Mukangala par les ONGs CICR (2008-2009), APIDE (2005-2006).
Tableau n°11. Adductions d'eau construites
|
N°
|
Rivières
|
Villages
|
Groupements
|
Exécutant
|
|
1.
|
Kanjege
|
Muhimbili
|
Mukangala
|
CICR
|
|
2.
|
Nembenembe
|
Kidasa
|
Mukangala
|
CICR
|
|
3.
|
Kisima
|
Lutambi
|
Mukangala
|
CICR
|
|
4.
|
Nalumbalana
|
Kwapinga
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
5
|
Chemu
|
Mulamba
|
Mukangala
|
APIDE
|
Tableau n°12 L'adduction d'eau
réhabilitée
|
N°
|
Rivières
|
Villages
|
Groupements
|
Exécutant
|
|
01
|
Mundovu
|
Muhimbili
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
02
|
Kisima
|
Balimu
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
03
|
Kabamba
|
Mushinga
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
04
|
Kalemba
|
Kalangilo
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
05
|
Kilindo
|
Ilongo
|
Mukangala
|
CICR
|
|
06
|
Nakichabuti
|
Izembwe
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
07
|
Ka Mabondo
|
Miki
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
08
|
Mushinga
|
Mushinga
|
Mukangala
|
CICR
|
|
09
|
Nakiukulu
|
Nyakavogo
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
10
|
Kisima
|
Collectivite
|
Mukangala
|
PIDE
|
|
11
|
Banamunywa
|
Kibakuli
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
12
|
Chemu
|
Lutambi
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
13
|
Kaka Nadada
|
Mukasa
|
Mukangala
|
APIDE
|
|
14
|
Kashweshwe
|
Ngengje
|
Mukangala
|
APIDE
|
Source : Bureau du développement de la chefferie
de Lwindi, Rapport annuel, inédit, Kasika, avril 2022, p. 15-17
Commentaire : Le groupement de Muangala a malheureusement
connu des cas d'incendie des villages, des maisons et des récoltes et la
destruction des édifices d'intérêt public par les troupes
rwandaises entrées sous le label du RCD/Goma dans la chefferie de Luindi
en 1998. Plus de six villages et deux cents maisons des citoyens ont
été incendiés. Les centres de santé ont
été détruits. Ces évènements ont
coûté la vie à des milliers de civils non armés
parmi lesquels les personnels soignants, les malades et leurs gardes. Le
dépôt pharmaceutique de Kasika a été pillé,
puis incendié. Les centres de santé sont devenus des
« musées d'horreurs ». Après leur
réhabilitation, les structures santé présentent un
état acceptable du point de vue de bâtiments. Mais, les infirmiers
titulaires ont soulevé les difficultés ci-dessous :
1° le Manque de matériels et équipement
médical ;
2° le manque d'énergie électrique ;
3° le manque d'eau potable56(*).
II.4.4. SPORTS ET LOISIRS
Le sport qui domine dans le groupement de Mukangala est le
football. Plusieurs équipes sont actuellement opérationnelles
dans le milieu, soit une équipe par localité. Ces équipes
organisent des championnats avec une coupe qui sera bien sûr
attribuée à la formation qui sortira championne du tournoi.
Les grandes rencontres sont organisées au terrain de
Mukasa à Kasika tout près de la paroisse catholique. Les autres
sports sont inexistants, excepté le Karaté qui est
pratiqué dans le cadre de loisirs, car ses championnats ne sont jamais
organisés.
Tableau n°13. Quelques équipes de football
du groupement de Mukangala
|
Localités
|
Equipes
|
|
Muhimbili
|
Exode
|
|
Ilemba
|
Molende
|
|
Mukasa
|
Maika
|
|
Mukole
|
Vision de Loin
|
|
Ilongo
|
Shoka
|
|
Kidasa
|
Nouvelle Génération
|
|
Mulamba
|
Chuwi Ndogo
|
Commentaire :
Les équipes citées dans le tableau ci-dessus
manquent parfois d'équipements sportifs tels les bottines, ballons,
vareuses, protèges et bandages et de sponsors managers,
présidents et supporteurs pour les faire évoluer57(*). Il existe deux terrains de
football dans ce groupement ; l'un de Mukasa et l'autre de Kanenge, il y a
des poteaux en métal et des filets qui ont été
dotés par feu l'honorable Songa Byemba Yaya. Dans ce groupement, il y a
deux équipes rivales dont l'une appartenant à la population
locale de Muhimbili, Exode, et l'autre appartient à la cour royale,
Vision de loin. Cette dernière est l'équipe du Mwami et ses
collaborateurs. Dans cette équipe jouent uniquement des enfants des
travailleurs et d'autres membres proches de la cour royale. C'est par exemple
les enfants des gardiens de la coutume, des conseillers, des familles proches
du Mwami et quelques fois les enfants de certains chefs de localité.
Tableau n°14. Championnats organisés,
équipes championnes ; joueurs et arbitres
célèbres.
|
N°
|
Equipes championnes
|
Années
|
Noms des joueurs célèbres
|
Noms des arbitres célèbres
|
Localités
|
|
1.
|
Exode
|
2008
|
Wakenge Kabingwa
|
Maroyi Munenge
|
Kipinda
|
|
2.
|
Vision de Loin
|
2009
|
Mazambi Kidiaba
|
Mushiwa Lisasu
|
Kipinda
|
|
3.
|
Nouvelle Génération
|
2010
|
Wabulakombe Lisasu
|
Kabonga Kaliza
|
Ngenje
|
|
4.
|
Eléphant
|
2011
|
Byamungu Mukambilwa
|
Nyongolo Lwesso
|
Kasika
|
|
5.
|
Shoka
|
2012
|
Mbilizi Mushagwa
|
Faraja Mangala
|
Kasika
|
|
6.
|
Exode
|
2013
|
Nyangi Kipusha
|
Wangalala Ikingi
|
Kasika
|
|
7.
|
Vision de Loin
|
2014
|
Bahati Kyatangalwa
|
Letoto Mwassa
|
Kasika
|
|
8.
|
Eléphant
|
2015
|
Riziki Mukamba
|
Mazambi Kagombe
|
Kasika
|
|
9.
|
Exode
|
2016
|
Mukamba Muluta
|
Kabonga Kalaza
|
Kasika
|
|
10.
|
Nouvelle Génération
|
2019
|
Dieu-donné Lisasu
|
Kabovu Ibonja
|
Kasika
|
|
11.
|
Exode
|
2020
|
Mbale Mukamba
|
Byamungu Mazambi
|
Kasika
|
Source : Mukamba Muluta F, chargé de sports et
loisirs dans la chefferie de Luindi, âgé de 38 ans,
interviewé à Kasila, le 10 Mai 2022.
Commentaire :
Le championnat local, n'a pas eu lieu dans les années
2017 et 2018 à cause de l'insécurité et l'intensification
des activités électorales.
II.4.5. RELIGION
La majorité de la population de la population actuelle
du groupement de Mukangala est chrétienne. Ce sont des catholiques de la
paroisse Mukasa de Kasika. C'est la première église construite
dans ce groupement par les colons belges. Elle a une chapelle à
Kashaka. Les protestants sont encore plus nombreux et dominent tout le
groupement avec au moins une église par localité. Il s'agit
principalement de la Communauté des Eglises Libres de Pentecôte en
Afrique (5ème CELPA) qui compte vingt églises. Elle
est suivie de la Communauté des Eglises de Pentecôte en Afrique
Centrale (8ème CEPAC) avec cinq églises. Avant
l'introduction du christianisme, les habitants de Mukangala croyaient en
l'existence d'un être suprême à qui on donnait du
respect et qu'on appelait « Namahanga » pour signifier
Dieu créateur, le Tout Puissant. Ils croyaient également en
survivance des ancêtres après la mort58(*).
Quels que soient les dangers auxquels l'église est
exposée, elle fournit des efforts pour convertir les gens en leur
apprenant à s'auto-protéger et s'auto-promouvoir. Pendant les 24
années sur lesquelles porte notre étude, soit de 1998 à
2022, l'Eglise a initié la population de Mukangala et surtout ses
fidèles à parler la langue kiswahili qu'elle utilise dans la
prédication de l'évangile. Elle initie ainsi, à la fois
ses anciens et évangélistes qui prêchent en cette langue et
ses fidèles qui suivent la prédication. Avant les massacres, la
prédication se faisait uniquement en Kinyindu, surtout dans les
localités de Pinga, Mulamba et Kalangilo aux villages Mushinga et
Kanenge.
Sur le plan moral, les habitants de Mukangala craignent ont
appris avec la religion à ne plus nuire aux autres par la magie et la
sorcellerie. Ils évitent et abandonnent progressivement les pratiques
maléfiques grâce à l'évangile qu'ils
reçoivent. La majorité de jeunes filles sont attirées par
le mariage religieux et évitent le vagabondage sexuel. Elles aiment
fréquenter les chambres des prières, les chorales et les
personnes qu'elles trouvent dignes pour qu'elles tirent d'elles des bons
conseils.
En plus de l'évangélisation pure, l'Eglise a
favorablement contribué au développement dans l'entité
sous étude en réhabilitant et en construisant des écoles
primaires et secondaires et par des formations professionnelles à
l'intention de la population locale59(*)
CHAPITRE TROISIEME. FONCTIONNEMENT
DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
Ce chapitre analyse le fonctionnement du groupement de
Mukangala en rapport avec les évolutions récentes
observées dans cette entité pour relancer son
développement après les tristes événements des
massacres de Kasika. En effet, ces massacres perpétrés en 2008
par les rebelles du RCD/Goma et leurs alliés Rwandais ont
constitué comme un moment de rupture dans l'évolution normale de
tous les secteurs de la vie, tant au niveau de la chefferie de Luindi, en
général, qu'à celui du groupement de Mukangala, en
particulier.
III.1. IMPACTS DE MASSACRES DE KASIKA SUR LE GROUPEMENT DE
MUKANGALA
En 1998, la RDC fut attaquée par des envahisseurs
regroupés au sein du RCD/Goma, en complicité avec le pays
limitrophes dont le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Pour ce faire, ces pays
avaient déployé un nombre important des militaires dans les
provinces conquises du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema. Le samedi 22 août
1998, les militaires du RCD/Goma et leurs alliés quittaient Bukavu pour
le Maniema embarquées à bord de huit camions et une
camionnette Toyota double cabine de marque « hilux » qui
transportait neuf ingénieurs de guère venus des études aux
Etats-Unis d'Amérique. Cette camionnette tomba dans une embuscade tendue
par le colonel N'yikiriba Matebura Daniel au niveau de Kahulile situé
à quelques mètres du marché de Kidasa60(*). Après avoir
laissé passer les sept camions des troupes du RCD/Goma et ses
alliées, les majors Asukulu et Munga firent descendre un jeune
garçon de dix ans habillé en peau de léopard sur la route
où il dansait pour distraire la cible. Arrivés sur le lieu,
les officiers rwandais embarqués à bord de la camionnette
s'arrêtèrent pour contempler le jeune danseur. Subitement, ils
essuyèrent des tirs nourris d'armes lourdes des Mai-Mai du colonel
N'yikiriba Daniel embusqués à environ vingt mètres de la
route. En ce moment, le petit danseur disparut dans la brousse laissant les
neuf membres de l'équipage tués sur le champ. Les militaires
d'escorte embarqués à bord du 8ème et dernier
camion, les trouvèrent déjà morts et leur camionnette
renversée, criblée des balles. Ces derniers informèrent
par motorola Talkie-Walkie leurs compagnons d'armes qui les attendaient
à Kirungutwe, un village situé à la limite de la chefferie
de Lwindi et celle de Burhinyi. Ils en informèrent également
leurs autorités basées à Bukavu61(*).
Sur ordre des autorités de RCD/Goma et rwandaises, des
renforts y furent déployés avec la consigne de
« tirer sur tout ce qui bouge », en prétextant que
la chefferie de Luindi était en connivence avec les Mai-Mai
jusque-là présumés auteurs de cette tuerie.
Les premières victimes furent signalées le lundi
matin du 24 Août 1998 dans le village Kilungutwe où même les
gens qui venaient au marché furent ressemblés, puis
massacrés sous des coups des marteaux, couteaux, haches et machettes.
Les corps furent, soit incinérés, soit jetés dans les
fosses de toilettes, soit encore dans la rivière Kilungutwe.
Jusqu'à Kasika via les villages de Kalama et Muhimbili où les
chrétiens, les prêtres et les religieuses de la
congrégation des Soeurs de la Résurrection en prière
matinale dans l'église de la paroisse catholique Saint Joseph à
Kasika furent massacrés avant de décimer la population. Le Mwami
François Mubeza III fut assassiné et son épouse, madame
Yaya Nyange Maua Yvette enceinte de huit mois, éventrée.
Plusieurs membres de la famille royale et d'autres gens trouvés dans la
cour du mwami furent également passés sous l'épée.
A part les corps de deux ingénieurs de guerre
incinérés par leurs bourreaux à Kahulile, les troupes du
RCD/Goma rentrèrent à Bukavu avec les sept autres corps qui
furent ramenés à Kigali pour l'inhumation62(*).
En termes d'impacts, ces événements
infligèrent de lourdes pertes matérielles et en vies humaines
à la chefferie de Lwindi, en général, et au groupement de
Mukangala, en particulier.En ce qui concerne le nombre de personnes
tuées dans le massacre du 24 août 1998, il y a toujours des
imprécisions parce que beaucoup de cadavres ont été
jetés dans les fosses de toilettes, dans la rivière Kilungutwe et
d'autres incinérés. Néanmoins, certains auteurs ont
avancé les chiffres suivants :
1. Bulambo Katambu Ambroise, plus 1200 personnes tuées
dans cet évènement63(*) ;
2. Mubuto Kuzindamolo W., 450 personnes tuées64(*) ;
3. Jason Stearns K., plus de 2000 âmes
disparues65(*) ;
4. Muhumba Kanga Oscar, 1973 personnes disparues66(*) ;
5. Enfin, la Cour Internationale de Justice, 786 personnes
massacrées à Luindi sur un trajet de 12 Km, depuis Kilungutwe
jusqu'à Kasika en précisant :
a. A Kilungutwe, plus de 127 personnes massacrées sans
compter beaucoup de cadavres d'enfants, femmes, hommes et jeunes jetés
dans les fosses communes, dans la rivière Kilungutwe et d'autres
incinérés.
b. A Kalama, 16 personnes massacrées, membres de la
famille Mutewa résidant à Bukavu, sur l'avenue Kasai en commune
d'Ibanda.
c. A Kasika, plus de 633 personnes massacrées notamment
le Mwami François Bwami Mubeza III et son épouse Yvette
Nyange Yaya:
- Dans la parcelle royale : 37 cadavres
découverts ;
- A la paroisse catholique de Saint Joseph : ont
été victimes un Abbé, quatre religieuses et plusieurs
personnes ;
- Au domicile de défunt Mupali Zotos alias Mbilizi un
grec qui s'était installé depuis les années 1950 à
Kasika, ainsi que quatre travailleurs dont une femme et trois hommes ;
- Dans la forêt avoisinant les villages de Kasika
où les habitants avaient pris refuge dans les cachettes dites en
kilega « Tupiengenge », plus de 400 personnes dont hommes,
femmes, enfants, jeunes et vieux.
Ainsi, la liste des victimes des massacres de Kasika est-elle
très longue, car beaucoup d'autres commerçants ambulants Shi en
provenance de territoires de Kabare et Walungu qui venaient vendre leurs
produits à Kamituga ont été massacrés par les
agresseurs sur la route de Kilungutwe, notamment entre Kasika et
Kalama67(*). Ces
événements ont provoqué des déplacements massifs de
la population rescapée si bien que le groupement de Mukanagala s'est
pratiquement vidé de ses habitants pendant une longue période. Le
retour progressif au bercail a commencé à s'effectuer avec le
rétablissement de la paix et de la sécurité dans le milieu
après la réunification du pays au terme de l'Accord Global et
inclusif de Sun City de 2002.
III.2.FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT SUR LE PLAN ECONOMIQUE
Le domaine économiquea été tellement
affecté par la guerre du RCD/Goma et ses alliés. Des pillages
systématiques ont été également effectués
par les groupes armés Interhamwe et Mai-mai. La situation ne s'est
progressivement rétablie qu'avecla stabilisation intervenue dès
l'installation au sommet de la chefferie du mwamiNyumba Bugoma Mubeza IV,en
2004.
III.2.1. Evolution du revenu familial
L'une de plus importantes évolutionsau niveau
familialpendant cette période est la progression du panier de la
ménagère qui a augmenté jusqu'à 20 dollars en
moyenne pour chaque ménage. Grace à cette augmentation du panier
de la ménagère, les familles se trouvent dans une situation
favorable face aux problèmes de rareté des denrées
alimentaires selon les saisons et les époques.
Le retour de la population dans ce groupement et leur courage
pour cultiver leurs champs sont à la base de l'augmentation de ce panier
ménagère ainsi que l'intronisation du Mwami NYUMBA Bugoma Mubeza
V à la tête de la chefferie de Luindi en 2004.
Partant de cette situation, certaines maladies comme le
marasme et le kwashiorkor ont presque disparu dans le groupement de Mukangala.
Ceci a, à son tour, conduit à la diminution des
décès, surtout des enfants dont l'âge varie entre 4 et 10
ans. D'après nos investigations sur terrain, 9 enfants sur 15 atteints
de kwashiorkor meurent tous les 2ans de cette maladie. Avec cette
amélioration des conditions de vie,on a constatéune diminution
sensible de certains comportements pervers au sein de la population comme le
banditisme, la prostitution, le tribalisme, l'intolérance envers les
autres etl'alcoolisme68(*).
III.2.2. Evolution du secteur agricole
L'économie du groupement de Mukangala est actuellement
basée sur l'agriculture. Mais celle-ci est menacée la
mosaïque. Ensuite, viennent l'élevage, la pêche et le petit
commerce. Elle est devenue une économie de substance. Cette
évolution, quoi que timide, permet tant soit peu l'instauration d'un
équilibre vitalau sein des structures du groupement et l'adaptation de
la population à la situation qu'elle traverse.
En effet, presque la totalité de la population de ce
groupement vit de l'agriculture. Elle pratique diverses cultures citées
dans les tableaux ci-dessous avec les quantités produites en tonnes.
Tableau n°15.Différents types des cultures
et leurs produits en tonnes dans le groupement de Mukangala en
2021.
|
N°
|
Types de production
|
Production en tonnes
|
|
1
|
Mais
|
12
|
|
2
|
Riz
|
7
|
|
3
|
Haricot
|
15
|
|
4
|
Arachide
|
3
|
|
5
|
Manioc
|
25
|
|
6
|
Banane
|
30
|
|
7
|
Aubergine
|
3
|
|
8
|
Tomate
|
2
|
|
9
|
Colocase
|
4
|
Source : Archives du bureau agronomique de la chefferie
de Luindi, rapport annuel de l'ONGD, ADMR, de 2019, p11 à 14
Commentaire : La culture de manioc occupe une place
prépondérante par rapport aux autres cultures, car elle apporte
un revenu considérable à la population. La culture du haricot
prédomine dans les localités de Mulamba, Pinga, Ndola et Kashaka.
L'élevage des porcs, chèvres, ovins et oiseaux de la basse-cour
est très pratiqué parce qu'ils'adapte bien au climat local et se
trouve être très rentable. La pêche traditionnelle utilisant
les hameçons et les nasses est pratiquée pour capturer les
poissons dans les rivières Ulindi et zokwe ainsi que dans les
étangs piscicoles.
Certaines innovations ont été
enregistrées sur le plan agricole avec l'introduction de nouvelles
méthodes culturales de semis en ligne pour le cas de paddy, de haricotet
d'arachide ainsi qu'avec l'introduction de nouvelles
variétés des boutures de manioc résistantes à la
mosaïque.
III.2.3. Formation à l'auto-prise en charge
Sur ce registre, il faut noter l'installation du bureau de
l'ONG CAMPS/HIA2005-2009 dont le but était d'encadrer les mères
et les jeunes filles violées à travers l'animation sanitaire et
l'apprentissage des métiers (coupe-couture, menuiserie) en vue de leur
auto-prise en charge.
La création de l'ONGD Kinguti de monsieur Jean-Marie
Bulambo Kilosho, ayant pour finalité la promotion des agriculteurs et
des vendeuses en leur octroyant gratuitement des semences et un peu d'argent
pour relancer leurs activités commerciales.D'autres ONGD sont
opérationnelles à Mukangala, comme par exemple IRC, APIDE
dans son projet Tuungane. Ces organisations fonctionnent timidement.La
construction des étalages, des hangars et d'un petit dépôt
dans le marché de Kidasa par l'ONGD CAPANAMIR de l'honorable Jean-Claude
Kibala N'Koldet d'autres projets de l'organisation internationale USAID sont
venus donner du tonus à la vie économique du groupement de
Mukangala.
III.3.PERSISTANCE DES TRAITS CULTURELS
TRADITIONNELS
Dans le groupement de Mukangala, la transmission des
connaissances se faisait à travers des contes et des historiettes, par
les vieux et les griots aux jeunes garçons au
« barza » ; et par les vielles femmes aux jeunes
filles à la cuisine ou au champ. En effet, cette éducation
traditionnelle,toujours en vigueur, porte notamment sur les travaux
champêtres comme le défrichage, l'abattage des arbres, le semis,
le sarclage et la moisson ; sur la chasse, comment tendre les
pièges oucomment pêcher, et surtout sur la vie en
société.Dans la culture lega, la principale
référence est le « Mutanga »,
c'est-à-dire la corde de la sagesse lega. Le
« Bwali » ou la circoncision chez les Lega est une
initiation qui vise à orienter le jeune homme vers un style et une
qualité de vie jugés souhaitables et irréprochables pour
la société. L'initiation au « Bwali » se
réalise sous la conduite de « Kimbilikiti »,
l'esprit principal d'initiation, toujours assisté de sa soeur
« Kabile ». Le « Bwali » couvre une
période allant de 1 à 3 mois. L'âge de recrutement pour
cette initiation est de 12 ans minimum. Tout homme Mulega est obligé d'y
aller quel que soit son âge. Les néophytes sont internés en
brousse et y reçoivent les rites, les enseignements, les épreuves
d'endurance, l'apprentissage des métiers et les pratiques de la vie
visant à éveiller une réelle mutation dans leur
manière d'être et d'agir.Le caractère sacré de
l'initiation et le combat recherché avec les énergies
primordiales renforcent le sentiment de passage d'une vie à une autre.La
nudité temporaire, la couleur blanche du Kaolin ou le vêtement
minimisé marquent la connaissance d'un nouveau genre de vie et
l'apprentissage d'un comportement différent qui va dans le même
sens.
L'intégration culturelle se réalise tout d'abord
dans la découverte des valeurs spécifiques de sa
société et de tous les messages contenus dans les divers
éléments du milieu naturel. Elle se prolonge dans la saisie de la
valeur de l'homme, de sa virilité et des relations sociales. Pour mieux
marquer l'accord nécessaire à la vie du groupe, tout acte
agressif et toute violence sont sévèrement prohibés durant
toute la durée de la réclusion. En effet, des pareilles
réactions sont supposées fracasser les côtés de
« Kimbiliki », le grand inspirateur du camp. Elles seront
donc sanctionnées par des rites significatifs et des punitions assez
pénibles pour qu'elles restent dans la mémoire. Cette
intégration culturelle met l'accent sur le courage au travail
vécu au camp, des lourdes corvées de jour et de nuit. La
durée de cette initiation est relative et dépend des
organisateurs.
Donc pendant cette période, l'enfant est
séparé de sa famille et va vivre avec les autres initiés
« Batende » dans la brousse sous la direction des sages qui
sont notamment des gens très avancés en âge. Il apprend
à chasser, à piéger, à pêcher, à
tisser, à construire une case et des préceptes de la vie
conjugale. Chaque initié est contrôlé par son parrain
appelé « Kikundi ». Les relations entre
l'initié et le village ne se font que par l'intermédiaire du
« Kikundi », car pendant toute cette période, l'on
reste éloigné du village et surtout entouré des interdits.
Dès le soir de l'installation du camp appelé
« Lutende », on procède au recrutement. Les jeunes
recrues accompagnées de leurs parrains font une sortie nocturne
officielle et une sortie diurne officielle aussi.Pour la première
sortie, ils sont accompagnés de « Kimbilikiti », et
lors de la seconde, celui-ci reste au camp entrain d'injurier les
femmes68(*).
III.4.EVOLUTION SUR LE PLAN SOCIAL
La société du groupement de Mukangala a connu
une certaine évolution après les événements
macabres de l'année 1998. Toutefois, elle a également
conservé des aspects permanents. C'est ce que tentent de
démontrer les lignes qui suivent.
La population du groupement de Mukangala est
hospitalière. Elle s'organise en familles. La vie de la famille
africaine est marquée par une attitude de respect et d'obligation
mutuels qui lient les membres l'un à l'autre et une attitude d'amour. La
famille est une unité importante pour chaque membre qui doit penser
à lui- même et aux autres dans son appartenance au groupe69(*). La société du
groupement de Mukangala a su conservé son organisation clanique
même au-delà des événements sanglants de 1998. Elle
est donc caractérisée par les permanences sociales
ci-après.
III.4.1. CLANS ET LIGNAGES DE MUKANGALA APRES L'ANNEE 1998
A. Le clan de Bahofa
C'est le clan régnant dans le groupement de Mukangala
et qui contrôle deux groupements en Chefferie de Luindi. Il s'agit de
groupements d'Ihanga et Mukangala.
B. Le clan Bachoka
Ce clan est composé par les principaux lignages
ci-après : Bamisungwe, Bakilicha, Babusamwa, Benemugamba et
Balicha.
C. Le clan de Bashilubanda
Dans cette entité de Bashilubanda, on trouve d'autres
clans suivants : Bashikumbilwa, Bashilubanda, Bashitabyale, Balimbizi,
Bashikasa, Bashibugembe et Bashitonga.
D. Les autres clans du Groupement de
Mukangala
Ce sont les clans : Balobola, Bamunda, Bandala, Babundu,
Bakanga, Basele, Babumbi, Bashimwenda et Babulinzi.
III.4.2. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
La démographie du groupement de Mukangala est en
croissance, d'une part, et en décroissance, d'autre part, suite aux
déplacements massifs des populations enregistrés de 1998 à
nos jours. En effet, d'après nos enquêtes sur terrain au bureau de
la chefferie de Luindi, en 1998, on a enregistré la première
grande vague de déplacement des habitants pour des raisons
sécuritaires.Ce déplacement a entraîné une
décroissance démographique de l'ordre de plus de la moitié
de la population du groupement de Mukangala. Après la vague de 1998,
d'autres se sont produites de 2007 à 2010 lors des affrontements entre
les soldats de l'opération Kimia II et les Hutus rwandais.
Avec l'arrivée au pouvoir du chef de la chefferie de
Luindi, en la personne de mwami Nyumba Bugoma Mubeza IV, et de celui du
groupement de Mukangala ainsi qu'avec le rétablissement de la
sécurité par le gouvernement central,on observe le retour dans
presque tous les villages de ce groupement des populations qui avaient fui pour
se réfugier à Bukavu, Mwenga-centre, Kamituga et Uvira. Le retour
des populations dans leurs milieux respectifs explique l'augmentation rapide de
la démographie dans ce groupement qui compte environ 126052
habitants en 2019, alors qu'après les massacres de 1998, il
était presque inhabité et ne comptait
que 4 567habitants en 2005.
III.5. EVOLUTION SUR LE PLAN POLITIQUE
L'évolution sur le plan politique se caractérise
par des continuités au sommet des entités administratives avec la
présence d'une seule autorité coutumière, d'un seul chef
de groupement et des chefs de localité. Les changements se situent
surtout au niveau des forces armées et de la police affectée sur
place en vue de sécuriser les personnes et leurs biens dans ce
milieu qui était devenu pendant longtemps un champ d'affrontements lors
de différentes rébellions. Ces aspects ont facilité la
réunification du groupementde Mukangala et même celle de l'ethnie
nyindu, en général.
D'autres évolutions s'observent, sur le plan
administratif avec la construction et la réhabilitation des
bâtiments administratifs, des toilettes de la chefferie, la
réhabilitation des routes de desserte agricole et des ponts
(Kasika-Ngingu via Kigogo). Il y a enfin la réhabilitation du
micro-barrage hydroélectrique de Kidasa dans la rivière
Lumetekelo par l'ONGD Tuungane70(*).
CHAPITRE IV. DIFFICULTES ET PERSPECTIVES DU GROUPEMENT DE
MUKANGALA
Ce chapitre est consacré aux difficultés
rencontrées dans le groupement de Mukangala et aux perspectives pour y
remédier. La première section montre les difficultés que
connaît ce groupement de Mukangala depuis 1998 jusqu' à nos
jours ; tandis que la deuxième est consacrée aux
perspectives et recommandations.
IV.1.
DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE GROUPEMENT DE MUKANGALA
Depuis l'an 1998, les localités du groupement de
Mukangala sont devenues le théâtre des atrocités sous
diverses formes commises par les différents groupes armés qui s'y
sont succédé. Ceci interpelle plus d'une personne et
particulièrement les habitants et les ressortissants de Mukangala qui
sont concernés en premier lieu, étant donné que la plupart
d'entre eux ont été victimes de l'une ou l'autre exaction et/ou
atrocité commise par les groupes armés et cela directement ou
indirectement. Le tableau n°8 ci-dessous reprend les difficultés
qui sévissent dans ces localités. Cette section présente
les difficultés que nous avons-nous-même aussi observées
sur le terrain à Mukangala. Nous avons eu l'occasion de rencontrer et
d'interroger les autorités politico-administratives et
ecclésiales du groupement ainsi que la population locale
constituée des hommes, femmes, jeunes garçons et filles.
L'enquête menée dans les localités représentant les
¾ des villages du groupement sous étude, nous avons
synthétisé les difficultés, leurs causes et leurs
conséquences observées dans notre champ d'investigation dans le
tableau qui suit.
Tableau 8. Difficultés rencontrées dans
les localités du groupement de Mukangala
|
N°
|
Domaines
|
Difficultés
|
Causes
|
Conséquences
|
|
1.
|
Eau et Assainissement
|
Inaccessibilité de la population à l'eau potable
dans certains villages
Dégradation du cadre de vie
|
Eloignement des sources d'eau par rapport aux villages,
présence des sources nos aménagées
Insalubrité
|
- Maladies hydriques ;
- Corvées fréquentes à la recherche d'eau
(les longues distances à parcourir pour la recherche de l'eau) par les
femmes et les enfants
- Perte de temps ;
- Maladie et destruction de l'environnement
|
|
2.
|
Education
|
Infrastructures scolaires insuffisantes, en mauvais
état et non viables
|
- Guerre à répétition (pillages des
fournitures scolaires par les groupes armés FDLR et autre) ;
- Vétusté de certains bâtiments et
écoles ;
- Faible budget alloué au secteur de
l'éducation ;
- Absence d'un institut supérieur ;
- Faible niveau de revenu, faible implication des partenaires.
|
- Accroissement du taux de déperdition
scolaire ;
- Recrudescence du phénomène des enfants
abandonnés ;
- Faible niveau de formation ;
- Insécurité sociale...
|
|
3.
|
Habitat
|
Cadre de vie non décent (présence des
habitations non décentes, maisons construites en pisées, en
paille et matériaux non durables),...
|
- Guerres à répétitions (pillages et
destructions massives des maisons) ;
- Pillages par des groupes armés ;
- Incapacité de la population à améliorer
son cadre (faible niveau de revenu) ;
- Difficulté d'accès à certains
matériaux de base (ciments, tôles,....)
|
- Risque d'exposition de la population aux intempéries
et maladies diverses ;
- Environnement non embelli, ...
|
|
4.
|
Santé
|
Difficulté d'accès aux soins de santé de
base
|
- Eloignement des structures de santé ;
- Personnel de santé insuffisant et peu
qualifié ;
- Faible revenu de la population ;
- Insuffisance de formations de santé et
maternité
- Mauvais état des infrastructures de santé
- Surpeuplement des structures de santé dans les grands
centres, ...
|
- Risque élevé de mortalité ;
- Corvées fréquentes (longues distances à
parcours pour le transport des malades) ;
- Accouchements domestiques, maternité à
risque ;
- Faible qualité des soins administrés ;
- Recrudescence des traitements ambulatoires
|
|
5.
|
Energie
|
Manque d'énergie
|
Manque des sources de production d'énergie
(électricité et mécanique,...)
|
Frein aux activités de développement,
accès difficile à certaines commodités
(télévision, radio, élévateur,...)
|
|
6.
|
VIH/SIDA
|
Faible niveau d'information sur la pandémie et la
connaissance de l'état sérologique
|
- Faible niveau des activités de
sensibilisation ;
- Coutume, ...
|
- Risque de contamination grave
|
|
7.
|
Gestion durable des ressources naturelles et
protection de l'environnement
|
Dégradation de l'écosystème
|
- Pillages, razzias des groupes armés,
- Coupes abusives des arbres ;
- Erosions, forte exploitation des charbons de bois,
perturbation climatique, déforestation, disparition des espèces
animales, végétales et utilisation des emballages en
plastique ;
- Recherche de refuge et du lucre (exploitation : bois,
minerais,...
|
- Déficit pluviométrique, appauvrissement du sol
à cause des érosions ;
- Disparition des emballages en plastiques,
perméabilité difficile de l'eau dans le sol ;
- Risque de désertification.
|
|
8.
|
Agriculture et Elevage
|
Difficulté d'accès aux intrants
Difficultés de transformation et de commercialisation
des produits agricoles
Diminution de la production et du cheptel
|
- Faible niveau de revenu de la population ;
- Manque de magasins d'intrants, faible niveau des
activités commerciales
- Mauvais état des routes, inaccessibilités,
absence de transformations ;
- Manque d'énergie, organisations des petits
marchés périodiques
- Méthodes culturales non appropriées,
insuffisances des semences ;
- Maladies des animaux ;
- Techniques culturales inappropriées
- Guerres répétitives (pillages des groupes FDLR
et autre)
- Absence de points de vente des bétails
|
- Baisse de la production, insécurité,
alimentaire, découragement pour les activités agricoles,
- Durs travaux ménagers pour la transformation des
produits (surtout pour les femmes et enfants) ;
- Faible circulation de la monnaie, risque accru du troc
- Rareté des produits laitiers et d'élevage des
cheptels.
- Carence en protéines animales, piscicoles
|
|
9.
|
Transport, Communication et
Télécommunication
|
Manque d'entretien et mauvais état des routes de
desserte agricole et impraticabilité des routes de desserte agricole et
la route nationale n°2
Difficultés d'accès à l'information
rapide
|
- Manque d'entretien des ponts ;
- Manque de moyens financiers, pas de terrassement
- Faible couverture téléphonique (pas d'antenne
de télécommunication cellulaire dans beaucoup de
localités, sauf dans le village de Kasika
- Faible accès aux médias.
|
- Enclavement de certains groupements ;
- Limitation des échanges et des mouvements
d'écoulement de la production agricole ;
- Baisse du pouvoir d'achat de la population ;
- Abandon des activités agricoles ;
- Production agricole de subsistance
- Sous - information
|
|
10.
|
Commerce
|
Insuffisance d'épargne
Manque d'un marché moderne pour évacuer les
produits agricoles
|
- Les guerres à répétition, pillages,
chômage, absence de structures d'octroi des crédits et faible
revenu de la population
- Faible développement des activités
commerciales, manque de ressources financières
|
- Insuffisance des activités commerciales
- Difficultés d'accès aux produits
manufactures
- Exode rural de la population pour chercher mieux ailleurs
- Exposition des marchands aux intempéries, faible
niveau de circulation de la monnaie...
|
|
11.
|
Artisanat
|
Faible niveau des activités artisanales
|
Désintéressement, méfiance car moins
lucratif, ignorance
|
Non valorisation des produits locaux et de la culture
|
|
12.
|
Tourisme
|
Manque d'activités touristiques dans le groupement
|
Guerres, insécurité, présences des
groupes armés, inaccessibilité des sites touristiques
|
Manque à gagner en termes de taxes, sous valorisation
des sites touristiques
|
|
13.
|
Infrastructures administratives, sociales et sportives
|
Manque d'infrastructures administratives, socioculturelles de
base dans tous les localités
|
Pillage par des groupes armés, état
avancé de délabrement, manque d'autres infrastructures
|
Désintéressement aux activités
culturelles, conditions difficiles de travail pour les agents de
l'administration publique
|
|
14.
|
Sécurité
|
Insécurité dans toutes les localités.
|
Présence des différents groupes armés
|
Frein aux mouvements des biens et des personnes, destructions
massives et tueries accables.
|
|
15.
|
Autorités ou Dirigeants
|
Incompétence de certaines autorités de
résoudre certaines problèmes dans le groupement
|
Manque de dirigeants compétents dans certaines
localités pour résoudre les petits problèmes conflictuels
entre les villages et même familles.
|
- Frein aux relations entre les tribus, familles, ...
- Création des conflits, manque d'amour entre les
gens,...
|
Source : C.T.B./PAIDECO-WAGA avec la
collaboration de l'Université de Bukavu,Plan de développement
local 2010 - 2014 de la collectivité-chefferie de Luindi en territoire
de Mwenga, inédit, Bukavu, 2010, pp. 55-5
IV.2.
PERCEPTIVES DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
Dans le but de remédieraux difficultés que
connaît le groupement de Mukangala, nous suggérons ce qui
suit :
- La mise en place des taxes de faveur pour permettre de
maximiser les recettes ;
- L'introduction des types d'élevage et de cultures
spécifiques à chaque localité ;
- La sensibilisation à l'auto-prise en charge
individuelle et collective ;
- La démobilisation des ex-combattants et leur
réinsertion sociale ;
- Encourager les déplacés au retour
volontaire ;
- Qu'une solution soit trouvée pour mettre fin aux
conflits politiques et fonciers qui déchirent ce groupement ;
- Que les autorités compétences s'impliquent
dans ces conflits pour réconcilier les parties antagonistes ou pour les
départager en tranchant sur base de la coutume locale, en respectant la
culture nyindu et les lois du pays ;
- Que le chef de groupement deMukangala applique une bonne
gouvernance dans son entité basée sur les principes de gestion
démocratique et progressiste ;
- La chefferie de Luindi devrait intervenir dans la
construction des infrastructures qui font défaut au sein du groupement
de Mukangala parce que cette entité administrative dépend
d'elle ;
- Il serait mieux de remplacer les éléments
incompétents dans la gestion de cette entité administrative par
de nouvelles unités beaucoup plus dynamiques.
CONCLUSION
Au terme de notre étude ayant porté sur
l'histoire du groupement de Mukangala (1930-2021), il sied de résumer
les résultats de nos recherches et de rappeler comment nos
hypothèses de travail ont été vérifiées.
En effet, à travers les différents chapitres de
ce travail, nous avons démontré que, contrairement aux traditions
orales qui racontent que les Bohofa sont des Nyindu d'origine, ceux-ci sont
plutôt d'origine shi de Mwenga dans la chefferie de Luwinja.Quant
à la création du groupement de Mukangala, nous avons
démontré qu'elle s'inscrit dans la mouvance da la création
des entités indigènes par les colonisateurs belges. En ce que
concerne l'organisation politico-administrative du groupement de Mukangala, nos
recherches prouvent qu'elle est hiérarchisée à partir du
pouvoir central jusqu'au niveau des villages. Les chefs de villages
possèdent le pouvoir politiqueet ont également des attributions
sociales, économiques et même culturelles.
Le deuxième chapitre a démontré que
l'évolution économique de ce groupement repose sur l'agriculture,
l'élevage et l'exploitation minière. Nous avons, en outre,
trouvé que chacune de ces activités contribue au fonctionnement
et ou développement économique de cette entité.
Le troisième chapitre prouve que les initiations et
les interdits sociaux, les écoles primaires et secondaires construites
et réhabilitées, les sports et loisirs, les rites et les coutumes
font partie de l'immense patrimoine culturel de ce groupement.
Le quatrième chapitre, enfin, montre les
difficultés que connaît le groupement de Mukangala face aux
différents conflits (guerres et rébellions) qui ont secoué
cette entité. Ces difficultés ont été d'ordre
économique avec les pillages répétitifs effectués
par les différents groupes armés Interahamwe et milices dans les
champs et maisons des paysans; d'ordre sociodémographique tel l'exode
rural, les massacres, tueries et les déplacements des populations ainsi
que d'ordre politique comme les guerresde l'AFDL, du RCD/Goma, des Mai-Mai
Nyakiriba; des conflits hégémoniques entre lesclans des Nyindu,
en général, et au sein de la famille royale, en particulier.
Au vu de difficultés que connaît le groupement de
Mukangala, nous avons suggéré au gouvernement congolais de
prendre ses responsabilités en désenclavant cette entité
politico-administrative, de revoir le système d'imposition, de mettre
sur pied une bonne politique agricole en vue de lutter contre la mosaïque
de manioc et de créer de l'emploi pour les jeunes, surtout les
ex-miliciens.
Ce travail n'a pas la prétention d'être exhaustif
; il est plutôt partiel et perfectible. Néanmoins, il apporte sa
contribution à la connaissance de l'histoire politique et administrative
de la RD Congo tout en ouvrant des pistes des recherches ultérieures sur
le groupement de Mukangala dans tous les domaines, politique,
économique, social et culturel.
SOURCES UTILISEES
SOURCES ECRITES
I.1.
DOCUMENTS D'ARCHIVES
1.archive de la chefferie de luindi, rapport
annuel 2015-2016 inédit kasika 2016
2.Archives administratives de la chefferie de
luindi, rapport annuel sur la situation actuelle de celle-ci 2019
3.archive de la chefferie de luindi, rapport
annuel de 2013 inédit kasika
4. CADHOM, rapport sur le massacre de kasika
en 2006
5. C.I.J, livre blanc terme 1 et 2 de 1999
6. archive du bureau agronomique de la
chefferie de luindi, rapport annuel de l'ONGD ADMR de 2019
7. archive du groupement de mukangala
inédit, Mwimbili 2021
8. CTB/PAIDECO-WAGA, avec la participation de
l'UOB pour la rédaction, plan du développement focal 2010-2011 de
la chefferie de luindi en territoire de mwenga, BKV 2010
I.2.OUVRAGES
1.NICOLAS MACHIAVEL : les princes,
Paris, puf, 1532
2. BULAMBO KATAMBU A : mourir au Kivu du
génocide face au massacre dans l'est du congo, paris, ed harmatan,
2001
3. BOB KABAMBA et A. MUHOLONGO
MALUMALU : cadastre des infrastructures : problèmes et
recommandations, province du nord et sud-kivu, Belgique
(ULG-Liège)CAPAC, 2010.
4. RONGER méthodologie des sciences
sociales, paris, ed, Daloz 1971
5. LUKA-NE-KONGO, Schéma du travail
scientifique, Kinshasa, ed, puf 1987.
6. SAUVET T, le dictionnaire économique et sociale,
paris, ed, ouvrière, 1962
7. DEPELTEAU F, la démarche d'une recherche en sciences
sociales, de la question du départ à la communication des
résultats, ed, lovel de Breeck université de Canada, 2010
8. MUHINDO MALONGA T, droit administratif et constitution
administrative, P.U.G-C.U.P, Butembo 2010
9. CHEIK.D, l'Afrique noir précoloniale,
présence africaine, paris 1960
10. LEYBETH, l'Afrique coloniale, paris, 1962
11. DARCET, B, les conflits de génération,
paris, ed, puf, 1963
12. CHIMANGA,W. TSHI : histoire du zaïre ed, du
ceruki, Bukavu, 1976
13. MARIE-CLAUDE SMUTS, DARIO BATISTELA et PASCAL VANESSA,
dictionnaire des rélations internationales, paris, ed, daloz, 1992
14. JASON STEARNS K, dacing in the glory of ministers :
collopre of the congo and the great war of Africa. New-York Affaires blacks,
2011
I.3.
ARTICLES DE REVUES
1.ordonnance-loi n°82/006 du 25
Février 1982 portant l'organisation territoriale politique et
administrative de la République du Zaïre
2.journal officiel de la République du
zaïre n°6, Kinshasa, le 16 Janver 1982
3.MUHUMBA KANGA O, la guerre de 1998 une
véritable hécatombe pour les Batwa, Banyindu, de voir les
mémoires pour les pygmées de Kasika, Bkv, 2004, article produit
à l'USK/BKV
I.4. MEMOIRES, TFE, COURS
1. AHADI LUKOGO, évolution sociale et
économique dans la chefferie de Luindi(1996-2015), mémoire en
histoire, inédit, isp/Bukavu, 2016
2. KISHUGI MASTAKI. T. application des
mécanismes de la justice traditionnelle, altérnative pour la
stabilité locale dans la chefferie de Luindi en territoire de Mwenga, de
1998-2010. Mémoire en développement rural, inédit
ISDR/Bukavu 2010
3.MUBUTO KUZINDAMOLO W, dynamique
sociopolitique dans les collectivités, chefferies de Luindi, Basile,
Wamuzimu de 1998-2003. Mémoire en SPA, UOB, 2003, inédit
4. MWAVITA K, effet de guerre sur
l'environnement naturel de la chefferie de luindi en territoire de Mwenga,
mémoire en développement rural inédit, ISDR/Bukavu 2011
5. ZAMUKULU MILENGE H, l'impact de massacre
de kasika sur le développement sociopolitique dans la chefferie de
luindi( de 1998-2014). Mémoire e, SPA inédit, UOB, 2014
6. MIHALI MUBEZA S, histoire sociopolitique
de la collectivité chefferie de luindi de 1923-2007, mémoire en
histoire ISP/Bukavu inédit 2011.
LES TFE
1. MIHALI Mubeza S, l'histoire sociopolitique de la chefferie
de luindi, de 1993 - 2007. TFC en histoire, inédit, ISP/Bukavu 2008
2. MUTIKI LUTALA Jean, effet sur l'exercice du pouvoir
politique chez les Nyindu dans la collectivité chefferie de luindi en
territoire de mwenga de 1976-1977. TFC en histoire, inédit, ISP/Bukavu
1977
3. WILONDA MWATI E. : les incidences socioculturelles de
la décolonisation des jeunes filles âgées de 6 à
17ans dans le groupement d'Ihanga en chefferie de luindi de 2006 à 2007,
TFC en développement rural, inédit ISDR/Bukavu, 2007
4. WILONDJA LWIMBO, impact de massacre de kasika sur le
développement socioéconomique dans la chefferie de luindi en
territoire de mwenga, tfc en développement rural ISDR/BKV 2007
5. NAMASHEWA KABAMBA, les rôles de l'église dans
la gestion des conflits du pouvoir coutumier cas de la collectivité
chefferie de luindi, tfc en théologie inédit, UEA/BKV 2004
6. BYAMUNGU MUKOBELWA J, conflit au succession au pouvoir dans
la chefferie de luindi de 1988 à 2012, Tfc en SPA inédit, USK/BKV
2013
7. BUBALA KAZAMWALI H, histoire du groupement d'ihanga dans la
chefferie de luindi en territoire de mwenga de 1929-2014, Tfc en histoire,
inédit, ISP/BKV 2017
8. MUKAMBA R, histoire du groupement de babulinzi dans la
chefferie de basile en territoire de mwenga «en 1960 à 2010 en HSS,
inédit, ISP/BKV 2015
9. POLEPOLE I, histoire politique de la collectivité de
wamuzimu fin du 19ème siècle à 1960, Tfc en
HSS, inédit, ISP/BKV 1976
10. ZAMUKULU MILENGE H, la dynamique sociopolitique en
chefferie de luindi de 1997-2012, Tfc en SPA, inédit, UOB, 2012
11. MULENGWA KARANGWA R, le pouvoir coutumier et
l'évolution de la fonction sociale cas de la collectivité
chefferie de Burhinyi, Tfc en SPA, UOB inédit 2001.
THESES
1. KASIGWA MASUMBUKO Ch, intégration économique
du sud-kivu dans la région du Grands-Lacs Africains : analyse
appliquér au système de transport et à l'agriculture,
thèse de doctorat en sciences économiques et gestions,
inédit, UNIKIS, décembre 2012.
D.E.S
1. ABAMUNGU BASHWIRA J, les églises et leurs incidences
dans le développement dans la ville de Bukavu, une analyse
interdiscurtive D.E.S en sociologie de la religion UOB, inédit 2013.
COURS
1. KAGANDA Mulumeoderhwa P, cours d'initiation à la
recherche scientifique, inédit UOB/BKV, FSSPA, G1 SPA 2009-2010 p2
2. USUNGO Ulungu J, cours d'initiation à la recherche
scientifique en G2 HSS, inédit, ISP/BKV, 2020-2021
3. KASAY KATCHUVA L.A, cours d'aménagement du
territoire de, L2 SPA, UOB 2014
I.5. INSTRUMENTS DE TRAVAIL :
Encyclopédies, Dictionnaires
1. Dictionnaire petit Larousse, ed, dalloz,
paris 1997
2. Petit Robert, dictionnaire de langue
française, paris, 1994
NETOGRAPHIE
SOURCES ORALES : LISTE DES PERSONNES
ENQUETEES
|
N°
|
Noms et Post-Noms
|
Sexe
|
Age
|
Fonctions
|
Lieux et dates d'interview
|
|
1
|
Bulambo Kakobanya
|
M
|
88 ans
|
Commerçant
|
Kadutu,
|
|
2
|
Takubusoga Musingi
|
F
|
50 ans
|
Enseignante
|
Kasika,
|
|
3
|
Nyumba Bugoma
|
M
|
60 ans
|
Commerçant
|
Kasali
|
|
4
|
Milemba Kitoga
|
M
|
52 ans
|
Commerçant
|
Bukavu
|
|
5
|
Mazambi Winene
|
M
|
49 ans
|
Commerçant
|
Panzi
|
|
6
|
Mutimanwa Mwagalwa
|
M
|
35ana
|
Enseignant
|
Muhimbili
|
|
7
|
Lutanda Mutimanwa
|
M
|
63ans
|
Pasteur
|
Bizimana
|
|
8
|
Museme Kabasele
|
M
|
60ans
|
Agent de l'état civil
|
Kasika
|
|
9
|
Mwenebatende Nabuhombya
|
M
|
102ans
|
Chef de groupement
|
Kasika
|
|
10
|
Katambu Miali Ulia
|
M
|
43ans
|
Transporteur
|
Kasika
|
|
11
|
Bulambo Kilombwe Toto
|
M
|
40ans
|
Commerçant
|
Kasika
|
|
12
|
Mugambwa Rwanyonga
|
M
|
40ans
|
Transporteur
|
Kasika
|
|
13
|
Mukamba Kamundala
|
M
|
32ans
|
Commerçant
|
Kasika
|
|
14
|
Milenge Muhanyaingwa
|
M
|
45ans
|
Commerçant
|
Kidasa
|
|
15
|
Serge Lisasu Lubula
|
M
|
38ans
|
Agent Airtel
|
Kasika
|
|
16
|
Bulambo Mulungula
|
M
|
35ans
|
Préfet et président de la société
civile de luindi
|
Kalambi
|
|
17
|
Balolwa Mulungula
|
M
|
50ans
|
Cultivateur
|
Bukavu
|
|
18
|
Anna Ngalya
|
M
|
82ans
|
Cultivateur
|
Kasika
|
|
19
|
Bonane Maumba
|
M
|
40ans
|
Directeur d'école
|
Kasika
|
|
20
|
Zamba Mwenebatende
|
M
|
55ans
|
Enseignant
|
Kasika
|
|
21
|
Milenge Kahumba
|
M
|
50 ans
|
Notable
|
Kidasa
|
|
22
|
Walasa Mbale
|
M
|
49 ans
|
Professeur
|
Kanenge
|
|
23
|
Georgette Musano Nyumba
Yababo
|
F
|
45 ans
|
Cultivatrice
|
Kalangilo
|
|
24
|
Wabiwa Manyumba
|
F
|
5à ans
|
Enseignante
|
Mukasa
|
|
25
|
Mazambi Ngwasa
|
M
|
45 ans
|
Préfet des études
|
Mulamba
|
|
26
|
Elias Mazambi Wtukalusu
|
M
|
53 ans
|
Pasteur
|
Muhimbili
|
|
27
|
Milenge Muhanyahingwa
|
M
|
45 ans
|
Commerçant
|
Klidasa
|
|
28
|
Lwesso Kaseke
|
M
|
52 ans
|
Pasteur
|
Muhimbili
|
|
29
|
Wangalala Ikingisha
|
M
|
55 ans
|
Directeur d'école
|
Mukasa
|
|
30
|
Mukamba Mulita
|
M
|
36 ans
|
Charger de sport
|
Kahulile
|
|
31
|
Mukamba Mutekulwa
|
M
|
37 ans
|
Cultivateur
|
Kidasa
|
|
32
|
Milonda Rudia
|
F
|
63 ans
|
Cultivatrice
|
Kasika
|
|
33
|
David Bikombolwa
|
M
|
50 ans
|
Pasteur
|
Bizimana
|
|
34
|
Neema Shamululi
|
F
|
28 ans
|
Cultivatrice
|
Kasika
|
|
35
|
Bitondo Lisasu
|
F
|
63 ans
|
Enseignante
|
Bagira
|
|
36
|
Feza Lisasu Lea
|
F
|
61 ans
|
Cultivatrice
|
Ilemba
|
|
37
|
Wilondja Musombwa
|
M
|
65 ans
|
Directeur
|
Kasika
|
|
38
|
Mukungilwa Lukogo
|
M
|
68 ans
|
Pasteur
|
Mulamba
|
|
39
|
Muganza Ilolwa
|
M
|
55 ans
|
Cultivateur
|
Mukasa
|
|
40
|
Mambo Kivukutu
|
M
|
63 ans
|
Cultivateur
|
Mukasa
|
|
41
|
Akilimali Mulelembuko
|
M
|
28 ans
|
Trafiquant des minerais
|
Ilongo
|
|
42
|
Mazambi Witakenge
|
M
|
30 ans
|
Enseignant
|
Kasika
|
|
43
|
Faida Kika
|
F
|
32 ans
|
Cultivatrice
|
Mukasa
|
|
44
|
Bahati Mauwa Pascasie
|
F
|
30 ans
|
Juriste
|
Labote
|
|
45
|
Mutumbwa Mushingilwa Senghor
|
M
|
41 ans
|
Enseignant
|
Bukavu
|
|
46
|
Mihali Mubeza
|
M
|
37 ans
|
Enseignant à l'institut ACECO
|
Bukavu
|
|
47
|
Bugoma Kimbu Vicky
|
M
|
58 ans
|
Superviseur de la zone de santé de Mwenga
|
Mwenga
|
|
48
|
Mwati Mulungula Vianney
|
M
|
62 ans
|
Administrateur Gestionnaire de la Zone de Santé de
Mwenga
|
Mwenga
|
|
49
|
Takubusoga Musingi Dorcas
|
F
|
56 ans
|
Point Focal de la Fondation Panzi
|
Kasika
|
|
50
|
Shewa Kabumbanyungu
|
M
|
45 ans
|
Rév. Pasteur
|
Bukavu
|
Notre enquête a eu lieu dans deux milieux
différents, à Bukavu du 1erau 7 Juin 2022 et à
kasika/lwindi dans le groupement de Mukagala du 7 au 14 Juillet 202
Table des matières
MEMORIAM
I
EPIGRAPHE
II
REMERCIEMENTS
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
V
INTRODUCTION GENERALE
1
CHOIX ET INTERET DU SUJET
1
ETAT DE LA QUESTION
1
PROBLEMATIQUE DE L'ETUDE
5
HYPOTHESES
5
0.5. DELIMITATION DU SUJET
6
0.5.1. DELIMITATION CHRONOLOGIQUE
6
0.5.2. DELIMITATION SPATIALE
6
0.5.1. METHODES
7
La méthode historique
7
0.5.2. TECHNIQUES
7
0.5.3. SOURCES UTILISEES
8
0.7. DIFFICULTES RENCONTREES
8
0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
9
CHAPITRE PREMIER. ORIGINES DU GROUPEMENT DE
MUKANGALA
10
I.1. PRESENTATION PHYSIQUE DU GROUPEMENT DE
MUKANGALA
10
I.1.1. Situation
géographique
10
CARTE DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
10
I.1.2. Relief
11
I.1.3. Climat
11
I.1.4. Végétation
11
I.1.5. Sol et sous-sol
11
I.1.6.Hydrographie
11
I.2. SITUATION DEMOGRAPHIQUE DU GROUPEMENT DE
MUKANGALA
11
I.2.1. Population
12
Tableau n°1. Evolution de la population
de Mukangala (1930- 2019)
12
I.2.2. Habitat
13
I.2.3. Origines et mise en place des
habitants de Mukangala
13
I.2.4. ORGANISATION DES NYINDU
14
ORGANISATION POLITIQUE DES NYINDU
14
A.1. Origines de la royauté de
Luindi
14
A.2. Les insignes du pouvoir monarchique de
Luindi
14
A.3. Les dignitaires du royaume de
Luindi
15
Tableau n°2. Entités
administratives de la chefferie de Luindi
16
A.4. Les maisons royales de
Luindi
18
ORGANISATION SOCIALE
18
B.2. Toponymie et anthroponymie chez les Nyindu
19
B.3. Mariage coutumier chez les Nyindu
20
ORGANISATION CULTURELLE DES NYINDU
21
CONSIDERATIONS SOCIOLINGUISTIQUES
22
I.3. CREATION DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
23
I.4. Origines des Lega : Bunyoro
24
Arbre généalogique des Lega
27
CHAPITRE DEUXIEME. ORGANISATION DU GROUPEMENT DE
MUKANGALA
29
II.1. ORGANISATION POLITICO-ADMINISTRATIVE DU
GROUPEMENT DE MUKANGALA
29
II.1.1. DEFINITION DES CONCEPTS
29
II.1.2. ANIMATEURS DE LA VIE POLITIQUE ET
ADMINISTRATIVE
30
ORGANIGRAMME DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
31
II.2. ATTRIBUTIONS DES ANIMATEURS DU GROUPEMENT DE
MUKANGALA
32
II.2.1. Le chef de groupement
32
II.2.2. Le Secrétaire administratif
32
II.2.3. Les chefs de localités
33
II.2.5. Le bureau d'état civil
33
II.3. ORGANISATION SUR LE PLAN ECONOMIQUE
35
II.3.1. AGRICULTURE ET PECHE
36
II.3.2. ELEVAGE
38
II.3.3. CHASSE
38
II.3.4. COMMERCE
39
II.3.7. ARTISANAT
42
II.4. SITUATION SOCIO-CULTURELLE
42
II.4.2. FORMATIONS SANITAIRES
45
II.4.3. HABITAT
46
II.4.5. RELIGION
52
CHAPITRE TROISIEME. FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT DE
MUKANGALA
53
III.1. IMPACTS DE MASSACRES DE KASIKA SUR LE
GROUPEMENT DE MUKANGALA
53
III.2. FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT SUR LE PLAN
ECONOMIQUE
55
III.2.1. Evolution du revenu familial
55
III.2.2. Evolution du secteur agricole
56
III.4.1. CLANS ET LIGNAGES DE MUKANGALA APRES
L'ANNEE 1998
59
III.5. EVOLUTION SUR LE PLAN POLITIQUE
60
CHAPITRE IV. DIFFICULTES ET PERSPECTIVES DU
GROUPEMENT DE MUKANGALA
62
IV.1. DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE GROUPEMENT DE
MUKANGALA
62
IV.2. PERCEPTIVES DU GROUPEMENT DE MUKANGALA
0
CONCLUSION
1
SOURCES UTILISEES
2
SOURCES ECRITES
2
I.1. DOCUMENTS D'ARCHIVES
2
I.2. OUVRAGES
2
I.3. ARTICLES DE REVUES
3
I.4. MEMOIRES, TFE, COURS
3
I.5. INSTRUMENTS DE TRAVAIL :
Encyclopédies, Dictionnaires
5
SOURCES ORALES : LISTE DES PERSONNES
ENQUETEES
5
* 1M.Grawitz, cité par
P. Kaganda Mulumeo-Derhwa, Cours d'initiation à la recherche
scientifique, inédit, UOB, FSSPA, G1SPA, 2009-2010, p.2.
* 2Ahadi Lukogo,
Evolution sociale et économique de la chefferie de Lwindi (1996-2015),
mémoire de licence en Histoire, inédit, ISP/Bukavu,
2016.
* 3Bulambo Katambu, A.,
Mourir au Kivu : du génocide Tutsi aux massacres dans l'Est du
Congo, Paris, Ed. Le Harmattan, 2001.
* 4 Bob Kabamba et A
Muholongo Malumalu, Cadastre des infrastructures : problèmes et
recommandations/Provinces du Nord et du Sud-Kivu, Belgique (ULG-Liège),
CAPAC, 2010, pp.444-446.
* 5Chishugi Mastaki, T.,
Application des mécanismes de la justice traditionnelle, une alternative
pour la stabilité locale dans la chefferie de Luindi dans le territoire
de Mwenga de 1998-2010, mémoire de licence en Développement
rural, inédit, ISDR/Bukavu, 2010.
* 6 Miyali Mubeza, S.,
Histoire socio-politique de la chefferie de Luindi (1923-2007), TFE en
Histoire-Sciences Sociales, inédit, ISP/Bukavu, 2008.
* 7Mubuto Kuzindamolo,
W., Dynamique sociopolitique dans les collectivités-chefferies de
Basile, Lwindi et Wamuzimu de 1998 à 2003, mémoire de
licence en SPA, inédit, UOB, 2003.
* 8 Mutiki Lutala, J.,
Essai sur l'exercice du pouvoir politique chez les Banyindu dans la
collectivité chefferie de Luindi en territoire de Mwenga :
1976-1977 », TFE en Histoire-Sciences Sociales, inédit,
ISP/Bukavu, 1977.
* 9Mwavita, K.,
Effets des guerres sur l'environnement naturel de la chefferie de Luindi en
territoire de Mwenga, mémoire de licence en Développement
rural, inédit, ISDR/Bukavu, 2011.
* 10 Wilondja Mwati, E.,
Les incidences socio-culturelles de la déscolarisation des jeunes filles
âgées de 6 à 17 ans dans le groupement d'Ihanga en
chefferie de Luindi (2006-2007) », TFC en Développement
rural, inédit, ISDR/Bukavu, 2007.
* 11Zamukulu Milenge,
H., L'impact des massacres de Kasika sur le développement
socio-politique dans la chefferie de Luindi » (1998-2013),
mémoire de licence en SPA, inédit, UOB, 2014, p67, .
*
12Dictionnaire Petit Larousse, Ed. Dalloz, Paris,
1997, p85.
* 13Usungo Ulungu, J.,
Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2HSS,
inédit, ISP/Bukavu, 2020-2021.
* 14Nyamatomwa,
M., cité par Mubuto Kuzindamolo, Dynamique socio-politique dans les
collectivités-chefferies de Basile, Luindi et Wamuzimu, de 1998 à
2003, mémoire de licence en SPA, inédit, CUB, 2003, p.1.
* 15Rongere, P.,
Méthodologies de sciences sociales, Paris, Ed Dalloz, 1971,
p.20.
* 16 Loka-Ne-Kongo,
Schéma du travail scientifique, Kinshasa, Ed. P.U.Z, 1987, p.86.
* 17Mihali Mubeza, S.,
Histoire socio-politique de la collectivité chefferie de Luindi
(1923-2007), ISP/Bukavu, mémoire de licence en Histoire,
inédit, ISP/Bukavu, 2011, pp.5-6.
* 18Mihali Mubeza, S., 2011,
op.cit., pp. 7,10.
* 19 Wilondja Lwimbo,
Impact des massacres de Kasika sur le développement
socioéconomique dans la chefferie de Luindi en territoire de Mwenga,
TFE en développement rural, ISRD/Bukavu, 2006-2007, p.25.
* 20Sauvet, T., Le
dictionnaire économique et social, Ed. Ouvrière, Paris,
1962, p.38.
* 21Namashewa
Kabamba, Le rôle de l'église dans la gestion des conflits du
pouvoir coutumier : cas de la collectivité-chefferie de Luindi,
TFE en Théologie, inédit, UEA/BUKAVU, 2004, pp.18-24.
* 22Archives de la
chefferie de Luindi, Rapport annuel 2015-2016, inédit, Kasika,
2016, pp.10-21.
* 23 Bulambo Kakobanya M.,
interviewé, le 27 Août 2022, à Bukavu.
* 24Mwenebatende
NabuhobyaJoseph chef de groupement, Interviewé à Kasika, le 12
janvier 2022
* 25Depelteau, F., La
démarche d'une recherche en science sociale. De la question du
départ à la communication des résultats, Laval, Ed de
Boeck, Université de canada, 2000, p.175.
* 26Muhindo Malonga, T.,
Droit administratif et institutions administratives, P.U.G-C.R.I. P,
Butembo, 2010, pp.130-134.
* 27Bubala
Kazamwali, op.cit., pp.21-22.
* 28 CHIK.A.D.,
L'Afrique noire précoloniale, Présence Africaine, Paris,
1960, p162.
* 29 Leybeth, L'Afrique
coloniale, Paris, 1962, p.89.
* 30 Darcet, B., Les
conflits de générations, PUF, Paris, 1963, p.7.
* 31 Mukamba,R., Histoire
du groupement des Babulinzi dans la chefferie de Basile en territoire de
Mwenga, 1960-2010, TFE, Histoire-Sciences Sociales, inédit,
ISP/Bukavu, 2015, p.8.
* 32Poleole, I.,
Histoire politique de la collectivité des Wamuzimu fin
19ème S-1960, TFE, Histoire-Sciences Sociales,
inédit ISP/Bukavu, 1976, p.18.
* 33 TSHIMANGA W. TSH.,
Histoire du Zaïre, éd. du CERUKI, Bukavu, 1976, p.23.
*
34Ordonnance-loi n°82/006 du 25 février
1982 portant l'organisation territoriale, politique et administrative de la
République du Zaïre, journal officiel de la République du
Zaïre n°06, Kinshasa, le 16 février 1982.
* 35Depelteau,
F., La démarche d'une recherche en science sociale. De la question du
départ à la communication des résultats, Ed. Laval de
Boeck, Université de canada, 2000, p.175.
* 36Muhindo
Malonga, Droit administratif et institutions administratives, PUG, CRIP,
Butembo, 2010, pp.130-134.
* 37Marie-Claude Smuts,
Dario Battistella et Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations
Internationales, Paris, Ed. Dalloz, p.480.
* 38 Petit Robert,
Dictionnaire de la Langue Française, Paris, 1994, p.854.
* 39Bitondo Kabala,
Agée de 69 ans, fille de Songa Lisasu Modeste, interrogée
à Bagira, le 15/02/2022.
* 40 Bubala Kazamwali,
op.cit., pp.27-28.
* 41Mwenebatende Nabuhobya
Joseph, chef de groupement de Mukangala, Interviewé à Kasika, le
12 janvier 2022.
* 42 R. Boudon,
cité par Abamungu Bashwira John, Les églises et leurs incidences
dans le développement dans la ville de Bukavu (une analyse
praxeo-interdiscursive), DES en sociologie de la religion,UOB, Inédit
2012-2013, p.24,.
* 43Abamungu Bashwira, J.,
op.cit., p.75
* 44Birou, A., cité
par Abamungu Bashwira J., op.cit., p.56.
* 45Fossaert, R.,
cité par Abamungu Bashwira, J., p.72.
* 46Marchal, J., cité
par Kasigwa Masumbuko Christophe, Intégration économique du
Sud-Kivu dans la région des grands-lacs africains : analyse
appliquée au système de transport et à l'agriculture,
Thèse de doctorat en Sciences économiques et de gestion,
inédit, Unikis Décembre 2012, p.158.
* 47Archives de la
chefferie de Lwindi, Rapport annuel, 2012-2013, inédit, Kasika,
pp. 5-13.
* 48Zamukulu Milenge,
H., La dynamique socio-politique en chefferie de Lwindi : 1997-2012,
TFC en SPA, inédit, UOB, 2012, pp. 15-17.
* 49Musa Kakobanya, 88 ans,
interviewé à Bukavu, le 1er Décembre 2021.
* 50Mulengwa Karhangwa, R.,
Le pouvoir coutumier et l'évolution de sa fonction sociale. Cas
de la collectivité-chefferie de Burhinyi, TFE en SPA,
inédit, UOB, 2000-2001, p.10.
* 51Bahizire Kabage Dunia,
Révérend Pasteur de la 5ème CELPA Kilimbwe,
âgé de 65 ans, interviewé à Kasika, le 07 Mai
2022.
* 52 Kasindi Lubunga,
secrétaire du chef de groupement de Mukangala, âgé de 54
ans, interviewé à Kasika, le 12 Mai 2022.
* 53Bugoma Kimbu Vicky,
Superviseur principal de la zone de santé de Mwenga, interviewé
le 20 décembre 2021 à Mwenga-centre.
* 54Kasay Katchuva, L. A.,
cours d'aménagement du territoire II, mémoire de licence en
SPA, inédit, UOB, 2014 p.37.
* 55 Bugoma Kimbu Vicky,
Infirmier superviseur de la zone de santé de Mwenga, âgé de
58 ans, interviewé le 20 Février 2022 à Mwenga-centre.
* 56 Bugoma Kimbu Vicky,
informateur déjà cité.
* 57R. Mulengwa Karangwa,
Le pouvoir coutumier et l'évolution de sa fonction sociale. Cas de la
collectivité chefferie de Burhinyi, TFC en SPA, inédit, UOB,
2001, p.10.
* 58Zamukulu Milenge, H.,
op.cit., p.18.
* 59 CADDHOM, Rapport
sur les massacres de Kasika, 2006, pp.3-5.
* 60Muhumba Kanga
O, La guerre de 1998, une veritable hécatombe pour le Batwa
Banyindu, devoir de mémoire pour les pygmées de Kasika,
Bukavu, 2004, p.2. article sur le massacre de Kasika produit à
l'USK
* 61 Bulambo Katambu, A.,
op. cit., p.88.
* 62 Zamukulu Milenge, H.,
op.cit., pp. 32-33.
* 63Bulambo Katambu, A.,
op.cit., p.86.
* 64Mubuto
Kuzindamolo, W., op.cit., p.41.
* 65Jason Stearns,
K., op. cit., p.263.
* 66 Muhumba Kanga
Oscar, op. cit., 2004, p.7.
* 67 CIJ, Livre blanc
(tome I et II), 1999, pp.18-19.
* 68 Mwessi, L.,
Histoire de l'ancien secteur de Kasanza et l'évolution des luttes pour
sa restauration en Territoire de Shabunda (1924-2000), mémoire de
licence en Histoire, inédit, ISP/Bukavu, année 2014, p39
* 69 Nyerere, J.,
op.cit., p.9.
| 


