|
Les problèmes de pauvreté sont d'un
grand intérêt pour les praticiens du développement. Dans le
souci d'apporter une solution à ces problèmes, la
communauté du développement tente de définir les
indicateurs qui permettent de mesurer et de délimiter ce
phénomène. Mesurer la pauvreté signifie produire des
nombres, par lesquels nous pouvons évaluer le degré de
pauvreté dans une société donnée et d'identifier
les membres de la société qui doivent être
considérés pauvres. Or, il n'est pas sûr que ce que nous
voulons mesurer soit effectivement mesurable. En effet, ni le bien-être
économique, ni les capacités d'un individu, encore moins la
satisfaction des besoins ne sont directement observables. Dans ces conditions,
le recours à des variables observables qui permettent d'inférer
approximativement la réalité à laquelle nous
référons par le terme pauvreté est nécessaire. Ces
dites variables portent le nom d'indicateur. Un indicateur de pauvreté
peut être défini comme étant une variable
« proxy » mesurable et aussi presque possible d'une
dimension particulière spécifiée dans l'espace de
pauvreté. Ainsi, si nous prenons comme mesure de pauvreté ;
être adéquatement nourri, l'indicateur à ce niveau pourrait
être la consommation journalière de denrées de base comme
le riz.
Mais, comment peut-on mieux définir la
pauvreté et la mesurer avec ses indicateurs ? Comment les
différentes formes de pauvreté évoluent - elles à
travers le monde, et quelles leçons pouvons-nous en tirer ?
La grande difficulté à laquelle les
théoriciens du développement sont-ils confrontés à
ce niveau, est qu'il n'existe pas une définition unique da la
pauvreté. Plusieurs définitions sont ainsi proposées, qui
engagent des instruments différents pour la caractériser et la
mesurer sous ses diverses formes. Ils existent donc plusieurs approches pour
aborder et comprendre la pauvreté dans l'espace temporale et temporel
entre les sociétés. Dans ce contexte, les analyses divergent d'un
auteur à un autre. Néanmoins, tous semblent unanimes que la
pauvreté est un problème sérieux auquel il faut s'attaquer
pour l'équilibre social. Déjà, au Vème
siècle avant Jésus Christ, Platon prévenait le
législateur athénien de la menace que représentait
l'inégalité : « Il ne faut pas que certains
citoyens souffrent de la pauvreté, tandis que d'autres sont riches,
parce que ces deux états sont causes de dissensions » (in PNUD
2005, p.55)1(*). Ce n'est
que bien plus tard, au début du XIXème siècle, que le
problème et les solutions de la pauvreté commencent à
prendre leur forme moderne.
L'économiste anglais Thomas Malthus faisait
déjà une analyse pessimiste à la fin du XVIIIème
siècle. Selon l'auteur, les subsistances croissent à une
progression arithmétique, alors que la population a une progression
géométrique, d'où la stagnation économique
inéluctable. Pour lui, les pauvres doivent arrêter de
procréer, car ils sont incapables de subvenir aux besoins de leur
progéniture. Si les pauvres sont pauvres, c'est de leur faute et leur
fécondité excessive en est responsable. Il propose donc que les
familles qui désirent un, ou plusieurs, enfants soient capables de les
nourrir ; les aident par des prestations en nature ou autres ne feraient
qu'accentuer la paupérisation globale. C'est cette vision que Galbraith
développait quand il affirme que « Dans la vie
économique comme dans le développement biologique, la
règle suprême était la survie des plus aptes [...]
l'élimination des plus pauvres est le moyen utilisé par la nature
pour améliorer la race. La qualité de la famille humaine sort
renforcée de la disparition des faibles et des
déshérités ».
C'est contre ces perceptions que s'éleva Adam
Smith dès la fin du XVIIIème siècle. L'idée selon
laquelle il existe des limites aux privations tolérables est
fondamentale selon la plupart des sociétés et systèmes de
valeurs : « aucune société ne peut être
florissante et heureuse si une écrasante majorité de ses membres
vivent dans la pauvreté et la misère ... ». C'est
Smith qui élabora l'idée de la pauvreté relative, arguant
que tous les membres de la société devaient jouir d'un revenu
suffisant leur permettant de se monter « sans honte »
en public » (in PNUD, 2005, p.56).
Pour Tocqueville, la pauvreté n'existe pas en
elle-même mais permet de cerner la différenciation des besoins
entre sociétés, entre époques, entre groupes ou classes
sociales d'une même nation. La création des richesses dans un
contexte de révolution industrielle ne peut qu'accroître les
besoins et, de fait, les insatisfactions et les
inégalités : « le nombre de ceux qui auront
besoin de recourir à l'appui de leurs semblables pour recueillir une
faible part des besoins, le nombre de ceux-là s'accroîtra, sans
cesse » ( in Paugam, 1983, p. 23 et 24)2(*). Il aborde également la question de
l'assistance aux pauvres et s'interroge notamment sur le sens du droit à
l'assistance aux pauvres : « Toute charité publique
ne peut guère résoudre le problème de pauvreté, si
ce n'est que créer une classe oisive et paresseuse, vivant aux
dépens de la classe industrielle et travaillante » (in Pogam,
1983, P. 30).
Karl Marx3(*), contrairement à Tocqueville, pense que les
indigents ne sont pas « un accident » de l'histoire mais
forment une armée industrielle de réserve. Pour lui, dans les
pays capitalistes, la classe propriétaire des moyens de production
domine la classe des prolétaires. Les inégalités sont
profondes et croissantes. Elles s'inscrivent dans un mouvement historique de
lutte des classes, et la richesse et la pauvreté sont des aspects d'un
même processus d'exploitation du travail par le capital. La solution
réside dans la création d'une société sans classe
et sans Etat du communisme.
Georg Simmel, quant à lui, considère
qu'un individu est pauvre dès lors qu'il est
assisté. « Les pauvres, en tant que catégorie
sociale, ne sont pas ceux qui souffrent de manques et de privations
spécifiques, mais ceux qui reçoivent assistance ou devraient la
recevoir selon les normes sociales. Par conséquent, la pauvreté
ne peut, dans ce sens, être définie comme un état
quantitatif en elle-même, mais seulement par rapport à la
réaction sociale qui résulte d'une situation
spécifique » (Ibid.p.98 in Paugam, 1983 p. 42). Tout comme
Marx, l'auteur pense que les pauvres ne sont pas en dehors de la
société mais bien en dedans. SEN4(*) utilisera cette même vision pour donner un
contenu révolutionnaire à la mesure de la pauvreté, en
introduisant les notions d'inégalité, de capacité...
Pour l'auteur, « les égalités
formelles doivent être soutenues parce qu'elles appellent les
libertés de fond, les capacités de choisir un style de vie et de
faire ce à quoi on attache de la valeur [...] les grandes
inégalités dans les chances de vie limitent ces libertés
de fond et vident l'idée de l'égalité devant la loi de son
sens » (in PNUD 2005, p. 59). Ainsi, évaluer
l'impossibilité des individus à choisir ce qui leur semble utile
ou appréciable est une méthode plus efficace pour mesurer la
pauvreté.
Comme nous le constatons à travers les
divergences de conceptions dans l'approche théorique de l'explication de
la pauvreté, les praticiens du développement semblent
partagés quant à la manière de concevoir et d'expliquer ce
phénomène. Nous pouvons néanmoins synthétiser les
différentes conceptions en trois groupes d'intérêts.
Tout d'abord, l'approche essentiellement
économique de la pauvreté s'appuie sur les revenus, la
consommation et, la qualité de vie en tant qu'indicateurs indirects pour
saisir et mesurer le degré de pauvreté et de bien-être
d'une personne. Le concept de bien-être économique, à cet
égard, découle de la question de savoir si une personne dispose
de moyens suffisants pour parvenir à un niveau indispensable de
consommation ou de qualité de vie.
En suite, d'autres approches lient la pauvreté
au manque de capacités individuelles, telles qu'éducation ou
santé, qui empêche de jouir d'une qualité de vie
indispensable.
Enfin, les approches un peu plus récentes se
sont concentrées sur les facteurs sociaux, comportementaux et
politiques de la qualité de vie. Si c'est alors le comportement aberrant
ou l'isolement qui sont considérés, les avis divergent quant
à savoir qui, des individus ou des institutions, écartent les
pauvres du reste de la société ou les isolent. Si les
études sur la pauvreté ont adopté certains indicateurs de
définition et de mesure que l'on peut résumer en gros au
bien-être économique, aux capacités et à l'exclusion
sociale, il reste encore d'importants efforts à faire pour les
intégrer afin de combattre cette pandémie.
Concevoir la pauvreté sous ces multiples
aspects implique une réflexion profonde sur les mesures à prendre
pour lutter efficacement contre ce phénomène. Les Institutions de
Bretton Woods5(*) ont
longtemps privilégié le rôle du marché dans la lutte
contre la pauvreté. Elles ont à ce titre conditionné
l'aide apportée aux pays en développement à la mise en
place des programmes d'ajustements structurels (P.A.S.)6(*) pour relancer leur croissance.
Mais, si la croissance est nécessaire pour lutter contre la
pauvreté, elle n'est pas cependant suffisante. L'échec des P.A.S.
a conduit d'une part à élaborer les stratégies qui
prennent en compte les spécificités de chaque pays. D'autre part,
il interpelle la communauté du développement à
considérer les problèmes de redistribution, de justice sociale,
de réduction des inégalités... Ainsi, l'Etat apparait donc
prépondérant pour compléter le marché, même
si certains libertaires nient l'existence de la justice sociale.
L'économiste F.A. Hayek, défenseur du libre échange,
estimait à ce propos qu'il est insensé de parler de distribution
équitable ou inéquitable des moyens. Pour lui, il incombe aux
marchés libres et non au facteur humain de déterminer la
répartition appropriée de la richesse et des biens. Toute
tentative de réduire la pauvreté via l'intervention de l'Etat
apparait veine. Dans ce sens, Galbraith affirmait que « l'Etat est
incompétent et inefficace, on ne saurait lui demander de se porter au
secours des pauvres : il ne ferait que mettre davantage de gaspillage et
aggraverait encore leur sort. » Malgré tout, il précise
que la plupart des initiatives à prendre en faveur des pauvres
relèvent, d'une manière ou d'une autre, de l'Etat. L'aide
publique aux indigents permet de se « laver les mains du sort des
pauvres ».
Malgré cette vision pessimiste du rôle de
l'Etat dans la réduction de la pauvreté, beaucoup de
théoriciens du développement, ainsi que les Institutions de
Bretton Woods, reconnaissent actuellement le rôle moteur que l'Etat doit
jouer dans la lutte contre ce phénomène. En effet, le combat
touche plusieurs domaines de la société, et il apparait
prépondérant d'associer en même temps l'Etat et le
marché, l'un venant compléter l'autre.
L'intégration des externalités, la prise
en compte des générations présente et future, le souci de
lutter contre toutes les formes de pauvretés tout en respectant les
systèmes vivants donnent une dimension planétaire à ce
combat. La mise en place des objectifs du millénaire pour le
développement nous permet de voir l'importance que la communauté
internationale accorde désormais à cette lutte.
Ainsi, en septembre 2000, les dirigeants du monde
réunis sous l'égide des Nations Unies ont adopté la
déclaration du millénaire, engageant ainsi leurs pays à
consentir des efforts plus importants au plan international en vue de
réduire la pauvreté, d'améliorer la santé et de
promouvoir la paix, les droits de l'homme et un environnement durable. Dans ce
contexte, la société civile a également sa place pour
atteindre ces objectifs. Mais, l'analyse de la situation des pauvres et des
déshérités à travers le monde laisse
présager un certain scepticisme quant à la réalisation du
premier engagement de cette déclaration.
La pauvreté mondiale a globalement
diminué depuis 1981, mais les résultats restent inégaux
(Nations Unies 2004, Rapport Mondiale sur le Développement
Humain)7(*). La
pauvreté monétaire varie fortement entre les différentes
régions du monde. Dans les pays développés, on constate
« le paradoxe de la pauvreté dans l'abondance ».
Mais, c'est en Afrique Subsaharienne qu'on enregistre des niveaux de
pauvreté plus élevés. Cependant, l'extrême
pauvreté pourrait affecter moins d'individus si la distribution des
revenus évoluait en faveur des pauvres. En ce qui concerne la
pauvreté humaine, l'étude montre un retard de
développement pour une majorité de pays. Les niveaux les plus
élevés de l'indicateur du développement humain sont
localisés globalement en Amérique du Nord, en Australie et en
Union Européenne, tandis que les niveaux les plus faibles sont en
Afrique. Mais les résultats cachent parfois de fortes disparités
tant au sein d'un même pays qu'entre pays de niveaux économiques
différents. La pauvreté sociale quant à elle, apparait
très difficile à mesurer ; la difficulté de trouver
des données renforçant de plus en plus cet obstacle. Cependant,
la réalité peut être saisie par la prise en compte de
certains risques familiaux, naturels, sanitaires et politiques. Il apparait
donc que beaucoup reste à faire pour mesurer et mieux lutter contre ce
phénomène. Car, si certaines formes de pauvreté sont
d'origine naturelle, il est clair qu'elle est la résultante des actions
de l'homme. Ainsi, l'homme crée la pauvreté ; il lui
appartient naturellement de la combattre.
Vu la complexité de la définition de
ce que la pauvreté est réellement, une conception
réductionniste de ce phénomène axée sur un aspect
seulement ne nous permet pas de bien comprendre les facteurs qui sont au coeur
des problèmes de pauvreté dans le monde, afin de trouver des
solutions adéquates. Notre analyse intègrera donc toutes les
approches de la pauvreté que nous avons évoquées. Ainsi,
au lieu de parler de la pauvreté dans le monde, il est nécessaire
de parler des pauvretés dans le monde. La question est de savoir comment
évoluent les pauvretés dans le monde en intégrant toutes
ces différentes approches. Il convient de voir les disparités de
développement entre les pays et au sein des pays, afin de prendre en
compte la notion de « développement
durable »8(*).
L'étude des données des pauvretés dans le monde nous
révèle un fort taux de concentration des pauvres en Afrique
Subsaharienne, et le nombre ne fait qu'augmenter. Alors que cette
évolution est à la baisse dans les autres parties du monde. Il
convient donc de trouver les déterminants de ce phénomène
en Afrique Subsaharienne, afin de proposer une solution. Aussi, si la
communauté du développement a-t-elle formalisé les
indicateurs pour saisir la pauvreté monétaire et humaine,
beaucoup reste encore à faire en ce qui concerne la pauvreté
sociale. Conscient que la société varie d'une partie du monde
à une autre, nous proposons un indicateur de pauvreté sociale
pour l'Afrique Subsaharienne qui peut servir de piste de réflexion. Dans
ce contexte, après avoir mis en exergue la nécessité
d'une approche globale dans l'étude des pauvretés et les
disparités des résultats obtenus dans la lutte contre les
pauvretés dans le monde, nous nous concentrons sur le cas
spécifique de l'Afrique Subsaharienne.
Dans la suite de notre analyse, nous aborderons, dans
une première partie, les fondements théoriques de la mesure et
indicateurs des pauvretés. Elle conduit à la
nécessité d'une approche globale, c'est-à-dire
intégratrice du phénomène de pauvreté. La
deuxième partie sera consacrée à l'étude empirique
des pauvretés dans le monde. Elle nous amènera à avoir une
approche critique du phénomène.
« Face à la pauvreté, et
avant toute intervention visant à la réduire, on se pose
généralement deux grandes questions. La première, de
source conceptuelle, consiste à déterminer ce qu'est la
pauvreté, ce qui, en termes opérationnels, peut se traduire par :
à partir de quand peut-on considérer que l'on est pauvre? Ceci
amène alors à distinguer diverses formes de pauvreté. La
deuxième question, plus méthodologique, concerne la façon
d'appréhender et de mesurer ces différentes formes. Elle se
déduit naturellement de la question précédente et implique
le recours à des méthodes particulières et, dans certains
cas, à des instruments spécifiques », disait J.L.
DUBOIT9(*). Mesurer la
pauvreté sous ses différentes formes implique le
développement des indicateurs pouvant nous permettre de bien
appréhender ce phénomène. Cependant, un indicateur de
pauvreté ne doit pas être confondu avec une mesure de
pauvreté ni avec un indice de pauvreté. Les mesures et les
indices vont plus loin que les indicateurs de pauvreté en donnant un
sens précis au niveau critique appelé seuil de pauvreté.
Ces deux concepts sont plus fréquemment utilisés lorsque
l'indicateur est une variable numérique. « Soit y un
indicateur de pauvreté numérique mesuré sur une
unité statistique U, et soit y* le seuil de pauvreté, toute
fonction de (y, y*) est alors une mesure de pauvreté, comme par
exemple : y<y*, y*-y, etc. C'est un nombre prenant sa valeur au niveau
de l'unité statistique. Toute fonction de l'ensemble des valeurs y pour
un groupe de la population ou pour la population complète est un indice
de pauvreté ». Nous devons donc bien distinguer, par exemple,
un indicateur de revenu d'un ménage (indicateur de pauvreté), y,
avec le fait que ce ménage soit pauvre (mesure de pauvreté) selon
un seuil de pauvreté y*, ou encore avec le pourcentage des
ménages pauvres dans la population (indice de pauvreté). Pour
être utile à un cadre conceptuel centré sur la mesure de la
pauvreté, la notion d'indicateur doit être
développée autour d'une typologie des indicateurs de
pauvreté, ce qui requiert l'attribution d'un ensemble de
caractéristiques à chaque indicateur. Ces caractéristiques
varient donc en fonction des indicateurs qui sont spécifiques à
la mesure de pauvreté que nous voulons saisir.
Dans cette partie de notre travail qui analyse
les fondements théoriques de la mesure et indicateurs des
pauvretés, nous développerons les approches selon le
bien-être économique (pauvreté monétaire), les
capacités (pauvreté humaine) et l'exclusion sociale
(pauvreté sociale). Nous reprenons et soutenons la thèse selon
laquelle pour mieux saisir et lutter contre la pauvreté, la
communauté du développement doit adopter une approche
intégratrice qui prend en compte toutes ces manifestations du
phénomène (U. WAGLE, 2002)10(*). En terme clair, il y a interdépendance entre
ces différentes approches, d'où la nécessité de
parler des pauvretés dans le monde, et non plus de la pauvreté
dans le monde.
Le critère le plus
utilisé par la communauté du développement pour
définir et mesurer la pauvreté est le bien-être
économique. A ce titre, la théorie du bien-être sert de
référence à l'analyse de la pauvreté
monétaire. Ainsi, dans leurs recherches sur la pauvreté, les
économistes ont tenté de la définir selon divers modes
quantifiables. Du fait de l'impossibilité de mesurer les
utilités, la littérature sur cette question donne trois types
d'indicateurs du bien-être économique : le revenu, la
consommation et la qualité de vie. De surcroît, les trois
indicateurs sont définis à l'aide de concepts absolus, relatifs
et subjectifs. La pauvreté monétaire est,
à ce titre, retracée par un revenu insuffisant, ou à
défaut par une trop faible consommation. En Afrique, notamment, vu les
aléas dans le revenu des individus, on préfère s'appuyer
sur la consommation comme le meilleur estimateur du revenu. On peut donc dire
qu'une trop faible consommation traduit un niveau de vie trop faible. En ce
sens, cette approche peut-être considérée comme la plus
quantitative de toutes car elle ne fait appel à aucun aspect de
conditions de vie, notamment concernant la composition des dépenses du
ménages (DUBOIT J.L., 1998)11(*). Depuis Rowntree (1901), la pauvreté
monétaire se détermine à partir de l'élaboration
d'un seuil de pauvreté au dessous duquel un individu pourra être
considéré comme pauvre. Ce seuil de pauvreté
peut-être absolu, en s'appuyant sur une consommation calorique
donnée à partir d'une composition donnée du panier de la
ménagère. Il peut être relatif en considérant une
part de la consommation médiane ou moyenne ou une part de la population.
Sur la base de ce seuil de pauvreté, et de la distribution de la
consommation par tête, on peut alors calculer des indicateurs de
pauvreté.
1/ Pauvreté absolue
Selon cette approche, est pauvre toute personne qui ne
peut consommer, faute de moyens, un certain nombre de biens d'usage ordinaire
ou de consommation de base (biens nécessaires), selon la Banque
Mondiale. On définit un seuil monétaire en deçà
duquel on est considéré comme pauvre, et l'on comptabilise le
nombre de pauvres par référence à ce seuil (ligne de
pauvreté). Ce seuil peut être estimé soit à partir
de revenu, très variable, soit de la consommation plus stable dans le
temps. Il est sensé déterminer une pauvreté absolue, en
considérant le revenu nécessaire à l'achat du panier
minimal de biens alimentaires indispensables à la survie quotidienne
auquel on ajoute le revenu nécessaire à l'achat de biens non
alimentaires indispensables (habillement, transport, hygiène...). Dans
le cas de ces comparaisons internationales, la Banque Mondiale se fonde sur un
seuil fixé à 1dollar américain par jour et par personne.
Il est recommandé d'utiliser un seuil de pauvreté
monétaire correspondant à 2 dollars par jour et par personne pour
l'Amérique Latine et les Caraïbes, 4 dollars pour l'Europe de l'Est
et la communauté des Etats indépendants. Pour les comparaisons
entre pays industrialisés, le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) a adopté le seuil de pauvreté valable
pour les Etats Unis d'Amérique, autour de 14,4 dollars par jour et par
personne. En termes simples, il faut à une personne 1 dollar par jour
pour bien vivre en Afrique, 2 dollars par jour en Amérique Latine,...
Dans ce cas, le non pauvre est celui qui échappe à la
misère absolue. « Cependant, si l'on veut définir ce
que sont les moyens essentiels de survie, on est notamment amené
à arrêter des normes arbitraires parce que la question de la
survie a un lien immédiat avec la qualité de la survie. Il y a
des désaccords considérables sur ce que sont les
éléments essentiels de la survie ; une personne peut par
exemple avoir besoin de moyens de survie économiques, sociaux,
psychologiques et politiques, et nombre de ces moyens ne sont pas
quantifiables, à plus forte raison en termes
pécuniaires », affirmait WAGLE U12(*). Aussi, convaincue que les
besoins de revenu, de consommation et les besoins de bien-être d'une
personne sont-ils fonction de ceux des autres membres de la
société et que l'indicateur de la richesse d'une personne est
fonction de la richesse du reste de la société, la
communauté du développement a également défini des
seuils de pauvreté à l'aide d'indicateurs relatifs.
2/ La pauvreté relative et
subjective
Il y a bien longtemps que les économistes ont
remarqué que lorsque ton voisin s'achète une grosse voiture,
notre niveau de vie relatif baisse. La pauvreté est donc
également un phénomène relatif. A ce niveau, le seuil est
déterminé d'une manière relative en considérant,
sur la distribution des revenus ou de la consommation, un pourcentage de
population : soit les 20% de la population les moins riches, ou ceux qui
ont un revenu inférieur à la moitié du revenu
médian. On obtient alors une estimation de la pauvreté relative.
Mais, cet indicateur utilisé par la Banque Mondiale mériterait
mieux d'être appelé : indicateur d'inégalité de
répartition.
Car, dans un pays donné, à chaque fois
que le revenu médian s'élève, le nombre de pauvres peut
augmenter mécaniquement si l'enrichissement profite moins aux
ménages modestes qu'aux plus aisés. C'est ainsi que les
périodes de forte croissance économique et de recule de
chômage peuvent s'accompagner d'une montée de la pauvreté
relative (les riches s'enrichissant plus que les autres) ; inversement en
période de récession et de reculs boursiers, les nantis sont les
plus affectés par la baisse des revenus. Si l'on double d'un coup de
baguette magique tous les revenus, cela ne diminue en rien le nombre de
pauvres. Selon le seuil de revenu retenu, le nombre de pauvres change ; en
augmentant avec l'augmentation de ce dernier. En outre, dans les
sociétés plus égalitaires, davantage d'individus sont
regroupés autour de la médiane des revenus. On peut donc avoir
les pays où la pauvreté monétaire relative est quasiment
inexistante en raison d'une pauvreté absolue partagée par
beaucoup.
Ainsi, de l'analyse de la pauvreté
monétaire relative se déduit l'étude des
inégalités monétaires. « De même
qu'on peut opposer pauvreté monétaire et pauvreté des
conditions ou des potentialités, on peut opposer inégalité
en termes monétaires - concernant la distribution du revenu ou de la
consommation - à l'inégalité des conditions de vie, qui
tient compte des différences qualitatives et à
l'inégalité des chances qui considère l'accès
à nombre de biens et services fondamentaux », disait DUBOIS
J.L13(*).
L'inégalité monétaire est retracée par trois
courbes reliées les unes aux autres : la courbe de distribution de
la consommation par tête qui donne le nombre de personnes par niveau de
revenu, la courbe de répartition qui donne le pourcentage de population
au dessous d'un certain seuil de revenu, et la courbe de Lorenz qui donne le
pourcentage de population détenant un pourcentage de richesse.
Il existe une panoplie d'indicateurs pour mesurer
l'inégalité monétaire : coefficient de Gini,
d'Atkinson, indicateurs de Theil et variance logarithmique. Dans la
pratique, l'indicateur le plus fréquemment utilisé est le
coefficient de Gini et, dans une moindre mesure, l'indicateur de Theil. Le
coefficient de Gini traduit l'écart entre une distribution
hypothétique uniforme des revenus et la distribution effectivement
ajustée sur les données recueillies. Allant de 0, pour
l'égalité absolue, lorsque chaque individu ou ménage
reçoit une part identique du revenu, à 100, lorsqu'une seule
personne ou un seul ménage reçoit la totalité du revenu,
il présente plusieurs inconvénients. A l'inverse, l'indicateur de
Theil permet de décomposer l'inégalité totale entre
inégalités interclasses et inégalités intra-classes
et donc être utilisé pour comparer différentes
catégories sociales.
S'agissant de la pauvreté subjective, elle
désigne toute personne qui estime que son revenu donne un niveau de
satisfaction inférieur au minimum qu'il juge nécessaire pour
vivre, selon la Banque Mondiale. On fait des enquêtes. L'approche
subjective consiste donc, non pas à se référer à un
seuil minimal de ressources défini conventionnellement ou à des
conditions objectives d'existence, mais à interroger directement les
ménages sur la perception qu'ils ont de ces réalités,
à partir de questions sur leur revenu, le revenu minimum
nécessaire selon eux "pour joindre les deux bouts" et/ou leur
degré "d'aisance financière". Différentes méthodes
permettent ensuite, sur la base de ces réponses, d'établir un
seuil de pauvreté subjectif : les ménages dont le revenu est
inférieur à ce seuil seront alors considérés comme
pauvres (insécurité d'existence objective). Un autre indicateur
(insécurité d'existence subjective) consiste à
dénombrer les ménages qui déclarent éprouver les
difficultés financières à boucler leur budget.
« Les réponses à ce type de questions ne sont pas
dénuées d'ambigüité. D'abord parce que, dans leurs
réponses sur le revenu minimal nécessaire, la
référence retenue par les ménages n'est pas
nécessairement la même et peut traduire une aspiration plus qu'une
nécessité. Ensuite, parce que la perception que les
ménages ont de ces réalités peut être
influencée par le besoin psychologique de minimiser les écarts
entre les aspirations et la réalité »,
s'inquiétait VEREZ J.C14(*). Les ménages les plus démunis, qui
"doivent faire avec" peu de ressources, peuvent avoir ainsi tendance à
minimiser les difficultés objectives qu'ils rencontrent dans leur vie
quotidienne, ce qui risque de biaiser les résultats. La mesure
subjective de la pauvreté monétaire s'effectue donc par
l'introduction de questions relatives au sentiment pour le ménage
d'être à l'aise, de pouvoir mettre de l'argent de
côté, à la comparaison entre le revenu reçu et le
montant déclaré comme minimal pour vivre décemment, qui
permettent de construire des lignes de pauvreté subjectives. Ces
méthodes peuvent cependant donner une image de la pauvreté plus
importante que celle déterminée par les mesures objectives d'une
part parce que les effets subjectifs du phénomène
d'appauvrissement sont retracés par les questions, d'autre part parce
que la croissance économique créant de nouveaux besoins, ceci
maintient l'insatisfaction du consommateur.
Si les économistes n'ignorent pas que de
nombreux autres facteurs jouent sur les revenus, la consommation et la
qualité de vie des personnes, ils tendent à croire que tous les
problèmes de pauvreté peuvent se réduire à des
questions de bien-être, ou plus précisément de revenus.
Cette approche de la pauvreté en termes de bien-être donne
évidemment à penser que l'on peut remédier efficacement
aux problèmes de pauvreté en augmentant les revenus ou les
possibilités de consommation des pauvres. Les débats ne cessent
cependant pas sur la façon d'y parvenir : faut-il
accélérer la croissance économique et augmenter les
perspectives d'emploi (Banque Mondiale, 2001)15(*) ou améliorer la structure de la
répartition des revenus pour aboutir à plus
d'égalité (Townsend, 1999) ? Si, avec la conception
fondée sur le bien-être économique, le débat est
essentiellement axé sur les questions de revenu et de consommation, des
études portant sur l'ensemble du monde en développement donnent
à penser que la croissance économique avec ou sans
développement de l'emploi n'entraîne pas nécessairement des
améliorations du bien-être des pauvres (Friedman, 1996 ;
Gaiha et Kulharni, 1998). De même, ces études et d'autres comme
celles du PNUD (2000)16(*)
ont indiqué que la notion de bien-être humain allait
au-delà du bien-être économique. Au départ, il y a
l'idée que le bien-être humain est fonction de la qualité
de vie, elle-même résultante de toutes sortes de facteurs tels que
consommation, capacité et engagement social.
1/ Approche selon les
capacités
La pauvreté humaine a fait
l'objet d'études et de comparaisons internationales à la suite
des travaux de SEN et de l'élaboration de l'indicateur de
développement humain (IDH) par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD). L'IDH qui chiffre le niveau moyen de
développement atteint dans un pays est construit à partir de la
combinaison de l'espérance de vie à la naissance, le niveau de
l'éducation qui prend en compte le taux d'analphabétisme des
adultes et le taux de scolarisation qui intègre en son sein le primaire,
le secondaire et le supérieur, enfin le Produit Intérieur Brut
(PIB) par tête exprimé en parité du pouvoir d'achat (PPA).
C'est donc une moyenne arithmétique de la somme de ces trois
indicateurs. La valeur de l'IDH est comprise entre 0 et 1. Aucun pays n'a la
valeur 0 et aucun n'a la valeur 1. La distance entre la valeur obtenue pour un
pays et 1 montre le chemin que ce dernier a déjà parcouru et la
distance qui lui reste à parcourir pour atteindre le maximum
théorique 1. Ainsi, on distingue des pays disposant d'un indicateur de
développement élevé, ceux ayant un IDH moyen, ceux enfin
d'un faible développement.
L'IDH se calcule comme moyenne des indices de
longévité, niveau d'éducation et niveau de vie. Ces
indices sont calculés à partir d'une donnée
chiffrée par interpolation linéaire entre deux valeurs
extrémales possibles et/ou admissibles de cette donnée ; la
valeur maximale correspond à un indice de 1 (excellent) et la valeur
minimale, de 0 (exécrable).
L'IDH vaut :
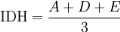
![]() 17(*) 17(*)
Où A, D et E sont
respectivement les indices de longévité, niveau
d'éducation et niveau de vie.
Les formules des indices qui composent l'IDH peuvent
être présentées sous la forme d'un tableau (selon le
PNUD) :
Tableau n°1 : indices composites de
l'IDH
|
Calcul des indices composant l'indice de
développement humain.
|
|
Indice
|
Mesure
|
Valeur minimale
|
Valeur maximale
|
Formule
|
|
Longévité
|
Espérance de vie à la naissance (EV)
|
25 ans
|
85 ans
|
|
|
Education
|
Taux d'alphabétisation (TA)
|
0%
|
100%
|
|
|
Taux brut de scolarisation (TBS)
|
0%
|
100%
|
|
Niveau de vie
|
Logarithme du PIB par habitant
en parité de pouvoir
d'achat
|
100 USD
|
40 000 USD
|
|
Source :
www.wikipedia.org
18(*)
Les indicateurs de la pauvreté humaine peuvent
aussi se calculer selon les sexes pour mettre en évidence les
inégalités entre les hommes et les femmes.
En 1995, le PNUD a introduit l'indicateur
sexo-spécifique du développement humain (ISDH) et l'indicateur de
participation de la femme (IPF) qui sont aussi des instruments composites
permettant de mesurer les inégalités entre homme et femme en
termes de développement. La constitution de l'ISDH nécessite de
calculer la variable de revenu pour les populations féminine et
masculine. On utilise donc le PIB par habitant (en PPA) pour chacun des deux
sexes. L'ISDH est composé des mêmes variables que l'IDH. Il s'en
distingue toutefois car il corrige les niveaux moyens obtenus par chaque pays
en termes d'espérance de vie, de niveau d'instruction et de revenu, de
façon à refléter les disparités sociologiques entre
hommes et femmes dans ces trois domaines. Hormis l'ISDH, le PNUD a aussi
développé l'IPF pour mettre en exergue les disparités de
développement entre les différents sexes.
L'IPF mesure les inégalités entre les
hommes et les femmes sur le plan des opportunités économiques et
politiques. Il intègre le pourcentage des parlementaires hommes et
femmes, le pourcentage des postes d'encadrement supérieur et des postes
techniques occupés par les hommes et les femmes. Enfin, il
intègre le revenu par habitant perçu par les hommes et les femmes
corrigés par les PPA.
Les indicateurs que nous venons de voir souffrent
d'une grande limite. Ils ne prennent pas en compte l'importance de la
pauvreté humaine et résiduelle. C'est pourquoi en 1997, le PNUD a
développé l'indicateur de la pauvreté humaine ( IPH)
basé sur une approche par manque. Il vise spécifiquement à
exprimer la condition des pauvres et des déshérités dans
les communautés des divers pays. L'IPH se concentre sur trois aspects
essentiels de la vie humaine : la longévité, l'instruction
et les conditions de vie en les envisageant sous l'angle des manques. La
longévité (P1) mesure la probabilité de
décéder à un âge relativement précoce.
L'instruction (P2) est un critère à partir duquel on se trouve
exclu du monde de la lecture et de la communication. Enfin (P3) concerne
l'absence d'accès à des conditions de vie décentes et
s'attache en particulier à ce que procure l'économie dans son
ensemble. Pour les pays en développement, l'IPH intègre dans son
calcul le pourcentage d'individus dont l'espérance de vie ne
dépasse pas 40 ans, ensuite le taux d'analphabétisme des adultes,
le pourcentage de la population privée d'accès à l'eau
potable, et enfin le pourcentage des enfants de moins de 5 ans souffrant
d'insuffisance pondérale. S'agissant des pays industrialisés,
l'IPH intègre dans son calcul le pourcentage d'individus dont
l'espérance de vie ne dépasse pas 60 ans, le taux d'illettrisme
des adultes et le pourcentage de la population vivant en deçà du
seuil de pauvreté monétaire, et enfin le taux de chômage de
longue durée (au moins 1 an).
L'IPH-1(pour les pays en développement) est
calculé à partir de la moyenne cubique de trois indicateurs
exprimés en pourcentages P1, P2
et P3 :
§ P1 est le pourcentage de
décès avant 40 ans.
§ P2 est le pourcentage
d'analphabétisme des adultes.
§ P3 représente le manque de
conditions de vies décentes, il est lui-même la moyenne
arithmétique de trois sous-indices P31,
P32 et P33 :
§ P31 est le pourcentage de personne
privées d'accès à l'eau potable ;
§ P32 est le pourcentage de personne
privées d'accès aux services de santé ;
§ P33 est le pourcentage d'enfants de
moins de cinq ans souffrant d'insuffisance pondérale
(modérée ou aiguë).
§ On calcule alors :
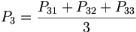
![]()
Et
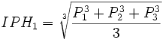
![]() 19(*) 19(*)
L'IPH-2 (pour les pays
développés) est calculé à partir de la moyenne
cubique de quatre indicateurs exprimés en pourcentages,
P1, P2, P3 et
P4.
§ P1 est le pourcentage de
décès avant 60 ans.
§ P2 est le pourcentage
d'illettrisme.
§ P3 représente le manque de
conditions de vie décentes, estimé par le pourcentage de
personnes vivant en dessous de la demi-médiane de revenu disponible des
ménages :
si M est niveau de revenus tel qu'une moitié
de la population a un revenu supérieur à M et l'autre
moitié un revenu inférieur à M, alors
P3 est le pourcentage de personnes ayant un revenu
inférieur à M/2.
§ P4 est le pourcentage de personnes
en chômage de longue durée, c'est-à-dire membre de la
population active et sans emploi depuis au moins 12 mois.
On calcule alors :
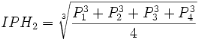
![]() 20(*) 20(*)
2/ Approche selon l'exclusion sociale
Le dernier critère de définition
et de la mesure de pauvreté utilisé par la communauté du
développement est l'exclusion sociale. Certaines personnes peuvent
être pauvres bien qu'elles aient un revenu suffisant ou des moyens de
survie suffisants, c'est-à-dire une consommation adéquate en
matière notamment d'alimentation, de logement et de vêtements. De
même, « des personnes peuvent être pauvres même si
elles sont, de manière générale, capables de fonctionner
dans une certaine mesure. Tel qui jouit d'un revenu et d'une capacité
suffisants pour assurer un certain fonctionnement peut néanmoins rester
pauvre si, par exemple, il est exclu des activités économiques,
civiques et culturelles dominantes inscrites dans la notion même de
bien-être humain », affirmait Vérez J.C21(*). Le concept d'exclusion
sociale dépasse donc les explications du bien-être fondé
sur l'économie et la capacité. La solitude et l'isolement
frappent de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde, sans que ce soit
leur choix. Au sein des pays pauvres, diverses catastrophes, de nature
différente, peuvent engendrer de l'isolement et, de fait, de la
pauvreté sociale soit des conditions de vie dans lesquelles les
relations familiales, professionnelles, sociales sont réduits au
minimum. Quand ce n'est le sentiment de l'abandon qui prédomine. Les
épidémies tel que le sida sont nombreuses et touchent un nombre
croissant d'individus. Certaines familles sont décimées et les
rescapés se retrouvent seuls. Nous pouvons y associer les victimes des
problèmes politiques tels que les conflits armés, les attentats,
les luttes ethniques etc. Se retrouver sans famille, sans emploi, sans toit
..., handicapé d'un point de vue physique et /ou psychologique,
peut conduire au-delà de l'isolement, à l'exclusion voire
à la marginalité. Cependant, la notion de pauvreté sociale
parait imprécise, d'autant que la quantifier est délicats car les
risques sont multiples et recouvrent des situations très variées.
Mais, un indicateur de pauvreté sociale dans les pays
développés pourrait se concentrer dans un premier temps sur les
risques familiaux et sur les aspects essentiels des risques de solitude
subie : le divorce, le veuvage, le célibat et les familles
monoparentales (Vérez J-C, 2007)22(*).
Depuis longtemps, et en particulier depuis David
Hume et Adam Smith, le concept de pauvreté est associé à
la notion de dénuement matériel, auquel on a parfois tenté
de remédier par d'autres politiques sociales visant à satisfaire
les besoins fondamentaux. Les efforts pour définir et mesurer la
pauvreté en termes de bien-être économique reposent sur des
notions de dénuement matériel et ont été
vigoureusement critiqués pour insister de façon
exagérée sur les explications centrées sur les biens
matériels. Nombre de spécialistes ont contesté la
conception absolue que la Banque mondiale se fait de la mesure de
pauvreté. Les conceptions relative et subjective sont, elles aussi,
sévèrement critiquées pour leurs tendances à
sous-estimer le noyau absolu irréductible nécessaire pour assurer
une existence minimale (Sen, 1987, 1992,1999). Les êtres humains ne
veulent pas seulement survivre comme le suggèrent les concepts de
« minimum vital » ou de minimum calorique. Ils veulent une
vie qualitativement meilleure et digne. Le concept de pauvreté
fondé sur la capacité considère plutôt les
dimensions individuelles de la pauvreté : l'éducation, la
santé, la nutrition, les relations entre les sexes et le statut
ethnique... Cependant, si elle a fortement contribué à
l'élaboration d'explications plus réalistes de la
pauvreté, la notion de capacité n'a pas reconnu la valeur des
processus sociaux, politiques et psychologiques qui poussent certaines
personnes vers la pauvreté. D'où l'idée que tout
débat sur la pauvreté est incomplet s'il écarte les
aspects d'exclusion économique, politique, civique ou culturelle. Par
ailleurs, cet ensemble riche d'idées sur les trois problèmes qui
maintiennent certaines couches de la population dans la pauvreté nous
conduit à la nécessité d'intégrer toutes ces
approches dans une démarche de lutte contre la pauvreté (U.
WAGLE, 2002)23(*). Ainsi,
il apparait désormais justifié de parler des pauvretés
dans le monde, plutôt que de la pauvreté dans le monde.
1/ Analyse de la pauvreté monétaire dans
le monde
Pour étudier comment
évolue la pauvreté monétaire dans le monde, nous allons
utiliser le rapport 2004 de la Banque Mondiale24(*).
Ainsi, la proportion de la population vivant dans la
pauvreté absolue (avec moins de 1 dollar par jour) dans les pays en
développement a été réduite pratiquement de
moitié entre 1981 et 2001, passant de 40 à 21% de la population
mondiale (Banque Mondiale, 2004). Toutefois, si la rapidité de la
croissance économique en Asie du Sud et de l'Est a permis de tirer de la
pauvreté plus de 500 millions de personnes dans ces deux régions,
la proportion de pauvres a augmenté, ou du moins n'a
décliné que légèrement, dans de nombreux pays
d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe orientale et d'Asie centrale.
Au regard de l'inégalité des
résultats obtenus, il est à craindre que les huit objectifs de
développement pour le Millénaire (OMD), approuvés par 189
nations en 2000, dont le premier vise à réduire de moitié,
d'ici 2015, le taux de pauvreté enregistré en 1990, soient hors
d'atteinte de certains pays. « La croissance économique en
Chine et en Inde a entraîné une réduction spectaculaire du
nombre de pauvres » déclarait François Bourgnon,
économiste en chef de la Banque mondiale. « Mais d'autres
régions n'ont pas connu une expansion soutenue et trop souvent, le
nombre de pauvres a en fait augmenté. Il est vraisemblable que le
premier des objectifs de développement pour le Millénaire qui
vise à réduire la pauvreté de moitié dans le monde
d'ici 2015 sera réalisé, mais pour que tous les OMD soient
atteints dans tous les pays, il faudra consentir une aide beaucoup plus
considérable, libéraliser davantage les échanges et
généraliser les mesures de réformes. »25(*)
Le rapport statistique de la Banque Mondiale
(Indicateurs du développement dans le monde, 2004) fait apparaitre une
diminution du nombre absolu de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour
dans l'ensemble des pays en développement, ceux-ci passant de 1,5
milliard en 1981, à 1,1 milliard en 2001, les progrès les plus
substantiels étant réalisés au cours de la décennie
1980. Entre 1990 et 2001, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté
absolue a baissé d'environ 120 millions, passant de 1,2 milliard
à 1,1 milliard de personnes, soit un certain ralentissement de cette
tendance à l'échelle mondiale, alors que la proportion de
personnes pauvres tombait de 28 à 21% du total de la population.
En Asie de l'Est, la proportion de la population
vivant dans la pauvreté absolue est tombée de 58 à 16%,
plus de 400 millions de personnes ayant été tirées de la
pauvreté absolue depuis 1981.
Des progrès spectaculaires dans la lutte contre
la pauvreté absolue ont été enregistrés en Chine,
le nombre de personnes vivant dans un état de pauvreté absolue
passant de 600 à un peu plus de 200 millions de personnes, soit une
diminution de 64 à 17%. La moitié environ des progrès se
sont produits durant la première moitié des années
1980.
En Asie du Sud, au cours de la décennie 1990,
la proportion des personnes vivant dans une pauvreté absolue passe de
41% en 1990 à 31%. Toutefois, le nombre absolu de personnes vivant avec
moins de 1 dollar par jour n'est tombé que de 34 millions depuis 1990,
pour atteindre 428 millions en 2001.
A l'inverse des résultats obtenus en Asie de
l'Est et du Sud, la pauvreté a augmenté en Afrique subsaharienne.
Depuis 1981, le nombre des personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour a
pratiquement doublé passant de 164 à 314 millions, soit une
augmentation de 42 à 47% de la population de cette région.
De même en Europe orientale et en Asie centrale,
les taux de pauvreté absolue pratiquement nuls dans les années
1980 passent à 6% en 1999, même si l'on assiste depuis peu
à un déclin du taux de pauvreté. Le nombre de personnes
vivant avec moins de 2 dollars par jour en Europe orientale et en Asie centrale
est passé de huit millions (2%) en 1981 à plus de 100 millions
(24%) en 1999, pour retomber à un peu plus de 90 millions (20%) en
2001.
En Amérique latine et dans les Caraïbes, la
pauvreté n'a été réduite que de façon
marginale. En 2001, la proportion de pauvres vivant dans la région,
englobant aussi bien ceux vivant avec moins de un dollar par jour que ceux
vivant avec deux dollars par jour, (10% et 25% respectivement) était
sensiblement la même que celle enregistrées en 1981, soit 10% et
27%.
Au Moyen Orient et en Afrique de Nord, la
pauvreté absolue a été réduite environ de
moitié depuis 1981, passant de 5 à 2% en 2001, tandis que la
proportion de la population vivant avec moins de 2 dollars par jour est
passée de 29% en 1981 à 23% en 2001. L'évolution de la
pauvreté monétaire dans le monde est présentée dans
les tableaux et graphique ci-dessous, par la Banque Mondiale :
Tableau n°2 :
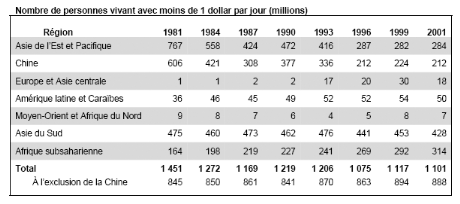
![]() Source : Banque Mondiale,
Rapport 200426(*) Source : Banque Mondiale,
Rapport 200426(*)
Tableau n°3 :
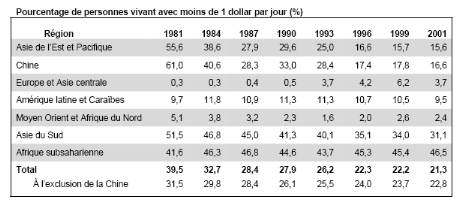
![]() Source :
Banque Mondiale, Rapport 2004 Source :
Banque Mondiale, Rapport 2004
Tableau n°4 :
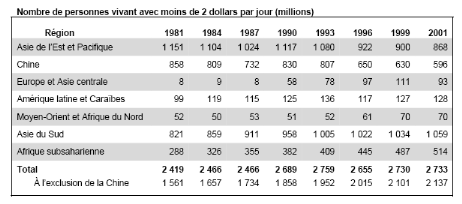
![]()
Tableau n°5 :
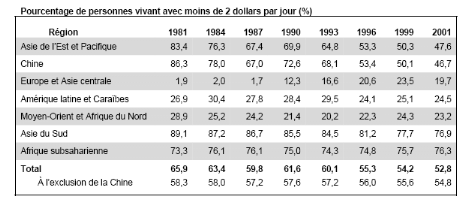
![]() Source : Banque Mondiale,
Rapport 2004 Source : Banque Mondiale,
Rapport 2004
Graphique n°1 :
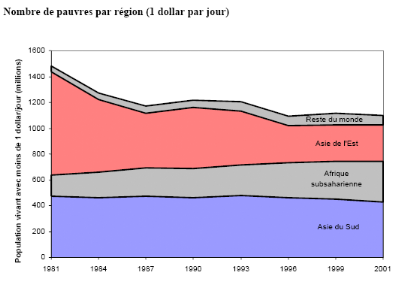
![]()
Source : Banque Mondiale, Rapport
200427(*)
Ces statistiques révèlent
l'inégalité des résultats obtenus dans la lutte contre la
pauvreté. Si certaines régions semblent s'en sortir, d'autres par
contre éprouvent de sérieuses difficultés. C'est ce qui
nous amène à étudier les écarts de revenu dans le
monde et leur impact sur la pauvreté.
Le débat relatif à la répartition
et à l'évolution du revenu mondial reste animé, notamment
à propos du rapport entre cette évolution et la pauvreté.
L'intégration des économies aux marchés mondiaux
entraîne-t-elle une convergence ou une divergence des revenus entre les
pays riches et les pays pauvres ? Pour répondre à cette
problématique, regardons la variation du taux de croissance du PIB par
habitant (%), de 1975 à 1999.
Graphique n°2 :
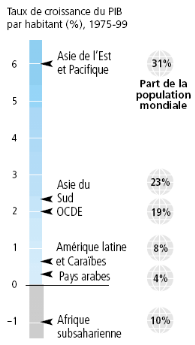
![]()
Source : calculs du bureau du Rapport mondial sur le
développement humain, d'après la Banque Mondiale, 200128(*)
Nous remarquons que le taux de croissance du PIB a
été élevé en Asie de l'Est et Pacifique (6%), moyen
en Asie du Sud et OCDE (2%), un peu moins en Amérique Latine et
Caraïbes et les Pays arabes. En Afrique Subsaharienne, il est de -1%.
Cette évolution cadre parfaitement avec celle de la pauvreté
monétaire des tableaux précédant. Les régions,
comme l'Afrique Subsaharienne, qui ont un nombre important de pauvres
enregistrent un faible taux de croissance. Ainsi, les inégalités
de croissance entre les pays peuvent être considérées comme
l'une des causes de disparités des résultats obtenus dans la
lutte contre la pauvreté dans le monde. Pour approfondir l'analyse de
l'impact des inégalités de revenu dans la lutte contre la
pauvreté, examinons le graphique ci-dessous :
Graphique n°3 :
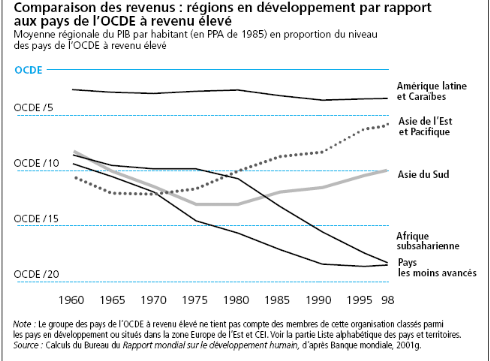
![]() 29(*) 29(*)
Nous remarquons que les pays en développement
qui ont un revenu proche de celui de l'OCDE ont réussi à
réduire sensiblement le nombre de pauvres (en se référant
aux tableaux qui ont les évolutions de la pauvreté
monétaire dans le monde de 1981 à 2001). L'Afrique Subsaharienne
et les pays les moins avancés sont très loin de l'OCDE et ont
également un grand nombre de pauvres. Ainsi, l'écart de revenu
se creuse entre les régions. Ce qui est illustré dans la figure
ci-dessous :
Graphique n°4 :
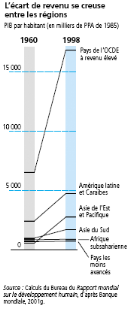
![]() 30(*) 30(*)
Entre 1960 et 1998, le revenu a fortement
augmenté dans les pays de l'OCDE. Il a également eu une
augmentation considérable en Amérique latine et Caraïbes et
en Asie de l'Est et Pacifique. L'Asie du Sud, l'Afrique Subsaharienne et les
Pays les moins avancés sont à la traine. Ainsi, l'écart de
revenu se creuse entre les régions. Ce qui entraine des
inégalités dans la lutte contre la pauvreté dans le monde,
les pays à revenu élevé s'en sortant mieux que ceux
à revenu faible. Voyons maintenant ce qui se passe au sein des pays,
s'agissant des inégalités de revenu. Nous nous inspirons de la
figure ci-dessous :
Graphique n°5 :
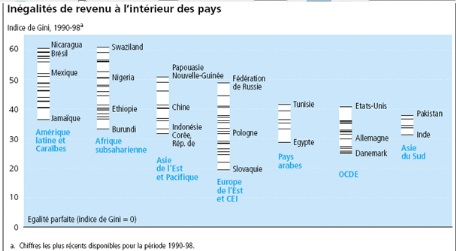
![]()
Source : calculs du bureau du Rapport mondial sur le
développement humain, d'après la Banque Mondiale, 200131(*)
L'indicateur retenu est le coefficient de
concentration de Gini. On mesure la concentration d'une distribution en la
comparant à une distribution (de revenu) où la masse totale (des
revenus) serait également répartie entre les individus. Dans une
répartition totalement égalitaire, 10% des individus sont
titulaires de 10% de la masse totale des revenus. Le coefficient de Gini a le
mérite d'éviter l'ambiguïté de la
référence à la moyenne. Il est généralement
compris entre 0 et 1. Sur le graphique, il est compris entre 0 et 100.
Bien qu'il n y ait pas de valeurs de seuil clairement
établies, les pays dont le coefficient est supérieur à 50
sont considérés comme faisant partie de la catégorie
d'inégalité de revenus élevée. En termes
généraux, plus le coefficient de Gini est élevé,
plus la part de revenu national correspondant aux catégories les plus
pauvres de la société est faible. Il est aisé de constater
que l'inégalité dans le revenu varie fortement entre les
régions.
En Amérique latine et Caraïbes, les
inégalités sont trop élevées au Nicaragua,
Brésil, un peu de 50% au Mexique et moins de 40% en Jamaïque. En
Afrique Subsaharienne, elles sont élevées au Nigéria et un
peu moins au Burundi. Les autres régions ont des pays à
inégalités de répartition, mais elles ne sont pas trop
prépondérantes. Nous remarquons donc que les
inégalités existent entre les pays et au sein des pays.
L'étude des inégalités dans le
monde montre la nécessité, pour la communauté du
développement, de promouvoir le « développement
durable »32(*).
C'est un genre de développement qui prône l'équité
entre les générations et au sein des générations.
Le progrès doit favoriser le rattrapage des revenus entre les habitants
des différentes régions du monde, dans le souci de vaincre la
pauvreté.
2/ Analyse de la pauvreté humaine et
sociale
a/ La pauvreté humaine
Pour analyser la pauvreté humaine dans le monde,
nous allons utiliser les rapports de la banque mondiale et du PNUD sur le
développement humain dans le monde. La première étude
concernera l'IDH, ensuite l'ISDH et enfin l'IPH.
S'agissant tout d'abord de l'IDH, nous utilisons la
carte ci-après qui nous donne les écarts d'IDH dans le monde.
Carte n°1 : IDH dans le monde en
2003 :

![]()
Ainsi, nous remarquons que les écarts d'IDH
sont considérables selon les pays et les continents. Les niveaux les
plus élevés sont localisés en Amérique du Nord, en
Australie et en Union Européenne. Les niveaux les plus faibles se
trouvent dans les pays en développement, particulièrement en
Afrique Subsaharienne. « Ce qui nous paraît essentiel, c'est
à la fois la hiérarchie des niveaux de développement dont
la compréhension ne peut ignorer l'histoire de l'humanité et la
distance entre ces niveaux qui montre le chemin qui reste à parcourir
pour les pays les plus pauvres. S'il faut se réjouir de
l'évolution positive des IDH depuis 30 ans (sauf en Afrique
Subsaharienne, infra), il reste que les indices compris entre 0,3 et 0,8
attestent des progrès considérables qu'il reste à
accomplir et des efforts à fournir », affirmait Vérez
J.-C33(*).
En somme, cette carte montre les disparités qui
existent entre les pays en termes d'IDH. Le monde n'est donc pas un ensemble
homogène, d'où la nécessité, pour la
communauté du développement, de favoriser les progrès dans
les pays pauvres afin de permettre le rattrapage.
S'agissant ensuite de l'ISDH, les
inégalités entre hommes et femmes en matière de
capacités sont souvent énormes dans les différentes
régions du monde. La figure ci-dessous montre l'évolution des
inégalités entre les populations masculine et féminine
(entre 1997 et 2000) en ce qui concerne certains aspects du
développement humain.
Graphique n°6 :
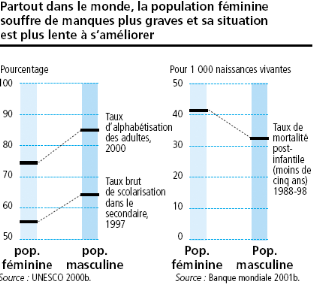
![]()
Nous remarquons que le taux d'alphabétisation
des adultes et le taux brut de scolarisation dans le secondaire ont beaucoup
plus augmenté dans la population masculine que dans celle
féminine entre 1997 et 2000. Le taux de mortalité à la
naissance est également élevé dans la population
féminine que dans celle masculine. Ce qui prouve qu'il y a une
augmentation des inégalités entre les hommes et les femmes en
matière de développement humain dans le monde.
S'agissant enfin de l'IPH, nous utilisons le
classement de 2000 du PNUD (tableau se trouve dans les annexes)34(*). En ce qui concerne les pays
développés (IPH-2), la Suède est en tête, suivis de
la Norvège. Les Etats Unis d'Amérique et l'Irlande occupent la
dernière place. Ils régressent, en comparant avec le classement
de l'IDH. Cela signifie que ces pays ont encore beaucoup d'efforts à
faire pour lutter contre la pauvreté humaine.
Le classement selon l'IPH-1 révèle que
l'Uruguay et le Costa Rica occupent les deux premières places.
L'Ethiopie et le Niger sont au bas du tableau. Ces pays ont encore
d'énormes efforts à fournir pour lutter contre la pauvreté
humaine.
b/ La pauvreté sociale
Dans les pays riches et dans ceux en
développement, certaines personnes peuvent avoir un revenu
élevé et les capacités, tout en étant pauvres
socialement. La pauvreté sociale fait référence à
l'isolement et/ou la solitude. Elle peut avoir différentes formes, selon
qu'on soit dans les pays riches ou dans ceux pauvres. « La solitude
et l'isolement frappent de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde,
sans que ce ne soit leur choix », affirmait Vérez
J.-C35(*). Comme cette
notion parait encore un peu vague pour la communauté du
développement, la Banque Mondiale se base sur les victimes de certains
risques pour saisir le phénomène. Nous pouvons prendre les
exemples des victimes du Sida, des attentats, des catastrophes naturelles, des
guerres...
La carte ci-dessous montre les catastrophes naturelles par
grande région dans le monde de 1970 à 2001.
Carte n°2 : catastrophes naturelles dans le
monde de 1970 à 2001
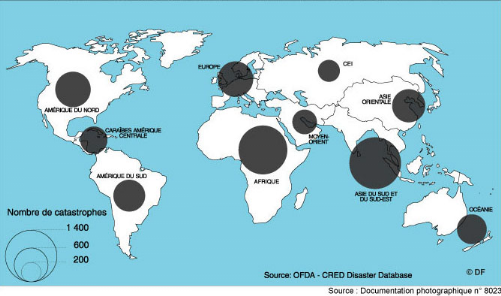
![]() 36(*) 36(*)
Nous voyons donc que le monde a été
secoué par plusieurs catastrophes naturelles qui ont fait plusieurs
victimes. La presse nous parle actuellement du tremblement de terre en Chine et
la catastrophe de la Birmanie. Ainsi, la nature est l'une des causes de
pauvreté sociale dans le monde. A côté des victimes des
catastrophes naturelles, nous pouvons également voir ceux des conflits
armés.
La figure qui va suivre montre les principaux conflits dans le
monde dans les années 1990.
Carte n°3 : conflits dans le monde dans les
années 1990
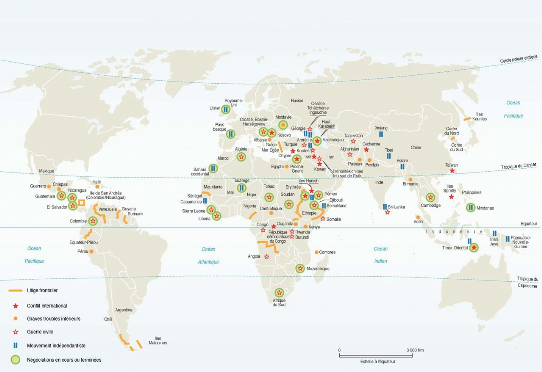
![]() Source : Source :
www.monde-diplomatique.fr37(*)
Les conflits ont été beaucoup
présents dans le monde en développement, causant beaucoup de
victimes. Le nombre de refugiés, de mutilés, est important. Tout
ce qui concourt à l'isolement et/ou à la solitude. Beaucoup
d'autres causes peuvent favoriser la pauvreté sociale. Par ailleurs,
parce que la structure sociale varie fortement et que la notion de
pauvreté sociale est encore nouvelle, la communauté du
développement n'a pas encore défini un indicateur fiable pour
saisir cette forme de pauvreté. Nous allons, dans la suite de notre
travail, proposer un indicateur de pauvreté et d'exclusion sociale pour
l'Afrique Subsaharienne.
En effet, l'organisation sociale et culturelle de
l'Afrique a des spécificités qui font naître, dans cette
partie du monde, des formes et des causes de pauvreté sociale
particulières qui ne se retrouvent pas dans d'autre
société. Nous pouvons prendre l'exemple de la structure
familiale. Dans la plupart des sociétés occidentales, la famille
c'est le père, la mère et les enfants. Les autres membres
appartiennent à la famille plus ou moins élargie. Par contre en
Afrique, la famille regroupe bien sûr le père, la mère et
les enfants, mais aussi les frères et soeurs de ton père, leurs
enfants et petits enfants.
En Occident, le frère du père est un oncle,
alors qu'en Afrique, il est considéré comme un père lui
aussi en lui accordant le même respect et la même
considération que le père biologique. Cet exemple nous permet
d'affirmer que la structure sociale est différente selon qu'on soit en
Afrique ou en Europe. Ce qui nous permet d'en déduire qu'un indicateur
social doit être spécifique à chaque
société.
L'indicateur que nous proposons est bien sûr
limité, mais il nous permet d'avoir une approche de la pauvreté
sociale plus spécifique au continent africain. Il nous permet de voir
les liens qui peuvent exister entre la société africaine, la
nature, l'économie, le politique, dans les causes de l'isolement et/ou
la solitude. Nous l'appelons l'Indicateur de Pauvreté Sociale d'Afrique
au Sud du Sahara (IPSASS).
Il est important de préciser que notre
proposition n'est qu'une piste de réflexion. Les données ne sont
pas encore disponibles. Nous ne pouvons donc pas calculer l'IPSASS. C'est donc
un indicateur limité. Aussi, nous nous baserons sur certains travaux
existants que nous citerons à chaque étape.
L'IPSASS est composé de trois
indicateurs : l'indicateur économique et de redistribution (IER),
l'indicateur du progrès démocratique (IPD), enfin l'indicateur
de santé et les catastrophes naturelles (ISCN).
S'agissant d'abord de l'IER, beaucoup de personnes en
Afrique Subsaharienne vivent l'isolement et/ou la solitude inhérentes
aux difficultés économiques et aux inégalités de
redistribution des richesses issues, pour la plupart, de l'exploitation des
ressources naturelles. Beaucoup de liens peuvent être établis
entre la situation économie d'un individu, l'isolement, et la solitude.
Le chômage, par exemple, peut être considéré comme
l'une des causes économiques. Combien de personnes se sont vues exclues
de leur groupe d'amis et de relations professionnelles parce qu'elles
n'appartiennent plus à la même classe sociale, une fois
licenciées ? La pauvreté monétaire, les
difficultés économiques poussent des familles entières
à « tenter l'aventure »38(*) dans les autres pays africains
où la situation semble meilleure, mais aussi et surtout en occident. Ces
personnes laissent derrière elles un vide irremplaçable. Des gens
d'un âge avancé se retrouvent seuls, dans des pays où il
n'y a pas de structures d'accueil pour des personnes âgées. Leurs
fils ou leurs proches parents sont partis demander ce que nous appelons l'exil
économique. Ces personnes qui décident de « tenter
l'aventure » courent le plus souvent des risques mortels ! Qui
n'a pas été horrifié par des images de clandestins
africains qui prennent des bateaux de fortune pour aller chercher la survie
économique en Europe ? Des images de noyades, des morts
assassinés par les passeurs, des violes...qui défilent les
écrans de télévision ? Ceux qui ont la chance
d'arriver sur le sol européen courent également des risques
énormes tels : « l'exploitation de l'homme par
l'homme »39(*),
la brutalité policière...Par ailleurs, l'actualité nous
apprend que les travailleurs immigrés sont chassés en Afrique du
Sud. Certains, plus malchanceux, sont assassinés ! Ainsi, nous
pouvons soutenir que le facteur économique est une cause de
pauvreté sociale en Afrique, cette pauvreté sociale qui est
traduite par la solitude et l'isolement qui sont d'un genre particulier.
S'agissant de la redistribution, les pays africains
sont pour la plupart producteurs de matières premières. Une
spécialisation qui trouve ses origines dans la colonisation. Les revenus
sont le plus souvent mal redistribués.
En effet, dans la plupart de ces pays, on y trouve un
déficit démocratique qui entraine la mauvaise gouvernance. Pour
adopter l'économie de production, le système économique
africain a subi d'énormes mutations. Même la conception et les
formes de richesses avaient changé. Dans les sociétés
traditionnelles, les plus riches étaient des personnes possédant
une grande famille ; donc beaucoup de forces pour travailler le sol et
faire l'élevage. Par contre dans la société moderne, le
riche est différent. Nous pouvons donc dire qu'au départ,
c'est-à-dire au début de la mutation économique, tous les
africains étaient égaux. Ils suffisait tout simplement de mettre
en place un système de redistribution des revenus issus des ressources
naturelles qui fasse en sorte que tous puissent accéder à
l'éducation, à la santé, au logement...Afin de donner
à chacun des moyens de base nécessaires pour créer sa
propre richesse en particulier, et celle de la société en
général.
Malheureusement, cela n'a pas été le
cas. Il y a eu la mise en place des régimes dictatoriaux qui pensaient
d'abord à leur ventre, et non à ceux de la collectivité.
Les occidentaux, soucieux de préserver d'abord leurs
intérêts stratégiques, soutiennent ces régimes
contre les peuples africains. On a donc un jeu à trois joueurs où
l'optimum social ne peut pas être atteint car les deux leaders qui sont
l'occident et les dirigeants politiques ont chacun un intérêt
particulier qui se trouve aux antipodes de l'intérêt du peuple
africain qui est la redistribution équitable des richesses. Les
conséquences peuvent être les guerres civiles, la recherche
d'asile économique en occident... Tout se qui concoure, d'une
façon ou d'une autre, à l'isolement et à la solitude, et
donc à la pauvreté et l'exclusion sociale.
Pour prendre en compte l'aspect économique ici
(Ie), nous utilisons le Produit Intérieur Brut (PIB) qui mesure la
richesse produite dans un pays. Nous adoptons donc l'approche de la
création de richesse des modèles de croissance. Ainsi, nous
utilisons l'indicateur du PIB du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD). On intègre une notion d'utilité
marginale décroissance des richesses en prenant le log du PIB.
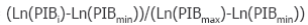
![]() 40(*) 40(*)
Ln (PIBi) = PIB du pays i, Ln (PIB min) = PIB minimum, Ln
(PIBmax) = PIB maximal
et Ln = Logarithme népérien.
Pour prendre en compte l'aspect de redistribution, nous
utilisons l'indice de Gini (Ig). C'est un indice qui mesure les
inégalités de revenu au sein d'un pays. Le coefficient de Gini
est un nombre variant de 0 à 1, où 0 signifie
l`égalité parfaite (tout le monde a le même revenu) et 1
signifie l'inégalité totale (une personne a tout le revenu, les
autres n'ont rie).
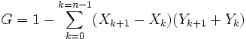
![]() 41(*) 41(*)
Où X est la part cumulée de la population, n
l'effectif total et Y la part cumulée du revenu.
Ici, nous mettons l'hypothèse que cet indice
prend en compte tous les contours du développement durable. Car, il
permet de mesurer les inégalités au sein d'une
génération. Nous pouvons, par extension, affirmer que s'il y a
une meilleure redistribution des revenus au sein d'une population, il y a
également équité entre générations, avec
l'hypothèse supplémentaire que les africains sont altruistes.
Dans ce cas, nous avons la formule suivante pour l'IER :
IER : (Ie + Ig) / 2
S'agissant ensuite de l'IPD, il mesure le
progrès accompli par ces pays sur le plan démocratique. La
définition de la démocratie varie d'un régime à un
autre. Ici, nous tentons d'élucider certains déterminants qui
caractérisent en général toute forme de démocratie.
Nous pouvons citer la participation, la sécurité, la non
discrimination... La Banque Mondiale prend déjà en compte le
progrès démocratique accompli par les Etats en donnant un
classement qui reflète le niveau de leur démocratie. Notre
analyse s'appuie donc sur cette base.
Concernant la participation, les droits
témoins de cette catégorie peuvent être : le droit de
vote, le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, la
liberté d'association et de réunion et la liberté
d'opinion et d'expression.
Si ces principes
démocratiques sont, dans une proportion considérable,
appliqués dans la plupart des sociétés occidentales, il
faut souligner que cela n'est pas le cas de l'Afrique.
En effet, ces pays sont caractérisés par
un déficit démocratique qui se manifeste par la tenu des
élections truquées, le bâillonnement de la presse, les
assassinats politiques, le tribalisme... Comme le dirait l'ancien
président congolais Pascal Lissouba42(*) : « On n'organise pas les élections pour
les perdre ». Ce qui entraine des guerres civiles, la mauvaise gestion des
biens publics... Le nombre de refugiés politiques, de mutilés,
s'accroit, provoquant la pauvreté sociale.
La situation démocratique en Afrique est
illustrée sur la carte ci-dessous :
Carte n°4 : démocratie en
Afrique
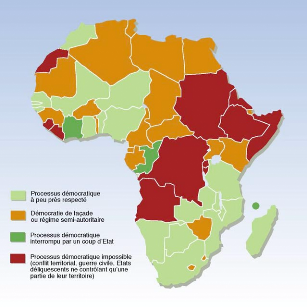
![]() Source : Source :
www.monde-diplomatique.fr43(*)
Nous remarquons que les démocraties de
façade ou régimes autoritaires, les coups d'Etat et processus
démocratique impossible sont prépondérants sur cette
carte.
Nous sommes conscients qu'il est très difficile
de quantifier les progrès démocratiques accomplis. Nous proposons
ici une piste de réflexion. Pour prendre en compte la liberté
d'expression, nous pouvons nous baser sur le nombre de prisonniers d'opinion et
d'assassinats politiques que compte un pays (Ilp). En ce qui concerne les
élections politiques, nous pouvons prendre en compte l'existence des
partis politiques de tout bord, le nombre de fois que la constitution a
été manipulée, le nombre de refugiés politiques...
On pourrait également, après chaque élection, demander
à la population de donner une note qui juge la qualité des
élections (Ip). En ce qui concerne la discrimination, nous retenons
celle basée sur le sexe, car le PNUD, depuis quelques années, a
trouvé les moyens de quantifier ce phénomène. L'indicateur
de discrimination (Id) prend donc en compte l'IPH1, l'ISDH. Aussi, le
tribalisme est-il l'une des formes de discriminations les plus répandues
dans les administrations africaines. Favoriser les membres de son ethnie, tout
en barrant la route à ceux des autres ethnies est souvent
fréquent dans les relations interethniques en Afrique. Pour quantifier
ce phénomène, nous proposons une méthode contingente qui
est les enquêtes par sondage. Nous proposons de demander aux gens s'ils
ont été victimes d'une discrimination tribaliste dans les
administrations, leur environnement professionnel... Nous appelons Det ce
phénomène. La formule de l'Id s'écrit de la façon
suivante :
Id = (IPH1+ISDH+Det)/3
Ainsi, l'IPD est la moyenne de l'Ilp, Ip et Id :
IPD = (Ilp+Ip+Id)/3
S'agissant enfin de la santé et
des catastrophes naturelles, nous retenons l'indicateur de
longévité du PNUD et un indicateur qui prend en compte le nombre
de personnes victimes des catastrophes naturelles (Vcn). Les liens entre la
qualité du système sanitaire et la pauvreté sociale sont
multiples.
En effet, beaucoup d'individus peuvent brutalement se
retrouver sans famille, sans soutien, à cause de la perte d'un
être chère. Les orphelins du SIDA, du paludisme qui n'est pas
présent dans les pays occidentaux, sont multiples. Certaines personnes
atteintes d'une maladie peuvent se retrouver abandonnées,
isolées, dans des pays où il n y a pas un système sociale
adéquat. Ainsi, la santé d'une population a un lien direct avec
la pauvreté sociale de certains de ses membres.
Pour prendre en compte ce phénomène, nous
utilisons l'indicateur de longévité du PNUD (Il) :
Il = (EVi - EVmin)/ (EVmax/EVmin)44(*)
Avec : EVi = espérance de vie à la
naissance dans le pays i, EVmin = espérance de vie minimale (25 ans),
EVmax = espérance de vie maximale (85 ans).
La formule de l'ISCN s'écrit ainsi qu'il
suit :
ISCN = (2/3Il+1/3Vcn)/2
Nous mettons 1/3Vcn car, nous faisons l'hypothèse
que les victimes inhérentes à la santé sont plus
nombreuses que ceux provenant des catastrophes naturelles en Afrique.
Maintenant que nous avons montré les liens qui
peuvent exister entre l'isolement et/ou la solitude et les quatre
éléments que sont : la démocratie, l'économie,
la santé et les catastrophes naturelles, nous pouvons en déduire
l'Indicateur de pauvreté sociale que nous proposons pour l'Afrique
Subsaharienne. La formule de l'IPSASS donne :
IPSASS = (IER + IPD
+ ISCN)/3
1/ Modèle
L'étude de la pauvreté monétaire
dans le monde et l'évolution des inégalités de revenus
révèlent que l'Afrique Subsaharienne est la région la plus
défavorisée. Le nombre de pauvres est en constante augmentation.
Ce qui n'est pas le cas dans les autres régions. La question est de
savoir ce qui pourrait expliquer ce manque de résultats satisfaisants
dans cette partie du monde.
Pour ce faire, nous l'expliquons par un modèle de
régression linéaire simple dans lequel nous prenons comme
variable endogène « le nombre d'individus vivant avec moins de
1$ par jour » (Y). Les variables exogènes sont :
- Consommation finale des ménages africains
(CF) ;
- La dette extérieure (DETEXT) ;
- La valeur ajoutée dans l'agriculture (AGR) ;
- La valeur ajoutée dans l'industrie (IND) ;
- La valeur ajoutée dans les services (SER) ;
- La population (POP) ;
- Le produit intérieur brut (PIB).
Nous allons, dans le travail qui va suivre, justifier
le choix des variables exogènes, présenter le modèle,
analyser et commenter les résultats. L'étude concerne une
région : l'Afrique Subsaharienne et la période est de 1981
à 2001.
S'agissant de la population, les études
concernant l'impact de la population sur la pauvreté trouvent leur
origine à la suite des travaux de Malthus45(*). Dans l'Essai sur le
principe de population, l'auteur met en relief l'opposition entre la
progression démographique et celle des subsistances. Il fait une
description cyclique de l'évolution des sociétés
humaines. Ainsi, il pose deux postulats :
- « La nourriture est nécessaire à
l'existence de l'homme » ;
- « La passion réciproque des sexes est une
nécessité ».
Le premier fait référence au besoin de
nourriture et le second à la croissance démographique. Pour lui,
la croissance des subsistances a une progression arithmétique46(*), alors que la population croit
selon une progression géométrique47(*). Ainsi, la difficulté de se nourrir va
constituer un frein à la reproduction ; donc à la croissance
démographique. En réponse, il faut un frein actif et
préventif. S'agissant du frein préventif, quand la population
s'appauvrit, les plus pauvres doivent reculer l'âge du mariage, faire peu
d'enfants... Le frein actif fait référence à la
misère qui fera que la mortalité infantile augmente (il ne faut
pas aider les pauvres). Il aboutit donc à un cycle démographique
qui est en rapport avec les subsistances.
A la suite des travaux de Malthus, il y a eu le
développement des théories démographiques malthusiennes et
anti-malthusiennes. Les malthusiens prônaient la limitation des
naissances comme condition de la prospérité
générale, alors que les anti-malthusiens pensaient que la
population est neutre dans le développement.
L'introduction de la variable population dans
l'étude des déterminants de la pauvreté monétaire
en Afrique nous permet donc de départager ces deux thèses dans
cette partie du monde.
Par ailleurs, Modigliani, prix Nobel 1985, et Brumberg
relient l'épargne au cycle de vie de l'individu. Ils proposent que
l'individu cherche à maximiser l'utilité de sa consommation
future. Ce dernier répartit sa consommation au cours du temps et
accumule une richesse qu'il consommera au cours de sa retraite. Ainsi,
l'épargne est déterminée par des facteurs
économiques et démographiques.
L'introduction des variables : PIB, AGR, IND et SER
est motivée par les travaux de certains auteurs physiocrates (Quesnay),
classiques (Ricardo) et les théories de la croissance.
Dans les années 1760, le docteur Quesnay
(1694-1774), dans son ouvrage le Tableau Economique48(*), propose un système de
production qui repose sur deux conceptions : l'ordre naturel et
l'existence d'un produit net. Selon cet auteur et les autres physiocrates,
seule la terre est productive. Elle fournit un produit net : un rendement
qui dépasse le coût. Rien de tel ne se passe dans le commerce ou
l'industrie qui constituent des activités stériles en se
contentant de la transformation des biens sans les multiplier. De son
côté, l'économiste classique Ricardo, pensait que la
production est fonction du travail, des ressources naturelles et du capital.
Chacun de ces facteurs est rémunéré à sa
productivité marginale. Après son analyse, l'auteur aboutit
à l'état stationnaire à cause des rendements
décroissants des terres. Ainsi, nous voyons que l'agriculture a un
rôle prépondérant dans la création de richesses, et
donc la réduction de la pauvreté.
Par ailleurs, en 2006, A. Sarris et S.
Savastano49(*) ont
réalisé une étude sur la Répiblique-Unie de
Tanzanie concernant l'impact du développement agricole sur la
pauvreté. Leurs résultats indiquent que les ménages les
plus pauvres non seulement possédaient moins d'actifs mais aussi qu'ils
étaient beaucoup moins productifs. Ceci confirme que la
productivité agricole a une incidence directe sur la consommation des
ménages et, par conséquent, sur la pauvreté et le
bien-être en général.
En ce qui concerne les théories de la
croissance, l'idée générale est que le niveau de vie dans
un pays dépend de sa capacité productive. Les capacités
productives dépendent à leur tour ; des ressources
naturelles, du travail, du capital, du capital physique, de la technologie et
du capital humain. Le modèle de base est celui de Solow50(*) (1956). L'utilisation du PIB
permet donc d'évaluer le niveau de richesse produit dans cette partie
du monde et son impact sur la pauvreté monétaire. L'IND et SER
permettent de mesurer la corrélation spécifique qui peut exister
entre ces secteurs d'activité et la pauvreté monétaire.
L'idée est que le développement de ces secteurs peut
générer des revenus qui permettent d'augmenter le niveau de vie
des populations. Ainsi, le débat entre la création des richesses
dans un pays et la pauvreté retrouve-t-il son intérêt. La
croissance économique est-elle « pro
pauvre »51(*) ou
pas, s'agissant de l'Afrique Subsaharienne ?
La DETEXT soulève le débat de
l'endettement des pays africains. Cette dette a-t-elle servi pour les objectifs
de réduction de la pauvreté ou pour d'autres fins ? Si oui,
les organismes et Etats préteurs doivent continuer à prêter
aux pays africains afin que ces derniers continuent de financer les programmes
de lutte contre la pauvreté. Si cela n'a pas été le cas,
un suivi, pour vérifier l'utilisation du prêt, est
nécessaire.
En ce qui concerne CF, le rapport entre la
consommation des ménages et la pauvreté trouve son origine
à la suite des travaux de Keynes. En effet, cet auteur pense que la
meilleure façon de relancer une économie est d'encourager la
consommation. A l'opposé des économistes de l'offre comme J.B.
Say52(*), Keynes53(*) pense que la création
d'emplois permet de donner le pouvoir d'achat aux ménages. Ces derniers
vont augmenter leur consommation. Ce qui va, par le processus du multiplicateur
keynésien, relancer l'économie et permettre la croissance. Dans
ce conteste, la consommation a une relation avec la pauvreté. Aussi, la
Banque Mondiale se base-t-elle sur la consommation des ménages africains
pour voir la manifestation de la pauvreté monétaire dans cette
partie du monde.
Ainsi, après avoir montré les liens
qui peuvent exister entre la pauvreté et les variables exogènes,
tout en insistant sur les auteurs qui ont fait des analyses dans ce sens, nous
présentons le modèle théorique, celui estimé et les
interprétations économétriques et économiques. Le
modèle théorique est de la forme :
Y = c+aCF+bAGR+dIND+ePIB+fPOP+gSER+hDETEXT+u
Avec c la constante, a, b, d, e, f, g et h les coefficients de
régression respectifs des variables exogènes, et u l'erreur.
Le test a été réalisé sur
21 observations54(*),
allant de 1981 à 2001. Nous avons fait deux tests : un qui utilise
les données brutes, et l'autre qui utilise les différentielles
des logarithmes pour étudier la stationnarité des variables. Il
est important de signaler que nous ne retenons que le test avec des
données brutes dans notre analyse. Car, c'est ce dernier qui donne de
bons résultats. Le nombre d'observation n'est pas suffisant pour que
celui avec les différentielles des logarithmes soient significatifs.
Nous l'avons mis ici tout simplement pour montrer la démarche que nous
avons adoptée. Les résultats sont les suivants :
Test n°1 : des données en
différentielles des logarithmes (ignoré)
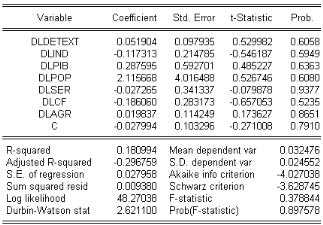
![]()
Test n°2 : des
données brutes (retenu)
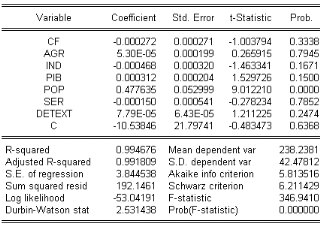
![]()
Nous allons faire une interprétation
économétrique et économique des résultats. Ainsi,
en ce qui concerne l'interprétation économétrique, les
fluctuations ou les variations des variables exogènes expliquent
à concurrence de 99% la variance de Y, car, R^2 = 0.99.
Le Fisher est trop grand (346,94). Le test est donc
bon. Il y a donc une relation corrélative entre les variables.
L'ensemble des variables explicatives explique significativement la variable
endogène, même si certains tests de Student ne sont pas
significatifs.
Le Durbin-Watson est proche de 2 (2.53). Il y a donc
indépendance des résidus. Le test est bon.
S'agissant de l'interprétation
économique, les coefficients de CF (-0.000272), IND (-0.000468), SER
(-0.000150) sont négatifs. Ce qui signifie que l'augmentation de la
valeur ajoutée dans les secteurs de l'IND et SER entraine la
réduction du nombre de pauvres. En termes de politique
économique, il faut développer ces secteurs en Afrique
Subsaharienne pour mieux lutter contre la pauvreté absolue, tout en
mettant en oeuvre des politiques de relances néo-keynésiennes
pour stimuler la consommation des ménages.
Les coefficients de : AGR (5.30 E-05),
PIB (0.000312), POP (0.477635) et DETEXT (7.79 E-05) sont positifs.
Ce sont des facteurs influençant la croissance. Ainsi, l'agriculture et
la croissance en Afrique Subsaharienne ne sont pas
« pro-pauvres ». Il faut donc oeuvrer pour une croissance
qui réduit les inégalités de revenus entre les classes,
tout en réformant le secteur agricole. Ce qui stimulera la consommation
et l'investissement.
La dette extérieure contractée par ces
pays n'a pas servi à réduire la pauvreté. Les institutions
et les Etats préteurs doivent donc s'assurer que leurs prêts
servent à atteindre l'objectif du millénaire qui est la
réduction de l'extrême pauvreté. L'augmentation de la
population a également un impact négatif dans la lutte contre la
pauvreté. Les pays africains doivent donc réguler leur
population. Ce qui confirme la thèse malthusienne et les recommandations
du rapport Meadow55(*) qui
suggère aux pays pauvres de réguler leur population.
La pauvreté monétaire en Afrique
Subsaharienne peut être également analysée en se basant
sur le lien que la Banque Mondiale établit entre la consommation et le
revenu, d'une part, et le seuil de revenu utilisé par cette
dernière pour définir le pauvre, d'autre part. C'est ce qui
justifie la critique qui va suivre.
2/ Critique de la pauvreté monétaire
en Afrique Subsaharienne
La pauvreté monétaire,
selon la Banque Mondiale, fait référence à la survie pour
un individu. On définit un seuil en dessous duquel on est pauvre. C'est
le revenu nécessaire à l'achat du panier minimal de biens
indispensables à la survie quotidienne. En Afrique Subsaharienne, on
s'appuie sur la consommation comme indicateur du revenu, et le seuil retenu est
1$ par jour et par personne. Ce qui signifie que pour survivre en Afrique, il
faut qu'une personne ait 1$ par jour. Sinon, on est pauvre du point de vue
monétaire. Cette conception de la pauvreté a été
beaucoup critiquée par les théoriciens du développement.
Pour les uns comme SEN, les individus n'ont pas pour seul soucie la survie,
mais aussi les capacités et les potentialités, pour les autres,
il faut également regarder l'aspect social du
phénomène.
Notre objet dans cette partie n'est pas de critiquer la
notion ou le concept de pauvreté monétaire, mais de voir les
limites qui peuvent apparaître lorsqu'on applique cet indicateur dans le
cadre africain. Nous relevons les limites inhérentes au lien entre
consommation et revenu, et à la valeur réelle du panier de
bien.
S'agissant du lien entre consommation et revenu, la
Banque Mondiale estime qu'il faut 1$ par jour pour survivre en Afrique. Mais,
la survie quotidienne en Afrique peut dépendre d'autres facteurs qui ne
sont pas souvent monétaires ou monnayables. Beaucoup d'études ont
démontré que la fonction de consommation du ménage
africain ne dépendait pas seulement de son revenu, mais aussi des
revenus des autres ménages qui composent la famille. Si on prend la
fonction de consommation keynésienne : C = cY+C056(*), avec C la consommation, Y le
revenu, c la propension marginale à consommer et C0 la consommation
autonome qui ne dépend pas du revenu. En Afrique, le C0 peut être
trop grand pour un nombre important d'individus et de ménages sans
revenus, grâce à la famille élargie... Donc, un individu
peut ne pas avoir 1$ par jour, et survivre. Nous prenons une famille africaine
composée de 20 membres. Nous supposons que cette famille a 7 de ces
membres qui travaillent et qui gagnent au total 3500$ par mois. Selon la Banque
Mondiale, le nombre de pauvres est de 13. Supposons en plus que ces 7
travailleurs consacrent 1000 $ pour l'achat des biens de survie et qu'elles
gardent sous leur toit 5 de leurs parents sans revenus (les chômeurs
à la recherche d'un emploi, les étudiants...). Chacun aura en
moyenne 2$ par jour. Le nombre de pauvres passe à 8 au lieu de 13. La
Banque Mondiale doit donc prendre en compte le revenu de tous les membres d'une
famille pour calculer le nombre de pauvres de la famille en particulier, et en
déduire celui du pays en général, au risque de surestimer
la réalité.
Aussi, dans les campagnes, les populations pratiquent
l'autosuffisance alimentaire. La plus grande partie de leur consommation
journalière est composée des aliments qui sont produits dans
leurs plantations. Donc, ils n'ont pas besoin d'acheter les biens alimentaires
pour survivre, en faisant l'hypothèse que la nourriture constitue le
principal élément de survie. La conséquence de cette
approche est que la pauvreté monétaire est surestimée dans
les zones rurales en Afrique.
Le dernier point concerne le prix du panier de bien qui
est 1$. Nous pensons qu'il est nécessaire de prendre en compte
l'inflation entre les différents pays et au sein des zones d'un
même pays pour trouver le revenu nécessaire à la survie
quotidienne. Pour un consommateur, détenir 1$ à
Libreville57(*) (capitale
politique du Gabon) qui est la quatrième ville la plus chère au
monde et à Johannesburg58(*) (Afrique du Sud) qui occupe la 117eme place, selon le
classement 2000 de l'Economist Intelligence Unit59(*), ne donne pas la même
satisfaction.
Nous faisons l'hypothèse que le panier de bien de
survie (B) coûte 1$ par jour comme l'estime la Banque Mondiale. Ce
coût est le même à Johannesburg (Cj), avec le prix
égal à l'unité. Le différentiel d'inflation est de
0.5 entre Johannesburg et Libreville. Le coût de B à Libreville
(Cl), en calculant Cl par rapport à Cj, nous donne:
Cl = Cj*1 + Cj*0.5 = Cj*1.5
Ce qui signifie que le seuil nécessaire pour la survie
journalière par personne est 1.5$ à Libreville et 1$ à
Johannesburg.
En somme, la pauvreté est une notion
multidimensionnelle. Elle évolue dans l'espace et dans le temps. Les
transformations structurelles des conditions de vie des populations
évoluent en enrichissant le débat sur les formes de
pauvreté et la façon de mieux combattre ce
phénomène. Dans ce contexte, la communauté du
développement détermine trois grandes formes de pauvreté
qui sont : la pauvreté monétaire, la pauvreté humaine
et résiduelle et la pauvreté sociale. Ainsi, pour mieux
comprendre la mesure et indicateurs de pauvreté dans le monde, nous
adoptons une démarche qui intègre toutes ces formes de
pauvreté. Il apparait donc justifié de parler des
pauvretés dans le monde, en lieu et place de la pauvreté dans le
monde.
S'agissant d'abord de la pauvreté
monétaire, elle a régressé dans la quasi-totalité
des régions du monde. Cependant, elle reste en constante augmentation en
Afrique Subsaharienne. La croissance économique a permis de tirer des
millions de personnes de la pauvreté absolue dans le monde. Cependant,
les inégalités entre les différentes régions du
monde en termes de développement économique constituent un frein
pour avoir des résultats homogènes dans la lutte contre la
pauvreté monétaire. C'est pourquoi nous relatons la
nécessité d'un « développement
durable ».
S'agissant ensuite de la lutte contre la
pauvreté humaine et résiduelle, elle a également connu des
résultats divers. Comme la pauvreté monétaire, les
régions développées semblent mieux s'en sortir, en
comparaison avec celles en développement. Mais, c'est en Afrique
Subsaharienne que beaucoup d'efforts restent encore à faire. Par
ailleurs, les inégalités entre les sexes persistent. Il reste
donc encore un grand chemin à faire pour réduire les
inégalités entre les pays, les classes sociales et les sexes afin
d'établir « l'ordre juste ».
S'agissant enfin de la pauvreté sociale, c'est
une notion qui varie d'une société à une autre. La lutte
contre cette forme de pauvreté doit intégrer toutes les
spécificités inhérentes à chaque
société. Lutter contre l'isolement et/ou la solitude
intègre les catastrophes naturelles, les risques politiques, les
épidémies, les conflits sociaux... Dans ce contexte, la
communauté du développement réfléchit sur les
indicateurs qui peuvent bien saisir ce phénomène. Nous proposons
un indicateur pour servir de piste de réflexion en ce qui concerne
l'Afrique. Dans le sens d'une approche intégratrice des formes de
pauvreté, nous faisons l'hypothèse que l'économie, les
capacités et les risques naturels font partie intégrante des
déterminants de la pauvreté sociale dans cette partie du monde.
Après l'étude empirique des
pauvretés dans le monde, un constat se dégage : l'Afrique
Subsaharienne est la région qui enregistre plus de résultats non
satisfaisants. Les explications peuvent être : historique,
politique, sociale, culturelle, économique... Dans notre analyse, nous
tentons d'expliquer la pauvreté monétaire. Il ressort que la
croissance de l'Afrique Subsaharienne n'est pas « pro
pauvre ». Aussi, l'augmentation constante de la population annihile
tout impact positif que celle-ci pourrait-elle avoir sur la pauvreté. Ce
qui permet de faire un plaidoyer en faveur d'une croissance « pro
pauvre » dans cette partie du monde, tout en maitrisant la croissance
de la population. Le développement économique en Afrique doit
beaucoup concerner les secteurs de l'industrie et les services qui ont un
impact significatif sur la réduction du nombre de personnes vivant sous
un seuil de pauvreté absolue, tout en stimulant la consommation et en
réformant le secteur agricole.
Par ailleurs, la mesure et indicateurs de
pauvreté monétaire en Afrique souffrent de plusieurs limites
inhérentes au lien établi par la Banque Mondiale entre le revenu
et la consommation, d'une part, et le seuil de pauvreté, d'autre part.
Ce qui peut entrainer une surestimation ou sous-estimation de la
pauvreté monétaire dans cette partie du monde.
En outre, la hausse actuelle du baril de pétrole
entraine une inflation persistante dans toutes les régions du monde. Les
manifestations contre la vie chère se multiplient. En Afrique
Subsaharienne, le phénomène est plus persistant. Les programmes
d'ajustement structurel imposés à ces pays et l'injuste
spécialisation des économies africaines issue de la colonisation
font que cette partie du monde est beaucoup dépendante des importations
des denrées alimentaires de base comme le riz et les produits
manufacturés. La crise a donc pour effet : l'augmentation
spectaculaire du nombre de pauvres. Dans ce contexte, la
nécessité d'une révolution profonde des structures :
économique, sociale, politique, culturel... est
prépondérante.
Bibliographie
I/ OUVRAGES
Amin S., 1989, La faillite du développement en Afrique et
dans le Tiers-Monde analyse politique, Paris, l'Harmattan.
Amin S., 1993, L'empire du chaos, Paris, l'Harmattan.
Amin, S., 1994, Démocratie, développement, droits
de l'homme, Genève, Centre. International de Formation à
l'Enseignement des droits de l'homme et de la paix.
Asselin L.M., Dauphin A., 2000, « Mesure de la
pauvreté : un cadre conceptuel », Centre Canadien d'Etude
et de Coopération Internationale.
Bairoch, P., 1992, Le Tiers-Monde dans l'impasse, Paris,
Gallimard.
Banque Africaine pour le Développement (B.A.D.), 1996,
Rapport sur le développement en Afrique, Abidjan.
Duboit J.C., 1998, «Integrating
Poverty Reduction Policies into the Development Strategy: a Challenge for
Cameroon», UNDP, New York, 36 p.
Malthus T.R., 1798, Essai sur le principe de population, Edition
PUF, 166P.
Milano S., 1988, La pauvreté absolue, Hachette.
Nations Unies, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, Rapport mondial sur le développement humain, United Nations
Development Programme.
Nations Unies, 2005, Objectifs du millénaire pour le
développement.
Paugam S., 2005, Les formes élémentaires de la
pauvreté, Lien social, PUF.
Programme des Nations Unies pour le Développement
(P.N.U.D.), Commission Economique pour l'Afrique (C.E.A.), 2002,
« Gouvernance locale dans la perspective de la réduction de la
pauvreté en Afrique », Mozambique, cinquième Forum sur
la Gouvernance en Afrique.
Vérez J.-C., 2007, Pauvretés dans le monde,
Ellipse.
II/ ARTICLES
Economist Intelligence Unit, 2000, n°2.
Grelle P., Wery A., 1980, « La relativité du
concept de pauvreté », Economie et Humanisme, n° de
juillet, août, P.21.
Sarris A., Savastano S., 2006, « Agriculture et
pauvreté dans les pays africains dépendant de produits de
base : perspective des ménages de zones rurales de la
Répiblique-Unie de Tanzanie », Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, document technique sur les produits de
base et le commerce n°9.
Wagle U., 2002, « Repenser la pauvreté :
définition et mesure », Revue Internationale des Sciences
Sociales, n° 17.
III/ SITES INTERNET
www.banquemondiale.org
www.bi.undp.ogr
www.fraternet.com
www.monde-diplomatique.fr
www.oecd.org
www.undp.org
www.wikipedia.org
Table des matières
INTRODUCTION
GENERALE.............................................................1
PREMIERE PARTIE : Fondements théoriques
de la mesure et indicateurs des
pauvretés.............................................................................................8
A/ Approches selon le bien-être
économique..................................................9
1/ Pauvreté
absolue................................................................................10
2/ Pauvreté relative et
subjective.................................................................11
B/ Approches selon les capacités et l'exclusion
sociale.....................................14
1/ Approche selon les
capacités...................................................................15
2/ Approche selon l'exclusion
sociale............................................................19
DEUXIEME PARTIE : Etude empirique des
pauvretés dans le monde...............21
A/ Analyse des indicateurs des pauvretés dans
le monde..................................21
1/ Analyse de la pauvreté
monétaire..............................................................21
2/ Analyse de la pauvreté humaine et
sociale...................................................30
a/ La pauvreté
humaine............................................................................30
b/ La pauvreté
sociale..............................................................................
.33
B/ Modèle et critique de la pauvreté
monétaire en Afrique Subsaharienne.............42
1/
Modèle..............................................................................................42
2/ Critique de la pauvreté monétaire en Afrique
Subsaharienne..............................48
CONCLUSION
GENERALE..................................................................51
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................53
TABLE DES
MATIERES........................................................................55
* 1 PNUD, 2005.
* 2 Paugam, 1983.
* 3 Economiste, sociologue et
père du socialisme scientifique.
* 4 Economiste et prix Nobel
indien, il a introduit la notion de capacité pour définir la
pauvreté.
* 5 C'est la Banque Mondiale
(BM) et le Fond Monétaire International (FMI).
* 6 Ils ont été
imposés aux économies des PED par la BM et le FMI.
* 7 Rapport Mondiale sur le
Développement Humain, Nations Unies 2004.
* 8 C'est un genre de
développement qui prône l'équité entre pays et au
sein des pays.
* 9 Duboit J.C.,
1998, «Integrating Poverty Reduction Policies into the
Development Strategy: a Challenge for Cameroon», UNDP, New York,
36 p.
* 10 Wagle U., 2002,
« Repenser la pauvreté : définition et
mesure », Revue Internationale des Sciences Sociales, n°17.
* 11 Duboit J.C.,
1998, «Integrating Poverty Reduction Policies into the
Development Strategy: a Challenge for Cameroon», UNDP, New York,
36 p.
* 12 Wagle U., 2002,
« Repenser la pauvreté : définition et
mesure », Revue Internationale des Sciences Sociales, n° 17.
* 13 Duboit J.C.,
1998, «Integrating Poverty Reduction Policies into the
Development Strategy: a Challenge for Cameroon», UNDP, New York,
36 p.
* 14 Vérez J.-C., 2007,
Pauvretés dans le monde, Ellipse.
* 15 Banque Mondiale, 2001,
Rapport sur le développement dans le monde.
* 16 PUNUD, 2000, Rapport
sur le développement humain dans le monde.
* 17 Selon la formulation du
PNUD.
* 18 www.wikipedia.org.
* 19 Formulation du PNUD.
* 20 Formulation du PNUD.
* 21 Vérez J.-C., 2007,
Pauvretés dans le monde, Ellipse.
* 22 Vérez J.-C., 2007,
Pauvretés dans le monde, Ellipse.
* 23 Wagle U., 2002,
« Repenser la pauvreté : définition et
mesure », Revue Internationale des Sciences Sociales, n° 17.
* 24 Banque Mondiale, Rapport
2004.
* 25 François
Bourgnon, économiste en chef de la Banque Mondiale.
* 26 Banque Mondiale, Rapport
2004.
* 27 Banque Mondiale, Rapport
2004.
* 28 Calculs du bureau du
Rapport mondial sur le développement humain, d'après la Banque
Mondiale, 2001.
* 29 Calculs du bureau du
Rapport mondial sur le développement humain, d'après la Banque
Mondiale, 2001.
* 30 Calculs du bureau du
Rapport mondial sur le développement humain, d'après la Banque
Mondiale, 2001.
* 31 Calculs du bureau du
Rapport mondial sur le développement humain, d'après la Banque
Mondiale, 2001.
* 32 Développement qui
prône l'équité entre générations et au sein
des générations
* 33 Vérez J.-C., 2007,
Pauvretés dans le monde, Ellipse.
* 34 Selon le classement
2000, tableau se trouvant aux annexes
* 35 Vérez J.-C., 2007,
Pauvretés dans le monde, Ellipse.
* 36 Documentation
photographique n°8
* 37
www.monde-diplomatique.fr
* 38 Expression souvent
utilisée par les aventuriers (es) quand ils partent en aventure.
* 39 Expression
utilisée par Marx pour désigner l'exploitation du travail par le
capital dans les sociétés capitalistes.
* 40 Indicateur du PIB du
PNUD
* 41 Selon la formule de
GINI
* 42 Ancien président
du Congo Brazzaville, élu démocratiquement et renversé par
l'actuel président SASSOU.
* 43
www.monde-diplomatique.fr
* 44 Indicateur de
longévité du PNUD
* 45 Pasteur et
économiste anglais
* 46 Une suite de nombres
rangés dans un ordre tel que chacun d'eux s'obtient en ajoutant un
nombre constant à celui qui le précède.
* 47 Une suite de nombres
rangés dans un ordre tel que chacun d'eux s'obtient en multipliant un
nombre constant à celui qui le précède.
* 48
Première tentative de représentation chiffrée du
mécanisme de la vie économique. Elle distingue trois agents
économiques : les propriétaires, les fermiers et les
industriels et commerçants.
* 49 Sarris A., Savastano S.,
2006, « Agriculture et pauvreté dans les pays africains
dépendant de produits de base : perspective des ménages de
zones rurales de la République-Unie de Tanzanie »,
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, document
technique sur les produits de base et le commerce n°9.
* 50 Théoricien de la
croissance
* 51 Qui permet de
réduire la pauvreté
* 52 Economiste
français, il est souvent considéré comme le père de
l'école classique française
* 53 Economiste anglais,
père fondateur de l'économie de la demande
* 54 Les observations sont
tirées de : B.M., Rapport 2004, Worl Bank Africa Database 2005,
Worl Development Indictors 2004.
* 55 Construction d'un
modèle qui représente l'écosystème mondial,
basé sur des simulations
* 56 Fonction de consommation
keynésienne de base
* 57 Capitale politique du
Gabon
* 58 Ville Sud-Africaine
* 59 Economist Intelligence
Unit, 2000, n°2.
| 


