|
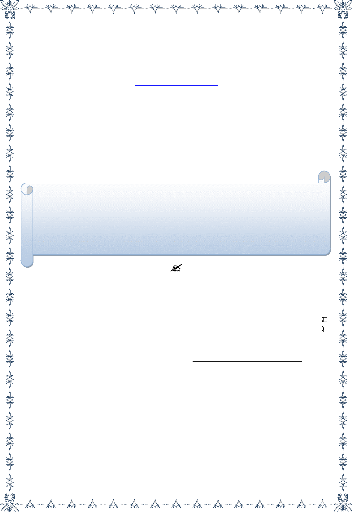
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
UNIVERSITAIRE
INSTITUT SUPERIEUR AGRO -- VETERINAIRE
SAINT PIERRE CANISIUS/KIMWENZA
www.isav-kimwenza.net
ETUDE DE L'EFFICACITE DES EXTRAITS DE
Cucurma
longa, Tithonia diversifolia et Zingiber
officinale
SUR LES MICRO - ORGANISMES DE L'AIR
«
Cas de l'Aspergillus flavus et
Aspergillus niger »
Fabrice IMPION MOKUBA
Travail de fin de cycle défendu pour l'obtention du
titre d'ingénieur technicien en agriculture et en élevage.
Directeur : Prof. MUMBA DJAMBA Antoine, Ph. D
Année Académique 2010 - 2011

EPIGRAPHE
L'essentiel n'est pas c'est qu'on a fait de l'homme, mais
plutôt c'est ce que l'homme a fait de ce qu'on a fait de lui.
Jean - Paul SARTRE

DEDICACE
A l'Eternel, le Dieu souverain.
A mes très chers parents, à mon
regretté père Paul IMPION que Dieu a rappelé si tôt
et à ma mère Gabrielle N'KONKO pour tous les efforts et
sacrifices consentis depuis ma naissance.
A mes très chers frères et soeurs IMPION :
Cathy, Lily, Eric, Popol, Chrétien, Grâce, Patrick, Thierry et
Gaby - Paule IMPION.
A ma future et tendre épouse dont j'ignore encore le
nom.
Je dédie ce travail
iv
AVANT - PROPOS
Ce présent travail est le fruit d'un long parcours
de formation et des différents efforts consentis, qui est abouti
à la fin de notre cycle d'études en science agro -
vétérinaire à l'I.S.AV. De ce fait, nous voudrions nous
acquitter d'un désir noble ; celui de remercier avec joie et
reconnaissance toutes les énergies conjuguées de près ou
de loin, nous ayant permis d'atterrir en douceur.
Nos remerciements s'adressent à l'Institut
Supérieur Agro - Vétérinaire, plus spécialement aux
autorités académiques ainsi qu'au corps professoral et
administratif. La volonté, l'abnégation qui les ont
caractérisés méritent notre profonde
reconnaissance.
Nous présentons notre gratitude à l'endroit
de Monsieur le professeur Dr. Ir. MUMBA DJAMBA Antoine, directeur de ce travail
de fin de cycle pour avoir accepté de nous accompagné tout au
long de sa réalisation, ses conseils, ses remarques, sa rigueur, sa
disponibilité, les sacrifices consentis, nous incitent à lui
rendre un hommage particulier.
Nous remercions également la Clinique des Plantes
de Kinshasa, particulièrement la responsable l'Ir. Lyna MUKWA et son
assistant l'Ir. Emmanuel MUKOMA pour avoir mis à notre disposition la
volonté et tout le matériel de laboratoire approprié pour
les études menées au sein de ce laboratoire.
Nous présentons des bouquets des fleurs à
nos frères et soeurs qui étaient toujours présents pour
nous encourager, nous pensons à : Ir Fraternel KUYENGA, Junior MULAMBA,
Roddy NGOMA, Joseph MANGALABOY, Guelord MUZUMBU, Coco KUTOMA, Canny BOTAKA,
Alain MAWELO, Glady LUZOLO, Raphael SADIKI, Euphrasie KITANGA, Florence
MALINGUMU, Tity TSHIKA, Lysette BOPIO, Bruno TETANI, Dercy KOMBO, Patrick
KILEMBEKA.

Il nous serait ingrat de clore ce travail sans pour autant
remercier nos compagnons d'élite avec qui nous avons traversé
vent et marais durant notre séjour à l'I.S.AV ; nous citons :
Fabrice TSHISHIMBI, Fils BONZENGA, Bernard NGUDI, Serge MAYASI, Marc KIALA,
Patrick NKANGA, Jeancy MUNAYENO, Lafthony TUSEVO, Job NTEMBI, Joël VUNZI,
Joyce ABATA, Albine PULULU, Obed NGITUKULU.
Que tous ceux dont les noms ne sont pas cités ici,
mais qui nous ont été utiles pour notre formation et à la
réalisation de ce travail, trouvent ici l'expression de notre
reconnaissance.
Fabrice IMPION MOKUBA
vi
SIGLES ET ABREVIATIONS
- CPK : Clinique des Plantes de Kinshasa
- I.S.AV : Institut Supérieur Agro -
Vétérinaire
- J - C : Jésus - Christ
- DDT : Dichloro - diphényl - trichloroéthane
- % : Pourcent
- EPA : Agence de Protection Environnementale (Etats - Unis) -
Fig : Figure
- g : Gramme
- kg : Kilogramme
- Bt : Bacillus thuriengiensis - ° C : Degré
Celsius
- PDA : Potato Dextrose Agar - ml : Millilitre
- pH : Potentiel en hydrogène
INTRODUCTION
1. Problématique
L'agriculture est un ensemble des activités
destinées à tirer de la terre les productions des animaux et des
végétaux utiles à l'homme, surtout sur le plan
alimentaire. Mais les producteurs sont butés à des
problèmes liés à plusieurs facteurs, notamment aux
maladies qui diminuent cette production. Ainsi, des luttes ont
été initiées et proposées pour palier à ce
problème tel que l'utilisation des pesticides.
Les pesticides sont des produits chimiques ou
synthétiques destiné à tuer tout être nuisible
à la plante. Mais les plus utilisés sont les pesticides
chimiques, lesquels doivent être utilisés avec beaucoup de
précautions au risque d'intoxication nuisible à l'homme, à
l'animal, à la plante aussi bien qu'à l'environnement et
demandent une durée de rémanence relativement longue ; et avec
cette durée de rémanence, il est difficile voir même
impossible d'utiliser ces pesticides chimiques sur les cultures
maraîchères.
A cet effet, touché par ces risques d'intoxications,
une lutte biologique a été mise en place comme alternative
à la lutte chimique ayant comme outils de base les bio - pesticides
à base des micro - organismes, des végétaux et des
substances naturelles et enfin la mise en place d'un traitement bio - pesticide
qui se fait en plusieurs étapes : l'identification des plantes à
vertus bio - pesticides, l'extraction du jus de ces plantes et leur utilisation
en protection des plantes contre les principales maladies des cultures
maraichères.
Abordant dans le même sens, des expériences ont
été entreprises au laboratoire de la Clinique des Plantes de
Kinshasa sur l'efficacité des extraits de Curcuma longa, Tithonia
diversifolia et Zingiber officinale sur les micro - organismes, qui sont
des organismes vivants microscopiques qui peuvent être bactériens,
végétaux, animaux, saprophytes et pathogènes ayant une
possibilité de vivre et de se développer dans
différentes conditions, même dans l'air. Ainsi, une forte
densité d'animaux et des végétaux entraine une
possibilité de propagation des maladies par les micro - organismes de
l'air1.
Les micro - organismes peuvent exister en suspension libre
dans l'air ou être attachés aux particules de poussière. La
plupart de ces micro - organismes sont probablement sans danger faisant partie
du milieu environnemental naturel et qui sont nécessaires pour la
décomposition des déchets, de la matière organique ;
d'autres sont pathogènes ou partiellement pathogènes aussi bien
pour l'homme que pour les animaux et les végétaux2.
Des expériences dans le laboratoire de la Clinique des
Plantes de Kinshasa ont été faites pour essayer de freiner le
développement mycélien des micro - organismes de l'air à
l'aide des extraits des plantes à vertus fongicides comme : Curcuma
longa, Zingiber officinale et Tithonia diversifolia. Et
ces expériences seront faites à plusieurs doses de chaque plantes
pour déterminer une dose qui convient pour le traitement.
Face aux micro - organismes de l'air, est - ce que les
extraits obtenus de plantes seront efficaces pour freiner le
développement mycélien de ces micro - organismes ? Si le
développement mycélien des micro - organismes de l'air est
freiné, cela se fera à quelle dose ?
2. Hypothèse
Les expériences sur ces bio - pesticides auront pour
finalité une mise en place d'une lutte efficace, moins coûteux,
facile à avoir et convenable aux conditions des producteurs congolais,
mais aussi de déterminer une dose exacte pour inhiber la croissance et
le développement des micro - organismes de l'air.
1 SCIENCES ET TECHNIQUES AVICOLES, « Les micro -
organismes de l'air », Septembre 1997, hors série.
2 SCIENCES ET TECHNIQUES AVICOLES, op. cit.
D'autres micro - organismes de l'air étant
pathogènes, les extraits de Curcuma longa, Tithonia
diversifolia et Zingiber officinale seront en mesure avec une
dose précise d'inhiber la croissance et le développement des miro
- organismes de l'air jugés pathogènes.
3. Objectifs
Ce présent travail a pour objectif de contribuer
à l'étude de l'efficacité des extraits des plantes bio -
pesticides utilisé en protection des plantes cultivées en
République Démocratique du Congo. Ce, en vue de mettre au moins
une méthode de lutte biologique adaptée aux conditions de
cultures de la R. D. Congo, moins couteux pour les producteurs et en rapport
avec la protection de l'environnement, à réduire le
développement des micro - organismes pathogènes de l'air en
utilisant les bio - pesticides comme substitut à la lutte chimique.
Il vise à tester :
i' L'efficacité des bio - pesticides à base de
Curcuma longa, Tithonia diversifolia et Zingiber
officinale ;
i' Les doses précises pouvant jouer le rôle
d'inhibiteur sur la croissance mycélien des micro - organismes
pathogènes de l'air.
4. Subdivision du travail
A part l'introduction et la conclusion, ce travail est
subdivisé en trois chapitres. Le premier chapitre parle des
généralités sur les pesticides, le deuxième aborde
le matériel et les méthodes utilisés et enfin le
troisième chapitre présente les résultats et leur
discussion.
Chapitre I. GENERALITES SUR LES PESTICIDES
I. 1. Etymologie
Le mot pesticide a été
créé en anglais, sur le modèle des nombreux mots se
terminant par le suffixe -cide du latin « -cida »,
du verbe latin « caedo », « caedere
» qui veut dire « tuer », et sur la base du mot anglais
pest signifiant animal, insecte ou plante nuisible, lequel provient
(comme le français peste) du latin « pestis
» qui désignait notamment un animal nuisible.
Un pesticide ou produit phytosanitaire est une substance mise
dans une culture pour lutter contre des organismes nuisibles. C'est un terme
générique qui rassemble les insecticides, les fongicides, les
herbicides, les parasiticides. Ils s'attaquent respectivement aux insectes
ravageurs, aux champignons, aux mauvaises herbes et aux vers parasites.
Le terme pesticide englobe donc les substances «
phytosanitaires » ou « phytopharmaceutiques »3.
I. 2. Historique
La lutte chimique existe depuis des millénaires :
l'usage du soufre remonte à la Grèce Antique (1000 ans avant J -
C) et l'arsenic est recommandé par Pline, naturaliste romain, en tant
qu'insecticide. Des plantes connues pour leurs propriétés
toxiques ont été utilisées comme pesticides (par exemple
les aconits, au moyen âge, contre les rongeurs)4.
Des traités sur ces plantes ont été
rédigés (Ex : traité des poisons de Maïmonide en
1135). Les produits arsenicaux ou à base de plomb (Arséniate de
plomb) étaient utilisés au XVIe siècle en Chine et en
Europe.
3 Http : //
www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
Les propriétés insecticides du tabac
étaient connues dès 1690. En Inde, les jardiniers utilisaient les
racines de Derris et Lonchocarpus (roténone) comme
insecticide. Leur usage s'est répandu en Europe vers
19005.
La chimie minérale s'est développée au
XIXe siècle, fournissant de nombreux pesticides minéraux à
base de sels de cuivre. Les fongicides à base de sulfate de cuivre se
répandirent, en particulier la fameuse bouillie bordelaise
(mélange de sulfate de cuivre et de chaux) pour lutter contre les
invasions fongiques de la vigne et de la pomme de terre, non sans
séquelles de pollution sur les sols (cuivre non dégradable). Des
sels mercuriels sont employés au début du XXe siècle pour
le traitement des semences.
Les pesticides font l'objet d'usage géographiquement et
temporellement ciblés, ce qui explique de fortes variations
régionales et saisonnières dans la pollution de l'eau et de l'air
par ces produits6.
L'ère des pesticides de synthèse débute
vraiment dans les années 1930, profitant du développement de la
chimie organique de synthèse et de la recherche sur les armes chimiques
durant la première guerre mondiale.
En 1874, Zeidler synthétise le DDT (dichloro -
diphényl - trichloroéthane), dont Muller en 1939 établit
les propriétés insecticides. Le DDT est commercialisé
dès 1943 et ouvre la voie à la famille des organochlorés.
Le DDT a dominé le marché des insecticides jusqu'au début
des années 19707.
5 Http: //
www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
6 Http, op. cit.
Structure chimique du DDT :
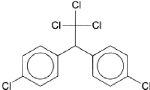
En 1944, l'herbicide 2,4-D, copié sur une hormone de
croissance des plantes et encore fortement employé de nos jours, est
synthétisé8.
La seconde guerre mondiale a généré,
à travers les recherches engagées pour la mise au point de gaz de
combat, la famille des organophosphorés qui, depuis 1945, a vu un
développement considérable encore de mise aujourd'hui pour
certains de ces produits, tel que le malathion9.
En 1950 - 1955 se développe aux États-Unis les
herbicides de la famille des urées substituées (linuron, diuron),
suivis peu après par les herbicides du groupe ammonium quaternaire et
triazines.
Dans les années 1970 - 80 apparaît une nouvelle
classe d'insecticides, les pyréthrinoïdes qui dominent pour leur
part le marché des insecticides.
Désormais, l'accent est mis sur la compréhension
des modes d'action et la recherche de cibles nouvelles. Connaissant les cibles,
on peut alors établir des relations structure-activité pour
aboutir à l'obtention de matières actives. Ceci est possible
grâce au développement de la recherche fondamentale dans les
domaines de la biologie et de la chimie et aux nouveaux outils fournis par la
chimie quantique, les mathématiques et l'informatique qui permettent la
modélisation de ces futures molécules10.
8 Http : //
www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
9 Http, op. cit.
10 Http, op. cit.
Actuellement, on assiste à une consolidation du
marché au niveau des familles les plus récemment
découvertes avec la recherche de nouvelles propriétés. En
même temps, de nouvelles cibles physiologiques de l'animal ou du
végétal sont explorées dans le but de développer
des produits à modes d'action originaux, des produits issus de la
biotechnologie ou des médiateurs chimiques11.
I. 3. Catégories et mode d'action des
pesticides
Les catégories de produits suivants,
désignés commercialement comme « produits phytosanitaires
», sont utilisées pour soigner ou prévenir les maladies des
végétaux. Il s'agit :
· Les acaricides pour tuer les acariens,
· Les bactéricides pour tuer les
bactéries,
· Les corvicides ou corvifuges pour tuer les corbeaux,
· Les fongicides pour l'inhibition ou la prévention
du développement des champignons,
· Les herbicides, désherbants, phytocides ou
débroussaillants pour détruire les adventices (mauvaises
herbes),
· Les insecticides pour détruire ou prévenir
le développement des insectes,
· Les molluscicides pour tuer les limaces et les
escargots,
· Les nématicides pour tuer les nématodes,
· Les parasiticides pour tuer les parasites,
· Les rodenticides pour tuer les rongeurs,
· Les taupicides pour tuer les taupins,
11 Http : //
www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
· Les virucides. Il s'agit d'un terme commercial
désignant un produit, une solution ou un traitement censé tuer
les virus12.
Selon l'action exercée au niveau du cycle parasitaire
de base, un pesticide exerce une activité : (1) préventive ou
anti - pénétrante, s'il agit avant l'infection ; (2) curative,
s'il intervient pendant la phase d'incubation ; (3) anti - sporulante ; s'il
empêche la sporulation du parasite et (4) éradicante ; s'il
élimine les parasites déjà visibles13.
Par ailleurs, en fonction de son comportement dans les
plantes, le pesticide sera qualifié de produit de :
· Surface ou de contact, si seule la fraction
présente sur la surface traitée entraîne un effet anti -
fongique qui sera donc de type préventif ;
· Pénétrant, s'il se présente en
quantité suffisante dans les assises cellulaires sous jacentes aux
surfaces traitées pour entraîner un effet curatif ;
· Translaminaire, si après son application sur une
face foliaire, il inhibe le développement d'un champignon inoculé
sur l'autre face ;
· Systémique, si après une migration
interne via le xylène ou le phloème, il exerce une
activité fongique (préventive ou curative) hors de la zone
traitée14.
I. 4. Pesticides chimiques
Les pesticides chimiques sont des substances chimiques ou de
synthèse, destinées à lutter contre les parasites
végétaux et animaux nuisibles aux cultures, aux récoltes
et à l'homme15. Un pesticide peut être composé
d'un ou de plusieurs matières actives ou substances actives
équivalant des principes
12 Http: //
www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
13 LEPOIVRE, P. 2003, << Phytopathologie »,
Edition De boeck Université, Bruxelles Belgique, 415 pages.
14 LEPOIVRE, op. cit.
15 Microsoft Corporation, 2009. << Microsoft
encarta », 1993 - 2008.
actifs chez l'homme et l'animal (une substance active
équivaut à un pesticide simple et plusieurs substances actives
équivalent à un pesticide composé)16.
Un pesticide contient :
· Une substance active empêchant les ennemis et
parasites des s'installer ;
· Un diluant ou charge : sont représentés par
une substance neutre destinée à réduire la concentration
de substance active ;
· Des adjuvants : sont des produits utilisés pour
améliorer les qualités physiologiques ou chimiques d'un
pesticide, à savoir : adhésif (permet au produit de rester le
plus longtemps sur la plante), dispersif ou émulsif et le synergiste qui
améliore l'efficacité des produits17.
I. 4. 1. Présentation des pesticides
chimiques
Un code international de 2 lettres majuscules, placées
à la suite du nom commercial indique le type de formulation. Les
principaux types de formulation sont les suivants :
· Les présentations solides :
o Les poudres mouillables (WP) : la
matière active est finement broyée (solide) ou fixée
(liquide) sur un support adsorbant ou poreux (silice). Des agents tensio-actifs
(dodécylbenzène, lignosulfonate de Ca, Al ou Na) et des charges
de dilution (kaolin, talc, craie, silicate d'aluminium et magnésium ou
carbonate de Ca) sont ajoutés ainsi que des agents anti -
redépositions , anti - statiques ou anti - mousses. Des stabilisateurs
(anti - oxygène et tampon pH) sont inclus pour les rendre compatibles
avec d'autres préparations.
16 PULULU, G. 2009 - 2010, « Notes de
phytopathologie », ISAV, inédit.
17 PULULU, G. op. cit.
o Les granules à disperser (WG) :
granules obtenus par l'agglomeration avec un peu d'eau de matière
active, de charge et d'agents liants et dispersants, suivi d'un sechage.
o Les micro-granules (MG) : identiques aux
WG mais d'une taille plus petite (0,1 à 0,6 mm)18.
· Les présentations liquides
:
o Les concentres solubles (SL) : c'est une
solution de matière active
à diluer dans l'eau, additionnee d'agents
tensio-actifs.
o Les suspensions concentrees (SC) : les
matières actives solides, insolubles dans l'eau sont maintenues en
suspension concentree dans l'eau, en presence de mouillants, de dispersants,
d'epaississants (bentonite, silice) ou d'agents anti - redeposition, d'anti -
gel (ethylène glycol, uree), d'anti - moussants et parfois de
bactericides (methanal ou formol).
o Les concentrees emulsionnables (EC) : les
matières actives sont mises en solution concentree dans un solvant
organique et additionnee d'emulsifiants charges de stabiliser les emulsions
obtenues au moment de l'emploi par dilution dans l'eau.
o Les emulsions concentrees (EW) : la
matière active est dissoute dans un solvant organique. La solution
additionnee d'agents emulsifiants est dispersee dans une petite quantite
d'eau19.
I. 4. 2. Modalité de traitement
Les manières d'appliquer les traitements
phytosanitaires varient avec les cultures et les ravageurs. D'une
manière générale, un traitement rationnel est prepare par
la determination des causes des dommages et du cycle de
18 Http : //
www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
19 Http, op. cit.
développement du ravageur mettant en évidence les
époques les plus favorables au traitement.
L'expérimentation permet de choisir la (ou les)
matière active efficace contre le (ou les) ravageur(s) à
contrôler, les conditions matérielles optimales et la
fréquence des répétitions de traitement nécessaire
ainsi que les doses d'emploi20.
Toutefois, la désinfection peut se faire de
différentes manières, à savoir :
· Par enrobage ou immersion : consiste à plonger
ou à recouvrir les semences, les bulbes ou les racines d'une solution
contenant des produits phytopharmaceutiques ;
· Par arrosage : les produits phytosanitaires sont
dissouts dans l'eau et ensuite appliqués par arrosage pour tuer les
ennemis et parasites du sol ;
· Par injection : elle consiste à injecter dans
le sol une substance active qui va produire de la vapeur tuant les ennemis et
parasites du sol. Ces produits sont appelés des fumugants ;
· Par pulvérisation : consiste à projecter le
produit phytosanitaire sous pression en fines gouttelettes ;
· Par atomisation : consiste à vaporiser le produit
phytosanitaire pour désinfecter les parties aériennes de la
plante21.
I. 4. 3. Toxicité
Il existe deux types de toxicité :
1. Toxicité aiguë par absorption massive de
pesticides. Les effets sont ceux d'un empoisonnement par substance chimique
pouvant entraîner des
20 Mémento de l'Agronome, 1980. << Les
pesticides », pp 1223 - 1237, Champ-de-Mars, Ministère de la
coopération à Paris, France.
21 PULULU, G. 2009 - 2010, << Notes de
phytopathologie », ISAV, inédit.
troubles graves du métabolisme et de la
fécondation, voire la mort de l'individu, homme ou animal ;
2. Toxicité chronique ou indirecte par exposition
à des doses faibles mais répétées. On a
observé depuis les années 1970 des effets
cancérigènes, mutagènes et tératogènes sur
les êtres vivants exposés à des faibles doses de
pesticides22.
I. 4. 4. Principaux fongicides utilisés en zone
tropico - équatoriale
Les principaux fongicides se répartissent dans les
catégories suivantes :
· Les produits minéraux ;
· Les produits organiques23.
1. 4. 4. 1. Les produits minéraux
Ces sont d'abord les produits à base de sulfate de cuivre
:
- Bouillie Bordelaise : sulfate de cuivre 1 à 2 % + chaux
vive 0,5 à 1 % ;
- Bouillie Bourguignonne : sulfate de cuivre 1 à 2 % +
carbonate de soude 1,3 à 2,6 % ;
- Bouillie Ibadan ou << Carbide Bordeaux >> : sulfate
de cuivre 1 kg + carbure de calcium 400 g.
Et aussi des produits à base de soufre :
- Soufre en fleur ;
- Soufre jaune sublimé 99 % de S ;
- Soufre noir précipité brun 40 - 50 % ;
- Soufre micronisé ;
- Soufre mouillable (80 % minimum) ;
- Bouillies sulfo - calciques 15 à 25 % de S des
polysulfures.
22 Microsoft Corporation, 2009. << Microsoft encarta
>>, 1993 - 2008.
23 Mémento de l'Agronome, 1980. << Les
pesticides >>, pp 1223 - 1237, Champ-de-Mars, Ministère de la
coopération à Paris, France.
Ces produits ont une action préventive contre les
oïdiums, ils sont des phytotoxiques au - dessus de 30°
C24.
1. 4. 4. 2. Les produits organiques
Ces sont d'abord les produits à base des
différentes familles, à savoir :
- Les carbonates, les dérivés du benzène
;
- Phenyls substitués, les quinones ;
- Dicarboximides, les amines ;
- Diazines, les thiadiazines ;
- Sulfones sulfonyl sulfamides ;
- Oxyquinoléines, les mono - éthyle phosphites
métalliques ; - Dérivés divers25.
I. 5. Pesticides biologiques ou bio -
pesticides
Schématiquement, le bio - pesticide est formé de
<< pesticides >> qui veut dire << tuer les pestes >> et
du préfixe << bios >> qui signifie << vie
>> en grec. L'antinomie de ces deux termes souligne que les bio -
pesticides s'inscrivent dans la lutte contre les organismes fléaux et
sont basés sur l'utilisation d'agents ou facteurs liés à
la vie.
On a longtemps débattu pour savoir s'il fallait prendre
en considération comme bio - pesticides les seuls organismes vivants
antagonistes aux fléaux ou si des molécules bio -
synthétisées et des composés extraits d'un organisme
vivant pouvait être considérés comme bio - pesticide.
Aujourd'hui, la définition retenue est la plus large26.
24 Mémento de l'Agronome, 1980. << Les
pesticides >>, pp 1223 - 1237, Champ-de-Mars, Ministère de la
coopération à Paris, France.
25 Mémento de l'Agronome, op. cit.
26 Http : //www.universitecentrale.net/
Un bio - pesticide se définit comme tout produit de
protection des plantes à base d'organismes vivants ou
substances27.
I. 5. 1. Historique
Dans le contexte de développement des pesticides
chimiques, dont la production était aisée et les coûts peu
élevés, a constitué à la charnière de la
moitié du 20è siècle, une révolution technologique
dans le domaine de la protection des cultures. Mais les succès qu'ils
rencontrèrent immédiatement dans le contrôle des
espèces nuisibles aux cultures ainsi qu'à la santé humaine
et animale, ont conduit à leur utilisation intensive et souvent sans
discernement. On connaît la suite : des désordres
écologiques à de multiples niveaux.
Aussi de nombreuses initiatives sont déployées
depuis plusieurs années pour développer des méthodes
alternatives à l'utilisation de ces pesticides chimiques. Nous vous
proposons d'examiner les méthodes qui ont trait à l'emploi de, ce
que l'on appelle communément les bio - pesticides et de voir dans quelle
mesure ils sont prêts à prendre la relève du « tout
chimique »28.
I. 5. 2. Type des bio - pesticides
Selon l'agence de protection environnementale des Etats - Unis
(EPA), les bio - pesticides ou les pesticides biologiques sont des
dérivés de matériels naturels tels que les animaux, les
plantes, les bactéries et certains animaux.
27 Http : //www.universitecentrale.net/
28 REGNAULT, C. 2005, « Enjeux phytosanitaires pour
l'agriculture et l'environnement », Lavoisier (Cachan), France, 1013
pages.
L'EPA réparti ces bio - pesticides en trois types :
1. Les pesticides microbiens dont l'ingrédient actif est
un micro - organisme (bactérie, champignon, protozoaire, algue) ou un
virus ;
2. Les pesticides d'origine végétale y compris
les molécules que les plantes transgéniques produisent
après l'incorporation d'un transgène comme la protéine Bt
de Bacillus thuriengiensis d'origine végétale.
3. Les pesticides biochimiques sont des substances naturelles
ne présentant pas de toxicité directe vis - à - vis des
ravageurs et agents phytopathogènes, mais qui interfèrent avec
leur croissance ou leur reproduction ainsi qu'à la physiologie de
plante29.
I. 5. 3. Plantes à vertus fongicides
1. Curcuma ou Safran des Indes (Curcuma
longa)

Fig 1. Rhizomes de Curcuma longa Fig 2. Les parties de
Curcuma longa
Origine
Le curcuma (Curcuma longa) est une plante
herbacée rhizomateuse vivace de la famille des Zingiberaceae,
originaire du sud de l'Asie. Parfois appelée safran des Indes, son nom
provient du sanskrit « kunkuma », Arabe «
ãßÑß », « kourkoum »,
Hébreu « », « karkom ». Il est largement
cultivé en
29 LEPOIVRE, P. 2003, « Phytopathologie »,
Edition De boeck Université, Bruxelles Belgique, 415 pages.
Inde mais aussi, à un moindre degré, en Chine,
à Taïwan, au Japon, en Birmanie, en Indonésie et en
Afrique.
Règne : Plantae, Division :
Magnoliophyta, Classe : Liliopsida, Ordre :
Zingiberales, Famille : Zingiberaceae, Genre :
Curcuma, Espèce : Curcuma longa et le nom vernaculaire
: Curcuma ou Safran des Indes30.
Description botanique
C'est une plante herbacée à rhizome qui ressemble
au gingembre, mais dont la production est bien plus faible.
Les rhizomes sont ramifiés, de forme ellipsoïde
à la base, portant des excroissances cylindriques plus ou moins
incurvées pouvant atteindre 10 cm de long. Ils contiennent de la
curcumine qui leur donne une couleur jaune orangé. Obtenue sous forme
d'oléorésine puis isolée, la curcumine est un colorant
alimentaire intéressant. Des huiles essentielles responsables de
l'arôme sont également obtenues à partir des
rhizomes31.
Plante persistante avec les pousses feuillées entourant la
tige. Elle pousse d'un rhizome jusqu'à une hauteur de 1 à 1,5 m.
Elle a une odeur caractéristique32.
Composition
Le curcuma est riche en amidon à 45 - 55 %, renferma 2
- 8 % d'huile essentielle et des colorants, les curcuminoïdes
jusqu'à 8 % dont le composé majoritaire est la curcumine (50 - 60
%)33.
30 Http : //
floramedicina.com/spip.php?page=backend"/curcuma
31 Mémento de l'Agronome, 2006. « Les plantes
à épice, Curcuma », pp 1094 - 1095, Jouve, CIRAD - GRET,
Paris, France.
32 LATHAM, P. et KONDE, M. 2006. « Quelques plantes
utiles de la province de Bas - Congo », DFID, Royaume unis, 330
pages.
33 Http : //
www.phytomania.com
Usage
Le rhizome de curcuma est utilisé comme épice
(dans les poudres de carry essentiellement), comme médicament et
cosmétique. Le principal producteur est l'Inde, probablement pays
d'origine de cette plante34.
Le curcuma était aussi largement utilisé comme
teinture jaune orangé - pour le costume safran des <<
sâdhus » ou des moines bouddhistes par exemple - avant l'invention
des teintures chimiques35.
Le curcuma inhibe la croissance de nombreuses bactéries
gram positifs et gram négatifs, dont celles qui causent la dysenterie
amibienne (Entamoeba hisolytic) et d'autres, comme le Clostridium
perfringens, le Sarcina, le Gaffkya, les
Staphylococcus, les Streptococcus, les Bacillus et plusieurs
champignons pathogènes. Il aide également lors d'infections en
inhibant la production de certaines toxines bactériennes qui peuvent
causer de sérieux torts à l'organisme, dont les aflatoxines,
produites par les champignons qui croissent dans la nourriture mal
préservée36.
Culture
La culture dure environ deux ans, ce qui explique que cette
plante est souvent associée à d'autres. La culture
bénéficie du paillage et là où les sols sont
très secs ou très humides, il vaut mieux la cultiver en
contre-pente37. C'est dans des conditions humides et sur les sols
bien drainés, relâchés, friables et fertiles qu'elle se
développe le mieux38.
Multiplication
La multiplication se fait par fragments de rhizome,
plantés dans des trous peu profonds. Les distances entre plants sont de
0,15 à 0,30 m. Comme
34 Mémento de l'Agronome, 2006. << Les plantes
à épice, Curcuma », pp 1094 - 1095, Jouve, CIRAD - GRET,
Paris, France.
35 Http : //
floramedicina.com/spip.php?page=backend"/curcuma
36 Http, op. cit.
37 Mémento de l'Agronome, op. cit.
38 LATHAM, P. et KONDE, M. 2006. << Quelques plantes
utiles de la province de Bas - Congo », DFID, Royaume unis, 330
pages.
pour le gingembre, le sol doit être bien
préparé, affiné et enrichi en matière organique.
La plantation est faite à plat ou sur planches, selon
le niveau d'humidité du sol. Le curcuma réagit bien à des
apports fractionnés d'azote. En Inde, des essais ont montré
l'effet bénéfique du paillage sur le rendement39.
2. Tithonia (Tithonia diversifolia)

Fig 3. Fleurs et feuilles de Tithonia Fig 4. La fleur de
Tithonia
Origine
Originaire du Mexique, le tithonia est une plante buissonnante
qui a été introduite partout dans le monde autour de
l'équateur et s'y est naturalisée40.
Description botanique
Ce « Tournesol du Mexique » autrement appelé
« la grosse marguerite jaune » de la famille des Asteraceae
a pour nom Tithonia diversifolia. Il forme rapidement de grands
buissons herbacés très ramifiés, persistants pouvant
dépasser 3 m de haut. Les feuilles, longues de 13 à 15 cm, sont
alternes, avec un limbe comportant de 3 à 5 lobes.
39 Mémento de l'Agronome, 2006. « Les plantes
à épice, Curcuma », pp 1094 - 1095, Jouve, CIRAD - GRET,
Paris, France.
40 Http: //
floramedicina.com/spip.php?page=backend"/tithonia
Les inflorescences sont portées par un pédoncule
de 7 à 20 cm. La fleur évoque la marguerite (même forme,
même parfum), mais en jaune orange vif et en beaucoup plus gros, elle
atteint plus ou moins 10 cm de diamètre. La partie centrale est
composée de tubes serrés (chacun donnera une graine après
fécondation). Autour d'elle le nombre de pétales est variable.
Ces grosses fleurs apparaissant en mai et juin. Elles attirent les abeilles et
les papillons. En bouquet, elles durent quelques jours41.
Usage
Le tithonia utilisé seule comme engrais ou
conjugué à des fertilisants phosphorés, peut doubler et
même tripler les récoltes. En Afrique, il est aussi utilisé
pour prévenir la malaria, réduire les remontées d'acide
gastrique, les fièvres et pour supprimer les vers des enfants.
Il agit comme un pesticide naturel : là où on
l'utilisait les plantes n'étaient pas attaquées, ce qui a fait
découvrir cette propriété qui a ensuite été
étudiée42.
Il y a plusieurs façons d'utiliser les branches
coupées :
- en mulch : couper les déchets assez finement (bouts
de 20 à 30 cm), les déposer sur le sol et les recouvrir de terre
ou de paille,
- en purin : remplir une grosse poubelle de feuilles et tiges,
recouvrir d'eau, mettre le couvercle, attendre 10 jours. Diluer à 50% le
liquide obtenu avec de l'eau et arroser les plantes et les arbres avec le
mélange. Répandre la matière restante autour d'un arbre
fruitier.
- pour améliorer le sol du potager ou d'une plate-bande
: couper les déchets comme pour le mulch, en mettre une couche de 20 cm
et les recouvrir également de 20 cm de terre végétale
contenant un peu de sable et bien arroser.
41 Http : //
floramedicina.com/spip.php?page=backend"/tithonia
42 Http, op. cit.
On estime également que l'infusion des feuilles peut
être appliquée sur les troncs d'arbre ou versée dans les
trous pour éliminer les termites. Les abeilles butinent le nectar mais
la production varie avec l'altitude et le type de sol. Le miel obtenu est
ambré et saccharifie rapidement43.
Culture
Le tithonia se plaît en plein soleil, supporte bien la
chaleur et la sécheresse, et peut pousser partout : il a la vigueur des
mauvaises herbes. On le reproduit par boutures ou par graines. Il nous surprend
par sa créativité et son aptitude à produire, sur une
même plante, tant de différences dans la forme des fleurs et des
feuilles. C'est une bonne plante pour maintenir la santé du jardin : ses
feuilles regorgent de nombreuses substances nutritives nécessaires aux
cultures, dont le phosphore44.
Multiplication
On plante les boutures directement en terre, en les inclinant :
c'est la méthode de reproduction la plus simple et la plus
rapide45.
Ne pas planter trop profondément sous un paillage
d'herbes. On peut également utiliser des boutures de 20 à 30 cm
ou diviser la touffe46.
43 LATHAM, P. et KONDE, M. 2006. « Quelques plantes
utiles de la province de Bas - Congo », DFID, Royaume unis, 330
pages.
44 Http: //
floramedicina.com/spip.php?page=backend"/tithonia
45 Http, op. cit.
46 LATHAM, P. et KONDE, M. op. cit.
3. Gingembre (Zingiber officinale)

Fig 5. Rhizomes de Gingembre Fig 6. La plante de Gingembre
Origine
Le gingembre est connu en Asie depuis des milliers
d'années. Il est mentionné dans l'ouvrage de Confucius au
5ième siècle avant notre ère. Il était
utilisé comme épice par les Grecs et les Romains. Les espagnols
l'ont introduit en Jamaïque et d'autres îles des Antilles.
Au 16ième siècle, le gingembre
était exporté en grande quantité des Antilles vers
l'Espagne47.
Description botanique
Cette plante, qui regroupe 85 espèces, est
cultivée pour son rhizome, utilisé comme épice. C'est une
plante herbacée vivace, à feuilles lancéolées,
alternes, certaines tiges étant stériles et d'autres
florifères48.
Usage
Le gingembre sert dans des préparations culinaires comme
épice, des boissons, des confiseries et en pharmacie.
47 STOLL, G. 2002. « Protection naturelle des
végétaux en zone tropicales », Margraf Verlag,
Allemagne, 386 pages.
48 Mémento de l'Agronome, 2006. « Les plantes
à épice, Gingembre », pp 1094 - 1095, Jouve, CIRAD -
GRET, Paris, France.
Culture
Le gingembre est une plante de climat tropical humide, qui
supporte des températures moyennes annuelles de l'ordre de 22°
C.
Il est cultivé comme une plante annuelle. Il ne se
développe correctement que dans des sols pas trop lourds et sans
éléments grossiers49.
Multiplication
La multiplication se fait par éclats de rhizome portant
au moins un oeil. Le sol doit être labouré soigneusement, puis
préparé en planches ou en billons (un apport de fumier au moment
du labour est conseillé). Le paillage, pratiqué
traditionnellement, est très bénéfique à la
culture. Le gingembre réagit bien à des apports d'azote (doses
optimales de 200 à 300 kg de N/ha, selon des essais
réalisés en Australie)50.
49 Mémento de l'Agronome, 2006. « Les plantes
à épice, Gingembre », pp 1094 - 1095, Jouve, CIRAD -
GRET, Paris, France.
50 Mémento de l'Agronome, op. cit.
Chapitre II. MATERIEL ET METHODES
Dans ce deuxième chapitre, nous décrivons les
méthodes utilisées ainsi que le matériel ayant servi dans
l'élaboration, la réalisation et l'aboutissement de notre
étude.
II. 1. Matériel
Deux types de matériels ont été
utilisés pour mener les recherches au laboratoire, à savoir :
1. Matériel végétal,
2. Matériel de laboratoire.
II. 1. 1. Matériel végétal
1. Curcuma ou Safran des Indes (Curcuma
longa)
Curcuma longa possède d'excellentes
propriétés insectifuges. Il a une mode d'action : insectifuge,
insecticide, fongicide et la partie de la plante possédant toutes ces
propriétés est le rhizome51.
2. Tithonia (Tithonia diversifolia)
Tithonia diversifolia est utilisé comme bio -
insecticide pour les sesquiterpènes lactones qu'il
contient52. Le tithonia a été utilisé dans
cette expérience comme bio - fongicide.
3. Gingembre (Zingiber officinale)
Zingiber officinale utilisé en phytopathologie
comme bio - fongicide. Le rhizome de gingembre possède un mode d'action
: insectifuge, insecticide,
51 STOLL, G. 2002. « Protection naturelle des
végétaux en zone tropicales », Margraf Verlag,
Allemagne, 386 pages.
52 STOLL, G. op. cit.
nématicide et fongicide53. Il est
utilisé dans notre expérience comme bio - fongicide.
II. 1. 2. Matériel de laboratoire
Le milieu utilisé pour cette étude est le milieu
PDA (Potato Dextrose Agar) qui est un milieu de culture propice pour
la croissance d'une large gamme des champignons phytopathogènes à
étudier.
Les ingrédients utilisés pour la
préparation du milieu PDA sont les suivants : la pomme de terre, le
dextrose ou sucre blanc de canne, l'agar - agar, la gélose ou la
gélatine et de l'eau distillée54.
On a aussi utilisé d'autres matériels de la
désinfection de matériel biologique jusqu'à
l'observation.
Le matériel de laboratoire utilisé lors de
l'expérience sont les suivants :
· La hotte à flux laminaire qui sert d'enceinte
stérile pour les isolements et on y travaille dessus pour être
exempt de contamination ;
· L'autoclave qui sert à la stérilisation des
matériels ;
· Le bi - oculaire est un matériel qui se place
entre l'oeil et le microscope et peut aller jusqu'à l'objectif 5x ;
· Deux étuves, une grande sert
généralement à sécher les échantillons et
à la croissance des agents pathogènes, et une petite sert
à la croissance des agents pathogènes en culture
contrôlée ;
· Le microscope pour les examens microscopiques ;
· Le vortex ;
· Le pH mètre et
· Une balance de précision pour des mesures
exactes.
53 STOLL, G. 2002. << Protection naturelle des
végétaux en zone tropicales », Margraf Verlag,
Allemagne, 386 pages.
54 CLINIQUE DES PLANTES DE KINSHASA, 2009. << Protocole
commun de laboratoire, Milieu pour la croissance des champignons »,
CPK Kinshasa.
Et quelques matériels dont on se sert pour les
prélèvements des échantillons et autres pratiques, tels
que les lames ou lames porte - objet et lamelles ou les lames couvre - objet,
les boîtes de Pétri en verre et plastique, les erlène -
meyers, une pipette, les lames bistouris, la lampe, le bleu de lactophenol,
l'alcool, ...
II. 2. Méthodes
II. 2. 1. Préparation du milieu de culture
Le milieu de culture PDA est favorable pour la croissance des
champignons phyto - pathogènes. A chaque préparation, une dose de
0,4 g de sodium azide a été ajouté dans 1 l de milieu pour
limiter les contaminations bactériennes des milieux de culture.
Voici le protocole utilisé pour la préparation de
milieu de culture pour la croissance des champignons :
Constituants :
- 200 g de Pomme de terre ;
- 15 g de Dextrose ou de sucre blanc de cannes ; - 20 g d'agar -
agar, gélose ou de gélatine ;
- 1 litre d'eau distillée.
Préparation :
1. Dissoudre 20g d'agar-agar dans 300 ml d'eau distillée,
homogénéiser la solution.
2. Peser 200g de pomme de terre, éplucher la pomme de
terre, mélanger 200g de pomme de terre bien découpé avec
300 ml d'eau distillée,
bouillir à 100° C pendant 20 à 25 minutes,
ensuite recueillir l'eau de la pomme de terre environ 300 ml.
3. Le 300 ml de l'eau venant de la pomme de terre est
mélangé à 300 ml de la solution agar - agar.
4. Ajuster ensuite le volume du mélange au moyen de l'eau
distillée jusqu'à 1000 ml.
5. Auto - claver le mélange à la
température de 125° C, la pression de 1,4 bar pendant 15
minutes.
6. Sous hotte à flux laminaire, couler la solution
obtenue sur des boîtes de Pétri.
7. Laisser sécher pendant 24 à 48
heures55.
En présence de PDA de synthèse, la procédure
devient simple, car il suffit de :
1. Prendre 39 gr de PDA de synthèse,
2. Le mélanger à 1 l d'eau distillée,
3. Secouer doucement jusqu'à obtenir un mélange
homogène,
4. Auto - claver sous une pression de 1,4 bar à la
température de 125°C durant 15 minutes,
5. Laisser refroidir un peu sous le hotte, puis couler la
solution sur les boîtes de Pétri,
6. Laisser sécher pendant 24 à 48
heures56.
55 CLINIQUE DES PLANTES DE KINSHASA, 2009. « Protocole
commun de laboratoire, Milieu pour la croissance des champignons »,
CPK Kinshasa.
56 CLINIQUE DES PLANTES DE KINSHASA, op. cit.
II. 2. 2. Préparation des bio - pesticides
1. Préparation d'extrait de Curcuma
longa
Pour commencer toutes les opérations, il faut
stériliser le matériel ou les mains. Et les étapes de
préparation d'extrait de bio - pesticide sont les suivants :
1.

Pesage
Rinçage Broyage Récolte Emploi
Epluchage : consiste à ôter la couche superficielle
du rhizome de Curcuma longa ;
2. Pesage : peser 20 gr de la biomasse des rhizomes de
Curcuma longa ;
3. Rinçage : laver la quantité obtenue à
l'eau ;
4. Broyage : à l'aide du pilon et du mortier en
porcelaine, il suffit d'écraser pour réduire les rhizomes en
petites particules pour en tirer le jus ;
5. Récolte : il suffit de presser les petites
particules des rhizomes broyées pour que ressorte le jus de Curcuma
longa et l'extraire à l'aide d'une pipette ;
6. Emploi : mettre dans un tube à essai pour mesurer le
pH et vortexer, et sera utilisé directement.
Le jus de Curcuma longa extrait avec un pH de 7,9 sera
mélangé avec 125 ml de milieu de PDA à différentes
doses de la manière suivante :
- 3 ml d'extrait de Curcuma longa + 125 ml de PDA ; - 6
ml d'extrait de Curcuma longa + 125 ml de PDA et - 9 ml d'extrait de
Curcuma longa + 125 ml de PDA ;
2. Préparation d'extrait de Tithonia
diversifolia
Contrairement au Curcuma longa dont les rhizomes ont
été utilisés, chez le Tithonia diversifolia, ce
sont les feuilles qui ont été utilisées. Les
opérations d'extraction du jus de Tithonia diversifolia se
succèdent de la manière suivante :
1.

.
Pesage
Rinçage Broyage Récolte Emploi
Pesage : peser 20 gr de la biomasse des feuilles de Tithonia
diversifolia ;
2. Rinçage : laver la quantité obtenue à
l'eau ;
3. Broyage : à l'aide du pilon et du mortier en
porcelaine, il suffit d'écraser pour réduire les feuilles en
petites particules pour en tirer le jus ;
4. Récolte : il suffit de presser les petites
particules des feuilles broyées pour que ressorte le jus de Tithonia
diversifolia et l'extraire à l'aide d'une pipette ;
5. Emploi : mettre dans un tube à essai pour mesurer le
pH et vortexer, et sera utilisé directement.
Le jus de Tithonia diversifolia extrait avec un pH de
6,5 sera mélangé avec 125 ml de milieu de PDA à
différentes doses de la manière suivante :
- 3 ml d'extrait de Tithonia diversifolia + 125 ml de
PDA ;
- 6 ml d'extrait de Tithonia diversifolia + 125 ml de
PDA et - 9 ml d'extrait de Tithonia diversifolia + 125 ml de PDA ;
3. Préparation d'extrait de Zingiber
officinale
Le jus de gingembre à partir de ces rhizomes sera obtenu
de la manière suivante :
1.

Pesage
Rinçage Broyage Récolte Emploi
Epluchage : consiste à ôter la couche superficielle
du rhizome de Zingiber officinale ;
2. Pesage : peser 20 gr de la biomasse des rhizomes de
Zingiber officinale ;
3. Rinçage : laver la quantité obtenue à
l'eau ;
4. Broyage : à l'aide du pilon et du mortier en
porcelaine, il suffit d'écraser pour réduire les rhizomes en
petites particules pour en tirer le jus ;
5. Récolte : il suffit de presser les petites
particules des rhizomes broyées pour que ressorte le jus de Zingiber
officinale et l'extraire à l'aide d'une pipette ;
6. Emploi : mettre dans un tube à essai pour mesurer le
pH et vortexer, et sera utilisé directement.
Après extraction, le jus de Zingiber
officinale a un pH de 6,4 et sera mélangé avec 125 ml de
milieu de PDA à différentes doses de la manière suivante
:
- 3 ml d'extrait de Zingiber officinale + 125 ml de PDA
;
- 6 ml d'extrait de Zingiber officinale + 125 ml de PDA
et - 9 ml d'extrait de Zingiber officinale + 125 ml de PDA ;
Il faut noter que chaque préparation de 125 ml de
milieu PDA + une dose de différent extrait de plante seront
coulées dans les boîtes de Pétri en 3
répétitions.
II. 2. 3. Exposition
Après préparation du milieu PDA qui contient
différentes doses de Curcuma longa, de Tithonia
diversifolia et de Zingiber officinale utilisées
directement après extraction. Cette utilisation consiste à couler
la préparation sur boîte de Pétri et placée à
l'étuve durant 48 heures sous une température de 30° C.
Les observations sur la croissance mycélienne ont
été faites à 11 heures, après la mise à
l'étuve respectivement 24 heures et 48 heures après la mise en
place à l'étuve et à la même heure 11 h 00.
II. 2. 4. Paramètres à observer
Le paramètre à relever lors de
l'expérience sur les boîtes de Pétri est : le niveau de
croissance et du développement des micro - organismes de l'air
incubés. Et les données seront transcrites dans un tableau qui
reprend toutes les répétitions tel que repris au tableau 1.
Tableau 1. Matrice de la présentation des
résultats
Préparations Doses Traitements
PDA + Curcuma longa 3 ml
|
6 ml
|
T1
|
|
9 ml
|
|
|
PDA + Tithonia
diversifolia
|
3 ml
|
|
|
6 ml
|
T2
|
|
9 ml
|
|
|
PDA + Zingiber
officinale
|
3 ml
|
|
|
6 ml
|
T3
|
|
9 ml
|
|
Les résultats de la croissance et du développement
des micro - organismes incubés a comme légende :
· +++ : très forte formation des micro -
organismes,
· ++ : forte formation des micro - organismes,
· + : faible formation des micro - organismes et
· - : absence des colonies microbiennes.
Chapitre III. RESULTATS ET DISCUSSION
Ce dernier chapitre présente les résultats obtenus
durant tout le processus expérimental et leur discussion.
III. 1. Identification des colonies des micro -
organismes
Après incubation, les micro - organismes devraient
être identifiés.
Pour ce faire, la méthode d`analyse et d'identification
des champignons utilisée est la méthode de scotch et
l'identification se faisait à l'aide de la fiche C.M.I contenant toutes
les espèces d'agents phytopathogènes existantes. On
procédait de la manière suivante :
1. Bien observer la surface du tissus malade (au binoculaire ou
loupe grossissante et faire une description détaillée),
2. Identifier la présence des fructifications des
champignons (Conidiospores, Pycnides, Périthèces,
Sporodochium, Acervule, etc.)
3. Poser un morceau de scotch sur l'échantillon, en vue
de prélever les structures observées,
4. Sur une lame porte objet, déposer d'abord une goutte
de colorant (lactophenol),
5. Y déposer l'objet et rajouter une seconde goutte de
colorant (lactophenol),
6. Chauffer l'ensemble de la préparation à la
flamme,
7. Observer la lame chauffée au microscope,
8. Les structures des champignons observées au
microscope sont identifiées au moyen des fiches d'identification CMI et
des compendiums pour identifier des agents phyto -
pathogènes57.
Après analyse, voici les résultats :
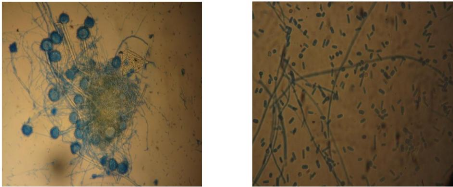
Fig 7. Conidiophores de l'Aspergillus flavus Fig 8.
Conidie et conidiophores de
l'Aspergillus niger
De ces résultats il s'avère que la
présence de l'Aspergillus flavus et de l'Aspergillus
niger est très remarquable par le simple fait qu'ils constituent la
partie importante des micro - organismes aérien en régions
chaudes. L'Aspergillus flavus est un agent pouvant être
la cause de plusieurs maladies respiratoire chez les oiseaux58.
L'Aspergillus niger est impliqué dans
l'apparition de certaines maladies de l'oreille chez l'homme. Chez les
végétaux, l'Aspergillus niger est un agent
pathogène responsable d'une maladie grave de l'arachide : « la
pourriture de la couronne ». Sa pathogenicité a également
été signalé sur le sorgho. Sur oignon, Aspergillus
niger entraîne la moisissure noire tandis que chez l'ail et
l'échalote, il provoque une pourriture de la tige. Il se
développe de fois sur les aliments d'origine animale en conservation,
où il entraîne un empoisonnement, par la sécrétion
de l'acide oxalique (fiche CMI, 94)59.
.
58 Fiche CMI, 1995. « Descriptions of
pathogenic fungi and bacteria », n° 91, CPK Kinshasa,
inédit.
59 Fiche CMI, op. cit.
III. 2. Action d'extrait de Curcuma longa sur la
croissance mycélienne d'Aspergillus flavus et Aspergillus niger
Le Curcuma longa a été
expérimenté avec une dose de 3 ml, 6 ml et 9 ml pour
apprécier son action fongique. Les résultats obtenus au cours de
l'essai sont présenté dans le tableau 2 ci - après :
Tableau 2. Action de Curcuma longa sur la croissance
mycélienne de l'Aspergillus flavus et Aspergillus
niger
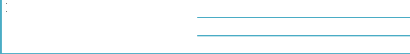
FDA + Curcuma longa + ++ ++
+ ++ ++
+ ++ ++
Légende :
· +++ : très forte formation des micro -
organismes,
· ++ : forte formation des micro - organismes,
· + : faible formation des micro - organismes et
· - : absence des colonies microbiennes.
Les résultats rassemblés dans le tableau II ci
après montre que : 48 heures après incubation, à des doses
de 3 ml d'extrait de Curcuma longa, il ya développement de la
microflore. Et celle-ci se développe de manière proportionnelle
à l'augmentation de la dose. Aux doses de 3 ml, seule la microflore
à mycélium blanche et noire (Aspergillus niger).
À 6 ml de dose de Curcuma longa, il a été
observé trois différents types de mycélium. Une colonie
blanche avec un centre jaune, une autre blanche avec un centre noire et une
troisième colonie blanche avec un centre bleu à la surface de la
boîte de pétri. À 9 ml de dose de curcuma longa il a
été remarqué le développement de colonies blanches
avec un centre de couleur jaune et des colonies grises au bord
blanchâtre.
III. 3. Action d'extrait de Tithonia diversifolia sur
la croissance mycélienne d'Aspergillus flavus et Aspergillus niger
Les doses respectives de 3 ml, 6 ml, 9 ml de Tithonia
diversifolia ont été expérimentées l pour
apprécier son action fongique sur la microflore aérienne. Les
résultats des essais sont présentés dans le tableau 3 ci
après :
Tableau 3. Action de Tithonia diversifolia sur la
croissance mycélienne de l'Aspergillus flavus et
Aspergillus niger

FDA + Tithonia diversifolia ++ + +
++ + +
++ + +
Légende :
· +++ : très forte formation des micro -
organismes,
· ++ : forte formation des micro - organismes,
· + : faible formation des micro - organismes et
· - : absence des colonies microbiennes.
A l'issu de ces résultats il est claire que, plus la
dose de Thitonia diversifolia augmente, moins la microflore
aérienne se développe. Ces résultats indiquent que le
Tithonia diversifolia aurait un effet sur le développement des
microorganismes. Puisque à la dose de 3 ml il a été
remarqué le développement des colonies jaunes avec bordures
noires tandis qu'à 6 ml et à 9 ml de dose, une seule
espèce de micro - organisme à colonie blanche a été
observé.
III. 4. Action d'extrait de Zingiber officinale sur la
croissance mycélienne d'Aspergillus flavus et Aspergillus niger
Des doses respectives de Zingiber officinal ont
été testées à 3 ml, 6 ml et 9 ml en vue
d'apprécier l'action fongicide du jus de cette plante. Les
résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 4 ci -
après :
Tableau 4. Action de Zingiber officinale sur la
croissance mycélienne de l'Aspergillus flavus et
Aspergillus niger
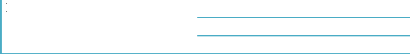
FDA + Zingiber officinale ++ ++ +
++ ++ +
++ ++ +
Légende :
· +++ : très forte formation des micro -
organismes,
· ++ : forte formation des micro - organismes,
· + : faible formation des micro - organismes et
· - : absence des colonies microbiennes.
Du tableau 4 ci - dessus, il est remarquable que le
Zingiber officinale ait une action fongicide à des doses
élevée de 9 ml. A la dose de 3 ml il y a développement des
colonies noires d'Aspergillus niger, le mycélium
blanchâtre et des colonies bactériennes à contour
irrégulière.
Le tableau 5 reprend la synthèse des résultats
obtenus avec chaque extrait.
Tableau 5. Synthèse de l'action des divers extraits sur
la croissance mycélienne de l'Aspergillus flavus et
Aspergillus niger
Préparations Doses Traitements
Résultats
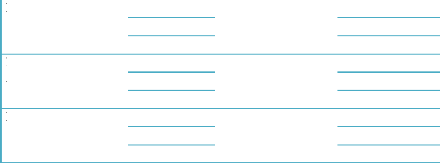
PDA + Curcuma longa
PDA + Tithonia diversifolia
PDA + Zingiber officinale
3 ml
3 ml
3 ml
6 ml T1 ++
9 ml ++
6 ml T2 +
9 ml +
6 ml T3 ++
9 ml +
++
++
+
Légende :
· +++ : très forte formation des micro -
organismes,
· ++ : forte formation des micro - organismes,
· + : faible formation des micro - organismes et
· - : absence des colonies microbiennes.
Interprétation :
- L'extrait de Curcuma longa a eu un effet inhibiteur
allant d'une forte
croissance à une faible croissance
d'Aspergillus flavus à la dose de 3 ml ;
- L'extrait de Tithonia diversifolia a eu un effet
inhibiteur allant d'une forte croissance à une faible croissance
d'Aspergillus flavus aux doses de 6 ml et 9 ml ;
- L'extrait de Zingiber officinale a eu un effet
inhibiteur allant d'une forte
croissance à une faible croissance
d'Aspergillus flavus à la dose de 9 ml.
- 38 -
CONCLUSION ET SUGGESTION
Des expériences ont été menées
pour trouver des alternatives à la lutte chimique, qui présente
beaucoup d'inconvénients et des dommages sur plusieurs domaines :
agricole, sanitaire, environnemental, etc.
Ce, en vue de mettre au point une méthode de lutte
biologique moins couteux pour les producteurs, pour l'environnement et
adaptée aux conditions de cultures de la R. D. Congo. De manière
plus spécifique ce travail visait à tester :
i' L'efficacité des bio - pesticides à base de
Curcuma longa, Tithonia diversifolia et Zingiber
officinale ;
i' Les doses précises pouvant jouer le rôle
d'inhibiteur sur la croissance mycélien des micro - organismes
pathogènes de l'air.
Ainsi, dans cette même perspective, des études
ont été menées à la Clinique des Plantes de
Kinshasa et on a abouti à des résultats concluants. Les
résultants obtenus après préparation, exposition,
incubation et observation, laissent croire que la croissance mycélienne
des micro - organismes de l'air, cas de l'Aspergillus flavus peut
être freinée par les extraits des plantes utilisées.
A cet effet, les extraits de Curcuma longa,
Tithonia diversifolia et de Zingiber officinale ont eu un
effet inhibiteur sur l'Aspergillus flavus et Aspergillus
niger à une dose 3 ml pour l'extrait de Curcuma longa,
à des doses de 6 ml et 9 ml pour l'extrait de Tithonia diversifolia
qui d'ailleurs est une plante insecticide, mais qui a eu plus d'effet
à deux doses différentes et à une dose de 9 ml pour
l'extrait de Zingiber officinale. Ainsi, les plantes à vertu
fongicide et insecticide utilisées ont manifestement
révélé des résultats escomptés ce qui
confirme l'hypothèse de départ. Le Tithonia diversifolia
et le Curcuma longa semble être le meilleur traitement pour
freiner la croissance mycélienne de l'Aspergillus flavus
et Aspergillus niger et c'est à la dose de 6 ml
pour le Tithonia diversifolia et 3 ml pour le Curcuma
longa.
Il est à préciser que ces résultats ne sont
valides qu'en milieu artificiel.
Nous suggérons que d'autres études de ce genre
puissent continuer mais en milieu naturel.
- 40 -
BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages
1. Mémento de l'Agronome, 1980. << Les
pesticides », Champ-de-Mars, Ministère de la coopération
à Paris, France, 1573 pages.
2. SCIENCES ET TECHNIQUES AVICOLES, << Les micro -
organismes de l'air », Septembre 1997, hors série.
3. LEPOIVRE, P. 2003, << Phytopathologie »,
Edition De boeck Université, Bruxelles Belgique, 415 pages.
4. Mémento de l'Agronome, 2006. « Les plantes
à épice, Curcuma et Gingembre », Jouve, CIRAD - GRET,
Paris, France, 1698 pages.
5. LATHAM, P. et KONDE, M. 2006. << Quelques plantes
utiles de la province de Bas - Congo », DFID, Royaume unis, 330
pages.
6. STOLL, G. 2002. << Protection naturelle des
végétaux en zones tropicales, Vers une dynamique de
l'information », Margraf Verlag, Allemagne, 386 pages.
7. REGNAULT, C. 2005, << Enjeux phytosanitaires pour
l'agriculture et
l'environnement », Lavoisier (Cachan), France, 1013
pages.
II. Encyclopédie
1. Microsoft Corporation, 2009. << Microsoft encarta
», 1993 - 2008.
III. Autres documentations
1. Clinique des Plantes de Kinshasa, 2009. <<
Protocole commun de laboratoire, Milieu pour la croissance des champignons
et Méthode de scotch », CPK Kinshasa, inédit.
2. Fiche CMI, 1995. << Descriptions of pathogenic fungi
and bacteria », n° 91, CPK Kinshasa, inédit.
IV. Note du cours 1. PULULU, G. 2009 - 2010,
« Notes de phytopathologie », ISAV, inédit.
V. Site internet
1. Http: //
floramedicina.com/spip.php?page=backend"
2. Http: //
www.fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
3. Http: //
www.phytomania.com
4. Http: //
www.universitecentrale.net
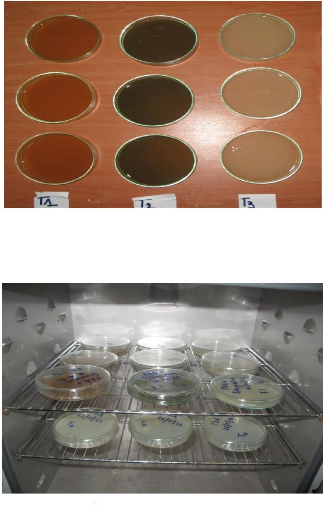
Fig 1. Boîtes de Pétri à
l'exposition
Fig 2. Boîtes de Pétri à
l'étuve
ANNEXE
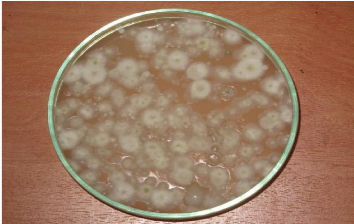
Fig 3. Préparation de Zingiber officinale
après 48 h d'incubation
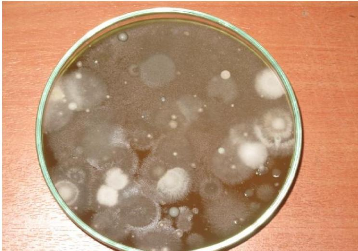
Fig 4. Préparation de Tithonia diversifolia
après 48 h d'incubation

- 44 -
Fig 5. Préparation de Curcuma longa après
48 h d'incubation
- 45 -
TABLE DE MATIERE
EPIGRAPHE ii
DEDICACE iii
AVANT - PROPOS iv
SIGLES ET ABREVIATIONS vi
INTRODUCTION - 1 -
1. Problématique - 1 -
2. Hypothèse - 2 -
3. Objectifs - 3 -
4. Subdivision du travail - 3 -
Chapitre I. GENERALITES SUR LES PESTICIDES - 4
-
I. 1. Etymologie - 4 -
I. 2. Historique - 4 -
I. 3. Catégories et mode d'action des pesticides - 7 -
I. 4. Pesticides chimiques - 8 -
I. 4. 1. Présentation des pesticides chimiques - 9 -
I. 4. 2. Modalité de traitement - 10 -
I. 4. 3. Toxicité - 11 -
I. 4. 4. Principaux fongicides utilisés en zones tropico -
équatoriale - 12 -
1. 4. 4. 1. Les produits minéraux - 12 -
1. 4. 4. 2. Les produits organiques - 13 -
I. 5. Pesticides biologiques ou bio - pesticides - 13 -
I. 5. 1. Historique - 14 -
I. 5. 2. Type des bio - pesticides - 14 -
I. 5. 3. Plantes à vertus fongicides - 15 -
1. Curcuma ou Safran des Indes (Curcuma longa) - 15
-
2. Tithonia (Tithonia diversifolia) - 18 -
3. Gingembre (Zingiber officinale) - 21 -
Chapitre II. MATERIEL ET METHODES - 23 -
|
II. 1. Matériel
|
- 23 -
|
|
II. 1. 1. Matériel végétal
|
- 23 -
|
1. Curcuma ou Safran des Indes (Curcuma longa)
|
- 23 -
|
2. Tithonia (Tithonia diversifolia)
|
- 23 -
|
3. Gingembre (Zingiber officinale)
|
|
- 23 -
|
|
|
II. 1. 2. Matériel de laboratoire
|
- 24 -
|
|
II. 2. Méthodes
|
- 25 -
|
|
II. 2. 1. Préparation du milieu de culture
|
- 25 -
|
|
II. 2. 2. Préparation des bio - pesticides
|
- 27 -
|
|
1. Préparation d'extrait de Curcuma longa
|
- 27 -
|
|
2. Préparation d'extrait de Tithonia diversifolia
|
- 28 -
|
|
3. Préparation d'extrait de Zingiber officinale
|
- 29 -
|
|
II. 2. 4. Paramètres à observer
|
- 30 -
|
|
Chapitre III. RESULTATS ET DISCUSSION
|
- 32 -
|
|
III. 1. Identification des colonies des micro - organismes
|
- 32 -
|
III. 2. Action d'extrait de Curcuma longa sur la
croissance mycélienne d'Aspergillus flavus et Aspergillus
niger - 34 -
III. 3. Action d'extrait de Tithonia diversifolia sur
la croissance mycélienne
|
d'Aspergillus flavus et Aspergillus niger - 35
-
III. 4. Action d'extrait de Zingiber officinale sur la
croissance mycélienne
|
|
d'Aspergillus flavus et Aspergillus niger
|
- 36 -
|
|
CONCLUSION
|
- 38 -
|
|
BIBLIOGRAPHIE
|
- 40 -
|
|
ANNEXE
|
- 42 -
|
|
TABLE DE MATIERE
|
- 45 -
|
| 

