|

Zones économiques spéciales et
nouveaux enjeux fonciers :
Le cas de Marg Swarnabhoomi au
Tamil Nadu, Inde
Paul Bertin
Master 1 Territoires, Développement et
Cultures
Sous la co -direction de Kamala Marius-Gnanou
Ma»tresse de conférence Ð Université Bordeaux
III
et d'Eric Denis
Directeur du département de Sciences Sociales - Institut
français de Pondichéry
Université Bordeaux III
UFR de
Géographie
Juin 2010

SOMMAIRE
Introduction - Exposé de la démarche
1ère partie : Zones Economiques Speciales : une
politique qui divise
1.1 - Un modéle venu d'ailleurs
1.2 - Des Export Processing Zones au SEZ Act 1.3 - Les
limites d'une politique mal contrTMlée 1.4 - Le cas particulier du Tamil
Nadu
2ème partie : Aux sources du projet
Swarnabhoomi
2.1 - Chennai et son contexte metropolitain 2.2 - Le point
sur la question des Reddyars 2.3 - Le groupe Marg
2.4 - Marg Swarnabhoomi : détails sur le
projet
3ème partie : Les dessous du mirage -
Enquête de terrain
Introduction
3.1 - Questions de méthode
3.2 - Sept villages pour autant de réalités 3.4
- Stratégies et conséquences
Conclusion
Remerciements Bibliographie Annexes
Introduction - Exposé de la démarche
Depuis maintenant quelques années, les médias
n'ont de cesse de faire l'éloge de la nouvelle économie
émergente que représente l'Inde. Avec un taux de croissance qui
devrait atteindre 7,5 à 8% pour l'année budgétaire
2009-2010, l'Inde ne conna»t pas la crise. Le tournant initié par
Rajiv Gandhi à la fin des années 80 en matiere de
stratégie de développement, désormais fondée sur
l'intégration à l'économie globale, semble porter ses
fruits. Disposant d'avantages comparatifs certains, avec une main d'oeuvre
abondante et qualifiée, des pTMles de compétitivité
susceptibles d'attirer les grandes firmes multinationales, et l'appartenance
à l'aire linguistique anglo-saxonne, le pays ne manque pas d'atouts.
Désireux d'améliorer les capacités de son
économie en matiere de compétitivité et de
flexibilité, le gouvernement central a fait le choix de
développer, sur l'exemple de la Chine et de nombreux pays en voie de
développement, les zones économiques spéciales (ZES)
à partir de 2005.
Les ZES possedent entre autres l'avantage d'être
exemptes des lois fiscales et environnementales. Les entreprises qui font le
choix de s'y installer bénéficient d'une main d'oeuvre bon
marché, et louent leur terrain à des prix défiants toute
concurrence. De plus ils profitent de ressources naturelles illimitées.
Le ministere de l'Industrie et du Commerce entend par ce moyen augmenter les
exportations et les flux d'IDE. Cependant, l'établissement d'une ZES
suppose la déportation des primo-occupants de ladite zone. Ceux qui
soutiennent les ZES prétendent que de nombreux emplois sont
créés, mais l'opinion internationale se montre sceptique. Les
instit utions financieres ont à plusieurs reprises exprimé leur
désaccord vis-à-vis de ce type de politique ultra
-libérale. Aussi la vice-présidente au développement du
secteur privé de la Société financière
internationale , une branche de la Banque Mondiale, exprime ses doutes sur
son blogue « La plupart des ZES sont situées sur des terres
agricoles fertiles. Détruire ces terres ne semble pas approprié
dans la mesure ou les fermiers ne deviendront pas facilement ouvriers
È, affirme t-elle.
C'est ainsi que les terres agricoles indiennes se transforment
tous les jours un peu plus en champ de bataille. Dans l'Orissa, le Bengale
Occidentale (affaire de l'usine Tata de Singur) le Maharashtra et le Karnataka,
les paysans manifestent par milliers contre le vol manifeste de leurs terres
par des géants de l'industrie. Pres d'un million d'indiens,
dépendant des revenus
de l'agriculture dans un pays oü 70% de la population
travaille encore aujourd'hui dans ce secteur, sont menacés par
l'avancée du phénomène des ZES, qui ont d'ores et
déjà grignoté plusieurs centaines de milliers d'hectares
du territoire national. De 1990 à 2003, la surface cultivée
s'était déjà réduite de 1,5% soit 2,1 millions
d'hectares. Le processus tend aujourd'hui à
s'accélérer.
L'Etat peine aujourd'hui à adopter une position ferme
et claire sur le sujet. Le Land acquisition Act, hérité
des temps de la colonisation, et datant de 1894, autorise les Etats
fédéraux à acheter des terrains au nom de l' Ç
intérét général È. L'ambiguité de ce
texte permet ainsi l'acquisition forcée de terres à la faveur des
grands groupes industriels, sans que les paysans ne percoivent une compensation
à la hauteur du préjudice causé.
C'est précisément sur ce point que se porte mon
étude. J'ai choisi de m'intéresser au cas de Marg Swarnabhoomi,
un mega-projet de ville nouvelle particulièrement ambitieux
développé entre Chennai et Pondichéry, sur le littoral du
Tamil Nadu, et comportant deux ZES. Lancé dès 2005, on verra
qu'il entre pleinement dans le cadre de la politique volontariste
développée par le gouvernement du Tamil Nadu, et qu'il
soulève à ce titre bon nombre de questionnements. De quelle facon
le groupe Marg est-il parvenu à acquérir les terres
nécessaires au lancement de son projet? Ce processus s'est-il
déroulé de facon démocratique? Comment les habitants
appréhendent -ils l'avenir? Et surtout quels bénéfices
peuvent-ils espérer de l'arrivée d'un tel projet? Tous les
villageois sont-ils égaux face au processus d'acquisition ? Étant
donnée la situation au niveau national, on peut supposer que
l'arrivée de Marg ne s'est pas déroulée sans heurts. Nous
verrons en quoi la structure sociale, pas toujours homogène sur toute la
zone, intervient dans le jeu des acteurs et les rapports de force liés
au processus d'acquisition, et comment le groupe Marg a su utiliser la
situation dans le cadre de sa stratégie. De ce fait, en quoi peut-on
dire que l'établissement du projet a pu bouleverser les rapports entre
villageois et entre communautés?
Pour réaliser cette étude, j'ai d'abord dü
me doter d'un cadre théorique, gr%oce aux recherches
réalisées à l'Institut francais de Pondichéry
et au Madras Institute of Development Studies, qui m'ont permis
d'avoir une vision globale du phénomène des ZES au Tamil Nadu et
ainsi de formuler mes premières hypothèses. J'ai ensuite pu me
lancer dans mon étude de terrain, d'abord sous l'angle du promoteur,
Marg, puis sous l'angle des populations en contact direct avec le projet
Swarnabhoomi. Les intéréts de chacun étant largement
divergeants, j'ai dü
prêter une attention toute particulière à
recueillir un maximum de points de vue. C'est dans cette logique que je me suis
ensuite intéressé à l'implication des politiques, de
l'échelle locale à l'échelle du Taluk puis du
District. Afin de compléter mon enquête, je me suis enfin
orienté vers le front militant, notamment le SPMEI (mouvement
anti-ZES opérant à l'échelle du Tamil Nadu) et le
CPI-M (parti communiste marxiste), ce qui m'a permis de confronter mon
étude de cas à un contexte plus large, et ainsi de confirmer mes
hypothèses.
Le dossier qui suit se compose de trois blocs:
- Une première partie pose le cadre du sujet par
l'exposé du processus qui a amené à l'émergence des
Zones Economiques Spéciales, et à leur contestation. Quels
avantages offrent-elles (cadre légal)? Quels enjeux accompagnent leur
mise en place? Quelle est la stratégie adoptée par le
gouvernement central, puis relayée par les gouvernements
régionaux ? Quelles en sont les limites?
- La deuxième partie vise à apporter les
élément s nécessaires à la compréhension du
contexte qui entoure la mise en place de Marg Swarnabhoomi. Localisation et
nouvelle réalité socio-économique, rappels historiques et
détails concernant le groupe Marg et le projet sont ici
développés.
- La troisième partie quant à elle est
entièrement consacrée à l'étude de terrain, et
à une rélexion approfondie sur les dynamiques à
l'Ïuvre à l'heure actuelle.
1ère partie - Zones Economiques Speciales: une
politique
qui divise
1.1 - Un modèle venu d'ailleurs
C'est à la suite d'une visite officielle dans l'Empire
du milieu que le ministre indien du commerce prit la décision, en l'an
2000, de se lancer dans la course aux investissements en adaptant la politique
des zones économiques spéciales à son propre pays. L'Inde
n'est pas la seule a avoir embo»té le pas du géant chinois,
et à l'heure actuelle près de 3000 projets sont en cours dans
plus d'une centaine de pays, parmi lesquels le Brésil, l'Iran, le
Pakistan, la Corée, les Emirats Arabes Unis, et plusieurs pay s issus de
l'ex URSS. Le modèle est transposé, tant bien que mal, et les
bénéfices sont aléatoires. Aussi peut-on se poser la
question de l'adaptabilité d'un modèle issu d'un régime
aux méthodes et aux moyens plutôt radicaux.
Lancée par Deng Xioping au tournant des années
80, la politique des ZES conna»t très vite un succès
remarquable. Shenzhen, aujourd'hui la plus puissante ZES du monde, a
transformé un petit village de pécheurs en une mégapole de
10 millions d'habitants en seulement une vingtaine d'années.
1.1.1 - Naissance d'un succès
Pour commencer, le gouvernement central lance en 1980 cinq vastes
zones économiques
1
spéciales, que sont Shenzhen , Zhuhai, Shantou, Xiamen
et Hainan. Si la Chine fait le choix d'expérimenter ses ZES dans ces
régions, c'est avant tout du fait de leurs avantages
géographiques. Shenzhen est accollée à Hong Kong, Zhuhai
à Macao, et Xiamen fait face à l'»le de Taiwan2.
Il s'agit donc là de lieux privilégiés d'investissement
pour les chinois d'outre-mer. Les raisons sont également politiques,
puisque Deng Xioping entend se livrer à une expérience pilote en
ouvrant une fenétre sur son pays, dans le but de frayer la voie à
une réforme plus profonde et à une ouverture plus large.
1 La ZES de Shenzhen représente 396 km2 à sa
création
2 Cf. Annexes / figure 1
Les ZES chinoises se veulent être des zones
synthétiques, combinant les secteurs de l'industrie, du commerce, de
l'agriculture, de l'élevage, de l'immobilier et du tourisme (c'est le
cas de l'»le de Hainan). Elles ont été créées
de façon à absorber des capitaux étrangers gr%oce à
l'application d'une polit ique de souplesse, visant à faciliter et
à accélérer les installations.
L'objectif principal de la création des ZES vise aussi
à importer des techniques et des méthodes de gestion d'avant
garde, à créer de l'emploi, et à obtenir d'avantage de
devises pour le compte de l'Etat.
Les ZES sont la vitrine de l'ouverture de la Chine sur
l'extérieur. Elles se présentent comme un terrain d'essai pour
greffer l'économie de marché sur le socialisme. Le but est
ensuite de répandre l'expérience, si toutefois elle fonctionne,
d'abord sur la côte, puis vers l'intérieur du pays. Elles sont le
point de départ d'un passage de l'économie planifiée
à l'économie de marché. Des 1984, 14 villes
côtières dont Shanghai, Canton et Tianjin sont ouvertes aux
investissements étrangers, sans pour autant acquérir le statut de
ZES. En 1988, les 5 ZES chinoises sont agrandies et l'»le et province de
Hainan est convertie dans sa totalité en ZES. Depuis, nombre de
capitales de provinces ont été ouvertes sur
l'extérieur.
Le fonctionnement des ZES chinoises repose sur plusieurs
ÇpilliersÈ :
- Des incitations fiscales spéciales pour les
investissements étrangers: Tant que l'entreprise ne fait pas de profit
elle ne paye pas de taxes, puis bénéficie d'allegements fiscaux
pendant une durée de cinq ans une fois la machine lancée.
- Une plus grande autonomie pour les activités
internationales
- La production doit être orientée en
priorité vers l'exportation
- Les activités économiques sont
déterminées par le marché
- Leur fonctionnement n'est pas régi par le gouvernement
central mais par les gouvernements provinciaux qui peuvent
légiférer par eux-même.
1.1.2 - Une croissance qui a un coat
Gr%oce au développement des ZES et au pari de l'ouverture,
la Chine est devenue cette année
2ême
la puissance économique mondiale, et le premier pays
exportateur, devant l'Allemagne.
Cependant, cette métamorphose spectaculaire,
opérée en seulement une vingtaine d'années, ne s'est pas
faite sans conséquences.
Les investisseurs étrangers ont été
attirés par les SEZ chinoises d'une part du fait du faible coüt des
terrains et des avantages précédemment détaillés,
mais aussi et surtout du fait d'une législation du travail et d'une
politique environnementale profondémment laxiste. En 2006,
l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement a désigné
Shenzhen comme étant un Ç hotspot mondialÈ de la crise
environnementale. En à peine treize années, de 1992 à
2005, vingt millions de paysans ont dü abandonner l'agriculture pour cause
de développement industriel, et 21% des terres arables ont vu leur
utilisation détournée en raison de l'explosion de l'urbanisation.
Les protestations contre l'acquisition forcée des terres arables sont
devenues monnaie courante, en particulier dans la province du Guangdong,
oü l'instabilité sociale est devenue un grave sujet de
préoccupation pour le gouvernement. Une partie de la classe
ouvrière employée dans des ateliers clandestins gagne à
peine 80 dollars par mois. L'émergence de la prostitution, de la
criminalité, sont les nouveaux symptômes d'une
génération d'ouvriers condamnés à l'esclavage.
Par ailleurs, les écarts de revenus sont devenus tels
qu'ils se rapprochent maintenant de ceux du Brésil3. Le
revenu moyen des citadins est ainsi plus de trois fois supérieur
à celui de leurs homologues ruraux. En raison des concessions massives
imposées à la Chine pour adhérer à l'OMC, la
tendance ne fait que se confirmer.
Il ne fait aucun doute que les exportations jouent un rôle
important dans la stimulation du PIB. Mais le prix à payer ne
risque-t-il pas d'être le même pour un pays tel que l'Inde?
1.2 - Des Export Processing Zones au SEZ act de 2005
Si la Chine fût la première à se lancer
dans le développement de ZES, l'Inde, dès 1965, fit
l'expérience des toutes premières zones franches d'exportation
asiatiques. Leur portée resta très limitée cependant, avec
une contribution aux exportations aux alentours de 5% en 2000.
La première pierre est posée en 1965, avec la
création de la zone de libre-échange Kandla dans l'état du
Gujarat, puis la mise en place de Santacruz electronics à Mumbai, et des
EPZ de Falta, Cochin, Chennai, Noida, et Visakhapatnam en 1980,
créées suite au choc pétrolier.
3 Selon le coefficient de Gini ou 0 signifie
légalité parfaite et 1 l'inégalité maximale, la
Chine obtient 0,5 en 2006, le Brésil 0,56, là oü l'inde
obtient seulement 0,3.
Le principe de fonctionnement de ces zones franches repose sur
toutes sortes d'avantages censés promouvoir les exportations. L'Etat met
donc en place une législation spécifique, avec notamment la mise
en place d'une exonération fiscale en ce qui concerne les
matiéres premières et les biens d'équipement, d'une
exonération des droits de douane et de l'impTMt aux
sociétés, d'une aide à la fourniture de produits de base.
L'alimentation en eau et en électricité est garantie sans
interruptions, et des infrastructures appropriées sont mises à
disposition.
A partir de 1991, l'Inde souhaite accélérer son
intégration dans l'économie-monde et lance un programme
d'ajustement structurel, appuyé par l'OMC, la banque mondiale et le FMI.
Il en résulte une simplification des dispositions administratives, des
incitations fiscales accrues, et l'intégration de nouvelles industries,
notamment agro-alimentaires.
Forcé de constater le manque d'efficacité des
EPZ, le nouveau gouvernement de coalition mis en place à partir de 2005
adopte une nouvelle politique, en théorie directement inspirée de
celle des ZES chinoises, mais différente dans sa pratique. Pourvues d'un
cadre réglementaire solide, et permettant l'attraction d'investissements
étrangers sans pour autant exiger la mise en oeuvre de réformes
impopulaires et sensibles en matiére de législation du travail,
les ZES indiennes voient le jour en 2005 avec le coup d'envoi donné par
l'adoption du Special Economic Zones Act . Le gouvernement entend
ainsi faire affluer les investissements privés dans l'infrastructure
industrielle, qui accuse des retards considérables. Le but est
d'opérer un basculement de l'économie, jusque-là
essentiellement axée sur le secteur primaire. Dans le même temps,
c'est un moyen pour le gouvernement de se désengager et de laisser le
secteur privé le remplacer dans son rTMle de fournisseur de services aux
citoyens. La loi sur les ZES vise ainsi à créer un nouveau
systeme de gouvernance, un nouvel ordre économique, politique et
géographique, détaché des droits constitutionnels, et des
méchanismes parlementaires et juridiques.
La loi sur les ZES entre en application en février
2006, et alors même qu'elle s'apprête à affecter des
millions de vies, aucun report dans les médias n'est observé. Il
faut dire qu'aucun débat public ou parlementaire n'a eu lieu avant son
adoption.
Les objectifs tels que décrits dans le SEZ Act
sont les suivants :
- Générer de nouvelles activités
économiques,
- Promouvoir les exportations de biens et services
- Promouvoir l'investissement étranger et domestique
- Créer de l'emploi
- Développer de nouvelles infrastructures
- Maintenir la souveraineté et l'intégrité
de l'Inde, la sécurité de l'Etat et les bonnes relations avec les
Etats étrangers.
Pour ce faire, le gouvernement reconduit les principes
édictés pour le développement de ses EPZ, avec des
exonérations fiscales de 100% pour la production destinée
à l'exportation au cours des cinq premières années
d'exploitation, puis réduites à 50% les cinq années
suivantes, une suppression des droits de douane, des taxes indirectes et des
impTMts sur les bénéfices. Mais désormais, l'Etat n'est
plus l'initiateur de ces nouvelles ZES. Ce sont des agences parapubliques ou
des promoteurs entiérement privés qui vont se charger de les
développer. Les promoteurs restent de fait propriétaires de ces
enclaves, et découpent leur terrain en lots qu'ils vont ensuite proposer
à la location à des entreprises. Par ailleurs, la loi
prévoit autour de ces ZES la possibilité pour les promoteurs de
développer, en plus de l'aire de production, une zone plus large pouvant
contenir commerces, logements, structures de loisirs et hotelliéres,
autorisant ainsi la construction de villes privées.
Comme on l'a vu, les ZES s'accompagnent de la création
d'un nouveau systeme de régulation, totalement séparé des
mécanismes institutionels existants. En déclarant chaque nouvelle
SEZ d'intérêt public, les gouvernements fédéraux
déléguent le pouvoir décisionnel jusque-là
détenu par le Commissaire au Travail vers le Commissaire au
Développement, notamment pour ce qui concerne la question de la
législation du travail et des salaires minimums, du régime
d'assurance, etc. Les fonctions policiéres et judicières sont
elles aussi altérées, puisqu'en vertu de la loi, « aucune
enquête, perquisition ou saisie ne pourra être effectuée
dans une ZES par un organisme ou un dirigeant, sauf avec la permission du
commissaire au développement4 » . La loi prévoit
aussi que des tribunaux spéciaux doivent être mis en place pour
tra»ter spécifiquement des litiges dans les ZES 5
civils .
Les ZES sont par ailleurs extraites de la juridiction des
panchayats et organismes municipaux élus dans de nombreux états,
du fait de leur classement en tant que « cantons industriels »,
assurant ainsi l'effacement des institutions locales de gouvernance
démocratique dans les ZES. Par ailleurs, il est important de noter que
toute ZES se doit d'être cloturée et sécurisée, et
que seules les personnes autorisées ont droit d'accés à la
zone6.
4
Section 22, SEZ Act 2005
5
Section 23, SEZ Act 2005
6 Article 11, section 2, SEZ Act 2005
1.3 - Les limites d'une politique mal
contrôlée
1.3.1 - Profil des ZES indiennes
La politique des ZES met en avant la nouvelle direction prise par
le gouvernement en matière d'ouverture et d'expansion économique,
et provoque très vite l'intérêt des investisseurs.
Ë ce jour, plus de 700 projets ont été
déposés auprès du gouvernement central à New Delhi,
parmi lesquels:
- 105 sont fonctionnels,
- 348 sont Çnotifiés È, c'est-à-dire
qu'ils ont recu toutes les autorisations nécessaires au démarrage
de leur activité,
- 573 ont recu une approbation Çformelle È,
c'est -à-dire que les promoteurs du projet ont déjà acquis
tous les terrains nécessaires, mais qu'ils sont encore dans l'attente
des dernières autorisations
- 147 ont recu une approbation de Ç principe È,
c'est-à-dire que les promoteurs sont encore en phase d'étude
Un nombre important de ZES sont développées dans
le domaine des technologies de l'information, puisqu'en Decembre 2008, 181 ZES
notifiées sont issues de ce secteur, ce qui représente 66% du
total. Cette prédominance s'explique sans doute par le fait que les ZES
de ce secteur sont peu gourmandes en espace comparativement aux ZES
multi-produits par exemple, qui représentent seulement 9% du total des
ZES notifiées.
Au niveau de la répartition régionale, en 2008,
on remarque que trois Etats émergent très distinctement en
matière de développement de ZES. L'Andhra Pradesh est l'Etat qui
compte le plus de ZES sur son sol avec 57 zones notifiées, suivi du
Tamil Nadu avec 44 zones notifiées, et du Maharashtra avec 43 zones
notifiées. Ces trois Etats comptent à eux seuls près de la
moitié du total des ZES du pays.
Par ailleurs, il convient de souligner le rTMle
prépondérant joué par les métropoles d'Hyderabad et
de Chennai, qui concentrent respectivement 48 des 99 ZES notifiées en
Andhra Pradesh, et 34 des 66 ZES notifiées au Tamil Nadu.
On ne peut en outre que constater l'inégale
répartition des ZES sur le territoire national, ainsi
qu'au niveau
régional. En effet, la loi sur les ZES ne prévoit aucune
restriction en matière
d'implantation, et les entreprises, par conséquent,
choisissent naturellement de s'installer à proximité des points
chauds du pays, profitant ainsi de meilleures infrastructures et de
débouchés plus faciles. Dans un tel contexte, il est
évident que l'aggravation d'inégalités régionales
déjà profondes ne fait que se confirmer.
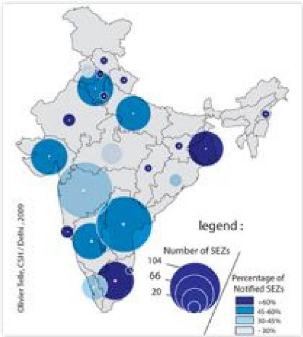
Carte n°1
Une différence majeure oppose en outre les ZES indiennes
et chinoises : la taille. En effet, la Chine s'est concentrée sur la
mise en place de zones très vastes, incluant des régions
entières, alors que l'Inde de son côté mise sur la
création d'une multitude de petites zones, dont la majorité
n'excèdent pas la cinquantaine d'hectares. Cependant, l'Inde compte 53
ZES multiproduits ayant une approbation Ç en principe È en 2008.
Hors, ces zones recquièrent de très larges zones de terres pour
leur installation et sont aujourd'hui au cÏur des débats.
Récemment, le quota qui limitait la surface maximale des ZES à
5.000 hectares a été levé., et le groupe indien Adani
spécialisé dans la distribution de gaz naturel a recu la
permission de s'établir à Mundra dans l'Etat du Gujarat sur trois
ZES qui ensemble représentent un total de 9.500 hectares. Avant 2008, le
total des ZES notifiées représentait une surface de 30.122
hectares. Mais les ZES multi-produits, une fois notifiées,
couvriront une surface totale de 122.000 hectares, avec une moyenne de 869
hectares par ZES. Le Gujarat a ainsi clairement fait le choix du
développement prioritaire des zones de grande ampleur, contrairement au
reste du pays qui donne la priorité aux petites structures, de type IT
park.
|
Les 10 plus grandes ZES multi-produits de la
catégorie Ç en principeÈ
|
Surface (ha)
|
|
DLF Universal, Gurgaon, Haryana
|
8,097
|
|
Omaxe Ltd., Alwar District, Rajasthan
|
6,070
|
|
D.S. Constructions Ltd., Palwal, Haryana
|
5,000
|
|
Skil Infrastructure Ltd., Nandagudi Hobli, Karnataka
|
5,000
|
|
Reliance Haryana SEZ Ltd., Jhajjar District, Haryana
|
5,000
|
|
New Kolkata International Development, Medinipur, West Bengal
|
5,000
|
|
Writers and Publishers Ltd., Indore, Madhya Pradesh
|
4,050
|
|
Suncity Haryana SEZ Developer Private Limited, Ambala, Haryana
|
3,237
|
|
Skil Infrastructure Limited, Himachal Pradesh, Airport based
|
3,230
|
|
Rewas Ports Ltd., Rewas, District Raigarh, Maharashtra
|
2,850
|
Source: Ministry of Commerce and Industry, Government
ofIndia,janvier 2008 (
http://sezindia.nic.in).
Tableau n°1
1.3.2 - La question de l'acquisition forcee des terres
L'originalité de l'Inde dans sa facon de concevoir les
ZES repose sur le fait que la taille, l'emplacement et la nature de la zone est
non pas déterminée par l'Etat comme dans la majorité des
pays, mais par le capital privé souhaitant s'y installer. En outre, la
seule condition pour les promoteurs repose sur l'acquisition au
préalable d'une surface adéquate au projet .
Malgré la ligne de conduite émanant du
Ministère du Commerce qui interdit l'acquisition forcée de
terrains à des fins économiques, la majorité des Etats
continuent à utiliser le Land Acquisition Act de 1894
dans le but d'établir des ZES. Dans des Etats comme l'Andhra Pradesh et
le Tamil Nadu, les gouvernements vont jusqu'à utiliser la clause
d'urgence de cette loi, de facon à acquérir des terrains au nom
de l' Ç intérét général È. De cette
façon les Etats parviennent à se constituer des réserves
de terres, qu'ils peuvent ensuite mettre à la disposition des
développeurs privés. Dans certains cas, les Etats n'interviennent
pas
directement dans le processus d'acquisition mais viennent en
aide aux sociétés privées en leur
apportant un soutien
plus stratégique (Kennedy, 2010), notamment en déployant des
forces
7
militaires ou po licières de facon à faire
céder les plus récalcitrants , ou plus simplement en s'assurant
que la presse ne vienne pas les déranger. Peu à peu une
véritable compétition émerge entre les Etats les plus
industrialisés, désireux d'attirer un maximum de capitaux sur
leurs terres.
Dans la majorité des cas, les acquéreurs
promettent monts et merveilles aux agriculteurs, en matière d'emploi par
exemple. Dans la réalité cependant, étant donné les
lacunes en matière d'éducation dans les zones rurales, les
possibilités de reconversion se révèlent quasi-nulles, et
les emplois créés dans le cadre des nouvelles ZES attirent
surtout les jeunes venus des villes, mieux formés. On considère
que pour trois emplois non-qualifiés détruits,
l'établissement d'une ZES crée seulement un emploi,
qualifié.
Par ailleurs, presque 80% de la population agricole en Inde
possède seulement 17% des terres cultivables, ce qui signifie qu'une
grande partie des paysans peut être considérée
<<sansterres È. De nombreuses familles voire même des
communautés entières dépendent de l'exploitation d'un
lopin de terre qui bien souvent ne leur appartient pas. Et même dans le
cas de propriétaires, il n'est pas rare que les titres de
propriété soient inexistants, du fait d'un droit coutumier et
ancestral sur la terre. Cependant, lors du processus d'acquisition, les
compensations sont reversées uniquement aux possesseurs d'un titre de
propriété. Aucune compensation n'a été
prévue pour ceux qui en sont dépourvus.
Dans des Etats comme le Gujarat, une large part des terres
converties en ZES sont classées dans la catégorie
<<wasteland È, c'est-à-dire qu'il s'agit de friches ou de
terres <<communes È. Ces terres, arides, sont situées pour
la plupart sur la côte, et sont utilisées par les
communautés de pêcheurs, entre autres, pour leur subsistance.
Étant donné leur statut, ces terres n'appartiennent à
personne et sont transférées au domaine industriel sans aucune
consultation auprès des communautés locales ou des panchayats. On
trouve aussi de nombreux exemples de terrains appartenant au domaine public et
transférés au domaine privé au Tamil Nadu et en Andhra
Pradesh, notamment des terrains religieux.
On considère que les acquisitions les plus sensibles ont
eu lieu en Andhra Pradesh, qui
possède le plus grand nombre de ZES
notifiées sur son sol, et oü des terres autrefois
attribuées
7 Comme ce fIt le cas à Nandigram dans le Bengale
occidental, en mars 2007, oü la police s'est interposée entre les
promoteurs et les paysans refusant de céder leurs terres. Bilan: 14
personnes tuées.
aux Dalits et aux Scheduled Tribes ont été
cédées à des investisseurs privés, à
Polepally, Kakinada ou Chittoor par exemple. Ces actions vont à
l'encontre même de la constitution indienne, et de l'artice 21 de la
Constitution and special rights to Scheduled Tribes and Castes, qui
garantit des droits sur la terre à cette partie de la population.
1.3.3 - Une économie rurale en péril, des
conditions de travail négligées
Les récents déplacements de populations issues
du domaine agricole et de la pêche conduisent aujourd'hui certaines
régions à se poser des questions quant à la hausse de
l'insécurité alimentaire. Une majorité des terres acquises
pour le développement de futures ZES sont en effet hautement fertiles en
particulier dans le cas des zones multi-produits, les plus larges. Les
scientifiques estiment que 82.000 familles de travailleurs agricoles
dépendant de la terre pour leur subsistance vont surement être
déplacées à cause des projets qui ont été
adoptés jusqu'à ce jour. On estime que la perte de revenus totale
annuelle pour toutes ces familles est proche des 35 millions d'euros (Bhaskar
Goswami 2006). On doit ajouter à cela la destruction de nombreux emplois
indirectement liés à l'agriculture dans l'artisanat, le commerce
et la petite industrie.
La pêche est menacée du fait d'une privation
croissante de l'accès à la mer à cause du
développement de projets de ZES portuaires, au Gujarat, au Maharashtra,
en Andhra Pradesh et au Tamil Nadu.
Par ailleurs les rudes conditions de travail dans les ZES
indiennes comme chinoises est une réalité aujourd'hui reconnue.
Le Commissaire au Développement, en déclarant les ZES comme
étant un Çservice d'utilité publique È, suspend
ainsi le droit de grève et le droit d'association. Aucune protestation
n'est possible de la part des travailleurs dans les ZES. Dans certains Etats
comme le Maharashtra, du fait de sa toute puissance, le Commissaire au
Développement peut même refuser une inspection de la Direction de
la Sécurité Industrielle et de la Santé. En Andra Pradesh,
le salaire minimum a été récemment revu à la
baisse, et le travail y est maintenant possible 365 jours par an, et 24h par
jour, moyennant une prime pour les heures supplémentaires.
Le Ministère des Finances a récemment conduit une
étude, et estime que les pertes cumulées
dues aux
réductions fiscales offertes en cinq ans dans le cadre de la politique
des ZES
sÕelevent à plus de trois milliards dÕeuros,
ce qui represente 6 à 7% des recettes annuelles du pays en 2006.
Le refus systématique de la vente de terres fertiles dans
lÕEtat de Goa a récemment
conduit le
gouvernement à stopper le processus de creation des
ZES, et à dénotifier la totalité des projets supposes
sÕy établir. Dans un tel contexte, et notamment à la suite
des incidents de Nandigram en 2007, le gouvernement central réagit et
apporte quelques corrections à sa politique en matiére de ZES. En
juin 2007, le Ministére du Commerce interdit explicitement
lÕacquisition forcée de terrains dans un but privé, et
interdit egalement lÕacquisition de terres arables. Les gouvernements
provinciaux sont priés de ne plus venir en aide aux promoteurs.
Cependant, la machine étant déjà
lancée à pleine vitesse et les considerations sociales et
environnementales nÕétant pas une priorité, les
repercussions de ces corrections se font toujours attendre.
1.4 - Le cas particulier du Tamil Nadu
En 2005, le Tamil Nadu se lance de plain-pied dans la nouvelle
politique adoptée par le gouvernement central en adoptant le Tamil
Nadu Special Economic Zones Act, et entend ainsi prendre de
lÕavance sur les Etats concurrents en vue de devenir à terme le
veritable hub manufacturier du pays. Usant du Tamil Nadu Acquisition of
Land for Industrial Purposes Act de 1999, le gouvernement du Tamil Nadu
decide à partir de cette période de promouvoir la creation
dÕune banque de terrains via ses agences para-publiques que sont la
SIPCOT 8et la TIDCO, dans le but de faciliter et
dÕaccélérer lÕimplantation des industries, et plus
tard, des ZES. La durée du processus dÕacquisition passe ainsi de
trois ans à seulement six mois (Vijayabaskar 2010). En plus d'être
plus agressif que le Land Acquisition Act dans la mesure oil il ne
laisse pas de place à la dissidence, le TNALIPA manque
cruellement de precision quant aux termes utilisés. Aussi il ne
définit pas précisément la notion dÕ Ç
intérêt public È. Pourtant, cÕest en son nom que le
Tamil Nadu peut se permettre dÕacquérir tous types de terrains et
notamment les terres arables et les « dry lands È. La notion
même de compensation nÕest pas abordée dans la loi. Le flou
est de rigueur, et les individus ayant perdu leurs terres ont seulement droit
à un Ç montant déterminé par le District
Collector È, equivalent du préfet
8
State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu
et Tamil Nadu Industrial Development Corporation
en France, et qui avec lÕadoption du Tamil Nadu SEZ
Act se voit investi de la delicate mission de fixer les prix et
dÕorganiser les discussions entre acheteurs et acquéreurs. La
négociation sur la compensation monétaire devient le seul recours
pour les propriétaires dépossédés, qui sont
privés de leur recours legal via les circuits traditionnels de la
justice.
La SIPCOT et la TIDCO visent à accumuler une banque de
terrains de 8000 hectares chacune sur cinq ans. La plupart des ZES du Tamil
Nadu vont par la suite etre implantées sur ces terres, acquises
graduellement à partir de la fin des années 90.
Pour autant, aussi étrangement que cela puisse
para»tre, on observe une relative absence de resistance face au processus
de creation des ZES au Tamil Nadu. Plusieurs raisons expliquent ce fait
surprenant, et méritent que lÕon sÕy penche de plus
pres.
1.4.1 - Un rapport à la terre de plus en plus
distant
Le Tamil Nadu, on lÕa vu, se trouve actuellement dans
le trio de tete dans la course aux investissements avec à lÕheure
actuelle pas moins de 50 ZES notifiées sur son sol. Il fut par ailleurs
lÕinitiateur de la toute première ZES opérationnelle du
pays avec lÕimplantation de la fameuse Mahindra World City, au
sud de Chennai. Dès le milieu des années 90, il devient
lÕun des Etats indiens les plus dynamiques sur le plan
économique, avec une croissance annuelle moyenne avoisinant les 7%. En
lÕan 2000, il devient le deuxieme Etat le plus industrialise en terme de
valeur derrière le Maharashtra, et le premier en terme dÕactifs
avec un taux de 21,1% (Ramaswamy 2007). Il est également lÕEtat
le plus urbanise avec un taux dÕurbanisation de 44% (Census of India
2001) et bénéficie dÕune repartition urbaine
particulierement homogène en comparaison des Etats voisins. Pour
completer le tableau, on peut noter également un très fort taux
dÕactivité chez les hommes comme chez les femmes, en ville comme
à la campagne, un excellent niveau dÕéducation ainsi
quÕun rapide déclin de la fertilité, qui ont fait du Tamil
Nadu le troisieme Etat indien le mieux note en terme dÕIDH (Govt of
India, 2003).
Dans le même temps, on constate depuis maintenant deux
décennies une relative stagnation, voire même une crise du secteur
primaire. En effet, entre 1993 et 2005, la part du revenu agricole dans le PIB
du Tamil Nadu a chute de 24,82% à seulement 13,3%. En 2003, le revenu
moyen issu de lÕexploitation pour une famille dÕagriculteurs
(138€) est inférieur aux dépenses nécessaires
à la mise en culture (150€) (Narayanamoorthy 2006). Par consequent
le
taux d'endettement de ces familles explose, et 70% d'entre
elles sont touchées par le phénomène. Les suicides se
multiplient, et l'agriculture est désormais percue comme un
véritable fardeau.
En réaction à ce phénomène, une
part importante des ruraux choisissent de changer d'activité. On assiste
alors à une intensification des migrations journalières ou
saisonnières vers les bourgs ou les grandes villes, facilitées
par l'urbanisation diffuse du Tamil Nadu, oü la ville n'est jamais
très loin des champs. C'est l'émergence de cette nouvelle
mobilité qui a permis le développement de nombreux Ç
clusters È indu striels à travers tout le Tamil Nadu, avec une
production largement tournée vers le textile et la tannerie,
l'ameublement, ou l'agro - alimentaire. La culture du riz, de l'arachide ou de
la canne à sucre est alors abandonnée au profit des plantations
de cocotiers, de manguiers ou d'anacardiers, qui nécessitent moins de
main d'Ïuvre et surtout moins de temps pour leur entretien.
S `ajoute à cela un profond exode des jeunes vers les
grandes agglomérations et les emplois plus qualifiés. En effet,
du fait d'une forte volonté d'intégration des castes les plus
basses, menée principalement par l'Anti Caste Dravidian
Movement, on observe une importante mobilité verticale dans
l'espace rural tamoul. La politique de réservation de places dans
l'enseignement supérieur pour les Backward casts et les
Dalits sur une longue période a fait du Tamil Nadu l'Etat le
mieux noté en terme d'accès à l'éducation pour ce
type de population, juste derrière Delhi.
1.4.2 - Une habile strategie gouvernementale
Contrairement à d'autres Etats où l'on a souvent
pu observer une résistance de grande ampleur face aux projets
d'implantation de ZES, on constate que le Tamil Nadu n'a connu que de petits
mouvements sporadiques, individuels, et oü il était plus souvent
question de négocier une meilleure compensation que de refuser la vente.
Comme on l'a vu, la crise du secteur primaire, la forte mobilité sociale
et la hausse des débouchés dans le secteur secondaire
appuyée par un urbanisme diffus expliquent en partie cette
volonté d'abandon de la terre. Mais d'autres réalités ont
participé au fait qu'au Tamil Nadu, on ne résiste pas face
à l'avancée des promoteurs.
Depuis plus d'une décennie maintenant, le gouvernement
du Tamil Nadu a mené une politique de souplesse, visant à
étouffer dans l'Ïuf la moindre protestation, en mettant tout en
Ïuvre pour empêcher le développement de mouvements
organisés.
Un premier élément de cette stratégie
repose sur une acquisition graduelle des terres, depuis la fin des
années 90. Donc contrairement à d'autres Etats qui ont connu de
brusques transactions, et portant parfois sur plusieurs villages en même
temps, le Tamil Nadu a préféré jouer la carte de guerre
d'usure, et de la négociation. Les parcelles sont acquises au
goutte-à- goutte, comme on le verra dans le cas de Swarnabhoomi.
Par ailleurs, le Tamil Nadu est l'un des premiers Etats
à réagir face à la montée de la contestation au
niveau national contre les ZES, et procede à quelques ajustements dans
sa politique des 2007. A l'issue de cette correction, et dans le but de
faciliter l'intégration des ZES dans l'économie locale, l'Etat
stipule que désormais un minimum de 10% des terres acquises dans le
cadre de l'établissement d'une ZES doit être consacré au
développement de nouvelles infrastructures sociales. Une partie des
terres doit également être attribuée aux petits
commercants.
Compte tenu de la forte concentration de ZES dans les environs
immédiats de Chennai, le gouvernement propose désormais des
incitations fiscales accrues pour les entreprises souhaitant s'installer dans
les régions les plus reculées.
Dans le même temps, l'Etat se désengage
partiellement de ses responsabilités en laissant les promoteurs
privés gérer seuls les acquisitions. De plus, et dans la mesure
du possible, les transactions doivent désormais concerner en
priorité les terres non irriguées, les terres arides et
stériles. Le gouvernement promet de s'opposer aux projets incluant plus
de 10% de terres cultivables (Vijayabaskar 2010).
En 2009, le gouvernement promet également de faire des
efforts en s'assurant qu'au moins une personne par foyer ayant
cédé au moins 4000m2 de terres à des promoteurs se voit
attribuer un emploi.
Enfin, l'émergence de l'utilisation de leaders
informels, locaux, issus de partis politiques ou simplement chefs de village
comme intermédiaires dans le processus de négociation permet
souvent d'apaiser les esprits, et facilite les transactions. Ces
intermédiaires montrent souvent l'exemple, lorsqu'ils possedent des
terrains, en étant les premiers à vendre.
Cependant, les efforts consentis par les politiques au cours
des dernières années en vue de rendre le
développement des ZES plus équitable attendent toujours d'entrer
en application sur le terrain. En effet, étant donné la mauvaise
conjoncture économique internationale actuelle, le social n'est pas une
priorité, et il para»t important de ne pas froisser les
investisseurs. C'est dans ce contexte qu'on assiste finalement à
l'émergence de quelques fronts collectifs, tels que le SPMEI (Sirapu
Porulaathara Mandalam Ethirpu Iyyakam), basé à Chennai, et qui
vise à coordonner la création de petits groupes de
résistance à travers tout le Tamil Nadu, formés pour
lutter contre les acquisitions forcées de terrains. Sans cet
accompagnement, la contestation a beaucoup de mal à s'organiser. Le
poids du système de castes, particulièrement lourd au Tamil Nadu
comme a pu me le faire comprendre Madhumita Datta; l'une des co - fondatrices
du SPMEI avec qui j'ai pu avoir une longue discussion ; se traduit trop souvent
en fatalisme, chacun acceptant sa condition, pour le meilleur, mais surtout
pour le pire.
2eme partie - Aux sources du projet Swarnabhoomi
Afin de comprendre les raisons d'être du projet
Swarnabhoomi, il convient de revenir sur les dynamiques urbaines et
économiques récentes de la ville de Chennai, puisque le projet a
été voulu dans le but de répondre à une demande,
incontestablement liée à un nouveau contexte metropolitain.
2.1 - Chennai et son contexte metropolitain
Chennai, anciennement Madras, capitale de lÕEtat
fédéral du Tamil Nadu, est aujourdÕhui la
4eme 9
ville du pays avec ses 9 millions dÕhabitants ,
derrière les megapoles que sont Delhi, Bombay, et Calcutta.
Malgré un contexte indien oil le processus dÕurbanisation se fait
à petits pas, Chennai attire , et sÕinsére
aujourdÕhui pleinement dans une réalité globale.
Située à quelques heures seulement de Bangalore, cinquieme ville
du pays et centre majeur de la production et de la recherche en informatique et
technologies de pointe, Chennai, elle aussi, a fait le choix de la
spécialisation. Elle est aujourdÕhui à la tete de
lÕEtat le plus urbanisé et le plus industrialisé du pays,
et contribue à hauteur de 30% de la production automobile indienne.
Ville portuaire, elle reste egalement trés competitive dans le domaine
du textile qui a fait sa richesse au cours des siécles
précédents, et contribue à la moitié des
exportations nationales de cuir en 2008. Depuis les années 80 et surtout
9010 et lÕémergence de politiques incitatives, on
observe le développement de corridors industriels le long de grands axes
routiers et autoroutiers, principalement à lÕouest et au sud,
avec lÕémergence notamment dÕun IT corridor, probablement
lÕune des plus grosses concentration sud asiatiques en matiére de
recherche et développement dans le secteur des technologies de
lÕinformation et de la communication. De trés nombreux
frabricants informatiques ou éditeurs de logiciels y ont élu
domicile, comme par exemple Hewlett Packard, Dell ou IBM, pour ne citer que les
plus célébres, si bien que ce secteur représente 11,5% des
revenus de la métropole en 2007 (Ramesh, 2007).
9
Estimation e'tant donne que le dernier recensement date de
2001
10 Et lÕouverture economique du pays initiee en 1991
Cette concentration post-libérale sur le modele
nord-américain des edge-cities, qui fait suite à un
processus de développement urbain déjà complexe au vu de
la polynuclé arité de l'agglomération, essentiellement due
aux gonflements successifs de bourgs ruraux qui peu à peu ont
fusionné, a conduit à l'appartition d'une bipolarité au
sein de la région métropolitaine de Chennai. Graduellement, on
passe ainsi d'une partie nord consacrée aux industries lourdes et
polluantes, à une partie ouest consacrée principalement à
l'assemblage (avec par exemple l'installation ces dernieres années de
centres de production dans les secteur de la téléphonie et de
l'électronique, par de grandes firmes multinationales telles que Nokia,
Siemens, Motorola ou Sony-Ericsson), et à une partie sud, plus moderne,
et tournée vers les industries de pointe, l'enseignement
supérieur et la recherche. Le haut niveau d'éducation,
l'émergence récente de nombreuses ZES qui attirent les flux de
capitaux étrangers, le développement d'infrastructures
adaptées et l'avenement du transport individuel, participent à la
tertiarisation de la periphérie sud de Chennai, qui n'en finit plus de
s'étendre, toujours plus loin le long de l'autoroute NH45, de la Old
Mahabalipuram Road (OMR), et de l'East Coast Road (ECR). Les
anciennes activités, dans le secteur primaire pour l'essentiel,
disparaissent, et cedent la place à des quartiers créés de
toutes pieces, à des gated commu nities, et à des villes
nouvelles, rivalisant tant par leur ampleur que par la qualité des
équipements qu'elles proposent. Les grues sont partout, le béton
coule à flot, et le visage de l'Inde de demain prend forme, à
l'image de la Chine au cours de la derniere décennie. Tant et si bien
que pour se rendre du centre-ville à la pointe sud de
l'agglomération, on doit désormais parcourir plus d'une trentaine
de kilometres. Cette coulée vers le sud prend également sa source
dans la flambée des prix de l'immmobilier dans la partie centrale de
Chennai, qui rivalisent parfois avec ceux des grandes villes
européennes11. La proximité de l'aéroport
international a évidemment participé à attirer une
population riche et mobile.
Le projet Swarnabhoomi, sur lequel je reviendrai plus en
détail dans une deuxieme partie, s'inscrit pleinement dans cette logique
de fuite vers le sud,
et se trouve de fait directement lié aux dynamiques
métropolitaines de la ville de Chennai. De plus, à l'issue d'un
entretien avec le Chief Planner du CMDA (Chennai Metropolitan
Development Authority), j'ai appris que l'ECR, qui relie Chennai
à Swarnabhoomi et à Pondichéry, a été prise
pour cible dans le cadre du développement d'un corridor touristique, qui
devrait profondément influer sur l'attrait de
11
Quartier de Nungambakam notamment
la zone au cours des prochaines annees. Pour faciliter cette
transformation, lÕECR devrait etre elargie tres prochainement à
2x2 voies, ce qui devrait permettre une acceleration des flux.
2.2 - Le point sur la question des Reddyars
Un petit detour par lÕhistoire me para»t
essentiel, puisque comme on le verra par la suite à travers la
presentation du groupe Marg et de mon travail de terrain, le rTMle joue par
cette communauté dans le cadre du projet Swarnabhoomi est predominant,
et sans quelques explications il me para»t impossible de comprendre les
processus en Ïuvre à lÕheure actuelle.
2.2.1 - Les origines
Majoritairement présente en Andhra Pradesh oil elle
représente de 11 à 15% de la population, et dans une moindre
mesure dans les états voisins du Maharashtra, du Karnataka, et du Tamil
Nadu, la caste dite des Ç Reddys È est considérée
comme dominante dans le domaine politique et socio-économique.
CÕest la caste des grands propriétaires terriens et des hommes
dÕaffaires.
Sous la domination britannique, le terme de Reddy était
utilisé communément pour designer les chefs de villages, souvent
confondus avec les Ç Kapus È, terme qui signifie Ç
protecteurs È en Telugu, langue officielle de lÕAndhra
Pradesh12. Le rTMle du Reddy consiste à collecter les taxes,
à assumer la protection la stabilité la subsitance
13
du village, à en assurer et . Il joue
egalement le rTMle dÕintermédiaire entre les
villageois et le monde extérieur, et notamment le gouvernement. Le terme
de Reddy recouvre historiquement dÕautres réalités,
puisque nombre de soldats au service de ces chefs de villages, petit à
petit, vont se retrouver incorporés à la communauté Reddy,
par recompense aux services rendus. On peut supposer lÕexistence
dÕun processus dÕanoblissement tel quÕon a pu le
conna»tre dans nos sociétés occidentales.
LÕorigine de la communauté Reddy remonte
à 200 ans av-JC, avec les rois Rathis et Maha rathis. Ces royaumes
étaient originellement constitués de petites principautés,
disséminées à travers le Maharashtra, le Karnataka et
lÕAndhra Pradesh, et ce bien avant lÕémergence des Mauryas
ou des Satavahanas dans la region. La récente découverte de
pièces de monnaies
12
Et plus generalement langue de communication privilegiee entre
Reddyars
13
Cf. Edgar Thurston dans son énorme ouvrage Castes and
tribes of Southern India
dans le nord de lÕAndhra Pradesh, et pros de la ville
de Pune témoignent de cette presence. Le mot Ç rathi » fait
reference à Ç ratha È qui signifie Ç celui qui
conduit un char È, ce qui nous permet dÕétablir là
encore un lien entre la communauté Reddy et le monde guerrier. Pendant
les siecles qui ont suivi, les Rathis ont perduré, mais sans que
lÕon puisse parler encore véritablement de caste, puisque la
structure tribale, largement majoritaire, a mis beaucoup de temps à se
dissoudre, malgré lÕarrivée du bouddhisme. TantTMt
guerriers, tantTMt agriculteurs, les Reddys se mêlent aux dynasties
successives, tout en restant discrets.
La tradition orale nous rend compte de lÕimportance de
la communauté Reddy, puisquÕil semblerait que leurs ancetres,
peut-être originaires du nord de lÕInde comme tendent à le
prouver certaines analyses génétiques, furent les premiers
praticiens de lÕagriculture et de lÕélevage. Si tel est le
cas, il para»trait evident quÕautour de ces premières fermes
se soient constitués rapidement des villages, avec évidemment
à leur tote, les ancetres des Reddys. Le terme actuel de Reddy
réfere dÕailleurs au mot telugu « Redu », qui signifie
la terre ferme. La première trace dÕutilisation du terme de Reddy
remonte à des inscriptions datant de lÕépoque Chola Renati
(7eme siècle de notre ere).
2.2.2 - La maturation
LÕhistorien et chercheur B.N.Shastry dans son ouvrage
Ç Reddy Sarwaswam Rajya È fixe les fondations de la
communauté moderne des Reddys aux Xieme et XIIemes siecles. Apres la
mort de Musunuri Kaapaya Nayaka, les Reddys, qui en tant que commandants de
lÕarmée ont collaboré avec Musunuri afin de garder les
musulmans à distance, retournent à la terre et créent leur
propre royaume. CÕest ainsi que les premières dynasties Reddy
voient le jour, entre 1353 et 1448 sur les cTMtes de lÕAndhra Pradesh,
avec entre autres les royaumes de Kondaveedu et Rajahmundry. Malgré les
guerres incessantes et la fragilité de ces royaumes, les Reddys laissent
derrière eux de nombreux forts, barrages et reservoirs, toujours
utilisés de nos jours.
Ils appararaissent également comme prédominants
dans lÕémergence des beaux-arts et de la littérature en
langue telugu, oil ils excellent dans lÕart de la poésie. Mais il
convient surtout de retenir de cette période lÕenrichissement
considerable de la communauté, et son appropriation massive de terres
dans tout le sud de lÕInde.
Aussi, du fait dÕune longue tradition de chefs de
villages et dÕune certaine force militaire et
aristocratique
residuelle, les Reddys conservent aujourdÕhui leur rTMle politique et
continuent à
etre tres actifs au niveau local, étatique et national,
et en particulier dans lÕAndhra Pradesh, oi un certain
nombre dÕanciens ministres et patrons de grandes entreprises
appartiennent à cette communauté. Les Reddys ont joué par
ailleurs un rTMle important dans le développement économique et
social de LÕEtat, et représentent lÕune des
premières communautés hors brahamanes à participer
activement à la nouvelle démocratie. Ils ont occupé
jusquÕà 40% des sieges de lÕassemblée legislative
en Andhra Pradesh. Cependant, les réformes entreprises à partir
de 1969 sous lÕimpulsion dÕIndira Gandhi et visant à
favoriser les basses castes affectent les riches propriétaires, qui
émigrent alors en masse vers les Etats-Unis. Nombre dÕentre eux
travaillent dans les domaines des technologies de lÕinformation, et de
la médecine. La communauté 2 ème
Andhr a a dÕailleurs été classée
récemment comme étant la plus riche aux
Etats-Unis parmi les communautés minoritaires. De ce
fait et étant donné le décollage économique recent
de lÕInde, les Reddys de lÕétranger tendent à
investir de plus en plus massivement dans leur pays dÕorigine, dans le
domaine de lÕéducation, de la sante, et des hautes
technologies.
En Inde, le statut de Reddy ayant perdu une part de son
prestige passé, nombre dÕentre eux quittent les campagnes pour
les grands centres urbains, tout en conservant des terres, exploitées
par des paysans de castes inférieures14.
2.3 - Le groupe Marg
2.3.1 - La tête : GRK Reddy
G.R.K Reddy, comme son nom lÕindique, est issu
dÕune famille de Reddys, riches propriétaires terriens.
Originaire de la region cTMtiere de Tenali, en Andhra Pradesh, oil il suit sa
scolarité jusquÕà la fin de ses etudes secondaires, il
sÕexile ensuite vers Delhi oil il étudie le commerce au SV
College et obtient sa ma»trise. Il commence à travailler comme
assistant dans une banque dÕinvestissement, Sarin Consultants, toujours
à Delhi, oil il acquiert une précieuse experience en matiere de
conseils et de structuration financiere. Il rejoint ensuite le groupe
dÕinvestissement chinois CIFCO, oil il complete sa formation
dÕhomme dÕaffaires.
Étant issu dÕune famille dÕentrepreneurs
dans le domaine de lÕingénierie civile, et constatant
lÕénorme potentiel, encore inexploité, de son pays dans ce
secteur, GRK Reddy decide de
14
Constatations issues de discussions sur le terrain, Tamil Nadu,
district de Kanchipuram, taluk de Cheyyur
monter sa propre affaire. Avec l'appui financier de sa famille,
il crée Marg Constructions en 1994.
2.3.2 - L'émergence d'un géant
Les débuts sont difficiles. Marg Constructions,
basée à Chennai, commence par investir au sud de la ville,
à Thiruvanmiyur, en se lancant dans la construction de quelques
appartements et immeubles de bureaux. Mais étant donné la crise
soudaine du secteur immobilier, de nombreux acteurs font faillite, et Marg
frôle de justesse le dépôt de bilan. Le projet Thiruvanmiyur
ne décolle pas comme prévu. Cependant, le développement
d'un centre commercial à Vijayawada, dans la région d'origine de
GRK Reddy sur la côte de l'Andhra Pradesh, lui procure suffisamment de
fonds pour se lancer dans un projet de parc éolien dont personne ne
voulait, toujours en Andhra Pradesh, et dans une région reculée
et sensible, terrain de jeu des militants naxalites. Le risque paye, et les
contrats pleuvent. En trois ans, Marg installe plus de 200 éoliennes
à travers le pays, ce qui lui permet de rembourser ses dettes
antérieures, et de devenir une entreprise rentable. En 2004, la
Marg's Digital Zone 1 ouvre ses portes sur l'IT corridor au
sud de Chennai, puis Marg obtient l'accord pour le développement d'un
très gros projet: le port de Karikal, en 2006. Les chantiers de centre
commerciaux, de parcs technologiques le long de l'IT corridor et de la
Old Mahabalipuram Road, et de gated communities se multiplient,
profitant allègrement de l'emballement de la croissance indienne.
En 2008, c'est l'explosion. Marg, renommée Marg
Constructions Limited, obtient les feux
15
verts pour le développement de Swarnabhoomi ,
un projet de ville nouvelle intégrée qui pèsera à
terme plus d'un milliard de dollars... le vieux réve mégalomane
de GRK Reddy prend forme. Dans le méme temps, un contrat pour la
construction d'un aéroport régional dans le Karnataka est
signé, et un projet de port de péche près de Kanyakumari,
à la pointe sud du Tamil Nadu, est en route. La méme
année, Marg se voit attribuer le prix de la plus forte croissance pour
une firme de développement d'infrastructures aux 6èmes Annual
Construction World Awards à Bombay.
Ë travers la mise sur pied de tous ces projets, on peut se
rendre compte de la volonté affichée
par le groupe
d'opérer un développement vertical. Dans le cadre de
Swarnabhoomi par
15 Littéralement Ç le pays de l'or È, en
Tamoul
exemple seront regroupés tous les savoirs-faire de
Marg, des infastructures électriques, logistiques et routières au
développement de parcs technologiques, de centre commerciaux, et de
zones résidentielles. La compagnie Marg déploie tout son
savoir-faire afin de prouver que désormais, elle est capable de tout.
En octobre 2009, le groupe pose son premier pied à
l'étranger et signe son premier contrat avec le gouvernement du Sri
Lanka, pour la création d'un lotissement de logements sociaux, dans la
capitale Colombo. Ë l'heure actuelle, un projet de complexe touristique
est en cours de négociations aux Maldives. Pour les trois derniers mois
de 2009, Marg Ltd a dégagé un bénéfice net de
3.500.000!, soit le double de 2008 sur le méme période.
2.3.4 - Une responsabilité sociale
Au fil du temps, Marg Ltd a compartimenté ses
activités à travers plusieurs appellations, telles que Marg
ProperTies pour ce qui a trait à la branche résidentielle,
Marg's Real Estate Commercial pour la division commerciale, Marg
Foundation pour la division infrastructures, Marg Aviations pour
la récente branche aéroportuaire, et enfin, Marg
Parivarthan, pour ce qui est du social...
En effet, conjointement à la création du projet
Swarnabhoomi, Marg a adopté le principe
d' <<inclusive living16È. Se
considérant comme une entreprise socialement responsable, Marg a
concentré ses initiatives dans les domaines de l'éducation, de la
santé, de l'assainissement, et des compétences pour l'emploi.
Ë ce titre, elle a établi un partenariat avec la
Confédération des Industries Indiennes (CII) afin de lancer un
programme de formation à destination des jeunes du taluk de Cheyyur, au
voisinage direct donc, du projet Swarnabhoomi. Ce programme permettra de former
chaque année 200 jeunes de la région à des
compétences industrielles de base, pendant une durée d'un an et
demi, directement dans le centre Marg
Parivarthan17, dont le slogan laisse réveur:
<< un centre pour inspirer le changement È. Le centre se
concentrera également sur l'orientation professionnelle, la
sensibilisation à la nutrition, et la formation au développement
rural. Ce projet vise à créer du lien social, et à
intégrer des jeunes économiquement vulnérables dans le
système de l'économie formelle.
16 Principe de vie intégrée à la
société
17 Dont la construction n'est pas encore à l'ordre du
jour, malheureusementÉ
En aout 2008, en soutien à l'association Givelife
Charity, Marg a également organisé le semi-marathon de
Chennai, qui a rassemblé près de 170.000 personnes.
L'expérience a été renouvelée cette année au
mois de février.
2.4 - Marg Swarnabhoomi: details sur le projet
Lorsque l'on quitte Chennai par le sud et que l'on emprunte
L'East Coast Road en direction de Pondichéry, Marg est partout. Le
péage, recouvert des slogans Marg Visioneering New India, et
Swarnabhoomi A New for business, living and learning 18
paradigm , annonce l'entrée
dans le domaine de la firme de GRK Reddy. Et les panneaux
publicitaires ne manquent pas tout le long du trajet, dévoilant aux
automobilistes les divers projets en cours, et exposant ainsi toute la force du
groupe. On y détaille méme le prix des appartements.
2.4.1 - Presentations
On l'a dit, Marg Swarnabhoomi est un méga projet de
ville nouvelle, privée, que l'on peut également qualifier d'
<<integrated business city È, c'est à dire qu'il
s'agit là d'une cité clé en main, oü
théoriquement tout est disponible sur place. On peut y travailler, y
résider, et y disposer de tous les types de services nécessaires
à la vie de tous les jours. Choisir d'habiter une ville de ce genre
permet donc de se retrouver en situation de totale autarcie, comme sur une
»le. Le but est de proposer aux classes moyennes et aux plus aisés
un lieu de vie verdoyant, oü les déplacements ne posent plus de
problème puisque tout est accessible à pied, loin de la
pollution, de l'encombrement et de la surpopulation des grandes
agglomérations. Par ailleurs, le regroupement entre catégories
sociales les plus favorisées, surtout dans un pays tel que l'Inde, est
un atout certain. L'entre soi devient possible. La mendicité, le
bruit,
la
saleté et le désordre sont ici bannis. Le groupe
Marg qualifie cela de << nouvel urbanisme È.
Concu par un cabinet d'architecte américain, HOK, le
projet s'est vu implanté sur les bords de
la lagune de Cheyyur,
à 2km des plages du Golfe de Bengale. Il s'agit là d'une
région rurale à
18 Visionnaires de l'Inde nouvelle / Un nouveau paradigme pour
vivre, travailler et apprendre
l'écart de l'agitation, mais bien reliée à
Chennai et à Pondichéry par l'ECR, distantes respectivement de 90
et 60km.
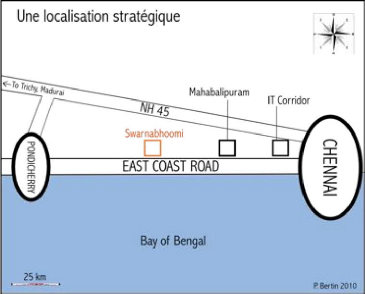
Figure n°1
2.4.2 - Un pôle à la pointe de la
technologie
Le projet, d'une surface totale de 4500 hectares19,
comprend tout d'abord la création de deux ZES, notifiées depuis
septembre 2007:
- L'une consacrée aux technologies de l'information,
à la recherche en bio - pharmaceutique et dans le domaine des
nano-technologies, à l'animation et à la simulation, à la
santé, et comprenant un parc scientifique spécialisé dans
les sciences de la vie (Multi-Services SEZ, sur 121 hectares)
19 Une première phase sur 400ha avec pour
échéance 2013, une deuxieme sur 2000ha, et une troisieme non
planifiée pour l'instant.
- L'autre consacrée à l'industrie de haute
précision, c'est-à-dire à la production de pièces
automobiles, à la production de composants électroniques pour
l'aéronautique, le domaine spatial et le domaine médical, et
à l'ingénierie électrique. (Engineering &
Electronics SEZ, sur 312 hectares).
Ë l'heure actuelle, seule une dizaine de firmes sur la
centaine de prévue ont établi un contrat avec Marg, telles que
Virgo Engineering (Valves - USA), Vanspall (Climatisation - Royaume-Uni),
Grundfos (Pompes, Danemark), ou Acer (Informatique, Taiwan). L'objectif
affiché est de faire de Swarnabhoomi un hub scientifique de niveau
international d'ici à 2020. Seules de petites unités de
production sont prévues, censées fonctionner en synergie. Pour
cela, Marg fournira toutes les infrastructures nécessaires.
En association avec ces deux SEZ est d'ores et
déjà entamée la construction d'un campus vert
qualifié de Çpôle de la connaissance È, qui
s'étendra dans un premier temps sur 15 hectares. L'école BVM
global, premier élément complété, a
déjà ouvert l'été dernier, et regroupe 1300
élèves. Bientôt suivront:
- Une annexe de Virginia Tech, une université
américaine, qui prévoit d'implanter une
bibliothèque scientifique, un centre de recherche sur les
sciences appliquées, la
bioinformatique, et les transports. Ces centres visent à
travailler en collaboration avec
l'industrie présente sur place, dans le souci de produire,
évidemment, de l'innovation. - Un institut de management singapourien
- Un institut national de management et de recherche dans la
construction, le NICMAR
- La Swarnabhoomi Academy of Music, première
académie de musique contemporaine
implantée en Inde et dirigée par le compositeur et
guitariste de renom R. Prasanna. - Un institut de formation
cinématographique et dans l'animation
- Un institut de la mode et de l'art
- Un institut de formation aux soins infirmiers
Et bien d'autres, dans le domaine des bio-technologies, de
l'ingénierie, de l'aviationÉ mais tout n'est pas encore
confirmé.
Figure n°2
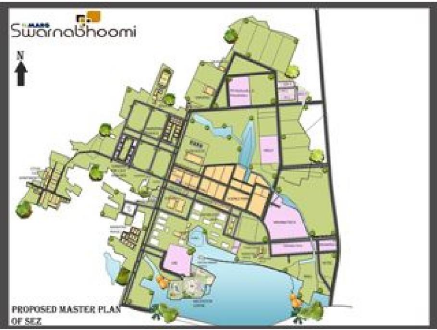
Ci-dessus : Plan d 'ensemble des
phases I et II du projet. Pour le moment, seule la BVM Global School et le
réseau routier sont achevés. Ci-dessous: L'
unité d'habitation Navratna phase I (image 1) est en cours definition,
et Navratna phase II (image 2) est bien avancée. BVM School (image 3),
ouvriers sur le chantier (image 4) - Photo : P. Bertin

2.4.3 - Tous les attributs d'une grande ville ?
En 2020, Marg Swarnabhoomi devrait accueillir prés de
100.000 habitants. Selon le concept des integrated business cities,
tout doit etre mis en Ïuvre pour satisfaire la population et subvenir
à ses besoins. Dans le cas de Swarnabhoomi on va même plus loin,
du fait quÕil sÕagit là de la future vitrine du groupe
Marg.
La construction des 15.000 unites de logement
sÕétalera sur 3 phases, la première étant
prétendument terminée. Tous types de logements vont etre
réalisés, de la villa luxueuse avec piscine aux lotissements plus
denses, et aux immeubles collectifs de differents niveaux de standing. Comme
pour la zone dÕactivités, la fourniture dÕeau et
dÕélectricité sera garantie en continue, gr%oce à
la mise en place dÕune station de désalinisation dÕeau de
mer et dÕune centrale electrique interne. Une station
dÕépuration est egalement prévue.
Un réseau de monorail devrait relier ces zones
résidentielles à une sorte de centre-ville pourvue à
lÕhorizon 2015 dÕun hTMpital généraliste
dÕune capacité de 300 lits et de sa clinique estampillée
Apollo Hospital20 de 25 lits, dÕun centre commercial
de 100.000 metres carrés, dÕune zone hoteliére,
dÕun auditorium de 1500 places, dÕun multiplex, dÕun
complexe religieux, et même dÕun golf et dÕun parc
dÕattraction, le tout dans un environnement à la
végétation luxuriante. Marg prévoit en effet la plantation
de 45.000 arbres pour une surface verte occupant 30% de lÕespace de la
ville. Pour cela, un important systeme de récupération et de
stockage de lÕeau de pluie sera installé.
20
Fameuse cha»ne dÕhopitaux privés
déjà bien implantée dans la region metropolitaine de
Chennai
2.4.4 - Les raisons de l'attractivité
|
Marg Swarnabhoomi
|
Chennai Metropolitan
|
|
Revenu moyen annuel par foyer
|
900.000
|
1.000.000
|
|
Budget nourriture
|
189.000
|
210.000
|
|
Budget habillement
|
56.430
|
62.700
|
|
Logement
|
198.192
|
330.324
|
|
Transports
|
24.000
|
61.500
|
|
Education
|
66.420
|
73.800
|
|
Loisirs
|
21.420
|
23.800
|
|
Santé
|
27.000
|
36.000
|
|
Equipement
|
32.940
|
36.600
|
|
Autres
|
63.000
|
70.000
|
|
Total des dépenses
|
678.402
|
904.724
|
|
Epargne
|
221.598
|
95.276
|
Tableau n° 2 : Budget Familial - Marg Swarnabhoomi
vs. Chennai (Source Marg) On l'a vu, Marg mise sur la qualité
de l'environnement
et de l'équipement pour attirer les futurs occupants de
Swarnabhoomi. Mais la possibilité pour un nouvel arrivant de vivre
à moindre frais est un paramètre primordial à prendre en
compte dans cette attractivité mise en avant par le groupe.
Évidemment, les chiffres issus de ce tableau sont à analyser avec
précaution, étant donné la source. Mais néanmoins,
il para»t évident que les économies réalisées
sur l'achat ou la location d'un logement à près d'une centaine de
kilomètres de Chennai, ainsi que l'annulation des frais de transports,
est un atout certain.
Mais l'essentiel de l'attractivité de Swarnabhoomi repose
sur le faible coüt d'installation pour les entreprises, puisque, en plus
des bénéfices issus du statut de ZES, on note :
- Des coüts de location divisés par trois
- Une maintenance moitié moins cher, du fait d'une main
d'Ïuvre locale très bon marché - Là encore, des
coüts de transport moindre, d'autant que la création d'un port sur
le taluk de Cheyyur est prévue très
prochainement21.
Sur le papier, donc, Marg Swarnabhoomi promet une belle
réussite. Pour autant, la ville rêvée vendue par Marg ne
fait pas l'unanimité.
21 Public ou privé, pour l'instant, la question reste en
suspens.
3ème partie : Les dessous du mirage -
Enquête de terrain
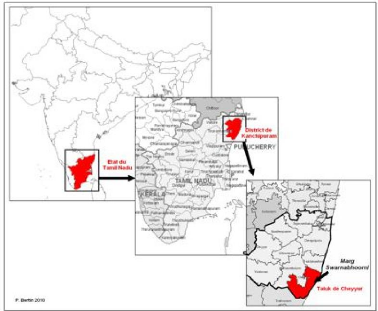
Carte n°2 : Zoom sur la localisation de la zone
d'étude
Introduction - Une première approche par
l'intérieur
Afin de me rendre compte de l'ampleur du projet et de son
avancement, j'ai commencé par me rendre directement sur le chantier. Une
fois passé le barrage de sécurité à l'entrée
du site, j'ai d'abord rencontré le General Manager, Mr. J.
Krishnamaraju, qui m'a soumis à un interrogatoire pendant près
d'une demi-heure, en me questionnant sur mes motivations, mon niveau
d'étude, ma vie en France, mes relations en Inde. Après avoir
détaillé mon projet de recherche, que j'avais volontairement
Çarrangé È pour qu'il ne soulève pas
d'inquiétude, j'ai été prié de revenir
ultérieurement muni de tous les justificatifs nécessaires. Ce que
j'ai fait quelques jours plus tard, accompagné cette fois-ci de Venkat,
ingénieur d'études à l'IFP, de facon à prouver mon
sérieux et surtout ma non-appartenance au monde journalistique ou
à un quelconque mouvement revendicatif. Malgré cela, le climat
s'est avéré d'une extreme froideur. Nous avons pu rencontrer de
nouveau le General Manager, qui, ne souhaitant pas
particulièrement communiquer, nous a renvoyé
vers le Project Manager, M.K.A Pasha, auquel j'ai enfin pu soumettre
mon questionnaire. Disposant déjà d'informations à propos
du projet en lui même tel que j'ai pu le détailler dans la partie
précédente, j'ai tenté d'en savoir plus à propos du
processus d'acquisition, des acteurs impliqués, des difficultés
éventuellement rencontrées, des rapports avec les villages
alentours, et des perspectives pour l'avenir. L'entretien fut bref, le
Project Manager étant visiblement embarrassé par mes
questions. Je n'ai pu tirer de cet entretien que de simples banalités,
dictées probablement par la direction. Cependant, une phrase trop
souvent répétée m'a permis de me rendre compte d'un
certain malaise vis-à-vis des populations alentour.
Ç N'allez pas voir les villageois, ils ne vous
apprendront rien È.
Après cette seconde visite, je ne suis retourné
qu'une seule fois dans les bureaux de Marg, afin de rencontrer le Sales
Manager, Kamalthiagarajan N., que j'avais déjà croisé
lors de mon premier passage, et qui m'avait paru plus loquace et surtout plus
abordable que ses collègues. Lui non plus n'a rien pu m'apprendre de
nouveau, mais il m'a clairement fait entendre que les employés de Marg
avaient des consignes très strictes en matière de communication,
et que je n'obtiendrai rien d'intéressant de leur part. C'est à
partir de là que j'ai décidé de me consacrer au cÏur
de l'enquête de terrain, en interrogeant les villageois.
3.1 - Questions de méthode
Afin de partir à la rencontre des populations, dans une
grande majorité uniquement tamoulophone, Venkat m'a mis en contact avec
un jeune interprète, Anthony, qui m'a accompagné sur le terrain
tous les jours pendant deux semaines. Nous avons entamé notre
enquête par le village de Seekinankuppam, situé juste à
l'entrée du projet, à quelques mètres seulement des
immenses panneaux marquant l'entrée du territoire Marg. Nous
étions déjà venus une première fois discuter avec
les villageois avec Venkat quelques jours plus tTMt, ce qui m'avait permis de
me faire une idée du type de popu lation vivant là, des
différents types d'occupation des sols, de la quantité de
terrains vendus. J'avais cependant été déçu par
le
manque evident de sincérité de la part de ces
premiers individus rencontrés. JÕai compris plus tard que
plusieurs elements sont à prendre en compte lorsquÕon part
à la rencontre dÕune population rurale, pauvre, visiblement
opprimée, et nÕayant jamais eu aucun contact avec un occidental.
Pour une grande majorité des personnes rencontrées au cours de
lÕenquête, jÕai pu constater lÕétroitesse de
lÕespace vécu et pratiqué, se limitant aux villages
alentours et aux petites villes telles que Cheyyur ou Kalpakkam situées
à une quinzaine de kilomètres. Rares étaient les
villageois à avoir déjà fait le trajet
jusquÕà Pondichéry, Kanchipuram ou Chennai. Dans un tel
contexte, la catégorie sociale, la façon de se presenter, la
posture verbale adoptée, et même la tenue vestimentaire ont une
importance capitale. Je suppose donc que lors de ma première visite, au
cours de laquelle Venkat avait fait le lien entre moi et les villageois, ces
derniers avaient été intimidés par son charisme naturel et
surtout par son statut de brahmane.
Apres avoir discuté de la question avec Anthony, nous
avons donc prêté une attention toute particuliere à ces
parametres. Il a fallu au début de chaque interview préciser que
nous nÕavions aucun rapport avec Marg22 et que les
informations issues de la rencontre ne sortiraient pas du cadre de mon travail
dÕétudiant, expliquer le but de lÕopération en
detail et nous presenter lÕun apres lÕautre. La mise en confiance
est une étape tres importante. Cela passe aussi par le regard, et
lÕutilisation, pour ma part, de quelques mots tamouls dans les
échanges. Anthony se montrant tres souriant et ouvert, tout en restant
simple, les échanges ont été souvent tres riches, parfois
enflammés. DÕautant quÕau fur et à mesure que les
jours passaient, tout le monde ou presque avait été mis au
courant de notre présence et du caractere amical de nos interviews.
Méfiants de prime abord, les villageois ont fini par nous accepter, et
il nÕétait pas rare quÕon nous salue sur le bord des
routes, ou que lÕon nous invite à boire un jus de coco ou un
the.
Au départ, jÕavais prepare un questionnaire pour
donner un cadre aux échanges. Mais finalement, je me suis vite
aperçu, malgré la simplicité et la souplesse de mes
questions, que la méthode rendait lÕexercice trop rigide, et
orientait de fait les réponses des interrogés. Par la suite, et
naturellement, nous avons plutTMt fait le choix de la discussion ouverte et de
lÕéchange naturel, orienté en priorité vers le
ressenti de chacun. Le sourire et surtout lÕhumour ont été
nos meilleurs allies, malgré le caractère sérieux et
souvent accablant de lÕenquête.
22
Beaucoup nous percevaient au depart comme des investisseurs, et
craignaient de nous parler à cÏur ouvert
Une fois corrigée cette question du rapport et de la
présentation, il a fallu faire face au caractère aléatoire
des réponses, du fait de la variété des communautés
rencontrées, et de la divergence de leurs intéréts par
rapport au projet Swarnabhoomi. On remarque que le type de réponse colle
à plusieurs grandes catégories, à savoir:
- Celle des riches propriétaires, des Reddyars en
particulier, qui entretiennent des relations étroites avec la compagnie
Marg, et qui en général ont participé aux transactions et
se sont enrichis par ce biais. Le discours est alors élogieux par
rapport au projet, et les réponses aux questions vont entièrement
dans le sens de celles des employés de Marg. Il s'agit là
assurément de la catégorie dominante, et souvent la plus hostile
à notre présence sur le terrain.
- Celle des Reddyars qui ne se sentent pas concernés
par le projet et qui ne comptent pas vendre leurs terres pour le moment.
Ceux-là ne subissent pas de pression et se révèlent
souvent satisfaits de leur situation, qu'ils souhaitent voir perdurer le plus
longtemps possible. Ces gens là, le plus souvent, ne travaillent pas et
vivent du revenu de leurs terres, exploitées par de petits paysans.
- Celle des petits propriétaires, issus de
différentes communautés, et largement sollicités dans le
cadre du processus d'acquisition. Leur situation est très inégale
suivant qu'ils se trouvent au contact direct de la zone, suivant la
qualité de leurs terres et la quantité de terrains vendus. C'est
pour cette catégorie que les réponses sont les plus
aléatoires et les plus difficiles à interpréter.
- Celle des petits exploitants dépourvus de terres, qui
sont souvent les plus enclins à communiquer, mais aussi les plus
critiques vis à vis du projet. On verra pourquoi dans la partie
suivante.
- Enfin, une séparation très nette oppose les
jeunes générations, en général
éduquées, poursuivant souvent des études à
l'extérieur, donc plus mobiles et plus aptes à trouver un emploi
hors du domaine agricole, et les personnes agées, souvent
analphabètes, n'ayant jamais quitté leur village, et entretenant
un rapport très étroit à la terre. Les premiers se
montrent optimistes et espèrent trouver un emploi au sein de
Swarnabhoomi, les seconds se sentent marginalisés, et craignent des
retombées
négatives. En règle générale, plus
les populations interrogées ont un niveau d'études
élevé, plus elles soutiennent le projet. Ce n'est donc pas
forcément une question de richesse.
La question de l'unité est aussi primordiale. En effet
suivant les villages, on observe un niveau d'unité très variable
au sein de la population. Ainsi, dans les villages oü l'on a plutot
tendance à se serrer les coudes face au danger et à l'oppression
exercée par les castes dominantes, on aura largement tendance à
critiquer l'avancée du rouleau compresseur Marg. Sans pour autant que le
ressenti se traduise en revendications. Mais on y reviendra.
Difficile au final de faire le tri dans toutes les
informations récoltées, en particulier pour les données
quantitatives. Aussi, nous avons dü veiller à interroger pour
chaque village un représentant de chaque communauté, de facon
à obtenir une vision globale, et la plus proche de la
vérité.
3.2 - Sept villages pour autant de
réalités
Une rapide présentation de la zone d'étude
s'impose, de facon à rendre compte des différents niveaux de
vulnérabilité face à l'établissement du projet
Swarnabhoomi. Les sept villages concernés par la vente de terrains ont
été regroupés en fonction de leur appartenance à un
méme Pânchayat23, c'est-à-dire qu'ils
ont en commun le méme thalaivar, ou chef de village. C'est
important dans la mesure ou le thalaivar influe
énormément sur les liens entre les villageois et la compagnie
Marg.
23 Village Panchayat pour ôtre plus précis.
Il s'agit d'une assemblée traditionnelle élue, équivalente
en quelque sorte au conseil municipal, et chargée de régler les
différents entre individus ou entre villages.
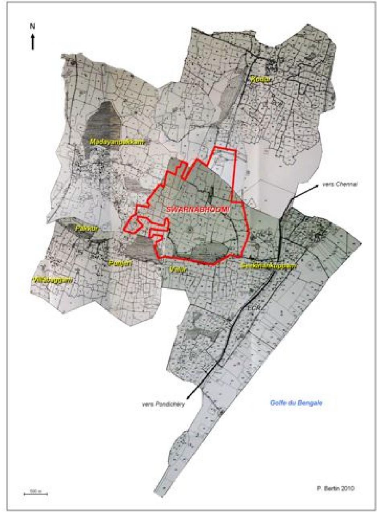

Carte n°3 - Emprise spatiale du projet
Swarnabhoomi
(basée sur un assemblage de plans
cadastraux)
Seekinankuppam - Velur - Punjeri

A gauche : parcelles rizicoles
encore en exploitation à Seekinankuppam.
A droite: le projet vu depuis
Velur. Au premier plan, l'ancien Water Tank utilisé pour l'irrigation
des terres du village, aujourd'hui dans l'enceinte de Swarnabhoomi.
Ces trois villages se trouvent au contact direct du projet, et
sous la domination d'un seul homme, le Reddyar N.Jaya Prakash. A eux trois ils
regroupent plus de 1.500 habitants, dont la plupart appartiennent à la
catégorie SC (Scheduled Cast, 50%), viennent ensuite les
Yadav (25%), principalement installés à Velur et
à Punjeri, les Vanyars (15%), les Reddyars (5%), et
les OC (Other Cast, 5%), principalement installés à
Seekinankuppam, qui regroupe les 2/3 de la population du Panchayat. Pour ces
trois villages, on observe une nette division nord/sud en ce qui concerne la
qualité des terres, avec au nord des sols de type White soil,
c'est à dire nonirrigués et secs, qui pour la grande
majorité ont été vendus à Marg, et des sols de bien
meilleure qualité au sud du fait de leur moindre altitude. Il s'agit de
sols de type Red Soil (c'est à dire de qualité
intermédiaire, disposant souvent de puits comme on peut en apercevoir
partout à Velur et à Punjeri) et Black Soil (c'est
à dire les sols pourvus d'un système d'irrigation régulier
tout au long de l'année, notamment par le biais des mares et des
réservoirs). En tout, depuis 2005, date à laquelle Marg a
commencé à acquérir des terres pour son projet, 70% de la
surface totale de Seekinankuppam a été vendue, 60% de la surface
de Velur, ainsi que 35% de la surface de Punjeri. Cela représente la
quasi-totalité des terres de type White Soil. En deux ans,
entre 2005 et 2007, on a pu noter une augmentation des prix de 400!/ha à
plus de 2500!/ha, toujours pour les terres non-irriguées.
A Seekinankuppam, 40% seulement de la population active
travaille dans le secteur agricole,
pour 90% à Velur et à
Punjeri. Cette différence s'explique par une forte intégration
des
travailleurs de Seekinankuppam à l'intérieur
même du chantier, qui fournit par exemple la majeure partie des
watchmen chargés de la sécurité.
Nous y reviendrons par la suite, mais c'est dans ces trois
villages que la contestation est la plus forte, du fait de la toute puissance
du chef du Panchayat, N.Jaya Prakash, que l'on surnomme parfois the
devil, et qui depuis 2006 a été pris d'une folie acheteuse
et qui a littéralement réquisitionné plusieurs centaines
d'hectares de terres qu'il a ensuite revendu à Marg, plus cher bien
entendu, profitant au passage d'un bénéfice de 20 à 40%. A
ce titre il se présente lui-même comme l'un des partenaires
privilégiés du groupe, et représente certainement l'un des
personnages clés du processus d'acquisition.
Villabaggam - Pakkur - Punjeri

A gauche : puit utilisé pour
l'irrigation à Pakkur.
A droite : parcelles anciennement
rizicoles à Punjeri, aujourd'hui vendues au groupe Marg.
Une petite précision avant de commencer: le village de
Punjeri est partagé entre deux Panchayats, une petite partie ouest
étant rattachée au village de Pakur.
Ë la tête de ces trois villages on trouve
A.Varathan, un individu diametralement opposé à N.Jaya Prakash
dans la mesure oü il appa rtient à la catégorie des
Scheduled Cast, et oü il n'adhère pas aux pratiques du
groupe Marg en matière d'acquisition des terres. Il a pourtant lui aussi
été contacté dans le but de remplir le rTMle
d'intermédiaire entre Marg et les villageois. En effet, comme on a pu le
voir précedemment (cf. 1.4.2), Marg, comme beaucoup d'autres
développeurs au Tamil Nadu, a fait appel à des leaders locaux,
ici les chefs de village, dans le but de rassurer et de convaincre les
villageois quant aux bénéfices de la vente de leurs terres.
A.Varathan ayant refusé de remplir ce rTMle, Marg a d'abord fait appel
à des
brokers indépendants chargés de
réaliser les transactions, mais du fait de leur manque
d'efficacité, Marg a directement investi le terrain depuis quelques
mois, et il n'est pas rare de croiser le 4x4 des brokers du groupe ,
estampillé Marg ProperTies, au détour d'un chemin.
La première phase d'acquisition a ici commencé en
2008/2009, et étant donné la distance au projet, on peut se poser
la question de l'utilité de ces extensions.
Pour une population de 1550 habitants, on constate la encore
une nette prédominance des basses castes, c'est a dire des Scheduled
Cast (30% a Villabaggam, 70% a Pakkur) et des Backward Cast (60%
a Villabaggam, 10% a Pakkur), qui représentent la majeure
partie de la population. Viennent ensuite les MBC et les
Yadav, installés principalement a Punjeri. Aucune famille de
Reddyars n'est présente sur cette portion.
Comme pour les villages précédents, on a ici
vendu la majeure partie des terrains de mauvaise qualité. Cependant, les
sols de type Black Soil et Red Soil dominent, et le processus
d'acquisition est bien moins avancé pour cette catégorie de
terrains, dont les prix dépassent de 50 a 70% ceux des parcelles de
type White Soil. C'est pourquoi seulement 10 a 15% de la surface de
Villabaggam a été cédée, puisqu'il s'agit du
village qui concentre les meilleures terres. Pakkur et Punjeri étant
moins avantagés, 50% des terres ont été vendues.
La prospection ayant débuté ici plus
tardivement, le s tarifs des transactions sont largement supérieurs a
ceux observés plus tTMt, a Seekinankuppam, Velur et Punjeri. Les terres
nonirriguées ont ainsi été cédées en moyenne
pour 14000€/ha, et les meilleures terres entre 30000 et 35000€/ha. On
remarque donc la rapide explosion du prix de la terre depuis l'arrivée
de Marg en 2005. Les tarifs paraissent même exhorbitants, en comparaison
du prix de la terre en France. Cependant, il convient de noter que la plupart
des familles ne possedent que de petites parcelles, dont la taille varie
généralement entre 0,1ha et 0,5ha.
Madayanpakkam
Encore un village sous la domination d'un Reddyar,
Veeraragava Reddy, marié a la niece de N.Jaya Prakash. Malgré la
proximité familiale entre les deux hommes, leur rapport a la terre
differe, et V. Reddy, comme A.Varathan, n'est pas intervenu dans les rapports
entre Marg et les villageois. Fait surprenant d'ailleurs, c'est même
N.Jaya Prakash qui serait intervenu a Madayanpakkam a la place de son
homologue, en rachetant des terres en vue d'une revente au groupe Marg. Pour un
total de 1400 habitants, 4% appartiennent a la catégorie
Scheduled
Tribes, 75% à la categorie Scheduled
Casts , 15% à celle des Backward Casts, et 6% sont des
Reddyars.

A gauche : type d'habitat
traditionnel tel qu'on peut en trouver dans tous les villages de la zone
d'etude A droite : recolte de l'arachide. Au fond, on peut
apercevoir Swarnabhoomi
Les surfaces cédées à Marg à
partir de 2007 représentent un total de 20% de la surface totale du
village. Comme à Villabaggam, la majorité des terres
sont de relativement bonne qualité, de type Red et Black
Soil principalement, ce qui explique la faible proportion de terrains
vendus jusquÕà present. Les tarifs semblent
intermédiaires, entre 3000 et 10000€/ha.
Koddur
Il sÕagit de loin du village le plus étendu, le
plus riche aussi, puisque contrairement aux précédents, la
quasi-totalité des maisons sont ici construites en dur, là oil
les habitations des autres villages étaient en général
faites de terre et de branches de palmiers. Le chef du village, là
encore un Reddyar, a catégoriquement refusé de
communiquer, ayant été mis au courant de notre presence par ses
amis employés dans les bureaux de Swarnabhoomi.
Parmi les 2000 habitants de Koddur, 40% appartiennent à
la communauté Reddy, 50% à la catégorie SC,
5% à la catégorie BC, et enfin 5% à la
catégorie OC (pour Other Casts). La large proportion
de Reddyars explique probablement le niveau de richesse du village.

A gauche : au premier plan,
parcelle rizicole toujours active. En arrière plan, parcelles
cédées à Marg. A droite : maisons de la
communauté Reddy.
Comme à Seekinankuppam, le début du processus
d'acquisition a aussi commencé dès 2005, et a abouti a la vente
de 30% de la surface du village, dans sa partie sud c'est-à-dire dans la
partie oü les terres souffraient depuis plusieurs années d'un
assèchement progressif de la nappe phréatique. Le nord du
village, disposant de terres de bonne qualité (à dominance
Black Soil), résiste toujours à l'envahisseur. Comme
c'est le cas dans tous les villages visités, on attend une nouvelle
hausse des prix des terrains pour vendre. Marg para»t cependant moins
gourmand ici qu'ailleurs, étant donné la qualité et donc
le prix des terrains, aujourd'hui plus chers encore qu'à Villabaggam.
Je ne l'ai pas évoqué jusque-là, mais je
me permets une petite parenthèse à propos de la production
agricole locale. La majeure partie des terres cultivées est
utilisée pour la culture du Paddy, c'est à dire du riz,
viennent ensuite par ordre d'importance l'arachide, la canne à sucre, la
noix de coco, la mangue et le casaurina tree.
Pour compléter ce tour d'horizon de la zone
d'étude, venons-en maintenant aux données plus
générales, en matière d'éducation pour commencer. A
part pour Koddur, il est important de préciser que
l'analphabétisme touche une large part de la population, puisque
seulement 40% des habitants de Madayanpakkam par exemple sont capables de lire
et écrire, hommes et femmes confondus. Les plus jeunes s'en sortent
mieux, et on note la présence d'une école primaire dans chaque
village, mis à part à Pakkur. On trouve aussi une école
privée catholique à Punjeri, et une autre à Koddur,
anglophone. Pour la poursuite d'études, les jeunes doivent se rendre
à Cheyyur, à 7km au sud de Villabaggam, ou à Kalpakkam,
à 10km au nord de Swarnabhoomi. Cependant, du fait de l'absence de
transports publics et du faible taux
dÕéquipement en moyens de transport
privés (on ne dispose souvent que dÕun simple vélo pour la
famille, parfois dÕune moto), les déplacements sont
compliqués. Le bus nÕest accessible que depuis Villabaggam ou
Madayanpakkam. De ce fait, le travail à lÕextérieur est
rendu difficile, et lÕagriculture est la seule source dÕemploi.
Avant lÕarrivée de Marg, la quasitotalité des actifs
était concentrée dans le secteur primaire. Depuis, une petite
part des villageois ayant vendu leurs terres a été
employée sur le chantier. Sur les 2.000 ouvriers, entre
24
10 et 20% seulement sont issus des villages alentour . Les
autres ouvriers sont originaires de regions plus lointaines, souvent du nord du
pays, de lÕUttar Pradesh, du Bihar, ou du Nepal. Les promesses
dÕemploi de la part de Marg pour les villageois ayant cédé
leurs terres nÕont visiblement pas été tenues, et beaucoup
se retrouvent aujourdÕhui au chTMmage et survivent gr%oce à
lÕargent issu de la vente, qui sert par ailleurs à rembourser les
dettes qui touchent plus de la moitié des exploitants.
Par ailleurs, si lÕon fait la moyenne pour tous les
villages de la zone, entre 30 et 40% des habitants ne possedent pas de terres,
et travaillent en partie sur les terres des Reddyars, ou dans le cadre
de petits travaux gouvernementaux, les 100 days work s.
Au niveau du rapport à la politique, on observe un
relatif désintérêt, mis à part pour les
Reddyars, qui se rangent tres nettement du cTMte du DMK, le parti
à la tete du gouvernement. Le DMK domine donc, suivi de lÕAIADMK
et du PMK, puis de quelques pa rtis minoritaires. Il semblerait cependant
quÕune petite partie des villageois entretienne des rapports avec des
partis dÕextrême gauche, souvent les plus opprimés,
notamment à Seekinankuppam. Mais dans la majorité des interviews,
jÕai pu constater une certaine distance, une certaine lassitude,
vis-à-vis du monde politique. LÕimpression d'être mis
à lÕécart et réduits au silence domine. Le poids de
lÕanalphabetisation est sans doute à prendre en compte dans ce
constat.
3.3 - Stratégie et conséquences
Apres avoir mene mon enquete et realise le compte-rendu
dÕune cinquantaine dÕinterviews,
jÕai pu me faire une
idee plus precise du deroulement du processus dÕacquisition.
JÕaurais
24
Mais les salaires ne sont pas toujours ceux
espérés, souvent inférieurs à 90E par mois, et ne
sont pas toujours verses à temps. La hausse de revenus est tout de meme
appreciable aux dires des villageois, puisque la hausse de revenus mensuel
dépasse les 40% pour la plupart.
néanmoins aimé compléter mes observations
gr%oce à une entrevue avec le Thasildar, c ' est-à- dire
avec le chef du Taluk de Cheyyur, mais celui-ci venant tout juste de prendre
ses fonctions en février 2010, ce dernier n'a pas pu, ou en tout cas a
prétendu ne pas pouvoir m'aider. Déçu, j'ai alors
pensé pouvoir me rattraper en rencontrant le District
Collector, le chef du district de Kanchipuram. Apres m'y etre rendu une
première fois et avoir patienté pendant 5h dans la salle
d'attente du Collectorate sans pour autant avoir accès à
son bureau, j'ai dii y retourner la semaine suivante, cette fois-ci avec
succes. Succes relatif cependant, puisque je n'ai pu lui poser la moindre
question au sujet de Marg et de Swarnabhoomi. En effet, malgré son
apparence amicale et paisible, celui-ci s'est montré tres rude lorsque
je lui ai expliqué le theme de mon enquête, et a
immédiatement exigé que je lui fournisse quantité
d'autorisations que je n'avais malheureusement pas en ma possession. De plus,
mon visa étant estampillé « touristic visa », j'ai
préféré ne pas insister puisque le District
Collector m'a assuré que j'aurais des problemes si mes papiers
n'étaient pas en regle. Personne ne s'étant jamais penché
avant moi sur le sujet de Swarnabhoomi, je ne dispose donc que des informations
récoltées tant bien que mal sur le terrain.
3.3.1 - Diviser pour mieux régner ?
On l'a vu, Marg a entamé la première phase
d'acquision en 2005. Au départ, je supposais que la totalité du
projet avait été établi sur des terrains achetés
à des privés. C'est en faisant l'acquisition des précieux
plans cadastraux aupres du Survey and Land Records Office de Chennai,
que je me suis aperçu de la présence d'un vide entre les plans de
Koddur et de celui de Seekinankuppam (référencé sous le
nom de l'unité administrative c'est à dire Paramankeni). J'ai
alors posé la question à Bhavana, une étudiante de
M.Vijayabaskar rencontrée lors d'une entrevue au MIDS, qui m'a
expliqué que ce vide était dii à la présence de
Wastelands, c'est-à-dire de terrains relevant du domaine public,
comme je l'ai précédemment évoqué (cf. paragraphe
1-2-2). Il s'agit en fait plus précisément de p%oturages et
de Dry Lands, comme on peut le voir sur les images satellites
disponibles via Google Earth . Hors, c'est précisément
dans ce périmètre que se situe le cÏur du projet. Cette
découverte confirme donc que la base du projet à
été établie à cet emplacement, du fait des
facilités offertes par le gouvernement.
Par la suite, étant donné l'ampleur du projet
Swarnabhoomi et des ambitions du groupe Marg,
il a fallu élargir le
périmetre, en acquérant dans un premier temps uniquement les
Dry Lands,
conformément aux regles édictées par le
gouvernement dans le cadre du Tamil Nadu SEZ Act,
cette fois-ci aux privés. Pour cela, Marg s'est
doté d'un atout de choix en la personne de N.Jaya Prakash, et de la
communauté Reddy de facon plus générale, bien
implantée, notamment à Koddur. Non seulement la communauté
Reddy a été utilisée pour servir d'exemple en
étant la première à céder ses terrains, mais elle a
également été mise à contribution dans la mesure
oü Marg lui a proposé de jouer le rTMle d'intermédiaire, en
rachetant les terres des petits propriétaires, avant de les lui
céder à un prix supérieur, ce qui avait de quoi susciter
des vocations. Certains, satisfait de leur situation, ont laissé passer
l'occasion de s'enrichir d'avantage. D'autres, comme N. Jaya Prakash, se sont
pris au jeu et ont permis la rapide acquisition des terrains necessaires au
lancement du chantier, en 2008.
Selon toute vraisemblance, le projet tel qu'on peut le visiter
à l'heure actuelle a donc été implanté uniquement
sur des terres arides, ce qui ne pose donc pas de véritable
problème, puisque la perte de ressources pour la population se trouve
minimisée. Mise à part la destruction de quelques rares
habitations à Velur, pour lesquelles les habitants ont percu de
généreuses compensations après négociation, et d'un
cimetière à l'entrée de Seekinankuppam, les dommages sont
minimes. C'est pour les événements survenus ultérieurement
que les problèmes se dessinent, puisque le processus d'acquisition s'est
poursuivi, toujours sur des terres arides, mais pas seulement. Le gouvernement
se montrant visiblement laxiste dans le cadre de sa politique en matière
de ZES, Marg s'attaque au rachat de terres fertiles.
Personne n'a été en mesure de me dire pour
quelle raison Marg a décidé d'élargir le processus
à des terrains situés parfois à plusieurs
kilomètres de son projet. Certes, sur certaines images du projet
à son terme, c'est-à-dire d'ici à une vingtaine
d'années, l'emprise spatiale semble effectivement
considérablement plus vaste qu'elle ne l'est aujourd'hui. De plus, des
accès reliant Swarnabhoomi au futur port sur la lagune de Cheyyur, ainsi
qu'à l'autoroute NH 45, sont à l'étude. Mais
l'hypothèse de la spéculation para»t visiblement plus
plausible. Marg, conscient de l'engouement suscité par son projet, mais
surtout de la hausse future des tarifs du foncier aux alentours de
Swarnabhoomi, déjà constatée d'ailleurs, achèterait
donc des terrains, encore accessibles aujourd'hui, en vue d'une revente
ultérieure, à un tarif bien supérieur.
La stratégie reste la méme, Marg contacte les
chefs de village, leur proposant de jouer le rTMle d'intermédiaire avec
les villageois. Parfois, en réponse au refus constaté de ce
partenariat, Marg fait appel à des brokers indépendants, voire
méme à ses propres brokers, comme c'est le cas aujourd'hui
à Madayanpakkam et à Villabaggam, dans le but
d'accélérer la cadence. L'opération s'avère
délicate dans le cas des transactions concernant les terres
cultivées, et la
résistance ralentit le processus dÕacquisition.
Dans ce cas, Marg doit affiner sa stratégie, et pour parvenir à
ses fins, il nÕest pas rare quÕelle vise en premier lieu
lÕachat de terrains permettant lÕacces aux puits et aux mares
(water tanks). De cette façon, les parcelles alentour se
trouvent privées de leur ressource en eau, et il est plus facile de
pousser les propriétaires à la vente. CÕest en usant de
cette stratégie quÕune bonne partie de Seekinankuppam, de Velur
et de Punjeri a pu etre acquise, le reservoir dÕeau utilisé pour
irriguer les terres ayant été inclus dans le
périmétre de Swarnabhoomi (on le distingue dÕailleurs
trés bien sur toutes les photos du projet). CÕest par
lÕasphyxie que Marg parvient tranquillement à étendre son
emprise.
Un autre exemple de lÕaggressivité manifeste des
operations fonciéres concerne, une fois de plus, N.Jaya Prakash, et
rejoint les propos développés dans la première partie du
dossier (cf. 1-3-2). JÕai dÕailleurs pu en etre le témoin,
lorsque je me suis rendu pour la première fois dans le village de
Punjeri, et lorsque quÕun homme visiblement affolé est arrive en
trombe sur sa moto, expliquant aux villageois que plusieurs acres de terres, de
bonnes terres, venaient tout juste d'être vendues à Marg par
N.Jaya Prakash. Ces terres avaient été cédées aux
basses castes deux siécles plus tTMt par les ancetres du chef actuel du
village, sans quÕaucun papier ne le stipule. Le droit coutumier ne
justifiant pas, selon Mr Prakash, sa libre utilisation à lÕheure
actuelle, il a donc procédé à la vente, sans même en
informer ses occupants. Et aux dires des habitants, il ne sÕagissait pas
là dÕun fait surprenant. Je ne sais pas si Marg est tenu au
courant des agissements de N.Jaya Prakash, mais étant donné
quÕil ne sÕagit pas là de son coup dÕessai, le
District Collector, avec qui jÕaurais aimé en discuter,
lÕest certainement.
Par ailleurs, jÕai été trés
surpris du fatalisme ambiant et de manque de réactivité de la
population face à tous ces agissements. Même si nombreux ont
été les villageois interrogés à adopter des propos
trés rudes vis-à-vis de Swarnabhoomi, aucun ne proteste
ouvertement. Aussi, on mÕa souvent avoué quÕavant
lÕarrivée de Marg, lÕunité entre villages et
villageois était la regle. Mais certains, en cédant leurs terres
au groupe, ont depuis été pointés du doigt, et la discorde
sÕest peu à peu installée. DÕautant que Marg, en
offrant du travail à certains, attise le feu en créant de
lÕinjustice, et dans le même temps impose le silence auprés
des proches des employés, craignant un licenciement de ces derniers dans
le cas oil un mouvement de résistance était mis en place.
Certains villages disposent de facilités offertes par Marg, comme
à Seekinankuppam, oil des vélos sont offerts aux étudiants
poursuivant des etudes à Cheyyur, oil des fournitures scolaires sont
mises à disposition, et oil le groupe participe à
lÕagrandissement du temple du village, ce qui ne fait là encore
que renforcer les
inégalités entre villages, et provoque une
certaine jalousie. Tout cela mis bout à bout explique en partie la
difficile émergence de groupes de résistance. En montant les
villageois les uns contre les autres, peut être involontairement
d'ailleurs, Marg peut ainsi agir en toute quiétude. Comme à
l'époque de la colonisation britannique, c'est par la division que le
groupe parvient à étendre son emprise.
3.3.2 - Désastre ou nouveau départ ? - Un
bilan contrasté
Pour le moment, il para»t difficile de dresser un bilan.
La construction n'en est encore qu'à ses débuts, puisque le
projet s'étale sur une quinzaine d'années. Les villageois
espèrent trouver du travail une fois les premiers néo -habitants
installés, et prennent leur mal en patience, sans trop se faire
d'illusions étant donné le nombre de promesses non-tenues par
Marg jusqu'à présent, puisque seule une minor ité de
propriétaires ayant été dépossédés de
leurs terres a pu obtenir du travail25. Toujours est-il que jamais
rien ne sera plus comme avant. Et le doute gagne du terrain.
Les Reddyars, comme on a pu le voir, s'en sortent
plutôt bien. La situation est plus délicate pour les petits
propriétaires, qui, soumis aux pressions, sont souvent pris au
piège et vendent leurs terres contre leur gré. Les sommes
offertes en échange compensent cependant cette perte, même si cela
implique une reconversion, et la recherche d'un emploi à
l'extérieur du village. Avec la peur de l'inconnu, beaucoup
préfèrent encore attendre le démarrage de Swarnabhoomi.
Les conséquences les plus douloureuses concernent donc en premier lieu
les travailleurs sans-terres, qui, privés de leur source de revenu une
fois les terrains vendus et ne recevant aucune compensation, se retrouvent dans
l'impasse. Ë terme, c'est environ 2.300 personnes qui sont directement
menacées. Certains ont déjà fui vers les villes en
quête d'un emploi, les jeunes surtout, ayant recu une meilleure
éducation. Les plus chanceux sont parvenus à trouver du travail
et envoient régulièrement de l'argent à leur famille
restée au village, ce qui leur permet de survivre. Mais très
vite, tous vont devoir les rejoindre, participant ainsi à la croissance
démographique des slums de Chennai, de Chengalpattu, de Kanchipuram ou
de Pondichéry. Selon eux, il n'y a pas d'autre issue. C'est le
début d'un exode rural forcé, et inexorable.
25 On rappelle que le cadre légal prévoit de donner
du travail au minimum à un individu par famille ayant cédé
des terres.
Conclusion
Pour un occidental, il est tres difficile d'appréhender
la société indienne d'aujourd'hui. Ë travers l'étude
qui m'a été confiée, j'ai pris conscience de
l'extrême complexité d'un systeme socio-économique dans
lequel les époques semblent se percuter à bien des égards.
Ainsi coexistent un monde figé, quasi-féodal, dans lequel les
relations entre les hommes semblent s'inscrire dans une tradition ancestrale
qui ne permet pas la remise en question, et un monde plus chaotique, oil tout
se bouscule, et dans lequel la soif de vaincre justifie tous les sacrifices
moraux. L'un se nourissant de l'autre pour cro»tre, on peut se poser des
questions quant aux suites de cette cohabitation. L'Union indienne, qui s'est
construite sur les principes d'une démocratie se devant « d'assurer
aux plus faible les mêmes oppportunités qu'au plus fort »,
pour reprendre les paroles de Gandhi, traverse aujourd'hui une crise
d'identité, et si le creusement accéléré des
inégalités entre communautés en est le symptTMme, quelle
en est la cause ? Le gouvernement central, en déléguant ses
responsabilités aux grandes compagnies telles que Marg, n'aurait-il pas
vendu son âme au diable ? C'est vrai, l'Etat manque de liquidités,
et il y a tant à faire. Alors on cherche à attirer la croissance,
à n'importe quel prix. La mise en place des Zones Economiques
Spéciales répond directement à cette
nécessité. Car il faut aller vite. Mais il ne faut pas oublier
que si la recette a si bien fonctionné en Chine, c'est parce-que le
régime politique le permettait. Et si l'on veut que cette recette
fonctionne tout aussi bien dans le cas de l'Inde, il ne s'agira pas d'adapter
le modèle, mais de s'adapter au modéle. C'est bien cette nuance
qui est la source du probléme. Et c'est pourquoi certains diront que
l'on assiste aujourd'hui à l'émergence d'une « dictature
économique », dans laquelle la puissance de frappe monétaire
aurait pris le pas sur le pouvoir politique.
Beaucoup cependant se complaisent dans cette nouvelle
réalité, comme on a pu le voir dans le cadre de l'étude de
Swarnabhoomi.
Ë l'heure actuelle, donc, la responsabilité de
centaines de milliers de petits paysans semble reposer sur les épaules
des compagnies ayant fait le choix de s'installer dans la myriade de ZES qui
parsément le pays. Malgré le fatalisme ambiant, et un profond
laxisme de la part des politiques, l'émergence récente d'une
prise de conscience laisse entrevoir quelques issues possible. Et comme il n'y
a pas de solutions sans problémes, on peut espérer que les
échecs d'aujourd'hui donnent naissance à une impulsion nouvelle,
menée pourquoi pas, par les entreprises à la source de la
contestation. Ë mes yeux, elles seules disposent des moyens
nécessaires à la mise en Ïuvre de grands
chantiers sociaux. Et si l'espoir est permis, c'est parce-que des indices
laissent à penser qu'un sentiment de responsabilité
(mélé de culpabilité) tend à se répandre.
Marg, avec son projet Parivarthan (cf. 2.3.3), en est un bel
exemple. Bien sür, il est fort probable qu'il ne s'agisse là que
d'un outil de publicité, mais on peut envisager que ce type de projets
puisse un jour se concrétiser. Une prise de responsabilité
sociale des entreprises est encore possible.
REMERCIEMENTS
Merci tout d'abord à vous, Kamala, Eric, qui m'avez permis
de partir pour l'Inde dans le cadre de cette année de Master. Merci pour
votre disponibilité, votre suivi, vos conseils, et pour votre
soutien.
Merci également à l'Institut Français de
Pondichéry, pour son accueil chaleureux, et plus particulièrement
à Venkat, pour son oreille attentive et ses conseils. Merci aussi
à Léo, de la cafétéria, qui a largement
contribué à mon intégration sur place, ainsi qu'à
Anthony, mon interprète, sans qui mon travail de terrain n'aurait pas
été aussi enthousiasmant.
Je tiens aussi à remercier Loraine Kennedy, Benjamin
Salomon, Bhavana et le MIDS à Chennai, ainsi que Bhuvana Raman, qui
m'ont soutenu dans ma démarche et ont participé à la bonne
orientation de mes recherches.
Merci à Madhumita Datta, du SPMEI, qui m'a fourni un bon
nombre des informations utiles à la rédaction de ce
mémoire, et qui m'a beaucoup encouragé.
Et enfin, un très grand merci à tous les villageois
de Seekinankuppam, Velur, Punjeri, Pakkur, Villabaggam, Madayanpakkam et
Koddur.
BIBLIOGRAPHIE
Anonymes, << A citizens report card on special economic
zones È, ed. intercultural ressources, 2009
Anonymes (membres du SPMEI Chennai), Peoples's audit of
Special Economic Zones, a report, dossier, 2009
BOUISSOU J. , << En Inde, guerre des terres entre paysans
et industriels È, in Le Monde, 10 mars 2010
DATTA R. , << A year after Tata Motors left Singur, cost of
damage is still being counted È, in The Wall Street Journal, 19
octobre 2009
DUTTA M. , <<Nokia SEZ : The public price of success
È, Economic and Political Weekly, 19-26 avril 2008
GIROD P. , << Etalement urbain et planification urbaine
: L'exemple de Maraimalai Nagar, ville satellite de la périphérie
sud de Chennai (Tamil Nadu, Inde) È, memoire de M1, juin 2009
GRASSET J. , LANDY F. , << Les zones franches de l'Inde,
entre ouverture à l'international et speculation immobilière
È, in Annales de géographie, n° 658, pp. 608 -627,
2007
JACQUEMET E. , << Les dalits dans l'espace urbain
à Chennai È, memoire de M1, juin 2010
KENNEDY L. , << La politique contestée des zones
économiques spéciales en Inde È, in Les editos du
réseau Asie,
reseau-asie.com, mai 2010
MANICK M.S. , << Special Economic Zones and agrarian unrest
in Punjab È, in Social Action, n°4, 2009
MARIUS GNANOU K. , << Nouvelles activités
économiques et dynamiques métropolitaine : le cas de la
périphérie Sud de Chennai È, version auteure, in
Annales de Géographie, 2010
OLIVEAU S. , << Etalement urbain et fragmentation: Chennai,
un exemple en Inde du sud È, in Etalement urbain et
villefragmentée dans le monde, des théories aux faits,
2007
RAMASWAMY K.V. , <<Regional Dimension of Growth and
employement >>, in Economic and Political Weekly, 2008
THRUSTON E. , <<Castes and tribes of southern India
>>, vol. 5, Government Press, Madras, 1909
VIJAYABASKAR M. , <<Saving Agricultural Labour from
Agriculture : SEZs and Politics of Silence in Tamil Nadu>>, in
Economic and Political Weekly, fevrier 2010
sites internet :
www.fr.wikipedia.org
www.marggroup.com
www.margswarnabhoomi.com
www.reddyonline.in
www.sezindia.nic.in
www.sipcot.com
www.tidco.com
www.tnantisez.wordpress.com
www.tn.gov.in
www.worldbank.org.in
ANNEXES
1 - Les ZES Chinoises
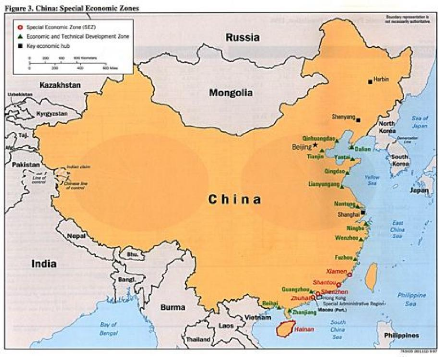

2 - Tamil Nadu Special Economic Zones Act (2005)
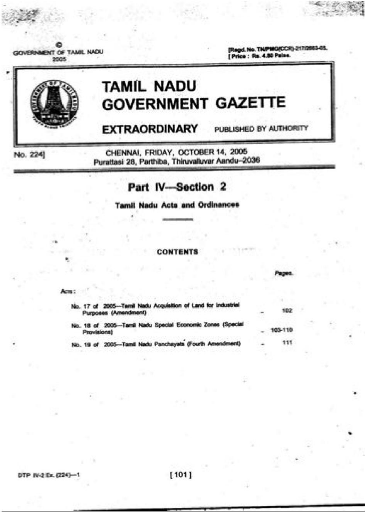
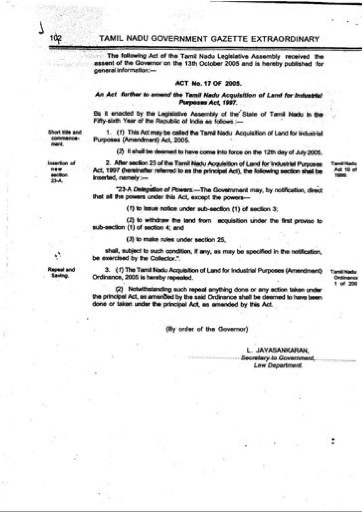
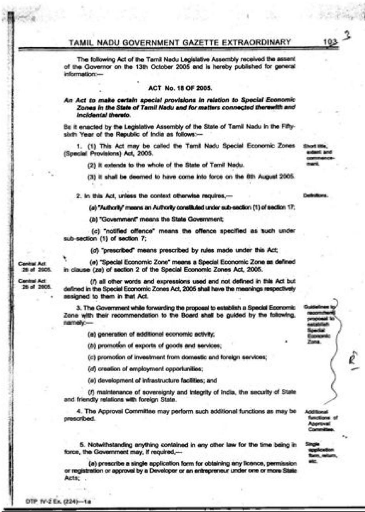
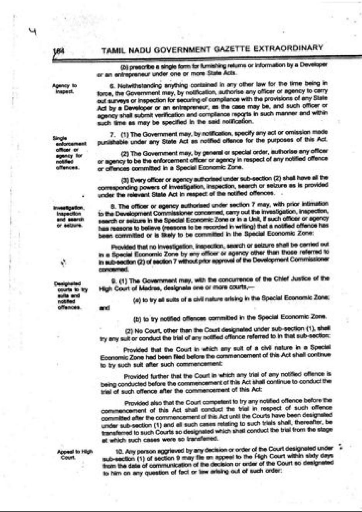
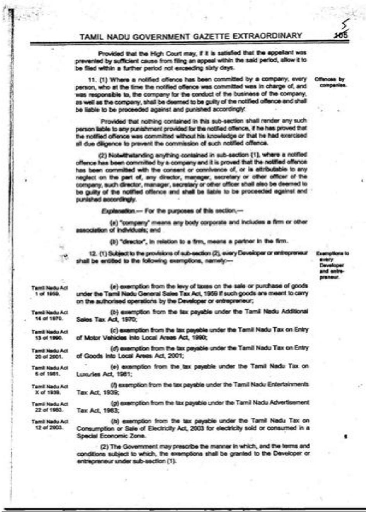
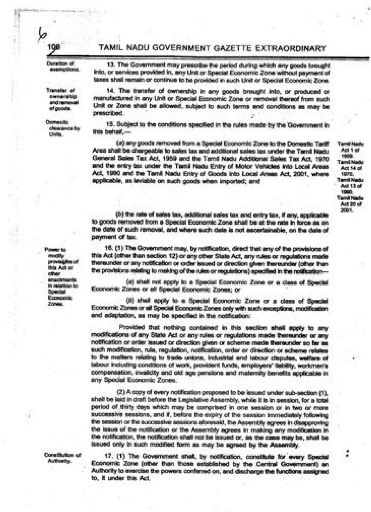
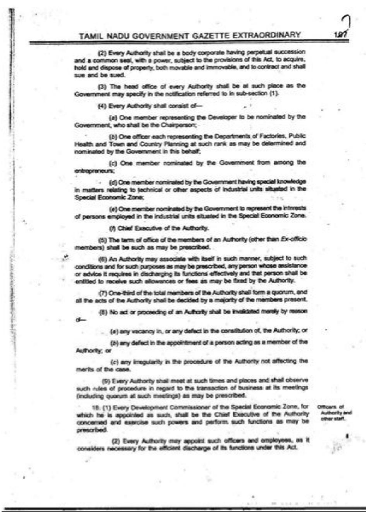

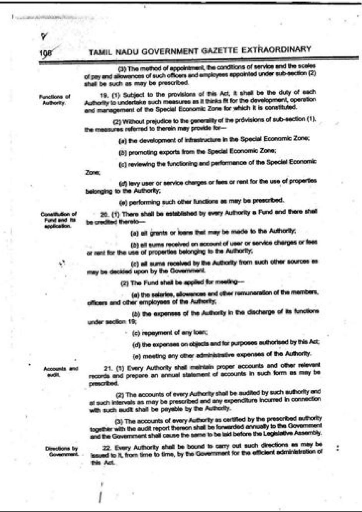
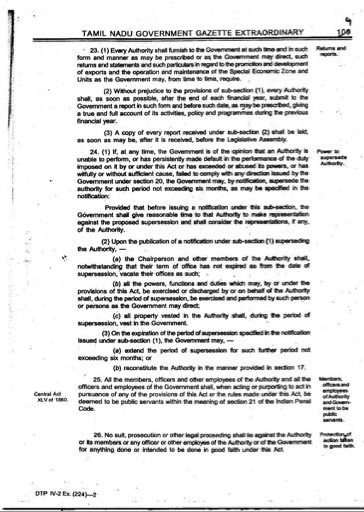

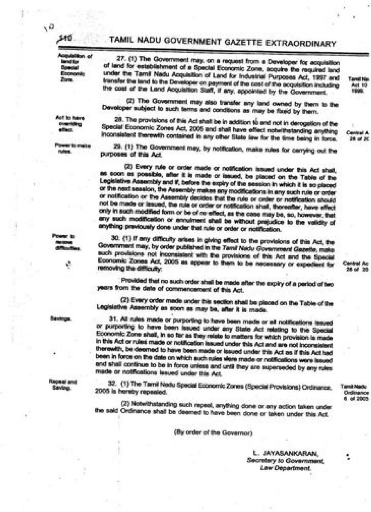
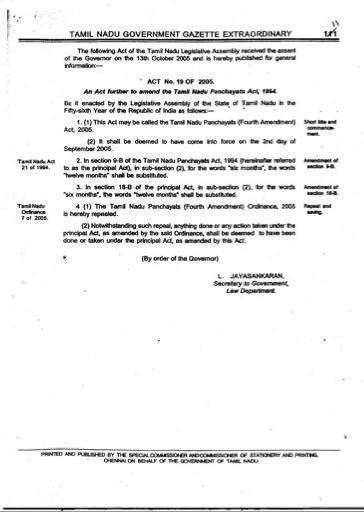
|
|


