|
|
|
|
|
MINISTERE SUPERIEUR UNITE
DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE BURKINA FASO
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Unité-Progrès-Justice
UNIVERSITE DE OUAGADOUGOU
DE FORMATION ET DE RECHERCHE
EN SCIENCES HUMAINES
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE
MEMOIRE DE MASTER EN SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE
(SIG)
OPTION : GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
|
|
|
SIG ET GESTION DES DECHETS SOLIDES A OUAGADOUGOU: CAS DU
SECTEUR 30 DE L'ARRONDISSEMENT DE BOGODOGO
|
|
KOLANI
Industriels
Présenté par :
IDANI Bapandi Donatien
Sous la Direction de :
MEUNIER Aude/ NIKIEMA, Docteur en Géographie de
la Santé, Chargée de Recherche à
l'Institut des
Sciences des Sociétés (INSS/CNRST)
Bandékni Pakidame, Ingénieur du
Génie de l'Environnement, Manager des Risques et Environnementaux, Chef
du Projet Stratégie de Réduction des Déchets
de
Ouagadougou (PSRDO)
Année académique 2009-2010
|
|
DEDICACES

A la mémoire de ma tante THANOU née IDANI Fatimata
rappelée à Dieu le lundi 22 décembre 2009. Que son
âme repose en paix
A mon père IDANI Boama Boniface qui m'a toujours
encouragé d'aller de l'avant. Sa patience et son dévouement pour
ma cause m'ont permis de poursuivre mes études sans crainte.
A ma mère OUALY Joséphine, toi qui m'a appris
à marcher, toi qui a été patiente et endurante pendant mes
longues années d'études ;
A mes oncles Oumarou IDANI et Talaridia Fulgence IDANI vous qui
avez su m'orienter, me guider et me conseiller tout le long de mon cycle
universitaire
A mes frères et soeurs Eugénie, Caroline,
Honoré et Benjamin, je dédis entièrement ce présent
mémoire.
REMERCIEMENTS
A la fin de cette oeuvre, nous tenons à signifier toute
notre gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de
près ou de loin à notre formation. Nous tenons à remercier
particulièrement :
> Monsieur ZOUNGRANA Tanga Pierre et le corps professoral du
Master SIG pour la qualité de la formation reçue ;
> La commune de Ouagadougou et le CREPA pour nous avoir
accueilli au sein de leur institution et fourni de bonnes conditions de travail
;
> Madame Aude NIKIEMA, qui malgré son emploi de temps
chargé, a bien voulu nous accompagner dans le présent projet;
> Monsieur Pakidame Bandékni KOLANI, chef du projet
déchet, notre maitre de stage pour ses suggestions et son soutien pour
la production du document;
> Madame Léocadie BOUDA, coordonatrice
sectorielle-CREPA du PSRDO, Messieurs Cyrille AMEGNAN et Yeni YARO au CREPA,
tout le personnel du PSRDO et de la Direction de la Propreté, pour avoir
permis que notre stage se passe dans les meilleurs conditions et pour n'avoir
ménagé aucun effort pour nous 'intégrer dans leur
équipe et nous faire bénéficier de leurs avis et
conseils
> Toutes les associations de pré-collecte du secteur 30
pour leur constante disponibilité
> Rodrigue BICABA, Ousmane BARRY, Eric MILLOGO,
Jean-René BATIONO, Constant Yiyé Bazié et Sarata Laurence
NIKIEMA pour nous avoir aidé et soutenu tout au long de la campagne de
collecte des données et de la rédaction de ce document.
> Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont
oeuvré à la réalisation de ce document et que je n'ai pas
pu citer. Nous n'oublions pas nos camarades du master professionnel SIG avec
qui nous avons passé deux années de difficultés et de
joies.
SOMMAIRE
DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
SOMMAIRE iv
LISTE DES CARTES v
LISTE DES FIGURES vi
LISTE DES TABLEAUX vii
SIGLES ET ABREVIATIONS viii
RESUME ix
INTRODUCTION GENERALE 10
PREMIERE PARTIE : PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DES DECHETS SOLIDES
A OUAGADOUGOU 14
CHAPITRE I: DU CONTEXTE A LA METHODOLOGIE 15
CHAPITRE II : DE L'ETUDE DU MILIEU A LA PRESENTATION DE LA
FILIERE DECHETS 30
CONCLUSION PARTIELLE 45
DEUXIEME PARTIE : APPLICATION DU SIG A LA GESTION DES ORDURES
MENAGERES 46
CHAPITRE III: MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNEES A REFERENCE
SPATIALE POUR LA GESTION DES ORDURES MENAGERES DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU
47
CHAPITRE IV: ANALYSE DE LA GESTION DES DECHETS ET
PERSPECTIVES 59
CONCLUSION PARTIELLE 87
CONCLUSION GENERALE 88
BIBLIOGRAPHIE 90
ANNEXES 95
TABLE DES MATIERES 100
LISTE DES CARTES
Carte 1 : Présentation de la commune de Ouagadougou 31
Carte 2 : Présentation de l'arrondissement de Bogodogo
35
Carte 3 : Présentation de la filière déchet
38
Carte 4: Localisation géographique du PSRDO/CER et de son
champ d'action 41
Carte 5 : Répartition spatiale des sièges des
opérateurs de pré-collecte oeuvrant au secteur 30 60
Carte 6 : Répartition spatiale des abonnés de
Cosalu et de Sougre-Nooma 64
Carte 7 : Répartition spatiale des abonnés au
service de pré-collecte des déchets en fonction de l'unité
d'occupation 66
Carte 8 : Circuit hebdomadaire de collecte des déchets de
l'association Cosalu 68
Carte 9 : Circuit hebdomadaire de collecte des déchets de
l'association Sougre-Nooma 69
Carte 10 : Proposition de circuits de collecte à
l'intention de l'association Cosalu 71
Carte 11 : Proposition de circuits de collecte à
l'intention de l'association Sougre-Nooma 72
Carte 12 : Distribution spatiale des abonnés de
l'association Sougre-Nooma en fonction de l'état de leur(s) poubelle(s)
74
Carte 13 : Distribution spatiale des abonnés de
l'association Cosalu en fonction de l'état de leur(s) poubelle(s) 75
Carte 14: Les dépotoirs ou points de regroupement des
déchets 77
Carte 15: Circuits de transfert des déchets
ménagers des abonnés de Cosalu et Sougre-Nooma au niveau des
points de regroupement des déchets 80
Carte 16 : Proposition de sites pour l'implantation de nouveaux
centres de collecte 83
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Les résultats atteints à l'issue de la
phase de collecte des données 24
Figure 2 : Exemple du formalisme entité- relation
utilisé pour le schéma conceptuel de la BD 51
Figure 3 : Modèle Conceptuel de donnée 53
Figure 4 : Menu Général de la Base de
données 54
Figure 5 : Menu de la base de donnée 55
Figure 6 : Masque de saisie pour les points de regroupement des
déchets 55
Figure 7 : Masque de saisie pour les nouveaux abonnés
56
Figure 8: Fiche de consultation des données concernant les
abonnés 56
Figure 9 : Taux d'abonnement au service de pré-collecte
d'ordures ménagères 61
Figure 10 : Profil socio-économique des abonnés au
service de pré-collecte des déchets 63
Figure 11: Les abonnés des associations Sougr-Nooma et
Cosalu en fonction de l'unité d'occupation
65
Figure 12: Appréciation du montant de la redevance 73
Figure 13: Niveau de satisfaction de la prestation 73
Figure 14: Etat de la poubelle des abonnés de Cosalu et de
Sougre-Nooma 73
Figure 15: Taux de déchets théoriques
acheminés vers les centres de collecte et dépotoirs sauvages
79
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Les associations de pré-collecte des ordures
ménagères du secteur 30 et leurs clients. 23
Tableau 2 : Grille conceptuelle 26
Tableau 3: Exemple de résultat d'analyse des
données de la base de données 57
Tableau 4 : Les associations collectrices de déchets
solides opérant au secteur 30 59
Tableau 5 : Quantité de déchets théoriques
acheminée dans les dépotoirs 78
SIGLES ET ABREVIATIONS
BD : Base de données
CNRST : Centre National de la Recherche
Scientifique et Technologique CREPA : Centre Régional
pour l'Eau Potable et l'Assainissement à faible coût
CTVD : Centre de Traitement et de Valorisation
des Déchets
DINASENE : Direction Nationale des Services
d'Entretien de Nettoyage et d'Embellissement DP : Direction de
la Propreté
EBTE : Entreprise Burkinabè des Travaux
et d'Equipement ECHA : Entreprise de Construction et de
l'Habitat
GIE : Groupement d'Intérêt
Economique
M.A.H.R.H : Ministère de l'Agriculture,
de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques MECV :
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie
ONASENE : Office Nationale des Services
d'Entretien de Nettoyage et d'Embellissement ONEA : Office
National de l'Eau et de l'Assainissement
PSAO : Plan Stratégique d'Assainissement
de la ville de Ouagadougou PSNA : Politique et
Stratégie Nationales d'Assainissement
PSRDO-CER : Projet Stratégie de
Réduction des Déchets de Ouagadougou par des actions de
collecte de tri et de valorisation- Création d' Emploi et
de Revenu RGPH : Recensement Général de la
Population et de l'Habitat SDGD : Schéma Directeur de
Gestion des Déchets
SIG : Système d'Information
Géographique
RESUME
La ville de Ouagadougou connaît une forte croissance
démographique accompagnée d'une extension spatiale mal
maîtrisée. En outre, le profil économique d'une part
importante de la population est marqué par une forte pauvreté qui
explique en partie les difficultés d'accès aux services
essentiels de base, en particulier celui de l'assainissement individuel
notamment dans les quartiers périphériques de la ville.
La présente étude porte sur les applications de
la géomatique à la gestion des déchets solides. Elle a
permis de mettre en place une base de données à
référence spatiale sur la gestion des déchets solides
à l'échelle du secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo. Cette
dernière regroupe diverses informations concernant les opérateurs
de pré-collecte des déchets, les abonnés à ce
service, les points de regroupement des déchets présents dans le
secteur.
L'analyse du dispositif officiel de gestion des déchets
existant dans ce secteur a permis de mettre en évidence le faible taux
d'abonnement (seulement 15%) au service de pré-collecte de
déchets ; les non abonnés, s'ils ne font pas appel au service des
informels pour se débarrasser de leurs déchets, vont eux
mêmes les déposer dans les centres de collecte ou les
dépotoirs sauvages créés spontanément notamment sur
les terrains non occupés de la ville.
L'analyse de la distribution spatiale des abonnés au
service de pré-collecte des déchets et des circuits de collecte
révèle que la répartition des abonnés dans l'aire
géographique est fonction de l'opportunité offerte aux
opérateurs d'avoir de nouveaux abonnés. Une grande partie de ces
abonnés, satisfaits de la prestation de leurs opérateurs ne
dispose toujours pas d'installations adéquates (poubelles) pour la
gestion de leurs déchets domestiques.
L'évaluation des quantités théoriques de
déchets transportés au niveau des points de regroupement des
déchets montre que seulement 10 % des déchets collectés
par les opérateurs de pré-collecte des déchets vont vers
un centre de collecte des déchets contre 90% vers les dépotoirs
sauvages.
Mots-clés : SIG, gestion des déchets,
opérateurs de pré-collecte, abonnés au service de
pré
collecte, centre de collecte, dépotoirs sauvages,
arrondissement de Bogodogo, secteur 30.
INTRODUCTION GENERALE
L'urbanisation est un phénomène universel qui a
connu une accélération particulière dans les pays en voie
de développement et principalement en Afrique. A ce propos, Dominique
Moro (1998) note que la population totale de l'Afrique a plus que triplé
entre 1950 et 1997 pendant que celle des villes a été
multipliée par 11, passant de 22 à 250 millions. Selon les
projections des Nations Unies, plus d'un africain sur deux vivra en ville en
2020. Cette forte urbanisation essentiellement due à un accroissement
naturel soutenu dans les villes (le taux de fécondité demeure
élevé en milieu urbain du fait de la surreprésentation des
jeunes adultes) et à un exode rural massif est source de divers
problèmes de gestion urbaine. En effet, les économies urbaines
offrent désormais de moins en moins d'emplois alors que la demande est
de plus en plus forte. Au début des années 90, le Bureau
International du Travail (BIT) mentionnait que les villes africaines comptaient
9 millions de sans-emploi officiels ; en 1998, le nombre est passé
à 28 millions. Il en résulte un ébranlement des
mécanismes socio- organisationnels. On assiste à la
création de zones d'habitation non structurées (bidonvilles et
zones non loties) en périphérie. Cette consommation de l'espace
résulte à la fois d'extensions illégales (habitat
précaire, bidonvilles construits par les nouveaux habitants), mais
également des formes dominantes d'habitat à l'horizontal. Selon
le rapport du Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA 2010), 72% de la
population urbaine de l'Afrique au sud du Sahara, vit dans des bidonvilles.
Malgré les efforts des pouvoirs publics, les
infrastructures et les équipements en matière d'eau potable et
d'assainissement n'ont pas suivi l'accroissement des villes. On constate une
détérioration du cadre et des conditions de vie des populations.
Pendant que l'accès à l'eau devient problématique, les
déchets s'entassent dans les quartiers nouvellement construits ou non
lotis. La mauvaise gestion de ces déchets, une des principales causes de
pollution dans la quasi-totalité des villes des pays du sud a des
conséquences graves en termes de risques sanitaires (lieu de
reproduction de moustiques, de prolifération de rats), d'impact
environnemental (apparence, odeurs, pollution de l'eau et de l'air), de
toxicité (notamment pour les déchets médicaux et les
métaux lourds), d'impact social (pour les personnes vivant à
proximité, et pour les personnes vivant de la récupération
des déchets) et d'infrastructure (les déchets non
collectés bloquent les canaux et les voies d'accès). Selon
l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS 2007) environ un quart des maladies
affectant l`humanité sont attribuables à l'exposition
prolongée à la pollution environnementale avec en première
ligne les enfants, plus vulnérables que des adultes. Dans les pays en
voie de développement, 25% des décès sont liés aux
facteurs environnementaux comparés à 17% des décès
dans le monde développé. Les maladies répandues ainsi,
comprennent le choléra, la typhoïde, la schistosomiase,
l'hépatite infectieuse et la polio.
Les conséquences de ce phénomène sont
particulièrement visibles au Burkina Faso, pays enclavé
situé au coeur de l'Afrique de l'ouest dont la capitale Ouagadougou a
connu une urbanisation galopante (85% durant la période 1996-2006)
occasionnant l'absorption progressive des petits villages rattachés
à ses arrondissements.
Cet accroissement de la population expose la ville à
des problèmes majeurs de santé, de détérioration de
l'environnement et de gestion des déchets solides liquides et gazeux.
Sur le plan sanitaire, on note que 50% des motifs de consultation dans les
formations sanitaires en 2001 étaient liés essentiellement
à trois pathologies : le paludisme, les infections respiratoires
aigües et les maladies diarrhéiques. La méningite et surtout
le choléra (infection liée au manque d'hygiène publique)
sévissent sous forme d'épidémie.
Pour ce qui concerne les problèmes de gestion des
déchets et de détérioration de l'environnement, sur les
quelques 300 000 tonnes (PSRDO 2009) annuellement générées
par la ville, les services techniques municipaux n'en évacuent qu'un peu
plus de 50 % vers le centre de stockage, dénommé « Centre de
traitement et de Valorisation des Déchets » (CTVD)
créé sur financement Banque Mondiale. Les coûts de
transport et de mise en décharge reviennent excessivement chers et
grèvent dangereusement le budget de la ville.
Les associations de collecte qui se sont regroupées
pour assainir les quartiers se trouvent confrontées à la
nécessité d'agir sans bénéficier de moyens et de
revenus suffisants. Ce phénomène est encore plus visible dans les
quartiers périphériques défavorisés, ayant des
difficultés d'accès aux services de base. Une grande partie de la
population de ces quartiers, compte tenu de sa pauvreté, ne peut
régler la redevance d'enlèvement de ses déchets à
domicile.
A titre illustratif, dans les secteurs n° 20, 21, 22 et
30 de Ouagadougou, les déchets non collectés sont rejetés
de manière sauvage dans les rues, dans les caniveaux, dans d'anciennes
carrières, incinérés par les habitants ou
déversés tels quels comme engrais dans les champs à la
demande d'agriculteurs, entraînant de ce fait une dispersion de
très nombreux sachets plastiques (utilisés comme emballages) et
de divers déchets toxiques comme les piles. Aussi, la mise en
décharge pose de sérieux problèmes environnementaux. Au
Centre de Valorisation et de Traitement des Déchets (CVTD), les
déchets verts et fermentescibles stockés produisent trop de
méthane. L'inquiétude de la mairie est que ce gaz s'enflamme et
que les incendies provoqués, alimentés par l'importante masse de
sachets plastiques et les pneus n'ayant pas été
préalablement triés produisent des fumées toxiques,
difficiles à maîtriser et pouvant entraîner des
conséquences extrêmement graves pour la santé des habitants
et l'environnement urbain. Cet excès de pollution entraîne un
mécontentement des populations, qui, souvent, motivent leur refus
d'adhérer à la filière de collecte et d'en payer la
redevance, menaçant, d'une part, la pérennité du
système et, d'autre part, la cohésion sociale du quartier.
Les processus de décentralisation ont renforcé
les pouvoirs et les responsabilités de la commune de Ouagadougou et
créé une « nouvelle donne » urbaine, qui implique la
mise en place de modes de gestion renouvelés, comme la privatisation de
certains services ou la prise en compte accrue de la société
civile à travers des processus de type « gouvernance ». Les
réformes de gestion des déchets dans cette ville, d'abord
techniques possèdent également une dimension politique forte
puisqu'elles interrogent sur la capacité des municipalités
à contrôler leur territoire et à répondre aux
demandes des acteurs internationaux et gouvernementaux (QUENOT H., 2010). Les
outils de spatialisation de l'information sont dans ce contexte d'une grande
utilité pour les collectivités dans leur quête continue de
trouver des solutions novatrices les plus économiques aux
différents problèmes urbains.
En effet, les technologies spatiales, et de façon plus
particulière les systèmes d'observation de la Terre, constituent
désormais des outils incontournables dans la problématique du
développement durable qui vise à permettre à tout
être humain de satisfaire ses besoins fondamentaux tout en
préservant son environnement. La géomatique, par ses fonctions
fondamentales d'acquisition, de stockage, de traitement, de production et de
diffusion de l'information à référence spatiale, contribue
à la recherche de cette solution globale. Les données à
référence spatiale (DRS) acquises et traitées avec des
méthodes des plus simples
aux plus complexes sur des stations informatiques de plus en
plus puissantes (rapidité, capacité de stockage et traitement)
aident à la prise de décision, à la planification et
à la gestion dans un environnement de résolution de
problème. La planification implique plusieurs décisions prises
à partir de choix qui nécessitent des informations
géographiques. Les SIG rendent possible la représentation d'une
multitude d'informations simultanément et constitue un outil de
visualisation parfait afin de faciliter les interprétations.
Ce mémoire intitulé « SIG et
gestion des déchets à Ouagadougou : Cas du secteur 30 de
l'arrondissement de Bogodogo» s'inscrit dans cette logique. Il
est structuré en deux parties distinctes. La première partie
aborde le contexte, la méthodologie de l'étude, et la
présentation de la filière déchets solide à
Ouagadougou. La deuxième partie quant à elle présente les
étapes d'élaboration d'une base de données
géoreferencée (SIG) sur la gestion des ordures
ménagères au secteur 30 avant de faire une analyse de la gestion
actuelle des déchets avec les outils ainsi mis en place.
PREMIERE PARTIE : PROBLEMATIQUE DE LA GESTION
DES DECHETS
SOLIDES A OUAGADOUGOU
La gestion des déchets ménagers n'est pas une
activité récente, cependant, en Europe et plus
particulièrement en France, elle a pris une nouvelle image
récemment avec la disparition des corps de métiers
spécialisés dans la collecte des objets jetés par les
populations urbaines. Ce que S. Barles (2005) nomme l'invention des
déchets urbains est apparu progressivement à mesure que l'objet
jeté n'avait plus de fonction et devenait alors encombrant. Cette partie
est donc consacrée à la justification du problème et
à la définition des objectifs dans un pays dit en
développement dont la protection de l'environnement ne constitue pas une
priorité malgré les efforts accomplis dans ce domaine.
CHAPITRE I: DU CONTEXTE A LA METHODOLOGIE
Ce chapitre traite en cinq sections la problématique de
la gestion des déchets dans une métropole africaine, la ville de
Ouagadougou en l'occurrence. Il s'agit du contexte et de la justification, des
objectifs, des hypothèses, de la définition des concepts, ainsi
que de l'approche méthodologique de la présente étude
intitulée : « SIG et gestion des déchets solides à
Ouagadougou : Cas du secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo ».
1.1. Le contexte et la justification de
l'étude
Si les déchets constituent aujourd'hui un
problème majeur en milieu urbain, cette perception est relativement
récente. S. Barles (2005) montre que longtemps les ordures issues des
activités humaines, quelles soient ménagères ou
liées aux activités économiques, ont constitué un
bien monnayable. Ainsi, beaucoup de petits métiers, comme les
chiffonniers, existaient grâce à la présence de ce que l'on
n'appelait pas encore déchets. A l'instar de la capitale
française, Ouagadougou à l'arrivée des explorateurs
donnait une image considérée insalubre au regard des perceptions
d'aujourd'hui. Ainsi, le capitaine Binger décrivait Ouagadougou en ces
termes lors de son passage en 1892 : Je m'attendais à trouver
quelque chose de mieux que ce qu'on voit d'ordinaire comme résidence
royale dans le Soudan, car partout on m'avait vanté la richesse du Naba,
le nombre de ses femmes et de ses eunuques. Je ne tardai pas à
être fixé, car le soir même de mon arrivée, je
m'aperçus que ce que l'on est convenu d'appeler palais et sérail
n'est autre chose qu'un groupe de misérables cases entourées de
tas d'ordures autour desquelles se trouvent des paillotes servant
d'écuries et de logements pour les captifs et les griots.
A l'époque, ce qui est considéré comme un
dépotoir par le colonisateur sert de fumure dans les champs de case. Y.
Déverin Kouanda (1993) dans sa thèse portant sur la
représentation et la gestion de l'environnement en pays mosse
explique la place du Taampure (tas d'ordures).
Les déchets jouent un rôle important. Il s'agit
d'objets considérés sans déchéance, qui ont
toujours une utilité sous une forme ou sous une autre (L.
Albigès, 2007). L'excrément animal, la matière
végétale ont une destination finale pour l'agriculture ou
l'élevage. Le « taampure » constitue également une
sorte de jalon marquant la limite entre le domaine familial et
l'extérieur (J. Etienne, 2004).
L'arrivée des colonisateurs impose un modèle
urbain calqué sur un plan géométrique. Désormais,
à l'habitat dispersé succède la concentration de la
population sur de petits espaces (les parcelles). Or, en pays mossi, la
dispersion de l'habitat allait, jusqu'à présent, de pair avec le
tas d'ordures proches de la cour qui devient alors objet de
désagrément concomitant aux changements de modes de vie (Y.
Deverin-Kouanda, 1993).
Les décennies suivantes ont confirmé la
difficile gestion des ordures ménagères. La croissance urbaine
mal maîtrisée par les autorités municipales a
contribué à la multiplication des déchets à travers
la ville et particulièrement en périphérie.
En 2004, sous l'égide du bureau d'étude canadien
DESSAU-SOPRIN, un Schéma Directeur de Gestion des Déchets (SDGD)
était mis en place. L'objectif principal était d'améliorer
la collecte des déchets ménagers notamment par la mise en place
de centres de pré-collecte (au nombre de trente cinq) et d'un centre
d'enfouissement technique implanté en périphérie nord de
la capitale. Par ailleurs, la ville était découpée en 12
zones dont la gestion était attribuée à des entrepreneurs
privés ou des Groupements d'Intérêt Economique (GIE).
Il est rapidement apparu qu'une partie des déchets
collectés pouvaient faire l'objet d'une valorisation contribuant d'une
part à une diminution des tonnages enfouis au CTVD dont le site de
regroupement des déchets est prévu pour durer 10 ans, et d'autre
part, à la création d'activités génératrices
de revenus.
Le Projet Stratégie de Réduction des
Déchets Solides de Ouagadougou -Création d'emploi par des actions
de collecte, de tri et de valorisation (PSRDO-CER) a été
créé en 2009 comme un élément de réponse
à ces observations.
Ce projet, initié par la commune de Ouagadougou en
collaboration avec l'Initiative Développement Stratégique
(Organisation Non Gouvernementale de solidarité et de coopération
internationale basée en France), la Communauté Urbaine de Lyon
(France), le Centre Régional pour l'Eau Potable et l'Assainissement
à faible coût (Institution Inter-états regroupant 17 pays
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre dont le siège est basé
à Ouagadougou au Burkina Faso) et l'Association de Volontariat et de
Coopération Internationale (LVIA Italie), se propose de contribuer
à donner une plus value aux déchets en les valorisant. Il s'agit
également de participer à la réduction de la
pauvreté, tout en participant à assainir les quartiers,
grâce à l'implication des ménages et des opérateurs
économiques, producteurs de
déchets et à la mobilisation des associations de
quartier impliquées dans la filière de collecte et de traitement
des déchets.
Afin de préciser et de tester la méthodologie,
le projet se limite à deux zones d'intervention : la zone de
pré-collecte 12 qui regroupe les secteurs 20, 21 et 22 (arrondissement
de SigNonghin) et la zone de pré-collecte 6 qui est composée en
partie du secteur 30 (arrondissement de Bogodogo). Ces zones concernent des
quartiers périphériques défavorisés,
caractérisés par un déficit d'accès aux services
sociaux de base et qui sont l'objet d'une restructuration en cours dans le
cadre du projet « Projet de désenclavement des quartiers
périphériques de Ouagadougou et d'accès aux services
essentiels », sur financement de l'Agence Française de
Développement (AFD).
Les premières activités du PSRDO-CER ont
porté sur la connaissance précise de l'existant en matière
de gestion des déchets (contexte, opérations engagées,
producteurs de déchets, etc.), des éléments indispensables
à une meilleure planification des actions futures. Cette étude
s'inscrit dans cette étape préliminaire. Elle pose l'application
SIG comme un outil susceptible de participer à une meilleure
connaissance des pratiques actuelles. Ce travail pose la double contrainte
cadre universitaire et professionnel et impose donc une obligation de
résultats appliqués dans un cadre conceptuel tourné vers
la recherche fondamentale.
1.2. Les objectifs
L'objectif principal de cette étude est de créer
une base de données spatialisées, donc gérée sous
SIG, dont le but est l'optimisation des circuits de collecte des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) et des Groupement d'Intérêt Economiques
(GIE) oeuvrant dans le secteur de la collecte des déchets. Il s'agit
également de capitaliser les informations disponibles en vue de mieux
suivre et évaluer les performances des actions qui seront menées
dans le cadre du (PSRDO- CER) et concernant le volet collecte des
déchets organisé par la Municipalité. Le secteur 30 de
l'arrondissement de Bogodogo constitue le cadre de l'étude.
Quatre objectifs spécifiques sont fixés :
- identifier les acteurs de la gestion des déchets ;
- définir l'utilité d'un SIG ainsi que des
indicateurs d'analyse spatiale pour la gestion des ordures
ménagères ;
- cartographier le siège des associations de collecte
des déchets, les abonnés aux services de pré-collecte des
déchets du secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo, et les circuits
des collecteurs ;
- identifier les types de points de regroupement des
déchets utilisés par les opérateurs de précollecte
du secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo et déterminer les
quantités théoriques de déchets qui y sont
transférés.
1.3. Les hypothèses
Dans l'optique d'améliorer nos connaissances sur la
gestion des déchets solides dans la
ville de Ouagadougou, nous posons l'hypothèse
principale que le SIG constitue un outil efficace de capitalisation, d'aide
à la décision et de suivi-évaluation des actions en
matière de gestion des déchets ménagers.
De cette hypothèse principale, découlent quatre
hypothèses spécifiques :
- les acteurs intervenant dans la gestion des déchets
solides à Ouagadougou sont clairement identifiés et
catégorisés ; chacun d'eux jouant un rôle bien
déterminé dans le cycle de gestion des déchets ;
- le SIG est un outil qu'on peut appliquer à la gestion
des ordures ménagères ;
- la répartition spatiale des abonnés par
opérateurs de pré-collecte des déchets au secteur 30 de
l'arrondissement de Bogodogo repose sur une logique territoriale ;
- les centres de collecte du secteur 30 de l'arrondissement de
Bogodogo, tous fonctionnels constituent les points de regroupement
privilégiés de la quasi-totalité des déchets
collectés dans le secteur.
1.4. La définition des concepts
Cette partie donne une définition des mots et termes
consacrés que nous avons utilisés dans ce rapport. Le lecteur
pourra donc aborder dans les chapitres suivants le vocabulaire avec plus de
facilité.
Base de données: C'est un
ensemble de données qui correspond à une représentation
fidèle des données d'un domaine avec un minimum de contraintes
imposés par le matériel. C'est donc une entité dans
laquelle, il est possible de stocker des données de façon
structurée, exhaustive et sans redondance.
Déchets : Il existe plusieurs
définitions du terme « déchets » ; cependant pour les
besoins de cette étude, nous retiendrons celles relatives à la
loi française du 15 juillet 1975 et aux conventions de Bâle et de
Bamako.
Selon la loi française du 15 juillet 1975, un
déchet est tout résidu d'un processus de production, de
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou
tout généralement tout bien meuble abandonné ou que son
détenteur destine à l'abandon. Ce sont les mêmes termes qui
ont été retenus pour définir les déchets dans le
code de l'environnement burkinabé.
Les conventions de Bâle et de Bamako entendent par
« déchet », des substances ou objets, qu'on élimine,
qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en
vertu des dispositions du droit national.
En toute logique, on englobe sous terme « déchets
» tous les déchets solides, liquides et gazeux qui ont un impact
négatif sur l'environnement. Les déchets solides étant des
matériaux mis au rebut et qui ne sont pas évacués par le
biais de canalisations comme les eaux usées et les boues.
Gestion des déchets : C'est
la collecte, le transport, le traitement (le traitement de rebut), la
réutilisation ou l'élimination des déchets, habituellement
ceux produits par l'activité humaine, afin de réduire leurs
effets sur la santé humaine, l'environnement, l'esthétique ou
l'agrément local. C'est un processus qui intègre à la fois
la production des déchets et leur traitement. La production correspond
aux choix des produits à la source, à leur utilisation, à
leur valorisation. Le traitement correspond au tri des déchets, à
leur collecte, au transport, et au traitement et/ou le stockage des
déchets.
La gestion des déchets concerne tous les types de
déchets, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, chacun
possédant sa filière spécifique. Les manières de
gérer les déchets diffèrent selon qu'on se trouve dans un
pays développé ou en voie de développement, dans une ville
ou dans une zone rurale, que l'on ait affaire à un particulier, un
industriel ou un commerçant. La gestion des déchets non toxiques
pour les particuliers ou les institutions dans les agglomérations est
habituellement sous la responsabilité des autorités locales,
alors que la gestion des déchets des industriels est sous leur propre
responsabilité.
Recyclage : C'est un
procédé par lequel les matériaux qui composent un produit
en fin de vie (généralement des déchets industriels ou
ménagers) sont réutilisés en tout ou en partie. Pour la
plupart des gens dans les pays développés, le recyclage regroupe
la récupération et la réutilisation des divers
déchets ménagers. Ceux-ci sont collectés et triés
en différentes catégories pour que les matières
premières qui les composent soient réutilisées.
Système d'Information Géographique
(SIG) : Les Systèmes d'Information
Géographiques, nés dans les années 60 au Canada, ont
été définis par plusieurs auteurs. Selon la
Société française de Photogrammétrie et de
télédétection (1989) les SIG sont : «Un
système informatique permettant, à partir de diverses sources, de
rassembler et d'organiser, de gérer, d'analyser et de combiner,
d'élaborer et de présenter des informations localisées
géographiquement (géoréférencées)
».
Selon R Randremanana et al. (2001), un SIG peut
être défini comme « Un ensemble de données de
nature diverse, structurées de façon à être
gérées facilement et dont le point commun est d'être
géoréférencées, c'est-à-dire être
repérées dans l'espace, à l'aide de coordonnées
géographiques. »
Nous retiendrons pour les besoins de notre étude la
définition de P Givaudan (2009) pour qui les Systèmes
d'Information Géographiques « associent des composantes
matérielles, logicielles et humaines afin de définir et
décrire un espace géographique, de le connaître, de le
gérer et de prendre des décisions le concernant.
».C'est un ensemble de données repérées dans
l'espace structurées de façon à pouvoir en extraire
commodément des synthèses utiles à la décision.
Valorisation des déchets : Elle
consiste dans " le réemploi, le recyclage ou toute autre action visant
à obtenir, à partir de déchets, des matériaux
réutilisables ou de l'énergie". C'est
l'objectif des politiques de gestion des déchets, en plus
de la prévention. Deux types de valorisation sont retenus : la
valorisation matière et la valorisation énergétique.
1.5. L'approche méthodologique
Elle a consisté à rechercher la documentation
sur la gestion des déchets solides dans les pays en développement
et plus particulièrement au Burkina Faso. Les principales sources de
documentation ont été le Centre Régional pour l'Eau
Potable et l'Assainissement à faible coût (CREPA siège),
l'Université de Ouagadougou, ainsi que la mairie de la ville de
Ouagadougou.
La revue de la littérature relative à la gestion
des déchets en milieu urbain comme à Ouagadougou est riche.
Toutefois, nous avons privilégié 4 documents qui constituent des
axes de recherche en réponse aux objectifs posés lors de notre
stage.
DESSAU-SOPRIN, SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES DECHETS
DE OUAGADOUGOU (2000) propose une organisation intégrée
de toutes les activités reliées à la gestion des
déchets et des aménagements appropriés. Il fournit
également les cadres financier, institutionnel et réglementaire
propres à assurer la gestion efficace des déchets selon le
concept de quartier propre qui a été préalablement
établi dans un plan d'action devant permettre au Gouvernement du Burkina
Faso d'atteindre les objectifs reliés à la gestion des
déchets solides et assignés par le vaste projet d'environnement
urbain, soit le 3ème Projet de Développement Urbain
(PDU) sous la responsabilité du Projet d'Amélioration des
Conditions de Vie Urbaines (PACVU).
MAS.S, VOGLER.C. (2006) dans le cadre d'un
stage réalisé au CREPA ont réalisé un état
des lieux des transformations des déchets solides de la ville de
Ouagadougou et recensé les filières de valorisation. Il ressort
de cette étude que, la mise en oeuvre progressive du schéma
directeur de gestion des déchets porte ses fruits bien que certaines
difficultés sont observées au niveau de la pré-collecte et
de l'évacuation des déchets.
NIKIEMA/Meunier. A (2007) s'est
intéressée à la gestion des déchets à
travers une analyse
essentiellement descriptive des pratiques
déclarées par les chefs de ménages lors du
Recensement
Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 1996. De cette
analyse, il
ressort que les comportements en matière
d'élimination des déchets se traduisent par une opposition
spatiale centre périphérie. En effet, dans les quartiers
centraux, la majorité des ménages utilisait à cette
époque les bacs mis à leur disposition. Dans l'auréole
péricentrale hétérogène cohabitent des
ménages convertis à l'utilisation de poubelles avec d'autres
évacuants encore simplement leurs déchets dans la rue. Certains
quartiers comme les 1200 logements, la zone du bois, la patte d'oie et plus
ponctuellement ceux ou sont implantés les cités de la
période révolutionnaire s'individualisent par leur abonnement
à un service privé de ramassage des ordures. Dans la
périphérie, on observe un mode d'évacuation dans la rue
s'apparentant aux pratiques villageoises fondées sur le rejet des
ordures ménagères à l'extérieur de la cour.
SCHERRER M. (2007) à partir d'une
étude réalisée à Ouahigouya (Burkina Faso) a
élaboré une base de données (BD) et un Système
d'Information Géographique (SIG) contenant des informations relative
à la gestion des déchets de la ville et permettant
d'évaluer les performances du système mis en place.
La base de données, créée avec le
logiciel Access, regroupe diverses informations concernant les
opérateurs de pré-collecte des ordures ménagères,
les points de regroupement des déchets présents dans la ville, la
décharge, ainsi que la production de déchets de la population de
Ouahigouya. Quant au SIG, il a été réalisé avec le
logiciel Arc View. Il comporte différentes cartes thématiques
présentant les résultats d'analyse des données tels que le
taux d'abonnement au service pré- collecte des déchets,
différentes statistiques sur la population de Ouahigouya ou encore
l'état et la localisation des bacs publics.
Il convient toute fois de noter que, compte tenu du
délai imparti pour le travail, les outils mis en place n'ont pas
été totalement finalisés car signale l'auteur, toutes les
données nécessaires n'ont pas pu être obtenues. De ce fait,
plusieurs cartes thématiques n'ont pas pu être
créées car aucune information sur les abonnées n'a pu
être obtenue. Aussi, le géoréférencement
c'està-dire l'attribution des coordonnées géographiques
réelles aux éléments du SIG n'a pas été
possible à cause des raisons citées plus haut.
1.5.1. L'échantilonnage
Le secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo, zone
d'intervention du PSRDO-CER, a été retenu comme site
d'étude. Les activités ont porté sur le recensement des
associations collectrices de déchets, et des ménages
abonnés aux services de pré-collecte de la zone
d'étude.
Le tableau suivant dresse l'état des associations
opératrices de collecte des déchets de notre zone d'étude
et du nombre de leurs clients.
Tableau 1 : Les associations de
pré-collecte des ordures ménagères du secteur 30 et leurs
clients.
|
Numéro d'ordre
|
Nom de l'association
|
Nombre d'abonnés de l'association
|
|
1
|
Association Souto-Nooma
|
150
|
|
2
|
Association Sougre- Nooma
|
1268
|
|
3
|
Association Santé plus
|
417
|
|
4
|
Association Yilemdé
|
573
|
|
5
|
Association Cosalu
|
120
|
|
Totaux d'abonnés du secteur 30
|
2735
|
Source : PSRDO, Résultat d'enquête
Cinq opérateurs de pré-collecte de déchets
officiellement déclarés se partagent donc le territoire du
secteur 30. Ces derniers totalisent un nombre d'abonnés estimé
à 2735.
Nos activités devaient consister au
géoréférencement de l'ensemble des abonnés de la
zone. Or, il est rapidement apparu que le temps disponible pour cette
étude serait trop court pour finaliser les activités du
calendrier de travail. Un échantillon a donc été
défini sur la base des associations. Les associations Sougr-Nooma et
Cosalu représentant respectivement la plus grande association (avec un
nombre total d'abonné estimé à 1268) et la plus petite
association (avec un nombre total d'abonnés estimé à 120)
ont été retenues. Ce choix avait pour but de comparer les
différences de fonctionnement selon la taille de la structure. Ainsi,
nos travaux ont porté sur 1388 clients, soit un taux de couverture du
secteur 30 d'environ 51% (figure 1).
Figure 1 : Les résultats atteints à
l'issue de la phase de collecte des données
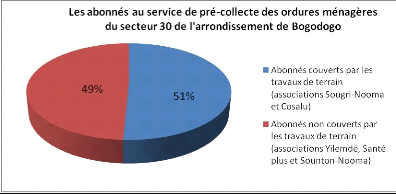
Source : PSRDO-CER, Résultat d'enquête
1.5.2. La collecte des données
Elle s'est appuyée sur différents outils.
Un guide d'entretien (cf. annexe 1) a été
adressé aux services municipaux ; cela dans le but d'obtenir de plus
amples informations sur les caractéristiques sociodémographiques
de la ville de Ouagadougou, de connaître le schéma d'organisation
de la filière déchets et le rôle de la commune dans la
gestion des ordures ménagères dans la ville de Ouagadougou.
Le relevé des coordonnées géographiques
des sièges des opérateurs de pré-collecte des
déchets solides, des abonnés aux services de pré-collecte
et des points de regroupement des déchets du secteur 30 a
été réalisé par Global Positioning System (GPS).
Des fiches d'identification étaient parallèlement remplies
à l'aide des propriétaires. Pour valider ces relevés, une
carte sur support papier était utilisée pour matérialiser
la position de l'abonné.
Un guide d'observation des points de regroupement des
déchets a permis de compléter le panel d'outils
utilisés.
D'une manière générale, les
enquêtes nous ont permis de recueillir des informations sur la gestion
des déchets solides, sur le profil sociodémographique et
économique des opérateurs de collecte et de leurs
clientèles, ainsi que sur les destinations desservies et la
répartition du marché de collecte entre les opérateurs.
1.5.3. Les variables de l'étude
Les variables d'études définissent les besoins
d'informations pour tester les hypothèses de notre travail. En
regroupant les objectifs spécifiques, les hypothèses, les
variables, la population cible et les outils de collecte, nous obtenons le
tableau suivant. Ce tableau est nommé : grille conceptuelle.
Tableau 2 : Grille conceptuelle
|
Objectifs spécifiques
|
Hypothèses
|
Variables
|
Population cible
|
Outils de collecte des données
|
Echelle d'observation
|
|
Identifier les acteurs de
|
Les acteurs
|
-Type et nombre d'acteurs
|
-Commune de
|
-Exploitation de
|
Secteur 30 de
|
|
la gestion des déchets
|
intervenant dans la
|
intervenant dans la filière
|
Ouagadougou
|
documents
|
l'arrondissement
|
|
dans la zone d'étude
|
gestion des déchets
|
déchets au secteur 30.
|
|
existants
|
de Bogodogo
|
|
solides à
|
|
-CREPA
|
|
|
|
|
-Types d'activités se
|
|
-Guide d'entretien
|
|
|
Ouagadougou sont
clairement
identifiés et catégorisés ; chacun
d'eux
jouant un rôle bien déterminé dans le cycle de gestion des
déchets.
|
rapportant à la gestion des
déchets solides dans
le
secteur 30 de Ouagadougou.
|
-Entreprise CGMED
-Les opérateurs de pré-
collecte
|
-Fiche d'identification
|
|
|
Objectifs spécifiques
|
Hypothèses
|
Variables
|
Population cible
|
Outils de collecte de données
|
Echelle d'observation
|
|
Définir l'utilité d'un SIG
ainsi que des
indicateurs
d'analyse spatiale pour
la gestion des ordures
ménagères.
|
Le SIG est un outil qu'on peut appliquer à la gestion
des ordures ménagères.
|
-Les fonctions du SIG
-Les avantages fournis par le SIG dans le domaine de la gestion
des déchets.
|
-CREPA
-Commune de
Ouagadougou
-Entreprise CGMED
|
- Exploitation de documents existants.
|
Commune de
Ouagadougou, secteur 30 de
l'arrondissement de Bogodogo.
|
|
|
|
-Les opérateurs de pré-
collecte
|
|
|
|
Cartographier le siège
|
La répartition
|
Le nombre d'abonnés au
|
-Commune de
|
-Guide d'entretien
|
Commune de
|
|
des associations de
collecte des déchets, les
abonnés aux services
de
|
spatiale des abonnés
par opérateurs de
pré-collecte des
|
service de pré collecte.
-La satisfaction des abonnés
par rapport à la
prestation
|
Ouagadougou -CREPA
|
-Fiche d'identification
|
Ouagadougou, secteur 30 de
l'arrondissement
|
|
pré-collecte des déchets
du secteur 30 de
l'arrondissement de
|
déchets au secteur 30
de l'arrondissement
de
Bogodogo repose
|
des opérateurs de pré-
collecte.
|
-Les opérateurs de pré-
collecte
|
-Relevé GPS
|
de Bogodogo.
|
|
Bogodogo, et les circuits des collecteurs.
|
sur une logique
territoriale.
|
-Les zones de couverture de chaque opérateur de
précollecte.
|
-Les abonnés au service de pré-collecte des
déchets.
|
|
|
|
Objectifs spécifiques
|
Hypothèses
|
Variables
|
Population cible
|
Outils de collecte de données
|
Echelle d'observation
|
|
identifier les types de
|
les centres de
|
- Les centres de pré-
|
-Direction de la Propreté
|
Exploitation de
|
Commune de
|
|
points de regroupement
|
collecte du secteur
|
collecte
|
-Projet PSRDO-CER
|
documents
|
Ouagadougou,
|
|
des déchets utilisés par
|
30 de
|
|
|
existants
|
secteur 30 de
|
|
|
- L'état des bacs publics et
|
|
|
|
|
les opérateurs de pré-
collecte du secteur 30 de
|
l'arrondissement de
Bogodogo, tous
|
des sites de transit.
|
--CREPA
|
-Guide d'entretien
|
l'arrondissement de Bogodogo
|
|
|
|
-Entreprise CGMED
|
|
|
|
l'arrondissement de
|
fonctionnels
|
-La couverture spatiale des
|
|
-Fiche
|
|
|
Bogodogo et déterminer
les quantités
théoriques
|
constituent les points
de regroupement
|
bacs publics et des sites de transit
|
-Les opérateurs de collecte
|
d'identification
|
|
|
de déchets qui y sont transférés.
|
privilégiés de la
quasi-totalité des
déchets collectés
dans le secteur.
|
-La fréquence de vidange des bacs et des sites de
transit.
|
-Les abonnés au service de pré-collecte des
déchets.
|
-Relevé GPS
--Guide d'observation
|
|
1.5.4. Les outils de traitement de
données
Le traitement des données collectées a
été effectué sous diverses formes :
- le transfert des données du GPS vers un fichier Excel a
été réalisé avec le logiciel GPS expert.
- Une base de données créée avec le
logiciel MS Access a regroupé les diverses informations concernant les
opérateurs de collecte des ordures ménagères, les
ménages abonnés à ce service, ainsi que les points de
regroupement des déchets dans ces secteurs.
- couplé à MS Access le logiciel SIG Arc View 3.2 a
été utilisé aussi bien pour des requêtes spatiales
que pour des représentations cartographiques.
De façon générale, il est à noter
que, les analyses ont été réalisées avec MS Excel,
MS Access, ArcView; cela suivant la nature des informations
recherchées.
1.5.5. Les difficultés
rencontrées
La réalisation de cette étude a été
jalonnée de nombreuses difficultés qui ont nui à
l'exhaustivité de la base de données. Ce sont :
- la réticence de certains enquêtés :
parler des pratiques d'assainissement n'est pas chose aisée car c'est
toucher à la vie privée des personnes. De ce fait, nous avons
été confrontés à la réticence voire au refus
de communication de certaines personnes ;
- les contraintes liées au climat : la campagne de
collecte de données s'est déroulée en saison chaude du 15
mars au 25 avril 2010. Compte tenu du temps disponible pour cette étude
et afin de recenser le maximum d'abonnés, les enquêtes
débutaient à 7h pour se terminer à 18h30, quelque soit le
jour de la semaine.
CHAPITRE II : DE L'ETUDE DU MILIEU A LA PRESENTATION
DE LA FILIERE DECHETS
Ce chapitre traite, en deux sections, des
généralités sur la gestion des déchets solides
à Ouagadougou. D'une part, il présente le milieu de
l'étude, d'autre part, l'historique et les acteurs de la gestion des
déchets.
2.1. Présentation du milieu de
l'étude
Le cadre général de notre étude est la
ville de Ouagadougou. Elle est située entre 12° 18 et 12° 36
de latitude nord et 1° 26 et 1° 36 de longitude ouest. Les limites
communales vont audelà de la limite urbanisée. En effet, les
limites de la commune se fondent sur celles de la province du Kadiogo. La
commune compte trente (30) secteurs urbains et dix-sept (17) villages
périphériques et est découpée administrativement en
cinq (05) arrondissements (cf. carte 1).
Carte 1 : Présentation de la commune de
Ouagadougou
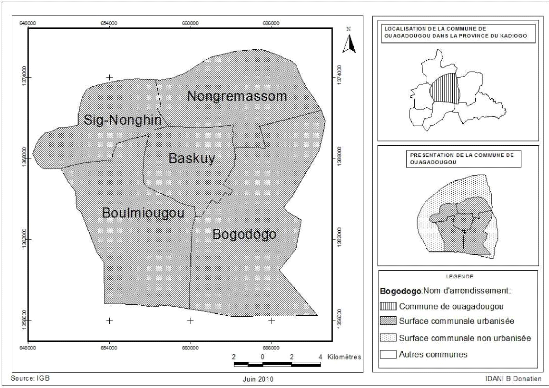
2.1.1. Influence des aspects physiques sur la gestion des
déchets
Le relief de la ville de Ouagadougou est monotone. Il est
constitué d'une vaste pénéplaine appelée couramment
« plateau mossi » qui correspond à l'affleurement du socle
granitogneissique ancien et qui occupe près de 85% de la superficie du
pays. Il s'élève à une altitude de 250 à 300
mètres (Kietiyeta, 2003). Cette platitude du relief rend plus facile la
collecte des ordures ménagères d'autant plus que la quasi
majorité des véhicules utilisés pour la collecte sont
à traction asine.
Sur le plan climatique, Ouagadougou est sous l'influence de la
zone soudanienne du climat tropical sec. La ville comme tout le reste du pays
connaît une saison pluvieuse qui dure de juin à septembre (4
mois), et une saison sèche d'environ huit mois, qui s'étend
d'octobre à mai. La pluviométrie moyenne annuelle se situe entre
700 et 900 millimètres avec 60% des précipitations qui se
concentrent entre juillet-août (Direction de la
météorologie nationale, 2003). Durant la période
hivernale, les acteurs de la filière déchets rencontrent divers
problèmes liés à la collecte et à
l'évacuation des ordures. Cela n'est pas sans conséquences. En
effet on peut noter des troubles environnementaux (nuisances olfactives chez
certains abonnés et aux alentours des dépotoirs) et des cas de
maladies (paludisme et bronchite notamment) chez les collecteurs de
déchets qui sont presque tout le temps contraints de braver la pluie
pour accomplir leur tache quotidienne.
Les températures sont sous l'influence des deux grandes
saisons. Pendant la saison des pluies, la température diurne est
d'environ 26°C. Elle atteint une moyenne de 42°C pendant la saison
sèche avec cependant, quelques fortes baisses au mois de décembre
-janvier (température minimale moyenne de 19°C). En termes de
gestion des déchets, il convient toutefois de noter que les fortes
températures ont une influence sur la décomposition
précoce de diverses matières dont celles organiques contenues
dans les déchets. Cela engendre des nuisances olfactives et peut
également être sources de divers problèmes de
santé.
Deux principaux vents soufflent sur Ouagadougou. On distingue
l'Harmattan, un vent sec et actif soufflant d'octobre à mai et la
Mousson un autre vent qui soufflant de mai à octobre apporte de
l'humidité. Ces vents sont souvent responsables de la dispersion des
divers déchets plastiques (sachets plastiques utilisés comme
emballages) et toxiques (piles) pouvant entraîner des conséquences
extrêmement graves pour la santé des habitants et l'environnement
urbain.
Sur le plan hydrologique, Ouagadougou est située dans
le bassin versant du Massili (affluent du Nakambé). La présence
de trois barrages (n°1, 2 et 3) permet de constituer des retenues d'eau
pour la ville. Ces retenues se succèdent sur un talweg qui s'allonge
d'Ouest en Est. Quatre marigots drainent l'ensemble des eaux de ruissellement
vers la zone de dépression. Ces marigots ont été
aménagés en caniveaux à ciel ouvert et ont prit
respectivement les noms de : Canal du Kadiogo, Canal du Centre, Canal de
Wemtenga, et Canal de Zogona. Ces différents canaux jouent un rôle
important dans l'évacuation des eaux pluviales de la ville. Mais le
manque d'entretien de ces ouvrages en fait de véritables lieux de
dépotoir où stagnent des eaux usées de toute sorte et
parfois également des déchets solides.
2.1.2. Profil socio-économique de la ville de
Ouagadougou
En termes de gestion des déchets solides, le profil
socio-économique de la population est particulièrement important
dans la mesure où de nombreuses études ont montré que le
statut économique impliquait une production d'ordures souvent plus
importante et d'une composition différente d'un ménage à
l'autre.
D'après les résultats du dernier Recensement
Générale de la Population et de l'Habitation (RGPH), la ville de
Ouagadougou comptait 1 475 223 habitants en 2006. La pyramide des âges de
Ouagadougou à l'image de celle du Burkina Faso a la physionomie
classique d'une pyramide des villes des pays en développement : une base
élargie correspondant à une population majoritairement jeune
s'effilant doucement vers les classes les plus âgées. L'habitat
ouagalais forme un paysage composite ou se côtoient le moderne et
l'ancien, et ou cohabitent diverses formes d'habitats alliant le banco
traditionnel et le béton. Du point de vue de l'équipement,
Ouagadougou présente un profil très différencié.
Elle donne de ce fait l'image d'une ville à plusieurs vitesses avec un
coeur loti, équipé et desservi par des réseaux d'adduction
en eau et en électricité, de voiries, de caniveaux etc., qui
offre un certain confort individuel aux résidents du centre, une
périphérie viabilisée mais ne disposant pas de la
totalité de ces équipements et enfin une auréole
extrême correspondant aux périphéries non loties au sein
desquelles les résidents dépendent des équipements
collectifs disponibles dans les quartiers réguliers plus ou moins
proches, voire parfois dans les villages alentours.
Le profil de la population est donc très
différencié selon les quartiers, cependant la gestion des
déchets répondant à une logique administrative (les
limites communales) englobe une diversité de situations.
L'arrondissement de Bogodogo, qui s'étend sur 105 km2 au
sud-est de la commune de Ouagadougou, a été retenu comme site
d'étude (cf. carte n°2). Le secteur 30 a fait l'objet d'une
attention particulière puisqu'il constitue le site d'intervention du
projet PRSDO-CER, structure d'accueil de notre stage.
Carte 2 : Présentation de l'arrondissement
de Bogodogo
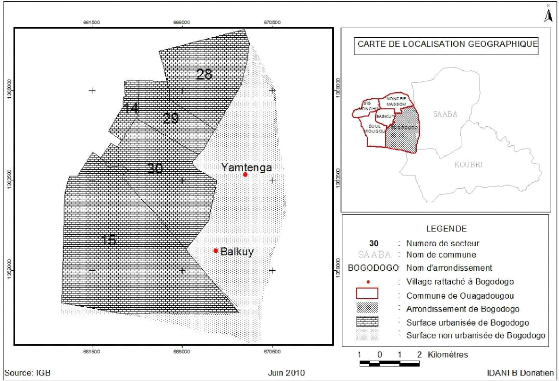
Avec une population estimée à 108119 habitants
(RGPH 2006), le secteur 30, site de notre étude est partagé entre
un habitat loti et un habitat non loti. L'alimentation en eau potable dans ce
secteur est essentiellement assurée par l'ONEA, des forages à
motricité humaine et, dans quelques rares cas des puits
traditionnels.
De grands éléments structurent le secteur. On
distingue, le Secrétariat Permanent du Salon International de
l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO), un Centre Médical avec Antenne
chirurgicale (CMA) et la SONABEL.
2.2. Présentation de la filière
déchet 2.2.1. Historique de la gestion des déchets
Depuis l'indépendance du pays en 1960,
différents modes de gestion des déchets ont été mis
en place dans la ville de Ouagadougou avec plus ou moins de succès.
Ainsi, la régie municipale actrice principale de la
gestion des déchets et de l'assainissement de la ville depuis 1958
concède la responsabilité de la filière au privé
(société Nakoulma) en 1968. Entre 1979 et 1986, le manque de
moyens financiers conduit la collectivité municipale à une
rupture du contrat avec cette entreprise. La commune procède alors,
à travers son service de la voirie, à l'enlèvement et
à l'enfouissement des ordures dans les bancotières de la ville,
jusqu'en 1986.
A partir de cette date, la Direction Nationale des Services
d'Entretien de Nettoyage et d'Embellissement (DINASENE) prend le relais. Elle
est transformée en Office en 1988. Cependant, incapable d'assurer la
charge de la collecte dans l'ensemble de la ville, l'ONASENE est contraint de
se soumettre au Partenariat Public-Privé (PPP). La collecte de la
redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères oscille
entre 300 et 1000 FCFA (Bayili, 1996). L'ouverture de ce nouveau secteur
d'activités favorise la multiplication des entreprises ; Cependant
aucune structure officielle ne vient régir ce marché qui ne
respecte pas la réglementation environnementale dans la mesure où
les déchets sont dispersés par les acteurs de la collecte dans
des lieux non appropriés, parfois à quelques centaines de
mètres seulement de là où ils avaient été
collectés.
En 1993, la dégradation de la situation conduit la mairie
à reprendre la gestion de ce secteur par l'intermédiaire de la
Direction des Services Techniques Municipaux (DSTM).
A partir de 2000, la municipalité
bénéficie du soutien de la Banque Mondiale à travers le
2ème et le 3ème Projet de Développement Urbain (PDU). Ce
projet a eu pour objet d'asseoir les bases du principe du «pollueur
payeur» par la récupération partielle des coûts de
fonctionnement. En 2001, à la faveur de la décentralisation et de
la mise en oeuvre du Plan Stratégique d'Assainissement de la ville de
Ouagadougou (PSAO), la commune se dote d'une direction qui s'occupe de la
propreté et de l'assainissement de la ville.
De concert avec le Projet d'Amélioration des Conditions
de Vie Urbaine (PACVU), le 3ème PDU favorise la création des
structures privées de gestion des déchets et améliore les
possibilités locales de valorisation. Aussi, soutient-il selon les
recommandations du Schéma Directeur de Gestion des Déchets, la
construction de trente cinq (35) centres de transit des déchets solides
et la réalisation du Centre d'Enfouissement Technique (CET) en 2001
devenu de nos jours le Centre de Traitement et de Valorisation des
Déchets (CTVD). Les trente secteurs (30) de la ville de Ouagadougou sont
alors divisés en douze (12) zones de collecte dont la gestion est
confiée aux entrepreneurs privés et aux GIE et en trois lots pour
le transport des déchets à destination du CTVD.
Carte 3 : Présentation de la filière
déchet
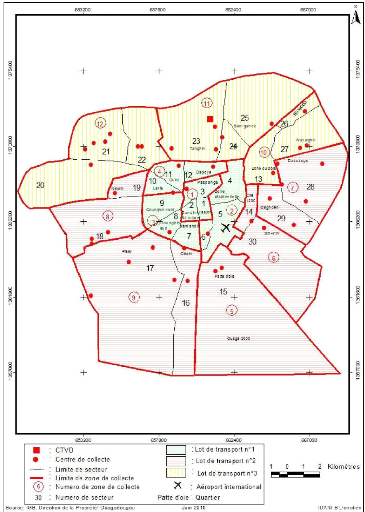
2.2.2. Les acteurs de la gestion des déchets
solides
La filière déchets regroupe plusieurs acteurs
qui concourent à sa mise en oeuvre. Au Burkina Faso, la Politique et
Stratégie Nationale d'Assainissement (PNSA) distingue cinq principaux
types d'acteurs aux rôles différents. Ce sont l'Etat, les
collectivités territoriales, le secteur privé, les populations et
leurs organisations, et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Pour ce
qui concerne le cas spécifique de la ville de Ouagadougou, on distingue
:
+ L'Etat
Plusieurs départements ministériels
interviennent dans la filière déchets solides mais le
Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie (MECV) joue un
rôle prépondérant ; à ce titre, il assure :
- l'élaboration de la Stratégie Nationale
d'Assainissement ;
- la définition du cadre juridique applicable à la
gestion des déchets
- la réalisation d'études d'impact et de suivi
environnemental du CTVD
+ La Direction de la Propreté (DP) : une structure
rattachée à la commune
Au Burkina Faso, la décentralisation a
conféré aux communes la gestion de l'assainissement. Ainsi, le
maire de Ouagadougou est chargé sous le contrôle du conseil
municipal de veiller à:
- la protection de l'environnement et de prendre en
conséquence les mesures propres à empêcher ou à
supprimer la pollution et les nuisances ;
- la protection des espaces verts et contribuer à
l'embellissement de la commune.
Pour atteindre ces objectifs, il se fait quotidiennement
accompagner par la Direction de la Propreté (DP), une structure
créée à cet effet.
Créée en mai 2001 par arrêté portant
organisation de la mairie de Ouagadougou, la DP assure cinq missions
principales :
- le nettoiement et la collecte des déchets ;
- le transport des déchets à partir des centres de
collecte jusqu'au centre technique de valorisation des déchets ;
- le traitement et la valorisation des déchets ;
- la prévention des pollutions et nuisances ;
- le curage des ouvrages hydrauliques (caniveaux, canaux) ;
D'une manière générale, pour la collecte et
la pré-collecte des déchets, la DP utilise des bennes tasseuses,
des camions portes-bacs et portes bennes ainsi que des bacs.
+ Le Projet Stratégie de Réduction des
Déchets de Ouagadougou (PSRDO) : Un outil au service de la
commune
Le Projet Stratégie de Réduction des
Déchets de Ouagadougou- Création d'Emplois et de Revenus par des
actions de tri et de valorisation (PSRDO-CER), est un projet initié par
la commune de Ouagadougou en collaboration avec l'Initiative
Développement Stratégique (IDS), la Communauté Urbaine de
Lyon, le Centre Régional de l'Eau Potable et d'Assainissement à
faible cout (CREPA) et l'Association de Volontariat et de Coopération
Internationale (LVIA). Avec un budget global estimé à un million
cent vingt cinq milles six cents soixante quinze (1.125.675) euros, c'est un
projet d'une durée de vie de 3 ans dont le lancement a eu lieu le 10
juin 2009. Il a l'ambition de fédérer tous les acteurs
concernés par la filière des déchets (administration,
opérateurs de collecte, ménages) autour de nouveaux
systèmes rentables et durables de gestion du tri, collecte, compostage
et valorisation.
Carte 4: Localisation géographique du
PSRDO/CER et de son champ d'action
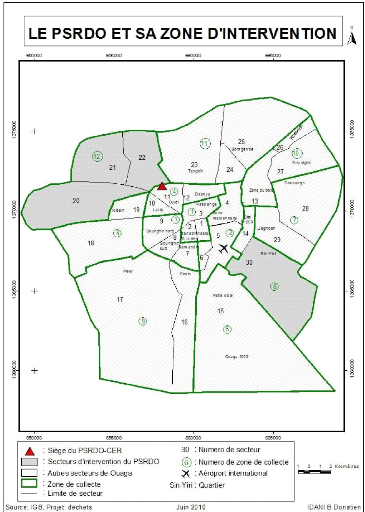
+ Les entreprises privées
Depuis le début des années 90, compte tenu de
l'ampleur des tâches et de l'insuffisance des moyens du secteur public,
on assiste à une implication progressive des acteurs du secteur
privé dans la gestion des ordures. Ces entreprises interviennent
notamment dans la précollecte, le transport des déchets solides
des centres de collecte vers le CTVD, ainsi que dans la gestion de ce
même CTVD. A titre illustratif, l'entreprise CGMED est adjudicataire de
la zone de collecte n°6 qui contient les secteurs n°14 et 30 de la
ville.
Pour ce qui concerne le transport des déchets, il
convient ici de signaler qu'il incombe à l'entreprise EBTE (Entreprise
Burkinabè des Travaux et d'Equipement) de s'occuper du transport des
déchets du lot n°3 ; le transport des lots n°1 et n°2
(auquel appartient le secteur 30) étant toujours à la charge de
la commune.
La gestion du CTVD quant à elle est assurée par
l'entreprise ECHA (Entreprise de Construction et de l'Habitat). A ce titre,
elle a en charge l'enfouissement des déchets, ainsi que le
contrôle des pollutions dues à l'activité
d'enfouissement.
+ Les associations et groupements
Les structures communautaires (associations, groupements)
comme les entreprises privées font la pré-collecte dans les
différents secteurs de la ville de Ouagadougou.
Le fonctionnement de ces dernières est très
distinct. En effet, d'un côté, nous distinguons des
fédérations d'associations qui bien que menant une vie
associative sont par le biais des Groupements d'Intérêt Economique
(GIE) adjudicataires par appel d'offre des zones de collecte où elles
exercent. De l'autre côté, ce sont les entreprises privées
concessionnaires des zones de collecte qui confèrent des autorisations
d'exploiter des sous parties de leurs zones à des associations contre
redevance de sous-traitance.
C'est ainsi que, dans l'arrondissement de SIG NOGHIN, nous
avons des associations de collecte qui sont adjudicataires d'une zone de
collecte. Pour être adjudicataires, ces associations ont dû se
regrouper en GIE Action pour la Protection de l'Environnement et payent chacune
au GIE une cotisation mensuelle de 10.000 F.
A BOGODOGO (précisément au secteur 30), il n'y a
pas de GIE et les associations n'ont pas de relation entre elles. Elles sont
sous-traitantes de l'entreprise privée CGMED, adjudicataire de la zone
de collecte. Ces associations ont d'abord été de petites
structures informelles qui se sont par la suite regroupées pour former
les associations sous l'impulsion d'une personne, en général une
femme, qui n'intervenait pas dans la collecte mais seulement dans la gestion.
Ainsi, cette dernière mettait les outils à la disposition des
femmes et se chargeait des fiches d'abonnés et de la collecte des
redevances. La motivation principale de ces femmes pionnières
était le souci de la préservation de l'environnement dans leur
quartier. Ces associations au départ informelles ont dû prendre le
statut d'association de Loi n°10/92/ADP (portant Liberté
d'association) pour pouvoir répondre à l'appel d'offre en 2005
que lançait l'entreprise CGEMED qui était devenue concessionnaire
de la zone de collecte. Les contrats d'enlèvement des ordures se font
sous le nom de CGMED et les associations collectrices de déchets doivent
en échange payer une redevance équivalente à 20 % des
recettes. Les contrats avec GCMED étaient pour une durée d'un an
renouvelable. En juin 2009, CGMED a signé des contrats avec ses
sous-traitants pour trois ans correspondant à la durée de vie du
PSRDOCER.
+ Les Partenaires Techniques et Financiers
(PTF)
Des organisations non gouvernementales appuient techniquement
et/ou financièrement le secteur de la gestion des ordures
ménagères dans la ville de Ouagadougou.
Pour ce qui concerne les domaines de la recherche et de l'appui
technique, nous distinguons principalement :
L'Institut International d'Ingénierie pour
l'Eau et L'Environnement (2ie)
- Participation à l'élaboration de la
Stratégie Nationale d'Assainissement ;
- Réalisation d'études sur la gestion des
déchets. L'Université de Ouagadougou
(UO)
- Participation au comité de contrôle et de suivi
Environnemental (CCSE) ;
- Réalisation d'études sur la gestion des
déchets.
Le Centre National de Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST)
- Participation au Comité de Contrôle et de Suivi
Environnemental (CCSE) du CTVD. Jumelage du Grand Lyon avec la
Commune de Ouagadougou
- Fourniture de matériel à la DP ;
- Appui à la formation des cadres municipaux.
Le Centre Régional pour l'Eau Potable et
l'Assainissement à faible coût (CREPA)
- Réalisation d'études et de projets pilotes sur la
pré-collecte et la valorisation des déchets ;
- Formation des acteurs de la filière ;
- Participation aux activités d'Information, d'Education
et de Communication (IEC) dans le domaine de l'assainissement.
Outre les aspects techniques, la filière de gestion des
déchets est aussi soutenue sur le plan financier. Les aides proviennent
d'organismes très différents. On peut citer : la Banque Mondiale,
l'Union Européenne, le FAARF, l'Ambassade d'Allemagne, le CREPA,
l'UNICEF, le Ministère de la Promotion de la Femme, Projet National
Karité (PNK), et Promo Femme.
CONCLUSION PARTIELLE
L'historique de la gestion des déchets montre que,
depuis l'indépendance du pays en 1960, différents acteurs se sont
essayés à la gestion des déchets de la ville de
Ouagadougou. Les réglementations en vigueur en la matière ont
à la faveur du mouvement de décentralisation
conféré aux communes la responsabilité de la gestion de
l'assainissement. Ces derniers sont donc amenés à mettre en place
des dispositifs de gestion adaptés aux exigences du terrain.
C'est dans ce contexte qu'en 2000, la municipalité de
Ouagadougou a bénéficié du soutien de la Banque Mondiale
à travers le 2ème et le 3ème Projet de
Développement Urbain (PDU) pour mettre en place son Schéma
Directeur de Gestion de Déchets. La mise en oeuvre de ce schéma
intervenu le 15 avril 2005 a permis d'engranger de grands acquis en
matière de gestion des déchets, au nombre desquels on distingue
la mise en place de nouveaux systèmes de collecte, de transport et de
valorisation des déchets, ainsi qu'une privatisation partielle de la
filière. De nos jours, cette dernière regroupe principalement
cinq types d'acteurs concourant à sa mise en oeuvre ; ce sont : l'Etat,
les collectivités locales, les entreprises privées, les
associations et groupements, et les Partenaires Techniques et Financiers
(PTF).
DEUXIEME PARTIE : APPLICATION DU SIG A LA GESTION DES
ORDURES MENAGERES
L'objectif de départ de ce projet est de créer
une base de données spatialisées (gérée sous SIG)
regroupant diverses informations sur les opérateurs de
pré-collecte des ordures ménagères, les points de
regroupement des déchets présents au secteur 30 de la ville, les
ménages abonnés au service de pré-collecte, ainsi que,
l'état des poubelles et les quantités de déchets
théoriques produits par ces derniers. La deuxième partie de ce
mémoire, essentiellement consacrée à l'élaboration
et à la validation de cette base de données à
référence spatiale s'articule autour de deux chapitres. Le
premier chapitre s'attache à définir l'utilité d'un SIG
dans la gestion des déchets et à retracer les grandes
étapes de la création de cette base de données à
référence spatiale. Le deuxième chapitre se propose de
faire quelques analyses du dispositif de gestion des déchets avec les
outils mis en place.
CHAPITRE III: MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNEES A
REFERENCE SPATIALE POUR LA GESTION DES ORDURES MENAGERES DE LA VILLE DE
OUAGADOUGOU
Ce chapitre comporte deux sections. La première traite
de l'intérêt de l'utilisation du SIG dans la gestion des ordures
ménagère; la seconde retrace les grandes étapes de
création de la base de données à référence
spatiale élaborée lors de notre stage au PSRDO-CER.
3.1. Utilité et objectifs d'un SIG dans la gestion
des ordures ménagères 3.1.1. Utilité d'un SIG pour la
gestion des ordures ménagères
Un Système d'Information Géographique (SIG) est
défini par Thériault (1996) comme étant « un ensemble
de principes, de méthodes, d'instruments et de données à
référence spatiales utilisé pour saisir, conserver,
transformer, analyser, modéliser, stimuler et cartographier les
phénomènes et les processus distribués dans l'espace
géographique ». Il s'agit donc d'un outil informatique qui stocke
et gère des informations ayant une référence au
territoire.
Les fonctions les plus importantes des SIG sont :
+ l'archivage c'est-à-dire le stockage des données
au moyen de la saisie de l'information sous forme numérique ;
+ l'analyse des données spatiales et thématiques
qui fait des SIG un puissant outil d'aide à la décision ;
+ la visualisation des résultats des analyses sous forme
de cartes thématiques.
Dans le domaine de la gestion des ordures
ménagères, les avantages fournis par les SIG sont nombreux. Tout
d'abord, les SIG permettent une visualisation de la situation. Il est en effet
plus aisé de se représenter la réalité en ayant un
support visuel tel qu'une carte thématique. Avec le SIG, les
utilisateurs peuvent par exemple :
+ voir où se trouvent les opérateurs de
pré-collecte et matérialiser leurs circuits journalier ou
hebdomadaire de collecte ;
+ voir les abonnés au système de
pré-collecte des déchets et les points de regroupement des
déchets collectés ;
+ voir dans quels secteurs le taux d'abonnement est le plus
élevé ou le plus bas, dans quels secteurs le recouvrement des
redevances est le plus bas, etc.
La visualisation rapide de ces informations peut permettre aux
différents acteurs de la gestion des déchets de localiser des
zones prioritaires en matière d'amélioration des services
d'assainissement. Les acteurs et décideurs peuvent ainsi voir où
se situent les problèmes et ou il est préférable ou urgent
d'agir immédiatement. Ceci permet non seulement d'agir plus rapidement
mais aussi d'une manière coordonnée et mieux adaptée
à la spécificité de chaque zone.
3.1.2. Objectifs du SIG sur la gestion des
déchets
Le système d'information conçu lors de ce
travail regroupe sous forme informatique diverses données relatives
à la gestion des déchets à l'échelle du secteur 30
de la ville de Ouagadougou. Les données qui seront
complétées et mises à jour permettront premièrement
de suivre dans le temps l'évolution et les performances du
système de gestion des déchets dans la zone d'intervention du
PSRDO-CER. Ce suivi ne peut se faire qu'avec une collaboration de la part de
tous les acteurs de la gestion des déchets et une transparence des
données. Deuxièmement, le système d'information est
conçu non seulement pour les services municipaux mais aussi pour
permettre aux opérateurs de pré-collecte des déchets
d'analyser leur fonctionnement et leur évolution. Pour eux, le
système d'information devrait être un outil de monitoring et
d'aide à la décision pour leur développement futur. Il
sera donc un outil évolutif qui permettra non seulement le stockage des
données mais aussi une analyse de celles-ci.
Les logiciels utilisés pour la réalisation du
système d'information sur la gestion des déchets ont
principalement été Access pour la constitution de la base de
données et Arc View GIS 3.2 pour le travail sous environnement SIG.
L'atout d'Access est de présenter des possibilités de connexion
avec Arc View, logiciel dont dispose le projet PRSDO-CER.
3.1.3. Choix des données intégrées
au système
Trois types de données ont été pris en
compte dans l'élaboration du SIG, il s'agit :
+ Des coordonnées géographiques issues des travaux
de géoréférencement (abonnés, centres de collecte,
opérateurs de pré-collecte, dépotoirs sauvages etc.) ;
+ Des attributs des entités géographiques ;
+ Et le plan cadastral de la ville de Ouagadougou.
Le choix des attributs des entités géographiques
de la gestion de la ville de Ouagadougou a été inspiré du
Schéma Directeur de Gestion des Déchets de la ville de
Ouagadougou élaboré en novembre 2000. Ces derniers concernent
:
+ Des données générales sur la ville et la
démographie ;
+ Des données sur les points de regroupement des
déchets ; + Des données sur les abonnés ;
+ Des données sur les opérateurs de
pré-collecte des déchets ; + Des données sur les
décharges.
3.2. Elaboration des outils
3.2.1. Structuration des données
Après la définition des données à
intégrer au système, il s'est agit de les organiser et de les
structurer. Ainsi, la définition de règles de gestion
(confère annexe 4) a permis d'aligner dans l'ordre de leur apparition,
toutes les données retenues. Aussi, pour passer de la
réalité complexe à une représentation informatique,
on a procédé à la réalisation d'un modèle
conceptuel de données, ainsi qu'à l'implantation des
données structurées dans un système informatique.
+ Le modèle conceptuel de données
Le modèle conceptuel de données (MCD) est une
représentation facilement compréhensible,
permettant de
décrire le système d'information. Le MCD sert à formaliser
la description des
informations qui sont mémorisées dans le
système d'information (SI) d'une entreprise ou d'un organisme. Il sert
aussi à conceptualiser les contraintes d'intégrité qui
doivent être maintenues pour refléter correctement les
règles de gestion de l'entreprise. En d'autres termes, il exprime la vue
que les acteurs doivent avoir de la mémoire de l'entreprise. Il permet
enfin aux différents intervenants du projet d'informatisation de
s'accorder sur cette vue.
Il repose sur les concepts d'entité, d'association, de
propriété et est élaboré dans un langage
appelé « formalisme entité -relation » (voire figure
n°2).
Figure 2 : Exemple du formalisme entité-
relation utilisé pour le schéma conceptuel de la BD
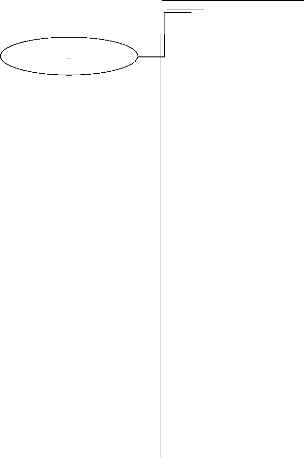
Abonnés
Description
Nom_abonné
Profession_abonné Numero_rue
Numero_porte
Année d'abonnement Nature_occupation Nombre_menages
Nombre_personnes Date abonnement Type_poubelle
Etat_ poubelle Volume_dechets_produit_par_semaine
Collecteurs
Numéro collecteur
Nom collecteur
Nom de l'OPprécollecte
1,n 1,n
Collecter_dechets
en litre
Quantité_dechets_produit_par_semaine en kilogramme
Frequence_enlevement_par_semaine Redevance_mensuelle
Appreciation_montant_redevance_FCFA Niveau_satisfaction
Le formalisme entité-relation de la figure n°2
structure les données sous forme d'entités ou
tables qui sont
représentées par les rectangles dans le schéma. Le nom de
l'entité ou table
apparait en gras en haut du rectangle ; ensuite
viennent les attributs, c'est-à-dire les données
caractérisant l'entité (table). Chaque
entité (table) a un identifiant ; soit une valeur unique qui permet
d'identifier un objet sur la table ; celui-ci est souligné dans le
schéma. Aussi, les entités sont reliées entre elles par
des relations. Ces dernières ont des cardinalités. Par exemple,
dans le schéma de la figure n°1, un collecteur peut collecter les
déchets chez un à plusieurs abonnés au service de
pré-collecte et les déchets d'un abonnés peuvent
être collectés par au moins un collecteur.
Ainsi, toutes les données contenues dans le MCD sont
organisées selon ce schéma. Elles sont regroupées en
entités ou tables présentant les mêmes
caractéristiques (attributs) et liées entre elles par des
relations. Le modèle conceptuel de données final de la base de
données est présenté à la figure 3.
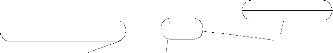


1,n
Figure 3 : Modèle Conceptuel de
donnée
OP_précollecte
|
NumerofichesuiviOPprécollecte Secteurs_precollecte
Nombre_dejours_de_precollecte Nombre_de_menages_visites
Volume_de_dechets_collectes
Quant ite_de_dechets_plastiques_recupere
Quant ite_de_matiere_organique_recyclee
Quant ite_de_metaux_recuperes1
|
1,1

fiche_OPprécollecte_concerner
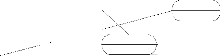
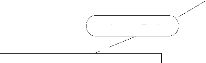
OPprécollecte_remplir
1,1
Fiche_suivi_OPprécollecte
Adjudicataire
IDadjudicataire
Type_adjudicataire
Annee_création
Secteurs_intervention 1,n
Nombre_opérateurs_precollecte
employer_animateurs
1,n
1,1
1,n
est attribuée
Zone de collecte
IDzonedecollecte Nombre_de_secteurs_de_la_zone_de_collecte
Secteurs_concernés

1,n
1,n
Sous traite
1,1
Paiement_redevance
Numero paiement Montant_redevance Date_de_paiement
Montant_Payé
1,1
1,n
OP_collecte
IDOPcollecte
Type
Nom_OPprecollecte
Date_creat ion Nombre_de_lots_attribue Nombre_employes
Nombre_camions
1,1
employer_collecteur
1,1
collecteurs
IDcollecteur Nom_collecteur Nom_OPprecollecte
Points_regroupement_déchets
ID pointregroupementdéchets Type
Année_construction
Etat
Nombre_de_bacs Nombre_vidange_par_mois
recupéré
|
IDOP précollecte Type
Nom_OPprecollecte Date_creat ion Nom_representant
Profession_representant Contact_representant Nombre_membre
Nombre_abonnés Nombre_collecteurs Nombre_animateurs Nombre_camions
Nombre_anes Nombre_charrettes Nombre_poubelles
|
1,n
désservir_secteurs
1,n
11 1,n

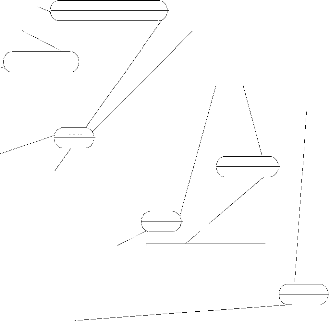
Animateurs
Période_ficheOPprécollecte
Code périodeficheOPprecollecte
Date_fiche_OPprecollecte
correspondre_paiement

1,n
Période_paiement
Code periode paiement Date_paiement
OPcollecte_remplir
transporter_déchets_points_regroupement_déchets
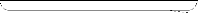

1,n
1,1
Abonnés
Description
Nom_abonne
Profession_abonne Numero_rue
Numero_porte
Annee_abonnement Nature_occupat ion Nombre_menage
Nombre_personne Type_poubelle
Capacité_poubelle Etat_poubelle
Volume_déchets_produit_par_semaine en litre
Quant ité_déchets_produits_par_semaine en
kilogramme Fréquence_enlèvement_par_semaine
Redevance_mensuelle Appréciation_montant_redevance_FCFA
Niveau_sat isfaction

1,1
effectuer
Numeroanimateur Nom_animateur Nom_OPprecolecte
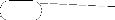
desservir
1,n

1,n
1,1
1,n
Collecter_déchets
1,n
1,n
habiter
0,1
1,1
transporter_déchets_abonnés
|
1,n
|
CTVD
|
|
|
|
ID
Superficie_en_hectares Capacite_en_m3 Distance_a_la_Ville_en_KM
Accessibilite
Nombre_de_personnel
|
|
1,n
|
1,1
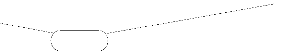
CET remplir
1,1
1,1
Fiche_suivi_OPcollecte
|
NumerofichesuiviOPcollecte Lot
Secteur
Nombre_dejours_de_precollecte
|
1,1

Fiche_suiviOPcollecte_concerner
1,n
Période_ficheOPcollecte
Code periodeficheOPcollecte Mois_fiche_suivi_O Pcollecte
Annee_fiche_suivi_OPcollecte
ZC_appartenir
1,n
1,1
Secteurs
Numerosecteur
Annee_lot issement
Standing_du_secteur 1,n
Nombre_habitants
Nombre_de_ménages Nombre_abonnés
1,n 1,1
Période_fiche_CTVD
Code periodefiche CTVD Mois_de_la_Fiche_suivi_CTVD
Annee_de_la_fiche_suivi_CTVD
1,n
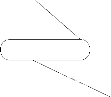
fiche_CET_concerner
1,1
Fiche_suivi_CTVD
NumerofichesuiviCTVD
Quant ite_de_dechets_mis_en_decharge Quant
ite_de_compost_produit
Quant ite_de_sachets_plastiques_recuperes Quant
ite_de_dechets_fermentescibles_valorises Quant ite_de_metaux_recuperes1
0,1
appartenir_LS
contenir
1,n
Lot_sect eurs
|
IDdulot
Nombre_de_secteurs_du_lot Secteurs_concernés_par_le_lot
|
situé_dans
3.2.2. L'implantation des données
structurées dans un système informatique
Les données structurées en modèle
conceptuel de la figure 3 ont été implantées dans un
système informatique (Access notamment) et les attributs des
différentes entités (tables) ont été
renseignés à l'aide des données collectées sur le
terrain. La base de données créée a ensuite
été testée afin de contrôler son fonctionnement.
C'est ainsi que des requêtes en langage SQL (Structured Query Language)
ont été créées dans le but d'analyser et
d'exploiter les données.
La base de données conçue doit être
exploitable et compréhensible pour des personnes ne maitrisant pas
forcément le logiciel Access. C'est pourquoi, il a été
nécessaire de créer une interface graphique (formulaires) simple
et conviviale aussi bien pour le démarrage d'une session, la saisie et
la mise à jour des données et l'exploitation des données.
Ainsi, les utilisateurs pourront utiliser cet outil sans même connaitre
le fonctionnement et le langage d'Access.
+ Présentation des formulaires
La base de données sur la gestion des déchets
contient plusieurs formulaires qui structurent la présentation du masque
de saisie. Le lancement de la base se fait à partir d'un double clic sur
un formulaire intitulé « Menu Général » qui
permet d'ouvrir une session.
Figure 4 : Menu Général de la Base
de données
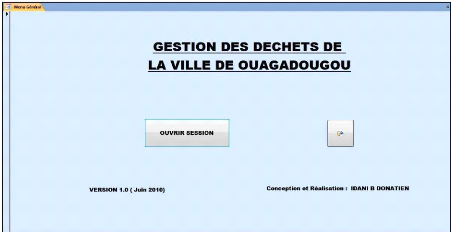
L'utilisateur choisit ensuite l'action qu'il souhaite
réaliser parmi les volets saisie, consultation ou exploitation des
données.
Figure 5 : Menu de la base de
donnée
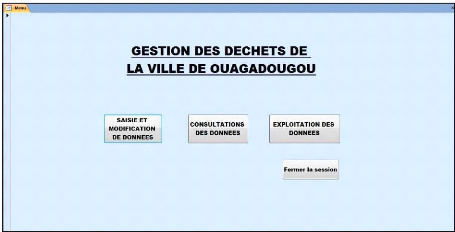
Le premier volet concerne la saisie et la modification des
données. Des masques de saisie ont été conçus et
regroupés par thèmes. Ils se présentent sous la forme
illustrée à la figure 6.
Figure 6 : Masque de saisie pour les points de
regroupement des déchets
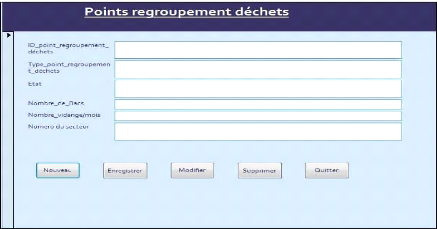
Figure 7 : Masque de saisie pour les nouveaux
abonnés
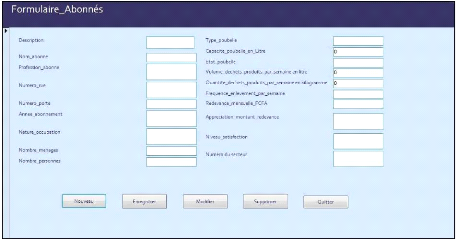
Le deuxième volet conduit à la consultation des
données enregistrées dans la base. Cette consultation se fait par
des listes des données regroupées par thème et
présentées sous forme imprimable. Un exemple est
présenté à la figure 8.
Figure 8: Fiche de consultation des données
concernant les abonnés
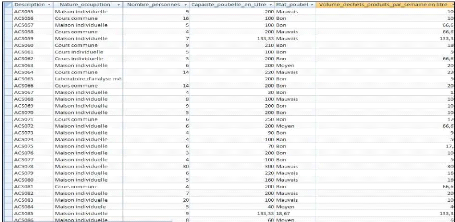
Le dernier volet est relatif à l'exploitation et
à l'analyse des résultats. L'utilisateur peut visionner des
résultats de requêtes, les différentes analyses des
données et les statistiques engendrées. Ces résultats se
présentent sous forme d'état. L'état est une
manière de présenter les données des tables relationnelles
à l'écran ou à l'impression. Les états se
présentent sous forme de tableaux ou de graphiques comme illustré
dans le tableau 3.
Tableau 3: Exemple de résultat d'analyse
des données de la base de données
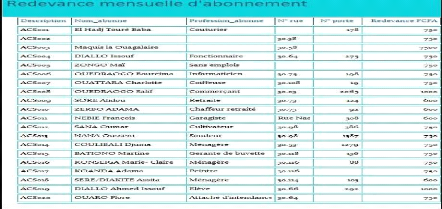
+ Le travail sous environnement SIG : Intégration
des données géographiques et traitement de
l'information
Dans cette partie, les cordonnées des entités
géographiques (opérateurs de pré-collecte, abonnés
au service de pré-collecte, points de regroupement des déchets)
prises sur le terrain lors de nos enquêtes ont été
exportées du GPS à l'ordinateur pour être ensuite
intégrées dans le SIG. Le logiciel utilisé pour
l'exportation a été « Expert GPS ». En somme, 1398
points répartis comme suit ont été intégrés
dans le SIG :
- 5 points représentant les coordonnées des
opérateurs de pré-collecte de déchets ;
-1388 points représentant les coordonnées des
abonnés au service de pré-collecte de déchets ;
-5 points représentant les coordonnées des
décharges ou points de regroupement des déchets.
Les coordonnées des entités géographiques
(secteurs, opérateurs de pré-collecte, abonnés au service
de pré-collecte, points de regroupement des déchets) étant
matérialisées dans le SIG et leurs différents attributs
stockés dans la base de données Access, il a été
indispensable de créer un lien entre la base de données (Access)
et Arc View (le logiciel de SIG utilisé). Pour ce faire, les tables de
la base de données Access (secteurs, opérateurs de
pré-collecte, abonnés, points de regroupement des déchets
etc.) ayant une référence spatiale ont été
converties en format dBASE 4. Ces fichiers dBASE, successivement chargés
dans Arc View sous forme de tables ont été ensuite ajoutés
au SIG par jointure avec les tables attributaires des entités
géographiques correspondantes. La jointure de table est un
procédé qui permet d'attribuer des données d'une table
extérieure (fichier dBASE) à des objets du SIG. Le logiciel SIG
mémorise l'endroit du disque ou réside le fichier et rappelle les
données qu'il contient chaque fois que le projet est ouvert. De ce fait,
les valeurs d'une table obtenue par jointure de table ne sont pas modifiables
dans le SIG. La base de données ayant été conçue
pour être gérée sous SIG, nous avions pu pallier à
ce problème par le rappel (en tant que nouvelles tables) dans Arc View
des différentes tables obtenues par jointure. Cela a pu se faire
grâce aux commandes « Exporter » et « Ajouter une
table» des menus « Fichier » et « Projet ».
Associées à chaque point, les données
recueillies peuvent nous permettre de réaliser une cartographie
thématique plus ciblée à mettre à la disposition du
PSRDO/CER et des acteurs institutionnels agissant dans la gestion des
déchets. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment peut être
exploité l'ensemble de ces données dans une approche de
spatialisation de la gestion des déchets.
CHAPITRE IV: ANALYSE DE LA GESTION DES DECHETS ET
PERSPECTIVES
Ce chapitre est subdivisé en deux sections. La
première analyse le dispositif de gestion des déchets au secteur
30 de la ville de Ouagadougou avec les outils mis en place dans le
précédent chapitre ; la seconde quant à elle,
présente des perspectives d'extension de la présente
étude.
4.1. Analyse du dispositif de gestion des déchets
dans le secteur 30
4.1.1. Les opérateurs de pré-collecte de
déchets actuels
Le secteur 30 de Ouagadougou compte à nos jours
essentiellement cinq associations officiellement déclarées et
toutes sous-traitante de l'entreprise CGMED adjudicataire de la zone de
collecte.
Tableau 4 : Les associations collectrices de
déchets solides opérant au secteur 30
|
Associations
|
Date d'obtention du récépissé
|
Nombre de
membre
|
Nombre d'abonnés
|
Charretièr e
|
Collecteur de redevance
|
Animatrice
|
Gardien
|
|
1 Yilemdé 03 mars 2005 50 573 10 2 2 0
|
|
2
|
Santé Plus
|
21 décembre 1999
|
23
|
417
|
4
|
1
|
1
|
1
|
|
3 Cosalu 1er mars 1982 10 120 4 1 1 0
|
|
4
|
Soungton- Nooma
|
29 Juin 2009
|
30
|
357
|
6
|
--
|
--
|
1
|
|
5 Sougre-Nooma 12 mai 2005 57 1268 10 4 -- 1
|
|
Total 170 2735 34 8 3 3
|
Source : PSRDO, Résultat d'enquête
Les associations Santé Plus, Yilemdé et Cosalu
s'occupent uniquement de la collecte des ordures ménagères ;
elles font également de la sensibilisation sur la protection de
l'environnement et sur la nécessité de collecter les
déchets. Quant aux associations SougreNooma et Sounton-Nooma, elles
complètent leurs activités entre le balayage (employées
par la mairie) et la production de Karité, de savon, de soumbala et du
dolo.
Carte 5 : Répartition spatiale des
sièges des opérateurs de pré-collecte oeuvrant au secteur
30
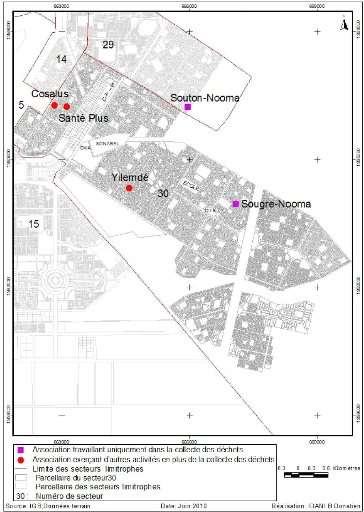
En 2010, ces associations collectent les déchets
auprès de 2735 abonnés (chefs de ménage), soient 15% des
ménages recensés dans le secteur par l'INSD en 2006 (voir figure
9).
Figure 9 : Taux d'abonnement au service de
pré-collecte d'ordures ménagères
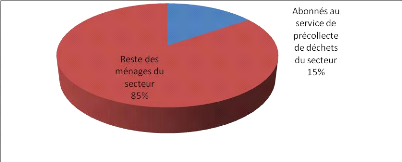
Source : PSRDO, Résultat d'enquête
Diverses raisons peuvent expliquer ce faible taux
d'abonnement. Outre celles d'ordre économique évoquées par
certains résidents de la zone pour ne pas s'abonner à un service
de pré-collecte de déchets, il y a la non application de
certaines orientations du SDGD notamment celle relative à
l'exclusivité des zones de collecte. En effet, suivant le SDGD et la
convention de concession, les PME/GIE attributaires de zones (et leurs
sous-traitants naturellement) doivent bénéficier du monopole de
la pré-collecte sur leurs zones. Cependant sur le terrain,
l'exclusivité n'est pas respectée totalement. Une pléthore
d'informels pratique la pré-collecte sans être attributaires. Ces
derniers sont de deux types : les associations non structurées et les
collecteurs individuels.
Les associations non structurées sont en
réalité des organisations non reconnues et peu fonctionnelles qui
en majorité n'ont ni statut juridique, ni siège social et
agissent sous le couvert d'un individu possédant une ou deux charrettes
dont les utilisateurs proviennent de la même famille. Proposant leur
service de façon ponctuelle là où les PME et GIE n'ont pas
pu exécuter leur contrat hebdomadaire, elles déversent les
ordures collectées sur des sites non autorisés (espaces verts,
dans ou à côté des canaux d'évacuation des eaux de
pluies).
De loin les plus nombreux, les collecteurs individuels sont le
plus souvent d'anciens membres des GIE et associations. Des entretiens avec ces
acteurs ont révélé que certains sous-traitants ou membres
des GIE, dénonçant les modalités des traitements
effectués par les GIE désertent parfois pour aller exercer dans
l'informel.
L'entretien avec l'association SOUGRE-NOOMA affiliée
à l'entreprise CGMED a montré que les informels exerçant
à titre individuel sur leur territoire se chiffrent à plus de 50
individus. Ces derniers n'ont souvent que quelques abonnés
réguliers et pratiquent l'enlèvement au coup par coup contre
rémunération auprès des ménages non abonnés.
Ce qui caractérise cette catégorie d'informels est à la
fois leur extrême pauvreté et la précarité de leur
activité. La collecte des déchets ne constituant pas leur unique
activité, ils transportent également souvent du sable ou divers
chargements suivant les opportunités du moment.
Si la présence de ces acteurs dits informels augmente
les capacités de collecte des déchets dans la commune, elle ne va
pas sans créer une rupture totale avec les orientations du SDGD et sans
troubler le système de gestion mis en place par la commune et ses
partenaires. En effet, ces informels pratiquent une concurrence déloyale
aux PME/GIE puisqu'ils ne payent aucune taxe. De ce fait, ils pratiquent
souvent des prix modiques (100 et 200FCFA) qui ne sont pas compatibles avec une
collecte organisée des déchets sur l'ensemble de la ville. Par
ailleurs, les informels sont difficilement contrôlables et contribuent
à la multiplication des tas sauvages. La présence de ces tas mine
les efforts des attributaires pour convaincre les ménages à
cesser de se débarrasser eux même de leurs ordures. Enfin, la
présence de ces non attributaires réduit significativement le
nombre d'abonnés et donc les revenus potentiels pour les attributaires.
De ce fait elle fausse le jeu de la territorialisation de la collecte et
augmente les efforts et les coûts de fonctionnement des attributaires,
les forçant à parcourir de plus grandes distances avant de
remplir leur charrette ou leur engin. En outre elle rend plus difficile le
suivi de la collecte et menace aussi la cohérence et la
durabilité de la filière.
4.1.2. Les abonnés au service de
pré-collecte de déchets
Dans tous les secteurs de la commune de Ouagadougou, la
plupart des résidents vont déposer leurs déchets soit dans
des décharges sauvages créées spontanément
notamment sur des terrains vacants de la ville, soit dans les bacs
installés dans certains secteurs centraux et dans les centres de
collecte (S.Mas., C.Vogler. 2006). D'autres par contre font appel aux
services de pré-collecte qu'offrent les
opérateurs privés et les associations ; Ces sont les
abonnés aux services de pré-collecte des ordures
ménagères. Nos recherches au secteur 30 de la ville de
Ouagadougou nous ont permis de faire une nette distinction entre les
abonnés suivant divers critères.
La figure 10 résume le statut socio-économique
des abonnés au service de pré-collecte des déchets
ménagers. Sept catégories socio-économiques se
dégagent. Il s'agit des salariés, des indépendants, des
informels, des retraités, des élèves et étudiants,
des ménagères et de quelques sans emplois.
Figure 10 : Profil socio-économique des
abonnés au service de pré-collecte des déchets
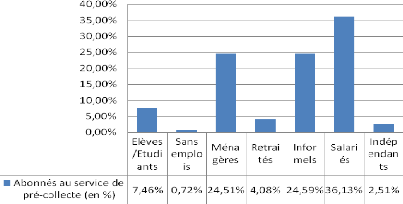
Source : Résultat d'enquête
La carte ci-dessous présente la répartition
spatiale de l'ensemble des abonnés des associations Cosalu et
Sougre-Nooma. A travers cette carte nous nous rendons aisément compte
que la répartition des abonnés dans l'aire géographique ne
suit pas une logique territoriale mais, est plutôt fonction de
l'opportunité qu'ont les opérateurs d'avoir de nouveaux
abonnés.
Carte 6 : Répartition spatiale des
abonnés de Cosalu et de Sougre-Nooma
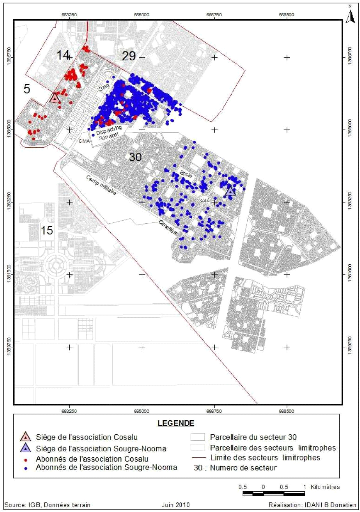
De l'analyse des abonnés suivant la fonction de
l'unité d'occupation, nous retiendrons que la grande majorité des
abonnés du secteur 30 de la ville de Ouagadougou est constitué
à 94% de ménages dont 73% habitent des maisons individuelles et
21% vivent dans des cours communes. Le reste des abonnés (6%) font de
leur espace d'occupation des services ou administrations (écoles,
centres de santé, entreprises, mairie d'arrondissement), des commerces
de tous genres (kiosques, boutiques, salon de coiffures etc.) et des
débits de boissons.
Figure 11: Les abonnés des associations
Sougr-Nooma et Cosalu en fonction de l'unitéd'occupation
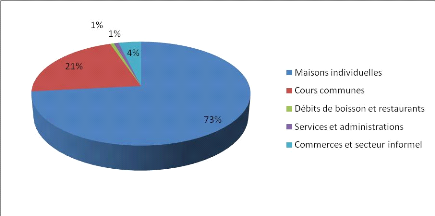
Carte 7 : Répartition spatiale des
abonnés au service de pré-collecte des déchets en fonction
de l'unité d'occupation
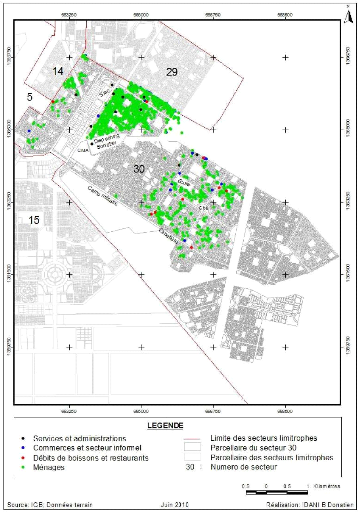
Généralement, les ordures
ménagères sont ramassées une fois par semaine. La
fréquence peut varier de deux à trois fois par semaine pour les
commerces, les administrations et les institutions, selon les besoins et les
termes de l'entente contractuelle avec l'opérateur de
précollecte. Les cartographies 8 et 9 matérialisent les circuits
de collecte hebdomadairement empruntés par les associations Cosalu et
Sourgre-Nooma pour la collecte des déchets ménagers de leurs
abonnés.
Carte 8 : Circuit hebdomadaire de collecte des
déchets de l'association Cosalu
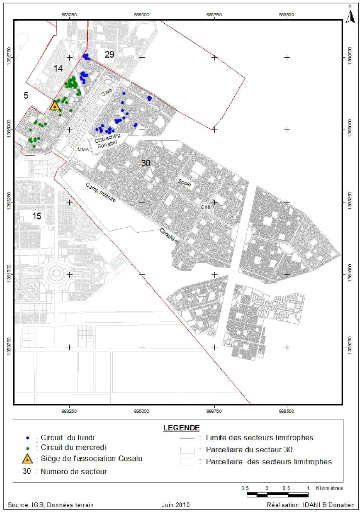
Carte 9 : Circuit hebdomadaire de collecte des
déchets de l'association Sougre-Nooma
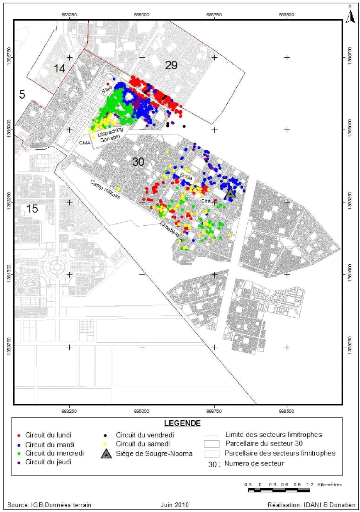
L'analyse de ces éléments de cartographie (carte
9 surtout), revèle que la collecte journalière des déchets
des abonnés se déroule de façon disparate à travers
le territoire (circuits non optimisés). Ces observations nous conduisent
donc à proposer de nouveaux circuits pour optimiser la collecte des
déchets de ces deux associations. Le principe de ces proposions à
consisté a faire des buffer (cercles concentriques à partir des
sièges de chaque association) pour réprésenter les zones
à égal jour de collecte de chacune de ces deux associations. Les
rayons des cercles concentriques sont de 1160 m pour l'association Cosalu et de
700 m pour l'association Sougre-Nooma. On obtient donc les circuits suivant
(cf. cartes 10 et 11).
Carte 10 : Proposition de circuits de collecte
à l'intention de l'association Cosalu
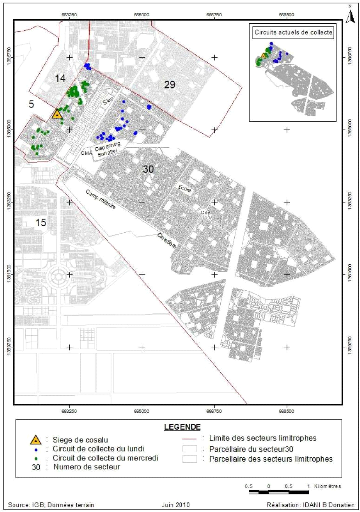
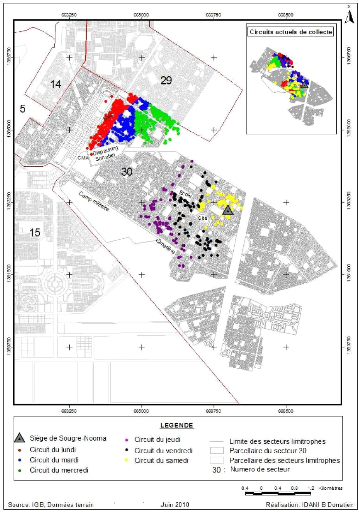
Le tarif mensuel d'abonnement des ménages est en
moyenne de 500 FCFA pour l'association Sougr-Nooma et de 750 FCFA pour
l'association Cosalu. Pour les commerces, les institutions, les édifices
gouvernementaux et autres, le tarif varie de 250 FCFA à 2000 FCFA pour
les abonnés de l'association Sougr-Nooma et de 500 FCFA à 7500
FCFA pour ceux de l'association Cosalu. Selon nos enquêtes, les
abonnés de ces deux associations
trouvent le montant d'enlèvement de leurs ordures
acceptable, et sont satisfaits de la qualitéde la prestation (cf. figure
12 et 13).
Figure 12 : Appréciation
du Figure13 : Niveau de satisfaction
montant de la redevance de la prestation
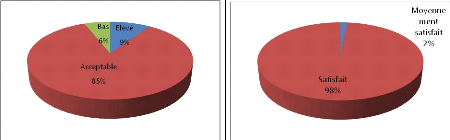
Source : Résultat d'enquête Source : Résultat
d'enquête
Une autre classification des abonnés peut se faire
également suivant la présence/l'absence ou l'état de
leur(s) poubelle(s). Ainsi, pour ce qui concerne la présence/absence de
poubelle, il convient de relever qu'environ 6,38% des abonnés sont
dépourvus de poubelles. Parmi les abonnés qui possèdent au
moins une poubelle (93,62%), on a la subdivision suivante (cf. figure 14).
Figure 14: Etat de la poubelle des abonnés
de Cosalu et de Sougre-Nooma
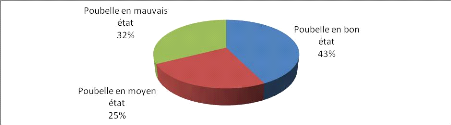
Source : Résultat d'enquête
Carte 12 : Distribution spatiale des
abonnés de l'association Sougre-Nooma en fonction de l'état de
leur(s) poubelle(s)
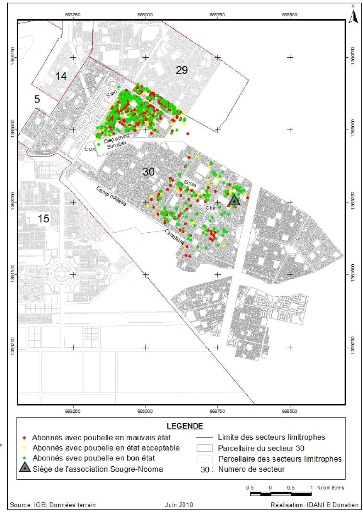
Carte 13 : Distribution spatiale des
abonnés de l'association Cosalu en fonction de l'état de leur(s)
poubelle(s)
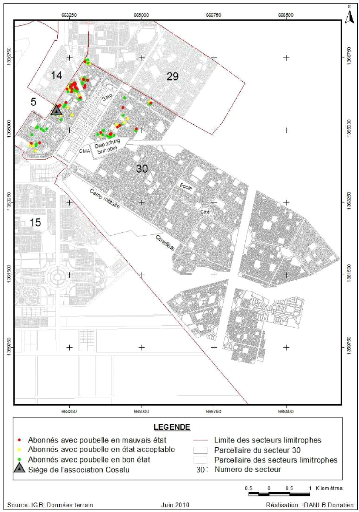
4.1.3. Les points de regroupements des
déchets
Une fois les déchets collectés auprès des
abonnés, ils sont convoyés par les opérateurs de
précollecte au niveau de différents points de regroupements de
déchets. Au cours de nos travaux de terrain, nous avions pu identifier
cinq principaux points de regroupements des déchets (cf. carte 14).
Carte 14: Les dépotoirs ou points de
regroupement des déchets
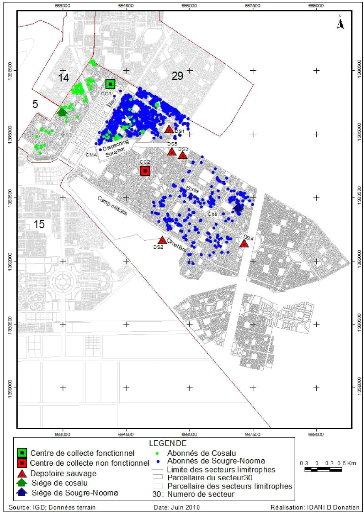
Selon les orientations données par le SDGD, les
déchets collectés chez les usagers doivent être
transportés au CTVD via les centres de collecte. Mais sur le terrain, on
.constate qu'une partie importante des déchets collectés par les
pré-collecteurs ne transite par aucun centre de collecte de
déchets et n'est par conséquent pas évacué vers le
CTVD. Le tableau nous renseigne sur des quantités théoriques de
déchets acheminées par semaine au niveau des points de
regroupement des déchets du secteur 30 de Ouagadougou par les
associations Cosalu et Sougre-Nooma.
Tableau 5 : Quantité de déchets
théoriques acheminée dans les dépotoirs
|
Type de dépotoirs
|
Identifiant du dépotoir
|
Opérateurs de pré-collecte
|
Quantité théorique de déchets
acheminés (en kilogrammes)
|
|
Centres de collecte
|
CC1(Fonctionnel)
|
Association Cosalu
|
187,536
|
|
C (Non fonctionnel)
|
0,00
|
|
Total déchets théoriques acheminés vers les
centres de collecte
|
187,536
|
|
Dépotoirs sauvages
|
DS1
|
Association Sougr-Nooma
|
1233,718
|
|
DS2
|
240,461
|
|
DS3
|
110,659
|
|
DS4
|
37,986
|
|
DS5
|
106,552
|
|
Total déchets théoriques acheminés vers les
dépotoirs sauvages
|
1725,456
|
Source : Résultat d'enquête
L'analyse du tableau ci-dessus nous indique que la
quantité théorique totale de déchets collectés
auprès des abonnées des associations Sougr-Nooma et Cosalu est
d'environ 1920 kilogrammes par semaine acheminés vers les points de
regroupement de la manière suivante (cf. figure 15)
Figure 15: Taux de déchets
théoriques acheminés vers les centres de collecte et
dépotoirs sauvages
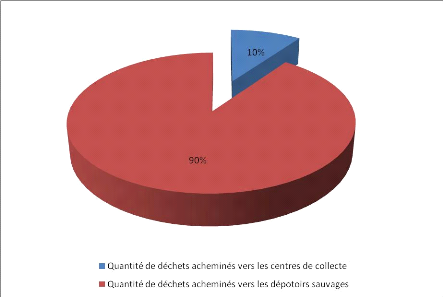
Source : Résultat d'enquête
Carte 15: Circuits de transfert des déchets
ménagers des abonnés de Cosalu et SougreNooma au niveau des
points de regroupement des déchets
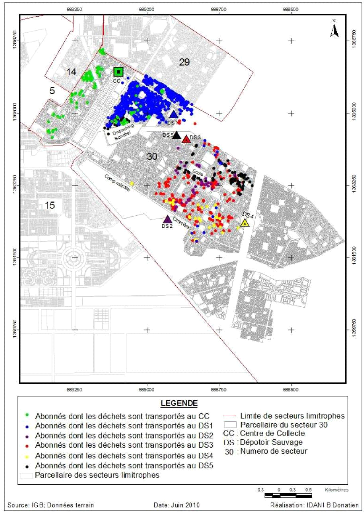
Parmi les causes éventuelles de la sous utilisation des
centres de collecte comme sites de transit des déchets, nous pouvons
citer les problèmes de conception de ces centres et la
fonctionnalité de certains d'entre eux.
Pour ce qui concerne les problèmes de conception, on
note particulièrement que le choix de quais centraux avec versement de
coté gène quasiment l'ensemble des acteurs. En effet, les centres
de collecte ne sont pas construits pour les bennes tasseuses, de même,
l'utilisation des charrettes et le versement par les usagers n'ont pas
suffisamment été pris en compte. Les tracteurs et les camions qui
disposent de vérins hydrauliques versent généralement par
l'arrière et les tracteurs doivent être vidés à la
main de même que les charrettes. Le fait que les bacs soient parfois un
peu éloignés des quais rend difficile le versement à la
pelle, au seau ou avec une brouette. De ce fait, les déchets tombent
donc régulièrement au sol à coté des bacs. Aussi,
les ânes éprouvent de grandes difficultés à hisser
les charrettes sur les quais, les rampes étant trop abruptes et les
quais trop élevés.
Pour ce qui est de la fonctionnalité des centres de
collecte, on note de façon générale que sur les 35 centres
de collecte qui ont été construits dans le cadre de la mise en
oeuvre du SDGD, environ 31(source : Direction de la Propreté de
Ouagadougou, octobre 2010) sont fonctionnels de nos jours et la plupart
fonctionnent en dessous des besoins. Pour ce qui concerne le cas
spécifique du secteur 30, le non fonctionnement de l'un des deux centres
de collecte (cf. carte 14) hypothèque l'évacuation des
déchets produits dans les périphéries du secteur et
augmente considérablement les quantités de déchets qui
transitent par celui situé dans la partie nord du secteur rapidement
rempli. Les pré-collecteurs de déchets sont donc contrains de
trouver une autre solution pour se débarrasser de leurs déchets,
toute chose qui contribue à expliquer la persistance des tas ou
dépotoirs sauvages.
Le recours aux dépotoirs sauvages constitue un risque
environnemental et une contrainte économique. En effet, le Projet
Stratégie de Réduction des déchets de
OuagadougouCréation d'Emplois et de Revenus par des actions de collecte,
de tri et de valorisation, (PSRDO-CER), prévoit la réalisation et
l'opérationnalisation d'un centre de tri de déchets au niveau de
chaque centre de collecte. La quasi-totalité des déchets
collectés (environ 90%) par les associations Sougre-Nooma et Cosalu ne
transitant pas dans un centre de collecte, il serait donc difficile d'optimiser
le tri de déchets au niveau des centres de collecte secteur 30 de
Ouagadougou. Pour palier à ce problème, nous préconisons
la réhabilitation du centre de
collecte non fonctionnel, ainsi que la construction de trois
nouveaux centres de collecte (cf. carte 16). Le choix de ces sites pour
l'implantation de nouveaux centres de collecte se justifie du fait tout d'abord
que ces derniers fassent parti des dépotoirs sauvages actuellement
utilisés pré-collecteurs. A ce titre, ils reçoivent
environ 87,64% des déchets collectés dans le secteur. Ces sites
servant actuellement de dépotoirs sauvages, un tel choix rencontrera
sans nul doute l'assentiment de pré-collecteurs qui ne se verront pas
contraints de modifier leurs itinéraires et leurs habitudes. Aussi, ces
sites se trouvent être des espaces verts non aménagés, donc
propriété de la municipalité.
Carte 16 : Proposition de sites pour
l'implantation de nouveaux centres de collecte
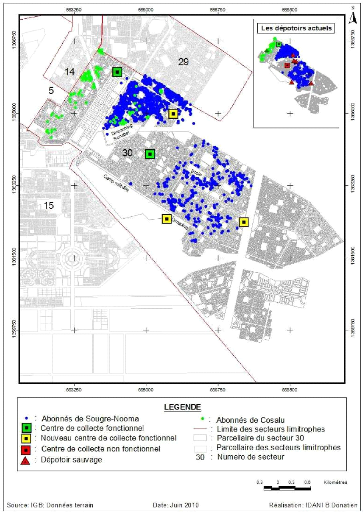
4.2. Perspectives
Aujourd'hui, les gestionnaires du territoire ont besoin
d'informations spatiales leur permettant de caractériser l'espace dont
ils ont la responsabilité, d'en faire un suivi et de répondre aux
questions qui leurs sont posées, à différentes
échelles.
Mettre à disposition des outils cartographiques et
visuels aux aménageurs, aux décideurs et aux entreprises et GIE
pour améliorer la gestion des déchets solides et optimiser les
circuits des opérateurs de pré-collecte par une politique
adaptée semble essentiel.
Nous avons mis à la disposition du Projet
Stratégie de Réduction des Déchets de
Ouagadougou/Création d'emplois par des actions de collecte, de tri et de
valorisation une base de données qui permet d'associer à chaque
abonnés au système de pré-collecte des associations Cosalu
et Sougre-Nooma les données lui correspondant afin de réaliser
une cartographie thématique.
La table attributaire du shapefile contenant les
abonnés au système de pré-collecte de ces deux
associations est dotée des informations suivantes, extraites directement
de la BD ou extrapolée en fonction des besoins :
- Description: identifiant de l'abonné
-Type : Type d'implantation
-Utm_zone : zone Utm
-Utm_eastin : coordonnées en X
-Utm_northi : coordonnées en Y
-Nom_abonne : nom de l'abonné
-Profession : profession de l'abonné
-Numero_rue : numéro de rue de l'abonné
-Numero_porte : numéro de portail de l'abonné
-Annee_abon : date d'abonnement au service de pré-collecte
des déchets
-Nature_occ : nature de l'unité d'occupation de
l'abonné
-Nombre_men : nombre de ménages dans la cours de
l'abonné
-Nombre_per : nombre de personnes dans la cours de
l'abonné
-Type_poub : type de poubelle (s) utilisé par
l'abonné
-Capacite_p : capacité de la ou des poubelles de
l'abonné
-Etat_poub : état de la ou des poubelles de
l'abonné
-Volume_dec : volume de déchets produit chez
l'abonné
-Quantite_d : quantité de déchets produit chez
l'abonné
-Frequence_ : fréquence d'enlèvement par semaine
des ordures chez l'abonné -Redevance_ : montant de la redevance
d'enlèvement des ordures payé par l'abonné -Appreciati :
appréciation du montant de la redevance faite par l'abonné
-Niveau_sat : niveau de satisfaction de l'abonné par rapport à la
prestation
Si nous avons montré l'intérêt que
revêt l'utilisation de SIG pour la gestion des déchets, il est
certain qu'il faudra plus de quatre mois (période correspondant à
la durée de notre stage de master 2) pour arriver à mettre en
place un véritable système.
Cependant, notre travail est un premier pas dans ce sens et la
lecture de ce rapport pourra faire prendre conscience aux collectivités,
institutions et entreprises intervenant dans la gestion des déchets des
opportunités à saisir.
Pour aller plus loin, le PSRDO-CER pourrait étendre
l'étude à l'échelle de sa zone d'intervention (zones de
pré-collecte n°6 et 12 de la ville de Ouagadougou.
Le géoreferencement du reste des abonnés au
service de pré-collecte de la zone d'intervention du projet sera
à même de proposer une meilleure distribution dans l'espace des
activités et des circuits journaliers des opérateurs de
pré-collecte des déchets. Cela permettra aux Petites et Moyennes
Entreprises (PME) et Groupement d'Intérêt Economiques (GIE)
oeuvrant dans le secteur de la collecte des déchets d'optimiser leurs
circuits de collecte notamment par la réduction des distances, du temps
et des efforts accordés à la collecte.
De même, les données de la table attributaire
permettront de capitaliser les informations disponibles en vue de mieux suivre
et évaluer les performances des actions qui sont menées dans le
cadre du (PSRDO- CER) et concernant le volet collecte des déchets
organisé par la Municipalité.
La mise en place d'un SIG nécessite de posséder
un certain nombre de couches géographiques
référencées. Ces dernières peuvent être
acquises de différentes manières : en effectuant un travail de
terrain (comme nous avons pu l'effectuer pour la localisation des
opérateurs de précollecte, des abonnés aux services de
pré-collecte et des points de regroupement des déchets) ou en
numérisant manuellement les informations disponibles sous format
papier.
Il existe déjà des bases d'information au sein
de certains services (ONEA par exemple). Si un projet concret monté sur
des bases solides doit être mise en place, il sera nécessaire
de
proposer des partenariats avec les différents services
concernés afin d'échanger les données et ainsi
éviter de numériser des informations déjà
existantes dans un autre service. Ainsi, dans la perspective de monter un
projet SIG sur la gestion des déchets, il est essentiel d'envisager des
partenariats à différentes échelles et ayant des
rôles différents.
La gestion des équipements par SIG au niveau de
l'ensemble des services urbains favoriserait l'échange de données
actualisées entre les services toujours dans une optique de gestion
intégrée du territoire. Des partenariats institutionnels avec les
différents services urbains sont aussi primordiaux puisque les
conclusions tirées de ces analyses nécessiteront d'engager des
aménagements urbains pour ne pas rester au simple stade de description
mais pour mettre en oeuvre une véritable politique d'actions
opérationnelles.
.
CONCLUSION PARTIELLE
Les entretiens auprès des acteurs de la filière
déchet et le géoreferencement des entités
géographique relatives à la question des déchets ont
permis de réaliser une base de données
géoreferencée (SIG)sur la gestion des déchets au secteur
30 de Ouagadougou. A travers le SIG quelques éléments de
l'organisation de la filière déchet du secteur ont
été analysés ; il s'est agit essentiellement des
opérateurs de pré-collecte, des abonnées au service de
précollecte et des points de regroupement des déchets.
CONCLUSION GENERALE
Dans cette étude intitulée « SIG et gestion
des déchets solides à Ouagadougou : cas du secteur 30 de
l'arrondissement de Bogodogo », nous avons pu identifié les acteurs
intervenant dans la filière déchets. Notre première
hypothèse relative au fait que dans la ville de Ouagadougou les acteurs
intervenant dans la gestion des déchets solides sont clairement
identifiés et catégorisés ; chacun d'eux jouant un
rôle bien déterminé dans le cycle de gestion des
déchets est vraie du fait que la Politique et Stratégie Nationale
d'Assainissement (PNSA) distingue cinq principaux types d'acteurs (l'Etat, les
collectivités territoriales, le secteur privé, les populations et
leurs organisations, et les partenaires techniques et financiers) aux
rôles différents.
Aussi, nous avons pu constituer et mettre à la
disposition du PSRDO-CER la première version d'une base de
données géoreferencée sur la gestion des déchets au
secteur 30 de Ouagadougou, une des principales zones d'intervention du projet.
L'application mise en place dans ce travail sera très utile à
tous les acteurs de la gestion des ordures ménagères. En effet,
à travers elle, les responsables du PSRDO-CER et de la DP ont une
possibilité de capitaliser toutes les informations disponibles en
matière de gestion des déchets et de mieux suivre et
évaluer les performances des actions qui seront menées dans le
cadre du dit projet et concernant le volet collecte des déchets. Ceci
confirme donc notre deuxième hypothèse, selon laquelle, le SIG
est un outil utile à la gestion des ordures ménagères.
L'utilisation de l'outil SIG dans cette étude a permis
de cartographier l'ensemble des abonnés au service de
pré-collecte et les circuits de collecte des associations Sougre-Nooma
et Cosalu. A travers cette cartographie, nous avions pu nous rendre compte que
la répartition des abonnés dans l'aire géographique ne
suit pas une logique territoriale mais, est plutôt fonction de
l'opportunité qu'ont les opérateurs d'avoir de nouveaux
abonnés ; La troisième hypothèse affirmant que la
répartition spatiale des abonnés par opérateurs de
pré-collecte des déchets au secteur 30 de l'arrondissement de
Bogodogo repose sur une logique territoriale n'est donc pas
vérifiée.
Pour ce qui concerne la quatrième et dernière
hypothèse disant que les centres de collecte du secteur 30 de
l'arrondissement de Bogodogo sont tous fonctionnels et constituent les points
de regroupement privilégies de la quasi-totalité des
déchets collectés dans le secteur, nous disons qu'elle aussi
n'est pas vérifiée. Car en effet, sur les deux centres de
collecte construits au secteur 30 dans le cadre de la mise en oeuvre du SDGD,
un seul est fonctionnel à nos jours. Ce dernier reçoit seulement
10% des déchets collectés dans le secteur ; le reste des
déchets à savoir les 90% étant tout naturellement
évacué vers les dépotoirs sauvages.
Au terme de cette étude, nous retenons que, le projet
sur lequel nous avons travaillé six mois recèle encore de
nombreuses facettes à explorer et que rien n'est encore gagné en
termes d'assimilation du projet par les différents acteurs. L'objectif
était de voir comment appliquer au mieux les outils de la
géomatique à un contexte particulier, d'identifier les
indicateurs pertinents pour répondre à une problématique
et de voir comment un SIG pourrait être construit, avec quelles
données et quelles seraient les perspectives de développement de
l'outil dans la mesure où les moyens restent encore limités et
où le contexte n'est pas forcément favorable au
développement de ce type de projet nécessitant des
investissements, en temps, en hommes et en moyens assez importants. Nous avons
essayé d'apporter quelques éléments de réponse mais
un énorme travail de démarches auprès des
différents interlocuteurs reste à faire afin de mobiliser les
partenariats et concrétiser ce projet qui requiert une participation
importante de nombreux acteurs. Nous espérons que nos travaux permettent
de créer une nouvelle impulsion pour la prise de conscience de la
nécessité d'agir sur cette question.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages généraux
CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA ET LES IST,
INITIATIVE DE L'ALLIANCE DES MAIRES ET RESPONSABLES MUNICIPAUX POUR DES ACTIONS
COMMUNAUTAIRES DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA AU NIVEAU LOCAL (AMICAALL). 2006.
Profil municipal de l'arrondissement de Bogodogo-Commune de
Ouagadougou, 20 p.
DESSAU-SOPRIN. 2000. Schéma directeur de gestion des
déchets - ville de Ouagadougou (Burkina Faso), rapport final, 217
p.
Portman F.R. 2005. L'environnement et la santé en
Afrique : Manuel de santé pour éducateurs et promoteurs
communautaires, Édition et coordination : Programme Vita, programme
de coopération au développement en matière de santé
en Afrique,
Agence espagnole de Coopération internationale (AECI), 161
p.
Thèses et mémoires
BENARD C., 2007. Mise en place d'outils de la
géomatique au sein de la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers.
Mémoire de master TRIAD, Université de Rouen, 97 p.
GBEMADE B., 1996. Gestion des ordures municipales de
Ouagadougou évaluation complémentaire de la composition des
déchets, des technologies alternatives de leur pré collecte et de
leur valorisation. Diplôme d'Ingénieur EIER, 49 p.
KABORE N.A.F., 2009. Distribution spatiale des pratiques
d'assainissement à Ouagadougou : cas de l'arrondissement de Boulmiougou.
Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme de
master en SIG, Université de Ouagadougou, UFR/SH, Département de
Géographie, 66 p
KASSIE D., 2007. Caractérisation socio-spatiale du
choléra en 2005 à Ouagadougou : cas des secteurs 23 et 24.
Mémoire de maîtrise de géographie, Université
de Ouagadougou, IRD, 113 p.
SCHERRER M., 2007. Elaboration d'une base de
données et d'un système d'information géographique pour la
gestion des ordures ménagères de la ville de Ouahigouya.
Projet de master, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPA),
Faculté de l'Environnement Naturel Architectural et Construit (ENAC),
Section des Sciences et Ingénierie de l'Environnement (SIE), 60 p.
QUÉNOT H., 2010. La construction du champ politique
local à Accra (Ghana) et Ouagadougou (Burkina Faso) : Le cas de la
politique de gestion des déchets. Thèse pour le Doctorat en
Sciences politiques, Université de Montesquieu-Bordeaux IV, Institut
Doctorale de sciences politiques de Bordeaux, 461 p.
YAMEOGO S.G., 2009. La gestion géomatique des
officines pharmaceutiques. Mémoire de fin d'études pour
l'obtention diplôme de master en SIG, Université de Ouagadougou,
UFR/SH, Département de Géographie, 78 p.
Rapports et revues
ARCENS M.T., 1993. La gestion des déchets solides :
une étude de cas au Burkina Faso : relations entre hommes et femmes dans
le projet pilote du quartier de Wogodogo-Nossin, secteur 10 de la ville de
Ouagadougou. Ouagadougou (BF), CREPA, 44 p.
ARCENS M.T., 1995. Le projet pilote de wogodogo : une
initiative locale de gestion des déchets solides de Ouagadougou (BF.
Ouagadougou (BF), CREPA, 31 p.
BOUDA L., 2005. Evaluation participative des contraintes
et des opportunités dans la gestion des déchets : l'agriculture
urbaine et le compostage. Ouagadougou (BF) : CREPA, 24 p.
CLERC A., 1996. Analyse critique du
système de gestion par la division économique des déchets
municipaux de Ouagadougou. Ouagadougou (BF), Lausanne (CH) : CREPA, EPFL,
47 p.
COMMUNE DE OUAGADOUGOU, CERCLE POUR LE RENFORCEMENT DE
L'EXPERTISE EN AFRIQUE (CREA)., 2009. Etude de base sur le
rôle du secteur informel dans la gestion des déchets dans la
commune de Ouagadougou (rapport provisoire), 29 p.
COMMUNE DE OUAGADOUGO., 2009. Rapport d'audit des acteurs de
collecte des ordures ménagères des secteurs 20, 21, 22, et 30 de
Ouagadougou, 70 p.
CENTRE REGIONAL POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT A
FAIBLE COUT (CREPA), COMITE INTERAFRICAIN D'ETUDES HYDRAULIQUES
(CIEH)., 1992. Environnement et développement des
villes africaines : contribution à la gestion des déchets solides
: projet pilote de Ouagadougou (avant projet) Ouagadougou (BF), 25 p.
CENTRE REGIONAL POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT A
FAIBLE COUT (CREPA), INSTITUT AFRICAIN DE GESTION URBAINE (IAGU)., 1992.
Environnement et développement des villes africaines : contribution
à la gestion des déchets solides : projet pilote de Ouagadougou
(Burkina Faso) : étude du milieu. Ouagadougou (BF); Dakar (SN), 105
p.
CENTRE REGIONAL POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT A
FAIBLE COUT (CREPA)., 1993. Gestion des déchets solides : projet
pilote de ramassage des ordures ménagères à Wogodogo
secteur 10 de Ouagadougou : suivi et animation de l'équipe de travail.
Ouagadougou (BF), 72 p.
CENTRE REGIONAL POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT A
FAIBLE COUT (CREPA)., 1993. Projet d'amélioration des conditions de
vie urbaine à Ouagadougou : composante gestion des déchets
solides municipaux (rapport du consultant local - version provisoire).
Ouagadougou (BF), CREPA; 3e Projet de Développement Urbain, 84
p.
CENTRE REGIONAL POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT A
FAIBLE COUT (CREPA)., 1994. Rapport de suivi de projets de collecte des
ordures ménagères à Wogodogo-Nossin, secteurs 10 et 19 de
la ville de Ouagadougou. Ouagadougou (BF), 15 p.
CREPA/CENTRE REGIONAL POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT A
FAIBLE COUT/OUAGADOUGOU/BF., 1996. Atelier de recherche pour la mise en
place d'un système de collecte et d'évacuation des ordures
ménagères dans la ville de Tenkodogo, du 03 au 05 décembre
1996 au CRESA de Tenkodogo. Ouagadougou (BF), 46 p.
CENTRE REGIONAL POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT A
FAIBLE COUT (CREPA)., 1996. Projet d'assainissement de Fada N'Gourma :
document de projet. Ouagadougou (BF), 15 p.
CENTRE REGIONAL POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT A
FAIBLE COUT (CREPA)., 1997. Document de projet : le projet d'assainissement
de Kaya. Ouagadougou (BF), 5 p.
DIOP O.E., 1993. Projet d'amélioration des
conditions de vie urbaine à Ouagadougou : gestion des déchets
solides municipaux : étude de faisabilité et d'ingénierie
préliminaire (rapport provisoire). Ouagadougou (BF) : PDU, 82 p.
ECOLE INTER ETAT DES INGENIEURS DE L'EQUIPEMENT RURAL (EIER),
Projet FNRS/ALTER EGO., 2000. Rapport d'exécution :
élaboration d'un SIG pour la gestion des déchets solides de la
ville de Ouagadougou. 13+ 18 p.
ILBOUDO J.N., 1997. Présentation de sites de
décharges de déchets solides au Burkina Faso. Ouagadougou
(BF) : Ministère de l'Environnement et de l'Eau, COLLOQUE : Atelier sur
la problématique des déchets solides en Afrique - Ouagadougou,
Burkina Faso, 169 p.
MAS S ; VOGLER.C., 2006. La gestion des déchets
solides à Ouagadougou. CREPA, 112 p.
MEUNIER-NIKIEMA A., 2007. Géographie d'une ville
à travers la gestion des déchets, Ouagadougou (Burkina
Faso). INSS/CNRST Ouagadougou, 15 p.
NIKIEMA D., 2009. Exemple de mise en oeuvre d'un
Schéma directeur de gestion des déchets à travers CGMED,
une entreprise de pré-collecte à Ouagadougou. Atelier CIFAL,
Octobre 2009, 21 p.
RABO A, GBEMADE B, GUENE O., 1998. Profil environnemental
de la gestion des déchets biomédicaux à Ouagadougou :
rapport provisoire. Ouagadougou (BF), Sénégal (SN), CREPA,
IAGU, 45 p.
TOURE F., 1993. Chronique du
déroulement du projet Wogodogo-Nossin, ramassage des ordures.
Ouagadougou (BF), CREPA, 12 p.
ZAGRE F., 1998. Amélioration des systèmes de
collecte et de transport des déchets solides dans les quartiers urbains
défavorisés. Ouagadougou (BF), EIER, 34 p.
Quelques références sur Internet
http://claire.gougeon.free-fr/framesetdechets.html
http://www.envirobf.org/dechets/409-historique-de-la-gestion-des-dechets-et-del'assainissement-à-ouagadougou.html
http://mappemonde.mgm.fr/num15/article/art07305.html.
http://www.demographie.auf.org/IMG/pdf/Affiches.pdf
ANNEXES
Annexe 1 : Guide d'entretien à l'intention des
services municipaux
I- Commune de Bogodogo
1) Localisation géographique
2) Superficie
3) Les secteurs
4) La population
5) Réseau routier
· Route bitumée en bon état
· Route bitumée en bon état
· Route en terre en bon état
· Route en terre dégradée
· Route non aménagée
6) Cours d'eau, eau de ruissellement et caniveaux
II- Le secteur 30 de l'arrondissement de Bogodogo
1) Localisation géographique
2) Superficie
3) Population
4) Activité des chefs de ménages
5) Eau potable (Taux de raccordement)
6) Assainissement et eaux usées
7) Utilisation des latrines
8) Cours d'eau, eau de ruissellement et caniveaux
Annexe 2 : Fiche d'identification des
abonnés aux services de collecte des ordures ménagères au
secteur 30 de Ouagadougou
Numéro abonné :
Numéro GPS :
Numéro de la rue :
Numéro de la porte :
Nature du logement : Cours individuelle Cours commune
Nom abonné :
Activité principale :
Date d'abonnement :
Type de poubelle : Fut (Barrique) Grand saut Petit seau
Sac
Bassine Pas de poubelle
Etat de la poubelle : Bon Moyen Mauvais
Nombre de
ménages dans la cours :
Nombre de personnes dans la cours :
Quantité de déchets produits :
Nom de l'opérateur collecteur :
Redevance mensuelle :
Appréciation du montant de la redevance : Elevé
Acceptable Bas Fréquence de l'enlèvement par semaine :
Niveau de satisfaction : Satisfait Moyennement satisfait Non
satisfait
Annexe 3 : Guides d'observation au niveau des points de
regroupement des ordures
ménagères
- Code GPS du point de regroupement des déchets
- Type : Centre de collecte Dépotoir sauvage
- Nombre
de bacs par centre de collecte
- Etat des bacs : Bon Moyen Mauvais
- Niveau de remplissage et débordement des bacs
- Présence de déchets aux alentours des bacs
- Nature des déchets dans les bacs
Annexe 4: Les règles de gestion de la base de
données
RG1 : La ville de Ouagadougou comprend 30
secteurs repartis en 12 zones de collecte et en 3 lots de secteurs pour le
transport des déchets.
RG2 : Un secteur ne peut appartenir qu'à
une et une seule zone de collecte et une zone de collecte peut contenir
plusieurs secteurs.
RG3 : Un secteur ne peut être contenu que
dans un seul lot pour le transport des déchets et un lot peut contenir
plusieurs secteurs.
RG4 : Plusieurs zones de collecte peuvent
être attribuées à un adjudicataire (Groupement
d'Intérêt Economique ou Petite et Moyenne Entreprise) et une zone
de collecte peut relever de plusieurs adjudicataires (GIE/PME).
RG5 : Un adjudicataire confère des
autorisations d'exploiter des sous zones de collecte à plusieurs
opérateurs de pré-collecte et un opérateur de
pré-collecte ne peut sous traiter qu'avec un seul adjudicataire.
RG6: Un opérateur de pré-collecte
peut desservir plusieurs secteurs et un secteur peut être desservi par
plusieurs opérateurs de pré-collecte.
RG7 : Une fiche de suivi périodique est
remplie par un opérateur de pré-collecte
RG8 : Un opérateur de pré-collecte
emploie un à plusieurs collecteurs et un collecteur ne peut travailler
que pour un seul opérateur de pré-collecte.
RG9 : Plusieurs collecteurs d'un même
opérateur de pré-collecte collectent les ordures
ménagères chez plusieurs abonnés (ménages) et les
ordures d'un seul ménage sont collectées par plusieurs
collecteurs d'un même opérateur de collecte.
RG10 : Un opérateur de
pré-collecte emploie un à plusieurs animateurs qui sont
chargées de récupérer les redevances mensuelles au
près des abonnés. Et un animateur ne peut travailler que pour un
opérateur de pré-collecte.
RG11: Un Paiement de redevance peut
être effectué par un abonné pour la collecte des ordures et
chaque abonné paye une redevance.
RG12 : Le paiement de la redevance se fait
à une période
RG13 : Plusieurs collecteurs d'un
opérateur de pré-collecte transportent les ordures
ménagères collectées auprès des abonnés vers
au moins un point de regroupement des déchets (centre de collecte ou
dépotoir sauvage).
RG14 : Le transport des ordures
ménagères des points de regroupement des déchets (centre
de collecte ou dépotoir sauvage) au centre de traitement et de
valorisation des déchets de plusieurs lots de secteurs peut être
assuré par un opérateur de collecte (commune ou entreprise
privée) et le transport des ordures ménagères des points
de regroupement des déchets au centre de traitement et de valorisation
des déchets d'un lot de secteurs peut être assuré par
plusieurs opérateurs de collecte.
RG15: Une fiche de suivi périodique est remplie par un
opérateur de collecte
RG16: Une fiche de suivi périodique est remplie au niveau
du centre de traitement et de valorisation des déchets.
Annexe 5 : Carte de distribution spatiale des
abonnés de Cosalu et de Sougre-Nooma en suivant le statut
socioprofessionnel
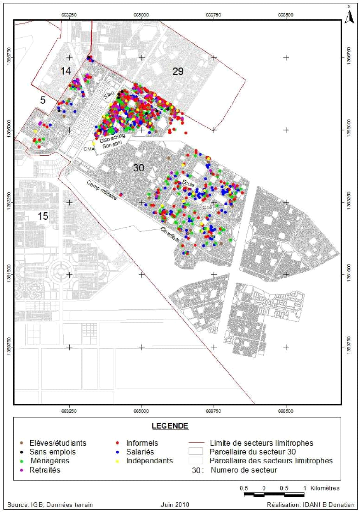
TABLE DES MATIERES
DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
SOMMAIRE iv
LISTE DES CARTES v
LISTE DES FIGURES vi
LISTE DES TABLEAUX vii
SIGLES ET ABREVIATIONS viii
RESUME ix
INTRODUCTION GENERALE 10
PREMIERE PARTIE : PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DES DECHETS SOLIDES
A OUAGADOUGOU 14
CHAPITRE I: DU CONTEXTE A LA METHODOLOGIE 15
1.1. Le contexte et la justification de l'étude 15
1.2. Les objectifs 17
1.3. Les hypothèses 18
1.4. La définition des concepts 19
1.5. L'approche méthodologique 21
1.5.1. L'échantillonnage 22
1.5.2. La collecte des données 24
1.5.3. Les variables de l'étude 25
1.5.4. Les outils de traitement de données 29
1.5.5. Les difficultés rencontrées 29
CHAPITRE II : DE L'ETUDE DU MILIEU A LA PRESENTATION DE LA
FILIERE DECHETS 30
2.1. Présentation du milieu de l'étude 30
2.1.1. Influence des aspects physiques sur la gestion des
déchets 32
2.1.2. Profil socio-économique de la ville de Ouagadougou
33
2.2. Présentation de la filière déchet 36
2.2.1. Historique de la gestion des déchets solides 36
2.2.2. Les acteurs de la gestion des déchets solides 39
CONCLUSION PARTIELLE 45
DEUXIEME PARTIE : APPLICATION DU SIG A LA GESTION DES ORDURES
MENAGERES 46
CHAPITRE III: MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNEES A
REFERENCE SPATIALE POUR LA GESTION
DES ORDURES MENAGERES DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU 47
3.1. Utilité et objectifs d'un SIG dans la gestion des
ordures ménagères 47
3.1.1. Utilité d'un SIG pour la gestion des ordures
ménagères 47
3.1.2. Objectif du SIG sur la gestion des déchets 48
3.1.3. Choix des données à intégrer au
système 48
3.2. Elaboration des outils 49
3.2.1. Structuration des données 49
3.2.2. Implantation des données structurées dans un
système informatique 53
CHAPITRE IV: ANALYSE DE LA GESTION DES DECHETS ET
PERSPECTIVES 59
4.1. Analyse du dispositif de gestion des déchets dans le
secteur 30 59
4.1.1. Les opérateurs de pré-collecte actuels 58
4.1.2. Les abonnés au service de pré-collecte de
déchets 61
4.1.3. Les points de regroupement des déchets 75
4.2. Perspectives 84
CONCLUSION PARTIELLE 87
CONCLUSION GENERALE 88
BIBLIOGRAPHIE 90
ANNEXES 95
Annexe 1 : Guide d'entretien à l'intention des
services municipaux 95
Annexe 2 : Fiche d'identification des abonnés aux
services de collecte des ordures ménagères au secteur 30 de
Ouagadougou 96
Annexe 3 : Guides d'observations au niveau des points de
regroupement des ordures ménagères 97
Annexe 4: Les
règles de gestion de la base de données 97
Annexe 5 : Carte de distribution spatiale des abonnés
de Cosalu et de Sougr-Nooma en suivant le statut socioprofessionnel 99
TABLE DES MATIERES 100
| 


